
Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique (1848)
4 vols. in 1
 |
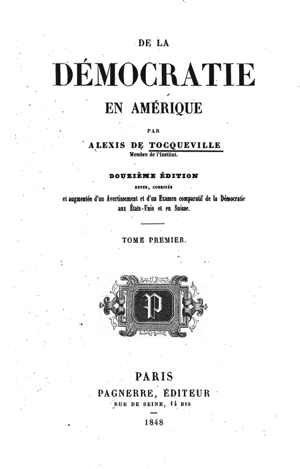 |
| Alexis de Tocqueville (1805-1859) |
[Created: 31 Aug. 2022]
[Updated: May 2, 2023 ] |
The Guillaumin Collection
 |
This title is part of “The Guillaumin Collection” within “The Digital Library of Liberty and Power”. It has been more richly coded and has some features which other titles in the library do not have, such as the original page numbers, formatting which makes it look as much like the original text as possible, and a citation tool which makes it possible for scholars to link to an individual paragraph which is of interest to them. These titles are also available in a variety of eBook formats for reading on portable devices. |
Source
, De la Démocratie en Amérique. Par Alexis de Tocqueville, Membre de l’Institut. Revue, corrigée et augmentée d’un Avertissement et d’un Examen comparatif de la Démocratie aux États-Unis et en Suisse. (Paris: Pagnerre, Éditeur. Rue de Seine, 14 Bis, 1848).http://davidmhart.com/liberty/FrenchClassicalLiberals/Tocqueville/1848-DA/eBook/DA-4vols-in1.html
- Tome Premier et Tome Deuxième (Douzième Édition).
- Tome Troisième et Tome Quatrième (Cinquième Édition).
This title is also available in a facsimile PDF of the original and various eBook formats - HTML, PDF, and ePub.
- Volume 1: facs. PDF; eBook HTML, PDF, and ePub
- Volume 2: facs. PDF; eBook HTML, PDF, and ePub
- Volume 3: facs. PDF; eBook HTML, PDF, and ePub
- Volume 4: facs. PDF; eBook HTML, PDF, and ePub
This book is part of a collection of works by Alexis de Tocqueville (1805-1859).
Editor's Note
The first volume (in two parts or "volumes") was published in 1835 by Charles Gosselin, which were followed by 6 further editions (2nd to 7th). The 6th edition of 1838 included a number of revisions.
The second volume (also consisting of 2 parts or "volumes") appeared in 1840 and was a "combined edition" with volume 1, known as the 8th edition. This full edition was republished in 4 volumes by Gosselin three times in 1842 as the 9th, 10th, and 11th editions.
The 12 edition was published by Pagnerre shortly after the 1848 Revolution and contained a new preface and an Appendix with a copy of a report Tocqueville had given to the Académie des sciences morales et politiques on January 15, 1848. In the 1848 edition of Pagnerre the first two volumes were called the "12th" edition, and the second two volumes were called the "5th edition."
A 13th edition of 1850 (Pagnerre), the last to appear in Tocqueville's lifetime (he died in 1859), contained the Preface and Appendix from the 12th edition as well as a speech Tocqueville gave in the Chamber of Deputies.
After his death, a "14th edition" was published in 1864 (Michel Levy Frères) as part of the Oeuvres completes d’Alexis de Tocqueville, edited by his wife, Madame de Tocqueville.
The first English translation of the first volume was by Henry Reeve and appeared in 1835. Subsequent editions followed.
LES TABLE DES MATIÈRES
PREMIER VOLUME - TABLE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE PREMIER VOLUME
DEUXIÈME VOLUME - TABLE DES CONTENUES DANS LE DEUXIÈME VOLUME
Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Tome I (1848)
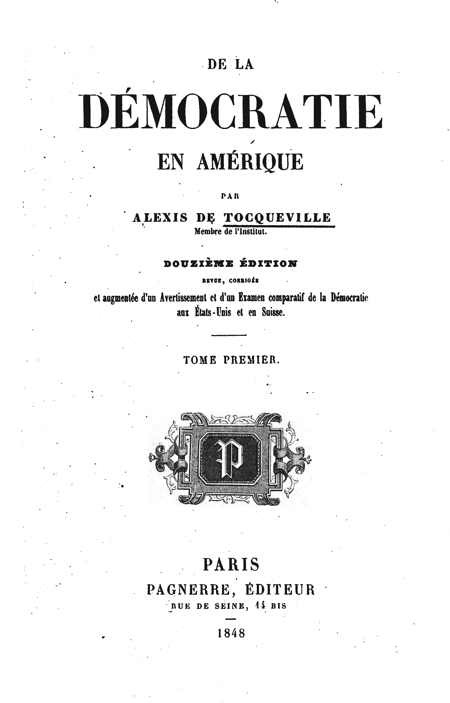
[I-357]
TABLE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE PREMIER VOLUME↩
- Avertissement de la Dixième Édition. p. I
- Introduction. p. 1
- Chapitre I. — Configuration extérieure de l’Amérique du Nord. p. 27
- Chap. II. — Du point de départ et de l’importance pour l’avenir des Anglo-Américains. p. 41
- Raisons de quelques singularités que présentent les lois et les coutumes des Anglo-Américains. p. 69
- Chap. III. — État social des Anglo-Américains. p. 72
- Que le point saillant de l’état social des Anglo-Américains est essentiellement d’être démocratique. Ib.
- Conséquences politiques de l’état social des Anglo-Américains. p. 84
- Chap. IV. — Du principe de la souveraineté du peuple en Amérique. p. 86
- Chap. V. — Nécessité d’étudier ce qui se passe dans les États particuliers avant de parler du gouvernement de l’Union. p. 91
- Du système communal en Amérique. p. 95
- Circonscription de la commune. p. 96
- Pouvoir communaux dans la Nouvelle-Angleterre. p. 100
- De l’existence communale. p. 104
- De l’esprit communal dans la Nouvelle-Angleterre. p. 108
- Du comté dans la Nouvelle-Angleterre. p. 110
- De l’administration dans la Nouvelle-Angleterre. p. 126
- Idées générales sur l’administration aux États-Unis. p. 132
- De l’État. p. 133
- Du pouvoir exécutif de l’État. p. 135
- Des effets politiques de la décentralisation administrative aux États-Unis. p. 137
- Chap. VI. — Du pouvoir judiciaire aux États-Unis et de son action sur la société politique. p. 157
- Autres pouvoirs accordés aux juges américains. p. 166
- Chap. VII. — Du jugement politique aux États-Unis. p. 170
- Chap. VIII. — De la constitution fédérale. p. 179
- Historique de la constitution fédérale. Ib.
- Tableau sommaire de la constitution fédérale. p. 183
- Attributions du gouvernement fédéral p. 185
- Pouvoirs fédéraux p. 188
- Pouvoirs législatifs Ib.
- Autre différence entre le sénat et la chambre des représentants p. 192
- Du pouvoir exécutif p. 194
- En quoi la position du président aux États-Unis diffère de celle d’un roi constitutionnel en France p. 197
- Causes accidentelles qui peuvent accroître l’influence du pouvoir exécutif p. 202
- Pourquoi le président des États-Unis n’a pas besoin, pour diriger les affaires, d’avoir la majorité dans les chambres p. 203
- De l’élection du président p. 205
- Mode de l’élection p. 212
- Crise de l’élection p. 217
- De la réélection du président p. 219
- Des tribunaux fédéraux p. 223
- Manière de fixer la compétence des tribunaux fédéraux p. 229
- Différents cas de juridiction p. 231
- Manière de procéder des tribunaux fédéraux p. 238
- Rang élevé qu’occupe la cour suprême parmi les grands pouvoirs de l’État p. 241
- En quoi la constitution fédérale est supérieure à la constitution des États p. 245
- Ce qui distingue la constitution fédérale des États-Unis d’Amérique de toutes les autres constitutions fédérales p. 251
- Désavantages du système fédératif en général, et de son utilité spéciale pour l’Amérique p. 257
- Ce qui fait que le système fédéral n’est pas à la portée de tous les peuples, et ce qui a permis aux Anglo-Américains de l’adopter p. 266
- Notes p. 279
- Constitutions des États-Unis et de l’État de New-York p. 305
- Endnotes
FIN DE LA TABLE DU PREMIER VOLUME.
[I-i]
AVERTISSEMENT DE LA DIXIÈME ÉDITION.↩
Quelque grands et soudains que soient les événements qui viennent de s’accomplir en un moment sous nos yeux, l’auteur du présent ouvrage a le droit de dire qu’il n’a point été surpris par eux. Ce livre a été écrit il y a quinze ans, sous la préoccupation constante d’une seule pensée : l’avénement prochain, irrésistible, universel de la Démocratie dans le monde. Qu’on le relise : on y rencontrera à chaque page un avertissement solennel qui rappelle aux hommes que la société change de formes, l’humanité de condition, et que de nouvelles destinées s’approchent.
En tête étaient tracés ces mots :
[I-ii]
Le développement graduel de l’égalité est un fait providentiel. Il en a les principaux caractères : il est universel, il est durable, il échappe chaque jour à la puissance humaine ; tous les événements comme tous les hommes ont servi à son développement. Serait-il sage de croire qu’un mouvement social qui vient de si loin puisse être suspendu par une génération ? Pense-t-on qu’après avoir détruit la féodalité et vaincu les rois, la Démocratie reculera devant les bourgeois et les riches ? S’arrêtera-t-elle maintenant qu’elle est devenue si forte et ses adversaires si faibles ?
L’homme qui en présence d’une monarchie, raffermie plutôt qu’ébranlée par la révolution de juillet, a tracé ces lignes, que l’événement a rendu prophétiques, peut aujourd’hui sans crainte appeler de nouveau sur son œuvre l’attention du public.
On doit lui permettre également d’ajouter que les circonstances actuelles donnent à son livre un intérêt du moment et une utilité pratique qu’il n’avait point quand il a paru pour la première fois.
La royauté existait alors. Aujourd’hui elle est détruite. Les institutions de l’Amérique, qui n’étaient qu’un sujet de curiosité pour la France monarchique, doivent être un sujet d’étude pour la France républicaine. Ce n’est pas la force seule qui asseoit un gouvernement nouveau ; ce sont de bonnes lois. Après le combattant, le législateur. L’un a détruit, l’autre fonde. À chacun son œuvre. Il ne s’agit plus, il est vrai, de savoir si nous aurons en France la royauté ou la république ; mais il nous [I-iii] reste à apprendre si nous aurons une république agitée ou une république tranquille, une république régulière ou une république irrégulière, une république pacifique ou une république guerroyante, une république libérale ou une république oppressive, une république qui menace les droits sacrés de la propriété et de la famille ou une république qui les reconnaisse et les consacre. Terrible problème, dont la solution n’importe pas seulement à la France, mais à tout l’univers civilisé. Si nous nous sauvons nous-mêmes, nous sauvons en même temps tous les peuples qui nous environnent. Si nous nous perdons, nous les perdons tous avec nous. Suivant que nous aurons la liberté démocratique ou la tyrannie démocratique, la destinée du monde sera différente, et l’on peut dire qu’il dépend aujourd’hui de nous que la république finisse par être établie partout ou abolie partout.
Or, ce problème que nous venons seulement de poser, l’Amérique l’a résolu il y a plus de soixante ans. Depuis soixante ans le principe de la souveraineté du peuple que nous avons intronisé hier parmi nous règne là sans partage. Il y est mis en pratique de la manière la plus directe, la plus illimitée, la plus absolue. Depuis soixante ans, le peuple qui en a fait la source commune de toutes ses lois grandit sans cesse en population, en territoire, en richesse ; et remarquez-le bien, il se trouve avoir été durant cette période non-seulement le plus prospère, mais le plus stable de tous les peuples de la terre. Tandis que toutes les nations de l’Europe étaient ravagées par la guerre ou [I-iv] déchirées par les discordes civiles, le peuple américain seul dans le monde civilisé restait paisible. Presque toute l’Europe était bouleversée par des révolutions ; l’Amérique n’avait pas même d’émeutes : la république n’y était pas perturbatrice, mais conservatrice de tous les droits ; la propriété individuelle y avait plus de garanties que dans aucun pays du monde ; l’anarchie y restait aussi inconnue que le despotisme.
Où pourrions-nous trouver ailleurs de plus grandes espérances et de plus grandes leçons ! Tournons donc nos regards vers l’Amérique, non pour copier servilement les institutions qu’elle s’est données, mais pour mieux comprendre celles qui nous conviennent ; moins pour y puiser des exemples que des enseignements, pour lui emprunter les principes plutôt que les détails de ses lois. Les lois de la République française peuvent et doivent, en bien des cas, être différentes de celles qui régissent les États-Unis, mais les principes sur lesquels les constitutions américaines reposent, ces principes d’ordre, de pondération des pouvoirs, de liberté vraie, de respect sincère et profond du droit, sont indispensables à toutes les républiques ; ils doivent être communs à toutes, et l’on peut dire à l’avance que là où ils ne se rencontreront pas, la République aura bientôt cessé d’exister.
[I-1]
INTRODUCTION.↩
Parmi les objets nouveaux qui, pendant mon séjour aux États-Unis, ont attiré mon attention, aucun n’a plus vivement frappé mes regards que l’égalité des conditions. Je découvris sans peine l’influence prodigieuse qu’exerce ce premier fait sur la marche de la société ; il donne à l’esprit public une certaine direction, un certain tour aux lois ; aux gouvernants des maximes nouvelles, et des habitudes particulières aux gouvernés.
Bientôt je reconnus que ce même fait étend son influence fort au-delà des mœurs politiques et des lois, et qu’il n’obtient pas moins d’empire sur la société civile que sur le gouvernement : il crée des opinions, fait naître des sentiments, suggère des usages et modifie tout ce qu’il ne produit pas.
Ainsi donc, à mesure que j’étudiais la société américaine, je voyais de plus en plus, dans l’égalité des conditions, le fait générateur dont chaque fait [I-2] particulier semblait descendre, et je le retrouvais sans cesse devant moi comme un point central où toutes mes observations venaient aboutir.
Alors je reportai ma pensée vers notre hémisphère, et il me sembla que j’y distinguais quelque chose d’analogue au spectacle que m’offrait le Nouveau-Monde. Je vis l’égalité des conditions qui, sans y avoir atteint comme aux États-Unis ses limites extrêmes, s’en rapprochait chaque jour davantage ; et cette même démocratie, qui régnait sur les sociétés américaines, me parut en Europe s’avancer rapidement vers le pouvoir.
De ce moment j’ai conçu l’idée du livre qu’on va lire.
Une grande révolution démocratique s’opère parmi nous, tous la voient ; mais tous ne la jugent point de la même manière. Les uns la considèrent comme une chose nouvelle, et, la prenant pour un accident, ils espèrent pouvoir encore l’arrêter ; tandis que d’autres la jugent irrésistible, parce qu’elle leur semble le fait le plus continu, le plus ancien et le plus permanent que l’on connaisse dans l’histoire.
Je me reporte pour un moment à ce qu’était la France il y a sept cents ans : je la trouve partagée entre un petit nombre de familles qui possèdent la terre et gouvernent les habitants ; le droit de commander descend alors de générations en générations avec les héritages ; les hommes n’ont qu’un seul [I-3] moyen d’agir les uns sur les autres, la force ; on ne découvre qu’une seule origine de la puissance, la propriété foncière.
Mais voici le pouvoir politique du clergé qui vient à se fonder et bientôt à s’étendre. Le clergé ouvre ses rangs à tous, au pauvre et au riche, au roturier et au seigneur ; l’égalité commence à pénétrer par l’Église au sein du gouvernement, et celui qui eût végété comme serf dans un éternel esclavage, se place comme prêtre au milieu des nobles, et va souvent s’asseoir au-dessus des rois.
La société devenant avec le temps plus civilisée et plus stable, les différents rapports entre les hommes deviennent plus compliqués et plus nombreux. Le besoin des lois civiles se fait vivement sentir. Alors naissent les légistes ; ils sortent de l’enceinte obscure des tribunaux et du réduit poudreux des greffes, et ils vont siéger dans la cour du prince, à côté des barons féodaux couverts d’hermine et de fer.
Les rois se ruinent dans les grandes entreprises ; les nobles s’épuisent dans les guerres privées ; les roturiers s’enrichissent dans le commerce. L’influence de l’argent commence à se faire sentir sur les affaires de l’État. Le négoce est une source nouvelle qui s’ouvre à la puissance, et les financiers deviennent un pouvoir politique qu’on méprise et qu’on flatte.
Peu à peu, les lumières se répandent ; on voit se réveiller le goût de la littérature et des arts ; l’esprit [I-4] devient alors un élément de succès ; la science est un moyen de gouvernement, l’intelligence une force sociale ; les lettrés arrivent aux affaires.
À mesure cependant qu’il se découvre des routes nouvelles pour parvenir au pouvoir, on voit baisser la valeur de la naissance. Au XIe siècle, la noblesse était d’un prix inestimable ; on l’achète au XIIIe ; le premier anoblissement a lieu en 1270, et l’égalité s’introduit enfin dans le gouvernement par l’aristocratie elle-même.
Durant les sept cents ans qui viennent de s’écouler, il est arrivé quelquefois que, pour lutter contre l’autorité royale ou pour enlever le pouvoir à leurs rivaux, les nobles ont donné une puissance politique au peuple.
Plus souvent encore, on a vu les rois faire participer au gouvernement les classes inférieures de l’État, afin d’abaisser l’aristocratie.
En France, les rois se sont montrés les plus actifs et les plus constants des niveleurs. Quand ils ont été ambitieux et forts, ils ont travaillé à élever le peuple au niveau des nobles ; et quand ils ont été modérés et faibles, ils ont permis que le peuple se plaçât au-dessus d’eux-mêmes. Les uns ont aidé la démocratie par leurs talents, les autres par leurs vices. Louis XI et Louis XIV ont pris soin de tout égaliser au-dessous du trône, et Louis XV est enfin descendu lui-même avec sa cour dans la poussière.
[I-5]
Dès que les citoyens commencèrent à posséder la terre autrement que suivant la tenure féodale, et que la richesse mobilière, étant connue, put à son tour créer l’influence et donner le pouvoir, on ne fit point de découvertes dans les arts, on n’introduisit plus de perfectionnements dans le commerce et l’industrie, sans créer comme autant de nouveaux éléments d’égalité parmi les hommes. À partir de ce moment, tous les procédés qui se découvrent, tous les besoins qui viennent à naître, tous les désirs qui demandent à se satisfaire, sont des progrès vers le nivellement universel. Le goût du luxe, l’amour de la guerre, l’empire de la mode, les passions les plus superficielles du cœur humain comme les plus profondes, semblent travailler de concert à appauvrir les riches et à enrichir les pauvres.
Depuis que les travaux de l’intelligence furent devenus des sources de force et de richesses, on dut considérer chaque développement de la science, chaque connaissance nouvelle, chaque idée neuve, comme un germe de puissance mis à la portée du peuple. La poésie, l’éloquence, la mémoire, les grâces de l’esprit, les feux de l’imagination, la profondeur de la pensée, tous ces dons que le ciel répartit au hasard, profitèrent à la démocratie, et lors même qu’ils se trouvèrent dans la possession de ses adversaires, ils servirent encore sa cause en mettant en relief la grandeur naturelle de l’homme ; ses conquêtes [I-6] s’étendirent donc avec celles de la civilisation et des lumières, et la littérature fut un arsenal ouvert à tous, où les faibles et les pauvres vinrent chaque jour chercher des armes.
Lorsqu’on parcourt les pages de notre histoire, on ne rencontre pour ainsi dire pas de grands événements qui depuis sept cents ans n’aient tourné au profit de l’égalité.
Les croisades et les guerres des Anglais déciment les nobles et divisent leurs terres ; l’institution des communes introduit la liberté démocratique au sein de la monarchie féodale ; la découverte des armes à feu égalise le vilain et le noble sur le champ de bataille ; l’imprimerie offre d’égales ressources à leur intelligence ; la poste vient déposer la lumière sur le seuil de la cabane du pauvre comme à la porte des palais ; le protestantisme soutient que tous les hommes sont également en état de trouver le chemin du ciel. L’Amérique, qui se découvre, présente à la fortune mille routes nouvelles, et délivre à l’obscur aventurier les richesses et le pouvoir.
Si, à partir du XIe siècle, vous examinez ce qui se passe en France de cinquante en cinquante années, au bout de chacune de ces périodes, vous ne manquerez point d’apercevoir qu’une double révolution s’est opérée dans l’état de la société. Le noble aura baissé dans l’échelle sociale, le roturier s’y sera élevé ; l’un descend, l’autre monte. Chaque [I-7] demi-siècle les rapproche, et bientôt ils vont se toucher.
Et ceci n’est pas seulement particulier à la France. De quelque côté que nous jetions nos regards, nous apercevons la même révolution qui se continue dans tout l’univers chrétien.
Partout on a vu les divers incidents de la vie des peuples tourner au profit de la démocratie ; tous les hommes l’ont aidée de leurs efforts : ceux qui avaient en vue de concourir à ses succès et ceux qui ne songeaient point à la servir ; ceux qui ont combattu pour elle, et ceux mêmes qui se sont déclarés ses ennemis ; tous ont été poussés pêle-mêle dans la même voie, et tous ont travaillé en commun, les uns malgré eux, les autres à leur insu, aveugles instruments dans les mains de Dieu.
Le développement graduel de l’égalité des conditions est donc un fait providentiel, il en a les principaux caractères : il est universel, il est durable, il échappe chaque jour à la puissance humaine ; tous les événements, comme tous les hommes, servent à son développement.
Serait-il sage de croire qu’un mouvement social qui vient de si loin, pourra être suspendu par les efforts d’une génération ? Pense-t-on qu’après avoir détruit la féodalité et vaincu les rois, la démocratie reculera devant les bourgeois et les riches ? S’arrêtera-t-elle maintenant qu’elle est devenue si forte et ses adversaires si faibles ?
[I-8]
Où allons-nous donc ? Nul ne saurait le dire ; car déjà les termes de comparaison nous manquent : les conditions sont plus égales de nos jours parmi les chrétiens, qu’elles ne l’ont jamais été dans aucun temps ni dans aucun pays du monde ; ainsi la grandeur de ce qui est déjà fait empêche de prévoir ce qui peut se faire encore.
Le livre entier qu’on va lire a été écrit sous l’impression d’une sorte de terreur religieuse produite dans l’âme de l’auteur par la vue de cette révolution irrésistible qui marche depuis tant de siècles à travers tous les obstacles, et qu’on voit encore aujourd’hui s’avancer au milieu des ruines qu’elles a faites.
Il n’est pas nécessaire que Dieu parle lui-même pour que nous découvrions des signes certains de sa volonté ; il suffit d’examiner quelle est la marche habituelle de la nature et la tendance continue des événements ; je sais, sans que le Créateur élève la voix, que les astres suivent dans l’espace les courbes que son doigt a tracées.
Si de longues observations et des méditations sincères amenaient les hommes de nos jours à reconnaître que le développement graduel et progressif de l’égalité est à la fois le passé et l’avenir de leur histoire, cette seule découverte donnerait à ce développement le caractère sacré de la volonté du souverain maître. Vouloir arrêter la démocratie paraîtrait alors lutter contre Dieu même, et il ne resterait aux nations [I-9] qu’à s’accommoder à l’état social que leur impose la Providence.
Les peuples chrétiens me paraissent offrir de nos jours un effrayant spectacle ; le mouvement qui les emporte est déjà assez fort pour qu’on ne puisse le suspendre, et il n’est pas encore assez rapide pour qu’on désespère de le diriger : leur sort est entre leurs mains ; mais bientôt il leur échappe.
Instruire la démocratie, ranimer s’il se peut ses croyances, purifier ses mœurs, régler ses mouvements, substituer peu à peu la science des affaires à son inexpérience, la connaissance de ses vrais intérêts à ses aveugles instincts ; adapter son gouvernement aux temps et aux lieux ; le modifier suivant les circonstances et les hommes : tel est le premier des devoirs imposé de nos jours à ceux qui dirigent la société.
Il faut une science politique nouvelle à un monde tout nouveau.
Mais c’est à quoi nous ne songeons guère : placés au milieu d’un fleuve rapide, nous fixons obstinément les yeux vers quelques débris qu’on aperçoit encore sur le rivage, tandis que le courant nous entraîne et nous pousse à reculons vers des abîmes.
Il n’y a pas de peuples de l’Europe chez lesquels la grande révolution sociale que je viens de décrire ait fait de plus rapides progrès que parmi nous ; mais elle y a toujours marché au hasard.
[I-10]
Jamais les chefs de l’État n’ont pensé à rien préparer d’avance pour elle ; elle s’est faite malgré eux ou à leur insu. Les classes les plus puissantes, les plus intelligentes et les plus morales de la nation n’ont point cherché à s’emparer d’elle, afin de la diriger. La démocratie a donc été abandonnée à ses instincts sauvages ; elle a grandi comme ces enfants, privés des soins paternels, qui s’élèvent d’eux-mêmes dans les rues de nos villes, et qui ne connaissent de la société que ses vices et ses misères. On semblait encore ignorer son existence, quand elle s’est emparée à l’improviste du pouvoir. Chacun alors s’est soumis avec servilité à ses moindres désirs ; on l’a adorée comme l’image de la force ; quand ensuite elle se fut affaiblie par ses propres excès, les législateurs conçurent le projet imprudent de la détruire au lieu de chercher à l’instruire et à la corriger, et sans vouloir lui apprendre à gouverner, ils ne songèrent qu’à la repousser du gouvernement.
Il en est résulté que la révolution démocratique s’est opérée dans le matériel de la société, sans qu’il se fît, dans les lois, les idées, les habitudes et les mœurs, le changement qui eût été nécessaire pour rendre cette révolution utile. Ainsi nous avons la démocratie, moins ce qui doit atténuer ses vices et faire ressortir ses avantages naturels ; et voyant déjà les maux qu’elle entraîne, nous ignorons encore les biens qu’elle peut donner.
[I-11]
Quand le pouvoir royal, appuyé sur l’aristocratie, gouvernait paisiblement les peuples de l’Europe, la société, au milieu de ses misères, jouissait de plusieurs genres de bonheur, qu’on peut difficilement concevoir et apprécier de nos jours.
La puissance de quelques sujets élevait des barrières insurmontables à la tyrannie du prince ; et les rois, se sentant d’ailleurs revêtus aux yeux de la foule d’un caractère presque divin, puisaient, dans le respect même qu’ils faisaient naître, la volonté de ne point abuser de leur pouvoir.
Placés à une distance immense du peuple, les nobles prenaient cependant au sort du peuple cette espèce d’intérêt bienveillant et tranquille que le pasteur accorde à son troupeau ; et, sans voir dans le pauvre leur égal, ils veillaient sur sa destinée, comme sur un dépôt remis par la Providence entre leurs mains.
N’ayant point conçu l’idée d’un autre état social que le sien, n’imaginant pas qu’il pût jamais s’égaler à ses chefs, le peuple recevait leurs bienfaits, et ne discutait point leurs droits. Il les aimait lorsqu’ils étaient cléments et justes, et se soumettait sans peine et sans bassesse à leurs rigueurs, comme à des maux inévitables que lui envoyait le bras de Dieu. L’usage et les mœurs avaient d’ailleurs établi des bornes à la tyrannie, et fondé une sorte de droit au milieu même de la force.
[I-12]
Le noble n’ayant point la pensée qu’on voulût lui arracher des privilèges qu’il croyait légitimes ; le serf regardant son infériorité comme un effet de l’ordre immuable de la nature, on conçoit qu’il put s’établir une sorte de bienveillance réciproque entre ces deux classes si différemment partagées du sort. On voyait alors dans la société, de l’inégalité, des misères, mais les âmes n’y étaient pas dégradées.
Ce n’est point l’usage du pouvoir ou l’habitude de l’obéissance qui déprave les hommes, c’est l’usage d’une puissance qu’ils considèrent comme illégitime, et l’obéissance à un pouvoir qu’ils regardent comme usurpé et comme oppresseur.
D’un côté étaient les biens, la force, les loisirs, et avec eux les recherches du luxe, les raffinements du goût, les plaisirs de l’esprit, le culte des arts ; de l’autre, le travail, la grossièreté et l’ignorance.
Mais au sein de cette foule ignorante et grossière, on rencontrait des passions énergiques, des sentiments généreux, des croyances profondes et de sauvages vertus.
Le corps social, ainsi organisé, pouvait avoir de la stabilité, de la puissance, et surtout de la gloire.
Mais voici les rangs qui se confondent ; les barrières élevées entre les hommes s’abaissent ; on divise les domaines, le pouvoir se partage, les lumières se répandent, les intelligences s’égalisent ; l’état social devient démocratique, et l’empire de la démocratie [I-13] s’établit enfin paisiblement dans les institutions et dans les mœurs.
Je conçois alors une société où tous, regardant la loi comme leur ouvrage, l’aimeraient et s’y soumettraient sans peine ; où l’autorité du gouvernement étant respectée comme nécessaire et non comme divine, l’amour qu’on porterait au chef de l’État ne serait point une passion, mais un sentiment raisonné et tranquille. Chacun ayant des droits, et étant assuré de conserver ses droits, il s’établirait entre toutes les classes une mâle confiance, et une sorte de condescendance réciproque, aussi éloignée de l’orgueil que de la bassesse.
Instruit de ses vrais intérêts, le peuple comprendrait que, pour profiter des biens de la société, il faut se soumettre à ses charges. L’association libre des citoyens pourrait remplacer alors la puissance individuelle des nobles, et l’État serait à l’abri de la tyrannie et de la licence.
Je comprends que dans un État démocratique, constitué de cette manière, la société ne sera point immobile ; mais les mouvements du corps social pourront y être réglés et progressifs ; si l’on y rencontre moins d’éclat qu’au sein d’une aristocratie, on y trouvera moins de misères ; les jouissances y seront moins extrêmes, et le bien-être plus général ; les sciences moins grandes, et l’ignorance plus rare ; les sentiments moins énergiques, et les habitudes plus [I-14] douces ; on y remarquera plus de vices et moins de crimes.
À défaut de l’enthousiasme et de l’ardeur des croyances, les lumières et l’expérience obtiendront quelquefois des citoyens de grands sacrifices ; chaque homme étant également faible sentira un égal besoin de ses semblables ; et connaissant qu’il ne peut obtenir leur appui qu’à la condition de leur prêter son concours, il découvrira sans peine que pour lui l’intérêt particulier se confond avec l’intérêt général.
La nation prise en corps sera moins brillante, moins glorieuse, moins forte peut-être ; mais la majorité des citoyens y jouira d’un sort plus prospère, et le peuple s’y montrera paisible, non qu’il désespère d’être mieux, mais parce qu’il sait être bien.
Si tout n’était pas bon et utile dans un semblable ordre de choses, la société du moins se serait approprié tout ce qu’il peut présenter d’utile et de bon, et les hommes, en abandonnant pour toujours les avantages sociaux que peut fournir l’aristocratie, auraient pris à la démocratie tous les biens que celle-ci peut leur offrir.
Mais nous, en quittant l’état social de nos aïeux, en jetant pêle-mêle derrière nous leurs institutions, leurs idées et leurs mœurs, qu’avons-nous pris à la place ?
Le prestige du pouvoir royal s’est évanoui, sans être remplacé par la majesté des lois ; de nos jours, le [I-15] peuple méprise l’autorité, mais il la craint, et la peur arrache de lui plus que ne donnaient jadis le respect et l’amour.
J’aperçois que nous avons détruit les existences individuelles qui pouvaient lutter séparément contre la tyrannie ; mais je vois le gouvernement qui hérite seul de toutes les prérogatives arrachées à des familles, à des corporations ou à des hommes : à la force quelquefois oppressive, mais souvent conservatrice, d’un petit nombre de citoyens, a donc succédé la faiblesse de tous.
La division des fortunes a diminué la distance qui séparait le pauvre du riche ; mais en se rapprochant, ils semblent avoir trouvé des raisons nouvelles de se haïr, et jetant l’un sur l’autre des regards pleins de terreur et d’envie, ils se repoussent mutuellement du pouvoir ; pour l’un comme pour l’autre, l’idée des droits n’existe point, et la force leur apparaît, à tous les deux, comme la seule raison du présent, et l’unique garantie de l’avenir.
Le pauvre a gardé la plupart des préjugés de ses pères, sans leurs croyances ; leur ignorance, sans leurs vertus ; il a admis, pour règle de ses actions, la doctrine de l’intérêt, sans en connaître la science, et son égoïsme est aussi dépourvu de lumières que l’était jadis son dévouement.
La société est tranquille, non point parce qu’elle a la conscience de sa force et de son bien-être, mais [I-16] au contraire parce qu’elle se croit faible et infirme ; elle craint de mourir en faisant un effort ; chacun sent le mal, mais nul n’a le courage et l’énergie nécessaires pour chercher le mieux ; on a des désirs, des regrets, des chagrins et des joies qui ne produisent rien de visible, ni de durable, semblables à des passions de vieillards qui n’aboutissent qu’à l’impuissance.
Ainsi nous avons abandonné ce que l’état ancien pouvait présenter de bon, sans acquérir ce que l’état actuel pourrait offrir d’utile ; nous avons détruit une société aristocratique, et, nous arrêtant complaisamment au milieu des débris de l’ancien édifice, nous semblons vouloir nous y fixer pour toujours.
Ce qui arrive dans le monde intellectuel n’est pas moins déplorable.
Gênée dans sa marche ou abandonnée sans appui à ses passions désordonnées, la démocratie de France a renversé tout ce qui se rencontrait sur son passage, ébranlant ce qu’elle ne détruisait pas. On ne l’a point vue s’emparer peu à peu de la société, afin d’y établir paisiblement son empire ; elle n’a cessé de marcher au milieu des désordres et de l’agitation d’un combat. Animé par la chaleur de la lutte, poussé au-delà des limites naturelles de son opinion, par les opinions et les excès de ses adversaires, chacun perd de vue l’objet même de ses poursuites, et tient un langage qui répond mal à ses vrais sentiments et à ses instincts secrets.
[I-17]
De là l’étrange confusion dont nous sommes forcés d’être les témoins.
Je cherche en vain dans mes souvenirs, je ne trouve rien qui mérite d’exciter plus de douleur et plus de pitié que ce qui se passe sous nos yeux ; il semble qu’on ait brisé de nos jours le lien naturel qui unit les opinions aux goûts et les actes aux croyances ; la sympathie qui s’est fait remarquer de tout temps entre les sentiments et les idées des hommes paraît détruite, et l’on dirait que toutes les lois de l’analogie morale sont abolies.
On rencontre encore parmi nous des chrétiens pleins de zèle, dont l’âme religieuse aime à se nourrir des vérités de l’autre vie ; ceux-là vont s’animer sans doute en faveur de la liberté humaine, source de toute grandeur morale. Le christianisme, qui a rendu tous les hommes égaux devant Dieu, ne répugnera pas à voir tous les citoyens égaux devant la loi. Mais, par un concours d’étranges événements, la religion se trouve momentanément engagée au milieu des puissances que la démocratie renverse, et il lui arrive souvent de repousser l’égalité qu’elle aime, et de maudire la liberté comme un adversaire, tandis qu’en la prenant par la main, elle pourrait en sanctifier les efforts.
À côté de ces hommes religieux, j’en découvre d’autres dont les regards sont tournés vers la terre plutôt que vers le ciel ; partisans de la liberté, non [I-18] seulement parce qu’ils voient en elle l’origine des plus nobles vertus, mais surtout parce qu’ils la considèrent comme la source des plus grands biens, ils désirent, sincèrement assurer son empire et faire goûter aux hommes ses bienfaits : je comprends que ceux-là vont se hâter d’appeler la religion à leur aide, car ils doivent savoir qu’on ne peut établir le règne de la liberté sans celui des mœurs, ni fonder les mœurs sans les croyances ; mais ils ont aperçu la religion dans les rangs de leurs adversaires, c’en est assez pour eux : les uns l’attaquent, et les autres n’osent la défendre.
Les siècles passés ont vu des âmes basses et vénales préconiser l’esclavage, tandis que des esprits indépendants et des cœurs généreux luttaient sans espérance pour sauver la liberté humaine. Mais on rencontre souvent de nos jours des hommes naturellement nobles et fiers, dont les opinions sont en opposition directe avec leurs goûts, et qui vantent la servilité et la bassesse qu’ils n’ont jamais connues pour eux-mêmes. Il en est d’autres au contraire qui parlent de la liberté comme s’ils pouvaient sentir ce qu’il y a de saint et de grand en elle, et qui réclament bruyamment en faveur de l’humanité des droits qu’ils ont toujours méconnus.
J’aperçois des hommes vertueux et paisibles que leurs mœurs pures, leurs habitudes tranquilles, leur aisance et leurs lumières placent naturellement à la [I-19] tête des populations qui les environnent. Pleins d’un amour sincère pour la patrie, ils sont prêts à faire pour elle de grands sacrifices : cependant la civilisation trouve souvent en eux des adversaires ; ils confondent ses abus avec ses bienfaits, et dans leur esprit l’idée du mal est indissolublement unie à celle du nouveau.
Près de là j’en vois d’autres qui, au nom des progrès, s’efforçant de matérialiser l’homme, veulent trouver l’utile sans s’occuper du juste, la science loin des croyances, et le bien-être séparé de la vertu : ceux-là se sont dits les champions de la civilisation moderne, et ils se mettent insolemment à sa tête, usurpant une place qu’on leur abandonne et dont leur indignité les repousse.
Où sommes-nous donc ?
Les hommes religieux combattent la liberté, et les amis de la liberté attaquent les religions ; des esprits nobles et généreux vantent l’esclavage, et des âmes basses et serviles préconisent l’indépendance ; des citoyens honnêtes et éclairés sont ennemis de tous les progrès, tandis que des hommes sans patriotisme et sans mœurs se font les apôtres de la civilisation et des lumières !
Tous les siècles ont-ils donc ressemblé au nôtre ? L’homme a-t-il toujours eu sous les yeux, comme de nos jours, un monde où rien ne s’enchaîne, où la vertu est sans génie, et le génie sans honneur ; où [I-20] l’amour de l’ordre se confond avec le goût des tyrans et le culte saint de la liberté avec le mépris des lois ; où la conscience ne jette qu’une clarté douteuse sur les actions humaines ; où rien ne semble plus défendu, ni permis, ni honnête, ni honteux, ni vrai, ni faux ?
Penserai-je que le Créateur a fait l’homme pour le laisser se débattre sans fin au milieu des misères intellectuelles qui nous entourent ? Je ne saurais le croire : Dieu prépare aux sociétés européennes un avenir plus fixe et plus calme ; j’ignore ses desseins, mais je ne cesserai pas d’y croire parce que je ne puis les pénétrer, et j’aimerai mieux douter de mes lumières que de sa justice.
Il est un pays dans le monde où la grande révolution sociale dont je parle semble avoir à peu près atteint ses limites naturelles ; elle s’y est opérée d’une manière simple et facile, ou plutôt on peut dire que ce pays voit les résultats de la révolution démocratique qui s’opère parmi nous, sans avoir eu la révolution elle-même.
Les émigrants qui vinrent se fixer en Amérique au commencement du xviie siècle dégagèrent en quelque façon le principe de la démocratie de tous ceux contre lesquels il luttait dans le sein des vieilles sociétés de l’Europe, et ils le transplantèrent seul sur les rivages du Nouveau-Monde. Là, il a pu grandir en liberté, et, marchant avec les mœurs, se développer paisiblement dans les lois.
[I-21]
Il me paraît hors de doute que tôt ou tard nous arriverons, comme les Américains, à l’égalité presque complète des conditions. Je ne conclus point de là que nous soyons appelés un jour à tirer nécessairement, d’un pareil état social, les conséquences politiques que les Américains en ont tirées. Je suis très loin de croire qu’ils aient trouvé la seule forme de gouvernement que puisse se donner la démocratie ; mais il suffit que dans les deux pays la cause génératrice des lois et des mœurs soit la même, pour que nous ayons un intérêt immense à savoir ce qu’elle a produit dans chacun d’eux.
Ce n’est donc pas seulement pour satisfaire une curiosité, d’ailleurs légitime, que j’ai examiné l’Amérique ; j’ai voulu y trouver des enseignements dont nous puissions profiter. On se tromperait étrangement si l’on pensait que j’aie voulu faire un panégyrique ; quiconque lira ce livre sera bien convaincu que tel n’a point été mon dessein ; mon but n’a pas été non plus de préconiser telle forme de gouvernement en général ; car je suis du nombre de ceux qui croient qu’il n’y a presque jamais de bonté absolue dans les lois ; je n’ai même pas prétendu juger si la révolution sociale, dont la marche me semble irrésistible, était avantageuse ou funeste à l’humanité ; j’ai admis cette révolution comme un fait accompli ou prêt à s’accomplir, et, parmi les peuples qui l’ont vue s’opérer dans leur sein, j’ai cherché celui chez lequel elle a [I-22] atteint le développement le plus complet et le plus paisible, afin d’en discerner clairement les conséquences naturelles, et d’apercevoir, s’il se peut, les moyens de la rendre profitable aux hommes. J’avoue que dans l’Amérique j’ai vu plus que l’Amérique ; j’y ai cherché une image de la démocratie elle-même, de ses penchants, de son caractère, de ses préjugés, de ses passions ; j’ai voulu la connaître, ne fût-ce que pour savoir du moins ce que nous devions espérer ou craindre d’elle.
Dans la première partie de cet ouvrage, j’ai donc essayé de montrer la direction que la démocratie, livrée en Amérique à ses penchants et abandonnée presque sans contrainte à ses instincts, donnait naturellement aux lois, la marche qu’elle imprimait au gouvernement, et en général la puissance qu’elle obtenait sur les affaires. J’ai voulu savoir quels étaient les biens et les maux produits par elle. J’ai recherché de quelles précautions les Américains avaient fait usage pour la diriger, et quelles autres ils avaient omises, et j’ai entrepris de distinguer les causes qui lui permettent de gouverner la société.
Mon but était de peindre dans une seconde partie l’influence qu’exercent en Amérique l’égalité des conditions et le gouvernement de la démocratie, sur la société civile, sur les habitudes, les idées et les mœurs ; mais je commence à me sentir moins d’ardeur pour l’accomplissement de ce dessein. Avant [I-23] que je puisse fournir ainsi la tâche que je m’étais proposée, mon travail sera devenu presque inutile. Un autre doit bientôt montrer aux lecteurs les principaux traits du caractère américain, et, cachant sous un voile léger la gravité des tableaux, prêter à la vérité des charmes dont je n’aurais pu la parer [1] .
Je ne sais si j’ai réussi à faire connaître ce que j’ai vu en Amérique, mais je suis assuré d’en avoir eu sincèrement le désir, et de n’avoir jamais cédé qu’à mon insu au besoin d’adapter les faits aux idées, au lieu de soumettre les idées aux faits.
Lorsqu’un point pouvait être établi à l’aide de documents écrits, j’ai eu soin de recourir aux textes originaux et aux ouvrages les plus authentiques et les plus estimés [2] . J’ai indiqué mes sources en notes, et [I-24] chacun pourra les vérifier. Quand il s’est agi d’opinions, d’usages politiques, d’observations de mœurs, j’ai cherché à consulter les hommes les plus éclairés. S’il arrivait que la chose fût importante ou douteuse, je ne me contentais pas d’un témoin, mais je ne me déterminais que sur l’ensemble des témoignages.
Ici il faut nécessairement que le lecteur me croie sur parole. J’aurais souvent pu citer à l’appui de ce que j’avance l’autorité de noms qui lui sont connus, ou qui du moins sont dignes de l’être ; mais je me suis gardé de le faire. L’étranger apprend souvent auprès du foyer de son hôte d’importantes vérités, que celui-ci déroberait peut-être à l’amitié ; on se soulage avec lui d’un silence obligé ; on ne craint pas son indiscrétion, parce qu’il passe. Chacune de ces confidences était enregistrée par moi aussitôt que reçue, mais elles ne sortiront jamais de mon portefeuille ; j’aime mieux nuire au succès de mes récits que d’ajouter mon nom à la liste de ces voyageurs qui renvoient des chagrins et des embarras en retour de la généreuse hospitalité qu’ils ont reçue.
Je sais que, malgré mes soins, rien ne sera plus facile [I-25] que de critiquer ce livre, si personne songe jamais à le critiquer.
Ceux qui voudront y regarder de près retrouveront, je pense, dans l’ouvrage entier, une pensée-mère qui enchaîne, pour ainsi dire, toutes ses parties. Mais la diversité des objets que j’ai eus à traiter est très grande, et celui qui entreprendra d’opposer un fait isolé à l’ensemble des faits que je cite, une idée détachée à l’ensemble des idées, y réussira sans peine. Je voudrais donc qu’on me fît la grâce de me lire dans le même esprit qui a présidé à mon travail, et qu’on jugeât le livre par l’impression générale qu’il laisse, comme je me suis décidé moi-même, non par telle raison, mais par la masse des raisons.
Il ne faut pas non plus oublier que l’auteur qui veut se faire comprendre est obligé de pousser chacune de ses idées dans toutes leurs conséquences théoriques, et souvent jusqu’aux limites du faux et de l’impraticable ; car s’il est quelquefois nécessaire de s’écarter des règles de logique dans les actions, on ne saurait le faire de même dans les discours, et l’homme trouve presque autant de difficultés à être inconséquent dans ses paroles qu’il en rencontre d’ordinaire à être conséquent dans ses actes.
Je finis en signalant moi-même ce qu’un grand nombre de lecteurs considérera comme le défaut capital de l’ouvrage. Ce livre ne se met précisément à la suite de personne ; en l’écrivant, je n’ai entendu [I-26] servir ni combattre aucun parti ; j’ai entrepris de voir, non pas autrement, mais plus loin que les partis ; et tandis qu’ils s’occupent du lendemain, j’ai voulu songer à l’avenir.
[I-27]
CHAPITRE I.↩
CONFIGURATION EXTÉRIEURE DE L’AMÉRIQUE DU NORD.
L’Amérique du Nord divisée en deux vastes régions, l’une descendant vers le pôle, l’autre vers l’équateur. — Vallée du Mississipi, — Traces qu’on y rencontre des révolutions du globe. — Rivage de l’océan Atlantique, sur lequel se sont fondées les colonies anglaises. — Différent aspect que présentaient l’Amérique dit Sud et l’Amérique du Nord à l’époque de la découverte. — Forêts de l’Amérique du Nord. — Prairies. — Tribus errantes des indigènes. Leur extérieur, leurs mœurs, leurs langues. — Traces d’un peuple inconnu.
L’Amérique du Nord présente, dans sa configuration extérieure, des traits généraux qu’il est facile de discerner au premier coup d’œil.
Une sorte d’ordre méthodique y a présidé à la séparation des terres et des eaux, des montagnes et des vallées. Un arrangement simple et majestueux s’y révèle au milieu même de la confusion des objets et parmi l’extrême variété des tableaux.
Deux vastes régions la divisent d’une manière presque égale [3] .
[I-28]
L’une a pour limite, au septentrion, le pôle arctique ; à l’est, à l’ouest, les deux grands océans. Elle s’avance ensuite vers le midi, et forme un triangle dont les côtés irrégulièrement tracés se rencontrent enfin au-dessous des grands lacs du Canada.
La seconde commence où finit la première, et s’étend sur tout le reste du continent.
L’une est légèrement inclinée vers le pôle, l’autre vers l’équateur.
Les terres comprises dans la première région descendent au nord par une pente si insensible, qu’on pourrait presque dire qu’elles forment un plateau. Dans l’intérieur de cet immense terre-plein, on ne rencontre ni hautes montagnes ni profondes vallées.
Les eaux y serpentent comme au hasard ; les fleuves s’y entremêlent, se joignent, se quittent, se retrouvent encore, se perdent dans mille marais, s’égarent à chaque instant au milieu d’un labyrinthe humide qu’ils ont créé, et ne gagnent enfin qu’après d’innombrables circuits les mers polaires. Les grands lacs qui terminent cette première région ne sont pas encaissés, comme la plupart de ceux de l’ancien monde, dans des collines ou des rochers ; leurs rives sont plates et ne s’élèvent que de quelques pieds au-dessus du niveau de l’eau. Chacun d’eux forme donc comme une vaste coupe remplie jusqu’aux bords ; les plus légers changements dans la structure du globe précipiteraient leurs ondes du côté du pôle ou vers la mer des tropiques.
La seconde région est plus accidentée et mieux préparée pour devenir la demeure permanente de l’homme ; deux longues chaînes de montagnes la [I-29] partagent dans toute sa longueur : l’une, sous le nom d’Alléghanys, suit les bords de l’océan Atlantique ; l’autre court parallèlement à la mer du Sud.
L’espace renfermé entre les deux chaînes de montagnes comprend 228 843 lieues carrées [4] . Sa superficie est donc environ six fois plus grande que celle de la France [5] .
Ce vaste territoire ne forme cependant qu’une seule vallée, qui, descendant du sommet arrondi des Alléghanys, remonte, sans rencontrer d’obstacles, jusqu’aux cimes des montagnes Rocheuses.
Au fond de la vallée, coule un fleuve immense. C’est vers lui qu’on voit accourir de toutes parts les eaux qui descendent des montagnes.
Jadis les Français l’avaient appelé le fleuve Saint-Louis, en mémoire de la patrie absente ; et les Indiens, dans leur pompeux langage, l’ont nommé le Père des eaux, ou le Mississipi.
Le Mississipi prend sa source sur les limites des deux grandes régions dont j’ai parlé plus haut, vers le sommet du plateau qui les sépare.
Près de lui naît un autre fleuve [6] qui va se décharger dans les mers polaires. Le Mississipi lui-même semble quelque temps incertain du chemin qu’il doit prendre : plusieurs fois il revient sur ses pas, et ce n’est qu’après avoir ralenti son cours au sein des lacs et des marécages qu’il se décide enfin et trace lentement sa route vers le midi.
[I-30]
Tantôt tranquille au fond du lit argileux que lui a creusé la nature, tantôt gonflé par les orages, le Mississipi arrose plus de mille lieues dans son cours [7] .
Six cents lieues [8] au-dessus de son embouchure, le fleuve a déjà une profondeur moyenne de 15 pieds, et des bâtiments de 300 tonneaux le remontent pendant un espace de près de deux cents lieues.
Cinquante-sept grandes rivières navigables viennent lui apporter leurs eaux. On compte, parmi les tributaires du Mississipi, un fleuve de 1,300 lieues de cours [9] , un de 900 [10] , un de 600 [11] , un de 500 [12] , quatre de 200 [13] , sans parler d’une multitude innombrable de ruisseaux qui accourent de toutes parts se perdre dans son sein.
La vallée que le Mississipi arrose semble avoir été créée pour lui seul ; il y dispense à volonté le bien et le mal, et il en est comme le dieu. Aux environs du fleuve, la nature déploie une inépuisable fécondité ; à mesure qu’on s’éloigne de ses rives, les forces végétales s’épuisent, les terrains s’amaigrissent, tout languit ou meurt. Nulle part les grandes convulsions du globe n’ont laissé de traces plus évidentes que dans la vallée du Mississipi. L’aspect tout entier du pays y [I-31] atteste le travail des eaux. Sa stérilité comme son abondance est leur ouvrage. Les flots de l’océan primitif ont accumulé dans le fond de la vallée d’énormes couches de terre végétale qu’ils ont eu le temps d’y niveler. On rencontre sur la rive droite du fleuve des plaines immenses, unies comme la surface d’un champ sur lequel le laboureur aurait fait passer son rouleau. À mesure qu’on approche des montagnes, le terrain, au contraire, devient de plus en plus inégal et stérile ; le sol y est, pour ainsi dire, percé en mille endroits, et des roches primitives apparaissent çà et là, comme les os d’un squelette après que le temps a consumé à l’entour d’eux les muscles et les chairs. Un sable granitique, des pierres irrégulièrement taillées, couvrent la surface de la terre ; quelques plantes poussent à grand’peine leurs rejetons à travers ces obstacles ; on dirait un champ fertile couvert des débris d’un vaste édifice. En analysant ces pierres et ce sable, il est facile en effet de remarquer une analogie parfaite entre leurs substances et celles qui composent les cimes arides et brisées des montagnes Rocheuses. Après avoir précipité la terre dans le fond de la vallée, les eaux ont sans doute fini par entraîner avec elles une partie des roches elles-mêmes ; elles les ont roulées sur les pentes les plus voisines ; et, après les avoir broyées les unes contre les autres, elles ont parsemé la base des montagnes de ces débris arrachés à leurs sommets (A).
La vallée du Mississipi est, à tout prendre, la plus magnifique demeure que Dieu ait jamais préparée pour l’habitation de l’homme, et pourtant on peut dire qu’elle ne forme encore qu’un vaste désert.
[I-32]
Sur le versant oriental des Alléghanys, entre le pied de ses montagnes et l’océan Atlantique, s’étend une longue bande de roches et de sable que la mer semble avoir oubliée en se retirant. Ce territoire n’a que 48 lieues de largeur moyenne [14] , mais il compte 390 lieues de longueur [15] . Le sol, dans cette partie du continent américain, ne se prête qu’avec peine aux travaux du cultivateur. La végétation y est maigre et uniforme.
C’est sur cette côte inhospitalière que se sont d’abord concentrés les efforts de l’industrie humaine. Sur cette langue de terre aride sont nées et ont grandi les colonies anglaises qui devaient devenir un jour les États-Unis d’Amérique. C’est encore là que se trouve aujourd’hui le foyer de la puissance, tandis que sur les derrières s’assemblent presque en secret les véritables éléments du grand peuple auquel appartient sans doute l’avenir du continent.
Quand les Européens abordèrent les rivages des Antilles, et plus tard les côtes de l’Amérique du Sud, ils se crurent transportés dans les régions fabuleuses qu’avaient célébrées les poètes. La mer étincelait des feux du tropique ; la transparence extraordinaire de ses eaux découvrait pour la première fois, aux yeux du navigateur, la profondeur des abîmes [16] . Çà et [I-33] là se montraient de petites îles parfumées qui semblaient flotter comme des corbeilles de fleurs sur la surface tranquille de l’Océan. Tout ce qui, dans ces lieux enchantés, s’offrait à la vue, semblait préparé pour les besoins de l’homme, ou calculé pour ses plaisirs. La plupart des arbres étaient chargés de fruits nourrissants, et les moins utiles à l’homme charmaient ses regards par l’éclat et la variété de leurs couleurs. Dans une forêt de citronniers odorants, de figuiers sauvages, de myrtes à feuilles rondes, d’acacias et de lauriers-roses, tout entrelacés par des lianes fleuries, une multitude d’oiseaux inconnus à l’Europe faisaient étinceler leurs ailes de pourpre et d’azur, et mêlaient le concert de leurs voix aux harmonies d’une nature pleine de mouvement et de vie (B).
La mort était cachée sous ce manteau brillant ; mais on ne l’apercevait point alors, et il régnait d’ailleurs dans l’air de ces climats je ne sais quelle influence énervante qui attachait l’homme au présent, et le rendait insouciant de l’avenir.
L’Amérique du Nord parut sous un autre aspect : tout y était grave, sérieux, solennel ; on eût dit qu’elle avait été créée pour devenir le domaine de l’intelligence, comme l’autre la demeure des sens.
Un océan turbulent et brumeux enveloppait ses rivages ; des rochers granitiques ou des grèves de sable lui servaient de ceinture ; les bois qui couvraient ses rives étalaient un feuillage sombre et mélancolique ; on n’y voyait guère croître que le pin, le [I-34] mélèze, le chêne vert, l’olivier sauvage et le laurier.
Après avoir pénétré à travers cette première enceinte, on entrait sous les ombrages de la forêt centrale ; là se trouvaient confondus les plus grands arbres qui croissent sur les deux hémisphères. Le platane, le catalpa, l’érable à sucre et le peuplier de Virginie entrelaçaient leurs branches avec celles du chêne, du hêtre et du tilleul.
Comme dans les forêts soumises au domaine de l’homme, la mort frappait ici sans relâche ; mais personne ne se chargeait d’enlever les débris qu’elle avait faits. Ils s’accumulaient donc les uns sur les autres : le temps ne pouvait suffire à les réduire assez vite en poudre et à préparer de nouvelles places. Mais, au milieu même de ces débris, le travail de la reproduction se poursuivait sans cesse. Des plantes grimpantes et des herbes de toute espèce se faisaient jour à travers les obstacles ; elles rampaient le long des arbres abattus, s’insinuaient dans leur poussière, soulevaient et brisaient l’écorce flétrie qui les couvrait encore, et frayaient un chemin à leurs jeunes rejetons. Ainsi la mort venait en quelque sorte y aider à la vie. L’une et l’autre étaient en présence, elles semblaient avoir voulu mêler et confondre leurs œuvres.
Ces forêts recélaient une obscurité profonde ; mille ruisseaux, dont l’industrie humaine n’avait point encore dirigé le cours, y entretenaient une éternelle humidité. À peine y voyait-on quelques fleurs, quelques fruits sauvages, quelques oiseaux.
La chute d’un arbre renversé par l’âge, la cataracte d’un fleuve, le mugissement des buffles et le [I-35] sifflement des vents y troublaient seuls le silence de la nature.
À l’est du grand fleuve, les bois disparaissaient en partie ; à leur place s’étendaient des prairies sans bornes. La nature, dans son infinie variété, avait-elle refusé la semence des arbres à ces fertiles campagnes, ou plutôt la forêt qui les couvrait avait-elle été détruite jadis par la main de l’homme ? C’est ce que les traditions ni les recherches de la science n’ont pu découvrir.
Ces immenses déserts n’étaient pas cependant entièrement privés de la présence de l’homme ; quelques peuplades erraient depuis des siècles sous les ombrages de la forêt ou parmi les pâturages de la prairie. À partir de l’embouchure du Saint-Laurent jusqu’au delta du Mississipi, depuis l’océan Atlantique jusqu’à la mer du Sud, ces sauvages avaient entre eux des points de ressemblance qui attestaient leur commune origine. Mais, du reste, ils différaient de toutes les races connues [17] : ils n’étaient ni blancs comme les Européens, ni jaunes comme la plupart des Asiatiques, ni noirs comme les nègres ; leur peau était rougeâtre, leurs cheveux longs et luisants, leurs [I-36] lèvres minces et les pommettes de leurs joues très saillantes. Les langues que parlaient les peuplades sauvages de l’Amérique différaient entre elles par les mots, mais toutes étaient soumises aux mêmes règles grammaticales. Ces règles s’écartaient en plusieurs points de celles qui jusque là avaient paru présider à la formation du langage parmi les hommes.
L’idiome des Américains semblait le produit de combinaisons nouvelles ; il annonçait de la part de ses inventeurs un effort d’intelligence dont les Indiens de nos jours paraissent peu capables (C).
L’état social de ces peuples différait aussi sous plusieurs rapports de ce qu’on voyait dans l’ancien monde : on eût dit qu’ils s’étaient multipliés librement au sein de leurs déserts, sans contact avec des races plus civilisées que la leur. On ne rencontrait donc point chez eux ces notions douteuses et incohérentes du bien et du mal, cette corruption profonde qui se mêle d’ordinaire à l’ignorance et à la rudesse des mœurs, chez les nations policées qui sont redevenues barbares. L’Indien ne devait rien qu’à lui-même ; ses vertus, ses vices, ses préjugés, étaient son propre ouvrage il avait grandi dans l’indépendance sauvage de sa nature.
La grossièreté des hommes du peuple, dans les pays policés, ne vient pas seulement de ce qu’ils sont ignorants et pauvres, mais de ce qu’étant tels ils se trouvent journellement en contact avec des hommes éclairés et riches.
La vue de leur infortune et de leur faiblesse, qui vient chaque jour contraster avec le bonheur et la puissance de quelques uns de leurs semblables, [I-37] excite en même temps dans leur cœur de la colère et de la crainte ; le sentiment de leur infériorité et de leur dépendance les irrite et les humilie. Cet état intérieur de l’âme se reproduit dans leurs mœurs, ainsi que dans leur langage ; ils sont tout à la fois insolents et bas.
La vérité de ceci se prouve aisément par l’observation. Le peuple est plus grossier dans les pays aristocratiques que partout ailleurs ; dans les cités opulentes que dans les campagnes.
Dans ces lieux, où se rencontrent des hommes si forts et si riches, les faibles et les pauvres se sentent comme accablés de leur bassesse ; ne découvrant aucun point par lequel ils puissent regagner l’égalité, ils désespèrent entièrement d’eux-mêmes, et se laissent tomber au-dessous de la dignité humaine.
Cet effet fâcheux du contraste des conditions ne se retrouve point dans la vie sauvage : les Indiens, en même temps qu’ils sont tous ignorants et pauvres, sont tous égaux et libres.
Lors de l’arrivée des Européens, l’indigène de l’Amérique du Nord ignorait encore le prix des richesses et se montrait indifférent au bien-être que l’homme civilisé acquiert avec elles. Cependant on n’apercevait en lui rien de grossier ; il régnait au contraire dans ses façons d’agir une réserve habituelle et une sorte de politesse aristocratique.
Doux et hospitalier dans la paix, impitoyable dans la guerre, au-delà même des bornes connues de la férocité humaine, l’Indien s’exposait à mourir de faim pour secourir l’étranger qui frappait le soir à la porte de sa cabane, et il déchirait de ses propres mains les [I-38] membres palpitants de son prisonnier. Les plus fameuses républiques antiques n’avaient jamais admiré de courage plus ferme, d’âmes plus orgueilleuses, de plus intraitable amour de l’indépendance, que n’en cachaient alors les bois sauvages du Nouveau-Monde [18] . Les Européens ne produisirent que peu d’impression en abordant sur les rivages de l’Amérique du Nord ; leur présence ne fit naître ni envie ni peur. Quelle prise pouvaient-ils avoir sur de pareils hommes ? l’Indien savait vivre sans besoins, souffrir sans se plaindre, et mourir en chantant [19] . Comme tous les autres membres de la grande famille humaine, ces sauvages croyaient du reste à l’existence d’un monde meilleur, et adoraient sous différents noms le Dieu créateur de l’univers, Leurs notions sur les grandes vérités intellectuelles étaient en général simples et philosophiques (D).
Quelque primitif que paraisse le peuple dont nous traçons ici le caractère, on ne saurait pourtant douter qu’un autre peuple plus civilisé, plus avancé en toutes [I-39] choses que lui, ne l’eût précédé dans les mêmes régions.
Une tradition obscure, mais répandue chez la plupart des tribus indiennes des bords de l’Atlantique, nous enseigne que jadis la demeure de ces mêmes peuplades avait été placée à l’ouest du Mississipi. Le long des rives de l’Ohio et dans toute la vallée centrale, on trouve encore chaque jour des monticules élevés par la main de l’homme. Lorsqu’on creuse jusqu’au centre de ces monuments, on ne manque guère, dit-on, de rencontrer des ossements humains, des instruments étranges, des armes, des ustensiles de tous genres faits d’un métal, ou rappelant des usages ignorés des races actuelles.
Les Indiens de nos jours ne peuvent donner aucun renseignement sur l’histoire de ce peuple inconnu. Ceux qui vivaient il y a trois cents ans, lors de la découverte de l’Amérique, n’ont rien dit non plus dont on puisse inférer même une hypothèse. Les traditions, ces monuments périssables et sans cesse renaissants du monde primitif, ne fournissent aucune lumière. Là, cependant, ont vécu des milliers de nos semblables ; on ne saurait en douter. Quand y sont-ils venus, quelle a été leur origine, leur destinée, leur histoire ? quand et comment ont-ils péri ? Nul ne pourrait le dire.
Chose bizarre ! il y a des peuples qui sont si complètement disparus de la terre, que le souvenir même de leur nom s’est effacé ; leurs langues sont perdues, leur gloire s’est évanouie comme un son sans écho ; mais je ne sais s’il en est un seul qui n’ait pas au moins laissé un tombeau en mémoire de son passage. Ainsi, [I-40] de tous les ouvrages de l’homme, le plus durable est encore celui qui retrace le mieux son néant et ses misères !
Quoique le vaste pays qu’on vient de décrire fût habité par de nombreuses tribus d’indigènes, on peut dire avec justice qu’à l’époque de la découverte il ne formait encore qu’un désert. Les Indiens l’occupaient, mais ne le possédaient pas. C’est par l’agriculture que l’homme s’approprie le sol, et les premiers habitants de l’Amérique du Nord vivaient du produit de la chasse. Leurs implacables préjugés, leurs passions indomptées, leurs vices, et plus encore peut-être leurs sauvages vertus, les livraient à une destruction inévitable. La ruine de ces peuples a commencé du jour où les Européens ont abordé sur leurs rivages ; elle a toujours continué depuis ; elle achève de s’opérer de nos jours. La Providence, en les plaçant au milieu des richesses du Nouveau-Monde, semblait ne leur en avoir donné qu’un court usufruit ; ils n’étaient là, en quelque sorte, qu’en attendant. Ces côtes, si bien préparées pour le commerce et l’industrie, ces fleuves si profonds, cette inépuisable vallée du Mississipi, ce continent tout entier, apparaissaient alors comme le berceau encore vide d’une grande nation.
C’est là que les hommes civilisés devaient essayer de bâtir la société sur des fondements nouveaux, et qu’appliquant pour la première fois des théories jusqu’alors inconnues ou réputées inapplicables, ils allaient donner au monde un spectacle auquel l’histoire du passé ne l’avait pas préparé.
[I-41]
CHAPITRE II.↩
DU POINT DE DÉPART ET DE SON IMPORTANCE POUR L’AVENIR DES ANGLO-AMÉRICAINS.
Utilité de connaître le point de départ des peuples pour comprendre leur état social et leurs lois. — L’Amérique est le seul pays où l’on ait pu apercevoir clairement le point de départ d’un grand peuple. — En quoi tous les hommes qui vinrent peupler l’Amérique anglaise se ressemblaient. — En quoi ils différaient. — Remarque applicable à tous les Européens qui vinrent s’établir sur le rivage du Nouveau-Monde. — Colonisation de la Virginie. — Id. de la Nouvelle-Angleterre. — Caractère original des premiers habitants de la Nouvelle-Angleterre. — Leur arrivée. — Leurs premières lois. — Contrat social. — Code pénal emprunté à la législation de Moïse. — Ardeur religieuse. — Esprit républicain. — Union intime de l’esprit de religion et de l’esprit de liberté.
Un homme vient à naître ; ses premières années se passent obscurément parmi les plaisirs ou les travaux de l’enfance. Il grandit ; la virilité commence ; les portes du monde s’ouvrent enfin pour le recevoir ; il entre en contact avec ses semblables. On l’étudie alors pour la première fois, et l’on croit voir se former en lui le germe des vices et des vertus de son âge mûr.
C’est là, si je ne me trompe, une grande erreur.
Remontez en arrière ; examinez l’enfant jusque dans les bras de sa mère ; voyez le monde extérieur se refléter pour la première fois sur le miroir encore obscur de son intelligence ; contemplez les premiers [I-42] exemples qui frappent ses regards ; écoutez les premières paroles qui éveillent chez lui les puissances endormies de la pensée ; assistez enfin aux premières luttes qu’il a à soutenir ; et alors seulement vous comprendrez d’où viennent les préjugés, les habitudes et les passions qui vont dominer sa vie. L’homme est pour ainsi dire tout entier dans les langes de son berceau.
Il se passe quelque chose d’analogue chez les nations. Les peuples se ressentent toujours de leur origine. Les circonstances qui ont accompagné leur naissance et servi à leur développement influent sur tout le reste de leur carrière.
S’il nous était possible de remonter jusqu’aux éléments des sociétés, et d’examiner les premiers monuments de leur histoire, je ne doute pas que nous ne pussions y découvrir la cause première des préjugés, des habitudes, des passions dominantes, de tout ce qui compose enfin ce qu’on appelle le caractère national ; il nous arriverait d’y rencontrer l’explication d’usages qui, aujourd’hui, paraissent contraires aux mœurs régnantes ; de lois qui semblent en opposition avec les principes reconnus ; d’opinions incohérentes qui se rencontrent çà et là dans la société, comme ces fragments de chaînes brisées qu’on voit pendre encore quelquefois aux voûtes d’un vieil édifice, et qui ne soutiennent plus rien. Ainsi s’expliquerait la destinée de certains peuples qu’une force inconnue semble entraîner vers un but qu’eux-mêmes ignorent. Mais jusqu’ici les faits ont manqué à une pareille étude ; l’esprit d’analyse n’est venu aux nations qu’à mesure qu’elles vieillissaient, et lorsqu’elles ont enfin [I-43] songé à contempler leur berceau, le temps l’avait déjà enveloppé d’un nuage, l’ignorance et l’orgueil l’avaient environné de fables, derrière lesquelles se cachait la vérité.
L’Amérique est le seul pays où l’on ait pu assister aux développements naturels et tranquilles d’une société, et où il ait été possible de préciser l’influence exercée par le point de départ sur l’avenir des États.
À l’époque où les peuples européens descendirent sur les rivages du Nouveau-Monde, les traits de leur caractère national étaient déjà bien arrêtés ; chacun d’eux avait une physionomie distincte ; et comme ils étaient déjà arrivés à ce degré de civilisation qui porte les hommes à l’étude d’eux-mêmes, ils nous ont transmis le tableau fidèle de leurs opinions, de leurs mœurs et de leurs lois. Les hommes du XVe siècle nous sont presque aussi bien connus que ceux du nôtre. L’Amérique nous montre donc au grand jour ce que l’ignorance ou la barbarie des premiers âges a soustrait à nos regards.
Assez près de l’époque où les sociétés américaines furent fondées pour connaître en détail leurs éléments, assez loin de ce temps pour pouvoir déjà juger ce que ces germes ont produit, les hommes de nos jours semblent être destinés à voir plus avant que leurs devanciers dans les événements humains. La Providence a mis à notre portée un flambeau qui manquait à nos pères, et nous a permis de discerner, dans la destinée des nations, des causes premières que l’obscurité du passé leur dérobait.
Lorsque, après avoir étudié attentivement l’histoire de l’Amérique, on examine avec soin son état [I-44] politique et social, on se sent profondément convaincu de cette vérité : qu’il n’est pas une opinion, pas une habitude, pas une loi, je pourrais dire pas un événement, que le point de départ n’explique sans peine. Ceux qui liront ce livre trouveront donc dans le présent chapitre le germe de ce qui doit suivre et la clef de presque tout l’ouvrage.
Les émigrants qui vinrent, à différentes périodes, occuper le territoire que couvre aujourd’hui l’Union Américaine, différaient les uns des autres en beaucoup de points ; leur but n’était pas le même, et ils se gouvernaient d’après des principes divers.
Ces hommes avaient cependant entre eux des traits communs, et ils se trouvaient tous dans une situation analogue.
Le lien du langage est peut-être le plus fort et le plus durable qui puisse unir les hommes. Tous les émigrants parlaient la même langue ; ils étaient tous enfants d’un même peuple. Nés dans un pays qu’agitait depuis des siècles la lutte des partis, et où les factions avaient été obligées, tour à tour, de se placer sous la protection des lois, leur éducation politique s’était faite à cette rude école, et on voyait répandus parmi eux plus de notions des droits, plus de principes de vraie liberté que chez la plupart des peuples de l’Europe. À l’époque des premières émigrations, le gouvernement communal, ce germe fécond des institutions libres, était déjà profondément entré dans les habitudes anglaises, et avec lui le dogme de la souveraineté du peuple s’était introduit au sein même de la monarchie des Tudors.
On était alors au milieu des querelles religieuses [I-45] qui ont agité le monde chrétien. L’Angleterre s’était précipitée avec une sorte de fureur dans cette nouvelle carrière. Le caractère des habitants, qui avait toujours été grave et réfléchi, était devenu austère et argumentateur. L’instruction s’était beaucoup accrue dans ces luttes intellectuelles ; l’esprit y avait reçu une culture plus profonde. Pendant qu’on était occupé à parler religion, les mœurs étaient devenues plus pures. Tous ces traits généraux de la nation se retrouvaient plus ou moins dans la physionomie de ceux de ses fils qui étaient venus chercher un nouvel avenir sur les bords opposés de l’Océan.
Une remarque, d’ailleurs, à laquelle nous aurons occasion de revenir plus tard, est applicable non seulement aux Anglais, mais encore aux Français, aux Espagnols et à tous les Européens qui sont venus successivement s’établir sur les rivages du Nouveau-Monde. Toutes les nouvelles colonies européennes contenaient, sinon le développement, du moins le germe d’une complète démocratie. Deux causes conduisaient à ce résultat : on peut dire qu’en général, à leur départ de la mère-patrie, les émigrants n’avaient aucune idée de supériorité quelconque les uns sur les autres. Ce ne sont guère les heureux et les puissants qui s’exilent, et la pauvreté ainsi que le malheur sont les meilleurs garants d’égalité que l’on connaisse parmi les hommes. Il arriva cependant qu’à plusieurs reprises de grands seigneurs passèrent en Amérique à la suite de querelles politiques ou religieuses. On y fit des lois pour y établir la hiérarchie des rangs, mais on s’aperçut bientôt que le sol américain repoussait absolument l’aristocratie territoriale. On vit [I-46] que pour défricher cette terre rebelle il ne fallait rien moins que les efforts constants et intéressés du propriétaire lui-même. Le fonds préparé, il se trouva que ses produits n’étaient point assez grands pour enrichir tout à la fois un maître et un fermier. Le terrain se morcela donc naturellement en petits domaines que le propriétaire seul cultivait. Or, c’est à la terre que se prend l’aristocratie, c’est au sol qu’elle s’attache et qu’elle s’appuie ; ce ne sont point les priviléges seuls qui l’établissent, ce n’est pas la naissance qui la constitue, c’est la propriété foncière héréditairement transmise. Une nation peut présenter d’immenses fortunes et de grandes misères ; mais si ces fortunes ne sont point territoriales, on voit dans son sein des pauvres et des riches ; il n’y a pas, à vrai dire, d’aristocratie.
Toutes les colonies anglaises avaient donc entre elles, à l’époque de leur naissance, un grand air de famille. Toutes, dès leur principe, semblaient destinées à offrir le développement de la liberté, non pas la liberté aristocratique de leur mère-patrie, mais la liberté bourgeoise et démocratique dont l’histoire du monde ne présentait point encore de complet modèle.
Au milieu de cette teinte générale, s’apercevaient cependant, de très fortes nuances qu’il est nécessaire de montrer.
On peut y distinguer dans la grande famille anglo-américaine deux rejetons principaux qui, jusqu’à présent, ont grandi sans se confondre entièrement, l’un au sud, l’autre au nord.
La Virginie reçut la première colonie anglaise. Les émigrants y arrivèrent en 1607. L’Europe, à cette [I-47] époque, était encore singulièrement préoccupée de l’idée que les mines d’or et d’argent, font la richesse des peuples : idée funeste qui a plus appauvri les nations européennes qui s’y sont livrées, et détruit plus d’hommes en Amérique, que la guerre et toutes les mauvaises lois ensemble. Ce furent donc des chercheurs d’or que l’on envoya en Virginie [20] , gens sans ressources et sans conduite, dont l’esprit inquiet et turbulent troubla l’enfance de la colonie [21] , et en rendit les progrès incertains. Ensuite arrivèrent les industriels et les cultivateurs, race plus morale et plus tranquille, mais qui ne s’élevait presque en aucuns points au-dessus du niveau des classes inférieures d’Angleterre [22] . Aucune noble pensée, aucune combinaison immatérielle ne présida à la fondation des nouveaux établissements. À peine la colonie était-elle créée qu’on y introduisait l’esclavage [23] ; ce fut là le fait [I-48] capital qui devait exercer une immense influence sur le caractère, les lois et l’avenir tout entier du Sud.
L’esclavage, comme nous l’expliquerons plus tard, déshonore le travail ; il introduit l’oisiveté dans la société, et avec elle l’ignorance et l’orgueil, la pauvreté et le luxe. Il énerve les forces de l’intelligence et endort l’activité humaine. L’influence de l’esclavage, combinée avec le caractère anglais, explique les mœurs et l’état social du Sud.
Sur ce même fond anglais se peignaient, au Nord, des nuances toutes contraires. Ici on me permettra quelques détails.
C’est dans les colonies anglaises du Nord, plus connues sous le nom d’États de la Nouvelle-Angleterre [24] , que se sont combinées les deux ou trois idées principales qui aujourd’hui forment les bases de la théorie sociale des États-Unis.
Les principes de la Nouvelle-Angleterre se sont d’abord répandus dans les États voisins ; ils ont ensuite gagné de proche en proche les plus éloignés, et ont fini, si je puis m’exprimer ainsi, par pénétrer la confédération entière. Ils exercent maintenant leur influence au-delà de ses limites sur tout le monde américain. La civilisation de la Nouvelle-Angleterre a été comme ces feux allumés sur les hauteurs qui, après avoir répandu [I-49] la chaleur autour d’eux, teignent encore de leurs clartés les derniers confins de l’horizon.
La fondation de la Nouvelle-Angleterre a offert un spectacle nouveau ; tout y était singulier et original.
Presque toutes les colonies ont eu pour premiers habitants des hommes sans éducation et sans ressources, que la misère et l’inconduite poussaient hors du pays qui les avait vus naître, ou des spéculateurs avides et des entrepreneurs d’industrie. Il y a des colonies qui ne peuvent pas même réclamer une pareille origine : Saint-Domingue a été fondé par des pirates, et de nos jours, les cours de justice d’Angleterre se chargent de peupler l’Australie.
Les émigrants qui vinrent s’établir sur les rivages de la Nouvelle-Angleterre appartenaient tous aux classes aisées de la mère-patrie. Leur réunion sur le sol américain présenta, dès l’origine, le singulier phénomène d’une société où il ne se trouvait ni grands seigneurs ni peuple, et, pour ainsi dire, ni pauvres ni riches. Il y avait, à proportion gardée, une plus grande masse de lumières répandue parmi ces hommes que dans le sein d’aucune nation européenne de nos jours. Tous, sans en excepter peut-être un seul, avaient reçu une éducation assez avancée, et plusieurs d’entre eux s’étaient fait connaître en Europe par leurs talents et leur science. Les autres colonies avaient été fondées par des aventuriers sans famille ; les émigrants de la Nouvelle-Angleterre apportaient avec eux d’admirables éléments d’ordre et de moralité ; ils se rendaient au désert accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants. Mais ce qui les distinguait surtout de tous les autres, était le but même de leur entreprise. [I-50] Ce n’était point la nécessité qui les forçait d’abandonner leur pays ; ils y laissaient une position sociale regrettable et les moyens de vivre assurés ; ils ne passaient point non plus dans le Nouveau-Monde afin d’y améliorer leur situation ou d’y accroître leurs richesses ; ils s’arrachaient aux douceurs de la patrie pour obéir à un besoin purement intellectuel ; en s’exposant aux misères inévitables de l’exil, ils voulaient faire triompher une idée.
Les émigrants, ou, comme ils s’appelaient si bien eux-mêmes, les pèlerins (pilgrims), appartenaient à cette secte d’Angleterre à laquelle l’austérité de ses principes avait fait donner le nom de puritaine. Le puritanisme n’était pas seulement une doctrine religieuse ; il se confondait encore en plusieurs points avec les théories démocratiques et républicaines les plus absolues. De là lui étaient venus ses plus dangereux adversaires. Persécutés par le gouvernement de la mère-patrie, blessés dans la rigueur de leurs principes par la marche journalière de la société au sein de laquelle ils vivaient, les puritains cherchèrent une terre si barbare et si abandonnée du monde, qu’il fût encore permis d’y vivre à sa manière et d’y prier Dieu en liberté.
Quelques citations feront mieux connaître l’esprit de ces pieux aventuriers que tout ce que nous pourrions ajouter nous-même.
Nathaniel Morton, l’historien des premières années de la Nouvelle-Angleterre, entre ainsi en matière [25] :
« J’ai toujours cru, dit-il, que c’était un devoir sacré [I-51] pour nous, dont les pères ont reçu des gages si nombreux et si mémorables de la bonté divine dans l’établissement de cette colonie, d’en perpétuer par écrit le souvenir. Ce que nous avons vu et ce qui nous a été raconté par nos pères, nous devons le faire connaître à nos enfants, afin que les générations à venir apprennent à louer le Seigneur ; afin que la lignée d’Abraham son serviteur, et les fils de Jacob son élu, gardent toujours la mémoire des miraculeux ouvrages de Dieu (Ps. CV, 5, 6). Il faut qu’ils sachent comment le Seigneur a apporté sa vigne dans le désert ; comment il l’a plantée et en a écarté les païens ; comment il lui a préparé une place, en a enfoncé profondément les racines et l’a laissée ensuite s’étendre et couvrir au loin la terre (Ps. LXXX, 15, 13) ; et non seulement cela, mais encore comment il a guidé son peuple vers son saint tabernacle, et l’a établi sur la montagne de son héritage (Exod., XV, 13). Ces faits doivent être connus, afin que Dieu en retire l’honneur qui lui est dû, et que quelques rayons de sa gloire puissent tomber sur les noms vénérables des saints qui lui ont servi d’instruments. »
Il est impossible de lire ce début sans être pénétré malgré soi d’une impression religieuse et solennelle ; il semble qu’on y respire un air d’antiquité et une sorte de parfum biblique.
La conviction qui anime l’écrivain relève son langage. Ce n’est plus à vos yeux, comme aux siens, une petite troupe d’aventuriers allant chercher fortune au-delà des mers ; c’est la semence d’un grand peuple que Dieu vient déposer de ses mains sur une terre prédestinée.
[I-52]
L’auteur continue et peint de cette manière le départ des premiers émigrants [26] :
« C’est ainsi, dit-il, qu’ils quittèrent cette ville (Delft-Haleft) qui avait été pour eux un lieu de repos ; cependant ils étaient calmes ; ils savaient qu’ils étaient pèlerins et étrangers ici-bas. Ils ne s’attachaient pas aux choses de la terre, mais levaient les yeux vers le ciel, leur chère patrie, où Dieu avait préparé pour eux sa cité sainte. Ils arrivèrent enfin au port où le vaisseau les attendait. Un grand nombre d’amis qui ne pouvaient partir avec eux, avaient du moins voulu les suivre jusque là. La nuit s’écoula sans sommeil ; elle se passa en épanchements d’amitié, en pieux discours, en expressions pleines d’une véritable tendresse chrétienne. Le lendemain ils se rendirent à bord ; leurs amis voulurent encore les y accompagner ; ce fut alors qu’on ouït de profonds soupirs, qu’on vit des pleurs couler de tous les yeux, qu’on entendit de longs embrassements et d’ardentes prières dont les étrangers eux-mêmes se sentirent émus. Le signal du départ étant donné, ils tombèrent à genoux, et leur pasteur, levant au ciel des yeux pleins de larmes, les recommanda à la miséricorde du Seigneur. Ils prirent enfin congé les uns des autres, et prononcèrent cet adieu qui, pour beaucoup d’entre eux, devait être le dernier. »
Les émigrants étaient au nombre de cent cinquante à peu près, tant hommes que femmes et enfants. Leur but était de fonder une colonie sur les rives de [I-53] l’Hudson ; mais, après avoir erré longtemps dans l’Océan, ils furent enfin forcés d’aborder les côtes arides de la Nouvelle-Angleterre, au lieu où s’élève aujourd’hui la ville de Plymouth. On montre encore le rocher où descendirent les pèlerins [27] .
« Mais avant d’aller plus loin, dit l’historien que j’ai déjà cité, considérons un instant la condition présente de ce pauvre peuple, et admirons la bonté de Dieu qui l’a sauvé [28] .
Ils avaient passé maintenant le vaste Océan, ils arrivaient au but de leur voyage, mais ils ne voyaient point d’amis pour les recevoir, point d’habitation pour leur offrir un abri ; on était au milieu de l’hiver, et ceux qui connaissent notre climat savent combien les hivers sont rudes, et quels furieux ouragans désolent alors nos côtes. Dans cette saison, il est difficile de traverser des lieux connus, à plus forte raison de s’établir sur des rivages nouveaux. Autour d’eux n’apparaissait qu’un désert hideux et désolé, plein d’animaux et d’hommes sauvages, dont ils ignoraient le degré de férocité et le nombre. La terre était glacée ; le sol était couvert de forêts et de buissons. Le tout avait un aspect barbare. Derrière eux, ils n’apercevaient que l’immense Océan qui les [I-54] séparait du monde civilisé. Pour trouver un peu de paix et d’espoir, ils ne pouvaient tourner leurs regards qu’en haut. »
Il ne faut pas croire que la piété des puritains fût seulement spéculative, ni qu’elle se montrât étrangère à la marche des choses humaines. Le puritanisme, comme je l’ai dit plus haut, était presque autant une théorie politique qu’une doctrine religieuse. À peine débarqués sur ce rivage inhospitalier, que Nathaniel Morton vient de décrire, le premier soin des émigrants est donc de s’organiser en société. Ils passent immédiatement un acte qui porte [29] :
« Nous, dont les noms suivent, qui, pour la gloire de Dieu, le développement de la foi chrétienne et l’honneur de notre patrie, avons entrepris d’établir la première colonie sur ces rivages reculés, nous convenons dans ces présentes, par consentement mutuel et solennel, et devant Dieu, de nous former en corps de société politique, dans le but de nous gouverner, et de travailler à l’accomplissement de nos desseins ; et en vertu de ce contrat, nous convenons de promulguer des lois, actes, ordonnances, et d’instituer selon les besoins des magistrats auxquels nous promettons soumission et obéissance. »
Ceci se passait en 1620. À partir de cette époque, l’émigration ne s’arrêta plus… Les passions religieuses et politiques, qui déchirèrent l’empire britannique [I-55] pendant tout le règne de Charles Ier, poussèrent chaque année, sur les côtes de l’Amérique, de nouveaux essaims de sectaires. En Angleterre, le foyer du puritanisme continuait à se trouver placé dans les classes moyennes ; c’est du sein des classes moyennes que sortaient la plupart des émigrants. La population de la Nouvelle-Angleterre croissait rapidement, et, tandis que la hiérarchie des rangs classait encore despotiquement les hommes dans la mère-patrie, la colonie présentait de plus en plus le spectacle nouveau d’une société homogène dans toutes ses parties. La démocratie, telle que n’avait point osé la rêver l’antiquité, s’échappait toute grande et tout armée du milieu de la vieille société féodale.
Content d’éloigner de lui des germes de troubles et des éléments de révolutions nouvelles, le gouvernement anglais voyait sans peine cette émigration nombreuse. Il la favorisait même de tout son pouvoir, et semblait s’occuper à peine de la destinée de ceux qui venaient sur le sol américain chercher un asile contre la dureté de ses lois. On eût dit qu’il regardait la Nouvelle-Angleterre comme une région livrée aux rêves de l’imagination, et qu’on devait abandonner aux libres essais des novateurs.
Les colonies anglaises, et ce fut l’une des principales causes de leur prospérité, ont toujours joui de plus de liberté intérieure et de plus d’indépendance politique que les colonies des autres peuples ; mais nulle part ce principe de liberté ne fut plus complètement appliqué que dans les États de la Nouvelle-Angleterre.
Il était alors généralement admis que les terres du [I-56] Nouveau-Monde appartenaient à la nation européenne qui, la première, les avait découvertes.
Presque tout le littoral de l’Amérique du Nord devint de cette manière une possession anglaise vers la fin du XVIe siècle. Les moyens employés par le gouvernement britannique pour peupler ces nouveaux domaines furent de différente nature : dans certains cas, le roi soumettait une portion du Nouveau-Monde à un gouverneur de son choix, chargé d’administrer le pays en son nom et sous ses ordres immédiats [30] ; c’est le système colonial adopté dans le reste de l’Europe. D’autres fois, il concédait à un homme ou à une compagnie la propriété de certaines portions de pays [31] . Tous les pouvoirs civils et politiques se trouvaient alors concentrés dans les mains d’un ou de plusieurs individus qui, sous l’inspection et le contrôle de la couronne, vendaient les terres et gouvernaient les habitants. Un troisième système enfin consistait à donner à un certain nombre d’émigrants le droit de se former en société politique sous le patronage de la mère-patrie, et de se gouverner eux-mêmes en tout ce qui n’était pas contraire à ses lois.
Ce mode de colonisation, si favorable à la liberté, ne fut mis en pratique que dans la Nouvelle-Angleterre [32] .
[I-57]
Dès 1628 [33] , une charte de cette nature fut accordée par Charles Ier à des émigrants qui vinrent fonder la colonie du Massachusetts.
Mais, en général, on n’octroya les chartes aux colonies de la Nouvelle-Angleterre que long-temps après que leur existence fut devenue un fait accompli. Plymouth, Providence, New-Haven, l’État de Connecticut et celui de Rhode-Island [34] furent fondés sans le concours et en quelque sorte à l’insu de la mère-patrie. Les nouveaux habitants, sans nier la suprématie de la métropole, n’allèrent pas puiser dans son sein la source des pouvoirs ; ils se constituèrent eux-mêmes, et ce ne fut que trente ou quarante ans après, sous Charles II, qu’une charte royale vint légaliser leur existence.
Aussi est-il souvent difficile, en parcourant les premiers monuments historiques et législatifs de la Nouvelle-Angleterre, d’apercevoir le lien qui attache les émigrants au pays de leurs ancêtres. On les voit à chaque instant faire acte de souveraineté ; ils nomment [I-58] leurs magistrats, font la paix et la guerre, établissent les règlements de police, se donnent des lois comme s’ils n’eussent relevé que de Dieu seul [35] .
Rien de plus singulier et de plus instructif tout à la fois que la législation de cette époque ; c’est là surtout que se trouve le mot de la grande énigme sociale que les États-Unis présentent au monde de nos jours.
Parmi ces monuments, nous distinguerons particulièrement, comme l’un des plus caractéristiques, le code de lois que le petit État de Connecticut se donna en 1650 [36] .
Les législateurs du Connecticut [37] s’occupent d’abord des lois pénales ; et, pour les composer, ils conçoivent l’idée étrange de puiser dans les textes sacrés :
« Quiconque adorera un autre Dieu que le Seigneur, disent-ils en commençant, sera mis à mort. » Suivent dix ou douze dispositions de même nature empruntées textuellement au Deutéronome, à l’Exode et au Lévitique.
Le blasphème, la sorcellerie, l’adultère [38] , le viol, [I-59] sont punis de mort ; l’outrage fait par un fils à ses parents est frappé de la même peine. On transportait ainsi la législation d’un peuple rude et à demi civilisé au sein d’une société dont l’esprit était éclairé et les mœurs douces : aussi ne vit-on jamais la peine de mort plus prodiguée dans les lois, ni appliquée à moins de coupables.
Les législateurs, dans ce corps de lois pénales, sont surtout préoccupés du soin de maintenir l’ordre moral et les bonnes mœurs dans la société ; ils pénètrent ainsi sans cesse dans le domaine de la conscience, et il n’est presque pas de péchés qu’ils ne parviennent à soumettre à la censure du magistrat. Le lecteur a pu remarquer avec quelle sévérité ces lois frappaient l’adultère et le viol. Le simple commerce entre gens non mariés y est sévèrement réprimé. On laisse au juge le droit d’infliger aux coupables l’une de ces trois peines : l’amende, le fouet ou le mariage [39] ; et s’il en faut croire les registres des anciens tribunaux de New-Haven, les poursuites de cette nature n’étaient pas rares ; on trouve, à la date du 1er mai 1660, un jugement portant amende et réprimande contre une jeune fille qu’on accusait d’avoir prononcé quelques [I-60] paroles indiscrètes et de s’être laissé donner un baiser [40] . Le code de 1650 abonde en mesures préventives. La paresse et l’ivrognerie y sont sévèrement punies [41] . Les aubergistes ne peuvent fournir plus d’une certaine quantité de vin à chaque consommateur ; l’amende ou le fouet répriment le simple mensonge quand il peut nuire [42] . Dans d’autres endroits, le législateur, oubliant complétement les grands principes de liberté religieuse réclamés par lui-même en Europe, force, par la crainte des amendes, à assister au service divin [43] , et il va jusqu’à frapper de peines sévères [44] et souvent de mort les chrétiens qui veulent adorer Dieu sous une autre formule que la sienne [45] . Quelquefois, enfin, l’ardeur réglementaire qui le possède le porte à s’occuper des soins les plus indignes de lui. C’est ainsi qu’on trouve dans le même code une loi qui prohibe l’usage du tabac [46] . Il ne faut [I-61] pas, au reste, perdre de vue que ces lois bizarres ou tyranniques n’étaient point imposées ; qu’elles étaient votées par le libre concours de tous les intéressés eux-mêmes, et que les mœurs étaient encore plus austères et plus puritaines que les lois. À la date de 1649, on voit se former à Boston une association solennelle ayant pour but de prévenir le luxe mondain des longs cheveux [47] (E).
De pareils écarts font sans doute honte à l’esprit humain ; ils attestent l’infériorité de notre nature, qui, incapable de saisir fermement le vrai et le juste, en est réduite le plus souvent à ne choisir qu’entre deux excès.
À côté de cette législation pénale si fortement empreinte de l’étroit esprit de secte et de toutes les passions religieuses que la persécution avait exaltées et qui fermentaient encore au fond des âmes, se trouve placé, et en quelque sorte enchaîné avec elles, un corps de lois politiques qui, tracé il y a deux cents ans, semble encore devancer de très loin l’esprit de liberté de notre âge.
Les principes généraux sur lesquels reposent les constitutions modernes, ces principes, que la plupart des Européens du XVIIe siècle comprenaient à peine, et qui triomphaient alors incomplétement dans la Grande-Bretagne, sont tous reconnus et fixés par les lois de la Nouvelle-Angleterre : l’intervention du peuple dans les affaires publiques, le vote libre de l’impôt, la responsabilité des agents du pouvoir, la liberté individuelle et le jugement par jury, y sont établis sans discussion et en fait.
[I-62]
Ces principes générateurs y reçoivent une application et des développements qu’aucune nation de l’Europe n’a encore osé leur donner.
Dans le Connecticut, le corps électoral se composait, dès l’origine, de l’universalité des citoyens, et cela se conçoit sans peine [48] . Chez ce peuple naissant régnait alors une égalité presque parfaite entre les fortunes et plus encore entre les intelligences [49] .
Dans le Connecticut, à cette époque, tous les agents du pouvoir exécutif étaient élus, jusqu’au gouverneur de l’État [50] .
Les citoyens au-dessus de seize ans étaient obligés d’y porter les armes ; ils formaient une milice nationale qui nommait ses officiers, et devait se trouver prête en tous temps à marcher pour la défense du pays [51] .
C’est dans les lois du Connecticut, comme dans toutes celles de la Nouvelle-Angleterre, qu’on voit naître et se développer cette indépendance communale qui forme encore de nos jours comme le principe et la vie de la liberté américaine.
Chez la plupart des nations européennes, l’existence politique a commencé dans les régions supérieures de la société, et s’est communiquée peu à peu, et toujours d’une manière incomplète, aux diverses parties du corps social.
[I-63]
En Amérique, au contraire, on peut dire que la commune a été organisée avant le comté, le comté avant l’État, l’État avant l’Union.
Dans la Nouvelle-Angleterre, dès 1650, la commune est complétement et définitivement constituée. Autour de l’individualité communale viennent se grouper et s’attacher fortement des intérêts, des passions, des devoirs et des droits. Au sein de la commune on voit régner une vie politique réelle, active, toute démocratique et républicaine. Les colonies reconnaissent encore la suprématie de la métropole ; c’est la monarchie qui est la loi de l’État, mais déjà la république est toute vivante dans la commune.
La commune nomme ses magistrats de tout genre ; elle se taxe ; elle répartit et lève l’impôt sur elle-même [52] . Dans la commune de la Nouvelle-Angleterre, la loi de la représentation n’est point admise. C’est sur la place publique et dans le sein de l’assemblée générale des citoyens que se traitent, comme à Athènes, les affaires qui touchent à l’intérêt de tous.
Lorsqu’on étudie avec attention les lois qui ont été promulguées durant ce premier âge des républiques américaines, on est frappé de l’intelligence gouvernementale et des théories avancées du législateur.
Il est évident qu’il se fait des devoirs de la société envers ses membres une idée plus élevée et plus complète que les législateurs européens d’alors, et qu’il lui impose des obligations auxquelles elle échappait encore ailleurs. Dans les États de la Nouvelle-Angleterre, dès l’origine, le sort des pauvres est assuré [53] ; [I-64] des mesures sévères sont prises pour l’entretien des routes, on nomme des fonctionnaires pour les surveiller [54] ; les communes ont des registres publics où s’inscrivent le résultat des délibérations générales, les décès, les mariages, la naissance des citoyens [55] ; des greffiers sont préposés à la tenue de ces registres [56] ; des officiers sont chargés d’administrer les successions vacantes, d’autres de surveiller la borne des héritages ; plusieurs ont pour principales fonctions de maintenir la tranquillité publique dans la commune [57] .
La loi entre dans mille détails divers pour prévenir et satisfaire une foule de besoins sociaux, dont encore de nos jours on n’a qu’un sentiment confus en France.
Mais c’est par les prescriptions relatives à l’éducation publique que, dès le principe, on voit se révéler dans tout son jour le caractère original de la civilisation américaine.
« Attendu, dit la loi, que Satan, l’ennemi du genre humain, trouve dans l’ignorance des hommes ses plus puissantes armes, et qu’il importe que les lumières qu’ont apportées nos pères ne restent point ensevelies dans leur tombe ; — attendu que l’éducation des enfants est un des premiers intérêts de l’État, avec l’assistance du Seigneur… [58] » Suivent des dispositions qui créent des écoles dans toutes les communes, et obligent les habitants, sous peine de fortes amendes, à s’imposer pour les soutenir. Des [I-65] écoles supérieures sont fondées de la même manière dans les districts les plus populeux. Les magistrats municipaux doivent veiller à ce que les parents envoient leurs enfants dans les écoles ; ils ont le droit de prononcer des amendes contre ceux qui s’y refusent ; et si la résistance continue, la société, se mettant alors à la place de la famille, s’empare de l’enfant, et enlève aux pères les droits que la nature leur avait donnés, mais dont ils savaient si mal user [59] . Le lecteur aura sans doute remarqué le préambule de ces ordonnances : en Amérique, c’est la religion qui mène aux lumières ; c’est l’observance des lois divines qui conduit l’homme à la liberté.
Lorsqu’après avoir ainsi jeté un regard rapide sur la société américaine de 1650, on examine l’état de l’Europe et particulièrement celui du continent vers cette même époque, on se sent pénétré d’un profond étonnement : sur le continent de l’Europe, au commencement du XVIIe siècle, triomphait de toutes parts la royauté absolue sur les débris de la liberté oligarchique et féodale du moyen âge. Dans le sein de cette Europe brillante et littéraire, jamais peut-être l’idée des droits n’avait été plus complétement méconnue ; jamais les peuples n’avaient moins vécu de la vie politique ; jamais les notions de la vraie liberté n’avaient moins préoccupé les esprits ; et c’est alors que ces mêmes principes, inconnus aux nations européennes ou méprisés par elles, étaient proclamés dans les déserts du Nouveau-Monde, et devenaient le symbole futur d’un grand peuple. Les plus hardies [I-66] théories de l’esprit humain étaient réduites en pratique dans cette société si humble en apparence, et dont aucun homme d’État n’eût sans doute alors daigné s’occuper ; livrée à l’originalité de sa nature, l’imagination de l’homme y improvisait une législation sans précédents. Au sein de cette obscure démocratie, qui n’avait encore enfanté ni généraux, ni philosophes, ni grands écrivains, un homme pouvait se lever en présence d’un peuple libre, et donner, aux acclamations de tous, cette belle définition de la liberté :
« Ne nous trompons pas sur ce que nous devons entendre par notre indépendance. Il y a en effet une sorte de liberté corrompue, dont l’usage est commun aux animaux comme à l’homme, et qui consiste à faire tout ce qui plaît. Cette liberté est l’ennemie de toute autorité ; elle souffre impatiemment toutes règles ; avec elle, nous devenons inférieurs à nous-mêmes ; elle est l’ennemie de la vérité et de la paix ; et Dieu a cru devoir s’élever contre elle ! Mais il est une liberté civile et morale qui trouve sa force dans l’union, et que la mission du pouvoir lui-même est de protéger : c’est la liberté de faire sans crainte tout ce qui est juste et bon. Cette sainte liberté, nous devons la défendre dans tous les hasards, et exposer, s’il le faut, pour elle notre vie [60] . »
[I-67]
J’en ai déjà dit assez pour mettre en son vrai jour le caractère de la civilisation anglo-américaine. Elle est le produit (et ce point de départ doit sans cesse être présent à la pensée) de deux éléments parfaitement distincts, qui ailleurs se sont fait souvent la guerre, mais qu’on est parvenu, en Amérique, à incorporer en quelque sorte l’un dans l’autre ; et à combiner merveilleusement. Je veux parler de l’esprit de religion et de l’esprit de liberté.
Les fondateurs de la Nouvelle-Angleterre était tout à la fois d’ardents sectaires et des novateurs exaltés. Retenus dans les liens les plus étroits de certaines croyances religieuses, ils étaient libres de tous préjugés politiques.
De là deux tendances diverses, mais non contraires, dont il est facile de retrouver partout la trace, dans les mœurs comme dans les lois. Des hommes sacrifient à une opinion religieuse leurs amis, leur famille et leur patrie ; on peut les croire absorbés dans la poursuite de ce bien intellectuel qu’ils sont venus acheter à si haut prix. On les voit cependant rechercher d’une ardeur presque égale les richesses matérielles et les jouissances morales, le ciel dans l’autre monde, et le bien-être et la liberté dans celui-ci.
Sous leur main, les principes politiques, les lois et les institutions humaines semblent choses malléables, qui peuvent se tourner et se combiner à volonté.
Devant eux s’abaissent les barrières qui emprisonnaient la société au sein de laquelle ils sont nés ; les vieilles opinions, qui depuis des siècles dirigeaient le monde, s’évanouissent ; une carrière presque sans [I-68] bornes, un champ sans horizon se découvre : l’esprit humain s’y précipite ; il les parcourt en tous sens ; mais, arrivé aux limites du monde politique, il s’arrête de lui-même ; il dépose en tremblant l’usage de ses plus redoutables facultés ; il abjure le doute ; il renonce au besoin d’innover ; il s’abstient même de soulever le voile du sanctuaire ; il s’incline avec respect devant des vérités qu’il admet sans les discuter.
Ainsi, dans le monde moral, tout est classé, coordonné, prévu, décidé à l’avance. Dans le monde politique, tout est agité, contesté, incertain ; dans l’un, obéissance passive, bien que volontaire ; dans l’autre, indépendance, mépris de l’expérience et jalousie de toute autorité.
Loin de se nuire, ces deux tendances, en apparence si opposées, marchent d’accord et semblent se prêter un mutuel appui.
La religion voit dans la liberté civile un noble exercice des facultés de l’homme ; dans le monde politique, un champ livré par le Créateur aux efforts de l’intelligence. Libre et puissante dans sa sphère, satisfaite de la place qui lui est réservée, elle sait que son empire est d’autant mieux établi qu’elle ne règne que par ses propres forces et domine sans appui sur les cœurs.
La liberté voit dans la religion la compagne de ses luttes et de ses triomphes ; le berceau de son enfance, la source divine de ses droits. Elle considère la religion comme la sauve-garde des mœurs ; les mœurs comme la garantie des lois et le gage de sa propre durée (F).
[I-69]
RAISONS DE QUELQUES SINGULARITÉS QUE PRÉSENTENT LES LOIS ET LES COUTUMES DES ANGLO-AMÉRICAINS.
Quelques restes d’institutions aristocratiques au sein de la plus complète démocratie. — Pourquoi ? il faut distinguer avec soin ce qui est d’origine puritaine et d’origine anglaise.
Il ne faut pas que le lecteur tire des conséquences trop générales et trop absolues de ce qui précède. La condition sociale, la religion et les mœurs des premiers émigrants ont exercé sans doute une immense influence sur le destin de leur nouvelle patrie. Toutefois, il n’a pas dépendu d’eux de fonder une société dont le point de départ ne se trouvât placé qu’en eux-mêmes ; nul ne saurait se dégager entièrement du passé ; il leur est arrivé de mêler, soit volontairement, soit à leur insu, aux idées et aux usages qui leur étaient propres, d’autres usages et d’autres idées qu’ils tenaient de leur éducation ou des traditions nationales de leur pays.
Lorsqu’on veut connaître et juger les Anglo-Américains de nos jours, on doit donc distinguer avec soin ce qui est d’origine puritaine ou d’origine anglaise.
On rencontre souvent aux États-Unis des lois ou des coutumes qui font contraste avec tout ce qui les environne. Ces lois paraissent rédigées dans un esprit opposé à l’esprit dominant de la législation américaine ; ces mœurs semblent contraires à l’ensemble de l’état social. Si les colonies anglaises avaient été fondées dans un siècle de ténèbres, ou si leur origine se perdait déjà dans la nuit des temps, le problème serait insoluble.
[I-70]
Je citerai un seul exemple pour faire comprendre ma pensée.
La législation civile et criminelle des Américains ne connait que deux moyens d’action : la prison ou le cautionnement. Le premier acte d’une procédure consiste à obtenir caution du défendeur, ou, s’il refuse, à le faire incarcérer ; on discute ensuite la validité du titre ou la gravité des charges.
Il est évident qu’une pareille législation est dirigée contre le pauvre, et ne favorise que le riche.
Le pauvre ne trouve pas toujours de caution, même en matière civile, et, s’il est contraint d’aller attendre justice en prison, son inaction forcée le réduit bientôt à la misère.
Le riche, au contraire, parvient toujours à échapper à l’emprisonnement en matière civile ; bien plus, a-t-il commis un délit, il se soustrait aisément à la punition qui doit l’atteindre : après avoir fourni caution, il disparaît. On peut donc dire que pour lui toutes les peines qu’inflige la loi se réduisent à des amendes [61] . Quoi de plus aristocratique qu’une semblable législation ?
En Amérique, cependant, ce sont les pauvres qui font la loi, et ils réservent habituellement pour eux-mêmes les plus grands avantages de la société.
C’est en Angleterre qu’il faut chercher l’explication de ce phénomène : les lois dont je parle sont anglaises [62] . Les Américains ne les ont point changées, [I-71] quoiqu’elles répugnent à l’ensemble de leur législation et à la masse de leurs idées.
La chose qu’un peuple change le moins après ses usages, c’est sa législation civile, Les lois civiles ne sont familières qu’aux légistes, c’est-à-dire à ceux qui ont un intérêt direct à les maintenir telles qu’elles sont, bonnes ou mauvaises, par la raison qu’ils les savent. Le gros de la nation les connaît à peine ; il ne les voit agir que dans des cas particuliers, n’en saisit que difficilement la tendance, et s’y soumet sans y songer.
J’ai cité un exemple, j’aurais pu en signaler beaucoup d’autres.
Le tableau que présente la Société américaine est, si je puis m’exprimer ainsi, couvert d’une couche démocratique, sous laquelle on voit de temps en temps percer les anciennes couleurs de l’aristocratie.
CHAPITRE III.↩
ÉTAT SOCIAL DES ANGLO-AMÉRICAINS.
L’état social est ordinairement le produit d’un fait, quelquefois des lois, le plus souvent de ces deux causes réunies ; mais une fois qu’il existe, on peut le considérer lui-même comme la cause première de la plupart des lois, des coutumes et des idées qui règlent la conduite des nations ; ce qu’il ne produit pas, il le modifie.
Pour connaître la législation et les mœurs d’un peuple, il faut donc commencer par étudier son état social.
QUE LE POINT SAILLANT DE L’ÉTAT SOCIAL DES ANGLO-AMÉRICAINS EST D’ÊTRE ESSENTIELLEMENT DÉMOCRATIQUE.
Premiers émigrants de la Nouvelle-Angleterre. — Égaux entre eux. — Lois aristocratiques introduites dans le Sud. — Époque de la révolution. — Changement des lois de succession. — Effets produits par ce changement. — Égalité poussée à ses dernières limites dans les nouveaux États de l’Ouest. — Égalité parmi les intelligences.
On pourrait faire plusieurs remarques importantes sur l’état social des Anglo-Américains, mais il y en a une qui domine toutes les autres.
L’état social des Américains est éminemment démocratique. Il a eu ce caractère dès la naissance des colonies ; il l’a plus encore de nos jours.
[I-73]
J’ai dit dans le chapitre précédent qu’il régnait une très grande égalité parmi les émigrants qui vinrent s’établir sur les rivages de la Nouvelle-Angleterre. Le germe même de l’aristocratie ne fut jamais déposé dans cette partie de l’Union. On ne put jamais y fonder que des influences intellectuelles. Le peuple s’habitua à révérer certains noms, comme des emblèmes de lumières et de vertus. La voix de quelques citoyens obtint sur lui un pouvoir qu’on eût peut-être avec raison appelé aristocratique, s’il avait pu se transmettre invariablement de père en fils.
Ceci se passait à l’est de l’Hudson ; au sud-ouest de ce fleuve, et en descendant jusqu’aux Florides, il en était autrement.
Dans la plupart des États situés au sud-ouest de l’Hudson, de grands propriétaires anglais étaient venus s’établir. Les principes aristocratiques, et avec eux les lois anglaises sur les successions, y avaient été importés. J’ai fait connaître les raisons qui empêchaient qu’on pût jamais établir en Amérique une aristocratie puissante. Ces raisons, tout en subsistant au sud-ouest de l’Hudson, y avaient cependant moins de puissance qu’à l’est de ce fleuve. Au sud, un seul homme pouvait, à l’aide d’esclaves, cultiver une grande étendue de terrain. On voyait donc dans cette partie du continent de riches propriétaires fonciers ; mais leur influence n’était pas précisément aristocratique, comme on l’entend en Europe, puisqu’ils ne possédaient aucuns privilèges, et que la culture par esclaves ne leur donnait point de tenanciers, par conséquent point de patronage. Toutefois, les grands propriétaires, au sud de l’Hudson, formaient une [I-74] classe supérieure, ayant des idées et des goûts à elle, et concentrant en général l’action politique dans son sein. C’était une sorte d’aristocratie peu différente de la masse du peuple dont elle embrassait facilement les passions et les intérêts, n’excitant ni l’amour ni la haine ; en somme, débile et peu vivace. Ce fut cette classe qui, dans le Sud, se mit à la tête de l’insurrection : la révolution d’Amérique lui doit ses plus grands hommes.
À cette époque, la société tout entière fut ébranlée : le peuple, au nom duquel on avait combattu, le peuple, devenu une puissance, conçut le désir d’agir par lui-même ; les instincts démocratiques s’éveillèrent ; en brisant le joug de la métropole, on prit goût à toute espèce d’indépendance : les influences individuelles cessèrent peu à peu de se faire sentir ; les habitudes comme les lois commencèrent à marcher d’accord vers le même but.
Mais ce fut la loi sur les successions qui fit faire à l’égalité son dernier pas.
Je m’étonne que les publicistes anciens et modernes n’aient pas attribué aux lois sur les successions [63] une plus grande influence dans la marche des affaires humaines. Ces lois appartiennent, il est vrai, à l’ordre civil ; mais elles devraient être placées [I-75] en tête de toutes les institutions politiques, car elles influent incroyablement sur l’état social des peuples, dont les lois politiques ne sont que l’expression. Elles ont de plus une manière sûre et uniforme d’opérer sur la société ; elles saisissent en quelque sorte les générations avant leur naissance. Par elles, l’homme est armé d’un pouvoir presque divin sur l’avenir de ses semblables. Le législateur règle une fois la succession des citoyens, et il se repose pendant des siècles : le mouvement donné à son œuvre, il peut en retirer la main ; la machine agit par ses propres forces, et se dirige comme d’elle-même vers un but indiqué d’avance. Constituée d’une certaine manière, elle réunit, elle concentre, elle groupe autour de quelque tête la propriété, et bientôt après le pouvoir ; elle fait jaillir en quelque sorte l’aristocratie du sol. Conduite par d’autres principes, et lancée dans une autre voie, son action est plus rapide encore ; elle divise, elle partage, elle dissémine les biens et la puissance ; il arrive quelquefois alors qu’on est effrayé de la rapidité de sa marche ; désespérant d’en arrêter le mouvement, on cherche du moins à créer devant elle des difficultés et des obstacles ; on veut contre-balancer son action par des efforts contraires ; soins inutiles ! elle broie, ou fait voler en éclats tout ce qui se rencontre sur son passage, elle s’élève et retombe incessamment sur le sol, jusqu’à ce qu’il ne présente plus à la vue qu’une poussière mouvante et impalpable, sur laquelle s’asseoit la démocratie.
Lorsque la loi des successions permet, et à plus forte raison ordonne le partage égal des biens du père [I-76] entre tous les enfants, ses effets sont de deux sortes ; il importe de les distinguer avec soin, quoiqu’ils tendent au même but.
En vertu de la loi des successions, la mort de chaque propriétaire amène une révolution dans la propriété ; non seulement les biens changent de maîtres, mais ils changent, pour ainsi dire, de nature ; ils se fractionnent sans cesse en portions plus petites.
C’est là l’effet direct et en quelque sorte matériel de la loi. Dans les pays où la législation établit l’égalité des partages, les biens, et particulièrement les fortunes territoriales, doivent donc avoir une tendance permanente à s’amoindrir. Toutefois, les effets de cette législation ne se feraient sentir qu’à la longue, si la loi était abandonnée à ses propres forces ; car, pour peu que la famille ne se compose pas de plus de deux enfants (et la moyenne des familles dans un pays peuplé comme la France n’est, dit-on, que de trois), ces enfants se partageant la fortune de leur père et de leur mère, ne seront pas plus pauvres que chacun de ceux-ci individuellement.
Mais la loi du partage égal n’exerce pas seulement son influence sur le sort des biens ; elle agit sur l’âme même des propriétaires, et appelle leurs passions à son aide. Ce sont ses effets indirects qui détruisent rapidement les grandes fortunes et surtout les grands domaines.
Chez les peuples où la loi des successions est fondée sur le droit de primogéniture, les domaines territoriaux passent le plus souvent de générations en générations sans se diviser. Il résulte de là que l’esprit de famille se matérialise en quelque sorte dans la [I-77] terre. La famille représente la terre, la terre représente la famille ; elle perpétue son nom, son origine, sa gloire, sa puissance, ses vertus. C’est un témoin impérissable du passé, et un gage précieux de l’existence à venir.
Lorsque la loi des successions établit le partage égal, elle détruit la liaison intime qui existait entre l’esprit de famille et la conservation de la terre, la terre cesse de représenter la famille, car, ne pouvant manquer d’être partagée au bout d’une ou de deux générations, il est évident qu’elle doit sans cesse s’amoindrir, et finir par disparaître entièrement. Les fils d’un grand propriétaire foncier, s’ils sont en petit nombre, ou si la fortune leur est favorable, peuvent bien conserver l’espérance de n’être pas moins riches que leur auteur, mais non de posséder les mêmes biens que lui ; leur richesse se composera nécessairement d’autres éléments que la sienne.
Or, du moment où vous enlevez aux propriétaires fonciers un grand intérêt de sentiment, de souvenirs, d’orgueil, d’ambition à conserver la terre, on peut être assuré que tôt ou tard ils la vendront, car ils ont un grand intérêt pécuniaire à la vendre, les capitaux mobiliers produisant plus d’intérêts que les autres, et se prêtant bien plus facilement à satisfaire les passions du moment.
Une fois divisées, les grandes propriétés foncières ne se refont plus ; car le petit propriétaire tire plus de revenu de son champ [64] , proportion gardée, que le grand propriétaire du sien ; il le vend donc beaucoup [I-78] plus cher que lui. Ainsi les calculs économiques qui ont porté l’homme riche à vendre de vastes propriétés, l’empêcheront, à plus forte raison, d’en acheter de petites pour en recomposer de grandes.
Ce qu’on appelle l’esprit de famille est souvent fondé sur une illusion de l’égoïsme individuel. On cherche à se perpétuer et à s’immortaliser en quelque sorte dans ses arrière-neveux. Là où finit l’esprit de famille, l’égoïsme individuel rentre dans la réalité de ses penchants. Comme la famille ne se présente plus à l’esprit que comme une chose vague, indéterminée, incertaine, chacun se concentre dans la commodité du présent ; on songe à l’établissement de la génération qui va suivre, et rien de plus.
On ne cherche donc pas à perpétuer sa famille, ou du moins on cherche à la perpétuer par d’autres moyens que par la propriété foncière.
Ainsi, non seulement la loi des successions rend difficile aux familles de conserver intacts les mêmes domaines, mais elle leur ôte le désir de le tenter, et elle les entraîne, en quelque sorte, à coopérer avec elle à leur propre ruine.
La loi du partage égal procède par deux voies : en agissant sur la chose, elle agit sur l’homme ; en agissant sur l’homme, elle arrive à la chose.
Des deux manières elle parvient à attaquer profondément la propriété foncière et à faire disparaître avec rapidité les familles ainsi que les fortunes [65] . [I-79]
Ce n’est pas sans doute à nous, Français du XIXe siècle, témoins journaliers des changements politiques et sociaux que la loi des successions fait naître, à mettre en doute son pouvoir. Chaque jour nous la voyons passer et repasser sans cesse sur notre sol, renversant sur son chemin les murs de nos demeures, et détruisant la clôture de nos champs. Mais si la loi des successions a déjà beaucoup fait parmi nous, beaucoup lui reste encore à faire. Nos souvenirs, nos opinions et nos habitudes lui opposent de puissants obstacles.
Aux États-Unis, son œuvre de destruction est à peu près terminée. C’est là qu’on peut étudier ses principaux résultats.
La législation anglaise sur la transmission des biens fut abolie dans presque tous les États à l’époque de la révolution.
La loi sur les substitutions fut modifiée de manière à ne gêner que d’une manière insensible la libre circulation des biens (G).
La première génération passa ; les terres [I-80] commencèrent à se diviser. Le mouvement devint de plus en plus rapide à mesure que le temps marchait. Aujourd’hui, quand soixante ans à peine se sont écoulés, l’aspect de la société est déjà méconnaissable ; les familles des grands propriétaires fonciers se sont presque toutes englouties au sein de la masse commune. Dans l’État de New-York, où on en comptait un très grand nombre, deux surnagent à peine sur le gouffre prêt à les saisir. Les fils de ces opulents citoyens sont aujourd’hui commerçants, avocats, médecins. La plupart sont tombés dans l’obscurité la plus profonde. La dernière trace des rangs et des distinctions héréditaires est détruite ; la loi des successions a partout passé son niveau.
Ce n’est pas qu’aux États-Unis comme ailleurs il n’y ait des riches ; je ne connais même pas de pays où l’amour de l’argent tienne une plus large place dans le cœur de l’homme, et où l’on professe un mépris plus profond pour la théorie de l’égalité permanente des biens. Mais la fortune y circule avec une incroyable rapidité, et l’expérience apprend qu’il est rare de voir deux générations en recueillir les faveurs.
Ce tableau, quelque coloré qu’on le suppose, ne donne encore qu’une idée incomplète de ce qui se passe dans les nouveaux États de l’Ouest et du Sud-Ouest.
À la fin du siècle dernier, de hardis aventuriers commencèrent à pénétrer dans les vallées du Mississipi. Ce fut comme une nouvelle découverte de l’Amérique : bientôt le gros de l’émigration s’y porta ; on vit alors des sociétés inconnues sortir tout-à-coup du désert. Des États, dont le nom même n’existait [I-81] pas peu d’années auparavant, prirent rang au sein de l’Union américaine. C’est dans l’Ouest qu’on peut observer la démocratie parvenue à sa dernière limite. Dans ces États, improvisés en quelque sorte par la fortune, les habitants sont arrivés d’hier sur le sol qu’ils occupent. Ils se connaissent à peine les uns les autres, et chacun ignore l’histoire de son plus proche voisin. Dans cette partie du continent américain, la population échappe donc non seulement à l’influence des grands noms et des grandes richesses, mais à cette naturelle aristocratie qui découle des lumières et de la vertu. Nul n’y exerce ce respectable pouvoir que les hommes accordent au souvenir d’une vie entière occupée à faire le bien sous leurs yeux. Les nouveaux États de l’Ouest ont déjà des habitants ; la société n’y existe point encore.
Mais ce ne sont pas seulement les fortunes qui sont égales en Amérique, l’égalité s’étend jusqu’à un certain point sur les intelligences elles-mêmes.
Je ne pense pas qu’il y ait de pays dans le monde où, proportion gardée avec la population, il se trouve aussi peu d’ignorants et moins de savants qu’en Amérique.
L’instruction primaire y est à la portée de chacun ; l’instruction supérieure n’y est presque à la portée de personne.
Ceci se comprend sans peine, et est pour ainsi dire le résultat nécessaire de ce que nous avons avancé plus haut.
Presque tous les Américains ont de l’aisance ; ils peuvent donc facilement se procurer les premiers éléments des connaissances humaines.
[I-82]
En Amérique, il y a peu de riches ; presque tous les Américains ont donc besoin d’exercer une profession. Or, toute profession exige un apprentissage. Les Américains ne peuvent donc donner à la culture générale de l’intelligence que les premières années de la vie : à quinze ans, ils entrent dans une carrière ; ainsi leur éducation finit le plus souvent à l’époque où la nôtre commence. Si elle se poursuit au-delà, elle ne se dirige plus que vers une matière spéciale et lucrative ; on étudie une science comme on prend un métier ; et l’on n’en saisit que les applications dont l’utilité présente est reconnue.
En Amérique, la plupart des riches ont commencé par être pauvres ; presque tous les oisifs ont été, dans leur jeunesse, des gens occupés ; d’où il résulte que, quand on pourrait avoir le goût de l’étude, on n’a pas le temps de s’y livrer ; et que, quand on a acquis le temps de s’y livrer, on n’en a plus le goût.
Il n’existe donc point en Amérique de classe dans laquelle le penchant des plaisirs intellectuels se transmette avec une aisance et des loisirs héréditaires, et qui tienne en honneur les travaux de l’intelligence.
Aussi la volonté de se livrer à ces travaux manque-t-elle aussi bien que le pouvoir.
Il s’est établi en Amérique, dans les connaissances humaines, un certain niveau mitoyen. Tous les esprits s’en sont rapprochés ; les uns en s’élevant, les autres en s’abaissant.
Il se rencontre donc une multitude immense d’individus qui ont le même nombre de notions à peu près en matière de religion, d’histoire, de sciences, [I-83] d’économie politique, de législation, de gouvernement.
L’inégalité intellectuelle vient directement de Dieu, et l’homme ne saurait empêcher qu’elle ne se retrouve toujours.
Mais il arrive du moins de ce que nous venons de dire, que les intelligences, tout en restant inégales, ainsi que l’a voulu le Créateur, trouvent à leur disposition des moyens égaux.
Ainsi donc, de nos jours, en Amérique, l’élément aristocratique, toujours faible depuis sa naissance, est sinon détruit, du moins affaibli de telle sorte, qu’il est difficile de lui assigner une influence quelconque dans la marche des affaires.
Le temps, les événements et les lois y ont au contraire rendu l’élément démocratique, non pas seulement prépondérant, mais pour ainsi dire unique. Aucune influence de famille ni de corps ne s’y laisse apercevoir ; souvent même on ne saurait y découvrir d’influence individuelle quelque peu durable.
L’Amérique présente donc, dans son état social, le plus étrange phénomène. Les hommes s’y montrent plus égaux par leur fortune et par leur intelligence, ou, en d’autres termes, plus également forts, qu’ils ne le sont dans aucun pays du monde, et qu’ils ne l’ont été dans aucun siècle dont l’histoire garde le souvenir.
[I-84]
CONSÉQUENCES POLITIQUES DE L’ÉTAT SOCIAL DES ANGLO-AMÉRICAINS.
Les conséquences politiques d’un pareil état social sont faciles à déduire.
Il est impossible de comprendre que l’égalité ne finisse pas par pénétrer dans le monde politique comme ailleurs. On ne saurait concevoir les hommes éternellement inégaux entre eux sur un seul point, égaux sur les autres ; ils arriveront donc, dans un temps donné, à l’être sur tous.
Or, je ne sais que deux manières de faire régner l’égalité dans le monde politique : il faut donner des droits à chaque citoyen, ou n’en donner à personne.
Pour les peuples qui sont parvenus au même état social que les Anglo-Américains, il est donc très difficile d’apercevoir un terme moyen entre la souveraineté de tous et le pouvoir absolu d’un seul.
Il ne faut point se dissimuler que l’état social que je viens de décrire ne se prête presque aussi facilement à l’une et à l’autre de ces deux conséquences.
Il y a en effet une passion mâle et légitime pour l’égalité qui excite les hommes à vouloir être tous forts et estimés. Cette passion tend à élever les petits au rang des grands, mais il se rencontre aussi dans le cœur humain un goût dépravé pour l’égalité, qui porte les faibles à vouloir attirer les forts à leur niveau, et qui réduit les hommes à préférer l’égalité dans la servitude à l’inégalité dans la liberté. Ce n’est pas que les peuples dont l’état social est [I-85] démocratique méprisent naturellement la liberté ; ils ont au contraire un goût instinctif pour elle. Mais la liberté n’est pas l’objet principal et continu de leur désir ; ce qu’ils aiment d’un amour éternel, c’est l’égalité ; ils s’élancent vers la liberté par impulsion rapide et par efforts soudains, et, s’ils manquent le but, ils se résignent ; mais rien ne saurait les satisfaire sans l’égalité, et ils consentiraient plutôt à périr qu’à la perdre.
D’un autre côté, quand les citoyens sont tous à peu près égaux, il leur devient difficile de défendre leur indépendance contre les agressions du pouvoir. Aucun d’entre eux n’étant alors assez fort pour lutter seul avec avantage, il n’y a que la combinaison des forces de tous qui puisse garantir la liberté. Or, une pareille combinaison ne se rencontre pas toujours.
Les peuples peuvent donc tirer deux grandes conséquences politiques du même état social : ces conséquences diffèrent prodigieusement entre elles, mais elles sortent toutes deux du même fait.
Soumis les premiers à cette redoutable alternative que je viens de décrire, les Anglo-Américains ont été assez heureux pour échapper au pouvoir absolu. Les circonstances, l’origine, les lumières, et surtout les mœurs, leur ont permis de fonder et de maintenir la souveraineté du peuple.
[I-86]
CHAPITRE IV.↩
DU PRINCIPE DE LA SOUVERAINETÉ DU PEUPLE EN AMÉRIQUE.
Il domine toute la société américaine. — Application que les Américains faisaient déjà de ce principe avant leur révolution. — Dévelopment que lui a donné cette révolution. — Abaissement graduel et irrésistible du cens.
Lorsqu’on veut parler des lois politiques des États-Unis, c’est toujours par le dogme de la souveraineté du peuple qu’il faut commencer.
Le principe de la souveraineté du peuple, qui se trouve toujours plus ou moins au fond de presque toutes les institutions humaines, y demeure d’ordinaire comme enseveli. On lui obéit sans le reconnaître, ou si parfois il arrive de le produire un moment au grand jour, on se hâte bientôt de le replonger dans les ténèbres du sanctuaire.
La volonté nationale est un des mots dont les intrigants de tous les temps et les despotes de tous les âges ont le plus largement abusé. Les uns en ont vu l’expression dans les suffrages achetés de quelques agents du pouvoir ; d’autres dans les votes d’une minorité intéressée ou craintive ; il y en a même qui l’ont découverte toute formulée dans le silence des [I-87] peuples, et qui ont pensé que du fait de l’obéissance naissait pour eux le droit du commandement.
En Amérique, le principe de la souveraineté du peuple n’est point caché ou stérile comme chez certaines nations ; il est reconnu par les mœurs, proclamé par les lois ; il s’étend avec liberté, et atteint sans obstacles ses dernières conséquences.
S’il est un seul pays au monde où l’on puisse espérer apprécier à sa juste valeur le dogme de la souveraineté du peuple, l’étudier dans son application aux affaires de la société, et juger ses avantages et ses dangers, ce pays-là est assurément l’Amérique.
J’ai dit précédemment que, dès l’origine, le principe de la souveraineté du peuple avait été le principe générateur de la plupart des colonies anglaises d’Amérique.
Il s’en fallut de beaucoup cependant qu’il dominât alors le gouvernement de la société comme il le fait de nos jours.
Deux obstacles, l’un extérieur, l’autre intérieur, retardaient sa marche envahissante.
Il ne pouvait se faire jour ostensiblement au sein des lois, puisque les colonies étaient encore contraintes d’obéir à la métropole ; il était donc réduit à se cacher dans les assemblées provinciales et surtout dans la commune. Là il s’étendait en secret.
La société américaine d’alors n’était point encore préparée à l’adopter dans toutes ses conséquences, Les lumières dans la Nouvelle-Angleterre, les richesses au sud de l’Hudson, exercèrent long-temps, comme je l’ai fait voir dans le chapitre qui précède, une sorte d’influence aristocratique qui tendait à resserrer en [I-88] peu de mains l’exercice des pouvoirs sociaux. Il s’en fallait encore beaucoup que tous les fonctionnaires publics fussent électifs et tous les citoyens électeurs. Le droit électoral était partout renfermé dans de certaines limites, et subordonné à l’existence d’un cens. Ce cens était très faible au Nord, plus considérable au Midi.
La révolution d’Amérique éclata. Le dogme de la souveraineté du peuple sortit de la commune, et s’empara du gouvernement ; toutes les classes se compromirent pour sa cause ; on combattit, et on triompha en son nom ; il devint la loi des lois.
Un changement presque aussi rapide s’effectua dans l’intérieur de la société. La loi des successions acheva de briser les influences locales.
Au moment où cet effet des lois et de la révolution commença à se révéler à tous les yeux, la victoire avait déjà irrévocablement prononcé en faveur de la démocratie. Le pouvoir était, par le fait, entre ses mains. Il n’était même plus permis de lutter contre elle. Les hautes classes se soumirent donc sans murmure et sans combat à un mal désormais inévitable. Il leur arriva ce qui arrive d’ordinaire aux puissances qui tombent : l’égoïsme individuel s’empara de leurs membres ; comme on ne pouvait plus arracher la force des mains du peuple, et qu’on ne détestait point assez la multitude pour prendre plaisir à la braver, on ne songea plus à gagner sa bienveillance à tout prix. Les lois les plus démocratiques furent donc votées à l’envi par les hommes dont elles froissaient le plus les intérêts. De cette manière, les hautes classes n’excitèrent point contre elles les passions populaires ; mais [I-89] elles hâtèrent elles-mêmes le triomphe de l’ordre nouveau. Ainsi, chose singulière ! on vit l’élan démocratique d’autant plus irrésistible dans les États ou l’aristocratie avait le plus de racines.
L’État du Maryland, qui avait été fondé par de grands seigneurs, proclama le premier le vote universel [66] , et introduisit dans l’ensemble de son gouvernement les formes des plus démocratiques.
Lorsqu’un peuple commence à toucher au cens électoral, on peut prévoir qu’il arrivera, dans un délai plus ou moins long, à le faire disparaître complétement. C’est là l’une des règles les plus invariables qui régissent les sociétés. À mesure qu’on recule la limite des droits électoraux, on sent le besoin de la reculer davantage ; car, après chaque concession nouvelle, les forces de la démocratie augmentent, et ses exigences croissent avec son nouveau pouvoir. L’ambition de ceux qu’on laisse au-dessous du cens s’irrite en proportion du grand nombre de ceux qui se trouvent au-dessus. L’exception devient enfin la règle ; les concessions se succèdent sans relâche, et l’on ne s’arrête plus que quand on est arrivé au suffrage universel.
De nos jours le principe de souveraineté du peuple a pris aux États-Unis tous les développements pratiques que l’imagination puisse concevoir. Il s’est dégagé de toutes les fictions dont on a pris soin de l’environner ailleurs ; on le voit se revêtir successivement de toutes les formes, suivant la nécessité des cas. Tantôt le peuple en corps fait les lois comme à [I-90] Athènes ; tantôt des députés, que le vote universel a créés, le représentent et agissent en son nom sous sa surveillance presque immédiate.
Il y a des pays où un pouvoir, en quelque sorte extérieur au corps social, agit sur lui et le force de marcher dans une certaine voie.
Il y en a d’autres où la force est divisée, étant tout à la fois placée dans la société et hors d’elle. Rien de semblable ne se voit aux États-Unis ; la société y agit par elle-même et sur elle-même. Il n’existe de puissance que dans son sein ; on ne rencontre même presque personne qui ose concevoir et surtout exprimer l’idée d’en chercher ailleurs. Le peuple participe à la composition des lois par le choix des législateurs, à leur application par l’élection des agents du pouvoir exécutif ; on peut dire qu’il gouverne lui-même, tant la part laissée à l’administration est faible et restreinte, tant celle-ci se ressent de son origine populaire et obéit à la puissance dont elle émane. Le peuple règne sur le monde politique américain comme Dieu sur l’univers. Il est la cause et la fin de toutes choses ; tout en sort et tout s’y absorbe (H).
[I-91]
CHAPITRE V.↩
NÉCESSITÉ D’ÉTUDIER CE QUI SE PASSE DANS LES ÉTATS PARTICULIERS, AVANT DE PARLER DU GOUVERNEMENT DE L’UNION.
On se propose d’examiner, dans le chapitre suivant, quelle est en Amérique la forme du gouvernement fondé sur le principe de la souveraineté du peuple ; quels sont ses moyens d’action, ses embarras, ses avantages et ses dangers.
Une première difficulté se présente : les États-Unis ont une constitution complexe ; on y remarque deux sociétés distinctes engagées, et, si je puis m’expliquer ainsi, emboitées l’une dans l’autre ; on y voit deux gouvernements complètement séparés et presque indépendants : l’un, habituel et indéfini, qui répond aux besoins journaliers de la société ; l’autre, exceptionnel et circonscrit, qui ne s’applique qu’à certains intérêts généraux. Ce sont, en un mot, vingt-quatre petites nations souveraines, dont l’ensemble forme le grand corps de l’Union.
Examiner l’Union avant d’étudier l’État, c’est s’engager dans une route semée d’obstacles. La forme du gouvernement fédéral aux États-Unis a paru la dernière ; elle n’a été qu’une modification de la [I-92] république, un résumé des principes politiques répandus dans la société entière avant elle, et y subsistant indépendamment d’elle. Le gouvernement fédéral, d’ailleurs, comme je viens de le dire, n’est qu’une exception ; le gouvernement des États est la règle commune. L’écrivain qui voudrait faire connaitre l’ensemble d’un pareil tableau avant d’en avoir montré les détails, tomberait nécessairement dans des obscurités ou des redites.
Les grands principes politiques qui régissent aujourd’hui la société américaine ont pris naissance et se sont développés dans l’État ; on ne saurait en douter. C’est donc l’État qu’il faut connaître pour avoir la clef de tout le reste.
Les États qui composent de nos jours l’Union américaine, présentent tous, quant à l’aspect extérieur des institutions, le même spectacle. La vie politique ou administrative s’y trouve concentrée dans trois foyers d’action, qu’on pourrait comparer aux divers centres nerveux qui font mouvoir le corps humain.
Au premier degré se trouve la commune, plus haut le comté, enfin l’État.
DU SYSTÈME COMMUNAL EN AMÉRIQUE.
Pourquoi l’auteur commence l’examen des institutions politiques par la commune. — La commune se retrouve chez tous les peuples. — Difficulté d’établir et de conserver la liberté communale. — Son importance. — Pourquoi l’auteur a choisi l’organisation communale de la Nouvelle-Angleterre pour objet principal de son examen.
Ce n’est pas par hasard que j’examine d’abord la commune.
[I-93]
La commune est la seule association qui soit si bien dans la nature, que partout où il y a des hommes réunis, il se forme de soi-même une commune.
La société communale existe donc chez tous les peuples quels que soient leurs usages et leurs lois ; c’est l’homme qui fait les royaumes et crée les républiques ; la commune paraît sortir directement des mains de Dieu. Mais si la commune existe depuis qu’il y a des hommes, la liberté communale est chose rare et fragile. Un peuple peut toujours établir de grandes assemblées politiques, parce qu’il se trouve habituellement dans son sein un certain nombre d’hommes chez lesquels les lumières remplacent jusqu’à un certain point l’usage des affaires. La commune est composée d’éléments grossiers qui se refusent souvent à l’action du législateur. La difficulté de fonder l’indépendance des communes, au lieu de diminuer à mesure que les nations s’éclairent, augmente avec leurs lumières. Une société très civilisée ne tolère qu’avec peine les essais de la liberté communale ; elle se révolte à la vue de ses nombreux écarts, et désespère du succès avant d’avoir atteint le résultat final de l’expérience.
Parmi toutes les libertés, celle des communes, qui s’établit si difficilement, est aussi la plus exposée aux invasions du pouvoir. Livrées à elles mêmes, les institutions communales ne sauraient guère lutter contre un gouvernement entreprenant et fort ; pour se défendre avec succès, il faut qu’elles aient pris tous leurs développements et qu’elles se soient mêlées aux idées et aux habitudes nationales. Ainsi, tant que la liberté communale n’est pas entrée dans les mœurs, [I-94] il est facile de la détruire, et elle ne peut entrer dans les mœurs qu’après avoir long-temps subsisté dans les lois.
La liberté communale échappe donc, pour ainsi dire, à l’effort de l’homme. Aussi arrive-t-il rarement qu’elle soit créée ; elle naît en quelque sorte d’elle-même. Elle se développe presque en secret au sein d’une société demi-barbare. C’est l’action continue des lois et des mœurs, les circonstances et surtout le temps, qui parviennent à la consolider. De toutes les nations du continent de l’Europe, on peut dire qu’il n’y en a pas une seule qui la connaisse.
C’est pourtant dans la commune que réside la force des peuples libres. Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science ; elles la mettent à la portée du peuple ; elles lui en font goûter l’usage paisible et l’habituent à s’en servir. Sans institutions communales une nation peut se donner un gouvernement libre, mais elle n’a pas l’esprit de la liberté. Des passions passagères, des intérêts d’un moment, le hasard des circonstances, peuvent lui donner les formes extérieures de l’indépendance ; mais le despotisme refoulé dans l’intérieur du corps social reparaît tôt ou tard à la surface.
Pour faire bien comprendre au lecteur les principes généraux sur lesquels repose l’organisation politique de la commune et du comté aux États-Unis, j’ai cru qu’il était utile de prendre pour modèle un État en particulier ; d’examiner avec détail ce qui s’y passe, et de jeter ensuite un regard rapide sur le reste du pays.
J’ai choisi l’un des États de la Nouvelle-Angleterre.
[I-95]
La commune et le comté ne sont pas organisés de la même manière dans toutes les parties de l’Union ; il est facile de reconnaître, cependant, que dans toute l’Union les mêmes principes, à peu près, ont présidé à la formation de l’un et de l’autre.
Or, il m’a paru que ces principes avaient reçu dans la Nouvelle-Angleterre des développements plus considérables, et atteint des conséquences plus éloignées que partout ailleurs. Ils s’y montrent donc pour ainsi dire plus en relief, et se livrent ainsi plus aisément à l’observation de l’étranger.
Les institutions communales de la Nouvelle-Angleterre forment un ensemble complet et régulier ; elles sont anciennes ; elles sont fortes par les lois, plus fortes encore par les mœurs ; elles exercent une influence prodigieuse sur la société entière.
À tous ces titres elles méritent d’attirer nos regards.
CIRCONSCRIPTION DE LA COMMUNE.
La commune de la Nouvelle-Angleterre (Township) tient le milieu entre le canton et la commune de France. On y compte en général de deux à trois mille habitants [67] ; elle n’est donc point assez étendue pour que tous ses habitants n’aient pas à peu près les mêmes intérêts, et, d’un autre côté, elle est assez peuplée pour qu’on soit toujours sûr de trouver dans son sein les éléments d’une bonne administration.
[I-96]
POUVOIRS COMMUNAUX DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE.
Le peuple, origine de tous les pouvoirs dans la commune comme ailleurs. — Il y traite les principales affaires par lui-même. — Point de conseil municipal. — La plus grande partie de l’autorité communale concentrée dans la main des select-men. — Comment les select-men agissent. — Assemblée générale des habitants de la commune (Town-Meeting). — Énumération de tous les fonctionnaires comnunaux. — Fonctions obligatoires et rétribuées.
Dans la commune comme partout ailleurs, le peuple est la source des pouvoirs sociaux, mais nulle part il n’exerce sa puissance plus immédiatement. Le peuple en Amérique, est un maître auquel il a fallu complaire jusqu’aux dernières limites du possible.
Dans la Nouvelle-Angleterre, la majorité agit par représentants lorsqu’il faut traiter les affaires générales de l’État. Il était nécessaire qu’il en fût ainsi ; mais dans la commune où l’action législative et gouvernementale est plus rapprochée des gouvernés, la loi de la représentation n’est point admise. Il n’y a point de conseil municipal ; le corps des électeurs, après avoir nommé ses magistrats, les dirige lui-même dans tout ce qui n’est pas l’exécution pure et simple des lois de l’État [68] .
Cet ordre de choses est si contraire à nos idées, et [I-97] tellement opposé à nos habitudes, qu’il est nécessaire de fournir ici quelques exemples pour qu’il soit possible de bien le comprendre.
Les fonctions publiques sont extrêmement nombreuses et fort divisées dans la commune, comme nous le verrons plus bas ; cependant la plus grande partie des pouvoirs administratifs est concentrée dans les mains d’un petit nombre d’individus élus chaque année et qu’on nomme les select-men [69] .
Les lois générales de l’État ont imposé aux select-men un certain nombre d’obligations. Ils n’ont pas besoin de l’autorisation de leurs administrés pour les remplir, et ils ne peuvent s’y soustraire sans engager leur responsabilité personnelle. La loi de l’État les charge, par exemple, de former, dans leur commune, les listes électorales ; s’ils omettent de le faire, ils se rendent coupables d’un délit. Mais, dans toutes les choses qui sont abandonnées à la direction du pouvoir communal, les select-men sont les exécuteurs des volontés populaires, comme parmi nous le maire est l’exécuteur des délibérations du conseil municipal. Le plus souvent ils agissent sous leur responsabilité privée, et ne font que suivre, dans la pratique, la conséquence des principes que la majorité a précédemment posés. Mais veulent-ils introduire un changement quelconque dans l’ordre établi ; désirent-ils se [I-98] livrer à une entreprise nouvelle, il leur faut remonter à la source de leur pouvoir. Je suppose qu’il s’agisse d’établir une école ; les select-men convoquent à certain jour, dans un lieu indiqué d’avance, la totalité des électeurs ; là, ils exposent le besoin qui se fait sentir ; ils font connaître les moyens d’y satisfaire, l’argent qu’il faut dépenser, le lieu qu’il convient de choisir. L’assemblée, consultée sur tous ces points, adopte le principe, fixe le lieu, vote l’impôt, et remet l’exécution de ses volontés dans les mains des select-men.
Les select-men ont seuls le droit de convoquer la réunion communale (town-meeting), mais on peut les provoquer à le faire. Si dix propriétaires conçoivent un projet nouveau et veulent le soumettre à l’assentiment de la commune, ils réclament une convocation générale des habitants ; les select-men sont obligés d’y souscrire, et ne conservent que le droit de présider l’assemblée [70] .
Ces mœurs politiques, ces usages sociaux sont sans doute bien loin de nous. Je n’ai pas en ce moment la volonté de les juger ni de faire connaître les causes cachées qui les produisent et les vivifient ; je me borne à les exposer.
Les select-men sont élus tous les ans au mois d’avril ou de mai. L’assemblée communale choisit en même temps une foule d’autres magistrats municipaux [71] , préposés à certains détails administratifs importants. Les uns, sous le nom d’assesseurs, doivent établir l’impôt ; les autres, sous celui de [I-99] collecteurs, doivent le lever. Un officier, appelé constable, est chargé de faire la police, de veiller sur les lieux publics, et de tenir la main à l’exécution matérielle des lois. Un autre, nommé le greffier de la commune, enregistre toutes les délibérations ; il tient note des actes de l’état civil. Un caissier garde les fonds communaux. Ajoutez à ces fonctionnaires un surveillant des pauvres, dont le devoir, fort difficile à remplir, est de faire exécuter la législation relative aux indigents ; des commissaires des écoles, qui dirigent l’instruction publique ; des inspecteurs des routes, qui se chargent de tous les détails de la grande et petite voirie, et vous aurez la liste des principaux agents de l’administration communale. Mais la division des fonctions ne s’arrête point là : on trouve encore, parmi les officiers municipaux [72] , des commissaires de paroisses, qui doivent régler les dépenses du culte ; des inspecteurs de plusieurs genres, chargés, les uns de diriger les efforts des citoyens en cas d’incendie ; les autres, de veiller aux récoltes, ceux-ci, de lever provisoirement les difficultés qui peuvent naître relativement aux clôtures ; ceux-là, de surveiller le mesurage du bois, ou d’inspecter les poids et mesures.
On compte en tout dix-neuf fonctions principales dans la commune. Chaque habitant est contraint, sous peine d’amende, d’accepter ces différentes fonctions ; mais aussi la plupart d’entre elles sont [I-100] rétribuées, afin que les citoyens pauvres puissent y consacrer leur temps sans en souffrir de préjudice. Du reste, le système américain n’est point de donner un traitement fixe aux fonctionnaires. En général, chaque acte de leur ministère a un prix, et ils ne sont rémunérés qu’en proportion de ce qu’ils ont fait.
DE L’EXISTENCE COMMUNALE.
Chacun est le meilleur juge de ce qui ne regarde que lui seul. — Corollaire du principe de la souveraineté du peuple. — Application que font les communes américaines de ces doctrines. — La commune de la Nouvelle-Angleterre, souveraine pour tout ce qui ne se rapporte qu’à elle, sujette dans tout le reste. — Obligation de la commune envers l’État. — En France, le gouvernement prête ses agents à la commune. — En Amérique, la commune prête les siens au gouvernement.
J’ai dit précédemment que le principe de la souveraineté du peuple plane sur tout le système politique des Anglo-Américains. Chaque page de ce livre fera connaître quelques applications nouvelles de cette doctrine.
Chez les nations où règne le dogme de la souveraineté du peuple, chaque individu forme une portion égale du souverain, et participe également au gouvernement de l’État.
Chaque individu est donc censé aussi éclairé, aussi vertueux, aussi fort qu’aucun autre de ses semblables.
Pourquoi obéit-il donc à la société, et quelles sont les limites naturelles de cette obéissance ?
Il obéit à la société, non point parce qu’il est inférieur à ceux qui la dirigent, ou moins capable qu’un [I-101] autre homme de se gouverner lui-même ; il obéit à la société, parce que l’union avec ses semblables lui paraît utile, et qu’il sait que cette union ne peut exister sans un pouvoir régulateur.
Dans tout ce qui concerne les devoirs des citoyens entre eux, il est donc devenu sujet. Dans tout ce qui ne regarde que lui-même, il est resté maître : il est libre, et ne doit compte de ses actions qu’à Dieu. De là cette maxime, que l’individu est le meilleur comme le seul juge de son intérêt particulier, et que la société n’a le droit de diriger ses actions que quand elle se sent lésée par son fait, ou lorsqu’elle a besoin de réclamer son concours.
Cette doctrine est universellement admise aux États-Unis. J’examinerai autre part quelle influence générale elle exerce jusque sur les actions ordinaires de la vie ; mais je parle en ce moment des communes.
La commune, prise en masse et par rapport au gouvernement central, n’est qu’un individu comme un autre, auquel s’applique la théorie que je viens d’indiquer.
La liberté communale découle donc, aux États-Unis, du dogme même de la souveraineté du peuple ; toutes les républiques américaines ont plus ou moins reconnu cette indépendance ; mais chez les peuples de la Nouvelle-Angleterre, les circonstances en ont particulièrement favorisé le développement.
Dans cette partie de l’Union, la vie politique a pris naissance au sein même des communes ; on pourrait presque dire qu’à son origine chacune d’elles était une nation indépendante. Lorsqu’ensuite les rois d’Angleterre réclamèrent leur part de la souveraineté, ils se [I-102] bornèrent à prendre la puissance centrale. Ils laissèrent la commune dans l’état où ils la trouvèrent ; maintenant les communes de la Nouvelle-Angleterre sont sujettes ; mais dans le principe elles ne l’étaient point ou l’étaient à peine. Elles n’ont donc pas reçu leurs pouvoirs ; ce sont elles au contraire qui semblent s’être dessaisies, en faveur de l’État, d’une portion de leur indépendance : distinction importante, et qui doit rester présente à l’esprit du lecteur.
Les communes ne sont en général soumises à l’État que quand il s’agit d’un intérêt que j’appellerai social, c’est-à-dire qu’elles partagent avec d’autres.
Pour tout ce qui n’a rapport qu’à elles seules, les communes sont restées des corps indépendants ; et parmi les habitants de la Nouvelle-Angleterre, il ne s’en rencontre aucun, je pense, qui reconnaisse au gouvernement de l’État le droit d’intervenir dans la direction des intérêts purement communaux.
On voit donc les communes de la Nouvelle-Angleterre vendre et acheter, attaquer et se défendre devant les tribunaux, charger leur budget ou le dégrever, sans qu’aucune autorité administrative quelconque songe à s’y opposer [73] .
Quant aux devoirs sociaux, elles sont tenues d’y satisfaire. Ainsi, l’État a-t-il besoin d’argent, la commune n’est pas libre de lui accorder ou de lui refuser son concours [74] . L’État veut-il ouvrir une route, la commune n’est pas maîtresse de lui fermer son territoire. Faut-il un règlement de police, la commune doit l’exécuter. Veut-il organiser l’instruction [I-103] sur un plan uniforme dans toute l’étendue du pays, la commune est tenue de créer les écoles voulues par la loi [75] . Nous verrons, lorsque nous parlerons de l’administration aux États-Unis, comment et par qui les communes, dans tous ces différents cas, sont contraintes à l’obéissance. Je ne veux ici qu’établir l’existence de l’obligation. Cette obligation est étroite, mais le gouvernement de l’État, en l’imposant, ne fait que décréter un principe ; pour son exécution, la commune rentre en général dans tous ses droits d’individualité. Ainsi, la taxe est, il est vrai, votée par la législature, mais c’est la commune qui la répartit et la perçoit ; l’existence d’une école est imposée, mais c’est la commune qui la bâtit, la paie et la dirige.
En France, le percepteur de l’État lève les taxes communales ; en Amérique, le percepteur de la commune lève la taxe de l’État.
Ainsi, parmi nous, le gouvernement central prête ses agents à la commune ; en Amérique, la commune prête ses fonctionnaires au gouvernement. Cela seul fait comprendre à quel degré les deux sociétés diffèrent.
[I-104]
DE L’ESPRIT COMMUNAL DANS LA NOUVELLE-ANGLETERRE.
Pourquoi la commune de la Nouvelle-Angleterre attire les affections de ceux qui l’habite. — Difficulté qu’on rencontre en Europe à créer l’esprit communal. — Droits et devoirs communaux concourant en Amérique à former cet esprit. — La patrie a plus de physionomie aux États-Unis qu’ailleurs. — En quoi l’esprit communal se manifeste dans la Nouvelle-Angleterre. — Quels heureux effets il y produit.
En Amérique, non seulement il existe des institutions communales, mais encore un esprit communal qui les soutient et les vivifie.
La commune de la Nouvelle-Angleterre réunit deux avantages qui, partout où ils se trouvent, excitent vivement l’intérêt des hommes ; savoir : l’indépendance et la puissance. Elle agit, il est vrai, dans un cercle dont elle ne peut sortir, mais ses mouvements y sont libres. Cette indépendance seule lui donnerait déjà une importance réelle, quand sa population et son étendue ne la lui assureraient pas.
Il faut bien se persuader que les affections des hommes ne se portent en général que là où il y a de la force. On ne voit pas l’amour de la patrie régner longtemps dans un pays conquis. L’habitant de la Nouvelle-Angleterre s’attache à sa commune, non pas tant parce qu’il y est né, que parce qu’il voit dans cette commune une corporation libre et forte dont il fait partie, et qui mérite la peine qu’on cherche à la diriger.
Il arrive souvent, en Europe, que les gouvernants eux-mêmes regrettent l’absence de l’esprit communal ; car tout le monde convient que l’esprit communal est un grand élément d’ordre et de tranquillité publique ; [I-105] mais ils ne savent comment le produire. En rendant la commune forte et indépendante, ils craignent de partager la puissance sociale et d’exposer l’État à l’anarchie. Or, ôtez la force et l’indépendance de la commune, vous n’y trouverez jamais que des administrés et point de citoyens.
Remarquez d’ailleurs un fait important : la commune de la Nouvelle-Angleterre est ainsi constituée qu’elle peut servir de foyer à de vives affections, et en même temps il ne se trouve rien à côté d’elle qui attire fortement les passions ambitieuses du cœur humain.
Les fonctionnaires du comté ne sont point élus et leur autorité est restreinte. L’État lui-même n’a qu’une importance secondaire ; son existence est obscure et tranquille. Il y a peu d’hommes qui, pour obtenir le droit de l’administrer, consentent à s’éloigner du centre de leurs intérêts et à troubler leur existence.
Le gouvernement fédéral confère de la puissance et de la gloire à ceux qui le dirigent ; mais les hommes auxquels il est donné d’influer sur ses destinées sont en très petit nombre. La présidence est une haute magistrature à laquelle on ne parvient guère que dans un âge avancé ; et quand on arrive aux autres fonctions fédérales d’un ordre élevé, c’est en quelque sorte par hasard, et après qu’on s’est rendu célèbre en suivant une autre carrière. L’ambition ne peut pas les prendre pour le but permanent de ses efforts. C’est dans la commune, au centre des relations ordinaires de la vie, que viennent se concentrer le désir de l’estime, le besoin d’intérêts réels, le goût du pouvoir et du bruit ; ces passions qui troublent si [I-106] souvent la société, changent de caractère lorsqu’elles peuvent s’exercer ainsi près du foyer domestique et en quelque sorte au sein de la famille.
Voyez avec quel art, dans la commune américaine, on a eu soin, si je puis m’exprimer ainsi, d’éparpiller la puissance, afin d’intéresser plus de monde à la chose publique. Indépendamment des électeurs appelés de temps en temps à faire des actes de gouvernement, que de fonctions diverses, que de magistrats différents, qui tous, dans le cercle de leurs attributions, représentent la corporation puissante au nom de laquelle ils agissent ! Combien d’hommes exploitent ainsi à leur profit la puissance communale et s’y intéressent pour eux-mêmes !
Le système américain, en même temps qu’il partage le pouvoir municipal entre un grand nombre de citoyens, ne craint pas non plus de multiplier les devoirs communaux. Aux États-Unis on pense avec raison que l’amour de la patrie est une espèce de culte auquel les hommes s’attachent par les pratiques.
De cette manière, la vie communale se fait en quelque sorte sentir à chaque instant ; elle se manifeste chaque jour par l’accomplissement d’un devoir ou par l’exercice d’un droit. Cette existence politique imprime à la société un mouvement continuel, mais en même temps paisible, qui l’agite sans la troubler.
Les Américains s’attachent à la cité par une raison analogue à celle qui fait aimer leur pays aux habitants des montagnes. Chez eux la patrie a des traits marqués et caractéristiques ; elle a plus de physionomie qu’ailleurs.
Les communes de la Nouvelle-Angleterre ont en [I-107] général une existence heureuse. Leur gouvernement est de leur goût aussi bien que de leur choix. Au sein de la paix profonde et de la prospérité matérielle qui règnent en Amérique, les organes de la vie municipale sont peu nombreux. La direction des intérêts communaux est aisée. De plus, il y a longtemps que l’éducation politique du peuple est faite, ou plutôt il est arrivé tout instruit sur le sol qu’il occupe. Dans la Nouvelle-Angleterre, la division des rangs n’existe pas même en souvenir : il n’y a donc point de portion de la commune qui soit tentée d’opprimer l’autre, et les injustices, qui ne frappent que des individus isolés, se perdent dans le contentement général. Le gouvernement présentât-il des défauts, et certes il est facile d’en signaler, ils ne frappent point les regards, parce que le gouvernement émane réellement des gouvernés, et qu’il lui suffit de marcher tant bien que mal, pour qu’une sorte d’orgueil paternel le protège. Ils n’ont rien d’ailleurs à quoi le comparer. L’Angleterre a jadis régné sur l’ensemble des colonies, mais le peuple a toujours dirigé les affaires communales. La souveraineté du peuple dans la commune est donc non seulement un état ancien, mais un état primitif.
L’habitant de la Nouvelle-Angleterre s’attache à sa commune, parce qu’elle est forte et indépendante ; il s’y intéresse, parce qu’il concourt à la diriger ; il l’aime, parce qu’il n’a pas à s’y plaindre de son sort : il place en elle son ambition et son avenir ; il se mêle à chacun des incidents de la vie communale : dans cette sphère restreinte qui est à sa portée, il s’essaie à gouverner la société ; il s’habitue aux formes sans lesquelles la liberté ne procède que par révolutions, se pénètre de [I-108] leur esprit, prend goût à l’ordre, comprend l’harmonie des pouvoirs, et rassemble enfin des idées claires et pratiques sur la nature de ses devoirs ainsi que sur l’étendue de ses droits.
DU COMTÉ DANS LA NOUVELLE-ANGLETERRE.
Le comté de la Nouvelle-Angleterre, analogue à l’arrondissement de France. — Créé dans un intérêt purement administratif. — N’a point de représentation. — Est administré par des fonctionnaires non électifs.
Le comté américain a beaucoup d’analogie avec l’arrondissement de France. On lui a tracé, comme à ce dernier, une circonscription arbitraire ; il forme un corps dont les différentes parties n’ont point entre elles de liens nécessaires, et auquel ne se rattachent ni affection ni souvenir, ni communauté d’existence. Il n’est créé que dans un intérêt purement administratif.
La commune avait une étendue trop restreinte pour qu’on pût y renfermer l’administration de la justice. Le comté forme donc le premier centre judiciaire. Chaque comté a une cour de justice [76] , un shérif pour exécuter les arrêts des tribunaux, une prison qui doit contenir les criminels.
Il y a des besoins qui sont ressentis d’une manière à peu près égale par toutes les communes du comté ; il était naturel qu’une autorité centrale fût chargée d’y pourvoir. Au Massachusetts, cette autorité réside [I-109] dans les mains d’un certain nombre de magistrats, que désigne le gouverneur de l’État, de l’avis [77] de son conseil [78] .
Les administrateurs du comté n’ont qu’un pouvoir borné et exceptionnel, qui ne s’applique qu’à un très petit nombre de cas prévus à l’avance. L’État et la commune suffisent à la marche ordinaire des choses. Ces administrateurs ne font que préparer le budget du comté, la législature le vote [79] . Il n’y a point d’assemblée qui représente directement ou indirectement le comté.
Le comté n’a donc point, à vrai dire, d’existence politique.
On remarque, dans la plupart des constitutions américaines, une double tendance qui porte les législateurs à diviser le pouvoir exécutif et à concentrer la puissance législative. La commune de la Nouvelle-Angleterre a, par elle-même, un principe d’existence dont on ne la dépouille point ; mais il faudrait créer fictivement cette vie dans le comté, et l’utilité n’en a point été sentie : toutes les communes réunies n’ont qu’une seule représentation, l’État, centre de tous les pouvoirs nationaux ; hors de l’action communale et nationale, on peut dire qu’il n’y a que des forces individuelles.
[I-110]
DE L’ADMINISTRATION DANS LA NOUVELLE-ANGLETERRE.
En Amérique, on n’aperçoit point l’administration. — Pourquoi. — Les Européens croient fonder la liberté en ôtant au pouvoir social quelques uns de ses droits ; les Américains, en divisant son exercice. — Presque toute l’administration proprement dite renfermée dans la commune, et divisée entre les fonctionnaires communaux. — On n’aperçoit la trace d’une hiérarchie administrative, ni dans la commune, ni au-dessus d’elle. — Pourquoi il en est ainsi. — Comment il arrive cependant que l’État est administré d’une manière uniforme. — Qui est chargé de faire obéir à la loi les administrations de la commune et du comté. — De l’introduction du pouvoir judiciaire dans l’administration. — Conséquence du principe de l’élection étendue à tous les fonctionnaires. — Du juge de paix dans la Nouvelle-Angleterre. — Par qui nommé. — Administre le comté. — Assure l’administration des communes. — Cour des sessions. — Manière dont elle agit. — Qui la saisit. — Le droit d’inspection et de plainte, éparpillé comme toutes les fonctions administratives. — Dénonciateurs encouragés par le partage des amendes.
Ce qui frappe le plus l’Européen qui parcourt les États-Unis, c’est : l’absence de ce qu’on appelle chez nous le gouvernement ou l’administration. En Amérique, on voit des lois écrites ; on en aperçoit l’exécution journalière ; tout se meut autour de vous, et on ne découvre nulle part le moteur. La main qui dirige la machine sociale échappe à chaque instant.
Cependant, de même que tous les peuples sont obligés, pour exprimer leurs pensées, d’avoir recours à certaines formes grammaticales constitutives des langues humaines, de même toutes les sociétés, pour subsister, sont contraintes de se soumettre à une certaine somme d’autorité sans laquelle elles tombent en anarchie. Cette autorité peut être distribuée de différentes manières, mais il faut toujours qu’elle se retrouve quelque part.
[I-111]
Il y a deux moyens de diminuer la force de l’autorité chez une nation.
Le premier est d’affaiblir le pouvoir dans son principe même, en ôtant à la société le droit ou la faculté de se défendre en certains cas : affaiblir l’autorité de cette manière, c’est en général ce qu’on appelle en Europe fonder la liberté.
Il est un second moyen de diminuer l’action de l’autorité : celui-ci ne consiste pas à dépouiller la société de quelques uns de ses droits, ou à paralyser ses efforts, mais à diviser l’usage de ses forces entre plusieurs mains ; à multiplier les fonctionnaires en attribuant à chacun d’eux tout le pouvoir dont il a besoin pour faire ce qu’on le destine à exécuter. Il se rencontre des peuples que cette division des pouvoirs sociaux peut encore mener à l’anarchie ; par elle-même, cependant, elle n’est point anarchique. En partageant ainsi l’autorité, on rend, il est vrai, son action moins irrésistible et moins dangereuse, mais on ne la détruit point.
La révolution aux États-Unis a été produite par un goût mûr et réfléchi pour la liberté, et non par un instinct vague et indéfini d’indépendance. Elle ne s’est point appuyée sur des passions de désordre ; mais, au contraire, elle a marché avec l’amour de l’ordre et de la légalité.
Aux États-Unis donc on n’a point prétendu que l’homme dans un pays libre eût le droit de tout faire ; on lui a au contraire imposé des obligations sociales plus variées qu’ailleurs ; on n’a point eu l’idée d’attaquer le pouvoir de la société dans son principe et de lui contester ses droits, on s’est borné à le diviser [I-112] dans son exercice. On a voulu arriver de cette manière à ce que l’autorité fût grande et le fonctionnaire petit, afin que la société continuât à être bien réglée et restât libre.
Il n’est pas au monde de pays où la loi parle un langage aussi absolu qu’en Amérique, et il n’en existe pas non plus ou le droit de l’appliquer soit divisé entre tant de mains.
Le pouvoir administratif aux États-Unis n’offre dans sa constitution rien de central ni de hiérarchique ; c’est ce qui fait qu’on ne l’aperçoit point. Le pouvoir existe mais on ne sait ou trouver son représentant.
Nous avons vu plus haut que les communes de la Nouvelle-Angleterre n’étaient point en tutelle. Elles prennent donc soin elles-mêmes de leurs intérêts particuliers.
Ce sont aussi les magistrats municipaux que, le plus souvent, on charge de tenir la main à l’exécution des lois générales de l’État, ou de les exécuter eux-mêmes [80] .
Indépendamment des lois générales, l’État fait quelquefois des règlements généraux de police ; mais ordinairement ce sont les communes et les officiers [I-113] communaux qui, conjointement avec les juges de paix, et suivant les besoins des localités, règlent les détails de l’existence sociale, et promulguent les prescriptions relatives à la santé publique, au bon ordre et à la moralité des citoyens [81] .
Ce sont enfin les magistrats municipaux qui, d’eux-mêmes, et sans avoir besoin de recevoir une impulsion étrangère pourvoient à ces besoins imprévus que ressentent souvent les sociétés [82] .
Il résulte de ce que nous venons de dire, qu’au Massachusetts le pouvoir administratif est presque entièrement renfermé dans la commune [83] ; mais il s’y trouve divisé entre beaucoup de mains.
Dans la commune de France, il n’y a, à vrai dire, qu’un seul fonctionnaire administratif, le maire.
Nous avons vu qu’on en comptait au moins dix-neuf dans la commune de la Nouvelle-Angleterre.
Ces dix-neuf fonctionnaires ne dépendent pas en général les uns des autres. La loi a tracé avec soin autour de chacun de ces magistrats un cercle d’action. Dans ce cercle, ils sont tout-puissants pour remplir les [I-114] devoirs de leur place, et ne relèvent d’aucune autorité communale.
Si l’on porte ses regards au-dessus de la commune, on aperçoit à peine la trace d’une hiérarchie administrative. Il arrive quelquefois que les fonctionnaires du comté réforment la décision prise par les communes ou par les magistrats communaux [84] ; mais en général on peut dire que les administrateurs du comté n’ont pas le droit de diriger la conduite des administrateurs de la commune [85] . Ils ne les commandent que dans les choses qui ont rapport au comté.
Les magistrats de la commune et ceux du comté sont tenus, dans un très petit nombre de cas prévus à l’avance, de communiquer le résultat de leurs opérations aux officiers du gouvernement central [86] . Mais le gouvernement central n’est point représenté par un homme chargé de faire des règlements généraux de police ou des ordonnances pour l’exécution des lois ; de communiquer habituellement avec les administrateurs [I-115] du comté de la commune ; d’inspecter leur conduite, de diriger leurs actes et de punir leurs fautes.
Il n’existe donc nulle part de centre auquel les rayons du pouvoir administratif viennent aboutir.
Comment donc parvient-on à conduire la société sur un plan à peu près uniforme ? Comment peut-on faire obéir les comtés et leurs administrateurs, les communes et leurs fonctionnaires ?
Dans les États de la Nouvelle-Angleterre, le pouvoir législatif s’étend à plus d’objets que parmi nous. Le législateur pénètre, en quelque sorte, au sein même de l’administration ; la loi descend à de minutieux détails ; elle prescrit en même temps les principes et le moyen de les appliquer ; elle enferme ainsi les corps secondaires et leurs administrateurs dans une multitude d’obligations étroites et rigoureusement définies.
Il résulte de là que, si tous les corps secondaires et tous les fonctionnaires se conforment à la loi, la société procède d’une manière uniforme dans toutes ses parties ; mais reste toujours à savoir comment on peut forcer les corps secondaires et leurs fonctionnaires à se conformer à la loi.
On peut dire, d’une manière générale, que la société ne trouve à sa disposition que deux moyens pour obliger les fonctionnaires à obéir aux lois :
Elle peut confier à l’un le pouvoir discrétionnaire de diriger tous les autres et de les destituer en cas de désobéissance ;
Ou bien elle peut charger les tribunaux d’infliger des peines judiciaires aux contrevenants.
On n’est pas toujours libre de prendre l’un ou l’autre de ces moyens.
[I-116]
Le droit de diriger le fonctionnaire suppose le droit de le destituer, s’il ne suit pas les ordres qu’on lui transmet, ou de l’élever en grade s’il remplit avec zèle tous ses devoirs. Or, on ne saurait ni destituer ni élever en grade un magistrat élu. Il est de la nature des fonctions électives d’être irrévocables jusqu’à la fin du mandat. En réalité, le magistrat élu n’a rien à attendre ni à craindre que des électeurs, lorsque toutes les fonctions publiques sont le produit de l’élection. Il ne saurait donc exister une véritable hiérarchie entre les fonctionnaires, puisqu’on ne peut réunir dans le même homme le droit d’ordonner et le droit de réprimer efficacement la désobéissance, et qu’on ne saurait joindre au pouvoir de commander celui de récompenser et de punir.
Les peuples qui introduisent l’élection dans les rouages secondaires de leur gouvernement, sont donc forcément amenés à faire un grand usage des peines judiciaires comme moyen d’administration.
C’est ce qui ne se découvre pas au premier coup d’œil. Les gouvernants regardent comme une première concession de rendre les fonctions électives, et comme une seconde concession de soumettre le magistrat élu aux arrêts des juges. Ils redoutent également ces deux innovations ; et comme ils sont plus sollicités de faire la première que la seconde, ils accordent l’élection au fonctionnaire et le laissent indépendant du juge. Cependant, l’une de ces deux mesures est le seul contre-poids qu’on puisse donner à l’autre. Qu’on y prenne bien garde, un pouvoir électif qui n’est pas soumis à un pouvoir judiciaire, échappe tôt ou tard à tout contrôle, ou est détruit. Entre le pouvoir central et les [I-117] corps administratifs élus, il n’y a que les tribunaux qui puissent servir d’intermédiaire. Eux seuls peuvent forcer le fonctionnaire élu à l’obéissance sans violer le droit de l’électeur.
L’extension du pouvoir judiciaire dans le monde politique doit donc être corrélative à l’extension du pouvoir électif. Si ces deux choses ne vont point ensemble, l’État finit par tomber en anarchie ou en servitude.
On a remarqué de tout temps que les habitudes judiciaires préparaient assez mal les hommes à l’exercice du pouvoir administratif.
Les Américains ont pris à leurs pères, les Anglais, l’idée d’une institution qui n’a aucune analogie avec ce que nous connaissons sur le continent de l’Europe, c’est celle des juges de paix.
Le juge de paix tient le milieu entre l’homme du monde et le magistrat, l’administrateur et le juge. Le juge de paix est un citoyen éclairé, mais qui n’est pas nécessairement versé dans la connaissance des lois. Aussi ne le charge-t-on que de faire la police de la société ; chose qui demande plus de bon sens et de droiture que de science. Le juge de paix apporte dans l’administration, lorsqu’il y prend part, un certain goût des formes et de la publicité, qui en fait un instrument fort gênant pour le despotisme ; mais il ne s’y montre pas l’esclave de ces superstitions légales qui rendent les magistrats peu capables de gouverner.
Les Américains se sont approprié l’institution des juges de paix, tout en lui ôtant le caractère aristocratique qui la distinguait dans la mère-patrie.
[I-118]
Le gouverneur du Massachusetts [87] nomme, dans tous les comtés, un certain nombre de juges de paix, dont les fonctions doivent durer sept ans [88] .
De plus, parmi ces juges de paix, il en désigne trois qui forment dans chaque comté ce qu’on appelle la cour des sessions.
Les juges de paix prennent part individuellement à l’administration publique. Tantôt ils sont chargés, concurremment avec les fonctionnaires élus, de certains actes administratifs [89] ; tantôt ils forment un tribunal devant lequel les magistrats accusent sommairement le citoyen qui refuse d’obéir, ou le citoyen dénonce les délits des magistrats. Mais c’est dans la cour des sessions que les juges de paix exercent les plus importantes de leurs fonctions administratives.
La cour des sessions se réunit deux fois par an au chef-lieu du comté. C’est elle qui, dans le Massachusetts, est chargée de maintenir le plus grand nombre [90] [I-119] des fonctionnaires publics dans l’obéissance [91] .
Il faut bien faire attention qu’au Massachusetts la cour des sessions est tout à la fois un corps administratif proprement dit, et un tribunal politique.
Nous avons dit que le comté n’avait qu’une existence administrative. C’est la cour des sessions qui dirige par elle-même le petit nombre d’intérêts qui se rapportent en même temps à plusieurs communes ou à toutes les communes du comté à la fois, et dont par conséquent on ne peut charger aucune d’elles en particulier [92] .
Quand il s’agit du comté, les devoirs de la cour des sessions sont donc purement administratifs, et si elle introduit souvent dans sa manière de procéder les formes judiciaires, ce n’est qu’un moyen de s’éclairer [93] , et qu’une garantie qu’elle donne aux administrés. Mais lorsqu’il faut assurer l’administration des communes, elle agit presque toujours comme [I-120] corps judiciaire, et dans quelques cas rares seulement, comme corps administratif.
La première difficulté qui se présente est de faire obéir la commune elle-même, pouvoir presque indépendant, aux lois générales de l’État.
Nous avons vu que les communes doivent nommer chaque année un certain nombre de magistrats qui, sous le nom d’assesseurs, répartissent l’impôt. Une commune tente d’échapper à l’obligation de payer l’impôt en ne nommant pas les assesseurs. La cour des sessions la condamne à une forte amende [94] . L’amende est levée par corps sur tous les habitants. Le shériff du comté, officier de justice, fait exécuter l’arrêt. C’est ainsi qu’aux États-Unis le pouvoir semble jaloux de se dérober avec soin aux regards. Le commandement administratif s’y voile presque toujours sous le mandat judiciaire ; il n’en est que plus puissant, ayant alors pour lui cette force presque irrésistible que les hommes accordent à la forme légale.
Cette marche est facile à suivre, et se comprend sans peine. Ce qu’on exige de la commune est, en général, net et défini ; il consiste dans un fait simple et non complexe, en un principe, et non une application de détail [95] . Mais la difficulté commence lorsqu’il s’agit de faire obéir, non plus la commune, mais les fonctionnaires communaux.
[I-121]
Toutes les actions répréhensibles que peut commettre un fonctionnaire public rentrent en définitive dans l’une de ces catégories :
Il peut faire, sans ardeur et sans zèle, ce que lui commande la loi.
Il peut ne pas faire ce que lui commande la loi.
Enfin, il peut faire ce que lui défend la loi.
Un tribunal ne saurait atteindre la conduite d’un fonctionnaire que dans les deux derniers cas. Il faut un fait positif et appréciable pour servir de base à l’action judiciaire.
Ainsi, les select-men omettent de remplir les formalités voulues par la loi en cas d’élection communale ; ils peuvent être condamnés à l’amende [96] .
Mais lorsque le fonctionnaire public remplit sans intelligence son devoir ; lorsqu’il obéit sans ardeur et sans zèle aux prescriptions de la loi, il se trouve entièrement hors des atteintes d’un corps judiciaire.
La cour des sessions, lors même qu’elle est revêtue de ses attributions administratives, est impuissante pour le forcer dans ce cas à remplir ses obligations tout entières. Il n’y a que la crainte de la révocation qui puisse prévenir ces quasi-délits, et la cour des sessions n’a point en elle l’origine des pouvoirs communaux ; elle ne peut révoquer des fonctionnaires qu’elle ne nomme point.
Pour s’assurer d’ailleurs qu’il y a négligence et [I-122] défaut de zèle, il faudrait exercer sur le fonctionnaire inférieur une surveillance continuelle. Or, la cour des sessions ne siège que deux fois par an ; elle n’inspecte point, elle juge les faits répréhensibles qu’on lui dénonce.
Le pouvoir arbitraire de destituer les fonctionnaires publics peut seul garantir, de leur part, cette sorte d’obéissance éclairée et active que la répression judiciaire ne peut leur imposer.
En France, nous cherchons cette dernière garantie dans la hiérarchie administrative ; en Amérique, on la cherche dans l’élection.
Ainsi, pour résumer en quelques mots ce que je viens d’exposer :
Le fonctionnaire public de la Nouvelle-Angleterre commet-il un crime dans l’exercice de ses fonctions, les tribunaux ordinaires sont toujours appelés à en faire justice.
Commet-il une faute administrative, un tribunal purement administratif est chargé de le punir, et quand la chose est grave ou pressante, le juge fait ce que le fonctionnaire aurait dû faire [97] .
Enfin, le même fonctionnaire se rend-il coupable de l’un de ces délits insaisissables que la justice humaine ne peut ni définir ni apprécier, il comparaît annuellement devant un tribunal sans appel, qui peut le réduire tout-à-coup à l’impuissance ; son pouvoir lui échappe avec son mandat.
[I-123]
Ce système renferme assurément en lui-même de grands avantages, mais il rencontre dans son exécution une difficulté pratique qu’il est nécessaire de signaler.
J’ai déjà fait remarquer que le tribunal administratif, qu’on nomme la cour des sessions, n’avait pas le droit d’inspecter les magistrats communaux ; elle ne peut, suivant un terme de droit, agir que lorsqu’elle est saisie. Or, c’est là le point délicat du système.
Les Américains de la Nouvelle-Angleterre n’ont point institué de ministère public près la cour des sessions [98] ; et l’on doit concevoir qu’il leur était difficile d’en établir un. S’ils s’étaient bornés à placer au chef-lieu de chaque comté un magistrat accusateur, et qu’ils ne lui eussent point donné d’agents dans les communes, pourquoi ce magistrat aurait-il été plus instruit de ce qui se passait dans le comté que les membres de la cour des sessions eux-mêmes ? Si on lui avait donné des agents dans chaque commune, on centralisait dans ses mains le plus redoutable des pouvoirs, celui d’administrer judiciairement. Les lois d’ailleurs sont filles des habitudes, et rien de semblable n’existait dans la législation anglaise.
Les Américains ont donc divisé le droit d’inspection et de plainte comme toutes les autres fonctions administratives.
Les membres du grand jury doivent, aux termes de la loi, avertir le tribunal, près duquel ils agissent, des délits de tous genres qui peuvent se commettre [I-124] dans leur comté [99] . Il y a certains grands délits administratifs que le ministère public ordinaire doit poursuivre d’office [100] ; le plus souvent, l’obligation de faire punir les délinquants est imposée à l’officier fiscal, chargé d’encaisser le produit de l’amende ; ainsi le trésorier de la commune est chargé de poursuivre la plupart des délits administratifs qui sont commis sous ses yeux.
Mais c’est surtout à l’intérêt particulier que la législation américaine en appelle [101] ; c’est là le grand principe que l’on retrouve sans cesse quand on étudie les lois des États-Unis.
Les législateurs américains ne montrent que peu de confiance dans l’honnêteté humaine ; mais ils supposent l’homme intelligent. Ils se reposent donc le plus souvent sur l’intérêt personnel pour l’exécution des lois.
Lorsqu’un individu est positivement et actuellement lésé par un délit administratif, l’on comprend en effet que l’intérêt personnel garantisse la plainte.
Mais il est facile de prévoir que s’il s’agit d’une prescription légale, qui, tout en étant utile à la société, n’est point d’une utilité actuellement sentie par un individu, chacun hésitera à se porter accusateur. [I-125] De cette manière, et par une sorte d’accord tacite, les lois pourraient bien tomber en désuétude.
Dans cette extrémité où leur système les jette, les Américains sont obligés d’intéresser les dénonciateurs en les appelant dans certains cas au partage des amendes [102] ·
Moyen dangereux qui assure l’exécution des lois en dégradant les mœurs.
Au-dessus des magistrats du comté, il n’y a plus, à vrai dire, de pouvoir administratif, mais seulement un pouvoir gouvernemental.
[I-126]
IDÉES GÉNÉRALES SUR L’ADMINISTRATION AUX ÉTATS-UNIS.
En quoi les États de l’Union diffèrent entre eux, par le système d’administration. — Vie communale moins active et moins complète à mesure qu’on descend vers le midi. — Le pouvoir du magistrat devient alors plus grand, celui de l’électeur plus petit. — L’administration passe de la commune au comté. — États de New-York, d’Ohio, de Pensylvanie. — Principes administratifs applicables à toute l’Union. — Élection des fonctionnaires publics ou inamovibilité de leurs fonctions. — Absence de hiérarchie. — Introduction des moyens judiciaires dans l’administration.
J’ai annoncé précédemment, qu’après avoir examiné en détail la constitution de la commune et du comté dans la Nouvelle-Angleterre, je jetterais un coup d’œil général sur le reste de l’Union.
Il y a des communes et une vie communale dans chaque État ; mais dans aucun des États confédérés on ne rencontre une commune identiquement semblable à celle de la Nouvelle-Angleterre.
À mesure qu’on descend vers le midi, on s’aperçoit que la vie communale devient moins active ; la commune a moins de magistrats, de droits et de devoirs ; la population n’y exerce pas une influence si directe sur les affaires ; les assemblées communales sont moins fréquentes et s’étendent à moins d’objets. Le pouvoir du magistrat élu est donc comparativement plus grand et celui de l’électeur plus petit, l’esprit communal y est moins éveillé et moins puissant [103] .
[I-127]
On commence à apercevoir ces différences dans l’État de New-York ; elles sont déjà très sensibles dans la Pensylvanie ; mais elles deviennent moins frappantes lorsqu’on s’avance vers le nord-ouest. La plupart des émigrants qui vont fonder les États du nord-ouest sortent de la Nouvelle-Angleterre, et ils transportent les habitudes administratives de la mère-patrie dans leur patrie adoptive. La commune de l’Ohio a beaucoup d’analogie avec la commune du Massachusetts.
Nous avons vu qu’au Massachusetts le principe de l’administration publique se trouve dans la commune. La commune est le foyer dans lequel viennent se réunir les intérêts et les affections des hommes. Mais il cesse d’en être ainsi à mesure que l’on descend vers des États où les lumières ne sont pas si universellement répandues, et où par conséquent la commune offre moins de garanties de sagesse et moins d’éléments d’administration. À mesure donc que l’on s’éloigne de la Nouvelle-Angleterre, la vie communale passe en quelque sorte au comté. Le comté devient le grand centre administratif, et forme [I-128] le pouvoir intermédiaire entre le gouvernement et les simples citoyens.
J’ai dit qu’au Massachusetts les affaires du comté sont dirigées par la cour des sessions. La cour des sessions se compose d’un certain nombre de magistrats nommés par le gouverneur et son conseil. Le comté n’a point de représentation, et son budget est voté par la législature nationale.
Dans le grand État de New-York, au contraire, dans l’État de l’Ohio et dans la Pensylvanie, les habitants de chaque comté élisent un certain nombre de députés ; la réunion de ces députés forme une assemblée représentative du comté [104] .
L’assemblée du comté possède, dans de certaines limites, le droit d’imposer les habitants ; elle constitue, sous ce rapport, une véritable législature ; c’est elle en même temps qui administre le comté, dirige en plusieurs cas l’administration des communes, et resserre leurs pouvoirs dans des limites beaucoup plus étroites qu’au Massachusetts.
Ce sont là les principales différences que présente la constitution de la commune et du comté dans les divers États confédérés. Si je voulais descendre jusqu’aux détails des moyens d’exécution, j’aurais [I-129] beaucoup d’autres dissemblances à signaler encore. Mais mon but n’est pas de faire un cours de droit administratif américain.
J’en ai dit assez, je pense, pour faire comprendre sur quels principes généraux repose l’administration aux États-Unis. Ces principes sont diversement appliqués ; ils fournissent des conséquences plus ou moins nombreuses suivant les lieux ; mais au fond ils sont partout les mêmes. Les lois varient ; leur physionomie change ; un même esprit les anime.
La commune et le comté ne sont pas constitués partout de la même manière ; mais on peut dire que l’organisation de la commune et du comté, aux États-Unis, repose partout sur cette même idée ; que chacun est le meilleur juge de ce qui n’a rapport qu’à lui-même, et le plus en état de pourvoir à ses besoins particuliers. La commune et le comté sont donc chargés de veiller à leurs intérêts spéciaux. L’État gouverne et n’administre pas. On rencontre des exceptions à ce principe, mais non un principe contraire.
La première conséquence de cette doctrine a été de faire choisir, par les habitants eux-mêmes, tous les administrateurs de la commune et du comté, ou du moins de choisir ces magistrats exclusivement parmi eux.
Les administrateurs étant partout élus, ou du moins irrévocables, il en est résulté que nulle part on n’a pu introduire les règles de la hiérarchie. Il y a donc eu presque autant de fonctionnaires indépendants que de fonctions. Le pouvoir administratif s’est trouvé disséminé en une multitude de mains.
[I-130]
La hiérarchie administrative n’existant nulle part, les administrateurs étant élus et irrévocables jusqu’à la fin du mandat, il s’en est suivi l’obligation d’introduire plus ou moins les tribunaux dans l’administration. De là le système des amendes, au moyen desquelles les corps secondaires et leurs représentants sont contraints d’obéir aux lois. On retrouve ce système d’un bout à l’autre de l’Union.
Du reste, le pouvoir de réprimer les délits administratifs, ou de faire au besoin des actes d’administration, n’a point été accordé dans tous les États aux mêmes juges.
Les Anglo-Américains ont puisé à une source commune l’institution des juges de paix ; on la retrouve dans tous les États. Mais ils n’en ont pas toujours tiré le même parti.
Partout les juges de paix concourent à l’administration des communes et des comtés [105] , soit en administrant eux-mêmes, soit en réprimant certains délits administratifs ; mais, dans la plupart des États, les plus graves de ces délits sont soumis aux tribunaux ordinaires.
Ainsi donc, élections des fonctionnaires administratifs, ou inamovibilité de leurs fonctions, absence de hiérarchie administrative, introduction des moyens judiciaires dans le gouvernement secondaire de la société, tels sont les caractères principaux auxquels on reconnaît l’administration américaine, depuis le Maine jusqu’aux Florides.
[I-131]
Il y a quelques États dans lesquels on commence à apercevoir les traces d’une centralisation administrative. L’État de New-York est le plus avancé dans cette voie.
Dans l’État de New-York, les fonctionnaires du gouvernement central exercent, en certains cas, une sorte de surveillance et de contrôle, sur la conduite des corps secondaires [106] . Ils forment, en certains autres, une espèce de tribunal d’appel pour la décision des affaires [107] . Dans l’État de New-York, les peines judiciaires sont moins employées qu’ailleurs [I-132] comme moyen administratif. Le droit de poursuivre les délits administratifs y est aussi placé en moins de mains [108] .
La même tendance se fait légèrement remarquer dans quelques autres États [109] . Mais, en général, on peut dire que le caractère saillant de l’administration publique aux États-Unis est d’être prodigieusement décentralisée.
DE L’ÉTAT.
J’ai parlé des communes et de l’administration, il me reste à parler de l’État et du gouvernement.
Ici je puis me hâter, sans craindre de n’être pas compris ; ce que j’ai à dire se trouve tout tracé dans des constitutions écrites que chacun peut aisément se [I-133] procurer [110] . Ces constitutions reposent elles-mêmes sur une théorie simple et rationnelle.
La plupart des formes qu’elles indiquent ont été adoptées par tous les peuples constitutionnels ; elles nous sont ainsi devenues familières.
Je n’ai donc à faire ici qu’un court exposé. Plus tard je tâcherai de juger ce que je vais décrire.
POUVOIR LÉGISLATIF DE L’ÉTAT.
Division du corps législatif en deux chambres. — Sénat. — Chambre des représentants. — Différentes attributions de ces deux corps.
Le pouvoir législatif de l’État est confié à deux assemblées ; la première porte en général le nom de sénat.
Le sénat est habituellement un corps législatif ; mais quelquefois il devient un corps administratif et judiciaire.
Il prend part à l’administration de plusieurs manières, suivant les différentes constitutions [111] ; mais c’est en concourant au choix des fonctionnaires qu’il pénètre ordinairement dans la sphère du pouvoir exécutif.
Il participe au pouvoir judiciaire, en prononçant sur certains délits politiques, et aussi quelquefois en statuant sur certaines causes civiles [112] .
[I-134]
Ses membres sont toujours peu nombreux.
L’autre branche de la législature, qu’on appelle d’ordinaire la chambre des représentants, ne participe en rien au pouvoir administratif, et ne prend part au pouvoir judiciaire qu’en accusant les fonctionnaires publics devant le sénat.
Les membres des deux chambres sont soumis presque partout aux mêmes conditions d’éligibilité. Les uns et les autres sont élus de la même manière et par les mêmes citoyens.
La seule différence qui existe entre eux provient de ce que le mandat des sénateurs est en général plus long que celui des représentants. Les seconds restent rarement en fonction plus d’une année ; les premiers siègent ordinairement deux ou trois ans.
En accordant aux sénateurs le privilége d’être nommés pour plusieurs années, et en les renouvelant par série, la loi a pris soin de maintenir au sein des législateurs un noyau d’hommes habitués aux affaires, et qui pussent exercer une influence utile sur les nouveaux venus.
Par la division du corps législatif en deux branches, les Américains n’ont donc pas voulu créer une assemblée héréditaire et une autre élective, ils n’ont pas prétendu faire de l’une un corps aristocratique, et de l’autre un représentant de la démocratie ; leur but n’a point été non plus de donner dans la première un appui au pouvoir, en laissant à la seconde les intérêts et les passions du peuple.
Diviser la force législative, ralentir ainsi le mouvement des assemblées politiques, et créer un tribunal d’appel pour la révision des lois, tels sont les seuls [I-135] avantages qui résultent de la constitution actuelle de deux chambres aux États-Unis.
Le temps et l’expérience ont fait connaître aux Américains que, réduite à ces avantages, la division des pouvoirs législatifs est encore une nécessité du premier ordre. Seule, parmi toutes les républiques unies, la Pensylvanie avait d’abord essayé d’établir une assemblée unique. Franklin lui-même, entraîné par les conséquences logiques du dogme de la souveraineté du peuple, avait concouru à cette mesure. On fut bientôt obligé de changer de loi et de constituer les deux chambres. Le principe de la division du pouvoir législatif reçut ainsi sa dernière consécration ; on peut donc désormais considérer comme une vérité démontrée la nécessité de partager l’action législative entre plusieurs corps. Cette théorie, à peu près ignorée des républiques antiques, introduite dans le monde presque au hasard, ainsi que la plupart des grandes vérités, méconnue de plusieurs peuples modernes, est enfin passée comme un axiome dans la science politique de nos jours.
DU POUVOIR EXÉCUTIF DE L’ÉTAT.
Ce qu’est le gouverneur dans un État américain. — Quelle position il occupe vis-à-vis de la législature. — Quels sont ses droits et ses devoirs. — Sa dépendance du peuple.
Le pouvoir exécutif de l’État a pour représentant le gouverneur.
Ce n’est pas au hasard que j’ai pris ce mot de représentant. Le gouverneur de l’État représente en effet [I-136] le pouvoir exécutif ; mais il n’exerce que quelques uns de ses droits.
Le magistrat suprême, qu’on nomme le gouverneur, est placé à côté de la législature comme un modérateur et un conseil. Il est armé d’un véto suspensif qui lui permet d’en arrêter ou du moins d’en ralentir à son gré les mouvements. Il expose au corps législatif les besoins du pays, et lui fait connaître les moyens qu’il juge utile d’employer afin d’y pourvoir ; il est l’exécuteur naturel de ses volontés pour toutes les entreprises qui intéressent la nation entière [113] . En l’absence de la législature, il doit prendre toutes les mesures propres à garantir l’État des chocs violents et des dangers imprévus.
Le gouverneur réunit dans ses mains toute la puissance militaire de l’État. Il est le commandant des milices et le chef de la force armée.
Lorsque la puissance d’opinion, que les hommes sont convenus d’accorder à la loi, se trouve méconnue, le gouverneur s’avance à la tête de la force matérielle de l’État ; il brise la résistance, et rétablit l’ordre accoutumé.
Du reste, le gouverneur n’entre point dans l’administration des communes et des comtés, ou du moins il n’y prend part que très indirectement par la nomination des juges de paix qu’il ne peut ensuite révoquer [114] .
[I-137]
Le gouverneur est un magistrat électif. On a même soin en général de ne l’élire que pour un ou deux ans ; de telle sorte qu’il reste toujours dans une étroite dépendance de la majorité qui l’a créé.
DES EFFETS POLITIQUES DE LA DÉCENTRALISATION ADMINISTRATIVE AUX ÉTATS-UNIS.
Distinction à établir entre la centralisation gouvernementale et la centralisation administrative. — Aux États-Unis, pas de centralisation administrative, mais très grande centralisation gouvernementale. — Quelques effets fâcheux qui résultent aux États-Unis de l’extrême décentralisation administrative. — Avantages administratifs de cet ordre de choses. — La force qui administre la société, moins réglée, moins éclairée, moins savante, bien plus grande qu’en Europe. — Avantages politiques du même ordre de choses. — Aux États-Unis, la patrie se fait sentir partout. — Appui que les gouvernés prêtent au gouvernement. — Les institutions provinciales plus nécessaires à mesure que l’état social devient plus démocratique. — Pourquoi.
La centralisation est un mot que l’on répète sans cesse de nos jours, et dont personne, en général, ne cherche à préciser le sens.
Il existe cependant deux espèces de centralisation très distinctes, et qu’il importe de bien connaître.
Certains intérêts sont communs à toutes les parties de la nation, tels que la formation des lois générales et les rapports du peuple avec les étrangers.
D’autres intérêts sont spéciaux à certaines parties de la nation, telles, par exemple, que les entreprises communales.
Concentrer dans un même lieu ou dans une même main le pouvoir de diriger les premiers, c’est [I-138] fonder ce que j’appellerai la centralisation gouvernementale.
Concentrer de la même manière le pouvoir de diriger les seconds, c’est fonder ce que je nommerai la centralisation administrative.
Il est des points sur lesquels ces deux espèces de centralisation viennent à se confondre. Mais en prenant, dans leur ensemble, les objets qui tombent plus particulièrement dans le domaine de chacune d’elles, on parvient aisément à les distinguer.
On comprend que la centralisation gouvernementale acquiert une force immense quand elle se joint à la centralisation administrative. De cette manière elle habitue les hommes à faire abstraction complète et continuelle de leur volonté ; à obéir, non pas une fois et sur un point, mais en tout et tous les jours. Non seulement alors elle les dompte par la force, mais encore elle les prend par leurs habitudes ; elle les isole et les saisit ensuite un à un dans la masse commune.
Ces deux espèces de centralisation se prêtent un mutuel secours, s’attirent l’une l’autre ; mais je ne saurais croire qu’elles soient inséparables.
Sous Louis XIV, la France a vu la plus grande centralisation gouvernementale qu’on pût concevoir, puisque le même homme faisait les lois générales et avait le pouvoir de les interpréter, représentait la France à l’extérieur et agissait en son nom. L’État, c’est moi, disait-il ; et il avait raison.
Cependant, sous Louis XIV, il y avait beaucoup moins de centralisation administrative que de nos jours.
[I-139]
De notre temps, nous voyons une puissance, l’Angleterre, chez laquelle la centralisation gouvernementale est portée à un très haut degré : l’État semble s’y mouvoir comme un seul homme ; il soulève à sa volonté des masses immenses, réunit et porte partout où il le veut tout l’effort de sa puissance.
L’Angleterre, qui a fait de si grandes choses depuis cinquante ans, n’a pas de centralisation administrative.
Pour ma part, je ne saurais concevoir qu’une nation puisse vivre ni surtout prospérer sans une forte centralisation gouvernementale.
Mais je pense que la centralisation administrative n’est propre qu’à énerver les peuples qui s’y soumettent, parce qu’elle tend sans cesse à diminuer parmi eux l’esprit de cité. La centralisation administrative parvient, il est vrai, à réunir à une époque donnée, et dans un certain lieu, toutes les forces disponibles de la nation, mais elle nuit à la reproduction des forces. Elle la fait triompher le jour du combat, et diminue à la longue sa puissance. Elle peut donc concourir admirablement à la grandeur passagère d’un homme, non point à la prospérité durable d’un peuple.
Qu’on y prenne bien garde, quand on dit qu’un État ne peut agir parce qu’il n’a pas de centralisation, on parle presque toujours, sans le savoir, de la centralisation gouvernementale. L’empire d’Allemagne, répète-t-on, n’a jamais pu tirer de ses forces tout le parti possible. D’accord. Mais pourquoi ? parce que la force nationale n’y a jamais été centralisée ; parce que l’État n’a jamais pu faire obéir à ses lois [I-140] générales ; parce que les parties séparées de ce grand corps ont toujours eu le droit ou la possibilité de refuser leur concours aux dépositaires de l’autorité commune, dans les choses mêmes qui intéressaient tous les citoyens ; en d’autres termes, parce qu’il n’y avait pas de centralisation gouvernementale. La même remarque est applicable au moyen âge : ce qui a produit toutes les misères de la société féodale, c’est que le pouvoir, non seulement d’administrer, mais de gouverner, était partagé entre mille mains et fractionné de mille manières ; l’absence de toute centralisation gouvernementale empêchait alors les nations de l’Europe de marcher avec énergie vers aucun but.
Nous avons vu qu’aux États-Unis il n’existait point de centralisation administrative. On y trouve à peine la trace d’une hiérarchie. La décentralisation y a été portée à un degré qu’aucune nation européenne ne saurait souffrir, je pense, sans un profond malaise, et qui produit même des effets fâcheux en Amérique. Mais, aux États-Unis, la centralisation gouvernementale existe au plus haut point. Il serait facile de prouver que la puissance nationale y est plus concentrée qu’elle ne l’a été dans aucune des anciennes monarchies de l’Europe. Non seulement il n’y a dans chaque État qu’un seul corps qui fasse les lois ; non seulement il n’existe qu’une seule puissance qui puisse créer la vie politique autour d’elle ; mais, en général, on a évité d’y réunir de nombreuses assemblées de districts ou de comtés, de peur que ces assemblées ne fussent tentées de sortir de leurs attributions administratives et d’entraver la marche du [I-141] gouvernement. En Amérique, la législature de chaque État n’a devant elle aucun pouvoir capable de lui résister. Rien ne saurait l’arrêter dans sa voie, ni priviléges, ni immunité locale, ni influence personnelle, pas même l’autorité de la raison, car elle représente la majorité qui se prétend l’unique organe de la raison. Elle n’a donc d’autres limites, dans son action, que sa propre volonté. À côté d’elle, et sous sa main, se trouve placé le représentant du pouvoir exécutif, qui, à l’aide de la force matérielle, doit contraindre les mécontents à l’obéissance.
La faiblesse ne se rencontre que dans certains détails de l’action gouvernementale.
Les républiques américaines n’ont pas de force armée permanente pour comprimer les minorités ; mais les minorités n’y ont jamais été réduites, jusqu’à présent, à faire la guerre, et la nécessité d’une armée n’a pas encore été sentie. L’État se sert, le plus souvent, des fonctionnaires de la commune ou du comté pour agir sur les citoyens. Ainsi, par exemple, dans la Nouvelle-Angleterre, c’est l’assesseur de la commune qui répartit la taxe ; le percepteur de la commune la lève ; le caissier de la commune en fait parvenir le produit au trésor public, et les réclamations qui s’élèvent sont soumises aux tribunaux ordinaires. Une semblable manière de percevoir l’impôt est lente, embarrassée ; elle entraverait à chaque moment la marche d’un gouvernement qui aurait de grands besoins pécuniaires. En général, on doit désirer que, pour tout ce qui est essentiel à sa vie, le gouvernement ait des fonctionnaires à lui, choisis par lui, révocables par lui, et des formes rapides de [I-142] procéder. Mais il sera toujours facile à la puissance centrale, organisée comme elle l’est en Amérique, d’introduire, suivant les besoins, des moyens d’action plus énergiques et plus efficaces.
Ce n’est donc pas, comme on le répète souvent, parce qu’il n’y a point de centralisation aux États-Unis, que les républiques du Nouveau-Monde périront ; bien loin de n’être pas assez centralisées, on peut affirmer que les gouvernements américains le sont trop ; je le prouverai plus tard. Les assemblées législatives engloutissent chaque jour quelques débris des pouvoirs gouvernementaux ; elles tendent à les réunir tous en elles-mêmes, ainsi que l’avait fait la Convention. Le pouvoir social, ainsi centralisé, change sans cesse de mains, parce qu’il est subordonné à la puissance populaire. Souvent il lui arrive de manquer de sagesse et de prévoyance, parce qu’il peut tout. Là se trouve pour lui le danger. C’est donc à cause de sa force même, et non par suite de sa faiblesse, qu’il est menacé de périr un jour.
La décentralisation administrative produit en Amérique plusieurs effets divers.
Nous avons vu que les Américains avaient presque entièrement isolé l’administration du gouvernement ; en cela ils me semblent avoir outrepassé les limites de la saine raison ; car l’ordre, même dans les choses secondaires, est encore un intérêt national [115]
L’État n’ayant point de fonctionnaires [I-143] administratifs à lui, placés à poste fixe sur les différents points du territoire, et auxquels il puisse imprimer une impulsion commune, il en résulte qu’il tente rarement d’établir des règles générales de police. Or, le besoin de ces règles se fait vivement sentir. L’Européen en remarque souvent l’absence. Cette apparence de désordre qui règne à la surface, lui persuade, au premier abord, qu’il y a anarchie complète dans la société, ce n’est qu’en examinant le fond des choses qu’il se détrompe.
Certaines entreprises intéressent l’État entier, et ne peuvent cependant s’exécuter, parce qu’il n’y a point d’administration nationale qui les dirige. Abandonnées aux soins des communes et des comtés, livrées à des agents élus et temporaires, elles n’amènent aucun résultat, ou ne produisent rien de durable.
Les partisans de la centralisation en Europe soutiennent que le pouvoir gouvernemental administre mieux les localités qu’elles ne pourraient s’administrer elles-mêmes : cela peut être vrai, quand le pouvoir central est éclairé et les localités sans lumières, quand il est actif et qu’elles sont inertes, quand il a l’habitude d’agir et elles l’habitude d’obéir. On comprend même que plus la centralisation augmente, plus cette double tendance s’accroît, et plus la [I-144] capacité d’une part et l’incapacité de l’autre deviennent saillantes.
Mais je nie qu’il en soit ainsi quand le peuple est éclairé, éveillé sur ses intérêts, et habitué à y songer comme il le fait en Amérique.
Je suis persuadé, au contraire, que dans ce cas la force collective des citoyens sera toujours plus puissante pour produire le bien-être social que l’autorité du gouvernement.
J’avoue qu’il est difficile d’indiquer d’une manière certaine le moyen de réveiller un peuple qui sommeille, pour lui donner des passions et des lumières qu’il n’a pas ; persuader aux hommes qu’ils doivent s’occuper de leurs affaires, est, je ne l’ignore pas, une entreprise ardue. Il serait souvent moins malaisé de les intéresser aux détails de l’étiquette d’une cour qu’à la réparation de la maison commune.
Mais je pense aussi que lorsque l’administration centrale prétend remplacer complétement le concours libre des premiers intéressés, elle se trompe ou veut vous tromper.
Un pouvoir central, quelque éclairé, quelque savant qu’on l’imagine ne peut embrasser à lui seul tous les détails de la vie d’un grand peuple. Il ne le peut, parce qu’un pareil travail excède les forces humaines. Lorsqu’il veut, par ses seuls soins, créer et faire fonctionner tant de ressorts divers, il se contente d’un résultat fort incomplet, ou s’épuise en inutiles efforts.
La centralisation parvient aisément, il est vrai, à soumettre les actions extérieures de l’homme à une certaine uniformité qu’on finit par aimer pour [I-145] elle-même, indépendamment des choses auxquelles elle s’applique ; comme ces dévots qui adorent la statue oubliant la divinité qu’elle représente. La centralisation réussit sans peine à imprimer une allure régulière aux affaires courantes ; à régenter savamment les détails de la police sociale ; à réprimer les légers désordres et les petits délits ; à maintenir la société dans un statu quo qui n’est proprement ni une décadence ni un progrès ; à entretenir dans le corps social une sorte de somnolence administrative que les administrateurs ont coutume d’appeler le bon ordre et la tranquillité publique [116] . Elle excelle, en un mot, à empêcher, non à faire. Lorsqu’il s’agit de remuer profondément la société, ou de lui imprimer une marche rapide, sa force l’abandonne. Pour peu que ses mesures aient besoin du concours des individus, on est tout surpris alors de la faiblesse de cette immense machine ; elle se trouve tout-à-coup réduite à l’impuissance.
Il arrive quelquefois alors que la centralisation essaie, en désespoir de cause, d’appeler les citoyens à son aide ; mais elle leur dit : Vous agirez comme je voudrai, autant que je voudrai, et précisément dans le sens que je voudrai. Vous vous chargerez de ces [I-146] détails sans aspirer à diriger l’ensemble ; vous travaillerez dans les ténèbres, et vous jugerez plus tard mon œuvre par ses résultats. Ce n’est point à de pareilles conditions qu’on obtient le concours de la volonté humaine. Il lui faut de la liberté dans ses allures, de la responsabilité dans ses actes. L’homme est ainsi fait qu’il préfère rester immobile que marcher sans indépendance vers un but qu’il ignore.
Je ne nierai pas qu’aux États-Unis on regrette souvent de ne point trouver ces règles uniformes qui semblent sans cesse veiller sur chacun de nous.
On y rencontre de temps en temps de grands exemples d’insouciance et d’incurie sociale. De loin en loin apparaissent des taches grossières qui semblent en désaccord complet avec la civilisation environnante.
Des entreprises utiles qui demandent un soin continuel et une exactitude rigoureuse pour réussir, finissent souvent par être abandonnées ; car, en Amérique comme ailleurs, le peuple procède par efforts momentanés et impulsions soudaines.
L’Européen, accoutumé à trouver sans cesse sous sa main un fonctionnaire qui se mêle à peu près de tout, se fait difficilement à ces différents rouages de l’administration communale. En général, on peut dire que les petits détails de la police sociale qui rendent la vie douce et commode sont négligés en Amérique ; mais les garanties essentielles à l’homme en société y existent autant que partout ailleurs. Chez les Américains, la force qui administre l’État est bien moins réglée, moins éclairée, moins savante, mais cent fois plus grande qu’en Europe. Il n’y a pas de [I-147] pays au monde où les hommes fassent, en définitive, autant d’effort pour créer le bien-être social. Je ne connais point de peuple qui soit parvenu à établir des écoles aussi nombreuses et aussi efficaces ; des temples plus en rapport avec les besoins religieux des habitants ; des routes communales mieux entretenues. Il ne faut donc pas chercher aux États-Unis l’uniformité et la permanence des vues, le soin minutieux des détails, la perfection des procédés administratifs [117] ; ce qu’on y trouve, c’est l’image de la force, un peu sauvage il est vrai, mais pleine de puissance ; de la vie, accompagnée d’accidents, mais aussi de mouvements et d’efforts.
[I-148]
J’admettrai, du reste, si l’on veut, que les villages et les comtés des États-Unis seraient plus utilement administrés par une autorité centrale placée loin d’eux, et qui leur resterait étrangère, que par des fonctionnaires pris dans leur sein. Je reconnaîtrai, si on l’exige, qu’il règnerait plus de sécurité en Amérique, qu’on y ferait un emploi plus sage et plus judicieux des ressources sociales, si l’administration de tout le pays était concentrée dans une seule main. Les avantages politiques que les Américains retirent du système de la décentralisation me le feraient encore préférer au système contraire.
Que m’importe, après tout, qu’il y ait une autorité toujours sur pied, qui veille à ce que mes plaisirs soient tranquilles, qui vole au-devant de mes pas pour détourner tous les dangers, sans que j’aie même le besoin d’y songer ; si cette autorité, en même temps qu’elle ôte ainsi les moindres épines sur mon passage, est maîtresse absolue de ma liberté et de ma vie ; si elle monopolise le mouvement et l’existence tel point qu’il faille que tout languisse autour d’elle quand elle languit, que tout dorme quand elle dort, que tout périsse si elle meurt ?
Il y a telles nations de l’Europe où l’habitant se considère comme une espèce de colon indifférent à la destinée du lieu qu’il habite. Les plus grands changements surviennent dans son pays sans son concours ; il ne sait même pas précisément ce qui s’est passé ; il s’en doute ; il a entendu raconter l’événement par hasard. Bien plus, la fortune de son village, la police de sa rue, le sort de son église et de son presbytère ne le touchent point ; ils pense que toutes ces choses [I-149] ne le regardent en aucune façon, et qu’elles appartiennent à un étranger puissant qu’on appelle le gouvernement. Pour lui, il jouit de ces biens comme un usufruitier, sans esprit de propriété et sans idées d’amélioration quelconque. Ce désintéressement de soi-même va si loin, que si sa propre sûreté ou celle de ses enfants est enfin compromise, au lieu de s’occuper d’éloigner le danger, il croise les bras pour attendre que la nation tout entière vienne à son aide. Cet homme, du reste, bien qu’il ait fait un sacrifice si complet de son libre arbitre, n’aime pas plus qu’un autre l’obéissance. Il se soumet, il est vrai, au bon plaisir d’un commis ; mais il se plaît à braver la loi comme un ennemi vaincu, dès que la force se retire. Aussi le voit-on sans cesse osciller entre la servitude et la licence.
Quand les nations sont arrivées à ce point, il faut qu’elles modifient leurs lois et leurs mœurs, ou qu’elles périssent, car la source des vertus publiques y est comme tarie : on y trouve encore des sujets, mais on n’y voit plus de citoyens.
Je dis que de pareilles nations sont préparées pour la conquête. Si elles ne disparaissent pas de la scène du monde, c’est qu’elles sont environnées de nations semblables ou inférieures à elles ; c’est qu’il reste encore dans leur sein une sorte d’instinct indéfinissable de la patrie, je ne sais quel orgueil irréfléchi du nom qu’elle porte, quel vague souvenir de leur gloire passée, qui, sans se rattacher précisément à rien, suffit pour leur imprimer au besoin une impulsion conservatrice.
On aurait tort de se rassurer en songeant que [I-150] certains peuples ont fait de prodigieux efforts pour défendre une patrie dans laquelle ils vivaient pour ainsi dire en étrangers. Qu’on y prenne bien garde, et on verra que la religion était presque toujours alors leur principal mobile.
La durée, la gloire, ou la prospérité de la nation étaient devenues pour eux des dogmes sacrés, et en défendant leur patrie, ils défendaient aussi cette cité sainte dans laquelle ils étaient tous citoyens.
Les populations turques n’ont jamais pris aucune part à la direction des affaires de la société ; elles ont cependant accompli d’immenses entreprises, tant qu’elles ont vu le triomphe de la religion de Mahomet dans les conquêtes des sultans. Aujourd’hui la religion s’en va ; le despotisme seul leur reste : elles tombent.
Montesquieu, en donnant au despotisme une force qui lui fût propre, lui a fait, je pense, un honneur qu’il ne méritait pas. Le despotisme, à lui tout seul, ne peut rien maintenir de durable. Quand on y regarde de près, on aperçoit que ce qui a fait long-temps prospérer les gouvernements absolus, c’est la religion et non la crainte.
On ne rencontrera jamais, quoi qu’on fasse, de véritable puissance parmi les hommes, que dans le concours libre des volontés. Or, il n’y a au monde que le patriotisme, ou la religion, qui puisse faire marcher pendant long-temps vers un même but l’universalité des citoyens.
Il ne dépend pas des lois de ranimer des croyances qui s’éteignent ; mais il dépend des lois d’intéresser les hommes aux destinées de leur pays. Il dépend des lois de réveiller et de diriger cet instinct vague de la [I-151] patrie qui n’abandonne jamais le cœur de l’homme, et, en le liant aux pensées, aux passions, aux habitudes de chaque jour, d’en faire un sentiment réfléchi et durable. Et qu’on ne dise point qu’il est trop tard pour le tenter ; les nations ne vieillissent point de la même manière que les hommes. Chaque génération qui naît dans leur sein est comme un peuple nouveau qui vient s’offrir à la main du législateur.
Ce que j’admire le plus en Amérique, ce ne sont pas les effets administratifs de la décentralisation, ce sont ses effets politiques. Aux États-Unis, la patrie se fait sentir partout. Elle est un objet de sollicitude depuis le village jusqu’à l’Union entière. L’habitant s’attache à chacun des intérêts de son pays comme aux siens mêmes. Il se glorifie de la gloire de la nation ; dans les succès qu’elle obtient, il croit reconnaître son propre ouvrage, et il s’en élève ; il se réjouit de la prospérité générale dont il profite. Il a pour sa patrie un sentiment analogue à celui qu’on éprouve pour sa famille, et c’est encore par une sorte d’égoïsme qu’il s’intéresse à l’État.
Souvent l’Européen ne voit dans le fonctionnaire public que la force ; l’Américain y voit le droit. On peut donc dire qu’en Amérique l’homme n’obéit jamais à l’homme, mais à la justice ou à la loi.
Aussi a-t-il conçu de lui-même une opinion souvent exagérée, mais presque toujours salutaire. Il se confie sans crainte à ses propres forces, qui lui paraissent suffire à tout. Un particulier conçoit la pensée d’une entreprise quelconque ; cette entreprise eût-elle un rapport direct avec le bien-être de la société, il ne lui vient pas l’idée de s’adresser à l’autorité publique pour [I-152] obtenir son concours. Il fait connaître son plan, s’offre à l’exécuter, appelle les forces individuelles au secours de la sienne, et lutte corps à corps contre tous les obstacles. Souvent, sans doute, il réussit moins bien que si l’État était à sa place mais, à la longue, le résultat général de toutes les entreprises individuelles dépasse de beaucoup ce que pourrait faire le gouvernement.
Comme l’autorité administrative est placée à côté des administrés, et les représente en quelque sorte eux-mêmes, elle n’excite ni jalousie ni haine. Comme ses moyens d’action sont bornés, chacun sent qu’il ne peut s’en reposer uniquement sur elle.
Lors donc que la puissance administrative intervient dans le cercle de ses attributions, elle ne se trouve point abandonnée à elle-même comme en Europe. On ne croit pas que les devoirs des particuliers aient cessé, parce que le représentant du public vient à agir. Chacun, au contraire, le guide, l’appuie et le soutient.
L’action des forces individuelles se joignant à l’action des forces sociales, on en arrive souvent à faire ce que l’administration la plus concentrée et la plus énergique serait hors d’état d’exécuter (M).
Je pourrais citer beaucoup de faits à l’appui de ce que j’avance, mais j’aime mieux n’en prendre qu’un seul, et choisir celui que je connais le mieux.
En Amérique, les moyens qui sont mis à la disposition de l’autorité pour découvrir les crimes et poursuivre les criminels, sont en petit nombre.
La police administrative n’existe pas ; les passeports sont inconnus. La police judiciaire, aux États-Unis, [I-153] ne saurait se comparer à la nôtre ; les agents du ministère public sont peu nombreux, ils n’ont pas toujours l’initiative des poursuites ; l’instruction est rapide et orale. Je doute cependant que, dans aucun pays, le crime échappe aussi rarement à la peine.
La raison en est que tout le monde se croit intéressé à fournir les preuves du délit et à saisir le délinquant.
J’ai vu, pendant mon séjour aux États-Unis, les habitants d’un comté ou un grand crime avait été commis, former spontanément des comités, dans le but de poursuivre le coupable et de le livrer aux tribunaux.
En Europe, le criminel est un infortuné qui combat pour dérober sa tête aux agents du pouvoir ; la population assiste en quelque sorte à la lutte. En Amérique, c’est un ennemi du genre humain, et il a contre lui l’humanité tout entière.
Je crois les institutions provinciales utiles à tous les peuples ; mais aucun ne me semble avoir un besoin plus réel de ces institutions que celui dont l’état social est démocratique.
Dans une aristocratie, on est toujours sûr de maintenir un certain ordre au sein de la liberté.
Les gouvernants ayant beaucoup à perdre, l’ordre est un d’un grand intérêt pour eux.
On peut dire également que dans une aristocratie le peuple est à l’abri des excès du despotisme, parce qu’il se trouve toujours des forces organisées prêtes à résister au despote.
Une démocratie sans institutions provinciales ne possède aucune garantie contre de pareils maux.
[I-154]
Comment faire supporter la liberté dans les grandes choses à une multitude qui n’a pas appris à s’en servir dans les petites ?
Comment résister à la tyrannie dans un pays où chaque individu est faible, et où les individus ne sont unis par aucun intérêt commun ?
Ceux qui craignent la licence, et ceux qui redoutent le pouvoir absolu, doivent donc également désirer le développement graduel des libertés provinciales.
Je suis convaincu, du reste, qu’il n’y a pas de nations plus exposées à tomber sous le joug de la centralisation administrative que celles dont l’état social est démocratique.
Plusieurs causes concourent à ce résultat, mais entre autres celle-ci :
La tendance permanente de ces nations est de concentrer toute la puissance gouvernementale dans les mains du seul pouvoir qui représente directement le peuple, parce que, au delà du peuple, on n’aperçoit plus que des individus égaux confondus dans une masse commune.
Or, quand un même pouvoir est déjà revêtu de tous les attributs du gouvernement, il lui est fort difficile de ne pas chercher à pénétrer dans les détails de l’administration, et il ne manque guère de trouver à la longue l’occasion de le faire. Nous en avons été témoins parmi nous.
Il y a eu, dans la révolution française, deux mouvements en sens contraire qu’il ne faut pas confondre : l’un favorable à la liberté, l’autre favorable au despotisme.
Dans l’ancienne monarchie, le roi faisait seul la loi. [I-155] au-dessous du pouvoir souverain se trouvaient placés quelques restes, à moitié détruits, d’institutions provinciales. Ces institutions provinciales étaient incohérentes, mal ordonnées, souvent absurdes. Dans les mains de l’aristocratie, elles avaient été quelquefois des instruments d’oppression.
La révolution s’est prononcée en même temps contre la royauté et contre les institutions provinciales. Elle a confondu dans une même haine tout ce qui l’avait précédé, le pouvoir absolu et ce qui pouvait tempérer ses rigueurs ; elle a été tout à la fois républicaine et centralisante.
Ce double caractère de la révolution française est un fait dont les amis du pouvoir absolu se sont emparés avec grand soin. Lorsque vous les voyez défendre la centralisation administrative, vous croyez qu’ils travaillent en faveur du despotisme ? Nullement, ils défendent une des grandes conquêtes de la révolution (K). De cette manière, on peut rester populaire et ennemi des droits du peuple ; serviteur caché de la tyrannie et amant avoué de la liberté.
J’ai visité les deux nations qui ont développé au plus haut degré le système des libertés provinciales, et j’ai écouté la voix des partis qui divisent ces nations.
En Amérique, j’ai trouvé des hommes qui aspiraient en secret à détruire les institutions démocratiques de leur pays. En Angleterre, j’en ai trouvé d’autres qui attaquaient hautement l’aristocratie ; je n’en ai pas rencontré un seul qui ne regardât la liberté provinciale comme un grand bien.
J’ai vu, dans ces deux pays, imputer les maux de l’État à une infinité de causes diverses, mais jamais à la liberté communale.
[I-156]
J’ai entendu les citoyens attribuer la grandeur ou la prospérité de leur patrie à une multitude de raisons ; mais je les ai entendus tous mettre en première ligne et classer à la tête de tous les autres avantages la liberté provinciale.
Croirai-je que des hommes naturellement si divisés qu’ils ne s’entendent ni sur les doctrines religieuses, ni sur les théories politiques, tombent d’accord sur un seul fait, celui dont ils peuvent le mieux juger, puisqu’il se passe chaque jour sous leurs yeux, et que ce fait soit erroné ?
Il n’y a que les peuples qui n’ont que peu ou point d’institutions provinciales qui nient leur utilité ; c’est-à-dire que ceux-là seuls qui ne connaissent point la chose en médisent.
[I-157]
CHAPITRE VI.↩
DU POUVOIR JUDICIAIRE AUX ÉTATS-UNIS ET DE SON ACTION SUR LA SOCIÉTÉ POLITIQUE.
Les Anglo-Américains ont conservé au pouvoir judiciaire tous les caractères qui le distinguent chez les autres peuples. — Cependant ils en ont fait un grand pouvoir poIitique. — Comment. — En quoi le système judiciaire des Anglo-Américains diffère de tous les autres. — Pourquoi les juges américains ont le droit de déclarer les lois inconstitutionnelles. — Comment les juges américains usent de ce droit. — Précautions prises par le législateur pour empêcher l’abus de ce droit.
J’ai cru devoir consacrer un chapitre à part au pouvoir judiciaire. Son importance politique est si grande qu’il m’a paru que ce serait la diminuer aux yeux des lecteurs que d’en parler en passant.
Il y a eu des confédérations ailleurs qu’en Amérique ; on a vu des républiques autre part que sur les rivages du Nouveau-Monde ; le système représentatif est adopté dans plusieurs États de l’Europe ; mais je ne pense pas que jusqu’à présent aucune nation du monde ait constitué le pouvoir judiciaire de la même manière que les Américains.
Ce qu’un étranger comprend avec le plus de peine, aux États-Unis, c’est l’organisation judiciaire. Il n’y a pour ainsi dire pas d’événement politique dans lequel [I-158] il n’entende invoquer l’autorité du juge ; et il en conclut naturellement qu’aux États-Unis le juge est une des premières puissances politiques. Lorsqu’il vient ensuite à examiner la constitution des tribunaux, il ne leur découvre, au premier abord, que des attributions et des habitudes judiciaires. À ses yeux, le magistrat ne semble jamais s’introduire dans les affaires publiques que par hasard ; mais ce même hasard revient tous les jours.
Lorsque le parlement de Paris faisait des remontrances et refusait d’enregistrer un édit ; lorsqu’il faisait citer lui-même à sa barre un fonctionnaire prévaricateur, ou apercevait à découvert l’action politique du pouvoir judiciaire. Mais rien de pareil ne se voit aux États-Unis.
Les Américains ont conservé au pouvoir judiciaire tous les caractères auxquels on a coutume de le reconnaître. Ils l’ont exactement renfermé dans le cercle où il a l’habitude de se mouvoir.
Le premier caractère de la puissance judiciaire, chez tous les peuples, est de servir d’arbitre. Pour qu’il y ait lieu à action de la part des tribunaux, il faut qu’il y ait contestation. Pour qu’il y ait juge, il faut qu’il y ait procès. Tant qu’une loi ne donne pas lieu à une contestation, le pouvoir judiciaire n’a donc point occasion de s’en occuper. Il existe, mais il ne la voit pas. Lorsqu’un juge, à propos d’un procès, attaque une loi relative à ce procès, il étend le cercle de ses attributions, mais il n’en sort pas, puisqu’il lui a fallu, en quelque sorte, juger la loi pour arriver à juger le procès. Lorsqu’il prononce sur une loi, sans partir d’un procès, il sort complétement [I-159] de sa sphère, et il pénètre dans celle du pouvoir législatif.
Le second caractère de la puissance judiciaire est de prononcer sur des cas particuliers et non sur des principes généraux. Qu’un juge, en tranchant une question particulière, détruise un principe général, par la certitude où l’on est que, chacune des conséquences de ce même principe étant frappée de la même manière, le principe devient stérile, il reste dans le cercle naturel de son action. Mais que le juge attaque directement le principe général, et le détruise sans avoir en vue un cas particulier, il sort du cercle où tous les peuples se sont accordés à l’enfermer. Il devient quelque chose de plus important, de plus utile peut-être qu’un magistrat, mais il cesse de représenter le pouvoir judiciaire.
Le troisième caractère de la puissance judiciaire est de ne pouvoir agir que quand on l’appelle, ou, suivant l’expression légale, quand elle est saisie. Ce caractère ne se rencontre point aussi généralement que les deux autres. Je crois cependant que, malgré les exceptions, on peut le considérer comme essentiel. De sa nature, le pouvoir judiciaire est sans action ; il faut le mettre en mouvement pour qu’il se remue. On lui dénonce un crime, et il punit le coupable ; on l’appelle à redresser une injustice, et il la redresse ; on lui soumet un acte, et il l’interprète ; mais il ne va pas de lui-même poursuivre les criminels, rechercher l’injustice et examiner les faits. Le pouvoir judiciaire ferait en quelque sorte violence à cette nature passive, s’il prenait de lui-même l’initiative et s’établissait en censeur des lois.
[I-160]
Les Américains ont conservé au pouvoir judiciaire ces trois caractères distinctifs. Le juge américain ne peut prononcer que lorsqu’il il y a litige. Il ne s’occupe jamais que d’un cas particulier ; et, pour agir, il doit toujours attendre qu’on l’ait saisi.
Le juge américain ressemble donc parfaitement aux magistrats des autres nations. Cependant il est revêtu d’un immense pouvoir politique.
D’où vient cela ? Il se meut dans le même cercle et se sert des mêmes moyens que les autres juges ; pourquoi possède-t-il une puissance que ces derniers n’ont pas ?
La cause en est dans ce seul fait : les Américains ont reconnu aux juges le droit de fonder leurs arrêts sur la constitution plutôt que sur les lois. En d’autres termes, ils leur ont permis de ne point appliquer les lois qui leur paraitraient inconstitutionnelles.
Je sais qu’un droit semblable a été quelquefois réclamé par les tribunaux d’autres pays ; mais il ne leur a jamais été concédé. En Amérique, il est reconnu par tous les pouvoirs ; on ne rencontre ni un parti, ni même un homme qui le conteste.
L’explication de ceci doit se trouver dans le principe même des constitutions américaines.
En France, la constitution est une œuvre immuable ou censée telle. Aucun pouvoir ne saurait y rien changer : telle est la théorie reçue (L).
En Angleterre, on reconnaît au parlement le droit de modifier la constitution. En Angleterre, la constitution peut donc changer sans cesse, ou plutôt elle n’existe point. Le parlement, en même temps qu’il est corps législatif, est corps constituant (M).
[I-161]
En Amérique, les théories politiques sont plus simples et plus rationnelles.
Une constitution américaine n’est point censée immuable comme en France ; elle ne saurait être modifiée par les pouvoirs ordinaires de la société, comme en Angleterre. Elle forme une œuvre à part, qui, représentant la volonté de tout le peuple, oblige les législateurs comme les simples citoyens, mais qui peut être changée par la volonté du peuple, suivant des formes qu’on a établies, et dans des cas qu’on a prévus.
En Amérique, la constitution peut donc varier ; mais, tant qu’elle existe, elle est l’origine de tous les pouvoirs. La force prédominante est en elle seule.
Il est facile de voir en quoi ces différences doivent influer sur la position et sur les droits du corps judiciaire dans les trois pays que j’ai cités.
Si, en France, les tribunaux pouvaient désobéir aux lois, sur le fondement qu’ils les trouvent inconstitutionnelles, le pouvoir constituant serait réellement dans leurs mains, puisque seuls ils auraient le droit d’interpréter une constitution dont nul ne pourrait changer les termes. Ils se mettraient donc à la place de la nation et domineraient la société, autant du moins que la faiblesse inhérente au pouvoir judiciaire leur permettrait de le faire.
Je sais qu’en refusant aux juges le droit de déclarer les lois inconstitutionnelles, nous donnons indirectement au corps législatif le pouvoir de changer la constitution, puisqu’il ne rencontre plus de barrière légale qui l’arrête. Mais mieux vaut encore accorder le pouvoir de changer la constitution du peuple à [I-162] des hommes qui représentent imparfaitement les volontés du peuple, qu’à d’autres qui ne représentent qu’eux-mêmes.
Il serait bien plus déraisonnable encore de donner aux juges anglais le droit de résister aux volontés du corps législatif, puisque le parlement, qui fait la loi, fait également la constitution, et que, par conséquent, on ne peut, en aucun cas, appeler une loi inconstitutionnelle quand elle émane des trois pouvoirs.
Aucun de ces deux raisonnements n’est applicable à l’Amérique.
Aux, États-Unis, la constitution domine les législateurs comme les simples citoyens. Elle est donc la première des lois, et ne saurait être modifiée par une loi. Il est donc juste que les tribunaux obéissent à la constitution, préférablement à toutes les lois. Ceci tient à l’essence même du pouvoir judiciaire : choisir entre les dispositions légales celles qui l’enchaînent le plus étroitement, est, en quelque sorte, le droit naturel du magistrat.
En France, la constitution est également la première des lois, et les juges ont un droit égal à la prendre pour base de leurs arrêts ; mais, en exerçant ce droit, ils ne pourraient manquer d’empiéter sur un autre plus sacré encore que le leur : celui de la société au non de laquelle ils agissent. Ici la raison ordinaire doit céder devant la raison d’État.
En Amérique, ou la nation peut toujours, en changeant sa constitution, réduire les magistrats à l’obéissance, un semblable danger n’est pas à craindre. Sur ce point, la politique et la logique sont donc [I-163] d’accord, et le peuple ainsi que le juge y conservent également leurs privilèges.
Lorsqu’on invoque, devant les tribunaux des États-Unis ; une loi que le juge estime contraire à la constitution, il peut donc refuser de l’appliquer. Ce pouvoir est le seul qui soit particulier au magistrat américain, mais une grande influence politique en découle.
Il est, en effet, bien peu de lois qui soient de nature à échapper pendant long-temps à l’analyse judiciaire car il en est bien peu qui ne blessent un intérêt individuel, et que des plaideurs ne puissent ou ne doivent invoquer devant les tribunaux.
Or, du jour où le juge refuse d’appliquer une loi dans un procès ; elle perd à l’instant une partie de sa force morale. Ceux qu’elle a lésés sont alors avertis qu’il existe un moyen de se soustraire à l’obligation de lui obéir : les procès se multiplient et elle tombe dans l’impuissance. Il arrive alors l’une de ces deux choses : le peuple change sa constitution ou la législature rapporte sa loi.
Les Américains ont donc confié à leurs tribunaux un immense pouvoir politique ; mais en les obligeant à n’attaquer les lois que par des moyens judiciaires, ils ont beaucoup diminué les dangers de ce pouvoir.
Si le juge avait pu attaquer les lois d’une façon théorique en générale ; s’il avait pu prendre l’initiative et censurer le législateur, il fût entré avec éclat sur la scène politique ; devenir le champion ou l’adversaire d’un parti, il eût appelé toutes les passions qui divisent le pays à prendre part à la lutte. Mais quand le juge attaque une loi dans un débat obscur et sur une application particulière, il dérobe en partie [I-164] l’importance de l’attaque aux regards du public. Son arrêt n’a pour but que de frapper un intérêt individuel ; la loi ne se trouve blessée que par hasard.
D’ailleurs, la loi ainsi censurée n’est pas détruite : sa force morale est diminuée, mais son effet matériel n’est point suspendu. Ce n’est que peu à peu, et sous les coups répétés de la jurisprudence, qu’enfin elle succombe.
De plus, on comprend sans peine qu’en chargeant l’intérêt particulier de provoquer la censure des lois, en liant intimement le procès fait à la loi au procès fait à un homme, on s’assure que la législation ne sera pas légèrement attaquée. Dans ce système, elle n’est plus exposée aux agressions journalières des partis. En signalant les fautes du législateur, on obéit à un besoin réel : on part d’un fait positif et appréciable, puisqu’il doit servir de base à un procès.
Je ne sais si cette manière d’agir des tribunaux américains, en même temps qu’elle est la plus favorable à l’ordre public, n’est pas aussi la plus favorable à la liberté.
Si le juge ne pouvait attaquer les législateurs que de front, il y a des temps où il craindrait de le faire ; il en est d’autres où l’esprit de parti le pousserait chaque jour à l’oser. Ainsi il arriverait que les lois seraient attaquées quand le pouvoir dont elles émanent serait faible, et qu’on s’y soumettrait sans murmurer quand il serait fort ; c’est-à-dire que souvent on attaquerait les lois lorsqu’il serait le plus utile de les respecter, et qu’on les respecterait quand il deviendrait facile d’opprimer en leur nom.
Mais le juge américain est amené malgré lui sur le [I-165] terrain de la politique. Il ne juge la loi que parce qu’il a à juger un procès, et il ne peut s’empêcher de juger le procès. La question politique qu’il doit résoudre se rattache à l’intérêt des plaideurs, et il ne saurait refuser de la trancher sans faire un déni de justice. C’est en remplissant les devoirs étroits imposés à la profession du magistrat, qu’il fait l’acte du citoyen. Il est vrai que, de cette manière, la censure judiciaire, exercée par les tribunaux sur la législation, ne peut s’étendre sans distinction à toutes les lois, car il en est qui ne peuvent jamais donner lieu à cette sorte de contestation nettement formulée qu’on nomme un procès. Et lorsqu’une pareille contestation est possible, on peut encore concevoir qu’il ne se rencontre personne qui veuille en saisir les tribunaux.
Les Américains ont souvent senti cet inconvénient, mais ils ont laissé le remède incomplet, de peur de lui donner, dans tous les cas, une efficacité dangereuse.
Resserré dans ses limites, le pouvoir accordé aux tribunaux américains de prononcer sur l’inconstitutionnalité des lois, forme encore une des plus puissantes barrières qu’on ait jamais élevées contre la tyrannie des assemblées politiques.
[I-166]
AUTRES POUVOIRS ACCORDÉS AUX JUGES AMÉRICAINS.
Aux États-Unis tous les citoyens ont le droit d’accuser les fonctionnaires publics devant les tribunaux ordinaires. — Comment ils usent de ce droit. — Art. 75 de la constitution française de l’an VIII. — Les Américains et les Anglais ne peuvent comprendre le sens de cet article.
Je ne sais si j’ai besoin de dire que chez un peuple libre, comme les Américains, tous les citoyens ont le droit d’accuser les fonctionnaires publics devant les juges ordinaires, et que tous les juges ont le droit de condamner les fonctionnaires publics ; tant la chose est naturelle.
Ce n’est pas accorder un privilège particulier aux tribunaux que de leur permettre de punir les agents du pouvoir exécutif, quand ils violent la loi. C’est leur enlever le droit naturel que de le leur défendre.
Il ne m’a pas paru qu’aux États-Unis, en rendant tous les fonctionnaires responsables des tribunaux, on eût affaibli les ressorts du gouvernement.
Il m’a semblé, au contraire, que les Américains, en agissant ainsi, avaient augmenté le respect qu’on doit aux gouvernants, ceux-ci prenant beaucoup plus de soin d’échapper à la critique.
Je n’ai point observé, non plus, qu’aux États-Unis on intentât beaucoup de procès politiques, et je me l’explique sans peine. Un procès est toujours, quelle que soit sa nature, une entreprise difficile et coûteuse. Il est aisé d’accuser un homme public dans les journaux, mais ce n’est pas sans de graves motifs qu’on se décide à le citer devant la justice. Pour poursuivre juridiquement un fonctionnaire, il faut [I-167] donc avoir un juste motif de plainte ; et les fonctionnaires ne fournissent guère un semblable motif quand ils craignent d’être poursuivis.
Ceci ne tient à pas la forme républicaine qu’ont adoptée les Américains, car la même expérience peut se faire tous les jours en Angleterre.
Ces deux peuples n’ont pas cru avoir assuré leur indépendance, en permettant la mise en jugement des principaux agents du pouvoir. Ils ont pensé que c’était bien plutôt par de petits procès, mis chaque jour à la portée des moindres citoyens, qu’on parvenait à garantir la liberté, que par de grandes procédures auxquelles on n’a jamais recours ou qu’on emploie trop tard.
Dans le moyen-âge, où il était très difficile d’atteindre les criminels, quand les juges en saisissaient quelques-uns, il leur arrivait souvent d’infliger à ces malheureux d’affreux supplices ; ce qui ne diminuait pas le nombre des coupables. On a découvert depuis qu’en rendant la justice tout à la fois plus sûre et plus douce, on la rendait en même temps plus efficace.
Les Américains et les Anglais pensent qu’il faut traiter l’arbitraire et la tyrannie comme le vol : faciliter la poursuite et adoucir la peine.
En l’an VIII de la république française, il parut une constitution dont l’art. 75 était ainsi conçu : « Les agents du gouvernement, autres que les ministres, ne peuvent être poursuivis, pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu’en vertu d’une décision du Conseil d’État ; en ce cas, la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires. »
[I-168]
La constitution de l’an VIII passa, mais non cet article, qui resta après elle ; et on l’oppose, chaque jour encore, aux justes réclamations des citoyens.
J’ai souvent essayé de faire comprendre le sens de cet art. 75 à des Américains ou à des Anglais, et il m’a toujours été très difficile d’y parvenir.
Ce qu’ils apercevaient d’abord, c’est que le Conseil d’État, en France, étant un grand tribunal fixé au centre du royaume, il y avait une sorte de tyrannie à renvoyer préliminairement devant lui tous les plaignants.
Mais quand je cherchais à leur faire comprendre que le Conseil d’État n’était point un corps judiciaire, dans le sens ordinaire du mot, mais un corps administratif, dont les membres dépendaient du roi ; de telle sorte que le roi, après avoir souverainement commandé à l’un de ses serviteurs, appelé préfet, de commettre une iniquité, pouvait commander souverainement à un autre de ses serviteurs, appelé conseiller d’État, d’empêcher qu’on ne fit punir le premier ; quand je leur montrais le citoyen, lésé par l’ordre du prince, réduit à demander au prince lui-même l’autorisation d’obtenir justice, ils refusaient de croire à de semblables énormités, et m’accusaient de mensonge et d’ignorance.
Il arrivait souvent, dans l’ancienne monarchie, que le parlement décrétait de prise de corps le fonctionnaire public qui se rendait coupable d’un délit. Quelquefois l’autorité royale, intervenant, faisait annuler la procédure. Le despotisme se montrait alors à découvert, et, en obéissant, on ne se soumettait qu’à la force.
[I-169]
Nous avons donc bien reculé du point où étaient arrivés nos pères ; car nous laissons faire, sous couleur de justice, et consacrer au nom de la loi, ce que la violence seule leur imposait.
[I-170]
CHAPITRE VII.↩
DU JUGEMENT POLITIQUE AUX ÉTATS-UNIS.
Ce que l’auteur entend par jugement politique. — Comment on comprent le jugement politique en France, en Angleterre, aux États-Unis. — En Amérique le juge politique ne s’occupe que des fonctionnaires publics. — Il prononce des destitutions plutôt que des peines. — Le jugement politique, moyen habituel du gouvernement. — Le jugement politique, tel qu’on l’entend aux États-Unis, est, malgré sa douceur, et peut-être à cause de sa douceur, une arme très puissante dans les mains de la majorité.
J’entends par jugement politique, l’arrêt que prononce un corps politique momentanément revêtu du droit de juger.
Dans les gouvernements absolus, il est inutile de donner aux jugements des formes extraordinaires : le prince, au nom duquel on poursuit l’accusé, étant maître des tribunaux comme de tout le reste, n’a pas besoin de chercher de garantie ailleurs que dans l’idée qu’on puisse concevoir est qu’on ne garde même pas les apparences extérieures de la justice et qu’on déshonore son autorité en voulant l’affermir.
Mais dans la plupart des pays libres, où la [I-171] majorité ne peut jamais agir sur les tribunaux, comme le ferait un prince absolu, il est quelquefois arrivé de placer momentanément la puissance judiciaire entre les mains des représentants mêmes de la société. On a mieux aimé y confondre ainsi momentanément les pouvoirs, que d’y violer le principe nécessaire de l’unité du gouvernement. L’Angleterre, la France et les États-Unis ont introduit le jugement politique dans leurs lois : il est curieux d’examiner le parti que ces trois grands peuples en ont tiré.
En Angleterre et en France, la chambre des pairs forme la haute cour criminelle [118] de la nation. Elle ne juge pas tous les délits politiques, mais elle peut les juger tous.
À côté de la chambre des pairs se trouve un autre pouvoir politique, revêtu du droit d’accuser. La seule différence qui existe, sur ce point, entre les deux pays, est celle-ci : en Angleterre, les députés peuvent accuser qui bon leur plaît devant les pairs ; tandis qu’en France ils ne peuvent poursuivre de cette manière que les ministres du roi.
Du reste, dans les deux pays, la chambre des pairs trouve à sa disposition toutes les lois pénales pour en frapper les délinquants.
Aux États-Unis, comme en Europe, l’une des deux branches de la législature est revêtue du droit d’accuser, et l’autre du droit de juger. Les représentants dénoncent le coupable, le sénat le punit.
Mais le sénat ne peut être saisi que par les représentants, et les représentants ne peuvent accuser [I-172] devant lui que des fonctionnaires publics. Ainsi le sénat a une compétence plus restreinte que la cour des pairs de France, et les représentants ont un droit d’accusation plus étendu que nos députés.
Mais voici la plus grande différence qui existe entre l’Amérique et l’Europe : en Europe, les tribunaux politiques peuvent appliquer toutes les dispositions du Code pénal ; en Amérique, lorsqu’ils ont enlevé à un coupable le caractère public dont il était revêtu, et l’ont déclaré indigne d’occuper aucunes fonctions politiques à l’avenir, leur droit est épuisé, et la tâche des tribunaux ordinaires commence.
Je suppose que le président des États-Unis ait commis un crime de haute trahison.
La chambre des représentants l’accuse, les sénateurs prononcent sa déchéance. Il paraît ensuite devant un jury, qui seul peut lui enlever la liberté ou la vie.
Ceci achève de jeter une vive lumière sur le sujet qui nous occupe.
En introduisant le jugement politique dans leurs lois, les Européens ont voulu atteindre les grands criminels, quels que fussent leur naissance, leur rang, ou leur pouvoir dans l’État. Pour y parvenir, ils ont réuni momentanément, dans le sein d’un grand corps politique, toutes les prérogatives des tribunaux.
Le législateur s’est transformé alors en magistrat ; il a pu établir le crime, le classer et le punir. En lui donnant les droits de juge, la loi lui en a imposé toutes les obligations, et l’a lié à l’observation de toutes les formes de justice.
Lorsqu’un tribunal politique, français ou anglais, [I-173] a pour justiciable un fonctionnaire public, et qu’il prononce contre lui une condamnation, il lui enlève par le fait ses fonctions, et peut le déclarer indigne d’en occuper aucune à l’avenir mais ici la destitution et l’interdiction politiques sont une conséquence de l’arrêt et non l’arrêt lui-même.
En Europe, le jugement politique est plutôt un acte judiciaire qu’une mesure administrative.
Le contraire se voit aux États-Unis, et il est facile de se convaincre que le jugement politique y est bien plutôt une mesure administrative qu’un acte judiciaire.
Il est vrai que l’arrêt du sénat est judiciaire par la forme ; pour le rendre, les sénateurs sont obligés de se conformer à la solennité et aux usages de la procédure. Il est encore judiciaire par les motifs sur lesquels il se fonde ; le sénat est en général obligé de prendre pour base de sa décision un délit du droit commun. Mais il est administratif par son objet.
Si le but principal du législateur eût été réellement d’armer un corps politique d’un grand pouvoir judiciaire, il n’aurait pas resserré son action dans le cercle des fonctionnaires publics, car les plus dangereux ennemis de l’État peuvent n’être revêtus d’aucune fonction : ceci est vrai, surtout dans les républiques, où l’on est souvent d’autant plus fort qu’on n’exerce légalement aucun pouvoir.
Si le législateur américain avait voulu donner à la société elle-même le droit de prévenir les grands crimes, à la manière du juge, par la crainte du châtiment, il aurait mis à la disposition des tribunaux [I-174] politiques toutes les ressources du Code pénal ; mais il ne leur a fourni qu’une arme incomplète, et qui ne saurait atteindre les plus dangereux d’entre les criminels. Car peu importe un jugement d’interdiction politique à celui qui veut renverser les lois elles-mêmes.
Le but principal du jugement politique, aux États-Unis, est donc de retirer le pouvoir à celui qui en fait un mauvais usage, et d’empêcher que ce même citoyen n’en soit revêtu à l’avenir. C’est, comme on le voit, un acte administratif auquel on a donné la solennité d’un arrêt.
En cette matière, les Américains ont donc créé quelque chose de mixte. Ils ont donné à la destitution administrative toutes les garanties du jugement politique, et ils ont ôté au jugement politique ses plus grandes rigueurs.
Ce point fixé, tout s’enchaîne ; on découvre alors pourquoi les constitutions américaines soumettent tous les fonctionnaires civils à la juridiction du sénat, et en exemptent les militaires, dont les crimes sont cependant plus à redouter. Dans l’ordre civil, les Américains n’ont pour ainsi dire pas de fonctionnaires révocables : les uns sont inamovibles, les autres tiennent leurs droits d’un mandat qu’on ne peut abroger. Pour leur ôter le pouvoir, il faut donc les juger tous. Mais les militaires dépendent du chef de l’État, qui lui-même est un fonctionnaire civil. En atteignant le chef de l’État, on les frappe tous du même coup [119] .
[I-175]
Maintenant, si on en vient à comparer le système européen et le système américain, dans les effets que chacun produit ou peut produire, on découvre des différences non moins sensibles.
En France et en Angleterre, on considère le jugement politique comme une arme extraordinaire, dont la société ne doit se servir que pour se sauver dans les moments de grands périls.
On ne saurait nier que le jugement politique, tel qu’on l’entend en Europe, ne viole le principe conservateur de la division des pouvoirs, et qu’il ne menace sans cesse la liberté et la vie des hommes.
Le jugement politique, aux États-Unis, ne porte qu’une atteinte indirecte au principe de la division des pouvoirs ; il ne menace point l’existence des citoyens ; il ne plane pas, comme en Europe, sur toutes les têtes, puisqu’il ne frappe que ceux qui, en acceptant des fonctions publiques, se sont soumis d’avance à ses rigueurs.
Il est tout à la fois moins redoutable et moins efficace.
Aussi les législateurs des États-Unis ne l’ont-ils pas considéré comme un remède extrême aux grands maux de la société, mais comme un moyen habituel de gouvernement.
Sous ce point de vue, il exerce peut-être plus d’influence réelle sur le corps social en Amérique qu’en Europe. Il ne faut pas en effet se laisser prendre à l’apparente douceur de la législation américaine, dans ce qui a rapport aux jugements politiques. On doit remarquer, en premier lieu, qu’aux États-Unis le tribunal qui prononce ces jugements est composé [I-176] des mêmes éléments et soumis aux mêmes influences que le corps chargé d’accuser, ce qui donne une impulsion presque irrésistible aux passions vindicatives des partis. Si les juges politiques, aux États-Unis, ne peuvent prononcer des peines aussi sévères que les juges politiques d’Europe, il y a donc moins de chances d’être acquitté par eux. La condamnation est moins redoutable et plus certaine.
Les Européens, en établissant les tribunaux politiques, ont eu pour principal objet de punir les coupables ; les Américains, de leur enlever le pouvoir. Le jugement politique, aux États-Unis, est en quelque façon une mesure préventive. On ne doit donc pas y enchaîner le juge dans des définitions criminelles bien exactes.
Rien de plus effrayant que le vague des lois américaines, quand elles définissent les crimes politiques proprement dits. « Les crimes qui motiveront la condamnation du président (dit la constitution des États-Unis, section 4, art. Ier) sont la haute trahison, la corruption, ou autres grands crimes et délits. » La plupart des constitutions d’États sont bien plus obscures encore.
« Les fonctionnaires publics, dit la constitution du Massachusetts, seront condamnés pour la conduite coupable qu’ils auront tenue et pour leur mauvaise administration [120] . Tous les fonctionnaires qui auront mis l’État en danger, par mauvaise administration, corruption, ou autres délits, dit la constitution de Virginie, pourront être accusés par la [I-177] chambre des députés. » Il y a des constitutions qui ne spécifient aucun crime, afin de laisser peser sur les fonctionnaires publics une responsabilité illimitée [121] .
Mais ce qui rend, en cette matière, les lois américaines si redoutables, naît, j’oserai le dire, de leur douceur même.
Nous avons vu qu’en Europe la destitution d’un fonctionnaire, et son interdiction politique, étaient une des conséquences de la peine, et qu’en Amérique c’était la peine même. Il en résulte ceci : en Europe, les tribunaux politiques sont revêtus de droits terribles dont quelquefois ils ne savent comment user et il leur arrive de ne pas punir, de peur de punir trop. Mais, en Amérique, on ne recule pas devant une peine qui ne fait pas gémir l’humanité : condamner un ennemi politique à mort, pour lui enlever le pouvoir, est au yeux de tous un horrible assassinat ; déclarer son adversaire indigne de posséder ce même pouvoir, et le lui ôter, en lui laissant la liberté et la vie, peut paraître le résultat honnête de la lutte.
Or, ce jugement si facile à prononcer n’en est pas moins le comble du malheur pour le commun de ceux auxquels il s’applique. Les grands criminels braveront sans doute ses vaines rigueurs les hommes ordinaires verront en lui un arrêt qui détruit leur position, entache leur honneur, et qui les condamne à une honteuse oisiveté pire que la mort.
Le jugement politique, aux États-Unis, exerce donc sur la marche de la société une influence [I-178] d’autant plus grande qu’elle semble moins redoutable. Il n’agit pas directement sur les gouvernés, mais il rend la majorité entièrement maîtresse ce ceux qui gouvernent il ne donne point à la législature un immense pouvoir qu’elle ne pourrait exercer que dans un jour de crise il lui laisse prendre une puissance modérée et régulière, dont elle peut user tous les jours. Si la force est moins grande, d’un autre côté l’emploi en est plus commode et l’abus facile.
En empêchant les tribunaux politiques de prononcer des peines judiciaires, les Américains me semblent donc avoir prévenu les conséquences les plus terribles de la tyrannie législative, plutôt que la tyrannie elle-même. Et je ne sais si, à tout prendre, le jugement politique, tel qu’on l’entend aux États-Unis, n’est point l’arme la plus formidable qu’on ait jamais remise aux mains de la majorité.
Lorsque les républiques américaines commenceront à dégénérer, je crois qu’on pourra aisément le reconnaître : il suffira de voir si le nombre de jugement politiques augmente (N).
[I-179]
CHAPITRE VIII.↩
DE LA CONSTITUTION FÉDÉRALE.
J’ai considéré jusqu’à présent chaque État comme formant un tout complet, et j’ai montré les différents ressorts que le peuple y fait mouvoir, ainsi que les moyens d’action dont il se sert. Mais tous ces États que j’ai envisagés comme indépendants, sont pourtant forcés d’obéir, en certains cas, à une autorité supérieure, qui est celle de l’Union. Le temps est venu d’examiner la part de souveraineté qui a été concédée à l’Union, et de jeter un coup d’œil rapide sur la constitution fédérale [122] .
HISTORIQUE DE LA CONSTITUTION FÉDÉRALE.
Origine de la première Union. — Sa faiblesse. — Le congrès en appelle au pouvoir constituant. — Intervalle de deux années qui s’écoule entre ce moment et celui ou la nouvelle constitution est promulguée.
Les treize colonies qui secouèrent simultanément le joug de l’Angleterre à la fin du siècle dernier [I-180] avaient, comme je l’avais déjà dit, la même religion, la même langue, les mêmes mœurs, presque les mêmes lois ; elles luttaient contre un ennemi commun ; elles devaient donc avoir de fortes raisons pour s’unir intimement les unes aux autres, et s’absorber dans une seule et même nation.
Mais chacune d’elles, ayant toujours eu une existence à part et un gouvernement à sa portée, s’était créé des intérêts ainsi que des usages particuliers, et répugnait à une union solide et complète qui eut fait disparaître son importance individuelle dans une importance commune. De là, deux tendances opposées : l’une qui portait les Anglo-Américains à s’unir, l’autre qui les portait à se diviser.
Tant que dura la guerre avec la mère-patrie, la nécessité fit prévaloir le principe de l’union. Et quoique les lois qui constituaient cette union fussent défectueuses le lien commun subsista en dépit d’elles [123] .
Mais dès que la paix fut conclue, les vices de la législation se montrèrent à découvert : l’État parut se dissoudre tout-à-coup. Chaque colonie, devenue une république indépendante, s’empara de la souveraineté entière. Le gouvernement fédéral, que sa constitution même condamnait à la faiblesse, et que le sentiment du danger public ne soutenait plus, vit son pavillon abandonné aux outrages des grands peuples de l’Europe, tandis qu’il ne pouvait trouver assez de [I-181] ressource pour tenir tête aux nations indiennes, et payer l’intérêt des dettes contractées pendant la guerre de l’Indépendance. Près de périr, il déclara lui-même officiellement son impuissance et en appela au pouvoir constituant [124] .
Si jamais l’Amérique sut s’élever pour quelques instants à ce haut degré de gloire ou l’imagination orgueilleuse de ses habitants voudrait sans cesse nous la montrer, ce fut dans ce moment suprême, où le pouvoir national venait en quelque sorte d’abdiquer l’empire.
Qu’un peuple lutte avec énergie pour conquérir son indépendance, c’est un spectacle que tous les siècles ont pu fournir. On a beaucoup exagéré, d’ailleurs, les efforts que firent les Américains pour se soustraire au joug des Anglais. Séparés par 1,300 lieues de mer de leurs ennemis, secourus par un puissant allié, les États-Unis durent la victoire à leur position bien plus encore qu’à la valeur de leurs armées, ou au patriotisme de leurs citoyens. Qui oserait comparer la guerre d’Amérique aux guerres de la révolution française, et les efforts des Américains aux nôtres, alors que la France, en butte aux attaques de l’Europe entière, sans argent, sans crédit, sans alliés, jetait le vingtième de sa population au-devant de ses ennemis, étouffant d’une main l’incendie qui dévorait ses entrailles, et de l’autre promenant la torche autour d’elle ? Mais ce qui est nouveau dans l’histoire des sociétés, c’est de voir un grand peuple, averti par ses législateurs que les rouages du gouvernement [I-182] s’arrêtent, tourner sans précipitation et sans crainte ses regards sur lui-même, sonder la profondeur du mal, se contenir pendant deux ans entiers, afin d’en découvrir à loisir le remède, et, lorsque ce remède est indiqué, s’y soumettre volontairement sans qu’il en coûte une larme ni une goutte de sang à l’humanité.
Lorsque l’insuffisance de la première constitution fédérale se fit sentir, l’effervescence des passions politiques qu’avait fait naître la révolution était en partie calmée, et tous les grands hommes qu’elle avait créés existaient encore. Ce fut un double bonheur pour l’Amérique. L’assemblée peu nombreuse [125] , qui se chargea de rédiger la seconde constitution, renfermait les plus beaux esprits et les plus nobles caractères qui eussent jamais paru dans le Nouveau-Monde. Georges Washington la présidait.
Cette commission nationale, après de longues et mûres délibérations, offrit enfin à l’adoption du peuple le corps de lois organiques qui régit encore de nos jours l’Union. Tous les États l’adoptèrent successivement [126] . Le nouveau gouvernement fédéral entra en fonctions en 1789, après deux ans d’interrègne. La révolution d’Amérique finit donc précisément au moment où commençait la nôtre.
[I-183]
TABLEAU SOMMAIRE DE LA CONSTITUTION FÉDÉRALE.
Division des pouvoirs entre la souveraineté fédérale et celle des États. — Le gouvernement des États reste le droit commun ; — le gouvernement fédéral, l’exception.
Une première difficulté dut se présenter à l’esprit des Américains. Il s’agissait de partager la souveraineté de telle sorte que les différents États qui formaient l’Union continuassent à se gouverner eux-mêmes dans tout ce qui ne regardait que leur prospérité intérieure, sans que la nation entière, représentée par l’Union, cessât de faire un corps et de pourvoir à tous ses besoins généraux. Question complexe et difficile à résoudre.
Il était impossible de fixer d’avance d’une manière exacte et complète la part de puissance qui devait revenir à chacun des deux gouvernements entre lesquels la souveraineté allait se partager. Qui pourrait prévoir à l’avance tous les détails de la vie d’un peuple ?
Les devoirs et les droits du gouvernement fédéral étaient simples et assez faciles à définir, parce que l’Union avait été formée dans le but de répondre à quelques grands besoins généraux. Les devoirs et les droits du gouvernement des États étaient, au contraire, multiples et compliqués, parce que ce gouvernement pénétrait dans tous les détails de la vie sociale.
On définit donc avec soin les attributions du gouvernement fédéral, et l’on déclara que tout ce qui n’était pas compris dans la définition rentrait dans les attributions du gouvernement des États. Ainsi le [I-184] gouvernement des États resta le droit commun le gouvernement fédéral fut l’exception [127] .
Mais comme ou prévoyait que, dans la pratique, des questions pourrait s’élever relativement aux limites exactes de ce gouvernement exceptionnel, et qu’il eût été dangereux d’abandonner la solution de ces questions aux tribunaux ordinaires institués dans les différents États par ces États eux-mêmes, on créa une haute-cour [128] fédérale, tribunal unique, dont l’une des attributions fut de maintenir entre les deux gouvernements rivaux la division des pouvoirs telle que la constitution l’avait établie [129] .
[I-185]
ATTRIBUTIONS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL.
Pouvoir accordé au gouvernement fédéral de faire la paix, la guerre, d’établir des taxes générales. — Objet de politique intérieure dont il peut s’occuper. — Le gouvernement de l’Union, plus centralisé sur quelques points que ne l’était le gouvernement royal sous l’ancienne monarchie française.
Les peuples entre eux ne sont que des individus. C’est surtout pour paraître avec avantage vis-à-vis des étrangers qu’une nation à besoin d’un gouvernement unique.
À l’Union fut donc accordé le droit exclusif de faire la paix et la guerre ; de conclure les traités de commerce ; de lever des armées, d’équiper des flottes [130] .
La nécessité d’un gouvernement national ne se fait pas aussi impérieusement sentir dans la direction des affaires intérieures de la société.
Toutefois, il est certains intérêts généraux auxquels une autorité générale peut seule utilement pourvoir.
À l’Union fut abandonné le droit de régler tout ce qui a rapport à la valeur de l’argent ; on la chargea du service des postes ; on lui donna le droit d’ouvrir les [I-186] grandes communications qui devaient unir les diverses parties du territoire [131] .
En général, le gouvernement des différents États fut considéré comme libre dans sa sphère ; cependant il pouvait abuser de cette indépendance, et compromettre, par d’imprudentes mesures, la sûreté de l’Union entière ; pour ces cas rares et définis d’avance, on permit au gouvernement fédéral d’intervenir dans les affaires intérieures des États [132] . C’est ainsi que, tout en reconnaissant à chacune des républiques confédérées le pouvoir de modifier et de changer sa législation, on lui défendit cependant de faire des lois rétroactives, et de créer dans son sein un corps de nobles [133] .
Enfin, comme il fallait que le gouvernement fédéral pût remplir les obligations qui lui étaient imposées, on lui donna le droit illimité de lever des taxes [134] .
Lorsqu’on fait attention au partage des pouvoirs tel que la constitution fédérale l’a établi ; quand, d’une part, on examine la portion de souveraineté que se sont réservée les États particuliers, et de l’autre la part de puissance que l’Union à prise, on [I-187] découvre aisément que les législateurs fédéraux s’étaient formé des idées très nettes et très justes de ce que j’ai nommé précédemment la centralisation gouvernementale.
Non seulement les États-Unis forment une république, mais encore une confédération. Cependant l’autorité nationale y est, à quelques égards, plus centralisée qu’elle ne l’était à la même époque dans plusieurs des monarchies absolues de l’Europe. Je n’en citerai que deux exemples.
La France comptait treize cours souveraines, qui le plus souvent avaient le droit d’interpréter la loi sans appel. Elle possédait, de plus, certaines provinces appelées pays d’États, qui, après que l’autorité souveraine, chargée de représenter la nation, avait ordonné la levée d’un impôt, pouvaient refuser leur concours.
L’Union n’a qu’un seul tribunal pour interpréter la loi, comme une seule législature pour la faire ; l’impôt voté par les représentants de la nation oblige tous les citoyens. L’Union est donc plus centralisée sur ces deux points essentiels que ne l’était la monarchie française ; cependant, l’Union n’est qu’un assemblage de républiques confédérées.
En Espagne, certaines provinces avaient le pouvoir d’établir un système de douanes qui leur fût propre, pouvoir qui tient, par son essence même, à la souveraineté nationale.
En Amérique, le congrès seul a droit de régler les rapports commerciaux des États entre eux. Le gouvernement de la confédération est donc plus centralisé sur ce point que celui du royaume d’Espagne.
[I-188]
Il est vrai qu’en France et en Espagne le pouvoir royal étant toujours en état d’exécuter au besoin, par la force, ce que la constitution du royaume lui refusait le droit de faire, on en arrivait, en définitive, au même point. Mais je parle ici de la théorie.
POUVOIRS FÉDÉRAUX.
Après avoir renfermé le gouvernement fédéral dans un cercle d’actions nettement tracé, il s’agissait de savoir comment on l’y ferait mouvoir.
POUVOIRS LÉGISLATIFS.
Division du corps législatif en deux branches. — Différences dans la manière de former les deux chambres. — Le principe de l’indépendance des États triomphe dans la formation du sénat. — Le dogme de la souveraineté nationale, dans la composition de la chambre des représentants. — Effets singuliers qui résultent de ceci, que les constitutions ne sont logiques que quand les peuples sont jeunes.
Dans l’organisation des pouvoirs de l’Union, on suivit en beaucoup de points le plan qui était tracé d’avance par la constitution particulière de chacun des États.
Le corps législatif fédéral de l’Union se composa d’un sénat et d’une chambre des représentants.
L’esprit de conciliation fit suivre dans la formation de chacune de ces assemblées des règles diverses.
[I-189]
J’ai fait sentir plus haut que, quand on avait voulu établir la constitution fédérale, deux intérêts opposés s’étaient trouvés en présence. Ces deux intérêts avaient donné naissance à deux opinions.
Les uns voulaient faire de l’Union une ligue d’États indépendants, une sorte de congrès, où les représentants de peuples distincts viendraient discuter certains points d’intérêt commun.
Les autres voulaient réunir tous les habitants des anciennes colonies dans un seul et même peuple, et leur donner un gouvernement qui, bien que sa sphère fût bornée, pût agir cependant, dans cette sphère, comme le seul et unique représentant de la nation. Les conséquences pratiques de ces deux théories étaient fort diverses.
Ainsi, s’agissait-il d’organiser une ligue et non un gouvernement national, c’était à la majorité des États à faire la loi, et non point à la majorité des habitants de l’Union. Car chaque État, grand ou petit, conservait alors son caractère de puissance indépendante, et entrait dans l’Union sur le pied d’une égalité parfaite.
Du moment, au contraire, où l’on considérait les habitants des États-Unis comme formant un seul et même peuple, il était naturel que la majorité seule des citoyens de l’Union fît la loi.
On comprend que les petits États ne pouvaient consentir à l’application de cette doctrine sans abdiquer complétement leur existence, dans ce qui regardait la souveraineté fédérale ; car de puissance corégulatrice, ils devenaient fraction insignifiante d’un grand peuple. Le premier système leur eût accordé [I-190] une puissance déraisonnable ; le second les annulait.
Dans cet état de choses, il arriva ce qui arrive presque toujours lorsque les intérêts sont en opposition avec les raisonnements : on fit plier les règles de la logique. Les législateurs adoptèrent un terme moyen qui conciliait de force deux systèmes théoriquement inconciliables.
Le principe de l’indépendance des États triompha dans la formation du sénat ; le dogme de la souveraineté nationale, dans la composition de la chambre des représentants.
Chaque État dut envoyer deux sénateurs au congrès et un certain nombre de représentant, en proportion de sa population [135] .
Il résulte de cet arrangement que, de nos jours, l’État de New-York a au congrès quarante représentants et seulement deux sénateurs ; l’État de Delaware deux sénateurs et seulement un représentant. L’État de Delaware est donc, dans le sénat, l’égal de l’État de New-York ; tandis que celui-ci a, dans la chambre [I-191] des représentants, quarante fois plus d’influence que le premier. Ainsi, il peut arriver que la minorité de la nation, dominant le sénat, paralyse entièrement les volontés de la majorité, représentée par l’autre chambre ; ce qui est contraire à l’esprit des gouvernements constitutionnels.
Tout ceci montre bien à quel degré il est rare et difficile de lier entre elles d’une manière logique et rationnelle toutes les parties de la législation.
Le temps fait toujours naître à la longue, chez le même peuple, des intérêts différents, et consacre des droits divers. Lorsqu’il s’agit ensuite d’établir une constitution générale, chacun de ces intérêts et de ces droits forme comme autant d’obstacles naturels qui s'opposent à ce qu’aucun principe politique ne suive toutes ses conséquences. C’est donc seulement à la naissance des sociétés qu’on peut être complétement logique dans les lois. Lorsque vous voyez un peuple jouir de cet avantage, ne vous hâtez pas de conclure qu’il est sage ; pensez plutôt qu’il est jeune.
À l’époque où la constitution fédérale a été formée, il n’existait encore parmi les Anglo-Américains que deux intérêts positivement opposés l’un à l’autre : l’intérêt d’individualité pour les États particuliers, l’intérêt d’union pour le peuple entier ; et il a fallu en venir à un compromis.
On doit reconnaître, toutefois, que cette partie de la constitution n’a point, jusqu’à présent, produit les maux qu’on pouvait craindre.
Tous les États sont jeunes ; ils sont rapprochés les uns des autres ; ils ont des mœurs, des idées et des besoins homogènes ; la différence qui résulte de leur [I-192] plus ou moins de grandeur, ne suffit pas pour leur donner des intérêts fort opposés. On n’a donc jamais vu les petits États se liguer, dans le sénat, contre les desseins des grands. D’ailleurs, il y a une force tellement irrésistible dans l’expression légale des volontés de tout un peuple, que, la majorité venant à s’exprimer par l’organe de la chambre des représentants, le sénat se trouve bien faible en sa présence.
De plus, il ne faut pas oublier qu’il ne dépendait pas des législateurs américains de faire une seule et même nation du peuple auquel ils voulaient donner des lois. Le but de la constitution fédérale n’était pas de détruire l’existence des États, mais seulement de la restreindre. Du moment donc où on laissait un pouvoir réel à ces corps secondaires (et on ne pouvait le leur ôter), on renonçait d’avance à employer habituellement la contrainte pour les plier aux volontés de la majorité. Ceci posé, l’introduction de leurs forces individuelles dans les rouages du gouvernement fédéral n’avait rien d’extraordinaire. Elle ne faisait que constater un fait existant, celui d’une puissance reconnue qu’il fallait ménager et non violenter.
AUTRE DIFFÉRENCE ENTRE LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.
Le sénat nommé par les législateurs provinciaux. — Les représentants, par le peuple. — Deux degrés d’élection pour le premier. — Un seul pour le second. — Durée des différents mandats. — Attributions.
Le sénat ne diffère pas seulement de l’autre chambre par le principe même de la représentation, mais [I-193] aussi par le mode de l’élection, par la durée du mandat et par la diversité des attributions.
La chambre des représentants est nommée par le peuple ; le sénat, par les législateurs de chaque État.
L’une est le produit de l’élection directe, l’autre de l’élection à deux degrés.
Le mandat des représentants ne dure que deux ans ; celui des sénateurs, six.
La chambre des représentants n’a que des fonctions législatives ; elle ne participe au pouvoir judiciaire qu’en accusant les fonctionnaires publics ; le sénat concourt à la formation des lois ; il juge les délits politiques qui lui sont déférés par la chambre des représentants ; il est, de plus, le grand conseil exécutif de la nation. Les traités conclus par le président doivent être validés par le sénat ; ses choix, pour être définitifs, ont besoin de recevoir l’approbation du même corps [136] .
[I-194]
DU POUVOIR EXÉCUTIF [137] .
Dépendance du président. — Électif et responsable. — Libre dans sa sphère, le sénat le surveille et ne le dirige pas. — Le traitement du président fixé à son entrée en fonctions. — Véto suspensif.
Les législateurs américains avaient une tâche difficile à remplir : ils voulaient créer un pouvoir exécutif qui dépendit de la majorité, et qui pourtant fût assez fort par lui-même pour agir avec liberté dans sa sphère.
Le maintien de la forme républicaine exigeait que le représentant du pouvoir exécutif fût soumis à la volonté nationale.
Le président est un magistrat électif. Son honneur, ses biens, sa liberté, sa vie, répondent sans cesse au peuple du bon emploi qu’il fera de son pouvoir. En exerçant ce pouvoir, il n’est pas d’ailleurs complètement indépendant : le sénat le surveille dans ses rapports avec les puissances étrangères, ainsi que dans la distribution des emplois ; de telle sorte qu’il ne peut ni être corrompu ni corrompre.
Les législateurs de l’Union reconnurent que le pouvoir exécutif ne pourrait remplir dignement et utilement sa tâche, s’ils ne parvenaient à lui donner plus de stabilité et plus de force qu’on ne lui en avait accordé dans les États particuliers.
Le président fut nommé pour quatre ans, et put être réélu. Avec de l’avenir, il eut le courage de travailler au bien public, et les moyens de l’opérer.
[I-195]
On fit du président le seul et unique représentant de la puissance exécutive de l’Union. On se garda même de subordonner ses volontés à celles d’un conseil : moyen dangereux, qui, tout en affaiblissant l’action du gouvernement, diminue la responsabilité des gouvernants. Le sénat a le droit de frapper de stérilité quelques uns des actes du président ; mais il ne saurait le forcer à agir, ni partager avec lui la puissance exécutive.
L’action de la législature sur le pouvoir exécutif peut être directe ; nous venons de voir que les Américains avaient pris soin qu’elle ne le fût pas. Elle peut aussi être indirecte.
Les chambres, en privant le fonctionnaire public de son traitement, lui ôtent une partie de son indépendance ; maîtresses de faire les lois, on doit craindre qu’elles ne lui enlèvent peu à peu la portion de pouvoir que la constitution avait voulu lui conserver.
Cette dépendance du pouvoir exécutif est un des vices inhérents aux constitutions républicaines. Les Américains n’ont pu détruire la pente qui entraîne les assemblées législatives a s’emparer du gouvernement, mais ils ont rendu cette pente moins irrésistible.
Le traitement du président est fixé, à son entrée en fonctions, pour tout le temps que doit durer sa magistrature. De plus, le président est armé d’un véto suspensif, qui lui permet d’arrêter à leur passage les lois qui pourraient détruire la portion d’indépendance que la constitution lui a laissée. Il ne saurait pourtant y avoir qu’une lutte inégale entre le [I-196] président et la législature, puisque celle-ci, en persévérant dans ses desseins, est toujours maîtresse de vaincre la résistance qu’on lui oppose ; mais le véto suspensif la force du moins à retourner sur ses pas ; il l’oblige à considérer de nouveau la question, et, cette fois, elle ne peut plus la trancher qu’à la majorité des deux tiers des opinants. Le véto, d’ailleurs, est une sorte d’appel au peuple. Le pouvoir exécutif, qu’on eût pu, sans cette garantie, opprimer en secret, plaide alors sa cause, et fait entendre ses raisons.
Mais si la législature persévère dans ses desseins, ne peut-elle pas toujours vaincre la résistance qu’on lui oppose ? À cela, je répondrai qu’il y a dans la constitution de tous les peuples, quelle que soit du reste sa nature, un point où le législateur est obligé de s’en rapporter au bon sens et à la vertu des citoyens. Ce point est plus rapproché et plus visible dans les républiques, plus éloigné et caché avec plus de soin dans les monarchies ; mais il se trouve toujours quelque part. Il n’y a pas de pays où la loi puisse tout prévoir, et où les institutions doivent tenir lieu de la raison et des mœurs.
[I-197]
EN QUOI LA POSITION DU PRÉSIDENT AUX ÉTATS-UNIS DIFFÈRE DE CELLE D’UN ROI CONSTITUTIONNEL EN FRANCE.
Le pouvoir exécutif, aux États-Unis, borné et exceptionnel comme la souveraineté au nom de laquelle il agit. — Le pouvoir exécutif en France s’étend à tout comme elle. — Le roi est un des auteurs de la loi. — Le président n’est que l’exécuteur de la loi. — Autres différences qui naissent de la durée des deux pouvoirs. — Le président gêné dans la sphère du pouvoir exécutif. — Le roi y est libre. — La France, malgré ces différences, ressemble plus à une république que l’Union à une monarchie. — Comparaison du nombre des fonctionnaires qui, dans les deux pays, dépendent du pouvoir exécutif.
Le pouvoir exécutif joue un si grand rôle dans la destinée des nations, que je veux m’arrêter un instant ici, pour mieux faire comprendre quelle place il occupe chez les Américains.
Afin de concevoir une idée claire et précise de la position du président des États-Unis, il est utile de la comparer à celle du roi, dans l’une des monarchies constitutionnelles d’Europe.
Dans cette comparaison, je m’attacherai peu aux signes extérieurs de la puissance ; ils trompent l’œil de l’observateur plus qu’ils ne le guident.
Lorsqu’une monarchie se transforme peu à peu en république, le pouvoir exécutif y conserve des titres, des honneurs, des respects, et même de l’argent, longtemps après qu’il y a perdu la réalité de la puissance. Les Anglais, après avoir tranché la tête à l’un de leurs rois et en avoir chassé un autre du trône, se mettaient encore à genoux pour parler aux successeurs de ces princes.
D’un autre côté, lorsque les républiques tombent [I-198] sous le joug d’un seul, le pouvoir continue à s’y montrer simple, uni et modeste dans ses manières, comme s’il ne s’élevait point déjà au-dessus de tous. Quand les empereurs disposaient despotiquement de la fortune et de la vie de leurs concitoyens, on les appelait encore Césars en leur parlant, et ils allaient souper familièrement chez leurs amis.
Il faut donc abandonner la surface et pénétrer plus avant.
La souveraineté, aux États-Unis, est divisée entre l’Union et les États, tandis que, parmi nous, elle est une et compacte ; de là naît la première et la plus grande différence que j’aperçoive entre le président des États-Unis et le roi en France.
Aux États-Unis, le pouvoir exécutif est borné et exceptionnel, comme la souveraineté même au nom de laquelle il agit ; en France il s’étend à tout comme elle.
Les Américains ont un gouvernement fédéral ; nous avons un gouvernement national.
Voilà une première cause d’infériorité qui résulte de la nature même des choses ; mais elle n’est pas seule. La seconde en importance est celle-ci : on peut, à proprement parler, définir la souveraineté, le droit de faire les lois.
Le roi, en France, constitue réellement une partie du souverain, puisque les lois n’existent point s’il refuse de les sanctionner ; il est, de plus, l’exécuteur des lois.
Le président est également l’exécuteur de la loi, mais il ne concourt pas réellement à la faire, puisque, en refusant son assentiment, il ne peut l’empêcher [I-199] d’exister. Il ne fait donc point partie du souverain ; il n’en est que l’agent.
Non seulement le roi, en France, constitue une portion du souverain, mais encore il participe à la formation de la législature, qui en est l’autre portion. Il y participe en nommant les membres d’une chambre, et en faisant cesser à sa volonté la durée du mandat de l’autre. Le président des États-Unis ne concourt en rien à la composition du corps législatif et ne saurait le dissoudre.
Le roi partage avec les chambres le droit de proposer la loi.
Le président n’a point d’initiative semblable.
Le roi est représenté, au sein des chambres, par un certain nombre d’agents qui exposent ses vues ; soutiennent ses opinions, et font prévaloir ses maximes de gouvernement.
Le président n’a point entrée au congrès ; ses ministres en sont exclus comme lui-même, et ce n’est que par des voies indirectes qu’il fait pénétrer dans ce grand corps son influence et ses avis.
Le roi de France marche donc d’égal à égal avec la législature, qui ne peut agir sans lui, comme il ne saurait agir sans elle.
Le président est placé à côté de la législature, comme un pouvoir inférieur et dépendant.
Dans l’exercice du pouvoir exécutif proprement dit, point sur lequel sa position semble le plus se rapprocher de celle du roi en France, le président a encore plusieurs causes d’infériorité très grandes.
Le pouvoir du roi, en France, a d’abord, sur celui du président, l’avantage de la durée. Or, la [I-200] durée est un des premiers éléments de la force. On n’aime et on ne craint que ce qui doit exister longtemps.
Le président des États-Unis est un magistrat élu pour quatre ans. Le roi, en France, est un chef héréditaire.
Dans l’exercice du pouvoir exécutif, le président des États-Unis est continuellement soumis à une surveillance jalouse. Il prépare les traités, mais il ne les fait pas ; il désigne aux emplois, mais il n’y nomme point [138] .
Le roi de France est maître absolu dans la sphère du pouvoir exécutif.
Le président des États-Unis est responsable de ses actes. La loi française dit que la personne du roi de France est inviolable.
Cependant, au-dessus de l’un comme au-dessus de l’autre, se tient un pouvoir dirigeant, celui de l’opinion publique. Ce pouvoir est moins défini en France qu’aux États-Unis ; moins reconnu, moins formulé dans les lois ; mais de fait il y existe. En Amérique, il procède par des élections et des arrêts, en France par des révolutions. La France et les États-Unis ont ainsi, malgré la diversité de leur constitution, ce point de commun, que l’opinion publique y est, en résultat, le pouvoir dominant. Le principe [I-201] générateur des lois est donc, à vrai dire, le même chez les deux peuples, quoique ses développements y soient plus ou moins libres, et que les conséquences qu’on en tire soient souvent différentes. Ce principe, de sa nature, est essentiellement républicain. Ainsi pensé-je que la France, avec son roi, ressemble plus a une république, que l’Union, avec son président, à une monarchie.
Dans tout ce qui précède, j’ai pris soin de ne signaler que les points capitaux de différence. Si j’eusse voulu entrer dans les détails, le tableau eût été bien plus frappant encore. Mais j’ai trop à dire pour ne pas vouloir être court.
J’ai remarqué que le pouvoir du président des États-Unis ne s’exerce que dans la sphère d’une souveraineté restreinte, tandis que celui du roi, en France, agit dans le cercle d’une souveraineté complète.
J’aurais pu montrer le pouvoir gouvernemental du roi en France dépassant même ses limites naturelles, quelque étendues qu’elles soient, et pénétrant, de mille manières, dans l’administration des intérêts individuels.
À cette cause d’influence, je pouvais joindre celle qui résulte du grand nombre des fonctionnaires publics qui, presque tous, doivent leur mandat à la puissance exécutive. Ce nombre a dépassé chez nous toutes les bornes connues ; il s’élève à 138,000 [139] . Chacune de ces 138,000 nominations doit être considérée comme un élément de force. Le président n’a [I-202] pas le droit absolu de nommer aux emplois publics, et ces emplois n’excèdent guère 12,000 [140] .
CAUSES ACCIDENTELLES QUI PEUVENT ACCROÎTRE L’INFLUENCE DU POUVOIR EXÉCUTIF.
Sécurité extérieure dont jouit l’Union. — Politique expectante. — Armée de 6,000 soldats. — Quelques vaisseaux seulement. — Le président possède de grandes prérogatives dont il n’a pas l’occasion de se servir. — Dans ce qu’il a occasion d’exécuter il est faible.
Si le pouvoir exécutif est moins fort en Amérique qu’en France, il faut en attribuer la cause aux circonstances plus encore peut-être qu’aux lois.
C’est principalement dans ses rapports avec les étrangers que le pouvoir exécutif d’une nation trouve l’occasion de déployer de l’habileté et de la force.
Si la vie de l’Union était sans cesse menacée, si ses grands intérêts se trouvaient tous les jours mêlés à ceux d’autres peuples puissants, on verrait le pouvoir exécutif grandir dans l’opinion, par ce qu’on attendrait de lui, et par ce qu’il exécuterait.
Le président des États-Unis est, il est vrai, le chef de l’armée, mais cette armée se compose de 6,000 soldats ; il commande la flotte, mais la flotte ne compte que quelques vaisseaux ; il dirige les affaires de l’Union [I-203] vis-à-vis des peuples étrangers, mais les États-Unis n’ont pas de voisins. Séparés du reste du monde par l’Océan, trop faibles encore pour vouloir dominer la mer, ils n’ont point d’ennemis, et leurs intérêts ne sont que rarement en contact avec ceux des autres nations du globe.
Ceci fait bien voir qu’il ne faut pas juger de la pratique du gouvernement par la théorie.
Le président des États-Unis possède des prérogatives presque royales, dont il n’a pas l’occasion de se servir, et les droits dont, jusqu’à présent, il peut user sont très circonscrits : les lois lui permettent d’être fort, les circonstances le maintiennent faible.
Ce sont, au contraire, les circonstances qui, plus encore que les lois, donnent à l’autorité royale de France sa plus grande force.
En France, le pouvoir exécutif lutte sans cesse contre d’immenses obstacles, et dispose d’immenses ressources pour les vaincre. Il s’accroît de la grandeur des choses qu’il exécute et de l’importance des événements qu’il dirige, sans pour cela modifier sa constitution.
Les lois l’eussent-elles créé aussi faible et aussi circonscrit que celui de l’Union, son influence deviendrait bientôt beaucoup plus grande.
POURQUOI LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS N’A PAS BESOIN POUR DIRIGER LES AFFAIRES D’AVOIR LA MAJORITÉ DANS LES CHAMBRES.
C’est un axiome établi en Europe, qu’un roi constitutionnel, ne peut gouverner quand l’opinion des [I-204] chambres législatives ne s’accorde pas avec la sienne.
On a vu plusieurs présidents des États-Unis perdre l’appui de la majorité dans le corps législatif, sans être obligés d’abandonner le pouvoir, ni sans qu’il en résultât pour la société un grand mal.
J’ai entendu citer ce fait pour prouver l’indépendance et la force du pouvoir exécutif en Amérique. Il suffit de réfléchir quelques instants pour y voir, au contraire, la preuve de son impuissance.
Un roi d’Europe a besoin d’obtenir l’appui du corps législatif pour remplir la tâche que la constitution lui impose, parce que cette tâche est immense. Un roi constitutionnel d’Europe n’est pas seulement l’exécuteur de la loi : le soin de son exécution lui est si complètement dévolu, qu’il pourrait, si elle lui était contraire, en paralyser les forces. Il a besoin des chambres pour faire la loi, les chambres ont besoin de lui pour l’exécuter : ce sont deux puissances qui ne peuvent vivre l’une sans l’autre ; les rouages du gouvernement s’arrêtent au moment où il y a désaccord entre elles.
En Amérique, le président ne peut empêcher la formation des lois ; il ne saurait se soustraire à l’obligation de les exécuter. Son concours zélé et sincère est sans doute utile, mais n’est point nécessaire à la marche du gouvernement. Dans tout ce qu’il fait d’essentiel, on le soumet directement ou indirectement à la législature ; où il est entièrement indépendant d’elle, il ne peut presque rien. C’est donc sa faiblesse, et non sa force, qui lui permet de vivre en opposition avec le pouvoir législatif.
En Europe, il faut qu’il y ait accord entre le roi et les chambres, parce qu’il peut y avoir lutte sérieuse [I-205] entre eux. En Amérique, l’accord n’est pas obligé, parce que la lutte est impossible.
DE L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT.
Le danger du système d’élection augmente en proportion de l’étendue des prérogatives du pouvoir exécutif. — Les Américains peuvent adopter ce système, parce qu’ils peuvent se passer d’un pouvoir exécutif fort. — Comment les circonstances favorisent l’établissement du système électif. — Pourquoi l’élection du président ne fait point varier les principes du gouvernement. — Influence que l’élection du président ne fait point varier les principes du gouvernement. — Influence que l’élection du président exerce sur le sort des fonctionnaires secondaires·
Le système de l’élection, appliqué au chef du pouvoir exécutif chez un grand peuple, présente des dangers que l’expérience et les historiens ont suffisamment signalés.
Aussi je ne veux en parler que par rapport à l’Amérique.
Les dangers qu’on redoute du système de l’élection sont plus ou moins grands, suivant la place que le pouvoir exécutif occupe, et son importance dans l’État, suivant le mode de l’élection et les circonstances dans lesquelles se trouve le peuple qui élit.
Ce qu’on reproche non sans raison au système électif, appliqué au chef de l’État, c’est d’offrir un appât si grand aux ambitions particulières, et de les enflammer si fort à la poursuite du pouvoir, que souvent les moyens légaux ne leur suffisant plus, elles en appellent à la force quand le droit vient à leur manquer.
Il est clair que plus le pouvoir exécutif a de [I-206] prérogatives, plus l’appât est grand ; plus l’ambition des prétendants est excitée, plus aussi elle trouve d’appui dans une foule d’ambitions secondaires qui espèrent se partager la puissance après que leur candidat aura triomphé.
Les dangers du système d’élection croissent donc en proportion directe de l’influence exercée par le pouvoir exécutif sur les affaires de l’État.
Les révolutions de Pologne ne doivent pas seulement être attribuées au système électif en général, mais à ce que le magistrat élu était le chef d’une grande monarchie.
Avant de discuter la bonté absolue du système électif, il y a donc toujours une question préjudicielle à décider, celle de savoir si la position géographique, les lois, les habitudes, les mœurs et les opinions du peuple chez lequel on veut l’introduire permettent d’y établir un pouvoir exécutif faible et dépendant ; car vouloir tout à la fois que le représentant de l’État reste armé d’une vaste puissance et soit élu, c’est exprimer, suivant moi, deux volontés contradictoires. Pour ma part, je ne connais qu’un seul moyen de faire passer la royauté héréditaire à l’état de pouvoir électif : il faut rétrécir d’avance sa sphère d’action, diminuer graduellement ses prérogatives, et habituer peu à peu le peuple à vivre sans son aide. Mais c’est ce dont les républicains d’Europe ne s’occupent guère. Comme beaucoup d’autre eux ne baissent la tyrannie que parce qu’ils sont en butte à ses rigueurs, l’étendue du pouvoir exécutif ne les blesse point ; ils n’attaquent que son origine, sans apercevoir le lien étroit qui lie ces deux choses.
[I-207]
Il ne s’est encore rencontré personne qui se souciât d’exposer son honneur et sa vie pour devenir président des États-Unis, parce que le président n’a qu’un pouvoir temporaire, borné et dépendant. Il faut que la fortune mette un prix immense en jeu pour qu’il se présente des joueurs désespérés dans la lice. Nul candidat, jusqu’à présent, n’a pu soulever en sa faveur d’ardentes sympathies et de dangereuses passions populaires. La raison en est simple : parvenu à la tête du gouvernement, il ne peut distribuer à ses amis ni beaucoup de puissance, ni beaucoup de richesses, ni beaucoup de gloire, et son influence dans l’État est trop faible pour que les factions voient leurs succès ou leur ruine dans son élévation au pouvoir.
Les monarchies héréditaires ont un grand avantage : l’intérêt particulier d’une famille y étant continuellement lié d’une manière étroite à l’intérêt de l’État, il ne se passe jamais un seul moment où celui-ci reste abandonné à lui-même. Je ne sais si dans ces monarchies les affaires sont mieux dirigées qu’ailleurs ; mais du moins il y a toujours quelqu’un qui, bien ou mal, suivant sa capacité, s’en occupe.
Dans les États électifs, au contraire, à l’approche de l’élection et long-temps avant qu’elle n’arrive, les rouages du gouvernement ne fonctionnent plus, en quelque sorte, que d’eux-mêmes. On peut sans doute combiner les lois de manière à ce que l’élection s’opérant d’un seul coup et avec rapidité, le siège de la puissance exécutive ne reste pour ainsi dire jamais vacant ; mais, quoi qu’on fasse, le vide existe dans les esprits en dépit des efforts du législateur.
À l’approche de l’élection, le chef du pouvoir exé[I-208] cutif ne songe qu’à la lutte qui se prépare ; il n’a plus d’avenir ; il ne peut rien entreprendre, et ne poursuit qu’avec mollesse ce qu’un autre peut-être va achever. « Je suis si près du moment de ma retraite, écrivait le président Jefferson, le 21 janvier 1809 (six semaines avant l’élection), que je ne prends plus part aux affaires que par l’expression de mon opinion. Il me semble juste de laisser à mon successeur l’initiative des mesures dont il aura à suivre l’exécution et à supporter la responsabilité. »
De son côté, la nation n’a les yeux tournés que sur un seul point ; elle n’est occupée qu’à surveiller le travail d’enfantement qui se prépare.
Plus la place qu’occupe le pouvoir exécutif dans la direction des affaires est vaste, plus son action habituelle est grande et nécessaire, et plus un pareil état de choses est dangereux. Chez un peuple qui a contracté l’habitude d’être gouverné par le pouvoir exécutif, et à plus forte raison d’être administré par lui, l’élection ne pourrait manquer de produire une perturbation profonde.
Aux États-Unis, l’action du pouvoir exécutif peut se ralentir impunément, parce que cette action est faible et circonscrite.
Lorsque le chef du gouvernement est élu, il en résulte presque toujours un défaut de stabilité dans la politique intérieure et extérieure de l’État. C’est là un des vices principaux de ce système.
Mais ce vice est plus ou moins sensible suivant la part de puissance accordée au magistrat élu. À Rome, les principes du gouvernement ne variaient point, quoique les consuls fussent changés tous les ans, [I-209] parce que le sénat était le pouvoir dirigeant, et que le sénat était un corps héréditaire. Dans la plupart des monarchies de l’Europe, si on élisait le roi, le royaume changerait de face à chaque nouveau choix.
En Amérique, le président exerce une assez grande influence sur les affaires de l’État, mais il ne les conduit point ; le pouvoir prépondérant réside dans la représentation nationale tout entière. C’est donc la masse du peuple qu’il faut changer, et non pas seulement le président, pour que les maximes de la politique varient. Aussi, en Amérique, le système de l’élection, appliqué au chef du pouvoir exécutif, ne nuit-il pas d’une manière très sensible à la fixité du gouvernement.
Du reste, le manque de fixité est un mal tellement inhérent au système électif, qu’il se fait encore vivement sentir dans la sphère d’action du président, quelque circonscrite qu’elle soit.
Les Américains ont pensé avec raison que le chef du pouvoir exécutif, pour remplir sa mission et porter le poids de la responsabilité tout entière, devait rester, autant que possible, libre de choisir lui même ses agents et de les révoquer à volonté ; le corps législatif surveille le président plutôt qu’il ne le dirige. Il suit de là qu’à chaque élection nouvelle, le sort de tous les employés fédéraux est comme en suspens.
On se plaint, dans les monarchies constitutionnelles d’Europe, de ce que la destinée des agents obscurs de l’administration dépend souvent du sort des ministres. C’est bien pis encore dans les États ou le chef du gouvernement est élu. La raison en est simple : dans les monarchies constitutionnelles, les [I-210] ministres se succèdent rapidement ; mais le représentant principal du pouvoir exécutif ne change jamais, ce qui renferme l’esprit d’innovation entre certaines limites. Les systèmes administratifs y varient donc dans les détails plutôt que dans les principes ; on ne saurait les substituer brusquement les uns aux autres sans causer une sorte de révolution. En Amérique, cette révolution se fait tous les quatre ans au nom de la loi.
Quant aux misères individuelles qui sont la suite naturelle d’une pareille législation, il faut avouer que le défaut de fixité dans le sort des fonctionnaires ne produit pas en Amérique les maux qu’on pourrait en attendre ailleurs. Aux États-Unis, il est si facile de se créer une existence indépendante, qu’ôter à un fonctionnaire la place qu’il occupe, c’est quelquefois lui enlever l’aisance de la vie, mais jamais les moyens de la soutenir.
J’ai dit au commencement de ce chapitre que les dangers du mode de l’élection appliqué au chef du pouvoir exécutif étaient plus ou moins grands, suivant les circonstances au milieu desquelles se trouve le peuple qui élit.
Vainement on s’efforce d’amoindrir le rôle du pouvoir exécutif, il est une chose sur laquelle ce pouvoir exerce une grande influence, quelle que soit la place que les lois lui aient faite, c’est la politique extérieure : une négociation ne peut guère être entamée et suivie avec fruit que par un seul homme.
Plus un peuple se trouve dans une position précaire et périlleuse, et plus le besoin de suite et de fixité se fait sentir dans la direction des affaires extérieures, [I-211] plus aussi l’application du système de l’élection au chef de l’État devient dangereuse.
La politique des Américains vis-à-vis du monde entier est simple ; on pourrait presque dire que personne n’a besoin d’eux, et qu’ils n’ont besoin de personne. Leur indépendance n’est jamais menacée.
Chez eux le rôle du pouvoir exécutif est donc aussi restreint par les circonstances que par les lois. Le président peut fréquemment changer de vues sans que l’État souffre ou périsse.
Quelles que soient les prérogatives dont le pouvoir exécutif est revêtu, on doit toujours considérer le temps qui précède immédiatement l’élection, et celui pendant lequel elle se fait, comme une époque de crise nationale.
Plus la situation intérieure d’un pays est embarrassée, et plus ses périls extérieurs sont grands, plus ce moment de crise est dangereux pour lui. Parmi les peuples de l’Europe, il en est bien peu qui n’eussent à craindre la conquête ou l’anarchie, toutes les fois qu’ils se donneraient un nouveau chef.
En Amérique, la société est ainsi constituée qu’elle peut se soutenir d’elle-même et sans aide ; les dangers extérieurs n’y sont jamais pressants. L’élection du président est une cause d’agitation, non de ruine.
[I-212]
MODE DE L’ÉLECTION.
Habileté dont les législateurs américains ont fait preuve dans le choix du mode d’élection. — Création d’un corps électoral spécial. — Vote séparé des électeurs spéciaux. — Dans quel cas la chambre des représentants est appelée à choisir le président. — Ce qui s’est passé aux douze élections qui ont eu lieu depuis que la constitution est en vigueur.
Indépendamment des dangers inhérents au principe, il en est beaucoup d’autres qui naissent des formes mêmes de l’élection, et qui peuvent être évités par les soins du législateur.
Lorsqu’un peuple se réunit en armes sur la place publique pour choisir son chef, il s’expose non seulement aux dangers que présente le système électif en lui même, mais encore à tous ceux de la guerre civile qui naissent d’un semblable mode d’élection.
Quand les lois polonaises faisaient dépendre le roi du choix du veto d’un seul homme, elles invitaient au meurtre de cet homme, ou constituaient d’avance l’anarchie.
À mesure qu’on étudie les institutions des États-Unis et qu’on jette un regard plus attentif sur la situation politique et sociale de ce pays, on y remarque un merveilleux accord entre la fortune et les efforts de l’homme. L’Amérique était une contrée nouvelle ; cependant le peuple qui l’habitait avait fait ailleurs un long usage de la liberté : deux grandes causes d’ordre intérieur. De plus, l’Amérique ne redoutait point la conquête. Les législateurs américains, s’emparant de ces circonstances favorables, n’eurent point de peine à établir un pouvoir exécutif [I-213] faible et dépendant ; l’ayant créé tel, ils purent sans danger le rendre électif.
Il ne leur restait plus qu’à choisir, parmi les différents systèmes d’élection, le moins dangereux ; les règles qu’ils tracèrent à cet égard complètent admirablement les garanties que la constitution physique et politique du pays fournissait déjà.
Le problème à résoudre était de trouver le mode d’élection qui, tout en exprimant les volontés réelles du peuple, excitât peu ses passions et le tînt le moins possible en suspens. On admit d’abord que la majorité simple ferait la loi. Mais c’était encore une chose fort difficile que d’obtenir cette majorité sans avoir à craindre des délais qu’avant tout on voulait éviter.
Il est rare en effet de voir un homme réunir du premier coup la majorité des suffrages chez un grand peuple. La difficulté s’accroît encore dans une république d’États confédérés, ou les influences locales sont beaucoup plus développées et plus puissantes.
Pour obvier à ce second obstacle, il se présentait un moyen, c’était de déléguer les pouvoirs électoraux de la nation à un corps qui la représentât.
Ce mode d’élection rendait la majorité plus probable ; car, moins les électeurs sont nombreux, plus il leur est facile de s’entendre. Il présentait aussi plus de garanties pour la bonté du choix.
Mais devait-on confier le droit d’élire au corps législatif lui-même, représentant habituel de la nation, ou fallait-il, au contraire, former un collège électoral dont l’unique objet fût de procéder à la nomination du président ?
Les Américains préférèrent ce dernier parti. Ils [I-214] pensèrent que les hommes qu’on envoyait pour faire les lois ordinaires ne représenteraient qu’incomplétement les vœux du peuple relativement à l’élection de son premier magistrat. Étant d’ailleurs élus pour plus d’une année, ils auraient pu représenter une volonté déjà changée. Ils jugèrent que si l’on changeait la législature d’élire le chef du pouvoir exécutif, ses membres deviendraient, long-temps avant l’élection, l’objet de manœuvres corruptrices et le jouet de l’intrigue ; tandis que, semblables aux jurés, les électeurs spéciaux resteraient inconnus dans la foule, jusqu’au jour où ils devraient agir, et n’apparaîtraient un instant que pour prononcer leur arrêt.
On établit donc que chaque État nommerait un certain nombre d’électeurs [141] , lesquels éliraient à leur tour le président. Et comme on avait remarqué que les assemblées chargées de choisir les chefs du gouvernement dans les pays électifs devenaient inévitablement des foyers de passions et de brigue ; que quelquefois elles s’emparaient de pouvoirs qui ne leur appartenaient pas, et que souvent leurs opérations, et l’incertitude qui en était la suite, se prolongeaient assez long-temps pour mettre l’État en péril, on régla que les électeurs voteraient tous à un jour fixé, mais sans s’être réunis [142] .
Le mode de l’élection à deux degrés rendait la majorité probable, mais ne l’assurait pas, car il se [I-215] pouvait que les électeurs différassent entre eux comme leurs commettants l’auraient pu faire.
Ce cas venant à se présenter, on était nécessairement amené à prendre l’une de ces trois mesures : il fallait ou faire nommer de nouveaux électeurs, ou consulter de nouveau ceux déjà nommés, ou enfin déférer le choix à une autorité nouvelle.
Les deux premières méthodes, indépendamment de ce qu’elles étaient peu sûres, amenaient des lenteurs, et perpétuaient une agitation toujours dangereuse.
On s’arrêta donc à la troisième, et l’on convint que les votes des électeurs seraient transmis cachetés au président du sénat ; qu’au jour fixé, et en présence des deux chambres, celui-ci en ferait le dépouillement. Si aucun des candidats n’avait réuni la majorité, la chambre des représentants procéderait immédiatement elle-même à l’élection ; mais on eut soin de limiter son droit. Les représentants ne purent élire que l’un des trois candidats qui avaient obtenu le plus de suffrages [143] .
Ce n’est, comme on le voit, que dans un cas rare et difficile à prévoir d’avance, que l’élection est confiée aux représentants ordinaires de la nation, et [I-216] encore ne peuvent-ils choisir qu’un citoyen déjà désigné par une forte minorité des électeurs spéciaux ; combinaison heureuse, qui concilie le respect qu’on doit à la volonté du peuple avec la rapidité d’exécution, et les garanties d’ordre qu’exige l’intérêt de l’État. Du reste, en faisant décider la question par la chambre des représentants, en cas de partage, on n’arrivait point encore à la solution complète de toutes les difficultés ; car la majorité pouvait à son tour se trouver douteuse dans la chambre des représentants, et cette fois la constitution n’offrait point de remède. Mais en établissant des candidatures obligées, en restreignant leur nombre à trois, en s’en rapportant au choix de quelques hommes éclairés, elle avait aplani tous les obstacles [144] sur lesquels elle pouvait avoir quelque puissance ; les autres étaient inhérents au système électif lui-même.
Depuis quarante-quatre ans que la constitution fédérale existe, les États-Unis ont déjà élu douze fois leur président.
Dix élections se sont faites en un instant, par le vote simultané des électeurs spéciaux placés sur les différents points du territoire.
La chambre des représentants n’a encore usé que deux fois du droit exceptionnel dont elle est revêtue en cas de partage. La première, en 1801, lors de l’élection de M. Jefferson ; et la seconde, en 1825, quand M. Quincy Adams a été nommé.
[I-217]
CRISE DE L’ÉLECTION.
On peut considérer le moment de l’élection du président comme un moment de crise nationale. — Pourquoi. — Passion du peuple. — Préoccupation du président. — Calme qui succède à l’agitation de l’élection.
J’ai dit dans quelles circonstances favorables se trouvaient les États-Unis pour l’adoption du système électif, et j’ai fait connaître les précautions qu’avaient prises les législateurs, afin d’en diminuer les dangers. Les Américains sont habitués à procéder à toutes sortes d’élections. L’expérience leur a appris à quel degré d’agitation ils peuvent parvenir et doivent s’arrêter. La vaste étendue de leur territoire et la dissémination des habitants y rend une collision entre les différents partis moins probable et moins périlleuse que partout ailleurs. Les circonstances politiques au milieu desquelles la nation s’est trouvée lors des élections n’ont jusqu’ici présenté aucun danger réel.
Cependant on peut encore considérer le moment de l’élection du président des États-Unis comme une époque de crise nationale.
L’influence qu’exerce le président sur la marche des affaires est sans doute faible et indirecte, mais elle s’étend sur la nation entière ; le choix du président n’importe que modérément à chaque citoyen, mais il importe à tous les citoyens. Or, un intérêt, quelque petit qu’il soit, prend un grand caractère d’importance, du moment qu’il devient un intérêt général.
Comparé à un roi d’Europe, le président a sans doute peu de moyens de se créer des partisans ; toutefois, les places dont il dispose sont en assez grand [I-218] nombre pour que plusieurs milliers d’électeurs soient directement ou indirectement intéressés à sa cause.
De plus, les partis, aux États-Unis comme ailleurs, sentent le besoin de se grouper autour d’un homme, afin d’arriver ainsi plus aisément jusqu’à l’intelligence de la foule. Ils se servent donc, en général, du nom du candidat à la présidence comme d’un symbole ; ils personnifient en lui leurs théories. Ainsi, les partis ont un grand intérêt à déterminer l’élection en leur faveur, non pas tant pour faire triompher leurs doctrines à l’aide du président élu, que pour montrer, par son élection, que ces doctrines ont acquis la majorité.
Long-temps avant que le moment fixé n’arrive, l’élection devient la plus grande, et pour ainsi dire l’unique affaire, qui préoccupe les esprits. Les factions redoublent alors d’ardeur ; toutes les passions factices que l’imagination peut créer, dans un pays heureux et tranquille, s’agitent en ce moment au grand jour.
De son côté, le président est absorbé par le soin de se défendre. Il ne gouverne plus dans l’intérêt de l’État, mais dans celui de sa réélection ; il se prosterne devant la majorité, et souvent, au lieu de résister à ses passions, comme son devoir l’y oblige, il court au devant de ses caprices.
À mesure que l’élection approche, les intrigues deviennent plus actives, l’agitation plus vive et plus répandue. Les citoyens se divisent en plusieurs camps, dont chacun prend le nom de son candidat. La nation entière tombe dans un état fébrile, l’élection est alors le texte journalier des papiers publics, le sujet des [I-219] conversations particulières, le but de toutes les démarches, l’objet de toutes les pensées, le seul intérêt du présent.
Aussitôt, il est vrai, que la fortune a prononcé, cette ardeur se dissipe, tout se calme, et le fleuve, un moment débordé, rentre paisiblement dans son lit. Mais ne doit-on pas s’étonner que l’orage ait pu naître ?
DE LA RÉÉLECTION DU PRÉSIDENT.
Quand le chef du pouvoir exécutif est rééligible, c’est l’État lui-même qui intrigue et corrompt. — Désir d’être réélu qui domine toutes les pensées du président des États-Unis. — Inconvénient de la réélection spécial à l’Amérique. — Le vice naturel des démocraties est l’asservissement graduel de tous les pouvoirs aux moindres désirs de la majorité. — La réélection du président favorise ce vice.
Les législateurs des États-Unis ont-ils eu tort ou raison de permettre la réélection du président ?
Empêcher que le chef du pouvoir exécutif ne puisse être réélu, paraît, au premier abord, contraire à la raison. On sait quelle influence les talents ou le caractère d’un seul homme exercent sur la destinée de tout un peuple, surtout dans les circonstances difficiles et en temps de crise. Les lois qui défendraient aux citoyens de réélire leur premier magistrat leur ôteraient le meilleur moyen de faire prospérer l’État ou de le sauver. On arriverait d’ailleurs ainsi à ce résultat bizarre, qu’un homme serait exclu du gouvernement au moment même où il aurait achevé de prouver qu’il était capable de bien gouverner.
[I-220]
Ces raisons sont puissantes, sans doute ; ne peut-on pas cependant leur en opposer de plus fortes encore ?
L’intrigue et la corruption sont des vices naturels aux gouvernements électifs. Mais lorsque le chef de l’État peut être réélu, ces vices s’étendent indéfiniment et compromettent l’existence même du pays. Quand un simple candidat veut parvenir par l’intrigue, ses manœuvres ne sauraient s’exercer que sur un espace circonscrit. Lorsque au contraire le chef de l’État lui-même se met sur les rangs, il emprunte pour son propre usage la force du gouvernement.
Dans le premier cas, c’est un homme avec ses faibles moyens ; dans le second, c’est l’État lui-même, avec ses immenses ressources, qui intrigue et qui corrompt.
Le simple citoyen qui emploie des manœuvres coupables pour parvenir au pouvoir, ne peut nuire que d’une manière indirecte à la prospérité publique ; mais si le représentant de la puissance exécutive descend dans la lice, le soin du gouvernement devient pour lui l’intérêt secondaire ; l’intérêt principal est son élection. Les négociations, comme les lois, ne sont plus pour lui que des combinaisons électorales ; les places deviennent la récompense des services rendus, non à la nation, mais à son chef. Alors même que l’action du gouvernement ne serait pas toujours contraire à l’intérêt du pays, du moins elle ne lui sert plus. Cependant c’est pour son usage seul qu’elle est faite.
Il est impossible de considérer la marche ordinaire [I-221] des affaires aux États-Unis, sans s’apercevoir que le désir d’être réélu domine les pensées du président ; que toute la politique de son administration tend vers ce point ; que ses moindres démarches sont subordonnées à cet objet ; qu’à mesure surtout que le moment de la crise approche, l’intérêt individuel se substitue dans son esprit à l’intérêt général.
Le principe de la réélection rend donc l’influence corruptrice des gouvernements électifs plus étendue et plus dangereuse. Il tend à dégrader la morale politique du peuple, et à remplacer par l’habileté le patriotisme.
En Amérique, il attaque de plus près encore les sources de l’existence nationale.
Chaque gouvernement porte en lui-même un vice naturel qui semble attaché au principe même de sa vie ; le génie du législateur consiste à le bien discerner. Un État peut triompher de beaucoup de mauvaises lois, et l’on s’exagère souvent le mal qu’elles causent. Mais toute loi dont l’effet est de developper ce germe de mort, ne saurait manquer, à la longue, de devenir fatale, bien que ses mauvais effets ne se fassent pas immédiatement apercevoir.
Le principe de ruine, dans les monarchies absolues, est l’extension illimitée et hors de raison du pouvoir royal. Une mesure qui enlèverait les contrepoids que la constitution avait laissés à ce pouvoir, serait donc radicalement mauvaise, quand même ses effets paraîtraient long-temps insensibles.
De même, dans les pays où la démocratie gouverne, et où le peuple attire sans cesse tout à lui, les lois qui rendent son action de plus en plus prompte [I-222] et irrésistible attaquent d’une manière directe l’existence du gouvernement.
Le plus grand mérite des législateurs américains est d’avoir aperçu clairement cette vérité, et d’avoir eu le courage de la mettre en pratique.
Ils conçurent qu’il fallait qu’en dehors du peuple il y eût un certain nombre de pouvoirs qui, sans être complétement indépendants de lui, jouissent pourtant, dans leur sphère, d’un assez grand degré de liberté ; de telle sorte que, forcés d’obéir à la direction permanente de la majorité, ils pussent cependant lutter contre ses caprices, et se refuser à ses exigences dangereuses.
À cet effet, ils concentrèrent tout le pouvoir exécutif de la nation dans une seule main ; ils donnèrent au président des prérogatives étendues, et l’armèrent du véto, pour résister aux empiétements de la législature.
Mais en introduisant le principe de la réélection, ils ont détruit en partie leur ouvrage. Ils ont accordé au président un grand pouvoir, et lui ont ôté la volonté d’en faire usage.
Non rééligible, le président n’était point indépendant du peuple, car il ne cessait pas d’être responsable envers lui ; mais la faveur du peuple ne lui était pas tellement nécessaire qu’il dût se plier en tout à ses volontés.
Rééligible (et ceci est vrai, surtout de nos jours, où la morale politique se relâche, et où les grands caractères disparaissent), le président des États-Unis n’est qu’un instrument docile dans les mains de la majorité. Il aime ce qu’elle aime, hait ce qu’elle hait ; [I-223] il vole au-devant de ses volontés, prévient ses plaintes, se plie à ses moindres désirs : les législateurs voulaient qu’il la guidât, et il la suit.
Ainsi, pour ne pas priver l’État des talents d’un homme, ils ont rendu ces talents presque inutiles et, pour se ménager une ressource dans des circonstances extraordinaires, ils ont exposé le pays à des dangers de tous les jours.
DES TRIBUNAUX FÉDÉRAUX [145] .
Importance politique du pouvoir judiciaire aux États-Unis. — Difficulté de traiter ce sujet. — Utilité de la justice dans les confédérations. — De quels tribunaux l’Union pouvait-elle se servir ? — Nécessité d’établir des cours de justice fédérale. — Organisation de la justice fédérale. — La cour suprême. — En quoi elle diffère de toutes les cours de justice que nous connaissons.
J’ai examiné le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif de l’Union. Il me reste encore à considérer la puissance judiciaire.
Ici je dois exposer mes craintes aux lecteurs.
Les institutions judiciaires exercent une grande influence sur la destinée des Anglo-Américains ; elles tiennent une place très importante parmi les institutions politiques proprement dites. Sous ce point de [I-224] vue, elles méritent particulièrement d’attirer nos regards.
Mais comment faire comprendre l’action politique des tribunaux américains, sans entrer dans quelques détails techniques sur leur constitution et sur leurs formes ; et comment descendre dans les détails sans rebuter, par l’aridité naturelle d’un pareil sujet, la curiosité du lecteur ? Comment rester clair, sans cesser d’être court ?
Je ne me flatte point d’avoir échappé à ces différents périls. Les hommes du monde trouveront encore que je suis trop long ; les légistes penseront que je suis trop bref. Mais c’est là un inconvénient attaché à mon sujet, en général, et à la matière spéciale que je traite dans ce moment.
La plus grande difficulté n’était pas de savoir comment on constituerait le gouvernement fédéral, mais comment on ferait obéir a ses lois.
Les gouvernements, en général, n’ont que deux moyens de vaincre les résistances que leur opposent les gouvernés : la force matérielle qu’ils trouvent en eux-mêmes ; la force morale que leur prêtent les arrêts des tribunaux.
Un gouvernement qui n’aurait que la guerre pour faire obéir à ses lois serait bien près de sa ruine. Il lui arriverait probablement l’une de ces deux choses : s’il était faible et modéré, il n’emploierait la force qu’à la dernière extrémité, et laisserait passer inaperçues une foule de désobéissances partielles ; alors l’État tomberait peu et peu en anarchie.
S’il était audacieux et puissant, il recourrait chaque jour à l’usage de la violence, et bientôt on le verrait [I-225] dégénérer en pur despotisme militaire. Son inaction et son activité seraient également funestes aux gouvernés.
Le grand objet de la justice est de substituer l’idée du droit à celle de la violence ; de placer des intermédiaires entre le gouvernement et l’emploi de la force matérielle.
C’est une chose surprenante que la puissance d’opinion accordée en général, par les hommes, à l’intervention des tribunaux. Cette puissance est si grande, qu’elle s’attache encore à la forme judiciaire quand la substance n’existe plus ; elle donne un corps à l’ombre.
La force morale dont les tribunaux sont revêtus rend l’emploi de la force matérielle infiniment plus rare, en se substituant à elle dans la plupart des cas ; et quand il faut enfin que cette dernière agisse, elle double son pouvoir en s’y joignant.
Un gouvernement fédéral doit désirer plus qu’un autre d’obtenir l’appui de la justice, parce que, de sa nature, il est plus faible, et qu’on peut plus aisément organiser contre lui des résistances [146] . S’il lui fallait arriver toujours et de prime-abord à l’emploi de la force, il ne suffirait point à sa tâche.
Pour faire obéir les citoyens à ses lois, ou repousser les agressions dont elles seraient l’objet, l’Union avait donc un besoin particulier des tribunaux.
[I-226]
Mais de quels tribunaux devait-elle se servir ? Chaque État avait déjà un pouvoir judiciaire organisé dans son sein. Fallait-il recourir à ses tribunaux ? fallait-il créer une justice fédérale ? Il est facile de prouver que l’Union ne pouvait adapter à son usage la puissance judiciaire établie dans les États.
Il importe sans doute a la sécurité de chacun et à la liberté de tous que la puissance judiciaire soit séparée de toutes les autres ; mais il n’est pas moins nécessaire à l’existence nationale que les différents pouvoirs de l’État aient la même origine, suivent les mêmes principes et agissent dans la même sphère, en un mot, qu’ils soient corrélatifs et homogènes. Personne, j’imagine, n’a jamais pensé à faire juger par des tribunaux étrangers les délits commis en France, afin d’être plus sûr de l’impartialité des magistrats.
Les Américains ne forment qu’un seul peuple, par rapport à leur gouvernement fédéral ; mais, au milieu de ce peuple, on a laissé subsister des corps politiques dépendant du gouvernement national en quelques points, indépendants sur tous les autres ; qui ont leur origine particulière, leurs doctrines propres et leurs moyens spéciaux d’agir. Confier l’exécution des lois de l’Union aux tribunaux institués par ces corps politiques, c’était livrer la nation à des juges étrangers.
Bien plus, chaque État n’est pas seulement un étranger par rapport à l’Union, c’est encore un adversaire de tous les jours, puisque la souveraineté de l’Union ne saurait perdre qu’au profit de celle des États.
[I-227]
En faisant appliquer les lois de l’Union par les tribunaux des États particuliers, on livrait donc la nation, non seulement à des juges étrangers, mais encore à des juges partiaux.
D’ailleurs ce n’était pas leur caractère seul qui rendait les tribunaux des États incapables de servir dans un but national ; c’était surtout leur nombre.
Au moment où la constitution fédérale a été formée, il se trouvait déjà aux États-Unis treize cours de justice jugeant sans appel. On en compte vingt-quatre aujourd’hui. Comment admettre qu’un État puisse subsister, lorsque ses lois fondamentales peuvent être interprétées et appliquées de vingt-quatre manières différentes à la fois ! Un pareil système est aussi contraire à la raison qu’aux leçons de l’expérience.
Les législateurs de l’Amérique convinrent donc de créer un pouvoir judiciaire fédéral, pour appliquer les lois de l’Union, et décider certaines questions d’intérêt général, qui furent définies d’avance avec soin.
Toute la puissance judiciaire de l’Union fut concentrée dans un seul tribunal, appelé la cour suprême des États-Unis. Mais pour faciliter l’expédition des affaires, on lui adjoignit des tribunaux intérieurs, chargés de juger souverainement les causes peu importantes, ou de statuer, en première instance, sur des contestations plus graves. Les membres de la cour suprême ne furent pas élus par le peuple ou la législature ; le président des États-Unis dut les choisir après avoir pris l’avis du sénat.
Afin de les rendre indépendants des autres [I-228] pouvoirs, on les inamovibles, et l’on décida que leur traitement, une fois fixé, échapperait au contrôle de la législature [147] .
Il était assez facile de proclamer en principe l’établissement d’une justice fédérale, mais les difficultés naissaient en foule dès qu’il s’agissait de fixer ses attributions.
[I-229]
MANIÈRE DE FIXER LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX FÉDÉRAUX.
Difficulté de fixer la compétence des divers tribunaux dans les confédérations. — Les tribunaux de l’Union obtinrent le droit de fixer leur propre compétence. — Pourquoi cette règle attaque la portion de souveraineté que les États particuliers s’étaient réservée. — La souveraineté de ces États restreinte par les lois et par l’interprétation des lois. — Les États particuliers courent ainsi un danger plus apparent que réel.
Une première question se présentait : la constitution des États-Unis, mettant en regard deux souverainetés distinctes, représentées, quant à la justice, par deux ordres de tribunaux différents, quelque soin qu’on prit d’établir la juridiction de chacun de ces deux ordres de tribunaux, on ne pouvait empêcher qu’il n’y eût de fréquentes collisions entre eux. Or, dans ce cas, à qui devait appartenir le droit d’établir la compétence ?
Citez les peuples qui ne forment qu’une seule et même société politique, lorsqu’une question de compétence s’élève entre deux tribunaux, elle est portée en général devant un troisième qui sert d’arbitre.
Ceci se fait sans peine, parce que, chez ces peuples, les questions de compétence judiciaire n’ont aucun rapport avec les questions de souveraineté nationale.
Mais, au-dessus de la cour supérieure d’un État particulier et de la cour supérieure des États-Unis, il était impossible d’établir un tribunal quelconque qui ne fût ni l’un ni l’autre.
Il fallait donc nécessairement donner à l’une des deux cours le droit de juger dans sa propre cause, [I-230] et de prendre ou de retenir la connaissance de l’affaire qu’on lui contestait. On ne pouvait accorder ce privilège aux diverses cours des États ; c’eût été détruire la souveraineté de l’Union en fait après l’avoir établie en droit ; car l’interprétation de la constitution eût bientôt rendu aux États particuliers la portion d’indépendance que les termes de la constitution leur ôtaient.
En créant un tribunal fédéral, on avait voulu enlever aux cours des États le droit de trancher, chacun à sa manière, des questions d’intérêt national, et parvenir ainsi à former un corps de jurisprudence uniforme pour l’interprétation des lois de l’Union. Le but n’aurait point été atteint si les cours des États particuliers, tout en s’abstenant de juger les procès comme fédéraux, avaient pu les juger en prétendant qu’ils n’étaient pas fédéraux.
La cour suprême des États-Unis fut donc revêtue du droit de décider de toutes les questions de compétence [148] .
Ce fut là le coup le plus dangereux porté à la souveraineté des États. Elle se trouva ainsi restreinte, non seulement par les lois, mais encore par l’interprétation des lois ; par une borne connue et par une [I-231] autre qui ne l’était point ; par une règle fixe et par une règle arbitraire. La constitution avait posé, il est vrai, des limites précises à la souveraineté fédérale ; mais chaque fois que cette souveraineté est en concurrence avec celle des États, un tribunal fédéral doit prononcer.
Du reste, les dangers dont cette manière de procéder semblait menacer la souveraineté des États, n’était pas aussi grands en réalité qu’ils paraissaient l’être.
Nous verrons plus loin qu’en Amérique la force réelle réside dans les gouvernements provinciaux, plus que dans le gouvernement fédéral. Les juges fédéraux sentent la faiblesse relative du pouvoir au nom duquel ils agissent, et ils sont plus près d’abandonner un droit de juridiction dans des cas où la loi le leur donne, que portés à le réclamer illégalement.
DIFFÉRENTS CAS DE JURIDICTION.
La manière et la personne, bases de la juridiction fédérale. — Procès faits à des ambassadeurs, — à l’Union, — à un État particulier. — Par qui jugés. — Procès qui naissent des lois de l’Union. — Pourquoi jugés par les tribunaux fédéraux. — Procès relatifs à l’inexécution des contrats jugés par la justice fédérale. — Conséquence de ceci.
Après avoir reconnu le moyen de fixer la compétence fédérale, les législateurs de l’Union déterminèrent les cas de juridiction sur lesquels elle devait s’exercer.
On admit qu’il y avait certains plaideurs qui ne pouvaient être jugés que par les cours fédérales, quel que fût d’ailleurs l’objet du procès.
[I-232]
On établit ensuite qu’il y avait certains procès qui ne pouvaient être décidés que par ces mêmes cours, quelle que fût d’ailleurs la qualité des plaideurs.
La personne et la matière devinrent donc les deux bases de la compétence fédérale.
Les ambassadeurs représentent les nations amies de l’Union ; tout ce qui intéresse les ambassadeurs intéresse en quelque sorte l’Union entière. Lorsqu’un ambassadeur est partie dans un procès, le procès devient une affaire qui touche au bien-être de la nation ; il est naturel que ce soit un tribunal fédéral qui prononce.
L’Union elle-même peut avoir des procès : dans ce cas, il eut été contraire à la raison, ainsi qu’à l’usage des nations, d’en appeler au jugement des tribunaux représentant une autre souveraineté que la sienne. C’est aux cours fédérales seules à prononcer.
Lorsque deux individus, appartenant à deux États différents, ont un procès, on ne peut, sans inconvénient, les faire juger par les tribunaux de l’un des deux États. Il est plus sur de choisir un tribunal qui ne puisse exciter les soupçons d’aucune des parties, et le tribunal qui se présente tout naturellement, c’est celui de l’Union.
Lorsque les deux plaideurs sont, non plus des individus isolés, mais des États, à la même raison d’équité vient se joindre une raison politique du premier ordre. Ici la qualité des plaideurs donne une importance nationale à tous les procès ; la moindre question litigieuse entre deux États intéresse la paix de l’Union tout entière [149] .
[I-233]
Souvent la nature même des procès dut servir de règle à la compétence. C’est ainsi que toutes les questions qui se rattachent au commerce maritime durent être tranchées par les tribunaux fédéraux [150] .
La raison est facile à indiquer : presque toutes ces questions rentrent dans l’appréciation du droit des gens. Sous ce rapport, elles intéressent essentiellement l’Union entière vis-à-vis des étrangers. D’ailleurs, la mer n’étant point renfermée dans une circonscription judiciaire plutôt que dans une autre, il n’y a que la justice nationale qui puisse avoir un titre à connaître des procès qui ont une origine maritime.
La constitution a renfermé dans une seule catégorie presque tous les procès qui, par leur nature, doivent ressortir des cours fédérales.
La règle qu’elle indique à cet égard est simple, mais elle comprend, à elle seule un vaste système d’idées et une multitude de faits.
Les cours fédérales, dit-elle, devront juger tous les procès qui prendront naissance dans les lois des États-Unis.
[I-234]
Deux exemples feront parfaitement comprendre la pensée du législateur.
La constitution interdit aux États le droit de faire des lois sur la circulation de l’argent ; malgré cette prohibition, un État fait une loi semblable. Les parties intéressées refusent d’obéir, attendu qu’elle est contraire à la constitution. C’est devant un tribunal fédéral qu’il faut aller, parce que le moyen d’attaque est pris dans les lois des États-Unis.
Le congrès établit un droit d’importation. Des difficultés s’élèvent sur la perception de ce droit. C’est encore devant les tribunaux fédéraux qu’il faut se présenter, parce que la cause du procès est dans l’interprétation d’une loi des États-Unis.
Cette règle est parfaitement d’accord avec les bases adoptées pour la constitution fédérale.
L’Union, telle qu’on l’a constituée en 1789, n’a, il est vrai, qu’une souveraineté restreinte, mais on a voulu que dans ce cercle elle ne formât qu’un seul et même peuple [151] . Dans ce cercle, elle est souveraine. Ce point posé et admis, tout le reste devient facile ; car si vous reconnaissez que les États-Unis, dans les limites posées par leur constitution, ne forment qu’un peuple, il faut bien leur accorder les droits qui appartiennent à tous les peuples.
Or, depuis l’origine des sociétés, on est d’accord sur ce point : que chaque peuple a le droit de faire [I-235] juger par ses tribunaux toutes les questions qui se rapportent à l’exécution de ses propres lois. Mais on répond : L’Union est dans cette position singulière qu’elle ne forme un peuple que relativement à certains objets ; pour tous les autres elle n’est rien. Qu’en résulte-t-il ? C’est que, du moins pour toutes les lois qui se rapportent à ces objets, elle a les droits qu’on accorderait à une souveraineté complète. Le point réel de la difficulté est de savoir quels sont ces objets. Ce point tranché (et nous avons vu plus haut, en traitant de la compétence, comment il l’avait été), il n’y a plus, à vrai dire, de questions ; car une fois qu’on a établi qu’un procès était fédéral, c’est-à-dire rentrait dans la part de souveraineté réservée à l’Union par la constitution, il s’ensuivait naturellement qu’un tribunal fédéral devait seul prononcer.
Toutes les fois donc qu’on veut attaquer les lois des États-Unis, ou les invoquer pour se défendre, c’est aux tribunaux fédéraux qu’il faut s’adresser.
Ainsi, la juridiction des tribunaux de l’Union s’étend ou se resserre suivant que la souveraineté de l’Union se resserre ou s’étend elle-même.
Nous avons vu que le but principal des législateurs de 1789 avait été de diviser la souveraineté en deux parts distinctes. Dans l’une, ils placèrent la direction de tous les intérêts généraux de l’Union, dans l’autre, la direction de tous les intérêts spéciaux à quelques unes de ses parties.
Leur principal soin fut d’armer le gouvernement fédéral d’assez de pouvoirs pour qu’il pût ; dans sa sphère, se défendre contre les empiétements des États particuliers.
[I-236]
Quant à ceux-ci, on adopte comme principe général de les laisser libres dans la leur. Le gouvernement central ne peut ni les diriger, ni même y inspecter leur conduite.
J’ai indiqué au chapitre de la division des pouvoirs que ce dernier principe n’avait pas toujours été respecté. Il y a certaines lois qu’un État particulier ne peut faire, quoiqu’elles n’intéressent en apparence que lui seul.
Lorsqu’un État de l’Union rend une loi de cette nature, les citoyens qui sont lésés par l’exécution de cette loi peuvent en appeler aux cours fédérales.
Ainsi, la juridiction des cours fédérales s’étend non seulement à tous les procès qui prennent leur source dans les lois de l’Union, mais encore à tous ceux qui naissent dans les lois que les États particuliers ont faites contrairement à la constitution.
On interdit aux États de promulguer des lois rétroactives en matière criminelle ; l’homme qui est condamné en vertu d’une loi de cette espèce peut en appeler à la justice fédérale.
La constitution a également interdit aux États de faire des lois qui puissent détruire ou altérer les droits acquis en vertu d’un contrat (impairing the obligations of contracts) [152] .
[I-237]
Du moment où un particulier croit voir qu’une loi de son État blesse un droit de cette espèce, il peut refuser d’obéir, et en appeler à la justice fédérale [153] .
Cette disposition me paraît attaquer plus profondément que tout le reste la souveraineté des États.
Les droits accordés au gouvernement fédéral, dans des buts évidemment nationaux, sont définis et faciles à comprendre. Ceux que lui concède indirectement l’article que je viens de citer ne tombent pas facilement sous le sens, et leurs limites ne sont pas nettement tracées. Il y a en effet une multitude de lois politiques qui réagissent sur l’existence des contrats et qui pourraient ainsi fournir matière à un empiétement du pouvoir central.
[I-238]
MANIÈRE DE PROCÉDER DES TRIBUNAUX FÉDÉRAUX.
Faiblesse naturelle de la justice dans les confédérations. — Efforts que doivent faire les législateurs pour ne placer, autant que possible, que des individus isolés, et non des États, en face des tribunaux fédéraux. — Comment les Américains y sont parvenus. — Action directe des tribunaux fédéraux sur les simples particuliers. — Attaque indirecte contre les États qui violent les lois de l’Union. — L’arrêt de la justice Fédérale ne détruit pas la loi provinciale, il l’énerve.
J’ai fait connaître quels étaient les droits des cours fédérales ; il n’importe pas moins de savoir comment elles les exercent.
La force irrésistible de la justice, dans les pays où la souveraineté n’est point partagée, vient de ce que les tribunaux, dans ces pays, représentent la nation tout entière en lutte avec le seul individu que l’arrêt a frappé. À l’idée du droit se joint l’idée de la force qui appuie le droit.
Mais dans les pays ou la souveraineté est divisée, il n’en est pas toujours ainsi. La justice y trouve le plus souvent en face d’elle, non un individu isolé, mais une fraction de la nation. Sa puissance morale et sa force matérielle en deviennent moins grandes.
Dans les États fédéraux, la justice est donc naturellement plus faible et le justiciable plus fort.
Le législateur, dans les confédérations, doit travailler sans cesse à donner aux tribunaux une place analogue à celle qu’ils occupent chez les peuples qui n’ont pas partagé la souveraineté ; en d’autres termes, ses plus constants efforts doivent tendre à ce que la justice fédérale représente la nation, et le justiciable un intérêt particulier.
[I-239]
Un gouvernement, de quelque nature qu’il soit, a besoin d’agir sur les gouvernés, pour les forcer à lui rendre ce qui lui est dû ; il a besoin d’agir contre eux pour se défendre de leurs attaques.
Quant à l’action directe du gouvernement sur les gouvernés, pour les forcer d’obéir aux lois, la constitution des États-Unis fit en sorte (et ce fut là son chef-d’œuvre) que les cours fédérales, agissant au nom de ces lois, n’eussent jamais affaire qu’à des individus. En effet, comme on avait déclaré que la confédération ne formait qu’un seul et même peuple dans le cercle tracé par la constitution, il en résultait que le gouvernement créé par cette constitution et agissant dans ses limites, était revêtu de tous les droits d’un gouvernement national, dont le principal est de faire parvenir ses injonctions sans intermédiaire jusqu’au simple citoyen. Lors donc que l’Union ordonna la levée d’un impôt, par exemple, ce ne fut point aux États qu’elle dut s’adresser pour le percevoir, mais à chaque citoyen américain, suivant sa cote. La justice fédérale, à son tour, chargée d’assurer l’exécution de cette loi de l’Union, eut à condamner, non l’État récalcitrant, mais le contribuable. Comme la justice des autres peuples, elle ne trouva vis-à-vis d’elle qu’un individu.
Remarquez qu’ici l’Union a choisi elle-même son adversaire. Elle l’a choisi faible ; il est tout naturel qu’il succombe.
Mais quand l’Union, au lieu d’attaquer, en est réduite elle-même à se défendre, la difficulté augmente. La constitution reconnaît aux États le pouvoir de faire des lois. Ces lois peuvent violer les droits de [I-240] l’Union. Ici, nécessairement, on se trouve en lutte avec la souveraineté de l’État qui a fait la loi. Il ne reste plus qu’à choisir, parmi les moyens d’action, le moins dangereux. Ce moyen était indiqué d’avance par les principes généraux que j’ai précédemment énoncés [154] .
On conçoit que dans le cas que je viens de supposer, l’Union aurait pu citer l’État devant un tribunal fédéral, qui eût déclaré la loi nulle ; c’eût été suivre la marche la plus naturelle des idées. Mais, de cette manière, la justice fédérale se serait trouvée directement en face d’un État, ce qu’on voulait, autant que possible, éviter.
Les Américains ont pensé qu’il était presque impossible qu’une loi nouvelle ne lésât pas dans son exécution quelque intérêt particulier.
C’est sur cet intérêt particulier que les auteurs de la constitution fédérale se reposent pour attaquer la mesure législative dont l’Union peut avoir et se plaindre. C’est à lui qu’ils offrent un abri.
Un État vend des terres à une compagnie ; un an après, une nouvelle loi dispose autrement des mêmes terres, et viole ainsi cette partie de la constitution qui défend de changer les droits acquis par un contrat. Lorsque celui qui a acheté en vertu de la nouvelle loi se présente pour entrer en possession, le possesseur, qui tient ses droits de l’ancienne, l’actionne devant les tribunaux de l’Union, et fait déclarer son titre nul [155] . Ainsi, en réalité, la justice fédérale se trouve aux prises avec la souveraineté de [I-241] l’État ; mais elle ne l’attaque qu’indirectement et sur une application de détail. Elle frappe ainsi la loi dans ses conséquences, non dans son principe ; elle ne la détruit pas, elle l’énerve.
Restait enfin une dernière hypothèse :
Chaque État formait une corporation qui avait une existence et des droits civils à part ; conséquemment, il pouvait actionner ou être actionné devant les tribunaux. Un État pouvait, par exemple, poursuivre en justice un autre État.
Dans ce cas, il ne s’agissait plus pour l’Union d’attaquer une loi provinciale, mais de juger un procès dans lequel un État était partie. C’était un procès comme un autre ; la qualité seule des plaideurs était différente. Ici le danger signalé au commencement de ce chapitre existe encore ; mais cette fois on ne saurait l’éviter ; il est inhérent à l’essence même des constitutions fédérales, dont le résultat sera toujours de créer au sein de la nation des particuliers assez puissants pour que la justice s’exerce contre eux avec peine.
RANG ÉLEVÉ QU’OCCUPE LA COUR SUPRÊME PARMI LES GRANDS POUVOIRS DE L’ÉTAT.
Aucun peuple n’a constitué un aussi grand pouvoir judiciaire que les Américains. — Étendue de ses attributions. — Son influence politique. — La paix et l’existence même de l’Union dépendent de la sagesse des sept juges fédéraux.
Quand, après avoir examiné en détail l’organisation de la cour suprême, on arrive à considérer dans leur ensemble les attributions qui lui ont été don[I-242] nées, on découvre sans peine que jamais un plus immense pouvoir judiciaire n’a été constitué chez aucun peuple.
La cour suprême est placée plus haut qu’aucun tribunal connu, et par la nature de ses droits et par l’espèce de ses justiciables.
Chez toutes les nations policées de l’Europe, le gouvernement a toujours montré une grande répugnance à laisser la justice ordinaire trancher des questions qui l’intéressaient lui-même. Cette répugnance est naturellement plus grande lorsque le gouvernement est plus absolu. À mesure, au contraire, que la liberté augmente, le cercle des attributions des tribunaux va toujours en s’élargissant ; mais aucune des nations européennes n’a encore pensé que toute question judiciaire, quelle qu’en fût l’origine, pût être abandonnée aux juges du droit commun.
En Amérique, on a mis cette théorie en pratique. La cour suprême des États-Unis est le seul et unique tribunal de la nation.
Elle est chargée de l’interprétation des lois et de celle des traités ; les questions relatives au commerce maritime, et toutes celles en général qui se rattachent au droit des gens, sont de sa compétence exclusive. On peut même dire que ses attributions sont presque entièrement politiques, quoique sa constitution soit entièrement judiciaire. Son unique but est de faire exécuter les lois de l’Union, et l’Union ne règle que les rapports du gouvernement avec les gouvernés, et de la nation avec les étrangers ; les rapports des citoyens entre eux sont presque tous régis par la souverainté des États.
[I-243]
À cette première cause d’importance, il faut en ajouter une autre plus grande encore. Chez les nations de l’Europe, les tribunaux n’ont que des particuliers pour justiciables ; mais on peut dire que la cour suprême des États-Unis fait comparaître des souverains à sa barre. Lorsque l’huissier ; s’avançant sur les degrés du tribunal, vient à prononcer ce peu de mots ; « L’État de New-York contre celui de l’Ohio, » on sent qu’on n’est point là dans l’enceinte d’une cour de justice ordinaire. Et quand on songe que l’un de ces plaideurs représente un million d’hommes, et l’autre deux millions, on s’étonne de la responsabilité qui pèse sur les sept juges dont l’arrêt va réjouir ou attrister un si grand nombre de leurs concitoyens.
Dans les mains des sept juges fédéraux reposent incessamment la paix, la prospérité, l’existence même de l’Union. Sans eux, la constitution est une œuvre morte ; c’est à eux qu’en appelle le pouvoir exécutif pour résister aux empiétements du corps législatif ; la législature, pour se défendre des entreprises du pouvoir exécutif ; l’Union, pour se faire obéir des États ; les États, pour repousser les prétentions exagérées de l’Union ; l’intérêt public contre l’intérêt privé ; l’esprit de conservation contre l’instabilité démocratique. Leur pouvoir est immense ; mais c’est un pouvoir d’opinion. Ils sont tout-puissants tant que le peuple consent à obéir à la loi ; ils ne peuvent rien dès qu’il la méprise. Or, la puissance d’opinion est celle dont il est le plus difficile de faire usage, parce qu’il est impossible de dire exactement où sont ses limites. Il est souvent aussi dangereux de rester en deçà que de les dépasser.
[I-244]
Les juges fédéraux ne doivent donc pas seulement être de bons citoyens, des hommes instruits et probes, qualités nécessaires à tous magistrats, il faut encore trouver en eux des hommes d’État ; il faut qu’ils sachent discerner l’esprit de leur temps, affronter les obstacles qu’on peut vaincre, et se détourner du courant lorsque le flot menace d’emporter avec eux-mêmes la souveraineté de l’Union et l’obéissance due à ses lois.
Le président peut faillir sans que l’État souffre, parce que le président n’a qu’un pouvoir borné. Le congrès peut errer sans que l’Union périsse, parce qu’au-dessus du congrès réside le corps électoral qui peut en changer l’esprit en changeant ses membres.
Mais si la cour suprême venait jamais à être composée d’hommes imprudents ou corrompus, la confédération aurait a craindre l’anarchie ou la guerre civile.
Du reste, qu’on ne s’y trompe point, la cause originaire du danger n’est point dans la constitution du tribunal, mais dans la nature même des gouvernements fédéraux. Nous avons vu que nulle part il n’est plus nécessaire de constituer fortement le pouvoir judiciaire que chez les peuples confédérés, parce que nulle part les existences individuelles, qui peuvent lutter contre le corps social, ne sont plus grandes et mieux en état de résister à l’emploi de la force matérielle du gouvernement.
Or, plus il est nécessaire qu’un pouvoir soit fort, plus il faut lui donner d’étendue et d’indépendance. Plus un pouvoir est étendu et indépendant, et plus l’abus qu’on en peut faire est dangereux. L’origine du [I-245] mal n’est donc point dans la constitution de ce pouvoir, mais dans la constitution même de l’État qui nécessite l’existence d’un pareil pouvoir.
EN QUOI LA CONSTITUTION FÉDÉRALE EST SUPÉRIEURE À LA CONSTITUTION DES ÉTATS.
Comment on peut comparer la constitution de l’Union à celle des États particuliers. — On doit particulièrement attribuer à la sagesse des législateurs fédéraux la supériorité de la constitution de l’Union. — La législature de l’Union moins dépendante du peuple que celle des États. — Le pouvoir exécutif plus libre dans sa sphère. — Le pouvoir judiciaire moins assujetti aux volontés de la majorité. — Conséquences pratiques de ceci. — Les législateurs fédéraux ont atténué les dangers inhérents au gouvernement de la démocratie ; les législateurs des États ont accru ces dangers.
La constitution fédérale diffère essentiellement de la constitution des États par le but qu’elle se propose, mais elle s’en rapproche beaucoup quant aux moyens d’atteindre ce but. L’objet du gouvernement est différent, mais les formes du gouvernement sont les mêmes. Sous ce point de vue spécial, ou peut utilement les comparer.
Je pense que la constitution fédérale est supérieure à toutes les constitutions d’État. Cette supériorité tient à plusieurs causes.
La constitution actuelle de l’Union n’a été formée que postérieurement à celles de la plupart des États ; on a donc pu profiter de l’expérience acquise.
Ou se convaincra toutefois que cette cause n’est que secondaire, si l’on songe que, depuis l’établissement de la constitution fédérale, la confédération fédérale, la confédération américaine s’est accrue de onze nouveaux États, et que [I-246] ceux-ci ont presque toujours exagéré plutôt qu’atténué les défauts existants dans les constitutions de leurs devanciers.
La grande cause de la supériorité de la constitution fédérale est dans le caractère même des législateurs.
À l’époque où elle fut formée, la ruine de la confédération paraissait imminente ; elle était pour ainsi dire présente à tous les yeux. Dans cette extrémité le peuple choisit, non pas peut-être les hommes qu’il aimait le mieux, mais ceux qu’il estimait le plus.
J’ai déjà fait observer plus haut que les législateurs de l’Union avaient presque tous été remarquables par leurs lumières, plus remarquables encore par leur patriotisme.
Ils s’étaient tous élevés au milieu d’une crise sociale, pendant laquelle l’esprit de liberté avait eu continuellement à lutter contre une autorité forte et dominatrice. La lutte terminée, et tandis que, suivant l’usage, les passions excitées de la foule s’attachaient encore à combattre des dangers qui depuis longtemps n’existaient plus, eux s’étaient arrêtés ; ils avaient jeté un regard plus tranquille et plus pénétrant sur leur patrie ; ils avaient vu qu’une révolution définitive était accomplie, et que désormais les périls qui menaçaient le peuple ne pouvaient naître que des abus de la liberté. Ce qu’ils pensaient, ils eurent le courage de le dire, parce qu’ils sentaient au fond de leur cœur un amour sincère et ardent pour cette même liberté ; ils osérent parler de la restreindre, parce qu’ils étaient sûrs de ne pas vouloir la détruire [156] .
[I-247]
La plupart des constitutions d’État ne donnent au mandat de la chambre des représentants qu’un an de durée, et deux à celui du sénat. De telle sorte que les membres du corps législatif sont liés sans cesse, et de la manière la plus étroite, aux moindres désirs de leurs constituants.
[I-248]
Les législateurs de l’Union pensèrent que cette extrême dépendance de la législature dénaturait les principaux effets du système représentatif, en plaçant dans le peuple lui-même non seulement l’origine des pouvoirs, mais encore le gouvernement.
Ils accrurent la durée du mandat électoral pour laisser au député un plus grand emploi de son libre arbitre.
La constitution fédérale, comme les différentes constitutions d’États, divisa le corps législatif en deux branches.
Mais, dans les États, on composa ces deux parties de la législature des mêmes éléments et suivant le même mode, l’élection. Il en résulta que les passions et les volontés de la majorité se firent jour avec la même facilité, et trouvèrent aussi rapidement un organe et un instrument dans l’une que dans l’autre chambre. Ce qui donna un caractère violent et précipité à la formation des lois.
La constitution fédérale fit aussi sortir les deux chambres des votes du peuple ; mais elle varia les conditions d’éligibilité et le mode de l’élection ; afin que si, comme chez certaines nations, l’une des deux branches de la législature ne représentait pas des intérêts différents de l’autre, elle représentât au moins une sagesse supérieure.
Il fallut avoir atteint un âge mûr pour être sénateur, et ce fut une assemblée déjà choisie elle-même et peu nombreuse qui fut chargée d’élire.
Les démocraties sont naturellement portées à concentrer toute la force sociale dans les mains du corps législatif. Celui-ci étant le pouvoir qui émane le plus [I-249] directement du peuple, est aussi celui qui participe le plus de sa toute-puissance.
Ou remarque donc en lui une tendance habituelle qui le porte à réunir toute espèce d’autorité dans son sein.
Cette concentration des pouvoirs, en même temps qu’elle nuit singulièrement à la bonne conduite des affaires, fonde le despotisme de la majorité.
Les législateurs des États se sont fréquemment abandonnés à ces instincts de la démocratie ; ceux de l’Union ont toujours courageusement lutté contre eux.
Dans les États, le pouvoir exécutif est remis aux mains d’un magistrat placé en apparence à côté de la législature, mais qui, en réalité, n’est qu’un agent aveugle et un instrument passif de ses volontés. Où puiserait-il sa force ? Dans la durée des fonctions ? Il n’est en général nommé que pour une année. Dans ses prérogatives ? Il n’en a point pour ainsi dire. La législature peut le réduire à l’impuissance, en chargeant de l’exécution de ses lois des commissions spéciales prises dans son sein. Si elle le voulait, elle pourrait en quelque sorte l’annuler en lui retranchant son traitement.
La constitution fédérale a concentré tous les droits du pouvoir exécutif, comme toute sa responsabilité, sur un seul homme. Elle a donné au président quatre ans d’existence ; elle lui a assuré, pendant toute la durée de sa magistrature, la jouissance de son traitement ; elle lui a composé une clientèle, et l’a armé d’un véto suspensif. En un mot, après avoir soigneusement tracé la sphère du pouvoir exécutif, elle a [I-250] cherché à lui donner autant que possible, dans cette sphère, une position forte et libre.
Le pouvoir judiciaire est de tous les pouvoirs celui qui, dans les constitutions d’État, est resté le moins dépendant de la puissance législative.
Toutefois, dans tous les États, la législature est demeurée maîtresse de fixer les émoluments des juges, ce qui soumet nécessairement ces derniers à son influence immédiate.
Dans certains États, les juges ne sont nommés que pour un temps, ce qui leur ôte encore une grande partie de leur force et de leur liberté.
Dans d’autres, on voit les pouvoirs législatifs et judiciaires entièrement confondus. Le sénat de New-York, par exemple, forme pour certains procès le tribunal supérieur de l’État.
La constitution fédérale a pris soin, au contraire, de séparer le pouvoir judiciaire de tous les autres. Elle a de plus rendu les juges indépendants, en déclarant leur traitement fixe et leurs fonctions irrévocables.
Les conséquences pratiques de ces différences sont faciles à apercevoir. Il est évident, pour tout observateur attentif, que les affaires de l’Union sont infiniment mieux conduites que les affaires particulières d’aucun État.
Le gouvernement fédéral est plus juste et plus modéré dans sa marche que celui des États. Il y a plus de sagesse dans ses vues, plus de durée et de combinaison savante dans ses projets, plus d’habileté, de suite et de fermeté dans l’exécution de ses mesures.
Peu de mots suffisent pour résumer ce chapitre.
[I-251]
Deux dangers principaux menacent l’existence des démocraties :
L’asservissement complet du pouvoir législatif aux volontés du corps électoral.
La concentration, dans le pouvoir législatif, de tous les autres pouvoirs du gouvernement.
Les législateurs des États ont favorisé le développement de ces dangers. Les législateurs de l’Union ont fait ce qu’ils ont pu pour les rendre moins redoutables.
CE QUI DISTINGUE LA CONSTITUTION FÉDÉRALE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE DE TOUTES LES AUTRES CONSTITUTIONS FÉDÉRALES.
La confédération américaine ressemble en apparence à toutes les autres confédérations. — Cependant ses effets sont différents. — D’où vient cela ? — En quoi cette confédération s’éloigne de toutes les autres. — Le gouvernement américain n’est point un gouvernement fédéral, mais un gouvernement national incomplet.
Les États-Unis d’Amérique n’ont pas donné le premier et unique exemple d’une confédération. Sans parler de l’antiquité, l’Europe moderne en a fourni plusieurs. La Suisse, l’Empire germanique, la république des Pays-Bas, ont été ou sont encore des confédérations.
Quand on étudie les constitutions de ces différents pays, on remarque avec surprise que les pouvoirs conférés par elles au gouvernement fédéral sont à peu près les mêmes que ceux accordés par la constitution américaine au gouvernement des États-Unis. Comme cette dernière, elle donne à la puissance [I-252] centrale le droit de faire la paix et la guerre, le droit de lever les hommes et l’argent, de pourvoir aux besoins généraux et de régler les intérêts communs de la nation.
Cependant le gouvernement fédéral, chez ces différents peuples, est presque toujours resté débile et impuissant, tandis que celui de l’Union conduit les affaires avec vigueur et facilité.
Il y a plus, la première Union américaine n’a pas pu subsister, à cause de l’excessive faiblesse de son gouvernement, et pourtant ce gouvernement si faible avait reçu des droits aussi étendus que le gouvernement fédéral de nos jours. On peut même dire qu’à certains égards ses privilèges étaient plus grands.
Il se trouve donc dans la constitution actuelle des États-Unis quelques principes nouveaux qui ne frappent point d’abord, mais dont l’influence se fait profondément sentir.
Cette constitution, qu’à la première vue on est tenté de confondre avec les constitutions fédérales qui l’ont précédée, repose en effet sur une théorie entièrement nouvelle, et qui doit marquer comme une grande découverte dans la science politique de nos jours.
Dans toutes les confédérations qui ont précédé la confédération américaine de 1789, les peuples qui s’alliaient dans un but commun consentaient à obéir aux injonctions d’un gouvernement fédéral ; mais ils gardaient le droit d’ordonner et de surveiller chez eux l’exécution des lois de l’Union.
Les États américains qui s’unirent en 1789 ont non [I-253] seulement consenti à ce que le gouvernement fédéral leur dictât des lois, mais encore à ce qu’il fît exécuter lui-même ses lois.
Dans les deux cas le droit est le même, l’exercice seul du droit est différent. Mais cette seule différence produit d’immenses résultats.
Dans toutes les confédérations qui ont précédé l’Union américaine de nos jours, le gouvernement fédéral, afin de pourvoir à ses besoins, s’adressait aux gouvernements particuliers. Dans le cas où la mesure prescrite déplaisait à l’un d’eux, ce dernier pouvait toujours se soustraire à la nécessité d’obéir. S’il était fort, il en appelait aux armes ; s’il était faible, il tolérait la résistance aux lois de l’Union devenues les siennes, prétextait l’impuissance, et recourait à la force d’inertie.
Aussi a-t-on constamment vu arriver l’une de ces deux choses : le plus puissant des peuples unis, prenant en main les droits de l’autorité fédérale, a dominé tous les autres en son nom [157] ; ou le gouvernement fédéral est resté abandonné à ses propres forces, et alors l’anarchie s’est établie parmi les confédérés et l’Union est tombée dans l’impuissance d’agir [158] .
En Amérique, l’Union a pour gouvernés, non des [I-254] États, mais de simples citoyens. Quand elle veut lever une taxe, elle ne s’adresse pas au gouvernement du Massachusetts, mais à chaque habitant du Massachusetts. Les anciens gouvernements fédéraux avaient en face d’eux des peuples, celui de l’Union a des individus. Il n’emprunte point sa force, mais il la puise en lui-même. Il a ses administrateurs à lui, ses tribunaux, ses officiers de justice et son armée.
Sans doute l’esprit national, les passions collectives, les préjugés provinciaux de chaque État, tendent encore singulièrement à diminuer l’étendue du pouvoir fédéral ainsi constitué, et à créer des centres de résistance à ses volontés ; restreint dans sa souveraineté, il ne saurait être aussi fort que celui qui la possède tout entière ; mais c’est là un mal inhérent au système fédératif.
En Amérique, chaque État a beaucoup moins d’occasions et de tentations de résister ; et si la pensée lui en vient, il ne peut la mettre à exécution qu’en violant ouvertement les lois de l’Union, en interrompant le cours ordinaire de la justice, en levant l’étendard de la révolte ; il lui faut, en un mot, prendre tout d’un coup un parti extrême, ce que les hommes hésitent long-temps à faire.
Dans les anciennes confédérations, les droits accordés à l’Union étaient pour elle des causes de guerres et non de puissance, puisque ces droits multipliaient ses exigences, sans augmenter ses moyens de se faire obéir. Aussi a-t-on presque toujours vu la faiblesse réelle des gouvernements fédéraux croître en raison directe de leur pouvoir nominal.
Il n’en est pas ainsi dans l’Union américaine ; comme [I-255] la plupart des gouvernements ordinaires, le gouvernement fédéral peut faire tout ce qu’on lui donne le droit d’exécuter.
L’esprit humain invente plus facilement les choses que les mots : de là vient l’usage de tant de termes impropres et d’expressions incomplètes.
Plusieurs nations forment une ligue permanente et établissent une autorité suprême, qui, sans avoir action sur les simples citoyens, comme pourrait le faire un gouvernement national, a cependant action sur chacun des peuples confédérés, pris en corps.
Ce gouvernement, si différent de tous les autres, reçoit le nom de fédéral.
On découvre ensuite une forme de société dans laquelle plusieurs peuples se fondent réellement en un seul quant à certains intérêts communs, et restent séparés et seulement confédérés pour tous les autres.
Ici le pouvoir central agit sans intermédiaire sur les gouvernés, les administre et les juge lui-même, comme le font les gouvernements nationaux, mais il n’agit ainsi que dans un cercle restreint. Évidemment ce n’est plus la un gouvernement fédéral, c’est un gouvernement national incomplet. Ainsi on a trouvé une forme de gouvernement qui n’était précisément ni nationale ni fédérale ; mais on s’est arrêté là, et le mot nouveau qui doit exprimer la chose nouvelle n’existe point encore.
C’est pour n’avoir pas connu cette nouvelle espèce de confédération, que toutes les Unions sont arrivées à la guerre civile, à l’asservissement, ou à l’inertie. Les peuples qui les composaient ont tous manqué de [I-256] lumières pour voir le remède à leurs maux, ou de courage pour l’appliquer.
La première Union américaine était aussi tombée dans les mêmes défauts.
Mais en Amérique, les États confédérés, avant d’arriver à l’indépendance, avaient long-temps fait partie du même empire ; ils n’avaient donc point encore contracté l’habitude de se gouverner complétement eux-mêmes, et les préjugés nationaux n’avaient pu jeter de profondes racines ; plus éclairés que le reste du monde, ils étaient entre eux égaux en lumières, ils ne sentaient que faiblement les passions qui, d’ordinaire, s’opposent chez les peuples à l’extension du pouvoir fédéral, et ces passions étaient combattues par les plus grands citoyens. Les Américains, en même temps qu’ils sentirent le mal, envisagèrent avec fermeté le remède. Ils corrigèrent leurs lois et sauvèrent le pays.
[I-257]
DES AVANTAGES DU SYSTÈME FÉDÉRATIF, EN GÉNÉRAL, ET DE SON UTILITÉ SPÉCIALE POUR L’AMÉRIQUE.
Bonheur et liberté dont jouissent les petites nations. — Puissance des grandes nations. — Les grands empires favorisent les développements de la civilisation. — Que la force est souvent pour les nations le premier élément de prospérité. — Le système fédéral a pour but d’unir les avantages que les peuples tirent de la grandeur et de la petitesse de leur territoire. — Avantages que les États-Unis retirent de ce système. — La loi se plie aux besoins des populations, et les populations ne se plient pas aux nécessités de la loi. — Activité, progrès, goût et usage de la liberté parmi les peuples américains. — L’esprit public de l’Union n’est que le résumé du patriotisme provincial. — Les choses et les idées circulent librement sur le territoire des États-Unis. — L’Union est libre et heureuse comme une petite nation, respectée comme une grande.
Chez les petites nations, l’œil de la société pénètre partout ; l’esprit d’amélioration descend jusque dans les moindres détails : l’ambition du peuple étant fort tempérée par sa faiblesse, ses efforts et ses ressources se tournent presque entièrement vers son bien-être intérieur, et ne sont point sujets à se dissiper en vaine fumée de gloire. De plus, les facultés de chacun y étant généralement bornées, les désirs le sont également. La médiocrité des fortunes y rend les conditions à peu près égales ; les mœurs y ont une allure simple et paisible. Ainsi, à tout prendre et en faisant état des divers degrés de moralité et de lumière, on rencontre ordinairement chez les petites nations plus d’aisance, de population et de tranquillité que chez les grandes.
Lorsque la tyrannie vient à s’établir dans le sein d’une petite nation, elle y est plus incommode que partout ailleurs, parce qu’agissant dans un cercle plus [I-258] restreint, elle s’étend à tout dans ce cercle. Ne pouvant se prendre à quelque grand objet, elle s’occupe d’une multitude de petits ; elle se montre à la fois violente et tracassière. Du monde politique, qui est, à proprement parler, son domaine, elle pénètre dans la vie privée. Après les actions, elle aspire à régenter les goûts, après l’État, elle veut gouverner les familles. Mais cela arrive rarement ; la liberté forme, à vrai dire, la condition naturelle des petites sociétés. Le gouvernement y offre trop peu d’appât à l’ambition, les ressources des particuliers y sont trop bornées, pour que le souverain pouvoir s’y concentre aisément dans les mains d’un seul. Le cas arrivant, il n’est pas difficile aux gouvernés de s’unir, et, par un effort commun, de renverser en même temps le tyran et la tyrannie.
Les petites nations ont donc été de tout temps le berceau de la liberté politique. Il est arrivé que la plupart d’entre elles ont perdu cette liberté en grandissant ; ce qui fait bien voir qu’elle tenait à la petitesse du peuple et non au peuple lui-même.
L’histoire du monde ne fournit pas d’exemple d’une grande nation qui soit restée long-temps en république [159] , ce qui a fait dire que la chose était impraticable. Pour moi, je pense qu’il est bien imprudent à l’homme de vouloir borner le possible, et juger l’avenir, lui auquel le réel et le présent échappent tous les jours, et qui se trouve sans cesse surpris à l’improviste dans les choses qu’il connaît le mieux. [I-259] Ce qu’on peut dire avec certitude, c’est que l’existence d’une grande république sera toujours infiniment plus exposée que celle d’une petite.
Toutes les passions fatales aux républiques grandissent avec l’étendue du territoire, tandis que les vertus qui leur servent d’appui ne s’accroissent point suivant la même mesure.
L’ambition des particuliers augmente avec la puissance de l’État ; la force des partis, avec l’importance du but qu’ils se proposent ; mais l’amour de la patrie, qui doit lutter contre ces passions destructives, n’est pas plus fort dans une vaste république que dans une petite. Il serait même facile de prouver qu’il y est moins développé et moins puissant. Les grandes richesses et les profondes misères, les métropoles, la dépravation des mœurs, l’égoïsme individuel, la complication des intérêts, sont autant de périls qui naissent presque toujours de la grandeur de l’État. Plusieurs de ces choses ne nuisent point à l’existence d’une monarchie, quelques unes même peuvent concourir à sa durée. D’ailleurs, dans les monarchies, le gouvernement a une force qui lui est propre ; il se sert du peuple et ne dépend pas de lui ; plus le peuple est grand, plus le prince est fort ; mais le gouvernement républicain ne peut opposer à ces dangers que l’appui de la majorité. Or, cet élément de force n’est pas plus puissant, proportion gardée, dans une vaste république que dans une petite. Ainsi, tandis que les moyens d’attaque augmentent sans cesse de nombre et de pouvoir, la force de résistance reste la même. On peut même dire qu’elle diminue, car plus le peuple est nombreux et plus la nature des esprits et [I-260] des intérêts se diversifie, plus par conséquent il est difficile de former une majorité compacte.
On a pu remarquer d’ailleurs que les passions humaines acquéraient de l’intensité, non seulement par la grandeur du but qu’elles veulent atteindre, mais aussi par la multitude d’individus qui les ressentent en même temps. Il n’est personne qui ne se soit trouvé plus ému au milieu d’une foule agitée qui partageait son émotion, que s’il eût été seul à l’éprouver. Dans une grande république, les passions politiques deviennent irrésistibles, non seulement parce que l’objet qu’elles poursuivent est immense, mais encore parce que des millions d’hommes les ressentent de la même manière et dans le même moment.
Il est donc permis de dire d’une manière générale que rien n’est si contraire au bien-être et à la liberté des hommes que les grands empires.
Les grands États ont cependant des avantages qui leur sont particuliers et qu’il faut reconnaître.
De même que le désir du pouvoir y est plus ardent qu’ailleurs parmi les hommes vulgaires, l’amour de la gloire y est aussi plus développé chez certaines âmes qui trouvent dans les applaudissements d’un grand peuple un objet digne de leurs efforts et propre à les élever en quelque sorte au-dessus d’elles-mêmes. La pensée y reçoit en toute chose une impulsion plus rapide et plus puissante, les idées y circulent plus librement, les métropoles y sont comme de vastes centres intellectuels ou viennent resplendir et se combiner tous les rayons de l’esprit humain : ce fait nous explique pourquoi les grandes nations font faire aux lumières et à la cause générale de la civilisation des [I-261] progrès plus rapides que les petits. Il faut ajouter que les découvertes importantes exigent souvent un développement de force nationale dont le gouvernement d’un petit peuple est incapable ; chez les grandes nations, le gouvernement a plus d’idées générales, il se dégage plus complétement de la routine des antécédents et de l’égoïsme des localités. Il y a plus de génie dans ses conceptions, plus de hardiesse dans ses allures.
Le bien-être intérieur est plus complet et plus répandu chez les petites nations, tant qu’elles se maintiennent en paix ; mais l’état de guerre leur est plus nuisible qu’aux grandes. Chez celles-ci l’éloignement des frontières permet quelquefois à la masse du peuple de rester pendant des siècles éloignée du danger. Pour elle, la guerre est plutôt une cause de malaise que de ruine.
Il se présente d’ailleurs, en cette matière comme en beaucoup d’autres, une considération qui domine tout le reste : c’est celle de la nécessité.
S’il n’y avait que de petites nations et point de grandes, l’humanité serait à coup sur plus libre et plus heureuse ; mais on ne peut faire qu’il n’y ait pas de grandes nations.
Ceci introduit dans le monde un nouvel élément de prospérité nationale, qui est la force. Qu’importe qu’un peuple présente l’image de l’aisance et de la liberté, s’il se voit exposé chaque jour à être ravagé ou conquis ? qu’importe qu’il soit manufacturier et commerçant, si un autre domine les mers et fait la loi sur tous les marchés ? Les petites nations sont souvent misérables, non point parce qu’elles sont [I-262] petites, mais parce qu’elles sont faibles ; les grandes prospèrent, non point parce qu’elles sont grandes, mais parce qu’elles sont fortes. La force est donc souvent pour les nations une des premières conditions du bonheur et même de l’existence. De là vient qu’à moins de circonstances particulières, les petits peuples finissent toujours par être réunis violemment aux grands ou par s’y réunir d’eux-mêmes. Je ne sache pas de condition plus déplorable que celle d’un peuple qui ne peut se défendre ni se suffire.
C’est pour unir les avantages divers qui résultent de la grandeur et de la petitesse des nations que le système fédératif a été créé.
Il suffit de jeter un regard sur les États-Unis d’Amérique pour apercevoir tous les biens qui découlent pour eux de l’adoption de ce système.
Chez les grandes nations centralisées, le législateur est obligé de donner aux lois un caractère uniforme que ne comporte pas la diversité des lieux et les moeurs ; n’étant jamais instruit des cas particuliers, il ne peut procéder que par des règles générales ; des hommes sont alors obligés de se plier aux nécessités de la législation, car la législation ne sait point s’accommoder aux besoins et aux mœurs des hommes ; ce qui est une grande cause de troubles et de misères.
Cet inconvénient n’existe pas dans les confédérations : le congrès règle les principaux actes de l’existence sociale ; tout le détail en est abandonné aux législations provinciales.
On ne saurait se figurer à quel point cette division de la souveraineté sert au bien-être de chacun des États dont l’Union se compose. Dans ces petites [I-263] sociétés que ne préoccupe point le soin de se défendre ou de s’agrandir, toute la puissance publique et toute l’énergie individuelle sont tournées du côté des améliorations intérieures. Le gouvernement central de chaque État étant placé tout à côté des gouvernés, est journellement averti des besoins qui se font sentir : aussi voit-on présenter chaque année de nouveaux plans qui, discutés dans les assemblées communales ou devant la législature de l’État, et reproduits ensuite par la presse, excitent l’intérêt universel et le zèle des citoyens. Ce besoin d’améliorer agite sans cesse les républiques américaines et ne les trouble pas ; l’ambition du pouvoir y laisse la place à l’amour du bien-être, passion plus vulgaire, mais moins dangereuse. C’est une opinion généralement répandue en Amérique, que l’existence et la durée des formes républicaines dans le Nouveau-Monde dépendent de l’existence et de la durée du système fédératif. On attribue une grande partie des misères dans lesquelles sont plongés les nouveaux États de l’Amérique du Sud à ce qu’on a voulu y établir de grandes républiques, au lieu d’y fractionner la souveraineté.
Il est incontestable, en effet, qu’aux États-Unis le goût et l’usage du gouvernement républicain sont nés dans les communes et au sein des assemblées provinciales. Chez une petite nation, comme le Connecticut, par exemple, où la grande affaire politique est l’ouverture d’un canal et le tracé d’un chemin, où l’État n’a point d’armée à payer, ni de guerre à soutenir, et ne saurait donner à ceux qui le dirigent ni beaucoup de richesses, ni beaucoup de gloire, on ne peut rien imaginer de plus naturel et de mieux [I-264] approprié à la nature des choses que la république. Or, c’est ce même esprit républicain, ce sont ces mœurs et ces habitudes d’un peuple libre qui, après avoir pris naissance et s’être développées dans les divers États, s’appliquent ensuite sans peine à l’ensemble du pays. L’esprit public de l’Union n’est en quelque sorte lui-même qu’un résumé du patriotisme provincial. Chaque citoyen des États-Unis transporte pour ainsi dire l’intérêt que lui inspire sa petite république dans l’amour de la patrie commune. En défendant l’Union, il défend la prospérité croissante de son canton, le droit d’en diriger les affaires, et l’espérance d’y faire prévaloir des plans d’amélioration qui doivent l’enrichir lui-même : toutes choses qui, pour l’ordinaire, touchent plus les hommes que les intérêts généraux du pays et la gloire de la nation.
D’un autre côté, si l’esprit et les mœurs des habitants les rendent plus propres que d’autres à faire prospérer une grande république, le système fédératif a rendu la tâche bien moins difficile. La confédération de tous les États américains ne présente pas les inconvénients ordinaires des nombreuses agglomérations d’hommes. L’Union est une grande république quant à l’étendue ; mais on pourrait en quelque sorte l’assimiler à une petite république, à cause du peu d’objets dont s’occupe son gouvernement. Ses actes sont importants, mais ils sont rares. Comme la souveraineté de l’Union est gênée et incomplète, l’usage de cette souveraineté n’est point dangereux pour la liberté. Il n’excite pas non plus ces désirs immodérés de pouvoir et de bruit qui sont [I-265] si funestes aux grandes républiques. Comme tout n’y vient point aboutir nécessairement à un centre commun, on n’y voit ni vastes métropoles, ni richesses immenses, ni grandes misères, ni subites révolutions. Les passions politiques, au lieu de s’étendre en un instant, comme une nappe de feu, sur toute la surface du pays, vont se briser contre les intérêts et les passions individuelles de chaque État.
Dans l’Union cependant, comme chez un seul et même peuple, circulent librement les choses et les idées. Rien n’y arrête l’essor de l’esprit d’entreprise. Son gouvernement appelle à lui les talents et les lumières. En dedans des frontières de l’Union règne une paix profonde, comme dans l’intérieur d’un pays soumis au même empire ; en dehors, elle prend rang parmi les plus puissantes nations de la terre ; elle offre au commerce étranger plus de 800 lieues de rivages ; et tenant dans ses mains les clefs de tout un monde, elle fait respecter son pavillon jusqu’aux extrémités des mers.
L’Union est libre et heureuse comme une petite nation, glorieuse et forte comme une grande.
[I-266]
CE QUI FAIT QUE LE SYSTÈME FÉDÉRAL N’EST PAS À LA PORTÉE DE TOUS LES PEUPLES, ET CE QUI A PERMIS AUX ANGLO-AMERICAINS DE L’ADOPTER.
Il y a dans tout système fédéral des vices inhérents que le législateur ne peut combattre. — Complication de tout système fédéral. — Il exige des gouvernés un usage journalier de leur intelligence. — Science pratique des Américains en matière de gouvernement. — Faiblesse relative du gouvernement de l’Union, autre vice inhérent au système fédéral. — Les Américains l’ont rendu moins grave, mais n’ont pu le détruire. — La souveraineté des États particuliers plus faible en apparence, plus forte en réalité que celle de l’Union. — Pourquoi. — Il faut donc qu’il existe, indépendamment des lois, des causes naturelles d’union chez les peuples confédérés. — Quelles sont ces causes parmi les Anglo-Américains. — Le Maine et la Géorgie, éloignés l’un de l’autre de 400 lieues, plus naturellement unis que la Normandie et la Bretagne. — Que la guerre est le principal écueil des confédérations. — Ceci prouvé par l’exemple même des États-Unis. — L’Union n’a pas de grandes guerres à craindre. — Pourquoi. — Dangers que courraient les peuples de l’Europe en adoptant le système fédéral des Américains.
Le législateur parvient quelquefois, après mille efforts, à exercer une influence indirecte sur la destinée des nations, et alors on célèbre son génie, tandis que souvent la position géographique du pays, sur laquelle il ne peut rien, un état social qui s’est créé sans son concours, des mœurs et des idées dont il ignore l’origine, un point de départ qu’il ne connaît pas, imprimant à la société des mouvements irrésistibles contre lesquels il lutte en vain, et qui l’entraînent à son tour.
Le législateur ressemble à l’homme qui trace sa route au milieu des mers. Il peut aussi diriger le vaisseau qui le porte, mais il ne saurait en changer la structure, créer les vents, ni empêcher l’Océan de se soulever sous ses pieds.
[I-267]
J’ai montré quels avantages les Américains retirent du système fédéral. Il me reste à faire comprendre ce qui leur a permis d’adopter ce système ; car il n’est pas donné à tous les peuples de jouir de ses bienfaits.
On trouve dans le système fédéral des vices accidentels naissant des lois ; ceux-là peuvent être corrigés par les législateurs. On en rencontre d’autres qui, étant inhérents au système, ne sauraient être détruits par les peuples qui l’adoptent. Il faut donc que ces peuples trouvent en eux-mêmes la force nécessaire pour supporter les imperfections naturelles de leur gouvernement.
Parmi les vices inhérents à tout système fédéral, le plus visible de tous est la complication des moyens qu’il emploie. Ce système met nécessairement en présence deux souverainetés. Le législateur parvient à rendre les mouvements de ces deux souverainetés aussi simples et aussi égaux que possible, et peut les renfermer toutes les deux dans des sphères d’action nettement tracées ; mais il ne saurait faire qu’il n’y en ait qu’une, ni empêcher qu’elles ne se touchent en quelque endroit.
Le système fédératif repose donc, quoi qu’on fasse, sur une théorie compliquée, dont l’application exige, dans les gouvernés, un usage journalier des lumières de leur raison.
Il n’y a, en général, que les conceptions simples qui s’emparent de l’esprit du peuple. Une idée fausse, mais claire et précise, aura toujours plus de puissance dans le monde qu’une idée vraie, mais complexe. De là vient que les partis, qui sont comme de petites nations dans une grande, se hâtent toujours d’adopter [I-268] pour symbole un nom ou un principe qui, souvent, ne représente que très incomplétement le but qu’ils se proposent et les moyens qu’ils emploient, mais sans lequel ils ne pourraient subsister ni se mouvoir. Les gouvernements qui ne reposent que sur une seule idée ou sur un seul sentiment facile à définir, ne sont peut-être pas les meilleurs, mais ils sont à coup sûr les plus forts et les plus durables.
Lorsqu’on examine la constitution des États-Unis, la plus parfaite de toutes les constitutions fédérales connues, on est effrayé au contraire de la multitude de connaissances diverses et du discernement qu’elle suppose chez ceux qu’elle doit régir. Le gouvernement de l’Union repose presque tout entier sur des fictions légales. L’Union est une nation idéale qui n’existe pour ainsi dire que dans les esprits, et dont l’intelligence seule découvre l’étendue et les bornes.
La théorie générale étant bien comprise, restent les difficultés d’application ; elles sont sans nombre, car la souveraineté de l’Union est tellement engagée dans celle des États, qu’il est impossible, au premier coup d’œil, d’apercevoir leurs limites. Tout est conventionnel et artificiel dans un pareil gouvernement, et il ne saurait convenir qu’à un peuple habitué depuis long-temps à diriger lui-même ses affaires, et chez lequel la science politique est descendue jusque dans les derniers rangs de la société. Je n’ai jamais plus admiré le bon sens et l’intelligence pratique des Américains que dans la manière dont ils échappent aux difficultés sans nombre qui naissent de leur constitution fédérale. Je n’ai presque jamais rencontré d’homme du peuple, en Amérique, qui ne discernât [I-269] avec une surprenante facilité les obligations nées des lois du Congrès et celles dont l’origine est dans les lois de son État, et qui, après avoir distingué les objets placés dans les attributions générales de l’Union de ceux que la législature locale doit régler, ne pût indiquer le point ou commence la compétence des cours fédérales et la limite ou s’arrête celle des tribunaux de l’État.
La constitution des États-Unis ressemble à ces belles créations de l’industrie humaine qui comblent de gloire et de biens ceux qui les inventent, mais qui restent stériles en d’autres mains.
C’est ce que le Mexique a fait voir de nos jours.
Les habitants du Mexique, voulant établir le système fédératif, prirent pour modèle et copièrent presque entièrement la constitution fédérale des Anglo-Américains leurs voisins [160] . Mais en transportant chez eux la lettre de la loi, ils ne purent transporter en même temps l’esprit qui la vivifie. On les vit donc s’embarrasser sans cesse parmi les rouages de leur double gouvernement. La souveraineté des États et celle de l’Union, sortant du cercle que la constitution avait tracé, pénétrèrent chaque jour l’une dans l’autre. Actuellement encore, le Mexique est sans cesse entraîné de l’anarchie au despotisme militaire, et du despotisme militaire à l’anarchie.
Le second et le plus funeste de tous les vices, que je regarde comme inhérent au système fédéral lui-même, c’est la faiblesse relative du gouvernement de l’Union.
[I-270]
Le principe sur lequel reposent toutes les confédérations est le fractionnement de la souveraineté. Les législateurs rendent ce fractionnement peu sensible ; ils le dérobent même pour un temps aux regards, mais ils ne sauraient faire qu’il n’existe pas. Or, une souveraineté fractionnée sera toujours plus faible qu’une souveraineté complète.
On a vu, dans l’exposé de la constitution des États-Unis, avec quel art les Américains, tout en renfermant le pouvoir de l’Union dans le cercle restreint des gouvernements fédéraux, sont cependant parvenus à lui donner l’apparence et, jusqu’à un certain point, la force d’un gouvernement national.
En agissant ainsi, les législateurs de l’Union ont diminué le danger naturel des confédérations ; mais ils n’ont pu le faire disparaître entièrement.
Le gouvernement américain, dit-on, ne s’adresse point aux États : il fait parvenir immédiatement ses injonctions jusqu’aux citoyens, et les plie isolément sous l’effort de la volonté commune.
Mais si la loi fédérale heurtait violemment les intérêts et les préjugés d’un État, ne doit-on pas craindre que chacun des citoyens de cet État ne se crut intéressé dans la cause de l’homme qui refuse d’obéir ? Tous les citoyens de l’État, se trouvant ainsi lésés en même temps et de la même manière, par l’autorité de l’Union, en vain le gouvernement fédéral chercherait-il à les isoler pour les combattre : ils sentiraient instinctivement qu’ils doivent s’unir pour se défendre, et ils trouveraient une organisation toute préparée dans la portion de souveraineté dont on a laissé jouir leur État. La fiction disparaîtrait alors [I-271] pour faire place à la réalité, et l’on pourrait voir la puissance organisée d’une partie du territoire en lutte avec l’autorité centrale.
J’en dirai autant de la justice fédérale. Si, dans un procès particulier, les tribunaux de l’Union violaient une loi importante d’un État, la lutte, sinon apparente, au moins réelle, serait entre l’État lésé représenté par un citoyen, et l’Union représentée par ses tribunaux [161] .
Il faut avoir bien peu d’expérience des choses de ce monde pour s’imaginer qu’après avoir laissé aux passions des hommes un moyen de se satisfaire, on les empêchera toujours à l’aide de fictions légales de l’apercevoir et de s’en servir.
Les législateurs américains, en rendant moins probable la lutte entre les deux souverainetés n’en ont donc pas détruit les causes.
On peut même aller plus loin, et dire qu’ils n’ont pu, en cas de lutte, assurer au pouvoir fédéral la prépondérance.
Ils donnèrent à l’Union de l’argent et des soldats, mais les États gardèrent l’amour et les préjugés des peuples.
[I-272]
La souveraineté de l’Union est un être abstrait qui ne se rattache qu’à un petit nombre d’objets extérieurs. La souveraineté des États tombe sous tous les sens ; on la comprend sans peine ; on la voit agir à chaque instant. L’une est nouvelle, l’autre est née avec le peuple lui-même.
La souveraineté de l’Union est l’œuvre de l’art. La souveraineté des États est naturelle ; elle existe par elle-même, sans efforts, comme l’autorité du père de famille.
La souveraineté de l’Union ne touche les hommes que par quelques grands intérêts ; elle représente une partie immense, éloignée, un sentiment vague et indéfini. La souveraineté des États enveloppe chaque citoyen, en quelque sorte, et le prend chaque jour en détail. C’est elle qui se charge de garantir sa propriété, sa liberté, sa vie ; elle influe à tout moment sur son bien-être ou sa misère. La souveraineté des États s’appuie sur les souvenirs, sur les habitudes, sur les préjugés locaux, sur l’égoïsme de province et de famille ; en un mot, sur toutes les choses qui rendent l’instinct de la patrie si puissant dans le cœur de l’homme. Comment douter de ses avantages ?
Puisque les législateurs ne peuvent empêcher qu’il ne survienne, entre les deux souverainetés que le système fédéral met en présence, des collisions dangereuses, il faut donc qu’à leurs efforts pour détourner les peuples confédérés de la guerre, il se joigne des dispositions particulières qui portent ceux-ci à la paix.
Il résulte de là que le pacte fédéral ne saurait avoir une longue existence, s’il ne rencontre, dans [I-273] les peuples auxquels il s’applique, un certain nombre de conditions d’union qui leur rendent aisée cette vie commune, et facilitent la tâche du gouvernement.
Ainsi, le système fédéral, pour réussir, n’a pas seulement besoin de bonnes lois, il faut encore que les circonstances le favorisent.
Tous les peuples qu’on a vus se confédérer avaient un certain nombre d’intérêts communs, qui formaient comme les liens intellectuels de l’association.
Mais outre les intérêts matériels, l’homme a encore des idées et des sentiments. Pour qu’une confédération subsiste long-temps, il n’est pas moins nécessaire qu’il y ait homogénéité dans la civilisation que dans les besoins des divers peuples qui la composent. Entre la civilisation du canton de Vaud et celle du canton d’Uri, il y a comme du XIXe siècle au XVe : aussi la Suisse n’a-t-elle jamais eu, à vrai dire, de gouvernement fédéral. L’union entre ces différents cantons n’existe que sur la carte ; et l’on s’en apercevrait bien, si une autorité centrale voulait appliquer les mêmes lois à tout le territoire.
Il y a un fait qui facilite admirablement, aux États-Unis, l’existence du gouvernement fédéral. Les différents États ont non seulement les mêmes intérêts à peu près, la même origine et la même langue, mais encore le même degré de civilisation ; ce qui rend presque toujours l’accord entre eux chose facile. Je ne sais s’il y a si petite nation européenne qui ne présente un aspect moins homogène dans ses différentes parties que le peuple américain, dont le territoire est aussi grand que la moitié de l’Europe. De l’État du Maine à l’État de Géorgie on compte [I-274] environ 400 lieues. Il existe cependant moins de différence entre la civilisation du Maine et celle de la Géorgie, qu’entre la civilisation de la Normandie et celle de la Bretagne. Le Maine et la Géorgie, placés aux deux extrémités d’un vaste empire, trouvent donc naturellement plus de facilités réelles à former une confédération que la Normandie et la Bretagne, qui ne sont séparées que par un ruisseau.
À ces facilités, que les mœurs et les habitudes du peuple offraient aux législateurs américains, s’en joignaient d’autres qui naissaient de la position géographique du pays. Il faut principalement attribuer à ces dernières l’adoption et le maintien du système fédéral.
Le plus important de tous les actes qui peuvent signaler la vie d’un peuple, c’est la guerre. Dans la guerre, un peuple agit comme un seul individu vis-à-vis des peuples étrangers : il lutte pour son existence même.
Tant qu’il n’est question que de maintenir la paix dans l’intérieur d’un pays et de favoriser sa prospérité, l’habileté dans le gouvernement, la raison dans les gouvernés, et un certain attachement naturel que les hommes ont presque toujours pour leur patrie, peuvent aisément suffire ; mais pour qu’une nation se trouve en état de faire une grande guerre, les citoyens doivent s’imposer des sacrifices nombreux et pénibles. Croire qu’un grand nombre d’hommes seront capables de se soumettre d’eux-mêmes à de pareilles exigences sociales, c’est bien mal connaître l’humanité.
De là vient que tous les peuples qui ont eu à faire [I-275] de grandes guerres ont été amenés, presque malgré eux, à accroître les forces du gouvernement. Ceux qui n’ont pas pu y réussir ont été conquis. Une longue guerre place presque toujours les nations dans cette triste alternative, que leur défaite les livre à la destruction, et leur triomphe au despotisme.
C’est donc, en général, dans la guerre que se révèle, d’une manière plus visible et plus dangereuse, la faiblesse d’un gouvernement ; et j’ai montré que le vice inhérent des gouvernements fédéraux était d’être très faibles.
Dans le système fédératif, non seulement il n’y a point de centralisation administrative ni rien qui en approche, mais la centralisation gouvernementale elle-même n’existe qu’incomplétement, ce qui est toujours une grande cause de faiblesse, lorsqu’il faut se défendre contre des peuples chez lesquels elle est complète.
Dans la constitution fédérale des États-Unis, celle de toutes où le gouvernement central est revêtu de plus de forces réelles, ce mal se fait encore vivement sentir.
Un seul exemple permettra au lecteur d’en juger.
La constitution donne au congrès le droit d’appeler la milice des différents États au service actif, lorsqu’il s’agit d’étouffer une insurrection ou de repousser une invasion ; un autre article dit que dans ce cas le président des États-Unis est le commandant en chef de la milice.
Lors de la guerre de 1812, le président donna l’ordre aux milices du Nord de se porter vers les frontières ; le Connecticut et le Massachusetts, dont [I-276] la guerre lésait les intérêts, refusèrent d’envoyer leur contingent.
La constitution, dirent-ils, autorise le gouvernement fédéral à se servir des milices en cas d’insurrection et d’invasion or il n’y a, quant à présent ni insurrection ni invasion. Ils ajoutèrent que la même constitution qui donnait à l’Union le droit d’appeler les milices en service actif, laissait aux États le droit de nommer les officiers ; il s’ensuivait, selon eux, que, même à la guerre, aucun officier de l’Union n’avait le droit de commander les milices, excepté le président en personne. Or, il s’agissait de servir dans une armée commandée par un autre que lui.
Ces absurdes et destructives doctrines reçurent non seulement la sanction des gouverneurs et de la législature, mais encore celle des cours de justice de ces deux États ; et le gouvernement fédéral fut contraint de chercher ailleurs les troupes dont il manquait [162] .
D’où vient donc que l’Union américaine toute protégée qu’elle est par la perfection relative de ses lois, ne se dissout pas au milieu d’une grande guerre ? c’est qu’elle n’a point de grandes guerres à craindre.
[I-277]
Placée au centre d’un continent immense, ou l’industrie humaine peut s’étendre sans bornes, l’Union est presque aussi isolée du monde que si elle se trouvait resserrée de tous côtés par l’Océan.
Le Canada ne compte qu’un million d’habitants ; sa population est divisée en deux nations ennemies. Les rigueurs du climat limitent l’étendue de son territoire et ferment pendant six mois ses ports.
Du Canada au golfe du Mexique, on rencontre encore quelques tribus sauvages à moitié détruites que 6,000 soldats poussent devant eux.
Au sud, l’Union touche par un point à l’empire du Mexique ; c’est de là probablement que viendront un jour les grandes guerres. Mais, pendant long-temps encore, l’état peu avancé de la civilisation, la corruption des mœurs et la misère, empêcheront le Mexique de prendre un rang élevé parmi les nations. Quant aux puissances de l’Europe, leur éloignement les rend peu redoutables (O).
Le grand bonheur des États-Unis n’est donc pas d’avoir trouvé une constitution fédérale qui leur permette de soutenir de grandes guerres, mais d’être tellement situés qu’il n’y en a pas pour eux à craindre.
Nul ne saurait apprécier plus que moi les avantages du système fédératif. J’y vois l’une des plus puissantes combinaisons en faveur de la prospérité et de la liberté humaine. J’envie le sort des nations auxquelles il a été permis de l’adopter. Mais je me refuse pourtant à croire que des peuples confédérés puissent lutter long-temps, à égalité de force, contre une nation où la puissance gouvernementale serait centralisée.
Le peuple qui, en présence des grandes [I-278] monarchies militaires de l’Europe, viendrait à fractionner sa souveraineté, me semblerait abdiquer, par ce seul fait, son pouvoir, et peut-être son existence et son nom.
Admirable position du Nouveau-Monde, qui fait que l’homme n’y a encore d’ennemis que lui-même ! Pour être heureux et libre, il lui suffit de le vouloir.
NOTES.↩
[I-281]
(A) PAGE 31. (↑)
Voyez, sur tous les pays de l’ouest où les Européens n’ont pas encore pénétré, les deux voyages entrepris par le major Long, aux frais du congrès.
M. Long dit notamment, à propos du grand désert américain, qu’il faut tirer une ligne à peu près parallèle au 20e degré de longitude (méridien de Washington [163] ), partant de la rivière Rouge et aboutissant à la rivière Plate. De cette ligne imaginaire jusqu’aux montagnes Rocheuses, qui bornent la vallée du Mississipi à l’ouest, s’étendent d’immenses plaines, couvertes en général de sable qui se refuse à la culture, ou parsemées de pierres granitiques. Elles sont privées d’eau en été. On n’y rencontre que de grands troupeaux de buffles et de chevaux sauvages. On y voit aussi quelques hordes d’Indiens, mais en petit nombre.
Le major Long a entendu dire qu’en s’élevant au-dessus de la rivière Plate dans la même direction, on rencontrait toujours à sa gauche le même désert ; mais il n’a pas pu vérifier par lui-même l’exactitude de ce rapport. Long’s expedition, vol. 2, p. 361.
Quelque confiance que mérite la relation du major Long, il ne faut pas cependant oublier qu’il n’a fait que traverser le pays dont il parle, sans tracer de grands zigzags au-dehors de la ligne qu’il suivait.
(B) PAGE 33. (↑)
L’Amérique du Sud, dans ses régions intertropicales, produit avec une incroyable profusion ces plantes grimpantes connues sous le nom [I-282] générique de lianes. La flore des Antilles en présente à elle seule plus de quarante espèces différentes.
Parmi les plus gracieux d’entre ces arbustes se trouve la grenadille. Cette jolie plante, dit Descourtiz dans sa description du règne végétal aux Antilles, au moyen des vrilles dont elle est munie, s’attache aux arbres et y forme des arcades mobiles, des colonnades riches et élégantes par la beauté des fleurs pourpres variées de bleu qui les décorent, et qui flattent l’odorat par le parfum qu’elles exhalent ; vol. 1, p. 265.
L’acacia à grandes gousses est une liane très grosse qui se développe rapidement, et, courant d’arbres en arbres, couvre quelquefois plus d’une demi-lieue ; vol. 3, p. 227.
(C) PAGE 56. (↑)
Les langues que parlent les Indiens de l’Amérique, depuis le pôle arctique jusqu’au cap Horn, sont toutes formées, dit-on, sur le même modèle, et soumises aux mêmes règles grammaticales ; d’où on peut conclure avec une grande vraisemblance que toutes les nations indiennes sont sorties de la même souche.
Chaque peuplade du continent américain parle un dialecte différent ; mais les langues proprement dites sont en très petit nombre, ce qui tendrait encore à prouver que les nations du Nouveau-Monde n’ont pas une origine fort ancienne.
Enfin les langues de l’Amérique sont d’une extrême régularité ; il est donc probable que les peuples qui s’en servent n’ont pas encore été soumis à de grandes révolutions, et ne se sont pas mêlés forcément ou volontairement à des nations étrangères ; car c’est en général l’union de plusieurs langues dans une seule qui produit les irrégularités de la grammaire.
Il n’y a pas long-temps que les langues américaines, et en particulier les langues de l’Amérique du Nord, ont attiré l’attention sérieuse des philologues. On a découvert alors, pour la première fois, que cet idiome d’un peuple barbare était le produit d’un système d’idées très compliquées et de combinaisons fort savantes. On s’est aperçu que ces langues étaient fort riches, et qu’en les formant on avait pris grand soin de ménager la délicatesse de l’oreille.
[I-283]
Le système grammatical des Américains diffère de tous les autres en plusieurs points, mais principalement en celui-ci.
Quelques peuples de l’Europe, entre autres les Allemands, ont la faculté de combiner au besoin différentes expressions, et de donner ainsi un sens complexe à certains mots. Les Indiens ont étendu de la manière la plus surprenante cette même faculté, et sont parvenus à fixer pour ainsi dire sur un seul point un très grand nombre d’idées. Ceci se comprendra sans peine à l’aide d’un exemple cité par M. Duponceau, dans les Mémoires de la Société philosophique d’Amérique.
Lorsqu’une femme delaware joue avec un chat ou avec un jeune chien, dit-il, on l’entend quelquefois prononcer le mot kuligatschi. Ce mot est ainsi composé : K est le signe de la seconde personne, et signifie tu ou ton ; uli, qu’on prononce ouli, est un fragment du mot wulit, qui signifie beau, joli ; gat est un autre fragment du mot wichtgat, qui signifie patte ; enfin schis, qu’on prononce chise, est une terminaison diminutive qui apporte avec elle l’idée de la petitesse. Ainsi, dans un seul mot, la femme indienne a dit : Ta jolie petite patte.
Voici un autre exemple qui montre avec quel bonheur les sauvages de l’Amérique savaient composer leurs mots.
Un jeune homme en delaware se dit pilapé. Ce mot est formé de pilsit, chaste, innocent ; et de lénapé, homme : c’est-à-dire l’homme dans sa pureté et son innocence.
Cette faculté de combiner entre eux les mots se fait surtout remarquer d’une manière fort étrange dans la formation des verbes. L’action la plus compliquée se rend souvent par un seul verbe ; presque toutes les nuances de l’idée agissent sur le verbe et le modifient.
Ceux qui voudraient examiner plus en détail ce sujet, que je n’ai fait moi-même qu’effleurer très superficiellement, devront lire :
1o La Correspondance de M. Duponceau avec le révérend Hecwelder, relativement aux langues indiennes. Cette correspondance se trouve dans le 1er volume des Mémoires de la Société philosophique d’Amérique, publiés à Philadelphie, en 1819, chez Abraham Small, p. 356-464.
2o La grammaire de la langue delaware ou lenape, par Geiberger, et la préface de M. Duponceau, qui y est jointe. Le tout se trouve dans les mêmes collections, vol. 3.
3o Un résumé fort bien fait de ces travaux, contenu à la fin du volume 6 de l’Encyclopédie américaine.
[I-284]
( D) PAGE 58. (↑)
On trouve dans Charlevoix, tome I, p. 235, l’histoire de la première guerre que les Français du Canada eurent à soutenir, en 1610, contre les Iroquois. Ces derniers, quoique armés de flèches et d’arcs, opposèrent une résistance désespérée aux Français et à leurs alliés. Charlevoix, qui n’est cependant pas un grand peintre, fait très bien voir dans ce morceau le contraste qu’offraient les mœurs des Européens et celles des sauvages, ainsi que les différentes manières dont ces deux races entendaient l’honneur.
« Les Français, dit-il, se saisirent des peaux de castor dont les Iroquois, qu’ils voyaient étendus sur la place, étaient couverts. Les Hurons, leurs alliés, furent scandalisés à ce spectacle. Ceux-ci, de leur côté, commencèrent à exercer leurs cruautés ordinaires sur les prisonniers, et dévorèrent un de ceux qui avaient été tués, ce qui fit horreur aux Français. Ainsi, ajoute Charlevoix, ces barbares faisaient gloire d’un désintéressement qu’ils étaient surpris de ne pas trouver dans notre nation, et ne comprenaient pas qu’il y eût bien moins de mal à dépouiller les morts qu’à se repaître de leurs chairs comme des bêtes féroces. »
Le même Charlevoix, dans un autre endroit, vol. 1, p. 230, peint de cette manière le premier supplice dont Champlain fut le témoin, et le retour des Hurons dans leur village.
« Après avoir fait huit lieues, dit-il, nos alliés s’arrêtèrent, et, prenant un de leurs captifs, ils lui reprochèrent toutes les cruautés qu’il avait exercées sur des guerriers de leur nation qui étaient tombés dans ses mains, et lui déclarèrent qu’il devait s’attendre à être traité de la même manière, ajoutant que, s’il avait du cœur, il le témoignerait en chantant : il entonna aussitôt sa chanson de guerre, et toutes celles qu’il savait, mais sur un ton fort triste, dit Champlain, qui n’avait pas encore eu le temps de connaître que toute la musique des sauvages a quelque chose de lugubre. Son supplice, accompagné de toutes les horreurs dont nous parlerons dans la suite, effraya les Français, qui firent en vain tous leurs efforts pour y mettre fin. La nuit suivante, un Huron ayant rêvé qu’on était poursuivi, la retraite se changea en une véritable fuite, et les sauvages ne s’arrêtèrent plus dans aucun endroit qu’ils ne fussent hors de tout danger.
[I-285]
« Du moment qu’ils eurent aperçu les cabanes de leur village, ils coupèrent de longs bâtons auxquels ils attachèrent les chevelures qu’ils avaient eues en partage, et les portèrent comme en triomphe. À cette vue les femmes accoururent, se jetèrent à la nage, et, ayant joint les canots, elles prirent ces chevelures toutes sanglantes des mains de leurs maris, et se les attachèrent au cou.
« Les guerriers offrirent un de ces horribles trophées à Champlain, et lui firent en outre présent de quelques arcs et de quelques flèches, seules dépouilles des Iroquois dont ils eussent voulu s’emparer, le priant de les montrer au roi de France. »
Champlain vécut seul tout un hiver au milieu de ces barbares, sans que sa personne ou ses propriétés fussent un instant compromises.
( E) PAGE 61. (↑)
Quoique le rigorisme puritain qui a présidé à la naissance des colonies anglaises d’Amérique se soit déjà fort affaibli, on en trouve encore dans les habitudes et dans les lois des traces extraordinaires.
En 1792, à l’époque même ou la république antichrétienne de France commençait son existence éphémère, le corps législatif du Massachusetts promulguait la loi qu’on va lire, pour forcer les citoyens à l’observation du dimanche. Voici le préambule et les principales dispositions de cette loi, qui mérite d’attirer toute l’attention du lecteur :
« Attendu, dit le législateur, que l’observation du dimanche est d’un intérêt public, qu’elle produit une suspension utile dans les travaux ; qu’elle porte les hommes à réfléchir sur les devoirs de la vie et sur les erreurs auxquelles l’humanité est si sujette ; qu’elle permet d’honorer en particulier et en public le Dieu créateur et gouverneur de l’univers, et de se livrer à ces actes de charité qui font l’ornement et le soulagement des sociétés chrétiennes ;
« Attendu que les personnes irréligieuses ou légères, oubliant les devoirs que le dimanche impose et l’avantage que la société en retire, en profanent la sainteté en se livrant à leurs plaisirs ou à leurs travaux ; que cette manière d’agir est contraire à leurs propres intérêts comme chrétiens ; que, de plus, elle est de nature à troubler ceux qui ne suivent pas leur exemple, et porte un préjudice réel à la société tout entière en introduisant dans son sein le goût de la dissipation et les habitudes dissolues ;
[I-286]
« Le sénat et la chambre des représentants ordonnent ce qui suit :
« 1o Nul ne pourra, le jour du dimanche, tenir ouvert sa boutique ou son atelier. Nul ne pourra, le même jour, s’occuper d’aucun travail ou affaires quelconques, assister à aucun concert, bal ou spectacle d’aucun genre, ni se livrer à aucune espèce de chasse, jeu, récréation, sous peine d’amende. L’amende ne sera pas moindre de 10 shellings, et n’excédera pas 20 shellings pour chaque contravention.
« 2o Aucun voyageur, conducteur, charretier, excepté en cas de nécessité, ne pourra voyager le dimanche, sous peine de la même amende.
« 3o Les cabaretiers, détaillants, aubergistes, empêcheront qu’aucun habitant domicilié dans leur commune ne vienne chez eux le dimanche, pour y passer le temps en plaisirs ou en affaires. En cas de contravention, l’aubergiste et son hôte paieront l’amende. De plus, l’aubergiste pourra perdre sa licence.
« 4o Celui qui, étant en bonne santé et sans raison suffisante, omettra pendant trois mois de rendre à Dieu un culte public, sera condamné à 10 shellings d’amende.
« 5o Celui qui, dans l’enceinte d’un temple, tiendra une conduite inconvenante, paiera une amende de 5 shellings à 40.
« 6o Sont chargés de tenir la main à l’exécution de la présente loi, les tythingmen des communes [164] . Ils ont le droit de visiter le dimanche tous les appartements des hôtelleries ou lieux publics. L’aubergiste qui leur refuserait l’entrée de sa maison sera condamné pour ce seul fait à 40 shellings d’amende.
« Les tythingmen devront arrêter les voyageurs, et s’enquérir de la raison qui les a obligés de se mettre en route le dimanche. Celui qui refusera de répondre sera condamné à une amende qui pourra être de 5 livres sterling.
« Si la raison donnée par le voyageur ne parait pas suffisante au tythingman, il poursuivra ledit voyageur devant le juge de paix du canton. » Loi du 8 mars 1792. General Laws of Massachusetts, vol. 1, p. 410.
Le 11 mars 1797, une nouvelle loi vint augmenter le taux des amendes, dont moitié dut appartenir à celui qui poursuivait le délinquant. Même collection, vol. 1, p. 525.
[I-287]
Le 16 février 1816, une nouvelle loi confirme ces mêmes mesures. Même collection, vol. 2, p. 405.
Des dispositions analogues existent dans les lois de l’État de New-York, révisées en 1827 et 1828. (Voyez Revised statutes, partie 1, chapitre 20, p. 675.) Il y est dit que le dimanche nul ne pourra chasser, pêcher, jouer, ni fréquenter les maisons où l’on donne à boire. Nul ne pourra voyager, si ce n’est en cas de nécessité.
Ce n’est pas la seule trace que l’esprit religieux et les mœurs austères des premiers émigrants aient laissée dans les lois.
On lit dans les statuts révisés de l’État de New-York, vol. 1, p. 662, l’article suivant :
« Quiconque gagnera ou perdra dans l’espace de vingt-quatre heures, en jouant ou en pariant, la somme de 25 dollars (environ 132 francs), sera réputé coupable d’un délit (misdemeanor), et sur la preuve du fait, sera condamné à une amende égale au moins à cinq fois la valeur de la somme perdue ou gagnée ; laquelle amende sera versée dans les mains de l’inspecteur des pauvres de la commune.
« Celui qui perd 25 dollars ou plus peut les réclamer en justice. S’il omet de le faire, l’inspecteur des pauvres peut actionner le gagnant, et lui faire donner, au profit des pauvres, la somme gagnée et une somme triple de celle-là. »
Les lois que nous venons de citer sont très récentes ; mais qui pourrait les comprendre sans remonter jusqu’à l’origine même des colonies ? Je ne doute point que de nos jours la partie pénale de cette législation ne soit que fort rarement appliquée ; les lois conservent leur inflexibilité quand déjà les mœurs se sont pliées au mouvement du temps. Cependant l’observation du dimanche en Amérique est encore ce qui frappe le plus vivement l’étranger.
Il y a notamment une grande ville américaine dans laquelle, à partir du samedi soir, le mouvement social est comme suspendu. Vous parcourez ses murs à l’heure qui semble convier l’âge mûr aux affaires et la jeunesse aux plaisirs, et vous vous trouvez dans une profonde solitude. Non seulement personne ne travaille, mais personne ne paraît vivre. On n’entend ni le mouvement de l’industrie, ni les accents de la joie, ni même le murmure confus qui s’élève sans cesse du sein d’une grande cité. Des chaînes sont tendues aux environs des églises ; les volets des maisons à demi fermés ne laissent qu’à regret pénétrer un rayon [I-288] du soleil dans la demeure des citoyens. À peine de loin en loin apercevez-vous un homme isolé qui se coule sans bruit à travers les carrefours déserts et le long des rues abandonnées.
Le lendemain à la pointe du jour, le roulement des voitures, le bruit des marteaux, les cris de la population recommencent à se faire entendre ; la cité se réveille ; une foule inquiète se précipite vers les foyers du commerce et de l’industrie ; tout se remue, tout s’agite, tout se presse autour de vous. À une sorte d’engourdissement léthargique succède une activité fébrile ; on dirait que chacun n’a qu’un seul jour à sa disposition pour acquérir la richesse et pour en jouir.
( F) PAGE 69. (↑)
Il est inutile de dire que, dans le chapitre qu’on vient de lire, je n’ai point prétendu faire une histoire de l’Amérique. Mon seul but a été de mettre le lecteur à même d’apprécier l’influence qu’avaient exercée les opinions et les mœurs des premiers émigrants sur le sort des différentes colonies et de l’Union en général. J’ai donc dû me borner à citer quelques fragments détachés.
Je ne sais si je me trompe, mais il me semble qu’en marchant dans la route que je ne fais ici qu’indiquer, on pourrait présenter sur le premier âge des républiques américaines des tableaux qui ne seraient pas indignes d’attirer les regards du public, et qui donneraient sans doute matière à réfléchir aux hommes d’État. Ne pouvant me livrer moi-même à ce travail, j’ai voulu du moins le faciliter à d’autres. J’ai donc cru devoir présenter ici une courte nomenclature et une analyse abrégée des ouvrages dans lesquels il me paraîtrait le plus utile de puiser.
Au nombre des documents généraux qu’on pourrait consulter avec fruit, je placerai d’abord l’ouvrage intitulé Historical collection of state-papers and other authentic documents, intended as materials for an history of the United States of America ; by Ebenezer Hazard.
Le premier volume de cette compilation, qui fut imprimé à Philadelphie en 1792, contient la copie textuelle de toutes les chartes accordées par la couronne d’Angleterre aux émigrants, ainsi que les principaux actes des gouvernements coloniaux durant les premiers temps de leur existence. On y trouve entre autres un grand nombre de documents authentiques sur les affaires de la Nouvelle-Angleterre et de la Virginie pendant cette période.
[I-289]
Le second volume est consacré presque tout entier aux actes de la confédération de 1643. Ce pacte fédéral, qui eut lieu entre les colonies de la Nouvelle-Angleterre, dans le but de résister aux indiens, fut le premier exemple d’union que donnèrent les Anglo-Américains. Il y eut encore plusieurs autres confédérations de la même nature, jusqu’à celle de 1776, qui amena l’indépendance des colonies.
La collection historique de Philadelphie se trouve à la Bibliothèque Royale.
Chaque colonie a de plus ses monuments historiques, dont plusieurs sont très précieux. Je commence mon examen par la Virginie, qui est l’État le plus anciennement peuplé.
Le premier de tous les historiens de la Virginie est son fondateur, le capitaine Jean Smith. Le capitaine Smith nous a laissé un volume in-4o intitulé : The general history of Virginia and New-England, by Captain John Smith, some time governor in those countryes and admiral of New-England, imprimé à Londres en 1627. (Ce volume se trouve à la Bibliothèque Royale.) L’ouvrage de Smith est orné de cartes et de gravures très curieuses, qui datent du temps où il a été imprimé. Le récit de l’historien s’étend depuis l’année 1584 jusqu’en 1626. Le livre de Smith est estimé et mérite de l’être. L’auteur est un des plus célèbres aventuriers qui aient paru dans le siècle plein d’aventures à la fin duquel il a vécu : le livre lui-même respire cette ardeur de découvertes, cet esprit d’entreprise, qui caractérisait les hommes d’alors ; on y retrouve ces mœurs chevaleresques qu’on mêlait au négoce, et qu’on faisait servir à l’acquisition des richesses.
Mais ce qui est surtout remarquable dans le capitaine Smith, c’est qu’il mêle aux vertus de ses contemporains des qualités qui sont restées étrangères à la plupart d’entre eux ; son style est simple et net, ses récits ont tous le cachet de la vérité, ses descriptions ne sont point ornées.
Cet auteur jette sur l’état des Indiens à l’époque de la découverte de l’Amérique du Nord des lumières précieuses.
Le second historien à consulter est Beverley. L’ouvrage de Beverley, qui forme un volume in-12, a été traduit en français, et imprimé à Amsterdam en 1707. L’auteur commence ses récits à l’année 1585, et les termine à l’année 1700. La première partie de son livre contient des documents historiques proprement dits, relatifs à l’enfance de la [I-290] colonie. La seconde renferme une peinture curieuse de l’état des Indiens à cette époque reculée. La troisième donne des idées très claires sur les mœurs, l’état social, les lois et les habitudes politiques des Virginiens du temps de l’auteur.
Beverley était originaire de la Virginie, ce qui lui fait dire en commençant, « qu’il supplie les lecteurs de ne point examiner son ouvrage en critiques trop rigides, attendu qu’étant né aux Indes il n’aspire point à la pureté du langage. » Malgré cette modestie de colon, l’auteur témoigne, dans tout le cours de son livre, qu’il supporte impatiemment la suprématie de la mère-patrie. On trouve également dans l’ouvrage de Beverley des traces nombreuses de cet esprit de liberté civile qui animait dès lors les colonies anglaises d’Amérique. On y rencontre aussi la trace des divisions qui ont si long-temps existé au milieu d’elles, et qui ont retardé leur indépendance. Beverley déteste ses voisins catholiques du Maryland plus encore que le gouvernement anglais. Le style de cet auteur est simple ; ses récits sont souvent pleins d’intérêt et inspirent la confiance. La traduction française de l’histoire de Beverley se trouve dans la Bibliothèque Royale.
J’ai vu en Amérique, mais je n’ai pu retrouver en France, un ouvrage qui mériterait aussi d’être consulté ; il est intitulé : History of Virginia, by William Stith. Ce livre offre des détails curieux ; mais il m’a paru long et diffus.
Le plus ancien et le meilleur document qu’on puisse consulter sur l’histoire des Carolines est un livre petit in-4o intitulé : The History of Carolina by John Lawson, imprimé à Londres en 1718.
L’ouvrage de Lawson contient d’abord un voyage de découvertes, dans l’ouest de la Caroline. Ce voyage est écrit en forme de journal ; les récits de l’auteur sont confus ; ses observations sont très superficielles ; on y trouve seulement une peinture assez frappante des ravages que causaient la petite-vérole et l’eau-de-vie parmi les sauvages de cette époque, et un tableau curieux de la corruption des mœurs qui régnait parmi eux, et que la présence des Européens favorisait.
La deuxième partie de l’ouvrage de Lawson est consacrée à retracer l’état physique de la Caroline, et à faire connaitre ses productions.
Dans la troisième partie, l’auteur fait une description intéressante des mœurs, des usages et du gouvernement des Indiens de cette époque. Il y a souvent de l’esprit et de l’originalité dans cette portion du livre.
[I-291]
L’histoire de Lawson est terminée par la charte accordée à la Caroline du temps de Charles II.
Le ton général de cet ouvrage est léger, souvent licencieux, et forme un parfait contraste avec le style profondément grave des ouvrages publiés à cette même époque dans la Nouvelle-Angleterre.
L’histoire de Lawson est un document extrêmement rare en Amérique, et qu’on ne peut se procurer en Europe. Il y en a cependant un exemplaire à la Bibliothèque Royale.
De l’extrémité sud des États-Unis, je passe immédiatement à l’extrémité nord. L’espace intermédiaire n’a été peuplé que plus tard.
Je dois indiquer d’abord une compilation fort curieuse intitulée Collection of the Massachusetts historical society, imprimée pour la première fois à Boston en 1792, réimprimée en 1806. Cet ouvrage n’existe pas à la Bibliothèque Royale, ni, je crois, dans aucune autre.
Cette collection (qui se continue) renferme une foule de documents très précieux relativement à l’histoire des différents États de la Nouvelle-Angleterre. On y trouve des correspondances inédites et des pièces authentiques qui étaient enfouies dans les archives provinciales. L’ouvrage tout entier de Gookin relatif aux Indiens y a été inséré.
J’ai indiqué plusieurs fois dans le cours du chapitre auquel se rapporte cette note, l’ouvrage de Nathaniel Morton intitulé New England’s Memorial. Ce que j’en ai dit suffit pour prouver qu’il mérite d’attirer l’attention de ceux qui voudraient connaître l’histoire de le Nouvelle-Angleterre. Le livre de Nathaniel Morton forme un vol. in-8o, réimprimé à Boston en 1826. Il n’existe pas à la Bibliothèque Royale.
Le document le plus estimé et le plus important que l’on possède sur l’histoire de la Nouvelle-Angleterre est l’ouvrage de R. Cotton Mather intitulé Magnalia Christi Americana, or the ecclesiastical history of New-England, 1620-1698, 2 vol. in-8o, réimprimés à Hartford en 1820. Je ne crois pas qu’on le trouve à la Bibliothèque Royale.
L’auteur a divisé son ouvrage en sept livres.
Le premier présente l’histoire de ce qui a préparé et amené la fondation de la Nouvelle-Angleterre.
Le second contient la vie des premiers gouverneurs et des principaux magistrats qui ont administré ce pays.
Le troisième est consacré à la vie et aux travaux des ministres évangéliques qui, pendant la même période, y ont dirigé les âmes.
[I-292]
Dans le quatrième, l’auteur fait connaitre la fondation et le développement de l’Université de Cambridge (Massachusetts).
Au cinquième, il expose les principes et la discipline de l’Église de la Nouvelle-Angleterre.
Le sixième est consacré à retracer certains faits qui dénotent, suivant Mather, l’action bienfaisante de la Providence sur les habitants de la Nouvelle-Angleterre.
Dans le septième, enfin, l’auteur nous apprend les hérésies et les troubles auxquels a été exposée l’Église de la Nouvelle-Angleterre.
Cotton Mather était un ministre évangélique qui, après être né à Boston, y a passé sa vie.
Toute l’ardeur et toutes les passions religieuses qui ont amené la fondation de la Nouvelle-Angleterre animent et vivifient ses récits. On découvre fréquemment des traces de mauvais goût dans sa manière d’écrire : mais il attache, parce qu’il est plein d’un enthousiasme qui finit par se communiquer au lecteur. Il est souvent intolérant, plus souvent crédule ; mais on n’aperçoit jamais en lui envie de tromper ; quelquefois même son ouvrage présente de beaux passages et des pensées vraies et profondes, telles que celles-ci :
« Avant l’arrivée des puritains, dit-il, vol. 1, chap. IV, p. 61, les Anglais avaient plusieurs fois essayé de peupler le pays que nous habitons ; mais comme ils ne visaient pas plus haut qu’au succès de leurs intérêts matériels, ils furent bientôt abattus par les obstacles ; il n’en a pas été ainsi des hommes qui arrivèrent en Amérique, poussés et soutenus par une haute pensée religieuse. Quoique ceux-ci aient trouvé plus d’ennemis que n’en rencontrèrent peut-être jamais les fondateurs d’aucune colonie, ils persistèrent dans leur dessein, et l’établissement qu’ils ont formé subsiste encore de nos jours. »
Mather mêle parfois à l’austérité de ses tableaux des images pleines de douceur et de tendresse : après avoir parlé d’une dame anglaise que l’ardeur religieuse avait entraînée avec son mari en Amérique, et qui bientôt après succomba aux fatigues et aux misères de l’exil, il ajoute : « Quant à son vertueux époux, Isaac Johnson, il essaya de vivre sans elle, et ne l’ayant pas pu, il mourut. » (V. 1, p. 71.)
Le livre de Mather fait admirablement connaître le temps et le pays qu’il cherche à décrire.
[I-293]
Veut-il nous apprendre quels motifs portèrent les puritains à chercher un asile au-delà des mers, il dit :
« Le Dieu du ciel fit un appel à ceux d’entre son peuple qui habitaient l’Angleterre. Parlant en même temps à des milliers d’hommes qui ne s’étaient jamais vus les uns les autres, il les remplit du désir de quitter les commodités de la vie qu’ils trouvaient dans leur patrie, de traverser un terrible océan pour aller s’établir au milieu de déserts plus formidables encore, dans l’unique but de s’y soumettre sans obstacle à ses lois. »
« Avant d’aller plus loin, ajoute-t-il, il est bon de faire connaître quels ont été les motifs de cette entreprise, afin qu’ils soient bien compris de la postérité ; il est surtout important d’en rappeler le souvenir aux hommes de nos jours, de peur que, perdant de vue l’objet que poursuivaient leurs pères, ils ne négligent les vrais intérêts de la Nouvelle-Angleterre. Je placerai donc ici ce qui se trouve dans un manuscrit où quelques uns de ces motifs furent alors exposés.
« Premier motif : Ce serait rendre un très grand service à l’Église que de porter l’Évangile dans cette partie du monde (l’Amérique du Nord), et d’élever un rempart qui puisse défendre les fidèles contre l’Antechrist, dont on travaille à fonder l’empire dans le reste de l’univers.
« Second motif : Toutes les autres Églises d’Europe ont été frappées de désolation, et il est à craindre que Dieu n’ait porté le même arrêt contre la nôtre. Qui sait s’il n’a pas eu soin de préparer cette place (la Nouvelle-Angleterre) pour servir de refuge à ceux qu’il veut sauver de la destruction générale ?
« Troisième motif : Le pays où nous vivons semble fatigué d’habitants ; l’homme, qui est la plus précieuse des créatures, a ici moins de valeur que le sol qu’il foule sous ses pas. On regarde comme un pesant fardeau d’avoir des enfants, des voisins, des amis ; on fuit le pauvre ; les hommes repoussent ce qui devrait causer les plus grandes jouissances de ce monde, si les choses étaient suivant l’ordre naturel.
« Quatrième motif : Nos passions sont arrivées à ce point qu’il n’y a pas de fortune qui puisse mettre un homme en état de maintenir son rang parmi ses égaux. Et cependant celui qui ne peut y réussir est en butte au mépris : d’où il résulte que dans toutes les professions on [I-294] cherche à s’enrichir par des moyens illicites, et il devient difficile aux gens de bien d’y vivre à leur aise et sans déshonneur.
« Cinquième motif : Les écoles où l’on enseigne les sciences et la religion sont si corrompues, que la plupart des enfants, et souvent les meilleurs, les plus distingués d’entre eux, et ceux qui faisaient naître les plus légitimes espérances, se trouvent entièrement pervertis par la multitude des mauvais exemples dont ils sont témoins, et par la licence qui les environne.
« Sixième motif : La terre entière n’est-elle pas le jardin du Seigneur ? Dieu ne l’a-t-il pas livrée aux fils d’Adam pour qu’ils la cultivent et l’embellissent ? Pourquoi nous laissons nous mourir de faim faute de place, tandis que de vastes contrées également propres à l’usage de l’homme restent inhabitées et sans culture ?
« Septième motif : Élever une Église réformée et la soutenir dans son enfance ; unir nos forces avec celles d’un peuple fidèle pour la fortifier, la faire prospérer, et la sauver des hasards, et peut être de la misère complète à laquelle elle serait exposée sans cet appui, quelle œuvre plus noble et plus belle, quelle entreprise plus digne d’un chrétien ?
« Huitième motif : Si les hommes dont la piété est connue, et qui vivent ici (en Angleterre) au milieu de la richesse et du bonheur abandonnaient ces avantages pour travailler à l’établissement de cette Église réformée, et consentaiement à partager avec elle un sort obscur et pénible, ce serait un grand et utile exemple qui ranimerait la foi des fidèles dans les prières qu’ils adressent à Dieu en faveur de la colonie, et qui porterait beaucoup d’autres hommes à se joindre à eux. »
Plus loin, exposant les principes de l’Église de la Nouvelle-Angleterre en matière de morale, Mather s’élève avec violence contre l’usage de porter des santés à table, ce qu’il nomme une habitude païenne et abominable.
Il proscrit avec la même rigueur tous les ornements que les femmes peuvent mêler à leurs cheveux, et condamne sans pitié la mode qui s’établit, dit-il, parmi elles, de se découvrir le cou et les bras.
Dans une autre partie de son ouvrage, il nous raconte fort au long plusieurs faits de sorcellerie qui ont effrayé la Nouvelle-Angleterre. On semble une vérité incontestable et démontrée.
[I-295]
Dans un grand nombre d’endroits de ce même livre se révèle l’esprit de liberté civile et d’indépendance politique qui caractérisait les contemporains de l’auteur. Leurs principes en matière de gouvernement se montrent à chaque pas. C’est ainsi, par exemple, qu’on voit les habitants du Massachusetts, dès l’année 1630, dix ans après la fondation de Plymouth, consacrer 400 livres sterling à l’établissement de l’Université de Cambridge.
Si je passe des documents généraux relatifs à l’histoire de la Nouvelle-Angleterre à ceux qui se rapportent aux divers États compris dans ses limites, j’aurai d’abord à indiquer l’ouvrage intitulé : The History of the colony of Massachusetts, by Huchinson, lieutenant-governor of the Massachusetts province, 2 vol. in-8o. Il se trouve à la Bibliothèque Royale un exemplaire de ce livre : c’est une seconde édition imprimée à Londres en 1765.
L’histoire de Hutchinson, que j’ai plusieurs fois citée dans le chapitre auquel cette note se rapporte, commence à l’année 1628 et finit en 1750. Il règne dans tout l’ouvrage un grand air de véracité ; le style en est simple et sans apprêt. Cette histoire est très détaillée.
Le meilleur document à consulter, quant au Connecticut, est l’histoire de Benjamin Trumbull, intitulée : A complete History of Connecticut, civil and ecclesiastical, 1630-1764, 2 vol. in-8o, imprimés en 1818 à New-Haven. Je ne crois pas que l’ouvrage de Trumbull se trouve à la Bibliothèque Royale.
Cette histoire contient un exposé clair et froid de tous les événements survenus dans le Connecticut durant la période indiquée au titre. L’auteur a puisé aux meilleures sources, et ses récits conservent le cachet de la vérité. Tout ce qu’il dit des premiers temps du Connecticut est extrêmement curieux. Voyez notamment dans son ouvrage la Constitution de 1639, vol. 1, chap. VI, p. 100 ; et aussi les Lois pénales du Connecticut, vol. I, chap. VII, p. 123.
On estime avec raison l’ouvrage de Jérémie Belknap intitulé : History of New-Hampshire, 2 vol. in-8o, imprimés à Boston en 1792. Voyez particulièrement, dans l’ouvrage de Belknap, le chap. III du premier volume. Dans ce chapitre, l’auteur donne sur les principes politiques et religieux des puritains, sur les causes de leur émigration, et sur leurs lois, des détails extrêmement précieux. On y trouve cette citation curieuse d’un sermon prononcé en 1663 : « Il faut que la Nouvelle-Angleterre se [I-296] rappelle sans cesse qu’elle a été fondée dans un but de religion et non dans un but de commerce. On lit sur son front qu’elle a fait profession de pureté en matière de doctrine et de discipline. Que les commerçants et tous ceux qui sont occupés à placer denier sur denier se souviennent donc que c’est la religion et non le gain qui a été l’objet de la fondation de ces colonies. S’il est quelqu’un parmi nous qui, dans l’estimation qu’il fait du monde et de la religion, regarde le premier comme 13 et prend la seconde seulement pour 12, celui-là n’est pas animé des sentiments d’un véritable fils de la Nouvelle-Angleterre. » Les lecteurs rencontreront dans Belknap plus d’idées générales et plus de force de pensée que n’en présentent jusqu’à présent les autres historiens américains.
J’ignore si ce livre se trouve à la Bibliothèque Royale.
Parmi les États du centre dont l’existence est déjà ancienne, et qui méritent de nous occuper, se distinguent surtout l’État de New-York et la Pensylvanie. La meilleure histoire que nous ayons de l’État de New-York est intitulée : History of New-York, par William Smith, imprimée à Londres en 1757. Il en existe une traduction française, également imprimée à Londres en 1767, 1 vol. in-12. Smith nous fournit d’utiles détails sur les guerres des Français et des Anglais en Amérique. C’est de tous les historiens américains celui qui fait le mieux connaître la fameuse confédération des Iroquois.
Quant à la Pensylvanie, je ne saurais mieux faire qu’indiquer l’ouvrage de Proud intitulé : The history of Pensylvania, from the original institution and settlement of that province, under the first proprietor and governor William Penn, in 1681 till after the year 1742, par Robert Proud, 2 vol. in-8o, imprimés à Philadelphie en 1797.
Ce livre mérite particulièrement d’attirer l’attention du lecteur ; il contient une foule de documents très curieux sur Penn, la doctrine des quakers, le caractère, les mœurs, les usages des premiers habitants de la Pensylvanie, Il n’existe pas, à ce que je crois, à la Bibliothèque.
Je n’ai pas besoin d’ajouter que parmi les documents les plus importants relatifs à la Pensylvanie se placent les œuvres de Penn lui-même et celles de Franklin. Ces ouvrages sont connus d’un grand nombre de lecteurs.
La plupart des livres que je viens de citer avaient déjà été consultés par moi durant mon séjour en Amérique. La Bibliothèque Royale a bien [I-297] voulu m’en confier quelques uns ; les autres m’ont été prêtés par M. Varden, ancien consul-général des États-Unis à Paris, auteur d’un excellent ouvrage sur l’Amérique. Je ne veux point terminer cette note sans prier M. Varden d’agréer ici l’expression de ma reconnaissance.
( G) PAGE 79. (↑)
On trouve ce qui suit dans les Mémoires de Jefferson : « Dans les premiers temps de l’établissement des Anglais en Virginie, quand on obtenait des terres pour peu de chose, ou même pour rien, quelques individus prévoyants avaient acquis de grandes concessions, et désirant maintenir la splendeur de leur famille, ils avaient substitué leurs biens à leurs descendants. La transmission de ces propriétés de génération en génération, à des hommes qui portaient le même nom, avait fini par élever une classe distincte de familles qui, tenant de la loi le privilége de perpétuer leurs richesses, formaient de cette manière une espèce d’ordre de patriciens distingués par la grandeur et le luxe de leurs établissements. C’est parmi cet ordre que le roi choisissait d’ordinaire ses conseillers d’État. » (Jefferson’s Memoirs.)
Aux États-Unis, les principales dispositions de la loi anglaise relative aux successions ont été universellement rejetées.
« La première règle que nous suivons en matière de succession, dit M. Kent, est celle-ci : Lorsqu’un homme meurt intestat, son bien passe à ses héritiers en ligne directe ; s’il n’y a qu’un héritier ou une héritière, il ou elle recueille seul toute la succession. S’il existe plusieurs héritiers du même degré, ils partagent également entre eux la succession, sans distinction de sexe. »
Cette règle fut prescrite pour la première fois dans l’État de New-York par un statut du 23 février 1786 (voyez Revised Statutes, vol. 3 ; Appendice, p. 48) ; elle a été adoptée depuis dans les statuts révisés du même État. Elle prévaut maintenant dans toute l’étendue des États-Unis, avec cette seule exception que dans l’État de Vermont l’héritier mâle prend double portion.
Kent’s commentaries, vol. 4, p. 370.
M. Kent, dans le même ouvrage, vol. 4, p. 1-22, fait l’historique de la législation américaine relative aux substitutions. Il en résulte qu’avant la révolution d’Amérique les lois anglaises sur les substitutions formaient le droit commun dans les colonies. Les substitutions [I-298] proprement dites (Estates’ tail) furent abolies en Virginie dès 1776 (cette abolition eut lieu sur la motion de Jefferson ; voyez Jefferson’s Memoirs), dans l’État de New-York en 1786. La même abolition a eu lieu depuis dans la Caroline du Nord, le Kentucky, le Tennessee, la Géorgie, le Missouri. Dans le Vermont, l’État d’Indiana, d’Illinois, de la Caroline du Sud et de la Louisiane, les substitutions ont toujours été inusitées. Les États qui ont cru devoir conserver la législation anglaise relative aux substitutions, l’ont modifiée de manière à lui ôter ses principaux caractères aristocratiques. « Nos principes généraux en matière de gouvernement, dit M. Kent, tendent à favoriser la libre circulation de la propriété. »
Ce qui frappe singulièrement le lecteur français qui étudie la législation américaine relative aux successions, c’est que nos lois sur la même matière sont infiniment plus démocratiques encore que les leurs.
Les lois américaines partagent également les biens du père, mais dans le cas seulement où sa volonté n’est pas connue : « car chaque homme, dit la loi, dans l’État de New-York (Revised Statutes, vol. 3 ; Appendix, p. 51), a pleine liberté, pouvoir et autorité, de disposer de ses biens par testament, de léguer, diviser, en faveur de quelque personne que ce puisse être, pourvu qu’il ne teste pas en faveur d’un corps politique ou d’une société organisée. »
La loi française fait du partage égal ou presque égal la règle du testateur.
La plupart des républiques américaines admettent encore les substitutions, et se bornent à en restreindre les effets.
La loi française ne permet les substitutions dans aucun cas.
Si l’état social des Américains est encore plus démocratique que le nôtre, nos lois sont donc plus démocratiques que les leurs. Ceci s’explique mieux qu’on ne le pense : en France, la démocratie est encore occupée à démolir ; en Amérique, elle règne tranquillement sur des ruines.
( H) PAGE 90. Résumé des conditions électorales aux États-Unis. (↑)
Tous les États accordent la jouissance des droits électoraux à vingt-un ans. Dans tous les États, il faut avoir résidé un certain temps dans le district où l’on vote. Ce temps varie depuis trois mois jusqu’à deux ans.
[I-299]
Quant au cens : dans l’État de Massachusetts, il faut, pour être électeur, avoir 3 livres sterling de revenu, ou 60 de capital.
Dans le Rhode-Island, il faut posséder une propriété foncière valant 133 dollars (704 francs).
Dans le Connecticut, il faut avoir une propriété dont le revenu soit de 17 dollars (90 francs environ). Un an de service dans la milice donne également le droit électoral.
Dans le New-Jersey, l’électeur doit avoir 50 livres sterling de fortune.
Dans la Caroline du Sud et le Maryland, l’électeur doit posséder 50 acres de terre.
Dans le Tennessee, il doit posséder une propriété quelconque.
Dans les États du Mississipi, Ohio, Géorgie, Virginie, Pensylvanie, Delaware, New-York, il suffit, pour être électeur, de payer des taxes : dans la plupart de ces États, le service de la milice équivaut au paiement de la taxe.
Dans le Maine et dans le New-Hampshire, il suffit de n’être pas porté sur la liste des indigents.
Enfin, dans les États de Missouri, Alabama, Illinois, Louisiana, Indiana, Kentucky, Vermont, on n’exige aucune condition qui ait rapport à la fortune de l’électeur.
Il n’y a, je pense, que la Caroline du Nord qui impose aux électeurs du sénat d’autres conditions qu’aux électeurs de la chambre des représentants. Les premiers doivent posséder en propriété 50 acres de terre. Il suffit, pour pouvoir élire les représentants, de payer une taxe.
( I) PAGE 152. (↑)
Il existe aux États-Unis un système prohibitif. Le petit nombre des douaniers et la grande étendue des côtes rendent la contrebande très facile ; cependant on l’y fait infiniment moins qu’ailleurs, parce que chacun travaille à la réprimer.
Comme il n’y a pas de police préventive aux États-Unis, on y voit plus d’incendies qu’en Europe ; mais en général ils y sont éteints plus tôt, parce que la population environnante ne manque pas de se porter avec rapidité sur le lieu du danger.
( K) PAGE 155. (↑)
Il n’est pas juste de dire que la centralisation soit née de la révolution [I-300] française ; la révolution française l’a perfectionnée, mais ne l’a point créée. Le goût de la centralisation et la manie réglementaire remontent, en France, à l’époque où les légistes sont entrés dans le gouvernement ; ce qui nous reporte au temps de Philippe-le-Bel. Depuis lors, ces deux choses n’ont jamais cessé de croître. Voici ce que M. de Malhesherbes, parlant au nom de la cour des Aides, disait au roi Louis XVI, en 1775 [165] :
«……… Il restait à chaque corps, à chaque communauté de citoyens le droit d’administrer ses propres affaires ; droit que nous ne disons pas qui fasse partie de la constitution primitive du royaume, car il remonte bien plus haut : c’est le droit naturel, c’est le droit de la raison. Cependant il a été enlevé à vos sujets, sire, et nous ne craindrons pas de dire que l’administration est tombée à cet égard dans des excès qu’on peut nommer puérils.
Depuis que des ministres puissants se sont fait un principe politique de ne point laisser convoquer d’assemblée nationale, on en est venu de conséquences en conséquences jusqu’à déclarer nulles les délibérations des habitants d’un village quand elles ne sont pas autorisées par un intendant ; en sorte que, si cette communauté a une dépense à faire, il faut prendre l’attache du subdélégué de l’intendant, par conséquent suivre le plan qu’il a adopté, employer les ouvriers qu’il favorise, les payer suivant son arbitraire ; et si la communauté a un procès à soutenir, il faut aussi qu’elle se fasse autoriser par l’intendant. Il faut que la cause soit plaidée à ce premier tribunal avant d’être portée devant la justice. Et si l’avis de l’intendant est contraire aux habitants, ou si leur adversaire a du crédit à l’intendance, la communauté est déchue de la faculté de défendre ses droits. Voilà, sire, par quels moyens on a travaillé à étouffer en France tout esprit municipal, à éteindre, si on le pouvait, jusqu’aux sentiments de citoyens ; on a pour ainsi dire interdit la nation entière, et on lui a donné des tuteurs. »
Que pourrait-on dire de mieux aujourd’hui, que la révolution française a fait ce qu’on appelle ses conquêtes en matière de centralisation ?
En 1789, Jefferson écrivait de Paris à un de ses amis : « Il n’est pas [I-301] de pays où la manie de trop gouverner ait pris de plus profondes racines qu’en France, et où elle cause plus de mal. » Lettres à Madisson, 28 août 1789.
La vérité est qu’en France, depuis plusieurs siècles, le pouvoir central a toujours fait tout ce qu’il a pu pour étendre la centralisation administrative ; il n’a jamais eu dans cette carrière d’autres limites que ses forces.
Le pouvoir central né de la révolution française a marché plus avant en ceci qu’aucun de ses prédécesseurs, parce qu’il a été plus fort et plus savant qu’aucun d’eux. Louis XIV soumettait les détails de l’existence communale aux bons plaisirs d’un intendant ; Napoléon les a soumis à ceux du ministre. C’est toujours le même principe, étendu à des conséquences plus ou moins reculées.
( L) PAGE 160. (↑)
Cette immutabilité de la constitution en France est une conséquence forcée de nos lois.
Et pour parler d’abord de la plus importante de toutes les lois, celle qui règle l’ordre de succession au trône, qu’y a-t-il de plus immuable dans son principe qu’un ordre politique fondé sur l’ordre naturel de succession de père en fils ? En 1814, Louis XVIII avait fait reconnaître cette perpétuité de la loi de succession politique en faveur de sa famille ; ceux qui ont réglé les conséquences de la révolution de 1830 ont suivi son exemple : seulement ils ont établi la perpétuité de la loi au profit d’une autre famille ; ils ont imité en ceci le chancelier Meaupou, qui, en instituant le nouveau parlement sur les ruines de l’ancien, eut soin de déclarer dans la même ordonnance que les nouveaux magistrats seraient inamovibles, ainsi que l’étaient leurs prédécesseurs.
Les lois de 1830, non plus que celles de 1814, n’indiquent aucun moyen de changer la constitution. Or, il est évident que les moyens ordinaires de la législation ne sauraient suffire à cela.
De qui le roi tient-il ses pouvoirs ? de la constitution. De qui les pairs ? de la constitution. De qui les députés ? de la constitution. Comment donc le roi, les pairs et les députés, en se réunissant, pourraient-ils changer quelque chose à une loi en vertu de laquelle seule ils gouvernent ? Hors de la constitution ils ne sont rien : sur quel terrain se placeraient-ils donc pour changer la constitution ? De deux choses l’une : ou leurs efforts sont impuissants contre la Charte, qui continue à exister en [I-302] dépit d’eux, et alors ils continuent à régner en son nom ; ou ils parviennent à changer la Charte, et alors la loi par laquelle ils existaient n’existant plus, ils ne sont plus rien eux-mêmes. En détruisant la Charte, ils se sont détruits.
Cela est bien plus visible encore dans les lois de 1830 que dans celles de 1814. En 1814, le pouvoir royal se plaçait en quelque sorte en dehors et au-dessus de la constitution ; mais en 1830, il est, de son aveu, créé par elle, et n’est absolument rien sans elle.
Ainsi donc une partie de notre constitution est immuable, parce qu’on l’a jointe à la destinée d’une famille ; et l’ensemble de la constitution est également immuable, parce qu’on n’aperçoit point de moyens légaux de la changer.
Tout ceci n’est point applicable à l’Angleterre. L’Angleterre n’ayant point de constitution écrite, qui peut dire qu’on change sa constitution ?
( M) PAGE 160. (↑)
Les auteurs les plus estimés qui ont écrit sur la constitution anglaise établissent comme à l’envi cette omnipotence du parlement.
Delolme dit, chap. x, p. 77 : It is a fundamental principle with the English lawyers, that parliament can do every thing ; except making a woman a man or a man a woman.
Blackstone s’explique plus catégoriquement encore, sinon plus énergiquement, que Delolme ; voici en quels termes :
« La puissance et la juridiction du parlement sont si étendues et si absolues, suivant sir Edouard Coke (4 Hist. 36), soit sur les personnes, soit sur les affaires, qu’aucunes limites ne peuvent lui être assignées… On peut, ajoute-il, dire avec vérité de cette cour : Si antiquitatem spectes, est vetustissima ; si dignitatem, est honoratissima ; si jurisdictionem, est capacissima. Son autorité, souveraine et sans contrôle, peut faire confirmer, étendre, restreindre, abroger, révoquer, renouveler et interpréter les lois sur les matières de toutes dénominations ecclésiastiques, temporelles, civiles, militaires, maritimes, criminelles. C’est au parlement que la constitution de ce royaume a confié ce pouvoir despotique et absolu qui, dans tout gouvernement, doit résider quelque part. Les griefs, les remèdes à apporter, les déterminations hors du cours ordinaire des lois, tout est atteint par ce tribunal extraordinaire. Il peut régler ou changer la succession au trône, comme il l’a [I-303] fait sous les règnes de Henri VIII et de Guillaume III ; il peut altérer la religion nationale établie, comme il l’a fait en diverses circonstances sous les règnes de Henri VIII et de ses enfants ; il peut changer et créer de nouveau la constitution du royaume et des parlements eux-mêmes, comme il l’a fait par l’acte d’union de l’Angleterre et de l’Écosse, et par divers statuts pour les élections triennales et septennales. En un mot, il peut faire tout ce qui n’est pas naturellement impossible : aussi n’a-t-on pas fait scrupule d’appeler son pouvoir, par une figure peut-être trop hardie, la toute-puissance du parlement. »
( N) PAGE 178. (↑)
Il n’y a pas de matière sur laquelle les constitutions américaines s’accordent mieux que sur le jugement politique.
Toutes les constitutions qui s’occupent de cet objet donnent à la chambre des représentants le droit exclusif d’accuser ; excepté la seule constitution de la Caroline du Nord, qui accorde ce même droit aux grands jurys (article 23).
Presque toutes les constitutions donnent au sénat, ou à l’assemblée qui en tient la place, le droit exclusif de juger.
Les seules peines que puissent prononcer les tribunaux politiques sont : la destitution ou l’interdiction des fonctions publiques à l’avenir. Il n’y a que la constitution de Virginie qui permette de prononcer toute espèce de peines.
Les crimes qui peuvent donner lieu au jugement politique sont : dans la constitution fédérale (sect. IV, art. I), dans celle d’Indiana (art. 3, p. 23 et 24), de New-York (art. 5), de Delaware (art. 5), la haute trahison, la corruption, et autres grands crimes ou délits ;
Dans la constitution de Massachusetts (chap. 1, sect. 2), de la Caroline du Nord (art. 23) et de Virginie (p. 252), la mauvaise conduite et la mauvaise administration ;
Dans la constitution de New-Hampshire (p. 105), la corruption, les manœuvres coupables et la mauvaise administration ;
Dans le Vermont (chap. II, art. 24), la mauvaise administration ;
Dans la Caroline du Sud (art. 5), le Kentucky (art. 5), le Tennessee (art. 4), l’Ohio (art. I, § 23, 24), la Louisiane (art. 5), le Mississipi (art. 5), l’Alabama (art. 6), la Pensylvanie (art. 4), les délits commis dans les fonctions.
[I-304]
Dans les États d’Illinois, de Géorgie, du Maine et du Connecticut, on ne spécifie aucun crime.
( O) PAGE 277. (↑)
Il est vrai que les puissances de l’Europe peuvent faire à l’Union de grandes guerres maritimes ; mais il y a toujours plus de facilité et moins de danger à soutenir une guerre maritime qu’une guerre continentale. La guerre maritime n’exige qu’une seule espèce d’efforts. Un peuple commerçant qui consentira à donner à son gouvernement l’argent nécessaire, est toujours sûr d’avoir des flottes. Or, on peut beaucoup plus aisément déguiser aux nations les sacrifices d’argent que les sacrifices d’hommes et les efforts personnels. D’ailleurs des défaites sur mer compromettent rarement l’existence ou l’indépendance du peuple qui les éprouve.
Quant aux guerres continentales, il est évident que les peuples de l’Europe ne peuvent en faire de dangereuses à l’Union américaine.
Il est bien difficile de transporter ou d’entretenir en Amérique plus de 25,000 soldats ; ce qui représente une nation de 2,000,000 d’hommes à peu près. La plus grande nation européenne luttant de cette manière contre l’Union est dans la même position où serait une nation de 2,000,000 d’habitants en guerre contre une de 12,000,000. Ajoutez à cela que l’Américain est à portée de toutes ses ressources et l’Européen à 1,500 lieues des siennes, et que l’immensité du territoire des États-Unis présenterait seule un obstacle insurmontable à la conquête.
[I-305]
CONSTITUTIONS DES ÉTATS-UNIS ET DE L’ÉTAT DE NEW-YORK.↩
[I-307]
CONSTITUTIONS DES ÉTATS-UNIS
Nous le peuple des États-Unis, afin de former une union plus parfaite, d’établir la justice, d’assurer la tranquillité intérieure, de pourvoir à la défense commune, d’accroître le bien-être général, et de rendre durable pour nous comme pour notre postérité les bienfaits de la liberté, nous faisons, nous décrétons et nous établissons cette Constitution pour les États-Unis d’Amérique.
[I-308]
ARTICLE PREMIER.
SECTION PREMIÈRE.
Un congrès des États-Unis, composé d’un sénat et d’une chambre de représentants, sera investi de tous les pouvoirs législatifs déterminés par les représentants.
SECTION DEUXIÈME.
1. La chambre des représentants sera composée de membres élus tous les deux ans par le peuple des divers États, et les électeurs de chaque État devront avoir les qualifications exigées des électeurs de la branche la plus nombreuse de la législature de l’État.
2. Personne ne pourra être représentant, à moins d’avoir atteint l’âge de vingt-cinq ans, d’avoir été pendant sept ans citoyen des États-Unis, et d’être, au moment de son élection, habitant de l’État qui l’aura élu.
3. Les représentants et les taxes directes seront répartis entre les divers États qui pourront faire partie de l’Union, selon le nombre respectif de leurs habitants, nombre qui sera déterminé en ajoutant au nombre total des personnes libres, y compris ceux servant pour un terme limité, et non compris les Indiens non taxés, trois cinquièmes de toutes autres personnes. L’énumération pour l’époque actuelle sera faite trois ans après la première réunion du congrès des États-Unis, et ensuite de dix ans en dix ans, d’après le mode qui sera réglé par une loi. Le nombre des représentants n’excédera pas celui d’un par trente [I-309] mille habitants ; mais chaque État aura au moins un représentant. Jusqu’à ce que l’énumération ait été faite, l’État de New-Hampshire en enverra trois, Massachusetts huit, Rhode-island et les plantations de Providence un, Connecticut cinq, New-York six, New-Jersey quatre, la Pensylvanie huit, le Delaware un, le Maryland six, la Virginie dix, la Caroline septentrionale cinq, la Caroline méridionale cinq, et la Géorgie trois.
4. Quand des places viendront à vaquer dans la représentation d’un État au congrès, l’autorité exécutive de l’État convoquera le corps électoral pour les remplir.
5. La chambre des représentants élira ses orateurs et autres officiers ; elle exercera seule le pouvoir de mise en accusation pour cause politique (impeachments).
SECTION TROISIÈME.
1. Le sénat des États-Unis sera composé de deux sénateurs de chaque État, élus par sa législature, et chaque sénateur aura un vote.
2. Immédiatement après leur réunion, en conséquence de leur première élection, ils seront divisés, aussi également que possible, en trois classes. Les sièges des sénateurs de la première classe seront vacants au bout de la seconde année ; ceux de la seconde classe, au bout de la quatrième année, et ceux de la troisième, à l’expiration de la sixième année, de manière à ce que tous les deux ans un tiers du sénat soit réélu. Si des places deviennent vacantes par démission ou par toute autre cause, pendant [I-310] l’intervalle entre les sessions de la législature de chaque État, le pouvoir exécutif de cet État fera une nomination provisoire, jusqu’à ce que la législature puisse remplir le siège vacant.
3. Personne ne pourra être sénateur, à moins d’avoir atteint l’âge de trente ans, d’avoir été pendant neuf ans citoyen des États-Unis, et d’être, au moment de son élection, habitant de l’État qui l’aura choisi.
4. Le vice-président des États-Unis sera président du sénat, mais il n’aura point le droit de voter, à moins que les voix ne soient partagées également.
5. Le sénat nommera ses autres officiers, ainsi qu’un président pro tempore, qui présidera dans l’absence du vice-président, ou quand celui-ci exercera les fonctions de président des États-Unis.
6. Le sénat aura seul le pouvoir de juger les accusations intentées par la chambre des représentants (impeachments). Quand il agira dans cette fonction, ses membres prêteront serment ou affirmation. Si c’est le président des États-Unis qui est mis en jugement, le chef de la justice présidera. Aucun accusé ne peut être déclaré coupable qu’à la majorité des deux tiers des membres présents.
7. Les jugements rendus en cas de mise en accusation n’auront d’autre effet que de priver l’accusé de la place qu’il occupe, de le déclarer incapable de posséder quelque office d’honneur, de confiance, ou de profit que ce soit, dans les États-Unis ; mais la partie convaincue pourra être mise en jugement, jugée et punie, selon les lois, par les tribunaux ordinaires.
[I-311]
SECTION QUATRIÈME.
1. Le temps, le lieu et le mode de procéder aux élections des sénateurs et des représentants seront réglés dans chaque État par la législature ; mais le congrès peut, par une loi, changer ces règlements ou en faire de nouveaux, excepté pourtant en ce qui concerne le lieu où les sénateurs doivent être élus.
2. Le congrès s’assemblera au moins une fois l’année, et cette réunion sera fixée pour le premier lundi de décembre, à moins qu’une loi ne la fixe à un autre jour.
SECTION CINQUIÈME.
1. Chaque chambre sera juge des élections et des droits et titres de ses membres. Une majorité de chacune suffira pour traiter les affaires ; mais un nombre moindre que la majorité peut s’ajourner de jour en jour, et est autorisé à forcer les membres absents à se rendre aux séances, par telle pénalité que chaque chambre pourra établir.
2. Chaque chambre fera son règlement, punira ses membres pour conduite inconvenante, et pourra, à la majorité des deux tiers, exclure un membre.
3. Chaque chambre tiendra un journal de ses délibérations et le publiera d’époque en époque, à l’exception de ce qui lui paraîtra devoir rester secret ; et les votes négatifs on approbatifs des membres de chaque chambre sur une question quelconque, seront, sur la demande d’un cinquième des membres présents, consignés sur le journal.
4. Aucune des deux chambres ne pourra, pendant [I-312] la session du congrès, et sans le consentement de l’autre chambre, s’ajourner à plus de trois jours, ni transférer ses séances dans un autre lieu que celui où siègent les deux chambres.
SECTION SIXIÈME.
1. Les sénateurs et les représentants recevront pour leurs services une indemnité qui sera fixée par une loi et payée par le trésor des États-Unis. Dans tous les cas, excepté ceux de trahison, de félonie et de trouble à la paix publique, ils ne pourront être arrêtés, soit pendant leur présence à la session, soit en s’y rendant ou en retournant dans leurs foyers ; dans aucun autre lieu ils ne pourront être inquiétés, ni interrogés en raison de discours ou opinions prononcés dans leurs chambres respectives.
2. Aucun sénateur ou représentant ne pourra, pendant le temps pour lequel il a été élu, être nommé à une place dans l’ordre civil sous l’autorité des États-Unis, lorsque cette place aura été créée ou que les émoluments en auront été augmentés pendant cette époque. Aucun individu occupant une place sous l’autorité des États-Unis ne pourra être membre d’une des deux chambres, tant qu’il conservera cette place.
SECTION SEPTIÈME.
1. Tous les bills établissant des impôts doivent prendre naissance dans la chambre des représentants ; mais le sénat peut y concourir par des amendements comme aux autres bills.
2. Tout bill qui aura reçu l’approbation du sénat [I-313] et de la chambre des représentants sera, avant de devenir loi, présenté au président des États-Unis ; s’il l’approuve, il y apposera sa signature, sinon il le renverra avec ses objections à la chambre dans laquelle il aura été proposé ; elle consignera les objections intégralement dans son journal, et discutera de nouveau le bill. Si, après cette seconde discussion, deux tiers de la chambre se prononcent en faveur du bill, il sera envoyé, avec les objections du président, à l’autre chambre, qui le discutera également et si la même majorité l’approuve, il deviendra loi : mais en pareil cas, les votes des chambres doivent être donnés par oui et par non, et les noms des personnes votant pour ou contre seront inscrits sur le journal de leurs chambres respectives. Si dans les dix jours (les dimanches non compris) le président ne renvoie point un bill qui lui aura été présenté, ce bill aura force de loi, comme s’il l’avait signé, à moins cependant que le congrès, en s’ajournant, ne prévienne le renvoi ; alors le bill ne fera point loi.
3. Tout ordre, toute résolution ou vote pour lequel le concours des deux chambres est nécessaire (excepté pourtant pour la question d’ajournement), doit être présenté au président des États-Unis, et approuvé par lui avant de recevoir son exécution ; s’il le rejette, il doit être de nouveau adopté par les deux tiers des deux chambres, suivant les règles prescrites pour les bills.
SECTION HUITIÈME.
Le congrès aura le pouvoir :
1o D’établir et de faire percevoir des taxes, droits [I-314] impôts et excises ; de payer les dettes publiques, et de pourvoir à la défense commune et au bien général des États-Unis ; mais les droits, impôts et excises devront être les mêmes dans tous les États-Unis ;
2o D’emprunter de l’argent sur le crédit des États-Unis ;
3o De régler le commerce avec les nations étrangères, entre les divers États, et avec les tribus indiennes ;
4o D’établir une règle générale pour les naturalisations, et des lois générales sur les banqueroutes dans les États-Unis ;
5o De battre la monnaie, d’en régler la valeur, ainsi que celle des monnaies étrangères, et de fixer la base des poids et mesures ;
6o D’assurer la punition de la contrefaçon de la monnaie courante et du papier public des États-Unis ;
7o D’établir des bureaux de poste et des routes de poste ;
8o D’encourager les progrès des sciences et des arts utiles, en assurant, pour des périodes limitées, aux auteurs et inventeurs, le droit exclusif de leurs écrits et de leurs découvertes ;
9o De constituer des tribunaux subordonnés à la cour suprême ;
10o De définir et punir les pirateries et les félonies commises en haute mer, et les offenses contre la loi des nations ;
11o De déclarer la guerre, d’accorder des lettres de marque et de représailles, et de faire des règlements concernant les captures sur terre et sur mer ;
[I-315]
12o De lever et d’entretenir des armées ; mais aucun argent pour cet objet ne pourra être voté pour plus de deux ans ;
13o De créer et d’entretenir un force maritime ;
14o D’établir des règles pour l’administration et l’organisation des forces de terre et de mer ;
15o De pourvoir à ce que la milice soit convoquée pour exécuter les lois de l’Union, pour réprimer les insurrections et repousser les invasions ;
16o De pourvoir à ce que la milice soit organisée, armée et disciplinée, et de disposer de cette partie de la milice qui peut se trouver employée au service des États-Unis, en laissant aux États respectifs la nomination des officiers, et le soin d’établir dans la milice la discipline prescrite par le congrès ;
17o D’exercer la législation exclusive dans tous les cas quelconques, sur tel district (ne dépassant pas dix milles carrés) qui pourra, par la cession des États particuliers et par l’acceptation du congrès, devenir le siège du gouvernement des États-Unis, et d’exercer une pareille autorité sur tous les lieux acquis par achat, d’après le consentement de la législature de l’État ou ils seront situés, et qui serviront à l’établissement de forteresses, de magasins, d’arsenaux, de chantiers et autres établissements d’utilité publique ;
18o Enfin, le congrès aura le pouvoir de faire toutes les lois nécessaires ou convenables pour mettre à exécution les pouvoirs qui lui ont été accordés, et tous les autres pouvoirs dont cette constitution a investi le gouvernement des États-Unis, ou une de ses branches.
[I-316]
SECTION NEUVIÈME.
1. La migration ou l’importation de telles personnes dont l’admission peut paraître convenable aux États actuellement existants, ne sera point prohibée par le congrès avant l’année 1808 ; mais une taxe ou droit n’excédant point dix dollars par personne, peut être imposée sur cette importation.
2. Le privilège de l’habeas corpus ne sera suspendu qu’en cas de rébellion on d’invasion, et lorsque la sûreté publique l’exigera.
3. Aucun bill d’attainder ni loi rétroactive ex post facto ne pourront être décrétés.
4. Aucune capitation ou autre taxe directe ne sera établie, si ce n’est en proportion du dénombrement prescrit dans une section précédente.
5. Aucune taxe ou droit ne sera établi sur des articles exportés d’un État quelconque, aucune préférence ne sera donnée par des règlements commerciaux ou fiscaux aux ports d’un État sur ceux d’un autre ; les vaisseaux destinés pour un État ou sortant de ses ports, ne pourront être forcés d’entrer dans ceux d’un autre ou d’y payer des droits.
6. Aucun argent ne sera tiré de la trésorerie qu’en conséquence de dispositions prises par une loi, et de temps en temps on publiera un tableau régulier des recettes et des dépenses publiques.
7. Aucun titre de noblesse ne sera accordé par les États-Unis, et aucune personne tenant une place de profit ou de confiance sous leur autorité, ne pourra, sans le consentement du congrès, accepter quelque [I-317] présent, émolument, place ou titre quelconque, d’un roi, prince ou État étranger.
SECTION DIXIÈME.
1. Aucun État ne pourra contracter ni traité, ni alliance, ni confédération, ni accorder des lettres de marque ou des représailles, ni battre monnaie, ni émettre des bills de crédit, ni déclarer qu’autre chose que la monnaie d’or et d’argent doive être acceptée en paiement de dettes, ni passer quelque bill d’attainder, ou loi rétroactive ex post facto, ou affaiblissement des obligations des contrats, ni accorder aucun titre de noblesse.
2. Aucun État ne pourra, sans le consentement du congrès, établir quelque impôt ou droit sur les importations ou exportations, à l’exception de ce qui lui sera absolument nécessaire pour l’exécution de ses lois d’inspection ; et le produit net de tous droits et impôts établis par quelque État sur les importations et exportations, sera à la disposition de la trésorerie des États-Unis, et toute loi pareille sera sujette à la révision et au contrôle du congrès. Aucun État ne pourra, sans le consentement du congrès, établir aucun droit sur le tonnage, entretenir des troupes ou des vaisseaux de guerre en temps de paix, contracter quelque traité ou union avec un autre État ou avec une puissance étrangère, ou s’engager dans une guerre, si ce n’est dans les cas d’invasion ou d’un danger assez imminent pour n’admettre aucun délai.
[I-318]
ARTICLE DEUXIÈME.
SECTION PREMIÈRE.
1. Le président des États-Unis sera investi du pouvoir exécutif ; il occupera sa place pendant le terme de quatre ans ; son élection et celle du vice-président, nommé pour le même terme, auront lieu ainsi qu’il suit :
2. Chaque État nommera, de la manière qui sera prescrite par sa législature, un nombre d’électeurs égal au nombre total de sénateurs et de représentants que l’État envoie au congrès ; mais aucun sénateur ou représentant, ni aucune personne possédant une place de profit ou de confiance sous l’autorité des États-Unis, ne peut être nommé électeur.
3. Les électeurs s’assembleront dans leurs États respectifs, et ils voteront au scrutin pour deux individus, dont un au moins ne sera point habitant du même État qu’eux. Ils feront une liste de toutes les personnes qui ont obtenu des suffrages, et du nombre de suffrages que chacune d’elles aura obtenu ; ils signeront et certifieront cette liste, et la transmettront scellée au siége du gouvernement des États-Unis, sous l’adresse du président du sénat, qui, en présence du sénat et de la chambre des représentants, ouvrira tous les certificats, et comptera les votes. Celui qui aura obtenu le plus grand nombre de votes sera président. Si ce nombre forme la majorité des électeurs, si plusieurs ont obtenu cette majorité, et que deux ou un plus grand nombre réunissent la même quantité de suffrages, alors la chambre des [I-319] représentants choisira l’un d’entre eux pour président par la voie du scrutin. Si nul n’a réuni cette majorité, la chambre prendra les cinq personnes qui en ont approché davantage, et choisira parmi elles le président de la même manière. Mais en choisissant ainsi le président, les votes seront pris par État, la représentation de chaque État ayant un vote : un membre ou des membres des deux tiers des États devront être présents, et la majorité de tous ces États sera indispensable pour que le choix soit valide. Dans tous les cas, après le choix du président, celui qui réunira le plus de voix sera vice-président. Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu un nombre égal de voix, le sénat choisira parmi ces candidats le vice-président par voie de scrutin.
4. Le congrès peut déterminer l’époque de la réunion des électeurs, et le jour auquel ils donneront leurs suffrages, lequel jour sera le même pour tous les États-Unis.
5. Aucun individu autre qu’un citoyen né dans les États-Unis, ou étant citoyen lors de l’adoption de cette constitution, ne peut être éligible à la place de président ; aucune personne ne sera éligible à cette place, à moins d’avoir atteint l’âge de trente-cinq ans, et d’avoir résidé quatorze ans aux États-Unis.
6. En cas que le président soit privé de sa place, on en cas de mort, de démission ou d’inhabilité à remplir les fonctions et les devoirs de cette place, elle sera confiée au vice-président, et le congrès peut par une loi pourvoir au cas du renvoi, de la mort, de la démission ou de l’inhabileté, tant du président que du vice-président, et indiquer quel fonctionnaire public [I-320] remplira en pareils cas la présidence, jusqu’à ce que la cause de l’inhabileté n’existe plus, ou qu’un nouveau président ait été élu.
7. Le président recevra pour ses services, à des époques fixées, une indemnité qui ne pourra être augmentée ni diminuée pendant la période pour laquelle il aura été élu, et pendant le même temps il ne pourra recevoir aucun autre émolument des États-Unis ou de l’un des États.
8. Avant son entrée en fonctions, il prêtera le serment ou affirmation qui suit :
9. « Je jure (ou j’affirme) solennellement que je remplirai fidèlement la place de président des États-Unis, et que j’emploierai tous mes soins à conserver, protéger et défendre la constitution des États-Unis. »
SECTION DEUXIÈME.
1. Le président sera commandant en chef de l’armée et des flottes des États-Unis et de la milice des divers États, quand elle sera appelée au service actif des États-Unis ; il peut requérir l’opinion écrite du principal fonctionnaire dans chacun des départements exécutifs, sur tout objet relatif aux devoirs de leurs offices respectifs, et il aura le pouvoir d’accorder diminution de peine et pardon pour délits envers les États-Unis, excepté en cas de mise en accusation par la chambre des représentants.
2. Il aura le pouvoir de faire des traités, de l’avis et du consentement du sénat, pourvu que les deux tiers des sénateurs présents y donnent leur [I-321] approbation ; il nommera, de l’avis et du consentement du sénat, et désignera les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls, les juges des Cours suprêmes, et tous autres fonctionnaires des États-Unis aux nominations desquels il n’aura point été pourvu d’une autre manière dans cette constitution, et qui seront institués par une loi. Mais le congrès peut par une loi attribuer les nominations de ces employés subalternes au président seul, aux Cours de justice, ou aux chefs des départements.
3. Le président aura le pouvoir de remplir toutes les places vacantes pendant l’intervalle des sessions du sénat, en accordant des commissions qui expireront à la fin de la session prochaine.
SECTION TROISIÈME.
1. De temps en temps le président donnera au congrès des informations sur l’État de l’Union, et il recommandera à sa considération les mesures qu’il jugera nécessaires et convenables ; il peut, dans des occasions extraordinaires, convoquer les deux chambres, ou l’une d’elles, et en cas de dissentiments entre elles sur le temps de leur ajournement, il peut les ajourner à telle époque qui lui paraîtra convenable. Il recevra les ambassadeurs et les autres ministres publics ; il veillera à ce que les lois soient fidèlement exécutées, et il commissionnera tous les fonctionnaires des États-Unis.
SECTION QUATRIÈME.
Les président, vice-président et tous les fonctionnaires civils pourront être renvoyés de leurs places, [I-322] si à la suite d’une accusation ils sont convaincus de trahison, de dilapidation du trésor public ou d’autres grands crimes et d’inconduite (misdemeanors).
ARTICLE TROISIÈME.
SECTION PREMIÈRE.
Le pouvoir judiciaire des États-Unis sera confié à une Cour suprême et aux autres Cours inférieures que le congrès peut de temps à autre former et établir. Les juges, tant des Cours suprêmes que des Cours inférieures, conserveront leurs places tant que leur conduite sera bonne, et ils recevront pour leurs services, à des époques fixées, une indemnité qui ne pourra être diminuée tant qu’ils conserveront leur place.
SECTION DEUXIÈME.
1. Le pouvoir judiciaire s’étendra à toutes les causes en matière de lois et d’équité qui s’élèveront sous l’empire de cette constitution, des lois des États-Unis, et des traités faits ou qui seront faits sous leur autorité ; à toutes les causes concernant des ambassadeurs, d’autres ministres publics ou des consuls ; à toutes les causes de l’amirauté ou de la juridiction maritime ; aux contestations dans lesquelles les États-Unis seront partie ; aux contestations entre deux ou plusieurs États, entre un État et des citoyens d’un autre État, entre des citoyens d’États différents, entre des citoyens du même État réclamant des terres en vertu de concessions émanées de différents États, et entre un État ou les citoyens de cet État, et des États, citoyens ou sujets étrangers.
[I-323]
2. Dans tous les cas concernant les ambassadeurs, d’autres ministres publics ou des consuls, et dans les causes dans lesquelles un État sera partie, la Cour suprême exercera la juridiction originelle. Dans tous les autres cas susmentionnés, la Cour suprême aura la juridiction d’appel, tant sous le rapport de la loi que du fait, avec telles exceptions et tels règlements que le congrès pourra faire.
3. Le jugement de tous crimes, excepté en cas de mise en accusation par la chambre des représentants, sera fait par jury : ce jugement aura lieu dans l’état ou le crime aura été commis ; mais si le crime n’a point été commis dans un des États, le jugement sera rendu dans tel ou tel lieu que le congrès aura désigné à cet effet par une loi.
SECTION TROISIÈME.
1. La trahison contre les États-Unis consistera uniquement à prendre les armes contre eux ou à se réunir à leurs ennemis en leur donnant aide et secours. Aucune personne ne sera convaincue de trahison si ce n’est sur le témoignage de deux témoins déposant sur le même acte patent, ou lorsqu’elle se sera reconnue coupable devant la Cour.
2. Le congrès aura le pouvoir de fixer la peine de la trahison ; mais ce crime n’entraînera point la corruption du sang, ni la confiscation, si ce n’est pendant la vie de la personne convaincue.
ARTICLE QUATRIÈME.
SECTION PREMIÈRE.
Pleine confiance et crédit seront donnés en chaque [I-324] État aux actes publics et aux procédures judiciaires de tout autre État, et le congrès peut, par des lois générales, déterminer quelle sera la forme probante de ces actes et procédures, et les effets qui y seront attachés.
SECTION DEUXIÈME.
1. Les citoyens de chaque État auront droit à tous les privilèges et immunités attachés au titre de citoyen dans les autres États.
2. Un individu accusé dans un État de trahison, félonie ou autre crime, qui se sauvera de la justice et qui sera trouvé dans un autre État, sera, sur la demande de l’autorité exécutive de l’État dont il s’est enfui, livré et conduit vers l’État ayant juridiction sur ce crime.
3. Aucune personne tenue au service ou au travail dans un État, sous les lois de cet État, et qui se sauverait dans un autre, ne pourra, en conséquence d’une loi ou d’un règlement de l’État où elle s’est réfugiée, être dispensée de ce service ou travail, mais sera livrée sur la réclamation de la partie à laquelle ce service et ce travail sont dus.
SECTION TROISIÈME.
1. Le congrès pourra admettre de nouveaux États dans cette union ; mais aucun nouvel État ne sera érigé ou formé dans la juridiction d’un autre État, aucun État ne sera formé non plus de la réunion de deux ou de plusieurs États, ni de quelques parties d’État, sans le consentement de la législature des États intéressés, et sans celui du congrès.
[I-325]
2. Le congrès aura le pouvoir de disposer du territoire et des autres propriétés appartenant aux États-Unis, et d’adopter à ce sujet tous les règlements et mesures convenables ; et rien dans cette constitution ne sera interprété dans un sens préjudiciable aux droits que peuvent faire valoir les États-Unis, ou quelques États particuliers.
SECTION QUATRIÈME.
Les États-Unis garantissent à tous les États de l’Union une forme de gouvernement républicain, et protégeront chacun d’eux contre toute invasion, et aussi contre toute violence intérieure, sur la demande de la législature ou du pouvoir exécutif, si la législature ne peut être convoquée.
ARTICLE CINQUIÈME.
Le congrès, toutes les fois que les deux tiers des deux chambres le jugeront nécessaire, proposera des amendements à cette constitution ; ou, sur la demande de deux tiers des législatures des divers États, il convoquera une convention pour proposer des amendements, lesquels, dans les deux cas, seront valables à toutes fins, comme partie de cette constitution ; quand ils auront été ratifiés par les législatures des trois quarts des divers États, ou par les trois quarts des conventions formées dans le sein de chacun d’eux ; selon que l’un ou l’autre mode de ratification aura été prescrit par le congrès, pourvu qu’aucun amendement fait avant l’année 1808 n’affecte d’une manière quelconque la première et la quatrième [I-326] clause de la 9e section du 1er article, et qu’aucun État ne soit privé, sans son consentement, de son suffrage dans le sénat.
ARTICLE SIXIÈME.
1. Toutes les dettes contractées et les engagements pris avant la présente constitution seront aussi valides à l’égard des États-Unis, sous la présente constitution, que sous la confédération.
2. Cette constitution et les lois des États-Unis qui seront faites en conséquence, et tous les traités faits ou qui seront faits sous l’autorité desdits États-Unis, composeront la loi suprême du pays ; les juges de chaque État seront tenus de s’y conformer, nonobstant toute disposition qui, dans les lois ou la constitution d’un État quelconque, serait en opposition avec cette loi suprême.
3. Les sénateurs et les représentants sus-mentionnés et les membres des législatures des États et tous les officiers du pouvoir exécutif et judiciaire, tant des États-Unis que des divers États, seront tenus, par serment ou par affirmation, de soutenir cette constitution ; mais aucun serment religieux ne sera, jamais requis comme condition pour remplir une fonction ou charge publique, sous l’autorité des États-Unis.
ARTICLE SEPTIÈME.
1. La ratification donnée par les conventions de neuf États sera suffisante pour l’établissement de cette constitution entre les États qui l’auront ainsi ratifiée.
[I-327]
2. Fait en convention, par le consentement unanime des États présents, le 17e jour de septembre, l’an du Seigneur 1787, et de l’indépendance des États-Unis, le 12e ; en témoignage de quoi, nous avons apposé ci-dessous nos noms.
AMENDEMENTS.
ARTICLE PREMIER.
Le congrès ne pourra faire aucune loi relative à l’établissement d’une religion, ou pour en prohiber une ; il ne pourra point non plus restreindre la liberté de la parole ou de la presse, ni attaquer le droit qu’a le peuple de s’assembler paisiblement et d’adresser des pétitions au gouvernement pour obtenir le redressement de ses griefs.
ARTICLE DEUXIÈME.
Une milice bien réglée étant nécessaire à la sécurité d’un État libre, on ne pourra restreindre le droit qu’a le peuple de garder et de porter des armes.
ARTICLE TROISIÈME.
Aucun soldat ne sera, en temps de paix, logé dans une maison sans le consentement du propriétaire ; ni en temps de guerre, si ce n’est de la manière qui sera prescrite par une loi.
[I-328]
ARTICLE QUATRIÈME.
Le droit qu’ont les citoyens de jouir de la sûreté de leurs personnes, de leur domicile, de leurs papiers et effets, à l’abri des recherches et saisies déraisonnables, ne pourra être violé ; aucun mandat ne sera émis, si ce n’est dans des présomptions fondées, corroborées par le serment ou l’affirmation ; et ces mandats devront contenir la désignation spéciale du lieu ou les perquisitions devront être faites et des personnes ou objets à saisir.
ARTICLE CINQUIÈME.
Aucune personne ne sera tenue de répondre à une accusation capitale ou infamante, à moins d’une mise en accusation émanant d’un grand jury, à l’exception des délits commis par des individus appartenant aux troupes de terre ou de mer, ou à la milice, quand elle est en service actif en temps de guerre ou de danger public : la même personne ne pourra être soumise deux fois pour le même délit a une procédure qui compromettrait sa vie ou un de ses membres. Dans aucune cause criminelle, l’accusé ne pourra être forcé à rendre témoignage contre lui-même ; il ne pourra être privé de la vie, de la liberté ou de sa propriété, que par suite d’une procédure légale. Aucune propriété privée ne pourra être appliquée à un usage public sans juste compensation.
ARTICLE SIXIÈME.
Dans toute procédure criminelle, l’accusé jouira du droit d’être jugé promptement et publiquement [I-329] par un jury impartial de l’État et du district dans lequel le crime aura été commis, district dont les limites auront été tracées par une loi préalable ; il sera informé de la nature et du motif de l’accusation ; il sera confronté avec les témoins à charge ; il aura la faculté de faire comparaître des témoins en sa faveur, et il aura l’assistance d’un conseil pour sa défense.
ARTICLE SEPTIÈME.
Dans les causes qui devront être décidées selon la loi commune (in suits at common law), le jugement par jury sera conservé dès que la valeur des objets en litige excédera vingt dollars ; et aucun fait jugé par un jury ne pourra être soumis à l’examen d’une autre cour dans les États-Unis, que conformément à la loi commune.
ARTICLE HUITIÈME.
On ne pourra exiger des cautionnements exagérés, ni imposer des amendes excessives, ni infliger des punitions cruelles et inaccoutumées.
ARTICLE NEUVIÈME.
L’énumération faite, dans cette constitution, de certains droits, ne pourra être interprétée de manière à exclure ou affaiblir d’autres droits conservés par le peuple.
ARTICLE DIXIÈME.
Les pouvoirs non délégués aux États-Unis par la constitution, ou à ceux qu’elle ne défend pas aux États [I-330] d’exercer, sont réservés aux États respectifs ou au peuple.
ARTICLE ONZIÈME.
Le pouvoir judiciaire des États-Unis ne sera point organisé de manière à pouvoir s’étendre par interprétation à une procédure quelconque, commencée contre un des États par les citoyens d’un autre État, ou par les citoyens ou sujets d’un État étranger.
ARTICLE DOUZIÈME.
1. Les électeurs se rassembleront dans leurs États respectifs, et ils voteront au scrutin pour la nomination du président et du vice-président, dont un au moins ne sera point habitant du même État qu’eux ; dans leurs bulletins ils nommeront la personne pour laquelle ils votent comme président, et dans les bulletins distincts celle qu’ils portent à la vice-présidence : ils feront des listes distinctes de toutes les personnes portées à la présidence, et de toutes celles désignées pour la vice-présidence, et du nombre des votes pour chacune d’elles ; ces listes seront par eux signées et certifiées, et transmises, scellées, au siége du gouvernement des États-Unis, à l’adresse du président du sénat. Le président du sénat, en présence des deux chambres, ouvrira tous les procès-verbaux, et les votes seront comptés. La personne réunissant le plus grand nombre de suffrages pour la présidence sera président, si ce nombre forme la majorité de tous les électeurs réunis ; et si aucune personne n’avait cette majorité, alors, parmi les trois candidats ayant réuni le plus de voix pour la présidence, la chambre des [I-331] représentants choisira immédiatement le président par la voix du scrutin. Mais dans ce choix du président les votes seront comptés par État, la représentation de chaque État n’ayant qu’un vote ; un membre ou des membres de deux tiers des États devront être présents pour cet objet, et la majorité de tous les États sera nécessaire pour le choix. Et si la chambre des représentants ne choisit point le président, quand ce choix lui sera dévolu, avant le quatrième jour du mois de mars suivant, le vice-président sera président, comme dans le cas de mort ou d’autre inhabileté constitutionnelle du président.
2. La personne réunissant le plus de suffrages pour la vice-présidence sera vice-président, si ce nombre forme la majorité du nombre total des électeurs réunis ; et si personne n’a obtenu cette majorité, alors le sénat choisira le vice-président parmi les deux candidats ayant le plus de voix ; la présence des deux tiers des sénateurs et la majorité du nombre total sont nécessaires pour ce choix.
3. Aucune personne constitutionnellement inéligible à la place de président ne sera éligible à celle de vice-président des États-Unis.
[I-332]
CONSTITUTION DE L’ÉTAT DE NEW-YORK.↩
Pénétré de reconnaissance envers la bonté divine qui nous a permis de choisir la forme de notre gouvernement, nous, le peuple de l’État de New-York, nous avons établi la présente constitution :
ARTICLE PREMIER.
1. Le pouvoir législatif de l’État sera confié à un sénat et à une chambre des représentants.
2. Le sénat se composera de trente-deux membres.
Les sénateurs seront choisis parmi les propriétaires fonciers et seront nommés pour quatre ans.
L’assemblée des représentants aura cent vingt-huit membres, qui seront soumis tous les ans à une nouvelle élection.
[I-333]
3. Dans l’une et l’autre chambre, la majorité absolue décidera.
Chacune formera ses règlements intérieurs, et vérifiera les pouvoirs de ses membres.
Chacune nommera ses officiers.
Le sénat se choisira un président temporaire, quand le lieutenant gouverneur ne présidera pas, ou qu’il remplira les fonctions de gouverneur.
4. Chaque chambre tiendra un procès-verbal de ses séances. Ces procès-verbaux seront publiés en entier, à moins qu’il ne devienne nécessaire d’en tenir secrète une partie.
Les séances seront publiques ; elles peuvent cependant avoir lieu à huis clos, si l’intérêt général l’exige.
Une chambre ne pourra s’ajourner plus de deux jours sans le consentement de l’autre.
5. L’État sera divisé en huit districts, qui prendront le nom de districts sénatoriaux. Dans chacun, il sera choisi quatre sénateurs.
Aussitôt que le sénat sera assemblé, après les premières élections qui auront lieu en conséquence de la présente constitution, il se divisera en quatre classes. Chacune de ces classes se composera de huit sénateurs, de sorte que, dans chaque classe, il y ait un sénateur de chaque district. Ces classes seront numérotées par première, deuxième, troisième et quatrième.
Les siéges de la première classe seront vacants à la fin de la première année, ceux de la deuxième à la fin de la deuxième, ceux de la troisième à la fin de la troisième, et ceux de la quatrième à la fin de la [I-334] quatrième année. De cette manière, un sénateur sera nommé annuellement dans chaque district sénatorial.
6. Le dénombrement des habitants de l’État se fera en 1825, sous la direction du pouvoir législatif ; et ensuite il aura lieu tous les dix ans.
À chaque session qui suivra un dénombrement, la législature fixera de nouveau la circonscription des districts, afin qu’il se trouve toujours, s’il est possible, un nombre égal d’habitants dans chacun d’eux. Les étrangers, les indigents et les hommes de couleur qui ne sont point imposés ne seront point comptés dans ces calculs. La circonscription des districts ne pourra être changée qu’aux époques fixées plus haut. Chaque district sénatorial aura un territoire compacte ; et, pour le former, on ne divisera point les comtés.
7. Les représentants seront élus par les comtés, chaque comté nommant un nombre de députés proportionné au nombre de ses habitants. Les étrangers, les pauvres et les hommes de couleur qui ne paient point de taxes ne seront point compris dans ce calcul. À la session qui suivra un recensement, la législature fixera le nombre de députés que doit envoyer chaque comté, et ce nombre restera le même jusqu’au recensement suivant.
Chacun des comtés anciennement formés et organisés séparément enverra un membre à l’assemblée des représentants. On ne formera point de nouveaux comtés, à moins que leur population ne leur donne le droit d’élire au moins un représentant.
8. Les deux chambres possèdent également le droit d’initiative pour tous les bills.
[I-335]
Un bill adopté par une chambre peut être amendé par l’autre.
9. Il sera alloué aux membres de la législature, comme indemnité, une somme qui sera fixée par une loi et payée par le trésor public.
La loi qui augmenterait le montant de cette indemnité ne pourrait être exécutée que l’année qui suivrait celle où elle aurait été rendue. On ne pourra augmenter le montant de l’indemnité accordée aux membres du corps législatif que jusqu’à la concurrence de la somme de 3 dollars (16 francs 5 centimes).
10. Aucun membre des deux chambres, tant que durera son mandat, ne pourra être nommé à des fonctions de l’ordre civil par le gouverneur, le sénat ou la législature.
11. Ne pourra siéger dans les deux chambres aucun membre du congrès, ni autre personne remplissant une fonction judiciaire ou militaire pour les États-Unis.
Si un membre de la législature était appelé au congrès, ou était nommé à un emploi civil ou militaire pour le service des États-Unis, son option pour ces nouvelles fonctions rendra son siége vacant.
12. Tout bill qui aura reçu la sanction du sénat et de la chambre des représentants devra être présenté au gouverneur, avant de devenir loi de l’État.
Si le gouverneur sanctionne le bill, il le signera ; si, au contraire, il le désapprouve, il le renverra, en expliquant les motifs de son refus, à la chambre qui l’avait en premier lieu proposé. Celle-ci insérera en entier les motifs du gouverneur dans le procès verbal des séances, et procédera à un nouvel examen. [I-336] Si, après avoir discuté une seconde fois le bill, les deux tiers des membres présents se prononcent de nouveau en sa faveur, le bill sera alors renvoyé, avec les objections du gouverneur, à l’autre chambre ; celle-ci lui fera de même subir un nouvel examen ; et si les deux tiers des membres présents l’approuvent, ce bill aura force de loi ; mais dans ces derniers cas, les votes seront exprimés par oui ou non, et on insérera le vote de chaque membre dans le procès-verbal.
Tout bill qui, après avoir été présenté au gouverneur, ne sera pas renvoyé par lui dans les dix jours (le dimanche excepté), aura force de loi comme si le gouverneur l’avait signé, à moins que, dans l’intervalle des dix jours, le corps législatif ne s’ajourne. Dans ce cas, le bill restera comme non avenu.
13. Les magistrats dont les fonctions ne sont pas temporaires (holding their offices during good behaviour) peuvent cependant être révoqués par le vote simultané des deux chambres. Mais il faut que les deux tiers de tous les représentants élus et la majorité des membres du sénat consentent à la révocation.
14. L’année politique commencera le 1er janvier, et le corps législatif devra être assemblé annuellement le premier mardi de janvier, à moins qu’un autre jour ne soit désigné par une loi.
15. Les élections pour la nomination du gouverneur, du lieutenant-gouverneur, des sénateurs et des représentants, commenceront le premier lundi de novembre 1822.
Toutes les élections subséquentes auront toujours [I-337] lieu à peu près dans le même temps, c’est-à-dire en octobre ou en novembre, ainsi que la législature le fixera par une loi.
16. Le gouverneur, le lieutenant-gouverneur, les sénateurs et les représentants qui seront les premiers élus en vertu de la présente constitution, entreront dans l’exercice de leurs fonctions respectives le 1er janvier 1823.
Le gouverneur, le lieutenant-gouverneur, les sénateurs et les membres de la chambre des représentants maintenant en fonctions, continueront de les remplir jusqu’au 1er janvier 1823.
ARTICLE DEUXIÈME.
1. Aura le droit de voter dans la ville ou dans le quartier où il fait sa résidence, et non ailleurs, pour la nomination de tous fonctionnaires qui maintenant ou à l’avenir seront élus par le peuple, tout citoyen âgé de vingt et un ans qui aura résidé dans cet État un an avant l’élection à laquelle il veut concourir, qui en outre aura résidé pendant les six derniers mois dans la ville ou dans le comté ou il peut donner son vote, et qui dans l’année précédant les élections aura payé à l’État ou au comté une taxe foncière ou personnelle ; ou qui, étant armé et équipé, aura durant l’année rempli un service militaire dans la milice. Ces dernières conditions ne seront pas exigées de ceux que la loi exempte de toute imposition, ou qui ne font pas partie de la milice, parce qu’ils servent comme pompiers.
Auront également le droit de voter, les citoyens de l’âge de vingt et un ans qui résideront dans l’État [I-338] pendant les trois ans qui précéderont une élection, et pendant la dernière année dans la ville ou dans le comté où ils peuvent donner leur vote, et qui en outre auront pendant le cours de la même année contribué de leur personne à la réparation des routes, ou auront payé l’équivalent de leur travail, suivant qu’il est réglé par la loi.
Aucun homme de couleur n’aura le droit de voter, à moins qu’il ne soit depuis trois ans citoyen de l’État, qu’il ne possède un an avant les élections une propriété foncière de la valeur de 250 dollars (1,337 fr. 50 c.) libre de toutes dettes et hypothèques. L’homme de couleur qui aura été imposé pour cette propriété, et qui aura payé la taxe, sera admis à voter à toute élection.
Si les hommes de couleur ne possèdent pas un bien foncier tel qu’il a été désigné plus haut, ils ne paieront aucune contribution directe.
2. Des lois ultérieures pourront exclure du droit de suffrage toute personne qui a été ou qui serait frappée d’une peine infamante.
3. Des lois régleront la manière dont les citoyens doivent établir le droit électoral dont les conditions viennent d’être fixées.
4. Toutes les élections auront lieu par bulletins écrits, à l’exception de celles relatives aux fonctionnaires municipaux. La manière dont ces dernières doivent être faites sera déterminée par une loi.
ARTICLE TROISIÈME.
1. Le pouvoir exécutif sera confié à un gouverneur, dont les fonctions dureront deux années.
[I-339]
Un lieutenant-gouverneur sera choisi en même temps et pour la même période.
2. Pour être éligible aux fonctions de gouverneur il faut être citoyen né des États-Unis, être franc-tenancier, avoir atteint l’âge de trente ans, et avoir résidé cinq ans dans l’État, à moins que, pendant ce temps, l’absence n’ait été motivée par un service public pour l’État ou pour les États-Unis.
3. Le gouverneur et le lieutenant-gouverneur seront élus en même temps et aux mêmes lieux que les membres de la législature, et à la pluralité des suffrages. En cas d’égalité de suffrages entre deux ou plusieurs candidats pour les fonctions de gouverneur ou lieutenant-gouverneur, les deux chambres de la législature choisiront parmi ces candidats, par un scrutin de ballottage commun et à la pluralité des voix, le gouverneur et le lieutenaut-gouverneur.
4. Le gouverneur sera commandant en chef de la milice et amiral de la marine de l’État ; il pourra, dans les circonstances extraordinaires, convoquer la législature ou seulement le sénat. Il devra, à l’ouverture de chaque session, communiquer par un message, à la législature, l’exposé de la situation de l’État et lui recommander les mesures qu’il croira nécessaires ; il dirigera les affaires administratives, civiles ou militaires avec les fonctionnaires du gouvernement, promulguera les décisions de la législature, et veillera soigneusement à la fidèle exécution des lois.
En rémunération de ses services, il recevra, à des époques déterminées, une somme qui ne pourra être ni augmentée ni diminuée pendant le temps pour lequel il aura été élu.
[I-340]
5. Le gouverneur aura le droit de faire grâce, ou de suspendre l’exécution après condamnation, excepté en cas de trahison ou d’accusation par les représentants ; dans ce dernier cas, la suspension ne peut aller que jusqu’à la plus prochaine session de la législature, qui peut ou faire grâce, ou ordonner l’exécution de la sentence, ou prolonger le répit.
6. En cas d’accusation du gouverneur, ou de sa destitution, de sa démission, de sa mort, ou de son absence de l’État, les droits et les devoirs de sa place seront remis au lieutenant-gouverneur, qui les conservera pendant le reste du temps déterminé, ou si la vacance est occasionnée par une accusation ou une absence, jusqu’à l’acquittement ou le retour du gouverneur.
Cependant le gouverneur continuera d’être commandant en chef de toutes les forces militaires de l’État lorsque son absence sera motivée par la guerre et autorisée par la législature, pour commander la force armée de l’État.
7. Le lieutenant-gouverneur sera président du sénat, mais il n’aura voix délibérative qu’en cas d’égalité de votes. Si, pendant l’absence du gouverneur, le lieutenant-gouverneur s’absente, abdique, meurt, ou s’il est accusé ou destitué, le président du sénat [166] remplira les fonctions du gouverneur jusqu’à ce que l’on ait pourvu au remplacement, ou que l’incapacité ait cessé.
[I-341]
ARTICLE QUATRIÈME.
1. Les officiers de la milice seront élus et nommés de la manière suivante :
Les sous-officiers et officiers jusqu’aux capitaines inclusivement, par les votes écrits des membres de leurs compagnies respectives.
Les chefs de bataillon et officiers supérieurs des régiments, par les votes écrits des officiers de leurs bataillons et de leurs régiments.
Les brigadiers-généraux, par les officiers supérieurs de leurs brigades respectives.
Enfin les majors-généraux, les brigadiers-généraux et les colonels des régiments ou chefs de bataillon nommeront les officiers d’état-major de leurs divisions, brigades, régiments ou bataillons respectifs.
2. Le gouverneur nommera, et, avec l’autorisation du sénat, installera les majors-généraux, les inspecteurs de brigades et les chefs d’état-major, excepté le commissaire-général et l’adjudant-général. Ce dernier sera installé par le gouverneur seul.
3. La législature déterminera par une loi l’époque et le mode des élections des officiers de milice et la manière de les notifier au gouverneur.
4. Les officiers recevront leurs brevets du gouverneur. Aucun officier breveté ne pourra être privé de son emploi que par le sénat et sur une demande du gouverneur, indiquant les motifs pour lesquels on réclame la destitution, ou par décision d’une cour martiale, conformément à la loi.
Les officiers actuels de la milice conserveront leurs brevets et leurs emplois aux conditions ci-dessus.
[I-342]
5. Dans le cas où le mode d’élection et de nomination ci-dessus ne produirait pas d’amélioration dans la milice, la législature pourra l’abroger et lui en substituer une autre par une loi, pourvu que ce soit avec l’assentiment des deux tiers des membres présents dans chaque chambre.
6. Le secrétaire d’État, le contrôleur, le trésorier, l’avocat-général, l’inspecteur-général et le commissaire-général seront nommés de la manière suivante :
Le sénat et l’assemblée présenteront chacun un candidat pour chacune de ces fonctions, puis se réuniront. Si ces choix tombent sur les mêmes candidats, les personnes ainsi choisies seront installées dans les fonctions auxquelles on les aura nommées. S’il y a divergence dans les présentations, le choix sera fait par un scrutin commun, et à la majorité des suffrages du sénat et de l’assemblée réunis.
Le trésorier sera élu chaque année. Le secrétaire d’État, le contrôleur, l’avocat-général, l’inspecteur-général et le commissaire-général conserveront leurs fonctions pendant trois ans, à moins qu’ils ne soient révoqués par une décision commune du sénat et de l’assemblée.
7. Le gouverneur nommera par message écrit, et, avec l’assentiment du sénat, instituera tous les officiers judiciaires, excepté les juges de paix, qui seront nommés ainsi qu’il suit :
La commission des surveillants (supervisors) [167] de chacun des comtés de l’État sassemblera au jour fixé [I-343] par la législature, et désignera, à la majorité des voix, un nombre de personnes égal au nombre des juges de paix a établir dans les villes du comté ; les juges des cours de comté s’assembleront aussi et nommeront de même un égal nombre de candidats ; puis, à l’époque et au lieu indiqués par la législature, les surveillants et les juges de paix du comté se réunissent et examinent leurs choix respectifs. Lorsqu’il y a unanimité pour certains choix, ils la constatent par un certificat qu’ils déposent aux archives du secrétaire du comté, et la personne ou les personnes nommées dans ces certificats sont juges de paix.
S’il y a dissentiment total ou partiel dans les choix, la commission des surveillants et les juges devront transmettre leurs choix différents au gouverneur, qui prendra et instituera parmi ces candidats autant de juges de paix qu’il en faudra pour remplir les places vacantes.
Les juges de paix resteront en place pendant quatre ans, à moins qu’ils ne soient révoqués par les cours des comtés, lesquelles devront spécifier les motifs de la révocation ; mais cette révocation ne peut avoir lieu sans que, préalablement, le juge de paix ait reçu signification des faits imputés, et qu’il ait pu présenter sa défense.
8. Les shérifs, les greffiers des comtés et les archivistes, aussi bien que le greffier de la cité-comté de New-York, seront choisis tous les trois ans, ou lorsqu’il y aura une vacance, par les électeurs de ces comtés respectifs. Les shérifs ne pourront exercer aucune autre fonction, et ne pourront être réélus que trois ans après leur sortie de service. On peut [I-344] exiger d’eux, conformément à la loi, de renouveler de temps en temps leurs cautionnements, et faute par eux de les fournir, leur emploi sera considéré comme vacant.
Le comté ne sera jamais responsable des actes du shérif. Le gouverneur peut destituer ce magistrat aussi bien que les greffiers et les archivistes des comtés, mais jamais sans leur avoir communiqué les accusations portées contre eux, et sans leur avoir donné la faculté de se défendre.
9. Les greffiers des cours, excepté ceux dont il est question dans la section précédente, seront nommés par les cours auprès desquelles ils exerceront, et les procureurs de districts par les cours de comté. Ces greffiers et ces procureurs resteront en place pendant trois ans, à moins de révocation par les cours qui les auront nommés.
10. Les maires de toutes les cités de cet État seront nommés par les conseils communaux de ces cités respectives.
11. Les coroners seront élus de la même manière que les shérifs, et pour le même temps ; leur révocation n’aura lieu que dans les mêmes formes. La législature en déterminera le nombre, qui pourtant ne pourra être de plus de quatre par comté.
12. Le gouverneur nommera, et, avec l’assentiment du sénat, installera les maîtres et auditeurs en chancellerie, qui conserveront leurs fonctions pendant trois ans, à moins de révocation par le sénat, sur la demande du gouverneur. Les greffiers et sous-greffiers seront nommés et remplacés à volonté par le chancelier.
[I-345]
13. Le greffier de la cour d’oyer et terminer, et des sessions générales de paix, pour la ville et comté de New-York, sera nommé par la cour des sessions générales de la ville, et exercera tant qu’il plaira à la cour. Les autres commis et employés des cours, dont la nomination n’est pas déterminée ici, seront au choix des différentes cours, ou du gouverneur, avec l’assentiment du sénat, suivant que l’indiquera la loi.
14. Les juges spéciaux et leurs adjoints, ainsi que leurs greffiers dans la cité de New-York, seront nommés par le conseil communal de cette cité. Leurs fonctions auront la même durée que celles des juges de paix des autres comtés, et ils ne pourront être révoqués que dans les mêmes formes.
15. Tous les fonctionnaires qui aujourd’hui sont nommés par le peuple continueront à être nommés par lui. Les fonctions à la nomination desquelles il n’est pas pourvu par cette constitution, ou qui pourront être créées à l’avenir, seront de même à la nomination du peuple, à moins que la loi ne dispose autrement.
16. La durée des fonctions non fixée par la présente constitution pourra être déterminée par une loi, sinon elle dépendra du bon plaisir de l’autorité qui nommera à ces fonctions.
ARTICLE CINQUIÈME.
1. Le tribunal auquel doivent être déférées les accusations politiques (trials by impeachment) [168] [I-346] et les procès relatifs à la correction des erreurs (correction of errors), se composera du président du sénat, des sénateurs, du chancelier, des juges de la cour suprême ou de la majeure partie d’entre eux. Lorsque cette accusation sera intentée contre le chancelier on un juge de la cour suprême, la personne accusée sera suspendue de ses fonctions jusqu’à son acquittement.
Dans les appels contre les arrêts de chancellerie, le chancelier informera le tribunal des motifs de sa première décision, mais n’aura pas voix délibérative ; et si l’appel a lieu pour erreur dans un jugement de la cour suprême, les juges de cette cour exposeront de même les motifs de leur arrêt, mais ne pourront prendre part à la délibération.
2. La chambre des représentants a droit de mettre en accusation tous les employés civils de l’État, pour corruption ou malversation dans l’exercice de leurs fonctions, pour crimes ou pour délits ; mais il faut pour cela l’assentiment de la majorité de tous les membres élus.
Les membres de la cour chargés de prononcer sur cette accusation s’engageront par serment ou par affirmation, au commencement du procès, à juger et prononcer suivant les preuves. La condamnation ne pourra être prononcée qu’aux deux tiers des voix des membres présents. La peine à prononcer ne peut être que la révocation des fonctions et une déclaration d’incapacité, pour le condamné de remplir aucune fonction et de jouir d’aucun honneur ou avantage dans l’État ; mais le condamné peut alors être accusé de nouveau, suivant [I-347] les formes ordinaires, et puni conformément à la loi.
3. Le chancelier et les juges de la cour suprême conserveront leurs fonctions tant qu’ils les rempliront bien (during good behaviour) [169] , mais pas au-delà de l’âge de soixante ans.
4. La cour suprême se composera d’un président et de deux juges ; mais un seul des trois peut tenir l’audience.
5. L’État sera, par une loi, divisé en un nombre proportionné de circuits. Il n’y en aura pas moins de quatre et pas plus de huit. La législature pourra de temps en temps, suivant le besoin, changer cette division. Chaque circuit aura un juge qui sera nommé de la même manière et pour le même temps que les juges de la cour suprême. Ces juges de circuit auront le même pouvoir que les juges de la cour suprême jugeant seuls, et dans les jugements de causes portées en première instance à la cour suprême, et dans les cours d’oyer et terminer et des assises. La législature pourra, en outre, suivant le besoin, accorder à ces juges ou aux cours de comté, ou aux tribunaux inférieurs, une juridiction d’équité (equity powers), mais en la subordonnant toujours à l’appel du chancelier.
6. Les juges des cours de comté, et les recorders des cités seront nommés pour cinq ans ; mais ils peuvent être destitués par le sénat sur la demande motivée du gouverneur.
7. Le chancelier, les juges de la cour suprême et les juges de circuit ne pourront exercer aucune autre [I-348] fonction publique ; tout suffrage qui leur serait donné pour des fonctions électives, par la législature ou par le peuple, est nul.
ARTICLE SIXIÈME.
1. Les membres de la législature et tous les fonctionnaires administratifs ou judiciaires, excepté les employés subalternes exemptés par la loi, devront, avant l’entrer en exercice, prononcer et souscrire la formule de serment ou d’affirmation suivante :
« Je jure solennellement (ou, suivant le cas, j’affirme) que je maintiendrai la constitution des États-Unis et la constitution de l’État de New-York, et que je remplirai fidèlement, et aussi bien qu’il me sera possible, les fonctions de… »
Aucun autre serment, déclaration ou épreuve ne pourront être exigés pour aucune fonction ou service public.
ARTICLE SEPTIÈME.
1. Aucun membre de l’État de New-York ne pourra être privé des droits et privilèges assurés à tous les citoyens de l’État, si ce n’est par les lois du pays et par les jugements de ses pairs.
2. Le jugement par jury sera inviolablement et a toujours conservé dans toutes les affaires où il a été appliqué jusqu’à aujourd’hui. Aucun nouveau tribunal ne sera établi, si ce n’est pour procéder suivant la loi commune, excepté les cours d’équité, que la législature est autorisée à établir par la présente constitution.
3. La profession et l’exercice libre de toutes les croyances religieuses et de tous les cultes, sans aucune [I-349] prééminence, sont permis à chacun, et le seront toujours ; mais la liberté de conscience garantie par cet article ne peut s’étendre jusqu’à excuser des actes licencieux et des pratiques incompatibles avec la paix et la sécurité de l’État.
4. Attendu que les ministres de l’Évangile sont, par leur profession, dévoués au service de Dieu et au soin des âmes, et qu’ils ne doivent pas être distraits des grands devoirs de leur état, aucun ministre de l’Évangile ou prêtre d’aucune dénomination ne pourra, dans quelque circonstance et pour quelque motif que ce soit, être appelé, par élection ou autrement, à aucune fonction civile ou militaire.
5. La milice de l’État devra être toujours armée, disciplinée et prête au service ; mais tout habitant de l’État appartenant à une religion quelconque, ou des scrupules de conscience font condamner l’usage des armes, sera exempte, en payant en argent une compensation que la législature déterminera par une loi, et qui sera estimée d’après la dépense de temps et d’argent que fait un bon milicien.
6. Le privilège de l’acte d’habeas corpus ne pourra être suspendu qu’en cas de rébellion ou d’invasion, lorsque le salut public requiert cette suspension.
7. Personne ne pourra être traduit en jugement pour une accusation capitale ou infamante, si ce n’est sur l’accusation ou le rapport d’un grand jury. Il est fait plusieurs exceptions à ce principe : la première, lorsqu’il sagit d’un cas d’accusation par les représentants ; la seconde, quand on poursuit un milicien en service actif et un soldat en temps de guerre (ou en temps de paix, si le congrès a permis à l’État [I-350] d’entretenir des troupes) ; la troisième, quand il n’est question que de petits vols (little larceny) : la législature fixera lesquels.
Dans tout jugement par accusation des représentants ou du grand jury, l’accusé pourra toujours être assisté d’un conseil, comme dans les causes civiles.
Personne ne pourra être mis en jugement deux fois pour le même fait sur une accusation capitale, ni être forcé a donner témoignage contre lui-même dans une affaire criminelle, ni être privé de sa liberté, de sa propriété ou de sa vie, que conformément à la loi.
L’expropriation pour cause d’utilité publique ne pourra avoir lieu qu’après une juste compensation.
8. Tout citoyen peut librement exprimer, écrire et publier son opinion sur tout sujet, et il demeure responsable de l’abus qu’il peut faire de ce droit. Aucune loi ne pourra être faite pour restreindre la liberté de la parole ou de la presse. Dans toutes les poursuites ou accusations pour libelle, on sera admis à la preuve des faits, et si le jury pense que les faits sont vrais, qu’ils ont été publiés dans de bons motifs et pour un but utile, l’accusé sera acquitté, Le jury, dans ces causes, décidera en droit comme en fait.
9. L’assentiment de deux tiers des membres élus de chaque branche de la législature est nécessaire pour l’application des revenus et la disposition des propriétés de l’État, pour les lois d’intérêt particulier ou local, pour créer, prolonger, renouveler ou modifier les associations politiques ou privées.
10. Le produit de la vente ou cession de toutes les terres appartenant à l’État, excepté de celles réservées ou appropriées à un usage public, ou cédées aux [I-351] États-Unis, et le fonds appelé des écoles communales, formeront et resteront un fonds perpétuel, dont l’intérêt sera inviolablement appliqué à l’entretien des écoles communales de l’État.
Un droit de barrières sera perçu sur toutes les parties navigables du canal, entre les grands lacs de l’Ouest et du Nord et l’océan Atlantique, qui sont établies ou qu’on établira par la suite. Ces droits ne seront pas inférieurs à ceux agréés par les commissaires des canaux, et spécifiés dans leur rapport à la législature du 12 mars 1831.
Ce droit, ainsi que celui sur toutes les salines, établi par la loi du 15 avril 1817, et les droits sur les ventes à l’enchère (excepté une somme de 33,500 dollars dont il est disposé par cette même loi), et enfin le montant du revenu établi par décision de la législature du 15 mars 1820 (au lieu de la taxe sur les passagers des bâtiments à vapeur), sont et resteront inviolablement appliqués à l’achèvement des communications par eau, au paiement de l’intérêt et au remboursement du capital des sommes empruntées déjà, ou qu’on emprunterait par la suite, pour terminer ces travaux.
Ces droits de barrières sur les communications navigables, ceux sur les salines, ceux sur les ventes à l’enchère, établis par la loi du 15 avril 1817, non plus que le montant du revenu fixé par la loi du 13 mars 1820, ne pourront être réduits ou appliqués autrement, jusqu’à entier et parfait paiement des intérêts et du capital des sommes empruntées ou qu’on emprunterait encore pour ces travaux.
La législature ne pourra jamais vendre, ni aliéner [I-352] les sources salines appartenant à l’État, ni les terres contiguës qui peuvent être nécessaires à leur exploitation, ni en tout, ni en partie, les communications navigables, tout cela étant et devant rester toujours la propriété de l’État.
11. Aucune loterie ne sera désormais autorisée ; et la législature prohibera par une loi la vente dans cet État des billets de loteries autres que celles déjà autorisées par la loi.
12. Aucun contrat, pour l’acquisition de terrains avec les Indiens, qui aurait été ou qui serait fait dans l’État, à dater du 14 octobre 1775, ne sera valide que par le consentement et avec l’autorisation de la législature.
13. Continueront d’être lois de l’État, avec les changements que la législature jugera convenable de faire, les parties du droit coutumier (common law) et des actes de la législature de la colonie de New-York, qui composaient la loi de cette colonie, le 19 avril 1775, et les résolutions du congrès de cette colonie et de la convention de l’État de New-York, en vigueur le 20 avril 1777, qui ne sont pas périmées, ou qui n’ont pas été révoquées ou modifiées, ainsi que les décrets de la législature de cet État, en vigueur aujourd’hui ; mais toutes les parties de ce droit coutumier et des actes ci-dessus mentionnés qui ne sont pas en accord avec la présente constitution, sont abrogées.
14. Toute concession de terre faite dans l’État par le roi de la Grande-Bretagne, ou par les personnes exerçant son autorité, après le 14 octobre 1775, est nulle et non avenue ; mais rien, dans la présente [I-353] constitution, n’invalidera les concessions de terre faites antérieurement par ce roi et ses prédécesseurs, ou n’annulera les chartes concédées, avant cette époque, par lui ou eux, ni les concessions et chartes faites depuis par l’État ou par des personnes exerçant son autorité, ni n’infirmera les obligations ou dettes contractées par l’État, par les individus et par les corporations, ni les droits de propriété, les droits éventuels, les revendications ou aucune procédure dans les cours de justice.
ARTICLE HUITIÈME.
1. Il est permis au sénat ou à la chambre des représentants de proposer un ou plusieurs amendements à la présente constitution. Si la proposition d’amendement est appuyée par la majorité des membres élus des deux chambres, l’amendement ou les amendements proposés seront transcrits sur leurs registres, avec les votes pour et contre, et remis à la décision de la législature suivante.
Trois mois avant l’élection de cette législature, ces amendements seront publiés ; et si, lorsque cette nouvelle législature entrera en fonctions, les amendements proposés sont adoptés par les deux tiers de tous les membres élus dans chaque chambre, la législature devra les soumettre au peuple, à l’époque et de la même manière qu’elle prescrira.
Si le peuple, c’est-à-dire si la majorité de tous les citoyens ayant droit de voter pour l’élection des membres de la législature, approuve et ratifie ces amendements, ils deviendront partie intégrante de la constitution.
[I-354]
ARTICLE NEUVIÈME.
1. La présente constitution deviendra exécutoire à dater du 31 décembre 1822. Tout ce qui y a rapport au début du suffrage, à la division de l’État en districts sénatoriaux, au nombre des membres à élire à la chambre des représentants et à la convocation des électeurs pour le premier lundi de novembre 1822, à la prolongation des fonctions de la législature actuelle jusqu’au 1er janvier 1823, à la prohibition des loteries ou à la défense d’appliquer des propriétés et des revenus publics à des intérêts locaux ou privés, à la création, au changement, renouvellement ou à la prorogation des chartes des corporations politiques, sera exécutoire à dater du dernier jour de février prochain.
Le premier lundi de mars prochain, les membres de la présente législature prêteront et signeront le serment ou l’obligation de maintenir la constitution alors en vigueur.
Les shérifs, greffiers de comté et les coroners seront élus dans les élections fixées par la présente constitution au premier lundi de novembre 1822 ; mais ils n’entreront en fonctions que le 1er janvier suivant. Les brevets de toutes les personnes occupant des emplois civils le 31 décembre 1822 expireront ce jour-là ; mais les titulaires pourront continuer leurs fonctions jusqu’à ce que les nouvelles nominations ou élections prescrites par la présente constitution aient été faites.
2. Les lois maintenant existantes sur la convocation aux élections, sur leur ordre, le mode de voter, de [I-355] recueillir les suffrages et de proclamer le résultat, seront observées aux élections fixées par la présente constitution au premier lundi de novembre 1822, en tout ce qui sera applicable, et la législature actuelle fera les lois qui pourraient encore être nécessaires pour ces élections, conformément à la présente constitution.
Fait en Convention, au capitole de la ville d’Albany, le dix novembre mil huit cent vingt et un, et le quarante-sixième de l’indépendance des États-Unis de l’Amérique.
En foi de quoi nous avons signé.
DANIEL D. TOMPKINS, Président.
Secrétaires.
JOHN F. BACON,
SAMUEL S. GARDINER,
FIN DU PREMIER VOLUME.
Notes Volume I↩
[1] (↑) À l’époque où je publiai la première édition de cet ouvrage, M. Gustave de Beaumont, mon compagnon de voyage en Amérique, travaillait encore à son livre intitulé Marie, ou l’Esclavage aux États-Unis, qui a paru depuis. Le but principal de M. de Beaumont a été de mettre en relief et de faire connaître la situation des nègres au milieu de la société anglo-américaine. Son ouvrage jettera une vive et nouvelle lumière sur la question de l’esclavage, question vitale pour les républiques unies. Je ne sais si je me trompe, mais il me semble que le livre de M. de Beaumont, après avoir vivement intéressé ceux qui voudront y puiser des émotions et y chercher des tableaux, doit obtenir un succès plus solide et plus durable encore parmi les lecteurs qui, avant tout, désirent des aperçus vrais et de profondes vérités.
[2] (↑) Les documents législatifs et administratifs m’ont été fournis avec une obligeance dont le souvenir excitera toujours ma gratitude. Parmi les fonctionnaires américains qui ont ainsi favorisé mes recherches, je citerai surtout M. Edward Livingston, alors secrétaire d’État (maintenant ministre plénipotentiaire à Paris). Durant mon séjour au sein du congrès, M. Livingston voulut bien me faire remettre la plupart des documents que je possède, relativement au gouvernement fédéral. M. Livingston est un de ces hommes rares qu’on aime en lisant leurs écrits, qu’on admire et qu’on honore avant même de les connaître, et auxquels on est heureux de devoir de la reconnaissance.
[3] (↑) Voyez la carte placée à la fin de l’ouvrage.
[4] (↑) 1, 341, 649 milles. Voyez Darby’s View of the United States, p. 499. J’ai réduit ces milles en lieues de 2 000 toises.
[5] (↑) La France a 35 181 lieues carrées.
[6] (↑) La rivière Rouge
[7] (↑) 2,500 milles, 1,032 lieues. Voyez Description des États-Unis, par Warden, vol. 1, p. 166.
[8] (↑) 1,364 milles, 563 lieues. Voyez id., vol. 1, p. 169.
[9] (↑) Le Missouri. Voyez id., vol. 1, p. 132 (1,278 lieues).
[10] (↑) L’Arkansas. Voyez id., vol. 1, p. 188 (877 lieues).
[11] (↑) La rivière Rouge. Voyez id., vol. 1, p. 190 (598 lieues).
[12] (↑) L’Ohio. Voyez id., vol. 1, p. 192 (490 lieues).
[13] (↑) L’Illinois, le Saint-Pierre, le Saint-François, la Moingona. Dans les mesures ci-dessus, j’ai pris pour base le mille légal (statute mile) et la lieue de poste de 2,000 toises.
[14] (↑) 100 milles.
[15] (↑) Environ 900 milles.
[16] (↑) Les eaux sont si transparentes dans la mer des Antilles, dit Malte-Brun, vol. 3, p. 726, qu’on distingue les coraux et les poissons à 60 brasses de profondeur. Le vaisseau semble planer dans l’air ; une sorte de vertige saisit le voyageur dont l’œil plonge à travers le fluide cristallin au milieu des jardins sous-marins où des coquillages et des poissons dorés brillent parmi les touffes de fucus et des bosquets d’algues marines.
[17] (↑) On a découvert depuis quelques ressemblances entre la conformation physique, la langue et les habitudes des Indiens de l’Amérique du Nord et celles des Tongouses, des Mantchoux, des Mongols, des Tatars et autres tribus nomades de l’Asie. Ces derniers occupent une position rapprochée du détroit de Behring, ce qui permet de supposer qu’à une époque ancienne ils ont pu venir peupler le continent désert de l’Amérique. Mais la science n’est pas encore parvenue à éclaircir ce point. Voyez sur cette question Malte-Brun, v. 5 ; les ouvrages de M. de Humboldt ; Fischer, Conjectures sur l’origine des Américains ; Adair, History of ihe American Indians.
[18] (↑) On a vu chez les Iroquois, attaqués par des forces supérieures, dit le président Jefferson (Observations sur la Virginie (Notes sur la Virginie), p. 148), les vieillards dédaigner de recourir à la fuite ou de survivre à la destruction de leur pays, et braver la mort, comme les anciens Romains dans le sac de Rome par les Gaulois.
Plus loin, p. 150 : « Il n’y a point d’exemple, dit-il, d’un Indien tombé au pouvoir de ses ennemis qui ait demandé la vie. On voit au contraire le prisonnier rechercher pour ainsi dire la mort des mains de ses vainqueurs, en les insultant et les provoquant de toutes les manières.
[19] (↑) Voyez Histoire de la Louisiane, par Lepage-Dupratz ; Charlevoix, Histoire de la Nouvelle-France ; Lettres du R. Hecwelder, Transactions of the American philosophical society, v. 1 ; Jefferson, Observations sur la Virginie(Notes sur la Virginie), p. 135-190. Ce que dit Jefferson est surtout d’un grand poids, à cause du mérite personnel de l’écrivain, de sa position particulière, et du siècle positif et exact dans lequel il écrivait.
[20] (↑) La charte accordée par la couronne d’Angleterre, en 1609, portait entre autres clauses que les colons paieraient à la couronne le cinquième du produit des mines d’or et d’argent. Voyez Vie de Washington, par Marshalls, vol. 1, p. 18-66.
[21] (↑) Une grande partie des nouveaux colons, dit Stith (History of Virginia), étaient des jeunes gens de famille déréglés, et que leurs parents avaient embarqués pour les soustraire à un sort ignominieux ; d’anciens domestiques, des banqueroutiers frauduleux, des débauchés et d’autres gens de cette espèce, plus propres à piller et à détruire qu’à consolider l’établissement, formaient le reste. Des chefs séditieux entraînèrent aisément cette troupe dans toutes sortes d’extravagances et d’excès. Voyez, relativement à l’histoire de la Virginie, les ouvrages qui suivent :
History of Virginia from the first Settlements in the year 1624 by Smith.
History of Virginia, by William Stith.
History of Virginia from the earliest period, by Beverly, traduit en français en 1807.
[22] (↑) Ce n’est que plus tard qu’un certain nombre de riches propriétaires anglais vinrent se fixer dans la colonie.
[23] (↑) L’esclavage fut introduit vers l’année 1620 par un vaisseau hollandais qui débarqua vingt nègres sur les rivages de la rivière James. Voyez Charmer.
[24] (↑) Les États de la Nouvelle-Angleterre sont ceux situés à l’est de l’Hudson ; ils sont aujourd’hui au nombre de six : 1o le Connecticut ; 2o Rhode-Island ; 3o Massachusetts ; 4o Vermont ; 5o New-Hampshire ; 6o Maine.
[25] (↑) New-England’s Memorial, p. 14 ; Boston, 1826. Voyez aussi l’Histoire de Hutchinson, vol. 2, p. 440.
[26] (↑) New-England’s Memorial, p. 22.
[27] (↑) Ce rocher est devenu un objet de vénération aux États-Unis. J’en ai vu des fragments conservés avec soin dans plusieurs villes de l’Union. Ceci ne montre-t-il pas bien clairement que la puissance et la grandeur de l’homme est tout entière dans son âme ? Voici une pierre que les pieds de quelques misérables touchent un instant, et cette pierre devient célèbre ; elle attire les regards d’un grand peuple ; on en vénère les débris, on s’en partage au loin la poussière. Qu’est devenu le seuil de tant de palais ? qui s’en inquiète ?
[28] (↑) New-England’s Memorial, p. 33.
[29] (↑) Les émigrants qui créèrent l’État de Rhode-Island en 1638, ceux qui s’établirent à New-Haven en 1637, les premiers habitants du Connecticut en 1639, et les fondateurs de Providence en 1640, commencèrent également par rédiger un contrat social qui fut soumis à l’approbation de tous les intéressés. Pitkin’s History, p. 42 et 47.
[30] (↑) Ce fut là le cas de l’État de New-York.
[31] (↑) Le Maryland, les Carolines, la Pennsylvanie, le New-Jersey, étaient dans ce cas. Voyez Pitkin’s History, vol. 1, p. 11-31.
[32] (↑) Voyez dans l’ouvrage intitulé : Historical collection of state papers and other authentic documents intended as materials for an history of the United States of America, by Ebeneser Hasard, printed at Philadelphia MDCCXCII, un très grand nombre de documents précieux par leur contenu et leur authenticité, relatifs au premier âge des colonies, entre autres les différentes chartes qui leur furent concédées par la couronne d’Angleterre, ainsi que les premiers actes de leurs gouvernements.
Voyez également l’analyse que fait de toutes ces chartes M. Story, juge à la cour suprême des États-Unis, dans l’introduction de son Commentaire sur la constitution des États-Unis.
Il résulte de tous ces documents que les principes du gouvernement représentatif et les formes extérieures de la liberté politique furent introduits dans toutes les colonies presque dès leur naissance. Ces principes avaient reçu de plus grands développements au nord qu’au sud, mais ils existaient partout.
[33] (↑) Voyez Pitkin’s History, p. 35, t. I. Voyez the History of the colony of Massachusetts, by Hutchinson, vol. 1, p. 9.
[34] (↑) Voyez id., p. 42-47.
[35] (↑) Les habitants du Massachusetts, dans l’établissement des lois criminelles et civiles des procédures et des cours de justice, s’étaient écartés des usages suivis en Angleterre : en 1600, le nom du roi ne paraissait point encore en tête des mandats judiciaires. Voyez Hutchinson, vol. 1, p. 452.
[36] (↑) Code of 1650, p. 28 (Hartford 1830).
[37] (↑) Voyez également dans l’histoire de Hutchinson, vol. 1, p. 435-456, l’analyse du Code pénal adopté en 1648 par la colonie du Massachusetts ; ce code est rédigé sur des principes analogues à celui du Connecticut.
[38] (↑) L’adultère était de même puni de mort par la loi du Massachusetts, et Hutchinson, vol. 1, p. 441, dit que plusieurs personnes souffrirent en effet la mort pour ce crime ; il cite à ce propos une anecdote curieuse, qui se rapporte à l’année 1663. Une femme mariée avait eu des relations d’amour avec un jeune homme ; elle devint veuve, elle l’épousa ; plusieurs années se passèrent : le public étant enfin venu à soupçonner l’intimité qui avait jadis régné entre les époux, ils furent poursuivis criminellement ; on les mit en prison, et peu s’en fallut qu’on ne les condamnât l’un et l’autre à mort.
[39] (↑) Code of 1650, p. 48.
Il arrivait, à ce qu’il paraît, quelquefois aux juges de prononcer cumulativement ces diverses peines, comme on le voit, dans un arrêt rendu en 1643 (p. 114, New-Haven antiquities), qui porte que Marguerite Bedfort, convaincue de s’être livrée à des actes répréhensibles, subira la peine du fouet, et qu’il lui sera enjoint de se marier avec Nicolas Jemmings, son complice.
[40] (↑) New-Haven antiquities, p. 104. Voyez aussi dans l’Histoire d’Hutchinson, vol. 1, p. 435, plusieurs jugements aussi extraordinaires que celui-là.
[41] (↑) Id., 1650, p. 50, 57.
[42] (↑) Id., p. 64.
[43] (↑) Id.
[44] (↑) Ceci n’était pas particulier au Connecticut. Voyez entre autres la loi rendue le 13 septembre 1644, dans le Massachusetts, qui condamne au bannissement les anabaptistes. Historical collection of state papers, vol. 1, p. 538. Voyez aussi la loi publiée le 14 octobre 1656 contre les quakers : « Attendu, dit la loi, qu’il vient de s’élever une secte maudite d’hérétiques appelés quakers… » Suivent les dispositions qui condamnent à une très forte amende les capitaines de vaisseaux qui amèneront des quakers dans le pays. Les quakers qui parviendront à s’y introduire seront fouettés et renfermés dans une prison pour y travailler. Ceux qui défendront leurs opinions seront d’abord mis l’amende, puis condamnés à la prison, et chassés de la province. Même collection, vol. 1, p. 630.
[45] (↑) Dans la loi pénale du Massachusetts ; le prêtre catholique qui met le pied dans la colonie après en avoir été chassé, est puni de mort.
[46] (↑) Code of 1650, p. 96.
[47] (↑) New-England’s Memorial, 316.
[48] (↑) Constitution de 1638, p. 17.
[49] (↑) Dès 1641, l’assemblée générale de Rhode-Island déclarait à l’unanimité que le gouvernement de l’État consistait en une démocratie, et que le pouvoir reposait sur le corps des hommes libres, lesquels avaient seuls le droit de faire les lois et d’en surveiller l’exécution. Code of 1650, p. 70.
[50] (↑) Pitkin’s History, p. 47.
[51] (↑) Constitution de 1638, p. 12.
[52] (↑) Code of 1650, p. 80.
[53] (↑) Id., p. 78.
[54] (↑) Code of 1650, p. 49.
[55] (↑) Voyez l’Histoire de Hutchinson, vol. 1, p. 455.
[56] (↑) Code of 1650, p. 86.
[57] (↑) Id., p. 40.
[58] (↑) Id., p. 90.
[59] (↑) Code of 1650, p. 83.
[60] (↑) Mathiew’s magnalia Christi americana, vol. 2, p. 13.
Ce discours fut tenu par Winthrop ; on l’accusait d’avoir commis, comme magistrat, des actes arbitraires ; après avoir prononcé le discours dont je viens de rappeler un fragment, il fut acquitté avec applaudissements, et depuis lors il fut toujours réélu gouverneur de l’État. Voyez Marshall, vol. 1, p. 166.
[61] (↑) Il y a sans doute des crimes pour lesquels on ne reçoit pas caution, mais ils sont en très petit nombre.
[62] (↑) Voyez Blakstone et Delolme, liv. 1, chap. X.
[63] (↑) J’entends par les lois sur les successions toutes les lois dont le but principal est de régler le sort des biens après la mort du propriétaire.
La loi sur les substitutions est de ce nombre ; elle a aussi pour résultat, il est vrai, d’empêcher le propriétaire de disposer de ses biens avant sa mort ; mais elle ne lui impose l’obligation de les conserver que dans la vue de les faire parvenir intacts à son héritier. Le but principal de la loi des substitutions est donc de régler le sort des biens après la mort du propriétaire. Le reste est le moyen qu’elle emploie.
[64] (↑) Je ne veux pas dire que le petit propriétaire cultive mieux, mais il cultive avec plus d’ardeur et de soin, et regagne par le travail ce qui lui manque du côté de l’art.
[65] (↑) La terre étant la propriété la plus solide, il se rencontre de temps en temps des hommes riches qui sont disposés à faire de grands sacrifices pour l’acquérir, et qui perdent volontiers une portion considérable de leur revenu pour assurer le reste. Mais ce sont là des accidents. L’amour de la propriété immobilière ne se retrouve plus habituellement que chez le pauvre. Le petit propriétaire foncier, qui a moins de lumières, moins d’imagination et moins de passions que le grand, n’est, en général, préoccupé que du désir d’augmenter son domaine, et souvent il arrive que les successions, les mariages, ou les chances du commerce, lui en fournissent peu à peu les moyens.
À côté de la tendance qui porte les hommes à diviser la terre, il en existe donc une autre qui les porte à l’agglomérer. Cette tendance, qui suffit à empêcher que les propriétés ne se divisent à l’infini, n’est pas assez forte pour créer de grandes fortunes territoriales, ni surtout pour les maintenir dans les mêmes familles.
[66] (↑) Amendements faits à la constitution du Maryland en 1801 et 1809.
[67] (↑) Le nombre des communes, dans l’État de Massachusetts, était, en 1830, de 305 ; le nombre des habitants de 610,014 ; ce qui donne à peu près un terme moyen de 2,000 habitants par commune.
[68] (↑) Les mêmes règles ne sont pas applicables aux grandes communes. Celles-ci ont en général un maire et un corps municipal divisé en deux branches ; mais c’est là une exception qui a besoin d’être autorisée par une loi. Voyez la loi du 22 février 1822, régulatrice des pouvoirs de la ville de Boston. Laws of Massachusetts, vol. 2, p. 588. Ceci s’applique aux grandes villes. Il arrive fréquemment aussi que les petites villes sont soumises à une administration particulière. On comptait en 1832 104 communes administrées de cette manière dans l’État de New-York (William’s Register).
[69] (↑) On en élit trois dans les plus petites communes, neuf dans les plus grandes. Voyez The Town officer, p. 186. Voyez aussi les principales lois du Massachusetts relatives aux select-men :
Loi du 20 février 1786, vol. 1, p. 219 ; — du 24 février 1796, vol. 1, p. 488 ; — 7 mars 1801, vol. 2, p. 45 ; — 16 juin 1795, vol. 1, p. 475 — 12 mars 1808, vol. 2, p. 186 ; — 28 février 1787, vol. 1, p. 302 ; — 22 juin 1797, vol. 1, pag. 539.
[70] (↑) Voyez Law of Massachusetts, vol. 1, p. 150 ; loi du 22 mars 1796.
[71] (↑) Ibid.
[72] (↑) Tous ces magistrats existent réellement dans la pratique.
Pour connaître les détails des fonctions de tous ces magistrats communaux, voyez le livre intitulé : Town officer, by Isaac Goodwin ; Worcester, 1827 ; et la collection des lois générales du Massachusetts en 3 vol. Boston, 1823.
[73] (↑) Voyez Laws of Massachusetts, loi du 23 mars 1796, vol. 1, p. 250.
[74] (↑) Ibid., loi du 20 février 1786, vol. 1, p. 217.
[75] (↑) Voyez même collection, loi du 25 juin 1789, et 8 mars 1827, vol. 1, p. 367, et vol. 3, p. 179.
[76] (↑) Voyez la loi du 14 février 1821, Laws of Massachusetts, vol. 1, p. 551.
[77] (↑) Voyez la loi du 20 février 1819, Laws of Massachusetts, vol. 2, p. 494.
[78] (↑) Le conseil du gouverneur est un corps électif.
[79] (↑) Voyez la loi du 2 novembre 1791, Laws of Massachusetts, vol. 1, p. 61.
[80] (↑) Voyez le Town offficer, particulièrement aux mots select-men, assessors, collectors, schools, surveyors of highways… Exemple entre mille : l’État défend de voyager sans motif le dimanche. Ce sont les tythingmen, officiers communaux, qui sont spécialement chargés de tenir la main à l’exécution de la loi.
Voyez la loi du 8 mars 1792, Laws of Massachusetts, vol. 1, p. 410.
Les select-men dressent les listes électorales pour l’élection du gouverneur et transmettent le résultat du scrutin au secrétaire de la république. Loi du 24 février 1796, id., vol. 1. p. 488.
[81] (↑) Exemple : les select-men autorisent la construction des égouts, désignent les lieux dont on peut faire des abattoirs, et où l’on peut établir certain genre de commerce dont le voisinage est nuisible.
Voyez la loi du 7 juin 1785, vol. 1, p. 193.
[82] (↑) Exemple : les select-men veillent à la santé publique en cas de maladies contagieuses, et prennent les mesures nécessaires conjointement avec les juges de paix. Loi du 22 juin 1797, vol. 1, p. 539.
[83] (↑) Je dis presque, car il y a plusieurs incidents de la vie communale qui sont réglés, soit par les juges de paix dans leur capacité individuelle, soit par les juges de paix réunis en corps au chef-lieu de comté. Exemple : ce sont les juges de paix qui accordent les licences. Voyez la Loi du 28 février 1787, vol. 1, p. 297.
[84] (↑) Exemple : on n’accorde de licence qu’à ceux qui présentent un certificat de bonne conduite donné par les select-men. Si les select-men refusent de donner ce certificat, la personne peut se plaindre aux juges de paix réunis en cours de session, et ces derniers peuvent accorder la licence. Voyez la loi du 12 mars 1808, vol. 2, p. 136. Les communes ont le droit de faire ces règlements (by-laws), et d’obliger à l’observation de ces règlements par des amendes dont le taux est fixé mais ces règlements ont besoin d’être approuvés par la cour des sessions. Voyez la loi du 23 mars 1786, vol. 1, p. 284
[85] (↑) Au Massachussets, les administrateurs du comté sont souvent appelés à apprécier les actes des administrateurs de la commune ; mais on verra plus loin qu’ils se livrent à cet examen comme pouvoir judiciaire, et non comme autorité administrative.
[86] (↑) Exemple : les comités communaux des écoles sont tenus annuellement de faire un rapport de l’état de l’école au secrétaire de la république. Voyez la loi du 10 mars 1827, vol. 3, p. 183.
[87] (↑) Nous verrons plus loin ce que c’est que le gouverneur ; je dois dire dès à présent que le gouverneur représente le pouvoir exécutif de tout l’État.
[88] (↑) Voyez constitution du Massachusetts, ch. II, section i, paragraphe g ; ch. III, paragraphe 3.
[89] (↑) Exemple entre beaucoup d’autres : un étranger arrive dans une commune, venant d’un pays que ravage une maladie contagieuse. Il tombe malade. Deux juges de paix peuvent donner, avec l’avis des select-men, au shériff du comté, l’ordre de le transporter ailleurs et de veiller sur lui. Loi du 22 juin 1797, vol. 1, p. 540.
En général, les juges de paix interviennent dans tous les actes importants de la vie administrative, et leur donnent un caractère semi-judiciaire.
[90] (↑) Je dis le plus grand nombre, parce qu’en effet certains délits administratifs sont déférés aux tribunaux ordinaires. Exemple : lorsqu’une commune refuse de faire les fonds nécessaires pour ses écoles, ou de nommer le comité des écoles, elle est condamnée à une amende très considérable. C’est la cour appelée supreme judicial court, ou la cour de common pleas, qui prononce cette amende. Voyez loi du 10 mars 1827, vol. 3, p. 190. Id.. Lorsqu’une commune omet de faire provision de munitions de guerre. Loi du 21 février 1822, vol. 2, p. 570.
[91] (↑) Les juges de paix prennent part, dans leur capacité individuelle, au gouvernement des communes et des comtés. Les actes les plus importants de la vie communale ne se font en général qu’avec le concours de l’un d’eux.
[92] (↑) Les objets qui ont rapport au comté, et dont la cour des sessions s’occupe, peuvent se réduire à ceux-ci :
1o l’érection des prisons et des cours de justice ; 2o le projet du budget du comté (c’est la législature de l’État qui le vote) ; 3o la répartition de ces taxes ainsi votée ; 4o la distribution de certaines patentes ; 5o l’établissement et la réparation des routes du comté.
[93] (↑) C’est ainsi que, quand il s’agit d’une route, la cour des sessions tranche presque toutes les difficultés d’exécution à l’aide du jury.
[94] (↑) Voyez loi du 20 février 1786, vol. 1, p. 117.
[95] (↑) Il y a une manière indirecte de faire obéir la commune. Les communes sont obligées par la loi à tenir leurs routes en bon état. Négligent-elles de voter les fonds qu’exige cet entretien, le magistrat communal chargé des routes est alors autorisé à lever d’office l’argent nécessaire. Comme il est lui-même responsable vis-à-vis des particuliers du mauvais état des chemins, et qu’il peut être actionné par eux devant la cour des sessions, on est assuré qu’il usera contre la commune du droit extraordinaire que lui donne la loi. Ainsi, en menaçant le fonctionnaire, la cour des sessions force la commune à l’obéissance. Voyez la loi du 5 mars 1787, vol. 2, p. 305.
[96] (↑) Loi du Massachusetts, vol. 2, p. 45.
[97] (↑) Exemple : Si une commune s’obstine à ne pas nommer d’assesseurs, la cour des sessions les nomme, et les magistrats ainsi choisis sont revêtus des mêmes pouvoirs que les magistrats élus. Voyez la loi précitée du 20 février 1787.
[98] (↑) Je dis près la cour des sessions. Il y a un magistrat qui remplit près des tribunaux ordinaires quelques unes des fonctions du ministère public.
[99] (↑) Les grands jurés sont obligés, par exemple, d’avertir les cours du mauvais état des routes. Loi du Massachusetts, vol. 1, p. 308.
[100] (↑) Si, par exemple, le trésorier du comté ne fournit point ses comptes. Loi du Massachusetts, vol. 1, p. 406.
[101] (↑) Exemple entre mille : un particulier endommage sa voiture ou se blesse sur une route mal entretenue ; il a le droit de demander des dommages-intérêts devant la cour des sessions, à la commune ou au comté chargé de la route. Loi du Massachusetts, vol. 1, p. 309.
[102] (↑) En cas d’invasion ou d’insurrection, lorsque les officiers communaux négligent de fournir à la milice les objets et munitions nécessaires, la commune peut être condamnée à une amende de 200 à 500 dollars (1,000 à 2,780 francs).
On conçoit très bien que, dans un cas pareil, il peut arriver que personne n’ait l’intérêt ni le désir de prendre le rôle d’accusateur. Aussi la loi ajoute-t-elle : « Tous les citoyens auront droit de poursuivre la punition de semblables délits, et la moitié de l’amende appartiendra au poursuivant ». Voyez loi du 6 mars 1810, vol. 2, p. 236.
Quelquefois ce n’est pas le particulier que la loi excite de cette manière à poursuivre les fonctionnaires publiques ; c’est le fonctionnaire qu’elle encourage ainsi à faire punir la désobéissance des particuliers. Exemple : un habitant refuse de faire la part de travail qui lui a été assignée sur une grande route. Le surveillant des routes doit le poursuivre ; et s’il le fait condamner, la moitié de l’amende lui revient. Voyez les lois précitées, vol. 1, p. 308.
[103] (↑) Voyez pour le détail, The Revised statutes de l’État de New-York, à la partie 1, chap. XI, intitulé : Of the powers, duties and privileges of towns. Des droits, des obligations et des privilèges des communes, vol. 1, p. 336-364.
Voyez dans le recueil intitulé : Digest of the laws of Pensylvania, les mots Assessors, Collectors, Constables, Overseers of the poor, Supervisor of highway. Et dans le recueil intitulé : Acts of a general nature of the state of Ohio, la loi du 25 février 1834, relative aux communes, p. 412. Et ensuite les dispositions particulières relatives aux divers officiers communaux, tels que : Township’s Clerk ("Twonship’s Clercks"), Trustees, Overseers ("Oversees") of the poor, Fence-Viewers ("Fence-Niewers"), Appraisers of property, Township’s Treasurer ("Treasure"), Constables, Supervisor of highways ("Supervisors of high’ways").
[104] (↑) Voyez Revised statutes of the state of New-York, partie I, chap. XI, vol. 1, p. 336. Id., ch. XII ; Id., p. 336. Id., Acts of the state of Ohio, Loi du 25 février 1824, relative aux county commissioners, p. 262.
Voyez Digest of the laws Pensylvania, aux mots County-rates ("Supervisors of high’ways"), and levies, p.170.
Dans l’État de New-York, chaque commune élit un député, et ce même député participe en même temps à l’administration du comté et à celle de la commune.
[105] (↑) Il y a même des États du Sud ou les magistrats des county-counts sont chargés de tout le détail de l’administration. Voyez The Statute of the state of Tennessee aux art. Judiciary, Taxes…..
[106] (↑) Exemple : la direction de l’instruction publique est centralisée dans les mains du gouvernement. La législature nomme les membres de l’Université, appelés régents ; le gouverneur et le lieutenant-gouverneur de l’État en font nécessairement partie. (Revised statutes, vol. 1, p. 456.) Les régents de l’Université visitent tous les ans les colléges et les académies, et font un rapport annuel à la législature ; leur surveillance n’est point illusoire, par les raisons particulières que voici : les colléges, afin de devenir des corps constitués (corporations) qui puissent acheter, vendre et posséder, ont besoin d’une charte ; or cette charte n’est accordée par la législature que de l’avis des régents. Chaque année l’État distribue aux colléges et académies les intérêts d’un fonds spécial créé pour l’encouragement des études. Ce sont les régents qui sont les distributeurs de cet argent. Voyez ch. xv, Instruction publique, Revised statutes, vol. 1 p. 455.
Chaque année les commissaires des écoles publiques sont tenus d’envoyer un rapport de la situation au surintendant de la république. Id., p. 488.
Un rapport semblable doit lui être fait annuellement sur le nombre et l’état des pauvres. Id., p. 681.
[107] (↑) Lorsque quelqu’un se croit lésé par certains actes émanés des commissaires des écoles (ce sont des fonctionnaires communaux), il peut en appeler au surintendant des écoles primaires, dont la décision est finale. Revised statutes, vol. 1, p. 487.
On trouve de loin en loin, dans les lois de l’État de New-York, des dispositions analogues à celles que je viens de citer comme exemples. Mais en général ces tentatives de centralisation sont faibles et peu productives. En donnant aux grands fonctionnaires de l’État le droit de surveiller et de diriger les agents inférieurs, on ne leur donne point le droit de les récompenser ou de les punir. Le même homme n’est presque jamais chargé de donner l’ordre et de réprimer la désobéissance ; il a donc le droit de commander, mais non la faculté de se faire obéir.
En 1830, le surintendant des écoles, dans son rapport annuel à la législature, se plaignait de ce que plusieurs commissaires des écoles ne lui avaient pas transmis, malgré ses avis, les comptes qu’ils lui devaient. « Si cette omission se renouvelle, ajoutait-il, je serai réduit à les poursuivre, aux termes de la loi, devant les tribunaux compétents. »
[108] (↑) Exemple : l’officier du ministère dans chaque comté (district-attorney) est chargé de poursuivre le recouvrement de toutes les amendes s’élevant au-dessus de 50 dollars, à moins que le droit n’ait été donné expressément par la loi à un autre magistrat. Revised statutes, part. 1, ch. x, vol. 1, p. 383.
[109] (↑) Il y a plusieurs traces de centralisation administrative au Massachusetts. Exemple : les comités des écoles communales sont chargés de faire chaque année un rapport au secrétaire d’État. Laws of Massachusets, vol. 1, p. 367.
[110] (↑) Voyez, à la fin du volume, le texte de la constitution de New-York.
[111] (↑) Dans le Massachusetts, le sénat n’est revêtu d’aucune fonction administrative.
[112] (↑) Comme dans l’État de New-York. Voyez la constitution à la fin du volume.
[113] (↑) Dans la pratique, ce n’est pas toujours le gouverneur qui exécute les entreprises que la législature a conçues ; il arrive souvent que cette dernière, en même temps qu’elle vote un principe, nomme des agents spéciaux pour en surveiller l’exécution.
[114] (↑) Dans plusieurs États, les juges de paix ne sont pas nommés par le gouverneur.
[115] (↑) L’autorité qui représente l’État, lors même qu’elle n’administre pas elle-même, ne doit pas, je pense, se dessaisir du droit d’inspecter l’administration locale. Je suppose, par exemple, qu’un agent du gouvernement, placé à poste fixe dans chaque comté, pût déférer au pouvoir judiciaire des délits qui se commettent dans les communes et dans le comté ; l’ordre n’en serait-il pas plus uniformément suivi sans que l’indépendance des localités fût compromise ? Or, rien de semblable n’existe en Amérique. Au-dessus des cours des comtés, il n’y a rien ; et ces cours ne sont, en quelques sorte, saisies que par hasard de la connaissance des délits administratifs qu’elles doivent réprimer.
[116] (↑) La Chine me paraît offrir le plus parfait emblème de l’espèce de bien-être social que peut fournir une administration très centralisée aux peuples qui s’y soumettent. Les voyageurs nous disent que les Chinois ont de la tranquillité sans bonheur, de l’industrie sans progrès, de la stabilité sans force, et de l’ordre matériel sans moralité publique. Chez eux, la société marche toujours assez bien, jamais très bien. J’imagine que quand la Chine sera ouverte aux Européens, ceux-ci y trouveront le plus beau modèle de centralisation administratif qui existe dans l’univers.
[117] (↑) Un écrivain de talent qui, dans une comparaison entre les finances des États-Unis et celles de la France, a prouvé que l’esprit ne pouvait pas toujours suppléer à la connaissance des faits, reproche avec raison aux Américains l’espèce de confusion qui règne dans leurs budgets communaux, et après avoir donné le modèle d’un budget départemental de France, il ajoute : « Grâce à la centralisation, création admirable d’un grand homme, les budgets municipaux, d’un bout du royaume à l’autre, ceux des grandes villes comme ceux des plus humbles communes, ne présentent pas moins d’ordre et de méthode. » Voilà certes un résultat que j’admire ; mais je vois la plupart de ces communes françaises, dont la comptabilité est si parfaite, plongées dans une profonde ignorance de leurs vrais intérêts, et livrées à une apathie si invincible, que la société semble plutôt y végéter qu’y vivre ; d’un autre côté, j’aperçois dans ces mêmes communes américaines, dont les budgets ne sont pas dressés sur des plans méthodiques, ni surtout uniformes, une population éclairée, active, entreprenante ; j’y contemple la société toujours en travail. Ce spectacle m’étonne ; car à mes yeux le but principal d’un bon gouvernement est de produire le bien-être des peuples et non d’établir un certain ordre au sein de leur misère. Je me demande donc s’il ne serait pas possible d’attribuer à la même cause la prospérité de la commune américaine et le désordre apparent de ses finances, la détresse de la commune de France et le perfectionnement de son budget. En tous cas, je me défie d’un bien que je trouve mêlé à tant de maux, et je me console aisément d’un mal qui est compensé par tant de bien.
[118] (↑) La cour des pairs en Angleterre forme en outre le dernier degré de l’appel dans certaines affaires civiles. Voyez Blackstone, liv. III, ch. IV.
[119] (↑) Ce n’est pas qu’on puisse ôter à un officier son grade, mais on peut lui enlever son commandement.
[120] (↑) Chap. I, sect. 2, §8.
[121] (↑) Voyez la constitution des Illinois, du Maine, du Connecticut et de la Géorgie.
[122] (↑) Voyez à la fin du volume le texte de la constitution fédérale.
[123] (↑) Voyez les articles de la première confédération formée en 1778. Cette constitution fédérale ne fut adoptée par tous les États qu’en 1781.
Voyez également l’analyse que fait de cette constitution le Fédéraliste, depuis le no 15 jusqu’au no 22 inclusivement, et M. Story dans ses Commentaires sur la constitution des États-Unis, p. 85-115.
[124] (↑) Ce fut le 21 février 1787 que le congrès fit cette déclaration.
[125] (↑) Elle n’était composée que de 25 membres. Washington, Madisson, Hamilton, les deux Morris, en faisaient partie.
[126] (↑) Ce ne furent point les législateurs qui l’adoptèrent, Le peuple nomma pour ce seul objet des députés. La nouvelle constitution fut dans chacune de ces assemblées l’objet de discussions approfondies.
[127] (↑) Voyez amendement à la constitution fédérale. Fédéraliste, n°32, Story, p. 711. Kent’s commentaries, vol. I, p. 364.
Remarquez même que, toutes les fois que la constitution n’a pas réservé au congrès le droit exclusif de régler certaines matières, les États peuvent le faire, en attendant qu’il lui plaise de s’en occuper. Exemple : Le congrès a le droit de faire une loi générale de banqueroute, il ne la fait pas : chaque État pourrait en faire une à sa manière. Au reste, ce point n’a été établi qu’après discussion devant les tribunaux. Il n’est que de jurisprudence.
[128] (↑) L’action de cette cour est indirecte, comme nous le verrons plus bas.
[129] (↑) C’est ainsi que le Fédéraliste, dans le n° 45, explique ce partage de la souveraineté entre l’Union et les États particuliers : « Les pouvoirs que la constitution délègue au gouvernement fédéral, dit-il, sont définis, et en petit nombre. Ceux qui restent a la disposition des États particuliers sont au contraire indéfinis, et en grand nombre. Les premiers s’exercent principalement dans les objets extérieurs, tels que la paix, la guerre, les négociations, le commerce. Les pouvoirs que les États particuliers se réservent s’étendent à tous les objets qui suivent le cours ordinaire des affaires, intéressent la vie, la liberté et la prospérité de l’État. »
J’aurai souvent occasion de citer le Fédéraliste dans cet ouvrage. Lorsque le projet de loi qui depuis est devenu la constitution des États-Unis était encore devant le peuple, et soumis à son adoption, trois hommes déjà célèbres, et qui le sont devenus encore plus depuis, John Jay, Hamilton et Madisson, s’associèrent dans le but de faire ressortir aux yeux de la nation les avantages du projet qui leur était soumis. Dans ce dessein, ils publièrent sous la forme d’un journal une suite d’articles dont l’ensemble forme un traité complet. Ils avaient donné à leur journal le nom de Fédéraliste, qui est resté à l’ouvrage.
Le Fédéraliste est un beau livre, qui, quoique spécial à l’Amérique devrait être familier aux hommes d’État de tous les pays.
[130] (↑) Voyez la constitution, sect. VIII. Fédéraliste, nos 41 et 42. Kent’s commentaries, vol. I, p. 207 et suiv. Story p.358-382 ; id., p.409-426
[131] (↑) Il y a encore plusieurs autres droits de cette espèce, tels que celui de faire une loi générale sur les banqueroutes, d’accorder des brevets d’invention.… On sent assez ce qui rendait nécessaire l’intervention de l’Union entière dans ces matières.
[132] (↑) Même dans ce cas, son intervention est indirecte. L’Union intervient par ses tribunaux, comme nous le verrons plus loin.
[133] (↑) Constitution fédérale, sect. x, art. 1.
[134] (↑) Constitution, sect. VIII, IX et X. Fédéraliste, no 30-36, inclusivement. Id., 41, 42, 43, 44. Kent’s commentaries, vol. 1, p. 207 et 381, Story, id., p. 329, 514.
[135] (↑) Tous les dix ans, le congrès fixe de nouveau le nombre des députés que chaque État doit envoyer à la chambre des représentants. Le nombre total était de 69 en 1789 ; il était en 1833 de 240. (American almanac, 1834, p. 194.)
La constitution avait dit qu’il n’y aurait pas plus d’un représentant par 30,000 personnes ; mais elle n’avait pas fixé de limite en moins. Le congrès n’a pas cru devoir accroitre le nombre des représentants dans la proportion de l’accroissement de la population. Par la première loi qui intervint sur ce sujet, le 14 avril 1792 (voyez laws of the United States by Story, vol. 1, p. 235), il fut décidé qu’il y aurait un représentant par 33,000 habitants. La dernière loi, qui est intervenue en 1832, fixa le nombre à 1 représentant par 48,000 habitants. La population représentée se compose de tous les hommes libres, et des trois cinquièmes du nombre des esclaves
[136] (↑) Voyez Fédéraliste, n° 52-56, inclusivement. Story, p. 199-314. Constitution, sect. II et III.
[137] (↑) Fédéraliste, n°67-77, inclusivement. Constitution, art. 2. Story, p. 315, p. 515-780. Kent’s commentaries, p. 255.
[138] (↑) La constitution avait laissé douteux le point de savoir si le président était tenu de prendre l’avis du sénat, en cas de discussion, comme en cas de nomination d’un fonctionnaire fédéral. Le Fédéraliste, dans son n° 77, semblait établir l’affirmative ; mais en 1789, le congrès décida avec toute raison que, puisque le président était responsable, on ne pouvait le forcer de se servir d’agents qui n’avaient pas sa confiance. Voyez Kent’s commentaries, vol. I, p. 289
[139] (↑) Les sommes payées par l’État à ces divers fonctionnaires montent chaque année à 200,000,000 de francs.
[140] (↑) On publie chaque année aux États-Unis un almanach appelé National calendar ; on y trouve le nom de tous les fonctionnaires fédéraux. C’est le National calendar de 1833 qui m’a fourni le chiffre que je donne ici.
Il résulterait de ce qui précède que le roi de France dispose de onze fois plus de places que le président des États-Unis, quoique la population de la France ne soit qu’une fois et demie plus considérable que celle de l’Union.
[141] (↑) Autant qu’il envoyait du membres au congrès. Le nombre des électeurs à l’élection de 1833 était de 288. (The National calendar.)
[142] (↑) Les électeurs du même État se réunissent ; mais ils transmettent au siége du gouvernement central la liste des votes individuels, et non le produit du vote de la majorité.
[143] (↑) Dans cette circonstance, c’est la majorité des États, et non la majorité des membres, qui décide la question. De telle sorte que New-York n’a pas plus d’influence sur la délibération que Rhode-Island. Ainsi on consulte d’abord les citoyens de l’Union comme ne formant qu’un seul et même peuple ; et quand ils ne peuvent pas s’accorder, on fait revivre la division par État, et l’on donne à chacun de ces derniers un vote séparé et indépendant.
[144] (↑) Jefferson, en 1801, ne fut cependant nommé qu’au trente-sixième tour de scrutin.
[145] (↑) Voyez le chapitre VI, intitulé : Du pouvoir judiciaire aux États-Unis. Ce chapitre fait connaître les principes généraux des Américains en fait de justice. Voyez aussi la constitution Fédérale, art. iii.
Voyez l’ouvrage ayant pour titre : The Federalist, no 78-83 inclusivement, Constitutional law, being a view of the practice and jurisdiclion of the courts of the United States, by Thomas Sergeant.
Voyez Story, p. 134-162, 489-511, 581, 668. Voyez la loi organique du 24 septembre 1789, dans le recueil intitulé : Laws of the United States, par Story, vol. i, p. 53.
[146] (↑) Ce sont les lois fédérales qui ont le plus besoin de tribunaux, et ce sont elles pourtant qui les ont le moins admis. La cause en est que la plupart des confédérations ont été formées par des États indépendants, qui n’avaient pas l’intention réelle d’obéir au gouvernement central, et qui, tout en lui donnant le droit de commander, se réservaient soigneusement la faculté de lui désobéir.
[147] (↑) On divisa l’Union en districts ; dans chacun de ces districts, on plaça à demeure un juge fédéral. La cour que présida ce juge se nomma la Cour du district (district-court).
De plus, chacun des juges composant la Cour suprême dut parcourir tous les ans une certaine portion du territoire de la république, afin de décider sur les lieux mêmes certains procès plus importants : la cour présidée par ce magistrat fut désignée sous le nom de Cour du circuit (circuit-court).
Enfin, les affaires les plus graves durent parvenir, soit directement, soit par appel, devant la Cour suprême, au siége de laquelle tous les juges de circuit se réunissent une fois par an, pour tenir une session solennelle.
Le système du jury fut introduit dans les cours fédérales, de la même manière que dans les cours d’État, et pour des cas semblables.
Il n’y a presque aucune analogie, comme on le voit, entre la Cour suprême des États-Unis et notre Cour de cassation. La Cour suprême peut être saisie en première instance, et la Cour de cassation ne peut l’être qu’en second ou en troisième ordre. La Cour suprême forme à la vérité, comme la Cour de cassation, un tribunal unique chargé d’établir une jurisprudence uniforme ; mais la Cour suprême le fait comme le droit, et prononce elle-même, sans renvoyer devant un autre tribunal ; deux choses que la Cour de cassation ne saurait faire.
Voyez la loi organique du 24 septembre 1789, Laws of the United States, par Story, vol. i, p. 53.
[148] (↑) Au reste, pour rendre ces procès de compétence moins fréquents, on décida que, dans un très grand nombre de procès fédéraux, les tribunaux des États particuliers auraient droit de prononcer concurremment avec les tribunaux de l’Union ; mais alors la partie condamnée eut toujours la faculté de former appel devant la cour suprême des États-Unis. La cour suprême de la Virginie contesta à la cour suprême des États-Unis le droit de juger l’appel de ses sentences, mais inutilement. Voyez Kent’s commentaries, vol. i, p. 300, 370 et suivantes. Voyez Story’s comm., p. 646, et la loi organique de 1789 ; Laws of the United States, vol. i, p. 53.
[149] (↑) La constitution dit également que les procès qui pourront naître entre un État et les citoyens d’un autre État seront du ressort des cours fédérales. Bientôt s’éleva la question de savoir si la constitution avait voulu parler de tous les procès qui peuvent naître entre l’État et les citoyens d’un autre État, soit que les uns ou les autres fussent demandeurs. La Cour suprême se prononça pour l’affirmative ; mais cette décision alarma les États particuliers, qui craignirent d’être traduits malgré eux, à tout propos, devant la justice fédérale. Un amendement fut donc introduit dans la constitution, en vertu duquel le pouvoir judiciaire de l’Union ne put s’étendre jusqu’à juger les procès qui auraient été intentés contre l’un des États-Unis par les citoyens d’un autre.
Voyez Story’s commentaries, p.624
[150] (↑) Exemple : tous les faits de piraterie.
[151] (↑) On a bien apporté quelques restrictions à ce principe en introduisant les États particuliers comme puissance indépendante dans le sénat, et en les faisant voter séparément dans la chambre des représentants en cas d’élection du président ; mais ce sont des exceptions. Le principe contraire est dominateur.
[152] (↑) Il est parfaitement clair, dit M. Story, p. 503, que toute loi qui étend, resserre ou change de quelque manière que ce soit l’intention des parties, telles qu’elles résultent des stipulations contenues dans un contrat, altère (impairs) ce contrat. Le même auteur définit avec soin au même endroit ce que la jurisprudence fédérale entend par un contrat. La définition est fort large. Une concession faite par l’État à un particulier et acceptée par lui est un contrat, et ne peut être enlevée par l’effet d’une nouvelle loi. Une charte accordée par l’État à une compagnie est un contrat, et fait la loi à l’État aussi bien qu’au concessionnaire. L’article de la constitution dont nous parlons assure donc l’existence d’une grande partie des droits acquis, mais non de tous. Je puis posséder très légitimement une propriété sans qu’elle soit passée dans mes mains par suite d’un contrat. Sa possession est pour moi un droit acquis, et ce droit n’est pas garanti par la constitution fédérale.
[153] (↑) Voici un exemple remarquable cité par M. Story, p. 508. Le college de Darmouth, dans le New-Hampshire, avait été fondé en vertu d’une charte accordée à certains individus avant la révolution d’Amérique. Ses administrateurs formaient, en vertu de cette charte, un corps constitué, ou, suivant l’expression américaine, une corporation. La législature du New-Hampshire crut devoir changer les termes de la charte originaire, et transporta à de nouveaux administrateurs tous les droits, priviléges et franchises qui résultaient de cette charte. Les anciens administrateurs résistèrent, et en appelèrent à la cour fédérale, qui leur donna gain de cause, attendu que la charte originaire étant un véritable contrat entre l’État et les concessionnaires, la loi nouvelle ne pouvait changer les dispositions de cette charte sans violer les droits acquis en vertu d’un contrat, et en conséquence violer l’article i, section x, de la constitution des États-Unis.
[154] (↑) Voyez le chapitre intitulé : Du pouvoir judiciaire en Amérique.
[155] (↑) Voyez Kent’s commentaries, vol. 1, p. 387.
[156] (↑) À cette époque, le célèbre Alexandre Hamilton, l’un des rédacteurs les plus influents de la constitution, ne craignait pas de publier ce qui suit dans le Fédéraliste, no 71 :
« Je sais, disait-il, qu’il y a des gens près desquels le pouvoir exécutif ne saurait mieux se recommander qu’en se pliant avec servilité aux désirs du peuple ou de la législature ; mais ceux-là me paraissent posséder des notions bien grossières sur l’objet de tout gouvernement, ainsi que sur les vrais moyens de produire la prospérité publique.
» Que les opinions du peuple, quand elles sont raisonnées et mûries, dirigent la conduite de ceux auxquels il confie ses affaires, c’est ce qui résulte de l’établissement d’une constitution républicaine ; mais les principes républicains n’exigent point qu’on se laisse emporter au moindre vent des passions populaires, ni qu’on se hâte d’obéir à toutes les impulsions momentanées que la multitude peut recevoir par la main artificieuse des hommes qui flattent ses préjugés pour trahir ses intérêts.
» Le peuple ne veut, le plus ordinairement, qu’arriver au bien public, ceci est vrai ; mais il se trompe souvent en le cherchant. Si on venait lui dire qu’il juge toujours sainement les moyens à employer pour produire la prospérité nationale, son bon sens lui ferait mépriser de pareilles flatteries ; car il a appris par expérience qu’il lui est arrivé quelquefois de se tromper ; et ce dont on doit s’étonner, c’est qu’il ne se trompe pas plus souvent, poursuivi comme il l’est toujours par les ruses des parasites et des sycophantes ; environné par les pièges que lui tendent sans cesse tant d’hommes avides et sans ressources, déçu chaque jour par les artifices de ceux qui possèdent sa confiance sans la mériter, ou qui cherchent plutôt à la posséder qu’à s’en rendre dignes.
» Lorsque les vrais intérêts du peuple sont contraires à ses désirs, le devoir de tous ceux qu’il a préposés à la garde de ces intérêts est de combattre l’erreur dont il est momentanément la victime, afin de lui donner le temps de se reconnaître et d’envisager les choses de sang-froid. Et il est arrivé plus d’une fois qu’un peuple, sauvé ainsi des fatales conséquences de ses propres erreurs, s’est plu à élever des monuments de sa reconnaissance aux hommes qui avaient eu le magnanime courage de s’exposer à lui déplaire pour le servir. »
[157] (↑) C’est ce qu’on a vu chez les Grecs, sous Philippe, lorsque ce prince se chargea d’exécuter le décret des amphictyons. C’est ce qui est arrivé à la république des Pays-Bas, où la province de Hollande a toujours fait la loi. La même chose se passe encore de nos jours dans le corps germanique. L’Autriche et la Prusse se font les agents de la diète, et dominent toute la confédération en son nom.
[158] (↑) Il en a toujours été ainsi pour la confédération suisse. — Il y a des siècles que la Suisse n’existerait plus sans les jalousies de ses voisins.
[159] (↑) Je ne parle point ici d’une confédération de petites républiques, mais d’une grande république consolidée.
[160] (↑) Voyez la constitution mexicaine de 1824.
[161] (↑) Exemple : La constitution a donné à l’Union le droit de faire vendre pour son compte les terres inoccupées. Je suppose que l’Ohio revendique ce même droit pour celles qui sont renfermées dans ses limites, sous le prétexte que la constitution n’a voulu parler que du territoire qui n’est encore soumis à aucune juridiction d’État, et qu’en conséquence il veuille lui-même les vendre. La question judiciaire se poserait, il est vrai, entre les acquéreurs qui tiennent leur titre de l’Union et les acquéreurs qui tiennent leur titre de l’État, et non pas entre l’Union et l’Ohio. Mais si la cour des États-Unis ordonnait que l’acquérenr fédéral fût mis en possession, et que les tribunaux de l’Ohio maintinssent dans ses biens son compétiteur, alors que deviendrait la fiction légale ?
[162] (↑) Kent’s commentaries, vol. I, p. 244. Remarquez que j’ai choisi l’exemple cité plus haut dans des temps postérieurs à l’établissement de la constitution actuelle. Si j’avais voulu remonter à l’époque de la première confédération, j’aurais signalé des faits bien plus concluants encore. Alors il régnait un véritable enthousiasme dans la nation ; la révolution était représentée par un homme éminemment populaire, et pourtant, à cette époque, le congrès ne disposait, à proprement parler, de rien. Les hommes et l’argent lui manquaient à tous moments ; les plans les mieux combinés par lui échouaient dans l’exécution, et l’Union, toujours sur le point de périr, fut sauvée bien plus par la faiblesse de ses ennemis que par sa propre force.
[163] (↑) Le 20e degré de longitude, suivant le méridien de Washington, se rapporte à peu près au 99e degré suivant le méridien de Paris.
[164] (↑) Ce sont des officiers élus chaque année, et qui, par leurs fonctions, se rapprochent tout à la fois du garde champêtre et de l’officier de police judiciaire en France.
[165] (↑) Voyez Mémoires pour servir à l’histoire du droit public de la France en matière d’impôts, p. 654, imprimés à Bruxelles, en 1779.
[166] (↑) Il s’agit du président temporaire nommé conformément au paragraphe 3 de l’article premier de la constitution.
[167] (↑) Les supervisors sont des magistrats chargés en partie de l’administration des communes, et qui, en outre, forment, en se réunissant, le pouvoir législatif de chaque comté.
[168] (↑) Il s’agit ici du cas où la chambre des représentants accuse un fonctionnaire public devant le sénat.
[169] (↑) C’est la forme dont on se sert pour indiquer que les juges ne sont pas révocables, et ne peuvent perdre leur place qu’en vertu d’un arrêt.
Alexis de Tocqueville,
De la démocratie en Amérique, Tome 2 (1848)
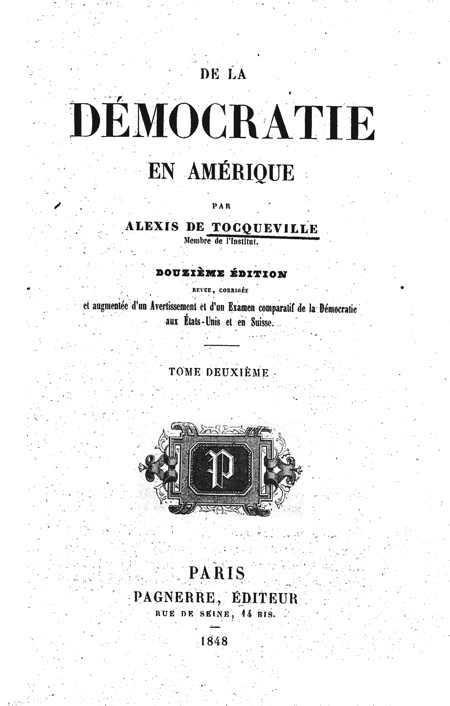
[II-421]
TABLE DES CONTENUES DANS LE DEUXIÈME VOLUME↩
- [Introduction] p. 1
- Chap. Ier. — Comment on peut dire rigoureusement qu’aux États-Unis c’est le peuple qui gouverne. p. 1
- Chap. II. — Des partis aux États-Unis. p. 3
- Des restes du parti aristocratique aux États-Unis. p. 11
- Chap. III. — De la liberté de la presse aux États-Unis. p. 14
- Chap. IV. — De l’association politique aux États-Unis. p. 29
- Chap. V. — Du gouvernement de la démocratie en Amérique. p. 42
- Du vote universel. p. 43
- Des choix du peuple et des instincts de la démocratie américaine dans ses choix. Ib.
- Des causes qui peuvent corriger en partie ces instincts de la démocratie. p. 47
- Influence qu’a exercée la démocratie américaine sur les lois électorales. p. 50
- Des fonctionnaires publics sous l’empire de la démocratie américaine. p. 54
- De l’arbitraire des magistrats sous l’empire de la démocratie américaine. p. 58
- Instabilité administrative aux États-Unis. p. 61
- Des charges publiques sous l’empire de la démocratie américaine. p. 64
- Des instincts de la démocratie américaine dans la fixation du traitement des fonctionnaires. p. 70
- Difficulté de discerner les causes qui portent le gouvernement américain à l’économie. p. 74
- Peut-on comparer les dépenses publiques des États-Unis à celles de France ? p. 75
- De la corruption et des vices des gouvernants dans la démocratie ; des effets qui en résultent sur la moralité publique. p. 83
- De quels efforts la démocratie est capable. p. 86
- Du pouvoir qu’exerce en général la démocratie américaine sur elle-même. p. 91
- De la manière dont la démocratie américaine conduit les affaires extérieures de l’État. p. 94
- Chap. VI. — Quels sont les avantages réels que la société américaine retire du gouvernement de la démocratie p. 102
- De la tendance générale des lois sous l’empire de la démocratie américaine, et des instincts de ceux qui les appliquent. Ib.
- De l’esprit public aux États-Unis. p. 109
- De l’idée des droits aux États-Unis. p. 113
- Du respect pour la loi aux États-Unis. p. 118
- Activité qui règne dans toutes les parties du corps politique aux États-Unis ; influence qu’elle exerce sur la société. p. 120
- Chap. VII. — De l’omnipotence de la majorité aux États-Unis et de ses effets. p. 128
- Comment l’omnipotence de la majorité augmente, en Amérique, l’instabilité législative et administrative qui est naturelle aux démocraties. p. 132
- Tyrannie de la majorité. p. 135
- Effets de l’omnipotence de la majorité sur l’arbitraire des fonctionnaires publics américains. p. 140
- Du pouvoir qu’exerce la majorité en Amérique sur la pensée. p. 141
- Effets de la tyrannie de la majorité sur le caractère national des Américains ; de l’esprit de cour aux États-Unis. p. 146
- Que le plus grand danger des républiques américaines vient de l’omnipotence de la majorité. p. 151
- Chap. VIII. — De ce qui tempère, aux États-Unis, la tyrannie de la majorité. — Absence de centralisation administrative. p. 154
- De l’esprit légjste aux États-Unis, et comment il sert de contrepoids à la démocratie. p. 156
- Du jury aux États-Unis considéré comme institution politique. p. 169
- Chap. IX. — Des causes principales qui tendent à maintenir la république démocratique aux États-Unis. p. 180
- Des causes accidentelles on providentielles qui contribuent au maintien de la république démocratique aux États-Unis. p. 181
- De l’influence des lois sur le maintien de la république démocratique aux États-Unis. p. 197
- De l’influence des mœurs sur le maintien de la république démocratique aux États-Unis. p. 198
- De la religion considérée comme institution politique, et comment elle sert puissamment au maintien de la république démocratique chez les Américains. p. 199
- Influence indirecte qu’exercent les croyances religieuses sur la société politique aux États-Unis. p. 204
- Des principales causes qui rendent la religion puissante en Amérique. p. 211
- Comment les lumières, les habitudes et l’expérience pratique des Américains contribuent au succès des institutions démocratiques. p. 223
- Que les lois servent plus au maintien de la république démocratique, aux États-Unis, que les causes physiques, et les mœurs plus que les lois 230
- Les lois et les mœurs suffiraient-elles pour maintenir les institutions démocratiques autre part qu’en Amérique ? p. 236
- Importance de ce qui précède par rapport à l’Europe p. 241
- Chap. X. — Quelques considérations sur l’état actuel et l’avenir probable des trois races qui habitent le territoire des États-Unis p. 249
- État actuel et avenir probable des tribus indiennes qui habitent le territoire possédé par l’Union p. 258
- Position qu’occupe la race noire aux États-Unis ; dangers que sa présence fait courir aux blancs p. 289
- Quelles sont les chances de durée de l’Union américaine — Quels dangers la menacent p. 330
- Des institutions républicaines aux États-Unis ; quelles sont leurs chances de durée p. 384
- Quelques considérations sur les causes de la grandeur commerciale des États-Unis p. 393
- Conclusion. p. 405
- Notes. p. 415
- Endnotes
FIN DE LA TABLE DU DEUXIÈME VOLUME.
[II-1]
DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.
[Introduction]
Jusqu’à présent j’ai examiné les institutions, j’ai parcouru les lois écrites, j’ai peint les formes actuelles de la société politique aux États-Unis.
Mais, au-dessus de toutes les institutions et en dehors de toutes les formes, réside un pouvoir souverain, celui du peuple, qui les détruit ou les modifie à son gré.
Il me reste à faire connaître par quelles voies procède ce pouvoir, dominateur des lois ; quels sont ses instincts, ses passions ; quels ressorts secrets le poussent, le retardent, ou le dirigent dans sa marche irrésistible ; quel effet produit sa toute-puissance, et quel avenir lui est réservé.
CHAPITRE I.↩
COMMENT ON PEUT DIRE RIGOUREUSEMENT QU’AUX ÉTATS-UNIS C’EST LE PEUPLE QUI GOUVERNE.
En Amérique, le peuple nomme celui qui fait la loi et celui qui l’exécute ; lui-même forme le jury qui punit les infractions à la loi. Non seulement les institutions sont démocratiques dans leur principe, mais [II-2] encore dans tous leurs développements ; ainsi le peuple nomme directement ses représentants et les choisit en général tous les ans, afin de les tenir plus complétement dans sa dépendance. C’est donc réellement le peuple qui dirige, et quoique la forme du gouvernement soit représentative, il est évident que les opinions, les préjugés, les intérêts, et même les passions du peuple, ne peuvent trouver d’obstacles durables qui les empêchent de se produire dans la direction journalière de la société.
Aux États-Unis, comme dans tous les pays où le peuple règne, c’est la majorité qui gouverne au nom du peuple.
Cette majorité se compose principalement des citoyens paisibles, qui, soit par goût, soit par intérêt, désirent sincèrement le bien du pays. Autour d’eux s’agitent sans cesse les partis, qui cherchent à les attirer dans leur sein et à s’en faire un appui. [II-3] .
[II-3]
CHAPITRE II.↩
DES PARTIS AUX ÉTATS-UNIS.
Il faut faire une grande division entre les partis. — Partis qui sont entre eux comme des nations rivales. — Partis proprement dits. — Différence entre les grands et les petits partis. — Dans quels temps ils naissent. — Leurs divers caractères. — L’Amérique a eu de grands partis. — Elle n’en a plus. — Fédéralistes. — Républicains. — Défaite des fédéralistes. — Difficulté de créer aux États-Unis des partis. — Ce qu’on fait pour y parvenir. — Caractère aristocratique ou démocratique qui se retrouve dans tous les partis. — Lutte du général Jackson contre la banque.
Je dois établir d’abord une grande division entre les partis.
Il est des pays si vastes, que les différentes populations qui les habitent, quoique réunies sous la même souveraineté, ont des intérêts contradictoires, d’où naît entre elles une opposition permanente. Les diverses fractions d’un même peuple ne forment point alors, à proprement parler, des partis, mais des nations distinctes ; et si la guerre civile vient à naître, il y a conflit entre des peuples rivaux plutôt que lutte entre des factions.
Mais quand les citoyens diffèrent entre eux sur des points qui intéressent également toutes les portions du pays, tels, par exemple, que les principes [II-4] généraux du gouvernement, alors on voit naître ce que j’appellerai véritablement des partis.
Les partis sont un mal inhérent aux gouvernements libres ; mais ils n’ont pas dans tous les temps le même caractère et les mêmes instincts.
Il arrive des époques où les nations se sentent tourmentées de maux si grands, que l’idée d’un changement total dans leur Constitution politique se présente à leur pensée. Il y en a d’autres où le malaise est plus profond encore, et où l’état social lui-même est compromis. C’est le temps des grandes révolutions et des grands partis.
Entre ces siècles de désordres et de misères, il s’en rencontre d’autres où les sociétés se reposent et où la race humaine semble reprendre haleine. Ce n’est encore là, à vrai dire, qu’une apparence ; le temps ne suspend pas plus sa marche pour les peuples que pour les hommes ; les uns et les autres s’avancent chaque jour vers un avenir qu’ils ignorent ; et lorsque nous les croyons stationnaires, c’est que leurs mouvements nous échappent. Ce sont des gens qui marchent ; ils paraissent immobiles à ceux qui courent.
Quoi qu’il en soit, il arrive des époques où les changements qui s’opèrent dans la constitution politique et l’état social des peuples sont si lents et si insensibles que les hommes pensent être arrivés à un état final ; l’esprit humain se croit alors fermement assis sur certaines bases et ne porte pas ses regards au-delà d’un certain horizon.
C’est le temps des intrigues et des petits partis.
Ce que j’appelle les grands partis politiques sont ceux qui s’attachent aux principes plus qu’à leurs [II-5] conséquences ; aux généralités et non aux cas particuliers ; aux idées et non aux hommes. Ces partis ont, en général, des traits plus nobles, des passions plus généreuses, des convictions plus réelles, une allure plus franche et plus hardie que les autres. L’intérêt particulier, qui joue toujours le plus grand rôle dans les passions politiques, se cache ici plus habilement sous le voile de l’intérêt public ; il parvient même quelquefois à se dérober aux regards de ceux qu’il anime et fait agir.
Les petits partis, au contraire, sont en général sans foi politique. Comme ils ne se sentent pas élevés et soutenus par de grands objets, leur caractère est empreint d’un égoïsme qui se produit ostensiblement à chacun de leurs actes. Ils s’échauffent toujours à froid ; leur langage est violent, mais leur marche est timide et incertaine. Les moyens qu’ils emploient sont misérables comme le but même qu’ils se proposent. De là vient que quand un temps de calme succède à une révolution violente, les grands hommes semblent disparaître tout-à-coup et les âmes se renfermer en elles-mêmes.
Les grands partis bouleversent la société, les petits l’agitent ; les uns la déchirent et les autres la dépravent ; les premiers la sauvent quelquefois en l’ébranlant, les seconds la troublent toujours sans profit.
L’Amérique a eu de grands partis ; aujourd’hui ils n’existent plus : elle y a beaucoup gagné en bonheur, mais non en moralité.
Lorsque la guerre de l’indépendance eut pris fin, et qu’il s’agit d’établir les bases du nouveau gouvernement, la nation se trouva divisée entre deux [II-6] opinions. Ces opinions étaient aussi anciennes que le monde, et on les retrouve sous différentes formes et revêtues de noms divers dans toutes les sociétés libres. L’une voulait restreindre le pouvoir populaire, l’autre l’étendre indéfiniment.
La lutte entre ces deux opinions ne prit jamais chez les Américains le caractère de violence qui l’a souvent signalée ailleurs. En Amérique, les deux partis étaient d’accord sur les points les plus essentiels. Aucun des deux, pour vaincre, n’avait à détruire un ordre ancien, ni à bouleverser tout un état social. Aucun des deux, par conséquent, ne rattachait un grand nombre d’existences individuelles au triomphe de ses principes. Mais ils touchaient à des intérêts immatériels du premier ordre, tels que l’amour de l’égalité et de l’indépendance. C’en était assez pour soulever de violentes passions.
Le parti qui voulait restreindre le pouvoir populaire chercha surtout à faire l’application de ses doctrines à la Constitution de l’Union, ce qui lui valut le nom de fédéral.
L’autre, qui se prétendait l’amant exclusif de la liberté, prit le titre de Républicain.
L’Amérique est la terre de la démocratie. Les fédéralistes furent donc toujours en minorité ; mais ils comptaient dans leurs rangs presque tous les grands hommes que la guerre de l’indépendance avait fait naître, et leur puissance morale était très étendue. Les circonstances leur furent d’ailleurs favorables. La ruine de la première confédération fit craindre au peuple de tomber dans l’anarchie, et les fédéralistes profitèrent de cette disposition passagère. [II-7] Pendant dix ou douze ans, ils dirigèrent les affaires et purent appliquer, non tous leurs principes, mais quelques-uns d’entre eux ; car le courant opposé devenait de jour en jour trop violent pour qu’on osât lutter contre lui.
En 1801, les républicains s’emparèrent enfin du gouvernement. Thomas Jefferson fut nommé président ; il leur apporta l’appui d’un nom célèbre, d’un grand talent et d’une immense popularité.
Les fédéralistes ne s’étaient jamais maintenus que par des moyens artificiels et à l’aide de ressources momentanées ; c’étaient la vertu ou les talents de leurs chefs, ainsi que le bonheur des circonstances, qui les avaient poussés au pouvoir. Quand les républicains y arrivèrent à leur tour, le parti contraire fut comme enveloppé au milieu d’une inondation subite. Une immense majorité se déclara contre lui, et il se vit sur-le-champ en si petite minorité, qu’aussitôt il désespéra de lui-même. Depuis ce moment, le parti républicain ou démocratique a marché de conquêtes en conquêtes, et s’est emparé de la société tout entière.
Les fédéralistes se sentant vaincus, sans ressources et se voyant isolés au milieu de la nation, se divisèrent ; les uns se joignirent aux vainqueurs ; les autres déposèrent leur bannière et changèrent de nom. Il y a déjà un assez grand nombre d’années qu’ils ont entièrement cessé d’exister comme parti.
Le passage des fédéralistes au pouvoir est, à mon avis, l’un des événements les plus heureux qui aient accompagné la naissance de la grande union américaine. Les fédéralistes luttaient contre la pente [II-8] irrésistible de leur siècle et de leur pays. Quelle que fût la bonté ou le vice de leurs théories, elles avaient le tort d’être inapplicables dans leur entier à la société qu’ils voulaient régir ; ce qui est arrivé sous Jefferson serait donc arrivé tôt ou tard. Mais leur gouvernement laissa du moins à la nouvelle république le temps de s’asseoir, et lui permit ensuite de supporter sans inconvénient le développement rapide des doctrines qu’ils avaient combattues. Un grand nombre de leurs principes finit d’ailleurs par s’introduire dans le symbole de leurs adversaires ; et la Constitution fédérale, qui subsiste encore de notre temps, est un monument durable de leur patriotisme et de leur sagesse.
Ainsi donc, de nos jours, on n’aperçoit point aux États-Unis de grands partis politiques. On y rencontre bien des partis qui menacent l’avenir de l’Union ; mais il n’en existe pas qui paraissent s’attaquer à la forme actuelle du gouvernement et à la marche générale de la société. Les partis qui menacent l’Union reposent, non sur des principes, mais sur des intérêts matériels. Ces intérêts constituent dans les différentes provinces d’un si vaste empire des nations rivales plutôt que des partis. C’est ainsi qu’on a vu dernièrement le Nord soutenir le système des prohibitions commerciales, et le Sud prendre les armes en faveur de la liberté du commerce, par la seule raison que le Nord est manufacturier et le Sud cultivateur, et que le système restrictif agit au profit de l’un et au détriment de l’autre.
À défaut des grands partis, les États-Unis fourmillent de petits, et l’opinion publique se fractionne [II-9] à l’infini sur des questions de détails. On ne saurait imaginer la peine qu’on s’y donne pour créer des partis ; ce n’est pas chose aisée de notre temps. Aux États-Unis, point de haine religieuse, parce que la religion est universellement respectée et qu’aucune secte n’est dominante ; point de haine de classes, parce que le peuple est tout, et que nul n’ose encore lutter avec lui ; enfin point de misères publiques à exploiter, parce que l’état matériel du pays offre une si immense carrière à l’industrie, qu’il suffit de laisser l’homme à lui-même pour qu’il fasse des prodiges. Il faut bien pourtant que l’ambition parvienne à créer des partis, car il est difficile de renverser celui qui tient le pouvoir, par la seule raison qu’on veut prendre sa place. Toute l’habileté des hommes politiques consiste donc à composer des partis : un homme politique, aux États-Unis, cherche d’abord à discerner son intérêt, et à voir quels sont les intérêts analogues qui pourraient se grouper autour du sien ; il s’occupe ensuite à découvrir s’il n’existerait pas par hasard, dans le monde, une doctrine ou un principe qu’on pût placer convenablement à la tête de la nouvelle association, pour lui donner le droit de se produire et de circuler librement. C’est comme qui dirait le privilége du roi que nos pères imprimaient jadis sur la première feuille de leurs ouvrages, et qu’ils incorporaient au livre, bien qu’il n’en fît point partie.
Ceci fait, on introduit la nouvelle puissance dans le monde politique.
Pour un étranger, presque toutes les querelles domestiques des Américains paraissent, au premier abord, incompréhensibles ou puériles, et l’on ne sait [II-10] si l’on doit prendre en pitié un peuple qui s’occupe sérieusement de semblables misères, ou lui envier le bonheur de pouvoir s’en occuper.
Mais lorsqu’on vient à étudier avec soin les instincts secrets qui, en Amérique, gouvernent les factions, on découvre aisément que la plupart d’entre elles se rattachent plus ou moins à l’un ou à l’autre des deux grands partis qui divisent les hommes, depuis qu’il y a des sociétés libres. À mesure qu’on pénètre plus profondément dans la pensée intime de ces partis, on s’aperçoit que les uns travaillent à resserrer l’usage de la puissance publique, les autres à l’étendre.
Je ne dis point que les partis américains aient toujours pour but ostensible ni même pour but caché de faire prévaloir l’aristocratie ou la démocratie dans le pays ; je dis que les passions aristocratiques ou démocratiques se retrouvent aisément au fond de tous les partis ; et que, bien qu’elles s’y dérobent aux regards, elles en forment comme le point sensible et l’âme.
Je citerai un exemple récent : le président attaque la banque des États-Unis ; le pays s’émeut et se divise ; les classes éclairées se rangent en général du côté de la banque, le peuple en faveur du président. Pensez-vous que le peuple a su discerner les raisons de son opinion au milieu des détours d’une question si difficile, et où les hommes expérimentés hésitent ? Nullement. Mais la banque est un grand établissement qui a une existence indépendante ; le peuple, qui détruit ou élève toutes les puissances, ne peut rien sur elle, cela l’étonne. Au milieu du mouvement [II-11] universel de la société, ce point immobile choque ses regards, et il veut voir s’il ne parviendra pas à le mettre en branle comme le reste.
DES RESTES DU PARTI ARTISTOCRATIQUE AUX ÉTATS-UNIS.
Opposition secrète des riches à la démocratie. — Ils se retirent dans la vie privée. — Goût qu’ils montrent dans l’intérieur de leur demeure pour les plaisirs exclusifs et le luxe. — Leur simplicité au-dehors. — Leur condescendance affectée pour le peuple.
Il arrive quelquefois, chez un peuple divisé d’opinions, que l’équilibre entre les partis venant à se rompre, l’un d’eux acquiert une prépondérance irrésistible. Il brise tous les obstacles, accable son adversaire et exploite la société entière à son profit. Les vaincus, désespérant alors du succès, se cachent ou se taisent. Il se fait une immobilité et un silence universels. La nation semble réunie dans une même pensée. Le parti vainqueur se lève et dit : « J’ai rendu la paix au pays, on me doit des actions de grâces. ».
Mais sous cette unanimité apparente se cachent encore des divisions profondes et une opposition réelle.
C’est ce qui arriva en Amérique : quand le parti démocratique eut obtenu la prépondérance, on le vit s’emparer de la direction exclusive des affaires. Depuis, il n’a cessé de modeler les mœurs et les lois sur ses désirs.
De nos jours, on peut dire qu’aux États-Unis les classes riches de la société sont presque entièrement hors des affaires politiques, et que la richesse, loin [II-12] d’y être un droit, y est une cause réelle de défaveur et un obstacle pour parvenir au pouvoir.
Les riches aiment donc mieux abandonner la lice, que d’y soutenir une lutte souvent inégale contre les plus pauvres de leurs concitoyens. Ne pouvant pas prendre dans la vie publique un rang analogue à celui qu’ils occupent dans la vie privée, ils abandonnent la première pour se concentrer dans la seconde. Ils forment au milieu de l’État comme une société particulière qui a ses goûts et ses jouissances à part.
Le riche se soumet à cet état de choses comme à un mal irrémédiable ; il évite même avec grand soin de montrer qu’il le blesse ; on l’entend donc vanter en public les douceurs du gouvernement républicain et les avantages des formes démocratiques. Car, après le fait de haïr leurs ennemis, qu’y a-t-il de plus naturel aux hommes que de les flatter ?.
Voyez-vous cet opulent citoyen ? ne dirait-on pas un juif du moyen-âge qui craint de laisser soupçonner ses richesses ? Sa mise est simple, sa démarche est modeste ; entre les quatre murailles de sa demeure on adore le luxe ; il ne laisse pénétrer dans ce sanctuaire que quelques hôtes choisis qu’il appelle insolemment ses égaux. On ne rencontre point de noble en Europe qui se montre plus exclusif que lui dans ses plaisirs, plus envieux des moindres avantages qu’une position privilégiée assure. Mais le voici qui sort de chez lui pour aller travailler dans un réduit poudreux qu’il occupe au centre de la ville et des affaires, et où chacun est libre de venir l’aborder. Au milieu du chemin, son cordonnier vient à passer, et ils s’arrêtent : tous deux se mettent alors à discourir. [II-13] Que peuvent-ils dire ? Ces deux citoyens s’occupent des affaires de l’État, et ils ne se quitteront pas sans s’être serré la main.
Au fond de cet enthousiasme de convention et au milieu de ces formes obséquieuses envers le pouvoir dominant, il est facile d’apercevoir dans les riches un grand dégoût pour les institutions démocratiques de leur pays. Le peuple est un pouvoir qu’ils craignent et qu’ils méprisent. Si le mauvais gouvernement de la démocratie amenait un jour une crise politique ; si la monarchie se présentait jamais aux États-Unis comme une chose praticable, on découvrirait bientôt la vérité de ce que j’avance.
Les deux grandes armes qu’emploient les partis pour réussir sont les journaux et les associations. [II-14]
[II-14]
CHAPITRE III.↩
DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE AUX ÉTATS-UNIS.
Difficulté de restreindre la liberté de la presse. — Raisons particulières qu’ont certains peuples de tenir à cette liberté. — La liberté de la presse est une conséquence nécessaire de la souveraineté du peuple comme on l’entend en Amérique. — Violence du langage de la presse périodique aux États-Unis. — La presse périodique a des instincts qui lui sont propres ; l’exemple des États-Unis le prouve. — Opinion des Américains sur la répression judiciaire des délits de la presse. — Pourquoi la presse est moins puissante aux États-Unis qu’en France.
La liberté de la presse ne fait pas seulement sentir son pouvoir sur les opinions politiques, mais encore sur toutes les opinions des hommes. Elle ne modifie pas seulement les lois, mais les mœurs. Dans une autre partie de cet ouvrage, je chercherai à déterminer le degré d’influence qu’a exercée la liberté de la presse sur la société civile aux États-Unis ; je tâcherai de discerner la direction qu’elle a donnée aux idées, les habitudes qu’elle a fait prendre à l’esprit et aux sentiments des Américains. En ce moment, je ne veux examiner que les effets produits par la liberté de la presse dans le monde politique.
J’avoue que je ne porte point à la liberté de la presse cet amour complet et instantané qu’on accorde [II-15] aux choses souverainement bonnes de leur nature. Je l’aime par la considération des maux qu’elle empêche bien plus que pour les biens qu’elle fait.
Si quelqu’un me montrait, entre l’indépendance complète et l’asservissement entier de la pensée, une position intermédiaire où je pusse espérer me tenir, je m’y établirais peut-être ; mais qui découvrira cette position intermédiaire ? Vous partez de la licence de la presse et vous marchez vers l’ordre : que faites-vous ? vous soumettez d’abord les écrivains aux jurés ; mais les jurés acquittent, et ce qui n’était que l’opinion d’un homme isolé devient l’opinion du pays. Vous avez donc fait trop et trop peu ; il faut encore marcher. Vous livrez les auteurs à des magistrats permanents ; mais les juges sont obligés d’entendre avant que de condamner ; ce qu’on eût craint d’avouer dans le livre, on le proclame impunément dans le plaidoyer ; ce qu’on eût dit obscurément dans un écrit se trouve ainsi répété dans mille autres. L’expression est la forme extérieure et, si je puis m’exprimer ainsi, le corps de la pensée, mais elle n’est pas la pensée elle-même. Vos tribunaux arrêtent le corps, mais l’âme leur échappe et glisse subtilement entre leurs mains. Vous avez donc fait trop et trop peu ; il faut continuer à marcher. Vous abandonnez enfin les écrivains à des censeurs ; fort bien ! nous approchons. Mais la tribune politique n’est-elle pas libre ? Vous n’avez donc encore rien fait ; je me trompe, vous avez accru le mal. Prendriez-vous, par hasard, la pensée pour une de ces puissances matérielles qui s’accroissent par le nombre de leurs agents ? compterez-vous les écrivains comme les soldats d’une [II-16] armée ? Au rebours de toutes les puissances matérielles, le pouvoir de la pensée s’augmente souvent par le petit nombre même de ceux qui l’expriment. La parole d’un homme puissant, qui pénètre seule au milieu des passions d’une assemblée muette, a plus de pouvoir que les cris confus de mille orateurs ; et pour peu qu’on puisse parler librement dans un seul lieu public, c’est comme si on parlait publiquement dans chaque village. Il vous faut donc détruire la liberté de parler comme celle d’écrire ; cette fois, vous voici dans le port : chacun se tait. Mais où êtes-vous arrivé ? Vous étiez parti des abus de la liberté, et je vous retrouve sous les pieds d’un despote.
Vous avez été de l’extrême indépendance à l’extrême servitude, sans rencontrer, sur un si long espace, un seul lieu où vous puissiez vous poser.
Il y a des peuples qui, indépendamment des raisons générales que je viens d’énoncer, en ont de particulières qui doivent les attacher à la liberté de la presse.
Chez certaines nations qui se prétendent libres, chacun des agents du pouvoir peut impunément violer la loi sans que la Constitution du pays donne aux opprimés le droit de se plaindre devant la justice. Chez ces peuples il ne faut plus considérer l’indépendance de la presse comme l’une des garanties, mais comme la seule garantie qui reste de la liberté et de la sécurité des citoyens.
Si donc les hommes qui gouvernent ces nations parlaient d’enlever son indépendance à la presse, le peuple entier pourrait leur répondre : Laissez-nous poursuivre vos crimes devant les juges ordinaires, et [II-17] peut-être que nous consentirons alors à ne point en appeler au tribunal de l’opinion.
Dans un pays où règne ostensiblement le dogme de la souveraineté du peuple, la censure n’est pas seulement un danger, mais encore une grande absurdité.
Lorsqu’on accorde à chacun un droit à gouverner la société, il faut bien lui reconnaître la capacité de choisir entre les différentes opinions qui agitent ses contemporains, et d’apprécier les différents faits dont la connaissance peut le guider.
La souveraineté du peuple et la liberté de la presse sont donc deux choses entièrement corrélatives : la censure et le vote universel sont au contraire deux choses qui se contredisent et ne peuvent se rencontrer longtemps dans les institutions politiques d’un même peuple. Parmi les douze millions d’hommes qui vivent sur le territoire des États-Unis, il n’en est pas un seul qui ait encore osé proposer de restreindre la liberté de la presse.
Le premier journal qui tomba sous mes yeux, en arrivant en Amérique, contenait l’article suivant, que je traduis fidèlement :.
« Dans toute cette affaire, le langage tenu par Jackson (le Président) a été celui d’un despote sans cœur, occupé uniquement à conserver son pouvoir. L’ambition est son crime, et il y trouvera sa peine. Il a pour vocation l’intrigue, et l’intrigue confondra ses desseins et lui arrachera sa puissance. Il gouverne par la corruption, et ses manœuvres coupables tourneront à sa confusion et à sa honte. Il s’est [II-18] montré dans l’arène politique comme un joueur sans pudeur et sans frein. Il a réussi ; mais l’heure de la justice approche ; bientôt il lui faudra rendre ce qu’il a gagné, jeter loin de lui son détrompeur, et finir dans quelque retraite où il puisse blasphémer en liberté contre sa folie ; car le repentir n’est point une vertu qu’il ait été donné à son cœur de jamais connaître. »
(Vincenne's Gazette.)
Bien des gens en France s’imaginent que la violence de la presse tient parmi nous à l’instabilité de l’état social, à nos passions politiques, et au malaise général qui en est la suite. Ils attendent donc sans cesse une époque où la société reprenant une assiette tranquille, la presse à son tour deviendra calme. Pour moi, j’attribuerais volontiers aux causes indiquées plus haut l’extrême ascendant qu’elle a sur nous ; mais je ne pense point que ces causes influent beaucoup sur son langage. La presse périodique me paraît avoir des instincts et des passions à elle, indépendamment des circonstances au milieu desquelles elle agit. Ce qui se passe en Amérique achève de me le prouver.
L’Amérique est peut-être, en ce moment, le pays du monde qui renferme dans son sein le moins de germes de révolution. En Amérique, cependant, la presse a les mêmes goûts destructeurs qu’en France, et la même violence sans les mêmes causes de colère. En Amérique, comme en France, elle est cette puissance extraordinaire, si étrangement mélangée de biens et de maux, que sans elle la liberté ne saurait [II-19] vivre, et qu’avec elle l’ordre peut à peine se maintenir.
Ce qu’il faut dire, c’est que la presse a beaucoup moins de pouvoir aux États-Unis que parmi nous. Rien pourtant n’est plus rare dans ce pays que de voir une poursuite judiciaire dirigée contre elle. La raison en est simple : les Américains, en admettant parmi eux le dogme de la souveraineté du peuple, en ont fait l’application sincère. Ils n’ont point eu l’idée de fonder, avec des éléments qui changent tous les jours, des constitutions dont la durée fût éternelle. Attaquer les lois existantes n’est donc pas criminel, pourvu qu’on ne veuille point s’y soustraire par la violence.
Ils croient d’ailleurs que les tribunaux sont impuissants pour modérer la presse, et que la souplesse des langages humains échappant sans cesse à l’analyse judiciaire, les délits de cette nature se dérobent en quelque sorte devant la main qui s’étend pour les saisir. Ils pensent qu’afin de pouvoir agir efficacement sur la presse, il faudrait trouver un tribunal qui, non seulement fût dévoué à l’ordre existant, mais encore pût se placer au-dessus de l’opinion publique qui s’agite autour de lui ; un tribunal qui jugeât sans admettre la publicité, prononçât sans motiver ses arrêts, et punît l’intention plus encore que les paroles. Quiconque aurait le pouvoir de créer et de maintenir un semblable tribunal, perdrait son temps à poursuivre la liberté de la presse ; car alors il serait maître absolu de la société elle-même, et pourrait se débarrasser des écrivains en même temps que de leurs écrits. En matière de presse, il n’y a donc réellement [II-20] pas de milieu entre la servitude et la licence. Pour recueillir les biens inestimables qu’assure la liberté de la presse, il faut savoir se soumettre aux maux inévitables qu’elle fait naître. Vouloir obtenir les uns en échappant aux autres, c’est se livrer à l’une de ces illusions dont se bercent d’ordinaire les nations malades, alors que, fatiguées de luttes et épuisées d’efforts, elles cherchent les moyens de faire coexister à la fois, sur le même sol, des opinions ennemies et des principes contraires.
Le peu de puissance des journaux en Amérique tient à plusieurs causes, dont voici les principales :.
La liberté d’écrire, comme toutes les autres, est d’autant plus redoutable qu’elle est plus nouvelle ; un peuple qui n’a jamais entendu traiter devant lui les affaires de l’État croit le premier tribun qui se présente. Parmi les Anglo-Américains, cette liberté est aussi ancienne que la fondation des colonies ; la presse d’ailleurs, qui sait si bien enflammer les passions humaines, ne peut cependant les créer à elle toute seule. Or, en Amérique, la vie politique est active, variée, agitée même, mais elle est rarement troublée par des passions profondes ; il est rare que celles-ci se soulèvent quand les intérêts matériels ne sont pas compromis, et aux États-Unis ces intérêts prospèrent. Pour juger de la différence qui existe sur ce point entre les Anglo-Américains et nous, je n’ai qu’à jeter les yeux sur les journaux des deux peuples. En France, les annonces commerciales ne tiennent qu’un espace fort restreint, les nouvelles mêmes sont peu nombreuses ; la partie vitale d’un journal, c’est celle où se trouvent les discussions politiques. En [II-21] Amérique, les trois quarts de l’immense journal qui est placé sous vos yeux sont remplis par des annonces, le reste est occupé le plus souvent par des nouvelles politiques ou de simples anecdotes ; de loin en loin seulement, on aperçoit dans un coin ignoré l’une de ces discussions brûlantes qui sont parmi nous la pâture journalière des lecteurs.
Toute puissance augmente l’action de ses forces à mesure qu’elle en centralise la direction ; c’est là une loi générale de la nature que l’examen démontre à l’observateur, et qu’un instinct plus sûr encore a toujours fait connaître aux moindres despotes.
En France, la presse réunit deux espèces de centralisations distinctes.
Presque tout son pouvoir est concentré dans un même lieu, et pour ainsi dire dans les mêmes mains, car ses organes sont en très petit nombre.
Ainsi constitué au milieu d’une nation sceptique, le pouvoir de la presse doit être presque sans bornes. C’est un ennemi avec qui un gouvernement peut faire des trêves plus ou moins longues, mais en face duquel il lui est difficile de vivre long-temps.
Ni l’une ni l’autre des deux espèces de centralisations dont je viens de parler n’existent en Amérique.
Les États-Unis n’ont point de capitale : les lumières comme la puissance sont disséminées dans toutes les parties de cette vaste contrée ; les rayons de l’intelligence humaine, au lieu de partir d’un centre commun, s’y croisent donc en tous sens ; les Américains n’ont placé nulle part la direction générale de la pensée, non plus que celle des affaires.
Ceci tient à des circonstances locales qui ne [II-22] dépendent point des hommes ; mais voici qui vient des lois :.
Aux États-Unis, il n’y a pas de patentes pour les imprimeurs, de timbre ni d’enregistrement pour les journaux ; enfin la règle des cautionnements est inconnue.
Il résulte de là que la création d’un journal est une entreprise simple et facile ; peu d’abonnés suffisent pour que le journaliste puisse couvrir ses frais : aussi le nombre des écrits périodiques ou semi-périodiques, aux États-Unis, dépasse-t-il toute croyance. Les Américains les plus éclairés attribuent à cette incroyable dissémination des forces de la presse son peu de puissance : c’est un axiome de la science politique aux États-Unis, que le seul moyen de neutraliser les effets des journaux est d’en multiplier le nombre. Je ne saurais me figurer qu’une vérité aussi évidente ne soit pas encore devenue chez nous plus vulgaire. Que ceux qui veulent faire des révolutions à l’aide de la presse cherchent à ne lui donner que quelques puissants organes, je le comprends sans peine ; mais que les partisans officiels de l’ordre établi et les soutiens naturels des lois existantes croient atténuer l’action de la presse en la concentrant, voilà ce que je ne saurais absolument concevoir. Les gouvernements d’Europe me semblent agir vis-à-vis de la presse de la même façon qu’agissaient jadis les chevaliers envers leurs adversaires : ils ont remarqué par leur propre usage que la centralisation était une arme puissante, et ils veulent en pourvoir leur ennemi, afin sans doute d’avoir plus de gloire à lui résister.
Aux États-Unis, il n’y a presque pas de bourgade qui n’ait son journal. On conçoit sans peine que, [II-23] parmi tant de combattants, on ne peut établir ni discipline, ni unité d’action : aussi voit-on chacun lever sa bannière. Ce n’est pas que tous les journaux politiques de l’Union se soient rangés pour ou contre l’administration ; mais ils l’attaquent et la défendent par cent moyens divers. Les journaux ne peuvent donc pas établir aux États-Unis de ces grands courants d’opinions qui soulèvent ou débordent les plus puissantes digues. Cette division des forces de la presse produit encore d’autres effets non moins remarquables : la création d’un journal étant chose facile, tout le monde peut s’en occuper ; d’un autre côté, la concurrence fait qu’un journal ne peut espérer de très grands profits ; ce qui empêche les hautes capacités industrielles de se mêler de ces sortes d’entreprises. Les journaux fussent-ils d’ailleurs la source des richesses, comme ils sont excessivement nombreux, les écrivains de talent ne pourraient suffire à les diriger. Les journalistes, aux États-Unis, ont donc en général une position peu élevée, leur éducation n’est qu’ébauchée, et la tournure de leurs idées est souvent vulgaire. Or, en toutes choses la majorité fait loi ; elle établit de certaines allures auxquelles chacun ensuite se conforme ; l’ensemble de ces habitudes communes s’appelle un esprit : il y a l’esprit du barreau, l’esprit de cour. L’esprit du journaliste, en France, est de discuter d’une manière violente, mais élevée, et souvent éloquente, les grands intérêts de l’État ; s’il n’en est pas toujours ainsi, c’est que toute règle a ses exceptions. L’esprit du journaliste, en Amérique, est de s’attaquer grossièrement, sans apprêt et sans art, aux passions de ceux auxquels [II-24] il s’adresse, de laisser là les principes pour saisir les hommes ; de suivre ceux-ci dans leur vie privée, et de mettre à nu leurs faiblesses et leurs vices.
Il faut déplorer un pareil abus de la pensée ; plus tard, j’aurai occasion de rechercher quelle influence exercent les journaux sur le goût et la moralité du peuple américain ; mais, je le répète, je ne m’occupe en ce moment que du monde politique. On ne peut se dissimuler que les effets politiques de cette licence de la presse ne contribuent indirectement au maintien de la tranquillité publique. Il en résulte que les hommes qui ont déjà une position élevée dans l’opinion de leurs concitoyens n’osent point écrire dans les journaux, et perdent ainsi l’arme la plus redoutable dont ils puissent se servir pour remuer à leur profit les passions populaires [1] . Il en résulte surtout que les vues personnelles exprimées par les journalistes ne sont pour ainsi dire d’aucun poids aux yeux des lecteurs. Ce qu’ils cherchent dans un journal, c’est la connaissance des faits ; ce n’est qu’en altérant ou en dénaturant ces faits que le journaliste peut acquérir à son opinion quelque influence.
Réduite à ces seules ressources, la presse exerce encore un immense pouvoir en Amérique. Elle fait circuler la vie politique dans toutes les portions de ce vaste territoire. C’est elle dont l’œil toujours ouvert met sans cesse à nu les secrets ressorts de la politique, et force les hommes publics à venir tour à [II-25] tour comparaître devant le tribunal de l’opinion. C’est elle qui rallie les intérêts autour de certaines doctrines et formule le symbole des partis ; C’est par elle que ceux-ci se parlent sans se voir, s’entendent sans être mis en contact. Lorsqu’un grand nombre des organes de la presse parvient à marcher dans la même voie, leur influence à la longue devient presque irrésistible, et l’opinion publique, frappée toujours du même côté, finit par céder sous leurs coups.
Aux États-Unis, chaque journal a individuellement peu de pouvoir ; mais la presse périodique est encore, après le peuple, la première des puissances (A).
Que les opinions qui s’établissent sous l’empire de la liberté de la presse aux États-Unis sont souvent plus tenaces que celles qui se forment ailleurs sous l’empire de la censure.
Aux États-Unis, la démocratie amène sans cesse des hommes nouveaux à la direction des affaires ; le gouvernement met donc peu de suite et d’ordre dans ses mesures. Mais les principes généraux du gouvernement y sont plus stables que dans beaucoup d’autres pays, et les opinions principales qui règlent la société s’y montrent plus durables. Quand une idée a pris possession de l’esprit du peuple américain, qu’elle soit juste ou déraisonnable, rien n’est plus difficile que de l’en extirper.
Le même fait a été observé en Angleterre, le pays de l’Europe où l’on a vu pendant un siècle la liberté la plus grande de penser et les préjugés les plus invincibles. [II-26] .
J’attribue cet effet à la cause même qui, au premier abord, semblerait devoir l’empêcher de se produire, à la liberté de la presse. Les peuples chez lesquels existe cette liberté s’attachent à leurs opinions par orgueil autant que par conviction. Ils les aiment, parce qu’elles leur semblent justes, et aussi parce qu’elles sont de leur choix, et ils y tiennent, non seulement comme à une chose vraie, mais encore comme à une chose qui leur est propre.
Il y a plusieurs autres raisons encore.
Un grand homme a dit que l’ignorance était aux deux bouts de la science. Peut-être eût-il été plus vrai de dire que les convictions profondes ne se trouvent qu’aux deux bouts, et qu’au milieu est le doute. On peut considérer, en effet, l’intelligence humaine dans trois états distincts et souvent successifs.
L’homme croit fermement, parce qu’il adopte sans approfondir. Il doute quand les objections se présentent. Souvent il parvient à résoudre tous ses doutes, et alors il recommence à croire. Cette fois, il ne saisit plus la vérité au hasard et dans les ténèbres ; mais il la voit face à face et marche directement à sa lumière [2] .
Lorsque la liberté de la presse trouve les hommes dans le premier état, elle leur laisse pendant longtemps encore cette habitude de croire fermement sans réfléchir ; seulement elle change chaque jour l’objet de leurs croyances irréfléchies. Sur tout l’horizon intellectuel, l’esprit de l’homme continue donc [II-27] à ne voir qu’un point à la fois ; mais ce point varie sans cesse. C’est le temps des révolutions subites. Malheur aux générations qui, les premières, admettent tout-à-coup la liberté de la presse !.
Bientôt cependant le cercle des idées nouvelles est à peu près parcouru. L’expérience arrive, et l’homme se plonge dans un doute et dans une méfiance universelle.
On peut compter que la majorité des hommes s’arrêtera toujours dans l’un de ces deux états : elle croira sans savoir pourquoi, ou ne saura pas précisément ce qu’il faut croire.
Quant à cette autre espèce de conviction réfléchie et maîtresse d’elle-même qui naît de la science et s’élève du milieu même des agitations du doute, il ne sera jamais donné qu’aux efforts d’un très petit nombre d’hommes de l’atteindre.
Or, on a remarqué que, dans les siècles de ferveur religieuse, les hommes changeaient quelquefois de croyance ; tandis que dans les siècles de doute, chacun gardait obstinément la sienne. Il en arrive ainsi dans la politique, sous le règne de la liberté de la presse. Toutes les théories sociales ayant été contestées et combattues tour à tour, ceux qui se sont fixés à l’une d’elles la gardent, non pas tant parce qu’ils sont sûrs qu’elle est bonne, que parce qu’ils ne sont pas sûrs qu’il y en ait une meilleure.
Dans ces siècles, on ne se fait pas tuer si aisément pour ses opinions ; mais on ne les change point, et il s’y rencontre, tout à la fois, moins de martyrs et d’apostats.
Ajoutez à cette raison cette autre plus puissante [II-28] encore : dans le doute des opinions, les hommes finissent par s’attacher uniquement aux instincts et aux intérêts matériels, qui sont bien plus visibles, plus saisissables et plus permanents de leur nature que les opinions.
C’est une question très difficile à décider que celle de savoir qui gouverne le mieux, de la démocratie, ou de l’aristocratie. Mais il est clair que la démocratie gêne l’un, et que l’aristocratie opprime l’autre.
C’est là une vérité qui s’établit d’elle-même et qu’on n’a pas besoin de discuter : vous êtes riche et je suis pauvre. [II-29] .
[II-29]
CHAPITRE IV.↩
DE L’ASSOCIATION POLITIQUE AUX ÉTATS-UNIS.
Usage journalier que les Anglo-Américains font du droit d’association. — Trois genres d’associations politiques. — Comment les Américains appliquent le système représentatif aux associations. — Dangers qui en résultent pour l’État. — Grande convention de 1831 relative au tarif. — Caractère législatif de cette convention. — Pourquoi l’exercice illimité du droit d’association n’est pas aussi dangereux aux États-Unis qu’ailleurs. — Pourquoi on peut l’y considérer comme nécessaire. — Utilité des associations chez les peuples démocratiques.
L’Amérique est le pays du monde où l’on a tiré le plus de parti de l’association, et où l’on a appliqué ce puissant moyen d’action à une plus grande diversité d’objets.
Indépendamment, des associations permanentes créées par la loi sous le nom de communes, de villes et de comtés, il y en a une multitude d’autres qui ne doivent leur naissance et leur développement qu’à des volontés individuelles.
L’habitant des États-Unis apprend dès sa naissance qu’il faut s’appuyer sur soi-même pour lutter contre les maux et les embarras de la vie ; il ne jette sur l’autorité sociale qu’un regard défiant et inquiet, et n’en appelle à son pouvoir que quand il ne peut s’en passer. [II-30] Ceci commence à s’apercevoir dès l’école, où les enfants se soumettent, jusque dans leurs jeux, à des règles qu’ils ont établies, et punissent entre eux des délits par eux-mêmes définis. Le même esprit se retrouve dans tous les actes de la vie sociale. Un embarras survient sur la voie publique, le passage est interrompu, la circulation arrêtée ; les voisins s’établissent aussitôt en corps délibérant ; de cette assemblée improvisée sortira un pouvoir exécutif qui remédiera au mal, avant que l’idée d’une autorité préexistante à celle des intéressés se soit présentée à l’imagination de personne. S’agit-il de plaisir, on s’associera pour donner plus de splendeur et de régularité à la fête. On s’unit enfin pour résister à des ennemis tout intellectuels, on combat en commun l’intempérance. Aux États-Unis, on s’associe dans des buts de sécurité publique, de commerce et d’industrie, de morale et de religion. Il n’y a rien que la volonté humaine désespère d’atteindre par l’action libre de la puissance collective des individus.
J’aurai occasion, plus tard, de parler des effets que produit l’association dans la vie civile. Je dois me renfermer en ce moment dans le monde politique.
Le droit d’association étant reconnu, les citoyens peuvent en user de différentes manières.
Une association consiste seulement dans l’adhésion publique que donnent un certain nombre d’individus à telles ou telles doctrines, et dans l’engagement qu’ils contractent de concourir d’une certaine façon à les faire prévaloir. Le droit de s’associer ainsi se confond presque avec la liberté d’écrire ; déjà cependant l’association possède plus de puissance que la [II-31] presse. Quand une opinion est représentée par une association, elle est obligée de prendre une forme plus nette et plus précise. Elle compte ses partisans et les compromet dans sa cause. Ceux-ci apprennent eux-mêmes à se connaître les uns les autres, et leur ardeur s’accroît de leur nombre. L’association réunit en faisceau les efforts des esprits divergents, et les pousse avec vigueur vers un seul but clairement indiqué par elle.
Le second degré dans l’exercice du droit d’association est de pouvoir s’assembler. Quand on laisse une association politique placer sur certains points importants du pays des foyers d’action, son activité en devient plus grande et son influence plus étendue. Là, les hommes se voient ; les moyens d’exécution se combinent, les opinions se déploient avec cette force et cette chaleur que ne peut jamais atteindre la pensée écrite.
Il est enfin dans l’exercice du droit d’association, en matière politique, un dernier degré : les partisans d’une même opinion peuvent se réunir en colléges électoraux, et nommer des mandataires pour les aller représenter dans une assemblée centrale. C’est à proprement parler le système représentatif appliqué à un parti.
Ainsi, dans le premier cas, les hommes qui professent une même opinion établissent entre eux un lien purement intellectuel ; dans le second, ils se réunissent en petites assemblées qui ne représentent qu’une fraction du parti ; dans le troisième enfin, ils forment comme une nation à part dans la nation, un gouvernement dans le gouvernement. Leurs [II-32] mandataires, semblables aux mandataires de la majorité, représentent à eux seuls toute la force collective de leurs partisans ; ainsi que ces derniers, ils arrivent avec une apparence de nationalité et toute la puissance morale qui en résulte. Il est vrai qu’ils n’ont pas comme eux le droit de faire la loi ; mais ils ont le pouvoir d’attaquer celle qui existe et de formuler d’avance celle qui doit exister.
Je suppose un peuple qui ne soit pas parfaitement habitué à l’usage de la liberté, ou chez lequel fermentent des passions politiques profondes. À côté de la majorité qui fait les lois, je place une minorité qui se charge seulement des considérants et s’arrête au dispositif ; et je ne puis m’empêcher de croire que l’ordre public est exposé à de grands hasards.
Entre prouver qu’une loi est meilleure en soi qu’une autre, et prouver qu’on doit la substituer à cette autre, il y a loin sans doute. Mais où l’esprit des hommes éclairés voit encore une grande distance, l’imagination de la foule n’en aperçoit déjà plus. Il arrive d’ailleurs des temps où la nation se partage presque également entre deux partis, dont chacun prétend représenter la majorité. Près du pouvoir qui dirige, s’il vient à s’établir un pouvoir dont l’autorité morale soit presque aussi grande, peut-on croire qu’il se borne longtemps à parler sans agir ?.
S’arrêtera-t-il toujours devant cette considération métaphysique, que le but des associations est de diriger les opinions et non de les contraindre, de conseiller la loi, non de la faire ?.
Plus j’envisage l’indépendance de la presse dans ses principaux effets, plus je viens à me convaincre [II-33] que chez les modernes l’indépendance de la presse est l’élément capital, et pour ainsi dire constitutif de la liberté. Un peuple qui veut rester libre a donc le droit d’exiger qu’à tout prix on la respecte. Mais la liberté illimitée d’association en matière politique ne saurait être entièrement confondue avec la liberté d’écrire. L’une est tout à la fois moins nécessaire et plus dangereuse que l’autre. Une nation peut y mettre des bornes sans cesser d’être maîtresse d’elle-même ; elle doit quelquefois le faire pour continuer à l’être.
En Amérique, la liberté de s’associer dans des buts politiques est illimitée.
Un exemple fera mieux connaître que tout ce que je pourrais ajouter, jusqu’à quel degré on la tolère.
On se rappelle combien la question du tarif ou de la liberté du commerce a agité les esprits en Amérique. Le tarif favorisait ou attaquait non seulement des opinions, mais des intérêts matériels très puissants. Le Nord lui attribuait une partie de sa prospérité, le Sud presque toutes ses misères. On peut dire que pendant long-temps le tarif a fait naître les seules passions politiques qui aient agité l’Union.
En 1831, lorsque la querelle était le plus envenimée, un citoyen obscur du Massachusetts imagina de proposer, par la voie des journaux, à tous les ennemis du tarif d’envoyer des députés à Philadelphie, afin d’aviser ensemble aux moyens de faire rendre au commerce sa liberté. Cette proposition circula en peu de jours par la puissance de l’imprimerie, depuis le Maine jusqu’à la Nouvelle-Orléans. Les ennemis du tarif l’adoptèrent avec ardeur. Ils se réunirent de toutes parts et nommèrent des députés. Le plus grand [II-34] nombre de ceux-ci étaient des hommes connus, et quelques-uns d’entre eux s’étaient rendus célèbres. La Caroline du Sud, qu’on a vue depuis prendre les armes dans la même cause, envoya pour sa part soixante-trois délégués. Le 1er octobre 1831, l’assemblée, qui, suivant l’habitude américaine, avait pris le nom de convention, se constitua à Philadelphie ; elle comptait plus de deux cents membres. Ses discussions étaient publiques et prirent, dès le premier jour, un caractère tout législatif ; on discuta l’étendue des pouvoirs du congrès, les théories de la liberté du commerce, et enfin les diverses dispositions du tarif. Au bout de dix jours, l’assemblée se sépara après avoir rédigé une adresse au peuple américain. Dans cette adresse on exposait : 1º que le congrès n’avait pas le droit de faire un tarif, et que le tarif existant était inconstitutionnel ; 2º qu’il n’était dans l’intérêt d’aucun peuple, et en particulier du peuple américain, que le commerce ne fût pas libre.
Il faut reconnaître que la liberté illimitée de s’associer en matière politique n’a pas produit jusqu’à présent, aux États-Unis, les résultats funestes qu’on pourrait peut-être en attendre ailleurs. Le droit d’association y est une importation anglaise, et il a existé de tout temps en Amérique. L’usage de ce droit est aujourd’hui passé dans les habitudes et dans les mœurs.
De notre temps, la liberté d’association est devenue une garantie nécessaire contre la tyrannie de la majorité. Aux États-Unis, quand une fois un parti est devenu dominant, toute la puissance publique passe dans ses mains ; ses amis particuliers occupent tous les emplois et disposent de toutes les forces organisées. [II-35] Les hommes les plus distingués du parti contraire ne pouvant franchir la barrière qui les sépare du pouvoir, il faut bien qu’ils puissent s’établir en dehors ; il faut que la minorité oppose sa force morale tout entière à la puissance matérielle qui l’opprime. C’est donc un danger qu’on oppose à un danger plus à craindre.
L’omnipotence de la majorité me paraît un si grand péril pour les républiques américaines, que le moyen dangereux dont on se sert pour la borner me semble encore un bien.
Ici j’exprimerai une pensée qui rappellera ce que j’ai dit autre part à l’occasion des libertés communales : il n’y a pas de pays où les associations soient plus nécessaires, pour empêcher le despotisme des partis ou l’arbitraire du prince, que ceux où l’état social est démocratique. Chez les nations aristocratiques, les corps secondaires forment des associations naturelles qui arrêtent les abus de pouvoir. Dans les pays où de pareilles associations n’existent point, si les particuliers ne peuvent créer artificiellement et momentanément quelque chose qui leur ressemble, je n’aperçois plus de digue à aucune sorte de tyrannie, et un grand peuple peut être opprimé impunément par une poignée de factieux ou par un homme.
La réunion d’une grande convention politique (car il y en a de tous genres), qui peut souvent devenir une mesure nécessaire, est toujours, même en Amérique, un événement grave et que les amis de leur pays n’envisagent qu’avec crainte.
Ceci se vit bien clairement dans la convention de 1831, où tous les efforts des hommes distingués qui [II-36] faisaient partie de l’assemblée tendirent à en modérer le langage et à en restreindre l’objet. Il est probable que la convention de 1831 exerça en effet une grande influence sur l’esprit des mécontents et les prépara à la révolte ouverte qui eut lieu en 1832 contre les lois commerciales de l’Union.
On peut se dissimuler que la liberté illimitée d’association, en matière politique, ne soit, de toutes les libertés, la dernière qu’un peuple puisse supporter. Si elle ne le fait pas tomber dans l’anarchie, elle la lui fait pour ainsi dire toucher à chaque instant. Cette liberté, si dangereuse, offre cependant sur un point des garanties ; dans les pays où les associations sont libres, les sociétés secrètes sont inconnues. En Amérique, il y a des factieux, mais point de conspirateurs.
Des différentes manières dont on entend le droit d’association en Europe et aux États-Unis, et de l’usage différent qu’on en fait.
Après la liberté d’agir seul, la plus naturelle à l’homme est celle de combiner ses efforts avec les efforts de ses semblables et d’agir en commun. Le droit d’association me paraît donc presque aussi inaliénable de sa nature que la liberté individuelle. Le législateur ne saurait vouloir le détruire sans attaquer la société elle-même. Cependant s’il est des peuples chez lesquels la liberté de s’unir n’est que bienfaisante et féconde en prospérité, il en est d’autres aussi qui, par leurs excès, la dénaturent, et d’un élément de vie font une cause de destruction. Il m’a semblé que la comparaison des voies diverses que suivent [II-37] les associations, dans les pays où la liberté est comprise, et dans ceux où cette liberté se change en licence, serait tout à la fois utile aux gouvernements et aux partis.
La plupart des Européens voient encore dans l’association une arme de guerre qu’on forme à la hâte pour aller l’essayer aussitôt sur un champ de bataille.
On s’associe bien dans le but de parler, mais la pensée prochaine d’agir préoccupe tous les esprits. Une association, c’est une armée ; on y parle pour se compter et s’animer, et puis on marche à l’ennemi. Aux yeux de ceux qui la composent, les ressources légales peuvent paraître des moyens, mais elles ne sont jamais l’unique moyen de réussir.
Telle n’est point la manière dont on entend le droit d’association aux États-Unis. En Amérique, les citoyens qui forment la minorité s’associent, d’abord pour constater leur nombre et affaiblir ainsi l’empire moral de la majorité ; le second objet des associés est de mettre au concours et de découvrir de cette manière les arguments les plus propres à faire impression sur la majorité ; car ils ont toujours l’espérance d’attirer à eux cette dernière, et de disposer ensuite, en son nom, du pouvoir.
Les associations politiques aux États-Unis sont donc paisibles dans leur objet et légales dans leurs moyens ; et lorsqu’elles prétendent ne vouloir triompher que par les lois, elles disent en général la vérité.
La différence qui se remarque sur ce point entre les Américains et nous tient à plusieurs causes.
Il existe en Europe des partis qui diffèrent tellement de la majorité, qu’ils ne peuvent espérer de [II-38] s’en faire jamais un appui, et ces mêmes partis se croient assez forts par eux-mêmes pour lutter contre elle. Quand un parti de cette espèce forme une association, il ne veut point convaincre, mais combattre. En Amérique, les hommes qui sont placés très loin de la majorité par leur opinion ne peuvent rien contre son pouvoir : tous les autres espèrent la gagner.
L’exercice du droit d’association devient donc dangereux en proportion de l’impossibilité où sont les grands partis de devenir la majorité. Dans un pays comme les États-Unis, où les opinions ne diffèrent que par des nuances, le droit d’association peut rester pour ainsi dire sans limites.
Ce qui nous porte encore à ne voir dans la liberté d’association que le droit de faire la guerre aux gouvernants, C’est notre inexpérience en fait de liberté. La première idée qui se présente à l’esprit d’un parti comme à celui d’un homme, quand les forces lui viennent, c’est l’idée de la violence : l’idée de la persuasion n’arrive que plus tard ; elle naît de l’expérience.
Les Anglais, qui sont divisés entre eux d’une manière si profonde, font rarement abus du droit d’association, parce qu’ils en ont un plus long usage.
On a de plus, parmi nous, un goût tellement passionné pour la guerre, qu’il n’est pas d’entreprise si insensée, dût-elle bouleverser l’État, dans laquelle on ne s’estimât glorieux de mourir les armes à la main.
Mais de toutes les causes qui concourent aux États-Unis à modérer les violences de l’association [II-39] politique, la plus puissante peut-être est le vote universel. Dans les pays où le vote universel est admis, la majorité n’est jamais douteuse, parce que nul parti ne saurait raisonnablement s’établir comme le représentant de ceux qui n’ont point voté. Les associations savent donc, et tout le monde sait qu’elles ne représentent point la majorité. Ceci résulte du fait même de leur existence ; car, si elles la représentaient, elles changeraient elles-mêmes la loi au lieu d’en demander la réforme.
La force morale du gouvernement qu’elles attaquent s’en trouve très augmentée ; la leur, fort affaiblie.
En Europe, il n’y a presque point d’associations qui ne prétendent ou ne croient représenter les volontés de la majorité. Cette prétention ou cette croyance augmente prodigieusement leur force, et sert merveilleusement à légitimer leurs actes. Car quoi de plus excusable que la violence pour faire triompher la cause opprimée du droit ?.
C’est ainsi que dans l’immense complication des lois humaines il arrive quelquefois que l’extrême liberté corrige les abus de la liberté, et que l’extrême démocratie prévient les dangers de la démocratie.
En Europe, les associations se considèrent en quelque sorte comme le conseil législatif et exécutif de la nation, qui elle-même ne peut élever la voix ; partant de cette idée, elles agissent et commandent. En Amérique, où elles ne représentent aux yeux de tous qu’une minorité dans la nation, elles parlent et pétitionnent. [II-40] .
Les moyens dont se servent les associations en Europe sont d’accord avec le but qu’elles se proposent.
Le but principal de ces associations étant d’agir et non de parler, de combattre et non de convaincre, elles sont naturellement amenées à se donner une organisation qui n’a rien de civil, et à introduire dans leur sein les habitudes et les maximes militaires : aussi les voit-on centraliser, autant qu’elles le peuvent, la direction de leurs forces, et remettre le pouvoir de tous dans les mains d’un très petit nombre.
Les membres de ces associations répondent à un mot d’ordre comme des soldats en campagne ; ils professent le dogme de l’obéissance passive, ou plutôt, en s’unissant, ils ont fait d’un seul coup le sacrifice entier de leur jugement et de leur libre arbitre : aussi règne-t-il souvent dans le sein de ces associations une tyrannie plus insupportable que celle qui s’exerce dans la société au nom du gouvernement qu’on attaque.
Cela diminue beaucoup leur force morale. Elles perdent ainsi le caractère sacré qui s’attache à la lutte des opprimés contre les oppresseurs. Car celui qui consent à obéir servilement en certains cas à quelques uns de ses semblables, qui leur livre sa volonté et leur soumet jusqu’à sa pensée, comment celui-là peut-il prétendre qu’il veut être libre ?.
Les Américains ont aussi établi un gouvernement au sein des associations ; mais c’est, si je puis m’exprimer ainsi, un gouvernement civil. L’indépendance individuelle y trouve sa part : comme dans la société, tous les hommes y marchent en même temps vers le [II-41] même but ; mais chacun n’est pas tenu d’y marcher exactement par les mêmes voies. On n’y fait point le sacrifice de sa volonté et de sa raison ; mais on applique sa volonté et sa raison à faire réussir une entreprise commune. [II-42] .
[II-424]
CHAPITRE V.↩
DU GOUVERNEMENT DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.
Je sais que je marche ici sur un terrain brûlant. Chacun des mots de ce chapitre doit froisser en quelques points les différents partis qui divisent mon pays. Je n’en dirai pas moins toute ma pensée.
En Europe, nous avons peine à juger le véritable caractère et les instincts permanents de la démocratie, parce qu’en Europe il y a lutte entre deux principes contraires et qu’on ne sait pas précisément quelle part il faut attribuer aux principes eux-mêmes, ou aux passions que le combat a fait naître.
Il n’en est pas de même en Amérique. Là, le peuple domine sans obstacles ; il n’a pas de périls à craindre ni d’injures à venger.
En Amérique, la démocratie est donc livrée à ses propres pentes. Ses allures sont naturelles et tous ses mouvements sont libres. C’est là qu’il faut la juger. Et pour qui cette étude serait-elle intéressante et profitable, si ce n’était pour nous, qu’un mouvement irrésistible entraîne chaque jour, et qui marchons en aveugles, peut-être vers le despotisme, peut-être vers la république, mais a coup sûr vers un état social démocratique ? [II-43] .
DU VOTE UNIVERSEL.
J’ai dit précédemment que tous les États de l’Union avaient admis le vote universel. On le retrouve chez des populations placées à différents degrés de l’échelle sociale. J’ai eu occasion de voir ses effets dans des lieux divers et parmi des races d’hommes que leur langue, leur religion ou leurs mœurs rendent presque étrangères les unes aux autres : à la Louisiane comme dans la Nouvelle-Angleterre, à la Géorgie comme au Canada. J’ai remarqué que le vote universel était loin de produire, en Amérique, tous les biens et tous les maux qu’on en attend en Europe, et que ses effets étaient en général autres qu’on ne les suppose.
DES CHOIX DU PEUPLE, ET DES INSTINCTS DE LA DÉMOCRATIE AMÉRICAINE DANS SES CHOIX.
Aux États-Unis les hommes les plus remarquables sont rarement appelés à la direction des affaires publiques. — Causes de ce phénomène. — L’envie qui anime les classes inférieures de France contre les supérieures n’est pas un sentiment français, mais démocratique. — Pourquoi, en Amérique, les hommes distingués s’écartent souvent d’eux-mêmes de la carrière politique.
Bien des gens, en Europe, croient sans le dire, ou disent sans le croire, qu’un des grands avantages du vote universel est d’appeler à la direction des affaires des hommes dignes de la confiance publique. Le peuple ne saurait gouverner lui-même, dit-on, mais il veut toujours sincèrement le bien de l’État, et son instinct ne manque guère de lui désigner ceux qu’un [II-44] même désir anime et qui sont les plus capables de tenir en main le pouvoir.
Pour moi, je dois le dire, ce que j’ai vu en Amérique ne m’autorise point à penser qu’il en soit ainsi. À mon arrivée aux États-Unis, je fus frappé de surprise en découvrant à quel point le mérite était commun parmi les gouvernés, et combien il l’était peu chez les gouvernants. C’est un fait constant que, de nos jours, aux États-Unis, les hommes les plus remarquables sont rarement appelés aux fonctions publiques, et l’on est obligé de reconnaître qu’il en a été ainsi à mesure que la démocratie a dépassé toutes ses anciennes limites. Il est évident que la race des hommes d’État américains s’est singulièrement rapetissée depuis un demi-siècle.
On peut indiquer plusieurs causes de ce phénomène.
Il est impossible, quoi qu’on fasse, d’élever les lumières du peuple au-dessus d’un certain niveau. On aura beau faciliter les abords des connaissances humaines, améliorer les méthodes d’enseignement et mettre la science à bon marché, on ne fera jamais que les hommes s’instruisent et développent leur intelligence sans y consacrer du temps.
Le plus ou moins de facilité que rencontre le peuple à vivre sans travailler forme donc la limite nécessaire de ses progrès intellectuels. Cette limite est placée plus loin dans certains pays, moins loin dans certains autres ; mais pour qu’elle n’existât point, il faudrait que le peuple n’eût point à s’occuper des soins matériels de la vie, c’est-à-dire qu’il ne fût plus le peuple. Il est donc aussi difficile de concevoir une [II-45] société où tous les hommes soient très éclairés, qu’un État où tous les citoyens soient riches ; ce sont là deux difficultés corrélatives. J’admettrai sans peine que la masse des citoyens veut très sincèrement le bien du pays ; je vais même plus loin, et je dis que les classes inférieures de la société me semblent mêler, en général, à ce désir moins de combinaisons d’intérêt personnel que les classes élevées ; mais ce qui leur manque toujours, plus ou moins, c’est l’art de juger des moyens tout en voulant sincèrement la fin. Quelle longue étude, que de notions diverses sont nécessaires pour se faire une idée exacte du caractère d’un seul homme ! Les plus grands génies s’y égarent, et la multitude y réussirait ! Le peuple ne trouve jamais le temps et les moyens de se livrer à ce travail. Il lui faut toujours juger à la hâte et s’attacher au plus saillant des objets. De là vient que les charlatans de tous genres savent si bien le secret de lui plaire, tandis que, le plus souvent, ses véritables amis y échouent.
Du reste, ce n’est pas toujours la capacité qui manque à la démocratie pour choisir les hommes de mérite, mais le désir et le goût.
Il ne faut pas se dissimuler que les institutions démocratiques développent à un très haut degré le sentiment de l’envie dans le cœur humain. Ce n’est point tant parce qu’elles offrent à chacun des moyens de s’égaler aux autres, mais parce que ces moyens défaillent sans cesse à ceux qui les emploient. Les institutions démocratiques réveillent et flattent la passion de l’égalité sans pouvoir jamais la satisfaire entièrement. Cette égalité complète s’échappe tous les jours des mains du peuple au moment où il croit [II-46] la saisir, et fuit, comme dit Pascal, d’une fuite éternelle ; le peuple s’échauffe à la recherche de ce bien d’autant plus précieux qu’il est assez près pour être connu, assez loin pour n’être point goûté. La chance de réussir l’émeut, l’incertitude du succès l’irrite ; il s’agite, il se lasse, il s’aigrit. Tout ce qui le dépasse par quelque endroit lui paraît alors un obstacle à ses désirs, et il n’y a pas de supériorité si légitime dont la vue ne fatigue ses yeux.
Beaucoup de gens s’imaginent que cet instinct secret qui porte chez nous les classes inférieures à écarter autant qu’elles le peuvent les supérieures de la direction des affaires ne se découvre qu’en France ; c’est une erreur : l’instinct dont je parle n’est point français, il est démocratique ; les circonstances politiques ont pu lui donner un caractère particulier d’amertume, mais elles ne l’ont pas fait naître.
Aux États-Unis, le peuple n’a point de haine pour les classes élevées de la société ; mais il se sent peu de bienveillance pour elles et les tient avec soin en dehors du pouvoir ; il ne craint pas les grands talents, mais il les goûte peu. En général, on remarque que tout ce qui s’élève sans son appui obtient difficilement sa faveur.
Tandis que les instincts naturels de la démocratie portent le peuple à écarter les hommes distingués du pouvoir, un instinct non moins fort porte ceux-ci à s’éloigner de la carrière politique, où il leur est si difficile de rester complétement eux-mêmes et de marcher sans s’avilir. C’est cette pensée qui est fort naïvement exprimée par le chancelier Kent. L’auteur célèbre dont je parle, après avoir donné de grands [II-47] éloges à cette portion de la Constitution qui accorde au pouvoir exécutif la nomination des juges, ajoute : « Il est probable, en effet, que les hommes les plus propres à remplir ces places auraient trop de réserve dans les manières, et trop de sévérité dans les principes, pour pouvoir jamais réunir la majorité des suffrages à une élection qui reposerait sur le vote universel. » (Kent’s Commentaries, v. I, p. 272.) Voilà ce qu’on imprimait sans contradiction en Amérique dans l’année 1830.
Il m’est démontré que ceux qui regardent le vote universel comme une garantie de la bonté des choix, se font une illusion complète. Le vote universel a d’autres avantages, mais non celui-là.
DES CAUSES QUI PEUVENT CORRIGER EN PARTIE CES INSTINCTS DE LA DÉMOCRATIE.
Effets contraires produits sur les peuples comme sur les hommes par les grands périls. — Pourquoi l’Amérique a vu tant d’hommes remarquables à la tête de ses affaires il y a cinquante ans. — Influence qu’exercent les lumières et les mœurs sur les choix du peuple. — Exemple de la Nouvelle-Angleterre. — États du Sud-Ouest. — Comment certaines lois influent sur les choix du peuple. — Élection à deux degrés. — Ses effets dans la composition du sénat.
Lorsque de grands périls menacent l’État, on voit souvent le peuple choisir avec bonheur les citoyens les plus propres à le sauver.
On a remarqué que l’homme dans un danger pressant restait rarement à son niveau habituel ; il s’élève bien au-dessus, ou tombe au-dessous. Ainsi arrive-t-il aux peuples eux-mêmes. Les périls extrêmes, au lieu [II-48] d’élever une nation, achèvent quelquefois de l’abattre ; ils soulèvent ses passions sans les conduire et troublent son intelligence, loin de l’éclairer. Les juifs s’égorgeaient encore au milieu des débris fumants du temple. Mais il est plus commun de voir, chez les nations comme chez les hommes, les vertus extraordinaires naître de l’imminence même des dangers. Les grands caractères paraissent alors en relief comme ces monuments que cachait l’obscurité de la nuit, et qu’on voit se dessiner tout à coup à la lueur d’un incendie. Le génie ne dédaigne plus de se reproduire de lui-même, et le peuple, frappé de ses propres périls, oublie pour un temps ses passions envieuses. Il n’est pas rare de voir alors sortir de l’urne électorale des noms célèbres. J’ai dit plus haut qu’en Amérique les hommes d’État de nos jours semblent fort inférieurs à ceux qui parurent, il y a cinquante ans, à la tête des affaires. Ceci ne tient pas seulement aux lois, mais aux circonstances. Quand l’Amérique luttait pour la plus juste des causes, celle d’un peuple échappant au joug d’un autre peuple ; lorsqu’il s’agissait de faire entrer une nation nouvelle dans le monde, toutes les âmes s’élevaient pour atteindre à la hauteur du but de leurs efforts. Dans cette excitation générale, les hommes supérieurs couraient au-devant du peuple, et le peuple, les prenant dans ses bras, les plaçait à sa tête. Mais de pareils événements sont rares ; c’est sur l’allure ordinaire des choses qu’il faut juger.
Si des événements passagers parviennent quelquefois à combattre les passions de la démocratie, les lumières, et surtout les mœurs, exercent sur ses penchants une influence non moins puissante, mais [II-49] plus durable. On s’en aperçoit bien aux États-Unis.
Dans la Nouvelle-Angleterre, où l’éducation et la liberté sont filles de la morale et de la religion ; où la société, déjà ancienne et depuis longtemps assise, a pu se former des maximes et des habitudes, le peuple, en même temps qu’il échappe à toutes les supériorités que la richesse et la naissance ont jamais créées parmi les hommes, s’est habitué à respecter les supériorités intellectuelles et morales, et à s’y soumettre sans déplaisir : aussi voit-on que la démocratie dans la Nouvelle-Angleterre fait de meilleurs choix que partout ailleurs.
À mesure, au contraire, qu’on descend vers le midi, dans les États où le lien social est moins ancien et moins fort, où l’instruction s’est moins répandue, et où les principes de la morale, de la religion et de la liberté se sont combinés d’une manière moins heureuse, on aperçoit que les talents et les vertus deviennent de plus en plus rares parmi les gouvernants.
Lorsqu’on pénètre enfin dans les nouveaux États du sud-ouest, où le corps social, formé d’hier, ne présente encore qu’une agglomération d’aventuriers ou de spéculateurs, on est confondu de voir en quelles mains la puissance publique est remise, et l’on se demande par quelle force indépendante de la législation et des hommes, l’État peut y croire et la société y prospérer.
Il y a certaines lois dont la nature est démocratique et qui réussissent cependant à corriger en partie ces instincts dangereux de la démocratie.
Lorsque vous entrez dans la salle des représentants [II-50] à Washington, vous vous sentez frappé de l’aspect vulgaire de cette grande assemblée. L’œil cherche souvent en vain dans son sein un homme célèbre. Presque tous ses membres sont des personnages obscurs, dont le nom ne fournit aucune image à la pensée. Ce sont, pour la plupart, des avocats de village, des commerçants, ou même des hommes appartenant aux dernières classes. Dans un pays où l’instruction est presque universellement répandue, on dit que les représentants du peuple ne savent pas toujours correctement écrire.
À deux pas de là s’ouvre la salle du sénat, dont l’étroite enceinte renferme une grande partie des célébrités de l’Amérique. À peine y aperçoit-on un seul homme qui ne rappelle l’idée d’une illustration récente. Ce sont d’éloquents avocats, des généraux distingués, d’habiles magistrats, ou des hommes d’État connus. Toutes les paroles qui s’échappent de cette assemblée feraient honneur aux plus grands débats parlementaires d’Europe.
D’où vient ce bizarre contraste ? Pourquoi l’élite de la nation se trouve-t-elle dans cette salle plutôt que dans cette autre ? Pourquoi la première assemblée réunit-elle tant d’éléments vulgaires, lorsque la seconde semble avoir le monopole des talents et des lumières ? L’une et l’autre cependant émanent du peuple, l’une et l’autre sont le produit du suffrage universel, et nulle voix, jusqu’à présent, ne s’est élevée en Amérique pour soutenir que le sénat fût ennemi des intérêts populaires. D’où vient donc une si énorme différence ? Je ne vois qu’un seul fait qui l’explique : l’élection qui produit la Chambre des [II-51] représentants est directe ; celle dont le sénat émane est soumise à deux degrés. L’universalité des citoyens nomme la législature de chaque État, et la constitution fédérale, transformant à leur tour chacune de ces législatures en corps électoraux, y puise les membres du sénat. Les sénateurs expriment donc, quoique indirectement, le résultat du vote universel ; car la législature, qui nomme les sénateurs, n’est point un corps aristocratique ou privilégié qui tire son droit électoral de lui-même ; elle dépend essentiellement de l’universalité des citoyens ; elle est, en général élue par eux tous les ans, et ils peuvent toujours diriger ses choix en la composant de membres nouveaux. Mais il suffit que la volonté populaire passe à travers cette assemblée choisie pour s’y élaborer en quelque sorte, et en sortir revêtue de formes plus nobles et plus belles. Les hommes ainsi élus représentent donc toujours exactement la majorité de la nation qui gouverne ; mais ils ne représentent que les pensées élevées qui ont cours au milieu d’elle, les instincts généreux qui l’animent, et non les petites passions qui souvent l’agitent et les vices qui la déshonorent.
Il est facile d’apercevoir dans l’avenir un moment où les républiques américaines seront forcées de multiplier les deux degrés dans leur système électoral, sous peine de se perdre misérablement parmi les écueils de la démocratie.
Je ne ferai pas difficulté de l’avouer ; je vois dans le double degré électoral le seul moyen de mettre l’usage de la liberté politique à la portée de toutes les classes du peuple. Ceux qui espèrent faire de ce [II-52] moyen l’arme exclusive d’un parti, et ceux qui le craignent, me paraissent tomber dans une égale erreur.
INFLUENCE QU’A EXERCÉE LA DÉMOCRATIE AMÉRICAINE SUR LES LOIS ÉLECTORALES.
La rareté des élections expose l’État à de grandes crises. — Leur fréquence l’entretient dans une agitation fébrile. — Les Américains ont choisi le second de ces deux maux. — Versatilité de la loi. — Opinion de Hamilton, de Madison et de Jefferson sur ce sujet.
Quand l’élection ne revient qu’à de longs intervalles, à chaque élection l’État court risque d’un bouleversement.
Les partis font alors de prodigieux efforts pour se saisir d’une fortune qui passe si rarement à leur portée ; et le mal étant presque sans remède pour les candidats qui échouent, il faut tout craindre de leur ambition poussée au désespoir. Si, au contraire, la lutte légale doit bientôt se renouveler, les vaincus patientent.
Lorsque les élections se succèdent rapidement, leur fréquence entretient dans la société un mouvement fébrile et maintient les affaires publiques dans un état de versatilité continuelle.
Ainsi, d’un côté, il y a pour l’État chance de malaise ; de l’autre, chance de révolution ; le premier système nuit à la bonté du gouvernement, le second menace son existence.
Les Américains ont mieux aimé s’exposer au premier mal qu’au second. En cela, ils se sont dirigés par instinct bien plus que par raisonnement, la [II-53] démocratie poussant le goût de la variété jusqu’à la passion. Il en résulte une mutabilité singulière dans la législation.
Beaucoup d’Américains considèrent l’instabilité de leurs lois comme la conséquence nécessaire d’un système dont les effets généraux sont utiles. Mais il n’est personne, je crois, aux États-Unis, qui prétende nier que cette instabilité existe ou qui ne la regarde pas comme un grand mal.
Hamilton, après avoir démontré l’utilité d’un pouvoir qui pût empêcher ou du moins retarder la promulgation des mauvaises lois, ajoute : « On me répondra peut-être que le pouvoir de prévenir de mauvaises lois implique le pouvoir de prévenir les bonnes. Cette objection ne saurait satisfaire ceux qui ont été à même d’examiner tous les maux qui découlent pour nous de l’inconstance et de la mutabilité de la loi. L’instabilité législative est la plus grande tache qu’on puisse signaler dans nos institutions. » Form the greatest blemish in the character and genius of our government. (Federalist, n. 73.).
« La facilité qu’on trouve à changer les lois, dit Madison, et l’excès qu’on peut faire du pouvoir législatif me paraissent les maladies les plus dangereuses auxquelles notre gouvernement soit exposé. » (Federalist, n. 62.).
Jefferson lui-même, le plus grand démocrate qui soit encore sorti du sein de la démocratie américaine, a signalé les mêmes périls.
« L’instabilité de nos lois est réellement un inconvénient très grave, dit-il. Je pense que nous [II-54] aurions dû y pourvoir en décidant qu’il y aurait toujours un intervalle d’une année entre la présentation d’une loi et le vote définitif. Elle serait ensuite discutée et votée, sans qu’on pût y changer un mot, et si les circonstances semblaient exiger une plus prompte résolution, la proposition ne pourrait être adoptée à la simple majorité, mais à la majorité des deux tiers de l’une et de l’autre chambre [3] . »
DES FONCTIONNAIRES PUBLICS SOUS L’EMPIRE DE LA DÉMOCRATIE AMÉRICAINE.
Simplicité des fonctionnaires américains. — Absence de costume. — Tous les fonctionnaires sont payés. – Conséquences politiques de ce fait. — En Amérique il n’y a pas de carrière publique. — Ce qui en résulte.
Les fonctionnaires publics, aux États-Unis, restent confondus au milieu de la foule des citoyens ; ils n’ont ni palais, ni gardes, ni costumes d’apparat. Cette simplicité des gouvernants ne tient pas seulement à un tour particulier de l’esprit américain, mais aux principes fondamentaux de la société.
Aux yeux de la démocratie, le gouvernement n’est pas un bien, c’est un mal nécessaire. Il faut accorder aux fonctionnaires un certain pouvoir ; car, sans ce pouvoir, à quoi serviraient-ils ? mais les apparences extérieures du pouvoir ne sont point indispensables à la marche des affaires ; elles blessent inutilement la vue du public. [II-55] .
Les fonctionnaires eux-mêmes sentent parfaitement qu’ils n’ont obtenu le droit de se placer au-dessus des autres par leur puissance, que sous la condition de descendre au niveau de tous par leurs manières.
Je ne saurais rien imaginer de plus uni dans ses façons d’agir, de plus accessible à tous, de plus attentif aux demandes, et de plus civil dans ses réponses, qu’un homme public aux États-Unis.
J’aime cette allure naturelle du gouvernement de la démocratie ; dans cette force intérieure qui s’attache à la fonction plus qu’au fonctionnaire, à l’homme plus qu’aux signes extérieurs de la puissance, j’aperçois quelque chose de viril que j’admire.
Quant à l’influence que peuvent exercer les costumes, je crois qu’on s’exagère beaucoup l’importance qu’ils doivent avoir dans un siècle comme le nôtre. Je n’ai point remarqué qu’en Amérique le fonctionnaire, dans l’exercice de son pouvoir, fût accueilli avec moins d’égards et de respects, pour être réduit à son seul mérite.
D’une autre part, je doute fort qu’un vêtement particulier porte les hommes publics à se respecter eux-mêmes, quand ils ne sont pas naturellement disposés à le faire ; car je ne saurais croire qu’ils aient plus d’égards pour leur habit que pour leur personne.
Quand je vois, parmi nous, certains magistrats brusquer les parties ou leur adresser des bons mots, lever les épaules aux moyens de la défense et sourire avec complaisance à l’énumération des charges, je voudrais qu’on essayât de leur ôter leur robe, afin de découvrir si, se trouvant vêtus comme les simples [II-56] citoyens, cela ne les rappellerait pas à la dignité naturelle de l’espèce humaine.
Aucun des fonctionnaires publics des États-Unis n’a de costume, mais tous reçoivent un salaire.
Ceci découle, plus naturellement encore que ce qui précède, des principes démocratiques. Une démocratie peut environner de pompe ses magistrats et les couvrir de soie et d’or sans attaquer directement le principe de son existence. De pareils priviléges sont passagers ; ils tiennent à la place, et non à l’homme. Mais établir des fonctions gratuites, c’est créer une classe de fonctionnaires riches et indépendants, c’est former le noyau d’une aristocratie. Si le peuple conserve encore le droit du choix, l’exercice de ce droit a donc des bornes nécessaires.
Quand on voit une république démocratique rendre gratuites les fonctions rétribuées, je crois qu’on peut en conclure qu’elle marche vers la monarchie. Et quand une monarchie commence à rétribuer les fonctions gratuites, c’est la marque assurée qu’on s’avance vers un état despotique ou vers un état républicain.
La substitution des fonctions salariées aux fonctions gratuites me semble donc à elle toute seule constituer une véritable révolution.
Je regarde comme un des signes les plus visibles de l’empire absolu qu’exerce la démocratie en Amérique, l’absence complète des fonctions gratuites. Les services rendus au public, quels qu’ils soient, s’y payent : aussi chacun a-t-il, non pas seulement le droit, mais la possibilité de les rendre.
Si, dans les États démocratiques, tous les citoyens [II-57] peuvent obtenir les emplois, tous ne sont pas tentés de les briguer. Ce ne sont pas les conditions de la candidature, mais le nombre et la capacité des candidats, qui souvent y limitent le choix des électeurs.
Chez les peuples où le principe de l’élection s’étend à tout, il n’y a pas, à proprement parler, de carrière publique. Les hommes n’arrivent en quelque sorte aux fonctions que par hasard, et ils n’ont aucune assurance de s’y maintenir. Cela est vrai surtout lorsque les élections sont annuelles. Il en résulte que, dans les temps de calme, les fonctions publiques offrent peu d’appât à l’ambition. Aux États-Unis, ce sont les gens modérés dans leurs désirs qui s’engagent au milieu des détours de la politique. Les grands talents et les grandes passions s’écartent en général du pouvoir, afin de poursuivre la richesse ; et il arrive souvent qu’on ne se charge de diriger la fortune de l’État que quand on se sent peu capable de conduire ses propres affaires.
C’est à ces causes autant qu’aux mauvais choix de la démocratie qu’il faut attribuer le grand nombre d’hommes vulgaires qui occupent les fonctions publiques. Aux États-Unis, je ne sais si le peuple choisirait les hommes supérieurs qui brigueraient ses suffrages, mais il est certain que ceux-ci ne les briguent pas. [II-58]
DE L’ARBITRAIRE DES MAGISTRATS[4] SOUS L’EMPIRE DE LADÉMOCRATIE AMÉRICAINE.
Pourquoi l’arbitraire des magistrats est plus grand sous les monarchies absolues et dans les républiques démocratiques que dans les monarchies tempérées. — Arbitraire des magistrats dans la Nouvelle-Angleterre.
Il y a deux espèces de gouvernements sous lesquels il se mêle beaucoup d’arbitraire à l’action des magistrats ; il en est ainsi sous le gouvernement absolu d’un seul et sous le gouvernement de la démocratie.
Ce même effet provient de causes presque analogues.
Dans les États despotiques, le sort de personne n’est assuré, pas plus celui des fonctionnaires publics que celui des simples particuliers. Le souverain, tenant toujours dans sa main la vie, la fortune, et quelquefois l’honneur des hommes qu’il emploie, pense n’avoir rien à craindre d’eux, et il leur laisse une grande liberté d’action, parce qu’il se croit assuré qu’ils n’en abuseront jamais contre lui.
Dans les États despotiques, le souverain est si amoureux de son pouvoir, qu’il craint la gêne de ses propres règles ; et il aime à voir ses agents aller à peu près au hasard, afin d’être sûr de ne jamais rencontrer en eux une tendance contraire à ses désirs.
Dans les démocraties, la majorité pouvant chaque année enlever le pouvoir des mains auxquelles elle l’a confié, ne craint point non plus qu’on en abuse contre elle. Maîtresse de faire connaître à chaque [II-59] instant ses volontés aux gouvernants, elle aime mieux les abandonner à leurs propres efforts que de les enchaîner à une règle invariable qui, en les bornant, la bornerait en quelque sorte elle-même.
On découvre même, en y regardant de près, que, sous l’empire de la démocratie, l’arbitraire du magistrat doit être plus grand encore que dans les États despotiques.
Dans ces États, le souverain peut punir en un moment toutes les fautes qu’il aperçoit ; mais il ne saurait se flatter d’apercevoir toutes les fautes qu’il devrait punir. Dans les démocraties, au contraire, le souverain, en même temps qu’il est tout-puissant, est partout à la fois : aussi voit-on que les fonctionnaires américains sont bien plus libres dans le cercle d’action que la loi leur trace qu’aucun fonctionnaire d’Europe. Souvent on se borne à leur montrer le but vers lequel ils doivent tendre, les laissant maîtres de choisir les moyens.
Dans la Nouvelle-Angleterre, par exemple, on s’en rapporte aux select-men de chaque commune du soin de former la liste du jury ; la seule règle qu’on leur trace est celle-ci : ils doivent choisir les jurés parmi les citoyens qui jouissent des droits électoraux et qui ont une bonne réputation [5] .
En France, nous croirions la vie et la liberté des hommes en péril si nous confiions à un fonctionnaire, quel qu’il fût, l’exercice d’un droit aussi redoutable.
Dans la Nouvelle-Angleterre, ces mêmes magistrats [II-60] peuvent faire afficher dans les cabarets le nom des ivrognes, et empêcher sous peine d’amende les habitants de leur fournir du vin [6] .
Un pareil pouvoir censorial révolterait le peuple dans la monarchie la plus absolue ; ici, pourtant, on s’y soumet sans peine.
Nulle part la loi n’a laissé une plus grande part à l’arbitraire que dans les républiques démocratiques, parce que l’arbitraire n’y paraît point à craindre. On peut même dire que le magistrat y devient plus libre, à mesure que le droit électoral descend plus bas et que le temps de la magistrature est plus limité.
De là vient qu’il est si difficile de faire passer une république démocratique à l’état de monarchie. Le magistrat, en cessant d’être électif, y garde d’ordinaire les droits et y conserve les usages du magistrat élu. On arrive alors au despotisme.
Ce n’est que dans les monarchies tempérées que la loi, en même temps qu’elle trace un cercle d’action autour des fonctionnaires publics, prend encore le soin de les y guider à chaque pas. La cause de ce fait est facile à dire.
Dans les monarchies tempérées, le pouvoir se trouve divisé entre le peuple et le prince. L’un et [II-61] l’autre ont intérêt à ce que la position du magistrat soit stable.
Le prince ne veut pas remettre le sort des fonctionnaires dans les mains du peuple, de peur que ceux-ci ne trahissent son autorité ; de son côté, le peuple craint que les magistrats, placés dans la dépendance absolue du prince, ne servent à opprimer la liberté ; on ne les fait donc dépendre en quelque sorte de personne.
La même cause qui porte le prince et le peuple à rendre le fonctionnaire indépendant, les porte à chercher des garanties contre les abus de son indépendance, afin qu’il ne la tourne pas contre l’autorité de l’un ou la liberté de l’autre. Tous deux s’accordent donc sur la nécessité de tracer d’avance au fonctionnaire public une ligne de conduite, et trouvent leur intérêt à lui imposer des règles dont il lui soit impossible de s’écarter.
INSTABILITÉ ADMINISTRATIVE AUX ÉTATS-UNIS.
En Amérique, les actes de la société laissent souvent moins de traces que les actions d’une famille. — Journaux, seuls monuments historiques. — Comment l’extrême instabilité administrative nuit à l’art de gouverner.
Les hommes ne faisant que passer un instant au pouvoir, pour aller ensuite se perdre dans une foule qui, elle-même, change chaque jour de face, il en résulte que les actes de la société, en Amérique, laissent souvent moins de trace que les actions d’une simple famille. L’administration publique y est en quelque sorte orale et traditionnelle. On n’y écrit [II-62] point, ou ce qui est écrit s’envole au moindre vent, comme les feuilles de la Sibylle, et disparaît sans retour.
Les seuls monuments historiques des États-Unis sont les journaux. Si un numéro vient à manquer, la chaîne des temps est comme brisée : le présent et le passé ne se rejoignent plus. Je ne doute point que dans cinquante ans il ne soit plus difficile de réunir des documents authentiques sur les détails de l’existence sociale des Américains de nos jours, que sur l’administration des Français au Moyen Age ; et si une invasion de Barbares venait à surprendre les États-Unis, il faudrait, pour savoir quelque chose du peuple qui les habite, recourir à l’histoire des autres nations.
L’instabilité administrative a commencé par pénétrer dans les habitudes ; je pourrais presque dire qu’aujourd’hui chacun a fini par en contracter le goût. Nul ne s’inquiète de ce qu’on a fait avant lui. On n’adopte point de méthode ; on ne compose point de collection ; on ne réunit pas de documents, lors même qu’il serait aisé de le faire. Quand par hasard on les possède, on n’y tient guère. J’ai dans mes papiers des pièces originales qui m’ont été données dans des administrations publiques pour répondre à quelques-unes de mes questions. En Amérique, la société semble vivre au jour le jour, comme une armée en campagne. Cependant, l’art d’administrer est à coup sûr une science ; et toutes les sciences, pour faire des progrès, ont besoin de lier ensemble les découvertes des différentes générations, a mesure qu’elles se succèdent. Un homme, dans le court [II-63] espace de la vie, remarque un fait, un autre conçoit une idée ; celui-ci invente un moyen, celui-là trouve une formule ; l’humanité recueille en passant ces fruits divers de l’expérience individuelle, et forme les sciences. Il est très difficile que les administrateurs américains apprennent rien les uns des autres. Ainsi ils apportent à la conduite de la société les lumières qu’ils trouvent répandues dans son sein, et non des connaissances qui leur soient propres. La démocratie, poussée dans ses dernières limites, nuit donc au progrès de l’art de gouverner. Sous ce rapport, elle convient mieux à un peuple dont l’éducation administrative est déjà faite, qu’à un peuple novice dans l’expérience des affaires.
Ceci, du reste, ne se rapporte point uniquement à la science administrative. Le gouvernement démocratique, qui se fonde sur une idée si simple et si naturelle, suppose toujours, cependant, l’existence d’une société très civilisée et très savante [7] . D’abord on le croirait contemporain des premiers âges du monde ; en y regardant de près, on découvre aisément qu’il n’a dû venir que le dernier. [II-64]
DES CHARGES PUBLIQUES SOUS L’EMPIRE DE LA DÉMOCRATIE AMÉRICAINE.
Dans toutes les sociétés, les citoyens se divisent en un certain nombre de classes. — Instinct qu’apporte chacune de ces classes dans la direction des finances de l’État. — Pourquoi les dépenses publiques doivent tendre à croître quand le peuple gouverne. — Ce qui rend les profusions de la démocratie moins à craindre en Amérique. — Emploi des deniers publics sous la démocratie.
Le gouvernement de la démocratie est-il économique ? Il faut d’abord savoir à quoi nous entendons le comparer.
La question serait facile à résoudre si l’on voulait établir un parallèle entre une république démocratique et une monarchie absolue. On trouverait que les dépenses publiques dans la première sont plus considérables, que dans la seconde. Mais il en est ainsi pour tous les États libres, comparés à ceux qui ne le sont pas. Il est certain que le despotisme ruine les hommes en les empêchant de produire, plus qu’en leur enlevant les fruits de la production ; il tarit la source des richesses et respecte souvent la richesse acquise. La liberté, au contraire, enfante mille fois plus de biens qu’elle n’en détruit, et, chez les nations qui la connaissent, les ressources du peuple croissent toujours plus vite que les impôts.
Ce qui m’importe en ce moment, est de comparer entre eux les peuples libres, et parmi ces derniers de constater quelle influence exerce la démocratie sur les finances de l’État.
Les sociétés, ainsi que les corps organisés, suivent [II-65] dans leur formation certaines règles fixes dont elles ne sauraient s’écarter. Elles sont composées de certains éléments qu’on retrouve partout et dans tous les temps.
Il sera toujours facile de diviser idéalement chaque peuple en trois classes.
La première classe se composera des riches. La seconde comprendra ceux qui, sans être riches, vivent au milieu de l’aisance de toutes choses. Dans la troisième seront renfermés ceux qui n’ont que peu ou point de propriétés et qui vivent particulièrement du travail que leur fournissent les deux premières.
Les individus renfermés dans ces différentes catégories peuvent être plus ou moins nombreux, suivant l’état social ; mais vous ne sauriez faire que ces catégories n’existent pas.
Il est évident que chacune de ces classes apportera dans le maniement des finances de l’État certains instincts qui lui seront propres.
Supposez que la première seule fasse les lois : il est probable qu’elle se préoccupera assez peu d’économiser les deniers publics, parce qu’un impôt qui vient à frapper une fortune considérable n’enlève que du superflu et produit un effet peu sensible.
Admettez au contraire que ce soient les classes moyennes qui seules fassent la loi. On peut compter qu’elles ne prodigueront pas les impôts, parce qu’il n’y a rien de si désastreux qu’une grosse taxe venant à frapper une petite fortune.
Le gouvernement des classes moyennes me semble devoir être, parmi les gouvernements libres, je ne [II-66] dirai pas le plus éclairé, ni surtout le plus généreux, mais le plus économique.
Je suppose maintenant que la dernière classe soit exclusivement chargée de faire la loi ; je vois bien des chances pour que les charges publiques augmentent au lieu de décroître, et ceci pour deux raisons :.
La plus grande partie de ceux qui votent alors la loi n’ayant aucune propriété imposable, tout l’argent qu’on dépense dans l’intérêt de la société semble ne pouvoir que leur profiter sans jamais leur nuire ; et ceux qui ont quelque peu de propriété trouvent aisément les moyens d’asseoir l’impôt de manière qu’il ne frappe que sur les riches et ne profite qu’aux pauvres, chose que les riches ne sauraient faire de leur côté lorsqu’ils sont maîtres du gouvernement.
Les pays où les pauvres [8] seraient exclusivement chargés de faire la loi ne pourraient donc espérer une grande économie dans les dépenses publiques : ces dépenses seront toujours considérables, soit parce que les impôts ne peuvent atteindre ceux qui les votent, soit parce qu’ils sont assis de manière à ne pas les atteindre. En d’autres termes, le gouvernement de la démocratie est le seul où celui qui vote l’impôt puisse échapper à l’obligation de le payer.
En vain objectera-t-on que l’intérêt bien entendu du peuple est de ménager la fortune des riches, parce qu’il ne tarderait pas à se ressentir de la gêne qu’il [II-67] ferait naître. Mais l’intérêt des rois n’est-il pas aussi de rendre leurs sujets heureux, et celui des nobles de savoir ouvrir à propos leurs rangs ? Si l’intérêt éloigné pouvait prévaloir sur les passions et les besoins du moment, il n’y aurait jamais eu de souverains tyranniques ni d’aristocratie exclusive.
L’on m’arrête encore en disant : Qui a jamais imaginé de charger les pauvres de faire seuls la loi ? Qui ? Ceux qui ont établi le vote universel. Est-ce la majorité ou la minorité qui fait la loi ? La majorité sans doute ; et si je prouve que les pauvres composent toujours la majorité, n’aurai-je pas raison d’ajouter que dans les pays où ils sont appelés à voter, les pauvres font seuls la loi ?.
Or, il est certain que jusqu’ici, chez toutes les nations du monde, le plus grand nombre a toujours été composé de ceux qui n’avaient pas de propriété, ou de ceux dont la propriété était trop restreinte pour qu’ils pussent vivre dans l’aisance sans travailler. Le vote universel donne donc réellement le gouvernement de la société aux pauvres.
L’influence fâcheuse que peut quelquefois exercer le pouvoir populaire sur les finances de l’État se fit bien voir dans certaines républiques démocratiques de l’antiquité, où le trésor public s’épuisait à secourir les citoyens indigents, ou à donner des jeux et des spectacles au peuple.
Il est vrai de dire que le système représentatif était à peu près inconnu à l’antiquité. De nos jours, les passions populaires se produisent plus difficilement dans les affaires publiques ; on peut compter cependant qu’à la longue, le mandataire finira [II-68] toujours par se conformer à l’esprit de ses commettants et par faire prévaloir leurs penchants aussi bien que leurs intérêts.
Les profusions de la démocratie sont, du reste, moins à craindre à proportion que le peuple devient propriétaire, parce qu’alors, d’une part, le peuple a moins besoin de l’argent des riches, et que, de l’autre, il rencontre plus de difficultés à ne pas se frapper lui-même en établissant l’impôt. Sous ce rapport, le vote universel serait moins dangereux en France qu’en Angleterre, où presque toute la propriété imposable est réunie en quelques mains. L’Amérique, où la grande majorité des citoyens possède, se trouve dans une situation plus favorable que la France.
Il est d’autres causes encore qui peuvent élever la somme des dépenses publiques dans les démocraties.
Lorsque l’aristocratie gouverne, les hommes qui conduisent les affaires de l’État échappent par leur position même à tous les besoins ; contents de leur sort, ils demandent surtout à la société de la puissance et de la gloire ; et, placés au-dessus de la foule obscure des citoyens, ils n’aperçoivent pas toujours clairement comment le bien-être général doit concourir à leur propre grandeur. Ce n’est pas qu’ils voient sans pitié les souffrances du pauvre ; mais ils ne sauraient ressentir ses misères comme s’ils les partageaient eux-mêmes ; pourvu que le peuple semble s’accommoder de sa fortune, ils se tiennent donc pour satisfaits, et n’attendent rien de plus du gouvernement. L’aristocratie songe à maintenir plus qu’à perfectionner. [II-69] .
Quand, au contraire, la puissance publique est entre les mains du peuple, le souverain cherche partout le mieux parce qu’il se sent mal.
L’esprit d’amélioration s’étend alors à mille objets divers ; il descend à des détails infinis, et surtout il s’applique à des espèces d’améliorations qu’on ne saurait obtenir qu’en payant ; car il s’agit de rendre meilleure la condition du pauvre qui ne peut s’aider lui-même.
Il existe de plus dans les sociétés démocratiques une agitation sans but précis ; il y règne une sorte de fièvre permanente qui se tourne en innovation de tout genre, et les innovations sont presque toujours coûteuses.
Dans les monarchies et dans les aristocraties, les ambitieux flattent le goût naturel qui porte le souverain vers la renommée et vers le pouvoir, et le poussent souvent ainsi à de grandes dépenses.
Dans les démocraties, où le souverain est nécessiteux, on ne peut guère acquérir sa bienveillance qu’en accroissant son bien-être ; ce qui ne peut presque jamais se faire qu’avec de l’argent.
De plus, quand le peuple commence lui-même à réfléchir sur sa position, il lui naît une foule de besoins qu’il n’avait pas ressentis d’abord, et qu’on ne peut satisfaire qu’en recourant aux ressources de l’État. De là vient qu’en général les charges publiques semblent s’accroître avec la civilisation, et qu’on voit les impôts s’élever à mesure que les lumières s’étendent.
Il est enfin une dernière cause qui rend souvent le gouvernement démocratique plus cher qu’un autre. [II-70] Quelquefois la démocratie veut mettre de l’économie dans ses dépenses, mais elle ne peut y parvenir, parce qu’elle n’a pas l’art d’être économe.
Comme elle change fréquemment de vues et plus fréquemment encore d’agents, il arrive que ses entreprises sont mal conduites, ou restent inachevées : dans le premier cas, l’État fait des dépenses disproportionnées à la grandeur du but qu’il veut atteindre ; dans le second, il fait des dépenses improductives.
DES INSTINCTS DE LA DÉMOCRATIE AMÉRICAINE DANS LA FIXATION DU TRAITEMENT DES FONCTIONNAIRES.
Dans les démocraties, ceux qui instituent les grands traitements n’ont pas de chance d’en profiter. — Tendance de la démocratie américaine à élever le traitement des fonctionnaires secondaires et à baisser celui des principaux. — Pourquoi il en est ainsi. — Tableau comparatif du traitement des fonctionnaires publics aux États-Unis et en France.
Il y a une grande raison qui porte, en général, les démocraties à économiser sur les traitements des fonctionnaires publics.
Dans les démocraties, ceux qui instituent les traitements étant en très grand nombre, ont très peu de chance d’arriver jamais à les toucher.
Dans les aristocraties, au contraire, ceux qui instituent les grands traitements ont presque toujours le vague espoir d’en profiter. Ce sont des capitaux qu’ils se créent pour eux-mêmes, ou tout au moins des ressources qu’ils préparent à leurs enfants.
Il faut avouer pourtant que la démocratie ne se montre très parcimonieuse qu’envers ses principaux agents. [II-71] .
En Amérique, les fonctionnaires d’un ordre secondaire sont plus payés qu’ailleurs, mais les hauts fonctionnaires le sont beaucoup moins.
Ces effets contraires sont produits par la même cause ; le peuple, dans les deux cas, fixe le salaire des fonctionnaires publics ; il pense à ses propres besoins, et cette comparaison l’éclaire. Comme il vit lui-même dans une grande aisance, il lui semble naturel que ceux dont il se sert la partagent [9] . Mais quand il en arrive à fixer le sort des grands officiers de l’État, sa règle lui échappe, et il ne procède plus qu’au hasard.
Le pauvre ne se fait pas une idée distincte des besoins que peuvent ressentir les classes supérieures de la société. Ce qui paraîtrait une somme modique à un riche, lui paraît une somme prodigieuse, à lui qui se contente du nécessaire ; et il estime que le gouverneur de l’État, pourvu de ses deux mille écus, doit encore se trouver heureux et exciter l’envie [10] .
Que si vous entreprenez de lui faire entendre que le représentant d’une grande nation doit paraître avec une certaine splendeur aux yeux des étrangers, il vous comprendra tout d’abord ; mais, lorsque, venant à penser à sa simple demeure et aux modestes fruits [II-72] de son pénible labeur, il songera à tout ce qu’il pourrait exécuter lui-même avec ce même salaire que vous jugez insuffisant, il se trouvera surpris et comme effrayé à la vue de tant de richesses.
Ajoutez à cela que le fonctionnaire secondaire est presque au niveau du peuple, tandis que l’autre le domine. Le premier peut donc encore exciter son intérêt, mais l’autre commence à faire naître son envie.
Ceci se voit bien clairement aux États-Unis, où les salaires semblent en quelque sorte décroître à mesure que le pouvoir des fonctionnaires est plus grand [11] . [II-73] .
Sous l’empire de l’aristocratie, il arrive au contraire que les hauts fonctionnaires reçoivent de très grands émoluments, tandis que les petits ont souvent à peine de quoi vivre. Il est facile de trouver la raison de ce fait dans des causes analogues à celles que nous avons indiquées plus haut.
Si la démocratie ne conçoit pas les plaisirs du riche ou les envie, de son côté l’aristocratie ne comprend point les misères du pauvre, ou plutôt elle les ignore. Le pauvre n’est point, à proprement parler, le semblable du riche ; C’est un être d’une autre espèce. L’aristocratie s’inquiète donc assez peu du sort de ses agents inférieurs. Elle ne hausse leurs salaires que quand ils refusent de la servir à trop bas prix.
C’est la tendance parcimonieuse de la démocratie envers les principaux fonctionnaires qui lui a fait attribuer de grands penchants économiques qu’elle n’a pas.
Il est vrai que la démocratie donne à peine de quoi vivre honnêtement à ceux qui la gouvernent, mais elle dépense des sommes énormes pour secourir les besoins ou faciliter les jouissances du peuple [12] . Voilà un emploi meilleur du produit de l’impôt, non une économie.
En général, la démocratie donne peu aux gouvernants et beaucoup aux gouvernés. Le contraire se voit dans les aristocraties où l’argent de l’État profite surtout à la classe qui mène les affaires. [II-74]
DIFFICULTÉ DE DISCERNER LES CAUSES QUI PORTENT LE GOUVERNEMENT AMÉRICAIN À L’ÉCONOMIE.
Celui qui recherche dans les faits l’influence réelle qu’exercent les lois sur le sort de l’humanité, est exposé à de grandes méprises, car il n’y a rien de si difficile à apprécier qu’un fait.
Un peuple est naturellement léger et enthousiaste ; un autre réfléchi et calculateur. Ceci tient à sa constitution physique elle-même ou à des causes éloignées que j’ignore.
On voit des peuples qui aiment la représentation, le bruit et la joie, et qui ne regrettent pas un million dépensé en fumée. On en voit d’autres qui ne prisent que les plaisirs solitaires et qui semblent honteux de paraître contents.
Dans certains pays, on attache un grand prix à la beauté des édifices. Dans certains autres, on ne met aucune valeur aux objets d’art, et l’on méprise ce qui ne rapporte rien. Il en est enfin où l’on aime la renommée, et d’autres où l’on place avant tout l’argent.
Indépendamment des lois, toutes ces causes influent d’une manière très puissante sur la conduite des finances de l’État.
S’il n’est jamais arrivé aux Américains de dépenser l’argent du peuple en fêtes publiques, ce n’est point [II-75] seulement parce que, chez eux, le peuple vote l’impôt, c’est parce que le peuple n’aime pas à se réjouir.
S’ils repoussent les ornements de leur architecture et ne prisent que les avantages matériels et positifs, ce n’est pas seulement parce qu’ils forment une nation démocratique, c’est aussi parce qu’ils sont un peuple commerçant.
Les habitudes de la vie privée se sont continuées dans la vie publique ; et il faut bien distinguer chez eux les économies qui dépendent des institutions, de celles qui découlent des habitudes et des mœurs.
PEUT-ON COMPARER LES DÉPENSES PUBLIQUES DES ÉTATS-UNIS À CELLES DE FRANCE ?
Deux points à établir pour apprécier l’étendue des charges publiques : la richesse nationale et l’impôt. — On ne connaît pas exactement la fortune et les charges de la France. — Pourquoi on ne peut espérer de connaître la fortune et les charges de l’Union. — Recherches de l’auteur pour apprendre le montant des impôts dans la Pensylvanie. — Signes généraux auxquels on peut reconnaître l’étendue des charges d’un peuple. — Résultat de cet examen pour l’Union.
On s’est beaucoup occupé dans ces derniers temps à comparer les dépenses publiques des États-Unis aux nôtres. Tous ces travaux ont été sans résultats, et peu de mots suffiront, je crois, pour prouver qu’ils devaient l’être.
Afin de pouvoir apprécier l’étendue des charges publiques chez un peuple, deux opérations sont nécessaires : il faut d’abord apprendre quelle est la richesse de ce peuple, et ensuite quelle portion de cette richesse il consacre aux dépenses de l’État. Celui qui [II-76] rechercherait le montant des taxes sans montrer l’étendue des ressources qui doivent y pourvoir, se livrerait à un travail improductif ; car ce n’est pas la dépense, mais le rapport de la dépense au revenu qu’il est intéressant de connaître.
Le même impôt que supporte aisément un contribuable riche, achèvera de réduire un pauvre à la misère.
La richesse des peuples se compose de plusieurs éléments : les fonds immobiliers forment le premier, les biens mobiliers constituent le second.
Il est difficile de connaître l’étendue des terres cultivables que possède une nation et leur valeur naturelle ou acquise. Il est plus difficile encore d’estimer tous les biens mobiliers dont un peuple dispose. Ceux-là échappent, par leur diversité et par leur nombre, à presque tous les efforts de l’analyse.
Aussi voyons-nous que les nations les plus anciennement civilisées de l’Europe, celles mêmes chez lesquelles l’administration est centralisée, n’ont point établi jusqu’à présent d’une manière précise l’état de leur fortune.
En Amérique, on n’a pas même conçu l’idée de le tenter. Et comment pourrait-on se flatter d’y réussir dans ce pays nouveau où la société n’a pas encore pris une assiette tranquille et définitive, où le gouvernement national ne trouve pas à sa disposition, comme le nôtre, une multitude d’agents dont il puisse commander et diriger simultanément les efforts ; où la statistique enfin n’est point cultivée, parce qu’il ne s’y rencontre personne qui ait la faculté de réunir des documents ou le temps de les parcourir ? [II-77] .
Ainsi donc les éléments constitutifs de nos calculs ne sauraient être obtenus. Nous ignorons la fortune comparative de la France et de l’Union. La richesse de l’une n’est pas encore connue, et les moyens d’établir celle de l’autre n’existent point.
Mais je veux bien consentir, pour un moment, à écarter ce terme nécessaire de la comparaison ; je renonce à savoir quel est le rapport de l’impôt au revenu, et je me borne à vouloir établir quel est l’impôt.
Le lecteur va reconnaître qu’en rétrécissant le cercle de mes recherches je n’ai pas rendu ma tâche plus aisée.
Je ne doute point que l’administration centrale de France, aidée de tous les fonctionnaires dont elle dispose, ne parvint à découvrir exactement le montant des taxes directes ou indirectes qui pèsent sur les citoyens. Mais ces travaux, qu’un particulier ne peut entreprendre, le gouvernement français lui-même ne les a point encore achevés, ou du moins il n’a pas fait connaître leurs résultats. Nous savons quelles sont les charges de l’État ; le total des dépenses départementales nous est connu ; nous ignorons ce qui se passe dans les communes : nul ne saurait donc dire, quant à présent, à quelle somme s’élèvent les dépenses publiques en France.
Si je retourne maintenant à l’Amérique, j’aperçois les difficultés qui deviennent plus nombreuses et plus insurmontables. L’Union me fait connaître avec exactitude quel est le montant de ses charges ; je puis me procurer les budgets particuliers des vingt-quatre États dont elle se compose ; mais qui m’apprendra ce [II-78] que dépensent les citoyens pour l’administration du comté et de la commune [13] ?.
L’autorité fédérale ne peut s’étendre jusqu’à obliger les gouvernements provinciaux à nous éclairer sur ce point ; et ces gouvernements voulussent-ils eux-mêmes nous prêter simultanément leur concours, je doute qu’ils fussent en état de nous satisfaire. [II-79] Indépendamment de la difficulté naturelle de l’entreprise, l’organisation politique du pays s’opposerait encore au succès de leurs efforts. Les magistrats de la commune et du comté ne sont point nommés par les administrateurs de l’État, et ne dépendent point de ceux-ci. Il est donc permis de croire que si l’État voulait obtenir les renseignements qui nous sont nécessaires, il rencontrerait de grands obstacles dans la négligence des fonctionnaires inférieurs dont il serait obligé de se servir [14] . [II-80] .
Inutile d’ailleurs de rechercher ce que les Américains pourraient faire en pareille matière, puisqu’il est certain que, jusqu’à présent, ils n’ont rien fait.
Il n’existe donc pas aujourd’hui en Amérique ou en Europe un seul homme qui puisse nous apprendre ce que paie annuellement chaque citoyen de l’Union, pour subvenir aux charges de la société [15] . [II-81] .
Concluons qu’il est aussi difficile de comparer avec fruit les dépenses sociales des Américains aux nôtres, que la richesse de l’Union à celle de la France. J’ajoute qu’il serait même dangereux de le tenter. Quand la statistique n’est pas fondée sur des calculs rigoureusement vrais, elle égare au lieu de diriger. L’esprit se laisse prendre aisément aux faux airs d’exactitude qu’elle conserve jusque dans ses écarts, et il se repose sans trouble sur des erreurs qu’on revêt à ses yeux des formes mathématiques de la vérité.
Abandonnons donc les chiffres, et tâchons de trouver nos preuves ailleurs.
Un pays présente-t-il l’aspect de la prospérité matérielle ; après avoir payé l’État, le pauvre y conserve-t-il des ressources et le riche du superflu ; l’un et l’autre y paraissent-ils satisfaits de leur sort, et cherchent-ils chaque jour à l’améliorer encore, de telle sorte que les capitaux ne manquant jamais à l’industrie, l’industrie à son tour ne manque point aux capitaux : tels sont les signes auxquels, faute de documents positifs, il est possible de recourir pour connaître si les charges publiques qui pèsent sur un peuple sont proportionnées à sa richesse.
L’observateur qui s’en tiendrait à ces témoignages jugerait sans doute que l’Américain des États-Unis donne à l’État une moins forte part de son revenu que le Français.
Mais comment pourrait-on concevoir qu’il en fût autrement ?.
Une partie de la dette française est le résultat de deux invasions ; l’Union n’a point à en craindre. [II-82] Notre position nous oblige à tenir habituellement une nombreuse armée sous les armes ; l’isolement de l’Union lui permet de n’avoir que 6,000 soldats. Nous entretenons près de 300 vaisseaux ; les Américains n’en ont que 52 [16] . Comment l’habitant de l’Union pourrait-il payer à l’État autant que l’habitant de la France ?.
Il n’y a donc point de parallèle à établir entre les finances de pays si diversement placés.
C’est en examinant ce qui se passe dans l’Union, et non en comparant l’Union à la France, que nous pouvons juger si la démocratie américaine est véritablement économe.
Je jette les yeux sur chacune des diverses républiques dont se forme la confédération, et je découvre que leur gouvernement manque souvent de persévérance dans ses desseins, et qu’il n’exerce point une surveillance continue sur les hommes qu’il emploie. J’en tire naturellement cette conséquence qu’il doit souvent dépenser inutilement l’argent des contribuables, ou en consacrer plus qu’il n’est nécessaire à ses entreprises.
Je vois que, fidèle à son origine populaire, il fait de prodigieux efforts pour satisfaire les besoins des classes inférieures de la société, leur ouvrir les chemins du pouvoir, et répandre dans leur sein le bien-être et les lumières. Il entretient les pauvres, distribue chaque année des millions aux écoles, paie tous les services et rétribue avec générosité ses moindres agents. Si une pareille manière de [II-83] gouverner me semble utile et raisonnable, je suis obligé de reconnaître qu’elle est dispendieuse.
Je vois le pauvre qui dirige les affaires publiques et dispose des ressources nationales ; et je ne saurais croire que, profitant des dépenses de l’État, il n’entraîne pas souvent l’État dans de nouvelles dépenses.
Je conclus donc, sans avoir recours à des chiffres incomplets, et sans vouloir établir des comparaisons hasardées, que le gouvernement démocratique des Américains n’est pas, comme on le prétend quelquefois, un gouvernement à bon marché ; et je ne crains pas de prédire que, si de grands embarras venaient un jour assaillir les peuples des États-Unis, on verrait chez eux les impôts s’élever aussi haut que dans la plupart des aristocraties ou des monarchies de l’Europe.
DE LA CORRUPTION ET DES VICES DES GOUVERNANTS DANS LA DÉMOCRATIE ; DES EFFETS QUI EN RÉSULTENT SUR LAMORALITÉ PUBLIQUE.
Dans les aristocraties, les gouvernants cherchent quelquefois à corrompre. — Souvent, dans les démocraties, ils se montrent eux-mêmes corrompus. — Dans les premières, les vices attaquent directement la moralité du peuple. — Ils exercent sur lui, dans les secondes, une influence indirecte qui est plus redoutable encore.
L’aristocratie et la démocratie se renvoient mutuellement le reproche de faciliter la corruption ; il faut distinguer :.
Dans les gouvernements aristocratiques, les hommes qui arrivent aux affaires sont des gens riches qui ne désirent que du pouvoir. Dans les [II-84] démocraties, les hommes d’État sont pauvres et ont leur fortune à faire.
Il s’ensuit que, dans les États aristocratiques, les gouvernants sont peu accessibles à la corruption et n’ont qu’un goût très modéré pour l’argent, tandis que le contraire arrive chez les peuples démocratiques.
Mais, dans les aristocraties, ceux qui veulent arriver à la tête des affaires disposant de grandes richesses, et le nombre de ceux qui peuvent les y faire parvenir étant souvent circonscrit entre certaines limites, le gouvernement se trouve en quelque sorte à l’enchère. Dans les démocraties, au contraire, ceux qui briguent le pouvoir ne sont presque jamais riches, et le nombre de ceux qui concourent à le donner est très grand. Peut-être dans les démocraties n’y a-t-il pas moins d’hommes à vendre, mais on n’y trouve presque point d’acheteurs ; et, d’ailleurs, il faudrait acheter trop de monde à la fois pour atteindre le but.
Parmi les hommes qui ont occupé le pouvoir en France depuis quarante ans, plusieurs ont été accusés d’avoir fait fortune aux dépens de l’État et de ses alliés ; reproche qui a été rarement adressé aux hommes publics de l’ancienne monarchie. Mais, en France, il est presque sans exemple qu’on achète le vote d’un électeur à prix d’argent, tandis que la chose se fait notoirement et publiquement en Angleterre.
Je n’ai jamais ouï dire qu’aux États-Unis on employât ses richesses à gagner les gouvernés ; mais souvent j’ai vu mettre en doute la probité des fonctionnaires publics. Plus souvent encore j’ai entendu [II-85] attribuer leurs succès à de basses intrigues ou à des manœuvres coupables.
Si donc les hommes qui dirigent les aristocraties cherchent quelquefois à corrompre, les chefs des démocraties se montrent eux-mêmes corrompus. Dans les unes on attaque directement la moralité du peuple ; on exerce dans les autres, sur la conscience publique, une action indirecte qu’il faut plus redouter encore.
Chez les peuples démocratiques, ceux qui sont à la tête de l’État étant presque toujours en butte à des soupçons fâcheux, donnent en quelque sorte l’appui du gouvernement aux crimes dont on les accuse. Ils présentent ainsi de dangereux exemples à la vertu qui lutte encore, et fournissent des comparaisons glorieuses au vice qui se cache.
En vain dirait-on que les passions déshonnêtes se rencontrent dans tous les rangs ; qu’elles montent souvent sur le trône par droit de naissance ; qu’ainsi on peut rencontrer des hommes fort méprisables à la tête des nations aristocratiques comme au sein des démocraties.
Cette réponse ne me satisfait point : il se découvre, dans la corruption de ceux qui arrivent par hasard au pouvoir, quelque chose de grossier et de vulgaire qui la rend contagieuse pour la foule ; il règne, au contraire, jusque dans la dépravation des grands seigneurs, un certain raffinement aristocratique, un air de grandeur qui souvent empêche qu’elle ne se communique.
Le peuple ne pénétrera jamais dans le labyrinthe obscur de l’esprit de cour ; il découvrira toujours avec [II-86] peine la bassesse qui se cache sous l’élégance des manières, la recherche des goûts et les grâces du langage. Mais voler le trésor public, ou vendre à prix d’argent les faveurs de l’État, le premier misérable comprend cela et peut se flatter d’en faire autant à son tour.
Ce qu’il faut craindre d’ailleurs, ce n’est pas tant la vue de l’immoralité des grands que celle de l’immoralité menant à la grandeur. Dans la démocratie, les simples citoyens voient un homme qui sort de leurs rangs et qui parvient en peu d’années à la richesse et à la puissance ; ce spectacle excite leur surprise et leur envie ; ils recherchent comment celui qui était hier leur égal est aujourd’hui revêtu du droit de les diriger. Attribuer son élévation à ses talents ou à ses vertus est incommode, car c’est avouer qu’eux-mêmes sont moins vertueux et moins habiles que lui. Ils en placent donc la principale cause dans quelques-uns de ses vices, et souvent ils ont raison de le faire. Il s’opère ainsi je ne sais quel odieux mélange entre les idées de bassesse et de pouvoir, d’indignité et de succès, d’utilité et de déshonneur.
DE QUELS EFFORTS LA DÉMOCRATIE EST CAPABLE.
L’Union n’a lutté qu’une seule fois pour son existence — Enthousiasme au commencement de la guerre. — Refroidissement à la fin. — Difficulté d’établir en Amérique la conscription ou l’inscription maritime. — Pourquoi un peuple démocratique est moins capable qu’un autre de grands efforts continus.
Je préviens le lecteur que je parle ici d’un gouvernement qui suit les volontés réelles du peuple, et non [II-87] d’un gouvernement qui se borne seulement à commander au nom du peuple.
Il n’y a rien de si irrésistible qu’un pouvoir tyrannique qui commande au nom du peuple, parce qu’étant revêtu de la puissance morale qui appartient aux volontés du plus grand nombre, il agit en même temps avec la décision, la promptitude et la ténacité qu’aurait un seul homme.
Il est assez difficile de dire de quel degré d’effort est capable un gouvernement démocratique en temps de crise nationale.
On n’a jamais vu jusqu’à présent de grande république démocratique. Ce serait faire injure aux républiques que d’appeler de ce nom l’oligarchie qui régnait sur la France en 1793. Les États-Unis seuls présentent ce spectacle nouveau.
Or, depuis un demi-siècle que l’Union est formée, son existence n’a été mise en question qu’une seule fois, lors de la guerre de l’Indépendance. Au commencement de cette longue guerre, il y eut des traits extraordinaires d’enthousiasme pour le service de la patrie [17] . Mais à mesure que la lutte se prolongeait, on voyait reparaître l’égoïsme individuel : l’argent n’arrivait plus au trésor public ; les hommes ne se présentaient plus à l’armée ; le peuple voulait encore l’indépendance, mais il reculait devant les moyens de l’obtenir. « En vain nous avons multiplié les taxes et [II-88] essayé de nouvelles méthodes de les lever, dit Hamilton dans le Fédéraliste (no 12) ; l’attente publique a toujours été déçue, et le trésor des États est resté vide. Les formes démocratiques de l’administration, qui sont inhérentes à la nature démocratique de notre gouvernement, venant à se combiner avec la rareté du numéraire que produisait l’état languissant de notre commerce, ont jusqu’à présent rendu inutiles tous les efforts qu’on a pu tenter pour lever des sommes considérables. Les différentes législatures ont enfin compris la folie de semblables essais. ».
Depuis cette époque, les États-Unis n’ont pas eu une seule guerre sérieuse à soutenir.
Pour juger quels sacrifices savent s’imposer les démocraties, il faut donc attendre le temps où la nation américaine sera obligée de mettre dans les mains de son gouvernement la moitié du revenu des biens, comme l’Angleterre, ou devra jeter à la fois le vingtième de sa population sur les champs de bataille, ainsi que l’a fait la France.
En Amérique, la conscription est inconnue ; on y enrôle les hommes à prix d’argent. Le recrutement forcé est tellement contraire aux idées, et si étranger aux habitudes du peuple des États-Unis, que je doute qu’on osât jamais l’introduire dans les lois. Ce qu’on appelle en France la conscription forme assurément le plus lourd de nos impôts ; mais, sans la conscription, comment pourrions-nous soutenir une grande guerre continentale ?.
Les Américains n’ont point adopté chez eux la presse des Anglais. Ils n’ont rien qui ressemble à notre inscription maritime. La marine de l’État, comme la [II-89] marine marchande, se recrute à l’aide d’engagements volontaires.
Or, il n’est pas facile de concevoir qu’un peuple puisse soutenir une grande guerre maritime sans recourir à l’un des deux moyens indiqués plus haut : aussi l’Union, qui a déjà combattu sur mer avec gloire, n’a-t-elle jamais eu cependant des flottes nombreuses, et l’armement du petit nombre de ses vaisseaux lui a-t-il toujours coûté très cher.
J’ai entendu des hommes d’État américains avouer que l’Union aura peine à maintenir son rang sur les mers, si elle ne recourt pas à la presse ou à l’inscription maritime ; mais la difficulté est d’obliger le peuple, qui gouverne, à souffrir la presse ou l’inscription maritime.
Il est incontestable que les peuples libres déploient en général, dans les dangers, une énergie infiniment plus grande que ceux qui ne le sont pas, mais je suis porté à croire que ceci est surtout vrai des peuples libres chez lesquels domine l’élément aristocratique. La démocratie me paraît bien plus propre à diriger une société paisible, ou à faire au besoin un subit et vigoureux effort, qu’à braver pendant long-temps les grands orages de la vie politique des peuples. La raison en est simple : les hommes s’exposent aux dangers et aux privations par enthousiasme, mais ils n’y restent longtemps exposés que par réflexion. Il y a dans ce qu’on appelle le courage instinctif lui-même, plus de calcul qu’on ne pense ; et quoique les passions seules fassent faire, en général, les premiers efforts, c’est en vue du résultat qu’on les continue. On risque une partie de ce qui est cher pour sauver le reste. [II-90] .
Or, c’est cette perception claire de l’avenir, fondée sur les lumières et l’expérience, qui doit souvent manquer à la démocratie. Le peuple sent bien plus qu’il ne raisonne ; et si les maux actuels sont grands, il est à craindre qu’il oublie les maux plus grands qui l’attendent peut-être en cas de défaite.
Il y a encore une autre cause qui doit rendre les efforts d’un gouvernement démocratique moins durables que les efforts d’une aristocratie.
Le peuple, non seulement voit moins clairement que les hautes classes ce qu’il peut espérer ou craindre de l’avenir, mais encore il souffre bien autrement qu’elles des maux du présent. Le noble, en exposant sa personne, court autant de chances de gloire que de périls. En livrant à l’État la plus grande partie de son revenu, il se prive momentanément de quelques uns des plaisirs de la richesse ; mais, pour le pauvre, la mort est sans prestige, et l’impôt qui gêne le riche attaque souvent chez lui les sources de la vie.
Cette faiblesse relative des républiques démocratiques, en temps de crise, est peut-être le plus grand obstacle qui s’oppose à ce qu’une pareille république se fonde en Europe. Pour que la république démocratique subsistât sans peine chez un peuple européen, il faudrait qu’elle s’établît en même temps chez tous les autres.
Je crois que le gouvernement de la démocratie doit, à la longue, augmenter les forces réelles de la société ; mais il ne saurait réunir à la fois, sur un point et dans un temps donné, autant de forces qu’un gouvernement aristocratique ou qu’une monarchie absolue. Si un pays démocratique restait soumis pendant [II-91] un siècle au gouvernement républicain, on peut croire qu’au bout du siècle il serait plus riche, plus peuplé et plus prospère que les États despotiques qui l’avoisinent ; mais pendant ce siècle, il aurait plusieurs fois couru le risque d’être conquis par eux.
DU POUVOIR QU’EXERCE EN GÉNÉRAL LA DÉMOCRATIE AMÉRICAINE SUR ELLE-MÊME.
Que le peuple américain ne se prête qu’à la longue, et quelquefois se refuse à faire ce qui est utile à son bien-être. — Faculté qu’ont les Américains de faire des fautes réparables.
Cette difficulté que trouve la démocratie à vaincre les passions et à faire taire les besoins du moment en vue de l’avenir se remarque aux États-Unis dans les moindres choses.
Le peuple, entouré de flatteurs, parvient difficilement à triompher de lui-même. Chaque fois qu’on veut obtenir de lui qu’il s’impose une privation ou une gêne, même dans un but que sa raison approuve, il commence presque toujours par s’y refuser. On vante avec raison l’obéissance que les Américains accordent aux lois. Il faut ajouter qu’en Amérique la législation est faite par le peuple et pour le peuple. Aux États-Unis, la loi se montre donc favorable à ceux qui, partout ailleurs, ont le plus d’intérêt à la violer. Ainsi il est permis de croire qu’une loi gênante, dont la majorité ne sentirait pas l’utilité actuelle, ne serait pas portée ou ne serait pas obéie.
Aux États-Unis, il n’existe pas de législation relative aux banqueroutes frauduleuses. Serait-ce qu’il n’y a [II-92] pas de banqueroutes ? Non, c’est au contraire parce qu’il y en a beaucoup. La crainte d’être poursuivi comme banqueroutier surpasse, dans l’esprit de la majorité, la crainte d’être ruiné par les banqueroutes ; et il se fait dans la conscience publique une sorte de tolérance coupable pour le délit que chacun individuellement condamne.
Dans les nouveaux États du Sud-Ouest, les citoyens se font presque toujours justice à eux-mêmes, et les meurtres s’y renouvellent sans cesse. Cela vient de ce que les habitudes du peuple sont trop rudes, et les lumières trop peu répandues dans ces déserts, pour qu’on sente l’utilité d’y donner force à la loi : on y préfère encore les duels aux procès.
Quelqu’un me disait un jour, à Philadelphie, que presque tous les crimes, en Amérique, étaient causés par l’abus des liqueurs fortes, dont le bas peuple pouvait user à volonté, parce qu’on les lui vendait à vil prix. D’où vient, demandai-je, que vous ne mettez pas un droit sur l’eau-de-vie ? — Nos législateurs y ont bien souvent pensé, répliqua-t-il, mais l’entreprise est difficile. On craint une révolte ; et d’ailleurs, les membres qui voteraient une pareille loi seraient bien sûrs de n’être pas réélus. — Ainsi donc, repris-je, chez vous les buveurs sont en majorité, et la tempérance est impopulaire.
Quand on fait remarquer ces choses aux hommes d’État, ils se bornent à vous répondre : Laissez faire le temps ; le sentiment du mal éclairera le peuple et lui montrera ses besoins. Cela est souvent vrai : si la démocratie a plus de chances de se tromper qu’un roi ou un corps de nobles, elle a aussi plus de chances de [II-93] revenir à la vérité, une fois que la lumière lui arrive, parce qu’il n’y a pas, en général, dans son sein d’intérêts contraires à celui du plus grand nombre, et qui luttent contre la raison. Mais la démocratie ne peut obtenir la vérité que de l’expérience, et beaucoup de peuples ne sauraient attendre, sans périr, les résultats de leurs erreurs.
Le grand privilége des Américains n’est donc pas seulement d’être plus éclairés que d’autres, mais d’avoir la faculté de faire des fautes réparables.
Ajoutez que, pour mettre facilement à profit l’expérience du passé, il faut que la démocratie soit déjà parvenue à un certain degré de civilisation et de lumières.
On voit des peuples dont l’éducation première a été si vicieuse, et dont le caractère présente un si étrange mélange de passions, d’ignorance et de notions erronées de toutes choses, qu’ils ne sauraient d’eux-mêmes discerner la cause de leurs misères ; ils succombent sous des maux qu’ils ignorent.
J’ai parcouru de vastes contrées habitées jadis par de puissantes nations indiennes qui aujourd’hui n’existent plus ; j’ai habité chez des tribus déjà mutilées qui chaque jour voient décroître leur nombre et disparaître l’éclat de leur gloire sauvage ; j’ai entendu ces Indiens eux-mêmes prévoir le destin final réservé à leur race. Il n’y a pas d’Européen, cependant, qui n’aperçoive ce qu’il faudrait faire pour préserver ces peuples infortunés d’une destruction inévitable. Mais eux ne le voient point ; ils sentent les maux qui, chaque année, s’accumulent sur leurs têtes, et ils périront jusqu’au dernier en rejetant le [II-94] remède. Il faudrait employer la force pour les contraindre à vivre.
On s’étonne en apercevant les nouvelles nations de l’Amérique du Sud s’agiter, depuis un quart de siècle, au milieu de révolutions sans cesse renaissantes, et chaque jour on s’attend à les voir rentrer dans ce qu’on appelle leur état naturel. Mais qui peut affirmer que les révolutions ne soient pas, de notre temps, l’état le plus naturel des Espagnols de L’Amérique du Sud ? Dans ce pays, la société se débat au fond d’un abîme dont ses propres efforts ne peuvent la faire sortir.
Le peuple qui habite cette belle moitié d’un hémisphère semble obstinément attaché à se déchirer les entrailles ; rien ne saurait l’en détourner. L’épuisement le fait un instant tomber dans le repos, et le repos le rend bientôt à de nouvelles fureurs. Quand je viens à le considérer dans cet état alternatif de misères et de crimes, je suis tenté de croire que pour lui le despotisme serait un bienfait.
Mais ces deux mots ne pourront jamais se trouver unis dans ma pensée.
DE LA MANIÈRE DONT LA DÉMOCRATIE AMÉRICAINE CONDUIT LES AFFAIRES EXTÉRIEURES DE L’ÉTAT.
Direction donnée à la politique extérieure des États-Unis par Washington et Jefferson. — Presque tous les défauts naturels de la démocratie se font sentir dans la direction des affaires extérieures, et ses qualités y sont peu sensibles.
Nous avons vu que la Constitution fédérale mettait la direction permanente des intérêts extérieurs [II-95] de la nation dans les mains du président et du sénat [18] , ce qui place jusqu’à un certain point la politique générale de l’Union hors de l’influence directe et journalière du peuple. On ne peut donc pas dire d’une manière absolue que ce soit la démocratie qui, en Amérique, conduise les affaires extérieures de l’État.
Il y a deux hommes qui ont imprimé à la politique des Américains une direction qu’on suit encore de nos jours ; le premier est Washington, et Jefferson est le second.
Washington disait, dans cette admirable lettre adressée à ses concitoyens, et qui forme comme le testament politique de ce grand homme :.
« Étendre nos relations commerciales avec les peuples étrangers, et établir aussi peu de liens politiques que possible entre eux et nous, telle doit être la règle de notre politique. Nous devons remplir avec fidélité les engagements déjà contractés, mais il faut nous garder d’en former d’autres.
« L’Europe a un certain nombre d’intérêts qui lui sont propres et qui n’ont pas de rapport, ou qui n’ont qu’un rapport très indirect avec les nôtres ; elle doit donc se trouver fréquemment engagée dans des querelles qui nous sont naturellement étrangères ; nous attacher par des liens artificiels aux vicissitudes de sa politique, entrer dans les différentes [II-96] combinaisons de ses amitiés et de ses haines, et prendre part aux luttes qui en résultent, serait agir imprudemment.
« Notre isolement et notre éloignement d’elle nous invitent à adopter une marche contraire et nous permettent de la suivre. Si nous continuons à former une seule nation, régie par un gouvernement fort, le temps n’est pas loin où nous n’aurons rien à craindre de personne. Alors nous pourrons prendre une attitude qui fasse respecter notre neutralité ; les nations belligérantes, sentant l’impossibilité de rien acquérir sur nous, craindront de nous provoquer sans motifs ; et nous serons en position de choisir la paix ou la guerre, sans prendre d’autres guides de nos actions que notre intérêt et la justice.
« Pourquoi abandonnerions-nous les avantages que nous pouvons tirer d’une situation si favorable ? Pourquoi quitterions-nous un terrain qui nous est propre, pour aller nous établir sur un terrain qui nous est étranger ? Pourquoi, enfin, liant notre destinée à celle d’une portion quelconque de l’Europe, exposerions-nous notre paix et notre prospérité à l’ambition, aux rivalités, aux intérêts ou aux caprices des peuples qui l’habitent ?.
« Notre vraie politique est de ne contracter d’alliance permanente avec aucune nation étrangère ; autant du moins que nous sommes encore libres de ne pas le faire, car je suis bien loin de vouloir qu’on manque aux engagements existants. L’honnêteté est toujours la meilleure politique ; c’est une maxime que je tiens pour également applicable aux affaires des nations et à celles des individus. [II-97] Je pense donc qu’il faut exécuter dans toute leur étendue les engagements que nous avons déjà contractés ; mais je crois inutile et imprudent d’en contracter d’autres. Plaçons-nous toujours de manière à faire respecter notre position, et des alliances temporaires suffiront pour nous permettre de faire face à tous les dangers. ».
Précédemment Washington avait énoncé cette belle et juste idée : « La nation qui se livre à des sentiments habituels d’amour ou de haine envers une autre, devient en quelque sorte esclave. Elle est esclave de sa haine ou de son amour. ».
La conduite politique de Washington fut toujours dirigée d’après ces maximes. Il parvint à maintenir son pays en paix, lorsque tout le reste de l’univers était en guerre, et il établit comme point de doctrine que l’intérêt bien entendu des Américains était de ne jamais prendre parti dans les querelles intérieures de l’Europe.
Jefferson alla plus loin encore, et il introduisit dans la politique de l’Union cette autre maxime : « Que les Américains ne devaient jamais demander de priviléges aux nations étrangères, afin de n’être pas obligés eux-mêmes d’en accorder. ».
Ces deux principes, que leur évidente justesse mit facilement à la portée de la foule, ont extrêmement simplifié la politique extérieure des États-Unis.
L’Union ne se mêlant pas des affaires de l’Europe, n’a pour ainsi dire point d’intérêts extérieurs à débattre, car elle n’a pas encore de voisins puissants en Amérique. Placée par sa situation autant que par sa volonté en dehors des passions de l’Ancien Monde, [II-98] elle n’a pas plus à s’en garantir qu’à les épouser. Quant à celles du Nouveau Monde, l’avenir les cache encore.
L’Union est libre d’engagements antérieurs ; elle profite donc de l’expérience des vieux peuples de l’Europe, sans être obligée, comme eux, de tirer parti du passé et de l’accommoder au présent ; ainsi qu’eux, elle n’est pas forcée d’accepter un immense héritage que lui ont légué ses pères ; mélange de gloire et de misère, d’amitiés et de haines nationales. La politique extérieure des États-Unis est éminemment expectante ; elle consiste bien plus à s’abstenir qu’à faire.
Il est donc bien difficile de savoir, quant à présent, quelle habileté développera la démocratie américaine dans la conduite des affaires extérieures de l’État. Sur ce point, ses adversaires comme ses amis doivent suspendre leur jugement.
Quant à moi, je ne ferai pas difficulté de le dire : C’est dans la direction des intérêts extérieurs de la société que les gouvernements démocratiques me paraissent décidément inférieurs aux autres. L’expérience, les mœurs et l’instruction finissent presque toujours par créer chez la démocratie cette sorte de sagesse pratique de tous les jours, et cette science des petits événements de la vie qu’on nomme le bon sens. Le bon sens suffit au train ordinaire de la société ; et chez un peuple dont l’éducation est faite, la liberté démocratique appliquée aux affaires intérieures de l’État produit plus de biens que les erreurs du gouvernement de la démocratie ne sauraient amener de maux. Mais il n’en est pas toujours ainsi dans les rapports de peuple à peuple. [II-99] .
La politique extérieure n’exige l’usage de presque aucune des qualités qui sont propres à la démocratie, et commande au contraire le développement de presque toutes celles qui lui manquent. La démocratie favorise l’accroissement des ressources intérieures de l’État ; elle répand l’aisance, développe l’esprit public, fortifie le respect à la loi dans les différentes classes de la société ; toutes choses qui n’ont qu’une influence indirecte sur la position d’un peuple vis-à-vis d’un autre. Mais la démocratie ne saurait que difficilement coordonner les détails d’une grande entreprise, s’arrêter à un dessein et le suivre ensuite obstinément à travers les obstacles. Elle est peu capable de combiner des mesures en secret et d’attendre patiemment leur résultat. Ce sont là des qualités qui appartiennent plus particulièrement à un homme ou à une aristocratie. Or, ce sont précisément ces qualités qui font qu’à la longue un peuple, comme individu, finit par dominer.
Si au contraire vous faites attention aux défauts naturels de l’aristocratie, vous trouverez que l’effet qu’ils peuvent produire n’est presque point sensible dans la direction des affaires extérieures de l’État. Le vice capital qu’on reproche à l’aristocratie, c’est de ne travailler que pour elle seule, et non pour la masse. Dans la politique extérieure, il est très rare que l’aristocratie ait un intérêt distinct de celui du peuple.
La pente qui entraîne la démocratie à obéir, en politique, à des sentiments plutôt qu’à des raisonnements, et à abandonner un dessein long-temps mûri pour la satisfaction d’une passion momentanée, se fit bien voir en Amérique lorsque la révolution [II-100] française éclata. Les plus simples lumières de la raison suffisaient alors, comme aujourd’hui, pour faire concevoir aux Américains que leur intérêt n’était point de s’engager dans la lutte qui allait ensanglanter l’Europe, et dont les États-Unis ne pouvaient souffrir aucun dommage.
Les sympathies du peuple en faveur de la France se déclarèrent cependant avec tant de violence qu’il ne fallut rien moins que le caractère inflexible de Washington et l’immense popularité dont il jouissait pour empêcher qu’on ne déclarât la guerre à l’Angleterre. Et, encore, les efforts que fit l’austère raison de ce grand homme pour lutter contre les passions généreuses, mais irréfléchies, de ses concitoyens, faillirent-ils lui enlever la seule récompense qu’il se fût jamais réservée, l’amour de son pays. La majorité se prononça contre sa politique ; maintenant le peuple entier l’approuve [19] .
Si la Constitution et la faveur publique n’eussent pas donné à Washington la direction des affaires [II-101] extérieures de l’État, il est certain que la nation aurait précisément fait alors ce qu’elle condamne aujourd’hui.
Presque tous les peuples qui ont agi fortement sur le monde, ceux qui ont conçu, suivi et exécuté de grands desseins, depuis les Romains jusqu’aux Anglais, étaient dirigés par une aristocratie, et comment s’en étonner ?.
Ce qu’il y a de plus fixe au monde dans ses vues, c’est une aristocratie. La masse du peuple peut être séduite par son ignorance ou ses passions ; on peut surprendre l’esprit d’un roi et le faire vaciller dans ses projets ; et d’ailleurs un roi n’est point immortel. Mais un corps aristocratique est trop nombreux pour être capté, trop peu nombreux pour céder aisément à l’enivrement de passions irréfléchies. Un corps aristocratique est un homme ferme et éclairé qui ne meurt point. [II-102] .
[II-102]
CHAPITRE VI.↩
QUELS SONT LES AVANTAGES RÉELS QUE LA SOCIÉTÉ AMÉRICAINE RETIRE DU GOUVERNEMENT DE LA DÉMOCRATIE.
Avant de commencer le présent chapitre, je sens le besoin de rappeler au lecteur ce que j’ai déjà indiqué plusieurs fois dans le cours de ce livre.
La constitution politique des États-Unis me paraît l’une des formes que la démocratie peut donner à son gouvernement ; mais je ne considère pas les institutions américaines comme les seules ni comme les meilleures qu’un peuple démocratique doive adopter.
En faisant connaître quels biens les Américains retirent du gouvernement de la démocratie, je suis donc loin de prétendre ni de penser que de pareils avantages ne puissent être obtenus qu’à l’aide des mêmes lois.
DE LA TENDANCE GÉNÉRALE DES LOIS SOUS L’EMPIRE DE LA DÉMOCRATIE AMÉRICAINE, ET DE L’INSTINCT DE CEUX QUI LES APPLIQUENT.
Les vices de la démocratie se voient tout d’un coup. — Ses avantages ne s’aperçoivent qu’à la longue. — La démocratie américaine est souvent inhabile, mais la tendance générale de ses lois est profitable. — Les fonctionnaires publics, sous la démocratie américaine, n’ont point d’intérêts permanents qui diffèrent de ceux du plus grand nombre. — Ce qui en résulte.
Les vices et les faiblesses du gouvernement de la démocratie se voient sans peine ; on les démontre par [II-103] des faits patents, tandis que son influence salutaire s’exerce d’une manière insensible, et pour ainsi dire occulte. Ses défauts frappent du premier abord, mais ses qualités ne se découvrent qu’à la longue.
Les lois de la démocratie américaine sont souvent défectueuses ou incomplètes ; il leur arrive de violer des droits acquis, ou d’en sanctionner de dangereux : fussent-elles bonnes, leur fréquence serait encore un grand mal. Tout ceci s’aperçoit au premier coup d’œil.
D’où vient donc que les républiques américaines se maintiennent et prospèrent ?.
On doit distinguer soigneusement, dans les lois, le but qu’elles poursuivent, de la manière dont elles marchent vers ce but ; leur bonté absolue, de celle qui n’est que relative.
Je suppose que l’objet du législateur soit de favoriser les intérêts du petit nombre aux dépens de ceux du grand ; ses dispositions sont combinées de façon à obtenir le résultat qu’il se propose dans le moins de temps et avec le moins d’efforts possibles. La loi sera bien faite, son but mauvais ; elle sera dangereuse en proportion de son efficacité même.
Les lois de la démocratie tendent en général au bien du plus grand nombre, car elles émanent de la majorité de tous les citoyens, laquelle peut se tromper, mais ne saurait avoir un intérêt contraire à elle-même.
Celles de l’aristocratie tendent au contraire à monopoliser dans les mains du petit nombre la richesse et le pouvoir, parce que l’aristocratie forme toujours de sa nature une minorité. [II-104] .
On peut donc dire, d’une manière générale, que l’objet de la démocratie, dans sa législation, est plus utile à l’humanité que l’objet de l’aristocratie dans la sienne.
Mais là finissent ses avantages.
L’aristocratie est infiniment plus habile dans la science du législateur que ne saurait l’être la démocratie. Maîtresse d’elle-même, elle n’est point sujette à des entraînements passagers ; elle a de longs desseins qu’elle sait mûrir jusqu’à ce que l’occasion favorable se présente. L’aristocratie procède savamment ; elle connaît l’art de faire converger en même temps, vers un même point, la force collective de toutes ses lois.
Il n’en est pas ainsi de la démocratie : ses lois sont presque toujours défectueuses ou intempestives.
Les moyens de la démocratie sont donc plus imparfaits que ceux de l’aristocratie : souvent elle travaille, sans le vouloir, contre elle-même ; mais son but est plus utile.
Imaginez une société que la nature, ou sa constitution, ait organisée de manière à supporter l’action passagère de mauvaises lois, et qui puisse attendre sans périr le résultat de la tendance générale des lois, et vous concevrez que le gouvernement de la démocratie, malgré ses défauts, soit encore de tous le plus propre à faire prospérer cette société.
C’est précisément là ce qui arrive aux États-Unis ; je répète ici ce que j’ai déjà exprimé ailleurs : le grand privilège des Américains est de pouvoir faire des fautes réparables. [II-105] .
Je dirai quelque chose d’analogue sur les fonctionnaires publics.
Il est facile de voir que la démocratie américaine se trompe souvent dans le choix des hommes auxquels elle confie le pouvoir ; mais il n’est pas aussi aisé de dire pourquoi l’État prospère en leurs mains.
Remarquez d’abord que si, dans un État démocratique, les gouvernants sont moins honnêtes ou moins capables, les gouvernés sont plus éclairés et plus attentifs.
Le peuple, dans les démocraties, occupe comme il l’est sans cesse de ses affaires, et jaloux de ses droits, empêche ses représentants de s’écarter d’une certaine ligne générale que son intérêt lui trace.
Remarquez encore que si le magistrat démocratique use plus mal qu’un autre du pouvoir, il le possède en général moins long-temps.
Mais il y a une raison plus générale que celle-là, et plus satisfaisante.
Il importe sans doute au bien des nations que les gouvernants aient des vertus ou des talents ; mais ce qui, peut-être, leur importe encore davantage, c’est que les gouvernants n’aient pas d’intérêts contraires à la masse des gouvernés ; car, dans ce cas, les vertus pourraient devenir presque inutiles, et les talents funestes.
J’ai dit qu’il importait que les gouvernants n’aient point d’intérêts contraires ou différents de la masse des gouvernés ; je n’ai point dit qu’il importait qu’ils eussent des intérêts semblables à ceux de tous les gouvernés, car je ne sache point que la chose se soit encore rencontrée. [II-106] .
On n’a point découvert jusqu’ici de forme politique qui favorisât également le développement et la prospérité de toutes les classes dont la société se compose. Ces classes ont continué à former comme autant de nations distinctes dans la même nation, et l’expérience a prouvé qu’il était presque aussi dangereux de s’en remettre complétement à aucune d’elles du sort des autres, que de faire d’un peuple l’arbitre des destinées d’un autre peuple. Lorsque les riches seuls gouvernent, l’intérêt des pauvres est toujours en péril ; et lorsque les pauvres font la loi, celui des riches court de grands hasards. Quel est donc l’avantage de la démocratie ? L’avantage réel de la démocratie n’est pas, comme on l’a dit, de favoriser la prospérité de tous, mais seulement de servir au bien-être du plus grand nombre.
Ceux qu’on charge, aux États-Unis, de diriger les affaires du public, sont souvent inférieurs en capacité et en moralité aux hommes que l’aristocratie porterait au pouvoir ; mais leur intérêt se confond et s’identifie avec celui de la majorité de leurs concitoyens. Ils peuvent donc commettre de fréquentes infidélités et de graves erreurs, mais ils ne suivront jamais systématiquement une tendance hostile à cette majorité ; et il ne saurait leur arriver d’imprimer au gouvernement une allure exclusive et dangereuse.
La mauvaise administration d’un magistrat, sous la démocratie, est d’ailleurs un fait isolé qui n’a d’influence que pendant la courte durée de cette administration. La corruption et l’incapacité ne sont pas des intérêts communs qui puissent lier entre eux les hommes d’une manière permanente. [II-107] .
Un magistrat corrompu, ou incapable, ne combinera pas ses efforts avec un autre magistrat, par la seule raison que ce dernier est incapable et corrompu comme lui, et ces deux hommes ne travailleront jamais de concert à faire fleurir la corruption et l’incapacité chez leurs arrière-neveux. L’ambition et les manœuvres de l’un serviront, au contraire, à démasquer l’autre. Les vices du magistrat, dans les démocraties, lui sont en général tout personnels.
Mais les hommes publics, sous le gouvernement de l’aristocratie, ont un intérêt de classe qui, s’il se confond quelquefois avec celui de la majorité, en reste souvent distinct. Cet intérêt forme entre eux un lien commun et durable ; il les invite à unir et à combiner leurs efforts vers un but qui n’est pas toujours le bonheur du plus grand nombre : il ne lie pas seulement les gouvernants les uns aux autres ; il les unit encore à une portion considérable de gouvernés ; car beaucoup de citoyens, sans être revêtus d’aucun emploi, font partie de l’aristocratie.
Le magistrat aristocratique rencontre donc un appui constant dans la société, en même temps qu’il en trouve un dans le gouvernement.
Cet objet commun, qui, dans les aristocraties, unit les magistrats à l’intérêt d’une partie de leurs contemporains, les identifie encore et les soumet pour ainsi dire à celui des races futures. Ils travaillent pour l’avenir aussi bien que pour le présent. Le magistrat aristocratique est donc poussé tout à la fois vers un même point, par les passions des gouvernés, par les siennes propres, et je pourrais presque dire par les passions de sa postérité. [II-108] .
Comment s’étonner s’il ne résiste point ? Aussi voit-on souvent, dans les aristocraties, l’esprit de classe entraîner ceux mêmes qu’il ne corrompt pas, et faire qu’à leur insu ils accommodent peu à peu la société à leur usage, et la préparent pour leurs descendants.
Je ne sais s’il a jamais existé une aristocratie aussi libérale que celle d’Angleterre, et qui ait, sans interruption, fourni au gouvernement du pays des hommes aussi dignes et aussi éclairés.
Il est cependant facile de reconnaître que dans la législation anglaise le bien du pauvre a fini par être souvent sacrifié à celui du riche, et les droits du plus grand nombre aux privilèges de quelques-uns : aussi l’Angleterre, de nos jours, réunit-elle dans son sein tout ce que la fortune a de plus extrême, et l’on y rencontre des misères qui égalent presque sa puissance et sa gloire.
Aux États-Unis, où les fonctionnaires publics n’ont point d’intérêt de classe à faire prévaloir, la marche générale et continue du gouvernement est bienfaisante, quoique les gouvernants soient souvent inhabiles, et quelquefois méprisables.
Il y a donc, au fond des institutions démocratiques, une tendance cachée qui fait souvent concourir les hommes à la prospérité générale, malgré leurs vices ou leurs erreurs, tandis que dans les institutions aristocratiques, il se découvre quelquefois une pente secrète qui, en dépit des talents et des vertus, les entraîne à contribuer aux misères de leurs semblables. C’est ainsi qu’il peut arriver que, dans les gouvernements aristocratiques, les hommes publics [II-109] fassent le mal sans le vouloir, et que dans les démocraties ils produisent le bien sans en avoir la pensée.
DE L’ESPRIT PUBLIC AUX ÉTATS-UNIS.
Amour instinctif de la patrie. — Patriotisme réfléchi. — Leurs différents caractères. — Que les peuples doivent tendre de toutes leurs forces vers le second quand le premier disparaît. — Efforts qu’ont faits les Américains pour y parvenir. — L’intérêt de l’individu intimement lié à celui du pays.
Il existe un amour de la patrie qui a principalement sa source dans ce sentiment irréfléchi, désintéressé et indéfinissable, qui lie le cœur de l’homme aux lieux ou l’homme a pris naissance. Cet amour instinctif se confond avec le goût des coutumes anciennes, avec le respect des aïeux et la mémoire du passé ; ceux qui l’éprouvent chérissent leur pays comme on aime la maison paternelle. Ils aiment la tranquillité dont ils y jouissent ; ils tiennent aux paisibles habitudes qu’ils y ont contractées ; ils s’attachent aux souvenirs qu’elle leur présente, et trouvent même quelque douceur à y vivre dans l’obéissance. Souvent cet amour de la patrie est encore exalté par le zèle religieux, et alors on lui voit faire des prodiges. Lui-même est une sorte de religion ; il ne raisonne point, il croit, il sent, il agit. Des peuples se sont rencontrés qui ont, en quelque façon, personnifié la patrie, et qui l’ont entrevue dans le prince. Ils ont donc transporté en lui une partie des sentiments dont le patriotisme se compose ; ils se sont enorgueillis de ses triomphes, et ont été fiers de sa [II-110] puissance. Il fut un temps, sous l’ancienne monarchie, où les Français éprouvaient une sorte de joie en se sentant livrés sans recours à l’arbitraire du monarque, et disaient avec orgueil : « Nous vivons sous le plus puissant roi du monde. ».
Comme toutes les passions irréfléchies, cet amour du pays pousse à de grands efforts passagers plutôt qu’à la continuité des efforts. Après avoir sauvé l’État en temps de crise, il le laisse souvent dépérir au sein de la paix.
Lorsque les peuples sont encore simples dans leurs mœurs et fermes dans leur croyance ; quand la société repose doucement sur un ordre de choses ancien, dont la légitimité n’est point contestée, on voit régner cet amour instinctif de la patrie.
Il en est un autre plus rationnel que celui-là ; moins généreux, moins ardent peut-être, mais plus fécond et plus durable ; celui-ci naît des lumières ; il se développe à l’aide des lois, il croît avec l’exercice des droits et il finit, en quelque sorte, par se confondre avec l’intérêt personnel. Un homme comprend l’influence qu’a le bien-être du pays sur le sien propre ; il sait que la loi lui permet de contribuer à produire ce bien-être, et il s’intéresse à la prospérité de son pays, d’abord comme à une chose qui lui est utile, et ensuite comme à son ouvrage.
Mais il arrive quelquefois, dans la vie des peuples, un moment où les coutumes anciennes sont changées, les mœurs détruites, les croyances ébranlées, le prestige des souvenirs évanoui, et où, cependant, les lumières sont restées incomplètes et les droits politiques mal assurés ou restreints. Les hommes alors [II-111] n’aperçoivent plus la patrie que sous un jour faible et douteux ; ils ne la placent plus ni dans le sol, qui est devenu à leurs yeux une terre inanimée, ni dans les usages de leurs aïeux, qu’on leur a appris à regarder comme un joug ; ni dans la religion, dont ils doutent ; ni dans les lois qu’ils ne font pas, ni dans le législateur qu’ils craignent et méprisent. Ils ne la voient donc nulle part, pas plus sous ses propres traits que sous aucun autre, et ils se retirent dans un égoïsme étroit et sans lumière. Ces hommes échappent aux préjugés sans reconnaître l’empire de la raison ; ils n’ont ni le patriotisme instinctif de la monarchie, ni le patriotisme réfléchi de la république ; mais ils se sont arrêtés entre les deux, au milieu de la confusion et des misères.
Que faire en un pareil état ? Reculer. Mais les peuples ne reviennent pas plus aux sentiments de leur jeunesse, que les hommes aux goûts innocents de leur premier âge ; ils peuvent les regretter, mais non les faire renaître. Il faut donc marcher en avant, et se hâter d’unir aux yeux du peuple l’intérêt individuel à l’intérêt du pays, car l’amour désintéressé de la patrie fuit sans retour.
Je suis assurément loin de prétendre que pour arriver à ce résultat on doive accorder tout-à-coup l’exercice des droits politiques à tous les hommes ; mais je dis que le plus puissant moyen, et peut-être le seul qui nous reste, d’intéresser les hommes au sort de leur patrie, c’est de les faire participer à son gouvernement. De nos jours, l’esprit de cité me semble inséparable de l’exercice des droits politiques ; et je pense que désormais on verra augmenter ou diminuer [II-112] en Europe le nombre des citoyens en proportion de l’extension de ces droits.
D’où vient qu’aux États-Unis, où les habitants sont arrivés d’hier sur le sol qu’ils occupent, où ils n’y ont apporté ni usages, ni souvenirs ; où ils s’y rencontrent pour la première fois sans se connaître ; où, pour le dire en un mot, l’instinct de la patrie peut à peine exister ; d’où vient que chacun s’intéresse aux affaires de sa commune, de son canton et de l’État tout entier comme aux siennes mêmes ? C’est que chacun, dans sa sphère, prend une part active au gouvernement de la société.
L’homme du peuple, aux États-Unis, a compris l’influence qu’exerce la prospérité générale sur son bonheur, idée si simple et cependant si peu connue du peuple. De plus, il s’est accoutumé à regarder cette prospérité comme son ouvrage. Il voit donc dans la fortune publique la sienne propre, et il travaille au bien de l’État, non seulement par devoir ou par orgueil, mais j’oserais presque dire par cupidité.
On n’a pas besoin d’étudier les institutions et l’histoire des Américains pour connaître la vérité de ce qui précède, les mœurs vous en avertissent assez. L’Américain prenant part à tout ce qui se fait dans son pays, se croit intéressé à défendre tout ce qu’on y critique ; car ce n’est pas seulement son pays qu’on attaque alors, c’est lui-même : aussi voit-on son orgueil national recourir à tous les artifices et descendre à toutes les puérilités de la vanité individuelle.
Il n’y a rien de plus gênant dans l’habitude de la [II-113] vie que ce patriotisme irritable des Américains. L’étranger consentirait bien à louer beaucoup dans leur pays ; mais il voudrait qu’on lui permît de blâmer quelque chose, et c’est ce qu’on lui refuse absolument.
L’Amérique est donc un pays de liberté, où, pour ne blesser personne, l’étranger ne doit parler librement ni des particuliers, ni de l’État, ni des gouvernés, ni des gouvernants, ni des entreprises publiques, ni des entreprises privées ; de rien enfin de ce qu’on y rencontre, sinon peut-être du climat et du sol ; encore trouve-t-on des Américains prêts à défendre l’un et l’autre, comme s’ils avaient concouru à les former.
De nos jours, il faut savoir prendre son parti, et oser choisir entre le patriotisme de tous et le gouvernement du petit nombre; car on ne peut réunir à la fois la force et l’activité sociales que donne le premier, avec les garanties de tranquillité que fournit quelquefois le second.
DE L’IDÉE DES DROITS AUX ÉTATS-UNIS.
Il n’y a pas de grands peuples sans idée des droits. — Quel est le moyen de donner au peuple l’idée des droits. — Respect des droits aux États-Unis. — D’où il naît.
Après l’idée générale de la vertu, je n’en sais pas de plus belle que celle des droits, ou plutôt ces deux idées se confondent. L’idée des droits n’est autre chose que l’idée de la vertu introduite dans le monde politique.
C’est avec l’idée des droits que les hommes ont défini ce qu’étaient la licence et la tyrannie. Éclairé [II-114] par elle, chacun a pu se montrer indépendant sans arrogance et soumis sans bassesse. L’homme qui obéit à la violence se plie et s’abaisse ; mais quand il se soumet au droit de commander qu’il reconnaît à son semblable, il s’élève en quelque sorte au-dessus de celui même qui lui commande. Il n’est pas de grands hommes sans vertu ; sans respect des droits il n’y a pas de grand peuple : on peut presque dire qu’il n’y a pas de société ; car qu’est-ce qu’une réunion d’êtres rationnels et intelligents dont la force est le seul lien ?.
Je me demande quel est, de nos jours, le moyen d’inculquer aux hommes l’idée des droits, et de le faire pour ainsi dire tomber sous leur sens ; et je n’en vois qu’un seul, c’est de leur donner à tous le paisible exercice de certains droits : on voit bien cela chez les enfants, qui sont des hommes, à la force et à l’expérience près. Lorsque l’enfant commence à se mouvoir au milieu des objets extérieurs, l’instinct le porte à mettre à son usage tout ce qui se rencontre sous ses mains ; il n’a pas d’idée de la propriété des autres, pas même de celle de l’existence ; mais a mesure qu’il est averti du prix des choses, et qu’il découvre qu’on peut à son tour l’en dépouiller, il devient plus circonspect et finit par respecter dans ses semblables ce qu’il veut qu’on respecte en lui.
Ce qui arrive à l’enfant pour ses jouets, arrive plus tard à l’homme pour tous les objets qui lui appartiennent. Pourquoi en Amérique, pays de démocratie par excellence, personne ne fait-il entendre contre la propriété en général ces plaintes qui [II-115] souvent retentissent en Europe ? Est-il besoin de le dire ? c’est qu’en Amérique il n’y a point de prolétaires. Chacun ayant un bien particulier à défendre, reconnaît en principe le droit de propriété.
Dans le monde politique il en est de même. En Amérique, l’homme du peuple a conçu une haute idée des droits politiques, parce qu’il a des droits politiques ; il n’attaque pas ceux d’autrui pour qu’on ne viole pas les siens. Et tandis qu’en Europe ce même homme méconnaît jusqu’à l’autorité souveraine, l’Américain se soumet sans murmurer au pouvoir du moindre de ses magistrats.
Cette vérité paraît jusque dans les plus petits détails de l’existence des peuples. En France, il y a peu de plaisirs exclusivement réservés aux classes supérieures de la société ; le pauvre est admis presque partout où le riche peut entrer : aussi le voit-on se conduire avec décence et respecter tout ce qui sert à des jouissances qu’il partage. En Angleterre, où la richesse a le privilége de la joie comme le monopole du pouvoir, on se plaint que quand le pauvre parvient à s’introduire furtivement dans le lieu destiné aux plaisirs du riche, il aime à y causer des dégâts inutiles : comment s’en étonner ? on a pris soin qu’il n’ait rien à perdre.
Le gouvernement de la démocratie fait descendre l’idée des droits politiques jusqu’au moindre des citoyens, comme la division des biens met l’idée du droit de propriété en général à la portée de tous les hommes. C’est là un de ses plus grands mérites à mes yeux.
Je ne dis point que ce soit chose aisée que [II-116] d’apprendre à tous les hommes à se servir des droits politiques ; je dis seulement que, quand cela peut être, les effets qui en résultent sont grands.
Et j’ajoute que s’il est un siècle où une pareille entreprise doive être tentée, ce siècle est le nôtre.
Ne voyez-vous pas que les religions s’affaiblissent et que la notion divine des droits disparaît ? Ne découvrez-vous point que les mœurs s’altèrent, et qu’avec elles s’efface la notion morale des droits ?.
N’apercevez-vous pas de toutes parts les croyances qui font place aux raisonnements, et les sentiments aux calculs ? Si, au milieu de cet ébranlement universel, vous ne parvenez à lier l’idée des droits à l’intérêt personnel qui s’offre comme le seul point immobile dans le cœur humain, que vous restera-t-il donc pour gouverner le monde, sinon la peur ?.
Lors donc qu’on me dit que les lois sont faibles, et les gouvernés turbulents ; que les passions sont vives, et la vertu sans pouvoir, et que dans cette situation il ne faut point songer à augmenter les droits de la démocratie; je réponds que c’est à cause de ces choses mêmes que je crois qu’il faut y songer ; et, en vérité, je pense que les gouvernements y sont plus intéressés encore que la société, car les gouvernements périssent, et la société ne saurait mourir. Du reste, je ne veux point abuser de l’exemple de l’Amérique.
En Amérique, le peuple a été revêtu de droits politiques à une époque où il lui était difficile d’en faire un mauvais usage, parce que les citoyens étaient en petit nombre et simples de mœurs. En grandissant, les Américains n’ont point accru pour ainsi dire les [II-117] pouvoirs de la démocratie ; ils ont plutôt étendu ses domaines.
On ne peut douter que le moment où l’on accorde des droits politiques à un peuple qui en a été privé jusqu’alors, ne soit un moment de crise, crise souvent nécessaire, mais toujours dangereuse.
L’enfant donne la mort quand il ignore le prix de la vie ; il enlève la propriété d’autrui avant de connaître qu’on peut lui ravir la sienne. L’homme du peuple, à l’instant où on lui accorde des droits politiques, se trouve, par rapport à ses droits, dans la même position que l’enfant vis-à-vis de toute la nature, et c’est le cas de lui appliquer ce mot célèbre : Homo puer robustus.
Cette vérité se découvre en Amérique même. Les États où les citoyens jouissent le plus anciennement de leurs droits sont ceux où ils savent encore le mieux s’en servir.
On ne saurait trop le dire : il n’est rien de plus fécond en merveilles que l’art d’être libre ; mais il n’y a rien de plus dur que l’apprentissage de la liberté. Il n’en est pas de même du despotisme. Le despotisme se présente souvent comme le réparateur de tous les maux soufferts ; il est l’appui du bon droit, le soutien des opprimés et le fondateur de l’ordre. Les peuples s’endorment au sein de la prospérité momentanée qu’il fait naître ; et lorsqu’ils se réveillent, ils sont misérables. La liberté, au contraire, naît d’ordinaire au milieu des orages, elle s’établit péniblement parmi les discordes civiles et ce n’est que quand elle est déjà vieille qu’on peut connaître ses bienfaits. [II-118]
DU RESPECT POUR LA LOI AUX ÉTATS-UNIS.
Respect des Américains pour la loi. — Amour paternel qu’ils ressentent pour elle. — Intérêt personnel que chacun trouve à augmenter la puissance de la loi.
Il n’est pas toujours loisible d’appeler le peuple entier, soit directement, soit indirectement, à la confection de la loi ; mais on ne saurait nier que, quand cela est praticable, la loi n’en acquière une grande autorité. Cette origine populaire, qui nuit souvent à la bonté et à la sagesse de la législation, contribue singulièrement à sa puissance.
Il y a dans l’expression des volontés de tout un peuple une force prodigieuse. Quand elle se découvre au grand jour, l’imagination même de ceux qui voudraient lutter contre elle en est comme accablée.
La vérité de ceci est bien connue des partis.
Aussi les voit-on contester la majorité partout où ils le peuvent. Quand elle leur manque parmi ceux qui ont voté, ils la placent parmi ceux qui se sont abstenus de voter, et lorsque là encore elle vient à leur échapper, ils la retrouvent au sein de ceux qui n’avaient pas le droit de voter.
Aux États-Unis, excepté les esclaves, les domestiques et les indigents nourris par les communes, il n’est personne qui ne soit électeur, et qui a ce titre ne concoure indirectement à la loi. Ceux qui veulent attaquer les lois sont donc réduits à faire ostensiblement l’une de ces deux choses : ils doivent ou changer l’opinion de la nation, ou fouler aux pieds ses volontés.
Ajoutez à cette première raison cette autre plus directe et plus puissante, qu’aux États-Unis chacun [II-119] trouve une sorte d’intérêt personnel à ce que tous obéissent aux lois ; car celui qui aujourd’hui ne fait pas partie de la majorité, sera peut-être demain dans ses rangs ; et ce respect qu’il professe maintenant pour les volontés du législateur, il aura bientôt occasion de l’exiger pour les siennes. Quelque fâcheuse que soit la loi, l’habitant des États-Unis s’y soumet donc sans peine, non seulement comme à l’ouvrage du plus grand nombre, mais encore comme au sien propre ; il la considère sous le point de vue d’un contrat dans lequel il aurait été partie.
On ne voit donc pas, aux États-Unis, une foule nombreuse et toujours turbulente, qui, regardant la loi comme un ennemi naturel, ne jette sur elle que des regards de crainte et de soupçons. Il est impossible, au contraire, de ne point apercevoir que toutes les classes montrent une grande confiance dans la législation qui régit le pays, et ressentent pour elle une sorte d’amour paternel.
Je me trompe en disant toutes les classes. En Amérique, l’échelle européenne des pouvoirs étant renversée, les riches se trouvent dans une position analogue à celle des pauvres en Europe ; ce sont eux qui souvent se défient de la loi. Je l’ai dit ailleurs : l’avantage réel du gouvernement démocratique n’est pas de garantir les intérêts de tous, ainsi qu’on l’a prétendu quelquefois, mais seulement de protéger ceux du plus grand nombre. Aux États-Unis, où le pauvre gouverne, les riches ont toujours à craindre qu’il n’abuse contre eux de son pouvoir.
Cette disposition de l’esprit des riches peut produire un mécontentement sourd ; mais la société n’en [II-120] est pas violemment troublée ; car la même raison qui empêche le riche d’accorder sa confiance au législateur, l’empêche de braver ses commandements. Il ne fait pas la loi parce qu’il est riche, et il n’ose la violer à cause de sa richesse. Chez les nations civilisées, il n’y a en général que ceux qui n’ont rien à perdre qui se révoltent. Ainsi donc, si les lois de la démocratie ne sont pas toujours respectables, elles sont presque toujours respectées ; car ceux qui en général violent les lois ne peuvent manquer d’obéir à celles qu’ils ont faites et dont ils profitent, et les citoyens qui pourraient avoir intérêt à les enfreindre sont portés par caractère et par position à se soumettre aux volontés quelconques du législateur. Au reste, le peuple, en Amérique, n’obéit pas seulement à la loi parce qu’elle est son ouvrage, mais encore parce qu’il peut la changer, quand par hasard elle le blesse ; il s’y soumet d’abord comme à un mal qu’il s’est imposé à lui-même, et ensuite comme à un mal passager.
ACTIVITÉ QUI RÈGNE DANS TOUTES LES PARTIES DU CORPS POLITIQUE AUX ÉTATS-UNIS ; INFLUENCE QU’ELLE EXERCE SUR LA SOCIÉTÉ.
Il est plus difficile de concevoir l’activité politique qui règne aux États-Unis que la liberté ou l’égalité qu’on y rencontre. — Le grand mouvement qui agite sans cesse les législatures n’est qu’un épisode, un prolongement de ce mouvement universel. — Difficulté que trouve l’Américain à ne s’occuper que de ses propres affaires. — L’agitation politique se propage dans la société civile. — Activité industrielle des Américains venant en partie de cette cause. — Avantages indirects que retire la société du gouvernement de la démocratie.
Quand on passe d’un pays libre dans un autre qui ne l’est pas, on est frappé d’un spectacle fort [II-121] extraordinaire : là, tout est activité et mouvement ; ici, tout semble calme et immobile. Dans l’un, il n’est question que d’amélioration et de progrès ; on dirait que la société, dans l’autre, après avoir acquis tous les biens, n’aspire qu’à se reposer pour en jouir. Cependant, le pays qui se donne tant d’agitation pour être heureux est en général plus riche et plus prospère que celui qui paraît si satisfait de son sort. Et en les considérant l’un et l’autre, on a peine à concevoir comment tant de besoins nouveaux se font sentir chaque jour dans le premier, tandis qu’on semble en éprouver si peu dans le second.
Si cette remarque est applicable aux pays libres qui ont conservé la forme monarchique et à ceux où l’aristocratie domine, elle l’est bien plus encore aux républiques démocratiques. Là, ce n’est plus une portion du peuple qui entreprend d’améliorer l’état de la société ; le peuple entier se charge de ce soin. Il ne s’agit pas seulement de pourvoir aux besoins et aux commodités d’une classe, mais de toutes les classes en même temps.
Il n’est pas impossible de concevoir l’immense liberté dont jouissent les Américains ; on peut aussi se faire une idée de leur extrême égalité ; mais ce qu’on ne saurait comprendre sans en avoir déjà été le témoin, c’est l’activité politique qui règne aux États-Unis.
À peine êtes-vous descendu sur le sol de l’Amérique, que vous vous trouvez au milieu d’une sorte de tumulte ; une clameur confuse s’élève de toutes parts ; mille voix parviennent en même temps à votre oreille ; chacune d’elles exprime quelques besoins sociaux. [II-122] Autour de vous, tout se remue : ici, le peuple d’un quartier est réuni pour savoir si l’on doit bâtir une église ; là, on travaille au choix d’un représentant ; plus loin, les députés d’un canton se rendent en toute hâte à la ville, afin d’aviser à certaines améliorations locales ; dans un autre endroit, ce sont les cultivateurs d’un village qui abandonnent leurs sillons pour aller discuter le plan d’une route ou d’une école. Des citoyens s’assemblent, dans le seul but de déclarer qu’ils désapprouvent la marche du gouvernement; tandis que d’autres se réunissent afin de proclamer que les hommes en place sont les pères de la patrie. En voici d’autres encore qui, regardant l’ivrognerie comme la source principale des maux de l’État, viennent s’engager solennellement à donner l’exemple de la tempérance [20] .
Le grand mouvement politique qui agite sans cesse les législatures américaines, le seul dont on s’aperçoive au-dehors, n’est qu’un épisode et une sorte de prolongement de ce mouvement universel qui commence dans les derniers rangs du peuple, et gagne ensuite, de proche en proche, toutes les classes des citoyens. On ne saurait travailler plus laborieusement à être heureux.
Il est difficile de dire quelle place occupent les soins de la politique dans la vie d’un homme aux États-Unis. Se mêler du gouvernement de la société [II-123] et en parler, c’est la plus grande affaire et pour ainsi dire le seul plaisir qu’un Américain connaisse. Ceci s’aperçoit jusque dans les moindres habitudes de sa vie : les femmes elles-mêmes se rendent souvent aux assemblées publiques et se délassent, en écoutant des discours politiques, des ennuis du ménage. Pour elles, les clubs remplacent jusqu’à un certain point les spectacles. Un Américain ne sait pas converser, mais il discute ; il ne discourt pas, mais il disserte. Il vous parle toujours comme à une assemblée ; et s’il lui arrive par hasard de s’échauffer, il dira : Messieurs, en s’adressant à son interlocuteur.
Dans certains pays, l’habitant n’accepte qu’avec une sorte de répugnance les droits politiques que la loi lui accorde ; il semble que ce soit lui dérober son temps que de l’occuper des intérêts communs, et il aime à se renfermer dans un égoïsme étroit dont quatre fossés surmontés d’une haie forment l’exacte limite.
Du moment, au contraire, où l’Américain serait réduit à ne s’occuper que de ses propres affaires, la moitié de son existence lui serait ravie ; il sentirait comme un vide immense dans ses jours, et il deviendrait incroyablement malheureux [21] .
Je suis persuadé que si le despotisme parvient jamais à s’établir en Amérique, il trouvera plus de difficultés encore à vaincre les habitudes que la liberté a fait naître qu’à surmonter l’amour même de la liberté.
Cette agitation sans cesse renaissante, que le [II-124] gouvernement de la démocratie a introduite dans le monde politique, passe ensuite dans la société civile. Je ne sais si, à tout prendre, ce n’est pas là le plus grand avantage du gouvernement démocratique, et je le loue bien plus à cause de ce qu’il fait faire que de ce qu’il fait.
Il est incontestable que le peuple dirige souvent fort mal les affaires publiques ; mais le peuple ne saurait se mêler des affaires publiques sans que le cercle de ses idées ne vienne à s’étendre, et sans qu’on ne voie son esprit sortir de sa routine ordinaire. L’homme du peuple qui est appelé au gouvernement de la société conçoit une certaine estime de lui-même. Comme il est alors une puissance, des intelligences très éclairées se mettent au service de la sienne. On s’adresse sans cesse à lui pour s’en faire un appui, et en cherchant à le tromper de mille manières différentes, on l’éclaire. En politique, il prend part à des entreprises qu’il n’a pas conçues, mais qui lui donnent le goût général des entreprises. On lui indique tous les jours de nouvelles améliorations à faire à la propriété commune ; il sent naître le désir d’améliorer celle qui lui est personnelle. Il n’est ni plus vertueux ni plus heureux peut-être, mais plus éclairé et plus actif que ses devanciers. Je ne doute pas que les institutions démocratiques, jointes à la nature physique du pays, ne soient la cause, non pas directe, comme tant de gens le disent, mais la cause indirecte du prodigieux mouvement d’industrie qu’on remarque aux États-Unis. Ce ne sont pas les lois qui le font naître, mais le peuple apprend à le produire en faisant la loi. [II-125] .
Lorsque les ennemis de la démocratie prétendent qu’un seul fait mieux ce dont il se charge que le gouvernement de tous, il me semble qu’ils ont raison. Le gouvernement d’un seul, en supposant de part et d’autre égalité de lumières, met plus de suite dans ses entreprises que la multitude ; il montre plus de persévérance, plus d’idée d’ensemble, plus de perfection de détail, un discernement plus juste dans le choix des hommes. Ceux qui nient ces choses n’ont jamais vu de république démocratique, ou n’ont jugé que sur un petit nombre d’exemples. La démocratie, lors même que les circonstances locales et les dispositions du peuple lui permettent de se maintenir, ne présente pas le coup d’œil de la régularité administrative et de l’ordre méthodique dans le gouvernement ; cela est vrai. La liberté démocratique n’exécute pas chacune de ses entreprises avec la même perfection que le despotisme intelligent ; souvent elle les abandonne avant d’en avoir retiré le fruit, ou en hasarde de dangereuses : mais à la longue elle produit plus que lui ; elle fait moins bien chaque chose, mais elle fait plus de choses. Sous son empire, ce n’est pas surtout ce qu’exécute l’administration publique qui est grand, c’est ce qu’on exécute sans elle et en dehors d’elle. La démocratie ne donne pas au peuple le gouvernement le plus habile, mais elle fait ce que le gouvernement le plus habile est souvent impuissant à créer ; elle répand dans tout le corps social une inquiète activité, une force surabondante, une énergie qui n’existent jamais sans elle, et qui, pour peu que les circonstances soient favorables, peuvent enfanter des merveilles. Là sont ses vrais avantages. [II-126] .
Dans ce siècle, où les destinées du monde chrétien paraissent en suspens, les uns se hâtent d’attaquer la démocratie comme une puissance ennemie, tandis qu’elle grandit encore ; les autres adorent déjà en elle un dieu nouveau qui sort du néant ; mais les uns et les autres ne connaissent qu’imparfaitement l’objet de leur haine ou de leur désir ; ils se combattent dans les ténèbres et ne frappent qu’au hasard.
Que demandez-vous de la société et de son gouvernement ? Il faut s’entendre.
Voulez-vous donner à l’esprit humain une certaine hauteur, une façon généreuse d’envisager les choses de ce monde ? Voulez-vous inspirer aux hommes une sorte de mépris des biens matériels ? Désirez-vous faire naître ou entretenir des convictions profondes et préparer de grands dévouements ?.
S’agit-il pour vous de polir les mœurs, d’élever les manières, de faire briller les arts ? Voulez-vous de la poésie, du bruit, de la gloire ?.
Prétendez-vous organiser un peuple de manière à agir fortement sur tous les autres ? Le destinez-vous à tenter les grandes entreprises, et, quel que soit le résultat de ses efforts, à laisser une trace immense dans l’histoire ?.
Si tel est, suivant vous, l’objet principal que doivent se proposer les hommes en société, ne prenez pas le gouvernement de la démocratie ; il ne vous conduirait pas sûrement au but.
Mais s’il vous semble utile de détourner l’activité intellectuelle et morale de l’homme sur les nécessités de la vie matérielle, et de l’employer à produire le bien-être ; si la raison vous paraît plus profitable aux [II-127] hommes que le génie ; si votre objet n’est point de créer des vertus héroïques, mais des habitudes paisibles ; si vous aimez mieux voir des vices que des crimes, et préférez trouver moins de grandes actions, à la condition de rencontrer moins de forfaits ; si, au lieu d’agir dans le sein d’une société brillante, il vous suffit de vivre au milieu d’une société prospère ; si, enfin, l’objet principal d’un gouvernement n’est point, suivant vous, de donner au corps entier de la nation le plus de force ou le plus de gloire possible, mais de procurer à chacun des individus qui le composent le plus de bien-être et de lui éviter le plus de misère ; alors égalisez les conditions et constituez le gouvernement de la démocratie.
Que s’il n’est plus temps de faire un choix, et qu’une force supérieure à l’homme vous entraîne déjà, sans consulter vos désirs, vers l’un des deux gouvernements, cherchez du moins à en tirer tout le bien qu’il peut faire ; et connaissant ses bons instincts, ainsi que ses mauvais penchants, efforcez-vous de restreindre l’effet des seconds et de développer les premiers. [II-128] .
CHAPITRE VII.↩
[II-128]
DE L’OMNIPOTENCE DE LA MAJORITÉ AUX ÉTATS-UNIS ET DE SES EFFETS.
Force naturelle de la majorité dans les démocraties. — La plupart des constitutions américaines ont accru artificiellement cette force naturelle. — Comment. — Mandats impératifs. — Empire moral de la majorité. — Opinion de son infaillibilité. — Respect pour ses droits. — Ce qui l’augmente aux États-Unis.
Il est de l’essence même des gouvernements démocratiques que l’empire de la majorité y soit absolu ; car en dehors de la majorité, dans les démocraties, il n’y a rien qui résiste.
La plupart des constitutions américaines ont encore cherché à augmenter artificiellement cette force naturelle de la majorité [22] .
La législature est, de tous les pouvoirs politiques, celui qui obéit le plus volontiers à la majorité. Les Américains ont voulu que les membres de la législature fussent nommés directement par le peuple, et [II-129] pour un terme très court, afin de les obliger à se soumettre non seulement aux vues générales, mais encore aux passions journalières de leurs constituants.
Ils ont pris dans les mêmes classes et nommé de la même manière les membres des deux chambres ; de telle sorte que les mouvements du corps législatif sont presque aussi rapides et non moins irrésistibles que ceux d’une seule assemblée.
La législature ainsi constituée, ils ont réuni dans son sein presque tout le gouvernement.
En même temps que la loi accroissait la force des pouvoirs qui étaient naturellement forts, elle énervait de plus en plus ceux qui étaient naturellement faibles. Elle n’accordait aux représentants de la puissance exécutive, ni stabilité ni indépendance ; et, en les soumettant complétement aux caprices de la législature, elle leur enlevait le peu d’influence que la nature du gouvernement démocratique leur aurait permis d’exercer.
Dans plusieurs États, elle livrait le pouvoir judiciaire à l’élection de la majorité, et dans tous elle faisait, en quelque sorte, dépendre son existence de la puissance législative, en laissant aux représentants le droit de fixer chaque année le salaire des juges.
Les usages ont été plus loin encore que les lois.
Il se répand de plus en plus, aux États-Unis, une coutume qui finira par rendre vaines les garanties du gouvernement représentatif : il arrive très fréquemment que les électeurs, en nommant un député, lui tracent un plan de conduite et lui imposent un certain nombre d’obligations positives dont il ne [II-130] saurait nullement s’écarter. Au tumulte près, c’est comme si la majorité elle-même délibérait sur la place publique.
Plusieurs circonstances particulières tendent encore à rendre, en Amérique, le pouvoir de la majorité non seulement prédominant, mais irrésistible.
L’empire moral de la majorité se fonde en partie sur cette idée, qu’il y a plus de lumières et de sagesse dans beaucoup d’hommes réunis que dans un seul, dans le nombre des législateurs que dans le choix. C’est la théorie de l’égalité appliquée aux intelligences. Cette doctrine attaque l’orgueil de l’homme dans son dernier asile : aussi la minorité l’admet-elle avec peine ; elle ne s’y habitue qu’à la longue. Comme tous les pouvoirs, et plus peut-être qu’aucun d’entre eux, le pouvoir de la majorité a donc besoin de durer pour paraître légitime. Quand il commence à s’établir, il se fait obéir par la contrainte ; ce n’est qu’après avoir long-temps vécu sous ses lois qu’on commence à le respecter.
L’idée du droit que possède la majorité, par ses lumières, de gouverner la société, a été apportée sur le sol des États-Unis par leurs premiers habitants. Cette idée, qui seule suffirait pour créer un peuple libre, est aujourd’hui passée dans les mœurs, et on la retrouve jusque dans les moindres habitudes de la vie.
Les Français, sous l’ancienne monarchie, tenaient pour constant que le roi ne pouvait jamais faillir ; et quand il lui arrivait de faire mal, ils pensaient que la faute en était à ses conseillers. Ceci facilitait merveilleusement l’obéissance. On pouvait murmurer [II-131] contre la loi, sans cesser d’aimer et de respecter le législateur. Les Américains ont la même opinion de la majorité.
L’empire moral de la majorité se fonde encore sur ce principe, que les intérêts du plus grand nombre doivent être préférés à ceux du petit. Or, on comprend sans peine que le respect qu’on professe pour ce droit du plus grand nombre augmente naturellement ou diminue suivant l’état des partis. Quand une nation est partagée entre plusieurs grands intérêts inconciliables, le privilège de la majorité est souvent méconnu, parce qu’il devient trop pénible de s’y soumettre.
S’il existait en Amérique une classe de citoyens que le législateur travaillât à dépouiller de certains avantages exclusifs, possédés pendant des siècles, et voulût faire descendre d’une situation élevée pour les ramener dans les rangs de la multitude, il est probable que la minorité ne se soumettrait pas facilement à ses lois.
Mais les États-Unis ayant été peuplés par des hommes égaux entre eux, il ne se trouve pas encore de dissidence naturelle et permanente entre les intérêts de leurs divers habitants.
Il y a tel état social où les membres de la minorité ne peuvent espérer d’attirer à eux la majorité, parce qu’il faudrait pour cela abandonner l’objet même de la lutte qu’ils soutiennent contre elle. Une aristocratie, par exemple, ne saurait devenir majorité en conservant ses priviléges exclusifs, et elle ne saurait laisser échapper ses privilèges sans cesser d’être une aristocratie. [II-132] .
Aux États-Unis, les questions politiques ne peuvent se poser d’une manière aussi générale et aussi absolue, et tous les partis sont prêts à reconnaître les droits de la majorité, parce que tous ils espèrent pouvoir un jour les exercer à leur profit.
La majorité a donc aux États-Unis une immense puissance de fait et une puissance d’opinion presque aussi grande ; et lorsqu’elle est une fois formée sur une question, il n’y a pour ainsi dire point d’obstacles qui puissent, je ne dirai pas arrêter, mais même retarder sa marche, et lui laisser le temps d’écouter les plaintes de ceux qu’elle écrase en passant.
Les conséquences de cet état de choses sont funestes et dangereuses pour l’avenir.
COMMENT L’OMNIPOTENCE DE LA MAJORITÈ AUGMENTE, EN AMÉRIQUE L’INSTABILITÉ LÉGISLATIVE ET ADMINISTRATIVE QUI EST NATURELLE AUX DÉMOCRATIES.
Comment les Américains augmentent l’instabilité législative, qui est naturelle à la démocratie, en changeant chaque année le législateur, et en l’armant d’un pouvoir presque sans bornes. — Le même effet produit sur l’administration. — En Amérique on apporte aux améliorations sociales une force infiniment plus grande, mais moins continue qu’en Europe.
J’ai parlé précédemment des vices qui sont naturels au gouvernement de la démocratie ; il n’en est pas un qui ne croisse en même temps que le pouvoir de la majorité. [II-133] .
Et, pour commencer par le plus apparent de tous :.
L’instabilité législative est un mal inhérent au gouvernement démocratique, parce qu’il est de la nature des démocraties d’amener des hommes nouveaux au pouvoir. Mais ce mal est plus ou moins grand suivant la puissance et les moyens d’action qu’on accorde au législateur.
En Amérique, on remet à l’autorité qui fait les lois un souverain pouvoir. Elle peut se livrer rapidement et irrésistiblement à chacun de ses désirs, et tous les ans on lui donne d’autres représentants. C’est-à-dire qu’on a adopté précisément la combinaison qui favorise le plus l’instabilité démocratique, et qui permet à la démocratie d’appliquer ses volontés changeantes aux objets les plus importants.
Aussi l’Amérique est-elle de nos jours le pays du monde où les lois ont le moins de durée. Presque toutes les constitutions américaines ont été amendées depuis trente ans. Il n’y a donc pas d’État américain qui n’ait, pendant cette période, modifié le principe de ses lois.
Quant aux lois elles-mêmes, il suffit de jeter un coup d’œil sur les archives des différents États de l’Union pour se convaincre qu’en Amérique l’action du législateur ne se ralentit jamais. Ce n’est pas que la démocratie américaine soit de sa nature plus instable qu’une autre, mais on lui a donné le moyen de suivre, dans la formation des lois, l’instabilité naturelle de ses penchants [23] . [II-134] .
L’omnipotence de la majorité et la manière rapide et absolue dont ses volontés s’exécutent aux États-Unis ne rend pas seulement la loi instable, elle exerce encore la même influence sur l’exécution de la loi et sur l’action de l’administration publique.
La majorité étant la seule puissance à laquelle il soit important de plaire, on concourt avec ardeur aux œuvres qu’elle entreprend ; mais du moment où son attention se porte ailleurs, tous les efforts cessent ; tandis que dans les États libres de l’Europe, où le pouvoir administratif a une existence indépendante et une position assurée, les volontés du législateur continuent à s’exécuter, alors même qu’il s’occupe d’autres objets.
En Amérique, on apporte à certaines améliorations beaucoup plus de zèle et d’activité qu’on ne le fait ailleurs.
En Europe, on emploie à ces mêmes choses une force sociale infiniment moins grande, mais plus continue.
Quelques hommes religieux entreprirent, il y a plusieurs années, d’améliorer l’état des prisons. Le public s’émut à leur voix, et la régénération des criminels devint une œuvre populaire.
De nouvelles prisons s’élevèrent alors. Pour la première fois, l’idée de la réforme du coupable pénétra dans un cachot en même temps que l’idée du [II-135] châtiment. Mais l’heureuse révolution à laquelle le public s’était associé avec tant d’ardeur, et que les efforts simultanés des citoyens rendaient irrésistible, ne pouvait s’opérer en un moment.
À côté des nouveaux pénitenciers, dont le vœu de la majorité hâtait le développement, les anciennes prisons subsistaient encore et continuaient à renfermer un grand nombre de coupables. Celles-ci semblaient devenir plus insalubres et plus corruptrices à mesure que les nouvelles devenaient plus réformatrices et plus saines. Ce double effet se comprend aisément : la majorité, préoccupée par l’idée de fonder le nouvel établissement, avait oublié celui qui existait déjà. Chacun alors détournant les yeux de l’objet qui n’attirait plus les regards du maître, la surveillance avait cessé. On avait d’abord vu se détendre, puis, bientôt après, se briser les liens salutaires de la discipline. Et à côté de la prison, monument durable de la douceur et des lumières de notre temps, se rencontrait un cachot qui rappelait la barbarie du moyen âge.
TYRANNIE DE LA MAJORITÉ.
Comment il faut entendre le principe de la souveraineté du peuple. — Impossibilité de concevoir un gouvernement mixte. — Il faut que le souverain pouvoir soit quelque part. – Précautions qu’on doit prendre pour modérer son action. — Ces précautions n’ont pas été prises aux États-Unis. — Ce qui en résulte.
Je regarde comme impie et détestable cette maxime, qu’en matière de gouvernement la majorité d’un peuple a le droit de tout faire, et pourtant je place dans [II-136] les volontés de la majorité l’origine de tous les pouvoirs. Suis-je en contradiction avec moi-même ?.
Il existe une loi générale qui a été faite ou du moins adoptée, non pas seulement par la majorité de tel ou tel peuple, mais par la majorité de tous les hommes. Cette loi, c’est la justice.
La justice forme donc la borne du droit de chaque peuple.
Une nation est comme un jury chargé de représenter la société universelle et d’appliquer la justice qui est sa loi. Le jury, qui représente la société, doit-il avoir plus de puissance que la société elle-même dont il applique les lois ?.
Quand donc je refuse d’obéir à une loi injuste, je ne dénie point à la majorité le droit de commander, j’en appelle seulement de la souveraineté du peuple à la souveraineté du genre humain.
Il y a des gens qui n’ont pas craint de dire qu’un peuple, dans les objets qui n’intéressaient que lui-même, ne pouvait sortir entièrement des limites de la justice et de la raison, et qu’ainsi on ne devait pas craindre de donner tout pouvoir à la majorité qui le représente. Mais c’est là un langage d’esclave.
Qu’est-ce donc qu’une majorité prise collectivement, sinon un individu qui a des opinions et le plus souvent des intérêts contraires à un autre individu qu’on nomme la minorité ? Or, si vous admettez qu’un homme revêtu de la toute-puissance peut en abuser contre ses adversaires, pourquoi n’admettez-vous pas la même chose pour une majorité ? Les hommes, en se réunissant, ont-ils changé de caractère ? Sont-ils devenus plus patients dans les obstacles en devenant plus [II-137] forts [24] ? Pour moi, je ne saurais le croire ; et le pouvoir de tout faire, que je refuse à un seul de mes semblables, je ne l’accorderai jamais à plusieurs.
Ce n’est pas que, pour conserver la liberté, je croie qu’on puisse mélanger plusieurs principes dans un même gouvernement, de manière à les opposer réellement l’un à l’autre.
Le gouvernement qu’on appelle mixte m’a toujours semblé une chimère. Il n’y a pas, à vrai dire, de gouvernement mixte (dans le sens qu’on donne à ce mot), parce que, dans chaque société, on finit par découvrir un principe d’action qui domine tous les autres.
L’Angleterre du dernier siècle, qu’on a particulièrement citée comme exemple de ces sortes de gouvernements, était un état essentiellement aristocratique, bien qu’il se trouvât dans son sein de grands éléments de démocratie ; car les lois et les mœurs y étaient ainsi établies que l’aristocratie devait toujours, à la longue, y prédominer et diriger à sa volonté les affaires publiques.
L’erreur est venue de ce que, voyant sans cesse les intérêts des grands aux prises avec ceux du peuple, on n’a songé qu’à la lutte, au lieu de faire attention au résultat de cette lutte, qui était le point important. Quand une société en vient à avoir réellement un gouvernement mixte, c’est-à-dire également partagé entre [II-138] des principes contraires, elle entre en révolution ou elle se dissout.
Je pense donc qu’il faut toujours placer quelque part un pouvoir social supérieur à tous les autres, mais je crois la liberté en péril lorsque ce pouvoir ne trouve devant lui aucun obstacle qui puisse retenir sa marche et lui donner le temps de se modérer lui-même.
La toute-puissance me semble en soi une chose mauvaise et dangereuse. Son exercice me paraît au-dessus des forces de l’homme, quel qu’il soit, et je ne vois que Dieu qui puisse sans danger être tout-puissant, parce que sa sagesse et sa justice sont toujours égales à son pouvoir. Il n’y a donc pas sur la terre d’autorité si respectable en elle-même, ou revêtue d’un droit si sacré, que je voulusse laisser agir sans contrôle et dominer sans obstacles. Lors donc que je vois accorder le droit et la faculté de tout faire à une puissance quelconque, qu’on l’appelle peuple ou roi, démocratie ou aristocratie, qu’on l’exerce dans une monarchie ou dans une république, je dis : là est le germe de la tyrannie, et je cherche à aller vivre sous d’autres lois.
Ce que je reproche le plus au gouvernement démocratique, tel qu’on l’a organisé aux États-Unis, ce n’est pas, comme beaucoup de gens le prétendent en Europe, sa faiblesse, mais au contraire sa force irrésistible. Et ce qui me répugne le plus en Amérique, ce n’est pas l’extrême liberté qui y règne, c’est le peu de garantie qu’on y trouve contre la tyrannie.
Lorsqu’un homme ou un parti souffre d’une injustice aux États-Unis, à qui voulez-vous qu’il s’adresse ? [II-139] À l’opinion publique ? c’est elle qui forme la majorité ; au corps législatif ? il représente la majorité et lui obéit aveuglément ; au pouvoir exécutif ? il est nommé par la majorité et lui sert d’instrument passif ; à la force publique ? la force publique n’est autre chose que la majorité sous les armes ; au jury ? le jury, c’est la majorité revêtue du droit de prononcer des arrêts : les juges eux-mêmes, dans certains États, sont élus par la majorité. Quelque inique ou déraisonnable que soit la mesure qui vous frappe, il faut donc vous y soumettre [25] . [II-140] .
Supposez, au contraire, un corps législatif composé de telle manière qu’il représente la majorité, sans être nécessairement l’esclave de ses passions ; un pouvoir exécutif qui ait une force qui lui soit propre, et une puissance judiciaire indépendante des deux autres pouvoirs ; vous aurez encore un gouvernement démocratique, mais il n’y aura presque plus de chances pour la tyrannie.
Je ne dis pas que dans le temps actuel on fasse en Amérique un fréquent usage de la tyrannie, je dis qu’on n’y découvre point de garantie contre elle, et qu’il faut y chercher les causes de la douceur du gouvernement dans les circonstances et dans les mœurs, plutôt que dans les lois.
EFFETS DE L’OMNIPOTENCE DE LA MAJORITÉ SUR L’ARBITRAIRE DES FONCTIONNAIRES PUBLICS AMÉRICANS.
Liberté que laisse la loi américaine aux fonctionnaires dans le cercle qu’elle a tracé. — Leur puissance.
Il faut bien distinguer l’arbitraire de la tyrannie. La tyrannie peut s’exercer au moyen de la loi même, et alors elle n’est point arbitraire ; l’arbitraire peut s’exercer dans l’intérêt des gouvernés, et alors il n’est pas tyrannique.
La tyrannie se sert ordinairement de l’arbitraire, mais au besoin elle sait s’en passer.
Aux États-Unis, l’omnipotence de la majorité, en [II-141] même temps qu’elle favorise le despotisme légal du législateur, favorise aussi l’arbitraire du magistrat. La majorité étant maîtresse absolue de faire la loi et d’en surveiller l’exécution, ayant un égal contrôle sur les gouvernants et sur les gouvernés, regarde les fonctionnaires publics comme ses agents passifs, et se repose volontiers sur eux du soin de servir ses desseins. Elle n’entre donc point d’avance dans le détail de leurs devoirs et ne prend guère la peine de définir leurs droits. Elle les traite comme pourrait faire un maître ses serviteurs, si, les voyant toujours agir sous ses yeux, il pouvait diriger ou corriger leur conduite à chaque instant.
En général, la loi laisse les fonctionnaires américains bien plus libres que les nôtres dans le cercle qu’elle trace autour d’eux. Quelquefois même il arrive que la majorité leur permet d’en sortir. Garantis par l’opinion du plus grand nombre et forts de son concours, ils osent alors des choses dont un Européen, habitué au spectacle de l’arbitraire, s’étonne encore. Il se forme ainsi au sein de la liberté des habitudes qui un jour pourront lui devenir funestes.
DU POUVOIR QU’EXERCE LA MAJORITÉ EN AMÉRIQUE SUR LA PENSÉE.
Aux États-Unis, quand la majorité s’est irrévocablement fixée sur une question, on ne discute plus. — Pourquoi. — Puissance morale que la majorité exerce sur la pensée. — Les républiques démocratiques immatérialisent le despotisme.
Lorsqu’on vient à examiner quel est aux États-Unis l’exercice de la pensée, c’est alors qu’on aperçoit bien [II-142] clairement à quel point la puissance de la majorité surpasse toutes les puissances que nous connaissons en Europe.
La pensée est un pouvoir invisible et presque insaisissable qui se joue de toutes les tyrannies. De nos jours, les souverains les plus absolus de l’Europe ne sauraient empêcher certaines pensées hostiles à leur autorité de circuler sourdement dans leurs États et jusqu’au sein de leurs cours. Il n’en est pas de même en Amérique : tant que la majorité est douteuse, on parle ; mais dès qu’elle s’est irrévocablement prononcée, chacun se tait, et amis comme ennemis semblent alors s’attacher de concert à son char. La raison en est simple : il n’y a pas de monarque si absolu qui puisse réunir dans sa main toutes les forces de la société et vaincre les résistances, comme peut le faire une majorité revêtue du droit de faire les lois et de les exécuter.
Un roi d’ailleurs n’a qu’une puissance matérielle qui agit sur les actions et ne saurait atteindre les volontés ; mais la majorité est revêtue d’une force tout à la fois matérielle et morale, qui agit sur la volonté autant que sur les actions, et qui empêche en même temps le fait et le désir de faire.
Je ne connais pas de pays où il règne en général moins d’indépendance d’esprit et de véritable liberté de discussion qu’en Amérique.
Il n’y a pas de théorie religieuse ou politique qu’on ne puisse prêcher librement dans les États constitutionnels de l’Europe et qui ne pénètre dans les autres ; car il n’est pas de pays en Europe tellement soumis à un seul pouvoir, que celui qui veut y dire la vérité n’y [II-143] trouve un appui capable de le rassurer contre les résultats de son indépendance. S’il a le malheur de vivre sous un gouvernement absolu, il a souvent pour lui le peuple ; s’il habite un pays libre, il peut au besoin s’abriter derrière l’autorité royale. La fraction aristocratique de la société le soutient dans les contrées démocratiques, et la démocratie dans les autres. Mais au sein d’une démocratie organisée ainsi que celle des États-Unis, on ne rencontre qu’un seul pouvoir, un seul élément de force et de succès, et rien en dehors de lui.
En Amérique, la majorité trace un cercle formidable autour de la pensée. Au-dedans de ces limites l’écrivain est libre ; mais malheur à lui s’il ose en sortir. Ce n’est pas qu’il ait à craindre un auto-da-fé, mais il est en butte à des dégoûts de tous genres et à des persécutions de tous les jours. La carrière politique lui est fermée : il a offensé la seule puissance qui ait la faculté de l’ouvrir. On lui refuse tout, jusqu’à la gloire. Avant de publier ses opinions, il croyait avoir des partisans ; il lui semble qu’il n’en a plus, maintenant qu’il s’est découvert à tous ; car ceux qui le blâment s’expriment hautement, et ceux qui pensent comme lui, sans avoir son courage, se taisent et s’éloignent. Il cède, il plie enfin sous l’effort de chaque jour, et rentre dans le silence, comme s’il éprouvait des remords d’avoir dit vrai.
Des chaînes et des bourreaux, ce sont là les instruments grossiers qu’employait jadis la tyrannie ; mais de nos jours la civilisation a perfectionné jusqu’au despotisme lui-même, qui semblait pourtant n’avoir plus rien à apprendre. [II-144] .
Les princes avaient pour ainsi dire matérialisé la violence ; les républiques démocratiques de nos jours l’ont rendue tout aussi intellectuelle que la volonté humaine qu’elle veut contraindre. Sous le gouvernement absolu d’un seul, le despotisme, pour arriver à l’âme, frappait grossièrement le corps ; et l’âme, échappant à ces coups, s’élevait glorieuse au-dessus de lui ; mais dans les républiques démocratiques, ce n’est point ainsi que procède la tyrannie ; elle laisse le corps et va droit à l’âme. Le maître n’y dit plus : Vous penserez comme moi, ou vous mourrez ; il dit : Vous êtes libre de ne point penser ainsi que moi ; votre vie, vos biens, tout vous reste ; mais de ce jour vous êtes un étranger parmi nous. Vous garderez vos privilèges à la cité, mais ils vous deviendront inutiles ; car si vous briguez le choix de vos concitoyens, ils ne vous l’accorderont point, et si vous ne demandez que leur estime, ils feindront encore de vous la refuser. Vous resterez parmi les hommes, mais vous perdrez vos droits à l’humanité. Quand vous vous approcherez de vos semblables, ils vous fuiront comme un être impur ; et ceux qui croient à votre innocence, ceux-là mêmes vous abandonneront, car on les fuirait à leur tour. Allez en paix, je vous laisse la vie, mais je vous la laisse pire que la mort.
Les monarchies absolues avaient déshonoré le despotisme ; prenons garde que les républiques démocratiques ne le réhabilitent, et qu’en le rendant plus lourd pour quelques-uns, elles ne lui ôtent, aux yeux du plus grand nombre, son aspect odieux et son caractère avilissant. [II-145] .
Chez les nations les plus fières de l’Ancien Monde, on a publié des ouvrages destinés à peindre fidèlement les vices et les ridicules des contemporains ; La Bruyère habitait le palais de Louis XIV quand il composa son chapitre sur les grands, et Molière critiquait la cour dans des pièces qu’il faisait représenter devant les courtisans. Mais la puissance qui domine aux États-Unis n’entend point ainsi qu’on la joue. Le plus léger reproche la blesse, la moindre vérité piquante l’effarouche ; et il faut qu’on loue depuis les formes de son langage jusqu’à ses plus solides vertus. Aucun écrivain, quelle que soit sa renommée, ne peut échapper à cette obligation d’encenser ses concitoyens. La majorité vit donc dans une perpétuelle adoration d’elle-même ; il n’y a que les étrangers ou l’expérience qui puissent faire arriver certaines vérités jusqu’aux oreilles des Américains.
Si l’Amérique n’a pas encore eu de grands écrivains, nous ne devons pas en chercher ailleurs les raisons : il n’existe pas de génie littéraire sans liberté d’esprit, et il n’y a pas de liberté d’esprit en Amérique.
L’Inquisition n’a jamais pu empêcher qu’il ne circulât en Espagne des livres contraires à la religion du plus grand nombre. L’empire de la majorité fait mieux aux États-Unis : elle a ôté jusqu’à la pensée d’en publier. On rencontre des incrédules en Amérique, mais l’incrédulité n’y trouve pour ainsi dire pas d’organe.
On voit des gouvernements qui s’efforcent de protéger les mœurs en condamnant les auteurs de livres licencieux. Aux États-Unis, on ne condamne personne pour ces sortes d’ouvrages ; mais personne n’est [II-146] tenté de les écrire. Ce n’est pas cependant que tous les citoyens aient des mœurs pures, mais la majorité est régulière dans les siennes.
Ici, l’usage du pouvoir est bon sans doute : aussi ne parlé-je que du pouvoir en lui-même. Ce pouvoir irrésistible est un fait continu, et son bon emploi n’est qu’un accident.
EFFETS DE LA TYRANNIE DE LA MAJORITÉ SUR LE CARACTÈRE NATIONAL DES AMÉRICAINS ; DE L’ESPRIT DE COUR AUX ÉTATS-UNIS.
Les effets de la tyrannie de la majorité se font jusqu’à présent plus sentir sur les mœurs que sur la conduite de la société. — Ils arrêtent le développement des grands caractères. — Les républiques démocratiques organisées comme celles des États-Unis mettent l’esprit de cour à la portée du grand nombre. — Preuves de cet esprit aux États-Unis. — Pourquoi il y a plus de patriotisme dans le peuple que dans ceux qui gouvernent en son nom.
L’influence de ce qui précède ne se fait encore sentir que faiblement dans la société politique ; mais on en remarque déjà de fâcheux effets sur le caractère national des Américains. Je pense que c’est à l’action toujours croissante du despotisme de la majorité, aux États-Unis, qu’il faut surtout attribuer le petit nombre d’hommes remarquables qui s’y montrent aujourd’hui sur la scène politique.
Lorsque la révolution d’Amérique éclata, ils parurent en foule ; l’opinion publique dirigeait alors les volontés et ne les tyrannisait pas. Les hommes célèbres de cette époque, s’associant librement au mouvement des esprits, eurent une grandeur qui leur fut propre : [II-147] ils répandirent leur éclat sur la nation et ne l’empruntèrent pas d’elle.
Dans les gouvernements absolus, les grands qui avoisinent le trône flattent les passions du maître, et se plient volontairement à ses caprices. Mais la masse de la nation ne se prête pas à la servitude, elle s’y soumet souvent par faiblesse, par habitude ou par ignorance ; quelquefois par amour de la royauté ou du roi. On a vu des peuples mettre une espèce de plaisir et d’orgueil à sacrifier leur volonté à celle du prince, et placer ainsi une sorte d’indépendance d’âme jusqu’au milieu même de l’obéissance. Chez ces peuples, on rencontre bien moins de dégradation que de misères. Il y a d’ailleurs une grande différence entre faire ce qu’on n’approuve pas, ou feindre d’approuver ce qu’on fait : l’un est d’un homme faible, mais l’autre n’appartient qu’aux habitudes d’un valet.
Dans les pays libres, où chacun est plus ou moins appelé à donner son opinion sur les affaires de l’État ; dans les républiques démocratiques, où la vie publique est incessamment mêlée à la vie privée, où le souverain est abordable de toutes parts, et où il ne s’agit que d’élever la voix pour arriver jusqu’à son oreille, on rencontre beaucoup plus de gens qui cherchent à spéculer sur ses faiblesses et à vivre aux dépens de ses passions, que dans les monarchies absolues. Ce n’est pas que les hommes y soient naturellement pires qu’ailleurs, mais la tentation y est plus forte, et s’offre à plus de monde en même temps. Il en résulte un abaissement bien plus général dans les âmes.
Les républiques démocratiques mettent l’esprit de cour à la portée du grand nombre, et le font pénétrer [II-148] dans toutes les classes à la fois. C’est un des principaux reproches qu’on peut leur faire.
Cela est surtout vrai dans les États démocratiques, organisés comme les républiques américaines, où la majorité possède un empire si absolu et si irrésistible, qu’il faut en quelque sorte renoncer à ses droits de citoyen, et pour ainsi dire à sa qualité d’homme, quand on veut s’écarter du chemin qu’elle a tracé.
Parmi la foule immense qui, aux États-Unis, se presse dans la carrière politique, j’ai vu bien peu d’hommes qui montrassent cette virile candeur, cette mâle indépendance de la pensée, qui a souvent distingué les Américains dans les temps antérieurs, et qui, partout où on la trouve, forme comme le trait saillant des grands caractères. On dirait, au premier abord, qu’en Amérique les esprits ont tous été formés sur le même modèle, tant ils suivent exactement les mêmes voies. L’étranger rencontre il est vrai, quelquefois des Américains qui s’écartent de la rigueur des formules ; il arrive à ceux-là de déplorer le vice des lois, la versatilité de la démocratie, et son manque de lumières ; ils vont même souvent jusqu’à remarquer les défauts qui altèrent le caractère national, et ils indiquent les moyens qu’on pourrait prendre pour les corriger ; mais nul, excepté vous, ne les écoute ; et vous, à qui ils confient ces pensées secrètes, vous n’êtes qu’un étranger, et vous passez. Ils vous livrent volontiers des vérités qui vous sont inutiles, et, descendus sur la place publique, ils tiennent un autre langage.
Si ces lignes parviennent jamais en Amérique, je [II-149] suis assuré de deux choses : la première, que les lecteurs élèveront tous la voix pour me condamner ; la seconde, que beaucoup d’entre eux m’absoudront au fond de leur conscience.
J’ai entendu parler de la patrie aux États-Unis. J’ai rencontré du patriotisme véritable dans le peuple ; j’en ai souvent cherché en vain dans ceux qui le dirigent. Ceci se comprend facilement par analogie : le despotisme déprave bien plus celui qui s’y soumet que celui qui l’impose. Dans les monarchies absolues, le roi a souvent de grandes vertus ; mais les courtisans sont toujours vils.
Il est vrai que les courtisans, en Amérique, ne disent point : Sire et Votre Majesté, grande et capitale différence ; mais ils parlent sans cesse des lumières naturelles de leur maître ; ils ne mettent point au concours la question de savoir quelle est celle des vertus du prince qui mérite le plus qu’on l’admire ; car ils assurent qu’il possède toutes les vertus, sans les avoir acquises, et pour ainsi dire sans le vouloir ; ils ne lui donnent pas leurs femmes et leurs filles pour qu’il daigne les élever au rang de ses maîtresses ; mais en lui sacrifiant leurs opinions, ils se prostituent eux-mêmes.
Les moralistes et les philosophes, en Amérique, ne sont pas obligés d’envelopper leurs opinions dans les voiles de l’allégorie ; mais, avant de hasarder une vérité fâcheuse, ils disent : Nous savons que nous parlons à un peuple trop au-dessus des faiblesses humaines, pour ne pas toujours rester maître de lui-même. Nous ne tiendrions pas un semblable langage, si nous ne nous adressions à des hommes que leurs [II-150] vertus et leurs lumières rendent seuls, parmi tous les autres, dignes de rester libres.
Comment les flatteurs de {roi|Louis|XIV}} pouvaient-ils mieux faire ?.
Pour moi, je crois que dans tous les gouvernements, quels qu’ils soient, la bassesse s’attachera à la force, et la flatterie au pouvoir. Et je ne connais qu’un moyen d’empêcher que les hommes ne se dégradent : c’est de n’accorder à personne, avec la toute-puissance, le souverain pouvoir de les avilir.
QUE LE PLUS GRAND DANGER DES RÉPUBLIQUES AMÉRICAINES VIENT DE L’OMNIPOTENCE DE LA MAJORITÉ.
C’est par le mauvais emploi de leur puissance, et non par impuissance, que les républiques démocratiques sont exposées à périr. — Le gouvernement des républiques américaines plus centralisé et plus énergique que celui des monarchies de l’Europe. — Danger qui en résulte. — Opinion de Madison et de Jefferson à ce sujet.
Les gouvernements périssent ordinairement par impuissance ou par tyrannie. Dans le premier cas, le pouvoir leur échappe ; on le leur arrache dans l’autre.
Bien des gens, en voyant tomber les États démocratiques en anarchie, ont pensé que le gouvernement, dans ces États, était naturellement faible et impuissant. La vérité est que quand une fois la guerre y est allumée entre les partis, le gouvernement perd son action sur la société. Mais je ne pense pas que la nature d’un pouvoir démocratique soit de manquer de force et de ressources ; je crois, au contraire, que c’est presque toujours l’abus de ses forces et le [II-151] mauvais emploi de ses ressources qui le font périr. L’anarchie naît presque toujours de sa tyrannie ou de son inhabileté, mais non pas de son impuissance.
Il ne faut pas confondre la stabilité avec la force, la grandeur de la chose et sa durée. Dans les républiques démocratiques, le pouvoir qui dirige [26] la société n’est pas stable, car il change souvent de mains et d’objet. Mais, partout où il se porte, sa force est presque irrésistible.
Le gouvernement des républiques américaines me paraît aussi centralisé et plus énergique que celui des monarchies absolues de l’Europe. Je ne pense donc point qu’il périsse par faiblesse [27] .
Si jamais la liberté se perd en Amérique, il faudra s’en prendre à l’omnipotence de la majorité, qui aura porté les minorités au désespoir, et les aura forcées de faire un appel à la force matérielle. On verra alors l’anarchie, mais elle arrivera comme conséquence du despotisme.
Le président James Madison a exprimé les mêmes pensées. (Voyez le Fédéraliste, no 51.).
« Il est d’une grande importance dans les républiques, dit-il, non seulement de défendre la société contre l’oppression de ceux qui la gouvernent, mais encore de garantir une partie de la société contre l’injustice de l’autre. La justice est le but où doit [II-152] tendre tout gouvernement ; c’est le but que se proposent les hommes en se réunissant. Les peuples ont fait et feront toujours des efforts vers ce but, jusqu’à ce qu’ils aient réussi à l’atteindre, ou qu’ils aient perdu leur liberté.
« S’il existait une société dans laquelle le parti le plus puissant fût en état de réunir facilement ses forces et d’opprimer le plus faible, on pourrait considérer que l’anarchie règne dans une pareille société aussi bien que dans l’état de nature, où l’individu le plus faible n’a aucune garantie contre la violence du plus fort ; et de même que dans l’état de nature, les inconvénients d’un sort incertain et précaire décident les plus forts à se soumettre à un gouvernement qui protège les faibles ainsi qu’eux-mêmes ; dans un gouvernement anarchique, les mêmes motifs conduiront peu à peu les partis les plus puissants à désirer un gouvernement qui puisse protéger également tous les partis, le fort et le faible. Si l’État de Rhode-Island était séparé de la Confédération et livré à un gouvernement populaire, exercé souverainement dans d’étroites limites, on ne saurait douter que la tyrannie des majorités n’y rendît l’exercice des droits tellement incertain, qu’on n’en vînt à réclamer un pouvoir entièrement indépendant du peuple. Les factions elles-mêmes, qui l’auraient rendu nécessaire, se hâteraient d’en appeler à lui. ».
Jefferson disait aussi : « Le pouvoir exécutif, dans notre gouvernement, n’est pas le seul, il n’est peut-être pas le principal objet de ma sollicitude. La tyrannie des législateurs est actuellement, et sera [II-153] pendant bien des années encore, le danger le plus redoutable. Celle du pouvoir exécutif viendra à son tour, mais dans une période plus reculée [28] . ».
J’aime, en cette matière, à citer Jefferson de préférence à tout autre, parce que je le considère comme le plus puissant apôtre qu’ait jamais eu la démocratie. [II-154]
CHAPITRE VIII.↩
[II-154]
DE CE QUI TEMPÈRE AUX ÉTATS-UNIS LA TYRANNIE DE LA MAJORITÉ.
ABSENCE DE CENTRALISATION ADMINISTRATIVE.
La majorité nationale n’a pas l’idée de tout faire. — Elle est obligée de se servir des magistrats de la commune et des comtés pour exécuter ses volontés souveraines.
J’ai distingué, précédemment deux espèces de centralisations ; j’ai appelé l’une gouvernementale, et l’autre administrative.
La première seule existe en Amérique ; la seconde y est à peu près inconnue.
Si le pouvoir qui dirige les sociétés américaines trouvait à sa disposition ces deux moyens de gouvernement, et joignait au droit de tout commander la faculté et l’habitude de tout exécuter par lui-même ; si, après avoir établi les principes généraux du gouvernement, il pénétrait dans les détails de l’application, et qu’après avoir réglé les grands intérêts du pays, il pût descendre jusqu’à la limite des intérêts individuels, la liberté serait bientôt bannie du Nouveau-Monde. [II-155] .
Mais, aux États-Unis, la majorité, qui a souvent les goûts et les instincts d’un despote, manque encore des instruments les plus perfectionnés de la tyrannie.
Dans aucune des républiques américaines, le gouvernement central ne s’est jamais occupé que d’un petit nombre d’objets, dont l’importance attirait ses regards. Il n’a point entrepris de régler les choses secondaires de la société. Rien n’indique qu’il en ait même conçu le désir. La majorité, en devenant de plus en plus absolue, n’a point accru les attributions du pouvoir central ; elle n’a fait que le rendre tout-puissant dans sa sphère. Ainsi le despotisme peut être très lourd sur un point, mais il ne saurait s’étendre à tous.
Quelque entraînée, d’ailleurs, que puisse être par ses passions la majorité nationale ; quelque ardente qu’elle soit dans ses projets, elle ne saurait faire qu’en tous lieux, de la même manière, et au même moment, tous les citoyens se plient à ses désirs. Quand le gouvernement central qui la représente a ordonné souverainement, il doit s’en rapporter, pour l’exécution de son commandement, à des agents qui souvent ne dépendent point de lui, et qu’il ne peut diriger à chaque instant. Les corps municipaux et les administrations des comtés forment donc comme autant d’écueils cachés qui retardent ou divisent le flot de la volonté populaire. La loi fût-elle oppressive, la liberté trouverait encore un abri dans la manière dont on exécuterait la loi ; et la majorité ne saurait descendre dans les détails, et, si j’ose le dire, dans les puérilités de la tyrannie administrative. Elle n’imagine même pas qu’elle puisse le faire, car elle n’a point l’entière [II-156] conscience de son pouvoir. Elle ne connaît encore que ses forces naturelles, et elle ignore jusqu’où l’art pourrait en étendre les bornes.
Ceci mérite qu’on y songe. S’il venait jamais à se fonder une république démocratique comme celle des États-Unis dans un pays où le pouvoir d’un seul aurait déjà établi et fait passer dans les habitudes, comme dans les lois, la centralisation administrative, je ne crains pas de le dire, dans une semblable république, le despotisme deviendrait plus intolérable que dans aucune des monarchies absolues de l’Europe. Il faudrait passer en Asie pour trouver quelque chose à lui comparer.
DE L’ESPRIT LÉGISTE AUX ÉTATS-UNIS, ET COMMENT IL SERT DE CONTRE-POIDS À LA DÉMOCRATIE.
Utilité de rechercher quels sont les instincts naturels de l’esprit légiste. — Les légistes appelés à jouer un grand rôle dans la société qui cherche à naître. — Comment le genre de travaux auxquels se livrent les légistes donne une tournure aristocratique a leurs idées. — Causes accidentelles qui peuvent s’opposer au développement de ces idées. — Facilité que trouve l’aristocratie à s’unir aux légistes. — Parti qu’un despote pourrait tirer des légistes. Comment les légistes forment le seul élément aristocratique qui soit de nature à se combiner avec les éléments naturels de la démocratie. — Causes particulières qui tendent à donner un tour aristocratique à l’esprit du légiste anglais et américain. — L’aristocratie américaine est au banc des avocats et sur le siège des juges. — Influence exercée par les légistes sur la société américaine. — Comment leur esprit pénètre au sein des législatures, dans l’administration, et finit par donner au peuple lui-même quelque chose des instincts des magistrats.
Lorsqu’on visite les Américains et qu’on étudie leurs lois, on voit que l’autorité qu’ils ont donnée [II-157] aux légistes, et l’influence qu’ils leur ont laissé prendre dans le gouvernement, forment aujourd’hui la plus puissante barrière contre les écarts de la démocratie. Cet effet me semble tenir à une cause générale qu’il est utile de rechercher, car elle peut se reproduire ailleurs.
Les légistes ont été mêlés à tous les mouvements de la société politique, en Europe, depuis cinq cents ans. Tantôt ils ont servi d’instruments aux puissances politiques, tantôt ils ont pris les puissances politiques pour instruments. Au moyen-âge, les légistes ont merveilleusement coopéré à étendre la domination des rois ; depuis ce temps, ils ont puissamment travaillé à restreindre ce même pouvoir. En Angleterre, on les a vus s’unir intimement à l’aristocratie ; en France, ils se sont montrés ses ennemis les plus dangereux. Les légistes ne cèdent-ils donc qu’à des impulsions soudaines et momentanées, ou obéissent-ils plus ou moins, suivant les circonstances, à des instincts qui leur soient naturels, et qui se reproduisent toujours ? Je voudrais éclaircir ce point ; car peut-être les légistes sont-ils appelés à jouer le premier rôle dans la société politique qui cherche à naître.
Les hommes qui ont fait leur étude spéciale des lois ont puisé dans ces travaux des habitudes d’ordre, un certain goût des formes, une sorte d’amour instinctif pour l’enchaînement régulier des idées, qui les rendent naturellement fort opposés à l’esprit révolutionnaire et aux passions irréfléchies de la démocratie.
Les connaissances spéciales que les légistes [II-158] acquièrent en étudiant la loi leur assurent un rang à part dans la société ; ils forment une sorte de classe privilégiée parmi les intelligences. Ils retrouvent chaque jour l’idée de cette supériorité dans l’exercice de leur profession ; ils sont les maîtres d’une science nécessaire, dont la connaissance n’est point répandue ; ils servent d’arbitres entre les citoyens, et l’habitude de diriger vers le but les passions aveugles des plaideurs leur donne un certain mépris pour le jugement de la foule. Ajoutez à cela qu’ils forment naturellement un corps. Ce n’est pas qu’ils s’entendent entre eux et se dirigent de concert vers un même point ; mais la communauté des études et l’unité des méthodes lient leurs esprits les uns aux autres, comme l’intérêt pourrait unir leurs volontés.
On retrouve donc cachée au fond de l’âme des légistes une partie des goûts et des habitudes de l’aristocratie. Ils ont comme elle un penchant instinctif pour l’ordre, un amour naturel des formes ; ainsi qu’elle, ils conçoivent un grand dégoût pour les actions de la multitude et méprisent secrètement le gouvernement du peuple.
Je ne veux point dire que ces penchants naturels des légistes soient assez forts pour les enchaîner d’une façon irrésistible. Ce qui domine chez les légistes, comme chez tous les hommes, c’est l’intérêt particulier, et surtout l’intérêt du moment.
Il y a telle société où les hommes de loi ne peuvent prendre dans le monde politique un rang analogue à celui qu’ils occupent dans la vie privée ; on peut être assuré que, dans une société organisée de cette [II-159] manière, les légistes seront des agents très actifs de révolution. Mais il faut rechercher si la cause qui les porte alors à détruire ou à changer naît, chez eux, d’une disposition permanente ou d’un accident. Il est vrai que les légistes ont singulièrement contribué à renverser la monarchie française en 1789. Reste à savoir s’ils ont agi ainsi parce qu’ils avaient étudié les lois, ou parce qu’ils ne pouvaient concourir à les faire.
Il y a cinq cents ans, l’aristocratie anglaise se mettait à la tête du peuple et parlait en son nom ; aujourd’hui elle soutient le trône et se fait le champion de l’autorité royale. L’aristocratie a pourtant des instincts et des penchants qui lui sont propres.
Il faut bien se garder aussi de prendre des membres isolés du corps pour le corps lui-même.
Dans tous les gouvernements libres, quelle qu’en soit la forme, on trouvera des légistes aux premiers rangs de tous les partis. Cette même remarque est encore applicable à l’aristocratie. Presque tous les mouvements démocratiques qui ont agité le monde ont été dirigés par des nobles.
Un corps d’élite ne peut jamais suffire à toutes les ambitions qu’il renferme ; il s’y trouve toujours plus de talents et de passions que d’emplois, et on ne manque point d’y rencontrer un grand nombre d’hommes qui, ne pouvant grandir assez vite en se servant des privilèges du corps, cherchent à le faire en attaquant ces privilèges.
Je ne prétends donc point qu’il arrive une époque où tous les légistes, ni que dans tous les temps, la [II-160] plupart d’entre eux doivent se montrer amis de l’ordre et ennemis des changements.
Je dis que dans une société où les légistes occuperont sans contestation la position élevée qui leur appartient naturellement, leur esprit sera éminemment conservateur et se montrera antidémocratique.
Lorsque l’aristocratie ferme ses rangs aux légistes, elle trouve en eux des ennemis d’autant plus dangereux qu’au-dessous d’elle par leur richesse et leur pouvoir, ils sont indépendants d’elle par leurs travaux et se sentent à son niveau par leurs lumières.
Mais toutes les fois que les nobles ont voulu faire partager aux légistes quelques uns de leurs priviléges, ces deux classes ont rencontré pour s’unir de grandes facilités et se sont pour ainsi dire trouvées de la même famille.
Je suis également porté à croire qu’il sera toujours aisé à un roi de faire des légistes les plus utiles instruments de sa puissance.
Il y a infiniment plus d’affinité naturelle entre les hommes de loi et le pouvoir exécutif, qu’entre eux et le peuple, quoique les légistes aient souvent aidé à renverser le premier ; de même qu’il y a plus d’affinité naturelle entre les nobles et le roi qu’entre les nobles et le peuple, bien que souvent on ait vu les classes supérieures de la société s’unir aux autres pour lutter contre le pouvoir royal.
Ce que les légistes aiment par-dessus toutes choses, c’est la vie de l’ordre, et la plus grande garantie de l’ordre est l’autorité. Il ne faut pas d’ailleurs [II-161] oublier que, s’ils prisent la liberté, ils placent en général la légalité bien au-dessus d’elle ; ils craignent moins la tyrannie que l’arbitraire, et, pourvu que le législateur se charge lui-même d’enlever aux hommes leur indépendance, ils sont à peu près contents.
Je pense donc que le prince qui, en présence d’une démocratie envahissante, chercherait à abattre le pouvoir judiciaire dans ses États, et à y diminuer l’influence politique des légistes, commettrait une grande erreur. Il lâcherait la substance de l’autorité pour en saisir l’ombre.
Je ne doute point qu’il ne lui fût plus profitable d’introduire les légistes dans le gouvernement. Après leur avoir confié le despotisme sous la forme de la violence, peut-être le retrouverait-il en leurs mains sous les traits de la justice et de la loi.
Le gouvernement de la démocratie est favorable à la puissance politique des légistes. Lorsque le riche, le noble et le prince sont exclus du gouvernement, les légistes y arrivent pour ainsi dire de plein droit ; car ils forment alors les seuls hommes éclairés et habiles que le peuple puisse choisir hors de lui.
Si les légistes sont naturellement portés par leurs goûts vers l’aristocratie et le prince, ils le sont donc naturellement vers le peuple par leur intérêt.
Ainsi, les légistes aiment le gouvernement de la démocratie, sans partager ses penchants, et sans imiter ses faiblesses, double cause pour être puissant par elle et sur elle.
Le peuple, dans la démocratie, ne se défie point des légistes, parce qu’il sait que leur intérêt est de servir sa cause ; il les écoute sans colère, parce qu’il [II-162] ne leur suppose pas d’arrière-pensées. En effet, les légistes ne veulent point renverser le gouvernement que s’est donné la démocratie, mais ils s’efforcent sans cesse de le diriger suivant une tendance qui n’est pas la sienne, et par des moyens qui lui sont étrangers. Le légiste appartient au peuple par son intérêt et par sa naissance, et à l’aristocratie par ses habitudes et par ses goûts ; il est comme la liaison naturelle entre ces deux choses, comme l’anneau qui les unit.
Le corps des légistes forme le seul élément aristocratique qui puisse se mêler sans efforts aux éléments naturels de la démocratie, et se combiner d’une manière heureuse et durable avec eux. Je n’ignore pas quels sont les défauts inhérents à l’esprit légiste ; sans ce mélange de l’esprit légiste avec l’esprit démocratique, je doute cependant que la démocratie pût gouverner long-temps la société, et je ne saurais croire que de nos jours une république pût espérer de conserver son existence, si l’influence des légistes dans les affaires n’y croissait pas en proportion du pouvoir du peuple.
Ce caractère aristocratique que j’aperçois dans l’esprit légiste est bien plus prononcé encore aux États-Unis et en Angleterre que dans aucun autre pays. Cela ne tient pas seulement à l’étude que les légistes anglais et américains font des lois, mais à la nature même de la législation et à la position que ces interprètes occupent chez ces deux peuples.
Les Anglais et les Américains ont conservé la législation des précédents, c’est-à-dire qu’ils continuent à puiser, dans les opinions et les décisions légales de [II-163] leurs pères, les opinions qu’ils doivent avoir en matière de loi, et les décisions qu’ils doivent rendre.
Chez un légiste anglais ou américain, le goût et le respect de ce qui est ancien se joint donc presque toujours à l’amour de ce qui est régulier et légal.
Ceci a encore une autre influence sur le tour d’esprit des légistes, et par suite sur la marche de la société.
Le légiste anglais ou américain recherche ce qui a été fait, le légiste français ce qu’on a dû vouloir faire ; l’un veut des arrêts, l’autre des raisons.
Lorsque vous écoutez un légiste anglais ou américain, vous êtes surpris de lui voir citer si souvent l’opinion des autres, et de l’entendre si peu parler de la sienne propre, tandis que le contraire arrive parmi nous.
Il n’est pas de si petite affaire que l’avocat français consente à traiter, sans y introduire un système d’idées qui lui appartienne, et il discutera jusqu’aux principes constitutifs des lois, à cette fin qu’il plaise au tribunal reculer d’une toise la borne de l’héritage contesté.
Cette sorte d’abnégation que fait le légiste anglais et américain de son propre sens, pour s’en rapporter au sens de ses pères ; cette espèce de servitude, dans laquelle il est obligé de maintenir sa pensée, doit donner à l’esprit légiste des habitudes plus timides, et lui faire contracter des penchants plus stationnaires, en Angleterre et en Amérique qu’en France.
Nos lois écrites sont souvent difficiles à comprendre, mais chacun peut y lire ; il n’y a rien, au contraire, de plus obscur pour le vulgaire, et de [II-164] moins à sa portée qu’une législation fondée sur des précédents. Ce besoin qu’on a du légiste en Angleterre et aux États-Unis, cette haute idée qu’on se forme de ses lumières, le sépare de plus en plus du peuple, et achèvent de le mettre dans une classe à part. Le légiste français n’est qu’un savant ; mais l’homme de loi anglais ou américain ressemble en quelque sorte aux prêtres de l’Égypte ; comme eux, il est l’unique interprète d’une science occulte.
La position que les hommes de loi occupent, en Angleterre et en Amérique, exerce une influence non moins grande sur leurs habitudes et leurs opinions. L’aristocratie d’Angleterre, qui a eu le soin d’attirer dans son sein tout ce qui avait quelque analogie naturelle avec elle, a fait aux légistes une très grande part de considération et de pouvoir. Dans la société anglaise, les légistes ne sont pas au premier rang, mais ils se tiennent pour contents du rang qu’ils occupent. Ils forment comme la branche cadette de l’aristocratie anglaise, et ils aiment et respectent leurs aînés, sans partager tous leurs priviléges. Les légistes anglais mêlent donc aux intérêts aristocratiques de leur profession les idées et les goûts aristocratiques de la société au milieu de laquelle ils vivent.
Aussi est-ce surtout en Angleterre qu’on peut voir en relief ce type légiste que je cherche à peindre : le légiste anglais estime les lois, non pas tant parce qu’elles sont bonnes que parce qu’elles sont vieilles ; et, s’il se voit réduit à les modifier en quelque point, pour les adapter aux changements que le temps fait subir aux sociétés, il recourt aux plus incroyables subtilités, afin de se persuader qu’en ajoutant quelque [II-165] chose à l’œuvre de ses pères, il ne fait que développer leur pensée et compléter leurs travaux. N’espérez pas lui faire reconnaître qu’il est novateur ; il consentira à aller jusqu’à l’absurde avant que de s’avouer coupable d’un si grand crime. C’est en Angleterre qu’est né cet esprit légal, qui semble indifférent au fond des choses, pour ne faire attention qu’à la lettre, et qui sortirait plutôt de la raison et de l’humanité que de la loi.
La législation anglaise est comme un arbre antique, sur lequel les légistes ont greffé sans cesse les rejetons les plus étrangers, dans l’espérance que, tout en donnant des fruits différents, ils confondront du moins leur feuillage avec la tige vénérable qui les supporte.
En Amérique, il n’y a point de nobles ni de littérateurs, et le peuple se défie des riches. Les légistes forment donc la classe politique supérieure et la portion la plus intellectuelle de la société. Ainsi, ils ne pourraient que perdre à innover : ceci ajoute un intérêt conservateur au goût naturel qu’ils ont pour l’ordre.
Si l’on me demandait où je place l’aristocratie américaine, je répondrais sans hésiter que ce n’est point parmi les riches, qui n’ont aucun lien commun qui les rassemble. L’aristocratie américaine est au banc des avocats et sur le siège des juges.
Plus on réfléchit à ce qui se passe aux États-Unis, plus l’on se sent convaincu que le corps des légistes forme dans ce pays le plus puissant et, pour ainsi dire, l’unique contrepoids de la démocratie.
C’est aux États-Unis qu’on découvre sans peine [II-166] combien l’esprit légiste, par ses qualités, et je dirai même par ses défauts, est propre à neutraliser les vices inhérents au gouvernement populaire.
Lorsque le peuple américain se laisse enivrer par ses passions, ou se livre à l’entraînement de ses idées, les légistes lui font sentir un frein presque invisible qui le modère et l’arrête. À ses instincts démocratiques, ils opposent secrètement leurs penchants aristocratiques ; à son amour de la nouveauté, leur respect superstitieux de ce qui est ancien ; à l’immensité de ses desseins, leurs vues étroites ; à son mépris des règles, leur goût des formes ; et à sa fougue, leur habitude de procéder avec lenteur.
Les tribunaux sont les organes les plus visibles dont se sert le corps des légistes pour agir sur la démocratie.
Le juge est un légiste qui, indépendamment du goût de l’ordre et des règles qu’il a contracté dans l’étude des lois, puise encore l’amour de la stabilité dans l’inamovibilité de ses fonctions. Ses connaissances légales lui avaient déjà assuré une position élevée parmi ses semblables ; son pouvoir politique achève de le placer dans un rang à part, et de lui donner les instincts des classes privilégiées.
Armé du droit de déclarer les lois inconstitutionnelles, le magistrat américain pénètre sans cesse dans les affaires politiques [29] . Il ne peut pas forcer le peuple à faire des lois, mais du moins il le contraint à ne point être infidèle à ses propres lois et à rester d’accord avec lui-même. [II-167] .
Je n’ignore pas qu’il existe aux États-Unis une secrète tendance qui porte le peuple à réduire la puissance judiciaire ; dans la plupart des constitutions particulières d’État, le gouvernement, sur la demande de deux Chambres, peut enlever aux juges leur siège. Certaines constitutions font élire les membres des tribunaux, et les soumettent à de fréquentes réélections. J’ose prédire que ces innovations auront tôt ou tard des résultats funestes, et qu’on s’apercevra un jour qu’en diminuant ainsi l’indépendance des magistrats, on n’a pas seulement attaqué le pouvoir judiciaire, mais la république démocratique elle-même.
Il ne faut pas croire, du reste, qu’aux États-Unis l’esprit légiste soit uniquement renfermé dans l’enceinte des tribunaux ; il s’étend bien au-delà.
Les légistes, formant la seule classe éclairée dont le peuple ne se défie point, sont naturellement appelés à occuper la plupart des fonctions publiques. Ils remplissent les législatures, et sont à la tête des administrations ; ils exercent donc une grande influence sur la formation de la loi et sur son exécution. Les légistes sont pourtant obligés de céder au courant d’opinion publique qui les entraîne ; mais il est facile de trouver des indices de ce qu’ils feraient s’ils étaient libres. Les Américains, qui ont tant innové dans leurs lois politiques, n’ont introduit que de légers changements, et à grand-peine, dans leurs lois civiles, quoique plusieurs de ces lois répugnent fortement à leur état social. Cela vient de ce qu’en matière de droit civil la majorité est toujours obligée de s’en rapporter aux légistes ; et les légistes américains, livrés à leur propre arbitre, n’innovent point. [II-168] .
C’est une chose fort singulière pour un Français que d’entendre les plaintes qui s’élèvent, aux États-Unis, contre l’esprit stationnaire et les préjugés des légistes en faveur de ce qui est établi.
L’influence de l’esprit légiste s’étend plus loin encore que les limites précises que je viens de tracer.
Il n’est presque pas de question politique, aux États-Unis, qui ne se résolve tôt ou tard en question judiciaire. De là, l’obligation où se trouvent les partis, dans leur polémique journalière, d’emprunter à la justice ses idées et son langage. La plupart des hommes publics étant, ou ayant d’ailleurs été des légistes, font passer dans le maniement des affaires les usages et le tour d’idées qui leur sont propres. Le jury achève d’y familiariser toutes les classes. La langue judiciaire devient ainsi, en quelque sorte, la langue vulgaire ; l’esprit légiste, né dans l’intérieur des écoles et des tribunaux, se répand donc peu à peu au-delà de leur enceinte ; il s’infiltre pour ainsi dire dans toute la société, il descend dans les derniers rangs, et le peuple tout entier finit par contracter une partie des habitudes et des goûts du magistrat.
Les légistes forment, aux États-Unis, une puissance qu’on redoute peu, qu’on aperçoit à peine, qui n’a point de bannière à elle, qui se plie avec flexibilité aux exigences du temps, et se laisse aller sans résistance à tous les mouvements du corps social ; mais elle enveloppe la société tout entière, pénètre dans chacune des classes qui la composent, la travaille en secret, agit sans cesse sur elle à son insu, et finit par la modeler suivant ses désirs. [II-169]
DU JURY AUX ÉTATS-UNIS CONSIDÉRÉ COMME INSTITUTION POLITIQUE.
Le jury, qui est un des modes de la souveraineté du peuple, doit être mis en rapport avec les autres lois qui établissent cette souveraineté. — Composition du jury aux États-Unis. — Effets produits par le jury sur le caractère national. Éducation qu’il donne au peuple. — Comment il tend à établir l’influence des magistrats et à répandre l’esprit légiste.
Puisque mon sujet m’a naturellement amené à parler de la justice aux États-Unis, je n’abandonnerai pas cette matière sans m’occuper du jury.
Il faut distinguer deux choses dans le jury : une institution judiciaire et une institution politique.
S’il s’agissait de savoir jusqu’à quel point le jury, et surtout le jury en matière civile, sert à la bonne administration de la justice, j’avouerais que son utilité pourrait être contestée.
L’institution du jury a pris naissance dans une société peu avancée, où l’on ne soumettait guère aux tribunaux que de simples questions de fait ; et ce n’est pas une tâche facile que de l’adapter aux besoins d’un peuple très civilisé, quand les rapports des hommes entre eux se sont singulièrement multipliés, et ont pris un caractère savant et intellectuel [30] . [II-170] .
Mon but principal, en ce moment, est d’envisager le côté politique du jury : une autre voie m’écarterait de mon sujet. Quant au jury considéré comme moyen judiciaire, je n’en dirai que deux mots. Lorsque les Anglais ont adopté l’institution du jury, ils formaient un peuple à demi barbare ; ils sont devenus, depuis, l’une des nations les plus éclairées du globe, et leur attachement pour le jury a paru croître avec leurs lumières. Ils sont sortis de leur territoire, et on les a vus se répandre dans tout l’univers : les uns ont formé des colonies ; les autres des États indépendants ; le corps de la nation a gardé un roi ; plusieurs des émigrants ont fondé de puissantes républiques ; mais partout les Anglais ont également préconisé l’institution du jury [31] . Ils l’ont établie partout, ou se sont hâtés de la rétablir. Une institution judiciaire qui obtient ainsi les suffrages d’un grand peuple durant une longue suite de siècles, qu’on reproduit avec zèle à toutes les époques de la civilisation, dans tous les [II-171] climats et sous toutes les formes de gouvernement, ne saurait être contraire à l’esprit de la justice [32] .
Mais quittons ce sujet. Ce serait singulièrement rétrécir sa pensée que de se borner à envisager le jury comme une institution judiciaire ; car, s’il exerce une grande influence sur le sort des procès, il en exerce une bien plus grande encore sur les destinées mêmes de la société. Le jury est donc avant tout une institution politique. C’est à ce point de vue qu’il faut toujours se placer pour le juger. [II-172] .
J’entends par jury un certain nombre de citoyens pris au hasard et revêtus momentanément du droit de juger.
Appliquer le jury à la répression des crimes me paraît introduire dans le gouvernement une institution éminemment républicaine. Je m’explique :.
L’institution du jury peut être aristocratique ou démocratique, suivant la classe dans laquelle on prend les jurés ; mais elle conserve toujours un caractère républicain, en ce qu’elle place la direction réelle de la société dans les mains des gouvernés ou d’une portion d’entre eux, et non dans celle des gouvernants.
La force n’est jamais qu’un élément passager de succès : après elle vient aussitôt l’idée du droit. Un gouvernement réduit à ne pouvoir atteindre ses ennemis que sur le champ de bataille, serait bientôt détruit. La véritable sanction des lois politiques se trouve donc dans les lois pénales, et si la sanction manque, la loi perd tôt ou tard sa force. L’homme qui juge au criminel est donc réellement le maître de la société. Or, l’institution du jury place le peuple lui-même, ou du moins une classe de citoyens, sur le siége du juge. L’institution du jury met donc réellement la direction de la société dans les mains du peuple ou de cette classe [33] . [II-173] .
En Angleterre, le jury se recrute dans la portion aristocratique de la nation. L’aristocratie fait les lois, applique les lois et juge les infractions aux lois (B). Tout est d’accord : aussi l’Angleterre forme-t-elle à vrai dire une république aristocratique. Aux États-Unis, le même système est appliqué au peuple entier. Chaque citoyen américain est électeur, éligible et juré (C). Le système du jury, tel qu’on l’entend en Amérique, me paraît une conséquence aussi directe et aussi extrême du dogme de la souveraineté du peuple que le vote universel. Ce sont deux moyens également puissants de faire régner la majorité.
Tous les souverains qui ont voulu puiser en eux-mêmes les sources de leur puissance, et diriger la société au lieu de se laisser diriger par elle, ont détruit l’institution du jury ou l’ont énervée. Les Tudors envoyaient en prison les jurés qui ne voulaient pas condamner, et Napoléon les faisait choisir par ses agents.
Quelque évidentes que soient la plupart des vérités qui précèdent, elles ne frappent point tous les esprits, et souvent, parmi nous, on ne semble encore se faire qu’une idée confuse de l’institution du jury. Veut on savoir de quels éléments doit se composer la liste des jurés, on se borne à discuter quelles sont les lumières et la capacité de ceux qu’on appelle à en faire partie, comme s’il ne s’agissait que d’une institution judiciaire. En vérité, il me semble que c’est là se préoccuper de la moindre portion du sujet ; le jury est avant tout une institution politique ; on doit le [II-174] considérer comme un mode de la souveraineté du peuple ; il faut le rejeter entièrement quand on repousse la souveraineté du peuple, ou le mettre en rapport avec les autres lois qui établissent cette souveraineté. Le jury forme la partie de la nation chargée d’assurer l’exécution des lois, comme les chambres sont la partie de la nation chargée de faire les lois ; et pour que la société soit gouvernée d’une manière fixe et uniforme, il est nécessaire que la liste des jurés s’étende ou se resserre avec celle des électeurs. C’est ce point de vue qui, suivant moi, doit toujours attirer l’attention principale du législateur. Le reste est pour ainsi dire accessoire.
Je suis si convaincu que le jury est avant tout une institution politique, que je le considère encore de cette manière lorsqu’on l’applique en matière civile.
Les lois sont toujours chancelantes, tant qu’elles ne s’appuient pas sur les mœurs ; les mœurs forment la seule puissance résistante et durable chez un peuple.
Quand le jury est réservé pour les affaires criminelles, le peuple ne le voit agir que de loin en loin et dans les cas particuliers ; il s’habitue à s’en passer dans le cours ordinaire de la vie, et il le considère comme un moyen et non comme le seul moyen d’obtenir justice [34] .
Lorsque, au contraire, le jury est étendu aux affaires civiles, son application tombe à chaque instant sous les yeux ; il touche alors à tous les intérêts ; chacun vient concourir à son action ; il pénètre ainsi jusque dans les usages de la vie ; il plie l’esprit [II-175] humain à ses formes et se confond pour ainsi dire avec l’idée même de la justice.
L’institution du jury, bornée aux affaires criminelles, est donc toujours en péril ; une fois introduite dans les matières civiles, elle brave le temps et les efforts des hommes. Si on eût pu enlever le jury des mœurs des Anglais aussi facilement que de leurs lois, il eût entièrement succombé sous les Tudors. C’est donc le jury civil qui a réellement sauvé les libertés de l’Angleterre.
De quelque manière qu’on applique le jury, il ne peut manquer d’exercer une grande influence sur le caractère national ; mais cette influence s’accroît infiniment à mesure qu’on l’introduit plus avant dans les matières civiles.
Le jury, et surtout le jury civil, sert à donner à l’esprit de tous les citoyens une partie des habitudes de l’esprit du juge ; et ces habitudes sont précisément celles qui préparent le mieux le peuple à être libre.
Il répand dans toutes les classes le respect pour la chose jugée et l’idée du droit. Ôtez ces deux choses, et l’amour de l’indépendance ne sera plus qu’une passion destructive.
Il enseigne aux hommes la pratique de l’équité. Chacun, en jugeant son voisin, pense qu’il pourra être jugé à son tour. Cela est vrai surtout du jury en matière civile : il n’est presque personne qui craigne d’être un jour l’objet d’une poursuite criminelle ; mais tout le monde peut avoir un procès.
Le jury apprend à chaque homme à ne pas reculer devant la responsabilité de ses propres actes ; [II-176] disposition virile, sans laquelle il n’y a pas de vertu politique.
Il revêt chaque citoyen d’une sorte de magistrature ; il fait sentir à tous qu’ils ont des devoirs à remplir envers la société, et qu’ils entrent dans son gouvernement. En forçant les hommes à s’occuper d’autre chose que de leurs propres affaires, il combat l’égoïsme individuel, qui est comme la rouille des sociétés.
Le jury sert incroyablement à former le jugement et à augmenter les lumières naturelles du peuple. C’est là, à mon avis, son plus grand avantage. On doit le considérer comme une école gratuite et toujours ouverte, où chaque juré vient s’instruire de ses droits, où il entre en communication journalière avec les membres les plus instruits et les plus éclairés des classes élevées, où les lois lui sont enseignées d’une manière pratique, et sont mises à la portée de son intelligence par les efforts des avocats, les avis du juge et les passions mêmes des parties. Je pense qu’il faut principalement attribuer l’intelligence pratique et le bon sens politique des Américains au long usage qu’ils ont fait du jury en matière civile.
Je ne sais si le jury est utile à ceux qui ont des procès, mais je suis sûr qu’il est très utile à ceux qui les jugent. Je le regarde comme l’un des moyens les plus efficaces dont puisse se servir la société pour l’éducation du peuple.
Ce qui précède s’applique à toutes les nations ; mais voici ce qui est spécial aux Américains, et en général aux peuples démocratiques.
J’ai dit plus haut que dans les démocraties les [II-177] légistes, et parmi eux les magistrats, forment le seul corps aristocratique qui puisse modérer les mouvements du peuple. Cette aristocratie n’est revêtue d’aucune puissance matérielle, elle n’exerce son influence conservatrice que sur les esprits. Or, c’est dans l’institution du jury civil qu’elle trouve les principales sources de son pouvoir.
Dans les procès criminels, où la société lutte contre un homme, le jury est porté à voir dans le juge l’instrument passif du pouvoir social, et il se défie de ses avis. De plus, les procès criminels reposent entièrement sur des faits simples que le bon sens parvient aisément à apprécier. Sur ce terrain, le juge et le juré sont égaux.
Il n’en est pas de même dans les procès civils : le juge apparaît alors comme un arbitre désintéressé entre les passions des parties. Les jurés le voient avec confiance, et ils l’écoutent avec respect, car ici son intelligence domine entièrement la leur. C’est lui qui déroule devant eux les divers arguments dont on a fatigué leur mémoire, et qui les prend par la main pour les diriger à travers les détours de la procédure ; c’est lui qui les circonscrit dans le point de fait et leur enseigne la réponse qu’ils doivent faire à la question de droit. Son influence sur eux est presque sans bornes.
Faut-il dire enfin pourquoi je me sens peu ému des arguments tirés de l’incapacité des jurés en matière civile ?.
Dans les procès civils, toutes les fois du moins qu’il ne s’agit pas de questions de fait, le jury n’a que l’apparence d’un corps judiciaire. [II-178] .
Les jurés prononcent l’arrêt que le juge a rendu. Ils prêtent à cet arrêt l’autorité de la société qu’ils représentent, et lui, celle de la raison et de la loi (D).
En Angleterre et en Amérique, les juges exercent sur le sort des procès criminels une influence que le juge français n’a jamais connue. Il est facile de comprendre la raison de cette différence : le magistrat anglais ou américain a établi son pouvoir en matière civile, il ne fait que l’exercer ensuite sur un autre théâtre ; il ne l’y acquiert point.
Il y a des cas, et ce sont souvent les plus importants, où le juge américain a le droit de prononcer seul [35] . Il se trouve alors, par occasion, dans la position où se trouve habituellement le juge français ; mais son pouvoir moral est bien plus grand : les souvenirs du jury le suivent encore, et sa voix a presque autant de puissance que celle de la société dont les jurés étaient l’organe.
Son influence s’étend même bien au-delà de l’enceinte des tribunaux : dans les délassements de la vie privée comme dans les travaux de la vie politique, sur la place publique comme dans le sein des législatures, le juge américain retrouve sans cesse autour de lui des hommes qui se sont habitués à voir dans son intelligence quelque chose de supérieur à la leur ; et, après s’être exercé sur les procès, son pouvoir se fait sentir sur toutes les habitudes de l’esprit et jusque sur l’âme même de ceux qui ont concouru avec lui à les juger.
Le jury, qui semble diminuer les droits de la [II-179] magistrature, fonde donc réellement son empire, et il n’y a pas de pays où les juges soient aussi puissants que ceux où le peuple entre en partage de leurs priviléges.
C’est surtout à l’aide du jury en matière civile que la magistrature américaine fait pénétrer ce que j’ai appelé l’esprit légiste jusque dans les derniers rangs de la société.
Ainsi le jury, qui est le moyen le plus énergique de faire régner le peuple, est aussi le moyen le plus efficace de lui apprendre à régner. [II-180]
[II-180]
CHAPITRE IX.↩
DES CAUSES PRINCIPALES QUI TENDENT À MAINTENIR LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE AUX ÉTATS-UNIS.
La république démocratique subsiste aux États-Unis. Le but principal de ce livre a été de faire comprendre les causes de ce phénomène.
Parmi ces causes, il en est plusieurs à côté desquelles le courant de mon sujet m’a entraîné malgré moi, et que je n’ai fait qu’indiquer de loin en passant. Il en est d’autres dont je n’ai pu m’occuper ; et celles sur lesquelles il m’a été permis de m’étendre sont restées derrière moi comme ensevelies sous les détails,.
J’ai donc pensé qu’avant d’aller plus loin et de parler de l’avenir, je devais réunir dans un cadre étroit toutes les raisons qui expliquent le présent.
Dans cette espèce de résumé je serai court, car j’aurai soin de ne faire que rappeler très sommairement au lecteur ce qu’il connaît déjà, et parmi les faits que je n’ai pas encore eu l’occasion d’exposer, je ne choisirai que les principaux.
J’ai pensé que toutes les causes qui tendent au maintien de la république démocratique aux États-Unis pouvaient se réduire à trois.
La situation particulière et accidentelle dans [II-181] laquelle la Providence a placé les Américains forme la première ;.
La deuxième provient des lois ;.
La troisième découle des habitudes et des mœurs.
DES CAUSES ACCIDENTELLES OU PROVIDENTIELLES QUI CONTRIBUENT AU MAINTIEN DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE AUX ÉTATS-UNIS.
L’Union n’a pas de voisins. — Point de grande capitale. — Les Américains ont eu pour eux le hasard de la naissance. — L’Amérique est un pays vide. — Comment cette circonstance sert puissamment au maintien de la république démocratique. — Manière dont se peuplent les déserts de l’Amérique. — Avidité des Anglo-Américains pour s’emparer des solitudes du Nouveau Monde. — Influence du bien-être matériel sur les opinions politiques des Américains.
Il y a mille circonstances indépendantes de la volonté des hommes qui, aux États-Unis, rendent la république démocratique aisée. Les unes sont connues, les autres sont faciles à faire connaître : je me bornerai à exposer les principales.
Les Américains n’ont pas de voisins, par conséquent point de grandes guerres, de crise financière, de ravages ni de conquête à craindre ; ils n’ont besoin ni de gros impôts, ni d’armée nombreuse, ni de grands généraux ; ils n’ont presque rien à redouter d’un fléau plus terrible pour les républiques que tous ceux-là ensemble, la gloire militaire.
Comment nier l’incroyable influence qu’exerce la gloire militaire sur l’esprit du peuple ? Le général Jackson, que les Américains ont choisi deux fois pour le placer à leur tête, est un homme d’un caractère violent et d’une capacité moyenne ; rien dans tout le cours de [II-182] sa carrière n’avait jamais prouvé qu’il eût les qualités requises pour gouverner un peuple libre : aussi la majorité des classes éclairées de l’Union lui a toujours été contraire. Qui donc l’a placé sur le siège du président et l’y maintient encore ? Le souvenir d’une victoire remportée par lui, il y a vingt ans, sous les murs de la Nouvelle-Orléans ; or, cette victoire de la Nouvelle-Orléans est un fait d’armes fort ordinaire dont on ne saurait s’occuper long-temps que dans un pays où l’on ne donne point de batailles ; et le peuple qui se laisse ainsi entraîner par le prestige de la gloire est, à coup sûr, le plus froid, le plus calculateur, le moins militaire, et, si je puis m’exprimer ainsi, le plus prosaïque de tous les peuples du monde.
L’Amérique n’a point de grande capitale [36] dont l’influence directe ou indirecte se fasse sentir sur toute l’étendue du territoire, ce que je considère comme une des premières causes du maintien des institutions républicaines aux États-Unis. Dans les villes, on ne peut guère empêcher les hommes de se concerter, de s’échauffer en commun, de prendre des résolutions subites et passionnées. Les villes forment comme de [II-183] grandes assemblées dont tous les habitants sont membres. Le peuple y exerce une influence prodigieuse sur ses magistrats, et souvent il y exécute sans intermédiaire ses volontés.
Soumettre les provinces à la capitale, c’est donc remettre la destinée de tout l’empire, non seulement dans les mains d’une portion du peuple, ce qui est injuste, mais encore dans les mains du peuple agissant par lui-même, ce qui est fort dangereux. La prépondérance des capitales porte donc une grave atteinte au système représentatif. Elle fait tomber les républiques modernes dans le défaut des républiques de l’antiquité, qui ont toutes péri pour n’avoir pas connu ce système.
Il me serait facile d’énumérer ici un grand nombre d’autres causes secondaires qui ont favorisé l’établissement et assurent le maintien de la république démocratique aux États-Unis. Mais au milieu de cette foule de circonstances heureuses, j’en aperçois deux principales, et je me hâte de les indiquer.
J’ai déjà dit précédemment que je voyais dans l’origine des Américains, dans ce que j’ai appelé leur point de départ, la première et la plus efficace de [II-184] toutes les causes auxquelles on puisse attribuer la prospérité actuelle des États-Unis. Les Américains ont eu pour eux le hasard de la naissance : leurs pères ont jadis importé sur le sol qu’ils habitent l’égalité des conditions et celle des intelligences, d’où la république démocratique devait sortir un jour comme de sa source naturelle. Ce n’est pas tout encore ; avec un état social républicain, ils ont légué à leurs descendants les habitudes, les idées et les mœurs les plus propres à faire fleurir la république. Quand je pense à ce qu’a produit ce fait originel, il me semble voir toute la destinée de l’Amérique renfermée dans le premier puritain qui aborda sur ses rivages, comme toute la race humaine dans le premier homme.
Parmi les circonstances heureuses qui ont encore favorisé l’établissement et assurent le maintien de la république démocratique aux États-Unis, la première en importance est le choix du pays lui-même que les Américains habitent. Leurs pères leur ont donné l’amour de l’égalité et de la liberté, mais c’est Dieu même qui, en leur livrant un continent sans bornes, leur a accordé les moyens de rester long-temps égaux et libres.
Le bien-être général favorise la stabilité de tous les gouvernements, mais particulièrement du gouvernement démocratique, qui repose sur les dispositions du plus grand nombre, et principalement sur les dispositions de ceux qui sont le plus exposés aux besoins. Lorsque le peuple gouverne, il est nécessaire qu’il soit heureux, pour qu’il ne bouleverse pas l’État. La misère produit chez lui ce que l’ambition fait [II-185] chez les rois. Or, les causes matérielles et indépendantes des lois qui peuvent amener le bien-être sont plus nombreuses en Amérique qu’elles ne l’ont été dans aucun pays du monde, à aucune époque de l’histoire.
Aux États-Unis, ce n’est pas seulement la législation qui est démocratique, la nature elle-même travaille pour le peuple.
Où trouver, parmi les souvenirs de l’homme, rien de semblable à ce qui se passe sous nos yeux dans l’Amérique du Nord ?.
Les sociétés célèbres de l’Antiquité se sont toutes fondées au milieu de peuples ennemis qu’il a fallu vaincre pour s’établir à leur place. Les modernes eux-mêmes ont trouvé dans quelques parties de l’Amérique du Sud de vastes contrées habitées par des peuples moins éclairés qu’eux, mais qui s’étaient déjà approprié le sol en le cultivant. Pour fonder leurs nouveaux États, il leur a fallu détruire ou asservir des populations nombreuses, et ils ont fait rougir la civilisation de ses triomphes.
Mais l’Amérique du Nord n’était habitée que par des tribus errantes qui ne pensaient point à utiliser les richesses naturelles du sol. L’Amérique du Nord était encore, à proprement parler, un continent vide, une terre déserte, qui attendait des habitants.
Tout est extraordinaire chez les Américains, leur état social comme leurs lois ; mais ce qui est plus extraordinaire encore, c’est le sol qui les porte.
Quand la terre fut livrée aux hommes par le Créateur, elle était jeune et inépuisable, mais ils étaient faibles et ignorants ; et lorsqu’ils eurent appris à tirer [II-186] parti des trésors qu’elle renfermait dans son sein, ils en couvraient déjà la face, et bientôt il leur fallut combattre pour acquérir le droit d’y posséder un asile et de s’y reposer en liberté.
C’est alors que l’Amérique du Nord se découvre, comme si Dieu l’eût tenue en réserve et qu’elle ne fit que sortir de dessous les eaux du déluge.
Elle présente, ainsi qu’aux premiers jours de la création, des fleuves dont la source ne tarit point, de vertes et humides solitudes, des champs sans bornes que n’a point encore retournés le soc du laboureur. En cet état, elle ne s’offre plus à l’homme isolé, ignorant et barbare des premiers âges, mais à l’homme déjà maître des secrets les plus importants de la nature, uni à ses semblables, et instruit par une expérience de cinquante siècles.
Au moment où je parle, treize millions d’Européens civilisés s’étendent tranquillement dans des déserts fertiles dont eux-mêmes ne connaissent pas encore exactement les ressources ni l’étendue. Trois ou quatre mille soldats poussent devant eux la race errante des indigènes ; derrière les hommes armés s’avancent des bûcherons qui percent les forêts, écartent les bêtes farouches, explorent le cours des fleuves et préparent la marche triomphante de la civilisation à travers le désert.
Souvent, dans le cours de cet ouvrage, j’ai fait allusion au bien-être matériel dont jouissent les Américains ; je l’ai indiqué comme une des grandes causes du succès de leurs lois. Cette raison avait déjà été donnée par mille autres avant moi : c’est la seule qui, tombant en quelque sorte sous le sens des Européens, [II-187] soit devenue populaire parmi nous. Je ne m’étendrai donc pas sur un sujet si souvent traité et si bien compris ; je ne ferai qu’ajouter quelques nouveaux faits.
On se figure généralement que les déserts de l’Amérique se peuplent à l’aide des émigrants européens qui descendent chaque année sur les rivages du Nouveau Monde, tandis que la population américaine croît et se multiplie sur le sol qu’ont occupé ses pères : c’est là une grande erreur. L’Européen qui aborde aux États-Unis y arrive sans amis et souvent sans ressources ; il est obligé, pour vivre, de louer ses services, et il est rare de lui voir dépasser la grande zone industrielle qui s’étend le long de l’Océan. On ne saurait défricher le désert sans un capital ou du crédit ; avant de se risquer au milieu des forêts, il faut que le corps se soit habitué aux rigueurs d’un climat nouveau. Ce sont donc des Américains qui, abandonnant chaque jour le lieu de leur naissance, vont se créer au loin de vastes domaines. Ainsi l’Européen quitte sa chaumière pour aller habiter les rivages transatlantiques, et l’Américain qui est né sur ces mêmes bords s’enfonce à son tour dans les solitudes de l’Amérique centrale. Ce double mouvement d’émigration ne s’arrête jamais : il commence au fond de l’Europe, il se continue sur le grand Océan, il se suit à travers les solitudes du Nouveau Monde. Des millions d’hommes marchent à la fois vers le même point de l’horizon : leur langue, leur religion, leurs mœurs diffèrent, leur but est commun. On leur a dit que la fortune se trouvait quelque part vers l’ouest, et ils se rendent en hâte au-devant d’elle. [II-188] .
Rien ne saurait se comparer à ce déplacement continuel de l’espèce humaine, sinon peut-être ce qui arriva à la chute de l’Empire romain. On vit alors comme aujourd’hui les hommes accourir tous en foule vers le même point et se rencontrer tumultueusement dans les mêmes lieux ; mais les desseins de la Providence étaient différents. Chaque nouveau venu traînait à sa suite la destruction et la mort ; aujourd’hui chacun d’eux apporte avec soi un germe de prospérité et de vie.
Les conséquences éloignées de cette migration des Américains vers l’Occident nous sont encore cachées par l’avenir, mais les résultats immédiats sont faciles à reconnaître : une partie des anciens habitants s’éloignant chaque année des États où ils ont reçu la naissance, il arrive que ces États ne se peuplent que très lentement, quoiqu’ils vieillissent ; c’est ainsi que dans le Connecticut, qui ne compte encore que cinquante-neuf habitants par mille carré, la population n’a crû que d’un quart depuis quarante ans, tandis qu’en Angleterre elle s’est augmentée d’un tiers durant la même période. L’émigrant d’Europe aborde donc toujours dans un pays à moitié plein, où les bras manquent à l’industrie ; il devient un ouvrier aisé ; son fils va chercher fortune dans un pays vide, et il devient un propriétaire riche. Le premier amasse le capital que le second fait valoir, et il n’y a de misère ni chez l’étranger ni chez le natif.
La législation, aux États-Unis, favorise autant que possible la division de la propriété ; mais une cause plus puissante que la législation empêche que la [II-189] propriété ne s’y divise outre mesure [37] . On s’en aperçoit bien dans les États qui commencent enfin à se remplir. Le Massachusetts est le pays le plus peuplé de l’Union ; on y compte quatre-vingts habitants par mille carré, ce qui est infiniment moins qu’en France, où il s’en trouve cent soixante-deux réunis dans le même espace.
Au Massachusetts cependant il est déjà rare qu’on divise les petits domaines : l’aîné prend en général la terre ; les cadets vont chercher fortune au désert.
La loi a aboli le droit d’aînesse ; mais on peut dire que la Providence l’a rétabli sans que personne ait à se plaindre, et cette fois du moins il ne blesse pas la justice.
On jugera par un seul fait du nombre prodigieux d’individus qui quittent ainsi la Nouvelle-Angleterre pour aller transporter leurs foyers au désert. On nous a assuré qu’en 1830, parmi les membres du congrès, il s’en trouvait trente-six qui étaient nés dans le petit État du Connecticut. La population du Connecticut, qui ne forme que la quarante-troisième partie de celle des États-Unis, fournissait donc le huitième de leurs représentants.
L’État de Connecticut n’envoie cependant lui-même que cinq députés au Congrès : les trente-un autres y paraissent comme les représentants des nouveaux États de l’Ouest. Si ces trente-un individus étaient demeurés dans le Connecticut, il est probable qu’au lieu d’être de riches propriétaires, ils seraient restés de petits laboureurs, qu’ils auraient vécu dans [II-190] l’obscurité sans pouvoir s’ouvrir la carrière politique, et que, loin de devenir des législateurs utiles, ils auraient été de dangereux citoyens.
Ces considérations n’échappent pas plus à l’esprit des Américains qu’au nôtre.
« On ne saurait douter, dit le chancelier Kent dans son Traité sur le droit américain (vol. IV, p. 380), que la division des domaines ne doive produire de grands maux quand elle est portée à l’extrême ; de telle sorte que chaque portion de terre ne puisse plus pourvoir à l’entretien d’une famille ; mais ces inconvénients n’ont jamais été ressentis aux États-Unis, et bien des générations s’écouleront avant qu’on les ressente. L’étendue de notre territoire inhabité, l’abondance des terres qui nous touchent et le courant continuel d’émigrations qui, partant des bords de l’Atlantique, se dirige sans cesse vers l’intérieur du pays, suffisent et suffiront long-temps encore pour empêcher le morcellement des héritages. ».
Il serait difficile de peindre l’avidité avec laquelle l’Américain se jette sur cette proie immense que lui offre la fortune. Pour la poursuivre, il brave sans crainte la flèche de l’Indien et les maladies du désert ; le silence des bois n’a rien qui l’étonne, l’approche des bêtes farouches ne l’émeut point : une passion plus forte que l’amour de la vie l’aiguillonne sans cesse. Devant lui s’étend un continent presque sans bornes, et on dirait que, craignant déjà d’y manquer de place, il se hâte de peur d’arriver trop tard. J’ai parlé de l’émigration des anciens États ; mais que dirai-je de celle des nouveaux ? Il n’y a pas cinquante [II-191] ans que l’Ohio est fondé ; le plus grand nombre de ses habitants n’y a pas vu le jour ; sa capitale ne compte pas trente années d’existence, et une immense étendue de champs déserts couvre encore son territoire ; déjà cependant la population de l’Ohio s’est remise en marche vers l’Ouest : la plupart de ceux qui descendent dans les fertiles prairies de l’Illinois sont des habitants de l’Ohio. Ces hommes ont quitté leur première patrie pour être bien ; ils quittent la seconde pour être mieux encore : presque partout ils rencontrent la fortune, mais non pas le bonheur. Chez eux, le désir du bien-être est devenu une passion inquiète et ardente qui s’accroît en se satisfaisant. Ils ont jadis brisé les liens qui les attachaient au sol natal ; depuis ils n’en ont point formé d’autres. Pour eux l’émigration a commencé par être un besoin ; aujourd’hui, elle est devenue à leurs yeux une sorte de jeu de hasard, dont ils aiment les émotions autant que le gain.
Quelquefois l’homme marche si vite que le désert reparaît derrière lui. La forêt n’a fait que ployer sous ses pieds ; dès qu’il est passé, elle se relève. Il n’est pas rare, en parcourant les nouveaux États de l’Ouest, de rencontrer des demeures abandonnées au milieu des bois ; souvent on découvre les débris d’une cabane au plus profond de la solitude, et l’on s’étonne en traversant des défrichements ébauchés, qui attestent tout à la fois la puissance et l’inconstance humaines. Parmi ces champs délaissés, sur ces ruines d’un jour, l’antique forêt ne tarde point à pousser des rejetons nouveaux ; les animaux reprennent possession de leur empire : la nature vient en riant couvrir de rameaux verts et de fleurs les vestiges [II-192] de l’homme, et se hâte de faire disparaître sa trace éphémère.
Je me souviens qu’en traversant l’un des cantons déserts qui couvrent encore l’État de New York, je parvins sur les bords d’un lac tout environné de forêts comme au commencement du monde. Une petite île s’élevait au milieu des eaux. Le bois qui la couvrait, étendant autour d’elle son feuillage, en cachait entièrement les bords. Sur les rives du lac, rien n’annonçait la présence de l’homme ; seulement on apercevait à l’horizon une colonne de fumée qui, allant perpendiculairement de la cime des arbres jusqu’aux nuages, semblait pendre du haut du ciel plutôt qu’y monter.
Une pirogue indienne était tirée sur le sable ; j’en profitai pour aller visiter l’île qui avait d’abord attiré mes regards, et bientôt après j’étais parvenu sur son rivage. L’île entière formait une de ces délicieuses solitudes du Nouveau-Monde qui font presque regretter à l’homme civilisé la vie sauvage. Une végétation vigoureuse annonçait par ses merveilles les richesses incomparables du sol. Il y régnait, comme dans tous les déserts de l’Amérique du Nord, un silence profond qui n’était interrompu que par le roucoulement monotone des ramiers ou par les coups que frappait le pic-vert sur l’écorce des arbres. J’étais bien loin de croire que ce lieu eût été habité jadis, tant la nature y semblait encore abandonnée à elle-même ; mais, parvenu au centre de l’île, je crus tout-à-coup rencontrer les vestiges de l’homme. J’examinai alors avec soin tous les objets d’alentour, et bientôt je ne doutai plus qu’un Européen ne fût venu [II-193] chercher un refuge en cet endroit. Mais combien son œuvre avait changé de face ! Le bois que jadis il avait coupé à a hâte pour s’en faire un abri avait depuis poussé des rejetons ; ses clôtures étaient devenues des haies vives, et sa cabane était transformée en un bosquet. Au milieu de ces arbustes, on apercevait encore quelques pierres noircies par le feu, répandues autour d’un petit tas de cendres ; c’était sans doute dans ce lieu qu’était le foyer : la cheminée, en s’écroulant, l’avait couvert de ses débris. Quelque temps j’admirai en silence les ressources de la nature et la faiblesse de l’homme ; et lorsque enfin il fallut m’éloigner de ces lieux enchantés, je répétai encore avec tristesse : Quoi ! déjà des ruines !.
En Europe, nous sommes habitués à regarder comme un grand danger social l’inquiétude de l’esprit, le désir immodéré des richesses, l’amour extrême de l’indépendance. Ce sont précisément toutes ces choses qui garantissent aux républiques américaines un long et paisible avenir. Sans ces passions inquiètes, la population se concentrerait autour de certains lieux et éprouverait bientôt, comme parmi nous, des besoins difficiles à satisfaire. Heureux pays que le Nouveau-Monde, où les vices de l’homme sont presque aussi utiles à la société que ses vertus !.
Ceci exerce une grande influence sur la manière dont on juge les actions humaines dans les deux hémisphères. Souvent les Américains appellent une louable industrie ce que nous nommons l’amour du gain, et ils voient une certaine lâcheté de cœur dans ce que nous considérons comme la modération des désirs.
En France, on regarde la simplicité des goûts, la [II-194] tranquillité des mœurs, l’esprit de famille et l’amour du lieu de la naissance comme de grandes garanties de tranquillité et de bonheur pour l’État ; mais en Amérique, rien ne paraît plus préjudiciable à la société que de semblables vertus. Les Français du Canada, qui ont fidèlement conservé les traditions des anciennes mœurs, trouvent déjà de la difficulté à vivre sur leur territoire, et ce petit peuple qui vient de naître sera bientôt en proie aux misères des vieilles nations. Au Canada, les hommes qui ont le plus de lumières, de patriotisme et d’humanité, font des efforts extraordinaires pour dégoûter le peuple du simple bonheur qui lui suffit encore. Ils célèbrent les avantages de la richesse, de même que parmi nous ils vanteraient peut-être les charmes d’une honnête médiocrité, et ils mettent plus de soin à aiguillonner les passions humaines qu’ailleurs on n’emploie d’efforts pour les calmer. Échanger les plaisirs purs et tranquilles que la patrie présente au pauvre lui-même contre les stériles jouissances que donne le bien-être sous un ciel étranger ; fuir le foyer paternel et les champs où reposent ses aïeux ; abandonner les vivants et les morts pour courir après la fortune, il n’y a rien qui à leurs yeux mérite plus de louanges.
De notre temps, l’Amérique livre aux hommes un fonds toujours plus vaste que ne saurait l’être l’industrie qui le fait valoir.
En Amérique, on ne saurait donc donner assez de lumières ; car toutes les lumières, en même temps qu’elles peuvent être utiles à celui qui les possède, tournent encore au profit de ceux qui ne les ont point. Les besoins nouveaux n’y sont pas à craindre, puisque [II-195] tous les besoins s’y satisfont sans peine : il ne faut pas redouter d’y faire naître trop de passions, puisque toutes les passions trouvent un aliment facile et salutaire ; on ne peut y rendre les hommes trop libres, parce qu’ils ne sont presque jamais tentés d’y faire un mauvais usage de la liberté.
Les républiques américaines de nos jours sont comme des compagnies de négociants formées pour exploiter en commun les terres désertes du Nouveau-Monde, et occupées d’un commerce qui prospère.
Les passions qui agitent le plus profondément les Américains sont des passions commerciales et non des passions politiques, ou plutôt ils transportent dans la politique des habitudes du négoce. Ils aiment l’ordre, sans lequel les affaires ne sauraient prospérer, et ils prisent particulièrement la régularité des mœurs, qui fonde les bonnes maisons ; ils préfèrent le bon sens qui crée les grandes fortunes au génie qui souvent les dissipe ; les idées générales effraient leurs esprits accoutumés aux calculs positifs, et parmi eux, la pratique est plus en honneur que la théorie.
C’est en Amérique qu’il faut aller pour comprendre quelle puissance exerce le bien-être matériel sur les actions politiques et jusque sur les opinions elles-mêmes, qui devraient n’être soumises qu’à la raison. C’est parmi les étrangers qu’on découvre principalement la vérité de ceci. La plupart des émigrants d’Europe apportent dans le Nouveau-Monde cet amour sauvage de l’indépendance et du changement qui naît si souvent au milieu de nos misères. Je rencontrais quelquefois aux États-Unis de [II-196] ces Européens qui jadis avaient été obligés de fuir leur pays pour cause d’opinions politiques. Tous m’étonnaient par leurs discours ; mais l’un d’eux me frappa plus qu’aucun autre. Comme je traversais l’un des districts les plus reculés de la Pensylvanie, la nuit me surprit, et j’allai demander asile à la porte d’un riche planteur : c’était un Français. Il me fit asseoir auprès de son foyer, et nous nous mîmes à discourir librement, comme il convient à des gens qui se retrouvent au fond d’un bois à deux mille lieues du pays qui les a vus naître. Je n’ignorais pas que mon hôte avait été un grand niveleur il y a quarante ans et un ardent démagogue. Son nom était resté dans l’histoire.
Je fus donc étrangement surpris de l’entendre discuter le droit de propriété comme aurait pu le faire un économiste, j’allais presque dire un propriétaire ; il parla de la hiérarchie nécessaire que la fortune établit parmi les hommes, de l’obéissance à la loi établie, de l’influence des bonnes mœurs dans les républiques, et du secours que les idées religieuses prêtent à l’ordre et à la liberté : il lui arriva même de citer comme par mégarde, à l’appui d’une de ses opinions politiques, l’autorité de Jésus-Christ.
J’admirais en l’écoutant l’imbécillité de la raison humaine. Cela est vrai ou faux : comment le découvrir au milieu des incertitudes de la science et des leçons diverses de l’expérience ? Survient un fait nouveau qui lève tous mes doutes. J’étais pauvre, me voici riche : du moins si le bien-être, en agissant sur ma conduite, laissait mon jugement en liberté ! Mais non, mes opinions sont en effet changées avec ma fortune, [II-197] et dans l’événement heureux dont je profite, j’ai réellement découvert la raison déterminante qui jusque là m’avait manqué.
L’influence du bien-être s’exerce plus librement encore sur les Américains que sur les étrangers. L’Américain a toujours vu sous ses yeux l’ordre et la prospérité publique s’enchaîner l’un à l’autre et marcher du même pas ; il n’imagine point qu’ils puissent vivre séparément : il n’a donc rien à oublier, et ne doit point perdre, comme tant d’Européens, ce qu’il tient de son éducation première.
DE L’INFLUENCE DES LOIS SUR LE MAINTIEN DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE AUX ÉTATS-UNIS.
Trois causes principales du maintien de la république démocratique. — Forme fédérale. — Institutions communales. — Pouvoir judiciaire.
Le but principal de ce livre était de faire connaître les lois des États-Unis ; si ce but a été atteint, le lecteur a déjà pu juger lui-même quelles sont, parmi ces lois, celles qui tendent réellement à maintenir la république démocratique et celles qui la mettent en danger. Si je n’ai pas réussi dans tout le cours du livre, j’y réussirais encore moins dans un chapitre.
Je ne veux donc pas rentrer dans la carrière que j’ai déjà parcourue, et quelques lignes doivent suffire pour me résumer.
Trois choses semblent concourir plus que toutes les autres au maintien de la république démocratique dans le Nouveau Monde :.
La première est la forme fédérale que les [II-198] Américains ont adoptée, et qui permet à l’Union de jouir de la puissance d’une grande république et de la sécurité d’une petite.
Je trouve la deuxième dans les institutions communales, qui, modérant le despotisme de la majorité, donnent en même temps au peuple le goût de la liberté et l’art d’être libre.
La troisième se rencontre dans la constitution du pouvoir judiciaire. J’ai montré combien les tribunaux servent à corriger les écarts de la démocratie, et comment, sans jamais pouvoir arrêter les mouvements de la majorité, ils parviennent à les ralentir et à les diriger.
DE L’INFLUENCE DES MŒURS SUR LE MAINTIEN DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE AUX ÉTATS-UNIS.
J’ai dit plus haut que je considérais les mœurs comme l’une des grandes causes générales auxquelles on peut attribuer le maintien de la république démocratique aux États-Unis.
J’entends ici l’expression de mœurs dans le sens qu’attachaient les Anciens au mot mores ; non seulement je l’applique aux mœurs proprement dites, qu’on pourrait appeler les habitudes du cœur, mais aux différentes notions que possèdent les hommes, aux diverses opinions qui ont cours au milieu d’eux, et à l’ensemble des idées dont se forment les habitudes de l’esprit.
Je comprends donc sous ce mot tout l’état moral et intellectuel d’un peuple. Mon but n’est pas de faire [II-199] un tableau des mœurs américaines ; je me borne en ce moment à rechercher parmi elles ce qui est favorable au maintien des institutions politiques.
DE LA RELIGION CONSIDÉRÉE COMME INSTITUTION POLITIQUE, COMMENT ELLE SERT PUISSAMMENT AU MAINTIEN DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE CHEZ LES AMÉRICAINS.
L’Amérique du Nord peuplée par des hommes qui professaient un christianisme démocratique et républicain. — Arrivée des catholiques. — Pourquoi de nos jours les catholiques forment la classe la plus démocratique et la plus républicaine.
À côté de chaque religion se trouve une opinion politique qui, par affinité, lui est jointe.
Laissez l’esprit humain suivre sa tendance, et il réglera d’une manière uniforme la société politique et la cité divine ; il cherchera, si j’ose le dire, à harmoniser la terre avec le ciel.
La plus grande partie de l’Amérique anglaise a été peuplée par des hommes qui, après s’être soustraits à l’autorité du pape, ne s’étaient soumis à aucune suprématie religieuse ; ils apportaient donc dans le Nouveau-Monde un christianisme que je ne saurais mieux peindre qu’en l’appelant démocratique et républicain : ceci favorisera singulièrement l’établissement de la république et de la démocratie dans les affaires. Dès le principe, la politique et la religion se trouvèrent d’accord, et depuis elles n’ont point cessé de l’être.
Il y a environ cinquante ans que l’Irlande commença à verser au sein des États-Unis une population catholique. De son côté, le catholicisme américain [II-200] fit des prosélytes : l’on rencontre aujourd’hui dans l’Union plus d’un million de chrétiens qui professent les vérités de l’Église romaine.
Ces catholiques montrent une grande fidélité dans les pratiques de leur culte, et sont pleins d’ardeur et de zèle pour leurs croyances ; cependant ils forment la classe la plus républicaine et la plus démocratique qui soit aux États-Unis. Ce fait surprend au premier abord, mais la réflexion en découvre aisément les causes cachées.
Je pense qu’on a tort de regarder la religion catholique comme un ennemi naturel de la démocratie. Parmi les différentes doctrines chrétiennes, le catholicisme me paraît au contraire l’une des plus favorables à l’égalité des conditions. Chez les catholiques, la société religieuse ne se compose que de deux éléments : le prêtre et le peuple. Le prêtre s’élève seul au-dessus des fidèles : tout est égal au-dessous de lui.
En matière de dogmes, le catholicisme place le même niveau sur toutes les intelligences ; il astreint aux détails des mêmes croyances le savant ainsi que l’ignorant, l’homme de génie aussi bien que le vulgaire ; il impose les mêmes pratiques au riche comme au pauvre, inflige les mêmes austérités au puissant comme au faible ; il ne compose avec aucun mortel, et appliquant à chacun des humains la même mesure, il aime à confondre toutes les classes de la société au pied du même autel, comme elles sont confondues aux yeux de Dieu.
Si le catholicisme dispose les fidèles à l’obéissance, il ne les prépare donc pas à l’inégalité. Je dirai le contraire du protestantisme qui, en général, porte les [II-201] hommes bien moins vers l’égalité que vers l’indépendance.
Le catholicisme est comme une monarchie absolue. Ôtez le prince, et les conditions y sont plus égales que dans les républiques.
Souvent il est arrivé que le prêtre catholique est sorti du sanctuaire pour pénétrer comme une puissance dans la société, et qu’il est venu s’y asseoir au milieu de la hiérarchie sociale ; quelquefois alors il a usé de son influence religieuse pour assurer la durée d’un ordre politique dont il faisait partie : alors aussi on a pu voir des catholiques partisans de l’aristocratie par esprit de religion.
Mais une fois que les prêtres sont écartés ou s’écartent du gouvernement, comme ils le font aux États-Unis, il n’y a pas d’hommes qui par leurs croyances soient plus disposés que les catholiques à transporter dans le monde politique l’idée de l’égalité des conditions.
Si donc les catholiques des États-Unis ne sont pas entraînés violemment par la nature de leurs croyances vers les opinions démocratiques et républicaines, du moins n’y sont-ils pas naturellement contraires, et leur position sociale, ainsi que leur petit nombre, leur fait une loi de les embrasser.
La plupart des catholiques sont pauvres, et ils ont besoin que tous les citoyens gouvernent pour arriver eux-mêmes au gouvernement. Les catholiques sont en minorité, et ils ont besoin qu’on respecte tous les droits pour être assurés du libre exercice des leurs. Ces deux causes les poussent, à leur insu même, vers des doctrines politiques qu’ils adopteraient peut-être [II-202] avec moins d’ardeur s’ils étaient riches et prédominants.
Le clergé catholique des États-Unis n’a point essayé de lutter contre cette tendance politique ; il cherche plutôt à la justifier. Les prêtres catholiques d’Amérique ont divisé le monde intellectuel en deux parts : dans l’une, ils ont laissé les dogmes révélés, et ils s’y soumettent sans les discuter ; dans l’autre, ils ont placé la vérité politique, et ils pensent que Dieu l’y a abandonnée aux libres recherches des hommes. Ainsi, les catholiques des États-Unis sont tout à la fois les fidèles les plus soumis et les citoyens les plus indépendants,.
On peut donc dire qu’aux États-Unis il n’y a pas une seule doctrine religieuse qui se montre hostile aux institutions démocratiques et républicaines. Tous les clergés y tiennent le même langage ; les opinions y sont d’accord avec les lois, et il n’y règne pour ainsi dire qu’un seul courant dans l’esprit humain.
J’habitais momentanément l’une des plus grandes villes de l’Union, lorsqu’on m’invita à assister à une réunion politique dont le but était de venir au secours des Polonais, et de leur faire parvenir des armes et de l’argent.
Je trouvai donc deux à trois mille personnes réunies dans une vaste salle qui avait été préparée pour les recevoir. Bientôt après, un prêtre, revêtu de ses habits ecclésiastiques, s’avança sur le bord de l’estrade destinée aux orateurs. Les assistants, après s’être découverts, se tinrent debout en silence, et il parla en ces termes : [II-203] .
« Dieu tout-puissant ! Dieu des armées ! toi qui as maintenu le cœur et conduit le bras de nos pères, lorsqu’ils soutenaient les droits sacrés de leur indépendance nationale ; toi qui les as fait triompher d’une odieuse oppression, et as accordé à notre peuple les bienfaits de la paix et de la liberté, ô Seigneur ! tourne un œil favorable vers l’autre hémisphère ; regarde en pitié un peuple héroïque qui lutte aujourd’hui comme nous l’avons fait jadis et pour la défense des mêmes droits ! Seigneur, qui as créé tous les hommes sur le même modèle, ne permets point que le despotisme vienne déformer ton ouvrage et maintenir l’inégalité sur la terre. Dieu tout-puissant ! veille sur les destinées des Polonais, rends-les dignes d’être libres ; que ta sagesse règne dans leurs conseils, que ta force soit dans leurs bras ; répands la terreur sur leurs ennemis, divise les puissances qui trament leur ruine, et ne permets pas que l’injustice dont le monde a été le témoin il y a cinquante ans se consomme aujourd’hui. Seigneur, qui tiens dans ta main puissante le cœur des peuples comme celui des hommes, suscite des alliés à la cause sacrée du bon droit ; fais que la nation française se lève enfin, et, sortant du repos dans lequel ses chefs la retiennent, vienne combattre encore une fois pour la liberté du monde.
« O Seigneur ! ne détourne jamais de nous ta face ; permets que nous soyons toujours le peuple le plus religieux comme le plus libre.
« Dieu tout-puissant, exauce aujourd’hui notre prière ; sauve les Polonais. Nous te le demandons au nom de ton fils bien-aimé, Notre-Seigneur [II-204] Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour le salut de tous les hommes. Amen. ».
Toute l’assemblée répéta amen avec recueillement.
INFLUENCE INDIRECTE QU’EXERCENT LES CROYANCES RELIGIEUSES SUR LA SOCIÉTÉ POLITIQUE AUX ÉTATS-UNIS.
Morale du christianisme qui se retrouve dans toutes les sectes. — Influence de la religion sur les mœurs des Américains. — Respect du lien du mariage. — Comment la religion renferme l’imagination des Américains entre certaines limites et modère chez eux la passion d’innover. — Opinion des Américains sur l’utilité politique de la religion. — Leurs efforts pour étendre et assurer son empire.
Je viens de montrer quelle était, aux États-Unis, l’action directe de la religion sur la politique. Son action indirecte me semble bien plus puissante encore, et c’est quand elle ne parle point de la liberté, qu’elle enseigne le mieux aux Américains l’art d’être libres.
Il y a une multitude innombrable de sectes aux États-Unis. Toutes diffèrent dans le culte qu’il faut rendre au Créateur, mais toutes s’entendent sur les devoirs des hommes les uns envers les autres. Chaque secte adore donc Dieu à sa manière, mais toutes les sectes prêchent la même morale au nom de Dieu. S’il sert beaucoup à l’homme comme individu que sa religion soit vraie, il n’en est point ainsi pour la société. La société n’a rien à craindre ni à espérer de l’autre vie ; et ce qui lui importe le plus, ce n’est pas tant que tous les citoyens professent la vraie religion, mais qu’ils professent une religion. D’ailleurs toutes les sectes aux États-Unis se retrouvent dans la grande [II-205] unité chrétienne, et la morale du christianisme est partout la même.
Il est permis de penser qu’un certain nombre d’Américains suivent, dans le culte qu’ils rendent à Dieu, leurs habitudes plus que leurs convictions. Aux États-Unis d’ailleurs le souverain est religieux, et par conséquent l’hypocrisie doit être commune ; mais l’Amérique est pourtant encore le lieu du monde où la religion chrétienne a conservé le plus de véritable pouvoir sur les âmes ; et rien ne montre mieux combien elle est utile et naturelle à l’homme, puisque le pays où elle exerce de nos jours le plus d’empire est en même temps le plus éclairé et le plus libre.
J’ai dit que les prêtres américains se prononcent d’une manière générale en faveur de la liberté civile, sans en excepter ceux mêmes qui n’admettent point la liberté religieuse ; cependant on ne les voit prêter leur appui à aucun système politique en particulier. Ils ont soin de se tenir en dehors des affaires, et ne se mêlent pas aux combinaisons des partis, On ne peut donc pas dire qu’aux États-Unis la religion exerce une influence sur les lois ni sur le détail des opinions politiques, mais elle dirige les mœurs, et c’est en réglant la famille qu’elle travaille à régler l’État.
Je ne doute pas un instant que la grande sévérité de mœurs qu’on remarque aux États-Unis n’ait sa source première dans les croyances. La religion y est souvent impuissante à retenir l’homme au milieu des tentations sans nombre que la fortune lui présente. Elle ne saurait modérer en lui l’ardeur de s’enrichir que tout vient aiguillonner, mais elle règne souverainement sur l’âme de la femme, et c’est la femme qui [II-206] fait les mœurs. L’Amérique est assurément le pays du monde où le lien du mariage est le plus respecté, et où l’on a conçu l’idée la plus haute et la plus juste du bonheur conjugal.
En Europe, presque tous les désordres de la société prennent naissance autour du foyer domestique et non loin de la couche nuptiale. C’est là que les hommes conçoivent le mépris des liens naturels et des plaisirs permis, le goût du désordre, l’inquiétude du cœur, l’instabilité des désirs. Agité par les passions tumultueuses qui ont souvent troublé sa propre demeure, l’Européen ne se soumet qu’avec peine aux pouvoirs législateurs de l’État. Lorsque, au sortir des agitations du monde politique, l’Américain rentre au sein de sa famille, il y rencontre aussitôt l’image de l’ordre et de la paix. Là, tous ses plaisirs sont simples et naturels, ses joies innocentes et tranquilles ; et comme il arrive au bonheur par la régularité de la vie, il s’habitue sans peine à régler ses opinions aussi bien que ses goûts.
Tandis que l’Européen cherche à échapper à ses chagrins domestiques en troublant la société, l’Américain puise dans sa demeure l’amour de l’ordre, qu’il porte ensuite dans les affaires de l’État.
Aux États-Unis, la religion ne règle pas seulement les mœurs, elle étend son empire jusque sur l’intelligence.
Parmi les Anglo-Américains, les uns professent les dogmes chrétiens parce qu’ils y croient, les autres parce qu’ils redoutent de n’avoir pas l’air d’y croire. Le christianisme règne donc sans obstacles de l’aveu de tous ; il en résulte, ainsi que je l’ai [II-207] déjà dit ailleurs, que tout est certain et arrêté dans le monde moral, quoique le monde politique semble abandonné à la discussion et aux essais des hommes. Ainsi l’esprit humain n’aperçoit jamais devant lui un champ sans limite : quelle que soit son audace, il sent de temps en temps qu’il doit s’arrêter devant des barrières insurmontables. Avant d’innover, il est forcé d’accepter certaines données premières, et de soumettre ses conceptions les plus hardies à certaines formes qui le retardent et qui l’arrêtent.
L’imagination des Américains, dans ses plus grands écarts, n’a donc qu’une marche circonspecte et incertaine ; ses allures sont gênées et ses œuvres incomplètes. Ces habitudes de retenue se retrouvent dans la société politique et favorisent singulièrement la tranquillité du peuple, ainsi que la durée des institutions qu’il s’est données. La nature et les circonstances avaient fait de l’habitant des États-Unis un homme audacieux ; il est facile d’en juger, lorsqu’on voit de quelle manière il poursuit la fortune. Si l’esprit des Américains était libre de toute entrave, on ne tarderait pas à rencontrer parmi eux les plus hardis novateurs et les plus implacables logiciens du monde. Mais les révolutionnaires d’Amérique sont obligés de professer ostensiblement un certain respect pour la morale et l’équité chrétiennes, qui ne leur permet pas d’en violer aisément les lois lorsqu’elles s’opposent à l’exécution de leurs desseins ; et s’ils pouvaient s’élever eux-mêmes au-dessus de leurs scrupules, ils se sentiraient encore arrêtés par ceux de leurs partisans. Jusqu’à présent il ne s’est rencontré personne, aux États-Unis, qui ait osé [II-208] avancer cette maxime : que tout est permis dans l’intérêt de la société. Maxime impie, qui semble avoir été inventée dans un siècle de liberté pour légitimer tous les tyrans à venir.
Ainsi donc, en même temps que la loi permet au peuple américain de tout faire, la religion l’empêche de tout concevoir et lui défend de tout oser.
La religion, qui, chez les Américains, ne se mêle jamais directement au gouvernement de la société, doit donc être considérée comme la première de leurs institutions politiques ; car si elle ne leur donne pas le goût de la liberté, elle leur en facilite singulièrement l’usage.
C’est aussi sous ce point de vue que les habitants des États-Unis eux-mêmes considèrent les croyances religieuses. Je ne sais si tous les Américains ont foi dans leur religion, car qui peut lire au fond des cœurs ? mais je suis sûr qu’ils la croient nécessaire au maintien des institutions républicaines. Cette opinion n’appartient pas à une classe de citoyens ou à un parti, mais à la nation entière ; on la retrouve dans tous les rangs.
Aux États-Unis, lorsqu’un homme politique attaque une secte, ce n’est pas une raison pour que les partisans mêmes de cette secte ne le soutiennent pas ; mais s’il attaque toutes les sectes ensemble, chacun le fuit, et il reste seul.
Pendant que j’étais en Amérique, un témoin se présenta aux assises du comté de Chester (État de New York) et déclara qu’il ne croyait pas à l’existence de Dieu et à l’immortalité de l’âme. Le président refusa de recevoir son serment, attendu, dit-il, [II-209] que le témoin avait détruit d’avance toute la foi qu’on pouvait ajouter à ses paroles [38] . Les journaux rapportèrent le fait sans commentaire.
Les Américains confondent si complètement dans leur esprit le christianisme et la liberté, qu’il est presque impossible de leur faire concevoir l’un sans l’autre ; et ce n’est point chez eux une de ces croyances stériles que le passé lègue au présent, et qui semble moins vivre que végéter au fond de l’âme.
J’ai vu des Américains s’associer pour envoyer des prêtres dans les nouveaux États de l’Ouest, et pour y fonder des écoles et des églises ; ils craignent que la religion ne vienne à se perdre au milieu des bois, et que le peuple qui s’élève ne puisse être aussi libre que celui dont il est sorti. J’ai rencontré des habitants riches de la Nouvelle-Angleterre qui abandonnaient le pays de leur naissance dans le but d’aller jeter, sur les bords du Missouri ou dans les prairies des Illinois, les fondements du christianisme et de la liberté. C’est ainsi qu’aux États-Unis le zèle religieux s’échauffe sans cesse au foyer du patriotisme. Vous pensez que ces hommes agissent uniquement dans la considération de l’autre vie, mais vous vous trompez : l’éternité n’est qu’un de leurs soins. Si vous interrogez [II-210] ces missionnaires de la civilisation chrétienne, vous serez tout surpris de les entendre parler si souvent des biens de ce monde, et de trouver des politiques où vous croyez ne voir que des religieux. « Toutes les républiques américaines sont solidaires les unes des autres, vous diront-ils ; si les républiques de l’Ouest tombaient dans l’anarchie ou subissaient le joug du despotisme, les institutions républicaines qui fleurissent sur les bords de l’océan Atlantique seraient en grand péril ; nous avons donc intérêt à ce que les nouveaux États soient religieux, afin qu’ils nous permettent de rester libres. ».
Telles sont les opinions des Américains ; mais leur erreur est manifeste : car chaque jour on me prouve fort doctement que tout est bien en Amérique, excepté précisément cet esprit religieux que j’admire ; et j’apprends qu’il ne manque à la liberté et au bonheur de l’espèce humaine, de l’autre côté de l’Océan, que de croire avec Spinoza à l’éternité du monde, et de soutenir avec Cabanis que le cerveau sécrète la pensée. À cela je n’ai rien à répondre, en vérité, sinon que ceux qui tiennent ce langage n’ont pas été en Amérique, et n’ont pas plus vu de peuples religieux que de peuples libres. Je les attends donc au retour.
Il y a des gens en France qui considèrent les institutions républicaines comme l’instrument passager de leur grandeur. Ils mesurent des yeux l’espace immense qui sépare leurs vices et leurs misères de la puissance et des richesses, et ils voudraient entasser des ruines dans cet abîme pour essayer de le combler. Ceux-là sont à la liberté ce que les compagnies [II-211] franches du moyen-âge étaient aux rois ; ils font la guerre pour leur propre compte, alors même qu’ils portent ses couleurs : la république vivra toujours assez longtemps pour les tirer de leur bassesse présente. Ce n’est pas à eux que je parle ; mais il en est d’autres qui voient dans la république un état permanent et tranquille, un but nécessaire vers lequel les idées et les mœurs entraînent chaque jour les sociétés modernes, et qui voudraient sincèrement préparer les hommes à être libres. Quand ceux-là attaquent les croyances religieuses, ils suivent leurs passions et non leurs intérêts. C’est le despotisme qui peut se passer de la foi, mais non la liberté. La religion est beaucoup plus nécessaire dans la république qu’ils préconisent, que dans la monarchie qu’ils attaquent, et dans les républiques démocratiques que dans toutes les autres. Comment la société pourrait-elle manquer de périr si, tandis que le lien politique se relâche, le lien moral ne se resserrait pas ? et que faire d’un peuple maître de lui-même, s’il n’est pas soumis à Dieu ?
DES PRINCIPALES CAUSES QUI RENDENT LA RELIGION PUISSANTE EN AMÉRIQUE.
Soins qu’ont pris les Américains de séparer l’Église de l’État. — Les lois, l’opinion publique, les efforts des prêtres eux-mêmes concourent à ce résultat. — C’est à cette cause qu’il faut attribuer la puissance que la religion exerce sur les âmes aux États-Unis. — Pourquoi. — Quel est de nos jours l’état naturel des hommes en matière de religion. — Quelle cause particulière et accidentelle s’oppose, dans certains pays, à ce que les hommes se conforment à cet état.
Les philosophes du XVIIIe siècle expliquaient d’une façon toute simple l’affaiblissement graduel des [II-212] croyances. Le zèle religieux, disaient-ils, doit s’éteindre à mesure que la liberté et les lumières augmentent. Il est fâcheux que les faits ne s’accordent point avec cette théorie.
Il y a telle population européenne dont l’incrédulité n’est égalée que par l’abrutissement et l’ignorance, tandis qu’en Amérique on voit l’un des peuples les plus libres et les plus éclairés du monde remplir avec ardeur tous les devoirs extérieurs de la religion.
À mon arrivée aux États-Unis, ce fut l’aspect religieux du pays qui frappa d’abord mes regards. À mesure que je prolongeais mon séjour, j’apercevais les grandes conséquences politiques qui découlaient de ces faits nouveaux.
J’avais vu parmi nous l’esprit de religion et l’esprit de liberté marcher presque toujours en sens contraire. Ici, je les retrouvais intimement unis l’un à l’autre : ils régnaient ensemble sur le même sol.
Chaque jour je sentais croître mon désir de connaître la cause de ce phénomène.
Pour l’apprendre, j’interrogeai les fidèles de toutes les communions ; je recherchai surtout la société des prêtres, qui conservent le dépôt des différentes croyances et qui ont un intérêt personnel à leur durée. La religion que je professe me rapprochait particulièrement du clergé catholique, et je ne tardai point à lier une sorte d’intimité avec plusieurs de ses membres. À chacun d’eux j’exprimai mon étonnement et j’exposai mes doutes : je trouvai que tous ces hommes ne différaient entre eux que sur des détails ; mais tous attribuaient principalement à la complète séparation [II-213] de l’Église et de l’État l’empire paisible que la religion exerce en leur pays. Je ne crains pas d’affirmer que, pendant mon séjour en Amérique, je n’ai pas rencontré un seul homme, prêtre ou laïque, qui ne soit tombé d’accord sur ce point.
Ceci me conduisit à examiner plus attentivement que je ne l’avais fait jusqu’alors la position que les prêtres américains occupent dans la société politique. Je reconnus avec surprise qu’ils ne remplissent aucun emploi public [39] . Je n’en vis pas un seul dans l’administration, et je découvris qu’ils n’étaient pas même représentés au sein des assemblées.
La loi, dans plusieurs États, leur avait fermé la carrière politique [40] ; l’opinion dans tous les autres.
Lorsque enfin je vins à rechercher quel était l’esprit du clergé lui-même, j’aperçus que la plupart de ses membres semblaient s’éloigner volontairement du [II-214] pouvoir, et mettre une sorte d’orgueil de profession à y rester étrangers.
Je les entendis frapper d’anathème l’ambition et la mauvaise foi, quelles que fussent les opinions politiques dont elles prennent soin de se couvrir. Mais j’appris, en les écoutant, que les hommes ne peuvent être condamnables aux yeux de Dieu à cause de ces mêmes opinions, lorsqu’elles sont sincères, et qu’il n’y a pas plus de péché à errer en matière de gouvernement, qu’à se tromper sur la manière dont il faut bâtir sa demeure ou tracer son sillon.
Je les vis se séparer avec soin de tous les partis, et en fuir le contact avec toute l’ardeur de l’intérêt personnel.
Ces faits achevèrent de me prouver qu’on m’avait dit vrai. Alors je voulus remonter des faits aux causes : je me demandai comment il pouvait arriver qu’en diminuant la force apparente d’une religion, on vint à augmenter sa puissance réelle, et je crus qu’il n’était pas impossible de le découvrir.
Jamais le court espace de soixante années ne renfermera toute l’imagination de l’homme ; les joies incomplètes de ce monde ne suffiront jamais a son cœur. Seul entre tous les êtres, l’homme montre un dégoût naturel pour l’existence et un désir immense d’exister : il méprise la vie et craint le néant. Ces différents instincts poussent sans cesse son âme vers la contemplation d’un autre monde, et c’est la religion qui l’y conduit. La religion n’est donc qu’une forme particulière de l’espérance, et elle est aussi naturelle au cœur humain que l’espérance elle-même. C’est par une espèce d’aberration de l’intelligence, et à l’aide [II-215] d’une sorte de violence morale exercée sur leur propre nature, que les hommes s’éloignent des croyances religieuses ; une pente invincible les y ramène. L’incrédulité est un accident ; la foi seule est l’état permanent de l’humanité.
En ne considérant les religions que sous un point de vue purement humain, on peut donc dire que toutes les religions puisent dans l’homme lui-même un élément de force qui ne saurait jamais leur manquer, parce qu’il tient à l’un des principes constitutifs de la nature humaine.
Je sais qu’il y a des temps où la religion peut ajouter à cette influence qui lui est propre la puissance artificielle des lois et l’appui des pouvoirs matériels qui dirigent la société. On a vu des religions intimement unies aux gouvernements de la terre, dominer en même temps les âmes par la terreur et par la foi : mais lorsqu’une religion contracte une semblable alliance, je ne crains pas de le dire, elle agit comme pourrait le faire un homme ; elle sacrifie l’avenir en vue du présent, et en obtenant une puissance qui ne lui est point due, elle expose son légitime pouvoir.
Lorsqu’une religion ne cherche à fonder son empire que sur le désir d’immortalité qui tourmente également le cœur de tous les hommes, elle peut viser à l’universalité ; mais quand elle vient à s’unir à un gouvernement, il lui faut adopter des maximes qui ne sont applicables qu’à certains peuples. Ainsi donc, en s’alliant à un pouvoir politique, la religion augmente sa puissance sur quelques uns, et perd l’espérance de régner sur tous. [II-216] .
Tant qu’une religion ne s’appuie que sur des sentiments qui sont la consolation de toutes les misères, elle peut attirer à elle le cœur du genre humain. Mêlée aux passions amères de ce monde, on la contraint quelquefois à défendre des alliés que lui a donnés l’intérêt plutôt que l’amour ; et il lui faut repousser comme adversaires des hommes qui souvent l’aiment encore, tout en combattant ceux auxquels elle s’est unie. La religion ne saurait donc partager la force matérielle des gouvernants, sans se charger d’une partie des haines qu’ils font naître.
Les puissances politiques qui paraissent le mieux établies n’ont pour garantie de leur durée que les opinions d’une génération, les intérêts d’un siècle, souvent la vie d’un homme. Une loi peut modifier l’état social qui semble le plus définitif et le mieux affermi, et avec lui tout change.
Les pouvoirs de la société sont tous plus ou moins fugitifs, ainsi que nos années sur la terre ; ils se succèdent avec rapidité comme les divers soins de la vie ; et l’on n’a jamais vu de gouvernement qui se soit appuyé sur une disposition invariable du cœur humain, ni qui ait pu se fonder sur un intérêt immortel.
Aussi long-temps qu’une religion trouve sa force dans des sentiments, des instincts, des passions qu’on voit se reproduire de la même manière à toutes les époques de l’histoire, elle brave l’effort du temps, ou du moins elle ne saurait être détruite que par une autre religion. Mais quand la religion veut s’appuyer sur les intérêts de ce monde, elle devient presque aussi fragile que toutes les puissances de la terre. Seule, elle peut espérer l’immortalité ; liée à des [II-217] pouvoirs éphémères, elle suit leur fortune, et tombe souvent avec les passions d’un jour qui les soutiennent.
En s’unissant aux différentes puissances politiques, la religion ne saurait donc contracter qu’une alliance onéreuse. Elle n’a pas besoin de leur secours pour vivre, et en les servant elle peut mourir.
Le danger que je viens de signaler existe dans tous les temps, mais il n’est pas toujours aussi visible.
Il est des siècles où les gouvernements paraissent immortels, et d’autres où l’on dirait que l’existence de la société est plus fragile que celle d’un homme.
Certaines constitutions maintiennent les citoyens dans une sorte de sommeil léthargique, et d’autres les livrent à une agitation fébrile.
Quand les gouvernements semblent si forts et les lois si stables, les hommes n’aperçoivent point le danger que peut courir la religion en s’unissant au pouvoir.
Quand les gouvernements se montrent si faibles et les lois si changeantes, le péril frappe tous les regards, mais souvent alors il n’est plus temps de s’y soustraire. Il faut donc apprendre à l’apercevoir de loin.
À mesure qu’une nation prend un état social démocratique, et qu’on voit les sociétés pencher vers la république, il devient de plus en plus dangereux d’unir la religion à l’autorité ; car les temps approchent où la puissance va passer de main en main, où les théories politiques se succéderont, où les hommes, les lois, les constitutions elles-mêmes disparaîtront ou se modifieront chaque jour, et cela non [II-218] durant un temps, mais sans cesse. L’agitation et l’instabilité tiennent à la nature des républiques démocratiques, comme l’immobilité et le sommeil forment la loi des monarchies absolues.
Si les Américains, qui changent le siège de l’État tous les quatre ans, qui tous les deux ans font choix de nouveaux législateurs, et remplacent les administrateurs provinciaux chaque année ; si les Américains, qui ont livré le monde politique aux essais des novateurs, n’avaient point placé leur religion quelque part en dehors de lui, à quoi pourrait-elle se tenir dans le flux et reflux des opinions humaines ? Au milieu de la lutte des partis, où serait le respect qui lui est dû ? Que deviendrait son immortalité quand tout périrait autour d’elle ?.
Les prêtres américains ont aperçu cette vérité avant tous les autres, et ils y conforment leur conduite. Ils ont vu qu’il fallait renoncer à l’influence religieuse, s’ils voulaient acquérir une puissance politique, et ils ont préféré perdre l’appui du pouvoir que partager ses vicissitudes.
En Amérique, la religion est peut-être moins puissante qu’elle ne l’a été dans certains temps et chez certains peuples, mais son influence est plus durable. Elle s’est réduite à ses propres forces, que nul ne saurait lui enlever ; elle n’agit que dans un cercle unique, mais elle le parcourt tout entier et y domine sans efforts.
J’entends en Europe des voix qui s’élèvent de toutes parts ; on déplore l’absence des croyances, et l’on se demande quel est le moyen de rendre à la religion quelque reste de son ancien pouvoir. [II-219] .
Il me semble qu’il faut d’abord rechercher attentivement quel devrait être, de nos jours, l’état naturel des hommes en matière de religion. Connaissant alors ce que nous pouvons espérer et avons à craindre, nous apercevrions clairement le but vers lequel doivent tendre nos efforts.
Deux grands dangers menacent l’existence des religions : les schismes et l’indifférence.
Dans les siècles de ferveur, il arrive quelquefois aux hommes d’abandonner leur religion, mais ils n’échappent à son joug que pour se soumettre à celui d’une autre. La foi change d’objet, elle ne meurt point. L’ancienne religion excite alors dans tous les cœurs d’ardents amours ou d’implacables haines ; les uns la quittent avec colère, les autres s’y attachent avec une nouvelle ardeur : les croyances diffèrent, l’irréligion est inconnue.
Mais il n’en est point de même lorsqu’une croyance religieuse est sourdement minée par des doctrines que j’appellerai négatives, puisqu’en affirmant la fausseté d’une religion elles n’établissent la vérité d’aucune autre.
Alors il s’opère de prodigieuses révolutions dans l’esprit humain, sans que l’homme ait l’air d’y aider par ses passions, et pour ainsi dire sans qu’il s’en doute. On voit des hommes qui laissent échapper, comme par oubli, l’objet de leurs plus chères espérances. Entraînés par un courant insensible contre lequel ils n’ont pas le courage de lutter, et auquel pourtant ils cèdent à regret, ils abandonnent la foi qu’ils aiment pour suivre le doute qui les conduit au désespoir. [II-220] .
Dans les siècles que nous venons de décrire, on délaisse ces croyances par froideur plutôt que par haine ; on ne les rejette point, elles vous quittent. En cessant de croire la religion vraie, l’incrédule continue à la juger utile. Considérant les croyances religieuses sous un aspect humain, il reconnaît leur empire sur les mœurs, leur influence sur les lois. Il comprend comment elles peuvent faire vivre les hommes en paix et les préparer doucement à la mort. Il regrette donc la foi après l’avoir perdue, et privé d’un bien dont il sait tout le prix, il craint de l’enlever à ceux qui le possèdent encore.
De son côté, celui qui continue à croire ne craint point d’exposer sa foi à tous les regards. Dans ceux qui ne partagent point ses espérances, il voit des malheureux plutôt que des adversaires ; il sait qu’il peut conquérir leur estime sans suivre leur exemple ; il n’est donc en guerre avec personne ; et ne considérant point la société dans laquelle il vit comme une arène où la religion doit lutter sans cesse contre mille ennemis acharnés, il aime ses contemporains en même temps qu’il condamne leurs faiblesses et s’afflige de leurs erreurs.
Ceux qui ne croient pas, cachant leur incrédulité, et ceux qui croient, montrant leur foi, il se fait une opinion publique en faveur de la religion ; on l’aime, on la soutient, on l’honore, et il faut pénétrer jusqu’au fond des âmes pour découvrir les blessures qu’elle a reçues.
La masse des hommes, que le sentiment religieux n’abandonne jamais, ne voit rien alors qui l’écarte des croyances établies. L’instinct d’une autre vie la [II-221] conduit sans peine au pied des autels et livre son cœur aux préceptes et aux consolations de la foi.
Pourquoi ce tableau ne nous est-il pas applicable ?.
J’aperçois parmi nous des hommes qui ont cessé de croire au christianisme sans s’attacher à aucune religion.
J’en vois d’autres qui sont arrêtés dans le doute, et feignent déjà de ne plus croire.
Plus loin, je rencontre des chrétiens qui croient encore et n’osent le dire.
Au milieu de ces tièdes amis et de ces ardents adversaires, je découvre enfin un petit nombre de fidèles prêts à braver tous les obstacles et a mépriser tous les dangers pour leurs croyances. Ceux-là ont fait violence à la faiblesse humaine pour s’élever au-dessus de la commune opinion. Entraînés par cet effort même, ils ne savent plus précisément où ils doivent s’arrêter. Comme ils ont vu que, dans leur patrie, le premier usage que l’homme a fait de l’indépendance a été d’attaquer la religion, ils redoutent leurs contemporains et s’écartent avec terreur de la liberté que ceux-ci poursuivent. L’incrédulité leur paraissant une chose nouvelle, ils enveloppent dans une même haine tout ce qui est nouveau. Ils sont donc en guerre avec leur siècle et leur pays, et dans chacune des opinions qu’on y professe ils voient une ennemie nécessaire de la foi.
Tel ne devrait pas être de nos jours l’état naturel des hommes en matière de religion.
Il se rencontre donc parmi nous une cause accidentelle et particulière qui empêche l’esprit humain de [II-222] suivre sa pente, et le pousse au-delà des limites dans lesquelles il doit naturellement s’arrêter.
Je suis profondément convaincu que cette cause particulière et accidentelle est l’union intime de la politique et de la religion.
Les incrédules d’Europe poursuivent les chrétiens comme des ennemis politiques, plutôt que comme des adversaires religieux : ils haïssent la foi comme l’opinion d’un parti, bien plus que comme une croyance erronée ; et c’est moins le représentant de Dieu qu’ils repoussent dans le prêtre, que l’ami du pouvoir.
En Europe, le christianisme a permis qu’on l’unît intimement aux puissances de la terre. Aujourd’hui ces puissances tombent, et il est comme enseveli sous leurs débris. C’est un vivant qu’on a voulu attacher à des morts : coupez les liens qui le retiennent, et il se relève.
J’ignore ce qu’il faudrait faire pour rendre au christianisme d’Europe l’énergie de la jeunesse. Dieu seul le pourrait ; mais du moins il dépend des hommes de laisser à la foi l’usage de toutes les forces qu’elle conserve encore. [II-223]
COMMENT LES LUMIÈRES, LES HABITUDES ET L’EXPÉRIENCE PRATIQUE DES AMÉRICAINS CONTRIBUENT AU SUCCÈS DES INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES.
Ce qu’on doit entendre par les lumières du peuple américain. — L’esprit humain a reçu aux États-Unis une culture moins profonde qu’en Europe. — Mais personne n’est resté dans l’ignorance. — Pourquoi. — Rapidité avec laquelle la pensée circule dans les États à moitié déserts de l’Ouest. — Comment l’expérience pratique sert plus encore aux Américains que les connaissances littéraires.
Dans mille endroits de cet ouvrage, j’ai fait remarquer aux lecteurs quelle était l’influence exercée par les lumières et les habitudes des Américains sur le maintien de leurs institutions politiques. Il me reste donc maintenant peu de choses nouvelles à dire.
L’Amérique n’a eu jusqu’à présent qu’un très petit nombre d’écrivains remarquables ; elle n’a pas de grands historiens et ne compte pas un poète. Ses habitants voient la littérature proprement dite avec une sorte de défaveur ; et il y a telle ville du troisième ordre en Europe qui publie chaque année plus d’œuvres littéraires que les vingt-quatre États de l’Union pris ensemble.
L’esprit américain s’écarte des idées générales ; il ne se dirige point vers les découvertes théoriques. La politique elle-même et l’industrie ne sauraient l’y porter. Aux États-Unis, on fait sans cesse des lois nouvelles ; mais il ne s’est point encore trouvé de grands écrivains pour y rechercher les principes généraux des lois.
Les Américains ont des jurisconsultes et des commentateurs, les publicistes leur manquent ; et en [II-224] politique ils donnent au monde des exemples plutôt que des leçons.
Il en est de même pour les arts mécaniques.
En Amérique, on applique avec sagacité les inventions de l’Europe, et après les avoir perfectionnées, on les adapte merveilleusement aux besoins du pays. Les hommes y sont industrieux, mais ils n’y cultivent pas la science de l’industrie. On y trouve de bons ouvriers et peu d’inventeurs. Fulton colporta long-temps son génie chez les peuples étrangers avant de pouvoir le consacrer à son pays.
Celui qui veut juger quel est l’état des lumières parmi les Anglo-Américains est donc exposé à voir le même objet sous deux différents aspects. S’il ne fait attention qu’aux savants, il s’étonnera de leur petit nombre ; et s’il compte les ignorants, le peuple américain lui semblera le plus éclairé de la terre.
La population tout entière se trouve placée entre ces deux extrêmes : je l’ai déjà dit ailleurs.
Dans la Nouvelle-Angleterre, chaque citoyen reçoit les notions élémentaires des connaissances humaines ; il apprend en outre quelles sont les doctrines et les preuves de sa religion : on lui fait connaître l’histoire de sa patrie et les traits principaux de la constitution qui la régit. Dans le Connecticut et le Massachusetts, il est fort rare de trouver un homme qui ne sache qu’imparfaitement toutes ces choses, et celui qui les ignore absolument est en quelque sorte un phénomène.
Quand je compare les républiques grecques et romaines à ces républiques d’Amérique, les bibliothèques manuscrites des premières et leur populace [II-225] grossière, aux mille journaux qui sillonnent les secondes et au peuple éclairé qui les habite ; lorsque ensuite je songe à tous les efforts qu’on fait encore pour juger de l’un à l’aide des autres, et prévoir, par ce qui est arrivé il y a deux mille ans, ce qui arrivera de nos jours, je suis tenté de brûler mes livres, afin de n’appliquer que des idées nouvelles à un état social si nouveau.
Il ne faut pas, du reste, étendre indistinctement à toute l’Union ce que je dis de la Nouvelle-Angleterre. Plus on s’avance à l’ouest ou vers le midi, plus l’instruction du peuple diminue. Dans les États qui avoisinent le golfe du Mexique, il se trouve, ainsi que parmi nous, un certain nombre d’individus qui sont étrangers aux éléments des connaissances humaines ; mais on chercherait vainement, aux États-Unis, un seul canton qui fût resté plongé dans l’ignorance. La raison en est simple : les peuples de l’Europe sont partis des ténèbres et de la barbarie pour s’avancer vers la civilisation et vers les lumières. Leur progrès ont été inégaux : les uns ont couru dans cette carrière, les autres n’ont fait en quelque sorte qu’y marcher ; plusieurs se sont arrêtés, et ils dorment encore sur le chemin.
Il n’en a point été de même aux États-Unis.
Les Anglo-Américains sont arrivés tout civilisés sur le sol que leur postérité occupe ; ils n’ont point eu à apprendre, il leur a suffi de ne pas oublier. Or, ce sont les fils de ces mêmes Américains qui, chaque année, transportent dans le désert, avec leur demeure, les connaissances déjà acquises et l’estime du savoir. L’éducation leur a fait sentir l’utilité des lumières, [II-226] et les a mis en état de transmettre ces mêmes lumières à leurs descendants. Aux États-Unis, la société n’a donc point d’enfance ; elle naît à l’âge viril.
Les Américains ne font aucun usage du mot de paysan ; ils n’emploient pas le mot, parce qu’ils n’ont pas l’idée ; l’ignorance des premiers âges, la simplicité des champs, la rusticité du village, ne se sont point conservées parmi eux, et ils ne conçoivent ni les vertus, ni les vices, ni les habitudes grossières, ni les grâces naïves d’une civilisation naissante.
Aux extrêmes limites des États confédérés, sur les confins de la société et du désert, se tient une population de hardis aventuriers qui, pour fuir la pauvreté prête à les atteindre sous le toit paternel, n’ont pas craint de s’enfoncer dans les solitudes de l’Amérique et d’y chercher une nouvelle patrie. À peine arrivé sur le lieu qui doit lui servir d’asile, le pionnier abat quelques arbres à la hâte et élève une cabane sous la feuillée. Il n’y a rien qui offre un aspect plus misérable que ces demeures isolées. Le voyageur qui s’en approche vers le soir aperçoit de loin reluire, à travers les murs, la flamme du foyer ; et la nuit, si le vent vient à s’élever, il entend le toit de feuillage s’agiter avec bruit au milieu des arbres de la forêt. Qui ne croirait que cette pauvre chaumière sert d’asile à la grossièreté et à l’ignorance ? Il ne faut pourtant établir aucuns rapports entre le pionnier et le lieu qui lui sert d’asile. Tout est primitif et sauvage autour de lui, mais lui est pour ainsi dire le résultat de dix-huit siècles de travaux et d’expérience. Il porte le vêtement des villes, en parle la langue ; sait le passé, est curieux de l’avenir, argumente sur le présent ; [II-227] c’est un homme très civilisé, qui, pour un temps, se soumet à vivre au milieu des bois, et qui s’enfonce dans les déserts du Nouveau-Monde avec la Bible, une hache et des journaux.
Il est difficile de se figurer avec quelle incroyable rapidité la pensée circule dans le sein de ces déserts [41] .
Je ne crois point qu’il se fasse un aussi grand mouvement intellectuel dans les cantons de France les plus éclairés et les plus peuplés [42] .
On ne saurait douter qu’aux États-Unis l’instruction du peuple ne serve puissamment au maintien de la république démocratique. Il en sera ainsi, je pense, partout où l’on ne séparera point l’instruction qui éclaire l’esprit, de l’éducation qui règle les mœurs. [II-228] .
Toutefois, je ne m’exagère point cet avantage, et je suis plus loin encore de croire, ainsi qu’un grand nombre de gens en Europe, qu’il suffise d’apprendre aux hommes à lire et à écrire pour en faire aussitôt des citoyens.
Les véritables lumières naissent principalement de l’expérience, et si l’on n’avait pas habitué peu à peu les Américains à se gouverner eux-mêmes, les connaissances littéraires qu’ils possèdent ne leur seraient point aujourd’hui d’un grand secours pour y réussir.
J’ai beaucoup vécu avec le peuple aux États-Unis, et je ne saurais dire combien j’ai admiré son expérience et son bon sens.
N’amenez pas l’Américain à parler de l’Europe ; il montrera d’ordinaire une grande présomption et un assez sot orgueil. Il se contentera de ces idées générales et indéfinies qui, dans tous les pays, sont d’un si grand secours aux ignorants. Mais interrogez-le sur son pays, et vous verrez se dissiper tout-à-coup le nuage qui enveloppait son intelligence : son langage deviendra clair, net et précis, comme sa pensée. Il vous apprendra quels sont ses droits et de quels moyens il doit se servir pour les exercer ; il saura suivant quels usages se mène le monde politique. Vous apercevrez que les règles de l’administration lui sont connues, et qu’il s’est rendu familier le mécanisme des lois. L’habitant des États-Unis n’a pas puisé dans les livres ces connaissances pratiques et ces notions positives : son éducation littéraire a pu le préparer à les recevoir, mais ne les lui a point fournies.
C’est en participant à la législation que l’Américain [II-229] apprend à connaître les lois ; c’est en gouvernant qu’il s’instruit des formes du gouvernement. Le grand œuvre de la société s’accomplit chaque jour sous ses yeux, et pour ainsi dire dans ses mains.
Aux États-Unis, l’ensemble de l’éducation des hommes est dirigé vers la politique ; en Europe, son but principal est de préparer à la vie privée. L’action des citoyens dans les affaires est un fait trop rare pour être prévu d’avance.
Dès qu’on jette les regards sur les deux sociétés, ces différences se révèlent jusque dans leur aspect extérieur.
En Europe, nous faisons souvent entrer les idées et les habitudes de l’existence privée dans la vie publique, et comme il nous arrive de passer tout-à-coup de l’intérieur de la famille au gouvernement de l’État, on nous voit souvent discuter les grands intérêts de la société de la même manière que nous conversons avec nos amis.
Ce sont, au contraire, les habitudes de la vie publique que les Américains transportent presque toujours dans la vie privée. Chez eux, l’idée du jury se découvre parmi les jeux de l’école, et l’on retrouve les formes parlementaires jusque dans l’ordre d’un banquet. [II-230]
QUE LES LOIS SERVENT PLUS AU MAINTIEN DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE AUX ÉTATS-UNIS QUE LES CAUSES PHYSIQUES, ET LES MŒURS PLUS QUE LES LOIS.
Tous les peuples de l’Amérique ont un état social démocratique. — Cependant les institutions démocratiques ne se soutiennent que chez les Anglo-Américains. — Les Espagnols de l’Amérique du Sud, aussi favorisés par la nature physique que les Anglo-Américains, ne peuvent supporter la république démocratique. — Le Mexique, qui a adopté la Constitution des États-Unis, ne le peut. — Les Anglo-Américains de l’Ouest la supportent avec plus de peine que ceux de l’Est. — Raisons de ces différences.
J’ai dit qu’il fallait attribuer le maintien des institutions démocratiques des États-Unis aux circonstances, aux lois et aux mœurs [43] .
La plupart des Européens ne connaissent que la première de ces trois causes, et ils lui donnent une importance prépondérante qu’elle n’a pas.
Il est vrai que les Anglo-Américains ont apporté dans le Nouveau-Monde l’égalité des conditions. Jamais on ne rencontra parmi eux ni roturiers ni nobles ; les préjugés de naissance y ont toujours été aussi inconnus que les préjugés de profession. L’état social se trouvant ainsi démocratique, la démocratie n’eut pas de peine à établir son empire.
Mais ce fait n’est point particulier aux États-Unis ; presque toutes les colonies d’Amérique ont été fondées par des hommes égaux entre eux ou qui le sont devenus en les habitant. Il n’y a pas une seule partie du Nouveau-Monde où les Européens aient pu créer une aristocratie. [II-231] .
Cependant les institutions démocratiques ne prospèrent qu’aux États-Unis.
L’Union américaine n’a point d’ennemis à combattre. Elle est seule au milieu des déserts comme une île au sein de l’Océan.
Mais la nature avait isolé de la même manière les Espagnols de l’Amérique du Sud, et cet isolement ne les a pas empêchés d’entretenir des armées. Ils se sont fait la guerre entre eux quand les étrangers leur ont manqué. Il n’y a que la démocratie anglo-américaine qui, jusqu’à présent, ait pu se maintenir en paix.
Le territoire de l’Union présente un champ sans bornes à l’activité humaine ; il offre un aliment inépuisable à l’industrie et au travail. L’amour des richesses y prend donc la place de l’ambition, et le bien-être y éteint l’ardeur des partis.
Mais dans quelle portion du monde rencontre-t-on des déserts plus fertiles, de plus grands fleuves, des richesses plus intactes et plus inépuisables que dans l’Amérique du Sud ? Cependant l’Amérique du Sud ne peut supporter la démocratie. S’il suffisait aux peuples pour être heureux d’avoir été placés dans un coin de l’univers et de pouvoir s’étendre à volonté sur les terres inhabitées, les Espagnols de l’Amérique méridionale n’auraient pas à se plaindre de leur sort. Et quand ils ne jouiraient point du même bonheur que les habitants des États-Unis, ils devraient du moins se faire envier des peuples de l’Europe. Il n’y a cependant pas sur la terre de nations plus misérables que celles de l’Amérique du Sud.
Ainsi, non seulement les causes physiques ne peuvent amener des résultats analogues chez les [II-232] Américains du Sud et ceux du Nord, mais elles ne sauraient même produire chez les premiers quelque chose qui ne fût pas inférieur à ce qu’on voit en Europe, où elles agissent en sens contraire.
Les causes physiques n’influent donc pas autant qu’on le suppose sur la destinée des nations.
J’ai rencontré des hommes de la Nouvelle-Angleterre prêts à abandonner une patrie où ils auraient pu trouver l’aisance, pour aller chercher fortune au désert. Près de là, j’ai vu la population française du Canada se presser dans un espace trop étroit pour elle, lorsque le même désert était proche ; et tandis que l’émigrant des États-Unis acquérait avec le prix de quelques journées de travail un grand domaine, le Canadien payait la terre aussi cher que s’il eût encore habité la France.
Ainsi la nature, en livrant aux Européens les solitudes du Nouveau Monde, leur offre des biens dont ils ne savent pas toujours se servir.
J’aperçois chez d’autres peuples de l’Amérique les mêmes conditions de prospérité que chez les Anglo-Américains, moins leurs lois et leurs mœurs ; et ces peuples sont misérables. Les lois et les mœurs des Anglo-Américains forment donc la raison spéciale de leur grandeur et la cause prédominante que je cherche.
Je suis loin de prétendre qu’il y ait une bonté absolue dans les lois américaines : je ne crois point qu’elles soient applicables à tous les peuples démocratiques ; et, parmi elles, il en est plusieurs qui, aux États-Unis même, me semblent dangereuses.
Cependant, on ne saurait nier que la législation des [II-233] Américains, prise dans son ensemble, ne soit bien adaptée au génie du peuple qu’elle doit régir et à la nature du pays.
Les lois américaines sont donc bonnes, et il faut leur attribuer une grande part dans le succès qu’obtient en Amérique le gouvernement de la démocratie ; mais je ne pense pas qu’elles en soient la cause principale. Et si elles me paraissent avoir plus d’influence sur le bonheur social des Américains que la nature même du pays, d’un autre côté j’aperçois des raisons de croire qu’elles en exercent moins que les mœurs.
Les lois fédérales forment assurément la portion la plus importante de la législation des États-Unis.
Le Mexique, qui est aussi heureusement situé que l’Union anglo-américaine, s’est approprié ces mêmes lois, et il ne peut s’habituer au gouvernement de la démocratie.
Il y a donc une raison indépendante des causes physiques et des lois, qui fait que la démocratie peut gouverner les États-Unis.
Mais voici qui prouve plus encore. Presque tous les hommes qui habitent le territoire de l’Union sont issus du même sang. Ils parlent la même langue, prient Dieu de la même manière, sont soumis aux mêmes causes matérielles, obéissent aux mêmes lois.
D’où naissent donc les différences qu’il faut observer entre eux ?.
Pourquoi, à l’est de l’Union, le gouvernement républicain se montre-t-il fort et régulier, et procède-t-il avec maturité et lenteur ? Quelle cause imprime à tous ses actes un caractère de sagesse et de durée ? [II-234] .
D’où vient, au contraire, qu’à l’ouest les pouvoirs de la société semblent marcher au hasard ?.
Pourquoi y règne-t-il dans le mouvement des affaires quelque chose de désordonné, de passionné, on pourrait presque dire de fébrile, qui n’annonce point un long avenir ?.
Je ne compare plus les Anglo-Américains à des peuples étrangers ; j’oppose maintenant les Anglo-Américains les uns aux autres, et je cherche pourquoi ils ne se ressemblent pas. Ici, tous les arguments tirés de la nature du pays et de la différence des lois me manquent en même temps. Il faut recourir à quelque autre cause ; et cette cause, où la découvrirai-je, sinon dans les mœurs ?.
C’est à l’est que les Anglo-Américains ont contracté le plus long usage du gouvernement de la démocratie, et qu’ils ont formé les habitudes et conçu les idées les plus favorables à son maintien. La démocratie y a peu à peu pénétré dans les usages, dans les opinions, dans les formes ; on la retrouve dans tout le détail de la vie sociale comme dans les lois. C’est à l’est que l’instruction littéraire et l’éducation pratique du peuple ont été le plus perfectionnées et que la religion s’est le mieux entremêlée à la liberté. Qu’est-ce que toutes ces habitudes, ces opinions, ces usages, ces croyances, sinon ce que j’ai appelé des mœurs ?.
À l’ouest, au contraire, une partie des mêmes avantages manque encore. Beaucoup d’Américains des États de l’Ouest sont nés dans les bois, et ils mêlent à la civilisation de leurs pères les idées et les coutumes de la vie sauvage. Parmi eux, les passions sont plus violentes, la morale religieuse moins [II-235] puissante, les idées moins arrêtées. Les hommes n’y exercent aucun contrôle les uns sur les autres, car ils se connaissent à peine. Les nations de l’Ouest montrent donc, jusqu’à un certain point, l’inexpérience et les habitudes déréglées des peuples naissants. Cependant les sociétés, dans l’Ouest, sont formées d’éléments anciens ; mais l’assemblage est nouveau.
Ce sont donc particulièrement les mœurs qui rendent les Américains des États-Unis, seuls entre tous les Américains, capables de supporter l’empire de la démocratie ; et ce sont elles encore qui font que les diverses démocraties anglo-américaines sont plus ou moins réglées et prospères.
Ainsi, l’on s’exagère en Europe l’influence qu’exerce la position géographique du pays sur la durée des institutions démocratiques. On attribue trop d’importance aux lois, trop peu aux mœurs. Ces trois grandes causes servent sans doute à régler et à diriger la démocratie américaine ; mais s’il fallait les classer, je dirais que les causes physiques y contribuent moins que les lois, et les lois moins que les mœurs.
Je suis convaincu que la situation la plus heureuse et les meilleures lois ne peuvent maintenir une constitution en dépit des mœurs, tandis que celles-ci tirent encore parti des positions les plus défavorables et des plus mauvaises lois. L’importance des mœurs est une vérité commune à laquelle l’étude et l’expérience ramènent sans cesse. Il me semble que je la trouve placée dans mon esprit comme un point central ; je l’aperçois au bout de toutes mes idées.
Je n’ai plus qu’un mot à dire sur ce sujet.
Si je ne suis point parvenu à faire sentir au lecteur [II-236] dans le cours de cet ouvrage l’importance que j’attribuais à l’expérience pratique des Américains, à leurs habitudes, à leurs opinions, en un mot à leurs mœurs, dans le maintien de leurs lois, j’ai manqué le but principal que je me proposais en l’écrivant.
LES LOIS ET LES MŒURS SUFFIRAIENT-ELLES POUR MAINTENIR LES INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES AUTRE PART QU’EN AMÉRIQUE ?
Les Anglo-Américains, transportés en Europe, seraient obligés d’y modifier leurs lois. — Il faut distinguer entre les institutions démocratiques et les institutions américaines. — On peut concevoir des lois démocratiques meilleures ou du moins différentes de celles que s’est données la démocratie américaine. — L’exemple de l’Amérique prouve seulement qu’il ne faut pas désespérer, à l’aide des lois et des mœurs, de régler la démocratie.
J’ai dit que le succès des institutions démocratiques aux États-Unis tenait aux lois elles-mêmes et aux mœurs plus qu’à la nature du pays.
Mais s’ensuit-il que ces mêmes causes transportées ailleurs eussent seules la même puissance, et si le pays ne peut pas tenir lieu des lois et des mœurs, les lois et les mœurs, à leur tour, peuvent-elles tenir lieu du pays ?.
Ici l’on concevra sans peine que les éléments de preuves nous manquent : on rencontre dans le Nouveau-Monde d’autres peuples que les Anglo-Américains, et ces peuples étant soumis aux mêmes causes matérielles que ceux-ci, j’ai pu les comparer entre eux.
Mais hors de l’Amérique il n’y a point de nations [II-237] qui, privées des mêmes avantages physiques que les Anglo-Américains, aient cependant adopté leurs lois et leurs mœurs.
Ainsi nous n’avons point d’objet de comparaison cette matière ; on ne peut que hasarder des opinions.
Il me semble d’abord qu’il faut distinguer soigneusement les institutions des États-Unis d’avec les institutions démocratiques en général.
Quand je songe à l’état de l’Europe, à ses grands peuples, à ses populeuses cités, à ses formidables armées, aux complications de sa politique, je ne saurais croire que les Anglo-Américains eux-mêmes, transportés avec leurs idées, leur religion, leurs mœurs, sur notre sol, pussent y vivre sans modifier considérablement leurs lois.
Mais on peut supposer un peuple démocratique organisé d’une autre manière que le peuple américain.
Est-il donc impossible de concevoir un gouvernement fondé sur les volontés réelles de la majorité, mais où la majorité, faisant violence aux instincts d’égalité qui lui sont naturels, en faveur de l’ordre et de la stabilité de l’État, consentirait à revêtir de toutes les attributions du pouvoir exécutif une famille ou un homme ? Ne saurait-on imaginer une société démocratique où les forces nationales seraient plus centralisées qu’aux États-Unis, où le peuple exercerait un empire moins direct et moins irrésistible sur les affaires générales, et où cependant chaque citoyen, revêtu de certains droits, prendrait part, dans sa sphère, à la marche du gouvernement ? [II-238] .
Ce que j’ai vu chez les Anglo-Américains me porte à croire que les institutions démocratiques de cette nature, introduites prudemment dans la société, qui s’y mêleraient peu à peu aux habitudes, et s’y fondraient graduellement avec les opinions mêmes du peuple, pourraient subsister ailleurs qu’en Amérique.
Si les lois des États-Unis étaient les seules lois démocratiques qu’on doive imaginer, ou les plus parfaites qu’il soit possible de rencontrer, je conçois qu’on pût en conclure que le succès des lois des États-Unis ne prouve rien pour le succès des lois démocratiques en général, dans un pays moins favorisé de la nature.
Mais si les lois des Américains me paraissent défectueuses en beaucoup de points, et qu’il me soit aisé de les concevoir autres, la nature spéciale du pays ne me prouve point que des institutions démocratiques ne puissent réussir chez un peuple où, les circonstances physiques se trouvant moins favorables, les lois seraient meilleures.
Si les hommes se montraient différents en Amérique de ce qu’ils sont ailleurs ; si leur état social faisait naître chez eux des habitudes et des opinions contraires à celles qui naissent en Europe de ce même état social, ce qui se passe dans les démocraties américaines n’apprendrait rien sur ce qui doit se passer dans les autres démocraties.
Si les Américains montraient les mêmes penchants que tous les autres peuples démocratiques, et que leurs législateurs s’en fussent rapportés à la nature du pays et à la faveur des circonstances pour contenir [II-239] ces penchants dans de justes limites, la prospérité des États-Unis devant être attribuée à des causes purement physiques, ne prouverait rien en faveur des peuples qui voudraient suivre leurs exemples sans avoir leurs avantages naturels.
Mais ni l’une ni l’autre de ces suppositions ne se trouvent vérifiées par les faits.
J’ai rencontré en Amérique des passions analogues à celles que nous voyons en Europe : les unes tenaient à la nature même du cœur humain ; les autres, à l’état démocratique de la société.
C’est ainsi que j’ai retrouvé aux États-Unis l’inquiétude du cœur, qui est naturelle aux hommes quand, toutes les conditions étant à peu près égales, chacun voit les mêmes chances de s’élever. J’y ai rencontré le sentiment démocratique de l’envie exprimé de mille manières différentes. J’ai remarqué que le peuple y montrait souvent, dans la conduite des affaires, un grand mélange de présomption et d’ignorance ; et j’en ai conclu qu’en Amérique comme parmi nous, les hommes étaient sujets aux mêmes imperfections et exposés aux mêmes misères.
Mais quand je vins à examiner attentivement l’état de la société, je découvris sans peine que les Américains avaient fait de grands et heureux efforts pour combattre ces faiblesses du cœur humain et corriger ces défauts naturels de la démocratie.
Leurs diverses lois municipales me parurent comme autant de barrières qui retenaient dans une sphère étroite l’ambition inquiète des citoyens, et tournaient au profit de la commune les mêmes passions démocratiques qui eussent pu renverser l’État. Il me sembla [II-240] que les législateurs américains étaient parvenus à opposer, non sans succès, l’idée des droits aux sentiments de l’envie ; aux mouvements continuels du monde politique, l’immobilité de la morale religieuse ; l’expérience du peuple, à son ignorance théorique, et son habitude des affaires, à la fougue de ses désirs.
Les Américains ne s’en sont donc pas rapportés à la nature du pays pour combattre les dangers qui naissent de leur constitution et de leurs lois politiques. À des maux qu’ils partagent avec tous les peuples démocratiques, ils ont appliqué des remèdes dont eux seuls, jusqu’à présent, se sont avisés ; et quoiqu’ils fussent les premiers à en faire l’essai, ils ont réussi.
Les mœurs et les lois des Américains ne sont pas les seules qui puissent convenir aux peuples démocratiques ; mais les Américains ont montré qu’il ne faut pas désespérer de régler la démocratie à l’aide des lois et des mœurs.
Si d’autres peuples, empruntant à l’Amérique cette idée générale et féconde, sans vouloir du reste imiter ses habitants dans l’application particulière qu’ils en ont faite, tentaient de se rendre propres à l’état social que la Providence impose aux hommes de nos jours, et cherchaient ainsi à échapper au despotisme ou à l’anarchie qui les menacent, quelles raisons avons-nous de croire qu’ils dussent échouer dans leurs efforts ?.
L’organisation et l’établissement de la démocratie parmi les chrétiens est le grand problème politique de notre temps. Les Américains ne résolvent point [II-241] sans doute ce problème, mais ils fournissent d’utiles enseignements à ceux qui veulent le résoudre.
IMPORTANCE DE CE QUI PRÉCÈDE, PAR RAPPORT À L’EUROPE.
On découvre aisément pourquoi je me suis livré aux recherches qui précèdent. La question que j’ai soulevée n’intéresse pas seulement les États-Unis, mais le monde entier ; non pas une nation, mais tous les hommes.
Si les peuples dont l’état social est démocratique ne pouvaient rester libres que lorsqu’ils habitent des déserts, il faudrait désespérer du sort futur de l’espèce humaine ; car les hommes marchent rapidement vers la démocratie, et les déserts se remplissent.
S’il était vrai que les lois et les mœurs fussent insuffisantes au maintien des institutions démocratiques, quel autre refuge resterait-il aux nations, sinon le despotisme d’un seul ?.
Je sais que de nos jours il y a bien des gens honnêtes que cet avenir n’effraie guère, et qui, fatigués de la liberté, aimeraient à se reposer enfin loin de ses orages.
Mais ceux-là connaissent bien mal le port vers lequel ils se dirigent. Préoccupés de leurs souvenirs, ils jugent le pouvoir absolu par ce qu’il a été jadis, et non par ce qu’il pourrait être de nos jours.
Si le pouvoir absolu venait à s’établir de nouveau chez les peuples démocratiques de l’Europe, je ne doute pas qu’il n’y prît une forme nouvelle et qu’il [II-242] ne s’y montrât sous des traits inconnus à nos pères.
Il fut un temps en Europe où la loi, ainsi que le consentement du peuple, avaient revêtu les rois d’un pouvoir presque sans bornes. Mais il ne leur arrivait presque jamais de s’en servir.
Je ne parlerai point des prérogatives de la noblesse, de l’autorité des cours souveraines, du droit des corporations, des privilèges de province, qui, tout en amortissant les coups de l’autorité, maintenaient dans la nation un esprit de résistance.
Indépendamment de ces institutions politiques, qui, souvent contraires à la liberté des particuliers, servaient cependant à entretenir l’amour de la liberté dans les âmes, et dont, sous ce rapport, l’utilité se conçoit sans peine, les opinions et les mœurs élevaient autour du pouvoir royal des barrières moins connues, mais non moins puissantes.
La religion, l’amour des sujets, la bonté du prince, l’honneur, l’esprit de famille, les préjugés de province, la coutume et l’opinion publique, bornaient le pouvoir des rois, et enfermaient dans un cercle invisible leur autorité.
Alors la constitution des peuples était despotique, et leurs mœurs libres. Les princes avaient le droit mais non la faculté ni le désir de tout faire.
Des barrières qui arrêtaient jadis la tyrannie, que nous reste-t-il aujourd’hui ?.
La religion ayant perdu son empire sur les âmes, la borne la plus visible qui divisait le bien et le mal se trouve renversée ; tout semble douteux et incertain dans le monde moral ; les rois et les peuples y marchent au hasard, et nul ne saurait dire où sont [II-243] les limites naturelles du despotisme et les bornes de la licence.
De longues révolutions ont pour jamais détruit le respect qui environnait les chefs de l’État. Déchargés du poids de l’estime publique, les princes peuvent désormais se livrer sans crainte à l’enivrement du pouvoir.
Quand les rois voient le cœur des peuples qui vient au devant d’eux, ils sont cléments, parce qu’ils se sentent forts ; et ils ménagent l’amour de leurs sujets, parce que l’amour des sujets est l’appui du trône. Il s’établit alors entre le prince et le peuple un échange de sentiments dont la douceur rappelle au sein de la société l’intérieur de la famille. Les sujets, tout en murmurant contre le souverain, s’affligent encore de lui déplaire, et le souverain frappe ses sujets d’une main légère, ainsi qu’un père châtie ses enfants.
Mais quand une fois le prestige de la royauté s’est évanoui au milieu du tumulte de révolutions ; lorsque les rois, se succédant sur le trône, y ont tour à tour exposé au regard des peuples la faiblesse du droit et la dureté de fait, personne ne voit plus dans le souverain le père de l’État, et chacun y aperçoit un maître. S’il est faible, on le méprise ; on le hait s’il est fort. Lui-même est plein de colère et de crainte ; il se voit ainsi qu’un étranger dans son pays, et il traite ses sujets en vaincus.
Quand les provinces et les villes formaient autant de nations différentes au milieu de la patrie commune, chacune d’elles avait un esprit particulier qui s’opposait à l’esprit général de la servitude ; mais [II-244] aujourd’hui que toutes les parties du même empire, après avoir perdu leurs franchises, leurs usages, leurs préjugés et jusqu’à leurs souvenirs et leurs noms, se sont habituées à obéir aux mêmes lois, il n’est pas plus difficile de les opprimer toutes ensemble que d’opprimer séparément l’une d’elles.
Pendant que la noblesse jouissait de son pouvoir, et long-temps encore après qu’elle l’eut perdu, l’honneur aristocratique donnait une force extraordinaire aux résistances individuelles.
On voyait alors des hommes qui malgré leur impuissance, entretenaient encore une haute idée de leur valeur individuelle, et osaient résister isolément à l’effort de la puissance publique.
Mais de nos jours, où toutes les classes achèvent de se confondre, où l’individu disparaît de plus en plus dans la foule et se perd aisément au milieu de l’obscurité commune ; aujourd’hui que l’honneur monarchique ayant presque perdu son empire sans être remplacé par la vertu, rien ne soutient plus l’homme au-dessus de lui-même, qui peut dire où s’arrêteraient les exigences du pouvoir et les complaisances de la faiblesse ?.
Tant qu’a duré l’esprit de famille, l’homme qui luttait contre la tyrannie n’était jamais seul, il trouvait autour de lui des clients, des amis héréditaires, des proches. Et cet appui lui eût-il manqué, il se sentait encore soutenu par ses aïeux et animé par ses descendants. Mais quand les patrimoines se divisent, et quand en peu d’années les races se confondent, où placer l’esprit de famille ?.
Quelle force reste-t-il aux coutumes chez un peuple [II-245] qui a entièrement changé de face et qui en change sans cesse, où tous les actes de tyrannie ont déjà un précédent, où tous les crimes peuvent s’appuyer sur un exemple, où l’on ne saurait rien rencontrer d’assez ancien pour qu’on redoute de le détruire, ni rien concevoir de si nouveau qu’on ne puisse l’oser ?.
Quelle résistance offrent des mœurs qui se sont déjà pliées tant de fois ?.
Que peut l’opinion publique elle-même, lorsqu’il n’existe pas vingt personnes qu’un lien commun rassemble ; quand il ne se rencontre ni un homme, ni une famille, ni un corps, ni une classe, ni une association libre qui puisse représenter et faire agir cette opinion ?.
Quand chaque citoyen étant également impuissant, également pauvre, également isolé, ne peut opposer que sa faiblesse individuelle à la force organisée du gouvernement ?.
Pour concevoir quelque chose d’analogue à ce qui se passerait alors parmi nous, ce n’est point à nos annales qu’on devrait recourir. Il faudrait peut-être interroger les monuments de l’antiquité et se reporter à ces siècles affreux de la tyrannie romaine, où les mœurs étant corrompues, les souvenirs effacés, les habitudes détruites, les opinions chancelantes, la liberté chassée des lois ne sut plus où se réfugier pour trouver un asile ; où rien ne garantissant plus les citoyens, et les citoyens ne se garantissant plus eux-mêmes, on vit des hommes se jouer de la nature humaine, et des princes lasser la clémence du Ciel plutôt que la patience de leurs sujets.
Ceux-là me semblent bien aveugles qui pensent [II-246] retrouver la monarchie de Henri IV ou de Louis XIV. Quant à moi, lorsque je considère l’état où sont déjà arrivées plusieurs nations européennes et celui où toutes les autres tendent, je me sens porté à croire que bientôt parmi elles il ne se trouvera plus de place que pour la liberté démocratique ou pour la tyrannie des Césars.
Ceci ne mérite pas qu’on y songe ? Si les hommes devaient arriver, en effet, à ce point qu’il fallût les rendre tous libres ou tous esclaves, tous égaux en droits ou tous privés de droits ; si ceux qui gouvernent les sociétés en étaient réduits à cette alternative d’élever graduellement la foule jusqu’à eux, ou de laisser tomber tous les citoyens au dessous du niveau de l’humanité, n’en serait-ce pas assez pour vaincre bien des doutes, rassurer bien des consciences, et préparer chacun à faire aisément de grands sacrifices ?.
Ne faudrait-il pas alors considérer le développement graduel des institutions et des mœurs démocratiques, non comme le meilleur, mais comme le seul moyen qui nous reste d’être libres ; et sans aimer le gouvernement de la démocratie, ne serait-on pas disposé à l’adopter comme le remède le mieux applicable et le plus honnête qu’on puisse opposer aux maux présents de la société ?.
Il est difficile de faire participer le peuple au gouvernement ; il est plus difficile encore de lui fournir l’expérience et de lui donner les sentiments qui lui manquent pour bien gouverner.
Les volontés de la démocratie sont changeantes ; ses agents, grossiers ; ses lois, imparfaites ; je l’accorde. [II-247] Mais s’il était vrai que bientôt il ne dût exister aucun intermédiaire entre l’empire de la démocratie et le joug d’un seul, ne devrions-nous pas plutôt tendre vers l’un que nous soumettre volontairement à l’autre ? et s’il fallait enfin en arriver à une complète égalité, ne vaudrait-il pas mieux se laisser niveler par la liberté que par un despote ?.
Ceux qui, après avoir lu ce livre, jugeraient qu’en l’écrivant j’ai voulu proposer les lois et les mœurs anglo-américaines à l’imitation de tous les peuples qui ont un état social démocratique, ceux-là auraient commis une grande erreur ; ils se seraient attachés à la forme, abandonnant la substance même de ma pensée. Mon but a été de montrer, par l’exemple de l’Amérique, que les lois et surtout les mœurs pouvaient permettre à un peuple démocratique de rester libre. Je suis, du reste, très loin de croire que nous devions suivre l’exemple que la démocratie américaine a donné, et imiter les moyens dont elle s’est servie pour atteindre ce but de ses efforts ; car je n’ignore point quelle est l’influence exercée par la nature du pays et les faits antécédents sur les constitutions politiques, et je regarderais comme un grand malheur pour le genre humain que la liberté dût en tous lieux se produire sous les mêmes traits.
Mais je pense que si l’on ne parvient à introduire peu à peu et à fonder enfin parmi nous des institutions démocratiques, et que si l’on renonce à donner à tous les citoyens des idées et des sentiments qui d’abord les préparent à la liberté, et ensuite leur en permettent l’usage, il n’y aura d’indépendance pour personne, ni pour le bourgeois, ni pour le noble, ni [II-248] pour le pauvre, ni pour le riche, mais une égale tyrannie pour tous ; et je prévois que si l’on ne réussit point avec le temps à fonder parmi nous l’empire paisible du plus grand nombre, nous arriverons tôt ou tard au pouvoir illimité d’un seul. [II-249]
[II-249]
CHAPITRE X.↩
QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR L’ÉTAT ACTUEL ET L’AVENIR PROBABLE DES TROIS RACES QUI HABITENT LE TERRITOIRE DES ÉTATS-UNIS.
La tâche principale que je m’étais imposée est maintenant remplie ; j’ai montré, autant du moins que je pouvais y réussir, quelles étaient les lois de la démocratie américaine ; j’ai fait connaître quelles étaient ses mœurs. Je pourrais m’arrêter ici, mais le lecteur trouverait peut-être que je n’ai point satisfait son attente.
On rencontre en Amérique autre chose encore qu’une immense et complète démocratie ; on peut envisager sous plus d’un point de vue les peuples qui habitent le Nouveau-Monde.
Dans le cours de cet ouvrage, mon sujet m’a souvent amené à parler des Indiens et des nègres, mais je n’ai jamais eu le temps de m’arrêter pour montrer quelle position occupent ces deux races au milieu du peuple démocratique que j’étais occupé à peindre ; j’ai dit suivant quel esprit, à l’aide de quelles lois la confédération anglo-américaine avait été formée ; je n’ai pu indiquer qu’en passant, et d’une manière fort incomplète, les dangers qui menacent cette confédération, et il m’a été impossible d’exposer en détail quelles [II-250] étaient, indépendamment des lois et des mœurs, ses chances de durée. En parlant des républiques unies, je n’ai hasardé aucune conjecture sur la permanence des formes républicaines dans le Nouveau-Monde, et faisant souvent allusion à l’activité commerciale qui règne dans l’Union, je n’ai pu cependant m’occuper de l’avenir des Américains comme peuple commerçant.
Ces objets, qui touchent à mon sujet, n’y entrent pas ; ils sont américains sans être démocratiques, et c’est surtout la démocratie dont j’ai voulu faire le portrait. J’ai donc dû les écarter d’abord ; mais je dois y revenir en terminant.
Le territoire occupé de nos jours, ou réclamé par l’Union américaine, s’étend depuis l’océan Atlantique jusqu’aux rivages de la mer du Sud. À l’est ou à l’ouest, ses limites sont donc celles mêmes du continent ; il s’avance au midi sur le bord des Tropiques, et remonte ensuite au milieu des glaces du Nord [44] .
Les hommes répandus dans cet espace ne forment point, comme en Europe, autant de rejetons d’une même famille. On découvre en eux, dès le premier abord, trois races naturellement distinctes, et je pourrais presque dire ennemies. L’éducation, la loi, l’origine, et jusqu’à la forme extérieure des traits, avaient élevé entre elles une barrière presque insurmontable ; la fortune les a rassemblées sur le même sol, mais elle les a mêlées sans pouvoir les confondre, et chacune poursuit à part sa destinée. [II-251] .
Parmi ces hommes si divers, le premier qui attire les regards, le premier en lumière, en puissance, en bonheur, c’est l’homme blanc, l’Européen, l’homme par excellence ; au-dessous de lui paraissent le nègre et l’Indien.
Ces deux races infortunées n’ont de commun ni la naissance, ni la figure, ni le langage, ni les mœurs ; leurs malheurs seuls se ressemblent. Toutes deux occupent une position également inférieure dans le pays qu’elles habitent ; toutes deux éprouvent les effets de la tyrannie ; et si leurs misères sont différentes, elles peuvent en accuser les mêmes auteurs.
Ne dirait-on pas, à voir ce qui se passe dans le monde, que l’Européen est aux hommes des autres races ce que l’homme lui-même est aux animaux ? Il les fait servir à son usage, et quand il ne peut les plier, il les détruit.
L’oppression a enlevé du même coup, aux descendants des Africains, presque tous les privilèges de l’humanité ! Le nègre des États-Unis a perdu jusqu’au souvenir de son pays ; il n’entend plus la langue qu’ont parlée ses pères ; il a abjuré leur religion et oublié leurs mœurs. En cessant ainsi d’appartenir à l’Afrique, il n’a pourtant acquis aucun droit aux biens de l’Europe ; mais il s’est arrêté entre les deux sociétés ; il est resté isolé entre les deux peuples ; vendu par l’un et répudié par l’autre ; ne trouvant dans l’univers entier que le foyer de son maître pour lui offrir l’image incomplète de la patrie.
Le nègre n’a point de famille ; il ne saurait voir dans la femme autre chose que la compagne [II-252] passagère de ses plaisirs, et, en naissant, ses fils sont ses égaux.
Appellerai-je un bienfait de Dieu ou une dernière malédiction de sa colère, cette disposition de l’âme qui rend l’homme insensible aux misères extrêmes, et souvent même lui donne une sorte de goût dépravé pour la cause de ses malheurs ?.
Plongé dans cet abîme de maux, le Nègre sent à peine son infortune ; la violence l’avait placé dans l’esclavage, l’usage de la servitude lui a donné des pensées et une ambition d’esclave ; il admire ses tyrans plus encore qu’il ne les hait, et trouve sa joie et son orgueil dans la servile imitation de ceux qui l’oppriment.
Son intelligence s’est abaissée au niveau de son âme.
Le Nègre entre en même temps dans la servitude et dans la vie. Que dis-je ? souvent on l’achète dès le ventre de sa mère, et il commence pour ainsi dire à être esclave avant que de naître.
Sans besoin comme sans plaisir, inutile à lui-même, il comprend, par les premières notions qu’il reçoit de l’existence, qu’il est la propriété d’un autre, dont l’intérêt est de veiller sur ses jours ; il aperçoit que le soin de son propre sort ne lui est pas dévolu ; l’usage même de la pensée lui semble un don inutile de la Providence, et il jouit paisiblement de tous les priviléges de sa bassesse.
S’il devient libre, l’indépendance lui paraît souvent alors une chaîne plus pesante que l’esclavage même ; car dans le cours de son existence, il a [II-253] appris à se soumettre à tout, excepté à la raison ; et quand la raison devient son seul guide, il ne saurait reconnaître sa voix. Mille besoins nouveaux l’assiègent, et il manque des connaissances et de l’énergie nécessaires pour leur résister. Les besoins sont des maîtres qu’il faut combattre, et lui n’a appris qu’à se soumettre et à obéir. Il en est donc arrivé à ce comble de misère, que la servitude l’abrutit et que la liberté le fait périr.
L’oppression n’a pas exercé moins d’influence sur les races indiennes, mais ces effets sont différents.
Avant l’arrivée des blancs dans le Nouveau-Monde, les hommes qui habitaient l’Amérique du Nord vivaient tranquilles dans les bois. Livrés aux vicissitudes ordinaires de la vie sauvage, ils montraient les vices et les vertus des peuples incivilisés. Les Européens, après avoir dispersé au loin les tribus indiennes dans les déserts, les ont condamnées à une vie errante et vagabonde, pleine d’inexprimables misères.
Les nations sauvages ne sont gouvernées que par les opinions et les mœurs.
En affaiblissant parmi les Indiens de l’Amérique du Nord le sentiment de la patrie, en dispersant leurs familles, en obscurcissant leurs traditions, en interrompant la chaîne des souvenirs, en changeant toutes leurs habitudes, et en accroissant outre mesure leurs besoins, la tyrannie européenne les a rendus plus désordonnés et moins civilisés qu’ils n’étaient déjà. La condition morale et l’état physique de ces peuples n’ont cessé d’empirer en même temps, et ils sont devenus plus barbares à mesure qu’ils étaient plus [II-254] malheureux. Toutefois, les Européens n’ont pu modifier entièrement le caractère des Indiens, et avec le pouvoir de les détruire, ils n’ont jamais eu celui de les policer et de les soumettre.
Le nègre est placé aux dernières bornes de la servitude ; l’Indien, aux limites extrêmes de la liberté. L’esclavage ne produit guère chez le premier des effets plus funestes que l’indépendance chez le second.
Le nègre a perdu jusqu’à la propriété de sa personne, et il ne saurait disposer de sa propre existence sans commettre une sorte de larcin.
Le sauvage est livré à lui-même dès qu’il peut agir. À peine s’il a connu l’autorité de la famille ; il n’a jamais plié sa volonté devant celle de ses semblables ; nul ne lui a appris à discerner une obéissance volontaire d’une honteuse sujétion, et il ignore jusqu’au nom de la loi. Pour lui, être libre, c’est échapper à presque tous les liens des sociétés. Il se complaît dans cette indépendance barbare, et il aimerait mieux périr que d’en sacrifier la moindre partie. La civilisation a peu de prise sur un pareil homme.
Le nègre fait mille efforts inutiles pour s’introduire dans une société qui le repousse ; il se plie aux goûts de ses oppresseurs, adopte leurs opinions, et aspire, en les imitant, à se confondre avec eux. On lui a dit dès sa naissance que sa race est naturellement inférieure à celle des blancs, et il n’est pas éloigné de le croire, il a donc honte de lui-même. Dans chacun de ses traits il découvre une trace d’esclavage, et, s’il le pouvait, il consentirait avec joie à se répudier tout entier.
L’Indien, au contraire, a l’imagination toute [II-255] remplie de la prétendue noblesse de son origine. Il vit et meurt au milieu de ces rêves de son orgueil. Loin de vouloir plier ses mœurs aux nôtres, il s’attache à la barbarie comme à un signe distinctif de sa race, et il repousse la civilisation moins encore peut-être en haine d’elle que dans la crainte de ressembler aux Européens [45] .
À la perfection de nos arts, il ne veut opposer que les ressources du désert ; à notre tactique, que son courage indiscipliné ; à la profondeur de nos desseins, [II-256] que les instincts spontanés de sa nature sauvage. Il succombe dans cette lutte inégale.
Le nègre voudrait se confondre avec l’Européen, et il ne le peut. L’Indien pourrait jusqu’à un certain point y réussir, mais il dédaigne de le tenter. La servilité de l’un le livre à l’esclavage, et l’orgueil de l’autre à la mort.
Je me souviens que, parcourant les forêts qui couvrent encore l’État d’Alabama, je parvins un jour auprès de la cabane d’un pionnier. Je ne voulus point pénétrer dans la demeure de l’Américain, mais j’allai me reposer quelques instants sur le bord d’une fontaine qui se trouvait non loin de là dans le bois. Tandis que j’étais en cet endroit, il y vint une Indienne (nous nous trouvions alors près du territoire occupé par la nation des Creeks) ; elle tenait par la main une petite fille de cinq à six ans, appartenant à la race blanche, et que je supposai être la fille du pionnier. Une négresse les suivait. Il régnait dans le costume de l’Indienne une sorte de luxe barbare : des anneaux de métal étaient suspendus à ses narines et à ses oreilles ; ses cheveux, mêlés de grains de verre, tombaient librement sur ses épaules, et je vis qu’elle n’était point épouse, car elle portait encore le collier de coquillages que les vierges ont coutume de déposer sur la couche nuptiale ; la négresse était revêtue d’habillements européens presque en lambeaux.
Elles vinrent s’asseoir toutes trois sur les bords de la fontaine, et la jeune sauvage, prenant l’enfant dans ses bras, lui prodiguait des caresses qu’on aurait pu croire dictées par le cœur d’une mère ; de [II-257] son côté, la négresse cherchait par mille innocents artifices à attirer l’attention de la petite créole. Celle-ci montrait dans ses moindres mouvements un sentiment de supériorité qui contrastait étrangement avec sa faiblesse et son âge ; on eût dit qu’elle usait d’une sorte de condescendance en recevant les soins de ses compagnes.
Accroupie devant sa maîtresse, épiant chacun de ses désirs, la négresse semblait également partagée entre un attachement presque maternel et une crainte servile ; tandis qu’on voyait régner jusque dans l’effusion de tendresse de la femme sauvage un air libre, fier et presque farouche.
Je m’étais approché et je contemplais en silence ce spectacle ; ma curiosité déplut sans doute à l’Indienne, car elle se leva brusquement, poussa l’enfant loin d’elle avec une sorte de rudesse, et, après m’avoir lancé un regard irrité, s’enfonça dans le bois.
Il m’était souvent arrivé de voir réunis dans les mêmes lieux des individus appartenant aux trois races humaines qui peuplent l’Amérique du Nord ; j’avais déjà reconnu dans mille effets divers la prépondérance exercée par les blancs ; mais il se rencontrait, dans le tableau que je viens de décrire, quelque chose de particulièrement touchant : un lien d’affection réunissait ici les opprimés aux oppresseurs, et la nature, en s’efforçant de les rapprocher, rendait plus frappant encore l’espace immense qu’avaient mis entre eux les préjugés et les lois. [II-258]
ÉTAT ACTUEL ET AVENIR PROBABLE DES TRIBUS INDIENNES QUI HABITENT LE TERRITOIRE POSSÉDÉ PAR L’UNION.
Disparition graduelle des races indigènes. — Comment elle s’opère. — Misères qui accompagnent les migrations forcées des Indiens. — Les sauvages de l’Amérique du Nord n’avaient que deux moyens d’échapper à la destruction : la guerre ou la civilisation. — Ils ne peuvent plus faire la guerre. — Pourquoi ils ne veulent pas se civiliser lorsqu’ils pourraient le faire, et ne le peuvent plus quand ils arrivent à le vouloir. — Exemple des Creeks et des Cherokees. — Politique des États particuliers envers ces Indiens. — Politique du gouvernement fédéral.
Toutes les tribus indiennes qui habitaient autrefois le territoire de la Nouvelle-Angleterre, les Narragansetts, les Mohicans, les Pecots, ne vivent plus que dans le souvenir des hommes ; les Lénapes, qui reçurent Penn, il y a cent cinquante ans, sur les rives de la Delaware, sont aujourd’hui disparus. J’ai rencontré les derniers des Iroquois : ils demandaient l’aumône. Toutes les nations que je viens de nommer s’étendaient jadis jusque sur les bords de la mer ; maintenant il faut faire plus de cent lieues dans l’intérieur du continent pour rencontrer un Indien. Ces sauvages n’ont pas seulement reculé, ils sont détruits [46] . À mesure que les indigènes s’éloignent et meurent, à leur place vient et grandit sans cesse un peuple immense. On n’avait jamais vu parmi les nations un développement si prodigieux, ni une destruction si rapide.
Quant à la manière dont cette destruction s’opère, il est facile de l’indiquer. [II-259] .
Lorsque les Indiens habitaient seuls le désert dont on les exile aujourd’hui, leurs besoins étaient en petit nombre ; ils fabriquaient eux-mêmes leurs armes, l’eau des fleuves était leur seule boisson, et ils avaient pour vêtement la dépouille des animaux dont la chair servait à les nourrir.
Les Européens ont introduit parmi les indigènes de l’Amérique du Nord les armes à feu, le fer et l’eau-de-vie ; ils leur ont appris à remplacer par nos tissus les vêtements barbares dont la simplicité indienne s’était jusque là contentée. En contractant des goûts nouveaux, les Indiens n’ont pas appris l’art de les satisfaire, et il leur a fallu recourir à l’industrie des blancs. En retour de ces biens, que lui-même ne savait point créer, le sauvage ne pouvait rien offrir, sinon les riches fourrures que ses bois renfermaient encore. De ce moment la chasse ne dut pas seulement pourvoir à ses besoins, mais encore aux passions frivoles de l’Europe. Il ne poursuivit plus les bêtes des forêts seulement pour se nourrir, mais afin de se procurer les seuls objets d’échange qu’il pût nous donner [47] .
Pendant que les besoins des indigènes [II-260] s’accroissaient ainsi, leurs ressources ne cessaient de décroître.
Du jour où un établissement européen se forme dans le voisinage du territoire occupé par les Indiens, le gibier prend aussitôt l’alarme [48] . Des milliers de sauvages, errant dans les forêts, sans demeures fixes, ne l’effrayaient point ; mais à l’instant où les bruits continus de l’industrie européenne se font entendre en quelque endroit, il commence à fuir et à se retirer vers l’ouest, où son instinct lui apprend qu’il rencontrera des déserts encore sans bornes. « Les troupeaux de bisons se retirent sans cesse, disent MM. Cass et Clark dans leur rapport au congrès, 4 février 1829 ; il y a quelques années, ils [II-261] s’approchaient encore du pied des Alleghanys ; dans quelques années, il sera peut-être difficile d’en voir sur les plaines immenses qui s’étendent le long des montagnes Rocheuses. » On m’a assuré que cet effet de l’approche des blancs se faisait souvent sentir à deux cents lieues de leur frontière. Leur influence s’exerce ainsi sur des tribus dont ils savent à peine le nom, et qui souffrent les maux de l’usurpation longtemps avant d’en connaître les auteurs [49] .
Bientôt de hardis aventuriers pénètrent dans les contrées indiennes ; ils s’avancent à quinze ou vingt lieues de l’extrême frontière des blancs, et vont bâtir la demeure de l’homme civilisé au milieu même de la barbarie. Il leur est facile de le faire : les bornes du territoire d’un peuple chasseur sont mal fixées. Ce territoire d’ailleurs appartient à la nation tout entière, et n’est précisément la propriété de personne ; l’intérêt individuel n’en défend donc aucune partie.
Quelques familles européennes, occupant des points fort éloignés, achèvent alors de chasser sans retour les animaux sauvages de tout l’espace intermédiaire qui s’étend entre elles. Les Indiens, qui avaient vécu jusque-là dans une sorte d’abondance trouvent difficilement à subsister, plus difficilement encore à se procurer les objets d’échange dont ils ont besoin. En faisant fuir leur gibier, c’est comme si on frappait de stérilité les champs de nos cultivateurs. Bientôt les [II-262] moyens d’existence leur manquent presque entièrement. On rencontre alors ces infortunés rôdant comme des loups affamés au milieu de leurs bois déserts. L’amour instinctif de la patrie les attache au sol qui les a vus naître [50] , et ils n’y trouvent plus que la misère et la mort. Ils se décident enfin ; ils partent, et suivant de loin dans sa fuite l’élan, le buffle et le castor, ils laissent à ces animaux sauvages le soin de leur choisir une nouvelle patrie. Ce ne sont donc pas, à proprement parler, les Européens qui chassent les indigènes de l’Amérique, c’est la famine : heureuse distinction qui avait échappé aux anciens casuistes et que les docteurs modernes ont découverte.
On ne saurait se figurer les maux affreux qui accompagnent ces émigrations forcées. Au moment où les Indiens ont quitté leurs champs paternels, déjà ils étaient épuisés et réduits. La contrée où ils vont fixer leur séjour est occupée par des peuplades qui ne voient qu’avec jalousie les nouveaux arrivants. Derrière eux est la faim, devant eux la guerre, partout la misère. Afin d’échapper à tant d’ennemis ils se divisent. Chacun d’eux cherche à s’isoler pour trouver furtivement les moyens de soutenir son existence, et vit dans l’immensité des déserts [II-263] comme le proscrit dans le sein des sociétés civilisées. Le lien social depuis long-temps affaibli se brise alors. Il n’y avait déjà plus pour eux de patrie, bientôt il n’y aura plus de peuple ; à peine s’il restera des familles ; le nom commun se perd, la langue s’oublie, les traces de l’origine disparaissent. La nation a cessé d’exister. Elle vit à peine dans le souvenir des antiquaires américains et n’est connue que de quelques érudits d’Europe.
Je ne voudrais pas que le lecteur pût croire que je charge ici mes tableaux. J’ai vu de mes propres yeux plusieurs des misères que je viens de décrire ; j’ai contemplé des maux qu’il me serait impossible de retracer.
À la fin de l’année 1831, je me trouvais sur la rive gauche du Mississipi, à un lieu nommé par les Européens Memphis. Pendant que j’étais en cet endroit, il y vint une troupe nombreuse de Choctaws (les Français de la Louisiane les nomment Chactas) ; ces sauvages quittaient leur pays et cherchaient à passer sur la rive droite du Mississipi, où ils se flattaient de trouver un asile que le gouvernement américain leur promettait. On était alors au cœur de l’hiver, et le froid sévissait cette année-là avec une violence inaccoutumée ; la neige avait durci sur la terre, et le fleuve charriait d’énormes glaçons. Les Indiens menaient avec eux leurs familles ; ils traînaient à leur suite des blessés, des malades, des enfants qui venaient de naître, et des vieillards qui allaient mourir. Ils n’avaient ni tentes ni chariots, mais seulement quelques provisions et des armes. Je les vis s’embarquer pour traverser le grand fleuve, et ce spectacle [II-264] solennel ne sortira jamais de ma mémoire. On n’entendait parmi cette foule assemblée ni sanglots ni plaintes ; ils se taisaient. Leurs malheurs étaient anciens et ils les sentaient irrémédiables. Les Indiens étaient déjà tous entrés dans le vaisseau qui devait les porter ; leurs chiens restaient encore sur le rivage ; lorsque ces animaux virent enfin qu’on allait s’éloigner pour toujours, ils poussèrent ensemble d’affreux hurlements, et s’élançant à la fois dans les eaux glacées du Mississipi, ils suivirent leurs maîtres à la nage.
La dépossession des Indiens s’opère souvent de nos jours d’une manière régulière et pour ainsi dire toute légale.
Lorsque la population européenne commence à s’approcher du désert occupé par une nation sauvage, le gouvernement des États-Unis envoie communément à cette dernière une ambassade solennelle ; les blancs assemblent les Indiens dans une grande plaine, et après avoir mangé et bu avec eux, ils leur disent : « Que faites-vous dans le pays de vos pères ? Bientôt il vous faudra déterrer leurs os pour y vivre. En quoi la contrée que vous habitez vaut-elle mieux qu’une autre ? N’y a-t-il des bois, des marais et des prairies que là où vous êtes, et ne sauriez-vous vivre que sous votre soleil ? Au-delà de ces montagnes que vous voyez à l’horizon, par-delà ce lac qui borde à l’ouest votre territoire, on rencontre de vastes contrées où les bêtes sauvages se trouvent encore en abondance ; vendez-nous vos terres; et allez vivre heureux dans ces lieux-là. » Après avoir tenu ce discours, on étale aux yeux des Indiens des armes à feu, des vêtements de laine, des barriques [II-265] d’eau-de-vie, des colliers de verre, des bracelets d’étain, des pendants d’oreilles et des miroirs [51] . Si, à la vue de toutes ces richesses, ils hésitent encore, on leur insinue qu’ils ne sauraient refuser le consentement qu’on leur demande, et que bientôt le gouvernement lui-même sera impuissant pour leur garantir la jouissance de leurs droits. Que faire ? À demi convaincus, à moitié contraints, les Indiens s’éloignent ; ils vont habiter de nouveaux déserts où les blancs ne les laisseront pas dix ans en paix. C’est ainsi que les Américains acquièrent à vil prix des provinces entières, que les plus riches souverains de l’Europe ne sauraient payer [52] .
Je viens de retracer de grands maux, j’ajoute qu’ils [II-266] me paraissent irrémédiables. Je crois que la race indienne de l’Amérique du Nord est condamnée à périr, et je ne puis m’empêcher de penser que le jour où les Européens se seront établis sur les bords de l’océan Pacifique, elle aura cessé d’exister [53] . [II-267] .
Les Indiens de l’Amérique du Nord n’avaient que deux votes de salut : la guerre ou la civilisation ; en d’autres termes, il leur fallait détruire les Européens ou devenir leurs égaux.
À la naissance des colonies, il leur eût été possible, en unissant leurs forces, de se délivrer du petit nombre d’étrangers qui venaient d’aborder sur les rivages du continent [54] . Plus d’une fois ils ont tenté de le faire et se sont vus sur le point d’y réussir. Aujourd’hui la disproportion des ressources est trop grande pour qu’ils puissent songer à une pareille entreprise. Il s’élève encore cependant, parmi les nations indiennes, des hommes de génie qui prévoient le sort final réservé aux populations sauvages et cherchent à réunir toutes les tribus dans la haine commune des Européens ; mais leurs efforts sont impuissants. Les peuplades qui avoisinent les blancs sont déjà trop affaiblies pour offrir une résistance efficace ; les autres, se livrant à cette insouciance puérile du lendemain qui caractérise la nature sauvage, attendent que le danger se présente pour s’en occuper ; les uns ne peuvent, les autres ne veulent point agir.
Il est facile de prévoir que les Indiens ne voudront jamais se civiliser, ou qu’ils l’essaieront trop tard, quand ils viendront à le vouloir. [II-268] .
La civilisation est le résultat d’un long travail social qui s’opère dans un même lieu, et que les différentes générations se lèguent les unes aux autres en se succédant. Les peuples chez lesquels la civilisation parvient le plus difficilement à fonder son empire sont les peuples chasseurs. Les tribus de pasteurs changent de lieux, mais elles suivent toujours dans leurs migrations un ordre régulier, et reviennent sans cesse sur leurs pas ; la demeure des chasseurs varie comme celle des animaux mêmes qu’ils poursuivent.
Plusieurs fois on a tenté de faire pénétrer les lumières parmi les Indiens en leur laissant leurs mœurs vagabondes ; les jésuites l’avaient entrepris dans le Canada, les puritains dans la Nouvelle-Angleterre [55] . Les uns et les autres n’ont rien fait de durable. La civilisation naissait sous la hutte et allait mourir dans les bois. La grande faute de ces législateurs des Indiens était de ne pas comprendre que, pour parvenir à civiliser un peuple, il faut avant tout obtenir qu’il se fixe, et il ne saurait le faire qu’en cultivant le sol ; il s’agissait donc d’abord de rendre les Indiens cultivateurs.
Non seulement les Indiens ne possèdent pas ce préliminaire indispensable de la civilisation, mais il leur est très difficile de l’acquérir.
Les hommes qui se sont une fois livrés à la vie oisive et aventureuse des chasseurs sentent un dégoût presque insurmontable pour les travaux constants et réguliers qu’exige la culture. On peut s’en apercevoir [II-269] au sein même de nos sociétés ; mais cela est bien plus visible encore chez les peuples pour lesquels les habitudes de chasse sont devenues des coutumes nationales.
Indépendamment de cette cause générale, il en est une non moins puissante et qui ne se rencontre que chez les Indiens. Je l’ai déjà indiquée ; je crois devoir y revenir.
Les indigènes de l’Amérique du Nord ne considèrent pas seulement le travail comme un mal, mais comme un déshonneur, et leur orgueil lutte contre la civilisation presque aussi obstinément que leur paresse [56] .
Il n’y a point d’Indien si misérable qui, sous sa hutte d’écorce, n’entretienne une superbe idée de sa valeur individuelle ; il considère les soins de l’industrie comme des occupations avilissantes ; il compare le cultivateur au bœuf qui trace un sillon, et dans chacun de nos arts il n’aperçoit que des travaux d’esclaves. Ce n’est pas qu’il n’ait conçu une très haute idée du pouvoir des blancs et de la grandeur de leur intelligence ; mais, s’il admire le résultat de nos efforts, il méprise les moyens qui nous l’ont fait obtenir, et, tout en subissant notre ascendant, il se croit encore supérieur à nous. La chasse et la guerre lui semblent les seuls soins dignes d’un homme [57] . [II-270] L’Indien, au fond de la misère de ses bois, nourrit donc les mêmes idées, les mêmes opinions que le noble du moyen âge dans son château-fort, et il ne lui manque, pour achever de lui ressembler, que de devenir conquérant. Ainsi, chose singulière ! c’est dans les forêts du Nouveau-Monde, et non parmi les Européens qui peuplent ses rivages, que se retrouvent aujourd’hui les anciens préjugés de l’Europe.
J’ai cherché plus d’une fois, dans le cours de cet ouvrage, à faire comprendre l’influence prodigieuse que me paraissait exercer l’état social sur les lois et les mœurs des hommes. Qu’on me permette d’ajouter à ce sujet un seul mot.
Lorsque j’aperçois la ressemblance qui existe entre les institutions politiques de nos pères, les Germains, et celles des tribus errantes de l’Amérique du Nord, entre les coutumes retracées par Tacite, et celles dont j’ai pu quelquefois être le témoin, je ne saurais m’empêcher de penser que la même cause a produit, dans les deux hémisphères, les mêmes effets, et qu’au [II-271] milieu de la diversité apparente des choses humaines, il n’est pas impossible de retrouver un petit nombre de faits générateurs dont tous les autres découlent. Dans tout ce que nous nommons les institutions germaines, je suis donc tenté de ne voir que des habitudes de barbares, et des opinions de sauvages dans ce que nous appelons les idées féodales,.
Quels que soient les vices et les préjugés qui empêchent les Indiens de l’Amérique du Nord de devenir cultivateurs et civilisés, quelquefois la nécessité les y oblige.
Plusieurs nations considérables du Sud, entre autres celles des Chérokées et des Creeks [58] , se sont trouvées comme enveloppées par les Européens, qui, débarquant sur les rivages de l’Océan, descendant l’Ohio et remontant le Mississipi, arrivaient à la fois autour d’elles. On ne les a point chassées de place en place, ainsi que les tribus du Nord, mais on les a resserrées peu à peu dans des limites trop étroites, comme des chasseurs font d’abord l’enceinte d’un taillis avant de pénétrer simultanément dans l’intérieur. Les Indiens, placés alors entre la civilisation [II-272] et la mort, se sont vus réduits à vivre honteusement de leur travail comme les blancs ; ils sont donc devenus cultivateurs ; et sans quitter entièrement ni leurs habitudes, ni leurs mœurs, en ont sacrifié ce qui était absolument nécessaire à leur existence.
Les Chérokées allèrent plus loin ; ils créèrent une langue écrite, établirent une forme assez stable de gouvernement ; et, comme tout marche d’un pas précipité dans le Nouveau-Monde, ils eurent un journal [59] avant d’avoir tous des habits.
Ce qui a singulièrement favorisé le développement rapide des habitudes européennes chez ces Indiens a été la présence des métis [60] . Participant aux lumières de son père sans abandonner entièrement les coutumes sauvages de sa race maternelle, le métis forme le lien naturel entre la civilisation et la barbarie. Partout où les métis se sont multipliés, on a vu les sauvages modifier peu à peu leur état social et changer leurs mœurs [61] . [II-273] .
Le succès des Cherokées prouve donc que les Indiens ont la faculté de se civiliser, mais il ne prouve nullement qu’ils puissent y réussir.
Cette difficulté que trouvent les Indiens à se soumettre à la civilisation, naît d’une cause générale à laquelle il leur est presque impossible de se soustraire.
Si l’on jette un regard attentif sur l’histoire, on découvre qu’en général les peuples barbares se sont élevés peu à peu d’eux-mêmes, et par leurs propres efforts, jusqu’à la civilisation.
Lorsqu’il leur est arrivé d’aller puiser la lumière chez une nation étrangère, ils occupaient alors vis-à-vis d’elle le rang de vainqueurs, et non la position de vaincus.
Lorsque le peuple conquis est éclairé et le peuple conquérant à demi sauvage, comme dans l’invasion de l’Empire romain par les nations du Nord, ou dans celle de la Chine par les Mongols, la puissance que la victoire assure au barbare suffit pour le tenir au [II-274] niveau de l’homme civilisé et lui permettre de marcher son égal, jusqu’à ce qu’il devienne son émule ; l’un a pour lui la force, l’autre l’intelligence ; le premier admire les sciences et les arts des vaincus, le second envie le pouvoir des vainqueurs. Les barbares finissent par introduire l’homme policé dans leurs palais, et l’homme policé leur ouvre à son tour ses écoles. Mais quand celui qui possède la force matérielle jouit en même temps de la prépondérance intellectuelle, il est rare que le vaincu se civilise ; il se retire ou est détruit.
C’est ainsi qu’on peut dire d’une manière générale que les sauvages vont chercher la lumière les armes à la main, mais qu’ils ne la reçoivent pas.
Si les tribus indiennes qui habitent maintenant le centre du continent pouvaient trouver en elles-mêmes assez d’énergie pour entreprendre de se civiliser, elles y réussiraient peut-être. Supérieures alors aux nations barbares qui les environneraient, elles prendraient peu à peu des forces et de l’expérience, et, quand les Européens paraîtraient enfin sur leurs frontières, elles seraient en état, sinon de maintenir leur indépendance, du moins de faire reconnaître leurs droits au sol et de s’incorporer aux vainqueurs. Mais le malheur des Indiens est d’entrer en contact avec le peuple le plus civilisé, et j’ajouterai le plus avide du globe, alors qu’ils sont encore eux-mêmes à moitié barbares ; de trouver dans leurs instituteurs des maîtres, et de recevoir à la fois l’oppression et la lumière.
Vivant au sein de la liberté des bois, l’Indien de l’Amérique du Nord était misérable, mais il ne se sentait inférieur à personne ; du moment où il veut [II-275] pénétrer dans la hiérarchie sociale des blancs, il ne saurait y occuper que le dernier rang ; car il entre ignorant et pauvre dans une société où règnent la science et la richesse. Après avoir mené une vie agitée, pleine de maux et de dangers, mais en même temps remplie d’émotions et de grandeur [62] , il lui [II-276] faut se soumettre à une existence monotone, obscure et dégradée. Gagner par de pénibles travaux et au milieu de l’ignominie le pain qui doit le nourrir, tel est à ses yeux l’unique résultat de cette civilisation qu’on lui vante.
Et ce résultat même, il n’est pas toujours sûr de l’obtenir.
Lorsque les Indiens entreprennent d’imiter les Européens leurs voisins, et de cultiver comme ceux-ci la terre, ils se trouvent aussitôt exposés aux effets d’une concurrence très funeste. Le blanc est maître des secrets de l’agriculture. L’Indien débute grossièrement dans un art qu’il ignore. L’un fait croître sans peine de grandes moissons, l’autre n’arrache des fruits à la terre qu’avec mille efforts.
L’Européen est placé au milieu d’une population dont il connaît et partage les besoins.
Le sauvage est isolé au milieu d’un peuple ennemi dont il connaît incomplètement les mœurs, la langue et les lois, et dont pourtant il ne saurait se passer. Ce n’est qu’en échangeant ses produits contre ceux des blancs qu’il peut trouver l’aisance, car ses compatriotes ne lui sont plus que d’un faible secours.
Ainsi donc, quand l’Indien veut vendre les fruits de ses travaux, il ne trouve pas toujours l’acheteur que le cultivateur européen découvre sans peine, et [II-277] il ne saurait produire qu’à grands frais ce que l’autre livre à bas prix.
L’Indien ne s’est donc soustrait aux maux auxquels sont exposées les nations barbares que pour se soumettre aux plus grandes misères des peuples policés, et il rencontre presque autant de difficultés à vivre au sein de notre abondance qu’au milieu de ses forêts.
Chez lui, cependant, les habitudes de la vie errante ne sont pas encore détruites. Les traditions n’ont pas perdu leur empire ; le goût de la chasse n’est pas éteint. Les joies sauvages qu’il a éprouvées jadis au fond des bois se peignent alors avec de plus vives couleurs à son imagination troublée ; les privations qu’il y a endurées lui semblent au contraire moins affreuses, les périls qu’il y rencontrait moins grands. L’indépendance dont il jouissait chez ses égaux contraste avec la position servile qu’il occupe dans une société civilisée.
D’un autre côté, la solitude dans laquelle il a si long-temps vécu libre est encore près de lui ; quelques heures de marche peuvent la lui rendre. Du champ à moitié défriché dont il tire à peine de quoi se nourrir, les blancs ses voisins lui offrent un prix qui lui semble élevé. Peut-être cet argent que lui présentent les Européens lui permettrait-il de vivre heureux et tranquille loin d’eux. Il quitte la charrue, reprend ses armes, et rentre pour toujours au désert [63] .
On peut juger de la vérité de ce triste tableau par [II-278] ce qui se passe chez les Creeks et les Cherokées, que j’ai cités.
Ces Indiens, dans le peu qu’ils ont fait, ont assurément montré autant de génie naturel que les peuples de l’Europe dans leurs plus vastes entreprises ; mais les nations, comme les hommes, ont besoin de temps pour apprendre, quels que soient leur intelligence et leurs efforts.
Pendant que ces sauvages travaillaient à se [II-279] civiliser, les Européens continuaient à les envelopper de toutes parts et a les resserrer de plus en plus. Aujourd’hui, les deux races se sont enfin rencontrées ; elles se touchent. L’Indien est déjà devenu supérieur à son père le sauvage, mais il est encore fort inférieur au blanc son voisin. À l’aide de leurs ressources et de leurs lumières, les Européens n’ont pas tardé à s’approprier la plupart des avantages que la possession du sol pouvait fournit aux indigènes ; ils se sont établis au milieu d’eux, se sont emparés de la terre ou l’ont achetés à vil prix, et les ont ruinés par une concurrence que ces derniers ne pouvaient en aucune façon soutenir. Isolés dans leur propre pays, les Indiens n’ont plus formés qu’une petite colonie d’étrangers incommodes au milieu d’un peuple nombreux et dominateur [64] .
Washington avait dit, dans un de ses messages au congrès : « Nous sommes plus éclairés et plus puissants [II-280] que les nations indiennes ; il est de notre honneur de les traiter avec bonté et même avec générosité. ».
Cette noble et vertueuse politique n’a point été suivie.
À l’avidité des colons se joint d’ordinaire la tyrannie du gouvernement. Quoique les Cherokées et les Creeks soient établis sur le sol qu’ils habitaient avant l’arrivée des Européens, bien que les Américains aient souvent traité avec eux comme avec des nations étrangères, les États au milieu desquels ils se trouvent n’ont point voulu les reconnaître pour des peuples indépendants, et ils ont entrepris de soumettre ces hommes, à peine sortis des forêts, à leurs magistrats, à leurs coutumes et à leurs lois [65] . La misère avait poussé ces Indiens infortunés vers la civilisation, l’oppression les repousse aujourd’hui vers la barbarie. Beaucoup d’entre eux, quittant leurs champs a moitié défrichés, reprennent l’habitude de la vie sauvage.
Si l’on fait attention aux mesures tyranniques adoptées par les législateurs des États du Sud, à la conduite de leurs gouverneurs et aux actes de leurs tribunaux, on se convaincra aisément que l’expulsion [II-281] complète des Indiens est le but final où tendent simultanément tous leurs efforts. Les Américains de cette partie de l’Union voient avec jalousie les terres que possèdent les indigènes [66] ; ils sentent que ces derniers n’ont point encore complétement perdu les traditions de la vie sauvage, et avant que la civilisation les ait solidement attachés au sol, ils veulent les réduire au désespoir et les forcer à s’éloigner.
Opprimés par les États particuliers, les Creeks et les Cherokées se sont adressés au gouvernement central. Celui-ci n’est point insensible à leurs maux, il voudrait sincèrement sauver les restes des indigènes et leur assurer la libre possession du territoire que lui-même leur a garantie [67] ; mais quand il cherche à exécuter ce dessein, les États particuliers lui opposent une résistance formidable, et alors il se résout sans peine à laisser périr quelques tribus sauvages déjà à moitié détruites, pour ne pas mettre l’Union américaine en danger.
Impuissant à protéger les Indiens, le gouvernement fédéral voudrait au moins adoucir leur sort ; dans ce but, il a entrepris de les transporter à ses frais dans d’autres lieux.
Entre les 33e et 37e degrés de latitude nord, s’étend [II-282] une vaste contrée qui a pris le nom d’Arkansas, du fleuve principal qui l’arrose. Elle borne d’un côté les frontières du Mexique, de l’autre les rives du Mississipi. Une multitude de ruisseaux et de rivières la sillonnent de tous côtés, le climat en est doux et le sol fertile. On n’y rencontre que quelques hordes errantes de sauvages. C’est dans la portion de ce pays, qui avoisine le plus le Mexique, et a une grande distance des établissements américains, que le gouvernement de l’Union veut transporter les débris des populations indigènes du Sud.
À la fin de l’année 1831, on nous a assuré que 10,000 Indiens avaient déjà été descendus sur les rivages de l’Arkansas ; d’autres arrivaient chaque jour. Mais le Congrès n’a pu créer encore une volonté unanime parmi ceux dont il veut régler le sort : les uns consentent avec joie à s’éloigner du foyer de la tyrannie ; les plus éclairés refusent d’abandonner leurs moissons naissantes et leurs nouvelles demeures ; ils pensent que si l’œuvre de la civilisation vient à s’interrompre, on ne la reprendra plus ; ils craignent que les habitudes sédentaires, à peine contractées, ne se perdent sans retour au milieu de pays encore sauvages, et où rien n’est préparé pour la subsistance d’un peuple cultivateur ; ils savent qu’ils trouveront dans ces nouveaux déserts les hordes ennemies, et pour leur résister ils n’ont plus l’énergie de la barbarie, sans avoir encore acquis les forces de la civilisation. Les Indiens découvrent d’ailleurs sans peine tout ce qu’il y a de provisoire dans l’établissement qu’on leur propose. Qui leur assurera qu’ils pourront enfin reposer en paix dans leur nouvel asile ? Les États-Unis [II-283] s’engagent à les y maintenir ; mais le territoire qu’ils occupent maintenant leur avait été garanti jadis par les serments les plus solennels [68] . Aujourd’hui le gouvernement américain ne leur ôte pas, il est vrai, leurs terres, mais il les laisse envahir. Dans peu d’années, sans doute, la même population blanche qui se presse maintenant autour d’eux sera de nouveau sur leurs pas dans les solitudes d’Arkansas ; ils retrouveront alors les mêmes maux sans les mêmes remèdes ; et la terre venant tôt ou tard à leur manquer, il leur faudra toujours se résigner à mourir.
Il y a moins de cupidité et de violence dans la manière d’agir de l’Union envers les Indiens que dans la politique suivie par les États ; mais les deux gouvernements manquent également de bonne foi.
Les États, en étendant ce qu’ils appellent le bienfait de leurs lois sur les Indiens, comptent que ces derniers aimeront mieux s’éloigner que de s’y soumettre ; et le gouvernement central, en promettant à ces infortunés un asile permanent dans l’Ouest, n’ignore pas qu’il ne peut le leur garantir [69] . [II-284] .
Ainsi, les États, par leur tyrannie, forcent les sauvages à fuir ; l’Union, par ses promesses et à l’aide de ses ressources, rend cette fuite aisée. Ce sont des mesures différentes qui tendent au même but [70] .
« Par la volonté de notre Père céleste qui gouverne l’univers, disaient les Cherokées dans leur pétition au congrès [71] , la race des hommes rouges d’Amérique est devenue petite ; la race blanche est devenue grande et renommée.
« Lorsque vos ancêtres arrivèrent sur nos rivages, l’homme rouge était fort, et, quoiqu’il fût ignorant et sauvage, il les reçut avec bonté et leur permit de reposer leurs pieds engourdis sur la terre sèche. Nos [II-285] pères et les vôtres se donnèrent la main en signe d’amitié, et vécurent en paix.
« Tout ce que demanda l’homme blanc pour satisfaire ses besoins, l’Indien s’empressa de le lui accorder. L’Indien était alors le maître, et l’homme blanc le suppliant. Aujourd’hui, la scène est changée : la force de l’homme rouge est devenue faiblesse. À mesure que ses voisins croissaient en nombre, son pouvoir diminuait de plus en plus ; et maintenant, de tant de tribus puissantes qui couvraient la surface de ce que vous nommez les États-Unis, à peine en reste-t-il quelques-unes que le désastre universel ait épargnées. Les tribus du Nord, si renommées jadis parmi nous pour leur puissance, ont déjà à peu près disparu. Telle a été la destinée de l’homme rouge d’Amérique.
« Nous voici les derniers de notre race, nous faut-il aussi mourir ?.
« Depuis un temps immémorial, notre Père commun, qui est au ciel, a donné à nos ancêtres la terre que nous occupons ; nos ancêtres nous l’ont transmise comme leur héritage. Nous l’avons conservée avec respect, car elle contient leur cendre. Cet héritage, l’avons-nous jamais cédé ou perdu ? Permettez-nous de vous demander humblement quel meilleur droit un peuple peut avoir à un pays que le droit d’héritage et la possession immémoriale ? Nous savons que l’État de Géorgie et le Président des États-Unis prétendent aujourd’hui que nous avons perdu ce droit. Mais ceci nous semble une allégation gratuite. À quelle époque l’aurions-nous perdu ? Quel crime avons-nous commis qui [II-286] puisse nous priver de notre patrie ? Nous reproche-t-on d’avoir combattu sous les drapeaux du roi de la Grande-Bretagne lors de la guerre de l’indépendance ? Si c’est là le crime dont on parle, pourquoi, dans le premier traité qui a suivi cette guerre, n’y déclarâtes-vous pas que nous avions perdu la propriété de nos terres ? pourquoi n’insérâtes-vous pas alors dans ce traité un article ainsi conçu : Les États-Unis veulent bien accorder la paix à la nation des Cherokées, mais pour les punir d’avoir pris part à la guerre, il est déclaré qu’on ne les considérera plus que comme fermiers du sol, et qu’ils seront assujettis à s’éloigner quand les États qui les avoisinent demanderont qu’ils le fassent ? C’était le moment de parler ainsi ; mais nul ne s’avisa alors d’y penser, et jamais nos pères n’eussent consenti à un traité dont le résultat eût été de les priver de leurs droits les plus sacrés et de leur ravir leur pays. ».
Tel est le langage des Indiens : ce qu’ils disent est vrai ; ce qu’ils prévoient me semble inévitable.
De quelque côté qu’on envisage la destinée des indigènes de l’Amérique du Nord, on ne voit que maux irrémédiables : s’ils restent sauvages, on les pousse devant soi en marchant ; s’ils veulent se civiliser, le contact d’hommes plus civilisés qu’eux les livre à l’oppression et à la misère. S’ils continuent à errer de déserts en déserts, ils périssent ; s’ils entreprennent de se fixer, ils périssent encore. Ils ne peuvent s’éclairer qu’à l’aide des Européens, et l’approche des Européens les déprave et les repousse vers la barbarie. Tant qu’on les laisse dans leurs solitudes, ils [II-287] refusent de changer leurs mœurs, et il n’est plus temps de le faire quand ils sont enfin contraints de le vouloir.
Les Espagnols lâchent leurs chiens sur les Indiens comme sur des bêtes farouches ; ils pillent le Nouveau-Monde ainsi qu’une ville prise d’assaut, sans discernement et sans pitié ; mais on ne peut tout détruire, la fureur a un terme : le reste des populations indiennes échappées aux massacres finit par se mêler à ses vainqueurs et par adopter leur religion et leurs mœurs [72] .
La conduite des Américains des États-Unis envers les indigènes respire au contraire le plus pur amour des formes et de la légalité. Pourvu que les Indiens demeurent dans l’état sauvage, les Américains ne se mêlent nullement de leurs affaires et les traitent en peuples indépendants ; ils ne se permettent point d’occuper leurs terres sans les avoir dûment acquises au moyen d’un contrat ; et si par hasard une nation indienne ne peut plus vivre sur son territoire, ils la prennent fraternellement par la main, et la conduisent eux-mêmes mourir hors du pays de ses pères.
Les Espagnols, à l’aide de monstruosités sans exemples, en se couvrant d’une honte ineffaçable, n’ont pu parvenir à exterminer la race indienne, ni même à l’empêcher de partager leurs droits ; les [II-288] Américains des États-Unis ont atteint ce double résultat avec une merveilleuse facilité, tranquillement, légalement, philanthropiquement, sans répandre de sang, sans violer un seul des grands principes de la morale [73] aux yeux du monde. On ne saurait détruire les hommes en respectant mieux les lois de l’humanité. [II-289]
POSITION QU’OCCUPE LA RACE NOIRE AUX ÉTATS-UNIS [74] ; DANGERS QUE SA PRÉSENCE FAIT COURIR AUX BLANCS.
Pourquoi il est plus difficile d’abolir l’esclavage et d’en faire disparaître la trace chez les modernes que chez les anciens. — Aux États-Unis, le préjugé des blancs contre les noirs semble devenir plus fort à mesure qu’on détruit l’esclavage. — Situation des nègres dans les États du Nord et du Sud. — Pourquoi les Américains abolissent l’esclavage. — La servitude, qui abrutit l’esclave, appauvrit le maître. — Différences qu’on remarque entre la rive droite et la rive gauche de l’Ohio. — À quoi il faut les attribuer. — La race noire rétrograde vers le Sud, comme le fait l’esclavage. — Comment ceci s’explique. — Difficultés que rencontrent les États du Sud à abolir l’esclavage. — Dangers de l’avenir. — Préoccupation des esprits. — Fondation d’une colonie noire en Afrique. — Pourquoi les Américains du Sud, en même temps qu’ils se dégoûtent de l’esclavage, accroissent ses rigueurs.
Les Indiens mourront dans l’isolement comme ils ont vécu ; mais la destinée des nègres est en quelque sorte enlacée dans celle des Européens. Les deux races sont liées l’une à l’autre, sans pour cela se confondre ; il leur est aussi difficile de se séparer complètement que de s’unir.
Le plus redoutable de tous les maux qui menacent l’avenir des États-Unis naît de la présence des noirs [II-290] sur leur sol. Lorsqu’on cherche la cause des embarras présents et des dangers futurs de l’Union, on arrive presque toujours à ce premier fait de quelque point qu’on parte.
Les hommes ont en général besoin de grands et constants efforts pour créer des maux durables ; mais il est un mal qui pénètre dans le monde furtivement : d’abord on l’aperçoit à peine au milieu des abus ordinaires du pouvoir ; il commence avec un individu dont l’histoire ne conserve pas le nom ; on le dépose comme un germe maudit sur quelque point du sol ; il se nourrit ensuite de lui-même, s’étend sans effort, et croît naturellement avec la société qui l’a reçu : ce mal est l’esclavage.
Le christianisme avait détruit la servitude ; les chrétiens du XVIe siècle l’ont rétablie ; ils ne l’ont jamais admise cependant que comme une exception dans leur système social, et ils ont pris soin de la restreindre à une seule des races humaines. Ils ont ainsi fait à l’humanité une blessure moins large, mais infiniment plus difficile à guérir.
Il faut discerner deux choses avec soin : l’esclavage en lui-même et ses suites.
Les maux immédiats produits par l’esclavage étaient à peu près les mêmes chez les anciens qu’ils le sont chez les modernes, mais les suites de ces maux étaient différentes. Chez les anciens, l’esclave appartenait à la même race que son maître, et souvent il lui était supérieur en éducation et en lumières [75] . La liberté seule les séparait ; la liberté étant donnée, ils se confondaient aisément. [II-291] .
Les anciens avaient donc un moyen bien simple de se délivrer de l’esclavage et de ses suites ; ce moyen était l’affranchissement, et dès qu’ils l’ont employé d’une manière générale, ils ont réussi.
Ce n’est pas que, dans l’antiquité, les traces de la servitude ne subsistassent encore quelque temps après que la servitude était détruite.
Il y a un préjugé naturel qui porte l’homme à mépriser celui qui a été son inférieur, long-temps encore après qu’il est devenu son égal ; à l’inégalité réelle que produit la fortune ou la loi, succède toujours une inégalité imaginaire qui a ses racines dans les mœurs ; mais chez les anciens, cet effet secondaire de l’esclavage avait un terme. L’affranchi ressemblait si fort aux hommes d’origine libre, qu’il devenait bientôt impossible de le distinguer au milieu d’eux.
Ce qu’il y avait de plus difficile chez les anciens, était de modifier la loi ; chez les Modernes, c’est de changer les mœurs, et, pour nous, la difficulté réelle commence où l’antiquité la voyait finir.
Ceci vient de ce que chez les modernes le fait immatériel et fugitif de l’esclavage se combine de la manière la plus funeste avec le fait matériel et permanent de la différence de race. Le souvenir de l’esclavage déshonore la race, et la race perpétue le souvenir de l’esclavage.
Il n’y a pas d’Africain qui soit venu librement sur les rivages du Nouveau-Monde ; d’où il suit que tous ceux qui s’y trouvent de nos jours sont esclaves ou [II-292] affranchis. Ainsi, le nègre, avec l’existence, transmet à tous ses descendants le signe extérieur de son ignominie. La loi peut détruire la servitude ; mais il n’y a que Dieu seul qui puisse en faire disparaître la trace.
L’esclave moderne ne diffère pas seulement du maître par la liberté, mais encore par l’origine. Vous pouvez rendre le nègre libre, mais vous ne sauriez faire qu’il ne soit pas vis-à-vis de l’Européen dans la position d’un étranger.
Ce n’est pas tout encore : cet homme qui est né dans la bassesse ; cet étranger que la servitude a introduit parmi nous, à peine lui reconnaissons-nous les traits généraux de l’humanité. Son visage nous paraît hideux, son intelligence nous semble bornée, ses goûts sont bas ; peu s’en faut que nous ne le prenions pour un être intermédiaire entre la brute et l’homme [76] .
Les modernes, après avoir aboli l’esclavage, ont donc encore à détruire trois préjugés bien plus insaisissables et plus tenaces que lui : le préjugé du maître, le préjugé de race, et enfin le préjugé du blanc.
Il nous est fort difficile, à nous qui avons eu le bonheur de naître au milieu d’hommes que la nature avait faits nos semblables et la loi nos égaux ; il nous est fort difficile, dis-je, de comprendre quel espace infranchissable sépare le nègre d’Amérique de l’Européen. Mais nous pouvons en avoir une idée éloignée en raisonnant par analogie. [II-293] .
Nous avons vu jadis parmi nous de grandes inégalités qui n’avaient leurs principes que dans la législation. Quoi de plus fictif qu’une infériorité purement légale ! Quoi de plus contraire à l’instinct de l’homme que des différences permanentes établies entre des gens évidemment semblables ! Ces différences ont cependant subsisté pendant des siècles ; elles subsistent encore en mille endroits ; partout elles ont laissé des traces imaginaires, mais que le temps peut à peine effacer. Si l’inégalité créée seulement par la loi est si difficile à déraciner, comment détruire celle qui semble, en outre, avoir ses fondements immuables dans la nature elle-même ?.
Pour moi, quand je considère avec quelle peine les corps aristocratiques, de quelque nature qu’ils soient, arrivent à se fondre dans la masse du peuple, et le soin extrême qu’ils prennent de conserver pendant des siècles les barrières idéales qui les en séparent, je désespère de voir disparaître une aristocratie fondée sur des signes visibles et impérissables.
Ceux qui espèrent que les Européens se confondront un jour avec les nègres me paraissent donc caresser une chimère. Ma raison ne me porte point à le croire, et je ne vois rien qui me l’indique dans les faits.
Jusqu’ici, partout où les Blancs ont été les plus puissants, ils ont tenu les Nègres dans l’avilissement ou dans l’esclavage. Partout où les nègres ont été les plus forts, ils ont détruit les blancs ; c’est le seul compte qui se soit jamais ouvert entre les deux races.
Si je considère les États-Unis de nos jours, je vois bien que, dans certaine partie du pays, la barrière [II-294] légale qui sépare les deux races tend à s’abaisser, non celle des mœurs : j’aperçois l’esclavage qui recule ; le préjugé qu’il a fait naître est immobile.
Dans la portion de l’Union où les nègres ne sont plus esclaves, se sont-ils rapprochés des blancs ? Tout homme qui a habité les États-Unis aura remarqué qu’un effet contraire s’était produit.
Le préjugé de race me paraît plus fort dans les États qui ont aboli l’esclavage que dans ceux où l’esclavage existe encore, et nulle part il ne se montre aussi intolérant que dans les États où la servitude a toujours été inconnue.
Il est vrai qu’au nord de l’Union la loi permet aux nègres et aux blancs de contracter des alliances légitimes ; mais l’opinion déclare infâme le blanc qui s’unirait à une négresse, et il serait très difficile de citer l’exemple d’un pareil fait.
Dans presque tous les États où l’esclavage est aboli, on a donné au nègre des droits électoraux ; mais s’il se présente pour voter, il court risque de la vie. Opprimé, il peut se plaindre, mais il ne trouve que des blancs parmi ses juges. La loi cependant lui ouvre le banc des jurés, mais le préjugé l’en repousse. Son fils est exclu de l’école où vient s’instruire le descendant des Européens. Dans les théâtres, il ne saurait, au prix de l’or, acheter le droit de se placer à côté de celui qui fut son maître ; dans les hôpitaux, il gît à part. On permet au noir d’implorer le même Dieu que les blancs, mais non de le prier au même autel. Il a ses prêtres et ses temples. On ne lui ferme point les portes du ciel : à peine cependant si l’inégalité s’arrête au bord de l’autre monde. Quand le [II-295] nègre n’est plus, on jette ses os à l’écart, et la différence des conditions se retrouve jusque dans l’égalité de la mort.
Ainsi le nègre est libre, mais il ne peut partager ni les droits, ni les plaisirs, ni les travaux, ni les douleurs, ni même le tombeau de celui dont il a été déclaré l’égal ; il ne saurait se rencontrer nulle part avec lui, ni dans la vie ni dans la mort.
Au Sud, où l’esclavage existe encore, on tient moins soigneusement les nègres à l’écart ; ils partagent quelquefois les travaux des blancs et leurs plaisirs ; on consent jusqu’à un certain point à se mêler avec eux ; la législation est plus dure à leur égard ; les habitudes sont plus tolérantes et plus douces.
Au Sud, le maître ne craint pas d’élever jusqu’à lui son esclave, parce qu’il sait qu’il pourra toujours, s’il le veut, le rejeter dans la poussière. Au Nord, le blanc n’aperçoit plus distinctement la barrière qui doit le séparer d’une race avilie, et il s’éloigne du nègre avec d’autant plus de soin qu’il craint d’arriver un jour à se confondre avec lui.
Chez l’Américain du Sud, la nature, rentrant quelquefois dans ses droits, vient pour un moment rétablir entre les blancs et les noirs l’égalité. Au Nord, l’orgueil fait taire jusqu’à la passion la plus impérieuse de l’homme. L’Américain du Nord consentirait peut-être à faire de la négresse la compagne passagère de ses plaisirs, si les législateurs avaient déclaré qu’elle ne doit pas aspirer à partager sa couche ; mais elle peut devenir son épouse, et il s’éloigne d’elle avec une sorte d’horreur.
C’est ainsi qu’aux États-Unis le préjugé qui [II-296] repousse les nègres semble croître à proportion que les nègres cessent d’être esclaves, et que l’inégalité se grave dans les mœurs à mesure qu’elle s’efface dans les lois.
Mais si la position relative des deux races qui habitent les États-Unis est telle que je viens de la montrer, pourquoi les Américains ont-ils aboli l’esclavage au nord de l’Union, pourquoi le conservent-ils au Midi, et d’où vient qu’ils y aggravent ses rigueurs ?.
Il est facile de répondre. Ce n’est pas dans l’intérêt des nègres, mais dans celui des blancs, qu’on détruit l’esclavage aux États-Unis.
Les premiers nègres ont été importés dans la Virginie vers l’année 1621 [77] . En Amérique, comme dans tout le reste de la terre, la servitude est donc née au Sud. De là elle a gagné de proche en proche ; mais à mesure que l’esclavage remontait vers le Nord, le nombre des esclaves allait décroissant [78] ; on a toujours vu très peu de Nègres dans la Nouvelle-Angleterre. [II-297] .
Les colonies étaient fondées ; un siècle s’était déjà écoulé, et un fait extraordinaire commençait à frapper tous les regards. Les provinces qui ne possédaient pour ainsi dire point d’esclaves croissaient en population, en richesses et en bien-être, plus rapidement que celles qui en avaient.
Dans les premières cependant, l’habitant était obligé de cultiver lui-même le sol, ou de louer les services d’un autre ; dans les secondes, il trouvait à sa disposition les ouvriers dont il ne rétribuait pas les efforts. Il y avait donc travail et frais d’un côté, loisirs et économie de l’autre : cependant l’avantage restait aux premiers.
Ce résultat paraissait d’autant plus difficile à expliquer que les émigrants, appartenant tous à la même race européenne, avaient les mêmes habitudes, la même civilisation, les mêmes lois, et ne différaient que par des nuances peu sensibles.
Le temps continuait à marcher : quittant les bords de l’océan Atlantique, les Anglo-Américains s’enfonçaient tous les jours davantage dans les solitudes de l’Ouest ; ils y rencontraient des terrains et des climats nouveaux ; ils avaient à y vaincre des obstacles de diverse nature ; leurs races se mêlaient, des hommes du Sud montaient au Nord, des hommes du Nord descendaient au Sud. Au milieu de toutes ces causes, le même fait se reproduisait à chaque pas ; et, en [II-298] général, la colonie où ne se trouvaient point d’esclaves devenait plus peuplée et plus prospère que celle où l’esclavage était en vigueur.
À mesure qu’on avançait, on commençait donc à entrevoir que la servitude, si cruelle à l’esclave, était funeste au maître.
Mais cette vérité reçut sa dernière démonstration lorsqu’on fut parvenu sur les bords de l’Ohio.
Le fleuve que les Indiens avaient nommé par excellence l’Ohio, ou la Belle-Rivière, arrose de ses eaux l’une des plus magnifiques vallées dont l’homme ait jamais fait son séjour. Sur les deux rives de l’Ohio s’étendent des terrains ondulés, où le sol offre chaque jour au laboureur d’inépuisables trésors : sur les deux rives, l’air est également sain et le climat tempéré ; chacune d’elles forme l’extrême frontière d’un vaste État : celui qui suit à gauche les mille sinuosités que décrit l’Ohio dans son cours se nomme le Kentucky ; l’autre a emprunté son nom au fleuve lui-même. Les deux États ne diffèrent que dans un seul point : le Kentucky a admis des esclaves, l’État de l’Ohio les a tous rejetés de son sein [79] .
Le voyageur qui, placé au milieu de l’Ohio, se laisse entraîner par le courant jusqu’à l’embouchure du fleuve dans le Mississipi, navigue donc pour ainsi dire entre la liberté et la servitude ; et il n’a qu’à jeter autour de lui ses regards pour juger en un instant laquelle est la plus favorable à l’humanité.
Sur la rive gauche du fleuve, la population est [II-299] clair-semée ; de temps en temps on aperçoit une troupe d’esclaves parcourant d’un air insouciant des champs à moitié déserts ; la forêt primitive reparaît sans cesse ; on dirait que la société est endormie ; l’homme semble oisif, la nature offre l’image de l’activité et de la vie.
De la rive droite s’élève au contraire une rumeur confuse qui proclame au loin la présence de l’industrie ; de riches moissons couvrent les champs ; d’élégantes demeures annoncent le goût et les soins du laboureur ; de toutes parts l’aisance se révèle ; l’homme paraît riche et content : il travaille [80] .
L’État du Kentucky a été fondé en 1775, l’État de l’Ohio ne l’a été que douze ans plus tard : douze ans en Amérique, c’est plus d’un demi-siècle en Europe. Aujourd’hui la population de l’Ohio excède déjà de 250,000 habitants celle du Kentucky [81] .
Ces effets divers de l’esclavage et de la liberté se comprennent aisément ; ils suffisent pour expliquer bien des différences qui se rencontrent entre la civilisation antique et celle de nos jours.
Sur la rive gauche de l’Ohio le travail se confond avec l’idée de l’esclavage ; sur la rive droite, avec celle [II-300] du bien-être et des progrès ; là il est dégradé, ici on l’honore ; sur la rive gauche du fleuve, on ne peut trouver d’ouvriers appartenant à la race blanche, ils craindraient de ressembler à des esclaves ; il faut s’en rapporter aux soins des nègres ; sur la rive droite on chercherait en vain un oisif : le blanc étend à tous les travaux son activité et son intelligence.
Ainsi donc les hommes qui, dans le Kentucky, sont chargés d’exploiter les richesses naturelles du sol, n’ont ni zèle, ni lumière ; tandis que ceux qui pourraient avoir ces deux choses ne font rien, ou passent dans l’Ohio, afin d’utiliser leur industrie et de pouvoir l’exercer sans honte.
Il est vrai que dans le Kentucky les maîtres font travailler les esclaves sans être obligés de les payer, mais ils tirent peu de fruits de leurs efforts, tandis que l’argent qu’ils donneraient aux ouvriers libres se retrouverait avec usure dans le prix de leurs travaux.
L’ouvrier libre est payé, mais il fait plus vite que l’esclave, et la rapidité de l’exécution est un des grands éléments de l’économie. Le blanc vend ses secours, mais on ne les achète que quand ils sont utiles ; le noir n’a rien à réclamer pour prix de ses services, mais on est obligé de le nourrir en tout temps ; il faut le soutenir dans sa vieillesse comme dans son âge mûr, dans sa stérile enfance comme durant les années fécondes de sa jeunesse, pendant la maladie comme en santé. Ainsi ce n’est qu’en payant qu’on obtient le travail de ces deux hommes : l’ouvrier libre reçoit un salaire ; l’esclave, une éducation, des aliments, des soins, des vêtements ; l’argent que dépense [II-301] le maître pour l’entretien de l’esclave s’écoule peu à peu et en détail ; on l’aperçoit à peine : le salaire que l’on donne à l’ouvrier se livre d’un seul coup, et il semble n’enrichir que celui qui le reçoit ; mais en réalité l’esclave a plus coûté que l’homme libre, et ses travaux ont été moins productifs [82] .
L’influence de l’esclavage s’étend encore plus loin ; elle pénètre jusque dans l’âme même du maître, et imprime une direction particulière à ses idées et à ses goûts.
Sur les deux rives de l’Ohio, la nature a donné à l’homme un caractère entreprenant et énergique ; mais de chaque côté du fleuve il fait de cette qualité commune un emploi différent.
Le blanc de la rive droite, obligé de vivre par ses propres efforts, a placé dans le bien-être matériel le but principal de son existence ; et comme le pays qu’il habite présente à son industrie d’inépuisables [II-302] ressources, et offre à son activité des appâts toujours renaissants, son ardeur d’acquérir a dépassé les bornes ordinaires de la cupidité humaine : tourmenté du désir des richesses, on le voit entrer avec audace dans toutes les voies que la fortune lui ouvre ; il devient indifféremment marin, pionnier, manufacturier, cultivateur, supportant avec une égale constance les travaux ou les dangers attachés à ces différentes professions ; il y a quelque chose de merveilleux dans les ressources de son génie, et une sorte d’héroïsme dans son avidité pour le gain.
L’Américain de la rive gauche ne méprise pas seulement le travail, mais toutes les entreprises que le travail fait réussir ; vivant dans une oisive aisance, il a les goûts des hommes oisifs ; l’argent a perdu une partie de sa valeur à ses yeux ; il poursuit moins la fortune que l’agitation et le plaisir, et il porte de ce côté l’énergie que son voisin déploie ailleurs ; il aime passionnément la chasse et la guerre ; il se plaît dans les exercices les plus violents du corps ; l’usage des armes lui est familier, et dès son enfance il a appris à jouer sa vie dans des combats singuliers. L’esclavage n’empêche donc pas seulement les blancs de faire fortune, il les détourne de le vouloir.
Les mêmes causes opérant continuellement depuis deux siècles en sens contraires dans les colonies anglaises de l’Amérique Septentrionale, ont fini par mettre une différence prodigieuse entre la capacité commerciale de l’homme du Sud et celle de l’homme du Nord. Aujourd’hui, il n’y a que le Nord qui ait des vaisseaux, des manufactures, des routes de fer et des canaux. [II-303] .
Cette différence se remarque non seulement en comparant le Nord et le Sud, mais en comparant entre eux les habitants du Sud. Presque tous les hommes qui dans les États les plus méridionaux de l’Union se livrent à des entreprises commerciales et cherchent à utiliser l’esclavage sont venus du Nord ; chaque jour, les gens du Nord se répandent dans cette partie du territoire américain où la concurrence est moins à craindre pour eux ; ils y découvrent des ressources que n’y apercevaient point les habitants, et se pliant à un système qu’ils désapprouvent, ils parviennent à en tirer un meilleur parti que ceux qui le soutiennent encore après l’avoir fondé.
Si je voulais pousser plus loin le parallèle, je prouverais aisément que presque toutes les différences qui se remarquent entre le caractère des Américains au Sud et au Nord ont pris naissance dans l’esclavage ; mais ce serait sortir de mon sujet : je cherche en ce moment, non pas quels sont tous les effets de la servitude, mais quels effets elle produit sur la prospérité matérielle de ceux qui l’ont admise.
Cette influence de l’esclavage sur la production des richesses ne pouvait être que très imparfaitement connue de l’antiquité. La servitude existait alors dans tout l’univers policé, et les peuples qui ne la connaissaient point étaient des barbares.
Aussi le christianisme n’a-t-il détruit l’esclavage qu’en faisant valoir les droits de l’esclave ; de nos jours on peut l’attaquer au nom du maître : sur ce point l’intérêt et la morale sont d’accord.
À mesure que ces vérités se manifestaient aux [II-304] États-Unis, on voyait l’esclavage reculer peu à peu devant les lumières de l’expérience.
La servitude avait commencé au Sud et s’était ensuite étendue vers le Nord, aujourd’hui elle se retire. La liberté, partie du Nord, descend sans s’arrêter vers le Sud. Parmi les grands États, la Pennsylvanie forme aujourd’hui l’extrême limite de l’esclavage vers le Nord, mais dans ces limites mêmes il est ébranlé ; le Maryland, qui est immédiatement au-dessous de la Pennsylvanie, se prépare chaque jour à s’en passer, et déjà la Virginie, qui suit le Maryland, discute son utilité et ses dangers [83] .
Il ne se fait pas un grand changement dans les institutions humaines sans qu’au milieu des causes de ce changement on ne découvre la loi des successions.
Lorsque l’inégalité des partages régnait au Sud, chaque famille était représentée par un homme riche qui ne sentait pas plus le besoin que le goût du travail ; autour de lui vivaient de la même manière, comme autant de plantes parasites, les membres de sa famille que la loi avait exclus de l’héritage commun ; on voyait alors dans toutes les familles du Sud ce qu’on voit encore de nos jours dans les familles [II-305] nobles de certains pays de l’Europe, où les cadets, sans avoir la même richesse que l’aîné, restent aussi oisifs que lui. Cet effet semblable était produit en Amérique et en Europe par des causes entièrement analogues. Dans le Sud des États-Unis, la race entière des blancs formait un corps aristocratique à la tête duquel se tenaient un certain nombre d’individus privilégiés dont la richesse était permanente et les loisirs héréditaires. Ces chefs de la noblesse américaine perpétuaient dans le corps dont ils étaient les représentants les préjugés traditionnels de la race blanche, et maintenaient l’oisiveté en honneur. Dans le sein de cette aristocratie, on pouvait rencontrer des pauvres, mais non des travailleurs ; la misère y paraissait préférable à l’industrie ; les ouvriers nègres et esclaves ne trouvaient donc point de concurrents, et, quelque opinion qu’on pût avoir sur l’utilité de leurs efforts, il fallait bien les employer, puisqu’ils étaient seuls.
Du moment où la loi des successions a été abolie, toutes les fortunes ont commencé à diminuer simultanément, toutes les familles se sont rapprochées par un même mouvement de l’état où le travail devient nécessaire à l’existence ; beaucoup d’entre elles ont entièrement disparu ; toutes ont entrevu le moment où il faudrait que chacun pourvût soi-même à ses besoins. Aujourd’hui on voit encore des riches, mais ils ne forment plus un corps compact et héréditaire ; ils n’ont pu adopter un esprit, y persévérer et le faire pénétrer dans tous les rangs. On a donc commencé à abandonner d’un commun accord le préjugé qui flétrissait le travail ; il y a eu plus de pauvres, et les [II-306] pauvres ont pu sans rougir s’occuper des moyens de gagner leur vie. Ainsi l’un des effets les plus prochains de l’égalité des partages a été de créer une classe d’ouvriers libres. Du moment où l’ouvrier libre est entré en concurrence avec l’esclave, l’infériorité de ce dernier s’est fait sentir, et l’esclavage a été attaqué dans son principe même, qui est l’intérêt du maître.
À mesure que l’esclavage recule, la race noire le suit dans sa marche rétrograde, et retourne avec lui vers les tropiques, d’où elle est originairement venue.
Ceci peut paraître extraordinaire au premier abord, on va bientôt le concevoir.
En abolissant le principe de servitude, les Américains ne mettent point les esclaves en liberté.
Peut-être comprendrait-on avec peine ce qui va suivre, si je ne citais un exemple ; je choisirai celui de l’État de New York. En 1788, l’État de New-York prohibe dans son sein la vente des esclaves. C’était d’une manière détournée en prohiber l’importation. Dès lors le nombre des Nègres ne s’accroît plus que suivant l’accroissement naturel de la population noire. Huit ans après, on prend une mesure plus décisive, et l’on déclare qu’à partir du 4 juillet 1799 tous les enfants qui naîtront de parents esclaves seront libres. Toute voie d’accroissement est alors fermée ; il y a encore des esclaves, mais on peut dire que la servitude n’existe plus.
À partir de l’époque où un État du Nord prohibe ainsi l’importation des esclaves, on ne retire plus de noirs du Sud pour les transporter dans son sein. [II-307] .
Du moment où un État du Nord défend la vente des nègres, l’esclave ne pouvant plus sortir des mains de celui qui le possède devient une propriété incommode, et on a intérêt à le transporter au Sud.
Le jour où un État du Nord déclare que le fils de l’esclave naîtra libre, ce dernier perd une grande partie de sa valeur vénale ; car sa postérité ne peut plus entrer dans le marché, et on a encore un grand intérêt à le transporter au Sud.
Ainsi la même loi empêche que les esclaves du Sud ne viennent au Nord, et pousse ceux du Nord vers le Sud.
Mais voici une autre cause plus puissante que toutes celles dont je viens de parler.
A mesure que le nombre des esclaves diminue dans un État, le besoin de travailleurs libres s’y fait sentir. À mesure que les travailleurs libres s’emparent de l’industriel, le travail de l’esclave étant moins productif, celui-ci devient une propriété médiocre ou inutile, et on a encore grand intérêt à l’exporter au Sud, où la concurrence n’est pas à craindre.
L’abolition de l’esclavage ne fait donc pas arriver l’esclave à la liberté ; elle le fait seulement changer de maître : du septentrion, il passe au midi.
Quant aux nègres affranchis et à ceux qui naissent après que l’esclavage a été aboli, ils ne quittent point le Nord pour passer au Sud, mais ils se trouvent vis-à-vis des Européens dans une position analogue à celle des indigènes ; ils restent à moitié civilisés et privés de droits au milieu d’une population qui leur est infiniment supérieure en richesses et en lumières ; [II-308] ils sont en butte à la tyrannie des lois [84] et à l’intolérance des mœurs. Plus malheureux sous un certain rapport que les Indiens, ils ont contre eux les souvenirs de l’esclavage, et ils ne peuvent réclamer la possession d’un seul endroit du sol ; beaucoup succombent à leur misère [85] ; les autres se concentrent dans les villes, où, se chargeant des plus grossiers travaux, ils mènent une existence précaire et misérable.
Quand, d’ailleurs, le nombre des nègres continuerait à croître de la même manière qu’à l’époque où ils ne possédaient pas encore la liberté, le nombre des blancs augmentant avec une double vitesse après l’abolition de l’esclavage, les noirs seraient bientôt comme engloutis au milieu des flots d’une population étrangère.
Un pays cultivé par des esclaves est en général moins peuplé qu’un pays cultivé par des hommes libres ; de plus, l’Amérique est une contrée nouvelle ; au moment donc où un État abolit l’esclavage, il n’est encore qu’à moitié plein. À peine la servitude y est-elle détruite, et le besoin des travailleurs libres s’y fait-il sentir, qu’on voit accourir dans son sein, de [II-309] toutes les parties du pays, une foule de hardis aventuriers ; ils viennent pour profiter des ressources nouvelles qui vont s’ouvrir à l’industrie. Le sol se divise entre eux ; sur chaque portion s’établit une famille de blancs qui s’en empare. C’est aussi vers les États libres que l’émigration européenne se dirige. Que ferait le pauvre d’Europe qui vient chercher l’aisance et le bonheur dans le Nouveau-Monde, s’il allait habiter un pays où le travail est entaché d’ignominie ?.
Ainsi la population blanche croît par son mouvement naturel et en même temps par une immense émigration, tandis que la population noire ne reçoit point d’émigrants et s’affaiblit. Bientôt la proportion qui existait entre les deux races est renversée. Les nègres ne forment plus que de malheureux débris, une petite tribu pauvre et nomade, perdue au milieu d’un peuple immense et maître du sol ; et l’on ne s’aperçoit plus de leur présence que par les injustices et les rigueurs dont ils sont l’objet.
Dans beaucoup d’États de l’Ouest, la race nègre n’a jamais paru ; dans tous les États du Nord elle disparaît. La grande question de l’avenir se resserre donc dans un cercle étroit ; elle devient ainsi moins redoutable, mais non plus facile à résoudre.
À mesure qu’on descend vers le Midi, il est plus difficile d’abolir utilement l’esclavage. Ceci résulte de plusieurs causes matérielles qu’il est nécessaire de développer.
La première est le climat : il est certain qu’à proportion que les Européens s’approchent des tropiques, le travail leur devient plus difficile ; beaucoup [II-310] d’Américains prétendent même que sous une certaine latitude il finit par leur être mortel, tandis que le nègre s’y soumet sans dangers [86] ; mais je ne pense pas que cette idée, si favorable à la paresse de l’homme du Midi, soit fondée sur l’expérience. Il ne fait pas plus chaud dans le sud de l’Union que dans le sud de l’Espagne et de l’Italie [87] . Pourquoi l’Européen n’y pourrait-il exécuter les mêmes travaux ? Et si l’esclavage a été aboli en Italie et en Espagne sans que les maîtres périssent, pourquoi n’en arriverait-il pas de même dans l’Union ? Je ne crois donc pas que la nature ait interdit, sous peine de mort, aux Européens de la Géorgie ou des Florides de tirer eux-mêmes leur subsistance du sol ; mais ce travail leur serait assurément plus pénible et moins productif [88] qu’aux habitants de la Nouvelle-Angleterre. Le travailleur libre perdant ainsi au Sud une partie de sa supériorité sur l’esclave, il est moins utile d’abolir l’esclavage.
Toutes les plantes de l’Europe croissent dans le nord de l’Union ; le Sud a des produits spéciaux. [II-311] .
On a remarqué que l’esclavage est un moyen dispendieux de cultiver les céréales. Celui qui récolte le blé dans un pays où la servitude est inconnue, ne retient habituellement à son service qu’un petit nombre d’ouvriers ; à l’époque de la moisson, et pendant les semailles, il en réunit, il est vrai, beaucoup d’autres ; mais ceux-là n’habitent que momentanément sa demeure.
Pour remplir ses greniers ou ensemencer ses champs, l’agriculteur qui vit dans un État à esclaves est oblige d’entretenir durant toute l’année un grand nombre de serviteurs, qui pendant quelques jours seulement lui sont nécessaires ; car, différents des ouvriers libres, les esclaves ne sauraient attendre, en travaillant pour eux-mêmes, le moment où l’on doit venir louer leur industrie. Il faut les acheter pour s’en servir.
L’esclavage, indépendamment de ses inconvénients généraux, est donc naturellement moins applicable aux pays où les céréales sont cultivées qu’à ceux où on récolte d’autres produits.
La culture du tabac, du coton et surtout de la canne à sucre, exige, au contraire, des soins continuels. On peut y employer des femmes et des enfants qu’on ne pourrait point utiliser dans la culture du blé. Ainsi, l’esclavage est naturellement plus approprié au pays d’où l’on tire les produits que je viens de nommer.
Le tabac, le coton, la canne ne croissent qu’au Sud ; ils y forment les sources principales de la richesse du pays. En détruisant l’esclavage, les hommes du Sud se trouveraient dans l’une de ces deux alternatives : ou ils seraient obligés de changer leur [II-312] système de culture, et alors ils entreraient en concurrence avec les hommes du Nord, plus actifs et plus expérimentés qu’eux ; ou ils cultiveraient les mêmes produits sans esclaves, et alors ils auraient à supporter la concurrence des autres États du Sud qui les auraient conservés.
Ainsi le Sud a des raisons particulières de garder l’esclavage, que n’a point le Nord.
Mais voici un autre motif plus puissant que tous les autres. Le Sud pourrait bien, à la rigueur, abolir la servitude ; mais comment se délivrerait-il des noirs ? Au Nord, on chasse en même temps l’esclavage et les esclaves. Au Sud, on ne peut espérer d’atteindre en même temps ce double résultat.
En prouvant que la servitude était plus naturelle et plus avantageuse au Sud qu’au Nord, j’ai suffisamment indiqué que le nombre des esclaves devait y être beaucoup plus grand. C’est dans le Sud qu’ont été amenés les premiers Africains ; c’est là qu’ils sont toujours arrivés en plus grand nombre. À mesure qu’on s’avance vers le Sud, le préjugé qui maintient l’oisiveté en honneur prend de la puissance. Dans les États qui avoisinent le plus les tropiques, il n’y a pas un blanc qui travaille. Les nègres sont donc naturellement plus nombreux au Sud qu’au Nord. Chaque jour, comme je l’ai dit plus haut, ils le deviennent davantage ; car, à proportion qu’on détruit l’esclavage à une des extrémités de l’Union, les nègres s’accumulent à l’autre. Ainsi, le nombre des noirs augmente au Sud, non seulement par le mouvement naturel de la population, mais encore par l’émigration forcée des nègres du Nord. La race [II-313] africaine a, pour croître dans cette partie de l’Union, des causes analogues à celles qui font grandir si vite la race européenne au Nord.
Dans l’État du Maine, on compte un Nègre sur trois cents habitants ; dans le Massachusetts, un sur 100 ; dans l’État de New York, deux sur 100 ; en Pennsylvanie, trois ; au Maryland, trente-quatre ; quarante-deux dans la Virginie, et cinquante-cinq enfin dans la Caroline du Sud [89] . Telle était la proportion des noirs par rapport à celle des blancs dans l’année 1830. Mais cette proportion change sans cesse : chaque jour elle devient plus petite au Nord et plus grande au Sud.
Il est évident que dans les États les plus méridionaux de l’Union, on ne saurait abolir l’esclavage comme on l’a fait dans les États du Nord, sans courir de très grands dangers, que ceux-ci n’ont point eu à redouter.
Nous avons vu comment les États du Nord ménageaient la transition entre l’esclavage et la liberté. Ils gardent la génération présente dans les fers et [II-314] émancipent les races futures ; de cette manière, on n’introduit les nègres que peu à peu dans la société, et tandis qu’on retient dans la servitude l’homme qui pourrait faire un mauvais usage de son indépendance, on affranchit celui qui, avant de devenir maître de lui-même, peut encore apprendre l’art d’être libre.
Il serait difficile de faire l’application de cette méthode au Sud. Lorsqu’on déclare qu’à partir de certaine époque le fils du nègre sera libre, on introduit le principe et l’idée de la liberté dans le sein même de la servitude : les noirs que le législateur garde dans l’esclavage, et qui voient leurs fils en sortir, s’étonnent de ce partage inégal que fait entre eux la destinée ; ils s’inquiètent et s’irritent. Dès lors, l’esclavage a perdu à leurs yeux l’espèce de puissance morale que lui donnaient le temps et la coutume ; il en est réduit à n’être plus qu’un abus visible de la force. Le Nord n’avait rien à craindre de ce contraste, parce qu’au Nord les Noirs étaient en petit nombre, et les blancs très nombreux. Mais si cette première aurore de la liberté venait à éclairer en même temps deux millions d’hommes, les oppresseurs devraient trembler.
Après avoir affranchi les fils de leurs esclaves, les Européens du Sud seraient bientôt contraints d’étendre à toute la race noire le même bienfait.
Dans le Nord, comme je l’ai dit plus haut, du moment où l’esclavage est aboli, et même du moment où il devient probable que le temps de son abolition approche, il se fait un double mouvement : les [II-315] esclaves quittent le pays pour être transportés plus au Sud ; les blancs des États du Nord et les émigrants d’Europe affluent à leur place.
Ces deux causes ne peuvent opérer de la même manière dans les derniers États du Sud. D’une part, la masse des esclaves y est trop grande pour qu’on puisse espérer de leur faire quitter le pays ; d’autre part, les Européens et les Anglo-Américains du Nord redoutent de venir habiter une contrée où l’on n’a point encore réhabilité le travail. D’ailleurs, ils regardent avec raison les États où la proportion des nègres surpasse ou égale celle des blancs comme menacés de grands malheurs, et ils s’abstiennent de porter leur industrie de ce côté.
Ainsi, en abolissant l’esclavage, les hommes du Sud ne parviendraient pas, comme leurs frères du Nord, à faire arriver graduellement les nègres à la liberté ; ils ne diminueraient pas sensiblement le nombre des noirs, et ils resteraient seuls pour les contenir. Dans le cours de peu d’années, on verrait donc un grand peuple de nègres libres placé au milieu d’une nation à peu près égale de blancs.
Les mêmes abus de pouvoir, qui maintiennent aujourd’hui l’esclavage, deviendraient alors dans le Sud la source des plus grands dangers qu’auraient à redouter les blancs. Aujourd’hui le descendant des Européens possède seul la terre ; il est maître absolu de l’industrie ; seul il est riche, éclairé, armé. Le noir ne possède aucun de ces avantages ; mais il peut s’en passer, il est esclave. Devenu libre, chargé de veiller lui-même sur son sort, peut-il rester privé de toutes ces choses sans mourir ? Ce qui faisait la force du blanc, [II-316] quand l’esclavage existait, l’expose donc à mille périls après que l’esclavage est aboli.
Laissant le nègre en servitude, on peut le tenir dans un état voisin de la brute ; libre, on ne peut l’empêcher de s’instruire assez pour apprécier l’étendue de ses maux et en entrevoir le remède. Il y a d’ailleurs un singulier principe de justice relative qu’on trouve très profondément enfoncé dans le cœur humain. Les hommes sont beaucoup plus frappés de l’inégalité qui existe dans l’intérieur d’une même classe que des inégalités qu’on remarque entre les différentes classes. On comprend l’esclavage, mais comment concevoir l’existence de plusieurs millions de citoyens éternellement pliés sous l’infamie et livrés a des misères héréditaires ? Dans le Nord, une population de nègres affranchis éprouve ces maux et ressent ces injustices ; mais elle est faible et réduite ; dans le Sud elle serait nombreuse et forte.
Du moment où l’on admet que les blancs et les nègres émancipés sont placés sur le même sol comme des peuples étrangers l’un à l’autre, on comprendra sans peine qu’il n’y a plus que deux chances dans l’avenir : il faut que les nègres et les blancs se confondent entièrement ou se séparent.
J’ai déjà exprimé plus haut quelle était ma conviction sur le premier moyen [90] . Je ne pense pas que la [II-317] race blanche et la race noire en viennent nulle part à vivre sur un pied d’égalité.
Mais je crois que la difficulté sera bien plus grande encore aux États-Unis que partout ailleurs. Il arrive qu’un homme se place en dehors des préjugés de religion, de pays, de race, et si cet homme est roi, il peut opérer de surprenantes révolutions dans la société : un peuple tout entier ne saurait se mettre ainsi en quelque sorte au-dessus de lui-même.
Un despote venant à confondre les Américains et leurs anciens esclaves sous le même joug parviendrait peut-être à les mêler : tant que la démocratie américaine restera à la tête des affaires, nul n’osera tenter une pareille entreprise, et l’on peut prévoir que, plus les blancs des États-Unis seront libres, plus ils chercheront à s’isoler [91] .
J’ai dit ailleurs que le véritable lien entre l’Européen et l’Indien était le métis ; de même la véritable transition entre le blanc et le nègre, c’est le mulâtre : partout où il se trouve un très grand nombre de mulâtres, la fusion entre les deux races n’est pas impossible.
Il y a des parties de l’Amérique où l’Européen et le nègre se sont tellement croisés, qu’il est difficile de rencontrer un homme qui soit tout-à-fait blanc ou tout-à-fait noir : arrivées a ce point, on peut réellement dire que les races se sont mêlées ; ou plutôt, à leur place, il en est survenu une troisième qui tient des deux sans être précisément ni l’une ni l’autre. [II-318] .
De tous les Européens, les Anglais sont ceux qui ont le moins mêlé leur sang à celui des Nègres. On voit au Sud de l’Union plus de mulâtres qu’au Nord, mais infiniment moins que dans aucune autre colonie européenne ; les mulâtres sont très peu nombreux aux États-Unis ; ils n’ont aucune force par eux-mêmes, et dans les querelles de races, ils font d’ordinaire cause commune avec les blancs. C’est ainsi qu’en Europe on voit souvent les laquais des grands seigneurs trancher du noble avec le peuple.
Cet orgueil d’origine, naturel à l’Anglais, est encore singulièrement accru chez l’Américain par l’orgueil individuel que la liberté démocratique fait naître. L’homme blanc des États-Unis est fier de sa race et fier de lui-même.
D’ailleurs, les blancs et les nègres ne venant pas à se mêler dans le Nord de l’Union, comment se mêleraient-ils dans le Sud ? Peut-on supposer un instant que l’Américain du Sud, placé, comme il le sera toujours, entre l’homme blanc, dans toute sa supériorité physique et morale, et le nègre, puisse jamais songer à se confondre avec ce dernier ? L’Américain du Sud a deux passions énergiques qui le porteront toujours à s’isoler : il craindra de ressembler au nègre son ancien esclave, et de descendre au-dessous du blanc son voisin.
S’il fallait absolument prévoir l’avenir, je dirais que, suivant le cours probable des choses, l’abolition de l’esclavage au Sud fera croître la répugnance que la population blanche y éprouve pour les noirs. Je fonde cette opinion sur ce que j’ai déjà remarqué d’analogue au Nord. J’ai dit que les hommes blancs [II-319] du Nord s’éloignent des Nègres avec d’autant plus de soin que le législateur marque moins la séparation légale qui doit exister entre eux : pourquoi n’en serait-il pas de même au Sud ? Dans le Nord, quand les blancs craignent d’arriver à se confondre avec les noirs, ils redoutent un danger imaginaire. Au Sud, où le danger serait réel, je ne puis croire que la crainte fût moindre.
Si, d’une part, on reconnaît (et le fait n’est pas douteux) que dans l’extrémité sud, les Noirs s’accumulent sans cesse et croissent plus vite que les blancs ; si, d’une autre, on concède qu’il est impossible de prévoir l’époque où les noirs et les blancs arriveront à se mêler et à retirer de l’état de société les mêmes avantages, ne doit-on pas en conclure que, dans les États du Sud, les noirs et les blancs finiront tôt ou tard par entrer en lutte ?.
Quel sera le résultat final de cette lutte ?.
On comprendra sans peine que sur ce point il faut se renfermer dans le vague des conjectures. L’esprit humain parvient avec peine à tracer en quelque sorte un grand cercle autour de l’avenir ; mais en dedans de ce cercle s’agite le hasard qui échappe à tous les efforts. Dans le tableau de l’avenir, le hasard forme toujours comme le point obscur où l’œil de l’intelligence ne saurait pénétrer. Ce qu’on peut dire est ceci : dans les Antilles, c’est la race blanche qui semble destinée à succomber ; sur le continent, la race noire.
Dans les Antilles, les blancs sont isolés au milieu d’une immense population de noirs ; sur le continent, les noirs sont placés entre la mer et un peuple [II-320] innombrable, qui déjà s’étend au-dessus d’eux comme une masse compacte, depuis les glaces du Canada jusqu’aux frontières de la Virginie, depuis les rivages du Missouri jusqu’aux bords de l’océan Atlantique. Si les blancs de l’Amérique du Nord restent unis, il est difficile de croire que les nègres puissent échapper à la destruction qui les menace ; ils succomberont sous le fer ou la misère. Mais les populations noires accumulées le long du golfe du Mexique, ont des chances de salut si la lutte entre les deux races vient à s’établir alors que la confédération américaine sera dissoute. Une fois l’anneau fédéral brisé, les hommes du Sud auraient tort de compter sur un appui durable de la part de leurs frères du Nord. Ceux-ci savent que le danger ne peut jamais les atteindre ; si un devoir positif ne les contraint de marcher au secours du Sud, on peut prévoir que les sympathies de race seront impuissantes.
Quelle que soit, du reste, l’époque de la lutte, les blancs du Sud, fussent-ils abandonnés à eux-mêmes, se présenteront dans la lice avec une immense supériorité de lumières et de moyens ; mais les noirs auront pour eux le nombre et l’énergie du désespoir. Ce sont là de grandes ressources quand on a les armes à la main. Peut-être arrivera-t-il alors à la race blanche du Sud ce qui est arrivé aux Maures d’Espagne. Après avoir occupé le pays pendant des siècles, elle se retirera enfin peu à peu vers la contrée d’où ses aïeux sont autrefois venus, abandonnant aux nègres la possession d’un pays que la Providence semble destiner à ceux-ci, puisqu’ils y vivent sans peine et y travaillent plus facilement que les blancs. [II-321] .
Le danger plus ou moins éloigné, mais inévitable, d’une lutte entre les noirs et les blancs qui peuplent le sud de l’Union, se présente sans cesse comme un rêve pénible à l’imagination des Américains. Les habitants du Nord s’entretiennent chaque jour de ces périls, quoique directement ils n’aient rien à en craindre. Ils cherchent vainement à trouver un moyen de conjurer les malheurs qu’ils prévoient.
Dans les États du Sud, on se tait ; on ne parle point de l’avenir aux étrangers ; on évite de s’en expliquer avec ses amis ; chacun se le cache pour ainsi dire à soi-même. Le silence du Sud a quelque chose de plus effrayant que les craintes bruyantes du Nord.
Cette préoccupation générale des esprits a donné naissance à une entreprise presque ignorée qui peut changer le sort d’une partie de la race humaine.
Redoutant les dangers que je viens de décrire, un certain nombre de citoyens américains se réunirent en société dans le but d’importer à leurs frais sur les côtes de la Guinée les nègres libres qui voudraient échapper à la tyrannie qui pèse sur eux [92] .
En 1820, la société dont je parle parvint à fonder en Afrique, par le 7e degré de latitude nord, un établissement auquel elle donna le nom de Liberia. Les dernières nouvelles annonçaient que deux mille cinq cents nègres se trouvaient déjà réunis sur ce point. Transportés dans leur ancienne patrie, les noirs y ont introduit des institutions américaines. Liberia a un [II-322] système représentatif, des jurés nègres, des magistrats nègres, des prêtres nègres ; on y voit des temples et des journaux, et par un retour singulier des vicissitudes de ce monde, il est défendu aux blancs de se fixer dans ses murs [93] .
Voilà à coup sûr un étrange jeu de la fortune ! Deux siècles se sont écoulés depuis le jour où l’habitant de l’Europe entreprit d’enlever les nègres à leur famille et à leur pays pour les transporter sur les rivages de l’Amérique du Nord. Aujourd’hui on rencontre l’Européen occupé à charrier de nouveau à travers l’océan Atlantique les descendants de ces mêmes nègres, afin de les reporter sur le sol d’où il avait jadis arraché leurs pères. Des barbares ont été puiser les lumières de la civilisation au sein de la servitude et apprendre dans l’esclavage l’art d’être libres.
Jusqu’à nos jours, l’Afrique était fermée aux arts et aux sciences des blancs. Les lumières de l’Europe, importées par des Africains, y pénétreront peut-être. Il y a donc une belle et grande idée dans la fondation de Liberia ; mais cette idée, qui peut devenir si féconde pour l’Ancien Monde, est stérile pour le Nouveau.
En douze ans, la Société de colonisation des noirs a transporté en Afrique deux mille cinq cents nègres. Pendant le même espace de temps, il en naissait environ sept cent mille dans les États-Unis. [II-323] .
La colonie de Liberia fût-elle en position de recevoir chaque année des milliers de nouveaux habitants, et ceux-ci en état d’y être conduits utilement ; l’Union se mît-elle à la place de la Société et employât-elle annuellement ses trésors [94] et ses vaisseaux à exporter des nègres en Afrique, elle ne pourrait point encore balancer le seul progrès naturel de la population parmi les noirs ; et n’enlevant pas chaque année autant d’hommes qu’il en vient au monde, elle ne parviendrait pas même à suspendre les développements du mal qui grandit chaque jour dans son sein [95] .
La race nègre ne quittera plus les rivages du continent américain, où les passions et les vices de l’Europe l’ont fait descendre; elle ne disparaîtra du Nouveau-Monde qu’en cessant d’exister. Les habitants des États-Unis peuvent éloigner les malheurs qu’ils redoutent, mais ils ne sauraient aujourd’hui en détruire la cause.
Je suis obligé d’avouer que je ne considère pas l’abolition de la servitude comme un moyen de retarder, dans les États du Sud, la lutte des deux races. [II-324] .
Les nègres peuvent rester long-temps esclaves sans se plaindre ; mais entrés au nombre des hommes libres, ils s’indigneront bientôt d’être privés de presque tous les droits de citoyens ; et ne pouvant devenir les égaux des blancs, ils ne tarderont pas à se montrer leurs ennemis.
Au Nord, on avait tout profit à affranchir les esclaves ; on se délivrait ainsi de l’esclavage, sans avoir rien à redouter des nègres libres. Ceux-ci étaient trop peu nombreux pour réclamer jamais leurs droits. Il n’en est pas de même au Sud.
La question de l’esclavage était pour les maîtres, au Nord, une question commerciale et manufacturière ; au Sud, c’est une question de vie ou de mort. Il ne faut donc pas confondre l’esclavage au Nord et au Sud.
Dieu me garde de chercher, comme certains auteurs américains, à justifier le principe de la servitude des nègres ; je dis seulement que tous ceux qui ont admis cet affreux principe autrefois ne sont pas également libres aujourd’hui de s’en départir.
Je confesse que quand je considère l’état du Sud, je ne découvre, pour la race blanche qui habite ces contrées, que deux manières d’agir : affranchir les nègres et les fondre avec elle ; rester isolés d’eux et les tenir le plus long-temps possible dans l’esclavage. Les moyens termes me paraissent aboutir prochainement à la plus horrible de toutes les guerres civiles, et peut-être à la ruine de l’une des deux races.
Les Américains du Sud envisagent la question sous ce point de vue, et ils agissent en conséquence. Ne [II-325] voulant pas se fondre avec les nègres, ils ne veulent point les mettre en liberté.
Ce n’est pas que tous les habitants du Sud regardent l’esclavage comme nécessaire à la richesse du maître ; sur ce point, beaucoup d’entre eux sont d’accord avec les hommes du Nord, et admettent volontiers avec ceux-ci que la servitude est un mal ; mais ils pensent qu’il faut conserver ce mal pour vivre.
Les lumières, en s’accroissant au Sud, ont fait apercevoir aux habitants de cette partie du territoire que l’esclavage est nuisible au maître, et ces mêmes lumières leur montrent, plus clairement qu’ils ne l’avaient vu jusqu’alors, la presque impossibilité de le détruire. De là un singulier contraste : l’esclavage s’établit de plus en plus dans les lois, à mesure que son utilité est plus contestée ; et tandis que son principe est graduellement aboli dans le Nord, on tire au Midi, de ce même principe, des conséquences de plus en plus rigoureuses.
La législation des États du Sud relative aux esclaves présente de nos jours une sorte d’atrocité inouïe, et qui seule vient révéler quelque perturbation profonde dans les lois de l’humanité. Il suffit de lire la législation des États du Sud pour juger la position désespérée des deux races qui les habitent.
Ce n’est pas que les Américains de cette partie de l’Union aient précisément accru les rigueurs de la servitude ; ils ont, au contraire, adouci le sort matériel des esclaves. Les Anciens ne connaissaient que les fers et la mort pour maintenir l’esclavage ; les Américains du Sud de l’Union ont trouvé des garanties plus [II-326] intellectuelles pour la durée de leur pouvoir. Ils ont, si je puis m’exprimer ainsi, spiritualisé le despotisme et la violence. Dans l’antiquité, on cherchait à empêcher l’esclave de briser ses fers ; de nos jours, on a entrepris de lui en ôter le désir.
Les anciens enchaînaient le corps de l’esclave, mais ils laissaient son esprit libre et lui permettaient de s’éclairer. En cela ils étaient conséquents avec eux-mêmes ; il y avait alors une issue naturelle à la servitude : d’un jour à l’autre l’esclave pouvait devenir libre et égal à son maître.
Les Américains du Sud, qui ne pensent point qu’à aucune époque les nègres puissent se confondre avec eux, ont défendu, sous des peines sévères, de leur apprendre à lire et à écrire. Ne voulant pas les élever à leur niveau, ils les tiennent aussi près que possible de la brute.
De tout temps, l’espérance de la liberté avait été placée au sein de l’esclavage pour en adoucir les rigueurs.
Les Américains du Sud ont compris que l’affranchissement offrait toujours des dangers, quand l’affranchi ne pouvait arriver un jour à s’assimiler au maître. Donner à un homme la liberté et le laisser dans la misère et l’ignominie, qu’est-ce faire, sinon fournir un chef futur à la révolte des esclaves ? On avait d’ailleurs remarqué depuis long-temps que la présence du nègre libre jetait une inquiétude vague au fond de l’âme de ceux qui ne l’étaient pas, et y faisait pénétrer, comme une lueur douteuse, l’idée de leurs droits. Les Américains du Sud ont enlevé [II-327] aux maîtres, dans la plupart des cas, la faculté d’affranchir [96] .
J’ai rencontré au sud de l’Union un vieillard qui jadis avait vécu dans un commerce illégitime avec une de ses négresses. Il en avait eu plusieurs enfants qui, en venant au monde, étaient devenus esclaves de leur père. Plusieurs fois celui-ci avait songé à leur léguer au moins la liberté, mais des années s’étaient écoulées avant qu’il pût lever les obstacles mis à l’affranchissement par le législateur. Pendant ce temps, la vieillesse était venue, et il allait mourir. Il se représentait alors ses fils traînés de marchés en marchés, et passant de l’autorité paternelle sous la verge d’un étranger. Ces horribles images jetaient dans le délire son imagination expirante. Je le vis en proie aux angoisses du désespoir, et je compris alors comment la nature savait se venger des blessures que lui faisaient les lois.
Ces maux sont affreux, sans doute ; mais ne sont-ils pas la conséquence prévue et nécessaire du principe même de la servitude parmi les modernes ?.
Du moment où les Européens ont pris leurs esclaves dans le sein d’une race d’hommes différente de la leur, que beaucoup d’entre eux considéraient comme inférieure aux autres races humaines, et à laquelle tous envisagent avec horreur l’idée de s’assimiler jamais, ils ont supposé l’esclavage éternel ; car, entre l’extrême inégalité que crée la servitude et la complète égalité que produit naturellement parmi les [II-328] hommes l’indépendance, il n’y a point d’état intermédiaire qui soit durable. Les Européens ont senti vaguement cette vérité, mais sans se l’avouer. Toutes les fois qu’il s’est agi des nègres, on les a vus obéir tantôt à leur intérêt ou à leur orgueil, tantôt à leur pitié. Ils ont violé envers le noir tous les droits de l’humanité, et puis ils l’ont instruit de la valeur et de l’inviolabilité de ces droits. Ils ont ouvert leurs rangs à leurs esclaves, et quand ces derniers tentaient d’y pénétrer, ils les ont chassés avec ignominie. Voulant la servitude, ils se sont laissé entraîner, malgré eux ou à leur insu, vers a liberté, sans avoir le courage d’être ni complètement iniques, ni entièrement justes.
S’il est impossible de prévoir une époque où les Américains du Sud mêleront leur sang à celui des nègres, peuvent-ils, sans s’exposer eux-mêmes à périr, permettre que ces derniers arrivent à la liberté ? Et s’ils sont obligés, pour sauver leur propre race, de vouloir les maintenir dans les fers, ne doit-on pas les excuser de prendre les moyens les plus efficaces pour y parvenir ?.
Ce qui se passe dans le sud de l’Union me semble tout à la fois la conséquence la plus horrible et la plus naturelle de l’esclavage. Lorsque je vois l’ordre de la nature renversé, quand j’entends l’humanité qui crie et se débat en vain sous les lois, j’avoue que je ne trouve point d’indignation pour flétrir les hommes de nos jours, auteurs de ces outrages ; mais je rassemble toute ma haine contre ceux qui, après plus de mille ans d’égalité, ont introduit de nouveau la servitude dans le monde. [II-329] .
Quels que soient, du reste, les efforts des Américains du Sud pour conserver l’esclavage, ils n’y réussiront pas toujours. L’esclavage, resserré sur un seul point du globe, attaqué par le christianisme comme injuste, par l’économie politique comme funeste ; l’esclavage, au milieu de la liberté démocratique et des lumières de notre âge, n’est point une institution qui puisse durer. Il cessera par le fait de l’esclave ou par celui du maître. Dans les deux cas, il faut s’attendre à de grands malheurs.
Si on refuse la liberté aux nègres du Sud, ils finiront par la saisir violemment eux-mêmes ; si on la leur accorde, ils ne tarderont pas à en abuser. [II-330]
QUELLES SONT LES CHANCES DE DURÉE DE L’UNION AMÉRICAINE, QUELS DANGERS LA MENACE.
Ce qui fait la force prépondérante réside dans les États plutôt que dans l’Union. — La confédération ne durera qu’autant que tous les États qui la composent voudront en faire partie. — Causes qui doivent les porter à rester unis. — Utilité d’être unis pour résister aux étrangers et pour n’avoir pas d’étrangers en Amérique. — La Providence n’a pas élevé de barrières naturelles entre les différents États. — Il n’existe pas d’intérêts matériels qui les divisent. — Intérêt qu’a le Nord à la prospérité et à l’union du Sud et de l’Ouest ; le Sud à celles du Nord et de l’Ouest ; l’Ouest à celles des deux autres. — Intérêts immatériels qui unissent les Américains. — Uniformité des opinions. — Les dangers de la confédération naissent de la différence des caractères, dans les hommes qui la composent, et de leurs passions. — Caractères des hommes du Sud et du Nord. — La croissance rapide de l’Union est un de ses plus grands périls. — Marche de la population vers le Nord-Ouest. — Gravitation de la puissance de ce côté. — Passions que ces mouvements rapides de la fortune font naître. — L’Union subsistant, son gouvernement tend-il à prendre de la force ou à s’affaiblir ? — Divers signes d’affaiblissement. — Internal improvements. — Terres désertes. — Indiens. — Affaire de la banque. — Affaire du tarif. — Le général Jackson.
De l’existence de l’Union dépend en partie le maintien de ce qui existe dans chacun des États qui la composent. Il faut donc examiner d’abord quel est le sort probable de l’Union. Mais, avant tout, il est bon de se fixer sur un point : si la confédération actuelle venait à se briser, il me paraît incontestable que les États qui en font partie ne retourneraient pas à leur individualité première. À la place d’une Union, il s’en formerait plusieurs. Je n’entends point rechercher sur quelles bases ces nouvelles Unions viendraient à s’établir ; ce que je veux montrer, ce sont les causes qui peuvent amener le démembrement de la confédération actuelle.
Pour y parvenir, je vais être obligé de parcourir [II-331] de nouveau quelques-unes des routes dans lesquelles j’étais précédemment entré. Je devrai exposer aux regards plusieurs objets qui sont déjà connus. Je sais qu’en agissant ainsi je m’expose aux reproches du lecteur ; mais l’importance de la matière qui me reste à traiter est mon excuse. Je préfère me répéter quelquefois que de n’être pas compris, et j’aime mieux nuire à l’auteur qu’au sujet.
Les législateurs qui ont formé la constitution de 1789 se sont efforcés de donner au pouvoir fédéral une existence à part et une force prépondérante.
Mais ils étaient bornés par les conditions mêmes du problème qu’ils avaient à résoudre. On ne les avait point chargés de constituer le gouvernement d’un peuple unique, mais de régler l’association de plusieurs peuples ; et quels que fussent leurs désirs, il fallait toujours qu’ils en arrivassent à partager l’exercice de la souveraineté.
Pour bien comprendre quelles furent les conséquences de ce partage, il est nécessaire de faire une courte distinction entre les actes de la souveraineté.
Il y a des objets qui sont nationaux par leur nature, c’est-à-dire qui ne se rapportent qu’à la nation prise en corps, et ne peuvent être confiés qu’à l’homme ou à l’assemblée qui représente le plus complétement la nation entière. Je mettrai de ce nombre la guerre et la diplomatie.
Il en est d’autres qui sont provinciaux de leur nature, c’est-à-dire qui ne se rapportent qu’à certaines localités et ne peuvent être convenablement traités que dans la localité même. Tel est le budget des communes. [II-332] .
On rencontre enfin des objets qui ont une nature mixte : ils sont nationaux, en ce qu’ils intéressent tous les individus qui composent la nation ; ils sont provinciaux, en ce qu’il n’y a pas nécessité que la nation elle-même y pourvoie. Ce sont, par exemple, les droits qui règlent l’état civil et politique des citoyens. Il n’existe pas d’état social sans droits civils et politiques. Ces droits intéressent donc également tous les citoyens ; mais il n’est pas toujours nécessaire à l’existence et à la prospérité de la nation que ces droits soient uniformes, et par conséquent qu’ils soient réglés par le pouvoir central.
Parmi les objets dont s’occupe la souveraineté, il y a donc deux catégories nécessaires ; on les retrouve dans toutes les sociétés bien constituées, quelle que soit du reste la base sur laquelle le pacte social ait été établi.
Entre ces deux points extrêmes, sont placés, comme une masse flottante, les objets généraux, mais non nationaux, que j’ai appelés mixtes. Ces objets n’étant ni exclusivement nationaux, ni entièrement provinciaux, le soin d’y pourvoir peut être attribué au gouvernement national ou au gouvernement provincial, suivant les conventions de ceux qui s’associent, sans que le but de l’association cesse d’être atteint.
Le plus souvent, de simples individus s’unissent pour former le souverain, et leur réunion compose un peuple. Au-dessous du gouvernement général qu’ils se sont donné, on ne rencontre alors que des forces individuelles ou des pouvoirs collectifs dont chacun représente une fraction très minime du [II-333] souverain. Alors aussi c’est le gouvernement général qui est le plus naturellement appelé à régler, non seulement les objets nationaux par leur essence, mais la plus grande partie des objets mixtes dont j’ai déjà parlé. Les localités en sont réduites à la portion de souveraineté qui est indispensable à leur bien-être.
Quelquefois, par un fait antérieur à l’association, le souverain se trouve composé de corps politiques déjà organisés ; il arrive alors que le gouvernement provincial se charge de pourvoir, non seulement aux objets exclusivement provinciaux de leur nature, mais encore à tout ou partie des objets mixtes dont il vient d’être question. Car les nations confédérées, qui formaient elles-mêmes des souverains avant leur union, et qui continuent à représenter une fraction très considérable du souverain, quoiqu’elles se soient unies, n’ont entendu céder au gouvernement général que l’exercice des droits indispensables à l’Union.
Quand le gouvernement national, indépendamment des prérogatives inhérentes à sa nature, se trouve revêtu du droit de régler les objets mixtes de la souveraineté, il possède une force prépondérante. Non seulement il a beaucoup de droits, mais tous les droits qu’il n’a pas sont à sa merci, et il est à craindre qu’il n’en vienne jusqu’à enlever aux gouvernements provinciaux leurs prérogatives naturelles et nécessaires.
Lorsque c’est, au contraire, le gouvernement provincial qui se trouve revêtu du droit de régler les objets mixtes, il règne dans la société une tendance opposée. La force prépondérante réside alors dans la province, non dans la nation ; et on doit [II-334] redouter que le gouvernement national ne finisse par être dépouillé des privilèges nécessaires à son existence.
Les peuples uniques sont donc naturellement portés vers la centralisation, et les confédérations vers le démembrement.
Il ne reste plus qu’à appliquer ces idées générales à l’Union américaine.
Aux États particuliers revenait forcément le droit de régler les objets purement provinciaux.
De plus, ces mêmes États retinrent celui de fixer la capacité civile et politique des citoyens, de régler les rapports des hommes entre eux, et de leur rendre la justice ; droits qui sont généraux de leur nature, mais qui n’appartiennent pas nécessairement au gouvernement national.
Nous avons vu qu’au gouvernement de l’Union fut délégué le pouvoir d’ordonner au nom de toute la nation, dans les cas où la nation aurait à agir comme un seul et même individu. Il la représenta vis-à-vis des étrangers ; il dirigea contre l’ennemi commun les forces communes. En un mot, il s’occupa des objets que j’ai appelés exclusivement nationaux.
Dans ce partage des droits de la souveraineté, la part de l’Union semble encore au premier abord plus grande que celle des États ; un examen un peu approfondi démontre que, par le fait, elle est moindre.
Le gouvernement de l’Union exécute des entreprises plus vastes, mais on le sent rarement agir. Le gouvernement provincial fait de plus petites choses, mais il ne se repose jamais et révèle son existence à chaque instant. [II-335] .
Le gouvernement de l’Union veille sur les intérêts généraux du pays ; mais les intérêts généraux d’un peuple n’ont qu’une influence contestable sur le bonheur individuel.
Les affaires de la province influent au contraire visiblement sur le bien-être de ceux qui l’habitent.
L’Union assure l’indépendance et la grandeur de la nation, choses qui ne touchent pas immédiatement les particuliers. L’État maintient la liberté, règle les droits, garantit la fortune, assure la vie, l’avenir tout entier de chaque citoyen.
Le gouvernement fédéral est placé à une grande distance de ses sujets ; le gouvernement provincial est à la portée de tous. Il suffit d’élever la voix pour être entendu de lui. Le gouvernement central a pour lui les passions de quelques hommes supérieurs qui aspirent à le diriger : du côté du gouvernement provincial se trouve l’intérêt des hommes de second ordre qui n’espèrent obtenir de puissance que dans leur État ; et ce sont ceux-là qui, placés près du peuple, exercent sur lui le plus de pouvoir.
Les Américains ont donc bien plus à attendre et à craindre de l’État que de l’Union ; et, suivant la marche naturelle du cœur humain, ils doivent s’attacher bien plus vivement au premier qu’à la seconde.
En ceci les habitudes et les sentiments sont d’accord avec les intérêts.
Quand une nation compacte fractionne sa souveraineté et arrive à l’état de confédération, les souvenirs, les usages, les habitudes, luttent long-temps contre les lois et donnent au gouvernement central [II-336] une force que celles-ci lui refusent. Lorsque des peuples confédérés se réunissent dans une seule souveraineté, les mêmes causes agissent en sens contraire. Je ne doute point que si la France devenait une république confédérée comme celle des États-Unis, le gouvernement ne s’y montrât d’abord plus énergique que celui de l’Union ; et si l’Union se constituait en monarchie comme la France, je pense que le gouvernement américain resterait pendant quelque temps plus débile que le nôtre. Au moment où la vie nationale a été créée chez les Anglo-Américains, l’existence provinciale était déjà ancienne, des rapports nécessaires s’étaient établis entre les communes et les individus des mêmes États ; on s’y était habitué à considérer certains objets sous un point de vue commun, et à s’occuper exclusivement de certaines entreprises comme représentant un intérêt spécial.
L’Union est un corps immense qui offre au patriotisme un objet vague à embrasser. L’État a des formes arrêtées et des bornes circonscrites ; il représente un certain nombre de choses connues et chères à ceux qui l’habitent. Il se confond avec l’image même du sol, s’identifie à la propriété, à la famille, aux souvenirs du passé, aux travaux du présent, aux rêves de l’avenir. Le patriotisme, qui le plus souvent n’est qu’une extension de l’égoïsme individuel, est donc resté dans l’État, et n’a pour ainsi dire point passé à l’Union.
Ainsi les intérêts, les habitudes, les sentiments, se réunissent pour concentrer la véritable vie politique dans l’État, et non dans l’Union.
On peut facilement juger de la différence des forces [II-337] des deux gouvernements, en voyant se mouvoir chacun d’eux dans le cercle de sa puissance.
Toutes les fois qu’un gouvernement d’État s’adresse à un homme ou à une association d’hommes, son langage est clair et impératif ; il en est de même du gouvernement fédéral, quand il parle à des individus ; mais dès qu’il se trouve en face d’un État, il commence à parlementer : il explique ses motifs et justifie sa conduite ; il argumente, il conseille, il n’ordonne guère. S’élève-t-il des doutes sur les limites des pouvoirs constitutionnels de chaque gouvernement, le gouvernement provincial réclame son droit avec hardiesse, et prend des mesures promptes et énergiques pour le soutenir. Pendant ce temps le gouvernement de l’Union raisonne ; il en appelle au bon sens de la nation, à ses intérêts, à sa gloire ; il temporise, il négocie ; ce n’est que réduit à la dernière extrémité qu’il se détermine enfin à agir. Au premier abord, on pourrait croire que c’est le gouvernement provincial qui est armé des forces de toute la nation, et que le congrès représente un État.
Le gouvernement fédéral, en dépit des efforts de ceux qui l’ont constitué, est donc, comme je l’ai déjà dit ailleurs, par sa nature même, un gouvernement faible qui, plus que tout autre, a besoin du libre concours des gouvernes pour subsister.
Il est aisé de voir que son objet est de réaliser avec facilité la volonté qu’ont les États de rester unis. Cette première condition remplie, il est sage, fort et agile. On l’a organisé de manière à ne rencontrer habituellement devant lui que des individus, et à vaincre aisément les résistances qu’on voudrait opposer à la [II-338] volonté commune ; mais le gouvernement fédéral n’a pas été établi dans la prévision que les États ou plusieurs d’entre eux cesseraient de vouloir être unis.
Si la souveraineté de l’Union entrait aujourd’hui en lutte avec celle des États, on peut aisément prévoir qu’elle succomberait ; je doute même que le combat s’engageât jamais d’une manière sérieuse. Toutes les fois qu’on opposera une résistance opiniâtre au gouvernement fédéral, on le verra céder. L’expérience a prouvé jusqu’à présent que quand un État voulait obstinément une chose et la demandait résolument, il ne manquait jamais de l’obtenir ; et que quand il refusait nettement d’agir [97] , on le laissait libre de faire.
Le gouvernement de l’Union eût-il une force qui lui fût propre, la situation matérielle du pays lui en rendrait l’usage fort difficile [98] .
Les États-Unis couvrent un immense territoire ; de longues distances les séparent ; la population y est éparpillée au milieu de pays encore à moitié déserts. Si l’Union entreprenait de maintenir par les armes les confédérés dans le devoir, sa position se trouverait analogue à celle qu’occupait l’Angleterre lors de la guerre de l’indépendance. [II-339] .
D’ailleurs, un gouvernement, fût-il fort, ne saurait échapper qu’avec peine aux conséquences d’un principe, quand une fois il a admis ce principe lui-même comme fondement du droit public qui doit le régir. La confédération a été formée par la libre volonté des États ; ceux-ci, en s’unissant, n’ont point perdu leur nationalité, et ne se sont point fondus dans un seul et même peuple. Si aujourd’hui un de ces mêmes États voulait retirer son nom du contrat, il serait assez difficile de lui prouver qu’il ne peut le faire. Le gouvernement fédéral, pour le combattre, ne s’appuierait d’une manière évidente ni sur la force, ni sur le droit.
Pour que le gouvernement fédéral triomphât aisément de la résistance que lui opposeraient quelques uns de ses sujets, il faudrait que l’intérêt particulier d’un ou de plusieurs d’entre eux fût intimement lié à l’existence de l’Union, comme cela s’est vu souvent dans l’histoire des confédérations.
Je suppose que parmi ces États que le lien fédéral rassemble, il en soit quelques-uns qui jouissent à eux seuls des principaux avantages de l’union, ou dont la prospérité dépende entièrement du fait de l’union ; il est clair que le pouvoir central trouvera dans ceux-là un très grand appui pour maintenir les autres dans l’obéissance. Mais alors il ne tirera plus sa force de lui-même, il la puisera dans un principe qui est contraire à sa nature. Les peuples ne se confédèrent que pour retirer des avantages égaux de l’union, et, dans le cas cité plus haut, c’est parce que l’inégalité règne entre les nations unies que le gouvernement fédéral est puissant. [II-340] .
Je suppose encore que l’un des États confédérés ait acquis une assez grande prépondérance pour s’emparer a lui seul du pouvoir central ; il considérera les autres États comme ses sujets, et fera respecter, dans la prétendue souveraineté de l’Union, sa propre souveraineté. On fera alors de grandes choses au nom du gouvernement fédéral, mais, à vrai dire, ce gouvernement n’existera plus [99] .
Dans ces deux cas, le pouvoir qui agit au nom de la confédération devient d’autant plus fort qu’on s’écarte davantage de l’état naturel et du principe reconnu des confédérations.
En Amérique, l’union actuelle est utile à tous les États, mais elle n’est essentielle à aucun d’eux. Plusieurs États briseraient le lien fédéral que le sort des autres ne serait pas compromis, bien que la somme de leur bonheur fût moindre. Comme il n’y a point d’État dont l’existence ou la prospérité soit entièrement liée à la confédération actuelle, il n’y en a pas non plus qui soit disposé à faire de très grands sacrifices personnels pour la conserver.
D’un autre côté, on n’aperçoit pas d’État qui ait, quant à présent, un grand intérêt d’ambition à maintenir la confédération telle que nous la voyons de nos jours. Tous n’exercent point sans doute la même influence dans les conseils fédéraux, mais on n’en voit aucun qui doive se flatter d’y dominer, et qui puisse traiter ses confédérés en inférieurs ou en sujets. [II-341] .
Il me paraît donc certain que si une portion de l’Union voulait sérieusement se séparer de l’autre, non seulement on ne pourrait pas l’en empêcher, mais on ne tenterait même pas de le faire. L’Union actuelle ne durera donc qu’autant que tous les États qui la composent continueront à vouloir en faire partie.
Ce point fixé, nous voici plus à l’aise : il ne s’agit plus de rechercher si les États actuellement confédérés pourront se séparer, mais s’ils voudront rester unis.
Parmi toutes les raisons qui rendent l’union actuelle utile aux Américains, on en rencontre deux principales dont l’évidence frappe aisément tous les yeux.
Quoique les Américains soient pour ainsi dire seuls sur leur continent, le commerce leur donne pour voisins tous les peuples avec lesquels ils trafiquent. Malgré leur isolement apparent, les Américains ont donc besoin d’être forts, et ils ne peuvent être forts qu’en restant tous unis.
Les États, en se désunissant, ne diminueraient pas seulement leur force vis-à-vis des étrangers, ils créeraient des étrangers sur leur propre sol. Dès lors ils entreraient dans un système de douanes intérieures ; ils diviseraient les vallées par des lignes imaginaires ; ils emprisonneraient le cours des fleuves et gêneraient de toutes les manières l’exploitation de l’immense continent que Dieu leur a accordé pour domaine.
Aujourd’hui ils n’ont pas d’invasion à redouter, conséquemment pas d’armées à entretenir, pas d’impôts à lever ; si l’Union venait à se briser, le besoin de [II-342] toutes ces choses ne tarderait peut-être pas à se faire sentir.
Les Américains ont donc un immense intérêt à rester unis.
D’un autre côté, il est presque impossible de découvrir quelle espèce d’intérêt matériel une portion de l’Union aurait, quant à présent, à se séparer des autres. .
Lorsqu’on jette les yeux sur une carte des États-Unis et qu’on aperçoit la chaîne des monts Alléghanys, courant du Nord-Est au Sud-Ouest, et parcourant le pays sur une étendue de 400 lieues, on est tenté de croire que le but de la Providence a été d’élever entre le bassin du Mississipi et les côtes de l’océan Atlantique une de ces barrières naturelles qui, s’opposant aux rapports permanents des hommes entre eux, forment comme les limites nécessaires des différents peuples.
Mais la hauteur moyenne des Alléghanys ne dépasse pas 800 mètres [100] . Leurs sommets arrondis et les spacieuses vallées qu’ils renferment dans leurs contours présentent en mille endroits un accès facile. Il y a plus, les principaux fleuves qui viennent verser leurs eaux dans l’océan Atlantique, l’Hudson, la Susquehanna, le Potomac [101] , ont leurs sources au-delà des Alléghanys, sur un plateau ouvert qui borde le bassin du Mississipi. Partis de cette région [102] , ils [II-343] se font jour à travers le rempart qui semblait devoir les rejeter à l’occident, et tracent, au sein des montagnes, des routes naturelles toujours ouvertes à l’homme.
Aucune barrière ne s’élève donc entre les différentes parties du pays occupé de nos jours par les Anglo-Américains. Loin que les Alléghanys servent de limites à des peuples, ils ne bornent même point des États. Le New-York, la Pennsylvanie et la Virginie les renferment dans leur enceinte et s’étendent autant à l’occident qu’à l’orient de ces montagnes [103] .
Le territoire occupé de nos jours par les vingt-quatre États de l’Union et les trois grands districts qui ne sont pas encore placés au nombre des États, quoiqu’ils aient déjà des habitants, couvre une superficie de 131,144 lieues carrées [104] , c’est-à-dire qu’il présente déjà une surface presque égale à cinq fois celle de la France. Dans ces limites se rencontrent un sol varié, des températures différentes et des produits très divers.
Cette grande étendue de territoire occupé par les républiques anglo-américaines a fait naître des doutes sur le maintien de leur union. Ici il faut distinguer : des intérêts contraires se créent quelquefois dans les différentes provinces d’un vaste empire, et finissent [II-344] par entrer en lutte : il arrive alors que la grandeur de l’État est ce qui compromet le plus sa durée. Mais si les hommes qui couvrent ce vaste territoire n’ont pas entre eux d’intérêts contraires, son étendue même doit servir à leur prospérité, car l’unité du gouvernement favorise singulièrement l’échange qui peut se faire des différents produits du sol, et en rendant leur écoulement plus facile, il en augmente la valeur.
Or, je vois bien dans les différentes parties de l’Union des intérêts différents, mais je n’en découvre pas qui soient contraires les uns aux autres.
Les États du Sud sont presque exclusivement cultivateurs ; les États du Nord sont, particulièrement manufacturiers et commerçants ; les États de l’Ouest sont en même temps manufacturiers et cultivateurs. Au Sud, on récolte du tabac, du riz, du coton et du sucre ; au Nord et à l’Ouest, du maïs et du blé. Voilà des sources diverses de richesses ; mais pour puiser dans ces sources, il y a un moyen commun et également favorable pour tous, c’est l’union.
Le Nord, qui charrie les richesses des Anglo-Américains dans toutes les parties du monde, et les richesses de l’univers dans le sein de l’Union, a un intérêt évident à ce que la confédération subsiste telle qu’elle est de nos jours, afin que le nombre des producteurs et des consommateurs américains qu’il est appelé à servir, reste le plus grand possible. Le Nord est l’entremetteur le plus naturel entre le Sud et l’Ouest de l’Union, d’une part, et de l’autre le reste du monde ; le Nord doit donc désirer que le Sud et l’Ouest restent unis et prospères, afin qu’ils [II-345] fournissent à ses manufactures des matières premières et du fret à ses vaisseaux.
Le Sud et l’Ouest ont, de leur côté, un intérêt plus direct encore à la conservation de l’Union et à la prospérité du Nord. Les produits du Sud s’exportent, en grande partie, au-delà des mers ; le Sud et l’Ouest ont donc besoin des ressources commerciales du Nord. Ils doivent vouloir que l’Union ait une grande puissance maritime pour pouvoir les protéger efficacement. Le Sud et l’Ouest doivent contribuer volontiers aux frais d’une marine, quoiqu’ils n’aient pas de vaisseaux ; car si les flottes de l’Europe venaient bloquer les ports du Sud et le delta du Mississipi, que deviendraient le riz des Carolines, le tabac de la Virginie, le sucre et le coton qui croissent dans les vallées du Mississipi ? Il n’y a donc pas une portion du budget fédéral qui ne s’applique à la conservation d’un intérêt matériel commun à tous les confédérés. .
Indépendamment de cette utilité commerciale, le Sud et l’Ouest de l’Union trouvent un grand avantage politique à rester unis entre eux et avec le Nord.
Le Sud renferme dans son sein une immense population d’esclaves, population menaçante dans le présent, plus menaçante encore dans l’avenir.
Les États de l’Ouest occupent le fond d’une seule vallée. Les fleuves qui arrosent le territoire de ces États, partant des montagnes Rocheuses ou des Alléghanys, viennent tous mêler leurs eaux à celles du Mississipi et roulent avec lui vers le golfe du Mexique. Les États de l’Ouest sont entièrement isolés, par leur [II-346] position, des traditions de l’Europe et de la civilisation de l’Ancien-Monde.
Les habitants du Sud doivent donc désirer de conserver l’Union, pour ne pas demeurer seuls en face des noirs, et les habitants de l’Ouest, afin de ne pas se trouver enfermés au sein de l’Amérique centrale sans communication libre avec l’univers.
Le Nord, de son côté, doit vouloir que l’Union ne se divise point, afin de rester comme l’anneau qui joint ce grand corps au reste du monde.
Il existe donc un lien étroit entre les intérêts matériels de toutes les parties de l’Union.
J’en dirai autant pour les opinions et les sentiments qu’on pourrait appeler les intérêts immatériels de l’homme.
Les habitants des États-Unis parlent beaucoup de leur amour pour la patrie ; j’avoue que je ne me fie point à ce patriotisme réfléchi qui se fonde sur l’intérêt et que l’intérêt, en changeant d’objet, peut détruire.
Je n’attache pas non plus une très grande importance au langage des Américains, lorsqu’ils manifestent chaque jour l’intention de conserver le système fédéral qu’ont adopté leurs pères.
Ce qui maintient un grand nombre de citoyens sous le même gouvernement, c’est bien moins la volonté raisonnée de demeurer unis, que l’accord instinctif et en quelque sorte involontaire qui résulte de la similitude des sentiments et de la ressemblance des opinions.
Je ne conviendrai jamais que des hommes forment [II-347] une société par cela seul qu’ils reconnaissent le même chef et obéissent aux mêmes lois ; il n’y a société que quand des hommes considèrent un grand nombre d’objets sous le même aspect ; lorsque, sur un grand nombre de sujets, ils ont les mêmes opinions ; quand enfin les mêmes faits font naître en eux les mêmes impressions et les mêmes pensées.
Celui qui, envisageant la question sous ce point de vue, étudierait ce qui se passe aux États-Unis, découvrirait sans peine que leurs habitants, divisés comme ils le sont en vingt-quatre souverainetés distinctes, constituent cependant un peuple unique ; et peut-être même arriverait-il à penser que l’état de société existe plus réellement au sein de l’Union anglo-américaine, que parmi certaines nations de l’Europe qui n’ont pourtant qu’une seule législation et se soumettent à un seul homme.
Quoique les Anglo-Américains aient plusieurs religions, ils ont tous la même manière d’envisager la religion.
Ils ne s’entendent pas toujours sur les moyens à prendre pour bien gouverner et varient sur quelques unes des formes qu’il convient de donner au gouvernement ; mais ils sont d’accord sur les principes généraux qui doivent régir les sociétés humaines. Du Maine aux Florides, du Missouri jusqu’à l’océan Atlantique, on croit que l’origine de tous les pouvoirs légitimes est dans le peuple. On conçoit les mêmes idées sur la liberté et l’égalité ; on professe les mêmes opinions sur la presse, le droit d’association, le jury, la responsabilité des agents du pouvoir.
Si nous passons des idées politiques et religieuses [II-348] aux opinions philosophiques et morales qui règlent les actions journalières de la vie et dirigent l’ensemble de la conduite, nous remarquerons le même accord.
Les Anglo-Américains [105] placent dans la raison universelle l’autorité morale, comme le pouvoir politique dans l’universalité des citoyens, et ils estiment que c’est au sens de tous qu’il faut s’en rapporter pour discerner ce qui est permis ou défendu, ce qui est vrai ou faux. La plupart d’entre eux pensent que la connaissance de son intérêt bien entendu suffit pour conduire l’homme vers le juste et l’honnête. Ils croient que chacun en naissant a reçu la faculté de se gouverner lui-même, et que nul n’a le droit de forcer son semblable à être heureux. Tous ont une foi vive dans la perfectibilité humaine ; ils jugent que la diffusion des lumières doit nécessairement produire des résultats utiles, l’ignorance amener des effets funestes ; tous considèrent la société comme un corps en progrès ; l’humanité comme un tableau changeant, où rien n’est et ne doit être fixe à toujours, et ils admettent que ce qui leur semble bien aujourd’hui peut demain être remplacé par le mieux qui se cache encore.
Je ne dis point que toutes ces opinions soient justes, mais elles sont américaines.
En même temps que les Anglo-Américains sont ainsi unis entre eux par des idées communes, ils sont [II-349] séparés de tous les autres peuples par un sentiment d’orgueil.
Depuis cinquante ans on ne cesse de répéter aux habitants des États-Unis qu’ils forment le seul peuple religieux, éclairé et libre. Ils voient que chez eux jusqu’à présent les institutions démocratiques prospèrent, tandis qu’elles échouent dans le reste du monde ; ils ont donc une opinion immense d’eux-mêmes, et ils ne sont pas éloignés de croire qu’ils forment une espèce à part dans le genre humain.
Ainsi donc les dangers dont l’Union américaine est menacée ne naissent pas plus de la diversité des opinions que de celle des intérêts. Il faut les chercher dans la variété des caractères et dans les passions des Américains.
Les hommes qui habitent l’immense territoire des États-Unis sont presque tous issus d’une souche commune ; mais à la longue le climat et surtout l’esclavage ont introduit des différences marquées entre le caractère des Anglais du sud des États-Unis et le caractère des Anglais du Nord.
On croit généralement parmi nous que l’esclavage donne à une portion de l’Union des intérêts contraires à ceux de l’autre. Je n’ai point remarqué qu’il en fût ainsi. L’esclavage n’a pas créé au Sud des intérêts contraires à ceux du Nord ; mais il a modifié le caractère des habitants du Sud, et leur a donné des habitudes différentes.
J’ai fait connaître ailleurs quelle influence avait exercée la servitude sur la capacité commerciale des Américains du Sud ; cette même influence s’étend également à leurs mœurs. [II-350] .
L’esclave est un serviteur qui ne discute point et se soumet à tout sans murmurer. Quelquefois il assassine son maître, mais il ne lui résiste jamais. Dans le Sud il n’y a pas de familles si pauvres qui n’aient des esclaves. L’Américain du Sud, dès sa naissance, se trouve investi d’une sorte de dictature domestique ; les premières notions qu’il reçoit de la vie lui font connaître qu’il est né pour commander, et la première habitude qu’il contracte est celle de dominer sans peine. L’éducation tend donc puissamment à faire de l’Américain du Sud un homme altier, prompt, irascible, violent, ardent dans ses désirs, impatient des obstacles ; mais facile à décourager s’il ne peut triompher du premier coup.
L’Américain du Nord ne voit pas d’esclaves accourir autour de son berceau. Il n’y rencontre même pas de serviteurs libres, car le plus souvent il en est réduit à pourvoir lui-même à ses besoins. À peine est-il au monde que l’idée de la nécessité vient de toutes parts se présenter à son esprit ; il apprend donc de bonne heure à connaître exactement par lui-même la limite naturelle de son pouvoir ; il ne s’attend point à plier par la force les volontés qui s’opposeront à la sienne, et il sait que, pour obtenir l’appui de ses semblables, il faut avant tout gagner leurs faveurs. Il est donc patient, réfléchi, tolérant, lent à agir, et persévérant dans ses desseins.
Dans les États méridionaux, les plus pressants besoins de l’homme sont toujours satisfaits. Ainsi l’Américain du Sud n’est point préoccupé par les soins matériels de la vie ; un autre se charge d’y songer pour lui. Libre sur ce point, son imagination se dirige vers [II-351] d’autres objets plus grands et moins exactement définis. L’Américain du Sud aime la grandeur, le luxe, la gloire, le bruit, les plaisirs, l’oisiveté surtout ; rien ne le contraint à faire des efforts pour vivre, et comme il n’a pas de travaux nécessaires, il s’endort et n’en entreprend même pas d’utiles.
L’égalité des fortunes régnant au Nord, et l’esclavage n’y existant plus, l’homme s’y trouve comme absorbé par ces mêmes soins matériels que le blanc dédaigne au Sud. Depuis son enfance il s’occupe à combattre la misère, et il apprend à placer l’aisance au-dessus de toutes les jouissances de l’esprit et du cœur. Concentrée dans les petits détails de la vie, son imagination s’éteint, ses idées sont moins nombreuses et moins générales, mais elles deviennent plus pratiques, plus claires et plus précises. Comme il dirige vers l’unique étude du bien-être tous les efforts de son intelligence, il ne tarde pas à y exceller ; il sait admirablement tirer parti de la nature et des hommes pour produire la richesse ; il comprend merveilleusement l’art de faire concourir la société à la prospérité de chacun de ses membres, et à extraire de l’égoïsme individuel le bonheur de tous.
L’homme du Nord n’a pas seulement de l’expérience, mais du savoir ; cependant il ne prise point la science comme un plaisir, il l’estime comme un moyen, et il n’en saisit avec avidité que les applications utiles.
L’Américain du Sud est plus spontané, plus spirituel, plus ouvert, plus généreux, plus intellectuel et plus brillant. [II-352] .
L’Américain du Nord est plus actif, plus raisonnable, plus éclairé et plus habile.
L’un a les goûts, les préjugés, les faiblesses et la grandeur de toutes les aristocraties.
L’autre, les qualités et les défauts qui caractérisent la classe moyenne.
Réunissez deux hommes en société, donnez à ces deux hommes les mêmes intérêts et en partie les mêmes opinions ; si leur caractère, leurs lumières et leur civilisation diffèrent, il y a beaucoup de chances pour qu’ils ne s’accordent pas. La même remarque est applicable à une société de nations.
L’esclavage n’attaque donc pas directement la confédération américaine par les intérêts, mais indirectement par les mœurs.
Les États qui adhérèrent au pacte fédéral en 1790 étaient au nombre de treize ; la confédération en compte vingt-quatre aujourd’hui. La population qui se montait à près de quatre millions en 1790, avait quadruplé dans l’espace de quarante ans ; elle s’élevait en 1830 à près de treize millions [106] .
De pareils changements ne peuvent s’opérer sans danger.
Pour une société de nations comme pour une société d’individus, il y a trois chances principales de durée : la sagesse des sociétaires, leur faiblesse individuelle, et leur petit nombre.
Les Américains qui s’éloignent des bords de l’océan Atlantique pour s’enfoncer dans l’Ouest sont des [II-353] aventuriers impatients de toute espèce de joug, avides de richesses, souvent rejetés par les États qui les ont vus naître. Ils arrivent au milieu du désert sans se connaître les uns les autres. Ils n’y trouvent pour les contenir ni traditions, ni esprit de famille, ni exemples. Parmi eux, l’empire des lois est faible, et celui des mœurs plus faible encore. Les hommes qui peuplent chaque jour les vallées du Mississipi sont donc inférieurs, à tous égards, aux Américains qui habitent dans les anciennes limites de l’Union. Cependant ils exercent déjà une grande influence dans ses conseils, et ils arrivent au gouvernement des affaires communes avant d’avoir appris à se diriger eux-mêmes [107] .
Plus les sociétaires sont individuellement faibles et plus la société a de chances de durée, car ils n’ont alors de sécurité qu’en restant unis. Quand, en 1790, la plus peuplée des républiques américaines n’avait pas 500,000 habitants [108] , chacune d’elles sentait son insignifiance comme peuple indépendant, et cette pensée lui rendait plus aisée l’obéissance à l’autorité fédérale. Mais lorsque l’un des États confédérés compte 2,000,000 d’habitants comme l’État de New-York, et couvre un territoire dont la superficie est égale au quart de celle de la France [109] , il se sent fort par lui-même, et s’il continue à désirer l’union comme utile à son bien-être, il ne la regarde plus comme nécessaire à son existence ; il peut se passer [II-354] d’elle ; et, consentant à y rester, il ne tarde pas à vouloir y être prépondérant.
La multiplication seule des membres de l’Union tendrait déjà puissamment à briser le lien fédéral. Tous les hommes placés dans le même point de vue n’envisagent pas de la même manière les mêmes objets. Il en est ainsi à plus forte raison quand le point de vue est différent. À mesure donc que le nombre des républiques américaines augmente, on voit diminuer la chance de réunir l’assentiment de toutes sur les mêmes lois.
Aujourd’hui les intérêts des différentes parties de l’Union ne sont pas contraires entre eux ; mais qui pourrait prévoir les changements divers qu’un avenir prochain fera naître dans un pays où chaque jour crée des villes et chaque lustre des nations ?.
Depuis que les colonies anglaises sont fondées, le nombre des habitants y double tous les vingt-deux ans à peu près ; je n’aperçois pas de causes qui doivent d’ici à un siècle arrêter ce mouvement progressif de la population anglo-américaine. Avant que cent ans se soient écoules, je pense que le territoire occupé ou réclamé par les États-Unis sera couvert par plus de cent millions d’habitants et divisé en quarante États [110] . [II-355] .
J’admets que ces cent millions d’hommes n’ont point d’intérêts différents ; je leur donne à tous, au contraire, un avantage égal à rester unis, et je dis que par cela même qu’ils sont cent millions formant quarante nations distinctes et inégalement puissantes, le maintien du gouvernement fédéral n’est plus qu’un accident heureux.
Je veux bien ajouter foi à la perfectibilité humaine ; mais jusqu’à ce que les hommes aient changé de nature et se soient complètement transformés, je refuserai de croire à la durée d’un gouvernement dont la tâche est de tenir ensemble quarante peuples divers répandus sur une surface égale à la moitié de l’Europe [111] , d’éviter entre eux les rivalités, l’ambition et les luttes, et de réunir l’action de leurs volontés indépendantes vers l’accomplissement des mêmes desseins.
Mais le plus grand péril que court l’Union en grandissant vient du déplacement continuel de forces qui s’opère dans son sein.
Des bords du lac Supérieur au golfe du Mexique, on compte, à vol d’oiseau, environ quatre cents lieues de France. Le long de cette ligne immense serpente la frontière des États-Unis ; tantôt elle rentre en dedans de ces limites, le plus souvent elle pénètre bien [II-356] au-delà parmi les déserts. On a calculé que sur tout ce vaste front les blancs s’avançaient chaque année, terme moyen, de sept lieues [112] . De temps en temps il se présente un obstacle : c’est un district improductif, un lac, une nation indienne qu’on rencontre inopinément sur son chemin. La colonne s’arrête alors un instant ; ses deux extrémités se courbent sur elles-mêmes et, après qu’elles se sont rejointes, on recommence à s’avancer. Il y a dans cette marche graduelle et continue de la race européenne vers les montagnes Rocheuses quelque chose de providentiel : c’est comme un déluge d’hommes qui monte sans cesse et que soulève chaque jour la main de Dieu.
Au dedans de cette première ligne de conquérants, on bâtit des villes et on fonde de vastes États. En 1790, il se trouvait à peine quelques milliers de pionniers répandus dans les vallées du Mississipi ; aujourd’hui ces mêmes vallées contiennent autant d’hommes qu’en renfermait l’Union tout entière en 1790. La population s’y élève à près de quatre millions d’habitants [113] . La ville de Washington a été fondée en 1800, au centre même de la confédération américaine ; maintenant, elle se trouve placée à l’une de ses extrémités. Les députés des derniers États de l’Ouest [114] , pour venir occuper leur siège au congrès, sont déjà obligés de faire un trajet aussi long que le voyageur qui se rendrait de Vienne à Paris. [II-357] .
Tous les États de l’Union sont entraînés en même temps vers la fortune ; mais tous ne sauraient croître et prospérer dans la même proportion.
Au nord de l’Union, des rameaux détachés de la chaîne des Alléghanys s’avançant jusque dans l’océan Atlantique, y forment des rades spacieuses et des ports toujours ouverts aux plus grands vaisseaux. À partir de la Potomac, au contraire, et en suivant les côtes de l’Amérique jusqu’à l’embouchure du Mississipi, on ne rencontre plus qu’un terrain plat et sablonneux. Dans cette partie de l’Union, la sortie de presque tous les fleuves est obstruée, et les ports qui s’ouvrent de loin en loin au milieu de ces lagunes ne présentent point aux vaisseaux la même profondeur, et offrent au commerce des facilités beaucoup moins grandes que ceux du Nord.
À cette première infériorité qui naît de la nature, s’en joint une autre qui vient des lois.
Nous avons vu que l’esclavage, qui est aboli au Nord, existe encore au Midi, et j’ai montré l’influence funeste qu’il exerce sur le bien-être du maître lui-même.
Le Nord doit donc être plus commerçant [115] et plus [II-358] industrieux que le Sud. Il est naturel que la population et la richesse s’y portent plus rapidement,.
Les États situés sur le bord de l’océan Atlantique sont déjà à moitié peuplés. La plupart des terres y ont un maître ; ils ne sauraient donc recevoir le même nombre d’émigrants que les États de l’Ouest qui livrent encore un champ sans bornes à l’industrie. Le bassin du Mississipi est infiniment plus fertile que les côtes de l’océan Atlantique. Cette raison, ajoutée à toutes les autres, pousse énergiquement les Européens vers l’Ouest. Ceci se démontre rigoureusement par des chiffres.
Si l’on opère sur l’ensemble des États-Unis, on trouve que, depuis quarante ans, le nombre des habitants y est à peu près triplé. Mais si on n’envisage que le bassin du Mississipi, on découvre que, dans le même espace de temps, la population [116] y est devenue trente et une fois plus grande [117] .
Chaque jour, le centre de la puissance fédérale se [II-359] déplace. Il y a quarante ans, la majorité des citoyens de l’Union était sur les bords de la mer, aux environs de l’endroit où s’élève aujourd’hui Washington ; maintenant elle se trouve plus enfoncée dans les terres et plus au Nord ; on ne saurait douter qu’avant vingt ans elle ne soit de l’autre côté des Alléghanys. L’Union subsistant, le bassin du Mississipi, par sa fertilité et son étendue, est nécessairement appelé à devenir le centre permanent de la puissance fédérale. Dans trente ou quarante ans, le bassin du Mississipi aura pris son rang naturel. Il est facile de calculer qu’alors sa population, comparée à celle des États placés sur les bords de l’Atlantique, sera dans les proportions de 40 à 11 à peu près. Encore quelques années, la direction de l’Union échappera donc complétement aux États qui l’ont fondée, et la population des vallées du Mississipi dominera dans les conseils fédéraux.
Cette gravitation continuelle des forces et de l’influence fédérale vers le Nord-Ouest se révèle tous les dix ans, lorsque après avoir fait un recensement général de la population on fixe de nouveau le nombre des représentants que chaque État doit envoyer au congrès [118] . [II-360] .
En 1790, la Virginie avait dix-neuf représentants au congrès. Ce nombre a continué à croître jusqu’en 1813, où on le vit atteindre le chiffre de vingt-trois. Depuis cette époque, il a commencé à diminuer. Il n’était plus en 1833 que de vingt et un [119] . Pendant cette même période, l’État de New-York suivait une progression contraire : en 1790, il avait au congrès dix représentants ; en 1813, vingt-sept ; en 1823, trente-quatre ; en 1833, quarante. L’Ohio n’avait qu’un seul représentant en 1803 ; en 1833 il en comptait dix-neuf.
Il est difficile de concevoir une union durable entre deux peuples dont l’un est pauvre et faible, l’autre riche et fort, alors même qu’il serait prouvé que la [II-361] force et la richesse de l’un ne sont point la cause de la faiblesse et de la pauvreté de l’autre. L’union est plus difficile encore à maintenir dans le temps où l’un perd des forces et où l’autre est en train d’en acquérir.
Cet accroissement rapide et disproportionné de certains États menace l’indépendance des autres. Si New-York, avec ses deux millions d’habitants et ses quarante représentants, voulait faire la loi au congrès, il y parviendrait peut-être. Mais alors même que les États les plus puissants ne chercheraient point à opprimer les moindres, le danger existerait encore, car il est dans la possibilité du fait presque autant que dans le fait lui-même.
Les faibles ont rarement confiance dans la justice et la raison des forts. Les États qui croissent moins vite que les autres jettent donc des regards de méfiance et d’envie vers ceux que la fortune favorise. De là ce profond malaise et cette inquiétude vague qu’on remarque dans une partie de l’Union, et qui contrastent avec le bien-être et la confiance qui règnent dans l’autre. Je pense que l’attitude hostile qu’a prise le Sud n’a point d’autres causes.
Les hommes du Sud sont, de tous les Américains, ceux qui devraient tenir le plus à l’Union, car ce sont eux surtout qui souffriraient d’être abandonnés à eux-mêmes ; cependant ils sont les seuls qui menacent de briser le faisceau de la confédération. D’où vient cela ? Il est facile de le dire : le Sud, qui a fourni quatre présidents à la confédération [120] , qui sait aujourd’hui que la puissance fédérale lui échappe, qui, chaque année, voit diminuer le nombre de ses représentants [II-362] au congrès et croître ceux du Nord et de l’Ouest ; le Sud, peuplé d’hommes ardents et irascibles, s’irrite et s’inquiète. Il tourne avec chagrin ses regards sur lui-même ; interrogeant le passé, il se demande chaque jour s’il n’est point opprimé. Vient-il à découvrir qu’une loi de l’Union ne lui est pas évidemment favorable, il s’écrie qu’on abuse à son égard de la force ; il réclame avec ardeur, et si sa voix n’est point écoutée, il s’indigne, et menace de se retirer d’une société dont il a les charges sans avoir les profits.
« Les lois du tarif, disaient les habitants de la Caroline en 1832, enrichissent le Nord et ruinent le Sud ; car, sans cela, comment pourrait-on concevoir que le Nord, avec son climat inhospitalier et son sol aride, augmentât sans cesse ses richesses et son pouvoir, tandis que le Sud, qui forme comme le jardin de l’Amérique, tombe rapidement en décadence [121] ? ».
Si les changements dont j’ai parlé s’opéraient graduellement, de manière que chaque génération ait au moins le temps de passer avec l’ordre de choses dont elle a été le témoin, le danger serait moindre ; mais il y a quelque chose de précipité, je pourrais presque dire de révolutionnaire, dans les progrès que fait la société en Amérique. Le même citoyen a pu voir son État marcher à la tête de l’Union et devenir ensuite impuissant dans les conseils fédéraux. Il y a telle république anglo-américaine qui a grandi aussi vite qu’un homme, et qui est née, a crû et est arrivée à maturité en trente ans. [II-363] .
Il ne faut pas s’imaginer cependant que les États qui perdent la puissance se dépeuplent ou dépérissent ; leur prospérité ne s’arrête point ; ils croissent même plus promptement qu’aucun royaume de l’Europe [122] . Mais il leur semble qu’ils s’appauvrissent, parce qu’ils ne s’enrichissent pas si vite que leur voisin, et ils croient perdre leur puissance parce qu’ils entrent tout-à-coup en contact avec une puissance plus grande que la leur [123] : ce sont donc leurs sentiments et leurs passions qui sont blessés plus que leurs intérêts. Mais n’en est-ce point assez pour que la confédération soit en péril ? Si, depuis le commencement du monde, les peuples et les rois n’avaient eu en vue que leur utilité réelle, on saurait à peine ce que c’est que la guerre parmi les hommes.
Ainsi le plus grand danger qui menace les États-Unis naît de leur prospérité même ; elle tend à créer chez plusieurs des confédérés l’enivrement qui accompagne l’augmentation rapide de la fortune, et, [II-364] chez les autres, l’envie, la méfiance et les regrets qui en suivent le plus souvent la perte.
Les Américains se réjouissent en contemplant ce mouvement extraordinaire ; ils devraient, ce me semble, l’envisager avec regret et avec crainte. Les Américains des États-Unis, quoi qu’ils fassent, deviendront un des plus grands peuples du monde ; ils couvriront de leurs rejetons presque toute l’Amérique du Nord ; le continent qu’ils habitent est leur domaine, il ne saurait leur échapper. Qui les presse donc de s’en mettre en possession dès aujourd’hui ? la richesse, la puissance et la gloire ne peuvent leur manquer un jour, et ils se précipitent vers cette immense fortune comme s’il ne leur restait qu’un moment pour s’en saisir.
Je crois avoir démontré que l’existence de la confédération actuelle dépendait entièrement de l’accord de tous les confédérés à vouloir rester unis ; et, partant de cette donnée, j’ai recherché quelles étaient les causes qui pouvaient porter les différents États à vouloir se séparer. Mais il y a pour l’Union deux manières de périr : l’un des États confédérés peut vouloir se retirer du contrat et briser violemment ainsi le lien commun ; c’est à ce cas que se rapportent la plupart des remarques que j’ai faites ci-devant ; le gouvernement fédéral peut perdre progressivement sa puissance par une tendance simultanée des républiques unies à reprendre l’usage de leur indépendance. Le pouvoir central, privé successivement de toutes ses prérogatives, réduit par un accord tacite à l’impuissance, deviendrait inhabile à remplir son [II-365] objet, et la seconde Union périrait comme la première par une sorte d’imbécillité sénile.
L’affaiblissement graduel du lien fédéral, qui conduit finalement à l’annulation de l’Union, est d’ailleurs en lui-même un fait distinct qui peut amener beaucoup d’autres résultats moins extrêmes avant de produire celui-là. La confédération existerait encore, que déjà la faiblesse de son gouvernement pourrait réduire la nation à l’impuissance, causer l’anarchie au-dedans et le ralentissement de la prospérité générale du pays.
Après avoir recherché ce qui porte les Anglo-Américains à se désunir, il est donc important d’examiner si, l’Union subsistant, leur gouvernement agrandit la sphère de son action ou la resserre, s’il devient plus énergique ou plus faible.
Les Américains sont évidemment préoccupés d’une grande crainte. Ils s’aperçoivent que chez la plupart des peuples du monde, l’exercice des droits de la souveraineté tend à se concentrer en peu de mains, et ils s’effrayent à l’idée qu’il finira par en être ainsi chez eux. Les hommes d’État eux-mêmes éprouvent ces terreurs, ou du moins feignent de les éprouver ; car en Amérique, la centralisation n’est point populaire, et on ne saurait courtiser plus habilement la majorité qu’en s’élevant contre les prétendus empiétements du pouvoir central. Les Américains refusent de voir que dans les pays où se manifeste cette tendance centralisante qui les effraie, on ne rencontre qu’un seul peuple, tandis que l’Union est une confédération de peuples différents ; fait qui suffit pour déranger toutes les prévisions fondées sur l’analogie. [II-366] .
J’avoue que je considère ces craintes d’un grand nombre d’Américains comme entièrement imaginaires. Loin de redouter avec eux la consolidation de la souveraineté dans les mains de l’Union, je crois que le gouvernement fédéral s’affaiblit d’une manière visible.
Pour prouver ce que j’avance sur ce point, je n’aurai pas recours à des faits anciens, mais à ceux dont j’ai pu être le témoin, ou qui ont eu lieu de notre temps.
Quand on examine attentivement ce qui se passe aux États-Unis, on découvre sans peine l’existence de deux tendances contraires ; ce sont comme deux courants qui parcourent le même lit en sens opposé.
Depuis quarante-cinq ans que l’Union existe, le temps a fait justice d’une foule de préjugés provinciaux qui d’abord militaient contre elle. Le sentiment patriotique qui attachait chacun des Américains à son État est devenu moins exclusif. En se connaissant mieux, les diverses parties de l’Union se sont rapprochées. La poste, ce grand lien des esprits, pénètre aujourd’hui jusque dans le fond des déserts [124] ; des bateaux à vapeur font communiquer entre eux chaque jour tous les points de la côte. Le commerce descend et remonte les fleuves de l’intérieur avec une rapidité sans exemple [125] . À ces facilités que la nature [II-367] et l’art ont créées, se joignent l’instabilité des désirs, l’inquiétude de l’esprit, l’amour des richesses, qui, poussant sans cesse l’Américain hors de sa demeure, le mettent en communication avec un grand nombre de ses concitoyens. Il parcourt son pays en tous sens ; il visite toutes les populations qui l’habitent. On ne rencontre pas de province de France dont les habitants se connaissent aussi parfaitement entre eux que les 13,000,000 d’hommes qui couvrent la surface des États-Unis.
En même temps que les Américains se mêlent, ils s’assimilent ; les différences que le climat, l’origine et les institutions avaient mises entre eux diminuent. Ils se rapprochent tous de plus en plus d’un type commun. Chaque année, des milliers d’hommes partis du Nord se répandent dans toutes les parties de l’Union : ils apportent avec eux leurs croyances, leurs opinions, leurs mœurs ; et comme leurs lumières sont supérieures à celles des hommes parmi lesquels ils vont vivre, ils ne tardent pas à s’emparer des affaires et à modifier la société à leur profit. Cette émigration continuelle du Nord vers le Midi favorise singulièrement la fusion de tous les caractères provinciaux dans un seul caractère national. La civilisation du Nord semble donc destinée à devenir la mesure commune sur laquelle tout le reste doit se régler un jour.
À mesure que l’industrie des Américains fait des progrès, on voit se resserrer les liens commerciaux [II-368] qui unissent tous les États confédérés, et l’union entre dans les habitudes après avoir été dans les opinions. Le temps, en marchant, achève de faire disparaître une foule de terreurs fantastiques qui tourmentaient l’imagination des hommes de 1789. Le pouvoir fédéral n’est point devenu oppresseur ; il n’a pas détruit l’indépendance des États ; il ne conduit pas les confédérés à la monarchie ; avec l’Union, les petits États ne sont pas tombés dans la dépendance des grands. La confédération a continué à croître sans cesse en population, en richesse, en pouvoir.
Je suis donc convaincu que de notre temps les Américains ont moins de difficultés naturelles à vivre unis, qu’ils n’en trouvèrent en 1789 ; l’Union a moins d’ennemis qu’alors.
Et, cependant, si l’on veut étudier avec soin l’histoire des États-Unis depuis quarante-cinq ans, on se convaincra sans peine que le pouvoir fédéral décroît.
Il n’est pas difficile d’indiquer les causes de ce phénomène.
Au moment où la constitution de 1789 fut promulguée, tout périssait dans l’anarchie ; l’Union qui succéda à ce désordre excitait beaucoup de crainte et de haine ; mais elle avait d’ardents amis, parce qu’elle était l’expression d’un grand besoin. Quoique plus attaqué alors qu’il ne l’est aujourd’hui, le pouvoir fédéral atteignit donc rapidement le maximum de son pouvoir, ainsi qu’il arrive d’ordinaire à un gouvernement qui triomphe après avoir exalté ses forces dans la lutte. À cette époque, l’interprétation de la constitution sembla étendre plutôt que resserrer la souveraineté fédérale, et l’Union présenta sous [II-369] plusieurs rapports le spectacle d’un seul et même peuple, dirigé, au-dedans comme au-dehors, par un seul gouvernement.
Mais pour en arriver à ce point, le peuple s’était mis en quelque sorte au-dessus de lui-même.
La constitution n’avait pas détruit l’individualité des États, et tous les corps, quels qu’ils soient, ont un instinct secret qui les porte vers l’indépendance. Cet instinct est plus prononcé encore dans un pays comme l’Amérique, où chaque village forme une sorte de république habituée à se gouverner elle-même.
Il y eut donc effort de la part des États qui se soumirent à la prépondérance fédérale. Et tout effort, fût-il couronné d’un grand succès, ne peut manquer de s’affaiblir avec la cause qui le fait naître.
À mesure que le gouvernement fédéral affermissait son pouvoir, l’Amérique reprenait son rang parmi les nations, la paix renaissait sur les frontières, le crédit public se relevait ; à la confusion succédait un ordre fixe et qui permettait à l’industrie individuelle de suivre sa marche naturelle et de se développer en liberté.
Ce fut cette prospérité même qui commença à faire perdre de vue la cause qui l’avait produite ; le péril passé, les Américains ne trouvèrent plus en eux l’énergie et le patriotisme qui avaient aidé à le conjurer. Délivrés des craintes qui les préoccupaient, ils rentrèrent aisément dans le cours de leurs habitudes, et s’abandonnèrent sans résistance à la tendance ordinaire de leurs penchants. Du moment où un gouvernement fort ne parut plus nécessaire, on recommença à penser qu’il était gênant. Tout prospérait avec [II-370] l’Union, et l’on ne se détacha point de l’Union ; mais on voulut sentir à peine l’action du pouvoir qui la représentait. En général, on désira rester uni, et dans chaque fait particulier on tendit à redevenir indépendant. Le principe de la confédération fut chaque jour plus facilement admis et moins appliqué ; ainsi le gouvernement fédéral, en créant l’ordre et la paix, amena lui-même sa décadence.
Dès que cette disposition des esprits commença à se manifester au-dehors, les hommes de parti, qui vivent des passions du peuple, se mirent à l’exploiter à leur profit.
Le gouvernement fédéral se trouva dès lors dans une situation très critique ; ses ennemis avaient la faveur populaire, et c’est en promettant de l’affaiblir qu’on obtenait le droit de le diriger.
À partir de cette époque, toutes les fois que le gouvernement de l’Union est entré en lice avec celui des États, il n’a presque jamais cessé de reculer. Quand il y a eu lieu d’interpréter les termes de la constitution fédérale, l’interprétation a été le plus souvent contraire à l’Union et favorable aux États.
La Constitution donnait au gouvernement fédéral le soin de pourvoir aux intérêts nationaux : on avait pensé que c’était à lui à faire ou à favoriser, dans l’intérieur, les grandes entreprises qui étaient de nature à accroître la prospérité de l’Union tout entière (internal improvements), telles, par exemple, que les canaux.
Les États s’effrayèrent à l’idée de voir une autre autorité que la leur disposer ainsi d’une portion de leur territoire. Ils craignirent que le pouvoir central, [II-371] acquérant de cette manière dans leur propre sein un patronage redoutable, ne vînt à y exercer une influence qu’ils voulaient réserver tout entière à leurs seuls agents.
Le parti démocratique, qui a toujours été opposé à tous les développements de la puissance fédérale, éleva donc la voix ; on accusa le congrès d’usurpation ; le chef de l’État, d’ambition. Le gouvernement central, intimidé par ces clameurs, finit par reconnaître lui-même son erreur, et par se renfermer exactement dans la sphère qu’on lui traçait.
La constitution donne à l’Union le privilège de traiter avec les peuples étrangers. L’Union avait en général considéré sous ce point de vue les tribus indiennes qui bordent les frontières de son territoire. Tant que ces sauvages consentirent à fuir devant la civilisation, le droit fédéral ne fut pas contesté ; mais du jour où une tribu indienne entreprit de se fixer sur un point du sol, les États environnants réclamèrent un droit de possession sur ces terres, et un droit de souveraineté sur les hommes qui en faisaient partie. Le gouvernement central se hâta de reconnaître l’un et l’autre, et, après avoir traité avec les Indiens comme avec des peuples indépendants, il les livra comme des sujets à la tyrannie législative des États [126] .
Parmi les États qui s’étaient formés sur le bord de l’Atlantique, plusieurs s’étendaient indéfiniment à l’Ouest dans des déserts où les Européens n’avaient [II-372] point encore pénétré. Ceux dont les limites étaient irrévocablement fixées voyaient d’un œil jaloux l’avenir immense ouvert à leurs voisins. Ces derniers, dans un esprit de conciliation, et afin de faciliter l’acte d’Union, consentirent à se tracer des limites, et abandonnèrent à la confédération tout le territoire qui pouvait se trouver au-delà [127] .
Depuis cette époque, le gouvernement fédéral est devenu propriétaire de tout le terrain inculte qui se rencontre en dehors des treize États primitivement confédérés. C’est lui qui se charge de le diviser et de le vendre, et l’argent qui en revient est versé exclusivement dans le trésor de l’Union. À l’aide de ce revenu, le gouvernement fédéral achète aux Indiens leurs terres, ouvre des routes dans les nouveaux districts, et y facilite de tout son pouvoir le développement rapide de la société.
Or, il est arrivé que dans ces mêmes déserts cédés jadis par les habitants des bords de l’Atlantique se sont formés avec le temps de nouveaux États. Le congrès a continué à vendre, au profit de la nation tout entière, les terres incultes que ces États renferment encore dans leur sein. Mais aujourd’hui ceux-ci prétendent qu’une fois constitués, ils doivent avoir le droit exclusif d’appliquer le produit de ces ventes à leur propre usage. Les réclamations étant devenues de plus en plus menaçantes, le congrès crut [II-373] devoir enlever à l’Union une partie des priviléges dont elle avait joui jusqu’alors, et à la fin de 1832, il fit une loi par laquelle, sans céder aux nouvelles républiques de l’Ouest la propriété de leurs terres incultes, il appliquait cependant à leur profit seul la plus grande partie du revenu qu’on en tirait [128] .
Il suffit de parcourir les États-Unis pour apprécier les avantages que le pays retire de la Banque. Ces avantages sont de plusieurs sortes ; mais il en est un surtout qui frappe l’étranger : les billets de la Banque des États-Unis sont reçus à la frontière des déserts pour la même valeur qu’à Philadelphie, où est le siège de ses opérations [129] .
La Banque des États-Unis est cependant l’objet de grandes haines. Ses directeurs se sont prononcés contre le Président, et on les accuse, non sans vraisemblance, d’avoir abusé de leur influence pour entraver son élection. Le Président attaque donc l’institution que ces derniers représentent avec toute l’ardeur d’une inimitié personnelle. Ce qui a encouragé le Président à poursuivre ainsi sa vengeance, c’est qu’il se sent appuyé sur les instincts secrets de la majorité.
La Banque forme le grand lien monétaire de l’Union comme le Congrès en est le grand lien législatif, et les [II-374] mêmes passions qui tendent à rendre les États indépendants du pouvoir central tendent à la destruction de la Banque.
La Banque des États-Unis possède toujours en ses mains un grand nombre de billets appartenant aux banques provinciales ; elle peut chaque jour obliger ces dernières à rembourser leurs billets en espèces. Pour elle au contraire un pareil danger n’est point à craindre ; la grandeur de ses ressources disponibles lui permet de faire face à toutes les exigences. Menacées ainsi dans leur existence, les banques provinciales sont forcées d’user de retenue, et de ne mettre dans la circulation qu’un nombre de billets proportionné à leur capital. Les banques provinciales ne souffrent qu’avec impatience ce contrôle salutaire. Les journaux qui leur sont vendus, et le président que son intérêt a rendu leur organe, attaquent donc la Banque avec une sorte de fureur. Ils soulèvent contre elle les passions locales et l’aveugle instinct démocratique du pays. Suivant eux, les directeurs de la Banque forment un corps aristocratique et permanent dont l’influence ne peut manquer de se faire sentir dans le gouvernement, et doit altérer tôt ou tard les principes d’égalité sur lesquels repose la société américaine.
La lutte de la Banque contre ses ennemis n’est qu’un incident du grand combat que livrent en Amérique les provinces au pouvoir central ; l’esprit d’indépendance et de démocratie, à l’esprit de hiérarchie et de subordination. Je ne prétends point que les ennemis de la Banque des États-Unis soient précisément les mêmes individus qui, sur d’autres points, [II-375] attaquent le gouvernement fédéral ; mais je dis que les attaques contre la Banque des États-Unis sont le produit des mêmes instincts qui militent contre le gouvernement fédéral, et que le grand nombre des ennemis de la première est un symptôme fâcheux de l’affaiblissement du second.
Mais jamais l’Union ne se montra plus débile que dans la fameuse affaire du tarif [130] .
Les guerres de la révolution française et celle de 1812, en empêchant la libre communication entre l’Amérique et l’Europe, avaient créé des manufactures au Nord de l’Union. Lorsque la paix eut rouvert aux produits de l’Europe le chemin du Nouveau-Monde, les Américains crurent devoir établir un système de douanes qui pût tout à la fois protéger leur industrie naissante, et acquitter le montant des dettes que la guerre leur avait fait contracter.
Les États du Sud, qui n’ont pas de manufactures à encourager, et qui ne sont que cultivateurs, ne tardèrent pas à se plaindre de cette mesure.
Je ne prétends point examiner ici ce qu’il pouvait y avoir d’imaginaire ou de réel dans leurs plaintes, je dis les faits.
Dès l’année 1820, la Caroline du Sud, dans une pétition au Congrès, déclarait que la loi du tarif était inconstitutionnelle, oppressive et injuste. Depuis, la Géorgie, la Virginie, la Caroline du Nord, l’État de l’Alabama et celui du Mississipi firent des réclamations plus ou moins énergiques dans le même sens. [II-376] .
Loin de tenir compte de ces murmures, le congrès, dans les années 1824 et 1828, éleva encore les droits du tarif et en consacra de nouveau le principe.
Alors on produisit, ou plutôt on rappela au Sud une doctrine célèbre qui prit le nom de nullification.
J’ai montré en son lieu que le but de la constitution fédérale n’a point été d’établir une ligue, mais de créer un gouvernement national. Les Américains des États-Unis, dans tous les cas prévus par leur constitution, ne forment qu’un seul et même peuple. Sur tous ces points-là, la volonté nationale s’exprime, comme chez tous les peuples constitutionnels, à l’aide d’une majorité. Une fois que la majorité a parlé, le devoir de la minorité est de se soumettre.
Telle est la doctrine légale, la seule qui soit d’accord avec le texte de la Constitution et l’intention connue de ceux qui l’établirent.
Les nullificateurs du Sud prétendent au contraire que les Américains, en s’unissant, n’ont point entendu se fondre dans un seul et même peuple, mais qu’ils ont seulement voulu former une ligue de peuples indépendants ; d’où il suit que chaque État ayant conservé sa souveraineté complète, sinon en action du moins en principe, a le droit d’interpréter les lois du Congrès, et de suspendre dans son sein l’exécution de celles qui lui semblent opposées à la constitution ou à la justice.
Toute la doctrine de la nullification se trouve résumée dans une phrase prononcée en 1833 devant le sénat des États-Unis par M. Calhoun, le chef avoué des nullificateurs du Sud :.
« La Constitution, dit-il, est un contrat dans lequel [II-377] les États ont paru comme souverains. Or, toutes les fois qu’il intervient un contrat entre des parties qui ne connaissent point de commun arbitre, chacune d’elles retient le droit de juger par elle-même l’étendue de son obligation. ».
Il est manifeste qu’une pareille doctrine détruit en principe le lien fédéral, et ramène en fait l’anarchie, dont la constitution de 1789 avait délivré les Américains.
Lorsque la Caroline du Sud vit que le congrès se montrait sourd à ses plaintes, elle menaça d’appliquer à la loi fédérale du tarif la doctrine des nullificateurs. Le congrès persista dans son système ; enfin l’orage éclata.
Dans le courant de 1832, le peuple de la Caroline du Sud [131] nomma une convention nationale pour aviser aux moyens extraordinaires qui restaient à prendre ; et le 24 novembre de la même année, cette convention publia, sous le nom d’ordonnance, une loi qui frappait de nullité la loi fédérale du tarif, défendait de prélever les droits qui y étaient portés, et de recevoir les appels qui pourraient être faits aux tribunaux fédéraux [132] . Cette ordonnance ne devait [II-378] être mise en vigueur qu’au mois de février suivant, et il était indiqué que si le Congrès modifiait avant cette époque le tarif, la Caroline du Sud pourrait consentir à ne pas donner d’autres suites à ses menaces. Plus tard, on exprima, mais d’une manière vague et indéterminée, le désir de soumettre la question à une assemblée extraordinaire de tous les États confédérés.
En attendant, la Caroline du Sud armait ses milices et se préparait à la guerre.
Que fit le congrès ? Le congrès, qui n’avait pas écouté ses sujets suppliants, prêta l’oreille à leurs plaintes dès qu’il leur vit les armes à la main [133] . Il fit une loi [134] suivant laquelle les droits portés au tarif devaient être réduits progressivement pendant dix ans, jusqu’à ce qu’on les eût amenés à ne pas dépasser les besoins du gouvernement. Ainsi le congrès abandonna complètement le principe du tarif. À un droit protecteur de l’industrie, il substitua une mesure [II-379] purement fiscale [135] . Pour dissimuler sa défaite, le gouvernement de l’Union eut recours à un expédient qui est fort à l’usage des gouvernements faibles : en cédant sur les faits, il se montra inflexible sur les principes. En même temps que le congrès changeait la législation du tarif, il passait une autre loi en vertu de laquelle le président était investi d’un pouvoir extraordinaire pour surmonter par la force les résistances qui dès lors n’étaient plus à craindre.
La Caroline du Sud ne consentit même pas à laisser à l’Union ces faibles apparences de la victoire ; la même convention nationale qui avait frappé de nullité la loi du tarif s’étant assemblée de nouveau, accepta la concession qui lui était offerte ; mais en même temps, elle déclara n’en persister qu’avec plus de force dans la doctrine des nullificateurs, et pour le prouver, elle annula la loi qui conférait des pouvoirs extraordinaires au président, quoiqu’il fût bien certain qu’on n’en ferait point usage.
Presque tous les actes dont je viens de parler ont eu lieu sous la présidence du général Jackson. On ne saurait nier que, dans l’affaire du tarif, ce dernier n’ait soutenu avec habileté et vigueur les droits de l’Union. Je crois cependant qu’il faut mettre au nombre des dangers que court aujourd’hui le pouvoir fédéral la conduite même de celui qui le représente.
Quelques personnes se sont formé en Europe, sur l’influence que peut exercer le général Jackson dans les affaires de son pays, une opinion qui paraît fort extravagante à ceux qui ont vu les choses de près. [II-380] .
On a entendu dire que le général Jackson avait gagné des batailles, que c’était un homme énergique, porté par caractère et par habitude à l’emploi de la force, désireux du pouvoir et despote par goût. Tout cela est peut-être vrai, mais les conséquences qu’on a tirées de ces vérités sont de grandes erreurs.
On s’est imaginé que le général Jackson voulait établir aux États-Unis la dictature, qu’il allait y faire régner l’esprit militaire, et donner au pouvoir central une extension dangereuse pour les libertés provinciales. En Amérique, le temps de semblables entreprises et le siècle de pareils hommes ne sont point encore venus : si le général Jackson eût voulu dominer de cette manière, il eût assurément perdu sa position politique et compromis sa vie : aussi n’a-t-il pas été assez imprudent pour le tenter.
Loin de vouloir étendre le pouvoir fédéral, le président actuel représente, au contraire, le parti qui veut restreindre ce pouvoir aux termes les plus clairs et les plus précis de la constitution, et qui n’admet point que l’interprétation puisse jamais être favorable au gouvernement de l’Union ; loin de se présenter comme le champion de la centralisation, le général Jackson est l’agent des jalousies provinciales ; ce sont les passions décentralisantes (si je puis m’exprimer ainsi) qui l’ont porté au souverain pouvoir. C’est en flattant chaque jour ces passions qu’il s’y maintient et y prospère. Le général Jackson est l’esclave de la majorité : il la suit dans ses volontés, dans ses désirs, dans ses instincts à moitié découverts, ou plutôt il la devine et court se placer à sa tête.
Toutes les fois que le gouvernement des États [II-381] entre en lutte avec celui de l’Union, il est rare que le président ne soit pas le premier à douter de son droit ; il devance presque toujours le pouvoir législatif ; quand il y a lieu à interprétation sur l’étendue de la puissance fédérale, il se range en quelque sorte contre lui-même ; il s’amoindrit, il se voile, il s’efface. Ce n’est point qu’il soit naturellement faible ou ennemi de l’Union ; lorsque la majorité s’est prononcée contre les prétentions des nullificateurs du Sud, on l’a vu se mettre à sa tête, formuler avec netteté et énergie les doctrines qu’elle professait et en appeler le premier à la force. Le général Jackson, pour me servir d’une comparaison empruntée au vocabulaire des partis américains, me semble fédéral par goût et républicain par calcul.
Après s’être ainsi abaissé devant la majorité pour gagner sa faveur, le général Jackson se relève ; il marche alors vers les objets qu’elle poursuit elle-même, ou ceux qu’elle ne voit pas d’un œil jaloux, en renversant devant lui tous les obstacles. Fort d’un appui que n’avaient point ses prédécesseurs, il foule aux pieds ses ennemis personnels partout où il les trouve, avec une facilité qu’aucun président n’a rencontrée ; il prend sous sa responsabilité des mesures que nul n’aurait jamais avant lui osé prendre ; il lui arrive même de traiter la représentation nationale avec une sorte de dédain presque insultant ; il refuse de sanctionner les lois du congrès, et souvent omet de répondre à ce grand corps. C’est un favori qui parfois rudoie son maître. Le pouvoir du général Jackson augmente donc sans cesse ; mais celui du président diminue. Dans ses mains, le gouvernement [II-382] fédéral est fort ; il passera énervé à son successeur.
Ou je me trompe étrangement, ou le gouvernement fédéral des États-Unis tend chaque jour à s’affaiblir ; il se retire successivement des affaires, il resserre de plus en plus le cercle de son action. Naturellement faible, il abandonne même les apparences de la force. D’une autre part, j’ai cru voir qu’aux États-Unis le sentiment de l’indépendance devenait de plus en plus vif dans les États, l’amour du gouvernement provincial de plus en plus prononcé.
On veut l’Union ; mais réduite à une ombre : on la veut forte en certains cas et faible dans tous les autres ; on prétend qu’en temps de guerre elle puisse réunir dans ses mains les forces nationales et toutes les ressources du pays, et qu’en temps de paix elle n’existe pour ainsi dire point ; comme si cette alternative de débilité et de vigueur était dans la nature.
Je ne vois rien qui puisse, quant à présent, arrêter ce mouvement général des esprits ; les causes qui l’ont fait naître ne cessent point d’opérer dans le même sens. Il se continuera donc, et l’on peut prédire que, s’il ne survient pas quelque circonstance extraordinaire, le gouvernement de l’Union ira chaque jour s’affaiblissant.
Je crois cependant que nous sommes encore loin du temps où le pouvoir fédéral, incapable de protéger sa propre existence et de donner la paix au pays, s’éteindra en quelque sorte de lui-même. L’Union est dans les mœurs, on la désire ; ses résultats sont vidents, ses bienfaits visibles. Quand on s’apercevra que la faiblesse du gouvernement fédéral compromet l’existence de l’Union, je ne doute point qu’on [II-383] ne voie naître un mouvement de réaction en faveur de la force.
Le gouvernement des États-Unis est, de tous les gouvernements fédéraux qui ont été établis jusqu’à nos jours, celui qui est le plus naturellement destiné à agir : tant qu’on ne l’attaquera pas d’une manière indirecte par l’interprétation de ses lois, tant qu’on n’altérera pas profondément sa substance, un changement d’opinion, une crise intérieure, une guerre, pourraient lui redonner tout à coup la vigueur dont il a besoin.
Ce que j’ai voulu constater est seulement ceci : bien des gens, parmi nous, pensent qu’aux États-Unis il y a un mouvement des esprits qui favorise la centralisation du pouvoir dans les mains du Président et du congrès. Je prétends qu’on y remarque visiblement un mouvement contraire. Loin que le gouvernement fédéral, en vieillissant, prenne de la force et menace la souveraineté des États, je dis qu’il tend chaque jour à s’affaiblir, et que la souveraineté seule de l’Union est en péril. Voilà ce que le présent révèle. Quel sera le résultat final de cette tendance, quels événements peuvent arrêter, retarder ou hâter le mouvement que j’ai décrit ? L’avenir les cache, et je n’ai pas la prétention de pouvoir soulever son voile. [II-384] .
DES INSTITUTIONS RÉPUBLICAINES AUX ÉTATS-UNIS, QUELLES SONT LEURS CHANCES DE DURÉE.
L’Union n’est qu’un accident. — Les institutions républicaines ont plus d’avenir. — La république est, quant à présent, l’état naturel des Anglo-Américains. — Pourquoi. — Afin de la détruire il faudrait changer en même temps toutes les lois et modifier toutes les mœurs. — Difficultés que trouvent les Américains à créer une aristocratie.
Le démembrement de l’Union, en introduisant la guerre au sein des États aujourd’hui confédérés, et avec elle les armées permanentes, la dictature et les impôts, pourrait à la longue y compromettre le sort des institutions républicaines.
Il ne faut pas confondre cependant l’avenir de la république et celui de l’Union.
L’Union est un accident qui ne durera qu’autant que les circonstances le favoriseront, mais la république me semble l’état naturel des Américains ; et il n’y a que l’action continue de causes contraires et agissant toujours dans le même sens qui pût lui substituer la monarchie.
L’Union existe principalement dans la loi qui l’a créée. Une seule révolution, un changement dans l’opinion publique peut la briser pour jamais. La république a des racines plus profondes.
Ce qu’on entend par république aux États-Unis, c’est l’action lente et tranquille de la société sur elle-même. C’est un état régulier fondé réellement sur la volonté éclairée du peuple. C’est un gouvernement conciliateur, où les résolutions se mûrissent longuement, se discutent avec lenteur et s’exécutent avec maturité. [II-385] .
Les républicains, aux États-Unis, prisent les mœurs, respectent les croyances, reconnaissent les droits. Ils professent cette opinion, qu’un peuple doit être moral, religieux et modéré, en proportion qu’il est libre. Ce qu’on appelle la république aux États-Unis, c’est le règne tranquille de la majorité. La majorité, après qu’elle a eu le temps de se reconnaître et de constater son existence, est la source commune des pouvoirs. Mais la majorité elle-même n’est pas toute-puissante. Au-dessus d’elle, dans le monde moral, se trouvent l’humanité, la justice et la raison ; dans le monde politique, les droits acquis. La majorité reconnaît ces deux barrières, et s’il lui arrive de les franchir, c’est qu’elle a des passions, comme chaque homme, et que, semblable à eux, elle peut faire le mal en discernant le bien.
Mais nous avons fait en Europe d’étranges découvertes.
La république, suivant quelques-uns d’entre nous, ce n’est pas le règne de la majorité, comme on l’a cru jusqu’ici, c’est le règne de ceux qui se portent fort pour la majorité. Ce n’est pas le peuple qui dirige dans ces sortes de gouvernements, mais ceux qui savent le plus grand bien du peuple : distinction heureuse, qui permet d’agir au nom des nations sans les consulter, et de réclamer leur reconnaissance en les foulant aux pieds. Le gouvernement républicain est, du reste, le seul auquel il faille reconnaître le droit de tout faire, et qui puisse mépriser ce qu’ont jusqu’à présent respecté les hommes, depuis les plus hautes lois de la morale jusqu’aux règles vulgaires du sens commun. [II-386] .
On avait pensé, jusqu’à nous, que le despotisme était odieux, quelles que fussent ses formes. Mais on a découvert de nos jours qu’il y avait dans le monde des tyrannies légitimes et de saintes injustices, pourvu qu’on les exerçât au nom du peuple.
Les idées que les Américains se sont faites de la république leur en facilitent singulièrement l’usage et assurent sa durée. Chez eux, si la pratique du gouvernement républicain est souvent mauvaise, du moins la théorie est bonne, et le peuple finit toujours par y conformer ses actes.
Il était impossible, dans l’origine, et il serait encore très difficile d’établir en Amérique une administration centralisée. Les hommes sont dispersés sur un trop grand espace et séparés par trop d’obstacles naturels pour qu’un seul puisse entreprendre de diriger les détails de leur existence. L’Amérique est donc par excellence le pays du gouvernement provincial et communal.
À cette cause, dont l’action se faisait également sentir sur tous les Européens du Nouveau Monde, les Anglo-Américains en ajoutèrent plusieurs autres qui leur étaient particulières.
Lorsque les colonies de l’Amérique du Nord furent établies, la liberté municipale avait déjà pénétré dans les lois ainsi que dans les mœurs anglaises, et les émigrants anglais l’adoptèrent non seulement comme une chose nécessaire, mais comme un bien dont ils connaissaient tout le prix.
Nous avons vu, de plus, de quelle manière les colonies avaient été fondées. Chaque province, et pour ainsi dire chaque district, fut peuplé séparément [II-387] par des hommes étrangers les uns aux autres, ou associés dans des buts différents.
Les Anglais des États-Unis se sont donc trouvés, dès l’origine, divisés en un grand nombre de petites sociétés distinctes qui ne se rattachaient à aucun centre commun, et il a fallu que chacune de ces petites sociétés s’occupât de ses propres affaires, puisqu’on n’apercevait nulle part une autorité centrale qui dût naturellement et qui pût facilement y pourvoir.
Ainsi la nature du pays, la manière même dont les colonies anglaises ont été fondées, les habitudes des premiers émigrants, tout se réunissait pour y développer à un degré extraordinaire les libertés communales et provinciales.
Aux États-Unis, l’ensemble des institutions du pays est donc essentiellement républicain ; pour y détruire d’une façon durable les lois qui fondent la république, il faudrait en quelque sorte abolir à la fois toutes les lois.
Si, de nos jours, un parti entreprenait de fonder la monarchie aux États-Unis, il serait dans une position encore plus difficile que celui qui voudrait proclamer dès à présent la république en France. La royauté ne trouverait point la législation préparée d’avance pour elle, et ce serait bien réellement alors qu’on verrait une monarchie entourée d’institutions républicaines.
Le principe monarchique pénétrerait aussi difficilement dans les mœurs des Américains.
Aux États-Unis, le dogme de la souveraineté du peuple n’est point une doctrine isolée qui ne tienne ni aux habitudes, ni à l’ensemble des idées [II-388] dominantes ; on peut, au contraire, l’envisager comme le dernier anneau d’une chaîne d’opinions qui enveloppe le monde anglo-américain tout entier. La Providence a donné à chaque individu, quel qu’il soit, le degré de raison nécessaire pour qu’il puisse se diriger lui-même dans les choses qui l’intéressent exclusivement. Telle est la grande maxime sur laquelle, aux États-Unis, repose la société civile et politique : le père de famille en fait l’application à ses enfants, le maître à ses serviteurs, la commune à ses administrés, la province aux communes, l’État aux provinces, l’Union aux États. Étendue à l’ensemble de la nation, elle devient le dogme de la souveraineté du Peuple.
Ainsi, aux États-Unis, le principe générateur de la république est le même qui règle la plupart des actions humaines. La république pénètre donc, si je puis m’exprimer ainsi, dans les idées, dans les opinions et dans toutes les habitudes des Américains en même temps qu’elle s’établit dans leurs lois ; et pour arriver à changer les lois, il faudrait qu’ils en vinssent à se changer en quelque sorte tout entiers. Aux États-Unis, la religion du plus grand nombre elle-même est républicaine ; elle soumet les vérités de l’autre monde à la raison individuelle, comme la politique abandonne au bon sens de tous le soin des intérêts de celui-ci, et elle consent que chaque homme prenne librement la voie qui doit le conduire au ciel, de la même manière que la loi reconnaît à chaque citoyen le droit de choisir son gouvernement.
Évidemment, il n’y a qu’une longue série de faits ayant tous la même tendance, qui puisse substituer à cet ensemble de lois, d’opinions et de mœurs, un [II-389] ensemble de mœurs, d’opinions et de lois contraires.
Si les principes républicains doivent périr en Amérique, ils ne succomberont qu’après un long travail social, fréquemment interrompu, souvent repris ; plusieurs fois ils sembleront renaître, et ne disparaîtront sans retour que quand un peuple entièrement nouveau aura pris la place de celui qui existe de nos jours. Or, rien ne saurait faire présager une semblable révolution, aucun signe ne l’annonce.
Ce qui vous frappe le plus à votre arrivée aux États-Unis, c’est l’espèce de mouvement tumultueux au sein duquel se trouve placée la société politique. Les lois changent sans cesse, et au premier abord il semble impossible qu’un peuple si peu sûr de ses volontés n’en arrive pas bientôt à substituer à la forme actuelle de son gouvernement une forme entièrement nouvelle. Ces craintes sont prématurées. Il y a, en fait d’institutions politiques, deux espèces d’instabilités qu’il ne faut pas confondre : l’une s’attache aux lois secondaires ; celle-là peut régner long-temps au sein d’une société bien assise ; l’autre ébranle sans cesse les bases mêmes de la constitution, et attaque les principes générateurs des lois ; celle-ci est toujours suivie de troubles et de révolutions ; la nation qui la souffre est dans un état violent et transitoire. L’expérience fait connaître que ces deux espèces d’instabilités législatives n’ont pas entre elles de lien nécessaire, car on les a vues exister conjointement ou séparément suivant les temps et les lieux. La première se rencontre aux États-Unis, mais non la seconde. Les Américains changent fréquemment les lois, mais le fondement de la constitution est respecté. [II-390] .
De nos jours, le principe républicain règne en Amérique comme le principe monarchique dominait en France sous Louis XIV. Les Français d’alors n’étaient pas seulement amis de la monarchie, mais encore ils n’imaginaient pas qu’on pût rien mettre à la place ; ils l’admettaient ainsi qu’on admet le cours du soleil et les vicissitudes des saisons. Chez eux le pouvoir royal n’avait pas plus d’avocats que d’adversaires.
C’est ainsi que la république existe en Amérique, sans combat, sans opposition, sans preuve, par un accord tacite, une sorte de consensus universalis.
Toutefois, je pense qu’en changeant aussi souvent qu’ils le font leurs procédés administratifs, les habitants des États-Unis compromettent l’avenir du gouvernement républicain.
Gênés sans cesse dans leurs projets par la versatilité continuelle de la législation, il est à craindre que les hommes ne finissent par considérer la république comme une façon incommode de vivre en société ; le mal résultant de l’instabilité des lois secondaires ferait alors mettre en question l’existence des lois fondamentales, et amènerait indirectement une révolution ; mais cette époque est encore bien loin de nous.
Ce qu’on peut prévoir dès à présent, c’est qu’en sortant de la république, les Américains passeraient rapidement au despotisme, sans s’arrêter très long-temps dans la monarchie. Montesquieu a dit qu’il n’y avait rien de plus absolu que l’autorité d’un prince qui succède à la république, les pouvoirs indéfinis qu’on avait livrés sans crainte à un magistrat électif se trouvant alors remis dans les mains d’un chef héréditaire. Ceci est généralement vrai, mais particulièrement [II-391] applicable à une république démocratique. Aux États-Unis, les magistrats ne sont pas élus par une classe particulière de citoyens, mais par la majorité de la nation ; ils représentent immédiatement les passions de la multitude, et dépendent entièrement de ses volontés ; ils n’inspirent donc ni haine ni crainte : aussi j’ai fait remarquer le peu de soins qu’on avait pris de limiter leur pouvoir en traçant des bornes à son action, et quelle part immense on avait laissée à leur arbitraire. Cet ordre de choses a créé des habitudes qui lui survivraient. Le magistrat américain garderait sa puissance indéfinie en cessant d’être responsable, et il est impossible de dire ou s’arrêterait alors la tyrannie.
Il y a des gens parmi nous qui s’attendent à voir l’aristocratie naître en Amérique, et qui prévoient déjà avec exactitude l’époque où elle doit s’emparer du pouvoir.
J’ai déjà dit, et je répète, que le mouvement actuel de la société américaine me semble de plus en plus démocratique.
Cependant je ne prétends point qu’un jour les Américains n’arrivent pas à restreindre chez eux le cercle des droits politiques, ou à confisquer ces mêmes droits au profit d’un homme ; mais je ne puis croire qu’ils en confient jamais l’usage exclusif à une classe particulière de citoyens, ou, en d’autres termes, qu’ils fondent une aristocratie.
Un corps aristocratique se compose d’un certain nombre de citoyens qui, sans être placés très loin de la foule, s’élèvent cependant d’une manière permanente au-dessus d’elle ; qu’on touche et qu’on ne peut [II-392] frapper ; auxquels on se mêle chaque jour, et avec lesquels on ne saurait se confondre.
Il est impossible de rien imaginer de plus contraire à la nature et aux instincts secrets du cœur humain qu’une sujétion de cette espèce : livrés à eux-mêmes, les hommes préféreront toujours le pouvoir arbitraire d’un roi à l’administration régulière des nobles.
Une aristocratie, pour durer, a besoin de fonder l’inégalité en principe, de la légaliser d’avance, et de l’introduire dans la famille en même temps qu’elle la répand dans la société ; toutes choses qui répugnent si fortement à l’équité naturelle, qu’on ne saurait les obtenir des hommes que par la contrainte.
Depuis que les sociétés humaines existent, je ne crois pas qu’on puisse citer l’exemple d’un seul peuple qui, livré à lui-même et par ses propres efforts, ait créé une aristocratie dans son sein : toutes les aristocraties du moyen-âge sont filles de la conquête. Le vainqueur était le noble, le vaincu le serf. La force imposait alors l’inégalité, qui, une fois entrée dans les mœurs, se maintenait d’elle-même et passait naturellement dans les lois.
On a vu des sociétés qui, par suite d’événements antérieurs à leur existence, sont pour ainsi dire nées aristocratiques, et que chaque siècle ramenait ensuite vers la démocratie. Tel fut le sort des Romains, et celui des barbares qui s’établirent après eux. Mais un peuple qui, parti de la civilisation et de la démocratie, se rapprocherait par degrés de l’inégalité des conditions, et finirait par établir dans son sein des privilèges inviolables et des catégories exclusives, voilà ce qui serait nouveau dans le monde. [II-393] .
Rien n’indique que l’Amérique soit destinée à donner la première un pareil spectacle.
QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR LES CAUSES DE LA GRANDEUR COMMERCIALE DES ÉTATS-UNIS.
Les Américains sont appelés par la nature à être un grand peuple maritime. — Étendue de leurs rivages. - Profondeur des ports. — Grandeur des fleuves. C’est cependant bien moins à des causes physiques qu’à des causes intellectuelles et morales qu’on doit attribuer la supériorité commerciale des Anglo-Américains. — Raison de cette opinion. — Avenir des Anglo-Américains comme peuple commerçant. — La ruine de l’Union n’arrêterait point l’essor maritime des peuples qui la composent. — Pourquoi. — Les Anglo-Américains sont naturellement appelés à servir les besoins des habitants de l’Amérique du Sud. — Ils deviendront, comme les Anglais, les facteurs d’une grande partie du monde.
Depuis la baie de Fondy jusqu’à la rivière Sabine dans le golfe du Mexique, la côte des États-Unis s’étend sur une longueur de 900 lieues à peu près.
Ces rivages forment une seule ligne non interrompue ; ils sont tous placés sous la même domination.
Il n’y a pas de peuple au monde qui puisse offrir au commerce des ports plus profonds, plus vastes et plus sûrs que les Américains.
Les habitants des États-Unis composent une grande nation civilisée que la fortune a placée au milieu des déserts, à 1,200 lieues du foyer principal de la civilisation. L’Amérique a donc un besoin journalier de l’Europe. Avec le temps, les Américains parviendront sans doute à produire ou à fabriquer chez eux la plupart des objets qui leur sont nécessaires, mais jamais les deux continents ne pourront vivre entièrement indépendants l’un de l’autre : il existe trop de liens [II-394] naturels entre leurs besoins, leurs idées, leurs habitudes et leurs mœurs.
L’Union a des productions qui nous sont devenues nécessaires, et que notre sol se refuse entièrement à fournir, ou ne peut donner qu’à grands frais. Les Américains ne consomment qu’une très petite partie de ces produits ; ils nous vendent le reste.
L’Europe est donc le marché de l’Amérique, comme l’Amérique est le marché de l’Europe ; et le commerce maritime est aussi nécessaire aux habitants des États-Unis pour amener leurs matières premières dans nos ports que pour transporter chez eux nos objets manufacturés.
Les États-Unis devaient donc fournir un grand aliment à l’industrie des peuples maritimes, s’ils renonçaient eux-mêmes au commerce, comme l’ont fait jusqu’à présent les Espagnols du Mexique ; ou devenir une des premières puissances maritimes du globe : cette alternative était inévitable.
Les Anglo-Américains ont de tout temps montré un goût décidé pour la mer. L’indépendance, en brisant les liens commerciaux qui les unissaient à l’Angleterre, donna à leur génie maritime un nouvel et puissant essor. Depuis cette époque, le nombre des vaisseaux de l’Union s’est accru dans une progression presque aussi rapide que le nombre de ses habitants. Aujourd’hui ce sont les Américains eux-mêmes qui transportent chez eux les neuf dixièmes des produits de l’Europe [136] . Ce sont encore des Américains qui [II-395] apportent aux consommateurs d’Europe les trois quarts des exportations du Nouveau Monde [137] .
Les vaisseaux des États-Unis remplissent le port du Havre et celui de Liverpool. On ne voit qu’un petit nombre de bâtiments anglais ou français dans le port de New-York [138] .
Ainsi non seulement le commerçant américain brave la concurrence sur son propre sol, mais il combat encore avec avantage les étrangers sur le leur.
Ceci s’explique aisément : de tous les vaisseaux du monde, ce sont les navires des États-Unis qui traversent les mers au meilleur marché. Tant que la marine marchande des États-Unis conservera sur les autres cet avantage, non seulement elle gardera ce qu’elle a conquis, mais elle augmentera chaque jour ses conquêtes.
C’est un problème difficile à résoudre que celui de [II-396] savoir pourquoi les Américains naviguent à plus bas prix que les autres hommes : on est tenté d’abord d’attribuer cette supériorité à quelques avantages matériels que la nature aurait mis à leur seule portée, mais il n’en est point ainsi.
Les vaisseaux américains coûtent presque aussi cher à bâtir que les nôtres [139] ; ils ne sont pas mieux construits, et durent en général moins long-temps.
Le salaire du matelot américain est plus élevé que celui du matelot d’Europe ; ce qui le prouve, c’est le grand nombre d’Européens qu’on rencontre dans la marine marchande des États-Unis.
D’où vient donc que les Américains naviguent à meilleur marché que nous ?.
Je pense qu’on chercherait vainement les causes de cette supériorité dans des avantages matériels ; elle tient à des qualités purement intellectuelles et morales.
Voici une comparaison qui éclaircira ma pensée :.
Pendant les guerres de la révolution, les Français introduisirent dans l’art militaire une tactique nouvelle qui troubla les plus vieux généraux et faillit détruire les plus anciennes monarchies de l’Europe. Ils entreprirent pour la première fois de se passer d’une foule de choses qu’on avait jusqu’alors jugées indispensables à la guerre ; ils exigèrent de leurs soldats des efforts nouveaux que les nations policées n’avaient jamais demandés aux leurs ; on les vit tout faire en courant, et risquer sans hésiter la vie des hommes en vue du résultat à obtenir.
Les Français étaient moins nombreux et moins [II-397] riches que leurs ennemis ; ils possédaient infiniment moins de ressources ; cependant ils furent constamment victorieux, jusqu’à ce que ces derniers eussent pris le parti de les imiter.
Les Américains ont introduit quelque chose d’analogue dans le commerce. Ce que les Français faisaient pour la victoire, ils le font pour le bon marché.
Le navigateur européen ne s’aventure qu’avec prudence sur les mers ; il ne part que quand le temps l’y convie ; s’il lui survient un accident imprévu, il rentre au port ; la nuit, il serre une partie de ses voiles, et lorsqu’il voit l’Océan blanchir à l’approche des terres, il ralentit sa course et interroge le soleil.
L’Américain néglige ces précautions et brave ces dangers. Il part tandis que la tempête gronde encore ; la nuit comme le jour il abandonne au vent toutes ses voiles ; il répare en marchant son navire fatigué par l’orage, et lorsqu’il approche enfin du terme de sa course, il continue à voler vers le rivage, comme si déjà il apercevait le port.
L’Américain fait souvent naufrage ; mais il n’y a pas de navigateur qui traverse les mers aussi rapidement que lui. Faisant les mêmes choses qu’un autre en moins de temps, il peut les faire à moins de frais.
Avant de parvenir au terme d’un voyage de long cours, le navigateur d’Europe croit devoir aborder plusieurs fois sur son chemin. Il perd un temps précieux à chercher le port de relâche ou à attendre l’occasion d’en sortir, et il paye chaque jour le droit d’y rester.
Le navigateur américain part de Boston pour aller [II-398] acheter du thé à la Chine. Il arrive à Canton, y reste quelques jours et revient. Il a parcouru en moins de deux ans la circonférence entière du globe, et il n’a vu la terre qu’une seule fois. Durant une traversée de huit ou dix mois, il a bu de l’eau saumâtre et a vécu de viande salée ; il a lutté sans cesse contre la mer, contre la maladie, contre l’ennui ; mais à son retour, il peut vendre la livre de thé un sou de moins que le marchand anglais : le but est atteint.
Je ne saurais mieux exprimer ma pensée qu’en disant que les Américains mettent une sorte d’héroïsme dans leur manière de faire le commerce.
Il sera toujours très difficile au commerçant d’Europe de suivre dans la même carrière son concurrent d’Amérique. L’Américain, en agissant de la manière que j’ai décrite plus haut, ne suit pas seulement un calcul, il obéit surtout à sa nature.
L’habitant des États-Unis éprouve tous les besoins et tous les désirs qu’une civilisation avancée fait naître, et il ne trouve pas autour de lui, comme en Europe, une société savamment organisée pour y satisfaire ; il est donc souvent obligé de se procurer par lui-même les objets divers que son éducation et ses habitudes lui ont rendus nécessaires. En Amérique, il arrive quelquefois que le même homme laboure son champ, bâtit sa demeure, fabrique ses outils, fait ses souliers et tisse de ses mains l’étoffe grossière qui doit le couvrir. Ceci nuit au perfectionnement de l’industrie, mais sert puissamment à développer l’intelligence de l’ouvrier. Il n’y a rien qui tende plus que la grande division du travail à matérialiser l’homme et à ôter de ses œuvres jusqu’à la trace de l’âme. Dans [II-399] un pays comme l’Amérique, où les hommes spéciaux sont si rares, on ne saurait exiger un long apprentissage de chacun de ceux qui embrassent une profession. Les Américains trouvent donc une grande facilité à changer d’état, et ils en profitent, suivant les besoins du moment. On en rencontre qui ont été successivement avocats, agriculteurs, commerçants, ministres évangéliques, médecins. Si l’Américain est moins habile que l’Européen dans chaque industrie, il n’y en a presque point qui lui soit entièrement étrangère. Sa capacité est plus générale, le cercle de son intelligence est plus étendu. L’habitant des États-Unis n’est donc jamais arrêté par aucun axiome d’état ; il échappe à tous les préjugés de profession ; il n’est pas plus attaché à un système d’opération qu’à un autre ; il ne se sent pas plus lié à une méthode ancienne qu’à une nouvelle ; il ne s’est créé aucune habitude, et il se soustrait aisément à l’empire que les habitudes étrangères pourraient exercer sur son esprit, car il sait que son pays ne ressemble à aucun autre, et que sa situation est nouvelle dans le monde.
L’Américain habite une terre de prodiges ; autour de lui tout se remue sans cesse, et chaque mouvement semble un progrès. L’idée du nouveau se lie donc intimement dans son esprit à l’idée du mieux. Nulle part il n’aperçoit la borne que la nature peut avoir mise aux efforts de l’homme ; à ses yeux, ce qui n’est pas est ce qui n’a point encore été tenté.
Ce mouvement universel qui règne aux États-Unis, ces retours fréquents de la fortune, ce déplacement imprévu des richesses publiques et privées, tout se réunit pour entretenir l’âme dans une sorte d’agitation [II-400] fébrile qui la dispose admirablement à tous les efforts, et la maintient pour ainsi dire au-dessus du niveau commun de l’humanité. Pour un Américain, la vie entière se passe comme une partie de jeu, un temps de révolution, un jour de bataille.
Ces mêmes causes opérant en même temps sur tous les individus, finissent par imprimer une impulsion irrésistible au caractère national. L’Américain pris au hasard doit donc être un homme ardent dans ses désirs, entreprenant, aventureux, surtout novateur. Cet esprit se retrouve, en effet, dans toutes ses œuvres ; il l’introduit dans ses lois politiques, dans ses doctrines religieuses, dans ses théories d’économie sociale, dans son industrie privée ; il le porte partout avec lui, au fond des bois comme au sein des villes. C’est ce même esprit qui, appliqué au commerce maritime, fait naviguer l’Américain plus vite et à meilleur marché que tous les commerçants du monde.
Aussi long-temps que les marins des États-Unis garderont ces avantages intellectuels et la supériorité pratique qui en dérive, non seulement ils continueront à pourvoir eux-mêmes aux besoins des producteurs et des consommateurs de leur pays, mais ils tendront de plus en plus à devenir, comme les Anglais [140] , les facteurs des autres peuples.
Ceci commence à se réaliser sous nos yeux. Déjà [II-401] nous voyons les navigateurs américains s’introduire comme agents intermédiaires dans le commerce de plusieurs nations de l’Europe [141] ; l’Amérique leur offre un avenir plus grand encore.
Les Espagnols et les Portugais ont fondé dans l’Amérique du Sud de grandes colonies qui, depuis, sont devenues des empires. La guerre civile et le despotisme désolent aujourd’hui ces vastes contrées. Le mouvement de la population s’y arrête, et le petit nombre d’hommes qui les habite, absorbé dans le soin de se défendre, éprouve à peine le besoin d’améliorer son sort.
Mais il ne saurait en être toujours ainsi. L’Europe, livrée à elle-même est parvenue par ses propres efforts à percer les ténèbres du moyen-âge ; l’Amérique du Sud est chrétienne comme nous ; elle a nos lois, nos usages ; elle renferme tous les germes de civilisation qui se sont développés au sein des nations européennes et de leurs rejetons ; l’Amérique du Sud a de plus que nous notre exemple : pourquoi resterait-elle toujours barbare ?.
Il ne s’agit évidemment ici que d’une question de temps : une époque plus ou moins éloignée viendra sans doute où les Américains du Sud formeront des nations florissantes et éclairées.
Mais lorsque les Espagnols et les Portugais de l’Amérique méridionale commenceront à éprouver les besoins des peuples policés, ils seront encore loin de pouvoir y satisfaire eux-mêmes ; derniers nés de la civilisation, ils subiront la supériorité déjà acquise [II-402] par leurs aînés. Ils seront agriculteurs long-temps avant d’être manufacturiers et commerçants, et ils auront besoin de l’entremise des étrangers pour aller vendre leurs produits au-delà des mers, et se procurer en échange les objets dont la nécessité nouvelle se fera sentir.
On ne saurait douter que les Américains du nord de l’Amérique ne soient appelés à pourvoir un jour aux besoins des Américains du Sud. La nature les a placés près d’eux. Elle leur a ainsi fourni de grandes facilités pour connaître et apprécier les besoins des premiers, pour lier avec ces peuples des relations permanentes et s’emparer graduellement de leur marché. Le commerçant des États-Unis ne pourrait perdre ces avantages naturels, que s’il était fort inférieur au commerçant d’Europe, et il lui est au contraire supérieur en plusieurs points. Les Américains des États-Unis exercent déjà une grande influence morale sur tous les peuples du Nouveau-Monde. C’est d’eux que part la lumière. Toutes les nations qui habitent sur le même continent sont déjà habituées à les considérer comme les rejetons les plus éclairés, les plus puissants et les plus riches de la grande famille américaine. Ils tournent donc sans cesse vers l’Union leurs regards, et ils s’assimilent, autant que cela est en leur pouvoir, aux peuples qui la composent. Chaque jour ils viennent puiser aux États-Unis des doctrines politiques et y emprunter des lois.
Les Américains des États-Unis se trouvent vis-à-vis des peuples de l’Amérique du Sud précisément dans la même situation que leurs pères les Anglais vis-à-vis des Italiens, des Espagnols, des Portugais et de [II-403] tous ceux des peuples de l’Europe qui, étant moins avancés en civilisation et en industrie, reçoivent de leurs mains la plupart des objets de consommation.
L’Angleterre est aujourd’hui le foyer naturel du commerce de presque toutes les nations qui l’approchent ; l’Union américaine est appelée à remplir le même rôle dans l’autre hémisphère. Chaque peuple qui naît ou qui grandit dans le Nouveau-Monde y naît donc et y grandit en quelque sorte au profit des Anglo-Américains.
Si l’Union venait à se dissoudre, le commerce des États qui l’ont formée serait sans doute retardé quelque temps dans son essor, moins toutefois qu’on ne le pense. Il est évident que, quoi qu’il arrive, les États commerçants resteront unis. Ils se touchent tous ; il y a entre eux identité parfaite d’opinions, d’intérêts et de mœurs, et seuls ils peuvent composer une très grande puissance maritime. Alors même que le Sud de l’Union deviendrait indépendant du Nord, il n’en résulterait pas qu’il pût se passer de lui. J’ai dit que le Sud n’est pas commerçant ; rien n’indique encore qu’il doive le devenir. Les Américains du Sud des États-Unis seront donc obligés pendant long-temps d’avoir recours aux étrangers pour exporter leurs produits et apporter chez eux les objets qui sont nécessaires à leurs besoins. Or, de tous les intermédiaires qu’ils peuvent prendre, leurs voisins du Nord sont à coup sûr ceux qui peuvent les servir à meilleur marché. Ils les serviront donc, car le bon marché est la loi suprême du commerce. Il n’y a pas de volonté souveraine ni de préjugés nationaux qui puissent lutter longtemps contre le bon marché. On ne saurait [II-404] voir de haine plus envenimée que celle qui existe entre les Américains des États-Unis et les Anglais. En dépit de ces sentiments hostiles, les Anglais fournissent cependant aux Américains la plupart des objets manufacturés, par la seule raison qu’ils les font payer moins cher que les autres peuples. La prospérité croissante de l’Amérique tourne ainsi, malgré le désir des Américains, au profit de l’industrie manufacturière de l’Angleterre.
La raison indique et l’expérience prouve qu’il n’y a pas de grandeur commerciale qui soit durable, si elle ne peut s’unir, au besoin, à une puissance militaire.
Cette vérité est aussi bien comprise aux États-Unis que partout ailleurs. Les Américains sont déjà en état de faire respecter leur pavillon ; bientôt ils pourront le faire craindre.
Je suis convaincu que le démembrement de l’Union, loin de diminuer les forces navales des Américains, tendrait fortement à les augmenter. Aujourd’hui les États commerçants sont liés à ceux qui ne le sont pas, et ces derniers ne se prêtent souvent qu’à regret à accroître une puissance maritime dont ils ne profitent qu’indirectement.
Si au contraire tous les États commerçants de l’Union ne formaient qu’un seul et même peuple, le commerce deviendrait pour eux un intérêt national du premier ordre ; ils seraient donc disposés à faire de très grands sacrifices pour protéger leurs vaisseaux, et rien ne les empêcherait de suivre sur ce point leurs désirs.
Je pense que les nations, comme les hommes, indiquent presque toujours, dès leur jeune âge, les [II-405] principaux traits de leur destinée. Quand je vois de quel esprit les Anglo-Américains mènent le commerce, les facilités qu’ils trouvent à le faire, les succès qu’ils y obtiennent, je ne puis m’empêcher de croire qu’ils deviendront un jour la première puissance maritime du globe. Ils sont poussés à s’emparer des mers, comme les Romains à conquérir le monde.
CONCLUSION.↩
Voici que j’approche du terme. Jusqu’à présent, en parlant de la destinée future des États-Unis, je me suis efforcé de diviser mon sujet en diverses parties, afin d’étudier avec plus de soin chacune d’elles.
Je voudrais maintenant les réunir toutes dans un seul point de vue. Ce que je dirai sera moins détaillé, mais plus sûr. J’apercevrai moins distinctement chaque objet ; j’embrasserai avec plus de certitude les faits généraux. Je serai comme le voyageur qui, en sortant des murs d’une vaste cité, gravit la colline prochaine. A mesure qu’il s’éloigne, les hommes qu’il vient de quitter disparaissent à ses yeux ; leurs demeures se confondent ; il ne voit plus les places publiques ; il discerne avec peine la trace des rues ; mais son œil suit plus aisément les contours de la ville, et pour la première fois, il en saisit la forme. Il me semble que je découvre de même devant moi l’avenir entier de la race anglaise dans le Nouveau-Monde. Les détails de cet immense tableau sont restés dans l’ombre ; mais mon regard en comprend l’ensemble, et je conçois une idée claire du tout. [II-406] .
Le territoire occupé ou possédé de nos jours par les États-Unis d’Amérique, forme à peu près la vingtième partie des terres habitées.
Quelque étendues que soient ces limites, on aurait tort de croire que la race anglo-américaine s’y renfermera toujours ; elle s’étend déjà bien au-delà.
Il fut un temps où nous aussi nous pouvions créer dans les déserts américains une grande nation française et balancer avec les Anglais les destinées du Nouveau-Monde. La France a possédé autrefois dans l’Amérique du Nord un territoire presque aussi vaste que l’Europe entière. Les trois plus grands fleuves du continent coulaient alors tout entiers sous nos lois. Les nations indiennes qui habitent depuis l’embouchure du Saint-Laurent jusqu’au delta du Mississipi n’entendaient parler que notre langue ; tous les établissements européens répandus sur cet immense espace rappelaient le souvenir de la patrie : c’étaient Louisbourg, Montmorency, Duquesne, Saint-Louis, Vincennes, la Nouvelle-Orléans, tous noms chers à la France et familiers à nos oreilles.
Mais un concours de circonstances qu’il serait trop long d’énumérer [142] nous a privés de ce magnifique héritage. Partout où les Français étaient peu nombreux et mal établis, ils ont disparu. Le reste s’est aggloméré sur un petit espace et a passé sous d’autres lois. Les quatre cent mille Français du Canada [II-407] forment aujourd’hui comme les débris d’un peuple ancien perdu au milieu des flots d’une nation nouvelle. Autour d’eux la population étrangère grandit sans cesse ; elle s’étend de tous côtés ; elle pénètre jusque dans les rangs des anciens maîtres du sol, domine dans leurs villes et dénature leur langue. Cette population est identique à celle des États-Unis. J’ai donc raison de dire que la race anglaise ne s’arrête point aux limites de l’Union, mais s’avance bien au-delà vers le Nord-Est.
Au Nord-Ouest, on ne rencontre que quelques établissements russes sans importance ; mais au Sud-Ouest, le Mexique se présente devant les pas des Anglo-Américains comme une barrière.
Ainsi donc, il n’y a plus, à vrai dire, que deux races rivales qui se partagent aujourd’hui le Nouveau-Monde, les Espagnols et les Anglais.
Les limites qui doivent séparer ces deux races ont été fixées par un traité. Mais quelque favorable que soit ce traité aux Anglo-Américains, je ne doute point qu’ils ne viennent bientôt à l’enfreindre.
Au-delà des frontières de l’Union s’étendent, du côté du Mexique, de vastes provinces qui manquent encore d’habitants. Les hommes des États-Unis pénétreront dans ces solitudes avant ceux mêmes qui ont droit à les occuper. Ils s’en approprieront le sol, ils s’y établiront en société, et quand le légitime propriétaire se présentera enfin, il trouvera le désert fertilisé et des étrangers tranquillement assis dans son héritage.
La terre du Nouveau-Monde appartient au premier occupant, et l’empire y est le prix de la course. [II-408] .
Les pays déjà peuplés auront eux-mêmes de la peine à se garantir de l’invasion.
J’ai déjà parlé précédemment de ce qui se passe dans la province du Texas. Chaque jour, les habitants des États-Unis s’introduisent peu à peu dans le Texas, ils y acquièrent des terres, et tout en se soumettant aux lois du pays, ils y fondent l’empire de leur langue et de leurs mœurs. La province du Texas est encore sous la domination du Mexique ; mais bientôt on n’y trouvera pour ainsi dire plus de Mexicains. Pareille chose arrive sur tous les points où les Anglo-Américains entrent en contact avec des populations d’une autre origine.
On ne peut se dissimuler que la race anglaise n’ait acquis une immense prépondérance sur toutes les autres races européennes du Nouveau-Monde. Elle leur est très supérieure en civilisation, en industrie et en puissance. Tant qu’elle n’aura devant elle que des pays déserts ou peu habités, tant qu’elle ne rencontrera pas sur son chemin des populations agglomérées, à travers lesquelles il lui soit impossible de se frayer un passage, on la verra s’étendre sans cesse. Elle ne s’arrêtera pas aux lignes tracées dans les traités, mais elle débordera de toutes parts au-dessus de ces digues imaginaires.
Ce qui facilite encore merveilleusement ce développement rapide de la race anglaise dans le Nouveau-Monde, c’est la position géographique qu’elle y occupe.
Lorsqu’on s’élève vers le Nord au-dessus de ses frontières septentrionales, on rencontre les glaces polaires, et lorsqu’on descend de quelques degrés [II-409] au-dessous de ses limites méridionales, on entre au milieu des feux de l’équateur. Les Anglais d’Amérique sont donc placés dans la zone la plus tempérée et la portion la plus habitable du continent.
On se figure que le mouvement prodigieux qui se fait remarquer dans l’accroissement de la population aux États-Unis ne date que de l’indépendance : c’est une erreur. La population croissait aussi vite sous le système colonial que de nos jours ; elle doublait de même à peu près en vingt-deux ans. Mais on opérait alors sur des milliers d’habitants ; on opère maintenant sur des millions. Le même fait qui passait inaperçu il y a un siècle, frappe aujourd’hui tous les esprits.
Les Anglais du Canada, qui obéissent à un roi, augmentent de nombre et s’étendent presque aussi vite que les Anglais des États-Unis, qui vivent sous un gouvernement républicain.
Pendant les huit années qu’a duré la guerre de l’indépendance, la population n’a cessé de s’accroître suivant le rapport précédemment indiqué.
Quoiqu’il existât alors, sur les frontières de l’Ouest, de grandes nations indiennes liguées avec les Anglais, le mouvement de l’émigration vers l’Occident ne s’est pour ainsi dire jamais ralenti. Pendant que l’ennemi ravageait les côtes de l’Atlantique, le Kentucky, les districts occidentaux de la Pensylvanie, l’État de Vermont et celui du Maine se remplissaient d’habitants. Le désordre qui suivit la guerre n’empêcha point non plus la population de croître et n’arrêta pas sa marche progressive dans le désert. Ainsi, la différence des lois, l’état de paix ou l’état de guerre, [II-410] l’ordre ou l’anarchie, n’ont influé que d’une manière insensible sur le développement successif des Anglo-Américains.
Ceci se comprend sans peine : il n’existe pas de causes assez générales pour se faire sentir à la fois sur tous les points d’un si immense territoire. Ainsi il y a toujours une grande portion de pays où l’on est assuré de trouver un abri contre les calamités qui frappent l’autre, et quelque grands que soient les maux, le remède offert est toujours plus grand encore.
Il ne faut donc pas croire qu’il soit possible d’arrêter l’essor de la race anglaise du Nouveau-Monde. Le démembrement de l’Union, en amenant la guerre sur le continent, l’abolition de la république, en y introduisant la tyrannie, peuvent retarder ses développements, mais non l’empêcher d’atteindre le complément nécessaire de sa destinée. Il n’y a pas de pouvoir sur la terre qui puisse fermer devant les pas des émigrants ces fertiles déserts ouverts de toutes parts à l’industrie et qui présentent un asile à toutes les misères. Les événements futurs, quels qu’ils soient, n’enlèveront aux Américains, ni leur climat, ni leurs mers intérieures, ni leurs grands fleuves, ni la fertilité de leur sol. Les mauvaises lois, les révolutions et l’anarchie, ne sauraient détruire parmi eux le goût du bien-être et l’esprit d’entreprise qui semble le caractère distinctif de leur race, ni éteindre tout-à-fait les lumières qui les éclairent.
Ainsi, au milieu de l’incertitude de l’avenir, il y a du moins un événement qui est certain. À une époque que nous pouvons dire prochaine, puisqu’il s’agit [II-411] ici de la vie des peuples, les Anglo-Américains couvriront seuls tout l’immense espace compris entre les glaces polaires et les tropiques ; ils se répandront des grèves de l’océan Atlantique jusqu’aux rivages de la mer du Sud.
Je pense que le territoire sur lequel la race anglo-américaine doit un jour s’étendre égale les trois quarts de l’Europe [143] . Le climat de l’Union est, à tout prendre, préférable à celui de l’Europe ; ses avantages naturels sont aussi grands ; il est évident que sa population ne saurait manquer d’être un jour proportionnelle à la nôtre.
L’Europe, divisée entre tant de peuples divers ; l’Europe, à travers les guerres sans cesse renaissantes et la barbarie du moyen-âge, est parvenue à avoir quatre cent dix habitants [144] par lieue carrée. Quelle cause si puissante pourrait empêcher les États-Unis d’en avoir autant un jour ?.
Il se passera bien des siècles avant que les divers rejetons de la race anglaise d’Amérique cessent de présenter une physionomie commune. On ne peut prévoir l’époque où l’homme pourra établir dans le Nouveau-Monde l’inégalité permanente des conditions.
Quelles que soient donc les différences que la paix ou la guerre, la liberté ou la tyrannie, la prospérité ou la misère, mettent un jour dans la destinée des divers rejetons de la grande famille anglo-américaine, [II-412] ils conserveront tous du moins un état social analogue, et auront de commun les usages et les idées qui découlent de l’état social. .
Le seul lien de la religion a suffi au moyen-âge pour réunir dans une même civilisation les races diverses qui peuplèrent l’Europe. Les Anglais du Nouveau-Monde ont entre eux mille autres liens, et ils vivent dans un siècle où tout cherche à s’égaliser parmi les hommes.
Le moyen-âge était une époque de fractionnement. Chaque peuple, chaque province, chaque cité, chaque famille, tendaient alors fortement à s’individualiser. De nos jours, un mouvement contraire se fait sentir, les peuples semblent marcher vers l’unité. Des liens intellectuels unissent entre elles les parties les plus éloignées de la terre, et les hommes ne sauraient rester un seul jour étrangers les uns aux autres, ou ignorants de ce qui se passe dans un coin quelconque de l’univers : aussi remarque-t-on aujourd’hui moins de différence entre les Européens et leurs descendants du Nouveau-Monde, malgré l’Océan qui les divise, qu’entre certaines villes du treizième siècle qui n’étaient séparées que par une rivière.
Si ce mouvement d’assimilation rapproche des peuples étrangers, il s’oppose à plus forte raison à ce que les rejetons du même peuple deviennent étrangers les uns aux autres.
Il arrivera donc un temps où l’on pourra voir dans l’Amérique du Nord cent cinquante millions d’hommes [145] égaux entre eux, qui tous appartiendront à [II-413] la même famille, qui auront le même point de départ, la même civilisation, la même langue, la même religion, les mêmes habitudes, les mêmes mœurs, et à travers lesquels la pensée circulera sous la même forme et se peindra des mêmes couleurs. Tout le reste est douteux, mais ceci est certain. Or, voici un fait entièrement nouveau dans le monde, et dont l’imagination elle-même ne saurait saisir la portée.
Il y a aujourd’hui sur la terre deux grands peuples qui, partis de points différents, semblent s’avancer vers le même but : ce sont les Russes et les Anglo-Américains.
Tous deux ont grandi dans l’obscurité ; et tandis que les regards des hommes étaient occupés ailleurs, ils se sont placés tout à coup au premier rang des nations, et le monde a appris presque en même temps leur naissance et leur grandeur.
Tous les autres peuples paraissent avoir atteint à peu près les limites qu’a tracées la nature, et n’avoir plus qu’à conserver ; mais eux sont en croissance [146] : tous les autres sont arrêtés ou n’avancent qu’avec mille efforts ; eux seuls marchent d’un pas aisé et rapide dans une carrière dont l’œil ne saurait encore apercevoir la borne.
L’Américain lutte contre les obstacles que lui oppose la nature ; le Russe est aux prises avec les hommes. L’un combat le désert et la barbarie, l’autre la civilisation revêtue de toutes ses armes : aussi les conquêtes de l’Américain se font-elles avec le soc du laboureur, celles du Russe avec l’épée du soldat. [II-414] .
Pour atteindre son but, le premier s’en repose sur l’intérêt personnel, et laisse agir, sans les diriger, la force et la raison des individus.
Le second concentre en quelque sorte dans un homme toute la puissance de la société.
L’un a pour principal moyen d’action la liberté ; l’autre, la servitude.
Leur point de départ est différent, leurs voies sont diverses ; néé par un dessein secret de la Providence à tenir un jour dans ses mains les destinées de la moitié du monde.
NOTES.↩
[II-417]
(A) PAGE 25. (↑)
C’est en avril 1704 que parut le premier journal américain. Il fut publié à Boston. Voyez Collection de la société historique de Massachusetts, vol. 6, p. 66.
On aurait tort de croire que la presse périodique ait toujours été entièrement libre en Amérique ; on a tenté d’y établir quelque chose d’analogue à la censure préalable et au cautionnement.
Voici ce qu’on trouve dans les documents législatifs du Massachusetts, à la date du 14 janvier 1722.
Le comité nommé par l’assemblée générale (le corps législatif de la province) pour examiner l’affaire relative au journal intitulé : New England courant, « pense que la tendance dudit journal est de tourner la religion en dérision et de la faire tomber dans le mépris ; que les saints auteurs y sont traités d’une manière profane et irrévérencieuse ; que la conduite des ministres de l’Évangile y est interprétée avec malice ; que le gouvernement de Sa Majesté y est insulté, et que la paix et la tranquillité de cette province sont troublées par ledit journal ; en conséquence, le comité est d’avis qu’on défende à James Francklin, l’imprimeur et l’éditeur, de ne plus imprimer et publier à l’avenir ledit journal ou tout autre écrit, avant de les avoir soumis au secrétaire de la province. Les juges de paix du canton de Suffolk seront chargés d’obtenir du sieur Francklin un cautionnement qui répondra de sa bonne conduite pendant l’année qui va s’écouler. ».
La proposition du comité fut acceptée et devint loi, mais l’effet en fut nul. Le journal éluda la défense en mettant le nom de Benjamin Francklin au lieu de James Francklin au bas de ses colonnes, et l’opinion acheva de faire justice de la mesure. [II-418] .
(B) PAGE 175. (↑)
Pour être électeurs des comtés (ceux qui représentent la propriété territoriale) avant le bill de la réforme passé en 1832, il fallait avoir en toute propriété ou en bail à vie un fonds de terre rapportant net 40 shellings de revenu. Cette loi fut faite sous Henri VI, vers 1450. Il a été calculé que 40 shellings du temps de Henri VI pouvaient équivaloir à 30 liv. sterling de nos jours. Cependant on a laissé subsister jusqu’en 1832 cette base adoptée dans le XVe siècle, ce qui prouve combien la constitution anglaise devenait démocratique avec le temps, même en paraissant immobile. Voyez Delolme, liv. I, chap. IV; voyez aussi Blakstone, liv. I, chap. IV.
Les jurés anglais sont choisis par le shériff du comté (Delolme, tom. I, chap. XII). Le shériff est en général un homme considérable du comté ; il remplit les fonctions judiciaires et administratives ; il représente le roi, et est nommé par lui tous les ans (Blakstone, liv. I, chap IX). Sa position le place au-dessus du soupçon de corruption de la part des partis ; d’ailleurs, si son impartialité est mise en doute, on peut récuser en masse le jury qu’il a nommé, et alors un autre officier est chargé de choisir de nouveaux jurés. Voyez Blakstone, liv. III, chap. XXIII.
Pour avoir le droit d’être juré, il faut être possesseur d’un fonds de terre de la valeur de 10 shellings au moins de revenu (Blakstone, liv. III, chap. XXIII). On remarquera que cette condition fut imposée sous le règne de Guillaume et Marie, c’est-à-dire vers 1700, époque où le prix de l’argent était infiniment plus élevé que de nos jours. On voit que les Anglais ont fondé leur système de jury, non sur la capacité, mais sur la propriété foncière, comme toutes leurs autres institutions politiques.
On a fini par admettre les fermiers au jury, mais on a exigé que leurs baux fussent très longs, et qu’ils se fissent un revenu net de 20 shellings, indépendamment de la rente. Blakstone, idem.
(C) PAGE 175. (↑)
La constitution fédérale a introduit le jury dans les tribunaux de l’Union de la même manière que les États l’avaient introduit eux-mêmes dans leurs cours particulières ; de plus, elle n’a pas établi de règles qui lui soient propres pour le choix des jurés. Les cours fédérales puisent dans la liste ordinaire des jurés que chaque État a dressée pour son usage. Ce sont donc les lois des États qu’il faut examiner pour connaître la théorie de la composition du jury en Amérique. Voyez Story’s [II-419] commentaries on the constitution, liv. III, chap. XXVIII, p. 654-659. Sergeant’s constitutionnal law, p. 165. Voyez aussi les lois fédérales de 1789, 1800 et 1802 sur la matière.
Pour faire bien connaître les principes des Américains dans ce qui regarde la composition du jury, j’ai puisé dans les lois d’États éloignés les uns des autres. Voici les idées générales qu’on peut retirer de cet examen.
En Amérique, tous les citoyens qui sont électeurs ont le droit d’être jurés. Le grand État de New-York a cependant établi une légère différence entre les deux capacités ; mais c’est dans un sens contraire à nos lois, c’est-à-dire qu’il y a moins de jurés dans l’État de New-York que d’électeurs. En général, on peut dire qu’aux États-Unis le droit de faire partie d’un jury, comme le droit d’élire des députés, s’étend à tout le monde ; mais l’exercice de ce droit n’est pas indistinctement remis entre toutes les mains.
Chaque année un corps de magistrats municipaux ou cantonaux, appelé select-men dans la Nouvelle-Angleterre, supervisors dans l’État de New-York, trustees dans l’Ohio, sheriffs de la paroisse dans la Louisiane, font choix pour chaque canton d’un certain nombre de citoyens ayant le droit d’être jurés, et auxquels ils supposent la capacité de l’être. Ces magistrats étant eux-mêmes électifs, n’excitent point de défiance ; leurs pouvoirs sont très étendus et fort arbitraires, comme ceux en général des magistrats républicains, et ils en usent souvent, dit-on, surtout dans la Nouvelle-Angleterre, pour écarter les jurés indignes ou incapables. .
Les noms des jurés ainsi choisis sont transmis à la cour du comté, et sur la totalité de ces noms on tire au sort le jury qui doit prononcer dans chaque affaire. .
Du reste, les Américains ont cherché par tous les moyens possibles à mettre le jury à la portée du peuple, et à le rendre aussi peu à charge que possible. Les jurés étant très nombreux, le tour de chacun ne revient guère que tous les trois ans. Les sessions se tiennent au chef-lieu de chaque comté, le comté répond à peu près à notre arrondissement. Ainsi, le tribunal vient se placer près du jury, au lieu d’attirer le jury près de lui, comme en France ; enfin les jurés sont indemnisés, soit par l’État, soit par les parties. Ils reçoivent en général un dollar (5 fr. 42 c.) par jour, indépendamment des frais de voyage. En Amérique, le jury est encore regardé comme une charge ; mais c’est une charge facile à porter, et à laquelle on se soumet sans peine.
Voyez Brevard’s Digest of the public statute law of South Carolina, 2e vol, p. 338 ; id., vol. 1, p. 454 et 456 ; id., vol. 2, p. 218. [II-420] .
Voyez The general laws of Massachusetts revised and published by authority of the legislature, vol. 2, p. 331, 187.
Voyez The revised statutes of the state of New-York, vol. 2, p. 720, 411, 717, 643.
Voyez The statute law of the state of Tennessee, vol. 1, p. 209.
Voyez Acts of the state of Ohio, p. 95 et 210.
Voyez Digeste général des actes de la législature de la Louisiane, vol. 2, p. 55.
(D) PAGE 178. (↑)
Lorsqu’on examine de près la constitution du jury civil parmi les Anglais, on découvre aisément que les jurés n’échappent jamais au contrôle du juge.
Il est vrai que le verdict du jury, au civil comme au criminel, comprend en général, dans une simple énonciation, le fait et le droit. Exemple : Une maison est réclamée par Pierre comme l’ayant achetée ; voici le fait. Son adversaire lui oppose l’incapacité du vendeur ; voici le droit. Le jury se borne à dire que la maison sera remise entre les mains de Pierre ; il décide ainsi le fait et le droit. En introduisant le jury en matière civile, les Anglais n’ont pas conservé à l’opinion des jurés l’infaillibilité qu’ils lui accordent en matière criminelle quand le verdict est favorable.
Si le juge pense que le verdict a fait une fausse application de la loi, il peut refuser de le recevoir, et renvoyer les jurés délibérer.
Si le juge laisse passer le verdict sans observation, le procès n’est pas encore entièrement vidé : il y a plusieurs voies de recours ouvertes contre l’arrêt. Le principal consiste à demander à la justice que le verdict soit annulé, et qu’un nouveau jury soit assemblé. Il est vrai de dire qu’une pareille demande est rarement accordée, et ne l’est jamais plus de deux fois ; néanmoins j’ai vu le cas arriver sous mes yeux. Voyez Blakstone, liv. III, chap. XXIV ; id., liv. III, chap. XXV.
Notes volume 2↩
[1] (↑) Ils n’écrivent dans les journaux que dans les cas rares où ils veulent s’adresser au peuple et parler en leur propre nom : lorsque, par exemple, on a répandu sur leur compte des imputations calomnieuses, et qu’ils désirent rétablir la vérité des faits.
[2] (↑) Encore je ne sais si cette conviction réfléchie et maîtresse d’elle élève jamais l’homme au degré d’ardeur et de dévouement qu’inspirent les croyances dogmatiques.
[3] (↑) Lettre à Madison, du 20 décembre 1787, traduction de M. Conseil.
[4] (↑) J’entends ici le mot magistrats dans son acception la plus étendue : je l’applique à tous ceux qui sont chargés de faire exécuter les lois.
[5] (↑) Voyez loi du 27 février 1813. Collection générale des lois du Massachusetts, vol. 2, p. 331. On doit dire qu’ensuite les jurés sont tirés au sort sur les listes.
[6] (↑) Loi du 28 février 1787. Voyez Collection générale des lois du Massachusetts, vol. 1, p. 302.
Voici le texte :.
« Les select-men de chaque commune feront afficher dans les boutiques des cabaretiers, aubergistes et détaillants, une liste des personnes réputées ivrognes, joueurs, et qui ont l’habitude de perdre leur temps et leur fortune dans ces maisons ; et le maître desdites maisons qui, après cet avertissement, aura souffert que lesdites personnes boivent et jouent dans sa demeure, ou leur aura vendu des liqueurs spiritueuses, sera condamné à l’amende. »
[7] (↑) Il est inutile de dire que je parle ici du gouvernement démocratique appliqué à un peuple et non à une petite tribu.
[8] (↑) On comprend bien que le mot pauvre à ici, comme dans le reste du chapitre, un sens relatif et non une signification absolue. Les pauvres d’Amérique, comparés à ceux d’Europe, pourraient souvent paraître des riches : on a pourtant raison de les nommer des pauvres, quand on les oppose à ceux de leurs concitoyens qui sont plus riches qu’eux.
[9] (↑) L’aisance dans laquelle vivent les fonctionnaires secondaires aux États-Unis tient encore à une autre cause ; celle-ci est étrangère aux instincts généraux de la démocratie : toute espèce de carrière privée est fort productive ; l’État ne trouverait pas de fonctionnaires secondaires s’il ne consentait à les bien payer. Il est donc dans la position d’une entreprise commerciale, obligée, quels que soient ses goûts économiques, de soutenir une concurrence onéreuse.
[10] (↑) l’État de l’Ohio, qui compte un million d’habitants, ne donne au gouverneur que 1,200 dollars de salaire ou 6,504 francs.
[11] (↑) Pour rendre cette vérité sensible aux yeux, il suffit d’examiner les traitements de quelques-uns des agents du gouvernement fédéral. J’ai cru devoir placer en regard le salaire attaché en France aux fonctions analogues, afin que la comparaison achève d’éclairer le lecteur.
| ÉTATS-UNIS | |
| MINISTÈRE DES FINANCES (treasury department) | |
| fr. | |
| L’huissier (messager) | 3,734 |
| Le commis le moins payé | 5,420 |
| Le commis le plus payé | 8,672 |
| Le secrétaire général (chief clerk) | 10,840 |
| Le ministre (secretary of State) | 32,520 |
| Le chef du gouvernement (le président) | 135,000 |
| FRANCE | |
| MINISTÈRE DES FINANCES | |
| Huissier du ministre | 1,500 |
| Le commis le moins payé | 1,000 à 1,800 |
| Le commis le plus payé | 3,200 à 3,600 |
| Le secrétaire général | 20,000 |
| Le ministre | 80,000 |
| Le chef du gouvernement (le roi) | 12,000,000 |
J’ai peut-être eu tort de prendre la France pour point de comparaison. En France, où les instincts démocratiques pénètrent tous les jours davantage dans le gouvernement, on aperçoit déjà une forte tendance qui porte les Chambres à élever les petits traitements et surtout à abaisser les grands. Ainsi le ministre des finances qui, en 1834, reçoit 80,000 fr., en recevait 160,000 sous l’Empire ; les directeurs généraux des finances, qui en reçoivent 20,000 en recevaient alors 50,000.
[12] (↑) Voyez entre autres, dans les budgets américains, ce qu’il en coûte pour l’entretien des indigents et pour l’instruction gratuite.
En 1831, on a dépensé dans l’État de New-York, pour le soutien des indigents, la somme de 1,290,000 francs. Et la somme consacrée à l’instruction publique est estimée s’élever à 5,420,000 francs au moins. (Williams, New York annual register, 1832, pp. 205 et 243.).
L’État de New York n’avait en 1830 que 1,900,000 habitants, ce qui ne forme pas le double de la population du département du Nord.
[13] (↑) Les Américains comme on le voit, ont quatre espèces de budgets : l’Union a le sien ; les États, les comtés et les communes ont également le leur. Pendant mon séjour en Amérique, j’ai fait de grandes recherches pour connaître le montant des dépenses publiques dans les communes et dans les comtés des principaux États de l’Union. J’ai pu facilement obtenir le budget des plus grandes communes, mais il m’a été impossible de me procurer celui des petites. Je ne puis donc me former aucune idée exacte des dépenses communales. Pour ce qui concerne les dépenses des comtés, je possède quelques documents qui, bien qu’incomplets, sont peut-être de nature à mériter la curiosité du lecteur. Je dois à l’obligeance de M. Richards, ancien maire de Philadelphie, les budgets de treize comtés de la Pensylvanie pour l’année de 1830. Ce sont ceux de Lebanon, Centre, Franklin, La Fayette, Montgomery, La Luzerne, Dauphin, Butler, Alléghany, Columbia, Northumberland, Northampton, Philadelphie. Il s’y trouvait, en 1830, 495,207 habitants. Si l’on jette les yeux sur une carte de la Pensylvanie, on verra que ces treize comtés sont dispersés dans toutes les directions et soumis à toutes les causes générales qui peuvent influer sur l’état du pays ; de telle sorte qu’il serait impossible de dire pourquoi ils ne fourniraient pas une idée exacte de l’état financier des comtés de la Pennsylvanie. Or, ces mêmes comtés ont dépensé, pendant l’année 1830, 1,800,221 francs, ce qui donne 3 fr. 64 cent. par habitant. J’ai calculé que chacun de ces mêmes habitants, durant l’année 1830, avait consacré aux besoins de l’Union fédérale 12 fr. 70 cent., et 3 fr. 80 cent. à ceux de la Pensylvanie ; d’où il résulte que dans l’année 1830 ces mêmes citoyens ont donné à la société, pour subvenir à toutes les dépenses publiques (excepté les dépenses communales), la somme de 20 fr. 14 cent. Ce résultat est doublement incomplet, comme on le voit, puisqu’il ne s’applique qu’à une seule année et à une partie des charges publiques, mais il a le mérite d’être certain.
[14] (↑) Ceux qui ont voulu établir un parallèle entre les dépenses des Américains et les nôtres ont bien senti qu’il était impossible de comparer le total des dépenses publiques de la France au total des dépenses publiques de l’Union ; mais ils ont cherché à comparer entre elles des portions détachées de ces dépenses. Il est facile de prouver que cette seconde manière d’opérer n’est pas moins défectueuse que la première.
À quoi comparerai-je, par exemple, notre budget national ? Au budget de l’Union ? Mais l’Union s’occupe de beaucoup moins d’objets que notre gouvernement central, et ses charges doivent naturellement être beaucoup moindres. Opposerai-je nos budgets départementaux aux budgets des États particuliers dont l’Union se compose ? Mais en général les États particuliers veillent à des intérêts plus importants et plus nombreux que l’administration de nos départements ; leurs dépenses sont donc naturellement plus considérables. Quant aux budgets des comtés, on ne rencontre rien dans notre système de finances qui leur ressemble. Ferons-nous rentrer les dépenses qui y sont portées dans le budget de l’État ou dans celui des communes ? Les dépenses communales existent dans les deux pays, mais elles ne sont pas toujours analogues. En Amérique, la commune se charge de plusieurs soins qu’en France elle abandonne au département ou à l’État. Que faut-il entendre d’ailleurs par dépenses communales en Amérique ? L’organisation de la commune diffère suivant les États. Prendrons-nous pour règle ce qui se passe dans la Nouvelle-Angleterre ou en Géorgie, dans la Pennsylvanie ou dans l’État des Illinois ?.
Il est facile d’apercevoir, entre certains budgets de deux pays, une sorte d’analogie ; mais les éléments qui les composent différant toujours plus ou moins, l’on ne saurait établir entre eux de comparaison sérieuse.
[15] (↑) On parviendrait à connaître la somme précise que chaque citoyen français ou américain verse dans le trésor public, qu’on n’aurait encore qu’une partie de la vérité.
Les gouvernements ne demandent pas seulement aux contribuables de l’argent, mais encore des efforts personnels qui sont appréciables en argent. L’État lève une armée ; indépendamment de la solde que la nation entière se charge de fournir, il faut encore que le soldat donne son temps, qui a une valeur plus ou moins grande suivant l’emploi qu’il en pourrait faire s’il restait libre. J’en dirai autant du service de la milice. L’homme qui fait partie de la milice consacre momentanément un temps précieux à la sûreté publique, et donne réellement à l’État ce que lui-même manque d’acquérir. J’ai cité ces exemples ; j’aurais pu en citer beaucoup d’autres. Le gouvernement de France et celui d’Amérique perçoivent des impôts de cette nature : ces impôts pèsent sur les citoyens : mais qui peut en apprécier avec exactitude le montant dans les deux pays ?.
Ce n’est pas la dernière difficulté qui vous arrête lorsque vous voulez comparer les dépenses publiques de l’Union aux nôtres. L’État se fait en France certaines obligations qu’il ne s’impose pas en Amérique, et réciproquement. Le gouvernement français paye le clergé ; le gouvernement américain abandonne ce soin aux fidèles. En Amérique, l’État se charge des pauvres ; en France, il les livre à la charité du public. Nous faisons à tous nos fonctionnaires un traitement fixe, les Américains leur permettent de percevoir certains droits. En France, les prestations en nature n’ont lieu que sur un petit nombre de routes ; aux États-Unis, sur presque tous les chemins. Nos voies sont ouvertes aux voyageurs, qui peuvent les parcourir sans rien payer ; on rencontre aux États-Unis beaucoup de routes à barrières. Toutes ces différences dans la manière dont le contribuable arrive à acquitter les charges de la société rendent la comparaison entre ces deux pays très difficile ; car il y a certaines dépenses que les citoyens ne feraient point ou qui seraient moindres, si l’État ne se chargeait d’agir en leur nom.
[16] (↑) Voyez les budgets détaillés du ministère de la Marine en France, et, pour l’Amérique, le National calendar de 1833, p. 228.
[17] (↑) L’un des plus singuliers, à mon avis, fut la résolution par laquelle les Américains renoncèrent momentanément à l’usage du thé. Ceux qui savent que les hommes tiennent plus en général à leurs habitudes qu’à leur vie, s’étonneront sans doute de ce grand et obscur sacrifice obtenu de tout un peuple.
[18] (↑) « Le président, dit la constitution, art. ii, sect. 2, § 2, fera les « traités de l’avis et avec le consentement du sénat. » Le lecteur ne doit pas perdre de vue que le mandat des sénateurs dure six ans, et qu’étant choisis par les législateurs de chaque État, ils sont le produit d’une élection à deux degrés.
[19] (↑) Voyez le cinquième volume de la Vie de Washington, par Marshall. « Dans un gouvernement constitué comme l’est celui des États-Unis, dit-il, Page 314, le premier magistrat ne peut, quelle que soit sa fermeté, opposer long-temps une digue au torrent de l’opinion populaire ; et celle qui prévalait alors semblait mener à la guerre. En effet, dans la session du congrès tenu à cette époque, on s’aperçut très fréquemment que Washington avait perdu la majorité dans la chambre des représentants. » En dehors, la violence du langage dont on se servait contre lui était extrême : dans une réunion politique, on ne craignit pas de le comparer indirectement au traître Arnold (page 265). « Ceux qui tenaient au parti de l’opposition, dit encore Marshall (page 355), prétendirent que les partisans de l’administration composaient une faction aristocratique qui était soumise à l’Angleterre, et qui, voulant établir la monarchie, était par conséquent ennemie de la France ; une faction dont les membres constituaient une sorte de noblesse, qui avait pour titres les actions de la Banque, et qui craignait tellement toute mesure qui pouvait influer sur les fonds, qu’elle était insensible aux affronts que l’honneur et l’intérêt de la nation commandaient également de repousser. »
[20] (↑) Les sociétés de tempérance sont des associations dont les membres s’engagent à s’abstenir de liqueurs fortes. À mon passage aux États-Unis, les sociétés de tempérance comptaient déjà plus de 270,000 membres, et leur effet avait été de diminuer, dans le seul État de Pensylvanie, la consommation des liqueurs fortes de 500,000 gallons par année.
[21] (↑) Le même fait fut déjà observé à Rome sous les premiers Césars. Montesquieu remarque quelque part que rien n’égala le désespoir de certains citoyens romains qui, après les agitations d’une existence politique, rentrèrent tout-à-coup dans le calme de la vie privée.
[22] (↑) Nous avons vu, lors de l’examen de la Constitution fédérale, que les législateurs de l’Union avaient fait des efforts contraires. Le résultat de ces efforts a été de rendre le gouvernement fédéral plus indépendant dans sa sphère que celui des États. Mais le gouvernement fédéral ne s’occupe guère que des affaires extérieures : ce sont les gouvernements d’États qui dirigent réellement la société américaine.
[23] (↑) Les actes législatifs promulgués dans le seul État de Massachusetts, à partir de 1780 jusqu’à nos jours, remplissent déjà trois gros volumes. Encore faut-il remarquer que le recueil dont je parle a été révisé en 1823, et qu’on en a écarté beaucoup de lois anciennes ou devenues sans objet. Or l’État de Massachusetts, qui n’est pas plus peuplé qu’un de nos départements, peut passer pour le plus stable de toute l’Union, et celui qui met le plus de suite et de sagesse dans ses entreprises.
[24] (↑) Personne ne voudrait soutenir qu’un peuple ne peut abuser de la force vis-à-vis d’un autre peuple. Or, les partis forment comme autant de petites nations dans une grande ; ils sont entre eux dans des rapports d’étrangers.
Si on convient qu’une nation peut être tyrannique envers une autre nation, comment nier qu’un parti puisse l’être envers un autre parti ?
[25] (↑) On vit à Baltimore, lors de la guerre de 1812, un exemple frappant des excès que peut amener le despotisme de la majorité. À cette époque la guerre était très populaire à Baltimore. Un journal qui s’y montrait fort opposé excita par cette conduite l’indignation des habitants. Le peuple s’assembla, brisa les presses, et attaqua les maisons des journalistes. On voulut réunir la milice, mais elle ne répondit point à l’appel. Afin de sauver les malheureux que menaçait la fureur publique, on prit le parti de les conduire en prison, comme des criminels. Cette précaution fut inutile : pendant la nuit, le peuple s’assembla de nouveau ; les magistrats ayant échoué pour réunir la milice, la prison fut forcée, un des journalistes fut tué sur la place, les autres restèrent pour morts : les coupables déférés au jury furent acquittés.
Je disais un jour à un habitant de la Pensylvanie : — Expliquez-moi, je vous prie, comment, dans un État fondé par des quakers. et renommé pour sa tolérance, les nègres affranchis ne sont pas admis à exercer les droits de citoyens. Ils payent l’impôt, n’est-il pas juste qu’ils votent ? — Ne nous faites pas cette injure, me répondit-il, de croire que nos législateurs aient commis un acte aussi grossier d’injustice et d’intolérance. — Ainsi, chez vous, les Noirs ont le droit de voter ? — Sans aucun doute. — Alors, d’où vient qu’au collége électoral ce matin je n’en ai pas aperçu un seul dans l’assemblée ? — Ceci n’est pas la faute de la loi, me dit l’Américain ; les nègres ont, il est vrai, le droit de se présenter aux élections, mais ils s’abstiennent volontairement d’y paraître. — Voilà bien de la modestie de leur part. — Oh ! ce n’est pas qu’ils refusent d’y aller, mais ils craignent qu’on ne les y maltraite. Chez nous, il arrive quelquefois que la loi manque de force, quand la majorité ne l’appuie point. Or, la majorité est imbue des plus grands préjugés contre les nègres, et les magistrats ne se sentent pas la force de garantir à ceux-ci les droits que le législateur leur a conférés. — Eh quoi ! la majorité, qui a le privilége de faire la loi, veut encore avoir celui de désobéir à la loi ? »
[26] (↑) Le pouvoir peut être centralisé dans une assemblée ; alors il est fort, mais non stable ; il peut être centralisé dans un homme : alors il est moins fort, mais il est plus stable.
[27] (↑) Il est inutile, je pense, d’avertir le lecteur qu’ici, comme dans tout le reste du chapitre, je parle, non du gouvernement fédéral, mais des gouvernements particuliers de chaque État que la majorité dirige despotiquement.
[28] (↑) Lettre de Jefferson à Madison, 15 mars 1789.
[29] (↑) Voyez au premier volume ce que je dis du pouvoir judiciaire.
[30] (↑) Ce serait déjà une chose utile et curieuse que de considérer le jury comme institution judiciaire, d’apprécier les effets qu’il produit aux États-Unis, et de rechercher de quelle manière les Américains en ont tiré parti. On pourrait trouver dans l’examen de cette seule question le sujet d’un livre entier, et d’un livre intéressant pour la France. On y rechercherait, par exemple, quelle portion des institutions américaines relatives, au jury pourrait être introduite parmi nous et à l’aide de quelle gradation. L’État américain qui fournirait le plus de lumières sur ce sujet serait l’État de la Louisiane. La Louisiane renferme une population mêlée de Français et d’Anglais. Les deux législations s’y trouvent en présence comme les deux peuples, et s’amalgament peu à peu l’une avec l’autre. Les livres les plus utiles à consulter seraient le recueil des lois de la Louisiane en deux volumes, intitulé : Digeste des lois de la Louisiane ; et plus encore peut-être un cours de procédure civile écrit dans les deux langues, et intitulé : Traité sur les règles des actions civiles, imprimé en 1830 à la Nouvelle-Orléans, chez Buisson. Cet ouvrage présente un avantage spécial ; il fournit aux Français une explication certaine et authentique des termes légaux anglais. La langue des lois forme comme une langue à part chez tous les peuples, et chez les Anglais plus que chez aucun autre.
[31] (↑) Tous les légistes anglais et américains sont unanimes sur ce point. M. Story, juge à la cour suprême des États-Unis, dans son Traité de la constitution fédérale, revient encore sur l’excellence de l’institution du jury en matière civile. « The inestimable privilege of a trial by jury in civil cases}, dit-il, a privilege scarcely inferior to that in criminal cases, which is conceded by all persons to be essential to political and civil liberty. » (Story, liv. III, chap. XXXVIII.)
[32] (↑) Si l’on voulait établir quelle est l’utilité du jury comme institution judiciaire, on aurait beaucoup d’autres arguments à donner, et entre autres ceux-ci:
À mesure que vous introduisez les jurés dans les affaires, vous pouvez sans inconvénient diminuer le nombre des juges ; ce qui est un grand avantage. Lorsque les juges sont très nombreux, chaque jour la mort fait un vide dans la hiérarchie judiciaire, et y ouvre de nouvelles places pour ceux qui survivent. L’ambition des magistrats est donc continuellement en haleine et elle les fait naturellement dépendre de la majorité ou de l’homme qui nomme aux emplois vacants : on avance alors dans les tribunaux comme on gagne des grades dans une armée. Cet état de choses est entièrement contraire à la bonne administration de la justice et aux intentions du législateur. On veut que les juges soient inamovibles pour qu’ils restent libres ; mais qu’importe que nul ne puisse leur ravir leur indépendance, si eux-mêmes en font volontairement le sacrifice ?.
Lorsque les juges sont très nombreux, il est impossible qu’il ne s’en rencontre pas parmi eux beaucoup d’incapables : car un grand magistrat n’est point un homme ordinaire. Or, je ne sais si un tribunal à demi éclairé n’est pas la pire de toutes les combinaisons pour arriver aux fins qu’on se propose en établissant des cours de justice.
Quant à moi, j’aimerais mieux abandonner la décision d’un procès à des jurés ignorants dirigés par un magistrat habile, que de la livrer à des juges dont la majorité n’aurait qu’une connaissance incomplète de la jurisprudence et des lois.
[33] (↑) Il faut cependant faire une remarque importante :
L’institution du jury donne, il est vrai, au peuple un droit général de contrôle sur les actions des citoyens, mais elle ne lui fournit pas les moyens d’exercer ce contrôle dans tous les cas, ni d’une manière toujours tyrannique.
Lorsqu’un prince absolu a la faculté de faire juger les crimes par ses délégués, le sort de l’accusé est pour ainsi dire fixé d’avance. Mais le peuple fût-il résolu à condamner, la composition du jury et son irresponsabilité offriraient encore des chances favorables à l’innocence.
[34] (↑) Ceci est à plus forte raison vrai lorsque le jury n’est appliqué qu’à certaines affaires criminelles.
[35] (↑) Les juges fédéraux tranchent presque toujours seuls les questions qui touchent de plus près au gouvernement du pays.
[36] (↑) L’Amérique n’a point encore de grande capitale, mais elle a déjà de très grandes villes. Philadelphie comptait, en 1830, 161,000 habitants, et New York 202,000. Le bas peuple qui habite ces vastes cités forme une populace plus dangereuse que celle même d’Europe. Elle se compose d’abord de nègres affranchis, que la loi et l’opinion condamnent à un état de dégradation et de misère héréditaires. On rencontre aussi dans son sein une multitude d’Européens que le malheur et l’inconduite poussent chaque jour sur les rivages du Nouveau Monde ; ces hommes apportent aux États-Unis nos plus grands vices, et ils n’ont aucun des intérêts qui pourraient en combattre l’influence. Habitant le pays sans en être citoyens, ils sont prêts à tirer parti de toutes les passions qui l’agitent ; aussi avons-nous vu depuis quelque temps des émeutes sérieuses éclater à Philadelphie et à New York. De pareils désordres sont inconnus dans le reste du pays, qui ne s’en inquiète point, parce que la population des villes n’a exercé jusqu’à présent aucun pouvoir ni aucune influence sur celle des campagnes.
Je regarde cependant la grandeur de certaines cités américaines, et surtout la nature de leurs habitants, comme un danger véritable qui menace l’avenir des républiques démocratiques du Nouveau-Monde, et je ne crains pas de prédire que c’est par là qu’elles périront, à moins que leur gouvernement ne parvienne à créer une force armée qui, tout en restant soumise aux volontés de la majorité nationale, soit pourtant indépendante du peuple des villes et puisse comprimer ses excès.
[37] (↑) Dans la Nouvelle-Angleterre, le sol est partagé en très petits domaines, mais il ne se divise plus.
[38] (↑) Voici en quels termes le New-York Spectator du 23 août 1831 rapporte le fait : « The court of common pleas of Chester county (New-York) a few days since rejected a witness who declared his disbelief in the existence of God. The presiding judge remarked that he had not before been aware that there was a man living who did not believe in the existence of God ; that this belief constituted the sanction of all testimony in a court of justice and that he knew of no cause in a christian country where a witness had been permitted to testify without such a belief. »
[39] (↑) À moins que l’on donne ce nom aux fonctions que beaucoup d’entre eux occupent dans les écoles. La plus grande partie de l’éducation est confiée au clergé.
[40] (↑) Voyez la Constitution de New-York, art. 7, § 4.
Idem de la Caroline du Nord, art. 31.
Idem de la Virginie.
Idem de la Caroline du Sud, art. 1, § 23.
Idem du Kentucky, art. 2, § 26.
Idem du Tennessee, art. 1, § 28.
Idem de la Louisiane, art. 2, § 22.
L’article de la Constitution de New-York est ainsi conçu :.
« Les ministres de l’Évangile étant par leur profession consacrés au service de Dieu, et livrés au soin de diriger les âmes, ne doivent point être troublés dans l’exercice de ces importants devoirs ; en conséquence, aucun ministre de l’Évangile ou prêtre, à quelque secte qu’il appartienne, ne pourra être revêtu d’aucunes fonctions publiques, civiles ou militaires. »
[41] (↑) J’ai parcouru une partie des frontières des États-Unis sur une espèce de charrette découverte qu’on appelait la malle. Nous marchions grand train nuit et jour par des chemins à peine frayés au milieu d’immenses forêts d’arbres verts ; lorsque l’obscurité devenait impénétrable, mon conducteur allumait des branches de mélèze, et nous continuions notre route à leur clarté. De loin en loin on rencontrait une chaumière au milieu des bois : c’était l’hôtel de la poste. Le courrier jetait à la porte de cette demeure isolée un énorme paquet de lettres, et nous reprenions notre course au galop, laissant à chaque habitant du voisinage le soin de venir chercher sa part du trésor.
[42] (↑) En 1832, chaque habitant du Michigan a fourni 1 fr. 22 c. à la taxe des lettres, et chaque habitant des Florides 1 fr. 5 c. (Voyez National Calendar, 1833, p. 244.) Dans la même année, chaque habitant du département du Nord a payé à l’État, pour le même objet, 1 fr. 4 c. (Voyez Compte général de l’administration des finances, 1833, p. 623.) Or, le Michigan ne comptait encore à cette époque que sept habitants par lieue carrée, et la Floride, cinq : l’instruction était moins répandue et l’activité moins grande dans ces deux districts que dans la plupart des États de l’Union, tandis que le département du Nord, qui renferme 3,400 individus par lieue carrée, forme une des portions les plus éclairées et les plus industrielles de la France.
[43] (↑) Je rappelle ici au lecteur le sens général dans lequel je prends le mot mœurs ; j’entends par ce mot l’ensemble des dispositions intellectuelles et morale, que les hommes apportent dans l’état de société.
[44] (↑) Voyez la carte à la fin du premier volume.
[45] (↑) L’indigène de l’Amérique du Nord conserve ses opinions et jusqu’au moindre détail de ses habitudes avec une inflexibilité qui n’a point d’exemple dans l’histoire. Depuis plus de deux cents ans que les tribus errantes de l’Amérique du Nord ont des rapports journaliers avec la race blanche, ils ne lui ont emprunté pour ainsi dire ni une idée ni un usage. Les hommes d’Europe ont cependant exercé une très grande influence sur les sauvages. Ils ont rendu le caractère indien plus désordonné, mais ils ne l’ont pas rendu plus européen.
Me trouvant dans l’été de 1831 derrière le lac Michigan, dans un lieu nommé Green-Bay, qui sert d’extrême frontière aux États-Unis du côté des Indiens du Nord-Ouest, je fis connaissance avec un officier américain, le major H., qui, un jour, après m’avoir beaucoup parlé de l’inflexibilité du caractère indien, me raconta le fait suivant : « J’ai connu autrefois, me dit-il, un jeune Indien qui avait été élevé dans un collège de la Nouvelle-Angleterre. Il y avait obtenu de grands succès, et y avait pris tout l’aspect extérieur d’un homme civilisé. Lorsque la guerre éclata entre nous et les Anglais, en 1810, je revis ce jeune homme ; il servait alors dans notre armée, à la tête des guerriers de sa tribu. Les Américains n’avaient admis les Indiens dans leurs rangs qu’à la condition qu’ils s’abstiendraient de l’horrible usage de scalper les vaincus. Le soir de la bataille de ***, C… vint s’asseoir auprès du feu de notre bivouac ; je lui demandai ce qui lui était arrivé dans la journée ; il me le raconta, et s’animant par degrés aux souvenirs de ses exploits, il finit par entrouvrir son habit en me disant : — Ne me trahissez pas, mais voyez ! ” Je vis en effet, ajouta le major H., entre son corps et sa chemise, la chevelure d’un Anglais encore toute dégouttante de sang. »
[46] (↑) Dans les treize États originaires, il ne reste plus que 6,373 Indiens. (Voyez Documents législatifs, 20e congrès, no 117, p. 20.)
[47] (↑) MM. Clark et Cass, dans leur rapport au Congrès, le 4 février 1829, p. 23, disaient :
« Le temps est déjà bien loin de nous où les Indiens pouvaient se procurer les objets nécessaires à leur nourriture et à leurs vêtements sans recourir à l’industrie des hommes civilisés. Au-delà du Mississipi, dans un pays où l’on rencontre encore d’immenses troupeaux de buffles, habitent des tribus indiennes qui suivent ces animaux sauvages dans leurs migrations ; les Indiens dont nous parlons trouvent encore le moyen de vivre en se conformant à tous les usages de leurs pères ; mais les buffles reculent sans cesse. On ne peut plus atteindre maintenant qu’avec des fusils ou des pièges (traps) les bêtes sauvages d’une plus petite espèce, telles que l’ours, le daim, le castor, le rat musqué, qui fournissent particulièrement aux Indiens ce qui est nécessaire au soutien de la vie.
« C’est principalement au nord-ouest que les Indiens sont obligés de se livrer à des travaux excessifs pour nourrir leur famille. Souvent le chasseur consacre plusieurs jours de suite à poursuivre le gibier sans succès ; pendant ce temps, il faut que sa famille se nourrisse d’écorces et de racines, ou qu’elle périsse : aussi il y en a beaucoup qui meurent de faim chaque hiver. ».
Les Indiens ne veulent pas vivre comme les Européens : cependant ils ne peuvent se passer des Européens, ni vivre entièrement comme leurs pères. On en jugera par ce seul fait, dont je puise également la connaissance à une source officielle. Des hommes appartenant à une tribu indienne des bords du lac Supérieur avaient tué un Européen ; le gouvernement américain défendit de trafiquer avec la tribu dont les coupables faisaient partie, jusqu’à ce que ceux-ci lui eussent été livrés : ce qui eut lieu.
[48] (↑) « Il y a cinq ans, dit Volney dans son Tableau des États-Unis, p. 370, en allant de Vincennes à Kaskaskias, territoire compris aujourd’hui dans l’État d’Illinois, alors entièrement sauvage (1797), l’on ne traversait point de prairies sans voir des troupeaux de quatre à cinq cents buffles : aujourd’hui il n’en reste plus ; ils ont passé le Mississipi à la nage, importunés par les chasseurs, et surtout par les sonnettes des vaches américaines. »
[49] (↑) On peut se convaincre de la vérité de ce que j’avance ici en consultant le tableau général des tribus indiennes contenues dans les limites réclamées par les États-Unis. (Documents législatifs, 20e congrès, no 117, pp. 90-105.) On verra que les tribus du centre de l’Amérique décroissent rapidement, quoique les Européens soient encore très éloignés d’elles.
[50] (↑) Les Indiens, disent MM. Clark et Cass dans leur rapport au congrès, p. 15, tiennent à leur pays par le même sentiment d’affection qui nous lie au nôtre ; et, de plus, ils attachent à l’idée d’aliéner les terres que le grand Esprit a données à leurs ancêtres certaines idées superstitieuses qui exercent une grande puissance sur les tribus qui n’ont encore rien cédé ou qui n’ont cédé qu’une petite portion de leur territoire aux Européens. « Nous ne vendons pas le lieu où reposent les cendres de nos pères, » telle est la première réponse qu’ils font toujours à celui qui leur propose d’acheter leurs champs.
[51] (↑) Voyez dans les Documents législatifs du congrès, doc. 117, le récit de ce qui se passe dans ces circonstances. Ce morceau curieux se trouve dans le rapport déjà cité, fait par MM. Clark et Lewis Cass, au congrès, le 4 février 1829. M. Cass est aujourd’hui secrétaire d’État de la guerre.
« Quand les Indiens arrivent dans l’endroit où le traité doit avoir lieu, disent MM. Clark et Cass, ils sont pauvres et presque nus. Là, ils voient et examinent un très grand nombre d’objets précieux pour eux, que les marchands américains ont eu soin d’y apporter. Les femmes et les enfants qui désirent qu’on pourvoie à leurs besoins, commencent alors à tourmenter les hommes de mille demandes importunes, et emploient toute leur influence sur ces derniers pour que la vente des terres ait lieu. L’imprévoyance des Indiens est habituelle et invincible. Pourvoir a ses besoins immédiats et gratifier ses désirs présents est la passion irrésistible du sauvage : l’attente d’avantages futurs n’agit que faiblement sur lui ; il oublie facilement le passé, et ne s’occupe point de l’avenir. On demanderait en vain aux Indiens la cession d’une partie de leur territoire, si l’on n’était en état de satisfaire sur-le-champ leurs besoins. Quand on considère avec impartialité la situation dans laquelle ces malheureux se trouvent, on ne s’étonne pas de l’ardeur qu’ils mettent à obtenir quelques soulagements à leurs maux. »
[52] (↑) Le 19 mai 1830, M. Ed. Everett affirmait devant la chambre des représentants que les Américains avaient déjà acquis par traité, à l’est et à l’ouest du Mississipi, 230,000,000 d’acres.
En 1808, les Osages cédèrent 48,000,000 d’acres pour une rente de 1,000 dollars.
En 1818, les Quapaws cédèrent 20,000,000 d’acres pour 4,000 dollars ; ils s’étaient réservé un territoire de 1,000,000 d’acres, afin d’y chasser. Il avait été solennellement juré qu’on le respecterait ; mais il n’a pas tardé a être envahi comme le reste.
« Afin de nous approprier les terres désertes dont les Indiens réclament la propriété, disait M. Bell, rapporteur du comité des affaires indiennes au congrès, le 24 février 1830, nous avons adopté l’usage de payer aux tribus indiennes ce que vaut leur pays de chasse (hunting-ground) après que le gibier a fui ou a été détruit. Il est plus avantageux et certainement plus conforme aux règles de la justice et plus humain d’en agir ainsi, que de s’emparer à main armée du territoire des sauvages.
« L’usage d’acheter aux Indiens leur titre de propriété n’est donc autre chose qu’un nouveau mode d’acquisition que l’humanité et l’intérêt (humanity and expediency) ont substitué à la violence, et qui doit également nous rendre maîtres des terres que nous réclamons en vertu de la découverte, et que nous assure d’ailleurs le droit qu’ont les nations civilisées de s’établir sur le territoire occupé par les tribus sauvages.
« Jusqu’à ce jour, plusieurs causes n’ont cessé de diminuer aux yeux des Indiens le prix du sol qu’ils occupent, et ensuite les mêmes causes les ont portés à nous le vendre sans peine. L’usage d’acheter aux sauvages leur droit d’occupant (right of occupancy) n’a donc jamais pu retarder, dans un degré perceptible, la prospérité des États-Unis. » (Documents législatifs, 21e congrès, no 227, p. 6.)
[53] (↑) Cette opinion nous a, du reste, paru celle de presque tous les hommes d’État américains.
« Si l’on juge de l’avenir par le passé, disait M. Cass au congrès, on doit prévoir une diminution progressive dans le nombre des Indiens, et s’attendre à l’extinction finale de leur race. Pour que cet événement n’eût pas lieu, il faudrait que nos frontières cessassent de s’étendre, et que les sauvages se fixassent au-delà, ou bien qu’il s’opérât un changement complet dans nos rapports avec eux, ce qu’il serait peu raisonnable d’attendre. »
[54] (↑) Voyez entre autres la guerre entreprise par les Wamponoags, et les autres tribus confédérées, sous la conduite de Métacom, en 1675, contre les colons de la Nouvelle-Angleterre, et celle que les Anglais eurent à soutenir en 1622 dans la Virginie.
[55] (↑) Voyez les différents historiens de la Nouvelle-Angleterre. Voyez aussi l’Histoire de la Nouvelle-France, par Charlevoix, et les Lettres édifiantes.
[56] (↑) « Dans toutes les tribus, dit Volney dans son Tableau des États-Unis, p. 423, il existe encore une génération de vieux guerriers qui, en voyant manier la houe, ne cessent de crier à la dégradation des mœurs antiques, et qui prétendent que les sauvages ne doivent leur décadence qu’à ces innovations, et que, pour recouvrer leur gloire et leur puissance, il leur suffirait de revenir à leurs mœurs primitives. »
[57] (↑) On trouve dans un document officiel la peinture suivante :
« Jusqu’à ce qu’un jeune homme ait été aux prises avec l’ennemi, et puisse se vanter de quelques prouesses, on n’a pour lui aucune considération : on le regarde a peu près comme une femme.
« À leurs grandes danses de guerre, les guerriers viennent l’un après l’autre frapper le poteau, comme ils l’appellent, et racontent leurs exploits. Dans cette occasion, leur auditoire est composé des parents, amis et compagnons du narrateur. L’impression profonde que produisent sur eux ses paroles paraît manifestement au silence avec lequel on l’écoute, et se manifeste bruyamment par les applaudissements qui accompagnent la fin de ses récits. Le jeune homme qui n’a rien à raconter dans de semblables réunions se considère comme très malheureux, et il n’est pas sans exemple que de jeunes guerriers dont les passions avaient été ainsi excitées, se soient éloignés tout à coup de la danse, et, partant seuls, aient été chercher des trophées qu’ils pussent montrer et des aventures dont il leur fût permis de se glorifier. »
[58] (↑) Ces nations se trouvent aujourd’hui englobées dans les États de Géorgie, de Tennessee, d’Alabama et de Mississipi.
Il y avait jadis au Sud (on en voit les restes) quatre grandes nations : les Choctaws, les Chickasaws, les Creeks et les Chérokées.
Les restes de ces quatre nations formaient encore, en 1830, environ 75,000 individus. On compte qu’il se trouve à présent, sur le territoire occupé ou réclamé par l’Union anglo-américaine, environ 300,000 Indiens. (Voyez Proceedings of the Indian Board in the city of New York.) Les documents officiels fournis au congrès portent ce nombre à 313,130. Le lecteur qui serait curieux de connaître le nom et la force de toutes les tribus qui habitent le territoire anglo-américain, devra consulter les documents que je viens d’indiquer. (Documents législatifs, 20e congrès, no 117, pp. 90-105.)
[59] (↑) J’ai rapporté en France un ou deux exemplaires de cette singulière publication.
[60] (↑) Voyez dans le rapport du comité des Affaires indiennes, 21e congrès, no 227, p. 23, ce qui fait que les métis se sont multipliés chez les Chérokées ; la cause principale remonte à la guerre de l’indépendance. Beaucoup d’Anglo-Américains de la Géorgie ayant pris parti pour l’Angleterre, furent contraints de se retirer chez les Indiens, et s’y marièrent.
[61] (↑) Malheureusement les métis ont été en plus petit nombre, et ont exercé une moindre influence dans l’Amérique du Nord que partout ailleurs.
Deux grandes nations de l’Europe ont peuplé cette portion du continent américain : les Français et les Anglais.
Les premiers n’ont pas tardé à contracter des unions avec les filles indigènes ; mais le malheur voulut qu’il se trouvât une secrète affinité entre le caractère indien et le leur. Au lieu de donner aux barbares le goût et les habitudes de la vie civilisée, ce sont eux qui souvent se sont attachés avec passion à la vie sauvage : ils sont devenus les hôtes les plus dangereux des déserts, et ont conquis l’amitié de l’Indien en exagérant ses vices et ses vertus. M. de Sénonville, gouverneur du Canada, écrivait à Louis XIV, en 1685 : « On a cru longtemps qu’il fallait approcher les sauvages de nous pour les franciser ; on a tout lieu de reconnaître qu’on se trompait. Ceux qui se sont approchés de nous ne se sont pas rendus Français, et les Français qui les ont hantés sont devenus sauvages. Ils affectent de se mettre comme eux, de vivre comme eux. » (Histoire de la Nouvelle-France, par Charlevoix, vol. ii, p. 345.).
L’Anglais, au contraire, demeurant obstinément attaché aux opinions, aux usages et aux moindres habitudes de ses pères, est resté au milieu des solitudes américaines ce qu’il était au sein des villes de l’Europe ; il n’a donc voulu établir aucun contact avec des sauvages qu’il méprisait, et a évité avec soin de mêler son sang à celui des barbares.
Ainsi, tandis que le Français n’exerçait aucune influence salutaire sur les Indiens, l’Anglais leur était toujours étranger.
[62] (↑) Il y a dans la vie aventureuse des peuples chasseurs je ne sais quel attrait irrésistible qui saisit le cœur de l’homme et l’entraîne en dépit de sa raison et de l’expérience. On peut se convaincre de cette vérité en lisant les Mémoires de Tanner.
Tanner est un Européen qui a été enlevé à l’âge de six ans par les Indiens, et qui est resté trente ans dans les bois avec eux. Il est impossible de rien voir de plus affreux que les misères qu’il décrit. Il nous montre des tribus sans chefs, des familles sans nations, des hommes isolés, débris mutilés de tribus puissantes, errant au hasard au milieu des glaces et parmi les solitudes désolées du Canada. La faim et le froid les poursuivent ; chaque jour la vie semble prête à leur échapper. Chez eux les mœurs ont perdu leur empire, les traditions sont sans pouvoir. Les hommes deviennent de plus en plus barbares. Tanner partage tous ces maux ; il connaît son origine européenne ; il n’est point retenu de force loin des blancs ; il vient au contraire chaque année trafiquer avec eux, parcourt leurs demeures, voit leur aisance ; il sait que du jour où il voudra rentrer au sein de la vie civilisée il pourra facilement y parvenir, et il reste trente ans dans les déserts. Lorsqu’il retourne enfin au milieu d’une société civilisée, il confesse que l’existence dont il a décrit les misères a pour lui des charmes secrets qu’il ne saurait définir ; il y revient sans cesse après l’avoir quittée; il ne s’arrache à tant de maux qu’avec mille regrets ; et lorsqu’il est enfin fixé au milieu des blancs, plusieurs de ses enfants refusent de venir partager avec lui sa tranquillité et son aisance.
J’ai moi-même rencontré Tanner à l’entrée du lac Supérieur. Il m’a paru ressembler bien plus encore à un sauvage qu’à un homme civilisé.
On ne trouve dans l’ouvrage de Tanner ni ordre ni goût ; mais l’auteur y fait, à son insu même, une peinture vivante des préjugés, des passions, des vices, et surtout des misères de ceux au milieu desquels il a vécu.
M. le vicomte Ernest de Blosseville, auteur d’un excellent ouvrage sur les colonies pénales d’Angleterre, à traduits les Mémoires de Tanner. M. de Blosseville a joint à sa traduction des notes d’un grand intérêt, qui permettront au lecteur de comparer les faits racontés par Tanner avec ceux déjà relatés par un grand nombre d’observateurs anciens et modernes.
Tous ceux qui désirent connaître l’état actuel et prévoir la destinée future des races indiennes de l’Amérique du Nord doivent consulter l’ouvrage du M. de Blosseville.
[63] (↑) Cette influence destructive qu’exercent les peuples très civilisés sur ceux qui le sont moins se fait remarquer chez les Européens eux-mêmes.
Des Français avaient fondé, il y a près d’un siècle, au milieu du désert, la ville de Vincennes sur le Wabash. Ils y vécurent dans une grande abondance jusqu’à l’arrivée des émigrants américains. Ceux-ci commencèrent aussitôt à ruiner les anciens habitants par la concurrence ; ils leur achetèrent ensuite leurs terres à vil prix. Au moment où M. de Volney, auquel j’emprunte ce détail, traversa Vincennes, le nombre des Français était réduit à une centaine d’individus, dont la plupart se disposaient à passer à la Louisiane et au Canada. Ces Français étaient des hommes honnêtes, mais sans lumières et sans industrie ; ils avaient contracté une partie des habitudes sauvages. Les Américains, qui leur étaient peut-être inférieurs sous le point de vue moral, avaient sur eux une immense supériorité intellectuelle : ils étaient industrieux, instruits, riches et habitués à se gouverner eux-mêmes.
J’ai moi-même vu au Canada, où la différence intellectuelle entre les deux races est bien moins prononcée, l’Anglais, maître du commerce et de l’industrie dans le pays du Canadien, s’étendre de tous côtés, et resserrer le Français dans des limites trop étroites.
De même, à la Louisiane, presque toute l’activité commerciale et industrielle se concentre entre les mains des Anglo-Américains.
Quelque chose de plus frappant encore se passe dans la province du Texas ; l’État du Texas fait partie, comme on sait, du Mexique, et lui sert de frontière du côté des États-Unis. Depuis quelques années, les Anglo-Américains pénètrent individuellement dans cette province encore mal peuplée, achètent les terres, s’emparent de l’industrie, et se substituent rapidement à la population originaire. On peut prévoir que si le Mexique ne se hâte d’arrêter ce mouvement, le Texas ne tardera pas à lui échapper.
Si quelques différences, comparativement peu sensibles dans la civilisation européenne, amènent de pareils résultats, il est facile de comprendre ce qui doit arriver quand la civilisation la plus perfectionnée de l’Europe entre en contact avec la barbarie indienne.
[64] (↑) Voyez, dans les documents législatifs, 21e congrès, no 89, les excès de tous genres commis par la population blanche sur le territoire des Indiens. Tantôt les Anglo-Américains s’établissent sur une partie du territoire, comme si la terre manquait ailleurs, et il faut que les troupes du congrès viennent les expulser ; tantôt ils enlèvent les bestiaux, brûlent les maisons, coupent les fruits des indigènes ou exercent des violences sur leurs personnes.
Il résulte de toutes ces pièces la preuve que les indigènes sont chaque jour victimes de l’abus de la force. L’Union entretient habituellement parmi les Indiens un agent chargé de la représenter ; le rapport de l’agent des Cherokées se trouve parmi les pièces que je cite : le langage de ce fonctionnaire est presque toujours favorable aux sauvages. « L’intrusion des blancs sur le territoire des Cherokées, dit-il, p. 12, causera la ruine de ceux qui y habitent, et qui y mènent une existence pauvre et inoffensive. » Plus loin on voit que l’État de Géorgie, voulant resserrer les limites des Cherokées, procède à un bornage ; l’agent fédéral fait remarquer que le bornage n’ayant été fait que par les blancs, et non contradictoirement, n’a aucune valeur.
[65] (↑) En 1829, l’État d’Alabama divise le territoire les Creeks en comtés, et soumet la population indienne à des magistrats européens.
En 1830, l’État de Mississipi assimile les Choctaws et les Chickasaws aux blancs, et déclare que ceux d’entre eux qui prendront le titre de chef seront punis de 1,000 dollars d’amende et d’un an de prison.
Lorsque l’État de Mississipi étendit ainsi ses lois sur les Indiens Chactas qui habitaient dans ses limites, ceux-ci s’assemblèrent ; leur chef leur fit connaître quelle était la prétention des blancs, et leur lut quelques unes des lois auxquelles on voulait les soumettre : les sauvages déclarèrent d’une commune voix qu’il valait mieux s’enfoncer de nouveau dans les déserts. (Mississipi papers.)
[66] (↑) Les Géorgiens, qui se trouvent si incommodés du voisinage des Indiens, occupent un territoire qui ne compte pas encore plus de sept habitants par mille carré. En France, il y a cent soixante-deux individus dans le même espace.
[67] (↑) En 1818, le congrès ordonna que le territoire d’Arkansas serait visité par des commissaires américains, accompagnés d’une députation de Creeks, de Choctaws et de Chickasaws. Cette expédition était commandée par MM. Kennerly, McCoy, Wash Hood et John Bell. Voyez les différents rapports des commissaires et leur journal, dans les papiers du congrès, no 87, Houses of Representatives.
[68] (↑) On trouve, dans le traité fait avec les Creeks en 1790, cette clause : « Les États-Unis garantissent solennellement à la nation des Creeks toutes les terres qu’elle possède dans le territoire de l’Union. »
Le traité conclu en juillet 1791 avec les Cherokées contient ce qui suit : « Les États-Unis garantissent solennellement à la nation des Cherokées toutes les terres qu’elle n’a point précédemment cédées. S’il arrivait qu’un citoyen des États-Unis, ou tout autre qu’un Indien, vînt s’établir sur le territoire des Cherokées, les États-Unis déclarent qu’ils retirent à ce citoyen leur protection, et qu’ils le livrent à la nation des Cherokées pour le punir comme bon lui semblera. » Art. 8.
[69] (↑) Ce qui ne l’empêche pas de le leur promettre de la manière la plus formelle. Voyez la lettre du président adressée aux Creeks le 23 mars 1829 : (Proceedings of the Indian Board in the city of New-York, p. 5) : « Au-delà du grand fleuve (le Mississipi), votre père, dit-il, a préparé, pour vous y recevoir, un vaste pays. Là, vos frères les blancs ne viendront pas vous troubler ; ils n’auront aucuns droits sur vos terres ; vous pourrez y vivre vous et vos enfants, au milieu de la paix et de l’abondance, aussi longtemps que l’herbe croîtra et que les ruisseaux couleront ; elles vous appartiendront à toujours. »
Dans une lettre écrite aux Cherokées par le secrétaire du département de la guerre, le 18 avril 18 29, ce fonctionnaire leur déclare qu’ils ne doivent pas se flatter de conserver la jouissance du territoire qu’ils occupent en ce moment, mais il leur donne cette même assurance positive pour le temps où ils seront de l’autre côté du Mississipi (même ouvrage, p. 6) : comme si le pouvoir qui lui manque maintenant ne devait pas lui manquer de même alors !
[70] (↑) Pour se faire une idée exacte de la politique suivie par les États particuliers et par l’Union vis-à-vis des Indiens, il faut consulter : 1o les lois des États particuliers relatives aux Indiens (ce recueil se trouve dans les documents législatifs, 21e congrès, no 319) ; 2o les lois de l’Union relatives au même objet, et en particulier celle du 30 mars 1802 (ces lois se trouvent dans l’ouvrage de M. Story intitulé : Laws of the United States) ; 3o enfin, pour connaître quel est l’état actuel des relations de l’Union avec toutes les tribus indiennes, voyez le rapport fait par M. Cass, secrétaire d’État de la guerre, le 29 novembre 1823.
[71] (↑) Le 19 novembre 1829. Ce morceau est traduit textuellement.
[72] (↑) Il ne faut pas du reste faire honneur de ce résultat aux Espagnols. Si les tribus indiennes n’avaient pas déjà été fixées au sol par l’agriculture au moment de l’arrivée des Européens, elles auraient sans doute été détruites dans l’Amérique du Sud comme dans l’Amérique du Nord.
[73] (↑) Voyez entre autres le rapport fait par M. Bell au nom du comité des affaires indiennes, le 24 février 1830, dans lequel on établit, p. 5, par des raisons très logiques, et où l’on prouve fort doctement que : « The fundamental principle, that the Indians had no right by virtue of their ancient possession either of soil, or sovereignty, has never been abandoned expressly or by implication. » C’est-à-dire que les Indiens, en vertu de leur ancienne possession, n’ont acquis aucun droit de propriété ni de souveraineté, principe fondamental qui n’a jamais été abandonné, ni expressément, ni tacitement.
En lisant ce rapport, rédigé d’ailleurs par une main habile, on est étonné de la facilité et de l’aisance avec lesquelles, dès les premiers mots, l’auteur se débarrasse des arguments fondés sur le droit naturel et sur la raison, qu’il nomme des principes abstraits et théoriques. Plus j’y songe et plus je pense que la seule différence qui existe entre l’homme civilisé et celui qui ne l’est pas, par rapport à la justice, est celle-ci : l’un conteste à la justice des droits que l’autre se contente de violer.
[74] (↑) Avant de traiter cette matière, je dois un avertissement au lecteur. Dans un livre dont j’ai déjà parlé au commencement de cet ouvrage, et qui est sur le point de paraître, M. Gustave de Beaumont, mon compagnon de voyage, a eu pour principal objet de faire connaître en France quelle est la position des nègres au milieu de la population blanche des États-Unis. M. de Beaumont a traité à fond une question que mon sujet m’a seulement permis d’effleurer.
Son livre, dont les notes contiennent un très grand nombre de documents législatifs et historiques, fort précieux et entièrement inconnus, présente en outre des tableaux dont l’énergie ne saurait être égalée que par la vérité. C’est l’ouvrage de M. de Beaumont que devront lire ceux qui voudront comprendre à quels excès de tyrannie sont peu à peu poussés les hommes quand une fois ils ont commencé à sortir de la nature et de l’humanité.
[75] (↑) On sait que plusieurs des auteurs les plus célèbres de l’antiquité étaient ou avaient été des esclaves : Ésope et Térence sont de ce nombre. Les esclaves n’étaient pas toujours pris parmi les nations barbares : la guerre mettait des hommes très civilisés dans la servitude.
[76] (↑) Pour que les blancs quittassent l’opinion qu’ils ont conçue de l’infériorité intellectuelle et morale de leurs anciens esclaves, il faudrait que les nègres changeassent, et ils ne peuvent changer tant que subsiste cette opinion.
[77] (↑) Voyez l’Histoire de la Virginie, par Beverley. Voyez aussi, dans les Mémoires de Jefferson, de curieux détails sur l’introduction des nègres en Virginie, et sur le premier acte qui en a prohibé l’importation en 1778.
[78] (↑) Le nombre des esclaves était moins grand dans le Nord, mais les avantages résultant de l’esclavage n’y étaient pas plus contestés qu’au Sud. En 1740, la législature de l’État de New York déclare qu’on doit encourager le plus possible l’importation directe des esclaves, et que la contrebande doit être sévèrement punie, comme tendant à décourager le commerçant honnête. (Kent’s Commentaries, vol. 2, p. 206.)
On trouve dans la Collection historique du Massachusetts, vol. 4, p. 193, des recherches curieuses de Belknap sur l’esclavage dans la Nouvelle-Angleterre. Il en résulte que, dès 1630, les nègres furent introduits, mais que dès lors la législation et les mœurs se montrèrent opposées à l’esclavage.
Voyez également dans cet endroit la manière dont l’opinion publique, et ensuite la loi, parvinrent à détruire la servitude.
[79] (↑) Non seulement l’Ohio n’admet pas l’esclavage, mais il prohibe l’entrée de son territoire aux nègres libres, et leur défend d’y rien acquérir. Voyez les statuts de l’Ohio.
[80] (↑) Ce n’est pas seulement l’homme individu qui est actif dans l’Ohio ; l’État fait lui-même d’immenses entreprises ; l’État d’Ohio a établi entre le lac Érié et l’Ohio un canal au moyen duquel la vallée du Mississipi communique avec la rivière du Nord. Grâce à ce canal, les marchandises d’Europe qui arrivent à New York peuvent descendre par eau jusqu’à La Nouvelle-Orléans, à travers plus de cinq cents lieues de continent.
[81] (↑) Chiffre exact d’après le recensement de 1830.
| | Kentucky, | 688,844. |
| | Ohio, | 937,679. |
[82] (↑) Indépendamment de ces causes, qui, partout où les ouvriers libres abondent, rendent leur travail plus productif et plus économique que celui des esclaves, il en faut signaler une autre qui est particulière aux États-Unis : sur toute la surface de l’Union on n’a encore trouvé le moyen de cultiver avec succès la canne à sucre que sur les bords du Mississipi, près de l’embouchure de ce fleuve, dans le golfe du Mexique. À la Louisiane, la culture de la canne est extrêmement avantageuse : nulle part le laboureur ne retire un aussi grand prix de ses travaux ; et, comme il s’établit toujours un certain rapport entre les frais de production et les produits, le prix des esclaves est fort élevé à la Louisiane. Or, la Louisiane étant du nombre des États confédérés, on peut y transporter des esclaves de toutes les parties de l’Union ; le prix qu’on donne d’un esclave à La Nouvelle-Orléans élève donc le prix des esclaves sur tous les autres marchés. Il en résulte que, dans les pays où la terre rapporte peu, les frais de la culture par les esclaves continuent à être très considérables, ce qui donne un grand avantage à la concurrence des ouvriers libres.
[83] (↑) Il y a une raison particulière qui achève de détacher de la cause de l’esclavage les deux derniers États que je viens de nommer.
L’ancienne richesse de cette partie de l’Union était principalement fondée sur la culture du tabac. Les esclaves sont particulièrement appropriés à cette culture : or, il arrive que depuis bien des années le tabac perd de sa valeur vénale ; cependant la valeur des esclaves reste toujours la même. Ainsi le rapport entre les frais de production et les produits est changé. Les habitants du Maryland et de la Virginie se sentent donc plus disposés qu’ils ne l’étaient il y a trente ans, soit à se passer d’esclaves dans la culture du tabac, soit à abandonner en même temps la culture du tabac et l’esclavage.
[84] (↑) Les États où l’esclavage est aboli s’appliquent ordinairement à rendre fâcheux aux nègres libres le séjour de leur territoire ; et comme il s’établit sur ce point une sorte d’émulation entre les différents États, les malheureux Nègres ne peuvent que choisir entre des maux.
[85] (↑) Il existe une grande différence entre la mortalité des blancs et celle des noirs dans les États où l’esclavage est aboli : de 1820 à 1831, il n’est mort à Philadelphie qu’un blanc sur quarante-deux individus appartenant à la race blanche, tandis qu’il y est mort un nègre sur vingt et un individus appartenant à la race noire. La mortalité n’est pas si grande à beaucoup près parmi les nègres esclaves. (Voyez Emmerson’s medical Statistics, p. 28.)
[86] (↑) Ceci est vrai dans les endroits où l’on cultive le riz. Les rizières, qui sont malsaines en tous pays, sont particulièrement dangereuses dans ceux que le soleil brûlant des tropiques vient frapper. Les Européens auraient bien de la peine à cultiver la terre dans cette partie du Nouveau-Monde, s’ils voulaient s’obstiner à lui faire produire du riz. Mais ne peut-on pas se passer de rizières ?
[87] (↑) Ces États sont plus près de l’équateur que l’Italie et l’Espagne, mais le continent de l’Amérique est infiniment plus froid que celui de l’Europe.
[88] (↑) L’Espagne fit jadis transporter dans un district de la Louisiane appelé Attakapas, un certain nombre de paysans des Açores. L’esclavage ne fut point introduit parmi eux ; c’était un essai. Aujourd’hui ces hommes cultivent encore la terre sans esclaves ; mais leur industrie est si languissante, qu’elle fournit à peine à leurs besoins.
[89] (↑) On lit dans l’ouvrage américain intitulé Letters on the colonisation Society, par Carey, 1833, ce qui suit : « Dans la Caroline du Sud, depuis quarante ans, la race noire croît plus vite que celle des blancs. En faisant un ensemble de la population des cinq États du Sud qui ont d’abord eu des esclaves, dit encore M. Carey, le Maryland, la Virginie, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Géorgie, on découvre que de 1790 à 1830, les blancs ont augmenté dans le rapport de 80 par 100. »
Aux États-Unis, en 1830, les hommes appartenant aux deux races étaient distribués de la manière suivante : États où l’esclavage est aboli, 6,565,434 blancs, 120,520 nègres. États où l’esclavage existe encore, 3,960,814 blancs, 2,208,102 nègres.
[90] (↑) Cette opinion, du reste, est appuyée sur des autorités bien autrement graves que la mienne. On lit entre autres dans les Mémoires de Jefferson : « Rien n’est plus clairement écrit dans le livre des destinées que l’affranchissement des noirs, et il est tout aussi certain que les deux races également libres ne pourront vivre sous le même gouvernement. La nature, l’habitude et l’opinion ont établi entre elles des barrières insurmontables. » (Voyez Extrait des Mémoires de Jefferson, par M. Conseil.)
[91] (↑) Si les Anglais des Antilles s’étaient gouvernés eux-mêmes, on peut compter qu’ils n’eussent pas accordé l’acte d’émancipation que la mère patrie vient d’imposer.
[92] (↑) Cette société prit le nom de Société de la Colonisation des noirs.
Voyez ses rapports annuels, et notamment le quinzième. Voyez aussi la brochure déjà indiquée intitulée : Letters on the colonisation Society and on its probable results, par M. Carey. Philadelphie, avril 1833.
[93] (↑) Cette dernière règle a été tracée par les fondateurs eux-mêmes de l’établissement. Ils ont craint qu’il n’arrivât en Afrique quelque chose d’analogue à ce qui se passe sur les frontières des États-Unis, et que les nègres, comme les Indiens, entrant en contact avec une race plus éclairée que la leur, ne fussent détruits avant de pouvoir se civiliser.
[94] (↑) Il se rencontrerait bien d’autres difficultés encore dans une pareille entreprise. Si l’Union, pour transporter les nègres d’Amérique en Afrique, entreprenait d’acheter les noirs à ceux dont ils sont les esclaves; le prix des nègres, croissant en proportion de leur rareté, s’élèverait bientôt à des sommes énormes, et il n’est pas croyable que les États du Nord consentissent à faire une semblable dépense, dont ils ne devraient point recueillir les fruits. Si l’Union s’emparait de force ou acquérait à un bas prix fixé par elle les esclaves du Sud, elle créerait une résistance insurmontable parmi les États situés dans cette partie de l’Union. Des deux côtés on aboutit à l’impossible.
[95] (↑) Il y avait en 1830 dans les États-Unis 2,010,327 esclaves, et 319,439 affranchis; en tout 2,329,766 nègres ; ce qui formait un peu plus du cinquième de la population totale des États-Unis à la même époque.
[96] (↑) L’affranchissement n’est point interdit, mais soumis à des formalités qui le rendent difficile.
[97] (↑) Voyez la conduite des États du Nord dans la guerre de 1812. « Durant cette guerre, dit Jefferson dans une lettre du 17 mars 1817 au général La Fayette, quatre des États de l’Est n’étaient plus liés au reste de l’Union que comme des cadavres à des hommes vivants. » — (Correspondance de Jefferson, publiée par M. Conseil.)
[98] (↑) L’état de paix où se trouve l’Union ne lui donne aucun prétexte pour avoir une armée permanente. Sans armée permanente, un gouvernement n’a rien de préparé d’avance pour profiter du moment favorable, vaincre la résistance, et enlever par surprise le souverain pouvoir.
[99] (↑) C’est ainsi que la province de la Hollande, dans la république des Pays-Bas, et l’empereur, dans la Confédération Germanique, se sont quelquefois mis à la place de l’Union, et ont exploité dans leur intérêt particulier la puissance fédérale.
[100] (↑) Hauteur moyenne des Alléghanys, suivant Volney (Tableau des États-Unis, p. 33), 700 à 800 mètres ; 5,000 à 6,000 pieds, suivant Darby : la plus grande hauteur des Vosges est de 1,400 mètres au-dessus du niveau de la mer.
[101] (↑) Voyez la carte à la fin du premier volume.
[102] (↑) Voyez View of the United States, par Darby, p. 64 et 79.
[103] (↑) La chaîne des Alléghanys n’est pas plus haute que celle des Vosges, et n’offre pas autant d’obstacles que cette dernière aux efforts de l’industrie humaine. Les pays situés sur le versant oriental des Alléghanys sont donc aussi naturellement liés à la vallée du Mississipi que la Franche-Comté, la haute Bourgogne et l’Alsace le sont à la France.
[104] (↑) 1,002,600 milles carrés. Voyez View of the United States, by Darby, p. 435.
[105] (↑) Je n’ai pas besoin, je pense, de dire que par ces expressions : les Anglo-Américains, j’entends seulement parler de la grande majorité d’entre eux. En dehors de cette majorité se tiennent toujours quelques individus isolés.
[106] (↑)
| Recensement | de 1790, | 3,929,328. |
| — | de 1830, | 12,856,165. |
[107] (↑) Ceci n’est, il est vrai, qu’un péril passager. Je ne doute pas qu’avec le temps la société ne vienne à s’asseoir et à se régler dans l’Ouest comme elle l’a déjà fait sur les bords de l’océan Atlantique.
[108] (↑) La Pennsylvanie, avait 431,373 habitants en 1790.
[109] (↑) Superficie de l’État de New-York, 6,213 lieus carrés (500 milles carrés.) Voyez View of United States, by Darby, p. 435.
[110] (↑) Si la population continue à doubler en vingt-deux ans, pendant un siècle encore, comme elle a fait depuis deux cents ans, en 1852 on comptera dans les États-Unis vingt-quatre millions d’habitants, quarante-huit en 1874, et quatre-vingt-seize en 1896. Il en serait ainsi quand même on rencontrerait sur le versant orientai des montagnes Rocheuses des terrains qui se refuseraient à la culture. Les terres déjà occupées peuvent très facilement contenir ce nombre d’habitants. Cent millions d’hommes répandus sur le sol occupé en ce moment par les vingt-quatre États et les trois territoires dont se compose l’Union ne donneraient que 762 individus par lieue carrée, ce qui serait encore bien éloigné de la population moyenne de la France, qui est de 1,006 ; de celle de l’Angleterre, qui est de 1,457 ; et ce qui resterait même au-dessous de la population de la Suisse. La Suisse, malgré ses lacs et ses montagnes, compte 783 habitants par lieue carrée. Voyez Malte-Brun, vol. 6, p. 92.
[111] (↑) Le territoire des États-Unis a une superficie de 295,000 lieues carrées ; celui de l’Europe, suivant Malte-Brun, vol. 6, p. 4, est de 500,000.
[112] (↑) Voyez Documents législatifs, 20e congrès, no 117, p. 105.
[113] (↑) 3,672,317, dénombrement de 1830.
[114] (↑) De Jefferson, capitale de l’État de Missouri, à Washington, on compte 1,019 milles, ou 420 lieues de poste. (American almanac, 1831, p 48.)
[115] (↑) Pour juger de la différence qui existe entre le mouvement commercial du Sud et celui du Nord, il suffit de jeter les yeux sur le tableau suivant :
En 1829, les vaisseaux du grand et du petit commerce appartenant à la Virginie, aux deux Carolines et à la Géorgie (les quatre grands États du Sud), ne jaugeaient que 5,243 tonn.
Dans la même année, les navires du seul État du Massachusetts jaugeaient 17,322 tonn. (Documents législatifs, 21e congrès, 2e session, no 140, p. 244.) Ainsi le seul État du Massachusetts avait trois fois plus de vaisseaux que les quatre États sus-nommés.
Cependant l’État du Massachusetts n’a que 959 lieues carrées de superficie (7,335 milles carrés) et 610,014 habitants, tandis que les quatre États dont je parle ont 27,204 lieues carrées (210,000 milles) et 3,047,767 habitants. Ainsi la superficie de l’État de Massachusetts ne forme que la trentième partie de la superficie des quatre États, et sa population est cinq fois moins grande que la leur. (View of the United States, par Darby.) L’esclavage nuit de plusieurs manières à la prospérité commerciale du Sud : il diminue l’esprit d’entreprise chez les blancs, et il empêche qu’ils ne trouvent à leur disposition les matelots dont ils auraient besoin. La marine ne se recrute en général que dans la dernière classe de la population. Or, ce sont les esclaves qui, au Sud, forment cette classe, et il est difficile de les utiliser à la mer : leur service serait inférieur à celui des blancs, et on aurait toujours à craindre qu’ils ne se révoltassent au milieu de l’Océan, ou ne prissent la fuite en abordant les rivages étrangers.
[116] (↑) View of the United States, by Darby, p. 444.
[117] (↑) Remarquez que, quand je parle du bassin du Mississipi, je n’y comprends point la portion des États de New York, de Pennsylvanie et de Virginie, placée à l’ouest des Alleghanys, et qu’on doit cependant considérer comme en faisant aussi partie.
[118] (↑) On s’aperçoit alors que, pendant les dix ans qui viennent de s’écouler, tel État a accru sa population dans la proportion de 5 sur 100, comme le Delaware ; tel autre dans la proportion de 250 sur 100, comme le territoire du Michigan. La Virginie découvre que, durant la même période, elle a augmenté le nombre de ses habitants dans le rapport de 13 sur 100, tandis que l’État limitrophe de l’Ohio a augmenté le nombre des siens dans le rapport de 61 à 100. Voyez la table générale continue au National Calendar, vous serez frappé de ce qu’il y a d’inégal dans la fortune des différents États.
[119] (↑) On va voir plus loin que, pendant la dernière période, la population de la Virginie a crû dans la proportion de 13 à 100. Il est nécessaire d’expliquer comment le nombre des représentants d’un État peut décroître lorsque la population de l’État, loin de décroître elle-même, est en progrès.
Je prends pour objet de comparaison la Virginie, que j’ai déjà citée. Le nombre des députés de la Virginie, en 1823, était en proportion du nombre total des députés de l’Union ; le nombre des députés de la Virginie en 1833 est de même en proportion du nombre total des députés de l’Union en 1833, et en proportion du rapport de sa population, accrue pendant ces dix années. Le rapport du nouveau nombre de députés de la Virginie à l’ancien sera donc proportionnel, d’une part au rapport du nouveau nombre total des députés à l’ancien, et d’autre part au rapport des proportions d’accroissement de la Virginie et de toute l’Union. Ainsi, pour que le nombre des députés de la Virginie reste stationnaire, il suffit que le rapport de la proportion d’accroissement du petit pays à celle du grand soit l’inverse du rapport du nouveau nombre total des députés à l’ancien ; et pour peu que cette proportion d’accroissement de la population virginienne soit dans un plus faible rapport avec la proportion d’accroissement de toute l’Union, que le nouveau nombre des députés de l’Union avec l’ancien, le nombre des députés de la Virginie sera diminué.
[120] (↑) Washington, Jefferson, Madison et Monroe.
[121] (↑) Voyez le rapport fait par son comité à la Convention, qui a proclamé la nullification dans la Caroline du Sud.
[122] (↑) La population d’un pays forme assurément le premier élément de sa richesse. Durant cette même période de 1820 à 1832, pendant laquelle la Virginie a perdu deux députés au congrès, sa population s’est accrue dans la proportion de 13,7 à 100 ; celle des Carolines dans le rapport de 15 à 100, et celle de la Géorgie dans la proportion de 51,5 à 100 (Voyez American Almanac, 1832, p. 162). Or, la Russie, qui est le pays d’Europe où la population croît le plus vite, n’augmente en dix ans le nombre de ses habitants que dans la proportion de 9,5 à 100 ; la France dans celle de 7 à 100, et l’Europe en masse dans celle de 4,7 à 100 (voyez Malte-Brun, vol. 6, p. 95).
[123] (↑) Il faut avouer cependant que la dépréciation qui s’est opérée dans le prix du tabac, depuis cinquante ans, a notablement diminué l’aisance des cultivateurs du Sud ; mais ce fait est indépendant de la volonté des hommes du Nord comme de la leur.
[124] (↑) En 1832, le district du Michigan, qui n’a que 31,639 habitants, et ne forme encore qu’un désert à peine frayé, présentait le développement de 940 milles de routes de poste. Le territoire presque entièrement sauvage d’Arkansas était déjà traversé par 1738 milles de routes de poste. Voyez the Report of the post general, 30 novembre 1833. Le port seul des journaux dans toute l’Union rapporte par an 254,796 dollars.
[125] (↑) Dans le cours de dix ans, de 1821 à 1831, 271 bateaux à vapeur ont été lancés dans les seules rivières qui arrosent la vallée du Mississipi.
En 1829, il existait aux États-Unis 256 bateaux à vapeur. Voyez Documents législatifs, no 140, p. 274.
[126] (↑) Voyez dans les documents législatifs, que j’ai déjà cités au chapitre des Indiens, la lettre du président des États-Unis aux Cherokées, sa correspondance à ce sujet avec ses agents et ses messages au congrès.
[127] (↑) Le premier acte de cession eut lieu de la part de l’État de New-York en 1780 ; la Virginie, le Massachusetts, le Connecticut, la Caroline du Sud, la Caroline du Nord, suivirent cet exemple à différentes périodes, la Géorgie fut la dernière ; son acte de cession ne remonte qu’à 1802.
[128] (↑) Le Président refusa, il est vrai, de sanctionner cette loi, mais il en admit complétement le principe. Voyez Message du 8 décembre 1833.
[129] (↑) La Banque actuelle des États-Unis a été créée en 1816, avec un capital de 35,000,000 de dollars (185,500,000 fr.) : son privilège expire en 1836. L’année dernière, le congrès fit une loi pour le renouveler ; mais le Président refusa sa sanction. La lutte est aujourd’hui engagée de part et d’autre avec une violence extrême, et il est facile de présager la chute prochaine de la Banque.
[130] (↑) Voyez principalement, pour les détails de cette affaire, les Documents législatifs, 22e congrès, 2e session, no 30.
[131] (↑) C’est-à-dire une majorité du peuple ; car le parti opposé, nommé Union Party, compta toujours une très forte et très active minorité en sa faveur. La Caroline peut avoir environ 47,000 électeurs ; 30,000 étaient favorables à la nullification, et 17,000 contraires.
[132] (↑) Cette ordonnance fut précédée du rapport d’un comité chargé d’en préparer la rédaction : ce rapport renferme l’exposition et le but de la loi. On y lit, p. 34 : « Lorsque les droits réservés aux différents États par la Constitution sont violés de propos délibéré, le droit et le devoir de ces États est d’intervenir, afin d’arrêter les progrès du mal, de s’opposer à l’usurpation, et de maintenir dans leurs respectives limites les pouvoirs et privilèges qui leur appartiennent comme souverains indépendants. Si les États ne possédaient pas ce droit, en vain se prétendraient-ils souverains. La Caroline du Sud déclare ne reconnaître sur la terre aucun tribunal qui soit placé au-dessus d’elle. Il est vrai qu’elle a passé, avec d’autres États souverains comme elle, un contrat solennel d’union (a solemn contract of union), mais elle réclame et exercera le droit d’expliquer quel en est le sens à ses yeux, et lorsque ce contrat est violé par ses associés et par le gouvernement qu’ils ont créé, elle veut user du droit évident (unquestionable), de juger quelle est l’étendue de l’infraction, et quelles sont les mesures à prendre pour en obtenir justice. »
[133] (↑) Ce qui acheva de déterminer le Congrès à cette mesure, ce fut une démonstration du puissant État de Virginie, dont la législature s’offrit à servir d’arbitre entre l’Union et la Caroline du Sud. Jusque là cette dernière avait paru entièrement abandonnée, même par les États qui avaient réclamé avec elle.
[134] (↑) Loi du 2 mars 1833.
[135] (↑) Cette loi fut suggérée par M. Clay et passa en quatre jours, dans les deux chambres du congrès, à une immense majorité.
[136] (↑) La valeur totale des importations de l’année finissant au 30 septembre 1832, a été de 101,129,266 dollars. Les importations faites sur navires étrangers ne figurent que pour une somme de 10,731,039 dollars, à peu près un dixième.
[137] (↑) La valeur totale des exportations, pendant la même année, a été de 87,176,943 dollars ; la valeur exportée sur vaisseaux étrangers a été de 21,036,183 dollars, ou à peu près le quart (Williams’s register, 1833, p. 398.)
[138] (↑) Pendant les années 1829, 1830, 1831, il est entré dans les ports de l’Union des navires jaugeant ensemble 3,307,719 tonneaux. Les navires étrangers ne fournissent à ce total que 544,571 tonneaux. Ils étaient donc dans la proportion de 16 à 100 à peu près. (National Calendar, 1833, p. 304.)
Durant les années 1820, 1826 et 1831, les vaisseaux anglais entrés dans les ports de Londres, Liverpool et Hull, ont jaugé 443,800 tonneaux. Les vaisseaux étrangers entrés dans les mêmes ports pendant les mêmes années jaugeaient 159,431 tonneaux. Le rapport entre eux était donc comme 36 est à 100 à peu près. (Companion to the almanac, 1834, p. 169.).
Dans l’année 1832, le rapport des bâtiments étrangers et des bâtiments anglais entrés dans les ports de la Grande-Bretagne était comme 29 à 100.
[139] (↑) Les matières premières, en général, coûtent moins cher en Amérique qu’en Europe, mais le prix de la main-d’œuvre y est beaucoup plus élevé.
[140] (↑) Il ne faut pas croire que les vaisseaux anglais soient uniquement occupés à transporter en Angleterre les produits étrangers, ou à transporter chez les étrangers les produits anglais ; de nos jours la marine marchande d’Angleterre forme comme une grande entreprise de voitures publiques, prêtes à servir tous les producteurs du monde et à faire communiquer tous les peuples entre eux. Le génie maritime des Américains les porte à élever une entreprise rivale de celle des Anglais.
[141] (↑) Une partie du commerce de la Méditerranée se fait déjà sur des vaisseaux américains.
[142] (↑) En première ligne celle-ci : les peuples livrés et habitués au régime municipal parviennent bien plus aisément que les autres à créer de florissantes colonies. L’habitude de penser par soi-même et de se gouverner est indispensable dans un pays nouveau, où le succès dépend nécessairement en grande partie des efforts individuels des colons.
[143] (↑) Les États-Unis seuls couvrent déjà un espace égal à la moitié de l’Europe. La superficie de l’Europe est de 500,000 lieues carrées ; sa population de 205,000,000 d’habitants. Malte-Brun, liv. CXIV, vol. 6, page 4.
[144] (↑) Voyez Malte-Brun, liv. CXVI, vol. 6, page 92.
[145] (↑) C’est la population proportionnelle à celle de l’Europe, en prenant la moyenne de 410 hommes par lieue carrée.
[146] (↑) La Russie est, de toutes les nations de l’Ancien-Monde, celle dont la population augmente le plus rapidement, proportion gardée.
Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Tome 3 (1848)
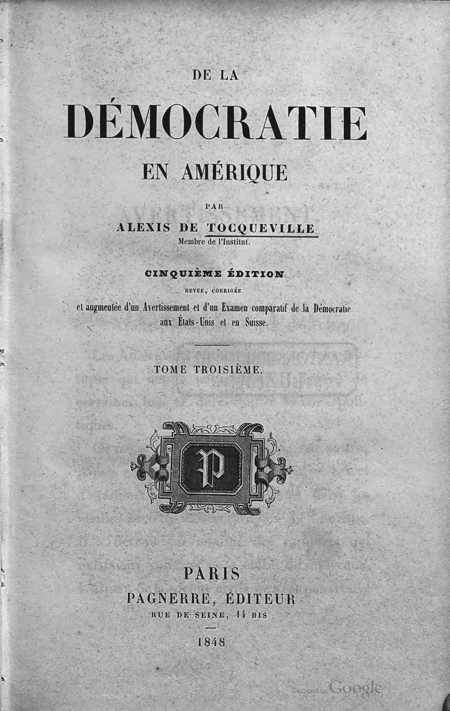
[3-331]
TABLE DU TROISIÈME VOLUME.↩
Avertissement. p. i
PREMIÈRE PARTIE. Influence de la Démocratie sur le Mouvement intellectuel aux États-Unis.
- Chapitre I. — De la méthode philosophique des Américains. p. 1
- Chapitre II. — De la source principale des croyances chez les peuples démocratiques. p. 11
- Chapitre III. — Pourquoi les Américains montrent plus d’aptitude et de goût pour les idées générales que leurs pères les Anglais. p. 21
- Chapitre IV. — Pourquoi les Américains n’ont jamais été aussi passionnés que les Français pour les idées générales en matière politique. p. 31
- Chapitre V. — Comment, aux États-Unis, la religion sait se servir des instincts démocratiques. p. 35
- Chapitre VI. — Des progrès du catholicisme aux Étuis-Unis. p. 53
- Chapitre VII. — Ce qui fait pencher l’esprit des peuples démocratiques vers le panthéisme. p. 57
- Chapitre VIII. — Comment l’égalité suggère aux Américains l’idée de la perfectibilité indéfinie de l’homme. p. 61
- Chapitre IX. — Comment l’exemple des Américains ne prouve point qu’un peuple démocrate ne saurait avoir de l’aptitude et du goût pour les sciences, la littérature et les arts. p. 67
- Chapitre X. — Pourquoi les Américains s’attachent plutôt à la pratique des sciences qu’à la théorie. p. 79
- Chapitre XI. — Dans quel esprit les Américains cultivent les arts. p. 93
- Chapitre XII. — Pourquoi les Américains élèvent en même temps de si petits et de si grands monuments. p. 103
- Chapitre XIII. — Physionomie littéraire des siècles démocratiques. p. 107
- Chapitre XIV. — De l’industrie littéraire. p. 119
- Chapitre XV. — Pourquoi l’étude de la littérature grecque et latine est particulièrement utile dans les sociétés démocratiques. p. 121
- Chapitre XVI. — Comment la démocratie américaine a modifié la langue anglaise. p. 125
- Chapitre XVII. — De quelques sources de poésie chez les nations démocratiques. p. 139
- Chapitre XVIII. — Pourquoi les écrivains et les orateurs américains sont souvent boursouflés. p. 153
- Chapitre XIX. — Quelques observations sur le théâtre des peuples démocratiques. p. 157
- Chapitre XX. — De quelques tendances particulières aux historiens dans les siècles démocratiques. p. 167
- Chapitre XXI. — De l’éloquence parlementaire aux États-Unis. p. 175
DEUXIÈME PARTIE. Influence de la Démocratie sur les sentiments des Américains.
- Chapitre I. — Pourquoi les peuples démocratiques montrent un amour plus ardent et plus durable pour l’égalité que pour la liberté. p. 185
- Chapitre II. — De l’individualisme dans les pays démocratiques. p. 195
- Chapitre III. — Comment l’individualisme est plus grand au sortir d’une révolution démocratique qu’à une autre époque. p. 201
- Chapitre IV. — Comment les Américains combattent l’individualisme par des institutions libres. p. 205
- Chapitre V. — De l’usage que les Américains font de l’association dans la vie civile. p. 213
- Chapitre VI. — Du rapport des associations et des journaux. p. 223
- Chapitre VII. — Rapport des associations civiles et des associations politiques. p. 231
- Chapitre VIII. — Comment les Américains combattent l’individualisme par la doctrine de l’intérêt bien entendu. p. 243
- Chapitre IX. — Comment les Américains appliquent la doctrine de l’intérêt bien entendu en matière de religion. p. 251
- Chapitre X. — Du goût du bien-être matériel en Amérique. p. 257
- Chapitre XI. — Des effets particuliers que produit l’amour des jouissances matérielles dans les siècles démocratiques. p. 263
- Chapitre XII. — Pourquoi certains Américains font voir un spiritualisme si exalté. p. 269
- Chapitre XIII. — Pourquoi les Américains se montrent si inquiets au milieu de leur bien-être. p. 273
- Chapitre XIV. — Comment le goût des jouissances matérielles s’unit chez les Américains à l’amour de la liberté et au soin des affaires publiques. p. 281
- Chapitre XV. — Comment les croyances religieuses détournent de temps en temps l’âme des Américains vers les jouissances immatérielles. p. 289
- Chapitre XVI. — Comment l’amour excessif du bien-être peut nuire au bien-être. p. 299
- Chapitre XVII. — Comment, dans les temps d’égalité et de doute, il importe de reculer l’objet des actions humaines. p. 303
- Chapitre XVIII. — Pourquoi, chez les Américains, toutes les professions honnêtes sont réputées honorables. p. 309
- Chapitre XIX. — Ce qui fait pencher presque tous les Américains vers les professions industrielles. p. 313
- Chapitre XX. — Comment l’aristocratie pourrait sortir de l’industrie. p. 321
NOTE. p. 329
FIN DE LA TABLE DU TROISIÈME VOLUME.
[III-i]
AVERTISSEMENT.↩
Les Américains ont un état social démocratique qui leur a naturellement suggéré de certaines lois et de certaines mœurs politiques.
Ce même état social a, de plus, fait naître, parmi eux, une multitude de sentiments et d’opinions qui étaient inconnus dans les vieilles sociétés aristocratiques de l’Europe. Il a détruit ou modifié des rapports qui existaient jadis, et en a établi de nouveaux. L’aspect de la société civile ne s’est pas trouvé [III-ii] moins changé que la physionomie du monde politique.
J’ai traité le premier sujet dans l’ouvrage publié par moi il y a cinq ans, sur la Démocratie américaine. Le second fait l’objet du présent livre. Ces deux parties se complètent l’une par l’autre et ne forment qu’une seule œuvre.
Il faut que, sur-le-champ, je prévienne le lecteur contre une erreur qui me serait fort préjudiciable.
En me voyant attribuer tant d’effets divers à l’égalité, il pourrait en conclure que je considère l’égalité comme la cause unique de tout ce qui arrive de nos jours. Ce serait me supposer une vue bien étroite.
Il y a, de notre temps, une foule d’opinions, de sentiments, d’instincts qui ont dû la naissance à des faits étrangers ou même contraires à l’égalité. C’est ainsi que, si je prenais les États-Unis pour exemple, je prouverais aisément que la nature du pays, [III-iii] l’origine de ses habitants, la religion des premiers fondateurs, leurs lumières acquises, leurs habitudes antérieures, ont exercé et exercent encore, indépendamment de la Démocratie, une immense influence sur leur manière de penser et de sentir. Des causes différentes mais aussi distinctes du fait de l’égalité se rencontreraient en Europe et expliqueraient une grande partie de ce qui s’y passe.
Je reconnais l’existence de toutes ces différentes causes et leur puissance, mais mon sujet n’est point d’en parler. Je n’ai pas entrepris de montrer la raison de tous nos penchants et de toutes nos idées ; j’ai seulement voulu faire voir en quelle partie l’égalité avait modifié les uns et les autres.
On s’étonnera peut-être qu’étant fermement de cette opinion que la révolution démocratique dont nous sommes témoins, est un fait irrésistible contre lequel il ne serait ni désirable ni sage de lutter, il me soit arrivé souvent dans ce livre d’adresser des paroles [III-iv] si sévères aux sociétés démocratiques que cette révolution a créées.
Je répondrai simplement que c’est parce que je n’étais point un adversaire de la Démocratie, que j’ai voulu être sincère envers elle.
Les hommes ne reçoivent point la vérité de leurs ennemis, et leurs amis ne la leur offrent guère ; c’est pour cela que je l’ai dite.
J’ai pensé que beaucoup se chargeraient d’annoncer les biens nouveaux que l’égalité promet aux hommes, mais que peu oseraient signaler de loin les périls dont elle les menace. C’est donc principalement vers ces périls que j’ai dirigé mes regards, et, ayant cru les découvrir clairement, je n’ai pas eu la lâcheté de les taire.
J’espère qu’on retrouvera dans ce second ouvrage l’impartialité qu’on a paru remarquer dans le premier. Placé au milieu des opinions contradictoires qui nous divisent, j’ai tâché de détruire momentanément dans mon cœur les [III-v] sympathies favorables ou les instincts contraires que m’inspire chacune d’elles. Si ceux qui liront mon livre y rencontrent une seule phrase dont l’objet soit de flatter l’un des grands partis qui ont agité notre pays, ou l’une des petites factions qui, de nos jours, le tracassent et l’énervent, que ces lecteurs élèvent la voix et m’accusent.
Le sujet que j’ai voulu embrasser est immense ; car il comprend la plupart des sentiments et des idées que fait naître l’état nouveau du monde. Un tel sujet excède assurément mes forces ; en le traitant, je ne suis point parvenu à me satisfaire.
Mais, si je n’ai pu atteindre le but auquel j’ai tendu, les lecteurs me rendront du moins cette justice que j’ai conçu et suivi mon entreprise dans l’esprit qui pouvait me rendre digne d’y réussir.
[III-1]
DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.
PREMIÈRE PARTIE.
INFLUENCE DE LA DÉMOCRATIE SUR LE MOUVEMENT INTELLECTUEL AUX ÉTATS-UNIS.
CHAPITRE I.↩
De la méthode philosophique des Américains.
Je pense qu’il n’y a pas, dans le monde civilisé, de pays où l’on s’occupe moins de philosophie qu’aux États-Unis.
Les Américains n’ont point d’école philosophique qui leur soit propre, et ils s’inquiètent [III-2] fort peu de toutes celles qui divisent l’Europe ; ils en savent à peine les noms.
Il est facile de voir cependant que presque tous les habitants des États-Unis dirigent leur esprit de la même manière, et le conduisent d’après les mêmes règles ; c’est-à-dire qu’ils possèdent, sans qu’ils se soient jamais donné la peine d’en définir les règles, une certaine méthode philosophique qui leur est commune à tous.
Echapper à l’esprit de système, au joug des habitudes, aux maximes de famille, aux opinions de classe, et, jusqu’à un certain point, aux préjugés de nation ; ne prendre la tradition que comme un renseignement, et les faits présents que comme une utile étude pour faire autrement et mieux ; chercher par soi-même et en soi seul la raison des choses, tendre au résultat sans se laisser enchaîner au moyen, et viser au fond à travers la forme, tels sont les principaux traits qui caractérisent ce que j’appellerai la méthode philosophique des Américains.
Que si je vais plus loin encore, et que parmi ces traits divers je cherche le principal, et celui qui peut résumer presque tous les autres, je découvre que, dans la plupart des opérations de l’esprit, chaque Américain n’en appelle qu’à l’effort individuel de sa raison.
L’Amérique est donc l’un des pays du monde [III-3] où l’on étudie le moins, et où l’on suit le mieux les préceptes de Descartes. Cela ne doit pas surprendre.
Les Américains ne lisent point les ouvrages de Descartes, parce que leur état social les détourne des études spéculatives, et ils suivent ses maximes parce que ce même état social dispose naturellement leur esprit à les adopter.
Au milieu du mouvement continuel qui règne au sein d’une société démocratique, le lien qui unit les générations entre elles se relâche ou se brise ; chacun y perd aisément la trace des idées de ses aïeux, ou ne s’en inquiète guère.
Les hommes qui vivent dans une semblable société ne sauraient non plus puiser leurs croyances dans les opinions de la classe à laquelle ils appartiennent, car il n’y a, pour ainsi dire, plus de classes, et celles qui existent encore sont composées d’éléments si mouvants, que le corps ne saurait jamais y exercer un véritable pouvoir sur ses membres.
Quant à l’action que peut avoir l’intelligence d’un homme sur celle d’un autre, elle est nécessairement fort restreinte dans un pays où les citoyens, devenus à peu près pareils, se voient tous de fort près, et, n’apercevant dans aucun d’entre eux les signes d’une grandeur et d’une supériorité incontestables, sont sans cesse [III-4] ramenés vers leur propre raison comme vers la source la plus visible et la plus proche de la vérité. Ce n’est pas seulement alors la confiance en tel homme qui est détruite, mais le goût d’en croire un homme quelconque sur parole.
Chacun se renferme donc étroitement en soi-même et prétend de là juger le monde.
L’usage où sont les Américains de ne prendre qu’en eux-mêmes la règle de leur jugement conduit leur esprit à d’autres habitudes.
Comme ils voient qu’ils parviennent à résoudre sans aide toutes les petites difficultés que présente leur vie pratique, ils en concluent aisément que tout dans le monde est explicable, et que rien n’y dépasse les bornes de l’intelligence.
Ainsi, ils nient volontiers ce qu’ils ne peuvent comprendre : cela leur donne peu de foi pour l’extraordinaire et un dégoût presque invincible pour le surnaturel.
Comme c’est à leur propre témoignage qu’ils ont coutume de s’en rapporter, ils aiment à voir très clairement l’objet dont ils s’occupent ; ils le débarrassent donc, autant qu’ils le peuvent, de son enveloppe, ils écartent tout ce qui les en sépare, et enlèvent tout ce qui le cache aux regards, afin de le voir de plus près et en plein jour. Cette disposition de leur esprit les conduit bientôt à mépriser les formes, qu’ils considèrent comme des [III-5] voiles inutiles et incommodes placés entre eux et la vérité.
Les Américains n’ont donc pas eu besoin de puiser leur méthode philosophique dans les livres, ils l’ont trouvée en eux-mêmes. J’en dirai autant de ce qui s’est passé en Europe.
Cette même méthode ne s’est établie et vulgarisée en Europe qu’à mesure que les conditions y sont devenues plus égales et les hommes plus semblables.
Considérons un moment l’enchaînement des temps :
Au seizième siècle, les réformateurs soumettent à la raison individuelle quelques-uns des dogmes de l’ancienne foi ; mais ils continuent à lui soustraire la discussion de tous les autres. Au dix-septième, Bacon, dans les sciences naturelles, et Descartes, dans la philosophie proprement dite, abolissent les formules reçues, détruisent l’empire des traditions et renversent l’autorité du maître.
Les philosophes du dix-huitième siècle, généralisant enfin le même principe, entreprennent de soumettre à l’examen individuel de chaque homme l’objet de toutes ses croyances.
Qui ne voit que Luther, Descartes et Voltaire, se sont servis de la même méthode, et qu’ils ne diffèrent que dans le plus ou moins grand usage qu’ils ont prétendu qu’on en fit ?
[III-6]
D’où vient que les réformateurs se sont si étroitement renfermés dans le cercle des idées religieuses ? Pourquoi Descartes, ne voulant se servir de sa méthode qu’en certaines matières, bien qu’il l’eût mise en état de s’appliquer à toutes, a-t-il déclaré qu’il ne fallait juger par soi-même que les choses de philosophie et non de politique ? Comment est-il arrivé qu’au dix-huitième siècle on ait tiré tout à coup, de cette même méthode, des applications générales que Descartes et ses prédécesseurs n’avaient point aperçues ou s’étaient refusés à découvrir ? D’où vient enfin qu’à cette époque la méthode dont nous parlons est soudainement sortie des écoles pour pénétrer dans la société et devenir la règle commune de l’intelligence, et qu’après avoir été populaire chez les Français, elle a été ostensiblement adoptée ou secrètement suivie par tous les peuples de l’Europe ?
La méthode philosophique dont il est question a pu naître au seizième siècle, se préciser et se généraliser au dix-septième ; mais elle ne pouvait être communément adoptée dans aucun des deux. Les lois politiques, l’état social, les habitudes d’esprit qui découlent de ces premières causes, s’y opposaient.
Elle a été découverte à une époque où les hommes commençaient à s’égaliser et à se ressembler. [III-7] Elle ne pouvait être généralement suivie que dans des siècles où les conditions étaient enfin devenues à peu près pareilles et les hommes presque semblables.
La méthode philosophique du dix-huitième siècle n’est donc pas seulement française, mais démocratique, ce qui explique pourquoi elle a été si facilement admise dans toute l’Europe dont elle a tant contribué à changer la face. Ce n’est point parce que les Français ont changé leurs anciennes croyances et modifié leurs anciennes mœurs qu’ils ont bouleversé le monde, c’est parce que, les premiers, ils ont généralisé et mis en lumière une méthode philosophique à l’aide de laquelle on pouvait aisément attaquer toutes les choses anciennes, et ouvrir la voie à toutes les nouvelles.
Que si maintenant l’on me demande pourquoi, de nos jours, cette même méthode est plus rigoureusement suivie, et plus souvent appliquée parmi les Français que chez les Américains, au sein desquels l’égalité est cependant aussi complète et plus ancienne, je répondrai que cela tient en partie à deux circonstances qu’il est d’abord nécessaire de faire bien comprendre.
C’est la religion qui a donné naissance aux sociétés anglo-américaines; il ne faut jamais l’oublier : aux États-Unis la religion se confond donc avec toutes les habitudes nationales et tous les [III-8] sentiments que la patrie fait naître ; cela lui donne une force particulière.
À cette raison puissante, ajoutez cette autre qui ne l’est pas moins : en Amérique la religion s’est, pour ainsi dire, posé elle-même ses limites; l’ordre religieux y est resté entièrement distinct de l’ordre politique, de telle sorte qu’on a pu changer facilement les lois anciennes sans ébranler les anciennes croyances.
Le christianisme a donc conservé un grand empire sur l’esprit des Américains, et, ce que je veux surtout remarquer, il ne règne point seulement comme une philosophie qu’on adopte après examen, mais comme une religion qu’on croit sans la discuter.
Aux États-Unis, les sectes chrétiennes varient à l’infini et se modifient sans cesse; mais le christianisme lui-même est un fait établi et irrésistible qu’on n’entreprend point d’attaquer ni de défendre.
Les Américains, ayant admis sans examen les principaux dogmes de la religion chrétienne, sont obligés de recevoir de la même manière un grand nombre de vérités morales qui en découlent et qui y tiennent. Cela resserre dans des limites étroites l’action de l’analyse individuelle, et lui soustrait plusieurs des plus importantes opinions humaines.
L’autre circonstance dont j’ai parlé est celle-ci :
[III-9]
Les Américains ont un état social et une constitution démocratiques, mais ils n’ont point eu de révolution démocratique. Ils sont arrivés à peu près tels que nous les voyons sur le sol qu’ils occupent. Cela est très considérable.
Il n’y a pas de révolutions qui ne remuent les anciennes croyances, n’énervent l’autorité et n’obscurcissent les idées communes. Toute révolution a donc plus ou moins pour effet de livrer les hommes à eux-mêmes et d’ouvrir devant l’esprit de chacun d’eux un espace vide et presque sans bornes.
Lorsque les conditions deviennent égales à la suite d’une lutte prolongée entre les différentes classes dont la vieille société était formée, l’envie, la haine et le mépris du voisin, l’orgueil et la confiance exagérée en soi-même, envahissent, pour ainsi dire, le cœur humain et en font quelque temps leur domaine. Ceci, indépendamment de l’égalité, contribue puissamment à diviser les hommes; à faire qu’ils se défient du jugement les uns des autres et qu’ils ne cherchent la lumière qu’en eux seuls.
Chacun entreprend alors de se suffire et met sa gloire à se faire sur toutes choses des croyances qui lui soient propres. Les hommes ne sont plus liés que par des intérêts et non par des idées, et l’on dirait que les opinions humaines ne forment [III-10] plus qu’une sorte de poussière intellectuelle qui s’agite de tous côtés, sans pouvoir se rassembler et se fixer.
Ainsi, l’indépendance d’esprit que l’égalité suppose n’est jamais si grande et ne paraît si excessive qu’au moment où l’égalité commence à s’établir et durant le pénible travail qui la fonde. On doit donc distinguer avec soin l’espèce de liberté intellectuelle que l’égalité peut donner, de l’anarchie que la révolution amène. Il faut considérer à part chacune de ces deux choses, pour ne pas concevoir des espérances et des craintes exagérées de l’avenir.
Je crois que les hommes qui vivront dans les sociétés nouvelles feront souvent usage de leur raison individuelle ; mais je suis loin de croire qu’ils en fassent souvent abus.
Ceci tient à une cause plus généralement applicable à tous les pays démocratiques et qui, à la longue, doit y retenir dans des limites fixes, et quelquefois étroites, l’indépendance individuelle de la pensée.
Je vais la dire dans le chapitre qui suit.
[III-11]
CHAPITRE II.↩
De la source principale des croyances chez les peuples démocratiques.
Les croyances dogmatiques sont plus ou moins nombreuses, suivant les temps. Elles naissent de différentes manières et peuvent changer de forme et d’objet ; mais on ne saurait faire qu’il n’y ait pas de croyances dogmatiques, c’est-à-dire d’opinions que les hommes reçoivent de confiance et sans les discuter. Si chacun entreprenait lui-même de former toutes ses opinions et de poursuivre isolément la vérité dans des chemins frayés par lui seul, il n’est pas probable qu’un grand nombre [III-12] d’hommes dût jamais se réunir dans aucune croyance commune.
Or, il est facile de voir qu’il n’y a pas de société qui puisse prospérer sans croyances semblables, ou plutôt il n’y en a point qui subsistent ainsi ; car, sans idées communes, il n’y a pas d’action commune, et, sans action commune, il existe encore des hommes, mais non un corps social. Pour qu’il y ait société, et, à plus forte raison, pour que cette société prospère, il faut donc que tous les esprits des citoyens soient toujours rassemblés et tenus ensemble par quelques idées principales ; et cela ne saurait être, à moins que chacun d’eux ne vienne quelquefois puiser ses opinions à une même source et ne consente à recevoir un certain nombre de croyances toutes faites.
Si je considère maintenant l’homme à part, je trouve que les croyances dogmatiques ne lui sont pas moins indispensables pour vivre seul que pour agir en commun avec ses semblables.
Si l’homme était forcé de se prouver à lui-même toutes les vérités dont il se sert chaque jour, il n’en finirait point ; il s’épuiserait en démonstrations préliminaires sans avancer ; comme il n’a pas le temps, à cause du court espace de la vie, ni la faculté, à cause des bornes de son esprit, d’en agir ainsi, il en est réduit à tenir pour assurés une foule de faits et d’opinions qu’il n’a eu ni le [III-13] loisir ni le pouvoir d’examiner et de vérifier par lui-même, mais que de plus habiles ont trouvés ou que la foule adopte. C’est sur ce premier fondement qu’il élève lui-même l’édifice de ses propres pensées. Ce n’est pas sa volonté qui l’amène à procéder de cette manière ; la loi inflexible de sa condition l’y contraint.
Il n’y a pas de si grand philosophe dans le monde qui ne croie un million de choses sur la foi d’autrui, et qui ne suppose beaucoup plus de vérités qu’il n’en établit.
Ceci est non seulement nécessaire, mais désirable. Un homme qui entreprendrait d’examiner tout par lui-même ne pourrait accorder que peu de temps et d’attention à chaque chose ; ce travail tiendrait son esprit dans une agitation perpétuelle qui l’empêcherait de pénétrer profondément dans aucune vérité et de se fixer avec solidité dans aucune certitude. Son intelligence serait tout à la fois indépendante et débile. Il faut donc que, parmi les divers objets des opinions humaines, il fasse un choix et qu’il adopte beaucoup de croyances sans les discuter, afin d’en mieux approfondir un petit nombre dont il s’est réservé l’examen.
Il est vrai que tout homme qui reçoit une opinion sur la parole d’autrui met son esprit en esclavage ; mais c’est une servitude salutaire qui permet de faire un bon usage de la liberté.
[III-14]
Il faut donc toujours, quoi qu’il arrive, que l’autorité se rencontre quelque part dans le monde intellectuel et moral. Sa place est variable, mais elle a nécessairement une place. L’indépendance individuelle peut être plus ou moins grande ; elle ne saurait être sans bornes. Ainsi, la question n’est pas de savoir s’il existe une autorité intellectuelle dans les siècles démocratiques, mais seulement où en est le dépôt et quelle en sera la mesure.
J’ai montré dans le chapitre précédent comment l’égalité des conditions faisait concevoir aux hommes une sorte d’incrédulité instinctive pour le surnaturel, et une idée très-haute et souvent fort exagérée de la raison humaine.
Les hommes qui vivent dans ces temps d’égalité sont donc difficilement conduits à placer l’autorité intellectuelle à laquelle ils se soumettent en dehors et au-dessus de l’humanité. C’est en eux-mêmes ou dans leurs semblables qu’ils cherchent d’ordinaire les sources de la vérité. Cela suffirait pour prouver qu’une religion nouvelle ne saurait s’établir dans ces siècles, et que toutes tentatives pour la faire naître ne seraient pas seulement impies, mais ridicules et déraisonnables. On peut prévoir que les peuples démocratiques ne croiront pas aisément aux missions divines, qu’ils se riront volontiers des nouveaux [III-15] prophètes et qu’ils voudront trouver dans les limites de l’humanité, et non au-delà, l’arbitre principal de leurs croyances.
Lorsque les conditions sont inégales et les hommes dissemblables, il y a quelques individus très-éclairés, très-savants, très-puissants par leur intelligence, et une multitude très-ignorante et fort bornée. Les gens qui vivent dans les temps d’aristocratie sont donc naturellement portés à prendre pour guide de leurs opinions la raison supérieure d’un homme ou d’une classe, tandis qu’ils sont peu disposés à reconnaître l’infaillibilité de la masse.
Le contraire arrive dans les siècles d’égalité.
À mesure que les citoyens deviennent plus égaux et plus semblables, le penchant de chacun à croire aveuglément un certain homme ou une certaine classe diminue. La disposition à en croire la masse augmente, et c’est de plus en plus l’opinion qui mène le monde.
Non seulement l’opinion commune est le seul guide qui reste à la raison individuelle chez les peuples démocratiques ; mais elle a chez ces peuples une puissance infiniment plus grande que chez nul autre. Dans les temps d’égalité, les hommes n’ont aucune foi les uns dans les autres, à cause de leur similitude ; mais cette même similitude leur donne une confiance presque [III-16] illimitée dans le jugement du public ; car il ne leur paraît pas vraisemblable qu’ayant tous des lumières pareilles, la vérité ne se rencontre pas du côté du plus grand nombre.
Quand l’homme qui vit dans les pays démocratiques se compare individuellement à tous ceux qui l’environnent, il sent avec orgueil qu’il est égal à chacun d’eux ; mais, lorsqu’il vient à envisager l’ensemble de ses semblables et à se placer lui-même à côté de ce grand corps, il est aussitôt accablé de sa propre insignifiance et de sa faiblesse.
Cette même égalité qui le rend indépendant de chacun de ses concitoyens en particulier, le livre isolé et sans défense à l’action du plus grand nombre.
Le public a donc chez les peuples démocratiques une puissance singulière dont les nations aristocratiques ne pouvaient pas même concevoir l’idée. Il ne persuade pas ses croyances, il les impose et les fait pénétrer dans les âmes par une sorte de pression immense de l’esprit de tous sur l’intelligence de chacun.
Aux États-Unis, la majorité se charge de fournir aux individus une foule d’opinions toutes faites, et les soulage ainsi de l’obligation de s’en former qui leur soient propres. Il y a un grand nombre de théories en matière de philosophie, [III-17] de morale ou de politique que chacun y adopte ainsi sans examen sur la foi du public ; et, si l’on regarde de très-près, on verra que la religion elle-même y règne bien moins comme doctrine révélée que comme opinion commune.
Je sais que parmi les Américains, les lois politiques sont telles que la majorité y régit souverainement la société ; ce qui accroît beaucoup l’empire qu’elle y exerce naturellement sur l’intelligence. Car il n’y a rien de plus familier à l’homme que de reconnaître une sagesse supérieure dans celui qui l’opprime.
Cette omnipotence politique de la majorité aux États-Unis augmente, en effet, l’influence que les opinions du public y obtiendraient sans elle sur l’esprit de chaque citoyen, mais elle ne la fonde point. C’est dans l’égalité même qu’il faut chercher les sources de cette influence, et non dans les institutions plus ou moins populaires que des hommes égaux peuvent se donner. Il est à croire que l’empire intellectuel du plus grand nombre serait moins absolu chez un peuple démocratique soumis à un roi, qu’au sein d’une pure démocratie ; mais il sera toujours très-absolu, et, quelles que soient les lois politiques qui régissent les hommes dans les siècles d’égalité, l’on peut prévoir que la foi dans l’opinion [III-18] commune y deviendra une sorte de religion dont la majorité sera le prophète.
Ainsi l’autorité intellectuelle sera différente, mais elle ne sera pas moindre ; et, loin de croire qu’elle doive disparaître, j’augure qu’elle deviendrait aisément trop grande et qu’il pourrait se faire qu’elle renfermât enfin l’action de la raison individuelle dans des limites plus étroites qu’il ne convient à la grandeur et au bonheur de l’espèce humaine. Je vois très-clairement dans l’égalité deux tendances ; l’une qui porte l’esprit de chaque homme vers des pensées nouvelles, et l’autre qui le réduirait volontiers à ne plus penser. Et j’aperçois comment, sous l’empire de certaines lois, la démocratie éteindrait la liberté intellectuelle que l’état social démocratique favorise, de telle sorte qu’après avoir brisé toutes les entraves que lui imposaient jadis des classes ou des hommes, l’esprit humain s’enchaînerait étroitement aux volontés générales du grand nombre.
Si, à la place de toutes les puissances diverses qui gênaient ou retardaient outre mesure l’essor de la raison individuelle, les peuples démocratiques substituaient le pouvoir absolu d’une majorité, le mal n’aurait fait que changer de caractère. Les hommes n’auraient point trouvé [III-19] le moyen de vivre indépendants ; ils auraient seulement découvert, chose difficile, une nouvelle physionomie de la servitude. Il y a là, je ne saurais trop le redire, de quoi faire réfléchir profondément ceux qui voient dans la liberté de l’intelligence une chose sainte et qui ne haïssent point seulement le despote, mais le despotisme. Pour moi, quand je sens la main du pouvoir qui s’appesantit sur mon front, il m’importe peu de savoir qui m’opprime, et je ne suis pas mieux disposé à passer ma tête dans le joug, parce qu’un million de bras me le présentent.
[III-21]
CHAPITRE III.↩
Pourquoi les Américains montrent plus d’aptitude et de goût pour les idées générales que leurs pères les anglais.
Dieu ne songe point au genre humain en général. Il voit d’un seul coup d’œil et séparément tous les êtres dont l’humanité se compose, et il aperçoit chacun d’eux avec les ressemblances qui le rapprochent de tous et les différences qui l’en isolent.
Dieu n’a donc pas besoin d’idées générales ; c’est-à-dire qu’il ne sent jamais la nécessité de renfermer un très-grand nombre d’objets analogues sous une même forme afin d’y penser plus commodément.
Il n’en est point ainsi de l’homme. Si l’esprit [III-22] humain entreprenait d’examiner et de juger individuellement tous les cas particuliers qui le frappent, il se perdrait bientôt au milieu de l’immensité des détails et ne verrait plus rien ; dans cette extrémité, il a recours a un procédé imparfait mais nécessaire, qui aide sa faiblesse et qui la prouve.
Après avoir considéré superficiellement un certain nombre d’objets et remarqué qu’ils se ressemblent, il leur donne à tous un même nom, les met à part et poursuit sa route.
Les idées générales n’attestent point la force de l’intelligence humaine, mais plutôt son insuffisance, car il n’y a point d’êtres exactement semblables dans la nature ; point de faits identiques ; point de règles applicables indistinctement et de la même manière à plusieurs objets à la fois.
Les idées générales ont cela d’admirable, qu’elles permettent à l’esprit humain de porter des jugements rapides sur un grand nombre d’objets à la fois ; mais, d’une autre part, elles ne lui fournissent jamais que des notions incomplètes, et elles lui font toujours perdre en exactitude ce qu’elles lui donnent en étendue.
À mesure que les sociétés vieillissent, elles acquièrent la connaissance de faits nouveaux et elles s’emparent chaque jour, presque à leur insu, de quelques vérités particulières.
[III-23]
À mesure que l’homme saisit plus de vérités de cette espèce, il est naturellement amené à concevoir un plus grand nombre d’idées générales. On ne saurait voir séparément une multitude de faits particuliers, sans découvrir enfin le lien commun qui les rassemble. Plusieurs individus font percevoir la notion de l’espèce ; plusieurs espèces conduisent nécessairement à celle du genre. L’habitude et le goût des idées générales seront donc toujours d’autant plus grands chez un peuple, que ses lumières y seront plus anciennes et plus nombreuses.
Mais il y a d’autres raisons encore qui poussent les hommes à généraliser leurs idées ou les en éloignent.
Les Américains font beaucoup plus souvent usage que les Anglais des idées générales et s’y complaisent bien davantage ; cela paraît fort singulier au premier abord, si l’on considère que ces deux peuples ont une même origine, qu’ils ont vécu pendant des siècles sous les mêmes lois, et qu’ils se communiquent encore sans cesse leurs opinions et leurs mœurs. Le contraste paraît beaucoup plus frappant encore lorsque l’on concentre ses regards sur notre Europe et que l’on compare entre eux les deux peuples les plus éclairés qui l’habitent.
On dirait que chez les Anglais l’esprit humain [III-24] ne s’arrache qu’avec regret et avec douleur à la contemplation des faits particuliers pour remonter de là jusqu’aux causes, et qu’il ne généralise qu’en dépit de lui-même.
Il semble, au contraire, que parmi nous le goût des idées générales soit devenu une passion si effrénée qu’il faille à tout propos la satisfaire. J’apprends, chaque matin, en me réveillant, qu’on vient de découvrir une certaine loi générale et éternelle dont je n’avais jamais ouï parler jusque-là. Il n’y a pas de si médiocre écrivain auquel il suffise pour son coup d’essai de découvrir des vérités applicables à un grand royaume, et qui ne reste mécontent de lui-même, s’il n’a pu renfermer le genre humain dans le sujet de son discours.
Une pareille dissemblance entre deux peuples très-éclairés m’étonne. Si je reporte enfin mon esprit vers l’Angleterre, et que je remarque ce qui se passe depuis un demi-siècle dans son sein, je crois pouvoir affirmer que le goût des idées générales s’y développe à mesure que l’ancienne constitution du pays s’affaiblit.
L’état plus ou moins avancé des lumières ne suffit donc point seul pour expliquer ce qui suggère à l’esprit humain l’amour des idées générales ou l’en détourne.
Lorsque les conditions sont fort inégales, et que les inégalités sont permanentes, les individus [III-25] deviennent peu à peu si dissemblables, qu’on dirait qu’il y a autant d’humanités distinctes qu’il y a de classes ; on ne découvre jamais à la fois que l’une d’elles, et, perdant de vue le lien général qui les rassemble toutes dans le vaste sein du genre humain, on n’envisage jamais que certains hommes et non pas l’homme.
Ceux qui vivent dans ces sociétés aristocratiques ne conçoivent donc jamais d’idées fort générales relativement à eux-mêmes, et cela suffit pour leur donner une défiance habituelle de ces idées et un dégoût instinctif pour elles.
L’homme qui habite les pays démocratiques ne découvre, au contraire, près de lui, que des êtres à peu près pareils ; il ne peut donc songer à une partie quelconque de l’espèce humaine, que sa pensée ne s’agrandisse et ne se dilate jusqu’à embrasser l’ensemble. Toutes les vérités qui sont applicables à lui-même lui paraissent s’appliquer également et de la même manière à chacun de ses concitoyens et de ses semblables. Ayant contracté l’habitude des idées générales dans celle de ses études dont il s’occupe le plus, et qui l’intéresse davantage, il transporte cette même habitude dans toutes les autres, et c’est ainsi que le besoin de découvrir en toutes choses des règles communes, de renfermer un grand nombre d’objets sous une même forme, et [III-26] d’expliquer un ensemble de faits par une seule cause, devient une passion ardente et souvent aveugle de l’esprit humain.
Rien ne montre mieux la vérité de ce qui précède que les opinions de l’antiquité relativement aux esclaves.
Les génies les plus profonds et les plus vastes de Rome et de la Grèce n’ont jamais pu arriver à cette idée si générale, mais en même temps si simple, de la similitude des hommes et du droit égal que chacun d’eux apporte, en naissant, à la liberté ; et ils se sont évertués à prouver que l’esclavage était dans la nature, et qu’il existerait toujours. Bien plus, tout indique que ceux des anciens qui ont été esclaves avant de devenir libres, et dont plusieurs nous ont laissé de beaux écrits, envisageaient eux-mêmes la servitude sous ce même jour.
Tous les grands écrivains de l’Antiquité faisaient partie de l’aristocratie des maîtres, ou du moins ils voyaient cette aristocratie établie sans contestation sous leurs yeux ; leur esprit, après s’être étendu de plusieurs côtés, se trouva donc borné de celui-là, et il fallut que Jésus-Christ vînt sur la terre pour faire comprendre que tous les membres de l’espèce humaine étaient naturellement semblables et égaux.
Dans les siècles d’égalité, tous les hommes sont indépendants les uns des autres, isolés et faibles ; [III-27] on n’en voit point dont la volonté dirige d’une façon permanente les mouvements de la foule ; dans ces temps, l’humanité semble toujours marcher d’elle-même. Pour expliquer ce qui se passe dans le monde, on en est donc réduit à rechercher quelques grandes causes, qui, agissant de la même manière sur chacun de nos semblables, les portent ainsi à suivre tous volontairement une même route. Cela conduit encore naturellement l’esprit humain à concevoir des idées générales et l’amène à en contracter le goût.
J’ai montré précédemment comment l’égalité des conditions portait chacun à chercher la vérité par soi-même. Il est facile de voir qu’une pareille méthode doit insensiblement faire tendre l’esprit humain vers les idées générales. Lorsque je répudie les traditions de classe, de profession et de famille, que j’échappe à l’empire de l’exemple pour chercher, par le seul effort de ma raison, la voie à suivre, je suis enclin à puiser les motifs de mes opinions dans la nature même de l’homme, ce qui me conduit nécessairement et presque à mon insu, vers un grand nombre de notions très générales.
Tout ce qui précède achève d’expliquer pourquoi les Anglais montrent beaucoup moins d’aptitude et de goût pour la généralisation des idées que leurs fils les Américains et surtout que leurs [III-28] voisins les Français, et pourquoi les Anglais de nos jours en montrent plus que ne l’avaient fait leurs pères.
Les Anglais ont été longtemps un peuple très-éclairé et en même temps très-aristocratique ; leurs lumières les faisaient tendre sans cesse vers des idées très générales, et leurs habitudes aristocratiques les retenaient dans des idées très-particulières. De là, cette philosophie, tout à la fois audacieuse et timide, large et étroite, qui à dominé jusqu’ici en Angleterre, et qui y tient encore tant d’esprits resserrés et immobiles.
Indépendamment des causes que j’ai montrées plus haut, on en rencontre d’autres encore, moins apparentes, mais non moins efficaces, qui produisent chez presque tous les peuples démocratiques le goût et souvent la passion des idées générales.
Il faut bien distinguer entre ces sortes d’idées. Il y en a qui sont le produit d’un travail lent, détaillé, consciencieux, de l’intelligence, et celles-là élargissent la sphère des connaissances humaines.
Il y en a d’autres qui naissent aisément d’un premier effort rapide de l’esprit, et qui n’amènent que des notions très-superficielles et très-incertaines.
Les hommes qui vivent dans les siècles d’égalité ont beaucoup de curiosité et peu de loisir ; leur vie est si pratique, si compliquée, si agitée, [III-29] si active, qu’il ne leur reste que peu de temps pour penser. Les hommes des siècles démocratiques aiment les idées générales, parce qu’elles les dispensent d’étudier les cas particuliers ; elles contiennent, si je puis m’exprimer ainsi, beaucoup de choses sous un petit volume, et donnent en peu de temps un grand produit. Lors donc qu’après un examen inattentif et court, ils croient apercevoir entre certains objets un rapport commun, ils ne poussent pas plus loin leur recherche, et, sans examiner dans le détail comment ces divers objets se ressemblent ou différent, ils se hâtent de les ranger tous sous la même formule, afin de passer outre.
L’un des caractères distinctifs des siècles démocratiques, c’est le goût qu’y éprouvent tous les hommes pour les succès faciles et les jouissances présentes. Ceci se retrouve dans les carrières intellectuelles comme dans toutes les autres. La plupart de ceux qui vivent dans les temps d’égalité sont pleins d’une ambition tout à la fois vive et molle ; ils veulent obtenir sur-le-champ de grands succès, mais ils désireraient se dispenser de grands efforts. Ces instincts contraires les mènent directement à la recherche des idées générales, à l’aide desquelles ils se flattent de peindre de très vastes objets à peu de frais, et d’attirer les regards du public sans peine.
[III-30]
Et je ne sais s’ils ont tort de penser ainsi ; car leurs lecteurs craignent autant d’approfondir, qu’ils peuvent le faire eux-mêmes et ne cherchent d’ordinaire dans les travaux de l’esprit que des plaisirs faciles et de l’instruction sans travail.
Si les nations aristocratiques ne font pas assez d’usage des idées générales, et leur marquent souvent un mépris inconsidéré, il arrive, au contraire, que les peuples démocratiques sont toujours prêts à faire abus de ces sortes d’idées et à s’enflammer indiscrètement pour elles.
[III-31]
CHAPITRE IV.↩
Pourquoi les américains n’ont jamais été aussi passionnes que les français pour les idées générales en matière politique.
J’ai dit précédemment que les Américains montraient un goût moins vif que les Français pour les idées générales. Cela est surtout vrai des idées générales relatives à la politique.
Quoique les Américains fassent pénétrer dans la législation infiniment plus d’idées générales que les Anglais, et qu’ils se préoccupent beaucoup plus que ceux-ci d’ajuster la pratique des affaires humaines à la théorie, on n’a jamais vu aux États-Unis de corps politiques aussi amoureux d’idées [III-32] générales que l’ont été chez nous l’Assemblée constituante et la Convention ; jamais la nation américaine tout entière ne s’est passionnée pour ces sortes d’idées de la même manière que le peuple français du dix-huitième siècle, et n’a fait voir une foi aussi aveugle dans la bonté et dans la vérité absolue d’aucune théorie.
Cette différence entre les Américains et nous, naît de plusieurs causes, mais de celle-ci principalement :
Les Américains forment un peuple démocratique qui a toujours dirigé par lui-même les affaires publiques, et nous sommes un peuple démocratique qui, pendant longtemps, n’a pu que songer à la meilleure manière de les conduire.
Notre état social nous portait déjà à concevoir des idées très générales en matière de gouvernement, alors que notre constitution politique nous empêchait encore de rectifier ces idées par l’expérience, et d’en découvrir peu à peu l’insuffisance: tandis que chez les Américains ces deux choses se balancent sans cesse et se corrigent naturellement.
Il semble, au premier abord, que ceci soit fort opposé à ce que j’ai dit précédemment que les nations démocratiques puisaient dans les agitations mêmes de leur vie pratique l’amour qu’elles montrent pour les théories. Un examen plus [III-33] attentif fait découvrir qu’il n’y a là rien de contradictoire.
Les hommes qui vivent dans les pays démocratiques sont fort avides d’idées générales parce qu’ils ont peu de loisirs et que ces idées les dispensent de perdre leur temps à examiner les cas particuliers ; cela est vrai, mais ne doit s’entendre que des matières qui ne sont pas l’objet habituel et nécessaire de leurs pensées. Des commerçants saisiront avec empressement et sans y regarder de fort près toutes les idées générales qu’on leur présentera relativement à la philosophie, à la politique, aux sciences et aux arts ; mais ils ne recevront qu’après examen celles qui auront trait au commerce et ne les admettront que sous réserve.
La même chose arrive aux hommes d’état, quand il s’agit d’idées générales relatives à la politique.
Lors donc qu’il y a un sujet sur lequel il est particulièrement dangereux que les peuples démocratiques se livrent aveuglément et outre mesure aux idées générales, le meilleur correctif qu’on puisse employer, c’est de faire qu’ils s’en occupent tous les jours et d’une manière pratique ; il faudra bien alors qu’ils entrent forcément dans les détails, et les détails leur feront apercevoir les côtés faibles de la théorie.
[III-34]
Le remède est souvent douloureux, mais son effet est sûr.
C’est ainsi que les institutions démocratiques qui forcent chaque citoyen de s’occuper pratiquement du gouvernement, modèrent le goût excessif des théories générales en matière politique, que l’égalité suggère.
[III-35]
CHAPITRE V.↩
Comment, aux États-Unis, la religion sait se servir des instincts démocratiques.
J’ai établi, dans un des chapitres précédents que les hommes ne peuvent se passer de croyances dogmatiques, et qu’il était même très à souhaiter qu’ils en eussent de telles. J’ajoute ici que, parmi toutes les croyances dogmatiques, les plus désirables me semblent être les croyances dogmatiques en matière de religion ; cela se déduit très-clairement, alors même qu’on ne veut faire attention qu’aux seuls intérêts de ce monde.
Il n’y a presque point d’action humaine, quelque particulière qu’on la suppose, qui ne prenne [III-36] naissance dans une idée très-générale que les hommes ont conçue de Dieu, de ses rapports avec le genre humain, de la nature de leur âme et de leurs devoirs envers leurs semblables. L’on ne saurait faire que ces idées ne soient pas la source commune dont tout le reste découle.
Les hommes ont donc un intérêt immense à se faire des idées bien arrêtées sur Dieu, leur âme, leurs devoirs généraux envers leur créateur et leurs semblables ; car le doute sur ces premiers points livrerait toutes leurs actions au hasard, et les condamnerait en quelque sorte, au désordre et à l’impuissance.
C’est donc la matière sur laquelle il est le plus important que chacun de nous ait des idées arrêtées, et malheureusement c’est aussi celle dans laquelle il est le plus difficile que chacun, livré à lui-même, et par le seul effort de sa raison, en vienne à arrêter ses idées.
Il n’y a que des esprits très-affranchis des préoccupations ordinaires de la vie, très-pénétrants, très-déliés, très-exercés, qui, à l’aide de beaucoup de temps et de soins, puissent percer jusqu’à ces vérités si nécessaires.
Encore voyons-nous que ces philosophes eux-mêmes sont presque toujours environnés d’incertitudes ; qu’à chaque pas la lumière naturelle qui les éclaire s’obscurcit et menace de s’éteindre, et [III-37] que, malgré tous leurs efforts, ils n’ont encore pu découvrir qu’un petit nombre de notions contradictoires, au milieu desquelles l’esprit humain flotte sans cesse depuis des milliers d’années, sans pouvoir saisir fermement la vérité ni même trouver de nouvelles erreurs. De pareilles études sont fort au-dessus de la capacité moyenne des hommes, et quand même la plupart des hommes seraient capables de s’y livrer, il est évident qu’ils n’en auraient pas le loisir.
Des idées arrêtées sur Dieu et la nature humaine sont indispensables à la pratique journalière de leur vie, et cette pratique les empêche de pouvoir les acquérir.
Cela me paraît unique. Parmi les sciences, il en est qui, utiles à la foule, sont à sa portée ; d’autres ne sont abordables qu’à peu de personnes et ne sont point cultivées par la majorité qui n’a besoin que de leurs applications les plus éloignées ; mais la pratique journalière de celle-ci est indispensable à tous, bien que son étude soit inaccessible au plus grand nombre.
Les idées générales relatives à Dieu et à la nature humaine sont donc parmi toutes les idées, celles qu’il convient le mieux de soustraire à l’action habituelle de la raison individuelle, et pour laquelle il y a le plus à gagner et le moins à perdre, en reconnaissant une autorité.
[III-38]
Le premier objet, et l’un des principaux avantages des religions, est de fournir sur chacune de ces questions primordiales une solution nette, précise, intelligible pour la foule et très-durable.
Il y a des religions très-fausses et très-absurdes ; cependant l’on peut dire que toute religion, qui reste dans le cercle que je viens d’indiquer et qui ne prétend pas en sortir, ainsi que plusieurs l’ont tenté, pour aller arrêter de tous côtés le libre essor de l’esprit humain, impose un joug salutaire à l’intelligence ; et il faut reconnaître que, si elle ne sauve point les hommes dans l’autre monde, elle est du moins très-utile à leur bonheur et à leur grandeur dans celui-ci.
Cela est surtout vrai des hommes qui vivent dans les pays libres.
Quand la religion est détruite chez un peuple, le doute s’empare des portions les plus hautes de l’intelligence et il paralyse à moitié toutes les autres. Chacun s’habitue à n’avoir que des notions confuses et changeantes sur les matières qui intéressent le plus ses semblables et lui-même ; on défend mal ses opinions ou on les abandonne, et, comme on désespère de pouvoir, à soi seul, résoudre les plus grands problèmes que la destinée humaine présente, on se réduit lâchement à n’y point songer.
Un tel état ne peut manquer d’énerver les âmes ; [III-39] il détend les ressorts de la volonté et il prépare les citoyens à la servitude.
Non-seulement il arrive alors que ceux-ci laissent prendre leur liberté, mais souvent ils la livrent.
Lorsqu’il n’existe plus d’autorité en matière de religion, non plus qu’en matière politique, les hommes s’effrayent bientôt à l’aspect de cette indépendance sans limites. Cette perpétuelle agitation de toutes choses les inquiète et les fatigue. Comme tout remue dans le monde des intelligences, ils veulent, du moins, que tout soit ferme et stable dans l’ordre matériel, et, ne pouvant plus reprendre leurs anciennes croyances, ils se donnent un maître.
Pour moi, je doute que l’homme puisse jamais supporter à la fois une complète indépendance religieuse et une entière liberté politique ; et je suis porté à penser que, s’il n’a pas de foi, il faut qu’il serve, et s’il est libre, qu’il croie.
Je ne sais cependant si cette grande utilité des religions n’est pas plus visible encore chez les peuples où les conditions sont égales que chez tous les autres.
Il faut reconnaître que l’égalité qui introduit de grands biens dans le monde, suggère cependant aux hommes, ainsi qu’il sera montré ci-après, des instincts fort dangereux ; elle tend à les isoler les uns des autres, pour porter chacun d’eux à ne s’occuper que de lui seul.
[III-40]
Elle ouvre démesurément leur âme à l’amour des jouissances matérielles.
Le plus grand avantage des religions est d’inspirer des instincts tout contraires. Il n’y a point de religion qui ne place l’objet des désirs de l’homme au-delà et au-dessus des biens de la terre, et qui n’élève naturellement son âme vers des régions fort supérieures à celles des sens. Il n’y en a point non plus qui n’impose à chacun des devoirs quelconques envers l’espèce humaine, ou en commun avec elle, et qui ne le tire ainsi, de temps à autre, de la contemplation de lui-même. Ceci se rencontre dans les religions les plus fausses et les plus dangereuses.
Les peuples religieux sont donc naturellement forts précisément à l’endroit où les peuples démocratiques sont faibles ; ce qui fait bien voir de quelle importance il est que les hommes gardent leur religion en devenant égaux.
Je n’ai ni le droit ni la volonté d’examiner les moyens surnaturels dont Dieu se sert pour faire parvenir une croyance religieuse dans le cœur de l’homme. Je n’envisage en ce moment les religions que sous un point de vue purement humain ; je cherche de quelle manière elles peuvent le plus aisément conserver leur empire dans les siècles démocratiques où nous entrons.
J’ai fait voir comment, dans les temps de lumières et d’égalité, l’esprit humain ne consentait [III-41] qu’avec peine à recevoir des croyances dogmatiques, et n’en ressentait vivement le besoin qu’en fait de religion. Ceci indique d’abord que, dans ces siècles-là, les religions doivent se tenir plus discrètement qu’en tous les autres dans les bornes qui leur sont propres, et ne point chercher à en sortir, car, en voulant étendre leur pouvoir plus loin que les matières religieuses, elles risquent de n’être plus crues en aucune matière. Elles doivent donc tracer avec soin le cercle dans lequel elles prétendent arrêter l’esprit humain, et au-delà le laisser entièrement libre de l’abandonner à lui-même.
Mahomet a fait descendre du ciel, et a placé dans le Coran, non-seulement des doctrines religieuses, mais des maximes politiques, des lois civiles et criminelles, des théories scientifiques. L’évangile ne parle, au contraire, que des rapports généraux des hommes avec Dieu et entre eux. Hors de là, il n’enseigne rien et n’oblige à rien croire. Cela seul, entre mille autres raisons, suffit pour montrer que la première de ces deux religions ne saurait dominer longtemps dans des temps de lumières et de démocratie, tandis que la seconde est destinée à régner dans ces siècles comme dans tous les autres.
Si je continue plus avant cette même recherche, je trouve que, pour que les religions [III-42] puissent, humainement parlant, se maintenir dans les siècles démocratiques, il ne faut pas seulement qu’elles se renferment avec soin dans le cercle des matières religieuses. Leur pouvoir dépend encore beaucoup de la nature des croyances qu’elles professent, des formes extérieures qu’elles adoptent, et des obligations qu’elles imposent.
Ce que j’ai dit précédemment, que l’égalité porte les hommes à des idées très-générales et très-vastes, doit principalement s’entendre en matière de religion. Des hommes semblables et égaux conçoivent aisément la notion d’un Dieu unique, imposant à chacun d’eux les mêmes règles et leur accordant le bonheur futur au même prix. L’idée de l’unité du genre humain les ramène sans cesse à l’idée de l’unité du Créateur, tandis qu’au contraire des hommes très-séparés les uns des autres et fort dissemblables en arrivent volontiers à faire autant de divinités qu’il y a de peuples, de castes, de classes et de familles, et à tracer mille chemins particuliers pour aller au ciel.
L’on ne peut disconvenir que le christianisme lui-même n’ait en quelque façon subi cette influence qu’exerce l’état social et politique sur les croyances religieuses.
Au moment où la religion chrétienne a paru sur la terre, la Providence, qui, sans doute, préparait le monde pour sa venue, avait réuni une [III-43] grande partie de l’espèce humaine, comme un immense troupeau, sous le sceptre des Césars. Les hommes qui composaient cette multitude différaient beaucoup les uns des autres ; mais ils avaient cependant ce point commun, qu’ils obéissaient tous aux mêmes lois ; et chacun d’eux était si faible et si petit par rapport à la grandeur du prince, qu’ils paraissaient tous égaux quand on venait à les comparer à lui.
Il faut reconnaître que cet état nouveau et particulier de l’humanité dut disposer les hommes à recevoir les vérités générales que le christianisme enseigne, et sert à expliquer la manière facile et rapide avec laquelle il pénétra alors dans l’esprit humain.
La contre-épreuve se fit après la destruction de l’Empire.
Le monde romain s’étant alors brisé, pour ainsi dire, en mille éclats, chaque nation en revint à son individualité première. Bientôt, dans l’intérieur de ces nations, les rangs se graduèrent à l’infini ; les races se marquèrent ; les castes partagèrent chaque nation en plusieurs peuples. Au milieu de cet effort commun qui semblait porter les sociétés humaines à se subdiviser elles-mêmes en autant de fragments qu’il était possible de le concevoir, le christianisme ne perdit point de vue les principales idées [III-44] générales qu’il avait mises en lumière. Mais il parut néanmoins se prêter, autant qu’il était en lui, aux tendances nouvelles que le fractionnement de l’espèce humaine faisait naître. Les hommes continuèrent à n’adorer qu’un seul Dieu créateur et conservateur de toutes choses ; mais chaque peuple, chaque cité, et, pour ainsi dire, chaque homme, crut pouvoir obtenir quelque privilège à part et se créer des protecteurs particuliers auprès du souverain maître. Ne pouvant diviser la Divinité, l’on multiplia du moins et l’on grandit outre mesure ses agents ; l’hommage dû aux anges et aux saints devint pour la plupart des chrétiens un culte presque idolâtre, et l’on put craindre un moment que la religion chrétienne ne rétrogradât vers les religions qu’elle avait vaincues.
Il me paraît évident que plus les barrières qui séparaient les nations dans le sein de l’humanité et les citoyens dans l’intérieur de chaque peuple tendent à disparaître, plus l’esprit humain se dirige, comme de lui-même, vers l’idée d’un être unique et tout puissant, dispensant également et de la même manière les mêmes lois à chaque homme. C’est donc particulièrement dans ces siècles de démocratie qu’il importe de ne pas laisser confondre l’hommage rendu aux agents secondaires avec le culte qui n’est dû qu’au Créateur.
[III-45]
Une autre vérité me paraît fort claire : c’est que les religions doivent moins se charger de pratiques extérieures dans les temps démocratiques que dans tous les autres.
J’ai fait voir, à propos de la méthode philosophique des Américains, que rien ne révolte plus l’esprit humain dans les temps d’égalité que l’idée de se soumettre à des formes. Les hommes qui vivent dans ces temps supportent impatiemment les figures ; les symboles leur paraissent des artifices puérils dont on se sert pour voiler ou parer à leurs yeux des vérités qu’il serait plus naturel de leur montrer toutes nues et au grand jour ; ils restent froids à l’aspect des cérémonies et ils sont naturellement portés à n’attacher qu’une importance secondaire aux détails du culte.
Ceux qui sont chargés de régler la forme extérieure des religions dans les siècles démocratiques doivent bien faire attention à ces instincts naturels de l’intelligence humaine pour ne point lutter sans nécessité contre eux.
Je crois fermement à la nécessité des formes ; je sais qu’elles fixent l’esprit humain dans la contemplation des vérités abstraites, et, l’aidant à les saisir fortement, les lui font embrasser avec ardeur. Je n’imagine point qu’il soit possible de maintenir une religion sans pratiques extérieures ; [III-46] mais, d’une autre part, je pense que, dans les siècles où nous entrons, il serait particulièrement dangereux de les multiplier outre mesure ; qu’il faut plutôt les restreindre, et qu’on ne doit en retenir que ce qui est absolument nécessaire pour la perpétuité du dogme lui-même, qui est la substance des religions [1] , dont le culte n’est que la forme. Une religion qui deviendrait plus minutieuse, plus inflexible et plus chargée de petites observances dans le même temps que les hommes deviennent plus égaux, se verrait bientôt réduite à une troupe de zélateurs passionnés au milieu d’une multitude incrédule.
Je sais qu’on ne manquera pas de m’objecter que les religions, ayant toutes pour objet des vérités générales et éternelles, ne peuvent ainsi se plier aux instincts mobiles de chaque siècle, sans perdre aux yeux des hommes le caractère de la certitude ; je répondrai encore ici qu’il faut distinguer très-soigneusement les opinions principales qui constituent une croyance et qui y forment ce que les théologiens appellent des articles de foi, et les notions accessoires qui s’y rattachent. Les religions sont obligées de tenir toujours ferme dans [III-47] les premières, quel que soit l’esprit particulier du temps ; mais elles doivent bien se garder de se lier de la même manière aux secondes, dans les siècles où tout change sans cesse de place et où l’esprit, habitué au spectacle mouvant des choses humaines, souffre à regret qu’on le fixe. L’immobilité dans les choses extérieures et secondaires ne me paraît une chance de durée que quand la société civile elle-même est immobile ; partout ailleurs, je suis porté à croire que c’est un péril.
Nous verrons que, parmi toutes les passions que l’égalité fait naître ou favorise, il en est une qu’elle rend particulièrement vive et qu’elle dépose en même temps dans le cœur de tous les hommes : c’est l’amour du bien-être. Le goût du bien-être forme comme le trait saillant et indélébile des âges démocratiques.
Il est permis de croire qu’une religion qui entreprendrait de détruire cette passion mère, serait à la fin détruite par elle ; si elle voulait arracher entièrement les hommes à la contemplation des biens de ce monde pour les livrer uniquement à la pensée de ceux de l’autre, on peut prévoir que les âmes s’échapperaient enfin d’entre ses mains, pour aller se plonger loin d’elle dans les seules jouissances matérielles et présentes.
La principale affaire des religions est de purifier, de régler et de restreindre le goût trop ardent [III-48] et trop exclusif du bien-être que ressentent les hommes dans les temps d’égalité ; mais je crois qu’elles auraient tort d’essayer de le dompter entièrement et de le détruire. Elles ne réussiront point à détourner les hommes de l’amour des richesses ; mais elles peuvent encore leur persuader de ne s’enrichir que par des moyens honnêtes.
Ceci m’amène à une dernière considération qui comprend, en quelque façon, toutes les autres. À mesure que les hommes deviennent plus semblables et plus égaux, il importe davantage que les religions, tout en se mettant soigneusement à l’écart du mouvement journalier des affaires, ne heurtent point sans nécessité les idées généralement admises, et les intérêts permanents qui règnent dans la masse ; car l’opinion commune apparaît de plus en plus comme la première et la plus irrésistible des puissances, et il n’y a pas en dehors d’elle d’appui si fort qui permette de résister longtemps à ses coups. Cela n’est pas moins vrai chez un peuple démocratique, soumis à un despote, que dans une république. Dans les siècles d’égalité, les rois font souvent obéir, mais c’est toujours la majorité qui fait croire ; c’est donc à la majorité qu’il faut complaire dans tout ce qui n’est pas contraire à la foi.
J’ai montré dans mon premier ouvrage comment les prêtres américains s’écartaient des affaires [III-49] publiques. Ceci est l’exemple le plus éclatant, mais non le seul exemple, de leur retenue. En Amérique, la religion est un monde à part où le prêtre règne, mais dont il a soin de ne jamais sortir ; dans ses limites, il conduit l’intelligence ; au dehors, il livre les hommes à eux-mêmes et les abandonne à l’indépendance et à l’instabilité qui sont propres à leur nature et au temps. Je n’ai point vu de pays où le christianisme s’enveloppât moins de formes, de pratiques et de figures qu’aux États-Unis, et présentât des idées plus nettes, plus simples et plus générales à l’esprit humain. Bien que les chrétiens d’Amérique soient divisés en une multitude de sectes, ils aperçoivent tous leur religion sous ce même jour. Ceci s’applique au catholicisme aussi bien qu’aux autres croyances. Il n’y a pas de prêtres catholiques qui montrent moins de goût pour les petites observances individuelles, les méthodes extraordinaires et particulières de faire son salut, ni qui s’attachent plus à l’esprit de la loi et moins à sa lettre que les prêtres catholiques des États-Unis ; nulle part on n’enseigne plus clairement et l’on ne suit davantage cette doctrine de l’Église qui défend de rendre aux saints le culte qui n’est réservé qu’à Dieu. Cependant, les catholiques d’Amérique sont très-soumis et très-sincères.
Une autre remarque est applicable au clergé [III-50] de toutes les communions : les prêtres américains n’essayent point d’attirer et de fixer tous les regards de l’homme vers la vie future ; ils abandonnent volontiers une partie de son cœur aux soins du présent ; ils semblent considérer les biens du monde comme des objets importants, quoique secondaires ; s’ils ne s’associent pas eux-mêmes à l’industrie, ils s’intéressent du moins à ses progrès et y applaudissent, et tout en montrant sans cesse au fidèle l’autre monde comme le grand objet de ses craintes et de ses espérances, ils ne lui défendent point de rechercher honnêtement le bien-être dans celui-ci. Loin de faire voir comment ces deux choses sont divisées et contraires, ils s’attachent plutôt à trouver par quel endroit elles se touchent et se lient.
Tous les prêtres américains connaissent l’empire intellectuel que la majorité exerce, et le respectent. Ils ne soutiennent jamais contre elle que des luttes nécessaires. Ils ne se mêlent point aux querelles des partis, mais ils adoptent volontiers les opinions générales de leur pays et de leur temps, et ils se laissent aller sans résistance dans le courant de sentiments et d’idées qui entraînent autour d’eux toutes choses. Ils s’efforcent de corriger leurs contemporains, mais ils ne s’en séparent point. L’opinion publique ne leur est donc jamais ennemie ; elle les soutient [III-51] plutôt et les protége, et leurs croyances règnent à la fois et par les forces qui lui sont propres et par celles de la majorité qu’ils empruntent.
C’est ainsi qu’en respectant tous les instincts démocratiques qui ne lui sont pas contraires et en s’aidant de plusieurs d’entre eux, la religion parvient à lutter avec avantage contre l’esprit d’indépendance individuelle, qui est le plus dangereux de tous pour elle.
[III-53]
CHAPITRE VI.↩
Du progrès du catholicisme aux États-Unis.
L’Amérique est la contrée la plus démocratique de la terre, et c’est en même temps le pays où, suivant des rapports dignes de foi, la religion catholique fait le plus de progrès. Cela surprend au premier abord.
Il faut bien distinguer deux choses : l’égalité dispose les hommes à vouloir juger par eux-mêmes ; mais, d’un autre côté, elle leur donne le goût et l’idée d’un pouvoir social unique, simple, et le même pour tous. Les hommes qui vivent dans les siècles démocratiques sont donc fort enclins à se soustraire à toute autorité religieuse. Mais, s’ils [III-54] consentent à se soumettre à une autorité semblable, ils veulent du moins qu’elle soit une et uniforme ; des pouvoirs religieux qui n’aboutissent pas tous à un même centre, choquent naturellement leur intelligence, et ils conçoivent presque aussi aisément qu’il n’y ait pas de religion que plusieurs.
On voit de nos jours, plus qu’aux époques antérieures, des catholiques qui deviennent incrédules et des protestants qui se font catholiques. Si l’on considère le catholicisme intérieurement, il semble perdre ; si on regarde hors de lui, il gagne. Cela s’explique.
Les hommes de nos jours sont naturellement peu disposés à croire ; mais, dès qu’ils ont une religion, ils rencontrent aussitôt en eux-mêmes un instinct caché qui les pousse à leur insu vers le catholicisme. Plusieurs des doctrines et des usages de l’église romaine les étonnent ; mais ils éprouvent une admiration secrète pour son gouvernement, et sa grande unité les attire.
Si le catholicisme parvenait enfin à se soustraire aux haines politiques qu’il a fait naître, je ne doute presque point que ce même esprit du siècle, qui lui semble si contraire, ne lui devînt très-favorable, et qu’il ne fît tout à coup de grandes conquêtes.
C’est une des faiblesses les plus familières à l’intelligence humaine de vouloir concilier des [III-55] principes contraires et d’acheter la paix aux dépens de la logique. Il y a donc toujours eu et il y aura toujours des hommes qui, après avoir soumis à une autorité quelques unes de leurs croyances religieuses, voudront lui en soustraire plusieurs autres, et laisseront flotter leur esprit au hasard entre l’obéissance et la liberté. Mais je suis porté à croire que le nombre de ceux-là sera moins grand dans les siècles démocratiques que dans les autres siècles, et que nos neveux tendront de plus en plus à ne se diviser qu’en deux parts, les uns sortant entièrement du christianisme, et les autres entrant dans le sein de l’église romaine.
[III-57]
CHAPITRE VII.↩
Ce qui fait pencher l’esprit des peuples démocratiques vers le panthéisme.
Je montrerai plus tard comment le goût prédominant des peuples démocratiques pour les idées très-générales se retrouve dans la politique ; mais je veux indiquer, dès à présent, son principal effet en philosophie.
On ne saurait nier que le panthéisme n’ait fait de grands progrès de nos jours. Les écrits d’une portion de l’Europe en portent visiblement l’empreinte. Les Allemands l’introduisent dans la philosophie, et les Français dans la littérature. Parmi les ouvrages d’imagination qui se publient en [III-58] France, la plupart renferment quelques opinions ou quelques peintures empruntées aux doctrines panthéistiques, ou laissent apercevoir chez leurs auteurs une sorte de tendance vers ces doctrines. Ceci ne me paraît pas venir seulement d’un accident, mais tenir à une cause durable.
À mesure que, les conditions devenant plus égales, chaque homme en particulier devient plus semblable à tous les autres, plus faible et plus petit, on s’habitue à ne plus envisager les citoyens pour ne considérer que le peuple ; on oublie les individus pour ne songer qu’à l’espèce.
Dans ces temps, l’esprit humain aime à embrasser à la fois une foule d’objets divers ; il aspire sans cesse à pouvoir rattacher une multitude de conséquences à une seule cause.
L’idée de l’unité l’obsède, il la cherche de tous côtés, et, quand il croit l’avoir trouvée, il s’étend volontiers dans son sein et s’y repose. Non seulement il en vient à ne découvrir dans le monde qu’une création et un créateur ; cette première division des choses le gêne encore, et il cherche volontiers à grandir et à simplifier sa pensée en renfermant Dieu et l’univers dans un seul tout. Si je rencontre un système philosophique suivant lequel les choses matérielles et immatérielles, visibles et invisibles, que renferme le monde, ne sont plus considérées que comme les [III-59] parties diverses d’un être immense qui seul reste éternel au milieu du changement continuel et de la transformation incessante de tout ce qui le compose, je n’aurai pas de peine à conclure qu’un pareil système, quoiqu’il détruise l’individualité humaine, ou plutôt parce qu’il la détruit, aura des charmes secrets pour les hommes qui vivent dans les démocraties ; toutes leurs habitudes intellectuelles les préparent à le concevoir et les mettent sur la voie de l’adopter. Il attire naturellement leur imagination et la fixe ; il nourrit l’orgueil de leur esprit et flatte sa paresse.
Parmi les différents systèmes à l’aide desquels la philosophie cherche à expliquer l’univers, le panthéisme me paraît l’un des plus propres à séduire l’esprit humain dans les siècles démocratiques ; c’est contre lui que tous ceux qui restent épris de la véritable grandeur de l’homme, doivent se réunir et combattre.
[III-61]
CHAPITRE VIII.↩
Comment l’égalité suggère aux Américains l’idée de la perfectibilité indéfinie de l’homme.
L’égalité suggère à l’esprit humain plusieurs idées qui ne lui seraient pas venues sans elle, et elle modifie presque toutes celles qu’il avait déjà. Je prends pour exemple l’idée de la perfectibilité humaine, parce qu’elle est une des principales que puisse concevoir l’intelligence, et qu’elle constitue à elle seule une grande théorie philosophique dont les conséquences se font voir à chaque instant dans la pratique des affaires.
Bien que l’homme ressemble sur plusieurs [III-62] points aux animaux, un trait n’est particulier qu’à lui seul : il se perfectionne, et eux ne se perfectionnent point. L’espèce humaine n’a pu manquer de découvrir dès l’origine cette différence. L’idée de la perfectibilité est donc aussi ancienne que le monde ; l’égalité ne l’a point fait naître, mais elle lui donne un caractère nouveau.
Quand les citoyens sont classés suivant le rang, la profession, la naissance, et que tous sont contraints de suivre la voie à l’entrée de laquelle le hasard les a placés, chacun croit apercevoir près de soi les dernières bornes de la puissance humaine, et nul ne cherche plus à lutter contre une destinée inévitable. Ce n’est pas que les peuples aristocratiques refusent absolument à l’homme la faculté de se perfectionner ; ils ne la jugent point indéfinie ; ils conçoivent l’amélioration, non le changement ; ils imaginent la condition des sociétés à venir meilleure, mais non point autre, et, tout en admettant que l’humanité a fait de grands progrès et qu’elle peut en faire quelques uns encore, ils la renferment d’avance dans de certaines limites infranchissables.
Ils ne croient donc point être parvenus au souverain bien et à la vérité absolue (quel homme ou quel peuple a été assez insensé pour [III-63] l’imaginer jamais ?), mais ils aiment à se persuader qu’ils ont atteint à peu près le degré de grandeur et de savoir que comporte notre nature imparfaite ; et, comme rien ne remue autour d’eux, ils se figurent volontiers que tout est à sa place. C’est alors que le législateur prétend promulguer des lois éternelles, que les peuples et les rois ne veulent élever que des monuments séculaires, et que la génération présente se charge d’épargner aux générations futures le soin de régler leurs destinées.
À mesure que les castes disparaissent, que les classes se rapprochent, que les hommes se mêlant tumultueusement, les usages, les coutumes, les lois varient, qu’il survient des faits nouveaux, que des vérités nouvelles sont mises en lumière, que d’anciennes opinions disparaissent, et que d’autres prennent leur place, l’image d’une perfection idéale et toujours fugitive se présente à l’esprit humain.
De continuels changements se passent alors à chaque instant sous les yeux de chaque homme. Les uns empirent sa position, et il ne comprend que trop bien qu’un peuple, ou qu’un individu, quelque éclairé qu’il soit, n’est point infaillible. Les autres améliorent son sort, et il en conclut que l’homme en général est doué de la faculté indéfinie de perfectionner. Ses revers lui font [III-64] voir que nul ne peut se flatter d’avoir découvert le bien absolu ; ses succès l’enflamment à le poursuivre sans relâche. Ainsi, toujours cherchant, tombant, se redressant, souvent déçu, jamais découragé, il tend incessamment vers cette grandeur immense qu’il entrevoit confusément au bout de la longue carrière que l’humanité doit encore parcourir.
On ne saurait croire combien de faits découlent naturellement de cette théorie philosophique suivant laquelle l’homme est indéfiniment perfectible, et l’influence prodigieuse qu’elle exerce sur ceux mêmes qui, ne s’étant jamais occupés que d’agir et non de penser, semblent y conformer leurs actions sans la connaître.
Je rencontre un matelot américain, et je lui demande pourquoi les vaisseaux de son pays sont construits de manière à durer peu, et il me répond sans hésiter que l’art de la navigation fait chaque jour des progrès si rapides, que le plus beau navire deviendrait bientôt presque inutile s’il prolongeait son existence au-delà de quelques années.
Dans ces mots prononcés au hasard par un homme grossier et à propos d’un fait particulier, j’aperçois l’idée générale et systématique suivant laquelle un grand peuple conduit toutes choses.
[III-65]
Les nations aristocratiques sont naturellement portées à trop resserrer les limites de la perfectibilité humaine, et les nations démocratiques les étendent quelquefois outre mesure.
[III-67]
CHAPITRE IX.↩
Comment l’exemple des Américains ne prouve point qu’un peuple démocratique ne saurait avoir de l’aptitude et du goût pour les sciences, la littérature et les arts.
Il faut reconnaître que, parmi les peuples civilisés de nos jours, il en est peu chez qui les hautes sciences aient fait moins de progrès qu’aux États-Unis, et qui aient fourni moins de grands artistes, de poëtes illustres et de célèbres écrivains.
Plusieurs Européens, frappés de ce spectacle, l’ont considéré comme un résultat naturel et inévitable de l’égalité, et ils ont pensé que, si l’état social et les institutions démocratiques venaient une fois à prévaloir sur toute la terre, l’esprit humain [III-68] verrait s’obscurcir peu à peu les lumières qui l’éclairent et que les hommes retomberaient dans les ténèbres.
Ceux qui raisonnent ainsi confondent, je pense, plusieurs idées qu’il serait important de diviser et d’examiner à part. Ils mêlent sans le vouloir ce qui est démocratique avec ce qui n’est qu’américain.
La religion que professaient les premiers émigrants, et qu’ils ont léguée à leurs descendants, simple dans son culte, austère et presque sauvage dans ses principes, ennemie des signes extérieurs et de la pompe des cérémonies, est naturellement peu favorable aux beaux-arts et ne permet qu’à regret les plaisirs littéraires.
Les Américains sont un peuple très-ancien et très-éclairé, qui a rencontré un pays nouveau et immense dans lequel il peut s’étendre à volonté, et qu’il féconde sans peine. Cela est sans exemple dans le monde. En Amérique, chacun trouve donc des facilités, inconnues ailleurs, pour faire sa fortune ou pour l’accroître. La cupidité y est toujours en haleine, et l’esprit humain, distrait à tout moment des plaisirs de l’imagination et des travaux de l’intelligence, n’y est entraîné qu’à la poursuite de la richesse. Non seulement on voit aux États-Unis, comme dans tous les autres pays, des classes industrielles et commerçantes, mais, ce [III-69] qui ne s’était jamais rencontré, tous les hommes s’y occupent à la fois d’industrie et de commerce.
Je suis cependant convaincu que, si les Américains avaient été seuls dans l’univers, avec les libertés et les lumières acquises par leurs pères, et les passions qui leur étaient propres, ils n’eussent point tardé à découvrir qu’on ne saurait faire longtemps des progrès dans la pratique des sciences sans cultiver la théorie ; que tous les arts se perfectionnent les uns par les autres, et, quelque absorbés qu’ils eussent pu être dans la poursuite de l’objet principal de leurs désirs, ils auraient bientôt reconnu qu’il fallait, de temps en temps, s’en détourner pour mieux l’atteindre.
Le goût des plaisirs de l’esprit est d’ailleurs si naturel au cœur de l’homme civilisé que, chez les nations polies, qui sont le moins disposées à s’y livrer, il se trouve toujours un certain nombre de citoyens qui le conçoivent. Ce besoin intellectuel, une fois senti, aurait été bientôt satisfait.
Mais, en même temps que les Américains étaient naturellement portés à ne demander à la science que ses applications particulières aux arts, que les moyens de rendre la vie aisée, la docte et littéraire Europe se chargeait de remonter aux sources générales de la vérité, et perfectionnait en même temps tout ce qui peut concourir aux plaisirs [III-70] comme tout ce qui doit servir aux besoins de l’homme.
En tête des nations éclairées de l’ancien monde, les habitants des États-Unis en distinguaient particulièrement une à laquelle les unissaient étroitement une origine commune et des habitudes analogues. Ils trouvaient chez ce peuple des savants célèbres, d’habiles artistes, de grands écrivains, et ils pouvaient recueillir les trésors de l’intelligence, sans avoir besoin de travailler à les amasser.
Je ne puis consentir à séparer l’Amérique de l’Europe, malgré l’Océan qui les divise. Je considère le peuple des États-Unis comme la portion du peuple anglais chargée d’exploiter les forêts du Nouveau-Monde ; tandis que le reste de la nation, pourvu de plus de loisirs et moins préoccupé des soins matériels de la vie, peut se livrer à la pensée et développer en tous sens l’esprit humain.
La situation des Américains est donc entièrement exceptionnelle, et il est à croire qu’aucun peuple démocratique n’y sera jamais placé. Leur origine toute puritaine, leurs habitudes uniquement commerciales, le pays même qu’ils habitent et qui semble détourner leur intelligence de l’étude des sciences, des lettres et des arts ; le voisinage de l’Europe qui leur permet de ne point les étudier sans retomber dans la barbarie ; mille causes particulières, dont je n’ai pu faire connaître que les [III-71] principales, ont dû concentrer d’une manière singulière l’esprit américain dans le soin des choses purement matérielles. Les passions, les besoins, l’éducation, les circonstances, tout semble, en effet, concourir pour pencher l’habitant des États-Unis vers la terre. La religion seule lui fait, de temps en temps, lever des regards passagers et distraits vers le ciel.
Cessons donc de voir toutes les nations démocratiques sous la figure du peuple américain, et tâchons de les envisager enfin sous leurs propres traits.
On peut concevoir un peuple dans le sein duquel il n’y aurait ni castes, ni hiérarchie, ni classes ; où la loi, ne reconnaissant point de priviléges, partagerait également les héritages, et qui, en même temps, serait privé de lumières et de liberté. Ceci n’est pas une vaine hypothèse : un despote peut trouver son intérêt à rendre ses sujets égaux, et à les laisser ignorants, afin de les tenir plus aisément esclaves.
Non seulement un peuple démocratique de cette espèce ne montrera point d’aptitude ni de goût pour les sciences, la littérature et les arts ; mais il est à croire qu’il ne lui arrivera jamais d’en montrer.
La loi des successions se chargerait elle-même à chaque génération de détruire les fortunes, et [III-72] personne n’en créerait de nouvelles. Le pauvre, privé de lumières et de liberté, ne concevrait même pas l’idée de s’élever vers la richesse, et le riche se laisserait entraîner vers la pauvreté sans savoir se défendre. Il s’établirait bientôt entre ces deux citoyens une complète et invincible égalité. Personne n’aurait alors ni le temps, ni le goût de se livrer aux travaux et aux plaisirs de l’intelligence. Mais tous demeureraient engourdis dans une même ignorance et dans une égale servitude.
Quand je viens à imaginer une société démocratique de cette espèce, je crois aussitôt me sentir dans un de ces lieux bas, obscurs et étouffés, où les lumières, apportées du dehors, ne tardent point à pâlir et à s’éteindre. Il me semble qu’une pesanteur subite m’accable, et que je me traîne au milieu des ténèbres qui m’environnent pour trouver l’issue qui doit me ramener à l’air et au grand jour. Mais tout ceci ne saurait s’appliquer à des hommes déjà éclairés qui, après avoir détruit parmi eux les droits particuliers et héréditaires qui fixaient à perpétuité les biens dans les mains de certains individus ou de certains corps, restent libres.
Quand les hommes, qui vivent au sein d’une société démocratique, sont éclairés, ils découvrent sans peine que rien ne les borne ni ne les fixe et ne les force de se contenter de leur fortune présente.
[III-73]
Ils conçoivent donc tous l’idée de l’accroître, et, s’ils sont libres, ils essaient tous de le faire, mais tous n’y réussissent pas de la même manière. La législature n’accorde plus, il est vrai, de priviléges, mais la nature en donne. L’inégalité naturelle étant très-grande, les fortunes deviennent inégales du moment où chacun fait usage de toutes ses facultés pour s’enrichir.
La loi des successions s’oppose encore à ce qu’il se fonde des familles riches, mais elle n’empêche plus qu’il n’y ait des riches. Elle ramène sans cesse les citoyens vers un commun niveau auquel ils échappent sans cesse ; ils deviennent plus inégaux en biens à mesure que leurs lumières sont plus étendues et leur liberté plus grande.
Il s’est élevé de nos jours une secte célèbre par son génie et ses extravagances, qui prétendait concentrer tous les biens dans les mains d’un pouvoir central, et charger celui-là de les distribuer ensuite, suivant le mérite, à tous les particuliers. On se fût soustrait, de cette manière, à la complète et éternelle égalité qui semble menacer les sociétés démocratiques.
Il y a un autre remède plus simple et moins dangereux, c’est de n’accorder à personne de privilége, de donner à tous d’égales lumières et une égale indépendance, et de laisser à chacun le soin de marquer lui-même sa place. L’inégalité [III-74] naturelle se fera bientôt jour et la richesse passera d’elle-même du côté des plus habiles.
Les sociétés démocratiques et libres renfermeront donc toujours dans leur sein une multitude de gens opulents ou aisés. Ces riches ne seront point liés aussi étroitement entre eux que les membres de l’ancienne classe aristocratique ; ils auront des instincts différents et ne possèderont presque jamais un loisir aussi assuré et aussi complet ; mais ils seront infiniment plus nombreux que ne pouvaient l’être ceux qui composaient cette classe. Ces hommes ne seront point étroitement renfermés dans les préoccupations de la vie matérielle et ils pourront, bien qu’à des degrés divers, se livrer aux travaux et aux plaisirs de l’intelligence : ils s’y livreront donc ; car, s’il est vrai que l’esprit humain penche par un bout vers le borné, le matériel et l’utile, de l’autre, il s’élève naturellement vers l’infini, l’immatériel et le beau. Les besoins physiques l’attachent à la terre, mais, dès qu’on ne le retient plus, il se redresse de lui-même.
Non seulement le nombre de ceux qui peuvent s’intéresser aux œuvres de l’esprit sera plus grand, mais le goût des jouissances intellectuelles descendra, de proche en proche, jusqu’à ceux mêmes qui, dans les sociétés aristocratiques, ne semblent avoir ni le temps ni la capacité de s’y livrer.
[III-75]
Quand il n’y a plus de richesses héréditaires, de priviléges de classes et de prérogatives de naissance, et que chacun ne tire plus sa force que de lui-même, il devient visible que ce qui fait la principale différence entre la fortune des hommes, c’est l’intelligence. Tout ce qui sert à fortifier, à étendre, à orner l’intelligence, acquiert aussitôt un grand prix.
L’utilité du savoir se découvre avec une clarté toute particulière aux yeux mêmes de la foule. Ceux qui ne goûtent point ses charmes prisent ses effets et font quelques efforts pour l’atteindre.
Dans les siècles démocratiques, éclairés et libres, les hommes n’ont rien qui les sépare ni qui les retienne à leur place ; ils s’élèvent ou s’abaissent avec une rapidité singulière. Toutes les classes se voient sans cesse, parce qu’elles sont fort proches. Elles se communiquent et se mêlent tous les jours, s’imitent et s’envient ; cela suggère au peuple une foule d’idées, de notions, de désirs qu’il n’aurait point eus si les rangs avaient été fixes et la société immobile. Chez ces nations le serviteur ne se considère jamais comme entièrement étranger aux plaisirs et aux travaux du maître, le pauvre à ceux du riche ; l’homme des champs s’efforce de ressembler à celui des villes, et les provinces à la métropole.
Ainsi, personne ne se laisse aisément réduire [III-76] aux seuls soins matériels de la vie, et le plus humble artisan y jette, de temps à autre, quelques regards avides et furtifs dans le monde supérieur de l’intelligence. On ne lit point dans le même esprit et de la même manière que chez les peuples aristocratiques ; mais le cercle des lecteurs s’étend sans cesse et finit par renfermer tous les citoyens.
Du moment où la foule commence à s’intéresser aux travaux de l’esprit, il se découvre qu’un grand moyen d’acquérir de la gloire, de la puissance, ou des richesses, c’est d’exceller dans quelques-uns d’entre eux. L’inquiète ambition que l’égalité fait naître se tourne aussitôt de ce côté comme de tous les autres. Le nombre de ceux qui cultivent les sciences, les lettres et les arts, devient immense. Une activité prodigieuse se révèle dans le monde de l’intelligence ; chacun cherche à s’y ouvrir un chemin, et s’efforce d’attirer l’œil du public à sa suite. Il s’y passe quelque chose d’analogue à ce qui arrive aux États-Unis dans la société politique ; les œuvres y sont souvent imparfaites, mais elles sont innombrables ; et, bien que les résultats des efforts individuels soient ordinairement très-petits, le résultat général est toujours très-grand.
Il n’est donc pas vrai de dire que les hommes qui vivent dans les siècles démocratiques soient [III-77] naturellement indifférents pour les sciences, les lettres et les arts ; seulement, il faut reconnaître qu’ils les cultivent à leur manière, et qu’ils apportent, de ce côté, les qualités et les défauts qui leur sont propres.
[III-79]
CHAPITRE X.↩
Pourquoi les Américains s’attachent plutôt à la pratique des sciences qu’à la théorie.
Si l’état social et les institutions démocratiques n’arrêtent point l’essor de l’esprit humain, il est du moins incontestable qu’ils le dirigent d’un côté plutôt que d’un autre. Leurs efforts, ainsi limités, sont encore très grands, et l’on me pardonnera, j’espère, de m’arrêter un moment pour les contempler.
Nous avons fait, quand il s’est agi de la méthode philosophique des Américains, plusieurs remarques dont il faut profiter ici.
L’égalité développe dans chaque homme le désir de juger tout par lui-même ; elle lui donne, en toutes [III-80] choses, le goût du tangible et du réel, le mépris des traditions et des formes. Ces instincts généraux se font principalement voir dans l’objet particulier de ce chapitre.
Ceux qui cultivent les sciences chez les peuples démocratiques craignent toujours de se perdre dans les utopies. Ils se défient des systèmes, ils aiment à se tenir très-près des faits et à les étudier par eux-mêmes ; comme ils ne s’en laissent point imposer facilement par le nom d’aucun de leurs semblables, ils ne sont jamais disposés à jurer sur la parole du maître ; mais, au contraire, on les voit sans cesse occupés à chercher le côté faible de sa doctrine. Les traditions scientifiques ont sur eux peu d’empire ; ils ne s’arrêtent jamais longtemps dans les subtilités d’une école et se payent malaisément de grands mots ; ils pénètrent, autant qu’ils le peuvent, jusqu’aux parties principales du sujet qui les occupe, et ils aiment à les exposer en langue vulgaire. Les sciences ont alors une allure plus libre et plus sûre, mais moins haute.
L’esprit peut, ce me semble, diviser la science en trois parts.
La première contient les principes les plus théoriques, les notions les plus abstraites, celles dont l’application n’est point connue ou est fort éloignée.
[III-81]
La seconde se compose des vérités générales qui, tenant encore à la théorie pure, mènent cependant par un chemin direct et court à la pratique.
Les procédés d’application et les moyens d’exécution remplissent la troisième.
Chacune de ces différentes portions de la science peut être cultivée à part, bien que la raison et l’expérience fassent connaître qu’aucune d’elles ne saurait prospérer longtemps, quand on la sépare absolument des deux autres.
En Amérique la partie purement pratique des sciences est admirablement cultivée, et l’on s’y occupe avec soin de la portion théorique immédiatement nécessaire à l’application ; les Américains font voir de ce côté un esprit toujours net, libre, original et fécond ; mais il n’y a presque personne, aux États-Unis, qui se livre à la portion essentiellement théorique et abstraite des connaissances humaines. Les Américains montrent en ceci l’excès d’une tendance qui se retrouvera, je pense, quoique à un degré moindre, chez tous les peuples démocratiques.
Rien n’est plus nécessaire à la culture des hautes sciences, ou de la portion élevée des sciences, que la méditation, et il n’y a rien de moins propre à la méditation que l’intérieur d’une société démocratique. On n’y rencontre pas, comme chez les peuples aristocratiques, une [III-82] classe nombreuse qui se tient dans le repos parce qu’elle se trouve bien; et une autre qui ne remue point parce qu’elle désespère d’être mieux. Chacun s’agite ; les uns veulent atteindre le pouvoir, les autres s’emparer de la richesse. Au milieu de ce tumulte universel, de ce choc répété des intérêts contraires, de cette marche continuelle des hommes vers la fortune, où trouver le calme nécessaire aux profondes combinaisons de l’intelligence ? comment arrêter sa pensée sur un seul point quand autour de soi tout remue, et qu’on est soi-même entraîné et ballotté chaque jour dans le courant impétueux qui roule toutes choses ?
Il faut bien discerner l’espèce d’agitation permanente qui règne au sein d’une démocratie tranquille et déjà constituée, des mouvements tumultueux et révolutionnaires qui accompagnent presque toujours la naissance et le développement d’une société démocratique.
Lorsqu’une violente révolution a lieu chez un peuple très-civilisé, elle ne saurait manquer de donner une impulsion soudaine aux sentiments et aux idées.
Ceci est vrai surtout des révolutions démocratiques, qui, remuant à la fois toutes les classes dont un peuple se compose, font naître en même temps d’immenses ambitions dans le cœur de chaque citoyen.
[III-83]
Si les Français ont fait tout à coup de si admirables progrès dans les sciences exactes, au moment même où ils achevaient de détruire les restes de l’ancienne société féodale, il faut attribuer cette fécondité soudaine, non pas à la démocratie, mais à la révolution sans exemple qui accompagnait ses développements. Ce qui survint alors était un fait particulier ; il serait imprudent d’y voir l’indice d’une loi générale.
Les grandes révolutions ne sont pas plus communes chez les peuples démocratiques que chez les autres peuples ; je suis même porté à croire qu’elles le sont moins. Mais il règne dans le sein de ces nations un petit mouvement incommode, une sorte de roulement incessant des hommes les uns sur les autres, qui trouble et distrait l’esprit sans l’animer ni l’élever.
Non seulement les hommes qui vivent dans les sociétés démocratiques se livrent difficilement à la méditation, mais ils ont naturellement peu d’estime pour elle. L’état social et les institutions démocratiques portent la plupart des hommes à agir constamment ; or, les habitudes d’esprit qui conviennent à l’action ne conviennent pas toujours à la pensée. L’homme qui agit en est réduit à se contenter souvent d’à peu près parce qu’il n’arriverait jamais au bout de son dessein, s’il voulait perfectionner chaque détail. Il lui faut [III-84] s’appuyer sans cesse sur des idées qu’il n’a pas eu le loisir d’approfondir, car c’est bien plus l’opportunité de l’idée dont il se sert que sa rigoureuse justesse qui l’aide ; et, à tout prendre, il y a moins de risque pour lui à faire usage de quelques principes faux, qu’à consumer son temps à établir la vérité de tous ses principes. Ce n’est point par de longues et savantes démonstrations que se mène le monde. La vue rapide d’un fait particulier, l’étude journalière des passions changeantes de la foule, le hasard du moment et l’habileté à s’en saisir, y décident de toutes les affaires.
Dans les siècles où presque tout le monde agit, on est donc généralement porté à attacher un prix excessif aux élans rapides et aux conceptions superficielles de l’intelligence, et, au contraire, à déprécier outre mesure son travail profond et lent.
Cette opinion publique influe sur le jugement des hommes qui cultivent les sciences, elle leur persuade qu’ils peuvent y réussir sans méditation, ou les écarte de celles qui en exigent.
Il y a plusieurs manières d’étudier les sciences. On rencontre chez une foule d’hommes un goût égoïste, mercantile et industriel pour les découvertes de l’esprit qu’il ne faut pas confondre avec la passion désintéressée qui s’allume dans le cœur d’un petit nombre ; il y a un désir d’utiliser les connaissances et un pur désir de connaître. Je ne [III-85] doute point qu’il ne naisse, de loin en loin, chez quelques uns, un amour ardent et inépuisable de la vérité, qui se nourrit de lui-même et jouit incessamment sans pouvoir jamais se satisfaire. C’est cet amour ardent, orgueilleux et désintéressé du vrai, qui conduit les hommes jusqu’aux sources abstraites de la vérité pour y puiser les idées mères.
Si Pascal n’eût envisagé que quelque grand profit, ou si même il n’eût été mû que par le seul désir de la gloire, je ne saurais croire qu’il eût jamais pu rassembler, comme il l’a fait, toutes les puissances de son intelligence pour mieux découvrir les secrets les plus cachés du Créateur. Quand je le vois arracher, en quelque façon, son âme du milieu des soins de la vie, afin de l’attacher tout entière à cette recherche, et, brisant prématurément les liens qui la retiennent au corps, mourir de vieillesse avant quarante ans, je m’arrête interdit, et je comprends que ce n’est point une cause ordinaire qui peut produire de si extraordinaires efforts.
L’avenir prouvera si ces passions, si rares et si fécondes, naissent et se développent aussi aisément au milieu des sociétés démocratiques qu’au sein des aristocraties. Quant à moi, j’avoue que j’ai peine à le croire.
Dans les sociétés aristocratiques, la classe qui dirige l’opinion et mène les affaires, étant placée [III-86] d’une manière permanente et héréditaire au-dessus de la foule, conçoit naturellement une idée superbe d’elle-même et de l’homme. Elle imagine volontiers pour lui des jouissances glorieuses, et fixe des buts magnifiques à ses désirs. Les aristocraties font souvent des actions fort tyranniques et fort inhumaines, mais elles conçoivent rarement des pensées basses, et elles montrent un certain dédain orgueilleux pour les petits plaisirs, alors même qu’elles s’y livrent ; cela y monte toutes les âmes sur un ton fort haut. Dans les temps aristocratiques, on se fait généralement des idées très vastes de la dignité, de la puissance, de la grandeur de l’homme. Ces opinions influent sur ceux qui cultivent les sciences comme sur tous les autres ; elles facilitent l’élan naturel de l’esprit vers les plus hautes régions de la pensée, et la disposent naturellement à concevoir l’amour sublime et presque divin de la vérité.
Les savants de ces temps sont donc entraînés vers la théorie, et il leur arrive même souvent de concevoir un mépris inconsidéré pour la pratique. « Archimède, dit Plutarque, a eu le cœur si haut qu’il ne daigna jamais laisser par écrit aucune œuvre de la manière de dresser toutes ces machines de guerre, et réputant toute cette science d’inventer et composer machines et généralement tout art qui rapporte quelque [III-87] utilité à le mettre en pratique, vil, bas et mercenaire, il employa son esprit et son étude à écrire seulement choses dont la beauté et la subtilité ne fût aucunement mêlée avec nécessité. » Voilà la visée aristocratique des sciences.
Elle ne saurait être la même chez les nations démocratiques.
La plupart des hommes qui composent ces nations sont fort avides de jouissances matérielles et présentes, comme ils sont toujours mécontents de la position qu’ils occupent, et toujours libres de la quitter, ils ne songent qu’aux moyens de changer leur fortune ou de l’accroître. Pour des esprits ainsi disposés, toute méthode nouvelle qui mène par un chemin plus court à la richesse, toute machine qui abrège le travail, tout instrument qui diminue les frais de la production, toute découverte qui facilite les plaisirs et les augmente, semble le plus magnifique effort de l’intelligence humaine. C’est principalement par ce côté que les peuples démocratiques s’attachent aux sciences, les comprennent et les honorent. Dans les siècles aristocratiques on demande particulièrement aux sciences les jouissances de l’esprit ; dans les démocraties, celles du corps.
Comptez que plus une nation est démocratique, éclairée et libre, plus le nombre de ces [III-88] appréciateurs intéressés du génie scientifique ira s’accroissant, et plus les découvertes immédiatement applicables à l’industrie donneront de profit, de gloire, et même de puissance à leurs auteurs ; car, dans les démocraties, la classe qui travaille prend part aux affaires publiques, et ceux qui la servent ont à attendre d’elle des honneurs aussi bien que de l’argent.
On peut aisément concevoir que, dans une société organisée de cette manière, l’esprit humain soit insensiblement conduit à négliger la théorie, et qu’il doit au contraire, se sentir poussé avec une énergie sans pareille vers l’application, ou tout au moins vers cette portion de la théorie qui est nécessaire à ceux qui appliquent.
En vain un penchant instinctif l’élève-t-il vers les plus hautes sphères de l’intelligence, l’intérêt le ramène vers les moyennes. C’est là qu’il déploie sa force et son inquiète activité, et enfante des merveilles. Ces mêmes Américains, qui n’ont pas découvert une seule des lois générales de la mécanique, ont introduit dans la navigation une machine nouvelle qui change la face du monde.
Certes, je suis loin de prétendre que les peuples démocratiques de nos jours soient destinés à voir éteindre les lumières transcendantes de l’esprit humain, ni même qu’il ne doive pas s’en allumer de nouvelles dans leur sein. À l’âge du monde où [III-89] nous sommes, et parmi tant de nations lettrées, que tourmente incessamment l’ardeur de l’industrie, les liens qui unissent entre elles les différentes parties de la science ne peuvent manquer de frapper les regards ; et le goût même de la pratique, s’il est éclairé, doit porter les hommes à ne point négliger la théorie. Au milieu de tant d’essais d’applications, de tant d’expériences chaque jour répétées, il est comme impossible que, souvent des lois très-générales ne viennent pas à apparaître ; de telle sorte que les grandes découvertes seraient fréquentes, bien que les grands inventeurs fussent rares.
Je crois d’ailleurs aux hautes vocations scientifiques. Si la démocratie ne porte point les hommes à cultiver les sciences pour elles-mêmes, d’une autre part elle augmente immensément le nombre de ceux qui les cultivent. Il n’est pas à croire que, parmi une si grande multitude, il ne naisse point de temps en temps quelque génie spéculatif, que le seul amour de la vérité enflamme. On peut être assuré que celui-là s’efforcera de percer les plus profonds mystères de la nature, quel que soit l’esprit de son pays et de son temps. Il n’est pas besoin d’aider son essor ; il suffit de ne point l’arrêter. Tout ce que je veux dire est ceci : l’inégalité permanente de conditions porte les hommes à se renfermer dans la recherche orgueilleuse et stérile [III-90] des vérités abstraites ; tandis que l’état social et les institutions démocratiques les disposent à ne demander aux sciences que leurs applications immédiates et utiles.
Cette tendance est naturelle et inévitable. Il est curieux de la connaître, et il peut être nécessaire de la montrer.
Si ceux qui sont appelés à diriger les nations de nos jours apercevaient clairement et de loin ces instincts nouveaux qui bientôt seront irrésistibles, ils comprendraient qu’avec des lumières et de la liberté, les hommes qui vivent dans les siècles démocratiques, ne peuvent manquer de perfectionner la portion industrielle des sciences, et que désormais tout l’effort du pouvoir social doit se porter à soutenir les hautes études, et à créer de grandes passions scientifiques.
De nos jours, il faut retenir l’esprit humain dans la théorie ; il court de lui-même à la pratique, et au lieu de le ramener sans cesse vers l’examen détaillé des effets secondaires, il est bon de l’en distraire quelquefois, pour l’élever jusqu’à la contemplation des causes premières.
Parce que la civilisation romaine est morte à la suite de l’invasion des barbares, nous sommes peut-être trop enclins à croire que la civilisation ne saurait autrement mourir.
Si les lumières qui nous éclairent venaient [III-91] jamais à s’éteindre, elles s’obscurciraient peu à peu, et comme d’elles-mêmes. À force de se renfermer dans l’application, on perdrait de vue les principes, et quand on aurait entièrement oublié les principes, on suivrait mal les méthodes qui en dérivent ; on ne pourrait plus en inventer de nouvelles et l’on emploierait sans intelligence et sans art de savants procédés qu’on ne comprendrait plus.
Lorsque les Européens abordèrent, il y a trois cents ans, à la Chine, ils y trouvèrent presque tous les arts parvenus à un certain degré de perfection, et ils s’étonnèrent, qu’étant arrivés à ce point, on n’eût pas été plus avant. Plus tard, ils découvrirent les vestiges de quelques hautes connaissances qui s’étaient perdues. La nation était industrielle ; la plupart des méthodes scientifiques s’étaient conservées dans son sein ; mais la science elle-même n’y existait plus. Cela leur expliqua l’espèce d’immobilité singulière dans laquelle ils avaient trouvé l’esprit de ce peuple. Les Chinois, en suivant la trace de leurs pères, avaient oublié les raisons qui avaient dirigé ceux-ci. Ils se servaient encore de la formule sans en rechercher le sens ; ils gardaient l’instrument et ne possédaient plus l’art de le modifier et de le reproduire. Les Chinois ne pouvaient donc rien changer. Ils devaient renoncer à améliorer. Ils étaient forcés d’imiter toujours et [III-92] en tout leurs pères, pour ne pas se jeter dans des ténèbres impénétrables, s’ils s’écartaient un instant du chemin que ces derniers avaient tracé. La source des connaissances humaines était presque tarie ; et, bien que le fleuve coulât encore, il ne pouvait plus grossir ses ondes ou changer son cours.
Cependant la Chine subsistait paisiblement, depuis des siècles ; ses conquérants avaient pris ses mœurs ; l’ordre y régnait. Une sorte de bien-être matériel s’y laissait apercevoir de tous côtés. Les révolutions y étaient très-rares, et la guerre pour ainsi dire inconnue.
Il ne faut donc point se rassurer en pensant que les barbares sont encore loin de nous ; car, s’il y a des peuples qui se laissent arracher des mains la lumière, il y en a d’autres qui l’étouffent eux-mêmes sous leurs pieds.
[III-93]
CHAPITRE XI.↩
Dans quel esprit les Américains cultivent les arts.
Je croirais perdre le temps des lecteurs et le mien, si je m’attachais à montrer comment la médiocrité générale des fortunes, l’absence du superflu, le désir universel du bien-être et les constants efforts auxquels chacun se livre pour se le procurer, font prédominer dans le cœur de l’homme le goût de l’utile sur l’amour du beau. Les nations démocratiques, chez lesquelles toutes ces choses se rencontrent, cultiveront donc les arts qui servent à rendre la vie commode, de [III-94] préférence à ceux dont l’objet est de l’embellir ; elles préféreront habituellement l’utile au beau, et elles voudront que le beau soit utile.
Mais je prétends aller plus avant, et après avoir indiqué le premier trait, en dessiner plusieurs autres.
Il arrive d’ordinaire que dans les siècles de priviléges, l’exercice de presque tous les arts devient un privilége, et que chaque profession est un monde à part où il n’est pas loisible à chacun d’entrer. Et lors même que l’industrie est libre, l’immobilité naturelle aux nations aristocratiques, fait que tous ceux qui s’occupent d’un même art, finissent néanmoins par former une classe distincte, toujours composée des mêmes familles, dont tous les membres se connaissent, et où il naît bientôt une opinion publique et un orgueil de corps. Dans une classe industrielle de cette espèce, chaque artisan n’a pas seulement sa fortune à faire, mais sa considération à garder. Ce n’est pas seulement son intérêt qui fait sa règle, ni même celui de l’acheteur, mais celui du corps, et l’intérêt du corps est que chaque artisan produise des chefs-d’œuvre. Dans les siècles aristocratiques, la visée des arts est donc de faire le mieux possible, et non le plus vite, ni au meilleur marché.
Lorsqu’au contraire chaque profession est ouverte à tous, que la foule y entre et en sort sans [III-95] cesse, et que ses différents membres deviennent étrangers, indifférents et presque invisibles les uns aux autres, à cause de leur multitude, le lien social est détruit, et chaque ouvrier ramené vers lui-même, ne cherche qu’à gagner le plus d’argent possible aux moindres frais, il n’y a plus que la volonté du consommateur qui le limite. Or, il arrive que, dans le même temps, une révolution correspondante se fait sentir chez ce dernier.
Dans les pays où la richesse comme le pouvoir se trouve concentrée, dans quelques mains, et n’en sort pas, l’usage de la plupart des biens de ce monde appartient à un petit nombre d’individus toujours le même ; la nécessité, l’opinion, la modération des désirs en écartent tous les autres.
Comme cette classe aristocratique se tient immobile au point de grandeur où elle est placée sans se resserrer, ni s’étendre, elle éprouve toujours les mêmes besoins et les ressent de la même manière. Les hommes qui la composent puisent naturellement dans la position supérieure et héréditaire qu’ils occupent, le goût de ce qui est très-bien fait et très-durable.
Cela donne une tournure générale aux idées de la nation en fait d’arts.
Il arrive souvent que, chez ces peuples, le paysan lui-même aime mieux se priver [III-96] entièrement des objets qu’il convoite, que de les acquérir imparfaits.
Dans les aristocraties, les ouvriers ne travaillent donc que pour un nombre limité d’acheteurs, très-difficiles à satisfaire. C’est de la perfection de leurs travaux que dépend principalement le gain qu’ils attendent.
Il n’en est plus ainsi lorsque, tous les priviléges étant détruits, les rangs se mêlent, et que tous les hommes s’abaissent et s’élèvent sans cesse sur l’échelle sociale.
On rencontre toujours dans le sein d’un peuple démocratique, une foule de citoyens dont le patrimoine se divise et décroît. Ils ont contracté, dans des temps meilleurs, certains besoins qui leur restent après que la faculté de les satisfaire n’existe plus, et ils cherchent avec inquiétude s’il n’y aurait pas quelques moyens détournés d’y pourvoir.
D’autre part, on voit toujours dans les démocraties un très-grand nombre d’hommes dont la fortune croît, mais dont les désirs croissent bien plus vite que la fortune, et qui dévorent des yeux les biens qu’elle leur promet, longtemps avant qu’elle ne les livre. Ceux-ci cherchent de tous côtés à s’ouvrir des voies plus courtes vers ces jouissances voisines. De la combinaison de ces deux causes, il résulte qu’on rencontre toujours [III-97] dans les démocraties une multitude de citoyens dont les besoins sont au-dessus des ressources, et qui consentiraient volontiers à se satisfaire incomplètement, plutôt que de renoncer tout à fait à l’objet de leur convoitise.
L’ouvrier comprend aisément ces passions, parce que lui-même les partage : dans les aristocraties, il cherchait à vendre ses produits très-cher à quelques uns ; il conçoit maintenant qu’il y aurait un moyen plus expéditif de s’enrichir ; ce serait de les vendre bon marché à tous.
Or, il n’y a que deux manières d’arriver à baisser le prix d’une marchandise.
La première est de trouver des moyens meilleurs, plus courts et plus savants de la produire. La seconde est de fabriquer en plus grande quantité des objets à peu près semblables, mais d’une moindre valeur. Chez les peuples démocratiques, toutes les facultés intellectuelles de l’ouvrier sont dirigées vers ces deux points.
Il s’efforce d’inventer des procédés qui lui permettent de travailler, non pas seulement mieux, mais plus vite et à moindres frais, et, s’il ne peut y parvenir, de diminuer les qualités intrinsèques de la chose qu’il fait, sans la rendre entièrement impropre à l’usage auquel on la destine. Quand il n’y avait que les riches qui eussent des montres, elles étaient presque toutes excellentes. On n’en [III-98] fait plus guère que de médiocres, mais tout le monde en a. Ainsi, la démocratie ne tend pas seulement à diriger l’esprit humain vers les arts utiles ; elle porte les artisans à faire très-rapidement beaucoup de choses imparfaites, et le consommateur à se contenter de ces choses.
Ce n’est pas que dans les démocraties l’art ne soit capable, au besoin, de produire des merveilles. Cela se découvre parfois, quand il se présente des acheteurs qui consentent à payer le temps et la peine. Dans cette lutte de toutes les industries, au milieu de cette concurrence immense et de ces essais sans nombre, il se forme des ouvriers excellents qui pénètrent jusqu’aux dernières limites de leur profession ; mais ceux-ci ont rarement l’occasion de montrer ce qu’ils savent faire : ils ménagent leurs efforts avec soin ; ils se tiennent dans une médiocrité savante qui se juge elle-même, et qui, pouvant atteindre au-delà du but qu’elle se propose, ne vise qu’au but qu’elle atteint. Dans les aristocraties, au contraire, les ouvriers font toujours tout ce qu’ils savent faire, et lorsqu’ils s’arrêtent, c’est qu’ils sont au bout de leur science.
Lorsque j’arrive dans un pays et que je vois les arts donner quelques produits admirables, cela ne m’apprend rien sur l’état social et la constitution politique du pays. Mais, si j’aperçois que les [III-99] produits des arts y sont généralement imparfaits, en très-grand nombre et à bas prix, je suis assuré que, chez le peuple où ceci se passe, les priviléges s’affaiblissent, et les classes commencent à se mêler et vont bientôt se confondre.
Les artisans qui vivent dans les siècles démocratiques ne cherchent pas seulement à mettre à la portée de tous les citoyens leurs produits utiles, ils s’efforcent encore de donner à tous leurs produits des qualités brillantes que ceux-ci n’ont pas.
Dans la confusion de toutes les classes, chacun espère pouvoir paraître ce qu’il n’est pas et se livre à de grands efforts pour y parvenir. La démocratie ne fait pas naître ce sentiment, qui n’est que trop naturel au cœur de l’homme ; mais elle l’applique aux choses matérielles : l’hypocrisie de la vertu est de tous les temps ; celle du luxe appartient plus particulièrement aux siècles démocratiques.
Pour satisfaire ces nouveaux besoins de la vanité humaine, il n’est point d’impostures auxquelles les arts n’aient recours ; l’industrie va quelquefois si loin dans ce sens qu’il lui arrive de se nuire à elle-même. On est déjà parvenu à imiter si parfaitement le diamant, qu’il est facile de s’y méprendre. Du moment où l’on aura inventé l’art de fabriquer les faux diamants, de manière à ce qu’on ne puisse plus les distinguer des véritables, on abandonnera vraisemblablement les uns [III-100] et les autres, et ils redeviendront des cailloux.
Ceci me conduit à parler de ceux des arts qu’on a nommés, par excellence, les beaux-arts.
Je ne crois point que l’effet nécessaire de l’état social et des institutions démocratiques soit de diminuer le nombre des hommes qui cultivent les beaux-arts ; mais ces causes influent puissamment sur la manière dont ils sont cultivés. La plupart de ceux qui avaient déjà contracté le goût des beaux-arts devenant pauvres, et, d’un autre côté, beaucoup de ceux qui ne sont pas encore riches commençant à concevoir, par imitation, le goût des beaux-arts, la quantité des consommateurs en général s’accroît, et les consommateurs très-riches et très-fins deviennent plus rares. Il se passe alors dans les beaux-arts quelque chose d’analogue à ce que j’ai déjà fait voir quand j’ai parlé des arts utiles. Ils multiplient leurs œuvres et diminuent le mérite de chacune d’elles.
Ne pouvant plus viser au grand, on cherche l’élégant et le joli ; on tend moins à la réalité qu’à l’apparence.
Dans les aristocraties on fait quelques grands tableaux, et, dans les pays démocratiques, une multitude de petites peintures. Dans les premières on élève des Statues de bronze, et dans les seconds on coule des statues de plâtre.
Lorsque j’arrivai pour la première fois à [III-101] New-York par cette partie de l’océan Atlantique qu’on nomme la rivière de l’Est, je fus surpris d’apercevoir, le long du rivage, à quelque distance de la ville, un certain nombre de petits palais de marbre blanc dont plusieurs avaient une architecture antique ; le lendemain, ayant été pour considérer de plus près celui qui avait particulièrement attiré mes regards, je trouvai que ses murs étaient de briques blanchies et ses colonnes de bois peint. Il en était de même de tous les monuments que j’avais admirés la veille.
L’état social et les institutions démocratiques donnent, de plus, à tous les arts d’imitation, de certaines tendances particulières qu’il est facile de signaler. Ils les détournent souvent de la peinture de l’âme pour ne les attacher qu’à celle du corps ; et ils substituent la représentation des mouvements et des sensations à celle des sentiments et des idées ; à la place de l’idéal ils mettent enfin le réel.
Je doute que Raphaël ait fait une étude aussi approfondie des moindres ressorts du corps humain que les dessinateurs de nos jours. Il n’attachait pas la même importance qu’eux à la rigoureuse exactitude sur ce point, car il prétendait surpasser la nature. Il voulait faire de l’homme quelque chose qui fût supérieur à l’homme, il entreprenait d’embellir la beauté même.
[III-102]
David et ses élèves étaient, au contraire, aussi bons anatomistes que bons peintres. Ils représentaient merveilleusement bien les modèles qu’ils avaient sous les yeux, mais il était rare qu’ils imaginassent rien au-delà ; ils suivaient exactement la nature, tandis que Raphaël cherchait mieux qu’elle. Ils nous ont laissé une exacte peinture de l’homme, mais le premier nous fait entrevoir la Divinité dans ses œuvres.
On peut appliquer au choix même du sujet ce que j’ai dit de la manière de le traiter.
Les peintres de la Renaissance cherchaient d’ordinaire au-dessus d’eux, ou loin de leur temps, de grands sujets qui laissassent à leur imagination une vaste carrière. Nos peintres mettent souvent leur talent à reproduire exactement les détails de la vie privée qu’ils ont sans cesse sous les yeux, et ils copient de tous côtés de petits objets qui n’ont que trop d’originaux dans la nature.
[III-103]
CHAPITRE XII.↩
Pourquoi les Américains élèvent en même temps de si petits et de si grands monuments.
Je viens de dire que, dans les siècles démocratiques, les monuments des arts tendaient à devenir plus nombreux et moins grands, je me hâte d’indiquer moi-même l’exception à cette règle.
Chez les peuples démocratiques, les individus sont très-faibles ; mais l’état qui les représente tous, et les tient tous dans sa main, est très-fort. Nulle part les citoyens ne paraissent plus petits que dans une nation démocratique. Nulle part la nation elle-même ne semble plus grande et l’esprit ne s’en fait plus aisément un vaste tableau. [III-104] Dans les sociétés démocratiques, l’imagination des hommes se resserre quand ils songent à eux-mêmes ; elle s’étend indéfiniment quand ils pensent à l’État. Il arrive de là que les mêmes hommes qui vivent petitement dans d’étroites demeures, visent souvent au gigantesque dès qu’il s’agit des monuments publics.
Les Américains ont placé sur le lieu dont ils voulaient faire leur capitale l’enceinte d’une ville immense qui, aujourd’hui encore, n’est guère plus peuplée que Pontoise, mais qui, suivant eux, doit contenir un jour un million d’habitants ; déjà, ils ont déraciné les arbres à dix lieues à la ronde, de peur qu’ils ne vinssent à incommoder les futurs citoyens de cette métropole imaginaire. Ils ont élevé, au centre de la cité, un palais magnifique pour servir de siège au congrès et ils lui ont donné le nom pompeux de Capitole.
Tous les jours, les États particuliers eux-mêmes conçoivent et exécutent des entreprises prodigieuses dont s’étonnerait le génie des grandes nations de l’Europe.
Ainsi, la démocratie ne porte pas seulement les hommes à faire une multitude de menus ouvrages ; elle les porte aussi à élever un petit nombre de très-grands monuments. Mais, entre ces deux extrêmes, il n’y a rien. Quelques restes épars de très-vastes édifices n’annoncent donc rien sur [III-105] l’état social et les institutions du peuple qui les a élevés.
J’ajoute, quoique cela sorte de mon sujet, qu’ils ne font pas mieux connaître sa grandeur, ses lumières et sa prospérité réelle.
Toutes les fois qu’un pouvoir quelconque sera capable de faire concourir tout un peuple à une seule entreprise, il parviendra avec peu de science et beaucoup de temps à tirer du concours de si grands efforts quelque chose d’immense, sans que pour cela il faille conclure que le peuple est très-heureux, très-éclairé ni même très-fort. Les Espagnols ont trouvé la ville de Mexico remplie de temples magnifiques et de vastes palais ; ce qui n’a point empêché Cortez de conquérir l’empire du Mexique avec six cents fantassins et 16 chevaux.
Si les Romains avaient mieux connu les lois de l’hydraulique, ils n’auraient point élevé tous ces aqueducs qui environnent les ruines de leurs cités, ils auraient fait un meilleur emploi de leur puissance et de leur richesse. S’ils avaient découvert la machine à vapeur, peut-être n’auraient-ils point étendu jusqu’aux extrémités de leur empire ces longs rochers artificiels qu’on nomme des voies romaines.
Ces choses sont de magnifiques témoignages de leur ignorance en même temps que de leur grandeur. [
III-106]
Le peuple qui ne laisserait d’autres vestiges de son passage que quelques tuyaux de plomb dans la terre et quelques tringles de fer sur sa surface, pourrait avoir été plus maître de la nature que les Romains.
[III-107]
CHAPITRE XIII.↩
Physionomie littéraire des siècles démocratiques.
Lorsqu’on entre dans la boutique d’un libraire aux États-Unis, et qu’on visite les livres américains qui en garnissent les rayons, le nombre des ouvrages y parait fort grand ; tandis que celui des auteurs connus y semble au contraire fort petit.
On trouve d’abord une multitude de traités élémentaires destinés à donner la première notion des connaissances humaines. La plupart de ces ouvrages ont été composés en Europe. Les Américains les réimpriment en les adaptant à leur usage. Vient ensuite une quantité presque innombrable de livres de religion, bibles, sermons, [III-108] anecdotes pieuses, controverses, comptes rendus d’établissements charitables. Enfin paraît le long catalogue des pamphlets politiques ; en Amérique, les partis ne font point de livres pour se combattre, mais des brochures qui circulent avec une incroyable rapidité, vivent un jour et meurent.
Au milieu de toutes ces obscures productions de l’esprit humain, apparaissent les œuvres plus remarquables d’un petit nombre d’auteurs seulement qui sont connus des Européens ou qui devraient l’être.
Quoique l’Amérique soit peut-être de nos jours le pays civilisé où l’on s’occupe le moins de littérature, il s’y rencontre cependant une grande quantité d’individus qui s’intéressent aux choses de l’esprit, et qui en font sinon l’étude de toute leur vie, du moins le charme de leurs loisirs. Mais c’est l’Angleterre qui fournit à ceux-ci, la plupart des livres qu’ils réclament. Presque tous les grands ouvrages anglais sont reproduits aux États-Unis. Le génie littéraire de la Grande-Bretagne darde encore ses rayons jusqu’au fond des forêts du Nouveau-Monde. Il n’y a guère de cabane de pionnier où l’on ne rencontre quelques tomes dépareillés de Shakespeare. Je me rappelle avoir lu pour la première fois le drame féodal d’Henri V dans une log-house.
Non seulement les Américains vont puiser [III-109] chaque jour dans les trésors de la littérature anglaise, mais on peut dire avec vérité qu’ils trouvent la littérature de l’Angleterre sur leur propre sol. Parmi le petit nombre d’hommes qui s’occupent aux États-Unis à composer des œuvres de littérature la plupart sont Anglais par le fond et surtout par la forme. Ils transportent ainsi au milieu de la démocratie les idées et les usages littéraires qui ont cours chez la nation aristocratique qu’ils ont prise pour modèle. Ils peignent avec des couleurs empruntées des mœurs étrangères ; ne représentant presque jamais dans sa réalité le pays qui les a vus naître, ils y sont rarement populaires.
Les citoyens des États-Unis semblent eux-mêmes si convaincus que ce n’est point pour eux qu’on publie des livres, qu’avant de se fixer sur le mérite d’un de leurs écrivains, ils attendent d’ordinaire qu’il ait été goûté en Angleterre. C’est ainsi, qu’en fait de tableaux on laisse volontiers à l’auteur de l’original le droit de juger la copie.
Les habitants des États-Unis n’ont donc point encore, à proprement parler, de littérature. Les seuls auteurs que je reconnaisse pour Américains sont des journalistes. Ceux-ci ne sont pas de grands écrivains, mais ils parlent la langue du pays et s’en font entendre. Je ne vois dans les autres que des étrangers. Ils sont pour les Américains ce que [III-110] furent pour nous les imitateurs des Grecs et des Romains à l’époque de la renaissance des lettres, un objet de curiosité, non de générale sympathie. Ils amusent l’esprit et n’agissent point sur les mœurs.
J’ai déjà dit que cet état de choses était bien loin de tenir seulement à la démocratie, et qu’il fallait en rechercher les causes dans plusieurs circonstances particulières et indépendantes d’elle.
Si les Américains, tout en conservant leur état social et leurs lois, avaient une autre origine et se trouvaient transportés dans un autre pays, je ne doute point qu’ils n’eussent une littérature. Tels qu’ils sont, je suis assuré qu’ils finiront par en avoir une ; mais elle aura un caractère différent de celui qui se manifeste dans les écrits américains de nos jours et qui lui sera propre. Il n’est pas impossible de tracer ce caractère à l’avance.
Je suppose un peuple aristocratique chez lequel on cultive les lettres ; les travaux de l’intelligence, de même que les affaires du gouvernement, y sont réglés par une classe souveraine. La vie littéraire, comme l’existence politique, est presque entièrement concentrée dans cette classe ou dans celles qui l’avoisinent le plus près. Ceci me suffit pour avoir la clé de tout le reste.
Lorsqu’un petit nombre d’hommes, toujours les mêmes, s’occupent en même temps des mêmes [III-111] objets, ils s’entendent aisément, et arrêtent en commun certaines règles principales qui doivent diriger chacun d’eux. Si l’objet qui attire l’attention de ces hommes est la littérature, les travaux de l’esprit seront bientôt soumis par eux à quelques lois précises dont il ne sera plus permis de s’écarter.
Si ces hommes occupent dans le pays une position héréditaire, ils seront naturellement enclins non seulement à adopter pour eux-mêmes un certain nombre de règles fixes, mais à suivre celles que s’étaient imposées leurs aïeux ; leur législation sera tout à la fois rigoureuse et traditionnelle.
Comme ils ne sont point nécessairement préoccupés des choses matérielles, qu’ils ne l’ont jamais été, et que leurs pères ne l’étaient pas davantage, ils ont pu s’intéresser, pendant plusieurs générations, aux travaux de l’esprit. Ils ont compris l’art littéraire et ils finissent par l’aimer pour lui-même et par goûter un plaisir savant à voir qu’on s’y conforme.
Ce n’est pas tout encore : les hommes dont je parle ont commencé leur vie et l’achèvent dans l’aisance ou dans la richesse ; ils ont donc naturellement conçu le goût des jouissances recherchées et l’amour des plaisirs fins et délicats.
Bien plus, une certaine mollesse d’esprit et de cœur, qu’ils contractent souvent au milieu de ce [III-112] long et paisible usage de tant de biens, les porte à écarter de leurs plaisirs mêmes ce qui pourrait s’y rencontrer de trop inattendu et de trop vif. Ils préfèrent être amusés que vivement émus ; ils veulent qu’on les intéresse, mais non qu’on les entraîne.
Imaginez maintenant un grand nombre de travaux littéraires exécutés par les hommes que je viens de peindre, ou pour eux, et vous concevrez sans peine une littérature où tout sera régulier et coordonné à l’avance. Le moindre ouvrage y sera soigné dans ses plus petits détails ; l’art et le travail s’y montreront en toutes choses ; chaque genre y aura ses règles particulières dont il ne sera point loisible de s’écarter et qui l’isoleront de tous les autres.
Le style y paraîtra presque aussi important que l’idée, la forme que le fond ; le ton en sera poli, modéré, soutenu. L’esprit y aura toujours une démarche noble, rarement une allure vive, et les écrivains s’attacheront plus à perfectionner qu’à produire.
Il arrivera quelquefois que les membres de la classe lettrée, ne vivant jamais qu’entre eux et n’écrivant que pour eux, perdront entièrement de vue le reste du monde, ce qui les jettera dans le recherché et le faux ; ils s’imposeront de petites règles littéraires à leur seul usage, qui les [III-113] écarteront insensiblement du bon sens et les conduiront enfin hors de la nature.
À force de vouloir parler autrement que le vulgaire ils en viendront à une sorte de jargon aristocratique qui n’est guère moins éloigné du beau langage que le patois du peuple.
Ce sont là les écueils naturels de la littérature dans les aristocraties.
Toute aristocratie qui se met entièrement à part du peuple devient impuissante. Cela est vrai dans les lettres aussi bien qu’en politique [2] .
Retournons présentement le tableau et considérons le revers.
Transportons-nous au sein d’une démocratie que ses anciennes traditions et ses lumières présentes rendent sensible aux jouissances de l’esprit. Les rangs y sont mêlés et confondus ; les connaissances comme le pouvoir y sont divisés à l’infini, et, si j’ose le dire, éparpillés de tous côtés.
[III-114]
Voici une foule confuse dont les besoins intellectuels sont à satisfaire. Ces nouveaux amateurs des plaisirs de l’esprit n’ont point tous reçu la même éducation ; ils ne possèdent pas les mêmes lumières, ils ne ressemblent point à leurs pères, et à chaque instant ils diffèrent d’eux-mêmes ; car ils changent sans cesse de place, de sentiments et de fortunes. L’esprit de chacun d’eux n’est donc point lié à celui de tous les autres par des traditions et des habitudes communes, et ils n’ont jamais eu ni le pouvoir, ni la volonté, ni le temps de s’entendre entre eux.
C’est pourtant au sein de cette multitude incohérente et agitée que naissent les auteurs, et c’est elle qui distribue à ceux-ci les profits et la gloire.
Je n’ai point de peine à comprendre que, les choses étant ainsi, je dois m’attendre à ne rencontrer dans la littérature d’un pareil peuple qu’un petit nombre de ces conventions rigoureuses que reconnaissent dans les siècles aristocratiques les lecteurs et les écrivains. S’il arrivait que les hommes d’une époque tombassent d’accord sur quelques unes, cela ne prouverait encore rien pour l’époque suivante ; car, chez les nations démocratiques, chaque génération nouvelle est un nouveau peuple. Chez ces nations, les lettres ne [III-115] sauraient donc que difficilement être soumises à des règles étroites, et il est comme impossible qu’elles le soient jamais à des règles permanentes.
Dans les démocraties, il s’en faut de beaucoup que tous les hommes qui s’occupent de littérature aient reçu une éducation littéraire et, parmi ceux d’entre eux qui ont quelque teinture de belles-lettres, la plupart suivent une carrière politique, ou embrassent une profession dont ils ne peuvent se détourner que par moments, pour goûter à la dérobée les plaisirs de l’esprit. Ils ne font donc point de ces plaisirs le charme principal de leur existence ; mais ils les considèrent comme un délassement passager et nécessaire au milieu des sérieux travaux de la vie : de tels hommes ne sauraient jamais acquérir la connaissance assez approfondie de l’art littéraire pour en sentir les délicatesses ; les petites nuances leur échappent. N’ayant qu’un temps fort court à donner aux lettres, ils veulent le mettre à profit tout entier. Ils aiment les livres qu’on se procure sans peine, qui se lisent vite, qui n’exigent point de recherches savantes pour être compris. Ils demandent des beautés faciles qui se livrent d’elles-mêmes et dont on puisse jouir sur l’heure ; il leur faut surtout de l’inattendu et du nouveau. Habitués à une existence pratique, contestée, monotone, ils ont besoin d’émotions [III-116] vives et rapides, de clartés soudaines, de vérités ou d’erreurs brillantes qui les tirent à l’instant d’eux-mêmes et les introduisent tout à coup, et comme par violence, au milieu du sujet.
Qu’ai-je besoin d’en dire davantage ? et qui ne comprend, sans que je l’exprime, ce qui va suivre ?
Prise dans son ensemble, la littérature des siècles démocratiques ne saurait présenter, ainsi que dans les temps d’aristocratie, l’image de l’ordre, de la régularité, de la science et de l’art ; la forme s’y trouvera, d’ordinaire, négligée et parfois méprisée. Le style s’y montrera souvent bizarre, incorrect, surchargé et mou, et presque toujours hardi et véhément. Les auteurs y viseront à la rapidité de l’exécution plus qu’à la perfection des détails. Les petits écrits y seront plus fréquents que les gros livres, l’esprit que l’érudition, l’imagination que la profondeur ; il y régnera une force inculte et presque sauvage dans la pensée, et souvent une variété très-grande et une fécondité singulière dans ses produits. On tâchera d’étonner plutôt que de plaire, et l’on s’efforcera d’entraîner les passions plus que de charmer le goût.
Il se rencontrera sans doute de loin en loin des écrivains qui voudront marcher dans une autre [III-117] voie, et, s’ils ont un mérite supérieur, ils réussiront, en dépit de leurs défauts et de leurs qualités, à se faire lire ; mais ces exceptions seront rares, et ceux mêmes qui, dans l’ensemble de leurs ouvrages, seront ainsi sortis du commun usage, y rentreront toujours par quelques détails.
Je viens de peindre deux états extrêmes ; mais les nations ne vont point tout à coup du premier au second ; elles n’y arrivent que graduellement et à travers des nuances infinies. Dans le passage qui conduit un peuple lettré de l’un à l’autre, il survient presque toujours un moment où le génie littéraire des nations démocratiques se rencontrant avec celui des aristocraties, tous deux semblent vouloir régner d’accord sur l’esprit humain.
Ce sont là des époques passagères, mais très-brillantes : on a alors la fécondité sans exubérance, et le mouvement sans confusion. Telle fut la littérature française du dix-huitième siècle.
J’irais plus loin que ma pensée, si je disais que la littérature d’une nation est toujours subordonnée à son état social et à sa constitution politique. Je sais que, indépendamment de ces causes, il en est plusieurs autres, qui donnent de certains caractères aux œuvres littéraires ; mais celles-là me paraissent les principales.
[III-118]
Les rapports qui existent entre l’état social et politique d’un peuple et le génie de ses écrivains sont toujours très-nombreux ; qui connaît l’un, n’ignore jamais complètement l’autre.
[III-119]
CHAPITRE XIV.↩
De l’industrie littéraire.
La démocratie ne fait pas seulement pénétrer le goût des lettres dans les classes industrielles, elle introduit l’esprit industriel au sein de la littérature.
Dans les aristocraties, les lecteurs sont difficiles et peu nombreux ; dans les démocraties, il est moins malaisé de leur plaire, et leur nombre est prodigieux. Il résulte de là que, chez les peuples aristocratiques, on ne doit espérer de réussir qu’avec d’immenses efforts, et que ces efforts, qui peuvent donner beaucoup de gloire, ne sauraient jamais procurer beaucoup d’argent ; tandis que, chez les nations démocratiques, un écrivain peut [III-120] se flatter d’obtenir à bon marché une médiocre renommée et une grande fortune. Il n’est pas nécessaire pour cela qu’on l’admire, il suffit qu’on le goûte.
La foule toujours croissante des lecteurs et le besoin continuel qu’ils ont du nouveau, assurent le débit d’un livre qu’ils n’estiment guère.
Dans les temps de démocratie, le public en agit souvent avec les auteurs comme le font d’ordinaire les rois avec leurs courtisans ; il les enrichit et les méprise. Que faut-il de plus aux âmes vénales qui naissent dans les cours, ou qui sont dignes d’y vivre ?
Les littératures démocratiques fourmillent toujours de ces auteurs qui n’aperçoivent dans les lettres qu’une industrie, et, pour quelques grands écrivains qu’on y voit, on y compte par milliers des vendeurs d’idées.
[III-121]
CHAPITRE XV.↩
Pourquoi l’étude de la littérature grecque et latine est particulièrement utile dans les sociétés démocratiques.
Ce qu’on appelait le peuple dans les républiques les plus démocratiques de l’antiquité ne ressemblait guère à ce que nous nommons le peuple. À Athènes, tous les citoyens prenaient part aux affaires publiques ; mais il n’y avait que vingt mille citoyens sur plus de trois cent cinquante mille habitants ; tous les autres étaient esclaves, et remplissaient la plupart des fonctions qui appartiennent de nos jours au peuple et même aux classes moyennes.
Athènes, avec son suffrage universel, n’était [III-122] donc, après tout, qu’une république aristocratique où tous les nobles avaient un droit égal au gouvernement.
Il faut considérer la lutte des patriciens et des plébéiens de Rome sous le même jour et n’y voir qu’une querelle intestine entre les cadets et les aînés de la même famille. Tous tenaient en effet à l’aristocratie, et en avaient l’esprit.
L’on doit, de plus, remarquer que dans toute l’antiquité, les livres ont été rares et chers, et qu’on a éprouvé une grande difficulté à les reproduire et à les faire circuler. Ces circonstances venant à concentrer dans un petit nombre d’hommes le goût et l’usage des lettres, formaient comme une petite aristocratie littéraire de l’élite d’une grande aristocratie politique. Aussi rien n’annonce que, chez les Grecs et les Romains, les lettres aient jamais été traitées comme une industrie.
Ces peuples, qui ne formaient pas seulement des aristocraties, mais qui étaient encore des nations très-policées et très-libres, ont donc dû donner à leurs productions littéraires les vices particuliers et les qualités spéciales qui caractérisent la littérature dans les siècles aristocratiques.
Il suffit, en effet, de jeter les yeux sur les écrits que nous a laissés l’antiquité, pour découvrir que si les écrivains y ont quelquefois manqué de variété et de fécondité dans les sujets, de hardiesse, [III-123] de mouvement et de généralisation dans la pensée, ils ont toujours fait voir un art et un soin admirables dans les détails ; rien dans leurs œuvres ne semble fait à la hâte ni au hasard ; tout y est écrit pour les connaisseurs, et la recherche de la beauté idéale s’y montre sans cesse. Il n’y a pas de littérature qui mette plus en relief que celle des anciens les qualités qui manquent naturellement aux écrivains des démocraties. Il n’existe donc point de littérature qu’il convienne mieux d’étudier dans les siècles démocratiques. Cette étude est, de toutes, la plus propre à combattre les défauts littéraires inhérents à ces siècles ; quant à leurs qualités naturelles, elles naîtront bien toutes seules sans qu’il soit nécessaire d’apprendre à les acquérir.
C’est ici qu’il est besoin de bien s’entendre.
Une étude peut être utile à la littérature d’un peuple et ne point être appropriée à ses besoins sociaux et politiques.
Si l’on s’obstinait à n’enseigner que les belles-lettres, dans une société où chacun serait habituellement conduit à faire de violents efforts pour accroître sa fortune ou pour la maintenir, on aurait des citoyens très-polis et très-dangereux ; car l’état social et politique leur donnant, tous les jours, des besoins que l’éducation ne leur apprendrait jamais à satisfaire, ils troubleraient [III-124] l’État, au nom des Grecs et des Romains, au lieu de le féconder par leur industrie.
Il est évident que, dans les sociétés démocratiques, l’intérêt des individus, aussi bien que la sûreté de l’État, exige que l’éducation du plus grand nombre soit scientifique, commerciale et industrielle plutôt que littéraire.
Le grec et le latin ne doivent pas être enseignés dans toutes les écoles ; mais il importe que ceux que leur naturel ou leur fortune destine à cultiver les lettres ou prédisposent à les goûter, trouvent des écoles où l’on puisse se rendre parfaitement maître de la littérature antique, et se pénétrer entièrement de son esprit. Quelques Universités excellentes vaudraient mieux, pour atteindre ce résultat, qu’une multitude de mauvais colléges, où des études superflues qui se font mal, empêchent de bien faire des études nécessaires.
Tous ceux qui ont l’ambition d’exceller dans les lettres, chez les nations démocratiques, doivent souvent se nourrir des œuvres de l’antiquité. C’est une hygiène salutaire.
Ce n’est pas que je considère les productions littéraires des anciens comme irréprochables. Je pense seulement qu’elles ont des qualités spéciales qui peuvent merveilleusement servir à contrebalancer nos défauts particuliers. Elles nous soutiennent par le bord où nous penchons.
[III-125]
CHAPITRE XVI.↩
Comment la démocratie américaine a modifié la langue anglaise.
Si ce que j’ai dit précédemment, à propos des lettres en général, a été bien compris du lecteur, il concevra sans peine quelle espèce d’influence l’état social et les institutions démocratiques peuvent exercer sur la langue elle-même, qui est le premier instrument de la pensée.
Les auteurs américains vivent plus, à vrai dire, en Angleterre que dans leur propre pays, puisqu’ils étudient sans cesse les écrivains anglais, et les prennent chaque jour pour modèle. Il n’en est pas ainsi de la population elle-même : celle-ci est [III-126] soumise plus immédiatement aux causes particulières qui peuvent agir sur les États-Unis. Ce n’est donc point au langage écrit, mais au langage parlé, qu’il faut faire attention, si l’on veut apercevoir les modifications que l’idiôme d’un peuple aristocratique peut subir en devenant la langue d’une démocratie.
Des Anglais instruits et appréciateurs plus compétents de ces nuances délicates que je ne puis l’être moi-même, m’ont souvent assuré que les classes éclairées des États-Unis différaient notablement, par leur langage, des classes éclairées de la Grande-Bretagne.
Ils ne se plaignaient pas seulement de ce que les Américains avaient mis en usage beaucoup de mots nouveaux ; la différence et l’éloignement des pays eût suffit pour l’expliquer ; mais de ce que ces mots nouveaux étaient particulièrement empruntés, soit au jargon des partis, soit aux arts mécaniques, ou à la langue des affaires. Ils ajoutaient que les anciens mots anglais étaient souvent pris par les Américains dans une acception nouvelle. Ils disaient enfin que les habitants des États-Unis entremêlaient fréquemment les styles d’une manière singulière, et qu’ils plaçaient quelquefois ensemble des mots qui, dans le langage de la mère-patrie, avaient coutume de s’éviter.
Ces remarques, qui me furent faites à plusieurs [III-127] reprises par des gens qui me parurent mériter d’être crus, me portèrent moi-même à réfléchir sur ce sujet, et mes réflexions m’amenèrent, par la théorie, au même point où ils étaient arrivés par la pratique.
Dans les aristocraties, la langue doit naturellement participer au repos où se tiennent toutes choses. On fait peu de mots nouveaux, parce qu’il se fait peu de choses nouvelles ; et fît-on des choses nouvelles, on s’efforcerait de les peindre avec les mots connus, et dont la tradition a fixé le sens.
S’il arrive que l’esprit humain s’y agite enfin de lui-même, ou que la lumière, pénétrant du dehors, le réveille, les expressions nouvelles qu’on crée ont un caractère savant, intellectuel et philosophique, qui indique qu’elles ne doivent pas la naissance à une démocratie. Lorsque la chute de Constantinople eut fait refluer les sciences et les lettres vers l’occident, la langue française se trouva presque tout à coup envahie par une multitude de mots nouveaux, qui tous avaient leur racine dans le grec et le latin. On vit alors en France un néologisme érudit, qui n’était à l’usage que des classes éclairées, et dont les effets ne se firent jamais sentir, ou ne parvinrent qu’à la longue jusqu’au peuple.
[III-128]
Toutes les nations de l’Europe donnèrent successivement le même spectacle. Le seul Milton a introduit dans la langue anglaise plus de six cents mots, presque tous tirés du latin, du grec et de l’hébreu.
Le mouvement perpétuel qui règne au sein d’une démocratie, tend au contraire à y renouveler sans cesse la face de la langue, comme celle des affaires. Au milieu de cette agitation générale et de ce concours de tous les esprits, il se forme un grand nombre d’idées nouvelles ; des idées anciennes se perdent ou reparaissent ; ou bien elles se subdivisent en petites nuances infinies.
Il s’y trouve donc souvent des mots qui doivent sortir de l’usage, et d’autres qu’il faut y faire entrer.
Les nations démocratiques aiment d’ailleurs le mouvement pour lui-même. Cela se voit dans la langue aussi bien que dans la politique. Alors qu’elles n’ont pas le besoin de changer les mots, elles en sentent quelquefois le désir.
Le génie des peuples démocratiques ne se manifeste pas seulement dans le grand nombre de nouveaux mots qu’ils mettent en usage, mais encore dans la nature des idées que ces mots nouveaux représentent.
Chez ces peuples c’est la majorité qui fait la loi [III-129] en matière de langue, ainsi qu’en tout le reste. Son esprit se révèle là comme ailleurs. Or, la majorité est plus occupée d’affaires que d’études, d’intérêts politiques et commerciaux que de spéculations philosophiques, ou de belles-lettres. La plupart des mots créés ou admis par elle, porteront l’empreinte de ces habitudes ; ils serviront principalement à exprimer les besoins de l’industrie, les passions des partis ou les détails de l’administration publique. C’est de ce côté-là que la langue s’étendra sans cesse, tandis qu’au contraire elle abandonnera peu à peu le terrain de la métaphysique et de la théologie.
Quant à la source où les nations démocratiques puisent leurs mots nouveaux, et à la manière dont elles s’y prennent pour les fabriquer, il est facile de les dire.
Les hommes qui vivent dans les pays démocratiques ne savent guère la langue qu’on parlait à Rome et à Athènes, et ils ne se soucient point de remonter jusqu’à l’antiquité, pour y trouver l’expression qui leur manque. S’ils ont quelquefois recours aux savantes étymologies, c’est d’ordinaire la vanité qui les leur fait chercher au fond des langues mortes ; et non l’érudition qui les offre naturellement à leur esprit. Il arrive même quelquefois que ce sont les plus ignorants d’entre eux [III-130] qui en font le plus d’usage. Le désir tout démocratique de sortir de sa sphère les porte souvent à vouloir rehausser une profession très-grossière, par un nom grec ou latin. Plus le métier est bas et éloigné de la science, plus le nom est pompeux et érudit. C’est ainsi que nos danseurs de corde se sont transformés en acrobates et en funambules
À défaut de langues mortes, les peuples démocratiques empruntent volontiers des mots aux langues vivantes ; car ils communiquent sans cesse entre eux, et les hommes des différents pays s’imitent volontiers, parce qu’ils se ressemblent chaque jour davantage.
Mais c’est principalement dans leur propre langue que les peuples démocratiques cherchent les moyens d’innover. Ils reprennent de temps en temps dans leur vocabulaire, des expressions oubliées qu’ils remettent en lumière ; ou bien, ils retirent à une classe particulière de citoyens, un terme qui lui est propre pour le faire entrer avec un sens figuré dans le langage habituel ; une multitude d’expressions qui n’avaient d’abord appartenu qu’à la langue spéciale d’un parti ou d’une profession, se trouvent ainsi entraînées dans la circulation générale.
L’expédient le plus ordinaire qu’emploient les [III-131] peuples démocratiques pour innover en fait de langage consiste à donner à une expression déjà en usage un sens inusité. Cette méthode-là est très-simple, très-prompte et très-commode. Il ne faut pas de science pour s’en bien servir, et l’ignorance même en facilite l’emploi. Mais elle fait courir de grands périls à la langue. Les peuples démocratiques en doublant ainsi le sens d’un mot, rendent quelquefois douteux celui qu’ils lui laissent et celui qu’ils lui donnent.
Un auteur commence par détourner quelque peu une expression connue de son sens primitif, et, après l’avoir ainsi modifiée, il l’adapte de son mieux à son sujet. Un autre survient qui attire la signification d’un autre côté ; un troisième l’entraîne avec lui dans une nouvelle route ; et, comme il n’y a point d’arbitre commun, point de tribunal permanent qui puisse fixer définitivement le sens du mot, celui-ci reste dans une situation ambulatoire. Cela fait que les écrivains n’ont presque jamais l’air de s’attacher à une seule pensée, mais qu’ils semblent toujours viser au milieu d’un groupe d’idées, laissant au lecteur le soin de juger celle qui est atteinte.
Ceci est une conséquence fâcheuse de la démocratie. J’aimerais mieux qu’on hérissât la langue de mots chinois, tartares ou hurons, que de rendre [III-132] incertain le sens des mots français. L’harmonie et l’homogénéité ne sont que des beautés secondaires du langage. Il y a beaucoup de convention dans ces sortes de choses, et l’on peut à la rigueur s’en passer. Mais il n’y a pas de bonne langue sans termes clairs.
L’égalité apporte nécessairement plusieurs autres changements au langage.
Dans les siècles aristocratiques, où chaque nation tend à se tenir à l’écart de toutes les autres, et aime à avoir une physionomie qui lui soit propre, il arrive souvent que plusieurs peuples qui ont une origine commune deviennent cependant fort étrangers les uns aux autres, de telle sorte, que sans cesser de pouvoir tous s’entendre, ils ne parlent plus tous de la même manière.
Dans ces mêmes siècles, chaque nation est divisée en un certain nombre de classes qui se voient peu et ne se mêlent point ; chacune de ces classes prend et conserve invariablement des habitudes intellectuelles qui ne sont propres qu’à elle, et adopte de préférence certains mots et certains termes qui passent ensuite de génération en génération comme des héritages. On rencontre alors dans le même idiome une langue de pauvres et une langue de riches, une langue de roturiers et une langue de nobles, une langue savante et une [III-133] langue vulgaire. Plus les divisions sont profondes et les barrières infranchissables, plus il doit en être ainsi. Je parierais volontiers que parmi les castes de l’Inde le langage varie prodigieusement, et qu’il se trouve presque autant de différence entre la langue d’un paria et celle d’un brame qu’entre leurs habits.
Quand, au contraire, les hommes, n’étant plus tenus à leur place, se voient et se communiquent sans cesse, que les castes sont détruites et que les classes se renouvellement et se confondent, tous les mots de la langue se mêlent. Ceux qui ne peuvent pas convenir au plus grand nombre périssent ; le reste forme une masse commune où chacun prend à peu près au hasard. Presque tous les différents dialectes qui divisaient les idiômes de l’Europe tendent visiblement à s’effacer ; il n’y a pas de patois dans le nouveau monde, et ils disparaissent chaque jour de l’ancien.
Cette révolution dans l’état social influe aussi bien sur le style que sur la langue.
Non seulement tout le monde se sert des mêmes mots, mais on s’habitue à employer indifféremment chacun d’eux. Les règles que le style avait créées sont presque détruites. On ne rencontre guère d’expressions qui, par leur nature, semblent vulgaires, et d’autres qui paraissent distinguées. Des individus sortis de rangs divers ayant amené [III-134] avec eux, partout où ils sont parvenus, les expressions et les termes dont ils avaient l’usage, l’origine des mots s’est perdue comme celle des hommes, et il s’est fait une confusion dans le langage comme dans la société.
Je sais que dans la classification des mots il se rencontre des règles qui ne tiennent pas à une forme de société plutôt qu’à une autre, mais qui dérivent de la nature même des choses. Il y a des expressions et des tours qui sont vulgaires parce que les sentiments qu’ils doivent exprimer sont réellement bas, et d’autres qui sont relevés parce que les objets qu’ils veulent peindre sont naturellement fort hauts.
Les rangs, en se mêlant, ne feront jamais disparaître ces différences. Mais l’égalité ne peut manquer de détruire ce qui est purement conventionnel et arbitraire dans les formes de la pensée. Je ne sais même si la classification nécessaire, que j’indiquais plus haut, ne sera pas toujours moins respectée chez un peuple démocratique que chez un autre ; parce que, chez un pareil peuple, il ne se trouve point d’hommes que leur éducation, leurs lumières et leurs loisirs disposent d’une manière permanente à étudier les lois naturelles du langage et qui les fassent respecter en les observant eux-mêmes.
Je ne veux point abandonner ce sujet sans [III-135] peindre les langues démocratiques par un dernier trait qui les caractérisera plus peut-être que tous les autres.
J’ai montré précédemment que les peuples démocratiques avaient le goût et souvent la passion des idées générales ; cela tient à des qualités et à des défauts qui leur sont propres. Cet amour des idées générales se manifeste, dans les langues démocratiques, par le continuel usage des termes génériques et des mots abstraits, et par la manière dont on les emploie. C’est là le grand mérite et la grande faiblesse de ces langues.
Les peuples démocratiques aiment passionnément les termes génériques et les mots abstraits, parce que ces expressions agrandissent la pensée et permettant de renfermer en peu d’espace beaucoup d’objets, aident le travail de l’intelligence.
Un écrivain démocratique dira volontiers d’une manière abstraite les capacités pour les hommes capables, et sans entrer dans le détail des choses auxquelles cette capacité s’applique. Il parlera des actualités pour peindre d’un seul coup les choses qui se passent en ce moment sous ses yeux, et il comprendra, sous le mot éventualités, tout ce qui peut arriver dans l’univers à partir du moment où il parle.
Les écrivains démocratiques font sans cesse des [III-136] mots abstraits de cette espèce, ou ils prennent dans un sens de plus en plus abstrait les mots abstraits de la langue.
Bien plus, pour rendre le discours plus rapide, ils personnifient l’objet de ces mots abstraits et le font agir comme un individu réel. Ils diront que la force des choses veut que les capacités gouvernent.
Je ne demande pas mieux que d’expliquer ma pensée par mon propre exemple :
J’ai souvent fait usage du mot égalité dans un sens absolu ; j’ai, de plus, personnifié l’égalité en plusieurs endroits, et c’est ainsi qu’il m’est arrivé de dire que l’égalité faisait de certaines choses, ou s’abstenait de certaines autres. On peut affirmer que les hommes du siècle de Louis XIV n’eussent point parlé de cette sorte ; il ne serait jamais venu dans l’esprit d’aucun d’entre eux d’user du mot égalité sans l’appliquer à une chose particulière, et ils auraient plutôt renoncé à s’en servir que de consentir à faire de l’égalité une personne vivante.
Ces mots abstraits qui remplissent les langues démocratiques, et dont on fait usage à tout propos sans les rattacher à aucun fait particulier, agrandissent et voilent la pensée ; ils rendent l’expression plus rapide et l’idée moins nette. Mais, en fait de langage, les peuples [III-137] démocratiques aiment mieux l’obscurité que le travail.
Je ne sais d’ailleurs si le vague n’a point un certain charme secret pour ceux qui parlent et qui écrivent chez ces peuples.
Les hommes qui y vivent étant souvent livrés aux efforts individuels de leur intelligence, sont presque toujours travaillés par le doute. De plus, comme leur situation change sans cesse, ils ne sont jamais tenus fermes à aucune de leurs opinions par l’immobilité même de leur fortune.
Les hommes qui habitent les pays démocratiques, ont donc souvent des pensées vacillantes ; il leur faut des expressions très-larges pour les renfermer. Comme ils ne savent jamais si l’idée qu’ils expriment aujourd’hui conviendra à la situation nouvelle qu'ils auront demain, ils conçoivent naturellement le goût des termes abstraits. Un mot abstrait est comme une boîte à double fond ; on y met les idées que l’on désire, et on les en retire sans que personne le voie.
Chez tous les peuples, les termes génériques et abstraits forment le fond du langage ; je ne prétends donc point qu’on ne rencontre ces mots que dans les langues démocratiques ; je dis seulement que la tendance des hommes, dans les temps d’égalité, est d’augmenter particulièrement le nombre des mots de cette espèce ; de les prendre [III-138] toujours isolément dans leur acception la plus abstraite, et d’en faire usage à tout propos, lors même que le besoin du discours ne le requiert point.
[III-139]
CHAPITRE XVII.↩
De quelques sources de poésie chez les nations démocratiques.
On a donné plusieurs significations fort diverses au mot poésie. Ce serait fatiguer les lecteurs que de rechercher avec eux lequel de ces différents sens il convient le mieux de choisir ; je préfère leur dire sur-le-champ celui que j’ai choisi.
La poésie, à mes yeux, est la recherche et la peinture de l’idéal.
Celui qui, retranchant une partie de ce qui existe, ajoutant quelques traits imaginaires au tableau, combinant certaines circonstances réelles, mais dont le concours ne se rencontre pas, complette, [III-140] agrandit la nature, celui-là est le poëte. Ainsi, la poésie n’aura pas pour but de représenter le vrai, mais de l’orner, et d’offrit à l’esprit une image supérieure.
Les vers me paraîtront comme le beau idéal du langage, et, dans ce sens, ils seront éminemment poétiques ; mais, à eux seuls, ils ne constitueront pas la poésie.
Je veux rechercher si parmi les actions, les sentiments et les idées des peuples démocratiques, il ne s’en rencontre pas quelques-uns qui se prêtent à l’imagination de l’idéal et qu’on doive, pour cette raison, considérer comme des sources naturelles de poésie.
Il faut d’abord reconnaître que le goût de l’idéal et le plaisir que l’on prend à en voir la peinture ne sont jamais aussi vifs et aussi répandus chez un peuple démocratique qu’au sein d’une aristocratie.
Chez les nations aristocratiques, il arrive quelquefois que le corps agit comme de lui-même, tandis que l’âme est plongée dans un repos qui lui pèse. Chez ces nations, le peuple lui-même fait souvent voir des goûts poétiques, et son esprit s’élance parfois au-delà et au-dessus de ce qui l’environne.
Mais, dans les démocraties, l’amour des jouissances matérielles, l’idée du mieux, la concurrence, le charme prochain du succès, sont comme [III-141] autant d’aiguillons qui précipitent les pas de chaque homme dans la carrière qu’il a embrassée, et lui défendent de s’en écarter un seul moment. Le principal effort de l’âme va de ce côté. L’imagination n’est point éteinte ; mais elle s’adonne presque exclusivement à concevoir l’utile et à représenter le réel.
L’égalité ne détourne pas seulement les hommes de la peinture de l’idéal ; elle diminue le nombre des objets à peindre.
L’aristocratie, en tenant la société immobile, favorise la fermeté et la durée des religions positives, comme la stabilité des institutions politiques.
Non seulement elle maintient l’esprit humain dans la foi, mais elle le dispose à adopter une foi plutôt qu’une autre. Un peuple aristocratique sera toujours enclin à placer des puissances intermédiaires entre Dieu et l’homme.
On peut dire qu’en ceci l’aristocratie se montre très favorable à la poésie. Quand l’univers est peuplé d’êtres surnaturels qui ne tombent point sous les sens, mais que l’esprit découvre ; l’imagination se sent à l’aise, et les poëtes, trouvant mille sujets divers à peindre, rencontrent des spectateurs sans nombre prêts à s’intéresser à leurs tableaux.
Dans les siècles démocratiques, il arrive, au contraire, quelquefois, que les croyances s’en vont flottantes, comme les lois. Le doute ramène alors [III-142] l’imagination des poëtes sur la terre, et les renferme dans le monde visible et réel.
Lors même que l’égalité n’ébranle point les religions, elle les simplifie ; elle détourne l’attention des agents secondaires, pour la porter principalement sur le souverain maître.
L’aristocratie conduit naturellement l’esprit humain à la contemplation du passé, et l’y fixe. La démocratie, au contraire, donne aux hommes une sorte de dégoût instinctif pour ce qui est ancien. En cela, l’aristocratie est bien plus favorable à la poésie ; car les choses grandissent d’ordinaire et se voilent à mesure qu’elles s’éloignent ; et, sous ce double rapport, elles prêtent davantage à la peinture de l’idéal.
Après avoir ôté à la poésie le passé, l’égalité lui enlève en partie le présent.
Chez les peuples aristocratiques, il existe un certain nombre d’individus privilégiés, dont l’existence est pour ainsi dire en dehors et au-dessus de la condition humaine ; le pouvoir, la richesse, la gloire, l’esprit, la délicatesse et la distinction en toutes choses paraissent appartenir en propre à ceux-là. La foule ne les voit jamais de fort près ; ou ne les suit point dans les détails ; on a peu à faire pour rendre poétique la peinture de ces hommes.
D’une autre part, il existe chez ces mêmes [III-143] peuples des classes ignorantes, humbles et asservies ; et celles-ci prêtent à la poésie, par l’excès même de leur grossièreté et de leur misère, comme les autres par leur raffinement et leur grandeur. De plus, les différentes classes dont un peuple aristocratique se compose étant fort séparées les unes des autres et se connaissant mal entre elles, l’imagination peut toujours, en les représentant, ajouter ou ôter quelque chose au réel.
Dans les sociétés démocratiques, où les hommes sont tous très petits et fort semblables, chacun, en s’envisageant soi-même, voit à l’instant tous les autres. Les poètes qui vivent dans les siècles démocratiques ne sauraient donc jamais prendre un homme en particulier pour sujet de leur tableau ; car un objet d’une grandeur médiocre, et qu’on aperçoit distinctement de tous les côtés, ne prêtera jamais à l’idéal.
Ainsi donc l’égalité, en s’établissant sur la terre, tarit la plupart des sources anciennes de la poésie.
Essayons de montrer comment elle en découvre de nouvelles.
Quand le doute eut dépeuplé le ciel, et que les progrès de l’égalité eurent réduit chaque homme à des proportions mieux connues et plus petites, les poètes, n’imaginant pas encore ce qu’ils pouvaient mettre à la place de ces grands objets qui fuyaient avec l’aristocratie, tournèrent les yeux [III-144] vers la nature inanimée. Perdant de vue les héros et les dieux, ils entreprirent d’abord de peindre des fleuves et des montagnes.
Cela donna naissance, dans le siècle dernier, à la poésie qu’on a appelée, par excellence, descriptive.
Quelques-uns ont pensé que cette peinture, embellie des choses matérielles et inanimées qui couvrent la terre, était la poésie propre aux siècles démocratiques ; mais je pense que c’est une erreur. Je crois qu’elle ne représente qu’une époque de passage.
Je suis convaincu qu’à la longue la démocratie détourne l’imagination de tout ce qui est extérieur à l’homme, pour ne la fixer que sur l’homme.
Les peuples démocratiques peuvent bien s’amuser un moment à considérer la nature ; mais ils ne s’animent réellement qu’à la vue d’eux-mêmes. C’est de ce côté seulement que se trouvent chez ces peuples les sources naturelles de la poésie, et il est permis de croire que tous les poëtes qui ne voudront point y puiser perdront tout empire sur l’âme de ceux qu’ils prétendent charmer, et qui finiront par ne plus avoir que de froids témoins de leurs transports.
J’ai fait voir comment l’idée du progrès et de la perfectibilité indéfinie de l’espèce humaine était propre aux âges démocratiques.
[III-145]
Les peuples démocratiques ne s’inquiètent guère de ce qui a été ; mais ils rêvent volontiers à ce qui sera, et, de ce côté, leur imagination n’a point de limites ; elle s’y étend et s’y agrandit sans mesure.
Ceci offre une vaste carrière aux poëtes et leur permet de reculer loin de l’œil leur tableau. La démocratie, qui ferme le passé à la poésie, lui ouvre l’avenir.
Tous les citoyens qui composent une société démocratique étant à peu près égaux et semblables, la poésie ne saurait s’attacher à aucun d’entre eux ; mais la nation elle-même s’offre à son pinceau. La similitude de tous les individus, qui rend chacun d’eux séparément impropre à devenir l’objet de la poésie, permet aux poëtes de les renfermer tous dans une même image, et de considérer enfin le peuple lui-même. Les nations démocratiques aperçoivent plus clairement que toutes les autres leur propre figure, et cette grande figure prête merveilleusement à la peinture de l’idéal.
Je conviendrai aisément que les Américains n’ont point de poètes ; je ne saurais admettre de même qu’ils n’ont point d’idées poétiques.
On s’occupe beaucoup en Europe des déserts de l’Amérique, mais les Américains eux-mêmes n’y songent guère. Les merveilles de la nature [III-146] inanimée les trouvent insensibles, et ils n’aperçoivent pour ainsi dire les admirables forêts qui les environnent qu’au moment où elles tombent sous leurs coups. Leur œil est rempli d’un autre spectacle. Le peuple américain se voit marcher lui-même à travers ces déserts, desséchant les marais, redressant les fleuves, peuplant la solitude et domptant la nature. Cette image magnifique d’eux-mêmes ne s’offre pas seulement de loin en loin à l’imagination des Américains ; on peut dire qu’elle suit chacun d’entre eux dans les moindres de ses actions comme dans les principales, et qu’elle reste toujours suspendue devant son intelligence.
On ne saurait rien concevoir de si petit, de si terne, de si rempli de misérables intérêts, de si antipoétique, en un mot, que la vie d’un homme aux États-Unis ; mais, parmi les pensées qui la dirigent, il s’en rencontre toujours une qui est pleine de poésie, et celle-là est comme le nerf caché qui donne la vigueur à tout le reste.
Dans les siècles aristocratiques, chaque peuple comme chaque individu, est enclin à se tenir immobile et séparé de tous les autres.
Dans les siècles démocratiques, l’extrême mobilité des hommes et leurs impatients désirs font qu’ils changent sans cesse de place, et que les habitants des différents pays se mêlent, se voient, [III-147] s’écoutent et s’empruntent. Ce ne sont donc pas seulement les membres d’une même nation qui deviennent semblables ; les nations elles-mêmes s’assimilent, et toutes ensemble ne forment plus à l’œil du spectateur qu’une vaste démocratie dont chaque citoyen est un peuple. Cela met pour la première fois au grand jour la figure du genre humain.
Tout ce qui se rapporte à l’existence du genre humain pris en entier, à ses vicissitudes, à son avenir, devient une mine très féconde pour la poésie.
Les poëtes qui vécurent dans les âges aristocratiques ont fait d’admirables peintures en prenant pour sujets certains incidents de la vie d’un peuple ou d’un homme, mais aucun d’entre eux n’a jamais osé renfermer dans son tableau les destinées de l’espèce humaine, tandis que les poëtes qui écrivent dans les âges démocratiques peuvent l’entreprendre.
Dans le même temps que chacun, élevant les yeux au-dessus de son pays, commence enfin à apercevoir l’humanité elle-même, Dieu se manifeste de plus en plus à l’esprit humain dans sa pleine et entière majesté.
Si dans les siècles démocratiques la foi aux religions positives est souvent chancelante, et que les croyances à des puissances intermédiaires, [III-148] quelque nom qu’on leur donne, s’obscurcissent ; d’autre part les hommes sont disposés à concevoir une idée beaucoup plus vaste de la Divinité elle-même, et son intervention dans les affaires humaines leur apparaît sous un jour nouveau et plus grand.
Apercevant le genre humain comme un seul tout, ils conçoivent aisément qu’un même dessein préside à ses destinées ; et, dans les actions de chaque individu, ils sont portés à reconnaître la trace de ce plan général et constant suivant lequel Dieu conduit l’espèce.
Ceci peut encore être considéré comme une source très-abondante de poésie, qui s’ouvre dans ces siècles.
Les poëtes démocratiques paraîtront toujours petits et froids s’ils essayent de donner à des dieux, à des démons ou à des anges, des formes corporelles, et s’ils cherchent à les faire descendre du ciel pour se disputer la terre.
Mais, s’ils veulent rattacher les grands événements qu’ils retracent aux desseins généraux de Dieu sur l’univers, et, sans montrer la main du souverain maître, faire pénétrer dans sa pensée, ils seront admirés et compris, car l’imagination de leurs contemporains suit d’elle-même cette route.
On peut également prévoir que les poëtes qui [III-149] vivent dans les âges démocratiques peindront des passions et des idées plutôt que des personnes et des actes.
Le langage, le costume et les actions journalières des hommes dans les démocraties se refusent à l’imagination de l’idéal. Ces choses ne sont pas poétiques par elles-mêmes, et elles cesseraient d’ailleurs de l’être, par cette raison qu’elles sont trop bien connues de tous ceux auxquels on entreprendrait d’en parler. Cela force les poëtes à percer sans cesse au-dessous de la surface extérieure que les sens leur découvrent, afin d’entrevoir l’âme elle-même. Or, il n’y a rien qui prête plus à la peinture de l’idéal que l’homme ainsi envisagé dans les profondeurs de sa nature immatérielle.
Je n’ai pas besoin de parcourir le ciel et la terre pour découvrir un objet merveilleux plein de contrastes, de grandeurs et de petitesses infinies, d’obscurités profondes et de singulières clartés ; capable à la fois de faire naître la pitié, l’admiration, le mépris, la terreur. Je n’ai qu’à me considérer moi-même : l’homme sort du néant, traverse le temps et va disparaître pour toujours dans le sein de Dieu. On ne le voit qu’un moment errer sur la limite des deux abîmes où il se perd.
Si l’homme s’ignorait complètement, il ne serait point poëtique ; car on ne peut peindre ce dont [III-150] on n’a pas l’idée. S’il se voyait clairement, son imagination resterait oisive et n’aurait rien à ajouter au tableau. Mais l’homme est assez découvert pour qu’il aperçoive quelque chose de lui-même, et assez voilé pour que le reste s’enfonce dans des ténèbres impénétrables parmi lesquelles il plonge sans cesse, et toujours en vain, afin d’achever de se saisir.
Il ne faut donc pas s’attendre à ce que, chez les peuples démocratiques, la poésie vive de légendes, qu’elle se nourrisse de traditions et d’antiques souvenirs, qu’elle essaye de repeupler l’univers d’êtres surnaturels auxquels les lecteurs et les poètes eux-mêmes ne croient plus, ni qu’elle personnifie froidement des vertus et des vices qu’on peut voir sous leur propre forme. Toutes ces ressources lui manquent ; mais l’homme lui reste, et c’est assez pour elle. Les destinées humaines, l’homme, pris à part de son temps et de son pays, et placé en face de la nature et de Dieu, avec ses passions, ses doutes, ses prospérités inouïes et ses misères incompréhensibles, deviendront pour ces peuples l’objet principal et presque unique de la poésie ; et c’est ce dont on peut déjà s’assurer, si l’on considère ce qu’ont écrit les plus grands poëtes qui aient paru depuis que le monde achève de tourner à la démocratie.
Les écrivains qui, de nos jours, ont si [III-151] admirablement reproduit les traits de Childe-Harold, de René et de Jocelyn, n’ont pas prétendu raconter les actions d’un homme ; ils ont voulu illuminer et agrandir certains côtés encore obscurs du cœur humain.
Ce sont là les poëmes de la démocratie.
L’égalité ne détruit donc pas tous les objets de la poésie ; elle les rend moins nombreux et plus vastes.
[III-153]
CHAPITRE XVIII.↩
Pourquoi les écrivains et les orateurs américains sont souvent boursouflés.
J’ai souvent remarqué que les Américains qui traitent en général les affaires dans un langage clair et sec, dépourvu de tout ornement et dont l’extrême simplicité est souvent vulgaire, donnent volontiers dans le boursouflé, dès qu’ils veulent aborder le style poétique. Ils se montrent alors pompeux sans relâche d’un bout à l’autre du discours, et l’on croirait, en les voyant prodiguer ainsi les images à tout propos, qu’ils n’ont jamais rien dit simplement.
Les Anglais tombent plus rarement dans un défaut semblable.
[III-154]
La cause de ceci peut être indiquée sans beaucoup de peine.
Dans les sociétés démocratiques, chaque citoyen est habituellement occupé à contempler un très-petit objet, qui est lui-même. S’il vient à lever plus haut les yeux, il n’aperçoit alors que l’image immense de la société, ou la figure plus grande encore du genre humain. Il n’a que des idées très-particulières et très-claires, ou des notions très-générales et très-vagues ; l’espace intermédiaire est vide.
Quand on l’a tiré de lui-même, il s’attend donc toujours qu’on va lui offrir quelque objet prodigieux à regarder, et ce n’est qu’à ce prix qu’il consent à s’arracher un moment aux petits soins compliqués qui agitent et charment sa vie.
Ceci me parait expliquer assez bien pourquoi les hommes des démocraties qui ont, en général, de si minces affaires, demandent à leurs poëtes des conceptions si vastes et des peintures si démesurées.
De leur côté, les écrivains ne manquent guère d’obéir à ces instincts qu’ils partagent : ils gonflent leur imagination sans cesse, et l’étendant outre mesure, ils lui font atteindre le gigantesque pour lequel elle abandonne souvent le grand.
De cette manière, ils espèrent attirer sur-le-champ les regards de la foule, et les fixer [III-155] aisément autour d’eux, et ils réussissent souvent à le faire ; car la foule, qui ne cherche dans la poésie que des objets très-vastes, n’a pas le temps de mesurer exactement les proportions de tous les objets qu’on lui présente, ni le goût assez sûr pour apercevoir facilement en quoi ils sont disproportionnés. L’auteur et le public se corrompent à la fois l’un par l’autre.
Nous avons vu d’ailleurs que, chez les peuples démocratiques, les sources de la poésie étaient belles, mais peu abondantes. On finit bientôt par les épuiser. Ne trouvant plus matière à l’idéal dans le réel et dans le vrai, les poëtes en sortent entièrement et créent des monstres.
Je n’ai pas peur que la poésie des peuples démocratiques se montre timide ni qu’elle se tienne très-près de terre. J’appréhende plutôt qu’elle ne se perde à chaque instant dans les nuages, et qu’elle ne finisse par peindre des contrées entièrement imaginaires. Je crains que les œuvres des poötes démocratiques n’offrent souvent des images immenses et incohérentes, des peintures surchargées, des composés bizarres, et que les êtres fantastiques sortis de leur esprit ne fassent quelquefois regretter le monde réel.
[III-157]
CHAPITRE XIX.↩
Quelques observations sur le théâtre des peuples démocratiques.
Lorsque la révolution qui a changé l’état social et politique d’un peuple aristocratique commence à se faire jour dans la littérature, c’est en général par le théâtre qu’elle se produit d’abord, et c’est là qu’elle demeure toujours visible.
Le spectateur d’une œuvre dramatique est, en quelque sorte, pris au dépourvu par l’impression qu’on lui suggère. Il n’a pas le temps d’interroger sa mémoire, ni de consulter les habiles ; il ne songe point à combattre les nouveaux instincts [III-158] littéraires qui commencent à se manifester en lui ; il y cède avant de les connaître.
Les auteurs ne tardent pas à découvrir de quel côté incline ainsi secrètement le goût du public. Ils tournent de ce côté-là leurs œuvres ; et les pièces de théâtre, après avoir servi à faire apercevoir la révolution littéraire qui se prépare, achèvent bientôt de l’accomplir. Si vous voulez juger d’avance la littérature d’un peuple qui tourne à la démocratie, étudiez son théâtre.
Les pièces de théâtre forment d’ailleurs chez les nations aristocratiques elles-mêmes la portion la plus démocratique de la littérature. Il n’y a pas de jouissance littéraire plus à portée de la foule que celles qu’on éprouve à la vue de la scène. Il ne faut ni préparation ni étude pour les sentir. Elles vous saisissent au milieu de vos préoccupations et de votre ignorance. Lorsque l’amour encore à moitié grossier des plaisirs de l’esprit commence à pénétrer dans une classe de citoyens, il la pousse aussitôt au théâtre. Les théâtres des nations aristocratiques ont toujours été remplis de spectateurs qui n’appartenaient point à l’aristocratie. C’est au théâtre seulement que les classes supérieures se sont mêlées avec les moyennes et les inférieures, et qu’elles ont consenti sinon à recevoir l’avis de ces dernières, du moins à souffrir que celles-ci le donnassent. C’est au théâtre que les [III-159] érudits et les lettrés ont toujours eu le plus de peine à faire prévaloir leur goût sur celui du peuple, et à se défendre d’être entraînés eux-mêmes par le sien. Le parterre y a souvent fait la loi aux loges.
S’il est difficile à une aristocratie de ne point laisser envahir le théâtre par le peuple, on comprendra aisément que le peuple doit y régner en maître, lorsque les principes démocratiques ayant pénétré dans les lois et dans les mœurs, les rangs se confondent et les intelligences se rapprochent comme les fortunes, et que la classe supérieure perd, avec ses richesses héréditaires, son pouvoir, ses traditions et ses loisirs.
Les goûts et les instincts naturels aux peuples démocratiques, en fait de littérature, se manifesteront donc d’abord au théâtre, et on peut prévoir qu’ils s’y introduiront avec violence. Dans les écrits, les lois littéraires de l’aristocratie se modifieront peu à peu, d’une manière graduelle et pour ainsi dire légale. Au théâtre, elles seront renversées par des émeutes.
Le théâtre met en relief la plupart des qualités et presque tous les vices inhérents aux littératures démocratiques.
Les peuples démocratiques n’ont qu’une estime fort médiocre pour l’érudition, et ils ne se soucient guère de ce qui se passait à Rome et à [III-160] Athènes ; ils entendent qu’on leur parle d’eux-mêmes, et c’est le tableau du présent qu’ils demandent.
Aussi, quand les héros et les mœurs de l’antiquité sont reproduits souvent sur la scène, et qu’on a soin d’y rester très-fidèle aux traditions antiques, cela suffit pour en conclure que les classes démocratiques ne dominent point encore au théâtre.
Racine s’excuse fort humblement, dans la préface de Britannicus, d’avoir fait entrer Junie au nombre des vestales, où, selon Aulu-Gelle, dit-il, « on ne recevait personne au-dessous de six ans, ni au-dessus de dix. » Il est à croire qu’il n’eût pas songé à s’accuser ou à se défendre d’un pareil crime s’il avait écrit de nos jours.
Un semblable fait m’éclaire, non seulement sur l’état de la littérature dans les temps où il a lieu, mais encore sur celui de la société elle-même. Un théâtre démocratique ne prouve point que la nation est en démocratie ; car, comme nous venons de le voir, dans les aristocraties mêmes il peut arriver que les goûts démocratiques influent sur la scène ; mais, quand l’esprit de l’aristocratie règne seul au théâtre, cela démontre invinciblement que la société tout entière est aristocratique, et l’on peut hardiment en conclure que cette même classe érudite et lettrée, qui dirige les auteurs, commande les citoyens et mène les affaires.
[III-161]
Il est bien rare que les goûts raffinés et les penchants hautains de l’aristocratie, quand elle régit le théâtre, ne la portent point à faire, pour ainsi dire, un choix dans la nature humaine. Certaines conditions sociales l’intéressent principalement, et elle se plaît à en retrouver la peinture sur la scène ; certaines vertus, et même certains vices, lui paraissent mériter plus particulièrement d’y être reproduits ; elle agrée le tableau de ceux-ci tandis qu’elle éloigne de ses yeux tous les autres. Au théâtre, comme ailleurs, elle ne veut rencontrer que de grands seigneurs, et elle ne s’émeut que pour des rois. Ainsi des styles. Une aristocratie impose volontiers, aux auteurs dramatiques, de certaines manières de dire, elle veut que tout soit dit sur ce ton.
Le théâtre arrive souvent ainsi à ne peindre qu’un des côtés de l’homme, ou même quelquefois à représenter ce qui ne se rencontre point dans la nature humaine ; il s’élève au-dessus d’elle et en sort.
Dans les sociétés démocratiques les spectateurs n’ont point de pareilles préférences, et ils font rarement voir de semblables antipathies ; ils aiment à retrouver sur la scène le mélange confus de conditions, de sentiments et d’idées qu’ils rencontrent sous leurs yeux ; le théâtre devient plus frappant, plus vulgaire, et plus vrai.
[III-162]
Quelquefois cependant ceux qui écrivent pour le théâtre, dans les démocraties, sortent aussi de la nature humaine, mais c’est par un autre bout que leurs devanciers. À force de vouloir reproduire minutieusement les petites singularités du moment présent et la physionomie particulière de certains hommes, ils oublient de retracer les traits généraux de l’espèce.
Quand les classes démocratiques règnent au théâtre, elles introduisent autant de liberté dans la manière de traiter le sujet que dans le choix même de ce sujet.
L’amour du théâtre étant, de tous les goûts littéraires, le plus naturel aux peuples démocratiques, le nombre des auteurs et celui des spectateurs s’accroît sans cesse chez ces peuples comme celui des spectacles. Une pareille multitude, composée d’éléments si divers et répandus en tant de lieux différents, ne saurait reconnaître les mêmes règles et se soumettre aux mêmes lois. Il n’y a pas d’accord possible entre des juges très-nombreux, qui ne sachant point où se retrouver, portent chacun à part leur arrêt. Si l’effet de la démocratie est en général de rendre douteuses les règles et les conventions littéraires, au théâtre elle les abolit entièrement pour n’y substituer que le caprice de chaque auteur et de chaque public.
[III-163]
C’est également au théâtre que se fait surtout voir ce que j’ai déjà dit ailleurs, d’une manière générale, à propos du style et de l’art dans les littératures démocratiques. Lorsqu’on lit les critiques que faisaient naître les ouvrages dramatiques du siècle de Louis XIV, on est surpris de voir la grande estime du public pour la vraisemblance et l’importance qu’il mettait à ce qu’un homme, restant toujours d’accord avec lui-même, ne fit rien qui ne pût être aisément expliqué et compris. Il est également surprenant combien on attachait alors de prix aux formes du langage et quelles petites querelles de mots on faisait aux auteurs dramatiques.
Il semble que les hommes du siècle de Louis XIV attachaient une valeur fort exagérée à ces détails qui s’aperçoivent dans le cabinet, mais qui échappent à la scène. Car, après tout, le principal objet d’une pièce de théâtre est d’être représentée et son premier mérite d’émouvoir. Cela venait de ce que les spectateurs de cette époque étaient en même temps des lecteurs. Au sortir de la représentation, ils attendaient chez eux l’écrivain, afin d’achever de le juger.
Dans les démocraties, on écoute les pièces de théâtre, mais on ne les lit point. La plupart de ceux qui assistent aux jeux de la scène n’y cherchent pas les plaisirs de l’esprit, mais les [III-164] émotions vives du cœur. Ils ne s’attendent point à y trouver une œuvre de littérature, mais un spectacle, et, pourvu que l’auteur parle assez correctement la langue du pays pour se faire entendre, et que ses personnages excitent la curiosité et éveillent la sympathie, ils sont contents ; sans rien demander de plus à la fiction, ils rentrent aussitôt dans le monde réel. Le style y est donc moins nécessaire ; car, à la scène, l’observation de ces règles échappe davantage.
Quant aux vraisemblances, il est impossible d’être souvent nouveau, inattendu, rapide en leur restant fidèle. On les néglige donc et le public le pardonne. On peut compter qu’il ne s’inquiétera point des chemins par où vous l’avez conduit, si vous l’amenez enfin devant un objet qui le touche. Il ne vous reprochera jamais de l’avoir ému en dépit des règles.
Les Américains mettent au grand jour les différents instincts que je viens de peindre, quand ils vont au théâtre. Mais il faut reconnaître qu’il n’y a encore qu’un petit nombre d’entre eux qui y aillent. Quoique les spectateurs et les spectacles se soient prodigieusement accrus depuis quarante ans aux États-Unis, la population ne se livre encore à ce genre d’amusement qu’avec une extrême retenue.
Cela tient à des causes particulières, que le [III-165] lecteur connaît déjà, et qu’il suffit de lui rappeler en deux mots:
Les puritains qui ont fondé les républiques américaines n’étaient pas seulement ennemis des plaisirs ; ils professaient de plus une horreur toute spéciale pour le théâtre. Ils le considéraient comme un divertissement abominable, et, tant que leur esprit a régné sans partage, les représentations dramatiques ont été absolument inconnues parmi eux. Ces opinions des premiers pères de la colonie ont laissé des traces profondes dans l’esprit de leurs descendants.
L’extrême régularité d’habitude et la grande rigidité de mœurs qui se voient aux États-Unis, ont d’ailleurs été jusqu’à présent peu favorables au développement de l’art théâtral.
Il n’y a point de sujets de drame dans un pays qui n’a pas été témoin de grandes catastrophes politiques, et où l’amour mène toujours par un chemin direct et facile au mariage. Des gens qui emploient tous les jours de la semaine à faire fortune et le dimanche à prier Dieu, ne prêtent point à la muse comique.
Un seul fait suffit pour montrer que le théâtre est peu populaire aux États-Unis.
Les Américains, dont les lois autorisent la liberté et même la licence de la parole en toutes choses, ont néanmoins soumis les auteurs [III-166] dramatiques à une sorte de censure. Les représentations théâtrales ne peuvent avoir lieu que quand les administrateurs de la commune les permettent. Ceci montre bien que les peuples sont comme les individus. Ils se livrent sans ménagement à leurs passions principales, et ensuite ils prennent bien garde de ne point trop céder à l’entraînement des goûts qu’ils n’ont pas.
Il n’y a point de portion de la littérature qui se rattache par des liens plus étroits et plus nombreux à l’état actuel de la société que le théâtre.
Le théâtre d’une époque ne saurait jamais convenir à l’époque suivante, si, entre les deux, une importante révolution a changé les mœurs et les lois.
On étudie encore les grands écrivains d’un autre siècle. Mais on n’assiste plus à des pièces écrites pour un autre public. Les auteurs dramatiques du temps passe ne vivent que dans les livres.
Le goût traditionnel de quelques hommes, la vanité, la mode, le génie d’un acteur peuvent soutenir quelque temps ou relever un théâtre aristocratique au sein d’une démocratie ; mais bientôt il tombe de lui-même. On ne le renverse point, on l’abandonne.
[III-167]
CHAPITRE XX.↩
De quelques tendances particulières aux historiens dans les siècles démocratiques.
Les historiens qui écrivent dans les siècles aristocratiques font dépendre d’ordinaire tous les événements de la volonté particulière et de l’humeur de certains hommes, et ils rattachent volontiers aux moindres accidents les révolutions les plus importantes. Ils font ressortir avec sagacité les plus petites causes, et souvent ils n’aperçoivent point les plus grandes.
Les historiens qui vivent dans les siècles démocratiques montrent des tendances toutes contraires.
[III-168]
La plupart d’entre eux n’attribuent presque aucune influence à l’individu sur la destinée de l’espèce, ni aux citoyens sur le sort du peuple. Mais, en retour, ils donnent de grandes causes générales à tous les petits faits particuliers. Ces tendances opposées s’expliquent.
Quand les historiens des siècles aristocratiques jettent les yeux sur le théâtre du monde, ils y aperçoivent tout d’abord un très petit nombre d’acteurs principaux qui conduisent toute la pièce. Ces grands personnages, qui se tiennent sur le devant de la scène, arrêtent leur vue et la fixent : tandis qu’ils s’appliquent à dévoiler les motifs secrets qui font agir et parler ceux-là, ils oublient le reste.
L’importance des choses qu’ils voient faire à quelques hommes leur donne une idée exagérée de l’influence que peut exercer un homme, et les dispose naturellement à croire qu’il faut toujours remonter à l’action particulière d’un individu pour expliquer les mouvements de la foule.
Lorsque, au contraire, tous les citoyens sont indépendants les uns des autres, et que chacun d’eux est faible, on n’en découvre point qui exerce un pouvoir fort grand, ni surtout fort durable, sur la masse. Au premier abord, les individus semblent absolument impuissants sur elle ; et l’on dirait que la société marche toute seule par le concours libre [III-169] et spontané de tous les hommes qui la composent.
Cela porte naturellement l’esprit humain à rechercher la raison générale qui a pu frapper ainsi à la fois tant d’intelligences, et les tourner simultanément du même côté.
Je suis très convaincu que, chez les nations démocratiques elles-mêmes, le génie, les vices ou les vertus de certains individus retardent ou précipitent le cours naturel de la destinée du peuple ; mais ces sortes de causes fortuites et secondaires sont infiniment plus variées, plus cachées, plus compliquées, moins puissantes, et par conséquent plus difficiles à démêler et à suivre dans des temps d’égalité que dans des siècles d’aristocratie, où il ne s’agit que d’analyser, au milieu des faits généraux, l’action particulière d’un seul homme ou de quelques uns.
L’historien se fatigue bientôt d’un pareil travail ; son esprit se perd au milieu de ce labyrinthe ; et, ne pouvant parvenir a apercevoir clairement et à mettre suffisamment en lumière les influences individuelles, il les nie. Il préfère nous parler du naturel des races, de la constitution physique du pays, ou de l’esprit de la civilisation. Cela abrège son travail, et à moins de frais satisfait mieux le lecteur.
M. de La Fayette a dit quelque part, dans ses Mémoires, que le système exagéré des causes [III-170] générales procurait de merveilleuses consolations aux hommes publics médiocres. J’ajoute qu’il en donne d’admirables aux historiens médiocres. Il leur fournit toujours quelques grandes raisons qui les tirent promptement d’affaire à l’endroit le plus difficile de leur livre et favorisent la faiblesse ou la paresse de leur esprit, tout en faisant honneur à sa profondeur.
Pour moi, je pense qu’il n’y a pas d’époque où il ne faille attribuer une partie des événements de ce monde à des faits très généraux, et une autre à des influences très particulières. Ces deux causes se rencontrent toujours ; leur rapport seul diffère. Les faits généraux expliquent plus de choses dans les siècles démocratiques que dans les siècles aristocratiques, et les influences particulières moins. Dans les temps d’aristocratie, c’est le contraire : les influences particulières sont plus fortes, et les causes générales sont plus faibles, à moins qu’on ne considère comme une cause générale le fait même de l’inégalité des conditions, qui permet à quelques individus de contrarier les tendances naturelles de tous les autres.
Les historiens qui cherchent à peindre ce qui se passe dans les sociétés démocratiques ont donc raison de faire une large part aux causes générales, et de s’appliquer principalement à les découvrir ; mais ils ont tort de nier entièrement [III-171] l’action particulière des individus, parce qu’il est mal aisé de la retrouver et de la suivre.
Non seulement les historiens qui vivent dans les siècles démocratiques sont entraînés à donner à chaque fait une grande cause, mais ils sont encore portés à lier les faits entre eux et à en faire sortir un système.
Dans les siècles d’aristocratie, l’attention des historiens étant détournée à tous moments sur les individus, l’enchaînement des événements leur échappe, ou plutôt ils ne croient pas à un enchaînement semblable. La trame de l’histoire leur semble à chaque instant rompue par le passage d’un homme.
Dans les siècles démocratiques, au contraire, l’historien voyant beaucoup moins les acteurs, et beaucoup plus les actes, peut établir aisément une filiation et un ordre méthodique entre ceux-ci.
La littérature antique, qui nous a laissé de si belles histoires, n’offre point un seul grand système historique, tandis que les plus misérables littératures modernes en fourmillent. Il semble que les historiens anciens ne faisaient pas assez usage de ces théories générales dont les nôtres sont toujours près d’abuser.
Ceux qui écrivent dans les siècles démocratiques ont une autre tendance plus dangereuse.
Lorsque la trace de l’action des individus sur [III-172] les nations se perd, il arrive souvent qu’on voit le monde se remuer sans que le moteur se découvre. Comme il devient très difficile d’apercevoir et d’analyser les raisons qui, agissant séparément sur la volonté de chaque citoyen, finissent par produire le mouvement du peuple, on est tenté de croire que ce mouvement n’est pas volontaire et que les sociétés obéissent sans le savoir à une force supérieure qui les domine.
Alors même que l’on doit découvrir sur la terre le fait général qui dirige la volonté particulière de tous les individus, cela ne sauve point la liberté humaine. Une cause assez vaste pour s’appliquer à la fois à des millions d’hommes, et assez forte pour les incliner tous ensemble du même côté, semble aisément irrésistible ; après avoir vu qu’on y cédait, on est bien près de croire qu’on ne pouvait y résister.
Les historiens qui vivent dans les temps démocratiques ne refusent donc pas seulement à quelques citoyens la puissance d’agir sur la destinée du peuple, ils ôtent encore aux peuples eux-mêmes la faculté de modifier leur propre sort, et ils les soumettent soit à une providence inflexible, soit à une sorte de fatalité aveugle. Suivant eux, chaque nation est invinciblement attachée, par sa position, son origine, ses antécédents, son naturel, à une certaine destinée que tous [III-173] ses efforts ne sauraient changer. Ils rendent les générations solidaires les unes des autres, et remontant ainsi, d’âge en âge et d’événements nécessaires en événements nécessaires, jusqu’à l’origine du monde, ils font une chaîne serrée et immense qui enveloppe tout le genre humain et le lie.
Il ne leur suffit pas de montrer comment les faits sont arrivés ; ils se plaisent encore à faire voir qu’ils ne pouvaient arriver autrement. Ils considèrent une nation parvenue à un certain endroit de son histoire, et ils affirment qu’elle a été contrainte de suivre le chemin qui l’a conduite là. Cela est plus aisé que d’enseigner comment elle aurait pu faire pour prendre une meilleure route.
Il semble, en lisant les historiens des âges aristocratiques et particulièrement ceux de l’antiquité, que, pour devenir maître de son sort et pour gouverner ses semblables, l’homme n’a qu’à savoir se dompter lui-même. On dirait, en parcourant les histoires écrites de notre temps, que l’homme ne peut rien, ni sur lui, ni autour de lui. Les historiens de l’antiquité enseignaient à commander, ceux de nos jours n’apprennent guère qu’à obéir. Dans leurs écrits, l’auteur paraît souvent grand, mais l’humanité est toujours petite.
Si cette doctrine de la fatalité, qui a tant d’attraits pour ceux qui écrivent l’histoire dans les temps démocratiques, passant des écrivains à [III-174] leurs lecteurs, pénétrait ainsi la masse entière des citoyens et s’emparait de l’esprit public, on peut prévoir qu’elle paralyserait bientôt le mouvement des sociétés nouvelles et réduirait les chrétiens en Turcs.
Je dirai de plus qu’une pareille doctrine est particulièrement dangereuse à l’époque où nous sommes ; nos contemporains ne sont que trop enclins à douter du libre arbitre, parce que chacun d’eux se sent borné de tous côtés par sa faiblesse, mais ils accordent encore volontiers de la force et de l’indépendance aux hommes réunis en corps social. Il faut se garder d’obscurcir cette idée, car il s’agit de relever les âmes et non d’achever de les abattre.
[III-175]
CHAPITRE XXI.↩
De l’éloquence parlementaire aux États-Unis.
Chez les peuples aristocratiques, tous les hommes se tiennent et dépendent les uns des autres ; il existe entre tous un lien hiérarchique à l’aide duquel on peut maintenir chacun à sa place et le corps entier dans l’obéissance. Quelque chose d’analogue se retrouve toujours au sein des assemblées politiques de ces peuples. Les partis s’y rangent naturellement sous de certains chefs auxquels ils obéissent par une sorte d’instinct qui n’est que le résultat d’habitudes contractées [III-176] ailleurs. Ils transportent dans la petite société les mœurs de la plus grande.
Dans les pays démocratiques, il arrive souvent qu’un grand nombre de citoyens se dirigent vers un même point ; mais chacun n’y marche, ou se flatte du moins de n’y marcher que de lui-même. Habitué à ne régler ses mouvements que suivant ses impulsions personnelles, il se plie mal aisément à recevoir du dehors sa règle. Ce goût et cet usage de l’indépendance le suivent dans les conseils nationaux. S’il consent à s’y associer à d’autres pour la poursuite du même dessein, il veut du moins rester maître de coopérer au succès commun à sa manière.
De là vient que dans les contrées démocratiques, les partis souffrent si impatiemment qu’on les dirige et ne se montrent subordonnés que quand le péril est très-grand. Encore, l’autorité des chefs, qui dans ces circonstances peut aller jusqu’à faire agir et parler, ne s’étend-elle presque jamais jusqu’au pouvoir de faire taire,
Chez les peuples aristocratiques, les membres des assemblées politiques sont en même temps les membres de l’aristocratie. Chacun d’eux possède par lui-même un rang élevé et stable, et la place qu’il occupe dans l’assemblée est souvent moins importante à ses yeux que celle qu’il remplit dans le pays. Cela le console de n’y point jouer un rôle dans la [III-177] discussion des affaires, et le dispose à n’en pas rechercher avec trop d’ardeur un médiocre.
En Amérique, il arrive d’ordinaire que le député n’est quelque chose que par sa position dans l’assemblée. Il est donc sans cesse tourmenté du besoin d’y acquérir de l’importance, et il sent un désir pétulant d’y mettre à tout moment ses idées au grand jour.
Il n’est pas seulement poussé de ce côté par sa vanité, mais par celle de ses électeurs et par la nécessité continuelle de leur plaire.
Chez les peuples aristocratiques, le membre de la législature est rarement dans une dépendance étroite des électeurs ; souvent il est pour eux un représentant en quelque façon nécessaire ; quelquefois il les tient eux-mêmes dans une étroite dépendance, et s’ils viennent enfin à lui refuser leur suffrage, il se fait aisément nommer ailleurs, ou, renonçant à la carrière publique, il se renferme dans une oisiveté qui a encore de la splendeur.
Dans un pays démocratique, comme les États-Unis, le député n’a presque jamais de prise durable sur l’esprit de ses électeurs. Quelque petit que soit un corps électoral, l’instabilité démocratique fait qu’il change sans cesse de face. Il faut donc le captiver tous les jours.
Il n’est jamais sûr d’eux ; et, s’ils l’abandonnent, [III-178] il est aussitôt sans ressource ; car il n’a pas naturellement une position assez élevée pour être facilement aperçu de ceux qui ne sont pas proches ; et, dans l’indépendance complète où vivent les citoyens, il ne peut espérer que ses amis ou le gouvernement l’imposeront aisément à un corps électoral qui ne le connaîtra pas. C’est donc dans le canton qu’il représente que sont déposés tous les germes de sa fortune ; c’est de ce coin de terre qu’il lui faut sortir pour s’élever à commander le peuple et à influer sur les destinées du monde.
Ainsi, il est naturel que, dans les pays démocratiques, les membres des assemblées politiques songent à leurs électeurs plus qu’à leur parti, tandis que, dans les aristocraties, ils s’occupent plus de leur parti que de leurs électeurs.
Or, ce qu’il faut dire pour plaire aux électeurs n’est pas toujours ce qu’il conviendrait de faire pour bien servir l’opinion politique qu’ils professent.
L’intérêt général d’un parti est souvent que le député qui en est membre ne parle jamais des grandes affaires qu’il entend mal ; qu’il parle peu des petites dont la marche des grandes serait embarrassée, et le plus souvent enfin qu’il se taise entièrement. Garder le silence est le plus utile service qu’un médiocre discoureur puisse rendre à la chose publique.
[III-179]
Mais ce n’est point ainsi que les électeurs l’entendent.
La population d’un canton charge un citoyen de prendre part au gouvernement de l’État, parce qu’elle a conçu une très-vaste idée de son mérite. Comme les hommes paraissent plus grands en proportion qu’ils se trouvent entourés d’objets plus petits, il est à croire que l’opinion qu’on se fera du mandataire sera d’autant plus haute que les talents seront plus rares parmi ceux qu’il représente. Il arrivera donc souvent que les électeurs espéreront d’autant plus de leur député qu’ils auront moins à en attendre ; et, quelque incapable qu’il puisse être, ils ne sauraient manquer d’exiger de lui des efforts signalés qui répondent au rang qu’ils lui donnent.
Indépendamment du législateur de l’État, les électeurs voient encore en leur représentant le protecteur naturel du canton près de la législature ; ils ne sont pas même éloignés de le considérer comme le fondé de pouvoirs de chacun de ceux qui l’ont élu, et ils se flattent qu’il ne déploiera pas moins d’ardeur à faire valoir leurs intérêts particuliers que ceux du pays.
Ainsi, les électeurs se tiennent d’avance pour assurés que le député qu’ils choisiront sera un orateur ; qu’il parlera souvent s’il le peut, et que, au cas où il lui faudrait se restreindre, il [III-180] s’efforcera du moins de renfermer dans ses rares discours l’examen de toutes les grandes affaires de l’État, joint à l’exposé de tous les petits griefs dont ils ont eux-mêmes à se plaindre ; de telle façon que, ne pouvant se montrer souvent, il fasse voir à chaque occasion ce qu’il sait faire, et que, au lieu de se répandre incessamment, il se resserre de temps à autre tout entier sous un petit volume, fournissant ainsi une sorte de résumé brillant et complet de ses commettants et de lui-même. À ce prix, ils promettent leurs prochains suffrages.
Ceci pousse au désespoir d’honnêtes médiocrités qui, se connaissant, ne se seraient pas produites d’elles-mêmes. Le député, ainsi excité, prend la parole au grand chagrin de ses amis, et, se jetant imprudemment au milieu des plus célèbres orateurs, il embrouille le débat et fatigue l’assemblée.
Toutes les lois qui tendent à rendre l’élu plus dépendant de l’électeur, ne modifient donc pas seulement la conduite des législateurs, ainsi que je l’ai fait remarquer ailleurs, mais aussi leur langage. Elles influent tout à la fois sur les affaires et sur la manière d’en parler.
Il n’est pour ainsi dire pas de membre du congrès qui consente à rentrer dans ses foyers sans s’y être fait précéder au moins par un discours, [III-181] ni qui souffre d’être interrompu avant d’avoir pu renfermer dans les limites de sa harangue tout ce qu’on peut dire d’utile aux vingt-quatre États dont l’Union se compose, et spécialement au district qu’il représente. Il fait donc passer successivement devant l’esprit de ses auditeurs de grandes vérités générales qu’il n’aperçoit souvent lui-même, et qu’il n’indique que confusément, et de petites particularités fort ténues qu’il n’a pas trop de facilité à découvrir et à exposer. Aussi arrive-t-il très-souvent que dans le sein de ce grand corps, la discussion devient vague et embarrassée, et qu’elle semble se traîner vers le but qu’on se propose plutôt qu’y marcher.
Quelque chose d’analogue se fera toujours voir, je pense, dans les assemblées publiques des démocraties.
D’heureuses circonstances et de bonnes lois pourraient parvenir à attirer dans la législature d’un peuple démocratique des hommes beaucoup plus remarquables que ceux qui sont envoyés par les Américains au congrès ; mais on n’empêchera jamais les hommes médiocres qui s’y trouvent de s’y exposer complaisamment, et de tous les côtés au grand jour.
Le mal ne me paraît pas entièrement guérissable, parce qu’il ne tient pas seulement au [III-182] règlement de l’assemblée, mais à sa constitution et à celle même du pays.
Les habitants des États-Unis semblent considérer eux-mêmes la chose sous ce point de vue, et ils témoignent leur long usage de la vie parlementaire, non point en s’abstenant de mauvais discours, mais en se soumettant avec courage à les entendre. Ils s’y résignent comme au mal que l’expérience leur a fait reconnaître inévitable.
Nous avons montré le petit côté des discussions politiques dans les démocraties ; faisons voir le grand.
Ce qui s’est passé depuis cent cinquante ans dans le parlement d’Angleterre n’a jamais eu un grand retentissement au dehors ; les idées et les sentiments exprimés par les orateurs ont toujours trouvé peu de sympathie chez les peuples même qui se trouvaient placés le plus près du grand théâtre de la liberté britannique. Tandis que, dès les premiers débats qui ont eu lieu dans les petites assemblées coloniales d’Amérique à l’époque de la révolution, l’Europe fut émue.
Cela n’a pas tenu seulement à des circonstances particulières et fortuites, mais à des causes générales et durables.
Je ne vois rien de plus admirable ni de plus puissant qu’un grand orateur discutant de grandes [III-183] affaires dans le sein d’une assemblée démocratique. Comme il n’y a jamais de classe qui y ait ses représentants chargés de soutenir ses intérêts, c’est toujours à la nation tout entière, et au nom de la nation tout entière que l’on parle. Cela agrandit la pensée et relève le langage.
Comme les précédents y ont peu d’empire ; qu’il n’y a plus de privilèges attachés à certains biens, ni de droits inhérents à certains corps ou à certains hommes, l’esprit est obligé de remonter jusqu’à des variétés générales puisées dans la nature humaine pour traiter l’affaire particulière qui l’occupe. De là naît dans les discussions politiques d’un peuple démocratique, quelque petit qu’il soit, un caractère de généralité qui les rend souvent attachantes pour le genre humain. Tous les hommes s’y intéressent parce qu’il s’agit de l’homme qui est partout le même.
Chez les plus grands peuples aristocratiques, au contraire, les questions les plus générales sont presque toujours traitées par quelques raisons particulières tirées des usages d’une époque ou des droits d’une classe ; ce qui n’intéresse que la classe dont il est question, ou tout au plus le peuple dans le sein duquel cette classe se trouve.
C’est à cette cause autant qu’à la grandeur de la nation française, et aux dispositions favorables [III-184] des peuples qui l’écoutent, qu’il faut attribuer le grand effet que nos discussions politiques produisent quelquefois dans le monde.
Nos orateurs parlent souvent à tous les hommes, alors même qu’ils ne s’adressent qu’à leurs concitoyens.
[III-185]
DEUXIÈME PARTIE.
INFLUENCE DE LA DÉMOCRATIE SUR LES SENTIMENTS DES AMÉRICAINS.
CHAPITRE I.↩
Pourquoi les peuples démocratiques montrent un amour plus ardent et plus durable pour l’égalité que pour la liberté.
La première et la plus vive des passions que l’égalité des conditions fait naître, je n’ai pas besoin de le dire, c’est l’amour de cette même égalité. On ne s’étonnera donc pas que j’en parle avant toutes les autres.
Chacun a remarqué que, de notre temps, et [III-186] spécialement en France, cette passion de l’égalité prenait chaque jour une place plus grande dans le cœur humain. On a dit cent fois que nos contemporains avaient un amour bien plus ardent et bien plus tenace pour l’égalité que pour la liberté ; mais je ne trouve point qu’on soit encore suffisamment remonté jusqu’aux causes de ce fait. Je vais l’essayer.
On peut imaginer un point extrême où la liberté et l’égalité se touchent et se confondent.
Je suppose que tous les citoyens concourent au gouvernement et que chacun ait un droit égal d’y concourir.
Nul ne différant alors de ses semblables, personne ne pourra exercer un pouvoir tyrannique ; les hommes seront parfaitement libres, parce qu’ils seront tous entièrement égaux ; et ils seront tous parfaitement égaux parce qu’ils seront entièrement libres. C’est vers cet idéal que tendent les peuples démocratiques.
Voilà la forme la plus complète que puisse prendre l’égalité sur la terre ; mais il en est mille autres, qui, sans être aussi parfaites, n’en sont guère moins chères à ces peuples.
L’égalité peut s’établir dans la société civile, et ne point régner dans le monde politique. On peut avoir le droit de se livrer aux mêmes plaisirs, d’entrer dans les mêmes professions, de se [III-187] rencontrer dans les mêmes lieux ; en un mot, de vivre de la même manière et de poursuivre la richesse par les mêmes moyens, sans prendre tous la même part au gouvernement.
Une sorte d’égalité peut même s’établir dans le monde politique, quoique la liberté politique n’y soit point. On est l’égal de tous ses semblables, moins un, qui est, sans distinction, le maître de tous, et qui prend également, parmi tous, les agents de son pouvoir.
Il serait facile de faire plusieurs autres hypothèses suivant lesquelles une fort grande egalité pourrait aisément se combiner avec des institutions plus ou moins libres, ou même avec des institutions qui ne le seraient point du tout.
Quoique les hommes ne puissent devenir absolument égaux sans être entièrement libres, et que par conséquent l’égalité, dans son degré le plus extrême, se confonde avec la liberté, on est donc fondé à distinguer l’une de l’autre.
Le goût que les hommes ont pour la liberté, et celui qu’ils ressentent pour l’égalité, sont, en effet, deux choses distinctes, et je ne crains pas d’ajouter que, chez les peuples démocratiques, ce sont deux choses inégales.
Si l’on veut y faire attention, on verra qu’il se rencontre dans chaque siècle un fait singulier et dominant auquel les autres se rattachent ; ce fait [III-188] donne presque toujours naissance à une pensée mère, ou à une passion principale qui finit ensuite par attirer à elle et par entraîner dans son cours tous les sentiments et toutes les idées. C’est comme le grand fleuve vers lequel chacun des ruisseaux environnants semble courir.
La liberté s’est manifestée aux hommes dans différents temps et sous différentes formes ; elle ne s’est point attachée exclusivement à un état social, et on la rencontre autre part que dans les démocraties. Elle ne saurait donc former le caractère distinctif des siècles démocratiques.
Le fait particulier et dominant qui singularise ces siècles, c’est l’égalité des conditions ; la passion principale qui agite les hommes dans ces temps-là, c’est l’amour de cette égalité.
Ne demandez point quel charme singulier trouvent les hommes des âges démocratiques à vivre égaux, ni les raisons particulières qu’ils peuvent avoir de s’attacher si obstinément à l’égalité plutôt qu’aux autres biens que la société leur présente : l’égalité forme le caractère distinctif de l’époque où ils vivent ; cela seul suffit pour expliquer qu’ils la préfèrent à tout le reste.
Mais, indépendamment de cette raison, il en est plusieurs autres qui, dans tous les temps, porteront habituellement les hommes à préférer l’égalité à la liberté.
[III-189]
Si un peuple pouvait jamais parvenir à détruire ou seulement à diminuer lui-même dans son sein l’égalité qui y règne, il n’y arriverait que par de longs et pénibles efforts. Il faudrait qu’il modifiât son état social, abolît ses lois, renouvelât ses idées, changeât ses habitudes, altérât ses mœurs. Mais, pour perdre la liberté politique, il suffit de ne pas la retenir, et elle s’échappe.
Les hommes ne tiennent donc pas seulement à l’égalité parce qu’elle leur est chère ; ils s’y attachent encore parce qu’ils croient qu’elle doit durer toujours.
Que la liberté politique puisse, dans ses excès, compromettre la tranquillité, le patrimoine, la vie des particuliers, on ne rencontre point d’hommes si bornés et si légers qui ne le découvrent. Il n’y a au contraire, que les gens attentifs et clairvoyants qui aperçoivent les périls dont l’égalité nous menace, et d’ordinaire ils évitent de les signaler. Ils savent que les misères qu’ils redoutent sont éloignées, et ils se flattent qu’elles n’atteindront que les générations à venir, dont la génération présente ne s’inquiète guère. Les maux que la liberté amène quelquefois sont immédiats ; ils sont visibles pour tous, et tous, plus ou moins, les ressentent. Les maux que l’extrême égalité peut produire ne se manifestent que peu à peu ; ils s’insinuent graduellement dans le corps social ; on [III-190] ne les voit que de loin en loin, et au moment où ils deviennent les plus violents, l’habitude a déjà fait qu’on ne les sent plus.
Les biens que la liberté procure ne se montrent qu’à la longue ; et il est toujours facile de méconnaître la cause qui les fait naître.
Les avantages de l’égalité se font sentir dès à présent, et chaque jour on les voit découler de leur source.
La liberté politique donne de temps en temps, à un certain nombre de citoyens, de sublimes plaisirs.
L’égalité fournit chaque jour une multitude de petites jouissances à chaque homme. Les charmes de l’égalité se sentent à tous moments, et ils sont à la portée de tous ; les plus nobles cœurs n’y sont pas insensibles, et les âmes les plus vulgaires en font leurs délices. La passion que l’égalité fait naître doit donc être tout à la fois énergique et générale.
Les hommes ne sauraient jouir de la liberté politique sans l’acheter par quelques sacrifices, et ils ne s’en emparent jamais qu’avec beaucoup d’efforts. Mais les plaisirs que l’égalité procure s’offrent d’eux-mêmes. Chacun des petits incidents de la vie privée semble les faire naître, et pour les goûter il ne faut que vivre.
Les peuples démocratiques aiment l’égalité dans [III-191] tous les temps, mais il est de certaines époques où ils poussent jusqu’au délire la passion qu’ils ressentent pour elle. Ceci arrive au moment où l’ancienne hiérarchie sociale, longtemps menacée, achève de se détruire, après une dernière lutte intestine, et que les barrières qui séparaient les citoyens sont enfin renversées. Les hommes se précipitent alors sur l’égalité comme sur une conquête et ils s’y attachent comme à un bien précieux qu’on veut leur ravir. La passion d’égalité pénètre de toutes parts dans le cœur humain, elle s’y étend, elle le remplit tout entier. Ne dites point aux hommes qu’en se livrant ainsi aveuglément à une passion exclusive, ils compromettent leurs intérêts les plus chers ; ils sont sourds. Ne leur montrez pas la liberté qui s’échappe de leurs mains, tandis qu’ils regardent ailleurs ; ils sont aveugles, ou plutôt ils n’aperçoivent dans tout l’univers qu’un seul bien digne d’envie.
Ce qui précède s’applique à toutes les nations démocratiques. Ce qui suit ne regarde que nous-mêmes.
Chez la plupart des nations modernes, et en particulier chez tous les peuples du continent de l’Europe, le goût et l’idée de la liberté n’ont commencé à naître et à se développer qu’au moment où les conditions commençaient à s’égaliser, [III-192] et comme conséquence de cette égalité même. Ce sont les rois absolus qui ont le plus travaillé à niveler les rangs parmi leurs sujets. Chez ces peuples, l’égalité a précédé la liberté ; l’égalité était donc un fait ancien, lorsque la liberté était encore une chose nouvelle ; l’une avait déjà créé des opinions, des usages, des lois qui lui étaient propres, lorsque l’autre se produisait seule, et pour la première fois, au grand jour. Ainsi, la seconde n’était encore que dans les idées et dans les goûts, tandis que la première avait déjà pénétré dans les habitudes, s’était emparée des mœurs, et avait donné un tour particulier aux moindres actions de la vie. Comment s’étonner si les hommes de nos jours préfèrent l’une à l’autre ?
Je pense que les peuples démocratiques ont un goût naturel pour la liberté ; livrés à eux-mêmes, ils la cherchent, ils l’aiment, et ils ne voient qu’avec douleur qu’on les en écarte. Mais ils ont pour l’égalité une passion ardente, insatiable, éternelle, invincible ; ils veulent l’égalité dans la liberté, et, s’ils ne peuvent l’obtenir, ils la veulent encore dans l’esclavage. Ils souffriront la pauvreté, l’asservissement, la barbarie, mais ils ne souffriront pas l’aristocratie.
Ceci est vrai dans tous les temps, et surtout dans le nôtre. Tous les hommes et tous les [III-193] pouvoirs qui voudront lutter contre cette puissance irrésistible, seront renversés et détruits par elle. De nos jours, la liberté ne peut s’établir sans son appui, et le despotisme lui-même ne saurait régner sans elle.
[III-195]
CHAPITRE II.↩
De l’individualisme dans les pays démocratiques.
J’ai fait voir comment, dans les siècles d’égalité, chaque homme cherchait en lui-même ses croyances ; je veux montrer comment, dans les mêmes siècles, il tourne tous ses sentiments vers lui seul.
L’individualisme est une expression récente qu’une idée nouvelle a fait naître. Nos pères ne connaissaient que l’égoïsme.
L’égoïsme est un amour passionné et exagéré de soi-même, qui porte l’homme à ne rien rapporter qu’à lui seul et à se préférer à tout.
[III-196]
L’individualisme est un sentiment réfléchi et paisible qui dispose chaque citoyen à s’isoler de la masse de ses semblables, et à se retirer à l’écart avec sa famille et ses amis ; de telle sorte que, après s’être ainsi créé une petite société à son usage, il abandonne volontiers la grande société à elle-même.
L’égoïsme naît d’un instinct aveugle ; l’individualisme procède d’un jugement erroné plutôt que d’un sentiment dépravé. Il prend sa source dans les défauts de l’esprit autant que dans les vices du cœur.
L’égoïsme dessèche le germe de toutes les vertus ; l’individualisme ne tarit d’abord que la source des vertus publiques ; mais, à la longue, il attaque et détruit toutes les autres, et va enfin s’absorber dans l’égoïsme.
L’égoïsme est un vice aussi ancien que le monde. Il n’appartient guère plus à une forme de société qu’à une autre.
L’individualisme est d’origine démocratique, et il menace de se développer à mesure que les conditions s’égalisent.
Chez les peuples aristocratiques, les familles restent pendant des siècles dans le même état, et souvent dans le même lieu. Cela rend, pour ainsi dire, toutes les générations contemporaines. Un homme connaît presque toujours ses aïeux et les [III-197] respecte ; il croit déjà apercevoir ses arrière-petits-fils, et il les aime. Il se fait volontiers des devoirs envers les uns et les autres, et il lui arrive fréquemment de sacrifier ses jouissances personnelles à ces êtres qui ne sont plus ou qui ne sont pas encore.
Les institutions aristocratiques ont, de plus, pour effet de lier étroitement chaque homme à plusieurs de ses concitoyens.
Les classes étant fort distinctes et immobiles dans le sein d’un peuple aristocratique, chacune d’elles devient pour celui qui en fait partie une sorte de petite patrie, plus visible et plus chère que la grande.
Comme, dans les sociétés aristocratiques, tous les citoyens sont placés à poste fixe, les uns au-dessus des autres, il en résulte encore que chacun d’entre eux aperçoit toujours plus haut que lui un homme dont la protection lui est nécessaire, et plus bas il en découvre un autre dont il peut réclamer le concours.
Les hommes qui vivent dans les siècles aristocratiques sont donc presque toujours liés d’une manière étroite à quelque chose qui est placé en dehors d’eux, et ils sont souvent disposés à s’oublier eux-mêmes. Il est vrai que, dans ces mêmes siècles, la notion générale du semblable est obscure, et qu’on ne songe guère à s’y dévouer [III-198] pour la cause de l’humanité ; mais on se sacrifie souvent à certains hommes.
Dans les siècles démocratiques, au contraire, où les devoirs de chaque individu envers l’espèce sont bien plus clairs, le dévouement envers un homme devient plus rare : le lien des affections humaines s’étend et se desserre.
Chez les peuples démocratiques, de nouvelles familles sortent sans cesse du néant, d’autres y retombent sans cesse, et toutes celles qui demeurent changent de face ; la trame des temps se rompt à tout moment, et le vestige des générations s’efface. On oublie aisément ceux qui vous ont précédé, et l’on n’a aucune idée de ceux qui vous suivront. Les plus proches seuls intéressent.
Chaque classe venant à se rapprocher des autres et à s’y mêler, ses membres deviennent indifférents et comme étrangers entre eux.
L’aristocratie avait fait de tous les citoyens une longue chaîne qui remontait du paysan au roi ; la démocratie brise la chaîne et met chaque anneau à part.
À mesure que les conditions s’égalisent, il se rencontre un plus grand nombre d’individus qui, n’étant plus assez riches ni assez puissants pour exercer une grande influence sur le sort de leurs semblables, ont acquis cependant ou ont conservé assez de lumières et de biens pour pouvoir se [III-199] suffire à eux-mêmes. Ceux-là ne doivent rien à personne, ils n’attendent pour ainsi dire rien de personne ; ils s’habituent à se considérer toujours isolément, et ils se figurent volontiers que leur destinée tout entière est entre leurs mains.
Ainsi, non seulement la démocratie fait oublier à chaque homme ses aïeux, mais elle lui cache ses descendants et le sépare de ses contemporains ; elle le ramène sans cesse vers lui seul, et menace de le renfermer enfin tout entier dans la solitude de son propre cœur.
[III-201]
CHAPITRE III.↩
Comment l’individualisme est plus grand au sortir d’une révolution démocratique qu’à une autre époque.
C’est surtout au moment où une société démocratique achève de se former sur les débris d’une aristocratie, que cet isolement des hommes les uns des autres, et l’égoïsme qui en est la suite, frappent le plus aisément les regards.
Ces sociétés ne renferment pas seulement un grand nombre de citoyens indépendants, elles sont journellement remplies d’hommes qui, arrivés d’hier à l’indépendance, sont enivrés de leur nouveau pouvoir : ceux-ci conçoivent une présomptueuse confiance dans leurs forces, et, [III-202] n’imaginant pas qu’ils puissent désormais avoir besoin de réclamer le secours de leurs semblables, ils ne font pas difficulté de montrer qu’ils ne songent qu’à eux-mêmes.
Une aristocratie ne succombe d’ordinaire qu’après une lutte prolongée, durant laquelle il s’est allumé entre les différentes classes des haines implacables. Ces passions survivent à la victoire ; et l’on peut en suivre la trace au milieu de la confusion démocratique qui lui succède.
Ceux d’entre les citoyens qui étaient les premiers dans la hiérarchie détruite ne peuvent oublier aussitôt leur ancienne grandeur ; longtemps ils se considèrent comme des étrangers au sein de la société nouvelle. Ils voient dans tous les égaux que cette société leur donne, des oppresseurs, dont la destinée ne saurait exciter la sympathie ; ils ont perdu de vue leurs anciens égaux, et ne se sentent plus liés par un intérêt commun à leur sort ; chacun, se retirant à part, se croit donc réduit à ne s’occuper que de lui-même. Ceux, au contraire, qui jadis étaient placés au bas de l’échelle sociale, et qu’une révolution soudaine a rapprochés du commun niveau, ne jouissent qu’avec une sorte d’inquiétude secrète de l’indépendance nouvellement acquise ; s’ils retrouvent à leurs côtés quelques uns de leurs anciens supérieurs, ils jettent sur eux des regards de triomphe et de crainte, et s’en écartent.
[III-203]
C’est donc ordinairement à l’origine des sociétés démocratiques que les citoyens se montrent le plus disposés à s’isoler.
La démocratie porte les hommes à ne pas se rapprocher de leurs semblables ; mais les révolutions démocratiques les disposent à se fuir, et perpétuent au sein de l’égalité les haines que l’inégalité a fait naître.
Le grand avantage des Américains est d’être arrivés à la démocratie sans avoir à souffrir de révolutions démocratiques, et d’être nés égaux au lieu de le devenir.
[III-205]
CHAPITRE IV.↩
Comment les Américains combattent l’individualisme par des institutions libres.
Le despotisme, qui, de sa nature, est craintif, voit dans l’isolement des hommes le gage le plus certain de sa propre durée, et il met d’ordinaire tous ses soins à les isoler. Il n’est pas de vice du cœur humain qui lui agrée autant que l’égoïsme : un despote pardonne aisément aux gouvernés de ne point l’aimer, pourvu qu’ils ne s’aiment pas entre eux. Il ne leur demande pas de l’aider à conduire l’État ; c’est assez qu’ils ne prétendent point à le diriger eux-mêmes. Il appelle esprits [III-206] turbulents et inquiets ceux qui prétendent unir leurs efforts pour créer la prospérité commune, et changeant le sens naturel des mots, il nomme bons citoyens ceux qui se renferment étroitement en eux-mêmes.
Ainsi, les vices que le despotisme fait naître sont précisément ceux que l’égalité favorise. Ces deux choses se complètent et s’entr’aident d’une manière funeste.
L’égalité place les hommes à côté les uns des autres, sans lien commun qui les retienne. Le despotisme élève des barrières entre eux et les sépare. Elle les dispose à ne point songer à leurs semblables, et il leur fait une sorte de vertu publique de l’indifférence.
Le despotisme, qui est dangereux dans tous les temps, est donc particulièrement à craindre dans les siècles démocratiques.
Il est facile de voir que dans ces mêmes siècles les hommes ont un besoin particulier de la liberté.
Lorsque les citoyens sont forcés de s’occuper des affaires publiques, ils sont tirés nécessairement du milieu de leurs intérêts individuels et arrachés, de temps à autre, à la vue d’eux-mêmes.
Du moment où l’on traite en commun les affaires communes, chaque homme aperçoit qu’il n’est pas aussi indépendant de ses semblables qu’il se le figurait d’abord, et que, pour obtenir leur [III-207] appui, il faut souvent leur prêter son concours.
Quand le public gouverne, il n’y a pas d’homme qui ne sente le prix de la bienveillance publique et qui ne cherche à la captiver en s’attirant l’estime et l’affection de ceux au milieu desquels il doit vivre.
Plusieurs des passions qui glacent les cœurs et les divisent sont alors obligées de se retirer au fond de l’âme et de s’y cacher. L’orgueil se dissimule ; le mépris n’ose se faire jour. L’égoïsme a peur de lui-même.
Sous un gouvernement libre, la plupart des fonctions publiques étant électives, les hommes que la hauteur de leur âme ou l’inquiétude de leurs désirs mettent à l’étroit dans la vie privée, sentent chaque jour qu’ils ne peuvent se passer de la population qui les environne.
Il arrive alors que l’on songe à ses semblables par ambition, et que souvent on trouve en quelque sorte son intérêt à s’oublier soi-même. Je sais qu’on peut m’opposer ici toutes les intrigues qu’une élection fait naître, les moyens honteux dont les candidats se servent souvent et les calomnies que leurs ennemis répandent. Ce sont là des occasions de haine, et elles se représentent d’autant plus souvent que les élections deviennent plus fréquentes.
Ces maux sont grands, sans doute, mais ils sont [III-208] passagers, tandis que les biens qui naissent avec eux demeurent.
L’envie d’être élu peut porter momentanément certains hommes à se faire la guerre ; mais ce même désir porte à la longue tous les hommes à se prêter un mutuel appui ; et, s’il arrive qu’une élection divise accidentellement deux amis, le système électoral rapproche d’une manière permanente une multitude de citoyens qui seraient toujours restés étrangers les uns aux autres. La liberté crée des haines particulières, mais le despotisme fait naître l’indifférence générale.
Les Américains ont combattu par la liberté l’individualisme que l’égalité faisait naître, et ils l’ont vaincu.
Les législateurs de l’Amérique n’ont pas cru que, pour guérir une maladie si naturelle au corps social dans les temps démocratiques et si funeste, il suffisait d’accorder à la nation tout entière une représentation d’elle-même ; ils ont pensé que de plus il convenait de donner une vie politique à chaque portion du territoire, afin de multiplier à l’infini, pour les citoyens, les occasions d’agir ensemble, et de leur faire sentir tous les jours qu’ils dépendent les uns des autres.
C’était se conduire avec sagesse.
Les affaires générales d’un pays n’occupent que les principaux citoyens. Ceux-là ne se rassemblent [III-209] que de loin en loin dans les mêmes lieux ; et comme il arrive souvent qu’ensuite ils se perdent de vue, il ne s’établit pas entre eux de liens durables. Mais quand il s’agit de faire régler les affaires particulières d’un canton par les hommes qui l’habitent, les mêmes individus sont toujours en contact, et ils sont en quelque sorte forcés de se connaître et de se complaire.
On tire difficilement un homme de lui-même pour l’intéresser à la destinée de tout l’État, parce qu’il comprend mal l’influence que la destinée de l’État peut exercer sur son sort. Mais faut-il faire passer un chemin au bout de son domaine, il verra d’un premier coup d’œil qu’il se rencontre un rapport entre cette petite affaire publique et ses plus grandes affaires privées, et il découvrira, sans qu’on le lui montre, le lien étroit qui unit ici l’intérêt particulier à l’intérêt général.
C’est donc en chargeant les citoyens de l’administration des petites affaires, bien plus qu’en leur livrant le gouvernement des grandes, qu’on les intéresse au bien public, et qu’on leur fait voir le besoin qu’ils ont sans cesse les uns des autres pour le produire.
On peut, par une action d’éclat, captiver tout à coup la faveur d’un peuple ; mais, pour gagner l’amour et le respect de la population qui vous entoure, il faut une longue succession de petits [III-210] services rendus, de bons offices obscurs, une habitude constante de bienveillance et une réputation bien établie de désintéressement.
Les libertés locales, qui font qu’un grand nombre de citoyens mettent du prix à l’affection de leurs voisins et de leurs proches, ramènent donc sans cesse les hommes les uns vers les autres, en dépit des instincts qui les séparent, et les forcent à s’entr’aider.
Aux États-Unis, les plus opulents citoyens ont bien soin de ne point s’isoler du peuple ; au contraire, ils s’en rapprochent sans cesse, ils l’écoutent volontiers et lui parlent tous les jours. Ils savent que les riches des démocraties ont toujours besoin des pauvres, et que dans les temps démocratiques on s’attache le pauvre par les manières plus que par les bienfaits. La grandeur même des bienfaits, qui met en lumière la différence des conditions, cause une irritation secrète à ceux qui en profitent ; mais la simplicité des manières a des charmes presque irrésistibles : leur familiarité entraîne et leur grossièreté même ne déplaît pas toujours.
Ce n’est pas du premier coup que cette vérité pénètre dans l’esprit des riches. Ils y résistent d’ordinaire tant que dure la révolution démocratique, et ils ne l’admettent même point aussitôt après que cette révolution est accomplie. Ils consentent [III-211] volontiers à faire du bien au peuple ; mais ils veulent continuer à le tenir soigneusement à distance. Ils croient que cela suffit ; ils se trompent. Ils se ruineraient ainsi sans réchauffer le cœur de la population qui les environne. Ce n’est pas le sacrifice de leur argent qu’elle leur demande ; c’est celui de leur orgueil.
On dirait qu’aux États-Unis il n’y a pas d’imagination qui ne s’épuise à inventer des moyens d’accroître la richesse et de satisfaire les besoins du public. Les habitants les plus éclairés de chaque canton se servent sans cesse de leurs lumières pour découvrir des secrets nouveaux propres à accroître la prospérité commune ; et, lorsqu’ils en ont trouvé quelques uns, ils se hâtent de les livrer à la foule.
En examinant de près les vices et les faiblesses que font voir souvent en Amérique ceux qui gouvernent, on s’étonne de la prospérité croissante du peuple, et on a tort. Ce n’est point le magistrat élu qui fait prospérer la démocratie américaine ; mais elle prospère parce que le magistrat est électif.
Il serait injuste de croire que le patriotisme des Américains et le zèle que montre chacun d’eux pour le bien-être de ses concitoyens n’aient rien de réel. Quoique l’intérêt privé dirige, aux États-Unis aussi bien qu’ailleurs, la plupart des actions humaines, il ne les règle pas toutes.
[III-212]
Je dois dire que j’ai souvent vu des Américains faire de grands et véritables sacrifices à la chose publique, et j’ai remarqué cent fois qu’au besoin ils ne manquaient presque jamais de se prêter un fidèle appui les uns aux autres.
Les institutions libres que possèdent les habitants des États-Unis, et les droits politiques dont ils font tant d’usage, rappellent sans cesse, et de mille manières, à chaque citoyen qu’il vit en société. Elles ramènent à tout moment son esprit vers cette idée, que le devoir aussi bien que l’intérêt des hommes est de se rendre utiles à leurs semblables ; et comme il ne voit aucun sujet particulier de les haïr, puisqu’il n’est jamais ni leur esclave ni leur maître, son cœur penche aisément du côté de la bienveillance. On s’occupe d’abord de l’intérêt général par nécessité, et puis par choix ; ce qui était calcul devient instinct ; et, à force de travailler au bien de ses concitoyens, on prend enfin l’habitude et le goût de les servir.
Beaucoup de gens en France considèrent l’égalité des conditions comme un premier mal, et la liberté politique comme un second. Quand ils sont obligés de subir l’une, ils s’efforcent du moins d’échapper à l’autre. Et moi, je dis que, pour combattre les maux que l’égalité peut produire, il n’y a qu’un remède efficace : c’est la liberté politique.
[III-213]
CHAPITRE V.↩
De l’usage que les américains font de l’association dans la vie civile.
Je ne veux point parler de ces associations politiques à l’aide desquelles les hommes cherchent à se défendre contre l’action despotique d’une majorité ou contre les empiétements du pouvoir royal. J’ai déjà traité ce sujet ailleurs. Il est clair que si chaque citoyen, a mesure qu’il devient individuellement plus faible, et par conséquent plus incapable de préserver isolément sa liberté, n’apprenait pas l’art de s’unir à ses semblables pour la défendre, la tyrannie croîtrait nécessairement avec l’égalité. Il ne s’agit ici que des associations [III-214] qui se forment dans la vie civile, et dont l’objet n’a rien de politique.
Les associations politiques qui existent aux États-Unis ne forment qu’un détail au milieu de l’immense tableau que l’ensemble des associations y présente.
Les Américains de tous les âges, de toutes les conditions, de tous les esprits, s’unissent sans cesse. Non seulement ils ont des associations commerciales et industrielles auxquelles tous prennent part ; mais ils en ont encore de mille autres espèces : de religieuses, de morales, de graves, de futiles, de fort générales et de très-particulières, d’immenses et de fort petites ; les Américains s’associent pour donner des fêtes, fonder des séminaires, bâtir des auberges, élever des églises, répandre des livres, envoyer des missionnaires aux antipodes ; ils créent de cette manière des hôpitaux, des prisons, des écoles. S’agit-il enfin de mettre en lumière une vérité ou de développer un sentiment par l’appui d’un grand exemple : ils s’associent. Partout où, à la tête d’une entreprise nouvelle, vous voyez en France le gouvernement, et en Angleterre un grand seigneur, comptez que vous apercevrez aux États-Unis une association.
J’ai rencontré en Amérique des sortes d’associations dont je confesse que je n’avais pas même [III-215] l’idée, et j’ai souvent admiré l’art infini avec lequel les habitants des États-Unis parvenaient à fixer un but commun aux efforts d’un grand nombre d’hommes, et à les y faire marcher librement.
J’ai parcouru depuis l’Angleterre, où les Américains ont pris quelques unes de leurs lois et beaucoup de leurs usages, et il m’a paru qu’on était fort loin d’y faire un aussi constant et un aussi habile emploi de l’association.
Il arrive souvent que des Anglais exécutent isolément de très-grandes choses, tandis qu’il n’est guère de si petite entreprise pour laquelle les Américains ne s’unissent. Il est évident que les premiers considèrent l’association comme un puissant moyen d’action ; mais les autres semblent y voir le seul moyen qu’ils aient d’agir.
Ainsi le pays le plus démocratique de la terre se trouve être celui de tous où les hommes ont le plus perfectionné de nos jours l’art de poursuivre en commun l’objet de leurs communs désirs, et ont appliqué au plus grand nombre d’objets cette science nouvelle.
Ceci résulte-t-il d’un accident, ou serait-ce qu’il existe en effet un rapport nécessaire entre les associations et l’égalité ?
Les sociétés aristocratiques renferment toujours dans leur sein, au milieu d’une multitude d’individus qui ne peuvent rien par eux-mêmes, un petit nombre de citoyens très-puissants et [III-216] très-riches ; chacun de ceux-ci peut exécuter à lui seul de grandes entreprises.
Dans les sociétés aristocratiques, les hommes n’ont pas besoin de s’unir pour agir, parce qu’ils sont retenus fortement ensemble.
Chaque citoyen, riche et puissant, y forme comme la tête d’une association permanente et forcée qui est composée de tous ceux qu’il tient dans sa dépendance et qu’il fait concourir à l’exécution de ses desseins.
Chez les peuples démocratiques, au contraire, tous les citoyens sont indépendants et faibles ; ils ne peuvent presque rien par eux-mêmes, et aucun d’entre eux ne saurait obliger ses semblables à lui prêter leur concours. Ils tombent donc tous dans l’impuissance s’ils n’apprennent à s’aider librement.
Si les hommes qui vivent dans les pays démocratiques n’avaient ni le droit, ni le goût de s’unir dans des buts politiques, leur indépendance courrait de grands hasards, mais ils pourraient conserver longtemps leurs richesses et leurs lumières ; tandis que s’ils n’acquéraient point l’usage de s’associer dans la vie ordinaire, la civilisation elle-même serait en péril. Un peuple chez lequel les particuliers perdraient le pouvoir de faire isolément de grandes choses sans acquérir la faculté de les produire en commun retournerait bientôt vers la barbarie.
Malheureusement le même état social qui rend [III-217] les associations si nécessaires aux peuples démocratiques les leur rend plus difficiles qu’à tous les autres.
Lorsque plusieurs membres d’une aristocratie veulent s’associer ils réussissent aisément à le faire. Comme chacun d’eux apporte une grande force dans la société, le nombre des sociétaires peut être fort petit, et, lorsque les sociétaires sont en petit nombre, il leur est très-facile de se connaître, de se comprendre et d’établir des règles fixes.
La même facilité ne se rencontre pas chez les nations démocratiques, où il faut toujours que les associés soient très-nombreux pour que l’association ait quelque puissance.
Je sais qu’il y a beaucoup de mes contemporains que ceci n’embarrasse point. Ils prétendent qu’à mesure que les citoyens deviennent plus faibles et plus incapables, il faut rendre le gouvernement plus habile et plus actif, afin que la société puisse exécuter ce que les individus ne peuvent plus faire. Ils croient avoir répondu à tout en disant cela. Mais je pense qu’ils se trompent.
Un gouvernement pourrait tenir lieu de quelques unes des plus grandes associations américaines, et, dans le sein de l’Union, plusieurs États particuliers l’ont déjà tenté. Mais quel pouvoir [III-218] politique serait jamais en état de suffire à la multitude innombrable de petites entreprises que les citoyens américains exécutent tous les jours à l’aide de l’association ?
Il est facile de prévoir que le temps approche ou l’homme sera de moins en moins en état de produire par lui seul les choses les plus communes et les plus nécessaires à sa vie. La tâche du pouvoir social s’accroîtra donc sans cesse, et ses efforts mêmes la rendront chaque jour plus vaste. Plus il se mettra à la place des associations, et plus les particuliers, perdant l’idée de s’associer, auront besoin qu’il vienne à leur aide : ce sont des causes et des effets qui s’engendrent sans repos. L’administration publique finira-t-elle par diriger toutes les industries auxquelles un citoyen isolé ne peut suffire ? et s’il arrive enfin un moment où, par une conséquence de l’extrême division de la propriété foncière, la terre se trouve partagée à l’infini, de sorte qu’elle ne puisse plus être cultivée que par des associations de laboureurs, faudra-t-il que le chef du gouvernement quitte le timon de l’État pour venir tenir la charrue ?
La morale et l’intelligence d’un peuple démocratique ne courraient pas de moindres dangers que son négoce et son industrie, si le gouvernement venait y prendre partout la place des associations.
[III-219]
Les sentiments et les idées ne se renouvellent, le cœur ne s’agrandit et l’esprit humain ne se développe que par l’action réciproque des hommes les uns sur les autres.
J’ai fait voir que cette action est presque nulle dans les pays démocratiques. Il faut donc l’y créer artificiellement. Et c’est ce que les associations seules peuvent faire.
Quand les membres d’une aristocratie adoptent une idée neuve, ou conçoivent un sentiment nouveau, ils les placent, en quelque sorte, à côté d’eux sur le grand théâtre où ils sont eux-mêmes, et, les exposant ainsi aux regards de la foule, ils les introduisent aisément dans l’esprit ou le cœur de tous ceux qui les environnent.
Dans les pays démocratiques il n’y a que le pouvoir social qui soit naturellement en état d’agir ainsi, mais il est facile de voir que son action est toujours insuffisante et souvent dangereuse.
Un gouvernement ne saurait pas plus suffire à entretenir seul et à renouveler la circulation des sentiments et des idées chez un grand peuple, qu’à y conduire toutes les entreprises industrielles. Dès qu’il essayera de sortit de la sphère politique pour se jeter dans cette nouvelle voie, il exercera, même sans le vouloir, une tyrannie insupportable ; car un gouvernement ne sait que dicter des règles précises ; il impose les sentiments et [III-220] les idées qu’il favorise, et il est toujours malaisé de discerner ses conseils de ses ordres.
Ce sera bien pis encore s’il se croit réellement intéressé à ce que rien ne remue. Il se tiendra alors immobile et se laissera appesantir par un sommeil volontaire.
Il est donc nécessaire qu’il n’agisse pas seul.
Ce sont les associations qui, chez les peuples démocratiques, doivent tenir lieu des particuliers puissants que l’égalité des conditions a fait disparaître.
Sitôt que plusieurs des habitants des États-Unis ont conçu un sentiment ou une idée qu’ils veulent produire dans le monde, ils se cherchent, et, quand ils se sont trouvés, ils s’unissent. Dès lors ce ne sont plus des hommes isolés, mais une puissance qu’on voit de loin, et dont les actions servent d’exemple ; qui parle, et qu’on écoute.
La première fois que j’ai entendu dire aux États-Unis que cent mille hommes s’étaient engagés publiquement à ne pas faire usage de liqueurs fortes, la chose m’a paru plus plaisante que sérieuse, et je n’ai pas bien vu d’abord pourquoi ces citoyens si tempérants ne se contentaient point de boire de l’eau dans l’intérieur de leur famille.
J’ai fini par comprendre que ces cent mille Américains, effrayés des progrès que faisait autour d’eux l’ivrognerie, avaient voulu accorder à la [III-221] sobriété leur patronage. Ils avaient agi précisément comme un grand seigneur qui se vêtirait très-uniment afin d’inspirer aux simples citoyens le mépris du luxe. Il est à croire que si ces cent mille hommes eussent vécu en France, chacun d’eux se serait adressé individuellement au gouvernement, pour le prier de surveiller les cabarets sur toute la surface du royaume.
Il n’y a rien, suivant moi, qui mérite plus d’attirer nos regards que les associations intellectuelles et morales de l’Amérique. Les associations politiques et industrielles des Américains tombent aisément sous nos sens ; mais les autres nous échappent ; et, si nous les découvrons, nous les comprenons mal, parce que nous n’avons presque jamais rien vu d’analogue. On doit reconnaître cependant qu’elles sont aussi nécessaires que les premières au peuple américain, et peut-être plus.
Dans les pays démocratiques, la science de l’association est la science mère ; le progrès de toutes les autres dépend des progrès de celle-là.
Parmi les lois qui régissent les sociétés humaines, il y en a une qui semble plus précise et plus claire que toutes les autres. Pour que les hommes restent civilisééveloppe et se perfectionne dans le mêégalité des conditions s’accroît.
[III-223]
CHAPITRE VI.↩
Du rapport des associations et des journaux.
Lorsque les hommes ne sont plus liés entre eux d’une manière solide et permanente on ne saurait obtenir d’un grand nombre d’agir en commun, à moins de persuader à chacun de ceux dont le concours est nécessaire que son intérêt particulier l’oblige à unir volontairement ses efforts aux efforts de tous les autres.
Cela ne peut se faire habituellement et commodément qu’à l’aide d’un journal ; il n’y a qu’un journal qui puisse venir déposer au même moment dans mille esprits la même pensée.
[III-224]
Un journal est un conseiller qu’on n’a pas besoin d’aller chercher, mais qui se présente de lui-même et qui vous parle tous les jours et brièvement de l’affaire commune, sans vous déranger de vos affaires particulières.
Les journaux deviennent donc plus nécessaires à mesure que les hommes sont plus égaux et l’individualisme plus à craindre. Ce serait diminuer leur importance que de croire qu’ils ne servent qu’à garantir la liberté ; ils maintiennent la civilisation.
Je ne nierai point que, dans les pays démocratiques, les journaux ne portent souvent les citoyens à faire en commun des entreprises fort inconsidérées ; mais, s’il n’y avait pas de journaux, il n’y aurait presque pas d’action commune. Le mal qu’ils produisent est donc bien moindre que celui qu’ils guérissent.
Un journal n’a pas seulement pour effet de suggérer à un grand nombre d’hommes un même dessein ; il leur fournit les moyens d’exécuter en commun les desseins qu’ils auraient conçus d’eux-mêmes.
Les principaux citoyens qui habitent un pays aristocratique s’aperçoivent de loin ; et s’ils veulent réunir leurs forces, ils marchent les uns vers les autres, entraînant une multitude à leur suite.
Il arrive souvent, au contraire, dans les pays [III-225] démocratiques, qu’un grand nombre d’hommes qui ont le désir ou le besoin de s’associer ne peuvent le faire, parce qu’étant tous fort petits et perdus dans la foule, ils ne se voient point et ne savent où se trouver. Survient un journal qui expose aux regards le sentiment ou l’idée qui s’était présentée simultanément, mais séparément, à chacun d’entre eux. Tous se dirigent aussitôt vers cette lumière, et ces esprits errants, qui se cherchaient depuis longtemps dans les ténèbres, se rencontrent enfin et s’unissent.
Le journal les a rapprochés, et il continue à leur être nécessaire pour les tenir ensemble.
Pour que chez un peuple démocratique une association ait quelque puissance, il faut qu’elle soit nombreuse. Ceux qui la composent sont donc disséminés sur un grand espace, et chacun d’entre eux est retenu dans le lieu qu’il habite par la médiocrité de sa fortune et par la multitude des petits soins qu’elle exige. Il leur faut trouver un moyen de se parler tous les jours sans se voir, et de marcher d’accord sans s’être réunis. Ainsi il n’y a guère d’association démocratique qui puisse se passer d’un journal.
Il existe donc un rapport nécessaire entre les associations et les journaux : les journaux font les associations, et les associations font les journaux ; et, s’il a été vrai de dire que les associations [III-226] doivent se multiplier à mesure que les conditions s’égalisent, il n’est pas moins certain que le nombre des journaux s’accroît à mesure que les associations se multiplient.
Aussi l’Amérique est-elle le pays du monde où l’on rencontre à la fois le plus d’associations et le plus de journaux.
Cette relation entre le nombre des journaux et celui des associations nous conduit à en découvrir une autre entre l’état de la presse périodique et la forme de l’administration du pays, et nous apprend que le nombre des journaux doit diminuer ou croître chez un peuple démocratique, à proportion que la centralisation administrative est plus ou moins grande. Car, chez les peuples démocratiques, on ne saurait confier l’exercice des pouvoirs locaux aux principaux citoyens comme dans les aristocraties. Il faut abolir ces pouvoirs ou en remettre l’usage à un très grand nombre d’hommes. Ceux-là forment une véritable association établie d’une manière permanente par la loi pour l’administration d’une portion du territoire, et ils ont besoin qu’un journal vienne les trouver chaque jour au milieu de leurs petites affaires, et leur apprenne en quel état se trouve l’affaire publique. Plus les pouvoirs locaux sont nombreux, plus le nombre de ceux que la loi appelle à les exercer est grand, et plus, cette [III-227] nécessité se faisant sentir à tout moment, les journaux pullulent.
C’est le fractionnement extraordinaire du pouvoir administratif, bien plus encore que la grande liberté politique et l’indépendance absolue de la presse, qui multiplie si singulièrement le nombre des journaux en Amérique. Si tous les habitants de l’Union étaient électeurs, sous l’empire d’un système qui bornerait leur droit électoral au choix des législateurs de l’État, ils n’auraient besoin que d’un petit nombre de journaux, parce qu’ils n’auraient que quelques occasions très-importantes, mais très-rares, d’agir ensemble ; mais, au dedans de la grande association nationale, la loi a établi dans chaque province, dans chaque cité, et pour ainsi dire dans chaque village, de petites associations ayant pour objet l’administration locale. Le législateur a forcé de cette manière chaque Américain de concourir journellement avec quelques uns de ses concitoyens à une œuvre commune, et il faut à chacun d’eux un journal pour lui apprendre ce que font tous les autres.
Je pense qu’un peuple démocratique [3] qui [III-228] n’aurait point de représentation nationale, mais un grand nombre de petits pouvoirs locaux, finirait par posséder plus de journaux qu’un autre chez lequel une administration centralisée existerait à côté d’une législature élective. Ce qui m’explique le mieux le développement prodigieux qu’a pris aux États-Unis la presse quotidienne, c’est que je vois chez les Américains la plus grande liberté nationale s’y combiner avec des libertés locales de toutes espèces.
On croit généralement en France et en Angleterre qu’il suffit d’abolir les impôts qui pèsent sur la presse, pour augmenter indéfiniment les journaux. C’est exagérer beaucoup les effets d’une semblable réforme. Les journaux ne se multiplient pas seulement suivant le bon marché, mais suivant le besoin plus ou moins répété qu’un grand nombre d’hommes ont de communiquer ensemble et d’agir en commun.
J’attribuerais également la puissance croissante des journaux à des raisons plus générales que celles dont on se sert souvent pour l’expliquer.
Un journal ne peut subsister qu’à la condition de reproduire une doctrine ou un sentiment commun à un grand nombre d’hommes. Un journal représente donc toujours une association dont ses lecteurs habituels sont les membres.
Cette association peut être plus ou moins [III-229] définie, plus ou moins étroite, plus ou moins nombreuse ; mais elle existe au moins en germe dans les esprits, par cela seul que le journal ne meurt pas.
Ceci nous mène à une dernière réflexion qui terminera ce chapitre.
Plus les conditions deviennent égales, moins les hommes sont individuellement forts, plus ils se laissent aisément aller au courant de la foule, et ont de peine à se tenir seuls dans une opinion qu’elle abandonne.
Le journal représente l’association ; l’on peut dire qu’il parle à chacun de ses lecteurs au nom de tous les autres, et il les entraîne d’autant plus aisément qu’ils sont individuellement plus faibles.
L’empire des journaux doit donc croître à mesure que les hommes s’égalisent.
[III-231]
CHAPITRE VII.↩
Rapports des associations civiles et des associations politiques.
Il n’y a qu’une nation sur la terre où l’on use chaque jour de la liberté illimitée de s’associer dans des vues politiques. Cette même nation est la seule dans le monde dont les citoyens aient imaginé de faire un continuel usage du droit d’association dans la vie civile, et soient parvenus à se procurer de cette manière tous les biens que la civilisation peut offrir.
Chez tous les peuples où J’association politique est interdite l’association civile est rare.
Il n’est guère probable que ceci soit le résultat [III-232] d’un accident ; mais on doit plutôt en conclure qu’il existe un rapport naturel et peut-être nécessaire entre ces deux genres d’associations.
Des hommes ont par hasard un intérêt commun dans une certaine affaire. Il s’agit d’une entreprise commerciale à diriger, d’une opération industrielle à conclure ; ils se rencontrent et s’unissent ; ils se familiarisent peu à peu de cette manière avec l’association.
Plus le nombre de ces petites affaires communes augmente, et plus les hommes acquièrent, à leur insu même, la faculté de poursuivre en commun les grandes.
Les associations civiles facilitent donc les associations politiques ; mais, d’une autre part, l’association politique développe et perfectionne singulièrement l’association civile.
Dans la vie civile, chaque homme peut, à la rigueur, se figurer qu’il est en état de se suffire. En politique, il ne saurait jamais l’imaginer. Quand un peuple a une vie publique, l’idée de l’association et l’envie de s’associer se présentent donc chaque jour à l’esprit de tous les citoyens : quelque répugnance naturelle que les hommes aient à agir en commun, ils seront toujours prêts à le faire dans l’intérêt d’un parti.
Ainsi la politique généralise le goût et [III-233] l’habitude de l’association ; elle fait désirer de s’unir et apprend l’art de le faire à une foule d’hommes qui auraient toujours vécu seuls.
La politique ne fait pas seulement naître beaucoup d’associations, elle crée des associations très-vastes.
Dans la vie civile il est rare qu’un même intérêt attire naturellement vers une action commune un grand nombre d’hommes. Ce n’est qu’avec beaucoup d’art qu’on parvient à en créer un semblable.
En politique, l’occasion s’en offre à tous moments d’elle-même. Or, ce n’est que dans de grandes associations que la valeur générale de l’association se manifeste. Des citoyens individuellement faibles ne se font pas d’avance une idée claire de la force qu’ils peuvent acquérir en s’unissant ; il faut qu’on le leur montre pour qu’ils le comprennent. De là vient qu’il est souvent plus facile de rassembler dans un but commun une multitude que quelques hommes ; mille citoyens ne voient point l’intérêt qu’ils ont à s’unir ; dix mille l’aperçoivent. En politique, les hommes s’unissent pour de grandes entreprises, et le parti qu’ils tirent de l’association dans les affaires importantes leur enseigne, d’une manière pratique, l’intérêt qu’ils ont à s’en aider dans les moindres.
Une association politique tire à la fois une [III-234] multitude d’individus hors d’eux-mêmes ; quelque séparés qu’ils soient naturellement par l’âge, l’esprit, la fortune, elle les rapproche et les met en contact. Ils se rencontrent une fois et apprennent à se retrouver toujours.
L’on ne peut s’engager dans la plupart des associations civiles qu’en exposant une portion de son patrimoine ; il en est ainsi pour toutes les compagnies industrielles et commerciales. Quand les hommes sont encore peu versés dans l’art de s’associer et qu’ils en ignorent les principales règles, ils redoutent, en s’associant pour la première fois de cette manière, de payer cher leur expérience. Ils aiment donc mieux se priver d’un moyen puissant de succès, que de courir les dangers qui l’accompagnent. Mais ils hésitent moins à prendre part aux associations politiques qui leur paraissent sans péril, parce qu’ils n’y risquent pas leur argent. Or, ils ne sauraient faire longtemps partie de ces associations-là sans découvrir comment on maintient l’ordre parmi un grand nombre d’hommes, et par quel procédé on parvient à les faire marcher, d’accord et méthodiquement, vers le même but. Ils y apprennent à soumettre leur volonté à celle de tous les autres, et à subordonner leurs efforts particuliers à l’action commune, toutes choses qu’il n’est pas moins nécessaire de savoir dans les [III-235] associations civiles que dans les associations politiques.
Les associations politiques peuvent donc être considérées comme de grandes écoles gratuites, où tous les citoyens viennent apprendre la théorie générale des associations.
Alors même que l’association politique ne servirait pas directement au progrès de l’association civile, ce serait encore nuire à celle-ci que de détruire la première.
Quand les citoyens ne peuvent s’associer que dans certains cas, ils regardent l’association comme un procédé rare et singulier, et ils ne s’avisent guère d’y songer.
Lorsqu’on les laisse s’associer librement en toutes choses, ils finissent par voir, dans l’association, le moyen universel, et pour ainsi dire unique, dont les hommes peuvent se servir pour atteindre les diverses fins qu’ils se proposent. Chaque besoin nouveau en réveille aussitôt l’idée. L’art de l’association devient alors, comme je l’ai dit plus haut, la science mère ; tous l’étudient et l’appliquent.
Quand certaines associations sont défendues et d’autres permises, il est difficile de distinguer d’avance les premières des secondes. Dans le doute on s’abstient de toutes, et il s’établit une sorte d’opinion publique qui tend à faire considérer une [III-236] association quelconque comme une entreprise hardie et presque illicite [4] .
C’est donc une chimère que de croire que l’esprit d’association, comprimé sur un point, ne laissera pas de se développer avec la même vigueur sur tous les autres, et qu’il suffira de permettre aux hommes d’exécuter en commun certaines entreprises, pour qu’ils se hâtent de le tenter. Lorsque les citoyens auront la faculté et l’habitude de s’associer pour toutes choses, ils s’associeront aussi volontiers pour les petites que pour les grandes. Mais s’ils ne peuvent s’associer que pour les petites, ils ne trouveront pas même [III-237] l’envie et la capacité de le faire. En vain leur laisserez-vous l’entière liberté de s’occuper en commun de leur négoce : ils n’useront que nonchalamment des droits qu’on leur accorde ; et, après vous être épuisés en efforts pour les écarter des associations défendues, vous serez surpris de ne pouvoir leur persuader de former les associations permises.
Je ne dis point qu’il ne puisse pas y avoir d’associations civiles dans un pays où l’association politique est interdite ; car les hommes ne sauraient jamais vivre en société sans se livrer à quelque entreprise commune. Mais je soutiens que, dans un semblable pays, les associations civiles seront toujours en très-petit nombre, faiblement conçues, inhabilement conduites, et qu’elles n’embrasseront jamais de vastes desseins, ou échoueront en voulant les exécuter.
Ceci nie conduit naturellement à penser que la liberté d’association en matière politique n’est point aussi dangereuse pour la tranquillité publique qu’on le suppose, et qu’il pourrait se faire qu’après avoir quelque temps ébranlé l’État, elle l’affermisse.
Dans les pays démocratiques, les associations politiques forment pour ainsi dire les seuls particuliers puissants qui aspirent à régler l’État. Aussi les gouvernements de nos jours [III-238] considèrent-ils ces espèces d’associations du même œil que les rois du moyen-âge regardaient les grands vassaux de la couronne : ils sentent une sorte d’horreur instinctive pour elles, et les combattent en toutes rencontres.
Ils ont, au contraire, une bienveillance naturelle pour les associations civiles, parce qu’ils ont aisément découvert que celles-ci, au lieu de diriger l’esprit des citoyens vers les affaires publiques, servent à l’en distraire, et, les engageant de plus en plus dans des projets qui ne peuvent s’accomplir sans la paix publique, les détournent des révolutions. Mais ils ne prennent point garde que les associations politiques multiplient et facilitent prodigieusement les associations civiles, et qu’en évitant un mal dangereux ils se privent d’un remède efficace. Lorsque vous voyez les Américains s’associer librement, chaque jour, dans le but de faire prévaloir une opinion politique, d’élever un homme d’État au gouvernement, ou d’arracher la puissance à un autre, vous avez de la peine à comprendre que des hommes si indépendants ne tombent pas à tous moments dans la licence.
Si vous venez, d’autre part, à considérer le nombre infini d’entreprises industrielles qui se poursuivent en commun aux États-Unis, et que vous aperceviez de tous côtés les Américains [III-239] travaillant sans relâche à l’exécution de quelque dessein important et difficile, que la moindre révolution pourrait confondre, vous concevez aisément pourquoi ces gens si bien occupés ne sont point tentés de troubler l’État ni de détruire un repos public dont ils profitent.
Est-ce assez d’apercevoir ces choses séparément, et ne faut-il pas découvrir le nœud caché qui les lie ? C’est au sein des associations politiques que les Américains de tous les états, de tous les esprits et de tous les âges, prennent chaque jour le goût général de l’association, et se familiarisent à son emploi. Là, ils se voient en grand nombre, se parlent, s’entendent et s’animent en commun à toutes sortes d’entreprises. Ils transportent ensuite dans la vie civile les notions qu’ils ont ainsi acquises, et les font servir à mille usages.
C’est donc en jouissant d’une liberté dangereuse que les Américains apprennent l’art de rendre les périls de la liberté moins grands.
Si l’on choisit un certain moment dans l’existence d’une nation, il est facile de prouver que les associations politiques troublent l’État et paralysent l’industrie ; mais qu’on prenne la vie toute entière d’un peuple, et il sera peut-être aisé de démontrer que la liberté d’association en matière [III-240] politique est favorable au bien-être et même à la tranquillité des citoyens.
J’ai dit dans la première partie de cet ouvrage : « La liberté illimitée d’association ne saurait être confondue avec la liberté d’écrire : l’une est tout à la fois moins nécessaire et plus dangereuse que l’autre. Une nation peut y mettre des bornes sans cesser être maîtresse d’elle-même ; elle doit quelquefois le faire pour continuer à l’être. » Et plus loin j’ajoutais : « On ne peut se dissimuler que la liberté illimitée d’association en matière politique ne soit, de toutes les libertés, la dernière qu’un peuple puisse supporter. Si elle ne le fait pas tomber dans l’anarchie, elle la lui fait pour ainsi dire toucher à chaque instant. »
Ainsi, je ne crois point qu’une nation soit toujours maîtresse de laisser aux citoyens le droit absolu de s’associer en matière politique, et je doute même que, dans aucun pays et à aucune époque, il fût sage de ne pas poser de bornes à la liberté d’association.
Tel peuple ne saurait, dit-on, maintenir la paix dans son sein, inspirer le respect des lois, ni fonder de gouvernement durable, s’il ne renferme le droit d’association dans d’étroites limites. De pareils biens sont précieux sans doute, et je conçois que, pour les acquérir ou les conserver, [III-241] une nation consente à s’imposer momentanément de grandes gênes ; mais encore est-il bon qu’elle sache précisément ce que ces biens lui coûtent.
Que, pour sauver la vie d’un homme, on lui coupe un bras, je le comprends ; mais je ne veux point qu’on m’assure qu’il va se montrer aussi adroit que s’il n’était pas manchot.
[III-243]
CHAPITRE VIII.↩
Comment les américains combattent l’individualisme par la doctrine de l’intérêt bien entendu.
Lorsque le monde était conduit par un petit nombre d’individus puissants et riches, ceux-ci aimaient à se former une idée sublime des devoirs de l’homme ; ils se plaisaient à professer qu’il est glorieux de s’oublier soi-même et qu’il convient de faire le bien sans intérêt, comme Dieu même. C’était la doctrine officielle de ce temps en matière de morale.
Je doute que les hommes fussent plus vertueux dans les siècles aristocratiques que dans les autres, mais il est certain qu’on y parlait sans cesse des [III-244] beautés de la vertu ; ils n’étudiaient qu’en secret par quel côté elle est utile ; mais, à mesure que l’imagination prend un vol moins haut, et que chacun se concentre en soi-même, les moralistes s’effrayent à cette idée de sacrifice, et ils n’osent plus l’offrir à l’esprit humain ; ils se réduisent donc à rechercher si l’avantage individuel des citoyens ne serait pas de travailler au bonheur de tous, et, lorsqu’ils ont découvert un de ces points où l’intérêt particulier vient à se rencontrer avec l’intérêt général, et à s’y confondre, ils se hâtent de le mettre en lumière ; peu à peu les observations semblables se multiplient. Ce qui n’était qu’une remarque isolée devient une doctrine générale, et l’on croit enfin apercevoir que l’homme en servant ses semblables se sert lui-même, et que son intérêt particulier est de bien faire.
J’ai déjà montré, dans plusieurs endroits de cet ouvrage, comment les habitants des États-Unis savaient presque toujours combiner leur propre bien-être avec celui de leurs concitoyens. Ce que je veux remarquer ici, c’est la théorie générale à l’aide de laquelle ils y parviennent.
Aux États-Unis, on ne dit presque point que la vertu est belle. On soutient qu’elle est utile, et on le prouve tous les jours. Les moralistes américains ne prétendent pas qu’il faille se sacrifier à ses semblables, parce qu’il est grand de le faire ; mais [III-245] ils disent hardiment que de pareils sacrifices sont aussi nécessaires à celui qui se les impose qu’à celui qui en profite.
Ils ont aperçu que, dans leur pays et de leur temps, l’homme était ramené vers lui-même par une force irrésistible et, perdant l’espoir de l’arrêter, ils n’ont plus songé qu’à le conduire.
Ils ne nient donc point que chaque homme ne puisse suivre son intérêt, mais ils s’évertuent à prouver que l’intérêt de chacun est d’être honnête.
Je ne veux point entrer ici dans le détail de leurs raisons, ce qui m’écarterait de mon sujet ; qu’il me suffise de dire qu’elles ont convaincu leurs concitoyens.
Il y a longtemps que Montaigne a dit : « Quand, pour sa droicture, je ne suyvray pas le droict chemin, je le suyvray pour avoir trouvé par expérience, qu’au bout du compte c’est communément le plus heureux et le plus utile. »
La doctrine de l’intérêt bien entendu n’est donc pas nouvelle, mais chez les Américains de nos jours elle a été universellement admise ; elle y est devenue populaire : on la retrouve au fond de toutes les actions ; elle perce à travers tous les discours. On ne la rencontre pas moins dans la bouche du pauvre que dans celle du riche.
En Europe, la doctrine de l’intérêt est beaucoup plus grossière qu’en Amérique, mais en même [III-246] temps elle y est moins répandue et surtout moins montrée, et l’on feint encore tous les jours parmi nous de grands dévouements qu’on n’a plus.
Les Américains, au contraire, se plaisent à expliquer, à l’aide de l’intérêt bien entendu, presque tous les actes de leur vie ; ils montrent complaisamment comment l’amour éclairé d’eux-mêmes les porte sans cesse à s’aider entre eux et les dispose à sacrifier volontiers au bien de l’État une partie de leur temps et de leurs richesses. Je pense qu’en ceci il leur arrive souvent de ne point se rendre justice ; car, on voit parfois aux États Unis, comme ailleurs, les citoyens s’abandonner aux élans désintéressés et irréfléchis qui sont naturels à l’homme ; mais les Américains n’avouent guère qu’ils cèdent à des mouvements de cette espèce ; ils aiment mieux faire honneur à leur philosophie qu’à eux-mêmes.
Je pourrais m’arrêter ici et ne point essayer de juger ce que je viens de décrire. L’extrême difficulté du sujet serait mon excuse. Mais je ne veux point en profiter, et je préfère que mes lecteurs, voyant clairement mon but, refusent de me suivre que de les laisser en suspens.
L’intérêt bien entendu est une doctrine peu haute, mais claire et sûre. Elle ne cherche pas à atteindre de grands objets ; mais elle atteint sans trop d’efforts, tous ceux auxquels elle vise. Comme [III-247] elle est à la portée de toutes les intelligences, chacun la saisit aisément et la retient sans peine. S’accommodant merveilleusement aux faiblesses des hommes, elle obtient facilement un grand empire, et il ne lui est point difficile de le conserver, parce qu’elle retourne l’intérêt personnel contre lui-même et se sert, pour diriger les passions, de l’aiguillon qui les excite.
La doctrine de l’intérêt bien entendu ne produit pas de grands dévouements ; mais elle suggère chaque jour de petits sacrifices ; à elle seule, elle ne saurait faire un homme vertueux ; mais elle forme une multitude de citoyens, réglés, tempérants, modérés, prévoyants, maîtres d’eux-mêmes ; et, si elle ne conduit pas directement à la vertu, par la volonté, elle en rapproche insensiblement par les habitudes.
Si la doctrine de l’intérêt bien entendu venait à dominer entièrement le monde moral, les vertus extraordinaires seraient sans doute plus rares. Mais je pense aussi qu’alors les grossières dépravations seraient moins communes. La doctrine de l’intérêt bien entendu empêche peut-être quelques hommes de monter fort au-dessus du niveau ordinaire de l’humanité ; mais un grand nombre d’autres qui tombaient au-dessous la rencontrent et s’y retiennent. Considérez quelques individus, elle les abaisse. Envisagez l’espèce, elle l’élève.
[III-248]
Je ne craindrai pas de dire que la doctrine de l’intérêt bien entendu me semble, de toutes les théories philosophiques, la mieux appropriée aux besoins des hommes de notre temps, et que j’y vois la plus puissante garantie qui leur reste contre eux-mêmes. C’est donc principalement vers elle que l’esprit des moralistes de nos jours doit se tourner. Alors même qu’ils la jugeraient imparfaite, il faudrait encore l’adopter comme nécessaire.
Je ne crois pas, à tout prendre, qu’il y ait plus d’égoïsme parmi nous qu’en Amérique ; la seule différence, c’est que là il est éclairé et qu’ici il ne l’est point. Chaque Américain sait sacrifier une partie de ses intérêts particuliers pour sauver le reste. Nous voulons tout retenir, et souvent tout nous échappe.
Je ne vois autour de moi que des gens qui semblent vouloir enseigner chaque jour à leurs contemporains, par leur parole et leur exemple, que l’utile n’est jamais déshonnête. N’en découvrirai-je donc point enfin qui entreprennent de leur faire comprendre comment l’honnête peut être utile ?
Il n’y a pas de pouvoir sur la terre qui puisse empêcher que l’égalité croissante des conditions ne porte l’esprit humain vers la recherche de l’utile, et ne dispose chaque citoyen a se resserrer en lui-même.
[III-249]
Il faut donc s’attendre que l’intérêt individuel deviendra plus que jamais le principal, sinon l’unique mobile des actions des hommes ; mais il reste à savoir comment chaque homme entendra son intérêt individuel.
Si les citoyens, en devenant égaux, restaient ignorants et grossiers, il est difficile de prévoir jusqu’à quel stupide excès pourrait se porter leur égoïsme, et l’on ne saurait dire à l’avance dans quelles honteuses misères ils se plongeraient eux-mêmes, de peur de sacrifier quelque chose de leur bien-être à la prospérité de leurs semblables.
Je ne crois point que la doctrine de l’intérêt, telle qu’on la prêche en Amérique, soit évidente dans toutes ses parties ; mais elle renferme un grand nombre de vérités si évidentes, qu’il suffit d’éclairer les hommes pour qu’ils les voient. Éclairez-les donc à tout prix ; car le siècle des dévouements aveugles et des vertus instinctives fuit déjà loin de nous, et je vois s’approcher le temps où la liberté, la paix publique et l’ordre social lui-même ne pourront se passer des lumières.
[III-251]
CHAPITRE IX.↩
Comment les américains appliquent la doctrine de l’intérêt bien entendu en matière de religion.
Si la doctrine de l’intérêt bien entendu n’avait en vue que ce monde, elle serait loin de suffire ; car il y a un grand nombre de sacrifices qui ne peuvent trouver leur récompense que dans l’autre ; et, quelque effort d’esprit que l’on fasse pour prouver l’utilité de la vertu, il sera toujours malaisé de faire bien vivre un homme qui ne veut pas mourir.
Il est donc nécessaire de savoir si la doctrine de l’intérêt bien entendu peut se concilier aisément avec les croyances religieuses.
[III-252]
Les philosophes qui enseignent cette doctrine disent aux hommes que, pour être heureux dans la vie, on doit veiller sur ses passions et en réprimer avec soin l’excès ; qu’on ne saurait acquérir un bonheur durable qu’en se refusant mille jouissances passagères, et qu’il faut enfin triompher sans cesse de soi-même pour se mieux servir.
Les fondateurs de presque toutes les religions ont tenu à peu près le même langage. Sans indiquer aux hommes une autre route, ils n’ont fait que reculer le but ; au lieu de placer en ce monde le prix des sacrifices qu’ils imposent, ils l’ont mis dans l’autre.
Toutefois, je me refuse à croire que tous ceux qui pratiquent la vertu par esprit de religion n’agissent que dans la vue d’une récompense.
J’ai rencontré des chrétiens zélés qui s’oubliaient sans cesse afin de travailler avec plus d’ardeur au bonheur de tous, et je les ai entendus prétendre qu’ils n’agissaient ainsi que pour mériter les biens de l’autre monde ; mais je ne puis m’empêcher de penser qu’ils s’abusent eux-mêmes. Je les respecte trop pour les croire.
Le christianisme nous dit, il est vrai, qu’il faut préférer les autres à soi, pour gagner le ciel ; mais le christianisme nous dit aussi qu’on doit faire le bien à ses semblables par amour de Dieu. C’est là une expression magnifique ; l’homme [III-253] pénètre par son intelligence dans la pensée divine ; il voit que le but de Dieu est l’ordre ; il s’associe librement à ce grand dessein, et, tout en sacrifiant ses intérêts particuliers à cet ordre admirable de toutes choses, il n’attend d’autres récompenses que le plaisir de le contempler.
Je ne crois donc pas que le seul mobile des hommes religieux soit l’intérêt ; mais je pense que l’intérêt est le principal moyen dont les religions elles-mêmes se servent pour conduire les hommes, et je ne doute pas que ce ne soit par ce côté qu’elles saisissent la foule et deviennent populaires.
Je ne vois donc pas clairement pourquoi la doctrine de l’intérêt bien entendu écarterait les hommes des croyances religieuses, et il me semble, au contraire, que je démêle comment elle les en rapproche.
Je suppose que, pour atteindre le bonheur de ce monde, un homme résiste en toutes rencontres à l’instinct, et raisonne froidement tous les actes de sa vie, qu’au lieu de céder aveuglément à la fougue de ses premiers désirs, il ait appris l’art de les combattre, et qu’il se soit habitué à sacrifier sans efforts le plaisir du moment à l’intérêt permanent de toute sa vie.
Si un pareil homme a foi dans la religion qu’il professe, il ne lui en coûtera guère de se soumettre aux gênes qu’elle impose. La raison même lui [III-254] conseille de le faire, et la coutume l’a préparé d’avance à le souffrir.
Que s’il a conçu des doutes sur l’objet de ses espérances, il ne s’y laissera point aisément arrêter, et il jugera qu’il est sage de hasarder quelques uns des biens de ce monde pour conserver ses droits à l’immense héritage qu’on lui promet dans l’autre.
« De se tromper en croyant la religion chrétienne vraie, a dit Pascal, il n’y a pas grand’chose à perdre ; mais quel malheur de se tromper en la croyant fausse ! »
Les Américains n’affectent point une indifférence grossière pour l’autre vie ; ils ne mettent pas un puéril orgueil à mépriser des périls auxquels ils espèrent se soustraire.
Ils pratiquent donc leur religion sans honte et sans faiblesse ; mais on voit d’ordinaire, jusqu’au milieu de leur zèle, je ne sais quoi de si tranquille de si méthodique et de si calculé, qu’il semble que ce soit la raison bien plus que le cœur qui les conduit au pied des autels.
Non seulement les Américains suivent leur religion par intérêt, mais ils placent souvent dans ce monde l’intérêt qu’on peut avoir à la suivre. Au moyen âge, les prêtres ne parlaient que de l’autre vie ; ils ne s’inquiétaient guère de prouver qu’un chrétien sincère peut être un homme heureux ici-bas. [III-255]
Mais les prédicateurs américains reviennent sans cesse à la terre, et ils ne peuvent qu’à grand peine en détacher leurs regards. Pour mieux toucher leurs auditeurs, ils leur font voir chaque jour comment les croyances religieuses favorisent la liberté et l’ordre public, et il est souvent difficile de savoir, en les écoutant, si l’objet principal de la religion est de procurer l’éternelle félicité dans l’autre monde ou le bien-être en celui-ci.
[III-257]
CHAPITRE X.↩
Du goût du bien-être matériel en Amérique.
En Amérique, la passion du bien-être matériel n’est pas toujours exclusive, mais elle est générale ; si tous ne l’éprouvent point de la même manière, tous la ressentent. Le soin de satisfaire les moindres besoins du corps et de pourvoir aux petites commodités de la vie y préoccupe universellement les esprits.
Quelque chose de semblable se fait voir de plus en plus en Europe.
Parmi les causes qui produisent ces effets pareils dans les deux mondes, il en est plusieurs qui [III-258] se rapprochent de mon sujet, et que je dois indiquer.
Quand les richesses sont fixées héréditairement dans les mêmes familles, on voit un grand nombre d’hommes qui jouissent du bien-être matériel, sans ressentir le goût exclusif du bien-être.
Ce qui attache le plus vivement le cœur humain, ce n’est point la possession paisible d’un objet précieux, mais le désir imparfaitement satisfait de le posséder et la crainte incessante de le perdre.
Dans les sociétés aristocratiques, les riches, n’ayant jamais connu un état différent du leur, ne redoutent point d’en changer ; à peine s’ils en imaginent un autre. Le bien-être matériel n’est donc point pour eux le but de la vie ; c’est une manière de vivre. Ils le considèrent, en quelque sorte, comme l’existence, et en jouissent sans y songer.
Le goût naturel et instinctif que tous les hommes ressentent pour le bien-être, étant ainsi satisfait sans peine et sans crainte, leur âme se porte ailleurs et s’attache à quelque entreprise plus difficile et plus grande, qui l’anime et l’entraîne.
C’est ainsi qu’au sein même des jouissances matérielles, les membres d’une aristocratie font souvent voir un mépris orgueilleux pour ces mêmes jouissances et trouvent des forces singulières quand il faut enfin s’en priver. Toutes les révolutions, qui ont troublé ou détruit les aristocraties, [III-259] ont montré avec quelle facilité des gens accoutumés au superflu pouvaient se passer du nécessaire, tandis que des hommes qui sont arrivés laborieusement jusqu’à l’aisance, peuvent à peine vivre après l’avoir perdue.
Si, des rangs supérieurs, je passe aux basses classes, je verrai des effets analogues produits par des causes différentes.
Chez les nations où l’aristocratie domine la société et la tient immobile, le peuple finit par s’habituer à la pauvreté comme les riches à leur opulence. Les uns ne se préoccupent point du bien-être matériel parce qu’ils le possèdent sans peine ; l’autre n’y pense point parce qu’il désespère de l’acquérir et qu’il ne le connaît pas assez pour le désirer.
Dans ces sortes de sociétés l’imagination du pauvre est rejetée vers l’autre monde ; les misères de la vie réelle la resserrent ; mais elle leur échappe et va chercher ses jouissances au dehors.
Lorsque, au contraire, les rangs sont confondus et les privilèges détruits, quand les patrimoines se divisent et que la lumière et la liberté se répandent, l’envie d’acquérir le bien-être se présente à l’imagination du pauvre, et la crainte de le perdre à l’esprit du riche. Il s’établit une multitude de fortunes médiocres. Ceux qui les possèdent ont assez de jouissances matérielles pour [III-260] concevoir le goût de ces jouissances, et pas assez pour s’en contenter. Ils ne se les procurent jamais qu’avec effort et ne s’y livrent qu’en tremblant.
Ils s’attachent donc sans cesse à poursuivre ou à retenir ces jouissances si précieuses, si incomplètes et si fugitives.
Je cherche une passion qui soit naturelle à des hommes que l’obscurité de leur origine ou la médiocrité de leur fortune excitent et limitent, et je n’en trouve point de mieux appropriée que le goût du bien-être. La passion du bien-être matériel est essentiellement une passion de classe moyenne ; elle grandit et s’étend avec cette classe ; elle devient prépondérante avec elle. C’est de là qu’elle gagne les rangs supérieurs de la société et descend jusqu’au sein du peuple.
Je n’ai pas rencontré, en Amérique, de si pauvre citoyen qui ne jetât un regard d’espérance et d’envie sur les jouissances des riches, et dont l’imagination ne se saisit à l’avance des biens que le sort s’obstinait à lui refuser.
D’un autre côté, je n’ai jamais aperçu chez les riches des États-Unis ce superbe dédain pour le bien-être matériel qui se montre quelquefois jusque dans le sein des aristocraties les plus opulentes et les plus dissolues.
La plupart de ces riches ont été pauvres ; ils ont senti l’aiguillon du besoin ; ils ont longtemps [III-261] combattu une fortune ennemie, et, maintenant que la victoire est remportée, les passions qui ont accompagné la lutte lui survivent ; ils restent comme enivrés au milieu de ces petites jouissances qu’ils ont poursuivies quarante ans.
Ce n’est pas qu’aux États-Unis, comme ailleurs, il ne se rencontre un assez grand nombre de riches qui, tenant leurs biens par héritage, possèdent sans efforts une opulence qu’ils n’ont point acquise. Mais ceux-ci mêmes ne se montrent pas moins attachés aux jouissances de la vie matérielle. L’amour du bien-être est devenu le goût national et dominant ; le grand courant des passions humaines porte de ce côté, il entraîne tout dans son cours.
[III-263]
CHAPITRE XI.↩
Des effets particuliers que produit l’amour des jouissances matérielles dans les siècles démocratiques.
On pourrait croire, d’après ce qui précède, que l’amour des jouissances matérielles doit entraîner sans cesse les Américains vers le désordre des mœurs, troubler les familles et compromettre enfin le sort de la société même.
Mais il n’en est point ainsi : la passion des jouissances matérielles produit dans le sein des démocraties d’autres effets que chez les peuples aristocratiques.
Il arrive quelquefois que la lassitude des affaires, l’excès des richesses, la ruine des [III-264] croyances, la décadence de l’État, détournent peu à peu vers les seules jouissances matérielles le cœur d’une aristocratie. D’autres fois, la puissance du prince ou la faiblesse du peuple, sans ravir aux nobles leur fortune, les forcent à s’écarter du pouvoir, et, leur fermant la voie aux grandes entreprises, les abandonnent à l’inquiétude de leurs désirs ; ils retombent alors pesamment sur eux-mêmes, et ils cherchent dans les jouissances du corps l’oubli de leur grandeur passée.
Lorsque les membres d’un corps aristocratique se tournent ainsi exclusivement vers l’amour des jouissances matérielles, ils rassemblent d’ordinaire de ce seul côté toute l’énergie que leur a donnée la longue habitude du pouvoir.
À de tels hommes la recherche du bien-être ne suffit pas ; il leur faut une dépravation somptueuse et une corruption éclatante. Ils rendent un culte magnifique à la matière, et ils semblent à l’envi vouloir exceller dans l’art de s’abrutir.
Plus une aristocratie aura été forte, glorieuse et libre, plus alors elle se montrera dépravée, et, quelle qu’ait été la splendeur de ses vertus, j’ose prédire qu’elle sera toujours surpassée par l’éclat de ses vices.
Le goût des jouissances matérielles ne porte point les peuples démocratiques à de pareils excès. L’amour du bien-être s’y montre une passion [III-265] tenace, exclusive, universelle, mais contenue. Il n’est pas question d’y bâtir de vastes palais, d’y vaincre ou d’y tromper la nature, d’épuiser l’univers pour mieux assouvir les passions d’un homme ; il s’agit d’ajouter quelques toises à ses champs, de planter un verger, d’agrandir une demeure, de rendre à chaque instant la vie plus aisée et plus commode, de prévenir la gêne, et de satisfaire les moindres besoins sans efforts et presque sans frais. Ces objets sont petits, mais l’âme s’y attache : elle les considère tous les jours et de fort près ; ils finissent par lui cacher le reste du monde, et ils viennent quelquefois se placer entre elle et Dieu.
Ceci, dira-t-on, ne saurait s’appliquer qu’à ceux d’entre les citoyens dont la fortune est médiocre ; les riches montreront des goûts analogues à ceux qu’ils faisaient voir dans les siècles d’aristocratie. Je le conteste.
En fait de jouissances matérielles, les plus opulents citoyens d’une démocratie ne montreront pas des goûts fort différents de ceux du peuple, soit que, étant sortis du sein du peuple, ils les partagent réellement, soit qu’ils croient devoir s’y soumettre. Dans les sociétés démocratiques, la sensualité du public a pris une certaine allure modérée et tranquille, à laquelle toutes les âmes sont tenues de se conformer. Il y est aussi difficile [III-266] d’échapper à la règle commune par ses vices que par ses vertus.
Les riches qui vivent au milieu des nations démocratiques visent donc à la satisfaction de leurs moindres besoins plutôt qu’à des jouissances extraordinaires ; ils contentent une multitude de petits désirs et ne se livrent à aucune grande passion désordonnée. Ils tombent ainsi dans la mollesse plutôt que dans la débauche.
Ce goût particulier que les hommes des siècles démocratiques conçoivent pour les jouissances matérielles n’est point naturellement opposé à l’ordre ; au contraire, il a souvent besoin de l’ordre pour se satisfaire. Il n’est pas non plus ennemi de la régularité des mœurs ; car les bonnes mœurs sont utiles à la tranquillité publique et favorisent l’industrie. Souvent même il vient à se combiner avec une sorte de moralité religieuse ; on veut être le mieux possible en ce monde, sans renoncer aux chances de l’autre.
Parmi les biens matériels, il en est dont la possession est criminelle ; on a soin de s’en abstenir. Il y en a d’autres dont la religion et la morale permettent l’usage ; à ceux-là on livre sans réserve son cœur, son imagination, sa vie, et l’on perd de vue, en s’efforçant de les saisir, ces biens plus précieux qui font la gloire et la grandeur de l’espèce humaine.
[III-267]
Ce que je reproche à l’égalité, ce n’est pas d’entraîner les hommes à la poursuite des jouissances défendues ; c’est de les absorber entièrement dans la recherche des jouissances permises.
Ainsi, il pourrait bien s’établir dans le monde une sorte de matérialisme honnête qui ne corromprait pas les âmes, mais qui les amollirait et finirait par détendre sans bruit tous leurs ressorts.
[III-269]
CHAPITRE XII.↩
Pourquoi certains Américains font voir un spiritualisme si exalté.
Quoique le désir d’acquérir des biens de ce monde soit la passion dominante des Américains, il y a des moments de relâche où leur âme semble briser tout à coup les liens matériels qui la retiennent, et s’échapper impétueusement vers le ciel.
On rencontre quelquefois dans tous les États de l’Union, mais principalement dans les contrées à moitié peuplées de l’Ouest, des prédicateurs ambulants qui colportent de place en place la parole divine.
Des familles entières, vieillards, femmes et [III-270] enfants, traversent des lieux difficiles et percent des bois déserts, pour venir de très-loin les entendre ; et, quand elles les ont rencontrées, elles oublient plusieurs jours et plusieurs nuits, en les écoutant, le soin des affaires et jusqu’aux plus pressants besoins du corps.
On trouve ça et là, au sein de la société américaine, des âmes toutes remplies d’un spiritualisme exalté et presque farouche, qu’on ne rencontre guère en Europe. Il s’y élève de temps à autre des sectes bizarres qui s’efforcent de s’ouvrir des chemins extraordinaires vers le bonheur éternel. Les folies religieuses y sont fort communes.
Il ne faut pas que ceci nous surprenne.
Ce n’est pas l’homme qui s’est donné à lui-même le goût de l’infini et l’amour de ce qui est immortel. Ces instincts sublimes ne naissent point d’un caprice de sa volonté : ils ont leur fondement immobile dans sa nature ; ils existent en dépit de ses efforts. Il peut les gêner et les déformer, mais non les détruire.
L’âme a des besoins qu’il faut satisfaire ; et, quelque soin que l’on prenne de la distraire d’elle-même, elle s’ennuie bientôt, s’inquiète et s’agite au milieu des jouissances des sens.
Si l’esprit de la grande majorité du genre humain se concentrait jamais dans la seule recherche [III-271] des biens matériels, on peut s’attendre qu’il se ferait une réaction prodigieuse dans l’âme de quelques hommes. Ceux-là se jetteraient éperdument dans le monde des esprits, de peur de rester embarrassés dans les entraves trop étroites que veut leur imposer le corps.
Il ne faudrait donc pas s’étonner si, au sein d’une société qui ne songerait qu’à la terre, on rencontrait un petit nombre d’individus qui voulussent ne regarder que le ciel. Je serais surpris si, chez un peuple uniquement préoccupé de son bien-être, le mysticisme ne faisait pas bientôt des progrès.
On dit que ce sont les persécutions des empereurs et les supplices du cirque qui ont peuplé les déserts de la Thébaïde ; et moi je pense que ce sont bien plutôt les délices de Rome et la philosophie épicurienne de la Grèce.
Si l’état social, les circonstances et les lois ne retenaient pas si étroitement l’esprit américain dans la recherche du bien-être, il est à croire que, lorsqu’il viendrait à s’occuper des choses immatérielles, il montrerait plus de réserve et plus d’expérience, et qu’il se modérerait sans peine. Mais il se sent emprisonné dans des limites dont on semble ne pas vouloir le laisser sortir. Dès qu’il dépasse ces limites, il ne sait où se fixer lui-même, et il court souvent, sans s’arrêter, par delà les bornes du sens commun.
[III-273]
CHAPITRE XIII.↩
Pourquoi les américains se montrent si inquiets au milieu de leur bien-être.
On rencontre encore quelquefois dans certains cantons retirés de l’ancien monde, de petites populations qui ont été comme oubliées au milieu du tumulte universel et qui sont restées immobiles quand tout remuait autour d’elles. La plupart de ces peuples sont fort ignorants et fort misérables ; ils ne se mêlent point aux affaires du gouvernement et souvent les gouvernements les oppriment. Cependant, ils montrent d’ordinaire un visage serein, et ils font souvent paraître une humeur enjouée.
[III-274]
J’ai vu en Amérique les hommes les plus libres et les plus éclairés, placés dans la condition la plus heureuse qui soit au monde ; il m’a semblé qu’une sorte de nuage couvrait habituellement leurs traits ; ils m’ont paru graves et presque tristes jusque dans leurs plaisirs.
La principale raison de ceci est que les premiers ne pensent point aux maux qu’ils endurent, tandis que les autres songent sans cesse aux biens qu’ils n’ont pas.
C’est une chose étrange de voir avec quelle sorte d’ardeur fébrile les Américains poursuivent le bien-être, et comme ils se montrent tourmentés sans cesse par une crainte vague de n’avoir pas choisi la route la plus courte qui peut y conduire,
L’habitant des États-Unis s’attache aux biens de ce monde, comme s’il était assuré de ne point mourir, et il met tant de précipitation à saisir ceux qui passent a sa portée, qu’on dirait qu’il craint à chaque instant de cesser de vivre avant d’en avoir joui. Il les saisit tous, mais sans les étreindre, et il les laisse bientôt échapper de ses mains pour courir après des jouissances nouvelles.
Un homme, aux États-Unis, bâtit avec soin une demeure pour y passer ses vieux jours, et il la vend pendant qu’on en pose le faîte ; il plante un jardin, et il le loue comme il allait en goûter les fruits ; il défriche un champ, et il laisse à d’autres [III-275] le soin d’en récolter les moissons. Il embrasse une profession, et la quitte. Il se fixe dans un lieu dont il part peu après pour aller porter ailleurs ses changeants désirs. Ses affaires privées lui donnent-elles quelque relâche, il se plonge aussitôt dans le tourbillon de la politique. Et quand, vers le terme d’une année remplie de travaux, il lui reste encore quelques loisirs, il promène çà et là dans les vastes limites des États-Unis sa curiosité inquiète. Il fera ainsi cinq cents lieues en quelques jours, pour se mieux distraire de son bonheur.
La mort survient enfin et elle l’arrête avant qu’il se soit lassé de cette poursuite inutile d’une félicité complète qui fuit toujours.
On s’étonne d’abord en contemplant cette agitation singulière que font paraître tant d’hommes heureux, au sein même de leur abondance. Ce spectacle est pourtant aussi vieux que le monde ; ce qui est nouveau, c’est de voir tout un peuple qui le donne.
Le goût des jouissances matérielles doit être considéré comme la source première de cette inquiétude secrète qui se révèle dans les actions des Américains, et de cette inconstance dont ils donnent journellement l’exemple.
Celui qui a renfermé son cœur dans la seule recherche des biens de ce monde est toujours pressé, car il n’a qu’un temps limité pour les trouver, [III-276] s’en emparer et en jouir. Le souvenir de la brièveté de la vie l’aiguillonne sans cesse. Indépendamment des biens qu’il possède, il en imagine à chaque instant mille autres que la mort l’empêchera de goûter, s’il ne se hâte. Cette pensée le remplit de troubles, de craintes et de regrets, et maintient son âme dans une sorte de trépidation incessante qui le porte à changer à tout moment de desseins et de lieu.
Si au goût du bien-être matériel vient se joindre un état social dans lequel la loi ni la coutume ne retiennent plus personne à sa place, ceci est une grande excitation de plus pour cette inquiétude d’esprit : on verra alors les hommes changer continuellement de route, de peur de manquer le plus court chemin, qui doit les conduire au bonheur.
Il est d’ailleurs facile de concevoir, que si les hommes qui recherchent avec passion les jouissances matérielles désirent vivement, ils doivent se rebuter aisément ; l’objet final étant de jouir, il faut que le moyen d’y arriver soit prompt et facile, sans quoi la peine d’acquérir la jouissance surpasserait la jouissance. La plupart des âmes y sont donc à la fois ardentes et molles, violentes et énervées. Souvent, la mort y est moins redoutée que la continuité des efforts vers le même but.
L’égalité conduit par un chemin plus direct [III-277] encore, à plusieurs des effets que je viens de décrire.
Quand toutes les prérogatives de naissance et de fortune sont détruites, que toutes les professions sont ouvertes à tous, et qu’on peut parvenir de soi-même au sommet de chacune d’elles, une carrière immense et aisée semble s’ouvrir devant l’ambition des hommes, et ils se figurent volontiers qu’ils sont appelés à de grandes destinées. Mais c’est là une vue erronée que l’expérience corrige tous les jours. Cette même égalité qui permet à chaque citoyen de concevoir de vastes espérances rend tous les citoyens individuellement faibles. Elle limite de tous côtés leurs forces, en même temps qu’elle permet à leurs désirs de s’étendre.
Non-seulement ils sont impuissants par eux-mêmes, mais ils trouvent à chaque pas d’immenses obstacles qu’ils n’avaient point aperçus d’abord.
Ils ont détruit les privilèges gênants de quelques uns de leurs semblables ; ils rencontrent la concurrence de tous. La borne a changé de forme plutôt que de place. Lorsque les hommes sont à peu près semblables et suivent une même route, il est bien difficile qu’aucun d’entre eux marche vite et perce à travers la foule uniforme qui l’environne et le presse.
Cette opposition constante qui règne entre les [III-278] instincts que fait naître l’égalité, et les moyens qu’elle fournit pour les satisfaire, tourmente et fatigue les âmes.
On peut concevoir des hommes arrivés à un certain degré de liberté qui les satisfasse entièrement. Ils jouissent alors de leur indépendance sans inquiétude et sans ardeur. Mais les hommes ne fonderont jamais une égalité qui leur suffise.
Un peuple a beau faire des efforts, il ne parviendra pas à rendre les conditions parfaitement égales dans son sein et s’il avait le malheur d’arriver à ce nivellement absolu et complet, il resterait encore l’inégalité des intelligences, qui, venant directement de Dieu, échappera toujours aux lois.
Quelque démocratique que soit l’état social et la constitution politique d’un peuple, on peut donc compter que chacun de ses citoyens apercevra toujours près de soi plusieurs points qui le dominent, et l’on peut prévoir qu’il tournera obstinément ses regards de ce seul côté. Quand l’inégalité est la loi commune d’une société, les plus fortes inégalités ne frappent point l’œil ; quand tout est à peu près de niveau, les moindres le blessent. C’est pour cela que le désir de l’égalité devient toujours plus insatiable à mesure que l’égalité est plus grande.
Chez les peuples démocratiques, les hommes [III-279] obtiennent aisément une certaine égalité ; ils ne sauraient atteindre celle qu’ils désirent. Celle-ci recule chaque jour devant eux, mais sans jamais se dérober à leurs regards, et, en se retirant, elle les attire à sa poursuite. Sans cesse ils croyent qu’ils vont la saisir, et elle échappe sans cesse à leurs étreintes. Ils la voient d’assez près pour connaître ses charmes, ils ne l’approchent pas assez pour en jouir, et ils meurent avant d’avoir savouré pleinement ses douceurs.
C’est à ces causes qu’il faut attribuer la mélancolie singulière que les habitants des contrées démocratiques font souvent voir au sein de leur abondance, et ces dégoûts de la vie qui viennent quelquefois les saisir au milieu d’une existence aisée et tranquille.
On se plaint en France que le nombre des suicides s’accroît ; en Amérique le suicide est rare, mais on assure que la démence est plus commune que partout ailleurs.
Ce sont là des symptômes différents du même mal.
Les Américains ne se tuent point, quelque agités qu’ils soient, parce que la religion leur défend de le faire, et que chez eux le matérialisme n’existe pour ainsi dire pas, quoique la passion du bien-être matériel soit générale.
[III-280]
Leur volonté résiste, mais souvent leur raison fléchit.
Dans les temps démocratiques les jouissances sont plus vives que dans les siècles d’aristocratie, et surtout le nombre de ceux qui les goûtent est infiniment plus grand ; mais, d’une autre part, il faut reconnaître que les espérances et les désirs y sont plus souvent déçus, les âmes plus émues et plus inquiètes, et les soucis plus cuisants.
[III-281]
CHAPITRE XIV.↩
Comment le goût des jouissances matérielles s’unit chez les Américains à l’amour de la liberté et au soin des affaires publiques.
Lorsqu’un état démocratique tourne à la monarchie absolue, l’activité qui se portait précédemment sur les affaires publiques et sur les affaires privées, venant, tout à coup, à se concentrer sur ces dernières, il en résulte, pendant quelque temps, une grande prospérité matérielle ; mais bientôt le mouvement se ralentit et le développement de la production s’arrête.
Je ne sais si l’on peut citer un seul peuple manufacturier et commerçant, depuis les Tyriens [III-282] jusqu’aux Florentins et aux Anglais, qui n’ait été un peuple libre. Il y a donc un lien étroit et un rapport nécessaire entre ces deux choses : liberté et industrie.
Cela est généralement vrai de toutes les nations, mais spécialement des nations démocratiques.
J’ai fait voir plus haut comment les hommes qui vivent dans les siècles d’égalité avaient un continuel besoin de l’association pour se procurer presque tous les biens qu’ils convoitent, et, d’une autre part, j’ai montré comment la grande liberté politique perfectionnait et vulgarisait dans leur sein l’art de s’associer. La liberté, dans ces siècles, est donc particulièrement utile à la production des richesses. On peut voir, au contraire, que le despotisme lui est particulièrement ennemi.
Le naturel du pouvoir absolu, dans les siècles démocratiques, n’est ni cruel ni sauvage, mais il est minutieux et tracassier. Un despotisme de cette espèce, bien qu’il ne foule point aux pieds l’humanité, est directement opposé au génie du commerce et aux instincts de l’industrie.
Ainsi, les hommes des temps démocratiques ont besoin d’être libres, afin de se procurer plus aisément les jouissances matérielles après lesquelles ils soupirent sans cesse.
Il arrive cependant, quelquefois, que le goût [III-283] excessif qu’ils conçoivent pour ces mêmes jouissances les livre au premier maître qui se présente. La passion du bien-être se retourne alors contre elle-même, et éloigne sans l’apercevoir l’objet de ses convoitises.
Il y a, en effet, un passage très-périlleux dans la vie des peuples démocratiques.
Lorsque le goût des jouissances matérielles se développe chez un de ces peuples plus rapidement que les lumières et que les habitudes de la liberté, il vient un moment où les hommes sont emportés, et comme hors d’eux-mêmes, à la vue de ces biens nouveaux qu’ils sont prêts à saisir. Préoccupés du seul soin de faire fortune, ils n’aperçoivent plus le lien étroit qui unit la fortune particulière de chacun d’eux à la prospérité de tous. Il n’est pas besoin d’arracher à de tels citoyens les droits qu’ils possèdent ; ils les laissent volontiers échapper eux-mêmes. L’exercice de leurs devoirs politiques leur paraît un contre-temps fâcheux qui les distrait de leur industrie. S’agit-il de choisir leurs représentants, de prêter main forte à l’autorité, de traiter en commun la chose commune, le temps leur manque ; ils ne sauraient dissiper ce temps si précieux en travaux inutiles. Ce sont là jeux d’oisifs qui ne conviennent point à des hommes graves et occupés des intérêts sérieux de la vie. Ces gens-là croient suivre la [III-284] doctrine de l’intérêt, mais ils ne s’en font qu’une idée grossière, et, pour mieux veiller à ce qu’ils nomment leurs affaires, ils négligent la principale, qui est de rester maîtres d’eux-mêmes.
Les citoyens qui travaillent ne voulant pas songer à la chose publique, et la classe qui pourrait se charger de ce soin pour remplir ses loisirs n’existant plus, la place du gouvernement est comme vide.
Si, à ce moment critique, un ambitieux habile vient à s’emparer du pouvoir, il trouve que la voie à toutes les usurpations est ouverte.
Qu’il veille quelque temps à ce que tous les intérêts matériels prospèrent ; on le tiendra aisément quitte du reste. Qu’il garantisse surtout le bon ordre. Les hommes qui ont la passion des jouissances matérielles découvrent d’ordinaire comment les agitations de la liberté troublent le bien-être, avant que d’apercevoir comment la liberté sert à se le procurer ; et, au moindre bruit des passions publiques qui pénètrent au milieu des petites jouissances de leur vie privée, ils s’éveillent et s’inquiètent ; pendant longtemps la peur de l’anarchie les tient sans cesse en suspens et toujours prêts à se jeter hors de la liberté au premier désordre.
Je conviendrai sans peine que la paix publique est un grand bien ; mais je ne veux pas oublier [III-285] cependant que c’est à travers le bon ordre que tous les peuples sont arrivés à la tyrannie. Il ne s’ensuit pas assurément que les peuples doivent mépriser la paix publique ; mais il ne faut pas qu’elle leur suffise. Une nation qui ne demande à son gouvernement que le maintien de l’ordre est déjà esclave au fond du cœur ; elle est esclave de son bien-être, et l’homme qui doit l’enchaîner peut paraître.
Le despotisme des factions n’y est pas moins à redouter que celui d’un homme.
Lorsque la masse des citoyens ne veut s’occuper que d’affaires privées, les plus petits partis ne doivent pas désespérer de devenir maîtres des affaires publiques.
Il n’est pas rare de voir alors sur la vaste scène du monde, ainsi que sur nos théâtres, une multitude représentée par quelques hommes. Ceux-ci parlent seuls au nom d’une foule absente ou inattentive ; seuls ils agissent au milieu de l’immobilité universelle ; ils disposent, suivant leur caprice, de toutes choses, ils changent les lois, et tyrannisent à leur gré les mœurs ; et l’on s’étonne en voyant le petit nombre de faibles et d’indignes mains dans lesquelles peut tomber un grand peuple.
Jusqu’à présent, les Américains ont évité avec bonheur tous les écueils que je viens d’indiquer ; [III-286] et en cela ils méritent véritablement qu’on les admire.
Il n’y a peut-être pas de pays sur la terre où l’on rencontre moins d’oisifs qu’en Amérique, et où tous ceux qui travaillent soient plus enflammés à la recherche du bien-être. Mais si la passion des Américains pour les jouissances matérielles est violente, du moins elle n’est point aveugle, et la raison, impuissante à la modérer, la dirige.
Un Américain s’occupe de ses intérêts privés comme s’il était seul dans le monde, et, le moment d’après, il se livre à la chose publique comme s’il les avait oubliés. Il paraît tantôt anime de la cupidité la plus égoïste, et tantôt du patriotisme le plus vif. Le cœur humain ne saurait se diviser de cette manière. Les habitants des États-Unis témoignent alternativement une passion si forte et si semblable pour leur bien-être et leur liberté, qu’il est à croire que ces passions s’unissent et se confondent dans quelque endroit de leur âme. Les Américains voient, en effet, dans leur liberté le meilleur instrument et la plus grande garantie de leur bien-être. Ils aiment ces deux choses l’une par l’autre. Ils ne pensent donc point que se mêler du public ne soit pas leur affaire ; ils croient, au contraire, que leur principale affaire est de [III-287] s’assurer par eux-mêmes un gouvernement qui leur permette d’acquérir les biens qu’ils désirent, et qui ne leur défende pas de goûter en paix ceux qu’ils ont acquis.
[III-289]
CHAPITRE XV.↩
Comment les croyances religieuses détournent de temps en temps l’âme des Américains vers les jouissances immatérielles.
Aux États-Unis, quand arrive le septième jour de chaque semaine, la vie commerciale et industrielle de la nation semble suspendue, tous les bruits cessent. Un profond repos, ou plutôt une sorte de recueillement solennel lui succède, l’âme rentre enfin en possession d’elle-même, et se contemple.
Durant ce jour, les lieux consacrés au commerce sont déserts ; chaque citoyen, entouré de ses enfants, se rend dans un temple ; là, on lui tient d’étranges discours qui semblent peu faits [III-290] pour son oreille. On l’entretient des maux innombrables causés par l’orgueil et la convoitise. On lui parle de la nécessité de régler ses désirs, des jouissances délicates attachées à la seule vertu, et du vrai bonheur qui l’accompagne.
Rentré dans sa demeure, on ne le voit point courir aux registres de son négoce. Il ouvre le livre des saintes Ecritures ; il y trouve des peintures sublimes ou touchantes, de la grandeur et de la bonté du Créateur, de la magnificence infinie des œuvres de Dieu, de la haute destinée réservée aux hommes, de leurs devoirs et de leurs droits à l’immortalité.
C’est ainsi que, de temps en temps, l’Américain se dérobe en quelque sorte à lui-même, et que, s’arrachant pour un moment aux petites passions qui agitent sa vie et aux intérêts passagers qui la remplissent, il pénètre tout à coup dans un monde idéal où tout est grand, pur, éternel.
J’ai recherché dans un autre endroit de cet ouvrage, les causes auxquelles il fallait attribuer le maintien des institutions politiques des Américains, et la religion m’a paru l’une des principales. Aujourd’hui que je m’occupe des individus, je la retrouve et j’aperçois qu’elle n’est pas moins utile à chaque citoyen qu’à tout l’État.
Les Américains montrent, par leur pratique, qu’ils sentent toute la nécessité de moraliser la [III-291] démocratie par la religion. Ce qu’ils pensent à cet égard sur eux-mêmes est une vérité dont toute nation démocratique doit être pénétrée.
Je ne doute point que la constitution sociale et politique d’un peuple ne le dispose à certaines croyances et à certains goûts dans lesquels il abonde ensuite sans peine ; tandis que ces mêmes causes l’écartent de certaines opinions et de certains penchants, sans qu’il y travaille de lui-même, et pour ainsi dire sans qu’il s’en doute.
Tout l’art du législateur consiste à bien discerner d’avance ces pentes naturelles des sociétés humaines, afin de savoir où il faut aider l’effort des citoyens, et où il serait plutôt nécessaire de le ralentir. Car ces obligations diffèrent suivant les temps. Il n’y a d’immobile que le but vers lequel doit toujours tendre le genre humain ; les moyens de l’y faire arriver varient sans cesse.
Si j’étais né dans un siècle aristocratique, au milieu d’une nation où la richesse héréditaire des uns et la pauvreté irrémédiable des autres, détournassent également les hommes de l’idée du mieux, et tinssent les âmes comme engourdies dans la contemplation d’un autre monde ; je voudrais qu’il me fût possible de stimuler chez un pareil peuple le sentiment des besoins, je songerais à découvrir les moyens plus rapides et plus aisés de satisfaire les nouveaux désirs que j’aurais fait [III-292] naître, et, détournant vers les études physiques les plus grands efforts de l’esprit humain, je tâcherais de l’exciter à la recherche du bien-être.
S’il arrivait que quelques hommes s’enflammassent inconsidérément à la poursuite de la richesse et fissent voir un amour excessif pour les jouissances matérielles, je ne m’en alarmerais point ; ces traits particuliers disparaîtraient bientôt dans la physionomie commune.
Les législateurs des démocraties ont d’autres soins.
Donnez aux peuples démocratiques des lumières et de la liberté, et laissez-les faire. Ils arriveront sans peine, à retirer de ce monde tous les biens qu’il peut offrir ; ils perfectionneront chacun des arts utiles, et rendront tous les jours la vie plus commode, plus aisée, plus douce ; leur état social les pousse naturellement de ce côté. Je ne redoute pas qu’ils s’arrêtent.
Mais tandis que l’homme se complaît dans cette recherche honnête et légitime du bien-être, il est à craindre qu’il ne perde enfin l’usage de ses plus sublimes facultés, et qu’en voulant tout améliorer autour de lui, il ne se dégrade enfin lui-même. C’est là qu’est le péril, et non point ailleurs.
Il faut donc que les législateurs des démocraties et tous les hommes honnêtes et éclairés qui [III-293] y vivent, s’appliquent sans relâche à y soulever les âmes et à les tenir dressées vers le ciel. Il est nécessaire que tous ceux qui s’intéressent à l’avenir des sociétés démocratiques, s’unissent, et que tous de concert fassent de continuels efforts pour répandre dans le sein de ces sociétés le goût de l’infini, le sentiment du grand et l’amour des plaisirs immatériels.
Que, s’il se rencontre parmi les opinions d’un peuple démocratique, quelques-unes de ces théories malfaisantes qui tendent à faire croire que tout périt avec le corps ; considérez les hommes qui les professent comme les ennemis naturels de ce peuple.
Il y a bien des choses qui me blessent dans les matérialistes. Leurs doctrines me paraissent pernicieuses, et leur orgueil me révolte. Si leur système pouvait être de quelque utilité à l’homme, il semble que ce serait en lui donnant une modeste idée de lui-même. Mais ils ne font point voir qu’il en soit ainsi ; et, quand ils croient avoir suffisamment établi qu’ils ne sont que des brutes, ils se montrent aussi fiers que s’ils avaient démontré qu’ils étaient des Dieux.
Le matérialisme est chez toutes les nations une maladie dangereuse de l’esprit humain ; mais il faut particulièrement le redouter chez un peuple démocratique, parce qu’il se combine [III-294] merveilleusement avec le vice de cœur le plus familier à ces peuples.
La démocratie favorise le goût des jouissances matérielles. Ce goût, s’il devient excessif, dispose bientôt les hommes à croire que tout n’est que matière ; et le matérialisme, à son tour, achève de les entraîner avec une ardeur insensée vers ces mêmes jouissances. Tel est le cercle fatal dans lequel les nations démocratiques sont poussées. Il est bon qu’elles voient le péril, et se retiennent.
La plupart des religions ne sont que des moyens généraux, simples et pratiques, d’enseigner aux hommes l’immortalité de l’âme. C’est là le plus grand avantage qu’un peuple démocratique retire des croyances, et ce qui les rend plus nécessaires à un tel peuple qu’à tous les autres.
Lors donc qu’une religion quelconque a jeté de profondes racines au sein d’une démocratie, gardez-vous de l’ébranler ; mais conservez-la plutôt avec soin comme le plus précieux héritage des siècles aristocratiques ; ne cherchez pas à arracher aux hommes leurs anciennes opinions religieuses, pour en substituer des nouvelles, de peur que, dans le passage d’une foi à une autre, l’âme se trouvant un moment vide de croyances, l’amour des jouissances matérielles ne vienne à s’y étendre, et à la remplir tout entière.
[III-295]
Assurément, la métempsycose n’est pas plus raisonnable que le matérialisme ; cependant, s’il fallait absolument qu’une démocratie fît un choix entre les deux, je n’hésiterais pas, et je jugerais que ses citoyens risquent moins de s’abrutir en pensant que leur âme va passer dans le corps d’un porc, qu’en croyant qu’elle n’est rien.
La croyance à un principe immatériel et immortel, uni pour un temps à la matière, est si nécessaire à la grandeur de l’homme, qu’elle produit encore de beaux effets lorsqu’on n’y joint pas l’opinion des récompenses et des peines, et que l’on se borne à croire qu’après la mort le principe divin renfermé dans l’homme s’absorbe en Dieu ou va animer une autre créature.
Ceux-là même considèrent le corps comme la portion secondaire et inférieure de notre nature ; et ils le méprisent alors même qu’ils subissent son influence ; tandis qu’ils ont une estime naturelle et une admiration secrète pour la partie immatérielle de l’homme, encore qu’ils refusent quelquefois de se soumettre à son empire. C’en est assez pour donner un certain tour élevé à leurs idées et à leurs goûts, et pour les faire tendre sans intérêt, et comme d’eux-mêmes, vers les sentiments purs et les grandes pensées.
Il n’est pas certain que Socrate et son école eussent des opinions bien arrêtées sur ce qui devait [III-296] arriver a l’homme dans l’autre vie ; mais la seule croyance sur laquelle ils étaient fixés, que l’âme n’a rien de commun avec le corps et qu’elle lui survit, a suffi pour donner à la philosophie platonicienne cette sorte d’élan sublime qui la distingue.
Quand on lit Platon, on aperçoit que dans les temps antérieurs à lui, et de son temps, il existait beaucoup d’écrivains qui préconisaient le matérialisme. Ces écrivains ne sont pas parvenus jusqu’à nous ou n’y sont parvenus que fort incomplètement. Il en a été ainsi dans presque tous les siècles : la plupart des grandes réputations littéraires se sont jointes au spiritualisme. L’instinct et le goût du genre humain soutiennent cette doctrine ; ils la sauvent souvent en dépit des hommes eux-mêmes, et font surnager les noms de ceux qui s’y attachent. Il ne faut donc pas croire que dans aucun temps, et quel que soit l’état politique, la passion des jouissances matérielles et les opinions qui s’y rattachent pourront suffire à tout un peuple. Le cœur de l’homme est plus vaste qu’on ne le suppose ; il peut renfermer à la fois le goût des biens de la terre et l’amour de ceux du ciel ; quelquefois il semble se livrer éperduement à l’un des deux ; mais il n’est jamais longtemps sans songer à l’autre.
S’il est facile de voir que c’est particulièrement dans les temps de démocratie qu’il importe de [III-297] faire régner les opinions spiritualistes ; il n’est pas aisé de dire comment ceux qui gouvernent les peuples démocratiques doivent faire pour qu’elles y règnent.
Je ne crois pas à la prospérité non plus qu’à la durée des philosophies officielles, et, quant aux religions d’État, j’ai toujours pensé que si parfois elles pouvaient servir momentanément les intérêts du pouvoir politique, elles devenaient toujours tôt ou tard fatales à l’Église.
Je ne suis pas non plus du nombre de ceux qui jugent que pour relever la religion aux yeux des peuples, et mettre en honneur le spiritualisme qu’elle professe, il est bon d’accorder indirectement à ses ministres une influence politique que leur refuse la loi.
Je me sens si pénétré des dangers presque inévitables que courent les croyances quand leurs interprètes se mêlent des affaires publiques, et je suis si convaincu qu’il faut à tout prix maintenir le christianisme dans le sein des démocraties nouvelles, que j’aimerais mieux enchaîner les prêtres dans le sanctuaire que de les en laisser sortir.
Quels moyens reste-t-il donc à l’autorité pour ramener les hommes vers les opinions spiritualistes ou pour les retenir dans la religion qui les suggère ?
Ce que je vais dire va bien me nuire aux yeux des politiques. Je crois que le seul moyen efficace [III-298] dont les gouvernements puissent se servir pour mettre en honneur le dogme de l’immortalité de l’âme, c’est d’agir chaque jour comme s’ils y croyaient eux-mêmes ; et je pense que ce n’est qu’en se conformant scrupuleusement à la morale religieuse dans les grandes affaires, qu’ils peuvent se flatter d’apprendre aux citoyens à la connaître, à l’aimer et à la respecter dans les petites.
[III-299]
CHAPITRE XVI.↩
Comment l’amour excessif du bien-être peut nuire au bien-être.
Il y a plus de liaison qu’on ne pense entre le perfectionnement de l’âme et l’amélioration des biens du corps ; l’homme peut laisser ces deux choses distinctes et envisager alternativement chacune d’elles ; mais il ne saurait les séparer entièrement sans les perdre enfin de vue l’une et l’autre.
Les bêtes ont les mêmes sens que nous et à peu près les mêmes convoitises : il n’y a pas de passions matérielles qui ne nous soient communes avec [III-300] elles, et dont le germe ne se trouve dans un chien aussi bien qu’en nous-mêmes.
D’où vient donc que les animaux ne savent pourvoir qu’à leurs premiers et à leurs plus grossiers besoins, tandis que nous varions à l’infini nos jouissances et les accroissons sans cesse ?
Ce qui nous rend supérieurs en ceci aux bêtes, c’est que nous employons notre âme à trouver les biens matériels vers lesquels l’instinct seul les conduit. Chez l’homme, l’ange enseigne à la brute l’art de se satisfaire. C’est parce que l’homme est capable de s’élever au-dessus des biens du corps, et de mépriser jusqu’à la vie, ce dont les bêtes n’ont pas même l’idée, qu’il sait multiplier ces mêmes biens à un degré qu’elles ne sauraient non plus concevoir.
Tout ce qui élève, grandit, étend l’âme, la rend plus capable de réussir à celle même de ses entreprises où il ne s’agit point d’elle.
Tout ce qui l’énerve, au contraire, ou l’abaisse, l’affaiblit pour toutes choses, les principales comme les moindres, et menace de la rendre presque aussi impuissante pour les unes que pour autres. Ainsi, il faut que l’âme reste grande et forte, ne fût-ce que pour pouvoir, de temps à autre, mettre sa force et sa grandeur au service du corps.
Si les hommes parvenaient jamais à se [III-301] contenter des biens matériels, il est à croire qu’ils perdraient peu à peu l’art de les produire, et qu’ils finiraient par en jouir sans discernement et sans progrès, comme les brutes.
[III-303]
CHAPITRE XVII.↩
Comment dans les temps d’égalité et de doute, il importe de reculer l’objet des actions humaines.
Dans les siècles de foi, on place le but final de la vie après la vie.
Les hommes de ces temps-là s’accoutument donc naturellement, et, pour ainsi dire, sans le vouloir, à considérer pendant une longue suite d’années un objet immobile vers lequel ils marchent sans cesse, et ils apprennent, par des progrès insensibles, à réprimer mille petits désirs passagers, pour mieux arriver à satisfaire ce grand et permanent désir qui les tourmente. Lorsque les mêmes hommes veulent s’occuper des choses [III-304] de la terre, ces habitudes se retrouvent. Ils fixent volontiers à leurs actions d’ici-bas un but général et certain, vers lequel tous leurs efforts se dirigent. On ne les voit point se livrer chaque jour à des tentatives nouvelles ; mais ils ont des desseins arrêtés qu’ils ne se lassent point de poursuivre.
Ceci explique pourquoi les peuples religieux ont souvent accompli des choses si durables. Il se trouvait qu’en s’occupant de l’autre monde, ils avaient rencontré le grand secret de réussir dans celui-ci.
Les religions donnent l’habitude générale de se comporter en vue de l’avenir. En ceci elles ne sont pas moins utiles au bonheur de cette vie qu’à la félicité de l’autre. C’est un de leurs plus grands côtés politiques.
Mais, à mesure que les lumières de la foi s’obscurcissent, la vue des hommes se resserre, et l’on dirait que chaque jour l’objet des actions humaines leur paraît plus proche.
Quand ils se sont une fois accoutumés à ne plus s’occuper de ce qui doit arriver après leur vie, on les voit retomber aisément dans cette indifférence complète et brutale de l’avenir qui n’est que trop conforme à certains instincts de l’espèce humaine. Aussitôt qu’ils ont perdu l’usage de placer leurs principales espérances à long terme, ils sont naturellement portés à vouloir réaliser sans retard [III-305] leurs moindres désirs, et il semble que du moment où ils désespèrent de vivre une éternité ils sont disposés à agir comme s’ils ne devaient exister qu’un seul jour.
Dans les siècles d’incrédulité il est donc toujours à craindre que les hommes ne se livrent sans cesse au hasard journalier de leurs désirs, et que, renonçant entièrement à obtenir ce qui ne peut s’acquérir sans de longs efforts, ils ne fondent rien de grand, de paisible et de durable.
S’il arrive que, chez un peuple ainsi disposé, l’état social devienne démocratique, le danger que je signale s’en augmente.
Quand chacun cherche sans cesse à changer de place, qu’une immense concurrence est ouverte à tous, que les richesses s’accumulent et se dissipent en peu d’instants au milieu du tumulte de la démocratie, l’idée d’une fortune subite et facile, de grands biens aisément acquis et perdus, l’image du hasard, sous toutes ses formes, se présente à l’esprit humain. L’instabilité de l’état social vient favoriser l’instabilité naturelle des désirs. Au milieu de ces fluctuations perpétuelles du sort, le présent grandit ; il cache l’avenir qui s’efface, et les hommes ne veulent songer qu’au lendemain.
Dans ces pays où, par un concours malheureux, l’irréligion et la démocratie se rencontrent, les philosophes et les gouvernants doivent s’attacher [III-306] sans cesse à reculer aux yeux des hommes l’objet des actions humaines ; c’est leur grande affaire.
Il faut que, se renfermant dans l’esprit de son siècle et de son pays, le moraliste apprenne à s’y défendre. Que chaque jour il s’efforce de montrer à ses contemporains, comment au milieu même du mouvement perpétuel qui les environne, il est plus facile qu’ils ne le supposent de concevoir et d’exécuter de longues entreprises. Qu’il leur fasse voir que, bien que l’humanité ait changé de face, les méthodes à l’aide desquelles les hommes peuvent se procurer la prospérité de ce monde sont restées les mêmes, et que, chez les peuples démocratiques, comme ailleurs, ce n’est qu’en résistant à mille petites passions particulières de tous les jours, qu’on peut arriver à satisfaire la passion générale du bonheur, qui tourmente.
La tâche des gouvernants n’est pas moins tracée.
Dans tous les temps il importe que ceux qui dirigent les nations se conduisent en vue de l’avenir. Mais cela est plus nécessaire encore dans les siècles démocratiques et incrédules que dans tous les autres. En agissant ainsi, les chefs des démocraties font non seulement prospérer les affaires publiques, mais ils apprennent encore, par leur exemple, aux particuliers l’art de conduire les affaires privées.
[III-307]
Il faut surtout qu’ils s’efforcent de bannir autant que possible le hasard du monde politique.
L’élévation subite et imméritée d’un courtisan, ne produit qu’une impression passagère dans un pays aristocratique, parce que l’ensemble des institutions et des croyances force habituellement les hommes à marcher lentement dans des voies dont ils ne peuvent sortir.
Mais il n’y a rien de plus pernicieux que de pareils exemples offerts aux regards d’un peuple démocratique. Ils achèvent de précipiter son cœur sur une pente où tout l’entraîne. C’est donc principalement dans les temps de scepticisme et d’égalité, qu’on doit éviter avec soin que la faveur du peuple, ou celle du prince, dont le hasard vous favorise ou vous prive, ne tienne lieu de la science et des services. Il est à souhaiter que chaque progrès y paraisse le fruit d’un effort, de telle sorte qu’il n’y ait pas de grandeurs trop faciles, et que l’ambition soit forcée de fixer longtemps ses regards vers le but avant de l’atteindre.
Il faut que les gouvernements s’appliquent à redonner aux hommes ce goût de l’avenir, qui n’est plus inspiré par la religion et l’état social, et que, sans le dire, ils enseignent chaque jour pratiquement aux citoyens que la richesse, la renommée, le pouvoir, sont les prix du travail ; que les grands [III-308] succès se trouvent placés au bout des longs désirs, et qu’on n’obtient rien de durable que ce qui s’acquiert avec peine.
Quand les hommes se sont accoutumés à prévoir de très-loin ce qui doit leur arriver ici-bas, et à s’y nourrir d’espérances, il leur devient malaisé d’arrêter toujours leur esprit aux bornes précises de la vie, et ils sont bien prêts d’en franchir les limites, pour jeter leurs regards au-delà.
Je ne doute donc point qu’en habituant les citoyens à songer à l’avenir dans ce monde, on ne les rapprochât peu à peu, et sans qu’ils le sussent eux-mêmes, des croyances religieuses.
Ainsi, le moyen qui permet aux hommes de se passer, jusqu’à un certain point, de religion, est peut-être, après tout, le seul qui nous reste pour ramener par un long détour le genre humain vers la foi.
[III-309]
CHAPITRE XVIII.↩
Pourquoi, chez les Américains, toutes les professions honnêtes sont réputées honorables.
Chez les peuples démocratiques, où il n’y a point de richesses héréditaires, chacun travaille pour vivre, ou a travaillé, ou est né de gens qui ont travaillé. L’idée du travail, comme condition nécessaire, naturelle et honnête de l’humanité s’offre donc de tout côté à l’esprit humain.
Non-seulement le travail n’est point en déshonneur chez ces peuples, mais il est en honneur, le préjugé n’est pas contre lui, il est pour lui. Aux États-Unis, un homme riche croit devoir à l’opinion publique de consacrer ses loisirs à quelque [III-310] opération d’industrie, de commerce ou à quelques devoirs publics. Il s’estimerait mal famé s’il n’employait sa vie qu’à vivre. C’est pour se soustraire à cette obligation du travail que tant de riches Américains viennent en Europe : là, ils trouvent des débris de sociétés aristocratiques parmi lesquelles l’oisiveté est encore honorée.
L’égalité ne réhabilite pas seulement l’idée du travail, elle relève l’idée du travail procurant un lucre.
Dans les aristocraties, ce n’est pas précisément le travail qu’on méprise, c’est le travail en vue d’un profit. Le travail est glorieux quand c’est l’ambition ou la seule vertu qui le fait entreprendre. Sous l’aristocratie cependant, il arrive sans cesse que celui qui travaille pour l’honneur n’est pas insensible à l’appât du gain. Mais ces deux désirs ne se rencontrent qu’au plus profond de son âme. Il a bien soin de dérober à tous les regards la place où ils s’unissent. Il se la cache volontiers à lui-même. Dans les pays aristocratiques, il n’y a guère de fonctionnaires publics qui ne prétendent servir sans intérêt l’État. Leur salaire est un détail auquel quelquefois ils pensent peu, et auquel ils affectent toujours de ne point penser.
Ainsi, l’idée du gain reste distincte de celle du travail. Elles ont beau être jointes au fait, la pensé les sépare.
[III-311]
Dans les sociétés démocratiques, ces deux idées sont au contraire toujours visiblement unies. Comme le désir de bien-être est universel, que les fortunes sont médiocres et passagères, que chacun a besoin d’accroître ses ressources ou d’en préparer de nouvelles à ses enfants, tous voient bien clairement que c’est le gain qui est sinon en tout, du moins en partie, ce qui les porte au travail. Ceux mêmes qui agissent principalement en vue de la gloire s’apprivoisent forcément avec cette pensée qu’ils n’agissent pas uniquement par cette vue, et ils découvrent, quoi qu’ils en aient, que le désir de vivre se mêle chez eux au désir d’illustrer leur vie.
Du moment où, d’une part, le travail semble à tous les citoyens une nécessité honorable de la condition humaine, et où, de l’autre, le travail est toujours visiblement fait, en tout ou en partie, par la considération du salaire, l’immense espace qui séparait les différentes professions dans les sociétés aristocratiques disparaît. Si elles ne sont pas toutes pareilles, elles ont du moins un trait semblable.
Il n’y a pas de profession où l’on ne travaille pas pour de l’argent. Le salaire, qui est commun à toutes, donne à toutes un air de famille.
Ceci sert à expliquer les opinions que les Américains entretiennent relativement aux diverses professions.
[III-312]
Les serviteurs américains ne se croient pas dégradés parce qu’ils travaillent ; car autour d’eux tout le monde travaille. Ils ne se sentent pas abaissés par l’idée qu’ils reçoivent un salaire ; car le président des États-Unis travaille aussi pour un salaire. On le paye pour commander, aussi bien qu’eux pour servir.
Aux États-Unis, les professions sont plus ou moins pénibles, plus ou moins lucratives, mais elles ne sont jamais ni hautes ni basses. Toute profession honnête est honorable.
[III-313]
CHAPITRE XIX.↩
Ce qui fait pencher presque tous les Américains vers les professions industrielles.
Je ne sais si de tous les arts utiles l’agriculture n’est pas celui qui se perfectionne le moins vite chez les nations démocratiques. Souvent même on dirait qu’il est stationnaire, parce que plusieurs autres semblent courir.
Au contraire, presque tous les goûts et les habitudes qui naissent de l’égalité conduisent naturellement les hommes vers le commerce et l’industrie.
Je me figure un homme actif, éclairé, libre, aisé, plein de désirs. Il est trop pauvre pour [III-314] pouvoir vivre dans l’oisiveté ; il est assez riche pour se sentir au-dessus de la crainte immédiate du besoin, et il songe à améliorer son sort. Cet homme a conçu le goût des jouissances matérielles ; mille autres s’abandonnent à ce goût sous ses yeux ; lui-même a commencé à s’y livrer, et il brûle d’accroître les moyens de le satisfaire davantage. Cependant la vie s’écoule, le temps presse. Que va-t-il faire ?
La culture de la terre promet à ses efforts des résultats presque certains, mais lents. On ne s’y enrichit que peu à peu et avec peine. L’agriculture ne convient qu’à des riches qui ont déjà un grand superflu, ou à des pauvres qui ne demandent qu’à vivre. Son choix est fait : il vend son champ, quitte sa demeure, et va se livrer à quelque profession hasardeuse, mais lucrative.
Or, les sociétés démocratiques abondent en gens de cette espèce ; et, à mesure que l’égalité des conditions devient plus grande, leur foule augmente.
La démocratie ne multiplie donc pas seulement le nombre des travailleurs ; elle porte les hommes à un travail plutôt qu’à un autre ; et, tandis qu’elle les dégoûte de l’agriculture, elle les dirige vers le commerce et l’industrie [5] .
[III-315]
Cet esprit se fait voir chez les plus riches citoyens eux-mêmes.
Dans les pays démocratiques, un homme, quelque opulent qu’on le suppose, est presque toujours mécontent de sa fortune, parce qu’il se trouve moins riche que son père et qu’il craint que ses fils ne le soient moins que lui. La plupart des riches des démocraties rêvent donc sans cesse aux moyens d’acquérir des richesses, et ils tournent naturellement les yeux vers le commerce et l’industrie, qui leur paraissent les moyens les plus prompts et les plus puissants de se les procurer. Ils partagent sur ce point les instincts du pauvre sans avoir ses besoins, ou plutôt ils sont poussés par le plus impérieux de tous les besoins : celui de ne pas déchoir.
Dans les aristocraties, les riches sont en même [III-316] temps les gouvernants. L’attention qu’ils donnent sans cesse à de grandes affaires publiques les détourne des petits soins que demandent le commerce et l’industrie. Si la volonté de quelqu’un d’entre eux se dirige néanmoins par hasard vers le négoce, la volonté du corps vient aussitôt lui barrer la route ; car on a beau se soulever contre l’empire du nombre, on n’échappe jamais complètement à son joug, et, au sein même des corps aristocratiques qui refusent le plus opiniâtrément de reconnaître les droits de la majorité nationale, il se forme une majorité particulière qui gouverne [6] .
Dans les pays démocratiques, où l’argent ne conduit pas au pouvoir celui qui le possède, mais souvent l’en écarte, les riches ne savent que faire de leurs loisirs. L’inquiétude et la grandeur de leurs désirs, l’étendue de leurs ressources, le goût de l’extraordinaire, que ressentent presque toujours ceux qui s’élèvent, de quelque manière que ce soit, au-dessus de la foule, les pressent d’agir. La seule route du commerce leur est ouverte. Dans les démocraties, il n’y a rien de plus grand ni de plus brillant que le commerce ; c’est lui qui attire les regards du public et remplit l’imagination de la foule ; vers lui toutes les passions énergiques se dirigent. Rien ne saurait empêcher les riches de [III-317] s’y livrer, ni leurs propres préjugés, ni ceux d’aucun autre. Les riches des démocraties ne forment jamais un corps qui ait ses mœurs et sa police ; les idées particulières de leur classe ne les arrêtent pas, et les idées générales de leur pays les poussent. Les grandes fortunes qu’on voit au sein d’un peuple démocratique ayant, d’ailleurs, presque toujours une origine commerciale, il faut que plusieurs générations se succèdent avant que leurs possesseurs aient entièrement perdu les habitudes du négoce.
Resserrés dans l’étroit espace que la politique leur laisse, les riches des démocraties se jettent donc de toutes parts dans le commerce ; là ils peuvent s’étendre et user de leurs avantages naturels ; et c’est, en quelque sorte, à l’audace même et à la grandeur de leurs entreprises industrielles qu’on doit juger le peu de cas qu’ils auraient fait de l’industrie s’ils étaient nés au sein d’une aristocratie.
Une même remarque est de plus applicable à tous les hommes des démocraties, qu’ils soient pauvres ou riches.
Ceux qui vivent au milieu de l’instabilité démocratique ont sans cesse sous les yeux l’image du hasard et ils finissent par aimer toutes les entreprises où le hasard joue un rôle.
Ils sont donc tous portés vers le commerce, non [III-318] seulement à cause du gain qu’il leur promet, mais par l’amour des émotions qu’il leur donne.
Les États-Unis d’Amérique ne sont sortis que depuis un demi-siècle de la dépendance coloniale dans laquelle les tenait l’Angleterre ; le nombre des grandes fortunes y est fort petit, et les capitaux encore rares. Il n’est pas cependant de peuple sur la terre qui ait fait des progrès aussi rapides que les Américains dans le commerce et l’industrie. Ils forment aujourd’hui la seconde nation maritime du monde ; et bien que leurs manufactures aient à lutter contre des obstacles naturels presque insurmontables, elles ne laissent pas de prendre chaque jour de nouveaux développements.
Aux États-Unis, les plus grandes entreprises industrielles s’exécutent sans peine, parce que la population tout entière se mêle d’industrie, et que le plus pauvre aussi bien que le plus opulent citoyen unissent volontiers en ceci leurs efforts. On est donc étonné chaque jour de voir les travaux immenses qu’exécute sans peine une nation qui ne renferme pour ainsi dire point de riches. Les Américains ne sont arrivés que d’hier sur le sol qu’ils habitent, et ils y ont déjà bouleversé tout l’ordre de la nature à leur profit. Ils ont uni l’Hudson au Mississipi, et fait communiquer l’Océan Atlantique avec le golfe du Mexique, à travers plus de cinq cents lieues de continent qui séparent ces [III-319] deux mers. Les plus longs chemins de fer qui aient été faits jusqu’à nos jours sont en Amérique.
Mais ce qui me frappe le plus aux États-Unis, ce n’est pas la grandeur extraordinaire de quelques entreprises industrielles ; c’est la multitude innombrable des petites entreprises.
Presque tous les agriculteurs des États-Unis ont joint quelque commerce à l’agriculture ; la plupart ont fait de l’agriculture un commerce.
Il est rare qu’un cultivateur américain se fixe pour toujours sur le sol qu’il occupe. Dans les nouvelles provinces de l’ouest principalement, on défriche un champ pour le revendre, et non pour le récolter ; on bâtit une ferme dans la prévision que, l’état du pays venant bientôt à changer par suite de l’accroissement de ses habitants, on pourra en obtenir un bon prix.
Tous les ans un essaim d’habitants du nord descend vers le midi, et vient s’établir dans les contrées où croissent le coton et la canne à sucre. Ces hommes cultivent la terre dans le but de lui faire produire en peu d’années de quoi les enrichir, et ils entrevoient déjà le moment où ils pourront retourner dans leur patrie jouir de l’aisance ainsi acquise. Les Américains transportent donc dans l’agriculture l’esprit du négoce, et leurs passions industrielles se montrent là comme ailleurs.
[III-320]
Les Américains font d’immenses progrès en industrie parce qu’ils s’occupent tous à la fois d’industrie ; et pour cette même cause ils sont sujets à des crises industrielles très-inattendues et très-formidables.
Comme ils font tous du commerce, le commerce est soumis chez eux à des influences tellement nombreuses et si compliquées, qu’il est impossible de prévoir à l’avance les embarras qui peuvent naître. Comme chacun d’eux se mêle plus ou moins d’industrie, au moindre choc que les affaires y éprouvent, toutes les fortunes particulières trébuchent en même temps, et l’État chancelle.
Je crois que le retour des crises industrielles est une maladie endémique chez les nations démocratiques de nos jours. On peut la rendre moins dangereuse, mais non la guérir, parce qu’elle ne tient pas à un accident, mais au tempérament même de ces peuples.
[III-321]
CHAPITRE XX.↩
Comment l’aristocratie pourrait sortir de l’industrie.
J’ai montré comment la démocratie favorisait les développements de l’industrie, et multipliait sans mesure le nombre des industriels ; nous allons voir par quel chemin détourné l’industrie pourrait bien à son tour ramener les hommes vers l’aristocratie.
On a reconnu que quand un ouvrier ne s’occupait tous les jours que du même détail, on parvenait plus aisément, plus rapidement et avec plus d’économie à la production générale de l’œuvre.
On a également reconnu que plus une industrie [III-322] était entreprise en grand, avec de grands capitaux, un grand crédit, plus ses produits étaient à bon marché.
Ces vérités étaient entrevues depuis longtemps, mais on les a démontrées de nos jours. Déjà on les applique à plusieurs industries très-importantes, et successivement les moindres s’en emparent.
Je ne vois rien dans le monde politique, qui doive préoccuper davantage le législateur que ces deux nouveaux axiomes de la science industrielle.
Quand un artisan se livre sans cesse et uniquement à la fabrication d’un seul objet, il finit par s’acquitter de ce travail avec une dextérité singulière. Mais il perd, en même temps, la faculté générale d’appliquer son esprit à la direction du travail. Il devient chaque jour plus habile et moins industrieux, et l’on peut dire qu’en lui, l’homme se dégrade à mesure que l’ouvrier se perfectionne.
Que doit-on attendre d’un homme qui a employé vingt ans de sa vie à faire des têtes d’épingles? et à quoi peut désormais s’appliquer chez lui cette puissante intelligence humaine, qui a souvent remué le monde, sinon à rechercher le meilleur moyen de faire des têtes d’épingles !
Lorsqu’un ouvrier a consumé de cette manière une portion considérable de son existence, sa pensée s’est arrêtée pour jamais près de l’objet [III-323] journalier de ses labeurs ; son corps a contracté certaines habitudes fixes dont il ne lui est plus permis de se départir. En un mot, il n’appartient plus à lui-même, mais à la profession qu’il a choisie. C’est en vain que les lois et les mœurs ont pris soin de briser autour de cet homme toutes les barrières et de lui ouvrir de tous côtés mille chemins différents vers la fortune ; une théorie industrielle plus puissante que les mœurs et les lois, l’a attaché à un métier, et souvent à un lieu qu’il ne peut quitter. Elle lui a assigné dans la société une certaine place dont il ne peut sortir. Au milieu du mouvement universel, elle l’a rendu immobile.
À mesure que le principe de la division du travail reçoit une application plus complète, l’ouvrier devient plus faible, plus borné et plus dépendant. L’art fait des progrès, l’artisan rétrograde. D’un autre côté, à mesure qu’il se découvre plus manifestement que les produits d’une industrie sont d’autant plus parfaits et d’autant moins chers que la manufacture est plus vaste et le capital plus grand, des hommes très-riches et très-éclairés se présentent pour exploiter des industries qui, jusque-là, avaient été livrées à des artisans ignorants ou malaisés. La grandeur des efforts nécessaires et l’immensité des résultats à obtenir les attire.
Ainsi donc, dans le même temps que la science [III-324] industrielle abaisse sans cesse la classe des ouvriers elle élève celle des maîtres.
Tandis que l’ouvrier ramène de plus en plus son intelligence à l’étude d’un seul détail, le maître promène chaque jour ses regards sur un plus vaste ensemble, et son esprit s’étend en proportion que celui de l’autre se resserre. Bientôt il ne faudra plus au second que la force physique sans l’intelligence ; le premier a besoin de la science, et presque du génie pour réussir. L’un ressemble de plus en plus à l’administrateur d’un vaste empire, et l’autre à une brute.
Le maître et l’ouvrier n’ont donc ici rien de semblable, et ils diffèrent chaque jour davantage. Ils ne se tiennent que comme les deux anneaux extrêmes d’une longue chaîne. Chacun occupe une place qui est faite pour lui, et dont il ne sort point. L’un est dans une dépendance continuelle, étroite et nécessaire de l’autre, et semble né pour obéir, comme celui-ci pour commander.
Qu’est-ce ceci, sinon de l’aristocratie ?
Les conditions venant à s’égaliser de plus en plus dans le corps de la nation, le besoin des objets manufacturés s’y généralise et s’y accroît, et le bon marché qui met ces objets à la portée des fortunes médiocres, devient un plus grand élément de succès.
Il se trouve donc chaque jour que des hommes [III-325] plus opulents et plus éclairés, consacrent à l’industrie leurs richesses et leurs sciences, et cherchent en ouvrant de grands ateliers, et en divisant strictement le travail, à satisfaire les nouveaux désirs qui se manifestent de toutes parts.
Ainsi, à mesure que la masse de la nation tourne à la démocratie, la classe particulière qui s’occupe d’industrie devient plus aristocratique. Les hommes se montrent de plus en plus semblables dans l’une, et de plus en plus différents dans l’autre, et l’inégalité augmente dans la petite société, en proportion qu’elle décroît dans la grande.
C’est ainsi que, lorsqu’on remonte à la source, il semble qu’on voie l’aristocratie sortir par un effort naturel du sein même de la démocratie.
Mais cette aristocratie-là ne ressemble point à celles qui l’ont précédée.
On remarquera d’abord, que ne s’appliquant qu’à l’industrie et à quelques-unes des professions industrielles seulement, elle est une exception, un monstre dans l’ensemble de l’état social.
Les petites sociétés aristocratiques que forment certaines industries au milieu de l’immense démocratie de nos jours, renferment comme les grandes sociétés aristocratiques des anciens temps, quelques hommes très-opulents et une multitude très-misérable. Ces pauvres ont peu de moyens de sortir de leur condition et de devenir [III-326] riches, mais les riches deviennent sans cesse des pauvres, ou quittent le négoce après avoir réalisé leurs profits. Ainsi, les éléments qui forment la classe des pauvres sont à peu près fixes ; mais les éléments qui composent la classe des riches ne le sont pas. À vrai dire, quoiqu’il y ait des riches, la classe des riches n’existe point ; car ces riches n’ont pas d’esprit ni d’objets communs, de traditions ni d’espérances communes. Il y a donc des membres, mais point de corps.
Non seulement les riches ne sont pas unis solidement entre eux, mais on peut dire qu’il n’y a pas de lien véritable entre le pauvre et le riche.
Ils ne sont pas fixés à perpétuité l’un près de l’autre ; à chaque instant l’intérêt les rapproche et les sépare. L’ouvrier dépend en général des maîtres, mais non de tel maître. Ces deux hommes se voient à la fabrique et ne se connaissent pas ailleurs, et tandis qu’ils se touchent par un point, ils restent fort éloignés par tous les autres. Le manufacturier ne demande à l’ouvrier que son travail, et l’ouvrier n’attend de lui que le salaire. L’un ne s’engage point à protéger, ni l’autre à défendre, et ils ne sont liés d’une manière permanente, ni par l’habitude, ni par le devoir. L’aristocratie que fonde le négoce ne se fixe presque jamais au milieu de la population industrielle qu’elle dirige ; son but n’est point de gouverner celle-ci, mais de s’en servir.
[III-327]
Une aristocratie ainsi constituée ne saurait avoir une grande prise sur ceux qu’elle emploie ; et parvint-elle à les saisir un moment, bientôt ils lui échappent. Elle ne sait pas vouloir et ne peut agir.
L’aristocratie territoriale des siècles passés était obligée par la loi, ou se croyait obligée par les mœurs, de venir au secours de ses serviteurs et de soulager leurs misères. Mais l’aristocratie manufacturière de nos jours, après avoir appauvri et abruti les hommes dont elle se sert, les livre en temps de crise à la charité publique pour les nourrir. Ceci résulte naturellement de ce qui précède. Entre l’ouvrier et le maître, les rapports sont fréquents, mais il n’y a pas d’association véritable.
Je pense, qu’à tout prendre, l’aristocratie manufacturière que nous voyons s’élever sous nos yeux est une des plus dures qui aient paru sur la terre ; mais elle est en même temps une des plus restreintes et des moins dangereuses.
Toutefois, c’est de ce côté que les amis de la démocratie doivent sans cesse tourner avec inquiétude leurs regards ; car, si jamais l’inégalité permanente des conditions et l’aristocratie pénètrent de nouveau dans le monde, on peut prédire qu’elles y entreront par cette porte.
FIN DU TOME TROISIÈME.↩
[III-329]
NOTE.↩
NOTE, PAGE 316.
Il y a cependant des aristocraties qui ont fait avec ardeur le commerce, et cultivé avec succès l’industrie. L’histoire du monde en offre plusieurs éclatants exemples. Mais, en général, on doit dire que l’aristocratie n’est point favorable au développement de l’industrie et du commerce. Il n’y a que les aristocraties d’argent qui fassent exception à cette règle.
Chez celles-là, il n’y a guère de désir qui n’ait besoin des richesses pour se satisfaire. L’amour des richesses devient, pour ainsi dire, le grand chemin des passions humaines. Tous les autres y aboutissent ou le traversent.
Le goût de l’argent et la soif de la considération et du pouvoir se confondent alors si bien, dans les mêmes âmes, qu’il devient difficile de discerner si c’est par ambition que les hommes sont cupides, ou si c’est par cupidité qu’ils sont ambitieux. C’est ce qui arrive en Angleterre où l’on veut être riche pour parvenir aux honneurs, et où l’on désire les honneurs comme manifestation de la richesse. L’esprit humain est alors saisi par tous les bouts et entraîné vers le commerce et l’industrie qui sont les routes les plus courtes qui mènent à l’opulence.
[III-330]
Ceci, du reste, me semble un fait exceptionnel et transitoire. Quand la richesse est devenue le seul signe de l’aristocratie, il est bien difficile que les riches se maintiennent seuls au pouvoir et en excluent tous les autres.
L’aristocratie de naissance et la pure démocratie sont aux deux extrémités de l’état social et politique des italiens ; au milieu se trouve l’aristocratie d’argent ; celle-ci se rapproche de l’aristocratie de naissance en ce qu’elle confère à un petit nombre de citoyens de grands privilèges ; elle tient à la démocratie en ce que les privilèges peuvent être successivement acquis par tous ; elle forme souvent comme une transition naturelle entre ces deux choses, et l’on ne saurait dire si elle termine le règne des institutions aristocratiques, ou si déjà elle ouvre la nouvelle ère de la démocratie.
Notes volume 3↩
[1] (↑) Dans toutes les religions, il y a des cérémonies qui sont inhérentes à la substance même de la croyance et à laquelle il faut bien se garder de rien changer. Cela se voir particulièrement dans le catholicisme où souvent la forme et le fond sont si étroitement unies qu’ils ne font qu’un.
[2] (↑) Tout ceci est surtout vrai des pays aristocratiques, qui ont été longtemps et paisiblement soumis au pouvoir d’un roi.
Quand la liberté règne dans une aristocratie, les hautes classes sont sans cesse obligées de se servir des basses ; et, en s’en servant, elles s’en rapprochent. Cela fait souvent pénétrer quelque chose de l’esprit démocratique dans leur sein. Il se développe, d’ailleurs, chez un corps privilégié qui gouverne une énergie et une habitude d’entreprise, un goût du mouvement et du bruit, qui ne peuvent manquer d’influer sur tous les travaux littéraires.
[3] (↑) Je dis un peuple démocratique. L’administration peut être très décentralisée chez un peuple aristocratique, sans que le besoin des journaux se fasse sentir, parce que les pouvoirs locaux sont alors dans les mains d’un très petit nombre d’hommes qui agissent isolément ou qui se connaissent et peuvent aisément se voir et s’entendre.
[4] (↑) Cela est surtout vrai lorsque c’est le pouvoir exécutif qui est chargé de permettre ou de défendre les associations suivant sa volonté arbitraire.
Quand la loi se borne à prohiber certaines associations et laisse aux tribunaux le soin de punir ceux qui désobéissent, le mal est bien moins grand ; chaque citoyen sait alors à peu près d’avance sur quoi compter ; il se juge en quelque sorte lui-même avant ses juges, et s’écartant des associations défendues, il se livre aux associations permises. C’est ainsi que tous les peuples libres ont toujours compris qu’on pouvait restreindre le droit d’association. Mais s’il arrivait que le législateur chargeât un homme de démêler d’avance quelles sont les associations dangereuses et utiles, et le laissât libre de détruire toutes les associations dans leur germe ou de les laisser naître, personne ne pouvant plus prévoir d’avance dans quel cas on peut s’associer, et dans quel autre il faut s’en abstenir, l’esprit d’association serait entièrement frappé d’inertie. La première de ces deux lois n’attaque que certaines associations, la seconde s’adresse à la société elle-même et la blesse. Je conçois qu’un gouvernement régulier ait recours à la première, mais je ne reconnais à aucun gouvernement le droit de porter la seconde.
[5] (↑) On a remarqué plusieurs fois que les industriels et les commerçants étaient possédés du goût immodéré des jouissances matérielles, et on a accusé de cela le commerce et l’industrie, je crois qu’ici on a pris l’effet pour la cause.
Ce n’est pas le commerce et l’industrie qui suggèrent le goût des jouissances matérielles aux hommes, mais plutôt ce goût qui porte les hommes vers les carrières industrielles et commerçantes, où ils espèrent se satisfaire plus complètement et plus vite.
Si le commerce et l’industrie font augmenter le désir du bien-être, cela vient de ce que toute passion se fortifie à mesure qu’on s’en occupe davantage, et s’accroît par tous les efforts qu’on tente pour l’assouvir.
Toutes les causes qui font prédominer dans le cœur humain l’amour des biens de ce monde développent le commerce et l’industrie. L’égalité est une de ces causes. Elle favorise le commerce, non point directement en donnant aux hommes le goût du négoce, mais indirectement en fortifiant et généralisant dans leurs âmes l’amour du bien-être.
[6] (↑) Voir la note à la fin du volume.
Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Tome 4 (1848)
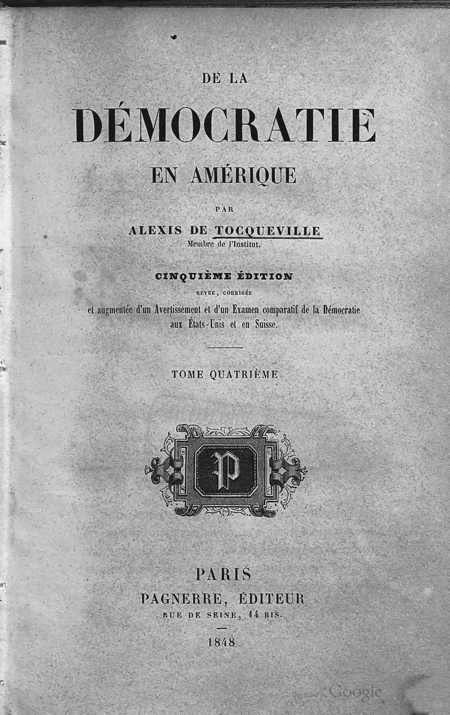
[IV-387]
TABLE DU QUATRIÈME VOLUME↩
TROISIÈME PARTIE. Influence de la démocratie sur les mœurs proprement dites.
- Chapitre I. — Comment les mœurs s’adoucissent à mesure que les conditions n’égalisent. p. 1
- Chapitre II. — Comment la démocratie rend les rapports habituels des Américains plus simples et plus aisés. p. 11
- Chapitre III. — Pourquoi les Américains ont si peu de susceptibilité dans leur pays, et se montrent si susceptibles dans le nôtre. p. 17
- Chapitre IV. — Conséquence des trois Chapitres précédents. p. 25
- Chapitre V. — Comment la démocratie modifie les rapports du serviteur et du maître. p. 29
- Chapitre VI. — Comment les institutions et les mœurs démocratiques tendent à élever le prix et à raccourcir la durée des baux. p. 47
- Chapitre VII. — Influence de la démocratie sur les salaires. p. 53
- Chapitre VIII. — Influence de la démocratie sur la famille. p. 59
- Chapitre IX. — Éducation des jeunes filles aux États-Unis. p. 71
- Chapitre X. — Comment la jeune fille se retrouve sous les traits de l’épouse. p. 77
- Chapitre XI. — Comment l’égalité des conditions contribue à maintenir les bonnes mœurs en Amérique. p. 83
- Chapitre XII. — Comment les Américains comprennent l’égalité de l’homme et de la femme. p. 97
- Chapitre XIII. — Comment l’égalité divise naturellement les Américains en une multitude de petites sociétés particulières. p. 105
- Chapitre XIV. — Quelques réflexions sur les manières américaines. p. 109
- Chapitre XV. — De la gravité des Américains, et qu’elle ne les empêche pas de faire souvent des choses inconsidérées. p. 117
- Chapitre XVI. — Pourquoi la vanité nationale des Américains est plus inquiète et plus querelleuse que celle des Anglais. p. 125
- Chapitre XVII. — Comment l’aspect de la société, aux États-Unis, est tout à la fois agité et monotone. p. 130
- Chapitre XVIII. — De l’honneur aux États-Unis et dans les sociétés démocratiques. p. 137
- Chapitre XIX. — Pourquoi on trouve aux États-Unis tant d’ambitieux et si peu de grandes ambitions. p. 162
- Chapitre XX. — De l’industrie des places chez certaines nations démocratiques. p. 175
- Chapitre XXI. — Pourquoi les grandes révolutions deviendront rares. p. 179
- Chapitre XXII. — Pourquoi les peuples démocratiques désirent naturellement la paix, et les armées démocratiques naturellement la guerre. p. 205
- Chapitre XXIII. — Quelle est, dans les armées démocratiques, la classe la plus démocratique et la plus révolutionnaire. p. 219
- Chapitre XXIV. — Ce qui rend les armées démocratiques plus faibles que les autres armées en entrant en campagne, et plus redoutables quand la guerre se prolonge. p. 227
- Chapitre XXV. — De la discipline dans les armées démocratiques. p. 237
- Chapitre XXVI. — Quelques considérations sur la guerre dans les sociétés démocratiques. p. 241
QUATRIÈME PARTIE.De l’influence qu’exercent les idées et les sentiments démocratiques sur la société politique.
- Chapitre I. — L’égalité donne naturellement aux hommes le goût des institutions libres. p. 254
- Chapitre II. — Que les idées des peuples démocratiques en matiére de gouvernement sont naturellement favorables à la concentration des pouvoirs. p. 257
- Chapitre III. — Que les sentiments des peuples démocratiques sont d’accord avec leurs idées pour les porter à concentrer le pouvoir. p. 265
- Chapitre IV. — De quelques causes particulières et accidentelles qui achèvent de porter un peuple démocratique à centraliser le pouvoir ou qui l’en détournent. p. 273
- Chapitre V. — Que parmi les nations européennes de nos jours, le pouvoir souverain s’accroît, quoique les souverains soient moins stables. p. 285
- Chapitre VI. — Quelle espèce de despotisme les nations démocratiques ont à craindre. p. 309
- Chapitre VII. — Suite des Chapitres précédents. p. 321
- Chapitre VIII. — Vue générale du sujet. p. 339
Notes. p. 347
Appendice. p. 361
[IV-1]
DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE.
TROISIÈME PARTIE
INFLUENCE DE LA DÉMOCRATIE SUR LES MŒURS PROPREMENT DITES.↩
CHAPITRE I.↩
Comment les mœurs s’adoucissent à mesure que les conditions s’égalisent.
Nous apercevons, depuis plusieurs siècles, que les conditions s’égalisent, et nous découvrons en même temps que les mœurs s’adoucissent. Ces deux choses sont-elles seulement contemporaines, ou existe-t-il entre elles quelque lien secret, de telle [IV-2] sorte que l’une ne puisse avancer sans faire marcher l’autre ?
Il y a plusieurs causes qui peuvent concourir à rendre les mœurs d’un peuple moins rudes ; mais, parmi toutes ces causes, la plus puissante me paraît être l’égalité des conditions. L’égalité des conditions et l’adoucissement des mœurs ne sont donc pas seulement à mes yeux des événements contemporains, ce sont encore des faits corrélatifs.
Lorsque les fabulistes veulent nous intéresser aux actions des animaux, ils donnent à ceux-ci des idées et des passions humaines. Ainsi font les poètes quand ils parlent des génies et des anges. Il n’y a point de si profondes misères, ni de félicités si pures qui puissent arrêter notre esprit et saisir notre cœur, si on ne nous représente à nous-mêmes sous d’autres traits.
Ceci s’applique fort bien au sujet qui nous occupe présentement.
Lorsque tous les hommes sont rangés d’une manière irrévocable, suivant leur profession, leurs biens et leur naissance, au sein d’une société aristocratique, les membres de chaque classe se considérant tous comme enfants de la même famille, éprouvent les uns pour les autres une sympathie continuelle et active qui ne peut jamais se rencontrer au même degré parmi les citoyens d’une démocratie.
[IV-3]
Mais il n’en est pas de même des différentes classes vis-à-vis les unes des autres.
Chez un peuple aristocratique chaque caste a ses opinions, ses sentiments, ses droits, ses mœurs, son existence à part. Ainsi les hommes qui la composent ne ressemblent point à tous les autres ; ils n’ont point la même manière de penser ni de sentir, et c’est à peine s’ils croient faire partie de la même humanité.
Ils ne sauraient donc bien comprendre ce que les autres éprouvent, ni juger ceux-ci par eux-mêmes.
On les voit quelquefois pourtant se prêter avec ardeur un mutuel secours ; mais cela n’est pas contraire à ce qui précède.
Ces mêmes institutions aristocratiques, qui avaient rendu si différents les êtres d’une même espèce, les avaient cependant unis les uns aux autres par un lien politique fort étroit.
Quoique le serf ne s’intéressât pas naturellement au sort des nobles, il ne s’en croyait pas moins obligé de se dévouer pour celui d’entre eux qui était son chef ; et, bien que le noble se crût d’une autre nature que les serfs, il jugeait néanmoins que son devoir et son honneur le contraignaient à défendre, au péril de sa propre vie, ceux qui vivaient sur ses domaines.
Il est évident que ces obligations mutuelles ne [IV-4] naissaient pas du droit naturel, mais du droit politique, et que la société obtenait plus que l’humanité seule n’eût pu faire. Ce n’était point à l’homme qu’on se croyait tenu de prêter appui ; c’était au vassal ou au seigneur. Les institutions féodales rendaient très sensible aux maux de certains hommes, non point aux misères de l’espèce humaine. Elles donnaient de la générosité aux mœurs plutôt que de la douceur, et, bien qu’elles suggérassent de grands dévouements, elles ne faisaient pas naître de véritables sympathies ; car il n’y a de sympathies réelles qu’entre gens semblables ; et, dans les siècles aristocratiques, on ne voit ses semblables que dans les membres de sa caste.
Lorsque les chroniqueurs du moyen âge, qui tous, par leur naissance ou leurs habitudes, appartenaient à l’aristocratie, rapportent la fin tragique d’un noble, ce sont des douleurs infinies ; tandis qu’ils racontent tout ne haleine et sans sourciller le massacre et les tortures des gens du peuple.
Ce n’est point que ces écrivains éprouvassent une haine habituelle ou un mépris systématique pour le peuple. La guerre entre les diverses classes de l’État n’était point encore déclarée. Ils obéissaient à un instinct plutôt qu’à une passion ; comme ils ne se formaient pas une idée nette des [IV-5] souffrances du pauvre, ils s’intéressaient faiblement à son sort.
Il en était ainsi des hommes du peuple, dès que le lien féodal venait à se briser. Ces mêmes siècles qui ont vu tant de dévouements héroïques de la part des vassaux pour leurs seigneurs, ont été témoins de cruautés inouies, exercées de temps en temps par les basses classes sur les hautes.
Il ne faut pas croire que cette insensibilité mutuelle tînt seulement au défaut d’ordre et de lumières ; car on en retrouve la trace dans les siècles suivants, qui, tout en devenant réglés et éclairés, sont encore restés aristocratiques.
En l’année 1675, les basses classes de la Bretagne s’émurent à propos d’une nouvelle taxe. Ces mouvements tumultueux furent réprimes avec une atrocité sans exemple. Voici comment madame de Sévigné, témoin de ces horreurs, en rend compte à sa fille :
Aux Rochers, 3 octobre 1675.
« Mon Dieu, ma fille, que votre lettre d’Aix est plaisante. Au moins relisez vos lettres avant que de les envoyer. Laissez-vous surprendre à leur agrément et consolez-vous, par ce plaisir, de la peine que vous avez d’en tant écrire. Vous avez donc baisé toute la Provence ? il n’y aurait pas satisfaction à baiser toute la Bretagne, à moins [IV-6] qu’on n’aimât à sentir le vin. Voulez-vous savoir des nouvelles de Rennes ? On a fait une taxe de cent mille écus, et si on ne trouve point cette somme dans vingt-quatre heures, elle sera doublée et exigible par les soldats. On a chassé et banni toute une grande rue, et défendu de recueillir les habitants sous peine de la vie ; de sorte qu’on voyait tous ces misérables, femmes accouchées, vieillards, enfants, errer en pleurs au sortir de cette ville, sans savoir où aller, sans avoir de nourriture, ni de quoi se coucher. Avant-hier on roua le violon qui avait commencé la danse et la pillerie du papier timbré ; il a été écartelé, et ses quatre quartiers exposés aux quatre coins de la ville. On a pris soixante bourgeois, et on commence demain à pendre. Cette province est un bel exemple pour les autres, et surtout de respecter les gouverneurs et les gouvernantes, et de ne point jeter de pierres dans leur jardin [1] .
« Mme de Tarente était hier dans ses bois par un temps enchanté. Il n’est question ni de chambre ni de collation. Elle entre par la barrière et s’en retourne de même… »
Dans une autre lettre elle ajoute :
« Vous me parlez bien plaisamment de nos [IV-7] misères ; nous ne sommes plus si roués ; un en huit jours, pour entretenir la justice. Il est vrai que la penderie me parait maintenant un rafraîchissement. J’ai une tout autre idée de la justice, depuis que je suis dans ce pays. Vos galériens me paraissent une société d’honnêtes gens qui se sont retirés du monde pour mener une vie douce. »
On aurait tort de croire que madame de Sévigné, qui traçait ces lignes, fût une créature égoïste et barbare : elle aimait avec passion ses enfants, et se montrait fort sensible aux chagrins de ses amis ; et l’on aperçoit même, en la lisant, qu’elle traitait avec bonté et indulgence ses vassaux et ses serviteurs. Mais madame de Sévigné ne concevait pas clairement ce que c’était que de souffrir quand on n’était pas gentilhomme.
De nos jours, l’homme le plus dur, écrivant à la personne la plus insensible, n’oserait se livrer de sang-froid au badinage cruel que je viens de reproduire, et, lors même que ses mœurs particulières lui permettraient de le faire, les mœurs générales de la nation le lui défendraient.
D’où vient cela ? Avons-nous plus de sensibilité que nos pères ? Je ne sais ; mais, a coup sûr, notre sensibilité se porte sur plus d’objets.
Quand les rangs sont presque égaux chez un peuple, tous les hommes ayant à peu près la même [IV-8] manière de penser et de sentir, chacun d’eux peut juger en un moment des sensations de tous les autres : il jette un coup d’œil rapide sur lui-même ; cela lui suffit. Il n’y a donc pas de misères qu’il ne conçoive sans peine, et dont un instinct secret ne lui découvre l’étendue. En vain s’agira-t-il d’étrangers ou d’ennemis : l’imagination le met aussitôt à leur place. Elle mêle quelque chose de personnel a sa pitié, et le fait souffrir lui-même tandis qu’on déchire le corps de son semblable.
Dans les siècles démocratiques, les hommes se dévouent rarement les uns pour les autres ; mais ils montrent une compassion générale pour tous les membres de l’espèce humaine. On ne les voit point infliger de maux inutiles, et quand, sans se nuire beaucoup à eux-mêmes, ils peuvent soulager les douleurs d’autrui, ils prennent plaisir à le faire ; ils ne sont pas désintéressés, mais ils sont doux.
Quoique les Américains aient pour ainsi dire réduit l’égoïsme en théorie sociale et philosophique, ils ne s’en montrent pas moins fort accessibles à la pitié.
Il n’y a point de pays où la justice criminelle soit administrée avec plus de bénignité qu’aux États-Unis. Tandis que les Anglais semblent vouloir conserver précieusement dans leur législation [IV-9] pénale les traces sanglantes du moyen-âge, les Américains ont presque fait disparaître la peine de mort de leurs codes.
L’Amérique du nord est, je pense, la seule contrée sur la terre où, depuis cinquante ans, on n’ait point arraché la vie à un seul citoyen pour délits politiques.
Ce qui achève de prouver que cette singulière douceur des Américains vient principalement de leur état social, c’est la manière dont ils traitent leurs esclaves.
Peut-être n’existe-t-il pas, à tout prendre, de colonie européenne dans le Nouveau-Monde où la condition physique des noirs soit moins dure qu’aux États-Unis. Cependant les esclaves y éprouvent encore d’affreuses misères, et sont sans cesse exposés à des punitions très-cruelles.
Il est facile de découvrir que le sort de ces infortunés inspire peu de pitié à leurs maîtres, et qu’ils voient dans l’esclavage non seulement un fait dont ils profitent, mais encore un mal qui ne les touche guère. Ainsi, le même homme qui est plein d’humanité pour ses semblables quand ceux-ci sont en même temps ses égaux, devient insensible à leurs douleurs dès que l’égalité cesse. C’est donc à cette égalité qu’il faut attribuer sa douceur, plus encore qu’à la civilisation et aux lumières.
[IV-10]
Ce que je viens de dire des individus s’applique jusqu’à un certain point aux peuples.
Lorsque chaque nation a ses opinions, ses croyances, ses lois, ses usages à part, elle se considère comme formant à elle seule l’humanité tout entière, et ne se sent touchée que de ses propres douleurs. Si la guerre vient à s’allumer entre deux peuples disposés de cette manière, elle ne saurait manquer de se faire avec barbarie.
Au temps de leurs plus grandes lumières, les Romains égorgeaient les généraux ennemis, après les avoir traînés en triomphe derrière un char, et livraient les prisonniers aux bêtes pour l’amusement du peuple. Cicéron, qui pousse de si grands gémissements, à l’idée d’un citoyen mis en croix, ne trouve rien à redire à ces atroces abus de la victoire. Il est évident qu’à ses yeux un étranger n’est point de la même espèce humaine qu’un Romain.
À mesure, au contraire, que les peuples deviennent plus semblables les uns aux autres, ils se montrent réciproquement plus compatissants pour leurs misères, et le droit des gens s’adoucit.
[IV-11]
CHAPITRE II.↩
Comment la démocratie rend les rapports habituels des Américains plus simples et plus aisés.
La démocratie n’attache point fortement les hommes les uns aux autres, mais elle rend leurs rapports habituels plus aisés.
Deux Anglais se rencontrent par hasard aux antipodes ; ils sont entourés d’étrangers dont ils connaissent à peine la langue et les mœurs.
Ces deux hommes se considèrent d’abord fort curieusement et avec une sorte d’inquiétude secrète ; puis ils se détournent, ou, s’ils s’abordent, ils ont soin de ne se parler que d’un air contraint [IV-12] et distrait, et de dire des choses peu importantes.
Cependant il n’existe entre eux aucune inimitié ; ils ne se sont jamais vus, et se tiennent réciproquement pour fort honnêtes. Pourquoi mettent-ils donc tant de soin à s’éviter ?
Il faut retourner en Angleterre pour le comprendre.
Lorsque c’est la naissance seule, indépendamment de la richesse, qui classe les hommes, chacun sait précisément le point qu’il occupe dans l’échelle sociale ; il ne cherche pas à monter, et ne craint pas de descendre. Dans une société ainsi organisée, les hommes des différentes castes communiquent peu les uns avec les autres ; mais, lorsque le hasard les met en contact, ils s’abordent volontiers, sans espérer ni redouter de se confondre. Leurs rapports ne sont pas basés sur l’égalité ; mais ils ne sont pas contraints.
Quand à l’aristocratie de naissance succède l’aristocratie d’argent, il n’en est plus de même.
Les privilèges de quelques-uns sont encore très-grands, mais la possibilité de les acquérir est ouverte à tous ; d’où il suit que ceux qui les possèdent sont préoccupés sans cesse par la crainte de les perdre ou de les voir partager : et ceux qui ne les ont pas encore veulent à tout prix les posséder, ou, s’ils ne peuvent y réussir, le paraître ; ce qui n’est point impossible. Comme la valeur [IV-13] sociale des hommes n’est plus fixée d’une manière ostensible et permanente par le sang, et qu’elle varie à l’infini suivant la richesse, les rangs existent toujours, mais on ne voit plus clairement et du premier coup d’œil ceux qui les occupent.
Il s’établit aussitôt une guerre sourde entre tous les citoyens ; les uns s’efforcent, par mille artifices, de pénétrer en réalité ou en apparence parmi ceux qui sont au-dessus d’eux ; les autres combattent sans cesse pour repousser ces usurpateurs de leurs droits, ou plutôt le même homme fait les deux choses, et tandis qu’il cherche à s’introduire dans la sphère supérieure, il lutte sans relâche contre l’effort qui vient d’en bas.
Tel est de nos jours l’état de l’Angleterre, et je pense que c’est à cet état qu’il faut principalement rapporter ce qui précède.
L’orgueil aristocratique étant encore très-grand chez les Anglais, et les limites de l’aristocratie étant devenues douteuses, chacun craint à chaque instant que sa familiarité ne soit surprise. Ne pouvant juger du premier coup d’œil quelle est la situation sociale de ceux qu’on rencontre, l’on évite prudemment d’entrer en contact avec eux. On redoute, en rendant de légers services, de former malgré soi une amitié mal assortie ; on craint les bons offices, et l’on se soustrait à la [IV-14] reconnaissance indiscrète d’un inconnu aussi soigneusement qu’à sa haine.
Il y a beaucoup de gens qui expliquent par des causes purement physiques cette insociabilité singulière et cette humeur réservée et taciturne des Anglais. Je veux bien que le sang y soit en effet pour quelque chose ; mais je crois que l’état social y est pour beaucoup plus. L’exemple des Américains vient le prouver.
En Amérique, où les privilèges de naissance n’ont jamais existé, et où la richesse ne donne aucun droit particulier à celui qui la possède, des inconnus se réunissent volontiers dans les mêmes lieux, et ne trouvent ni avantage ni péril à se communiquer librement leurs pensées. Se rencontrent-ils par hasard, ils ne se cherchent ni ne s’évitent ; leur abord est donc naturel, franc et ouvert ; on voit qu’ils n’espèrent et ne redoutent presque rien les uns des autres, et qu’ils ne s’efforcent pas plus de montrer que de cacher la place qu’ils occupent. Si leur contenance est souvent froide et sérieuse, elle n’est jamais hautaine ni contrainte ; et quand ils ne s’adressent point la parole, c’est qu’ils ne sont pas en humeur de parler, et non qu’ils croient avoir intérêt à se taire.
En pays étranger, deux Américains sont sur-le-champ amis, par cela seul qu’ils sont Américains. Il n’y a point de préjugé qui les repousse, et [IV-15] la communauté de patrie les attire. À deux Anglais le même sang ne suffit point : il faut que le même rang les rapproche.
Les Américains remarquent aussi bien que nous cette humeur insociable des Anglais entre eux, et ils ne s’en étonnent pas moins que nous ne le faisons nous-mêmes. Cependant les Américains tiennent à l’Angleterre par l’origine, la religion, la langue et en partie les mœurs ; ils n’en diffèrent que par l’état social. Il est donc permis de dire que la réserve des Anglais découle de la constitution du pays bien plus que de celle des citoyens.
[IV-17]
CHAPITRE III.↩
Pourquoi les américains ont si peu de susceptibilité dans leur pays et se montrent si susceptibles dans le nôtre.
Les Américains ont un tempérament vindicatif comme tous les peuples sérieux et réfléchis. Ils n’oublient presque jamais une offense ; mais il n’est point facile de les offenser, et leur ressentiment est aussi lent à s’allumer qu’à s’éteindre.
Dans les sociétés aristocratiques, où un petit nombre d’individus dirigent toutes choses, les rapports extérieurs des hommes entre eux, sont soumis à des conventions à peu près fixes. Chacun croit alors savoir, d’une manière précise, par [IV-18] quel signe il convient de témoigner son respect, ou de marquer sa bienveillance, et l’étiquette est une science dont on ne suppose pas l’ignorance.
Ces usages de la première classe servent ensuite de modèle à toutes les autres, et, de plus, chacune de celles-ci se fait un code à part, auquel tous ses membres sont tenus de se conformer.
Les règles de la politesse forment ainsi une législation compliquée, qu’il est difficile de posséder complètement, et dont pourtant il n’est pas permis de s’écarter sans péril ; de telle sorte, que chaque jour les hommes sont sans cesse exposés à faire ou à recevoir involontairement de cruelles blessures.
Mais à mesure que les rangs s’effacent, que des hommes divers par leur éducation et leur naissance se mêlent et se confondent dans les mêmes lieux, il est presque impossible de s’entendre sur les règles du savoir-vivre. La loi étant incertaine, y désobéir n’est point un crime aux yeux mêmes de ceux qui la connaissent ; on s’attache donc au fond des actions plutôt qu’à la forme, et l’on est tout à la fois moins civil et moins querelleur.
Il y a une foule de petits égards auxquels un Américain ne tient point : il juge qu’on ne les lui doit pas, ou il suppose qu’on ignore les lui devoir. Il ne s’aperçoit donc pas qu’on lui manque, ou bien il le pardonne ; ses manières en deviennent [IV-19] moins courtoises, et ses mœurs plus simples et plus mâles.
Cette indulgence réciproque que font voir les Américains, et cette virile confiance qu’ils se témoignent, résultent encore d’une cause plus générale et plus profonde. Je l’ai déjà indiquée dans le chapitre précédent.
Aux États-Unis, les rangs ne diffèrent que fort peu dans la société civile, et ne diffèrent point du tout dans le monde politique ; un Américain ne se croit donc pas tenu à rendre des soins particuliers à aucun de ses semblables, et il ne songe pas non plus à en exiger pour lui-même. Comme il ne voit point que son intérêt soit de rechercher avec ardeur la compagnie de quelques uns de ses concitoyens, il se figure difficilement qu’on repousse la sienne ; ne méprisant personne à raison de la condition, il n’imagine point que personne le méprise pour la même cause, et jusqu’à ce qu’il ait aperçu clairement l’injure, il ne croit pas qu’on veuille l’outrager.
L’état social dispose naturellement les Américains à ne point s’offenser aisément dans les petites choses. Et d’une autre part, la liberté démocratique dont ils jouissent, achève de faire passer cette mansuétude dans les mœurs nationales.
Les institutions politiques des États-Unis mettent sans cesse en contact les citoyens de toutes [IV-20] les classes, et les forcent de suivre en commun de grandes entreprises. Des gens ainsi occupés n’ont guère le temps de songer aux détails de l’étiquette, et ils ont d’ailleurs trop d’intérêt à vivre d’accord, pour s’y arrêter. Ils s’accoutument donc aisément a considérer, dans ceux avec lesquels ils se rencontrent, les sentiments et les idées, plutôt que les manières, et ils ne se laissent point émouvoir pour des bagatelles.
J’ai remarqué bien des fois qu’aux États-Unis, ce n’est point une chose aisée que de faire entendre à un homme que sa présence importune. Pour en arriver là, les voies détournées ne suffisent point toujours.
Je contredis un Américain à tout propos, afin de lui faire sentir que ses discours me fatiguent ; et à chaque instant je lui vois faire de nouveaux efforts pour me convaincre ; je garde un silence obstiné, et il s’imagine que je réfléchis profondément aux vérités qu’il me présente ; et quand je me dérobe enfin tout à coup à sa poursuite, il suppose qu’une affaire pressante m’appelle ailleurs. Cet homme ne comprendra pas qu’il m’excède, sans que je le lui dise, et je ne pourrai me sauver de lui qu’en devenant son ennemi mortel.
Ce qui surprend au premier abord, c’est que ce même homme transporté en Europe y devient [IV-21] tout à coup d’un commerce méticuleux et difficile, à ce point que souvent je rencontre autant de difficulté à ne point l’offenser que j’en trouvais à lui déplaire. Ces deux effets si différents sont produits par la même cause.
Les institutions démocratiques donnent en général aux hommes une vaste idée de leur patrie et d’eux-mêmes. L’Américain sort de son pays le cœur gonflé d’orgueil. Il arrive en Europe, et s’aperçoit d’abord qu’on ne s’y préoccupe point autant qu’il se l’imaginait des États-Unis et du grand peuple qui les habite. Ceci commence à l’émouvoir.
Il a entendu dire que les conditions ne sont point égales dans notre hémisphère. Il s’aperçoit en effet que parmi les nations de l’Europe la trace des rangs n’est pas entièrement effacée ; que la richesse et la naissance y conservent des privilèges incertains qu’il lui est aussi difficile de méconnaître que de définir. Ce spectacle le surprend et l’inquiète, parce qu’il est entièrement nouveau pour lui ; rien de ce qu’il a vu dans son pays ne l’aide à le comprendre. Il ignore donc profondément quelle place il convient d’occuper dans cette hiérarchie à moitié détruite, parmi ces classes qui sont assez distinctes pour se haïr et se mépriser, et assez rapprochées pour qu’il soit toujours prêt à les confondre. Il craint de se poser trop [IV-22] haut, et surtout d’être rangé trop bas: ce double péril tient constamment son esprit à la gêne, et embarrasse sans cesse ses actions comme ses discours.
La tradition lui a appris qu’en Europe le cérémonial variait à l’infini suivant les conditions ; ce souvenir d’un autre temps achève de le troubler, et il redoute d’autant plus de ne pas obtenir les égards qui lui sont dus, qu’il ne sait pas précisément en quoi ils consistent. Il marche donc toujours ainsi qu’un homme environné d’embûches ; la société n’est pas pour lui un délassement, mais un sérieux travail. Il pèse vos moindres démarches, interroge vos regards, et analyse avec soin tous vos discours, de peur qu’ils ne renferment quelques allusions cachées qui le blessent. Je ne sais s’il s’est jamais rencontré de gentilhomme campagnard plus pointilleux que lui sur l’article du savoir-vivre ; il s’efforce d’obéir lui-même aux moindres lois de l’étiquette, et il ne souffre pas qu’on en néglige aucune envers lui ; il est tout à la fois plein de scrupule et d’exigence ; il désirerait faire assez, mais il craint de faire trop, et, comme il ne connaît pas bien les limites de l’un et de l’autre, il se tient dans une réserve embarrassée et hautaine.
Ce n’est pas tout encore, et voici bien un autre détour du cœur humain.
[IV-23]
Un Américain parle tous les jours de l’admirable égalité qui règne aux États-Unis ; il s’en enorgueillit tout haut pour son pays ; mais il s’en afflige secrètement pour lui-même, et il aspire à montrer que, quant à lui, il fait exception à l’ordre général qu’il préconise.
On ne rencontre guère d’Américain qui ne veuille tenir quelque peu par sa naissance aux premiers fondateurs des colonies, et, quant aux rejetons de grandes familles d’Angleterre, l’Amérique m’en a semblé toute couverte.
Lorsqu’un Américain opulent aborde en Europe, son premier soin est de s’entourer de toutes les richesses du luxe ; et il a si grand’ peur qu’on ne le prenne pour le simple citoyen d’une démocratie, qu’il se replie de cent façons afin de présenter chaque jour devant vous une nouvelle image de sa richesse. Il se loge d’ordinaire dans le quartier le plus apparent de la ville ; il a de nombreux serviteurs qui l’entourent sans cesse.
J’ai entendu un Américain se plaindre que, dans les principaux salons de Paris, on ne rencontrât qu’une société mêlée. Le goût qui y règne ne lui paraissait pas assez pur, et il laissait entendre adroitement qu’à son avis, on y manquait de distinction dans les manières. Il ne s’habituait pas à voir l’esprit se cacher ainsi sous des formes vulgaires.
[IV-24]
De pareils contrastes ne doivent pas surprendre.
Si la trace des anciennes distinctions aristocratiques n’était pas si complètement effacée aux États-Unis, les Américains se montreraient moins simples et moins tolérants dans leur pays, moins exigeants et moins empruntés dans le nôtre.
[IV-25]
CHAPITRE IV.↩
Conséquences des trois chapitres précédents.
Lorsque les hommes ressentent une pitié naturelle pour les maux les uns des autres, que des rapports aisés et fréquents les rapprochent chaque jour sans qu’aucune susceptibilité les divise, il est facile de comprendre qu’au besoin ils se prêteront mutuellement leur aide. Lorsqu’un Américain réclame le concours de ses semblables, il est fort rare que ceux-ci le lui refusent, et j’ai observé souvent qu’ils le lui accordaient spontanément avec un grand zèle.
[IV-26]
Survient-il quelque accident imprévu sur la voie publique, on accourt de toutes parts autour de celui qui en est victime ; quelque grand malheur inopiné frappe-t-il une famille, les bourses de mille inconnus s’ouvrent sans peine ; des dons modiques, mais fort nombreux, viennent au secours de sa misère.
Il arrive fréquemment, chez les nations les plus civilisées du globe, qu’un malheureux se trouve aussi isolé au milieu de la foule que le sauvage dans ses bois ; cela ne se voit presque point aux États-Unis. Les Américains, qui sont toujours froids dans leurs manières, et souvent grossiers, ne se montrent presque jamais insensibles, et, s’ils ne se hâtent pas d’offrir des services, ils ne refusent point d’en rendre.
Tout ceci n’est point contraire à ce que j’ai dit ci-devant à propos de l’individualisme. Je vois même que ces choses s’accordent, loin de se combattre.
L’égalité des conditions, en même temps qu’elle fait sentir aux hommes leur indépendance, leur montre leur faiblesse ; ils sont libres, mais exposés à mille accidents, et l’expérience ne tarde pas à leur apprendre que, bien qu’ils n’aient pas un habituel besoin du secours d’autrui, il arrive presque toujours quelque moment où ils ne sauraient s’en passer.
[IV-27]
Nous voyons tous les jours en Europe que les hommes d’une même profession s’entraident volontiers ; ils sont tous exposés aux mêmes maux ; cela suffit pour qu’ils cherchent mutuellement à s’en garantir, quelque durs ou égoïstes qu’ils soient d’ailleurs. Lors donc que l’un d’eux est en péril, et que, par un petit sacrifice passager ou un élan soudain, les autres peuvent l’y soustraire, ils ne manquent pas de le tenter. Ce n’est point qu’ils s’intéressent profondément à son sort ; car, si, par hasard, les efforts qu’ils font pour le secourir sont inutiles, ils l’oublient aussitôt, et retournent à eux-mêmes ; mais il s’est fait entre eux une sorte d’accord tacite et presque involontaire, d’après lequel chacun doit aux autres un appui momentané qu’à son tour il pourra réclamer lui-même.
Étendez à un peuple ce que je dis d’une classe seulement, et vous comprendrez ma pensée.
Il existe en effet parmi tous les citoyens d’une démocratie, une convention analogue à celle dont je parle ; tous se sentent sujets à la même faiblesse et aux mêmes dangers, et leur intérêt, aussi bien que leur sympathie, leur fait une loi de se prêter au besoin une mutuelle assistance.
Plus les conditions deviennent semblables et plus les hommes laissent voir cette disposition réciproque à s’obliger.
[IV-28]
Dans les démocraties, où l’on n’accorde guère de grands bienfaits, on rend sans cesse de bons offices. Il est rare qu’un homme s’y montre dévoué, mais tous sont serviables.
[IV-29]
CHAPITRE V.↩
Comment la démocratie modifie les rapports du serviteur et du maître.
Un Américain qui avait longtemps voyagé en Europe, me disait un jour :
« Les Anglais traitent leurs serviteurs avec une hauteur et des manières absolues qui nous surprennent ; mais, d’une autre part, les Français usent quelquefois avec les leurs d’une familiarité, ou se montrent à leur égard d’une politesse, que nous ne saurions concevoir. On dirait qu’ils craignent de commander. L’attitude du supérieur et de l’inférieur est mal gardée. »
[IV-30]
Cette remarque est juste, et je l’ai faite moi-même bien des fois.
J’ai toujours considéré l’Angleterre comme le pays du monde où, de notre temps, le lien de la domesticité est le plus serré, et la France la contrée de la terre où il est le plus lâche. Nulle part le maître ne m’a paru plus haut ni plus bas que dans ces deux pays.
C’est entre ces extrémités que les Américains se placent.
Voilà le fait superficiel et apparent. Il faut remonter fort avant pour en découvrir les causes.
On n’a point encore vu de sociétés où les conditions fussent si égales, qu’il ne s’y rencontrât point de riches ni de pauvres ; et, par conséquent de maîtres et de serviteurs.
La démocratie n’empêche point que ces deux classes d’hommes n’existent ; mais elle change leur esprit et modifie leurs rapports.
Chez les peuples aristocratiques, les serviteurs forment une classe particulière, qui ne varie pas plus que celle des maîtres. Un ordre fixe ne tarde pas à y naître ; dans la première comme dans la seconde, on voit bientôt paraître une hiérarchie, des classifications nombreuses, des rangs marqués, et les générations s’y succèdent sans que les positions changent. Ce sont deux sociétés [IV-31] superposées l’une à l’autre, toujours distinctes, mais régies par des principes analogues.
Cette constitution aristocratique n’influe guère moins sur les idées et les mœurs des serviteurs que sur celles des maîtres, et, bien que les effets soient différents, il est facile de reconnaître la même cause.
Les uns et les autres forment de petites nations au milieu de la grande ; et il finit par naître, au milieu d’eux, de certaines notions permanentes en matière de juste et d’injuste. On y envisage les différents actes de la vie humaine sous un jour particulier qui ne change pas. Dans la société des serviteurs comme dans celle des maîtres, les hommes exercent une grande influence les uns sur les autres. Ils reconnaissent des règles fixes, et à défaut de loi ils rencontrent une opinion publique qui les dirige ; il y règne des habitudes réglées, une police.
Ces hommes, dont la destinée est d’obéir, n’entendent point sans doute la gloire, la vertu, l’honnêteté, l’honneur, de la même manière que les maîtres. Mais ils se sont fait une gloire, des vertus et une honnêteté de serviteurs, et ils conçoivent, si je puis m’exprimer ainsi, une sorte d’honneur servile [2] .
[IV-32]
Parce qu’une classe est basse, il ne faut pas croire que tous ceux qui en font partie aient le cœur bas. Ce serait une grande erreur. Quelque inférieure qu’elle soit, celui qui y est le premier, et qui n’a point l’idée d’en sortir, se trouve dans une position aristocratique qui lui suggère des sentiments élevés, un fier orgueil et un respect pour lui-même, qui le rendent propre aux grandes vertus, et aux actions peu communes.
Chez les peuples aristocratiques, il n’était point rare de trouver dans le service des grands, des âmes nobles et vigoureuses qui portaient la servitude sans la sentir, et qui se soumettaient aux volontés de leur maître sans avoir peur de sa colère.
Mais il n’en était presque jamais ainsi dans les rangs inférieurs de la classe domestique. On conçoit que celui qui occupe le dernier bout d’une hiérarchie de valets est bien bas.
Les Français avaient créé un mot tout exprès pour ce dernier des serviteurs de l’aristocratie. Ils l’appelaient le laquais.
Le mot de laquais servait de terme extrême, quand tous les autres manquaient, pour représenter [IV-33] la bassesse humaine ; sous l’ancienne monarchie, lorsqu’on voulait peindre en un moment un être vil et dégradé, on disait de lui qu’il avait l’âme d’un laquais. Cela seul suffisait. Le sens était complet et compris.
L’inégalité permanente des conditions ne donne pas seulement aux serviteurs de certaines vertus et de certains vices particuliers ; elle les place vis-à-vis des maîtres dans une position particulière.
Chez les peuples aristocratiques, le pauvre est apprivoisé, dès l’enfance, avec l’idée d’être commandé. De quelque côté qu’il tourne ses regards, il voit aussitôt l’image de la hiérarchie et l’aspect de l’obéissance.
Dans les pays où règne l’inégalité permanente des conditions, le maître obtient donc aisément de ses serviteurs une obéissance prompte, complète, respectueuse et facile, parce que ceux-ci révèrent en lui, non seulement le maître, mais la classe des maîtres. Il pèse sur leur volonté, avec tout le poids de l’aristocratie.
Il commande leurs actes ; il dirige encore jusqu’à un certain point leurs pensées. Le maître, dans les aristocraties, exerce souvent, à son insu même, un prodigieux empire sur les opinions, les habitudes, les mœurs de ceux qui lui obéissent, et son influence s’étend beaucoup plus loin encore que son autorité.
[IV-34]
Dans les sociétés aristocratiques, non seulement il y a des familles héréditaires de valets, aussi bien que des familles héréditaires de maîtres ; mais les mêmes familles de valets se fixent, pendant plusieurs générations, à côté des mêmes familles de maîtres ; (ce sont comme des lignes parallèles qui ne se confondent point ni ne se séparent) ; ce qui modifie prodigieusement les rapports mutuels de ces deux ordres de personnes.
Ainsi, bien que, sous l’aristocratie, le maître et le serviteur n’aient entre eux aucune ressemblance naturelle ; que la fortune, l’éducation, les opinions, les droits les placent, au contraire, à une immense distance sur l’échelle des êtres, le temps finit cependant par les lier ensemble. Une longue communauté de souvenirs les attache, et, quelque différents qu’ils soient, ils s’assimilent ; tandis que, dans les démocraties, où naturellement ils sont presque semblables, ils restent toujours étrangers l’un à l’autre.
Chez les peuples aristocratiques, le maître en vient donc a envisager ses serviteurs comme une partie inférieure et secondaire de lui-même, et il s’intéresse souvent à leur sort, par un dernier effort de l’égoïsme.
De leur côté, les serviteurs ne sont pas éloignés de se considérer sous le même point de vue, et ils [IV-35] s’identifient quelquefois à la personne du maître, de telle sorte qu’ils en deviennent enfin l’accessoire, à leurs propres yeux comme aux siens.
Dans les aristocraties, le serviteur occupe une position subordonnée, dont il ne peut sortir ; près de lui se trouve un autre homme, qui tient un rang supérieur qu’il ne peut perdre. D’un côté, l’obscurité, la pauvreté, l’obéissance, à perpétuité ; de l’autre, la gloire, la richesse, le commandement, à perpétuité. Ces conditions sont toujours diverses et toujours proches, et le lien qui les unit est aussi durable qu’elles-mêmes.
Dans cette extrémité, le serviteur finit par se désintéresser de lui-même ; il s’en détache ; il se déserte en quelque sorte, ou plutôt il se transporte tout entier dans son maître ; c’est là qu’il se crée une personnalité imaginaire. Il se pare avec complaisance des richesses de ceux qui lui commandent ; il se glorifie de leur gloire, se rehausse de leur noblesse, et se repaît sans cesse d’une grandeur empruntée, à laquelle il met souvent plus de prix que ceux qui en ont la possession pleine et véritable.
Il y a quelque chose de touchant et de ridicule à la fois dans une si étrange confusion de deux existences.
Ces passions de maîtres transportées dans des âmes de valets, y prennent les dimensions [IV-36] naturelles du lieu qu’elles occupent ; elles se rétrécissent et s’abaissent. Ce qui était orgueil chez le premier devient vanité puérile et prétention misérable chez les autres. Les serviteurs d’un grand se montrent d’ordinaire fort pointilleux sur les égards qu’on lui doit, et ils tiennent plus à ses moindres priviléges que lui-même.
On rencontre encore quelquefois parmi nous un de ces vieux serviteurs de l’aristocratie ; il survit à sa race et disparaîtra bientôt avec elle.
Aux États-Unis, je n’ai vu personne qui lui ressemblât. Non seulement les Américains ne connaissent point l’homme dont il s’agit ; mais on a grand’ peine à leur en faire comprendre l’existence. Ils ne trouvent guère moins de difficulté à le concevoir que nous n’en avons nous-mêmes à imaginer ce qu’était un esclave chez les Romains, ou un serf au moyen âge. Tous ces hommes sont en effet, quoique à des degrés différents, les produits d’une même cause. Ils reculent ensemble loin de nos regards et fuient chaque jour dans l’obscurité du passé avec l’état social qui les a fait naître.
L’égalité des conditions fait, du serviteur et du maître, des êtres nouveaux, et établit entre eux de nouveaux rapports.
Lorsque les conditions sont presque égales, les hommes changent sans cesse de place ; il y a encore une classe de valets et une classe de maîtres ; [IV-37] mais ce ne sont pas toujours les mêmes individus, ni surtout les mêmes familles qui les composent ; et il n’y a pas plus de perpétuité dans le commandement que dans l’obéissance.
Les serviteurs ne formant point un peuple à part, ils n’ont point d’usages, de préjugés ni de mœurs qui leur soient propres ; on ne remarque pas parmi eux un certain tour d’esprit, ni une façon particulière de sentir. Ils ne connaissent ni vices ni vertus d’état, mais ils partagent les lumières, les idées, les sentiments, les vertus et les vices de leurs contemporains ; et ils sont honnêtes ou fripons de la même manière que les maîtres.
Les conditions ne sont pas moins égales parmi les serviteurs que parmi les maîtres.
Comme on ne trouve point, dans la classe des serviteurs, de rangs marqués ni de hiérarchie permanente, il ne faut pas s’attendre à y rencontrer la bassesse et la grandeur qui se font voir dans les aristocraties de valets aussi bien que dans toutes les autres.
Je n’ai jamais vu aux États-Unis, rien qui pût me rappeler l’idée du serviteur d’élite, dont en Europe nous avons conservé le souvenir ; mais je n’y ai point trouvé non plus l’idée du laquais. La trace de l’un comme de l’autre y est perdue.
Dans les démocraties les serviteurs ne sont pas seulement égaux entre eux ; on peut dire [IV-38] qu’ils sont, en quelque sorte, les égaux de leurs maîtres.
Ceci a besoin d’être expliqué pour le bien comprendre.
À chaque instant, le serviteur peut devenir maître et aspire à le devenir ; le serviteur n’est donc pas un autre homme que le maître.
Pourquoi donc le premier a-t-il le droit de commander et qu’est-ce qui force le second à obéir ? L’accord momentané et libre de leurs deux volontés. Naturellement ils ne sont point inférieurs l’un à l’autre, ils ne le deviennent momentanément que par l’effet du contrat. Dans les limites de ce contrat, l’un est le serviteur et l’autre le maître ; en dehors, ce sont deux citoyens, deux hommes.
Ce que je prie le lecteur de bien considérer, c’est que ceci n’est point seulement la notion que les serviteurs se forment à eux-mêmes de leur état. Les maîtres considèrent la domesticité sous le même jour, et les bornes précises du commandement et de l’obéissance sont aussi bien fixées dans l’esprit de l’un que dans celui de l’autre.
Lorsque la plupart des citoyens ont depuis longtemps atteint une condition à peu près semblable, et que l’égalité est un fait ancien et admis, le sens public, que les exceptions n’influencent jamais, assigne, d’une manière générale, à la valeur de l’homme, de certaines limites au-dessus ou [IV-39] au-dessous desquelles il est difficile qu’aucun homme reste longtemps placé.
En vain la richesse et la pauvreté, le commandement et l’obéissance mettent accidentellement de grandes distances entre deux hommes, l’opinion publique, qui se fonde sur l’ordre ordinaire des choses, les rapproche du commun niveau, et crée entre eux une sorte d’égalité imaginaire, en dépit de l’inégalité réelle de leurs conditions.
Cette opinion toute-puissante finit par pénétrer dans l’âme même de ceux que leur intérêt pourrait armer contre elle ; elle modifie leur jugement en même temps qu’elle subjugue leur volonté.
Au fond de leur âme le maître et le serviteur n’aperçoivent plus entre eux de dissemblance profonde, et ils n’espèrent ni ne redoutent d’en rencontrer jamais. Ils sont donc sans mépris et sans colère, et ils ne se trouvent ni humbles ni fiers en se regardant.
Le maître juge que dans le contrat est la seule origine de son pouvoir, et le serviteur y découvre la seule cause de son obéissance. Ils ne se disputent point entre eux sur la position réciproque qu’ils occupent ; mais chacun voit aisément la sienne et s’y tient.
Dans nos armées le soldat est pris à peu près dans les mêmes classes que les officiers et peut parvenir aux mêmes emplois ; hors des rangs il se [IV-40] considère comme parfaitement égal à ses chefs, et il l’est en effet ; mais sous le drapeau il ne fait nulle difficulté d’obéir, et son obéissance, pour être volontaire et définie, n’est pas moins prompte, nette et facile.
Ceci donne une idée de ce qui se passe dans les sociétés démocratiques entre le serviteur et le maître.
Il serait insensé de croire qu’il pût jamais naître entre ces deux hommes aucune de ces affections ardentes et profondes qui s’allument quelquefois au sein de la domesticité aristocratique, ni qu’on dût y voir apparaître des exemples éclatants de dévouement.
Dans les aristocraties, le serviteur et le maître ne s’aperçoivent que de loin en loin, et souvent ils ne se parlent que par intermédiaire. Cependant ils tiennent d’ordinaire fermement l’un à l’autre.
Chez les peuples démocratiques, le serviteur et le maître sont fort proches ; leurs corps se touchent sans cesse ; leurs âmes ne se mêlent point ; ils ont des occupations communes, ils n’ont presque jamais d’intérêts communs.
Chez ces peuples, le serviteur se considère toujours comme un passant dans la demeure de ses maîtres. Il n’a pas connu leurs aïeux ; il ne verra pas leurs descendants ; il n’a rien à en attendre de durable. Pourquoi confondrait-il son existence [IV-41] avec la leur, et d’où lui viendrait ce singulier abandon de lui-même ? La position réciproque est changée ; les rapports doivent l’être.
Je voudrais pouvoir m’appuyer dans tout ce qui précède de l’exemple des Américains ; mais je ne saurais le faire sans distinguer avec soin les personnes et les lieux.
Au sud de l’Union l’esclavage existe. Tout ce que je viens de dire ne peut donc s’y appliquer.
Au nord la plupart des serviteurs sont des affranchis ou des fils d’affranchis. Ces hommes occupent dans l’estime Publique une position contestée : la loi les rapproche du niveau de leur maître ; les mœurs les en repoussent obstinément. Eux-mêmes ne discernent pas clairement leur place, et ils se montrent presque toujours insolents ou rampants.
Mais, dans ces mêmes provinces du nord, particulièrement dans la Nouvelle-Angleterre, on rencontre un assez grand nombre de blancs qui consentent, moyennant salaire, à se soumettre passagèrement aux volontés de leurs semblables. J’ai entendu dire que ces serviteurs remplissent d’ordinaire les devoirs de leur état avec exactitude et intelligence, et que, sans se croire naturellement inférieurs à celui qui les commande, ils se soumettent sans peine à lui obéir.
Il m’a semblé voir que ceux-là transportaient [IV-42] dans la servitude quelques-unes des habitudes viriles que l’indépendance et l’égalité font naître. Ayant une fois choisi une condition dure, ils ne cherchent pas indirectement à s’y soustraire, et ils se respectent assez eux-mêmes pour ne pas refuser à leurs maîtres une obéissance qu’ils ont librement promise.
De leur côté, les maîtres n’exigent de leurs serviteurs que la fidèle et rigoureuse exécution du contrat ; ils ne leur demandent pas des respects ; ils ne réclament pas leur amour ni leur dévouement ; il leur suffit de les trouver ponctuels et honnêtes.
Il ne serait donc pas vrai de dire que, sous la démocratie, les rapports du serviteur et du maître sont désordonnés ; ils sont ordonnés d’une autre manière ; la règle est différente, mais il y a une règle.
Je n’ai point ici à rechercher si cet état nouveau que je viens de décrire est inférieur à celui qui l’a précédé, ou si seulement il est autre. Il me suffit qu’il soit réglé et fixe ; car ce qu’il importe le plus de rencontrer parmi les hommes, ce n’est pas un certain ordre, c’est l’ordre.
Mais que dirai-je de ces tristes et turbulentes époques durant lesquelles l’égalité se fonde au milieu du tumulte d’une révolution, alors que la démocratie, après s’être établie dans l’état social, [IV-43] lutte encore avec peine contre les préjugés et les mœurs ?
Déjà la loi et en partie l’opinion proclament qu’il n’existe pas d’infériorité naturelle et permanente entre le serviteur et le maître. Mais cette foi nouvelle n’a pas encore pénétré jusqu’au fond de l’esprit de celui-ci, ou plutôt son cœur la repousse. Dans le secret de son âme, le maître estime encore qu’il est d’une espèce particulière et supérieure ; mais il n’ose le dire, et il se laisse attirer en frémissant vers le niveau. Son commandement en devient tout à la fois timide et dur ; déjà il n’éprouve plus pour ses serviteurs les sentiments protecteurs et bienveillants qu’un long pouvoir incontesté fait toujours naître, et il s’étonne qu’étant lui-même changé, son serviteur change ; il veut que, ne faisant pour ainsi dire que passer à travers la domesticité, celui-ci y contracte des habitudes régulières et permanentes ; qu’il se montre satisfait et fier d’une position servile, dont tôt ou tard il doit sortir ; qu’il se dévoue pour un homme qui ne peut ni le protéger ni le perdre, et qu’il s’attache enfin, par un lien éternel, à des êtres qui lui ressemblent et qui ne durent pas plus que lui.
Chez les peuples aristocratiques, il arrive souvent que l’état de domesticité n’abaisse point l’âme de ceux qui s’y soumettent, parce qu’ils n’en connaissent et qu’ils n’en imaginent pas d’autres, et [IV-44] que la prodigieuse inégalité qui se fait voir entre eux et le maître leur semble l’effet nécessaire et inévitable de quelque loi cachée de la Providence.
Sous la démocratie, l’état de domesticité n’a rien qui dégrade, parce qu’il est librement choisi, passagèrement adopté, que l’opinion publique ne le flétrit point, et qu’il ne crée aucune inégalité permanente entre le serviteur et le maître.
Mais, durant le passage d’une condition sociale à l’autre, il survient presque toujours un moment où l’esprit des hommes vacille entre la notion aristocratique de la sujétion et la notion démocratique de l’obéissance.
L’obéissance perd alors sa moralité aux yeux de celui qui obéit ; il ne la considère plus comme une obligation en quelque sorte divine, et il ne la voit point encore sous son aspect purement humain ; elle n’est à ses yeux ni sainte ni juste, et il s’y soumet comme a un fait dégradant et utile.
Dans ce moment l’image confuse et incomplète de l’égalité se présente à l’esprit des serviteurs ; ils ne discernent point d’abord si c’est dans l’état même de domesticité ou en dehors que cette égalité à laquelle ils ont droit se retrouve, et ils se révoltent au fond de leur cœur contre une infériorité à laquelle ils se sont soumis eux-mêmes et dont ils profitent. Ils consentent à servir, et ils ont [IV-45] honte d’obéir ; ils aiment les avantages de la servitude, mais point le maître, ou, pour mieux dire, ils ne sont pas sûrs que ce ne soit pas à eux à être les maîtres, et ils sont disposés à considérer celui qui les commande comme l’injuste usurpateur de leur droit.
C’est alors qu’on voit dans la demeure de chaque citoyen quelque chose d’analogue au triste spectacle que la société politique présente. Là se poursuit sans cesse une guerre sourde et intestine entre des pouvoirs toujours soupçonneux et rivaux : le maître se montre malveillant et doux, le serviteur malveillant et indocile ; l’un veut se dérober sans cesse, par des restrictions déshonnêtes, à l’obligation de protéger et de rétribuer, l’autre à celle d’obéir. Entre eux flottent les rênes de l’administration domestique, que chacun s’efforce de saisir. Les lignes qui divisent l’autorité de la tyrannie, la liberté de la licence, le droit du fait, paraissent à leurs yeux enchevêtrées et confondues, et nul ne sait précisément ce qu’il est, ni ce qu’il peut, ni ce qu’il doit.
Un pareil état n’est pas démocratique, mais révolutionnaire.
[IV-47]
CHAPITRE VI.↩
Comment les institutions et les mœurs démocratiques tendent à élever le prix et à raccourcir la durée des baux.
Ce que j’ai dit des serviteurs et des maîtres s’applique, jusqu’à un certain point, aux propriétaires et aux fermiers. Le sujet mérite cependant d’être considéré à part.
En Amérique, il n’y a pour ainsi dire pas de fermiers ; tout homme est possesseur du champ qu’il cultive.
Il faut reconnaître que les lois démocratiques tendent puissamment à accroître le nombre des propriétaires, et à diminuer celui des fermiers. Toutefois, ce qui se passe aux États-Unis doit [IV-48] être attribué, bien moins aux institutions du pays, qu’au pays lui-même. En Amérique, la terre coûte peu, et chacun devient aisément propriétaire. Elle donne peu, et ses produits ne sauraient qu’avec peine se diviser entre un propriétaire et un fermier.
L’Amérique est donc unique en ceci comme en d’autres choses ; et ce serait errer que de la prendre pour exemple.
Je pense que dans les pays démocratiques aussi bien que dans les aristocraties, il se rencontrera des propriétaires et des fermiers ; mais les propriétaires et les fermiers n’y seront pas liés de la même manière.
Dans les aristocraties, les fermages ne s’acquittent pas seulement en argent, mais en respect, en affection et en services. Dans les pays démocratiques, ils ne se payent qu’en argent. Quand les patrimoines se divisent et changent de mains, et que la relation permanente qui existait entre les familles et la terre disparaît, ce n’est plus qu’un hasard qui met en contact le propriétaire et le fermier. Ils se joignent un moment pour débattre les conditions du contrat, et se perdent ensuite de vue. Ce sont deux étrangers que l’intérêt rapproche et qui discutent rigoureusement entre eux une affaire, dont le seul sujet est l’argent.
[IV-49]
A mesure que les biens se partagent et que la richesse se disperse çà et là sur toute la surface du pays, l’État se remplit de gens dont l’opulence ancienne est en déclin, et de nouveaux enrichis dont les besoins s’accroissent plus vite que les ressources. Pour tous ceux-là, le moindre profit est de conséquence, et nul d’entre eux ne se sent disposé à laisser échapper aucun de ses avantages, ni à perdre une portion quelconque de son revenu.
Les rangs se confondant et les très-grandes ainsi que les très-petites fortunes devenant plus rares, il se trouve chaque jour moins de distance entre la condition sociale du propriétaire et celle du fermier ; l’un n’a point naturellement de supériorité incontestée sur l’autre. Or, entre deux hommes égaux et malaisés, quelle peut être la matière du contrat de louage ? sinon de l’argent !
Un homme qui a pour propriété tout un canton et possède cent métairies, comprend qu’il s’agit de gagner à la fois le cœur de plusieurs milliers d’hommes ; ceci lui paraît mériter qu’on s’y applique. Pour atteindre un si grand objet, il fait aisément des sacrifices.
Celui qui possède cent arpents ne s’embarrasse point de pareils soins ; et il ne lui importe guère de capter la bienveillance particulière de son fermier.
[IV-50]
Une aristocratie ne meurt point comme un homme en un jour. Son principe se détruit lentement au fond des âmes, avant d’être attaqué dans les lois. Longtemps donc avant que la guerre n’éclate contre elle, on voit se desserrer peu à peu le lien qui jusqu’alors avait uni les hautes classes aux basses. L’indifférence et le mépris se trahissent d’un côté ; de l’autre la jalousie et la haine : les rapports entre le pauvre et le riche deviennent plus rares et moins doux ; le prix des baux s’élève. Ce n’est point encore le résultat de la révolution démocratique, mais c’en est la certaine annonce. Car une aristocratie qui a laissé échapper définitivement de ses mains le cœur du peuple, est comme un arbre mort dans ses racines, et que les vents renversent d’autant plus aisément qu’il est plus haut.
Depuis cinquante ans, le prix des fermages s’est prodigieusement accru, non seulement en France, mais dans la plus grande partie de l’Europe. Les progrès singuliers qu’ont faits l’agriculture et l’industrie, durant la même période, ne suffisent point, à mon sens, pour expliquer ce phénomène. Il faut recourir à quelque autre cause plus puissante et plus cachée. Je pense que cette cause doit être recherchée dans les institutions démocratiques que plusieurs peuples européens ont adoptées, et dans les passions démocratiques qui agitent plus ou moins tous les autres.
[IV-51]
J’ai souvent entendu de grands propriétaires anglais se féliciter de ce que, de nos jours, ils tirent beaucoup plus d’argent de leurs domaines, que ne le faisaient leurs pères.
Ils ont peut-être raison de se réjouir ; mais, à coup sûr, ils ne savent point de quoi ils se réjouissent. Ils croient faire un profit net, et ils ne font qu’un échange. C’est leur influence qu’ils cèdent à deniers comptants ; et ce qu’ils gagnent en argent, ils vont bientôt le perdre en pouvoir.
Il y a encore un autre signe auquel on peut aisément reconnaître qu’une grande révolution démocratique s’accomplit ou se prépare.
Au moyen-âge, presque toutes les terres étaient louées à perpétuité, ou du moins à très-longs termes. Quand on étudie l’économie domestique de ce temps, on voit que les baux de quatre-vingt-dix-neuf ans y étaient plus fréquents que ceux de douze ne le sont de nos jours.
On croyait alors à l’immortalité des familles ; les conditions semblaient fixées à toujours, et la société entière paraissait si immobile, qu’on n’imaginait point que rien dût jamais remuer dans son sein.
Dans les siècles d’égalité, l’esprit humain prend un autre tour. Il se figure aisément que rien ne demeure. L’idée de l’instabilité le possède.
En cette disposition, le propriétaire et le [IV-52] fermier lui-même, ressentent une sorte d’horreur instinctive pour les obligations à long terme ; ils ont peur de se trouver bornés un jour par la convention dont aujourd’hui ils profitent. Ils s’attendent vaguement à quelque changement soudain et imprévu dans leur condition. Ils se redoutent eux-mêmes ; ils craignent que leur goût venant à changer, ils ne s’affligent de ne pouvoir quitter ce qui faisait l’objet de leurs convoitises, et ils ont raison de le craindre ; car, dans les siècles démocratiques, ce qu’il y a de plus mouvant, au milieu du mouvement de toutes choses, c’est le cœur de l’homme.
[IV-53]
CHAPITRE VII.↩
Influence de la démocratie sur les salaires.
La plupart des remarques que j’ai faites ci-devant, en parlant des serviteurs et des maîtres, peuvent s’appliquer aux maîtres et aux ouvriers.
À mesure que les règles de la hiérarchie sociale sont moins observées, tandis que les grands s’abaissent, que les petits s’élèvent et que la pauvreté aussi bien que la richesse cesse d’être héréditaire, on voit décroître chaque jour la distance de fait et d’opinion qui séparait l’ouvrier du maître.
L’ouvrier conçoit une idée plus élevée de ses droits, de son avenir, de lui-même ; une nouvelle [IV-54] ambition, de nouveaux désirs le remplissent, de nouveaux besoins l’assiègent. À tout moment il jette des regards pleins de convoitise sur les profits de celui qui l’emploie ; afin d’arriver à les partager, il s’efforce de mettre son travail à plus haut prix, et il finit d’ordinaire par y réussir.
Dans les pays démocratiques, comme ailleurs, la plupart des industries sont conduites à peu de frais par des hommes que la richesse et les lumières ne placent point au-dessus du commun niveau de ceux qu’ils emploient. Ces entrepreneurs d’industrie sont très-nombreux ; leurs intérêts diffèrent ; ils ne sauraient donc aisément s’entendre entre eux et combiner leurs efforts.
D’un autre côté, les ouvriers ont presque tous quelques ressources assurées qui leur permettent de refuser leurs services lorsqu’on ne veut point leur accorder ce qu’ils considèrent comme la juste rétribution du travail.
Dans la lutte continuelle que ces deux classes se livrent pour les salaires, les forces sont donc partagées, les succès alternatifs.
Il est même à croire qu’à la longue l’intérêt des ouvriers doit prévaloir ; car les salaires élevés qu’ils ont déjà obtenus les rendent chaque jour moins dépendants de leurs maîtres, et, à mesure qu’ils sont plus indépendants, ils peuvent plus aisément obtenir l’élévation des salaires.
[IV-55]
Je prendrai pour exemple l’industrie qui de notre temps est encore la plus suivie parmi nous, ainsi que chez presque toutes les nations du monde : la culture des terres.
En France, la plupart de ceux qui louent leurs services pour cultiver le sol en possèdent eux-mêmes quelques parcelles qui, à la rigueur, leur permettent de subsister sans travailler pour autrui. Lorsque ceux-là viennent offrir leurs bras au grand propriétaire ou au fermier voisin, et qu’on refuse de leur accorder un certain salaire, ils se retirent sur leur petit domaine, et attendent qu’une autre occasion se présente.
Je pense qu’en prenant les choses dans leur ensemble, on peut dire que l’élévation lente et progressive des salaires est une des lois générales qui régissent les sociétés démocratiques. À mesure que les conditions deviennent plus égales, les salaires s’élèvent, et à mesure que les salaires sont plus hauts, les conditions deviennent plus égales.
Mais, de nos jours, une grande et malheureuse exception se rencontre.
J’ai montré, dans un chapitre précédent, comment l’aristocratie, chassée de la société politique, s’était retirée dans certaines parties du monde industriel, et y avait établi sous une autre forme son empire.
Ceci influe puissamment sur le taux des salaires. [IV-56]
Comme il faut être déjà très-riche pour entreprendre les grandes industries dont je parle, le nombre de ceux qui les entreprennent est fort petit. Étant peu nombreux, ils peuvent aisément se liguer entre eux, et fixer au travail le prix qu’il leur plaît.
Leurs ouvriers sont, au contraire, en très-grand nombre, et la quantité s’en accroît sans cesse ; car il arrive de temps à autre des prospérités extraordinaires durant lesquelles les salaires s’élèvent outre mesure et attirent dans les manufactures les populations environnantes. Or, une fois que les hommes sont entrés dans cette carrière, nous avons vu qu’ils n’en sauraient sortir, parce qu’ils ne tardent pas à y contracter des habitudes de corps et d’esprit qui les rendent impropres à tout autre labeur. Ces hommes ont en général peu de lumières, d’industrie et de ressources ; ils sont donc presque à la merci de leur maître. Lorsqu’une concurrence, ou d’autres circonstances fortuites, fait décroître les gains de celui-ci, il peut restreindre leurs salaires presque à son gré, et reprendre aisément sur eux ce que la fortune lui enlève.
Refusent-ils le travail d’un commun accord : le maître, qui est un homme riche, peut attendre aisément, sans se ruiner, que la nécessité les lui ramène ; mais eux, il leur faut travailler tous les [IV-57] jours pour ne pas mourir ; car ils n’ont guère d’autre propriété que leurs bras. L’oppression les a dès longtemps appauvris, et ils sont plus faciles à opprimer à mesure qu’ils deviennent plus pauvres. C’est un cercle vicieux dont ils ne sauraient aucunement sortir.
On ne doit donc point s’étonner si les salaires, après s’être élevés quelquefois tout à coup, baissent ici d’une manière permanente, tandis que dans les autres professions le prix du travail, qui ne croît en général que peu à peu, s’augmente sans cesse.
Cet état de dépendance et de misère dans lequel se trouve de notre temps une partie de la population industrielle est un fait exceptionnel et contraire à tout ce qui l’environne ; mais, pour cette raison même, il n’en est pas de plus grave, ni qui mérite mieux d’attirer l’attention particulière du législateur ; car il est difficile, lorsque la société entière se remue, de tenir une classe immobile, et, quand le plus grand nombre s’ouvre sans cesse de nouveaux chemins vers la fortune, de faire que quelques uns supportent en paix leurs besoins et leurs désirs.
[IV-59]
CHAPITRE VIII.↩
Influence de la démocratie sur la famille.
Je viens d’examiner comment, chez les peuples démocratiques et en particulier chez les Américains, l’égalité des conditions modifie les rapports des citoyens entre eux.
Je veux pénétrer plus avant, et entrer dans le sein de la famille. Mon but n’est point ici de chercher des vérités nouvelles, mais de montrer comment des faits déjà connus se rattachent à mon sujet.
Tout le monde a remarqué que, de nos jours, [IV-60] il s’était établi de nouveaux rapports entre les différents membres de la famille, que la distance qui séparait jadis le père de ses fils était diminuée, et que l’autorité paternelle était sinon détruite, au moins altérée.
Quelque chose d’analogue, mais de plus frappant encore, se fait voir aux États-Unis.
En Amérique, la famille, en prenant ce mot dans son sens romain et aristocratique, n’existe point. On n’en retrouve quelques vestiges que durant les premières années qui suivent la naissance des enfants. Le père exerce alors, sans opposition, la dictature domestique, que la faiblesse de ses fils rend nécessaire, et que leur intérêt, ainsi que sa supériorité incontestables, justifie.
Mais, du moment où le jeune Américain s’approche de la virilité, les liens de l’obéissance filiale se détendent de jour en jour. Maître de ses pensées, il l’est bientôt après de sa conduite. En Amérique, il n’y a pas, à vrai dire, d’adolescence. Au sortir du premier âge, l’homme se montre et commence à tracer lui-même son chemin.
On aurait tort de croire que ceci arrive à la suite d’une lutte intestine, dans laquelle le fils aurait obtenu, par une sorte de violence morale, la liberté que son père lui refusait. Les mêmes habitudes, les mêmes principes qui poussent l’un, à se saisir de l’indépendance, disposent l’autre à en [IV-61] considérer l’usage comme un droit incontestable.
On ne remarque donc dans le premier aucune de ces passions haineuses et désordonnées qui agitent les hommes longtemps encore après qu’ils se sont soustraits à un pouvoir établi. Le second n’éprouve point ces regrets pleins d’amertume et de colère, qui survivent d’ordinaire à la puissance déchue : le père a aperçu de loin les bornes où devait venir expirer son autorité ; et quand le temps l’a approché de ces limites, il abdique sans peine. Le fils a prévu d’avance l’époque précise où sa propre volonté deviendrait sa règle ; et il s’empare de la liberté sans précipitation et sans efforts, comme d’un bien qui lui est dû, et qu’on ne cherche point à lui ravir [3] .
Il n’est peut-être pas inutile de faire voir comment ces changements qui ont lieu dans la famille, sont étroitement liés à la révolution sociale et [IV-62] politique qui achève de s’accomplir sous nos yeux,
Il y a certains grands principes sociaux qu’un peuple fait pénétrer partout, ou ne laisse subsister nulle part.
Dans les pays aristocratiquement et hiérarchiquement organisés, le pouvoir ne s’adresse jamais directement à l’ensemble des gouvernés. Les hommes tenant les uns aux autres, on se borne à conduire les premiers. Le reste suit. Ceci s’applique à la famille, comme à toutes les associations qui ont un chef. Chez les peuples aristocratiques, la société ne connaît, à vrai dire, que le père. Elle ne tient les fils que par les mains du père ; elle le gouverne et il les gouverne. Le père n’y a donc pas seulement un droit naturel. On lui donne un droit politique à commander. Il est l’auteur et le soutien de la famille ; il en est aussi le magistrat.
Dans les démocraties, où le bras du gouvernement va chercher chaque homme en particulier [IV-63] au milieu de la foule pour le plier isolément aux lois communes, il n’est pas besoin de semblable intermédiaire ; le père n’est aux yeux de la loi qu’un citoyen, plus âgé et plus riche que ses fils.
Lorsque la plupart des conditions sont très-inégales, et que l’inégalité des conditions est permanente, l’idée du supérieur grandit dans l’imagination des hommes ; la loi ne lui accordât-elle pas de prérogatives, la coutume et l’opinion lui en concèdent. Lorsqu’au contraire, les hommes diffèrent peu les uns des autres et ne restent pas toujours dissemblables, la notion générale du supérieur devient plus faible et moins claire ; en vain, la volonté du législateur s’efforce-t-elle de placer celui qui obéit fort au-dessous de celui qui commande, les mœurs rapprochent ces deux hommes l’un de l’autre, et les attirent chaque jour vers le même niveau.
Si donc je ne vois point, dans la législation d’un peuple aristocratique, de privilèges particuliers accordés au chef de la famille, je ne laisserai pas d’être assuré que son pouvoir y est fort respecté et plus étendu que dans le sein d’une démocratie ; car je sais que, quelles que soient les lois, le supérieur paraîtra toujours plus haut et l’inférieur plus bas dans les aristocraties que chez les peuples démocratiques.
Quand les hommes vivent dans le souvenir de [IV-64] ce qui a été, plutôt que dans la préoccupation de ce qui est, et qu’ils s’inquiètent bien plus de ce que leurs ancêtres ont pensé, qu’ils ne cherchent à penser eux-mêmes, le père est le lien naturel et nécessaire entre le passé et le présent, l’anneau où ces deux chaînes aboutissent et se rejoignent. Dans les aristocraties, le père n’est donc pas seulement le chef politique de la famille ; il y est l’organe de la tradition, l’interprète de la coutume, l’arbitre des mœurs. On l’écoute avec déférence ; on ne l’aborde qu’avec respect, et l’amour qu’on lui porte est toujours tempéré par la crainte.
L’état social devenant démocratique, et les hommes adoptant pour principe général qu’il est bon et légitime de juger toutes choses par soi-même en prenant les anciennes croyances comme renseignement et non comme règle, la puissance d’opinion exercée par le père sur les fils devient moins grande, aussi bien que son pouvoir légal.
La division des patrimoines qu’amène la démocratie, contribue peut-être plus que tout le reste à changer les rapports du père et des enfants.
Quand le père de famille a peu de bien, son fils et lui vivent sans cesse dans le même lieu, et s’occupent en commun des mêmes travaux. L’habitude et le besoin les rapprochent et les forcent à communiquer à chaque instant l’un avec l’autre ; il ne [IV-65] peut donc manquer de s’établir entre eux une sorte d’intimité familière qui rend l’autorité moins absolue, et qui s’accommode mal avec les formes extérieures du respect.
Or, chez les peuples démocratiques, la classe qui possède ces petites fortunes est précisément celle qui donne la puissance aux idées et le tour aux mœurs. Elle fait prédominer partout ses opinions en même temps que ses volontés, et ceux mêmes qui sont le plus enclins à résister à ses commandements, finissent par se laisser entraîner par ses exemples. J’ai vu de fougueux ennemis de la démocratie qui se faisaient tutoyer par leurs enfants.
Ainsi, dans le même temps que le pouvoir échappe à l’aristocratie, on voit disparaître ce qu’il y avait d’austère, de conventionnel et de légal dans la puissance paternelle, et une sorte d’égalité s’établit autour du foyer domestique.
Je ne sais si, à tout prendre, la société perd à ce changement ; mais je suis porté à croire que l’individu y gagne. Je pense qu’à mesure que les mœurs et les lois sont plus démocratiques, les rapports du père et du fils deviennent plus intimes et plus doux ; la règle et l’autorité s’y rencontrent moins ; la confiance et l’affection y sont souvent plus grandes, et il semble que le lien naturel se resserre, tandis que le lien social se détend.
Dans la famille démocratique, le père n’exerce [IV-66] guère d’autre pouvoir que celui qu’on se plaît à accorder à la tendresse et à l’expérience d’un vieillard. Ses ordres seraient peut-être méconnus ; mais ses conseils sont d’ordinaire pleins de puissance. S’il n’est point entouré de respects officiels, ses fils du moins l’abordent avec confiance. Il n’y a point de formule reconnue pour lui adresser la parole ; mais on lui parle sans cesse, et on le consulte volontiers chaque jour. Le maître et le magistrat ont disparu ; le père reste.
Il suffit, pour juger de la différence des deux états sociaux sur ce point, de parcourir les correspondances domestiques que les aristocraties nous ont laissées. Le style en est toujours correct, cérémonieux, rigide, et si froid, que la chaleur naturelle du cœur peut à peine s’y sentir à travers les mots.
Il règne, au contraire, dans toutes les paroles qu’un fils adresse à son père, chez les peuples démocratiques, quelque chose de libre, de familier et de tendre à la fois, qui fait découvrir au premier abord que des rapports nouveaux se sont établis au sein de la famille.
Une révolution analogue modifie les rapports mutuels des enfants.
Dans la famille aristocratique, aussi bien que dans la société aristocratique, toutes les places sont marquées. Non seulement le père y occupe [IV-67] un rang à part et y jouit d’immenses privilèges : les enfants eux-mêmes ne sont point égaux entre eux ; l’âge et le sexe fixent irrévocablement à chacun son rang et lui assurent certaines prérogatives. La démocratie renverse ou abaisse la plupart de ces barrières.
Dans la famille aristocratique, l’aîné des fils, héritant de la plus grande partie des biens et de presque tous les droits, devient le chef et jusqu’à un certain point le maître de ses frères. À lui la grandeur et le pouvoir, à eux la médiocrité et la dépendance. Toutefois, on aurait tort de croire que, chez les peuples aristocratiques, les privilèges de l’aîné ne fussent avantageux qu’a lui seul, et qu’ils n’excitassent autour de lui que l’envie et la haine.
L’aîné s’efforce d’ordinaire de procurer la richesse et le pouvoir à ses frères, parce que l’éclat général de la maison rejaillit sur celui qui la représente ; et les cadets cherchent à faciliter à l’aîné toutes ses entreprises, parce que la grandeur et la force du chef de la famille le met de plus en plus en état d’en élever tous les rejetons.
Les divers membres de la famille aristocratique sont donc fort étroitement liés les uns aux autres ; leurs intérêts se tiennent, leurs esprits sont d’accord ; mais il est rare que leurs cœurs s’entendent.
La démocratie attache aussi les frères les uns [IV-68] aux autres ; mais elle s’y prend d’une autre manière.
Sous les lois démocratiques, les enfants sont parfaitement égaux, par conséquent indépendants ; rien ne les rapproche forcément, mais aussi rien ne les écarte ; et comme ils ont une origine commune, qu’ils s’élèvent sous le même toit, qu’ils sont l’objet des mêmes soins, et qu’aucune prérogative particulière ne les distingue ni ne les sépare, on voit aisément naître parmi eux la douce et juvénile intimité du premier âge. Le lien ainsi formé au commencement de la vie, il ne se présente guère d’occasions de le rompre ; car la fraternité les rapproche chaque jour sans les gêner.
Ce n’est donc point par les intérêts, c’est par la communauté des souvenirs et la libre sympathie des opinions et des goûts, que la démocratie attache les frères les uns aux autres. Elle divise leur héritage, mais elle permet que leurs âmes se confondent.
La douceur de ces mœurs démocratiques est si grande, que les partisans de l’aristocratie eux-mêmes s’y laissent prendre, et que, après l’avoir goûtée quelque temps, ils ne sont point tentés de retourner aux formes respectueuses et froides de la famille aristocratiques. Ils conserveraient volontiers les habitudes domestiques de la démocratie, pourvu qu’ils pussent rejeter son état social et ses [IV-69] lois. Mais ces choses se tiennent, et l’on ne saurait jouir des unes sans souffrir les autres.
Ce que je viens de dire de l’amour filial et de la tendresse fraternelle, doit s’entendre de toutes les passions qui prennent spontanément leur source dans la nature elle-même.
Lorsqu’une certaine manière de penser ou de sentir est le produit d’un état particulier de l’humanité, cet état venant à changer, il ne reste rien. C’est ainsi que la loi peut attacher très-étroitement deux citoyens l’un à l’autre ; la loi abolie, ils se séparent. Il n’y avait rien de plus serré que le nœud qui unissait le vassal au seigneur, dans le monde féodal. Maintenant, ces deux hommes ne se connaissent plus. La crainte, la reconnaissance et l’amour qui les liaient jadis ont disparu. On n’en trouve point la trace.
Mais il n’en est pas ainsi des sentiments naturels à l’espèce humaine. Il est rare que la loi, en s’efforçant de plier ceux-ci d’une certaine manière, ne les énerve ; qu’en voulant y ajouter, elle ne leur ôte point quelque chose, et qu’ils ne soient pas toujours plus forts, livrés à eux-mêmes.
La démocratie qui détruit ou obscurcit presque toutes les anciennes conventions sociales, et qui empêche que les hommes ne s’arrêtent aisément à de nouvelles, fait disparaître entièrement la plupart des sentiments qui naissent de ces [IV-70] conventions. Mais elle ne fait que modifier les autres, et souvent elle leur donne une énergie et une douceur qu’ils n’avaient pas.
Je pense qu’il n’est pas impossible de renfermer dans une seule phrase tout le sens de ce chapitre et de plusieurs autres qui le précèdent. La démocratie détend les liens sociaux, mais elle resserre les liens naturels. Elle rapproche les parents dans le même temps qu’elle sépare les citoyens.
[IV-71]
CHAPITRE IX.↩
Éducation des jeunes filles aux États-Unis.
Il n’y a jamais eu de sociétés libres sans mœurs, et, ainsi que je l’ai dit dans la première partie de cet ouvrage, c’est la femme qui fait les mœurs. Tout ce qui influe sur la condition des femmes, sur leurs habitudes et leurs opinions, a donc un grand intérêt politique à mes yeux.
Chez presque toutes les nations protestantes, les jeunes filles sont infiniment plus maîtresses de leurs actions que chez les peuples catholiques.
Cette indépendance est encore plus grande dans les pays protestants qui, ainsi que l’Angleterre, ont [IV-72] conservé ou acquis le droit de se gouverner eux-mêmes. La liberté pénètre alors dans la famille par les habitudes politiques et par les croyances religieuses.
Aux États-Unis, les doctrines du protestantisme viennent se combiner avec une constitution très-libre et un état social très-démocratique ; et nulle part la jeune fille n’est plus promptement ni plus complètement livrée à elle-même.
Longtemps avant que la jeune Américaine ait atteint l’âge nubile, on commence à l’affranchir peu à peu de la tutelle maternelle ; elle n’est point encore entièrement sortie de l’enfance, que déjà elle pense par elle-même, parle librement et agit seule ; devant elle est exposé sans cesse le grand tableau du monde ; loin de chercher à lui en dérober la vue, on le découvre chaque jour de plus en plus à ses regards, et on lui apprend à le considérer d’un œil ferme et tranquille. Ainsi, les vices et les périls que la société présente ne tardent pas à lui être révélés ; elle les voit clairement, les juge sans illusion et les affronte sans crainte ; car elle est pleine de confiance dans ses forces, et sa confiance semble partagée par tous ceux qui l’environnent.
Il ne faut donc presque jamais s’attendre à rencontrer chez la jeune fille d’Amérique cette candeur virginale au milieu des naissants désirs, [IV-73] non plus que ces grâces naïves et ingénues qui accompagnent d’ordinaire chez l’Européenne le passage de l’enfance à la jeunesse. Il est rare que l’Américaine, quel que soit son âge, montre une timidité et une ignorance puériles. Comme la jeune fille d’Europe, elle veut plaire ; mais elle sait précisément à quel prix. Si elle ne se livre pas au mal, du moins elle le connaît ; elle a des mœurs pures plutôt qu’un esprit chaste.
J’ai souvent été surpris et presque effrayé en voyant la dextérité singulière et l’heureuse audace avec lesquelles ces jeunes filles d’Amérique savaient conduire leurs pensées et leurs paroles au milieu des écueils d’une conversation enjouée ; un philosophe aurait bronché cent fois sur l’étroit chemin qu’elles parcouraient sans accidents et sans peine.
Il est facile, en effet, de reconnaître que, au milieu même de l’indépendance de sa première jeunesse, l’Américaine ne cesse jamais entièrement d’être maîtresse d’elle-même ; elle jouit de tous les plaisirs permis sans s’abandonner à aucun d’eux, et sa raison ne lâche point les rênes, quoiqu’elle semble souvent les laisser flotter.
En France, où nous mêlons encore d’une si étrange manière, dans nos opinions et dans nos goûts, des débris de tous les âges, il nous arrive souvent de donner aux femmes une éducation [IV-74] timide, retirée et presque claustrale, comme au temps de l’aristocratie, et nous les abandonnons ensuite tout à coup, sans guide et sans secours, au milieu des désordres inséparables d’une société démocratique.
Les Américains sont mieux d’accord avec eux-mêmes.
Ils ont vu que, au sein d’une démocratie, l’indépendance individuelle ne pouvait manquer d’être très-grande, la jeunesse hâtive, les goûts mal contenus, la coutume changeante, l’opinion publique souvent incertaine ou impuissante, l’autorité paternelle faible et le pouvoir marital contesté.
Dans cet état de choses, ils ont jugé qu’il y avait peu de chances de pouvoir comprimer chez la femme les passions les plus tyranniques du cœur humain, et qu’il était plus sûr de lui enseigner l’art de les combattre elle-même. Comme ils ne pouvaient empêcher que sa vertu ne fût souvent en péril, ils ont voulu qu’elle sût la défendre, et ils ont plus compté sur le libre effort de sa volonté que sur des barrières ébranlées ou détruites. Au lieu de la tenir dans la défiance d’elle-même, ils cherchent donc sans cesse à accroître sa confiance en ses propres forces. N’ayant ni la possibilité ni le désir de maintenir la jeune fille dans une perpétuelle et complète ignorance, ils [IV-75] se sont hâtés de lui donner une connaissance précoce de toutes choses. Loin de lui cacher les corruptions du monde, ils ont voulu qu’elle les vît dès l’abord et qu’elle s’exerçât d’elle-même à les fuir, et ils ont mieux aimé garantir son honnêteté que de trop respecter son innocence.
Quoique les Américains soient un peuple fort religieux, ils ne s’en sont pas rapportés à la religion seule pour défendre la vertu de la femme ; ils ont cherché à armer sa raison. En ceci, comme en beaucoup d’autres circonstances, ils ont suivi la même méthode. Ils ont d’abord fait d’incroyables efforts pour obtenir que l’indépendance individuelle se réglât d’elle-même, et ce n’est qu’arrivés aux dernières limites de la force humaine qu’ils ont enfin appelé la religion à leur secours.
Je sais qu’une pareille éducation n’est pas sans danger ; je n’ignore pas non plus qu’elle tend à développer le jugement aux dépens de l’imagination, et à faire des femmes honnêtes et froides plutôt que des épouses tendres et d’aimables compagnes de l’homme. Si la société en est plus tranquille et mieux réglée, la vie privée en a souvent moins de charmes. Mais ce sont là des maux secondaires, qu’un intérêt plus grand doit faire braver. Parvenus au point où nous sommes, il ne [IV-76] nous est plus permis de faire un choix, il faut une éducation démocratique pour garantir la femme des périls dont les institutions et les mœurs de la démocratie l’environnent.
[IV-77]
CHAPITRE X.↩
Comment la jeune fille se retrouve sous les traits de l’épouse.
En Amérique, l’indépendance de la femme vient se perdre sans retour au milieu des liens du mariage. Si la jeune fille y est moins contrainte que partout ailleurs, l’épouse s’y soumet à des obligations plus étroites. L’une fait de la maison paternelle un lieu de liberté et de plaisir, l’autre vit dans la demeure de son mari comme dans un cloître.
Ces deux états si différents ne sont peut-être pas si contraires qu’on le suppose, et il est naturel que les Américains passent par l’un pour arriver à l’autre.
[IV-78]
Les peuples religieux et les nations industrielles se font une idée particulièrement grave du mariage. Les uns considèrent la régularité de la vie d’une femme comme la meilleure garantie et le signe le plus certain de la pureté de ses mœurs. Les autres y voient le gage assuré de l’ordre et de la prospérité de la maison.
Les Américains forment tout à la fois une nation puritaine, et un peuple commerçant ; leurs croyances religieuses aussi bien que leurs habitudes industrielles les portent donc à exiger de la femme une abnégation d’elle-même et un sacrifice continuel de ses plaisirs à ses affaires, qu’il est rare de lui demander en Europe. Ainsi, il règne aux États-Unis une opinion publique inexorable, qui renferme avec soin la femme dans le petit cercle des intérêts et des devoirs domestiques, et qui lui défend d’en sortir.
A son entrée dans le monde, la jeune Américaine trouve ces notions fermement établies ; elle voit les règles qui en découlent ; elle ne tarde pas à se convaincre qu’elle ne saurait se soustraire un moment aux usages de ses contemporains, sans mettre aussitôt en péril sa tranquillité, son honneur, et jusqu’à son existence sociale, et elle trouve dans la fermeté de sa raison et dans les habitudes viriles que son éducation lui a données, l’énergie de s’y soumettre.
[IV-79]
On peut dire que c’est dans l’usage de l’indépendance qu’elle a puisé le courage d’en subir sans lutte et sans murmure le sacrifice quand le moment est venu de se l’imposer.
L’Américaine d’ailleurs ne tombe jamais dans les liens du mariage comme dans un piège tendu à sa simplicité et à son ignorance. On lui a appris d’avance ce qu’on attendait d’elle, et c’est d’elle-même et librement qu’elle se place sous le joug. Elle supporte courageusement sa condition nouvelle, parce qu’elle l’a choisie.
Comme en Amérique la discipline paternelle est fort lâche et que le lien conjugal est fort étroit, ce n’est qu’avec circonspection et avec crainte qu’une jeune fille le contracte. On n’y voit guère d’unions précoces. Les Américaines ne se marient donc que quand leur raison est exercée et mûrie ; tandis qu’ailleurs la plupart des femmes ne commencent d’ordinaire à exercer et mûrir leur raison, que dans le mariage.
Je suis, du reste, très-loin de croire que ce grand changement qui s’opère dans toutes les habitudes des femmes aux États-Unis, aussitôt qu’elles sont mariées, ne doive être attribué qu’à la contrainte de l’opinion publique. Souvent elles se l’imposent elles-mêmes par le seul effort de leur volonté.
Lorsque le temps est arrivé de choisir un [IV-80] époux, cette froide et austère raison que la libre vue du monde a éclairée et affermie, indique à l’Américaine qu’un esprit léger et indépendant dans les liens du mariage, est un sujet de trouble éternel, non de plaisir ; que les amusements de la jeune fille ne sauraient devenir les délassements de l’épouse, et que pour la femme les sources du bonheur sont dans la demeure conjugale. Voyant d’avance et avec clarté le seul chemin qui peut conduire à la félicité domestique, elle y entre dès ses premiers pas, et le suit jusqu’au bout sans chercher à retourner en arrière.
Cette même vigueur de volonté que font voir les jeunes épouses d’Amérique, en se pliant tout à coup et sans se plaindre aux austères devoirs de leur nouvel état, se retrouve du reste dans toutes les grandes épreuves de leur vie.
Il n’y a pas de pays au monde où les fortunes particulières soient plus instables qu’aux États-Unis. Il n’est pas rare que dans le cours de son existence, le même homme monte et redescende tous les degrés qui conduisent de l’opulence à la pauvreté.
Les femmes d’Amérique supportent ces révolutions avec une tranquille et indomptable énergie. On dirait que leurs désirs se resserrent avec leur fortune, aussi aisément qu’ils s’étendent.
La plupart des aventuriers qui vont peupler [IV-81] chaque année les solitudes de l’ouest appartiennent, ainsi que je l’ai dit dans mon premier ouvrage, à l’ancienne race anglo-américaine du nord. Plusieurs de ces hommes qui courent avec tant d’audace vers la richesse jouissaient déjà de l’aisance dans leur pays. Ils mènent avec eux leurs compagnes, et font partager à celles-ci les périls et les misères sans nombre qui signalent toujours le commencement de pareilles entreprises. J’ai souvent rencontré jusque sur les limites du désert de jeunes femmes qui, après avoir été élevées au milieu de toutes les délicatesses des grandes villes de la Nouvelle-Angleterre, étaient passées presque sans transition de la riche demeure de leurs parents dans une hutte mal fermée au sein d’un bois. La fièvre, la solitude, l’ennui, n’avaient point brisé les ressorts de leur courage. Leurs traits semblaient altérés et flétris, mais leurs regards étaient fermes. Elles paraissaient tout à la fois tristes et résolues.[Note]
Je ne doute point que ces jeunes Américaines n’eussent amassé, dans leur éducation première, cette force intérieure dont elles faisaient alors usage.
C’est donc encore la jeune fille qui, aux États-Unis, se retrouve sous les traits de l’épouse ; le rôle a changé, les habitudes diffèrent, l’esprit est le même.
[IV-83]
CHAPITRE XI.↩
Comment l’égalité des conditions contribue à maintenir les bonnes mœurs en Amérique.[Note]
Il y a des philosophes et des historiens qui ont dit, ou ont laissé entendre, que les femmes étaient plus ou moins sévères dans leurs mœurs suivant qu’elles habitaient plus ou moins loin de l’équateur. C’est se tirer d’affaire à bon marché, et, à ce compte, il suffirait d’une sphère et d’un compas pour résoudre en un instant l’un des [IV-84] plus difficiles problèmes que l’humanité présente.
Je ne vois point que cette doctrine matérialiste soit établie par les faits.
Les mêmes nations se sont montrées, à différentes époques de leur histoire, chastes ou dissolues. La régularité ou le désordre de leurs mœurs tenait donc à quelques causes changeantes, et non pas seulement à la nature du pays, qui ne changeait point.
Je ne nierai pas que, dans certains climats, les passions qui naissent de l’attrait réciproque des sexes ne soient particulièrement ardentes ; mais je pense que cette ardeur naturelle peut toujours être excitée ou contenue par l’état social et les institutions politiques.
Quoique les voyageurs qui ont visité l’Amérique du Nord diffèrent entre eux sur plusieurs points, ils s’accordent tous à remarquer que les mœurs y sont infiniment plus sévères que partout ailleurs.
Il est évident que, sur ce point, les Américains sont très supérieurs à leurs pères les Anglais. Une vue superficielle des deux nations suffit pour le montrer.
En Angleterre, comme dans toutes les autres contrées de l’Europe, la malignité publique s’exerce sans cesse sur les faiblesses des femmes. On entend souvent les philosophes et les hommes d’État s’y plaindre de ce que les mœurs ne sont pas assez [IV-85] régulières, et la littérature le fait supposer tous les jours.
En Amérique tous les livres, sans en excepter les romans, supposent les femmes chastes, et personne n’y raconte aventures galantes.
Cette grande régularité des mœurs américaines tient sans doute en partie au pays, à la race, à la religion. Mais toutes ces causes, qui se rencontrent ailleurs, ne suffisent pas encore pour l’expliquer. Il faut pour cela recourir à quelque raison particulière.
Cette raison me paraît être l’égalité et les institutions qui en découlent.
L’égalité des conditions ne produit pas à elle seule la régularité des mœurs ; mais on ne saurait douter qu’elle ne la facilite et ne l’augmente.
Chez les peuples aristocratiques la naissance et la fortune font souvent de l’homme et de la femme des êtres si différents qu’ils ne sauraient jamais parvenir à s’unir l’un à l’autre. Les passions les rapprochent, mais l’état social et les idées qu’il suggère les empêchent de se lier d’une manière permanente et ostensible. De là naissent nécessairement un grand nombre d’unions passagères et clandestines. La nature s’y dédommage en secret de la contrainte que les lois lui imposent.
Ceci ne se voit pas de même quand l’égalité des [IV-86] conditions a fait tomber toutes les barrières imaginaires, ou réelles, qui séparaient l’homme de la femme. Il n’y a point alors de jeune fille qui ne croie pouvoir devenir l’épouse de l’homme qui la préfère ; ce qui rend le désordre des mœurs avant le mariage fort difficile. Car, quelle que soit la crédulité des passions, il n’y a guère moyen qu’une femme se persuade qu’on l’aime lorsqu’on est parfaitement libre de l’épouser et qu’on ne le fait point.
La même cause agit, quoique d’une manière plus indirecte, dans le mariage.
Rien ne sert mieux à légitimer l’amour illégitime aux yeux de ceux qui l’éprouvent, ou de la foule qui le contemple, que des unions forcées ou faites au hasard [4] .
[IV-87]
Dans un pays où la femme exerce toujours librement son choix, et où l’éducation l’a mise en état de bien choisir, l’opinion publique est inexorable pour ses fautes.
Le rigorisme des Américains naît, en partie, de là. Ils considèrent le mariage comme un contrat souvent onéreux, mais dont cependant on est tenu à la rigueur d’exécuter toutes les clauses, parce qu’on a pu les connaître toutes à l’avance, et qu’on a joui de la liberté entière de ne s’obliger à rien.
Ce qui rend la fidélité plus obligatoire la rend plus facile.
Dans les pays aristocratiques le mariage a plutôt pour but d’unir des biens que des personnes ; aussi arrive-t-il quelquefois que le mari y est pris à l’école et la femme en nourrice. Il n’est pas étonnant que le lien conjugal qui retient unies les fortunes des deux époux laisse leurs cœurs errer à l’aventure. Cela découle naturellement de l’esprit du contrat.
Quand, au contraire, chacun choisit toujours lui-même sa compagne, sans que rien d’extérieur ne le gêne, ni même ne le dirige, ce n’est [IV-88] d’ordinaire que la similitude des goûts et des idées qui rapproche l’homme et la femme ; et cette même similitude les retient et les fixe l’un à côté de l’autre.
Nos pères avaient conçu une opinion singulière en fait de mariage.
Comme ils s’étaient aperçu que le petit nombre de mariages d’inclination, qui se faisaient de leur temps avaient presque toujours eu une issue funeste, ils en avaient conclu résolument qu’en pareille matière il était très-dangereux de consulter son propre cœur. Le hasard leur paraissait plus clairvoyant que le choix.
Il n’était pas bien difficile de voir cependant que les exemples qu’ils avaient sous les yeux ne prouvaient rien.
Je remarquerai d’abord que si les peuples démocratiques accordent aux femmes le droit de choisir librement leur mari, ils ont soin de fournir d’avance à leur esprit les lumières, et à leur volonté la force qui peuvent être nécessaires pour un pareil choix ; tandis que les jeunes filles qui, chez les peuples aristocratiques, échappent furtivement à l’autorité paternelle pour se jeter d’elles-mêmes dans les bras d’un homme qu’on ne leur a donné ni le temps de connaître, ni la capacité de juger, manquent de toutes ces garanties. On ne saurait être surpris qu’elles fassent un mauvais usage de leur [IV-89] libre arbitre, la première fois qu’elles en usent ; ni qu’elles tombent dans de si cruelles erreurs, lorsque sans avoir reçu l’éducation démocratique, elles veulent suivre, en se mariant, les coutumes de la démocratie.
Mais il y a plus.
Lorsqu’un homme et une femme veulent se rapprocher à travers les inégalités de l’état social aristocratique, ils ont d’immenses obstacles à vaincre. Après avoir rompu ou desserré les liens de l’obéissance filiale, il leur faut échapper, par un dernier effort, à l’empire de la coutume et à la tyrannie de l’opinion ; et lorsque enfin ils sont arrivés au bout de cette rude entreprise, ils se trouvent comme des étrangers au milieu de leurs amis naturels et de leurs proches : le préjugé qu’ils ont franchi les en sépare. Cette situation ne tarde pas à abattre leur courage et à aigrir leurs cœurs.
Si donc il arrive que des époux unis de cette manière sont d’abord malheureux, et puis coupables, il ne faut pas l’attribuer à ce qu’ils se sont librement choisis, mais plutôt à ce qu’ils vivent dans une société qui n’admet point de pareils choix.
On ne doit pas oublier, d’ailleurs, que le même effort qui fait sortir violemment un homme d’une erreur commune l’entraîne presque toujours hors de la raison ; que, pour oser déclarer une guerre, [IV-90] même légitime, aux idées de son siècle et de son pays, il faut avoir dans l’esprit une certaine disposition violente et aventureuse, et que des gens de ce caractère, quelque direction qu’ils prennent, parviennent rarement au bonheur et à la vertu. Et c’est, pour le dire en passant, ce qui explique pourquoi, dans les révolutions les plus nécessaires et les plus saintes, il se rencontre si peu de révolutionnaires modérés et honnêtes.
Que, dans un siècle d’aristocratie, un homme s’avise par hasard de ne consulter dans l’union conjugale d’autres convenances que son opinion particulière et son goût, et que le désordre des mœurs et la misère ne tardent pas ensuite à s’introduire dans son ménage, il ne faut donc pas s’en étonner. Mais, lorsque cette même manière d’agir est dans l’ordre naturel et ordinaire des choses ; que l’état social la facilite ; que la puissance paternelle s’y prête, et que l’opinion publique la préconise, on ne doit pas douter que la paix intérieure des familles n’en devienne plus grande, et que la foi conjugale n’en soit mieux gardée.
Presque tous les hommes des démocraties parcourent une carrière politique ou exercent une profession, et, d’une autre part, la médiocrité des fortunes y oblige la femme à se renfermer chaque jour dans l’intérieur de sa demeure, afin de [IV-91] présider elle-même, et de très près, aux détails de l’administration domestique.
Tous ces travaux distincts et forcés sont comme autant de barrières naturelles qui, séparant les sexes, rendent les sollicitations de l’un plus rares et moins vives, et la résistance de l’autre plus aisée.
Ce n’est pas que l’égalité des conditions puisse jamais parvenir à rendre l’homme chaste ; mais elle donne au désordre de ses mœurs un caractère moins dangereux. Comme personne n’a plus alors le loisir ni l’occasion d’attaquer les vertus qui veulent se défendre, on voit tout à la fois un grand nombre de courtisanes et une multitude de femmes honnêtes.
Un pareil état de choses produit de déplorables misères individuelles, mais il n’empêche point que le corps social ne soit dispos et fort ; il ne détruit pas les liens de famille et n’énerve pas les mœurs nationales. Ce qui met en danger la société, ce n’est pas la grande corruption chez quelques uns ; c’est le relâchement de tous. Aux yeux du législateur, la prostitution est bien moins à redouter que la galanterie.
Cette vie tumultueuse et sans cesse tracassée, que l’égalité donne aux hommes, ne les détourne pas seulement de l’amour en leur ôtant le loisir de s’y livrer ; elle les en écarte encore par un chemin plus secret, mais plus sûr.
[IV-92]
Tous les hommes qui vivent dans les temps démocratiques contractent plus ou moins les habitudes intellectuelles des classes industrielles et commerçantes ; leur esprit prend un tour sérieux, calculateur et positif ; il se détourne volontiers de l’idéal pour se diriger vers quelque but visible et prochain qui se présente comme le naturel et nécessaire objet des désirs. L’égalité ne détruit pas ainsi l’imagination ; mais elle la limite et ne lui permet de voler qu’en rasant la terre.
Il n’y a rien de moins rêveur que les citoyens d’une démocratie, et l’on n’en voit guère qui veuillent s’abandonner à ces contemplations oisives et solitaires qui précèdent d’ordinaire et qui produisent les grandes agitations du cœur.
Ils mettent, il est vrai, beaucoup de prix à se procurer cette sorte d’affection profonde, régulière et paisible, qui fait le charme et la sécurité de la vie ; mais ils ne courent pas volontiers après des émotions violentes et capricieuses qui la troublent et l’abrégent.
Je sais que tout ce qui précède n’est complètement applicable qu’à l’Amérique, et ne peut, quant à présent, s’étendre d’une manière générale à l’Europe.
Depuis un demi-siècle que les lois et les habitudes poussent avec une énergie sans pareille plusieurs peuples européens vers la démocratie, on [IV-93] ne voit point que chez ces nations les rapports de l’homme et de la femme soient devenus plus réguliers et plus chastes. Le contraire se laisse même apercevoir en quelques endroits. Certaines classes sont mieux réglées ; la moralité générale paraît plus lâche. Je ne craindrai pas de le remarquer, car je ne me sens pas mieux disposé à flatter mes contemporains qu’à en médire.
Ce spectacle doit affliger, mais non surprendre. L’heureuse influence qu’un état social démocratique peut exercer sur la régularité des habitudes est un de ces faits qui ne sauraient se découvrir qu’à la longue. Si l’égalité des conditions est favorable aux bonnes mœurs, le travail social, qui rend les conditions égales, leur est très-funeste.
Depuis cinquante ans que la France se transforme, nous avons eu rarement de la liberté, mais toujours du désordre. Au milieu de cette confusion universelle des idées et de cet ébranlement général des opinions, parmi ce mélange incohérent du juste et de l’injuste, du vrai et du faux, du droit et du fait, la vertu publique est devenue incertaine, et la moralité privée chancelante.
Mais toutes les révolutions, quels que fussent leur objet et leurs agents, ont d’abord produit des effets semblables. Celles mêmes qui ont fini par resserrer le lien des mœurs ont commencé par le détendre.
[IV-94]
Les désordres dont nous sommes souvent témoins ne me semblent donc pas un fait durable. Déjà de curieux indices l’annoncent.
Il n’y a rien de plus misérablement corrompu qu’une aristocratie qui conserve ses richesses en perdant son pouvoir, et qui, réduite à des jouissances vulgaires, possède encore d’immenses loisirs. Les passions énergiques et les grandes pensées qui l’avaient animée jadis, en disparaissent alors, et l’on n’y rencontre plus guère qu’une multitude de petits vices rongeurs, qui s’attachent à elle, comme des vers à un cadavre.
Personne ne conteste que l’aristocratie française du dernier siècle ne fût très-dissolue ; tandis que d’anciennes habitudes et de vieilles croyances maintenaient encore le respect des mœurs dans les autres classes.
On n’aura pas de peine non plus à tomber d’accord que, de notre temps, une certaine sévérité de principes ne se fasse voir parmi les débris de cette même aristocratie, au lieu que le désordre des mœurs a paru s’étendre dans les rangs moyens et inférieurs de la société. De telle sorte que les mêmes familles qui se montraient, il y a cinquante ans, les plus relâchées, se montrent aujourd’hui les plus exemplaires, et que la démocratie semble n’avoir moralisé que les classes aristocratiques.
[IV-95]
La révolution, en divisant la fortune des nobles, en les forçant de s’occuper assidument de leurs affaires et de leurs familles, en les renfermant avec leurs enfants sous le même toit, en donnant enfin un tour plus raisonnable et plus grave à leurs pensées, leur a suggéré, sans qu’ils s’en aperçoivent eux-mêmes, le respect des croyances religieuses, l’amour de l’ordre, des plaisirs paisibles, des joies domestiques et du bien-être ; tandis que le reste de la nation, qui avait naturellement ces mêmes goûts, était entraîné vers le désordre par l’effort même qu’il fallait faire pour renverser les lois et les coutumes politiques.
L’ancienne aristocratie française a subi les conséquences de la révolution, et elle n’a point ressenti les passions révolutionnaires, ni partagé l’entraînement souvent anarchique qui l’a produite ; il est facile de concevoir qu’elle éprouve dans ses mœurs l’influence salutaire de cette révolution, avant ceux mêmes qui l’ont faite.
Il est donc permis de dire, quoique la chose au premier abord paraisse surprenante, que, de nos jours, ce sont les classes les plus anti-démocratiques de la nation qui font le mieux voir l’espèce de moralité qu’il est raisonnable d’attendre de la démocratie.
Je ne puis m’empêcher de croire, que quand [IV-96] nous aurons obtenu tous les effets de la révolution démocratique, après être sortis du tumulte qu’elle a fait naître, ce qui n’est vrai aujourd’hui que de quelques-uns le deviendra peu à peu de tous.
[IV-97]
CHAPITRE XII.↩
Comment les américains comprennent l’égalité de l’homme et de la femme.
J’ai fait voir comment la démocratie détruisait ou modifiait les diverses inégalités que la société fait naître ; mais est-ce là tout, et ne parvient-elle pas enfin à agir sur cette grande inégalité de l’homme et de la femme, qui a semblé, jusqu’à nos jours, avoir ses fondements éternels dans la nature ?
Je pense que le mouvement social qui rapproche du même niveau le fils et le père, le serviteur et le maître, et, en général, l’inférieur et le supérieur, élève la femme, et doit de plus en plus en faire l’égale de l’homme.
[IV-98]
Mais c’est ici, plus que jamais, que je sens le besoin d’être bien compris ; car, il n’y a pas de sujet sur lequel l’imagination grossière et désordonnée de notre siècle se soit donné une plus libre carrière.
Il y a des gens en Europe, qui, confondant les attributs divers des sexes, prétendent faire de l’homme et de la femme des êtres, non seulement égaux, mais semblables. Ils donnent à l’un comme à l’autre les mêmes fonctions, leur imposent les mêmes devoirs et leur accordent les mêmes droits ; ils les mêlent en toutes choses, travaux, plaisirs, affaires. On peut aisément concevoir qu’en s’efforçant d’égaler ainsi un sexe à l’autre, on les dégrade tous les deux ; et que de ce mélange grossier des œuvres de la nature, il ne saurait jamais sortir que des hommes faibles et des femmes déshonnêtes.
Ce n’est point ainsi que les Américains ont compris l’espèce d’égalité démocratique qui peut s’établir entre la femme et l’homme. Ils ont pensé que, puisque la nature avait établi une si grande variété entre la constitution physique et morale de l’homme et celle de la femme, son but clairement indiqué était de donner à leurs différentes facultés un emploi divers ; et ils ont jugé que le progrès ne consistait point à faire faire à peu près les mêmes choses à des [IV-99] êtres dissemblables, mais à obtenir que chacun d’eux s’acquittât le mieux possible de sa tâche. Les Américains ont appliqué aux deux sexes le grand principe d’économie politique qui domine de nos jours l’industrie. Ils ont soigneusement divisé les fonctions de l’homme et de la femme, afin que le grand travail social fût mieux fait.
L’Amérique est le pays du monde où l’on a pris le soin le plus continuel de tracer aux deux sexes des lignes d’action nettement séparées ; et où l’on a voulu que tous deux marchassent d’un pas égal, mais dans des chemins toujours différents. Vous ne voyez point d’Américaines diriger les affaires extérieures de la famille, conduire un négoce, ni pénétrer enfin dans la sphère politique ; mais on n’en rencontre point non plus qui soient obligées de se livrer aux rudes travaux du labourage, ni à aucun des exercices pénibles qui exigent le développement de la force physique. Il n’y a pas de familles si pauvres qui fassent exception à cette règle. Si l’Américaine ne peut point s’échapper du cercle paisible des occupations domestiques, elle n’est, d’autre part, jamais contrainte d’en sortir.
De là vient que les Américaines, qui font souvent voir une mâle raison et une énergie toute virile, conservent en général une apparence très-délicate, et restent toujours femmes par les manières, bien [IV-100] qu’elles se montrent hommes quelquefois par l’esprit et le cœur.
Jamais non plus les Américains n’ont imaginé que la conséquence des principes démocratiques fût de renverser la puissance maritale et d’introduire la confusion des autorités dans la famille. Ils ont pensé que toute association, pour être efficace, devait avoir un chef, et que le chef naturel de l’association conjugale était l’homme. Ils ne refusent donc point à celui-ci le droit de diriger sa compagne ; et ils croient que, dans la petite société du mari et de la femme, ainsi que dans la grande société politique, l’objet de la démocratie est de régler et de légitimer les pouvoirs nécessaires, et non de détruire tout pouvoir.
Cette opinion n’est point particulière à un sexe, et combattue par l’autre.
Je n’ai pas remarqué que les Américaines considérassent l’autorité conjugale comme une usurpation heureuse de leurs droits, ni qu’elles crussent que ce fût s’abaisser de s’y soumettre. Il m’a semblé voir, au contraire, qu’elles se faisaient une sorte de gloire du volontaire abandon de leur volonté, et qu’elles mettaient leur grandeur à se plier d’elles-mêmes au joug et non à s’y soustraire. C’est là, du moins, le sentiment qu’expriment les plus vertueuses : les autres se taisent, et l’on n’entend point aux États-Unis d’épouse adultère [IV-101] réclamer bruyamment les droits de la femme, en foulant aux pieds ses plus saints devoirs.
On a remarqué souvent qu’en Europe un certain mépris se découvre au milieu même des flatteries que les hommes prodiguent aux femmes : bien que l’Européen se fasse souvent l’esclave de la femme, on voit qu’il ne la croit jamais sincèrement son égale.
Aux États-Unis, on ne loue guère les femmes ; mais on montre chaque jour qu’on les estime.
Les Américains font voir sans cesse une pleine confiance dans la raison de leur compagne, et un respect profond pour sa liberté. Ils jugent que son esprit est aussi capable que celui de l’homme de découvrir la vérité toute nue, et son cœur assez ferme pour la suivre ; et ils n’ont jamais cherché à mettre la vertu de l’un plus que celle de l’autre à l’abri des préjugés, de l’ignorance ou de la peur.
Il semble qu’en Europe, où l’on se soumet si aisément à l’empire despotique des femmes, on leur refuse cependant quelques-uns des plus grands attributs de l’espèce humaine, et qu’on les considère comme des êtres séduisants et incomplets ; et, ce dont on ne saurait trop s’étonner, c’est que les femmes elles-mêmes finissent par se voir sous le même jour, et qu’elles ne sont pas éloignées de considérer comme un privilège la faculté qu’on [IV-102] leur laisse de se montrer futiles, faibles et craintives. Les Américaines ne réclament point de semblables droits.
On dirait, d’une autre part, qu’en fait de mœurs, nous ayons accordé à l’homme une sorte d’immunité singulière ; de telle sorte qu’il y ait comme une vertu à son usage, et une autre à celui de sa compagne ; et que, suivant l’opinion publique, le même acte puisse être alternativement un crime ou seulement une faute.
Les Américains ne connaissent point cet inique partage des devoirs et des droits. Chez eux, le séducteur est aussi déshonoré que sa victime.
Il est vrai que les Américains témoignent rarement aux femmes ces égards empressés dont on se plaît à les environner en Europe ; mais ils montrent toujours, par leur conduite, qu’ils les supposent vertueuses et délicates ; et ils ont un si grand respect pour leur liberté morale, qu’en leur présence chacun veille avec soin sur ses discours, de peur qu’elles ne soient forcées d’entendre un langage qui les blesse. En Amérique, une jeune fille entreprend, seule et sans crainte, un long voyage.
Les législateurs des États-Unis, qui ont adouci presque toutes les dispositions du Code pénal, punissent de mort le viol ; et il n’est point de crimes que l’opinion publique poursuive avec une [IV-103] ardeur plus inexorable. Cela s’explique : comme les Américains ne conçoivent rien de plus précieux que l’honneur de la femme, et rien de si respectable que son indépendance, ils estiment qu’il n’y a pas de châtiment trop sévère pour ceux qui les lui enlèvent malgré elle.
En France, où le même crime est frappé de peines beaucoup plus douces, il est souvent difficile de trouver un jury qui condamne. Serait-ce mépris de la pudeur, ou mépris de la femme ? Je ne puis m’empêcher de croire que c’est l’un et l’autre.
Ainsi, les Américains ne croient pas que l’homme et la femme aient le devoir ni le droit de faire les mêmes choses, mais ils montrent une même estime pour le rôle de chacun d’eux, et ils les considèrent comme des êtres dont la valeur est égale, quoique la destinée diffère. Ils ne donnent point au courage de la femme la même forme ni le même emploi qu’à celui de l’homme ; mais ils ne doutent jamais de son courage ; et s’ils estiment que l’homme et sa compagne ne doivent pas toujours employer leur intelligence et leur raison de la même manière, ils jugent, du moins, que la raison de l’une est aussi assurée que celle de l’autre, et son intelligence aussi claire.
Les Américains, qui ont laissé subsister dans la société l’infériorité de la femme, l’ont donc élevée [IV-104] de tout leur pouvoir, dans le monde intellectuel et moral, au niveau de l’homme ; et, en ceci, ils me paraissent avoir admirablement compris la véritable notion du progrès démocratique.
Pour moi, je n’hésiterai pas à le dire : quoique aux États-Unis la femme ne sorte guère du cercle domestique, et qu’elle y soit, à certains égards, fort dépendante, nulle part sa position ne m’a semblé plus haute ; et si, maintenant que j’approche de la fin de ce livre, où j’ai montré tant de choses considérables faites par les Américains, on me demandait à quoi je pense qu’il faille principalement attribuer la prospérité singulière et la force croissante de ce peuple, je répondrais que c’est à la supériorité de ses femmes.
[IV-105]
CHAPITRE XIII.↩
Comment l’égalité divise naturellement les Américains en une multitude de petites sociétés particulières.
On serait porté à croire que la conséquence dernière et l’effet nécessaire des institutions démocratiques est de confondre les citoyens dans la vie privée aussi bien que dans la vie publique, et de les forcer tous à mener une existence commune.
C’est comprendre sous une forme bien grossière et bien tyrannique, l’égalité que la démocratie fait naître.
Il n’y a point d’état social ni de lois qui puissent rendre les hommes tellement semblables, [IV-106] que l’éducation, la fortune et les goûts ne mettent entre eux quelque différence, et, si des hommes différents peuvent trouver quelquefois leur intérêt à faire, en commun, les mêmes choses, on doit croire qu’ils n’y trouveront jamais leur plaisir. Ils échapperont donc toujours, quoi qu’on fasse, à la main du législateur ; et, se dérobant par quelque endroit du cercle où l’on cherche à les renfermer, ils établiront, à côté de la grande société politique, de petites sociétés privées, dont la similitude des conditions, des habitudes et des mœurs sera le lien.
Aux États-Unis, les citoyens n’ont aucune prééminence les uns sur les autres ; ils ne se doivent réciproquement ni obéissance ni respect ; ils administrent ensemble la justice, et gouvernent l’État, et en général ils se réunissent tous pour traiter les affaires qui influent sur la destinée commune ; mais je n’ai jamais ouï dire qu’on prétendît les amener à se divertir tous de la même manière, ni à se réjouir confusément dans les mêmes lieux.
Les Américains, qui se mêlent si aisément dans l’enceinte des assemblées politiques et des tribunaux, se divisent, au contraire, avec grand soin en petites associations fort distinctes, pour goûter à part les jouissances de la vie privée. Chacun d’eux reconnaît volontiers tous ses concitoyens pour ses égaux, mais il n’en reçoit jamais qu’un [IV-107] très-petit nombre parmi ses amis et ses hôtes.
Cela me semble très-naturel. À mesure que le cercle de la société publique s’agrandit, il faut s’attendre à ce que la sphère des relations privées se resserre : au lieu d’imaginer que les citoyens des sociétés nouvelles vont finir par vivre en commun, je crains bien qu’ils n’arrivent enfin à ne plus former que de très-petites coteries.
Chez les peuples aristocratiques, les différentes classes sont comme de vastes enceintes, d’où l’on ne peut sortir et où l’on ne saurait entrer. Les classes ne se communiquent point entre elles ; mais, dans l’intérieur de chacune d’elles, les hommes se pratiquent forcément tous les jours. Lors même que naturellement ils ne se conviendraient point, la convenance générale d’une même condition les rapproche.
Mais lorsque ni la loi ni la coutume ne se chargent d’établir des relations fréquentes et habituelles entre certains hommes, la ressemblance accidentelle des opinions et des penchants en décide. Ce qui varie les sociétés particulières à l’infini.
Dans les démocraties, où les citoyens ne diffèrent jamais beaucoup les uns les autres, et se trouvent naturellement si proches qu’à chaque instant il peut leur arriver de se confondre tous dans une masse commune, il se crée une [IV-108] multitude de classifications artificielles et arbitraires à l’aide desquelles chacun cherche à se mettre à l’écart, de peur d’être entraîné malgré soi dans la foule.
Il ne saurait jamais manquer d’en être ainsi ; car on peut changer les institutions humaines, mais non l’homme : quel que soit l’effort général d’une société pour rendre les citoyens égaux et semblables, l’orgueil particulier des individus cherchera toujours à échapper au niveau, et voudra former quelque part, une inégalité dont il profite.
Dans les aristocraties, les hommes sont séparés les uns des autres par de hautes barrières immobiles ; dans les démocraties, ils sont divisés par une multitude de petits fils presque invisibles, qu’on brise à tout moment et qu’on change sans cesse de place.
Ainsi, quels que soient les progrès de l’égalité, il se formera toujours chez les peuples démocratiques un grand nombre de petites associations privées au milieu de la grande société politique. Mais aucune d’elles ne ressemblera, par les manières, à la classe supérieure qui dirige les aristocraties.
[IV-109]
CHAPITRE XIV.↩
Quelques réflexions sur les manières américaines.
Il n’y a rien, au premier abord, qui semble moins important que la forme extérieure des actions humaines, et il n’y a rien à quoi les hommes attachent plus de prix ; ils s’accoutument à tout, excepté à vivre dans une société qui n’a pas leurs manières. L’influence qu’exerce l’état social et politique sur les manières vaut donc la peine d’être sérieusement examinée.
Les manières sortent, en général, du fond même des mœurs ; et, de plus, elles résultent quelquefois d’une convention arbitraire entre certains [IV-110] hommes. Elles sont, en même temps, naturelles et acquises.
Quand des hommes s’aperçoivent qu’ils sont les premiers sans contestation et sans peine ; qu’ils ont chaque jour sous les yeux de grands objets dont ils s’occupent, laissant à d’autres les détails ; et qu’ils vivent au sein d’une richesse qu’ils n’ont pas acquise et qu’ils ne craignent pas de perdre, on conçoit qu’ils éprouvent une sorte de dédain superbe pour les petits intérêts et les soins matériels de la vie, et qu’ils aient dans la pensée une grandeur naturelle que les paroles et les manières révèlent.
Dans les pays démocratiques, les manières ont d’ordinaire peu de grandeur, parce que la vie privée y est fort petite. Elles sont souvent vulgaires, parce que la pensée n’y a que peu d’occasions de s’y élever au-delà de la préoccupation des intérêts domestiques.
La véritable dignité des manières consiste à se montrer toujours à sa place, ni plus haut, ni plus bas ; cela est à la portée du paysan comme du prince. Dans les démocraties, toutes les places paraissent douteuses ; d’où il arrive que les manières, qui y sont souvent orgueilleuses, y sont rarement dignes. De plus, elles ne sont jamais ni bien réglées ni bien savantes.
Les hommes qui vivent dans les démocraties [IV-111] sont trop mobiles pour qu’un certain nombre d’entre eux parvienne à établir un code de savoir-vivre et puissent tenir la main à ce qu’on le suive. Chacun y agit donc à peu près à sa guise, et il y règne toujours une certaine incohérence dans les manières, parce qu’elles se conforment aux sentiments et aux idées individuelles de chacun, plutôt qu’à un modèle idéal donné d’avance à l’imitation de tous.
Toutefois, ceci est bien plus sensible au moment où l’aristocratie vient de tomber que lorsqu’elle est depuis longtemps détruite.
Les institutions politiques nouvelles et les nouvelles mœurs réunissent alors dans les mêmes lieux et forcent souvent de vivre en commun des hommes que l’éducation et les habitudes rendent encore prodigieusement dissemblables ; ce qui fait ressortir à tout moment de grandes bigarrures. On se souvient encore qu’il a existé un code précis de la politesse ; mais on ne sait déjà plus ni ce qu’il contient ni où il se trouve. Les hommes ont perdu la loi commune des manières, et ils n’ont pas encore pris le parti de s’en passer ; mais chacun s’efforce de former, avec les débris des anciens usages, une certaine règle arbitraire et changeante ; de telle sorte que les manières n’ont ni la régularité ni la grandeur qu’elles font souvent voir chez les peuples aristocratiques, ni le [IV-112] tour simple et libre qu’on leur remarque quelquefois dans la démocratie ; elles sont tout à la fois gênées et sans gêne.
Ce n’est pas là l’état normal.
Quand l’égalité est complète et ancienne, tous les hommes ayant à peu près les mêmes idées et faisant à peu près les mêmes choses, n’ont pas besoin de s’entendre ni de se copier pour agir et parler de la même sorte ; on voit sans cesse une multitude de petites dissemblances dans leurs manières ; on n’y aperçoit pas de grandes différences. Ils ne se ressemblent jamais parfaitement, parce qu’ils n’ont pas le même modèle ; ils ne sont jamais fort dissemblables, parce qu’ils ont la même condition. Au premier abord, on dirait que les manières de tous les Américains sont exactement pareilles. Ce n’est qu’en les considérant de fort près, qu’on aperçoit les particularités par où tous diffèrent.
Les Anglais se sont fort égayés aux dépens des manières américaines ; et, ce qu’il y a de particulier, c’est que la plupart de ceux qui nous en ont fait un si plaisant tableau, appartenaient aux classes moyennes d’Angleterre, auxquelles ce même tableau est fort applicable. De telle sorte, que ces impitoyables détracteurs présentent d’ordinaire l’exemple de ce qu’ils blâment aux États-Unis ; ils ne s’aperçoivent pas qu’ils se raillent eux-mêmes, [IV-113] pour la grande joie de l’aristocratie de leur pays.
Rien ne fait plus de tort à la démocratie, que la forme extérieure de ses mœurs. Bien des gens s’accommoderaient volontiers de ses vices, qui ne peuvent supporter ses manières.
Je ne saurais admettre cependant qu’il n’y ait rien à louer dans les manières des peuples démocratiques.
Chez les nations aristocratiques, tous ceux qui avoisinent la première classe s’efforcent d’ordinaire de lui ressembler, ce qui produit des imitations très-ridicules et fort plates. Si les peuples démocratiques ne possèdent point chez eux le modèle des grandes manières, ils échappent du moins à l’obligation d’en voir tous les jours de méchantes copies.
Dans les démocraties, les manières ne sont jamais si raffinées que chez les peuples aristocratiques ; mais jamais non plus elles ne se montrent si grossières. On n’y entend ni les gros mots de la populace, ni les expressions nobles et choisies des grands seigneurs. Il y a souvent de la trivialité dans les mœurs, mais point de brutalité ni de bassesse.
J’ai dit que dans les démocraties, il ne saurait se former un code précis en fait de savoir-vivre. Ceci a son inconvénient et ses avantages. Dans [IV-114] les aristocraties, les règles de la bienséance imposent à chacun la même apparence ; elles rendent tous les membres de la même classe semblables, en dépit de leurs penchants particuliers ; elles parent le naturel et le cachent. Chez les peuples démocratiques, les manières ne sont ni aussi savantes ni aussi régulières ; mais elles sont souvent plus sincères. Elles forment comme un voile léger et mal tissu, à travers lequel les sentiments véritables et les idées individuelles de chaque homme se laissent aisément voir. La forme et le fond des actions humaines s’y rencontrent donc souvent dans un rapport intime, et, si le grand tableau de l’humanité est moins orné, il est plus vrai. Et c’est ainsi, que dans un sens, on peut dire que l’effet de la démocratie n’est point précisément de donner aux hommes certaines manières, mais d’empêcher qu’ils n’aient des manières.
On peut quelquefois retrouver dans une démocratie, des sentiments, des passions, des vertus et des vices de l’aristocratie ; mais non ses manières. Celles-ci se perdent et disparaissent sans retour, quand la révolution démocratique est complète.
Il semble qu’il n’y a rien de plus durable que les manières d’une classe aristocratique ; car elle les conserve encore quelque temps après avoir perdu ses biens et son pouvoir ; ni de si fragile, car à peine ont-elles disparu, qu’on n’en retrouve plus la [IV-115] trace, et qu’il est difficile de dire ce qu’elles étaient du moment qu’elles ne sont plus. Un changement dans l’état social opère ce prodige ; quelques générations y suffisent.
Les traits principaux de l’aristocratie restent gravés dans l’histoire, lorsque l’aristocratie est détruite, mais les formes délicates et légères de ses mœurs disparaissent de la mémoire des hommes, presque aussitôt après sa chute. Ils ne sauraient les concevoir dès qu’ils ne les ont plus sous les yeux. Elles leur échappent sans qu’ils le voient ni qu’ils le sentent. Car, pour éprouver cette espèce de plaisir raffiné que procurent la distinction et le choix des manières, il faut que l’habitude et l’éducation y aient préparé le cœur, et l’on en perd aisément le goût avec l’usage.
Ainsi, non seulement les peuples démocratiques ne sauraient avoir les manières de l’aristocratie ; mais ils ne les conçoivent ni ne les désirent ; ils ne les imaginent point, elles sont, pour eux, comme si elles n’avaient jamais été.
Il ne faut pas attacher trop d’importance à cette perte ; mais il est permis de la regretter.
Je sais qu’il est arrivé plus d’une fois que les mêmes hommes ont eu des mœurs très-distinguées et des sentiments très vulgaires ; l’intérieur des cours a fait assez voir que de grands dehors pouvaient souvent cacher des cœurs fort bas. Mais, si [IV-116] les manières de l’aristocratie ne faisaient point la vertu, elles ornaient quelquefois la vertu même. Ce n’était point un spectacle ordinaire que celui d’une classe nombreuse et puissante, où tous les actes extérieurs de la vie semblaient révéler à chaque instant la hauteur naturelle des sentiments et des pensées, la délicatesse et la régularité des goûts, l’urbanité des mœurs.
Les manières de l’aristocratie donnaient de belles illusions sur la nature humaine ; et quoique le tableau fût souvent menteur, on éprouvait un noble plaisir à le regarder.
[IV-117]
CHAPITRE XV.↩
De la gravité des américains et pourquoi elle ne les empêche pas de faire souvent des choses inconsidérées.
Les hommes qui vivent dans les pays démocratiques ne prisent point ces sortes de divertissements naïfs, turbulents et grossiers auxquels le peuple se livre dans les aristocraties ; ils les trouvent puérils ou insipides. Ils ne montrent guère plus de goût pour les amusements intellectuels et raffinés des classes aristocratiques ; il leur faut quelque chose de productif et de substantiel dans leurs plaisirs ; et ils veulent mêler des jouissances à leur joie.
Dans les sociétés aristocratiques, le peuple [IV-118] s’abandonne volontiers aux élans d’une gaieté tumultueuse et bruyante qui l’arrache tout à coup à la contemplation de ses misères ; les habitants des démocraties n’aiment point à se sentir ainsi tirés violemment hors d’eux-mêmes, et c’est toujours à regret qu’ils se perdent de vue. À ces transports frivoles, ils préfèrent des délassements graves et silencieux qui ressemblent à des affaires et ne les fassent point entièrement oublier.
Il y a tel Américain qui, au lieu d’aller dans ses moments de loisir danser joyeusement sur la place publique, ainsi que les gens de sa profession continuent à le faire dans une grande partie de l’Europe, se retire seul au fond de sa demeure, pour y boire. Cet homme jouit à la fois de deux plaisirs : il songe à son négoce, et il s’enivre décemment en famille.
Je croyais que les Anglais formaient la nation la plus sérieuse qui fût sur la terre, mais j’ai vu les Américains, et j’ai changé d’opinion.
Je ne veux pas dire que le tempérament ne soit pas pour beaucoup dans le caractère des habitants des États-Unis. Je pense, toutefois, que les institutions politiques y contribuent plus encore.
Je crois que la gravité des Américains naît en partie de leur orgueil. Dans les pays démocratiques, le pauvre lui-même a une haute idée de sa valeur personnelle. Il se contemple avec [IV-119] complaisance et croit volontiers que les autres le regardent. Dans cette disposition, il veille avec soin sur ses paroles et sur ses actes, et ne se livre point, de peur de découvrir ce qui lui manque. Il se figure que pour paraître digne il lui faut rester grave.
Mais j’aperçois une autre cause plus intime et plus puissante qui produit instinctivement chez les Américains cette gravité qui m’étonne.
Sous le despotisme, les peuples se livrent de temps en temps aux éclats d’une folle joie ; mais, en général, ils sont mornes et concentrés, parce qu’ils ont peur.
Dans les monarchies absolues, que tempèrent la coutume et les mœurs, ils font souvent voir une humeur égale et enjouée, parce qu’ayant quelque liberté et une assez grande sécurité, ils sont écartés des soins les plus importants de la vie ; mais tous les peuples libres sont graves, parce que leur esprit est habituellement absorbé dans la vue de quelque projet dangereux ou difficile.
Il en est surtout ainsi chez les peuples libres qui sont constitués en démocraties. Il se rencontre alors dans toutes les classes un nombre infini de gens qui se préoccupent sans cesse des affaires sérieuses du gouvernement ; et ceux qui ne songent point à diriger la fortune publique, sont livrés tout entiers aux soins d’accroître leur fortune privée. Chez un pareil peuple la gravité n’est plus [IV-120] particulière à certains hommes, elle devient une habitude nationale.
On parle des petites démocraties de l’antiquité dont les citoyens se rendaient sur la place publique avec des couronnes de roses, et qui passaient presque tout leur temps en danses et en spectacles. Je ne crois pas plus à de semblables républiques qu’à celle de Platon ; ou, si les choses s’y passaient ainsi qu’on nous le raconte, je ne crains pas d’affirmer que ces prétendues démocraties étaient formées d’éléments bien différents des nôtres, et qu’elles n’avaient avec celles-ci rien de commun que le nom.
Il ne faut pas croire, du reste, qu’au milieu de tous leurs labeurs, les gens qui vivent dans les démocraties se jugent à plaindre : le contraire se remarque. Il n’y a point d’hommes qui tiennent autant à leur condition que ceux-là. Ils trouveraient la vie sans saveur, si on les délivrait des soins qui les tourmentent, et ils se montrent plus attachés à leurs soucis que les peuples aristocratiques à leurs plaisirs.
Je me demande pourquoi les mêmes peuples démocratiques, qui sont si graves, se conduisent quelquefois d’une manière si inconsidérée.
Les Américains, qui gardent presque toujours un maintien posé et un air froid, se laissent néanmoins emporter souvent bien loin des limites de [IV-121] la raison par une passion soudaine ou une opinion irréfléchie, et il leur arrive de faire sérieusement des étourderies singulières.
Ce contraste ne doit pas surprendre.
Il y a une sorte d’ignorance qui naît de l’extrême publicité. Dans les états despotiques, les hommes ne savent comment agir, parce qu’on ne leur dit rien ; chez les nations démocratiques, ils agissent souvent au hasard, parce qu’on a voulu leur tout dire. Les premiers ne savent pas, et les autres oublient. Les traits principaux de chaque tableau disparaissent pour eux parmi la multitude des détails.
On s’étonne de tous les propos imprudents que se permet quelquefois un homme public dans les états libres et surtout dans les états démocratiques, sans en être compromis ; tandis que, dans les monarchies absolues, quelques mots qui échappent par hasard suffisent pour le dévoiler à jamais et le perdre sans ressource.
Cela s’explique par ce qui précède. Lorsqu’on parle au milieu d’une grande foule, beaucoup de paroles ne sont point entendues, ou sont aussitôt effacées du souvenir de ceux qui les entendent ; mais, dans le silence d’une multitude muette et immobile, les moindres chuchotements frappent l’oreille.
Dans les démocraties, les hommes ne sont [IV-122] jamais fixes ; mille hasards les font sans cesse changer de place, et il règne presque toujours je ne sais quoi d’imprévu et, pour ainsi dire, d’improvisé dans leur vie. Aussi sont-ils souvent forcés de faire ce qu’ils ont mal appris, de parler de ce qu’ils ne comprennent guère, et de se livrer à des travaux auxquels un long apprentissage ne les a pas prépares.
Dans les aristocraties, chacun n’a qu’un seul but qu’il poursuit sans cesse ; mais, chez les peuples démocratiques, l’existence de l’homme est plus compliquée ; il est rare que le même esprit n’y embrasse point plusieurs objets à la fois, et souvent des objets fort étrangers les uns aux autres. Comme il ne peut les bien connaître tous, il se satisfait aisément de notions imparfaites.
Quand l’habitant des démocraties n’est pas presse par ses besoins, il l’est du moins par ses désirs ; car, parmi tous les biens qui l’environnent, il n’en voit aucun qui soit entièrement hors de sa portée. Il fait donc toutes choses à la hâte, se contente sans cesse d’à peu près, et ne s’arrête jamais qu’un moment pour considérer chacun de ses actes.
Sa curiosité est tout à la fois insatiable et satisfaite à peu de frais ; car il tient à savoir vite beaucoup, plutôt qu’à bien savoir.
[IV-123]
Il n’a guère le temps, et il perd bientôt le goût d’approfondir.
Ainsi donc, les peuples démocratiques sont graves, parce que leur état social et politique les porte sans cesse à s’occuper de choses sérieuses ; et ils agissent inconsidérément, parce qu’ils ne donnent que peu de temps et d’attention à chacune de ces choses.
L’habitude de l’inattention doit être considérée comme le plus grand vice de l’esprit démocratique.
[IV-125]
CHAPITRE XVI.↩
Pourquoi la vanité nationale des Américains est plus inquiète et plus querelleuse que celle des Anglais.[Note]
Tous les peuples libres se montrent glorieux d’eux-mêmes ; mais l’orgueil national ne se manifeste pas chez tous de la même manière.
Les Américains, dans leurs rapports avec les étrangers, paraissent impatients de la moindre censure et insatiables de louanges. Le plus mince éloge leur agrée, et le plus grand suffit rarement à les satisfaire ; ils vous harcèlent à tout moments pour obtenir de vous d’être loués ; et, si vous résistez à leurs instances, ils se louent eux-mêmes. On dirait que, doutant de leur propre mérite, ils [IV-126] veulent à chaque instant en avoir le tableau sou leurs yeux. Leur vanité n’est pas seulement avide, elle est inquiète et envieuse. Elle n’accorde rien en demandant sans cesse. Elle est quêteuse et querelleuse à la fois.
Je dis à un Américain que le pays qu’il habite est beau ; il réplique : « Il est vrai, il n’y en a pas de pareil au monde ! » J’admire la liberté dont jouissent les habitants, et il me répond : « C’est un don précieux que la liberté ! mais il y a bien peu de peuples qui soient dignes d’en jouir. » Je remarque la pureté de mœurs qui règne aux États-Unis : « Je conçois, dit-il, qu’un étranger, qui a été frappé de la corruption qui se fait voir chez toutes les autres nations, soit étonné à ce spectacle. » Je l’abandonne enfin à la contemplation de lui-même ; mais il revient à moi et ne me quitte point qu’il ne soit parvenu à me faire répéter ce que je viens de lui dire. On ne saurait imaginer de patriotisme plus incommode et plus bavard. Il fatigue ceux même qui l’honorent.
Il n’en est point ainsi des Anglais. L’Anglais jouit tranquillement des avantages réels ou imaginaires qu’à ses yeux son pays possède. S’il n’accorde rien aux autres nations, il ne demande rien non plus pour la sienne. Le blâme des étrangers ne l’émeut point et leur louange ne le flatte guère. Il se tient vis-à-vis du monde entier dans [IV-127] une réserve pleine de dédain et d’ignorance. Son orgueil n’a pas besoin d’aliment ; il vit sur lui-même.
Que deux peuples sortis depuis peu d’une même souche se montrent si opposés l’un à l’autre, dans la manière de sentir et de parler, cela est remarquable.
Dans les pays aristocratiques, les grands possèdent d’immenses privilèges, sur lesquels leur orgueil se repose, sans chercher à se nourrir des menus avantages qui s’y rapportent. Ces privilèges leur étant arrivés par héritage, ils les considèrent, en quelque sorte, comme une partie d’eux-mêmes, ou du moins comme un droit naturel et inhérent à leur personne. Ils ont donc un sentiment paisible de leur supériorité ; ils ne songent point à vanter des prérogatives que chacun aperçoit et que personne ne leur dénie. Ils ne s’en étonnent point assez pour en parler. Ils restent immobiles au milieu de leur grandeur solitaire, sûrs que tout le monde les y voit, sans qu’ils cherchent à s’y montrer, et que nul n’entreprendra de les en faire sortir.
Quand une aristocratie conduit les affaires publiques, son orgueil national prend naturellement cette forme réservée, insouciante et hautaine, et toutes les autres classes de la nation l’imitent.
Lorsqu’au contraire, les conditions diffèrent [IV-128] peu, les moindres avantages ont de l’importance. Comme chacun voit autour de soi un million de gens qui en possèdent de tout semblables ou d’analogues, l’orgueil devient exigeant et jaloux ; il s’attache à des misères et les défend opiniâtrement.
Dans les démocraties, les conditions étant fort mobiles, les hommes ont presque toujours récemment acquis les avantages qu’ils possèdent ; ce qui fait qu’ils sentent un plaisir infini à les exposer aux regards, pour montrer aux autres et se témoigner à eux-mêmes qu’ils en jouissent ; et comme, à chaque instant, il peut arriver que ces avantages leur échappent, ils sont sans cesse en alarmes et s’efforcent de faire voir qu’ils les tiennent encore. Les hommes qui vivent dans les démocraties, aiment leur pays de la même manière qu’ils s’aiment eux-mêmes, et ils transportent les habitudes de leur vanité privée dans leur vanité nationale.
La vanité inquiète et insatiable des peuples démocratiques tient tellement à l’égalité et à la fragilité des conditions, que les membres de la plus fière noblesse montrent absolument la même passion dans les petites portions de leur existence où il y a quelque chose d’instable et de contesté.
Une classe aristocratique diffère toujours profondément des autres classes de la nation, par [IV-129] l’étendue et la perpétuité des prérogatives ; mais il arrive quelquefois que plusieurs de ses membres ne diffèrent entre eux que par de petits avantages fugitifs qu’ils peuvent perdre et acquérir tous les jours.
On a vu les membres d’une puissante aristocratie, réunis dans une capitale ou dans une cour, s’y disputer avec acharnement les privilèges frivoles qui dépendent du caprice de la mode ou de la volonté du maître. Ils montraient alors précisément les uns envers les autres les mêmes jalousies puériles qui animent les hommes des démocraties, la même ardeur pour s’emparer des moindres avantages que leurs égaux leur contestaient, et le même besoin d’exposer à tous les regards ceux dont ils avaient la jouissance.
Si les courtisans s’avisaient jamais d’avoir de l’orgueil national, je ne doute pas qu’ils n’en fissent voir un tout pareil à celui des peuples démocratiques.
[IV-131]
CHAPITRE XVII.↩
Comment l’aspect de la société, aux États-Unis, est tout à la fois agité et monotone.
Il semble que rien ne soit plus propre à exciter et à nourrir la curiosité que l’aspect des États-Unis. Les fortunes, les idées, les lois y varient sans cesse. On dirait que l’immobile nature elle-même est mobile, tant elle se transforme chaque jour sous la main de l’homme.
À la longue cependant la vue de cette société si agitée paraît monotone, et, après avoir contemplé quelque temps ce tableau si mouvant, le spectateur s’ennuie.
Chez les peuples aristocratiques, chaque homme [IV-132] est à peu près fixe dans sa sphère ; mais les hommes sont prodigieusement dissemblables ; ils ont des passions, des idées, des habitudes et des goûts essentiellement divers. Rien n’y remue, tout y diffère.
Dans les démocraties, au contraire, tous les hommes sont semblables et font des choses à peu près semblables. Ils sont sujets, il est vrai, à de grandes et continuelles vicissitudes ; mais, comme les mêmes succès et les mêmes revers reviennent continuellement, le nom des acteurs seul est différent, la pièce est la même. L’aspect de la société américaine est agité, parce que les hommes et les choses changent constamment ; et il est monotone, parce que tous les changements sont pareils.
Les hommes qui vivent dans les temps démocratiques ont beaucoup de passions ; mais la plupart de leurs passions aboutissent à l’amour des richesses, ou en sortent. Cela ne vient pas de ce que leurs âmes sont plus petites, mais de ce que l’importance de l’argent est alors réellement plus grande.
Quand les citoyens sont tous indépendants et indifférents, ce n’est qu’en payant qu’on peut obtenir le concours de chacun d’eux ; ce qui multiplie à l’infini l’usage de la richesse et en accroît le prix.
[IV-133]
Le prestige qui s’attachait aux choses anciennes ayant disparu, la naissance, l’état, la profession ne distinguent plus les hommes, ou les distinguent à peine ; il ne reste plus guère que l’argent qui crée des différences très-visibles entre eux, et qui puisse en mettre quelques uns hors de pair. La distinction qui naît de la richesse s’augmente de la disparition et de la diminution de toutes les autres.
Chez les peuples aristocratiques, l’argent ne mène qu’à quelques points seulement de la vaste circonférence des désirs ; dans les démocraties, il semble qu’il conduise à tous.
On retrouve donc d’ordinaire l’amour des richesses, comme principal ou accessoire, au fond des actions des Américains ; ce qui donne à toutes leurs passions un air de famille, et ne tarde point à en rendre fatigant le tableau.
Ce retour perpétuel de la même passion est monotone ; les procédés particuliers que cette passion emploie pour se satisfaire le sont également.
Dans une démocratie constituée et paisible, comme celle des États-Unis, où l’on ne peut s’enrichir ni par la guerre, ni par les emplois publics, ni par les confiscations politiques, l’amour des richesses dirige principalement les hommes vers l’industrie. Or, l’industrie, qui amène souvent [IV-134] de si grands désordres et de si grands désastres, ne saurait cependant prospérer qu’à l’aide d’habitudes très régulières et par une longue succession de petits actes très-uniformes. Les habitudes sont d’autant plus régulières et les actes plus uniformes que la passion est plus vive. On peut dire que c’est la violence même de leurs désirs qui rend les Américains si méthodiques. Elle trouble leur âme, mais elle range leur vie.
Ce que je dis de l’Amérique s’applique du reste à presque tous les hommes de nos jours. La variété disparaît du sein de l’espèce humaine ; les mêmes manières d’agir, de penser et de sentir se retrouvent dans tous les coins du monde. Cela ne vient pas seulement de ce que tous les peuples se pratiquent davantage et se copient plus fidèlement, mais de ce qu’en chaque pays les hommes s’écartant de plus en plus des idées et des sentiments particuliers à une caste, à une profession, à une famille, arrivent simultanément à ce qui tient de plus près à la constitution de l’homme, qui est partout la même. Ils deviennent ainsi semblables, quoiqu’ils ne se soient pas imités. Ils sont comme des voyageurs répandus dans une grande forêt dont tous les chemins aboutissent à un même point. Si tous aperçoivent à la fois le point central et dirigent de ce côté leurs pas, ils se rapprochent insensiblement les uns des autres, sans se [IV-135] chercher, sans s’apercevoir et sans se connaître, et ils seront enfin surpris en se voyant réunis dans le même lieu. Tous les peuples qui prennent pour objet de leurs études et de leur imitation, non tel homme, mais l’homme lui-même, finiront par se rencontrer dans les mêmes mœurs, comme ces voyageurs au rond-point.
[IV-137]
CHAPITRE XVIII.↩
De l’honneur aux États-Unis et dans les sociétés démocratiques [5] .
Il semble que les hommes se servent de deux méthodes fort distinctes dans le jugement public [IV-138] qu’ils portent des actions de leurs semblables : tantôt ils les jugent suivant les simples notions du juste et de l’injuste, qui sont répandues sur toute la terre ; tantôt ils les apprécient à l’aide de notions très-particulières qui n’appartiennent qu’à un pays et à une époque. Souvent il arrive que ces deux règles diffèrent ; quelquefois, elles se combattent, mais jamais elles ne se confondent entièrement, ni ne se détruisent.
L’honneur, dans le temps de son plus grand pouvoir, régit la volonté plus que la croyance, et les hommes, alors même qu’ils se soumettent sans hésitation et sans murmure a ses commandements, sentent encore, par une sorte d’instinct obscur, mais puissant, qu’il existe une loi plus générale, plus ancienne et plus sainte, à laquelle ils désobéissent quelquefois sans cesser de la connaître. Il y a des actions qui ont été jugées à la fois honnêtes et déshonorantes. Le refus d’un duel a souvent été dans ce cas.
Je crois qu’on peut expliquer ces phénomènes autrement que par le caprice de certains individus et de certains peuples, ainsi qu’on l’a fait jusqu’ici.
Le genre humain éprouve des besoins permanents et généraux, qui ont fait naître des lois morales à l’inobservation desquelles tous les hommes ont naturellement attaché, en tous [IV-139] lieux et en tous temps, l’idée du blâme et de la honte. Ils ont appelé faire mal s’y soustraire, faire bien s’y soumettre.
Il s’établit de plus, dans le sein de la vaste association humaine, des associations plus restreintes, qu’on nomme des peuples, et, au milieu de ces derniers, d’autres plus petites encore, qu’on appelle des classes ou des castes.
Chacune de ces associations forme comme une espèce particulière dans le genre humain ; et, bien qu’elle ne diffère point essentiellement de la masse des hommes, elle s’en tient quelque peu à part, et éprouve des besoins qui lui sont propres. Ce sont ces besoins spéciaux qui modifient en quelque façon et dans certains pays la manière d’envisager les actions humaines, et l’estime qu’il convient d’en faire.
L’intérêt général et permanent du genre humain est que les hommes ne se tuent point les uns les autres ; mais il peut se faire que l’intérêt particulier et momentané d’un peuple ou d’une classe soit, dans certains cas, d’excuser et même d’honorer l’homicide.
L’honneur n’est autre chose que cette règle particulière fondée sur un état particulier, à l’aide de laquelle un peuple ou une classe distribue le blâme ou la louange.
Il n’y a rien de plus improductif pour l’esprit [IV-140] humain qu’une idée abstraite. Je me hâte donc de courir vers les faits. Un exemple va mettre en lumière ma pensée.
Je choisirai l’espèce d’honneur le plus extraordinaire qui ait jamais paru dans le monde, et celui que nous connaissons le mieux : l’honneur aristocratique né au sein de la société féodale. Je l’expliquerai à l’aide de ce qui précède, et j’expliquerai ce qui précède par lui.
Je n’ai point à rechercher ici quand et comment l’aristocratie du moyen-âge était née, pourquoi elle s’était si profondément séparée du reste de la nation, ce qui avait fondé et affermi son pouvoir. Je la trouve debout, et je cherche à comprendre pourquoi elle considérait la plupart des actions humaines sous un jour si particulier.
Ce qui me frappe d’abord, c’est que, dans le monde féodal, les actions n’étaient point toujours louées ni blâmées en raison de leur valeur intrinsèque ; mais qu’il arrivait quelquefois de les priser uniquement par rapport à celui qui en était l’auteur ou l’objet ; ce qui répugne à la conscience générale du genre humain. Certains actes étaient donc indifférents de la part d’un roturier, qui déshonoraient un noble ; d’autres changeaient de caractère suivant que la personne qui en souffrait appartenait à l’aristocratie ou vivait hors d’elle.
[IV-141]
Quand ces différentes opinions ont pris naissance, la noblesse formait un corps à part au milieu du peuple, qu’elle dominait des hauteurs inaccessibles où elle s’était retirée. Pour maintenir cette position particulière qui faisait sa force, elle n’avait pas seulement besoin de privilèges politiques : il lui fallait des vertus et des vices à son usage.
Que telle vertu ou tel vice appartint à la noblesse plutôt qu’à la roture ; que telle action fût indifférente quand elle avait un vilain pour objet, ou condamnable quand il s’agissait d’un noble, voilà ce qui était souvent arbitraire ; mais qu’on attachât de l’honneur ou de la honte aux actions d’un homme suivant sa condition, c’est ce qui résultait de la constitution même d’une société aristocratique. Cela s’est vu, en effet, dans tous les pays qui ont eu une aristocratie. Tant qu’il en reste un seul vestige, ces singularités se retrouvent : débaucher une fille de couleur nuit à peine à la réputation d’un Américain ; l’épouser le déshonore.
Dans certains cas, l’honneur féodal prescrivait la vengeance et flétrissait le Pardon des injures ; dans d’autres, il commandait impérieusement aux hommes de se vaincre, il ordonnait l’oubli de soi-même. Il ne faisait point une loi de l’humanité, ni de la douceur ; mais il vantait la générosité ; il [IV-142] prisait la libéralité plus que la bienfaisance, il permettait qu’on s’enrichît par le jeu, par la guerre, mais non par le travail ; il préférait de grands crimes à de petits gains. La cupidité le révoltait moins que l’avarice, la violence lui agréait souvent, tandis que l’astuce et la trahison lui apparaissaient toujours méprisables.
Ces notions bizarres n’étaient pas nées du caprice seul de ceux qui les avaient conçues.
Une classe qui est parvenue à se mettre à la tête et au-dessus de toutes les autres, et qui fait de constants efforts pour se maintenir à ce rang suprême, doit particulièrement honorer les vertus qui ont de la grandeur et de l’éclat et qui peuvent se combiner aisément avec l’orgueil et l’amour du pouvoir. Elle ne craint pas de déranger l’ordre naturel de la conscience, pour placer ces vertus-là avant toutes les autres. On conçoit même qu’elle élève volontiers certains vices audacieux et brillans, au-dessus des vertus paisibles et modestes. Elle y est en quelque sorte contrainte par sa condition.
En avant de toutes les vertus, et à la place d’un grand nombre d’entre elles, les nobles du moyen âge mettaient le courage militaire.
C’était encore là une opinion singulière qui naissait forcément de la singularité de l’état social.
[IV-143]
L’aristocratie féodale était née par la guerre et pour la guerre ; elle avait trouvé dans les armes son pouvoir et elle le maintenait par les armes ; rien ne lui était donc plus nécessaire que le courage militaire ; et il était naturel qu’elle le glorifiât par-dessus tout le reste. Tout ce qui le manifestait au dehors, fût-ce même aux dépens de la raison et de l’humanité, était donc approuvé et souvent commandé par elle. La fantaisie des hommes ne se retrouvait que dans le détail.
Qu’un homme regardât comme une injure énorme de recevoir un coup sur la joue et fût obligé de tuer dans un combat singulier celui qui l’avait ainsi légèrement frappé, voilà l’arbitraire ; mais qu’un noble ne pût recevoir paisiblement une injure et fût déshonoré s’il se laissait frapper sans combattre, ceci ressortait des principes mêmes et des besoins d’une aristocratie militaire.
Il était donc vrai, jusqu’à un certain point, de dire que l’honneur avait des allures capricieuses ; mais les caprices de l’honneur étaient toujours renfermés dans de certaines limites nécessaires. Cette règle particulière, appelée par nos pères l’honneur, est si loin de me paraître une loi arbitraire, que je m’engagerais sans peine à rattacher à un petit nombre de besoins fixes et invariables des sociétés féodales ses prescriptions les plus incohérentes et les plus bizarres.
[IV-144]
Si je suivais l’honneur féodal dans le champ de la politique, je n’aurais pas plus de peine à y expliquer ses démarches.
L’état social et les institutions politiques du moyen-âge étaient tels que le pouvoir national n’y gouvernait jamais directement les citoyens. Celui-ci n’existait pour ainsi dire pas à leurs yeux ; chacun ne connaissait qu’un certain homme auquel il était obligé d’obéir. C’est par celui-là que, sans le savoir, on tenait à tous les autres. Dans les sociétés féodales, tout l’ordre public roulait donc sur le sentiment de fidélité à la personne même du seigneur. Cela détruit, on tombait aussitôt dans l’anarchie.
La fidélité au chef politique était d’ailleurs un sentiment dont tous les membres de l’aristocratie apercevaient chaque jour le prix, car chacun d’eux était à la fois seigneur et vassal, et avait à commander aussi bien qu’à obéir.
Rester fidèle à son seigneur, se sacrifier pour lui au besoin, partager sa fortune bonne ou mauvaise, l’aider dans ses entreprises quelles qu’elles fussent, telles furent les premières prescriptions de l’honneur féodal en matière politique. La trahison du vassal fut condamnée par l’opinion, avec une rigueur extraordinaire. On créa un nom particulièrement infamant pour elle, on l’appela félonie.
[IV-145]
On ne trouve, au contraire, dans le moyen-âge, ue peu de traces d’une passion qui a fait la vie des sociétés antiques. Je veux parler du patriotisme. Le nom même du patriotisme n’est point ancien dans notre idiome [6] .
Les institutions féodales dérobaient la patrie aux regards ; elles en rendaient l’amour moins nécessaire. Elles faisaient oublier la nation en passionnant pour un homme. Aussi, ne voit-on pas que l’honneur féodal ait jamais fait une loi étroite de rester fidèle à son pays.
Ce n’est pas que l’amour de la patrie n’existât point dans le cœur de nos pères ; mais il n’y formait qu’une sorte d’instinct faible et obscur, qui est devenu plus clair et plus fort, à mesure qu’on a détruit les classes et centralisé le pouvoir.
Ceci se voit bien par les jugements contraires que portent les peuples d’Europe sur les différents faits de leur histoire, suivant la génération qui les juge. Ce qui déshonorait principalement le connétable de Bourbon aux yeux de ses contemporains, c’est qu’il portait les armes contre son roi ; ce qui le déshonore le plus à nos yeux, c’est qu’il faisait la guerre à son pays. Nous le flétrissons autant que nos ayeux, mais par d’autres raisons.
J’ai choisi pour éclaircir ma pensée, l’honneur [IV-146] féodal, parce que l’honneur féodal a des traits plus marqués et mieux qu’aucun autre ; j’aurais pu prendre mon exemple ailleurs, je serais arrivé au même but par un autre chemin.
Quoique nous connaissions moins bien les Romains que nos ancêtres, nous savons cependant qu’il existait chez eux, en fait de gloire et de déshonneur, des opinions particulières qui ne découlaient pas seulement des notions générales du bien et du mal. Beaucoup d’actions humaines y étaient considérées sous un jour différent, suivant qu’il s’agisait d’un citoyen ou d’un étranger, d’un homme libre ou d’un esclave ; on y glorifiait certains vices, on y avait élevé certaines vertus par-delà toutes les autres.
« Or, était en ce temps-là, dit Plutarque dans la vie de Coriolan, la prouesse honorée et prisée à Rome par-dessus toutes les autres vertus. De quoi fait foi de ce que l’on la nommait virtus ; du nom même de la vertu, en attribuant le nom du commun genre à une espèce particulière. Tellement que vertu en latin était autant à dire comme vaillance. » Qui ne reconnaît là le besoin particulier de cette association singulière qui s’était formée pour la conquête du monde ?
Chaque nation prêtera à des observations analogues ; car, ainsi que je l’ai dit plus haut, toutes les fois que-les hommes se rassemblent en société [IV-147] particulière, il s’établit aussitôt parmi eux un honneur, c’est-à-dire un ensemble d’opinions qui leur est propre sur ce qu’on doit louer ou blâmer ; et ces règles particulières ont toujours leur source dans les habitudes spéciales et les intérêts spéciaux de l’association.
Cela s’applique dans une certaine mesure, aux sociétés démocratiques comme aux autres. Nous allons en retrouver la preuve chez les Américains [7] .
On rencontre encore éparses parmi les opinions des Américains, quelques notions détachées de l’ancien honneur aristocratique de l’Europe. Ces opinions traditionnelles sont en très-petit nombre ; elles ont peu de racine et peu de pouvoir. C’est une religion dont on laisse subsister quelques uns des temples, mais à laquelle on ne croit plus.
Au milieu de ces notions à demi effacées d’un honneur exotique, apparaissent quelques opinions nouvelles qui constituent ce qu’on pourrait appeler de nos jours, l’honneur américain.
J’ai montré comment les Américains étaient poussés incessamment vers le commerce et l’industrie. Leur origine, leur état social, les institutions politiques, le lieu même qu’ils habitent les [IV-148] entraîne irrésistiblement vers ce côté. Ils forment donc, quant à présent, une association presque exclusivement industrielle et commerçante, placée au sein d’un pays nouveau et immense qu’elle a pour principal objet d’exploiter. Tel est le trait caractéristique qui, de nos jours, distingue le plus particulièrement le peuple américain de tous les autres.
Toutes les vertus paisibles qui tendent à donner une allure régulière au corps social et à favoriser le négoce, doivent donc être spécialement honorées chez ce peuple ; et l’on ne saurait les négliger, sans tomber dans le mépris public.
Toutes les vertus turbulentes qui jettent souvent de l’éclat, mais plus souvent encore du trouble dans la société, occupent au contraire dans l’opinion de ce même peuple un rang subalterne. On peut les négliger sans perdre l’estime de ses concitoyens, et on s’exposerait peut-être à la perdre en les acquérant.
Les Américains ne font pas un classement moins arbitraire parmi les vices.
Il y a certains penchants condamnables aux yeux de la raison générale, et de la conscience universelle du genre humain, qui se trouvent être d’accord avec les besoins particuliers et momentanés de l’association américaine ; et elle ne les réprouve que faiblement, quelquefois elle les [IV-149] loue ; je citerai particulièrement l’amour des richesses et les penchants secondaires qui s’y rattachent. Pour défricher, féconder, transformer ce vaste continent inhabité, qui est son domaine, il faut à l’Américain l’appui journalier d’une passion énergique ; cette passion ne saurait être que l’amour des richesses ; la passion des richesses n’est donc point flétrie en Amérique, et pourvu qu’elle ne dépasse pas les limites que l’ordre public lui assigne, on l’honore. L’Américain appelle noble et estimable ambition, ce que nos pères du moyen-âge nommaient cupidité servile ; de même qu’il donne le nom de fureur aveugle et barbare à l’ardeur conquérante et à l’humeur guerrière qui les jetaient chaque jour dans de nouveaux combats.
Aux États-Unis, les fortunes se détruisent et se relèvent sans peine. Le pays est sans bornes et plein de ressources inépuisables. Le peuple a tous les besoins et tous les appétits d’un être qui croît, et quelques efforts qu’il fasse, il est toujours environné de plus de biens qu’il n’en peut saisir. Ce qui est à craindre chez un pareil peuple, ce n’est pas la ruine de quelques individus, bientôt réparée, c’est l’inactivité et la mollesse de tous. L’audace dans les entreprises industrielles, est la première cause de ses progrès rapides, de sa force, de sa grandeur. L’industrie est pour lui [IV-150] comme une vaste loterie où un petit nombre d’hommes perdent chaque jour, mais où l’État gagne sans cesse ; un semblable peuple doit donc voir avec faveur et honorer l’audace en matière d’industrie. Or, toute entreprise audacieuse compromet la fortune de celui qui s’y livre et la fortune de tous ceux qui se fient à lui. Les Américains, qui font de la témérité commerciale une sorte de vertu, ne sauraient, en aucun cas, flétrir les téméraires.
De là vient qu’on montre, aux États-Unis, une indulgence si singulière pour le commerçant qui fait faillite : l’honneur de celui-ci ne souffre point d’un pareil accident. En cela, les Américains diffèrent, non seulement des peuples européens, mais de toutes les nations commerçantes de nos jours ; aussi ne ressemblent-ils, par leur position et leurs besoins, à aucune d’elles.
En Amérique, on traite avec une sévérité inconnue dans le reste du monde tous les vices qui sont de nature à altérer la pureté des mœurs et à détruire l’union conjugale. Cela contraste étrangement, au premier abord, avec la tolérance qu’on y montre sur d’autres points. On est surpris de rencontrer chez le même peuple une morale si relâchée et si austère.
Ces choses ne sont pas aussi incohérentes qu’on le suppose. L’opinion publique, aux États-Unis, [IV-151] ne réprime que mollement l’amour des richesses, qui sert à la grandeur industrielle et à la prospérité de la nation ; et elle condamne particulièrement les mauvaises mœurs, qui distraient l’esprit humain de la recherche du bien-être et troublent l’ordre intérieur de la famille, si nécessaire au succès des affaires. Pour être estimés de leurs semblables, les Américains sont donc contraints de se plier à des habitudes régulières. C’est en ce sens qu’on peut dire qu’ils mettent leur honneur à être chastes.
L’honneur américain s’accorde avec l’ancien honneur de l’Europe sur un point. Il met le courage à la tête des vertus, et en fait pour l’homme la plus grande des nécessités morales ; mais il n’envisage pas le courage sous le même aspect.
Aux États-Unis, la valeur guerrière est peu prisée, le courage qu’on connaît le mieux et qu’on estime le plus est celui qui fait braver les fureurs de l’océan pour arriver plus tôt au port, supporter sans se plaindre les misères du désert, et la solitude, plus cruelle que toutes les misères ; le courage qui rend presque insensible au renversement subit d’une fortune péniblement acquise, et suggère aussitôt de nouveaux efforts pour en construire une nouvelle. Le courage de cette espèce est principalement nécessaire au maintien et à la prospérité de l’association américaine, et il est particulièrement honoré et glorifié par elle. On [IV-152] ne saurait s’en montrer privé, sans déshonneur.
Je trouve un dernier trait : il achèvera de mettre en relief l’idée de ce chapitre.
Dans une société démocratique, comme celle des États-Unis, où les fortunes sont petites et mal assurées, tout le monde travaille, et le travail mène à tout. Cela a retourné le point d’honneur et l’a dirigé contre l’oisiveté.
J’ai rencontré quelquefois en Amérique des gens riches, jeunes, ennemis par tempérament de tout effort pénible, et qui étaient forcés de prendre une profession. Leur nature et leur fortune leur permettaient de rester oisifs ; l’opinion publique le leur défendait impérieusement, et il lui fallait obéir. J’ai souvent vu au contraire chez les nations européennes où l’aristocratie lutte encore contre le torrent qui l’entraîne, j’ai vu, dis-je, des hommes que leurs besoins et leurs désirs aiguillonnaient sans cesse, demeurer dans l’oisiveté pour ne point perdre l’estime de leurs égaux, et se soumettre plus aisément à l’ennui et à la gêne qu’au travail.
Qui n’aperçoit dans ces deux obligations si contraires, deux règles différentes qui pourtant l’une et l’autre émanent de l’honneur.
Ce que nos pères ont appelé par excellence l’honneur, n’était, à vrai dire, qu’une de ses formes. Ils ont donné un nom générique à ce qui n’était qu’une espèce. L’honneur se retrouve donc [IV-153] dans les siècles démocratiques comme dans les temps d’aristocratie. Mais il ne sera pas difficile de montrer que dans ceux-là il présente une autre physionomie.
Non seulement ses prescriptions sont différentes, nous allons voir qu’elles sont moins nombreuses et moins claires et qu’on suit plus mollement ses lois.
Une caste est toujours dans une situation bien plus particulière qu’un peuple. Il n’y a rien de plus exceptionnel dans le monde qu’une petite société toujours composée des mêmes familles, comme l’aristocratie du moyen âge, par exemple, et dont l’objet est de concentrer et de retenir exclusivement et héréditairement dans son sein, la lumière, la richesse et le pouvoir.
Or, plus la position d’une société est exceptionnelle, plus ses besoins spéciaux sont en grand nombre, et plus les notions de son honneur, qui correspondent à ses besoins, s’accroissent.
Les prescriptions de l’honneur seront donc toujours moins nombreuses chez un peuple qui n’est point partagé en castes, que chez un autre. S’il vient à s’établir des nations où il soit même difficile de retrouver des classes, l’honneur s’y bornera à un petit nombre de préceptes, et ces préceptes s’éloigneront de moins en moins des lois morales adoptées par le commun de l’humanité.
[IV-154]
Ainsi les prescriptions de l’honneur seront moins bizarres et moins nombreuses, chez une nation démocratique que dans une aristocratie.
Elles seront aussi plus obscures ; cela résulte nécessairement de ce qui précède.
Les traits caractéristiques de l’honneur, étant en plus petit nombre, et moins singuliers, il doit souvent être difficile de les discerner.
Il y a d’autres raisons encore.
Chez les nations aristocratiques du moyen âge, les générations se succédaient en vain les unes aux autres ; chaque famille y était comme un homme immortel, et perpétuellement immobile ; les idées n’y variaient guère plus que les conditions.
Chaque homme y avait donc toujours devant les yeux les mêmes objets, qu’il envisageait du même point de vue ; son œil pénétrait peu à peu dans les moindres détails, et sa perception ne pouvait manquer, à la longue, de devenir claire et distincte. Ainsi non seulement les hommes des temps féodaux avaient des opinions fort extraordinaires qui constituaient leur honneur ; mais chacune de ces opinions se peignait dans leur esprit sous une forme nette et précise.
Il ne saurait jamais en être de même dans un pays comme l’Amérique, où tous les citoyens remuent ; où la société, se modifiant elle-même tous les jours, change ses opinions avec ses besoins. [IV-155] Dans un pareil pays, on entrevoit la règle de l’honneur ; on a rarement le loisir de la considérer fixement.
La société fût-elle immobile, il serait encore difficile d’y arrêter le sens qu’on doit donner au mot honneur.
Au moyen âge, chaque classe ayant son honneur, la même opinion n’était jamais admise à la fois par un très grand nombre d’hommes ; ce qui permettait de lui donner une forme arrêtée et précise ; d’autant plus que tous ceux qui l’admettaient, ayant tous une position parfaitement identique et fort exceptionnelle, trouvaient une disposition naturelle à s’entendre sur les prescriptions d’une loi qui n’était faite que pour eux seuls.
L’honneur devenait ainsi un code complet et détaillé, où tout était prévu et ordonné à l’avance, et qui présentait une règle fixe et toujours visible aux actions humaines. Chez une nation démocratique comme le peuple américain, où les rangs sont confondus et où la société entière ne forme qu’une masse unique, dont tous les éléments sont analogues, sans être entièrement semblables, on ne saurait jamais s’entendre à l’avance exactement sur ce qui est permis et défendu par l’honneur.
Il existe bien, au sein de ce peuple, de certains besoins nationaux qui font naître des opinions [IV-156] communes, en matière d’honneur ; mais de semblables opinions ne se présentent jamais en même temps, de la même manière, et avec une égale force à l’esprit de tous les citoyens ; la loi de l’honneur existe, mais elle manque souvent d’interprètes.
La confusion est bien plus grande encore dans un pays démocratique comme le nôtre où les différentes classes qui composaient l’ancienne société, venant à se mêler sans avoir pu encore se confondre, importent, chaque jour, dans le sein les unes des autres, les notions diverses et souvent contraires de leur honneur ; où chaque homme, suivant ses caprices, abandonne une partie des opinions de ses pères et retient l’autre ; de telle sorte, qu’au milieu de tant de mesures arbitraires, il ne saurait jamais s’établir une commune règle. Il est presque impossible alors de dire à l’avance quelles actions seront honorées ou flétries. Ce sont des temps misérables ; mais ils ne durent point.
Chez les nations démocratiques, l’honneur étant mal défini, est nécessairement moins puissant ; car il est difficile d’appliquer avec certitude et fermeté une loi qui est imparfaitement connue. L’opinion publique, qui est l’interprète naturel et souverain de la loi de l’honneur, ne voyant pas distinctement de quel côté il convient de faire pencher le blâme ou la louange, ne prononce [IV-157] qu’en hésitant son arrêt. Quelquefois il lui arrive de se contredire ; souvent elle se tient immobile, et laisse faire.
La faiblesse relative de l’honneur dans les démocraties tient encore à plusieurs autres causes.
Dans les pays aristocratiques, le même honneur n’est jamais admis que par un certain nombre d’hommes, souvent restreint et toujours séparé du reste de leurs semblables. L’honneur se mêle donc aisément et se confond, dans l’esprit de ceux-là, avec l’idée de tout ce qui les distingue. Il leur apparaît comme le trait distinctif de leur physionomie ; ils en appliquent les différentes règles avec toute l’ardeur de l’intérêt personnel, et ils mettent, si je puis m’exprimer ainsi, de la passion à lui obéir.
Cette vérité se manifeste bien clairement quand on lit les coutumiers du moyen-âge, à l’article des duels judiciaires. On y voit que les nobles étaient tenus, dans leurs querelles, de se servir de la lance et de l’épée, tandis que les vilains usaient entre eux du bâton, « attendu, ajoutent les coutumes, que les vilains n’ont pas d’honneur. » Cela ne voulait pas dire, ainsi qu’on se l’imagine de nos jours, que ces hommes fussent méprisables ; cela signifiait seulement que leurs actions n’étaient pas jugées d’après les mêmes règles que celles de l’aristocratie.
[IV-158]
Ce qui étonne, au premier abord, c’est que quand l’honneur règne avec cette pleine puissance, ses prescriptions sont en général fort étranges ; de telle sorte qu’on semble lui mieux obéir à mesure qu’il paraît s’écarter davantage de la raison ; d’où il est quelquefois arrivé de conclure que l’honneur était fort, à cause même de son extravagance.
Ces deux choses ont, en effet, la même origine ; mais elles ne découlent pas l’une de l’autre.
L’honneur est bizarre en proportion de ce qu’il représente des besoins plus particuliers et ressentis par un plus petit nombre d’hommes ; et c’est parce qu’il représente des besoins de cette espèce qu’il est puissant. L’honneur n’est donc pas puissant parce qu’il est bizarre ; mais il est bizarre et puissant par la même cause.
Je ferai une autre remarque.
Chez les peuples aristocratiques, tous les rangs diffèrent, mais tous les rangs sont fixes ; chacun occupe dans sa sphère un lieu dont il ne peut sortir, et où il vit au milieu d’autres hommes attachés autour de lui de la même manière. Chez ces nations, nul ne peut donc espérer ou craindre de n’être pas vu ; il ne se rencontre pas d’homme si bas placé qui n’ait son théâtre, et qui doive échapper, par son obscurité, au blâme ou à la louange.
[IV-159]
Dans les États démocratiques, au contraire, où tous les citoyens sont confondus dans la même foule et s’y agitent sans cesse, l’opinion publique n’a point de prise ; son objet disparaît à chaque instant, et lui échappe. L’honneur y sera donc toujours moins impérieux et moins pressant ; car l’honneur n’agit qu’en vue du public, différent en cela de la simple vertu, qui vit sur elle-même et se satisfait de son témoignage.
Si le lecteur a bien saisi tout ce qui précède, il a dû comprendre qu’il existe, entre l’inégalité des conditions et ce que nous avons appelé l’honneur, un rapport étroit et nécessaire qui, si je ne me trompe, n’avait point été encore clairement indiqué. Je dois donc faire un dernier effort pour le bien mettre en lumière.
Une nation se place à part dans le genre humain. Indépendamment de certains besoins généraux inhérents à l’espèce humaine, elle a ses intérêts et ses besoins particuliers. Il s’établit aussitôt dans son sein, en matière de blâme et de louange, de certaines opinions qui lui sont propres et que ses citoyens appellent l’honneur.
Dans le sein de cette même nation, il vient à s’établit une caste qui, se séparant à son tour de toutes les autres classes, contracte des besoins particuliers, et ceux-ci, à leur tout, font naître des opinions spéciales. L’honneur de cette caste, [IV-160] composé bizarre des notions particulières de la nation, et des notions plus particulières encore de la caste, s’éloignera, autant qu’on puisse l’imaginer, des simples et générales opinions des hommes. Nous avons atteint le point extrême, redescendons.
Les rangs se mêlent, les privilèges sont abolis. Les hommes qui composent la nation étant redevenus semblables et égaux, leurs intérêts et leurs besoins se confondent, et l’on voit s’évanouir successivement toutes les notions singulières que chaque caste appelait l’honneur ; l’honneur ne découle plus que des besoins particuliers de la nation elle-même ; il représente son individualité parmi les peuples.
S’il était permis enfin de supposer que toutes les races se confondissent, et que tous les peuples du monde en vinssent à ce point d’avoir les mêmes intérêts, les mêmes besoins, et de ne plus se distinguer les uns des autres par aucun trait caractéristique, on cesserait entièrement d’attribuer une valeur conventionnelle aux actions humaines ; tous les envisageraient sous le même jour ; les besoins généraux de l’humanité, que la conscience révèle à chaque homme, seraient la commune mesure. Alors, on ne rencontrerait plus dans ce monde que les simples et générales notions du bien et du mal, auxquelles [IV-161] s’attacheraient, par un lien naturel et nécessaire, les idées de louange ou de blâme.
Ainsi, pour renfermer enfin dans une seule formule toute ma pensée ce sont les dissemblances et les inégalités des hommes qui ont créé l’honneur ; il s’affaiblit à mesure que ces différences s’effacent, et il disparaîtrait avec elles.
[IV-163]
CHAPITRE XIX.↩
Pourquoi on trouve aux États-Unis tant d’ambitieux et si peu de grandes ambitions.
La première chose qui frappe aux États-Unis, c’est la multitude innombrable de ceux qui cherchent à sortir de leur condition originaire ; et la seconde, c’est le petit nombre de grandes ambitions qui se font remarquer au milieu de ce mouvement universel de l’ambition. Il n’y a pas d’Américains qui ne se montrent dévorés du désir de s’élever ; mais on n’en voit presque point qui paraissent nourrir de très-vastes espérances, ni tendre fort haut. Tous veulent acquérir sans cesse des biens, de la réputation, du pouvoir ; peu envisagent en grand toutes ces choses. Et cela surprend [IV-164] au premier abord. Puisqu’on n’aperçoit rien, ni dans les mœurs, ni dans les lois de l’Amérique, qui doive y borner les désirs et les empêcher de prendre de tous côtés leur essor.
Il semble difficile d’attribuer à l’égalité des conditions ce singulier état de choses ; car, au moment où cette même égalité s’est établie parmi nous, elle y a fait éclore aussitôt des ambitions presque sans limites. Je crois cependant que c’est principalement dans l’état social et les mœurs démocratiques des Américains qu’on doit chercher la cause de ce qui précède.
Toute révolution grandit l’ambition des hommes. Cela est surtout vrai de la révolution qui renverse une aristocratie.
Les anciennes barrières qui séparaient la foule de la renommée et du pouvoir, venant à s’abaisser tout à coup, il se fait un mouvement d’ascension impétueux et universel vers ces grandeurs longtemps enviées et dont la jouissance est enfin permise. Dans cette première exaltation du triomphe, rien ne semble impossible a personne. Non seulement les désirs n’ont pas de bornes, mais le pouvoir de les satisfaire n’en a presque point. Au milieu de ce renouvellement général et soudain des coutumes et des lois, dans cette vaste confusion de tous les hommes et de toutes les règles, les citoyens s’élèvent et tombent avec une [IV-165] rapidité inouïe, et la puissance passe si vite de mains en mains, que nul ne doit désespérer de la saisir à son tour.
Il faut bien se souvenir d’ailleurs que les gens qui détruisent une aristocratie ont vécu sous ses lois ; ils ont vu ses splendeurs, et ils se sont laissé pénétrer, sans le savoir, par les sentiments et les idées qu’elle avait conçus. Au moment donc où une aristocratie se dissout, son esprit flotte encore sur la masse, et l’on conserve ses instincts, longtemps après qu’on l’a vaincue.
Les ambitions se montrent donc toujours fort grandes, tant que dure la révolution démocratique ; il en sera de même quelque temps encore après qu’elle est finie.
Le souvenir des événements extraordinaires dont ils ont été témoins ne s’efface point en un jour de la mémoire des hommes. Les passions que la révolution avait suggérées ne disparaissent point avec elle. Le sentiment de l’instabilité se perpétue au milieu de l’ordre. L’idée de la facilité du succès survit aux étranges vicissitudes qui l’avaient fait naître. Les désirs demeurent très-vastes alors que les moyens de les satisfaire diminuent chaque jour. Le goût des grandes fortunes subsiste, bien que les grandes fortunes deviennent rares, et l’on voit s’allumer de toutes parts des ambitions disproportionnées et malheureuses, [IV-166] qui brûlent en secret et sans fruit le cœur qui les contient.
Peu à peu cependant les dernières traces de la lutte s’effacent ; les restes de l’aristocratie achèvent de disparaître. On oublie les grands événements qui ont accompagné sa chute ; le repos succède à la guerre, l’empire de la règle renaît au sein du monde nouveau ; les désirs s’y proportionnent aux moyens ; les besoins, les idées et les sentiments s’enchaînent ; les hommes achèvent de se niveler : la société démocratique est enfin assise.
Si nous considérons un peuple démocratique parvenu à cet état permanent et normal, il nous présentera un spectacle tout différent de celui que nous venons de contempler, et nous pourrons juger sans peine que, si l’ambition devient grande tandis que les conditions s’égalisent, elle perd ce caractère quand elles sont égales.
Comme les grandes fortunes sont partagées, et que la science s’est répandue, nul n’est absolument privé de lumières ni de biens ; les privilèges et les incapacités de classes étant abolies, et les hommes ayant brisé pour jamais les liens qui les tenaient immobiles, l’idée du progrès s’offre à l’esprit de chacun d’eux ; l’envie de s’élever naît à la fois dans tous les cœurs ; chaque homme veut sortir de sa place. L’ambition est le sentiment universel.
[IV-167]
Mais, si l’égalité des conditions donne à tous les citoyens quelques ressources, elle empêche qu’aucun d’entre eux n’ait des ressources très-étendues ; ce qui renferme nécessairement les désirs dans des limites assez étroites. Chez les peuples démocratiques, l’ambition est donc ardente et continue, mais elle ne saurait viser habituellement très-haut ; et la vie s’y passe d’ordinaire à convoiter avec ardeur de petits objets qu’on voit à sa portée.
Ce qui détourne surtout les hommes des démocraties de la grande ambition, ce n’est pas la petitesse de leur fortune, mais le violent effort qu’ils font tous les jours pour l’améliorer. Ils contraignent leur âme à employer toutes ses forces pour faire des choses médiocres : ce qui ne peut manquer de borner bientôt sa vue et de circonscrire son pouvoir. Ils pourraient être beaucoup plus pauvres et rester plus grands.
Le petit nombre d’opulents citoyens qui se trouvent au sein d’une démocratie ne fait point exception à cette règle. Un homme qui s’élève par degrés vers la richesse et le pouvoir contracte, dans ce long travail, des habitudes de prudence et de retenue dont il ne peut ensuite se départir. On n’élargit pas graduellement son âme comme sa maison.
Une remarque analogue est applicable aux fils de ce même homme. Ceux-ci sont nés, il est vrai, [IV-168] dans une position élevée, mais leurs parents ont été humbles ; ils ont grandi au milieu de sentiments et d’idées auxquels, plus tard, il leur est difficile de se soustraire ; et il est à croire qu’ils hériteront en même temps des instincts de leur père et de ses biens.
Il peut arriver, au contraire, que le plus pauvre rejeton d’une aristocratie puissante fasse voir une ambition vaste, parce que les opinions traditionnelles de sa race et l’esprit général de sa caste le soutiennent encore quelque temps au-dessus de sa fortune.
Ce qui empêche aussi que les hommes des temps démocratiques ne se livrent aisément à l’ambition des grandes choses, c’est le temps qu’ils prévoient devoir s’écouler avant qu’ils ne soient en état de les entreprendre. « C’est un grand avantage que la qualité, a dit Pascal, qui, dès dix-huit ou vingt ans, met un homme en passe, comme un autre pourrait l’être à cinquante ; ce sont trente ans de gagnés sans peine. » Ces trente ans-là manquent d’ordinaire aux ambitieux des démocraties. L’égalité, qui laisse à chacun la faculté d’arriver à tout, empêche qu’on ne grandisse vite.
Dans une société démocratique, comme ailleurs, il n’y a qu’un certain nombre de grandes fortunes à faire ; et les carrières qui y mènent étant ouvertes indistinctement à chaque citoyen, [IV-169] il faut bien que les progrès de tous se ralentissent. Comme les candidats paraissent à peu près pareils, et qu’il est difficile de faire entre eux un choix sans violer le principe de l’égalité, qui est la loi suprême des sociétés démocratiques, la première idée qui se présente est de les faire tous marcher du même pas et de les soumettre tous aux mêmes épreuves.
À mesure donc que les hommes deviennent plus semblables, et que le principe de l’égalité pénètre plus paisiblement et plus profondément dans les institutions et dans les mœurs, les règles de l’avancement deviennent plus inflexibles, l’avancement, plus lent ; la difficulté de parvenir vite à un certain degré de grandeur s’accroît.
Par haine du privilège et par embarras du choix, on en vient à contraindre tous les hommes, quelle que soit leur taille, à passer au travers d’une même filière ; et on les soumet tous indistinctement à une multitude de petits exercices préliminaires, au milieu desquels leur jeunesse se perd, et leur imagination s’éteint ; de telle sorte qu’ils désespèrent de pouvoir jamais jouir pleinement des biens qu’on leur offre ; et quand ils arrivent enfin à pouvoir faire des choses extraordinaires, ils en ont perdu le goût.
À la Chine, où l’égalité des conditions est très-grande et très-ancienne, un homme ne passe d’une [IV-170] fonction publique à une autre, qu’après s’être soumis à un concours. Cette épreuve se rencontre à chaque pas de sa carrière, et l’idée en est si bien entrée dans les mœurs, que je me souviens d’avoir lu un roman chinois où le héros, après beaucoup de vicissitudes, touche enfin le cœur de sa maîtresse en passant un bon examen. De grandes ambitions respirent mal à l’aise dans une semblable atmosphère.
Ce que je dis de la politique s’étend à toutes choses ; l’égalité produit partout les mêmes effets ; là où la loi ne se charge pas de régler et de retarder le mouvement des hommes, la concurrence y suffit.
Dans une société démocratique bien assise, les grandes et rapides élévations sont donc rares ; elles forment des exceptions à la commune règle. C’est leur singularité qui fait oublier leur petit nombre.
Les hommes des démocraties finissent par entrevoir toutes ces choses ; ils s’aperçoivent à la longue que le législateur ouvre devant eux un champ sans limites, dans lequel tous peuvent aisément faire quelques pas, mais que nul ne peut se flatter de parcourir vite. Entre eux et le vaste et final objet de leurs désirs, ils voient une multitude de petites barrières intermédiaires, qu’il leur faut franchir avec lenteur ; cette vue fatigue d’avance leur ambition et la rebute. Ils renoncent donc à ces [IV-171] lointaines et douteuses espérances, pour chercher près d’eux des jouissances moins hautes et plus faciles. La loi ne borne point leur horizon, mais ils le resserrent eux-mêmes.
J’ai dit que les grandes ambitions étaient plus rares dans les siècles démocratiques que dans les temps d’aristocratie ; j’ajoute que, quand, malgré ces obstacles naturels, elles viennent à naître, elles ont une autre physionomie.
Dans les aristocraties, la carrière de l’ambition est souvent étendue ; mais ses bornes sont fixes. Dans les pays démocratiques, elle s’agite d’ordinaire dans un champ étroit ; mais vient-elle à en sortir, on dirait qu’il n’y a plus rien qui la limite. Comme les hommes y sont faibles, isolés et mouvants ; que les précédents y ont peu d’empire, et les lois peu de durée, la résistance aux nouveautés y est molle, et le corps social n’y paraît jamais fort droit, ni bien ferme dans son assiette. De sorte que, quand les ambitieux ont une fois la puissance en main, ils croient pouvoir tout oser ; et, quand elle leur échappe, ils songent aussitôt à bouleverser l’état pour la reprendre. Cela donne à la grande ambition politique un caractère violent et révolutionnaire, qu’il est rare de lui voir, au même degré, dans les sociétés aristocratiques.
Une multitude de petites ambitions fort sensées, du milieu desquelles s’élancent de loin en loin [IV-172] quelques grands désirs mal réglés: tel est d’ordinaire le tableau que présentent les nations démocratiques. Une ambition proportionnée, modérée et vaste, ne s’y rencontre guère.
J’ai montré ailleurs par quelle force secrète l’égalité faisait prédominer, dans le cœur humain, la passion des jouissances matérielles, et l’amour exclusif du présent ; ces différents instincts se mêlent au sentiment de l’ambition, et le teignent, pour ainsi dire, de leurs couleurs.
Je pense que les ambitieux des démocraties se préoccupent moins que tous les autres des intérêts et des jugements de l’avenir : le moment actuel les occupe seul et les absorbe. Ils achèvent rapidement beaucoup d’entreprises, plutôt qu’ils n’élèvent quelques monuments très-durables ; ils aiment le succès bien plus que la gloire. Ce qu’ils demandent surtout des hommes, c’est l’obéissance. Ce qu’ils veulent avant tout, c’est l’empire. Leurs mœurs sont presque toujours restées moins hautes que leur condition ; ce qui fait qu’ils transportent très-souvent dans une fortune extraordinaire des goûts très-vulgaires, et qu’ils semblent ne s’être élevés au souverain pouvoir que pour se procurer plus aisément de petits et grossiers plaisirs.
Je crois que de nos jours il est fort nécessaire d’épurer, de régler et de proportionner le sentiment [IV-173] de l’ambition, mais qu’il serait très-dangereux de vouloir l’appauvrir, et le comprimer outre mesure. Il faut tâcher de lui poser d’avance des bornes extrêmes, qu’on ne lui permettra jamais de franchir ; mais on doit se garder de trop gêner son essor dans l’intérieur des limites permises.
J’avoue que je redoute bien moins pour les sociétés démocratiques, l’audace que la médiocrité des désirs ; ce qui me semble le plus à craindre, c’est que, au milieu des petites occupations incessantes de la vie privée, l’ambition ne perde son élan et sa grandeur ; que les passions humaines ne s’y apaisent, et ne s’y abaissent en même temps ; de sorte que chaque jour l’allure du corps social devienne plus tranquille et moins haute.
Je pense donc que les chefs de ces sociétés nouvelles auraient tort de vouloir y endormir les citoyens dans un bonheur trop uni et trop paisible, et qu’il est bon qu’ils leur donnent quelquefois de difficiles et de périlleuses affaires, afin d’y élever l’ambition et de lui ouvrir un théâtre.
Les moralistes se plaignent sans cesse que le vice favori de notre époque, est l’orgueil.
Cela est vrai dans un certain sens : il n’y a personne, en effet, qui ne croie valoir mieux que son voisin, et qui consente à obéir à son supérieur ; mais cela ce très-faux dans un autre : car ce même homme, qui ne peut supporter ni la subordination [IV-174] ni l’égalité, se méprise néanmoins lui-même à ce point qu’il ne se croit fait que pour goûter des plaisirs vulgaires. Il s’arrête volontiers dans de médiocres désirs sans oser aborder les hautes entreprises : il les imagine à peine.
Loin donc de croire qu’il faille recommander à nos contemporains l’humilité, je voudrais qu’on s’efforçât de leur donner une idée plus vaste d’eux-mêmes et de leur espèce ; l’humilité ne leur est point saine ; ce qui leur manque le plus, à mon avis, c’est de l’orgueil. Je céderais volontiers plusieurs de nos petites vertus pour ce vice.
[IV-175]
CHAPITRE XX.↩
De l’industrie des places chez certaines nations démocratiques.
Aux États-Unis, dès qu’un citoyen a quelques lumières et quelques ressources, il cherche à s’enrichir dans le commerce et l’industrie, ou bien il achète un champ couvert de forêts et se fait pionnier. Tout ce qu’il demande à l’État, c’est de ne point venir le troubler dans ses labeurs et d’en assurer le fruit.
Chez la plupart des peuples européens, lorsqu’un homme commence à sentir ses forces et à étendre ses désirs, la première idée qui se présente à lui est d’obtenir un emploi public. Ces différents effets, [IV-176] sortis d’une même cause, méritent que nous nous arrêtions un moment ici pour les considérer.
Lorsque les fonctions publiques sont en petit nombre, mal rétribuées, instables, et que, d’autre part, les carrières industrielles sont nombreuses et productives, c’est vers l’industrie et non vers l’administration que se dirigent de toutes parts les nouveaux et impatients désirs que fait naître chaque jour l’égalité.
Mais si, dans le même temps que les rangs s’égalisent, les lumières restent incomplètes ou les esprits timides, ou que le commerce et l’industrie, gênés dans leur essor, n’offrent que des moyens difficiles et lents de faire fortune, les citoyens, désespérant d’améliorer par eux-mêmes leur sort, accourent tumultueusement vers le chef de l’État et demandent son aide. Se mettre plus à l’aise aux dépens du Trésor public leur paraît être, sinon la seule voie qu’ils aient, du moins la voie la plus aisée et la mieux ouverte à tous pour sortir d’une condition qui ne leur suffit plus: la recherche des places devient la plus suivie de toutes les industries.
Il en doit être ainsi, surtout dans les grandes monarchies centralisées, où le nombre des fonctions rétribuées est immense et l’existence des fonctionnaires assez assurée ; de telle sorte que personne ne désespère d’y obtenir un emploi et [IV-177] d’en jouir paisiblement comme d’un patrimoine.
Je ne dirai point que ce désir universel et immodéré des fonctions publiques est un grand mal social ; qu’il détruit, chez chaque citoyen, l’esprit d’indépendance et répand dans tout le corps de la nation une humeur vénale et servile ; qu’il y étouffe les vertus viriles ; je ne ferai point observer non plus qu’une industrie de cette espèce ne crée qu’une activité improductive et agite le pays sans le féconder : tout cela se comprend aisément.
Mais je veux remarquer que le gouvernement qui favorise une semblable tendance risque sa tranquillité et met sa vie même en grand péril.
Je sais que, dans un temps comme le nôtre, où l’on voit s’éteindre graduellement l’amour et le respect qui s’attachaient jadis au pouvoir, il peut paraître nécessaire aux gouvernants d’enchaîner plus étroitement, par son intérêt, chaque homme, et qu’il leur semble commode de se servir de ses passions mêmes pour le tenir dans l’ordre et dans le silence ; mais il n’en saurait être ainsi longtemps, et ce qui peut paraître durant une certaine période une cause de force, devient assurément à la longue un grand sujet de trouble et de faiblesse.
Chez les peuples démocratiques comme chez tous les autres, le nombre des emplois publics finit par avoir des bornes ; mais, chez ces mêmes [IV-178] peuples, le nombre des ambitieux n’en a point ; il s’accroît sans cesse, par un mouvement graduel et irrésistible, à mesure que les conditions s’égalisent ; il ne se borne que quand les hommes manquent.
Lors donc que l’ambition n’a d’issue que vers l’administration seule, le gouvernement finit nécessairement par rencontrer une opposition permanente ; car sa tâche est de satisfaire avec des moyens limités des désirs qui se multiplient sans limites. Il faut se bien convaincre que, de tous les peuples du monde, le plus difficile à contenir et à diriger, c’est un peuple de solliciteurs. Quelques efforts que fassent ses chefs, ils ne sauraient jamais le satisfaire, et l’on doit toujours appréhender qu’il ne renverse enfin la constitution du pays et ne change la face de l’État, par le seul besoin de faire vaquer des places.
Les princes de notre temps, qui s’efforcent d’attirer vers eux seuls tous les nouveaux désirs que l’égalité suscite, et de les contenter, finiront donc, si je ne me trompe, par se repentir de s’être engagés dans une semblable entreprise ; ils découvriront un jour qu’ils ont hasardé leur pouvoir en le rendant si nécessaire, et qu’il eût été plus honnête et plus sûr d’enseigner à chacun de leurs sujets l’art de se suffire à lui-même.
CHAPITRE XXI.↩
[IV-179]
Pourquoi les grandes révolutions deviendront rares.
Un peuple qui a vécu pendant des siècles sous le régime des castes et des classes ne parvient à un état social démocratique qu’à travers une longue suite de transformations plus ou moins pénibles, à l’aide de violents efforts, et après de nombreuses vicissitudes durant lesquelles les biens, les opinions et le pouvoir changent rapidement de place.
Alors même que cette grande révolution est terminée, l’on voit encore subsister pendant longtemps les habitudes révolutionnaires créées par [IV-180] elles, et de profondes agitations lui succèdent.
Comme tout ceci se passe au moment où les conditions s’égalisent, on en conclut qu’il existe un rapport caché et un lien secret entre l’égalité même et les révolutions, de telle sorte que l’une ne saurait exister sans que les autres ne naissent.
Sur ce point, le raisonnement semble d’accord avec l’expérience.
Chez un peuple où les rangs sont à peu près égaux, aucun lien apparent ne réunit les hommes et ne les tient fermes à leur place. Nul d’entre eux n’a le droit permanent, ni le pouvoir de commander, et nul n’a pour condition d’obéir ; mais chacun, se trouvant pourvu de quelques lumières et de quelques ressources, peut choisir sa voie, et marcher à part de tous ses semblables.
Les mêmes causes qui rendent les citoyens indépendants les uns des autres, les poussent chaque jour vers de nouveaux et inquiets désirs, et les aiguillonnent sans cesse.
Il semble donc naturel de croire que, dans une société démocratique, les idées, les choses et les hommes doivent éternellement changer de formes et de places et que les siècles démocratiques seront des temps de transformations rapides et incessantes.
Cela est-il en effet ? l’égalité des conditions porte-t-elle les hommes d’une manière habituelle [IV-181] et permanente vers les révolutions ? contient-elle quelque principe perturbateur qui empêche la société de s’asseoir et dispose les citoyens à renouveler sans cesse leurs lois, leurs doctrines et leurs mœurs ? Je ne le crois point. Le sujet est important ; je prie le lecteur de me bien suivre.
Presque toutes les révolutions qui ont changé la face des peuples ont été faites pour consacrer ou pour détruire l’égalité. Écartez les causes secondaires qui ont produit les grandes agitations des hommes, vous en arriverez presque toujours à l’inégalité. Ce sont les pauvres qui ont voulu ravir les biens des riches, ou les riches qui ont essayé d’enchaîner les pauvres. Si donc vous pouvez fonder un état de société où chacun ait quelque chose à garder et peu à prendre, vous aurez beaucoup fait pour la paix du monde.
Je n’ignore pas que, chez un grand peuple démocratique, il se rencontre toujours des citoyens très pauvres, et des citoyens très riches ; mais les pauvres, au lieu d’y former l’immense majorité de la nation comme cela arrive toujours dans les sociétés aristocratiques, sont en petit nombre, et la loi ne les a pas attachés les uns aux autres par les liens d’une misère irrémédiable et héréditaire.
Les riches, de leur côté, sont clairsemés et impuissants ; ils n’ont point de priviléges qui attirent les regards ; leur richesse même n’étant [IV-182] plus incorporée à la terre, et représentée par elle, est insaisissable et comme invisible. De même qu’il n’y a plus de races de pauvres, il n’y a plus de races de riches ; ceux-ci sortent chaque jour du sein de la foule, et y retournent sans cesse. Ils ne forment donc point une classe à part, qu’on puisse aisément définir et dépouiller ; et, tenant d’ailleurs par mille fils secrets à la masse de leurs concitoyens, le peuple ne saurait guère les frapper sans s’atteindre lui-même. Entre ces deux extrémités de sociétés démocratiques, se trouve une multitude innombrable d’hommes presque pareils, qui, sans être précisément ni riches ni pauvres, possèdent assez de biens pour désirer l’ordre, et n’en ont pas assez pour exciter l’envie.
Ceux-là sont naturellement ennemis des mouvements violents ; leur immobilité maintient en repos tout ce qui se trouve au-dessus et au-dessous d’eux, et assure le corps social dans son assiette.
Ce n’est pas que ceux-là mêmes soient satisfaits de leur fortune présente, ni qu’ils ressentent de l’horreur naturelle pour une révolution dont ils partageraient les dépouilles sans en éprouver les maux ; ils désirent au contraire, avec une ardeur sans égale, de s’enrichir ; mais l’embarras est de savoir sur qui prendre. Le même état social qui [IV-183] leur suggère sans cesse des désirs, renferme ces désirs dans des limites nécessaires. Il donne aux hommes plus de liberté de changer et moins d’intérêt au changement.
Non seulement les hommes des démocraties ne désirent pas naturellement les révolutions, mais ils les craignent.
Il n’y a pas de révolution qui ne menace plus ou moins la propriété acquise. La plupart de ceux qui habitent les pays démocratiques sont propriétaires ; ils n’ont pas seulement des propriétés, ils vivent dans la condition où les hommes attachent à leur propriété le plus de prix.
Si l’on considère attentivement chacune des classes dont la société se compose, il est facile de voir qu’il n’y en a point chez lesquelles les passions que la propriété fait naître soient plus âpres et plus tenaces que chez les classes moyennes.
Souvent les pauvres ne se soucient guère de ce qu’ils possèdent, parce qu’ils souffrent beaucoup plus de ce qui leur manque qu’ils ne jouissent du peu qu’ils ont. Les riches ont beaucoup d’autres passions à satisfaire que celle des richesses, et d’ailleurs le long et pénible usage d’une grande fortune finit quelquefois par les rendre comme insensibles à ses douceurs.
Mais les hommes qui vivent dans une aisance également éloignée de l’opulence et de la [IV-184] misère mettent à leurs biens un prix immense. Comme ils sont encore fort voisins de la pauvreté, ils voient de près ses rigueurs, et ils les redoutent ; entre elle et eux il n’y a rien qu’un petit patrimoine sur lequel ils fixent aussitôt leurs craintes et leurs espérances. À chaque instant, ils s’y intéressent davantage par les soucis constants qu’il leur donne, et ils s’y attachent par les efforts journaliers qu’ils font pour l’augmenter. L’idée d’en céder la moindre partie leur est insupportable, et ils considèrent sa perte entière comme le dernier des malheurs. Or, c’est le nombre de ces petits propriétaires ardents et inquiets que l’égalité des conditions accroît sans cesse.
Ainsi, dans les sociétés démocratiques, la majorité des citoyens ne voit pas clairement ce qu’elle pourrait gagner à une révolution, et elle sent à chaque instant, et de mille manières, ce qu’elle pourrait y perdre.
J’ai dit, dans un autre endroit de cet ouvrage, comment l’égalité des conditions poussait naturellement les hommes vers les carrières industrielles et commerçantes, et comment elle accroissait et diversifiait la propriété foncière ; j’ai fait voir enfin comment elle inspirait à chaque homme un désir ardent et constant d’augmenter son bien-être. Il n’y a rien de plus contraire aux passions révolutionnaires que toutes ces choses.
[IV-185]
Il peut se faire que par son résultat final une révolution serve l’industrie et le commerce ; mais son premier effet sera presque toujours de ruiner les industriels et les commerçants, parce qu’elle ne peut manquer de changer tout d’abord l’état général de la consommation, et de renverser momentanément la proportion qui existait entre la reproduction et les besoins.
Je ne sache rien d’ailleurs de plus opposé aux mœurs révolutionnaires que les mœurs commerciales. Le commerce est naturellement ennemi de toutes les passions violentes. Il aime les tempéraments, se plaît dans les compromis, fuit avec grand soin la colère. Il est patient, souple, insinuant, et il n’a recours aux moyens extrêmes que quand la plus absolue nécessité l’y oblige. Le commerce rend les hommes indépendants les uns des autres ; il leur donne une haute idée de leur valeur individuelle ; il les porte à vouloir faire leurs propres affaires, et leur apprend à y réussir ; il les dispose donc à la liberté, mais il les éloigne des révolutions.
Dans une révolution, les possesseurs de biens mobiliers ont plus à craindre que tous les autres ; car, d’une part, leur propriété est souvent aisée à saisir, et, de l’autre, elle peut à tout moment disparaître complètement ; ce qu’ont moins à redouter les propriétaires fonciers qui, en perdant le [IV-186] revenu de leurs terres, espèrent du moins garder, à travers les vicissitudes, la terre elle-même. Aussi voit-on que les uns sont bien plus effrayés que les autres à l’aspect des mouvements révolutionnaires.
Les peuples sont donc moins disposés aux révolutions à mesure que, chez eux, les biens mobiliers se multiplient et se diversifient, et que le nombre de ceux qui les possèdent, devient plus grand.
Quelle que soit d’ailleurs la profession qu’embrassent les hommes, et le genre de biens dont ils jouissent, un trait leur est commun à tous.
Nul n’est pleinement satisfait de sa fortune présente, et tous s’efforcent chaque jour, par mille moyens divers, de l’augmenter. Considérez chacun d’entre eux à une époque quelconque de sa vie, et vous le verrez préoccupé de quelques plans nouveaux dont l’objet est d’accroître son aisance ; ne lui parlez pas des intérêts et des droits du genre humain ; cette petite entreprise domestique absorbe pour le moment toutes ses pensées, et lui fait souhaiter de remettre les agitations publiques à un autre temps.
Cela ne les empêche pas seulement de faire des révolutions, mais les détourne de le vouloir. Les violentes passions politiques ont peu de prise sur des hommes qui ont ainsi attaché toute leur [IV-187] âme à la poursuite du bien-être. L’ardeur qu’ils mettent aux petites affaires les calme sur les grandes.
Il s’élève, il est vrai, de temps à autre, dans les sociétés démocratiques, des citoyens entreprenants et ambitieux, dont les immenses désirs ne peuvent se satisfaire en suivant la route commune. Ceux-ci aiment les révolutions et les appellent ; mais ils ont grand’peine à les faire naître, si des événements extraordinaires ne viennent à leur aide.
On ne lutte point avec avantage contre l’esprit de son siècle et de son pays ; et un homme, quelque puissant qu’on le suppose, fait difficilement partager à ses contemporains des sentiments et des idées que l’ensemble de leurs désirs et de leurs sentiments repousse. Il ne faut donc pas croire que quand une fois l’égalité des conditions, devenue un fait ancien et incontesté, a imprimé aux mœurs son caractère, les hommes se laissent aisément précipiter dans les hasards à la suite d’un chef imprudent ou d’un hardi novateur.
Ce n’est pas qu’ils lui résistent d’une manière ouverte, à l’aide de combinaisons savantes, ou même par un dessein prémédité de résister. Ils ne le combattent point avec énergie, ils lui applaudissent même quelquefois, mais ils ne le suivent point. A sa fougue, ils opposent en secret leur inertie ; à ses instincts révolutionnaires, leurs [IV-188] intérêts conservateurs ; leurs goûts casaniers à ses passions aventureuses ; leur bon sens aux écarts de son génie ; à sa poésie, leur prose. Il les soulève un moment avec mille efforts, et bientôt ils lui échappent, et comme entraînés par leur propre poids, ils retombent. Il s’épuise à vouloir animer cette foule indifférente et distraite, et il se voit enfin réduit à l’impuissance, non qu’il soit vaincu, mais parce qu’il est seul.
Je ne prétends point que les hommes qui vivent dans les sociétés démocratiques soient naturellement immobiles ; je pense, au contraire, qu’il règne au sein d’une pareille société un mouvement éternel, et que personne n’y connaît le repos ; mais je crois que les hommes s’y agitent entre de certaines limites qu’ils ne dépassent guère. Ils varient, altèrent ou renouvellent chaque jour les choses secondaires ; ils ont grand soin de ne pas toucher aux principales. Ils aiment le changement ; mais ils redoutent les révolutions.
Quoique les Américains modifient ou abrogent sans cesse quelques-unes de leurs lois, ils sont bien loin de faire voir des passions révolutionnaires. Il est facile de découvrir, à la promptitude avec laquelle ils s’arrêtent et se calment lorsque l’agitation publique commence à devenir menaçante et au moment même où les passions semblent le plus excitées, [IV-189] qu’ils redoutent une révolution comme le plus grand des malheurs, et que chacun d’entre eux est résolu intérieurement à faire de grands sacrifices pour l’éviter. Il n’y a pas de pays au monde où le sentiment de la propriété se montre plus actif et plus inquiet qu’aux États-Unis, et où la majorité témoigne moins de penchants pour les doctrines qui menacent d’altérer d’une manière quelconque la constitution des biens.
J’ai souvent remarqué que les théories qui sont révolutionnaires de leur nature, en ce qu’elles ne peuvent se réaliser que par un changement complet et quelquefois subit dans l’état de la propriété et des personnes, sont infiniment moins en faveur aux États-Unis que dans les grandes monarchies de l’Europe. Si quelques hommes les professent, la masse les repousse avec une sorte d’horreur instinctive.
Je ne crains pas de dire que la plupart des maximes qu’on a coutume d’appeler démocratiques en France seraient proscrites par la démocratie des États-Unis. Cela se comprend aisément. En Amérique on a des idées et des passions démocratiques ; en Europe, nous avons encore des passions et des idées révolutionnaires.
Si l’Amérique éprouve jamais de grandes révolutions, elles seront amenées par la présence des noirs sur le sol des États-Unis ; c’est-à-dire que ce [IV-190] ne sera pas l’égalité des conditions, mais au contraire leur inégalité qui les fera naître.
Lorsque les conditions sont égales, chacun s’isole volontiers en soi-même et oublie le public. Si les législateurs des peuples démocratiques ne cherchaient point à corriger cette funeste tendance ou la favorisaient, dans la pensée qu’elle détourne les citoyens des passions politiques et les écarte ainsi des révolutions, il se pourrait qu’ils finissent eux-mêmes par produire le mal qu’ils veulent éviter, et qu’il arrivât un moment où les passions désordonnées de quelques hommes, s’aidant de l’égoïsme inintelligent et de la pusillanimité du plus grand nombre, finissent par contraindre le corps social à subir d’étranges vicissitudes.
Dans les sociétés démocratiques, il n’y a guère que de petites minorités qui désirent les révolutions ; mais les minorités peuvent quelquefois les faire.
Je ne dis donc point que les nations démocratiques soient à l’abri des révolutions, je dis seulement que l’état social de ces nations ne les y porte pas, mais plutôt les en éloigne. Les peuples démocratiques, livrés à eux-mêmes, ne s’engagent point aisément dans les grandes aventures ; ils ne sont entraînés vers les révolutions qu’à leur insu, ils les subissent quelquefois ; mais ils ne les font pas. Et j’ajoute que quand on leur a permis [IV-191] d’acquérir des lumières et de l’expérience, ils ne les laissent pas faire.
Je sais bien qu’en cette matière les institutions publiques elles-mêmes peuvent beaucoup; elles favorisent ou contraignent les instincts qui naissent de l’état social. Je ne soutiens donc pas, je le répète, qu’un peuple soit à l’abri des révolutions par cela seul que, dans son sein, les conditions sont égales ; mais le crois que, quelles que soient les institutions d’un pareil peuple, les grandes révolutions y seront toujours infiniment moins violentes et plus rares qu’on ne le suppose ; et j’entrevois aisément tel état politique qui, venant à se combiner avec l’égalité, rendrait la société plus stationnaire qu’elle ne l’a jamais été dans notre occident.
Ce que je viens de dire des faits s’applique en partie aux idées.
Deux choses étonnent aux États-Unis ; la grande mobilité de la plupart des actions humaines, et la fixité singulière de certains principes. Les hommes remuent sans cesse, l’esprit humain semble presque immobile.
Lorsqu’une opinion s’est une fois étendue sur le sol américain et y a pris racine, on dirait que nul pouvoir sur la terre n’est en état de l’extirper. Aux États-Unis, les doctrines générales en matière de religion, de philosophie, de morale et [IV-192] même de politique, ne varient point, ou du moins elles ne se modifient qu’après un travail caché et souvent insensible ; les plus grossiers préjugés eux-mêmes ne s’effacent qu’avec une lenteur inconcevable au milieu de ces frottements mille fois répétés des choses et des hommes.
J’entends dire qu’il est dans la nature et dans les habitudes des démocraties de changer à tout moment de sentiments et de pensées. Cela peut être vrai de petites nations démocratiques, comme celles de l’antiquité qu’on réunissait tout entières sur une place publique et qu’on agitait ensuite au gré d’un orateur. Je n’ai rien vu de semblable dans le sein du grand peuple démocratique qui occupe les rivages opposés de notre Océan. Ce qui m’a frappé aux États-Unis, c’est la peine qu’on éprouve à désabuser la majorité d’une idée qu’elle a conçue et de la détacher d’un homme qu’elle adopte. Les écrits ni les discours ne sauraient guère y réussir ; l’expérience seule en vient à bout ; quelquefois encore faut-il qu’elle se répète.
Cela étonne au premier abord ; un examen plus attentif l’explique.
Je ne crois pas qu’il soit aussi facile qu’on l’imagine de déraciner les préjugés d’un peuple démocratique ; de changer ses croyances ; de substituer de nouveaux principes religieux, philosophiques, [IV-193] politiques et moraux, à ceux qui s’y sont une fois établis ; en un mot, d’y faire de grandes et fréquentes révolutions dans les intelligences. Ce n’est pas que l’esprit humain y soit oisif ; il s’agite sans cesse ; mais il s’exerce plutôt à varier à l’infini les conséquences des principes connus et à en découvrir de nouvelles, qu’à chercher de nouveaux principes. Il tourne avec agilité sur lui-même plutôt qu’il ne s’élance en avant par un effort rapide et direct ; il étend peu à peu sa sphère par de petits mouvements continus et précipités ; il ne la déplace point tout à coup.
Des hommes égaux en droits, en éducation, en fortune, et, pour tout dire en un mot, de condition pareille, ont nécessairement des besoins, des habitudes et des goûts peu dissemblables. Comme ils aperçoivent les objets sous le même aspect, leur esprit incline naturellement vers des idées analogues, et, quoique chacun d’eux puisse s’écarter de ses contemporains et se faire des croyances à lui, ils finissent par se retrouver tous, sans le savoir et sans le vouloir, dans un certain nombre d’opinions communes.
Plus je considère attentivement les effets de l’égalité sur l’intelligence, plus je me persuade que l’anarchie intellectuelle dont nous sommes témoins n’est pas, ainsi que plusieurs le supposent, l’état naturel des peuples démocratiques. [IV-194] Je crois qu’il faut plutôt la considérer comme un accident particulier à leur jeunesse, et qu’elle ne se montre qu’à cette époque de passage où les hommes ont déjà brisé les antiques liens qui les attachaient les uns aux autres, et diffèrent encore prodigieusement par l’origine, l’éducation et les mœurs ; de telle sorte que, ayant conservé des idées, des instincts et des goûts fort divers, rien ne les empêche plus de les produire. Les principales opinions des hommes deviennent semblables à mesure que les conditions se ressemblent. Tel me paraît être le fait général et permanent ; le reste est fortuit et passager.
Je crois qu’il arrivera rarement que, dans le sein d’une société démocratique, un homme vienne à concevoir, d’un seul coup, un système d’idées fort éloignées de celui qu’ont adopté ses contemporains ; et, si un pareil novateur se présentait, j’imagine qu’il aurait d’abord grand’peine à se faire écouter, et plus encore à se faire croire.
Lorsque les conditions sont presque pareilles, un homme ne se laisse pas aisément persuader par un autre. Comme tous se voient de très-près ; qu’ils ont appris ensemble les mêmes choses et mènent la même vie, ils ne sont pas naturellement disposés à prendre l’un d’entre eux pour guide, et à le suivre aveuglément : on ne croit guère sur parole son semblable ou son égal.
[IV-195]
Ce n’est pas seulement la confiance dans les lumières de certains individus qui s’affaiblit chez les nations démocratiques, ainsi que je l’ai dit ailleurs, l’idée générale de la supériorité intellectuelle qu’un homme quelconque peut acquérir sur tous les autres ne tarde pas à s’obscurcir.
À mesure que les hommes se ressemblent davantage, le dogme de l’égalité des intelligences s’insinue peu à peu dans leurs croyances, et il devient plus difficile à un novateur, quel qu’il soit, d’acquérir et d’exercer un grand pouvoir sur l’esprit d’un peuple. Dans de pareilles sociétés, les soudaines révolutions intellectuelles sont donc rares ; car, si l’on jette les yeux sur l’histoire du monde, l’on voit que c’est bien moins la force d’un raisonnement que l’autorité d’un nom qui a produit les grandes et rapides mutations des opinions humaines.
Remarquez d’ailleurs que comme les hommes qui vivent dans les sociétés démocratiques ne sont attachés par aucun lien les uns aux autres, il faut convaincre chacun d’eux. Tandis que, dans les sociétés aristocratiques, c’est assez de pouvoir agir sur l’esprit de quelques-uns ; tous les autres suivent. Si Luther avait vécu dans un siècle d’égalité, et qu’il n’eût point eu pour auditeurs des seigneurs et des princes, il aurait peut-être trouvé plus de difficulté à changer la face de l’Europe.
[IV-196]
Ce n’est pas que les hommes des démocraties soient naturellement fort convaincus de la certitude de leurs opinions, et très-fermes dans leurs croyances ; ils ont souvent des doutes que personne, à leurs yeux, ne peut résoudre. Il arrive quelquefois dans ce temps-là que l’esprit humain changerait volontiers de place ; mais, comme rien ne le pousse puissamment ni ne le dirige, il oscille sur lui-même et ne se meut pas [8] .
Lorsqu’on a acquis la confiance d’un peuple [IV-197] démocratique, c’est encore une grande affaire que d’obtenir son attention. Il est très-difficile de se faire écouter des hommes qui vivent dans les démocraties, lorsqu’on ne les entretient point d’eux-mêmes. Ils n’écoutent pas les choses qu’on leur dit, parce qu’ils sont toujours fort préoccupés des choses qu’ils font.
Il se rencontre, en effet, peu d’oisifs chez les nations démocratiques. La vie s’y passe au milieu du mouvement et du bruit, et les hommes y sont si employés à agir, qu’il leur reste peu de temps pour penser. Ce que je veux remarquer surtout, c’est que non seulement ils sont occupés, mais que leurs occupations les passionnent. Ils sont perpétuellement en action, et chacune de leurs actions absorbe leur âme : le feu qu’ils mettent aux affaires les empêche de s’enflammer pour les idées.
Je pense qu’il est fort malaisé d’exciter l’enthousiasme d’un peuple démocratique pour une théorie quelconque qui n’ait pas un rapport visible, direct et immédiat avec la pratique journalière de sa vie. Un pareil peuple n’abandonne donc pas aisément ses anciennes croyances. Car c’est l’enthousiasme qui précipite l’esprit humain hors des routes frayées, et qui fait les grandes révolutions intellectuelles comme les grandes révolutions politiques.
[IV-198]
Ainsi, les peuples démocratiques n’ont ni le loisir ni le goût d’aller à la recherche d’opinions nouvelles. Lors même qu’ils viennent à douter de celles qu’ils possèdent, ils les conservent néanmoins, parce qu’il leur faudrait trop de temps et d’examen pour en changer ; ils les gardent, non comme certaines, mais comme établies.
Il y a d’autres raisons encore et de plus puissantes qui s’opposent à ce qu’un grand changement s’opère aisément dans les doctrines d’un peuple démocratique. Je l’ai déjà indiqué au commencement de ce livre.
Si, dans le sein d’un peuple semblable, les influences individuelles sont faibles et presque nulles, le pouvoir exercé par la masse sur l’esprit de chaque individu est très-grand. J’en ai donné ailleurs les raisons. Ce que je veux dire en ce moment, c’est qu’on aurait tort de croire que cela dépendît uniquement de la forme du gouvernement, et que la majorité dût y perdre son empire intellectuel avec son pouvoir politique.
Dans les aristocraties, les hommes ont souvent une grandeur et une force qui leur sont propres. Lorsqu’ils se trouvent en contradiction avec le plus grand nombre de leurs semblables, ils se retirent en eux-mêmes, s’y soutiennent et s’y consolent. Il n’en est pas de même parmi les peuples démocratiques. Chez eux, la faveur publique [IV-199] semble aussi nécessaire que l’air que l’on respire, et c’est, pour ainsi dire, ne pas vivre que d’être cri désaccord avec la masse. Celle-ci n’a pas besoin d’employer les lois pour plier ceux qui ne pensent pas comme elle. Il lui suffit de les désapprouver. Le sentiment de leur isolement et de leur impuissance les accable aussitôt et les désespère.
Toutes les fois que les conditions sont égales, l’opinion générale pèse d’un poids immense sur l’esprit de chaque individu ; elle l’enveloppe, le dirige et l’opprime : cela tient à la constitution même de la société bien plus qu’à ses lois politiques. À mesure que tous les hommes se ressemblent davantage, chacun se sent de plus en plus faible en face de tous. Ne découvrant rien qui l’élève fort au-dessus d’eux et qui l’en distingue, il se défie de lui-même, dès qu’ils le combattent ; non seulement il doute de ses forces, mais il en vient à douter de son droit, et il est bien près de reconnaître qu’il a tort, quand le plus grand nombre l’affirme. La majorité n’a pas besoin de le contraindre ; elle le convainc.
De quelque manière qu’on organise les pouvoirs d’une société démocratique et qu’on les pondère, il sera donc toujours très-difficile d’y croire ce que rejette la masse, et d’y professer ce qu’elle condamne.
[IV-200]
Ceci favorise merveilleusement la stabilité des croyances.
Lorsqu’une opinion a pris pied chez un peuple démocratique et s’est établie dans l’esprit du plus grand nombre, elle subsiste ensuite d’elle-même et se perpétue sans efforts, parce que personne ne l’attaque. Ceux qui l’avaient d’abord repoussée comme fausse, finissent par la recevoir comme générale, et ceux qui continuent à la combattre au fond de leur cœur, n’en font rien voir ; ils ont bien soin de ne point s’engager dans une lutte dangereuse et inutile.
Il est vrai que quand la majorité d’un peuple démocratique change d’opinion, elle peut opérer à son gré d’étranges et subites révolutions dans le monde des intelligences ; mais il est très difficile que son opinion change, et presque aussi difficile de constater qu’elle est changée.
Il arrive quelquefois que le temps, les événements, ou l’effort individuel et solitaire des intelligences, finissent par ébranler ou par détruire peu à peu une croyance, sans qu’il en paraisse rien au-dehors. On ne la combat point ouvertement. On ne se réunit point pour lui faire la guerre. Ses sectateurs la quittent un à un sans bruit ; mais chaque jour quelques uns l’abandonnent, jusqu’à ce qu’enfin elle n’est plus partagée que par le petit nombre.
[IV-201]
En cet état, elle règne encore.
Comme ses ennemis continuent à se taire, ou ne se communiquent qu’à la dérobée leurs pensées, ils sont eux-mêmes longtemps sans pouvoir s’assurer qu’une grande révolution s’est accomplie, et dans le doute ils demeurent immobiles. Ils observent et se taisent. La majorité ne croit plus ; mais elle a encore l’air de croire, et ce vain fantôme d’une opinion publique suffit pour glacer les novateurs, et les tenir dans le silence et le respect.
Nous vivons à une époque qui a vu les plus rapides changements s’opérer dans l’esprit des hommes. Cependant il se pourrait faire que bientôt les principales opinions humaines soient plus stables qu’elles ne l’ont été dans les siècles précédents de notre histoire ; ce temps n’est pas venu, mais peut-être il approche.
À mesure que j’examine de plus près les besoins et les instincts naturels des peuples démocratiques, je me persuade que, si jamais l’égalité s’établit d’une manière générale et permanente dans le monde, les grandes révolutions intellectuelles et politiques deviendront bien difficiles et plus rares qu’on ne le suppose.
Parce que les hommes des démocraties paraissent toujours émus, incertains, haletants, prêts à changer de volonté et de place, on se figure [IV-202] qu’ils vont abolir tout à coup leurs lois, adopter de nouvelles croyances et prendre de nouvelles mœurs. On ne songe point que si l’égalité porte les hommes au changement, elle leur suggère des intérêts et des goûts qui ont besoin de la stabilité pour se satisfaire ; elle les Pousse, et, en même temps, elle les arrête, elle les aiguillonne et les attache à la terre ; elle enflamme leurs désirs et limite leurs forces.
C’est ce qui ne se découvre pas d’abord : les passions qui écartent les citoyens les uns des autres dans une démocratie se manifestent d’elles-mêmes. Mais on n’aperçoit pas du premier coup d’œil la force cachée qui les retient et les rassemble.
Oserais-je le dire au milieu des ruines qui m’environnent ? Ce que je redoute le plus pour les générations à venir, ce ne sont pas les révolutions.
Si les citoyens continuent à se renfermer de plus en plus étroitement dans le cercle des petits intérêts domestiques, et à s’y agiter sans repos, on peut appréhender qu’ils ne finissent par devenir comme inaccessibles à ces grandes et puissantes émotions publiques qui troublent les peuples, mais qui les développent et les renouvellent. Quand je vois la propriété devenir si mobile, et l’amour de la propriété si inquiet et si ardent, je ne puis m’empêcher de craindre que les hommes [IV-203] n’arrivent à ce point de regarder toute théorie nouvelle comme un péril, toute innovation comme un trouble fâcheux, tout progrès social comme un premier pas vers une révolution, et qu’ils refusent entièrement de se mouvoir de peur qu’on les entraîne. Je tremble, je le confesse, qu’ils ne se laissent enfin si bien posséder par un lâche amour des jouissances présentes, que l’intérêt de leur propre avenir et de celui de leurs descendants disparaisse, et qu’ils aiment mieux suivre mollement le cours de leur destinée, que de faire au besoin un soudain et énergique effort pour le redresser.
On croit que les sociétés nouvelles vont chaque jour changer de face, et moi j’ai peur qu’elles ne finissent par être trop invariablement fixées dans les mêmes institutions, les mêmes préjugés, les mêmes mœurs ; de telle sorte que le genre humain s’arrête et se borne ; que l’esprit se plie et se replie éternellement sur lui-même sans produire d’idées nouvelles ; que l’homme s’épuise en petits mouvements solitaires et stériles ; et que, tout en se remuant sans cesse, l’humanité n’avance plus.
[IV-205]
CHAPITRE XXII.↩
Pourquoi les peuples démocratiques désirent naturellement la paix, et les armées démocratiques naturellement la guerre.
Les mêmes intérêts, les mêmes craintes, les mêmes passions qui écartent les peuples démocratiques des révolutions les éloignent de la guerre ; l’esprit militaire et l’esprit révolutionnaire s’affaiblissent en même temps et par les mêmes causes.
Le nombre toujours croissant des propriétaires amis de la paix, le développement de la richesse mobilière que la guerre dévore si rapidement, cette mansuétude des mœurs, cette mollesse de [IV-206] cœur, cette disposition à la pitié que l’égalité inspire, cette froideur de raison qui rend peu sensible aux poétiques et violentes émotions qui naissent parmi les armes, toutes ces causes s’unissent pour éteindre l’esprit militaire.
Je crois qu’on peut admettre comme règle générale et constante que, chez les peuples civilisés, les passions guerrières deviendront plus rares et moins vives, à mesure que les conditions seront plus égales.
La guerre cependant est un accident auquel tous les peuples sont sujets, les peuples démocratiques aussi bien que les autres. Quel que soit le goût que ces nations aient pour la paix, il faut bien qu’elles se tiennent prêtes à repousser la guerre ou, en d’autres termes, qu’elles aient une armée.
La fortune, qui a fait des choses si particulières en faveur des habitants des États-Unis, les a placés au milieu d’un désert où ils n’ont, pour ainsi dire, pas de voisins. Quelques milliers de soldats leur suffisent, mais ceci est américain et point démocratique.
L’égalité des conditions, et les mœurs ainsi que les institutions qui en dérivent, ne soustraient pas un peuple démocratique à l’obligation d’entretenir des armées, et ses armées exercent toujours une très-grande influence sur son sort. [IV-207] Il importe donc singulièrement de rechercher quels sont les instincts naturels de ceux qui les composent.
Chez les peuples aristocratiques, chez ceux surtout où la naissance règle seule le rang, l’inégalité se retrouve dans l’armée comme dans la nation ; l’officier est le noble, le soldat est le serf. L’un est nécessairement appelé à commander, l’autre à obéir. Dans les armées aristocratiques, l’ambition du soldat a donc des bornes très étroites.
Celle des officiers n’est pas non plus illimitée.
Un corps aristocratique ne fait pas seulement partie d’une hiérarchie ; il contient toujours une hiérarchie dans son sein ; les membres qui la composent sont placés les uns au-dessus des autres, d’une certaine manière qui ne varie point. Celui-ci est appelé naturellement par la naissance à commander un régiment, et celui-là une compagnie ; arrivés à ces termes extrêmes de leurs espérances, ils s’arrêtent d’eux-mêmes et se tiennent pour satisfaits de leur sort.
Il y a d’abord une grande cause qui, dans les aristocraties, attiédit le désir de l’avancement chez l’officier.
Chez les peuples aristocratiques, l’officier, indépendamment de son rang dans l’armée, occupe encore un rang élevé dans la société ; le premier n’est presque toujours à ses yeux qu’un accessoire [IV-208] du second ; le noble, en embrassant la carrière des armes, obéit moins encore à l’ambition qu’à une sorte de devoir que sa naissance lui impose. Il entre dans l’armée afin d’y employer honorablement les années oisives de sa jeunesse, et de pouvoir en rapporter dans ses foyers et parmi ses pareils quelques souvenirs honorables de la vie militaire ; mais son principal objet n’est point d’y acquérir des biens, de la considération et du pouvoir ; car il possède ces avantages par lui-même, et en jouit sans sortir de chez lui.
Dans les armées démocratiques, tous les soldats peuvent devenir officiers, ce qui généralise le désir de l’avancement et étend les limites de l’ambition militaire presque à l’infini.
De son côté, l’officier ne voit rien qui l’arrête naturellement et forcément à un grade plutôt qu’à un autre, et chaque grade a un prix immense à ses yeux, parce que son rang dans la société dépend presque toujours de son rang dans l’armée.
Chez les peuples démocratiques, il arrive souvent que l’officier n’a de bien que sa paye, et ne peut attendre de considération que de ses honneurs militaires. Toutes les fois qu’il change de fonctions, il change donc de fortune, et il est en quelque sorte un autre homme. Ce qui était l’accessoire de l’existence dans les armées [IV-209] aristocratiques est ainsi devenu le principal, le tout, l’existence elle-même.
Sous l’ancienne monarchie française, on ne donnait aux officiers que leur titre de noblesse. De nos jours, on ne leur donne que leur titre militaire. Ce petit changement des formes du langage suffit pour indiquer qu’une grande révolution s’est opérée dans la constitution de la société et dans celle de l’armée.
Au sein des armées démocratiques, le désir d’avancer est presque universel ; il est ardent, tenace, continuel ; il s’accroît de tous les autres désirs, et ne s’éteint qu’avec la vie. Or il est facile de voir que de toutes les armées du monde, celles où l’avancement doit être le plus lent en temps de paix sont les armées démocratiques. Le nombre des grades étant naturellement limité, le nombre des concurrents presque innombrable, et la loi inflexible de l’égalité pesant sur tous, nul ne saurait faire de progrès rapides, et beaucoup ne peuvent bouger de place. Ainsi le besoin d’avancer y est plus grand, et la facilité d’avancer moindre qu’ailleurs.
Tous les ambitieux que contient une armée démocratique souhaitent donc la guerre avec véhémence, parce que la guerre vide les places et permet enfin de violer ce droit de l’ancienneté, qui est le seul privilège naturel à la démocratie.
[IV-210]
Nous arrivons ainsi à cette conséquence singulière que, de toutes les armées, celles qui désirent le plus ardemment la guerre sont les armées démocratiques, et que, parmi les peuples, ceux qui aiment le plus la paix sont les peuples démocratiques ; et ce qui achève de rendre la chose extraordinaire, c’est que l’égalité produit à la fois ces effets contraires.
Les citoyens, étant égaux, conçoivent chaque jour le désir et découvrent la possibilité de changer leur condition et d’accroître leur bien-être : cela les dispose à aimer la paix, qui fait prospérer l’industrie et permet à chacun de pousser tranquillement à bout ses petites entreprises ; et, d’un autre côté, cette même égalité, en augmentant le prix des honneurs militaires aux yeux de ceux qui suivent la carrière des armes, et en rendant les honneurs accessibles à tous, fait rêver aux soldats les champs de bataille. Des deux parts, l’inquiétude du cœur est la même, le goût des jouissances est ussi insatiable, l’ambition égale ; le moyen de la satisfaire est seul différent.
Ces dispositions opposées de la nation et de l’armée font courir aux sociétés démocratiques de grands dangers.
Lorsque l’esprit militaire abandonne un peuple, la carrière militaire cesse aussitôt d’être honorée, [IV-211] et les hommes de guerre tombent au dernier rang des fonctionnaires publics. On les estime peu et on ne les comprend plus. Il arrive alors le contraire de ce qui se voit dans les siècles aristocratiques. Ce ne sont plus les principaux citoyens qui entrent dans l’armée, mais les moindres. On ne se livre à l’ambition militaire que quand nulle autre n’est permise. Ceci forme un cercle vicieux d’où on a de la peine à sortir. L’élite de la nation évite la carrière militaire, parce que cette carrière n’est pas honorée ; et elle n’est point honorée, parce que l’élite de la nation n’y entre plus.
Il ne faut donc pas s’étonner si les armées démocratiques se montrent souvent inquiètes, grondantes et mal satisfaites de leur sort, quoique la condition physique y soit d’ordinaire beaucoup plus douce et la discipline moins rigide que dans toutes les autres. Le soldat se sent dans une position inférieure, et son orgueil blessé achève de lui donner le goût de la guerre qui le rend nécessaire, ou l’amour des révolutions durant lesquelles il espère conquérir, les armes à la main, l’influence politique et la considération individuelle qu’on lui conteste.
La composition des armées démocratiques rend ce dernier péril fort à craindre.
Dans la société démocratique, presque tous les [IV-212] citoyens ont des propriétés à conserver ; mais les armées démocratiques sont conduites, en général, par des prolétaires. La plupart d’entre eux ont peu à perdre dans les troubles civils. La masse de la nation y craint naturellement beaucoup plus les révolutions que dans les siècles d’aristocratie ; mais les chefs de l’armée les redoutent bien moins.
De plus, comme chez les peuples démocratiques, ainsi que je l’ai dit ci-devant, les citoyens les plus riches, les plus instruits, les plus capables n’entrent guère dans la carrière militaire, il arrive que l’armée, dans son ensemble, finit par faire une petite nation à part, où l’intelligence est moins étendue et les habitudes plus grossières que dans la grande. Or, cette petite nation incivilisée possède les armes, et seule elle sait s’en servir.
Ce qui accroît, en effet, le péril que l’esprit militaire et turbulent de l’armée fait courir aux peuples démocratiques, c’est l’humeur pacifique des citoyens ; il n’y a rien de si dangereux qu’une armée au sein d’une nation qui n’est pas guerrière ; l’amour excessif de tous les citoyens pour la tranquillité y met chaque jour la constitution à la merci des soldats.
On peut donc dire d’une manière générale que si les peuples démocratiques sont naturellement [IV-213] portés vers la paix par leurs intérêts et leurs instincts, ils sont sans cesse attirés vers la guerre et les révolutions par leurs armées.
Les révolutions militaires, qui ne sont presque jamais à craindre dans les aristocraties, sont toujours à redouter chez les nations démocratiques. Ces périls doivent être rangés parmi les plus redoutables de tous ceux que renferme leur avenir ; il faut que l’attention des hommes d’état s’applique sans relâche à y trouver un remède.
Lorsqu’une nation se sent intérieurement travaillée par l’ambition inquiète de son armée, la première pensée qui se présente, c’est de donner à cette ambition incommode la guerre pour objet.
Je ne veux point médire de la guerre ; la guerre agrandit presque toujours la pensée d’un peuple et lui élève le cœur. Il y a des cas où seule elle peut arrêter le développement excessif de certains penchants que fait naturellement naître l’égalité, et où il faut la considérer comme nécessaire à certaines maladies invétérées auxquelles les sociétés démocratiques sont sujettes.
La guerre a de grands avantages ; mais il ne faut pas se flatter qu’elle diminue le péril qui vient d’être signalé. Elle ne fait que le suspendre, et il revient plus terrible après elle ; car l’armée souffre bien plus impatiemment la paix après avoir [IV-214] goûté de la guerre. La guerre ne serait un remède que pour un peuple qui voudrait toujours la gloire.
Je prévois que tous les princes guerriers qui s’élèveront au sein des grandes nations démocratiques trouveront qu’il leur est plus facile de vaincre avec leur armée que de la faire vivre en paix après la victoire. Il y a deux choses qu’un peuple démocratique aura toujours beaucoup de peine à faire : commencer la guerre et la finir.
Si d’ailleurs la guerre a des avantages particuliers pour les peuples démocratiques, d’un autre côté elle leur fait courir de certains périls que n’ont point à en redouter, au même degré, les aristocraties. Je n’en citerai que deux.
Si la guerre satisfait l’armée, elle gêne et souvent désespère cette foule innombrable de citoyens dont les petites passions ont, tous les jours, besoin de la paix pour se satisfaire. Elle risque donc de faire naître sous une autre forme le désordre qu’elle doit prévenir.
Il n’y a pas de longue guerre qui dans un pays démocratique ne mette en grand hasard la liberté. Ce n’est pas qu’il faille craindre précisément d’y voir, après chaque victoire, les généraux vainqueurs s’emparer par la force du souverain pouvoir, à la manière de Sylla et de César. Le péril est [IV-215] d’une autre sorte. La guerre ne livre pas toujours les peuples démocratiques au gouvernement militaire ; mais elle ne peut manquer d’accroître immensément, chez ces peuples, les attributions du gouvernement civil ; elle centralise presque forcément dans les mains de celui-ci la direction de tous les hommes et l’usage de toutes les choses. Si elle ne conduit pas tout à coup au despotisme par la violence, elle y amène doucement par les habitudes.
Tous ceux qui cherchent à détruire la liberté dans le sein d’une nation démocratique doivent savoir que le plus sûr et le plus court moyen d’y parvenir est la guerre. C’est là le premier axiôme de la science.
Un remède semble s’offrir de lui-même, lorsque l’ambition des officiers et des soldats devient à craindre, c’est d’accroître le nombre des places à donner, en augmentant l’armée. Ceci soulage le mal présent, mais engage d’autant plus l’avenir.
Augmenter l’armée peut produire un effet durable dans une société aristocratique, parce que, dans ces sociétés, l’ambition militaire est limitée à une seule espèce d’hommes, et s’arrête, pour chaque homme, à une certaine borne ; de telle sorte qu’on peut arriver à contenter à peu près tous ceux qui la ressentent.
[IV-216]
Mais chez un peuple démocratique on ne gagne rien à accroître l’armée, parce que le nombre des ambitieux s’y accroît toujours exactement dans le même rapport que l’armée elle-même. Ceux dont vous avez exaucé les vœux en créant de nouveaux emplois sont aussitôt remplacés par une foule nouvelle que vous ne pouvez satisfaire, et les premiers eux-mêmes recommencent bientôt à se plaindre ; car la même agitation d’esprit qui règne parmi les citoyens d’une démocratie se fait voir dans l’armée ; ce qu’on y veut, ce n’est pas de gagner un certain grade, mais d’avancer toujours. Si les désirs ne sont pas très-vastes, ils renaissent sans cesse. Un peuple démocratique qui augmente son armée ne fait donc qu’adoucir, pour un moment, l’ambition des gens de guerre ; mais bientôt elle devient plus redoutable, parce que ceux qui la ressentent sont plus nombreux.
Je pense, pour ma part, qu’un esprit inquiet et turbulent est un mal inhérent à la constitution même des armées démocratiques, et qu’on doit renoncer à le guérir. Il ne faut pas que les législateurs des démocraties se flattent de trouver une organisation militaire qui ait par elle-même la force de calmer et de contenir les gens de guerre ; ils s’épuiseraient en vains efforts avant d’y atteindre.
[IV-217]
Ce n’est pas dans l’armée qu’on peut rencontrer le remède aux vices de l’armée, mais dans le pays.
Les peuples démocratiques craignent naturellement le trouble et le despotisme. Il s’agit seulement de faire de ces instincts des goûts réfléchis, intelligents, et stables. Lorsque les citoyens ont enfin appris à faire un paisible et utile usage de la liberté et ont senti ses bienfaits ; quand ils ont contracté un amour viril de l’ordre, et se sont pliés volontairement à la règle, ces mêmes citoyens, en entrant dans la carrière des armes, y apportent, à leur insu et comme malgré eux, ces habitudes et ces mœurs. L’esprit général de la nation pénétrant dans l’esprit particulier de l’armée, tempère les opinions et les désirs que l’état militaire fait naître ; ou, par la force toute puisante de l’opinion publique, il les comprime. Ayez des citoyens éclairés, réglés, fermes et libres, et vous aurez des soldats disciplinés et obéissants.
Toute loi qui, en réprimant l’esprit turbulent de l’armée, tendrait à diminuer, dans le sein de la nation, l’esprit de liberté civile et à y obscurcir l’idée du droit et des droits, irait donc contre son objet. Elle favoriserait l’établissement de la tyrannie militaire, beaucoup plus qu’elle ne lui nuirait.
Après tout, et quoi qu’on fasse, une grande [IV-218] armée, au sein d’un peuple démocratique, sera toujours un grand péril ; et le moyen le plus efficace de diminuer ce péril, sera de réduire l’armée : mais c’est un remède dont il n’est pas donné à tous les peuples de pouvoir user.
[IV-219]
CHAPITRE XXIII.↩
Quelle est, dans les armées démocratiques, la classe la plus guerrière et la plus révolutionnaire.
Il est de l’essence d’une armée démocratique d’être très-nombreuse, relativement au peuple qui la fournit ; j’en dirai plus loin les raisons.
D’une autre part, les hommes qui vivent dans les temps démocratiques ne choisissent guère la carrière militaire.
Les peuples démocratiques sont donc bientôt amenés à renoncer au recrutement volontaire, pour avoir recours à l’enrôlement forcé. La nécessité de leur condition les oblige à prendre ce dernier moyen, et l’on peut aisément prédire que tous l’adopteront.
Le service militaire étant forcé, la charge s’en [IV-220] partage indistinctement et également sur tous les citoyens. Cela ressort encore nécessairement de la condition de ces peuples et de leurs idées. Le gouvernement y peut à peu près ce qu’il veut, pourvu qu’il s’adresse à tout le monde à la fois ; c’est l’inégalité du poids et non le poids qui fait d’ordinaire qu’on lui résiste.
Or, le service militaire étant commun à tous les citoyens, il en résulte évidemment que chacun d’eux ne reste qu’un petit nombre d’années sous les drapeaux.
Ainsi, il est dans la nature des choses que le soldat ne soit qu’en passant dans l’armée, tandis que chez la plupart des nations aristocratiques l’état militaire est un métier que le soldat prend, ou qui lui est imposé pour toute la vie.
Ceci a de grandes conséquences. Parmi les soldats qui composent une armée démocratique, quelques-uns s’attachent à la vie militaire ; mais le plus grand nombre, amenés ainsi malgré eux sous le drapeau, et toujours prêts à retourner dans leurs foyers, ne se considèrent pas comme sérieusement engagés dans la carrière militaire, et ne songent qu’à en sortir.
Ceux-ci ne contractent pas les besoins et ne partagent jamais qu’à moitié les passions que cette carrière fait naître. Ils se plient à leurs devoirs militaires, mais leur âme reste attachée aux [IV-221] intérêts et aux désirs qui la remplissaient dans la vie civile. Ils ne prennent donc pas l’esprit de l’armée ; ils apportent plutôt au sein de l’armée l’esprit de la société et l’y conservent. Chez les peuples démocratiques, ce sont les simples soldats qui restent le plus citoyens ; c’est sur eux que les habitudes nationales gardent le plus de prise, et l’opinion publique le plus de pouvoir. C’est par les soldats qu’on peut surtout se flatter de faire pénétrer dans une armée démocratique l’amour de la liberté, et le respect des droits qu’on a su inspirer au peuple lui-même. Le contraire arrive chez les nations aristocratiques, où les soldats finissent par n’avoir plus rien de commun avec leurs concitoyens, et par vivre au milieu d’eux comme des étrangers, et souvent comme des ennemis.
Dans les armées aristocratiques, l’élément conservateur est l’officier, parce que l’officier seul a gardé des liens étroits avec la société civile, et ne quitte jamais la volonté de venir tôt ou tard y reprendre sa place ; dans les armées démocratiques, c’est le soldat, et pour des causes toutes semblables.
Il arrive souvent, au contraire, que dans ces mêmes armées démocratiques, l’officier contracte des goûts et des désirs entièrement à part de ceux de la nation. Cela se comprend.
[IV-222]
Chez les peuples démocratiques, l’homme qui devient officier rompt tous les liens qui l’attachaient à la vie civile ; il en sort pour toujours, et il n’a aucun intérêt à y rentrer. Sa véritable patrie, c’est l’armée, puisqu’il n’est rien que par le rang qu’il y occupe ; il suit donc la fortune de l’armée, grandit ou s’abaisse avec elle, et c’est vers elle seule qu’il dirige désormais ses espérances. L’officier ayant des besoins fort distincts de ceux du pays, il peut se faire qu’il désire ardemment la guerre, ou travaille à une révolution dans le moment même où la nation aspire le plus à la stabilité et à la paix.
Toutefois il y a des causes qui tempèrent en lui l’humeur guerrière et inquiète. Si l’ambition est universelle et continue chez les peuples démocratiques, nous avons vu qu’elle y est rarement grande. L’homme qui, sorti des classes secondaires de la nation, est parvenu à travers les rangs inférieurs de l’armée jusqu’au grade d’officier, a déjà fait un pas immense. Il a pris pied dans une sphère supérieure à celle qu’il occupait au sein de la société civile, et il y a acquis des droits que la plupart des nations démocratiques considéreront toujours comme inaliénables [9] . Il s’arrête volontiers après [IV-223] ce grand effort, et songe à jouir de sa conquête. La crainte de compromettre ce qu’il possède amollit déjà dans son cœur l’envie d’acquérir ce qu’il n’a pas. Après avoir franchi le premier et le plus grand obstacle qui arrêtait ses progrès, il se résigne avec moins d’impatience à la lenteur de sa marche. Cet attiédissement de l’ambition s’accroît à mesure que, s’élevant davantage en grade, il trouve plus à perdre dans les hasards. Si je ne me trompe, la partie la moins guerrière comme la moins révolutionnaire d’une armée démocratique sera toujours la tête.
Ce que je viens de dire de l’officier et du soldat n’est point applicable à une classe nombreuse qui, dans toutes les armées, occupe entre eux la place intermédiaire ; je veux parler des sous-officiers.
Cette classe des sous-officiers qui, avant le siècle présent, n’avait point encore paru dans l’histoire, est appelée désormais, je pense, à y jouer un rôle.
De même que l’officier, le sous-officier a rompu dans sa pensée tous les liens qui l’attachaient à la société civile ; de même que lui, il a fait de l’état militaire sa carrière, et, plus que lui peut-être, il a dirigé de ce seul côté tous ses désirs ; mais il n’a [IV-224] pas encore atteint comme l’officier un point élevé et solide où il lui soit loisible de s’arrêter et de respirer à l’aise, en attendant qu’il puisse monter plus haut.
Par la nature même de ses fonctions qui ne saurait changer, le sous-officier est condamné à mener une existence obscure, étroite, malaisée et précaire. Il ne voit encore de l’état militaire que les périls. Il n’en connaît que les privations et l’obéissance, plus difficiles à supporter que les périls. Il souffre d’autant plus de ses misères présentes, qu’il sait que la constitution de la société et celle de l’armée lui permettent de s’en affranchir ; d’un jour à l’autre, en effet, il peut devenir officier. Il commande alors, il a des honneurs, de l’indépendance, des droits, des jouissances ; non-seulement cet objet de ses espérances lui parait immense, mais avant que de le saisir, il n’est jamais sûr de l’atteindre. Son grade n’a rien d’irrévocable ; il est livré chaque jour tout entier à l’arbitraire de ses chefs ; les besoins de la discipline exigent impérieusement qu’il en soit ainsi. Une faute légère, un caprice, peuvent toujours lui faire perdre, en un moment, le fruit de plusieurs années de travaux et d’efforts. Jusqu’à ce qu’il soit arrivé au grade qu’il convoite, il n’a donc rien fait. Là seulement il semble entrer dans la carrière. Chez un homme ainsi aiguillonné sans [IV-225] cesse par sa jeunesse, ses besoins, ses passions, l’esprit de son temps, ses espérances et ses craintes, il ne peut manquer de s’allumer une ambition désespérée.
Le sous-officier veut donc la guerre, il la veut toujours et à tout prix, et si on lui refuse la guerre, il désire les révolutions qui suspendent l’autorité des règles au milieu desquelles il espère, à la faveur de la confusion et des passions politiques, chasser son officier et en prendre la place ; et il n’est pas impossible qu’il les fasse naître, parce qu’il exerce une grande influence sur les soldats par la communauté d’origine et d’habitudes, bien qu’il en diffère beaucoup par les passions et les désirs.
On aurait tort de croire que ces dispositions diverses de l’officier, du sous-officier et du soldat, tinssent à un temps ou à un pays. Elles se feront voir à toutes les époques et chez toutes les nations démocratiques.
Dans toute armée démocratique, ce sera toujours le sous-officier qui représentera le moins l’esprit pacifique et régulier du pays, et le soldat qui le représentera le mieux. Le soldat apportera dans la carrière militaire la force ou la faiblesse des mœurs nationales ; il y fera voir l’image fidèle de la nation. Si elle est ignorante et faible, il se [IV-226] laissera entraîner au désordre par ses chefs, à son insu ou malgré lui. Si elle est éclairée et énergique, il les retiendra lui-même dans l’ordre.
[IV-227]
CHAPITRE XXIV.↩
Ce qui rend les armées démocratiques plus faibles que les autres armées en entrant en campagne, et plus redoutables quand la guerre se prolonge.
Toute armée qui entre en campagne après une longue paix risque d’être vaincue; toute armée qui a longtemps fait la guerre a de grandes chances de vaincre : cette vérité est particulièrement applicable aux armées démocratiques.
Dans les aristocraties, l’état militaire, étant une carrière privilégiée, est honorée même en temps de paix. Les hommes qui ont de grands talents, de grandes lumières et une grande ambition l’embrassent ; l’armée est, en toutes choses, au niveau de la nation ; souvent même elle le dépasse.
[IV-228]
Nous avons vu comment, au contraire, chez les peuples démocratiques, l’élite de la nation s’écartait peu à peu de la carrière militaire, pour chercher, par d’autres chemins, la considération, le pouvoir et surtout la richesse. Après une longue paix, et dans les temps démocratiques les paix sont longues, l’armée est toujours inférieure au pays lui-même. C’est en cet état que la trouve la guerre ; et jusqu’à ce que la guerre l’ait changée, il y a péril pour le pays et pour l’armée.
J’ai fait voir comment, dans les armées démocratiques et en temps de paix, le droit d’ancienneté était la loi suprême et inflexible de l’avancement. Cela ne découle pas seulement, ainsi que je l’ai dit, de la constitution de ces armées, mais de la constitution même du peuple, et se retrouvera toujours.
De plus, comme chez ces peuples l’officier n’est quelque chose dans le pays que par sa position militaire, et qu’il tire de là toute sa considération et toute son aisance, il ne se retire ou n’est exclu de l’armée qu’aux limites extrêmes de la vie.
Il résulte de ces deux causes que lorsqu’après un long repos un peuple démocratique prend enfin les armes, tous les chefs de son armée se trouvent être des vieillards. Je ne parle pas seulement des généraux, mais des officiers subalternes, dont la plupart sont restés immobiles, ou n’ont [IV-229] pu marcher que pas à pas. Si l’on considère une armée démocratique après une longue paix, on voit avec surprise que tous les soldats sont voisins de l’enfance et tous les chefs sur le déclin ; de telle sorte que les premiers manquent d’expérience et les seconds de vigueur.
Cela est une grande cause de revers ; car la première condition pour bien conduire la guerre, est d’être jeune ; je n’aurais pas osé le dire, si le plus grand capitaine des temps modernes ne l’avait dit.
Ces deux causes n’agissent pas de la même manière sur les armées aristocratiques.
Comme on y avance par droit de naissance bien plus que par droit d’ancienneté, il se rencontre toujours dans tous les grades un certain nombre d’hommes jeunes, et qui apportent à la guerre toute la première énergie du corps et de l’âme.
De plus, comme les hommes qui recherchent les honneurs militaires chez un peuple aristocratique ont une position assurée dans la société civile, ils attendent rarement que les approches de la vieillesse les surprennent dans l’armée. Après avoir consacré à la carrière des armes les plus vigoureuses années de leur jeunesse, ils se retirent d’eux-mêmes et vont user dans leurs foyers les restes de leur âge mûr.
Une longue paix ne remplit pas seulement les [IV-230] armées démocratiques de vieux officiers, elle donne encore à tous les officiers des habitudes de corps et d’esprit qui les rendent peu propres à la guerre. Celui qui a longtemps vécu au milieu de l’atmosphère paisible et tiède des mœurs démocratiques se plie d’abord malaisément aux rudes travaux et aux austères devoirs que la guerre impose. S’il n’y perd pas absolument le goût des armes, il y prend du moins des façons de vivre qui l’empêchent de vaincre.
Chez les peuples aristocratiques, la mollesse de la vie civile exerce moins d’influence sur les mœurs militaires, parce que, chez ces peuples, c’est l’aristocratie qui conduit l’armée. Or, une aristocratie, quelque plongée qu’elle soit dans les délices, a toujours plusieurs autres passions que celles du bien-être, et elle fait volontiers le sacrifice momentané de son bien-être, pour mieux satisfaire ces passions-là.
J’ai montré comment, dans les armées démocratiques, en temps de paix, les lenteurs de l’avancement sont extrêmes. Les officiers supportent d’abord cet état de choses avec impatience ; ils s’agitent, s’inquiètent et se désespèrent ; mais, à la longue, la plupart d’entre eux se résignent. Ceux qui ont le plus d’ambition et de ressources sortent de l’armée ; les autres, proportionnant enfin leurs goûts et leurs désirs à la médiocrité de leur sort, [IV-231] finissent par considérer l’état militaire sous un aspect civil. Ce qu’ils en prisent le plus, c’est l’aisance et la stabilité qui l’accompagnent ; sur l’assurance de cette petite fortune, ils fondent toute l’image de leur avenir, et ils ne demandent qu’à pouvoir en jouir paisiblement.[Note]
Ainsi, non seulement une longue paix remplit de vieux officiers les armées démocratiques, mais elle donne souvent des instincts de vieillards à ceux mêmes qui y sont encore dans la vigueur de l’âge.
J’ai fait voir également comment, chez les nations démocratiques, en temps de paix, la carrière militaire était peu honorée et mal suivie.
Cette défaveur publique est un poids très-lourd qui pèse sur l’esprit de l’armée. Les âmes en sont comme pliées ; et, quand enfin la guerre arrive, elles ne sauraient reprendre en un moment leur élasticité et leur vigueur.
Une semblable cause d’affaiblissement moral ne se rencontre point dans les armées aristocratiques. Les officiers ne s’y trouvent jamais abaissés à leurs propres yeux et à ceux de leurs semblables, parce que, indépendamment de leur grandeur militaire, ils sont grands par eux-mêmes.
L’influence de la paix se fit-elle sentir sur les deux armées de la même manière, les résultats seraient encore différents.
[IV-232]
Quand les officiers d’une armée aristocratique ont perdu l’esprit guerrier et le désir de s’élever par les armes, il leur reste encore un certain respect pour l’honneur de leur ordre, et une vieille habitude d’être les premiers et de donner l’exemple. Mais lorsque les officiers d’une armée démocratique n’ont plus l’amour de la guerre et l’ambition militaire, il ne reste rien.
Je pense donc qu’un peuple démocratique qui entreprend une guerre après une longue paix, risque beaucoup plus qu’un autre d’être vaincu ; mais il ne doit pas se laisser aisément abattre par les revers, car les chances de son armée s’accroissent par la durée même de la guerre.
Lorsque la guerre, en se prolongeant, a enfin arraché tous les citoyens à leurs travaux paisibles et fait échouer leurs petites entreprises, il arrive que les mêmes passions qui leur faisaient attacher tant de prix à la paix se tournent vers les armes. La guerre, après avoir détruit toutes les industries, devient elle-même la grande et unique industrie, et c’est vers elle seule que se dirigent alors de toutes parts les ardents et ambitieux désirs que l’égalité a fait naître. C’est pourquoi ces mêmes nations démocratiques qu’on a tant de peine à entraîner sur les champs de bataille y font quelquefois des choses prodigieuses, quand on est enfin parvenu à leur mettre les armes à la main.
[IV-233]
À mesure que la guerre attire de plus en plus vers l’armée tous les regards, qu’on lui voit créer en peu de temps de grandes réputations et de grandes fortunes, l’élite de la nation prend la carrière des armes ; tous les esprits naturellement entreprenants, fiers et guerriers, que produit non plus seulement l’aristocratie, mais le pays entier, sont entraînés de ce côté.
Le nombre des concurrents aux honneurs militaires étant immense, et la guerre poussant rudement chacun à sa place, il finit toujours par se rencontrer de grands généraux. Une longue guerre produit sur une armée démocratique ce qu’une révolution produit sur le peuple lui-même. Elle brise les règles et fait surgir tous les hommes extraordinaires. Les officiers dont l’âme et le corps ont vieilli dans la paix sont écartés, se retirent ou meurent. À leur place se presse une foule d’hommes jeunes que la guerre a déjà endurcis, et dont elle a étendu et enflammé les désirs, Ceux-ci veulent grandir à tout prix et grandir sans cesse ; après eux en viennent d’autres qui ont mêmes passions et mêmes désirs ; et après ces autres-là, d’autres encore, sans trouver de limites que celles de l’armée. L’égalité permet à tous l’ambition, et la mort se charge de fournir à toutes les ambitions des chances. La mort ouvre sans cesse [IV-234] les rangs, vide les places, ferme la carrière et l’ouvre.
Il y a d’ailleurs entre les mœurs militaires et les mœurs démocratiques un rapport caché que la guerre découvre.
Les hommes des démocraties ont naturellement le désir passionné d’acquérir vite les biens qu’ils convoitent, et d’en jouir aisément. La plupart d’entre eux adorent le hasard, et craignent bien moins la mort que la peine. C’est dans cet esprit qu’ils mènent le commerce et l’industrie ; et ce même esprit, transporté par eux sur les champs de bataille, les porte à exposer volontiers leur vie pour s’assurer, en un moment, les prix de la victoire. Il n’y a pas de grandeurs qui satisfassent plus l’imagination d’un peuple démocratique que la grandeur militaire, grandeur brillante et soudaine qu’on obtient sans travail, en ne risquant que sa vie.
Ainsi, tandis que l’intérêt et les goûts écartent de la guerre les citoyens d’une démocratie, les habitudes de leur âme les préparent à la bien faire ; ils deviennent aisément de bons soldats, dès qu’on a pu les arracher à leurs affaires et à leur bien-être.
Si la paix est particulièrement nuisible aux armées démocratiques, la guerre leur assure donc des avantages que les autres armées n’ont jamais ; [IV-235] et ces avantages, bien que peu sensibles d’abord, ne peuvent manquer, à la longue, de leur donner la victoire.
Un peuple aristocratique qui, luttant contre une nation démocratique, ne réussit pas à la ruiner, dès les premières campagnes, risque toujours beaucoup d’être vaincu par elle.
[IV-237]
CHAPITRE XXV.↩
De la discipline dans les armées démocratiques.
C’est une opinion fort répandue, surtout parmi les peuples aristocratiques, que la grande égalité qui règne au sein des démocraties y rend à la longue le soldat indépendant de l’officier, et y détruit ainsi le lien de la discipline.
C’est une erreur. Il y a en effet deux espèces de discipline qu’il ne faut pas confondre.
Quand l’officier est le noble et le soldat le serf ; l’un le riche, et l’autre le pauvre ; que le premier est éclairé et fort, et le second ignorant et faible, [IV-238] il est facile d’établir entre ces deux hommes le lien le plus étroit d’obéissance. Le soldat est plié à la discipline militaire avant, pour ainsi dire, que d’entrer dans l’armée, ou plutôt la discipline militaire n’est qu’un perfectionnement de la servitude sociale. Dans les armées aristocratiques, le soldat arrive assez aisément à être comme insensible à toutes choses, excepté à l’ordre de ses chefs. Il agit sans penser, triomphe sans ardeur, et meurt sans se plaindre. En cet état, ce n’est plus un homme, mais c’est encore un animal très-redoutable dressé à la guerre.
Il faut que les peuples démocratiques désespèrent d’obtenir jamais de leurs soldats cette obéissance aveugle, minutieuse, résignée et toujours égale, que les peuples aristocratiques leur imposent sans peine. L’état de la société n’y prépare point : ils risqueraient de perdre leurs avantages naturels en voulant acquérir artificiellement ceux-là. Chez les peuples démocratiques, la discipline militaire ne doit pas essayer d’anéantir le libre essor des âmes ; elle ne peut aspirer qu’à le diriger ; l’obéissance qu’elle crée est moins exacte, mais plus impétueuse et plus intelligente. Sa racine est dans la volonté même de celui qui obéit ; elle ne s’appuie pas seulement sur son instinct, mais sur sa raison ; aussi se resserre-t-elle [IV-239] souvent d’elle-même à proportion que le péril la rend nécessaire. La discipline d’une armée aristocratique se relâche volontiers dans la guerre, parce que cette discipline se fonde sur les habitudes, et que la guerre trouble ces habitudes. La discipline d’une armée démocratique se raffermit au contraire devant l’ennemi, parce que chaque soldat voit alors très-clairement qu’il faut se taire et obéir pour pouvoir vaincre.
Les peuples qui ont fait les choses les plus considérables par la guerre, n’ont point connu d’autre discipline que celle dont je parle. Chez les anciens, on ne recevait dans les armées que des hommes libres et des citoyens, lesquels différaient peu les uns des autres, et étaient accoutumés à se traiter en égaux. Dans ce sens, on peut dire que les armées de l’antiquité étaient démocratiques, bien qu’elles sortissent du sein de l’aristocratie ; aussi régnait-il dans ces armées une sorte de confraternité familière entre l’officier et le soldat. On s’en convainc en lisant la Vie des grands capitaines de Plutarque. Les soldats y parlent sans cesse et fort librement à leurs généraux, et ceux-ci écoutent volontiers les discours de leurs soldats, et y répondent. C’est par des paroles et des exemples, bien plus que par la contrainte et les châtiments, qu’ils les conduisent. On dirait des compagnons autant que des chefs.
[IV-240]
Je ne sais si les soldats grecs et romains ont jamais perfectionné au même point que les Russes les petits détails de la discipline militaire ; mais cela n’a pas empêché Alexandre de conquérir l’Asie, et Rome le monde.
[IV-241]
CHAPITRE XXVI.↩
Quelques considérations sur la guerre dans les sociétés démocratiques.
Lorsque le principe de l’égalité ne se développe pas seulement chez une nation, mais en même temps chez plusieurs peuples voisins, ainsi que cela se voit de nos jours en Europe, les hommes qui habitent ces pays divers, malgré la disparité des langues, des usages et des lois, se ressemblent toutefois en ce point, qu’ils redoutent également la guerre, et conçoivent pour la paix un même amour [10] . En vain, l’ambition ou la colère arme les [IV-242] princes, une sorte d’apathie et de bienveillance universelle les apaise en dépit d’eux-mêmes, et leur fait tomber l’épée des mains : les guerres deviennent plus rares.
À mesure que l’égalité, se développant à la fois dans plusieurs pays, y pousse simultanément vers l’industrie et le commerce les hommes qui les habitent, non seulement leurs goûts se ressemblent, mais leurs intérêts se mêlent et s’enchevêtrent, de telle sorte qu’aucune nation ne peut infliger aux autres des maux qui ne retombent pas sur elle-même, et que toutes finissent par considérer la guerre comme une calamité presque aussi grande pour le vainqueur que pour le vaincu.
Ainsi, d’un côté, il est très-difficile, dans les siècles démocratiques, d’entraîner les peuples à se combattre ; mais, d’une autre part, il est presque impossible que deux d’entre eux se fassent isolément la guerre. Les intérêts de tous sont si enlacés, leurs opinions et leurs besoins si semblables qu’aucun ne saurait se tenir en repos, quand les autres s’agitent. Les guerres deviennent donc plus rares ; mais lorsqu’elles naissent, elles ont un champ plus vaste.
[IV-243]
Des peuples démocratiques qui s’avoisinent ne deviennent pas seulement semblables sur quelques points, ainsi que je viens de le dire; ils finissent par se ressembler sur presque tous [11] .
Or, cette similitude des peuples a, quant à [IV-244] la guerre, des conséquences très-importantes.
Lorsque je me demande pourquoi la confédération helvétique du quinzième siècle faisait trembler les plus grandes et les plus puissantes nations de l’Europe, tandis que, de nos jours, son pouvoir est en rapport exact avec sa population, je trouve que les Suisses sont devenus semblables à tous les hommes qui les environnent, et ceux-ci aux Suisses ; de telle sorte que, le nombre seul faisant entre eux la différence, aux plus gros bataillons appartient nécessairement la victoire. L’un des résultats de la révolution démocratique qui s’opère en Europe, est donc de faire prévaloir, sur tous les champs de bataille, la force numérique, et de contraindre toutes les petites nations à s’incorporer aux grandes, ou du moins à entrer dans la politique de ces dernières.
La raison déterminante de la victoire étant le nombre, il en résulte que chaque peuple doit tendre de tous ses efforts à amener le plus d’hommes possible sur le champ de bataille.
Quand on pouvait enrôler sous les drapeaux une espèce de troupes supérieure à toutes les autres, comme l’infanterie suisse ou la chevalerie française du seizième siècle, on n’estimait pas avoir besoin de lever de très-grosses armées ; mais il n’en est plus ainsi quand tous les soldats se valent.
La même cause qui fait naître ce nouveau [IV-245] besoin fournit aussi les moyens de le satisfaire. Car, ainsi que je l’ai dit, quand tous les hommes sont semblables, ils sont tous faibles. Le pouvoir social est naturellement beaucoup plus fort chez les peuples démocratiques que partout ailleurs. Ces peuples, en même temps qu’ils sentent le désir d’appeler toute leur population virile sous les armes, ont donc la faculté de l’y réunir : ce qui fait que dans les siècles d’égalité les armées semblent croître à mesure que l’esprit militaire s’éteint.
Dans les mêmes siècles, la manière de faire la guerre change aussi par les mêmes causes.
Machiavel dit dans son livre du Prince « qu’il est bien plus difficile de subjuguer un peuple qui a pour chefs un prince et des barons, qu’une nation qui est conduite par un prince et des esclaves ». Mettons, pour n’offenser personne, des fonctionnaires publics au lieu d’esclaves, et nous aurons une grande vérité, fort applicable à notre sujet.
Il est très-difficile à un grand peuple aristocratique de conquérir ses voisins et d’être conquis par eux. Il ne saurait les conquérir, parce qu’il ne peut jamais réunir toutes ses forces et les tenir longtemps ensemble ; et il ne peut être conquis, parce que l’ennemi trouve partout de petits foyers de résistance qui l’arrêtent. Je comparerai la guerre dans un pays aristocratique à la guerre dans un [IV-246] pays de montagnes : les vaincus trouvent à chaque instant l’occasion de se rallier dans de nouvelles positions et d’y tenir ferme.
Le contraire précisément se fait voir chez les nations démocratiques.
Celles-ci amènent aisément toutes leurs forces disponibles sur le champ de bataille, et, quand la nation est riche et nombreuse, elle devient aisément conquérante ; mais, une fois qu’on l’a vaincue et qu’on pénètre sur son territoire, il lui reste peu de ressources, et, si l’on vient jusqu’à s’emparer de sa capitale, la nation est perdue. Cela s’explique très-bien : chaque citoyen étant individuellement très-isolé et très-faible, nul ne peut ni se défendre soi-même, ni présenter à d’autres un point d’appui. Il n’y a de fort dans un pays démocratique que l’état ; la force militaire de l’état étant détruite par la destruction de son armée, et son pouvoir civil paralysé par la prise de sa capitale, le reste ne forme plus qu’une multitude sans règle et sans force qui ne peut lutter contre la puissance organisée qui l’attaque ; je sais qu’on peut rendre le péril moindre en créant des libertés et par conséquent des existences provinciales ; mais ce remède sera toujours insuffisant.
Non seulement la population ne pourra plus alors continuer la guerre, mais il est à craindre qu’elle ne veuille pas le tenter.
[IV-247]
D’après le droit des gens adopté par les nations civilisées, les guerres n’ont pas pour but de s’approprier les biens des particuliers, mais seulement de s’emparer du pouvoir politique. On ne détruit la propriété privée que par occasion et pour atteindre le second objet.
Lorsqu’une nation aristocratique est envahie après la défaite de son armée, les nobles, quoiqu’ils soient en même temps les riches, aiment mieux continuer individuellement à se défendre que de se soumettre ; car, si le vainqueur restait maître du pays, il leur enlèverait leur pouvoir politique, auquel ils tiennent plus encore qu’à leurs biens : ils préfèrent donc les combats à la conquête, qui est pour eux le plus grand des malheurs, et ils entraînent aisément avec eux le peuple, parce que le peuple a contracté le long usage de les suivre et de leur obéir, et n’a d’ailleurs presque rien à risquer dans la guerre.
Chez une nation où règne l’égalité des conditions, chaque citoyen ne prend, au contraire, qu’une petite part au pouvoir politique, et souvent n’y prend point de part ; d’un autre côté, tous sont indépendants et ont des biens à perdre ; de telle sorte qu’on y craint bien moins la conquête et bien plus la guerre que chez un peuple aristocratique. Il sera toujours très-difficile de déterminer une population démocratique à prendre les armes [IV-248] quand la guerre sera portée sur son territoire. C’est pourquoi il est si nécessaire de donner à ces peuples des droits et un esprit politique qui suggère à chaque citoyen quelques-uns des intérêts qui font agir les nobles dans les aristocraties.
Il faut bien que les princes et les autres chefs des nations démocratiques se le rappellent : il n’y a que la passion et l’habitude de la liberté qui puissent lutter avec avantage contre l’habitude et la passion du bien-être. Je n’imagine rien de mieux préparé, en cas de revers, pour la conquête, qu’un peuple démocratique qui n’a pas d’institutions libres.
On entrait jadis en campagne avec peu de soldats ; on livrait de petits combats et l’on faisait de longs siéges. Maintenant, on livre de grandes batailles, et, dès qu’on peut marcher librement devant soi, on court sur la capitale, afin de terminer la guerre d’un seul coup.
Napoléon a inventé, dit-on, ce nouveau système. Il ne dépendait pas d’un homme, quel qu’il fût, d’en créer un semblable. La manière dont Napoléon a fait la guerre lui a été suggérée par l’état de la société de son temps, et elle lui a réussi parce qu’elle était merveilleusement appropriée à cet état, et qu’il la mettait pour la première fois en usage. Napoléon est le premier qui [IV-249] ait parcouru à la tête d’une armée le chemin de toutes les capitales. Mais c’est la ruine de la société féodale qui lui avait ouvert cette route. Il est permis de croire que, si cet homme extraordinaire fût né il y a trois cents ans, il n’eût pas retiré les mêmes fruits de sa méthode, ou plutôt il aurait eu une autre méthode.
Je n’ajouterai plus qu’un mot relatif aux guerres civiles, car je crains de fatiguer la patience du lecteur.
La plupart des choses que j’ai dites à propos des guerres étrangères, s’applique à plus forte raison aux guerres civiles. Les hommes qui vivent dans les pays démocratiques n’ont pas naturellement l’esprit militaire : ils le prennent quelquefois lorsqu’on les a entraînés malgré eux sur les champs de bataille ; mais se lever en masse de soi-même et s’exposer volontairement aux misères de la guerre et surtout que la guerre civile entraîne, c’est un parti auquel l’homme des démocraties ne se résout point. Il n’y a que les citoyens les plus aventureux qui consentent à se jeter dans un semblable hasard ; la masse de la population demeure immobile.
Alors même qu’elle voudrait agir, elle n’y parviendrait pas aisément ; car elle ne trouve pas dans son sein d’influences anciennes et bien établies auxquelles elle veuille se soumettre, point de chefs [IV-250] déjà connus pour rassembler les mécontents, les régler et les conduire ; point de pouvoirs politiques placés au-dessous du pouvoir national, et qui viennent appuyer efficacement la résistance qu’on lui oppose.
Dans les contrées démocratiques, la puissance morale de la majorité est immense, et les forces matérielle dont elle dispose hors de proportion avec celles qu’il est d’abord possible de réunir contre elle. Le parti qui est assis sur le siége de la majorité, qui parle en son nom et emploie son pouvoir, triomphe donc, en un moment et sans peine, de toutes les résistances particulières. Il ne leur laisse pas même le temps de naître ; il en écrase le germe.
Ceux qui, chez ces peuples, veulent faire une révolution par les armes, n’ont donc d’autres ressources que de s’emparer à l’improviste de la machine toute montée du gouvernement, ce qui peut s’exécuter par un coup de main plutôt que par une guerre ; car, du moment où il y a guerre en règle, le parti qui représente l’état est presque toujours sûr de vaincre.
Le seul cas où une guerre civile pourrait naître serait celui où, l’armée se divisant, une portion lèverait l’étendard de la révolte et l’autre resterait fidèle. Une armée forme une petite société fort étroitement liée et très-vivace, qui est en état de se suffire quelque temps à elle-même. La guerre [IV-251] pourrait être sanglante ; mais elle ne serait pas longue ; car, ou l’armée révoltée attirerait à elle le gouvernement par la seule démonstration de ses forces, ou par sa première victoire, et la guerre serait finie ; ou bien la lutte s’engagerait, et la portion de l’armée qui ne s’appuierait pas sur la puissance organisée de l’état, ne tarderait pas à se disperser d’elle-même ou à être détruite.
On peut donc admettre comme vérité générale que dans les siècles d’égalité, les guerres civiles deviendront beaucoup plus rares et plus courtes [12]
[IV-253]
QUATRIÈME PARTIE.
DE L’INFLUENCE QU’EXERCENT IDÉES ET LES SENTIMENTS DÉMOCRATIQUES SUR LA SOCIÉTÉ POLITIQUE.↩
Je remplirais mal l’objet de ce livre si, après avoir montré les idées et les sentiments que l’égalité suggère, je ne faisais voir, en terminant, quelle est l’influence générale que ces mêmes sentiments et ces mêmes idées peuvent exercer sur le gouvernement des sociétés humaines.
Pour y réussir, je serai obligé de revenir [IV-254] souvent sur mes pas. Mais j’espère que le lecteur ne refusera pas de me suivre, lorsque des chemins qui lui sont connus le conduiront vers quelque vérité nouvelle.
CHAPITRE I.↩
L’égalité donne naturellement aux hommes le goût des institutions libres.
L’égalité, qui rend les hommes indépendants les uns des autres, leur fait contracter l’habitude et le goût de ne suivre, dans leurs actions particulières, que leur volonté. Cette entière indépendance dont ils jouissent continuellement vis à vis de leurs égaux et dans l’usage de la vie privée les dispose à considérer d’un œil mécontent toute autorité, et leur suggère bientôt l’idée et l’amour de la liberté politique. Les hommes qui vivent dans ce temps marchent donc sur une pente naturelle qui les dirige vers les institutions libres. Prenez l’un d’eux [IV-255] au hasard ; remontez, s’il se peut, à ses instincts primitifs : vous découvrirez que, parmi les différents gouvernements, celui qu’il conçoit d’abord, et qu’il prise le plus c’est le gouvernement dont il a élu le chef et dont il contrôle les actes.
De tous les effets politiques que produit l’égalité des conditions, c’est cet amour de l’indépendance qui frappe le premier les regards et dont les esprits timides s’effrayent davantage, et l’on ne peut dire qu’ils aient absolument tort de le faire, car l’anarchie a des traits plus effrayants dans les pays démocratiques qu’ailleurs. Comme les citoyens n’ont aucune action les uns sur les autres, à l’instant où le pouvoir national qui les contient tous à leur place vient à manquer, il semble que le désordre doit être aussitôt à son comble, et que, chaque citoyen s’écartant de son côté, le corps social va tout à coup se trouver réduit en poussière.
Je suis convaincu toutefois que l’anarchie n’est pas le mal principal que les siècles démocratiques doivent craindre, mais le moindre.
L’égalité produit, en effet, deux tendances : l’une mène directement les hommes à l’indépendance, et peut les pousser tout à coup jusqu’à l’anarchie ; l’autre les conduit par un chemin plus long, plus secret, mais plus sûr, vers la servitude.
Les peuples voient aisément la première et y résistent ; ils se laissent entraîner par l’autre sans [IV-256] la voir ; il importe donc particulièrement de la montrer.
Pour moi, loin de reprocher à l’égalité l’indocilité qu’elle inspire, c’est de cela principalement que je la loue. Je l’admire en lui voyant déposer au fond de l’esprit et du cœur de chaque homme cette notion obscure et ce penchant instinctif de l’indépendance politique, préparant ainsi le remède au mal qu’elle fait naître. C’est par ce côté que je m’attache à elle.
[IV-257]
CHAPITRE II.↩
Que les idées des peuples démocratiques en matière de gouvernement sont naturellement favorables à la concentration des pouvoirs.
L’idée de pouvoirs secondaires, placés entre le souverain et les sujets, se présentait naturellement à l’imagination des peuples aristocratiques, parce qu’ils renfermaient dans leur sein des individus ou des familles que la naissance, les lumières, les richesses, tenaient hors de pair, et semblaient destinés à commander. Cette même idée est naturellement absente de l’esprit des hommes dans les siècles d’égalité par des raisons contraires ; on ne peut l’y introduire qu’artificiellement, et on ne l’y [IV-258] retient qu’avec peine ; tandis qu’ils conçoivent, pour ainsi dire sans y penser, l’idée d’un pouvoir unique et central qui mène tous les citoyens par lui-même.
En politique, d’ailleurs, comme en philosophie et en religion, l’intelligence des peuples démocratiques reçoit avec délices les idées simples et générales. Les systèmes compliqués la repoussent, et elle se plaît à imaginer une grande nation dont tous les citoyens ressemblent à un seul modèle et sont dirigés par un seul pouvoir.
Après l’idée d’un pouvoir unique et central, celle qui se présente le plus spontanément à l’esprit des hommes dans les siècles d’égalité est l’idée d’une législation uniforme. Comme chacun d’eux se voit peu différent de ses voisins, il comprend mal pourquoi la règle qui est applicable à un homme ne le serait pas également à tous les autres. Les moindres privilèges répugnent donc à sa raison. Les plus légères dissemblances dans les institutions politiques du même peuple le blessent, et l’uniformité législative lui paraît être la condition première d’un bon gouvernement.
Je trouve, au contraire, que cette même notion d’une règle uniforme, également imposée à tous les membres du corps social, est comme étrangère à l’esprit humain dans les siècles aristocratiques. Il ne la reçoit point ou il la rejette.
[IV-259]
Ces penchants opposés de l’intelligence finissent, de part et d’autre, par devenir des instincts si aveugles et des habitudes si invincibles qu’ils dirigent encore les actions, en dépit des faits particuliers. Il se rencontrait quelquefois, malgré l’immense variété du moyen âge, des individus parfaitement semblables : ce qui n’empêchait pas que le législateur n’assignât à chacun d’eux des devoirs divers et des droits différents. Et, au contraire, de nos jours, des gouvernements s’épuisent, afin d’imposer les mêmes usages et les mêmes lois à des populations qui ne se ressemblent point encore.
À mesure que les conditions s’égalisent chez un peuple, les individus paraissent plus petits et la société semble plus grande, ou plutôt chaque citoyen, devenu semblable à tous les autres, se perd dans la foule, et l’on n’aperçoit plus que la vaste et magnifique image du peuple lui-même.
Cela donne naturellement aux hommes des temps démocratiques une opinion très-haute des privilèges de la société et une idée fort humble des droits de l’individu. Ils admettent aisément que l’intérêt de l’un est tout et que celui de l’autre n’est rien. Ils accordent assez volontiers que le pouvoir qui représente la société possède beaucoup plus de lumières et de sagesse qu’aucun des hommes qui le composent, et que son devoir, aussi bien [IV-260] que son droit, est de prendre chaque citoyen par la main et de le conduire.
Si l’on veut bien examiner de près nos contemporains, et percer jusqu’à la racine de leurs opinions politiques, on y retrouvera quelques-unes des idées que je viens de reproduire, et l’on s’étonnera peut-être de rencontrer tant d’accord parmi des gens qui se font si souvent la guerre.
Les Américains croient que, dans chaque État, le pouvoir social doit émaner directement du peuple ; mais une fois que ce pouvoir est constitué, ils ne lui imaginent, pour ainsi dire, point de limites ; ils reconnaissent volontiers qu’il a le droit de tout faire.
Quant à des privilèges particuliers accordés à des villes, à des familles, ou à des individus, ils en ont perdu jusqu’à l’idée. Leur esprit n’a jamais prévu qu’on pût ne pas appliquer uniformément la même loi à toutes les parties du même État et à tous les hommes qui l’habitent.
Ces mêmes opinions se répandent de plus en plus en Europe ; elles s’introduisent dans le sein même des nations qui repoussent le plus violemment le dogme de la souveraineté du peuple. Celles-ci donnent au pouvoir une autre origine que les Américains ; mais elles envisagent le pouvoir sous les mêmes traits. Chez toutes, la notion de [IV-261] puissance intermédiaire s’obscurcît et s’efface. L’idée d’un droit inhérent à certains individus disparaît rapidement de l’esprit des hommes ; l’idée du droit tout puissant et pour ainsi dire unique de la société vient remplir sa place. Ces idées s’enracinent et croissent à mesure que les conditions deviennent plus égales et les hommes plus semblables ; l’égalité les fait naître, et elles hâtent à leur tour les progrès de l’égalité.
En France, où la révolution dont je parle est plus avancée que chez aucun autre peuple de l’Europe, ces mêmes opinions se sont entièrement emparées de l’intelligence. Qu’on écoute attentivement la voix de nos différents partis, on verra qu’il n’y en a point qui ne les adopte. La plupart estiment que le gouvernement agit mal ; mais tous pensent que le gouvernement doit sans cesse agir et mettre à tout la main. Ceux mêmes qui se font le plus rudement la guerre ne laissent pas de s’accorder sur ce point. L’unité, l’ubiquité, l’omnipotence du pouvoir social, l’uniformité de ses règles, forment le trait saillant qui caractérise tous les systèmes politiques enfantés de nos jours. On les retrouve au fond des plus bizarres utopies. L’esprit humain poursuit encore ces images quand il rêve.
Si de pareilles idées se présentent spontanément [IV-262] à l’esprit des particuliers, elles s’offrent plus volontiers encore à l’imagination des princes.[Note]
Tandis que le vieil état social de l’Europe s’altère et se dissout, les souverains se font sur leurs facultés et sur leurs devoirs des croyances nouvelles ; ils comprennent pour la première fois que la puissance centrale qu’ils représentent peut et doit administrer par elle-même, et sur un plan uniforme, toutes les affaires et tous les hommes. Cette opinion qui, j’ose le dire, n’avait jamais été conçue avant notre temps par les rois de l’Europe, pénètre au plus profond de l’intelligence de ces princes ; elle s’y tient ferme au milieu de l’agitation de toutes les autres.
Les hommes de nos jours sont donc bien moins divisés qu’on ne l’imagine ; ils se disputent sans cesse pour savoir dans quelles mains la souveraineté sera remise ; mais ils s’entendent aisément sur les devoirs et sur les droits de la souveraineté. Tous conçoivent le gouvernement sous l’image d’un pouvoir unique, simple, providentiel et créateur.
Toutes les idées secondaires, en matière politique, sont mouvantes ; celle-là reste fixe, inaltérable, pareille à elle-même. Les publicistes et les hommes d’État l’adoptent ; la foule la saisit avidement ; les gouvernés et les gouvernants [IV-263] s’accordent à la poursuivre avec la même ardeur : elle vient la première ; elle semble innée.
Elle ne sort donc point d’un caprice de l’esprit humain, mais elle est une condition naturelle de l’état actuel des hommes.
[IV-265]
CHAPITRE III.↩
Que les sentiments des peuples démocratiques sont d’accord avec leurs idées pour les porter à concentrer le pouvoir.
Si, dans les siècles d’égalité, les hommes perçoivent aisément l’idée d’un grand pouvoir central, on ne saurait douter, d’autre part, que leurs habitudes et leurs sentiments ne les prédisposent à reconnaître un pareil pouvoir et à lui prêter la main. La démonstration de ceci peut être faite en peu de mots, la plupart des raisons ayant été déjà données ailleurs.
Les hommes qui habitent les pays démocratiques n’ayant ni supérieurs, ni inférieurs, ni associés habituels et nécessaires, se replient volontiers [IV-266] sur eux-mêmes et se considèrent isolément. J’ai eu occasion de le montrer fort au long quand il s’est agi de l’individualisme.
Ce n’est donc jamais qu’avec effort que ces hommes s’arrachent à leurs affaires particulières, pour s’occuper des affaires communes ; leur pente naturelle est d’en abandonner le soin au seul représentant visible et permanent des intérêts collectifs, qui est l’État.
Non seulement ils n’ont pas naturellement le goût de s’occuper du public, mais souvent le temps leur manque pour le faire. La vie privée est si active dans les temps démocratiques, si agitée, si remplie de désirs, de travaux, qu’il ne reste presque plus d’énergie ni de loisir à chaque homme pour la vie politique.
Que de pareils penchants ne soient pas invincibles, ce n’est pas moi qui le nierai, puisque mon but principal en écrivant ce livre a été de les combattre. Je soutiens seulement que, de nos jours, une force secrète les développe sans cesse dans le cœur humain, et qu’il suffit de ne point les arrêter pour qu’ils le remplissent.
J’ai également eu l’occasion de montrer comment l’amour croissant du bien-être et la nature mobile de la propriété faisaient redouter aux peuples démocratiques le désordre matériel. L’amour de la tranquillité publique est souvent la seule passion [IV-267] politique que conservent ces peuples, et elle devient chez eux plus active et plus puissante, à mesure que toutes les autres s’affaissent et meurent ; cela dispose naturellement les citoyens à donner sans cesse ou à laisser prendre de nouveaux droits au pouvoir central, qui seul leur semble avoir l’intérêt et les moyens de les défendre de l’anarchie en se défendant lui-même.
Comme, dans les siècles d’égalité, nul n’est obligé de prêter sa force à son semblable, et nul n’a droit d’attendre de son semblable un grand appui ; chacun est tout à la fois indépendant et faible. Ces deux états, qu’il ne faut pas envisager séparément ni confondre, donnent au citoyen des démocraties des instincts fort contraires. Son indépendance le remplit de confiance et d’orgueil au sein de ses égaux, et sa débilité lui fait sentir, de temps en temps, le besoin d’un secours étranger qu’il ne peut attendre d’aucun d’eux, puisqu’ils sont tous impuissants et froids. Dans cette extrémité, il tourne naturellement ses regards vers cet être immense qui seul s’élève au milieu de l’abaissement universel. C’est vers lui que ses besoins et surtout ses désirs le ramènent sans cesse, et c’est lui qu’il finit par envisager comme le soutien unique et nécessaire de la faiblesse individuelle [13] .
[IV-268]
Ceci achève de faire comprendre ce qui se passe souvent chez les peuples démocratiques, où l’on voit les hommes qui supportent si malaisément des supérieurs souffrir patiemment un maître, et se montrer tout à la fois fiers et serviles.
La haine que les hommes portent au privilége s’augmente à mesure que les privilèges deviennent plus rares et moins grands, de telle sorte qu’on [IV-269] dirait que les passions démocratiques s’enflamment davantage dans le temps même où elles trouvent le moins d’aliments. J’ai déjà donné la raison de ce phénomène. Il n’y a pas de si grande inégalité qui blesse les regards lorsque toutes les conditions sont inégales ; tandis que la plus petite dissemblance paraît choquante au sein de l’uniformité générale ; la vue en devient plus insupportable à mesure que l’uniformité est plus complète. Il est donc naturel que l’amour de l’égalité croisse sans cesse avec l’égalité elle-même ; en le satisfaisant on le développe.
Cette haine immortelle, et de plus en plus allumée, qui anime les peuples démocratiques contre les moindres priviléges, favorise singulièrement la concentration graduelle de tous les droits politiques dans les mains du seul représentant de l’état. Le souverain, étant nécessairement et sans contestation au-dessus de tous les citoyens, n’excite l’envie d’aucun d’eux, et chacun croit enlever à ses égaux toutes les prérogatives qu’il lui concède.
L’homme des siècles démocratiques n’obéit qu’avec une extrême répugnance à son voisin qui est son égal ; il refuse de reconnaître à celui-ci des lumières supérieures aux siennes ; il se défie de sa justice et voit avec jalousie son pouvoir ; il le craint et le méprise ; il aime à lui faire [IV-270] sentir à chaque instant la commune dépendance où ils sont tous les deux du même maître.
Toute puissance centrale qui suit ces instincts naturels aime l’égalité et la favorise ; car l’égalité facilite singulièrement l’action d’une semblable puissance, l’étend et l’assure.[Note]
On peut dire également que tout gouvernement central adore l’uniformité ; l’uniformité lui évite l’examen d’un infinité de détails dont il devrait s’occuper, s’il fallait faire la règle pour les hommes, au lieu de faire passer indistinctement tous les hommes sous la même règle. Ainsi, le gouvernement aime ce que les citoyens aiment, et il hait naturellement ce qu’ils haïssent. Cette communauté de sentiments qui, chez les nations démocratiques, unit continuellement dans une même pensée chaque individu et le souverain établit entre eux une secrète et permanente sympathie. On pardonne au gouvernement ses fautes en faveur de ses goûts ; la confiance publique ne l’abandonne qu’avec peine au milieu de ses excès ou de ses erreurs, et elle revient à lui dès qu’il la rappelle. Les peuples démocratiques haïssent souvent les dépositaires du pouvoir central ; mais ils aiment toujours ce pouvoir lui-même.
Ainsi, je suis parvenu par deux chemins divers au même but. J’ai montré que l’égalité suggérait aux hommes la pensée d’un gouvernement unique [IV-271] uniforme et fort. Je viens de faire voir qu’elle leur en donne le goût ; c’est donc vers un gouvernement de cette espèce que tendent les nations de nos jours. La pente naturelle de leur esprit et de leur cœur les y mène, et il leur suffit de ne point se retenir pour qu’elles y arrivent.
Je pense que, dans les siècles démocratiques qui vont s’ouvrir, l’indépendance individuelle et les libertés locales seront toujours un produit de l’art. La centralisation sera le gouvernement naturel.
[IV-273]
CHAPITRE IV.↩
De quelques causes particulières et accidentelles qui achèvent de porter un peuple démocratique à centraliser le pouvoir ou qui l’en détournent.
Si tous les peuples démocratiques sont entraînés instinctivement vers la centralisation des pouvoirs, ils y tendent d’une manière inégale. Cela dépend des circonstances particulières qui peuvent développer ou restreindre les effets naturels de l’état social. Ces circonstances sont en très-grand nombre ; je ne parlerai que de quelques-unes.
Chez les hommes qui ont longtemps vécu libres avant de devenir égaux, les instincts que la liberté avait donnés combattent jusqu’à un certain point [IV-274] les penchants que suggère l’égalité ; et, bien que parmi eux le pouvoir central accroisse ses privilèges, les particuliers n’y perdent jamais entièrement leur indépendance.
Mais, quand l’égalité vient à se développer chez un peuple qui n’a jamais connu ou qui ne connaît plus depuis longtemps la liberté, ainsi que cela se voit sur le continent de l’Europe, les anciennes habitudes de la nation arrivant à se combiner subitement et par une sorte d’attraction naturelle avec les habitudes et les doctrines nouvelles que fait naître l’état social, tous les pouvoirs semblent accourir d’eux-mêmes vers le centre ; ils s’y accumulent avec une rapidité surprenante, et l’État atteint tout d’un coup les extrêmes limites de sa force, tandis que les particuliers se laissent tomber en un moment jusqu’au dernier degré de la faiblesse.
Les Anglais qui vinrent, il y a trois siècles, fonder dans les déserts du Nouveau-Monde une société démocratique, s’étaient tous habitués dans la mère patrie à prendre part aux affaires publiques ; ils connaissaient le jury ; ils avaient la liberté de la parole et celle de la presse, la liberté individuelle, l’idée du droit et l’usage d’y recourir.
Ils transportèrent en Amérique ces institutions libres et ces mœurs viriles, et elles le soutinrent contre les envahissements de l’État.
[IV-275]
Chez les Américains, c’est donc la liberté qui est ancienne ; l’égalité est comparativement nouvelle. Le contraire arrive en Europe où l’égalité introduite par le pouvoir absolu, et sous l’œil des rois, avait déjà pénétré dans les habitudes des peuples longtemps avant que la liberté ne fût entrée dans leurs idées.
J’ai dit que chez les peuples démocratiques le gouvernement ne se présentait naturellement à l’esprit humain que sous la forme d’un pouvoir unique et central, et que la notion des pouvoirs intermédiaires ne lui était pas familière. Cela est particulièrement applicable aux nations démocratiques qui ont vu le principe de l’égalité triompher à l’aide d’une révolution violente. Les classes qui dirigeaient les affaires locales disparaissant tout à coup dans cette tempête, et la masse confuse qui reste n’ayant encore ni l’organisation ni les habitudes qui lui permettent de prendre en main l’administration de ces mêmes affaires, on n’aperçoit plus que l’état lui-même qui puisse se charger de tous les détails du gouvernement. La centralisation devient un fait en quelque sorte nécessaire.
Il ne faut ni louer ni blâmer Napoléon d’avoir concentré dans ses seules mains presque tous les pouvoirs administratifs ; car, après la brusque disparition de la noblesse et de la haute bourgeoisie, ces pouvoirs lui arrivaient d’eux-mêmes ; il lui eût [IV-276] été presque aussi difficile de les repousser que de les prendre. Une semblable nécessité ne s’est jamais fait sentir aux Américains, qui, n’ayant point eu de révolution et s’étant, dès l’origine, gouvernés d’eux-mêmes, n’ont jamais dû charger l’état de leur servir momentanément de tuteur.
Ainsi la centralisation ne se développe pas seulement chez un peuple démocratique suivant le progrès de l’égalité, mais encore suivant la manière dont cette égalité se fonde.
Au commencement d’une grande révolution démocratique, et quand la guerre entre les différentes classes ne fait que de naître, le peuple s’efforce de centraliser l’administration publique dans les mains du gouvernement, afin d’arracher la direction des affaires locales à l’aristocratie. Vers la fin de cette même révolution, au contraire, c’est d’ordinaire l’aristocratie vaincue qui tâche de livrer à l’État la direction de toutes les affaires, parce qu’elle redoute la menue tyrannie du peuple, devenu son égal et souvent son maître.
Ainsi, ce n’est pas toujours la même classe de citoyens qui s’applique à accroître les prérogatives du pouvoir ; mais, tant que dure la révolution démocratique, il se rencontre toujours dans la nation une classe puissante par le nombre ou par la richesse, que des passions spéciales et des [IV-277] intérêts particuliers portent à centraliser l’administration publique, indépendamment de la haine pour le gouvernement du voisin, qui est un sentiment général et permanent chez les peuples démocratiques. On peut remarquer que, de notre temps, ce sont les classes inférieures d’Angleterre qui travaillent de toutes leurs forces à détruire l’indépendance locale et à transporter l’administration de tous les points de la circonférence au centre, tandis que les classes supérieures s’efforcent de retenir cette même administration dans ses anciennes limites. J’ose prédire qu’un jour viendra où l’on verra un spectacle tout contraire.
Ce qui précède fait bien comprendre pourquoi le pouvoir social doit toujours être plus fort et l’individu plus faible, chez un peuple démocratique qui est arrivé à l’égalité par un long et pénible travail social, que dans une société démocratique où, depuis l’origine, les citoyens ont toujours été égaux. C’est ce que l’exemple des Américains achève de prouver.
Les hommes qui habitent les États-Unis n’ont jamais été séparés par aucun privilège ; ils n’ont jamais connu la relation réciproque d’inférieur et de maître, et, comme ils ne se redoutent et ne se haïssent point les uns les autres, ils n’ont jamais connu le besoin d’appeler le souverain à diriger le [IV-278] détail de leurs affaires. La destinée des Américains est singulière : ils ont pris à l’aristocratie d’Angleterre l’idée des droits individuels et le goût des libertés locales ; et ils ont pu conserver l’une et l’autre, parce qu’ils n’ont pas eu à combattre d’aristocratie.
Si, dans tous les temps, les lumières servent aux hommes à défendre leur indépendance, cela est surtout vrai dans les siècles démocratiques. Il est aisé, quand tous les hommes se ressemblent, de fonder un gouvernement unique et tout-puissant ; les instincts suffisent. Mais il faut aux hommes beaucoup d’intelligence, de science et d’art, pour organiser et maintenir, dans les mêmes circonstances, des pouvoirs secondaires, et pour créer, au milieu de l’indépendance et de la faiblesse individuelle des citoyens, des associations libres qui soient en état de lutter contre la tyrannie, sans détruire l’ordre.
La concentration des pouvoirs et la servitude individuelle croîtront donc, chez les nations démocratiques, non seulement en proportion de l’égalité, mais en raison de l’ignorance.
Il est vrai que, dans les siècles peu éclairés, le gouvernement manque souvent de lumières pour perfectionner le despotisme, comme les citoyens pour s’y dérober. Mais l’effet n’est point égal des deux parts.
[IV-279]
Quelque grossier que soit un peuple démocratique, le pouvoir central qui le dirige n’est jamais complètement privé de lumières, parce qu’il attire aisément à lui le peu qui s’en rencontre dans le pays, et que, au besoin, il va en chercher au dehors. Chez une nation qui est ignorante aussi bien que démocratique, il ne peut donc manquer de se manifester bientôt une différence prodigieuse entre la capacité intellectuelle du souverain et celle de chacun de ses sujets. Cela achève de concentrer aisément dans ses mains tous les pouvoirs. La puissance administrative de l’état s’étend sans cesse, parce qu’il n’y a que lui qui soit assez habile pour administrer.
Les nations aristocratiques, quelque peu éclairées qu’on les suppose, ne donnent jamais le même spectacle, parce que les lumières y sont assez également réparties entre le prince et les principaux citoyens.
Le pacha qui règne aujourd’hui sur l’Égypte a trouvé la population de ce pays composée d’hommes très-ignorants et très-égaux, et il s’est approprie, pour la gouverner, la science et l’intelligence de l’Europe. Les lumières particulières du souverain arrivant ainsi à se combiner avec l’ignorance et la faiblesse démocratique des sujets, le dernier terme de la centralisation a été atteint sans peine, et le prince a pu faire du pays [IV-280] sa manufacture, et des habitants ses ouvriers.
Je crois que la centralisation extrême du pouvoir politique finit par énerver la société, et par affaiblir ainsi à la longue le gouvernement lui-même. Mais je ne nie point qu’une force sociale centralisée ne soit en état d’exécuter aisément, dans un temps donné et sur un point déterminé, de grandes entreprises. Cela est surtout vrai dans la guerre où le succès dépend bien plus de la facilité qu’on trouve à porter rapidement toutes ses ressources sur un certain point, que de l’étendue même de ces ressources. C’est donc principalement dans la guerre que les peuples sentent le désir et souvent le besoin d’augmenter les prérogatives du pouvoir central. Tous les génies guerriers aiment la centralisation qui accroît leurs forces, et tous les génies centralisateurs aiment la guerre, qui oblige les nations à resserrer dans les mains de l’état tous les pouvoirs. Ainsi, la tendance démocratique qui porte les hommes à multiplier sans cesse les privilèges de l’état et à restreindre les droits des particuliers est bien plus rapide et plus continue chez les peuples démocratiques, sujets par leur position à de grandes et fréquentes guerres, et dont l’existence peut souvent être mise en péril, que chez tous les autres.
J’ai dit comment la crainte du désordre et l’amour du bien-être portaient insensiblement les [IV-281] peuples démocratiques à augmenter les attributions du gouvernement central, seul pouvoir qui leur paraisse de lui-même assez fort, assez intelligent, assez stable pour les protéger contre l’anarchie. J’ai à peine besoin d’ajouter que toutes les circonstances particulières qui tendent à rendre l’état d’une société démocratique troublé et précaire, augmente cet instinct général et porte, de plus en plus, les particuliers à sacrifier à leur tranquillité leurs droits.
Un peuple n’est donc jamais si disposé à accroître les attributions du pouvoir central qu’au sortir d’une révolution longue et sanglante qui, après avoir arraché les biens des mains de leurs anciens possesseurs, a ébranlé toutes les croyances, rempli la nation de haines furieuses, d’intérêts opposés et de factions contraires. Le goût de la tranquillité publique devient alors une passion aveugle, et les citoyens sont sujets à s’éprendre d’un amour très-désordonné pour l’ordre.
Je viens d’examiner plusieurs accidents qui tous concourent à aider la centralisation du pouvoir. Je n’ai pas encore parlé du principal.
La première des causes accidentelles qui, chez les peuples démocratiques, peuvent attirer dans les mains du souverain la direction de toutes les affaires, c’est l’origine de ce souverain lui-même et ses penchants.
[IV-282]
Les hommes qui vivent dans les siècles d’égalité aiment naturellement le pouvoir central et étendent volontiers ses privilèges ; mais s’il arrive que ce même pouvoir représente fidèlement leurs intérêts et reproduise exactement leurs instincts, la confiance qu’ils lui portent n’a presque point de bornes, et ils croient accorder à eux-mêmes tout ce qu’ils lui donnent.
L’attraction des pouvoirs administratifs vers le centre sera toujours moins aisée et moins rapide avec des rois qui tiennent encore par quelque endroit à l’ancien ordre aristocratique, qu’avec des princes nouveaux, fils de leurs œuvres, que leur naissance, leurs préjugés, leurs instincts, leurs habitudes, semblent lier indissolublement à la cause de l’égalité. Je ne veux point dire que les princes d’origine aristocratique qui vivent dans les siècles de démocratie ne cherchent point à centraliser. Je crois qu’ils s’y emploient aussi diligemment que tous les autres. Pour eux, les seuls avantages de l’égalité sont de ce côté ; mais leurs facilités sont moindres, parce que les citoyens, au lieu d’aller naturellement au-devant de leurs désirs, ne s’y prêtent souvent qu’avec peine. Dans les sociétés démocratiques, la centralisation sera toujours d’autant plus grande que le souverain sera moins aristocratique : voilà la règle.
Quand une vieille race de rois dirige une [IV-283] aristocratie, les préjugés naturels du souverain se trouvant en parfait accord avec les préjugés naturels des nobles, les vices inhérents aux sociétés aristocratiques se développent librement, et ne trouvent point leur remède. Le contraire arrive quand le rejeton d’une tige féodale est placé à la tête d’un peuple démocratique. Le prince incline, chaque jour, par son éducation, ses habitudes et ses souvenirs, vers les sentiments que l’inégalité des conditions suggère ; et le peuple tend sans cesse, par son état social, vers les mœurs que l’égalité fait naître. Il arrive alors souvent que les citoyens cherchent à contenir le pouvoir central, bien moins comme tyrannique que comme aristocratique ; et qu’ils maintiennent fermement leur indépendance non seulement parce qu’ils veulent être libres, mais surtout parce qu’ils prétendent rester égaux.
Une révolution qui renverse une ancienne famille de rois pour placer des hommes nouveaux à la tête d’un peuple démocratique, peut affaiblir momentanément le pouvoir central ; mais quelque anarchique qu’elle paraisse d’abord, on ne doit point hésiter à prédire que son résultat final et nécessaire sera d’étendre, et d’assurer les prérogatives de ce même pouvoir.
La première et en quelque sorte la seule condition nécessaire pour arriver à centraliser la [IV-284] puissance publique dans une société démocratique est d’aimer l’égalité ou de le faire croire. Ainsi, la science du despotisme, si compliquée jadis, se simplifie : elle se réduit, pour ainsi dire, à un principe unique.
[IV-285]
CHAPITRE V.↩
Que parmi les nations européennes de nos jours, le pouvoir souverain s’accroît, quoique les souverains soient moins stables.
Si l’on vient à réfléchir sur ce qui précède, on sera surpris et effrayé de voir comment, en Europe, tout semble concourir à accroître indéfiniment les prérogatives du pouvoir central et à rendre chaque jour l’existence individuelle plus faible, plus subordonnée et plus précaire.
Les nations démocratiques de l’Europe ont toutes les tendances générales et permanentes qui portent les Américains vers la centralisation des pouvoirs, et, de plus, elles sont soumises à une multitude de causes secondaires et accidentelles [IV-286] que les Américains ne connaissent point. On dirait que chaque pas qu’elles font vers l’égalité les rapproche du despotisme.
Il suffit de jeter les yeux autour de nous et sur nous-mêmes pour s’en convaincre.
Durant les siècles aristocratiques qui ont précédé le nôtre, les souverains de l’Europe avaient été privés ou s’étaient dessaisis de plusieurs des droits inhérents à leur pouvoir. Il n’y a pas encore cent ans que, chez la plupart des nations européennes, il se rencontrait des particuliers ou des corps presque indépendants qui administraient la justice, levaient et entretenaient des soldats, percevaient des impôts, et souvent même faisaient ou expliquaient la loi. l’État a partout repris pour lui seul ces attributs naturels de la puissance souveraine ; dans tout ce qui a rapport au gouvernement, il ne souffre plus d’intermédiaire entre lui et les citoyens, et il les dirige par lui-même dans les affaires générales. Je suis bien loin de blâmer cette concentration des pouvoirs ; je me borne à la montrer.
A la même époque il existait en Europe un grand nombre de pouvoirs secondaires qui représentaient des intérêts locaux et administraient les affaires locales. La plupart de ces autorités locales ont déjà disparu ; toutes tendent rapidement à disparaître ou à tomber dans la complète [IV-287] dépendance. D’un bout de l’Europe a l’autre, les privilèges des seigneurs, les libertés des villes, les administrations provinciales, sont détruites ou vont l’être.
L’Europe a éprouvé, depuis un demi-siècle, beaucoup de révolutions et contre-révolutions qui l’ont remuée en sens contraire. Mais tous ces mouvements se ressemblent en un point : tous ont ébranlé ou détruit les pouvoirs secondaires. Des privilèges locaux, que la nation française n’avait pas abolis dans les pays conquis par elle, ont achevé de succomber sous les efforts des princes qui l’ont vaincue. Ces princes ont rejeté toutes les nouveautés que la révolution avait créées chez eux, excepté la centralisation : c’est la seule chose qu’ils aient consenti à tenir d’elle.
Ce que je veux remarquer, c’est que tous ces droits divers qui ont été arrachés successivement, de notre temps, à des classes, à des corporations, à des hommes, n’ont point servi à élever sur une base plus démocratique de nouveaux pouvoirs secondaires, mais se sont concentrés de toutes parts dans les mains du souverain. Partout l’état arrive de plus en plus à diriger par lui-même les moindres citoyens et à conduire seul chacun d’eux dans les moindres affaires [14] .
[IV-288]
Presque tous les établissements charitables de l’ancienne Europe étaient dans les mains de particuliers ou de corporations ; ils sont tous tombés plus ou moins sous la dépendance du souverain, et, dans plusieurs pays, ils sont régis par lui. C’est l’état qui a entrepris presque seul de donner du pain à ceux qui ont faim, des secours et un asile aux malades, du travail aux oisifs ; il s’est fait le réparateur presque unique de toutes les misères.
L’éducation, aussi bien que la charité, est devenue, chez la plupart des peuples de nos jours, une affaire nationale. L’état reçoit et souvent prend l’enfant des bras de sa mère, pour le confier à ses agents ; c’est lui qui se charge d’inspirer à chaque génération des sentiments, et de lui fournir [IV-289] des idées. L’uniformité règne dans les études comme dans tout le reste ; la diversité, comme la liberté, en disparaissent chaque jour.
Je ne crains pas non plus d’avancer que chez presque toutes les nations chrétiennes de nos jours, les catholiques aussi bien que les protestantes, la religion est menacée de tomber dans les mains du gouvernement. Ce n’est pas que les souverains se montrent fort jaloux de fixer eux-mêmes le dogme ; mais ils s’emparent de plus en plus des volontés de celui qui l’explique : ils ôtent au clergé ses propriétés, lui assignent un salaire, détournent et utilisent à leur seul profit l’influence que le prêtre possède ; ils en font un de leurs fonctionnaires et souvent un de leurs serviteurs, et ils pénètrent avec lui jusqu’au plus profond de l’âme de chaque homme [15] .
Mais ce n’est encore là qu’un côté du tableau.
Non seulement le pouvoir du souverain s’est étendu, comme nous venons de le voir, dans la sphère entière des anciens pouvoirs ; celle-ci ne suffit plus pour le contenir ; il la déborde de toutes [IV-290] parts et va se répandre sur le domaine que s’était réservé jusqu’ici l’indépendance individuelle. Une multitude d’actions qui échappaient jadis entièrement au contrôle de la société y ont été soumises de nos jours, et leur nombre s’accroît sans cesse.
Chez les peuples aristocratiques, le pouvoir social se bornait d’ordinaire à diriger et à surveiller les citoyens dans tout ce qui avait un rapport direct et visible avec l’intérêt national ; il les abandonnait volontiers à leur libre arbitre en tout le reste. Chez ces peuples, le gouvernement semblait oublier souvent qu’il est un point où les fautes et les misères des individus compromettent le bien-être universel, et qu’empêcher la ruine d’un particulier doit quelquefois être une affaire publique.
Les nations démocratiques de notre temps penchent vers un excès contraire.
Il est évident que la plupart de nos princes ne veulent pas seulement diriger le peuple tout entier ; on dirait qu’ils se jugent responsables des actions et de la destinée individuelle de leurs sujets, qu’ils ont entrepris de conduire et d’éclairer chacun d’eux dans les différents actes de sa vie, et, au besoin, de le rendre heureux malgré lui-même.
De leur côté les particuliers envisagent de plus en plus le pouvoir social sous le même jour ; dans [IV-291] tous leurs besoins, ils l’appellent à leur aide, et ils attachent à tout moment sur lui leurs regards comme sur un précepteur ou sur un guide.
J’affirme qu’il n’y a pas de pays en Europe où l’administration publique ne soit devenue non seulement plus centralisée, mais plus inquisitive et plus détaillée ; partout elle pénètre plus avant que jadis dans les affaires privées ; elle règle à sa manière plus d’actions, et des actions plus petites, et elle s’établit davantage tous les jours à côté, autour et au-dessus de chaque individu, pour l’assister, le conseiller et le contraindre.
Jadis, le souverain vivait du revenu de ses terres ou du produit des taxes. Il n’en est plus de même aujourd’hui que ses besoins ont crû avec sa puissance. Dans les mêmes circonstances où jadis un prince établissait un nouvel impôt, on a recours aujourd’hui à un emprunt. Peu à peu l’état devient ainsi le débiteur de la plupart des riches, et il centralise dans ses mains les plus grands capitaux.
Il attire les moindres d’une autre manière.
À mesure que les hommes se mêlent et que les conditions s’égalisent, le pauvre a plus de ressources, de lumières et de désirs. Il conçoit l’idée d’améliorer son sort, et il cherche à y parvenir par l’épargne. L’épargne fait donc naître, chaque jour, un nombre infini de petits capitaux, fruits lents et successifs du travail ; ils s’accroissent sans [IV-292] cesse. Mais le plus grand nombre resteraient improductifs, s’ils demeuraient épars. Cela a donné naissance à une institution philanthropique qui deviendra bientôt, si je ne me trompe, une de nos plus grandes institutions politiques. Des hommes charitables ont conçu la pensée de recueillir l’épargne du pauvre et d’en utiliser le produit. Dans quelques pays, ces associations bienfaisantes sont restées entièrement distinctes de l’état ; mais, dans presque tous, elles tendent visiblement à se confondre avec lui, et il y en a même quelques unes où le gouvernement les a remplacées, et où il a entrepris la tâche immense de centraliser dans un seul lieu et de faire valoir par ses seules mains l’épargne journalière de plusieurs millions de travailleurs.
Ainsi, l’état attire à lui l’argent des riches par l’emprunt, et par les caisses d’épargne il dispose à son gré des deniers du pauvre. Près de lui et dans ses mains, les richesses du pays accourent sans cesse ; elles s’y accumulent d’autant plus que l’égalité des conditions devient plus grande ; car, chez une nation démocratique, il n’y a que l’état qui inspire de la confiance aux particuliers, parce qu’il n’y a que lui seul qui leur paraisse avoir quelque force et quelque durée [16] .
[IV-293]
Ainsi le souverain ne se borne pas à diriger la fortune publique ; il s’introduit encore dans les fortunes privées ; il est le chef de chaque citoyen et souvent son maître, et, de plus, il se fait son intendant et son caissier.
Non seulement le pouvoir central remplit seul la sphère entière des anciens pouvoirs, l’étend et la dépasse, mais il s’y meut, avec plus d’agilité, de force et d’indépendance qu’il ne faisait jadis.
Tous les gouvernements de l’Europe ont prodigieusement perfectionné, de notre temps, la science administrative ; ils font plus de choses, et ils font chaque chose avec plus d’ordre, de rapidité, et moins de frais ; ils semblent s’enrichir sans cesse de toutes les lumières qu’ils ont enlevées aux particuliers. Chaque jour, les princes de l’Europe tiennent leurs délégués dans une dépendance plus étroite, et ils inventent des méthodes nouvelles pour les diriger de plus près, et les surveiller avec moins de peine. Ce n’est point assez pour eux de conduire toutes les affaires par leurs agents, ils entreprennent de diriger la conduite de leurs agents [IV-294] dans toutes leurs affaires ; de sorte que l’administration publique ne dépend pas seulement du même pouvoir ; elle se resserre de plus en plus dans un même lieu et se concentre dans moins de mains. Le gouvernement centralise son action en même temps qu’il accroît ses prérogatives : double cause de force.
Quand on examine la constitution qu’avait jadis le pouvoir judiciaire chez la plupart des nations de l’Europe, deux choses frappent : l’indépendance de ce pouvoir et l’étendue de ses attributions.
Non seulement les cours de justice décidaient presque toutes les querelles entre particuliers ; dans un grand nombre de cas, elles servaient d’arbitres entre chaque individu et l’état.
Je ne veux point parler ici des attributions politiques et administratives que les tribunaux avaient usurpées en quelques pays, mais des attributions judiciaires qu’ils possédaient dans tous. Chez tous les peuples d’Europe, il y avait et il y a encore beaucoup de droits individuels, se rattachant la plupart au droit général de propriété, qui étaient placés sous la sauvegarde du juge, et que l’état ne pouvait violer sans la permission de celui-ci.
C’est ce pouvoir semi-politique qui distinguait principalement les tribunaux de l’Europe de tous les [IV-295] autres ; car tous les peuples ont eu des juges, mais tous n’ont point donné aux juges les mêmes privilèges.
Si l’on examine maintenant ce qui se passe chez les nations démocratiques de l’Europe qu’on appelle libres, aussi bien que chez les autres, on voit que, de toutes parts, à côté de ces tribunaux, il s’en crée d’autres plus dépendants dont l’objet particulier est de décider exceptionnellement les questions litigieuses qui peuvent s’élever entre l’administration publique et les citoyens. On laisse à l’ancien pouvoir judiciaire son indépendance, mais on resserre sa juridiction, et l’on tend, de plus en plus, à n’en faire qu’un arbitre entre des intérêts particuliers.
Le nombre de ces tribunaux spéciaux augmente sans cesse, et leurs attributions croissent. Le gouvernement échappe donc chaque jour davantage à l’obligation de faire sanctionner par un autre pouvoir ses volontés et ses droits. Ne pouvant se passer de juges, il veut, du moins, choisir lui-même ses juges et les tenir toujours dans sa main, c’est-à-dire que, entre lui et les particuliers, il place encore l’image de la justice, plutôt que la justice elle-même.
Ainsi, il ne suffit point à l’état d’attirer à lui toutes les affaires, il arrive encore, de plus en plus, [IV-296] à les décider toutes par lui-même sans contrôle et sans recours [17] .
Il y a chez les nations modernes de l’Europe une grande cause qui, indépendamment de toutes celles que je viens d’indiquer, contribue sans cesse à étendre l’action du souverain ou à augmenter ses prérogatives ; on n’y a pas assez pris garde. Cette cause est le développement de l’industrie, que les progrès de l’égalité favorisent.
L’industrie agglomère d’ordinaire une multitude d’hommes dans le même lieu ; elle établit entre eux des rapports nouveaux et compliqués. Elle les expose à de grandes et subites alternatives d’abondance et de misère, durant lesquelles la tranquillité publique est menacée. Il peut arriver enfin que ces travaux compromettent la santé et même la vie de ceux qui en profitent, ou de ceux qui s’y livrent. Ainsi, la classe industrielle a plus besoin d’être réglementée, surveillée et contenue que les autres classes, et il est naturel que les attributions du gouvernement croissent avec elle.
[IV-297]
Cette vérité est généralement applicable ; mais voici ce qui se rapporte plus particulièrement aux nations de l’Europe.
Dans les siècles qui ont précédé ceux où nous vivons, l’aristocratie possédait le sol, et était en état de le défendre. La propriété immobilière fut donc environnée de garanties, et ses possesseurs jouirent d’une grande indépendance. Cela créa des lois et des habitudes qui se sont perpétuées, malgré la division des terres et la ruine des nobles ; et, de nos jours, les propriétaires fonciers et les agriculteurs sont encore de tous les citoyens ceux qui échappent le plus aisément au contrôle du pouvoir social.
Dans ces mêmes siècles aristocratiques, où se trouvent toutes les sources de notre histoire, la propriété mobilière avait peu d’importance, et ses possesseurs étaient méprisés et faibles ; les industriels formaient une classe exceptionnelle au milieu du monde aristocratique. Comme ils n’avaient point de patronage assuré, ils n’étaient point protégés, et souvent ils ne pouvaient se protéger eux-mêmes.
Il entra donc dans les habitudes de considérer la propriété industrielle comme un bien d’une nature particulière, qui ne méritait point les mêmes égards, et qui ne devait pas obtenir les mêmes garanties que la propriété en général, et les [IV-298] industriels comme une petite-classe à part dans l’ordre social, dont l’indépendance avait peu de valeur, et qu’il convenait d’abandonner à la passion réglementaire des princes. Si l’on ouvre en effet les codes du moyen-âge on est étonné de voir comment, dans ces siècles d’indépendance individuelle, l’industrie était sans cesse réglementée par les rois, jusque dans ses moindres détails ; sur ce point, la centralisation est aussi active et aussi détaillée qu’elle saurait l’être.
Depuis ce temps, une grande révolution a eu lieu dans le monde ; la propriété industrielle, qui n’était qu’un germe, s’est développée, elle couvre l’Europe ; la classe industrielle s’est étendue, elle s’est enrichie des débris de toutes les autres ; elle a crû en nombre, en importance, en richesse ; elle croît sans cesse ; presque tous ceux qui n’en font pas partie s’y rattachent, du moins par quelque endroit ; après avoir été la classe exceptionnelle, elle menace de devenir la classe principale, et pour ainsi dire, la classe unique ; cependant, les idées et les habitudes politiques que jadis elle avait fait naître, sont demeurées. Ces idées et ces habitudes n’ont point changé, parce qu’elles sont vieilles et ensuite parce qu’elles se trouvent en parfaite harmonie avec les idées nouvelles et les habitudes générales des hommes de nos jours.
La propriété industrielle n’augmente donc point [IV-299] ses droits avec son importance. La classe industrielle ne devient pas moins dépendante en devenant plus nombreuse ; mais on dirait, au contraire, qu’elle apporte le despotisme dans son sein, et qu’il s’étend naturellement à mesure qu’elle se développe [18] .
En proportion que la nation devient plus industrielle, elle sent un plus grand besoin de routes, de canaux, de ports et autres travaux d’une nature semi-publique, qui facilitent l’acquisition des [IV-300] richesses, et en proportion qu’elle est plus démocratique, les particuliers éprouvent plus de difficulté à exécuter de pareils travaux, et l’état plus de facilité à les faire. Je ne crains pas d’affirmer que la tendance manifeste de tous les souverains de notre temps est de se charger seuls de l’exécution de pareilles entreprises ; par là, ils resserrent chaque jour les populations dans une plus étroite dépendance.
D’autre part, à mesure que la puissance de l’état s’accroît, et que ses besoins augmentent, il consomme lui-même une quantité toujours plus grande de produits industriels, qu’il fabrique d’ordinaire dans ses arsenaux et ses manufactures. C’est ainsi que, dans chaque royaume, le souverain devient le plus grand des industriels ; il attire et retient à son service un nombre prodigieux d’ingénieurs, d’architectes, de mécaniciens, et d’artisans.
Il n’est pas seulement le premier des industriels, il tend de plus en plus à se rendre le chef ou plutôt le maître de tous les autres.
Comme les citoyens sont devenus plus faibles en devenant plus égaux, ils ne peuvent rien faire en industrie sans s’associer ; or, la puissance publique veut naturellement placer ces associations sous son contrôle.
Il faut reconnaître que ces sortes d’êtres [IV-301] collectifs qu’on nomme associations sont plus forts et plus redoutables qu’un simple individu ne saurait l’être, et qu’ils ont moins que ceux-ci la responsabilité de leurs propres actes, d’où il résulte qu’il semble raisonnable de laisser à chacune d’elles une indépendance moins grande de la puissance sociale qu’on ne le ferait pour un particulier.
Les souverains ont d’autant plus de pente à agir ainsi que leurs goûts les y convient. Chez les peuples démocratiques, il n’y a que par l’association que la résistance des citoyens au pouvoir central puisse se produire ; aussi ce dernier ne voit-il jamais qu’avec défaveur les associations qui ne sont pas sous sa main ; et ce qui est fort digne de remarque, c’est que, chez ces peuples démocratiques, les citoyens envisagent souvent ces mêmes associations, dont ils ont tant besoin, avec un sentiment secret de crainte et de jalousie, qui les empêche de les défendre. La puissance et la durée de ces petites sociétés particulières, au milieu de la faiblesse et de l’instabilité générale, les étonnent et les inquiètent, et ils ne sont pas éloignés de considérer comme de dangereux privilèges le libre emploi que fait chacune d’elles de ses facultés naturelles.
Toutes ces associations qui naissent de nos jours sont d’ailleurs autant de personnes nouvelles, dont le temps n’a pas consacré les droits et qui entrent [IV-302] dans le monde à une époque où l’idée des droits particuliers est faible, et où le pouvoir social est sans limites ; il n’est pas surprenant qu’elles perdent leur liberté en naissant.
Chez tous les peuples de l’Europe, il y a certaines associations qui ne peuvent se former qu’après que l’état a examiné leurs statuts, et autorisé leur existence. Chez plusieurs, on fait des efforts pour étendre à toutes les associations cette règle. On voit aisément où mènerait le succès d’une pareille entreprise.
Si une fois le souverain avait le droit général d’autoriser à certaines conditions les associations de toute espèce, il ne tarderait pas à réclamer celui de les surveiller et de les diriger, afin qu’elles ne puissent pas s’écarter de la règle qu’il leur aurait imposée. De cette manière, l’état, après avoir mis dans sa dépendance tous ceux qui ont envie de s’associer, y mettrait encore tous ceux qui se sont associés, c’est-à-dire presque tous les hommes qui vivent de nos jours.
Les souverains s’approprient ainsi de plus en plus et mettent à leur usage la plus grande partie de cette force nouvelle que l’industrie crée de notre temps dans le monde. L’industrie nous mène, et ils la mènent,
J’attache tant d’importance à tout ce que je viens de dire, que je suis tourmenté de la peur [IV-303] d’avoir nui à ma pensée, en voulant mieux la rendre.
Si donc le lecteur trouve que les exemples cités à l’appui de mes paroles sont insuffisants ou mal choisis ; s’il pense que j’ai exagéré en quelque endroit les progrès du pouvoir social, et qu’au contraire j’ai restreint outre mesure la sphère où se meut encore l’indépendance individuelle, je le supplie d’abandonner un moment le livre et de considérer à son tour par lui-même les objets que j’avais entrepris de lui montrer. Qu’il examine attentivement ce qui se passe chaque jour parmi nous et hors de nous ; qu’il interroge ses voisins ; qu’il se contemple enfin lui-même ; je suis bien trompé s’il n’arrive sans guide, et par d’autres chemins, au point où j’ai voulu le conduire.
Il s’apercevra que, pendant le demi-siècle qui vient de s’écouler, la centralisation a crû partout de mille façons différentes. Les guerres, les révolutions, les conquêtes ont servi à son développement ; tous les hommes ont travaillé à l’accroître. Pendant cette même période, durant laquelle ils se sont succédé avec une rapidité prodigieuse à la tête des affaires, leurs idées, leurs intérêts, leurs passions ont varié à l’infini ; mais tous ont voulu centraliser en quelques manières. L’instinct de la centralisation a été comme le seul point immobile, [IV-304] au milieu de la mobilité singulière de leur existence et de leurs pensées.
Et, lorsque le lecteur, ayant examiné ce détail des affaires humaines, voudra en embrasser dans son ensemble le vaste tableau, il restera étonné.
D’un côté, les plus fermes dynasties sont ébranlées ou détruites ; de toutes parts les peuples échappent violemment à l’empire de leurs lois ; ils détruisent ou limitent l’autorité de leurs seigneurs ou de leurs princes ; toutes les nations qui ne sont point en révolution paraissent du moins inquiètes et frémissantes ; un même esprit de révolte les anime. Et, de l’autre, dans ce même temps d’anarchie et chez ces mêmes peuples si indociles, le pouvoir social accroît sans cesse ses prérogatives ; il devient plus centralisé, plus entreprenant, plus absolu, plus étendu. Les citoyens tombent à chaque instant sous le contrôle de l’administration publique ; ils sont entraînés insensiblement, et comme à leur insu, à lui sacrifier tous les jours quelques nouvelles parties de leur indépendance individuelle, et ces mêmes hommes qui de temps à autre renversent un trône et foulent aux pieds des rois, se plient de plus en plus, sans résistance, aux moindres volontés d’un commis.
Ainsi donc, deux révolutions semblent s’opérer, de nos jours, en sens contraire ; l’une affaiblit [IV-305] continuellement le pouvoir, et l’autre le renforce sans cesse : à aucune autre époque de notre histoire il n’a paru si faible ni si fort.
Mais, quand on vient enfin à considérer de plus près l’état du monde, on voit que ces deux révolutions sont intimement liées l’une à l’autre, qu’elles partent de la même source, et qu’après avoir eu un cours divers, elles conduisent enfin les hommes au même lieu.
Je ne craindrai pas encore de répéter une dernière fois ce que j’ai déjà dit ou indiqué dans plusieurs endroits de ce livre : il faut bien prendre garde de confondre le fait même de l’égalité avec la révolution qui achève de l’introduire dans l’état social et dans les lois ; c’est là que se trouve la raison de presque tous les phénomènes qui nous étonnent.
Tous les anciens pouvoirs politiques de l’Europe, les plus grands aussi bien que les moindres, ont été fondés dans des siècles d’aristocratie, et ils représentaient ou défendaient plus ou moins le principe de l’inégalité et du privilége. Pour faire prévaloir dans le gouvernement les besoins et les intérêts nouveaux que suggérait l’égalité croissante, il a donc fallu aux hommes de nos jours renverser ou contraindre les anciens pouvoirs. Cela les a conduits à faire des révolutions, et a inspire a un grand nombre d’entre eux ce goût [IV-306] sauvage du désordre et de l’indépendance que toutes les révolutions, quel que soit leur objet, font toujours naître.
Je ne crois pas qu’il y ait une seule contrée en Europe où le développement de l’égalité n’ait point été précédé ou suivi de quelques changements violents dans l’état de la propriété et des personnes, et presque tous ces changements ont été accompagnés de beaucoup d’anarchie et de licence, parce qu’ils étaient faits par la portion la moins policée de la nation contre celle qui l’était le plus.
De là sont sorties les deux tendances contraires que j’ai précédemment montrées. Tant que la révolution démocratique était dans sa chaleur, les hommes occupés à détruire les anciens pouvoirs aristocratiques qui combattaient contre elle, se montraient animés d’un grand esprit d’indépendance, et à mesure que la victoire de l’égalité devenait plus complète, ils s’abandonnaient peu à peu aux instincts naturels que cette même égalité fait naître, et ils renforçaient et centralisaient le pouvoir social. Ils avaient voulu être libres pour pouvoir se faire égaux, et, à mesure que l’égalité s’établissait davantage à l’aide de la liberté, elle leur rendait la liberté plus difficile.
Ces deux états n’ont pas toujours été successifs. Nos pères ont fait voir comment un peuple pouvait organiser une immense tyrannie dans son [IV-307] sein au moment même où il échappait à l’autorité des nobles et bravait la puissance de tous les rois, enseignant à la fois au monde la manière de conquérir son indépendance et de la perdre.
Les hommes de notre temps s’aperçoivent que les anciens pouvoirs s’écroulent de toutes parts ; ils voient toutes les anciennes influences qui meurent, toutes les anciennes barrières qui tombent ; cela trouble le jugement des plus habiles ; ils ne font attention qu’à la prodigieuse révolution qui s’opère sous leurs yeux, et ils croient que le genre humain va tomber pour jamais en anarchie. S’ils songeaient aux conséquences finales de cette révolution, ils concevraient peut-être d’autres craintes.
Pour moi, je ne me fie point, je le confesse, à l’esprit de liberté qui semble animer mes contemporains ; je vois bien que les nations de nos jours sont turbulentes ; mais je ne découvre pas clairement qu’elles soient libérales, et je redoute qu’au sortir de ces agitations qui font vaciller tous les trônes, les souverains ne se trouvent plus puissants qu’ils ne l’ont été.
[IV-309]
CHAPITRE VI.↩
Quelle espèce de despotisme les nations démocratiques ont à craindre.
J’avais remarqué durant mon séjour aux États-Unis qu’un état social démocratique, semblable à celui des Américains, pourrait offrir des facilités singulières à l’établissement du despotisme, et j’avais vu, à mon retour en Europe, combien la plupart de nos princes s’étaient déjà servis des idées, des sentiments et des besoins que ce même état social faisait naître pour étendre le cercle de leur pouvoir.
Cela me conduisit à croire que les nations chrétiennes finiraient peut-être par subir quelque [IV-310] oppression pareille à celle qui pesa jadis sur plusieurs des peuples de l’antiquité.
Un examen plus détaillé du sujet, et cinq ans de méditations nouvelles n’ont point diminué mes craintes, mais ils en ont changé l’objet.
On n’a jamais vu dans les siècles passés de souverain si absolu et si puissant qui ait entrepris d’administrer par lui-même, et sans les secours de pouvoirs secondaires, toutes les parties d’un grand empire ; il n’y en a point qui ait tenté d’assujettir indistinctement tous ses sujets aux détails d’une règle uniforme, ni qui soit descendu à côté de chacun d’eux pour le régenter et le conduire. L’idée d’une pareille entreprise ne s’était jamais présentée à l’esprit humain, et, s’il était arrivé à un homme de la concevoir, l’insuffisance des lumières, l’imperfection des procédés administratifs, et surtout les obstacles naturels que suscitait l’inégalité des conditions, l’auraient bientôt arrêté dans l’exécution d’un si vaste dessein.
On voit qu’au temps de la plus grande puissance des Césars, les différents peuples qui habitaient le monde romain avaient encore conservé des coutumes et des mœurs diverses : quoique soumises au même monarque, la plupart des provinces étaient administrées à part ; elles étaient remplies de municipalités puissantes et actives, et, quoique tout le gouvernement de l’empire fût concentré dans [IV-311] les seules mains de l’empereur, et qu’il restât toujours, au besoin, l’arbitre de toutes choses, les détails de la vie sociale et de l’existence individuelle échappaient d’ordinaire à son contrôle.
Les empereurs possédaient, il est vrai, un pouvoir immense et sans contrepoids, qui leur permettait de se livrer librement à la bizarrerie de leurs penchants et d’employer à les satisfaire la force entière de l’état ; il leur est arrivé souvent d’abuser de ce pouvoir pour enlever arbitrairement à un citoyen ses biens ou sa vie : leur tyrannie pesait prodigieusement sur quelques-uns ; mais elle ne s’étendait pas sur un grand nombre ; elle s’attachait à quelques grands objets principaux, et négligeait le reste ; elle était violente et restreinte.
Il semble que, si le despotisme venait à s’établir chez les nations démocratiques de nos jours, il aurait d’autres caractères : il serait plus étendu et plus doux, et il dégraderait les hommes sans les tourmenter.
Je ne doute pas que, dans des siècles de lumières et d’égalité comme les nôtres, les souverains ne parvinssent plus aisément à réunir tous les pouvoirs publics dans leurs seules mains, et à pénétrer plus habituellement et plus profondément dans le cercle des intérêts privés, que n’a jamais pu le faire aucun de ceux de l’antiquité. Mais cette même égalité, qui facilite le despotisme, le [IV-312] tempère ; nous avons vu comment, à mesure que les hommes sont plus semblables et plus égaux, les mœurs publiques deviennent plus humaines et plus douces ; quand aucun citoyen n’a un grand pouvoir ni de grandes richesses, la tyrannie manque, en quelque sorte, d’occasion et de théâtre. Toutes les fortunes étant médiocres, les passions sont naturellement contenues, l’imagination bornée, les plaisirs simples. Cette modération universelle modère le souverain lui-même, et arrête dans de certaines limites l’élan désordonné de ses désirs.
Indépendamment de ces raisons puisées dans la nature même de l’état social, je pourrais en ajouter beaucoup d’autres que je prendrais en dehors de mon sujet ; mais je veux me tenir dans les bornes que je me suis posées.
Les gouvernements démocratiques pourront devenir violents et même cruels dans certains moments de grande effervescence et de grands périls ; mais ces crises seront rares et passagères.
Lorsque je songe aux petites passions des hommes de nos jours, à la mollesse de leurs mœurs, à l’étendue de leurs lumières, à la pureté de leur religion, à la douceur de leur morale, à leurs habitudes laborieuses et rangées, à la retenue qu’ils conservent presque tous dans le vice comme dans la vertu ; je ne crains pas qu’ils [IV-313] rencontrent dans leurs chefs des tyrans, mais plutôt des tuteurs.[Note]
Je pense donc que l’espèce d’oppression dont les peuples démocratiques sont menacés ne ressemblera à rien de ce qui l’a précédée dans le monde ; nos contemporains ne sauraient en trouver l’image dans leurs souvenirs. Je cherche en vain moi-même une expression qui reproduise exactement l’idée que je m’en forme et la renferme ; les anciens mots de despotisme et de tyrannie ne conviennent point. La chose est nouvelle, il faut donc tâcher de la définir, puisque je ne peux la nommer.
Je veux imaginer sous quels traits nouveaux le despotisme pourrait se produire dans le monde : je vois une foule innombrable d’hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs, dont ils remplissent leur âme. Chacun d’eux, retiré à l’écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres, ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l’espèce humaine ; quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d’eux, mais il ne les voit pas ; il les touche et ne les sent point ; il n’existe qu’en lui-même et pour lui seul, et s’il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu’il n’a plus de patrie.
Au-dessus de ceux-là, s’élève un pouvoir [IV-314] immense et tutélaire, qui se charge seul d’assurer leurs jouissances, et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle, si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l’âge viril ; mais il ne cherche, au contraire, qu’à les fixer irrévocablement dans l’enfance ; il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu’ils ne songent qu’à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur ; mais il veut en être l’unique agent et le seul arbitre ; il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leurs successions, divise leurs héritages, que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre ?
C’est ainsi que tous les jours il rend moins utile et plus rare l’emploi du libre arbitre ; qu’il renferme l’action de la volonté dans un plus petit espace, et dérobe peu à peu à chaque citoyen jusqu’à l’usage de lui-même. L’égalité a préparé les hommes à toutes ces choses ; elle les a disposés à les souffrir et souvent même à les regarder comme un bienfait.
Après avoir pris ainsi tour à tour dans ses puissantes mains chaque individu, et l’avoir pétri à sa guise, le souverain étend ses bras sur la société tout entière ; il en couvre la surface d’un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes, à [IV-315] travers lesquelles les esprits les plus originaux et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient se faire jour pour dépasser la foule ; il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie et les dirige ; il force rarement d’agir, mais il s’oppose sans cesse à ce qu’on agisse ; il ne détruit point, il empêche de naître ; il ne tyrannise point, il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il hébète, et il réduit enfin chaque nation à n’être plus qu’un troupeau d’animaux timides et industrieux, dont le gouvernement est le berger.
J’ai toujours cru que cette sorte de servitude, réglée, douce et paisible, dont je viens de faire le tableau, pourrait se combiner mieux qu’on ne l’imagine avec quelques unes des formes extérieures de la liberté, et qu’il ne lui serait pas impossible de s’établir à l’ombre même de la souveraineté du peuple.
Nos contemporains sont incessamment travaillés par deux passions ennemies : ils sentent le besoin d’être conduits et l’envie de rester libres. Ne pouvant détruire ni l’un ni l’autre de ces instincts contraires, ils s’efforcent de les satisfaire à la fois tous les deux. Ils imaginent un pouvoir unique, tutélaire, tout puissant, mais élu par les citoyens. Ils combinent la centralisation et la souveraineté du peuple. Cela leur donne quelque relâche. Ils se consolent d’être en tutelle, en songeant qu’ils ont [IV-316] eux-mêmes choisi leurs tuteurs. Chaque individu souffre qu’on l’attache, parce qu’il voit que ce n’est pas un homme ni une classe, mais le peuple lui-même qui tient le bout de la chaîne.
Dans ce système, les citoyens sortent un moment de la dépendance pour indiquer leur maître, et y rentrent.
Il y a, de nos jours, beaucoup de gens qui s’accommodent très-aisément de cette espèce de compromis entre le despotisme administratif et la souveraineté du peuple, et qui pensent avoir assez garanti la liberté des individus, quand c’est au pouvoir national qu’ils la livrent. Cela ne me suffit point. La nature du maître m’importe bien moins que l’obéissance.
Je ne nierai pas cependant qu’une constitution semblable ne soit infiniment préférable à celle qui, après avoir concentré tous les pouvoirs, les déposerait dans les mains d’un homme ou d’un corps irresponsable. De toutes les différentes formes que le despotisme démocratique pourrait prendre, celle-ci serait assurément la pire.
Lorsque le souverain est électif ou surveillé de près par une législature réellement élective et indépendante, l’oppression qu’il fait subir aux individus est quelquefois plus grande ; mais elle est toujours moins dégradante parce que chaque citoyen, alors qu’on le gêne et qu’on le réduit à [IV-317] l’impuissance, peut encore se figurer qu’en obéissant il ne se soumet qu’à lui-même, et que c’est à l’une de ses volontés qu’il sacrifie toutes les autres.
Je comprends également que, quand le souverain représente la nation et dépend d’elle, les forces et les droits qu’on enlève à chaque citoyen ne servent pas seulement au chef de l’état, mais profitent à l’état lui-même, et que les particuliers retirent quelque fruit du sacrifice qu’ils ont fait au public de leur indépendance.
Créer une représentation nationale dans un pays très-centralisé, c’est donc diminuer le mal que l’extrême centralisation peut produire, mais ce n’est pas le détruire.
Je vois bien que, de cette manière, on conserve l’intervention individuelle dans les plus importantes affaires ; mais on ne la supprime pas moins dans les petites et les particulières. L’on oublie que c’est surtout dans le détail qu’il est dangereux d’asservir les hommes. Je serais, pour ma part, porté à croire la liberté moins nécessaire dans les grandes choses que dans les moindres, si je pensais qu’on pût jamais être assuré de l’une, sans posséder l’autre.
La sujétion dans les petites affaires se manifeste tous les jours et se fait sentir indistinctement à tous les citoyens. Elle ne les désespère point ; mais elle les contrarie sans cesse, et elle les porte à [IV-318] renoncer à l’usage de leur volonté. Elle éteint ainsi peu à peu leur esprit et énerve leur âme ; tandis que l’obéissance, qui n’est due que dans un petit nombre de circonstances très-graves, mais très-rares, ne montre la servitude que de loin en loin, et ne la fait peser que sur certains hommes. En vain chargerez-vous ces mêmes citoyens que vous avez rendus si dépendants du pouvoir central de choisir de temps à autre les représentants de ce pouvoir ; cet usage si important, mais si court et si rare de leur libre arbitre n’empêchera pas qu’ils ne perdent peu à peu la faculté de penser, de sentir et d’agir par eux-mêmes, et qu’ils ne tombent ainsi graduellement au-dessous du niveau de l’humanité.
J’ajoute qu’ils deviendront bientôt incapables d’exercer le grand et unique privilège qui leur reste. Les peuples démocratiques qui ont introduit la liberté dans la sphère politique, en même temps qu’ils accroissaient le despotisme dans la sphère administrative, ont été conduits à des singularités bien étranges. Faut-il mener les petites affaires où le simple bon sens peut suffire, ils estiment que les citoyens en sont incapables ; s’agit-il du gouvernement de tout l’état, ils confient à ces citoyens d’immenses prérogatives ; ils en font alternativement les jouets du souverain et ses maîtres ; plus que des rois et moins que des hommes. Après [IV-319] avoir épuisé tous les différents systèmes d’élection, sans en trouver un qui leur convienne, ils s’étonnent et cherchent encore ; comme si le mal qu’ils remarquent ne tenait pas à la constitution du pays bien plus qu’à celle du corps électoral.[Note]
Il est, en effet, difficile de concevoir comment des hommes qui ont entièrement renoncé à l’habitude de se diriger eux-mêmes pourraient réussir à bien choisir ceux qui doivent les conduire ; et l’on ne fera point croire qu’un gouvernement libéral, énergique et sage, puisse jamais sortir des suffrages d’un peuple de serviteurs.
Une constitution qui serait républicaine par la tête et ultra-monarchique dans toutes les autres parties, m’a toujours semblé un monstre éphémère. Les vices des gouvernants et l’imbécillité des gouvernés ne tarderaient pas à en amener la ruine ; et le peuple, fatigué de ses représentants et de lui-même, créerait des institutions plus libres, ou retournerait bientôt s’étendre aux pieds d’un seul maître.
[IV-321]
CHAPITRE VII.↩
Suite des chapitres précédents.
Je crois qu’il est plus facile d’établir un gouvernement absolu et despotique chez un peuple où les conditions sont égales que chez un autre, et je pense que, si un pareil gouvernement était une fois établi chez un semblable peuple, non seulement il y opprimerait les hommes, mais qu’à la longue il ravirait à chacun d’eux plusieurs des principaux attributs de l’humanité.
Le despotisme me parait donc particulièrement à redouter dans les âges démocratiques.
[IV-322]
J’aurais, je pense, aimé la liberté dans tous les temps ; mais je me sens enclin à l’adorer dans le temps où nous sommes.
Je suis convaincu, d’autre part, que tous ceux qui, dans les siècles où nous entrons, essaieront d’appuyer la liberté sur le privilège et l’aristocratie échoueront. Tous ceux qui voudront attirer et retenir l’autorité dans le sein d’une seule classe échoueront. Il n’y a pas, de nos jours, de souverain assez habile et assez fort pour fonder le despotisme en rétablissant des distinctions permanentes entre ses sujets ; il n’y a pas non plus de législateur si sage et si puissant qui soit en état de maintenir des institutions libres, s’il ne prend l’égalité pour premier principe et pour symbole. Il faut donc que tous ceux de nos contemporains qui veulent créer ou assurer l’indépendance et la dignité de leurs semblables, se montrent amis de l’égalité ; et le seul moyen digne d’eux de se montrer tels, c’est de l’être : le succès de leur sainte entreprise en dépend.
Ainsi il ne s’agit point de reconstruire une société aristocratique, mais de faire sortir la liberté du sein de la société démocratique où Dieu nous fait vivre.
Ces deux premières vérités me semblent simples, claires et fécondes, et elles m’amènent naturellement à considérer quelle espèce de gouvernement [IV-323] libre peut s’établir chez un peuple où les conditions sont égales.
Il résulte de la constitution même des nations démocratiques et de leurs besoins, que chez elles le pouvoir du souverain doit être plus uniforme, plus centralisé, plus étendu, plus pénétrant, plus puissant qu’ailleurs. La société y est naturellement plus agissante et plus forte, l’individu plus subordonné et plus faible ; l’une fait plus, l’autre moins ; cela est forcé.
Il ne faut donc pas s’attendre à ce que, dans les contrées démocratiques, le cercle de l’indépendance individuelle soit jamais aussi large que dans les pays d’aristocratie. Mais cela n’est point à souhaiter ; car, chez les nations aristocratiques, la société est souvent sacrifiée à l’individu, et la prospérité du plus grand nombre à la grandeur de quelques-uns.
Il est tout à la fois nécessaire et désirable que le pouvoir central qui dirige un peuple démocratique soit actif et puissant. Il ne s’agit point de le rendre faible ou indolent, mais seulement de l’empêcher d’abuser de son agilité et de sa force.
Ce qui contribuait le plus à assurer l’indépendance des particuliers dans les siècles aristocratiques, c’est que le souverain ne s’y chargeait pas seul de gouverner et d’administrer les citoyens ; il était obligé de laisser en partie ce soin aux membres [IV-324] de l’aristocratie ; de telle sorte que le pouvoir social, étant toujours divisé, ne pesait jamais tout entier et de la même manière sur chaque homme.
Non seulement le souverain ne faisait pas tout par lui-même, mais la plupart des fonctionnaires qui agissaient à sa place, tirant leur pouvoir du fait de leur naissance, et non de lui, n’étaient pas sans cesse dans sa main. Il ne pouvait les créer ou les détruire à chaque instant, suivant ses caprices, et les plier tous uniformément à ses moindres volontés. Cela garantissait encore l’indépendance des particuliers.
Je comprends bien que de nos jours on ne saurait avoir recours au même moyen ; mais je vois des procédés démocratiques qui les remplacent.
Au lieu de remettre au souverain seul tous les pouvoirs administratifs, qu’on enlève à des corporations ou à des nobles, on peut en confier une partie à des corps secondaires temporairement formés de simples citoyens ; de cette manière, la liberté des particuliers sera plus sûre, sans que leur égalité soit moindre.
Les Américains, qui ne tiennent pas autant que nous aux mots, ont conservé le nom de comté à la plus grande de leurs circonscriptions administratives ; mais ils ont remplacé en partie le comte par une assemblée provinciale.
[IV-325]
Je conviendrai sans peine qu’à une époque d’égalité comme la nôtre, il serait injuste et déraisonnable d’instituer des fonctionnaires héréditaires ; mais rien n’empêche de leur substituer, dans une certaine mesure, des fonctionnaires électifs. L’élection est un expédient démocratique qui assure l’indépendance du fonctionnaire vis-à-vis du pouvoir central, autant et plus que ne saurait le faire l’hérédité chez les peuples aristocratiques.
Les pays aristocratiques sont remplis de particuliers riches et influents, qui ne savent se suffire à eux-mêmes, et qu’on n’opprime pas aisément ni en secret ; et ceux-là maintiennent le pouvoir dans des habitudes générales de modération et de retenue.
Je sais bien que les contrées démocratiques ne présentent point naturellement d’individus semblables ; mais on peut y créer artificiellement quelque chose d’analogue.
Je crois fermement qu’on ne saurait fonder de nouveau, dans le monde, une aristocratie ; mais je pense que les simples citoyens, en s’associant, peuvent y constituer des êtres très-opulents, très-influents, très-forts, en un mot des personnes aristocratiques.
On obtiendrait de cette manière plusieurs des plus grands avantages politiques de l’aristocratie, [IV-326] sans ses injustices ni ses dangers. Une association politique, industrielle, commerciale ou même scientifique et littéraire, est un citoyen éclairé et puissant qu’on ne saurait plier à volonté ni opprimer dans l’ombre, et qui, en défendant ses droits particuliers contre les exigences du pouvoir, sauve les libertés communes.
Dans les temps d’aristocratie, chaque homme est toujours lié d’une manière très-étroite à plusieurs de ses concitoyens, de telle sorte qu’on ne saurait attaquer celui-là, que les autres n’accourent à son aide. Dans les siècles d’égalité, chaque individu est naturellement isolé ; il n’a point d’amis héréditaires dont il puisse exiger le concours, point de classe dont les sympathies lui soient assurées ; on le met aisément à part, et on le foule impunément aux pieds. De nos jours, un citoyen qu’on opprime n’a donc qu’un moyen de se défendre ; c’est de s’adresser à la nation tout entière, et, si elle lui est sourde, au genre humain ; et il n’a qu’un moyen de le faire, c’est la presse. Ainsi la liberté de la presse est infiniment plus précieuse chez les nations démocratiques que chez toutes les autres ; elle seule guérit la plupart des maux que l’égalité peut produire. L’égalité isole et affaiblit les hommes ; mais la presse place à côté de chacun d’eux une arme très-puissante, dont le plus faible et le plus [IV-327] isolé peut faire usage. L’égalité ôte à chaque individu l’appui de ses proches ; mais la presse lui permet d’appeler à son aide tous ses concitoyens et tous ses semblables. L’imprimerie a hâté les progrès de l’égalité, et elle est un de ses meilleurs correctifs.
Je pense que les hommes qui vivent dans les aristocraties peuvent, à la rigueur, se passer de la liberté de la presse ; mais ceux qui habitent les contrées démocratiques ne peuvent le faire. Pour garantir l’indépendance personnelle de ceux-ci, je ne m’en fie point aux grandes assemblées politiques, aux prérogatives parlementaires, à la proclamation de la souveraineté du peuple. Toutes ces choses se concilient, jusqu’à un certain point, avec la servitude individuelle ; mais cette servitude ne saurait être complète si la presse est libre. La presse est, par excellence, l’instrument démocratique de la liberté.
Je dirai quelque chose d’analogue du pouvoir judiciaire.
Il est de l’essence du pouvoir judiciaire de s’occuper d’intérêts particuliers et d’attacher volontiers ses regards sur de petits objets qu’on expose à sa vue ; il est encore de l’essence de ce pouvoir de ne point venir de lui-même au secours de ceux qu’on opprime, mais d’être sans cesse à la disposition du plus humble d’entre eux. Celui-ci, [IV-328] quelque faible qu’on le suppose, peut toujours forcer le juge d’écouter sa plainte et d’y répondre : cela tient à la constitution même du pouvoir judiciaire.
Un semblable pouvoir est donc spécialement applicable aux besoins de la liberté, dans un temps où l’œil et la main du souverain s’introduisent sans cesse parmi les plus minces détails des actions humaines, et où les particuliers, trop faibles pour se protéger eux-mêmes, sont trop isolés pour pouvoir compter sur le secours de leurs pareils. La force des tribunaux a été, de tout temps, la plus grande garantie qui se puisse offrir à l’indépendance individuelle, mais cela est surtout vrai dans les siècles démocratiques ; les droits et les intérêts particuliers y sont toujours en péril, si le pouvoir judiciaire ne grandit et ne s’étend à mesure que les conditions s’égalisent.
L’égalité suggère aux hommes plusieurs penchants fort dangereux pour la liberté, et sur lesquels le législateur doit toujours avoir l’œil ouvert. Je ne rappellerai que les principaux.
Les hommes qui vivent dans les siècles démocratiques ne comprennent pas aisément l’utilité des formes ; ils ressentent un dédain instinctif pour elles. J’en ai dit ailleurs les raisons. Les formes excitent leur mépris et souvent leur haine. Comme ils n’aspirent d’ordinaire qu’à des [IV-329] jouissances faciles et présentes, ils s’élancent impétueusement vers l’objet de chacun de leurs désirs ; les moindres délais les désespèrent. Ce tempérament, qu’ils transportent dans la vie politique les indispose contre les formes, qui les retardent ou les arrêtent chaque jour dans quelques-uns de leurs desseins.
Cet inconvénient que les hommes des démocraties trouvent aux formes est pourtant ce qui rend ces dernières si utiles à la liberté, leur principal mérite étant de servir de barrière entre le fort et le faible, le gouvernant et le gouverné, de retarder l’un et de donner à l’autre le temps de se reconnaître. Les formes sont plus nécessaires à mesure que le souverain est plus actif et plus puissant et que les particuliers deviennent plus indolents et plus débiles. Ainsi les peuples démocratiques ont naturellement plus besoin de formes que les autres peuples, et naturellement ils les respectent moins. Cela mérite une attention très-sérieuse.
Il n’y a rien de plus misérable que le dédain superbe de la plupart de nos contemporains pour les questions de formes ; car les plus petites questions de formes ont acquis de nos jours une importance qu’elles n’avaient point eue jusque-là. Plusieurs des plus grands intérêts de l’humanité s’y rattachent.
[IV-330]
Je pense que si les hommes d’état qui vivaient dans les siècles aristocratiques pouvaient quelquefois mépriser impunément les formes et s’élever souvent au-dessus d’elles, ceux qui conduisent les peuples d’aujourd’hui doivent considérer avec respect la moindre d’entre elles et ne la négliger que quand une impérieuse nécessité y oblige. Dans les aristocraties, on avait la superstition des formes ; il faut que nous ayons un culte éclairé et réfléchi pour elles.
Un autre instinct très-naturel aux peuples démocratiques, et très-dangereux, est celui qui les porte à mépriser les droits individuels et à en tenir peu de compte.
Les hommes s’attachent en général à un droit et lui témoignent du respect en raison de son importance ou du long usage qu’ils en ont fait. Les droits individuels qui se rencontrent chez les peuples démocratiques sont d’ordinaire peu importants, très-récents et fort instables ; cela fait qu’on les sacrifie souvent sans peine et qu’on les viole presque toujours sans remords.
Or il arrive que, dans ce même temps et chez ces mêmes nations où les hommes conçoivent un mépris naturel pour les droits des individus, les droits de la société s’étendent naturellement et s’affermissent ; c’est-à-dire que les hommes deviennent moins attachés aux droits particuliers, [IV-331] au moment où il serait le plus nécessaire de retenir et de défendre le peu qui en reste.
C’est donc surtout dans les temps démocratiques où nous sommes que les vrais amis de la liberté et de la grandeur humaine doivent sans cesse se tenir debout et prêts à empêcher que le pouvoir social ne sacrifie légèrement les droits particuliers de quelques individus à l’exécution générale de ses desseins. Il n’y a point dans ces temps-là de citoyen si obscur qu’il ne soit très-dangereux de laisser opprimer, ni de droits individuels si peu importants qu’on puisse impunément livrer à l’arbitraire. La raison en est simple : quand on viole le droit particulier d’un individu, dans un temps où l’esprit humain est pénétré de l’importance et de la sainteté des droits de cette espèce, on ne fait de mal qu’à celui qu’on dépouille ; mais violer un droit semblable, de nos jours, c’est corrompre profondément les mœurs nationales et mettre en péril la société tout entière ; parce que l’idée même de ces sortes de droits tend sans cesse parmi nous à s’altérer et à se perdre.
Il y a de certaines habitudes, de certaines idées, de certains vices qui sont propres à l’état de révolution, et qu’une longue révolution ne peut manquer de faire naître et de généraliser, quels que soient d’ailleurs son caractère, son objet et son théâtre.
[IV-332]
Lorsque une nation quelconque a plusieurs fois, dans un court espace de temps, changé de chefs, d’opinions et de lois, les hommes qui la composent finissent par contracter le goût du mouvement et par s’habituer à ce que tous les mouvements s’opèrent rapidement à l’aide de la force. Ils conçoivent alors naturellement du mépris pour les formes dont ils voient chaque jour l’impuissance, et ils ne supportent qu’avec impatience l’empire de la règle, auquel on s’est soustrait tant de fois sous leurs yeux.
Comme les notions ordinaires de l’équité et de la morale ne suffisent plus pour expliquer et justifier toutes les nouveautés auxquelles la révolution donne chaque jour naissance, on se rattache au principe de l’utilité sociale, on crée le dogme de la nécessité politique, et l’on s’accoutume volontiers à sacrifier sans scrupule les intérêts particuliers et à fouler aux pieds les droits individuels, afin d’atteindre plus promptement le but général qu’on se propose.
Ces habitudes et ces idées que j’appellerai révolutionnaires, parce que toutes les révolutions les produisent, se font voir dans le sein des aristocraties aussi bien que chez les peuples démocratiques ; mais chez les premières elles sont souvent moins puissantes et toujours moins durables, parce qu’elles y rencontrent des habitudes, des idées, des [IV-333] défauts et des travers qui leur sont contraires. Elles s’effacent donc d’elles-mêmes dès que la révolution est terminée, et la nation en revient à ses anciennes allures politiques. Il n’en est pas toujours ainsi dans les contrées démocratiques où il est toujours à craindre que les instincts révolutionnaires, s’adoucissant et se régularisant sans s’éteindre, ne se transforment graduellement en mœurs gouvernementales et en habitudes administratives.
Je ne sache donc pas de pays où les révolutions soient plus dangereuses que les pays démocratiques, parce que, indépendamment des maux accidentels et passagers qu’elles ne sauraient jamais manquer de faire, elles risquent toujours d’en créer de permanents et, pour ainsi dire d’éternels.
Je crois qu’il y a des résistances honnêtes et des rébellions légitimes. Je ne dis donc point, d’une manière absolue, que les hommes des temps démocratiques ne doivent jamais faire de révolutions ; mais je pense qu’ils ont raison d’hésiter plus que tous les autres avant d’entreprendre, et qu’il leur vaut mieux souffrir beaucoup d’incommodités de l’état présent que de recourir à un si périlleux remède.
Je terminerai par une idée générale qui renferme dans son sein non seulement toutes les idées particulières qui ont été exprimées dans ce présent [IV-334] chapitre, mais encore la plupart de celles que ce livre a pour but d’exposer.
Dans les siècles d’aristocratie qui ont précédé le nôtre, il y avait des particuliers très-puissants et une autorité sociale fort débile. L’image même de la société était obscure et se perdait sans cesse au milieu de tous les pouvoirs différents qui régissaient les citoyens. Le principal effort des hommes de ce temps-là dut se porter à grandir et à fortifier le pouvoir social, à accroître et à assurer ses prérogatives et, au contraire, à resserrer l’indépendance individuelle dans des bornes plus étroites, et à subordonner l’intérêt particulier à l’intérêt général.
D’autres périls et d’autres soins attendent les hommes de nos jours.
Chez la plupart des nations modernes, le souverain, quels que soient son origine, sa constitution et son nom, est devenu presque tout puissant, et les particuliers tombent, de plus en plus, dans le dernier degré de la faiblesse et de la dépendance.
Tout était différent dans les anciennes sociétés. L’unité et l’uniformité ne s’y rencontraient nulle part. Tout menace de devenir si semblable dans les nôtres, que la figure particulière de chaque individu se perdra bientôt entièrement dans la physionomie commune. Nos pères étaient [IV-335] toujours prêts à abuser de cette idée que les droits particuliers sont respectables, et nous sommes naturellement portés à exagérer cette autre que l’intérêt d’un individu doit toujours plier devant l’intérêt de plusieurs.
Le monde politique change ; il faut désormais chercher de nouveaux remèdes à des maux nouveaux.
Fixer au pouvoir social des limites étendues, mais visibles et immobiles ; donner aux particuliers de certains droits et leur garantir la jouissance incontestée de ces droits ; conserver à l’individu le peu d’indépendance, de force et d’originalité qui lui restent ; le relever à côté de la société et le soutenir en face d’elle : tel me paraît être le premier objet du législateur, dans l’âge où nous entrons.
On dirait que les souverains de notre temps ne cherchent qu’à faire avec les hommes des choses grandes. Je voudrais qu’ils songeassent un peu plus à faire de grands hommes ; qu’ils attachassent moins de prix à l’œuvre et plus à l’ouvrier, et qu’ils se souvinssent sans cesse qu’une nation ne peut rester longtemps forte quand chaque homme y est individuellement faible, et qu’on n’a point encore trouvé de formes sociales ni de combinaisons politiques qui puissent faire un peuple énergique en le composant de citoyens pusillanimes et mous.
[IV-336]
Je vois chez nos contemporains deux idées contraires mais également funestes.
Les uns n’aperçoivent dans l’égalité que les tendances anarchiques qu’elle fait naître. Ils redoutent leur libre arbitre ; ils ont peur d’eux-mêmes.
Les autres, en plus petit nombre, mais mieux éclairés, ont une autre vue. A côté de la route qui, partant de l’égalité, conduit à l’anarchie, ils ont enfin découvert le chemin qui semble mener invinciblement les hommes vers la servitude. Ils plient d’avance leur âme à cette servitude nécessaire ; et, désespérant de rester libres, ils adorent déjà au fond de leur cœur le maître qui doit bientôt venir.
Les premiers abandonnent la liberté, parce qu’ils l’estiment dangereuse ; les seconds parce qu’ils la jugent impossible.
Si j’avais eu cette dernière croyance, je n’aurais pas écrit l’ouvrage qu’on vient de lire ; je me serais borné à gémir en secret sur la destinée de mes semblables.
J’ai voulu exposer au grand jour les périls que l’égalité fait courir à l’indépendance humaine, parce que je crois fermement que ces périls sont les plus formidables aussi bien que les moins prévus de tous ceux que renferme l’avenir. Mais je ne les crois pas insurmontables.
[IV-337]
Les hommes qui vivent dans les siècles démocratiques où nous entrons ont naturellement le goût de l’indépendance. Naturellement ils supportent avec impatience la règle : la permanence de l’état même qu’ils préfèrent les fatigue. Ils aiment le pouvoir ; mais ils sont enclins à mépriser et à haïr celui qui l’exerce, et ils échappent aisément d’entre ses mains à cause de leur petitesse et de leur mobilité même.
Ces instincts se retrouveront toujours, parce qu’ils sortent du fond de l’état social, qui ne changera pas. Pendant longtemps, ils empêcheront qu’aucun despotisme ne puisse s’asseoir, et ils fourniront de nouvelles armes à chaque génération nouvelle qui voudra lutter en faveur de la liberté des hommes.
Ayons donc de l’avenir cette crainte salutaire qui fait veiller et combattre, et non cette sorte de terreur molle et oisive qui abat les cœurs et les énerve. ]
[IV-339
CHAPITRE VIII.↩
Vue générale du sujet.
Je voudrais, avant de quitter pour jamais la carrière que je viens de parcourir, pouvoir embrasser d’un dernier regard tous les traits divers qui marquent la face du monde nouveau, et juger enfin de l’influence générale que doit exercer l’égalité sur le sort des hommes ; mais la difficulté d’une pareille entreprise m’arrête ; en présence d’un si grand objet je sens ma vue qui se trouble et ma raison qui chancelle.
Cette société nouvelle que j’ai cherché à peindre et que je veux juger ne fait que de naître. Le temps n’en a point encore arrêté la forme ; la grande révolution qui l’a créée dure encore, et, dans ce qui arrive de nos jours, il est presque impossible de [IV-340] discerner ce qui doit passer avec la révolution elle-même, et ce qui doit rester après elle.
Le monde qui s’élève est encore à moitié engagé sous les débris du monde qui tombe, et, au milieu de l’immense confusion que présentent les affaires humaines, nul ne saurait dire ce qui restera debout des vieilles institutions et des anciennes mœurs, et ce qui achèvera d’en disparaître.
Quoique la révolution qui s’opère dans l’état social, les lois, les idées, les sentiments des hommes, soit encore bien loin d’être terminée, déjà on ne saurait comparer ses œuvres avec rien de ce qui s’est vu précédemment dans le monde. Je remonte de siècle en siècle jusqu’à l’antiquité la plus reculée ; je n’aperçois rien qui ressemble à ce qui est sous mes yeux. Le passé n’éclairant plus l’avenir, l’esprit marche dans les ténèbres.
Cependant, au milieu de ce tableau si vaste, si nouveau, si confus, j’entrevois déjà quelques traits principaux qui se dessinent, et je les indique :
Je vois que les biens et les maux se répartissent assez également dans le monde. Les grandes richesses disparaissent ; le nombre des petites fortunes s’accroît ; les désirs et les jouissances se multiplient ; il n’y a plus de prospérités extraordinaires ni de misères irrémédiables. L’ambition est un sentiment universel ; il y a peu d’ambitions vastes. Chaque individu est isolé et faible ; la société est [IV-341] agile, prévoyante et forte ; les particuliers font de petites choses, et l’état d’immenses.
Les âmes ne sont pas énergiques ; mais les mœurs sont douces et les législations humaines. S’il se rencontre peu de grands dévouements, de vertus très-hautes, très-brillantes et très-pures, les habitudes sont rangées, la violence rare, la cruauté presque inconnue. L’existence des hommes devient plus longue et leur propriété plus sûre. La vie n’est pas très-ornée, mais très-aisée et très-paisible. Il y a peu de plaisirs très-délicats et très-grossiers, peu de politesses dans les manières et peu de brutalité dans les goûts. On ne rencontre guère d’hommes très-savants ni de populations très-ignorantes. Le génie devient plus rare et les lumières plus communes. L’esprit humain se développe par les petits efforts combinés de tous les hommes, et non par l’impulsion puissante de quelques-uns d’entre eux. Il y a moins de perfection, mais plus de fécondité dans les œuvres. Tous les liens de race, de classe, de patrie se détendent ; le grand lien de l’humanité se resserre.
Si, parmi tous ces traits divers je cherche celui qui me parait le plus général et le plus frappant, j’arrive à voir que ce qui se remarque dans les fortunes se représente sous mille autres formes. Presque tous les extrêmes s’adoucissent et s’émoussent ; presque tous les points saillants s’effacent [IV-342] pour faire place à quelque chose de moyen, qui est tout à la fois moins haut et moins bas, moins brillant et moins obscur que ce qui se voyait dans le monde.
Je promène mes regards sur cette foule innombrable composée d’êtres pareils, où rien ne s’élève ni ne s’abaisse. Le spectacle de cette uniformité universelle m’attriste et me glace, et je suis tenté de regretter la société qui n’est plus.
Lorsque le monde était rempli d’hommes très-grands et très-petits, très-riches et très-pauvres, très-savants et très-ignorants, je détournais mes regards des seconds pour ne les attacher que sur les premiers, et ceux-ci réjouissaient ma vue ; mais je comprends que ce plaisir naissait de ma faiblesse : c’est parce que je ne puis voir en même temps tout ce qui m’environne qu’il m’est permis de choisir ainsi et de mettre à part, parmi tant d’objets, ceux qu’il me plaît de contempler. Il n’en est pas de même de l’être tout puissant et éternel dont l’œil enveloppe nécessairement l’ensemble des choses, et qui voit distinctement, bien qu’à la fois, tout le genre humain et chaque homme.
Il est naturel de croire que ce qui satisfait le plus les regards de ce créateur et de ce conservateur des hommes, ce n’est point la prospérité singulière de quelques-uns, mais le plus grand bien-être de tous ; ce qui me semble une décadence [IV-343] est donc à ses yeux un progrès ; ce qui me blesse lui agrée. L’égalité est moins élevée peut-être ; mais elle est plus juste, et sa justice fait sa grandeur et sa beauté.
Je m’efforce de pénétrer dans ce point de vue de Dieu ; et c’est de là que je cherche à considérer et à juger les choses humaines.
Personne, sur la terre, ne peut encore affirmer d’une manière absolue et générale que l’état nouveau des sociétés soit supérieur à l’état ancien ; mais il est déjà aisé de voir qu’il est autre.
Il y a de certains vices et de certaines vertus qui étaient attachés à la constitution des nations aristocratiques, et qui sont tellement contraires au génie des peuples nouveaux qu’on ne saurait les introduire dans leur sein. Il y a de bons penchants et de mauvais instincts qui étaient étrangers aux premiers et qui sont naturels aux seconds ; des idées qui se présentent d’elles-mêmes à l’imagination des uns, et que l’esprit des autres rejette. Ce sont comme deux humanités distinctes, dont chacune a ses avantages et ses inconvénients particuliers, ses biens et ses maux qui lui sont propres.
Il faut donc bien prendre garde de juger les sociétés qui naissent avec les idées qu’on a puisées dans celles qui ne sont plus. Cela serait injuste, car ces sociétés différant prodigieusement entre elles, sont incomparables.
[IV-344]
Il ne serait guère plus raisonnable de demander aux hommes de notre temps les vertus particulières qui découlaient de l’état social de leurs ancêtres, puisque cet état social lui-même est tombé, et qu’il a entraîné confusément dans sa chute tous les biens et tous les maux qu’il portait avec lui.
Mais ces choses sont encore mal comprises de nos jours.
J’aperçois un grand nombre de mes contemporains qui entreprennent de faire un choix entre les institutions, les opinions, les idées qui naissaient de la constitution aristocratique de l’ancienne société ; ils abandonneraient volontiers les unes, mais ils voudraient retenir les autres et les transporter avec eux dans le monde nouveau.
Je pense que ceux-là consument leur temps et leurs forces dans un travail honnête et stérile.
Il ne s’agit plus de retenir les avantages particuliers que l’inégalité des conditions procure aux hommes, mais de s’assurer les biens nouveaux que l’égalité peut leur offrir. Nous ne devons pas tendre à nous rendre semblables à nos pères, mais nous efforcer d’atteindre l’espèce de grandeur et de bonheur qui nous est propre.
Pour moi qui, parvenu à ce dernier terme de ma course, découvre de loin, mais à la fois, tous les objets divers que j’avais contemplés à part en [IV-345] marchant, je me sens plein de craintes et plein d’espérances. Je vois de grands périls qu’il est possible de conjurer ; de grands maux qu’on peut éviter ou restreindre, et je m’affermis de plus en plus dans cette croyance que, pour être honnêtes et prospères, il suffit encore aux nations démocratiques de le vouloir.
Je n’ignore pas que plusieurs de mes contemporains ont pensé que les peuples ne sont jamais ici-bas maîtres d’eux-mêmes, et qu’ils obéissent nécessairement à je ne sais quelle force insurmontable et inintelligente qui naît des événements antérieurs, de la race, du sol ou du climat.
Ce sont là de fausses et lâches doctrines, qui ne sauraient jamais produire que des hommes faibles et des nations pusillanimes : la providence n’a créé le genre humain ni entièrement indépendant, ni tout à fait esclave. Elle trace, il est vrai, autour de chaque homme, un cercle fatal dont il ne peut sortir ; mais dans ses vastes limites, l’homme est puissant et libre ; ainsi des peuples.
Les nations de nos jours ne sauraient faire que dans leur sein les conditions ne soient pas égales ; mais il déégalité les conduise à la servitude ou à la liberté, aux lumières ou à la barbarie, à la prospérité ou aux misères.
[IV-347]
NOTES.
NOTE PAGE 81.↩
Je trouve, dans le journal de mon voyage, le morceau suivant qui achèvera de faire connaître à quelles épreuves sont souvent soumises les femmes d’Amérique qui consentent à accompagner leur mari au désert. Il n’y a rien qui recommande cette peinture au lecteur que sa grande vérité.
…Nous rencontrons de temps à autre de nouveaux défrichements. Tous ces établissements se ressemblent. Je vais décrire celui où nous nous sommes arrêtés ce soir, il me laissera une image de tous les autres.
La clochette que les pionniers ont soin de suspendre au cou des bestiaux pour les retrouver dans les bois, nous a annoncé de très-loin l’approche du défrichement ; bientôt nous avons entendu le bruit de la hache qui abat les arbres de la forêt. À mesure que nous approchons, des traces de destruction nous annoncent la présence de l’homme civilisé. Des branches coupées couvrent le che [IV-348] min ; des troncs à moitié calcinés par le feu ou mutilés par la coignée se tiennent encore debout sur notre passage. Nous continuons notre marche et nous parvenons dans un bois dont tous les arbres semblent avoir été frappés de mort subite ; au milieu de l’été, ils ne présentent plus que l’image de l’hiver ; en les examinant de plus près, nous apercevons qu’on a tracé dans leur écorce un cercle profond qui, arrêtant la circulation de la sève, n’a pas tardé à les faire périr ; nous apprenons que c’est par là en effet que débute ordinairement le pionnier. Ne pouvant, durant la première année, couper tous les arbres qui garnissent sa nouvelle propriété, il sème du maïs sous leurs branches et, en les frappant de mort, il les empêche de porter ombre à sa récolte. Après ce champ, ébauche incomplète, premier pas de la civilisation dans le désert, nous apercevons tout à coup la cabane du propriétaire ; elle est placée au centre d’un terrain plus soigneusement cultivé que le reste, mais où l’homme soutient encore cependant une lutte inégale contre la forêt ; là les arbres sont coupés mais non arrachés, leurs troncs garnissent encore et embarrassent le terrain qu’ils ombrageaient autrefois. Autour de ces débris desséchés, du blé, des rejetons de chênes, de plantes de toutes espèces, des herbes de toute nature croissent pêle-mêle et grandissent ensemble sur un sol indocile et à demi sauvage. C’est au milieu de cette végétation vigoureuse et variée que s’élève la maison du pionnier, ou comme on l’appelle dans le pays, la log-house. Ainsi que le champ qui l’entoure, cette demeure rustique annonce une œuvre nouvelle et précipitée ; sa longueur ne nous paraît pas excéder trente pieds, sa hauteur quinze ; ses murs ainsi que le toit sont formés de troncs d’arbres non écarris, entre lesquels on a placé de la mousse et de [IV-349] la terre pour empêcher le froid et la pluie de pénétrer dans l’intérieur.
La nuit approchant, nous nous déterminons à aller demander un asile au propriétaire de la log-house.
Au bruit de nos pas, des enfants qui se roulaient au milieu des débris de la forêt se lèvent précipitamment et fuient vers la maison comme effrayés à la vue d’un homme, tandis que deux gros chiens à demi sauvages, les oreilles droites et le museau allongé, sortent de leur cabane et viennent en grommelant couvrir la retraite de leurs jeunes maîtres. Le pionnier paraît lui-même à la porte de sa demeure ; il jette sur nous un regard rapide et scrutateur, fait signe à ses chiens de rentrer au logis, il leur en donne lui-même l’exemple sans témoigner que notre vue excite sa curiosité ou son inquiétude.
Nous entrons dans la log-house : l’intérieur n’y rappelle point les cabanes des paysans d’Europe ; on y trouve plus le superflu et moins le nécessaire.
Il n’y a qu’une seule fenêtre à laquelle pend un rideau de mousseline ; sur un foyer de terre battue pétille un grand feu qui éclaire tout le dedans de l’édifice ; au-dessus de ce foyer on aperçoit une belle carabine rayée, une peau de daim, des plumes d’aigles ; à droite de la cheminée est étendue une carte des États-Unis que le vent soulève et agite en s’introduisant entre les interstices du mur ; près d’elle, sur un rayon formé d’une planche mal équarrie, sont placés quelques volumes : j’y remarque la Bible, les six premiers chants de Milton et deux drames de Shakespeare ; le long des murs sont placés des malles au lieu d’armoires ; au centre se trouve une table grossièrement travaillée, et dont les pieds formés d’un bois encore vert et non dépouillé de son écorce semblent être poussés d’eux-mêmes sur le sol qu’elle occupe ; je vois sur cette [IV-350] table une théière de porcelaine anglaise, des cuillères d’argent, quelques tasses ébréchées et des journaux.
Le maître de cette demeure a les traits anguleux et les membres effilés qui distinguent l’habitant de la Nouvelle-Angleterre ; il est évident que cet homme n’est pas né dans la solitude où nous le rencontrons : sa constitution physique suffit pour annoncer que ses premières années se sont passées au sein d’une société intellectuelle, et qu’il appartient à cette race inquiète, raisonnante et aventurière, qui fait froidement ce que l’ardeur seule des passions explique, et qui se soumet pour un temps à la vie sauvage afin de mieux vaincre et de civiliser le désert.
Lorsque le pionnier s’aperçoit que nous franchissons le seuil de sa demeure, il vient à notre rencontre et nous tend la main, suivant l’usage ; mais sa physionomie reste rigide ; il prend le premier la parole pour nous interroger sur ce qui arrive dans le monde, et quand il a satisfait sa curiosité, il se tait ; on le croirait fatigué des importuns et du bruit. Nous l’interrogeons à notre tour, et il nous donne tous les renseignements dont nous avons besoin ; il s’occupe ensuite sans empressement, mais avec diligence, de pourvoir à nos besoins. En le voyant ainsi se livrer a ces soins bienveillants, pourquoi sentons-nous malgré nous se glacer notre reconnaissance ? c’est que lui-même, en exerçant l’hospitalité, semble se soumettre à une nécessité pénible de son sort : il y voit un devoir que sa position lui impose, non un plaisir.
À l’autre bout du foyer est assise une femme qui berce un jeune enfant sur ses genoux ; elle nous fait un signe de tête sans s’interrompre. Comme le pionnier, cette femme est dans la fleur de l’âge, son aspect semble supérieur à sa condition, son costume annonce même encore un goût de parure mal éteint : mais ses membres [IV-351] délicats paraissent amoindris, ses traits sont fatigués, son œil est doux et grave ; on voit répandu sur toute sa physionomie une résignation religieuse, une paix profonde des passions, et je ne sais quelle fermeté naturelle et tranquille qui affronte tous les maux de la vie sans les craindre ni les braver.
Ses enfants se pressent autour d’elle, ils sont pleins de santé, de turbulence et d’énergie ; ce sont de vrais fils du désert ; leur mère jette de temps en temps sur eux des regards pleins de mélancolie et de joie ; à voir leur force et sa faiblesse, on dirait qu’elle s’est épuisée en leur donnant la vie, et qu’elle ne regrette pas ce qu’ils lui ont coûté.
La maison habitée par les émigrants n’a point de séparation intérieure ni de grenier. Dans l’unique appartement qu’elle contient, la famille entière vient le soir chercher un asile. Cette demeure forme, à elle seule, comme un petit monde ; c’est l’arche de la civilisation perdue au milieu d’un océan de feuillage. Cent pas plus loin, l’éternelle forêt étend autour d’elle son ombre, et la solitude recommence.
[IV-352]
NOTE PAGE 83.↩
Ce n’est point l’égalité des conditions qui rend les hommes immoraux et irréligieux. Mais quand les hommes sont immoraux et irréligieux en même temps qu’égaux, les effets de l’immoralité et de l’irreligion se produisent aisément au dehors, parce que les hommes ont peu d’action les uns sur les autres, et qu’il n’existe pas de classe qui puisse se charger de faire la police de la société. L’égalité des conditions qui rend les hommes immoraux et irréligieux. Mais quand les hommes sont immoraux et irréligieux en mêéééharger de faire la police de la sociétéégalité des conditions ne crée jamais la corruption des mœurs, mais quelquefois elle la laissé paraître.
[IV-353]
NOTE PAGE 125.↩
Si on met de côté tous ceux qui ne pensent point et ceux qui n’osent dire ce qu’ils pensent, on trouvera encore que l’immense-majorité des Américains paraît satisfaite des institutions politiques qui la régissent ; et, en fait, je crois qu’elle l’est. Je regarde ces dispositions de l’opinion publique comme un indice, mais non comme une preuve de la bonté absolue des lois américaines. L’orgueil national, la satisfaction donnée par les législations à certaines passions dominantes, des événements fortuits, des vices inaperçus, et plus que tout cela l’intérêt d’une majorité qui ferme la bouche aux opposants, peuvent faire pendant longtemps illusion à tout un peuple aussi bien qu’à un homme.
Voyez l’Angleterre dans tout le cours du dix-huitième siècle. Jamais nation se prodigua-t-elle plus d’encens ; aucun peuple fut-il jamais plus parfaitement content de lui-même ; tout était bien alors dans sa constitution, tout y était irréprochable, jusqu’à ses plus visibles défauts. Aujourd’hui une multitude d’anglais semblent n’être occupés qu’à prouver que cette même constitution était défectueuse en mille endroits. Qui avait raison du peuple [IV-354] anglais du dernier siècle ou du peuple anglais de nos jours ?
La même chose arriva en France. Il est certain que sous Louis XIV, la grande masse de la nation était passionnée pour la forme du gouvernement qui régissait alors la société. Ceux-ci se trompent grandement qui croient qu’il y eut abaissement dans le caractère français d’alors. Dans ce siècle il pouvait y avoir à certains égards en France servitude, mais l’esprit de la servitude n’y était certainement point. Les écrivains du temps éprouvaient une sorte d’enthousiasme réel en élevant la puissance royale au-dessus de toutes les autres, et il n’y a pas jusqu’à l’obscur paysan qui ne s’enorgueillit dans sa chaumière de la gloire du souverain et qui ne mourût avec joie en criant : Vive le roi ! Ces mêmes formes nous sont devenues odieuses. Qui se trompait des Français de Louis XIV ou des Français de nos jours ?
Ce n’est donc pas sur les dispositions seules d’un peuple qu’il faut se baser pour juger ses lois, puisque d’un siècle à l’autre elles changent, mais sur des motifs plus élevés et une expérience plus générale.
L’amour que montre un peuple pour ses lois ne prouve qu’une chose, c’est qu’il ne faut pas se hâter de les changer.
[IV-355]
NOTE PAGE 231.↩
Je viens, dans le chapitre auquel cette note se rapporte, de montrer un péril ; je veux en indiquer un autre plus rare, mais qui, s’il apparaissait jamais, serait bien plus à craindre.
Si l’amour des jouissances matérielles et le goût du bien-être que l’égalité suggère naturellement aux hommes, s’emparant de l’esprit d’un peuple démocratique, arrivaient à le remplir tout entier, les mœurs nationales deviendraient si antipathiques à l’esprit militaire, que les armées elles-mêmes finiraient peut-être par aimer la paix en dépit de l’intérêt particulier qui les porte à désirer la guerre. Placés au milieu de cette mollesse universelle, les soldats en viendraient à penser que mieux vaut encore s’élever graduellement mais commodément et sans efforts dans la paix, que d’acheter un avancement rapide au prix des fatigues et des misères de la vie des camps. Dans cet esprit, l’armée prendrait ses armes sans ardeur et en userait sans énergie ; elle se laisserait mener à l’ennemi plutôt qu’elle n’y marcherait elle-même.
Il ne faut pas croire que cette disposition pacifique de l’armée l’éloignât des révolutions, car les révolutions et [IV-356] surtout les révolutions militaires qui sont d’ordinaire fort rapides, entraînent souvent de grands périls, mais non de longs travaux ; elles satisfont l’ambition à moins de frais que la guerre ; on n’y risque que la vie, à quoi les hommes des démocraties tiennent moins qu’à leurs aises.
Il n’y a rien de plus dangereux pour la liberté et la tranquillité d’un peuple qu’une armée qui craint la guerre, parce que, ne cherchant plus sa grandeur et son influence sur les champs de bataille, elle veut les trouver ailleurs. Il pourrait donc arriver que les hommes qui composent une armée démocratique perdissent les intérêts du citoyen sans acquérir les vertus du soldat, et que l’armée cessât d’être guerrière sans cesser d’être turbulente.
Je répééjà dit plus haut. Le remède àée, mais dans le pays. Un peuple démocratique qui conserve des mœurs viriles trouvera toujours au besoin dans ses soldats des mœurs guerrières.
[IV-357]
NOTE PAGE 262.↩
Les hommes mettent la grandeur de l’idée d’unité dans les moyens, Dieu dans la fin ; de là vient que cette idée de grandeur nous mène à mille petitesses. Forcer tous les hommes à marcher de la même marche, vers le même objet, voilà une idée humaine. Introduire une variété infinie dans les actes, mais les combiner de manière à ce que tous ces actes conduisent par mille voies diverses vers l’accomplissement d’un grand dessein, voilà une idée divine.
L’idée humaine de l’unité est presque toujours stérile, celle de Dieu immensément féconde. Les hommes croient téà l’infini.
[IV-358]
NOTE PAGE 270.↩
Un peuple démocratique n’est pas seulement porté par ses goûts à centraliser le pouvoir ; les passions de tous ceux qui le conduisent l’y poussent sans cesse.
On peut aisément prévoir que presque tous les citoyens ambitieux et capables que renferme un pays démocratique travailleront sans relâche à étendre les attributions du pouvoir social, parce que tous espèrent le diriger un jour. C’est perdre son temps que de vouloir prouver à ceux-la que l’extrême centralisation peut être nuisible à l’État, puisqu’ils centralisent pour eux-mêmes.
Parmi les hommes publics des déère que des gens très-désintéressés ou très-médiocres qui veuillent décentraliser le pouvoir. Les uns sont rares et les autres impuissants.
[IV-359]
NOTE PAGE 313.↩
Je me suis souvent demandé ce qu’il arriverait si, au milieu de la mollesse des mœurs démocratiques et par suite de l’esprit inquiet de l’armée, il se fondait jamais, chez quelques-unes des nations de nos jours, un gouvernement militaire.
Je pense que le gouvernement lui-même ne s’éloignerait pas du tableau que j’ai tracé dans le chapitre auquel cette note se rapporte, et qu’il ne reproduirait pas les traits sauvages de l’oligarchie militaire.
Je suis convaincu que, dans ce cas, il se ferait une sorte de fusion entre les habitudes du commis et celles du soldat. L’administration prendrait quelque chose de l’esprit militaire, et le militaire quelques usages de l’administration civile. Le résultat de ceci serait un commandement réée, et la société tenue comme une caserne.
[IV-360]
NOTE PAGE 319.↩
On ne peut pas dire d’une manière absolue et générale que le plus grand danger de nos jours soit la licence ou la tyrannie, l’anarchie ou le despotisme. L’un et l’autre est également à craindre, et peut sortir aussi aisément d’une seule et même cause qui est l’apathie générale, fruit de l’individualisme ; c’est cette apathie qui fait que le jour où le pouvoir exécutif rassemble quelques forces, il est en état d’opprimer, et que le jour d’après, où un parti peut mettre trente hommes en bataille, celui-ci est également en état d’opprimer. Ni l’un ni l’autre ne pouvant rien fonder de durable, ce qui les fait réussir aisément les empêche de réussir longtemps. Ils s’élèvent parce que rien ne leur résiste, et ils tombent parce que rien ne les soutient.
Ce qu’il est important de combattre, c’est donc bien moins l’anarchie ou le despotisme que l’apathie qui peut créer presque indifféremment l’un ou l’autre.
FIN DES NOTES.
[IV-361]
APPENDICE
M. Cherbuliez, professeur de droit public à l’académie de Genève, a publié un ouvrage sur les institutions et les mœurs politiques de son pays, intitulé : De la Démocratie en Suisse, et en a fait hommage d’un exemplaire à l’Académie des sciences morales.
Il m’a paru, messieurs, que l’importance du sujet traité par l’auteur méritait qu’on fît du livre un examen spécial ; et, pensant qu’un tel examen pourrait offrir quelque utilité, je l’ai entrepris.
Mon intention est de me placer complètement en dehors des préoccupations du moment, comme il convient de le faire dans cette enceinte, de passer sous silence les faits actuels qui ne relèvent point de nous, et de voir, en Suisse, moins les actes de la société politique, que cette société elle-même, les lois qui la constituent, leur origine, leurs tendances, leur caractère : J’espère que, circonscrit de cette manière, le tableau sera encore digne d’intérêt. Ce qui se passe en Suisse n’est pas un fait isolé. C’est un mouvement particulier au milieu du mouvement général qui précipite vers sa ruine tout l’ancien édifice des [IV-362] institutions de l’Europe. Si le théâtre est petit, le spectacle a donc de la grandeur ; il a surtout une originalité singulière. Nulle part, la révolution démocratique qui agite le monde ne s’était produite au milieu de circonstances si compliquées et si bizarres. Un même peuple, composé de plusieurs races, parlant plusieurs langues, professant plusieurs croyances, différentes sectes dissidentes, deux églises également constituées et privilégiées ; toutes les questions politiques tournant bientôt en questions de religion, et toutes les questions de religion aboutissant à des questions de politique ; deux sociétés enfin, l’une très-vieille, l’antre très-jeune, mariées ensemble malgré la différence de leurs âges. Tel est le tableau qu’offre la Suisse. Pour le bien peindre, il eût fallu, à mon avis, se placer plus haut que ne l’a fait l’auteur. M. Cherbuliez déclare dans sa préface, et je tiens l’assertion pour très-sincère, qu’il s’est imposé la loi de l’impartialité. Il craint même que le caractère complètement impartial de son œuvre ne jette une sorte de monotonie sur le sujet. Cette crainte est assurément mal fondée. L’auteur veut être impartial, en effet, mais il n’y parvient point. Il y a dans son livre de la science, de la perspicacité, un vrai talent, une bonne foi évidente qui éclate au milieu même d’approbations passionnées ; mais, ce qui ne se voit pas, c’est précisément l’impartialité. On y rencontre tout à la fois beaucoup d’esprit et peu de liberté d’esprit.
Vers quelles formes de société politique tend l’auteur ? Cela semble d’abord assez difficile à dire. Quoiqu’il approuve dans une certaine mesure la conduite politique qu’ont suivie, en Suisse, les catholiques les plus ardents, il est adversaire décidé du catholicisme, à ce point qu’il n’est pas éloigné de vouloir qu’on empêche, [IV-363] législativement, la religion catholique de s’étendre dans les lieux où elle ne règne pas. D’une autre part, il est fort ennemi des sectes dissidentes du protestantisme. Opposé au gouvernement du peuple, il l’est aussi à celui de la noblesse ; en religion, une église protestante régie par l’État ; en politique, un état régi par une aristocratie bourgeoise : tel semble être l’idéal de l’auteur. C’est Genève avant ses dernières révolutions.
Mais si l’on ne discerne pas toujours clairement ce qu’il aime, on aperçoit sans peine ce qu’il hait. Ce qu’il hait, c’est la démocratie. Atteint dans ses opinions, dans ses amitiés, dans ses intérêts peut-être, par la révolution démocratique qu’il décrit, il n’en parle jamais qu’en ennemi. Il n’attaque pas seulement la démocratie dans telles ou telles de ses conséquences, mais dans son principe même ; il ne voit pas les qualités qu’elle possède, il poursuit les défauts qu’elle a. Il ne distingue point, entre les maux qui en peuvent découler, ce qui est fondamental et permanent, et ce qui est accidentel et passager ; ce qu’il faut supporter d’elle comme inévitable et ce qu’on doit chercher à corriger. Peut-être le sujet ne pouvait-il pas être envisagé de cette manière par un homme aussi mêlé que l’a été M. Cherbuliez aux agitations de son pays. Il est permis de le regretter. Nous verrons, en poursuivant cette analyse, que la démocratie suisse a grand besoin qu’on l’éclaire sur l’imperfection de ses lois. Mais, pour le faire avec efficacité, la première condition était de ne point la haïr.
M. Cherbuliez a intitulé son œuvre : De la démocratie en Suisse. Ce qui pourrait faire croire qu’aux yeux de l’auteur la Suisse est un pays dans lequel on puisse faire sur la démocratie un ouvrage de doctrine, et où il soit permis [IV-364] de juger les institutions démocratiques en elles-mêmes. C’est là, à mon sens, la source principale d’où sont sorties presque toutes les erreurs du livre. Son vrai titre eût dû être : De la Révolution démocratique en Suisse. La Suisse, en effet, depuis quinze ans est un pays en révolution. La démocratie y est moins une forme régulière de gouvernement qu’une arme dont on s’est servi habituellement pour détruire et quelquefois défendre l’ancienne société. On peut bien y étudier les phénomènes particuliers qui accompagnent l’état révolutionnaire dans l’ère démocratique où nous sommes, mais non pas y peindre la démocratie dans son assiette permanente et tranquille. Quiconque n’aura pas sans cesse présent à l’esprit ce point de départ, ne comprendra qu’avec peine le tableau que les institutions de la Suisse lui présentent ; et, pour mon compte, j’éprouverais une difficulté insurmontable à expliquer comment je juge ce qui est, sans dire comment je comprends ce qui a été.
On se fait d’ordinaire illusion sur ce qu’était la Suisse lorsque la révolution française éclata. Comme les Suisses vivaient depuis longtemps en république, on se figura aisément qu’ils étaient beaucoup plus rapprochés que les autres habitants du continent de l’Europe, des institutions qui constituent et de l’esprit qui anime la liberté moderne. C’est le contraire qu’il faudrait penser.
Quoique l’indépendance des Suisses fût née au milieu d’une insurrection contre l’aristocratie, la plupart des gouvernements qui se fondèrent alors empruntèrent bientôt à l’aristocratie ses usages, ses lois, et jusqu’à ses opinions et ses penchants. La liberté ne se présenta plus à leurs yeux que sous la forme d’un privilège, et l’idée d’un droit général et préexistant qu’auraient tous les hommes [IV-365] à être libres, cette idée demeura aussi étrangère à leur esprit qu’elle pouvait l’être à celui même des princes de la maison d’Autriche, qu’ils avaient vaincus. Tous les pouvoirs ne tardèrent donc pas à être attirés et retenus dans le sein de petites aristocraties formées ou qui se recrutaient elles-mêmes. Au nord, ces aristocraties prirent un caractère industriel ; au midi, une constitution militaire. Mais, des deux côtés, elles furent aussi resserrées, aussi exclusives. Dans la plupart des cantons, les trois quarts des habitants furent exclus d’une participation quelconque, soit directe, soit même indirecte, à l’administration du pays ; et, de plus, chaque canton eut des populations sujettes.
Ces petites sociétés, qui s’étaient formées au milieu d’une agitation si grande, devinrent bientôt si stables qu’aucun mouvement ne s’y fit plus sentir. L’aristocratie ne s’y trouvant ni poussée par le peuple, ni guidée par un roi, y tint le corps social immobile dans les vieux vêtements du moyen âge.
Les progrès du temps faisaient déjà pénétrer depuis longtemps le nouvel esprit dans les sociétés les plus monarchiques de l’Europe, que la Suisse lui demeurait encore fermée.
Le principe de la division des pouvoirs était admis par tous les publicistes, il ne s’appliquait point en Suisse. La liberté de la presse, qui existait au moins en fait dans plusieurs monarchies absolues du continent, n’existait en Suisse ni en fait ni en droit ; la faculté de s’associer politiquement n’y était ni exercée ni reconnue ; la liberté de la parole y était restreinte dans des limites très-étroites. L’égalité des charges, vers laquelle tendaient tous les gouvernements éclairés, ne s’y rencontrant pas plus que [IV-366] celle des droits. L’industrie y trouvait mille entraves : la liberté individuelle n’y avait aucune garantie légale. La liberté religieuse, qui commençait pénétrer jusqu’au sein des États les plus orthodoxes, n’avait pu encore se faire jour en Suisse. Les cultes dissidents étaient entièrement prohibés dans plusieurs cantons, gênés dans tous. La différence des croyances y créait presque partout des incapacités politiques.
La Suisse était encore en cet état en 1798, lorsque la révolution française pénétra à main armée sur son territoire. Elle y renversa pour un moment les vieilles institutions, mais elle ne mit rien de solide et de stable à la place. Napoléon qui, quelques années après, tira les Suisses de l’anarchie par l’acte de médiation, leur donna bien l’égalité, mais non la liberté, les lois politiques qu’il imposa étaient combinées de manière à ce que la vie publique était paralysée. Le pouvoir, exercé au nom du peuple, mais placé très-loin de lui, était remis tout entier dans les mains de la puissance exécutive.
Quand, peu d’années après, l’acte de médiation tomba avec son auteur, les Suisses n’y gagneront point la liberté ; ils y perdirent seulement l’égalité. Partout les anciennes aristocraties reprirent les rênes du gouvernement, et remirent en vigueur les principes exclusifs et surannés qui avaient régné avant la révolution. Les choses revinrent alors, dit avec raison M. Cherbuliez, à peu près au point où elles étaient en 1798. On a accusé à tort les rois coalisés d’avoir imposé, par la force, cette restauration à la Suisse. Elle fut faite d’accord avec eux, mais non par eux. La vérité est que les Suisses furent entraînés alors, comme les autres peuples du continent, par cette réaction passagère, mais universelle, qui raviva tout à coup dans toute [IV-367] l’Europe la vieille société ; et, comme chez eux la restauration ne fut pas consommée par des princes dont, après tout, l’intérêt était distinct de celui des anciens privilégiés, mais par les anciens privilégiés eux-mêmes…, elle y fut plus complète, plus aveugle et plus obstinée que dans le reste de l’Europe. Elle ne s’y montra pas tyrannique, mais très-exclusive. Un pouvoir législatif entièrement subordonné à la puissance exécutive ; celle-ci exclusivement possédée par l’aristocratie de naissance ; la classe moyenne exclue des affaires ; le peuple entier privé de la vie politique : tel est le spectacle que présente la Suisse dans presque toutes ses parties jusqu’en 1830.
C’est alors que s’ouvrit pour elle l’ère nouvelle de la démocratie !
Ce court exposé a eu pour but de bien faire comprendre deux choses :
La première, que la Suisse est un des pays de l’Europe où la révolution avait été la moins profonde, et la restauration qui la suivit la plus complète. De telle sorte que les institutions étrangères ou hostiles à l’esprit nouveau, y ayant conservé ou repris beaucoup d’empire, l’impulsion révolutionnaire dut s’y conserver plus grande.
La seconde, que dans la plus grande partie de la Suisse, le peuple, jusqu’à nos jours, n’avait jamais pris la moindre part au gouvernement ; que les formes judiciaires qui garantissent la liberté civile, la liberté d’association, la liberté de parole, la liberté de la presse, la liberté religieuse, avaient toujours été aussi, et je pourrais presque dire, plus inconnues à la grande majorité de ces citoyens des républiques, qu’elles pouvaient l’être, à la même époque, aux sujets de la plupart des monarchies.
[IV-368]
Voilà ce que M. Cherbuliez perd souvent de vue, mais ce qui doit être sans cesse présent à notre pensée, dans l’examen que nous allons faire avec soin des institutions que la Suisse s’est données.
Tout le monde sait qu’en Suisse la souveraineté est divisée en deux parts : d’un côté se trouve le pouvoir fédéral, de l’autre les gouvernements cantonaux.
M. Cherbuliez commence par parler de ce qui se passe dans les cantons, et il a raison ; car c’est là qu’est le véritable gouvernement de la société. Je le suivrai dans cette voie, et je n’occuperai comme lui des constitutions cantonales.
Toutes les constitutions cantonales sont aujourd’hui démocratiques ; mais la démocratie ne se montre pas dans toutes sous les mêmes traits.
Dans la majorité des cantons, le peuple a remis l’exercice de ses pouvoirs à des assemblées qui le représentent, et dans quelques-uns il l’a conservée pour lui-même. Il se réunit en corps et gouverne. M. Cherbuliez appelle le gouvernement des premiers des démocraties représentatives, et celui des autres démocraties pures.
Je demanderai à l’Académie la permission de ne pas suivre l’auteur dans l’examen très-intéressant qu’il fait des démocraties pures. J’ai plusieurs raisons pour agir ainsi. Quoique les cantons qui vivent sous la démocratie pure aient joué un grand rôle dans l’histoire, et puissent en jouer encore un considérable dans la politique, ils donneraient lieu à une étude curieuse plutôt qu’utile.
La démocratie pure est un fait à peu près unique dans le monde moderne et très-exceptionnel, même en Suisse, puisque le treizième seulement de la population est gouverné de cette-manière. C’est, de plus, un fait passager. [IV-369] On ne sait point assez que dans les cantons suisses, où le peuple a le plus conservé l’exercice du pouvoir, il existe un corps représentatif sur lequel il se repose en partie des soins du gouvernement. Or, il est facile de voir, en étudiant l’histoire récente de la Suisse, que graduellement les affaires dont s’occupe le peuple en Suisse sont en moins grand nombre, et qu’au contraire celles que traitent ses représentants deviennent chaque jour plus nombreuses et plus variées. Ainsi, le principe de la démocratie pure perd un terrain que gagne le principe contraire. L’un devient insensiblement l’exception, l’autre la règle.
Les démocraties pures de la Suisse appartiennent d’ailleurs à un autre âge ; elles ne peuvent rien enseigner quant au présent ni quant à l’avenir. Quoiqu’on soit obligé de se servir, pour les désigner, d’un nom pris à la science moderne, elles ne vivent que dans le passé. Chaque siècle a son esprit dominateur auquel rien ne résiste. Vient-il à s’introduire sous son règne des principes qui lui soient étrangers ou contraires, il ne tarde pas à les pénétrer, et, quand il ne peut pas les annuler, il se les approprie et se les assimile. Le moyen âge avait fini par façonner aristocratiquement jusqu’à la liberté démocratique. Au milieu des lois les plus républicaines, à côté du suffrage universel lui-même, il avait placé des croyances religieuses, des opinions, des sentiments, des habitudes, des associations, des familles qui se tenaient en dehors du peuple, le vrai pouvoir. Il ne faut considérer les petits cantons suisses que comme des gouvernements démocratiques au moyen âge. Ce sont les derniers et respectables débris d’un monde qui n’est plus.
Les démocraties représentatives de la Suisse sont, au contraire, filles de l’esprit moderne. Toutes se sont [IV-370] fondées sur les ruines d’une ancienne société aristocratique ; toutes procèdent du seul principe de la souveraineté du peuple ; toutes en ont fait une application presque semblable dans leurs lois.
Nous allons voir que ces lois sont très-imparfaites, et elles suffiraient seules pour indiquer, dans le silence de l’histoire, qu’en Suisse la démocratie et même la liberté sont des puissances nouvelles et sans expérience.
Il faut remarquer d’abord que, même dans les démocraties représentatives de la Suisse, le peuple a retenu dans ses mains l’exercice direct d’une partie de son pouvoir. Dans quelques cantons, après que les lois principales ont eu l’assentiment de la législature, elles doivent encore être soumises au veto du peuple. Ce qui fait dégénérer, pour ces cas particuliers, la démocratie représentative en démocratie pure.
Dans presque tous, le peuple doit être consulté de temps en temps, d’ordinaire à des époques rapprochées, sur le point de savoir s’il veut modifier ou maintenir la constitution. Ce qui ébranle à la fois et périodiquement toutes les lois.
Tous les pouvoirs législatifs que le peuple n’a pas retenus dans ses mains, il les a confiés à une seule assemblée, qui agit sous ses yeux et en son nom. Dans aucun canton, la législature n’est divisée en deux branches ; partout elle se compose d’un corps unique ; non-seulement ses mouvements ne sont pas ralentis par le besoin de s’entendre avec une autre assemblée, mais ses volontés ne rencontrent même pas l’obstacle d’une délibération prolongée. Les discussions des lois générales sont soumises à de certaines formalités qui les prolongent, mais les résolutions les plus importantes peuvent être proposées, discutées et [IV-371] admises en un moment, sous le nom de décrets. Les décrets font des lois secondaires quelque chose d’aussi important, d’aussi rapide et d’aussi irrésistible que les passions d’une multitude.
En dehors de la législature, il n’y a rien qui résiste. La séparation et surtout l’indépendance relative du pouvoir législatif, administratif et judiciaire en réalité n’existent pas.
Dans aucun canton, les représentants du pouvoir exécutif ne sont élus directement par le peuple. C’est la législature qui les choisit. Le pouvoir exécutif n’est donc doué d’aucune force qui lui soit propre. Il n’est que la création et ne peut jamais être que l’agent servile d’un autre pouvoir. À cette cause de faiblesse s’en joignent plusieurs autres. Nulle part le pouvoir exécutif n’est exercé par un seul homme. On le confie à une petite assemblée, où sa responsabilité se divise et son action s’exerce. Plusieurs des droits inhérents à la puissance exécutive lui sont d’ailleurs refusés. Il n’exerce point de véto ou n’en exerce qu’un insignifiant sur les lois. Il est privé du droit de faire grâce, il ne nomme ni ne destitue ses agents. On peut même dire qu’il n’a pas d’agents, puisqu’il est d’ordinaire obligé de se servir des seuls magistrats communs.
Mais c’est surtout par la mauvaise constitution et la mauvaise composition du pouvoir judiciaire que les lois de la démocratie suisse sont défectueuses. M. Cherbuliez le remarque, mais pas assez, à mon avis. Il ne semble pas lui-même bien comprendre que c’est le pouvoir judiciaire qui est principalement destiné, dans les démocraties, à être tout à la fois la barrière et la sauve-garde du peuple.
L’idée de l’indépendance du pouvoir judiciaire est une [IV-372] idée moderne. Le moyen âge ne l'avait point aperçue, ou du moins il ne l’avait jamais conçue que très-confusément. On peut dire que chez toutes les nations de l’Europe la puissance exécutive et la puissance judiciaire ont commencé par être mêlées ; en France même où, par une très-heureuse exception, la justice a eu de bonne heure une existence individuelle très-vigoureuse, il est encore permis d’affirmer que la division des deux puissances était restée fort incomplète. Ce n’était pas, il est vrai, l’administration qui retint dans ses mains la justice, ce fut la justice qui attira en partie dans son sein l’administration. La Suisse, au contraire, a été de tous les pays d'Europe celui peut-être où la justice s’est le plus confondue avec le pouvoir politique, et est devenue le plus complètement un de ses attributs. On peut dire que l’idée que nous avons de la justice de cette puissance impartiale et libre qui s’interpose entre tous les intérêts et entre tous les pouvoirs pour les rappeler souvent tous au respect de la loi, cette idée a toujours été absente de l’esprit des Suisses, et qu’elle n’y est encore aujourd’hui que très-incomplétement entrée.
Les nouvelles constitutions ont sans doute donné aux tribunaux une place plus séparée que celle qu’ils occupaient parmi les anciens pouvoirs, mais non une position plus indépendante. Les tribunaux inférieurs sont élus par le peuple et soumis à réélection ; le tribunal suprême de chaque canton est choisi non par le pouvoir exécutif, mais par la puissance législative, et rien ne garantit ses membres contre les caprices journaliers de la majorité.
Non-seulement le peuple ou l’assemblée qui le représente choisit les juges, mais ils ne s’imposent pour les choisir aucune gène. En général, il n’y a point de [IV-373] condition de capacité exigées. Le juge, d’ailleurs, simple exécuteur de la loi, n’a pas le droit de rechercher si cette loi est conforme à la constitution. À vrai dire, c’est la majorité elle-même qui juge par l’organe des magistrats.
En Suisse, d’ailleurs, le pouvoir judiciaire eût-il reçu de la loi l’indépendance et les droits qui lui sont nécessaires, le pouvoir aurait encore de la peine à jouer son rôle, car la justice est une puissance de tradition et d’opinion qui a besoin de s’appuyer sur des idées et des mœurs judiciaires.
Je pourrais aisément faire ressortir les défauts qui se rencontrent dans les institutions que je viens de décrire, et prouver qu’elles tendent toutes à rendre le gouvernement du peuple irrégulier dans sa marche, précipité dans ses résolutions et tyrannique dans ses actes. Mais cela me mènerait trop loin. Je me bornerai à mettre en regard de ces lois celles que s’est données une société démocratique plus ancienne, plus paisible et plus prospère. M. Cherbuliez pense que les institutions imparfaites que possèdent les cantons suisses, sont les seules que la démocratie puisse suggérer ou veuille souffrir. La comparaison que je vais faire prouvera le contraire, et montrera comment, du principe de la souveraineté du peuple on a pu tirer ailleurs, avec plus d’expérience, plus d’art et plus de sagesse, des conséquences différentes. Je prendrai pour exemple l’état de New-York, qui contient lui seul autant d’habitants que la Suisse entière.
Dans l’état de New-York, comme dans les cantons suisses, le principe du gouvernement est la souveraineté du peuple, mise en action par le suffrage universel. Mais le peuple n’exerce sa souveraineté qu’un seul jour, par le choix de ses délégués. Il ne retient habituellement pour [IV-374] lui-même, dans aucun cas, aucune partie quelconque de la puissance législative, exécutive ou judiciaire. Il choisit ceux qui doivent gouverner en son nom, et jusqu’à la prochaine élection il abdique.
Quoique les lois soient changeantes, leur fondement est stable. On n’a point imaginé de soumettre d'avance, comme en Suisse, la constitution à des révisions successives et périodiques dont la venue ou seulement l’attente tient le corps social en suspens. Quand un besoin nouveau se fait sentir, la législature constate qu’une modification de la constitution est devenue nécessaire, et la législature qui suit l’opère.
Quoique la puissance législative ne puisse pas plus qu’en Suisse se soustraire à la direction de l’opinion publique, elle est organisée de manière a résister à ses caprices. Aucune proposition ne peut devenir loi qu’après avoir été soumise à l’examen de deux assemblées. Ces deux parties de la législature sont élues de la même manière et composées des mêmes éléments ; toutes deux sortent donc également du peuple, mais elles ne le représentent pas exactement de la même manière : l’une est chargée surtout de reproduire ses impressions journalières, l’autre ses instincts habituels et ses penchants permanents.
À New-York, la division des pouvoirs n’existe pas seulement en apparence, mais en réalité.
La puissance exécutive est exercée, non par un corps, mais par un homme qui seul en porte toute la responsabilité et en exerce avec décision et avec force les droits et les prérogatives. Élu par le peuple, il n’est point, comme en Suisse, la créature et l’agent de la législature ; il marche son égal, il représente comme elle, quoique dans une autre sphère, le souverain au nom duquel l’un et l’autre [IV-375] agissent. Il tire sa force de la même source où elle puise la sienne. Il n’a pas seulement le nom du pouvoir exécutif, il en exerce les prérogatives naturelles et légitimes. Il est le commandant de la force armée, dont il nomme les principaux officiers ; il choisit plusieurs des grands fonctionnaires de l'État ; il exerce le droit de grâce, le véto qu’il peut opposer aux volontés de la législature, sans être absolu et pourtant efficace. Si le gouverneur de l’État de New-York est beaucoup moins puissant sans doute qu’un roi constitutionnel d’Europe, il l’est du moins infiniment plus qu’un petit conseil de la Suisse.
Mais c’est surtout dans l’organisation du pouvoir judiciaire que la différence éclate.
Le juge, quoiqu’il émane du peuple et dépende de lui, est une puissance à laquelle se soumet le peuple lui-même.
Le pouvoir judiciaire y tient cette position exceptionnelle de son origine, de sa permanence, de sa compétence, et surtout des mœurs publiques et de l’opinion.
Les membres des tribunaux supérieurs ne sont pas choisis, comme en Suisse, par la législature, puissance collective qui, souvent, est passionnée, quelquefois aveugle, et toujours irresponsable, mais par le gouverneur de l’État. Le magistrat une fois institué est considéré comme inamovible. Aucun procès ne lui échappe, aucune peine ne saurait être prononcée que par lui. Non-seulement il interprète la loi, on peut dire qu’il la juge ; quand la législature, dans le mouvement rapide des partis, s’écarte de l’esprit ou de la lettre de la constitution, les tribunaux l’y ramènent en refusant d’appliquer ses décisions ; de sorte que si le juge ne peut obliger le peuple à garder sa constitution, il le force du moins à la respecter tant qu’elle existe. Il ne le dirige point, mais il le contraint et le limite. [IV-376] Le pouvoir judiciaire, qui existe à peine en Suisse, est le véritable modérateur de la démocratie américaine.
Maintenant, qu’on examine cette constitution dans les moindres détails, on n’y découvrira pas un atome d’aristocratie. Rien qui ressemble à une classe, pas un privilège, partout les mêmes droits, tous les pouvoirs sortant du peuple et y retournant, un seul esprit animant toutes les institutions, nulles tendances qui se combattent : le principe de la démocratie a tout pénétré et domine tout. Et pourtant ces gouvernements si complètement démocratiques ont une assiette bien autrement stable, une allure bien plus paisible et des mouvements bien plus réguliers que les gouvernements démocratiques de la Suisse.
Il est permis de dire que cela vient en partie de la différence des lois.
Les lois de l’état de New-York, que je viens de décrire, sont disposées de manière à lutter contre les défauts naturels de la démocratie, les institutions suisses dont j’ai tracé le tableau semblent faites au contraire pour les développer. Ici elles retiennent le peuple, là elles le poussent. En Amérique, on a craint que son pouvoir ne fût tyrannique, tandis qu’en Suisse on semble n’avoir voulu que le rendre irrésistible.
Je ne m’exagère pas l’influence que peut exercer le mécanisme des lois sur la destinée des peuples. Je sais que ce sont à des causes plus générales et plus profondes qu’il faut principalement attribuer les grands événements de ce monde ; mais on ne saurait nier que les institutions n’aient une certaine vertu qui leur soit propre, et que par elles-mêmes elles ne contribuent à la prospérité ou aux misères des sociétés.
Si au lieu de repousser d’une manière absolue presque [IV-377] toutes les lois de son pays, M. Cherbuliez avait fait voir ce qu’elles ont de défectueux et comment on eût pu perfectionner leurs dispositions, sans altérer leur principe, il eût écrit un livre plus digne de la postérité et plus utile à ses contemporains.
Après avoir montré ce qu’est la démocratie dans les cantons, l’auteur recherche l’influence qu’elle exerce sur la confédération elle-même.
Avant de suivre M. Cherbuliez dans cette voie, il est nécessaire de faire ce qu’il n’a pas fait lui-même, de bien indiquer ce que c’est que le gouvernement fédéral, comment il est organisé en droit et en fait, et comment il fonctionne.
Il serait permis de se demander d’abord si les législateurs de la confédération suisse ont voulu faire une constitution fédérale on seulement établir une ligue, en d’autres termes, s’ils ont entendu sacrifier une portion de la souveraineté des cantons ou n’en aliéner aucune partie. Si l’on considère que les cantons se sont interdit plusieurs des droits qui sont inhérents à la souveraineté et qu’ils les ont concédés d’une manière permanente au gouvernement fédéral, si l’on songe surtout qu’ils ont voulu que dans les questions ainsi abandonnées à ce gouvernement la majorité fît loi, on ne saurait douter que les législateurs de la confédération suisse n’aient voulu établir une véritable constitution fédérale et non une simple ligue. Mais il faut convenir qu’ils s’y sont fort mal pris pour y réussir.
Je n’hésiterai pas à dire qu’à mon sens, la constitution fédérale de la Suisse est la plus imparfaite de toutes les constitutions de ce genre qui aient paru jusqu’ici dans le monde. On se croirait revenu, en la lisant, en plein moyen âge, et l’on ne saurait trop s’étonner en songeant que cette [IV-378] œuvre confuse et incomplète est le produit d’un siècle aussi savant et aussi expérimenté que le nôtre.
On répète souvent, et non sans raison, que le pacte a limité outre mesure les droits de la Confédération, qu’il a laissé en dehors de l’action du gouvernement qui la représente certains objets d’une nature essentiellement nationale, et qui naturellement devraient rentrer dans la compétence de la Diète : tels, par exemple, que l’administration des postes, le règlement des poids et mesures, la fabrication de la monnaie… Et l’on attribue la faiblesse du pouvoir fédéral au petit nombre d’attributions qui lui sont confiées.
Il est bien vrai que le pacte a laissé en dehors de la constitution du gouvernement de la Confédération plusieurs des droits qui reviennent naturellement et même nécessairement à ce gouvernement ; mais ce n’est pas là que réside la véritable cause de sa faiblesse, car les droits que le pacte lui a donnés lui suffiraient, s’il pouvait en faire usage, pour acquérir bientôt tous ceux qui lui manquent, ou, en tous cas, pour les conquérir.
La Diète peut rassembler des troupes, lever de l’argent, faire la guerre, accorder la paix, conclure les traités de commerce, nommer les ambassadeurs. Les constitutions cantonales et les grands principes d’égalité devant la loi sont mis sous sa sauvegarde, ce qui lui permettrait, au besoin, de s’immiscer dans toutes les affaires locales.
Les péages et les droits sur les routes, etc., sont réglés par la Diète, ce qui l’autorise à diriger ou à contrôler les grands travaux publics.
Enfin, la Diète, dit l’art. 4 du pacte, prend toutes les mesures nécessaires pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, ce qui lui donne la faculté de tout faire.
[IV-379]
Les gouvernements fédéraux les plus forts n’ont pas eu de plus grandes prérogatives, et, loin de croire qu’en Suisse la compétence du pouvoir central soit trop limitée, je suis porté à penser que ses bornes ne sont pas assez soigneusement posées.
D’où vient donc qu’avec de si beaux privilèges le gouvernement de la Confédération a, d’ordinaire, si peu de pouvoir ? La raison en est simple : C’est qu’on ne lui a pas donné les moyens de faire ce qu’on lui a concédé, le droit de vouloir.
Jamais gouvernement ne fut mieux retenu dans l’inertie et plus condamné à l’impuissance par l’imperfection de ses organes
Il est de l’essence des gouvernements fédéraux d’agir non pas au nom du peuple, mais au nom des états dont la Confédération se compose. S’il en était autrement, la constitution cesserait immédiatement d’être fédérale.
Il résulte de là, entre autres conséquences nécessaires et inévitables, que les gouvernements fédéraux sont habituellement moins hardis dans leurs résolutions et plus lents dans leurs mouvements que les autres.
La plupart des législateurs des confédérations se sont efforcés, à l’aide de procédés plus ou moins ingénieux, dans l’examen desquels je ne veux pas entrer, à corriger en partie ce vice naturel du système fédéral. Les Suisses l’ont rendu infiniment plus sensible que partout ailleurs, par les formes particulières qu’ils ont adoptées. Chez eux, non-seulement les membres de la diète n’agissent qu’au nom des différents cantons qu’ils représentent. mais ils ne prennent en général aucune résolution qui n’ait été prévue ou ne soit approuvée par ceux-ci. Presque rien n’est laissé à leur libre arbitre ; chacun d’eux se croit lié [IV-380] par un mandat impératif, imposé d’avance ; de telle sorte que la diète est une assemblée délibérante où, à vrai dire, on n’a aucun intérêt à délibérer, où l’on parle non pas devant ceux qui doivent prendre la résolution, mais devant ceux qui ont seulement le droit de l’appliquer. La diète est un gouvernement qui ne veut rien par lui-même, mais qui se borne à réaliser ce que vingt-deux autres gouvernements ont séparément voulu ; un gouvernement qui, quelle que soit la nature des événements, ne peut rien décider, rien prévoir, pourvoir à rien. On ne saurait imaginer une combinaison qui soit plus propre à accroître l’inertie naturelle du gouvernement fédéral, et à changer sa noblesse en une sorte de débilité sénile.
Il y a bien d’autres causes encore qui, indépendamment des vices inhérents a toutes constitutions fédérales, expliquent l’impuissance habituelle du gouvernement de la Confédération suisse.
Non-seulement la Confédération a un gouvernement débile, mais on peut dire qu’elle n’a pas de gouvernement qui lui soit propre. Sa constitution, sous ce rapport, est unique dans le monde. La Confédération met à sa tête des chefs qui ne la représentent pas. Le directoire, qui forme le pouvoir exécutif de la Suisse, est choisi non par la diète, encore moins par le peuple helvétique ; c’est un gouvernement de hasard que la Confédération emprunte tous les deux ans à Berne, à Zurich ou à Lucerne. Ce pouvoir élu par les habitants d’un canton pour diriger les affaires d’un canton, devient ainsi accessoirement la tête et le bras de tout le pays. Ceci peut assurément passer pour une des plus grandes curiosités politiques que l’histoire des lois humaines présente. Les effets d’un pareil état de choses sont toujours déplorables et souvent très-extraordinaires. [IV-381] Rien de plus bizarre, par exemple, que ce qui est arrivé en 1839. Cette année-là la diète siégeait à Zurich, et la Confédération avait pour gouvernement le directoire de l’État de Zurich. Survient à Zurich une révolution cantonale. Une insurrection populaire renverse les autorités constituées. La Diète se trouve aussitôt sans président, et la vie fédérale demeure suspendue jusqu’à ce qu’il plaise au canton de se donner d’autres lois et d’autres chefs. Le peuple de Zurich, en changeant son administration locale, avait sans le vouloir décapité la Suisse.
La Confédération eût-elle un pouvoir exécutif en propre, le gouvernement serait encore impuissant à se faire obéir, faute d’action directe et immédiate sur les citoyens. Cette cause de faiblesse est plus féconde à elle seule que toutes les autres ensemble ; mais, pour qu’elle soit bien comprise, il faut faire plus que de l’indiquer.
Un gouvernement fédéral peut avoir une sphère d’action assez limitée et être fort ; si dans cette sphère étroite il peut agir par lui-même, sans intermédiaire, comme le font les gouvernements ordinaires dans la sphère illimitée ou ils se meuvent ; s’il a ses fonctionnaires qui s’adressent directement à chaque citoyen, ses tribunaux qui forcent chaque citoyen de se soumettre à ses lois ; il se fait obéir aisément, parce qu’il n’a jamais que des résistances individuelles à craindre, et que toutes les difficultés qu’on lui suscite se terminent par des procès.
Un gouvernement fédéral peut au contraire avoir une sphère d’action très-vaste et ne jouir que d’une autorité très-faible et très-précaire, si, au lieu de s’adresser individuellement aux citoyens, il est obligé de s’adresser aux gouvernements cantonaux ; car si ceux-ci résistent, le pouvoir fédéral trouve aussitôt en face de lui moins un [IV-382] sujet qu’un rival, dont il ne peut avoir raison que par la guerre.
La puissance d’un gouvernement fédéral réside donc bien moins dans l’étendue des droits qu’on lui confère, que dans la faculté plus ou moins grande qu’on lui laisse de les exercer par lui-même : il est toujours fort quand il peut commander aux citoyens ; il est toujours faible quand il est réduit à ne commander qu’aux gouvernements locaux.
L’histoire des confédérations présente des exemples de ces deux systèmes. Mais, dans aucune confédération, que je sache, le pouvoir central n’a été aussi complétement privé de toute action directe sur les citoyens qu’en Suisse. Là, il n’y a, pour ainsi dire, pas un de ses droits que le gouvernement fédéral puisse exercer par lui-même. Point de fonctionnaires qui ne relèvent que de lui, point de tribunaux qui représentent exclusivement sa souveraineté. On dirait un être auquel on aurait donné la vie, mais qu’on aurait privé d’organes.
Telle est la constitution fédérale ainsi que le pacte l’a faite. Voyons maintenant, en peu de mots, avec l'auteur du livre que nous analysons, quelle influence exerce sur elle la démocratie.
On ne saurait nier que les révolutions démocratiques qui ont successivement changé presque toutes les constitutions cantonales, depuis quinze ans n’aient eu sur le gouvernement fédéral une grande influence ; mais cette influence s’est énervée en deux sens fort opposés. Il est très-nécessaire de se rendre bien compte de ce double phénomène.
Les révolutions démocratiques qui ont eu lieu dans les cantons ont eu pour effet de donner à l’existence locale [IV-383] plus d’activité et de puissance. Les gouvernements nouveaux, créés par ces révolutions, s’appuyant sur le peuple, et, poussés par lui, se sont trouvé tout à la fois une force plus grande et une idée plus haute de leur force que ne pouvaient en montrer les gouvernements qu’ils avaient renversés. Et comme une rénovation semblable ne s’était point faite en même temps dans le gouvernement fédéral, il devait en résulter, et il en résulta en effet, que celui-ci se trouva comparativement plus débile vis-à-vis ceux-là qu’il ne l’avait été auparavant. L’orgueil cantonal, l’instinct de l’indépendance locale, l’impatience de tout contrôle dans les affaires intérieures de chaque canton, la jalousie contre une autorité centrale et suprême, sont autant de sentiments qui se sont accrus depuis l'établissement de la démocratie ; et, a ce point de vue, l’on peut dire qu’elle a affaibli le gouvernement déjà si faible de la Confédération, et il a rendu sa tâche journalière et habituelle plus laborieuse et plus difficile.
Mais, sous d’autres rapports. elle lui a donné une énergie, et pour ainsi dire une existence qu’il n’avait pas.
L’établissement des institutions démocratiques en Suisse a amené deux choses entièrement nouvelles.
Jusqu’alors, chaque canton avait un intérêt à part, un esprit à part. L’avénement de la démocratie a divisé tous les Suisses, à quelques cantons qu’ils appartinssent, en deux partis : l’un, favorable aux principes démocratiques ; l’autre, contraire. Il a créé des intérêts communs, des idées, des passions communes qui ont senti pour se satisfaire le besoin d’un pouvoir général et commun qui s’étendit en même temps sur tout le pays. Le gouvernement fédéral a ainsi possédé, pour la première fois, une grande force dont il avait toujours manqué ; il a pu s’appuyer sur [IV-384] un parti ; force dangereuse, mais indispensable dans les pays libres, où le gouvernement ne peut presque rien sans elle.
En même temps que la démocratie divisait la Suisse en deux partis, elle rangeait la Suisse dans l’un des grands partis qui se partagent le monde ; elle lui créait une politique extérieure ; si elle lui donnait des amitiés naturelles, elle lui créait des inimitiés nécessaires ; pour cultiver et contenir les unes, surveiller et repousser les autres, elle lui faisait sentir le besoin irrésistible d’un gouvernement. À l’esprit public local elle faisait succéder un esprit public national.
Tels sont les effets directs par lesquels elle fortifiait le gouvernement fédéral. L’influence indirecte qu’elle a exercée et exercera surtout, à la longue, n’est pas moins grande.
Les résistances et les difficultés qu’un gouvernement fédéral rencontre sont d’autant plus multiples et plus fortes, que les populations confédérées sont plus dissemblables par leurs institutions, leurs sentiments, leurs coutumes et leurs idées. C’est moins encore la similitude des intérêts que la parfaite analogie des lois, des opinions et des conditions sociales, qui rendent la tâche du gouvernement de l’Union américaine si facile. On peut dire de même que l'étrange faiblesse de l’ancien gouvernement fédéral en Suisse était due principalement à la prodigieuse différence et à la singulière opposition qui existait entre l’esprit, les vues et les lois des différentes populations qu’il avait à régir. Maintenir sous une même direction et renfermer dans une même politique des hommes si naturellement éloignés, et si dissemblables les uns des autres, était l’œuvre la plus laborieuse. Un gouvernement [IV-385] beaucoup mieux constitué, et pourvu d’une organisation plus savante, n’y aurait pas réussi. L’effet de la révolution démocratique qui s’opère en Suisse est de faire prévaloir successivement dans tous les cantons certaines institutions, certaines maximes de gouvernement, certaines idées semblables ; si la révolution démocratique augmente l’esprit d’indépendance des cantons vis-à-vis du pouvoir central, elle facilite, d’un autre côté, l’action de ce pouvoir ; elle supprime, en grande partie, les causes de résistance, et, sans donner aux gouvernements cantonaux plus d’envie d’obéir au gouvernement fédéral, elle leur rend l’obéissance à ses volontés infiniment plus aisée.
Il est nécessaire d’étudier avec grand soin les deux effets contraires que je viens de décrire, pour comprendre l’état présent et prévoir l’état prochain du pays.
C’est en ne faisant attention qu’à l’une de ces deux tendances qu’on est induit à croire que l’avènement de la démocratie dans les gouvernements cantonaux aura pour effet immédiat et pour résultat facile d’étendre législativement la sphère du gouvernement fédéral, de concentrer dans ses mains la direction habituelle des affaires locales ; en un mot, de modifier, dans le sens de la centralisation, toute l’économie du pacte. Je suis convaincu, pour ma part, qu’une telle révolution rencontrera encore, pendant longtemps, plus d’obstacles qu’on ne le suppose. Les gouvernements cantonaux d’aujourd’hui ne montreront pas beaucoup plus de goût que leurs prédécesseurs pour une révolution de cette espèce, et ils feront tout ce qu’ils pourront pour s’y soustraire.
Je pense toutefois que, malgré ces résistances, le gouvernement fédéral est destiné à prendre de jour en jour plus de pouvoir en cela. Les circonstances le serviront [IV-386] plus que les lois. Il n’accroîtra peut-être pas très-visiblement ses prérogatives, mais il en fera un autre et plus fréquent usage. Il grandira beaucoup en fait, restât-il le même en droit ; il se développera plus par l’interprétation que par le changement du pacte, et il dominera la Suisse avant d’être en état de la gouverner.
On peut prévoir également que ceux mêmes qui jusqu’à présent se sont le plus opposés à son extension régulière, ne tarderont pas à la désirer, soit pour échapper à la pression intermittente d’un pouvoir si mal constitué, soit pour se garantir de la tyrannie plus prochaine et plus pesante des gouvernements locaux.
Ce qu’il y a de certain, c’est que désormais, quelles que soient les modifications apportées à la lettre du pacte, la constitution fédérale de la Suisse est profondément et irrévocablement altérée. La Confédération a changé de nature. Elle est devenue en Europe une chose nouvelle ; une politique d’action a succédé pour elle à une politique d’inertie et de neutralité ; de purement municipale son existence est devenue nationale ; existence plus laborieuse, plus troublée, plus précaire et plus grande.
A. DE TOCQUEVILLE,
Membre de l’institut.
Notes volume 4↩
[1] (↑) Pour sentir l’à-propos de cette dernière plaisanterie, il faut se rappeler que Mme de Grignan était gouvernante de Provence.
[2] (↑) Si l’on vient à examiner de près et dans le détail les opinions principales qui dirigent ces hommes, l’analogie paraît plus frappante encore, et l’on s’étonne de retrouver parmi eux, aussi bien que parmi les membres les plus altiers d’une hiérarchie féodale, l’orgueil de la naissance, le respect pour les aïeux et les descendants, le mépris de l’inférieur, la crainte du contact, le goût de l’étiquette, des traditions et de l’antiquité.
[3] (↑) Les Américains n’ont point encore imaginé cependant, comme nous l’avons fait en France, d’enlever aux pères l’un des principaux éléments de la puissance, en leur ôtant leur liberté de disposer après la mort de leurs biens. Aux États-Unis, la faculté de tester est illimitée.
En cela, comme dans presque tout le reste, il est facile de remarquer que, si la législation politique des Américains est beaucoup plus démocratique que la nôtre, nôtre législation civile est infiniment plus démocratique que la leur. Cela se conçoit sans peine.
Notre législation civile a eu pour auteur un homme qui voyait son intérêt à satisfaire les passions démocratiques de ses contemporains dans tout ce qui n’était pas directement et immédiatement hostile à son pouvoir. Il permettait volontiers que quelques principes populaires régissent les biens et gouvernassent les familles, pourvu qu’on ne prétendît pas les introduire dans la direction de l’État. Tandis que le torrent démocratique déborderait sur les lois civiles, il espérait se tenir aisément à l’abri derrière les lois politiques. Cette vue est à la fois pleine d’habileté et d’égoïsme ; mais un pareil compromis ne pouvait être durable. Car à la longue, la société politique ne saurait manquer de devenir l’expression et l’image de la société civile ; et c’est dans ce sens qu’on peut dire qu’il n’y a rien de plus politique chez un peuple que la législation civile.
[4] (↑) Il est aisé de se convaincre de cette vérité en étudiant les différentes littératures de l’Europe.
Lorsqu’un Européen veut retracer dans ses fictions quelques-unes des grandes catastrophes qui se font voir si souvent parmi nous, au sein du mariage, il a soin d’exciter d’avance la pitié du lecteur en lui montrant des êtres mal assortis ou contraints. Quoique une longue tolérance ait depuis longtemps relâché nos mœurs, il parviendrait difficilement à nous intéresser aux malheurs de ces personnages s’il ne commençait par faire excuser leur faute. Cet artifice ne manque guère de réussir. Le spectacle journalier dont nous sommes témoins nous prépare de loin à l’indulgence.
Les écrivains américains ne sauraient rendre aux yeux de leurs lecteurs de pareilles excuses vraisemblables ; leurs usages, leurs lois, s’y refusent et, désespérant de rendre le désordre aimable, ils ne le peignent point. C’est, en partie, à cette cause qu’il faut attribuer le petit nombre de romans qui se publient aux États-Unis.
[5] (↑) Le mot honneur n’est pas toujours pris dans le même sens en français.
1º Il signifie d’abord l’estime, la gloire, la considération qu’on obtient de ses semblables : c’est dans ce sens qu’on dit conquérir de l’honneur ;
2º Honneur signifie encore l’ensemble des règles, à l’aide desquelles on obtient cette gloire, cette estime et cette considération. C’est ainsi qu’on dit qu’un homme s’est toujours conformé strictement aux lois de l’honneur ; qu’il a forfait à l’honneur. En écrivant le présent chapitre, j’ai toujours pris le mot honneur dans ce dernier sens.
[6] (↑) Le mot patrie lui-même ne se rencontre dans les auteurs français qu’à partir du seizième siècle.
[7] (↑) Je parle ici des Américains qui habitent les pays où l’esclavage n’existe pas. Ce sont les seuls qui puissent présenter l’image complète d’une société démocratique.
[8] (↑) Si je recherche quel est l’état de société le plus favorable aux grandes révolutions de l’intelligence, je trouve qu’il se rencontre quelque part entre l’égalité complète de tous les citoyens et la séparation absolue des classes.
Sous le régime des castes, les générations se succèdent sans que les hommes changent de place ; les uns n’attendent rien de plus, et les autres n’espèrent rien de mieux. L’imagination s’endort au milieu de ce silence et de cette immobilité universelle, et l’idée même du mouvement ne s’offre plus à l’esprit humain.
Quand les classes ont été abolies et que les conditions sont devenues presque égales, tous les hommes s’agitent sans cesse, mais chacun d’eux est isolé, indépendant et faible. Ce dernier état diffère prodigieusement du premier ; cependant, il lui est analogue en un point. Les grandes révolutions de l’esprit humain y sont fort rares.
Mais entre ces deux extrémités de l’histoire des peuples, se rencontre un âge intermédiaire, époque glorieuse et troublée, où les conditions ne sont pas assez fixes pour que l’intelligence sommeille, et où elles sont assez inégales pour que les hommes exercent un très-grand pouvoir sur l’esprit les uns des autres, et que quelques uns puissent modifier les croyances de tous. C’est alors que les puissant réformateurs s’élèvent, et que de nouvelles idées changent tout à coup la face du monde.
[9] (↑) La position de l’officier est, en effet, bien plus assurée chez les peuples démocratiques que chez les autres. Moins l’officier est par lui-même, plus le grade a comparativement de prix, et plus le législateur trouve juste et nécessaire d’en assurer la jouissance.
[10] (↑) La crainte que les peuples européens montrent de la guerre ne tient pas seulement au progrès qu’a fait chez eux l’égalité ; je n’ai pas besoin, je pense, de le faire remarquer au lecteur. Indépendamment de cette cause permanente, il y en a plusieurs accidentelles qui sont très-puissantes. Je citerai, avant toutes les autres, la lassitude extrême que les guerres de la révolution et de l’empire ont laissée.
[11] (↑) Cela ne vient pas uniquement de ce que ces peuples ont le même état social, mais de ce que ce même état social est tel qu’il porte naturellement les hommes à s’imiter et à se confondre.
Lorsque les citoyens sont divisés en castes et en classes, non seulement ils diffèrent les uns des autres, mais ils n’ont ni le goût ni le désir de se ressembler ; chacun cherche, au contraire, de plus en plus, à garder intactes ses opinions et ses habitudes propres et à rester soi. L’esprit d’individualité est très-vivace.
Quand un peuple a un état social démocratique, c’est-à-dire qu’il n’existe plus dans son sein de castes ni de classes, et que tous les citoyens y sont à peu près égaux en lumières et en biens, l’esprit humain chemine en sens contraire. Les hommes se ressemblent, et de plus ils souffrent, en quelque sorte, de ne pas se ressembler. Loin de vouloir conserver ce qui peut encore singulariser chacun d’eux, ils ne demandent qu’à le perdre pour se confondre dans la masse commune, qui seule représente à leurs yeux le droit et la force. L’esprit d’individualité est presque détruit.
Dans les temps d’aristocratie, ceux mêmes qui sont naturellement pareils aspirent à créer entre eux des différences imaginaires. Dans les temps de démocratie, ceux mêmes qui naturellement ne se ressemblent pas ne demandent qu’à devenir semblables et se copient, tant l’esprit de chaque homme est toujours entraîné dans le mouvement général de l’humanité.
Quelque chose de semblable se fait également remarquer de peuple à peuples. Deux peuples auraient le même état social aristocratique, qu’ils pourraient rester fort distincts et très-différents, parce que l’esprit de l’aristocratie est de s’individualiser. Mais deux peuples voisins ne sauraient avoir un même état social démocratique, sans adopter aussitôt des opinions et des mœurs semblables, parce que l’esprit de démocratie fait tendre les hommes à s’assimiler.
[12] (↑) Il est bien entendu que je parle ici des nations démocratiques uniques, et non point des nations démocratiques confédérées. Dans les confédérations, le pouvoir prépondérant résidant toujours, malgré les fictions, dans les gouvernements d’état et non dans le gouvernement fédéral, les guerres civiles ne sont que des guerres étrangères déguisées.
[13] (↑) Dans les sociétés démocratiques, il n’y a que le pouvoir central qui ait quelque stabilité dans son assiette et quelque permanence dans ses entreprises. Tous les citoyens remuent sans cesse et se transforment. Or, il est dans la nature de tout gouvernement de vouloir agrandir continuellement sa sphère. Il est donc bien difficile qu’à la longue celui-ci ne parvienne pas à réussir, puisqu’il agit avec une pensée fixe et une volonté continue sur des hommes dont la position, les idées et les désirs varient tous les jours.
Souvent il arrive que les citoyens travaillent pour lui sans le vouloir.
Les siècles démocratiques sont des temps d’essais, d’innovations et d’aventures. Il s’y trouve toujours une multitude d’hommes qui sont engagés dans une entreprise difficile ou nouvelle qu’ils poursuivent à part, sans s’embarrasser de leurs semblables. Ceux-là admettent bien, pour principe général, que la puissance publique ne doit pas intervenir dans les affaires privées ; mais, par exception, chacun d’eux désire qu’elle l’aide dans l’affaire spéciale qui le préoccupe et cherche à attirer l’action du gouvernement de son côté, tout en voulant la resserrer de tous les autres. Une multitude de gens ayant à la fois sur une foule d’objets différents cette vue particulière, la sphère du pouvoir central s’étend insensiblement de toutes parts, bien que chacun d’eux souhaite de la restreindre.
Un gouvernement démocratique accroît donc ses attributions par le seul fait qu’il dure. Le temps travaille par lui ; tous les accidents lui profitent ; les passions individuelles l’aident à leur insu même, et l’on peut dire qu’il devient d’autant plus centralisé que la société démocratique est plus vieille.
[14] (↑) Cet affaiblissement graduel de l’individu en face de la société, se se manifeste de mille manières. Je citerai entre autres ce qui à rapport aux testaments.
Dans les pays aristocratiques, on professe d’ordinaire un profond respect pour la dernière volonté des hommes. Cela allait même quelquefois, chez les anciens peuples de l’Europe, jusqu’à la superstition : le pouvoir social, loin de gêner les caprices du mourant, prêtait aux moindres d’entre eux sa force ; il lui assurait une puissance perpétuelle.
Quand tous les vivants sont faibles, la volonté des morts est moins respectée. On lui trace un cercle très-étroit, et si elle vient à en sortir, le souverain l’annule ou la contrôle. Au moyen âge, le pouvoir de tester n’avait, pour ainsi dire, point de bornes. Chez les Français de nos jours, on ne saurait distribuer son patrimoine entre ses enfants, sans que l’état intervienne. Après avoir régenté la vie entière, il veut encore en régler le dernier acte.
[15] (↑) À mesure que les attributions du pouvoir central augmentent, le nombre des fonctionnaires qui le représentent s’accroît. Ils forment une nation dans chaque nation ; et comme le gouvernement leur prête sa stabilité, ils remplacent de plus en plus chez chacune d’elles l’aristocratie.
Presque partout en Europe, le souverain domine de deux manières : il mène une partie des citoyens par la crainte qu’ils éprouvent de ses agents, et l’autre par l’espérance qu’ils conçoivent de devenir ses agents.
[16] (↑) D’une part, le goût du bien-être augmente sans cesse, et le gouvernement s’empare de plus en plus de toutes les sources du bien-être.
Les hommes vont donc par deux chemins divers vers la servitude. Le goût du bien-être les détourne de se mêler du gouvernement, et l’amour du bien-être les met dans une dépendance de plus en plus étroite des gouvernants.
[17] (↑) On fait à ce sujet en France un singulier sophisme. Lorsqu’il vient à naître un procès entre l’administration et un particulier, on refuse d’en soumettre l’examen au juge ordinaire, afin, dit-on, de ne point mêler le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire. Comme si ce n’était pas mêler ces deux pouvoirs, et les mêler de la façon la plus périlleuse et la plus tyrannique, que de revêtir le gouvernement du droit de juger et d’administrer tout à la fois.
[18] (↑) Je citerai à l’appui de ceci quelques faits. C’est dans les mines que se trouvent les sources naturelles de la richesse industrielle. À mesure que l’industrie s’est développée en Europe, que le produit des crimes est devenu un intérêt plus général et leur bonne exploitation plus difficile par la division des biens que l’égalité amène, la plupart des souverains ont réclamé le droit de posséder le fonds des mines et d’en surveiller les travaux ; ce qui ne s’était point vu pour les propriétés d’une autre espèce.
Les mines, qui étaient des propriétés individuelles soumises aux mêmes obligations et pourvues des mêmes garanties que les autres biens immobiliers, sont ainsi tombées dans le domaine public. C’est l’état qui les exploite ou qui les concède ; les propriétaires sont transformés en usagers ; ils tiennent leurs droits de l’état, et, de plus, l’état revendique, presque partout, le pouvoir de les diriger ; il leur trace des règles, leur impose des méthodes, les soumet à une surveillance habituelle, et, s’ils lui résistent, un tribunal administratif les dépossède ; et l’administration publique transporte à d’autres leurs privilèges ; de sorte que le gouvernement ne possède pas seulement les mines, il tient tous les mineurs sous sa main.
Cependant, à mesure que l’industrie se développe, l’exploitation des anciennes mines augmente. On en ouvre de nouvelles. La population des mines s’étend et grandit. Chaque jour, les souverains étendent sous nos pieds leur domaine et le peuplent de leurs serviteurs.