
GUSTAVE DE MOLINARI,
Les Lois naturelles de l'économie politique (1887)
 |
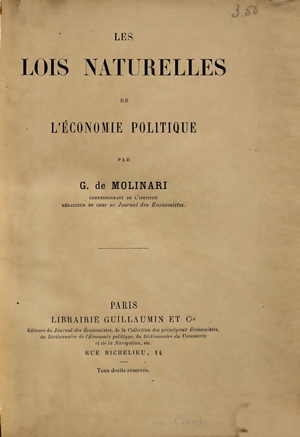 |
| Gustave de Molinari (1819-1912) |
[Created: 29 May, 2024]
[Updated: 29 May, 2024] |
The Guillaumin Collection
 |
This title is part of “The Guillaumin Collection” within “The Digital Library of Liberty and Power”. It has been more richly coded and has some features which other titles in the library do not have, such as the original page numbers, formatting which makes it look as much like the original text as possible, and a citation tool which makes it possible for scholars to link to an individual paragraph which is of interest to them. These titles are also available in a variety of eBook formats for reading on portable devices. |
Source
, Les Lois naturelles de l'économie politique (Paris: Guillaumin, 1887).http://davidmhart.com/liberty/FrenchClassicalLiberals/Molinari/Books/1887-LoisNaturelles/index.html
Gustave de Molinari, Les Lois naturelles de l'économie politique (Paris: Guillaumin, 1887).
This title is also available in a facsimile PDF of the original and various eBook formats - HTML, PDF, and ePub.
This book is part of a collection of works by Gustave de Molinari (1819-1912).
TABLE DES MATIERES
- PRÉFACE, V
- PREMIÈRE PARTIE. Les lois naturelles.
- CHAPITRE Ier. — La valeur et la loi de l'économie des forces. 1
- II. — La production de la valeur et l'organisation naturelle des entreprises 5
- III. — La concurrence et ses effets sur la production. 16
- IV. — La production est-elle anarchique? La loi naturelle de l'échange 18
- V — La distribution de la richesse. Comment elle est réglée par la loi de l’échange. 26
- DEUXIÈME PARTIE. Les causes de perturbation.
- CHAPITRE Ier. — Les obstacles provenant de l'homme. Le vol, le monopole et l'usure 33
- II — Les effets de la tendance au vol. Nécessité et raison d'être des gouvernements. 41
- III. — L'incapacité de se gouverner soi-même. La tutelle 46
- IV. — Le capital. Les mobiles qui déterminent sa formation 52
- V. — Le capital. Les obstacles à sa formation. 60
- VI. — Les obstacles provenant du milieu. L'instabilité des rendements de la production. 72
- VII. — Les progrès de la machinerie de la production 76
- VIII. — Le rétablissement naturel de: l'ordre économique 79
- TROISIÈME PARTIE. L’évolution économique. — Formes et transformations de la concurrence.
- CHAPITRE Ier. — La concurrence animale. 87
- II. — La concurrence politique. La constitution des États. 91
- III. — Los progrès déterminés par la concurrence politique. 104
- IV. — Comment est née et s'est développée la concurrence industrielle 113
- V. — Comment les marchés isolés se sont agrandis et ont tendu à. s’unifier. 118
- VI. — Conclusion. Résultats de l'opération de la concurrence industrielle, libre et illimitée. 133
- QUATRIEME PARTIE. La servitude politique.
- CHAPITRE Ier. — La guerre 139
- II. — La servitude politique. Sa raison d'être et ses freins dans le passé. 146
- III. — L'affaiblissement du risque de guerre. Ses conséquences. 150
- IV. —- La lutte pour la possession du pouvoir. Les révolutions et leurs résultats 155
- V. — L'affaiblissement du frein de la concurrence politique. Ses effets eu Russie, dans les États germaniques et en Italie. 161
- VI. — L'affaiblissement du frein de la concurrence politique en Angleterre et aux États-Unis 171
- VII — Insignifiance des fermes de gouvernement. Accroissement progressif du poids du gouvernement dans les États modernes. 182
- VIII. —Comment les classes gouvernantes maintiennent leur prépondérance. Les impôts indirects. Le patriotisme et l'enseignement officiel. 191
- IX. — Le malaise et lo mécontentement. Le pessimisme 203
- X. — Le protectionnisme. 206
- XI. — Le socialisme. 218
- XII. — Les contrepoids artificiels. Pourquoi la guerre devient impossible. 225
- XIII. — L'abolition de la servitude politique est-elle possible? En quoi consistait la servitude économique? La concurrence et la constitution naturelle de l'industrie. 238
- XIV. — La constitution naturelle des gouvernements. La commune. La province. L'État. 245
- XV. — La liberté de gouvernement. 260
- XVI. — La tutelle imposée et la tutelle libre. 269
- XVII. — Comment la servitude politique pourra être abolie. 272
- RÉSUMÉ ET CONCLUSION. 278
- APPENDICE
- I. — La guerre civile du capital et du travail. Causes et remèdes. 295
- II. — Le marchandage. Projet d'une Société à bénéfices limités pour le placement des ouvriers. 307
- III. — Projet d'émancipation des esclaves au Brésil. 320
- IV. — Tableau des dépenses et des dettes des États européens en 1885. 330
- NOTES
PRÉFACE↩
[vii]
Dans une série d'ouvrages publiés depuis quarante ans [1] , nous avons entrepris de démontrer, à l'exemple de nos devanciers, les économistes du XVIIIe siècle, que l'existence de l'homme, la constitution des sociétés et le développement de la civilisation sont gouvernés par des « lois naturelles ». Cette démonstration, nous venons de la résumer et de la compléter, sans nous dissimuler qu'elle est en opposition avec la tendance générale des esprits. L'étatisme, le protectionnisme et le socialisme, fondés sur la négation des lois naturelles, sont aujourd’hui [viii] plus que jamais en vogue, et ils sont destinés, selon toute apparence, à fournir encore une longue carrière. L'expérience finira sans doute et quoi qu'il arrive, par en faire justice. Mais, comme le remarquait Franklin, l'expérience tient une école dont les leçons coûtent cher ; la science travaille à meilleur marché. C'est pourquoi, en admettant qu'il contienne quelque parcelle de vérité, ce livre couvrira amplement ses frais.
PREMIERE PARTIE.
LES LOIS NATURELLES
[1]
CHAPITRE PREMIER.
LA VALEUR ET LA LOI DE L'ÉCONOMIE DES FORCES.↩
Le premier phénomène naturel que nous rencontrons au seuil de l'économie politique, c'est le phénomène de la création de la « valeur ». Créer de la valeur, voilà l'objet que se proposent toutes les entreprises de production, petites ou grandes, et quelle que soit leur nature. La valeur créée, on la consomme soit directement soit indirectement, après avoir échangé les produits ou les services dans lesquels elle est investie. A mesure que l'industrie progresse, que la division du travail se développe, la valeur se consomme de moins en moins directement, de plus en plus après échange. Considérons une société civilisée, quel spectacle frappera nos regards? Nous verrons la multitude occupée à créer de [2] la valeur, en façonnant des produits ou des services d'une infinie diversité, échanger ces produits ou ces services en raison de la quantité de valeur qu'ils contiennent, puis consommer cette valeur, en appliquant à la satisfaction de ses besoins matériels ou moraux les choses dans lesquelles elle est investie. Nous verrons encore de nombreuses individualités, isolées ou associées, tantôt en recourant à la force, tantôt en se servant de combinaisons variées, les unes condamnées, les autres sanctionnées par la loi, s'efforcer de s'emparer de la valeur créée par autrui. Qu'est-ce donc que la valeur? C'est une puissance d'une espèce particulière, une puissance économique.
La nature de ce pouvoir dérive de celle de l'homme lui-même, qui en est la source. L'homme est un composé de forces et de matière vivantes; ces forces et cette matière, il est obligé de les entretenir et de les renouveler incessamment par l'assimilation d'éléments puisés dans le milieu où il vit et qui contiennent ou sont susceptibles d'acquérir un pouvoir de réparation et d'extension de ses forces, d'entretien et d'expansion de sa vie. Quand ce pouvoir est fourni gratuitement par la nature, c'est-à-dire sans que l'homme soit obligé de faire aucune dépense de forces pour se le procurer, on dit simplement des choses qui le contiennent, qu'elles sont utiles ou pourvues d'utilité; quand, au contraire, il doit être créé par l'homme lui-même, on dit dés choses qui le contiennent qu'elles ont de la valeur.
Comment l'homme crée-t-il la valeur? par le travail. En quoi consiste le travail? En une dépense de forces ou [3] de puissance vitale. Ainsi donc quand la nature ne fournit pas gratis à L'homme les pouvoirs nécessaires à l'entretien et à l'expansion de sa vie, il est obligé de les produire, et il ne peut les produire qu'en dépensant une portion de sa force ou de sa puissance vitale. Qu'en faut-il conclure? C'est que la valeur est composée de deux éléments : un pouvoir dépensé et un pouvoir acquis, un pouvoir producteur et un pouvoir réparateur. Telle est la constitution naturelle de la valeur, constitution qu'il ne dépend pas plus de l'homme de modifier qu'il ne dépend de lui de changer la composition de l'eau ou celle de l'air.
La composition de la valeur étant connue, il reste à étudier ses propriétés, qui sont de diverses sortes. La valeur est mesurable, échangeable, accumulable et appropriable. Elle est susceptible d'augmentation ou de diminution; elle peut se conserver d'une manière indéfinie, grâce à son échangeabilité, ou être détruite au moment même où elle se produit. A mesure que l'organisme économique de la société humaine se développe et se perfectionne, ces propriétés naturelles de la valeur deviennent plus visibles, et on peut mieux apprécier l'importance de leur rôle. Sans l'appropriabilité et la mensurabilité de la valeur l'association des forces productives et la distribution des produits seraient impossibles ; il en serait de même de la division du travail, de la capitalisation et du crédit si la valeur n'était pas échangeable et accumulable; enfin si l'ordre s'établit naturellement dans là production et la distribution des choses nécessaires à l'homme, c'est grâce à la [4] propriété de la valeur d'augmenter ou de diminuer, de hausser ou de baisser. -
Si maintenant nous observons l'homme, qui produit la valeur et qui la consomme, nous constaterons un autre phénomène naturel : c'est que toute dépense de sa puissance vitale, tout travail est accompagné d'une peine, d'une souffrance, tandis que toute consommation d'un pouvoir réparateur de ses forces ou.de sa puissance vitale est accompagnée d'une jouissance; d'où il suit que toute valeur contient à la fois une certaine somme de peine subie et une certaine somme de jouissance possible. De là une loi naturelle qui gouverne la production de toutes les choses matérielles ou immatérielles, pourvues de valeur : la loi de l'économie des forces, en vertu de laquelle tout producteur s'efforce d'obtenir la somme la plus considérable du pouvoir réparateur contenu dans la valeur, en échange de la moindre dépense du pouvoir producteur et qui dérive de la tendance naturelle de l'homme à diminuer ses peines et à augmenter ses jouissances.
[5]
CHAPITRE II.
LA PRODUCTION DE LA VALEUR ET L'ORGANISATION NATURELLE DES ENTREPRISES.↩
Si nous étudions le phénomène de la production tel qu'il s'est manifesté de tout temps et tel qu'il apparaît à nos yeux dans la multitude des branches de l'activité humaine, que trouverons-nous? Nous trouverons que la production s'opère invariablement sous forme d'entreprises et qu'elle a pour objet la création d'une quantité quelconque de valeur. Sans doute, quand nous voyons en oeuvre une entreprise de production, qu'il s'agisse d'un article nécessaire à l'alimentation, au vêtement, au logement, à la locomotion, ou d'un service nécessaire à la sécurité, à l'instruction, à l'amusement, etc., nous n'apercevons que ces produits ou ces services; mais si nous considérons le but que se proposent ceux qui les produisent, nous constaterons uniformément que ce but est de créer la plus grande somme possible de valeur en échange de la moindre dépense de forces productives. S'ils se portent dans une industrie plutôt que dans une autre, c'est à cette considération qu'ils obéissent, et telle est la première loi générale et naturelle [6] qui gouverne le phénomène de la production.
Si nous considérons maintenant de quelle façon s'accomplit l'oeuvre de la production, nous nous trouverons en présence d'agents productifs de diverse sorte, associés dans des proportions diverses aussi, selon la nature du produit ou du service qu'il s'agit de créer. C'est d'abord un personnel dirigeant, ayant les aptitudes, les connaissances et l'expérience nécessaires pour entreprendre l'oeuvre productive et la mener à bien; c'est ensuite le personnel auxiliaire et subordonné, chargé de l'exécution; c'est enfin le matériel d'agents et d'éléments extérieurs qu'il s'agit de mettre en oeuvre, de façonner ou de transformer ou dont il s'agit d'extraire un produit : c'est la terre, ce sont les bâtiments d'exploitation, lés outils, les machines, les matières premières, etc. C'est encore, si, comme la chose arrive d'habitude, le personnel ou une partie du personnel ne possède pas les avances nécessaires pour subsister jusqu'à ce que l'opération de la production soit achevée et le produit réalisé, une somme de valeur accumulée, constituant un capital dit circulant, qui suffise pour fournir ces avances. Le personnel et le matériel sont associés ou combinés dans des proportions diverses, déterminées par la nature de là production; ces proportions varient suivant que l'industrie est plus ou moins avancée et perfectionnée, qu'elle emploie des moteurs physiques ou des moteurs mécaniques, mais elles sont « naturelles » en ce sens qu'elles dépendent de la nature de la production et des agents productifs et non de la volonté ou de la fantaisie des entrepreneurs. [7] On peut, à la vérité, ne pas les observer, mais quand on ne s'y conforme point, on court le risque de ne peint obtenir le résultat que l'on a en vue. La même observation s'applique aux dimensions des entreprises, lesquelles sont naturellement déterminées par le degré d'avancement de l'outillage et des méthodes de la production. Elle s'applique encore à l'objet des entreprises, lequel doit être unique et non multiple, sous peine d'occasionner une déperdition de forces productives.
La même observation s'applique enfin aux modes de constitution des entreprises, et d'association de ceux qui y coopèrent soit par l'apport de leur travail de direction et d'exécution, soit par l'apport de leur capital. Ces modes sont très variés; ils diffèrent surtout selon la grandeur de l'entreprise et les risques auxquels elle est exposée; mais la construction des entreprises comme celle des édifices n'en a pas moins ses règles ou ses lois naturelles, dont la méconnaissance entraîne inévitablement leur chute. Le mode de constitution, encore aujourd'hui le plus général des entreprises, quoiqu'il soit destiné selon toute apparence à cesser de l'être avec les progrès de l'industrie, c'est celui de l'entreprise individuelle, ou en nom collectif constituée au moyen d'un personnel de direction et d'un capital d'entreprise, qui en courent les risques et en recueillent les profits, d'un personnel d'exécution et d'un capital auxiliaire qui sont assurés contre les risques, et reçoivent leur part dans le produit sous forme de salaire pour le travail, d'intérêt pour le capital. Les entreprises [8] qui exigent une agrégation considérable de matériaux et d'agents productifs ont les mêmes éléments constitutifs, mais réunis de préférence sous la forme de « sociétés », et cette forme des entreprises a pris une extension de plus en plus rapide depuis l'avènement de la grande industrie; elle finira même, selon toute apparence, par prévaloir. Elle est en effet plus économique que la précédente, en ce que le capital engagé est divisé en coupures mobilisables. Ajoutons que la société comporte une infinité de combinaisons constitutives et de modes de gestion, et que l'expérience ne tarderait pas à faire découvrir les plus avantageuses, si la réglementation à laquelle les associations, de tous genres, sont demeurées assujetties n'entravait les progrès de leur organisation. Quoi qu'il en soit, la constitution des entreprises sous la forme individuelle ou collective a ses lois naturelles qui doivent être observées sous peine de ruine.
Cette constitution naturelle des entreprises a été particulièrement l'objet des attaques des socialistes; mais chaque fois qu'ils ont essayé de lui substituer une « organisation » conçue d'après les inspirations de leur génie, cette organisation a misérablement échoué dans la pratique. Pourquoi? parce que ces inventeurs, remplaçant la science par l'imagination, ne tenaient aucun compte des lois naturelles qui régissent la constitution des entreprises, et notamment parce qu'ils refusaient d'attribuer, dans cette constitution, au travail de direction et au capital responsable la place qu'ils y doivent occuper naturellement et nécessairement, pour attribuer [9] la prépondérance au travail d'exécution. Le capital d'entreprise surtout a trouvé en eux des adversaires irréconciliables : les uns, ignorant certainement ce que c'est que le capital et à quoi il sert, ont voulu le supprimer, les autres se sont contentés de le subordonner au travail d'exécution. Cependant il leur aurait suffi d'analyser l'opération de la production pour se convaincre : 1° qu'elle exige toujours l'avance d'un capital, 2° que la place que ce capital occupe et qu'il a occupée de tout temps dans la constitution des entreprises est bien celle qui lui appartient nécessairement et qu'elle ne peut être changée.
L'objet de toute entreprise c'est d'obtenir dans l'opération de la production une valeur supérieure à la valeur dépensée. Or, cette opération ne s'accomplit pas d'une manière instantanée et assurée; elle exige du temps et elle comporte des risques. Jusqu'à ce qu'elle soit achevée et que le produit soit réalisé, toute production nécessite une avance de capital investi sous forme de matériel et de personnel ou, pour conserver la nomenclature en usage, une avance de capital et de travail. Qui pourvoit aux frais et risques de cette avance sinon le capital d'entreprise, le capital responsable? Sauf dans les entreprises individuelles où le travail de direction est associé au capital d'entreprise, travail de direction et travail d'exécution reçoivent leur part dans le produit éventuel sous une forme anticipative et assurée, autrement dit sous la forme d'un « salaire » indépendant des résultats de l'entreprise et qui se paye régulièrement à des intervalles plus ou moins [10] rapprochés, dans le cours de l'opération; il en est de même du capital auxiliaire, qui reçoit également sa part sous la forme d-un « intérêt fixe » et qui est garanti par le capital responsable. Supposons maintenant que l'opération, au lieu de se solder par une augmentation de la somme de valeur engagée, se solde par une diminution, par une perte au lieu d'un bénéfice, qui supportera cette perte? Le capital responsable. A lui donc revient le bénéfice éventuel de l'opération, à lui aussi appartient le contrôle sinon la direction d'une entreprise dont il est appelé « naturellement » à supporter les pertes. Si on lui dénié, dans la constitution de l'entreprise, ce droit au contrôle et au bénéfice, il refusera son concours, et, en admettant même qu’il ne le refuse point, qu'il consente à être subordonné aux autres agents non responsables, ne finira-t-il point par être absorbé et détruit par les risques accrus d'une gestion et d'une exécution non contrôlées et, en fait, sans responsabilité effective? Les socialistes de toutes les écoles ne s'accordent pas moins pour condamner la subordination du travail non responsable au capital et à la gestion responsables: tous condamnent aussi, d'Une façon absolue, le salariat et prétendent le remplacer par un mode quelconque de participation directe aux résultats de l'entreprise. Car, à leurs yeux, le salariat implique nécessairement l'exploitation du travailleur par l'entrepreneur capitaliste. Cette condamnation de la forme la plus générale de la rétribution du travail d'exécution est-elle fondée? Le salarié ne peut-il recevoir la part utile qui lui revient dans les résultats de la production? Il serait facile de [11] citer des exemples, entre autres ceux de certains artistes lyriques et dramatiques, attestant que la part des salariés est parfois supérieure à celle des entrepreneurs-capitalistes eux-mêmes; mais en laissant de côté les exceptions, il suffit d'analyser le salariat dans sa généralité pour se convaincre que rien dans ce mode de rétribution n'implique l'exploitation du salarié par le salariant; que s'il s'est universellement et spontanément établi depuis que le travailleur est devenu propriétaire de sa personne et libre de disposer de son travail, c'est qu'il répondait mieux qu'aucune autre forme de rétribution à sa situation ; c'est qu'il était le mode de rétribution naturellement adapté à la condition et aux convenances de l'immense majorité des travailleurs, ce qui ne veut pas dire que cette condition et ces convenances venant à changer, un autre mode de rétribution ne puisse être préférable et préféré.
Si nous nous reportons, en effet, à l'analyse que nous venons d'esquisser de l'opération productive, à laquelle coopère le travail d'exécution, deux phénomènes naturels frappent notre esprit : le premier, c'est que toute opération productive s'accomplit dans le temps, c'est qu'il s'écoule toujours un intervalle plus ou moins long entre le moment où elle est commencée et le moment où les résultats en sont réalisés : cet intervalle se compte tantôt par journées, tantôt par semaines ou par mois, tantôt même par années. Le second, c'est que la réalisation des résultats d'une entreprise est toujours plus ou moins grevée de risques, c'est que la valeur acquise peut demeurer inférieure à la valeur dépensée et ne [12] pas reconstituer entièrement les matériaux et les agents productifs employés: bref, c'est qu'elle peut aboutir à une perte aussi bien qu'à un bénéfice. II faut donc que les travailleurs possèdent un capital suffisant pour subvenir à leur entretien depuis le commencement jusqu'à la fin de l'opération productive, suffisant aussi pour couvrir leur part des risques; il faut encore qu'il leur convienne d'appliquer ce capital à cette destination plutôt qu'à toute autre. Or dans les circonstances actuelles la généralité des travailleurs ne possèdent point le capital nécessaire, et quand ils le possèdent, ils ne sont pas toujours disposés à l'engager dans l'entreprise, parfois grevée de gros risques, à laquelle ils coopèrent. Cela étant, l'entrepreneur d'industrie, individu ou société, ne peut se procurer leur concours qu'à une condition, c'est de leur avancer et de leur assurer leur part dans les résultats de l'opération productive, c'est de leur fournir une rétribution sans attendre ces résultats, c'est de leur payer un « salaire » au lieu de leur attribuer simplement une part proportionnelle et éventuelle dans la production, malgré les facilités et les avantages que lui offrirait cette dernière combinaison. Sans doute, en débattant avec eux le montant et les conditions du salaire, il s'efforce d'élever aussi haut que possible l'intérêt de son avance et le taux de sa prime d'assurance, tandis que le travailleur s'efforce de son côté de les abaisser au taux le plus bas ; mais aucun obstacle irrésistible et fatal n'empêche, comme le supposent les socialistes, cet intérêt et cette prime de se fixer au taux le plus utile et le plus équitable. Nous constaterons même tout à l'heure [13] que leur tendance constante est de s'y établir, en vertu des « lois naturelles » qui président à la distribution des valeurs sous le régime de la division du travail et de rechange.
Si le salariat est une forme naturelle de la rétribution du travail, ce n'est pas toutefois une forme immuable. On peut fort bien concevoir que la situation de la généralité des travailleurs se modifie de telle sorte qu'ils disposent des ressources nécessaires pour attendre les résultats de la production et supporter leur part dans les risques industriels, mais dans ce cas même, on peut douter qu'ils préfèrent jamais la part proportionnelle au salaire. Enfin, et cette combinaison est la plus probable parce qu'elle réaliserait dans un grand nombre de cas une économie des frais d'avance et d'assurance à la charge du salarié, on peut concevoir que la part du travail d'exécution cesse d'être avancée et assurée par l'entrepreneur capitaliste, qui, étant obligé trop souvent d'en emprunter lui-même le montant à un taux élevé, ne peut à son tour la fournir au travailleur qu'à un taux plus élevé encore; qu'un tiers bien pourvu de capitaux se charge de faire cette avance et cette assurance à des conditions plus favorables au travailleur et en exonérant l'entrepreneur de l'obligation de se procurer la portion de capital circulant nécessaire au payement des salaires, sauf à se rembourser par la réalisation de la part éventuelle du travail dans les résultats de la production. Cette combinaison que nous nous bornons à indiquer [2] est [14] possible, car elle n'est point en opposition avec les lois naturelles qui président à l'organisation et au fonctionnement des entreprises; mais ce qui est impossible, c'est de subordonner là direction et le capital effectivement responsable au travail d'exécution non responsable, c'est de substituer la participation au salariat, alors que l'immense majorité, disons même la presque totalité des travailleurs salariés sont incapables de faire les avances et de supporter les risques attachés à la participation.
On voit donc que la constitution et l'organisation des entreprises sont « naturelles », en ce qu'elles sont déterminées par la nature des agents et des éléments de la production^ et par celle de l'opération productive. On ne peut pas produire sans mettre en oeuvre une certaine quantité de matériel et de personnel, réunis dans des proportions déterminées par la nature particulière de la production. De même, l'opération productive, en vertu de sa nature, exige toujours du temps pour être achevée et réalisée, partant, une avance de capital ; elle comporte aussi toujours des risques, partant, une assurance. De là enfin une responsabilité naturelle qui se partage entre le travail de direction et le capital d'entreprise, morale pour l'un, matérielle pour l'autre, et la nécessité de leur subordonner le travail d'exécution non responsable. L'analyse du phénomène de la production nous montre ainsi clairement que la subordination de la direction et du capital d'entreprise au travail d'exécution, et l'attribution de la totalité du produit au travail, à l'exclusion du capital, qui sont les fondements de toutes les organisations [13] socialistes, se.trouvent en opposition avec la nature des choses et doivent être, par conséquent, reléguées au nombre des conceptions chimériques.
De l'analyse du phénomène de la production se dégage encore la loi naturelle de l'économie des forces, que nous avons signalée plus haut et qui est le propulseur de tous les progrès économiques. Toute production impliquant une dépense de forces et toute dépense de forces impliquant une peine, une souffrance, le producteur est naturellement incité à découvrir, à inventer et à appliquer des outils, des procédés et des méthodes qui lui permettent d'obtenir un plus grand produit en échange d'une moindre dépense.
[16]
CHAPITRE III.
LA CONCURRENCE ET SES EFFETS SUR LA PRODUCTION.↩
Une autre loi naturelle vient en aide à celle de l'économie des forces et lui sert en quelque sorte de sanction pour stimuler le progrès, en le rendant nécessaire, c'est la loi de la concurrence. Les valeurs agissent les unes sur les autres, et cette action naturelle se nomme la concurrence. A mesure que les entreprises de production se multiplient et qu'elles offrent à l'échange une quantité plus grande de leurs produits ou de leurs services, les valeurs investies dans ces produits ou ces services pressent davantage--les unes sur les autres, et c'est encore un phénomène naturel qu'à mesure que cette pression augmente, les valeurs baissent, tandis qu'elles haussent à mesure que la pression diminue. Mais les produits ou les services offerts à l'échange contiennent des quantités inégales de forces productives dépensées, autrement dit de frais de production. Ceux qui ont été créés dans de bonnes conditions, par des entreprises bien organisées et outillées, représentent la moindre dépense, la moindre somme de frais, tandis que d'autres, mal organisées, dirigées et outillées, [17] représentent au contraire le maximum de frais. Aussi longtemps que les valeurs offertes sont peu nombreuses, qu'elles pressent faiblement les unes sur les autres, elles se maintiennent à un taux élevé, et il se peut que ce taux dépasse celui des produits ou services qui ont exigé le maximum de dépense ou de frais. Mais à mesure que la quantité des valeurs offertes vient à augmenter et que la concurrence se développe entre elles, on les voit baisser, et elles peuvent tomber successivement, si rien ne vient entraver le développement de la concurrence, jusqu'au niveau des frais des produits ou services qui représentent le minimum. Ce niveau constitue, comme nous le verrons plus loin, la limite naturelle que la baisse ne peut dépasser d'une manière normale. Mais que résulte-t-il de là? C'est qu'à moins d'abaisser leurs frais au niveau minimum, les entreprises concurrentes doivent périr faute de pouvoir les couvrir entièrement; c'est que la concurrence agit comme un adjuvant à là loi de l'économie des forces pour rendre le progrès nécessaire. Pour que cette action stimulante s'exerce dans toute sa plénitude, il suffit que la concurrence soit libre.
[19]
CHAPITRE IV.
LA PRODUCTION EST-ELLE ANARCHIQUE? LA LOI NATURELLE DE L'ÉCHANGE.↩
Au reproche que les socialistes adressent à la « production capitalistique » de ne laisser au travail qu'une part insuffisante dans un produit qui.devrait,' selon eux, lui revenir en totalité, vient se joindre un autre grief non moins sérieux : c'est de manquer de règle, c'est d'être « anarchique ». Cette règle qui lui fait défaut, les collectivistes de l'école de Karl Marx prétendent l'établir en instituant des « commissions de statistique » qui auraient pour mission de constater officiellement et quotidiennement l'étendue des besoins de la consommation et d'y faire proportionner la production des milliers de produits ou services qu'elle exige ; en un mot, d'établir un équilibre permanent entre la production et la consommation. Ces « commissions de statistique « seraient évidemment fort occupées; voyons si elles sont indispensables; cherchons s'il n'existe aucune « loi naturelle » qui agisse pour faire régner l'ordre dans le monde économique en établissant un équilibre nécessaire entre la production et la consommation.
[19]
Si l'homme vivait dans l'isolement, cette question ne se poserait point; il réglerait sa production bien ou mal, mais rien ne lui serait plus facile que de la régler, car il connaît ses besoins, et il peut, par approximation, évaluer les quantités de produits et de services qu'ils demandent. Il peut faire à chacun sa part, en raison de la quantité de forces productives dont il dispose, du nombre et de l'intensité des besoins qui le sollicitent. Il en est autrement' sous le régime de la production divisée. Tandis que l'homme isolé ou associé à un petit nombre de ses semblables et sans relations avec les autres produit les choses qu'il consomme lui et les siens, il n'en produit que la plus faible part sous le régime de la production divisée, et se procure les autres par voie d'échange. Il arrive même qu'il ne produise aucune des choses qu'il consomme, qu'il se procure par voie d'échange la totalité des articles de sa consommation. C'est déjà actuellement le cas presque général dans les sociétés en progrès, et il en sera de plus en plus ainsi, à mesure que l'industrie se perfectionnera et que la division du travail s'étendra davantage. Songez maintenant au nombre croissant d'articles de tout genre qui entrent dans la consommation individuelle même la plus restreinte, songez que ces articles sont produits fréquemment dans les régions les plus éloignées du consommateur, et parfois même longtemps avant qu'il ne les consomme, et vous vous émerveillerez de voir la production s'ajuster, comme elle le fait, sauf des perturbations passagères, avec la consommation; vous vous demanderez comment, par quel [20] procédé magique, les besoins multiples de la multitude des consommateurs disséminés dans toutes les parties du globe peuvent être satisfaits par des producteurs dont ils ignorent même l'existence et qui ignorent la leur. Ce problème si ardu, si compliqué, et qui semble au premier abord insoluble, la « loi naturelle » qui régit l'échange des valeurs le résout avec une simplicité admirable et une précision mathématique.
Considérez le monde économique, vous le trouverez partagé en une foule de marchés, que les progrès de l'industrie et le développement des moyens de communication agrandissent sans cesse et qu'ils finiront par unifier. Sur ces marchés, toutes les entreprises de production versent leurs produits ou leurs services, et, de même, tous les coopérateurs de la production apportent qui leur travail intellectuel ou matériel, qui leurs capitaux sous la forme des agents et des matériaux dans lesquels ils sont investis. Produits, services, capitaux, travail s'offrent à l'échange en raison de leur valeur. Cette valeur est plus ou moins grande, elle peut se mesurer et elle se mesure à un étalon commun qui est la monnaie, elle se fixe dans l'échange et s'exprime au moyen des divisions ou des degrés de cet étalon ou de ce mètre de la valeur. Comment se fixe-t-elle? Sous l'influence de quelle cause voit-on la valeur investie dans les choses augmenter ou diminuer, hausser ou baisser et finalement se fixer dans l'échange à un niveau plutôt qu'à un autre ? Sous l'influence d'un fait purement mécanique, savoir la pression que les valeurs exercent les unes sur les autres. Plus cette pression [21] augmente, plus ces valeurs baissent; elles haussent au contraire à mesure que la pression diminue, et nous avons remarqué ailleurs [3] que cette hausse et cette baisse s'opèrent en raison géométrique. Mais qu'est-ce qui détermine le degré de pression des valeurs offertes? C'est la quantité des produits ou des services dans lesquels elles sont investies. Voici par exemple une quantité de 1000 hectolitres de blé qui est apportée au marché; cette quantité s'échange contre une somme de 20 000 fr., soit à raison de 20 fr. par hectolitre; ce qui signifie qu'un hectolitre de blé contient une valeur égale à celle qui est contenue dans une pièce de 20 fr. Si l'on augmente la quantité des hectolitres offerts, vous verrez leur valeur baisser instantanément dans une proportion plus forte ; vous la verrez hausser de même si l'apport diminue. Qu'il s'agisse de tout autre article, le même « phénomène naturel » se produira, avec cette seule différence que les fluctuations en hausse ou en baisse auront plus ou moins d'amplitude selon que la hausse ou la baisse déterminera à son tour, d'après la nature de l'article mis au marché et du besoin auquel il répond, une diminution plus ou moins grande de la quantité de monnaie offerte en échange. Au lieu de monnaie, on peut supposer n'importe quel autre article ; seulement la monnaie étant devenue l'intermédiaire universel des échanges, nous nous en tenons au phénomène, tel qu'il se produit chaque jour sous nos yeux.
Le taux auquel se fixe la valeur dans l'échange est [22] donc déterminé par la quantité offerte des produits ou des services dans lesquels elle est investie, et cette quantité est déterminée, de son côté, par le degré d'abondance de la production. Rappelons ici comment les choses se passent sous le régime de la production divisée. La généralité des produits et des services est créée en vue de l'échange. Or en quoi consiste leur valeur avant qu'ils ne soient échangés? Elle consiste dans le montant de leurs frais de production, c'est-à-dire dans la somme de capital et de travail qu'il a fallu dépenser pour les créer et qui se trouve investie dans ces produits ou ces services.L'échange s'opère.Trois cas peuvent se présenter : Ou la valeur obtenue en échange d'un produit ou d'un service est inférieure à ses frais de production ; elle ne suffit pas à reconstituer le capital et le travail employés à la créer; ou elle est égale, elle reconstitue le capital et le travail, mais rien de plus; ou elle est supérieure, elle donne un excédent. Dans le premier cas, la production est en perte, la valeur obtenue dans l'échange n'égalant point la valeur dépensée ; dans le troisième, elle est en bénéfice, la valeur obtenue dépassant la valeur dépensée; mais toute dépense de valeur représensentant une peine, une souffrance, tandis que toute acquisition de valeur représente une jouissance, et l'homme en vertu de sa nature, s'appliquant d'instinct à diminuer la somme de ses peines et à augmenter celle de ses jouissances, qu'arrive-t-il ? C'est que les producteurs abandonnent les industries en perte pour porter de préférence leurs capitaux et leur travail dans les industries en bénéfice, à commencer par celles où ce bénéfice [23] est le plus élevé. Mais quelle est la conséquence de ce retrait d'un côté, de cet afflux de l'autre? C'est d'établir un « équilibre naturel » entre la multitude des branches de la production, au niveau des frais qu'il a fallu faire, dit capital et du travail qu'il a fallu dépenser et qu'il faut reconstituer pour mettre, d'une manière continue, un produit ou un service quelconque à la disposition de ceux qui en ont besoin. Quand cet équilibre vient à se rompre, par un accident ou par un autre, il tend aussitôt à se rétablir, sous l'impulsion de la loi naturelle de dilatation et de contraction des valeurs, et il se rétablit d'autant plus vite qu'il a été rompu davantage. Le déplacement d'une quantité de produits ou de services engendrant une hausse ou une baisse progressivement plus forte des valeurs qui y sont investies, la tendance au rétablissement de l'équilibre économique des valeurs agit d'un mouvement égal à celui qui détermine l'équilibre physique des corps. L'ordre s'établit ainsi « naturellement » dans la production; la multitude des produits et des services, créés parfois dans les régions et aux époques les plus éloignées, tend toujours à se présenter au marché et à s'offrir dans le lieu, le moment et les quantités les plus utiles. Les plus utiles, disons-nous, car l'utilité se mesure à la grandeur du sacrifice que l'on est disposé à faire pour se la procurer. Si l'on ne consent pas à donner en échange d'un article quelconque une valeur suffisante pour couvrir ses frais de production, autrement dit la somme qui a été dépensée pour le produire, tandis que l'on donne en échange d'un autre une valeur qui dépasse les frais [24] qu'il a fallu faire pour le créer, n'est-ce pas une preuve irréfragable que le second est plus utile que le premier? C'est ainsi, disons-nous, que la loi naturelle de progression des valeurs agit pour faire mettre toujours, dans le temps, le lieu et les quantités les plus utiles, à la disposition des consommateurs tous les produits et services dont ils ont besoin pour la réparation et l'expansion de leurs forces physiques ou morales, et pour l'acquisition desquels ils consentent à s'imposer des sacrifices d'autant plus grands que le besoin qu'ils en ont est plus intense. La production s'établit et se proportionne donc en raison de l'utilité des produits ou des services, et l'utilité se mesure à la grandeur des sacrifices que les consommateurs sont disposés à faire et qu'ils font pour obtenir les choses qui la contiennent. Quelle règle supérieure le socialisme pourrait-il substituer à cette règle naturelle ?Sous le régime des « commissions de statistique » du collectivisme, les produits seraient créés et distribués entre les consommateurs, en raison de leurs besoins, mais quelle serait la mesure des besoins? Comment s'y prendraient les « commissions de statistique » pour connaître cette mesure, pour savoir, en tous temps et en tous lieux, quelles quantités de chaque sorte et qualité de produits et de services il convient de mettre à la disposition d'un milliard et demi de consommateurs, de telle façon qu'il n'y ait jamais excédent des uns, déficit des autres? Quelle armée de statisticiens pourrait suffire à cette tâche colossale ? Eh! bien, ce problème de l'équilibre de la production et de la consommation que tous les statisticiens [25] de la terre essayeraient en vain de résoudre, il se résout, comme on vient de le voir, de lui-même, avec une précision mathématique, en vertu de la « loi naturelle » de progression des valeurs [4]
[26]
CHAPITRE V.
LA DISTRIBUTION DE LA RICHESSE. — COMMENT ELLE EST RÉGLÉE PAR LA LOI DE L’ÉCHANGE.↩
Si les collectivistes prétendent résoudre le problème de l'équilibre de la production et de la consommation, au moyen des « commissions de statistique », ils n'ont pas encore réussi à découvrir — ils l'avouent eux-mêmes— la règle en vertu de laquelle les produits doivent se distribuer entre les producteurs. Cette règle ou cette loi qu'ils ont cherchée en vain, elle existe cependant et elle préside, depuis la naissance des sociétés, à la distribution des richesses. C'est la même « loi naturelle » qui détermine l'équilibre de la production et de la consommation. Voyons comment elle agit pour répartir utilement les produits entre les producteurs.
Un produit ou un service, créé par la mise en oeuvre d'une certaine quantité d'agents productifs, capital et travail, est échangé. Le problème à résoudre — ce problème qui est demeuré jusqu'à présent la quadrature du cercle du socialisme—consiste à partager utilement, entre les pourvoyeurs des agents productifs, la valeur obtenue en échange ou réalisée. Sous le régime actuel [27] de la production, une portion de cette valeur a déjà été fournie d'une manière anticipalive et assurée au travail d'exécution et au capital auxiliaire. La portion restante se partage entre le travail de direction et le capital d'entreprise. Chacune de ces parties prenantes s'efforce naturellement de s'attribuer la fraction la plus considérable possible de la valeur à partager. Qui décide entre ces prétentions opposées? Comment s'opère le partage? Quand des obstacles naturels ou artificiels ne viennent point se mettre en travers, il s'opère de la manière la plus utile, c'est-à-dire de manière à permettre aux pourvoyeurs des agents productifs, capital et travail, de les reconstituer et de les accroître dans la proportion nécessaire pour continuer la production et l'étendre au besoin. Et quel est l'instrument au moyen duquel s'opère ce partage utile? Cet instrument c'est la « loi naturelle » des valeurs.
Comme chacun ne peut obtenir les produits et les services nécessaires à sa consommation qu'à la condition ou de les produire lui-même isolément, ou de les obtenir par voie d'échange ; comme d'une autre part, grâce à l'action continue et progressive de la « loi naturelle » de l'économie des forces, le régime de la division du travail et de l'échange a remplacé successivement le régime de la production isolée, des marchés se sont créés où chacun apporte les pouvoirs productifs dont il dispose : celui-ci apporte des pouvoirs investis sous forme de terres, de machines, d'outils, de matières premières ou de monnaie, celui-là d'autres pouvoirs investis dans son intelligence ou sa force musculaire. Ces agents et [28] ces matériaux productifs sont mis au marché, en quantités plus ou moins considérables, les uns à titre de capital et de travail d'entreprise, offrant d'entreprendre la production pour leur compte, d'en courir tous les risques et d'attendre pour être rétribués que le produit soit réalisé, les autres à titre de capital et de travail auxiliaires, offrant simplement de coopérer à la production, moyennant escompte et assurance de ses résultats. Mais il ne faut pas oublier que ces divers agents productifs ne peuvent être employés que dans des proportions rigoureusement déterminées par la « nature » des entreprises; que ces proportions ne se modifient qu'à la longue sous l'influence du progrès; qu'il n'est pas indifférent, par conséquent, que les agents productifs s'offrent sur le marché en telle quantité ou en telle autre, qu'ils doivent y être offerts dans les proportions déterminées par la nature et les besoins des entreprises; d'où il suit que certains agents productifs peuvent se présenter au marché en quantité surabondante, et d'autres en quantité insuffisante. Tous s'efforcent naturellement d'obtenir en échange de leur coopération la part la plus forte possible dans le produit; mais c'est la proportion des quantités offertes qui décide du partage. Les quantités surabondantes obtiennent moins, les quantités en déficit obtiennent davantage, et le résultat c'est une perpétuelle tendance à l'équilibre au niveau des frais nécessaires pour mettre d'une manière continue chaque espèce d'agent productif au service des entreprises, et lui permettre de s'accroître dans la proportion où elles s'accroissent elles-mêmes. Lorsque [29] l’équilibre vient à être rompu en faveur d'un agent productif, qui obtient ainsi au delà de sa part proportionnelle, il y a profit à en augmenter la production et l'offre, en diminuant celles des autres. S'il s'agit du capital d'entreprise, on en met davantage au marché, en affectant de préférence à cette destination une portion du capital auxiliaire à rétribution fixe et assurée; s'il s'agit du capital, en général, il y a profit à accumuler l'excédent des résultats de la production sous forme d'un surplus de matériel plutôt que d'un surplus de personnel; si le travail, au contraire, est en déficit, il y a profit à investir l'épargne sous forme d'un surplus de ..personnel, en élevant un plus grand nombre d'enfants, et en leur donnant l'instruction requise pour les emplois vacants, plutôt que sous forme de terres défrichées, d'animaux de travail, de bâtiments d'exploitation, de machines, d'outils, de matières premières. En vertu de cette loi naturelle d'équilibre, la valeur de tous les produits et services tend incessamment à se partager de la manière la plus utile entre les différents agents qui concourent à les créer, capital d'entreprise et capital auxiliaire, travail de direction et travail d'exécution, et quelle que soit la forme particulière de leur rétribution, profits, dividendes, intérêts ou salaires.
Telles sont les « lois naturelles », qui gouvernent la production et la distribution des richesses.
Ces lois naturelles sont immuables, l'homme ne les a point-faites-et il n'est pas en son pouvoir de les changer, pas plus qu'il ne peut changer sa propre nature et les conditions de son existence sur la terre. Il n'est pas [30] en son pouvoir de modifier la composition de la valeur ; il ne dépend pas de lui d'empêcher la valeur d'être appropriable, accumulable, mesurable, échangeable, ou de remplacer par une loi issue de sa sagesse légiférante la loi naturelle qui fixe la valeur dans l'échange, de faire que les produits et services croissent en valeur à mesure qu'ils sont offerts en quantités plus grandes, et que leur valeur diminue à mesure qu'ils sont offerts en quantités plus faibles. Il ne dépend pas de lui davantage de changer les lois naturelles qui président à la production, aussi bien qu'à la constitution et à la gestion des entreprises, de faire que la production puisse s'opérer sans agents productifs, que le produit puisse être achevé et réalisé d'une manière instantanée, sans exiger aucune avance et sans comporter aucun risque, de constituer des entreprises sans associer dans des proportions déterminées du matériel et du personnel, du capital et du travail, sans que ces entreprises aient leurs limites utiles quant à leurs dimensions et à leur objet, sans que la direction et le contrôle en soient attribués au travail et au capital responsables, etc. Ce sont là autant de lois naturelles que l'homme peut enfreindre, mais qu'il est hors de son pouvoir de changer. Maintenant, que disons-nous, nous autres économistes? Nous disons que ces lois naturelles gouvernent la production et la distribution de la richesse de la manière la plus utile, c'est-à-dire la plus conforme au bien général de l'espèce humaine; qu'il suffit de les observer en aplanissant les obstacles naturels qui s'opposent à leur action et surtout en n'y ajoutant point des [31] obstacles artificiels pour que la condition de l'homme soit aussi bonne que la comporte l'état d'avancement de ses connaissances et de son industrie. C'est pourquoi notre évangile se résume en ces quatre mots : laissez, faire, laissez passer.
DEUXIÈME PARTIE.
LES OBSTACLES
[33]
CHAPITRE PREMIER.
LES OBSTACLES PROVENANT DE L'HOMME. LE VOL, LE MONOPOLE ET L'USURE.↩
C'est à la notion de la valeur qu'il faut revenir si l'on veut se rendre compte des obstacles qui s'opposent à la multiplication et à la distribution utiles de la richesse. L'homme, source de la valeur, est composé de forces et de matière. La force maîtresse et dirigeante qui est le moteur moral de son être s'approprie les autres, les discipline, les gouverne et les applique à la satisfaction des besoins qui le sollicitent. L'homme commence donc par s'approprier les pouvoirs qui sont en lui, en vue de les employer à la production. Ce sont des matériaux bruts qu'il transforme en valeurs productives et qui constituent la propriété personnelle. Il s'approprie aussi, dans le milieu ambiant, les matériaux et les agents qui lui sont nécessaires pour produire; il s'approprie enfin les résultats de la production. C'est la propriété immobilière et mobilière. Comment s'opère [34] l'appropriation des forces intérieures, des matériaux et des agents extérieurs que l'homme transforme par cette appropriation en valeurs? Elle s'opère au moyen d'une dépense préalable de la force maîtresse ou dirigeante, aidée des autres forces qu'elle a assujetties. Ces forces dépensées, c'est du travail. Toute valeur est le produit du travail, et elle est la propriété naturelle de celui qui l'a créée, en y investissant une portion des forces intérieures de son être et des forces extérieures qu'il s'est appropriées. La substance de la propriété c'est la valeur. On ne possède que des valeurs, investies dans l'homme lui-même, valeurs personnelles, et dans le milieu où il vit, valeurs immobilières et mobilières. La propriété naît avec la valeur et périt avec elle [5] .
Mais que ressort-il de cette analyse? C'est que toute entrave opposée à la liberté, c'est-à-dire à la mise en oeuvre de la puissance créatrice de la valeur, et toute atteinte portée à la propriété, c'est-à-dire à la valeur créée doit avoir pour effet naturel de diminuer ou même d'empêcher la création des valeurs, et par conséquent de causer un dommage, une nuisance à la généralité de l'espèce humaine. Cela étant, comment s'expliquer la tendance plus ou moins prononcée, mais universelle, qui pousse l'homme à attenter à la liberté et à la propriété des autres hommes?
Cette tendance nuisible et qu'on peut considérer comme la cause principale des maux de l'humanité a [35] ses racines dans la constitution même de la valeur. La valeur est constituée par la combinaison de deux éléments économiques : une dépense de forces ou de pouvoirs producteurs, une acquisition de forces ou de pouvoirs réparateurs. Toute dépense de forces est accompagnée d'une peine, toute réparation ou consommation procure au contraire une jouissance. Or quelle est l'impulsion naturelle à laquelle obéissent toutes les créatures vivantes? C'est de" chercher le plaisir et d'éviter la douleur, c'est d'obtenir un maximum de jouissances en échange d'un minimum de peine. Tel est le principe de la loi de l'économie des forces, et c'est à cette loi, corroborée par la concurrence, que l'espèce humaine est redevable de tous ses progrès.
Mais il y a deux manières de se procurer le pouvoir réparateur, partant la jouissance que contient la valeur C'est de produire ce pouvoir en dépensant la force, en s'imposant la peine que cette production exige, ou bien c'est de l'enlever par violence ou de le soustraire par ruse à ceux qui le produisent. Si le second de ces procédés comporte une peine moindre que le premier, ne sera-t-on pas porté à l'employer de préférence et d'autant plus que la différence sera plus grande? Tel était le cas surtout dans l'enfance de l'industrie. La quantité de forces qu'il fallait dépenser, la somme de peine qu'il fallait s'imposer pour produire les pouvoirs réparateurs nécessaires à l'entretien de la vie était alors à son maximum.Les hommes qui dépassaient les autres en force et en courage physiques, tout en leur demeurant peut-être inférieurs sous le rapport des aptitudes productives, [36] n'ont pas manqué de s'apercevoir qu'il leur était plus avantageux de dérober les fruits du travail d'autrui que de produire eux-mêmes leur subsistance » Cette méthode économique d'appropriation de la valeur s'est développée ensuite et diversifiée à mesure que l'industrie, s'est perfectionnée et que la richesse s'est multipliée. Il suffit de jeter un simple coup d'oeil sur le rôle énorme qu'elle n'a cessé de jouer dans les affaires du monde et sur les coûteux appareils de défense qu'elle a nécessités, pour se convaincre qu'aucune nuisance n'a plus contribué à contrarier Faction bienfaisante des lois naturelles qui gouvernent la production et la distribution de la richesse.
Si nous analysons les différentes manières de s'emparer du bien d'autrui, nous trouverons : 1° Le vol proprement dit, pratiqué par l'action de la violence ou de la ruse, aggravé du meurtre, quand la victime du vol défend son bien, ou quand ceux qui la dépouillant veulent se garantir contre ses dénonciations ou ses revendications. Le vol des propriétés mobilières peut s'opérer individuellement ou par petites bandes. Le vol des propriétés personnelles et immobilières nécessite, au contraire, généralement, la constitution de vastes et puissantes associations et prend le nom de « conquête ». Ce genre de vol a pu avoir toutefois sa raison d'être et. sa légitimité, sous l'influence de l'état de barbarie économique et morale qui a caractérisé l'enfance de l’humanité. Il s'est particulièrement développé lorsque les> progrès de l'outillage de la production eurent permise mettre le sol en culture et rendu l'exploitation [37] de l'homme profitable à titre d'instrument de travail ou de bête de somme ; 2° Ces mêmes progrès, en donnant naissance aux phénomènes de la division du travail, de l'échange et du prêt ou du loyer, ont suscité d'autres méthodes de vol, adaptées à ces phénomènes, telles que la tromperie sur la quantité et la qualité des produits et des services offerts à l'échange, la banqueroute et l'infidélité aux engagements pris, le monopole et l'usure. La tromperie sur la quantité et la qualité des marchandises, la banqueroute et l'infidélité aux engagements peuvent être rangés dans la catégorie des vols ordinaires, quoique la manière de procéder soit différente. Quand on trompe sur la quantité ou la qualité de la chose vendue, c'est comme si l'on dérobait une portion de la valeur que l'on obtient en échange; quand on emprunte un capital avec l'intention de ne point le restituer, quand on prend des engagements avec l'intention de ne point les tenir, c'est comme si l'on volait ce capital ou le montant de ces engagements. Cependant le manquement aux engagements peut provenir de causes étrangères à la volonté de celui qui les a contractés, et s'il n’est guère moins dommageable, en ce cas, il peut être excusable. Il en est de même du monopole et de l'usure, selon que ces deux phénomènes sont artificiels ou naturels. Rappelons, en deux mots, comment ils se produisent. C'est la loi naturelle de l'échange et du prêt (échange dans le temps) qui leur donne naissance. En vertu de cette loi, la valeur des choses se fixe dans l'échange en raison des quantités offertes, mais elle varie en progression géométrique suivant que les quantités [38] se modifient simplement en raison arithmétique. Il résulte de là qu'il suffit de diminuer dans une faible proportion la quantité d'un produit ou d'un service offert pour en accroître considérablement îa valeur d'échange, surtout quand ce produit ou ce service est d'une nature telle que le besoin qu'on en a est urgent et nécessaire. Si donc vous avez le monopole, c’est-à-dire la propriété exclusive d'un produit ou d'un service, ou le pouvoir exclusif de l'échanger, et si cet article monopolisé a un caractère de nécessité, vous pourrez, en réduisant la quantité offerte jusqu'au niveau le plus productif (celui auquel on peut la réduire sans provoquer une diminution correspondante de la demande, partant de la quantité de monnaie ou d'autres produits offerts en échange), vous pourrez, disons-nous, obtenir un prix bien supérieur à celui que vous auriez obtenu sous un régime de concurrence réciproque et libre. La différence constituera la rente ou l'usure du monopole. Cependant le monopole peut être naturel ou artificiel. S'il est naturel, s'il provient de l'insuffisance des éléments de la production ou de toute autre cause indépendante de la volonté de ceux qui le possèdent, on ne peut taxer d'illégitime la rente qui y est afférente; elle constitue d'ailleurs une prime qui excite à découvrir et à multiplier les produits similaires. Cette prime attire les intelligences et les capitaux, le monopole disparaît et sa rente avec lui. Il en est autrement, lorsqu'il s'agit d'un monopole artificiel, établi en vue de procurer à ceux qui le détiennent une valeur d'échange ou un prix supérieur à celui auquel le fixerait la [39] concurrence. Dans ce cas, et c'est celui des monopoles constitués par voie de privilège ou de restriction de la concurrence intérieure ou étrangère, la rente du monopole n'est autre chose qu'un impôt, prélevé d'une manière indue, au profit d'un certain nombre d'individus et aux dépens de la généralité des consommateurs du produit ou du service monopolisé, ou pour parler net, c'est un « vol public », qui ne diffère que pàiia méthode du vol ordinaire. Ceux qui établissent le monopole et ceux qui en recueillent les profits sont des voleurs aussi bien que ceux qui dérobent par violence ou par ruse un objet quelconque appartenant à autrui.
Il est encore des monopoles, d'un caractère mixte, en partie naturels, en partie artificiels, qui proviennent, par exemple, de l'inégalité de la situation des échangistes et du degré d'intensité du besoin qui les pousse à conclure un échange. Tel est le cas ordinaire des ouvriers qui échangent leur travail contre un salaire et des emprunteurs qui se procurent un capital en échange d'un intérêt. Le besoin que l'ouvrier a du salaire est communément plus urgent et plus intense que le besoin que l'entrepreneur a du travail; de même, l'emprunteur a plus besoin du capital que le prêteur n'a besoin de l'intérêt. Cette inégalité d'urgence et d'intensité provoque, au lieu et au moment où s'opère l'échange ou le prêt, une inégalité correspondante des quantités réciproquement offertes, et il en résulte une usure au profit de l'entrepreneur ou du prêteur. Cette usure mériterait d'être condamnée au même titre que la précédente si les ouvriers et les emprunteurs étaient [40] empêchés de recourir aux moyens propres à faire disparaître l'inégalité de leur situation; si le commerce du travail et le prêt des capitaux étaient systématiquement entravés sous l'influence et dans l'intérêt des entrepreneurs et des prêteurs. C'est une question de mobilité. Il suffit de laisser à chacun des éléments en présence la liberté de ses mouvements pour que l'échange finisse par s'établir sur le pied de l'égalité. C'est ainsi que la liberté du prêta intérêt et la multiplication des intermédiaires qui en a été la conséquence sont en train de faire disparaître l'usure attachée au prêt; c'est ainsi encore que la liberté du louage d'ouvrage et le développement des moyens de mobilisation des travailleurs supprimeront graduellement l'usure du travail. Mais, en attendant, tout obstacle artificiel qui entrave les mouvements du travail ou du capital engendre une usure, laquelle ne diffère en rien du vol.
[41]
CHAPITRE II.
LES EFFETS DE LA TENDANCE AU VOL. NÉCESSITÉ ET RAISON D'ÊTRE DES GOUVERNEMENTS.↩
Analysons maintenant l'influence perturbatrice et le dommage que cause cette propension naturelle et à des degrés divers universelle chez l'homme à s'emparer du bien d'autrui, soit qu'il s’agisse de valeurs personnelles, immobilières ou mobilières. Elle engendre nécessairement une déperdition de richesses, au détriment de la généralité de l'espèce. Cette perte est causée : 1° par le transfert de la valeur possédée par le volé entre les mains du voleur, dans le cas où celui-ci est moins capable d'en faire un usage productif, ce qui est le cas général dans le vol ordinaire. En revanche, il peut en être autrement dans le cas de la conquête, et c'est une des circonstances qui la justifiaient, aux époques où l'on ne pouvait recourir un autre à mode d'acquisition; 2° la seconde cause de perte réside dans le détournement d'activité productive qui résulte de ce mode vicieux d'appropriation. L'industrie que le voleur emploie à s'emparer du bien d'autrui, c'est-à-dire des valeurs déjà existantes, il pourrait l'employer à créer d'autres [42] valeurs ; et d'un autre côté, ceux dont la propriété est menacée appliquent à sa défense une partie des forces qu'ils consacreraient à la production, si leur sécurité était entière. Enfin 3° ce défaut de sécurité crée un risque qui diminue la production à mesure qu'il s'élève et finit même par la paralyser. Lorsqu'on n'est plus assuré de conserver une portion assez grande des valeurs que l'on crée pour que la jouissance attachée à leur consommation dépasse la peine que leur production a coûtée, on cesse de produire; la société s'appauvrit et elle ne tarde pas à périr.
Tel serait le cas d'une société au sein de laquelle aucun pouvoir n'existerait pour assurer contre ce risque les valeurs personnelles, immobilières ou mobilières. C'est cet état de société que l'on a désigné sous le nom d'anarchie, et qu'une école d'utopistes a entrepris de réhabiliter. On ne peut concevoir l'existence d'une telle société qu'à une condition, savoir que les individualités humaines de toute race et de toute couleur soient naturellement aussi portées à respecter la propriété d'autrui qu'elles sont animées de la tendance contraire. Ajoutons que si cette perversion morale est particulièrement prononcée chez les races et les individus les moins cultivés, elle existe encore cependant, à un degré appréciable, jusque dans l'élite des sociétés les plus civilisées. Il se peut qu'elle finisse par disparaître, tant sous l'influence du progrès moral que sous celle du progrès général de la machinerie et des méthodes de la production qui rend la création de la valeur moins coûteuse, combiné avec le progrès spécial de [43] l’industrie de la répression qui rend le vol plus difficile et moins avantageux. Mais en attendant que ces divers progrès soient réalisés, aucune société ne pourrait subsister si la propriété, sous ses différentes formes, n'y était point garantie contre le vol et la destruction.
Quelle serait, dans l'état actuel des choses, la situation des membres d'une société anarchique ? Tous seraient obligés de consacrer la plus grande partie de leurs pouvoirs productifs à la défense de leurs propriétés, en même temps qu'ils en emploieraient une autre partie à essayer de s'emparer des propriétés d'autrui. Ce serait une lutte permanente et universelle. Remarquons encore que si chacun en s'assurant ainsi soi-même pouvait garantir ses propriétés contre les atteintes individuelles, il serait dans l'impossibilité de résister à des agressions collectives, venant du dedans ou du dehors, et que les anarchistes finiraient invariablement par être détruits ou réduits en esclavage. C'est pourquoi nulle part, même chez les peuples les plus pauvres et les plus arriérés, on ne constate, sauf d'une manière accidentelle, l'existence de l'anarchie. Tous sont pourvus d'un gouvernement, c'est-à-dire d'une entreprise dont la fonction principale consiste à garantir la propriété sous ses trois formes : personnelle, immobilière et mobilière. Ce gouvernement est un produit naturel de la loi de l'économie des forces. Si coûteux et si imparfait qu'il soit, il revient moins cher et il est plus efficace que ne pourrait l'être l'assurance de chacun par soi-même. On le trouve, constitué et organisé sous des formes diverses, selon les lieux et les époques, mais [44] sous ces différences de formes, on reconnaît une similitude de procédés déterminée par la similitude des fonctions. D'abord, quand on veut garantir une propriété contre un risque quelconque, risque de vol ou risque d'incendie, on doit avant tout la reconnaître, la délimiter et l'évaluer. C'est ce que font les compagnies d'assurances en vue de savoir ce qu'elles assurent, de connaître l'importance des risques qu'elles se chargent de couvrir, et de fixer le montant de la prime qu'elles doivent exiger pour compenser leurs frais et réaliser un bénéfice. C'est ce que font aussi les gouvernements, quoique d'une manière plus grossière. Ils « reconnaissent » la propriété, et c'est là ce qui a porté les juriconsultes, étrangers à l'économie politique, à déclarer qu'ils la créent. Est-il nécessaire de remarquer que les gouvernements ne créent pas plus les valeurs dont ils garantissent la propriété et l'usage contre le vol et la destruction que les compagnies d'assurances ne créent les valeurs qu'elles assurent contre l'incendie? De même encore que les compagnies d'assurances, les gouvernements imposent des règles et des restrictions ou des servitudes à l'usage de la propriété, afin de faciliter leur tâche et de diminuer leurs risques; seulement ces règles et ces servitudes sont plus compliquées et plus étendues, en raison de la plus grande complexité des risques et de la difficulté de les couvrir. Enfin, comme les compagnies d'assurances, les gouvernements exigent une prime destinée à pourvoir aux frais de la production de la sécurité des personnes et des propriétés. Cette prime a été perçue jusqu'à présent sous les formes barbares et compliquées de l'impôt et elle est trop souvent sans aucun rapport avec le service rendu, mais, telle quelle, elle n'en constitue pas moins une prime d'assurance.
[46]
CHAPITRE III.
L’INCAPACITÉ DE SE GOUVERNER SOI-MÊME. LA TUTELLE.↩
Assurer la propriété contre la tendance naturelle aux hommes à s'emparer par violence ou par ruse du bien d'autrui, telle est donc la fonction essentielle des gouvernements. Ils ont encore d'autres attributions, nécessitées par les autres défectuosités de la nature humaine, se traduisant par l'incapacité ou la capacité insuffisante de l'immense majorité des hommes à gouverner utilement leurs affaires et leur vie, utilement, c'est-à-dire d'une manière conforme aux lois naturelles. Cette insuffisance de capacité du self-government devient, il faut le remarquer, plus nuisible à mesure que le mécanisme de la production se perfectionne et s'agrandit davantage. D'où la nécessité de la tutelle, savoir du gouvernement libre ou imposé de l'homme par l'homme.
Considérons la multitude des individus de toutes rayées, de toute condition et de tout âge qui peuplent notre globe, combien en trouverons-nous qui aient la capacité physique, intellectuelle et morale nécessaire pour résoudre le problème de l'existence, sans nuire aux autres et à eux-mêmes ; qui sachent, d'une part, appliquer les [47] pouvoirs productifs dont ils disposent aux entreprises les plus utiles : qui sachent, d'une autre part, les conserver par une consommation saine et judicieuse, et les reproduire à la fois par une juste proportion établie entre leur consommation actuelle et leur consommation future, une proportion non moins rigoureuse dans l'application de leur épargne à la formation des capitaux personnels, immobiliers et mobiliers. Cette capacité du self-government est rare et inégalement distribuée. Le trait dominant et caractéristique de la multitude, après la tendance à s'emparer du bien d'autrui, c'est l'imprévoyance : c'est la-propension à satisfaire ses besoins et ses appétits actuels sans se préoccuper de ses besoins futurs et des obligations à échéance, qu'elle se crée en les satisfaisant; c'est, par exemple, la tendance à se multiplier sans aviser aux moyens de pourvoir à l'éducation et à l'entretien des enfants jusqu'à ce qu'ils soient en état de pourvoir eux-mêmes i à leur subsistance. De là, dans toutes les sociétés humaines, non seulement le besoin d'une assurance contre la tendance à s'emparer du bien d'autrui, mais encore le besoin d'une tutelle destinée à subvenir à l'insuffisance du self-government individuel, en obligeant chacun, sous des pénalités physiques ou morales, à donner aux pouvoirs productifs dont il dispose la destination la plus utile, à régler sa consommation, et finalement à prendre l'habitude de remplir de lui-même, par sa propre initiative, toutes les obligations qui dérivent de la nature de l'homme et des conditions de son existence. Cette tutelle a un code qui embrasse tous les actes de [48] la vie et qui se compose d'un ensemble de règles, lois, coutumes ou usages, dont l'expérience a démontré l'utilité. Elle peut être, elle est même nécessairement imparfaite, comme tout ce qui vient de l'homme : elle doit se modifier et se restreindre à mesure que l'individu devient plus capable du self-government ; bref, n'être ni excessive ni insuffisante, et n'enlever au pupille pour l'attribuer au tuteur que la portion de pouvoir dont celui-ci ferait un usage plus utile. Mais ce qui atteste sa nécessité, en dépit de son imperfection souvent grossière et des frais de l'appareil coercitif qu'elle exige, dans quelques-unes de ses parties, c'est son universalité. Il n'existe aucun pays où l'individu ne soit assujetti, en dehors des restrictions et impositions nécessaires à assurer sa sécurité, à une certaine tutelle destinée à suppléer à l'insuffisance de son self-government.
Faisons maintenant une simple hypothèse. Supposons que les hommes devinssent assez parfaits pour pouvoir se passera la fois de l'assurance et de la tutelle, qu'en résulterait-il au point de vue de la production et de la distribution de la richessse ?
S'ils acquéraient une notion assez exacte de la justice pour avoir horreur du vol ; si, au lieu de la tendance universelle chez eux à s'emparer du bien d'autrui, les hommes venaient à se faire un devoir et un plaisir de le respecter, il en résulterait aussitôt une économie énorme des forces productives qui ont été jusqu'à présent gaspillées individuellement et collectivement pour s'emparer de la propriété sous ses différentes formes, personnelle, immobilière et mobilière,. ou [49] pour la défendre. Il n'y aurait plus de vols, plus de monopoles artificiels, plus de procès, .plus de guerres. On pourrait débarrasser la propriété du fardeau que lui impose l'énorme appareil de l'assurance de la sécurité intérieure et extérieure, ainsi que des restrictions et des servitudes qu'exige l'exercice efficace de l'industrie de l'assurance contre le vol individuel ou collectif; enfin, on verrait disparaître le risque que la mauvaise foi, l'infidélité aux engagements pris, les perturbations causées par la guerre ou simplement la crainte de la guerre font peser sur toutes les entreprises. Dans cette hypothèse, le mobile qui pousse l'homme à produire, savoir de se procurer la plus grande somme de jouissance en échange de la moindre peine, acquerrait toute sa puissance. Car le producteur serait exonéré du risque de se donner une peine pour qu'un autre recueille, en tout ou en partie, la jouissance attachée à cette peine, ainsi que de la lourde prime qu'il a payée de tout temps pour s'assurer, toujours imparfaitement, cette jouissance. La production, affranchie du risque principal qui la grève, pourrait prendre tout son essor, surtout si, en même temps qu’il se trouverait débarrassé de sa propension vicieuse à s'emparer du bien d'autrui, l'homme avait réussi à s'affranchir de ses autres vices et défauts, et à acquérir une capacité de self government suffisante pour pouvoir se dispenser de toute tutelle. Non seulement il économiserait les frais de cette tutelle, mais encore il serait dégagé des entraves et des gênes qu'elle lui impose, et qui, en vue d'empêcher l'emploi nuisible de la liberté et de la propriété, en empêchent [50] presque toujours, dans une mesure plus ou moins grande, l'emploi utile. Aucune perturbation provenant du fait de l'homme lui-même ne viendrait plus ralentir les progrès de la production et empêcher l'établissement de l'ordre économique. La production acquerrait son maximum de développement, tous ceux qui y concourent étant assurés de recueillir toute la jouissance attachée à la peine que nécessite la création de la valeur. D'un autre côté, la capacité de chacun à gouverner ses affaires, c'est-à-dire à fonder des entreprises et à y coopérer, étant entière, les industries qui pourvoient à la satisfaction de la multitude des besoins des hommes s'établiraient toujours dans les endroits et les conditions les plus économiques, elles seraient dirigées, gouvernées, administrées et desservies d'une manière irréprochable, leur production et leur offre dans les différentes parties du vaste marché du monde ne seraient jamais ni. insuffisantes ni surabondantes. La distribution ne serait troublée ni par les monopoles, qui empêchent les prix des produits et des services de se fixer au taux nécessaire, auquel la concurrence tend incessamment à les ramener, ni par les vices, qui font obstacle à la conservation, à la reproduction et à l'accroissement du capital et à son investissement proportionnel dans les agents productifs, en grossissant la rétribution de ceux qui sont à l'état de déficit aux dépens de ceux qui sont à l'état d'excédent. L'équilibre s'établirait de lui-même entre la production et la consommation au niveau des moindres frais de production, et de même entre la rétribution des agents productifs, personnel et matériel, [51] capital et travail, au niveau des frais nécessaires pour les entretenir, les reproduire et déterminer ceux qui les possèdent à les engager dans la production au lieu de les laisser inactifs et improductifs. Il n'y aurait plus d'autres causes de souffrances et de désordres que celles qui proviennent des difficultés de la production et de l'imperfection du milieu où l'homme est placé. Encore ces difficultés et ces imperfections iraient-elles en diminuant avec rapidité. L'industrie humaine, animée par le stimulant que procurerait à chacun la certitude d'obtenir toute la jouissance qui est le fruit de sa peine, acquerrait bientôt un maximum de puissance et de fécondité, elle finirait sinon par venir à bout des obstacles que l'irrégularité des saisons, les accidents atmosphériques et terrestres opposent à rétablissement du bien-être permanent et de l'ordre universel, du moins par les réduire à un imperceptible minimum. Bref, ce serait l'âge d'or.
Mais est-il nécessaire de remarquer combien nous sommes loin de cet idéal, et malgré la longueur du chemin que nous avons déjà parcouru, combien long est encore le chemin que nous avons à parcourir pour l'atteindre. De plus, si nous considérons la grossièreté et la bassesse originaires de notre nature, nous ne pouvons guère nous flatter d'arriver jamais à l'état de perfection morale qu'il exige. Nous pouvons avoir seulement l'espérance d'en approcher.
[52]
[52]
CHAPITRE IV.
LE CAPITAL. LES MOBILES QUI DÉTERMINENT SA FORMATION.↩
Revenons sur le terrain des réalités et reprenons l'examen des obstacles que l'insuffisance de la capacité de l'homme à gouverner ses affaires et sa vie, son ignorance et ses penchants vicieux opposent à l'opération utile des lois naturelles. Toutefois, avant d'aller plus loin, il nous paraît nécessaire de compléter en l'éclaircissant la notion du capital que les socialistes se sont plu à obscurcir, et sans laquelle il est impossible de se faire une idée nette du rôle nuisible de quelques-uns des obstacles principaux, tels que l'imprévoyance en matière de population, qui troublent la production et la distribution de la richesse.
Ce qui caractérise, en effet, uniformément toutes les conceptions du socialisme, c'est qu'elles reposent sur une analyse incomplète des éléments et des opérations de la production, et surtout qu'elles méconnaissent la nature et le rôle du capital. Les socialistes ne tiennent compte que du travail, c'est-à-dire du personnel employé à la production. Associer les travailleurs dans de [53] certaines conditions et par de certains procédés, et répartir entre eux, en vertu d'une règle qui est encore à trouver, les résultats de la production, voilà en quoi se résume à leurs yeux l'oeuvre qu'il s'agit d'accomplir pour résoudre la « question sociale ». Ils ne s'occupent guère du capital que pour chercher les moyens les plus expéditifs et les plus efficaces d'enlever à ce « tyran » la dîme usuraire qu'il prélève sur le travail, en restituant aux travailleurs « l'intégralité du produit ». Ils ne paraissent pas se douter que le travail ne peut produire sans l'assistance d'un matériel de plus en plus considérable, lequel doit être incessamment entretenu, renouvelé et augmenté. Ils ne paraissent, pas savoir davantage que toute opération productive s'accomplit dans le temps aussi bien que dans l'espace; qu'un intervalle parfois très court, mais aussi parfois très long, s'écoule avant que le produit puisse être achevé et réalisé, que dans toute la durée de cet intervalle la production exige une « avance de capital ». Enfin, les socialistes paraissent ignorer que les agents productifs, personnel et matériel, sont associés ou combinés dans des proportions déterminées par la nature des entreprises et l'état d'avancement de l'outillage.
Il suffit cependant d’examiner, dans un moment donné, une branche quelconque de la production pour y trouver : 1° l'avance d'une certaine somme de valeur, autrement dit d'un capital, investi sous, forme de terre, de bâtiments d'exploitation, de machines, d'outils, de matières premières, de monnaie ou d'articles nécessaires à l'entretien du personnel jusqu'à ce que le [54] produit soit réalisé, et au renouvellement du matériel dans le cas d'une insuffisance de réalisation ; 2° l'avance d'une autre somme de valeur, investie dans un personnel de travailleurs de tout ordre, pourvus, les uns d'aptitudes et de connaissances techniques, les autres simplement de force physique. Cela étant, il est nécessaire que le matériel et le personnel, le capital et le travail soient produits, et, de plus, qu'ils le soient dans des proportions déterminées par la nature des entreprises et l'état d'avancement de l'outillage.
Voyons donc comment se créent le capital elle travail et à quelles conditions ils peuvent être mis au service de la production.
Nous avons constaté que l'universalité des produits et des services nécessaires à la satisfaction des besoins de l'homme, autrement dit à sa consommation, sont créés au moyen d'entreprises et constituent, quelle que soit leur nature, des valeurs. Toute entreprise a pour objet la création d'une certaine somme de valeurs. Cette somme se distribue entre les pourvoyeurs des agents productifs engagés dans l'entreprise et elle forme leur revenu. Chaque homme, riche ou pauvre, possède un revenu aléatoire ou assuré, mais dérivé directement ou indirectement d'une ou plusieurs entreprises, et c'est au moyen de ce revenu qu'il pourvoit, bien ou mal, à sa consommation.
Considérez la population d'un pays tel que la France et examinez en quoi consistent ses moyens d'existence. Vous trouverez qu'elle les tire d'une multitude d'entreprises de toute sorte, agricoles, industrielles, commerciales, [55] littéraires, artistiques, sans oublier l'entreprise politique de l'État, dans lesquelles est investie une quantité énorme de capital sous forme de matériel et auxquelles coopère un personnel qui se dénombre par millions. Capitalistes et travailleurs (et presque tous sont, quoique dans des proportions inégales, à la fois l'un et l'autre) se partagent le produit des entreprises, et ces paris constituent leurs revenus. Comment les emploient-ils? Ils en consacrent une partie à la satisfaction de leurs besoins présents, et ils en réservent ou en « épargnent » le restant, soit qu'ils veulent employer les valeurs qu'ils soustrayent ainsi à leur consommation actuelle à augmenter leur puissance productive, partant leur revenu, en les utilisant dans leur propre industrie ou en les prêtant à autrui, soit qu'ils aient simplement en vue de pourvoir à leurs nécessités futures. Cet emploi du revenu comporte toutefois une extrême diversité, et ce partage entre la consommation actuelle et l'épargne en vue de l'avenir ne s'opère pas toujours. Les uns consomment au jour le jour la totalité de leur revenu, et il arrive même qu'ils entament leur capital, qu'ils fassent des dettes ou se livrent, d'une manière ou d'une autre, à la mendicité et au vol, ce qui signifie qu'ils subsistent en consommant une partie du capital ou du revenu d'autrui. Les autres, au contraire, ne consomment actuellement que la plus faible portion de leur revenu et accumulent le reste, Cela dépend de l'importance du revenu, de son caractère plus ou moins stable ou aléatoire, des nécessités auxquelles il doit pourvoir et des propensions naturelles à la prodigalité ou à l'économie [56] poussée parfois jusqu'à l'avarice de l'individu qui en dispose. Toute valeur épargnée, n'importe sous quelle forme, estime parcelle de capital et elle peut être investie dans le matériel ou dans le personnel de la production.
Le capital est, en résumé, le produit d'une épargne faite sur la consommation. Quels sont les mobiles et quelles sont les nécessités qui poussent l'homme à s'imposer les privations et les sacrifices qu'implique cette épargne? Ces mobiles et ces nécessites dérivent de sa nature et des conditions de son existence.
La vie de l'homme est naturellement limitée à un terme assez court, et, comme nous l'avons remarqué ailleurs, elle se partage en trois périodes : la période d'enfance et d'apprentissage, pendant laquelle l'individu, ne pouvant se créer lui-même un revenu suffisant pour le faire subsister, et ne possédant point la capacité nécessaire au gouvernement de ses affaires et de sa vie, son existence est plus ou moins à la charge d'autrui; 2° la période de maturité, pendant laquelle il possède la plénitude de ses forces productives, et de l'aptitude au gouvernement de soi-même ; 3° la période de décadence ou de vieillesse, pendant laquelle il ne possède plus qu'une portion progressivement déclinante de ses forces, ou même il finit par devenir absolument impropre à travailler et à se gouverner. De cette limitation et de cette division naturelle de son existence, qu'il est certes hors de son pouvoir de changer, dérive une série de nécessités et d'obligations correspondant-aces nécessités, auxquelles l'individu doit pourvoir sous peine de souffrir et de périr avant le terme marqué par la nature.
[57]
Le revenu que l'individu recueille dans sa période productive en utilisant les forces et les matériaux dont il dispose, qu'ils soient investis en lui sous forme de valeurs personnelles, ou en dehors de lui, sous forme de valeurs immobilières et mobilières, ce revenu, il doit l'appliquer à différentes destinations, nécessaires, quoique à des degrés divers, à sa conservation et à celle de sa progéniture. En premier lieu, il doit l'employer à l'entretien et à la réparation des forces productives ou des valeurs investies dans sa personne, et cette réparation est plus ou moins étendue et coûteuse, selon la quantité et la qualité des forces qu'il applique à la production ; en second lieu, il doit en réserver ou en épargner une partie, afin de pourvoir aux accidents, maladies et autres risques de nature à interrompre son activité productive : en troisième lieu, il doit en épargner une autre partie, en vue de subvenir à ses besoins pendant sa vieillesse ; en quatrième lieu, il doit appliquer une portion et non la moindre de son revenu à élever et à former, en lui faisant les avances indispensables, la génération destinée à remplacer la sienne ; enfin s'il n'a point à prendre sur son revenu la somme nécessaire à l'entretien et au renouvellement du capital investi en dehors de sa personne, sous forme de terres, d'instruments, de matériaux, de monnaie, etc., et composé de valeurs immobilières, ce capital pouvant communément, quand il demeure inactif, être investi sous des formes et dans des conditions qui en garantissent la conservation et la durée, et, quand il est en activité — ce qui est le cas général, — recevant une rétribution dans [58] laquelle se trouve comprise la somme requise pour le reconstituer d'une manière indéfinie, en revanche, c'est, sur son revenu qu'il doit prendre et épargner la somme nécessaire pour accroître sa puissance productive, s'il veut augmenter cette puissance et son revenu avec elle. Tel est l'aménagement utile du revenu ou de la consommation. L'aménagement utile, disons-nous, c'est-à-dire celui qui, en le supposant généralisé, procurerait à l'espèce et par conséquent aux individus qui la composent, la plus grande somme de jouissances en leur épargnant la plus grande somme de peine ou de souffrances.
Supposons, en effet, que l'aménagement du revenu, tel que nous venons de l'esquisser, jt tel que le prescrit la morale ou la science du gouvernement de l'homme par lui-même, soit le fait universel ; supposons que tous les hommes possèdent assez d'intelligence et de force morale pour faire cet emploi utile de leur revenu, en satisfaisant dans la mesure requise à toutes les obligations que leur imposent leur nature et les conditions de leur existence, quel serait le résultat ? C'est que les hommes, non seulement entretiendraient en bon état leurs forces productives tout en s'assurant une vieillesse exempte de soucis, mais encore qu'ils élèveraient une nouvelle génération de tous points apte à remplacer la génération existante, et qu'ils augmenteraient, en même temps, d'une manière progressive, le capital nécessaire à l'accroissement de l'espèce et à l'amélioration de ses moyens d'existence.
Ce supplément de capital, ajouté par la génération [59] présente à l'héritage des générations antérieures, devrait être partagé, dans la proportion déterminée par la nature des entreprises de production, entre le personnel et le matériel d'accroissement. Mais, dans un tel état de choses, les lois de la concurrence et de la progression des valeurs agiraient sans rencontrer d'obstacles provenant du fait de l'homme lui-même, pour maintenir cette proportion. Quand, par exemple, la quantité de capital investie dans le personnel tendrait à devenir surabondante, la concurrence agissant aussitôt avec une impulsion progressive, diminuerait sa rétribution pour augmenter celle du matériel, l'équilibre ne tarderait pas à se rétablir, et chacun des agents productifs recevrait de nouveau sa rétribution utile, c'est-à-dire la somme nécessaire pour l'entretenir et l'augmenter dans la proportion déterminée par la nature des entreprises. La production atteindrait alors le maximum que comporterait l'état d'avancement de l'industrie humaine et la distribution de ses fruits serait aussi utile, partant aussi équitable que possible.
[60]
CHAPITRE V.
LE CAPITAL. LES OBSTACLES A SA FORMATION.↩
Malheureusement, la distance est grande entre la réalité et l'hypothèse que nous venons de formuler. Des obstacles de toute sorte, provenant principalement de l'infériorité de notre nature, vicient l'emploi du revenu, troublent l'aménagement, utile de la consommation, entravent la création du capital et son investissement proportionnel dans le personnel et le matériel de la production, le plus souvent au détriment du personnel. Les lois de la concurrence et de la progression des valeurs n'agissent pas moins au milieu de ce désordre pour rétablir l'équilibre entre les agents productifs, en faisant tomber au-dessous du nécessaire la rétribution de ceux qui surabondent, en élevant au-dessus la rétribution de ceux qui sont en déficit. Mais cette police de la consommation, la nature ne la fait point sans infliger aux uns des pénalités cruelles et sans accorder aux autres des récompenses exagérées, et comme elle ne se préoccupe point des individus, comme elle rend l'innocent solidaire du coupable dans l'application de ses pénalités, comme ses récompenses tombent, en vertu de la même [61] loi de solidarité, indifféremment sur ceux qui les méritent et sur ceux qui en sont indignes, l'instrument dont elle se sert pour faire renaître l'ordre, la concurrence, soulève un concert de malédictions. Cependant, au lieu de la maudire, ne serait-il pas plus sage de rechercher pourquoi elle écrase ceux-ci, pourquoi elle élève ceux-là, et de s'appliquer à remédier aux maux qu'elle corrige en faisant crier le malade ?
C'est à ces causes que nous allons remonter en examinant les obstacles que nos vices et notre ignorance opposent à l'aménagement utile de la consommation.
Si nous considérons, en premier lieu, les obstacles au bon entretien des forces productives et à la conservation de la vie de l'individu, que trouverons-nous? D'abord que l'immense majorité des hommes accordent à leur consommation actuelle une part excessive, en disproportion avec les nécessités de la consommation future. Les ouvriers, par exemple, ne réservent rien ou réservent peu de chose, même dans les périodes de prospérité et de hauts salaires, pour subvenir aux cas de maladie, d'accidents ou de chômages, et finalement pour pourvoir à l'entretien de leur vieillesse. De plus, cette pari disproportionnée qu'ils accordent à la consommation actuelle, est communément viciée dans son emploi : au lieu d'être consacrée à réparer les forces et à conserver la vie de l'individu, elle sert trop souvent à affaiblir les unes et à abréger l'autre. Les consommations nuisibles, l'abus des liqueurs fortes, du tabac, le jeu, la débauche enlèvent une portion considérable du revenu qui devrait être affecté exclusivement à la consommation utile du [62] présent ou réservé à celle de l'avenir. Quelles sont les conséquences naturelles et inévitables de ces nuisances? C'est que l'individu, ne réparant point suffisamment ses forces, devient un coopérateur moins efficace de la production, et ne peut plus prétendre qu'à une moindre part de ses résultats; c'est encore que sa période de validité et d'activité productive se trouve abrégée et qu'il est voué à une incurable misère dans « a période d'invalidité et de vieillesse.
Si nous considérons, en second lieu, les obstacles qui entravent le renouvellement utile du personnel de la production, nous rie serons pas moins frappés de leur multiplicité et des maux qu'ils entraînent à leur suite. Chaque génération est obligée d'avancer les frais d'élève et d'éducation de celle qui lui succède jusqu'à ce que celle-ci soit en état de pourvoir elle-même à sa subsistance, et cette avance de capital est d'autant plus considérable que l'outillage de la production est plus perfectionné, qu'il exige par conséquent un personnel plus intelligent, attentif et consciencieux pour le desservir. Elle s'élève de nos jours à une somme énorme et toujours croissante, et elle absorbe une portion notable du revenu de chaque famille. Mais comment est-elle aménagée et distribuée? Comment la nouvelle génération est-elle mise au monde, élevée et rendue apte aux fonctions productives qu'elle est destinée à remplir? Les mobiles qui poussent les hommes à la reproduction de leur espèce sont de diverse nature : physiques, moraux et économiques. C'est l'attrait des sexes ou l'appétit sexuel, l'amour des, enfants et du foyer; c'est encore, [63] pour la grande majorité, l'intérêt à se créer des auxiliaires productifs. Ces mobiles sont plus ou moins actifs d'individu à individu. Ils se combinent à des degrés très différents, et ils sont influencés par les circonstances ambiantes ; mais l'expérience atteste qu'ils ont agi jusqu'à présent avec une énergie plus que suffisante pour assurer la reproduction croissante de l'espèce. Seulement, malgré les mesures qui ont été prises de tout temps pour contraindre ceux qui, obéissant à l'appétit sexuel, mettent un enfant au monde, à s'acquitter de l'obligation née de cet acte, c'est-à-dire à subvenir aux frais d'élève, d'éducation et d'apprentissage de l'enfant jusqu'à ce qu'il soit en état de pourvoir lui-même à sa subsistance, et sans escompter à leur profit.ses forces naissantes, cette obligation, la plus importante de toutes, n'a été jamais et nulle part généralement et complètement remplie. Même dans les sociétés les plus civilisées, bien des gens ne paraissent pas se douter que l'action de donner le jour à un enfant implique une responsabilité dont ils ne peuvent s'affranchir sans commettre un assassinat ou un vol, — un assassinat s'ils ne fournissent pas les soins et la subsistance nécessaires à l'être qu'ils ont appelé à la vie, un vol s'ils rejettent ce fardeau sur autrui. On peut constater même un affaiblissement de ce sentiment de responsabilité depuis que les garanties préventives que les anciennes législations ou les coutumes établissaient pour assurer la reproduction utile de l'espèce, ont en partie disparu avec la réprobation qui frappait les délinquants et qui s'étendait jusqu'aux fruits innocents de leur faute. Dans les [64] classes inférieures, on s'unit devant la loi ou en dehors de la loi et on pullule, sans se demander si l'on possède les moyens d'élever ses enfants ; encore moins se demande-t-on s'ils pourront trouver une place dans l'atelier de la production. On compte sur la charité publique et privée ; on compte aussi sur l'exploitation de l'enfant que l'on se hâte d'assujettir au travail avant que ses forces soient développées. Dans les classes supérieures, on est plus prévoyant: si l'on se préoccupe peu du nombre et de la destinée des enfants naturels, on s'abstient de mettre au monde plus d'enfants légitimes qu'on n'en peut élever conformément au rang que l'on occupe dans la société; quelquefois même on pousse à cet égard la prévoyance à l'excès. A quoi il faut ajouter que les convenances de fortune décident le plus souvent des mariages, en dehors des convenances physiques et morales, quand ce n'est pas en opposition avec elles. Quel est le résultat de cet aménagement vicieux de la reproduction de l'espèce ? C'est, dans les régions inférieures de la société, une mortalité excessive des enfants, multipliés tantôt sans prévoyance, tantôt sous l'impression d'un calcul sordide, mal nourris et mal soignés, et la perte du capital que leur entretien a absorbé depuis leur naissance jusqu'à leur mort; c'est encore l'affaiblissement des survivants^ que leurs par rents exploitent avant l'âge comme s'il s'agissait de bêtes de somme dont la propriété cesserait de leur appartenir dès qu'elles auraient acquis toute leur croissance. Dans les classes supérieures, c'est la formation d'une génération insuffisante et chétive, qu'une instruction [65] prétendue classique rend ensuite impropre à exercer utilement les fonctions dirigeantes de la production. Bref, tandis que les éleveurs d'animaux domestiques s'appliquent non seulement à en proportionner aussi exactement que possible le nombre au débouché qui leur est ouvert, mais encore à en conserver et en améliorer les races, l'immense majorité des hommes vaque à la reproduction de l'espèce sans aucune préoccupation de ce genre. C'est à la Providence qu'on laisse le soin de la conservation et de l'amélioration des races humaines; c'est à la Providence encore qu'on se fie pour trouver un débouché et des moyens d'existence à toutes les créatures que l'on met au monde.
Voilà comment se produit et se multiplie la population qui fournit le travail physique et intellectuel nécessaire à la production, et qui n'est autre chose, au point de vue économique, qu'un capital composé de valeurs investies dans les personnes, autrement dit, de « valeurs personnelles ». Voyons maintenant comment se constitue cette autre portion du capital d'une nation qui s'investit dans le matériel des entreprises et qui se compose de valeurs immobilières et mobilières.
Si, comme nous l'avons démontré, toutes les entreprises qui fournissent aux hommes leurs moyens d'existence exigent la coopération dans des proportions déterminées par la nature de chaque production, d'un « personnel » et d'un « matériel », c'est-à-dire d'une accumulation de pouvoirs productifs, ou, ce qui est synonyme, de valeurs investies les unes dans l'homme, les autres hors de l'homme, la formation du capital [66] mobilier et immobilier, son renouvellement et son accroissement ne sont pas moins nécessaires que ceux du capital personnel. Si l'on ne peut produire sans un personnel pourvu des aptitudes et des connaissances techniques exigées par l'entreprise, on ne le peut pas davantage sans un matériel composé, comme nous l'avons vu, dans des proportions diverses, selon la nature de l'entreprise, de terre, de bâtiments d'exploitation, de machines, d'outils, de matières premières, de monnaie et d'articles destinés à la subsistance du personnel jusqu'à ce que le produit soit réalisé, en admettant, ce qui est le cas général, que le personnel ne possède point cette avance de subsistance ou préfère l'appliquer à une autre destination. Il faut donc incessamment produire du capital pour renouveler et accroître le matériel des entreprises, de même qu'il faut en produire pour renouveler et accroître le personnel. Et cette double production s'opère par le même procédé, quoique avec des différences dans la forme, savoir, par l'épargne d'une portion des valeurs réalisées et distribuées aux coopérateurs des entreprises, dont elles constituent le revenu. La différence essentielle à signaler, au moins sous le régime de la liberté du travail (car cette différence n'existe pas lorsque le travail est esclave), c'est que la part afférente au personnel qui fournit le travail lui est entièrement distribuée, à charge par lui de pourvoir à son entretien et à son renouvellement, tandis que l'on compte dans les frais de l'entreprise, l'entretien et la reproduction du matériel dont une partie est plus ou moins usée et dont une [67] autre partie est entièrement détruite par l'opération productive. Sous forme de salaire, les travailleurs reçoivent donc une somme destinée à couvrir leurs frais d'entretien et de renouvellement, à laquelle peut s'ajouter aussi une autre somme destinée à les déterminer à coopérer à la production plutôt qu'à laisser improductif leur capital de « valeurs personnelles ». Les pourvoyeurs du matériel, au contraire, ne reçoivent sous forme de profits, d'intérêts ou de rentes, qu'un simple excédent destiné à couvrir les risques de l'emploi de leur capital mobilier ou immobilier, avec un bénéfice suffisant pour les déterminer à s'en dessaisir et à l'engager dans une entreprise au lieu de le conserver inactif [6] . C'est en soustrayant, par l'opération de [68] l'épargne, une partie de cet excédent à leur consommation actuelle et à celle de leur famille que les [69] « capitalistes » contribuent à l'augmentation du capital. Les « travailleurs » y contribuent de leur côté, quoique [70] dans une mesure ordinairement moindre, par la même opération.
Cependant, il faut bien remarquer qu'aucun des mobiles qui excitent l'homme à s'imposer les privations et les sacrifices qu'impliquent l'épargne et l'investissement des valeurs épargnées sous la forme du matériel mobilier ou immobilier, n'est comparable en véhémence à l'appétit sexuel, qui est le premier agent de la production du personnel. Quoique cet appétit ne suffise pas seul à la création du « capital personnel », il constitue une amorce qui n'existe pas pour l'épargne appliquée à la capitalisation mobilière et immobilière. Pour opérer celle-ci, il faut sacrifier des jouissances présentes et s'imposer des privations souvent fort dures en vue d'éviter des maux et de se procurer des biens futurs, toujours plus ou moins incertains, soit qu'il s'agisse de pourvoir aux maladies, aux chômages, à la vieillesse, ou d'augmenter son revenu, en appliquant [71] un supplément de capital à ses affaires ou en le prêtant à autrui. On conçoit que ces fins de l'épargne, malgré la supériorité des jouissance ultérieures qu'elles promettent en comparaison des jouissances actuelles d'une consommation imprévoyante, ne suffisent pas toujours pour déterminer l'individu à réfréner ses appétits ; que l'absence de prévoyance, le goût du luxe, l'ivrognerie, la débauche, opposent un obstacle naturel à l'épargne et à ses applications utiles. Toutefois, l'action perturbatrice de ces défectuosités et de ces vices est combattue par celle des vertus qui poussent l'homme à remplir ses obligations et à améliorer son sort. Si la production du capital est loin d'atteindre le développement auquel elle ne manquerait pas d'arriver, en admettant que l'étalon de la prévoyance et de la moralité fût plus élevé, elle va néanmoins en augmentant toujours. Ce qui l'atteste, c'est la quantité visiblement croissante des capitaux qui sont mis, sous toutes les formes, au service de la production dans les pays civilisés ou qui servent à agrandir le domaine de la civilisation.
[72]
CHAPITRE VI.
LES OBSTACLES PROVENANT DU MILIEU. L'INSTABILITÉ DES RENDEMENTS DE LA PRODUCTION.↩
A la propension de l'homme à s'emparer par violence ou par ruse des valeurs créées par autrui, à l'insuffisance de sa capacité à maîtriser ses autres inclinations vicieuses et à gouverner utilement ses affaires et sa vie, viennent se joindre encore : 1° les obstacles qui proviennent de l'imperfection et de l'état arriéré de l'appareil d'assurance et de tutelle, autrement dit du gouvernement établi pour prévenir ces nuisances ou y remédier; 2° ceux qui ont leur source dans l'imperfection du « milieu » et dans le progrès lui-même.
Nous renvoyons l'examen des premiers à la quatrième partie (la servitude politique) et nous nous bornerons à dire quelques mots des seconds — irrégularité des saisons, sécheresses, inondations, tremblements de terre, etc. Parmi ceux-ci, l'irrégularité des saisons est la cause la plus générale des perturbations provenant du « milieu », en ce qu'elle engendre, dans les branches les plus importantes de la production, « l'instabilité des rendements ».
[73]
Il n'existe, en effet, jusqu'à présent qu'un bien petit nombre d'industries dont l'homme soit absolument le maître de régler la production, en raison des besoins du marché [7] . Telles sont généralement les industries manufacturières. En revanche, telles ne sont point les industries agricoles ou minières. Dans ces branches nombreuses et importantes de la production, les résultats sont toujours plus ou moins incertains et aléatoires. Sous l'influence des circonstances climatériques qui échappent à l'action de l'homme, la même surface de terre livrée à la culture des céréales, du coton et des autres plantes alimentaires ou industrielles, donne, d'une année à l'autre, des rendements fort inégaux; il en est de même du rendement des mines : celui-ci demeure tantôt inférieur aux besoins du marché et tantôt supérieur. Dans ce dernier cas, à la vérité, le producteur peut continuer à proportionner son offre aux besoins du marché, mais non sans opérer dans son exploitation un ralentissement d'activité qui cause un chômage, partant une perte à une portion du capital et du travail engagés dans l'entreprise. Quelle est la conséquence de cette instabilité des résultats de la production et, en particulier, de la variabilité des récoltes des plantes alimentaires ou industrielles? C'est de causer une série de perturbations plus ou moins étendues et profondes, selon l'amplitude de l’écart [74] entre la quantité des produits à obtenir pour couvrir exactement les frais de la production et celle des produits obtenus. Si cette dernière quantité est inférieure à la première, et si l'article en déficit est une nécessité de la vie, le consommateur sera obligé, tout en réduisant autant que possible sa demande, de consacrer à l'achat de cet article une portion de son revenu plus considérable que celle qu'il y affecte d'habitude; il devra, en conséquence, réduire d'autant toutes ses autres dépenses, c'est-à-dire demander moins de tous les autres articles; ce qui en fera baisser le prix au détriment de ceux qui les produisent. En revanche, les producteurs de l'article en déficit, obtenant, en vertu de la loi des valeurs, un prix supérieur à la diminution des quantités, voient leur revenu s'élever et avec lui leur puissance d'achat. Leur demande s'augmente en proportion; mais comme elle ne se produit pas dans les mêmes localités et ne se porte pas sur les mêmes articles, il n'y a pas compensation. S'il s'agit d'un article de seconde nécessité ou de luxe, la perturbation causée par le déficit et le renchérissement est moindre; les consommateurs diminuent leur demande, ce qui ralentit la hausse du prix, et dans ce cas, le dommage causé par le déficit se partage entre le producteur dont le profit est diminué et le consommateur qui obtient une quantité moindre à un prix augmenté. Si, au contraire, les résultats de la production dépassent les prévisions, le surcroît des quantités offertes fera baisser les prix, toujours dans une proportion plus forte, les producteurs subiront une perte, qu'atténuera [75] seulement l'augmentation de la demande déterminée par la baisse; les consommateurs réaliseront une économie qui leur permettra de demander un supplément des divers articles dont ils ont besoin. Les producteurs de ces articles verront ainsi s'accroître leurs profits, tandis que ceux des produits ou des services habituellement demandés par les producteurs de l'article surabondant verront diminuer les leurs. Ces perturbations causées par l'inégalité des résultats de la production s'étendent de proche en proche et elles contribuent, pour une bonne part, à rendre perpétuellement instable l'équilibre de la production et de la consommation.
[76]
CHAPITRE VII.
LES PROGRÈS DE LA MACHINERIE DE LA PRODUCTION.↩
Un autre obstacle au maintien de l'ordre économique réside dans les progrès mêmes qui améliorent la condition de l'espèce humaine.
Les progrès qui transforment le matériel et les méthodes de la production, et qui augmentent d'une manière permanente, avec la puissance productive de l'homme, le cercle de ses consommations et l'étendue de ses jouissances, sont toujours achetés par une perturbation temporaire. Comment opèrent-ils? Prenons pour exemple l'introduction des métiers mécaniques dans l'industrie du tissage. Ces métiers perfectionnés permettent de réaliser dans la fabrication des étoffes une économie que nous supposons de 25 0/0. Quels sont les résultats immédiats de leur introduction? D'une part, c'est de mettre hors de service l'ancien matériel et une partie de l'ancien personnel, devenu inutile ou impropre à s'adapter aux nouveaux métiers, et d'infliger ainsi une perte ou une moins-value à toute une catégorie d'entrepreneurs, de capitalistes et d'ouvriers, perte et moins-value qui ont leurs répercussions [77] naturelles et inévitables. D'une autre part, en revanche, les inventeurs, les entrepreneurs et les capitalistes qui introduisent ce progrès obtiennent des profits exceptionnels jusqu'à ce qu'il se soit généralisé, c'est-à-dire jusqu'à ce que la concurrence ait fait baisser le prix des étoffes dé tout le montant de l'économie réalisée sur les frais de la production. Les inventeurs bénéficient de leur invention jusqu'à l'expiration de leur brevet ou jusqu'au jour où une machine ou un procédé plus économique vient supplanter le leur; les entrepreneurs bénéficient d'une partie de l'économie des frais ; les capitalistes, à l'exception de ceux qui possédaient le matériel réformé, profitent de l'augmentation de la demande de capital pour l'établissement des nouvelles manufactures et le renouvellement de l'outillage des anciennes. Les ouvriers, au contraire, à l'exception de ceux qui sont particulièrement aptes à mettre en oeuvre le nouvel outillage, voient baisser temporairement leurs salaires par le fait du changement que le progrès opère dans la proportion du capital et du travail requis pour la production, le travail mécanique se substituant, dans une mesure plus ou moins forte selon l'importance du progrès accompli, au travail physique ; mais, en compensation de cette dépression temporaire, le progrès procure aux ouvriers un bénéfice permanent, tandis que celui des autres coopérateurs de la production est passager; il élève la qualité de leur travail et avec elle sa rétribution nécessaire, au niveau de laquelle le taux du salaire tend inévitablement à s'établir. Quant aux consommateurs, le progrès [78] leur procure un bénéfice croissant et qui n'est acheté par aucune perte. Il n'est pas moins vrai que tout progrès est une cause de perturbations et de dommages immédiats; à quoi il faut ajouter que les mesures que les gouvernements ont l'habitude de prendre pour protéger les industries en retard contre les industries en progrès n'ont d'autre résultat que de prolonger ces perturbations et de les transformer en un mal chronique.
[79]
CHAPITRE VIII.
LE RÉTABLISSEMENT NATUREL DE L'ORDRE ÉCONOMIQUE.↩
Si l'on examine le mode d'opération des causes de perturbation dont nous venons de donner un aperçu sommaire, nous trouverons invariablement qu'elles agissent sur chacun des marchés de la multitude des produits et services que les différentes branches de la production offrent à la consommation, pour augmenter ou diminuer l'offre, de manière à abaisser le prix du marché au-dessous du prix de revient, ou, ce qui revient au même, des frais de production d'une partie ou de la totalité des produits ou des services offerts, ou pour l'élever au-dessus ; en d'autres termes, ces causes de perturbation agissent pour déranger l'équilibre de la production et de la consommation, tout en augmentant ou en diminuant les frais de la production. Mais alors qu'arrive-il? c'est que la loi naturelle de la concurrence, combinée avec la loi de progression des valeurs, agit à son tour pour rétablir cet équilibre nécessaire. Rappelons comment elle agit. Deux cas peuvent se présenter. Ou l'offre tombe au-dessous des besoins du marché, ou elle s'élève au-dessus. Dans le premier [80] cas l'insuffisance des quantités offertes provoquant une augmentation progressive du prix de l'article en déficit, il y a un avantage croissant à en augmenter la production ; l'esprit d'entreprise et les capitaux y sont attirés par une prime d'autant plus élevée que le déficit est plus grand, jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli. Parfois, sans doute, les obstacles naturels ou artificiels qui s'opposent au rétablissement de l'équilibre sont assez forts et assez résistants pour empêcher l'offre de s'accroître, mais ces obstacles sont battus en brèche d'autant plus vigoureusement qu'ils procurent un bénéfice plus élevé aux producteurs, partant, qu'ils causent une perte plus forte aux consommateurs. S'il s'agit d'un article de première, nécessité, dont le prix hausse de manière à dépasser la puissance d'achat des consommateurs, concentrée sur ce seul article, le déficit engendrera une famine, et l'équilibre se rétablira brutalement par la suppression des consommateurs dont la puissance d'achat est inférieure au prix surhaussé. Dans le second cas, au contraire, lorsque les quantités offertes sont à l'état d'excédent, les prix baissent de même en progression géométrique, et à mesure qu'ils tombent au-dessous des frais de production d'une entreprise, celle-ci subit des pertes croissantes, elle est forcée de réduire sa production, faute d'en pouvoir rétablir entièrement les agents, ou même de disparaître. Par suite de cette élimination des entreprises les moins économiques et de la diminution de l'offre qui en résulte, l'équilibre se rétablit encore.
C'est grâce à cette opération de la loi naturelle de la [81] concurrence que, dans toutes les branches de la production, les entreprises qui fonctionnent de la manière la plus économique, c'est-à-dire la plus utile à la généralité, subsistent et se développent tandis que les autres tombent en faillite et disparaissent; d'où il résulte que ce qu'il y a de malsain et de vicieux dans l'organisme de la production est constamment éliminé au profit des parties saines et vigoureuses [8] , c'est grâce à [82] cette même opération que l'équilibre tend continuellement à se maintenir où à se rétablir, en dépit dé tous les obstacles, entre la production et la consommation; que lorsqu'une branche quelconque d'industrie produit [83] moins que ce qui est nécessaire ou au delà de ce qui est nécessaire pour réaliser par l'échange la somme de valeur indispensable pour rétablir ses agents productifs et mettre ses produits, d'une manière continue, au service de la consommation, elle est poussée ou ramenée, par une force croissante, à cet état de développement utile. Supposons encore que la loi de la concurrence n'existât point, comment les entreprises seraient-elles excitées à améliorer leur production, à perfectionner leurs machines et leurs méthodes, à produire mieux et avec plus d'économie? Sans doute, la loi de l'économie des forces, en les faisant bénéficier de toute épargne réalisée dans leurs frais, agit comme un stimulant au progrès, mais telle est la paresse de l'homme que cette récompense est insuffisante pour le faire sortir de sa routine accoutumée, si une pénalité n'y est pas jointe. Cette pénalité, c'est la loi de la concurrence qui l'établit, en contraignant l'universalité des producteurs à obéir, sous peine de ruine, à la loi de l'économie des forces.
Telle est la double opération de la loi de la concurrence : combinée avec la loi de progression des valeurs, [84] elle impose le progrès et elle rétablit l'équilibre entre la production et la consommation, en dépit de tous les obstacles. Mais cette oeuvre nécessaire et bienfaisante, elle ne l'accomplit point, ces obstacles, elle ne les surmonte point sans occasionner des « crises », lesquelles sont toujours accompagnées de souffrances plus ou moins étendues et cruelles. Les esprits superficiels, qui n'aperçoivent que les causes immédiates des phénomènes sans remonter plus loin, ne manquent point de la rendre responsable de ces souffrances, de même qu'on accuse volontiers la police des maux qui accompagnent la répression d'une émeute, sans se demander si l'absence d'une force répressive chargée du maintien de l'ordre et le triomphe des éléments de désordre n'auraient point occasionné des maux plus graves et plus dangereux.
Les causes premières des crises, celles auxquelles il faut faire remonter la responsabilité des maux que l'on a l'habitude d'imputer à la concurrence, résident dans les obstacles qui s'opposent à l'établissement de l'équilibre de la production et de la consommation au niveau des moindres frais de production. Supposons que toutes les entreprises fussent également bien situées, constituées et desservies ; qu'elles réalisassent ensemble les mêmes progrès ; que toutes les industries pussent régler leur production exactement en proportion des besoins du marché: que les guerres, les épidémies, les modifications de tarifs, les monopoles, les coalitions, les changements de la mode et des habitudes de la consommation, ne vinssent point jeter la perturbation [85] dans les débouchés, il n'y aurait point d'autres crises que celles que le progrès occasionne, en frappant de moins-value les agents productifs qu'il remplace. Malheureusement, cette hypothèse est fort éloignée de la réalité, et de plus, il ne dépend pas de l'homme de supprimer entièrement les obstacles qui s'opposent à l'établissement de l'ordre économique. Il ne peut supprimer que ceux qu'il a créés lui-même; il ne peut qu'atténuer ceux qui sont l'oeuvre de la nature, en attendant qu'il ait acquis la puissance de maîtriser et de gouverner absolument le monde physique ; mais il peut connaître les uns et les autres, se rendre compte de leur action perturbatrice et s'assurer contre leurs nuisances. Pour ne citer qu'un exemple, l'homme n'a pas le pouvoir de régler la production des fruits du sol et des produits du sous-sol comme celle des produits manufacturés. L'instabilité de ces deux grandes branches de la production constitue un obstacle naturel à l'établissement de l'ordre économique, qu'il n'est point parvenu encore à surmonter et qu'il ne surmontera peut-être jamais entièrement. Cependant, il faut remarquer que les progrès de la science et de l'industrie ont pour résultat de lui assujettir de plus en plus les forces de la nature, et qu'à mesure que la culture des céréales devient plus scientifique, ses produits deviennent moins incertains. Mais si, à cet égard, la puissance de l'homme est limitée, en revanche, il dépend de lui de prévoir et de corriger, dans une large mesure, les effets de cet aléa. Il peut découvrir et employer des méthodes de plus en plus parfaites de conservation des grains, et créer un [86] organisme commercial et financier qui permette aux producteurs de céréales de ne point apporter immédiatement au marché la totalité d'une récolte surabondante, d'en réserver une partie pour combler les déficits éventuels des années suivantes; il peut prévoir les changements d'ailleurs graduels des habitudes et même des modes, et régler sa production en conséquence. Il dépend encore de lui d'empêcher la perturbation des débouchés par la guerre, les monopoles, les coalitions, les changements dans la fiscalité et en particulier dans les tarifs des douanes. Enfin, il peut se prémunir contre le risque du progrès et tous les autres risques, qu'il n'est pas en son pouvoir d'éviter, en assurant ses capitaux et sa vie.
En attendant, la nature impassible agit quand même pour faire observer ses lois; elle balaye impitoyablement les entreprises mal constituées et mal desservies ou rétives au progrès, sans s'inquiéter de la destinée de ceux qui en vivent; elle rétablit l'équilibre rompu entre la production et la consommation, tantôt par la ruine des producteurs, tantôt par la mort des consommateurs. L'agent qu'elle emploie pour faire cette police rude, mais nécessaire, pour empêcher les hommes de s'attarder sur le chemin du progrès et faire régner l'ordre dans le monde économique, c'est la concurrence, l'infâme concurrence, que les socialistes de toutes les écoles s'accordent à vouloir anéantir. Mais, en admettant même qu'il fût au pouvoir de ces myrmidons de supprimer cette « loi naturelle », par quoi la remplaceraient-ils?
TROISIÈME PARTIE.
L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE. FORMES ET TRANSFORMATIONS DE LA CONCURRENCE
[87]
CHAPITRE PREMIER.
LA CONCURRENCE ANIMALE.↩
Nous venons de donner un aperçu des lois générales qui gouvernent le monde économique, et dés obstacles qu'elles rencontrent dans l'homme et le milieu où se déploie son activité. Si nous voulons maintenant nous faire une idée du développement' futur de l'édifice de civilisation qui s'est construit, d'âge en âge, sous l'impulsion de ces lois, il nous faut revenir en arrière et rechercher comment elles ont agi pour l'élever.
Mais d'abord il s'agit de savoir de quels matériaux est composé cet édifice et comment l'homme a dû procéder pour les découvrir, s'en emparer et les mettre en oeuvre.
Le globe qui a été mis à la disposition de l'homme renferme tous les éléments et toutes les forces nécessaires pour subvenir à la satisfaction la plus ample de ses besoins. Seulement ils y sont à, l'état brut et en [88] quelque sorte chaotique. Essayons de nous représenter r ce qu'était ce globe, un des moins importants et, selon toute apparence, des moins richement dotés de notre monde planétaire, à l'époque où l'espèce humaine y est née et ce qu'était l'homme lui-même.
Remarquons que nous commençons seulement, après tant de centaines et peut-être de milliers de siècles d'existence, à connaître notre planète. Avant la découverte de l’Amérique, les hommes dont les explorations et les conquêtes avaient embrassé le cercle le plus étendu, n'en connaissaient pas même la moitié. Encore moins connaissaient-ils ses éléments constitutifs et son mobilier vivant. Aujourd'hui même, malgré les progrès extraordinaires qu'ont réalisés, depuis deux ou trois siècles, les sciences physiques et naturelles, nous sommes loin de posséder un inventaire complet de notre domaine terrestre.
Nous pouvons toutefois nous rendre compte, d'une manière approximative, des difficultés et des périls qu'allait rencontrer, dès sa naissance, l'espèce à laquelle était échue la mission de le mettre en valeur. Des climats inégaux et dans lesquels une saison glacée succédait à une saison torride, des plaines inondées et marécageuses, des déserts sans eau, des océans dont la surface mouvante était bouleversée par des vents furieux, des montagnes couvertes de-neige, labourées de précipices et creusées de cratères d'où s'échappaient des torrents de lave enflammée, une nuit pleine de mystère et d'épouvante succédant au jour : tel était le domaine où l'homme était appelé à vivre et à chercher [89] sa subsistance. Cette subsistance indispensable à l'entretien de sa vie, elle ne pouvait lui être fournie que par les autres espèces vivantes, végétales et animales. Ces espèces étaient innombrables, quoique inégalement distribuées sur le globe; mais, parmi les végétaux, quelques-uns seulement étaient propres à sa consommation alimentaire; d'autres étaient des poisons mortels; il fallait qu'il découvrît les espèces utiles avec les moyens de les multiplier et de les défendre contre les espèces nuisibles. Il en était de même pour les espèces animales qui peuplaient la terre, le ciel et les eaux. S'il en était un certain nombre dont la chair pouvait servira le nourrir et les dépouilles à le vêtir, à l'abriter et à l'outiller, d'autres, en revanche, et bien plus nombreuses, étaient ses ennemies naturelles. Parmi ces espèces ennemies pour lesquelles lui et les espèces animales et végétales qu'il assujettissait à son service étaient une proie, quelques-unes possédaient une force et des armes naturelles bien supérieures aux siennes. Dès son apparition sur la terre, il se trouva donc soumis à l'impérieuse nécessité de disputer sa subsistance et sa propre vie à ces espèces concurrentes.
Qu'était l'homme pour engager une pareille lutte et se rendre maître d'une terre qui appartenait depuis un temps immémorial aux colosses et aux monstres? Il était, lui aussi, un animal et non des plus vigoureux. Il appartenait aux espèces vivant sur le sol ; il ne pouvait s'élever dans les airs et franchir comme l'oiseau de vastes espaces; il ne pouvait subsister dans les eaux comme le poisson. Il était moins fort que l'ours, moins rapide [90] que le cerf, moins armé que le lion, le tigre et le loup; il ne pouvait suppléer à ce qui lui manquait de force, d'agilité et d'armes naturelles en distillant un venin mortel comme le scorpion et la vipère. Enfin, il était soumis aux mêmes besoins physiques que tous les autres animaux, obligé comme eux de pourvoir incessamment à sa subsistance, voué à des souffrances de plus en plus aiguës s'il demeurait privé d'aliments au delà de quelques heures, exposé à périr dans les tortures de la faim s'il en manquait pendant quelques jours. Mais s'il était, sous tant de rapports, inférieur aux espèces auxquelles il venait faire concurrence, il possédait en revanche un cerveau plus puissant et plus complet. Cette supériorité de l'instrument à l'aide duquel se produit l'intelligence et où elle capitalise ses acquisitions, devait à la longue lui procurer la victoire, et, cette victoire obtenue, lui donner, avec la possession du globe, les moyens de le mettre en pleine valeur.
Cependant, il fallait un moteur pour imprimer le mouvement à ce mécanisme producteur de l'intelligence humaine. Ce moteur, commun à l'homme et aux autres espèces vivantes, c'est la sensation de la douleur et du plaisir, par laquelle se manifeste la loi des forces aux êtres pourvus de vie, toute dépense ou déperdition de forces occasionnant une douleur, toute acquisition de forces procurant une jouissance ou un plaisir. Sous l'impulsion progressive, partant irrésistible de ce moteur, toutes les espèces vivantes se mettent au travail pour chercher les subsistances propres à entretenir et, s'il se peut, à accroître leurs forces vitales. Mais ce [91] travail tantôt simple, tantôt compliqué, soit qu'il suffise de découvrir la subsistance et de s'en emparer, soit qu'il faille en outre la façonner et la préparer à l'assimilation, es travail implique toujours une dépense préalable de forces, partant une souffrance. D'où, en premier lieu, la loi de l'économie des forces, en vertu de laquelle toutes les espèces vivantes s'appliquent à diminuer leur travail ou, ce qui revient au même, à en augmenter les résultats, et les plus intelligentes à inventer des instruments et des procédés qui leur permettent d'obtenir une certaine quantité de forces réparatrices et de jouissances en échange d'une moindre quantité de travail et de peine. D'où, en second lieu, la loi de la concurrence, en vertu de laquelle toutes les individualités vivantes luttent pour l'acquisition des subsistances nécessaires à la réparation de leurs forces vitales, et qui procure la victoire aux plus fortes ou, ce qui revient au même, à celles qui savent le mieux employer et, au besoin, combiner leurs forces, en assurant ainsi la conservation et le progrès général des espèces.
Voilà donc l'homme à l'oeuvre pour chercher sa subsistance. Il s'applique à découvrir les végétaux et à capturer les animaux propres à lui servir d'aliments. Mais, dans cette recherche de la subsistance, il se trouve tout d'abord en conflit avec les grandes espèces, plus anciennes que lui sur le globe et auxquelles il vient ravir une portion de leur stock alimentaire. C'est la concurrence animale, la première forme sous laquelle se produit la concurrence. Elle procède par le vol et le meurtre accomplis sur les autres espèces ou à leurs [92] dépens, et même sur les variétés les plus faibles de l'espèce humaine, dans les régions où le règne animal est pauvre, où les espèces inférieures sont peu nombreuses, peu abondantes en chair et difficiles à atteindre. Elle demeure absolument prédominante dans cette période de l'enfance de l'humanité que l'on désigne sous la dénomination de temps primitifs ou préhistoriques, période dont la durée est l'objet d'appréciations si diverses et que quelques-uns portent jusqu'à deux cent mille ans et même davantage. C'est à cette concurrence rudimentaire que l'espèce humaine est redevable de ses premiers progrès, germes de tous les autres. Parmi ses concurrents, quelques-uns lui étaient bien supérieurs sous le rapport de la force et de l'armement. Sous peine d'être détruits par eux, les hommes sont obligés d'associer et de combiner leurs forces, à l'exemple de beaucoup d'espèces plus faibles, et ils sont excités, en même temps à mettre en oeuvre leurs qualités supérieures d'observation et d'invention pour se créer un armement artificiel qui supplée à l'insuffisance de leur armement naturel.
Grâce ce double progrès, il peuvent lutter chaque jour avec plus d'avantage contre leurs formidables compétiteurs, et les détruire ou s'emparer de la meilleure part de leur stock alimentaire, en déterminant ainsi, à la longue, l’extinction des espèces qui avaient besoin, pour subsister, de consommer régulièrement la masse la plus considérable d'aliments. Nous ignorons, et sans doute nous ignorerons toujours, quelles ont été les péripéties de cette lutte, mais en considérant la [93] puissante ossature des concurrents auxquels l'homme a arraché la domination du globe, nous pouvons conjecturer que la victoire a dû. être longtemps incertaine et qu'elle a été chèrement achetée. Bien des troupeaux humains ont dû être anéantis dans cette lutte avec les premiers occupants du globe, mais ceux qui ont survécu avaient réalisé des progrès essentiels. Non seulement ils étaient entrés en possession du stock alimentaire de leurs concurrents détruits ou refoulés, mais encore leurs facultés de combat, de combinaison et d'invention s'étaient développées; l'organisation et le gouvernement de leurs associations embryonnaires s'étaient perfectionnés avec leur armement et leur tactique [9] . Ajoutons [94] que les hommes les plus utiles dans cette période de lutte contre l'animalité inférieure étaient les forts chasseurs, ceux qui excellaient à purger la terre des monstres primitifs et dont les travaux héroïques procuraient à l'homme la domination du globe. Ces héros méritaient justement de partager avec les inventeurs des premiers procédés de gouvernement et des premières armes la reconnaissance de l’humanité.
Les philanthropes pourront s'affliger qu'après avoir conquis le globe sur les types inférieurs et grossiers de l'animalité, les hommes se soient disputé et se disputent encore aujourd'hui cette conquête. Mais si l'on considère leur nature et le développement particulier que la lutte avec les espèces inférieures avait imprimé à leurs facultés; si l'on considère encore la nature du [95] milieu où ils étaient placés, on s'aperçoit qu'il n'en pouvait être autrement. On retrouve dans l'homme les types de la plupart des autres espèces, et particulièrement ceux des espèces carnassières; lo lion, le tigre, l'ours, le loup, le renard, et il y a apparence que les individus humains ne différaient point sensiblement, au point de vue moral, des animaux dont ils reproduisaient le type. de plus, la nature du milieu ne pouvait manquer de susciter des conflits entre.les troupeaux concurrents, de ces animaux humains de types différents. Les végétaux et les animaux alimentaires étaient fort inégalement distribués sur la surface du globe; tandis qu'ils abondaient dans certaines localités, ils étaient rares dans les lieux avoisinants [10] . Les troupeaux humains ne pouvaient manquer de se disputer la possession de ces riches placers alimentaires, ou bien encore de se quereller au sujet des limites des terrains de chasse, des gisements de végétaux, de mollusques ou de poissons qu'ils avaient découverts et dont l'exploitation leur fournissait leur subsistance ; el ces querelles ne devaient-elles pas être d'autant plus violentes que les ressources alimentaires étaient plus rares ou, [90] ce qui revient au même, que l'industrie humaine était moins avancée? Les troupeaux les plus forts par la supériorité de leurs facultés de combat, leur organisation et leur armement, l'emportaient sur les autres, et leur victoire était à l'avantage de l'espèce. La sélection, commencée par la lutte avec les autres espèces animales, se continuait ainsi par la guerre entre les variétés différentes de l'espèce humaine. Les variétés inférieures — celles qui étaient par conséquent les moins propres à continuer l'oeuvre laborieuse de l'exploration et de la conquête du globe — disparaissaient, ou bien encore étaient refoulées dans des régions abruptes et sauvages, où les moyens de subsistance étaient rares et exigeaient des travaux dangereux et pénibles. Si les vaincus réussissaient à se préserver de la dent des ours ou des loups, en s'ingéniant, par exemple, comme en Suisse, à bâtir leurs demeures sur les eaux des lacs, leurs facultés de lutte et d'invention se développaient par un exercice plus rude et plus prolongé, ils acquéraient à leur tour la] supériorité et prenaient leur revanche sur ceux qui les avaient vaincus et refoulés.
[97]
CHAPITRE II.
LA CONCURRENCE POLITIQUE. LA CONSTITUTION DES ÉTATS.↩
Un moment arrive,— et ce moment marque dans l'histoire de la civilisation le commencement d'une nouvelle ère, celle que nous avons désignée sous la dénomination d'ère de la petite industrie [11] , un moment arrive, disons-nous, où l'homme a réussi à réduire à l'état de domesticité les animaux les plus propres à lui fournir des aliments et du travail, et à soumettre à une culture régulière les plantes, alimentaires et textiles. A ce moment apparaît une nouvelle forme de la concurrence, qui va peu à peu devenir prépondérante : la concurrence politique. Les troupeaux, ou les tribus qui vivaient de la récolte précaire des produits naturels du sol, de la chasse, de la pêche et des razzias opérées sur leurs territoires respectifs, une fois mis en possession de ces moyens nouveaux et incomparablement plus puissants et féconds de se procurer des subsistances, purent croître en nombre et en richesse, —car le même territoire sur lequel vivaient avec difficulté une [98] centaine de chasseurs, put fournir des aliments pour 200,000 individus en possession de l'élève du bétail et de la culture des céréales. Que se passa-t-il alors? Les forts chasseurs et les guerriers qui constituaient les tribus les plus puissantes, les plus courageuses, les mieux organisées et armées, au lieu de se borner à massacrer les tribus ou les troupeaux concurrents et à piller leurs approvisionnements, trouvèrent avantage à les réduire, comme les animaux inférieurs, en servitude, et à les employer, sinon à grossir directement leur stock alimentaire, —car la mouton et le boeuf, se reproduisant et grandissant plus rapidement, étaient, sous ce rapport, plus avantageux que l'homme et leur chair de simples herbivores était plus saine, — du moins à fournir la force, unie à une certaine qualité d'intelligence que les animaux inférieurs ne possédaient point, et qu'exigeaient les opérations de la culture, de la confection des vêtements et des habitations. Choisissant pour leurs établissements les régions fertiles des deltas des fleuves et des climats tempérés, ces tribus progressives y fondèrent des États, dont la population d'esclaves et de bétail ne tarda pas à se compter par millions de têtes, tandis qu'elles-mêmes, passées à la condition de classes souveraines, se multiplièrent grâce: à l'accroissement de leurs moyens de subsistances. Mais ces classes souveraines, fondatrices et propriétaires des États politiques, se trouvèrent aussitôt exposées à la concurrence sous sa forme primitive et sous sa forme nouvelle. Elles eurent à lutter : 1° contre les tribus arriérées qui continuaient à vivre de chasse et [99] de simples razzias, et qui, victorieuses, se livraient simplement au massacre et au pillage; 2° contre celles qui" s'efforçaient de conquérir leurs établissements pour se les approprier et les exploiter ; 3° contre les propriétaires des autres États, qui cherchaient à s'en emparer en totalité ou en partie, en vue d'accroître les profits de leurs exploitations, ou de se débarrasser d'un concurrent à la conquête et à l'exploitation des États plus faibles.
Supposons maintenant un observateur placé en dehors de notre globe et appliqué à suivre dans le cours des temps la marche de l'humanité, de quel spectacle aurait-il été témoin dans cette seconde phase de la civilisation? Après avoir vu les sociétés d'hommes se former comme celles des animaux inférieurs pour se défendre contre les espèces individuellement plus fortes et mieux armées, grandir grâce aux progrès de leur outillage, et constituer des États politiques, il aurait vu ces États se multiplier, en refoulant peu à peu ou en détruisant les troupeaux primitifs, et croître graduellement en puissance et en richesse, tout en continuant à se livrer entre eux à des luttes qui deviennent plus fréquentes à mesure qu'ils se multiplient et se rapprochent.
Ces États politiques, dans les cadres desquels entre successivement la plus grande partie de l'espèce humaine, forment autant de forteresses ou de camps retranchés que leurs propriétaires s'appliquent à rendre inexpugnables, et d'où ils se précipitent sur les territoires avoisinants pour s'en emparer ou y exécuter des [100] razzias. En examinant leur constitution intérieure, l'observateur aurait constaté que chacun d'eux était la propriété d'une « société » relativement peu nombreuse, mais composée d'individus supérieurs en force et en intelligence au reste de la population, appartenant même communément à une race différente; il aurait constaté encore que cette société n'était pas seulement propriétaire du territoire et de la généralité des valeurs immobilières et mobilières qui s'y trouvaient accumulées, mais aussi de la multitude réduite en esclavage, c’est-à-dire ne se possédant pas elle-même, appropriée comme les animaux et les choses, et appliquée à la production des denrées et des articles nécessaires à la consommation de ses maîtres et à la sienne. Il aurait constaté enfin que cette société propriétaire de l'État était organisée, hiérarchisée et commandée comme une armée; qu'elle était soumise à une discipline d'autant plus étroite, et que son organisation se perfectionnait d'autant plus que la concurrence entre les États politiques de tout ordre était plus serrée.
Cette organisation, elle s'était imposée comme une nécessité dès la constitution des premiers troupeaux humains, et elle ne fit que se développer lors de la fondation des États politiques. Si chacun des individus rassemblés et réunis par la nécessité de la lutte contre les autre espèces animales, avait continué de suivre librement ses impulsions naturelles, sans respect pour la vie et la propriété de ses co-associés, sans considération pour les nécessités de la protection mutuelle et de l'aide réciproque, l'association n'aurait pas tardé à se [101] dissoudre et ses membres, réduits à leurs propres forces, auraient péri misérablement. C'est ainsi qu'il fallait leur interdire, les uns à l'égard des autres, des actes qu'ils avaient coutume de pratiquer à l'égard du reste de la création, sans excepter les individus de leur espèce: le meurtre, le rapt et le vol. Il fallait encore les obliger ou les déterminer à accomplir volontairement une série d'actes de prévoyance, impliquant une privation ou une peine que ne récompensait point une jouissance immédiate; actes nécessités par la conservation des individus et leur reproduction, le renouvellement et l'accroissement de leur matériel de défense et d'agression; il fallait enfin assurer la coopération de tous les membres de l'association en proportion de leurs forces (et l'inégalité des forces impliquait l'inégalité nécessaire des rétributions) à toutes les entreprises et à tous les actes commandés par l'avantage commun. Cet ensemble de règles de conduite individuelle ou collective, autrement dit cette organisation se formait et se complétait pièce à pièce, à mesure que l'expérience en révélait là nécessité aux membres les plus intelligents de l'association auxquels cette supériorité intellectuelle procurait un ascendant naturel sur les autres.
Cependant, ces règles, nécessaires au salut ou à l'avantage commun, rencontraient des obstacles dans les vices, les défectuosités morales et l'ignorance des associés, dans la lâcheté, la paresse, l'appétit furieux des jouissances immédiates, l'imprévoyance des besoins futurs, la propension à s'exonérer des charges de l'association tout en en recueillant les profits ; comme aussi dans [102] l'incapacité de la multitude à apprécier la nécessité des règles établies, jointe à la tendance à les remplacer par des règles différentes, généralement moins dures et moins gênantes. Cette dernière tendance pouvait se justifier sans doute par l'imperfection inévitable des règles existantes, elle n'en constituait pas moins un péril, surtout lorsqu'elle se manifestait par un appel à la révolte, adressé à la foule passionnée et ignorante. Il fallait donc découvrir et mettre en oeuvre les procédés les plus propres à vaincre les résistances que les défectuosités morales et l'ignorance des associés opposaient à l'observation des règles indispensables au maintien et aux progrès de l'association. Ces procédés, l'expérience les révéla de même sous la pression de la nécessité, pression d'autant plus forte que la concurrence, animale d'abord, politique ensuite, se serrait davantage. C'était, d'une part, un système de répression effective, infligeant aux contempteurs des règles établies une peine, une souffrance supérieure à la jouissance que pouvait leur procurer l'infraction à ces règles. C'était, d'une autre part, un système de pénalités idéales ou imaginaires, renforçant le premier et dérivé de la propension naturelle de l'esprit humain à croire à l'existence de puissances supérieures, intéressées à la conduite et aux destinées de l'espèce humaine. A ces puissances supérieures, dont l'existence et la puissance étaient attestées par des phénomènes dont on ne pouvait s'expliquer autrement les causes, on attribuait l'inspiration ou la révélation des règles nécessaires à la conservation et à la prospérité de la société, la volonté et le pouvoir de [103] punir ceux qui les enfreignaient, de récompenser ceux qui les observaient. L'invention religieuse de l'immortalité de l'âme, que le sentiment inné de la conservation individuelle devait faire accueillir avec avidité, lorsque l'homme commença à s'élever au-dessus de l'animalité inconsciente, ne pouvait manquer de renforcer singulièrement le prestige et l'autorité des puissances supérieures, en étendant dans l'infinité du temps leur pouvoir de répression aussi bien que de récompense. En considérant les difficultés et la dureté primitives de l'existence, la véhémence des besoins et des appétits, l'insuffisance et l'imperfection des moyens de les satisfaire, l'ignorance et l'imprévoyance naturelles de l'homme, enfin la grandeur et l'imminence des périls que les moindres infractions aux règles de discipline et d'ordre pouvaient faire courir à des sociétés entourées d'ennemis, l'observateur ne se serait point étonné de la barbarie, de l'atrocité même de ce double système de, répression ; il aurait reconnu encore que les pénalités matérielles étaient et devaient être d'autant plus impitoyables et cruelles que la croyance aux puissances supérieures et la foi dans l'étendue de leur pouvoir illimité d'infliger des peines et d'accorder des récompenses étaient moins profondes et moins générales. En comparant enfin les différents codes, il lui eût été facile de se faire une idée des défectuosités et des vices dominants des membres de chaque société, ainsi que de leur degré d'intelligence et de culture.
[104]
CHAPITRE III.
LES PROGRÈS DÉTERMINÉS PAR LA CONCURRENCE POLITIQUE.↩
Des siècles s'écoulent, offrant aux yeux de l'observateur le spectacle d'une série continue de scènes de carnage et de destruction. Toutes les sociétés petites ou grandes sont en lutte pour se défendre ou pour s'emparer des éléments et des instruments de bien-être que la nature a inégalement distribués sur la surface du globe aussi bien que des richesses créées et accumulées par l'industrie de l'homme ; la guerre est universelle, et le monde est comme un vaste cirque où combattent des troupeaux de bêtes féroces. Cependant, à travers ces luttes fratricides, l'observateur aurait aperçu un progrès constant et irrésistible, déterminé par l'opération des lois de l'économie des forces et de la concurrence. La manière dont ce progrès s'accomplissait l'eût certainement intéressé au plus haut point.
De même que nous voyons aujourd'hui la concurrence industrielle ruiner et faire disparaître les entreprises mal situées, mal construites et organisées, pourvues d'un matériel arriéré et dirigées par un personnel [105] incapable ou peu appliqué aux affaires, pour élever et faire grandir sur leurs ruines des entreprises établies et mises en oeuvre d'une manière plus conforme à la loi de l'économie des forces (à moins que les premières ne soient protégées contre la concurrence des secondes) et stimuler ainsi à la fois, par la crainte de la ruine et l'appât des profits, les progrès de l'organisation des entreprises, de l'outillage et des méthodes de la production, la concurrence politique à laquelle se livraient les associations propriétaires des Étals, en vue de défendre leur domination ou de l'étendre, avait pour résultat d'éliminer les plus faibles, et de provoquer les progrès de tous les arts qui contribuaient directement ou indirectement à la production de la puissance politique et militaire. Les races les plus débiles au physique et au moral, celles dont les établissements politiques étaient les moins résistants ou qui se laissaient amollir et gangrener par l'abus des jouissances matérielles, étaient détruites ou asservies (quand les progrès de l'outillage eurent rendu leur asservissement plus profitable que leur destruction) parles plus fortes, qui prenaient leur place, à l'avantage général de l'espèce. Lorsqu'elles étaient asservies, la rude discipline de l'esclavage, le travail régulier et continu auquel elle les assujettissait, les privations qu'elle leur infligeait avaient pour résultat de les retremper, à moins qu'elles ne fussent incapables d'y résister, et dans ce cas leur disparition était plutôt avantageuse à l'espèce. D'un autre côté, cette compétition universelle, avec les pénalités inexorables dont elle frappait les vaincus — la mort [106] ou la servitude — et les récompenses magnifiques qu'elle offrait aux vainqueurs — la puissance et la richesse — était un stimulant énergique pour toute sorte de progrès. On ne pouvait conserver et accroître ses chances de succès, dans l'arène de la concurrence politique, qu'à la condition de réaliser des progrès incessants dans l'art de combattre et de gouverner. Il fallait perfectionner le matériel de guerre et développer au plus haut point dans le personnel les qualités requises pour la lutte, les forces physiques et morales, l'aptitude aux exercices du corps, l'art de commander, l'aptitude à obéir. De plus, comme on ne pouvait organiser et mettre en oeuvre une force défensive ou offensive qu'au moyen d'une avance de capital, avance qui allait s'augmentant à mesure que le matériel de guerre se perfectionnait et que les entreprises militaires devenaient plus importantes, plus difficiles et plus lointaines, il fallait développer parallèlement les ressources de l'État. Augmenter au maximum possible la production dans toutes ses branches, découvrir et employer les procédés les plus propres à capter la proportion la plus considérable de ses résultats sans tuer la poule aux oeufs d'or, en évitant de décourager les producteurs, ce qui arrivait quand la satisfaction que leur procurait leur travail demeurait inférieure à la peine qu'elle leur coûtait, voilà le problème qui s'imposait de plus en plus aux propriétaires et aux gouvernants des États, sous la pression de la concurrence politique. Comment pouvait-on augmenter la production? En intéressant davantage le producteur à ses résultats, [107] c’est-à-dire, d'une part, en empêchant d'une manière plus efficace qu'ils ne lui fussent enlevés par violence ou par ruse, en garantissant mieux sa sécurité contre toute atteinte intérieure ou extérieure; d'une autre part, en lui laissant une plus grande liberté de travailler conformément à ses aptitudes, de disposer des produits de son travail et de jouir d'une portion plus considérable de ces produits.
Sous le régime de l'esclavage, tel qu'il s'établit par la conquête des territoires et l'appropriation des populations qui les garnissaient, les esclaves travaillaient d'abord exclusivement pour leurs propriétaires, individuels ou collectifs. Leur rétribution ne consistait que dans la portion de subsistances et de moyens d'entretien qui était indispensable pour les faire vivre, travailler et se reproduire : l'excédent de produits qu'ils auraient pu créer au moyen d'un supplément d'activité et d'industrie ne profitant qu'à leurs propriétaires, ils n'avaient aucun intérêt à être actifs, laborieux et ingénieux, au contraire ! Leur intérêt consistait à diminuer autant que possible leur dépense de forces, partant leur peine, puisqu'en l'augmentant, ils n'accroissaient point leurs jouissances. On ne pouvait donc les déterminer à travailler qu'en employant la contrainte, en se servant du bâton, c'est-à-dire en leur causant une peine qui dépassât celle que leur causait le travail. Cependant, les maîtres, sous la pression croissante de la nécessité d'augmenter leurs ressources pour subvenir à la défense ou à l'agrandissement de leurs exploitations, s'efforçaient d'accroître la productivité du travail [108] de leurs esclaves. Comme ils remarquaient qu'en accordant à ceux qui se montraient actifs et laborieux quelque chose en sus du nécessaire et en leur permettant de disposer de ce surplus, soit pour le consommer, soit pour se racheter, ils en obtenaient un travail plus assidu et meilleur, ils leur abandonnèrent un « pécule » et y trouvèrent leur profit. Allant plus loin dans cette voie progressive, ils découvrirent et adoptèrent successivement des modes d'exploitation de la terre et de l'homme qui simplifiaient économiquement la gestion de leurs domaines tout en augmentant là puissance productive des travailleurs qui les mettaient en valeur, le servage, le colonat, le métayage, le fermage avec redevance fixe en nature, puis en argent. Ces procédés d'exploitation économique, ils trouvèrent avantage à les appliquer à l'ensemble des branches de la production, aux métiers industriels aussi bien qu'à l'agriculture. Alors les travailleurs pouvant se vouer aux branches d'industrie qui convenaient le mieux à leurs aptitudes et disposer librement des fruits de leur labeur, sauf payement d'une simple redevance à leurs, anciens propriétaires, tandis qu'auparavant ils ne disposaient de rien et recevaient toujours la même pitance, les travailleurs, disons-nous, se trouvèrent encouragés, non seulement à déployer une plus grande somme d'efforts, à cultiver leur champ ou à exercer leur métier avec plus d'ardeur et d'assiduité, mais encore à perfectionner leur outillage et leurs procédés, et cet encouragement était porté au plus haut point lorsque la redevance ou l'impôt qu'ils avaient à fournir ne s'élevait point au delà de [109] la proportion accoutumée. Alors aussi apparurent des phénomènes nouveaux, d'une importance extraordinaire : les cultivateurs et les hommes de métiers ne travaillant plus exclusivement pour leur maître, n'ayant plus à lui fournir qu'une portion limitée de leurs récoltes ou de leurs produits industriels, ou bien encore un certain nombre de journées de travail, et finalement une certaine somme d'argent, échangèrent les articles qui excédaient leurs propres besoins contre ceux qu'ils ne produisaient point ; on vit se créer des marchés, où ils apportèrent régulièrement les denrées et les autres produits destinés à l'échange, et apparaître des intermédiaires qui effectuèrent cet apport avec plus d'économie. Mais ces échangistes, producteurs ou intermédiaires, se trouvaient naturellement en compétition entre eux. De là une troisième forme de la concurrence : la concurrence industrielle.
Avant d'étudier cette forme nouvelle de la concurrence, résumons l'oeuvre des deux précédentes.
Dès son apparition sur la terre, l'homme est soumis à la concurrence des puissantes espèces animales qui occupaient le globe avant lui et y trouvaient leur subsistance aux dépens des espèces plus faibles. La plupart lui sont supérieures sous le rapport de la force et de l'armement. Il supplée à l'insuffisance de ses forces individuelles, en les associant; à l'insuffisance de son armement naturel, en inventant des armes artificielles. Il parvient ainsi, après une longue période de luttes, à détruire ou à refouler les espèces qui étaient auparavant prépondérantes. Il conquiert le globe sur l'animalité.
[110]
Mais les hommes ne font pas seulement concurrence aux autres espèces, ils se font concurrence à eux-mêmes. Ces gisements de végétaux et d'animaux alimentaires qu'ils ont enlevés à leurs concurrents des espèces vaincues, ils s'en disputent la possession et l'exploitation. Dans cette lutte, les troupeaux d'hommes les plus forts, les mieux organisés, disciplinés et armés, l'emportent sur les autres, à l'avantage général de l'espèce. Mais plus ces troupeaux se multiplient, plus la lutte devient entre eux vive et serrée, et plus il leur devient nécessaire d'augmenter leur puissance, en perfectionnant soit leur armement, soit les moyens d'accroître leurs subsistances et par conséquent leur nombre. L'agriculture et les premières industries: prennent naissance, et, dès lors, aux petites sociétés ayant besoin de vastes espaces pour subsister, succèdent des agglomérations nombreuses, concentrées dans les régions les plus propres à la culture végétale et animale. Les tribus les plus progressives fondent des « États politiques » en réduisant en esclavage, au lieu de continuer à les détruire et même à les manger, leurs concurrents vaincus. A mesure que les États politiques se multiplient et qu'ils se font davantage concurrence, ils sont obligés, comme auparavant les troupeaux ou les tribus dont ils sont issus, à chercher les moyens les plus propres à augmenter leur puissance et leurs ressources. Ils perfectionnent, avec leur organisation politique et leur armement, les méthodes d'exploitation des populations qu’ils ont assujetties. L'industrie se développe, les échanges se multiplient, la richesse s’accroît [111] et la puissance des États avec elle. Ceux qui réalisent au plus haut point ces divers progrès acquièrent une prépondérance décisive. Ils occupent la plus grande partie du globe et finissent par dominer le reste. Au moment où nous sommes, le monde civilisé a acquis sur le monde barbare une supériorité que les progrès de l'art et du matériel de la guerre ont rendue définitive en assurant la victoire au capital et à la force morale sur la force et le courage purement physiques. Cela étant, l'oeuvre de la concurrence politique peut être considérée comme à sa fin. La civilisation peut s'étendre sur toute la surface du globe et s'y établir, sans avoir à redouter un retour offensif de la barbarie animale ou humaine.
Voilà ce qu'on pourrait appeler l'oeuvre extérieure de la concurrence, sous ses deux premières formes, animale et politique. Mais son oeuvre intérieure n'a pas été moins essentielle. Au sein de chacune des tribus, puis des Étals concurrents, il a fallu établir un ensemble de règles, de coutumes et de lois destinées à remédier à l'imperfection et à l'ignorance originaires de l'homme, en contraignant les individus à vivre en paix, à remplir leurs obligations envers eux-mêmes, envers les autres et envers l'État chargé du salut commun ; il a fallu en même temps instituer un pouvoir assez autorisé et assez fort pour imposer l'observation de ces règles, de ces coutumes et de ces lois nécessaires. Grâce à cet appareil de gouvernement, appuyé sur un double système de pénalités et de récompenses terrestres et extra-terrestres, les individus ont appris peu à peu à contenir leurs [112] appétits, et notamment à réprimer la tendance naturelle au vol et au meurtre, qui était née et s'était développée chez eux sous la pression de la nécessité originelle de subsister aux dépens des autres créatures vivantes. Ils ont appris encore à remplir plus ou moins exactement les obligations multiples qui dérivent de leur nature et des conditions de leur existence.
Cependant, cette oeuvre intérieure de la concurrence sous ses formes primitives et loin d'être achevée; elle l'est moins peut-être que son oeuvre extérieure; mais, au point où l'une et l'autre sont parvenues, elles ont cessé d'exiger l'assujettissement de toutes les forces des sociétés civilisées à la puissance politique. Il suffit, comme nous le verrons plus loin, pour garantir la sécurité des personnes et des propriétés contre toute agression intérieure ou extérieure, et pour assurer l'accomplissement de toutes les obligations qu'implique la vie en société, d'un pouvoir placé sous le régime de la concurrence industrielle.
[113]
CHAPITRE IV.
COMMENT EST NÉE ET S'EST DÉVELOPPÉE LA CONCURRENCE INDUSTRIELLE.↩
Si la concurrence, sous sa forme primitive d'une lutte pour l'existence engagée entre l'homme et les autres espèces qui lui disputaient sa subsistance, et pour lesquelles il était une proie, si la concurrence animale s'est imposée à l'homme dès son apparition sur la terre, il en a été autrement de la concurrence industrielle. Celle-ci est née de la division du travail et de l'échange, et ces deux phénomènes économiques à leur tour ont été le résultat des premières découvertes et inventions qui ont accru les éléments et créé l'outillage rudimentaire de la production, à commencer par l'armement artificiel indispensable à l'homme pour suppléer à l'insuffisance de son armement naturel. Mais ces progrès se fussent, selon toute apparence, arrêtés et bornés à ce qui était nécessaire pour soutenir au jour le jour la concurrence animale, si les hommes n'avaient pu se procurer une sécurité de quelque étendue dans l'espace et dans le temps. Que serait-il arrivé, en effet, si leurs personnes et les biens qu'ils pouvaient acquérir par [114] leur industrie avaient été continuellement exposés à la destruction et au pillage? C'est qu'ils n'auraient pourvu qu'à leurs besoins immédiats, en se gardant de produire et d'accumuler des moyens de subsistance et d'amélioration dont ils n'auraient pas été assurés de jouir eux-mêmes. La sécurité, tel était donc le premier besoin de l'homme et la condition essentielle de ses progrès.
Comment il a été pourvu « naturellement » à ce besoin par la constitution de sociétés de plus en plus nombreuses et puissantes, réunies en vue de la lutte contre les animaux et les hommes de proie; comment, sous l'impulsion des lois de l'économie des forces et de la concurrence, d'abord animale, ensuite politique, la sécurité produite dans cette sorte d'ateliers s'est successivement accrue dans l'espace et le temps, c'est ce que nous venons de rechercher [12] . Des associations se sont constituées lorsque l'individu isolé a pu se convaincre de son impuissance à assurer sa sécurité contre le monde animal, et ces associations ont créé les États politiques, véritables forteresses où se sont cantonnées, avec leur cheptel d'esclaves et de bétail, les variétés les plus progressives de l'espèce humaine, tant en vue de se défendre contre les autres espèces concurrentes que de les détruire ou de vivre à leurs dépens. C'est dans l'enceinte de ces forteresses et à l'abri de leur appareil défensif et offensif que la sécurité a grandi et que l'industrie a pu se développer.
Cependant, il faut remarquer que le débouché qu’elle [115] y trouvait à l'origine était singulièrement étroit. Ce débouché était limité aux frontières de l'État, en dehors desquelles aucune sécurité n'existait pour l'étranger, considéré comme un ennemi naturel et qui l'avait été, en effet, au début. En sortant des limites de son Etat, tout homme était exposé à être massacré ou réduit en esclavage; plus tard même, lorsque les progrès des relations commerciales firent trouver avantage à accueillir dans l'enceinte de l'État un certain nombre d'étrangers, on ne leur permettait point d'acquérir des immeubles, et l'État s'emparait, à leur mort, de leurs biens mobiliers ; enfin, jusqu'à une époque récente, les navires naufragés et leurs cargaisons étaient confisqués de même en vertu du droit d'épave. Le débouché n'était pas seulement limité par la rupture des garanties de sécurité aux frontières, il l'était encore dans l'intérieur même de l'État par l'insuffisance de la sécurité à distance, l'absence ou la rareté des moyens de transport. Sauf un petit nombre d'exceptions, la production ne pourvoyait qu'à la consommation locale, et les échanges ne dépassaient pas les bornes d'un canton, c'est-à-dire d'un morceau de territoire dont les habitants pouvaient, sans trop d'obstacles, communiquer entre eux. Encore ce marché si peu étendu n'avait-il qu'une faible profondeur. La généralité des articles de consommation étaient produits par les consommateurs eux-mêmes. Les cultivateurs, par exemple, ne se bornaient point à produire leurs aliments, ils construisaient leurs habitations, fabriquaient la plupart de leurs meublés et de leurs outils, filaient, tissaient, confectionnaient [116] leurs vêtements, n'achetant guère au dehors que les matières premières qu'ils ne trouvaient point sur place. Ce furent les propriétaires du domaine territorial de l'Etat qui commencèrent à échanger le surcroit de leurs redevances en nature contre des produits de l'industrie ou de l'art, et à provoquer ainsi l'établissement de marchés temporaires qui devinrent ensuite permanents. Peu à peu ces marchés se multiplièrent et s'agrandirent grâce à l'extension de la sécurité et aux progrès de l'industrie. Les voies de communication naturelles, les rivières, les fleuves, les lacs furent utilisés, les mers cessèrent d'être inaccessibles, les échanges franchirent les frontières des États et les propriétaires de ceux-ci trouvèrent profit à les favoriser, en raison des revenus qu'ils en tiraient. Des traités de commerce furent conclus pour garantir la propriété et la liberté des trafiquants, et le commerce international, quoique limité aux régions comprises dans les traités et fréquemment interrompu par la guerre, alla croissant. Néanmoins, la presque totalité des échanges continuait de s'opérer dans l'enceinte des frontières de chaque État et de ses colonies. Il y a deux siècles, le commerce international du monde civilisé n'atteignait pas le chiffre actuel du commerce extérieur de la Belgique.
Sous ce régime de morcellement et d'isolement des marchés, la concurrence industrielle, encore dans l'enfance, ne pouvait remplir qu'imparfaitement sa fonction naturelle de régulateur, et il fallait y suppléer par des moyens artificiels. Si l'on examine la situation des [117] producteurs et des propriétaires ou détenteurs des agents productifs, on s'aperçoit qu'ils étaient pour la plupart en possession d'un « monopole naturel », dû à l'étroitesse et à l'insuffisance du marché. Grâce à ce monopole, ils pouvaient établir les prix de leurs produits ou de leurs services plus ou moins au-dessus du taux nécessaire auquel les aurait ramenés la concurrence si elle avait pu recevoir tout son développement utile. De là la création d'une « coutume », d'une réglementation ou d'une taxe destinée à remplir à sa place cette fonction indispensable. C'était, sans aucun doute, un procédé fort imparfait, mais qui empêchait du moins, dans une certaine mesure, les détenteurs du monopole des articles de nécessité d'abuser de leur pouvoir aux dépens des consommateurs. Il en reste encore aujourd'hui de nombreux vestiges. Seulement, après avoir eu sa raison d'être sous le régime du monopole, ce procédé artificiel est devenu un obstacle à l'action naturelle et bien autrement efficace de la concurrence, et une cause de retard pour l'industrie. Tel est visiblement l'effet de la limitation, toujours subsistante dans quelques pays, du taux de l'intérêt. Il est encore, toutefois, des situations et des circonstances où la concurrence est empêchée d'agir par des obstacles naturels insurmontables — en matière de communications urbaines, par exemple ;— mais ce qui était jadis la règle est maintenant l’exception.
[118]
CHAPITRE V.
COMMENT LES MARCHÉS ISOLÉS SE SONT AGRANDIS ET ONT TENDU A S'UNIFIER.↩
Comment les marchés se sont-ils successivement agrandis de manière à permettre à la concurrence d'y exercer pleinement sa fonction de régulateur? Ce progrès décisif et qui marque l'avènement d'une nouvelle ère dans l'histoire de la civilisation a été le produit de tout un ensemble de progrès réalisés dans la vaste sphère de l'activité humaine,— progrès de la sécurité dans l'intérieur de chaque État et au dehors, progrès de la machinery de la production et principalement des moyens de communication. —La sphère des échanges s'est élargie, les marchés se sont agrandis, ils ont débordé de plus en plus des frontières politiques des États et ils ont tendu à s'unifier. De ce rapprochement et de . cette tendance à l'unification des marchés morcelés de l'ancien régime économique, il s'est créé déjà, pour les denrées et les marchandises les plus commerçables.— et le nombre s'en accroît tous les jours — un « marché général » où les prix sont réglés par la concurrence universalisée et illimitée.
[119]
Considérons à cet égard l'état actuel des choses, tant pour les produits que pour les agents productifs, capital et travail, et comparons-le à la situation antérieure.
I. Les produits. — Le commerce des produits de toute sorte a pris, depuis l'avènement de la grande industrie, un développement extraordinaire, aussi bien en profondeur qu'en étendue. Sur place, ses progrès ont été peut-être encore plus considérables qu'au dehors, grâce à la division et à la spécialisation croissante du travail. Le temps n'est pas bien éloigné où l'on produisait encore dans le ménage agricole la presque totalité des articles que l'on y consommait. Dans les villes, où cependant la division du travail était poussée plus loin, chaque ménagère possédait un rouet, confectionnait ses vêtements, parfois même ceux de son mari, blanchissait le linge, etc. Aujourd'hui, l'industrie domestique est en voie de disparaître. Chacun s'applique à une seule branche de travail, fournit par ce procédé économique une somme plus considérable de produits, et se procure, au moyen de l'échange, la généralité de ses consommations. Le commerce local a reçu, en conséquence, un accroissement énorme, et on doit regretter que la statistique officielle ait négligé de constater et de chiffrer ses progrès. En revanche, on peut, en compulsant les relevés des douanes, se faire une idée suffisamment exacte du développement du commerce extérieur. Comme nous l'avons remarqué déjà [13] , la somme des échanges internationaux a au moins vingtuplé depuis [120] l'avènement de la grande industrie. Et notons que ces progrès se sont réalisés malgré des obstacles de tous genres, malgré les guerres, malgré les octrois, les douanes et la multitude des autres impôts directs et indirects, malgré les droits protecteurs ou prohibitifs, bref, malgré les obstacles artificiels que l'esprit de monopole associé à l'esprit de fiscalité élevait à mesure que les obstacles naturels allaient s'aplanissant, — en vue apparemment de les « compenser ».
Pendant que le commerce gagnait ainsi du terrain en profondeur et en étendue, on a vu se transformer et grandir son outillage. Aux échoppes et aux boutiques ont succédé des magasins dont les affaires se chiffrent, non plus par milliers de francs, mais par millions. Dans les grands centres d'affaires se sont créées et multipliées de puissantes maisons de commission et de transport dont les relations s'étendent à toutes les parties du globe. Des banques plus vastes et plus puissantes encore apportent aux opérations commerciales l'auxiliaire du crédit. Les chemins de for et les lignes de navigation à vapeur facilitent et activent, en concurrence avec l'ancienne marine à voiles, le transport des marchandises les plus encombrantes, en rendant illimité le rayon des échanges, tandis que le télégraphe met en communication instantanée les régions les plus éloignées du marché du monde. Jadis, la publicité commerciale n'avait d'autre instrument que l'enseigne. C'était l'enseigne seule qui informait le consommateur des endroits où ils pouvait s'approvisionner. Cette enseigne, il était obligé d'aller la chercher. Elle a passé dans les journaux sous la forme [121] d’annonce et elle est venue le trouver à domicile. A ce système perfectionné d'informations locales s'est joint un système d'informations à la fois générales et spéciales, qui embrasse l'ensemble des marchés et met tous les jours sous les yeux des intéressés la situation de chaque produit, le stock existant, l'état de l'offre et de la demande, le prix courant, etc. Non seulement les différentes régions de l'immense marché du monde sont aujourd'hui plus rapprochées, grâce à la vapeur, que ne l'étaient naguère les marchés morcelés et à peine en communication de la même province, mais, grâce à la publicité commerciale desservie par l'électricité, elles commencent à être éclairées à giorno. Or, du moment où l'état du marché de la masse des articles de consommation peut être connu jour par jour, ne devient-il pas possible d'en régler, jour par jour aussi, la production, de manière à la proportionner aux besoins de la consommation? Ne suffit-il pas de laisser faire la concurrence?
II. Les capitaux. — Si nous nous reportons à un siècle ou deux en arrière, nous nous trouverons en présence d'un marché des capitaux non moins morcelé que celui des produits. Sauf dans un petit nombre de centres commerciaux, ce marché n'existe même pas. Dans les campagnes comme dans les villes, le taux de l'intérêt varie d'une localité à une autre ; il n'y a entre les producteurs de capitaux et les consommateurs que des intermédiaires isolés, petits banquiers ou usuriers, qui récoltent les épargnes locales et les prêtent dans le court rayon de leur marché, le plus souvent en fixant à leur gré les conditions du prêt, en raison du degré d'intensité [122] du besoin ou d'imprévoyance de l'emprunteur. L'engagement des capitaux à distance est l'exception. Aujourd'hui, combien la situation est différente! Quoique l'état arriéré de la statistique, concentrée dans les officines gouvernementales, ne nous permette point de constater avec une exactitude suffisante les mouvements des capitaux, la quantité qui en est produite chaque année, les lieux de production et ceux de placement, nous pouvons cependant nous en faire une idée. On a évalué, en se servant de données plus ou moins précises et dignes de foi, le montant des épargnes annuelles des principales nations civilisées, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, le Belgique, la Hollande, la Suisse, les États-Unis, et l'on a cherché à se rendre compte de la destination que reçoivent ces épargnes. Une partie en est employée directement au développement des affaires des épargneurs ou conservée par eux improductive, en attendant que les éventualités en vue desquelles ils ont économisé une partie de leur revenu, la naissance et l'éducation des enfants, la maladie, la vieillesse, etc., viennent à échoir. Cette portion de l'épargne annuelle est généralement employée dans la localité même où elle a été faite. Mais une autre partie — et celle-ci l'emporte de plus en plus sur celle-là — est recueillie par une série d'intermédiaires, dont le nombre et l'importance vont croissant, caisses d'épargnes, banques générales ou spéciales, immobilières ou mobilières, et distribuée par eux aussi bien au dehors qu'au dedans des frontières de chaque État. Certains pays, ceux où l'épargne est particulièrement féconde, où la production [123] des capitaux est abondante, en exportent plus qu'ils n'en importent : telles sont l'Angleterre, la France, la Suisse, la Hollande ; certains autres en importent plus qu'ils n'en exportent : telles sont la Russie, l'Espagne, l'Italie et la plupart des pays extra-européens. Malheureusement, cette épargne sans cesse grossissante est fortement écrémée par les gouvernements pour être employée le plus souvent à des destinations improductives ou nuisibles.' Dans les pays qui produisent plus de capitaux que leur industrie n'en peut utiliser, les emprunts sont souscrits, pour la plus forte part, par les nationaux. Les emprunts du gouvernement anglais sont presque entièrement couverts en Angleterre, les emprunts du gouvernement français en France. Mais il en est autrement dans les pays où la production des capitaux est insuffisante : la proportion des emprunts souscrits par les nationaux est moindre en Italie, en Espagne, en Russie, aux États-Unis; elle est presque nulle en Turquie, au Brésil, au Japon. Dans ces pays, en effet — à l'exception des État-Unis, où la production des capitaux, si considérable qu'elle soit, suffit rarement à la demande de l'industrie, —l'épargne annuelle est faible et le peu qu'elle produit demeure à l'état improductif, faute de sécurité, ou est employée directement par les épargneurs eux-mêmes; le surplus, si surplus il y a, ne figure sur le marché que pour une quantité insignifiante, le taux de l'intérêt est excessif et son élévation attire, en dépit de tous les obstacles et de tous les risques, le capital étranger dans les emprunts d'États. Là même observation s'applique aux [124]emprunts des villes et aux fonds des entreprises particulières, canaux, chemins de fer, mines, manufactures, et généralement de toutes les entreprises dont le capital est divisé en actions et obligations, c'est-à-dire en valeurs aisément mobilisables. Sur toute la surface du globe, mais surtout dans les pays neufs, où la production des capitaux ne suffit pas à là demande, vous trouverez des entreprises fondées et alimentées, les unes en partie, les autres en totalité, parles capitaux étrangers. Des bourses ou marchés de valeurs mobilières se sont créées dans tous les foyers de production et de consommation des capitaux, et elles sont mises par le télégraphe en communication instantanée. En réalité — l'obstacle des distances se trouvant ainsi supprimé, — les bourses de Londres, de Paris, de Berlin, de New-York, etc., ne sont plus que des compartiments du marché général des valeurs mobilières, et les mouvements en hausse ou en baisse qui se produisent dans l'un de ces compartiments se répercutent aussitôt dans les autres. Et si l'on songe que tout accroissement ou toute diminution de la quantité du capital offert fait descendre ou monter en progression géométrique le taux de sa rétribution, on s'explique que le capital se répande et tende à se niveler dans toutes les parties du marché du monde, en dépit des barrages qui s'opposent à ses mouvements. Ces barrages sont nombreux et ils ne s'abaissent guère que pour les emprunts d'États. Seuls, ceux-ci peuvent être négociés presque sans entraves, tandis que les entreprises particulières n'obtiennent qu'avec difficulté le privilège d'être inscrites à la [125] cote des bourses placées sous la tutelle officielle. Cependant telle est là puissance d'impulsion de la concurrence, qu'elle fait circuler le capital dans toutes les parties du marché, en le portant toujours où il est le plus demandé et le mieux rétribué, partant le plus utile.
III. Le travail. — Une évolution analogue aux deux précédentes est en voie de s'accomplir, sous l'influence des mêmes phénomènes, dans le commerce du travail, mais elle est visiblement beaucoup moins avancée. La cause principale de ce retard réside dans la différence originaire de situation des capitalistes et des travailleurs. Les uns étaient libres au moins dans une certaine mesure, tandis que les autres étaient esclaves. Si les propriétaires fonciers, les capitalistes et les entrepreneurs d'industrie, à ces divers titres détenteurs d'un monopole naturel, étaient généralement soumis aune coutume ou à une réglementation limitative de ce monopole, on les contraignait rarement à employer ou à prêter leurs fonds productifs. Il en était autrement pour le travail. A l'origine de toutes les civilisations, nous voyons les races les plus fortes et les plus intelligentes réduire les autres en servitude. L'esclavage est le régime universel du travail. Or l'esclavage implique : 1° l'obligation de travailler ; 2° la limitation de la rétribution du travail. Le maître extrait de l'esclave toute la quantité de travail qu'il peut obtenir de lui sans détruire ou diminuer ses forces productives; il ne lui donne comme rétribution que ce qui lui est strictement nécessaire pour les réparer, autrement dit un minimum de subsistance. Quand l'esclave a été affranchi, il a cessé d'être obligé au [126] travail, mais il a continué pendant longtemps encore à être assujetti à des coutumes et à des réglementations directement ou indirectement limitatives de sa rétribution, maximum du salaire, interdiction de faire grève et de se coaliser pour faire monter le prix de son travail. Ces restrictions et ces limitations ont en grande partie ou même totalement disparu dans les pays, les plus avancés en industrie, les ouvriers sont devenus libres de débattre individuellement ou collectivement le prix de leur travail, mais des obstacles naturels et artificiels n'ont pas cessé d'entraver l'action régulatrice de la concurrence en matière de travail. Comme le remarquait Adam Smith, l'homme est de tous les bagages le plus difficile à transporter, et cette observation était vraie surtout avant l'application de la vapeur à la locomotion. Les marchés du travail étaient alors beaucoup plus.morcelés et isolés encore que ceux des produits et des capitaux. Partout un groupe plus ou. moins nombreux d'ouvriers fournis par la population locale se trouvait en présence d'un petit nombre d'entrepreneurs, parfois même d'un seul. Les ouvriers avaient bien la liberté théorique de porter leur travail ailleurs, mais ils n'en avaient guère la possibilité pratique. Dans cette situation, le prix du travail se fixait toujours, sans doute, comme celui de toute autre marchandise, en raison des quantités offertes, mais l'intensité respective des deux offres, celle du travail et celle du salaire, apparaissait comme un facteur décisif du débat. L'ouvrier, généralement imprévoyant, dépourvu d'avances et pressé par la nécessité de vivre et de faire vivre sa famille, précipitait [127] son offre, tandis que l'entrepreneur pouvait réserver la sienne, et fixer le taux du salaire à peu près à sa convenance. C'est ainsi qu'on voyait dans les marchés encombrés de bras le prix du travail descendre même, au-dessous de la somme nécessaire à l'entretien de l'ouvrier et de sa famille, tandis que la quantité de travail exigée de lui excédait et ruinait ses forces. En vain les ouvriers se mettaient en grève et formaient des coalitions pour obtenir une augmentation de salaire ou une diminution de la durée du travail, ces coalitions étaient rarement efficaces, faute de ressources suffisantes pour permettre aux coalisés de vivre sans travailler aussi longtemps que les entrepreneurs pouvaient vivre sans produire. Trop souvent d'ailleurs elles étaient empêchées ou dissoutes par la force et punies par des pénalités rigoureuses. Parfois les gouvernements intervenaient en faveur des entrepreneurs, en remplaçant les grévistes par des soldats ou en employant le produit des impôts, dont les travailleurs fournissaient leur quote-part, à subventionner l'importation du travail étranger. Cette situation inégale a, plus qu'aucune, autre cause, contribué à engendrer l'antagonisme du capital et du travail, et elle a servi de base aux théories socialistes qui ont entrepris de la retourner, en subordonnant le capital au travail, sans tenir aucun compte des lois naturelles de la constitution des entreprises.
Cependant, grâce au progrès des moyens de locomotion, les marchés du travail, à leur tour, vont s'agrandissant, plus lentement à la vérité que ceux des produits et des capitaux, mais d'une manière régulière et [128] continue. Si nous comparons à cet égard la situation actuelle à l'état de choses qui prévalait avant l'avènement de la navigation à vapeur et des chemins de fer, nous serons frappés du progrès énorme qui s'est accompli dans la circulation du travail. Dans l'intérieur de chaque pays, on peut constater des déplacements de plus en plus nombreux d'ouvriers; à mesure, par exemple , que la proportion du travail industriel grandit, relativement au travail agricole, on voit se développer le mouvement d'émigration des campagnes vers les villes. Mais ces déplacements ne sont pas limités aux frontières politiques des États. Ils débordent au dehors, malgré tous les obstacles qu'ils rencontrent : différence des langues, des climats et des habitudes, hostilité des ouvriers indigènes, lois et règlements restrictifs, défaut d'informations. Partout le travail émigré des marchés où il est à bas prix vers ceux où il est cher, et l'impulsion à laquelle il obéit est d'autant plus vive que la différence de niveau des salaires est plus forte. Les distances ne l'arrêtent plus, et nous avons vu, en peu d'années, l'émigration transatlantique, naguère presque nulle, prendre un essor extraordinaire. Toutefois le travail est loin encore d'être aussi mobilisable que le capital, et la machinery nécessaire pour le mobiliser est infiniment moins développée. Que faut-il pour placer sous ce rapport le travailleur dans des conditions d'égalité avec l'entrepreneur? Il faut : 1° qu'il puisse disposer de moyens de transport faciles et à bon marché; 2° qu'il possède des informations exactes sur la situation des marchés du travail, de manière à pouvoir se rendre en [129] toute sécurité dans ceux où ses services sont le plus demandés et le mieux rétribués ; 3° qu'il ait les moyens de se déplacer et de subsister dans l'intervalle; 4° qu'il ne rencontre point dans les lois restrictives de ses mouvements ou dans les organisations instituées en vue du monopole du marché, des obstacles trop difficiles à surmonter. Or, sur la plupart de ces points, il y a encore beaucoup à faire pour placer le commerce du travail au niveau des autres. Le transport des hommes est demeuré relativement plus cher que celui des choses, et la machinery indispensable pour opérer le déplacement utile du travail est encore à l'état rudimentaire. Les bureaux de placement, les sociétés et les agences d'émigration, les syndicats d'ouvriers et les trade-unions sont insuffisamment pourvus des capitaux et disposent moins encore des ressources du crédit. De là aussi l'absence d'un système d'informations régulières et rapides à l'usage du travailleur.
Il ne possède ni publicité spéciale, ni « bourses du travail [14] », ni banques prêtant sur la garantie des [130] « valeurs personnelles » des ouvriers, ni mutualités qui assurent cette garantie. C'est, disons-nous, une machinery à l'état d'embryon et dont le développement naturel et nécessaire est entravé plus encore peut-être par l'ignorance et l'esprit de monopole des ouvriers que par le mauvais vouloir de ceux qui les emploient. En effet, les ouvriers qui constituent des trade-unions ou des syndicats se proposent bien moins d'étendre leur marché que de s'en assurer le monopole et d'en écarter la concurrence. Sur ce marché limité, ils s'efforcent de suspendre et de restreindre leur offre, tout en empêchant l'apport du travail extérieur, et d'exhausser ainsi artificiellement le taux de leurs salaires. Ils échouent le plus souvent et gaspillent un capital qu'ils auraient pu employer utilement à l'extension de leur marché; mais parfois ils réussissent et ils élèvent, pour quelque temps, leurs salaires locaux au-dessus du niveau des marchés de concurrence. Seulement voici ce qui arrive [131] dans ce cas : c'est que les industries qui payent ces salaires artificiels finissent par succomber sous la concurrence de celles qui payent des salaires naturels; elles s'effondrent en entraînant les ouvriers dans leur chute.
Moins favorisés toutefois que les propriétaires fonciers et les industriels, les ouvriers ont été réduits jusqu'à présent à organiser eux-mêmes et à leurs frais lé système de protection destiné à leur procurer le monopole du marché ; ils n'ont pu employer à cette fin le puissant mécanisme de la loi et de la force publique. Mais il faut s'attendre à ce que cette lacune du système protecteur soit prochainement comblée. A mesure que la classe ouvrière acquiert des droits politiques et que son influence dans l'État va grandissant, on voit se répandre et se populariser l'idée de la protection des salaires nationaux par la taxation ou la prohibition du travail étranger. Aux États-Unis, les knights of labor (chevaliers du travail) ont obtenu la prohibition du travail chinois, et l'établissement d'une taxe sur les ouvriers étrangers ne manquerait pas de rallier la grande majorité des suffrages de nos classes ouvrières. Nous verrons donc probablement s'ajouter aux obstacles naturels qui ralentissent l'agrandissement et l'unification finale des marchés du travail, l'obstacle artificiel des taxes ou même des prohibitions douanières. Cependant il est permis de prévoir aussi que ces barrages finiront par être emportés, que la protection des salaires disparaîtra avec celle des rentes et des profits, et que les marchés du travail, agrandis et rapprochés s'unifieront à leur [132] tour. Alors le taux des salaires cessera de dépendre de l'intensité comparative des besoins et de la mesure des ressources de l'ouvrier et de l'entrepreneur en conflit sur un marché local; il dépendra, comme létaux de l'intérêt ou le prix des produits, des quantités offertes sur le marché général.
[133]
CHAPITRE VI.
CONCLUSION. RÉSULTATS DE L'OPÉRATION DE LA CONCURRENCE INDUSTRIELLE, LIBRE ET ILLIMITÉE.↩
En résumé, grâce aux progrès de la sécurité, grâce à la création successive du nouvel et puissant outillage de la production et de la circulation des richesses qui prend la place de l'ancien sous l'impulsion des mêmes lois d'économie des forces et de concurrence qui ont fait succéder aux espèces végétales et animales formant le mobilier primitif et grossier de notre globe, une végétation et une animalité plus parfaites, nous voyons les marchés s'agrandir, déborder des frontières des États politiques, communiquer entre eux, tendre enfin à s'unifier, en substituant à la multitude des marchés morcelés et isolés de l'ancien régime industriel où le monopole plus ou moins tempéré, par la coutume et la réglementation, dictait les prix, un « marché général » où la valeur de toutes choses, produits, capitaux et travail, est réglée par la concurrence illimitée et libre.
Quel doit être le résultat final de ce rapprochement et de cette unification des marchés au double point de [134] vue de la production et de la distribution de la richesse? C'est de rendre la production de plus en plus économique et la répartition de plus en plus utile, ou, ce qui revient au même, équitable.
Comment se fixe, en effet, la valeur des produits et services sur un marché où ils peuvent être apportés librement de tous les points du globe? Elle se fixe par la concurrence des quantités réciproquement offertes. C'est cette concurrence des quantités qui détermine la valeur d'échange ou le prix courant de toutes choses, et ce prix est « un ». Il n'y a et il ne peut y avoir qu'un prix courant sur un marché. Mais ces produits ou services apportés au marché d'une multitude d'ateliers et de pays divers ont des frais de production ou, pour nous servir de l'expression du père de l'économie politique,, des « prix naturels » différents et inégaux. Les uns dépassent le prix courant, les autres demeurent en dessous. Que résulte-t-il de là? c'est que les producteurs dont les frais ne sont pas couverts par le prix courant sont obligés de les réduire en perfectionnant leur industrie ou de cesser de produire, et que le marché finit ainsi par appartenir toujours à ceux dont la production est la plus économique.
Mais cette production, dont la concurrence améliore incessamment les procédés, elle agit aussi pour la régler. Si les quantités offertes dépassent les besoins du marché, le prix courant tombe au-dessous des frais de production, les producteurs se trouvent en perte et ils sont obligés de diminuer leur offre. Et, comme nous l'avons remarqué, cette gravitation du prix courant[135] autour des frais de production ou du prix naturel s'opère avec une force d'impulsion progressive, toute diminution ou augmentation dans la quantité d'un produit ou d'un service offert au marché engendrant une hausse ou une baisse croissant en raison géométrique dans la valeur de ce produit ou de ce service. La concurrence industrielle agit donc comme un moteur d'une puissance énorme, sinon irrésistible, d'abord pour contraindre les producteurs à réduire leurs frais au dernier minimum possible, partant les sacrifices et la peine que représente le prix des choses pour le consommateur ; elle agit ensuite comme un régulateur non moins puissant en ramenant l'offre dé chaque produit ou service au quantum nécessaire pour en couvrir les frais de production réduits au minimum, et en établissant ainsi au niveau du prix le plus bas, l'équilibre entre la.production et la consommation.
Enfin la concurrence industrielle agit comme le régulateur de la distribution de la richesse, en attribuant à tous ceux qui ont contribué directement à la produire, leur part nécessaire.
Nous venons de voir comment la concurrence règle la valeur des produits et services offerts au marché. L'échange effectué, comment se distribue la somme de valeurs réalisées? Elle se partage entre les coopérateurs de la production, les uns propriétaires ou détenteurs du matériel, fonds de terre, machines, outils, matières premières, engagés dans chaque entreprise ; les autres, constituant le personnel, propriétaires des facultés physiques, intellectuelles et morales requises pour [136] mettre le matériel en oeuvre, ou, pour nous servir des termes usités, elle se partage entre le capital et le travail. Comment se règle le prix des services respectifs de ces coopérateurs, le profit, le loyer, l'intérêt, le salaire? Il se règle comme celui des produits, par la concurrence des quantités réciproquement offertes, qu'il s'agisse du matériel ou du personnel, du travail physique ou intellectuel, du capital mobilier ou immobilier, et il gravite de même autour du niveau des frais de production nécessaires de chacun des agents productifs.
En effet, si le capital est offert en quantité telle que sa rétribution tombe au-dessous de la somme nécessaire pour le reconstituer et déterminer ses détenteurs à continuer à l'offrir, cette quantité diminue et la rétribution se relève; si elle dépasse la somme nécessaire, la prime ou la rente qui en résulte agit pour déterminer la création et la mise au marché d'un supplément de capital. La rétribution du travail est réglée de même par la concurrence des quantités offertes, engendrant la hausse ou la baisse en progression géométrique des prix, et comme le matériel et le personnel, le capital et le travail, engagés dans la production sont l'un et l'autre également le produit de l'épargne, comme chacun est libre d'investir son épargne sous forme de matériel ou de personnel et se trouve naturellement porté à lui donner celle de ces deux destinations qui est la plus avantageuse, — et d'autant plus que la différence est plus grande, — l'équilibre des rétributions tend perpétuellement à s'établir au niveau des frais de production [137] du capital et du travail. Ajoutons que les progrès deL l'outillage ayant pour résultat d'élever la qualité au travail et avec elle les frais de production des travailleurs, la part nécessaire du travail augmente tandis que celle du capital diminue. Le progrès industriel profite ainsi doublement aux travailleurs : 1° en élevant le taux de leurs salaires; 2° en abaissant les prix de leurs consommations.
Que ressort-il en fin de compte de l'analyse de ce mécanisme naturel de la production et de la distribution de la richesse? C'est que la concurrence industrielle n'agit pas seulement pour stimuler le progrès en le rendant nécessaire, mais encore pour établir l'ordre dans la production et la justice dans la distribution. Comment donc s'expliquer que cette machine puissante et merveilleuse ait été accueillie partout avec des malédictions? que des millions de voix s'élèvent chaque jour pour supplier les gouvernements de restreindre et de contrecarrer ses opérations? que les protectionnistes et toutes les sectes socialistes s'accordent à la considérer comme l'ennemi commun? que tous les systèmes imaginés pour améliorer la condition du peuple s'évertuent à la supprimer?
Cela tient, avant tout, à une insuffisance d'analyse. La concurrence ne peut agir avec une pleine efficacité que dans une arène suffisamment étendue et à la condition que ses mouvements soient libres. De plus à mesure que le champ où elle s'exerce, le marché où elle opère, va s'agrandissant, les obstacles qu'elle y rencontre et les perturbations qu'ils jettent dans ses [138] mouvements occasionnent des maux plus profonds et plus étendus. Jadis, sous le régime des marchés morcelés et isolés, les obstacles qui entravaient et troublaient le jeu naturel de la concurrence ne causaient qu'un mal local. Aujourd'hui, toute perturbation causée par une guerre, une épidémie, un changement dans l'assiette des tarifs de douane et des autres impôts, l'établissement d'un monopole, etc., se répercute dans la multitude des marchés en communication avec ceux où la cause perturbatrice s'est produite, et plus les marchés s'étendront et se rapprocheront, plus les perturbations acquerront d'amplitude et de profondeur, plus les « crises » industrielles, commerciales ou financières occasionneront de souffrances. Mais ces souffrances, est-ce la concurrence qu'il faut en rendre responsable? Autant vaudrait attribuer à la vapeur la responsabilité des accidents de chemins de fer.
Comme tout progrès, la concurrence industrielle s'impose. On ne pourrait la supprimer qu'à la condition de détruire l'outillage et les procédés perfectionnés de la production et des échanges dont elle est issue, en ramenant l'humanité à l'âge primitif de la concurrence animale. Cela étant, qu'y a-t-il à faire? Au lieu de maudire la concurrence, il faut commencer par l'étudier. En l'étudiant, on finira par s'apercevoir qu'elle est un principe de progrès, d'ordre et de justice, et que les maux dont on la rend responsable proviennent des obstacles naturels et artificiels qui entravent ses opérations. Ces obstacles, il faut travailler à les détruire et laisser faire la concurrence.
QUATRIÈME PARTIE.
LA SERVITUDE POLITIQUE
[139]
CHAPITRE PREMIER.
LA GUERRE.↩
Nous avons exposé sommairement, dans les deux premières parties de ce livre, les lois naturelles qui gouvernent le monde économique elles obstacles qu'elles rencontrent dans l'homme et le milieu où il vit ; nous avons montré, dans la troisième partie, comment ces lois et ces obstacles ont agi pour déterminer la marche de la civilisation. Il nous reste à étudier l'appareil de gouvernement que les hommes ont inventé pour combattre les causes de perturbation des lois naturelles et en atténuer les effets nuisibles. Cet appareil a cessé d'être adapté à l'état présent des sociétés civilisées. Il a conservé pour base la « servitude politique », laquelle, après avoir eu sa raison d'être aussi longtemps que la civilisation a subi, sans pouvoir s'en affranchir, la nécessité de la guerre, l'a successivement perdue, et, en la perdant, est devenue une nuisance universelle. C'est la servitude politique qui est la cause originaire de la crise politique et économique dans laquelle nous nous débattons, [140] et dont nous ne sortirons qu'en remplaçant, à la base du gouvernement, la servitude par la liberté.
Comme tous les autres êtres animés, l'homme s'applique d'instinct à obtenir la plus grande somme de choses propres à la satisfaction de ses besoins en échange de la moindre somme de travail, c'est-à-dire de peine. Si la force qu'il est obligé de dépenser, si la peine qu'il est obligé de s'infliger pour obtenir un produit est supérieure à la jouissance qu'il est dans la nature de ce produit de lui procurer, ou, ce qui revient au même, à la souffrance qu'il peut lui épargner, il ne travaillera et ne produira point. En revanche, son excitation à produire sera d'autant plus grande que la jouissance qu'il tire des résultats de sa production dépasse davantage la peine qu'ils lui ont coûtée.
Voilà la première vérité d'observation sur laquelle repose l'économie des sociétés, la première loi de l'économie politique. De cette vérité ou de cette loi découle une première nécessité, celle d'assurer au producteur, avec la liberté de produire, la propriété du produit, partant, la jouissance en vue de laquelle il s'est imposé la peine ou la souffrance indispensable pour le créer, en d'autres termes, la nécessité de procurer au producteur la sécurité.
Si notre globe n'avait été peuplé, à l'origine, que de créatures raisonnables, parfaitement capables de se gouverner elles-mêmes et connaissant à fond la morale et l'économie politique, la sécurité aurait existé naturellement; il n'eût pas été nécessaire de la créer [141] artificiellement. Chacun aurait travaillé pour subvenir à ses besoins et consommé les produits de son travail. Nul ne se serait avisé de s'emparer des fruits du travail d'autrui. L'âge d'or eût régné sur la terre.
Mais le globe n'a pas été peuplé par une colonie de moralistes et d'économistes. La vie s'y est épanouie sous une multitude de formes, et, quand l'homme est apparu, ignorant et sauvage, il l'a trouvé occupé par des espèces auxquelles il a dû disputer sa place, qu'il a dû détruire, refouler ou assujettir, sous peine d'être détruit par elles. Bref, dès son apparition sur la terre, il a subi la loi de la concurrence animale. Au lieu de consacrer toutes ses forces à produire, il a été obligé d'en employer la plus grande partie à défendre sa personne, les instruments et les résultats de sa production contre les autres espèces. Et, comme nous l'avons remarqué, cette lutte était physiquement fort inégale. L'homme était inférieur en forces et en armement aux grandes espèces carnassières, il ne leur était supérieur que par l'intelligence. Comment il parvint à les vaincre, nous l'avons dit : en associant et en combinant ses forces, en formant des sociétés et en suppléant à l'insuffisance de son armement naturel par un armement artificiel de plus en plus perfectionné. C'est ainsi qu'il a fini par conquérir le globe sur les espèces qui l'occupaient avant lui et par y établir son empire incontesté. Si sa sécurité n'est pas devenue complète de ce côté, si les espèces qui lui font la guerre et vivent à ses dépens ne sont pas entièrement détruites ou asservies, si les plus petites par exemple lui infligent encore des dommages, [142] en échappant à ses coups à cause de leur petitesse même, ces dommages sont peu de chose en comparaison de la masse de sa production. Aucun danger sérieux ne le menace plus du côté de l'animalité. Il n'y a plus aucune partie du globe dont les espèces inférieures interdisent encore l'accès à l'homme. Il en a fini avec la concurrence animale.
Mais si l'homme a réussi à fonder sa sécurité contre les autres espèces, il est loin, au moment où nous sommes, d'être parvenu à l'établir, dans la même mesure, contre ses semblables. A la lutte contre l'animalité inférieure est venue se joindre la lutte de l'homme contre l'homme, et celle-ci n'a pas cessé, dans la longue suite des siècles, d'absorber une portion considérable des forces et des ressources de l'espèce humaine. L'origine de cette lutte, manifestée par le meurtre, le YOI, l'esclavage et l'exploitation, est dans la nature même de l'homme et des nécessités de son existence. Toute production exigeant une dépense préalable de forces, partant une peine ou une souffrance, des hommes qui n'étaient ni des économistes ni des moralistes devaient, sous l'impulsion de l'instinct naturel qui les poussait à chercher la jouissance et à fuir la peine, s'efforcer d'obtenir l'une en épargnant autant que possible l'autre. Si, au lieu de travailler eux-mêmes à produire, ils pouvaient réaliser une économie de peine, en usant de la supériorité de leurs forces et de leur intelligence pour s'emparer des fruits du travail d'autrui, ils devaient être naturellement portés à recourir à ce procédé économique. On peut ajouter même que c'est seulement [143] quand il deviendra moins avantageux que le procédé de la production, quand il exigera plus d'efforts en comportant plus de risques qu'il sera abandonné comme le sont les méthodes surannées, et que la sécurité de l'homme contre l'homme se trouvera pleinement assurée.
Si donc nous portons nos regards sur le passé de l'humanité à dater des temps historiques où elle commence à apparaître victorieuse de l'animalité inférieure, nous constaterons que le phénomène dominant de son activité, c'est la lutte engagée pour la défense ou la conquête des instruments et des résultats de la production. Après être demeurée longtemps indécise, cette lutte devait aboutir à l'établissement graduel de la sécurité de l'homme contre l'homme et avoir pour conséquence le progrès continu de la production, de mieux en mieux.assurée contre le risque de la destruction et de la spoliation. Cette oeuvre, complément de la précédente, a été celle de la concurrence politique.
Comment la concurrence politique s'est-elle créée et développée de siècle en siècle, en s'étendant sur une aire de plus en plus vaste et en employant un matériel et des procédés de plus en plus puissants et efficaces ? Comment a-t-elle suscité l'établissement progressif de la sécurité dans le monde et l'avènement d'une forme supérieure de la concurrence, la concurrence industrielle? Par la guerre.
Le mode d'action de la concurrence animale, c'est la chasse; le mode d'action de la concurrence politique, c'est la guerre. A Tontine, la chasse et la guerre se ressemblaient par leurs procédés et elles s'imposaient [144] également à l'homme. Il a dû s'appliquer d'abord à détruire les espèces ennemies ou concurrentes sous peine d'être détruit par elles; il a réduit ensuite les espèces inoffensives en servitude, en vue de se nourrir de leur chair et de se vêtir de leurs dépouilles ou de s'aider de leur travail. Il chasse le lion, le tigre, le serpent pour se préserver de leurs atteintes ; il asservit le cheval, le boeuf, l'âne; il dérobe les oeufs des oiseaux et le miel de l'abeille. C'est par le meurtre, l'asservissement et le vol qu'il procède, sous l'empire des nécessités et des conditions naturelles de son existence, à l'égard des autres animaux. Pourquoi se serait-il abstenu d'employer ces procédés à l'égard de ses semblables? L'homme était une proie comme une autre. Les races et les individualités humaines étant inégales en aptitudes et en forces, les hommes les plus robustes et les plus agiles devaient trouver plus d'avantage à chasser les faibles pour les dévorer ou pour s'emparer des fruits de leur travail qu'à produire eux-mêmes, à une époque où l'industrie n'existait encore qu'en germe, leurs subsistances et leurs autres articles de consommation. En procédant ainsi à l'égard des hommes aussi bien que des animaux, ils obéissaient à la première des lois naturelles :: celle de l'économie des forces.
Mais la chasse et la guerre impliquaient la nécessité de l'association et de la combinaison des forces. Chasseurs et guerriers durent constituer des « sociétés » pour exercer leur industrie avec des chances suffisantes de succès. Ces sociétés, en s'agrandissant grâce aux progrès de l'outillage et à la création [145] de la petite industrie, devinrent des Etats politiques. Tous les États politiques ont été fondés et ont dû l'être en vue de la guerre, puisqu'elle s'imposait aux peuples comme une nécessité inévitable. Ceux-là mêmes qui avaient l'humeur la plus paisible, qui ne demandaient qu'à cultiver leurs champs, à s'appliquer aux travaux de l'industrie et des arts, et à acquérir ainsi, sans nuire à autrui, l'aisance et la richesse, y étaient exposés. Ils l'étaient même d'autant plus qu'ils offraient par leurs instincts et leurs occupations pacifiques, moins de résistance aux hommes de proie qui trouvaient plus de profit à s'emparer des fruits du travail d'autrui qu'à travailler eux-mêmes. Il fallait donc que les sociétés s'organisassent en vue de la guerre sous peine d'être détruites et asservies par la guerre; qu'elles instituassent un gouvernement et une armée; un gouvernement pour faire régner dans leur sein l'ordre et la paix, une armée pour repousser les invasions et, au besoin, pour envahir. Or cette organisation politique et militaire avait ses conditions naturelles; elle exigeait avant tout l'établissement en permanence d'une autorité dirigeante et d'une hiérarchie commise à l'exécution des ordres de l'autorité. De là, la constitution des monarchies et des aristocraties héréditaires. Parfois, à la vérité, le choix ou l'élection tenait lieu de l'hérédité et l'État prenait la forme d'une république. Mais si les formes de gouvernement différaient plus ou moins, en revanche tous les États reposaient sur un principe qui leur était commun et qui n'a pas cessé de l'être, savoir: la servitude politique.
[146]
CHAPITRE II.
LA SERVITUDE POLITIQUE. SA RAISON D'ÊTRE ET SES FREINS DANS LE PASSÉ.↩
En quoi consiste la servitude politique? Elle réside lans l'obligation imposée à tous les membres de la société vivant dans les limites du territoire de l'État, de ses soumettre à l'autorité du gouvernement, d'obéir aux lois et aux règles qu'il juge nécessaire d'établir et de lui fournir les services et les ressources qu'il juge nécessaire de requérir. Cette obligation a été à l'origine, et aussi longtemps qu'a subsisté la nécessité de la guerre, parfaitement légitime. Tous les habitants du territoire le l'État se trouvant exposés aux risques inhérents à la guerre, aux massacres, à l'incendie, au pillage qui accompagnaient les invasions étrangères ou les séditions intérieures, bénéficiaient de l'établissement de l'appareil lui les prémunissait contre ces risques ; tous bénéficiaient aussi des guerres offensives qui prévenaient les agressions, fortifiaient et perfectionnaient l'appareil défensif, même quand ils n'avaient aucune part substantielle dans le butin provenant de la victoire. Sous /reine de compromettre le salut commun dans lequel le [147] sien se trouvait compris, chacun devait donc se soumettre à toutes les restrictions à sa liberté que le pouvoir dirigeant jugeait nécessaire de lui imposer, à tous les sacrifices, y compris même celui de la vie qu'il jugeait nécessaire d'exiger.
Sans doute, cette « servitude » conférait à l'autorité dirigeante une puissance énorme. Si l'on songe à l'imperfection de la nature humaine, aux vices qu'encourage et développe le pouvoir de l'homme sur l'homme, la servitude politique ne pouvait manquer d'engendrer trop souvent l'oppression la plus dure. Les sujets de l'État en souffraient d'autant plus qu'il leur était plus difficile de s'en préserver. Car l'autorité dirigeante pouvait disposer de toutes les forces et de toutes les ressources de la collectivité, et l'inégalité entre ces forces et ces ressources et celles d'un individu était telle que la résistance à l'autorité, même dans ses exigences les plus abusives, était une entreprise plus insensée encore que criminelle. Il fallait se soumettre passivement à ses ordres à moins de s'y soustraire par l'exil, extrémité redoutable aux époques où l'étranger était considéré comme un ennemi (et il l'était en effet presque toujours) et offert d'habitude en sacrifice aux dieux ou réduit en esclavage. Ajoutons que les gouvernements des États politiques regardaient la révolte contre leur autorité ou même la simple désobéissance comme le plus grand et le moins excusable des crimes, et qu'ils la punissaient avec une rigueur impitoyable. Ajoutons encore qu'en vue de prévenir le danger des révoltes ou des résistances collectives, ils interdisaient les associations [148] particulières ou ne les autorisaient qu'en les soumettant à des restrictions étroites et à une surveillance méticuleuse. Ils ne toléraient point ce qu'ils appelaient un « État dans l'État », et, au point de vue de la sécurité collective, ils avaient raison.
Cependant, l'abus de la servitude politique était modéré, sinon empêché, par deux freins généralement efficaces surtout lorsqu'ils étaient associés ; l'appropriation perpétuelle de l'État à la famille ou à la classe investie de l'autorité dirigeante et la pression continue de la concurrence politique, à l'époque où la guerre, mode d'action de cette concurrence, était permanente et universelle.
L'expérience n'avait pas tardé à démontrer qu'en imposant à la collectivité des « sujets » un fardeau d'impôts et de sacrifices qui dépassait ses forces on finissait par l'affaiblir et l'appauvrir et, avec elle, l'État. Or l'État étant une propriété perpétuelle qui se transmettait d'ordinaire par voie d'hérédité, ceux qui le possédaient étaient naturellement intéressés à le conserver et à l'accroître non seulement pour eux-mêmes, mais encore pour leur postérité. En même temps, la pression constante de la concurrence politique, manifestée par la guerre, les obligeait à appliquer toutes les forces et les ressources dont ils pouvaient disposer à la défense et à l'agrandissement de leur patrimoine. S'ils en appliquaient une partie à d'autres fins, ils diminuaient leurs chances de succès dans des luttes inévitables, dont l'enjeu était l'État lui-même. Pourvoir à la sécurité extérieure de l'État et à son agrandissement, réprimer ou [149] prévenir les nuisances intérieures qui étaient de nature à l'affaiblir, tel était le cercle dans lequel se renfermaient leur activité utile et leurs attributions naturelles. Lorsqu'ils en sortaient en demandant à leurs sujets des sacrifices excessifs ut en les employant à des fins étrangères à la sécurité de l'Etat, ils ne manquaient point d'en être punis tôt ou tard .par la décadence de l'État suivie de la conquête et dé la dépossession.
[150]
CHAPITRE III.
L'AFFAIBLISSEMENT DU RISQUE DE GUERRE. SES CONSÉQUENCES.↩
A la longue, la situation des Etats subit des modifications décisives. Aussi longtemps que le monde barbare pour lequel la guerre, la conquête, le pillage ou. l'exploitation- des peuples enrichis par l'agriculture et l'industrie, constituaient la plus profitable des entreprises, avait été prédominant ou avait même simplement balancé la puissance du monde civilisé, le risque de guerre avec ses pires conséquences, qui pesait sur les États en voie de civilisation, demeurait à son maximum. Mais lorsque, après des luttes séculaires, le monde civilisé, successivement accru en puissance et en étendue, eut pris le dessus et commencé à envahir le monde barbare, le risque de guerre s'abaissa : la guerre cessa à la fois d'être inévitable et permanente, tout en devenant moins destructive. On n'avait plus que rarement à repousser les invasions barbares qui s'abattaient à l'improviste sur le domaine de la civilisation,, en marquant leur passage par le carnage et la destruction; [151] la guerre se faisait désormais, principalement, entre les propriétaires des États civilisés en vue de l'agrandissement de leur domination. Cela étant, les belligérants étaient intéressés à ne point ruiner et s'aliéner les populations qu'ils entreprenaient de conquérir. De là, les progrès des usages de la guerre, aboutissant chez les nations civilisées au respect plus ou moins complet des personnes et des propriétés privées.
Cet abaissement du risque de guerre devait avoir des conséquences d'une importance capitale. La guerre cessant d'être permanente, la classe gouvernante, qui y était spécialement adonnée, se trouva condamnée a l'oisiveté pendant les intermittences de plus en plus prolongées de la paix, elle contracta les vices qu'il est dans la nature de l'oisiveté d'engendrer, et elle alla se dégradant et s'affaiblissant. En revanche, la paix favorisait le déploiement fécond de l'activité des classes gouvernées, et à mesure qu'elles croissaient en richesse et en force, elles se montraient plus impatientes à supporter les abus de la domination qui pesait sui elles; elles se montraient aussi moins disposées aux sacrifices que la guerre nécessitait depuis qu'elle était motivée seulement par l'intérêt particulier des gouvernants à agrandir leurs débouchés, et qu'une invasion étrangère ne les exposait plus, d'ailleurs, qu'à un simple changement de domination.
Alors commença, entre les gouvernants et les gouvernés, une lutte qui dure encore. Grâce à la puissance de l'organisation, qui mettait à sa disposition toutes les forces et toutes les ressources de la masse [152] assujettie à la servitude politique, la classe gouvernante avait, malgré sa faiblesse numérique, un avantage incontestable dans cette lutte. Aussi les prétentions des « sujets » étaient-elles, à l'origine, des plus modestes : elles se réduisaient à réclamer le droit de débattre le prix des services qui leur étaient imposés, autrement dit de discuter et de consentir l'impôt cl d'être consultés sur les lois, ordonnances et autres mesures les concernant, qu'il plaisait aux maîtres de l'État d'édicter. Toutefois, dans les foyers de population où une industrie progressive avait enrichi lés sujets et où le pouvoir souverain se trouvait entre des mains débiles, les meneurs du peuple se proposaient bien moins de limiter le pouvoir que d'y participer ou même de s'en emparer sous le prétexte de restituer au peuple sa souveraineté. La lutte, ainsi engagée, se poursuivit avec des péripéties diverses depuis le commencement du moyen âge, jusqu'à l'époque de la Renaissance. La recrudescence des invasions barbares et notamment la conquête de Constantinople par les Turcs, la firent tournera l'avantage de la classe gouvernante. Partout, sauf en Angleterre où le risque des invasions se faisait moins sentir que sur le continent, on vit disparaître les institutions qui garantissaient avec plus ou moins d'efficacité les populations contre l'abus de la servitude politique. Cependant, la classe gouvernante avait dû, de son côté, pour remporter cette victoire et en assurer les résultats, se soumettre au régime de la dictature héréditaire ou de l'absolutisme monarchique. Dans toute l'Europe continentale, les souverains gouvernèrent désormais leurs [153] Etats selon leur bon plaisir, avec l'aide d'une noblesse et d'un clergé asservis.
Si la pression de la concurrence politique avait conservé l'intensité et la continuité des grandes époques de luttes avec le monde barbare, ce régime aurait pu subsister longtemps, mais elle les perdit bientôt sans retour : grâce aux progrès de leur-armement et de leur outillage industriel et commercial, les États civilisés envahirent les foyers de la barbarie, l'Asie et l'Afrique, et conquirent le nouveau monde; le risque des invasions barbares finit par disparaître. D'un autre côté, il s'était constitué, à l'intérieur de l'Europe civilisée, une sorte d'assurance politique mutuelle qui garantissait avec plus ou moins d'efficacité les propriétaires d'Etats contre lo risque de dépossession par voie de conquête ou de révolution. Les États civilisés passaient ainsi insensiblement du régime fortifiant et fécond de la concurrence politique au régime énervant et corrupteur du monopole. Si la maison régnante continuait, en sa qualité de propriétaire à perpétuité de l'Etat, à être intéressée à sa prospérité, elle n'était plus poussée par les impérieuses exigences de la concurrence à ménager et à développer ses forces et ses ressources. Comment le souverain, investi d'un pouvoir absolu, n'aurait-il pas abusé de l'énorme puissance que la servitude politique, dégagée de toute restriction et de tout contrepoids, plaçait entre ses mains? Comment la noblesse et le clergé, ses auxiliaires, n'auraient-ils pas profité de leur situation privilégiée pour opprimer et exploiter la multitude livrée à la merci du pouvoir dont ils étaient [154] les instruments et que la pression de la concurrence politique ne contenait plus? On vit donc, dans toute l'Europe civilisée, l'oppression et l'exploitation politique se donner pleine carrière.
[155]
CHAPITRE IV.
LA LUTTE POUR LA POSSESSION DU POUVOIR. LES RÉVOLUTIONS ET LEURS RÉSULTATS.↩
En dépit des abus et des excès de l'absolutisme, de l'oppression et de l'exploitation des classes privilégiées, l'extension de l'aire de la civilisation et la transformation progressive de l'outillage de la production agissaient pour développer l'industrie et le commerce, et enrichir la classe moyenne qui en vivait. La lutte recommença entre cette classe moyenne, qui croissait rapidement en richesse et en force, et les classes privilégiées., encore puissantes, grâce à la possession de là plus grande partie du sol, du quasi monopole des emplois publics et de la faveur du souverain, mais allanguies et énervées par l'affaiblissement de la concurrence politique en décadence, tandis que la classe moyenne était poussée en avant par l'aiguillon de la concurrence industrielle grandissante. En vain les classes privilégiées opposèrent à ce compétiteur menaçant toute la puissance de l'appareil de gouvernement qu'elles avaient entre leurs mains, elles ne réussirent point, cette fois, à arrêter ses progrès. Tantôt par l'emploi des moyens [156] révolutionnaires, tantôt par une simple pression morale, la classe moyenne a dépossédé les classes privilégiées de l'ancien régime. Dans les pays où elle ne les a pas violemment expropriées et expulsées du pouvoir, avec l'aide d'une multitude brutale et aveugle, elle les a obligées à lui faire une part qui est devenue peu à peu celle du lion. C'est la revanche de la défaite qu'elle avait subie à la fin du moyen âge et de l'asservissement séculaire qui en avait été la conséquence. Seulement, le mouvement d'ascension vers le pouvoir ne s'est pas arrêté là. Les progrès de l'industrie et la diffusion des connaissances ont accru graduellement l'importance de la couche inférieure de la bourgeoisie et de la couche supérieure des masses populaires. Celles-ci à leur tour ont voulu avoir leur part dans les bénéfices de l'exploitation politique. Comme leur aînée, elles ont recours aux moyens révolutionnaires quand elles se croient les plus fortes, aux moyens légaux et en particulier à l'extension du suffrage, quand elles ne peuvent recourir aux autres avec des chances suffisantes de succès; mais partout l'objectif politique est le même; partout il s'agit de se rendre maître du gouvernement, c'est-à-dire de l'appareil distributif des emplois, des faveurs et des honneurs. Ajoutons que l'ardeur à s'emparer de cet appareil va croissant à mesure que sa valeur augmente, et celle-ci s'accroît naturellement à mesure que les progrès de l'industrie élèvent le niveau de la richesse sur laquelle travaille la pompe aspirante de l'impôt. Tandis que dans la France de l'ancien régime par exemple, avant l'invention de la machine à [157] vapeur et l'avènement de la grande industrie, le souverain, investi cependant d'un droit presque illimité de légiférer et de taxer extrayait à grand'peine de la nation, généralement pauvre, une somme annuelle de 600 millions, aujourd'hui l'association ou le parti politique en possession du pouvoir sous la raison sociale de monarchie, d'empire ou de, république réussit à en tirer sans difficulté, et malgré toutes les restrictions et précautions limitatives du droit de légiférer et de taxer, la somme énorme de 3 à 4 milliards, à laquelle il convient d'ajouter les profits des monopoles économiques, monopoles de la banque, des compagnies de]chemins de fer, des professions et des industries protégées. On peut affirmer que la valeur de l'appareil d'exploitation politique a quadruplé en France depuis un siècle et qu'il n'a pas acquis une plus-value moindre dans la plupart des autres pays civilisés. On s'explique donc que l'ardeur à s'en emparer ait cru en proportion,
Il est intéressant de remarquer qu'au début de cette nouvelle période de la lutte aujourd'hui universelle et sans trêve pour la possession du pouvoir, on se proposait seulement d'obtenir pour les gouvernés des garanties efficaces contre l'exploitation politique des gouvernants. L'ambition des défenseurs du peuple n'allait pas plus loin sous ce rapport que n'avait été celle de leurs devanciers. Peut-être, s'ils s'en étaient tenus là, auraient-ils réussi à créer un régime de transition supportable entre l'ancien ordre de choses, fondé sur la concurrence politique, et l'ordre nouveau qui allait s'établir sous l'impulsion de la concurrence [158] industrielle. Mais il est facile de se convaincre, étant donnée l'imperfection de la nature humaine, qu'ils ne pouvaient s'en tenir là. Les maisons souveraines et les classes qui partageaient avec elles les bénéfices et les avantages attachés au droit illimité de légiférer et de taxer prétendaient le conserver intact; elles considéraient toute limitation de ce droit substantiel qui mettait les ressources de la nation à leur discrétion comme une atteinte illégitime et nuisible à leur pouvoir; elles hésitaient jusqu'au bout à l'accorder et quand elles l'accordaient, c'était de mauvaise grâce et avec l'intention plus ou moins dissimulée de le reprendre à la première occasion favorable. Cela étant, la nation sur laquelle pesait le fardeau d'une législation de privilège et d'une lourde taxation ne devait-elle pas se pénétrer de l'idée qu'aucune concession sérieuse et durable ne pouvait être obtenue des détenteurs infatués et obstinés du pouvoir, et que le seul moyen efficace d'acquérir les garanties nécessaires qu'elle leur réclamait, c'était de les déposséder pour mettre à leur place un personnel de son choix, autrement dit de faire une révolution?
C'était là, il faut bien en convenir, la marche inévitable des choses, étant données l'obstination invincible des uns et l'impatience aveugle des autres. Mais voici un phénomène que personne n'avait prévu : c'est que les révolutions, au lieu de diminuer les charges des nations, ont eu pour résultat invariable de les augmenter.
La raison de ce phénomène inattendu et décevant est cependant facile à découvrir. Les révolutionnaires [159] n’avaient pu vaincre et déposséder leurs adversaires qu'à la condition de leur opposer des forces supérieures, c'est-à-dire une armée plus nombreuse. La victoire obtenue, pouvait-on empêcher les vainqueurs de se jeter sur les dépouilles des vaincus? C'était, suivant une expression pittoresque, la « curée » qui suit invariablement toute révolution. Mais précisément parce que l'armée victorieuse était plus nombreuse que l'armée vaincue et, aussi, parce qu'elle se composait généralement d'hommes ayant leur fortune à faire tandis que les vaincus avaient leur fortune faite, on ne pouvait amoindrir le gâteau qu'il s'agissait de partager; il fallait au contraire, sous peine de s'exposer à des défections ou à des scissions dangereuses, s'ingénier à le grossir. Yoilà pourquoi toutes les révolutions ont eu à la fois pour programme la diminution des charges publiques et pour conséquence leur augmentation.
Ce résultat imprévu des révolutions à coups de fusil se produit également dans les révolutions à coups de bulletin, qui forment l'objectif des luttes électorales et parlementaires et à là suite desquelles un parti succède périodiquement à un autre dans la possession du pouvoir. Comme un parti d'opposition ne peut l'emporter sur son rival au pouvoir qu'à la condition de recruter une armée électorale plus nombreuse, il est obligé, la victoire obtenue et sous peine d'être abandonné par la portion de son effectif qu'il laisserait sans récompense, d'augmenter le nombre des « places » et des faveurs dont il peut disposer, c'est-à-dire encore une fois d'appesantir sur la multitude des gouvernés [160] le fardeau de l'exploitation politique au lieu de l'alléger. Ajoutons encore que la possession du pouvoir ayant cessé d'être perpétuelle, ceux qui le détiennent d'une façon temporaire sont beaucoup moins intéressées que ne l'étaient leurs devanciers à ménager les ressources de la nation. Leur intérêt est de conserver le pouvoir aussi longtemps que possible, dussent les sacrifices qu'ils imposent dans ce but à la nation excéder ses forces et engager les ressources des générations à venir.
Voilà comment il se fait que la multitude des consommateurs des services publics en ait vu et envoie tous les jours hausser le prix sans que la qualité en ait été sensiblement améliorée. A la vérité, elle paye ce prix avec plus de facilité qu'elle ne le faisait sous l'ancien régime, mais cela tient surtout à ce que les progrès de la production ont augmenté d'une manière continue ses moyens de le payer. Nous allons nous assurer cependant que la progression des dépenses publiques tend aujourd'hui partout et sous toutes les formes de gouvernement à dépasser celle des ressources privées qui les alimentent. Nous nous convaincrons en même temps, contrairement à l'opinion commune, qu'à mesure que le pouvoir de légiférer et de taxer descend dans une couche plus basse et plus nombreuse, qu'il passe de l'aristocratie à la bourgeoisie et de la bourgeoisie à la démocratie, il va s'alourdissant pour la généralité des consommateurs des services publics, assujettis, sous le nouveau régime comme ils l'étaient sous l'ancien, à la servitude politique.
[161]
CHAPITRE V.
L'AFFAIBLISSEMENT DU FREIN DE LA CONCURRENCE POLITIQUE. SES EFFETS EN RUSSIE, DANS LES ÉTATS GERMANIQUES ET EN ITALIE.↩
On a vu que tous les États civilisés ont un trait commun : c'est la servitude politique à laquelle est assujettie la population des territoires qui forment leur domaine et en vertu de laquelle le gouvernement de l'État impose ses services, fait des lois, rend des décrets et ordonnances, que la population tout entière est contrainte d'observer, établit des impôts et autres charges et redevances qu'elle est contrainte de payer. A part ce trait commun mais fondamental de ressemblance, les États politiques diffèrent par des points nombreux dans leur constitution et leur organisation, dans la forme et la contexture de leur gouvernement.
On peut ramener les formes de gouvernement actuellement existantes à trois types généraux, la monarchie absolue ou dictatoriale, la monarchie constitutionnelle et la république. Ces formes générales peuvent être sous-divisées à leur tour; les monarchies constitutionnelles se rapprochent les unes de la monarchie [162] absolue, les autres de la république; les républiques peuvent être plus ou moins constitutionnelles et parlementaires ou dictatoriales. Les théoriciens politiques attribuent une importance extraordinaire à ces formes de gouvernement et-à leurs différences. Selon les uns, la monarchie peut seule préserver la société de l'anarchie et d'un retour plus ou moins accéléré à la barbarie; encore y a-t-il parmi eux des divergences : ceux-ci attribuant cette vertu à la monarchie constitutionnelle, ceux-là uniquement à la monarchie absolue. Selon les autres, le progrès et en particulier l'amélioration du sort du peuple n'est possible que sous la république ; toutefois encore avec des divergences d'opinion, quant à l'espèce de république, ceux-ci répudiant avec horreur la république démocratique et sociale tandis qu'ils acclament la république constitutionnelle ou dictatoriale et impériale, et vice versa. Une importance presque égale à celle des formes de gouvernement est attribuée aux institutions qui ont pour objet d'étendre ou de limiter les pouvoirs du gouvernement, en matière de législation et de taxation, comme aussi d'accorder à une classe plus ou moins nombreuse la participation au gouvernement. C'est sur ce terrain que les théoriciens politiques piétinent depuis un siècle. Nous nous convaincrons, en passant en revue les principaux États civilisés, que l'expérience n'a en aucune façon confirmé leurs théories, que les formes de gouvernement n'ont qu'une importance fort secondaire et que les institutions elles-mêmes, soit qu'elles aient pour objet de fortifier et d'étendre les pouvoirs du gouvernement, ou de mieux garantir la propriété et la liberté des gouvernés, ont rarement l'efficacité qu'on leur prête; que si un changement quelconque dans la forme du gouvernement ou dans les institutions politiques peut avoir une importance capitale pour les politiciens qui tirent leurs moyens d'existence de l'exploitation de l'État et qui ont attaché leur fortune au succès de tel régime ou de tel autre, il n'intéresse que faiblement les consommateurs des services publics. L'imperfection et la cherté croissante de ces services tiennent avant tout à la servitude politique et au relâchement successif et inévitable du frein de la concurrence qui obligeait les propriétaires exploitants des États à améliorer leurs services et à en réduire le prix au taux nécessaires. Par suite du relâchement de ce frein indispensable, l'exploitation des États est devenue un monopole et les détenteurs de ce monopole ont acquis une puissance croissante sur les consommateurs qui y sont assujettis, en dépit de tous les freins artificiels que l'on a inventés pour remédier à l'affaiblissement du frein naturel de la concurrence politique.
Voyons donc quels sont les effets de cet affaiblissement d'un frein nécessaire dans les principaux États modernes, et recherchons si les différences dans les formes de gouvernement et dans la nature des institutions agissent d'une manière appréciable soit pour retarder, soit pour accélérer la décadence et finalement la faillite ou la chute, à laquelle l'insuffisance de la concurrence condamne toute exploitation politique ou autre.
[164]
Commençons cette revue par les gouvernements monarchiques.
En Russie et dans les États germaniques, l'État est demeuré la propriété héréditaire de la maison souveraine. Le frein de la la perpétuité de possession s'y est conservé intact, sauf le risque que la Révolution peut faire courir aux dynasties régnantes. En revanche, aucun système de contre-poids et de garanties ne remédie en Russie à l'affaiblissement du frein de la concurrence politique tandis que les États germaniques ont fini par se constitutionnaliser. Les gouvernés y possèdent un droit plus ou moins étendu de participation au gouvernement, d'intervention et de contrôle dans la gestion des affaires de l'État. A considérer la situation actuelle de la Russie, il semble au premier abord que l'absence d'un mécanisme modérateur du pouvoir du souverain soit la cause originaire des abus du gouvernement de cet empire, et qu'il suffise, pour y remédier, d'introduire en Russie le régime constitutionnel qui fleurit en Allemagne. Mais cette conclusion qui est celle du « parti libéral » serait trop hâtive. En Allemagne, le mécanisme modérateur du régime constitutionnel n'a opposé qu'un faible obstacle à la volonté souveraine ; il n'a enrayé ni la politique belliqueuse et annexante, ni la politique anti-religieuse et anti-économique de M. de Bismarck, et il n'a pas empêché davantage le développement progressif des dépenses publiques. Il a permis seulement au peuple allemand d'exprimer plus librement son opinion sur la direction des affaires publiques par la voie de la tribune et de la presse, mais [165] sans aucune efficacité appréciable. A la vérité, l'administration se distingue dans les États germaniques par des qualités de régularité, de ponctualité et d'honnêteté qu'on ne rencontre point en Russie, mais ces qualités elle les possédait avant l'avènement du régime constitutionnel. Celui-ci ne les a point créées et on peut se demander même s'il aura la vertu de les conserver, si l'abus des influences parlementaires ne finira point par gâter en Allemagne le recrutement de l'administration comme il l'a déjà gâté ailleurs. On peut contester l'efficacité de ce frein dans les États germaniques, à plus forte raison en Russie. Ce n'est pas à dire que la Russie ne souffre point gravement dès abus inhérents au monopole politique. La dictature impériale héréditaire ou le tzarisme s'appuie sur deux grands corps organisés : la bureaucratie et l'armée. Le tzar est le maître sans doute, mais il est enveloppé dans le réseau serré des influences bureaucratiques et militaires. S'il refusait d'y obéir, sa situation deviendrait précaire et l'histoire atteste que sa vie même ne tarderait pas à être menacée. Quoique la Russie soit aujourd'hui pleinement à l'abri dès invasions des Tartares [15] et des Polonais et qu'elle ait montré en 1812 ce qu'il en coûte à envahir son territoire, quoiqu'elle ne fasse plus en Europe de guerres qu'elle ne soit maîtresse d'éviter et qu'elle ait facilement raison des petits despotes asiatiques, les influences militaires opposent un obstacle insurmontable [166] à la réduction de son énorme effectif et à la diminution de son budget de la guerre. Les influences bureaucratiques agissent de même pour étendre le débouché et accroître l'importance de l'administration par l'augmentation des attributions de l'État en matière d'enseignement, de travaux publics, etc. Cette administration est infectée plus qu'aucune autre,— celle de la république des États-Unis exceptée, — de la plaie de la corruption et de la vénalité; mais ce vice tient à la nature du peuple slave et du milieu où il vit, et nullement à l'absence des institutions constitutionnelles. Les slaves ont le goût du luxe et de ses raffinements coûteux; ils sont imprévoyants et dépensiers. Joignez à cela la rareté des foyers de population, disséminés sur d'immenses espaces, et les difficultés qui en résultent au point de vue de la surveillance et du contrôle, et vous .vous expliquerez la vénalité de l'administration russe et l'impuissance des efforts consciencieux qui ont été faits, depuis quelques années, pour y remédier. Selon toute apparence même, le mal ira s'aggravant et s'étendant à mesure que le gouvernement multipliera ses attributions. Enfin, depuis l'avènement de la grande industrie et l'abolition du servage les influences protectionnistes s'ajoutent aux influences bureaucratiques et militaires pour aggraver les abus du monopole politique. C'est l’abolition du servage qui a sinon créé, du moins développé et rendu toutes-puissantes les influences protectionnistes. Cette grande réforme, opérée malheureusement par des procédés socialistes,, a eu pour résultat de diminuer sensiblement les revenus des propriétaires, [167] c'est-à-dire de la classe au sein de laquelle se recrutent les états-majors de la bureaucratie et de l'armée et qui gouverne, en réalité, la Russie sous la dictature nominale du Tzar. Cette classe partiellement dépossédée a cherché des.compensations à la diminution de ses revenus et elle les a trouvées d'une part dans l'augmentation du nombre des emplois civils et militaires, d'une autre part dans la protection industrielle. Lés impôts destinés à pourvoir à l'accroissement des dépenses publiques se sont multipliés et alourdis en même temps que les droits de douane, de manière à compenser et au delà sous forme d'appointements civils et militaires et de primes industrielles, la diminution de revenus que la classe gouvernante avait subie par la suppression de la corvée. Le fardeau qui pesait sur les épaules de la multitude s'est ainsi appesanti au lieu de s'alléger et la condition matérielle des classes inférieures est généralement devenue pire. L'établissement des institutions constitutionnelles et représentatives aurait-il pour effet de diminuer ces charges? S'il faut en juger par les résultats de l'institution des assemblées provinciales (zemstvos), rien n'est moins probable. Ces assemblées n'ont apporté aucun remède aux abus administratifs; elles ont augmenté seulement lo nombre des sinécures, créé des services d'une utilité illusoire et élevé le chiffre des dépenses locales. Autant peut-on en dire des municipalités électives. L'institution d'un parlement qui introduirait en Russie la lutte des partis pour la possession du pouvoir et, avec elle, la nécessité d'augmenter continuellement le butin des places et des [168] faveurs, qui sert de solde aux armées politiques enrôlées au service des partis, auraient pour conséquence une nouvelle aggravation des charges publiques jusqu'à ce qu'une réaction populaire emportât le parlementarisme pour rétablir la dictature tzarienne.
Si des pays où l'État a continué d'être la propriété perpétuelle d'une famille, nous passons à ceux où cette propriété a été reconquise par la nation et où la classe dirigeante, agissant comme fondée de pouvoirs de la communauté, a concédé aune « maison » la gestion héréditaire des affaires publiques sous des conditions spécifiées dans une constitution ou une charte et se résumant dans l'obligation d'abandonner cette gestion, dans ce qu'elle a d'effectif et de substantiel, au parti en majorité dans le parlement, en Italie, par exemple, nous nous trouverons en présence d'un entraînement encore plus vif vers l'augmentation des dépenses publiques. Avant l'unification et la constitutionnalisation de l'Italie, les frais de gouvernement de l'ensemble des États de la Péninsule n'atteignaient pas 600 millions ; ils approchent aujourd'hui de 2 milliards (1,707,000,000 en 1885-86), sans parler de l'énorme charge supplémentaire résultant de la généralisation de la corvée militaire. Cette aggravation des charges publiques a été provoquée, en premier lieu, par la révolution qui a transféré le pouvoir des mains de l'aristocratie et du clergé à celles de la classe moyenne ; en second lieu, par le vice naturel du mécanisme constitutionnel qui oblige les partis politiques à grossir incessamment le chapitre de la solde de leur armée pour conserver le pouvoir ou pour le [169] conquérir. L'ancienne aristocratie gouvernante, peu nombreuse et médiocrement prolifique, se contentait du débouché étroit que lui offraient les petites cours italiennes ; le clergé vivait du revenu des biens ecclésiastiques. La classe moyenne, bien autrement nombreuse et besoigneuse, avait besoin d'un débouché plus large pour satisfaire ses appétits de domination et de jouissances aiguisés par un long jeûne. Comme tous les parvenus, elle voulait d'ailleurs faire étalage de sa puissance et de sa fortune de fraîche date. Au lieu d'écouter les économistes naïfs qui lui conseillaient de doter l'Italie d'un gouvernement à bon marché, elle s'est lancée dans les voies d'une politique fastueuse et chère qui flattait sa vanité tout en élargissant son débouché. L'armée et la marine ont été mises sur le pied qui convenait à une grande puissance, non sans offrir aux rejetons de la classe gouvernante un supplément d'emplois aristocratiques qui les élevaient au niveau des fils de la noblesse, tout en leur procurant un revenu assuré. La carrière des emplois civils s'élargit de même sous la pression de la nécessité de récompenser les services rendus à la Révolution et, plus tard, les services rendus aux partis. Les douanes intérieures avaient été supprimées et c'était le bienfait le moins contestable de l'unification politique de l'Italie. Mais les appétits de la classe gouvernante allant croissant avec la possibilité de les satisfaire, elle est devenue protectionniste de libre-échangiste qu'elle se flattait d'être avant de posséder le pouvoir de s'enrichir aux dépens d'autrui. Actuellement, le tarif douanier de l'Italie unifiée dépasse la [170] moyenne des tarifs de l'Italie morcelée, elle mouvement protectionniste est encore à ses débuts. A la vérité, la nouvelle classe gouvernante a perfectionné la fiscalité, autrement dit l'art de dépouiller les gouvernés en leur double qualité de contribuables et de consommateurs, et ses finances sont dans un état prospère. Les revenus de la classe qui vit du budget se sont à la fois accrus et consolidés. En revanche, quelle est la condition de la multitude qui fournit ces revenus et qui paye l'intérêt usuraire des emprunts à l'aide desquels la classe moyenne a fondé sa domination et sa fortune ? L’enquête agricole et la statistique de l'émigration [16] attestent qu'une partie de la population ne mange pas à sa faim et qu'un nombre croissant de misérables fuit chaque année l'Italie unifiée et régénérée pour aller chercher ailleurs des moyens d'existence, ce qui signifie qu'en Italie, plus encore qu'en Russie et dans les États germaniques, le progrès des dépenses et des charges publiques dépasse celui des forces et des ressources privées qui les supportent et les alimentent.
[171]
CHAPITRE VI.
L'AFFAIBLISSEMENT DU FREIN DE LA CONCURRENCE POLITIQUE EN ANGLETERRE ET AUX ÉTATS-UNIS.↩
En Angleterre, où la gestion de l'État se trouve entre les mains d'une famille royale issue d'une usurpation, mais appuyée sur une aristocratie riche et fortement organisée, l'invasion du gouvernement dans le domaine de l'activité privée est plus lente que dans les pays continentaux. Cela tient d'abord à ce que la classe gouvernante est moins nombreuse en comparaison de la masse de la nation; ensuite, à ce qu'elle dédaigne les petits emplois dont se contente ailleurs la bourgeoisie. Elle n'en a pas moins imposé à l'Angleterre une politique singulièrement onéreuse, en s'appliquant à étendre la domination britannique sur toute la surface du globe, en intervenant dans les affaires des autres nations, en se mêlant de leurs querelles intérieures ou étrangères. De là les guerres que l'Angleterre a eu à soutenir presque sans interruption, tantôt en Europe, tantôt dans les autres parties du monde, et la dette colossale qu'elle a contractée, en précédant dans la voie de l'abus du crédit public tous les autres pays civilisés.
[172]
Le prétexte dont l'aristocratie gouvernante couvrait cette politique ambitieuse et dispendieuse, c'était la nécessité d'assurer la sécurité, la grandeur et le prestige de l'Angleterre, d'agrandir les débouchés de son industrie et de son commerce; mais le mobile réel quoique inavoué et peut-être inconscient auquel elle obéissait, c'était d'étendre le débouché des grands emplois civils et militaires dont elle avait le monopole et qui étaient nécessaires pour fournir à ses cadets des revenus honorables. Cette politique de domination et d'intervention a rendu l'Angleterre odieuse aux autres peuples. Peut-on affirmer qu'elle ait profité à la masse de la nation britannique? L'empire colonial de l'Angleterre est une oeuvre artificielle qui n'a rien de consistant et de solide ; les colonies de l'Amérique du Nord ont commencé à la démolir en se proclamant indépendantes, et elles ont gardé de la domination britannique un souvenir médiocrement respectueux et reconnaissant. Le dominion du Canada et l'Australie, en attendant de briser le faible lien politique qui les attache encore à la métropole, se sont séparés d'elle commercialement; ils ont élevé contre les produits anglais assimilés aux produits étrangers la barrière du protectionnisme et ils ne fournissent plus qu'un insignifiant débouché à un petit nombre de hauts fonctionnaires; en sorte que les avantages particuliers que la nation britannique retire de leur possession sont loin de couvrir les intérêts et l'amortissement du capital qu'elle a dépensé pour les conquérir et les défendre. L'Inde elle-même est devenue une possession précaire depuis que l'Angleterre a[173] commis la faute de l'enlever à la Compagnie pour la gouverner en régie. Car il est douteux que les pauvres Indous continuent à supporter avec patience le fardeau de plus en plus lourd dont les accable ce nouveau régime. Est-il nécessaire d'ajouter qu'ils trouveront dans la Russie, maîtresse de l'Asie centrale, un auxiliaire tout disposé à les en affranchir?
Cependant, si lourd qu'ait été pour les consommateurs des services publics, le gouvernement de l'aristocratie, on ne saurait se dissimuler que l'accession des classes moyenne et inférieure à la puissance politique est destinée à l'alourdir encore. Aussi longtemps que l'aristocratie avait le monopole des emplois, l'opinion des classes gouvernées était hostile à l'intervention de l'État dans le domaine de l'activité privée ; depuis que ce monopole leur est devenu accessible grâce à l'extension de l'électoral-et à la suppression des bourgs pourris, l'appétit des fonctions publiques s'est éveillé chez elles. Les doctrines libérales de l'école de Manchester ont cessé d'être en honneur, et le socialisme d'État recrute chaque jour des prosélytes. Or le socialisme d'État n'implique-t-il pas l'augmentation illimitée des dépenses, et par conséquent l'accroissement progressif des charges publiques ?
Dira-t-on que les monarchies possèdent dans la perpétuité du pouvoir héréditairement fixé dans une famille, un frein à l'augmentation des dépenses? Oui, sans doute, mais ce frein, d'ailleurs bien faible quand il n'est pas pas soutenu par la pression de la concurrence politique, n'a plus aujourd'hui qu'une existence [174] précaire. Quelles monarchies peuvent se dire à l'abri d'une dépossession révolutionnaire ? Enfin, dans les États monarchiques qui ont adopté le régime constitutionnel et parlementaire, le pouvoir du monarque est devenu presque nominal : le roi règne et ne gouverne pas, suivant une maxime caractéristique; le pouvoir effectif appartient au parti en possession de la majorité dans le parlement, et ce pouvoir est devenu mobile avec la majorité elle-même; il peut passer aussi vite d'un parti à un autre dans les monarchies que dans les républiques. Et, n'oublions pas que les partis, n'ayant qu'une possession temporaire et précaire du pouvoir, sont naturellement portés à sacrifier l'avenir au présent. Sous ce rapport, les monarchies constitutionnelles et parlementaires, sans parler des vices propres à la monarchie, tels que l'existence d'une « cour », ne présentent aucun avantage marqué sur les républiques. Néanmoins, dans celles-ci, en exceptant les oligarchies héréditaires qui n'existent plus qu'à l'état de souvenir historique, le frein, si faible et précaire qu'il soit, de la perpétuité du pouvoir, a complètement disparu. L'abus du monopole politique ne rencontre d'obstacle organique ni dans les républiques constitutionnelles ni.dans les républiques dictatoriales.
Dans la première catégorie se rangent les États-Unis, la France et la Suisse ; dans la seconde, la plupart des républiques de l'Amérique du sud, quoiqu'elles soient nominalement constitutionnelles et même parlementaires. Dans l'une et dans l'autre, la nation est propriétaire de l'État et elle l'exploite ou, pour mieux dire, elle [175] est censée l'exploiter en régie. Mais cette exploitation elle ne peut la gérer elle-même ; elle est obligée d'en confier la gestion à des délégués qu'elle élit sous des conditions et avec des restrictions variées, portant sur l'âge, le sexe, l'aptitude électorale, la durée et l'étendue du mandat. Le droit d'élire ses mandataires est sa seule garantie contre la mauvaise gestion de ses affaires, et cette garantie est malheureusement rendue illusoire par l'intervention des associations politiques désignées sous le nom de « partis ».
Aucune des innombrables constitutions des temps modernes ne fait mention des partis, quoiqu'ils jouent un rôle prépondérant dans la machinerie politique. Ils sont nés à la fois de l'impuissance matérielle des nations à gérer leur gouvernement et du désaccord qui règne parmi leurs membres sur la direction qu'il convient d'imprimer aux affaires publiques. Théoriquement, les partis se proposent de faire prévaloir certaines doctrines qu’ils déclarent nécessaires à la prospérité et à la grandeur de la nation ; pratiquement, ils s'efforcent de s'emparer du gouvernement, et de le conserver le plus longtemps possible per fas et nefas, en le mettant au service des classes particulières sur lesquelles ils s'appuient. Ils sont plus ou moins nombreux, mais habituellement les plus faibles se fusionnent avec les plus forts et ils finissent par se réduire à deux ou à trois, l'un issu généralement de la classe supérieure, c'est le parti conservateur, les autres recrutés dans les couches moyenne et inférieure, ce sont les partis libéraux, radicaux et socialistes.
[176]
Les partis s'organisent sur le modèle des. armées ; ils ont leur chef, leur état-major, leurs cadres d'officiers et de sous-officiers, qu'ils s'attachent en leur offrant en guise de solde, le butin d'emplois, de privilèges et de faveurs dont un gouvernement en possession du droit d'imposer ses services peut toujours disposer et qu'il est le maître d'augmenter. Ils observent une discipline exacte, l'expérience leur ayant démontré que la victoire est à ce prix, et se montrent d'ailleurs peu scrupuleux sur les moyens de s'emparer du pouvoir ou de le conserver.
Quand le procédé de la force leur paraît le plus avantageux, ils n'hésitent point à y recourir, ils font des coups d'État, des pronunciamentos ou des révolutions, et fusillent, déportent ou exilent leurs compétiteurs. Quand l'emploi de ce procédé expéditif n'est pas possible, ils se contentent de lutter sur le terrain électoral, en remplaçant la violence matérielle par l'intimidation et la corruption. Ils séduisent l'électeur par toutes sortes de promesses : protections et subventions à son industrie, émargement au budget ou décorations pour lui et les siens, avantages particuliers pour sa localité ; ils l'intimident par la crainte de l'administration, de l'enfer ou du communisme. Bref, ils mettent tout en oeuvre pour atteindre leur but, qui est la conquête ou la conservation du pouvoir, sans s'embarrasser autrement de la moralité de leurs paroles et de leurs actes. On peut affirmer même que les usages de la guerre des partis sont actuellement moins civilisés que ceux de la guerre ordinaire. C'est que le corps électoral ne se distinguant [177] point précisément par le courage, les lumières et la moralité, c'est le parti le plus audacieux et le moins scrupuleux qui a le plus de chances d'enlever ses suffrages. Il arrive cependant que la nation soit tellement lasse de la domination d'un parti qu'elle le dépossède du pouvoir par une sorte d'insurrection de l'opinion pour installer à sa place l'un ou l'autre de ses concurrents. Mais gagne-t-elle au change ? Le remplacement d'un parti par un autre dans l'exploitation du pouvoir a-t-il nécessairement pour résultat de diminuer le poids des services publics et d'en améliorer la qualité ? Il a généralement le résultat contraire, surtout quand il s'opère à des intervalles rapprochés. En premier lieu, le parti qui arrive aux affaires est obligé de distribuer à son armée ou tout au moins à L’état-major et aux cadres de cette armée les situations lucratives et les autres bénéfices en vue desquels ils ont combattu, tout en s'abstenant de dépouiller entièrement les occupants et de les transformer ainsi en ennemis irréconciliables. D'où la nécessité d'augmenter le nombre des places, de multiplier les faveurs, les privilèges et les protections, partant d'alourdir les charges de la nation. En second lieu, un personnel administratif dont la situation et les moyens d'existence sont à la merci des partis est intéressé, avant tout, à les servir; ses obligations envers le public sont reléguées au second plan ; enfin, si les changements politiques sont par trop fréquents, et.s'ils sont accompagnés chaque fois d'une razzia de fonctions au profit du parti vainqueur, les fonctionnaires ne seront-ils pas tentés de joindre à leurs appointements [178] réguliers des profits irréguliers qui les assurent contre ce risque ?
C'est surtout aux Etats-Unis que l'on peut observer ces curieux phénomènes et se rendre compte de leurs causes. Dans les premiers temps de la république américaine, la classe gouvernante était presque entièrement composée de grands et moyens propriétaires qui tiraient leurs revenus de l'exploitation du sol. Les plus riches et les plus influents appartenaient aux États du sud, où la traite et l'élevage des nègres avaient mis à leur service de nombreux esclaves, tandis que l'immigration d'Europe ne procurait aux colons des États du nord que des renforts insuffisants de travailleurs libres. La possession et l'exploitation de l'État se trouvaient alors fixées entre les mains d'une aristocratie territoriale qui pouvait se passer des emplois publics pour subsister et n'avait qu'un faible intérêt à [les multiplier. Mais peu à peu la situation changea ; le progrès des moyens de communication maritimes et terrestres amena dans les États du nord un nombre croissant d'émigrants libres d'Europe, tandis que l'abolition de la traite des nègres entravait l'approvisionnement du travail dans les États du sud. La production et la richesse commencèrent à se développer plus rapidement dans le nord, et l'on y vit naître un grand nombre d'industries nouvelles, qui demandaient à être protégées contre leurs similaires d'Europe. Un moment arriva où les politiciens du sud se trouvèrent à la veille d'être dépossédés pour toujours du gouvernement de l'Union. Cette extrémité leur paraissait d'autant plus redoutable que leurs propriétés [179] et leurs débouchés étaient chaque jour menacés davantage par l'abolitionnisme et le protectionnisme du nord. Que firent-ils pour parer à ce double danger et conserver au moins une partie de la domination dont ils étaient sur le point de perdre la totalité ? Ils entreprirent de séparer les États du sud du reste de l'Union et de fonder une confédération indépendante. Les politiciens du nord, appuyés sur les abolitionnistes et les protectionnistes, ne manquèrent pas de s'opposer à ce morcellement d'une domination qui allait leur appartenir tout entière, et, grâce au puissant mécanisme de la servitude politique, ils purent imposer à. la masse de là population les énormes sacrifices de sang et d'argent que coûta la guerre de la sécession.
La supériorité de ses ressources et de son crédit a donné la victoire au Nord, l'union a été maintenue et pendant un quart de siècle les vainqueurs ont conservé le gouvernement de la grande République. Ils en ont profité d'abord pour ruiner leurs adversaires en décrétant, comme une mesure de guerre, l'émancipation immédiate des esclaves, ensuite pour s'enrichir eux-mêmes en accaparant et en multipliant les emplois aux dépens des contribuables et en protégeant à outrance leurs industries aux dépens des consommateurs. Cependant, le parti vaincu s'est reconstitué peu à peu et la lutte pour la possession du pouvoir a recommencé de plus belle dans l'Union et dans les États particuliers. La durée dus fonctions du personnel gouvernant étant limitée à quatre ans pour l'Union, à deux ans et même à un an dans les États et les villes, cette lutte est pour [180] ainsi dire permanente. Les deux armées politiques en présence sont obligées de rester constamment sur pied, de maintenir leurs effectifs intacts et de s'efforcer de les augmenter, en leur offrant un butin croissant d'emplois et de faveurs. De là une augmentation progressive et, en quelque sorte, mécanique des frais de gouvernement. Quoique l'Union ait eu la sagesse de congédier sa colossale armée à l'issue de la guerre de la sécession, le prix du gouvernement est aussi élevé aux États-Unis qu'en Europe. Au moins, la qualité des services publics est-elle meilleure? La justice est-elle plus équitable et plus prompte? La police plus vigilante? La vie, la propriété et la liberté des citoyens sont-elles plus sûrement garanties ? Les villes sont-elles mieux entretenues, pavées, éclairées et balayées? Non! Les services publics valent moins encore aux Etats-Unis qu'en Europe.
A quoi cela tient-il? Cela tient avant tout à la durée précaire des fonctions publiques et à la corruption qui en est la conséquence. Cette corruption qui gangrène l'administration américaine plus encore peut-être que l'administration russe, en dépit des garanties, des libertés et de la publicité qui abondent en Amérique et qui font défaut en Russie, les partis la considèrent d'un oeil indulgent sinon bienveillant, surtout lorsque les coupables se sont signalés par l'importance de leurs services politiques. De même que, dans une armée en campagne, les généraux et les officiers excusent volontiers les actes de pillage et la pratique de la maraude, quand ils ne les autorisent point par leur exemple, et [181] ferment les yeux sur les pires méfaits de leurs troupes d'élite, les politiciens ont des trésors de mansuétude pour les dilapidations des fonctionnaires dévoués au parti. Qui sait d'ailleurs si les plus purs d'entre les purs ne seront pas obligés quelque jour d'user de pratiques analogues pour suppléer à l'insuffisance de la rétribution de leurs services et continuer à mener une existence honorable ?
Voilà comment s'explique le progrès rapide et continu des frais de gouvernement combiné avec l'abaissement de la qualité des services publics au sein de la grande République américaine. En vain, la « réforme du service civil » y a-t-elle été mise à l'ordre du jour. Cette réforme est une pure utopie, car les abus qu'il s'agit d'extirper ont leurs racines dans la constitution même de l'Union. Ils tiennent comme ailleurs à l'affaiblissement de la concurrence politique et plus qu'ailleurs à l'insuffisance de la durée de la possession du pouvoir. L'État est aujourd'hui dans l'Union américaine un monopole à court terme, le pire des monopoles, et la multitude assujettie à la servitude politique ne peut se soustraire à l'exploitation du parti qui a la possession précaire de ce monopole que pour se livrer à celle du parti qui aspire à le posséder.
[182]
CHAPITRE VII.
INSIGNIFIANCE DES FORMES DE GOUVERNEMENT. ACCROISSEMENT PROGRESSIF DU POIDS DU GOUVERNEMENT DANS LES ÉTATS MODERNES.↩
Nous pourrions prolonger davantage la revue des institutions politiques des États modernes et de leurs résultats, mais l'esquisse que nous venons d'en faire suffit pour démontrer que la question des formes de gouvernement, à laquelle on attache généralement une importance capitale, n'a qu'une portée fort secondaire. Au point de vue de l'intérêt des consommateurs des services publics, il importe peu que l'entreprise investie du monopole de la production de ces services soit entre les mains d'une famille qui en possède la gestion héréditaire ou qu'elle appartienne à une compagnie dont le personnel dirigeant se recrute par a voie de l'élection, autrement dit qu'elle ait la forme d'une monarchie ou d'une république. Cela leur importe aussi peu que de savoir si la mine qui leur fournit du combustible appartient à un propriétaire qui l'administre de père en fils ou à une société d'actionnaires qui élisent leur conseil [183] d’administration. Car cette différence de régime ne peut exerce qu'une influence insignifiante sur le prix et la qualité du charbon.
Supposons cependant que les consommateurs de combustible appartiennent à la mine comme les consommateurs politiques appartiennent à l'État, on verra se produire dans l'industrie minière des phénomènes analogues à ceux que nous venons de constater. Si la concurrence, agissant d'une manière ou d'une autre, ne vient pas les en empêcher, les propriétaires de charbonnages ne manqueront pas d'élever au maximum le prix du combustible. Les consommateurs mécontents finiront par se révolter contre cette exploitation abusive d'un monopole. Ou bien ils demanderont aux propriétaires des garanties contre leur tendance naturelle à augmenter le prix du charbon et peut-être le droit d'intervenir dans la direction de la mine, ou bien ils la confisqueront et se chargeront d'en organiser eux-mêmes l'exploitation. Mais s'ils sont trop nombreux et dépourvus des aptitudes et des connaissances nécessaires, ils ne pourront pratiquer eux-mêmes l'industrie charbonnière. Si cette industrie est particulièrement lucrative, on verra alors se constituer parmi eux des sociétés ou des coteries pour s'en disputer la direction et les bénéfices. Chacune recrutera des partisans parmi les consommateurs en leur offrant des avantages particuliers, et si leurs forces se balancent, elles se succéderont tour à tour dans la gestion de la mine. Sous ce nouveau régime, l'exploitation des charbonnages ne tardera pas, selon toute apparence, à redevenir aussi coûteuse et routinière [184] qu’elle l'était sous l'ancien et le charbon deviendra de plus en plus cher.
Tels sont les phénomènes dont les États politiques nous offrent le spectacle, quelle que soit la forme de leur gouvernement, monarchique ou républicaine, depuis l'époque où la pression de la concurrence politique a commencé à se ralentir. Le prix dont les nations payent leurs services s'est accru d'une manière progressive, sans qu'on puisse dire que la qualité de ces services soit sensiblement meilleure.
On s'en convaincra facilement en consultant la statistique de l'accroissement- des dépenses et des dettes des États civilisés depuis la fin du siècle dernier.
Voici, d'après M. Paul Boiteau [17] , quelle a été la progression des dépenses en France sous les divers régimes qui se sont succédé depuis la révolution.
| Budgets moyens des périodes. (fr.) | Augmentation p. 100 de l'un sur l'autre. | |
| Premier Empire | 985,770,129 | |
| Restauration | 1,031,912,170 | 4,7 |
| Monarchie de 1830 | 1,287,499,905 | 24,8 |
| Seconde République | 1,587,808,016 | 23,3 |
| Seconde Empire | 2,150,293,852 | 35,4 |
| Troisième République (1871-1884) | 3,492,906,046 | 62,4 |
L'accroissement des dépenses n'a guère été moindre dans les autres pays :
« L'Angleterre, lisons-nous encore dans le remarquable travail de M. Paul Boiteau, a dépensé de 1688 à 1801 au total 2,088,639,531 liv. sterl., et de 1801 à 1877, 9,996,730,051; d'une période à l'autre [185] et année par année, l'augmentation a été de 523 p. 100.
« Parmi ses colonies, l'Inde n'avait, en -1830-51, qu'une dépense de 27,000,624 liv. sterl. ; en 1SS2-S3, le compte des dépenses y a été de G9,41S,598 ou de 25S p. 100 de plus. Les dépenses du Canada étaient en 1867-68 de 13,480,093 dollars, et en 1SS1-82 de 27,067,104, juste le double, à quatorze ans de distance. Les colonies neuves vont d'un pas plus pressé encore : le Cap en 1865 avait un budget de dépenses de 870,089 liv. sterl,, et en 1878-79 de 3,994,933.
« L'Allemagne, comme empire, a augmenté déjà sa dépense déplus des deux tiers (330,970,000 marcs en 1872; 610,632,707 en 1SS2-83). En 1868, quand l'Empire n'était que la Confédération du Nord, son budget n'était que de 216,474,729 marcs. Dans le même laps de temps, la Prusse économe a plus que doublé son budget (518,757,000 de dépenses en 1871; 1,237,725,000 pour 1885-86 avec les chemins de fer) et elle a dépensé cinq ou six fois plus qu'en 1821, moment où la cour de Potsdam paraissait satisfaite de son. sort, songeait à peine à l'hégémonie de l'Allemagne et n'eût pas osé rêver,-même passagèrement, la direction de la politique de l'Europe.
« Si le budget commun des deux États d'Autriche et de Hongrie ne croît pas aussi vite que le budget fédéral de l'Allemagne (IH,714,641 florins de 2 fr. 50 en 1868, et 119,453,510 pour 1885), les budgets cisleithan et transleithan n'imitent pas sa retenue. Le budget des dépenses de l'Autriche était de 324,968,163 florins en 1868, et il est de 519,893,166 au projet de 1885; le budget de la Hongrie était de 170,037,593, et il dépasse 338 millions de florins. Les trois budgets réunis font 977 millions de florins (2,442,500,600 fr.). En 1816, la dépense totale de l'Empire n'était que de 131,486,466 florins; en 1840, que de 164,647,036, et encore en 1860 que de 344,554,316. Elle a presque triplé ea vingt-cinq ans.
[186]
« Prenons un État qui n'a pas eu maille à partir avec la guerre, la Belgique, et ne nous étonnons pas de la rapidité de l'accroissement de ses premiers budgets qui sont des budgets de premier établissement. De 1830 à 1840, elle monte d'un budget de 27,981,169 fr. à un budget de 165,914,371, aucun pays n'a fait une aussi large enjambée, mais elle n'est guère qu'à 200 millions en 1870, et son budget de dépenses, qui a dépassé la somme de 3H0 millions, marche sur celle de 400. La Hollande, pays des ménagères, dépensait 67,787,000 florins de 2 fr. 10 en 1852, et 99,107,000 en 1870. Son compte de 1882 est de 129,889,000 et ses derniers budgets s'élèvent plus haut avec l'inconvénient, depuis quelques années, de n'être plus en équilibre. Les budgets des colonies hollandaises ne sont pas, d'ailleurs, inférieurs à ceux de la métropole; elles ne dépensaient que 84,347,000 florins, en 1867 sur une recette de 111,400,000; en 1876, elles ont été jusqu'à dépenser 153,177,000 florins, avec un premier déficit, et, en 1882, la dépense prévue était de 145,870,000 florins quand la recette descendait à 125,218,000.
« Au 1 moment de sa première unification, en 1860, l'Italie s'est trouvée devant un budget de recettes de469,115,000 fr., un budget de dépenses de 571,277,000 fr. et une dette de 2,241,870,000 fr. Le compte de 1882 donne : 1° finances et charges financières, 887,298,970 fr. ; '2° services militaires 306,389,729; 3° services civils,343,437,486. Total 1,537,126,185,
« Autant qu'elle le peut, l'Espagne empêche ses budgets de s'élever, mais ils s'élèvent malgré elle, et doublés, de 1846 à 1870, ils ont encore augmenté d'un quart dans les années suivantes.
« S'il était vrai que les gouvernements d'autocratie sont les moins dépensiers, la Russie n'augmenterait que très faiblement ses budgets, mais même sans vivre sous une constitution, la Russie est un pays qui se meut, et, de plus, un pays qui, sans avoir une vieille histoire, s'est donné un rôle historique à jouer, et ses budgets s'en ressentent. Ils sont maintenant les plus gros de l'Europe après ceux dé la France. [187] Les dépenses, en 1873, étaient déjà de 539,140,337 rouilles, après avoir été de 432,669,012 en 1866; elles ont atteint la somme de 600,510,612 roubles en 1878, et celle de 732,413,150 en 1881. Le budget de 1885 est de 584,113,934 roubles pour les dépenses ordinaires, et de 866,204,997 en tout, avec la construction des chemins de fer et, pour la première fois, en absorbant le compte de rachat du servage..., enfin, depuis 1866, les dépenses de la Russie ont juste doublé.
« Combien les États-Unis n'ont-ils pas mis de temps à sortir des limites du programme de leurs fondateurs ! Ils ne dépensaient que 12,273,377 dollars en 1800-1801, que 13,592,605 en 1810-1811, que 48,470,104 en 1840-1841, que 85,387,313 encore en 1860-1861, et c'était déjà le double en dix ans. La guerre de la sécession a tout changé; en 1861-1862, la dépense est de 565,667,564 dollars; en 1865, elle dépasse 1,906 millions de dollars, plus que tout ce que la république a levé et employé d'argent depuis son origine. En 1883-1884, les dépenses sont retombées à 244,123,000 dollars (trois fois plus que dans l'année qui a précédé la guerre, cinq fois plus qu'en 1840-1841).
« La luxuriance des dépenses a été un fait universel depuis quinze ou vingt ans. En 1880, on avait déjà calculé que le budget européen, en quatorze ans, de 1865 à 1879, s'était élevé d'une dépense de 9,965 millions à une dépense de 14,641 millions, et d'après un autre calcul, qui ne tenait compte que des grands États, que de 1867-1868 à 1877-1878, eu iix ans, la différence était de 9,361 millions à 14,146 millions. Arrondissons les chiffres et mettons 10 et 15 milliards; c'est 50 p. 100 et 5 milliards de plus.
« Les deux tiers de cette augmentation sont des dépenses militaires et des charges de dettes contractées pour la guerre, soit que les peuples y aient pris part directement, soit qu'ils aient dû craindre d'y être entraînés.
« Malgré la multiplication générale des impôts, les recettes n'ont pu suffire aux dépenses, et les dettes des seuls États Européens, contractées en presque totalité [188] depuis un siècle, s'élèvent actuellement à 110 milliards de francs [18] . »
[189]
Cette statistique suggère des observations de diverses sortes. Elle atteste : 1° que les formes de gouvernement peuvent être considérées comme n'ayant aucune influence appréciable sur l'accroissement des dépenses publiques, autrement dit sur le prix des services des gouvernements. On peut ajouter qu'elles n'influent pas davantage sur la qualité de ces services. Si le despotisme moscovite ou turc ne fournit que de faibles garanties à la propriété et à la liberté des consommateurs politiques, le républicanisme constitutionnel ou dictatorial de certains États de l'Amérique du sud en offre-t-il de plus fortes? 2° Que cependant la mobilité de la gestion des affaires publiques a pour effet d'augmenter le prix des services des gouvernements et d'en détériorer la qualité, que ce prix s'élève et cette qualité s'abaisse d'autant plus vite que les changements dans la gestion politique sont plus fréquents ; 3° qu'en dépit de tous lés efforts qui ont été faits pour enrayer le développement des dépenses et des dettes publiques, soit par des réformes, soit par des révolutions ayant pour programme invariable la diminution des charges de la nation, au moyen de l'extension du suffrage ou du changement de la forme du gouvernement, les dépenses elles dettes des États civilisés ont cru dans une progression plus rapide que le nombre et les ressources des [190] consommateurs politiques qui y pourvoient; que celle inégalité des deux progressions va s'accentuant de plus en plus, enfin que le cours naturel des choses doit la précipiter, le fardeau croissant des dépenses publiques et la multiplication des impôts qu'il nécessite ayant pour effet de ralentir le mouvement ascensionnel de la puissance productive des nations.
D'où cette conclusion finale que les nations civilisées seront contraintes, par une nécessité de jour en jour plus pressante, de transformer l'État, devenu un monopole et un instrument d'exploitation abusive entre les mains de ceux qui le possèdent, en abolissant la « servitude politique ».
Mais est-il possible d'abolir la servitude politique ? peut-on concevoir l'existence d'un État qui n'imposerait point ses services .avec l'obligation d'en acquitter le prix, à la population vivant dans les limites du territoire soumis à sa domination? Voilà ce qu'il nous reste à examiner.
Achevons toutefois auparavant d'étudier l'état des choses et des esprits sous le régime en décadence de la concurrence politique.
[191]
CHAPITRE VIII.
COMMENT LES CLASSES GOUVERNANTES MAINTIENNENT LEUR PRÉPONDÉRANCE. LES IMPOTS INDIRECTS. LE PATRIOTISME ET L'ENSEIGNEMENT OFFICIEL.↩
Dans toutes les branches de l'activité humaine, qu'il s'agisse des services publics ou des industries privées, il y a un antagonisme naturel entre les producteurs et les consommateurs. Les producteurs s'efforcent d'augmenter les prix de leurs produits ou de leurs services et d'en abaisser la qualité, en vue d'élever leurs profits, c'est-à-dire, en dernière analyse, d'accroître leurs jouissances et d'économiser leur peine. La concurrence seule oppose un contrepoids efficace à cette tendance. Quand elle est libre et ne rencontre point d'obstacles naturels ou artificiels elle agit avec une force d'impulsion progressive pour réduire le prix des produits et des services au taux nécessaire, soit au taux qui couvre exactement, ni plus ni moins, les frais qu'il a fallu faire pour les créer. Quand la concurrence est absente ou insuffisante, les consommateurs se trouvent à la merci des producteurs et ceux-ci peuvent les exploiter d'autant plus qu'ils leur fournissent un produit ou un [192] service plus nécessaire. Lorsque l'oppression et l'exploitation sont devenues intolérables, les consommateurs se soulèvent et ils s'efforcent de s'emparer du monopole dont ils sont victimes ou d'en limiter la puissance. Mais on ne détruit pas les monopoles en s'en emparant et l'expérience a montré l'insuffisance de tous les procédés qui ont été inventés pour les limiter, et suppléer ainsi à l'action naturelle de la concurrence.
Tel est le cas de l'industrie de première nécessité qui procure aux hommes la sécurité, depuis que le frein de la concurrence politique s'est irrémédiablement affaibli. Les consommateurs de sécurité sont livrés à la merci des producteurs, en dépit de tous les freins: artificiels qui ont été inventés et mis en oeuvre pour les préserver de l'oppression et de l'exploitation politiques. La lutte entre ces deux catégories d'intérêts — ceux des classes gouvernantes et ceux des classes gouvernées — se poursuit avec une intensité croissante et elle a engendré un état des choses et des esprits intéressant à observer.
La tendance naturelle de la classe qui lire ses moyens d'existence des fonctions gouvernantes et des industries monopolisées ou privilégiées grâce à l'appui particulier que les gouvernements leur accordent contre la concurrence indigène ou étrangère, c'est d'étendre son débouché à l'intérieur et à l'extérieur, à l'intérieur, par l'augmentation des attributions du gouvernement et le renforcement du régime protecteur, à l'extérieur par l'agrandissement du territoire de l'État, au moyen de l’annexion de provinces avoisinantes ou de la fondation de [193] colonies. Mais à mesure que les armées civiles et militaires croissent en nombre, il faut aussi que les gouvernants exigent des gouvernés une somme de ressources plus considérable. Ces ressources, c'est l'impôt qui les fournit pour la plus grande part, les revenus des propriétés de l'État étant généralement insignifiants. Si l'accroissement des dépenses des gouvernements ne dépassait pas celui des ressources de la masse gouvernée, les impôts anciennement établis pourraient suffire; mais il n'en est pas ainsi. Malgré les merveilleux progrès de la machinerie industrielle, les dépenses publiques s'accroissent partout d'un mouvement plus rapide que les revenus privés. Il faut donc prélever par l'impôt une portion plus forte de ces revenus et, par conséquent, tantôt élever le taux des impôts existants, tantôt en augmenter le nombre, tout en évitant autant que possible de provoquer le mécontentement et les résistances des contribuables. Tel est l'objet essentiel que se propose la science des finances. Cet objet a été atteint par la multiplication des impôts indirects qui se confondent avec le prix des choses et qui sont acquittés par le contribuable au moment où il paye ses articles de consommation sans qu'il se doute qu'il les acquitte. Sous l'ancien régime, à l'époque où la science des finances et l'art des financiers étaient encore dans l'enfance, les impôts étaient pour la plupart perçus directement en travail (la corvée), en nature (la dîme), ou en argent. Levés par des procédés grossiers, ils excitaient les plaintes amères et trop souvent légitimes des contribuables, qui pouvaient se rendre un compte à peu près [194] exact de ce qu'ils payaient au fisc. Les impôts indirects ne formaient alors qu'un faible appoint des ressources du gouvernement. Aujourd'hui, sous l'influence combinée des progrès de la fiscalité et de l'accroissement de la richesse qui a développé toutes les consommations, la situation a complètement changé. Les impôts directs dont le contribuable porte le montant chez le percepteur et dont il connaît le chiffre ne forment plus que la fraction la plus faible de la totalité des sommes que le mécanisme perfectionné de la fiscalité au service des gouvernements et de leurs protégés, enlève aux gouvernés. En France, ce serait un quart environ si l'on ne comptait que les impôts perçus au profit du gouvernemental. [19] Mais aux impôts indirects dont le montant va [195] dans les caisses du Trésor, il faut ajouter ceux qui sont prélevés au profit des industries monopolisées, privilégiées ou protégées, la Banque de France, les compagnies de chemins de fer, les entrepreneurs d'industries protégées par le tarif des douanes. Or si l'on peut [196] calculer d'une manière approximative, la portion de leurs revenus que les impôts indirects enlèvent aux contribuables au profit du Trésor public, il est presque impossible de se rendre compte de celle que les monopoles, les privilèges et les protections accordés et garantis par l'État leur soustrayent au profit des particuliers. Mais les impôts qu'on ne voit pas et dont l'existence même est ignorée le plus souvent par ceux qui les payent n'en sont pas moins sentis ; ils renchérissent d'autant l'existence et exigent de la multitude un supplément de travail quotidien. De là, le phénomène de l'augmentation de la durée de la journée de travail, à une époque où les progrès de l'industrie agissent constamment pour diminuer la somme d'efforts nécessaire à l'acquisition des éléments du bien-être. Ce phénomène serait inexplicable si la pompe aspirante de l'impôt n'enlevait point à la multitude au delà de l'excédent de moyens de jouissance que lui procurent les progrès de la production.
Si l'on songe cependant combien la classe qui vit directement ou indirectement de l'exploitation politique est peu nombreuse relativement à la masse de la population, on pourra se demander comment elle parvient à maintenir sa domination et à imposer à la multitude des sacrifices hors de toute proportion avec la valeur réelle des services qu'elle lui rend ; comment, à une époque où le monde civilisé n'a plus rien à craindre des barbares, où il déborde de toutes parts sur le domaine de la barbarie, la classe gouvernante a réussi à imposer aux populations laborieuses et paisibles, les frais croissants d'un appareil militaire plus vaste et plus [197] coûteux que ne l'était jadis celui des nations les plus exposées aux invasions barbares.
Ce phénomène peut être ramené à deux causes principales : l'exploitation du patriotisme et l'accaparement de l'éducation par l'Etat.
L'amour de la patrie est un sentiment naturel et l'un des plus forts qui existent dans le coeur de l'homme. Il attache l'individu au sol où il est né, à la société dans laquelle il a vécu depuis son enfance et à laquelle le lie la communauté du langage, la manière d'être et de vivre. C'est une sorte de parenté agrandie et, à l'époque où la guerre était universelle et permanente, c'était une sorte de fraternité, resserrée par la communauté du danger. Ce sentiment, les politiciens modernes l'ont exploité au profit de leur domination, et en l'exploitant ils l'ont faussé, exagéré et dénaturé. Le patriotisme signifie, à leurs yeux, la haine de l'étranger, et il se fonde sur cet aphorisme suranné, qu'une nation ne peut prospérer et grandir qu'aux dépens des autres. Leur politique consiste à réveiller les haines nationales et à persuader aux nations qu'elles sont perpétuellement en danger d'être humiliées, insultées, envahies et pillées par leurs rivales, qu'il est par conséquent indispensable qu'elles entretiennent un appareil militaire de plus en plus formidable pour défendre l'honneur et l'intérêt national. Dans ces derniers temps surtout, ils ont activement travaillé à fomenter les antipathies de race et ils ont provoqué ce qu'on est convenu d'appeler le « réveil des nationalités » par un redoublement d'oppression et de vexations motivées par la nécessité « d'unifier » [198] les populations soumises à leur domination. Tandis que, dans les industries de concurrence, les producteurs sont obligés d'accommoder leurs produits et leurs services aux besoins et aux goûts de consommateurs, les gouvernements modernes, débarrassés du frein de la concurrence politique, obligent les gouvernés à accepter leurs services, tels qu'il leur plaît de les rendre. Chacun d'eux impose indistinctement à tous ses « sujets » — et on se fait gloire de ce progrès à rebours — des lois et une langue uniformes, sans se soucier de savoir si ces lois sont adaptées à leurs moeurs et s'ils comprennent la langue dans laquelle on les juge, on les administre et on prétend les instruire. Les gouvernements « unificateurs » rendent ainsi leur domination odieuse et insupportable aux populations d'origine différente de la leur. Qu'arrive-t-il alors? c'est qu'au sein de ces populations opprimées et vexées, des esprits généreux auxquels se joignent des ambitieux qui aspirent à des situations politiques que leur interdit l'esprit de monopole de la classe dominante, s'efforcent de reconstituer leur nationalité en lui donnant un gouvernement autonome. Parfois ils échouent dans leur entreprise comme en Pologne; parfois ils réussissent comme en Hongrie. Mais, chose digne de remarque, ces apôtres et ces régénérateurs de nationalités ne manquent jamais, quand ils sont arrivés à leurs fins, d'opprimer et de vexer les nationalités assujetties à la leur.
L'accaparement de l'éducation par l'État et ses subdivisions provinciales et communales prépare et facilite [199] l'exploitation du patriotisme. L'intérêt du consommateur, les avantages que l'enfant ou l'adolescent peut tirer de l'éducation dans la pratique de la vie ne sont pour les gouvernements éducateurs qu'un objet secondaire. L'intérêt de l'État ou ce que les exploitants de l'éducation publique croient être son intérêt, est leur objectif principal, sinon unique. On s'applique à donner avant tout à l'éducation un caractère national; on développe chez l'enfant un sentiment de vanité collective qui imprime dans son esprit la conviction de la supériorité incommensurable du peuple dont il fait partie; on lui montre les nations étrangères animées de sentiments de jalousie et de haine à l'égard de ce peuple d'élite et perpétuellement préoccupées de lui nuire. De leur histoire, on ne lui apprend guère que la partie qui concerne les démêlés de leur État politique avec l'État national. Leurs moeurs, leur littérature, les services , qu'elles ont rendus à la civilisation, demeurent pour lui lettres closes. Au lieu d'enseigner à l'enfant les langues vivantes qui le mettraient en communication avec les autres membres de la grande famille humaine, on voue à la stérilité ses années les plus fécondes, en le contraignant à étudier, je ne dis pas à apprendre, deux langues mortes qui ne peuvent lui être d'aucune utilité et dont l'étude lui inspire même une répugnance instinctive, car il pressent qu'elles ne lui serviront à rien. On le plonge ainsi dans des sociétés mortes comme leurs langues, on en fait un citoyen d'Athènes ou de Rome sans l'avoir averti que l'état du monde a changé, que les nécessités auxquelles obéissaient les sociétés mortes [200] n'ont plus rien de commun avec celles qui s'imposent aux sociétés vivantes; que notre grande affaire n'est plus de nous défendre contre des barbares qui ont cessé de nous assaillir, de les détruire ou de les asservir pour n'être pas détruits ou asservis par eux ; que l'étranger n'est plus un ennemi naturel, mais un client avec lequel nous sommes intéressés à entretenir des relations d'affaires et d'amitié, et dont la fortune bonne ou mauvaise est liée à la nôtre. La génération qui a reçu cette éducation rétrograde, superficielle et fausse, se distribue dans toutes les carrières que l'extinction successive de la génération précédente laisse vacantes. Celles-ci se partagent en deux branches : les fonctions publiques, politiques, militaires ou administratives, et les emplois privés de l'agriculture, de l'industrie, du commerce et des arts. Les jeunes gens qui entrent dans les fonctions publiques avec les idées et les sentiments qu'ils ont puisés et nourris dans l'éducation dite classique, sont parfaitement préparés à continuer les traditions d'un passé suranné. Ils considèrent les consommateurs des services publics comme un troupeau dont ils sont les pasteurs et dont la destination naturelle est de pourvoir à leur subsistance. Parmi les carrières privées, un certain nombre sont liées à l'Etat par les subventions, les monopoles et les protections qu'il leur accorde, et l'esprit qui y règne se rattache, sous l'influence de la communauté des intérêts, à celui qui domine dans la classe investie des fonctions publiques. Dans les carrières libres qu'il ne faut pas confondre avec les carrières dites libérales, les intérêts qui gouvernent les opinions [201] diffèrent, sans doute, de ceux des carrières publiques ou privilégiées, et on devrait croire que l'esprit qui y prévaut est mieux en harmonie avec les conditions actuelles d'existence des sociétés civilisées; que l'obligation onéreuse de pourvoir aux frais alourdis du gouvernement y a créé une opinion hostile à l'augmentation des charges publiques, à l'accroissement des dépenses de l'État, à l'extension du régime des monopoles, des privilèges et des protections qui s'exercent aux dépens des industries et des professions libres ; hostile aussi à la politique d'antagonisme international qui maintient les États civilisés sur un pied de guerre ou de paix armée de plus en plus dispendieux. Cependant il n'en est rien, et il est facile de s'expliquer pourquoi.
Il faut remarquer d'abord que les fonctions publiques et les carrières privilégiées attirent de préférence l'élite intellectuelle de chaque génération et que la masse vouée aux fonctions réputées inférieures ne reçoit qu'une instruction incomplète et subalterne; ensuite que les loisirs sont rares dans les carrières libres qui alimentent le budget, tandis qu'ils abondent dans les fonctions et les industries qui y émargent; enfin, que les hommes qui arrivent à la fortune dans une carrière libre mais considérée comme subalterne, éprouvent généralement le besoin de se hausser dans leur estime et dans celle de leurs proches, en jouant un rôle officiel ou en obtenant une distinction honorifique et en se rattachant ainsi à la classe gouvernante. Voilà comment on s'explique que cette classe, malgré son infériorité numérique, impose son opinion aux autres, et voilà [202] pourquoi on n'a vu jusqu'à présent nulle part se créer parmi les consommateurs politiques un noyau résistant de défense contre la tendance naturelle des producteurs à abuser de leur monopole. Une autre cause est venue s'ajouter à celle-là pour maintenir l'ascendant de la classe gouvernante, c'est la crainte du socialisme. La multitude des gens paisibles dont les intérêts sont menacés par la future « révolution sociale » se rassemblent comme un troupeau effaré sous l'abri tutélaire de l'État, sans s'aviser davantage de rechercher ni ce que vaut cet abri ni ce qu'il coûte.
[203]
CHAPITRE IX.
LE MALAISE ET LE MÉCONTENTEMENT. LE PESSIMISME.↩
Cependant l'état de choses anormal que nous avons décrit, crée un malaise dont souffrent toutes les classes de la société, à l'exception d'un petit nombre de privilégiés. Quoique l'accroissement des charges publiques demeure le plus souvent ignoré de la multitude, quoique nul ne sache et ne puisse savoir au juste ce qu'il paye à l'État et à ses protégés, ces charges n'en sont pas moins senties ; elles rendent l'existence du grand nombre plus coûteuse, tandis que les guerres, les changements dans l'assiette des impôts et les tarifs des douanes, s'ajoutant aux causes de perturbation naturelles, la rendent plus précaire. De là l'affluence extraordinaire qui se porte vers les emplois publics demeurés relativement stables au milieu de l'instabilité universelle. Cependant, malgré l'accroissement progressif de leur nombre, les emplois publics ne peuvent servir de port de refuge qu'à la moindre fraction de ceux qui les sollicitent. D'ailleurs, en les multipliant, il a bien fallu les rendre moins lucratifs, sous peine d'excéder les ressources possibles du budget. La généralité des emplois [204] publics ne fournit que des appointements modestes qui sont loin de répondre aux besoins et aux aspirations des employés. Même dans cette classe privilégiée, où chacun aspire à entrer, règne la gêne matérielle et, avec elle, le malaise moral.
A plus forte raison le renchérissement de la vie et l'instabilité pire encore des moyens d'existence, ont-ils engendré, au sein dé la multitude qui n'a point de port de refuge, un mécontentement général et profond. A son tour le mécontentement a produit la maladie régnante du pessimisme.
Au début de la période révolutionnaire qui s'est ouverte à la fin du siècle dernier, les esprits avaient une confiance illimitée dans l'efficacité souveraine des institutions politiques et dans l'aptitude de ceux qui étaient appelés à les façonner. On était généralement convaincu que les constitutions et les lois avaient le pouvoir de remédier à tous les maux de la société. D'un autre côté, on n'était pas éloigné de croire que l'investiture populaire, comme autrefois la descente du Saint-Esprit, conférait aux législateurs une sorte de sagesse mystique qui les rendait infaillibles. L'expérience ne manqua pas de faire justice de ces illusions naïves. On eut beau changer les constitutions et multiplier les lois, la condition de la multitude ne s'en trouva pas améliorée. On put constater même que les changements continuels que les constituants et les législateurs apportaient à la machinerie du gouvernement n'en modifiaient point, d'une manière appréciable, le fonctionnement ; d'où cet aphorisme populaire : plus ça change, plus c'est la [205] même chose ! La république eut beau succéder en France à la monarchie légitime, l'empire à la république, la monarchie constitutionnelle à l'empire, etc., l'administration des services publics conserva sous tous les régimes les mêmes habitudes autoritaires et routinières ; les frais de gouvernement seuls allèrent progressant, et, avec eux, renchérissement et l'instabilité de l'existence. Alors une réaction s'opéra dans les esprits. En présence de l'impuissance de l'instrument de progrès dans lequel on avait mis toute sa confiance, on désespéra du progrès et on s'abandonna au pessimisme. Telle est la tendance qui domine particulièrement chez les esprits cultivés auxquels l'éducation classique qu'ils ont reçue n'a fourni aucune notion des lois naturelles, qui gouvernent bien plus que les constitutions et les lois artificielles, l'existence et le développement des sociétés. Convaincus qu'aucun progrès n'est possible et que les sociétés sont condamnées à rouler à perpétuité le rocher de Sisyphe de la misère, ils maudissent le présent, désespèrent de l'avenir et sont d'avis que la seule solution raisonnable du problème social consiste à mettre fin à l'existence de la malheureuse humanité, sauf toutefois, en attendant, à jouir confortablement de la vie.
[206]
CHAPITRE X.
LE PROTECTIONNISME.↩
Si les pessimistes désespèrent de l'avenir parce qu'à leurs yeux le progrès ne peut venir que des gouvernements, et que l'impuissance des gouvernements à le produire est aujourd'hui manifeste, en dépit de tous les perfectionnements que les constitutions et les lois organiques ou autres ont apportés à la machinerie politique, les protectionnistes et les socialistes n'ont pas cessé de croire à la toute-puissance bienfaisante de l'État, les uns pour protéger et faire fleurir leurs intérêts particuliers, les autres pour refaire et régénérer la société tout entière.
Quelle est l'origine du protectionnisme et quel est son but?
L'origine du protectionnisme est dans l'état de guerre. A l'époque où la guerre était permanente et universelle, où les communications de peuple à peuple étaient difficiles et rares, le commerce ne dépassait que par exception les frontières politiques de État; le trafic avec l'étranger ne comprenait d'ordinaire qu'un petit nombre d'articles de luxe servant à la [207] consommation des classes supérieures. Quand, après quelque courte trêve, la guerre survenait, interrompant les communications avec le dehors, la perturbation qui en résultait dans l'industrie et les relations commerciales n'était ressentie que par le petit nombre d'individus dont le débouché se trouvait fermé ou rétréci, la masse de la population n'en était que très légèrement atteinte. Mais, à mesure que le risque de guerre a baissé, que les communications internationales sont devenues plus faciles et moins précaires, la situation a changé, le commerce a débordé davantage des frontières politiques des États, la division du travail a commencé à s'établir entre les nations, les échanges se sont multipliés en créant entre les échangistes une communauté d'intérêts et une solidarité de plus en plus vastes et étroites.
Nous n'avons pas besoin de faire ressortir les bienfaits de ce progrès; mais, comme il arrive pour tout progrès, ces bienfaits ne sont pas sans mélange de maux. La mise en communication de pays où l'industrie est inégalement développée et où les charges qui pèsent sur la production sont inégales, entraîne la ruine des industries arriérées, mal situées ou surchargées. C'est un mal inévitable comme celui qui résulte de l'introduction d'une machine ou d'un procédé perfectionné. A l'époque où les métiers mécaniques ont commencé à remplacer les métiers à la main, les propriétaires de filatures et de tissages et leurs ouvriers se trouvaient exposés les uns à perdre la valeur de ce matériel devenu suranné, les autres celle des [208] aptitudes et de l'expérience qu'ils employaient à sa mise en oeuvre.
Si les industriels menacés par la concurrencé des nouveaux métiers avaient eu le pouvoir d'en interdire l'emploi, ils n'auraient pas manqué d'en user. Quant aux ouvriers, ils n'hésitaient pas, lorsqu'ils pouvaient le faire impunément, à briser les machines qui leur enlevaient leurs moyens d'existence. Mais à défaut du pouvoir d'interdire les métiers mécaniques, les industriels, gens influents pour la plupart, possédaient celui d'empêcher l'introduction des produits étrangers fabriqués au moyen de ce matériel perfectionné. Il leur suffisait pour cela de mettre en oeuvre le puissant mécanisme de l'État, en faisant prohiber ou surtaxer dans toute l'étendue des territoires soumis à sa domination l'importation de ces produits. Sans remonter plus haut, telle a été la cause déterminante du mouvement protectionniste qui s'est manifesté sur le continent européen à l'issue des guerres de la république et de l'empire. Entrée la première dans la voie de la grande industrie, l'Angleterre y avait devancé toutes les autres nations. Lorsque l'état de guerre et de blocus eut cessé d'entraver l'importation de ses produits manufacturés à bon marché; les industriels arriérés du continent qui avaient continué à se servir des vieux métiers, s'empressèrent d'employer leur influence politique à faire interdire une concurrence contre laquelle ils se déclaraient hors d'état de lutter. Toutefois, ils se bornaient généralement à réclamer une protection temporaire, dont l'échéance devait expirer à l'époque où ils seraient [209] parvenus à maUre leur outillage au niveau de celui de leurs concurrents. Est-il nécessaire d'ajouter que cette échéance ne devait jamais arriver? Après avoir invoqué en faveur de l'interdiction de la concurrence étrangère l'état arriéré de leur outillage, ils ont mis en avant d'autres inégalités réelles ou prétendues, et, en particulier, celles qui résultent de la différence de l'assiette et du montant des impôts d'un pays à un autre; ils ont réclamé dés (« droits compensateurs » de cette différence. Ils ont invoqué encore la nécessité de préserver le marché intérieur des crises industrielles et commerciales; enfin, quand il s'agit d'articles indispensables à la vie de la population ou à la défense du pays, la nécessité d'être indépendant de l'étranger.
C'est contre l'Angleterre manufacturière que le mouvement protectionniste était dirigé au commencement du siècle ; c'est, à la fin de ce même siècle, contre l'Amérique agricole que nous l'avons vu renaître, sous l'empire de circonstances analogues. L'application de la vapeur à la navigation transocéanique et la multiplication des moyens de transport rapides et à bon marché dans le nouveau monde ont réduit des neuf dixièmes au moins la distance qui séparait l'Europe du far west américain et permis à une multitude croissante d'émigrants d'aller mettre en culture cet immense domaine agricole. Ayant la terre à vil prix et employant une machinerie agricole perfectionnée, ils ont pu produire avec une réduction de frais notable, le blé et la viande. Menacés dans leurs rentes et leurs profits par cette invasion de substances alimentaires à [210] bon marché, les propriétaires et les cultivateurs routiniers de notre vieille Europe ont réclamé à grands cris et en se servant des mêmes arguments que les industriels invoquaient naguère contre l'industrie britannique la protection de l'État contre l'agriculture américaine.
Mais ce qui a contribué plus qu'aucun argument à propager le système protectionniste dans tous les pays où les chefs d'industrie et les propriétaires fonciers possèdent une large .influence politique, ce sont les profits extraordinaires et immédiats quoique temporaires qu'il est dans sa nature de leur procurer. Quand un droit de douane vient à être établi ou augmenté, que se passe-t-il? Le prix du produit étranger qui est ainsi frappé se trouve exhaussé de tout le montant du droit. Si ce droit est prohibitif, le produit étranger ne peut plus entrer ou n'entre plus, qu'en; quantités insignifiantes. Alors les producteurs indigènes, maîtres du marché, réalisent des profits exceptionnels. En admettant même que leurs frais de production soient plus élevés de 10 p. 100, par exemple, que ceux de leurs concurrents étrangers, une protection de 50 p. 100 leur procure encore une prime de 40 p. 100, en sus des profits ordinaires de l'industrie. Grâce à cette prime dont les consommateurs font les frais, ils peuvent réaliser des fortunes rapides et colossales. Mais une industrie qui procure un profit extraordinaire de -40 p. 100, ne manque pas d'attirer l'esprit d'entreprise et les capitaux. Ils abandonnent tous les autres emplois pour se porter vers l'Eldorado que la protection leur a ouvert, [211] et ils finissent par s'y porter avec excès. Un moment arrive où l'afflux de la concurrence intérieure déterminé une surproduction et une crise. La surproduction amène la baisse des prix, — et n'oublions pas que l'accroissement en progression arithmétique des quantités offertes détermine la chute en progression géométrique des valeurs, — et la baisse des prix, à son tour, fait tomber par cascades successives, les profits au-dessous du taux ordinaire et nécessaire. L'abaissement excessif des profits provoque la faillite et la disparition des entreprises surabondantes; l'offre se remet en équilibre avec la demande, mais à un niveau plus élevé que celui des pays de libre-échange. Cette différence de niveau est particulièrement forte et durable dans les pays où le système protectionniste est appliqué à la production des denrées alimentaires. Parmi les agents de la production agricole, il en est un, la terre, dont la quantité est limitée dans chaque pays. Si les subsistances produites à l'intérieur ne suffisent pas pour nourrir la population et qu'il faille en importer du dehors, le prix de toute la quantité offerte au marché, quelle qu'en soit la provenance, s'augmentera de tout le montant du droit protecteur. Si la consommation demande 100 millions d'hectolitres de blé et si le droit est de 3 francs par hectolitre, ce sera un impôt de 300 millions prélevé sur la généralité des consommateurs. Cet impôt perçu au profit des propriétaires du sol s'ajoutera aux impôts de l'État et il aura, comme ceux-ci, pour effet d'augmenter les frais de production de toutes les industries. De plus, le renchérissement [212] artificiel déterminé par la protection sera permanent du moins jusqu'à ce que la population diminuée et appauvrie ait réduit sa demande de manière à l'abaisser au-dessous de l'offre de la production intérieure.
A l'époque où l'état de guerre et l'insuffisance des' moyens de communication empêchaient le développement des relations commerciales avec, le dehors, les effets nuisibles du renchérissement provoqué par la protection n'avaient qu'une importance secondaire. On pouvait se demander même s'il ne valait pas mieux s'abstenir de nouer des relations qui pouvaient être, d'un moment à l'autre, interrompues, au grand dommage du petit nombre de ceux qui en tiraient leurs moyens d'existence. Mais l'affaiblissement du risque de guerre, et, depuis un demi-siècle, le progrès extraordinaire des moyens de communication ont complètement changé cette situation. Malgré les obstacles que lui opposent les tarifs de douanes, le commerce international a pris un essor inattendu et prodigieux. En France, notamment, les exportations qui ne dépassaient pas 510 millions en1834 ont atteint de 3,524 millions en 1884; elles ont septuplé en cinquante ans, et, dans la plupart des autres pays civilisés les échanges avec le dehors se sont accrus dans une progression analogue. Qu'en résulte-t-il ? c'est qu'une portion de plus en plus considérable de la population des Etats civilisés lire ses moyens d'existence du débouché qu'elle trouve au delà des frontières politiques dans lesquelles elle est enfermée. En France, cette proportion est actuellement d'un dixième environ ; ce qui veut dire que 3 à 4 [213] millions de Français dépendent absolument des consommateurs étrangers pour leurs moyens d'existence, tandis qu'il y a dans le reste du globe, un nombre à peu près pareil de producteurs, capitalistes et ouvriers, qui dépendent des Consommateurs français. Mais le système protecteur ne peut protéger les producteurs nationaux qu'à l'intérieur des frontières de l'État. Au dehors, il se retourne contre eux, en exhaussant artificiellement leurs prix de revient. Il faudra donc que les nations civilisées finissent par abandonner la protection, à moins de renoncer au commerce extérieur. En attendant, celles qui s'obstineront à la conserver perdront successivement du terrain sur les marchés de concurrence, et ce recul entraînera la suppression des moyens d'existence d'une partie de leur population et l'appauvrissement du reste [20] .
En vain on invoquerait en faveur du système protecteur la nécessité de compenser l'inégalité des conditions de la production et, en particulier, des charges de l'impôt d'un pays à un autre. Il n'est pas au pouvoir de la protection d'opérer cette compensation. Tout ce qu'elle peut faire, c'est de déplacer le poids des impôts. Si elle protège l'agriculture, ce sera aux dépens de l'industrie dont elle augmentera les prix de revient, et vice versa. Or, toute augmentation d'un prix de revient aboutit nécessairement à une hausse du prix courant. Celle-ci a pour effet inévitable de provoquer la diminution de la consommation du produit à l'intérieur et son [214] exclusion partielle ou totale des marchés de concurrence. D'où une diminution correspondante de la production et la perte des moyens d'existence de ceux qui en vivent.
La protection est-elle, en revanche, un remède contre les crises? Elle contribue, au contraire, à les provoquer ou à les aggraver en ajoutant aux autres causes accidentelles de perturbation, telles que l'inégalité des récoltes, une cause à peu près permanente dov trouble. Chaque fois qu'un gouvernement modifie dans un sens ou dans un autre son tarif des douanes, il occasionne une perturbation qui va se répercutant de proche en proche dans tout le vaste marché de la production et de la consommation. S'il élève le tarif des tissus de coton, il privera de leur travail et de leurs moyens d'existence accoutumés, les industriels et les ouvriers étrangers qui approvisionnent le marché national, tandis qu'il obligera par l'augmentation du prix des tissus, les consommateurs à consacrer une fraction plus forte de leurs revenus à l'achat de leurs vêtements. Toutes les industries de gros ou de détail et toutes les professions qui approvisionnent à l'étranger là fabrication des tissus, personnel et matériel, seront atteintes, et, par contre-coup, toutes celles qui en dépendent. Il en sera de même des industries et professions qui pourvoient aux autres besoins des consommateurs; nationaux, obligés de dépenser davantage pour se vêtir. A la vérité, la production des tissus se développera dans le pays en même temps qu'elle diminuera à l'étranger; mais aussi longtemps qu'elle sera plus chère que ne [215] l'était l'industrie exclue du marché, la consommation se trouvera amoindrie et, avec elle, la production générale des tissus et la somme des moyens d'existence qu'elle procure.
Au moins, le système protecteur a-t-il la vertu d'empêcher les crises suscitées par les retours offensifs de l'état de guerre? Il en serait ainsi peut-être s'il avait réussi à arrêter le développement du commerce international. Mais les lois naturelles de l'économie des forces et de la concurrence ont agi pour étendre, en dépit de tous les obstacles, là sphère des relations commerciales. Toutes les nations civilisées sont unies aujourd'hui par les liens multiples, croisés et enchevêtrés, de l'échange, et chaque jour les milles du réseau des intérêts internationaux se resserrent davantage. Par conséquent chaque jour aussi, l'interruption des relations commerciales provoquée par la guerre détermine, dans toute l'étendue du vaste marché du monde, une crise plus grave, et qui atteint dans leurs moyens d'existence un plus grand nombre de créatures humaines.
Enfin la plupart des nations industrielles demandent actuellement en dehors de leurs frontières politiques une portion notable de leurs subsistances : (en France, c'est le dixième; en Angleterre, c'est le tiers), et se trouvent ainsi sous la dépendance de l'étranger pour les premières nécessités de la vie.
Le système protecteur est donc, à tous égards, suranné et nuisible. Ce serait cependant une illusion de croire que les nations mieux éclairées sur leurs vrais [216] intérêts abandonneront prochainement ce système. En ce moment par exemple nous assistons à une recrudescence de protectionnisme. Nous voyons se relever partout les barrières qui empêchent le développement du commerce international, pendant que la multiplication et le perfectionnement des moyens de communication agissent pour le faciliter. On s'est étonné devoir se produire en même temps ces deux phénomènes contradictoires. Mais c'est précisément parce que le progrès des moyens de communication rend le marché national plus accessible que les industries qui possédaient auparavant le monopole de ce marché emploient leur influence politique à faire remplacer par des obstacles artificiels les obstacles naturels qui les protégeaient contre la concurrence étrangère.
Aussi longtemps que l'exhaussement d'un tarif de douane pourra procurer des bénéfices exceptionnels aux industriels protégés, ils se serviront de là puissance de l'État pour l'imposer aux consommateurs. Sans doute des protestations continueront de s'élever au nom de l'intérêt général, mais l'expérience nous apprend que les intérêts particuliers, surtout quand ils sont excités par l'appât d'un bénéfice extraordinaire, sont autrement actifs et remuants que l'intérêt général. Le système protecteur ne disparaîtra, selon toute apparence, que lorsque l'Etat lui-même aura perdu le pouvoir de l'imposer.
En définitive, il n'est pas au pouvoir de l'Etat d'enrichir une nation par un système quelconque de protection. Il ne peut pas augmenter la richesse générale [217] en protégeant des intérêts particuliers. Il peut seulement la déplacer en la diminuant. Il peut faire rapidement la fortune d'un petit nombre d'industriels, de propriétaires et de capitalistes aux dépens de la multitude, mais en augmentant les frais de la production, le prix et l'instabilité de la vie et en préparant la décadence de la nation, engagée désormais, qu'elle le veuille ou non, dans l'engrenage de la concurrence universelle.
[218]
CHAPITRE XI.
LE SOCIALISME.↩
Le relâchement de la concurrence politique a transformé l'État en un instrument d'exploitation aux mains de ceux qui le possèdent et quelles que soient ces mains. Jusqu'à présent il est demeuré au pouvoir des classes supérieure et moyenne. Dans la plupart des pays civilisés, la classe moyenne a fini par acquérir une prépondérance décisive. C'est elle qui gouverne. Comme l'avaient fait ses devancières, la noblesse elle clergé, dès l'époque où leurs appétits avaient cessé d'être contenus par la permanence de l'état de guerre, et dans une plus forte mesure encore, car elle a un plus grand nombre de bouches à nourrir, la classe moyenne s'est servi de l'appareil à légiférer et à taxer pour augmenter les attributions de l'Étal et multiplier les emplois civils et militaires, elle a créé des monopoles à son usage et généralisé le protectionnisme, le tout en vue d'augmenter les jouissances de ses membres et de diminuer leur travail et leur peine. Ce but a-t-il été atteint? Oui, sans doute, si l'on compare la situation de la classe gouvernante, au profit de laquelle fonctionne l'appareil [219] d'exploitation et de protection de l'État, à celui de la multitude gouvernée qui fait les frais de cet appareil; non, si l'on suppose la nation débarrassée du fardeau du monopole de l'État et les classes supérieures maîtresses de déployer librement leur activité. Dans cette hypothèse, leur condition générale serait certainement préférable à ce qu'elle est actuellement, et elle serait surtout moins précaire. La classe moyenne, après avoir dépossédé et dépouillé la noblesse et le clergé, ne courrait pas le risque d'être dépossédée et dépouillée à son Jour par la classe ouvrière.
Cependant, c'est une opinion enracinée dans cette classe qu'elle est redevable de sa suprématie actuelle à la possession de l'État. C'est parce qu'elle possède l'État et qu'elle a pu l'employer, d'une part à multiplier les emplois dont elle dispose^ d'une autre part à protéger son industrie qu'elle est devenue puissante et riche. Elle considère l'État comme une sorte de palladium auquel sa fortune est attachée. Mais cette opinion, elle n'est pas seule à l'avoir. Les classes inférieures en sont imbues comme elle, et elles aspirent à s'emparer de l'État parce qu'à leurs yeux comme aux siens la possession de l'État, c'est la puissance et la richesse.
En effet, si la possession et l'exploitation de l'État ont fait la fortune des classes supérieures, pourquoi ne feraient-elles pas celle de la multitude ? S'il est au pouvoir de l'État de procurer une existence facile et assurée à un nombre croissant de fonctionnaires, s'il dépend de lui de doubler ou de tripler du jour au lendemain les rentes des propriétaires et les profits, des industriels, [220] pourquoi ne pourrait-il pas, en usant de sa toute-puissance, tirer de la misère, du jour au lendemain aussi, la multitude des prolétaires? Qu'y a-l-il à faire pour opérer cette révolution bienfaisante ? Il faut simplement enlever l'État aux classes actuellement dirigeantes pour le remettre aux mains du peuple.
Tel est le point sur lequel s'accordent toutes les écoles socialistes, quelles que soient les divergences qui les séparent. Toutes veulent s'emparer de l'État pour en faire l'instrument de la régénération sociale. Comment l'État s'y prendra-t-il pour opérer la transformation de la société? Quelles lois édictera-t-il? Quelles mesures prescrira-l-il? Reprendra-t-il toutes les propriétés et toutes les industries pour les exploiter en régie ? Ou les remettra-t-il à des corporations ou à des communautés ouvrières dont la direction appartiendra aux travailleurs eux-mêmes ? Accordera-t-il, dans la distribution des produits une part au capital, ou en attribuera-t-il la totalité au travail? Les parts du travail seront-elles égales ou inégales? Sur tous ces points, les écoles socialistes diffèrent d'opinion; en revanche, elles sont pleinement d'accord sur un seul, pratiquement le plus important et même le seul important : c'est qu'il faut enlever, avant tout, l'État aux classes capitalistes. Cette révolution faite, et elles sont encore généralement d'avis qu'elle ne peut se faire que par la force, — elles ont cru pendant quelque temps qu'elle pourrait s'accomplir au moyen du suffrage universel ; mais l'expérience leur a démontré que ce procédé pacifique était sinon inefficace, du moins trop lent au gré de leur impatience,— [221] des congrès ou des conventions ouvrières se chargeront de réorganiser la production et la distribution de la richesse, en se servant de la toute-puissance de l'Etat, qu'elles auront à leur service pour imposer leurs décisions et briser toutes les résistances. Les anarchistes eux-mêmes, tout en affichant l'intention de supprimer l'Etat, veulent d'abord s'en emparer et s'en servir pour établir le communisme; mais le communisme pourrait-il se maintenir autrement que par l'intervention continue de l'État pour empêcher la renaissance des inégalités sociales, expression" des inégalités naturelles?
A le bien considérer, le socialisme n'est autre chose qu'une extension du protectionnisme, mis au service des classes inférieures. Or, si l'on songe que cette multitude l'emporte considérablement en nombre sur les classes actuellement en possession de l'État ; qu'elle reçoit à grands frais de l'État lui-même une demi-instruction qui a principalement pour objet de la pénétrer de la puissance et des mérites de l'État, que ses meneurs disposent de moyens d'action moraux et physiques dont leurs devanciers étaient privés, la presse à bon marché, la facilité des communications, la dynamite, etc., on se convaincra que la révolution sociale et l'avènement de l'État ouvrier ne sont plus qu'une affaire de temps. On peut également prédire avec une quasi certitude de quelle façon procéderont les nouvelles couches en possession de cet instrument de régénération sociale. Elles s'en serviront d'abord, à l'exemple de leurs devancières, pour confisquer à leur profit les propriétés [222] des classes qu'elles auront politiquement dépossédées ; elles organiseront ensuite d'une manière ou d'une autre l'exploitation des champs, des manufactures, des ateliers, etc., dont elles se seront emparées. Au début, cette confiscation du capital au profit du travail pourra sans aucun doute leur être profitable, comme l'est aujourd'hui aux propriétaires fonciers et aux industriels la confiscation d'une portion du revenu des consommateurs, opérée en vertu du système de la protection. Mais, de même que les profits tirés de la protection, ceux que l'application du socialisme pourra conférer seront essentiellement temporaires, ils le seront même plus encore que ceux de la protection. En effet, si l'État s'emparait de toutes les propriétés et de toutes les industries, soit pour les exploiter en régie, soit pour en remettre l'exploitation à des communautés ouvrières dans lesquelles le capital et l'intelligence seraient subordonnés au travail, les prix de revient de tous les produits et services ne tarderaient pas à s'élever de manière à les faire exclure du marché universel, et la ruine de la nation, qui est la conséquence inévitable mais lointaine du protectionnisme, serait la conséquence prochaine du socialisme.
Ce serait néanmoins une illusion de croire qu'on puisse empêcher par le raisonnement ou par la force la classe la plus nombreuse et la plus pauvre comme la nommait Saint-Simon, de s'emparer de l'État, et de s'en servir pour, appliquer le socialisme. Nous avons constaté tout h l'heure, et l'expérience atteste suffisamment l'inefficacité du raisonnement pour convertir [223] les propriétaires et les industriels protectionnistes. En vain essayons-nous de leur démontrer que la protection est finalement ruineuse ; qu'elle ne peut manquer d'entraîner la décadence de la nation, aussi longtemps qu'elle leur procurera un surcroît immédiat de rentes ou de profits, ils demeureront réfractaires à tous les arguments libre-échangistes. Il n'y a pas de raisonnement qui puisse prévaloir contre un intérêt, même quand il s'adresse aux classes les plus éclairées, partant, les plus accessibles à la vérité. Comment pourrait-il avoir la vertu de convertir les classes les moins éclairées? On aura beau leur dire que la puissance et la richesse, que leur vaudront la conquête de l'État et la confiscation des biens des classes capitalistes seront éphémères; qu'elles ne manqueront pas d'être suivies d'un redoublement de misère, les meneurs voudront jouir quand même des bénéfices du pouvoir, bénéfices d'autant plus enviés qu'on les convoite de plus loin et de plus bas, et la foule des pauvres ne résistera pas à la tentation de faire aux dépens des riches le carnaval révolutionnaire que prédisait Proudhon, dût-il ne durer qu'un jour. Reste la force, mais la force est bien précaire. Du moment où les habitudes séculaires de respect et de subordination hiérarchique qui continuent encore à soumettre le grand nombre au petit auront disparu (et n'est-il pas visible qu'elles sont en voie de disparaître?) la propagande socialiste, secondée par le malaise et le mécontentement croissant qu'engendre l'état actuel des choses et favorisée par les progrès que nous énumérions tout à l'heure, la propagande [224] socialiste, disons-nous, ne viendra-t-elle pas à bout des résistances de la force ?
Il n'y a qu'un moyen efficace de préserver la société du socialisme, c'est d'enlever à l'État le pouvoir de l'imposer ; autrement dit, c'est d'abolir la servitude politique.
[225]
CHAPITRE XII.
LES CONTREPOIDS ARTIFICIELS. POURQUOI LA GUERRE DEVIENT IMPOSSIBLE.↩
Le droit que possédait le souverain d'imposer ses services à tous les individus vivant sur le territoire de l'État, et de contraindre les individus assujettis à la servitude politique de se soumettre aux lois et règlements qu'il lui plaisait d'édicter, et de payer les impôts et redevances qu'il lui plaisait d'établir, ce droit dont nous avons montré la raison d'être dans le passé, était contenu par deux freins : la perpétuité de la possession de l'État et la concurrence politique, manifestée par la guerre. Aussi longtemps que ces deux freins sont demeurés intacts, les populations assujetties à la servitude politique ont été préservées autant qu'elles pouvaient l'être de l'abus de l'exploitation de l'État. La maison ou la corporation propriétaire à perpétuité de l'État était intéressée à ne point épuiser les ressources des populations ; d'un autre côté la pression continue de la concurrence politique l'obligeait, sous peine de dépossession et de ruine, à appliquer ces ressources exclusivement à la défense, à la bonne gestion et, dans [226] une mesure utile, à l'agrandissement de l'État. Chaque fois qu'un souverain manquait à ces règles essentielles de conduite, il ne tardait pas à en être puni : son État s'affaiblissait, tombait en décadence et devenait la proie d'un concurrent plus fort et plus habile dans l'art de gouverner.
Cependant, à mesure que le monde civilisé a étendu son domaine et que la guerre, devenue moins productive, n'a plus été qu'intermittente après avoir été permanente, le frein de là concurrence a cessé de contenir suffisamment l'abus du droit de légiférer et de taxer; les populations assujetties à la servitude politique ont eu à supporter une oppression et une exploitation croissantes, et elles ont cherché, avec une ardeur croissante aussi, à. s'en préserver. Les procédés auxquels elles ont eu recours dans ce but étaient de deux sortes : 1° elles se sont emparées de la souveraineté et en ont confié l'exercice à un pouvoir limité dans sa durée; 2° soit qu'elles eussent laissé subsister la souveraineté établie, soit qu'elles l'eussent remplacée par un souverain temporaire, elles ont établi tout un appareil compliqué de règles relatives à l'exercice du pouvoir de légiférer et de taxer, en spécifiant que ce pouvoir serait exercé par leurs mandataires, etc., etc. Quels ont. été les résultats de l'application de ces procédés limitatifs de la puissance du souverain? Ces résultats, nous l'avons dit, ont été généralement négatifs. En premier lieu, la limitation de la durée de la souveraineté, loin d'être une garantie de bon gouvernement, a eu pour résultat d'affaiblir l'intérêt que le souverain, investi de [227] la perpétuité de possession;, avait à ménager les forces et les ressources de ses sujets, en prévision de l'avenir. En second lieu, aucune forme de gouvernement, aucune constitution monarchique ou républicaine n'a eu la vertu d'enrayer la puissance envahissante et absorbante de l'État, dégagé de la pression continue de la concurrence politique. On a pu constater même qu'en rendant les formes de gouvernement et les constitutions plus démocratiques, en élargissant ainsi la base de l'État, on mettait davantage l'individu à sa merci. Ces échecs ont découragé les inventeurs et les théoriciens politiques; leur fécondité exubérante a diminué sensiblement depuis un demi-siècle, et l'on commence à désespérer, de découvrir un système de contre-poids artificiels qui remplace le contre-poids naturel de la concurrence politique, manifestée par la guerre.
Mais ce contre-poids naturel, ne serait-il pas possible de le rétablir dans son efficacité primitive? Si la guerre était la condition de la prospérité et de la sûreté des États, si elle rendait le progrès nécessaire sous peine de dépossession et de ruine, si elle garantissait les gouvernés contre l'oppression et l'exploitation des gouvernants, n'y aurait-il pas lieu de revenir à l'état de guerre, tel qu'il florissait dans les premières étapes de la civilisation ? Ne pourrait-on pas rendre de nouveau la guerre permanente et universelle?
Si l'on considère le développement extraordinaire que la généralité des gouvernements civilisés ont donné à leurs armements depuis la fin du siècle dernier et, en particulier, depuis cinquante ans, on sera [228] certainement d'avis que tel est bien leur but. Jamais, en effet, même aux époques où les États civilisés étaient continuellement menacés de l'invasion soudaine dès hordes barbares, leur appareil défensif et offensif n'a eu les proportions qu'il a acquises de nos jours. Non seulement tous les hommes valides sont aujourd'hui astreints au service militaire dans les États de l'Europe continentale, tandis que les classes formant la majorité de la population en étaient exemptes dans les États civilisés de l'antiquité, mais on va jusqu'à mettre des engins de guerre entre les mains des enfants ; on organise des « bataillons scolaires » qui les dressent dès l'âge le plus tendre au métier des armes. Toutes les frontières sont de plus en plus hérissées de forteresses et de camps retranchés, et c'est par centaines de millions, parfois même de milliards, que se chiffrent chaque année les dépenses consacrées à l'augmentation et au perfectionnement du matériel de guerre sur terre et sur mer. Il semblerait donc que la guerre dût bientôt redevenir ce qu'elle était aux temps barbares, l'occupation la plus noble de l'homme civilisé et l'objet permanent de l'activité des nations. Comment se fait-il cependant qu'elle ne se produise plus que d'une manière intermittente, et qu'elle soit devenue impopulaire au point, que les professeurs des sciences militaires eux-mêmes se bornent à recommander aux nations de faire une grande guerre tous les quinze ou vingt ans[21] ? A quoi tient cette contradiction flagrante? Pourquoi les nations [229] civilisés emploient-elles chaque jour une proportion plus considérable de leurs forces et de leurs ressources à développer leur appareil de guerre, et s'appliquent-elles davantage, chaque jour aussi, à reculer le moment de s'en servir? Pourquoi la manufacture de la destruction est-elle condamnée à chômer pendant de longs intervalles, au risque de laisser se rouiller à la fois son matériel et son personnel?
Cela tient principalement à deux causes : la première, à ce que la guerre est devenue une industrie improductive, la seconde à ce qu'elle devient de plus en plus une « nuisance internationale ».
De tous temps, la guerre a causé la destruction, la ruine ou tout au moins l'affaiblissement et l'appauvrissement du vaincu ; en revanche, elle augmentait plus ou moins la puissance et la richesse du vainqueur. A l'époque où la guerre avait pour mobile l'anthropophagie ou le pillage et plus tard la réduction en esclavage, la vente ou l'exploitation des vaincus, elle était une source abondante de profits pour le vainqueur. C'est à la guerre que Rome a été redevable de sa grandeur et de sa richesse. Aucune autre industrie ne lui aurait rapporté autant que celle-là.
En revanche, si nous faisons le compte des guerres modernes, sans en excepter une seule, nous trouverons qu'elles ont invariablement coûté au vainqueur plus qu'elles ne lui ont rapporté; qu'elles se soldent des deux côtés par une perte ; en un mot, que la guerre a cessé d'être productive.
Ce changement provient de ce que les belligérants [230] emploient un matériel plus perfectionné et plus coûteux sans diminuer cependant, en proportion, leur personnel : la guerre leur revient en conséquence plus cher, tandis que les recettes nécessaires pour en couvrir les frais vont au contraire en diminuant : on ne peut plus, dans l'état présent de la civilisation, manger les vaincus, les réduire en esclavage ou même confisquer purement et simplement leurs biens, comme la chose se pratiquait:jadis. Tout ce qu'on peut faire, c'est de leur imposer une indemnité et de s'emparer d'une portion de leur domaine politique. C'est ainsi que l'Allemagne a enlevé à la France, à la suite de la guerre de 1870, l'Alsace et une partie de le Lorraine, et qu'elle a exigé une indemnité de 5 milliards. Ces produits de la victoire semblent, au premier abord, suffisamment rémunérateurs. Mais si l'on considère l'ensemble du peuple allemand, peut-on dire que cette annexion et cette indemnité aient compensé les sacrifices et les pertes que la guerre de 1870 lui a coûtés sans parler de ce qu'elle lui coûtera encore? L'annexion de l'AlsaceLorraine n'a profité qu'à la bureaucratie, dont le débouché s'est augmenté; encore les bureaucrates allemands ont-ils eu à subir la concurrence des AlsaciensLorrains auxquels la conquête a ouvert en Allemagne le marché des places en même temps qu'elle le leur fermait en France. La masse du peuple allemand a-telle profité davantage de l'indemnité de 5 milliards? Cette indemnité a-t-elle été équitablement répartie entre tous ceux qui avaient pris part à la guerre ou qui en avaient souffert, ou tout au moins a-l-elle servi à [231] alléger le poids des impôts? Chacun sait qu'elle n'a reçu ni l'une ni l'autre de ces destinations. De plus, l'exhaussement du risque de guerre, déterminé par l'appréhension d'une revanche de la France, a obligé l'Allemagne à développer au maximum son appareil de défense et à augmenter d'autant les charges de ses contribuables. Que l'on soumette à un calcul analogue toutes les guerres modernes, et l'on n'en trouvera pas une seule qui ait contribué à enrichir la nation victorieuse.
En même temps qu'elle devenait improductive, la guerre acquérait de plus en plus le caractère d'une nuisance internationale.
A l'origine, les maux qu'il est dans sa nature de causer, destruction de la vie et de la propriété, interruption des travaux productifs et des échanges, étaient concentrés sur une aire limitée. Non seulement l'-état de guerre à peu près permanent qui régnait entre les différentes sociétés rendait les échanges difficiles et rares, le commerce extérieur nul ou insignifiant, mais encore l'absence ou l'imperfection des moyens de communication empêchait le commerce de se développer dans l'intérieur du pays. Lorsqu'une guerre survenait, les dommages qu'elle causait ne dépassaient pas les limites du théâtre de la lutte. Quelques cantons étaient ravagés, mais les autres parties du territoire des belligérants ne s'en ressentaient point ; à plus forte raison les autres nations n'en subissaient-elles aucun dommage. Mais, à mesure que la sécurité s'est accrue, que les moyens de communication se sont multipliés et perfectionnés, que [232] l'industrie s'est établie sur un plan plus vaste, que le commerce s'est internationalisé, la situation a changé : la guerre n'a plus causé seulement un mal local, elle est devenue une nuisance universelle. Il faut remarquer aussi que ce sont les nations les plus avancées dans les arts de la civilisation, qui souffrent principalement de cette nuisance, car elles se trouvent liées davantage aux autres. Lors de la guerre de la sécession américaine, les manufactures de coton de l'Europe ont été, du jour au lendemain, privées de la matière première qui les alimentait et jusqu'au jour où le déficit a pu être comblé en partie par l'accroissement de la production cotonnière de l'Inde, de l'Egypte et du Brésil, des milliers d'ouvriers sont demeurés privés de leurs moyens d'existence et rejetés à la charge de la charité publique. La guerre finie, une seconde crise a éclaté par suite de la nécessité de diminuer la production du coton dans les pays où la suppression momentanée de la production américaine l'avait accrue. Ainsi la guerre ne cause plus seulement des « dommages directs » dans les localités qui en sont le théâtre, elle cause encore des « dommages indirects » qui s'étendent sur toute la surface du monde commercial. Ces dommages indirects sont de toute sorte; ils atteignent immédiatement ou par une série de répercussions toutes les nations engagées dans le commerce universel et toutes les classes de la société, à commencer par celles qui vivent au jour le jour du produit de leur travail. Enfin si l'on songe que le commerce international ne cesse point de s'accroître en dépit de tous [233] les obstacles, on se convaincra que la guerre acquerra de jour en jour davantage le caractère d'une nuisance internationale. Nous avons remarqué que près de 4 millions de Français dépendent aujourd'hui directement de l'étranger pour leurs moyens d'existence, tandis qu'il y a cinquante ans, on n'en comptait pas plus de 500,000, — huit fois moins. En supposant que dans cinquante ans, le nombre actuel soit simplement doublé, une guerre qui interromprait les relations commerciales de la France avec l'étranger causerait à la population qui produit les articles d'exportation en même temps qu'à celle, à peu près en pareil nombre, qui produit, dans les autres pays, les articles de l'importation française, un dommage si effroyable, en la privant de ses^ moyens d'existence, qu'on a peine à s'imaginer comment il pourrait être supporté.
C'est à cette extension des dommages occasionnés par la guerre qu'il faut attribuer, en premier lieu, l'horreur de plus en plus générale et profonde qu'elle inspire partout à la masse de la population vouée aux travaux de la production, en second lieu, les progrès du droit des gens, en matière de commerce maritime et de réparation des dommages causés par la guerre. Si l'on ne peut, en effet, contester à deux peuples le droit de se faire la guerre et de s'infliger les dommages qu'elle comporte, onpaut en revanche, leur dénier absolument le droit de causer un dommage à autrui et exiger la réparation de ce dommage. Déjà le droit des gens est entré dans cette voie : il reconnaît en cas de guerre, et même de révolution, le droit à l'indemnité pour les [234] dommages directs subis par les étrangers. Le jour où cette doctrine sera étendue aux dommages indirects, il n'y aura plus de nation assez riche pour s'accorder le luxe d'une guerre.
Cependant si, comme nous venons de le démontrer, la guerre est à la fois, et de plus en plus, improductive et nuisible, comment s'expliquer que les nations civilisées augmentent progressivement leurs armements ? Ce phénomène s'explique par l'opposition des intérêts des classes gouvernantes et des masses gouvernées en matière de guerre ou de paix. Les classes gouvernantes sont intéressées à augmenter incessamment les dépenses publiques; elles trouvent dans les fonctions rétribuées de la hiérarchie militaire aussi bien que dans les fonctions civiles un débouché assuré pour leurs enfants. Ce débouché, elles s'appliquent naturellement et pour ainsi dire d'une manière inconsciente, sous l'impulsion de leur intérêt, à l'agrandir. Grâce à l'influence prépondérante qu'elles doivent à leur situation et à leur supériorité intellectuelle, elles persuadent à la masse de la nation que sa sécurité exige le maintien d'un appareil de guerre formidable ; elles lui montrent les autres nations comme des troupeaux de barbares toujours prêts à envahir le sol de la patrie et à s'y livrer au meurtre et au pillage; ou bien encore comme animées de sentiments d'envie et de haine à l'égard d'un peuple dont elles sont forcées, quoi qu'elles en aient, de reconnaître la supériorité; et continuellement à la recherche des moyens de diminuer son influence, ou d'attenter à son honneur. Si la nation a été victorieuse dans une lutte [235] précédente, ne faut-il pas qu'elle se mette en mesure d'affronter là revanche de son ennemi? Si elle a été vaincue, n'est-il pas indispensable à sa sécurité et à son honneur qu'elle prépare cette revanche ? Les gens dont la guerre est le métier (nous ne parlons pas des corvéables qui remplissent les armées continentales, mais de la hiérarchie dont la guerre augmente les chances d'avan-. cernent, et à laquelle elle donne une importance extraordinaire) ne manquent pas d'y pousser de toute leur influence. Un moment arrive où une occasion favorable se présente. La guerre est sur le point d'éclater. Mais aussitôt les intérêts qu'elle menace prennent l'alarme ; ils pèsent de tout leur poids du côté de la paix, les familles qui fournissent les corvéables des armées leur viennent en aide. Le gouvernement hésite, le moment psychologique passe, la paix est maintenue, on se contente de s'armer davantage en prévision d'une guerre future et certainement inévitable. . On qualifie habituellement d'utopistes les hommes qui ont foi dans l'établissement de la paix perpétuelle. Mais quand on considère la voie que la civilisation a suivie et le point où elle est maintenant arrivée, on s'aperçoit que cette qualification conviendrait mieux aux esprits rétrogrades, utopistes à reculons, qui croient à la perpétuité de la guerre.
D'abord la guerre a été nécessaire en même temps qu'elle était productive. Aussi longtemps que le monde barbare a balancé les forces du monde civilisé, elle s'est imposée : il ne dépendait pas des peuples qui avaient même au plus haut point le goût de la paix de ne point faire [236] la guerre, et le soin de leur sécurité exigeait même qu'ils la fissent le plus souvent possible, afin d'y exceller. Mais les progrès généraux de là civilisation et, d'une manière spéciale, les progrès de l'outillage de la guerre, ont mis fin à cet état de choses. Le monde civilisé à pris un ascendant décisif sur le monde barbare. Il suffirait d'une centaine de mille hommes pourvus de l'armement formidable que la science a mis au service de la guerre pour avoir raison de tous les barbares de la terre et assujettir les portions du globe qu'ils occupent encore. Les peuples civilisés sont donc les maîtres de faire la guerre, ou de conserver la paix, et nous venons de constater que la guerre étant devenue à la fois de moins en moins productive et de plus en plus nuisible, ils sont intéressés à s'abstenir de la faire, en attendant le jour où la paix s'imposera à eux, sous peine de ruine et de mort.
On ne peut donc revenir au régime de la guerre permanente et universelle. La résurrection de la concurrence politique dans toute son intégrité efficace est encore moins possible que l'établissement de contrepoids artificiels assez puissants pour suppléer à ce contre-poids naturel de la servitude politique. Que faut-il conclure de là? De deux choses l'une, ou que les nations civilisées finiront par être écrasées sous le fardeau croissant du monopole de l'État ou qu'elles s'affranchiront de la servitude politique qui sert de base à ce monopole.
Mais, encore une fois, peut-on concevoir l'existence; d'un État qui ne serait pas fondé sur la servitude [237] politique, autrement dit d'un État dont le gouvernement n'aurait pas le droit d'imposer ses services à tous les individus vivant sur le territoire soumis à sa domination?
[238]
CHAPITRE XIII.
L'ABOLITION DE LA SERVITUDE POLITIQUE EST-ELLE POSSIBLE? EN QUOI CONSISTAIT LA SERVITUDE ÉCONOMIQUE. LA CONCURRENCE ET LA CONSTITUTION NATURELLE DE L'INDUSTRIE.↩
Avant d'aborder la question que nous venons de poser, savoir si la sécurité des personnes et des propriétés peut être assurée sans que les « consommateurs de sécurité » soient assujettis à la servitude politique, et obligés, en conséquence, d'accepter les services d'un gouvernement aux prix et conditions qu'il impose à la population établie sur le territoire soumis à sa domination, en d'autres termes, si l'industrie qui produit la sécurité peut être soumise à la loi de la concurrence industrielle, comme l'est déjà la généralité des autres branches de l'activité humaine, il importe de savoir quels ont été les effets de son application et comment elle opère dans les industries qu'elle régit.
Dans la période qui a précédé l'avènement de la liberté de l'industrie, la plupart des branches de la production étaient placées sous le même régime que les gouvernements. Elles étaient constituées en [239] corporations et ces corporations avaient, comme les gouvernements, leurs limites territoriales. Dans l'intérieur de ces limites, les consommateurs étaient obligés de s'approvisionner exclusivement auprès de la corporation propriétaire du marché, de subir ses prix et conditions, sauf les restrictions plus ou moins efficaces qui avaient pour objet de limiter la puissance de son monopole ; en un mot, ils étaient assujettis à la servitude économique. Ajoutons que cette servitude était universellement considérée comme naturelle et nécessaire, et qu'à l'époque où elle a été abolie, où le consommateur a été rendu libre de demander les produits ou les services dont il avait besoin aux associations ou aux individus auxquels il lui plaisait d'accorder sa clientèle, où il a été permis à ces associations et à ces individus de s'établir dans les localités qui constituaient auparavant le domaine des corporations, les conservateurs du temps prétendaient que ce régime de concurrence libre aboutirait à la plus épouvantable anarchie, que l'industrie serait ruinée et bientôt anéantie, que les consommateurs cesseraient d'être approvisionnés et que la société retournerait à la barbarie [22] . On sait ce qu'il est advenu de ces [240] pré visions sinistres. Depuis l'avènement de la concurrence industrielle et grâce à sa pression bienfaisante, toutes [241] les industries libres ont réalisé des progrès incessants, leur production s'est accrue dans des proportions extraordinaires, les consommateurs ont eu à leur disposition à des prix de plus en plus réduits une abondance et une variété de produits et de services, telles qu'ils n'auraient pas osé les rêver sous le régime de la servitude économique. Seules, les industries encore soumises à ce régime sont demeurées en retard et d'autant plus qu'elle continuent à imposer à leurs consommateurs une servitude à laquelle il leur est plus difficile d'échapper.
Remarquons enfin que l'action de la concurrence serait encore bien autrement efficace et bienfaisante si elle n'était pas entravée par les obstacles de la protection, du monopole et de la fiscalité. Mais c'est un [242] point que nous avons déjà touché et sur lequel il nous paraît inutile d'insister. Ce qu'il nous importe de considérer à présent, c'est le mode d'action de la concurrence, abstraction faite des obstacles qui le troublent. Ce mode d'action est lié à la constitution naturelle de l'industrie, et il n'est pas le même dans toutes les branches de la production.
Observez la plupart des industries, et vous constaterez que les produits n'arrivent point directement du producteur au consommateur. La constitution de chacune, constitution qui s'est faite d'elle-même, comporte d'abord une série d'entreprises de production ou de fabrication; c'est l'industrie proprement dite; ensuite une autre série d'entreprises commerciales, magasins de gros, de demi-gros et de détail, qui servent d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Cette constitution de l'industrie peut se modifier et se modifie : parfois le nombre des intermédiaires augmente et parfois il diminue, mais ce qu'il est essentiel de remarquer, c'est qu'elle s'impose. Qui voudrait se soustraire à cet ordre naturel des choses, fondé sur la loi de l'économie des forces,, ne manquerait pas d'en être puni. Un manufacturier qui voudrait vendre directement ses produits au consommateur en vue de réaliser lui-même les profits des intermédiaires ne tarderait pas à se ruiner, car il ne pourrait établir et faire fonctionner le rouage nécessaire du commerce à aussi bon marché et avec autant d'efficacité que les commerçants dont c'est la spécialité.
Les établissements appartenant à chacune de ces [243] catégories, industrie, commerce de gros, de demi-gros et de détail se font concurrence entre eux, et leur compétition profite en dernière analyse au consommateur.. Lorsque la concurrence est insuffisante ou excessive dans l'une ou dans l'autre, elle engendre des perturbations temporaires qui rompent l'équilibre des prix, tantôt au profit, tantôt au détriment des autres catégories et des consommateurs, mais qui sont d'autant moins durables qu'elles sont plus fortes.
Voilà un premier point à observer dans le mode d'action de la concurrence et qui tient à la constitution générale de l'industrie. Il y en a un second qui tient à la nature particulière de chacune des branches de la production. Comparons par exemple l'industrie de la confection des vêtements et celle des transports. Dans la première, l'action de la concurrence est immédiate et prochaine; aucun obstacle naturel n'empêchant, d'habitude, les magasins de confection de s'établir en nombre illimité dans le voisinage les uns des autres. Il arrive fréquemment, au contraire, que la nature et la configuration du terrain, sans parler des autres obstacles, empêchent la multiplication illimitée des chemins de fer dans une certaine.région, mais est-ce à dire qu'ils y soient soustraits complètement à l'action de la concurrence? Les lignes et les réseaux de chemins de fer se font concurrence à des centaines et même à des milliers de kilomètres de distance, et les entreprises qui prétendent se soustraire à cette loi naturelle, en persistant à conserver les prix et les habitudes du monopole, sont obligées à la longue, sous peine de ruine, de se [244] courber sous son inflexible niveau. La concurrence agit dans l'espace et dans le temps et son action, pour être médiate et lointaine, n'en est pas moins sûre.
Tels sont les deux points qu'il faut considérer dans le mode d'action de la concurrence. Il faut avoir en vue la constitution qui est commune à l'ensemble des branches de la production, la nature et les circonstances particulières de chacune si l'on veut savoir comment la concurrence peut y intervenir, et de quelle manière immédiate ou médiate, prochaine ou lointaine, elle peut y faire sentir son action propulsive et régulatrice.
[245]
CHAPITRE XIV.
LA CONSTITUTION NATURELLE DES GOUVERNEMENTS. LA COMMUNE. LA PROVINCE. L'ÉTAT.↩
Recherchons donc quelle est la constitution naturelle et quelles sont les circonstances particulières de l'industrie qui produit la sécurité et quel pourrait être dans cette industrie, en admettant qu'elle vînt à passer du régime de la servitude politique à celui de la liberté, le mode d'application et d'opération de la concurrence.
Si nous étudions la structure des États politiques, nous reconnaîtrons qu'elle comporte partout une division de services analogue à celle qui existe dans toutes les industries arrivées à un certain degré de développement. L'État ne rend directement qu'un petit nombre de services aux consommateurs; entre lui et l'individu, il y a deux intermédiaires, la province, sous des dénominations qui diffèrent de pays à pays, et la commune. Et si l'on remonte à la formation originaire des États, des provinces et des communes, on s'aperçoit qu'elle n'a rien eu d'artificiel et d'arbitraire, qu'elle a été déterminée par des nécessités inhérentes à la nature des services qu'ils étaient appelés à rendre, ou, si l'on [246] veut, de l'industrie qu'ils étaient appelés à exercer.
C'est la commune qui s'est constituée la première sous forme de troupeau, de tribu, de clan, et finalement, lorsque l'agriculture et l'industrie eurent fixé les populations au sol, sous sa forme actuelle ; l'association volontaire ou forcée des communes a constitué la province ; celle des provinces a constitué l'État. Les guerres étrangères et les révolutions intérieures ont pu modifier cette -formation primitive, mais sans en altérer la nécessité et le caractère. Voyons donc en quoi consiste la commune, et ce qui a déterminé sa constitution. Une commune est une association naturelle, déterminée par certains besoins individuels mais qui ne peuvent être satisfaits individuellement. Si nous étudions, à cet égard, les communes que nous avons sous les yeux, rurales et urbaines, nous remarquerons qu'elles pourvoient à une série de services nécessaires aux individus, mais qu'ils ne peuvent recevoir isolément, sans que d'autres y participent, tels sont les services de la voirie, du pavage, de l'éclairage, de l'entretien des rues et de la police. Ces services se distinguent par un caractère de collectivité naturelle, en ce qu'ils ne profitent pas seulement à l'individu, mais à l'ensemble du groupe local dont il fait partie. Supposons qu'un ou plusieurs habitants d'une localité dépourvue de police en établissent une à leurs frais, tous les habitants de; la localité profiteront de l'accroissement de sécurité qui; en résultera. Il en sera de même s'ils pavent la rue devant leur habitation, s'ils y élèvent un réverbère, etc. Or plutôt que de se charger seuls d'une dépense qui [247] profitera à la communauté entière, ils s'abstiendront de la faire. Il s'ensuivra que les habitants de la localité ne posséderont ni pavage, ni éclairage, ni police, à moins qu'ils ne consentent tous à en faire les frais.; De là, la nécessité de constituer une association communale pour satisfaire à des besoins qui ont un caractère commun. Mais cette association communale implique une organisation, une direction et un contrôle, autrement dit, un gouvernement. Ce gouvernement a sa constitution et ses attributions naturelles.
Les attributions du gouvernement de la commune sont naturellement limitées aux services ayant le caractère de là collectivité. L'obligation de participer à ces services collectifs, dans la mesure des avantages qu'ils en retirent, constitue pour les individus une servitude naturelle, c'est-à-dire une diminution de la liberté individuelle. Or, si nous nous reportons à la loi de l'économie des forces, nous remarquerons que toute diminution de la liberté de l'individu détermine une diminution correspondante de sa puissance productive; qu'il est essentiel par conséquent que les servitudes, qu'on lui impose soient réduites au strict nécessaire dans son intérêt et dans l'intérêt général de la société, dont les intérêts individuels forment la collection. En revanche, cette servitude implique l'obligation pour les membres de la commune de participer aux frais des services ayant un caractère collectif, dans la proportion de l'usage qu'ils en font et des avantages qu'ils en tirent. Car ceux qui refuseraient de s'acquitter de cette obligation rejetteraient sur les autres membres de [248] commune leur part naturelle dans les frais des services dont ils jouissent.
Mais si les services de la voirie et de la police ont un caractère collectif, il en est autrement de ceux qui pourvoient à la nourriture, au vêtement, au logement et à la généralité des autres besoins des membres de la commune, en y comprenant l'élève et l'éducation de leurs enfants. Une boulangerie, une boucherie, un magasin d'épiceries, ne sont utiles qu'à ceux qui vont s'y pourvoir; une école n'est utile qu'à ceux qui ont des enfants à instruire. Pourquoi obligerait-on les individus qui produisent eux-mêmes leurs articles d'alimentation ou qui les demandent à des entreprises particulières à participer aux frais d'une boulangerie ou d'une boucherie communale? Pourquoi contraindrait-on ceux qui n'ont point d'enfants, ou bien encore les pères de famille qui élèvent eux-mêmes les leurs ou qui les font instruire dans une école privée, à contribuer à l'établissement et à l'entretien d'une école communale? Ils ne profitaient point nécessairement de l'existence de ces services communaux, comme ils profitent nécessairement, en vertu de la nature des choses, des services de la voirie et de la police.
Cependant, parce qu'il y a des services ayant un caractère naturel de collectivité ou de communauté, il ne s'ensuit pas que la commune soit obligée de les établir et de les gérer elle-même; elle peut trouver et elle trouve, dans les pays où l'industrie est suffisamment avancée et spécialisée, des entreprises qui se chargent de construire et d'entretenir les égouts, de paver, de [249] balayer et d'éclairer les rues; elle pourrait en trouver de même, sous un régime de liberté politique, qui se chargeraient de faire la police. En admettant que ces entreprises spéciales pussent se multiplier de manière à se faire une pleine concurrence, le gouvernement de la commune trouverait avantage à leur confier les services dont la réunion constitue ses attributions naturelles. Ces services, il les rétribuerait en gros, et s'en rembourserait en détail, au moyen d'une cotisation spéciale pour chaque service, prélevée sur tous les habitants de la commune, et c'est ainsi en effet que les choses se passent dans les communes bien constituées et gouvernées.
En supposant, — et cette hypothèse deviendra une realité à mesure que l'industrie progressera et se développera sur un plan plus vaste, — en supposant, disons-nous, que des sociétés particulières se constituent pour fonder et exploiter des villes ou de grands domaines agricoles, pourvus des habitations nécessaires au personnel, la rétribution des services ayant un caractère collectif cessera d'être perçue sous la forme d'une cotisation spéciale; elle s'ajoutera simplement au prix du loyer, librement débattu entre la société propriétaire et le locataire. Le poids de la servitude naturelle qu'impliquent les services collectifs se trouvera alors réduit à son minimum, grâce à la double concurrence des entreprises ayant pour spécialité la production de ces services et de celles qui fonderont et exploiteront les villes et les domaines agricoles.
Mais nous n'en sommes pas là, et, dans l'état présent [250] des choses, les gouvernements des communes, comme ceux des États, ont une tendance de plus en plus, marquée à augmenter leurs attributions, par conséquent à alourdir les charges qui pèsent sur leurs sujets, et, en même temps, à s'écarter de plus en plus de la justice dans l'administration de ces charges. Cette tendance vicieuse provient d'une part de l'ignorance ou de la méconnaissance des lois naturelles qui président à la constitution des associations communales ou autres ; d'une autre part, de l'impossibilité où se trouvent les victimes des abus du gouvernement communal, de s'y soustraire autrement qu'en quittant la commune. La constitution naturelle de toute association implique, pour tous ses membres, le droit de participer à sa gestion ou bien encore à la nomination des mandataires chargés de la gérer à leur place, de contrôler leurs actes, et de vérifier leurs comptes. Ce droit n'est pas égalitaire, il est proportionnel au montant de leur apport dans l'association ou de la contribution qu'ils lui fournissent. Mais il est presque sans exemple que cette règle ait été, observée dans la constitution et la gestion des associations communales, et elle l'est aujourd'hui de moins en moins. Ou bien la portion la plus riche et la plus influente des habitants de la commune s'est emparée du gouvernement de cette association, à l'exclusion.du grand nombre, et dans ce cas, elle ne manque pas de. faire peser principalement la dépense sur la catégorie exclue; elle établit par exemple aux frontières de la commune un octroi qui prélève la plus grande partie du revenu communal. sur la subsistance du grand [251] nombre. Les droits d'octroi s'ajoutant au prix des choses, ceux qui les payent ignorent ce qu'ils payent, en sorte qu'il est facile de leur extorquer au delà de leur part légitime dans la dépense. Dans cet état des choses la minorité gouvernante, qui reçoit toute sa part des services communaux, souvent même au delà de sa part sans fournir toute sa part de la dépense, est intéressée à les multiplier, c'est-à-dire à étendre les attributions de la commune au delà de leurs limites naturelles. Ou bien tous les habitants de la commune possèdent un droit égal de participer à son gouvernement, quelle que soit l'inégalité de leur contribution à la dépense. En ce cas, le grand nombre des contribuables pauvres a une tendance naturelle à faire porter le fardeau de la dépense sur le petit nombre des contribuables riches que se trouvent à sa merci. L'impôt progressif est substitué à l'octroi, et le gouvernement communal livré à la classe inférieure des contribuables n'est pas moins que dans le cas précédent, intéressé à augmenter ses attributions. Seulement; c'est au profit du grand nombre et aux dépens du petit, qu'il les augmente.
Dans la plupart des pays du continent, on a essayé de remédier à ces vices des gouvernements communaux en plaçant les communes sous la tutelle du gouvernement de l'État. Mais l'expérience a démontré que ce remède est généralement inefficace, et, le plus souvent même, nuisible. Le gouvernement de l'État n'intervient guère pour empêcher les administrations communales d'augmenter abusivement leurs attributions ou d'asseoir arbitrairement leurs taxes ; il n'intervient que [252] lorsqu'elles lui paraissent empiéter sur son domaine, particulièrement en matière fiscale; parfois aussi il leur impose l'obligation de pourvoir à des services qui sortent de leurs attributions naturelles, telle est par exemple l'obligation de construire et d'entretenir des écoles.
En présence de l'impuissance avérée de l'État à les protéger, que peuvent faire les victimes des abus du gouvernement communal? Ils peuvent quitter la commune. Mais tout en subissant les dommages et les inconvénients d'un changement de résidence, ils courent le risque de retrouver les mêmes abus, parfois même des abus plus graves dans une autre commune.
Telle est cependant, l'unique et insuffisante garantie qui existe sous le régime actuel de la servitude politique contre les vices et les abus du gouvernement communal.
Chaque commune se trouve naturellement liée aux autres et particulièrement à celles qui occupent la même région par des intérêts et des rapports résultant de la contiguïté du territoire. Ces intérêts communs et ces rapports nécessaires déterminent la constitution d'une seconde association ayant pour fonction de gérer les uns et de régler les autres. C'est la province. Enfin, de même que les communes, les provinces d'une région dont les habitants se trouvent rattachés par des affinités particulières, peut-être aussi séparés des populations des autres régions par des mers, des fleuves ou des montagnes, ont des intérêts communs et des rapports nécessaires, lesquels déterminent la constitution [253] d'une troisième association supérieure aux deux autres. C'est l'État. Outre le règlement des rapports inter-provinciaux et inter-communaux ou de ceux de ces rapports qui ne peuvent être réglés directement de commune à commune et de province à province, l'État est chargé de pourvoir à la sécurité extérieure et d'entretenir des rapports avec les autres États. Ajoutons que les mêmes tendances vicieuses que nous avons signalées plus haut dans le gouvernement de la commune s'observent sous l'influence des mêmes causes dans les gouvernements de la province et de l'État.
Si nous examinons la contexture des États modernes, nous la trouverons dans tous, à quelques variantes près, telle que nous venons de l'esquisser. Tous sont superposés à des provinces ou à des agrégats analogues à la province, et les provinces à leur tour sont superposées aux communes, parfois avec un intermédiaire de plus, le district ou le canton. La constitution et la superposition de ces trois agrégats ne s'est point opérée partout de la même manière, et leurs limites, particulièrement celles des provinces et des États, ont subi des changements fréquents. Généralement, la constitution originaire des communes, des provinces et des États a été « naturelle », en ce qu'elle a été déterminée par les besoins collectifs auxquels ces trois associations superposées pouvaient seules pourvoir, notamment par le besoin de sécurité. Les limites des communes ont peu varié, dans le cours, des siècles; en revanche, la conquête a fréquemment changé les limites des provinces et surtout celles des États. Les conquérants d'une [254] province se sont bornés d'habitude à lui imposer une nouvelle administration sans modifier sa circonscription territoriale, mais il est arrivé aussi que la conquête a morcelé une province en attribuant ses parties à des états différents. A peu près seuls, les révolutionnaires français ont prétendu faire mieux que là nature en défaisant son oeuvre pour la remplacer par la leur : à la division naturelle des provinces, ils ont substitué la division artificielle et arbitraire des départements. Cette innovation révolutionnaire n'a eu d'autres résultats que de diminuer la vitalité des provinces en congestionnant la capitale et d'augmenter le nombre des fonctionnaires en remplaçant un gouverneur par trois préfets. Quant aux limites des États, on sait que la guerre et la conquête les ont constamment modifiées.
Mais s'il y a des différences dans la manière dont les communes, les provinces et les États se sont constitués, si leur constitution a changé, si leurs limites ont varié, ils ont conservé un trait commun et immuable, c'est la servitude politique.
De même que les consommateurs des produits de l'industrie étaient obligés, sous l'ancien régime, de demander ces produits exclusivement à la corporation propriétaire du marché, dans toute l'étendue de in circonscription de ce marché, les consommateurs de services politiques et administratifs continuent à être obligés de les demander au gouvernement de la commune, de la province ou de l'État auxquels ils appartiennent. Les constitutions politiques ont pu changer, l'organisation et les rapports des communes, des [255] provinces et de l'État ont pu recevoir des modifications de toute sorte, leur droit exclusif de pourvoir les consommateurs de leurs services dans les limites de leurs circonscriptions territoriales est demeuré immuable. De plus, et c'est là un droit que ne possédaient point les corporations industrielles de l'ancien régime, dont les attributions étaient strictement limitées, et qui s'exposaient à des procès quand elles empiétaient sur le domaine des autres corporations, les gouvernements ont le droit d'étendre et de multiplier leurs attributions; ils ont le droit de s'emparer d'une industrie étrangère à la leur pour l'exercer eux-mêmes en totalité ou en partie, de légiférer et réglementer sur toutes sortes de matières, d'établir de même des taxes, de créer des monopoles et des privilèges et nul ne peut, sans s'exposer à des pénalités variées, se soustraire à l'observation de leurs lois et règlements, au payement de leurs taxes, au tribut de leurs monopoles et privilèges, dans toute l'étendue de leur circonscription territoriale. Ce droit est illimité pour le gouvernement de l'État; il est limité plus ou moins pour le gouvernement de la commune et de la province, mais seulement en ce sens que ces deux gouvernements subordonnés ne peuvent jamais empiéter sur le domaine de l'État, à moins que celui-ci n'y consente, tandis que le gouvernement de l'État peut toujours, en observant certaines formes, augmenter ses attributions aux dépens des provinces et des communes ; enfin, le gouvernement de l'État exerçant d'habitude une certaine tutelle sur les deux autres, ils ne peuvent généralement augmenter leurs [256] attributions et modifier leurs taxes sans son consentement.
Dans toute l'étendue de sa circonscription territoriale, les droits du gouvernement de l'État sont donc illimités, et ceux des gouvernements de la commune et de la province ne sont limités dans les leurs que par la tutelle de l'État. D'un autre côté, ces droits sont réputés perpétuels comme les gouvernements eux-mêmes, et les limites des circonscriptions dans lesquelles ils s'exercent sont fixées à perpétuité. Toutefois le gouvernement de l'État, en sa qualité de tuteur des autres, a le droit de changer leurs circonscriptions territoriales ; il a aussi le droit de les céder, à l'amiable ou autrement, à un autre État, tandis que le droit de séparation est refusé aux provinces et aux communes. Sous l'ancien régime ce droit de cession était illimité ; la « maison » ou la corporation en possession de l'État avait le droit de le morceler, de donner une province en dot à une fille, de l'échanger ou de la vendre. La Révolution française a supprimé ce droit en déclarant la République « une et indivisible », ce qui signifie que le gouvernement de l'État n'a pas le droit de rétrécir son territoire ; en revanche, il lui est toujours permis de l'agrandir.
En dépit de cette perpétuité du droit du gouvernement de l'État sur l'ensemble des territoires soumis à sa domination et qui constituent sa propriété politique, on a vu des provinces se soustraire au joug de l'État auquel elles appartenaient, les provinces hollandaises se sont séparées de la monarchie espagnole, et plus récemment les provinces belges du royaume des Pays-Bas; enfin on a vu et on voit, tous les jours, des [257] États céder de gré (ordinairement par voie d'échange ou de vente) ou de force une partie de leur territoire à d'autres. Mais il faut bien remarquer que jamais un État n'a reconnu à une province ou même à un État placé sous sa dépendance le droit de se séparer de lui, et que le gouvernement de l'union américaine a fait une des guerres les plus meurtrières et les plus coûteuses du siècle plutôt que de consentir à la sécession des États du Sud. Il faut remarquer aussi que dans le cas où un État cède de gré ou de force une partie de son territoire, la population qui meuble ce territoire n'est pas plus consultée sur cette cession que l'esclave africain, lorsqu'on juge à propos de le vendre. A la vérité, on peut citer quelques exceptions à cette règle : lorsque le comté de Nice et la Savoie ont été cédés à la France, en échange du concours que le gouvernement impérial avait prêté à la formation de l'Italie « une », les populations ont été consultées, mais on connaissait d'avance le résultat de cette consultation bénévole. C'était une simple politesse qui ne tirait pas à conséquence. Est-il nécessaire d'ajouter que le gouvernement allemand ne s'est pas avisé de consulter les populations de l'Alsace-Lorraine pour savoir s'il leur convenait de se séparer de la France?
Tel est le droit public en vigueur dans tous les Etats civilisés. Partout ce droit public d'un autre âge confère aux gouvernements des états — et sous la réserve de la tutelle de l'État—des provinces et des communes, le droit illimité de légiférer, réglementer et taxer les populations qui meublent leurs territoires, sans qu'il soit [258] permis à celles-ci de se soustraire à leur domination; partout aussi ce droit est perpétuel, perpétuelles enfin sont les frontières dans lesquelles il s'exerce, et où sont enfermées, sans avoir le droit de les changer,.les populations assujetties à la servitude politique.
Nous avons vu quelle avait été, à l'origine, la raison d'être et la nécessité de cette servitude et comment la perpétuité de la possession de l'État et la concurrence politique, manifestée par la guerre, contribuèrent à en réfréner l'abus, comment à mesure que ces deux freins naturels ont disparu ou se sont affaiblis, on a entrepris de les remplacer par des freins artificiels, en changeant la constitution des gouvernements et en réglementant leur pouvoir de légiférer et taxer ; comment ces freins artificiels sont demeurés impuissants à contenir dans dès limites utiles la puissance d'oppression et d'exploitation des classes en possession de l'État ; comment enfin l'abus de cette puissance doit inévitablement conduire les nations à la ruine. Si l'on veut avoir une idée des excès auxquels elle peut se porter sans que les « consommateurs politiques » puissent s'en préserver autrement qu'en recourant à l'emploi hasardeux de la force, il nous suffira de remarquer qu'aucun obstacle constitutionnel ou légal ne pourrait empêcher une aristocratie en possession du mécanisme de l'État de replacer la multitude sous le joug de l'esclavage ou du servage, ou bien encore, chose plus probable, une démocratie souveraine de confisquer les biens de la minorité capitaliste, de supprimer le grand livre de la dette publique et de transférer aux ouvriers la propriété [259] du sol, du sous-sol et de l'outillage de la production, en réduisant à la misère les propriétaires actuels et, en cas de résistance, en les supprimant eux-mêmes. Ces mesures d'exploitation et d'oppression pourraient être prises légalement, en vertu des droits souverains et illimités que possède tout gouvernement dans toute l'étendue de son domaine politique, et les populations de ce domaine ne pourraient invoquer aucun droit pour s'y dérober. C'est encore grâce aux droits que lui confère ce régime que le gouvernement russe par exemple peut entreprendre d'interdire aux Polonais l'usage de leur langue maternelle et que le gouvernement de l'union américaine peut obliger les États agricoles du Sud à payer le tribut onéreux de la protection aux manufacturiers du Nord ; c'est en un mot la servitude politique qui place aujourd'hui plus que jamais les consommateurs des services publics à la discrétion des producteurs, naturellement intéressés à les exploiter, et qu'aucun frein efficace n'empêche plus d'abuser du pouvoir illimité qu'elle confère. La seule voie qui leur soit ouverte pour se dérober à l'oppression et à l'exploitation, c'est d'émigrer; encore ne font-ils, en émigrant, que changer de servitude.
[260]
CHAPITRE XV.
LA LIBERTÉ DE GOUVERNEMENT.↩
Peut-on concevoir cependant un état de choses différent de celui que nous venons de décrire? Peut-on admettre qu'un gouvernement soit capable de rendre les services en vue desquels il est institué s'il ne possède point le droit exclusif de les imposer dans toute l'étendue du territoire soumis à sa domination ? Nous avons remarqué que ce régime était autrefois commun à la généralité des industries et qu'on ne concevait pas alors la possibilité d'un autre régime. Il est assez naturel qu'on ne conçoive pas aujourd'hui que les hommes puissent être pourvus de sécurité s'ils renoncent à s'assujettir à la servitude politique, de-même qu'on ne concevait pas qu'ils pussent être nourris, vêtus et logés s'ils commettaient l'imprudence de s'affranchir de la servitude économique.
Essayons donc de rechercher ce qui arriverait si la servitude politique venait à être abolie, si la « liberté de gouvernement » venait à être établie comme un complément logique et nécessaire de la liberté de l'industrie. [261] Que seraient les gouvernements et comment fonctionneraient-ils sous ce nouveau régime?
Les prévisions que l'on peut formuler sur l'avenir de la liberté de gouvernement ont, à certains égards, un caractère hypothétique. A l'époque où la servitude économique a été abolie, on pouvait bien affirmer avec certitude que les articles de nécessité ou de luxe dont la production était rendue libre continueraient à être produits, et qu'ils seraient même livrés au consommateur en plus grande abondance et à meilleur marché, mais quelle serait l'influence de la liberté de l'industrie sur la constitution des établissements industriels et quel serait le mode d'action de la concurrence devenue libre, voilà ce que l'expérience seule pourrait révéler. De même, nous pouvons affirmer qu'après l'abolition de la servitude politique, les services dont les gouvernements ont aujourd'hui le monopole continueront à être rendus aux individus et aux sociétés et qu'ils le seront en plus grande abondance et à meilleur marché, ce qui, à tout prendre, est l'essentiel, mais nous ne pouvons pas plus prédire ce que sera l'organisation politique de l'avenir que nos devanciers ne pouvaient prévoir, à l'époque de l'établissement de la liberté industrielle, l'avenir de l'industrie. Nous ne pouvons faire à cet égard que de simples conjectures.
Toutefois, ce qu'il est permis d'affirmer encore, c'est que l'abolition de la servitude politique déterminerait nécessairement la simplification de l'énorme et coûteux appareil de gouvernement qui écrase aujourd'hui les peuples civilisés, et qui, par la complication de ses [262] rouages et la lenteur de ses mouvements [ sounds like FB here], ressemble à une sorte de colossale machine de Marly que là routine aurait conservée au milieu des appareils perfectionnés de l'industrie moderne.
Commençons par rappeler les conditions générales d'organisation qui s'imposent à toutes les industries et les conditions particulières qui caractérisent l'industrie du gouvernement. Toutes les industries arrivées à un certain degré de développement, et quel que soit le régime de liberté ou de monopole auquel elles sont soumises, comportent l'établissement d'une série d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur. L'industrie du gouvernement ne fait pas exception à cette règle : entre le consommateur et le producteur des services publics, l'État, on compte au moins deux intermédiaires, la commune et la province.
D'un autre côté, les services qui constituent les attributions naturelles des gouvernements et en vue desquels ils ont été institués, ont pour caractère d'être non point individuels, mais collectifs; ils profitent, en vertu de leur nature, à la totalité des habitants du territoire où ils sont établis ;.de là, l'obligation qui s'impose à l'individu ou de quitter le territoire ou de participer pour sa part proportionnelle aux frais de ces services. C'est une servitude naturelle.
L'individu vit dans la commune. Sous le régime actuel, il est obligé de pourvoir aux frais de tous les services que le gouvernement communal lui impose, que ces services soient individuels ou collectifs, Supposons que la servitude politique vienne à être abolie, il pourra [263] refuser ceux de ces services qui ont un caractère individuel, il s'abstiendra de faire usage de l'école communale, il n'ira point à l'église ou au théâtre s'il y a un théâtre, etc., etc., mais il ne pourra pas ne pas user des services de la voirie, des égouts, du pavage, de l'éclairage des rues et finalement de la police. La société communale dont il fait partie aura le droit de le contraindre à en payer sa part sous peine d'expulsion du territoire de la commune. En revanche, à moins de réduire ses attributions aux services ayant le caractère de la collectivité, le gouvernement communal ne pourra plus établir d'impôts ayant ce même caractère, les octrois par exemple. Enfin, ses attributions étant ainsi limitées aux services naturellement collectifs, il sera amené par la pression de la concurrence à réduire au minimum les frais de chacun et à établir pour couvrir ces frais une cotisation spéciale, proportionnelle à la consommation de chacun des participants. La concurrence interviendra ici de deux manières : d'une part, si la commune est trop petite pour être morcelée, les habitants qui se jugeront frustrés dans la répartition des dépenses collectives pourront émigrer dans les communes avoisinantes, ce qu'ils peuvent faire au surplus sous le régime actuel ; d'une autre part, si la commune est vaste, les habitants d'un quartier riche, surtaxés au profit des autres ou vice versa, pourront se séparer de l'ensemble, ce qui leur est interdit sous le régime actuel, soit pour former une commune indépendante, soit pour s'annexer à la commune voisine.
Supposons maintenant que des « anarchistes » se [264] refusent à participer aux frais des services collectifs qui nécessitent un gouvernement communal avec des règlements de voirie et de police. Ils seront libres de s'établir dans une localité à part où ils seront les maîtres de se passer de gouvernement et de services collectifs, où il n'y aura ni égouts, ni pavage, ni éclairage, ni police. Seulement, il y a apparence qu'ils ne manqueront point de se convaincre bientôt à leurs dépens de la nécessité de ces services. Quelle que soit leur confiance dans la bonté native de la nature humaine, ils ne tarderont pas à s'apercevoir qu'il existe des gens qui trouvent plus d'avantage à s'approprier les valeurs créées par autrui que de les créer eux-mêmes et qu'il est plus économique et plus efficace de payer une police spéciale pour se protéger contre ces gens-là que de faire soi-même sa police. De plus, ils auraient probablement maille à partir avec la province Sont leur commune anarchique ferait partie et à laquelle l'État réclamerait sa quotepart dans les frais du service naturellement collectif de la défense extérieure, aussi longtemps que subsistera le risque d'invasion.
Si l'individu reçoit des services de la commune, celle-ci, à son tour, en reçoit de la province, et la province de l'État, services de moyens de communication par terre et par eau, services de sécurité intérieure et extérieure. Ces services de la province et de l'État aboutissent à l'individu, comme le produit d'une manufacture aboutit, en passant par les magasins de gros et de détail, au consommateur qui rembourse dans le prix qu'il paye au détaillant tous les frais de production et [265] d'intermédiaires. L'organisation naturelle des services collectifs implique la répartition des frais des services de l'État entre les provinces, celle des frais des services des provinces en y ajoutant ceux de l'État entre les communes, enfin, celle des frais des services des communes, augmentés de ceux de la province et de l'État entre les individus. Mais, sous le régime actuel, les communes n'ont aucun moyen efficace de se préserver de la mauvaise qualité ni de l'exagération du prix des services de la province non plus que de la multiplication indue de ces services et la province est désarmée de même vis-à-vis de l'État, car la commune est liée et subordonnée à la province et la province à l'État. Il en serait autrement sous un régime de liberté de gouvernement. La commune, affranchie de la servitude politique, aurait le droit de se séparer de la province et la province de l'État.
Les conséquences de ce double droit de sécession sont faciles à apercevoir. Si les services que la commune reçoit de la province, augmentés de ceux que la province reçoit de l'État et qu'elle reporte sur la commune sont surabondants, s'il en est qui n'aient point le caractère de collectivité et que les individus aient par conséquent le droit de refuser, la commune refusera de payer sa quote-part de leurs frais de production; si les services collectifs qu'elle est obligée de recevoir sont de mauvaise qualité ou à trop haut prix, elle se séparera de la province pour se joindre à une autre et les provinces en useront de même vis-à-vis de l'État. Sans doute, des circonstances locales pourront faire obstacle à l'exercice de ce droit de sécession, mais si l'on songe [266] que la contiguïté des territoires n'est point—l'expérience l'atteste — nécessaire à la constitution d'une province et d'un État, qu'une commune on une province peut subsister comme une enclave, on se convaincra que le droit de sécession communal ou provincial suscitera une concurrence suffisante entre les Etats et les provinces pour améliorer la qualité de leurs services et en abaisser le prix. En tous cas, ce droit aurait pour résultat de déterminer la suppression de tous les services qui n'ont point, dans l'État ou la province, un caractère de collectivité, en même temps que tous les impôts ayant ce caractère, les douanes et les monopoles par exemple, soit que ceux-ci se trouvent établis au profit de l'État ou de la province, ou des particuliers. La spécialité s'imposerait pour la rétribution des services des provinces et de l'État comme pour celle des services des communes, et l'antique et barbare appareil de la fiscalité, avec la multiplicité des impôts et des entraves que leur perception nécessite serait remplacé par la perception annuelle d'une simple cotisation dans laquelle seraient compris, avec les frais des services communaux, ceux de la province et de la commune, divisés et spécialisés.
Telles seraient les premières conséquences de l'application du droit de sécession, du moment où l'abolition de la servitude politique autoriserait l'exercice de ce droit, actuellement interdit dans toute l'étendue du monde civilisé, et dont la simple revendication n'a pas cessé d'être considérée comme un « crime contre la sûreté de l'État ».
[267]
A ces premières conséquences, savoir la réduction des attributions de la commune, de la province et de l'Etat aux services naturellement collectifs, et la suppression des impôts qui frappent, également en vertu de leur nature particulière, la généralité de la population d'un territoire, sans qu'il soit possible de s'y soustraire individuellement, tels que les monopoles et les douanes, s'en joindraient d'autres, non moins avantageuses aux consommateurs de services collectifs. Ces services, les collectivités de consommateurs ne se chargeraient point nécessairement de les produire elles-mêmes. Déjà, dans les pays où l'industrie et l'esprit d'entreprise sont suffisamment développés, les gouvernements municipaux ne se chargent pas eux-mêmes du service des eaux, de l'éclairage au gaz, de l'établissement des tramways. Ils trouvent plus d'économie à les confier à des entreprises spéciales. Ce qui est avantageux pour certains services communaux pourrait l'être en vertu du même principe pour les services de la province et de l'Etat, et notamment pour le service essentiel de la sécurité intérieure et extérieure. Cela étant, les consommateurs de ces services profiteraient, d'une part, de la concurrence des collectivités dont ils feraient partie à titre de consommateurs, d'une autre part de celle des entreprises spéciales qui se chargeraient de la production des services collectifs; ils bénéficieraient en un mot de tous les progrès que susciterait cette double concurrence appliquée à des services, dont le monopole augmente continuellement le prix sans en améliorer la qualité.
[268]
Une autre conséquence ultérieure de l'abolition de la servitude politique serait l'impossibilité des guerres de conquêtes entre les peuples civilisés. Du moment où le droit de sécession serait appliqué et entré dans les moeurs de la civilisation, du moment où la commune serait toujours libre de se séparer de la province et la province de l'Etat, il ne serait plus possible à un gouvernement de s'emparer d'une population comme d'un troupeau pour l'annexer à son domaine politique. Cette infraction au droit public des peuples civilisés serait considérée comme un crime analogue à la piraterie, et réprimée, comme l'est déjà la piraterie, par l'accord général des Etats. Au besoin, tous se réuniraient pour châtier le gouvernement pirate qui entreprendrait de rétablir, sous un régime de liberté, la servitude politique.
[269]
CHAPITRE XVI.
LA TUTELLE IMPOSÉE ET LA TUTELLE LIBRE.↩
Tous les hommes ne sont pas également capables de supporter la responsabilité naturellement attachée à la liberté. Sans doute, l'état de liberté est celui où l'individu peut développer au maximum ses facultés productives, mais c'est à la condition d'en faire un usage utiles Or d'une parties hommes sont encore, en grande majorité, incapables de réfréner les passions et les vices qui font obstacle à l'emploi utile de la liberté de se gouverner soi-même; et la conséquence de cette incapacité, c'est de les plonger dans la misère, et de les rendre nuisibles à la société dans laquelle ils vivent; d'une autre part, à mesure que la civilisation se développe, le gouvernement de soi-même devient plus difficile et exige une capacité plus grande. Au point de vue de la consommation, les hommes sont assiégés par des tentations plus nombreuses; des jouissances plus variées et plus raffinées sont offertes aux classes moyenne et supérieure, tandis que la classe inférieure est exposée à la tentation violente et presque irrésistible des liqueurs fortes. Au point de vue de la [270] production, l'agrandissement des marchés, sans parler même des causes artificielles qui les troublent, les guerres, la fiscalité et la protection, en ne tenant compte que des causes naturelles, telles que l'inégalité des récoltes, les épidémies, etc., l'agrandissement des marchés, disons-nous, expose la multitude à des risques contre lesquels l'individu abandonné à lui-même est impuissant à se prémunir. De là, la nécessité de la tutelle. Dans les anciennes sociétés, la tutelle était le régime normal, et elle avait généralement pour caractère d'être imposée. En premier lieu, la majorité de la population était esclave et assujettie entièrement à la tutelle du maître pour sa production et sa consommation. Lorsque le servage a succédé à l'esclavage, la tutelle du maître s'est amoindrie et relâchée, mais elle a été remplacée en partie par celle de la commune et de la religion. En second lieu, les classes qui n'étaient point soumises au joug de l'esclavage subissaient la tutelle des corporations dont elles faisaient partie, corporations politiques, religieuses ou industrielles. La part qui était laissée, sous ce régime, à la liberté des individus était certainement moindre que celle de la tutelle collective. L'esclavage, le servage et les corporations ont disparu, mais le besoin de tutelle a subsisté, et il s'est même accru sous l'influence des progrès généraux de l'industrie et du développement de la civilisation. C'est l'État qui s'est chargé d'y pourvoir, et il a multiplié dans ce but les lois et les règlements de tutelle, en même temps que les secours aux individus dont le self government se soldait en perte. Mais l'inefficacité de cette tutelle [271] imposée n’est que trop sensible. Son insuffisance et ses défauts ont aggravé la démoralisation, les vices et la misère auxquels elle avait pour objet de porter remède, tandis qu'elle entravait le développement de la tutelle libre. En supposant que les gouvernements de la commune, de la province et de l'Etat soient obligés, sous l'influence de l'abolition de la servitude politique, à borner leurs attributions aux services ayant le caractère de la collectivité, tout l'appareil compliqué de la tutelle imposée ne tarderait pas à s'effondrer, mais le besoin de tutelle continuant de subsister, la tutelle libre prendrait sa place. Selon toute apparence et eu égard à l'incapacité de la grande majorité des hommes à gouverner utilement leurs affaires et leur vie, ainsi qu'aux difficultés croissantes de ce self government, la tutelle libre sera pendant longtemps le régime sous lequel se placera de préférence le plus grand nombre des créatures humaines. Nous avons donné ailleurs un aperçu de ce régime et nous avons esquissé quelques-unes des institutions qu'il comporte, notamment pour la tutelle des individus appartenant aux classes ouvrières. Nous nous bornons à y renvoyer le lecteur [23] .
[272]
CHAPITRE XVII.
COMMENT LA SERVITUDE POLITIQUE POURRA ÊTRE ABOLIE↩
Affranchie des contrepoids naturels qui en réfrénaient l'abus et qu'aucun contrepoids artificiel n'a pu remplacer avec une efficacité appréciable, la servitude politique place aujourd'hui plus que jamais l'individu à la merci de l'État; c'est la servitude politique qui rend possible la continuation de l'état de guerre entre les peuples civilisés à une époque où la guérie a cessé d'avoir sa raison d'être, ainsi que le rétablissement de la forme la plus lourde et la plus cruelle du servage, — le service militaire obligatoire — dans la plus grande partie du monde civilisé ; c'est la servitude politique qui permet à l'État d'augmenter continuellement ses attributions et démultiplier ses charges aux dépens de la liberté et de la propriété de chacun, en contraignant ceux-là mêmes qu'il dépouille à lui fournir les moyens de les dépouiller. Ce serait cependant une illusion de croire que les nations civilisées s'en affranchiront de sitôt, quelles que soient l'étendue et la gravité des maux dont elle est la source.
L'état de choses qu'elle a produit s'appuie sur des [273] croyances qu'on essayerait en vain de déraciner dans la disposition actuelle des esprits et sur des intérêts encore plus intraitables que les croyances. Songez à la subordination absolue, dans laquelle l'individu a vécu et dû vivre pendant des milliers d'années vis-à-vis de l'État, sous peine d'être la proie de barbares pires que les bêtes féroces ; songez à l'opinion qui s'est alors formée dans son esprit et enracinée davantage de génération en génération, car elle s'appuyait sur l'expérience visible de la nécessité de l'omnipotence de l'État pour sauvegarder la sécurité de chacun; songez enfin à l'éducation routinière et rétrograde que nous avons reçue dans les officines de l'État et qui nous enseigne comme un dogme que rien n'est changé dans le monde, depuis l'antiquité, et que nous sommes, nous, les héritiers directs de la civilisation d'Athènes et de Rome, entourés de barbares qui envient nos richesses et guettent perpétuellement le moment favorable pour nous en dépouiller. Calculez d'un autre côté la masse énorme des intérêts qui dépendent de l'État, le nombre et l'importance des fonctionnaires civils et militaires qui émargent au budget, considérez le nombre presque aussi considérable des intérêts engagés dans les monopoles, les privilèges et les protections que l'État accorde et garantit, et que l'abolition de la servitude politique laisserait sans support, et vous aurez une idée de la puissance presque inexpugnable de cette colossale place forte que l'on nomme l'État.
Cette forteresse, la garnison qui l'occupe n'est pas seule à vouloir la garder intacte; les socialistes qui [274] veulent s'en emparer sont d'accord sur la nécessité de la conserver, en élargissant même son enceinte afin qu'elle puisse contenir leur multitude, et de la rendre inexpugnable, quand ils l'auront conquise.
L'omnipotence de l'État et la servitude de l'individu qui sont les supports de l'ordre actuel des choses sont ainsi protégées par la coalition formidable des idées dominantes dans toutes les classes de la société et des intérêts des classes prépondérantes qui exploitent l'État à leur profit sans oublier ceux de la multitude qui prétend l'exploiter à son tour. Ce serait une entreprise vaine de prétendre l'emporter sur cette coalition universelle des idées et des intérêts. On peut se convaincre d'ailleurs, en constatant le peu de faveur dont jouissent les théories économiques et la vanité de nos efforts pour limiter même dans la plus faible mesure les attributions de l'État et arrêter l'essor du fonctionnarisme, du protectionnisme et du socialisme, combien serait vaine l'espérance de convertir prochainement l'opinion publique à l'abolition de la servitude politique.
Mais ce qu'aucune propagande libérale ne pourrait faire, la force des choses, c'est-à-dire l'opération naturelle et inévitable de l'omnipotence de l'État et de la servitude de l'individu se chargera, quoi qu'il arrive, de l'accomplir.
Nous pouvons constater les résultats de cette opération, et ces résultats sont particulièrement sensibles depuis un siècle. Ils se résument dans l'inégalité croissante de la progression des dépenses des États et de celle des ressources des nations qui sont obligées [275] d'y pourvoir. Malgré l'essor énorme que l'avènement de la grande industrie, et en particulier le progrès des moyens de communication, ont imprimé à la production et à la richesse, la progression des dépenses et des dettes des États civilisés a été constamment supérieure à celle des revenus qui servent à acquitter les unes et à servir les intérêts des autres. De plus, cette inégalité va croissant et il est facile de prévoir qu'elle est destinée à s'accélérer encore. Tandis que le volume et le poids de l'État augmentent à mesure que des classes plus nombreuses entrent en partage de la puissance politique, et prétendent avoir leur part dans le budget, l'essor de la production qui alimente le budget est ralenti par le poids croissant des impôts, des monopoles, des protections, et des entraves qu'ils nécessitent. Depuis quelques années déjà, le ralentissement est sensible; le mouvement ascendant de la richesse s'est affaibli et avec lui le mouvement de la population. Un moment viendra où les nations les plus progressives et les plus riches seront dans l'impossibilité de faire face à des charges plus rapidement multipliées que leurs ressources. En admettant même que la progression de ces charges demeure ce qu'elle est depuis un siècle, la France par exemple aura à alimenter à la fin du siècle prochain un budget de 12 milliards et à servir les intérêts d'une dette de 120 milliards. Pourra-t-elle y suffire avec sa production surchargée de taxes et de protections et sa population presque stationnaire? En attendant, le mal causé par cette inégalité progressive des charges et des ressources [276] ira s'aggravant. On ne manquera pas d'y chercher des remèdes ou des dérivatifs en recourant aux panacées en crédit de la guerre et des révolutions. Mais la guerre est désormais frappée d'improductivité : toute guerre victorieuse ou non a pour conséquence une augmentation du chiffre de la dette publique. Les révolutions, ces guerres intérieures, ont des résultats plus désastreux encore; elles arrêtent la production et augmentent d'une manière permanente les charges de l'État en rendant nécessaire l'extension de ses attributions. De plus les révolutions futures, en cessant d'être exclusivement politiques pour devenir sociales, placeront le matériel et la direction de la production entre les mains d'une classe moins capable d'entretenir et d'augmenter l'un et de gouverner l'autre, elles occasionneront une déperdition de richesse bien autrement considérable que les révolutions politiques. Un moment viendra alors où l'État omnipotent et absorbant s'effondrera faute de support et où il faudra bien le reconstituer sur une autre base.
Les amis de la liberté pourraient donc se croiser les bras et se contenter de « laisser faire » la force des choses pour assister au triomphe de leurs doctrines. Mais, si le développement de la civilisation est soumis à des lois naturelles qui gouvernent la marche de l'humanité et qui prévalent en dépit de tous les obstacles que leur opposent l'ignorance et la folie humaines, on peut cependant aplanir ces obstacles, accélérer ou ralentir la marche de l'humanité, diminuer ou augmenter la somme des forces qui la conduisent au but mystérieux qui lui est assigné.
[277]
Montrer les vices et les résultats funestes du système actuel de gouvernement des sociétés civilisées, et s'efforcer d'en hâter la transformation, voilà en quoi se résume aujourd'hui la tâche des amis du progrès. Si modeste et si ingrate que soit parfois cette tâche, ils ne doivent point l'abandonner. Leur devoir est de s'appliquer incessamment à éclairer l'opinion publique, dussent-ils lutter en vain contre le courant qui l'entraîne. Lorsque l'opinion sera convertie, l'évolution de l'ancien régime au nouveau s'accomplira d'elle-même sans secousses et sans violence, et la servitude politique fera place à la liberté.
[278]
RÉSUMÉ ET CONCLUSION↩
Les lois naturelles qui suscitent le progrès en maintenant l'ordre dans le monde économique sont celles de l'économie des forces, de la concurrence et de la progression des valeurs. Elles sont appropriées à la nature de l'homme, aux besoins qui le sollicitent, aux forces ou aux pouvoirs dont il dispose pour les satisfaire. L'homme a des besoins de toute sorte, matériels, intellectuels et moraux, auxquels il est obligé de pourvoir sous peine de souffrir et de périr. Ces besoins exigent l'assimilation ou la consommation d'éléments qui leur conviennent. Ces éléments ou ces articles de consommation, la nature en fournit une partie gratis, sans que l'homme soit obligé de les adapter à son usage, mais elle ne procure que les matériaux des autres ; ces matériaux, l'homme doit les découvrir, les façonner et les approprier à sa consommation, ce qui s'exprime par le mot produire. Les articles que la nature fournit gratis, dans l'état où ils peuvent être consommés, sont simplement utiles, ceux que l'homme est obligé de produire ont de la valeur, et ceux-ci sont l'objet de l'économie politique.
En quoi consiste la valeur? La valeur est un pouvoir [279] de consommation créé par l'homme. Ce pouvoir, l'homme le crée et ne peut le créer qu'au moyen d'une dépense préalable de forces, désignée sous le nom de travail. La valeur est le résultat ou le produit de l'échange d'une certaine somme de forces ou de travail contre une autre somme de forces ou de pouvoirs propres à là satisfaction des besoins du producteur. Ce résultat peut être plus ou moins avantageux. Tantôt le pouvoir acquis, est inférieur à la force dépensée; alors le producteur est en perte, ses forces s'épuisent et périssent ; tantôt le pouvoir acquis est égal ou supérieur à la force dépensée, et dans ce dernier cas, le producteur acquérant ou gagnant au delà de sa dépense crée de la richesse.
Toute création de valeur implique donc une dépense de forces; or toute dépense de forces détermine une fatigue, une peine, une souffrance. Toute création de valeur implique en même temps une acquisition de forces ou de pouvoirs de consommation; or, toute consommation de forces ou de pouvoirs réparateurs procure une satisfaction, un plaisir, une jouissance. Mais, comme tous les autres êtres pourvus de vie, l'homme fuit la douleur et cherche le plaisir ; en conséquence, il s'applique, dans la création de la valeur, à obtenir la plus grande somme possible de pouvoirs, de consommation en échange de la moindre dépense de forces productives. De là la loi de l'économie des forces. C'est sous l'impulsion de cette loi que l'homme invente des outils et des machines, qu'il recourt à la division du travail et à l'échange, qu'il s'ingénie en un mot à [280]produire toutes les choses dont il a besoin, au meilleur marché, c’est-à-dire en échange de la moindre dépense de forces.
Une seconde loi naturelle se joint à celle-là pour pousser l'homme au progrès, en rendant le progrès nécessaire sous peine de ruine et de mort, c'est la loi de la concurrence. Comment agit-elle ? Nous venons de voir que la nature ne fournit gratis à l'homme qu'une partie des choses nécessaires à sa consommation, et qu'il doit travailler pour se procurer les autres. De là une lutte entre ceux qui ont besoin de ces choses, lutte d'autant plus vive qu'ils sont plus nombreux, que le besoin est plus urgent, et que les choses sont plus difficiles à obtenir, ce qui s'exprime par le mot rareté. Dans cette lutte, les plus forts, les plus habiles, les plus industrieux l'emportent, et subsistent seuls, tandis que les autres succombent et disparaissent. L'homme se trouve ainsi excité au plus haut degré à déployer toutes ses forces productives et à les accroître.
La concurrence s'est manifestée sous trois formes successives depuis la naissance de l'humanité : elle a été d'abord animale, ensuite politique, et en dernier lieu industrielle. A l'origine, lorsque l'homme apparaît comme un animal dépourvu d'industrie, il lutte avec les autres espèces qui l'ont précédé sur le globe, pour se procurer la subsistance. Grâce à l'avantage de sa conformation physique et surtout à la supériorité de son intelligence, qui lui fait inventer des armes et des outils, il l'emporte, à la longue, sur ses concurrents, il les détruit ou les refoule, et assure contre eux sa [281] sécurité. C'est l'oeuvre de la concurrence animale. Cependant il lui reste encore un concurrent, plus redoutable qu'aucun animal inférieur, c'est l'homme lui-même. La lutte de l'homme avec l'homme s'engage d'abord, comme avec les autres animaux, pour la conquête des éléments naturels de la subsistance. Les plus ingénieux s'associent, créent un appareil de gouvernement qu leur permet de combiner et de discipliner leurs forces, asservissent les animaux inférieurs, inventent des armes et des outils qui augmentent leurs pouvoirs productifs. Ils exterminent leurs concurrents moins aptes à la civilisation, et plus tard, lorsque les progrès de leur industrie leur ont donné les moyens de les utiliser, ils les réduisent en esclavage. La production s'accroît dans des proportions extraordinaires, la population se multiplie, les troupeaux primitifs deviennent des nations, l'État succède au clan ou à la tribu. Les États apparaissent comme une réunion de fermes et d'ateliers d'exploitation possédés et gouvernés par l'association des hommes de facultés et d'industrie supérieures qui ont conquis le territoire, asservi et dressé la population à produire, sous leur direction, toutes les choses nécessaires à la satisfaction de leurs besoins. La concurrence alors s'agrandit et se transforme. Les associations propriétaires des États luttent entre elles et contre les tribus demeurées à un stage inférieur soit pour défendre leurs domaines, soit pour les agrandir et augmenter ainsi leur puissance et leurs profits. C'est la concurrence politique manifestée par la guerre.
Sous cette nouvelle forme, la concurrence suscite des [282] progrès de toute sorte : progrès de l'art et de l'outillage de la guerre, qui augmente les forces offensives et défensives de l'État ; progrès de l'art du gouvernement qui rend l'État plus résistant, en tirant un meilleur parti de ses forces et en combattant avec plus d'efficacité les nuisances qui l'affaiblissent; progrès des méthodes d'exploitation de la population asservie, qui développent ses pouvoirs productifs en substituant le servage à l'esclavage et la sujétion au servage. Les États qui réalisent au plus haut degré cet ensemble de progrès l'emportent sur les autres ; ils les détruisent ou les assujettissent et finissent par acquérir une prépondérance décisive. Au moment où nous sommes leur domination s'étend sur la plus grande partie du globe, qu'ils ont mise à l'abri des invasions des barbares ; ils ont assuré la sécurité du monde civilisé. Cette oeuvre essentielle, et qui ne pouvait s'accomplir autrement, a été l'oeuvre de la concurrence politique.
Cependant, une troisième forme de la concurrence a surgi dans l'intervalle et elle a acquis sous l'influence des progrès qui ont créé la grande industrie un développement prodigieux, c'est la concurrence industrielle. Elle est née de la division du travail et de l'échange. Sous l'impulsion de la loi de l'économie des forces stimulée par la concurrence animale et politique, les hommes ont séparé et spécialisé leur industrie ; au lieu de produire eux-mêmes directement tous les articles nécessaires à leur consommation, ils ont trouvé avantage à n'en produire qu'un petit nombre, puis un seul, et finalement une partie d'un seul, et à se procurer par [283] l'échange de ce produit ou de cette fraction de produit l'ensemble des articles qu'ils consomment. Sous ce nouveau régime, le producteur, qui auparavant ne faisait qu'un avec le consommateur, se sépare de lui ; et les divers producteurs du même article se font concurrence pour l'offrir sur un marché où les consommateurs se font concurrence pour le demander. L'échange s'opère en raison de la valeur investie dans l'article offert, qu'il s'agisse d'un produit ou d'un service, et le niveau auquel se fixe cette valeur, au moment où l'échange s'opère, est déterminé à la fois, mais en sens inverse, par la concurrence des producteurs et des consommateurs.
Alors apparaît et se manifeste la loi naturelle que nous avons désignée sous le nom de loi de progression des valeurs, et qui ne remplit pas, dans le mécanisme du gouvernement du monde économique, une fonction moins importante que les deux autres, car elle joue, sous l'impulsion de la concurrence, le rôle de régulateur de la production et de la distribution de la richesse.
En vertu de cette loi, la concurrence des quantités offertes au marché, en croissant ou décroissant en raison arithmétique, engendre une progression des valeurs décroissante ou croissante en raison géométrique, en sorte qu'il suffit de l'apport ou du retrait d'une faible quantité d'un produit ou d'un service pour engendrer une variation beaucoup plus considérable dans la valeur de ce produit ou de ce service. Que résulte-t-il delà? C'est, d'une part, que la valeur de toutes choses tend incessamment, [284] par une impulsion progressive, à être ramenée au niveau des frais qu'il a fallu faire ou des forces qu'il a fallu dépenser pour les produire, de manière à procurer au consommateur toute la différence entre la force dépensée et le pouvoir de consommation acquis dans la création de la valeur, et cette différence ou ce gain va croissant à mesure que l'industrie se perfectionne. C'est, d'une autre part, qu'un juste et nécessaire équilibre tend perpétuellement à s'établir dans la production et la distribution de la richesse. Quand la valeur d'un produit ou d'un service s'élève de manière à rendre cette branche particulière de la production plus profitable que les autres, la concurrence s'y porte jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli et vice versa. Dans l'un et l'autre cas, ce retour à l'équilibre de la production s'opère avec une force d'impulsion qui se développe suivant une progression géométrique. De même quand l'équilibre de la distribution de la richesse vient à être rompu, sous l'influence d'une cause de perturbation quelconque, quand une catégorie particulière des agents productifs entre lesquels se partage la valeur du produit reçoit au delà de sa part nécessaire ou moins que cette part, la concurrence s'y porte ou s'en retire et la progression croissante ou décroissante des valeurs engendrées par l'apport ou le retrait des quantités agit pour rétablir l'équilibre. Telle est l'opération de la loi de progression des valeurs, mais cette loi n'a pu se manifester et agir comme un régulateur qu'à mesure que les échanges se sont multipliés et que les mouvements de la concurrence sont devenus plus libres.
[285]
Ce double progrès a été lent à s'accomplir. Pendant une longue série de siècles la sphère de la presque généralité des échanges' n'a pas dépassé les limites du canton ou de la province. Mais l'extension de l'aire de la sécurité et lo progrès extraordinaire des moyens de communication d'une part, l'accroissement non moins prodigieux de la machinerie de la production industrielle de l'autre, ont imprimé, surtout depuis un demi-siècle, aux échanges un essor sans précédent dans l'histoire. Ils ont franchi et débordé de plus en plus les frontières des États; les marchés où ils s'opéraient naguère séparés et isolés se sont rapprochés et tendent rapidement à s'unifier.
Cette extension progressive de la sphère des échanges et ce développement de la concurrence industrielle ont eu deux conséquences importantes : la première, c'est de stimuler et d'accélérer le progrès de toutes les branches de l'activité humaine, en le rendant nécessaire, sous peine de ruine dans l'aire croissante où la concurrence agit; la seconde, c'est d'agrandir la sphère de la solidarité des intérêts en y englobant successivement tous les membres de la famille humaine.
Avant que les échanges se fussent multipliés et internationalisés, il n'existait de solidarité qu'entre les hommes appartenant à la même tribu ou à la même nation, réunis par un péril commun et par un intérêt commun de pillage ou d'exploitation. Ceux qui appartenaient à des tribus ou à des nations différentes se trouvaient au contraire à l'état d'antagonisme ; ils étaient des ennemis naturels, car leur industrie [286] principale consistait à s'entre-dévorer ou à s'entre-dépouiller. L'art de la politique, expression et instrument de l'antagonisme naturel des différentes sociétés humaines, consistait dans chaque État particulier à diviser et affaiblir les autres, de manière à se mettre à l'abri de leurs atteintes, et d'augmenter à leurs dépens sa puissance et sa richesse, en s'emparant de tout ou de partie de leurs territoires. Sous le nouveau régime, au contraire, tous les hommes unis par les liens de l'échange et du prêt (échange dans le temps), quelle que soit leur race, leur nationalité ou leur couleur, sont des « amis naturels », en ce qu'ils sont intéressés à la prospérité les uns des autres; quand quelques-uns s'enrichissent, tous profitent de leur richesse; quand ils s'appauvrissent, tous souffrent de leur appauvrissement. Sous ce régime encore, il n'y a plus ni calamités ni rétrogradations locales : de même que les progrès réalisés sur un point quelconque du globe procurent à. ceux qui les adoptent un surcroît de richesses auxquelles participent tous ceux qui font des échanges avec eux et, par contrecoup, la généralité des échangistes; de même les calamités ou les vices qui ruinent une population sont ressentis par tous ceux qui font des affaires avec elle. Enfin, tout obstacle qui trouble ou interrompt les échanges sur un point du réseau dont ils couvrent le monde occasionne une nuisance universelle. De là l'incompatibilité qui se manifeste entre la politique de l'ancien régime, fondée sur l'antagonisme naturel des tribus ou des États, et celle qui convient à ce nouveau régime de solidarité naturelle des intérêts. La [287] première s'appliquait et devait s'appliquer à diviser, à affaiblir et à appauvrir les autres États, en vue de faciliter l'oeuvre de la guerre et de la conquête ; la seconde doit s'appliquer au contraire à cimenter l'union entre les, populations unies par les liens de l'échange, à favoriser le développement de la prospérité générale, à combattre et autant que possible à supprimer toutes les causes de perturbation, toutes les nuisances qui [atteignent la communauté des échangistes.
Parmi ces causes de perturbation, la principale, celle à laquelle il faut attribuer l'état de crise et de malaise dans lequel se trouvent actuellement les sociétés civilisées, réside dans la persistance de l'organisme qui était adapté au régime de la concurrence politique, et qui a cessé d'être utile pour devenir une nuisance à mesure que la concurrence politique s'est affaiblie et a fait place à la concurrence industrielle. La base de cet organisme suranné, c'est la servitude politique.
La nécessité de la servitude politique à l'époque où chaque tribu ou nation était continuellement menacée de spoliation et de destruction par ses « ennemis naturels », n'a pas besoin d'être démontrée. Il fallait que le gouvernement de la tribu ou de la nation eût le droit de mettre en réquisition toutes les forces et toutes les ressources de la population vivant sur son territoire et profitant de l'appareil défensif et offensif qu'il avait établi, pour qu'il pût la protéger contre les risques de spoliation et de destruction auxquels elle était exposée ; il fallait encore que ce gouvernement eût le droit d'imposer à la généralité de cette population les lois et [288] règlements de tutelle qu'il jugeait nécessaires au maintien de l'ordre et au développement des ressources de l'État, sans lesquels il aurait infailliblement succombé dans l'arène de la concurrence politique. Ce droit souverain et illimité conférait sans doute aux gouvernements un pouvoir énorme sur les individus, et exposait ceux-ci à l'oppression la plus extrême. Cependant cette oppression était dans une certaine mesure contenue et empêchée par les deux freins combinés de l'appropriation perpétuelle de l'État et de la guerre. L'association ou la maison propriétaire à perpétuité de l'État était intéressée au développement continu des ressources dès populations qui lui fournissaient ses moyens d'existence, par conséquent aussi à leur procurer à des prix et conditions supportables une somme suffisante de sécurité et de liberté. D'un autre côté, la guerre agissait incessamment pour rendre nécessaires ces pratiques de bon gouvernement, en exposant les propriétaires de l'État à la dépossession et à la ruine, comme à une conséquence inévitable de la diminution de leurs forces et de leurs ressources; en même temps elle les obligeait à appliquer presque exclusivement ces forces et ces ressources à la défense et à l'agrandissement de l'État, et à limiter ainsi^ économiquement, leurs attributions.
Mais, à la longue, les progrès de l'art et du matériel de là, guerre joints à ceux de l'industrie et au développement des échanges affaiblirent le frein de la concurrence politique, en attribuant une prépondérance décisive aux peuples civilisés et en rendant à la fois la guerre de [289] moins en moins productive pour les belligérants, et de en plus plus nuisible à la communauté des nations, unies et solidarisées par l'échange. Sans doute les barbares n'ont pas cessé d'être tentes d'envahir le domaine de la civilisation, mais sauf sur certains points isolés et dont le nombre diminue tous les jours, ce domaine leur est devenu inaccessible; partout, grâce à la supériorité de leur armement et de leur science militaire, les peuples civilisés refoulent la barbarie et achèvent de soumettre le globe à leur domination. Après avoir été pour les barbares qui envahissaient les Etats civilises, la plus productive des industries, la guerre les expose aujourd'hui à une destruction ou à un asservissement certain. Entre les peuples civilisés, la guerre est non seulement devenue improductive, mais encore elle cause une diminution générale de la production et de la richesse. Elle exige une avance de plus en plus considérable de capital, tandis que les profits qu'on peut en tirer vont au contraire en diminuant; car on ne peut plus réduire les populations de l'Etat vaincu en esclavage, les exploiter, les vendre ou les manger ; on peut seulement leur imposer le payement d'une indemnité, toujours insuffisante pour couvrir les frais de la guerre. Enfin elle cause à la communauté des nations civilisées un dommage qui va croissant à mesure que la sphère, le nombre et la valeur des échanges s'étendent et se multiplient. Si elle continue à désoler le monde, c'est uniquement parce qu'elle est demeurée une source de profits pour les états-majors politiques et militaires, auxquels le maintien de la servitude politique a conservé le [290] pouvoir de la déchaîner. Mais, à mesure que les intérêts économiques pour lesquels elle est une nuisance, ont crû en nombre et en influence, elle est devenue l'exception après avoir été la règle. Ce n'est plus la guerre, c'est la paix qui est aujourd'hui l'état normal du monde civilisé.
Tous les Etats politiques ne sont pas moins demeurés constitués en vue de la guerre, tous ont conserva comme la base nécessaire de leur organisation la servitude politique. Qu'en est-il résulté? c'est que les gouvernements, en possession de cet instrument de domination et de moins en moins contenus par la pression de la concurrence politique, ont contracté tous les vices et donné carrière à tous les abus inhérents au monopole; c'est que les populations opprimées et exploitées par le monopole de l'État, se sont efforcées de le limiter ou de s'en emparer. Mais nous avons pu constater à quel point les freins artificiels qu'elles ont entrepris de substituer au frein naturellement affaibli de la concurrence politique, sont demeurés impuissants. Partout les gouvernements ne cessent point d'empiéter sur le domaine de l'activité privée ; partout les dépenses et les dettes publiques s'accroissent d'un mouvement plus rapide que la production et la richesse qui les alimentent, tandis que les services essentiels de la sécurité et de la tutelle imposées se reconnaissent à leur état grossièrement arriéré et vicieux en comparaison des produits et des services des industries de concurrence, malgré les entraves auxquelles celles-ci sont assujetties et les perturbations auxquelles elles sont exposées du fait du [291] monopole de l'État. A quoi on peut ajouter que ces maux et ces abus se produisent dans les pays, tels que l'Union américaine, où les freins artificiels du monopole politique passent pour avoir atteint le plus haut point de perfection, aussi bien qu'en Russie, où ces freins existent à peine.
Au sein de chaque nation civilisée, deux sociétés, dont les intérêts sont naturellement opposés, se trouvent actuellement en présence : la société particulière des producteurs de « services publics », qui possède le monopole de l'État et qui l'exploite à son profit, et la société générale des consommateurs de ces services, à laquelle la servitude politique permet de les imposer. La société des producteurs est intéressée à entretenir dans le monde civilisé un état d'antagonisme qui motive le maintien d'un énorme effectif politique et militaire ; elle est intéressée encore à étendre ses attributions, et par conséquent ses débouchés, enfin, comme tous les producteurs dégagés du frein de la concurrence, elle est irrésistiblement portée à augmenter le prix de ses services et à en abaisser la qualité. La société des consommateurs, au contraire, est intéressée à la paix, à la réduction des attributions de l'État, à l'abaissement du prix des services publics et à l'exhaussement de leur qualité, mais elle ne possède aucun moyen efficace de faire prévaloir son intérêt sur celui des producteurs, auxquels elle est assujettie.
Comment cet état de choses a engendré la crise politique et économique qui sévit actuellement dans toute l'étendue du monde civilisé ; comment l'abolition de la [292] servitude politique pourra seule mettre fin à celle crise, en faisant passer les services publics du régime du monopole né de l'affaiblissement de la concurrence politique à celui de la concurrence industrielle, en limitant par conséquent la sphère d'activité des gouvernements à leurs attributions naturelles, c'est-à-dire aux services ayant-le caractère de la collectivité; comment ce progrès s'accomplirait nécessairement quand même la science n'interviendrait pas pour le guider, par l'opération même du monopole engendrant un accroissement des dépenses publiques plus rapide que celui des ressources qui les alimentent : c'est ce que nous avons entrepris de démontrer.
Un facteur bien autrement puissant que la science, intervient d'ailleurs chaque jour, sans bruit, mais avec une efficacité croissante et qui finira par devenir irrésistible pour accélérer ce progrès, nous voulons parler de la concurrence industrielle. Par suite de l'extension progressive de la sphère des échanges, les industries de toutes les nations se trouvent de plus en plus en concurrence. Or, dans cette lutte devenue universelle, la victoire appartient aux industries qui produisent au meilleur marché et qui sont par conséquent les moins grevées d'impôts et de charges parasites. Qu'en faut-il conclure? c'est que les industries des nations où le militarisme, le fonctionnarisme et le protectionnisme se joignent pour grever la production, les révolutions et le socialisme pour l'interrompre et la bouleverser, c'est que ces industries créatrices de la richesse et de la puissance seront exclues peu à peu du marché universel, en entraînant dans leur [293] décadence celle de la nation. De même que les industries qui persistent à conserver leurs vieux métiers finissent par se ruiner cl disparaître, les nations qui continueront à se laisser imposer une machinerie politique surannée n'échapperont point à la décadence et à la ruine; elles tomberont à un rang inférieur et finiront par disparaître de la scène du monde. Celles au contraire qui prendront l'initiative de l'abandon d'un système vieilli, pour le remplacer par une machinerie de gouvernement moins coûteuse et plus efficace, acquerront une prépondérance analogue à celle que l'initiative du progrès industriel a value à l'Angleterre. Alors aussi, lo progrès qu'elles auront réalisé, s'imposera aux autres et un mouvement irrésistible de l'opinion emportera la servitude politique.
Avec la servitude politique disparaîtra la cause principale du malaise actuel des sociétés civilisées. Les causes artificielles de perturbation de l'action propulsive et régulatrice des « lois naturelles » provenant du désaccord existant entre l'état politique et l'état économique des sociétés, cesseront d'exister. Seules les causes naturelles provenant de l'imperfection de l'homme et du milieu continueront d'agir. Mais la production de la sécurité et de la tutelle devenue libre et désormais soumise à l'action de la concurrence industrielle, opposera une barrière de plus en plus efficace aux unes, tandis que les progrès de la science et de l'industrie entameront les autres. Sous l'impulsion des lois de l'économie des forces et de la concurrence industrielle débarrassée des entraves et des charges du monopole, [294] la production deviendra de plus en plus féconde; tandis que la distribution de la richesse, réglée par les mouvements libres de la concurrence et de la loi de progression des valeurs, se rapprochera davantage de la justice.
Maintenant, quelle conclusion finale s'impose à l'esprit? C'est que la marche de la civilisation et le gouvernement supérieur des sociétés humaines n'ont pas été abandonnés à la merci de l'homme ; c'est que cette marche est réglée, c'est que ce gouvernement est dirigé par des lois naturelles que l'homme peut à la-vérité observer ou méconnaître, mais qui s'imposent à lui et le poussent, malgré ses résistances, de progrès en progrès, vers un but qu'il ignore. Il ne dépend pas de lui de ne point s'acheminer vers ce but ; il peut seulement accélérer ou ralentir sa marche, et c'est trop souvent en croyant l'accélérer qu'il la ralentit. Il peut s'engager dans une voie fausse, et c'est ainsi que des esprits qui se croient progressifs se fourvoient aujourd'hui dans l'impasse des révolutions et du socialisme. Le rôle de la science consiste à découvrir le vrai chemin, de manière à procurer à l'humanité une économie de temps et de forces. C'est un rôle, en apparence modeste, et toujours ingrat, car la vérité est lente à triompher de l'illusion et de l'erreur. Qui sait cependant si cette économie que la science procure n'exerce pas une influence décisive sur les destinées ultérieures de l'espèce humaine?
[295]
APPENDICES
APPENDICE I.
La guerre civile du capital et du travail. Causes et remèdes.↩
La cause de cette guerre réside-t-elle dans le salariat, comme les différentes écoles socialistes s'accordent à le prétendre ? L'ouvrier salarié est-il nécessairement exploité par l'entrepreneur? Le régime du salariat est-il en soi naturellement inégal et oppressif? Qu'est-ce que le salaire ? C'est une part anticipative et assurée dans les résultats de la production, et c'est la forme de rétribution ,ïa mieux appropriée à la situation de l'ouvrier, c'est même, dans la généralité des cas, la seule qui y soit appropriée. L'ouvrier ne peut pas attendre que le produit que son travail a contribué à créer soit réalisé ; il ne peut pas davantage supporter les risques inhérents à toute entreprise de production. Il a besoin d'une rétribution.immédiate et certaine : cette rétribution, c'est le salaire.
Toute la question se réduit à savoir si le taux du salaire peut ou non êlre fixé d'une manière équitable; si l'ouvrier salarié peut ou non recevoir sa part légitime dans les résultats de la production ; si, parce qu'il reçoit cette part d'une manière anticipative et assurée, il est nécessairement obligé [296] de fournir à l'entrepreneur qui fait auprès de lui l'office d'un banquier et d'un assureur, un intérêt et une prime usuraires, ce qui, dans le langage populaire, s'exprime parle mot « exploitation « . Il se peut certainement qu'il paye cet intérêt et cette prime à un taux excessif, et nous verrons tout à l'heure que l'entrepreneur est obligé, dans l'état actuel des choses, de les lui-faire payer à un taux élevé, pour ne pas y perdre ; mais avons-nous besoin de rappeler que ce taux ne s'établit point d'une manière arbitraire, qu'il est déterminé par l'état du marché des salaires ; qu'il s'élève ou s'abaisse selon l'état de l'offre et de la demande des bras, et, pour nous servir de la formule de Cobden, que le salaire baisse quand deux ouvriers courent après un maître, qu'il hausse quand deux maîtres courent après un ouvrier? Le mal ne vient donc pas de la forme de la rétribution des ouvriers. Il a des causes plus profondes et qui résident d'une part dans l'état arriéré de la constitution et de la mise en oeuvre des entreprises, de l'autre, dans l'insuffisance du développement des marchés de travail.
I. — Dans l'étude de cette question actuellement brûlante des relations du capital et du travail, il faut se méfier également de l'esprit d'utopie et de l'esprit de routine. Les socialistes la résolvent ou, pour mieux dire, la tranchent sans s'embarrasser des conditions naturelles d'établissement et de fonctionnement des entreprises. Exproprier avec ou sans indemnité les entreprises existantes, à commencer par les charbonnages, et les mettre entre les mains d'associations ouvrières constituées d'une manière plus ou moins égalitaire, voilà leur solution. Avons-nous besoin de démontrer, une fois de plus, que c'est une solution absolument impraticable, qu'elle ne tient aucun compte de deux des éléments constitutifs de toute entreprise : l'esprit d'initiative et la science, qui la fondent et la mettent, en oeuvre, le capital.qui l'alimente. Supposons q"ue les industries minières et manufacturières passent entre les mains de communautés ouvrières dirigées par des chefs et un état-major élus, et dont [297] les parts ne dépassent pas celles des simples ouvriers, ce mode de recrutement et cette rétribution seront-ils bien propres à attirer dans les entreprises les hommes pourvus de l'énergie, de la capacité et des connaissances nécessaires pour les faire prospérer ? D'un autre côté, ces communautés ouvrières inspireront-elles assez de confiance au public des grands et des petits capitalistes pour obtenir les capitaux dont elles ne peuvent se passer, surtout si, se conformant aux principes élémentaires du socialisme, elles mettent le capital à la portion congrue? Sous ce régime, les entreprises existantes ne tarderaient pas à tomber en faillite et il ne s'en fonderait plus de nouvelles. La confiscation des entreprises capitalistes au profit des associations ou des communautés ouvrières, représentant le travail à l'exclusion du capital et de la science, entraînerait la ruine inévitable de l'industrie. Ce serait un désastre dont les travailleurs, généralement dépourvus d'avances, seraient les premières et les 1 plus lamentables victimes, el qui les guérirait peut-être pour longtemps du socialisme.
La solution, philanthropique du remplacement du régime du salariat par celui de la participation aux bénéfices, pour être moins grosse de périls et de maux, n'est guère moins utopique. Il suffit d'un simple coup d'oeil jeté sur la situation de l'immense majorité des ouvriers pour se convaincre qu'ils ne peuvent pas attendre la réalisation des bénéfices des entreprises pour subvenir aux nécessités courantes de la vie. Il ne saurait donc être question de remplacer en totalité et d'emblée le salariat par la participation. Ce remplacement devrait être partiel et graduel. Mais resterait toujours à résoudre la question de la fixation du taux de la participation. L'entrepreneur offrirait le taux le plus bas, les ouvriers demanderaient le taux le plus élevé, et les mêmes conflits qu'engendre aujourd'hui la fixation du taux des salaires se reproduiraient pour celle du taux de la participation aux bénéfices, avec une difficulté aggravante de plus : celle de lu constatation des bénéfices.
[298]
Mais de ce que les solutions dictées par le socialisme et la philanthropie ne tiennent compte ni des lois naturelles de la constitution des entreprises ni de la situation réelle des ouvriers , et sont par conséquent utopiques, s'ensuit il, comme le prétendent les routiniers plus nombreux encore que les utopistes, qu'il n'y ait absolument rien à changer dans l'état actuel des choses; que la constitution des entreprises et le mode de coopération et de rétribution des ouvriers soient immuables ? Voilà ce qu'il s'agit d'examiner.
II. — Ceux qui observent, comme nous, depuis près d'un demi-siècle, le développement progressif de l'industrie, ont pu constater à la fois la prodigieuse transformation qui s'est opérée dans le matériel des entreprises et l'immobilité du mode de recrutement, d'organisation et d'emploi du personnel. Sauf dans les industries attardées et abêties par le protectionnisme, le matériel a été complètement renouvelé; il est devenu incomparablement plus puissant et plus économique. La constitution des entreprises, au contraire, ne s'est pas sensiblement modifiée. Les sociétés par actions, anonymes ou en commandite, se sont, à la vérité, considérablement multipliées,, mais leur constitution, figée dans un moule légal et en quelque sorte hiératique par des législateurs ignorants des choses de l'industrie, est demeurée grossièrement imparfaite. Quant au mode de recrutement, d'organisation et d'emploi du personnel, et, en particulier, de l'armée des simples ouvriers, il est demeuré le même. L'entrepreneur d'industrie embauche ou engage les ouvriers individuellement, moyennant un salaire plus ou moins débattu et qu'il leur paye tous les huit jours, tous les quinze jours ou tous les mois. Ses ouvriers, lui, ses ingénieurs ou ses contre-maîtres, les dirigent ou les commandent, en les employant à la journée ou à la tâche; il leur impose une discipline et des règlements sanctionnés par des retenues et des amendes. En d'autres termes, le travail est généralement employé en « régie », et l'ouvrier se trouve sous les ordres et[299] sous la-dépendance immédiate de l'entrepreneur d'industrie et de ses agents.
Ce système de régie industrielle et de rapports individuels entre l'entrepreneur et l'ouvrier est-il aussi avantageux à l'entrepreneur qu'on se plaît à le supposer, et ne peut-on pas, sans être taxé d'esprit chimérique, concevoir la possibilité de le remplacer par un système plus économique? Essayons d'en analyser les avantages et les inconvénients au point de vue de l'intérêt de l'entrepreneur d'industrie d'abord.
L'avantage principal, je pourrais dire unique du système de régie ou d'exploitation directe du travail par l'entrepreneur d'industrie, réside dans l'inégalité ordinaire de situation des deux parties au moment où se débattent le taux et les conditions dû salaire. Cette inégalité tient à ce que l'ouvrier isolé dispose généralement à un moindre degré que l'entrepreneur de l'espace et du temps. « La plupart des ouvriers, remarquait Adam Smith, ne pourraient pas subsister une semaine, fort peu l'espace d'un mois et presque aucun l'espace d'un an sans travailler. A la longue, le maître ne peut pas plus se passer de l'ouvrier que l'ouvrier du maître; mais le besoin qu'il en a n'est pas si urgent. » Adam Smith remarque encore que l'ouvrier est obligé le plus souvent d'offrir son travail sur place, « l'homme, dit-il, étant de toutes les espèces de bagages le plus difficile à transporter. » Cette inégalité de situation permet trop souvent, à l'entrepreneur de dicter les conditions du salaire, et d'exiger de l'ouvrier une somme de . travail dépassant à la longue les forces humaines en échange d'une rétribution insuffisante pour les réparer et les reconstituer de génération en génération. Elle lui permet aussi d'obliger l'ouvrier à supporter des abus d'autorité injustifiables, qui laissent dans les coeurs de longs ressentiments et finissent par provoquer des explosions furieuses. Cependant ce mal a été en s'atténuant, depuis un demi-siècle, sous l'influence de diverses causes. Les ouvriers ont compris la nécessité de s'associer pour balancer, autant que possible, l'infériorité de leur situation vis-à-vis de l'entrepreneur, et la[300] législation, devenue plus équitable, a cessé de le leur interdire. Il ont pu constituer des sociétés de résistance et des Trades Unions, lever des cotisations et former des caisses qui leur ont permis de suspendre leur offre beaucoup plus longtemps qu'ils ne pouvaient le faire dans l'isolement. Enfin, le progrès des moyens de communication leur a donné la possibilité de se déplacer avec plus de facilité, et de se soustraire ainsi au monopole qu'un petit nombre d'entrepreneurs tacitement coalisés faisaient peser sur eux dans la plupart des localités industrielles [24] . L'inégalité de situation des deux [301] parties s'est peu à peu atténuée, si elle n'a point entièrement disparu, et avec elle l'avantage essentiel que l'entrepreneur en tirait, savoir, l'avilissement abusif du salaire.
Mais si les avantages du système de la régie industrielle ont été s'affaiblissant, les inconvénients de ce système ont subsisté et se sont même aggravés. Le payement individuel des salaires exige une comptabilité compliquée, et surtout l'avance onéreuse d'une quantité considérable de capital circulant, réalisée en espèces monnayées. Si l'entrepreneur ne possède point ce capital, il est obligé de l'emprunter, et s'il ne jouit pas d'un crédit de premier ordre, il le paye cher. Si élevé que soit le taux de l'intérêt et de la prime qu'il déduit de la part de l'ouvrier dans les résultats de la production, en la lui avançant et en la lui assurant par le payement du salaire, on peut douter que celle opération de crédit et d'assurance lui procure toujours un bénéfice et qu'il n'eût pas clé plus avantageux pour lui de l'abandonnera un tiers mieux pourvu de capitaux disponibles. D'un autre: côté, s'il peut user et parfois même abuser de son autorité vis-à-vis de son personnel inférieur, il n'est pas en son pouvoir d'imposer aux ouvriers une responsabilité effective pour les' malfaçons, le gaspillage ou le vol des matières premières et les dommages causés aux machines par leur incurie ou leur mauvais vouloir. L'ouvrier est généralement insolvable, et il ne servirait pas à grand'chose de lui demander des dommages-intérêts. L'entrepreneur est obligé de le soumettre à une surveillance de tous les instants pour prévenir des manquements et des perles dont il suit d'avance qu'il ne pourra être dédommagé, et cette surveillance, si minutieuse et même si vexatoire qu'elle soit, a rarement toute l'efficacité nécessaire. Enfin, c'est dans le moment où l'entrepreneur a le plus besoin des ouvriers qu'il peut le moins compter sur eux, car c'est le moment qu'ils choississent d'habitude pour multiplier leurs exigences, raisonnables ou non, et, s'il refuse d'y céder, pour se mettre en grève. Ajoutez à tout cela l'hostilité croissante des ouvriers à l'égard des [302] entrepreneurs, le mauvais esprit qui les anime et dont l’ouvrage ne manque pas de se ressentir, et vous vous convaincrez que le système de la régie industrielle et des rapports directs et individuels de l'entrepreneur avec les ouvriers est loin d'être le plus parfait des systèmes.
Que ce système ne soit pas plus avantageux aux ouvriers, l'impopularité dont il est frappé l'atteste suffisamment. Nous avons remarqué plus haut que l'ouvrier, généralement dépourvu d'avances, se trouve vis-à-vis de l'entrepreneur dans une situation d'inégalité incompatible avec le règlement équitable des conditions du salaire. On peut ajouter que cette inégalité de situation des deux parties contractantes, tout en s'atténuant d'un côté, grâce à l'augmentation des facilités de communication, va s'aggravant d'un autre, à mesure que les progrès de l'industrie déterminent l'agrandissement des entreprises et que l'ouvrier se trouve non plus seulement en présence de simples entrepreneurs, mais de puissantes compagnies. S'il a recours aux coalitions temporaires ou permanentes, s'il s'affilie à des sociétés de résistance ou à des Trades-Unions pour faire contre-poids à la puissance de l'entrepreneur, il se trouve livré à la merci de meneurs, qui doivent leur influence, parfois aussi leurs moyens d'existence, aux luttes engagées contre les patrons, qui ont intérêt par conséquent à les multiplier et à empêcher l'en lente de se faire entre les parties. Cette entente, des esprits plus bienveillants que pratiques ont essayé de l'établir, en ressuscitant le patronage, c'est-à-dire en attribuant à l'entrepreneur vis-à-vis de l'ouvrier, un rôle de protection et de tutelle. Un certain nombre d'entrepreneurs se sont prêtés à ce rôle, ils ont créé et subventionné des caisses de secours et de retraites, organisé des sociétés alimentaires, mis à la disposition de leurs ouvriers des maisons ou des logements à bon marché, etc. Mais ces tentatives ont peu réussi, et même il est arrivé fréquemment que l'intervention bienveillante des patrons dans la vie et les affaires privées des ouvriers a suscité entre eux un [303] surcroit de difficultés et de conflits. C'est ce qui arrive chaque fois que l'on veut, même abonne intention, aller à rencontre de la nature des choses. En effet, les chefs d'industrie n'ont pas trop de toute leur intelligence, pour diriger utilement leurs entreprises sous la pression salutaire, mais toujours périlleuse de la concurrence ; à moins de négliger leurs propres affaires, ils ne peuvent s'occuper activement et efficacement de celles de leurs ouvriers. Leur philanthropie ne peut être qu'une affaire d'apparat; elle a de plus un vice qui lui est propre, c'est d'aggraver la situation des ouvriers dans le débat du salaire, en entravant la liberté de leurs mouvements. Quand des ouvriers sont affiliés à une caisse de secours ou de retraites subventionnée par le patron, quand ils ont fourni des acomptes sur le payement de leurs habitations, ils sont liés à l'établissement et ne peuvent porter leur travail ailleurs sans subir une perte. Ils sont moins libres, ils ont à un moindre degré la disponibilité de leur travail et se trouvent ainsi davantage à la merci des entrepreneurs. On s'explique donc que la philanthropie du patron n'ait pas la vertu de provoquer la reconnaissance des ouvriers : c'est qu'elle leur coule en réalité plus qu'elle ne leur rapporte, et cela, quels que soient le bon vouloir et le désintéressement des patrons philanthropes.
III. — Mais si le socialisme ne peut que prolonger en l'aggravant la guerre civile du capital et du travail, si la philanthropie est impuissante à la faire cesser, faut-il renoncer à l'espérance de voir la bonne entente et l'harmonie se rétablir entre ces deux fadeurs indispensables de la production ? Faut-il se résigner à laisser aller les choses et se lier uniquement à la force pour maintenir une paix précaire dans le domaine de l'industrie? Non! il y a certainement mieux à faire. Si, comme on vient de le voir, la cause des conflits du capital et du travail a un caractère purement économique, si elle réside dans les vices et les abus d'un système routinier et arriéré de coopération du capital et du travail, c'est à un progrès économique qu'il faut eu demander [304] le remède. Ce progrès consiste dans la substitution du marchandage à la régie industrielle.
Je n'ignore point que c'est là un progrès essentiellement impopulaire, comme le sont au surplus tous les progrès. Le marchandage implique le marchandeur, c'est-à-dire un intermédiaire entre l'entrepreneur d'industrie et l'ouvrier, et chacun sait que les intermédiaires ne sont pas en odeur de sainteté auprès de la généralité du public imbu d'idées socialistes. Le marchandeur en particulier est la hôte noire de l'ouvrier, et, dans toutes les industries où le marchandage existe déjà, on en réclame la suppression, comme autrefois on réclamait celle des marchands de grains qualifiés d'accapareurs et d'affameurs du peuple. Mais les griefs que l'on fait valoir contre le marchandage, de même que ceux qu'on élevait contre le commerce des grains, tiennent non point à ce qu'il y a trop de marchandeurs, mais à ce qu'il n'y en a pas assez. Ils tiennent encore et surtout à ce que les préjugés subsistants et même croissants contre le marchandage en éloignent les capitaux comme ils les éloignaient, il n'y a pas bien longtemps encore, du commerce des grains. Les marchandeurs, peu nombreux et ne disposant que de faibles ressources, exploitent les ouvriers, pour nous servir de l'expression consacrée, en abusant de leur imprévoyance, et ils n'offrent aux entrepreneurs que des garanties insuffisantes.
Mais supposons que le marchandage cesse d'être frappé d'un discrédit immérité, qu'il attire les capitaux et vienne à se développer, et voyons quel sera son rôle.
On peut concevoir l'introduction de ce nouveau rouage dans l'organisme de la production sous la forme de simples entreprises de placement des ouvriers ou d'exécution de travaux à forfait ou en participation. Nous avons esquissé ailleurs, et nous reproduisons plus loin le plan d'une société déplacement à bénéfices limités. C'est la forme élémentaire du marchandage, savoir, le placement avec garantie. Mais on peut admettre que des sociétés pourvues de capitaux suffisants [305] ne se bornent pas simplement à faire avec les ouvriers, d'une part, avec les entrepreneurs de l'autre, des contrats pour la fourniture du travail ; qu'elles se chargent de l'exécution des travaux des mines ou des manufactures, soit de l'extraction d'une certaine quantité de charbon ou de minerais, de la filature, du tissage et des.autres opérations de la fabrication des étoffes, à un prix convenu. Ce système de marchandage est déjà appliqué sur une grande échelle dans la construction des chemins de fer, des canaux, etc.
À Panama, par exemple, la Compagnie n'exécute elle-même en régie que la plus faible partie des travaux du percement de l'isthme. Elle a divisé et réparti les travaux entre une série d'entrepreneurs qui ne sont autre chose que des marchandeurs, et qu'elle paye au fur et à mesure des travaux exécutés. Ce mode de payement est le seul que comporte ce genre de travaux. Mais, s'il s'agissait d'une industrie minière, manufacturière ou agricole, le marchandeur, en le supposant pourvu des capitaux nécessaires, pourrait, au lieu d'une rétribution fixe, se contenter d'une participation, en débarrassant ainsi complètement l'entrepreneur du rôle de banquier et d'assureur du travail, et en simplifiant économiquement l'organisation et la gestion de l'entreprise.
IV. — Quelles que soient, au surplus, les formes sous lesquelles so présente l'inlermédiaire entre le capital et le travail, et les conditions de son intervention — et ces formes et conditions peuvent être très variées, — on peut aisément se rendre compte des avantages qu'il offrirait aux entrepreneurs d'industrie et aux ouvriers, tout en écartant les causes qui provoquent aujourd'hui la guerre civile du capital et du travail.
Si l'entrepreneur avait affaire à un marchandeur ou à une société de marchandage pour l'exécution des travaux qu'il exécute aujourd'hui en régie, il cesserait d'être directement en contact avec les ouvriers. C'est avec l'entreprise de marchandage qu'il débattrait les prix du travail, c'est à elle qu'il aurait recours pour les malfaçons, les négligences, l’inexactitude [306] et les retards dans l'exécution des travaux, et ce recours cesserait d'être illusoire; en outre, il ne serait plus obligé de payer le travail en espèces et à court délai ; il le payerait comme la plupart des autres matériaux dont il a besoin, à terme et en billets escomptables. Son rôle serait simplifié et sa situation sensiblement améliorée. Les ouvriers, de leur côté, pourraient-ils encore se plaindre d'être exploités par l'entrepreneur? Le prix du travail, débattu entre une société de marchandage bien pourvue de capitaux et un entrepreneur d'industrie, ne se fixerait-il point désormais dans des conditions de parfaite égalité?
Bref, c'est à un « progrès naturel » dans l'organisation et la mise en oeuvre des entreprises, et non pointa des combinaisons purement artificielles et arbitraires qu'il faut demander la solution des difficultés qui engendrent aujourd'hui la guerre civile du capital et du travail. Ajoutons que ce progrès s'accomplira aussitôt que les préjugés populaires servant d'auxiliaires à la routine cesseront d'entraver la substitution économique du marchandage à la régie industrielle.
(Journal des Économistes, juillet 1886.)
[307]
II.
Le marchandage. — Projet d'une société à bénéfices limités pour le placement des ouvriers.↩
Les progrès du matériel et de la constitution de l'industrie, l'avènement de la liberté du travail et lé développement extraordinaire des moyens de communication ont complètement changé, depuis un siècle, les conditions de placement du travail. Sous l'ancien régime, et même longtemps après l'abolition du servage qui retenait les travailleurs attachés à la glèbe, le peu de développement de l'industrie, l'insuffisance dès moyens de transport et d'informations empêchaient les ouvriers de porter leur travail en dehors des limites étroites du marche local. Certaines catégories d'artisans et notamment les ouvriers en bâtiment, qui ne trouvaient point, dans le marché de la localité, un débouché régulier et suffisant, étendaient davantage la sphère de leurs opérations ; ils allaient bâtir des édifices religieux et des habitations seigneuriales dans les différentes parties du pays ; depuis un temps immémorial, ils avaient institué des sociétés de compagnonnage qui leur fournissaient, avec une mutualité de protection, les moyens de louer leurs services aux meilleures conditions et même de se loger et de se nourrir aux moindres frais dans les localités où ils portaient leur industrie; mais ces ouvriers que la nature particulière de leur profession obligeait à se déplacer ne formaient, en comparaison de la masse, qu’une [308] fraction insignifiante : chacun vivait et travaillait dans l'endroit où il était né, le déplacement était l'exception.
A mesure que l'industrie s'est développée et surtout depuis la révolution occasionnée par l'application de la vapeur au transport des hommes et des choses, tous les marchés se sont agrandis, y compris le marché du travail. La création de vastes manufactures remplaçant les petits ateliers, l'exploitation des - mines avec des machines de plus en plus puissantes, enfin l'établissement d'un immense réseau de voies de communication perfectionnées, ont exigé fa concentration permanente ou temporaire d'un personnel nombreux pourvu d'aptitudes diverses. Ce personnel, attiré par l'élévation momentanée des salaires dans des endroits où la demande de travail dépassait l'offre, arrivait de tous les points de l'horizon, ici des campagnes, là des localités que l'industrie abandonnait pour se placer dans des conditions mieux adaptées à ses progrès; mais ce recrutement se faisait le plus souvent au hasard, sans directions suffisantes ni informations positives. L'affluence ne s'arrêtait presque toujours qu'après que le marché se trouvait encombré de bras et que le prix du travail venait à baisser au-dessous de la limite des nécessités de la vie. Alors l'excédent refluait péniblement et lentement vers les marchés voisins, ou, s'il ne parvenait pas à s'écouler, il formait une mare stagnante de travail sans emploi dont l'offre au rabais pesait sur le cours du travail employé. En outre, ces masses ouvrières à peine sorties d'une tutelle séculaire et agglomérées dans un milieu nouveau où elles subissaient le contre-coup de toutes les crises, avaient à faire le difficile apprentissage de la liberté. Cet apprentissage s'est fait peu à peu, mais il a été accompagné de toutes les souffrances que peuvent engendrer l'ignorance et l'imprévoyance: une dure expérience a enseigné aux ouvriers, désormais responsables de leur destinée et de celle de leur famille, la nécessité de s'assurer contre les chômages, les maladies et les accidents au moyen de l'épargne; ils ont appris aussi à s'unir pour défendre leurs intérêts, mais il[309] leur manque encore, pour placer leur travail aux meilleures conditions que comportent les circonstances, la connaissance du marché et les moyens de l'exploiter commercialement.
Cette connaissance et ces moyens, il i peuvent les acquérir isolément, livrés à leurs propres ressources. On a dit avec raison que le travail est une marchandise comme une autre, mais toute marchandise est l'objet de deux sortes d'opérations complètement distinctes ; elle doit être produite, ce qui est l'affaire de l'industrie; elle doit être mise au marché dans le moment et dans l'endroit où elle est le plus demandée, où par conséquent elle peut être vendue avec le plus de profit ; ce qui est l'affaire du commerce. L'industrie et le commerce sont aujourd'hui généralement séparés : l'agriculteur produit le blé, et c'est le marchand de grains qui se charge de le porter sur le marché le plus avantageux ; le fabricant de tissus livre ses produits au marchand de nouveautés, qui les met à la portée du consommateur; enfin, le producteur de capitaux, le capitaliste, place le plus souvent ses économies par l'intermédiaire des banques. Seul, l'ouvrier est encore réduit à cumuler les fonctions de producteur et de marchand de travail. Or ces deux sortes de fonctions exigent des aptitudes et des connaissances fort différentes ; de plus, dans l'état actuel des choses, l'ouvrier, abandonné à lui-même, se trouve dans l'impossibilité presque absolue d'exploiter commercialement ses services. Un mécanicien, un fileur, un tisserand connaît bien son métier : c'est un bon producteur de travail; mais peut-il savoir où ses services sont le plus demandés, où ils seraient le mieux rétribués? Il ne connaît que le marché naturellement restreint de la localité dans laquelle il se trouve établi, et quand même il apprendrait que les salaires sont plus élevés ailleurs, possède-t-il les relations, les connaissances et les ressources nécessaires pour metlre celle information à profit? Tout déplacement est coûteux; est-il sage de s'exposer sur la foi d'un simple renseignement à perdre une situation, si insuffisante qu'elle soit, en vue d'une amélioration problématique?
[310]
L'ouvrier, surtout lorsqu'il est chargé de famille, se trouve donc immobilisé dans le marché local, et est-il bien en position d'obtenir dans ce marché étroit, le salaire le plus élevé possible? Il est en présence d'un petit nombre d'entrepreneurs d'industrie qui, sauf le cas de commandes urgentes, sont moins, presses d'acheter sa marchandise qu'il n'est pressé de la vendre, et il est bien rare que le cours qui s'établit ainsi, quand il n'y a point parité de situation entre celui qui offre et celui qui demande, soit la représentation du cours naturel de la marchandise. N'en serait-il pas autrement si l'ouvrier avait à son service le rouage commercial et financier grâce auquel lo prix des produits agricoles ou industriels et le taux de l'intérêt des capitaux se règlent déplus en plus d'après un cours général sur lequel la situation respective des parties en présence n'exerce aucune influence et qui dépend uniquement des quantités offertes et demandées dans l'ensemble des marchés que la vapeur et l'électricité mettent aujourd'hui en communication?
Ce rouage nécessaire a commencé déjà à s'établir. Un certain nombre de professions ont à leur service des bureaux ou des agences de placement; en outre, la plupart des associations ouvrières, notamment en Angleterre, se chargent de placer leurs affiliés, de débattre les conditions de leur rétribution, de fixer et même d'imposer aux deux parties les tarifs qu'elles ont rédigés; enfin, les journaux servent d'intermédiaires aux demandes et aux offres d'emplois de tous genres.
C'est le commencement de la séparation des fondions du producteur et du marchand chez l'ouvrier, et de la création du commerce du travail; mais, comme toute création à son origine, celle-ci est grossière et imparfaite. Les bureaux et les agences de placement, soumis à Paris notamment, à l'arbitraire de la police, sont fondés et exploités, en général, par un personnel peu recommandable et qui ne dispose point d'ailleurs des capitaux nécessaires pour étendre le marché de sa clientèle; les associations ouvrières sont presque toujours animées d'un esprit d'hostilité à l'égard des chefs [311] d’industrie; elles apportent dans le débat du salaire, c'est-à-dire dans une opération qui devrait avoir un caractère purement commercial, les passions et les procédés de la guerre; quant à la publicité des journaux, elle ne répond qu'imparfaitement aux besoins de ceux qui y ont recours faute de mieux, et elle est trop chère pour être accessible au grand nombre.
Maintenant que les obstacles naturels ou artificiels qui s'opposaient jadis à ce qu'on pourrait appeler la « mobilisation du travail » sont en grande partie levés, maintenant que l'homme a cessé d'être « de toutes les espèces de marchandises la plus difficile à transporter », suivant l'expression d'Adam Smith, n'y a-t-il pas lieu de développer et de perfectionner le mécanisme du placement du travail, au double avantage des ouvriers qui le produisent et des entrepreneurs d'industrie qui l'emploient?
Ce progrès n'a rien d'utopique, et nous croyons qu'on peut le réaliser dès à présent en mettant au service du travail le puisant instrument de la Société par actions, sous une forme appropriée à cette nouvelle destination.
Supposons, en effet, qu'une Société soit fondée avec un capital suffisant pour remplir sur une échelle plus étendue et au moyen de ressources plus considérables, les fonctions d'une agence de placement, examinons quels, services elle sera en mesure de rendre aux ouvriers et aux patrons auxquels elle servira d'intermédiaire.
En bornant d'abord son activité à un petit nombre de professions, elle pourra aisément acquérir la connaissance exacte et régulière de la situation du marché ouvert à ces professions dans leurs principaux foyers, de l'état de l'offre et de la demande et du taux des salaires. Elle offrira aux ouvriers de se charger pour eux de débattre avec les patrons les conditions de leur engagement, en s'assurant d'abord de leur capacité et de leurs antécédents. Grâce aux succursales et aux agences qu'elle établira dans les différents centres d'industrie, elle disposera bientôt d'un débouché plus étendu que celui qui est accessible aux ouvriers isolés, et elle pourra[312] faire passer ainsi d'une localité dans une autre les travailleurs sans ouvrage, en leur accordant au besoin les avances nécessaires. Elle s'efforcera naturellement de procurer à sa clientèle les meilleures conditions possibles de placement, et elle sera beaucoup mieux qu'ils ne pourraient l'être eux-même individuellement, en position de les obtenir. En premier lieu, elle ne sera point obligée, comme il arrive trop souvent aux ouvriers, de céder à tout prix, sous l'aiguillon de la nécessité du moment, le travail dont elle dispose ; elle pourra attendre. En second lieu, elle offrira aux patrons des garanties et des facilités que les ouvriers isolés ne peuvent leur apporter; elle s'appliquera, dans l'intérêt- même de sa bonne réputation et du développement de sa clientèle, à ne traiter qu'avec des ouvriers capables et consciencieux, sur lesquels elle exercera une surveillance constante et dont elle stimulera le zèle par des récompenses et des avantages particuliers ; elle se chargera, au besoin, de garantir lés patrons contre les malfaçons, le gaspillage ou le vol des matières premières; elle remplacera les ouvriers inhabiles, négligents ou paresseux; enfin, elle pourra accorder des crédits pour le payement des salaires, tout en exonérant les patrons des embarras de la paye individuelle. Tandis que l'ouvrier touchera son salaire chaque semaine ou même Chaque jour, suivant sa convenance, à la caisse de la Société, elle pourra accorder au chef d'industrie des crédits analogues à ceux qu'il obtient pour le payement des matériaux ou des instruments de sa fabrication. Il trouvera donc, en s'abouchant avec elle, des avantages que le système actuel de l'enrôlement direct ne peut lui procurer, et ces avantages, quand il aura pu les apprécier, il n'hésitera pas à les acheter au prix d'une augmentation de salaire. Est-il nécessaire d'ajouter que du moment où l'ouvrier cessera de traiter directement avec le patron et de recevoir de lui son salaire, où toutes les difficultés et contestations auxquelles pourra donner lieu la livraison du travail seront réglées par un tiers, la mutuelle .hostilité qui résulte de ce contact immédiat et incessant de [313] deux intérêts opposés cessera de se produire et que la bonne entente renaîtra d'elle-même entre les entrepreneurs d'industrie et les ouvriers ? Si le travail livré est de mauvaise qualité, si la conduite de l'ouvrier à l'atelier est répréhensible, c'est à la Société que s'adresseront les réclamations, et c'est elle qui se chargera d'y faire droit, soit en déplaçant l'ouvrier, soit même en l'excluant de sa clientèle.
Sans doute la Société ne pourra toujours préserver les ouvriers du chômage, mais, grâce au système d'informations qu'elle aura organisé, aux succursales et aux agences qu'elle aura établies, elle sera du moins en mesure de leur procurer en tout temps toute la quantité de travail disponible dans la sphère de son activité, comme aussi de garantir aux chefs d'industrie une fourniture régulière qui leur fait trop souvent défaut.
Mais la Société rendra encore d'autres services aux ouvriers : sans parler des avances qu'elle pourra leur faire en cas de déplacement ou en d'autres circonstances, avances pour lesquelles elle devra, à la vérité, se montrer particulièrement circonspecte, elle remplira auprès d'eux l'office d'une agence générale d'affaires; dans le cas où une entreprise exigerait l'apport immédiat d'une certaine quantité de travail, elle pourra demander des réductions sur les prix ordinaires de la locomotion pour des trains spéciaux d'ouvriers; elle se préoccupera de la sécurité et de k salubrité des ateliers, en renonçant même à traiter avec les patrons qui se refuseraient à faire à cet égard les améliorations nécessaires; elle se mettra en relation avec les propriétaires, les logeurs, les restaurants, les épiciers,.pour procurer à ses clients des logements plus sains et à meilleur marché, une nourriture plus substantielle et moins frelatée; elle se chargera encore de leur fournir des moyens d'instruction ou de délassement, et, en cas de maladie, de leur faciliter l'entrée dans les hôpitaux ou les maisons de santé; enfin elle s'appliquera à les préserver des tentations et des abus dont leur ignorance, leur faiblesse, leur isolement, les rendent si fréquemment victimes.
[314]
En admettant que les Sociétés de ce genre vinssent à se multiplier et que le commerce du travail s'organisât et se développai comme se sont organisées et développées toutes les autres branches de commerce, en y comprenant le commerce des capitaux, quel serait le résultat? C'est d'abord que le prix du travail se réglerait partout sur le cours du marché, sans être influencé par les circonstances locales et la situation particulière de l'ouvrier ou du patron ; que ni l'un ni l'autre ne pourrait plus se plaindre d'être « exploité », pas plus que le fabricant de cotonnades, par exemple, ne peut se plaindre d'être exploité par le négociant qui lui vend le colon et les autres matières premières de son industrie : c'est le prix du marché général du travail qui servirait de régulateur, et ce prix serait déterminé, comme Celai de toute autre marchandise, uniquement par l'étal de l'offre et de la demande. A ce résultat principal viendraient s'ajouter d'une part, une possibilité plus grande d'éviter ici les encombrements de travail qui avilissent le taux des salaires, là les déficits qui l'exhaussent soudainement pour le faire retomber plus tard avec non moins de rapidité; d'une autre part, une amélioration graduelle des conditions matérielles et morales de l'existence de l'ouvrier, assuré désormais de trouver aide et protection dans toutes les circonstances de la vie.
C'est en vue de créer ce rouage qui manque encore à notre nouveau régime industriel que nous nous proposons de fonder sous ce titre ; Le Travail, une société à bénéfices limités de placement des ouvriers. On trouvera ci-après un extrait des statuts, définissant l'objet de cette Société, et exposant quelques-unes des dispositions particulières de sa constitution, en tant du moins qu'elles pourront se concilier avec les entraves qu'opposent au progrès de l'association commerciale les lois existantes sur la matière. .
Nous nous bornerons à présenter au sujet du mode de constitution qui nous a paru le mieux adapté à une société destinée à servir d'intermédiaire entre les ouvriers et les patrons, quelques brèves observations :-
[315]
1° Tout en adoptant la forme ordinaire de la société anonyme, nous avons emprunté à l'association coopérative le principe de la limitation des profits des actionnaires et de la répartition de l'excédent à la clientèle. Nous limitons à 12 0/0 le taux des profits que pourra s'attribuer la Société, bien que la nouveauté de l'entreprise, les obstacles inévitables qu'elle devra surmonter et les risques particuliers qu'elle subira à cause de celle nouveauté, puissent justifier et nécessiter même des bénéfices plus élevés; mais nous voulons éviter l'accusation qu'on ne manquerait pas de nous adresser, « d'exploiter » notre clientèle, dussions-nous retarder ainsi le développement ultérieur de l'entreprise. La Société réduira donc au taux le plus bas possible le prix de ses services, et elle distribuera à sa clientèle l'excédent qu'elle aura réalisé, ou si cet excédent est insuffisant pour être distribué, elle l'appliquera à améliorer ses services et en abaisser le prix ; en tous cas, la rétribution de ses capitaux et de son industrie ne pourra jamais dépasser un maximum de 12 0/0.
2° Nous attribuons aux fondateurs une participation active au gouvernement de la Société, à la bonne gestion de laquelle ils sont d'autant plus intéressés que nous subordonnons entièrement la rétribution légitime qui leur est due au succès de l'affaire. L'expérience a suffisamment démontré les vices et les abus du mode actuel de fondation et de constitution des sociétés anonymes. Ces vices et ces abus pourront être en grande partie évités, au moyen de l'intervention des fondateurs, intéressés autant que les actionnaires eux-mêmes à la bonne gestion de l'entreprise, et généralement plus compétents.
3° Enfin, en rendant les actions de la Société divisibles en coupures de 100 francs— autant du moins que cette division est compatible avec la législation actuelle, nous avons voulu qu'une entreprise fondée principalement dans l'intérêt des ouvriers pût devenir à la longue, au moins pour une bonne part, leur propriété. A la longue, disons-nous, car nous ne les engageons pas à mettre dès à présent leur, modeste [310] épargne dans une affaire exposée aux risques attachés à toute entreprise nouvelle. C'est aux capitaux des classes aisées que nous faisons appel, et nous espérons que le désir de contribuer à la fondation d'une institution destinée à pacifier les rapports de l'entrepreneur d'industrie et de l'ouvrier, et à améliorer le sort de la classe la plus nombreuse, bien plus encore que l'appât d'un bénéfice, décidera les capitalistes intelligents et de bonne volonté à répondre à cet appel.
Extrait des statuts.
Article 1er. — Il est formé entre les fondateurs et les propriétaires des actions ci-après créées, une Société anonyme ayant pour dénomination : LE TRAVAIL, Société à bénéfices limites de placement des ouvriers.
Art. 3. — La Société a pour objet :
1° D'entreprendre le placement de certaines catégories d'ouvriers et d'ouvrières à déterminer par le conseil d'administration, moyennant une commission et sous des conditions spécifiées par lui.
2° Après avoir constaté la moralité et la capacité professionnelle de l'ouvrier ou de l'ouvrière et avoir fait une enquête sur ses antécédents, la Société pourra se charger, soit de lui procurer du travail, soit de l'engager pour un temps plus ou moins long.
3° Les renseignements recueillis seront consignés dans un dossier, où l'on consignera aussi au fur et à mesure, les informations sur le travail et la conduite de l'ouvrier aussi longtemps qu'il se servira de 3'intermédiaire de la Société ou qu'il demeurera à son service. Les actes de l'état civil de l'ouvrier pourront y être joints et demeureront à sa disposition. La Société délivrera à l'ouvrier un livret portant le numéro de son dossier, renfermant sa photographie et pouvant au besoin lui servir de passeport. Ce livret sera visé par un agent de la Société à chaque changement d'atelier, et clôturé lorsque le porteur renoncera à se servir de l'intermédiaire de la Société.
[317]
4° Aussitôt que l'ouvrier sera admis à faire partie de la clientèle de la Société, celle-ci s'efforcera de placer son travail aux meilleures conditions possibles; l'ouvrier restera toujours lo maître d'accepter ou de refuser les conditions qui lui seront offertes; la Société, de son côté, demeurera toujours maîtresse de renoncer à lui servir d'intermédiaire et de clôturer son livret sans avoir à lui rendre compte des motifs de sa décision.
5° La Société s'abouchera avec les entrepreneurs d'industrie pour le placement des ouvriers qui auront accepté son intermédiaire ou qu'elle aura engagés ; elle organisera dans ce but un système de publicité, de succursales ou d'agences, destiné à lui faire connaître, jour par jour, l'état du marché du travail, le mouvement de l'offre et de la demande, létaux du salaire, la durée de la journée, le prix de la vie dans toute la sphère de son activité. Ses opérations pourront s'étendre à la foison France et à l'étranger; elles n'établiront de même entre les ouvriers aucune distinction de race, de couleur ou de nationalité. La Société décidera toutefois, en tenant compte de la nature des professions, de l'âge auquel elle se chargera du placement du travail des enfants, en se réservant de refuser son intermédiaire aux ouvriers qui exploiteraient au-dessous de la limite fixée par elle, le travail de leurs enfants.
6° La Société offrira le travail des ouvriers ses clients et recevra les demandes des entrepreneurs d'industrie ; elle débattra avec ceux-ci, au lieu et place de ses clients, les conditions du salaire, taux, durée de la journée, mode de payement, etc. Avant la conclusion du marché, ses agents visiteront les ateliers, ils s'enquerront des conditions de sécurité et de salubrité, ils prendront connaissance du règlement ou des Usages de l'atelier, et ils communiqueront ces renseignements à la Société, qui en fera part à ses clients. Le marché conclu, les agents de la Société seront chargés de toucher, aux termes spécifiés dans le contrat, le montant des salaires, ils recevront et consigneront dans leurs carnets les observations de [318] l'entrepreneur ou de ses contre-maîtres sur la conduite et le travail des ouvriers. En cas de renvoi pour incapacité ou mauvaise conduite, ils décideront s'il y a lieu de chercher un autre emploi pour le client renvoyé, ou de l'exclure de la clientèle de la Société ; dans ce cas, il pourra toujours être fait appel de leur décision auprès de la direction de la succursale ou de l'agence, et, en dernier ressort, auprès de la direction de la Société.
Les notes, bonnes ou mauvaises sur la conduite et le travail de l'ouvrier, après avoir été duement contrôlées, seront transmises au siège de la Société et insérées à son dossier. Des primes et des récompenses honorifiques sous forme d'insignes, etc., pourront être accordées aux ouvriers qui se seront distingués parleur zèle, leur assiduité au travail et leur bonne conduite.
7° La Société pourra faire aux ouvriers le payement des salaires qui leur seront acquis, à la semaine, à la journée ou autrement, en anticipant au besoin sur les payements des patrons. Elle pourra, d'un autre côté, accorder des délais de payement aux patrons, s'ils lui présentent des garanties suffisantes et dans la mesure de ses ressources disponibles. La Société pourra encore se porter garant vis à vis des patrons pour les malfaçons et autres manquements commis par les ouvriers, sauf à exercer son recours contre ceux-ci; enfin elle pourra se charger, à forfait, de l'exécution de certains travaux agricoles, industriels ou autres.
8° La Société pourra se charger, moyennant une commission supplémentaire, de rendre aux ouvriers ses clients tous les services pour lesquels ils réclameront ses bon s offices : recherche de leurs actes d'état civil, mise en règle pour le service militaire, procès, payement des impôts, placement dé leurs économies aux caisses d'épargnes, aux assurances sur la vie, achat de valeurs mobilières, etc.; elle pourra encore s'occuper de leur procurer la nourriture et le logement aux meilleures conditions, en faisant des conventions particulières avec les propriétaires, logeurs, restaurants., [319] magasins d'épiceries et de denrées, et en exerçant une surveillance et un contrôle sur les fournitures : elle pourra intervenir pour leur procurer des secours médicaux, les placer dans des hôpitaux, des maisons de santé, des hospices et des maisons de refuge, comme aussi pour leur procurer des délassements dans les jours de repos ; elle pourra conclure des arrangements avec les compagnies de chemins de fer et les autres entreprises de locomotion pour le transport des ouvriers et de leur famille dans le cas où leur déplacement serait exigé par l'état du marché; enfin, dans ce cas et dans d'autres dont le conseil d'administration sera juge, elle pourra, en se conformant aux règles de la prudence la plus stricte, faire aux ouvriers ses c1ients des avances sur leur travail futur.
(Revue du mouvement social, 1880.)
[320]
III.
Projet d'émancipation des esclaves au Brésil.↩
Si nous consultons l'histoire de l'émancipation, nous trouvons que l'esclavage a été aboli tantôt par voie d'insurrection et de guerre, comme'à Haïti et aux États-Unis, et que celle solution violente d'un problème d'humanité a entraîné la ruine des propriétaires, sans élever sensiblement la condition matérielle et le niveau moral de la population émancipée ; tantôt par voie de rachat, comme dans les colonies anglaises et françaises, et que cette seconde solution, quoique bien préférable à la première, est loin cependant d'avoir répondu aux espérances des économistes et des amis de l'humanité. Malgré les sacrifices onéreux qu'elle a imposés aux contribuables des métropoles, elle a entraîné le déclin des cultures et l'appauvrissement, sinon la ruine, de la grande majorité des propriétaires, tout en réduisant les anciens esclaves à une condition si précaire que dans plusieurs colonies, la race nègre a diminué en nombre et menace de s'éteindre.
I1 importe de tenir compte de ces expériences et de profiler des leçons qu'elles contiennent, en se gardant de commettre des fautes qui étaient peut-être inévitables au début de l'émancipation, mais qui peuvent aujourd'hui aisément être évitées.
Trois intérêts sont à considérer dans l'oeuvre qu'il s'agit de mener à bonne fin: 1° l'intérêt des propriétaires d'esclaves-; [321] 2° l'intérêt des esclaves; 3° l'intérêt du pays. Examinons rapidement en quoi ils consistent et ce qu'ils demandent.
I. L’intérêt des propriétaires d'esclaves. — L'intérêt des propriétaires de plantations n'est attaché au régime de l'esclavage qu'autant qu'il leur procure la quantité de travail nécessaire à leurs cultures, avec plus de régularité et à meilleur marché que ne le ferait lé régime de la liberté du travail. Si ces avantages économiques n'existaient point, ils auraient au contraire des raisons déterminantes de préférer les ouvriers libres aux esclaves. Ils sont obligés d'acheter ou d'élever, d'entretenir, de surveiller, de gouverner leurs esclaves, et cette tutelle, sans parler du danger des révoltes et des pertes causées par les esclaves marrons, leur cause des frais, des embarras et des soucis de tout genre. Ils n'ont au contraire à s'occuper en aucune manière de l'existence des ouvriers libres; toutes leurs obligations envers eux se réduisent au payement exact du salaire convenu. Ils n'ont pas à s'inquiéter de la façon dont l'ouvrier dépense son salaire et gouverne son existence. C'est son affaire, ce n'est plus la leur.
Pourquoi donc les propriétaires de plantations, dans le nouveau monde et principalement dans les régions tropicales, ont-ils consenti à faire les frais de l'achat ou de l'élève des esclaves et à subir les embarras, les soucis et les dangers qu'entraîne le gouvernement d'un troupeau d'hommes à peine sortis de l'état sauvage, au lieu de recourir à des ouvriers libres? Tout simplement parte qu'ils ne pouvaient se procurer en nombre suffisant des ouvriers libres propres aux cultures tropicales. Dans les régions tempérées du nouveau monde l'esclavage n'a été qu'un fait accidentel et exceptionnel: aussitôt que les émigrants libres de race blanche ont pu arriver en Amérique et s'y multiplier assez pour répondre à la demande de travail, l'esclavage a été abandonné, pourquoi? parce que l'expérience ne tardait pas à démontrer que, dans ces conditions, le travail esclave revient plus cher que le travail libre. Mais il en était autrement dans les régions chaudes où les ouvriers de race blanche ne pouvaient s'acclimater, [322] ou pour mieux dire ne pouvaient s'adapter aux cultures. A moins de renoncer à exploiter ces régions les plus fertiles du globe, il fallait se procurer des travailleurs qui pussent s'y acclimater et s'y multiplier sans dégénérer. Ces travailleurs, que l'on ne trouvait pas en Europe, on les demanda à l'Afrique. Mais en Afrique on ne pouvait se procurer que des esclaves. Les hommes libres, vivant de chasse ou de pillage, ne se seraient point décidés volontairement à émigrer pour aller se livrer à un travail pénible et régulier dans le nouveau monde. Il ne possédaient point d'ailleurs, y eussent-ils consenti, les avances nécessaires pour subvenir aux frais de leur émigration, et le crédit n'était point assez développé à cet époque pour leur fournir ces avances sur l'hypothèque de leur travail. L'importation et l'exploitation du travail esclave s'imposaient donc comme des nécessités, par suite de l'impossibilité de se procurer du travail libre.
Mais cette impossibilité a cessé d'exister aujourd'hui. Grâce aux progrès de la navigation, l'émigration libre a pris depuis un demi-siècle un développement extraordinaire. Non seulement les travailleurs de race blanche traversent l'Océan, par centaines de milliers, en vue d'améliorer leur sort, mais les coolies de l'Inde et de la Chine se répandent en nombre croissant dans les îles de l'océan Indien, en Australie et en Amérique. C'est au point que les gouvernements démocratiques de l'Australie et des États-Unis, cédant aux injonctions populaires, ont limité ou interdit cette importation de travail de couleur, qui fait concurrence au travail blanc. On peut donc se procurer dans le vas le réservoir d'hommes du continent asiatique, toute la quantité de travail libre nécessaire pour mettre en valeur les immenses richesses naturelles du continent du sud. Reste, à la vérité, la difficulté de pourvoir aux frais d'émigration d'hommes dépourvus, pour la plupart, de tout capital. Cette difficulté a été résolue jusqu'à présent par le système de l'engagement, qui a renouvelé en les aggravant même, les excès et les horreurs de la traite. Mais, comme nous le verrons plus loin, on pourrait remplacer avec [323] avantage ce système grossier et vicieux, moyennant des garanties légales aisées à établir, par une combinaison de l'hypothèque cl de l'assurance appliquées au travail.
En supposant que l'émigration opérée par cette méthode introduise au Brésil une quantité de bras suffisante pour répondre à la demande de travail et assurer la culture régulière des plantations, sans exiger des propriétaires une dépense supérieure à celle que leur occasionne actuellement l'entretien de leur ateliers, et en leur épargnant les embarras et les soucis de la surveillance et du gouvernement des esclaves, n'est-il pas évident que les propriétaires cesseraient non seulement d'être intéressés à la conservation de l'esclavage, mais encore que la substitution du travail libre au travail esclave, opérée dans, ces conditions, leur serait visiblement avantageuse?
IL L'intérêt des esclaves. — Si la justice et l'humanité commandent de ne point abandonner un homme à la merci d'un autre homme, en lui enlevant tous ses droits pour ne lui laisser que des devoirs, ce serait cependant une illusion funeste de s'imaginer que l'émancipation ait la vertu de conférer à l'esclave toute la capacité dont l'homme libre a besoin pour se gouverner lui-même et supporter entièrement" la responsabilité attachée à la liberté. L'expérience a prononcé à cet égard. Sauf de rares exceptions, le nègre ne possède encore qu'une partie des qualités morales indispensables à l'homme pour gouverner sa vie sans nuire à lui-même et aux autres. Il est naturellement imprévoyant et trop facilement accessible aux tentations. Il a besoin d'une tutelle, et il en a si bien le sentiment qu'on a vu fréquemment des esclaves émancipés regretter la rude et onéreuse tutelle de la servitude. Le problème à résoudre en ce qui le concerne consisterait à le dégager des liens de l'esclavage, sans néanmoins le contraindre à subir-une responsabilité qu'il est le plus souvent incapable de supporter, et ce problème n'est nullement insoluble.
III. L'intérêt du pays. — Enfin, le pays est intéressé à ce [324] que la question d'esclavage, qui est devenue une cause permanente d'agitation et d'inquiétudes, soit résolue le plus promptement possible. Il est intéressé aussi et plus encore à ce que cette solution ne compromette point le développement de sa richesse et de sa civilisation, et n'impose point au Trésor public de trop lourds sacrifices.
Nous croyons que le plan d'émancipation dont nous allons exposer brièvement l'économie donnerait pleine satisfaction à ces divers intérêts, en épargnant au Brésil la crise désastreuse par laquelle ont passé toutes les contrées où l'esclavage des nègres a été aboli.
L'entreprise de l'émancipation serait confiée parle gouvernement brésilien aune Compagnie, qui se chargerait de l'exécuter et de la mener à bonne fin, moyennant une simple garantie de 6 p. 100 sur son capital effectivement versé.
Cette Compagnie s'aboucherait avec les propriétaires de plantations ou de cultures desservies par des esclaves et leur ferait les propositions suivantes:
1° Elle s'engagerait à leur fournir d'une manière régulière et assurée l'équivalent de la quantité de travail qu'ils retirent aujourd'hui de leurs ateliers d'esclaves, ou, ce qui revient au même, elle se chargerait d'effectuer toutes les opérations de la culture des terres actuellement en exploitation.
2° En échange, la Compagnie ne demanderait point aux propriétaires une rétribution en argent, qu'ils seraient, dans la situation présente, incapables de lui fournir ; elle leur demanderait simplement une pari dans le produit éventuel de la récolte. Cette part serait fixée de gré à gré comme dans le métayage ordinaire.
Elle serait plus ou moins forte selon que la quantité du travail requis pour l'exploitation serait plus ou moins considérable. Elle serait à son maximum dans les plantations dont l'outillage est arriéré, où par conséquent le travail de l'homme entre pour la plus grande part dans les opérations de la production. Elle serait au contraire beaucoup moindre dans les plantations pourvues d'un capital d'exploitation [325] suffisant, et disposant d'un matériel perfectionné, où par conséquent la part du travail serait plus restreinte. Les propriétaires se trouveraient ainsi intéressés à perfectionner incessamment leur outillage, en vue d'augmenter leur tantième proportionnel dans le produit, tandis que la Compagnie, de son côté, serait intéressée à aménager de la manière la plus efficace et la plus économique le travail de ses ateliers.
Nous n'avons pas besoin d'insister sur les avantages que cette combinaison offrirait aux propriétaires. Ils seraient entièrement débarrassés des frais d'entretien et de la surveillance des travailleurs et des soins de la direction du travail de culture ; ils n'auraient autre chose à faire qu'à fournir les semences, les bêtes de somme, les outils, et les machines, et à prendre leur part des résultats annuels de l'exploitation. On peut affirmer encore que la substitution du travail libre au travail esclave opérée par ce procédé, ne tarderait pas à leur procurer, par l'amélioration des cultures) une augmentation croissante de revenus.
Comment la Compagnie se procurerait-elle et s’assurerait-elle la quantité de travail dont elle aurait besoin pour l'accomplissement régulier et non interrompu de ses engagements envers des propriétaires ?
En premier lieu, elle ferait appel aux travailleurs agricoles disposés à émigrer, en Europe, en Asie et même en Afrique. Dans certaines contrées de l'Europe, notamment dans les Flandres belges, où la population est la plus dense du continent, elle trouverait sans peine, en leur faisant l'avance des frais d'émigration, des émigrants propres au travail de la terre dans les parties tempérées du Brésil; en Afrique et en Asie, particulièrement en Chine, elle irait chercher des travailleurs propres à la: culture des régions tropicales. Aux uns elle ferait l'avance des frais de transport, et elle s'en rembourserait avec adjonction des intérêts et du profit nécessaire de l'opération, en prenant une hypothèque sur le travail futur. Les émigrants de cette catégorie seraient entièrement [326] libres à leur arrivé au Brésil, et ils poliraient traiter de gré à gré soit avec les planteurs, soit avec la Compagnie elle-même pour la location de leur travail. Seulement, des agents à ce commissionnés par la Compagnie percevraient un tantième sur leurs salaires jusqu'à l'acquittement de leur dette. La loi garantirait l'exécution de ce genre de contrat comme elle garantit celle des autres engagements commerciaux. Aux émigrants qui préféreraient s'assurer un engagement aux lieux mêmes d'émigration, elle offrirait lin contrat d'une durée plus ou moins longue, à leur convenance, et au taux moyen du salaire agricole sur le marché du Brésil, en déduisant successivement la somme avancée pour les frais d'émigration.
Cependant la Compagnie ne se bornerait pas à employer dans ses ateliers des travailleurs libres ou engagés de provenance étrangère ; elle emploierait aussi, et probablement même en grande majorité, les travailleurs émancipés, et elle appliquerait aux uns et aux autres le système le plus propre à les y attirer et à les y retenir. Ce que pourrait être ce système, sauf les modifications qu'y ferait introduire la différence des aptitudes des travailleurs à conduire eux-mêmes leurs propres affaires, nous allons essayer de l'exposer en peu de mois.
Sous le régime actuel de la liberté du travail et du salariat, l'ouvrier a l'incontestable avantage de posséder la pleine propriété de ses forces productives, de pouvoir les employer lui-même en entreprenant une industrie qu'il est Je maître de choisir, ou d!en louer l'usage moyennant un loyer ou salaire librement débattu. En revanche, il est obligé de pourvoir lui-même à toutes les nécessités de son existence, il est responsable de sa vie et de celle de sa famille. S'il ne possède pas la capacité intellectuelle et morale nécessaire pour défendre ses intérêts et satisfaire à toutes ses obligations, s'il est paresseux, vicieux ou simplement imprévoyant, il s'expose aux plus dures extrémités de la misère. Est-il besoin d'ajouter que des ouvriers ainsi démoralisés sont de mauvais [327] auxiliaires de l'industrie? on ne peut obtenir d'eux un travail régulier et assuré, et, comme ils sont perpétuellement dans la gêne, quelle que soit l'élévation de leur salaire, ils sont accessibles à toutes les excitations malsaines et ils deviennent trop aisément les ennemis de ceux qui les emploient.
La Compagnie préviendrait ces maux en établissant au profit de ses ouvriers un système d'assurance libre, dont voici les principales dispositions :
Elle se chargerait de pourvoir à la nourriture, au logement, aux soins médicaux et autres des travailleurs employés dans ses ateliers, elle leur constituerait de plus, à leur volonté, une épargne, destinée soit à leur permettre' de former plus tard un établissement pour leur compte, de pourvoir à l'éducation de leurs enfants ou d'assurer leur vieillesse; elle leur procurerait en outre, à peu de irais, les délassements et les distractions qu'une bonne hygiène réclame après le travail, tout en éloignant d'eux la tentation des liqueurs fortes. Elle exercerait en un mot sur eux une tutelle analogue à celle du père de famille sur ses enfants. Elle stimulerait leur assiduité au travail et leur zèle par des récompenses honorifiques, des croix ou médailles ou des primes, et n'emploierait pas de pénalité plus rigoureuse que l'exclusion des réunions de plaisir, la mise à l'amende et, comme mesure extrême, le bannissement de ses ateliers. Les frais de cette tutelle, qui serait plus ou moins étendue selon le degré de développement intellectuel et moral des ouvriers, seraient pris sur le salaire, mais il est bien entendu qu'elle demeurerait purement libre, que les ouvriers qui préféreraient pourvoir eux-mêmes à leur entretien et gouverner leur vie à leur guise seraient mis en possession de la totalité de leur gain. Seulement les avantages de cette assurance libre qui les débarrasserait de la plupart des soucis de l'existence seraient tels que le plus grand nombre d'entre eux, sinon tous, voudraient probablement y participer.
Voilà pour ce qui concerne l'économie du régime de travail [328] qui serait substitué à celui du travail esclave. Notons que ce régime devrait s'introduire librement et d'une manière successive, à mesure que les propriétaires des plantations desservies par des esclaves en reconnaîtraient les avantages. Il serait même bon qu'on les laissât libres de l'adopter ou de conserver le régime actuel, ou bien encore de remplacer ce régime par tel autre qui serait mieux à leur convenance.
Examinons maintenant le côté financier de l'opération. La Compagnie aurait à pourvoir: 1° à l'avance des frais d'émigration des travailleurs étrangers, d'Europe, d'Asie ou d'Afrique; 2° à l'entretien et à la mise en oeuvre de ses ateliers dans chaque exploitation, au payement des salaires ou aux frais de nourriture, d'entretien, etc. dès travailleurs assurés; 3° à ses frais de direction et d'administration ; 4° à l’emmagasinement et à la vente de ses parts de récolte; 5° au payement dés dividendes de ses actionnaires. Pour subvenir à ces divers frais et dépenses, elle disposerait, à la fin de chaque excercice, de la part stipulée dans le produit de chacune, des plantations qu'elle alimenterait de travail, et celle part de produit, elle la réaliserait, à la manière de la Société de commerce des Pays-Bas, par des ventes publiques sur les marchés de consommation.
On conçoit qu'il serait difficile d'apprécier d'avance les résultats financiers de l'affaire. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les bénéfices d'une telle.entreprises dépasseraient selon toute apparence ceux du mode actuel d'exploitation au moyen du travail forcé. Mais il est clair que cette éventualité, si probable qu'elle pût être, ne suffirait pas pour attirer les capitaux dans une affaire dont les capitalistes européens ne pourraient évaluer les chances de succès et les risques.
La Compagnie demanderait en conséquence au gouvernement brésilien un minimum d'intérêt de 6 p. 100. Moyennant cette garantie, elle obtiendrait, croyons-nous, sur.les marchés de Paris et d'i Londres, toute la somme nécessaire pour moner à bonne fin l'oeuvre de l'émancipation. Cette somme pourrait être, au début, de 50 millions; elle serait [329] graduellement augmentée à mesure que les propriétaires demanderaient à traiter avec la Compagnie.
Enfin, la Compagnie, en vue de prévenir l'objection que les abolitionnistes ne manqueraient pas d'opposer au système dont nous venons d'esquisser l'économie, savoir, que ce système pourrait conduire à une exploitation indue et abusive des travailleurs, et à une reconstitution hypocrite du régime de la servitude, la Compagnie, suivant en cela l'exemple des associations coopératives, limiterait ses bénéfices à un maximum double de la garantie, soit à 12 p. 100. Ce revenu atteint, elle distribuerait le surplus à ses travailleurs et à ses employés, en proportion de leurs salaires ou de leurs émoluments.
Selon toute probabilité, le gouvernement brésilien n'aurait à débourser le montant de sa garantie que dans les premières années de l'opération ; on pourrait même stipuler que les sommes versées pour cette garantie lui seraient remboursées lorsque les bénéfices viendraient à dépasser 10 p. 100, et par tantièmes de 1 p. 100 sur ces bénéfices, en sorte que l'émancipation des esclaves ne coûterait rien au peuple brésilien, tout en lui épargnant les dommages et les dangers d'une crise de travail et en assurant l'avenir de la prospérité et de la civilisation du Brésil.
(Journal des Économistes, janvier 1885.)
[330]
IV.
Tableau des dépenses et des dettes des États européens en 1885 [25] .↩
| ÉTATS | PRÉVISIONS TOTALES des dépenses. |
CAPITALISATIONS DES DETTES consolidées, des dettes amortissables, annuités diverses et du papier-monnaie à retirer, sans défalcation de l’actif |
DÉPENSES DU SERVICE des dettes et de l’amortissement. |
DÉPENSES MILITAIRES. |
| Allemagne (budg.fédéral) | 776.496.064 | 493.455.750 | 21.312.500 | 477.191.384 |
| Alsace- Lorraine | 18.198.549 | 31.753.349 | 1.632.000 | » |
| Bade | 146.219.225 | 478.744 711 | 23.937.235 | » |
| Bavière | 177.373.779 | 1.678.374.552 | 62.308.945 | » |
| Hambourg | 47.030.000 | 190.708.100 | 8.262.300 | » |
| Mecklenbourg Schwérin. | 20.000.000 | 28.620.750 | 1.431.038 | » |
| Prusse | 1.573.600.495 | 4.877.400.506 | 220.988.241 | » |
| Saxe- Royale | 108.974.659 | 816.759.000 | 38.627.891 | » |
| Wurtemberg | 68.844.212 | 536.102.136 | 24.498.581 | » |
| Autriche-Hongrie (budget commun) | 313.396.275 | » | » | 300.196.810 |
| Autriche | 1.233.956.775 | 8.222.125.320 | 301.271.705 | 24.179.795 |
| Hongrie | 844.750.660 | 3.183.388.052 | 168.150.887 | 18.606.545 |
| Belgique | 319.403.295 | 2.119.131.953 | 86.378.559 | 49.065.000 |
| Bulgarie | 35.780.324 | 40.000.000 | 2.105.004 | 11.675.101 |
| Danemark | 77.177.902 | 276.718.778 | 13.524.916 | 82.863.915 |
| Espagne | 897.146.S90 | 6.356.253.000 | 264.848.435 | 195.174.175 |
| France | 3.217.103.595 | 27.141.161.432 | 1.111.101.291 | 906.896.639 |
| Grande-Bretagne | 2.364.551.173 | 18.339.013.188 | 594.848.000 | 722.968.100 |
| Grèce | 83.252.875 | 361.077.602 | 28.377.775 | 22.236.573 |
| Hollande | 283.963.168 | 2.231.340.092 | 72.002.701 | 67.063.967 |
| Italie | 1.707.312.769 | 10.084.93S.677 | 543.758.314 | 328.263.420 |
| Portugal | 217.295.222 | 3.334.027.878 | 82.177.179 | 38.366.616 |
| Roumanie | 130.038.720 | 729.870.188 | 52.129.173 | 28.447.280 |
| Russie | 3.465.179.988 | 13.822.576.152 | 1.041.930.964 | 944.174.936 |
| Serbie | 44.236.562 | 225.000.000 | 11583.824 | 20.000.000 |
| Suède | 114.472.755 | 319.986.054 | 15.255.200 | 39.065.950 |
| Norwège | 58.542.352 | 148.495.924 | 8.694.807 | 11.337.711 |
| Suisse | 45.740.000 | 35.510.342 | 1.869.160 | 13.259.918 |
| Turquie. | 425.500.000 | 2.328.702.132 | 55.435.645 | 200.000.000 |
Endnotes
[1] Etudes économiques, 1846. — Les soirées de la rue SaintLazare, entretiens sur les lois économiques, 1849. — Cours d'économie politique, 1855-1863. — L'évolution économique du XIXe siècle, 1880. — L'évolution politique et la révolution, 1884.
[2] Voir à l'Appendice : La guerre civile du capital et du travail et le Projet d'une société de placement des ouvriers.
[3] Cours d'économie politique. 3e leçon, La valeur et le prix.
[4] Nous l'avions d'abord nommée Loi des quantités et des prix (Voir notre Cours d'économie politique, 3e leçon); mais la dénomination de Loi ds progression des valeurs nous parait préférable.
[5] Voir notre Cours d'économie politique. 4e leçon, La valeur et la propriété.
[6] Dans toutes les entreprises, les résultats de la production ou lea valeurs produites se distribuent sous forme de revenus entre les coopérateurs de l'entreprise, capitalistes et travailleurs. Cette distribution s'opère en raison des quantités de capital et de travail offertes au marché, et celles-ci sont toujours dans quelque mesure inférieures aux quantités existantes. S'agit-il du personnel? Il faut eu déduire: 1° les individus impropres, par leurs défectuosités physiques et mentales, à toute espèce de travail, qui sont à la charge d'autrui et constituent les non-valeurs de la population; 2° ceux qui, possédant des agents productifs qui leur ont été légués par les générations précédentes, sous forme de valeurs mobilières et immobilières, s'abstiennent d'offrir au marché leurs valeurs personnelles. Ces deux fractions de la population ne constituent, toutefois, en comparaison du personnel engagé dans la production ou disposé à. s'y engager, qu'une quantité assez faible. S'agit-il du capital investi dans le matériel mobilier et immobilier? Une partie en est conservée inactive sous la forme de métaux précieux ou sous toute autre forme durable et facile h. garder; une autre partie sous la forme de terres non exploitées ou d'immeubles affectés à la jouissance de ceux qui les possèdent; mais ces agents productifs inactifs.ou appliqués à la consommation actuelle ne constituent de même qu'une fraction peu importante en comparaison des valeurs mobilières et immobilières mises au marché de la production, soit qu'elles so trouvent investies dans les anciennes entreprises, soit qu'elles s'offrent aux nouvelles.
C'est, disons-nous, entre les coopérateurs des entreprises que se distribuent les valeurs produites. Ces coopérateurs forment des catégories distinctes, selon la position qu'ils occupent et la nature des agents qu'ils fournissent. Analysons le mécanisme d'une entreprise quelconque et nous y trouverons : 1° un entrepreneur ou une association d'entrepreneurs qui y ont engagé d'abord des forces productives investies en eux-mêmes et représentant une somme plus ou moins considérable de valeurs personnelles, ensuite des forces productives investies dans le matériel et représentant des valeurs mobilières et immobilières. Ces entrepreneurs réalisent ordinairement par voie d'échange leurs produits ou leurs services, et ils opèrent la distribution de la somme de valeurs ainsi obtenue. Quand ils ont fourni à leurs coopérateurs la part qui leur revient, ils s'adjugent le reste, si reste il y a; c'est le profit; 2° des capitalistes et des propriétaires qui ont prêté ou loué aux entrepreneurs le matériel complémentaire, mobilier et immobilier, et qui reçoivent leur part sous la forme anticipative et assurée d'un intérêt ou d'un loyer; 3° un personnel d'ouvriers qui ont loué l'usage de leurs forces productives, et qui reçoivent également leur part sous la forme anticipative et assurée d'un salaire, auquel s'adjoint parfois une part éventuelle, mais toujours restreinte, dans les bénéfices, les pertes demeurant à la charge des entrepreneurs.
Remarquons d'abord que ces parts sont naturellement inégales; qu'il est nécessaire que les entrepreneurs et les capitalistes qui leur prêtent le complément de capital mobilier dont ils ont besoin reçoivent dans les résultats de la production une part proportionnellement plus forte que les propriétaires du complément de capital immobilier et les travailleurs. Cette inégalité dans les parts est motivée par celle des risques auxquels sont exposées ces différentes catégories des coopérateurs de la production.
Quelle est la situation de l'entrepreneur? Il engage dans son entreprise les agents productifs qu'il possède, il emprunte ou il loue les autres, matériel et personnel, capital et travail, moyennant une rétribution anticipative et assurée, intérêt, loyer, fermage ou salaire. Sa rétribution à lui est aléatoire. Elle consiste dans l'excédent de la somme que lui procure la réalisation de ses produits sur celle qu'il a dû déposer pour les confectionner, en rétablissant le capital qu'il y a employé, eu payant l'intérêt ou le loyer de co capital et le salaire du travail. Mais combien de circonstances contribuent à rendre cette rétribution incertaine I Dans un grand nombre d'industries, il n'est pas au pouvoir de l'entrepreneur de régler sa production conformément aux besoins du marché : il est exposé à dépasser ces besoins et par conséquent à voir son prix de vente tomber au-dessous de ses frais de production; il est exposé encore à la concurrence d'entreprises qui abaissent leurs prix au-dessous du niveau où il peut faire descendre les siens; il est exposé enfin à ce que son marché soit rétréci ou même fermé par une guerre, un changement dans les tarifs de douane ou une crise, parfois lointaine, qui bouleverse le marché, en diminuant la puissance d'achat de ses consommateurs, etc., etc.; bref, il n'est jamais assuré de son prix de vente. Il ne l'est pas davantage de son prix de revient. Le prix des matériaux qu'il met en oeuvre, le taux de l'intérêt des capitaux qu'il emprunte, le taux du salaire du travail qu'il loue, peuvent s'élever pendant la durée de l'opération productive et porter son prix de revient au-dessus de son prix de vente, de manière à lui laisser un déficit au lieu d'un excédent, une perte au lieu d'un bénéfice. Il faut donc, pour que l'entrepreneur puisse continuer son industrie, que. l'ensemble des risques auxquels il est exposé soient couverts par une prime, laquelle élève plus ou moins, selon l'importance des risques, le taux nécessaire de sa rétribution, eu comparaison de celle des autres coopérateurs de la production.
Ces derniers sont exposés de même à des risques inégaux, selon la nature des agents qu'ils fournissent à la production. Le capital emprunté sous forme de monnaie et investi ensuite sous forme d'outils, de machines, de matières premières, ou conservé en caisse pour le payement des salaires, quoique garanti par le capital d'entreprise, n'est point et ne peut être complètement assuré contre les risques de la production. Si celle-ci ne couvre point ses frais, non seulement le capital de l'entrepreneur, mais encore le capital mobilier qu'il a emprunté peut être absorbé en partie ou même en totalité par la perte qu'il subit. Il faut donc que dans la rétribution du capital mobilier prêté à l'industrie soit comprise une prime destinée à compenser ce risque. Les capitaux investis en immeubles et en forces ouvrières et composés de valeurs immobilières et personnelles sont dans une situation différente. Ces deux sortes de capitaux ne participent point ou ne participent que dans une faible mesure aux risques de la production. Si l'entreprise vient, par suite de pertes successives, à tomber en faillite, le propriétaire qui a loué un immeuble urbain ou rural en reprend possession, et sa perte se réduit, tout au plus, au montant d'un ou deux termes de loyer. L'ouvrier n'est, de même, exposé à perdre que le salaire de quelques jours ou de quelques semaines de travail. Sous l'influence de cette inégalité naturelle des risques, le taux nécessaire de la rétribution du propriétaire foncier et de l'ouvrier est proportionnellement inférieur à celui de la rétribution de l'entrepreneur et du capitaliste proprement dit. Il suit de là que, parmi ces coopérateurs de la production, les uns peuvent faire fortune plus rapidement que les autres, mais sont, en revanche, exposés davantage à se ruiner.
Cependant, le « taux nécessaire » de la rétribution des différents coopérateurs de la production n'est qu'un point ou un centre idéal vers lequel gravite la rétribution effective. Celle-ci est déterminée par les quantités des agents productifs respectivement offertes dans un moment et sur un point donnés. En supposant qu'aucun obstacle naturel ou artificiel ne vint troubler le libre jeu des lois de la concurrence et de la progression des valeurs, l'équilibre s'établirait entre les rétributions des agents productifs au niveau du c taux nécessaire », et la distribution de la richesse s'opérerait de la manière la plus utile.
[7] Rappelons ici ce qu'il faut entendre par besoins du marché : c'est la quantité de produits en échange desquels ceux qui en ont besoin sont disposés à fournir une somme de valeur suffisante pour couvrir les frais de la production en y comprenant le profit ou la rétribution nécessaire de l'entrepreneur.
[8] Voici, par exemple, une des nombreuses industries qui contribuent à-la production des articles de vêtement et d'ameublement, l'industrie cotonnière. Cette industrie est exercée dans un grand nombre de pays et partagée entre une foule d'entreprises ou d'établissements, différemment situés, constitués et mis en oeuvre, quoique renfermant tous les mêmes éléments constitutifs et ayant le même objet, savoir, de produire la plus grande somme possible de valeur en échange de la moindre sommé de frais, et de réaliser ainsi la plus forte somme de profits. Ils diffèrent, disons-nous, par leur assiette, leurs dimensions, leur mode de constitution et de gestion. Ceux-ci sont possédés et dirigés par des entrepreneurs d'industrie pourvus de capitaux qui leur appartiennent pour une part et qu'ils empruntent diversement pour une autre part; ceux-là sont constitués sous forma de sociétés avec un capital fourni par des actionnaires et des obligataires. Cette constitution-là, purement autocratique, ici, jusqu'à un certain point représentative, est plus ou moins conforme à la loi de l'économie des forces, quant à la situation, aux dimensions, à la concentration de l'entreprise, à la hiérarchie, à l'aménagement et au gouvernement intérieur, l'outillage est plus ou moins perfectionné, le personnel plus ou moins capable et laborieux, mais ce qu'il importe de remarquer, c'est que toutes ces différences, toutes ces inégalités dans la manière dont les entreprises sont constituées, dirigées et desservies se répercutent invariablement dans leurs prix de revient. Celles dont la constitution et le fonctionnement sont le plus conformes à la loi de l'économie des forces obtiennent leurs produits en échange de la moindre dépense; celles qui s'écartent le plus de cette loi ont, au contraire, le prix de revient le plus élevé. Toutes portent, indistinctement, leurs produits au marché, où ils sont échangés. Comment s'opère l'échange? Il s'opère, sans être aucunement influencé par l'inégalité des prix de revient, en raison des quantités réciproquement offertes, cotonnades d'un côté, monnaie ou instruments monétaires de l'autre, selon la proportion variable de ces quantités. Le prix des cotonnades s'élève plus ou moins, mais il tend toujours à s'établir au niveau des frais de production les plus bas. Lorsqu'il s'établit plus haut, les entreprises qui produisent au meilleur marché trouvent, avantage (et cet avantage est d'autant plus marqué que la différence est plus grande) à augmenter leur production et elles l'augmentent jusqu'à ce que le prix du marché vienne à tomber au niveau de leurs frais ou de leur prix de revient, en y comprenant le profit nécessaire. Mais ce prix du marché, qui se confond avec le prix de revient des entreprises les plus économiquement situées, constituées, dirigées et desservies, se trouve plus ou moins au-dessous du prix de revient des autres. Il ne fournit point à celles-ci la somme de valeur indispensable pour reconstituer leurs agents productifs; elles subissent des pertes successives: ceux qui les possèdent se ruinent et ils finissent par tomber en faillite.
En mettant ainsi en oeuvre la loi de la concurrence pour conserver et développer les entreprises qui observent le plus exactement la loi de l'économie des forces, comme aussi pour ruiner et faire disparaître les autres, la nature récompense l'intelligence, l'activité, l'énergie, l'assiduité au travail qui ont concouru à réduire au minimum les frais de production d'un article nécessaire, et elle procure cet article à ceux qui en ont besoin, en échange de la moindre somme de sacrifices, de peine, eu laissant par conséquent disponible une portion plus forte de leur revenu, qu'ils peuvent appliquer à la satisfaction de leurs autres besoins. Supposons que les lois naturelles n'eussent point agi ou que leur action eût été entravée par quelque obstacle, que le prix du marché eût été maintenu au-dessus des frais de production les moins élevés, que les entreprises les plus économiques eussent été exclues du marché, quelle eût été la conséquence? c'est que le défaut d'intelligence, d'activité, d'assiduité au travail eussent reçu une prime d'encouragement, d'une part, aux dépens du personnel intelligent et laborieux des entreprises exclues, d'une autre part aux dépens des consommateurs, obligés de sacrifier une portion supplémentaire du revenu acquis par la mise en oeuvre de leurs forces productives et représentant des forces dépensées, des peines souffertes, pour récompenser le mauvais emploi des agents productifs, la défaut d'intelligence et d'énergie des producteurs.
On voit donc que les lois naturelles agissent à la manière d'un crible qui sépare le bon grain d'avec le mauvais, mais ce n'est pas sans infliger de cruelles pénalités et de douloureuses souffrances. Les entreprises qui succombent entraînent dans leur chute tout un personnel, souvent digne d'intérêt et dont une partie n'a point-mémo sou soit. Les capitalistes perdent les fonds qu'ils y ont engagés, et s'ils ont commis l'imprudence d'y immobiliser tout leur avoir, ils sont réduits à une misère d'autant plus dure à supporter qu'elle succède à la richesse ou à l'aisance. Grâce à la bienfaisante assurance du salariat que des novateurs imprévoyants voudraient remplacer par la participation, les ouvriers ne supportent, au contraire, qu'une part limitée dans ce désastre.
[9] Plus la pression de la concurrence animale était intense, plus étaient nombreuses et puissantes les espèces inférieures auxquelles l'homme était obligé de disputer sa subsistance et pour lesquelles il était une proie, plus volumineux et plus serré devait être le faisceau des forces qu'il rassemblait pour lutter avec elles. C'est ainsi qu'après avoir réuni et combiné assez de forces individuelles pour dépasser celles d'un de ses formidables concurrents, il perfectionnait peu à peu l'organisation et la discipline de cette association, afin d'augmenter sa puissance d'action, qu'il inventait et perfectionnait de même des instruments, armes contondantes, perçantes, etc., qui ajoutaient à sa force physique une force mécanique.
C'est, disons-nous, dans les régions où la concurrence animale était la plus serrée que l'homme primitif réalisa les progrès les plus rapides et les plus décisifs; que ses forces individuelles, son agilité, sou courage, son adresse se développèrent et qu'il améliora encore ces qualités nécessaires par la sélection, les individus les plus faibles, les moins courageux, les moins agiles tombant sous la dent des bêtes féroces; ensuite que les associations humaines acquirent le plus de consistance et de force en perfectionnant leur organisation, leur discipline, leur armement et leur tactique. Dans les régions telles que l'Australie où il n'existait point d'espèces concurrentes, l'homme est resté au plus bas degré de l'échelle du progrès.
« Cette faune agressive et sanguinaire qui fait l'horreur des parties restées sauvages du globe, comme le coeur de l'Afrique ou les régions polaires, exerçait autrefois sa domination sur tous les continents, sauf l'Australie, qui, séparée depuis la période secondaire, a échappé à l'invasion des races déprédatrices que vit naitre l'âge suivant. L'Europe, durant la phase quaternaire et jusqu'au début des temps historiques, fut peuplée d'espèces formidables dont les unes ont été anéanties, les autres refoulées ou décimées. Parmi les premiers, citons plusieurs éléphants, des rhinocéros, un hippopotame, l'ours des cavernes, un grand tigre qui mesurait 4 mètres de long, le lion, l'hyène des cavernes, etc. Quels rudes combats ont dû livrer nos antiques prédécesseurs pour s'établir près de pareils occupants, les repousser et finalement les détruire! L'esprit s'effraye d'y penser. L'homme était alors aussi débile que ses ennemis étaient forts. Il ne put entamer la lutte avec quelques chances de succès que lorsqu'il disposa de moyens d'agression suffisamment efficaces; mais plus il accrut le pouvoir de ses armes} plus il devint entreprenant. Il tourna contre les fauves des expédients de toute sorte, les combattit par le fer, la flamme et le poison, dressa des pièges, appela comme auxiliaire le chien pour les assaillir, le cheval pour les atteindre ou les éviter, et réussit enfin à se faire, avec les armes à feu, un moyen de destruction qui mit tous ses adversaires à sa merci. » (Louis Bourdeau, Conquête du règne animal, p. 107.)
[10] Comme le remarque avec raison M. Bourdeau, certains gisements de substances alimentaires devaient avoir une valeur extraordinaire à une époque où l'on ne possédait point encore les moyens de produire des subsistances par uue culture régulière.
« Les moules et les huîtres qui se multiplient par bancs... durent être avidement recherchées par les plus anciens habitants des côtes, car, duraut le premier âge, la découverte d'un de ces gisements avait plus de valeur que celle d'une mine d'or, c'était une carrière d'aliments dans le voisinage de laquelle la tribu se fixait. » (Louis Bourdeau. Conquête du monde animal, p. 20.)
[11] Voir l'Évolution économique, chap. VI, le Passé.
[12] Voir aussi l'Evolution politique et là Révolution.
[13] Voir l'Évolution économique du XIXe siècle.
[14] Cette absence de publicité à l'usage des ouvriers nous avait particulièrement frappé au début de notre carrière et nous avions proposé l'établissement de « bourses du travail » pour y remédier (voir nos Études économiques et les Soirées de ta rue Saint-Lazare). Plus tard nous avons fondé dans le même but le journal la Bourse du travail. A Bruxelles, le bourgmestre, M. Aug. Buis et uu savant professeur d'économie politique, M. Hector Denis, ont entrepris récemment d'instituer une bourse du travail, mais ils n'ont pas réussi encore à surmonter les résistances que la routine nous avait opposées au début. A Paris, la création d'une bourse du travail est également à l'ordre du jour; mais les socialistes, en s'emparant de cette idée, n'ont pas manqué de la gâter. Le but que se propose la « Ligue » qu'ils ont organisée pour la « suppression des bureaux de placement », c'est de conférer le monopole exclusif du placement des ouvriers aux « syndicats professionnels » auxquels la loi du 21 mars 1884 a accordé la personnalité civile, et de mettre une Bourse du travail subventionnée à la fois par l'État et la ville au service de ce monopole. Avons-nous besoin de dire que nous n'avons jamais compris la Bourse du travail autrement que comme une institution libre? Est-il nécessaire d'ajouter aussi que le développement libre de l'industrie du placement pourra seul déterminer la création et la multiplication utiles des Bourses du travail? On trouvera à l'appendice l'esquisse des progrès qui pourraient être réalisés et qui le seront certainement quelque jour eu matière de placement et de publicité à l'usage du travail. Ce qui retarde encore ce progrès c'est, d'une part, le régime d'arbitraire administratif auquel sont généralement soumis les bureaux de placement (en vertu du décret du 25 mars 1852, les.bureaux de placement ne peuvent être ouverts à Paris qu'avec l'autorisation du préfet de police qui peut.toujours retirer cette autorisation), c'est, d'une autre part, l'esprit de monopole des patrons et des ouvriers eux-mêmes.
[15] Pendant 300 ans, à partir de 1221, la Russie subit vingt-quatre invasions tartares, sans compter les petites incursions chroniques de ces barbares. (L. Tikhomirov. La Russie politique et sociale.)
[16] Émigration italienne, d'après les documents officiels du ministère de l'agriculture, de l'industrie et du commerce :
| 1878 | 96,268 | 1882 | 161,562 |
| 1879 | 119,831 | 1883 | 169,101 |
| 1880 | 119,901 | 1884 | 147,017 |
| 1881 | 135,832 | 1885 | 157,193 |
[17] Article article Budget du Dictionnaire général des finances, publié sous la direction de M. Léon Say.
[18] Voir à l'Appendice le tableau, dressé par M. Paul Boiteau, des dépenses prévues pour l'exercice 18S5, des dettes publiques et des sommes absorbées par les dépenses militaires et le service des dettes des États européens.
Certains optimistes prétendent, a la vérité, que la diminution de la valeur ou du pouvoir d'achat de la monnaie a allégé progressivement le poids des budgets et que les Français, par exempta, payent aujourd'hui plus facilement un budget de •' » milliards qu'ils ne payaient, il y a soixante ans, un budget d'un milliard. Mais il suffit de consulter les prix du blé et de la plupart des autres articles de consommation pour se convaincre que le pouvoir d'achat de la monnaie ne s'est pas sensiblement abaissé depuis un demi-siècle, c'est-à-dire pendant la période où les dépenses publiques se sont accrues dans la proportion la plus considérable. C'est le développement de la production et l'augmentation de la richesse et de la population, conséquence des progrès dé la production, qui ont rendu les budgets plus supportables et non la diminution prétendue de la valeur de la monnaie ; mais le taux d'accroissement des dépenses publiques ne dépasse pas moins, chaque jour davantage, celui de la richesse et de la population. .
En Franco, le nombre des naissances pour une population de 10,000 âmes a suivi, d'après le Dr Bertillon, la progression décroissante que voici :
Nombre de naissances pour une population de 10,000 âmes.
| 1770-80 | 380 | 1841-50 | 274 |
| 1801-11 | 325 | 1851-60 | 267 |
| 1811-20 | 316 | 1861-68 | 264 |
| 1821-30 | 309 | 1869-80 | 245 |
| 1831-40 | 289 |
Dans la plupart des autres pays, notamment en Allemagne, en Angleterre et en Russie, le taux d'accroissement de la population, quoique plus considérable qu'en France, tend également a s'abaisser depuis quelques années. En Allemagne, la moyenne de l'excédent des naissances sur les décès, qui a été de 550,993, de 1875 à 1884, est tombé à 493,697 en 1883, et s'il s'est relevé en 1884 à 522,083, il est resté cependant encore au-dessous de la moyenne. En Angleterre, d'après les rapports officiels, le nombre des naissances tend à baisser et l'accroissement de la population tient surtout à la diminution constante des décès. En Russie, l'accroissement annuel de la population avait été de 1,44 p. 100 de 1815 à 1835, de 1,21 de 1835 k 1856 et de 1,14 seulement de 1858 à 1883; en 1882, cet accroissement était descendu à 1,06.
Ces renseignements sont empruntés à l’Affaiblissement de la natalité en France, ses causes et ses conséquences, par M. le marquis de Nadaillac, correspondant de l'Institut. F. 6, 18,25 et 118.
[19] D'après le tableau publié par M. Richard de Kaufmann, dans son livre des Finances de la France, cette proportion serait même inférieure à un quart. D'après M. de Kaufmann, la proportion de l'impôt indirect sur la totalité des recettes serait, en France, de 84 p. 100; en Angleterre, 82; en Suède, 78; en Autriche, 76; en Danemark, 76; en Hollande, 74; en Russie, 74; en Portugal, 73; en Belgique, 70; en Espagne, 65; en Italie, 65; en Prusse, 64; en Saxe, 56 ; en Hongrie. 52.
« Dans l'histoire de nos finances, dit M. Yves Guyot, dans son remarquable rapport relatif à l'impôt sur le revenu, nous constatons les variations suivantes du rapport de nos contributions directes à nos contributions indirectes. D'après M. Clamagerau, les impositions indirectes n'auraient pas, avant François Ier, atteint la proportion de 50 p. 100, et, à la fin du règne de Louis XI, cette proportion n'aurait même été que de 22,8 p. 100. Mais, sous Louis XIV, leur part, certaines années, fut de 175, lorsque l'imposition directe ne donnait que 100 de contribution.
« Les calculs de M. Paul Boiteau, sur le budget de Necker du 5 mai 1789, ont établi, qu'au moment où la Révolution commença, les contributions indirectes étaient aux contributions directes comme 115,8 est à 100.
« L'Assemblée nationale avait la haine de ces taxes. La proportion fut renversée. Dans le budget de 1791, l'impôt indirect ne produit plus que 66,1 relativement à 100, et en l'au VII, après divers rétablissements, il ne représente encoro que 51,4 contre 100. Sous le Consulat et lé premier Empire, il atteint 91,8 contre 100.
« Sous la Restauration, les contributions indirectes sont de 143,1, à peu près la proportion du ministère de Colbert; sous la monarchie de 1830, elles sont de 173,2; sous la seconde République, la charge dc3 centimes additionnels généraux ayant reparu dans nos budgets, elles ne sont plus que de 168,4.
« La moyenne du second Empire est de 225,2 contre 100, si l'on continue de joindre aux fonds généraux des contributions directes, les fonds spéciaux du budget des départements et des communes passés en 1863 au budget sur ressources spéciales; elle est de 368,5 si on les en détache.
Proportionnalité des impôts et revenus indirects, les contributions directes étant 100.
| Avec les fonds spéciaux | Sans les fonds spéciaux | |
| 1870 | 197,1 | 343,7 |
| 1875 | 299,9 | 534,7 |
| 1880 | 322,4 | 605,3 |
| 1881 | 323,9 | 610,6 |
| 1882 | 307,4 | 557,7 |
| 1885 | 304,4 | 550,1 |
« Il est clair, ajoute avec raison M. Yves Guyot, que la comparaison établie avec les fonds spéciaux est fausse, puisqu'ils comprennent des centimes destinés à des dépenses locales ; autrement, il faudrait ajouter aussi les octrois aux contributions indirectes. Dans ces conditions, on voit que, tandis que le contribuable paye 100 de contributions directes, il paye 550 de contributions indirectes ; ou, si l'on aime mieux, il paye 1 franc de contributions directes quand il paye 5,50 de contributions indirectes. »
Yves Guyot. Rapport fait au nom de la commission du budget, sur les questions soulevées par diverses propositions relatives à l'impôt sur le revenu. P. 6.
[20] Voir nos Conversations sur le commerce des grains et la protection de l'agriculture : Les effets de la protection.
[21] Voir l’Évolution politique et la Révolution, p. 181.
[22] « La liberté, disait l'avocat général Antoine-Louis Séguier, dans sa célèbre protestation faite au nom du parlement contre l'abolition des maîtrises et des jurandes (lit de justice du 12 mars 1776), la liberté est sans doute le principe de toutes les actions; elle est l'âme de tous les états; elle est principalement la vie et le premier mobile du commerce. Mais, Sire, par cette expression si commune aujourd'hui et qu'on a fait retentir d'une extrémité du royaume à l'autre, il ne faut point entendre une liberté indéfinie, qui ne connaît d'autres lois que ses caprices, qui n'admet d'autres règles que celles qu'elle se fait à elle-même. Ce genre de liberté n'est autre chose qu'une véritable indépendance; cette liberté se changerait bientôt en licence; ce serait ouvrir la porto à tous les abus, et ce principe de richesse deviendrait un principe de destruction, une source de désordre, une occasion de fraude et de rapines dont la suite inévitable serait l'anéantissement total des arts et des artistes, de la confiance et du commerce.
« … Tous vos sujets, Sire, sont divisés en autant de corps différents qu'il y a d'états différents dans le royaume. Le clergé, la noblesse, les cours souveraines, les tribunaux inférieurs, les officiers attachés à ces tribunaux, les universités, les académies, les compagnies de finances, les compagnies de commerce, tout présente et dans toutes les parties de l'État, des corps existants qu'on peut regarder comme les anneaux d'une grande chaîne dont le premier est dans la main de Votre Majesté, comme chef et souverain administrateur de tout co qui constitue le corps de la nation.
« La seule idée de détruire cette chaîne précieuse devrait être effrayante. Les communautés de marchands et artisans font une portion de co tout inséparable qui contribue à la police générale du royaume ; elles sont devenues nécessaires et pour nous renfermer dans ce seul objet, la loi, Sire, a érigé des corps de communautés, a créé des jurandes, a établi des règlements, parce que l'indépendance est un vice dans la constitution politique, parce que l'homme est toujours tenté d'abuser de la liberté. Elle a voulu provenir les fraudes en tout genre et remédier à tous les abus. La loi veille également sur l'intérêt de celui qui vend et sur l'intérêt de celui qui achète; elle entretient une confiance réciproque entre l'un et l'autre; c'est, pour ainsi dire, sous le sceau de la foi publique que le commerçant étale sa marchandise aux yeux de l'acquéreur et que l'acquéreur la reçoit avec sécurité des mains du commerçant.
« … Relâcher les ressorts qui font mouvoir cette multitude de corps différents, anéantir les jurandes, abolir les règlements, en un mot, désunir les membres des communautés, c'est détruire les ressources dé toute espèce que le commerce lui-même doit désirer pour sa propre conservation. Chaque fabricant, chaque artiste, chaque ouvrier se regardera comme un être isole, dépendant de lui seul et libre de donner dans tous les écarts d'une imagination souvent déréglée ; toute subordination sera détruite ; il n'y aura plus ni poids ni mesure; la soif du gain animera tous les ateliers, et comme l'honnêteté n'est pas toujours la voie la plus sûre pour arriver à la fortune, le public entier, les nationaux comme les étrangers, seront toujours la dupe des moyens secrets préparés avec art pour les aveugler et les séduire Et ne croyez pas, Sire, que notre ministère, toujours occupé du bien public, se livre en ce moment à de vaines terreurs; les motifs les plus puissants déterminent notre réclamation, et Votre Majesté serait en droit de nous accuser un jour de prévarication si nous cherchions à les dissimuler. Le principal motif est l'intérêt du commerce en général, non seulement dans la capitale, mais encore dans tout lo royaume, non seulement dans la France mais dans toute l'Europe, disons mieux, dans le monde entier.
« Le but qu'on a proposé à Votre Majesté est d'étendre et de multiplier le commerce en le délivrant des gênes, des entraves, des prohibitions introduites, dit-on, par le régime réglementaire. Nous osons avancer à Votre Majesté les propositions diamétralement contraires; ce sont ces gênes, ces eutraves, ces prohibitions qui font la gloire, la sûreté, l'immensité du commerce de la France.
« … La liberté indéfinie fera bientôt évanouir cette perfection qui est seule la cause de la préférence que nous avons obtenue j cette foule d'artistes et d'artisans de toutes professions, dont le commerce va se trouver surchargé, loin d'augmenter nos richesses, diminuera peut-être tout à coup le tribut des deux mondes... Le commerce deviendra languissant; il retombera dans l'inertie dont Colbert, ce ministre si sage, si laborieux, si prévoyant a eu tant de peine à le faire sortir. » (OEuvres de Turgot, t. II, p. 332. Ed. Guillaumin.)
[23] Voir l’Evolution politique et la Révolution. Chap. XI. Tutelle et liberté. Voir aussi à l'Appendice le projet d'établissement d'une société pour le placement des ouvriers et le plan d'émancipation des esclaves au Brésil.
[24] Citons encore cet admirable passage d'Adam Smith, le père des économistes bourgeois et « sans entrailles », au dire des socialistes. « Il est rare, dit-on, qu'on entende parler d'une ligue de la part des maîtres, et on parle souvent de celles que font les ouvriers. Mais quiconque imagine là-dessus que les maîtres ne s'entendent pas, connaît aussi peu le monde que le sujet dont il s'agit; il y a partout une coalition tacite mais constante parmi les maîtres pour que le prix actuel du travail ne monte point. S'écarter de cette loi ou convention tacite est partout faction d'un faux frère et une sorte de tache pour un maître parmi ses voisins et ses égaux. Il est vrai qu'on entend rarement parler de cette ligue, parce qu'elle est d'usage et qu'elle n'est pour ainsi dire que l'état naturel des choses, qui ne fait point sensation. Les maîtres se concertent aussi quelquefois pour faire baisser le salaire du travail au-dessous de son prix actuel. Ce projet est conduit dans le plus grand silence et le plus grand secret jusqu'au moment de l'exécution; et si les ouvriers cèdent sans résistance, comme il arrive quelquefois, quoiqu'ils sentent toute la rigueur du coup, le public n'en parle point. Cependant ils opposent souvent une ligue défensive et, dans certaines occasions, ils n'attendent pas qu'on les provoque; ils forment d'eux-mêmes une conspiration pour que les maîtres augmentent leur salaire. Les prétextes ordinaires dont ils se servent sont tantôt la cherté des denrées, tantôt la grandeur des profits que les maîtres font sur leur ouvrage. Mais soit que leurs ligues soient offensives ou défensives, elles font toujours grand bruit; pour faire décider promptement la question, ils ne manquent jamais de remplir lo monde de leurs clameurs, et ils poussent quelquefois la mutinerie jusqu'à la violence et aux outrages les moins pardonnables ; ils sont forcenés et agissent avec toute la folio et l'extravagance de gens désespérés qui se voient dans l'alternative de mourir de faim ou d'obtenir sur-le-champ par la teneur ce qu'ils demandent à leurs maîtres. »
[25] Paul Boiteau, article Budget du Dictionnaire général des finances, publié sous la direction de M. Léon Say, p. 719.