
Charles Comte, CR “De la Monarchie franÇaise depuis la seconde restauration jusqu'À la fin de 1816” (July 1818)
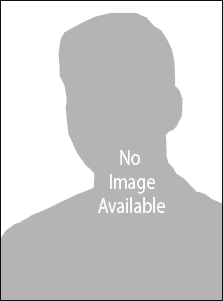 |
 |
| Charles Comte (1782-1837) |
This is part of an Anthology of writings by Charles Comte (1782-1837), Charles Dunoyer (1786-1862), and others from their journal Le Censeur (1814-15) and Le Censeur européen (1817-1819).
See also the others works by Charles Comte and Charles Dunoyer.
Source
[Unsigned, CC??], CR “De la Monarchie française depuis la seconde restauration jusqu'à la fin de 1816” (Montlosier), CE, T. 9, July 1818), pp. 156-91.
See also the facs. PDF of this article.
Text
[156]
DE LA MONARCHIE FRANÇAISE Depuis la seconde restauration jusqu'à la fin de la session de 1816, Avec un supplément sur la session actuelle ; Par M. le comte De Montlosier, [Un vol. in-8o. de 483 pages. ]
A Diverses époques, des assemblées populaires ont fait connaître en France les droits, ou, si l'on veut, les prétentions des hommes qu'elles représentaient; elles ont réclamé la sûreté des personnes et des propriétés, le libre exercice de l'industrie, la liberté des cultes, la liberté de la presse, l’égale répartition des impôts et des charges sociales, enfin l'égalité devant la loi, soit dans les punitions, soit dans les [157] récompenses; elles ont demandé aussi des institutions propres à garantir les droits qu'elles ont réclamés. En formant ces réclamations, elles n'ont pas demandé des priviléges; elles ont voulu que les charges et les avantages sociaux fussent communs à tous les Français, sans distinction de rang ou de naissance.
Les nobles se sont généralement opposés à l'établissement d'un tel ordre de choses, sans s'expliquer sur leurs prétentions particulières. Au commencement de la révolution, une explication de leur part n'était pas nécessaire; on savait qu'en allant invoquer le secours des puissances étrangères pour rentrer dans leur pays, pêle-mêle avec des soldats anglais, russes ou autrichiens, ils voulaient rétablir les choses dans l'état- où elles étaient avant la révolution, et prendre, contre les hommes qui l'avaient opérée, des mesures assez énergiques pour ne pas en craindre le retour. Mais aujourd'hui que les titres féodaux sont détruits, et que le retour pur et simple aux vieilleries du moyen âge paraît impossible, même à la plupart de ceux qui pourraient en profiter, une déclaration des prétentions nobiliaires serait d'une grande utilité, et nous regretterons long-temps que les braves et loyaux députés de la chambre de 1815 se [158] soient séparés avant de nous avoir donné une déclaration des droits des gentilshommes.
Lorsque plusieurs partis sont en présence, ils n'ont qu'un moyen de s'accorder : c'est de faire connaître, chacun de leur côté, les prétentions qu'ils élèvent. Ces prétentions connues, on peut les débattre, et transiger ensuite au moyen de quelques concessions réciproques: mais tant qu'elles restent dans le vague, ou que l'un des partis refuse de s’expliquer, il n'y a pas d'autre moyen d'en finir que d'en venir aux mains, ressource toujours dangereuse, même pour ceux qui ont la force et la raison, de leur côté. Un mauvais traité est préférable à la guerre la plus heureuse : les jugemens de Mars coûtent autant et ne valent pas mieux que ceux de Thémis.
Nulle assemblée de: nobles n'ayant fait la déclaration des droits du gentilhomme, nous sommes réduits à chercher dans les livres des écrivains de ce parti, .en quoi consistent ces droits, ces priviléges, ou ces prétentions, comme on voudra les appeler. Si nous parvenons à les bien déterminer, nous aurons fait un grand pas vers une conciliation générale; car alors il ne s'agira plus que de savoir si chacun des partis veut ou peut faire les sacrifices nécessaires pour [159] arriver à une pacification. Dans toute discussion, la plus grande difficulté est de s'entendre : une question bien posée, est une question à moitié résolue.
Mais nous ne devons pas nous dissimuler que, dans cette recherche, tous les désavantages sont de notre côté. Les droits ou les prétentions du parti populaire ne sont point équivoques; ils ont été développés dans une multitude d'ouvrages; ils sont réduits en articles de loi ; des assemblées de représentans les ont proclamés: il n'y a donc, à cet égard ni réticence, ni arrière-pensée. Les droits ou les prétentions des gentilshommes ne se trouvant consignés, au contraire, que dans quelques livres, le parti de la noblesse, peut toujours soutenir que les auteurs n'-avaient pas la mission d'exprimer son vœu, et étendre ou restreindre ses prétentions, selon qu'il se croira plus ou moins de force. Toutefois, nous ne laisserons pas que de rechercher dans les livres quelles, sont ces prétentions. Si la noblesse croit que les écrivains de son parti les ont exagérées, elle les démentira, et nous arriverons plus vite à une conciliation. Si elle pense au contraire qu'ils les ont trop restreintes, elle nous fera connaître celles qui ont été omises, et ce sera encore un moyen [160] d'arrangement, parce que ce sera un moyen de s'entendre.
De tous les gentilhommes écrivains, dont les ouvrages ne remontent pas au-delà de 1814, M. le comte de Montlosier est, à notre avis, celui qui a mis dans ses écrits le plus dé raison, le plus d'esprit et le plus de franchise ; nous dirions même le plus de modération, si son dernier volume ne devait pas apporter quelques modifications à ce jugement. C'est donc dans ses ouvrages' que nous devons chercher ce qu'il appelle les droits, et ce que d'autres nommeront les prétentions de son parti. Mais, avant de nous livrer à cette recherche, nous devons faire voir comment il considère les hommes et les choses : car c'est de sa manière de les voir que naissent toutes ses idées.
M. de Montlosier voit, deux Frances sur notre territoire :- une France ancienne et une France nouvelle ; il y voit aussi deux peuples, un peuple ancien et un peuple nouveau.
La France ancienne se compose des anciennes provinces, des anciennes lois, des anciennes institutions, des anciennes habitudes, des anciennes dénominations, enfin de tout ce qui a existé avant la révolution, et par conséquent [161] de tout le régime féodal. Le peuple ancien se compose de tous les gentilshommes.
Cette France et ce peuple ancien ont péri par la révolution, suivant M. de Montlosier. « J'entends continuellement, dit-il, parler de la France et du peuple français. Je sais qu'il y a eu autrefois en Europe un peuple de ce nom. Mais on n'en peut douter, ce peuple a disparu. Un grand nombre d'entre nous a assisté à ses derniers momens. Nous l’avons vu étendu à terre, massacré, dépécé. Nous avons vu comment la tête a été séparée du tronc, le tronc mis en pièces. Non-seulement la tête mise à part à été massacrée à part; nous avons vu encore comment on a dépécé les membres, comment on a dépecé aux differentes contrées leurs lois, leurs coutumes, leurs institutions, jusqu'à leur nom propre. »
La France a donc entièrement disparu aux jeux de M. de Montlosier; on peut en dire autant du peuple français. « On parle, en Europe, dit-il, du peuple français. Un peuple est quelque chose qui donne l'idée d'un passé, d'un présent, d'un avenir. Depuis la catastrophe qui a anéanti notre passé, bouleversé notre présent, et qui ne nous laisse apercevoir aucun avenir, sous quel rapport serions-nous [162] encore un peuple? Une multitude composée des débris d'une vieille nation qu'on reconnaît à certains signes avoir existé autrefois, et qui, par un acte de suicide sans exemple, s'est efforcée de se tuer elle-même et de s'abolir : voilà au juste ce que c'est aujourd'hui que le peuple français. » ( P. 4 et 5 ).
La destruction de la vieille France, c’est-à-dire, des anciennes institutions, des anciennes coutumes, enfin de tout ce qui a été détruit par la révolution, est, au jugement de l'auteur, une des catastrophes les plus déplorables. « Ah! s'écrie-t-il avec douleur, si, en 1789, l'assemblée qu'on appelle Constituante, se fût contentée de mettre le feu à la ville de Paris, et de proche en proche à Saint-Denis, à Versailles, à Lyon, à Rouen, à Toulouse, la France pouvait survivre à cette rage insensée … Quelque perte qu'il éprouve, un pays qui a conservé ses anciennes mœurs, ses anciennes institutions, ses anciennes lois, est, par cela même, plein de vie. … Mais un pays qui a abattu tout son ancien édifice social, un pays renégat de ses anciennes institutions et de ses anciennes lois; un pays qui a perdu tout son moral, en conservant seulement son matériel; un tel pays a beau figurer parmi les peuples, il n'est pas [163] moins détruit à mes yeux que la fameuse Thèbes aux cent portes, dont les ruines frappèrent de stupeur notre armée dans les déserts de l'Égypte. » (page 3 et 4).
La révolution opérée par l'assemblée constituante ayant été pour la France une catastrophe plus terrible que ne le fût jadis l'invasion des peuples barbares, il n'est aucun sacrifice qu'on ne doive faire pour détruire le peu qui nous reste de l'ouvrage de cette assemblée célèbre, et pour rétablir cette vieille France, dont la perte est si amèrement déplorée par tons nos loyaux gentilshommes. Il faut à tout prix rétablir les anciennes lois, les anciennes mœurs: il le faut, quand même cela exigerait que toutes nos villes fussent réduites en cendres. Ce rétablissement, plus précieux que toutes les richesses du monde et que l'existence de plusieurs millions de citoyens, est commandé par l'intérêt de l'Europe, par l'intérêt de la légitimité, par les droits et par les intérêts des gentilshommes auxquels se rattache le sort du genre humain, et même par l'intérêt de ceux qui n'appartiennent pas à la caste nobiliaire.
M. de Montlosier croit en effet que les principes de la révolution se sont répandus dans toute l'Europe, et qu'ils finiront, si l'on n’y [164] met ordre, par y généraliser les bouleversemens et les catastrophes de la France. « On assure, dit-il, que nous ne sommes pas loin de ce dénoûment. De toutes parts les colléges, les universités, les académies, sont en marche contre les anciennes institutions, c'est-à-dire, pour parler un peu plus clairement, contre les anciens droits et les anciennes propriétés; et, pour parler encore plus clairement, contre toutes les anciennes inégalités. »
Ailleurs, M. de Montlosier observe qu'à mesure que les événemens s'éloignent, une partie de la nation se relève et la révolution avec elle. Il assure que, si ce mouvement est abandonné à lui - même, elle se relèvera de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle se soit replacée au niveau de 1793. « Le mouvement que je signale ici, ajoute-t-il, n'est pas seulement propre à la France, c'est celui de toute l'Europe. Selon la conduite du gouvernement, la France préservera l'Europe de cet abîme, ou bien elle l’y entraînera. »
La légitimité se trouve également intéressée au rétablissement de l'ancienne France et de l'ancien peuple français. M. de Montlosier pense que le char légitime de Louis XVIII ne saurait marcher sur un essieu tout [165] révolutionnaire; et que l'ancien peuple, c'est-à-dire, le peuple des gentilshommes, est seul attaché au maintien de la légitimité. Il conjure, en conséquence, les puissans d'aujourd'hui de ne pas laisser le trône dans la position où il se trouve. « Si nous avions un roi nouveau, dit-il, il serait convenable de reprendre beaucoup de choses de la France ancienne. Avec un roi ancien, c'est indispensable. »
Enfin, le peuple nouveau est lui-même intéressé à relever le peuple ancien ou la noblesse. « En la relevant aujourd'hui pour vous, dit M. de Montlosier, vous êtes sûr qu'un jour elle ne se relèvera pas pour elle. En la relevant par votre force, vous préviendrez les suites d'un triomphe qui s'opérerait par la sienne. » Il faut donc que le peuple français, pour prévenir ce qui lui arriverait si la noblesse se rétablissait par elle-même, se hâte de lui donner lui-même l'existence. C’est ainsi qu'on prévient en effet les ravages de la petite vérole; pour se garantir du mal, il faut se l'inoculer.
Le rétablissement de l'ancienne France et de l'ancien peuple étant jugé nécessaire, il faut examiner en quoi ce rétablissement consiste; nous verrons ensuite par quels moyens on peut l'opérer. Mais comme la France nouvelle pourrait [166] ne pas accepter gracieusement le destin qu'on veut lui faire, il est nécessaire de prendre d'abord ses précautions. « Quand un cheval vigoureux vient à s’abattre et à s'engager dans les traits, dit M. de Montlosier, que faites-vous? vous le contenez d'abord vigoureusement; sans cela il brisé tout. La nation française; a été de même abattue par la révolution. Depuis vingt-cinq ans, elle se démène avec violence, et ne peut parvenir à aucune situation fixe. S'emparer d'abord de ses mouvemens pour avoir le temps de la dégager, la remettre ensuite dans sa véritable place : voilà ce qu'il faut effectuer. »
Lorsque la France aura été liée et garrotée, et qu'on se sera ainsi rendu maître de ses mouvemens, il faudra la conduire sans detours au but qu'on se propose, et la remettre dans.sa véritable place. Car, ce qui exciterait le plus la méfiance, « ce serait, dit l'auteur, un retour simulé, et néanmoins progressif, vers les choses anciennes., de manière que l'ensemble de la nation ne pût .savoir avec précision, ni où on va, ni où on s'arrêtera. Une marche franche qui marque; l'intention et le but n'inspirera aucunes alarmes : au contraire, elle les dissipera. »
M. de Montlosier pense donc qu'il faut en [167] agir franchement avec la France nouvelle, après s'être rendu maître de ses mouvemens. Suivant lui, une déclaration d'état sur les choses de l'ancien régime est absolument nécessaire. Cette déclaration devrait être faite par une haute commission formée à cet effet, commission qui serait composée des féaux de Louis XVIII, c'est-à-dire, de ses fidèles.
La France nouvelle liée, la haute commission des féaux composée, il est encore une mesure qu'il faudra ne pas oublier avant de marcher au but. « Avant tout, dit M. de Montlosier, ce qu'il faut faire, c'est de marcher bien armé, et avec du gros canon, s'il est possible, contre ce qui s'appelle aujourd'hui accroissement des lumières, progrès de la civilisation, esprit du siècle : masques nouveaux sous lesquels reparaissent nos anciens droits de l'homme, avec leur séquelle de liberté, égalité, fraternité, ou la mort. » Nous verrons plus loin que la considération attachée aux travaux utiles est principalement une des choses contre lesquelles il faut marcher bien armé, avec du gros canon, s'il est possible.
Tout est préparé : il ne reste plus qu'à se mettre en marche vers la grande restauration. D'abord « il faut, à quelque prix que ce soit, [168] qu'une nation soit distribuée en classes; en dépit de la haine du mot, il faut que chaque classe ait ses privilèges: ce qui ne veut dire autre chose que ses lois particulières, privatae leges. » Il faut donc établir des castes; mais quelles règles suivra-t-on pour les établir? quelles personnes seront dans la première? quelles dans la seconde? quelles dans la troisième? Le choix pourrait être embarrassant, si M. de Montlosier ne nous présentait des règles infaillibles.
On s'est imaginé qu'il n'existait en France qu'une seule légitimité : cette erreur a été commise par les rois, par leurs ministres et surtout par les peuples nouveaux. Les gentilshommes se sont seuls apercus qu'autour de la grande légitimité, il existait une multitude de légitimités moyennes ou petites, « On a affirmé, dit-il, que les puissances s'étaient armées, en faveur de la légitimité. C'est bien; mais n'y a-t-il qu'une seule légitimité au monde ? N'est-ce que dans les trônes qu'il faut la reconnaître? Ne pénètre-t-elle pas aussi en quelque manière dans les rangs, dans les droits, dans les possessions des simples citoyens? »
A la première restauration on ne reconnut qu'une seule légitimité, à la seconde on commit la même erreur : cependant « autour de la [169] grande légitimité qui avait reparu, on apercevait une multitude de petites légitimités qui voulaient reparaître. » On se préparait à venger les atteintes portées à la grande légitimité : on eût voulu venger aussi les atteintes portées aux légitimités inférieures : une « grande vengeance publique ne semblait réclamée dès lors, ajoute M. de Montlosier, que comme une belle occasion pour des vengeances privées. »
Nous avons donc, suivant ce système, des ducs, des marquis, des comtes, des barons légitimes; et cela par la même raison que nous avons un roi légitime. Les seigneurs existant ainsi en vertu du droit divin, il est évident que les lois humaines n'ont pu porter aucune atteinte à leurs droits, et que le peuple nouveau aurait tout-à-fait mauvaise grâce à ne pas se reconnaître vassal du peuple ancien. En même temps que la France a été soumise à son roi légitime, chaque village, chaque province a dû reconnaître la légitimité de son ancien seigneur.
S'il existe des ducs, des comtes, des barons légitimes, il en existe aussi qui sont illégitimes. Ceux-ci font à côté des premiers une fort triste figure; et il serait bien difficile de les fondre en un seul corps. On en jugera par la [170] comparaison qu'établit M. de Montlosier entre les uns et les autres.
« Je suppose, dit-il, que, fatiguée de la situation actuelle de Saint-Domingue, il vienne à la pensée de quelque grande puissance de le rendre à son souverain légitime, et qu'elle en fasse la conquête. Qu'on se représente un prince français, accompagné seulement de quelques serviteurs, allant siéger par capitulation dans un sénat mi-parti de blancs et de noirs. Si les blancs ont la prépondérance, on voit tout de suite quelle figure font les ducs de Marmelade et de Limonade. Si, au contraire, ce sont les noirs qui l'emportent, je tremble pour notre prince et pour ce qui l'accompagne.
» A la première restauration cette fable s'est réalisée. Par la conduite qu'ont tenue alors les puissances (les ennemis), les noirs se sont trouvés avoir une telle prépondérance, que la victoire a eu lieu sans combat. Depuis la seconde restauration, je conviens qu'une victoire ne serait plus si facile; mais on a laissé encore tous les élémens d'une crise. »
Nous n'avons pas seulement des ducs, des comtes et des barons illégitimes ; l'illégitimité se trouve aussi chez les hommes en place et même chez des bourgeois. L'assemblée [171] constituante, qui avait détruit la noblesse, n'avait en effet établi que des illégitimités. M. de Montlosier reproche aux puissances coalisées la conduite qu'elles ont tenue; il leur reproche d'avoir regardé comme une chose habile de faire rétrograder l'année 1814 vera l'année 1790 et 1792; puis il leur parle en ces termes: « Eh quoi! vous ne voyez pas qu'une seule chose a fait périr Louis XVI : c'est de se trouver comme tête ancienne sur un corps nouveau, et d'avoir à commander comme légitime à beaucoup d'illégitimités ! Ces illégitimités, si terribles dans leur jeunesse, vous les croyez adoucies aujourd'hui parce qu'elles ont vieilli! »
La nation devant à tout prix être divisée en classes, on voit qu'il est aisé de savoir comment la division sera faite : ce seront les ducs et les marquis, les comtes et les vicomtes, les barons et les chevaliers, enfin tous les gentilhommes ou tous les seigneurs légitimes qui composeront la première; et, pour que le mécontentement ne soit pas trop grand, on pourra leur adjoindre quelques ducs ou quelques barons de Limonade ou de Marmelade. Si ces noirs illégitimes font une triste figure, si les anciens les éclipsent par la blancheur de leur peau légitime, ce sera tant pis pour eux.
[172]
Mais quels seront les priviléges, les prérogatives dont jouiront les gentilshommes légitimes? Leur rendra-t-on les biens confisqués? Seront-ils remis en possession des droits féodaux? Les dîmes leur seront-elles payées en vertu du droit divin? Chacun d'eux aura-t-il ses tributaires particuliers, comme dans l'heureux temps de la féodalité, ou les tributs seront-ils perçus par des mesures générales sur la nation, et répartis ensuite entre eux, selon l'élévation de leurs grades?
Il faut reconnaître d'abord que le clergé n'est pour rien dans la question, et qu'ainsi la conformation des ventes des biens ecclésiastiques ne peut pas souffrir de difficulté. Il en est de même, suivant M. de Montlosier, de l'abolition des dîmes, des cens, des droits seigneuriaux. « Lorsque pendant un siècle entier, dit-il, tout un peuple aura été enseigné à regarder ces droits comme des usurpations; lorsque toutes les lumières d'un pays, se concertant pour créer les ténèbres, les savans pour créer l'ignorance, les juges pour consacrer l'injustice, auront réussi à diffamer un ordre de l'état, en même temps que tous ses droits, toutes ses possessions, comment un peuple résistera-t-il à cette action continue, à ce concert unanime? [173] Comment ne se croira-t-il pas dans la ligne de l’équité, en reprenant un jour, par la force, des avantages qu'on lui a enseigné avoir été envahis par la force ? »
Les acquisitions de biens confisqués souffrent plus de difficultés. « Les condamnations ayant été nulles, les effets de ces condamnations ne sont-ils pas nuls de droit? » M. de Montlosier, après avoir ainsi posé la question, distingue les acquisitions des acquéreurs. « Je ne balance pas, dit-il, à considérer les acquisitions comme illégitimes. Les acquéreurs me paraissent mériter une grande faveur. » L'auteur s'engage ici dans des questions de droit, dont nous ne croyons pas devoir nous occuper. Il avoue que ceux qui veulent recouvrer absolument tout ce qu'ils ont perdu visent à perdre ce qui leur reste : mais il croit que les mesures qu'on a prises pour consolider les ventes des biens confisqués sur les émigrés, ont été peu sages et peu convenables. Adoptant la maxime suivant laquelle ce qui est à nous ne peut pas être transporté à autrui sans nous, il pense que les émigrés doivent être appelés à sanctionner eux-mêmes les ventes de leurs biens.
Il serait cependant possible, suivant lui, de [174] dépouiller les acquéreurs sans blesser la charte. L'article 10 porte que l'état peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public, légalement constaté, mais avec une indemnité préalable. Partant de cet article, M. de Montlosier s'exprime en ces termes : «Si, après avoir pris le conseil constitutionnel de ses féaux et fait constater par eux l'intérêt public, Louis XVIII jugeait à propos d'exiger de la part des acquéreurs le sacrifice de leurs propriétés acquises, il le pourrait avec une indemnité préalable. D'après cet article, il n'y a nul doute. »
On voit qu'il n'est rien que des hommes d'esprit ne puissent démontrer. La liberté de la presse et la sûreté individuelle nous ont été confisquées en vertu de la charte qui les déclarait inviolables; il ne manquerait plus que de suivre la même marche à l'égard des ventes de biens nationaux. Il est cependant une difficulté que M. de Montlosier n'a pas prévue : c'est de savoir sur qui on prendrait les fonds nécessaires pour indemniser les acquéreurs. Les prendre sur ceux-ci serait absurde, car on ne se paie pas une indemnité à soi-même. Les prendre sur d'autres serait inique, puisque ce serait confisquer les biens de ceux qui n'ont rien acquis, [175] en faveur des émigrés ou des acquéreurs des biens vendus.
Le même raisonnement s'applique aux indemnités qu'on voudrait payer aux émigrés. Faire payer ces indemnités par les acquéreurs serait réellement les dépouiller ; les faire payer par d'autres serait une iniquité que rien ne pourrait justifier. Quant à ceux qui voudraient les faire payer par l'état, ils devraient bien nous expliquer quelles sont les personnes dont l'état se compose, lorsqu'on en a distrait les acquéreurs qui ne doivent rien restituer; les non-acquéreurs qui n'ont aucune restitution à faire n'ayant profité de rien, et les émigrés qui devraient profiter des indemnités.
Quoique dans le système de M. de Montlosier, les nobles légitimes ne doivent recouvrer ni les dîmes, ni les droits féodaux, ni même ceux de leurs biens qui ont été vendus, gardons-nous de croire qu'ils ne doivent recevoir aucune indemnité. Il est des honneurs, des titres, des dignités, des places dont ils jouiront exclusivement.
D'abord, on doit se bien pénétrer de l'importance d'un gentilhomme. Un gentilhomme, comme on l'a vu, est à un roturier, même quand celui-ci est devenu comte ou duc, ce [176] qu'un blanc est à un noir : cette comparaison établit, en faveur du premier sur le second, une supériorité incontestable; elle prouve sans difficulté que nos seigneurs les gentilshommes légitimes sont nés pour commander et se reposer, et que nous autres noirs illégitimes, nous sommes nés pour travailler et pour obéir. En partant de ce point, on peut faire la déclaration des droits du gentilhomme légitime; on va voir qu'en effet tout dérive de là.
M. de Montlosier rappelle que chez les Germains le travail et quelques tributs composaient toute la servitude, et que le loisir et le courage distinguaient l'homme d'une condition ingénue. Or, il est clair que les hommes du Nord ayant envahi nos ancêtres, ces conquérans légitimes transmirent à leurs descendans le droit d'exploiter les enfans des vaincus, et que ceux-ci ne peuvent pas se rendre maîtres de leurs propres personnes sans se constituer usurpateurs et sans violer le droit divin.
L'indépendance pleine est le partage exclusif du gentilhomme légitime. « Dans la noblesse, dît M. de Montlosier, l'indépendance est absolue. Il n'y a de dépendance que pour le roi et pour la patrie. »
Un gentilhomme légitime est un être [177] essentiellement courageux; car le courage est un droit qu'il tient des Germains ses ancêtres. En effet, que sont en France aujourd'hui les gentilshommes français, si ce n'est « des grenadiers ayant quelques lignes de plus que leurs camarades, avec le privilége d'un bonnet, et de figurer en première ligne au feu et à l'assaut ? » Si, comme nous l'assure ici M. de Montlosier, les gentilshommes ont le privilége de figurer en première ligne au feu et à l'assaut, nous n'avons pas à nous en plaindre; jamais la révolution du 20 mars ne serait arrivée, s'ils n'avaient pas plus abusé de leurs autres priviléges qu'ils n'ont abusé de celui-là.
Un gentilhomme est citoyen de l'état. « Sa cité, dit M. de Montlosier, est la France entière. » On peut bien, suivant lui, écarter dés assemblées électorales les fonctionnaires publics. Cette jalousie paraît raisonnable,. mais elle ne peut porter sur un chef de famille noble. « L'éloigner du collége électoral, sous prétexte qu'il ne paie pas telle ou telle somme de contribution, me paraît ridicule, je dirai plus, un scandale. Tout citoyen n'est sûrement pas gentilhomme; mais tout gentilhomme me paraît nécessairement citoyen, et, comme tel,membre né de son collége électoral. »
[178]
Nous avons vu qu'à tout prix il fallait que la population fût divisée en castes, et que chacun restât circonscrit dans la sienne. Voici quelle est la sphère d'un gentilhomme : « Au-dessus de lui, le gentilhomme ne peut exercer les fonctions dans la chambre des pairs; au-dessous, il ne peut exercer de profession lucrative. Entre ces deux exclusions sa condition est déterminée: c'est d'être candidat né pour toutes les places de service public. On n'est pas gentilhomme parce qu'on est seigneur, ou parce qu'on paie des impositions d'une dénomination particulière. On est gentilhomme parce qu'on a été voué par la faveur du roi, ou par sa naissance, aux professions de service public, à l’exclusion des professions de service privé. On a beaucoup reproché à la noblesse de prétendre aux places honorables. Ou par les mœurs, ou par les lois, ou par les ordonnances, ou par la charte, il faut absolument qu'elle ait les places honorables de l'état : car elle ne peut en avoir d'autres. » .
Ce n'est pas assez que la noblesse ne puisse pas faire autre chose que convoiter des places ou en occuper, il faut encore qu'elle en repousse, ceux qui, après avoir acquis de la fortune par leur industrie, voudraient entrer dans la même carrière. « En même temps que les [179] lois encourageront ce mouvement (industriel) comme principe de prospérité pour l'état, l'opinion s'empressera de le châtier, comme principe de dépravation pour les mœurs; elle repoussera constamment des rangs supérieurs ces colosses d'or formés récemment dans la boue. Conservatrice des rangs et des mœurs, elle refusera tout lustre d'état à ce lustre bourgeois; elle lui interdira tout poste d’honneur, jusqu'à ce que, se filtrant peu à peu, et dépouillant son impureté originaire, il ait mérité d'entrer dans les rangs élevés, et de renforcer de son éclat subalterne leur éclat. »
Ces priviléges, inhérens à la personne de tout gentilhomme, sont précieux. Il en est d'autres qui ne le sont pas moins. On vient de voir qu'il est dans leurs personnes des qualités occultes et légitimes qui les rendent seuls propres au service public, et qu'ils y sont tous voués par leur naissance. Cela seul les place exclusivement dans le domaine de l'honneur et de la gloire. « Un ministre de Louis XVI, dit M. de Montlosier, parla un jour dans une proclamation de l'honneur qui était dû aux professions bourgeoises; M. Burke remarqua qu'il n'y avait d'honneur que pour les professions vouées au service public. » M. de [180] Montlosier dit ailleurs : « L'honneur, le respect, la haute consideration appartiennent spécialement à tout ce qui est voué au service public. C'est dans les professions de l'honneur que se place le domaine de la gloire. »
Il est encore un autre privilége attaché à la personne de tout gentilhomme,- c'est de ne pas être appelé en qualité de simple soldat, en vertu de la loi sur le recrutement. Tout gentilhomme naissant officier, c'est le dégrader que de le faire servir dans une qualité inférieure. C'est un attachement excessif à ce privilége, qui a causé la grande colère qui s'est manifestée parmi la noblesse à l'occasion de la dernière loi sur le recrutement. « Au milieu des violations et des violences, des maux et des misères qui affligent l'humanité, dit à ce sujet M. de Montlosier, il en est d'une nature absolument insupportable et qu'il est convenable de supporter : il en est d'autres d'un caractère particulier qu'on ne supporte jamais. Je soupçonne, que c'est quelque chose qui se rapporte à ce que les Romains appelaient chez eux diminutio capites, mutation statûs, ou bien un simple déplacement de grade, d'où est venu chez nous le mot DÉGRADATION. »
L'oisiveté et la dissipation étant le [181] caractère distinctif de la caste, et tout gentilhomme devant, suivant M. de Montlosier, se laisser mourir de faim plutôt que de se livrer à un travail qui est réputé vil, toutes les issues se trouvent ouvertes pour perdre, et aucune pour acquérir, Il est donc nécessaire que les gentilshommes aient un privilége pour prévenir un résultat qui, pour eux, serait le néant. Ce privilége est celui des grands emplois et des grands mariages. « Par toutes les issues des grands mariages et des grands emplois se répare ce qui a échappé par d'autres issues. Les grandes propriétés mobilières glissent par cette pente vers les brèches des grandes propriétés territoriales. » Ainsi, lorsqu'un gentilhomme légitime aura dissipé sa fortune, il se gardera bien de s'en former une nouvelle en se livrant à un travail qui est réputé vil; il se traînera d'antichambre en antichambre pour solliciter un emploi qui le mette à même de s'enrichir aux dépens du public; et, s'il ne peut y parvenir, il s'adressera à l'un de ces colosses d'or formés récemment dans la boue, et, pourvu que le colosse veuille bien laisser glisser ses grandes propriétés mobilières vers les brèches survenues à la propriété territoriale du gentilhomme, celui-ci consentira à devenir le mari de sa fille ou de sa [182] nièce, et à renforcer son propre éclat de ce lustre bourgeois.
Les priviléges attachés à la personne d'un gentilhomme légitime seraient mal compris si l'on ne faisait pas connaître la sphère dans laquelle tout bourgeois et tout homme qui exerce quelque industrie doivent être circonscrits.
Il faut savoir d'abord que tout travail est essentiellement vil, et qu'il avilit nécessairement celui qui s'y livre : à cet égard, nous n'avons pas trouvé d'exception dans l'ouvrage de M. Montlosier; ainsi, l'agriculteur et le manufacturier, le banquier et le négociant, le courtier et l'agent de change, l'avocat et le médecin, l'astronome et le mathématicien, en un mot, tous ceux qui retirent quelques bénéfices de leurs talens, remplissent des professions serviles ; ils sont à l'égard des gentilshommes dans la position où se trouvaient les esclaves des conquérans venus du Nord, à l'égard de leurs maîtres.
M. de Montlosier observe que le pauvre qui n'a au monde que sa liberté, et qui est obligé d'acheter avec ce seul bien les choses nécessaires à sa subsistance, représente le dernier degré des conditions sociales, c'est-à-dire, l'état d'esclavage. Il convient qu'il y a sûrement de la différence dans les professions lucratives; mais, [183] dit-il, cette différence n'est pourtant pas aussi grande qu'on se l'imagine.
« Tout ce qui est condamné à se donner une certaine peine, ajoute-t-il, le gagne petit et le gagne gros; celui qui sue pour gagner du cuivre; celui qui, du soir au matin, se démène pour gagner de l'or; celui qui, ayant déjà beaucoup d'or, continue à se démener pour en avoir davantage ; celui qui appelle individuellement les passans pour les faire entrer dans son magasin ; celui qui se contente de les appeler collectivement dans des affiches ou dans des écriteaux ; tout cela, avec des nuances différentes, peut être censé du même ordre et de la même condition. »
Nous pourrions demander ici à M. de Montlosier si l'homme qui va de porte en porte mendier du cuivre, et l'homme qui va d'antichambre en antichambre mendier de l'or, ne peuvent pas aussi être censés du même ordre et de la même condition ; mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit : laissons aux mendians le privilége des injures.
L'honneur, le respect, la haute considération, le courage, la gloire, les grands emplois et les gros salaires, appartiennent exclusivement, ainsi que nous l'avons vu, aux [184] gentilshommes légitimes. Voici quel est le lot des roturiers: « Les classes inférieures sont faites pour le travail et pour l'économie : c'est de là qu'elles doivent prendre leur élan. Une certaine élégance, une certaine délicatesse, une certaine susceptibilité, et surtout une certaine ambition, me paraissent chez elle un indice de corruption, et non pas de perfection. »
Il faut donc prendre bien garde de ne laisser pénétrer aucun homme appartenant à l'industrie dans une des places réservées aux gentilshommes: une telle invasion serait une calamité publique. Un noble est citoyen de l'état. Sa cité est la France entière. Mais un bourgeois n'est citoyen que de sa ville ou de son village. « Là, dit M. de Montlosier, finit son importance. »
Cet écrivain parait singulièrement scandalisé que, pendant les cent jours du dernier règne de Bonaparte, un négociant ait été appelé à la chambre des pairs. « Nous avons pu nous applaudir, dit-il, de voir des marchands de toiles membres d'une cour des pairs; nous avons admiré des avocats et des procureurs devenus tout à coup comtes, ducs, princes. » Ailleurs, il dit que les classes qui ne sont pas nobles trouveraient beau, comme sous [185] Bonaparte, que le général d'armée et le marchand de toiles fussent ensemble admis à la chambre des pairs. » Comme Bonaparte, s'écrie-t-il dans un troisième passage, était un grand homme ! il donnait des titres de baron aux chirurgiens, et il faisait entrer les marchands de toiles peintes à la chambre des pars ! »
Cette ardeur de s'emparer des places et d'en exclure tout homme qui tient à une industrie quelconque, est un penchant très-raisonnable chez les hommes qui conservent les mœurs anciennes, c'est-à-dire les mœurs des conquérans ; le moyen le plus sûr d’exploiter une nation, et de la traiter en peuple conquis, est de s'emparer de tous les postes, et d'en chasser impitoyablement tout homme qui, par ses habitudes ou par sa position, pourrait faire cause commune avec les vaincus.
Ce n'est pas assez de tracer une ligne de démarcation entre les castes; il faut encore que chacune ait ses statuts et ses règlemens particuliers, les gentilshommes comme les bourgeois. Les classes inférieures doivent aussi avoir les leurs : les jurandes, les maîtrises, les corporations sont nécessaires comme moyen de façonner à l'obéissance, et de rétablir les choses anciennes. Sous ce rapport, la domination de [186] Bonaparte a été utile: elle a façonné le peuple nouveau à l'obéissance. La conscription elle-même n'a pas été sans utilité. « Cette mesure, dit M. de Montlosier, n'a pas été un aussi grand fléau qu'on pourrait le croire. Elle a délivré les parens de fils insolens; les maîtres, d'ouvriers, de compagnons, d'apprentis insubordonnés. Tout cela a été du moins apprendre dans les camps à obéir et à regretter la douceur des liens domestiques. »
Mais quels sont les hommes qu'on chargera de rétablir la France ancienne avec son peuple ancien ? Où trouvera-t-on des gens assez adroits et assez énergiques pour s'emparer de la nation et s'en rendre maître ; pour combattre avec force les progrès des lumières et de la civilisation; pour restituer aux gentilshommes légitimes les priviléges inhérens à leurs personnes, et pour renfermer les autres classes dans la sphère subalterne qui leur est propre?
M. de Montlosier croit que les puissances coalisées étaient fort propres pour remplir cet objet: il emploie plusieurs chapitres de son ouvrage, soit à démontrer qu'elles en avaient le droit, soit à les censurer de ce qu'elles n'ont pas usé de ce droit incontestable. Leur conduite à cet égard lui paraît inconcevable : [187] elles n'ont songé qu'à une seule légitimité, tandis qu'elles auraient dû s'occuper d'une multitude d'autres légitimités qui, à tout prix, voulaient reparaître, mais qui ne pouvaient y parvenir par leurs propres efforts.
Les puissances coalisées n'ayant rien fait pour rétablir les anciennes institutions, les anciennes mœurs, pour attaquer les progrès des lumières, en un mot, pour rétablir la France ancienne, il ne reste qu'à suivre l'exemple de Bonaparte; c'est-à-dire, qu'il faut faire pour les gentilshommes ce qu'il faisait pour les hommes qui s'étaient attachés à sa fortune. « Napoléon, dit M. de Montlosier, avait pour double objet de faire la contre-révolution dans les choses (c’est-à-dire, dans les institutions et dans les principes), et de compléter la révolution dans les personnes. Il élevait au plus haut point tout jacobin qui abandonnait ses principes. Il frappait de toutes ses forces le jacobin qui les conservait. Des révolutionnaires infidèles à la révolution, voilà ce qu'il lui fallait. »
Le choix du duc d'Otrante pour ministre, en 1815, pouvait être bon sous ce rapport; car, suivant M. de Montlosier, « Des hommes sortis de la révolution, sont souvent ses ennemis les plus ardens, et toujours ses ennemis les plus éclairés. » Enfin, pour arriver au rétablissement de la France ancienne, c’est-à-dire, à la contre-révolution dans les principes et dans les institutions, M. de Montlosier ne voit rien de mieux que de suivre la marche et d'employer les hommes du gouvernement impérial. « C'est là, selon moi, dit-il, qu'il faut faire usage de cette habileté tant prônée de Bonaparte, et employer les bons instrumens formés à son école. »
On va prendre peut-être M. de Montlosier pour un partisan outré de la chambre de 1815; point du tout: s'il montre une grande vénération pour les hommes qui la composaient, il désapprouve formellement la marche qu'ils ont suivie, et il applaudit à l'ordonnance du 5 septembre.
« Que la France ancienne, dit-il, ne fasse point de reproche au gouvernement. Dès les premiers momens de la seconde restauration, Louis XVIII s'est placé pleinement et franchement dans la ligne de la France ancienne. Si les meneurs de la France ancienne avaient voulu le permettre, le roi tiendrait encore aujourd'hui cette ligne ; mais ces hommes mal avisés n'ont pas voulu amener à eux la France nouvelle ; ils n'ont pas voulu, avec des liens [189] doux et honorables, la captiver et l'attacher. Ils ont montré l'intention de la garrotter et de la subjuguer. Au lieu de tempérer le déploiement de la force, ils en ont affecté l’éclat … Ils ont effrayé la nation ; ils ont effrayé le roi lui-même, la dissolution de l'assemblée est devenue inévitable. »
M. de Montlosier se montre un grand admirateur de l'administration actuelle. Trouve-t-il que les ministres élèvent au plus haut point tout jacobin qui abandonne ses principes, et qu'ils frappent de toutes leurs forces le jacobin qui les conserve? Pense-t-il qu'ils attaquent le progrès des lumières avec toute leur artillerie? A-t-il quelques raisons de croire qu'ils font usage de cette habileté tant vantée de Bonaparte, et qu'ils emploient les bons instrumens formés à son école? Enfin, a-t-il, pour les admirer, des motifs que nous ne connaissons pas? C'est ce que nous ne saurions dire; tout ce que nous pouvons affirmer, c'est qu'il est leur admirateur.
Nous nous sommes plus attachés à exposer les principes de M. de Montlosier qu’à les combattre, parce qu'on en trouve la réfutation dans nos volumes précédens. Les fonctions publiques ne doivent pas être établies dans l'intérêt de ceux qui [190] les remplissent; elles doivent l'être dans l'intérêt du public. Pour savoir quelles sont les personnes à qui il faut les confier, il faut donc chercher ce qui convient non à telle ou telle partie de la nation, mais à ceux qui paient pour faire aller le gouvernement. Or, nous avons prouvé précédemment qu'un titre de gentilhomme était un mauvais garant pour un administrateur. Quant à l'honneur, au respect, à la haute considération dont M. de Montlosier veut faire l'apanage exclusif de la noblesse, ce ne sont pas des choses dont on dispose par des règlemens ou des ordonnances : dans un pays où il existe une opinion publique, les gouvernemens donnent des places, des cordons ou de l'argent; c'est le public qui donne le reste.
Il est beaucoup de personnes auxquelles les prétentions exposées par M. de Montlosier feront jeter les hauts cris. Elles voudront qu'on maintienne à tout prix le droit acquis à chacun de solliciter des places. Pour faciliter l'exercice de ce droit, elles voudront abaisser, avilir même tout ce qui se montrera avec des prétentions de gentilhomme. Ces cris et ces efforts ne produisent rien : le meilleur moyen de rabattre les prétentions exclusives, c'est de réduire au plus petit nombre possible les agens [191] du gouvernement, et de diminuer les salaires, de telle sorte que les emplois deviennent de véritables charges. Alors, il faudra bien que les gentilshommes vivent sur leurs propres biens, ou qu'ils travaillent s'ils veulent vivre; alors, ceux qui n'ont point de propriétés, et qui trouvent que l'homme est avili par le travail, pourront adresser au monarque le discours que tient en leur nom M. de Montlosier: « Le roi peut prendre sur les opinions actuellement en faveur le parti que sa sagesse lui suggérera … Notre douleur ne peut avoir qu'un seul langage; notre devoir est de le saluer en mourant : Caesar, morituri te salutant. »
Nous nous sommes attachés dans cette analyse a exposer le système de M. de Montlosier, en faisant abstraction des accessoires. La partie que nous avons négligée n'est pas la moins intéressante de son ouvrage. L'auteur y parle des hommes et des partis avec une indépendance et avec une sincérité qui honorent son caractère; quoique nous ne soyons pas toujours de son avis, nous avons lu son ouvrage avec plaisir: les choses de détail font plus que racheter les vices du système.