
Charles Comte, “De la multiplication des pauvres, des gens À places, et des gens À pensions” (CE, March 1818)
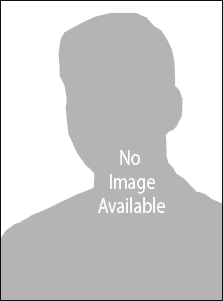 |
 |
| Charles Comte (1782-1837) |
This is part of an Anthology of writings by Charles Comte (1782-1837), Charles Dunoyer (1786-1862), and others from their journal Le Censeur (1814-15) and Le Censeur européen (1817-1819).
See also the others works by Charles Comte and Charles Dunoyer.
Source
CE10: (CC?), “De la multiplication des pauvres, des gens à places, et des gens à pensions” (CE, T. 7, 28 mar. 1818), pp. 1-79.
See also the facs. PDF of this article.
[1]
De la multiplication des pauvres, Des pauvres, des gens à places, et des gens à pensions.[1]
Nous l'avons déjà dit: il n'existe dans le monde que deux grands partis ; celui des hommes qui veulent vivre du produit de leur [2] travail ou de leurs propriétés, et celui des hommes qui veulent vivre sur le travail ou sur les propriétés d'autrui; celui des agriculteurs, des manufacturiers, des commerçans, des savans, des industrieux de toutes les classes, et celui des courtisans, des gens à places, des moines, des armées permanentes, des pirates, des mendians.
Depuis l'origine du monde, ces deux partis ont toujours été en état de guerre; et, selon que l'un ou l'autre a triomphé, la gloire, la richesse, la vertu ont été son partage. Quand le parti des mangeurs de gens a eu le dessus, il s'est proclamé exclusivement brave, loyal, vertueux; le parti contraire n'a été qu'un ramas de lâches esclaves, avilis et corrompus par le luxe. Quand celui-ci a pu se soustraire à l'asservissement, [3] ses ennemis n'ont été que de misérables brigands ou de vils imposteurs. Sois juste, et tu seras fort, dit le philosophe. Le monde répond: Sois fort, et je te proclamerai juste.
Notre dessein n'est pas de nous prononcer pour l'un ou l'autre de ces deux partis : ils sont tous les deux également redoutables; nous les respectons donc également, et nous nous plaisons à reconnaître qu'ils ont l'un et l'autre de grandes qualités.
Les mangeurs de gens sont braves, sobres et vigilans, lorsqu'ils ne peuvent vivre qu'en pillant des peuples pauvres, qui savent leur faire acheter chèrement la victoire : témoin le peuple de Rome, dans les premiers temps de la république ; témoin le peuple de Sparte, quand il était obligé de vivre sur le travail de ses ilotes. Les hommes industrieux ont aussi leurs qualités : ils sont doux, confians, économes et point querelleurs; et n'eussent-ils d'autre mérite que celui de faire vivre les mangeurs, on devrait leur en rendre des actions de grâces, et nous pardonner si parfois nous nous laissons aller à l'inclination qui nous porte de leur côté.
Mais, nous le répétons, nous n'embrassons aucun des deux partis ; nous voulons seulement [4] faire voir comment l'un et l'autre se recrutent naturellement, et par la seule force des choses: nous voulons faire remarquer comment chacun d'eux accroît sa puissance, et diminue celle de son ennemi. Lorsque tous les deux connaîtront bien leurs moyens respectifs, la guerre se fera d'une manière plus franche, et chacun pourra mieux s'opposer aux efforts de son adversaire. Nous ne pouvons pas nous dissimuler cependant que le parti des mangeurs a toujours été plus fort et plus rusé que le parti contraire: un loup est plus habile qu'un mouton; un renard en sait plus qu'une poule. Il est donc possible que nos idées ne soient utiles qu'au parti qui en a le moins besoin; s'il en est ainsi, nous nous trouverons heureux d'avoir quelques droits à sa reconnaissance.
C'est une loi de la nature que tous les individus du règne végétal et du règne animal tendent à se multiplier dans une progression toujours croissante. Un grain de blé peut en produire trente : chacun de ces trente peut en produire autant; de sorte que, dans un nombre donné d'années, un grain de blé suffirait pour couvrir la surface de la terre, si tous les germes qui sont produits étaient développés, et si rien n'en arrêtait l'accroissement. De [5] même, un animal quelconque, un renard ou un lapin, par exemple, pourraient couvrir la surface de la terre d'animaux de leur espèce, dans un petit nombre de siècles, s'ils trouvaient toujours de quoi subsister, et si rien,ne les détruisait à mesure qu'ils se multiplient.
Cette loi de la nature est commune à l'homme, comme à tous les êtres qui jouissent de la faculté de se reproduire. Le monde n'existe, dit-on, que depuis six mille ans; cet espace de temps a suffi pour que deux individus de l'espèce humaine aient peuplé la terre. Si aujourd'hui tout le genre humain, moins deux individus, périssait, ces deux individus pourraient suffire encore pour la repeupler. Depuis environ cent cinquante ans, la population des Etats-Unis d'Amérique double tous les vingt-cinq ans: si elle est dans ce moment de douze millions et demi, et si elle continuait à s'accroître dans la même proportion, il ne faudrait pas deux siècles, pour qu'elle fût plus nombreuse que ne l'est aujourd'hui la population du monde entier.
L'accroissement de la population a néanmoins des bornes : plusieurs obstacles peuvent le retarder; il n'en est qu'un qui puisse en arrêter les progrès; il n'en est qu'un qu'il soit [6] impossible de franchir : c'est le défaut des moyens d'existence. Tant que les moyens de vivre s'accroissent, la population se multiplie ; quand ils restent stationnaires, la population reste stationnaire; aussitôt qu'ils diminuent, la population diminue dans la même proportion. Ce phénomène s'observe chez les peuples les plus sauvages et les plus misérables, comme chez les plus civilisés; chez les uns comme chez les autres, la population tend toujours à se mettre au niveau des moyens d'existence, ou à les dépasser. Il parait même que plus un peuple est ignorant et misérable, plus il a de tendance à s'accroître au-delà de ce que le sol peut nourrir. Un sauvage, étant naturellement imprévoyant, s'abandonne à ses inclinations sans se mettre en peine si ses enfans trouveront ou ne trouveront pas les moyens de vivre. Un homme civilisé met plus de calcul dans ses actions; il réprime ses désirs, quand il prévoit qu'il ne peut les satisfaire qu'en faisant son malheur ou celui d'autrui.
Dans l'intérieur de l'Amérique, on peut parcourir des forêts immenses sans rencontrer un seul individu. Dans les parties dont le climat est moins rigoureux, et où par conséquent des animaux peuvent vivre, on trouve quelques [7] tribus peu nombreuses qui existent des faibles secours que leur fournit la chasse. Les tribus sont moins rares sur les bords des lacs et des fleuves, parce que le poisson est plus abondant que le gibier. Cependant tous ces sauvages sont extrêmement misérables, et leur nombre est toujours aussi grand que peut le supporter l'état du pays dans lequel ils se trouvent. Quand les moyens que la chasse et la pêche leur fournissent viennent à leur manquer, ils mangent des araignées, des œufs de fourmis, des vers, des lézards, des serpens, et une espèce de terre onctueuse. Ils conservent les os des poissons et des serpens, les mettent en poudre et les dévorent; quelquefois ils restent deux ou trois jours sans rien manger, ou ils mangent leurs enfans; quelquefois aussi des tribus entières périssent par la famine ou par les maladies qui en sont la suite.
Dans les pays que le despotisme a dévastés, en Syrie, en Egypte, partout où les Turcs se sont établis, la population, quelque peu nombreuse qu'elle soit, comparativement à l'étendue du pays, est aussi considérable que peuvent le permettre les moyens d'existence qu'il est possible d'y produire. C'est en attaquant les sources de la production que les Turcs font [8] disparaître les hommes de ce pays, et le transforment en désert. «Partout, dit un voyageur philosophe, les paysans sont réduits au petit pain plat d'orge ou de doura, aux ognons, aux lentilles et à l'eau. Leurs organes se connaissent si peu en mets, qu'ils regardent de l'huile forte et de la graisse rance comme un manger délicieux. Pour ne rien perdre du grain, ils y laissent toutes les graines étrangères, même l'ivraie, qui donne des vertiges et des éblouissemens pendant plusieurs heures, ainsi qu'il m'est arrivé de l'éprouver dans les montagnes du Liban et de Nablons : lorsqu'il y a disette, ils recueillent les glands de chêne; et, après les avoir fait bouillir ou cuire sous la cendre, ils les mangent.
» Dans les cantons ouverts aux Arabes, tels que la Palestine, il faut semer le fusil à la main. A peine le blé jaunit-il, qu'on le coupe pour le cacher dans les matmoures, ou caveaux souterrains. On en retire le moins que l'on peut pour les semences, parce que l'on ne sème qu'autant qu'il le faut pour vivre ; en un mot, l'on borne toute l'industrie à satisfaire les premiers besoins. Or, pour avoir un peu de pain, des ognons, une mauvaise chemise bleue et un pagne de laine, il ne faut pas la porter bien loin, Le paysan vit [9] donc dans la détresse, mais du moins il n'enrichit pas ses tyrans; et l'avarice du despotisme se trouve punie par son propre crime.[2] »
Si, dans les pays soumis à des gouvernemens despotiques, la population s'abaisse à mesure que les moyens d'existence diminuent, et si elle se met ainsi au niveau des subsistances; dans les pays où les hommes jouissent d'un gouvernement qui les protége, et qui laisse ainsi prendre à l'industrie humaine tous les développemens dont elle est susceptible, la population s'élève graduellement à mesure que la terre devient plus productive, et se met encore au niveau des moyens d'existence. C'est un fait qu'on a remarqué chez les premiers peuples civilisés, comme chez les derniers : partout on a vu un certain nombre d'individus qui n'avaient que les choses absolument nécessaires pour exister, et qui tendaient toujours à se multiplier au-delà des moyens qu'ils avaient pour vivre ; partout on à vu une classe de malheureux qu'on a toujours vainement tenté de secourir, parce qu'à mesure qu'on leur a donné [10] des secours, ils se sont multipliés dans la proportion des secours qu'on leur a donnés.
Il est difficile, nous pourrions même dire impossible, que les choses soient autrement. Cent mille individus peuvent doubler en nombre, dans un espace de temps donné, tout aussi-bien que deux mille; et il n'y a pas. de terme auquel l'espèce humaine perde la faculté de se reproduire. La population tend donc à s'accroître dans une progression géométrique: si la population des États-Unis d'Amérique, par exemple, était de douze millions et demi, et si elle continuait à s'accroître dans la proportion qu'elle a suivie jusqu'ici, elle serait de vingt-cinq millions dans vingt-cinq ans, de cinquante millions dans cinquante ans, de cent millions dans soixante-quinze ans, de deux cents millions dans cent ans, et de trois milliards deux cents millions dans deux cents ans. Mais, quelque fertile que soit le pays, et quelle que soit l'industrie des habitans, il est impossible que les moyens d'existence se multiplient dans même la proportion. En supposant qu'un peuple possède toute l'activité et toute la capacité imaginables, c'est aller au-delà du possible que d'admettre qu'il peut à l'infini accroître les produits de son sol, dans une proportion arithmétique.
[11]
Ainsi, la population tend à s'accroître dans cette proportion .-1,2,4,8, 16,32,64, 128, 256; tandis que les moyens de subsistances ne peuvent s'accroitre que dans celle-ci : 1,2,5, 4, 5, 6, 7, 8, 9; et encore arrive-t-on à un terme où tout accroissement ultérieur devient impossible. Il faut donc que l'excédent de population, dont la prudence ou d'autres causes ne préviennent pas l'existence, périsse de misère où des maux qu'elle enfante; puisqu'il est impossible que l'accroissement de la population marche d'un pas plus rapide que l'accroissement des moyens d'existence.
A la vérité, il existe chez tous les peuples un certain nombre d'individus qui consomment plus de choses qu'il ne leur en faudrait pour exister : si donc ces individus se réduisaient à ce qui leur est strictement nécessaire pour vivre, la population s'accroîtrait au moyen de ce qui serait retranché de leurs consommations habituelles, sans que la somme des moyens d'existence eût été augmentée. Mais alors il, arriverait que la moindre diminution dans les subsistances serait une calamité publique, et que ce qui produit une disette ou une simple augmentation dans le prix des grains, produirait une famine, et réduirait la population au [12] point où elle serait restée, si chacun eût conservé la faculté de retrancher quelque chose de ses consommations. C'est ce qu'on remarque dans la Chine : une grande' partie du peuple ne consomme que ce qui lui est absolument nécessaire; aussi, quoique ce pays soit le mieux cultivé de la terre, les famines y sont très-fréquentes, parce que la moindre diminution dans les récoltes peut les produire.
La population a une telle tendance à s'élever au niveau des moyens d'existence, que les calamités les plus terribles qui attaquent l'espèce humaine, sans porter une atteinte considérable à la production des choses nécessaires à la vie, ne produisent que des effets de peu de durée. De tout temps, l'Afrique a été le pays où les peuples des autres parties de la terre ont acheté des esclaves; dans ce pays, les parens vendent leurs enfans pour peu de chose à des hommes qui les exportent: ce commerce a couvert l'Amérique de nègres, et cependant il ne paraît pas que l'Afrique soit moins peuplée qu'elle l'était il y a plusieurs siècles.- La peste fait des ravages continuels chez les peuples orientaux, et cependant ces peuples sont aussi nombreux que le permet l'état misérable dans lequel le despotisme a plongé toute espèce d’industrie.
[13]
« Les effets de l'effroyable peste qui eut lieu à Londres, en 1666, dit le savant et profond auteur de l’Essai sur les principes de la population, ne furent plus perceptibles quinze ou vingt ans après. On peut douter même si la Turquie et l'Egypte sont généralement moins peuplées à cause des pestes qui les ravagent périodiquement. Si le nombre d'habitans que ces pays renferment est moins considérable qu'il le fut autrefois, on doit l'attribuer à la tyrannie et à l'oppression des gouvef nemens sous lesquels ils gémissent, et au découragement que l'agriculture en a ressenti, plutôt qu'aux pertes que la peste leur fait éprouver. Les traces des famines les plus destructives dans la Chine, dans l'Indostan, dans l'Egypte et dans tous les autres pays, sont, suivant tous les rapports, bientôt effacées; et les plus terribles convulsions de la nature, telles que les éruptions volcaniques, les tremblemens de terre, si elles n'arrivent pas assez fréquemment pour emporter les habitans ou pour détruire leur esprit d'industrie, ne produisent jamais que de faibles effets sur la population ordinaire des états. »[3]
[14]
On peut dire des guerres ce que nous disons de la peste et de la famine : quelque grand que soit le nombre de soldats qu'elles détruisent, les pertes quelles font éprouver à la population sont bientôt réparées, si elles n'attaquent pas la source des subsistances. La Belgique a été presque de tout temps le théâtre de la guerre; cependant elle a toujours été également peuplée. La France a été en état de guerre depuis le commencement de la révolution; elle a perdu, sur les champs de bataille ou dans les hôpitaux, un nombre incalculable de ses habitans; un nombre fort considérable encore a péri par l'émigration ou par les proscriptions, et cependant elle est plus populeuse aujourd'hui qu'elle ne l'était quand la révolution a commencé : elle n'a pas été plus épuisée par la conscription, que l'Afrique par la traite des nègres. La cessation de la guerre (si toutefois on peut dire que la guerre a cessé quand on paye des tributs ) n'augmentera pas la population d'un seul individu, si les impôts restent les mêmes, ou si les moyens d'existence ne prennent aucun accroissement. ïl y aura peut-être moins de décès; mais il y aura aussi moins de naissances.
Puisque l'accroissement des moyens [15] d’existence amènent toujours un accroissement de population, et que la population décroît à mesure que les moyens de vivre diminuent, il suffit d'examiner comment les subsistances se distribuent parmi les diverses classes d'hommes, pour savoir dans quelles proportions chacune de ces classes se fortifie ou s'affaiblit. Supposons que la France ait vingt-cinq millions d’habitans, et que l'Angleterre n'en ait que douze. Si les Anglais trouvent le moyen d'enlever annuellement à la France, sous une forme ou sous une autre, de quoi faire exister trois millions d'individus, la population française décroîtra d'un pareil nombre, et la partie de la nation anglaise, qui profitera des tributs, s'accroîtra d'autant, à moins que ces tributs ne soient dissipés en vaines profusions. Le peuple qui paye un tribut perd donc par cela même un nombre d'hommes égal à celui que ce tribut aurait fait exister; et en s'affaiblissant ainsi, il se rend plus incapable de résister à ceux qui voudront exiger de lui des tributs plus considérables encore. Au contraire, le peuple qui en a rendu un autre tributaire, se rend comparativement plus fort de tout ce qu'il fait perdre au peuple assujetti, et en outre de l'accroissement de population que peut produire [16] chez lui la distribution des tributs qu'il se fait payer.
La forme dans laquelle un tribut est levé ne change rien à la question : qu'on exige des subsistances en nature, ou une contribution en argent, c'est au fond la même chose, puisque les contribuables, ou, ce qui est la même chose, les tributaires ne peuvent se procurer de l'argent qu'en vendant leurs subsistances, et que ceux à qui ils la donnent ne peuvent s'en servir1 utilement qu'en l'employant à acheter les choses qu'ils croiront utiles à leur bien-être ou à leur sûreté. Des troupes cantonnées chez un peuple et vivant à ses dépens, produisent les mêmes effets qu'un tribut emporté chez un peuple conquérant. Celui-ci n'étant plus obligé de distraire de ses moyens d'existence ce qui était nécessaire à ses armées, s'accroît de tout ce qu'il n'est plus obligé de leur donner. Le peuple tributaire, au contraire, étant obligé de distraire de ses subsistances tout ce qu'il faut pour faire subsister une armée d'occupation, s'affaiblit ou décroît dans la même proportion.[4]
[17]
Nous pouvons appliquer à deux villes, à deux villages ou même à deux familles, les raisonnemens que nous venons de faire relativement à deux nations : la loi de l'accroissement ou du décaissement de la population est la même pour tous les individus de l'espèce ; elle est la même pour les peuples chasseurs que pour les peuples pasteurs, pour les peuples guerriers ou barbares, que pour les peuples agricoles ou commerçans. Si une ville de France était obligée de distribuer annuellement la moitié de ses moyens d'existence à une autre ville, il faudrait bien qu'elle perdît la moitié de ses habitans; et si la ville qui profiterait du tribut ne s'accroissait pas dans la même proportion, ce serait parce que la distribution du tribut ne serait pas sagement faite.
Si, au lieu de supposer qu'une ville est tributaire de l'autre, et lui fournit annuellement une partie de ses moyens d'existence, nous supposons que le tribut continue, mais que les tributaires et les hommes qui vivent du tribut se réunissent dans une même ville ou sur un [18] même territoire, il est évident que l'effet sera le même: les individus obligés de donner une partie de leur subsistance, diminueront dans la proportion de ce qu'ils seront obligés de donner; ceux qui en profiteront s'accroîtront dans la même proportion. Pour rendre ceci plus sensible, prenons pour exemple la ville de Paris. Supposons que, toutes les choses nécessaires à la vie pouvant y pénétrer sans payer d'impôt, il soit possible d'y élever une famille au moyen de trois mille francs par année; il est à peu près sûr que toutes les personnes qui jouiront de ce revenu au moyen de leur industrie ou de leurs capitaux, s'établiront, et que ceux qui n'en jouiront pas seront .obligés de vivre dans le célibat, et mourront sans avoir laissé de descendans. Si nous supposons maintenant qu'au lieu de laisser entrer librement les subsistances, on les soumet à un impôt qui en double le prix, il est clair qu'il faudra, pour élever une famille, six mille francs au lieu de trois mille. Tous ceux qui n'auront point ce revenu devront s'abstenir du mariage, et ceux qui seront déjà établis ne pourront plus élever leurs enfans. La partie de la population industrieuse ou propriétaire décroîtra donc à mesure que les impôts élèveront le prix des subsistances; et, si [19] ces impôts sont distribués a des courtisans, à des gens à places, à des moines, à des états-majors ou à des mendians, la race de ceux-ci s'accroîtra du nombre que perdra la classe industrieuse ou propriétaire.
Ces propositions nous paraissent évidentes par elles-mêmes; -cependant, si la vérité pouvait en être révoquée en doute, l'expérience viendrait à notre secours pour la confirmer. Aucun peuple n'a" su, autant que le peuple romain, fonder son existence sur le brigandage : avant qu'il eût asservi la plus grande partie des nations connues, il avait rendu tous les petits peuples de l'Italie ses tributaires. Or ces peuples, si nombreux lorsqu'ils luttaient contre la tyrannie romaine, et qu'une partie de leur population périssait en défendant son indépendance, avaient presque entièrement disparu vers la fin de la république. Les guerres les plus cruelles n'avaient pu détruire leur prospérité ; les tributs ou les impôts rendirent leur pays désert, et à leur place s'éleva cette populace romaine qui devint si terrible dans les mains de Marius et de César.
L'Angleterre nous offre un exemple plus éclatant encore de ce que peut une distribution forcée ou mal entendue des moyens [20] d’existence. Les monastères anglais, comme les monastères de tous les pays, avaient créé dans leurs environs un nombre assez considérable! de mendians. Lorsque la destruction en eut été prononcée, il fallut songer à faire vivre cette populace paresseuse, à laquelle la charité monacale avait donné naissance. Il fut établi, sous la reine Elizabeth, que chaque commune nourrirait ses pauvres : une taxe fut donc établie sur tous les propriétaires, et dès ce moment les individus qui n'avaient pas de quoi exister ou de quoi faire exister une famille, purent se multiplier sans craindre de voir périr de misère les enfans auxquels ils donnaient le jour. De leur côté, les cultivateurs, obligés de donner aux pauvres une partie de leur subsistance, durent se marier avec plus de circonspection, puisqu'ils n'eurent plus la certitude de pouvoir élever leurs enfans avec la même facilité. La taxe pour les pauvres, en effet, ne faisait pas venir un grain de blé de plus dans le pays, et puisqu'elle devait nécessairement augmenter la population nécessiteuse, il fallait bien qu'elle diminuât la population qui pouvait vivre des produits de ses propriétés ou de son travail.[5]
[21]
La taxe pour les pauvres a produit l'effet qu'on devait naturellement en attendre : elle a soulagé momentanément quelques malheurs individuels, mais elle a étendu la pauvreté sur une plus grande surface; elle a créé un plus grand nombre de misérables; elle a accablé d'impôts les agriculteurs ou les propriétaires, et elle a arrêté, ou au moins retardé l'accroissement de la partie industrieuse de la population. Les hommes laborieux qui ne gagnaient que ce qui leur était nécessaire pour vivre et pour élever leur famille, sont tombés dans la classe des pauvres, et ont été obligés de recourir à la taxe créée pour faire subsister ces derniers. Cette taxe n'ayant augmenté en rien les moyens de subsistance du pays, a jeté sur le marché un plus grand nombre d'acheteurs, puisqu'elle a donné aux pauvres qu'elle a créés, les moyens d'acheter les choses nécessaires à la vie :le prix des subsistances s'est élevé par la concurrence des acheteurs, et ceux qui auparavant avaient de quoi exister, n'ont plus trouvé le moyen de vivre qu'en ayant recours à la taxe.
[22]
Au commencement du dix-huitième siècle, en 1700, le nombre des pauvres s’élevait, en Angleterre, à cinq cent soixante-quinze mille; c'est-à-dire, que cette classe ne faisait pas tout-à-fait la dixième partie de la population. La taxe qui leur était accordée était de 700,000 livres sterling, environ dix-huit millions huit cent mille francs. Le nombre des pauvres s'est graduellement augmenté, et il a fallu augmenter, dans la même proportion, la taxe qui leur était accordée. En 1814, les pauvres faisaient la cinquième partie de la population;[6] la taxe s'était déjà élevée de dix millions huit cent mille francs, à seize millions sterling, ou à trois cent quatre-vingt-quatre millions de francs. Depuis 1800 jusqu'à 1814> la population d'Angleterre s'est accrue d'un million, et ce qu'on croira difficilement, c'est que la classe des pauvres est la seule qui se soit ainsi multipliée; la classe qui peut vivre du produit de son industrie ou de ses propriétés, obligée de livrer aux pauvres ses moyens d'existence, non-seulement ne s'est point accrue, mais elle a même [23] diminué, ainsi que nous le verrons bientôt.[7]
On croira peut-être qu'un pays dans lequel on donne régulièrement aux pauvres trois cent quatre-vingts millions de francs toutes les années, est un pays où tout le monde vit également à l'aise; mais point du tout. Il y a, proportion gardée, plus de misérables en Angleterre que dans tout autre pays. La loi qui établit une tàxe pour les pauvres, bien loin de diminuer le nombre des malheureux, ne fait au contraire que l'accroître; elle est tout à la fois une calamité pour les familles qu'elle fait naitre, et pour les cultivateurs ou pour les propriétaires qu'elle atteint. On a voulu constater en effet, il y a deux ans, l'état des ouvriers pauvres ou de leur famille, et l'état des agriculteurs qui paient la taxe, et il est résulté des [24] recherches qu'on a faites, que la somme énorme à laquelle se montait cette taxe, sans avoir soulagé sensiblement la classe pauvre, écrasait l'agriculture. Comme les faits se font toujours mieux entendre que les théories, on nous pardonnera de citer quelques exemples à l'appui de nos raisonnemens.
En 1816, le comité d'agriculture, voulant connaître les ressources agricoles du pays, a adressé à tous ses correspondans une circulaire dans laquelle il leur a posé neuf questions. Au nombre de ces questions était la suivante: Quel est l'état des ouvriers pauvres., et quelle est la proportion de la taxe des pauvres, comparée à celle des années 1811 et 1812? Sur cette question, deux cent soixante-treize lettres ont été écrites des divers comtés de l'Angleterre. De ces deux cent soixante-treize lettres, deux cent trente-sept annoncent que la classe pauvre manque de travail; et, au nombre de ces deux cent trente-sept, il en est cent une qui s'étendent sur ce défaut de travail, et qui dépeignent, en termes plus ou moins énergiques, la misère et la détresse qui en résultent. Quelques-unes annoncent que l'état des pauvres est tellement misérable, qu'il devient alarmant.[8]
[25]
Un propriétaire écrit du Cambridgeshire qu'il est effrayé de l'étendue du mal, et qu'il le croit trop profondément enraciné pour être aisément guéri. Les bandes de pillards et de braconniers, dit-il, s'accroissent d'une manière alarmante; les murmures et les plaintes des ouvriers demi-affamés (half-starved) s'accroissent dans la même proportion.[9] Un autre propriétaire écrit de la même province que le sort des ouvriers pauvres est affligeant. Un troisième, que leur état est véritablement déplorable : cet état, dit-il, est causé par le défaut d'occupation; ils cherchent de l'emploi, mais les fermiers ne peuvent leur en donner.[10]
L'état des pauvres et de la classe ouvrière, écrit-on du Herefordshire, est pire que je ne l'ai jamais vu, et chaque semaine il devient de plus en plus déplorable, parce que les moyens des fermiers diminuent.[11]
J. Boys écrit du comté de Kent, que l'état des ouvriers pauvres est pire que ce qu'il se [26] souvient de l'avoir vu. Dans la paroisse d'Ash, ajoute-t-il, dans laquelle je suis propriétaire et tenancier, l'officier de la paroisse m'a dernièrement informé que quarante-six ouvriers s'étaient adressés au comité pour avoir du travail ou de l'argent, et qu'on avait été obligé de secourir le plus grand nombre.[12]
W. Whiteside écrit du Lancashire en ces termes : L'état des ouvriers pauvres est tel, qu'un grand nombre parcourent le pays pour trouver du travail; mais c'est en vain, les fermiers qui ont de l'ouvrage à faire, n'ont pas le moyen de les payer; cela fait qu'un grand nombre, qui autrefois auraient rougi de penser à recevoir des secours publics, tombent à la charge de la paroisse.[13]
John Buckley écrit du Leicestershire : La condition des ouvriers pauvres, causée par la pauvreté des fermiers, et conséquemment par le défaut de travail, est incontestablement pire que ce qu'elle était lorsque le blé se vendait le double de ce qu'il se vend aujourd'hui : ils sont tous plus ou moins à la charge de leurs [27] paroisses; la taxe des pauvres est généralement aussi élevée, dans plusieurs paroisses elle est même plus élevée qu'elle ne l'était en 1811 et en 1812.[14]
Thomas Pilley écrit du Lincolnshire que les ouvriers pauvres, autrefois si utilement employés, meurent maintenant de faim (are now starving) à défaut d'occupation. Les taxes, continue-t-il, peuvent encore être levées, mais elles ne pourront être long-temps payées. Les fermiers, au lieu d'employer ou d'assister les pauvres, auront bientôt besoin d'être eux-mêmes employés ou assistés; et, je suis fâché de le dire, c'est ce qui dans ce moment arrive à un grand nombre.[15] Un autre écrit de la même province : La prison du comté est remplie de débiteurs insolvables, et les maisons de travail offrent un misérable asile à de pauvres familles qui naguère aidaient à supporter les charges de leurs paroisses.[16]
Le nombre des misérables ou des vagabonds est doublé dans quelques parties du comté de [28] Monmouth, suivant une lettre d'Edward Berry.[17] Dans le Norfolk, la misère ne paraît pas moins grande. L'état actuel des ouvriers pauvres, écrit John Thurtell, est véritablement affligeant; il est pire que nous ne l'avons jamais vu. Un grand nombre de ces malheureux, jouissant d'une parfaite santé, sont obligés d'implorer les secours de la paroisse dans le canton de Mutford et Lothingland, dans lequel je réside. Les admissions dans la maison de travail, depuis la Saint-Michel dernier, ont été plus nombreuses qu'à aucune autre époque où le prix du blé était plus élevé, et toutes les semaines elles s'accroissent à un degré alarmant. Nous sommes obligés d'accorder des secours, hors de la maison de travail, à beaucoup d'ouvriers en bonne santé, parce que nous ne pouvons pas les.employer.[18]
Samuel Taylor écrit du même comté en ces termes: Quant aux pauvres, je puis dire avec vérité que leur situation est un des caractères les plus alarmans de cette malheureuse époque. La nécessité d'en disposer et de les maintenir demande l'attention la plus profonde de la [29] législature. La maison de travail des cantons de Loddon et de Clavering est entièrement remplie, n'ayant pas moins de quatre cents pauvres; et lundi 1g, cent cinquante ouvriers ( tous robustes, actifs, voulant, mais ne pouvant pas se procurer du travail ) se sont présentés pour obtenir des secours.[19] L'état des ouvriers pauvres, écrit un riche propriétaire du même comté, est aussi misérable qu'en 1811 et en 1812, quoique les taxes des pauvres soient beaucoup plus élevées que dans ces années.[20] Un troisième s'exprime dans des termes bien plus remarquables : Soyez assurés, dit-il, que si des mesures ne sont point promptement prises, le produit du sol ne sera plus suffisant pour nourrir les pauvres qui l'habitent. La paroisse de Carbrooke, contenant environ cinq cents âmes, est annuellement chargée de huit cents à neuf cents livres sterling (environ deux cent mille francs ) pour la taxe de ses pauvres.[21]
Edward Martin écrit du Northamptonshire, que les ouvriers pauvres n'ont jamais été depuis vingt-cinq ans dans un état aussi misérable. [30] Un grand nombre de jeunes gens, dit-il, vont de maison en maison demander de l'ouvrage, et ils sont payés partie par celui qui les emploie, êt partie par l'inspecteur ou le surveillant des pauvres.[22]
Un habitant du Sommerset, Richard Loke, écrit que la taxe des pauvres, dans sa paroisse, s'élevait à quatre cent soixante-deux livres sterling en 1811; qu'elle s'éleva à cinq cent soixante-dix livres sterling en 1815 ; et cette année, ajoute-t-il ( en 1816 ), elle s'élève à sept cent vingt-trois livres sterling.[23] Le blé étant beaucoup moins cher en 1816 qu'en 1811, et la taxe des pauvres ayant presque doublé, on devrait croire que ces pauvres ont été beaucoup plus à leur aise; mais ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées. Les pauvres se sont multipliés plus rapidement que les taxes, et ils ont été plus misérables peut-être qu'ils ne l'étaient auparavant. Les ouvriers pauvres, dit M. Richard Loke que nous venons de citer, ont beaucoup de peine à se procurer du travail, même à un prix très-bas, et ils sont dans un état qui [31] n’est pas loin de la famine: They are in a state little short of starvation.[24]
Dans le Suffolk, les pauvres ne sont pas dans une situation beaucoup plus heureuse. John Tomson écrit de cette province qu'un des symptômes de décadence les plus alarmans est l'état des ouvriers pauvres. Beaucoup, dit-il, sont sans emploi, parce que les maîtres ne sont pas en état de leur payer leur travail. Que faut-il donc faire? On ne peut pas les laisser mourir de faim. On les envoie travailler sur les routes, et ils sont soutenus par la taxe des pauvres.[25] Studd écrit du même comté, que dans son voisinage l'état des pauvres est lamentable; que ne pouvant pas les faire travailler à l'agriculture, on les fait travailler sur les routes; que dans quelques paroisses on les trouve par dix, vingt, trente et jusqu'à soixante-dix; que cependant depuis 1811 jusqu'à 1815, la taxe des pauvres s'est accrue du tiers.[26]
Robert Fuller écrit de la même province : Si l'on n'y apporte un prompt remède, les pauvres [32] ne pourront plus être soutenus ni par ce qu'ils gagneront, ni par le moyen de taxes; ils ne peuvent déjà plus l'être par ce qu'ils gagnent, et ils s'accroissent de telle manière tous les jours, que je crains que les taxes ne puissent bientôt plus leur suffire; et lorsque les pauvres ne trouveront plus de travail, et que les fermiers ne pourront plus leur payer de taxes, les conséquences en seront terribles.[27] Du comté de .Surrey, Thomas Page écrit que les ouvriers de son voisinage sont dans un état de pauvreté qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il annonce que plusieurs vivent au moyen de la taxe des pauvres, et plusieurs par leurs déprédations nocturnes. Cependant, depuis 1812, cette taxe a été augmentée d'un cinquième.[28]
Nous bornerons ici nos citations : ceux qui ne seront pas convaincus de l'état de détresse dans lequel se trouve la classe ouvrière en Angleterre, pourront consulter le recueil que nous venons de citer : ils y en trouveront une preuve plus complète.
Les trois cent quatre-vingts millions qu’on [33] donne annuellement aux pauvres, bien loin de diminuer le nombre des misérables, n'a donc fait que l'augmenter. La taxe des pauvres, nous le répétons, n'a pas multiplié les moyens d'existence; elle les a déplacés. La partie de la population qui en a profité s'est accrue en conséquence, et elle est arrivée jusqu'au point où la misère ne lui a plus permis de se multiplier. La partie de la population qui a donné une partie de ses moyens d'existence a dû s'affaiblir, ou du moins rester stationnaire. Comparativement à ce qu'était celle-ci, lorsqu'elle a commencé à payer la taxe, elle peut ne pas avoir décru : mais comparativement à la classe qui vit sur elle, elle s'est excessivement affaiblie, puisque dans l'origine elle était dans la proportion de dix à un, et qu'elle est aujourd'hui dans la proportion de cinq ou même de trois à un.
Ce qui doit nous étonner, ce n'est pas que la classe pauvre se soit multipliée jusqu'au point où elle se trouve; c'est que la multiplication n'ait pas été plus rapide, et que tous les produits du sol de l'Angleterre n'aient pas été déjà absorbés par les pauvres. Si depuis que la taxe est établie, elle avait en effet alimenté les pauvres d'une manière tolérable, ceux qu’elle [34] aurait nourris couvriraient déjà la surface du sol; et ce n'est qu'à la parcimonie et à la dureté avec lesquelles elle a été accordée, que les Anglais doivent de n'avoir pas été entièrement envahis par une immense multitude de mendians.
« Le faible secours accordé aux personnes qui sont dans la misère, dit Malthus, la manière insultante et capricieuse avec laquelle ce secours est donné par les inspecteurs, et la fierté naturelle à l'homme, non encore entièrement éteinte chez les paysans anglais, ont détourné la partie la plus vertueuse et la mieux pensante d'entre eux, de se marier avant d'avoir, pour élever leur famille, de meilleures ressources que l'assistance de leurs paroisses. Le désir de rendre notre condition plus douce, et la crainte de la rendre pire, comme le vis mediatrix naturae en médecine, sont le vis mediatrix rei-publiae en politique, et tendent continuellement à arrêter les désordres qui naissent de nos étroites institutions. En dépit des préjugés en faveur de la population, et des encouragemens directs que donnent au mariage les lois des pauvres, ces deux sentimens opèrent comme un obstacle préventif à l'accroissement de la [35] population; et il est heureux pour ce pays qu'il en soit ainsi.
« Mais, ajoute le même écrivain, outre cet esprit d'indépendance et de prudence qui prévient la fréquence des mariages, malgré l'encouragement qui résulte des lois des pauvres, ces lois elles-mêmes sont un obstacle qui n'est pas peu considérable, et elles détruisent ainsi d'un côté ce qu'elles créent de l'autre; chaque paroisse, étant obligée de nourrir ses propres pauvres, craint naturellement d'en voir augmenter le nombre; et en conséquence, les propriétaires sont bien plus portés à détruire qu'à élever des chaumières (cottages), à moins qu'ils n'aient un besoin réel et pressant d'ouvriers. Ce défaut de chaumières est un obstacle puissant au mariage, et cet obstacle est probablement la principale raison pourquoi nous avons été capables de suivre le système des lois des pauvres pendant si long-temps.
» Ceux que ces causes n'empêchent pas de se marier, reçoivent de faibles secours dans leurs maisons, où ils souffrent toutes les conséquences qui naissent d'une sale pauvreté, ou bien ils sont réunis et enfermés dans des maisons de travail malsaines, où règne toujours, surtout parmi les enfans, une grande mortalité. Le [36] compte effrayant qui a été rendu par Jonas Hanway, du traitement des pauvres à Londres, est bien connu; et il paraît, d'après M. Howlet, et d'après d'autres écrivains, que, dans plusieurs autres parties de ce pays, leur situation n'est pas de beaucoup meilleure. Une grande partie de l'excès de population produit par les lois sur les pauvres, est ainsi emportée par l'effet même de ces lois, ou du moins par leur mauvaise exécution. La partie qui survit, exigeant que les subsistances destinées à la continuation du travail soient divisées entre un nombre plus grand que celui qu'elles peuvent naturellement faire exister, et ravissant une part considérable de ces subsistances aux ouvriers laborieux et économes, pour alimenter les fainéans ou les intempérans, rend plus dure la condition de ceux qui sont hors des maisons de travail, les oblige à y entrer toutes les années, et produit ce mal excessif dont nous nous plaignons avec tant de justice, ce nombre immense d'individus qui vivent sur la charité publique.[29] »
La population s'élevant toujours au niveau [37] des moyens de subsistance, comme nous l'avons dit, la manière dont ces moyens s'accroissent, n'en change pas les effets. Ainsi, qu'on livre à une classe d'individus les moyens de vivre ou sous le titre d'aumône, ou sous le titre de salaire, ou sous le titre de traitement, ou sous le titre de récompense, le nom ne fait rien à la chose: cette classe se multiplie dans la proportion des subsistances qui lui sont fournies. Plus on lui en donne, plus elle devient nombreuse, exigeante, insatiable. Si c'est une classe de gens à places, elle suit dans son accroissement exactement la même progression que nous avons remarquée dans la classe des pauvres. Elle n'encombre pas d'ouvriers les maisons de travail; mais, ce qui est bien pire, elle encombre les bureaux de surnuméraires, et les antichambres de valets ou de courtisans.
Que l'on crée une place et qu'on y attache un revenu suffisant pour faire vivre une famille, aussitôt il se présentera un oisif pour la remplir, et un père disposé à lui donner sa fille. Voilà déjà une pépinière de gens à places. Les enfans arrivent, et comme ils ne peuvent pas tous croître et multiplier sous le toit paternel, il faut bien-qu'on s'occupe de leur trouver des postes dans lesquels ils puissent vivre eux et les [38] descendans de chacun d'eux. C'est bien pire, si la place créée donne à celui qui doit l'occuper quelque crédit ou quelque influence. Alors, ce n'est pas seulement celui-ci qui engendre des gens à places, ce sont ses frères, ses neveux, ses cousins, ses arrière-petits-cousins. Il faut d'abord placer tous ces gens-là, et si parmi eux il se trouve des filles sans dot à marier, il faut trouver des hommes sachant lire et écrire, qui veuillent bien s'en charger moyennant une place.[30]
En Angleterre, les gens à places ou à pensions se sont recrutés dans une portion presque égale à celle des pauvres. Lorsqu'un individu rend à la caste quelque service signalé, on lui donne sur-le-champ les moyens de vivre dans l'opulence ; et, s'il a des descendans, il est convenu qu'on doit donner à chacun d'eux les moyens d'élever une famille. La multiplication des gens à places est déjà par elle-même une chose fort précieuse; mais la multiplication des individus qui peuvent protéger les gens à places [39] est une chose qui n'a point de prix; c'est la création d'une race presque divine. Qu'un chef d'armée se montre habile, soit à maintenir les tributaires dans la soumission, soit à en multiplier le nombre, en asservissant quelque peuple étranger, aussitôt les richesses pleuvent sur lui et sur les siens; on cherche, par tous les moyens, à multiplier une race si précieuse; on dote ses frères, ses sœurs; on crée des places pour leurs enfans, et on les dresse pour leur faire faire le même métier. En suivant ce système, les gens à places se sont multipliés au point de consommer à eux seuls la moitié des produits du sol et de l'industrie du pays.[31]
Lorsqu'une multitude excessive de pauvres et de gens à places absorbe, sous quelque forme que ce soit, la subsistance de la classe industrieuse ou propriétaire; lorsque les tributs sont arrivés au point qu'on ne peut plus les accroître sans danger, et qu'ils emportent la meilleure part des profits des capitaux, il se présente un autre moyen d'augmenter les dépenses; [40] c’est de consommer les capitaux eux-mêmes, et d'en faire payer les intérêts aux hommes laborieux : cela s'opère au moyen de ce qu'on appelle le crédit publie, ou au moyen du système des emprunts, système qui peut devenir le plus terrible des fléaux, quand il est employé régulièrement pour satisfaire à des besoins habituels.
Pour sentir les conséquences de ce système, il suffit d'examiner comment les choses se passent. Un homme, par exemple, possède un capital de cent mille francs. Ce capital, placé dans une entreprise industrielle, lui produit cinq pour cent. Tant que cet homme laissera son capital ainsi placé, il pourra consommer annuellement une somme de cinq mille francs, sans qu'il en coûte absolument rien à personne. Bien loin de là, celui qui fait valoir ce capital, et les ouvriers qu'il emploie, y trouvent un bénéfice, puisqu'il leur fournit le moyen d'exercer leur industrie. Le gouvernement établit un impôt; et, comme tout impôt ne peut être qu'un prélèvement des produits annuels d'une nation, les revenus des capitaux décroissent à mesure que les impôts augmentent. Celui qui, avec un capital de cent mille francs, jouissait de cinq mille francs de rente, [41] ne jouira plus que de quatre, de trois, ou de deux, selon que la partie qu'on lui en prendra sera plus ou moins forte. La partie qui lui sera enlevée ira grossir le revenu des gens à places; et, si, par la diminution de ses revenus, il ne peut plus élever une famille, la classe de ceux-ci pourra en élever une de plus.
Maintenant, si nous supposons qu'un gouvernement se présente, et dise à notre capitaliste : Vos cent mille francs, placés dans une entreprise industrielle, ne vous produisent qu'un revenu de trois mille francs; si vous les retirez des mains de celui qui les fait valoir, et si vous me les donnez, je les consommerai, et je vous paierai une rente annuelle de neuf mille francs; il est évident que cette opération, si elle s'exécute, aura pour effet 1°. de détruire un capital productif, et par conséquent de diminuer d'autant la production ou la matière imposable; 2°. d'accroître les impôts de tout ce qui sera nécessaire pour payer la rente de l'individu qui aura livré son capital; 3°. de faire sortir cet individu de la classe des hommes qui vivent sur leurs propriétés, et de l'enrégimenter dans la classe de ceux qui vivent sur les propriétés ou sur l'industrie d'autrui; 4°. enfin, [42] de lui donner les moyens d'élever un nombre d'enfans plus grand que celui qu'il aurait pu élever, s'il avait continué de vivre sans rien prendre sur les revenus des autres.
Les rentiers ou les pensionnaires, comme les mendians et les gens à places, ne peuvent vivre, en effet, que sur les revenus d’autrui; et, plus la part qu'on leur en donne est grande, plus ils se multiplient, plus ils acquièrent de force pour défendre ou pour se faire donner la part qui leur a été promise. On pourrait considérer les pensionnaires comme ces individus égoïstes et paresseux qui abandonnent leur industrie et livrent une partie de leur fortune, pour s'enrégimenter parmi les gentilshommes : les uns et les autres aspirent également à vivre sur les revenus d'autrui, à rester oisifs tandis que d'autres travaillent pour eux,, et à ne point payer d'impôts, ou, ce qui est la même chose, à s'exempter des charges qui devraient peser sur tous.
L'Angleterre nous offre encore un exemple des excès auxquels un gouvernement peut arriver, en se faisant livrer des capitaux qu'il consomme, et en en payant l'intérêt sur les revenus des propriétaires ou des industrieux. En 1689, époque où Guillaume et Marie montèrent sur [43] le trône, le gouvernement devait 1 million 54 mille 925 livres sterling. Il devait en 1815 la somme de 777 millions 470 mille livres sterling; c'est-à-dire que, dans l'espace d'un peu plus de deux siècles, il avait augmenté sa dette de 776 millions 405 mille 75 livres sterling, ou de 18 milliards 525 millions 721 mille 800 francs. Cette dette produisait en 1815, suivant le chancelier de l'échiquier, 55 millions 973 mille-livres sterling de rente, ou 865.millions 252 mille francs. Or, en supposant que, l'un portant l'autre, chaque individu consomme annuellement en Angleterre une somme de six cents francs, le parti des gens à places n'a pu établir ce tribut sur les propriétaires ou sur lés industrieux de cette nation, sans prévenir ou sans détruire l'existence d'un million et demi de personnes de ces deux classes, et sans créer une armée équivalente de pensionnaires; armée qui, par sa nature, est toujours disposée à soutenir les percepteurs et les dispensateurs des tributs. Le parti des gens à places a donc acquis, par cette seule combinaison, la force relative que peuvent donner près de trois millions d'individus.
Cette multiplication énorme de pauvres, de [44] gens à places et de pensionnaires, tous vivant aux dépens de la classe industrieuse, a produit un résultat digne d’être observé : elle a déplacé les avantages qui résultent de la propriété, et elle a en quelque sorte asservi la population laborieuse, à la population oisive et dévorante qui s'est élevée sur elle. Ce n'est pas, en effet, en cultivant un champ ou en le rendant productif, qu'on jouit des avantages de la propriété; c'est en en percevant et en en consommant les produits. Or, les véritables consommateurs en Angleterre sont les pauvres, les pensionnaires, les salariés, en un mot, tous ceux qui se partagent les produits enlevés aux diverses branches de l'industrie. Si, au moyen des capitaux qu'on place sur une terre, et des travaux qu'on y emploie, on lui fait produire des valeurs, par exemple, pour trois mille francs, celui-là peut se dire propriétaire, qui perçoit cette somme, et qui peut la consommer sans rien donner en échange. Si on exige du cultivateur une somme de mille francs pour faire subsister des pauvres, dès ce moment les pauvres jouissent d'un tiers de sa propriété. Si on exige encore mille francs pour faire vivre, des pensionnaires ou des rentiers, ceux-ci [45] jouissent d'un autre tiers de sa propriété. Enfin, si on lui enlève le dernier tiers pour alimenter des gens à places, la propriété entière disparaît de ses mains, et il ne se trouve plus que le colon ou l'esclave de ceux qui consomment ses produits.
Pour faire voir dans quelle proportion les pauvres se multiplient- en Angleterre, nous avons déjà cité les renseignemens recueillis par le comité d'agriculture ; qu'il nous soit permis d'avoir recours aux mêmes documens, pour faire remarquer l'influence des taxes, quelle qu'en soit la dénomination, sur le sort des propriétaires ou des agriculteurs; ces citations prouveront ce que nous avons déjà avancé, ce qui est d'ailleurs évident par soi-même, que plus les producteurs donnent de leurs produits, plus ils s'affaiblissent, et plus ils donnent de force à ceux qui ne peuvent vivre que sur les revenus d'autrui.
Le comité d'agriculture, au nombre des questions qu'il a adressées à ses correspondans, a placé celle-ci : Existe-t-il des fermes qui aient été réaffermées depuis peu avec une réduction de rente? S'il en existe, quelle est la proportion [46] de la réduction? Sur cette question, deux cent douze lettres ont été écrites des diverses parties du royaume, et toutes ces lettres s'accordent à reconnaître qu'il y a eu réduction dans les prix des baux. Le taux commun de la réduction a été de vingt-cinq pour cent. Dans quelques parties de l'Angleterre, la réduction a été moins considérable; mais dans d'autres elle l'a été bien davantage, et dans quelques-unes les terres ont été abandonnées, parce que les taxes établies pour alimenter les pauvres, les gens d'église, les pensionnaires ou les gens à places, faisaient plus qu'en absorber les produits.
Les lettres reçues par le comité d'agriculture sont classées suivant l'ordre des comtés, et celles qui sont relatives à chaque comté, sont précédées d'un tableau dans lequel on trouve l'indication des fermes qui ont été abandonnées par les fermiers, ou qui sont restées incultes. Le nombre de celles qui sont abandonnées par les fermiers s'élèvent au moins à six cent quarante ou à six cent cinquante, et forment une étendue de terrain immense. On en compte plusieurs que les propriétaires eux-mêmes ne peuvent plus cultiver. Dans le comté de Cambridge, par exemple, des paroisses entières [47] restent sans culture.[32] Dans d'autres comtes, on trouve jusqu'à vingt-quatre fermes, formant une étendue de quatre mille acres, qui sont dans le même cas. Il en est d'autres où l'on trouve neuf mille acres de terre également abandonnés par les fermiers et par les propriétaires.
Mais ce qui prouve surtout l'accroissement prodigieux de la classe des fainéans et des mangeurs, et l'affaiblissement de la classe industrieuse, c'est la détresse des agriculteurs-, et l'impuissance de leurs efforts pour échapper à leur ruine. Pour faire bien connaître l'état dans lequel ils se trouvent, il faudrait rapporter toutes les lettres adressées au comité d'agriculture. Qu on nous permette d'en insérer ici seulement quelques extraits; les passages que nous en rapporterons justifieront quelques-unes des propositions qui précèdent.
M. Macque en écrit du Bedfordhsire : Trois de mes fermes sont actuellement vacantes; une, contenant quatre cent quatre acres; l’autre, [48] quatre cents, et la troisième deux cent cinquante. Je suis obligé de cultiver ces fermes à des frais énormes, pour empêcher qu'elles ne tombent dans un état de dégradation complète. Je paie la taxe de la propriété comme propriétaire et comme tenancier. Je paie les dîmes, la taxe des pauvres, la taxe pour les routes, etc., sans attendre de rien récolter d'une année au moins; et les produits que je puis attendre pour l'avenir, seront, je le crains, au-dessous des charges que je suis obligé de supporter. J'ai perdu en outre seize cents livres sterling (trente-huit mille quatre cents francs ) d'arrérages de rente, par la vente clandestine que mes fermiers ont faite de leurs récoltes ou de leur autres biens, et par leur insolvabilité. Ces fermes sont situées dans le meilleur territoire du Bedfordshire, etc..[33]
Le passif des faillites des fermiers, écrit, du Cambridgeshire, J. Page, s'élève à soixante-treize mille livres sterling ( un million sept cent cinquante-deux mille francs), sans aucun dividende pour les créanciers.[34] Dans ce [49] voisinage, ajoute le docteur N. Thompson, beaucoup plus de tenanciers que je ne puis dire ont abandonné leurs fermes; plusieurs de ces fermes ont été prises par les propriétaires: un bien plus grand nombre sont restées absolument inoccupées. A peu de milles de Long-Stowe, c'est-à-dire dans les paroisses de Croxton, Eltisley, Joseland, Jelling, le Gransdens, le Hatleys, on suppose qu'il existe plus de huit mille acres inoccupés et l'on s'attend à en voir de jour en jour abandonner davantage.[35] Nos prisons, dit John Mortlock, sont remplies de fermiers, autrefois respectables, et à peine un propriétaire peut obtenir d'en être payé.[36] Thomas Briggs ajoute que dans sa paroisse plusieurs fermes sont abandonnées par les tenanciers. J'ai été obligé, dit-il, de prendre en main l'exploitation d'une des miennes; il en est trois, faisant ensemble sept cents acres, qui sont dans ce moment entièrement incultes: at the present time lying intirely waste.[37]
Les lettres du Cornwal renferment des [50] détails semblables. John Wallis annonce que les fermiers peuvent trouver à peine dans leurs récoltes les moyens de payer les taxes, et que conséquemment les rentes ne sont point payées. Les fermiers découragés, ajoute-t-il, négligent leurs terres, et ceux qui n'ont que les capitaux employés à la culture, sont indifférens aux conséquences de leur négligence, parce que ces capitaux ont perdu la moitié de leur valeur.[38] La société d'agriculture de Cornwal, écrit le président de cette société, peut établir que la détresse qui pèse sur toutes les classes engagées dans l'agriculture, est bien au-delà de tout ce qui, jusqu'à ce jour, était venu à la connaissance de la société ; le propriétaire est dans la misère, parce qu'il ne reçoit point de rente; le tenancier, parce qu'il ne peut pas vendre sa récolte; et l'ouvrier, parce qu'il ne trouve pas d’emploi. Si l'on n'y porte remède, non-seulement un grand nombre d'individus en souffriront, mais les taxes ne pourront pas être payées.[39]
Miles Bowker écrit du Dorsetshire : La dé. tresse des fermiers est ici tellement grande, [51] qu’il leur est impossible de payer la rente, les taxes et leurs ouvriers, sans prendre sur le capital nécessaire à l'exploitation de leurs fermes, capital qui dans ce moment ne trouve pas d'acquéreurs Il y a environ quatre ans que j'ai déboursé treize cents livres sterling (312 mille francs) pour élever un troupeau de mille mérinos, acquérir et améliorer cent cinquante acres de terre tenus à vie, et mettre en valeur mille acres de plus de ferme ; et cette somme, par des pertes et par la diminution de la valeur du capital, est à moitié consommée. S'il était nécessaire de vendre le capital, il ne me rapporterait pas autant de couronnes (écus) qu'il m'a coûté de livres sterling, quoiqu'il soit notoire que je fais le labourage à pins bas prix que les fermiers voisins, et que j'aie vécu avec moins d'un pour cent du capital. Mes enfans, au lieu d'aller à l'école, sont devenus ouvriers et laboureurs, et plus nous nous épuisons de travail, plus nos pertes deviennent considérables. Il y a déjà plusieurs semaines que j'ai abandonné deux de mes fermes; une seule personne s'est présentée pour voir l'une et l'autre, et il paraît probable que nul ne voudra s'en charger.[40]
[52]
Il est venu à ma connaissance, écrit Isaac Royer, du comté d'Essex, que plusieurs fermiers n'ont pu se sauver ni par leur industrie, ni par leur application. Les calamités sont si grandes et si nombreuses, qu'il faudrait un volume considérable pour les contenir. Là où une diminution de rente a eu lieu, la ruine des fermiers est retardée, mais elle n'est pas prévenue.[41] Je n'hésiterai point à dire, ajoute John Vaisey du même comté, qu'un tiers des possesseurs ( qui n'ont pas d'autre source de revenu), aussi loin que s'étendent mes connaissances dans le pays, sont insolvables dans ce moment.[42]
On écrit d'un autre comté, d'Huntingdonshire, que la misère des fermiers est extrême. La paroisse d'Atley Saint-George, dit un des propriétaires, est composée de neuf cents acres; une grande partie est en pâturage; environ trois cents acres sont sans fermiers; trois cents sont dans les mains d'un fermier; le surplus est occupé par le propriétaire, parce qu'il n'a pas trouvé à l'affermer. Quelques [53] paroisses du voisinage restent presque entièrement sans culture; d'où il résulte une grande détresse, parce que les ouvriers manquent de travail : Some parishes in the neighbourhood are almost wholly uncultivated, and great distress prevails, from the labourers not having it in their power to procure any work.[43]
Dans le comté de Kent, il est des paroisses où la seule taxe des pauvres monte presqu'au niveau de la rente.[44] C'est encore pire dans quelques parties du Lancastshire. La détresse des fermiers, écrit M. W.Whiteside,se montre de tous les côtés : plusieurs sont incapables de payer les dépenses les plus urgentes, ce qui les oblige à suspendre leurs paiemens ou a faire banqueroute. Leur misère est telle, qu'ils n'ont pas le moyen de se procurer même les choses nécessaires à la vie..... Je pense que des remèdes puissans doivent être promptement adoptés, ou que la race actuelle des fermiers sera ruinée. Une diminution de rente ( autant que mes faibles moyens me permettent d'en juger ) serait un remède inefficace pour un si grand mal ; [54] parce que, quand même on déchargerait les fermiers de la rente entière, il y en aurait encore peu qui pourraient vivre : As very few farmers could live, if they were exonerated from the whole rent.[45]
George Tennison écrit du Lincolnshire que les récoltes ont été bonnes; mais que le produit en est enlevé par les impôts, par la taxe des pauvres ou par les ouvriers. Les fermes, ajoute-t-il, sont ainsi devenues de nulle valeur, partout où l'on ne peut pas élever des troupeaux.[46] Turnet, de la même province, dit que plusieurs fermiers ont consommé leurs capitaux; que d'autres, en très-grand nombre, ont fait faillite; qu'il ne se fait plus d'améliorations, et que les fermes sont généralement négligées.[47] Thomas Pilly ajoute que dans peu de temps les taxes ne pourront plus être payées, et que les fermiers, au lieu d'employer et d'assister les pauvres, auront bientôt besoin d'être secourus eux-mêmes : je suis fâché de le [55] dire, continue-t-il, mais un grand nombre sont déjà dans ce cas.[48]
Dans la comté de Monmouth, les cultivateurs paraissent être encore plus écrasés par les taxes que dans les autres. Plusieurs fermiers, écrit un magistrat, M. J.-H. Moggridge, ont, avant la moisson, vendu tout le blé qu'ils avaient à vendre, pour payer les taxes des pauvres et du roi ( to pay parochial and Kings taxes ), et ils n'ont rien conservé pour payer les taxes ou la rente de la moitié de l'année courante. Plusieurs doivent déjà des arrérages considérables, particulièrement pour la taxe des pauvres et des routes. Le défaut considérable et toujours croissant de travail, la misère des tenanciers et de leurs familles ruinées, le désespoir qui se manifeste dans la contenance et dans les discours d'un grand nombre, les allusions à la résistance aux lois, et les tentatives faites pour la justifier, les multitudes traînées devant les magistrats pour le non-paiement des taxes ( multitudes qui excèdent le nombre de cent en même temps et d'un seul lieu ), le ton et l'esprit du pays, me font craindre que, lorsque les [56] ouvriers cesseront d'être employés aux travaux publics déjà bien avancés, il ne soit difficile de maintenir la tranquillité publique. Cette opinion est celle des personnes qui ont le plus de rapports avec la classe opprimée, et de ceux qui, conjointement avec moi, exercent les fonctions d'officiers de paix.
Dans une seconde lettre, le même magistrat, après avoir annoncé quelques violences causées par une excessive misère, ajoute : Dans le seul voisinage de la ville de Newport, j'en suis bien informé, les biens de près de deux cents personnes doivent être vendus pour le paiement de la taxe des pauvres, si elles ne la paient pas dès demain. Les fermiers de ces environs, continue-t-il, sont maintenant dans l'habitude d'abandonner leurs maisons, après avoir vendu aussi clandestinement qu'ils le peuvent ce qui leur reste de leur capital ou de leurs autres propriétés … La souffrance est presque universelle, et l'anticipation terrible.[49]
Les magistrats, les fermiers, tenanciers ou agriculteurs de trente paroisses du même comté - se sont réunis ( le 19 mars 1816 ), et il a été [57] unanimement reconnu, 1°. que les fermiers et possesseurs de terres dans ce pays sont accablés par une misère sans exemple et toujours croissante; 2°. qu'en conséquence plusieurs fermiers ont été déja ruinés, et que leur capital a été vendu, par suite d'exécutions judiciaires, pour le paiement des rentes et des taxes; que plusieurs autres sont menacés du même sort, et que ceux qui restent encore vivent sur leurs capitaux qu'ils sont obligés de retirer de la culture des terres; 3°. que le prix de vente de tout le produit disponible des fermes du voisinage, n'est pas suffisant pour acquitter les frais de culture, les contributions, la taxe des pauvres et autres charges publiques qui doivent être payées avant aucune rente; 4°- que le prix du blé et les autres produits des fermes n'est pas plus élevé qu'avant la guerre de 1793, et que les taxes sont près de cinq fois plus fortes; 5°. que, sans un remède prompt et efficace, la ruine générale des fermiers, la perte de la rente pour le propriétaire, et le non-paiement des taxes au gouvernement, ne pourront manquer d'arriver; que la terre cessera d'être cultivée ( comme cela a déjà eu lieu en partie ), et que la disette, sinon la famine, en sera la [58] conséquence, etc..[50] Ce tableau du comté de Monmoth est terminé par une lettre d'Edward Berry, qui finit par cette phrase : Je puis hardiment affirmer que, si les rentes ne sont pas diminuées de près de moitié, et les baux consentis pour vingt-un ans, le reste de ceux qui tiennent les propriétés les abandonneront ou seront ruinés. Ainsi, le comté de Monmouth ne présentera plus qu'un vaste désert: Thus the county of Monmouth will present a vast desart.[51]
Le poids des taxes n'est pas moindre dans le comté de Norfolk. La détresse des' fermiers, écrit Wm. Diball, est au-delà de ce que je puis dire : plusieurs qui ont déboursé des sommes considérables pour améliorer leurs fermes, en ont été chassés sans un shelling, n'ayant pas pu payer leurs rentes. L'état de détresse de ce comté, dans lequel je réside, est tel que je ne connais aucun remède qui puisse y apporter quelque secours : une faible diminution des rentes et des taxes ne serait pas suffisante ; et, avec les charges qui pèsent actuellement sur [59] l’agriculture, et au prix où se trouve le blé, je considère la meilleure terre comme ne valant pas la peine d'être cultivée : I do not consider even good land to be worth occupying. Cependant, ajoute-t-il, si l'on ne met promptement ordre à cet état de choses, je crains que les conséquences n'en soient terribles. Je crois que les huit dixièmes au moins d es possesseurs actuels ne pourront pas tenir leurs fermes encore deux années sans quelque grande révolution ; et il paraît digne de considération de savoir comment il sera possible de maintenir les pauvres en paix.[52]
En voilà suffisamment, sans doute, pour établir que les pauvres, les gens à pensions et les gens à places peuvent se multiplier comme les sauterelles qui formaient une des sept plaies d'Egypte, et dévorer à eux seuls les produits du sol dont ils ont couvert la surface. Nous aurions pu rapporter un bien plus grand nombre d'exemples; nous aurions pu citer le comté de Northumberland dans lequel se trouve tel district où, sur mille deux cent trente fermiers, il en est plus de mille qui payent les taxes, non [60] sur leurs profits, mais sur leurs pertes;[53] le Sommerset dans lequel il est des districts qui ne peuvent pas payer les trois quarts des dîmes ou des autres taxes, avec le prix de leur blé et de leurs troupeaux;[54] le comté de Suffolk, enfin, ' d'où l'on écrit, après avoir trace un tableau énergique des misères qui accablent les agriculteurs, que, sans un remède prompt et radical, le royaume sera dans peu entraîné dans une ruine et dans une destruction générales, et ne présentera plus à ses habitans qu'un désert inculte et sauvage.[55] Mais des citations plus nombreuses fatigueraient nos lecteurs sans leur donner plus de lumières.
Les classes qui dévorent en Angleterre les produits de l'agriculture sont principalement les pauvres et les gens d'église. Les premiers en prennent une part sous le nom de taxes, les seconds en prennent une autre sous le nom de dîmes. Les gens à places ou à pensions prennent aussi la leur; mais ceux-ci vivent et se multiplient spécialement au moyen de ce qu’ils [61] enlèvent aux autres branches de l'industrie. En 1815, la part qu'ils en prenaient était d'environ un milliard sept cents millions de francs: ces valeurs se répartissaient entre eux dans une proportion plus ou moins forte. M. Say[56] pense qu'on ne s'éloignerait guère de la vérité en annonçant que le gouvernement ( c’est-à-dire, la foule immense des gens à places ) consomme la moitié des revenus qu'enfantent le sol, les capitaux et l'industrie du peuple anglais. Qu'on ajoute à cela ce que consomment les pauvres, les gens d'église, l'entretien des routes, et toutes les charges locales, et l'on verra ce qui reste aux propriétaires ou aux industrieux de quelque classe qu'ils soient.
Rien, ce nous semble, ne prouve mieux l'énormité des consommations des gens à places ou à pensions que l'étendue de l'industrie anglaise, le travail opiniâtre auquel se livrent les hommes laborieux de cette nation, l'économie qu'ils apportent dans leurs dépenses personnelles, et l'état de détresse dans lequel ils se trouvent continuellement. Suivant l'écrivain que nous venons de citer, « la nation [62] anglaise en général, sauf quelques favoris de la fortune, est obligée à un travail opiniâtre; elle ne peut pas se reposer. On ne voit pas en Angleterre, dit-il, d'oisif de profession; on y est remarqué dès qu'on a l'air désoccupé, et qu'on regarde autour de soi. Il n'y a point de ces cafés, de ces billards remplis de désœuvrés du matin au soir, et les promenades y sont désertes tout autre jour que le dimanche; chacun y court absorbé par ses affaires. Ceux qui mettent quelque ralentissement dans leurs travaux, sont promptement atteints par la ruine; et l'on m'a assuré à Londres que beaucoup de familles, de celles qui avaient peu d'avances, sont tombées dans les derniers embarras pendant le séjour des souverains alliés, parce que ces princes excitaient vivement la curiosité, et que, pour les voir, on sacrifiait quelquefois ses occupations plusieurs jours de suite.[57] »
Cette prodigieuse activité ne sauve pas la classe industrieuse de la misère, parce que les gens à places ou à pensions sont encore plus avides que les industrieux ne sont laborieux. « Chaque consommation, chaque mouvement pour ainsi dire est soumis à une taxe : aussi un [63] Anglais qui a un commerce, si le capital qu'il emploie ne lui appartient pas, et s'il est obligé d'en payer l’intérêt, ne peut soutenir sa famille. Une terre, un fonds placé, qui partout ailleurs suffiraient pour procurer de l'aisance sans travail, ne suffisent point en Angleterre pour faire vivre leur possesseur : il faut encore, s'il ne les fait pas valoir lui-même, qu'il exerce un talent, qu'il concoure soit en chef, soit en sous ordre, à une autre entreprise.[58] »
On a vanté quelquefois la liberté dont jouit le peuple anglais, et peut-être nous est-il arrivé de tomber à cet égard dans l'erreur commune. II nous semble qu'on s'est mal entendu quand on a parlé de cette nation et de sa liberté. En Angleterre, comme dans presque tous les pays, il y a deux peuples : celui qui vit sur l'industrie d'autrui, et celui qui ne vit que sur son travail. Le premier peut se dire libre: il est parfaitement organisé pour imposer et pour percevoir les tributs sur lesquels son existence est fondée: il a des assemblées qui délibèrent, soit sur ce qu'il a besoin de percevoir, soit sur la manière dont il doit le percevoir;[59] [64] il a, sur tout le territoire, des receveurs chargés de la perception, des soldats ou d'autres agens pour forcer les tributaires récalcitrans; en cas de besoin, la partie organisée peut appeler à son secours la partie qui ne l'est point, et lui distribuer la prodigieuse quantité d'armes qui encombrent ses magasins. Les individus qui cultivent la terre, ou qui exercent tout autre genre d'industrie, sont libres dans ce sens, que nul ne peut les arrêter ou les gêner dans leur travail, et qu'ils peuvent impunément prendre la fuite; mais ils sont entièrement esclaves dans ce sens qu'ils ne s'appartiennent pas, et que les produits du sol qu'ils cultivent, ou de l'industrie qu'ils exercent, peuvent leur être et leur sont même régulièrement enlevés à mesure qu'ils prennent naissance. Dans ce sens, on peut dire que les industrieux Anglais sont les hommes les plus esclaves de l'Europe, par la raison que, de tous les maîtres, les leurs sont ceux qui sont organisés avec le plus de science et le plus de force. La sécurité des esclaves travailleurs est presque toute dans l'intérêt des maîtres, puisque ceux-ci sont les seuls qui profitent du surcroît de production qui en résulte.
Ce qui constitue en effet la liberté, ce n’est [65] pas de pouvoir seulement exercer ses facultés, sans obstacle, c'est de pouvoir les exercer à son profit. Il était à Rome des esclaves qui cultivaient les arts ou les sciences; et leurs maîtres, bien loin d'en gêner, en encourageaient au contraire l'exercice; mais aussitôt que ces esclaves avaient créé un produit, les maîtres étaient là pour s'en emparer et pour en jouir. Il y avait aussi des esclaves qui se livraient aux travaux de l'agriculture; mais les produits des champs qu'ils exploitaient étaient consommés par leurs maîtres. Les esclaves travailleurs de l'Angleterre sont précisément dans le même cas : ils ne peuvent pas dire qu'ils s'appartiennent, puisque le produit de leur .travail est consommé par d'autres; et si la propriété d'une chose consiste dans la faculté d'en percevoir et d'en consommer les produits sans rien donner en échange, les pauvres, les gens à places ou les gens à pensions, sont, à peu de chose près, en Angleterre, les vrais propriétaires du sol et des hommes qui le cultivent.
Les agriculteurs anglais commencent, quoique un peu tard, à s'apercevoir de ces vérités. La taxe pour les pauvres, écrit M. Taylor, est le plus grand de tous nos maux; elle est un mal à l'accroissement duquel nulle limite n'est [66] fixée, et qui ( à moins qu'il ne soit arrêté à temps) fera, dans quarante ans d'ici, du propriétaire nominal d'une terre un simple administrateur d'un bien des pauvres.[60] M. Walter Forbes ajoute qu'il ne se permettra pas de juger si le système actuel est nécessaire; mais qu'en admettant qu'il le soit en effet, il ne craindra pas d'annoncer que la propriété foncière du royaume est à la veille de changer de mains, dans une étendue dont on n'avait pas eu d'exemple : the landed property of this kingdom is on the eve of changing hands to an extent beyond all former example.[61] Nous avons vu précédemment que le bien des possesseurs était vendu pour payer les taxes des pauvres et du roi, et que les prisons étaient remplies de débiteurs insolvables, ce qui semblerait prouver que nous nous sommes trompés, quand nous avons dit que les industrieux Anglais étaient des esclaves travailleurs qui avaient la faculté de prendre la fuite.
Il est des gens qui s'imaginent que la partie laborieuse de la nation anglaise pourra se [67] soustraire à l'exploitation, au moyen d'une réforme parlementaire, d'une révolution ou d'une banqueroute. De toutes les chimères, celle-là est assurément la plus vaine. Une réforme parlementaire ne serait que la désunion ou la désorganisation des gens à places et des gens à pensions, et l'union ou l'organisation de ceux qui les nourrissent du produit de leur travail : or, comment peut-on s'imaginer que des hommes qui ne vivent que par la force de leur union, consentiront à se désunir et à laisser former une organisation dont le but unique serait de les faire mourir de faim? Qu'aurait-on dit si les esclaves de Rome s'étaient présentés devant leurs maîtres, pour leur demander la dissolution du sénat ou des comices, et la permission de se mettre à leur place? Les pétitions que présentent aux leurs une partie des habitans d'Angleterre, sont-elles beaucoup plus sensées?
Une révolution dans l'intérêt de la classe industrieuse est moins probable encore qu'une réforme. Il peut y avoir en Angleterre des séditions, des révoltes, des massacres; mais les maîtres resteront les maîtres, et les industrieux, de quelque classe qu'ils soient, achèveront de perdre le peu de sûreté dont ils jouissent encore. Quant à la banqueroute, elle est [68] tout aussi chimérique qu'une révolution utile. Les gens à places perdraient la moitié de leur armée s'ils licenciaient les gens à pensions; ce sont d'utiles auxiliaires qu'ils se garderont bien d'envoyer dans le camp ennemi. Ces auxiliaires, il est vrai, coûtent beaucoup; mais qu'importe! n'est - ce pas aux dépens des industrieux qu'ils vivent, et les gens à places en sont-ils bien moins nourris? Si l'on doutait de l'impossibilité d'une révolution utile et d'une banqueroute, il suffirait, pour en être convaincu, d'examiner les mœurs, les forces et l'organisation de la partie de la population qui vit sur les capitaux et sur le travail de l'autre.
Le premier effet de la taxe pour les pauvres a été, comme nous l'avons vu, de faire prendre à cette classe un accroissement prodigieux; le second, de lui inspirer du dégoût pour le travail et pour l'économie, et de lui donner ainsi tous les vices qu'enfantent la fainéantise et la misère; le troisième de lui faire considérer tous les biens du pays comme une propriété à laquelle elle a un droit incontestable, ou de répandre cet esprit de prétendue égalité qui forme un des élémens les plus actifs de la démagogie, et qui finit toujours par enfanter le despotisme militaire.
[69]
Le travail est le premier besoin de l'homme, parce que ce n'est que par lui que les hommes peuvent exister; mais le travail n'est point un plaisir par lui-même, au moins pour le plus grand nombre ; il n'est qu'un moyen de vivre ou de se procurer des jouissances. Lors donc qu'il est possible d'obtenir la fin, sans le secours du moyen, il arrive que le travail cesse; cette possibilité est produite par la taxe pour les pauvres. Les individus qui peuvent vivre et se multiplier sans rien faire, ne prennent pas beaucoup de peine : pour un mendiant, l'oisiveté est la première des jouissances; c'est à celle-là qu'il sacrifie toutes les autres. Aussi de toutes les plaintes formées par les cultivateurs anglais, celle-ci est-elle une des plus communes. Ils se plaignent beaucoup aussi que cette taxe engendre le vice et la dépravation. Nous avons déjà fait de si nombreuses citations, que nous n'en ferons ici qu'une seule, et nous renverrons à l'ouvrage même les lecteurs qui seront curieux de connaître un plus grand nombre de faits.[62]
[70]
M. Thomas Coburn rapporte que, pendant l'hiver, des ouvriers qu'il désigne, venaient régulièrement travailler à neuf heures, et s'en alloient à trois. Je leur représentai, dit-il, que les lois du pays m'obligeant à les nourrir eux et leurs familles, ils devaient en retour, pour me mettre à même de les faire vivre, travailler le même nombre d'heures que les autres ouvriers. Ils me répliquèrent que, pour moi ni pour qui que ce fût, ils ne voulaient pas travailler plus tard que trois heures. Je les citai donc devant le magistrat, M. Hide, qui leur dit que leur devoir était de travailler pendant l’hiver, depuis le point du jour, jusqu'à la nuit, et que, s'ils ne travaillaient pas ainsi, il les enverrait en prison. Ils reçurent cette menace avec mépris, et répliquèrent que, si on les envoyaient en prison ( ce qui leur était fort indiffèrent), la paroisse nourrirait leurs familles: this they treated with contempt, and said, « if they went to prison ( which was a matter of indifference to them) the parish must maintain their families.[63]
On connaît les vices de la basse classe de la [71] nation anglaise; on sait que, de l'aveu même des écrivains de cette nation, il se commet plus de crimes chez elle que chez toutes les autres nations de l'Europe ensemble; mais ce qu'on ne sait pas aussi-bien, c'est que la multitude immense qui vit, au moyen de la taxe des pauvres, quoique avilie par l'habitude de recevoir l'aumône,[64] n'en considère pas moins le sol du pays comme une propriété dont elle a-le droit de consommer les fruits. Ils n'ont oublié, dit le docteur Macqueen, ni la doctrine de l'égalité, ni les droits de l'homme ; ils les chérissent au contraire avec passion, et n'y renoncent qu'avec répugnance. Ils considèrent leurs paroisses respectives comme leur héritage ; ils croient avoir le droit d'y recourir à la moindre infortune réelle ou imaginaire, et quelle qu'en soit la cause. Si leur demande ne leur est pas immédiatement accordée, ils volent- chez le magistrat le plus voisoin, qui est ordinairement le curé de la paroisse, et en obtiennent un ordre pour l'inspecteur.[65] M. John Béresford écrit dans les mêmes termes : Il y a [72] plusieurs années, dit-il, qu'il était honteux de recevoir les secours de la paroisse; mais ce sentiment est malheureusement disparu : les ouvriers pauvres paraissent croire maintenant qu'ils ont un droit aussi incontestable aux secours de la paroisse qu'aux salaires qui sont le prix de leur travail, et ils les réclament avec la même confiance.[66]
Quelque extraordinaire que puisse nous paraître cette manière de voir des pauvres de l'Angleterre, elle est si naturelle à l'esprit humain, que le temps, bien loin de la détruire, lui donnera toutes les forces de l'habitude et des préjugés. Elle est ou sera, tôt ou tard, partagée par tous ceux qui vivent sur le bien d'autrui; et l'époque n'est peut-être pas bien éloignée où les mendians mangeront aussi les peuples en vertu du droit divin.[67] Or, que l'on songe maintenant au nombre immense d'individus qu'alimentent les 380 millions dont se compose la taxe des pauvres : qu'on songe aux habitudes, aux vices, aux idées dont cette [73] population est imbue; qu'on ajoute à cette force celle d'une multitude non moins considérable de gens à places et de gens à pensions, tous vivant sur les biens ou sur l'industrie d autrui, et pouvant employer tout leur temps, toute leur capacité, toute leur force à se soutenir, tandis que la partie laborieuse qui alimente cette multitude du produit de ses sueurs, n'a pas un moment à donner à sa défense, et qu'on se dise par quel moyen cette dernière classe pourrait se soustraire à l'asservissement.
Si le chef d'une armée, qui aurait acquis quelque influence, appelait tout à coup autour de lui la foule des mécontens en leur promettant la liberté et légalité, il pourrait peut-être renverser les chefs de l'administration actuelle, et substituer le despotisme militaire à l'olygarchie qui est en possession du pouvoir. Mais que gagnerait à cela la partie industrieuse de la nation? Quand les pauvres qu'elle alimente seraient couverts d'habits rouges ou bleus, en faudrait-il moins les nourrir, et seraient-ils beaucoup plus traitables quand chacun d'eux aurait un sabre ou une baïonnette à la main? Ce serait une déplorable révolution que celle qui consisterait à substituer des casernes à des maisons de travail, et des lieutenans généraux [74] ou des marechaux à des sinécurîstes d'une autre espèce. Il serait même très-probable que celui qui viendrait ainsi proclamer la liberté et l'égalité, sans faire croître un grain de blé de plus dans le pays, ferait alliance avec les premiers mangeurs, et que la classe industrieuse aurait à nourrir tout à la fois les anciens et les nouveaux parvenus.
Nous avons dit, en commençant, que la population s'élevait toujours au niveau des moyens de subsistance, et tendait même à les dépasser; qu'en ôtant à une partie d'un peuple des moyens de subsistance et en les donnant à une autre, on diminuait les forces de celle-là, ou l'on en arrêtait l'accroissement, et l'on augmentait, dans la même proportion, les forces de celle-ci; que le déplacement des subsistances, n'en augmentant pas la quantité, ne pouvait point augmenter la population ou l'empêcher de décroître; enfin, que, lorsqu'on donnait à des pauvres, à des gens à places ou à tout autre classe d'individus, les moyens de vivre ou d'élever des familles, on arrêtait l'accroissement de la classe laborieuse, et l'on substituait une race oisive et immorale à une population active et vertueuse.
Ces propositions ayant été prouvées par des [75] faits incontestables, chacun peut en déduire les conséquences qu'il croit utiles à ses intérêts. Ceux qui veulent vivre sur le travail d'autrui doivent faire multiplier les places et grossir les salaires: car plus il y aura d'employés, plus ils prendront sur les revenus d'autrui, plus aussi ils pourront se multiplier, plus ils acquerront de force. Si le pays qu'ils habitent a des assemblées représentatives, ils doivent faire leurs efforts pour les envahir, parce qu'ils pourront ainsi mieux veiller à leurs intérêts, c’est-à-dire, défendre et grossir leurs salaires. Ils doivent aussi, autant qu'ils le peuvent, se faire livrer les capitaux de ceux qui en ont, et, après les avoir consommés, en faire payer largement le revenu à la classe industrieuse; c'est un moyen excellent pour affaiblir celte classe, et pour fortifier la leur. Un pensionnaire avec lequel ils partagent est un ami toujours disposé à les secourir; un capitaliste dont ils prennent régulièrement les revenus, est un adversaire qu'il faut vaincre tous les jours. Ils doivent enfin, autant que possible, faire multiplier la classe des pauvres. Cette classe, quand elle est nombreuse, peut leur être d'une grande utilité. Elle est un épouvantail qui dispose toujours à la soumission la classe [76] qui l'alimente. Qu'on la lui fasse voir en tumulte, ou qu'on la lui montre enrégimentée et couverte d'habits rouges ou bleus, l'effet en est constamment le même.
Les hommes qui veulent vivre sur leurs revenus, et ne pas les laisser consommer par d'autres, doivent suivre une marche contraire: il faut qu'ils donnent de leurs biens la part la plus petite qu'il est possible : le comble de la perfection serait de ne rien donner du tout. Cette perfection, ils ne doivent pas espérer de l'atteindre; mais leurs efforts doivent y tendre continuellement. S'ils jouissent d'une représentation nationale, ils n'ont rien de plus pressé que de s'emparer de ce poste, et d'employer ensuite tous leurs efforts à diminuer, autant qu'il est possible, le nombre des places et la quotité des salaires. Au lieu de demander bêtement qu'on proclame comme un droit constitutionnel et imprescriptible la faculté de faire antichambre pour avoir une place, ils doivent faire en sorte que les salaires des places soient tellement réduits, que nul ne puisse plus les envier; ils doivent, en ce point, imiter ce sage peuple qui a fait, en tête de sa constitution, la déclaration suivante:
« Comme, pour conserver son indépendance, [77] tout homme libre qui n'a point une propriété suffisante, doit avoir quelque profession, métier, commerce ou ferme qui le fasse subsister honnêtement, il n'est pas nécessaire de créer des emplois lucratifs, parce que leur effet ordinaire est d'inspirer à ceux qui les possèdent ou qui les postulent, un esprit de dépendance ou de servitude, indigne d'hommes libres. Ainsi, toutes les fois que les émolumens d'un emploi augmenteront au point de le faire désirer à plusieurs personnes, il faudra que la législature en diminue les profits.[68] »
En réduisant le nombre des places et en en diminuant les profits, on n'aura pas besoin de consommer les capitaux des particuliers, et de créer ainsi des pensionnaires: une légère contribution suffira pour payer les dépenses absolument nécessaires. Les capitalistes resteront donc du côté des industrieux, et n'iront pas, après s'être transformés en pensionnaires, prêter main-forte à ceux qui voudraient grossir le nombre et les bénéfices des gens à places.
[78]
Mais ce serait vainement que les hommes qui ne veulent ni vivre aux dépens de personne, ni que personne vive à leurs dépens, aspireraient à la diminution des salaires et du nombre des salariés, s'ils alimentaient une classe de pauvres ou de mendians, et s'ils ne savaient pas prendre l'habitude de veiller eux-mêmes au maintien de l'ordre public.[69] Alimenter les mendians, c'est établir des pépinières de malfaiteurs ou de vagabonds; quand les vagabonds ou les malfaiteurs abondent, il faut une police pour les surveiller, des soldats ou des gendarmes pour les arrêter, des prisons et des geôliers pour les garder, des magistrats pour les juger: et, quand tous ces gens-là sont nécessaires, il faut les payer. En les payant ils se multiplient, et quand ils se multiplient et qu'ils deviennent forts, ils exploitent le peuple qu'ils devaient protéger : dès ce moment, ce peuple se trouve leur tributaire, et la liberté n'existe plus.
[79]
Nota. Dans le second volume de cet ouvrage, nous avons traité de l'organisation sociale considérée dans ses rapports avec les moyens d'existence des peuples. Si les idées que nous avons alors énoncées avaient pu paraître paradoxales à quelques-uns de nos lecteurs, nous les invitons à les examiner de nouveau : celles que nous venons de développer dans cet article leur en feront mieux sentir la vérité.
Endnotes
[1] Le mot pauvre n'est pas employé ici par opposition à riche; il signifie tout individu qui vit sur la charité publique, soit qu'il aille mendier de porte en porte, soit qu'il reçoive des secours à domicile. Les mots gens à places ne comprennent pas tous les hommes qui remplissent des fonctions publiques ; ils s'appliquent seulement aux individus qui recherchent les emplois publics comme un moyen de vivre ou de s'enrichir. Enfin, les mots gens à pensions se s'appliquent pas aux personnes qui, ayant rendu des services réels à leurs concitoyens, en reçoivent un dédommagement : ils s'appliquent à ceux qui spéculent pour vivre aux dépens du public, sans s'inquiéter s'ils lui ont, ou s'ils ne lui ont pas rendu quelques services.
[2] Voyage en Syrie et en Égypte, pendant les années 1783, 1784 et 1785; par M. C.-F- Volney, tome 11, pag. 377 et 378.
[3] An Essay on the principe of population, etc.; by T. R. Malthus, tom. II, pag. 198, cinquième édition.
[4] C'est ainsi que la populace romaine, qui vivait des tributs levés sur les peuples vaincus, s'accrut d’une manière prodigieuse; tandis que les peuples tributaires s'affaiblirent au point de ne pouvoir plus opposer aucune résistance.
[5] La taxe des pauvres a produit en Angleterre les règlemens les plus tyranniques et les plus vexatoires pour les ouvriers laborieux. Voyez Smith, Richesse des nations, liv. 1, chap. 10.
[6] II est des écrivains qui croient qu'elle en fait le tiers. De l'Angleterre et des Anglais ; par J.-B. Say, pag. 20, deuxième édition.
[7] From 1800 to 1814, the gênerai population had increased above a million, and within the same calamitous period, the population of the poor increased also above a million ; the increase of poor thus keeping equal peace with the increase of the gêneral population, or, in plainer phrase, every additional subject became a pauper. The poor were as one to five of the entire population. The poor rates rose from three to sixteen millions. Reflexions upon the progressive decline of the British empire, etc.; by Henry Schultes, p. 12.
[8] Agricultural state of the kingdom, in februari, march, and april, 1816; etc., première partie, pag. 7.
[9] Agricultural state of the kingdom, etc., première partie, pag. 40.
[10] Ibid, pag. 40 et 41.
[11] Ibid, pag. 102.
[12] Agricultural state of the kingdom, etc., pag. 128.
[13] Ibid, pag. 143.
[14] Agricultural state of the kingdom, etc., pag. 148.
[15] Ibid, pag. 157.
[16] Ibid, pag. 158.
[17] Agricultural state of the kingdom, etc.,pag. 184.
[18] Ibid, pag. 194.
[19] Agricultural state of the kingdom, etc., pag. 197.
[20] Ibid, pag. 204.
[21] Ibid, pag. 206.
[22] Agricultural state of the kingdom, etc., pag. 229.
[23] Ibid, part- deuxième, pag. 2.
[24] Agricultural state of the kingdom, etc, partie deuxième, pag. 2.
[25] Ibid, pag. 25.
[26] Ibid, pag. 29.
[27] Agricultural state of the kingdom, etc., partie deuxième, pag. 40.
[28] Ibid, pag. 50.
[29] An essay on the principle of population, etc., book 3, chap. 6, vol. 11, pag. 243, 246.
[30] On pourrait citer en France tel fonctionnaire, qui, de notoriété publique, a marié par ce moyen, sous le gouvernement impérial, au moins soixante cousines ou arrière-cousines.
[31] Les maximes des gens à places ont été exposées et défendues par le célèbre Burke. M. Jérémie Bentham a bien voulu prendre la peine de les réfuter dans un écrit intitulé : Défense of economy against the late M. Burke.
[32] Voici quelques passages du tableau relatif à ce comté: « Three farms, containing 700 acres, entierely waste; .... many and many uncultivated some parishes almost wholly uncultivated. »
[33] Agricultural state of the kingdom, etc., partie première, pag. 24.
[34] Ibid, pag. 35.
[35] Agricultural state of the kingdom, etc., partie première, pag. 35.
[36] Ibid, pag. 37.
[37] Ibid, pag. 42.
[38] Agricultural stale of the kingdom, etc., partie première, pag. 53.
[39] Ibid.
[40] Agricultural state of the kingdom, etc., partie première, pag. 75, 76.
[41] Agricultural state of the kingdom, etc., partie première, pag. 87.
[42] Ibid, pag.
[43] Agricultural state of thé kingdom, etc., partie première, pag. 114.
[44] Ibid, pag. 140.
[45] Agricultural state of the kingdom, etc., partie première, pag. 144, 145.
[46] Ibid, pag. 153.
[47] Ibid, pag. 155.
[48] Agricultural state of the kingdom, etc., partie première, pag. 167.
[49] Agricultural state of the kingdom, etc., partie première, pag. 173, 175.
[50] Agricultural state of the kingdom, etc., partie première, pag. 177, 178.
[51] Ibid , pag. 184.
[52] Agricultural state of the kingdom, etc., partie première, pag. 187-190.
[53] Agricultural state of the kingdom, etc., partie première, pag. 240.
[54] Ibid, partie deuxième, pag. 4.
[55] Ibid, pag. 26.
[56] De l'Angleterre et des Anglais; par J.-B. Say, pag. 16, deuxième édition.
[57] De l'Angleterre et des Anglais, pag. 21.
[58] De l'Angleterre et des Anglais, pag. 19.
[59] Voyez le tome v du Cens. Europ., p. 105 et suiv.
[60] Agricultural state of the kingdom, etc., partie première, pag. 71.
[61] Ibid, pag. 127.
[62] Agricultural state of the kingdom, etc., partie première, pag. 25, 60, 68, 139, 221, 256, 262 ; et partie deuxième, pag-. 5, 14, 25.
[63] Agricultural slate of the kingdom, etc., partie première, pag. 256.
[64] Agricultural state of the kingdom, etc., partie première.
[65] Ibid, pag. 25.
[66] Agricultural state of the kingdom, etc., partie première, pag. 60.
[67] La dîme, dans les pays où elle existe encore, est perçue en vertu des lois divines.
[68] Article 36 de la constitution de Pensilvanie. Les dispositions de cet article ont été adoptées dans presque tous les États-Unis. Il en est résulté que tous les impôts ont fini par être supprimes, moins les douanes qui suffisent aux dépenses du gouvernement.
[69] La manière dont on alimente les pauvres est étrangère à la question; ainsi, qu'on établisse une taxe pour leur distribuer des secours à domicile comme en Angleterre, ou qu'on établisse des impôts pour les faire subsister dans des hôpitaux, l'effet est à peu près toujours le même.