
Charles Comte, CR “Traité d'économie politique par M. Jean-Baptiste Say,” (March 1817)
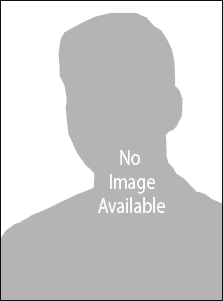 |
 |
| Charles Comte (1782-1837) |
This is part of an Anthology of writings by Charles Comte (1782-1837), Charles Dunoyer (1786-1862), and others from their journal Le Censeur (1814-15) and Le Censeur européen (1817-1819).
See also the others works by Charles Comte and Charles Dunoyer.
Source
[CC?], CR “Traité d'économie politique, ou simple exposition de la manière dont se forment, se distribuent et se consomment les richesses, 3e. édit., par M. Jean-Baptiste Say,” (CE, T. 2, 27 March 1817), pp. 169-221.
See also the facs. PDF of this article.
[169]
TRAITE D'ECONOMIE POLITIQUE, OU SIMPLE EXPOSITION DE LA MANIERE DONT SE FORMENT, SE DISTRIBUENT ET SE CONSOMMENT LES RICHESSES;
TROISIÈME ÉDITION,
A laquelle se trouve joint un Epitôme des principes fondamentaux de l'Economie politique;
Par Jean-Baptiste SAY,
Chevalier de Saint-Wolodimir, membre de l'Académie impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg, de celle de Zurich, etc.; professeur d'Économie politique à l'Athénée de Paris.
( 2 vol. in-8o. : prix, 12 fr., et 15 fr. par la poste. A Paris, chez Déterville, libraire, rue Hautefeuille, n°. 8.)
(Deuxième et dernier article.)
Nous avons fait voir précédemment comment M. Say, dans la première partie de son ouvrage, a exposé le phénomène de la production des richesses; comment à l'aide de quelques faits simples et incontestables, il est arrivé sans [170] effort à la solution des questions les plus délicates, et sur lesquelles on avait long-temps disputé sans s'entendre ; enfin, comment par la seule analyse des faits, il a détruit les erreurs et les préjugés les plus nuisibles, ceux qui rendent les peuples ennemis les uns des autres.
La seconde partie du Traité d'Economie politique renferme l'exposition de la manière dont se distribuent les richesses parmi les personnes qui concourent à la production.
Ce ne sont pas les produits qui se distribuent entre les personnes qui ont concouru à les former : les produits arrivent presque toujours aux consommateurs, sans que les producteurs en aient fait le moindre usage. Ce qui se distribue entre les producteurs, c'est la valeur des choses produites. Prenons pour exemple une montre, et suivons, depuis l'origine, la manière dont on s'est procuré ses moindres parties, et comment leur valeur a été acquittée entre les mains d'une foule de producteurs.
« On verra d'abord, dit M. Say, que l'or, le cuivre et l'acier qui entrent dans sa composition, ont été achetés à des exploitateurs de mines, qui ont trouvé dans ce produit le salaire de leur industrie, l'intérêt de leurs capitaux, le revenu foncier de leur terre.
[171]
» Les marchands de métaux qui les ont obtenus de ces premiers producteurs, les ont revendus à des ouvriers d'horlogerie ; ils ont ainsi été remboursés de leurs avances, et payés des profits de leur commerce.
» Les ouvriers qui dégrossissent les différentes pièces dont se compose une montre, les ont vendues à un horloger, qui, en les payant, a remboursé les avances faites de leur valeur, ainsi que l'intérêt de ces avances, et acquitté les profits du travail exécuté jusques-là. Une seule somme égale à ces valeurs réunies, a suffi pour opérer ce paiement complexe. L'horloger a fait de même à l'égard des fabricans qui lui ent fourni le cadran, le cristal, etc.; et, s'il y a des ornemens, à l'égard de ceux qui lui ont fourni les diamans, les émaux, ou tout ce qu'on voudra imaginer.
» Enfin, le particulier qui achète la montre pour son usage, rembourse à l'horloger toutes les avances qu'il a faites, avec leurs intérêts, et de plus, le profit de son talent et de ses travaux industriels.
» La valeur entière de cette montre s'est, comme on voit, avant qu'elle fût achevée, disséminée entre tous ces producteurs, qui sont bien plus nombreux que je ne l'ai dit et qu'on ne l'imagine [172] communément, et parmi lesquels peut se trouver, sans qu'il s'en doute, celui même qui a acheté la montre, et qui la porte dans sou gousset. En effet, ce particulier ne peut-il pas avoir placé ses capitaux entre les mains d'un exploitateur de mines, ou d'un commerçant qui fait arriver les métaux, ou d'un entrepreneur qui fait travailler une multitude d'ouvriers, ou enfin d'une personne qui n'est rien de tout cela, mais qui a sous-prêté à l'un de ces gens là une portion des fonds qu'il avait pris à intérêt du consommateur de la montre?
» On a remarqué qu'il n'est point du tout nécessaire que le produit ait été achevé, pour que plusieurs de ses producteurs aient pu retirer l'équivalent de la portion de valeur qu'ils y ont ajoutée; ils l'ont même consommée dans bien des cas, long-temps avant que le produit fût parvenu à son terme. Chaque producteur a fait à celui qui l'a précédé, l'avance de la valeur du produit, la façon qui lui a été donnée jusque-là. Son successeur, dans l'échelle de la production, lui a remboursé à son tour ce qu'il a payé, plus la valeur que la marchandise a reçue en passant par ses mains. Enfin le dernier producteur, qui est pour l'ordinaire un marchand en détail, a été remboursé par le consommateur [173] de la totalité de ses avances, plus de la dernière façon que lui-même a donnée au produit. »
C'est donc la valeur des produits qui se distribue entre toutes les personnes qui concourent à la créer, et qui forme leurs revenus. Pour déterminer la part qu'en retire chacun des producteurs, M. Say cherche d'abord sur quels fondemens elle s'établit. La valeur d'une chose évaluable étant la quantité d'une autre chose que le vendeur consent à recevoir et que l'acquéreur consent à céder en échange, deux volontés concourent à la former, celle du vendeur et celle de l'acquéreur. Le vendeur élève la valeur de sa chose aussi haut, et l'acheteur la baisse aussi bas qu'ils le peuvent l'un et l'autre. Le point où les deux efforts se balancent, est celui où se fixe la valeur de la chose. Cette valeur est appelée prix , lorsqu'elle est fixée en argent.
La valeur ainsi entendue, M. Say examine quelles sont les circonstances qui concourent à l'élever ou à l'abaisser, et les effets qui résultent de l'élévation et de l'abaissement. Les frais de production, et l'activité de l'offre et de la demande sont ce qui influe le plus sur la fixation de la valeur. Moins la chose produite exige de frais de production, moins la valeur en est élevée; et moins la valeur en est élevée, plus la demande [174] en est étendue, parce qu'à mesure que le produit baisse, il tombe au niveau d'un plus grand nombre de consommateurs.
Un procédé économique a donc l'avantage d'augmenter la richesse des consommateurs, sans diminuer les bénéfices des producteurs. Ainsi, lorsque le métier à bas, par exemple, a été inventé, si le prix des bas est tombé de la moitié, les consommateurs qui n'en usaient qu'une paire ont pu en user deux pour la même valeur, et un grand nombre de ceux qui étaient obligés de s’en passer, ont pu en avoir à leur usage. Un impôt qui augmente les frais de production, opère un effet contraire; il appauvrit tout à la fois les producteurs et les consommateurs.
Dans cette seconde partie de son ouvrage, M. Say cherche ce qu'il faut entendre par la quantité d'une marchandise qui est dans la circulation et par l'étendue de la demande ; il traite de l'argent considéré comme marchandise en circulation ; des variations réelles, des variations relatives, et des variations nominales dans les prix; de la distribution des revenus dans la société, des genres de production qui paient plus largement les services productifs; des revenus industriels, des revenus des capitaux, des revenus territoriaux, des effets des revenus perçus d’une [175] nation dans l'autre ; enfin de la population dans ses rapports avec l'économie politique. Toutes ces matières sont de la plus haute importance: cependant nous nous abstiendrons d'en faire ici l'analyse, pour nous occuper exclusivement de la partie qui est relative aux consommations, et de l'influence que doit exercer l'économie politique sur la civilisation.
Créer des richesses ce n'est pas créer de la matière; car la matière sans valeur n'est pas une richesse. Les hommes d'ailleurs ne créent point les choses, ils ne peuvent que les modifier, on en changer la forme. Créer des richesses, c'est créer de l'utilité, c'est donner de la valeur aux choses, c'est les mettre sous une forme qui les rende propres à notre usage. Détruire des richesses ou les consommer, ce n'est pas non plus annihiler de la matière; car il n'est pas plus au pouvoir de l'homme de détruire les choses que de les créer; c'est en détruire l'utilité, en faire disparaître la valeur.
La destruction ou la consommation des richesses ainsi entendue, il est évident qu'on peut détruire la valeur d'une chose, sans donner à une autre chose une valeur équivalente ou supérieure; et qu'on peut aussi la détruire pour la remplacer par une chose d'une valeur égale [176] ou même plus considérable. Celui qui jette du blé dans une rivière, le détruit sans donner à rien une valeur nouvelle. Celui qui le jette dans un champ bien préparé, le détruit également; mais, au moyen de cette destruction, il obtient une quantité de blé d'une valeur supérieure. De même, le seigneur qui fait consommer ses revenus par des courtisans, par des valets, par des chevaux de luxe, ou par des meutes de chiens, détruit la valeur de ses richesses sans obtenir aucune valeur en échange. L'agriculteur qui fait au contraire consommer les siens par des ouvriers laborieux et par des animaux qui lui servent à cultiver ou à améliorer ses terres, détruit également des richesses; mais cette destruction est suivie d'une création de valeurs supérieures à celles qui ont été détruites. Il existe donc deux sortes de consommations : les consommations improductives, et les consommations reproductives.
Toutes les valeurs ajoutées aux choses n'étant créées que pour l'usage, sont, par leur nature, destinées à périr; puisqu'il n'est rien qu'un long usage ne parvienne à détruire. Comment peuvent donc se faire les accumulations de capitaux? Pour qu'une valeur s'accumule, répond M. Say, il n'est pas nécessaire qu'elle réside dans le même produit ; il suffit qu'elle se [177] perpétue. Or, les valeurs capitales se perpétuent par la reproduction : les produits qui composent un capital, se consomment aussi bien que tout autre ; mais leur valeur, en même temps qu'elle est détruite par la consommation, se reproduit dans .d'autres matières ou dans la même. Quand je nourris un atelier d'ouvriers, il s'y fait une consommation d'alimens, de vêtemens, de matières premières; mais pendant cette consommation, il se fixe une nouvelle valeur dans les produits qui vont sortir de leurs mains. Les produits qui formaient mon capital ont bien été consommés; mais le capital, la valeur accumulée, ne l'est pas; elle reparaît sous d'autres formes, prête à être consommée de .nouveau; si, au contraire, elle est consommée improductivement, elle ne reparaît plus. »
Il n'y a, à proprement parler, que les deux espèces de consommations que nous avons déjà mentionnées; cependant on les divise encore en consommations privées et en consommations publiques. Les unes et les autres sont soumises aux mêmes règles, et produisent les mêmes effets pour les peuples et pour les particuliers. Les plus remarquables de ces effets sont que les consommations improductives diminuent la richesse nationale de toute la valeur des choses consommées, et que les consommations_ reproductives, au contraire, [178] l'accroissent presque toujours. Les premières n'exigent aucune espèce d'habileté ; on est capable, sans travail et sans gène, de manger de bons morceaux ou de se parer d'un bel habit. Les secondes exigent au contraire une certaine capacité; elles demandent de l'industrie. Les consommations improductives ne servent jamais à de nouvelles productions; elles n'encouragent pas même les hommes industrieux à produire, puisque les valeurs qu'on a consommées improductivement ne donnent pas les moyens d'acheter de nouveaux produits, et qu'il n'y a d'encouragement à produire que là où ces moyens existent.
Les consommations reproductives étant une condition nécessaire dé la création des richesses ou de la production, M. Say a dû s'en occuper dans la première partie de son ouvrage ; aussi dans la troisième partie s'est-il borné à faire remarquer quelques-uns des résultats qui en sont la suite, pour s'occuper exclusivement des consommations improductives, qu'il nomme tout simplement consommations.
Pour savoir si une consommation est bien ou mal faite, il suffit de comparer la perte qui en résulte pour le consommateur avec la satisfaction qui lui en revient. Du jugement sain ou faux [179] qui apprécie cette perte et la compare avec cette satisfaction, dit l'auteur, découlent les consommations bien ou mal entendues, c'est-à-dire, ce qui, après la production réelle des richesses, influe le plus puissamment sur le bonheur ou le malheur des familles et des nations.
» Sous ce rapport les consommations les mieux entendues seront:
» 1°. Celles qui satisfont des besoins réels. Par besoins réels, j'entends ceux à la satisfaction desquels tiennent notre existence, notre santé et le contentement de la plupart des hommes: ils sont opposés à ceux qui proviennent d'une sensualité recherchée, de l'opinion et du caprice. Ainsi les consommations d'une nation seront, en général, bien entendues, si l'on y trouve des choses commodes plutôt que splendides, beaucoup de linge et peu de dentelles; des alimens abondans et sains, en place de ragoûts recherchés; de bons habits et point de broderies. Chez une telle nation les établissemens publics auront peu de faste et beaucoup d'utilité; les indigens n'y verront pas des hôpitaux somptueux, mais ils y trouveront des secours assurés; les routes ne seront pas deux fois trop larges, mais les auberges en seront bien tenues ; les villes n'offriront peut-être pas de si beaux [180] palais, mais on y marchera en sûreté sur des trottoirs …
» 2°. Les consommations lentes plutôt que les consommations rapides, et celles qui choisissent de préférence les produis de la meilleure qualité. Une nation et des particuliers feront preuve de sagesse, s'ils recherchent principalement les objets dont la consommation est lente et l'usage fréquent. C'est par cette raison qu'ils auront une maison et des ameublemens commodes et propres ; car il est peu de choses qui se consomment plus lentement qu'une maison, ni dont on fasse un usage plus fréquent, puisqu'on y passe la majeure partie de sa vie. Leurs modes ne seront pas très-inconstantes; la mode a le privilége d'user les choses avant qu'elles aient perdu leur utilité, souvent même avant qu'elles aient perdu leur fraîcheur; elle multiplie les consommations, et condamne ce qui est encore excellent, commode et joli, à n'être plus bon à rien. Ainsi la rapide succession des modes appauvrit un état de ce qu'elle consomme et de ce qu'elle ne consomme pas.
» Il vaut mieux consommer les choses de bonne qualité, quoique plus chères; en voici la raison: dans toute espèce de fabrication, il y a de certains frais qui sont les mêmes, et qu'on paie [181] également, que le produit soit bon ou bien qu'il soit mauvais; une toile faite avec de mauvais lin a exigé, de la part du tisserand, du marchand en gros, de l'emballeur, du voiturier, du marchand en détail, un travail précisément égal à ce qu'aurait exigé pour parvenir au consommateur une toile excellente. L'économie que je fais en achetant une médiocre qualité, ne porte donc point sur le prix de ces divers travaux qu'il a toujours fallu payer selon leur entière valeur, mais sur le prix de la matière première seule ; et néanmoins ces différens travaux payés aussi chèrement, sont plus vite consommés, si la toile est mauvaise que si elle est bonne.
» On sent que les réglemens par lesquels l'autorité publique se mêle des détails de la fabrication ( en supposant qu'ils réussissent à faire fabriquer des marchandises de meilleure qualité, ce qui est fort douteux ) sont insuffisans pour les faire consommer ; ils ne donnent pas au consommateur le goût des bonnes choses et les moyens de les acquérir. La difficulté se rencontre ici, non du côté du producteur, mais du côté du consommateur. Qu'on me trouve des consommateurs qui veuillent et qui puissent se procurer du beau et du bon, je trouverai des producteurs qui leur en fourniront. C'est l'aisance d’une [182] nation qui la conduit à ce but ; l'aisance ne fournit pas seulement les moyens d'avoir du bon, elle en donne le goût. Or, ce ne sont point des réglemens qui procurent de l'aisance, c'est la production active et l'épargne; c'est l'amour du travail favorable à tous les genres d'industrie, et l'économie qui amasse des capitaux. C'est dans les pays où ces qualités se rencontrent, que chacun acquiert assez d'aisance pour mettre du choix dans ses consommations. La gêne, au contraire, marche toujours de front avec la prodigalité ; et lorsqu'on est commandé par le besoin, on ne choisit pas.
» Les jouissances de la table, des jeux, des feux d'artifice, sont au nombre des plus passagères. Je connais des villages qui manquent d'eau, et qui consomment dans un seul jour de fête ce qu'il faudrait d'argent pour amener de l'eau, et pour élever une fontaine sur leur place publique. Leurs habitans aiment mieux s'enivrer en l'honneur de leur patron, et aller péniblement, tous les jours de l'année, puiser de l'eau bourbeuse à la distance d'un quart de lieue. C'est en partie à la misère, en partie à des consommations malentendues, qu'il faut attribuer la mal-propreté qui environne la plupart des habitations des gens de la campagne.
[183]
» .En général, un pays où l'on dépenserait,, soit dans les villes, soit dans les campagnes, en jolies maisons, en vètemens propres, en ameublemens bien tenus, en instruction, une partie de ce qu'on dépense en jouissances frivoles et dangereuses ; un tel pays, dis-je, changerait totalement d'aspect, prendrait un air d'aisance y paraîtrait plus civilisé, et semblerait incomparablement plus attrayant à ses propres habitans et aux étrangers.
» 3°. Les consommations faites en commun. Il y a différens services dont les frais ne s'augmentent pas en proportion de la consommation qu'où en fait. Un seul cuisinier peut préparer également bien le repas d'une seule personne et celui de dix; un même foyer peut faire rôtir plusieurs pièces de viande aussi bien qu'une seule; de là l'économie qu'on trouve dans l'entretien en commun des communautés religieuses et civiles, des soldats, des ateliers nombreux ; de là celle, qui résulte de la préparation dans des marmites communes de la nourriture d'un grand nombre de personnes dispersées; c'est le principal avantage des établissemens connus sous le nom de soupes économiques.
» 4°. Enfin, par des considérations d'un autre ordre, les consommations bien entendues sont [184] celles qu'avoue la saine morale. Celles au contraire qui l'outragent, finissent ordinairement par tourner a mal pour les nations comme pour les particuliers. »
Après ces considérations sur les consommations en général, l'auteur traite des consommations privées, de leurs motifs et de leurs résultats. Le chapitre dans lequel cette partie de la science est traitée, est sans contredit un des plus intéressans de l'ouvrage, par les idées d’utilité et de morale pratique qu'il renferme. L'auteur ne perd pas son temps à faire des déclamations contre la prodigalité ou l'avarice, ou à faire l'apologie de l'économie et du bon ordre ; il démontre d'une manière simple et nette quels sont les résultats des deux excès entre lesquels une sage économie tient le milieu; et ses démonstrations qui présentent ces deux vices dans toute leur nudité, en les dépouillant de ce qui les rend agréables aux yeux des hommes superficiels, font aimer la vertu qui leur est opposée en en faisant Voir les heureuses conséquences. Nous en citerons ici quelques pages, en prévenant toutefois le lecteur qu'elles perdent beaucoup à être séparées de celles qui les précèdent et de celles qui les-suivent.
« Relativement à la «consommation, dît-il, [185] les excès sont la prodigalité et l’avarice. L'une et l'autre se privent des avantages que procurent les richesses : la prodigalité en épuisant ses moyens, l'avarice en se défendant d'y toucher. La prodigalité est plus aimable, et s'allie a plusieurs qualités sociales. Elle obtient grâce plus aisément, parce qu'elle invite à partager ses plaisirs; toutefois elle est, plus que l'avarice, fatale à la société : elle dissipe, elle ôte à l'industrie les capitaux qui la maintiennent : en détruisant un des grands agens de la production, elle tue l'autre. Ceux qui disent que l'argent n'est bon qu'à être dépensé, et que les produits sont faits pour être consommés, se trompent beaucoup, s'ils entendent seulement la dépense et la consommation consacrées à nous procurer des plaisirs. L'argent est bon encore à être occupé reproductivement : il ne l'est jamais sans qu'il en résulte un très-grand bien ; et toutes les fois qu'un fonds placé se dissipe, il y a dans quelque coin du monde une quantité équivalente d'industrie qui s'éteint : l'avare qui ne fait pas valoir son trésor dans la crainte de l'exposer, à la vérité ne favorise pas l'industrie, mais du moins il ne lui -ravit aucun de ses moyens; ce trésor amassé l'a été aux dépens de ses jouissances, et non, comme le vulgaire est porté à l'imaginer, aux dépens [186] du public ; il n'a pas été retiré d'un emploi productif, et à la mort de l'avare, du moins, il se place et court animer l'industrie, s'il n'est pas dissipé par ses successeurs, ou s'd n'a pas été tellement caché qu'on ne puisse le découvrir.
» Les prodigues ont grand tort de se glorifier de leurs dissipations : elles ne sont pas moins indignes de la noblesse de notre nature que les lésines de l'avare. Il n'y a aucun mérite à consommer tout ce qu'on peut, et à se passer des choses quand on ne les a plus. C'est ce que font les bêtes, et encore les plus intelligentes sont-elles mieux avisées. Ce qui doit caractériser les procédés de toute créature douée de raison, c'est, dans chaque circonstance, de ne faire aucune consommation sans un but raisonnable: tel est le conseil que donne l'économie.
» L'économie est le jugement appliqué aux consommations. Elle connaît ses ressources, et sait ne les pas excéder. Elle compare la valeur des sacrifices qu'elle fait, avec la satisfaction, l'avantage quelconque qui doit eu résulter. L'économie n'a point de principes absolus; elle est toujours relative à la fortune, à la situation, aux besoins du consommateur. Telle dépense conseillée par une sage économie dans une fortune médiocre, serait une mesquinerie pour un riche , et une prodigalité pour un ménage indigent. Il faut dans la maladie s'accorder des douceurs qu'on se refuserait en état de santé. Un bienfait qui mérite la plus haute louange, lorsqu'il est pris sur les jouissances personnelles du bienfaiteur, est digne de mépris, s'il n'est accordé qu'aux dépens de la subsistance de ses enfans.
» L'économie s'éloigne autant de l'avarice que de la prodigalité. L'avarice entasse, non pour consommer, non pour produire, mais pour entasser; c'est un instinct, un besoin machinal et honteux. L'économie est fille de la sagesse et d'une raison éclairée; elle sait se refuser le superflu pour se ménager le nécessaire, tandis que l'avare se refuse le nécessaire, afin de se procurer le superflu dans un avenir qui n'arrive jamais. On peut porter l'économie dans une fête somptueuse, et l'économie fournit les moyens de la rendre plus belle encore : l'avarice ne peut se montrer nulle part sans tout gâter. Une personne économe compare ses facultés avec ses besoins présens, avec ses besoins futurs, avec ce qu'exigent d'elles sa famille, ses amis, l'humanité. Un avare n'a point de famille, point d'amis, à peine a-t-il des besoins, et l'humanité n'existe pas pour lui. L'économie ne veut rien consommer en vain: l'avarice ne veut rien consommer du tout. La [188] première est l'effet d'un calcul louable, en ce qu'il offre seul le moyen de s'acquitter de ses devoirs, et d'être généreux sans injustice. L'avarice est une passion vile, par la raison qu'elle se considère exclusivement et sacrifie tout à elle.
» Ou a fait de l'économie une vertu, et ce n'est pas sans raison : elle suppose la force et l'empire de soi-même comme les autres vertus, et nulle n'est plus féconde en heureuses conséquences. C'est elle qui, dans les familles, prépare la bonne éducation physique et morale des enfans, et le soin des vieillards; c'est elle qui assure à l'âge mûr cette sénérité d'esprit nécessaire pour se bien conduire, et cette indépendance qui met un homme au-dessus des bassesses. C'est par l'économie seule qu'on peut être libéral, qu'on peut l'être long-temps, qu'on peut l'être avec fruit. Quand on n'est libéral que par prodigalité, on donne sans discernement à ceux qui ne méritent pas comme a ceux qui méritent; à ceux à qui l'on ne doit rien ; aux dépens de ceux à qui l'on doit. Souvent on voit le prodigue obligé d'implorer le secours des gens qu'il a comblés de profusions : il semble qu'il ne donne qu'à charge de revanche ; taudis qu'une personne économe donne toujours gratuitement, parce qu'elle ne donne que ce dont elle peut disposer. Elle est [189] riche avec une fortune médiocre, au lieu que l'avare et le prodigue sont pauvres avec de grands biens. »
Après avoir ainsi tracé le tableau des heureux effets de l'économie, après avoir démontré qu'elle est la base des plus hautes vertus, puisqu'elle met l'homme à l'abri du besoin, lui garantit son indépendance, et le dispense de recourir à des bassesses pour pourvoir à son existence, M. Say fait voir que le désordre exclut l'économie; qu'il marche au hasard, un bandeau sur les yeux, au travers des richesses, tantôt ayant sous la main ce qu'il desire le plus, et s'en passant faute de l'apercevoir, tantôt saisissant et dévorant ce qu'il lui importe de conserver.
« Est-ce manquer d'économie, se demande M. Say, que de dépenser tout son revenu ? Je le crois, répond-il. La prévoyance prescrit de faire la part des événemens. Qui peut répondre de conserver toujours sa fortune toute entière? Quelle est la fortune qui ne dépende en rien de l'injustice, de la mauvaise foi ou de la violence des hommes ? N'y a-t-il jamais eu de terres confisquées ? Aucun vaisseau n'a-t-il jamais fait naufrage ? Peut-on répondre de n'avoir point de procès ? ou peut-on répondre qu'on le gagnera? Aucun riche négociant n'a-t-il jamais été victime [190] d'une faillite ou d'une fausse spéculation ? Si chaque année on dépense tout sou revenu, le fonds peut décroître sans cesse ; il le doit même suivant toutes les probabilités.
» Mais, dût-il rester toujours le même, suffit-il de l'entretenir ? Une fortune fût-elle considérable, demeure-t-elle considérable lorsqu'elle vient à être partagée entre plusieurs enfans ?Et quand même elle ne devrait pas être partagée, quel mal y a-t-il à l'augmenter, pourvu que ce soit par de bonnes voies ? N'est-ce pas le desir qu'ont les particuliers d'ajouter à leur bien-être qui, en augmentant les capitaux par l'épargne, favorise l'industrie, rend les nations opulentes et civilisées ? Si nos pères n'avaient pas eu ce désir, nous serions encore sauvages, et l'on ne sait pas bien encore jusqu'à quel point on peut être civilisé. Beaucoup de gens croient qu'il y a un terme à l'opulence des nations; j'ai beau le rechercher, il m'est impossible de l'apercevoir. »
La question du luxe, qui a divisé tant de grands esprits, est résolue par le simple exposé des principes de la création et de la destruction des richesses. Du moment qu'il est démontré que les capitaux ne sont que des revenus accumulés, qu'ils sont un agent nécessaire à la production, [191] et que le luxe consomme improductivement et les revenus annuels, et même les revenus accumulés qui forment les capitaux, il est clair qu'il doit être funeste à tous les états, quelles que soient leurs richesses. Si le luxe consomme tous les revenus annuels, les capitaux ne peuvent point s'accroître, et par conséquent l'état reste stationnaire ; s'il consomme les revenus annuels, et de plus une partie des revenus accumulés, l'état perd ses capitaux, la production diminue, la population s'éteint.
On a cependant fait souvent l'apologie du luxe. Si les riches ne dépensent pas beaucoup, a .dit Montesquieu, les pauvres mourront de faim.[1] Voltaire n'était pas à cet égard plus éclairé que Montesquieu, lorsqu'il écrivait:
Sachez sur-tout que le luxe enrichit
Un grand état, s'il en perd un petit.
Cette splendeur, cette pompe mondaine
D'un règne heureux est la marque certaine;
Le riche est né pour beaucoup dépenser.
La Fontaine avait exprimé la même pensée long-temps avant Voltaire, en disant:
La République a bien à faire
De gens qui ne dépensent rien: [192]
Je ne sais d'homme nécessaire
Que celui dont le luxe épand beaucoup de bien.
L'homme le plus économe consomme ses revenus annuels, comme celui qui montre le plus de luxe; il y a seulement cette différence entre l'un et l'autre, que le premier les consomme d'une manière reproductive en augmentant ses capitaux, et en faisant subsister toutes les années un plus grand nombre d'hommes utiles et laborieux, et que le second lee consomme improductivement avec des oisifs, et sans rien ajouter à sa fortune.
« Ce que le raisonnement démontre, dit M. Say, est confirmé par l'expérience. La misère marche toujours à la suite du luxe. Un riche fastueux emploie en bijoux de prix, en repas somptueux, en hôtels magnifiques, en chiens, en chevaux, en maîtresses, des valeurs qui, placées productivement, auraient acheté des vêtemens chauds, des mets nourrissans, des meubles commodes à une foule de gens laborieux condamnés par lui à demeurer oisifs et misérables. Alors le riche a des boucles d'or, et le pauvre manque de souliers; le riche est habillé de velours, et le pauvre n'a pas de chemises.
» Telle est la force des choses, que la magnificence a beau vouloir éloigner de ses regards la pauvreté, la pauvreté la suit opiniâtrement comme [193] pour lui reprocher ses excès. C'est ce qu'on observait à Versailles, à Rome, à Madrid, dans toutes les cours; c'est ce dont la France a offert en dernier-lieu un triste exemple à 'la suite d'une administration dissipatrice et fastueuse, comme s'il avait fallu que des principes aussi incontestables dussent recevoir cette terrible confirmation. »
Le luxe ne produit pas seulement l’appauvrissement des nations et la destruction des classes laborieuses de la société, il démoralise ceux-là même qui s’y adonnent. Les-ressources lentes et bornées -de la -production véritable ne suffisent pas-à l’avidité de ses besoins-; il compte bien plutôt , comme l'observe M. Say, sur les profits rapides et honteux de l'intrigue, industrie ruineuse pour les nations, en ce qu'elle-ne produit pas, mais seulement entre en -partage des produits des autres. Lorsqu’on est porté à dépenser -par luxe ou par-ostentation, le fripon développe toutes les ressources de son génie; le chicaneur spécule sur l'obscurité des lois; l'homme en pouvoir vend à -la sottise et à l'improbité la protection qu'il doit gratuitement au-mérite et au bon droit. J'ai vu dans-un souper, dit Pline, Paulina couverte d’un-tissu de perles et d'émeraudes qui valait quarante-millions de sesterces; ce qu’clle pouvait-prouver, disait-elle, par ses [194] registres. Elle le devait aux rapines de ses ancêtres. C'était, ajoute l'auteur romain, pour que sa petite-fille parût dans un festin chargée de pierreries, que Lollius consentit à répandre la désolation dans plusieurs provinces, à être diffamé dans l'Orient, à perdre l'amitié du fils d'Auguste, et finalement à mourir par le poison.
Les effets des consommations privées étant connus, il est facile de se faire des idées exactes des effets des consommations publiques. Dans les unes comme dans les autres, les choses sont soumises aux mêmes lois. Ce que les gouvernemens consomment d'une manière reproductive, ne diminue point la richesse nationale y puisqu'une valeur qui paraît détruite, se montre sous une nouvelle forme après la consommation. Ce qu'ils consomment au contraire d'une manière improductive, est autant de retranché à la richesse publique ; c'est une valeur détruite sans retour. On peut faire à son égard la supposition que nous avons faite à l'égard d'un simple particulier. S'il consomme la portion de revenus enlevée à chaque individu au moyen de l'impôt, dans des travaux productifs d'utilité publique, s'il creuse des canaux, s'il fait de grandes routes, les biens pris au public sont consommés, mais la richesse [195] nationale n’est point diminuée; à mesure qu'une valeur a été détruite, une autre valeur a été créée. Si au lieu de faire consommer le produit des impôts par des hommes laborieux, qui rendent toujours par leurs travaux au-delà de ce qu'ils ont reçu, il le fait consommer par des hommes oisifs, par des valets, par des courtisans, par des moines, par des soldats inutiles à la sûreté de l'état, enfin par des gens qui ne produisent rien, la valeur en est entièrement détruite, et aucune valeur équivalente n'est créée pour la remplacer.
On a dit que l'argent, ou plutôt les valeurs levées sur les peuples au moyen des impôts, leur étaient restituées par les dépenses des gouvernemens ; on a prétendu que les impôts étaient favorables à la prospérité publique, en ce qu'ils faisaient circuler le numéraire. Cette erreur mise en principe par de grands écrivains, a été réduite en pratique par des princes qu'on a jugé grands. Madame de Maintenon rapporte dans une lettre au cardinal de Noailles, qu'un jour exhortant le Roi à faire des aumônes plus considérables, Louis XIV lui répondit : Le Roi fait l'aumône en dépensant beaucoup. « Mes nombreuses armées, écrivait Frédéric II à d'Alembert pour justifier ses guerres, » font circuler les espèces, [196] et répandent dans les provinces, avec une distribution égale, les subsides que les peuples fournissent au gouvernement. » Les contribuables les moins éclairés savent bien que cela n'est pas vrai; l'expérience leur a prouvé à tous, que pour payer l'impôt, ils sont obligés de vendre une partie de leurs revenus; que l'argent qu'ils en retirent étant une fois versé dans le trésor public, ne peut rentrer dans leurs mains pour payer l'impôt de l'année suivante qu'au moyen d une autre partie de leurs revenus; de sorte que le gouvernement leur en enlève annuellement la moitié, le tiers ou le quart, selon ses besoins, sans rien leur donner en échange. Il n'est donc pas à craindre que l’erreur, dont il est ici question, devienne populaire : jamais on ne fera entendre à un peuple qu'il s'enrichit en payant d'énormes impôts à un gouvernement dissipateur. Mais s'il n'est pas à craindre que les peuples adoptent cette erreur, il l’est beaucoup que des écrivains et des gouvernans la considèrent comme une vérité, ceux-ci pour justifier leurs profusions, et ceux-là pour y avoir part. Voici donc comment M. Say la réfute.
« Le gouvernement, dit-il, exige d'un contribuable le paiement en argent d'une contribution quelconque. Pour satisfaire le percepteur, ce [197] contribuable échange contre de la monnaie d'argent les produits dont il peut disposer, et remet cette monnaie aux préposés du fisc; d'autres agens en achètent des draps et des vivres pour la troupe : il n'y a point encore de valeur consommée ni perdue; il y a une valeur livrée gratuitement par le redevable, et des échanges opérés.. La valeur fournie existe encore sous la forme de vivres et d'étoffes dans les magasins de l'armée. Mais enfin cette valeur se consomme; dès-lors cette portion de richesse sortie des mains d'un contribuable est anéantie, détruite.
» Ce n'est point la somme d'argent qui est détruite: celle-ci a passé d'une main dans une autre, soit gratuitement, comme lorsqu'elle a passé du contribuable au percepteur; soit par voie d'échange, lorsqu'elle a passé de l'administrateur au fournisseur auquel on a acheté les vivres ou le drap; mais au travers de tous ces mouvemens, la valeur de l'argent s'est conservée ; et après avoir passé dans une troisième main, dans une quatrième, dans une dixième, elle existe encore sans aucune altération sensible : c'est la valeur du drap et des vivres qui n'existe plus; et ce résultat est précisément le même que si le contribuable avec le même argent, eût acheté des vivres et du drap, et les eût consommés lui-même. [198] Il n'y a d'autre différence, si ce n'est qu'il aurait joui de cette consommation, tandis que c'est l'État (c'est-à-dire le gouvernement ) qui en a joui.
Ce qui a pu accréditer l'erreur que les gouvernemens restituent au public par leurs dépenses, les valeurs qu'ils ont reçues de lui, c'est qu'on a remarqué qu'ils remettent en circulation l'argent qu'ils ont levé sur les peuples; mais remarquons bien qu'ils le reçoivent gratuitement, qu'ils ne le rendent qu'en recevant une valeur équivalente, et que les hommes qui l'ont donné l'auraient également dépensé. Si un gouvernement lève sur un peuple cent millions, par exemple, au-delà de ce qui est absolument nécessaire pour les besoin de l'Etat, il pourra employer cette somme à donner de gros salaires à des valets, des gratifications à des courtisans, des pensions à des poètes ; il pourra même l'employer, si l'on veut, à élever des arcs de triomphe, des pyramides, des palais. Il résultera de cet emploi que des valets qui ne produiront rien, seront bien vêtus et bien nourris ; que des courtisans qui ne produisent pas davantage, auront des habits brodés, une bonne table, des chevaux, des maîtresses, des meutes; que des poètes et des architectes vivront à l'aise, et que le public jouira de la [199] lecture de quelques vers de plus, et de la vue de quelques monumens. Mais il en résultera aussi que les hommes sur lesquels on aura levé des valeurs pour cent millions, ne pourront pas les dépenser à cultiver leurs champs, à accroître leurs manufactures, à étendre leur commerce. Chez une telle nation les laquais seront donc bien vêtus et bien nourris; et les ouvriers employés à l'industrie agricole ou manufacturière seront couverts de haillons et mourront de faim; les courtisans feront des dépenses énormes pour leurs plaisirs, et les agriculteurs, les manufacturiers, les commerçans vivront dans la gêne et ne pourront pas élever leur famille; on verra des monumens dans les grandes villes, et des masures dans les campagnes. Voilà de quelle manière le gouvernement rendra au peuple les valeurs qu'il aura reçues de lui. Un tel gouvernement, suivant Robert Hamilton, ressemble à un voleur qui, après avoir dérobé la caisse d'un négociant, lui dirait : je vais employer tout cet argent à vous acheter des denrées de votre commerce. De quoi vous plaignez-vous? N'aurez-vous pas tout votre argent ? et de plus, n'est-ce pas un encouragement pour votre industrie? L'encouragement que donne le gouvernement en dépensant l'argent des contributions, ajoute M. Say [200] qui rapporte cette comparaison, est exactement le même que celui-là.
Ayant établit que les valeurs prises aux peuples par leurs gouvernemens ne reviennent plus aux contribuables, M. Say examine en quoi consistent en général les dépenses publiques. Il traite des dépenses relatives à l'administration civile et judiciaire ; des dépenses relatives à l'armée, an dépenses relatives à l'enseignement public; des dépenses relatives aux établissemens de bienfaisance ; enfin des dépenses relatives aux édifices et constructions publics. Ces divers traités renferment tous des réflexions utiles ; mais il en est quelques-uns qui sont plus importans que d'antres . et de ce nombre sont ceux dans lesquels l'auteur s'occupe des dépenses de l'armée, et de l'enseignement public.
M. Say fait l’énumération de ce que coûtent les guerres, et des avantages qui en reviennent, et il démontre que les uns sont toujours immenses, tandis que les autres se réduisent à rien; il met au nombre des dépenses non-seulement ce que coûtent les armées et leur matériel, mais encore ce que les guerres empêchent de gagner et ce qu'elles détruisent.
« Ce serait apprécier imparfaitement les frais de la guerre, dit-il, si l'on n'y comprenait aussi [201] les ravages qu'elle commet, et il y a toujours un des deux partis pour le moins exposé à ses ravages, celui chez lequel s'établit le théâtre de la guerre. Plus un état est industrieux, et plus la guerre est pour lui destructive et funeste. Lorsqu'elle pénètre dans un pays riche de ses établissemens agricoles, manufacturiers et, commerciaux, c'est alors un feu qui gagne des lieux pleins de matières combustibles; sa rage s'en augmente, et la dévastation est immense. Smith appelle soldat un travailleur improductif : plut à Dieu! C'est bien plutôt un travailleur destructif; non-seulement il n'enrichit la société d'aucun produit, non-seulement il consomme ceux qui sont nécessaires à son entretien, mais trop souvent il est appelé à détruire, inutilement pour lui-même, le fruit pénible des travaux d'autrui.
» Des gouvernemens plus ambitieux que justes ont cherché souvent à justifier à leurs propres yeux, et à ceux de leurs sujets, les guerres en exaltant la puissance et le profit qu'ils attribuent aux conquêtes. Avec un peu de calme, et mettant le calcul à la place des passions, on trouvera qu'une conquête ne vaut jamais ce qu'elle a coûté.
» Lorsqu'on fait la conquête d'une province [202] ou d'un pays entier, la nation conquérante s'empare des revenus publics de la nation conquise, mais en même temps elle demeure chargée de ses dépenses publiques; autrement la nation conquise n'aurait plus ni administration, ni justice, ni défense, ni établissemens publics, et elle échapperait à ses conquérans par sa désorganisation même.
» Il est bon de remarquer que les dépenses publiques doivent même monter plus haut dans un pays qui a passé sous une domination étrangère, que sous un gouvernement indigène. Qui envoie-t-on pour le gouverner? Des proconsuls, des vice-rois, chez qui la cupidité naturelle se trouve rarement balancée par des sentimens nobles. Pourquoi ménageraient-ils les hommes qu'ils gouvernent ? Ce ne sont pas leurs compatriotes. Que leur importe leur amour et leur estime ? Ils ne séjourneront que passagèrement parmi eux; ils aiment bien mieux se livrer aux impulsions de leurs caprices et de leur avidité, jouir et amasser ; et pour faire tolérer leurs déprédations, les autoriser dans toutes les parties de l'administration. De là, l'épuissement d'une province, le déclin de son industrie, de sa population, de ses richesses, de ses forces.
» Ainsi, un pays conquérant ne retire d’une [203] province conquise que le montant des déprédations que ses agens y commettent, pourvu même qu'ils ne dissipent pas à mesure, tout entier, le montant de leurs déprédations, et qu'ils en rapportent chez eux une partie. C'est là tout ce que l'Inde rapporte aux Anglais.
» Lorsqu'on laisse au pays conquis son administration propre, le pays conquérant en retire un subside qui n'est jamais bien considérable, et qui ne dure pas long-temps : car un peuple conquis ne peut fournir beaucoup au-delà de ses propres consommations publiques, et s'affranchit d'un pareil tribut à la première occasion favorable.
» Lors donc qu'une nation a accru par des conquêtes son territoire, sa population, ses impôts d'un cinquième, il ne faut pas croire qu'elle ait accru sa puissance dans la même proportion; car ses charges sont en même temps plus fortes; et si l'on considère que plus un pays est vaste, moins il peut être bien administré ; si l'on considère qu'il est plus difficile à défendre contre les entreprises du dehors et contre celles du dedans, et qu'il engendre tous les abus dans son sein en même temps qu'il éveille toutes les jalousies au dehors, on ne sera plus surpris que les états s'affaiblissent en s'agrandissant ; vérité qui [204] aurait l'air d'un paradoxe, si elle n'était pas un fait. »
Au sujet des dépenses relatives à l'enseignement public, M. Say examine si le public est intéressé à ce qu'on cultive tous les genres de connaissances, et s'il est nécessaire qu'on enseigne à ses frais celle qu'il est de son intérêt qu'on cultive. Il observe que toutes les connaissances sont utiles à la société; cependant il les distingue en deux classes : les unes présentent à ceux qui les cultivent des avantages assez considérables pour que la société n'ait rien à faire à cet égard; les autres, quoiqu'utiles à la masse des citoyens, n'offrent pas assez de profit à ceux qui sont portés à les exercer, pour que la société puisse les abandonner à elles-mêmes. De ce nombre sont les hautes sciences dans lesquelles on ne s'occupe que de la théorie.
« En traitant des profits du savant, dit M. Say, j'ai montré par quelle cause ses talens n'étaient point récompensés selon leur valeur. Cependant les connaissances théoriques ne sont pas moins utiles à la société que les procédés d'exécution. Si l'on n'en conservait pas le dépôt, que deviendrait leur application aux besoins de l'homme? Cette application ne serait bientôt plus qu'une routine aveugle qui dégénérerait promptement; les arts tomberaient, la barbarie reparaîtrait [205] promptement; les arts tomberaient, la barbarie reparaîtrait.
» Les académies et les sociétés savantes, un petit nombre d'écoles très-fortes, où non-seulement on conserve le dépôt des connaissances et les bonnes méthodes d'enseignement, mais où l’étend sans cesse le domaine des sciences, sont donc regardés comme une dépense bien entendue en tout pays où l'on sait apprécier les avantages attachés au développement des facultés humaines. Mais il faut que ces académies et ces écoles soient tellement organisées, qu'elles n'arrêtent pas les progrès des lumières au lieu de les favoriser, qu'elles n'étouffent pas les bonnes méthodes d'enseignement au lieu de les répandre. Long-temps avant la révolution française on s'était aperçu que la plupart des universités avaient cet inconvénient. Toutes les grandes découvertes ont été faites hors de leur sein; et il en est peu auxquelles elles n'aient opposé le poids de leur influence sur la jeunesse, et de leur crédit sur l’autorité.[2]
[206]
» Cette expérience montre combien il est essentiel de ne leur attribuer aucune juridiction. Un candidat est-il appelé à faire des preuves ? il ne convient pas de consulter des professeurs qui sont juges et parties, qui doivent trouver bon tout ce qui sort de leur école, et mauvais tout ce n'en vient pas. Il faut constater le mérite du candidat, et non le lieu de ses études, ni le temps qu'il y a consacré ; car exiger qu'une certaine instruction, celle qui est relative à la médecine, par exemple, soit reçue dans un lieu désigné, c'est empêcher une instruction qui pourrait être meilleure; et prescrire un certain cours d'études, c'est prohiber toute autre marche plus expéditive. S'agit-il de juger le mérite d'un procédé quelconque ? il faut de même se défier de l'esprit de corps. »
M. Say pense qu'on ne saurait sur-tout donner trop d'encouragement à la composition des bons ouvrages élémentaires. L'honneur et le profit que procure un bon ouvrage de ce genre, dit-il, ne paient pas le travail et les connaissances qu’il suppose. C'est une duperie de servir le public par ce moyen, parce que la récompense [207] naturelle qu'on en reçoit n'est pas proportionnée au bien que le public en retire. Dans l'état actuel des connaissances, ces réflexions sont justes; celui qui composerait un bon ouvrage élémentaire en retirerait peu de profit, parce qu'il y a peu de professeurs qui aient assez de capacité pour apprécier un bon ouvrage élémentaire, et assez de désintéressement pour rendre justice à l'auteur. L'instruction étant d'ailleurs un objet de monopole, ceux qui l'exercent ont trouvé l'art d'y joindre le monopole des ouvrages élémentaires ; et, comme tous les monopoleurs, ils font payer cher de mauvaises denrées, et prohibent celles qui sont bonnes, mais qui ne viennent pas d'eux.
L'instruction qui doit être donnée aux dépens de la société, c'est celle qui ne pourrait pas être acquise, si elle n'en faisait pas les frais. A une époque où les arts sont perfectionnés, et où la division du travail est introduite jusques dans les moindres embranchemens, dit M. Say, la plupart des ouvriers sont forcés de réduire toutes leurs actions et toutes leurs pensées à une ou deux opérations, ordinairement très-simples et constamment répétées; nulle circonstance nouvelle, imprévue, ne s'offre jamais à eux; n'étant dans aucun cas appelés à faire usage de leurs [208] facultés intellectuelles, elles s'énervent, s'abrutissent, et ils deviendraient bientôt eux-mêmes non-seulement incapables de dire deux mots qui eussent le sens commun sur toute autre chose que leur outil, mais encore de concevoir, ni même de comprendre aucun dessein généreux, aucun sentiment noble. Les idées un peu élevées tiennent à la vue de l'ensemble; elles ne germent point dans un esprit incapable de saisir des rapports généraux; un ouvrier stupide ne comprendra jamais comment le respect de la propriété est favorable à la prospérité publique, ni pourquoi lui-même est plus intéressé à cette prospérité que l'homme riche; il regardera tous les grands biens comme une usurpation. Un certain degré d'instruction, un peu de lecture, quelques conversations avec d'autres personnes de son état, quelques réflexions pendant son travail, suffiraient pour l'élever à cet ordre d'idées, -et mettraient même plus de délicatesse dans ses relations de père, d'époux, de frère, de citoyen.
» Mais la position du simple manouvrier dans la machine productive de la société, réduit ses profits presqu’au niveau de ce qu'exige sa subsistance. C’est tout au plus s'il peut élever ses enfans et leur apprendre un métier ; il ne leur donnera pas ce degré d'instruction que nous supposons [209] nécessaire au bien-être de l'ordre social. Si la société veut jouir de l'avantage attaché à ce degré d'instruction dans cette classe, elle doit donc le donner à ses frais.
» On atteint ce but par des écoles où 1 on enseigne gratuitement à lire, à écrire et à compter. Ces connaissances sont le fondement de toute les autres, et suffisent pour civiliser le manouvrier le plus simple. A vrai dire, une nation n'est pas civilisée, et ne jouit pas par conséquent des avantages attachés à la civilisation, quand tout le monde n'y sait pas lire, écrire et compter, sans cela elle n'est pas encore complétement tirée de l'état de barbarie ».
Dans tous les temps, c'est donc un devoir pour les hommes qui jouissent d'une certaine aisance, le procurer à ceux des classes inférieures les premiers élémens de l'instruction. Mais quand même ce ne serait pas un devoir, et qu'on ne serait pas porté à instruire gratuitement la classe indigente par le seul plaisir de faire le bien, on devrait y être porté au moins par le sentiment de ses propres intérêts. Les révolutions qui ont agité l'Europe semblent n'avoir eu pour objet que de la préparer â des révolutions nouvelles, plus violentes encore que celles qu'on y a vues. L'esprit de démagogie qui a tout bouleversé en France, [210] paraît s'être étendu sur tous les autres états, et les menace d'une désorganisation totale. Le meilleur moyen de prévenir les désordres, est d'éclairer les hommes qui peuvent être les instrumens des factieux. Quand une fois l'agitation a commencé, il est bien difficile d'y porter remède.
La troisième partie du traité que nous avons cherché à faire connaître, est terminée par un chapitre sur l'impôt, et par un autre sur les emprunts; matières délicates, qu'on ne peut pas faire connaître par des extraits, et pour lesquelles nous renvoyons à l'ouvrage même de M. Say.
Nous avons annoncé, dans le précédent volume, que nous nous occuperions dans celui-ci de l'influence que doit exercer l'économie politique sur la morale, sur la législation civile, sur l'organisation des gouvernemens, et sur les relations des peuples entre eux. Pour faire connaître toute l'étendue de cette influence, il faudrait un traité non moins considérable que celui dont nous venons de rendre compte. Nous nous bornerons donc à indiquer les points principaux par lesquels ces diverses sciences tiennent à l'économie politique, et à faire voir qu'il est à peu près impossible d'avoir des idées bien exactes sur celles-là, si l'on ne connaît pas au moins les principes généraux de celle-ci.
[211]
Une des erreurs les plus funestes à l'espèce humaine est celle qui porte chaque homme à considérer tous les autres comme ses ennemis, et qui lui persuade que la prospérité de l'un est une calamité pour un autre, ou qu'il a toujours quelque chose à gagner dans le malheur d'autrui. Cette erreur, qui était celle de Rousseau,[3] étant une fois admise comme une vérité, tous les préceptes de la morale deviennent inutiles; on a beau enseigner aux hommes qu'ils descendent tous du même père, qu'ils doivent s'aimer comme des frères. L'intérêt, plus fort que toutes les maximes, fait qu'ils se considéreront comme ennemis ; jusqu'à ce qu'il leur ait été démontré qu'ils ont des intérêts communs, que le mal qui arrive à l'un est un mal pour les [212] outres, et que la prospérité de chacun est un avantage pour tous. Or, c'est à l'économie politique que nous devons la démonstration de cette importante vérité.
Par un effet de la division des occupations dans la société, chacun ne fait que la plus petite part des choses qui lui sont nécessaires; et l'homme dont les besoins sont les plus bornés, emploie peut-être à son usage le produit de l'industrie de cent mille personnes. Que l'on calcule le nombre d'hommes dont le concours a été nécessaire pour obtenir une paire de bas de coton, par exemple, et l'on verra que le nombre en est immense; il a fallu des agriculteurs, des astronomes, des mathématiciens, des mineurs, des constructeurs de vaisseaux, des géographes, des marins, des mécaniciens, des commerçans, et une foule d'autres, sans parler des simples manouvriers que chacun de ceux-là a employés. Mais si chacun ne produit qu'une faible parue des choses dont il a besoin, il se trouve évidemment intéressé à ce que les choses dont il manque soient produites en grande quantité et à peu de frais, puisque c'est le seul moyen de les obtenir sans qu'il lui en coûte beaucoup, et de se défaire avantageusement des produits de sa propre industrie.
[213]
Nous ferons mieux sentir ceci par un exemple.. Qu'un agriculteur se trouve placé au milieu d'un désert, il aura peu de profita retirer du produit de ses terres; il suffira qu'elles lui donnent du blé pour lui et pour sa famille, et qu'elles nourrissent un petit nombre d'animaux. Si, à côté de lui, il vient s'établir un forgeron, par exemple, aussitôt il trouvera à vendre une partie de sa récolte, et il pourra obtenir en échange des instrumens nécessaires à la culture. S'il vient ensuite s'établir près de sa terre des fileurs et un tisserand, ce sera encore un moyen de vendre ses produits, et d'obtenir des habits en échange. Toute branche d'industrie créée sera donc un débouché ouvert pour ses propres produits, et toute branche d'industrie détruite sera un débouché fermé. Il eu sera de même des artisans à l'égard de l'agriculteur, ou même à l'égard les uns des autres : chacun sera intéressé à voir prospérer l'industrie de ses voisins, parce que cette prospérité fera la sienne.
L'économie politique montre doue comment les hommes ont des intérêts communs; elle détruit les jalousies, les haines qui les rendent ennemis les uns des autres; elle unit les diverses classes de la société entre elles, et les dispose se secourir mutuellement.
[214]
Les moralistes ont dit que l'oisiveté est la mère de tous les vices; l'économie politique a montré qu'elle est en outre la source de toutes les misères, comme le travail est la source de toutes les richesses et d'un grand nombre de vertus. Les moralistes enseignent à l'homme à mettre ses devoirs avant ses intérêts; les économistes lui montrent comment il peut concilier ses intérêts et ses devoirs. Les uns lui apprennent à lutter contre les besoins de la nature, les autres lui apprennent à satisfaire ses besoins, non-seulement sans nuire à personne, mais même en faisant du bien aux autres. L'économie politique ne condamne pas l'orgueil, mais elle apprend aux hommes à s'apprécier et à se mettre chacun à sa place. Elle ne prêche pas contre les bassesses; elle montre comment on peut les éviter. Les richesses ne sont pas pour elle un objet de mépris, elles sont un moyen de bien-être et de bienfaisance. Elle ne les emploie pas à nourrir la paresse ou l'oisiveté; elle en fait un plus noble usage, elle s'en sert pour faire vivre des hommes utiles et laborieux. Elle ne se borne pas à recommander les vertus domestiques; elle enseigne les moyens de les pratiquer. Elle ne s'occupe point de patriotisme; elle fait mieux, elle montre comment les intérêts de chacun sont unis aux intérêts de tous, et [215] comment on peut faire le bien de son pays, sans faire du mal à aucun autre.
L'influence de l'économie politique sur la législation civile est moins sensible que sur la morale. Pour la faire apercevoir, il faudrait entrer dans des explications peu agréables, et qui seraient probablement peu intelligibles pour les personnes qui ne se sont point occupées de ces matières. Nous nous bornerons donc à faire apercevoir quelques-uns des rapports qui existent entre les deux sciences.
Il en est de nos lois comme de nos préjugés; pour la plupart, elles nous viennent de Rome. Il n'y a pas même fort long-temps que les décisions des jurisconsultes ou des empereurs romains avaient encore force de loi en France ; et aujourd'hui même l'étude des lois romaines sert d'introduction à l'étude des lois françaises.
La propriété est la base de toute législation: car on n'a que faire de lois là, où on ne reconnaît pas de propriété. Mais les Romains la connaissaient-ils ? Les, jurisconsultes français eux-mêmes l'ont-ils bien connue ? nous nous permettons d'en douter. Pour nous, peuples industrieux, il doit en être de la propriété comme de tous les actes de la vie ; comme du mariage, de la naissance , de la puissance paternelle, des contrats; ce sont [216] des faits que la loi reconnaît, et qu'elle protège. Ces faits résultent de notre organisation et de nos besoins. On peut en troubler la marche ou en arrêter quelques conséquences; mais on ne peut pas les empêcher sans détruire l'espèce humaine. C'est un fait que les richesses sont le produit du travail de l'homme sur la nature; que, sans le secours de ces richesses, il ne peut ni conserver son existence, ni perpétuer l'existence de sa famille, et que la loi qui lui en garantit la disposition, à lui ou aux siens, ne lui donne rien; mais que seulement elle le protège lui et sa volonté.
Pour les Romains, nos maîtres en législation il n'en était pas ainsi; comme ils étaient essentiellement pillards, ils ne pouvaient pas reconnaître la propriété telle que nous l'entendons, sans reconnaître en même temps qu'ils ne subsistaient que de brigandage. La propriété était pour eux un droit ; la loi formait le droit, et la volonté du peuple formait la loi; système commode, à l'aide duquel ils pouvaient légitimement dépouiller le monde, et acquérir des droits immenses à l'aide des proscriptions, des confiscations, des amendes, etc. Les Romains disaient qu'on acquérait la propriété par la guerre ; nous, nous dirons que, par la guerre, on vole la propriété [217] comme on la vole quelquefois sur les grands chemins. A nos yeux, une acquisition ne sera pas plus valable que l'autre; il n'y aura de différence que dans l'impunité. Il en serait autrement, si la propriété n était qu'un droit existant en vertu des lois civiles.
N'ayant aucune notion sur la création des valeurs, les jurisconsultes romains se sont trouvé fort embarrassés, lorsqu'ils ont eu à décider de la propriété d'un objet fabriqué avec des matières qui appartenaient à un autre que le fabricant. Est-ce la matière qui doit l'emporter sur la forme ? Est-ce la forme qui doit l'emporter sur la matière ? Il ne peut pas exister de forme sans matière, disait l'un. Il ne peut pas exister de matière sans forme, répondait l'autre; et là-dessus, grands débats, pour savoir lesquels des deux, de la forme ou de la matière, donne l'être à la chose. Les jurisconsultes français ne se sont pas jetés dans ces puérilités; mais ils auraient évité bien des embarras et bien des longueurs, s'ils avaient eu quelques connaissances sur la formation des valeurs.
Ceux-ci ont défini la propriété, le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue , pourvu qu'on n’en fasse pas un usage prohibé par les Lois ou par les Réglemens. [218] Remarquons d'abord que cette définition n'a pas de sens; car il en résulte qu'on a la propriété de tout, et qu'on n'a la propriété de rien. On peut en effet jouir et disposer de tout, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage contraire aux lois ou aux réglemens; puisque chacun a le droit de faire tout ce que les lois ou les réglemens ne lui défendent pas. On n'a la propriété de rien, si les lois et les réglemens peuvent arbitrairement fixer l'usage qu'on doit faire des choses; si ceux par qui sont faits les réglemens et les lois ne reconnaissent pas qu'il existe des faits qu'ils sont obligés de respecter.
Si, au lieu de dire que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, on avait dit que les propriétés sont des choses dont on a le droit de jouir et de disposer, on aurait pu donner encore une définition peu exacte; mais du moins on aurait vu, tout d'un coup, que les lois ne créent pas les propriétés, et que par conséquent on peut commettre des brigandages avec des lois comme on le peut avec des jugemens, comme on le peut avec des armes. Les législateurs se voyant d'ailleurs obligés de remonter aux faits primitifs qui donnent naissance aux propriétés, auraient trouvé que tout dérive du travail de l'homme sur les agens de la nature, et ils auraient senti [219] l’absurdité qu'il y a à proclamer le respect de la propriété, et à mettre en même temps des entraves aux travaux qui lui donnent naissance.
Pour n'avoir pas connu la manière dont se forment, se distribuent et se détruisent les richesses, on a mis beaucoup de confusion dans les lois, et souvent on a manqué de principes pour les faire. A chaque pas qu'on fait en législation, il est question d'apprécier les choses; et comment les appréciera-t-on, si l'on n'a aucune connaissance de la théorie des valeurs et des monnaies? Comment un magistrat appelé à prononcer sur des dommages soufferts, pourra-t-il prononcer avec connaissance de cause, s'il ne connaît pas tous les élémens qui entrent dans la composition de la valeur? L'ignorance dans laquelle on vit à cet égard est telle, que si les jugemens qu'on rend tous les jours étaient examinés d'après les vérités établies par l'économie politique, on en trouverait bien peu qui ne présentassent quelque grande iniquité.
L'influence de l'économie politique sur l'organisation des sociétés, sera beaucoup plus considérable qu'on ne saurait l'imaginer. Si depuis quelque temps les publicistes donnent à leurs écrits une direction plus juste et plus élevée, s'ils voient mieux le but des gouvernemens, et la manière dont il faut les organiser pour atteindre ce but, c'est à l'économie politique qu'il faut l'attribuer. Cette science, en faisant voir comment les peuples prospèrent ou dépérissent, a posé les véritables fondemens de la politique et détruit tous les préjugés qui servaient de base à une vieille routine ; elle a mis tous les écrivains qui savent lire, à même de voir la différence qui existe entre l'état de la civilisation du premier et du moyen âges, et l'état de la civilisation des peuples modernes. C'est pour n'avoir pas su apprécier cette différence, qu'on a commis tant d'erreurs et tant de crimes en France, depuis le commencement de la révolution.
Enfin, l'économie politique doit produire entre les peuples les mêmes effets qu'elle produit entre les individus; c'est de les unir ensemble en leur faisant voir qu'ils ont des intérêts communs, et que la prospérité ou la ruine de l’un, est toujours un bien ou un mal pour les autres.
On ne saurait donc trop inviter les jeunes gens à étudier cette science. Mais dans quelle ville iront-ils donc en faire une étude ? Nous pourrions leur indiquer plusieurs villes d'Allemagne, d'Angleterre, ou même d'Espagne. A Barcelone, par exemple, on en fait un cours qu'on dit fort bon. Nous regrettons de ne pouvoir pas leur citer [221] une ville plus voisine. Et, si nous nous permettions de donner un avis à ceux qui ne peuvent pas sortir de France pour aller suivre en pays étranger les écoles publiques où l'on enseigne des ouvrages traduits du français, nous leur conseillerions d'étudier les originaux.
Endnotes
[1] Esprit des lois, liv. vii, chap. 4.
[2] « Ce qui a été appelé Université sous Bonaparte était pis encore. Ce n'était qu'un moyen dispendieux et vexatoire de dépraver les facultés intellectuelles des jeunes gens, c'est-à-dire de remplacer dans leur esprit de justes notions des choses, par des opinions propres à perpétuer l'esclavage des Français. »
[3] « Qu'on admire tant qu'on voudra la société humaine, il n'en sera pas moins vrai qu'elle porte nécessaircment les hommes à s'entre-haïr à proportion que leurs intérêts se croisent, à se rendre mutuellement des services apparens, et â se faire en effet tous les maux imaginables. Que peut-on penser d'un commerce où la raison de chaque particulier lui dicte des maximes directement contraires â celles que la raison publique prêche au corps de la société, et où chacun trouve son compte dans le malheur d’autrui? » ( Rousseau, discours sur l'Origine de l'inégalité parmi les hommes. )