
Charles Comte, “De l’organisation sociale considérée dans ses rapports avec les moyens de subsistance des peuples” (CE, March 1817)
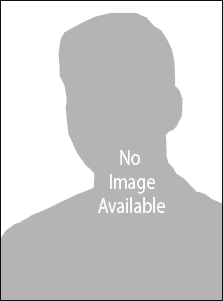 |
 |
| Charles Comte (1782-1837) |
This is part of an Anthology of writings by Charles Comte (1782-1837), Charles Dunoyer (1786-1862), and others from their journal Le Censeur (1814-15) and Le Censeur européen (1817-1819).
See also the others works by Charles Comte and Charles Dunoyer.
Source
CE2a: (CC?), “Considérations sur l’état moral de la nation française, et sur les causes de l’instabilité de ses institutions.” (CE, T1, Jan. 1817), pp. 1-92.
See also the facs. PDF of this article.
Text
[1]
Considérations sur l’état moral de la nation française, et sur les causes de l’instabilité de ses institutions.
Il est convenu, parmi les publicistes, qu'on doit attribuer l'asservissement et les malheurs des peuples aux vices et à la mauvaise organisation de leurs gouvernemens. Les hommes , [2] disent-ils, sont ce que les fout leurs institutions; et puisque les institutions sont l'ouvrage de ceux qui gouvernent, c'est à eux seuls qu'il faut imputer le mal qui en est la suite.
Cette manière de raisonner plaît beaucoup au commun des hommes; elle flatte les passions populaires; elle sert l'ambition qui aspire à tout et console là médiocrité qui ne peut parvenir à rien. Pour un peuple, surtout quand il est tombé dans la misère , il est agréable, en effet , de s’entendre dire qu'il était digne d’un meilleur sort; que ses lumières et son courage l'appelaient à une; autre destinée, et qu'il serait arrivé au comble de la gloire , s'il avait été bien gouverna mais ces flatteries , bonnes pour donner de la popularité à celui qui en est l'auteur, sont d'une utilité fort bornée pour le peuple qui on est l'objet.
Que les institutions politiques aient une très-grande influence sur le bonheur ou sur le malheur des peuples , delà est incontestable; Il est également hors de doute que les gouvernemens peuvent faire , par leurs actes , beaucoup de bien ou beaucoup de mal. Mais quand un peuple souffre , suffit-il , pour mettre un terme à ses maux, d'attaquer les actes de son Gouvernement , ou de réformer ses institutions ? Cela devrait suffire, si les institutions et l'administration [3] dont on se plaint, étaient la cause premiers des maux qu'on éprouve. Mais si elles n'étaient qu'une cause secondaire , si elles étaient l'effet inévitable d'une cause antérieure; c'est en vain qu'on les attaquerait et qu'on leur en substituerait de nouvelles. Tant que la cause première ne serait point détruite , l'effet serait le même; tous las gouvernemens seraient également mauvais.
En 1789, on se plaignait en France d'avoir des institutions vicieuses et d'être mal gouverné; on détruisit ces institutions, et on donna au Gouvernement une forme nouvelle: on établit une représentation nationale. La nouvelle constitution était à peine mise en vigueur, qu’on prétendit qu'elle était mauvaise, et que les choses n'allaient pas mieux qu'auparavant. En conséquence , le Gouvernement fut attaqué et renversé. La Convention qui lui succéda fit une seconde constitution qu'on trouva d'abord admirable , mais qui fut reconnue essentiellement vicieuse avant même que d'avoir été mise en. pratique. On en suspendit l'exécution ; le gouvernement révolutionnaire fut établi, et l'on se plaignit plus que jamais. Une quatrième constitution fut promulguée : le gouvernement révolutionnaire fut remplacé par le gouvernement [4] directorial; on continua de se plaindre ; des insurrections éclatèrent, et le gouvernement fut encore renversé. Une cinquième constitution créa le gouvernement consulaire : celle-ci , comme les autres , obtint une approbation presqu'universelle. Cependant elle ne fut pas plus stable que celles qui l'avaient précédée : elle disparut pour faire place à ce qu'on appela les constitutions de l'empire. Après ces dernières , vint la constitution du Sénat; puis la charte constitutionnelle; puis l'acte additionnel aux constitutions de l'empire; puis la constitution de la chambre des représentais; puis encore la charte constitutionnelle modifiée par une ordonnance; puis, enfin, une ordonnance qui révoquait celle qui avait reformé la charte.
En voyant cette longue série d'actes constitutionnels, renversés aussitôt qu'établis, une question se présente naturellement à l'esprit; c'est de savoir si ce sont les constitutions qui ont manqué aux Français , ou si ce ne sont pas au contraire les Français qui ont manqué aux constitutions. En d'autres termes , les malheurs de la France ont-ils été produits par les vices et la mauvaise organisation de ses divers gouvernemens , ou les vices et la mauvaise organisation de ces gouvernemens ont-ils eux-mêmes été le [5] résultat de l'ignorance et des vices de la nation française?
L'examen de cette question, pénible pour tout Français , l'est encore plus pour celui qui tient à son pays. On voudrait se dissimuler les défauts de sa patrie , comme ceux d'une personne qui nous est chère. Si l'on est fier de ses vertus, on est humilié de ses faiblesses; et quand elle est prête à succomber sous les maux qui l'accablent, on ose encore à peine lui en indiquer la source , dans la crainte de l'affliger et de lui faire mieux sentir son humiliation. Cependant, lorsqu'elle est arrivée au comble de la misère, les écrivains, jaloux de lui être utiles, doivent avoir le courage de lui dire la vérité, même au risque de lui déplaire. Car ce n'est pas en se lamentant sur ses malheurs , ou en flattant sa vanité , qu'ils peuvent espérer de la servir.
Il est dans la nature de l'homme de chercher à détruire les choses qui attaquent son existence, et de défendre celles qui tendent à sa conservation ou à son bien être. Toutes les fois donc qu'on se trouve appelé à donner des lois à un peuple, il faut, si l'on veut qu'elles soient durables , distinguer avec soin les choses qui doivent le conserver, et celles qui peuvent le détruire. Lorsque cette distinction est faite , toute [6] la science du législateur consiste à laisser agir les unes , et à écarter l'action des autres. Dans l'ordre social, le principe ou l'action qui constitue la propriété, est le premier besoin des hommes; car ce n'est que par la propriété qu'ils peuvent se conserver.
Des institutions qui attenteraient continuellement à la propriété , ou qui arrêteraient l'action qui tend à la produire , ne pourraient donc se maintenir , puisqu'elles attaqueraient l'espèce humaine dans les choses nécessaires à son existence. Le premier objet des institutions sociales doit donc être le respect de la propriété et du principe qui la constitue. Mais qu'est-ce donc que la propriété? Les jurisconsultes prétendent qu'elle est un droit. Peut-être serait-il plus exact de dire qu'elle est un fait, ou même une chose; car les hommes ne peuvent pas se nourrir ou se vêtir avec des droits , tandis que nous voyons qu'ils se nourrissent ou se vêtissent avec des choses. La propriété , il faut le dire , n'a jamais été bien définie ; et c'est parce qu'on en a méconnu la source , ou parce qu'on n'a pas su la faire respecter, que toutes nos institutions ont manqué de base , et qu'elles se sont écroulées.
On entend, en général, parle mot PROPRI´ET´E, ce qui est propre; ce qui appartient; ce qui fait [7] partie de; ce qui est tellement lié à une chose; qu'on ne peut l'en séparer, sans que cette chose soit détruite. Ainsi les facultés de l'homme lui appartiennent, elles font une partie essentielle de son être, elles sont sa propriété; comme c'est la propriété de tel arbre de porter des fruits. Si les facultés de l'homme lui appartiennent , ou font partie de lui-même, le produit de ses facultés lui appartient également. On peut cependant le séparer de lui; mais la séparation ne peut être que partielle ou momentanée. Car, si elle était totale et perpétuelle , si les produits créés par l'homme ne venaient pas se rejoindre à lui pour faire partie de son existence , il s'éteindrait de la même manière que si on le séparait de ses facultés elles-mêmes.
En effet, les produits spontanés de la terre sont si bornés comparativement aux besoins des hommes, que, si l'espèce humaine cessait un instant de diriger vers les objets qui lui sont nécessaires , les forces productives de la nature, elle périrait presqu'entièrement. Pour se convaincre de cette vérité , il suffit de jeter les regards autour de soi ; d'anéantir , par la pensée , tout ce que doit l'existence à l'agriculture , aux arts , au commerce, aux sciences , en un .mot à l'industrie de l'homme, et de voir ensuite ce qui [8] resterait pour se nourrir, se vêtir ou se loger. Nous serions bien surpris, si, après cette épreuve, chacun ne reconnaissait pas l'impossibilité de se conserver sans industrie.
Les hommes n'existent donc que par leurs facultés et par le produit de leurs facultés: or c'est ce produit, quand nous le considérons comme propre à satisfaire leurs besoins, que nous nommons propriété.[1] Considérée sous ce point de vue , la propriété est donc un fait qui dérive , non, des lois ou dès institutions sociales , mais de l’organisation même de l'homme. Ce fait peut être plus ou moins troublé dans sa marche. Quand une personne a.obtenu un produit, il est possible de le lui ravir , comme il est possible de lui faire perdre la vue , .ou de lui enlever l'usage des mains; -Mais , dans l'un et l'autre cas, on peut lui donner la mort; puisque nous avons vu que les produits de ses facultés doivent toujours se joindre à lui pour faire partie de son être. Les sauvages connaissent peu la propriété, [9] parce qu'ils produisent peu ; les animaux ne la connaissent point du tout , parce qu'ils ne produisent rien.
Dans les temps les plus barbares, les hommes vivent des produits spontanés de la nature, ou de ce qu'ils ravissent à des voisins plus industrieux. Quelquefois aussi , ils égorgent leurs prisonniers et les dévorent. Lorsqu'ils ont fait quelques pas dans la civilisation , et qu'ils ont acquis quelques notions sur la culture de la terre , ils ne tuent plus leurs prisonniers : ils en font des esclaves , et se nourrissent du produit de leur travail. C'est le second état de barbarie; c'est celui dans lequel se sont trouvé presque tous les peuples que nous appelons anciens. C'est aussi celui dans lequel se sont trouvé les Francs après la conquête des Gaules. Dans un tel état, c'est la partie la plus barbare , ou la moins civilisée de l'espèce humaine , qui vit au moyen de ce que produit la partie la plus avancée dans la civilisation. De là doivent résulter un profond mépris pour les producteurs considérés en leur qualité d'hommes , et un grand respect pour la terre et l'esclave qui la cultive, considérés comme instrumens de production.[2]
[10]
Lorsque des barbares sont parvenus à s'emparer d'un sol fertile , et à contraindre , soit les anciens habitans , soit des hommes pris à la guerre , à le cultiver à leur profit, ils se trouvent dans la position la plus favorable à des sauvages. Car tout ce qui est nécessaire à leurs besoins, continue d'être pour eux un produit spontané de la nature. Ils sont beaucoup mieux pourvus qu'auparavant des choses nécessaires â leur existence , et ils peuvent se livrer avec sécurité à toutes les habitudes de la vie sauvage. La guerre, la chasse et la pêche doivent être les seules occupations dignes d'eux. Ils doivent vouloir qu'on ait un profond respect pour leur profession de soldats , leurs terres et les bêtes sauvages. Mais l'habitude de s'approprier le produit de l'industrie des hommes qu'ils ont asservis , doit leur inspirer un grand mépris pour les occupations industrielles , et une grande inclination à s'emparer des richesses des producteurs.[3] Les fortunes récentes doivent aussi leur inspirer [11] du mépris : elles sont ordinairement le résultat de l'industrie. Les fortunes anciennes , au contraire , doivent leur inspirer du respect, et même de la vénération : elles attestent qu'on descend d'une suite d'aïeux qui n'ont point dégénéré , on qui continuent de vivre sans rien produire , e'est-à-dire en sauvages.[4]
Ces idées, si contraires aux progrès de la civilisation, paraissent s'être établies en France après l'asservissement des peuples du Midi de l'Europe , par les barbares venus du Nord; ou ce qui est à peu près la même chose , après l'établissement du régime féodal. Alors, en effet, on vit des peuples déjà civilisés, c'est-à-dire des producteurs, asservis à des hordes de sauvages, qui ne savaient que se battre , et qui ne pouvaient se nourrir que du fruit de leurs rapines. Poussés par leurs inclinations naturelles, et trouvant que les hommes qu'ils avaient vaincus et qu'ils s'étaient partagés comme des troupeaux , ne produisaient pas assez abondamment pour satisfaire leur avidité , ces sauvages spolièrent les gens 12] d'église , les personnes industrieuses qu'ils n'avaient point asservies, et se firent même la guerre entre eux , pour se disputer les produits de leurs esclaves; c'est ce qu'on appela les guerres privées ou féodales.
Le pape, Grégoire VII, dans une lettre adressée à plusieurs prélats de France , en 1074, fait un tableau assez énergique des mœurs de cette époque. « La dépravation des mœurs qui va toujours croissant , dit-il, a fait disparaître jusqu'aux traces de la vertu; et de cet honneur, jadis tant vanté , il n'en existe pas même l'apparence. Les lois sont méprisées; toute justice est foulée aux pieds. Les crimes les plus infames, les actes les plus cruels, les plus vils , les plus exécrables, se commettent impunément ; et ces déréglemens sont déjà passés eu habitude. »
Ce pape parle ensuite des guerres privées et de leurs dévastations; de l'usage où étaient les seigneurs de faire la guerre à leurs parens , à leurs propres frères, pour leur enlever leurs biens et les réduire à la misère; de l'usage où ils étaient d'arrêter les pèlerins, sur les chemins; de les piller; de les jeter dans les prisons; de leur faire subir les tortures les plus insupportables pour leur arracher des rançons qui excédaient la valeur de leurs propriétés. Parlant ensuite de Philippe Ier., roi de France, il ajoute : « Comment se conduit - il avec les marchands ? Dernièrement encore , plusieurs marchands , venus de divers pays, se rendaient ensemble à une foire qui se tenait en France; le roi , comme un voleur , les attaqua, et leur enleva une grande quantité d'argent; et celui qui devait être le soutien de la justice et l'exécuteur des lois , est le premier à les enfreindre par ses pillages.[5] »
Les faits de ce genre, qui nous paraissent aujourd'hui si extraordinaires, n'étaient cependant pas rares autrefois. Eudes, fils du roi Robert, frère du roi Henri Ier. , et oncle de ce même Philippe qui attaquait les marchands sur les grands chemins , n'ayant lui-même aucune propriété , cherchait à s'emparer de celles des autres. Il ne vivait, dit un écrivain de son temps, que de vol et de brigandages : rapinis et deprœdationibus operam impendens.[6] Suivant l'abbé Suger, Philippe , fils du roi Philippe Ier. , volait les pauvres, opprimait les églises et désolait toute la contrée. Son frère, [14] le roi Louis-le-Gros, fut obligé de prendre les. armes contre lui. Deprœdationibus pauperum, contritione ecclesiarum, totius etiam pagi dissolutione , Rcx lacessitub , illùc licèt invitua properavit.[7]
Si les habitudes des barbares de la Germanie, de s'emparer, par la violence, des richesses qu'ils ne savaient pas produire , étaient conservées par les chefs , on doit bien penser qu'elles l'étaient aussi par leurs inférieurs. Le pillage des personnes qui faisaient le commerce par terre ou par eau , s'exécutait avec d'autant plus de régularité , que les dominateurs avaient des chateaux d'où ils partaient armés, et où ils transportaient leur butin. Les écrivains du temps nomment ces châteaux receptacula , et souvent, cavernes de voleurs , speluncœ latronum.
Les maîtres de ces châteaux ne faisaient pas toujours les vols par eux-mêmes. Ils se bornaient souvent à receler les choses enlevées , et à partager la proie avec les voleurs. Quelquefois aussi, ils avaient des hommes à gages par lesquels ils faisaient faire les expéditions , et auxquels ils abandonnaient une partie des dépouilles des [15] marchands arrêtés sur les chemins. Ces satellites sont nommés cursores, coureurs, par les écrivains latins, et pillards par les écrivains français.
Ceux qui ne voulaient pas s'embusquer sur les chemins , bâtissaient des forteresses sur des passages indispensables; sur les bords d'une rivière, près d'un pont; et , détruisant les chemins qui s'en écartaient, ils forçaient les voyageurs à passer dans la cour de leur forteresse. Là ils les obligaient à payer une contribution arbitraire, qu'ils appelaient péages- Les écrivains de ce temps n'ont parlé de ces brigandages, que parce qu'ils attaquaient la source du revenu des églises. Les pèlerins n'osaient plus porter leurs offrandes dans les lieux où ils ne pouvaient pas arriver, sans passer par un chemin qui les exposait à des dangers et à des spoliations. Mais, ce qui prouve mieux que tout le reste combien l'habitude de s'emparer des richesses d'autrui était enracinée chez les descendans des barbares qui avaient inondé l'Europe , ce sont les nombreux conciles qui , pendant deux cents ans , ont inutilement renouvelé la loi appelée la trêve de Dieu, Par cette loi, il leur était accordé quelques jours et quelques nuits, pendant chaque semaine, pour exercer leurs brigandages, à condition qu'ils s'en abstiendraient pendant les autres jours.
[16]
Les voyageurs et les marchands n'étaient pas les seuls qui eussent à souffrir de l'avidité des' oppresseurs de la France. Ces barbares parcouraient-les campagnes, en enlevaient les troupeaux , les moissons , les habitans même. Les cultivateurs qui avaient le malheur de tomber dans leurs mains, étaient plongés dans des cachots; et là on leur faisait souffrir des tortures atroces, pour les contraindre à payer une rançon arbitraire. Oderic-Vital, qui écrivait en 1138 , dit que le peuple de Normandie , sans moyen de se défendre , dénué de protection et réduit au plus affreux désespoir, appelait Dieu à son aide. Mais , ajoute-t-il, les nobles persistaient dans leurs conduites turbulentes, dans leur perfidie et leur mauvaise foi. La plus grande partie était composée de traîtres qui favorisaient les ennemis du roi. Au lieu de défendre leurs sujets attaqués , ils étaient les premiers à les piller , à les opprimer, à les écraser sous le poids de leurs iniquités.[8]
Dans une lettre adressée au pape Eugène III, 1150, Pierre-le-Vénérable, abbé de Cluni, fait le tableau des brigandages commis par les grands [17] de son temps. « Les prêtres , les moines , les bourgeois, dit-il, en parlant du retour d'Humbert de Beaujeu, revenus de la croisade , trésaillaient de joie : les habitans des campagnes, les laboureurs , les pauvres, les veuves , les orphelins , tous ceux enfin de la classe du peuple qui sont ordinairement pillés par ces voleurs et par ces loups, se communiquaient leurs espérances avec des transports de joie ». L'abbé de Cluni ajoute qu'il ne croit pas qu'il existe sur la terre un pays aussi malheureux que le sien ( situé entre la Seine et la Loire ). « Il reste en proie, dit-il , aux dents des bêtes féroces ; et s'il s'y trouve quelques seigneurs qui portent le titre de ducs , de comtes ou de princes, loin d'employer leurs forces à protéger le peuple , ils ne s'en servent que pour le dévorer. ... Il (Humbert) avait rendu la sécurité aux églises , aux pauvres, et à tout ceux qui redoutent la tyrannie des nobles. Déjà les marchands sur les chemins commençaient à ne plus rien craindre; mais... » Pierre-le-Venérable termine sa lettre en disant que le comte Humbert a fini par faire comme les autres.[9]
Les habitans de Toulouse écrivaient, en 1164, [18] au roi Louis VII, pour se plaindre des ravages commis sur leur territoire par un grand seigneur du temps. Ils l'accusaient de militer, non pour le Christ, mais pour le roi d'Angleterre ; de faire des invasions jusqu'aux portes de leur ville ; d'en ravager tout le territoire ; de démolir et raser les châteaux ; de ne pas respecter même les églises; d'en avoir brûlé plusieurs, et le plus qu'il avait pu, comme un brigand et un incendiaire; d'avoir pris et poignardé, de ses propres mains, plusieurs habitans de la ville et des faubourgs. « Si vous tardez à nous porter du secours, disaient, en finissant, les habitans de Toulouse à Louis VII, notre territoire sera bientôt réduit en désert. » Mais quel était ce personnage qui militait pour l'Angleterre , et non pour le Christ; qui dévastait les campagnes; qui rasait les châteaux ; qui brûlait les églises; qui poignardait ses prisonniers de ses propres mains ? C'était un homme revêtu des plus hautes dignités; un homme qui professait la religion catholique, mais auquel les évangiles n'avaient pu faire perdre les mœurs des barbares de la Germanie; c'était Bertrand , archevêque de Bordeaux.[10]
[19]
La propriété étant une chose presqu'inconnue à des sauvages, ainsi que nous l'avons observé , il est naturel qu'ils cherchent à s'emparer de tous les produits qui peuvent satisfaire leurs besoins, sans examiner quelle en est la source.; Il est également naturel qu'en méprisant les hommes civilisés , c'est-à-dire les producteurs , ils exigent que ceux-ci respectent les objets qui leur sont les plus chers dans la vie sauvage. Les lois de tous les peuples d'Europe attestent la vérité de cette observation. On y voit que celui qui n'était puni que d'une simple amende, s'il tuait un homme, pouvait être puni de mort s'il tuait une bête sauvage. Ce n'est que vers le milieu du dix-septième siècle qu'il a été défendu en France de punir du dernier supplice les simples délits de chasse.[11] Guillaume-le-Conquérant, qui apporta en Angleterre les mœurs des Normands , après avoir dévasté trente milles du pays d'Hampshire , après en avoir chassé les habitans, rasé; les maisons et les églises, pour y élever une forêt , [20] publia des lois, par lesquelles il défendit la chassé sous les peines les plus sévères. On crevait les yeux , dit Hume , à quiconque tuait un cerf , un sanglier , ou même un lièvre , et cela dans un temps où le meurtre d'un homme restait impuni moyennant une amende modérée ou une composition.[12]
A mesure que le pouvoir s'est concentré vers un point unique , les dominateurs ont pu se livrer à leurs brigandages avec moins de facilité. Mais leur puissance s'est bien moins éteinte qu'elle n'a changé de main; et la propriété n'a été ni mieux connue, ni plus respectée. On pourrait citer ici beaucoup de faits qui prouveraient qu'en succédant au pouvoir des seigneurs, les rois avaient aussi succédé à leurs principes ; ou plutôt que , ces principes ayant toujours été les leurs , ils ne les avaient pas abandonnés en devenant les plus forts. Les vols faits avec violence , les altérations des monnaies , les banqueroutes , les confiscations , les entraves apportées à, l'industrie , sont [22] des événemens si communs dans nos histoires , qu'on ne finirait pas, si l'on voulait les rapporter tous. Louis XIV, faisant observer à son fils que les grandes sommes dont un petit nombre de financiers composaient leurs richesses excessives et monstrueuses , provenaient toujours des sueurs, des larmes et du sang des misérables, prétendait être le premier qui en eut fait la remarque. « Ces maximes que je vous apprends aujourd'hui, lui disait-il, ne m'ont été enseignées par personne , parce que mes devanciers ne s'en étaient pas avisés. ».[13]
On se tromperait, cependant, si l'on croyait que sous le règne de ce prince , la propriété a été mieux connue ou plus respectée que sous les règnes antérieurs. Tant que les seigneurs ont été les plus forts , ils ont considéré comme leur appartenant toutes les choses dont ils ont pu s'emparer. Aussitôt que les rois ont eu le dessus , ils ont pensé et agi de la même manière. Louis XIV, que nous venons de citer, enseignait à son fils que toutes les propriétés de ses sujets étaient à lui, et qu'il pouvait en disposer, comme il jugeait convenable , pour le plus grand bien de sou royaume. Celle maxime,. qui fit la base [22] de son administration , le conduisit à des consequences si terribles , qu'il en fut lui-même épouvanté. Mais le père Tellier , son confesseur , et les docteurs de la Sorbonne, parvinrent à le rassurer , en reconnaissant eux-mêmes la vérité de sa maxime favorite. Ce fait est si curieux, que le lecteur ne sera peut-être pas fâché d'en connaître toutes les circonstances.
« Vauban, dit Saint-Simon, avait imaginé une dîme royale; mais c'était un impôt unique. Desmarets imagina le dixième, mais ce fut un surcroît. Il faut avouer qu'il se trouvait dans le plus cruel embarras. Les papiers de toute espèce, dont le commerce se trouvait inondé, et qui tous avaient perdu plus ou moins de crédit, faisaient un chaos qu'on n'espérait pas voir jamais débrouiller : billets d'Etat, billets de commerce, billets de receveurs - généraux, billets sur les tailles, billets d'ustensiles, étaient la ruine des particuliers. Le roi forçait de les prendre en paiement. Ils perdaient moitié, deux tiers et plus avec lui comme avec les autres. Les escomptes enrichissaient les gens d'argent et de finance aux dépens du public. La circulation ne se faisait plus , parce que le roi tirait toujours , ne payait point; et que ce qu'il y avait d'espèces hors de ses mains , restait dans les coffres des [23] gros capitalistes. La capitation doublée et triplée à la volonté des intendant des provinces ; les marchandises et les denrées imposées au double, au triple, au quadruple de leur valeur; taxes des aisés , et cent autres impôts sous différens noms , écrasaient nobles et roturiers, seigneurs et gens d'église. La plus grande partie du produit restait entre les mains des traitans et de leurs employés , sans que ce qui revenait au roi pût suffire. Desmarets qui voyait cela mieux qu'un autre , et qui sentait le besoin d'un supplément fixe et à l'abri des réductions , forma son projet sans dire mot à personne, et le donna à examiner et à limer à un bureau qu'il composa exprès. . . .
» Les commissaires de ce bureau se mirent donc à travailler avec assiduité ; mais ils n'avaient pas plutôt surmonté une difficulté, qu'il s'en présentait une autre. La principale était qu'il fallait tirer de chacun une confession de bonne foi, nette et précise , de son bien , de ses dettes actives et passives et de leur nature , en obtenir des preuves certaines , et trouver les moyens de n'y être pas trompé. Après être parti de ce point, que l'impôt était une nécessité, on compta pour rien la désolation de l'impôt même , le désespoir d'hommes de tous états, forcés à révéler eux-mêmes [24] le secret de leurs familles, les mauvaises affaires d'un grand nombre , qui subsistaient à l'aide d'une réputation et d'un crédit que cette manifestation allait ruiner ; enfin la discussion des facultés , opérée par les rapports et l'espionage ; discussion semblable, pour ainsi dire , à une lampe portée par une main-ennemie sur les parties honteuses.
» Quand les commissaires eurent remédié à cet inconvénient le moins mal qu'il fut possible, ils dressèrent leur édit, tout hérissé de foudres, contre les délinquans qui seraient convaincus, et le présentèrent au roi. Quelque accoutumé qu'il fut aux impôts les plus énormes, il ne laissa pas de s'épouvanter de celui-ci. Cette surcharge l'inquiéta d'une manière si sensible, qu'il y parut sur son visage. Les gens de l'intérieur s'en aperçurent; et Maréchal , son chirurgien , qui m'a raconté cette anecdote , se hasarda de lui parler de sa tristesse qu'il remarquait depuis quelques jours, et qui était telle , qu'il craignait pour sa santé. Louis XIV lui avoua qu'il sentait des peines infinies, et se jeta vaguement sur la situation des affaires. Huit ou dix jours après ayant repris son calme accoutumé , il appela Maréchal, et seul avec lui : Maintenant, lui dit-il, que je me sens au large, je veux bien vous dire ce [25] qui a causé mes peines et ce qui y a mis fin. Il lui conta ensuite que l'extrême besoin de ses affaires l'ayant forcé à de nouveaux impôts , outre sa compassion pour son peuple, le scrupule de prendre le bien de tout le monde l'avait fort tourmenté. A la fin , fl]outa-t-il, je m en suis ouvert au père Tellier.[14] Il m'a demandé quelques jours pour y penser , et il est revenu avec une consultation des plus habiles docteurs de la Sorbonne, qui -décident nettement que tous les biens de mes sujets sont à moi en propre , et que, quand je les prends, je ne prends que ce qui m'appartient. Cette décision m'a rendu la tranquillité que j’avais perdue ».[15]
Nous avons vu que des barbares ayant envahi le Midi de l'Europe ,. en avaient asservi la population ; qu'ils l'avaient en quelque sorte attachée au sol, pour la contraindre à le cultiver et se nourrir du produit de son travail; que , plus tard , l'industrie ayant fait quelques progrès, les descendans de ces barbares , conservant toutes les habitudes de leurs ancêtres , avaient constamment cherché à s'emparer des biens de la [26] partie industrieuse ou civilisée de la nation; qu’ils. dévastaient les campagnes , en enlevaient les moissons, les troupeaux , et même ,les habitans ; qu'ils arrêtaient les voyageurs et les marchands sur les chemins pour les pilier; qu'afin d’opérer avec plus de sûreté la spoliation des personnes industrieuses, ils avaient des lieux fortifiés et des satellites à gages , nommés cursores par les écrivains Latins, et pillards par les écrivains français; que ces satellites partaient de ces châteaux forts , nommé par quelques écrivains du temps speluncae latronum, pour faire leurs excursions, et revenaieut partager le butin avec leur maître.
Maintenant la scène change; ce ne sont plus des seigneurs châtelains qui détroussent les voyageurs, qui vont dévaster les campagnes et en enlever les moissons, ou qui envoient des pillards gagés faire des excursions; ce n'est plus Philippe Ier. qui va s'embusquer sur les chemins pour enlever l'argent de quelques pauvres marchands ; ce n'est plus le frère de Louis-le-Gros ou le fils du roi Robert qui fondent leur revenu sur le vol et le brigandage. L'ordre se rétablit , .c'est-à-dire que les petits oppresseurs sont opprimés à leur tour. Un homme pose alors en principe qu'il est l'État; et que toutes les richesses [27] particulières appartiennent à l’État. Il ordonne ensuite à près de quatre-vingt mille famille de professer ce qu'elles ne croient pas ; et parce qu'elles refusent d'être des hypocrites , il les proscrit et confisque à son profit toutes leurs propriétés , croyant reprendre ce qui lui appartient. Ses revenus ordinaires ne pouvant plus suffire à ses dépenses ; il fait rechercher exactement quelle est la quantité de richesses que chacun possède , et il détermine la part qu'il doit en prendre. Mais comme il ne peut pas exécuter tout cela par lui-même , il tient à ses gages des bandes qu'il charge de l'exécution , et auxquelles il donne une partie du butin.
Quoique cette conduite paraisse la même que celle des seigneurs châtelains, il y a cependant quelques différences remarquables. D'abord ce n'est plus sur les chemins que les particuliers sont dépouillés. On les oblige à faire connaître ce qu'ils possèdent; l'on va prendre chez eux ce qu'on veut, et, s'ils ne font pas une déclaration exacte , on les punit comme les punissaient les seigneurs qui parvenaient à les enfermer dans leurs châteaux forts. On ne va plus dans les champs en ravir les moissons; on attend , pour prendre ce qu'on desire , que la récolte soit faite. Il est vrai que , d'un autre côté , on prend quelquefois le [28] fonds avec les fruits. Les actes de violences ne s'exécutent plus par des gens mal vêtus et portant des habits de couleurs différentes; ils s'exécutent par des hommes assez bien mis pour leur métier , et qui se ressemblent par l'habit comme par le caractère. Ces hommes ne sont plus appelés des coureurs ou des pillards; on les appelle des dragons ou des grenadiers. Enfin, ceux qui font commettre ces actes ne sont pas des brutaux sans éducation, ce sont des hommes polis et galans qui possèdent ce qu'on appelle l'usage du monde.. Du reste , la ressemblance est parfaite , si nous en jugeons par les auteurs qui ont écrit à cette époque.[16]
Dans le dix-huitième siècle , dans le siècle des lumières et de la philosophie, le principe de la propriété n'est ni mieux connu , ni plus respecté que dans le dix-septième. La caste dominante [29] conserve, sous les formes de la civilisation , les idées et le caractère de ses ancêtres. Comme eux, elle honore exclusivement un état d'oisiveté, de violence et de rapine. Elle méprise tout travail productif; elle se fait une espèce d'honneur de consommer ce qui a été produit par d'autres; en un mot, elle trouve ignobles les richesses que l'homme acquiert à la sueur de son front, et glorieuses celles qu'il acquiert en versant le sang de ses semblables.[17]
Vues de près et dépouillées de tout prestige, ces idées, qui étaient propres à une caste, étaient trop barbares pour devenir générales ; il fallait, pour les rendre séduisantes aux yeux du vulgaire , les lui présenter revêtues d'un style pompeux et placées à deux ou trois mille ans de distance. C'est ce qu'ont fait quelques écrivains du dernier siècle. Révoltés de l'absurdité de ces idées , tant qu'ils les ont vues sous un costume gothique, ils en ont été ravis , aussitôt qu'elles se sont présentées [30] à leurs yeux sous un costume ancien, et soutenues de l'autorité de Platon et d'Aristote.
Les Grecs et les Romains, ces éternels sujets de notre admiration, avaient sur la guerre et sur les travaux nécessaires à l'existence de l homme, les mêmes idées que les Goths et les Vandales. Le mépris que les Romains avaient pour toute espèce d'industrie est connu ; les Grecs n'étaient pas à cet égard plus avancés.[18]
« Il faut se mettre dans la tête, dit Montesquieu, que , dans les villes grecques , sur-tout [31] celles qui avaient pour principal objet la guerre, tous les travaux et toutes les professions qui pouvaient conduire à gagner de l’argent,[19] étaient regardés comme indignes d'un homme libre. Les arts , dit Xénophon , corrompent le corps do ceux qui les exercent; ils obligent de s'asseoir à l'ombre ou près du feu : on n'a de temps ni pour ses amis, ni pour la république. Ce ne fut que dans la corruption de quelques démocraties , que les artisans parvinrent à être citoyens. C'est ce qu'Aristote nous apprend, et il soutient qu'une bonne république ne leur donnera jamais le droit de cité[20]
» L'agriculture était encore une profession [32] servile, et ordinairement c'était quelque peuple vaincu qui l'exerçait ; les Ilotes chez les Lacédémoniens, les Périaciens chez les Cretois, les Penestes chez les Théssaliens , d'autres peuples esclaves dans d'autres républiques.
» Enfin tout bas commerce était infâme chez les Grecs ; il aurait fallu qu'un citoyen eût rendu des services à un esclave , à un locataire , à un étranger : cette idée choquait l'esprit de la liberté grecque.[21]
Les républiques des premiers âges, en sortant de la barbarie , ayant donc continué de méconnaître et d'avilir la source de la, propriété , et leurs philosophes ayant adopté leurs préjugés à cet égard, les écrivains modernes, qui se sont formés dans la lecture des ouvrages de ceux-ci , nous ont transmis toutes leurs opinions.[22] Ils [33] n'eut pas regardé les propriétés connue étant le produit de l'industrie de chaque individu; ils les ont considérées comme si elles avaient été spontanément produites par la nature; ou plutôt comme les Romains considéraient les richesses des peuples industrieux qu'ils dépouillaient: comme eux , ils ont voulu que les richesses produites par quelques-uns, fussent partagées de manière que chacun en eut une égale part.
Ne voyant dans les personnes industrieuses que des instrumens créés pour nourrir la classe oisive , quelques - uns se sont imaginé que le moyen le plus efficace de faire prospérer l'état était de dévorer inutilement la plus grande quantité possible de produits industriels. C'est alors qu'a été posée cette maxime que , « pour que l'Etat monarchique se soutienne, le luxe doit aller en croissant du laboureur à l'artisan , au négociant, aux nobles, aux magistrats, aux grands seigneurs, aux traitans principaux , aux princes, sans quoi tout serait perdu ».[23] C'est alors aussi qu'on a, osé écrire « qu'il faut que les lois favorisent tout, le commerce que la constitution de ce gouverne [34] peut donner ; afin que les sujets puissent, sans périr, satisfaire aux besoins toujours renaissants du prince et de sa cour ».[24]
Il est une multitude de moyens d'acquérir la propriété ; mais on a observé que les individus qui, étant incapables de rien produire par eux-mêmes, sont parvenus à s'enrichir par la violence , par la ruse ou par le vice, ont eu, en général, des mœurs atroces ou infâmes. Cette observation, confirmée par l'histoire de quelques peuples anciens, par les préjugés puisés dans la lecture de leurs philosophes , et par des exemples modernes, a fait croire que la propriété , c'est-à-dire , la production , était elle-même la source de tous les crimes. On n'a donc rien trouvé de mieux, pour donner de la morale aux peuples, que d'attaquer cette prétendue source de misères humaines. « Le premier, a dit Rousseau, qui, ayant enclos un terrain , s'avisa de dire , ceci est à moi , et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres ; que de misère et d'horreurs n'eût point épargnés au genre-humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables: [35] gardez -vous d'écouter cet imposteur; vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous,' et que la terre n'est à aucun. »
Ainsi , tandis que , d'un côté , une partie de la population , héritière des erreurs et des habitudes des sauvages de la Germanie , s'obstinait à regarder comme au-dessous d'elle tous les moyens de production , et à ne voir dans les hommes industrieux que de vils instrumens qu'il fallait sans doute ménager, mais assez seulement pour qu'ils pussent, sans périr, satisfaire aux: besoins toujours renaissans du prince et de sa cour ; d'un autre côté , les écrivains les plus éloquens, imbus des erreurs nées dans l'enfance des peuple de la Grèce ou de l'Italie , persuadaient aux hommes que les fruits de la terre étaient à tous; que la terre n'était à aucun, et que tous les crimes et les malheurs du monde étaient nés de l'industrie , des arts, des sciences , en un mot, de la production des choses nécessaires à l'homme, c'est-à-dire ,de la propriété. Toutes ces idées étaient les mêmes, quant aux résultats qu'elles devaient produire : elles ne différaient que dans la manière dont elles étaient présentées; et les philosophes qui attaquaient les préjugés nobiliaires, étaient eux-mêmes dominés par des préjugés de la même nature.
[36]
Il existe chez tous les peuples deux partis ; celui des hommes oisifs qui veulent vivre aux dépens d'autrui, et celui des hommes industrieux qui veulent qu'on respecte les produits de leur industrie. Tant que les premiers sont assez forts ou assez bien organisés pour comprimer les seconds, la lutte est sourde et peu apparente; il règne dans le monde une espèce de calme assez semblable à celui que montre un homme courageux au milieu des tourmens; ce calme, les forts sont convenus de l'appeler le bon ordre , parce qu'en effet ils trouvent cet ordre fort bon. Aussitôt que l'équilibre des forces s'établit, les agitations commencent : c'est le temps des révolutions. Si les hommes industrieux ont le dessous, on les appelle des esclaves révoltés , des séditieux , des rebelles, quelquefois aussi des révolutionnaires; on châtie les uns ,. on resserre les fers des autres , et le bon ordre se rétablit. Si c'est au contraire la classe dévorante, qui succombe, les hommes qui la composent sont, des oppresseurs, des tyrans; on les proscrit. Spartacus échoue dans la lutte qu'il engage contre la tyrannie romaine; il n'est qu'un esclave fugitif digne du dernier supplice : s'il eût réussi , il eût peut-être sauvé le monde.[25]
[37]
Telle est en deux mots l'histoire de la révolution française. La lutte qui s'est engagée entre la classe active et industrieuse , et la classe oisive et dévorante, n'a eu d'abord pour objet que de garantir à la première le libre exercice de ses facultés , et la jouissance paisible des produits de son industrie. Si, après avoir pris le dessus , les défenseurs de la cause populaire étaient restés dans les bornes d'une sage modération; s'ils avaient respecté chez leurs adversaires , les droits pour lesquels ils avaient combattu; si, au lieu de confisquer au profit de l'Etat, les propriétés des hommes qui allaient exciter des guerres contre la France , ils les avaient déclaré dévolues dans l'ordre naturel des successions aux plus proches de leurs parens qui resteraient fidèles à la [38] patrie ; enfin, si, après avoir montré un grand respect pour la propriété , ils avaient organisé le Gouvernement de manière qu'il fût obligé de la respecter toujours , la révolution se serait probablement opérée sans aucune secousse violente, et un ordre de choses durable se serait peut-être établi. Mais avec les fausses idées qu'on avait sur la propriété, et avec les principes d'une égalité mal entendue , il était impossible qu'on ne se précipitât point dans le désordre , et qu'on ne marchât pas de révolution en révolution.
L'ignorance des principes constitutifs de la propriété amène d'abord la confiscation des biens d'une classe nombreuse. On crée ensuite des assignats; et ils sont multipliés au point qu'après avoir progressivement perdu de leur valeur , ils n'en conservent plus aucune. Cette banqueroute générale amène une multitude de banqueroutes particulières. Celui qui ne reçoit que la moitié de ce qui lui est dû , s'acquitte en ne payant que la moitié de ce qu'il doit. Les propriétés passent ainsi, comme par enchantement, d'une personne à une autre , sans qu'il soit possible de les arrêter. Le malheureux qui ne possédait rien, ou qui même était accablé de dettes, se trouve tout-à-coup avoir une grande fortune , sans avoir rien fait pour la produire; et celui qui avait [39] des richesses immenses , se voit dans la pauvreté , sans avoir rien fait pour y tomber.
Cette banqueroute est bientôt suivie d'une autre, qui amène de nouveaux désordres. On fait perdre aux personnes qui avaient confié leurs propriétés à l'Etat, les deux tiers de leurs créances; et cette seconde banqueroute générale est encore suivie d'une multitude de banqueroutes particulières. Cependant toutes les idées, en matière de législation , se confondent. Ne voyant pas quelle est la source de la propriété, on croit que c'est la loi qui la crée, parce qu'on voit qu'elle la fait arbitrairement passer d'une main dans une autre. Au milieu du délire qu'inspirent les idées des peuples à demi-sauvages, l'industrie et le commerce sont décriés comme contraires à un gouvernement républicain; et l'homme qui travaille à la prospérité de son pays , s'expose à être traité comme celui qui en médite la ruine. C'est ainsi qu'au nom de Platon , d'Aristote et, de leurs disciples , on attaque successivement toutes les bases de la prospérité nationale , et que l'on crée des gouvernemens qui se montrent et disparaissent comme des décorations de théâtres. Ces attentats à la propriété , sont suivis par des attentats d'un autre genre. Mais pour concevoir la. gravité.de. ceux-ci , il faut remonter à quelques vérités fondamentales.
[40]
Nous avons précédemment observé que si la nature, abandonnée à elle-même , ne produisait pas toutes les choses propres à satisfaire nos besoins , chacun de nous portait en lui-même l'industrie nécessaire pour les lui faire produire , et pour approprier à notre usage des choses qui ne nous seraient d'aucune utilité dans leur forme primitive. Si chacun produisait assez pour soi , et que nul ne voulût ni s'emparer des produits d'autrui, ni troubler l'ordre le plus favorable à l'espèce humaine , on n'aurait besoin ni de lois , ni de gouvernement. Le plus habile serait le plus riche , et le plus sage le plus heureux. Mais ce n'est pas ainsi que les choses se passent, Parmi tous les peuples , même parmi les plus civilisés , il existe , comme dans les bois, un. certain nombre d'individus incapables de rien produire de bon , et ne sachant vivre que sur le travail des autres. Cette espèce de sauvages auxquels on donne des nons différens , selon qu'ils sont couverts de haillons ou d'habits brodés , troubleraient l'ordre public , s'ils n'étaient contenus ou occupés: Pour n'avoir rien à craindre d'eux, il faut leur ouvrir des prisons, des hôpitaux ou des antichambres. Il faut aussi tracer des règles de conduite aux cœurs gâtés, ou aux esprits de travers qui se trouvent parmi les peuples, [41] afin qu'ils ne troublent pas l'harmonie qui doit régner entre des hommes destinés à vivre ensemble.
Pour obtenir ces résultats et quelques autres dont il est inutile de parler ici, on est obligé de confier à quelques membres de la société , le soin de garantir les autres des atteintes qui pourraient être portées à leur personne ou à leurs biens; et comme les hommes qu'on charge de ce soin ne peuvent pas employer leur temps pour eux-mêmes , chacun s'oblige à leur donner une partie de ses revenus. Mais il arrive souvent qu'au lieu de protéger la classe active et industrieuse contre la classe oisive et dévorante, les gouveruans font cause commune avec celle-ci, pour opprimer celle-là, et s'en partager les dépouilles. Alors, ce ne sont plus les affaires d'une société qu'on administre, c'est une nation qu'on exploite à l'aide d'une nuée de commis, de soldats ou de moines. Tous ceux qui participent directement ou indirectement à l'exploitation, ne rendant point au public, par leurs services, l'équivalent de ce qu'ils reçoivent de lui, ou de ce qu'ils aident à lui ravir, doivent être considérés comme de véritables spoliateurs dont l'existence est un attentat continuel à la propriété. Pour connaître les maux sans nombre qui résultent d'un tel ordre [42] de choses, et pour avoir des idées complètes sur l'état moral de la France , il suffit de jeter un coup -d'œil sur la marche de son dernier gouvernement.
A peine un homme a-t-il saisi les rênes de l'Etat, qu'usurpant tous les droits de la nation, il s'empare des administrations des communes, des administrations des départemens, des gardes nationales, des tribunaux, de l'éducation publique , de la liberté de la presse , en un mot , de toutes les institutions destinées à protéger les citoyens contre les abus de pouvoir; il appelle aux emplois publics tous les hommes qui, à une grande bassesse d'àme et à une insigne lâcheté, peuvent joindre quelques talens; il fait disparaître peu-à-peu de la scène tous ceux auxquels il connaît du courage , des lumières et de la probité; il fait sortir de la classe industrieuse l'élite de la population, et la jette malgré elle dans la classe oisive des soldats pour la rendre inhabile à toute profession utile et en faire des complices; il va fouiller dans le cœur humain pour y soulever ce qu'il y a de plus vil, et toutes les passions lâches et honteuses accoururent se ranger autour de lui pour être ses auxiliaires; enfin, lorsqu'il s'est entouré de la lie de tous les partis , et qu'il a masqué en ducs, en barons, en [43] chambellans, en sénateurs, les vieux marquis du la monarchie féodale, et les républicains de Robespierre, il offre à cette troupe immonde les dépouilles de la France et de l'Europe , sans autre condition que de se prosterner à ses pieds et de l'adorer : Et ostendit ei omnia regna mundi , et dixit ei : haec omnia tibi dabo , si cadens adoraveris me.
Pendant ce long règne , le plus funeste qui ait jamais pesé sur un peuple, puisque les calamités actuelles de la France n'en sont qu'une conséquence nécessaire, la propriété a reçu des atteintes aussi funestes que celles qui lui avaient été portées pendant les troubles de la révolution. Une multitude de sénateurs , de courtisans , de préfets, de princesses, de conseillers d'état, de ministres , de législateurs, se sont partagé les impôts levés sur le public. Mais quels services lui ont-ils rendu en échange? Et ces nuées de soldats, de commis , de chansonniers; d'espions dont on avait fait l'appui du trône, de quelle utilité ont-ils été pour le peuple qui les nourrissait? Etaient-ils créés dans l'intérêt du peuple ou dans l'intérêt de l'homme qui voulait qu'on rapportât tout à lui? Nous ne parlons point de ce qui s'est passé dans les pays qui ont été occupés par la force militaire ; mais on conviendra que ce n'est pas là que les armées [44] françaises ont appris à connaître la propriété , et qu'elles ont contracté l'habitude de la respecter. Le mal le plus grand qu'ait produit ce pillage universel, n'est pas d'avoir enlevé , sans utilité, à la classe industrieuse , une partie de ses richesses. C'est d'avoir démoralisé un nombre immense d'individus, en les habituant à vivre dans l'oisiveté , ou à retirer un salaire, non pour le bien qu'ils faisaient, mais pour le mal dont ils étaient complices. C'est d'avoir fait disparaître le déshonneur qui doit flétrir tout homme qui devient un instrument d'usurpation ou de tyrannie. C'est enfin d'avoir habitué les yeux du peuple au spectacle du vice , et de l'avoir rendu incapable d'éprouver à son aspect aucun sentiment d'indignation.
Nous avons vu que les hommes ne pouvaient prospérer qu'en dirigeant vers les objets nécessaires à leurs besoins , les forces productives de la nature; que les produits de leur industrie , que nous avons nommés propriétés , étaient une suite de leur organisation , et faisaient une partie essentielle de leur existence; que les barbares qui avaient envahi l'Europe , étant incapables de rien produire , n'avaient pu exister qu'en ravissant à des hommes plus faibles ou moins féroces qu'eux, les produits de leur travail ; qu'ils avaient conservé cette manière de vivre jusqu'à ce que quelques-uns de leurs chefs, étant devenus les plus forts , les avaient asservis pour se mettre à leur place; qu'alors au lieu de devenir eux-mêmes des producteurs , ils s'étaient faits les auxiliaires de leurs chefs et avaient conservé tous les préjugés nés de la barbarie ; qu'en France la partie industrieuse ayant acquis enfin de la force , avait pris le dessus sur la classe oisive; mais que les divers gouvernemens qu'elle avait établis ayant adopté les maximes des peuples à demi-sauvages , propagées par les écrivains du dix-huitième siècle, et n'ayant pas su respecter la propriété , avaient été successivement renversés.
Si maintenant on demande comment il se peut que des erreurs qui étaient partagées par la population presque toute entière de la France, aient entraîné la chute des divers gouvernemens qui les ont commises, nous répondrons que la nature agit sur les peuples comme elle agit sur les individus. Pour altérer leur constitution ou pour leur rendre la santé , elle n'a besoin ni de leur avis , ni même de leur volonté. Elle agit sur eux, mais sans eux et souvent malgré eux. Les attaques qui sont portées à l'espèce humaine par quelques individus , peuvent bien ralentir ses progrès; mais elle finit tôt ou tard par vaincre [46] les obstacles qu'on lui oppose. En dépit des erreurs et des faux systèmes qu'elle adopte , elle agit toujours suivant les lois de sa nature ou de son organisation. Quand elle souffre elle reçoit avec joie le médecin qui se présente pour la guérir; mais , si elle découvre un empyrique là où elle avait cru voir un médecin habile ; si elle s'aperçoit qu’au lieu d'un remède salutaire qu'elle attendait, on lui administre du poison, elle repousse la main ennemie ou mal habile qui le lui présente , et se venge quelquefois des imposteurs qui l'ont trompée.
La chute de tous les gouvernemens qui se sont succédés en France n'a donc rien qui doive surprendre. Ils ont tous attaqué le corps social en portant des atteintes continuelles à la propriété ; et ils ont éprouvé le sort de tout individu , de tout gouvernement, de tout peuple même qui veut lutter contre la nature humaine : ils ont succombé. Plusieurs autres causes ont cependant concouru à accélérer leur chute ; et il faut placer au nombre des plus influentes, le mépris que les hommes ont conçu pour eux-mêmes ou pour leurs semblables; et l'ignorance, ou , ce qui est pis encore, la fausse science des peuples sur l'organisation sociale.
Les peuples sauvages ont pour eux-mêmes une [47] estime qui va jusqu'à l'exaltation; mais ils méprisent souverainement tout ce qui n'est pas eux ou qui ne vient pas d'eux. La force des muscles étant le seul moyen qu'ils sachent employer pour pourvoir à leur subsistance., devient , par cela même, la mesure de l'estime qu'ils s'accordent mutuellement. Un Hercule est un dieu devant lequel chacun se prosterne. Un Newton ne serait qu'un vil esclave, indigne d'être admis parmi les forts. Le mépris excessif de ce qui est étranger , combiné avec une estime exagérée des forces musculaires , a produit chez tous les peuples à demi-barbares, un effet qui mérite d'être remarqué. Il a partagé l'espèce humaine en deux classes : celle des hommes libres ou des plus forts , et celle des esclaves ou des plus faibles. Les esclaves étant ordinairement des hommes pris à la guerre , ont été méprisés sous le double rapport d'étrangers et d'hommes faibles. Rejetés dans une classe inférieure , et avilis jusqu'à l'excès , ils sont en effet devenus vils. Les hommes libres, au contraire, exaltés par l'idée de leur supériorité , et par l'égalité qui doit naturellement régner entre des personnes qui s’occupent d'une même chose, ou qui s'adonnent au même exercice, ont tourné toutes leurs idées vers le genre de perfection qui convenait à leur position ; et [48] chacun a été obligé d'accorder à son semblable; ou pour mieux dire à son égal, l'estime qu'il avait pour soi-même. La distance qui s'est ainsi établie entre les hommes de ces deux classes , a été si immense , que les premiers n'ont pu être atteints par le mépris dans lequel les seconds ont été plongés. Le rapprochement des classes a produit chez les modernes un effet contraire.
La propriété , comme nous l'avons déjà observé , se compose des produits propres à satisfaire nos besoins ; et ces produits résultent de l'usage de nos facultés. Tout homme porte donc en lui-même un trésor qui doit suffire à sou existence , s'il est assez heureux ou assez sage pour savoir l'exploiter; et c'est à la découverte et à l'exploitation de ce trésor que nous devons l'abolition de l'esclavage. Aussitôt, en effet, que quelques hommes ont eu trouvé l'art de donner de la valeur aux choses par le seul exercice de leurs facultés, ils ont pu acquérir des possesseurs des terres , les objets nécessaires à leur existance. Or , plus ils ont perfectionné leur industrie , plus ils ont pu acquérir de ces choses; plus ils ont pu se multiplier. A mesure que la, classe industrieuse s'est accrue en richesse et en puissance , la classe des esclaves a dû s'éteindre, dans la même proportion; car si les possesseurs [49] des terres ont pu acquérir des produits industriels, ce n'est qu'en donnant en échange les produits agricoles dont ils nourrissaient leurs esclaves. Ce n'est donc point aux préceptes de la religion chrétienne , à la volonté des gouvernemens, ou à la générosité des seigneurs féodaux qu'il faut attribuer l'abolition de l'esclavage. La race des esclaves n'a point été affranchie : elle a péri dans l'avilissement et dans la misère; elle a péri comme elle eût péri jadis dans la Grèce et dans l'Italie, si on ne l'eût pas continuellement renouvelée avec des hommes libres.[26]
Les effets du développement de l'industrie ne se sont pas bornés à l'extinction des esclaves; ils ont réduit à rien l'influence de leurs maîtres. Après les avoir mis à même de consommer leurs produits agricoles , l'industrie leur a fourni les moyens de consommer la valeur même de leurs terres , et n'a laissé à la plupart d'entre eux de leur ancienne grandeur , qu'un insupportable orgueil, des prétentions ridicules , une insatiable avidité , et une incapacité absolue de rien faire d'utile ou de bon. Lorsqu'on voit, d’un [50] côté, les esclaves et les maîtres formés par la conquête tomber insensiblement dans la misère, et s'éteindre presqu'en même temps ; et que, d'une autre côté , l'on considère l'industrie créant des richesses et des peuples nouveaux , on est tenté de croire que les déluges dont la tradition se trouve chez tons les peuples , représentent les conquérans qui ont dévasté le monde ; et que la fable de Deucalion n'est que l'image de l'industrie qui prenant dans ses mains des matières brutes, en fait sortir des générations nombreuses et florissantes.
L’industrie , en détruisant la domination qu'exerçait une partie de l'espèce humaine sur l'autre, ou , pour mieux dire , en faisant disparaître les maîtres et les esclaves , a donc créé de nouveaux hommes , étrangers aux préjugés et aux habitudes des uns , et à l'avilissement ou à la bassesse des autres. Celui qui trouve dans l'exercice de ses facultés, les moyens de pourvoir à sa subsistance sans nuire à aucun de ses semblables, n'est l'ennemi de personne, et ne peut avoir pour ennemis que ceux qui veulent mettre des entraves à son industrie, ou lui en ravir les produits. Tout sentiment de domination lui est donc étranger, et il ne peut savoir ce que c'est que les haines ou les prétentions nationales. Ces baisons [51] indissolubles, décorées du nom de patriotisme, et formées jadis entre des hommes qui s'associaient , soit pour ravir une proie qu'ils devaient se partager , soit pour ne pas devenir eux-mêmes la proie des autres, ne sont pour lui qu'un sentiment faible ou nul, à moins qu'il ne s'agisse de repousser des sauvages extérieurs ou intérieurs. N'appréciant les hommes que par leur valeur intrinsèque, dans un prince il ne trouve qu'un homme, mais il trouve un homme dans un simple manœuvre. Il ne suffit pas , pour être estimé de lui , d'être Français , Anglais ou Allemand , il faut être bon à quelque chose. Comme il ne reçoit rien des autres sans leur donner en échange une valeur égale, il n'est sous la dépendance de personne; et par conséquent les vices de l'esclavage sont aussi étrangers à son caractère que ceux de la domination. La philosophie et la religion avaient condamné les distinctions arbitraires établies par la violence ou par le caprice; il n'appartenait qu'à l'industrie de les faire disparaître , et.de ne laisser d'autre inégalité parmi les hommes que celle qui résulte de leur propre nature.
Les rapports de haine ou d'amitié qui existaient jadis entre les hommes ont donc entièrement changé. Dans les républiques de l’antiquité, [52] un citoyen n'avait à admirer et à chérir que vingt ou trente mille hommes ; tous les autres étaient des objets de haine ou de mépris. C'étaient des ennemis qu'il fallait vaincre et dépouiller, ou des ennemis déjà vaincus , dépouillés et asservis. Les sentimens d'affection de citoyen à citoyen , devaient avoir une grande énergie, d'abord , parce qu'ils s'étendaient sur peu de personnes , et , en second lieu , parce que l'état ne pouvait se maintenir que par l'union intime de ses membres. Les sentimens de haine devaient avoir également beaucoup de force , parce qu'on se trouvait dans un état d'hostilité continuel avec tous les peuples, et qu'on se battait pour savoir si l'on serait maître ou esclave. Tout homme qui était membre de l'état, devait avoir une grande importance , et la perte d'un général , pour si peu qu'il fût habile, devait être considérée comme une calamité publique.
Dans les états modernes c'est autre chose. Les hommes industrieux ont pour amis tous ceux qui respectent leur industrie , et qui n'en consomment les produits qu'en leur donnant en échange une valeur égale; ils ont pour ennemis tous ceux qui consomment leurs produits industriels sans leur en rendre la valeur. Mais ces amis et ces ennemis ne se trouvent pas réunis en groupes, et séparés comme autrefois par les frontières des états. Ils sont répandus en quelque sorte sur toute la surface du globe , et il n'est pas facile de les distinguer les uns des autres. En considérant les choses d'un peu haut, on croirait qu'il n'existe en effet au monde que deux nations; celle des hommes industrieux ou utiles , et celle des hommes nuisibles et dévorans.
L'affection et la haine des hommes n'ont donc pas , comme autrefois , un objet distinct et déterminé ; ce sont des sentimens vagues qui, par par (sic) cela même qu'ils ne portent sur rien de précis , et qu'ils s'étendent sur une multitude immense d'individus, ne peuvent avoir aucune énergie. Jadis les malheurs d'un citoyen pouvaient mettre tout un peuple en mouvement; aujourd'hui un homme produit peu d'effet sur ses concitoyens par le tableau de ses infortunes; c'est peu pour s'intéresser à lui on pour l'abandonner, de savoir s'il est ou non soumis au même gouvernement que soi; le point essentiel est de savoir s'il est ami ou ennemi, c'est-à-dire si l'on a avec lui des intérêts communs ou des intérêts contraires. Il est tel pays au monde où il suffifirait qu'un homme se présentât eu livrée ou en costume de moine pour être délaissé de chacun. Le titre de citoyen qu'il pourrait ajouter à sa [54] qualité ne serait peut-être qu'une raison de plus pour le mépriser ou pour le haïr.
Chez quelques peuples anciens la valeur réelle ou absolue des hommes était très-petite; mais leur valeur relative était immense. Chez les modernes, c'est tout le contraire : les hommes ont une assez grande valeur réelle; mais leur valeur relative est si petite qu'elle est à peine aperçue, et qu'elle ne forme entre eux aucun lien.[27] L'adulation peut bien dire encore que le [55] salut d'un peuple dépend de l'existence de tel homme ou même de tel enfant; elle peut bien dire qu'une nation toute entière est prête à s'immoler pour la défense ou pour la gloire d'un individu; mais ce langage, transmis de père en fils à nos gentillâtres par les sauvages de la Germanie,[28] n'est pas compris des peuples civilisés , et ne peut en imposer à personne. Ceux qui l'écoutent n'en sont pas plus la dupe que ceux qui le tiennent; les uns et les autres savent bien qu'un savant, un guerrier , ou un prince de moins chez un peuple , ne mettent pas ce peuple en péril. Des expériences récentes leur ont prouvé que lorsqu'il s'agit de se défendre, les empereurs et les maréchaux ne sont pas plus habiles que les nations elles-mêmes. Relativement à la masse des hommes civilisés, les plus grands personnages sont donc aujourd'hui fort petits , et leur importance se réduit à peu de chose. Mais que sera-ce des hommes ordinaires? Que sera-ce de ceux qui traversent la carrière de la vie sans être même aperçus ? Depuis que chacun trouve en soi-même les moyens de [56] conserver son existence , un individu , quel qu'il soit, est d'une utilité si bornée pour un autre, que sa perte est à peine comptée pour quelque chose, si ce n'est dans le sein de sa famille ou parmi le petit nombre de ses amis.
Nous avons déjà remarqué que , chez les anciens , il y avait une telle distance entre les maîtres et les esclaves, que le mépris dont ceux-ci étaient couverts ne pouvait jamais réjaillir sur ceux-là. Ce mépris attaché aux esclaves les suivait même dans l'état de liberté , lorsqu'il leur était permis d'y arriver ; car alors ils prenaient un nom particulier qui ne leur permettait pas de se confondre avec les hommes libres. Le respect attaché à la qualité de ceux-ci n'était donc point détruit ou affaibli par la confusion des classes. Chez les peuples modernes , qui ne connaissent pas l'esclavage domestique , les fonctions que remplissaient autrefois les esclaves, doivent être confiées à des personnes libres : or, beaucoup de ces fonctions supposant un caractère vil, ceux qui les remplissent sont nécessairement avilis. Mais , comme en général on est obligé de payer en argent ce qu'on refuse de payer en estime , ceux qui exercent des emplois méprisables font souvent en peu de temps des fortunes considérables. Ils abandonnent alors le métier [57] dans lequel ils se sont enrichis , et portent dans un rang plus élevé leur fortune et leur bassesse. Le mépris ne pouvant plus les poursuivre à travers leur déguisement, se répand presque toujours sur toute la classe dans laquelle ils entrent. Il arrive alors ce qu'on voit quelquefois dans des sociétés particulières. Si dans un nombre d'hommes respectables, mais inconnus, on sait qu'il existe un seul misérable , cela suffit pour que la méfiance se porte sur tous , et que l'estime ne puisse se reposer sur aucun. L'abaissement subit des fortunes produit le même effet qu'un avancement trop rapide; il engendre le mépris pour le commun des hommes. L'infortune est ordinairement la route qui conduit à l'infamie; et il est difficile d'estimer beaucoup celui à qui il ne manque pour être un homme méprisable , que d'être un homme ruiné.
Les causes de dépréciation relative, pour tous les individus dont se compose l'espèce humaine , existent chez tous les peuples qui ont déjà fait quelques progrès dans la civilisation , mais qui conservent encore des préjugés et des habitudes de barbarie. Il en est d'autres qui sont particulières à la France, et qu'il convient d'exposer , si l'on veut savoir comment elle est arrivée au point où elle se trouve.
[58]
Les progrès de l'industrie , en faisant dépendre le sort de chaque individu de l'exercice de ses facultés productives , et en détruisant de cette manière les causes de guerre de peuple à peuple, éteignent les haines nationales , et relâchent , ainsi que nous l'avons dit , les liens que produit entre les hommes d'un même état, le besoin d'attaquer ou de se défendre. Mais , dans un pays qui n'est qu'à demi civilisé , le peuple peut se diviser en deux partis : l'un peut vouloir dominer pour continuer de vivre sans rien produire ; l'autre peut se fatiguer de voir dévorer ses produits en pure perte. La classe improductive et dévorante peut aussi, lorsque les hommes industrieux sont asservis, se diviser en sections pour savoir quelle sera la partie qui dominera. Dans l'un et l'autre cas, aussitôt que les partis en viennent à une guerre ouverte, il se forme entre les hommes qui appartiennent à chacun , une liaison dont la force est toujours en raison de la haine que les partis se portent l'un à l'autre. Chacun des deux protège ses hommes quels qu'ils soient; mais aussi il se montre implacable pour tous ceux qui se trouvent dans les rangs opposés, quels qu'ils puissent être. Chacun a ses lois , ses mœurs , son langage, sa patrie- Il règne entre les individus qui le [59] composent la même union, le même desir de dépouiller l'ennemi, qu'entre les soldats des républiques des premiers âges; ce sont de vrais patriotes romains , avec cette différence cependant , qu'après la victoire, ceux ci n'égorgeaient pas leurs prisonniers.
Depuis que la révolution a commencé , la France a été presque constamment le théâtre sur lequel des factions de ce genre se sont ainsi déchirées , ou si elle a joui d'un calme intérieur apparent, pendant quelques années , ce calme lui a été plus funeste encore que les guerres civiles. A peine un parti a-t-il eu le dessus , qu'il s'est hâté de dresser une formule appelée Constitution , afin d'en imposer d'abord à la foule, et de préparer ensuite mieux à son aise les armes avec lesquelles il voulait achever d'écraser les vaincus. Comme les triomphateurs avaient des intérêts communs, ils n'ont jamais, voulu d'autre garantie de la part des gouvernans , toujours choisis parmi eux , que cette communauté même d'intérêts, persuadés , sans doute , qu'ils pourraient ainsi mieux satisfaire leur vengence et leur cupidité. Lorsque les armes de destruction ont été créées , ceux qui en étaient les auteurs ont été abandonnés par l'opinion publique; et alors elles ont passé dans les mains [60] de leurs adversaires qui s'en sont servis à leur tour pour les accabler. Les excès dont ces actions et ces réactions ont été suivies , ont habitué le peuple à voir couler le sang humain pour des faits souvent innocens , et quelquefois même honorables. En voyant égorger ou proscrire sans examen ni jugement , des hommes qui lui paraissaient respectables , il a fini par se persuader qu'un homme ne valait pas même la peine d'être jugé, et que chacun pouvait bien se faire justice sans se soumettre aux lentes formalités des lois. Quelle idée d'ailleurs a-t-on pu se faire de la dignité de l'homme , dans un pays où il faut prendre cent fois plus de précaution pour décider de la propriété d'une bête que pour faire égorger un citoyen ? Les excès révolutionnaires ont avili l'espèce humaine ; le régime de Bonaparte est venu mettre le comble à la dégradation. Sous ce régime les massacres ont été faits en masse ; les hommes ont été vendus ou se sont vendus eux-mêmes comme de vils troupeaux; et l'on a vu des pères bâtir l'espérance d'une fortune sur l'horrible trafic qu'ils se proposaient de faire de leurs enfans.
Nous ne pouvons nous empêcher de faire observer ici que les gouvernans qui, à l'exemple de Bonaparte , fondent leur puissance sur la [61] dégradation des hommes soumis à leur autorité, font un très-mauvais calcul; car, lorsque l'espèce humaine est avilie à ses propres yeux, elle n'oublie pas que ceux qui la gouvernent sont aussi des hommes. Quelqu'opinion qu'ait d'ailleurs une personne d'elle-même et de ses semblables , elle tient toujours à la vie et à son bien être, et se détache d'un gouvernement qui ne lui donne aucune protection. Sa force est petite sans doute, et l'on peut mettre peu d'importance à sa haine ou à son amour; mais si les individus ont peu de force , les grandes masses en ont beaucoup; et de quoi se composent-elles? On croit ne rien faire quand on repousse la demande d'un malheureux qui n'est sorti de 1a foule que pour faire entendre quelques plaintes, et qui doit bientôt y rentrer pour disparaître sans retour. On se trompe : l'injure faite à l'un est ressentie par tous; ils peuvent bien garder le silence , et laisser opprimer celui qui ne peut pas se défendre. Mais si la justice des nations est tardive, elle n'en est pas moins sûre. L'homme qui a reçu une injure la pardonne quelquefois : l'espèce humaine est implacable; quand les oppresseurs lui échappent, elle se venge sur leur mémoire, et les poursuit jusques dans les derniers de leurs descendans.
[62]
L'indépendance que les hommes ont acquise par l'exercice de leur industrie , les ayant rendu moins nécessaires les uns aux autres , et les diverses causes que nous avons rapportées précédemment, les ayant en quelque sorte dégradés à leurs propres yeux , ils n'ont pas senti le besoin de se protéger mutuellement, ou du moins ils n'en ont pas eu la capacité. Il est résulté de là que les gouvernans sur l'esprit desquels les mêmes causes avaient agi, et qui avaient d'ailleurs à satisfaire leurs intérêts particuliers, ont cru qu'ils pouvaient se dispenser de protéger des individus, et qu'il n'y avait aucun danger à courir à satisfaire leurs vengeances contre des hommes que rien ne paraissait protéger. L'événement les a détrompés : il leur a constamment prouvé que les masses les plus considérables n'étaient que des individus , et. que si elles étaient inhabiles à défendre les oprimés , elles savaient au moins ne pas défendre les oppresseurs.
Les gouvernés comme les gouvernans ayant méconnu la propriété , et n'ayant su ni respecter ni faire respecter les personnes,[29] il était difficile qu'ils fussent capables de bien organiser [63] un gouvernement, ou de le maintenir après l'avoir organisé. Quand on ne connaît pas ou qu'on oublie le but auquel on veut arriver, il est difficile de ne pas s'égarer en route.
On a reproché aux philosophes du dix-huitième siècle d'avoir tout détruit, et de n'avoir su rien édifier. Ce reproche, en le supposant fondé, est fort insignifiant sous quelques rapports; mais il est très-grave sous beaucoup d'autres. Il est en effet des erreurs nuisibles (et presque toutes les erreurs le sont) qu'on peut détruire, sans qu'il soit nécessaire de les remplacer par quelque chose que ce soit. Il est aussi des pratiques qu'on peut attaquer, par la raison ou par le ridicule , sans avoir besoin de leur en substituer de nouvelles. Mais, quand il s'agit- d'organisation sociale, il n'en est pas tout à fait ainsi. Comme un gouvernement défectueux est préférable à une absence totale de gouvernement, on ne doit attaquer les institutions d'un peuple, lors même qu'elles sont vicieuses , qu'après; lui avoir donné les moyens d'en établir et sur-tout d'en maintenir de moins mauvaises ; autrement, on lui inspire, sans utilité, du dégoût pour ce qui existe, et l'on s'expose à le jetfer dans l'anarchie ou dans le despotisme , seuls états pour lesquels il ne faut ni lumières , ni talens , ni vertus.
[64]
Les écrivains du dernier siècle, quand ils ont parlé de gouvernement, n'ont peut-être pas gardé toute la circonspection qu'exigeait l'état d'ignorance dans lequel se trouvaient presque tous les peuples de l'Europe. Indignés des vices des gouvernemens sous lesquels ils vivaient, ils les out attaqués sans ménagement :. et comme ils n'avaient eux-memes aucune idée de l'organisation sociale; qui convenais aux modernes , .ils ont tourné leurs regards vers les peuples de l’antiquité. La beauté de quelques grands caractères dont les défauts étaient- cachés par la distance des temps, les a saisis d'admiration ; et cette admiration pour quelques hommes , leurs a fait prendre pour modèle les institutions sous lesquelles ils s'étaient formée. Ils auraient dû voir cependant que ces instituions, faites pour des peuples dans l'enfance , n’avaient pour, base que l’état .militaire , le pillage, et l’esclavage domestique ; que par conséquent elles ne pouvaient convenir à des peuples qui n’admettaient pas la servitude personnelle, et qui fondaient leur existence sur le progrès des arts , de commerce et de l'agriculture.
Les écrits de Rousseau ont été pour la plupart rédigés dans cet esprit. Le contrat social est devenu , en quelque sorte, le manuel des politiques [65] du siècle. Tout homme , après l'avoir lu, s'est cru en état de donner des lois à un peuple , et une .génération presque toute entière s’est ainsi trouvé engagée dans une route qui ne pouvait la conduire qu'à l'anarchie d'abord , et ensuite au despotisme. Un petit nombre d'hommes qui avaient mieux étudié la marche de la civilisation, s'étaient préservés de l'erreur commune; mais leur influence n'a jamais été assez forte pour arrêter le mouvement rétrograde imprime à l’esprit public. Le retour vers les républiques des premiers âges a commencé à se faire sentir dans l'assemblée constituante; il a été plus marqué dans l'assemblée législative, et il s'est montré avec la plus:grande énergie dans la convention nationale. Ainsi, plus la classe ignorante a pris d'influence, et plus les maximes de l'enfance des peuples ont acquis de force. Cependant, on n cru qu'on, avait beaucoup avancé, parce qu'on avait fait de grands pas en arrière.[30]
[66]
Ils ne manquait plus à la France, pour avoir une république dans le genre de celles de Sparte ou de Rome, que d'abandonner entièrement les arts et le commerce, d'avoir trois ou quatre cent millions d'esclaves domestiques , de trouver des peuples à piller pour nourrir ou vêtir une partie de la population, et de savoir se contenter de la jaquette de bure, du lit de jonc et du brouet noir du Spartiate. Il eût fallu avoir en outre quelques vertus, sans quoi on aurait bien pu se trouver sous une république comme celles d'Alger ou de Maroc , qui du reste ressemblent beaucoup plus qu'on ne pense aux républiques de Rome ou de Sparte. Ces moyens ayant manqué, on est tombé dans des désordres épouvantables , on a sacrifié des hommes sans nombre , et les réformateurs ont eu le sort de tous ceux qui veulent soumettre les peuples à des lois ou à des opinions que leur caractère repousse : ils sont morts victimes de leurs propres folies.
Les peuples sauvages ne sachant pas diriger les forces productives de la nature , sont obligés de vivre de ce qu'elle produit quand elle est abondonnée à elle-même, ou de ce qu'ils ravissent à leurs voisins, ce qui leur donne ces habitudes de rapine et d'oisiveté que nous appelons militaires , et qui se sont fait remarquer chez tous [67] les peuples au moment où ils sont sortis de la barbarie. Quelques-uns de ces peuples, tels que les Spartiates ou les Romains, les ont même conservées jusqu'à leur extinction ou à leur asservissement. Cependant, quoique nées de la barbarie, ces habitudes n'en avaient pas moins fait l'objet de l'admiration des modernes , et elles avaient été regardées en France comme un exemple qu'on ne pouvait se dispenser de suivre. L'assemblée constituante , tout en déclarant que la nation française ne ferait jamais de guerre offensive,, avait transformé les gardes des communes en gardes nationales , et leur avait donné un costume entièrement militaire.[31] Plus tard, la convention avait décrété que tous les Français étaient soldats, et qu'ils seraient tous exercés au maniement des armes.
La passion pour l'art militaire, et l'affaiblissement ou l'extinction du courage civil ont produit un effet singulier. En donnant à un chef d'armée les moyens de s'emparer des rênes du Gouvernement, elles ont fait sortir la nation de la fausse route dans laquelle elle s'était aveuglément précipitée, et l'ont jetée dans une route [68] également fausse. Les républiques des premiers âges ont cessé d'être prises pour modèles ; mais comme Bonaparte était trop ignorant pour voir que, dans l'état actuel de la civilisation, la passion des armes n'était qu'une aberration de l'esprit humain; comme il ne concevait pas d'ailleurs une organisation sociale fondée sur la nature même de l'homme , il n'a abandonné les maximes républicaines que pour embrasser les maximes du gouvernement féodal. Rousseau a cessé dès ce moment d'être le guide des législateurs de la France, et c'est Montesquieu qui l'a remplacé. Ainsi, au lieu de rétrograder de deux ou trois mille ans, on n'a plus voulu reculer que de deux ou trois siècles. Alors a été formé ce gouvernement, dans lequel on a fait entrer tout à la fois les simulacres des institutions républicaines des anciens, des institutions de la chevalerie du moyen âge ou de la féodalité, et des institutions des temps modernes; assemblage monstrueux, qui en réalité ne comprenait qu'un chef et des soldats, mais qui en apparence réunissait en un seul corps les choses les plus incohérentes
cujus , velut aegri somnia ,
vanœ
Fingentur
species , ut nec pes , nec caput uni
Reddatur
formae.
Depuis le commencement de la révolution [69] jusqu'à la chute du gouvernement impérial, on a donc marché d'erreur en erreur , sans pouvoir trouver le point auquel il convenait de s'arrêter. Et remarquons que les hommes qui ont ainsi pris une fausse direction , et qui l'ont ensuite imprimée aux autres, n'étaient pas des ignorans sortis de la dernière classe du peuple ; c'étaient des philosophes, des jurisconsultes, des médecins, des prêtres, des généraux, en un mot des savans de toutes les classes; c'étaient des hommes dont l'éducation avait été soignée, et qui en général pouvaient ne pas être mal intentionnés; mais, au lieu d'étudier les choses, ils avaient appris des systèmes, et sans examiner quel était l'état de la civilisation ou les besoins de leurs contemporains, ils faisaient des lois qui ne pouvaient convenir qu'à des peuples d'un autre âge.
Les hommes les plus éclairés n'ayant eu pour la plupart aucune idée arrêtée sur le gouvernement qui convenait aux peuples modernes , et la multitude étant tout à fait ignorante à cet égard , faut-il s'étonner qu'aucune institution n'ait pu tenir ? Si, quand une constitution est faite , les gouvernés sont incapables d'en apprécier les avantages, et si les gouvernemens eux-mêmes ne trouvent aucun inconvénient à la violer, ou aucun [70] bénéfice à l'observer, comment pourrait-elle n'être pas détruite ? Donner une constitution à un peuple ignorant, n'est-ce pas faire présent d'un livre de maximes à un enfant ? il l'accepte avec joie , le parcourt avec rapidité, s'il sait lire, et le jette ensuite pour ne plus s'en souvenir.
Cependant, quand les calamités arrivent, on murmure , on crie, on se révolte, on renverse le gouvernement; comme si les hommes qui gouvernent n'étaient pas eux-mêmes tirés du sein de la nation ! comme s'ils pouvaient être plus éclairés ou plus honnêtes gens qu'on ne l'est communément dans leur pays! comme s'ils devaient donner une grande attention aux affaires de l'Etat, quand ceux qui y sont le plus intéressés n'y prennent seulement pas garde ! L'opinion publique environne toujours de quelque faveur celui qui attaque un ministre impopulaire : quelquefois , en effet, une pareille attaque prouve au moins du courage; ce serait cependant une question assez curieuse à traiter que celle de savoir lequel est le plus digne de pitié, du ministre qui débite publiquement et sciemment des inepties pour faire adopter une fausse mesure; de l’assemblée qui l'écoute avec patience, et qui adopte la mesure proposée sachant qu'elle est mauvaise; ou du peuple qui à choisi les membres de cette [71] assemblée par une lâche complaisance , et qui n'ose pas ou qui ne sait pas les désavouer, quand ils s'écartent de leur devoir.
Le défaut de connaissance d'une organisation sociale propre à l'état actuel de la civilisation , et l'incapacité de la multitude, quand il s'est agi de prendre une résolution dans les circonstances difficiles, suffisaient pour rendre instables toutes les institutions imaginables; mais rien n'a favorisé la marche du despotisme comme les craintes produites par las excès de la révolution , et les fausses idées sur la valeur militaire.
Tel homme aura bravé cent fois la mort sur un champ de bataille , qui tremblera à l'aspect d'un commissaire de police , et ne pourra résister à l'appât d'un ruban ; tel autre se sera caché au jour du combat , qui ne sera ébranlé ni par les menaces , ni par les caresses d'un tyran , et qui marchera à l'échafaud sans hésiter. Le courage militaire n'est donc pas le même que le courage civil ; le premier , quand il est destitué de toute qualité morale , fait les conquérans et les esclaves , le second fait les hommes libres; l'un peut se concilier avec toute sorte de vices , l'autre n'en admet peut-être aucun; et l'on peut avoir observé que , quoiqu'ils ne s'excluent pas , celui-ci a toujours été d'autant plus rare , que [72] celui-ci a été: plus commun. Un peuple qui triomphe , est donc bientôt un peuple esclave: la France a déjà fait l'épreuve de cette vérité; nous desirons que d’autres ne la fassent pas à leur tour, et qu'après de brillans triomphes , ils ne soient pas réduits à porter envie aux vaincus. L'affaiblissement, on pourrait presque dire l'extinction du courage civil,. et le développement excessif du courage militaire, ont donné aux gouvernemens de la France les moyens les plus efficaces de renverser les lois destinées à mettre des bornes à leur pouvoir.
Le spectacle des excès de tout genre commis pendant la révolution a frappé de terreur presque tous l'es hommes qui en ont été témoins, et. qui ont couru ou cru courir quelque danger. Cette impression a été si forte et si long-temps soutenue qu'elle est devenue ineffaçable , et qu'elle leur fait encore voir avec effroi tout ce qui peut leur rappeler ces temps de calamité. Ils ont entendu les cris de liberté, d'égalité, de droits de l'homme , de constitution , pendant qu'une populace effrénée se livrait aux crimes les plus atroces ; et il s'est formé dans leurs esprits une association d’idées qui rend à leurs yeux toutes ces choses inséparables, et ne leur permet plus de voir qu'elles n'ont rien de commun entre [73] elles. Locke avait observé qu'un homme qui avait souffert de la douleur dans un certain lieu, qui avait été malade ou qui avait vu mourir son ami dans une telle chambre , ne pouvait plus séparer l'idée du lieu, de l'idée de la douleur qu'il y avait éprouvée , et qu'il lui était aussi impossible de souffrir l'une que l'autre.[32] Il en est de même de la plupart des personnes qui ont traversé la révolution; les choses qu'elles s'imaginent avoir vues en même temps, ne peuvent plus se présenter séparément à leur esprit. Vouloir qu'elles les désunissent, c'est leur demander une chose qui n'est pas en leur puissance ; tant qu'elles entendront parler de liberté , d’égalité, d'assemblées populaires , elles se rappelleront les crimes dont elles ont été témoin, et ressentiront les terreurs qu'elles ont alors éprouvées.
Ces terreurs profondes ont produit une aliénation totale d'esprit chez beaucoup de personne;[33] des maladies graves chez beaucoup d'autres , et elles ont détruit tout sentiment d'énergie chez presque toutes. La crainte, lorsqu'elle a été [74] extrême , est de toutes les passions celle qui dure le plus long-temps , et qui se renouvelle avec le plus de facilité. « Pour juger de son influence , dit un médecin allemand, on n'a qu'à se représenter l'homme saisi d'épouvante: les sens internes , la perception , le souvenir , etc., perdent leur force, il est comme frappé de paralysie; il regarde sans voir , il entend sans comprendre. Tout le corps tremble ou se roidit; la figure devient rouge ou pâle , selon que le sang est arrêté à la surface ou dans l'intérieur : la respiration est gênée , le mouvement du cœur est suspendu , et les pulsations ou s'interrompent ou éprouvent des irrégularités. Le foie paraît également troublé dans ses fonctions ; la bile s'arrête ou produit un débordement, auquel succèdent parfois des vomissemens ou des évacuations d'autres matières , que suspendent souvent les spasmes.
» Quelquefois la rupture des vaisseaux dont les parois sont faibles ; dans d'autres cas leur extension , celle du cœur , ou quelques anévrismes , sont la suite de ces violentes motions : on a vu jusqu'à des apoplexies, et même la mort, frapper comme la foudre les êtres qui se trouvaient atteints d'un pareil effroi. La révolution française , qui a excité des craintes si justes et si [75] multipliées , a fait remarquer aussi un plus grand nombre de maladies pareilles ».[34]
Si les terreurs produites par les excès révolutionnaires ont produit une telle désorganisation physique chez un grand nombre de personnes; si elles ont produit une aliénation totale d'esprit chez plusieurs, elles ont causé , ainsi que nous l'avons déjà observé, de fausses associations d'idées chez le plus grand nombre. Lorsque des idées incohérentes sont tellement liées .entre elles qu'il n'est plus possible de les séparer , et qu'elles se rapportent aux choses les plus communes de la vie , la personne qui en est possédée se trouve atteinte de folie. Ainsi , par exemple, qu'une femme soit frappée de terreur, et que, dans son effroi, elle entende prononcer par les objets qui l'épouvantent, les mois de père, de mère , de frère, d'enfant; si ces mots, ou les idées qu'ils rappellent, ne peuvent plus se présenter à son esprit sans être accompagnés de l'idée des dangers qu'elle a courus, et sans lui faire éprouver les sentimens de terreur dont elle â été frappée , elle sera considérée comme ayant l'esprit aliéné. Mais celui qui ne peut [76] entendre les mots de liberté, d’égailté , de constitution, etc., sans que les idées des crimes de la révolution, et des dangers qu'il peut avoir personnellement courus se présentent à son esprit , ne se trouve-t-il pas atteint d'une folie duu même genre ? Si cette folie nous frappe moins , c'est d'abord parce qu'elle n'influe point sur la conduite ordinaire de la vie ; en second lieu, parce qu'elle est beaucoup plus commune que la première; et enfin, parce que pour la reconnaître, il faut être capable d'apercevoir l'incohérence des idées dont elle se forme.
Continuons notre parallèle , et supposons qu'un grand nombre de femmes atteintes de la folie dont nous avons parlé , se trouvent réunies dans un même lieu : elles pourront se conduire d'une manière fort raisonnable , pourvu qu'aucune des idées associées dans leurs esprits ne se présente à elles; mais que le mot fatal qui les aura frappées soit prononcé , toutes les idées dont l'association forme leur folie se présenteront à l'instant à elles, et reproduiront tous les symptômes précédemment décrits ; les sens internes,. la perception, le souvenir perdront leur force; elles seront comme frappées de paralysie; elles regarderont sans voir, entendront sans comprendre. Si, dans ce moment d'effroi , l'idée de leurs forces [77] vient se joindre aux idées qui les épouvantent, elles passeront de l'accablement à la fureur; elles pousseront des cris de rage , voudront égorger tout ce qui se présentera devant elles; et, dans leur impuissance, elles vomiront les injures les plus atroces sur ceux quelles ne pourront pas atteindre.
Si nous substituons à ces femmes les hommes atteints de la folie analogue , nous verrons que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Tant qu'ils se croîront'les plus faibles , les mots terribles qui les auront frappés, les feront pâlir d'effroi , et leur enlèveront l'usage-de tous leurs sens; ils regarderont sans voir, écouteront sans entendre; leur voix ne produira que dés sons inarticulés , ou dès mots décousus et sans idées. Mais si :au contraire ils viennent à éprouver un sentiment de force, ils entreront en fureur, dresseront des listes de proscriptions, voudront égorger tous les hommes que leur imagination effrayée leur présentera comme des ennemis.[35] Chercher à ramener ces malheureux: par le raisonnement, ou vouloir les punir des excès commis dans leur démence , serait une folie ou une cruauté. On ne peut avoir pour eux que ce sentiment de pitié qu'inspire à un homme calme et compatissant, la présence d'un de ses semblables privé de l'usage de la raison.[36]
Les excès de la révolution , outre l'antipathie qu'ils ont inspirée à un grand nombre de personnes [79] pour des institutions utiles, ou même nécessaires , ont rendu timides les hommes éclairés dont ils n'ont pas altéré le jugement. La plupart ont vu périr leurs amis pour la défense d'un peuple qui a paru insensible à leur perte, et qui n'a jamais fait le moindre mouvement pour les sauver ; ils ont vu que toutes les fois qu'il a été question de verser du sang, des adresses sont arrivées de toutes parts pour enflammer les fureurs des tyrans, ou pour les justifier, mais que jamais une voix courageuse ne s'est élevée en faveur des victimes; et il est difficile qu'après de si funestes expériences , et lorsque l'âge a amorti les passions qui seules peur vent produire un grand dévouement, il leur soit resté assez d'énergie pour soutenir une cause dont la défense a si mal réussi à leurs amis. Plusieurs se sont trouvés engagés dans les affaires publiques aux époques les plus déplorables; et quoiqu'ils n'aient point participé aux mesures funestes qui ont été prises , ou même qu'ils s’y soient opposés de tout leur pouvoir, il a suffi que leurs noms s'y soient trouvés mêlés , pour que cela ait dû leur inspirer une certaine méfiance d'eux-mêmes , et les rendre plus timides.
Le courage civil ainsi affaibli par les excès commis durant les troubles révolutionnaires, a été ensuite presque entièrement détruit par l'exaltation du courage militaire. Une des bizarreries les plus remarquables de la révolution de France, c’est l'opposition constante qui a régné entre les idées, les habitudes et les sentimens de la plupart des Français. On aurait voulu vivre en paix avec tous les peuples , on sentait le besoin de se livrer à des travaux utiles , et l'oisiveté était considérée comme un vice lâche et honteux; mais on avait en admiration les costumes, les exercices , ou les évolutions militaires , un beau corps d'armée excitait l'enthousiasme des gens les plus froids, et tel qui venait de se ruiner pour se faire remplacer dans le service, allait admirer le corps dont la formation était cause de sa ruine. D'une part, on déplorait le sort des peuples réduits à la triste nécessité de se défendre , on s'intéressait à eux, on aurait voulu les secourir; mais de l'autre, on admirait les armées qui allaient les combattre , on s'enorgueillissait de leurs victoires, les rubans qui étaient la récompense de leurs exploits étaient un objet de vénération et d'envie. D'où provenaient ces absurdes contradictions ? de ce qu'on jugeait en barbares, et de ce qu'on sentait en hommes civilisés: on avait la tète remplie d'idées grecques, romaines ou germaines, et on était affecté de sentimens qu'on ne devait qu'à soi. Or , il est impossible qu'il existe quelque courage civil, et, par conséquent [81] quelque liberté là où se trouve un gouvernement assez stupide pour honorer l'esprit, d'envahissement et de rapine , et un- peuple, assez sot pour s'extasier devant des parades de, théâtre qui le ruinent , ou pour accorder son estime à des gens payés et honorés pour l'asservir.[37]
Si l'on considère maintenant que la propriété a été constamment méconnue et que l'espèce humaine a été également méprisée par les seigneurs féodaux , par les princes dont le pouvoir était absolu , et par les gouvernemens populaires$ que les rois , les nobles, les prêtres , les philosophes [82] et les peuples mêmes , n'ont guère mieux connu les uns que les autres le but du gouvernement; que de tous les côtés on a commis des erreurs également graves, et que ces erreurs, produites par les révolutions arrivées dans la nature humaine, étaient inévitables, on ne sera plus surpris qu'aucune institution n'ait pu tenir, et qu'en changeant de gouvernement on n'ait jamais changé que de despotes. Peut-être aussi que les hommes seront portés à avoir un peu plus d'indulgence les uns pour les autres, et qu'ils finiront par comprendre que pour jouir d'une bonne organisation sociale , il faut posséder assez de capacité pour la concevoir, et assez de courage pour la maintenir, quand elle est établie. S'il y a de mauvaises lois , c'est parce que la masse des peuples est incapable d'en apprécier de bonnes ; s'il y a des ministres corrupteurs , c'est parce qu'il y a des hommes à vendre : il n'y aurait point de despotes, si personne ne voulait être esclave.
On s'est imaginé que pour avoir la liberté, un peuple n'avait besoin que d'une bonne constitution; c'est une erreur dont il est temps de se désabuser; les lois ni les constitutions ne créent rien, elles déclarent ce qui est, et le garantissent ou le prohibent selon le besoin. Mais il n'est pas [83] plus en leur pouvoir de transformer des esclaves en hommes libres, ou des hommes libres en esclaves, qu'il n'est au pouvoir d'un individu de donner à un enfant la force d'un homme, ou de rendre un homme semblable à un enfant. Vaincre tous les obstacles qui s'opposent à l'accomplissement de nos désirs, ce n'est pas la liberté, car dans ce sens nul homme ne saurait être libre ; mais avoir une volonté inébranlable de remplir ses devoirs dans toutes les circonstances de la vie , voilà ce qui la constitue ; partout où l'homme porte cette volonté, il est libre ; partout où cette volonté l'abandonne, il est esclave.[38] Qu'importe, par exemple, qu'on nous permette ou qu'on nous interdise de publier nos pensées, si nous sommes assez lâches pour ne pas oser dire la vérité quand la loi nous y autorise, ou si nous n'avons pas le courage de la faire entendre lorsqu'il y a quelque danger. Vous demandez qu'on vous permette de faire connaître par écrit vos opinions , et vous n'osez pas les faire connaître de vive voix ! pensez-vous qu'il existe une loi qui vous oblige à soumettre vos paroles à la censure préalable d'un agent de police, ou attendez-vous qu'un dieu [84] vienne vous délier la langue ? Vous avez peur de l'arbitraire ! mais si vous le craignez pour vos paroles , pourquoi ne le craindriez-vous pas pour vos écrits ? dites plutôt que vous êtes né pour être esclave , et que vous chargez les autres de votre propre honte. Non , ce n'est pas à la force qu'il faut attribuer l'asservissement des peuples, c'est à l'ignorance , à la cupidité , à la vanité , à la sottise et sur-tout à la lâcheté. Bonaparte ne se fut jamais rendu remarquable et fut mort peut-être inconnu, dans un pays où il n'eût pas trouvé tous ces vices à mettre en œuvre.
Mais faut-il donc désespérer de la liberté des peuples ? Gardons-nous de le penser : le temps emporte les vices et les erreurs avec les générations qui en ont été infectées. Les peuples ne sortent de la barbarie que par degrés , et tous les efforts qu'ils font pour s'en dégager sont douloureux. La puissance des seigneurs féodaux ne pouvait peut-être s'éteindre qu'en se concentrant dans les mains d'un seul; le pouvoir absolu , résultat nécessaire de cette concentration, ne pouvait s'établir sans enfanter ou sans laisser exister un grand nombre de vices et d'erreurs; et l'autorité ne pouvait ensuite sortir des mains des rois pour passer dans les mains des peuples, sans que ces vices et ces erreurs produisissent une explosion terrible , [85] et sans que les courages les plus fermes en fussent ébranlés.[39] Les Anglais, en cessant d'être soumis à la domination de Cromwel , se précipitèrent sous le joug des Stuarts : le parlement alla jusqu'à renoncer à faire usage des armes défensives , ce qui équivalait, dit Hume, à une renonciation absolue à toutes les limitations de la monarchie , et même à tous les privilèges de la nation. Mais à peine la génération dont les troubles civils et le despotisme militaire avaient détruit le caractère, fut éteinte, que les principes de liberté proclamés antérieurement reparurent avec une force nouvelle, et apprirent aux Stuarts qu'un gouvernement est bien près de sa ruine , quand il prend pour règles de conduite les maximes qui lui sont suggérées par des esprits malades.
En France, on verra de même disparaître successivement toutes les causes qui ont occasionné la chute des institutions sociales qu'on y avait établies. Les philosophes, qui, jusqu'au commencement de la révolution , s'étaient occupé [86] de politique , avaient presque tous considéré le gouvernement comme une fin à laquelle tout devait être subordonné. Aujourd'hui on ne le considèré plus que comme un moyen ; la fin et le bien-être des peuples. Cette différence , dans la manière d'envisager les choses, fait prendre à la législation une direction nouvelle, et peut seule mettre un terme aux révolutions; car les hommes ne consentiront jamais à se considérer comme une matière brute, destinée à mettre en œuvre tel ou tel système politique. Lorsque des lois leur seront données, ils ne demanderont pas si elles conviennent à une monarchie , à une républiqiue, ou à un gouvernement despotique ; ils demanderont si elles conviennent à leurs intérêts; et ce n'est que lorsqu'elles s'y rapporteront qu'elles auront de la stabilité.
La propriété, sans être guère plus sacrée qu'elle ne l'a été jusqu'ici, est cependant un peu mieux connue. Si l'on se permet encore de frapper de stérilité les facultés productives de l’homme,[40] du moins on respecte jusqu'à un certain point les choses qu'on lui permet de produire ; et s'il n'existe aucune proportion entre la part qu'il est tenu de donner de ses produits et les services qu'on lui rend en échange , cela tient à des circonstances qui tôt ou tard finiront par disparaître. La confiscation , d'ailleurs , est abolie; et cela seul est un avantage inappréciable.
Le respect pour soi-même et pour les autres , respect sans lequel il ne peut exister aucune liberté , se rétablira à mesure que les causes qui l'ont affaibli s'éloigneront de nous. Les guerres civiles, les meurtres, les spoliations, les imprisonnemens illégaux , les tribunaux d'exception , enfin toutes les choses qui avilissent les hommes [88] en leur donnant une existence précaire , disparaîtront avec les factions qui les ont enfantées; et ces temps ne sont pas éloignés : déjà la génération qui se présente, étrangère à tous les partis, flétrit ce que chacun d'eux a de criminel; et la plupart des hommes qui ont déshonoré leur pays par leurs excès ou par leur bassesse , peuvent, en descendant à la tombe, entendre le jugement de la postérité.
L'indépendance que chaque homme acquiert par l'exercice de ses talens où de son industrie, a dissout pour toujours ces liaisons intimes qui existaient autrefois entre les citoyens d'un mème état ; mais les individus ont gagné en qualité d'hommes beaucoup plus qu'ils n'ont perdu en qualité de citoyens: s'ils ont des amis moins ardens, ils en ont un plus grand nombre ; s'ils ne sont pas aussi bien défendus dans leur propre pays , ils ont beaucoup moins à craindre des peuples étrangers , ou pour mieux dire, il n'y a plus de peuples étrangers pour les hommes qui savent se rendre utiles à leurs semblables. D'ailleurs, plus l'organisation sociale se perfectionne, et plus les moyens honteux de s'enrichir deviennent rares : on pourrait donc , par l'extinction de la classe oisive et dévorante , arriver à ce point que la fortune de chacun serait presque en raison directe de son [89] mérite , c'est-à-dire de son utilité ; et qu'à quelques exceptions près, il n'y aurait de misérables que les gens vicieux ou inutiles. Alors l'estime reprendrait sa force parmi les hommes ; et ils seraient plus portés à se protéger mutuellement , ou pour mieux dire , ils n'en auraient presque plus besoin.
En France, comme dans beaucoup d'autres pays, la masse du peuple est encore peu instruite sur l'organisation sociale la plus convenable aux peuples modernes ; mais si on ne voit que confusément ce qui convient, on voit du moins d'une manière très-claire ce qui ne convient plus; et l'on est aussi peu disposé à se précipiter dans le régime de la féodalité , qu'à revenir à un système de démagogie qui dissoudrait le corps social , ou à un système militaire qui amènerait de nouveau la misère et la ruine de l'État. Un avantage inappréciable qu'a la France sur les autres peuples , c'est que l'intervalle qui sépare le régime féodal du gouvernement représentatif est franchi, et qu'il n'y a plus moyen de rétrograder. Par suite de cette transition, les intérêts des hommes les moins instruits se trouvent étroitement liés aux intérêts des hommes les plus éclairés et les plus déterminés à soutenir une forme de gouvernement qui protége tout ce qu'il [90] y a d'utile, et qui ne laisse pas aux abus le temps de prendre racine. De faux systèmes peuvent encore être produits; mais les hommes intéressés à les faire adopter , ont manifesté des prétentions si contraires aux intérêts du peuple, que la méfiance qu'ils inspirent aux esprits même les plus bornés , sert mieux la cause de la liberté que tous les raisonnemens possibles : pour un peuple qui a pris en haine , on pourrait même dire en horreur , toute institution féodale , c'est un mauvais signe de ralliement qu'un titre de marquis ou de baron.
L’esprit militaire, si dangereux pour la liberté, a perdu tout sou empire. Presque tous les hommes , dont la violence avait fait des instrumens de devastation et d'asservissement, sont rentrés dans la classe industrieuse à laquelle on les avait arrachés. En reprenant des habitudes d'ordre et de travail, ils se convaincront qu'il y a fort peu de gloire à vivre dans l'oisiveté, et au moyen de ce qu'on ravit à ses semblables, ou de ce qu'on aide à leur ravir. Après avoir appris de leurs concitoyens à respecter les propriétés des autres , ils pourront à leur tour leur enseigner à défendre leurs foyers, et à repousser toute force qui menacerait leur pays d'asservissement. Ainsi, la destruction d'une armée permanente trop [91] nombreuse , nuisible peut-être au moment où elle a en lieu , aura eu néanmoins le triple avantage de diminuer les forces du pouvoir arbitraire, d'augmenter la classe des personnes industrieuses, et de leur donner plus de capacité pour se défendre , dans le cas où elles auraient besoin d'empêcher que leurs rjchesses devinssent la proie de leurs ennemis. On doit d'ailleurs aux armées françaises cette justice qu’elles ont eu toujours horreur des guerres civiles; qu'à toutes les époques elles sont restées du côté de la nation contre les armées étrangères , et que si des généraux ont quelquefois trahi leur pays pour passer à l'ennemi , elles ont constamment abandonné les traîtres.
Les faux systèmes discrédités , l'esprit d'envahissememt détruit, et le spectacle des crimes de le révolution avant perdu sa funeste influence , toutes les idées saines reprennent leur empire , et chacun se sent assez de courage pour les défendre dès qu'il en a les moyens. Les fausses craintes et l'esprit de faction peuvent encore mettre quelques entraves aux progrès de l'esprit humain; mais le cercle des hommes peureux et des gens de parti se resserre de jour en jour; et le moment n'est peut-être pas loin où les uns et les autres sentiront qu'il n'est pas au pouvoir de quelques [92] individus de faire marcher les peuples en arrière.
Mais comment les Français jouiront-ils de quelque liberté civile ou politique , si l'indépendance nationale de la France est anéantie, et si des gouvernemens étrangers peuvent se mêler de ses affaires intérieures ? Cette objection est grave , sans doute; mais il ne faut pas lui donner plus d'importance qu'elle n'en mérite. Si tous les projets de paix perpétuelle qu'on a faits jusqu'à ce jour ont été jugé chimériques , quoique fondés sur l'intérêt commun des hommes , il serait difficile dé croire à la perpétuité d'une paix qui n'aurait pour but que l'inique asservissement d'une nation. Il peut bien convenir au gouvernement de tel peuple d'Europe que la France soit épuisée, et que toute influence de sa part soit anéantie ; mais ce qui convient à quelques-uns ne convient pas à tous. La maxime de Machiavel, d'asservir les peuples les uns par les autres en les divisant, est trop connue d'ailleurs pour être dangereux ; et ce n'est pas en Europe qu'un diplomate astucieux pourra trouver des Indiens.
Nota. Dans un second article nous développerons les moyens qui peuvent donner de la stabilité aux institutions des peuples modernes. Nous ferons voir que le premier est que chacun jouisse , dans l'ordre social , d'une influence et d'une considération proportionnées à sa valeur ou à son utilité absolue. (Voir la note de la page 54. )
Endnotes
[1] Si ta propriété, dira-t-on , n'est que le produit du travail de l'homme, les terres ne sont donc pas des propriétés. Si quelques personnes trouvaient l'objection spécieuse , qu'elles recherchent la cause première de la valeur des terres, ou qu'elles étudient l'économie politique; elles trouveront que cette valeur a été d'abord un produit
[2] Il faut même , pour que ce respect s'établisse, qu’un peuple soit assez avancé dans la civilisation , pour constituer un gouvernement durable.
[3] Nec arare terram , aut exspectare annum , tam facile persuaseris, quam vocare hostes et vulnera mereri: pigrum quin immò et iners videtur sudore adquirere, quod possis sanguine parari.(TACIT. de morib. ger., cap. xiv.)
[4] Je suppose que ces anciennes fortunes ont été créées par les personnes qu'on a asservies et attachées au sol dont on s'est emparé : il est impossible que des hommes qui n'ont jamais rien su produire , aient acquis de la fortune, autrement qu'en ravissant ce que d'autres avaient produite.
[5] Epistolœ Gregorii VII, lib. 11, Epist. V. Recueil des hist. de France. tom. xiv , pag. 582.
[6] Ib. , tom. xv, pag. 483.
[7] Vita Ludov. grossi, Recueil des hist. de France , tonm. 12 , pag. 31.
[8] Odericus Vitalis, hist. Eccl. , lib. xiii, Recueil des hist. de France , tom. xii , pag. 765.
[9] Epistola Petri venerabilis. Recueil des hist. de France, tonm. 15, pag. 651.
[10] Epistotœ Ludovici VII, Recueil des hist. ds France, tom. 16, pag. 109. Ces faits, puisés dans un ouvrage inédit, intitulé : Mémoires pour servir à l'histoire de la féodalité, de la barbarie et des progrès de la civilisation en France , sont très-communs dans l'histoire. Nous croyons en avoir assez rapportés pour notre objet.
[11] Ordonnance des eaux et forêts, du mois d'août 1669, tit. 3o , art. 2.
[12] « The killing of a deer or a boar, or even a hare, was punished with the loss of the delinquent's eyes ; and that at a time , when the killing of a man could be atoned for by paying a moderate fine or composition. History of England, chap. iv , The new forest.
[13] OEuvres de Louis XIV, tom. Ier., pag. 108.
[14] Ce père Tellier était un Jésuite; il est bon de le noter.
[15] Mémoires de Saint-Simon , tom. 3, p. 37.
[16] « Peut-on se rappeler, sans frémir, le pillage public et avoué des Dragons , la désunion des familles , parens armés contre parens pour se ravir leurs biens ; le spectacle d'un peuple nombreux, errant, nu, fugitif; nobles, riches, vieillards , gens souvent très-renommés par leurs vertus et leur savoir , faibles, délicats, accoutumés à une vie aisée, jetés dans les cachots , enchaînés à la rame , périssant sous le nerf des comites. . . .? » Mémoires de Saint-Simon , tom. vi, p. 128.
[17] Quelques écrivains ont loué cette manière d'acquérir : elle leur a paru très-noble. Ils auraient dû faire attention qu'un peuple ne pouvait acquérir par la guerre, que ce qu'un autre avait acquis par le travail; et que si tous avaient voulu employer le premier de ces moyens , le métier n'aurait rien valu pour aucun.
[18] On croit assez généralement que si les Romains méprisaient les arts industriels , ils avaient au moins beaucoup de goût pour les travaux agricoles. Cette erreur est venue de ce qu'au lieu de juger ce peuple par des faits généraux et constans , on l'a jugé d'après quelques faits particuliers et rares. Quand l'Italie était peuplée d'une multitude de petits états indépendans, son sol était assez bien cultivé pour en nourrir les habitans. Mais quand elle eût été subjuguée par les Romains , et réunie en un seul peuple , la Sicile , l'Afrique et l'Egypte purent à peine lui fournir assez de blé pour subsister. Cependant sa population était alors bien moins nombreuse qu'auparavant. Ce qui a fait croire que les Romains aimaient les travaux agricoles , c'est leur aversion pour l'habitation des villes. Cette aversion est cependant un sentiment commun à tous les peuples qui sortent de l'enfance , même à ceux qui-ne connaissent que le métier des armes.
[19] Le but final des travaux de l'homme n'est pas l’argent, sur-tout quand il est considéré comme monnaie; l’argent n'est qu'un moyen d'échanger des produits contre des produits d'une autre nature. Ainsi, pour parler avec exactitude , Montesquieu devait dire que, chez les grecs, tous les travaux et toutes les professions qui tendaient à créer des choses nécessaires à l'homme , étaient regardés comme indignes d'un homme libre. Tous les sauvages et tous les gentilshommes auraient été de cet avis.
[20] On voit qu'il n'est ici question que des simples ouvriers , et que les raisons pour lesquelles on leur refuse le droit de cité , peuvent s'appliquer aux ouvriers employés dans les travaux agricoles.
[21] Esprit des Lois , liv. iv , chap. 8.
[22] Tous les principes de Montesquieu , sur les gouvernemens républicains , sont absolument les mêmes que ceux, des républiques des premiers âges. Rousseau , dans le discours qui sert de base à son Contrat Social, se suppose dans le lycée d'Athènes, répétant les leçons de ses maîtres , ayant les Platons et les Xenocrates pour juges, et le genre humain pour auditeur. Mably, traitant de la législation ou des principes des lois , établit un dialogue entre un Suédois et un Anglais ; et il donne le beau rôle au Suedois , plus difficile à contenter, dit-il , et plein des idées des anciens philosophes sur l'art de régler une république.
[23] Montesquieu , Esprit des Lois , liv. vii, chap. 4.
[24] Esprit des Lois , liv. v, chap. 8.
[25] La guerre soutenue par des esclaves contre leurs maîtres , a quelque chose de vil à nos yeux. Ce sont des hommes qui se battent pour que le produit de leur industrie ne soit pas la proie de ceux qui les ont asservis: c'est une guerre ignoble. La guerre soutenue par Pompée contre César nous charme; elle a pour objet de savoir quel sera le parti qui tyrannisera le monde; elle se fait entre des hommes qui sont aussi incapables les uns que les autres de subsister par leurs propres moyens: c'est une guerre noble. — Si nous remontions à la source de nos opinions, nous trouverions que la plupart ont été faites par nos ennemis.
[26] Il y a eu une espèce d'hommes qui, .sans être entièrement libres , n'étaient cependant pas tout-à-fait esclaves; ce sont les tributaires. Ceux-là ont acquis leur entière liberté en donnant à leurs demi-maîtres plus de produits industriels , qu'ils n'étaient tenus de leur en donner.
[27] La -valeur absolue d'un individu se détermine par la balance du bien et du mal que cet individu fait à l'espèce humaine. Si la balance est égale, il n'y a point de valeur dans l'individu ; si la somme du mal l'emporte , il y a perte; si c'est la somme du bien, il y a valeur de tout ce qui excède la somme du mal. Ainsi, l'homme qui par un sage emploi de ses capitaux fait vivre dix familles , a une valeur décuple de celui qui n'en fait vivre qu'une. Mais ne résulte-t-il pas de là que le plus petit de nos manufacturiers est au-dessus du grand Pompée, et que César était au-dessous d'un bouvier? Cette idée ne peut manquer de déplaire beaucoup; puisque nos littérateurs et la plupart même de nos philosophes lisent l'histoire de Rome , comme nos ouvriers lisaient, il y a quelques années , les bulletins de la grande-armée. D'ailleurs , il y a au monde une multitude de gens aux yeux desquels les tyrans et les dévastateurs ont une très-grande valeur relative.
[28] Illum defendere , tueri, sua quoque fortia facta gloriae ejus adsignare, praecipuum sacramentum est. Principes pro victoria pugnant; comites pro principe. TACIT. de Morib. Germ. Cap. xiv.
[29] C'est bien attaquer les personnes que de porter atteinte à leurs propriétés ; mais c'est les attaquer d'une manière indirecte.
[30] On. trouve dans la constitution de 1793 presque tous les principes fondamentaux du Contrat Social, et dans les idées et les mœurs de ce temps , les idées et les mœurs des tribus sauvages de l'Amérique. Voy. Robertson's history of America , vol. 2 , book iv , pag. 124. — Ferguson's an essay on the history of civil society, part. 2 , sect. 1.
[31] Toute garde qui est instituée , non pour opprimer, mais pour défendre une nation , est nationale. Refuser cette dénomination aux troupes de ligne , c'est déclarer qu'elles ne font pas partie de la nation.
[32] Essai sur l'entendement humain, liv. xi , chap. xxxii , s. 12.
[33] Voir le Traité Médico-Philosophique, sur l'aliénation mentale, par M. Pinel.
[34] De l'Education physique de l'homme , chap. xi , p. 431, par M. Friedlander.
[35] Cette espèce de manie que nous signalons ici , n'est pas la- seule que la révolution a produite. M. Pinel, parlant des recherches qu'il a faites sur l'aliénation mentale, s'écrie : « Quelle époque plus favorable que les orages d'une révolution , toujours propres à exalter au plus haut degré les passions humaines, ou plutôt à produire la manie sous toutes ses formes! » Traite Médico-Philosophique , Sur l'alienation mentale , introduct. , p. 30 , 2e. édit. Quelquefois le vulgaire croit voir une assemblée de brigands, là où un observateur exercé ne voit qu'une réunion de maniaques. Il faut convenir cependant que le vulgaire aurait raison , si la manie était feinte et non réelle.
[36] Les associations d'idées qui forment la manie sont de plusieurs genres. Les unes produisent l'antipathie pour des choses bonnes en elles-mêmes; les autres produisent la sympathie pour des choses indifférentes ou nuisibles. Locke rapporte qu'un jeune homme ayant appris à danser dans une chambre où se trouvait un vieux coffre, ne pouvait plus danser dans cette chambre ni ailleurs , s’il ne voyait dans la même position , le vieux coffre ou quelque chose de semblable. Combien de braves gens qui ne se plaignent de la révolution que parce qu'elle a dérangé leur vieux coffre, et qui ne voudraient le rétablir que pour danser avec plus de grâce, au hasard de faire casser les jambes à tout le monde!
[37] On parle encore de gloire militaire : il serait bon de s'entendre sur la valeur de ces mots. Les Romains qui à cet égard peuvent passer pour nos maîtres , mesuraient la gloire d'un général par la quantité de butin qu'il apportait à la république; et l'on sait qu'ils étaient très-avides de gloire. Mais les modernes , d'après quoi la mesurent-ils ? Est-ce d'après le nombre d'hommes qu'ils égorgent , ou d'après le nombre de courtisans qu'ils nourrissent au moyen de leurs rapines ? Qu'est-ce donc que cette gloire dont ils se vantent ? Lorsqu'on voit des gens se consoler de l'asservissement de leur pays, en pensant à ce qu'ils appellent sa gloire militaire, on serait tenté de les assimiler à des fous qui se consoleraient des pertes faites dans un naufrage , en songeant à la beaute de la tempête qui aurait submergé leurs vaisseaux.
[38] La liberté dont il est ici question, n'est pas la liberté civile ou politique ; c'est une liberté morale qui engendre toutes les autres, et sans laquelle aucune ne peut exister.
[39] On a beaucoup crié , et l'on criera encore contre les hommes qu'on appelle des révolutionnaires : on devrait voir cependant que ces hommes avaient été élevés dans les temps pour lesquels on paraît avoir un si profond respect. La révolution a produit les constitutionnels ; mais la monarchie féodale avait enfanté les terroristes.
[40] Lorsqu'on établit un privilège , on n'accroît pas les facultés productives de ceux qui doivent en jouir ; on frappe seulement de stérilité les facultés productives de tous les autres; et l'on attaque leur propriété jusques dans sa source. Ainsi, par exemple, lorsqu'au lieu d’établir des règles générales pour prévenir l'abus des imprimeries, des journaux, ou de toute autre chose , et que l'on ne garantit qu'à quelques personnes privilégiées le droit d'exercer leur industrie par l'un de ces moyens, on frappe de nullité une partie des facultés productives de toute une nation , et l'on attente directement à sa propriété qui est de produire, aussi bien que de jouir de ses produits. Cela n'empêche pas du reste de proclamer que les propriétés sont inviolables; que tous les citoyens sont égaux devant la loi , et tant d'autres belles choses qu'on répète depuis près de trente ans, sans trop savoir ce qu'elles signifient.