
Charles Comte, "S'il est permis de tuer un tyran” (Nov. 1814)
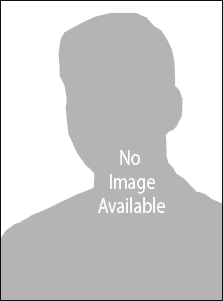 |
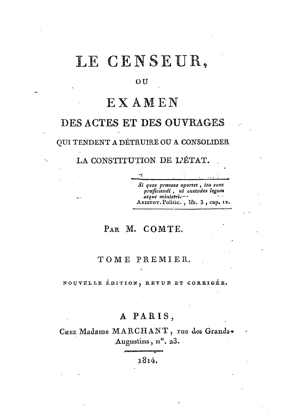 |
| Charles Comte (1782-1837) |
This is part of an Anthology of writings by Charles Comte (1782-1837), Charles Dunoyer (1786-1862), and others from their journal Le Censeur (1814-15) and Le Censeur européen (1817-1819).
See also the other works by Charles Comte and Charles Dunoyer.
Source
[CC??], “S’il est permis de tuer un tyran, ou Observations sur l'ordonnance du la octobre 1814, qui anoblit le père de Georges Cadoudal,” Le Censeur T2, Nov. 1814, pp. 267-80.
See also the facs. PDF of this article.
Text
[267]
S'IL EST PERMIS DE TUER UN TYRAN, ou Observations sur l'Ordonnance du 12 octobre 1814, qui annoblit le père de Georges Cadoudal.
Lorsque, dans une société, un individu parvient à s'emparer, par ruse ou par violence, d'un pouvoir sans limites, tous les citoyens se trouvent à l'instant dans un état pire que l'état sauvage ; car ils ne perdent pas seulement les garanties qu'ils trouvaient dans les lois, ils sont encore privés de la faculté de fuir ou de se défendre; faculté que les peuples sauvages ne peuvent jamais perdre.
Plus les avantages d'une bonne police sont connus, plus les hommes qui tendent à en priver leurs semblables doivent donc leur être odieux; et voilà pourquoi la haine que [268] portent les peuples à la tyrannie suit toujours les progrès qu'ils font dans le perfectionnement de l'art social ; voilà pourquoi les Grecs, qui connaissaient si bien les avantages de la liberté, s'écriaient: O tyrannie aimée des barbares!
Nous sommes encore bien éloignés d'avoir les lumières nécessaires à la formation et au maintien d'une bonne organisation sociale ; cependant nous avons déjà fait quelques progrès, si l'on en juge par l'aversion que nous inspirent les maximes qu'on professait dans les derniers siècles. Quels sont les ministères, qui oseraient aujourd'hui suivre les traces des Richelieu ou des Mazarin? Quel est le roi qui ne craindrait pas d'ébranler les fondemens de son trône, s'il déclarait, à l'exemple de Louis XIV, « que les rois sont seigneurs absolus, et ont naturellement la disposition pleine et libre de tous les biens qui sont possédés aussi bien par les gens d'église que par les séculiers, pour en user en tout temps comme des sages économes et suivant le besoin général de leur état ? »
[269]
Mais quelle que soit la haine que nous inspire la tyrannie , elle est encore bien faible en comparaison de celle que les anciens en avaient conçue. Les Grecs avaient tellement pris les tyrans en horreur, qu'ils les considéraient moins comme des hommes que comme des bêtes féroces, et que l'action la plus glorieuse, à leurs yeux, était celle de leur donner la mort.
Laarchus, tyran de Cirène, veut obtenir Erixo en mariage; cette femme, que Plutarque nous présente comme une personne sage, douce et humaine, attire le tyran chez elle , et le fait massacrer. Elle est appelée en Egypte pour rendre compte de cette action au Roi qui protégeait Laarchus; elle expose les motifs de sa conduite, et les hommes les plus puissans de l'état approuvent hautement ce qu'elle a fait
La femme d'Alexandre, tyran de Pheres, forme le dessein de délivrer son pays; elle trame une conspiration contre son propre mari ; le fait poignarder dans son lit, et l'abandonne aux habitans de la ville, qui, après avoir foulé son cadavre aux pieds, et l'avoir [270] traîné dans toutes les rues , le font dévorer par des chiens.
Harmodius et Aristogiton, outragés par un des deux enfans de Pisistrate, qui avaient succédé à la tyrannie de leur père, forment le projet d'en affranchir leur pays. Au milieu d'une fête publique, ils parviennent à en poignarder un. Ils sont mis à mort par celui qu'ils n'ont pu atteindre; mais trois ans après, Athènes devenue libre, leur élève des statues dans la place publique, et ordonne que leurs noms seront célébrés à perpétuité.
Timoléon s'expose à la mort pour sauver son frère tombé dans les mains des ennemis. Bientôt après, celui-ci s'empare de l'autorité publique; Timoléon se rend chez lui avec deux de ses amis, pour l'exhorter à ne pas devenir le tyran de sa patrie ; ne pouvant le dissuader, il s'éloigne en versant des larmes; ses amis frappent le tyran, elle peuple approuve le courage et la générosité d'un homme qui a su sacrifier ses affections particulières à l'intérêt de l'Etat.
Cette haine que les peuples de la Grèce [271] portaient à la tyrannie, se manifestait surtout dans les discours de leurs philosophes. La pire des bêtes sauvages, dit Bias, c'est 1e tyran , et des privées, c'est le flatteur. On demande à Thaïes ce qu'il a vu de plus extraordinaire dans ses longs voyages ; il répond que c'est un vieux tyran. Denis demande a Anthiphon quel est le meilleur cuivre connu; c'est celui, dit le philosophe, dont on a fondu les statues d'Harmodius et d'Aristogiton. Enfin les Grecs s'étaient fait un tel système de philosophie sur la nature de l'homme, que celui qui en admettait les principes était obligé d'en tirer la conséquence qu'un tyran n'était qu'une bête stupide ou féroce.[1]
Tuer un tyran n'était donc pas seulement une action licite chez eux; c'était une action glorieuse , qui n'était réservée qu'aux grandes ames. Les Romains partageaient à cet égard toutes les opinions des peuples de la Grèce; et depuis J. Brutus, qui condamna ses enfans à la mort pour avoir voulu replacer les Tarquins sur le trône, jusqu'à M. Brutus, [272] qui punit César d'avoir asservi la république, aucun citoyen, à l'exception de Sylla, n'aspira impunément à la tyrannie.
Ce sentiment de haine pour les oppresseurs ne pouvait produire que de bons résultats sous des gouvernemens républicains, parce que les droits et la durée des fonctions des premiers magistrats étant clairement déterminés par la loi, chaque citoyen pouvait juger sans peine, si les individus investis de. l’autorité publique excédaient leurs pouvoirs, ou se renfermaient dans les bornes qui leur étaient prescrites.
Mais, dans un gouvernement monarchique , la maxime qu’il est beau de tuer un tyran, peut avoir de funestes conséquences, sur-tout quand les ministres ne sont pas responsables, et que les pouvoirs du prince ne sont pas clairement déterminés par la constitution de l'état. Chacun ne peut-il pas dire alors ce que Sénèque disait à Néron : Quid interest inter tyrannum et regem? Species enim ipsa fortuna ac licencia par est, nisi quod tyranni in voluptate sœviunt, reges non nisi ex causa ac necessitqte….Tyrannus autem a rege distat factis, non nomine.[2]
Il faut cependant en convenir; quelque soit notre respect pour les peuples et les philosophes de l'antiquité, nous n'aurions jamais osé prendre sur nous, sur-tout sous un gouvernement sage et modéré, de décider qu'il était permis à chaque citoyen de tuer un tyran, et de juger par lui-même que tel ou tel chef du gouvernement était un tyran. Nous aurions craint, en professant de pareilles maximes , que quelque furieux, tel que Ravaillac, ne s'en autorisât pour porter le poignard dans le sein de quelqu'excellent prince; et cette crainte aurait suffi pour nous retenir.
Mais M. le chancelier de France est moins timide que nous. Non-seulement il décide qu'il est permis à un particulier de se défaire du chef d'un gouvernement; il croit même que c'est une action méritoire. Ce ne peut être en effet qu'en conséquence de cette opinion qu'il a demandé et obtenu des lettres [274] de noblesse pour le père de Georges Cadoudal.
Quelques rigoureux que soient sur cette matière les principes de M. le chancelier, nous conviendrons, si l'on veut, qu'ils sont justes, et qu'aujourd'hui), comme autrefois, il est beau d'attenter aux jours d'un tyran. Mais ce dont nous ne conviendrons pas également , c'est de la justesse de l'application qu'il a faite de cette maxime.
Sans doute, quand Bonaparte s'empara, par la force , des rênes du gouvernement, il fît un acte de tyrannie qui méritait d'être puni de mort ; et si, dans ce moment, Georges Cadoudal l'eût frappé d'un coup mortel, il n'est personne qui n'eût applaudi à son courage. Mais lorsque, pour son malheur , la France eut reconnu la constitution de l'an 8, l'autorité du consul se trouva légitime , et nul ne put tenter de la détruire par la violence, sans se rendre coupable d'un crime.
Nous admettrons cependant, si l'on veut, que l'acquiescement au gouvernement consulaire ne fut pas donné d'une manière légale et qu'il ne détruisit pas, par conséquent, [275] le vice d'usurpation dont l'autorité des consuls et de tous les autres corps de l'Etat se trouvait atteinte. Dans cette supposition, il est certain que Bonaparte n'était qu'un tyran, et qu'ainsi chacun pouvait le détruire sans crime pour en délivrer sa patrie.
Mais cela justifie-t-il Georges Cadoudal d'avoir attenté à sa personne ou à son autorité ? Brutus, Timoléon , Harmodius et plusieurs autres ont fait périr des tyrans, et ils se sont couverts de gloire aux yeux de leurs concitoyens, parce que, dans leurs actions, ils n'ont considéré que le salut de leur patrie et de la liberté. Mais si Brutus eût poignardé César pour faire triompher Pompée; si Timoléon eût autorisé le meurtre de son frère pour replacer tel ou tel magistrat sur son siége; si Harmodius eût assassiné Hipparque pour faire triompher un Archonte expulsé par la république, leurs concitoyens les eussent tous considérés comme de misérables brigands, dignes du dernier supplice. v
« Crillon, dit Montesquieu , refusa d'assassiner le duc de Guise , mais il offrit à [276] Henri III de se battre contre lui. Après la Saint-Barthélemi, Charles IX ayant écrit à tous les gouverneurs de faire massacrer les huguenots, le vicomte Dorte , qui commandait dans Bayonne, écrivit au roi: « Sire , je n'ai trouvé parmi les habitans et les gens de guerre , que de bons citoyens, de braves soldats , et pas un bourreau; ainsi, eux et moi, supplions Votre Majesté d'employer nos bras et nos vies à choses faisables. » Ce grand et généreux courage regardait une lâcheté comme une chose impossible.
On dira sans doute qu'il y a de la gloire à servir son roi comme à servir son pays; et qu'ainsi Georges Cadoudal ne mérite pas moins nos éloges que ces grands hommes de l'antiquité. Ceci demande une distinction : servir son roi dans l'intérêt de sa patrie, est une action très-glorieuse; mais le servir dans son intérêt purement individuel , est une action qui peut être bonne , indifférente ou criminelle. Elle est bonne , si, par affection pour sa personne, on lui rend des services qui, en eux-mêmes, n'ont rien de condamnable; elle est indifférente si, par intérêt, on le sert [277] dans des choses qui ne sont point répréhensibles , comme on servirait toute autre personne; elle est criminelle, si, pour quelque motif que ce soit, on lui rend des services contraires aux lois, à la morale ou à l'intérêt de sa patrie. Sully, Dubois , et l'assassin du duc de Guise, ont tous servi leur roi; mais si le premier est un grand homme, le second est un infâme, et le troisième un scélérat; et nous ne voyons pas, dans l'histoire, que les ministres d'Henri III aient fait obtenir des lettres de noblesse à celui-ci.
D'ailleurs, si Georges Cadoudal considérait Louis XVIII comme roi légitime des Français lorsqu'il vint tenter de renverser le gouvernement consulaire, il est certain que Napoléon Bonaparte se considérait aussi comme consul légitime; et cette erreur, si c'en était une , était partagée, non-seulement par la France, mais encore par toutes les puissances de l’Europe.[3]
[278]
Maintenant il s'agit de savoir si, lorsqu'un peuple reconnaît la légitimité de son gouvernement, et que tous les peuples voisins la reconnaissent avec lui, il appartient à un individu de considérer ce gouvernement comme illégitime, et de chercher à le renverser pour en mettre un autre à sa place.
Si l'on décide qu'un pareil droit ne peut appartenir à un simple particulier, on doit convenir que Georges Cadoudal n'a été qu'un brigand, et qu'il a justement péri sur l'échafaud; si l'on décide au contraire que chaque citoyen a le droit de prononcer sur la légitimité d'un gouvernement, et de le détruire quand il le croit illégitime , je demande ce qu'on aurait à répondre à celui qui, déniant la légitimité du gouvernement actuel, chercherait à le renverser.
Il est donc évident que l'ordonnance [279] obtenue par M. le chancelier consacre des maximes destructives de toute société, ou qu'elle a pour objet de récompenser la tentative d'un crime qui, à l'époque où il fut entrepris, ne pouvait pas même être utile aux personnes en faveur desquelles on prétend qu'il devait être commis.
Mais, en la considérant sous ce dernier rapport, cette ordonnance n'est-elle pas essentiellement contraire aux lois et à la morale? Si des individus, qui ont été justement punis comme des brigands sous un règne, sont honorés sous un autre pour les faits même qui ont motivé leur condamnation , quelle sera notre règle pour apprécier les actions des hommes? Les mêmes faits devront-ils être considérés comme des crimes ou comme des actions vertueuses , selon qu'ils seront favorables ou contraires aux passions des grands? On a bien vu des hommes salarier des traîtres ou des assassins; mais en a-t-on jamais vu qui aient cherché à fonder la noblesse sur le meurtre ou sur la trahison?
La noblesse est une récompense destinée [280] aux hommes qui ont rendu de grands services à leur pays ; mais quel est homme vertueux qui voudra la mériter, si on l'emploie à récompenser indifféremment des actions criminelles ou vertueuses? Il est en France un grand nombre d'anciennes familles dont les auteurs se sont signalés par les services qu'ils ont rendus à l'Etat; cependant s'enorgueilliraient-elles de leur origine, si leurs ayeux n'avaient eu que le mérite de Georges Cadoudal? Quand les Athéniens eurent abusé de l'ostracisme contre un homme sans mérite , ils cessèrent de l'employer; si la noblesse est accordée à des hommes déshonorés, loin d'être une récompense, elle ne sera qu'une marque d'ignominie, et personne ne voudra la recevoir.
Au reste, quand on veut consacrer la maxime qu'il est beau de tuer un tyran , on devrait, au moins par prudence , nous donner une définition exacte de ce mot.
Endnotes
[1]C'est en effet la conséquence qu'en lirait Platon : De. repubikâ vel de justo , lib. 9.
[2]De Clementia, lib. I,§. 11 et 12.
[3]Lorsque les armées coalisées sont entrées dans Paris, elles ont reconnu et proclamé que les Français avaient le droit de se donner le gouvernement qu'ils jugeraient convenable: et comment n'aurions-nous pas eu , après la chute du directoire , le droit que nous avons eu après la chute du gouvernement impérial.