
Charles Comte, [CR] “Traité d'économie politique par J.B. Say” (Censeur T.7, Sept 1815)
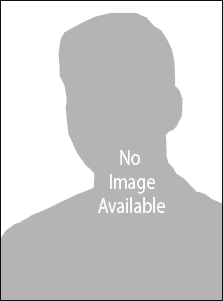 |
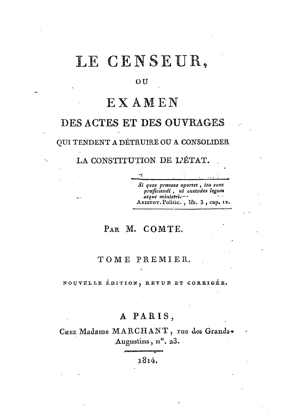 |
| Charles Comte (1782-1837) |
This is part of an Anthology of writings by Charles Comte (1782-1837), Charles Dunoyer (1786-1862), and others from their journal Le Censeur (1814-15) and Le Censeur européen (1817-1819).
See also the others works by Charles Comte and Charles Dunoyer.
Source
[CC??], CR “Traité d'économie politique, ou simple exposition de la manière dont se forment, se distribuent et se consomment les richesses, par M. J.B. Say” (Le Censeur T.7, 6 Sept. 1815), pp. 43-77.
See also the facs. PDF of this article.
Text
[43]
Traité d'économie politique, ou Simple exposition de la manière dont se forment, se distribuent et se consomment les richesses, par M. J. B. Say, exmembre du Tribunat. ( 2 vol., à Paris, chez Renoujrd, libraire, rue St.-Andrides-Arts. )
A l'affût comme nous le sommes de toutes les idées, de tous les ouvrages qui peuvent exercer une influence favorable sur le sort [44] de la nation, le Traité d'économie politique de M. Say ne pouvait nous échapper. Nous l'avons lu avec l'attention qu'il mérite, et nous pouvons affirmer que nous connaissons peu de livres qui renferment autant de notions saines, autant de vues immédiatement applicables et utiles. Nous le déclarons, cet ouvrage nous paraît avoir complètement tire l'économie politique de l'empire des opinions systématiques. Il fait apercevoir, il vous oblige d'observer des faits qui arrivent journellement, et qui n'en sont pas mieux connus pour cela; il montre la relation de ces faits entr'eux, celle qu’ils ont avec leurs causes, avec leurs résultats; et ces faits sont les plus intéressans pour l'homme, puisque ce sont ceux qui ont rapport à sa fortune, à son existence, aux biens qui peuvent la rendre douce; enfin l'on y rencontre plus que partout ailleurs, ce vrai, si bien caractérisé par Lamotte:
.... Ce vrai dont tous les esprits
Ont en eux-mêmes la semence,
Qu'on négligeait à tort, et qu'on est tout surpris
De trouver vrai quand on y pense.
[45]
L'ouvrage est précédé d'une introduction étendue, dont le but est d'abord de bien préciser l'objet que se propose l'économie politique, le sujet de ses recherches ; de faire ensuite l'histoire des progrès de cette science, et d'exposer la nouvelle méthode que l'auteur a suivie; de montrer l'importance de son étude, et les obstacles qui la contrarient; enfin de présager ce qu'on peut attendre de ses progrès ultérieurs. Des citations un peu étendues auront, outre l'avantage de justifier notre jugement, celui de présenter à nos lecteurs des idées tantôt profondes, tantôt élevées, toujours utiles, et qui, sous quelque régime qu'on soit, peuvent donner lieu à des méditations fécondes en bons résultats. Nous choisirons de préférence ce qui pourra se détacher.
De l'opposition qu'on établit quelquefois entre la théorie et la pratique.
» C'est une opposition bien vaine que celle de la théorie et de la pratique ! Qu’est-ce donc que la théorie, sinon la [46] connaissance des lois qui lient les effets aux causes, c'est-it-dire, des faits à des faits? Qui est-ce qui connaît mieux les faits que le théoricien qui les connaît sous toutes leurs faces, et qui sait les rapports qu'ils ont entre eux? Et qu'est-ce que la pratique sans la théorie, c'est-a-dire, l'emploi des moyens sans savoir comment ni pourquoi ils agissent ? Ce n'est qu'un empirisme dangereux, par lequel on applique les mêmes méthodes à des cas opposés qu'on croit semblables, et par où l'on parvient où l'on ne voulait pas aller.
» C'est ainsi qu'après avoir vu le système exclusif en matière de commerce (c’est-à-dire, l'opinion qu'une nation ne peut gagner que ce qu'une antre perd), adopté presque généralement en Europe dès la renaissance des arts et des lumières ; après avoir vu des impôts constans, et toujours croissans, s'étendre sur de certaines nations jusqu'à des sommes effrayantes; et après avoir vu ces nations plus riches, plus populeuses, plus puissantes qu'au temps où elles faisaient librement le commerce, et où elles ne supportaient presque point de charges, le vulgaire a conclu qu’elles [47] étaient riches et puissantes parce qu'on avait grevé d'impôts les revenus des particuliers; et le vulgaire a prétendu que cette opinion était fondée sur des faits, et il a relégué parmi les imaginations creuses et systématiques toute opinion différente.
» Il est bien évident-, au contraire, que ceux qui ont soutenu l'opinion opposée, connaissaient plus de faits que le vulgaire, et les connaissaient mieux. Ils savaient que l'effervescence très-marquée de l'industrie dans les états libres de l'Italie au moyen âge, et dans les villes anséatiques du nord de l'Europe, le spectacle des richesses que cette industrie avait procurées aux uns et aux autres, l'ébranlement opéré par les croisades, les progrès des arts et des sciences, ceux de la navigation, la découverre de la route des Indes et du continent de l'Amérique, et une foule d'autres circonstances moins importantes que celles là, sont les véritables causes qui ont multiplié les richesses des nations les plus ingénienses du globe, ils savaient que si cette activité a reçu successivement des entraves, elle a été débarassée, d'un autre côté, [48] d’obstacles plus fâcheux encore. L'autorité des barons et des seigneurs, en déclinant, ne pouvait plus empêcher les communications de province à province, d'états à états ; les routes devenaient meilleures et plus sûres, la législation plus constante, les villes affranchies ne relevaient plus que de l'autorité royale intéressée à leurs progrès ; de certains préjugés, tels que l'idée d'usure attachée au prêt à intérêt, celle de noblesse attachée à l'oisiveté, allaient en s'affaiblissant. Ce n'est pas tout: de bons esprits ont remarqué, non-seulement tous ces faits, mais l'action de beaucoup d'autres faits analogues ; ils ont mieux connu la marche et les résultats de l'industrie, l'effet des impôts, toutes choses qui sont des faits aussi; et ils ont été en état de conclure, avec bien plus de sûreté que le vulgaire, que si plusieurs états modernes ont prospéré au milieu des entraves et des impôts, ce n'est pas à cause des impôts et des entraves, c'est malgré eux, et que leur prospérité serait bien plus grande s'ils avaient été assujétis à un régime plus éclairé [1].
[49]
» Il faut donc, pour parvenir à la vérité, connaître, non beaucoup de faits, mais les fais essentiels et véritablement influens, les envisager sous toutes les faces, et surtout en tirer des conséquences justes, être assuré que l'effet qu'on leur attribue vient réellement d'eux, et non d'ailleurs. Toute autre connaissance de faits est un amas d'où il ne résulte rien, une érudition d'almanach. Et remarquez [50] que ceux qui possèdent ce mince avantage, qui ont une mémoire nette et un jugement obscur, qui déclament contre les doctrines les plus solides, fruits d'une vaste expérience et d'un raisonnement sûr, qui crient au système chaque fois qu'on sort de leur routine, sont précisément ceux qui ont le plus de systèmes et qui les soutiennent avec l'opiniâtreté de la sottise, c'est-à-dire, avec la crainte d'être convaincus, plutôt qu'avec le désir d'arriver au vrai.
» Ainsi, établissez sur l'ensemble des phénomènes de la production et sur l'expérience du commerce le plus relevé, que les communications libres entre les nations sont mutuellement avantageuses, et que la manière de s'acquitter envers l'étranger qui convient le mieux aux particuliers, est aussi celle qui convient le mieux aux nations, les gens à vues étroites et à présomption large vous accuseront de système. Questionnez-les sur leurs motifs, ils vous parleront balance du commerce ;- ils vous diront qu'il est clair qu'on se ruine si l'on donne son numéraire contre des marchandises … et cela même [51] et un système. D'autres vous diront que la circulation enrichit un état, et qu'une somma d'argent qui passe dans vingt mains différentes, équivaut à vingt fois sa valeur.... c'est encore un système. D'antres vous diront que le luxe est favorable à l'industrie, que l'économie ruine tout commerce... . c'est toujours un système; et tous diront qu'ils ont les faits pour eux; semblables à ce pâtre qui, sur la foi de ses jeux, affirme que le soleil qu'il voit se lever le matin et se coucher le soir, parcourt dans la journée toute l'étendue des cieux, et qui traite de rêveries toutes les lois du monde planétaire. »
Sur l'utilité de l'économie politique.
« A mesure que ces applications ( celles qu'on pourra faire des principes) deviendront plus faciles et plus communes, ou, en d'autres termes, à mesure qu'on connaîtra mieux la marche des choses, et qu'on y puisera davantage ses règles de conduite, on fera des pas plus assurés vers la prospérité et le bonheur, qui sont les véritables fins de l’art social. [52] Quoique plusieurs nations de l'Europe soient dans une situation assez florissante en apparence, et qu'il yen ait qui dépensent quatorze à quinze cents millions par an pour leurs besoins publics seulement, ou pour ce qu'elles croyent l'être, il ne faut cependant pas se persuader que leur situation ne laisse rien à désirer. Un riche sybarite, habitant à son choix son palais de ville ou son palais de campagne, goûtant à grands frais, dans l'un comme dans l'autre, toutes les recherches de la sensualité, se transportant commodément et avec rapidité partout où l'appellent de nouveaux plaisirs, disposant des bras et du talent d'un nombre considérable de serviteurs et de complaisans, et crevant dix chevaux pour satisfaire une fantaisie, peut trouver que les choses vont assez bien, et que l'économie politique est portée à sa perfection. Mais dans les pays que nous nommons florissans, combien compterez-vous de personnes en état de se procurer de pareilles jouissances ? une sur cent mille tout au plus; et il n'y en aura peut-être pas une sur mille à qui il soit permis de jouir de ce qu'on appelle [53] une honnête aisance. Partout on voit l'exténuation de la misère à côté de l'embonpoint de l'opulence, le travail forcé des uns compenser l'oisiveté des autres, des masures et des colonnades, les haillons de l'indigence mêlés aux enseignes du luxe, en un mot les plus inutiles profusions au milieu des besoins les plus urgens.
» Certes, si l'économie politique découvre les sources des richesses, si elle montre les moyens de les rendre abondantes, et enseigne l'art d'y puiser chaque jour davantage sans les épuiser jamais; si elle prouve que la population peut être à-la-fois bien plus nombreuse et incomparablement mieux pourvue des biens de ce monde ; s'il résulte de toutes ses démonstrations qu'une foule de maux qu'on croyait sans remède, sont, je ne dis pas guérissables, mais même faciles à guérir, et qu'on n'en souffrira qu'aussi long-temps qu'on le voudra bien, il faut convenir qu'il est peu d'étude plus importante, plus digne d'une âme noble et d'un esprit élevé.
» Quelques-uns de ceux qui ont attrapé une assez bonne part dans un ordre de choses [54] vicieux, ne manquent pas d'argumens pour le justifier aux yeux de la raison; car de quoi ne peut-on pas faire l'apologie, lorsqu'on ne présente les choses que sous un seul aspect? Peut-être que s'il fallait, dès demain, tirer de nouveau les lots qui leur assignent leur place dans la société, ils y trouveraient beaucoup à reprendre.
» D'autres personnes, dont l'esprit n'ayant jamais entrevu un meilleur état social, affirment fièrement qu'il ne peut pas exister y elles conviennent des maux de l'ordre établi, et s'en consolent en disant qu'il n'est pas possible que les choses soient autrement. Cela rappelle cet empereur du Japon, qui pensa étouffer de rire, lorsqu'on lui dit que les Hollandais n'avaient point de rois. Les Iroquois et les Algonquins ne conçoivent pas qu'on puisse faire la guerre sans rôtir ses prisonniers ».
Si l'antiquité des opinions est une preuve de leur justesse.
« On a dit à l'appui de vieilles erreurs, [55] qu'il faut bien qu'il y ait quelque fondement à des idées si généralement adoptées par toutes les nations ; ne doit-on pas se défier d'observations et de raisonnemens qui renversent ce qui a été tenu pour constant jusqu'à ce jour ? ce qui a été admis par tant de personnages que rendaient recommandables leurs lumières et leurs intentions ? Cet argument, je l'avoue, est digue de faire une profonde impression, et pourrait jeter du doute sur les points les plus incontestables, si l'on n'avait vu tour-à-tour les opinions les plus fausses, et que maintenant on reconnaît généralement pour telles, reçues et professées par tout le monde pendant une longue suite de siècles. Il n'y a pas encore bien long-temps que toutes les nations, depuis la plus grossière jusqu'à la plus éclairée, et que tous les hommes, depuis le porte-faix jusqu'au philosophe le plus savant, admettaient quatre élémens. Personne n'eût songé même à contester cette doctrine, qui pourtant est fausse; tellement qu'aujourd'hui il n'y a pas d'aide-naturaliste qui ne se décriât s'il regardait la terre, l'eau, l'air et le feu [56] comme des élémens[2]. Combien d’autres opinions bien régnantes, bien inattaquables, passeront de même ! Il y a quelque chose d'épidémique dans les opinions des hommes; il y a des maladies morales dont l'espèce entière est infectée, mais qui ne sont pas indestructibles, ou plutôt qui finissent infailliblement.
» En voyant cette fluctuation d'opinions qui se succèdent, on serait tenté de ne plus rien admettre d'assuré. On tomberait dans un excès tout aussi condamnable, dans le doute universel. Les faits observés à [57] plusieurs reprises par des hommes en état de les voir sous toutes leurs faces, une fois qu'ils sont bien constatés et bien décrits, sortent du domaine de l'opinion pour entrer dans celui de la vérité. Quelle que soit l'époque où l'on ait montré que la chaleur dilate les corps, cette vérité n'a pu être ébranlée. Les sciences morales et politiques offrent des vérités d'une démonstration plus difficile, mais tout aussi incontestables, quoique beaucoup plus contestées. Chacun se croit en droit d'y faire des découvertes et de juger souverainement les découvertes des autres; il n'y a cependant qu'un fort petit nombre d'hommes qui aient assez de connaissances acquises et des vues suffisamment étendues, pour être assurés qu'ils connaissent, sous tous les rapports, l'objet dont il s'agit de porter un jugement. On est étonné, dans la société, de voir les questions les plus épineuses décidées aussi lestement que si l'on savait tout ce qui peut, tout ce qui doit influer sur le jugement qu'on en porte. Il semble voir une compagnie de. gens qui, passant en toute hâte devant la façade d'un superbe château, se croiraient [58] fou dés à nous dire tout ce qui se passe dans son interieur ».
S'il est utile que les lumières soient répandues.
« On a cru très-long-temps que l'économie politique était à l'usage seulement du petit nombre d'hommes qui règlent les affaires de l'état. Sans doute le gouvernement est intéressé à voir se multiplier les richesses, parce qu'il ne peut en prendre sa part qu'à proportion de ce qu'il y en a dans la société; mais les particuliers y sont plus intéressés encore, puisque l'aisance, l'existence même de leur famille en dépendent[3]. Je sais qu’il [59] importe que les hommes élevés en pouvoir soient plus éclairés que les autres ; je sais que les fautes des particuliers ne peuvent jamais ruiner qu'un petit nombre de familles, tandis que celles des grands répandent la désolation sur tout un pays. Mais les grands peuvent-ils être éclairés lorsque les simples particuliers ne le sont pas? Cette question vaut la peine d'être faite. C'est dans la classe mitoyenne, également à l'abri de l'enivrement de la grandeur et des travaux forcés de l'indigence; c'est dans la classe où se rencontrent les fortunes honnêtes, les loisirs mêlés à l'habitude du travail, les libres [60] communications de l'amitié, le goût de la lecture et la possibilité de voyager; c'est dans cette classe, dis-je, que naissent les lumières; c'est de là qu'elles se répandent chez les grands et chez le peuple ; car les grands et le peuple n'ont pas le temps de méditer ; ils n'adoptent les vérités que lorsqu'elles leur parviennent sous la forme d'axiomes et qu'elles n'ont plus besoin de preuves.
» Et quand même un monarque et ses principaux ministres seraient familiarisés avec les principes sur lesquels se fonde la prospérité des nations, que feraient-ils de leur savoir, s'ils n'étaient secondés dans tons les degrés de l'administration par des hommes capables de les comprendre, d'entrer dans leurs vues, et de réaliser leurs conceptions? La prospérité d'une ville, d'une province, dépend quelquefois d'un travail de bureau, et le chef d'une très-petite administration, en provoquant une décision importante, exerce souvent une influence supérieure à celle du législateur lui-même.
» Enfin, en supposant que tous ceux qui prennent part à la gestion des affaires [61] publiques, dans tous les grades, pussent être habiles sans que la nation le fût, ce qui est tout-à-fait improbable, quelle résistance n'éprouverait pas l'accomplissement de leurs meilleurs desseins ? Quels obstacles ne rencontreraient-ils pas dans les préjugés de ceux mêmes que favoriseraient le plus leurs opérations?
» Pour qu'une nation jouisse des avantages d'un bon système économique, il ne suffit pas que ses chefs soient en état d'adoptes les meilleurs plans en tout genre, il faut de plus que la nation soit en état de les recevoir ».
Ce qu'on peut attendre du progrès des lumières.
« Que les nations qu'on dit civilisées, sont encore ignorantes et barbares! Parcourez des provinces entières de cette Europe si glorieuse, questionnez cent personnes, mille, dix mille : à peine sur ce nombre en trouverez-vous deux, une, peut-être qui ait quelque teinture de ces connaissances si relevées [62] dont le siècle se glorifie. On n'en ignore pas seulement les hautes vérités, ce qui n'aurait rien d'étonnant, mais les élémens les plus simples, les plus applicables à la position de chacun. Quoi de plus rare même que les qualités nécessaires pour s'instruire! qu'il est peu de gens capables seulement d'observer ce qu'ils voyent tous les jours, et qui sachent douter de ce qu'ils ne savent pas!
» Les hautes connaissances sont donc bien loin encore d'avoir procuré à la société les avantages qu'on en doit attendre, et sans lesquelles elles ne seraient que de curieuses difficultés. Peut-être est-ce au dix-neuvième siècle qu'il est réservé d'en perfectionner les applications. On verra des esprits supérieurs, dans les sciences morales comme dans les sciences physiques, après avoir reculé les bornes de leurs théories, découvrir des méthodes qui mettront les vérités importantes à la portée des esprits médiocres. Alors dans les occurences ordinaires de la vie, on sera guidé, non par des lumières transcendantes, mais par des notions saines. On jugera de tout, non sur parole, mais sur [63] la nature mieux connue des choses. On remontera ainsi par habitude et naturellement à la source de toute vérité. On ne se laissera pas éblouir par de vaines paroles; on ne se laissera pas guider par de fausses notions. La perversité ne pouvant plus s'armer du charlatanisme, perdra sa principale force, et n'obtiendra pas long-temps ces succès si tristes pour les gens de bien et si funestes pour les nations ».
On peut juger, par ces passages, extraits du discours préliminaire, de l'esprit dans le quel l’ouvrage de M. Say a été conçu. Nous allons maintenant donner une analyse de l'ouvrage même.
Pour connaître ce que c'est que la richesse, M. Say observe ce qui compose l'inventaire des biens d'un homme riche. Cet inventaire comprend toutes les choses de sa possession qui ont une valeur. Ces choses, dont l'or et l'argent ne forment souvent qu'une petite partie, ne figurent dans son inventaire qu'en raison de leur valeur; sa richesse totale se compose de toutes leurs valeurs réunies. La richesse est donc la même chose que la [64] valeur; les richesses d'une nation sont done la somme totale des valeurs possédées par les particuliers dont se compose cette nation.
On va voir combien cette vue devient féconde entre les mains de M. Say.
D'où vient aux choses cette valeur qui en fait des richesses et qu'on appelle leur prix, lorsqu'elle est évaluée en argent? Nous voyons que les unes ont un prix parce qu'elles servent immédiatement à satisfaire un des nombreux besoins de l'homme, comme tous les objets qui servent à sa nourriture, à sa parure, à son logement ; d'autres n'ont de prix, comme les fonds de terre, que parce qu'elles peuvent concourir à la production des premières. C'est donc, en dernière analyse, l’utilité que les choses ont pour l'homme qui leur donne de la valeur ou du prix; et par utilité l'auteur a soin de nous prévenir qu'il entend la faculté de satisfaire à quelque besoin que ce soit, même à notre vanité, qui est une espèce de besoin.
La conséquence bien naturelle de tout ceci est que puisque l'utilité suffit pour donner de la valeur et que la valeur est de la richesse, [65] créer de l'utilité, ou seulement augmenter le degré d'utilité qu'une chose a déjà, c'est créer de la richesse. Tel est le miracle opéré par l'industrie humaine.
Remarquez bien qu'en tout ceci, il n'est pas question de former de la matière : il n'est pas plus au pouvoir de l'homme de la créer que de l'anéantir; mais il peut donner de la valeur à une matière qui n'en avait point. » Le laboureur, en semant un grain de blé, en fait germer vingt autres; il ne les tire pas du néant: il se sert d'un outil puissant qui est la terre ; et il dirige une opération par laquelle différentes substances, auparavant répandues dans le sol, dans l'eau, dans l’air, se changent en grains de blé … La noix de galle, le sulfate de fer, la gomme arabique, sont des substances répandues dans la nature: l'industrie du négociant, du manufacturier, les réunit; et leur mélange donne cette liqueur noire qui permet de transmettre des connaissances utiles. »
Les différentes manières de donner de l’utilité et de la valeur aux choses sont innombrables ; mais, pour la commodité de [66] l'observateur, on peut les réunir sous trois chefs principaux. Lorsque l'industrie provoque l'action des forces naturelles, ou simplement recueille le produit spontané de la nature, on la nomme industrie agricole, lorsqu'elle sépare, mélange, façonne les produits de la nature pour les approprier à nos besoins, on la nomme industrie manufacturière ; lorsqu'elle met à notre portée les objets de nos besoins, on la nomme industrie commerciale.
Que si l’on entre plus avant dans le même sujet, et que l'on veuille connaître les procédés communs à toutes les industries, on trouve que toute la capacité industrielle de l'homme ou plutôt des hommes réunis ( car il faut ici, non une capacité individuelle, mais une capacité sociale), consiste d'abord à bien observer la marche et les lois de la nature : c'est l'objet de l'étude des savans. Ensuite, à se pourvoir des matières et des instrumens nécessaires, et à faire l'application de ces connaissances acquises à un usage quelconque: c'est l'affaire du cultivateur, ou du manufacturier, ou du commerçant. Enfin il faut [67] exécuter le travail manuel indiqué par les deux classes précédentes : c'est l'emploi de l’ouvrier.
Ce n'est pas tout, L'homme et son industrie ne pourraient s'exercer sans matériaux et sans outils. Ces matériaux et ces outils sont, les uns gratuitement fournis par la nature, comme le terrain, l'eau, la chaleur du soleil ; les autres sont des produits de l'industrie humaine, et ils ont déjà une valeur acquise au moment où l'industrie veut s'en servir pour créer de nouvelles valeurs. Dans ce dernier cas, la valeur de ces matériaux et de ces outils est ce qu'on nomme un capital.
De sorte que, industrie, agens naturels, capitaux, sont les élémens avec lesquels on produit des valeurs, de la richesse.
Les conséquences que M. Say tire ou laisse tirer de ces prémisses bien simples, sont pour ainsi dire innombrables, car leur enchaînement conduit à beaucoup plus de résultats qu'il ne peut en exprimer dans deux volumes. Parmi ceux qu'il indique comme importans, nous n'en citerons qu'un bien petit nombre, mais [68] qui suffiront pour justifier notre assertion.
Si les richesses peuvent se créer de toutes pièces, elles ne sont donc pas exclusives ; ce que l'un gagne n'est donc pas nécessairement perdu pour un autre. Deux individus peuvent s'enrichir ensemble; deux nations le peuvent également; et, en effet, comment expliquerait-on autrement les progrès que toutes les nations de l'Europe ont faits simultanément depuis l'époque où elles mangeaient du gland jusqu'à celle où nous les voyons ? Que penser enfin de cette prétendue Balance du commerce, pour laquelle on se livre, depuis cent ans, des guerres si meurtrières?
Autre conséquence. Si créer de la valeur c'est produire des richesses, c'est donc détruire des richesses que de détruire des valeurs. La richesse peut se défaire, pour ainsi dire, par une marche contraire à celle qui lui a donné naissance. La consommation n'est donc pas un simple déplacement de richesses; elle en est une véritable destruction ; et cela nous aide à apprécier ces antiques sophismes, que le riche par ses jouissances, les gouvernemens par leurs profusions, rendent d’une [69] main ce qu'ils-reçoivent de l'autre, et que toute cette belle circulation fait la prospérité des états.
Mais que deviennent l'or et l'argent dans tout cela ? Que devient la monnaie, que les uns regardent comme la seule richesse, les autres comme le signe représentatif de toutes les richesses de la société? La monnaie d'or ou d'argent se compose d'une matière que le commerce apporte des lieux où elle est produite, et à laquelle l'industrie du monnayeur ajoute, par l’empreinte, quelque valeur de plus. Une pièce de monnaie est une pièce d'orfévrerie, qui tire sa valeur de sa matière et de sa façon ; et qu'est-ce qui donne à cette matière et à cette façon quelque valeur? ce sont encore les usages auxquels elles rendent propres la pièce de monnaie. Du reste, elle n'est qu'une partie des richesses générales, et une bien petite partie; car sa valeur est bien peu considérable, comparée à toutes les autres valeurs réunies.
On voudra peut-être se former des idées justes relativement à la propriété. M.Say, qui s'attache avec un soin scrupuleux à simplifier [70] toutes les questions et à élaguer tout ce qui ne tient pas à son sujet, semble reléguer parmi les questions oiseuses, celles qui ont rapport à l'origine et au droit de propriété. Il la regarde comme une chose défait, et, comme telle, elle est si essentielle à la multiplication des richesses, que sans elle on no peut concevoir de richesse. En effet, qui voudrait faire les avances de la culture d'un champ, s'il ne devait pas en recueillir les fruits ? Qui voudrait amasser des capitaux, qui sont les valeurs consacrées à la reproduction, si la possession n'en était pas reconnue et garantie? Mais aussi, par la raison même que notre auteur ne regarde la propriété que comme une chose de fait, il ne voit de propriété que là où elle est non-seulement reconnue, mais assurée. « On sent, dit-il, que ce serait en vain que l'es lois consacreraient la propriété, si le gouvernement ne savait pas respecter les lois ; s'il était au-dessus de son pouvoir de réprimer le brigandage; s'il l'exerçait lui-même ; si la complication des dispositions législatives et les subtilités de la chicane rendaient tout le monde incertain dans sa possession. »
[71]
Mais aussi, quand un gouvernement respecte et protège la propriété, il procure aux nations le plus grand des bienfaits : « Sans cette protection, qui prête le secours de tous aux besoins d'un seul, il est impossible de concevoir aucun développement important des facultés productives de l'homme, des terres et des capitaux ; il est impossible de concevoir l'existence des capitaux eux-mêmes, puisqu'ils ne sont que des valeurs accumulées et travaillant sous la sauve-garde de l'autorité. C'est pour cette raison que jamais aucune nation n'est parvenue à quelque degré d'opulence, sans avoir été soumise à un gouvernement régulier. C'est à la sûreté que procure l'organisation politique, que les peuples policés doivent non-seulement les productions innombrables et variées qui satisfont à leurs besoins, mais encore les beaux-arts, les loisirs, fruits de quelques accumulations, et sans lesquels ils ne pourraient pas cultiver les dons de l'esprit, ni, par conséquent s'élever à la dignité que comporte la nature de l'homme. »
Une partie bien importante de l'ouvrage de M. Say, est celle où il discute l'influence [72] des actes du gouvernement sur la production, des richesses. Il fait connaître ce qui arrive lorsque les réglemens de l'administration ont pour but d'influer sur le choix des produits qu'il convient de créer; lorsque les mêmes réglemens ont la prétention de déterminer le mode de production; lorsque l'administration veut se mêler de produire elle-même. On sent que la profonde analyse que l'auteur a faite de la production, lui fournit les moyens de déterminer avec précision l'influence décès actes sur la production elle-même.
Le chapitre où il examine les colonies et leur influence par rapport à la richesse nationale, présente des résultats bien importans, et fournit plus d'un sujet de consolation à la France, lorsqu'elle se voit privée de presque toutes ses colonies.
Pour montrer sous combien de points de vue divers cet auteur envisage la richesse nationale, nous nous arrêterons un instant au chapitre où il examine comment elle peut être affectée par les voyages et l'expatriation.
« Partant toujours, dit M. Say, de ce principe, que la seule valeur réelle est celle qui [75] se montre sous la forme d'un métal, on voyait, à l'arrivée d'un étranger, une valeur de dix mille francs apportée en or ou en argent, et l'on appelait cela un gain de dix mille fr.; comme si le tailleur qui habillait l'étranger, le bijoutier qui le décorait, le traiteur qui le nourrissait, ne lui fournissaient aucune valeur en échange de son argent» ? Les développemens qui viennent ici montrent que les gains faits dans ces cas-là sont de même nature que ceux qu'on fait dans un commerce avantageux avec l'étranger; et que, quoi qu'on ne doive pas les dédaigner, il ne convient pas de les acheter par des sacrifices qui excèdent l'avantage qu'on en retire, et surtout par des fêtes somptueuses.
« Est-il bien sûr, ajoute-t-il, qu'une fête, un spectacle, quelque magnifiques qu'on les suppose, amènent beaucoup d'étrangers du dehors? Les étrangers ne sont-ils pas plutôt attirés ou par le commerce, ou par le climat, ou par de riches trésors d'antiquités, ou bien. encore par le desir de visiter des lieux illustrés par de grands événemens, et d'apprendre une langue fort répandue? Je serais tenté de [74] croire que la jouissance de quelques plaisirs futiles n'a jamais attiré de bien loin beaucoup de monde. Un spectacle, une fête, font faire quelques lieues, mais rarement font entreprendre un voyage. Il n'est pas vraisemblable que l'envie de voir l'Opéra de Paris soit le motif pour lequel tant d'Allemands, d'Anglais, d'Italiens, viennent, en temps de paix, visiter cette grande capitale, qui heureusement a de bien plus justes droits à la curiosité générale. Les Espagnols regardent leurs combats de taureaux comme excessivement curieux; cependant je ne pense pas que beaucoup de Français aient fait le voyage de Madrid pour en avoir le divertissement. Ces sortes de jeux sont fréquentés par les étrangers qui sont attirés dans le pays par d'autres causes; mais ce n'est pas celle-là qui détermine leur déplacement ».
Les fêtes si vantées de Louis XIV avaient un effet encore plus fâcheux. Ce n'était pas l'argent des étrangers qu'elles faisaient dépenser, c'était celui des Français qui arrivaient des provinces pour dissiper, en quelques jours, ce qui aurait pu faire subsister [75] leur famille pendant une année: de sorte que les Français y perdaient ce qui était consommé par les mains du roi et dont la valeur avait été levée par la voie des contributions, et ce qui y était consommé par les mains des particuliers. On y perdait le principal des choses consommées, pour faire gagner à quelques marchands leurs profits sur ce principal.
Ce qui est un gain véritable et bien précieux pour un Etat, c'est lorsqu’un étranger vient s'y fixer en transportant avec lui sa fortune : « Il lui procure à-la-fois deux sources de richesses, de l'industrie et des capitaux. Cela vaut des champs ajoutés à son territoire; sans parler d'un accroissement de population précieuse, quand il apporte en même temps de l'affection, des talens, et des vertus ». Mais cela fait sentir aussi le tort considérable que des émigrations du même genre font à un pays. C'est le tort que Louis XIV fit à la France. Il n'y a que les. personnes tout-à-fait étrangères aux allures du commerce et aux principes de l'économie politique, qui puissent s'imaginer qu'on peut empêcher les particuliers de sortir leurs [76] capitaux lorsqu'ils en ont envie. La valeur de ces capitaux importée en marchandises dont l'extraction est permise, est aussi bien perdue pour le pays que si elle sortait en argent. C'est une expédition qui n'amènera point de retour. « La meilleure manière d'attirer les hommes et de les retenir, dit à ce sujet M. Say, est d'être juste et bon envers eux, et d'assurer à tous la jouissance des droits qu'ils regardent comme les plus précieux, la libre disposition de leurs personnes et de leurs biens, la faculté d?aller, de venir, de rester, de parler, de lire et d'écrire avec une entière sûreté ».
La stricte morale est donc encore ici conforme à nos intérêts bien entendus.
Nous espérons en avoir dit assez, sinon pour avoir fait connaître le système complet de l'économie politique, devenue entre les mains de M. Say une science d'observations et de faits, du moins pour convaincre nos lecteurs de la solidité et de l'importance de cette étude. Nous terminerons en citant le passage suivant:
« On a dit que les nations et les particuliers savaient fort bien augmenter leur [77] fortune sans connaître la nature des richesses, et que c'était une connaissance purement spéculative et inutile. C'est comme si l'on disait qu'on sait très-bien vivre et respirer sans l'anatomie et la médecine, et que ces connaissances sont par-là même superflues. Cette proposition ne serait pas soutenable; mais que dirait-on si elle était soutenue par des docteurs qui, tout en décriant la médecine, vous soumettraient à un traitement fondé sur un vieil empirisme et sur les plus sots préjugés? s'ils écartaient tout enseignement méthodique et régulier? s'ils faisaient malgré vous, sur votre corps, de sanglantes expériences? si leurs ordonnances étaient accompagnées de l'appareil et de l'autorité des lois? et enfin s'ils les faisaient exécuter par des armées de commis et de soldats? »
Endnotes
[1] Cela explique aussi pourquoi les nations ne profitent presque jamais des leçons de l’expérience. Pour en profiter, il faudrait que la multitude fût en état de saisir la liaison des causes et des effets : ce qui suppose un très-haut degré de lumières et une grande capacité de réflexion. Lorsque les nations seraient en état de profiter de l'expérience, elles n'est auraient plus besoin. C'est une des raisons qui les mettent dans la nécessité d'être constamment dirigées, et qui établissent t'importance de ce grand problème de politique: Avec les caractères et les besoins des hommes tels qu'ils sont, trouver par quels moyens ils peuvent être constamment gouvernés par les plus éclairés d'entre eux. Ce problème paraît plus important encore à ceux qui savent que plus les gouvernans sont éclairés, et plus ils sont persuadés que leur intérêt est de gouverner suivant l'intérêt des administrés. »
[2] Toutes nos connaissances, même les plus importantes, ne datent que d'hier. Le célèbre agronome Arthur Young, après avoir soigneusement cherché à recueillir tout ce qu'on avait observé sur l'assolement des terres, c'est-à-dire, sur la partie la plut importante de l'agriculture, celle qui enseigne par quelle succession de récoltes on peut occuper constamment le terrain et avec te plus d'avantage, dit qu'il n'a pu recueillir aucune notion qui fût antérieure à l'année 1768. Il y a des arts non moins essentiels au bonheur de l'homme, sur lesquels on n’a encore aucune idée juste.
[3] « Indépendamment du tort que font aux familles les fautes de l'administration, elles sont trop souvent victimes de l'impéritie des particuliers. Ceux-ci provoquent parfois les opérations publiques les plus fâcheuses; et, dans les opérations privées, on ne peut nier que de justes notions sur la nature et sur la marche des valeurs, ne donnent beaucoup d'avantage pour juger sainement des entreprises où l'on est intéressé, soit comme partie principale, soit comme actionnaire; pour prévoir leurs besoins, leurs produits; pour deviner les moyens de les faire prospérer, et y faire valoir ses droits; pour choisir les placemens les plus solides, prévoir l'issue des emprunts et des autres actes de l'administration ; pour améliorer les terres à propos, balancer avec connaissance de cause les avances avec les produits; pour connaître les besoins généraux de la société, et embrasser un état; pour distinguer les symptômes de prospérité ou de déclin du corps social, etc., etc. »