
Charles Comte, CR “De la Monarchie franÇaise depuis son Établissement jusqu'À nos jours, par Montlosier,” (June, 1815)
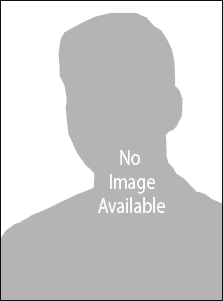 |
 |
| Charles Comte (1782-1837) |
This is part of an Anthology of writings by Charles Comte (1782-1837), Charles Dunoyer (1786-1862), and others from their journal Le Censeur (1814-15) and Le Censeur européen (1817-1819).
See also the others works by Charles Comte and Charles Dunoyer.
Source
[G.F.] (CC??) CR, “De la Monarchie française depuis son établissement jusqu'à nos jours, par Montlosier,” (Censeur, T. 6, June 1, 1815), pp. 192-244.
See also the facs. PDF of this article.
Text
[192]
De la Monarchie française depuis son établissement jusqu'à nos jours, ou Recherchés sur les anciennes institutions françaises, leurs progrès, leur décadence, et sur les causes qui ont amené la révolution et ses diverses phases jusqu'à la déclaration d'empire, avec un supplément sur le gouvernement, de Buonaparte, depuis ses commencemens jusqu'à sa chute, et sur le retour de la maison de Bourbon; par M. le comte de Montlosier, député de là noblesse d'Auvergne aux états-généraux.
Il n'a guère paru depuis bien long-temps d'ouvrage aussi instructif, aussi fortement [193] pensé, aussi neuf que celui de M. de Montlosier. Un an après la publication, de pareilles productions sont encore dans leur nouveauté, et dans les circonstances actuelles où celle-ci prend un nouvel intérêt, nous ne regrettons point d'avoir différé jusqu'à présent d'en rendre compte.
L'auteur de ce livre l'a composé par ordre de Napoléon, lors de son élévation à l'empire, et il l'a publié sous les Bourbons tel qu’il l'avait écrit à l'époque de nos espérances. Il n'a pas eu à refaire son histoire, mais à la continuer; un triste supplément lui a suffi pour amener son lecteur jusqu'à une nouvelle époque d'espérance .... qui ont été trompées … Attendons le nouveau supplément que M. de Montlosier nous donnera dans sa seconde édition.
Les premières parties de l'ouvrage sont consacrées spécialement à l'examen du gouvernement féodal dans sa nature, ses progrès et sa décadence. On peut considérer dans ce traité deux objets bien distincts, la critique historique et la doctrine politique de l'auteur; l'une forte, savante, lumineuse ; l’autre [194] singulière et bizarre tout au moins, quoiqu'elle soit soutenue d'une multitude d'aperçus particuliers pleins de sens et d'utilité. Quelque originale que soit cette doctrine, elle appartient néanmoins à l'une de ces deux grandes sectes qui, en France, partagent l'opinion depuis le dix-huitième siècle, depuis nos révolutions, et en particulier depuis la dernière. Leur esprit bien connu suffit pour donner le sens de nos écrits, de nos discours et de nos factions politiques. Il est vrai qu'il n'en faut point juger par leurs effets, toutes deux se sont deshonorés en se popularisant ; mais aussi toutes deux ont été adoptées par les esprits les plus distingués. Pour l'une, la théorie est tout, pour l'autre l'autorité des temps ; l'une s'en tient aux principes, l'autre aux institutions consacrées; ceux-là veulent renouveler les lois, ceux-ci rappeler les anciennes mœurs; les spéculations des premiers reçoivent, du moins en apparence, plus de rigueur et de clarté de l'esprit systématique qui les dirige ; celles des autres, toujours entre-mêlées de sentimens et d'antiques souvenirs, conservent, sous la plume [195] des meilleurs écrivains, quelque chose de vague, de mystérieux, de ténébreux qu'elles doivent à leur défaut de liaison et à la nature des principes sur lesquels elles reposent. Il est bon sans doute, que l'esprit novateur soit continuellement aux prises avec l'esprit conservateur afin qu'ils se corrigent l'un par l'autre dans leurs excès; d'ailleurs, les fonctions morales que l'une des deux écoles s'attribue plus particulièrement ne peuvent qu'être utiles et doivent être respectées.
M. de Montlosier aime son pays, mais il l'aime surtout au temps de Charlemagne, de Hugues-Capet et de Saint-Louis. Nul auteur n'a, ce me semble, mieux connu que lui la féodalité, nul ne s'est montré plus affectionné à ce système. M. de Montlosier était noble, et son ouvrage paraît un mémoire en faveur de la noblesse ancienne ; mais un esprit aussi élevé est-il susceptible de se laisser dominer par l'influence de l'intérêt personnel? Il convient dans quelques phrases éparses et fugitives; de la nécessité du grand changement qui s'est opéré dans nos mœurs et dans notre gouvernement; mais toutes les fois qu'il [196] revient à parler de l'organisation féodale, il prend en même temps le ton de l'admiration et du regret, celui de l'humeur et presque de l'animosité toutes les fois qu'il est question des causes qui ont si scandaleusement soustrait à la noblesse ses anciennes prérogatives.
Les services personnels des vassaux, les redevances et les justices seigneuriales, la servitude de la glèbe, les guerres particulières elles-mêmes sont l'objet de son enthousiasme; il oublie la dîme ecclésiastique, sans doute en faveur des censives. Cet état de choses lui présente un ordre parfait, un système aussi favorable aux bonnes mœurs qu'à la prospérité publique. Hors de là, il ne voit que désordre et confusion; il s'indigne presque contre la science, l'industrie et le commerce qui ont usurpé les droits sacrés de la naissance; il maintient jusqu'à la fin de son ouvrage la distinction de deux peuples en France, le peuple vainqueur ou les Francs de la Germanie, et le peuple vaincu ou les habitans de la Gaule primitive. Voilà bien des singularités dans un ouvrage d'ailleurs si précieux; [197] ce qu'il y a de plus singulier encore c'est que nulle part l'auteur ne cherche à démontrer en principe l'excellence du système féodal, et que la plupart de ses preuves de détail renferment des idées saines et solides.
Il n'est nullement prouvé qu'il ne puisse exister une forme de gouvernement bonne en elle-même, et indépendamment des circonstances particulières dans lesquelles un peuple peut se trouver placé. Bien plus, aucun gouvernement ne doit être appelé bon tant que la prudence humaine peut prévoir un changement de circonstances capables de le rendre mauvais. En effet, comme la société, en se donnant une constitution, stipule non-seulement pour une époque actuelle, mais encore pour un avenir indéfini, elle se doit à elle-même de se constituer le mieux possible, non en vue d'un temps donné, mais dans la supposition d'une durée indéfinie; elle ne doit pas préparer à sa postérité des malheurs inévitables par l'établissement d'un ordre de choses qui porte en soi-même les germes de sa destruction. Que penserons-nous donc de ces gouvernemens qui, prenant [198] pour base la vertu, comme chez les anciens, ou, comme chez les modernes, l'exclusion absolue des classes les plus nombreuses et l'extrême inégalité des droits, repoussent la civilisation, les lumières et l'industrie dont l'influence doit, tôt ou tard, l'emporter sur leurs institutions? De pareils systèmes sont mauvais du moment que nous apercevons le vice intérieur qui doit les faire périr, et ils sont essentiellement périssables, puisqu'ils sont contraires à la nature et aux progrès nécessaires du genre humain. Aussi leur chute est-elle ordinairement misérable ou désastreuse ; et, certes, nous avons assez appris ce que coûte à une génération le redressement de toutes les sottises des générations précédentes, pour n'être pas bien tentés de savoir gré à nos ancêtres de leurs priviléges allodiaux et féodaux, de leur noblesse et de leur roture, et de mille autres belles inventions tant regrettées par M. de Montlosier.
Si ce ne sont point les choses qui ont tort, mais les hommes; si les évènemens ne sont point blâmables, mais bien les institutions qui auraient dû les prévenir, concluons que [199] le régime féodal est mauvais, quels que soient les avantages partiels que l'on y peut découvrir, puisqu'il est tombé, ou plutôt puisque nous voyons comment il devait nécessairement tomber. Un système qui, partageant tous les hommes entre la profession des armes et l'esclavage de la glèbe, condamnait l'esprit humain à l'ignorance et à l'immobilité, était incompatible avec notre nature; sans doute il n'a dû son existence qu'à l'état imparfait de développement où il l'a trouvée à l'époque où il s'en est emparé, et dans lequel il l'a trop long-temps maintenu. Si la constitution que la France paraît vouloir adopter aujourd'hui, est, en apparence, dans quelques-unes de ses dispositions fondamentales, la moins mauvaise de toutes celles qui nous sont connues, c'est surtout parce qu'elle paraît moins qu'aucune autre en contradiction avec les progrès des lumières, de l'industrie et de la civilisation.
Ces considérations nous dispensent d'entrer dans le détail des lois féodales pour en montrer les inconvéniens; elles nous paraissent simples et décisives; un exemple [200] nous suffira pour montrer sous quel point de vue M. deMontlosier envisage les mêmes choses. Voici comment il nous présente l'heureuse époque de la renaissance des lettres qui a porté l'une des premières atteintes au régime féodal: « Les Francs ne cultivaient guère que le courage, l’honneur, le dévouement et toutes les vertus du cœur. On imagina d'établir en rivalité les facultés de l'esprit. L'étude convenait beaucoup à toute cette population des villes, qui avait du loisir, de l'opulence des habitudes sédentaires : on résolut de donner une grande considération à l'étude … ».
(Il est heureux que l'on ait pris cette résolution ; sans quoi l'étude ou pour nous exprimer de meilleure foi, l'instruction n'était pas une puissance capable d'emporter la considération par elle-même aussi bien que l'escrime et les autres talens de la chevalerie).
« Le goût du droit théologique s'étant joint à celui du droit romain, on en forma, avec la médecine et les humanités qui s’y [201] associèrent, je ne sais quoi de pompeux et d'imposant, sous le nom des quatre facultés. »
(II n'était pas besoin pour cela que l'on eût tramé une conspiration contre la noblesse ; c'est le défaut ordinaire des peuples qui commencent à s'instruire, de croire qu'ils ont aperçu les bornes du savoir humain; de là le nom des quatre facultés. La rivalité de la noblesse n'entrait pour rien dans le faste imposant étalé par le pédantisme, inséparable des doctrines renaissantes.)
«L'honneur de la science balança de cette manière celui des armes. Les hauts faits de la mémoire furent mis à côté des hauts faits du courage. Les grades de bachelier et de licencié se placèrent à côté de ceux d'écuyer et de chevalier : on s'empara ainsi des vanités, etc. ».
Voilà le ton et l'esprit qui se font sentir malheureusement dans la plus grande partie de l'ouvrage. Nous allons chercher çà et là les motifs de la prédilection que l'auteur témoigne pour le gouvernement féodal, ensuite nous en viendrons à la partie saine de [202] l'ouvrage, je veux dire aux recherches critiques sur les premières époques de la féodalité, sur les causes particulières de sa chute, enfin aux considérations sur nos dernières révolutions.
L'une des choses qui contribuent le plus à donner une couleur spécieuse aux idées de M. de Montlosier, relativement à la féodalité, c'est la comparaison continuelle qu'il fait de l'ordre qui en liait toutes les parties avec le désordre et l'incohérence faciles à remarquer dans le gouvernement qui lui succéda; c'est ce qui m'a fait dire plus haut que presque toutes les preuves particulières renferment des idées justes et utiles. Mais d'abord, en convenant de cette unité que l'auteur a si bien remarquée dans tout le système féodal, nous observerons que quand les principes sont mauvais, il n'est pas toujours avantageux que les conséquences en soient fidèlement observées; et quoiqu'en dise M. de Montlosier, nous aimerions mieux, s'il fallait choisir, vivre sous LouisXIV et Louis XV, que sous Louis-le-Hutin et Philippe-le-Long, bien que l'ensemble du gouvernement, des [203] usages et des mœurs, présentent moins de liaison et d'harmonie. Ensuite, comment M. de Montlosier a-t-il négligé de considérer que cette seconde monarchie française, qui a suivi la monarchie féodale, n'était dans le fait que l'intervalle du passage qui devait amener, par une révolution plus ou moins tardive, plus ou moins violente, le renouvellement de nos institutions? Et pourtant s'il en est ainsi, on voit qu'il n'est pas juste de comparer l'état d'un gouvernement qui se décompose pour se renouveler ensuite, avec celui d'un état formé et complet dans toutes ses parties.
En dépit de quelques-uns de nos vieux romanciers, nous devons reconnaître que les mœurs domestiques de la noblesse féodale étaient honnêtes, graves et religieuses ; l'éducation de la jeunesse noble, tait toute virile, et dirigée principalement vers la soumission, le dévouement et la fidélité. La loyauté, l’humanité, le courage, l'honneur étaient des vertus communes à tout le corps des nobles; enfin la pudeur, jointe à toutes sortes de sentimens généreux, avait chez les femmes [204] nobles une grâce et une dignité toute particulières. Une hiérarchie parfaite était établie entre les nobles, de telle sorte que les services qu'ils rendaient mutuellement étaient toujours honorables, même ceux de la livrée ou librée, ceux de varlet, de laquais ou lacquet, etc.
Tout cela est beau, sans doute ; mais quoi ! ne sera-t-il jamais question ici des roturiers qui peut-être sont aussi des hommes? Vous ne nous dites point s'ils participaient à tous ces avantages. Les roturiers, ou plus proprement les serfs, avaient en France l'avantage de n'être pas employés au service domestique et de n'être point considérés tout-à-fait comme esclaves: « La terre française étant réputée une terre essentiellement généreuse sur laquelle tout esclave devenait libre par cela seul qu'il en respirait l'air. » Il est vrai qu'ils étaient attachés à des domaines qu'ils ne pouvaient point abandonner, qu'ils passaient de main en main avec le fonds auquel ils appartenaient, et qu'ils ne pouvaient eux-mêmes en posséder. Outre les divers tributs qu'ils avaient à payer, [205] ils étaient tenus aussi à des corvées et à des devoirs réputés serviles. Mais ils avaient en propre des animaux, de l'argent, des marchandises dont ils pouvaient disposer; et « ils se composaient ainsi des fortunes plus ou moins considérables surtout dans les villes. » Prenez-y garde, ce sont ces fortunes, ouvrage de l'industrie et du commerce, qui vont par des progrès rapides effacer bientôt le lustre de vos propriétés seigneuriales, nécessiter l'affranchissement des communes et faire tomber tout votre système.
Il faut donc, pour le conserver, que vous trompiez le vœu de la nature en empêchant la société du plus grand nombre de se cimenter dans des villes, en disséminant vos paysans sur la surface de vos domaines, en détruisant les fruits de leur pécule qui bientôt étoufferaient ceux de votre usurpation. Que d'injustice dans les principes ! Quels torts envers des nations entières de la part d'un petit nombre d'hommes ! Quelles seront les mœurs, les avantages de l'éducation, et les effets du mérite personne! dans une [206] multitude que vous immolez ainsi à votre vanité encore plus qu'à votre ambition ? Ainsi vous mettez dans l'ombre la plus grande partie du genre humain pour relever l'éclat de votre gloire factice. Les peuples châtieront un jour avec quelque justice cet insolent orgueil qui ne trouve la liberté que dans l'esclavage d'autrui ; à ce prix nous ne voudrions pas même de la liberté des Romains et des Spartiates.
Pour achever cette partie morale des observations de M. de Montlosier, je dois dire qu'il tire un très-bon parti de ces idées de subordination, des liens civils et domestiques nécessaires, selon lui, à la bonne constitution d'un état. Il en fait de très-bonnes applications particulières. Mais je ne puis douter qu'il n'en abuse en faveur du système féodal. Il est bien vrai que tout est subordination dans la société; le fils dépend de son père; le fermier, de son propriétaire; le pauvre, du riche qui le fait travailler, etc.; mais il ne s'en suit pas delà que l'un appartienne à l'autre. Ceci a besoin d'explication. Nous devons distinguer deux sortes de [207] subordination ; l'une établie par la nature, l'autre par les hommes. Être subordonné par la volonté de la nature, c'est dépendre ; être subordonné par la volonté de l'homme, c’est appartenir. Le fils, le fermier, le pauvre dépendent du père, du propriétaire, puisque la nature seule, le besoin seul les obligent à se soumettre. L'esclave, le citoyen appartiennent, l'un à son maître; l'autre, sous quelques rapports seulement, à sa patrie, par le seul effet de la volonté de l'homme. La plus grande liberté à laquelle nous avons tous le droit de prétendre, consiste à dépendre le plus possible des besoins de notre nature, de nous-même enfin, et le moins possible des volontés étrangères.
La nécessité de conserver l'état social doit seule donner la mesure rigoureuse de proportion entre ces deux sortes de dépendances ; les gouvernemens dans lesquels l'une ou l'autre excède la mesure sont ou anarchiques ou despotiques. Le gouvernement féodal se trouve évidemment dans ce dernier cas. Cette distinction peut, je pense, jeter quelque lumière sur les sophismes renfermés [208] dans le passage suivant : « Prenons garde que nos vues de liberté ne soient pour de certaines classes une vaine théorie ou un malheureux piége. Que signifie la liberté politique dans un homme qui n'a pas même un peu de laine pour se faire des habits, ni un peu de chaume pour se faire un tôît ? Que Dieu me préserve de la liberté politique d'un homme de cinq pieds dix pouces, qui est mon voisin, et qui n'a pas de quoi dîner demain ! Au lieu de s'occuper de la liberté pour certaines classes, qu'on s'occupe de les arracher au besoin. » C'est fort bien fait sans doute de s'occuper d'arracher aux besoins les classes indigentes ; mais il est faux que la liberté politique ne signifie rien pour elles. Cet homme qui manque de pain aujourd'hui, peut demain, soit par lui-même, soit dans la personne de ses enfans, s'élever à l'aide de l'industrie et du talent au rang du propriétaire, de représentant, d'administrateur ou de général d'armée. Vous lui faites tort en étant à lui et à toute sa race une telle possibilité. Plusieurs fois dans son ouvrage, [209] M. de Montlosier semble déduire le gouvernement féodal de l'incapacité des non-propriétaires aux fonctions politiques, consacrée de tout temps chez les peuples libres. C'est une dérision : sans doute, il faut exclure les prolétaires; mais il ne faut pas les condamner à l'être éternellement avec toute leur postérité.
Venons à la doctrine historique de M. de Montlosier.
Il faut bien s'entendre, lorsque l'on prétend que les dominations féodales étaient usurpées. Sans doute, elles l’étaient pour le philosophe qui les juge sur les principes éternels du droit de l'homme en société ; mais elles ne l'étaient point pour le publiciste habile qui sait en retrouver l’origine dans l'ancien droit positif des Francs et des Gaulois. C'est ce qu'a fait M. de Montlosier, s'il; m'est permis de prononcer sur des matières aussi difficile, avec un succès digne de son talent. S'il en est ainsi, il se trouvera que depuis Philippe-le-Bel jusqu'à nos jours, tous les pouvoirs et les droits qui se sont élevés sur les débris de la [210] féodalité, ne sont que des usurpations plus ou moins illégitimes. Je ne vois pas d'inconvénient à avouer que ce sont autant d'usurpations du temps et de la raison sur le droit positif. Il fallait que les rois usurpassent le despotisme des nobles, afin qu'il fût possible à la nation à'usurper ses droits sur le despotisme ainsi concentré entre les mains d'un seul.
M. de Montlosier s'est proposé de montrer l'origine du système féodal, tout en établissant l'antiquité immémoriale des élémens qui ont composé ce système. La distinction des terres et des individus en tributaires et libres, les justices seigneuriales, les guerres particulières de cité à cité, et les corps armés sous la conduite des seigneurs, existaient dans la Gaule avant la conquête des Romains; leur domination n’apporta aucun changement dans le régime intérieur des Gaulois; seulement la contagion des mœurs romaines, la culture des terres, et l'habitation des villes, contribuèrent puissamment à affaiblir en eux l'esprit guerrier et l'énergie des mœurs des Germains que les Francs rapportèrent dans [211] toute leur pureté lors de leur invasion. Ceux-ci laissèrent subsister en tout l'ordre établi, se contentant de la portion de terres qui leur fut cédée, et d'un certain degré de considération au-dessus des Gaulois ingénus. Cela ne doit pas nous étonner. Les vainqueurs et les vaincus, Romains ou barbares, étaient trop peu civilisés pour qu'il fût possible à cette époque d'organiser une conquête. Les anciens n'avaient que deux manières d'envahir un pays; c'était ou de tout détruire et d'emmener la population entière en captivité, quand on s'emparait d'une ville, d'une contrée très-peu étendue, ou bien de laisser subsister tout l'ordre civil et polique (sic) en se bornant à une concession de territoire, soit à quelques tributs quand il s'agissait d'une vaste région.
Cependant ce mélange de deux peuples réunis sous une même domination présentait dans les premiers temps une confusion de lois et de coutumes différentes que M. de Montlosier s'applique à débrouiller. Mais bientôt les Gaulois propriétaires d'alleux s'honorent de porter le nom du peuple [212] vainqueur ; les mœurs des deux nations se modifient mutuellement; l'aversion des Francs pour la servitude domestique la fait disparaître de toute la Gaule ; leur goût pour la campagne leur fait abandonner les villes (castra), et les retient dans leurs domaines. Les châteaux (castella) se multiplient de toutes parts. Les guerres privées de domaine à domaine se multiplient en même-temps. L'ordre et les formes judiciaires subissent quelques modifications, entr'autres, l'usage des épreuves et des combats. Les assemblées germaines, dont parle Tacite, s'introduisent dans l'ordre politique sous le nom de champ de Mars et de Mai.
Nous arrivons à une époque nouvelle, l'institution de la féodalité. L'erreur de Montesquieu et de tant d'autres écrivains a été de croire que ce régime était un effet de la concession des bénéfices. Mais, comme le dit M. de Montlosier : « Si les bénéfices devaient être regardés comme l'origine principale de la féodalité, ce ne serait ni en France, ni à l'époque de l'établissement des Francs, qu'il conviendrait de placer [213] cette origine, ce serait à Rome même. On trouve assez dans l'Histoire Romaine de ces sortes de concessions qu'on y appelle aussi bénéfices. C'étaient des terres des vaincus qu'on partageait, etc. … Il y eut des ducs et des comtes sous les empereurs romains et sous les rois mérovingiens ; il n'y eut pas pour cela de féodalité. Pour ce qui est de l'usage soit des serfs domestiques, soit des serfs de la glèbe, qu'on a coutume d'y rattacher, il a fallu un grand aveuglément ou une grande ignorance pour voir dans cet usage commun à tous les peuples et aussi ancien que le monde, quelques rapports avec notre féodalité moderne. »
Ici l'auteur distingue trois sortes de patronage et de clientèles établies depuis des siècles chez trois peuples différens. L'une, toute civile, adoptée par les Romains, liait le patron au client par des services réciproques d'ambition ou d'intérêts civils ; l'autre, toute servile, pratiquée chez les Gaulois, livrait à l'homme puissant la nue-propriété de la terre de l'homme faible, [214] ainsi qu'une partie du revenu, sous la condition de lui conserver le reste. La troisième enfin, toute militaire et noble, confiait à un chef de guerriers la foi et le courage de ses compagnons, et leurs engagemens mutuels devaient être récompensés par le partage des fruits de la guerre. Par le rapprochement de ces diverses nations, leurs diverses espèces de clientèle se confondent et prennent toutes le caractère honorable de la dernière. La subordination des domaines devait être noble et rapportée exclusivement au service militaire, comme celle des personnes, chez les Francs devenus propriétaires. Les Gaulois, déjà confondus avec eux, devaient imiter cet exemple ou plutôt profiter de cette alliance de la clientèle des Francs avec la leur. « La clientèle civile des Romains reçut à son tour un lustre qu'elle n'avait pas. » Pourquoi M. de Montlosier ne développé-t-il pas les effets de cette nouvelle illustration de la clientèle civile, tandis qu'il insiste sur les deux autres. Ne serait-ce pas parce que cette distinction, quoique juste en elle-même, ne se retrouve [215] pas ici dans les faits? Quoi qu'il en soit, nous avons trouvé la féodalité. Des actes solennels déclarent que les soumissions de la personne et des biens ne portent aucune atteinte à l'ingénuité. Les dénominations de vassus et de miles, depuis celle de chevalier, succèdent à celle de client. On ne livre plus ses biens, on les recommande. Des cérémonies caractérisent la recommandation noble. Il est vrai que la recommandation servile des anciens Gaulois subsistait encore pour les individus de la dernière classe, lorsqu'après s'être coupé les cheveux du devant de la tête, ils se présentaient dans la cour d'un homme puissant pour les lui offrir.
Montesquieu, et plusieurs autres auteurs, ont trouvé dans l'hérédité des bénéfices établie, principalement sous Charles-le-Chauve, la cause d'une grande révolution en faveur du système féodal. M. de Montlosier prouve que l'on doit attacher peu d'importance à cet événement, en distinguant le bénéfice fictif du bénéfice réel. L'un avait lieu «quand un propriétaire d'alleu venait,une branche d'arbre à la main, remettre sa propriété à [216] un homme puissant qui la lui rendait aux charges de la féodalité; l'autre avait lieu quand un vassal avait réellement reçu en bienfait du roi, d'un Comte ou d'un seigneur un domaine quelconque. » Or, dans te premier cas, il était tout simple que l'alleu héréditaire devint fief héréditaire; dans le second cas, qui arrivait de jour en jour plus rarement, on devait suivre l'exemple donné dans le premier.
Telle est l'histoire de la constitution française sous les deux premières races. Quelques considérations sur la royauté sont nécessaires pour la completter (sic).
L'indépendance des mœurs germaines devait resserrer le pouvoir des rois Francs dans des limites très-étroites. Aussi voyons-nous qu'ils ne pouvaient régler les grandes affaires sans consulter la nation toute entière, et les moins importantes sans l'avis des principaux officiers. Ils trouvèrent un esprit et des mœurs toute différentes quand ils se virent à la tête d'une nation courbée depuis long-temps sous le pouvoir absolu des empereurs et au milieu d'un clergé accoutumé [217] à prêcher le droit divin du despotisme. L’influence de la nation dominante contint le pouvoir royal dans ses premières bornes ; seulement comme les rois n'étaient plus des chefs de hordes errantes, leurs soins s'étendirent à de nouvelles parties de l'ordre civil, mais toujours avec les mêmes restrictions. La diversité des dispositions des sujets à l'égard du pouvoir royal a donné naissance a une multitude de témoignages contradictoires de soumission et d'indépendance dont les écrivains des divers partis ont profité chacun dans leur sens, et que M. de Montlosier apprécie à leur juste valeur.
De-là il s'applique à établir les véritables principes de la succession au trône sous les deux premières races, et il démontre que, quoique la royauté fut attachée particulièrement à une même famille, le roi devait être élu par la nation qui ne se conformait pas toujours à l'ordre de primogéniture. L'exclusion des femmes, chez les Francs, est motivée d'abord sur un de leurs usages, qui consistait en ce que la femme recevait une dot du mari au lieu d'en apporter une, de sorte que le [218] droit de succession aurait fait échoir entre leurs mains un double héritage ; ensuite sur la nécessité d'avoir des hommes pour chefs chez une nation toujours armée, toujours vagabonde, et en état de guerre depuis si long-temps.
Voyons maintenant quelles furent les causes de la chute des deux premières races.
Les donations de bénéfices à perpétuité épuisaient de jour en jour les ressources de la couronne. Tout le domaine royal était déjà dissipé sous Chilpéric. « Notre fisc n'a plus rien, disait ce prince; nos richesses, ce sont les églises qui les possèdent. Elles sont dans l'abondance, et nous dans la misère. »
Les recommandations dont l'usage s'introduisit, rapidement, enlevèrent au monarque cette suprématie qu'il exerçait directement sur les individus et les domaines.
« Ces deux causes réunies me conduisent à une troisième plus grave. D'un côté, il était permis de se recommander à qui on voulait; d'un autre côté, comme les rois n'avaient plus de concessions à faire, la foule des recommandations commença à [219] se tourner vers le maire du palais, qui, ayant dans ses mains la garde du prince et la discipline des troupes, acquit facilement toute l'importance. De cette manière tout échappa au prince; il ne lui resta plus de son ancien royaume qu'un palais dont le gouverneur indépendant lui fut donné par une poignée de Leudes. » .
La moindre commotion devait abattre l'une de ces deux puissances ainsi minée dans ses fondemens. L'invasion des Sarrasins, les triomphes de Charles Martel, l'adroite ambition de Pepin renversèrent la dynastie mérovingienne presque sans effort. Cependant le partage du pouvoir entre les seigneurs augmentait de jour en jour la faiblesse des ressources matérielles du monarque. Il fallait tout le génie de Charlemagne pour suppléer an pouvoir de la couronne. Dès le règne de son successeur sa dynastie est en péril. Le duc de France et l'invasion des Normands furent pour cette race ce qu'avaient été pour la précédente le maire du palais et l'irruption des Sarrassins.
» Je ne puis m'empêcher, dit M. de [220] Montlosier, de remarquer à ce sujet les destinées de la France. Mérovée y forme quelques établissemens; c'est après l'avoir délivrée, dans les plaines de Châlons, des Huns et d'Attila. Clovis, son petit-fils, s'y établit tout-à-fait; c'est après l'avoir délivrée des Allemans à Tolbiac. La race de Charles Martel s'élève à la place de celle de Mérovée; c'est après nous avoir délivrés des Sarrasins. La maison Capétienne s'élève ensuite à la place de celle de Charmagne; c'est après nous avoir délivrés des Normands. Il était dans les décrets de la Providence qu'une autre maison s'élevât à son tour, après nous avoir délivrés de barbares d'un autre genre. » Ceci était écrit en 1806.
A la suite de ce tableau des deux premières races, l'auteur examine, dans une dissertation entièrement polémique, diverses opinions de M. de Boulainvilliers, de l'abbé Dubos, du président Hénault, de M. de Valois et de Montesquieu. Ses réfutations m'ont paru convaincantes. Il combat très-bien les déclamations modernes sur les [221] guerres particulières, en prouvant qu'elles faisaient partie du droit des Francs, qu'elles étaient autorisées par les édits des monarques et par les mœurs de la nation. Du reste, cet usage paraît n'avoir rien de choquant à ses yeux.
Deux graves erreurs de Montesquieu sont ici combattues par M. de Montlosier. L'une, que le gouvernement féodal a été établi dans toutes ses parties avec les Francs et par les Francs; l’autre, que toute la noblesse française résidait dans l'ordre des Antrustions ou officiers de la couronne. M. de Montlosier aurait pu relever ici la manière frivole et fausse avec laquelle l'auteur de l’Esprit des lois soutient cette dernière opinion contre l'abbé Dubos qui, cette fois du moins, ne méritait pas sa sanglante critique. Un décret de Childébert, cité par l'abbé Dubos, porte que si le juge trouve un voleur fameux, il le fera lier pour être envoyé devant le roi, si c'est un Franc ( Francus); mais si c'est une personne plus faible (debilior persona), il sera pendu sur le lieu. L'abbé Dubos entend par Francus un Franc, un homme [222] libre ; par debilior persona un serf. Montesquieu veut au contraire que Francus signifie un Antrustion, et debilior persona un Franc d'une condition inférieure ; mais non pas un serf. « Dans quelque langue que ce soit, dit-il, tout comparatif suppose nécessairement trois termes, le plus grand, le moindre, le plus plus petit… » Si ce principe était vrai sans restriction, il s'ensuivrait que quand les Latins disaient debilior manus, ils supposaient une troisième main, comme l'avare de Plaute. Montesquieu ajoute: « S'il n'était ici question que des hommes libres et des serfs, on aurait dit un serf, et non pas un homme d'une moindre puissance. » Nous pouvons répondre à cela que debilior persona est l'expression la plus juste pour désigner tout ce qui n'était pas Franc, soit serf, soit Gaulois ingénu. Il fallait un terme générique pour désigner en même-temps les deux ordres de personnes que l'on soumettait à la même peine. Laissons-là cette dispute grammaticale, et reprenons avec M. de Montlosier l'Histoire de France sous la troisième race.
[223]
Pendant les premiers siècles, les progrès de l'organisation féodale, qui s'étend aux moindres propriétés, n’amènent aucun changement dans les institutions. Cette chambre législative et judiciaire, nommée autrefois l'Assemblée d'automne, prend le titre de Parlement de pairs, ou barons. La succession au trône reste soumise aux mêmes lois; mais elle se fonde ensuite sur de nouveaux principes par l'accession des grands fiefs à la couronne. Les fiefs étaient héréditaires : la couronne ne l'était point. Mais la qualité de seigneur suzerain de tous les fiefs attribués à l'héritier du roi, devait entraîner nécessairement celle de roi, et donner naissance au droit héréditaire de la couronne. Cependant les formules de l'ancien droit ne sont point supprimées et forment, avec celles du nouveau, l'assemblage le plus bizarre. M. de Montlosier en trouve un exemple frappant dans un ancien cérémonial du sacre, « L'archevêque dit d'abord dans son oraison: Seigneur, multiplie les dons de tes bénédictions sur cettuy ton serviteur, lequel, par humble dévotion, élisons par [224] ensemble au royaume. Voilà pour le roi et pour le droit électif. L'archevêque s’adressant ensuite personnellement au prince, lui dit : Sois stable; et retiens long-temps l'état, lequel tu as tenu jusqu'à présent pour la suggestion de ton père, de droit héréditaire. Voilà pour le seigneur et pour la seigneurie héréditaire. »
Les femmes ne furent point appelés au trône quoiqu'elles le fussent aux successions de fiefs. C'est que les droits féodaux, en se réunissant sur les mêmes individus, durent se corriger ou s'altérer mutuellement.
Un grand événement va nous ouvrir une époque toute nouvelle. L'affranchissement des communes produira la révolution la plus importante des temps modernes. M. de Montlosier nous l'annonce en ces termes: « Nous allons voir s'élever au milieu de l’ancien état, un nouvel état; au milieu de l'ancien peuple, un nouveau peuple; au milieu des anciennes mœurs, des anciennes institutions et des anciennes lois, de nouvelles mœurs, de nouvelles institutions, de nouvelles lois. Nous allons voir un état [225] double, un peuple double, un ordre social double, marcher pendant long-temps parallèlement l'un à l'autre, s'attaquer ensuite, et se combattre avec acharnement. Telle est cette grande révolution qui a été elle-même la source d'une multitude de révolutions ; qui, en se propageant dans toute l'Europe, l’a couverte de guerres et de troubles, a rempli l'empire d'Allemagne de villes impériales, l'Italie de républiques ; a répandu partout une multitude de droits nouveaux, d'états nouveaux, de doctrines et de constitutions nouvelles. »
Comme, pour vous intéresser d'avance à cette malheureuse noblesse que l'on va dépouiller pièce à pièce de toutes ses prérogatives, et pour jeter de l'odieux sur tant d'usurpations, M. de Montlosier fait valoir avec une sorte de jactance l'abolition de l'esclavage ou servitude domestique, plaie funeste dont le genre humain semblait avoir désespéré de se guérir ! Il refuse positivement à la religion catholique, pour l'attribuer tout entier à la noblesse des mœurs germaines, le [226] mérite de cette importante révolution. « Les progrès en ont été lents, dit-il ; mais du moment qu'elle se manifeste elle présente tout-à-coup deux grands mouvemens : le premier, qui porte tous les esclaves à la condition de tributaires et abolit ainsi le véritable esclavage ; le second, qui porte le lustre de la grandeur et de la noblesse à des fonctions que les autres peuples avaient affecté de flétrir. » C'était une distinction honorable d'être appelé par un seigneur ou une femme de qualité au service intérieur de la maison. Le service militaire, inséparable du service domestique, lui communiquait tout son éclat. « En même temps que le vassal combattait à côté de son seigneur sur le champ de bataille, le fils de ce vassal ou vasselet faisait, conjointement avec le fils du seigneur, ou damoiseau, (domicellus,) le service de la maison. Les seigneurs envoyaient ainsi réciproquement les uns chez les autres, leurs enfans pour soigner les chevaux, servir à table, remplir les offices de page et de valet. Celui d'entr'eux qui, s'étant fait remarquer par son [227] courage et par son zèle, était désigné spécialement aux soins de l'armure et du cheval de bataille, se trouvait très-honoré. Sa place était désormais à côté du maître. Ecuyer était pour le château le premier grade militaire en même temps que le premier grade domestique ». Les anciennes charges de connétable (intendant des écuries), celles de chambrier, de bouteiller, etc., jointes aux plus importantes fonctions de l'état, présentent cet ordre de domesticité noble dans le palais long-temps, avant qu'il se soit introduit dans les châteaux des seigneurs.
Affranchir, dans notre histoire, ne veut pas dire délivrer de l'esclavage domestique, et élever à une condition moyenne, celle des libertini. Ce mot signifie donner la condition de Franc. Un tel acte, jusqu'à l'époque des croisades, n'avait porté que sur des individus. Le dénuement des gentilshommes croisés qui rentrèrent dans leur patrie, l'extinction d'un grand nombre de familles ; mais, plus que tout le reste, sans doute, l'instant besoin de la civilisation, déterminèrent les [228] communes à acheter leurs franchises à prît d'argent ou à les enlever de force. Les rois, dont l'autorité s'accroissait des pertes de la féodalité, secondèrent ce mouvement de tous leurs efforts. On les vit invoquer solennellement cette doctrine des droits de l'homme, qu'ils oublièrent dès qu'ils n'en eurent plus besoin. « Les habitans des campagnes, qui par ces mots, franc et franchise, entendaient spécialement l'exemption des tributs[1], se soulevèrent. On se mit, comme dans ces derniers temps, à massacrer les nobles et à incendier les châteaux ». Malheureusement les désordres de la jacquerie, insuffisans pour détruire le régime féodal, ne devaient être que les précurseurs d'une nouvelle jacquerie plus terrible dans ses effets et plus importante dans ses conséquences, qui devait entraîner la [229] royauté absolue avec les derniers débris de la féodalité.
Les villes et la plus grande partie des campagnes, délivrées du joug des seigneurs, se composèrent une administration et des justices nouvelles. Il leur fallait un nouveau droit; la découverte des ouvrages de Justinien leur offrit un corps complet de lois civiles qui fut reçu avec enthousiasme, étudié par-tout avec ardeur, et propagé soigneusement par les rois qui ne manquaient pas de bonnes raisons pour le faire. Ce nouveau droit leur présentait un double avantage dans l'exclusion du droit féodal, et les doctrines de despotisme monarchique qui en devaient résulter.
A cette époque, l'ancien peuple, pour me servir de l'expression de M. de Montlosier, fait un effort pour se maintenir dans ses libertés. Les grandes expéditions d'Asie et d'Afrique avaient déterminé l'armement des milices de tributaires, qui obtenaient la liberté du moment qu'elles s'associaient aux travaux militaires des nobles ; delà le nom de livrée, dont elles s'honorèrent long-temps. Tandis [230] qu'en Italie et en Angleterre, la noblesse se livrait en quelque sorte à la discrétion des villes et de la chambre des communes, nos anciens Francs, retranchés dans leurs châteaux, résistaient aux attaques du nouveau peuple à l'aide de leurs fidèles milices. Les assises de Jérusalem, le livre des fiefs, les établissemens de Philippe-Auguste et de St.-Louis, donnaient en même temps un corps plus régulier et plus imposant à la constitution féodale.
M, de Montlosier observe d'une manière aussi juste qu'ingénieuse les changemens que nos révolutions ont fait subir à la langue du système féodal. Nous avons vu les dénominations de seigneur et de vassal succéder à celles de patron et de client; les mots noble, noblesse, anoblissement, sont adoptés maintenant par les possesseurs de fiefs pour se distinguer de la multitude des nouveaux Francs ; les idées que ces mots expriment étaient exprimées auparavant par ceux de franchise et d'affranchissement; et ce serait une erreur de croire, comme le président Hénault, que la noblesse et les anoblissemens n'ont commencé qu'avec l'usage de ces deux mots. C’est [231] ainsi que les chevaliers existèrent long-temps sous les noms de milites, vassi, etc., avant de prendre celui de chevaliers.
Cependant la monarchie française s'achemine sans cesse vers un nouveau gouvernement. Nous aimerions à suivre pas à pas, comme nous l'avons fait jusqu’ici, la marche que lui fait tenir M. de Montlosier, interprète éclairé, quoique partial, de cette longue révolution ; mais l'haleine pourrait nous manquer sur ses traces. Cet ouvrage est tellement rempli d'aperçus ingénieux, vrais et profonds, qu'il faudrait une plume plus habile même que celle de M. Montlosier pour les présenter tous dans une analyse rapide et serrée, sans les effacer ou les affaiblir. Jusqu'ici nous n'avons eu que trop à redouter ce danger ; mais nous devions insister particulièrement sur les difficultés de notre ancienne histoire que l'auteur a décidées d'une manière qui lui est propre. Nous allons parcourir plus rapidement le tableau de la décadence de nos anciennes institutions, ensuite, nous nous arrêterons de préférence aux considérations qui sont relatives à l'histoire de la génération actuelle.
[232]
C’en est fait, la justice, la raison, les sciences, les arts, l'industrie et toute la nature humaine ont conspiré avec l'autorité royale la perte du régime féodal. D'abord on enlève à la noblesse ses juridictions seigneuriales. Des baillis choisis par le roi parmi les grands seigneurs, s'attribuent un certain nombre de causes dites cas royaux et cas d'appel, et finissent par les envahir toutes. De là il s'établit que le roi était dans l'état le seul juge, et que toute justice émanait de lui. Bientôt des gradués roturiers, associés aux baillis pour leur servir de conseils, prennent leur place et s'emparent des tribunaux. C'est ainsi que des légistes plébéiens, consultés d'abord par le parlement des barons, finissent par s'y asseoir et par en chasser les hauts et puissans seigneurs. De là cette institution équivoque, à la fois politique et judiciaire, sans vocation comme sans lois, qui fut si funeste à la France, en prévenant de meilleures institutions. … Ah ! si à cette époque d'une réorganisation défectueuse à tant d'égards, la France avait été assez heureuse pour que ses divers ordres agissent de concert, et que ces [233] grands mouvemens s'opérassent également dans toutes les parties de la monarchie, comme il est arrivé chez une nation voisine, la noblesse, dépouillée de ses priviléges onéreux, se serait réfugiée auprès du trône, qui aurait eu besoin également de s'en faire un appui solide contre la terrible puissance des communes unies. Alors la double représentation nationale se serait composée d’elle-même et de ses véritables élémens : nous n'aurions pas enfin attendu tant de siècles et de souffrances pour n'obtenir encore que l'espérance d'une bonne constitution.
Heu ! nihil invitis fus quemquam fidere divis.
Revenons aux pertes successives de la noblesse. La paix du roi et la trêve de Dieu lui enlèvent le droit de guerre particulière. On la dispense de gré ou de force du service des fiefs ; le droit de lever des impôts et de battre monnaie lui est soustrait insensiblement. L'usage des tournois est aboli. Les nobles, soigneusement préservés de la taille, sont soumis sous les noms de vingtième et de capitation.
[234]
Je le répète, en parcourant cet ouvrage le lecteur est sans cesse harcelé par les regrets de l'auteur, qui semble faire de cette belle histoire un mémoire pour la noblesse féodale. C'est ainsi, par exemple, que M. de Montlosier semble se consoler de l'abolition des guerres particulières en songeant que le duel fut la ressource habituelle de nos gentilshommes, et que toute la puissance des rois ne put vaincre cette mode affreuse et barbare, digne, comme dit Rousseau, de sa féroce origine.
Les villes affranchies s'étaient d'abord attribué des prérogatives importantes; l'université était devenue dans l'état une puissance du premier ordre. Mais bientôt les rois, qui n'avaient favorisé leurs entreprises qu'afin d'abaisser la noblesse, mirent tous leurs efforts à leur enlever les dépouilles de la féodalité. Cependant, comme rien ne se faisait ouvertement contre l'ordre établi, les diverses mutations du pouvoir ne changeaient rien aux formes extérieures, aux grades et aux titres. Le pouvoir royal ne faisait pas les mêmes conquêtes dans toutes les provinces; [235] de sorte que les droits du monarque, ceux des nobles, des municipalités, des parlemens, etc., restèrent jusqu'à la fin équivoques, obscurs, inégaux et sujets à tous les caprices du hasard. De sorte que la monarchie française n'était, jusqu'à l'époque de la révolution,qu'un mélange bizarre et désordonné d'institutions nouvelles avec des institutions vieillies, de pouvoirs sans titres et de titres sans pouvoirs, de despotisme, de liberté et de priviléges combinés fortuitement et sans proportion : sine nomine corpus.
Le règne de Louis XIV peut être considéré comme le terme de la révolution dont nous venons de nous occuper, et le commencement d'une nouvelle qui n'est pas encore achevée aujourd'hui. Il est également vrai de dire que ce règne a été non-seulement le point de contact entre la révolution consommée et la révolution naissante, mais encore la cause décisive du passage de l'une à l'autre. Louis XIV, en couvrant la noblesse pressée autour de son trône de l'éclat qui lui était propre, afin de l'éclipser entièrement; en séduisant nos seigneurs pour en faire ses [236] hommes de cour, et anéantir tout-à-fait le personnage qu'ils représentaient encore dans l'état, semble s'être attiré particulièrement l'animadversion de M. de Montlosier. Du reste, nous conviendrons sans peine que cette expression, siècle de Louis XIV, n'est qu'un terme de flatterie surpris à la postérité, attendu que les plus grands hommes de ce siècle avaient commencé à briller avant qu'il pût les connaître ; attendu qu'il a fait le malheur des générations sur lesquelles il a régné ainsi que des suivantes, par ses manies hautaines de conquête et de prodigalité, monarque doué d'ailleurs de peu de talens personnels, triste jouet des femmes, des jésuites et de la fortune.
Nous sommes forcés de renvoyer le lecteur à l'ouvrage même, pour l'exposé des vices et des désordres dont la France est remplie sous les deux règnes suivans, soit dans son administration, soit dans sa conduite politique, soit dans ses mœurs. Plus de religion, plus de patriotisme, et pas une seule institution assez forte pour soutenir cet édifice délabré.
La nécessité d'une reconstruction se fait [237] universellement sentir. Quels moyens doivent être employés ? Que signifient ces échafaudages, détruits et relevés sans cesse sans pouvoir différer seulement la grande ruine dès long-temps imminente ? et les conseils supérieurs du chancelier de Meaupeou, et les réformes militaires de M. de Saint-Germain, et les réformes féodales de M. Turgot, et les administrations provinciales de M. Necker, la cour plénière, les grands baillages de M. de Brienne? L'on se décide enfin pour les états-généraux; la multitude va se mettre à l'ouvrage, aplanir les difficultés en détruisant tout de fond en comble ; la France gémira long-temps au milieu des trophées et des décombres, jusqu'à ce qu'un guerrier lui ramène l'ordre et le calme intérieur, en comprimant avec force tous les partis qu'il paraît réunir. Bientôt il l'entraînera à sa suite dans de nouveaux désastres, chargée de chaînes et de deuil … ; et, chose inouïe dans les annales du monde, après avoir été banni, il reviendra fonder un empire pour la seconde fois, après l'avoir, comme à plaisir, réduit en pièces entre ses mains.
[238]
M. de Montlosier paraît être ennemi de la doctrine de la souveraineté du peuple. Nous lui demanderons s'il admet la souveraineté de l'intérêt public. Sans doute il n'aura pas de peine à nous l'accorder. Hé bien ! quand on parle de la souveraineté du peuple, on ne dit, ou plutôt on ne doit rien vouloir dire autre chose que la souveraineté de l'intérêt public. L'expression est propre: il ne s'agit que de l'expliquer. C'est une folie de chercher le peuple souverain dans une révolution. On ne l'y trouvera pas; il n'existe que dans un gouvernement libre et régulier, quel qu'il soit d'ailleurs dans sa forme particulière, soit dans la démocratie d'Athènes, soit dans l'aristocratie tempérée des Romains, soit dans la monarchie représentative de l'Angleterre.
Au reste, M. de Montlosier remarque très-bien comment, par suite de cette doctrine mal entendue de la souveraineté du peuple, les progrès de la révolution ont suivi les diverses acceptions données au mot peuple. « Dans le principe, dit-il, quand on parlait du peuple français, on [239] entendait tous les ordres de l'état, et le roi lui-même … Ce furent les parlemens qui, dans la ferveur de leur résistance aux grands bailliages, commencèrent à parler des droits du peuple en opposition à ceux du roi. Louis XVI sentit très-bien le danger de cette locution; il se plaignit de ce qu'on le séparait de son peuple. Il n'en consentit pas moins aux états-généraux, qui, dans le sens d'alors, était une révolution pour tout le peuple, moins le roi.
« A une seconde époque, lorsqu'on eut inventé que les deux ordres privilégiés n'étaient rien, et que le tiers-état était tout; la noblesse et le clergé se plaignirent à leur tour de ce qu'on voulait les séparer du peuple. On n'en fit pas moins le 14 juillet, qui fut une révolution pour le peuple, moins le roi, la noblesse et le » clergé.
» Après la révolution du 10 août, on croirait que les fondateurs de la république eurent envie de compter pour quelque chose dans l'état les propriétés et les propriétaires. Leurs adversaires leur [240] démontrèrent très-bien que cette classe n'était pas plus le peuple que le roi, la noblesse et le clergé. Cela fit la révolution du 31 mai, qui fut une révolution pour le peuple, moins les propriétaires.
» On voit comment le sens du mot peuple s'altérant à chaque crise, finit par s'entendre exclusivement de ce qu'on appelait alors sans-culottes, et leur porta ainsi graduellement la souveraineté. »
Après le 9 thermidor, les hommes d'état s'emparent de la révolution pour la ramener par un pas rétrograde au système des Brissotins. Cette réaction devait en amener de nouvelles et nous faire remonter par degrés au point d'où nous étions partis, la monarchie constitutionnelle, et antérieurement la monarchie absolue. C'est ainsi qu'une impulsion trop violente doit être suivie d'une répulsion trop violente également. Si de tant de travaux il ne nous reste que l'expérience, profitons-en du moins pour l'avenir.
Les fautes de l'émigration, celles de la Vendée, celles des puissances étrangères dans leur première alliance ; les vices et les [241] désordres du gouvernement directorial sont exposés par M. de Montlosier avec beaucoup de force-et de vérité. Il démêle ensuite avec une adresse digne du sujet les habiles précautions et les savantes manœuvres employées par le général du 18 brumaire pour vaincre la révolution (sans l'humilier, nous venons de voir ce qu'il devait en coûter à d'autres, après avoir osé le tenter). « Le trait de génie a été de voir dans un objet extrêmement complexe, deux points, dont l'un, les principes, était devenu insoutenable ; l'autre, les résultats, était devenu inattaquable. » Bonaparte jette ensuite les yeux sur les divers partis ; il les trouve harassés de tant d'épreuves infructueuses, et divisés plutôt dans les personnes que dans les opinions. « Au milieu de cette ostentation de zèle prétendu révolutionnaire, le premier consul a pu croire que c'était moins la contre-révolution qu'on craignait, que ceux qui voulaient la faire; que c'était moins des rangs qu'on se défendait, que de ceux qui se désignaient pour les reprendre ; que si on paraissait [242] redouter le rétablissement d’un ordre social, c'était en le supposant au profit des vaincus plutôt qu'au profit des vainqueurs. Enfin, il a pu croire que la révolution consentirait à transiger sur ses erreurs dès qu'on lui abandonnerait ses conquêtes. »
« C'est ainsi que le premier consul a mis en sa faveur les intérêts révolutionnaires. Il a pu s'arranger aussi avantageusement avec les intérêts opposés.
» Au milieu de cette ostentation de zèle pour l'ancien régime, il a pu s'apercevoir qu'en retranchant quelques traits d'hostilités particulières, tout cet ensemble de vues d'ordre, de religion, d'honneur et d'équité lui seraient d'un grand servies. Il a comprimé, non pas comme on le dit quelquefois, tous les partis; mais seulement dans chaque parti ce qu'il y avait d'offensif. De cette manière, il a tout réuni à lui, les amis et les ennemis, etc. »
L'histoire du gouvernement de Napoléon, présentée sous deux aspects si différens dans les deux dernières parties de cet ouvrage, pourrait être comparée, comme la vie [243] humaine dans Bernardin de Saint-Piasre, à ce globe terrestre dont un hémisphère est réjoui par la lumière d'un soleil radieux, et l'autre reste plongé dans une ténébreuse horreur. Dans la première partie, sont exposés tous les bienfaits, et surtout les espérances de la restauration consulaire; dans la seconde, tous les vices du despotisme, toutes ses erreurs, et tous les principes de mort qu'il portait en lui-même.
Les monarques de l'Egypte étaient jugés après leur mort par leurs propres sujets ; Napoléon, de son vivant, a entendu sa sentence prononcée par tout son siècle, comme l'observe M de Montlosier ... Et le voilà qui, après s'être donné le temps d'entendre et de méditer le jugement de son siècle et celui de M. de Montlosier, revient tranquillement pour recommencer sa carrière.
Il est bon que cette dernière partie de l'ouvrage existe : il serait inconvenant de reproduire ici tous les détails qu'elle renferme. Nous nous contenterons de la recommander aux lecteurs ainsi que tout le reste de ce livre. Le style de M. de Montlosier est [244] énergique, rapide et clair. Souvent il s'élève et se colore d'images brillantes. Nous croyons pouvoir lui reprocher de s'abaisser souvent jusqu'à la familiarité dans les tournures et les expressions. En général, on y voudrait trouver plus d'étendue et de soin.
G.F.
Endnotes
[1] N'y a-t-il pas un peu de mauvaise foi dans cette expression? Les habitans des campagnes avaient-ils tort d'entendre par la franchise l'exemption de leurs tributs et de leurs charges les plus onéreuses.