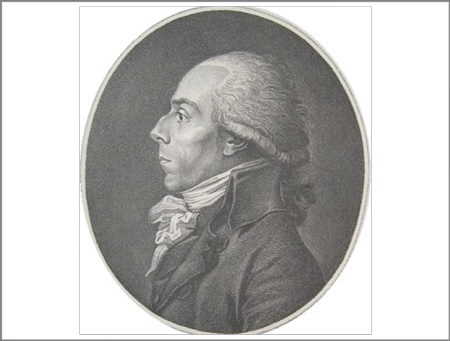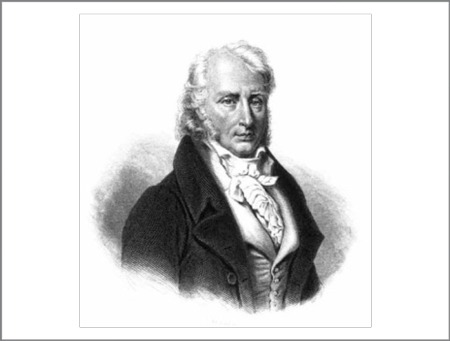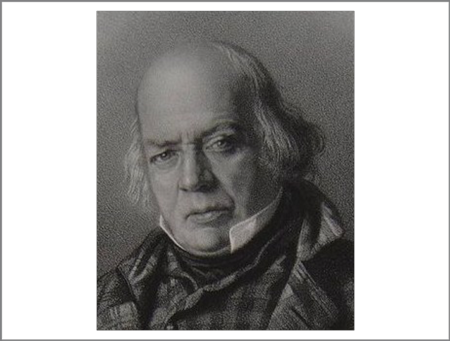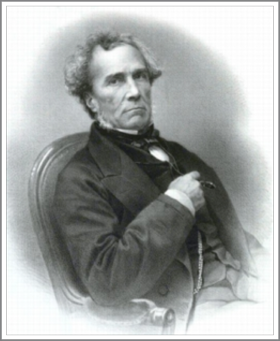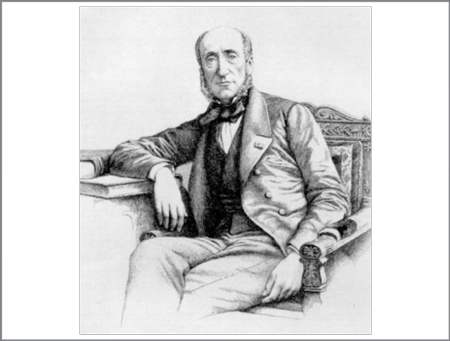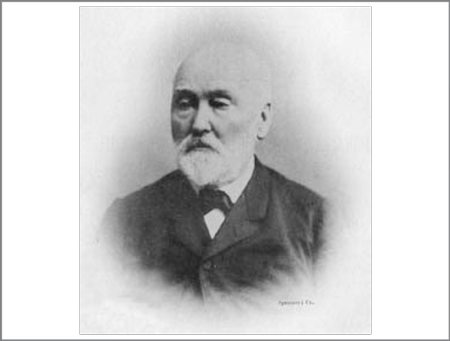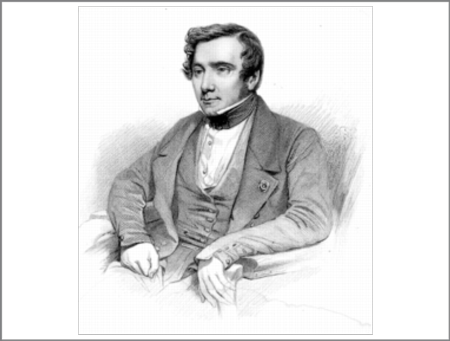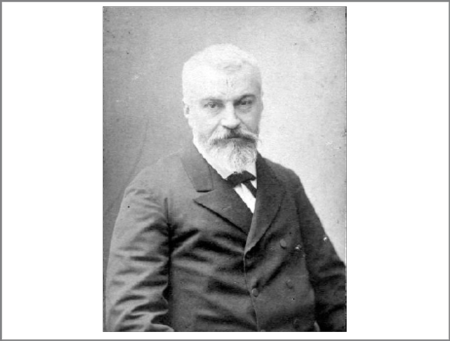The Golden Age of French Classical Liberal Thought: An Anthology of 19th Century Texts
[Created: 7 December, 2014]
[Updated:
January 17, 2017]
 |
Table of Contents
First Words: Optimism about Liberty and Human Perfectibility (1805)
PART I. The Empire (up to 1815)
- 2. Pierre-Louis Roederer on “Property Rights” (1800)
- 3. Jean-Baptiste Say on “The Division of Labour” (1803)
- 4. Destutt de Tracy on “The Laws and Public Liberty” (1811)
- 5. Benjamin Constant on “Usurpation and Despotism” (1814)
- 6. Charles Comte’s foreword to Le Censeur (1814)
- 7. Charles Comte (?) on “The Cause of Europe’s Wars” (Dec. 1814-15)
- 8. Charles Dunoyer on “Revolutions and Revolutionaries” (1815)
- 9. Benjamin Constant on "Individual Liberty and Arbitrary Government" (1815)
PART II. The Restoration (1815–30)
- 10. Pierre-Jean de Béranger’s “Conversation with the Censor” (1815)
- 11. Pierre-Jean de Béranger’s Songs about “Liberty and Politics” I (1813-1830)
- 12. Charles Comte and Charles Dunoyer’s foreword to Le Censeur européen (1817)
- 13. Destutt de Tracy on “Society” (1817)
- 14. Germaine de Staël on “The Love of Liberty” (1818)
- 15. Charles Dunoyer on "The Politics which comes from Political Economy" (1818)
- 16. Benjamin Constant on “The Liberty of the Ancients and the Moderns” (1819)
- 17. Pierre Daunou on “Freedom of Opinion” (1819)
- 18. Charles Dunoyer, “The Liberty of Industrious People” (1825)
- 19. Charles Comte on “The Influence of Slavery on Government and the Need for its Abolition” (1827)
- 20. Charles Dunoyer on “Political Place-Seeking” (1830)
PART III. The July Monarchy (1830–48)
- 21. Pierre-Jean de Béranger’s Songs about “Liberty and Politics” II (1830-1833)
- 22. Pierre-Jean de Béranger on “The Role of Political Songs” (1833)
- 23. Charles Comte on "Protecting Property against Threats from the State and the Problem of Property acquired by Usurpation" (1834)
- 24. Stendhal on “Political Corruption and Place-Seeking” (1834)
- 25. Alexis de Tocqueville on “The Liberty of the Press” (1835)
- 26. Alexis de Tocqueville on "The Centralisation of the State in America" (1835)
- 27. Gustave de Beaumont on “Slavery in America” (1835)
- 28. Gustave de Beaumont “The Abolition of the Aristocracy in Ireland” (1839)
- 29. Victor Schoelcher on “The Immediate Abolition of Slavery” (1842)
- 30. Charles Dunoyer on "The Proper Role of Government and the Danger of Political Speculators" (1845)
- 31. Frédéric Bastiat on "Refuting Economic Fallacies I: Petition of the Candle-makers" (1845)
- 32. Frédéric Bastiat on "Refuting Economic Fallacies II: The Economic Benefits of a Negative Railway" (1845)
- 33. Frédéric Bastiat on “Free Trade” (1846-1848)
- 34. Frédéric Bastiat's "Utopian Dream of Political and Economic Reform" (1847)
- 35. Frédéric Bastiat, “The Physiology of Plunder” (January, 1848)
- 36. Frédéric Bastiat on "Refuting Economic Fallacies III: A Small Play about Protection" (January, 1848)
PART IV. The Second Republic (1848–52)
- 37. Frédéric Bastiat on “The February Revolution” (March 1848)
- 38. Ambroise Clément on "Legal Plunder” (1848)
- 39. Charles Coquelin on “Free Banking” (1848)
- 40. Joseph Garnier, Tocqueville, Faucher, Wolowski, and Bastiat on “The Right to Work” (1848)
- 41. Gustave de Molinari on “The Private Production of Security I” (February 1849)
- 42. Gustave de Molinari on “The Liberty of Government” (mid-1849)
- 43. Joseph Garnier, Victor Hugo, Frédéric Bastiat on "Peace and Disarmament" (August 1849)
- 44. Charles Dunoyer on the “Demagogic Socialist Republic” (1849)
- 45. Frédéric Bastiat on “The State” (1849)
- 46. Frédéric Bastiat on “The Seen and the Unseen: The Broken Window” (1850)
- 47. Michel Chevalier on “The Protectionist System” (1852)
- 48. Guillaumin and Clément on “The State of Political Economy in France” (1852-3)
- 49. Léon Faucher on “Property” (1852-53)
- 50. Jean-Gustave Courcelle-Seneuil on “Sumptuary Laws” (1852)
- 51. Joseph Garnier on “The Cost of Collecting Taxes” (1852)
- 52. Joseph Garnier on “Laissez Faire – Laissez Passer” (1852)
- 53. Ambroise Clément on “Private Charity” (1852)
- 54. Horace Say on “The Division of Labour” (1852)
PART V. The Second Empire (1852–70)
- 55. Augustin Thierry on “The Birth of the Bourgeoisie” (1853)
- 56. Alexis de Tocqueville on “The Centralisation of the State in France” (1856)
- 57. Henri Baudrillart on “Political Economy” (1857)
- 58. Gustave de Molinari on "The Different Kinds of Property and Liberty" (1863)
- 59. Édouard Laboulaye on “Individual Liberties” (1863)
- 60. Louis Wolowski and Émile Levasseur on “Property” (1863)
- 61. Julie-Victoire Daubié on “The Equality of Women” (1866)
- 62. Ambroise Clément on "The Complete Liberty of Education" (1867)
- 63. Frédéric Passy on “Peace and War” (1867)
PART VI. The Third Republic (1871 onwards)
- 64. "T.S." on the "Emancipation of Women under Socialism and Liberalism" (1873)
- 65. Gustave de Molinari on "The Evolution of the Modern State" (1884)
- 66. Yves Guyot on “Colonial Policy” (1885)
- 67. Gustave de Molinari on “Why Politicians will not support Free Trade Ideas in the Chamber” (1886)
- 68. Hippolyte Taine on “Abusive Government Intervention” (1890)
- 69. Paul Leroy-Beaulieu on “The Definition of the State” (1890)
- 70. Yves Guyot on “The Tyranny of Socialism” (1893)
- 71. André Liesse on "State Socialism" (1894)
- 72. Yves Guyot on “The Rule of Law and the Dreyfus Affair” (1897)
- 73. Gustave de Molinari on "The Political Economy of Militarism and a plan for a League of Neutral States" (1898)
- 74. Gustave de Molinari on “Governments of the Future” (1899)
- 75. Gustave de Molinari on “The Achievements of the 19th Century” (1901)
- 76. Gustave de Molinari on “The Prospects for Liberty in the 20th Century” (1902)
- 77. Vilfredo Pareto on "The Circulation of Elites and Socialism" (1902)
- 78. Émile Faguet on “Why the French People are not Liberals” (1903)
Last Words: Pessimism about the Future of Peace and Liberty (1911)
Front Matter
Introduction↩
The working title for this anthology is L'Age d'or du libéralisme français: Anthologie sur les libéraux du XIXe siècle [The Golden Age of French Liberalism: An Anthology of 19th Century Liberals]. It is a longer, French-language version of an anthology we edited for Routledge which was published in May 2012: French Liberalism in the 19th Century: An anthology. Edited by Robert Leroux and David M. Hart (London: Routledge, 2012). <http://www.routledge.com/books/details/9780415687423/>. This volume is number 145 in the Routledge studies in the history of economics <http://www.routledge.com/books/series/SE0341/>. The table of contents and facsimile PDFs of the original source material can be found at:
<http://davidmhart.com/liberty/FrenchClassicalLiberals/Anthology/index.html>.
The table of contents of the longer, French-language version of the anthology can be found below. Also available online are the facsimile PDFs of the original source material:
<http://davidmhart.com/liberty/FrenchClassicalLiberals/Anthology/index-fr.html>.
A considerably shorter, edited version will be published by éditions Ellipses in Paris <http://www.editions-ellipses.fr/>.
As of 20 June, 2012 the anthology was 552,632 words long (1,530 pages in size 14 font) and consisted of 79 extracts by the following 35 authors (listed in chronological order of date of birth). We have given special attention to the “giants” of the French classical liberal tradition, which in our view are:
1.Jean-Baptiste Say (1767-1832)
2.Benjamin Constant (1767-1830)
3.Charles Dunoyer (1768-1862)
4.Charles Comte (1782-1837)
5.Frédéric Bastiat (1801-1850)
6.Alexis de Tocqueville (1805-1859)
7.Gustave de Molinari (1819-1912)
The complete list of authors in the anthology:
1.Pierre-Louis Roederer (1754-1835)
2.Destutt de Tracy (1754-1836)
3.Pierre Daunou (1761-1840)
4.Germaine de Staël (1766-1817)
5.Jean-Baptiste Say (1767-1832)
6.Benjamin Constant (1767-1830)
7.Charles Dunoyer (1768-1862)
8.Pierre-Jean de Béranger (1780-1857)
9.Charles Comte (1782-1837)
10.Stendhal (1783-1842)
11.Horace Say (1794-1860)
12.Augustin Thierry (1795-1856)
13.Frédéric Bastiat (1801-1850)
14.Gilbert Guillaumin (1801-1864)
15.Gustave de Beaumont (1802-1866)
16.Charles Coquelin (1802-1852)
17.Léon Faucher (1803-1854)
18.Victor Schoelcher (1804-1893)
19.Alexis de Tocqueville (1805-1859)
20.Ambroise Clément (1805-1886)
21.Michel Chevalier (1806-1887)
22.Louis Wolowski (1810-1876)
23.Joseph Garnier (1813-1881)
24.Jean-Gustave Courcelle-Seneuil (1813-1892)
25.Gustave de Molinari (1819-1912)
26.Henri Baudrillart (1821-1892)
27.Frédéric Passy (1822-1912)
28.Julie Daubié (1824-1874)
29.Émile Levasseur (1828-1911)
30.Hippolyte Taine (1828-1893)
31.Paul Leroy-Beaulieu (1843-1916)
32.Yves Guyot (1843-1928)
33.Émile Faguet (1847-1916)
34.Vilfredo Pareto (1848-1923)
35.André Liesse (1854-1944)
First Words: Optimism about Liberty and Human Perfectibility (1805)
1. Constant on “Liberty and the Perfectibility of the Human Race” (1805)↩
[Word Length: 5,615]
Source
Benjamin de Constant de Rebecque, Mélanges de littérature et de politique (Paris: Pichon et Didier, 1829). Chap. XVII. "De la perfectibilité de l'espèce humaine" (1805), pp. 387-415.
XVII. DE LA PERFECTIBILITÉ DE L'ESPÈCE HUMAINE.
Parmi les différens systèmes qui se sont suivis, combattus et modifiés, un seul me semble expliquer l'énigme de notre existence individuelle et sociale, un seul me paraît propre à donner un but à nos travaux, à motiver nos recherches, à nous soutenir dans nos incertitudes, à nous relever dans nos découragemens. Ce système est celui de la perfectibilité de l'espèce humaine. Pour qui n'adopte pas cette opinion, l'ordre social, comme tout ce qui tient, je ne dirai pas seulement à l'homme, mais à l'univers, n'est qu'une de ces mille combinaisons fortuites, l'une de ces mille formes plus ou moins passagères qui doivent perpétuellement se détruire et se remplacer, sans qu'il en résulte jamais aucune amélioration durable. Le système de la perfectibilité nous garantit seul de la perspective infaillible d'une destruction complète, qui ne laisse aucun souvenir de nos efforts, aucune trace de nos succès. Une calamité physique, une religion nouvelle, une invasion de barbares ou quelques siècles d'oppressions continues pourraient enlever à notre espèce tout ce qui l'élève, tout ce qui l'ennoblit, tout ce qui la rend à la fois, et plus morale, et plus heureuse et plus éclairée. Vainement on nous parle de lumières, de liberté, de philosophie: sous nos pas peuvent s'ouvrir des abîmes, au milieu de nous peuvent fondre des sauvages, de notre sein même des imposteurs peuvent s'élever, et plus facilement encore nos gouvernemens peuvent devenir tyranniques. S'il n'existe pas dans les idées une durée indépendante des hommes, il faut fermer nos livres, renoncer à nos spéculations, nous affranchir d'infructueux sacrifices, et tout au plus nous borner à ces arts utiles ou agréables, qui rendront moins insipide une vie sans espérance, et qui décorent momentanément un présent sans avenir.
Le perfectionnement progressif de notre espèce établit seul des communications assurées entre les générations. Elles s'enrichissent sans se connaître, et tant est profondément gravé dans l'homme l'instinct de cette opinion consolatrice, que chacune de ces générations fugitives attend et trouve sa récompense dans l'estime des générations lointaines qui doivent fouler un jour sa cendre insensible.
Dans ce système, les connaissances humaines forment une masse éternelle, à laquelle chaque individu porte son tribut particulier, certain qu'aucune puissance ne retranchera la moindre partie de cet impérissable trésor. Ainsi, l'ami de la liberté et de la justice lègue aux siècles futurs la plus précieuse partie de lui-même; il la met à l'abri de l'ignorance qui le méconnaît et de l'oppression qui le menace; il la dépose dans un sanctuaire dont ne peuvent jamais approcher les passions dégradantes ou féroces. Celui qui, par la méditation, découvre un seul principe, celui dont la main trace une seule vérité, peut laisser les peuples et les tyrans disposer de sa vie; il n'aura pas existé vainement, et si le temps efface jusqu'au nom qui désignait sa passagère existence, sa pensée restera néanmoins empreinte sur l'ensemble indestructible à la formation du quel rien ne pourra faire qu'il n'ait pas contribué. Je me propose donc de rechercher s'il existe dans l'homme une tendance à se perfectionner, quelle est la cause de cette tendance, quelle est sa nature, si elle a des limites ou si elle est illimitée, enfin quels obstacles retardent ou contrarient ses effets.
[cut from here to next marker]
Dans tous les temps, des écrivains d'opinions différentes se sont occupés de ces questions; mais ils ne les ont considérées que d'une manière fort incomplète, et leurs travaux n'ont guère servi qu'à les obscurcir. Les uns se sont contentés de preuves purement spéculatives, et les preuves de ce genre sont toujours très équivoques; les autres se sont bornés à des témoignages historiques, et ces témoignages peuvent être facilement combattus par des témoignages opposés. Personne jusqu'ici n'a, que je sache, essayé de donner à cette idée des développemens réguliers, de découvrir d'abord par quelle loi de sa nature l'individu était perfectible; d'expliquer ensuite comment cette loi s'appliquait à l'espèce, et de démontrer enfin par les faits l'application constante de cette loi.
Tel sera l'objet des pages suivantes. Je lâcherai d'être clair; je serai court. Je ne dirai que ce qui me paraîtra rigoureusement indispensable.
Toutes les impressions que l'homme reçoit lui sont transmises par les sens; elles sont néanmoins de deux espèces, ou, pour mieux dire, après avoir été à leur origine parfaitement homogènes, elles se divisent en deux classes différentes.
Les unes, qui sont les sensations proprement dites, sont passagères, isolées, et ne laissent d'autre trace de leur existence que la modification physique qu'elles ont produite sur nos organes. Les autres, qui se forment du souvenir d'une sensation ou de la combinaison de plusieurs, sont susceptibles de liaison et de durée; nous les appellerons idées.1 Ces dernières se placent dans la partie pensante de notre être, s'y conservent, s'y enchaînent l'une à l'autre, se reproduisent, et se multiplient l'une par l'autre, en formant de la sorte une espèce de monde au dedans de nous, monde qu'il est possible, par la pensée, de concevoir tout-à-fait indépendant du monde extérieur.
Dans la comparaison de l'influence des sensations proprement dites, et de ce que nous nommons idées, se trouve la solution du problème de la perfectibilité humaine.
L'homme jamais ne peut devenir le maître de ses sensations proprement dites. Il peut bien en écarter quelques-unes, en soigner, en appeler quelques autres; mais elles ne se conservent pas, elles fuient tout entières, elles ne s'enchaînent point. La sensation présente ne décide rien pour la sensation à venir; celle du jour est étrangère à celle du lendemain. Elles ne constituent point à l'homme une sorte de propriété. En quelque nombre qu'il les reçoive, quelque avidement qu'il les multiplie, chacune d'elles venant seule, passant seule, disparaissant seule, traverse la solitude, mais sans la peupler.
Les idées, au contraire, se conservant dans la partie pensante de notre être, s'associant, se reproduisant, constituent à l'homme une propriété véritable. Sans doute, pour recevoir ses idées, comme pour recevoir ses sensations, l'homme est dans la dépendance des objets extérieurs; mais les idées lui restent, lorsqu'une fois elles lui sont acquises, et s'il ne peut ni les rappeler ni les multiplier à sa volonté, elles ont du moins, comme nous l'avons dit, l'avantage inappréciable de se rappeler et de se multiplier l'une par l'autre.
Si chacun se gouverne, ou, pour mieux dire, est gouverné par ses sensations proprement dites, et que la nature ait voulu qu'elles dominassent ou même seulement balançassent l'influence des idées, il ne faut espérer aucun perfectionnement. Les idées s'améliorent, les sensations ne peuvent s'améliorer. Dans cette hypothèse, nous avons été de tout temps ce que nous sommes, nous sommes ce que nous serons toujours.
Si, au contraire, l'homme se gouverne par les idées, le perfectionnement est assuré. Lors même que nos idées actuelles seraient fausses, elles portent en elles un germe de combinaisons toujours nouvelles, de rectifications plus ou moins promptes, mais infailibles, et de progression non interrompue.
Il ne faut pas prendre la question que nous agitons ici pour un lieu commun de morale; c'est un fait qu'il importe d'éclaircir. Nous n'en sommes pas à répéter cet adage de tous les siècles, que l'homme doit s'affranchir de la sujétion des sens et se conduire par les lumières de la raison; nous recherchons ce qu'il fait, sans nous occuper de ce qu'il doit faire.
Soit qu'il se dirige par ses sensations proprement dites, ou par ce que nous nommons idées, c'est -à-dire par le souvenir et la combinaison de ses sensations passées, sa conduite est conforme à sa nature; il n'en changera pas, il n'en peut changer; seulement, comme nous venons de le dire, si l'empire est aux sensations, l'espèce humaine sera stationnaire; si l'empire est aux idées, elle sera progressive.
Maintenant l'examen le plus superficiel suffira pour nous convaincre que l'homme se gouverne entièrement et exclusivement par les idées, et qu'à moins qu'un choc violent et subit ne le prive de l'usage de toutes ses facultés, il sacrifie toujours la sensation présente aux souvenirs de la sensation passée ou à l'espoir de la sensation future, c'est-à-dire à une idée. Les faits que nous rapportons dans le langage vulgaire, comme une preuve de la puissance des sensations, sont, dans la réalité, une preuve de la puissance des idées. Ceci n'est point une subtilité chimérique. Lorsque Léandre traversait la mer à la nage pour aller rejoindre Héro, il supportait une douleur réelle dans l'espérance d'un plaisir futur; et dans le fait, il sacrifiait une sensation à une idée. Ces sacrifices se répètent à chaque instant dans la vie de chacun de nous; et les hommes les plus égoïstes, les plus sensuels s'y soumettent aussi fréquemment, aussi constamment, pour mieux dire, que les plus désintéressés et les plus généreux.
On doit en conclure qu'il existe dans la nature humaine une disposition qui lui donne perpétuellement la force d'immoler le présent à l'avenir, et par conséquent la sensation à l'idée.
L'opération est la même dans l'ouvrier laborieux qui s'épuise de travail pour nourrir sa famille, dans l'avare qui supporte le froid et la faim pour conserver son or, dans l'amant qui brave la fatigue et l'intempérie des nuits pour attendrir sa maîtresse, dans l'ambitieux qui repousse le sommeil ou néglige une blessure pour asservir sa patrie, dans le citoyen généreux qui veille, combat et souffre pour la sauver. Il y a dans tous, possibilité de sacrifice; dans tous, en un mot, domination sur les sensations par les idées.
L'homme ne se gouverne donc pas par les sensations proprement dites; il est au contraire en lutte perpétuelle avec elles, et les subjuguant toujours; et l'on pourrait démontrer que la vie du plus faible, du plus voluptueux, du plus efféminé sybarite est une série non interrompue de triomphes de ce genre.
L'homme, quoique essentiellement modifiable par les impressions extérieures, n'est donc point dans une dépendance absolue et passive de ces impressions. Il oppose sans cesse l'impression d'hier à celle d'aujourd'hui, et fait chaque jour, pour les plus petites causes et pour les plus faibles intérêts, une opération suffisante pour les plus beaux actes d'héroïsme et de désintéressement. S'il en est ainsi, on ne doit plus opposer la puissance des sensations à la puissance des idées; il ne faut plus parler que de la puissance comparative des idées entre elles. Or, qui dit la puissance des idées dit la puissance du raisonnement; car, dans tous ces sacrifices, tellement communs dans la vie de chacun de nous, que nous ne nous en apercevons pas nous-mêmes, il y a- comparaison, et par conséquent raisonnement.
Lorsque le plus sensuel des hommes s'abstient de boire avec excès d'un vin délicieux pour mieux posséder sa maîtresse, il y a sacrifice, par conséquent comparaison. Or, pour porter cet homme à des actions nobles, généreuses, utiles, il ne faudrait que perfectionner en lui la faculté de comparer.
Nous avons, ce me semble, gagné un grand point. Ce n'est plus la nature de l'homme qu'il faut subjuguer, ce ne sont plus ses sensations qu'il faut vaincre; c'est uniquement sa raison qu'il faut perfectionner. Il n'est plus question de créer en lui une force étrangère, mais de développer et d'étendre une force qui lui est propre.
Pour nier cette assertion, il faudrait nier la série de faits que nous avons allégués, et cela paraît impossible. Ce ne sont point les sensations qui dirigent les actions des hommes, ce sont les idées; elles sont toujours accompagnées de comparaison, de jugement. La nature de l'homme est tellement disposée au sacrifice, que la sensation présente est presque infailliblement sacrifiée lorsqu'elle est en opposition avec une sensation future, c'est-à-dire avec une idée,
La puissance que Zénon, qu'Épictète, que Marc-Aurèle, attribuaient à l'homme sur sa propre existence, n'est autre chose que le développement de cette vérité. C'est la suprématie des idées sur les sensations, en d'autres termes, l'assertion que l'homme par le souvenir, les combinaisons, l'usage, en un mot, des impressions qu'il a reçues, peut dompter les impressions qu'il reçoit.
Depuis que Socrate avait, pour employer une expression consacrée, fait descendre la philosophie du ciel pour la placer sur la terre, et l'appliquer à nos affections de chaque jour et à nos intérêts de chaque heure, les sages de l'antiquité avaient étudié l'homme sous tous les points de vue. Ils avaient trouvé pour résultat de leurs recherches, que les idées doivent l'emporter sur les sensations, que plus les premières se multiplient, se développent et se perfectionnent, plus leur empire est incontesté, et ils en avaient conclu pour l'espèce humaine, la possibilité d'une indépendance morale, complète et illimitée.
Tous leurs efforts tendaient à consolider l'empire des idées sur les sensations, a rendre l'homme maître de lui, à lui conserver toujours cette indépendance morale, source de dignité, de repos et de bonheur.
Plusieurs causes, parmi lesquelles je range en première ligne l'arbitraire des anciennes monarchies, nous ont ravi cette indépendance en nous énervant et nous corrompant. Devenus libres, il faut redevenir forts; il faut considérer la volonté de l'homme comme constituant le moi, et comme toute-puissante sur la nature physique. Ses organes, ses sensations, cette nature physique sont ses premiers instrumens. A l'aide de ce dernier, il dompte les objets étrangers, et de ces objets il se fait des instrumens secondaires; mais auparavant, il faut qu'il se soit assuré la conquête de ses premiers moyens, et qu'il en possède l'empire absolu. Il doit être maître chez lui avant de l'être au dehors.
Les passions mêmes peuvent et doivent être les instrumens de la volonté. Elles peuvent être, comme les liqueurs fortes, des moyens à l'aide desquels, lorsque nous avons besoin de telle impulsion, nous la donnons à nos organes, en observant toujours de ne pas la donner telle que nous ne puissions la diriger, comme nous observons, en recourant à des liqueurs spiritueuses pour nous ranimer, de ne pas nous enivrer de manière à n'être plus maîtres de nous.
Dans la seule faculté du sacrifice est le germe indestructible de la perfectibilité. A mesure que l'homme l'exerce, cette fatuité acquiert plus d'énergie; l'homme embrasse dans son horizon un plus grand nombre d'objets. Or, l'erreur ne provient jamais que de l'absence de quelque élément qui doit constituer la vérité; on la rectifie en complétant le nombre des élémens nécessaires. L'homme doit donc chaque jour acquérir un plus haut degré de rectitude.
Le perfectionnement qui s'opère de la sorte dans l'individu se communique à l'espèce, parce que de certaines vérités, répétées d'une manière constante et universelle, sont à la longue entourées par l'habitude d'une évidence entière et rapide; car une vérité évidente n'est autre chose qu'une vérité dont le signe nous est tellement familier, qu'il nous retrace à l'instant même l'opération intellectuelle par laquelle cette vérité a obtenu notre assentiment.
Dans les vérités morales, comme dans les vérités numériques, il n'est question que de simplifier les signes. Si nous saisissons tout d'un coup, et sans calcul, que deux et deux font quatre, et si nous ne saisissons pas avec la même rapidité que soixante-neuf et cent quatre-vingt-sept font deux cent cinquante-six, ce n'est pas que la première de ces propositions soit plus incontestable que l'autre, c'est que le signe de deux répété deux fois rappelle plus promptement l'idée qu'il désigne que la réunion des signes de soixante-neuf et de cent quatre-vingt-sept.
De la réunion de ces vérités, adoptées par tous les individus, et de l'habitude des sacrifices que ces vérités leur imposent, se forme une raison, s'établit une morale commune à tous, dont les principes, reçus sans discussion, ne se mettent plus en doute. Alors l'individu n'est plus obligé de recommencer une lâche remplie avant lui; il part, non du point où le placerait son inexpérience individuelle, mais du point où l'a porté l'expérience de l'association.
[cut stuff above, continue below?]
En même temps que la perfectibilité de l'homme s'exerce intérieurement, en le conduisant, lentement sans doute, d'une manière imperceptible, de vérités connues à des vérités encore obscures, elle s'exerce extérieurement en le conduisant de même de découvertes en découvertes.
On peut, en prenant des époques de l'histoire éloignées l'une de l'autre, montrer la marche de la perfectibilité extérieure et intérieure.
Pour la perfectibilité intérieure, c'est-à-dire la morale, nous avons l'abolition de l'esclavage, qui est pour nous une vérité évidente, et qui était le contraire pour Aristote.
Dans la lutte de la révolution française, les aristocrates les plus invétérés n'ont pas songé à proposer le rétablissement de l'esclavage, et Platon, dans sa république idéale, ne suppose pas qu'on puisse s'en passer.
Telle est la marche de l'esprit humain, que les hommes les plus absurdes d'aujourd'hui ne peuvent, en dépit d'eux, rétrograder au point où en étaient les plus éclairés des siècles antérieurs. Quand le temps et le raisonnement ont fait complètement justice d'une institution fausse, la sottise même et l'intérêt personnel n'osent plus la réclamer.
Pour la perfectibilité extérieure, nous avons une multitude de découvertes: celles de Galilée, de Copernic, de Newton; la circulation du sang, l'électricité, et une foule de machines qui rendent l'homme tous les jours plus maître de l'univers matériel; la poudre à canon, la boussole, l'imprimerie, la vapeur, moyens physiques pour la conquête du monde.
Cette marche de la perfectibilité peut être suspendue, et même l'espèce humaine forcée de rétrograder en apparence; mais elle tend à se replacer au point où elle était, et elle s'y replace aussitôt que la cause matérielle qui l'en avait éloignée vient à cesser.
Ainsi, les convulsions de la révolution française avaient bouleversé les idées et corrompu les hommes; mais aussitôt que ces convulsions ont été apaisées, les hommes sont retournés aux idées de morale qu'ils professaient immédiatement avant les secousses qui les avaient égarés; de manière qu'on peut dire que les excès de la révolution ont perverti des individus, mais non substitué au système de morale qui existait un système de morale moins parfait; et c'est ceci néanmoins qu'il faudrait prouver pour démontrer que l'espèce humaine se détériore.
Il en est de même de ce que nous avons nommé la perfectibilité extérieure.
L'homme a conquis beaucoup plus de moyens d'agir sur les objets extérieurs et de les faire céder à sa volonté qu'il n'en avait autrefois. C'est un perfectionnement pour l'espèce. Prenez cent hommes au hasard, dans tel peuple que vous voudrez de l'antiquité, et cent hommes dans les nations européennes de nos temps modernes; placez chacune de ces bandes, avec les découvertes de son époque, dans une île déserte, hérissée de rochers et de forêts: les cent hommes de l'antiquité périront, ou retourneront à l'état sauvage, faute de moyens de défrichement; les cent hommes des temps modernes se replaceront, . par leurs travaux, au point d'où vous les aurez tirés, et partiront aussitôt de là pour arriver à un degré de civilisation plus élevé. Cette différence tiendra à quelques découvertes physiques, à l'usage, par exemple, de la poudre à canon. Or, on ne peut nier que ce ne soit un véritable perfectionnement pour l'espèce humaine. Le mot de Vauban, cité contre la perfectibilité, prouve au contraire en sa faveur. Si César revenant aujourd'hui se trouvait en quinze jours au niveau des hommes les plus habiles, existant actuellement, c'est-à-dire bien au-dessus de son siècle, ne serait-ce pas une démonstration que notre espèce part d'un point plus avancé, et par conséquent va plus loin qu'alors?
Ceux qui ne veulent pas reconnaître cette marche progressive supposent que l'espèce humaine est condamnée à décrire perpétuellement un cercle, et, par une alternative éternelle, à repasser sans cesse de l'ignorance aux lumières et des lumières à l'ignorance, de l'état sauvage à l'état civilisé et de l'état civilisé à l'état sauvage. C'est qu'ils s'arrêtent à quelques portions de la terre, à quelques sociétés plus ou moins resserrées, à quelques individus remarquables ou dans leur siècle ou dans leur patrie. Mais pour apprécier le système de la perfectibilité, il ne faut pas le juger partiellement. Peu importe que telle peuplade, à telle époque, ait joui de plus de bonheur ou possédé plus de lumières que telle autre peuplade, à une époque suivante, s'il est démontré que la masse des hommes coexistant dans un temps quelconque est toujours plus heureuse que la masse des hommes coexistant dans un temps antérieur.
Il ne faut pas dire: les Athéniens étaient plus libres que nous; donc le genre humain perd en liberté. Les Athéniens étaient une petite partie des habitans de la Grèce, la Grèce une petite partie de l'Europe, et le reste du monde était barbare, et l'immense majorité des habitans de la Grèce elle-même était composée d'esclaves. Que l'on nous montre dans l'histoire une époque semblable à la nôtre, prise en grand. L'Europe entière est exempte du fléau de l'esclavage; les trois quarts de cette partie du globe sont affranchis de la féodalité, la moitié délivrée des priviléges de la noblesse. Sur cent vingt millions d'hommes, il n'en existe pas un seul qui, légalement, ait sur un autre le droit de vie et de mort. Dans les pays mêmes où ne règne pas encore la philosophie, la religion recommande la tolérance. Partout le despotisme couvre ses forfaits de prétextes ridicules sans doute, mais qui annoncent une pudeur jusqu'à présent inconnue. L'usurpation s'excuse comme nécessaire, l'erreur se justifie comme utile.
J'ai parlé dans un essai précédent, des quatre grandes révolutions qui se font remarquer jusqu'à nos jours: la destruction de la théocratie, celle de l'esclavage, celle de la féodalité, celle de la noblesse comme privilége. Mon sujet m'y ramène, et j'ajouterai quelques développemen. Ces quatre révolutions nous offrent une suite d'améliorations graduées; ce sont des échelons disposés régulièrement.
La noblesse privilégiée est plus près de nous que la féodalité, la féodalité que l'esclavage, l'esclavage que la théocratie. Si nous voulions rendre la noblesse plus oppressive, nous en ferions la la féodalité; si nous voulions rendre la féodalité plus odieuse, nous en ferions l'esclavage; si nous voulions rendre l'esclavage plus exécrable, nous en ferions la théocratie: et, par une marche inverse, pour adoucir l'état des castes que la théocratie proscrit, nous éléverions ces castes au rang d'esclaves; pour diminuer l'avilissement des esclaves, nous leur donnerions l'imparfaite garantie des serfs; pour affranchir les serfs, nous leur accorderions l'indépendance des roturiers. Chaque pas, dans ce sens, a été sans retour. N'est-il donc pas évident qu'une progression pareille est une loi de la nature, et que chacune de ces époques portait en elle-même les élémens des époques qui devaient la remplacer?
La durée de la théocratie nous est inconnue; mais il est probable que cette institution détestable a subsisté plus long-temps que l'esclavage. Nous voyons l'esclavage en force pendant plus de trois mille ans, la féodalité pendant douze cents ans, les priviléges de la noblesse sans féodalité à peine pendant deux siècles.
Il en est de la destruction des abus comme de l'accélération de la chute des corps: à mesure qu'ils s'approchent de la terre, ils se précipitent plus rapidement. C'est que les abus sont d'autant plus faciles à maintenir qu'ils sont plus grossiers et plus complets, car ils avilissent d'autant plus leurs victimes. L'esclavage était plus facile à maintenir que la féodalité, la féodalité que la noblesse. Lorsqu'on comprime toute l'existence et toutes les facultés de l'homme, il est bien autrement incapable de résistance que lorsqu'une portion seulement est comprimée. La main qui reste libre dégage l'autre de ses fers.
L'histoire nous montre l'établissement de la religion chrétienne et l'irruption des barbares du nord, comme les causes de la destruction de l'esclavage; les croisades, comme celles de la destruction de la féodalité} la révolution française, comme celles de la destruction des priviléges de la noblesse.
Mais ces destructions n'ont point été l'effet accidentel de circonstances particulières; l'invasion des barbares, l'établissement du christianisme, les croisades, la révolution française en ont été l'occasion, mais non la cause. L'espèce humaine était mûre pour ces délivrances successives. La force éternelle des choses amène les révolutions à leur tour. Celle que nous prenons pour l'effet immédiat d'une circonstance imprévue est une ère de l'esprit humain, et l'homme ou l'événement qui nous paraît l'avoir causée n'a fait que partager plus ostensiblement l'impulsion générale imprimée à tous les êtres.
Ces quatre révolutions, la destruction de l'esclavage théocratique, de l'esclavage civil, de la féodalité, de la noblesse privilégiée, sont autant de pas vers le rétablissement de l'égalité naturelle. La perfectibilité de l'espèce humaine n'est autre chose que la tendance vers l'égalité.
Cette tendance vient de ce que l'égalité seule est conforme à la vérité, c'est-à-dire aux rapports des choses entre elles et des hommes entre eux.
L'inégalité est ce qui seul constitue l'injustice. Si nous analysons toutes les injustices générales ou particulières, nous trouverons que toutes ont pour base l'inégalité.
Toutes les fois que l'homme réfléchit, et qu'il parvient, par la réflexion, à cette force de sacrifice qui forme sa perfectibilité, il prend l'égalité pour point de départ; car il acquiert la conviction qu'il ne doit pas faire aux autres ce qu'il ne voudrait pas qu'on lui fît, c'est-à-dire qu'il doit traiter les autres comme ses égaux, et qu'il a le droit de ne pas souffrir des autres ce qu'ils ne voudraient pas souffrir de lui; c'est-à-dire que les autres doivent le traiter comme leur égal.
Il en résulte que toutes les fois qu'une vérité se découvre, et la vérité tend par sa nature à se découvrir, l'homme se rapproche de l'égalité.
S'il en est resté si long-temps éloigné, c'est que la nécessité de suppléer aux vérités qu'il ignorait l'a poussé vers des idées plus ou moins bizarres, vers des opinions plus ou moins erronnées. Il faut une certaine masse d'opinions et d'idées pour mettre en action les forces physiques, qui ne sont que des instrumens passifs. Les idées seules sont actives; elles sont les souveraines du monde; l'empire de l'univers leur a été donné. Lors donc qu'il n'existe pas dans les têtes humaines assez de vérités pour servir de levier aux forces physiques, l'homme y supplée par des conjectures et par des erreurs. Lorsque ensuite la vérité paraît, les opinions erronnées qui tenaient sa place s'évanouissent, et c'est la lutte passagère qu'elles soutiennent ( lutte toujours terminée par leur anéantissement ) qui change les états, agite les peuples, froisse les individus, produit, en un mot, ce que nous appelons des révolutions.
De là découlent plusieurs conséquences importantes.
1°. Il est incontestable que la majorité de la race humaine, par une progression régulière et non interrompue,2 acquiert chaque jour en bonheur et surtout en lumière. Elle avance toujours d'un pas plus ou moins rapide. Si quelquefois, pour un instant, elle semble rétrograder, c'est pour réagir immédiatement contre l'obstacle impuissant que bientôt elle surmonte. Quand cette vérité ne serait démontrée que relativement aux lumières, la perfectibilité de l'homme n'en serait pas moins prouvée; car si le bonheur est le but immédiat, et l'amélioration le but éloigné, les lumières sont les moyens; et plus nous acquérons de moyens d'atteindre au but, plus nous en approchons, lors même que nous ne paraissons pas en approcher.
2°. L'espèce humaine, puisqu'elle n'est pas stationnaire, ne peut juger que d'une manière relative de ce qui n'est pas inhérent à sa nature, de ce qu'elle ne porte pas en elle, mais dont elle se sert dans la route, comme ressource supplémentaire et momentanée. Ainsi, parmi les opinions et les institutions ( car les institutions à leur origine ne sont que des opinions mises en pratique ), celles que nous considérons aujourd'hui comme des abus peuvent avoir eu leur temps d'utilité, de nécessité, de perfection relative. Ainsi, celles que nous regardons comme indispensables, et qui sont telles à notre égard, pourront, dans quelques siècles, être repoussées comme des abus. N'en concluons pas néanmoins que, parce que la plupart des abus ont eu leur temps d'utilité, il faille soigneusement conserver ceux qui existent au milieu de nous. La nature seule se charge de créer et de conserver les abus utiles. L'espèce humaine ne se défait jamais de ce dont elle a besoin. Lorsqu'un abus tombe, c'est que son utilité n'existe plus; mais on ne peut pas dire de même, que lorsqu'un abus ne tombe pas, c'est que son utilité existe encore; il peut y avoir d'autres causes.
L'utilité relative des institutions varie chaque jour, parce que chaque jour nous découvre un peu plus de vérité. L'abus utile de la veille est l'abus inutile du lendemain. Or, tout abus inutile est funeste, et comme obstacle aux progrès de notre espèce, et comme occasion de lutte entre les individus.
C'est presque toujours par un grand mal que les révolutions qui tendent au bien de l'humanité s'opèrent. Plus la chose à détruire est pernicieuse, plus le mal de la révolution est cruel. Cela tient à ce que, pour qu'une institution très pernicieuse s'introduise, il faut qu'à l'époque de son introduction, cette institution soit ou paraisse très nécessaire. Or, le souvenir de cette nécessité survit à cette nécessité même, et ce souvenir oppose une résistance obstinée à qui veut détruire l'institution, lors même qu'elle a cessé d'être nécessaire.
Prouver qu'un abus est la base de l'ordre social qui existe, ce n'est pas le justifier. Toutes les fois qu'il y a un abus dans l'ordre social, il en paraît la base, parce qu'étant hétérogène et seul de sa nature, il faut, pour qu'il se conserve, que tout se plie à lui, se groupe autour de lui, ce qui fait que tout repose sur lui. Certes, lorsque l'esclavage était en force, l'asservissement de la classe qui fertilisait la terre, qui seule était chargée de tous les travaux, qui assurait à ses maîtres le loisir indispensable à l'élégance des mœurs et à l'acquisition des lumières, paraissait bien la base de l'ordre social. Sous l'empire de la féodalité, la dépendance des serfs semblait inséparable de la sûreté publique. De nos jours, les priviléges de la noblesse ont été réclamés comme les seules garanties de la prospérité nationale. L'esclavage néanmoins a été détruit, et l'ordre social a subsisté. La féodalité s'est écroulée, et l'ordre social n'en a pas souffert. Nous avons vu tomber les priviléges de la noblesse, et si l'ordre social a été ébranlé, la faute n'en a pas été à la destruction de ces priviléges, mais à l'oubli des principes, à l'habitude de la corruption, à la domination de la sottise, au délire qui a paru long-temps saisir tour à tour tous les hommes ayant du pouvoir.
La destruction des priviléges de la noblesse est le commencement d'une époque nouvelle: c'est l'époque des conventions légales.
L'esprit humain a trop de lumières pour se laisser gouverner plus long-temps par la force ou par la ruse, mais il n'en a pas assez pour se gouverner par la raison seule. Il lui faut quelque chose qui soit à la fois plus raisonnable que la force, et moins abstrait que la raison. De là les besoins des conventions légales, c'est-à-dire d'une sorte de raison commune et convenue, le produit moyen de toutes les raisons individuelles, plus imparfaite que celle de quelques-uns, plus parfaite que celle de beaucoup d'autres, et qui compense le désavantage de soumettre des esprits éclairés à des erreurs qu'ils auraient secouées par l'avantage d'élever des esprits grossiers à des vérités qu'ils seraient encore incapables de comprendre.
En traitant des conventions légales, il ne faut jamais perdre de vue un premier principe, c'est que ces conventions ne sont pas des choses naturelles ou immuables, mais des choses factices, susceptibles de changement, créées pour remplacer des vérités encore peu connues, pour subvenir à des besoins momentanés, et devant par conséquent être amendées, perfectionnées, et surtout restreintes, à mesure que ces vérités se découvrent, ou que ces besoins se modifient.
On demandera peut-être pourquoi nous distinguons l'époque actuelle sous le nom d'époque des conventions légales, puisqu'il y a eu de tout temps des conventions de ce genre. C'est que cette époque est la première dans laquelle les conventions légales aient existé seules et sans mélange. Il y a toujours eu sans doute des conventions légales, parce que les hommes ne peuvent se passer de lois; mais ces conventions n'étaient que des choses secondaires; il y avait des préjugés, des erreurs, des vénérations superstitieuses qui les sanctionnaient, qui occupaient le premier rang, et qui caractérisaient ainsi les époques précédentes. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'arrivé au point de ne plus reconnaître de puissance occulte qui ait le droit de maîtriser sa raison, l'homme ne veut consulter qu'elle, et ne se prête tout au plus qu'aux conventions qui résultent d'une transaction avec la raison de ses semblables.
Nous croyons avoir prouvé par le raisonnement la perfectibilité de l'espèce humaine, et, par les faits, la marche de l'espèce humaine dans les divers développemens de cette faculté qui la distingue.
La nature a imprimé à l'homme une direction que les tyrans les plus barbares, les usurpateurs les plus insolens ne peuvent contrarier.
L'espèce humaine n'a pas reculé sous la tyrannie insensée des empereurs romains; elle n'a pas reculé, lors même que le double fléau de la féodalité grossière et de la superstition dégradante pesaient sur l'univers asservi. Après ces mémorables exemples, il faut désespérer du grand œuvre de notre abrutissement.
… Si Pergama dextrâ
Defendi possent, etiam hâc defensâ fuissent.3
Il serait à désirer que cette conviction pût se faire jour chez les gouvernans, de quelque pays et de quelque espèce que çe puisse être; elle leur épargnerait des luttes sanglantes et d'infructueux efforts. Nous, du moins, qui ne sommes pas sourds à la voix de l'expérience, et qui trouvons dans l'étude des siècles des preuves éclatantes de cette vérité décisive, ne nous laissons pas abattre par des retards accidentels. Sûrs que nous sommes de notre pensée et de la nature, peu nous importe la perversité des tyrans, ou l'avilissement des esclaves: un infaillible appel nous reste à la raison et au temps.
PART I. The Empire (up to 1815)
2.Pierre-Louis Roederer on “Property Rights” (1800)↩
[Word Length: 4,948]
Source
Pierre-Louis Roederer, Discours sur le droit de propriété, lus aux Lycée, les 9 décembre 1800 et 18 janvier 1801, (Paris, Didot, 1839). “Premiere discours sur let droit du propriété, lu au Lycée, le 9 décembre 1800,” pp. 7-24.
Brief Bio of the Author: Pierre-Louis Roederer (1754-1835)
[Pierre-Louis Roederer (1754-1835)]
Pierre-Louis Roederer (1754-1835) was a lawyer, historian and politician, born at Metz, he became familiar early on with many authors, including Montesquieu and Rousseau, and was a keen follower of the emerging discipline of political economy. A man of action, he spoke out in 1787 for the abolition of internal customs duties. He was elected to the Academy in 1832. His devotion to liberty marks the core of his writings, which today are largely neglected. He is known for his L’esprit de la Révolution de 1798 (1831) and Mémoires pour servir l’histoire polie en France (1835). [RL]
Ier Discours sur le droit de propriété, lu au Lycée, le 9 décembre 1800.
De tous les cours professés en ce Lycée, celui qui exigerait du professeur le plus de talent serait un cours d'économie publique. Le moindre malheur de la science économique est d'être embarrassée de préjugés entourée de préventions, dénuée d'expériences notoires et concluantes: elle est de plus, une science abstraite et compliquée; on ne peut y attaquer l'erreur que par de longues analyses; les vérités ne s'y laissent approcher que par l'étude la plus obstinée. L'amour du bien public peut seul aujourd'hui amener ici des auditeurs; mais par cette raison même combien il est désirable pour celui qu'on y vient entendre, de pouvoir s'y faire écouter quelque temps! quel intérêt que celui de soutenir l'attention, quand c'est en même temps répondre à un sentiment respectable, le nourrir et l'accroître ! La littérature a par elle-même tant de charmes, les sciences naturelles portent avec elles tant de clarté, qu'elles se passeraient presque de l'attrait qu'y ajoutent les maîtres qui les enseignent: la science économique au contraire, ne peut avoir que des attraits et une clarté d'emprunt. C'est donc en sens inverse du besoin des sciences que sont répartis dans ce Lycée les talents qui les professent: l'économie publique y manquera du nécessaire, tandis que les autres connaissances y seront parées d'un immense superflu.
Toutefois ce n'est pas un cours complet d'économie publique que j'ai eu dessein d'entreprendre, mais seulement la discussion de quelques questions économiques récemment agitées dans le public. Ne pouvant me mesurer à la science tout entière, je me suis borné à en saisir quelques rameaux qui se sont trouvés à ma hauteur.
L'objet que je me suis particulièrement proposé a été de combattre les opinions énoncées relativement aux emprunts publics et aux contributions, par les deux partis opposés qui se sont jusqu'à présent partagé l'opinion en France. Les uns, ce sont les économistes, ont prétendu que tout emprunt public était une véritable détérioration de la prospérité nationale, et que tout impôt autre que l'impôt foncier était un attentat sur la liberté et la propriété particulière. Les autres, ce sont les financiers par excellence, ont prétendu et soutenu que l'impôt direct était la ruine de la nation, que les emprunts étaient nécessaires pour l'enrichir, et que non-seulement l'argent emprunté était fort utile, mais même la dette contractée par l'emprunt; de sorte qu'une nation empruntant cent millions, et recevant cette somme dans ses coffres, devrait se croire riche d'abord des cent millions reçus, et en second lieu de la dette de ces cent millions.
Je voudrais voir s'il serait possible de sauver la science économique du ridicule qu'ont attiré sur elle et la secte économiste et la secte financière. L'Assemblée constituante semble avoir tenu un juste milieu entre les deux partis. Elle a partagé le poids des contributions en deux parts, qui ont paru dans les temps assez proportionnées. L'une était dans le système direct, l'autre dans le système indirect; la nation ne s'est plainte et n'a souffert de ce partage que quand les taxes additionnelles, et les emprunts forcés, et les taxes de guerre, ont rompu l'équilibre et ont rendu accablante la contribution directe. A l'égard des emprunts, elle n'a pas cru nécessaire d'en ouvrir; mais en repoussant la banqueroute, en consolidant la dette, en dispensant même de la contribution foncière les rentes constituées sur le trésor public, elle a fait pour le crédit tout ce qu'aurait conseillé le besoin le plus urgent d'un emprunt, et tout ce que demandait l'équité. Elle a donc tenu le juste milieu entre les opinions opposées. Tâchons de retrouver les principes qui l'ont guidée, et de les consacrer.
En considérant avec toute l'attention dont mon esprit et surtout ma conscience sont capables les questions qui intéressent l'impôt et l'emprunt, j'ai cru reconnaître que toutes les méprises où l'on tombait en traitant de ces deux objets provenaient de l'ignorance ou de l'imparfaite connaissance des vrais principes et de la véritable nature de la propriété, ainsi que de l'action qu'exercent les unes sur les autres diverses espèces de richesses qui sont la matière et l'objet de la propriété. Oui, toutes les erreurs de finance se rapportent ou à la méconnaissance des droits de la propriété, ou à l'ignorance de ses ressorts; pour qui connaît ses droits et son action naturelle, nécessaire, bien des obscurités sont éclaircies, bien des sophismes sont dissipés, bien des principes deviennent évidents.
Des douze discours que je me propose de lire ici, trois auront pour objet la propriété, trois les contributions, trois les emprunts publics4.
Relativement à la propriété, j'examinerai quatre choses;
SAVOIR:
1° Le droit de propriété.
2° L'utilité du maintien absolu de l'exercice de ce droit.
3° L'action de la propriété dans l'état social, à raison de la diversité des biens ou richesses qui la constituent.
4° Les droits politiques qui naissent de la propriété.
Ces deux derniers objets seront traités dans un même discours.
Il est inutile de présenter en ce moment les subdivisions des autres parties. Parlons de suite du premier objet que nous venons d'annoncer: du droit de propriété.
Quel est le fondement du droit de propriété?
C'est l'intérêt de la conservation individuelle joint à la propriété des moyens, c'est-à dire de l'adresse et des forces que l'homme a reçues de la nature pour y pourvoir.
Dans l'état de nature, l'homme est incontestablement libre: qu'est-ce à dire, libre? c'est-à-dire qu'il peut disposer seul des bras et des forces que la nature lui a donnés; c'est-à-dire qu'il en est propriétaire.
De la propriété que chaque homme a de ses forces et de son adresse, naît la propriété mobilière. Le sauvage grimpe sur un arbre et y cueille un fruit: ce fruit est à lui; il devient sa propriété par la peine et l'adresse qu'il a mises à le cueillir.
Si un autre avait le droit de le lui prendre, ce serait comme si cet autre avait eu le droit de disposer de l'adresse et de la force de celui-ci; ce serait comme si celui-ci n'avait pas été propriétaire de sa propre force et de sa propre adresse. La propriété mobilière, ou la propriété des fruits de la terre, est donc un premier produit de la propriété des propres moyens de l'individu.
Mais il y a loin de la propriété mobilière à la propriété foncière, de la propriété des fruits à la propriété du fonds. Comment donc naît la propriété foncière?
Elle naît de celle des fruits acquis par le travail; elle naît aussi immédiatement du travail même.
Pour défricher une terre, il faut deux choses: du travail et des avances. Pourquoi des avances? parce qu'il faut se nourrir pendant le travail, et parce qu'il faut ensemencer la terre après l'avoir défrichée.
Puisqu'il faut du travail pour défricher la terre, le travail devient une véritable prise de possession: car si un survenant pouvait chasser de son champ celui qui l'a défriché, ce serait comme s'il avait eu le droit de lui commander le travail nécessaire pour l'opérer; ce serait comme si celui-ci n'avait pas la propriété de ses bras et de sa force.
Puisqu'il faut des avances pour un défrichement, ces avances sont un nouveau titre à la possession de la terre défrichée. Car qu'est-ce que des avances? ce sont des fruits de la terre que j'ai recueillis, dont j'ai fait par là ma propriété, que j'aurais pu consommer, et que j'ai épargnés, c'est-à-dire dont j'ai fait un capital. Si j'ai eu le droit incontestable de les recueillir, de les consommer, ils deviennent pour moi un titre de propriété foncière lorsque je les attache au sol, que je les unis à la terre pour les en retirer avec usure. La terre qui les féconde est à moi, puisqu'elle renferme mon grain; autrement, un autre aurait droit à ce grain et aux peines que j'ai prises pour le recueillir.
C'est ainsi que le droit de propriété foncière naît de la propriété mobilière et de la propriété personnelle. Telle est l'origine de la propriété.
J'ai dit en commençant que l'intérêt et le droit naturel de la conservation individuelle étaient aussi une des bases du droit de propriété. En effet, c'est cet intérêt qui convertit le droit naturel de propriété en droit positif, qui lui donne une garantie dans l'état social, et qui le rend inaliénable, incessible par aucune convention politique, qui le rend inviolable pour la société elle-même. Quand les hommes ont éprouvé la nécessité d'assurer leur existence et celle de leur famille, quand ils ont appris que la terre cultivée rend incomparablement plus que la terre inculte, ils ont contracté le respect mutuel des propriétés: de là la société civile, c'est-à-dire la seule société véritablement susceptible de civilisation et de perfectionnement.
C'est à l'époque de la formation de cet état social qu'on peut se porter, pour discuter avec facilité toutes les questions qui peuvent s'élever au sujet du droit de propriété. Ici on peut supposer que le premier congrès de la société, en reconnaissant les droits des associés qui ont fait des défrichements, veut examiner dans quelles limites il conviendrait de les renfermer. Ici se présentent toutes les objections que les propriétaires peuvent avoir à combattre. Je suppose que je suis un Européen transplanté par ma mauvaise fortune dans un pays où j'ai défriché des terres et où les habitants contractent la société, et que j'aie à répondre aux orateurs de la multitude, Européens comme moi.
La première difficulté qui se présente, c'est que la société ne veut garantir que la mesure de droit nécessaire à la conservation; et l'on me dit: «Vous n'avez besoin que des fruits de la terre; ainsi nous nous réservons de voir comment nous disposerons du fonds, et comment nous en assurerons la culture; et pourvu que votre nourriture soit assurée, vous aurez reçu le prix de votre défrichement. »
Je réponds: Le besoin que j'ai des fruits fait naître pour moi le besoin de la terre. Mon besoin n'est pas seulement d'avoir aujourd'hui de quoi manger, mais de l'avoir encore demain; mon besoin est non-seulement dans mon estomac, mais dans ma prévoyance, qui est une faculté de l'esprit d'où l'homme tient plus de maux et de biens que de ses sensations mêmes. Mon droit de pourvoir à mes besoins éloignés n'est pas un droit qu'on puisse appeler métaphysique. Il est exercé par la fourmi laborieuse sur laquelle nous marchons.
Ce que je cherche dans la propriété, comme dans la liberté, c'est ma sûreté. Ce que je cherche dans la sûreté, c'est la sécurité qui en est le sentiment. La sécurité est donc celui de mes besoins qui comprend tous les autres. Ce qui est absolument nécessaire à ma sécurité fait donc partie de mes droits. Si donc je ne puis avoir de sécurité qu'autant que je possède une terre qui me donne des moissons annuelles et une maison pour serrer mes grains, le droit d'avoir un champ et une maison, c'est-à-dire une propriété foncière, est donc un de mes droits naturels et essentiels.
Mais, me dit-on, si la société, après s'être formée, peut assurer votre nourriture en reprenant votre propriété, et qu'elle veuille la reprendre, qu'avez-vous à lui objecter?
Je réponds, 1° que si ma terre m'est acquise avant que la société se soit formée, elle ne peut plus m'en dépouiller, parce que mon droit est établi avant elle, et qu'elle est établie pour garantir mon droit, non pour le sacrifier.
2° Quand je contracte une société, ce n'est pas pour qu'elle me donne du pain, mais pour qu'elle me garantisse la faculté d'en acquérir par mon travail ou par mon industrie.
3° Je soutiens que la société n'a pas la puissance physique de me garantir ma subsistance, à moins qu'elle ne confie la terre à l'intérêt privé, parce que des exploitations communes sont toujours mal soignées; parce que là où elles sont établies le système de chacun est de vivre avec le plus d'abondance possible, en mettant à l'œuvre commune le moins de travail qu'il pourra; parce qu'aussi le moindre échec donné à l'organisation sociale arrête tous les travaux de la culture ou fait piller les greniers communs.
4° Je dis que la société n'ayant pas et n'étant pas susceptible d'avoir la puissance physique de me garantir ma subsistance, elle n'a pas le droit d'exiger que je lui confie le soin de me la donner, et que je me dépouille de mes moyens individuels pour les paralyser dans une association générale. Je dis que la société n'ayant pas le droit d'ôter arbitrairement la vie à un citoyen, elle ne peut exiger d'aucun qu'il se repose pour sa conservation sur les soins équivoques que peut y donner la société.
5° J'ajoute que le besoin de jouir s'étend ou se restreint successivement dans les mêmes hommes, et diffère de l'un à l'autre; que ce besoin suit les développements de l'intelligence humaine, est extensible comme elle; d'où il s'ensuit que l'homme doit pouvoir appliquer plus ou moins de ses moyens à satisfaire ses besoins, c'est-à-dire, faire plus ou moins de travail suivant leur étendue. C'est donc une vérité que le travail doit être permis à l'homme suivant l'intérêt qu'il y met pour ses jouissances personnelles, et qu'il ne peut lui être rien commandé au delà de son besoin soit réel, soit d'habitude ou d'imagination. Or, si les propriétés étaient communes et non exploitées, l'homme ne pourrait pas proportionner son travail à son besoin. Si les propriétés étaient communes et cultivées, le citoyen serait obligé à une mesure toujours égale de travail, et cette mesure pourrait être plus forte ou plus faible que celui qui serait sollicité par le sentiment de son besoin. Il n'y a donc que la propriété foncière qui puisse lui assurer la jouissance de ses droits.
6° Enfin, la faculté de développer, de perfectionner ses moyens de travail, son industrie, ses talents, ses forces, n'est pas moins propre à l'homme, ne fait pas moins partie de ses droits que la faculté de jouir. Or, ce développement, ce perfectionnement, seraient impossibles dans un pays où les terres étant à tout le monde, toute propriété, et avec elle toute division des métiers, serait interdite à tout le monde, puisque c'est de la division des métiers que procède l'industrie, et que sont nées les machines presque intelligentes qui centuplent la force de l'homme et diminuent la peine de tous ses travaux.
Voilà mes réflexions sur le droit de la propriété foncière.
J'entends qu'après avoir bien disputé contre moi, on consentirait à allouer au travailleur, pour prix de son travail, la récolte des fruits de l'année; mais c'est se moquer. Pour avoir un droit évident aux fruits de l'année, il me suffit de labourer et ensemencer une terre défrichée, engraissée. J'acquiers donc un droit plus étendu lorsque je défriche, lorsque je plante, lorsque je bâtis une ferme, lorsque je construis des murs de clôture. Je n'aurais pas fait tout cela pour obtenir une récolte, je ne l'aurais pas fait pour vingt: car, il m'a fallu pour toutes ces exploitations plus de travail que pour vingt exploitations annuelles. Ce calcul vous parait exagéré? Il est au-dessous du vrai. Il ne suffit pas de comparer le temps du travail employé au défrichement avec celui qui l'est à une exploitation annuelle; il faut aussi comparer les avances, car toute avance est le produit accumulé d'un travail antérieur. Or, il en entre vingt fois plus dans la fondation d'une culture que dans une exploitation annuelle.
Ici on m'arrête encore, et l'on me dit: « Mais du moins votre jouissance n'est pas, de droit, héréditaire, et la propriété doit avoir un terme. Ce terme est le moment où le premier colon est censé indemnisé de ses avances. Passons-lui la jouissance pendant toute sa vie, mais à sa mort le bien doit être à l'État. »
Je mets de côté les inconvénients qui résulteraient d'une semblable disposition. Je montrerai ailleurs qu'elle serait désastreuse. Ici, je le répète, je ne parle que du droit, et je combats encore, sous ce rapport, l'opinion qui conteste l'hérédité.
Je dis d'abord qu'il y aurait lésion pour le premier colon, si l'on établissait cette opinion. Je dis en second lieu que l'hérédité ne lèse les droits de personne, et même est utile aux droits de tout le monde.
Ma première proposition: qu'il y aurait injustice à ce que l'hérédité ne fût pas établie, est facile à justifier. Les premiers exploitants, les premiers pères de la richesse n'ayant disposé la terre à la fécondité que par leur travail, à quel titre un survenant prétendrait-il obtenir une propriété sans travail? Les premiers agriculteurs auraient-ils donc été les serviteurs des générations suivantes? Quand les premiers cultivateurs des pays aujourd'hui civilisés ont exploité la terre, ils l'ont fait sans doute en proportion du nombre de leurs enfants; il était naturel qu'ils leur transmissent par l'hérédité ce qui avait été fait pour eux. Les premiers agriculteurs ayant aussi établi des ateliers d'exploitation, des fermes, des maisons toutes plus durables qu'eux, il était naturel que cela ne devint pas après eux la propriété de l'État ou d'un survenant.
À la rigueur, sans doute, l'hérédité pouvait être séparée de la première propriété. Mais en ce cas il aurait fallu que la société existant avant le défrichement, avertit le premier cultivateur de cette séparation, et qu'elle se fût résignée à ne voir que des exploitations imparfaites et improductives. Car alors le cultivateur se serait dit à lui-même: Je ne planterai rien, parce que je ne jouirais pas; je bâtirai pour ma vie seulement et sans solidité, parce que personne d'intéressé à se souvenir de moi, n'occupera ma maison après moi; je défricherai seulement pour me nourrir, moi et mes enfants en bas âge, puisque je ne puis rien leur laisser à ma mort; je réduirai même ou je négligerai au déclin de ma vie la culture du terrain, que j'aurai défriché, car mes forces et mes besoins étant alors diminués, je n'ai rien de plus sage à faire que de m'épargner de la peine et d'être ménager de mes avances. Si, au contraire, le premier colon a planté, a bâti solidement, a défriché, amendé son terrain de manière à le faire fructifier bien au delà de son existence, il faut qu'il ait le droit de le transmettre à ses enfants, ou bien on lui vole le fruit d'un travail qu'on n'avait pas le droit de lui commander, et d'avances qu'on ne pouvait lui contester; on viole tout à la fois sa propriété foncière et sa propriété mobilière.
J'ai dit, en second lieu, que l'hérédité ne blessait les droits de personne, et au contraire servait les droits de tout le monde. Quand la terre ne produit que des fruits spontanés ou du gibier, il en faut incontestablement davantage pour nourrir un homme, que quand elle est cultivée. Lors donc que la chasse ou les fruits spontanés sont la seule subsistance des hordes sauvages, et que la terre est en commun, chaque individu jouit d'un plus grand nombre d'arpents que quand il cultive. Un homme qui jouit de dix mille arpents de terre inculte en commun avec vingt autres hommes, ce qui fait cinq cents arpents pour chacun, et n'est pas trop, certainement, ne fait pas tort à ses compagnons lorsqu'il se renferme dans quatre arpents qu'il cultive, et qu'il leur abandonne les quatre cent quatre-vingt-seize autres.
Mais si quelques-uns se partagent tout le terrain et rebutent les autres! — La supposition est absurde. Pour devenir propriétaire il ne suffit pas de dire: Ceci est à moi, il faut pouvoir en prendre possession; or, on ne prend possession de la terre que par le travail, puisque le travail seul la rend féconde, et la puissance du travail ne s'étend pas à tout le domaine que l'imagination peut envahir. En second lieu, quand les facultés du travail seraient illimitées, la volonté du travail serait bornée par la faculté de consommer et de jouir. Or, un homme ne peut pas jouir au delà d'une certaine mesure qui est déterminée par ses facultés.
Mais si la horde est si nombreuse qu'elle ait besoin pour vivre de plus de terrain que celui qui est à partager, et qu'ainsi il faille rebuter quelque surnuméraire! — Autre supposition absurde. Car je le répète, un terrain inculte qui suffit pour nourrir la horde, étant cultivé, pourra nourrir cent fois le même nombre d'hommes.
Mais si à la suite, quand tout sera cultivé, il survient des hommes nouveaux, que ferez-vous de ces survenants? — Je réponds: Ou ils viennent du dehors, ou ils sont nés dans l'État même.
Au premier cas, il faut leur répondre: « Quand les lots sont faits, tu viens nous dire: Je suis homme comme vous; j'ai deux pieds, deux mains, autant d'orgueil et plus que vous, un esprit aussi désordonné pour le moins que le vôtre… Je viens vous demander ma part de terre. Il y a dans notre hémisphère connu environ cinquante mille millions d'arpents à cultiver, tant passables que stériles. Nous ne sommes qu'environ un milliard d'animaux à deux pieds, sans plumes, sur ce continent. Ce sont cinquante arpents pour chacun. Faites-moi justice; donnez-moi mes cinquante arpents. — Va-t'en les prendre chez les Hottentots, chez les Cafres ou chez les Samoiedes... Si tu veux a avoir ici le manger, le vêtir, le loger, travaille pour nous; sers-nous, amuse-nous.» (J'emprunte à Voltaire cette réponse, aussi originale dans la forme que judicieuse au fond.) En effet, la terre à laquelle chacun a droit est la terre inculte, couverte de ronces et d'épines. Demander une part de terres défrichées et labourées, c'est demander le fruit du travail, et des épargnes de nos pères et de nous-mêmes.
Si les pétitionnaires sont nés dans l'État même, je leur réponds: Que le survenant qui naît dénué de toute propriété est précisément dans la même situation que les premiers exploitants. Il a fallu que ceux-ci travaillassent pour exploiter la terre, qu'ils travaillassent pour former le capital nécessaire à cette exploitation. Eh bien, les survenants travailleront pour gagner de quoi acheter, s'ils le veulent, de cette terre défrichée. Leur position est même plus favorable que celle des premiers colons, puisqu'ils trouvent une terre en valeur et garantie à acquérir, et que ceux-ci couraient les chances de leurs essais, chances qui doivent être comptées pour quelque chose dans leurs droits de transmission. Voilà à quoi se réduit ce contraste si offensant, au premier aspect, des gens qui naissent avec une propriété, et de ceux qui naissent indigents; des gens qui naissent dotés par les institutions sociales, et de ceux qui naissent pour être délaissés ou rebutés par elles.
Mais il peut arriver superpopulation! En ce cas, pourquoi la décimation ou déportation devra-l-elle tomber sur l'un plutôt que sur l'autre? Et pourquoi y aura-t-il des pauvres dont la tête appellera la déportation, tandis que les riches en seront exempts? — Voilà encore une fausse supposition. Il n'y aura jamais de superpopulalion dans un État où la propriété sera établie et où il y aura des riches et des pauvres: car les mariages s'y proportionneront aux moyens de subsistance qu'auront les hommes.
C'est dans le cas de propriétés communes que la superpopulation peut être à craindre, parce que là nul n'étant obligé à plus de travail quand il a femme et enfants que quand il est seul, et la société garantissant à tous la subsistance, chacun est disposé à se marier, sans faire attention aux moyens de la société, qui alors est obligée de faire des lois pour restreindre les mariages dans les limites jugées nécessaires, de violer par là la liberté, et de porter une autorité vexatoire dans l'exercice des facultés de l'homme qui obéissent le moins et qui commandent le plus.
Voilà à peu près tous les arguments que l'on peut faire contre la propriété accompagnée des grandes circonstances qu'elle suppose, savoir, l'hérédité et l'inégalité des fortunes.
Je crois les avoir réfutés. Mais il me reste à venger Rousseau du reproche qu'on lui a fait d'avoir attaqué la propriété dans ses ouvrages, et du malheur d'avoir été cent fois cité par les scélérats qui l'ont si audacieusement violée dans ces derniers temps.
Six lignes du Discours sur l'inégalité des conditions ont servi, aux uns, de titre d'accusation, aux autres, d'autorisation au crime.
« Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire: Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, de misères et d'horreurs n'eût point épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables: Gardez-vous d'écouter cet imposteur; vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n'est à personne! »
Quel étrange abus on a fait de ces paroles! on a voulu en conclure que, selon Rousseau, la propriété foncière était opposée à l'état social bien ordonné; et tout au contraire Rousseau voulait prouver qu'elle en était le principe, et à ce titre il l'opposait a la vie sauvage. Tout le monde sait que son discours n'est qu'une apologie de l'état de nature contre la civilisation, et que c'est uniquement comme moyen de civilisation qu'il déplore la propriété. Ainsi la bêtise et la mauvaise foi, parlant effrontément au nom de Rousseau, nous ont présenté comme la suprême perfection de la société civile, l'abolition de la propriété que Rousseau regardait comme le plus sûr moyen de rétablir l'état sauvage, et d'empêcher la société d'exister.
Ce que je dis ici est prouvé non-seulement par l'ensemble du discours, mais encore par les premières lignes du morceau même dont on argumente: Le premier qui s'avisa de dire: Ceci est à moi, etc., fut le véritable fondateur de la société civile. Ce qui suit immédiatement le passage cité est aussi très-concluant pour mon assertion, « Mais il y a grande apparence, dit Rousseau, qu'alors (c'est-à-dire quand un homme eut dit: Ceci est à moi) les choses en étaient déjà venues au point de ne pouvoir plus durer comme elles étaient: car cette idée de propriété dépendant de beaucoup d'idées antérieures, qui n'ont pu naître que successivement, ne se forma pas tout d'un coup dans l'esprit humain; il fallut faire bien des progrès, acquérir bien de l'industrie et des lumières, les transmettre et les augmenter d'âge en âge, avant que d'arriver à ce dernier terme de l'état de « nature. »
Il est assez clair, par ces paroles, que Rousseau regardait l'établissement de la propriété comme un effet nécessaire des dispositions déjà prononcées pour l'état de société, et, si je puis le dire, pour la clôture de l'état de nature.
Les autres ouvrages que Rousseau a composés, non plus contre le régime social, mais sur son perfectionnement et sur ses véritables principes, renferment une foule de preuves de son respect profond pour la propriété.
Dans son discours sur l'économie politique, ouvrage postérieur à celui qui concerne l'inégalité des conditions, on lit ces paroles, page 303 de l'édition de Kehl: « Le fondement du a pacte social est la propriété; sa première a condition, que chacun soit maintenu dans la paisible jouissance de ce qui lui appartient. »
Dans le même discours, page 289, on trouve ce passage bien plus remarquable: « Il est certain, dit-il, que le droit de propriété est le plus sacré de tous les droits des citoyens, et plus important, à certains égards que, la liberté même; soit parce qu'il tient de plus près à la conservation de la vie, soit parce que les a biens étant plus faciles à usurper et plus pénibles à défendre que la personne, on doit plus respecter ce qui peut se ravir plus aisément, soit enfin parce que la propriété est le vrai fondement de la société civile, et le vrai o garant des engagements des citoyens: car si les biens ne répondaient pas des personnes, rien ne serait si facile que d'éluder ses devoirs et de se moquer des lois. »
Au fond, et à prendre même les paroles de Rousseau dans leur sens absolu, à transporter dans l'état social ce qu'il a dit de l'état de nature finissant, que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne, il s'ensuivrait qu'il faut faire non un nouveau partage de la terre, mais son exploitation en commun et le partage de ses fruits entre tous. Les fruits dans ce système n'appartiendraient donc qu'au travail. Eh bien, dans le système de la propriété, ils appartiennent de même au travail et à tous les genres de travaux, parce que les travaux sont l'équivalent les uns des autres; ainsi, comme je l'ai dit, il n'y a de lésion pour personne. Je dis plus, il y a de l'avantage pour tout le monde: car la terre produit plus par la division du travail entre les hommes, et par l'application constante de quelques-uns à sa culture, qu'elle ne produirait par un travail commun; ainsi, dans le régime actuel, non-seulement le travail est assuré d'obtenir, comme dans l'état de nature, une part des fruits de la terre, mais encore d'obtenir une part infiniment plus considérable, parce que ses produits sont plus abondants.
J'espère que ces observations suffisent pour ravir l'autorité de Rousseau aux ennemis de la propriété, s'il en est encore, et pour ôter aux détracteurs des philosophes, tout prétexte d'outrage contre lui; je me félicite d'avoir été conduit par mon sujet à remplir ce devoir de justice envers un des hommes les plus illustres et les plus calomniés de ce siècle, et de le remplir dans ce Lycée, qui jusqu'à présent n'a pas été moins consacré à la philosophie qu'au bon goût.
3.Jean-Baptiste Say on “The Division of Labour” (1803)↩
[Word Length: 5,426]
Source
Jean-Baptiste Say, Traité d’économie politique, ou simple exposition de la manière dont se forme, se distribuent et se consomment les richesses; Quatrième édition, corrigée et augmentée, à laquelle se trouve joint un épitome des principes fondamentaux de l’économie politique (Paris: Deterville, 1819). Tome premier, livre premier “De la production des richesse”, Chap. 7 “Du travail de l’Homme, du travail de la Nature et celui des Machines”, pp. 52-63; Chap. 8 “Des avantages, des inconvéniens, et des bornes qui se rencontrent dans la séparation des travaux”, pp. 64-79.
Brief Bio of the Author: Jean-Baptiste Say (1767-1832)
[Jean-Baptiste Say (1767-1832)]
Jean-Baptiste Say (1767-1832) was the leading French political economist in the first third of the nineteenth century. Before becoming an academic political economist quite late in life, Say apprenticed in a commercial office, working for a life insurance company; he also worked as a journalist, soldier, politician, cotton manufacturer, and writer. During the revolution he worked on the journal of the idéologues, La Décade philosophique, littéraire, et politique, for which he wrote articles on political economy from 1794 to 1799. In 1814 he was asked by the government to travel to England on a fact-finding mission to discover the secret of English economic growth and to report on the impact of the revolutionary wars on the British economy. His book De l'Angleterre et des Anglais (1815) was the result. After the defeat of Napoleon and the restoration of the Bourbon monarchy, Say was appointed to teach economics in Paris, first at the Athénée, then as a chair in "industrial economics" at the Conservatoire national des arts et métiers, and finally the first chair in political economy at the Collège de France. Say is best known for his Traité d'économie politique (1803), which went through many editions (and revisions) during his lifetime. One of his last major works, the Cours complet d'économie politique pratique (1828-33), was an attempt to broaden the scope of political economy, away from the preoccupation with the production of wealth, by examining the moral, political, and sociological requirements of a free society and how they interrelated with the study of political economy. [DMH]
CHAPITRE VII. Du travail de l'homme, du travail de la nature, et de celui des machines.
J'appelle travail l'action suivie à laquelle on se livre pour exécuter une des opérations de l'industrie 7 ou seulement une partie de ces opérations.
Quelle que soit celle de ces opérations à laquelle le travail s'applique, il est productif, puisqu'il concourt à la création d'un produit. Ainsi le travail du savant qui fait des expériences et des livres, est productif; le travail de l'entrepreneur, bien qu'il ne mette pas immédiatement la main à l'œuvre, est productif; enfin, le travail du manouvrier, depuis le journalier qui bêche la terre, jusqu'au matelot qui manœuvre un navire, est encore productif.
Il est rare qu'on se livre à un travail qui ne soit pas productif, c'est-à-dire qui ne concoure pas aux produits de l'une ou de l'autre industrie. Le travail, tel que je viens de le définir, est une peine; et cette peine ne serait suivie d'aucune compensation, d'aucun profit; quiconque la prendrait ferait une sottise ou une extravagance. Quand cette peine est employée à dépouiller, par force ou par adresse, une autre personne des biens qu'elle possède, ce n'est plus une extravagance: c'est un crime. Le résultat n'en est pas une production, mais un déplacement de richesse.
Nous avons vu que l'homme forçait les agens naturels, et même les produits de sa propre industrie, à travailler de concert avec lui à l'œuvre de la production. On ne sera donc point surpris de l'emploi de ces expressions: le travail ou les services productifs de la nature, le travail ou les services productifs des capitaux.
Ce travail des agens naturels et ce travail des produits auxquels nous avons donné le nom de capital, ont entre eux la plus grande analogie, et sont perpétuellement confondus; car les outils et les machines qui font partie d'un capital, ne sont en général que des moyens plus ou moins ingénieux de tirer parti des forces de la nature. La machine à vapeur, qu'on appelle vulgairement pompe à feu, n'est qu'un moyen compliqué de tirer parti alternativement de l'élasticité de l'eau vaporisée et de la pesanteur de l'atmosphère; de façon qu'on obtient réellement d'une pompe à feu plus que le service du capital nécessaire pour l'établir, puisqu'elle est un moyen d'obtenir le service de plusieurs agens naturels dont l'emploi gratuit peut excéder beaucoup en valeur, l'intérêt du capital que représente la machine.
Cela nous indique sous quel point de vue nous devons considérer toutes les machines, depuis le plus simple outil jusqu'au plus compliqué; depuis une lime jusqu'au plus vaste appareil; car les outils ne sont que des machines simples, et les machines ne sont que des outils compliqués que nous ajoutons au bout de nos doigts pour en augmenter la puissance; et les uns et les autres ne sont, à beaucoup d'égards, que des moyens d'obtenir le concours des agens naturels.5 Leur résultat est évidemment de donner moins de travail pour obtenir les mêmes produits, ou, ce qui revient exactement au même, d'obtenir plus de produit pour le même travail humain. C'est le comble de l'industrie.
Lorsqu'une nouvelle machine, ou en général un procédé expéditif quelconque, remplace un travail humain déjà en activité, une partie des bras industrieux dont le service est utilement suppléé, demeure sans ouvrage. Et l'on a tiré de là des argumens assez graves contre l'emploi des machines; en plusieurs lieux, elles ont été repoussées par la fureur populaire, et même par des actes de l'administration.
Pour être à même de tenir une conduite sage dans ces cas-là, il faut d'abord se faire une idée nette de l'effet économique qui résulte de l'introduction d'une machine.
Une machine nouvelle remplace le travail d'une partie des travailleurs, mais ne diminue pas la quantité des choses produites; car alors on se garderait de l'adopter. Quand pour abreuver une ville on substitue une machine hydraulique à l'approvisionnement à bras, les habitans n'ont pas moins d'eau à consommer. Il y a donc tout au moins revenu égal pour le pays; mais il y a un déplacement de revenu. Celui des porteurs d'eau diminue; mais celui des mécaniciens et des capitalistes qui fournissent les fonds, augmente. Que si l'abondance du produit et la modicité des frais de production en font baisser la valeur vénale, c'est alors le revenu des consommateurs qui en profite; car, pour ceux-ci, tout ce qu'ils dépensent de moins vaut autant que ce qu'ils gagnent de plus.
Ce déplacement de revenu, quelque avantageux qu'il soit pour la société, ainsi qu'on va le voir, présente toujours quelque chose de fâcheux; car qu'un capitaliste tire peu de parti de ses fonds, ou même soit obligé de les laisser oisifs pendant quelque temps, l'inconvénient est moindre que d'avoir des industrieux sans moyens de subsistance.
Jusque-là l'objection contre les machines subsiste dans toute sa force. Mais quelques circonstances qui accompagnent communément leur introduction, en. diminuent singulièrement les inconvéniens, en même temps qu'elles laissent à leurs bons effets tout leur développement.
1°. C'est avec lenteur que s'exécutent lés nouvelles machines, et que leur usage s'étend; ce qui laisse aux industrieux dont les intérêts peuvent en être affectés, le loisir de prendre leurs précautions, et à l'administration publique le temps de préparer des remèdes.6
2°. On ne peut établir des machines sans beaucoup de travaux qui procurent de l'ouvrage aux gens laborieux dont elles peuvent détruire les occupations. Pour distribuer de l'eau dans une grande ville, par exemple, il faut augmenter le nombre des ouvriers charpentiers, maçons, forgerons, terrassiers, qui construiront les édifices, qui poseront les tuyaux de conduite, les embranchemens, etc.
3°. Le sort du consommateur, et par conséquent de la classe ouvrière qui souffre, est amélioré par la baisse de la valeur du produit même, auquel elle concourait.
Au surplus, ce serait vainement qu'on voudrait éviter le mal passager qui peut résulter de l'invention d'une machine nouvelle, par la défense d'en faire usage. Si elle est avantageuse, elle est ou sera exécutée quelque part; ses produits seront moins chers que ceux que vos ouvriers continueront à créer laborieusement; et tôt ou tard leur bon marché enlèvera nécessairement à ces ouvriers leurs consommateurs et leur ouvrage. Si les fileurs de coton au rouet qui, en 1789, brisèrent les machines à filature qu'on introduisait alors en Normandie, avaient continué sur le même pied, il aurait fallu renoncer à fabriquer chez nous des étoffes de coton; on les aurait toutes tirées du dehors ou remplacées par d'autres tissus; et les fileurs de Normandie, qui pourtant finirent par être occupés en majeure partie dans les grandes filatures, seraient demeurés encore plus dépourvus d'occupation.
Voila pour ce qui est de l'effet prochain qui résulte de l'introduction des nouvelles machines. Quant à l'effet ultérieur, il est tout à l'avantage des machines.
En effet, si, par leur moyen, l'homme fait une conquête sur la nature, et oblige les forces naturelles, les diverses propriétés des agens naturels, à travailler pour son utilité, le gain est évident. Il y a toujours augmentation de produit, ou diminution de frais de production. Si le prix vénal du produit ne baisse pas, cette conquête est au profit du producteur, sans rien coûter au consommateur. Si le prix baisse, le consommateur fait son profit de tout le montant de la baisse, sans que ce soit aux dépens du producteur.
D'ordinaire la multiplication d'un produit en fait baisser le prix: le bon marché en étend l'usage; et sa production, quoique devenue plus expéditive, ne tarde pas à occuper plus de travailleurs qu'auparavant. Il n'est pas douteux que le travail du coton occupe plus de bras en Angleterre, en France et en Allemagne, dans ce moment, qu'avant l'introduction des machines qui ont singulièrement abrégé et perfectionné ce travail.
Un exemple assez frappant encore du même effet, est celui que présente la machine qui sert à multiplier rapidement les copies d'un même écrit: je veux dire l'imprimerie.
Je ne parle pas de l'influence qu'a eue l'imprimerie sur le perfectionnement des connaissances humaines et sur la civilisation; je ne veux la considérer que comme manufacture et sous ses rapports économiques. Au moment où elle fut employée, une foule de copistes durent rester inoccupés; car on peut estimer qu'un seul ouvrier imprimeur fait autant de besogne que deux cents copistes. Il faut donc croire que 199 ouvriers sur 200 restèrent sans ouvrage. Hé bien, la facilité de lire les ouvrages imprimés, plus grande que pour les ouvrages manuscrits, le bas prix auquel les livres tombèrent, l'encouragement que cette invention donna aux auteurs pour en composer en bien plus grand nombre, soit d'instruction, soit d'amusement; toutes ces causes firent qu'au bout de très peu de temps, il y eut plus d'ouvriers imprimeurs employés qu'il n'y avait auparavant de copistes. Et si à présent on pouvait calculer exactement, non-seulement le nombre des ouvriers imprimeurs, mais encore des industrieux que l'imprimerie fait travailler, comme graveurs de poinçons, fondeurs de caractères, fabricans de papier, voituriers, correcteurs, relieurs, libraires, on trouverait peut-être que le nombre des personnes occupées par la fabrication des livres est cent fois plus grand que celui qu'elle occupait avant l'invention de l'imprimerie.
Qu'on me permette d'ajouter ici que si nous comparons en grand l'emploi des bras avec l'emploi des machines, et dans la supposition extrême où les machines viendraient à remplacer presque tout le travail des hommes, le nombre des hommes n'en serait pas réduit, puisque la somme des productions ne serait pas diminuée, et il y aurait peut-être moins de souffrances à redouter pour la classe indigente, laborieuse; car alors, dans les fluctuations qui, par momens, font souffrir les diverses branches d'industrie, ce seraient des machines principalement, c'est-à-dire des capitaux, qui chômeraient, plutôt que des bras, plutôt que des hommes; or des machines ne meurent pas de faim; elles cessent de rapporter un profit à leurs entrepreneurs, qui, en général, sont moins près du besoin que de simples ouvriers.
Mais quelques avantages que présente définitivement l'emploi d'une nouvelle machine pour la classe des entrepreneurs et même pour celle des ouvriers, ceux qui en retirent le principal profit sont les consommateurs; et c'est toujours la classe essentielle, parce qu'elle est la plus nombreuse, parce que les producteurs de tout genre viennent s'y ranger, et que le bonheur de cette classe composée de toutes les autres, constitue le bien-être général, l'état de prospérité d'un pays.7 Je dis que ce sont les consommateurs qui retirent le principal avantage des machines: en effet, si leurs inventeurs jouissent exclusivement pendant quelques années du fruit de leur découverte, rien n'est plus juste; mais il est sans exemple que le secret ait pu être gardé long-temps. Tout finit par être su; principalement ce que l'intérêt personnel excite à découvrir, et ce qu'on est obligé de confier à la discrétion de plusieurs individus qui construisent la machine ou qui s'en servent. Dès lors la concurrence abaisse la valeur du produit de toute l'économie qui est faite sur les frais de production; c'est alors que commence le profit du consommateur. La mouture du blé ne rapporte probablement pas plus aux meuniers d'à présent qu'à ceux d'autrefois; mais la mouture coûte bien moins aux consommateurs.
Le bon marché n'est pas le seul avantage que l'introduction des procédés expéditifs procure aux consommateurs: ils y gagnent en général plus de perfection dans les produits. Des peintres pourraient exécuter au pinceau les dessins qui ornent nos indiennes, nos papiers pour tentures; mais les planches d'impression, mais les rouleaux qu'on emploie pour cet usage, donnent aux dessins une régularité, aux couleurs une uniformité que le plus habile artiste ne pourrait jamais atteindre.
En poursuivant cette recherche dans tous les arts industriels, on verrait que la plupart des machines ne se bornent pas à suppléer simplement le travail de l'homme, et qu'elles donnent un produit réellement nouveau en donnant une perfection nouvelle. Le balancier, le laminoir exécutent des produits que l'art et les soins du plus habile ouvrier n'accompliraient jamais sans ces puissantes machines.
Enfin les machines font plus encore: elles multiplient même les produits auxquels elles ne s'appliquent pas. On ne croirait peut-être pas, si l'on ne prenait la peine d'y réfléchir, que la charrue, la herse et. d'autres semblables machines, dont l'origine se perd dans la nuit des temps, ont puissamment concouru à procurer à l'homme une grande partie, non-seulement des nécessités de la vie, mais même des superfluités dont il jouit maintenant, et dont probablement il n'aurait jamais seulement conçu l'idée. Cependant, si les diverses façons que réclame le sol ne pouvaient se donner que par le moyen de la bêche, de la houe et d'autres instrumens aussi peu expéditifs; si nous ne pouvions faire concourir à ce travail, des animaux qui, considérés en économie politique, sont des espèces de machines, il est probable qu'il faudrait employer, pour obtenir les denrées alimentaires qui soutiennent notre population actuelle, la totalité des bras qui s'appliquent actuellement aux arts industriels. La charrue a donc permis à un certain nombre de personnes de se livrer aux arts, même les plus futiles, et, ce qui vaut mieux, à la culture des facultés de l'esprit.
Les anciens ne connaissaient pas les moulins: de leur temps c'étaient des hommes qui broyaient le froment dont on faisait le pain; il fallait peut-être vingt personnes pour broyer autant de blé qu'un seul moulin peut en moudre.8 Or un seul meunier, deux au plus, suffisent pour alimenter et surveiller le moulin. Ces deux hommes, à l'aide de cette ingénieuse machine, donnent un produit égal à celui de vingt personnes au temps de César. Nous forçons donc le vent ou un cours d?eau, dans chacun de nos moulins, à faire l'ouvrage de dix-huit personnes; et ces dix-huit personnes, que les anciens employaient de plus que nous, peuvent de nos jours trouver à subsister comme autrefois, puisque le moulin n'a pas diminué les produits de la société; et en même temps leur industrie peut s'appliquer à créer d'autres produits qu'elles donnent en échange du produit du moulin, et multiplie ainsi la masse des richesses.9
CHAPITRE VIII. Des avantages, des inconvéniens et des bornes qui se rencontrent dans la séparation des travaux.
Nous avons déjà remarqué que ce n'était pas ordinairement la même personne qui se chargeait des différentes opérations dont l'ensemble compose une même industrie: ces opérations exigent pour la plupart des talens divers, et des travaux assez considérables pour occuper un homme tout entier. Il est même telle de ces opérations qui se partage en plusieurs branches, dont une seule suffit pour occuper tout le temps et toute l'attention d'une personne.
C'est ainsi que l'étude de la nature se partage entre le chimiste, le botaniste, l'astronome et plusieurs autres classes de savans.
C'est ainsi que, lorsqu'il s'agit de l'application des connaissances de l'homme à ses besoins, dans l'industrie manufacturière, par exemple, nous trouvons que les étoffes, les faïences, les meubles, les quincailleries, etc., occupent autant de différentes classes de fabricans.
Enfin, dans le travail manuel de chaque industrie, il y a souvent autant de classes d'ouvriers qu'il y a de travaux différens. Pour faire le drap d'un habit, il a fallu occuper des fileuses, des tisseurs, des fouleurs, des tondeurs, des teinturiers, et plusieurs autres sortes d'ouvriers, dont chacun exécute toujours la même opération.
Le célèbre Adam Smith a le premier fait remarquer que nous devions à cette séparation des différens travaux une augmentation prodigieuse dans la production, et une plus grande perfection dans les produits.10
J'ai néanmoins fait honneur à Smith de l'idée sur la séparation des occupations, parce que très-probablement il l'avait professée avant Beccaria, dans sa chaire de philosophie à Glasgow, comme on sait qu'il a fait pour tous les principes qui servent de base à son ouvrage, et surtout parce que c'est lui qui en a tiré les conséquences les plus importantes.
Il cite comme un exemple, entre beaucoup d'autres, la fabrication des épingles. Chacun des ouvriers qui s'occupent de ce travail ne fait jamais qu'une partie d'une épingle. L'un passe le laiton à la filière, un autre le coupe, un troisième aiguise les pointes; la tête seule de l'épingle exige deux ou trois opérations distinctes, exécutées par autant de personnes différentes.
Au moyen de cette séparation d'occupations diverses, une manufacture assez mal montée, et où dix ouvriers seulement travaillaient, était en état de fabriquer chaque jour, au rapport de Smith, quarante-huit mille épingles.
Si chacun de ces dix ouvriers avait été obligé de faire des épingles les unes après les autres, eh commençant par la première opération et en finissant par la dernière, il n'en aurait peut-être terminé que vingt dans un jour; et les dix ouvriers n'en auraient fait que deux cents au lieu de quarante-huit mille.
Smith attribue ce prodigieux effet à trois causes.
Première cause. L'esprit et le corps acquièrent une habilité singulière dans les occupations simples et souvent répétées. Dans plusieurs fabrications, la rapidité avec laquelle sont exécutées de certaines opérations passe tout ce qu'on croirait pouvoir attendre de la dextérité de l'homme.
Deuxième cause. On évite le temps perdu à passer d'une occupation à une autre, à changer de place, de position et d'outils. L'attention, toujours paresseuse, n'a nul besoin de se porter vers un objet nouveau, de s'en occuper.
Troisième cause. C'est la séparation des occupations qui a fait découvrir les procédés les plus expéditifs; elle a naturellement réduit chaque opération à une tâche fort simple et sans-cesse répétée: or, ce sont de pareilles tâches qu'on" parvient plus aisément à faire exécuter par des outils ou machines.
Les hommes d'ailleurs trouvent bien mieux les manières d'atteindre un certain but, lorsque ce but est proche, et que leur attention est constamment tournée du même côté. Là plupart des découvertes, même celles que lés savans ont faites, doivent être attribuées originairement à la subdivision des travaux, puisque c'est par une suite de cette subdivision que des hommes se sont occupés à étudier de certaines branches de connaissances exclusivement à toutes les autres; ce qui leur a permis de les suivre beaucoup plus loin.11
Ainsi les connaissances nécessaires pour la prospérité de l'industrie commerciale, par exemple, sont bien plus perfectionnées quand ce sont des hommes differens qui étudient:
L'un, la géographie, pour connaître la situation des états et leurs produits;
L'autre, la politique, pour connaître ce qui a rapport à leurs lois, à leurs mœurs, et quels sont les inconvéniens ou les secours auxquels on doit s'attendre en trafiquant avec eux;
L'autre, la géométrie, la mécanique, pour déterminer la meilleure forme des navires, des chars, des machines;
L'autre, l'astronomie, la physique, pour naviguer avec succès, etc.
S'agit-il de la partie de l'application dans la même industrie commerciale, on sentira qu'elle sera plus parfaite lorsque ce seront des négocians différens qui feront le commerce d'une province à l'autre, le commerce de la Méditerranée, celui des Indes orientales, celui d'Amérique, le commerce en gros, le commerce en détail, etc. etc.
Cela n'empêche nullement de cumuler les opérations qui ne sont pas incompatibles, et surtout celles qui se prêtent un appui mutuel. Ce ne sont point deux négocians différens qui transportent dans un pays les produits que ce pays consomme, et qui rapportent les produits qu'il fournit, parce que l'une de ces opérations n'exclut pas l'autre, et qu'elles peuvent, au contraire, être exécutées en se prêtant un appui mutuel.
La séparation des travaux, en multipliant les produits relativement aux frais de production, les procure à meilleur marché. Le producteur, obligé par la concurrence d'en baisser le prix de tout le montant de l'économie qui en résulte, en profite beaucoup moins que le consommateur; et lorsque le consommateur met obstacle à cette division, c'est à lui-même qu'il porte préjudice.
Un tailleur qui voudrait faire non-seulement ses habits, mais encore ses souliers, se ruinerait infailliblement.12
On voit des personnes qui font, pour ce qui les regarde, les fonctions du commerçant, afin d'éviter de lui payer les profits ordinaires de son industrie; elles veulent, disent-elles, mettre ce bénéfice dans leur poche. Elles calculent mal: la séparation des travaux permet au commerçant d'exécuter pour elles ce travail à moins de frais qu'elles ne peuvent le faire elles-mêmes.
Comptez la peine que vous ayez prise, le temps que vous ayez perdu, les faux frais, toujours plus considérables à proportion dans les petits opérations que dans les grandes; et voyez si ce que tout cela vous coûte n'excède pas deux or trois pour cent que vous épargnerez sur un çhétjf objet de consommation, en supposant encore, que ce bénéfice ne vous ait pas été ravi par la çupidité de l'agriculteur ou du manufacturier avec qui vous ayez traité directement, et qui ont dû se prévaloir de votre inexpérience.
Il ne convient pas même à l'agriculteur et au manufacturier, si ce n'est dans des circonstances très-particulières, d'aller sur les brisées du commerçant, et de chercher à vendre sans intermédiaire leurs denrées au consommateur. Ils se détourneraient de leurs soins accoutumés, et perdraient un temps qu'ils peuvent employer plus utilement à leur affaire principale; il faudrait entretenir des gens, des chevaux, des voitures dont les frais surpasseraient les bénéfices du négociant, communément très-réduits par la concurrence.
On ne peut jouir des avantages attachés à la subdivision des travaux que dans certains produits, et lorsque la consommation des produits s'étend au-delà d'un certain point.
Dix ouvriers peuvent fabriquer 48 mille épingles dans un jour; mais ce ne peut être que là où il se consomme chaque jour un pareil nombre d'épingles; car, pour que la division s'étende jusque-là, il faut qu'un seul ouvrier ne s'occupe absolument que du soin d'en aiguiser les pointes, pendant que chacun des autres ouvriers s'occupe d'une autre partie de la fabrication. Si l'on n'avait besoin dans le pays que de 24 mille épingles par jour, il faudrait donc qu'il perdît une partie de sa journée, ou qu'il changeât d'occupation; dès lors la division du travail ne serait plus aussi grande.
Par cette raison, elle ne peut être poussée à son dernier terme que lorsque les produits sont susceptibles d'être transportés au loin, pour étendre le nombre de leurs consommateurs; ou lorsqu'elle s'exerce dans une grande ville qui offre par elle-même une grande consommation. C'est par la même raison que plusieurs sortes de travaux, qui doivent être consommés en même temps que produits, sont exécutés par une même main dans les lieux où la population est bornée.
Dans une petite ville, dans un village, c'est souvent le même homme qui fait l'office de barbier, de chirurgien, de médecin et d'apothicaire; tandis que dans une grande ville, non-seulement ces occupations sont exercées par des mains différentes, mais l'une d'entre elles, celle de chirurgien, par exemple, se subdivise en plusieurs autres, et c'est là seulement qu'on trouve des dentistes, des oculistes, des accoucheurs; lesquels, n'exerçant qu'une seule partie d'un art étendu, y deviennent beaucoup plus habiles qu'ils ne pourraient jamais l'être sans cette circonstance.
Il en est de même relativement à l'industrie commerciale. Voyez un épicier de village: la consommation bornée de ses denrées l'oblige à être en même temps marchand de merceries, marchand de papier, cabaretier, que sais-je? écrivain public peut-être, tandis que, dans les grandes villes, la vente, non pas des seules épiceries, mais même d'une seule drogue, suffit pour faire un commerce. A Amsterdam, à Londres, à Paris, il y a des boutiques où l'on ne vend autre chose que du thé, ou des huiles, ou des vinaigres; aussi chacune de ces boutiques est bien mieux assortie dans ces diverses denrées que les boutiques où l'on vend en même temps un grand nombre d'objets différens.
C'est ainsi que, dans un pays riche et populeux, le voiturier, le marchand en gros, en demi-gros, en détail, exercent différentes parties de l'industrie commerciale, et qu'ils y portent et plus de perfection et plus d'économie. Plus d'économie, bien qu'ils gagnent tous; et si les explications qui en ont été données ne suffisaient pas, l'expérience nous fournirait son témoignage irrécusable; car c'est dans les lieux où toutes les branches de l'industrie commerciale sont divisées entre plus de mains que le consommateur achète à meilleur marché. A qualités égales, on n'obtient pas dans un village une denrée venant de la même distance à un aussi bon prix que dans une grande ville ou clans une foire.
Le peu de consommation des bourgs et villages, non-seulement oblige les marchands à y cumuler plusieurs occupations, mais elle est même insuffisante pour que la vente de certaines denrées y soit constamment ouverte. Il y en a qu'on n'y trouve que les jours de marché ou de foire; il s'en achète ce jour-là seul tout ce qui s'en consomme dans la semaine, ou même dans l'année. Les autres jours le marchand va faire ailleurs son commerce, ou bien s'occupe d'autre chose. Dans un pays très-riche et très-populeux, les consommations sont assez fortes pour que le débit d'un genre de marchandise occupe une profession pendant tous les jours de la semaine. Les foires et les marchés appartiennent à un état encore peu avancé de prospérité publique, de même que le commerce par caravanes appartient à un état encore peu avancé des relations commerciales; mais ce genre de relations vaut encore mieux que rien.13
De ce qu'il faut nécessairement une consommation considérable pour que la séparation des occupations soit poussée à son dernier terme, il résulte qu'elle ne peut pas s'introduire dans la fabrique des produits qui, par leur haut prix, ne sont qu'à la portée d'un petit nombre d'acheteurs. Elle se réduit à peu de chose dans la bijouterie, surtout dans la bijouterie recherchée et, comme nous avons vu qu'elle est une des causes de la découverte et de l'application des procédés ingénieux, il arrive que c'est précisément dans les productions d'un travail exquis que de tels procédés se rencontrent plus rarement. En visitant l'atelier d'un lapidaire, on sera ébloui de la richesse des matières, de la patience et de l'habileté de l'ouvrier; mais c'est dans les ateliers où se préparent en grand les choses d'un usage commun, qu'on sera frappé d'une méthode heureusement imaginée pour expédier la fabrication et la rendre plus parfaite. En voyant un bijou, on s'imagine aisément les outils et les procédés par lesquels on est parvenu à le faire; mais en voyant un lacet de fil, il est peu de personnes qui se doutent qu'il ait été fabriqué par un cheval ou par un courant d'eau; ce qui est pourtant vrai.
L'industrie agricole est celle des trois qui admet le moins de division dans les travaux. Un grand nombre de cultivateurs ne sauraient se rassembler dans un même lieu pour concourir tous ensemble à la fabrication d'un même produit. La terre qu'ils travaillent est étendue sur tout le globe, et les force à se tenir à de grandes distances les uns des autres. De plus, l'agriculture n'admet pas la continuité d'une même opération. Un même homme ne saurait labourer toute l'année tandis qu'un autre récolterait constamment. Enfin, il est rare, qu'on puisse s'adonner à une même culture dans toute l'étendue de son terrain, et la continuer pendant plusieurs années de suite; la terre ne la supporterait pas; et si la culture était uniforme sur toute une propriété, les façons à donner aux terres et les récoltes tomberaient aux mêmes époques; tandis que dans d'autres instans les ouvriers resteraient oisifs.14
La nature des travaux et des produits de la campagne veut encore qu'il convienne au cultivateur de produire lui-même les légumes, les fruits, les bestiaux, et même une partie des instrumens et des constructions qui servent à la consommation de sa maison, quoique ces productions soient d'ailleurs l'objet des travaux exclusifs de plusieurs professions.
Dans les genres d'industrie qui s'exercent en ateliers, et où le même entrepreneur donne toutes les façons à un produit, il ne peut, sans de gros capitaux, subdiviser beaucoup ses opérations. Cette subdivision réclame de plus fortes avances en salaires, en matières premières, en outils. Si dix-huit ouvriers ne faisaient que 20 épingles chacun, c'est-à-dire, 360 épingles à la fois, pesant à peine une once, une once de cuivre successivement renouvelée suffirait pour les occuper. Mais si, au moyen de la séparation des occupations, les dix-huit ouvriers font par jour, ainsi qu'on vient de le voir, 86,400 épingles, la matière première nécessaire pour occuper ces dix-huit ouvriers devra être constamment du poids de 240 onces; elle exigera par conséquent une avance plus considérable. Et si l'on considère qu'il se passe peut-être un mois et plus, depuis le moment où le manufacturier achète le cuivre jusqu'à celui où il rentre dans cette avance par la vente des épingles, on sentira qu'il est obligé d'avoir constamment trente fois 240 onces de cuivre en fabrication à différens degrés, et que la portion de son capital, occupée par cette matière première seulement, est égale à la valeur de 450 livres de cuivre. Enfin la séparation des occupations ne peut avoir lieu qu'au moyen de plusieurs instrumens et machines qui sont eux-mêmes une partie importante du capital. Aussi voit-on fréquemment, dans les pays pauvres, le même travailleur commencer et achever toutes les opérations qu'exige un même produit, faute d'un capital suffisant pour bien séparer les occupations.
Mais il ne faut pas s'imaginer que la séparation des travaux ne puisse avoir lieu qu'au moyen des capitaux d'un seul entrepreneur et dans l'enceinte d'un même établissement. Toutes les façons d'une paire de bottes ne sont pas données par le bottier seulement, mais aussi par le nourrisseur de bestiaux, par le megissier, par le corroyeur, par tous ceux qui fournissent de près ou de loin quelque matière ou quelque outil propres à là fabrication des bottes; et quoiqu'il y ait une assez grande subdivision de travail dans la confection de ce produit, là plupart de ces producteurs y concourent avec d'assez petits capitaux.
Après avoir examine les avantages et les bornes de la subdivision des différens travaux de l'industrie, si nous voulons avoir une vue complète du sujet, il convient d'observer les inconvéniens qu'elle traîne à sa suite.
Un homme qui ne fait, pendant toute sa vie, qu'une même opération, parvient à coup sûr à l'exécuter mieux et plus promptement qu'un autre homme; mais en même temps il devient moins capable de toute autre occupation, soit physique, soit morale; ses autres facultés s'éteignent, et il en résulte une dégénération dans l'homme considéré individuellement. C'est un triste témoignage à se rendre, que de n'avoir jamais fait que la dix-huitième partie d'une épingle; et qu'on ne s'imagine pas que ce soit uniquement l'ouvrier qui toute sa vie conduit une lime où un marteau, qui dégénère ainsi de la dignité de sa nature; c'est encore l'homme qui par état exerce les facultés les plus déliées de son esprit. C'est bien par une suite de la séparation des occupations que près des tribunaux il y a des procureurs dont l'unique occupation est de représenter les plaideurs, et de suivre pour eux tous les détails de la procédure. On ne refusé pas en général à ces hommes de loi, l'adressé ni l'esprit de ressources dans les choses qui tiennent à leur métier; cependant il est tel procureur, même parmi les plus habiles, qui ignore les plus simples procédés des arts dont il fait usage à tout moment; s'il faut qu'il raccommode le moindre de ses meubles, il ne saura par où s'y prendre; il lui sera impossible même d'enfoncer un clou sans faire sourire le plus médiocre apprenti: et qu'on le mette dans une situation plus importante; qu'il s'agisse de sauver la vie d'un ami qui se noie, de préserver sa ville des embûches dé l'ennemi, il sera bien autrement embarrassé; tandis qu'un paysan grossier, l'habitant d'un pays demi-sauvage, se tirera avec honneur d'une semblable difficulté.
Dans là classe des ouvriers, cette incapacité pour plus d'un emploi rend plus dure, plus fastidieuse et moins lucrative la condition des travailleurs. Ils ont moins de facilité pour réclamer une part équitable dans la valeur totale du produit. L'ouvrier qui porte dans ses bras tout un métier, peut aller partout exercer son industrie, et trouver des moyens de subsister; l'autre n'est qu'un accessoire qui, séparé de ses confrères, n'a plus ni capacité, ni indépendance, et qui se trouve forcé d'accepter la loi qu'on juge à propos de lui imposer.
En résultat, on peut dire que la séparation des travaux est un habile emploi des forces de l'homme; qu'elle accroît en conséquence les produits de la société, c'est-à-dire sa puissance et ses jouissances, mais qu'elle ôte quelque chose à la capacité de chaque homme pris individuellement.
4.Destutt de Tracy on “The Laws and Public Liberty” (1811)↩
[Word length: 4,590]
Source
Antoine-Louis-Claude Destutt de Tracy, Commentaire sur l’Esprit des lois de Montesquieu; suivi d'observations inédites de Condorcet sur le 29e livre du même ouvrage. Édition entièrement conforme à celle publiée à Liége en 1817. (Paris: Delaunay, 1819). Chap. XI. Sur le Livre XI. Des lois qui forment la liberté politique dans son rapport avec la constitution,” Première partie, pp. 150-174.
Brief Bio of the Author: Comte Destutt de Tracy (1754-1836)
[Antoine Destutt de Tracy (1754-1836)]
Antoine Destutt de Tracy (1754-1836) was one of the leading intellectuals of the 1790s and early 1800s and a member of the ideologues (a philosophical movement not unlike the objectivists, who professed that the origin of ideas was material–not spiritual). In his writings on Montesquieu, Tracy defended the institutions of the American Republic, and in his writings on political economy he defended laissez-faire. During the French Revolution he joined the third estate and renounced his aristocratic title. During the Terror he was arrested and nearly executed. Tracy continued agitating for liberal reforms as a senator during Napoleon’s regime. One of his most influential works was the four-volume Éléments d’idéologie (first published in 1801-15) (Tracy coined the term “ideology”). He also wrote Commentaire sur l'ésprit des lois (1819), which Thomas Jefferson translated and brought to the United States. In 1822 he published his Traité d’économie politique (1823), much admired by Jefferson and Bastiat. [DMH]
Chapitre XI. Sur le Livre XI. -Des lois qui forment la liberté politique dans son rapport avec la constitution.
J'AI cru devoir partager mon commentaire sur ce livre en deux parties. La première a seule un rapport direct avec l'ouvrage de notre auteur. La seconde est la suite de la première; mais Montesquieu n'a pas poussé si loin ses recherches.
PREMIÈRE PARTIE.
Le problème qui consiste à distribuer les pouvoirs de la société de la manière la plus favorable à la liberté, est-il résolu?
Dans ce livre, dont le titre ne présente pas, ce me semble, un sens suffisamment clair, on examine de quel degré de liberté on peut jouir sous chaque espèce de constitutions, c'est-à-dire, quels effets produisent nécessairement sur la liberté des citoyens, les lois qui forment la constitution de l'état. Ces lois sont uniquement celles qui règlent la distribution, des pouvoirs politiques; car la constitution d'une société n'est autre chose que l'ensemble des règlemens qui déterminent la nature, l'étendue, et les limites des autorités qui la régissent. Aussi, lorsqu'on veut réunir tous ces règlemens en un seul corps de lois qui soit la base de l'édifice social, la première attention que l'on doit‘ avoir est de n'y faire entrer aucune disposition étrangère à cet objet unique; sans quoi ce n'est plus précisément une constitution que l'on a rédigée; ce n’est qu'une portion, plus ou moins considérable, du code général qui régit la nation.
Mais pour voir quelle est l'influence de l'organisation de la société sur la liberté de ses membres, il faut savoir précisément ce que c’est que la liberté. Le mot liberté, comme tous ceux qui expriment des idées abstraites très-générales, est souvent pris dans une multitude d'acceptions différentes qui sont autant de portions particulières de sa signification la plus étendue: ainsi,l'on dit qu’un homme est devenu libre, qu’il a acquis, qu’il a recouvré sa liberté, quand il a mis a fin une entreprise‘ qui l'occupait tout entier, quand il a terminé des affaires qui l'absorbaient, quand il a quitté des fonctions assujettissantes, quand il a renoncé à une place qui lui imposait des devoirs, quand, il s’est affranchi du joug de certaines passions, de certaines liaisons qui l'enchaînaient ‘ et le dominaient, quand il s’est évadé d'un prison, quand il s'est soustrait à l'empire‘ d'un gouvernement tyrannique. On dit de même qu’il a la liberté de penser, de parler, d'agir, décrire, qu’il a la parole, la respiration, tous les mouvemens libres, lorsque rien ne le gêne à tous ces égards. Ensuite on range toutes ces libertés partielles par groupes; et on en compose ce que l'on‘ appelle la liberté physique, la liberté morale ou la liberté naturelle, la liberté civile, la liberté politique. De là, il arrive que, quand on veut s’élever à l'idée la plus générale de la liberté, chacun la compose principalement de l'espèce de liberté à laquelle il attache le plus de prix, et de l'éloignement des gênes dont il est le plus préoccupé, et qui lui paraissaient les plus insupportables. Les uns la font-consister dans la vertu, ou dans l’indifférence, ou dans une sorte d’impassibilité, comme les stoïciens qui prétendaient que leur sage était libre dans les fers; d'autres la placent dans la pauvreté; d'autres, au contraire, dans une honnête aisance, ou bien dans l'état d’isolement et d'indépendance absolue de tout lien social. D'autres encore prétendent qu'être libre, c'est vivre sous un gouvernement d'une telle espèce, ou, en général, sous un gouvernement modéré, ou même seulement sous un gouvernement éclairé. Toutes ces opinions sont justes, relativement au côté par lequel on considère l’idée de la liberté; mais, dans aucune, on ne la voit sous tous ses aspects, et on ne l'embrasse dans toute son étendue. Cherchons donc ce que toutes ces différentes espèces de liberté ont de commun, et sous quel point de vue elles se ressemblent toutes; car cela seul peut entrer dans l'idée générale, abstraite de toutes les idées particulières, et les renferme toutes dans son extension.
Si nous y réfléchissons bien, nous trouverons que la qualité commune à toutes les espèces de liberté, est qu'elles procurent à celui qui en jouit un plus grandi développement de l'exercice de sa volonté, que s’il en était privé. Ainsi l'idée de liberté, dans son plus haut degré d'abstraction, et dans sa plus grande étendue, n'est autre que l'idée de la puissance d'exécuter sa volonté; et être libre, en général, c’est pouvoir faire ce qu'on veut.
D'après cela, l'on voit que l’idée de liberté n'est applicable qu'aux êtres doués de volonté. Aussi, quand nous disons que de l'eau coule plus librement quand on a enlevé les obstacles qui s'opposaient à son passage, ou qu'une roue tourne plus librement parce qu'on a diminué les frottemens qui retardaient son mouvement, ce n'est que par extension, et parce que nous supposons, pour ainsi dire, que cette eau a envie de couler, que cette roue a envie de tourner.
Par la même raison, cette question tant débattue, notre volonté est-elle libre? ne devait pas naître: car il ne peut s'agir de liberté, par rapport à notre volonté, que quand elle est formée, et non pas avant qu'elle le soit. Ce qui y a donné lieu, c’est que, dans certaines occasions, les motifs qui agissent sur nous sont si puissans, qu’il n'est pas possible qu'ils ne nous déterminent pas tout de suite à vouloir une chose plutôt qu'une autre; et alors nous disons que nous voulons forcément; tandis que, dans d'autres circonstances, les motifs ayant moins d’intensité et d'énergie, nous laissent la possibilité d'y réfléchir, de les peser et de les apprécier; et alors nous croyons que nous avons le pouvoir d'y résister ou d'y obéir, et de prendre une détermination plutot qu'une autre, uniquement parce que nous le voulons. Mais c’est une illusion; car, quelque faible que soit un motif, il entraîne nécessairement notre volonté, s’il n'est pas balancé par un autre qui soit plus fort; et alors celui-là est aussi nécessairement déterminant que l'aurait été l'autre, s’il avait existé seul. On veut ou on ne veut pas, mais on ne peut pas vouloir vouloir; et, quand on le pourrait, il y aurait encore une cause à cette volonté antécédente, et cette cause serait hors de l'empire de notre volonté, comme le sont toutes celles qui la font naître. Concluons que la liberté n'existe qu'après la volonté et relativement à elle, et qu'elle n'est que le pouvoir d'exécuter la volonté.15 Je demande pardon au lecteur de cette discussion métaphysique sur la nature de la liberté; mais il verra bientôt qu'elle n'est ni déplacée ni inutile. Il est impossible de bien parler des intérêts des hommes sans premièrement se bien rendre compte de la nature de leurs facultés. Si quelque chose a manqué aux lumières du grand homme que je commente, c’est surtout cette étude préliminaire. Aussi l'on peut voir combien est vague l’idée qu'il nous a donnée du sens du mot liberté, quoiqu’il ait consacré trois chapitres à le déterminer. Nous lui avons déjà fait, à peu près, le même reproche au sujet du mot loi, dans le premier chapitre.
La liberté, dans le sens le plus général de ce mot, n'est donc autre chose que la puissance d'exécuter sa volonté, et d'accomplir ses désirs. Maintenant, la nature de tout être doué de volonté est telle, qu’il n'est heureux ou malheureux que par cette faculté de vouloir et que relativement à elle. Il jouit quand ses désirs sont accomplis; il souffre quand ils ne le sont pas; et il ne saurait y avoir de bonheur et de malheur pour lui, qu'autant que ce qu'il désire arrive ou n'arrive pas. ll s’ensuit que sa liberté et son bonheur sont une seule et même chose. ll serait toujours complétement heureux, s’il avait toujours complètement le pouvoir d'exécuter sa volonté; et les degrés de son bonheur sont constamment proportionnels aux degrés de ce pouvoir.
Cette remarque nous explique pourquoi les hommes, même sans qu’ils s'en doutent, aiment tous si passionnément la liberté; c’est qu’ils ne sauraient jamais aimer rien d'autre. Quelque chose qu’ils souhaitent, c’est toujours, sous un nom ou sous un autre, la possibilité d'accomplir un désir; c’est toujours la possession d'une partie de pouvoir, l'anéantissement d'une portion de contrainte, qui constituent une certaine quantité de bonheur. L'exclamation: Ah si je pouvais...! renferme tous nos vœux: car il n'y en a pas un qui ne fût accompli, si celui-là l'était toujours. La toute-puissance, ou, ce qui est la même chose, la toute-liberté, est inséparable de la félicité parfaite.
Cette même remarque nous conduit plus loin. Elle nous fait voir pourquoi les hommes se sont souvent fait des idées si différentes de la liberté; c’est qu’ils en ont eu de différentes du bonheur. Ils ont toujours dû attacher éminemment l'idée de liberté, au pouvoir de faire les choses qu’ils désiraient le plus, celles auxquelles ils attachaient leur principale satisfaction.Montesquieu, dans son chap. II, paraît s’étonner que beaucoup de peuples aient eu de fausses idées de la liberté, et l'aient fait consister dans des choses qui étaient étrangères à leurs solides intérêts, ou qui, du moins, n'y étaient pas essentielles. Mais il aurait dû d'abord s’étonner que les hommes aient souvent placé leur bonheur et leur satisfaction dans la jouissance de choses peu importantes ou même nuisibles. Cette première faute faite, l'autre devait s’ensuivre. Dès qu’un Russe, du temps de Pierre-le-Grand, mettait tant d'intérêt à porter sa longue barbe, qui n'était peut-être qu’une gêne et un ridicule, dès qu’un Polonais était passionnément attaché à la possession de son liberum veto, qui était le fléau de sa patrie, il est tout simple qu’ils se trouvassent très-tyrannisés de se voir enlever l'un ou l'autre de ces prétendus avantages. Ils étaient réellement très-asservis, quand on les en a dépouillés; car leur volonté la plus forte a été subjuguée. Montesquieu se répond à lui-même, quand il ajoute cette phrase remarquable: Enfin chacun a appelé LIBERTÉ le gouvernemement qui était conforme à ses inclinations. Cela devait être ainsi et ne pouvait être autrement; en cela chacun a eu raison; car chacun est vraiment libre quand ses inclinations sont satisfaites, et on ne peut pas l'être d'une autre manière.
De cette dernière observation dérivent de nombreuses conséquences. La première qui se présente, est qu’une nation doit être regardée comme vraiment libre tant que son gouvernement lui plaît, quand même, par sa nature, il serait moins conforme aux principes de la liberté qu’un autre qui lui déplairait. On a souvent prétendu que Solon disait: Je n’ai pas donné aux Atheniens les meilleures lois possibles, mais les meilleures qu’ils PUSSENT recevoir, c'est-à-dire, les meilleures dont ils fussent dignes. Je ne crois pas que Solon ait dit cela. Cette vanterie méprisante aurait été bien déplacée dans sa bouche, lui qui avait si mal assorti ses lois au caractère national, qu’elles n'ont pas même duré autant que lui. Mais je crois qu’il a dit: Je leur ai donné les meilleures lois qu'ils VOULUSSENT recevoir. Cela peut être, et le justifie de son mauvais succès. Il y a plus, cela a dû être ainsi: puisqu'il n’imposait pas ses lois par la force, il a bien fallu qu'il les donnàt telles qu'on voulait les recevoir. Eh bien! les Athéniens, en se soumettant à ces lois si imparfaites, ont sans doute été très-mal avisés; mais ils ont été très-libres, tandis que ceux des Français qui ont reçu, malgré eux, leur constitution de l'an 3 (1795), quelque libre qu'elle pût être, ont été réellement assujettis, puisqu’ils n'en voulaient pas. Nous devons conclure de ceci, que les institutions ne peuvent s'améliorer que proportionnellement à l'accroissement des lumières dans la masse du peuple, et que les meilleures absolument, ne sont pas toujours les meilleures relativement; car, plus elles sont bonnes, plus elles sont contraires aux idées fausses; et, si elles en choquent un trop grand nombre, elles ne peuvent se maintenir que par un emploi exagéré de la force. Dès lors plus de liberté, plus de bonheur, plus de stabilité surtout. Cela en servant d'apologie à beaucoup d'institutions mauvaises en elles-mêmes, qui ont pu être convenables dans leur temps, ne doit pas nous les faire conserver. Cela peut aussi nous expliquer le mauvais succès de quelques institutions très-bonnes, et ne nous empêchera pas de les reprendre dans un autre temps.
Une seconde conséquence de l'observation que nous avons faite ci-dessus, c’est que le gouvernement sous lequel on est le plus libre, quelle que soit sa forme, est celui qui gouverne le mieux; car c’est celui où le plus grand nombre est le plus heureux; et, quand on est aussi heureux qu'on peut l'être, les volontés sont accomplies autant qu'il est possible. Si le prince qui exerce le pouvoir le plus despotique, administrait parfaitement, on serait, sous son empire, au comble du bonheur, qui est une seule et même chose avec la liberté. Ce n'est donc pas la forme du gouvernement qui, en elle-même, est une chose importante. Ce serait même une raison assez faible à alléguer en sa faveur, que de dire qu'elle est plus conforme qu'une autre aux vrais principes de la raison, car, en définitif, ce n'est pas de spéculation et de théorie qu’il s'agit dans les affaires de ce monde, mais de pratique et de résultats. C’est là ce qui affecte les individus qui sont des êtres sensibles et positifs, et non pas des êtres idéals et abstraits. Les hommes qui, dans les commotions politiques de nos temps modernes, disent, Je ne m'embarrasse pas d'être libre: la seule chose dont je me soucie, c'est d'être heureux, disent une chose à la fois très-sensée et très-insignifiante: très-sensée, en ce que le bonheur est effectivement la seule chose que l'on doive rechercher; très-insignifiante, en ce qu’il est une seule et même chose avec la vraie liberté. Par la même raison, les enthousiastes qui disent qu'on doit compter pour rien le bonheur quand il s'agit de la liberté, disent une chose doublement absurde; car, si le bonheur pouvait être séparé de la liberté, ce serait sans doute lui qu'il faudrait préférer; mais on n'est pas libre quand on n'est pas heureux; car certainement ce n'est pas faire sa volonté que de souffrir. Ainsi la seule chose qui rende une organisation sociale préférable à une autre, c’est qu'elle soit plus propre à rendre heureux les membres de la société: et, si l'on désire, en général, qu’elle leur laisse beaucoup de facilité pour manifester leur volonté, c’est qu'alors il est plus vraisemblable qu’ils seront gouvernés à leur gré. Cherchons donc, avec Montesquieu, quelles sont les conditions principales qu’elle doit remplir pour atteindre ce but: et, comme lui, ne nous occupons de cette question que d'une manière générale, et sans égard pour aucune localité, ni pour aucune conjoncture particulière.
Ce philosophe justement célèbre a remarqué d'abord, que toutes les fonctions publiques peuvent être considérées comme se réduisant à trois principales: celle de faire les lois; celle de conduire, suivant le vœu de ces lois, les affaires tant intérieures qu’extérieures; et celle de statuer, non-seulement sur les différens des particuliers, mais encore sur les accusations intentées contre les délits privés ou publics; c'est-à-dire, en trois mots, que toute la marche de la société se réduit à vouloir, à exécuter, et à juger.
Ensuite il s’est aisément aperçu que ces trois grandes fonctions, et même deux d’entr’elles, ne pouvaient jamais se trouver réunies dans les mêmes mains sans le plus grand danger pour la liberté du reste des citoyens; car, si un seul homme ou un seul corps était, en même temps, chargé de vouloir et d’exécuter, il serait certainement trop puissant pour que personne puisse le juger, ni par conséquent le réprimer. Si seulement celui qui fait les lois rendait les jugemens, il serait vraisemblablement bientôt le maître de celui qui les exécute; et si enfin celui-ci, toujours le plus redoutable de tous dans le fait, parce qu’il dispose de la force physique, y joignait encore la fonction de juger, il saurait bien faire en sorte que le législateur ne lui donnàt que les lois qu’il voudrait recevoir.
Ces dangers ne sont que trop réels et trop manifestes; il n'y a pas de mérite à les voir. La grande difficulté est de trouver les moyens de les éviter. Montesquieu s’est épargné la peine de chercher ces moyens. Il a mieux aimé se persuader qu’ils étaient trouvés. Il blâme même Harrington de s’en être occupé. On peut dire de lui, dit-il, qu’il n’a cherche la liberté qu'après l'avoir méconnue, et qu’il a bâti Chalcédoine ayant le rivage de Bysance devant les yeux. Il est tellement convaincu que le problème est pleinement résolu, qu'il dit ailleurs: Pour découvrir la liberté politique dans la constitution, il ne faut pas tant de peine: si on peut la voir où elle est, SI ON L'A TROUVÉE, pourquoi la chercher? et tout de suite il explique tout le mécanisme du gouvernement anglais, tel qu’il le conçoit dans son admiration. Il est vrai qu’à l'époque où il écrivait, l'Angleterre était extrêmement florissante et glorieuse, et que son gouvernement était, de tous ceux connus jusqu’alors, celui qui produisait ou paraissait produire les plus heureux résultats sous tous les rapports. Cependant ces succès, en partie réels, en partie apparens, en partie effets de causes étrangères, ne devaient pas faire illusion à une aussi forte tête, au point de lui masquer les défauts de la théorie de ce gouvernement, et de lui faire accroire qu’elle ne laissait absolument rien à désirer.
Cette prévention en faveur des institutions et des idées anglaises lui fait oublier d'abord que les fonctions législatives, exécutives et judiciaires, ne sont que des fonctions déléguées qui peuvent bien donner du pouvoir ou du crédit à ceux à qui elles sont confiées, mais qui ne sont pas des puissances existantes par elles-mêmes. ll n'y a en droit qu’une puissance, la volonté nationale; et en fait il n’y en a pas d'autre que l'homme ou le corps chargé des fonctions exécutives, lequel, disposant nécessairement de l'argent et des troupes, a en main toute la force physique. Montesquieu ne nie pas cela, mais il n'y songe pas. Il ne voit que ses trois prétendus pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Il les considère toujours comme des puissances indépendantes et rivales, qu’il ne s'agit que de concilier et de limiter les unes par les autres, pour que tout aille bien, sans faire entrer du tout en ligne de compte la puissance nationale.
Ne faisant point attention que la puissance exécutive est la seule réelle de fait et qu’elle emporte toutes les autres, il approuve, sans discussion, qu’elle soit confiée à un seul homme, même héréditairement dans sa famille, et cela, par l'unique raison qu’un homme seul est plus propre à l'action que plusieurs. Quand il en serait ainsi, il aurait été bon d'examiner s’il n'y est pas tellement propre, que bientôt il ne laisse plus aucune autre action libre autour de lui, et si d'ailleurs cet homme choisi par le hasard a toujours suffisamment les qualités nécessaires à la délibération qui doit précéder toute action.
Il approuve aussi que la puissance législative soit confiée à des représentans temporaires, librement élus par la nation dans toutes les parties de l'empire. Mais ce qui est plus extraordinaire, il approuve qu’il existe, dans le sein de cette nation, un corps de privilégiés héréditaires, et que ces privilégiés composent, à eux seuls et de droit, une section du corps législatif distincte et séparée de celle qui représente la nation, et ayant le droit d'empêcher par son veto l'effet des résolutions de celle-ici. La raison qu’il en donne est curieuse. C'est, dit-il, que leurs prérogatives sont odieuses en elles-mêmes, et qu’il faut qu'ils puissent les défendre. On croirait plutôt devoir conclure qu’il faut les abolir.
Il croit de plus que cette seconde section du corps législatif est encore très-utile pour lui confier tout ce qu’il y a de vraiment important dans la puissance judiciaire, le jugement des crimes d'état; par là elle devient, comme il le dit, la puissance réglante, dont la puissance exécutive et la puissance législative ont besoin pour se tempérer réciproquement. Il ne s'aperçoit pas, ce dont pourtant toute l'histoire d'Angleterre fait foi, que la chambre des pairs n'est rien moins qu'une puissance indépendante et réglante, mais seulement un appendice et une avant-garde du pouvoir exécutif dont elle a toujours suivi le sort; et qu'ainsi, en lui donnant un veto et un pouvoir judiciaire, on ne fait autre chose que le donner au parti de la cour, et rendre à peu près impossible la punition des criminels d'état qu’il favorise.
Malgré ces avantages, et malgré les forces réelles dont dispose la puissance exécutive, il croit nécessaire qu'elle possède encore le droit d'apposer son veto sur les résolutions, même unanimes, des deux sections du corps législatif, et qu'elle puisse le convoquer, le proroger, et le dissoudre: et il pense que la partie populaire de ce corps trouve suffisamment de quoi se défendre dans la précaution de ne jamais voter les impôts que pour un an, comme s'il ne fallait pas toujours les renouveler chaque année, sous peine de voir la société se dissoudre; et dans l'attention a ne souffrir ni camps, ni casernes, ni places fortes, comme si on ne pouvait pas à chaque instant l'y obliger en en faisant naître la nécessité.
Montesquieu termine ce long exposé par cette phrase aussi embarrassée qu’embarrassante: Voici donc la constitution fondamentale du gouvernement dont nous parlons. Le corps législatif étant composé de deux parties, l’une enchaînera l’autre, par sa faculté mutuelle d'empêcher. Toutes les deux seront liées par la puissance exécutrice, qui le sera elle-même par la législative. A quoi il ajoute cette singulière réflexion: Ces trois puissances devraient former un repos ou une inaction. Mais, comme par le mouvement nécessaire des choses, elles sont contraintes d’aller, elles seront forcées d’aller de concert. J'avoue que je ne sens pas du tout la nécessité de cette conclusion. Il me parait au contraire très-manifeste que rien ne pourrait aller, si tout était réellement enchevêtré comme on le dit, si le roi n'était pas effectivement le maître du parlement, et s’il n'était pas inévitable qu’il le mène comme il a toujours fait, ou par la crainte ou par la corruption. A la vérité, je ne trouve rien dans tout ce fragile échafaudage qui l'en empêche. Aussi je ne vois en faveur de cette organisation, à mon avis très-imparfaite, qu’une seule chose dont on ne parle pas. C’est la ferme volonté de la nation qui entend qu’elle subsiste; et, comme en même temps, elle a la sagesse d'être extrêmement attachée au maintien de la liberté individuelle et de la liberté de la presse, elle conserve toujours la facilité de faire connaître hautement l'opinion publique; en sorte que, quand le roi abuse trop du pouvoir dont il est réellement en possession, il est bientôt renversé par un mouvement général qui se fait en faveur de ceux qui lui résistent, comme cela est arrivé deux fois dans le dix-septième siècle, et comme cela est toujours assez aisé dans une île, où il n'existe jamais de raison pour avoir sur pied une armée de terre, bien forte. C'est là le seul véritable veto auprès duquel tous les autres ne sont rien. Le grand point de la constitution de l'Angleterre est que la nation a déposé six ou sept fois son roi. Mais, il faut en convenir, ce n'est pas là un expédient constitutionnel. C’est bien plutôt l'insurrection ordonnée par la nécessité, comme elle l'était autrefois, dit-on, par les lois de la Crète, disposition législative, dont, à mon grand étonnement, Montesquieu fait l'éloge dans un autre endroit de son livre. Malgré cet éloge, il est certain que ce remède est si cruel qu’un peuple un peu sensé endure bien des maux avant d'y avoir recours, et il peut même arriver qu’il diffère assez de s’y déterminer, pour que, si les usurpations du pouvoir sont conduites avec adresse, il prenne insensiblement les habitudes de l'assujettissement, au point de n'avoir plus ni le désir, ni la capacité de s’en affranchir par un pareil moyen.
Une chose "qui caractérise bien la vive imagination de Montesquieu, c’est que, sur la foi de trois lignes de Tacite, qui exigeraient de grands commentaires, il croit avoir trouvé chez les sauvages de l'ancienne Germanie, le modèle et tout l'esprit de ce gouvernement, qu’il regarde comme le chef-d'oeuvre de la raison humaine. Dans l'excès de son admiration, il s’écrie: Ce beau système u été trouvé dans les bois! et, un moment après, il ajoute: Ce n’est point à moi d'examiner si les Anglais jouissent actuellement de la liberté, ou non: il me suffit de dire qu’elle est établie PAR LEURS LOIS, et je n’en cherche pas davantage.
Je crois pourtant que le premier point méritait bien d'être examiné par lui, ne fût-ce que pour s'assurer qu’il avait bien vu le second; et, s’il avait cherché davantage dans leurs lois, il aurait trouvé que, chez les Anglais, il n'existe réellement que deux puissances au lieu de trois; que ces deux puissances ne subsistent en présence l'une de l'autre, que parce que l'une jouit de toute la force réelle et n'a presque aucune faveur publique, tandis que l'autre n'a aucune force et jouit de toute la faveur, jusqu'au moment où elle voudrait renverser sa rivale, et quelque-fois y compris ce moment; que de plus, ces deux puissances, en se réunissant, sont également maîtresses de changer toutes les lois établies, même celles qui déterminent leur existence et leurs relations, car aucun statut ne le leur défend, et elles l'ont fait plusieurs fois; que, par conséquent, la liberté n’est véritablement pas établie par les lois politiques; et que, si les Anglais en jouissent à un certain degré, cela vient des causes que j'ai expliquées, qui tiennent plus aux lois civiles et criminelles qu'aux autres, ou qui même sont tout-à-fait hors de la loi.
Je crois donc que le grand problème qui consiste à distribuer les pouvoirs de la société, de manière qu'aucun d'eux ne puisse franchir les limites que lui prescrit l’intérêt général, et qu’il soit toujours facile de l'y retenir ou de l'y ramener par des moyens paisibles et légaux, n'est pas résolu dans ce pays. Je réclamerais plutôt cet honneur pour nos États-Unis de l'Amérique, dont les constitutions déterminent ce qui doit arriver, quand le corps exécutif ou le corps législatif, ou tous les deux ensemble, outre-passent leurs pouvoirs, ou sont en opposition, et quand on éprouve la nécessité de faire des changemens à l'acte constitutionnel soit d'un état, soit de toute la fédération. Mais on m’objecterait qu’en fait de pareils règlemens, la grande difficulté c’est leur exécution: que, nous autres Américains, nous en trouvons la garantie, lorsqu’il s'agit des autorités d'un état en particulier, dans la force des autorités supérieures de la fédération; et que, lorsqu’il s'agit de celles-ci, cette garantie se trouve dans la réunion de la majorité des états fédérés; qu'ainsi nous avons éludé la difficulté plutôt que nous ne l'avons résolue, ou que, du moins, nous ne l'avons résolue qu'à l'aide du système fédératif, et qu’il reste à savoir comment on pourrait y parvenir dans un état un et indivisible. D'ailleurs, un pareil sujet demande à être traité plutôt théoriquement qu'historiquement. Je vais donc essayer d'établir, à priori, les principes d'une constitution vraiment libre, légale et paisible: pour cela, il convient de reprendre les choses d'un peu plus haut.
5.Constant on “Usurpation and Despotism” (1814)↩
[Word Length: 8,610]
Source
Benjamin Constant, De l'esprit de conquête et de l'usurpation, dans leurs rapports avec la civilisation européene. Troisiéme édition, revue et augmentée. (Paris: Le Normant, 1814).
•Introduction, [pp. 1-2]
•Première partie. De l'esprit de conquête.
•CHAPITRE XV. Résultats du système guerrier à l'époque actuelle. [pp. 63-67]
•Seconde partie. De l'usurpation
•CHAPITRE PREMIER. But précis de là Comparaison entre l'Usurpation et là Monarchie. [pp. 68-72]
•CHAPITRE II. Différences entre l Usurpation et la Monarchie. [pp. 73-86]
•CHAPITRE III. D'un rapport sous lequel l'usurpation est plus fâcheuse que le despotisme le plus absolu. [pp. 87-91]
•CHAPITRE IV. Que l'usurpation ne peut subsister à notre époque de la civilisation. [pp. 91-98]
•CHAPITRE XVIII. Causes qui rendent le despotisme particulièrement impossible à notre époque de la civilisation. [pp. 180-84]
•CHAPITRE XIX. Que l'usurpation, ne pouvant se maintenir par le despotisme, puisque le despotisme lui-même ne peut se maintenir aujourd'hui, il n'existe aucune chance de durée pour l'usurpation. [pp. 185-192]
Introduction
Je me propose d'examiner deux fléaux, dans leurs rapports avec l'état présent de l'espèce humaine, et la civilisation actuelle. L'un est l'esprit de conquête, l'autre l'usurpation.
Il y a des choses qui sont possibles à telle époque, et qui ne le sont plus à telle autre. Cette vérité semble triviale: elle est néanmoins souvent méconnue; elle ne l'est jamais sans danger.
Lorsque les hommes qui disposent des destinées de la terre se trompent sur ce qui est possible, c'est un grand mal. L'expérience, alors a loin de les servir, leur nuit et les égare. Ils lisent l'histoire, ils voient ce que l'on a fait précédémment, ils n'examinent point si cela peut se faire encore; ils prennent en main des leviers brisés; leur obstination, ou, si l'on veut, leur génie, procure à leurs efforts un succès éphémère; mais comme ils sont en lutte avec les dispositions, les intérêts, toute l'existence morale de leurs contemporains, ces forces de résistance réagissent contre eux; et au bout d'un certain temps, bien long pour leurs victimes, très-court quand on le considère historiquement, il ne reste de leurs entreprises que les crimes qu'ils ont commis et les souffrances qu'ils ont causées.
La durée de toute puissance dépend de la proportion qui existe entre son esprit et son époque. Chaque siècle attend, en quelque sorte, un homme qui lui serve de représentant. Quand ce représentant se montre, ou paroît se montrer, toutes les forces du moment se groupent autour de lui; s'il représente fidèlement l'esprit général, le succès est infaillible; s'il dévie, le succès devient douteux; et s'il persisté dans une faussé route, l'assentiment qui constituoit son pouvoir l'abandonné, et le pouvoir s'écroule.
Malheur donc à ceux qui, se croyant invincibles, jettent le gand à l'espèce humaine, et prétendent opérer par elle; car ils n'ont pas d'autre instrument, des bouleversemens qu'elle désapprouve, et des miracles qu'elle ne veut pas.
Première partie. De l'esprit de conquête.
CHAPITRE XV. Résultats du système guerrier à l'époque actuelle. [pp. 63-67]
Les nations commerçantes de l'Europe moderne, industrieuses, civilisées, placées sur un sol assez étendu pour leurs besoins, ayant avec les autres peuples des relations dont l'interruption devient un désastre, n'ont rien à espérer des conquêtes. Une guerre inutile est donc aujourd'hui le plus grand attentat qu'un gouvernement puisse commettre: elle ébranle, sans compensation, toutes les garanties sociales. Elle met en péril tous les genres de liberté, blesse tous les intérêts, trouble toutes les sécurités, pèse sur toutes les fortunes, combine et autorise tous les modes de tyrannie intérieure et extérieure. Elle introduit dans les formes judiciaires «ne rapidité destructive de leur sainteté, comme de leur but: elle tend à représenter tous les hommes que les agens de l'autorité voient avec malveillance, comme des complices de l'ennemi étranger: elle déprave les générations naissantes; elle divise le peuple en deux parts, dont l'une méprise l'autre, et passe volontiers du mépris à l'injustice; elle prépare des destructions futures par des destructions passées; elle achète par les malheurs du présent les malheurs de l'avenir.
Ce sont là des vérités qui ont besoin d'être souvent répétées; car l'autorité, dans son dédain superbe, les traite comme des paradoxes, en les appelant des lieux communs.
Il y a d'ailleurs parmi nous un assez grand nombre d'écrivains, toujours au service du système dominant, vrais lansquenets sauf la bravoure, à qui les désaveux ne coûtent rien, que les absurdités n'arrêtent pas, qui cherchent partout une force dont ils réduisent les volontés en principes, qui reproduisent toutes les doctrines les plus opposées, et qui ont un zèle d'autant plus infatigable qu'il se passe de leur conviction. Ces écrivains ont répété à satiété, quand ils en avoient reçu le signal, que la paix étoit le besoin du Monde; mais ils disent en même temps que la gloire militaire est la première des gloires, et que c'est par l'éclat des armes que la France doit s'illustrer. J'ai peine à m'expliquer comment la gloire militaire s'acquiert autrement que par la guerre, ou comment l'éclat des armes se concilie avec cette paix dont le Monde a besoin. Mais que leur importe? Leur but est de rédiger des phrases suivant la direction du jour. Du fond de leur cabinet obscur, ils vantent, tantôt la démagogie, tantôt le despotisme, tantôt le carnage, lançant, pour autant qu'il est en eux, tous les fléaux sur l'humanité, et prêchant le mal, faute de pouvoir le faire.
Je me suis demandé quelquefois ce que répondrait l'un de ces hommes qui veulent renouveler Cambyse, Alexandre ou Attila, si son peuple prenoit la parole, et s'il lui disoit: La nature vous a donné un coup d'œil rapide, une activité infatigable, un besoin dévorant d'émotions fortes, une soif inextinguible de braver le danger pour le surmonter, et de rencontrer des obstacles pour les vaincre. Mais est-ce à nous à payer le prix de ces facultés? n'existons-nous, que pour qu'à nos dépens elles soient exercées? Ne sommes-nous là, que pour vous frayer de nos corps expirans une route vers la renommée! Vous avez le génie des combats: que nous fait votre génie? Vous vous ennuyez dans le désœuvrement de la paix: que nous importe votre ennui? Le léopard aussi, si on le transportait dans nos cités populeuses, pourroit se plaindre de n'y pas trouver ces forêts épaisses, ces plaines immenses, où il se délectoit à poursuivre, à saisir et à dévorer sa proie, où sa vigueur se déployoit dans la course rapide et dans l'élan prodigieux. Vous êtes comme lui d'un autre climat, d'une autre terre, d'une autre que nous. Apprenez la civilisation, si vous voulez régner à une époque civilisée. Apprenez la paix, si vous prétendez régir des peuples pacifiques: ou cherchez ailleurs des instrumens qui vous ressemblent, pour qui le repos ne soit rien, pour qui la vie n'ait de charmes que lorsqu'ils la risquent au sein de la mêlée, pour qui la société n'ait créé ni les affections douces, ni les habitudes stables, ni les arts ingénieux, ni la pensée calme et profonde, ni toutes ces jouissances nobles ou élégantes, que le souvenir rend plus précieuses, et que double la sécurité. Ces choses sont l'héritage de nos pères, c'est notre patrimoine. Homme d'un autre monde, cessez d'en dépouiller celui-ci.
Qui pourroit ne pas applaudir à ce langage? Le traité ne tarderoit pas à être conclu entre des nations qui ne voudroient qu'être libres, et celle, que l'univers ne combattroit que pour la contraindre à être juste. On la verroit avec joie, abjurer enfin sa longue patience, réparer ses longues erreurs, exercer pour sa réhabilitation un courage naguères trop déplorablement employé. Elle se replaceroit, brillante de gloire, parmi les peuples civilisés, et le système des conquêtes, ce fragment d'un état de choses qui n'existe plus, cet élément désorganisateur de tout ce qui existe, seroit de nouveau banni de la terre, et flétri, par cette dernière expérience, d'une éternelle réprobation.
Seconde partie. De l'usurpation
CHAPITRE PREMIER. But précis de là Comparaison entre l'Usurpation et là Monarchie. [pp. 68-72]
Mon but n'est nullement, dans cet ouvrage, de me livrer à l'examen des diverses formes de gouvernement.
Je veux opposer un gouvernement régulier à ce qui n'en est pas un, mais non comparer les gouvernemens réguliers entre eux. Nous n'en sommes plus aux temps où l'on déclaroit la monarchie un pouvoir contre nature; et je n'écris pas non plus dans le pays où il est ordonné de proclamer que la république est une institution anti-sociale.
Il y a vingt ans qu'un homme, d'horrible mémoire, dont le nom ne doit plus souiller aucun écrit, puisque la mort a fait justice de sa personne, disoit, en examinant la constitution anglaise: J'y vois un roi, je recule d'horreur. Il y a dix ans qu'un anonyme prononçoit le même anathème contre les gouvernemens républicains, tant il est vrai, qu'à de certaines époques, il faut parcourir tout le cercle des folies, pour revenir à la raison.16
Quant à moi, je ne me réunirai point aux détracteurs des républiques. Celles de l'antiquité, où les facultés de l'homme se développoient dans un champ si vaste, tellement fortes de leurs propres forces, avec un tel sentiment d'énergie et de dignité, remplissent toutes les âmes qui ont quelque valeur d'une émotion d'un genre profond et particulier. Les vieux élémens d'une nature antérieure, pour ainsi dire, à la nôtre, semblent se réveiller en nous à ces souvenirs. Les républiques de nos temps modernes, moins brillantes et plus paisibles, ont favorisé d'autres développemens de facultés et créé d'autres vertus. Le nom de la Suisse rappelle cinq siècles de bonheur privé et de loyauté publique. Le nom de la Hollande en retrace trois d'activité, de bon sens, de fidélité, et d'une probité scrupuleuse, jusqu'au milieu des dissensions civiles, et même sous le joug de l'étranger: et l'imperceptible Genève a fourni aux annales des sciences, de la philosophie et de la morale, une moisson plus ample que bien des Empires cent fois plus vastes et plus puissans.
D'une autre part, en considérant les monarchies de nos jours, ces monarchies, où maintenant les peuples et les rois sont réunis par une confiance réciproque, et ont contracté une sincère alliance, on doit se plaire à leur rendre hommage. Celui-là seroit bien peu fait pour apprécier la nature humaine, qui auroit pu contempler froidement les transports de ces peuple au retour de leurs anciens chefs, et qui resteroit insensible témoin de cette passion de loyauté, qui est aussi pour l'homme une noble jouissance.
Enfin, lorsqu'on réfléchit que l'Angleterre est une monarchie, et que l'on y voit tous les droits des citoyens hors d'atteinte, l'élection populaire maintenant la vie dans le corps politique, malgré quelques abus plus apparens que réels, la liberté de la presse respectée, le talent assuré de son triomphe, et, dans les individus de toutes les classes, cette sécurité fière et calme de l'homme environné de la loi de sa patrie, sécurité dont naguères, dans notre continent misérable, nous avions perdu jusqu'au dernier souvenir, comment ne pas rendre justice à des institutions qui garantissent un pareil bonheur? Il y a quelques mois que chacun, regardant autour de soi, se demandoit dans quel asile obscur, si l'Angleterre étoit subjuguée, il pourroit écrire, parler, penser, respirer.
Mais l'usurpation ne présente aux peuples ni les avantages d'une monarchie, ni ceux d'une république, l'usurpation n'est point la monarchie: ce qui fait qu'on a méconnu cette vérité, c'est que voyant dans l'une comme dans l'autre, un seul homme dépositaire de la puissance, l'on n'a pas suffisamment distingué deux choses qui ne se ressemblent que sous ce rapport.
CHAPITRE II. Différences entre l Usurpation et la Monarchie. [pp. 73-86]
L'habitude qui veille au fond de tous les cœurs
Les frappe de respect, les poursuit de terreurs,
Et sur la foule aveugle un instant égarée,
Exerce une puissance invisible et sacrée,
Heritage des temps, culte du souvenir,
Qui toujours au passé ramène l'avenir.
Wallstein, act. II, se. 4.
[Greek words illegible]
Eschyle, Prometh.
La monarchie, telle qu'elle existe dans la plupart des états européens, est une institution modifiée par le temps, adoucie par l'habitude. Elle est entourée de corps intermédiaires qui la soutiennent à la fois et la limitent: et sa transmission régulière et paisible rend la soumission plus facile et la puissance moins ombrageuse. Le monarque est en quelque sorte un être abstrait. On voit en lui non pas un individu, mais une race entière de rois, une tradition de plusieurs siècles.
L'usurpation est une force qui n'est modifiée ni adoucie par rien. Elle est nécessairement empreinte de l'individualité de l'usurpateur, et cette individualité, par l'opposition qui existe entre elle et tous les intérêts antérieurs, doit être dans un état perpétuel de défiance et d'hostilité.
La monarchie n'est point une préférence accordée à un homme aux dépens des autres; c'est une suprématie consacrée d'avance: elle décourage les ambitions, mais n'offense point les vanités. L'usurpation exige de la part de tous une abdication immédiate, en faveur d'un seul: elle soulève toutes les prétentions: elle met en fermentation tous les amours-propres. Lorsque le mot de Pédarète porte sur trois cents hommes, il est moins difficile à prononcer, que lorsqu'il porte sur un seul.17
Ce n'est pas tout de se déclarer monarque héréditaire. Ce qui constitue tel, ce n'est pas le trône qu'on veut transmettre, mais le trône qu'on a hérité. On n'est monarque héréditaire qu'après la seconde génération. Jusques alors, l'usurpation peut bien s'intituler monarchie: mais elle conserve l'agitation des révolutions qui l'ont fondée: ces prétendues dynasties nouvelles sont aussi orageuses que les factions, ou aussi oppressives que la tyrannie. C'est l'anarchie de Pologne, ou le despotisme de Constantinople. Souvent c'est tous les deux.
Un monarque, montant sur le trône que ses ancêtres ont occupé, suit une route dans laquelle il ne s'est point lancé par sa volonté propre, il n'a point sa réputation à faire: il est seul de son espèce: on ne le compare à personne. Un usurpateur est exposé à toutes les comparaisons que suggèrent les regrets, les jalousies ou les espérances; il est obligé de justifier son élévation: il a contracté l'engagement tacite d'attacher de grands résultats à une si grande fortune: il doit craindre de tromper l'attente du public, qu'il a si puissamment éveillée. L'inaction la plus raisonnable, la mieux motivée lui devient un danger. Il faut donner aux Français tous les trois mois, disoit un homme qui s'y entend bien, quelque chose de nouveau: il a tenu parole.
Or, c'est sans doute un avantage que d'être propre à de grandes choses, quand le bien général l'exige: mais c'est un mal, que d'être condamné à de grandes choses, pour sa considération personnelle, quand le bien général ne l'exige pas. L'on a beaucoup déclamé contre les rois fainéans. Dieu nous rende leur fainéantise, plutôt que l'activité d'un usurpateur!
Aux inconvéniens de la position, joignez les vices du caractère: car il y en a que l'usurpation implique, et il y en a encore que l'usurpation produit.
Que de ruses, que de violences, que de parjures elle nécessite! Comme il faut invoquer des principes qu'on se prépare à fouler aux pieds, prendre desengagement que l'on veut enfreindre, se jouer de la bonne foi des uns, profiter de la foiblesse des autres, éveiller l'avidité là où elle sommeille, enhardir l'injustice là où elle se cache, la dépravation là où elle est timide, mettre, en un mot, toutes les passions coupables comme en serre-chaude, pour que la maturité soit plus rapide, et que la moisson soit plus abondante!
Un monarque arrive noblement au trône: un usurpateur s'y glisse à travers la boue et le sang; et quand il y prend place, sa robe tachée porte l'empreinte de la carrière qu'il a parcourue.
Croit-on que le succès viendra, de sa baguette magique, le purifier du passé? Tout au contraire, il ne seroit pas corrompu d'avance, que le succès suffiroit pour le corrompre.
L'éducation des princes, qui peut être défectueuse sous bien des rapports, a cet avantage, qu'elle les prépare, sinon toujours à remplir dignement les fonctions du rang suprême, du moins à n'être pas ébloui de son éclat. Le fils d'un roi, parvenant au pouvoir, n'est point transporté dans une sphère nouvelle. Il jouit avec calme de ce qu'il a, depuis sa naissance, considéré comme son partage. La hauteur à laquelle il est placé ne lui cause point de vertiges. Mais la tête d'un usurpateur n'est jamais assez forte, pour supporter: cette élévation subite. Sa raison ne peut résister à un tel changement de toute son existence. L'on a remarqué, que les particuliers mêmes, qui se trouvoient soudain, investis d'une extrême richesse,, concevoient des desirs, des caprices et des fantaisies désordonnées. Le superflu de leur opulence; les enivre, parce que l'opulence est une force ainsi que le pouvoir. Comment n'en seroit-il pas de même de celui qui s'est emparé illégalement de toutes les forces, et approprié illégalement tous les trésors? Illégalement, dis-je, car il y a quelque chose de miraculeux dans la conscience de la légitimité. Notre siècle fertil en expériences de tout genre, nous en fournit, une preuve remarquable. Voyez ces deux hommes, l'un que le voeu d'un peuple et l'adoptioin d'un roi prit appelé au trône, l'autre qui s'y est lancé, appuyé seulement sur sa volonté propre, et sur l'assentiment, arraché à la terreur. Le premier, confiant et tranquille, a pour allié le passé: il ne craint point la gloire de ses aïeux adoptifs, il la rehausse par sa propre gloire. Le second, inquiet et tourmente, ne croit pas aux droits qu'il s'arroge, bien qu'il force le monde à les reconnoitre. L'illégalité le poursuit comme un fantôme: il se réfugie vainement et dans le faste et dans la victoire. Le spectre l'accompagne, au sein des pompes et sur les champs de bataille. Il promulgue des lois, et il les change: il établit des constitutions, et il les viole: il fonde des empires, et il les renverse: il n'est jamais content de son édifice bâti sur le sable, et dont la base se perd dans l'abime.
Si nous parcourons tous les détails de l'administration extérieure et intérieure, partout nous verrons des différences, au désavantage de l'usurpation, et à l'avantage de la monarchie.
Un roi n'a pas besoin de commander ses armées. D'autres peuvent combattre pour lui, tandis que ses vertus pacifiques le rendent cher et respectable à son peuple. L'usurpateur doit être toujours à la tête de ses prétoriens. Il en seroit le mépris, s'il n'en étoit l'idole.
Ceux qui corrompirent les républiques-grecques, dit Montesquieu, ne devinrent pas toujours tyrans. C'est qu'ils s'étoient plus attachés à l éloquence qu'à l'art militaire.18 Mais dans nos associations nombreuses, l'éloquence est impuissante, l'usurpation n'a d'autre appui que la force armée: pour la fonder, cette force est nécessaire: elle l'est encore pour la conserver.
De là, sous un usurpateur, des guerres sans cesse renouvelées: ce sont des prétextes pour s'entourer de gardes; ce sont des occasions pour façonner ces gardes à l'obéissance; ce sont des moyens d'éblouir les esprits, et de suppléer, par le prestige de la conquête, au prestige de l'antiquité. L'usurpation nous ramène au système guerrier; elle entraîne donc tous les inconvéniens que nous avons rencontrés dans ce système.
La gloire d'un monarque légitime s'accroît des gloires environnantes. Il gagne à la considération dont il entoure ses ministres. Il n'a nulle concurrence à redouter. L'usurpateur, pareil naguères, ou même inférieur à ses instrumens, est obligé de les avilir, pour qu'ils ne deviennent pas rivaux. Il les froisse, pour les employer. Aussi, regardez-y de près, toutes les âmes fières s'éloignent: et quand les âmes fières s'éloignent, que reste-t-il? Des hommes, qui savent ramper, mais ne sauraient défendre, des hommes; qui insulteroient les premiers, après sa chute, le maître «qu'ils auroient flatté.
Ceci fait que l'usurpation est plus dispendieuse que la monarchie. Il faut d'abord payer les agens pour qu'ils se laissent dégrader: il faut ensuite payer encore ces agens dégradés, pour qu'ils se rendent utiles. L'argent doit faire le service et de l'opinion et de l'honneur. Mais ces agens, tout corrompus et tout zélés qu'ils sont, n'ont pas l'habitude du gouvernement. Ni eux, ni leur maître, nouveau comme eux, ne savent tourner les obstacles. A chaque difficulté qu'ils rencontrent, la violence leur est si commode qu'elle leur paroît toujours nécessaire. Ils seroient tyrans par ignorance, s'ils ne l'étoient par intention. Vous voyez les mêmes institutions subsister dans la monarchie durant des siècles. Vous ne voyez pas un usurpateur qui n'ait vingt fois révoqué ses propres lois, et suspendu les formes qu'il venoit d'instituer, comme un ouvrier novice et impatient brise ses outils.
Un monarque héréditaire peut exister à côté, ou pour mieux dire, à la tête d'une noblesse antique et brillante; il est comme elle, riche de souvenirs. Mais là où le monarque voit des soutiens, l'usurpateur voit des ennemis. Toute noblesse, dont l'existence a précédé la sienne, doit lui faire ombrage. Il faut que, pour appuyer sa nouvelle dynastie, il crée une nouvelle noblesse.19
Il y a confusion d'idées dans ceux qui parlent des avantages d'une hérédité déjà reconnue pour en conclure la possibilité de créer l'hérédité. La noblesse engage, envers un homme et ses descendans, le respect des générations, non-seulement futures, mais contemporaines. Or, ce dernier point est le plus difficile. On peut bien admettre un traité pareil, lorsqu'en naissant on le trouve sanctionné; mais assister au contrat, et s'y résigner, est impossible, si l'on n'est la partie avantagée.
L'hérédité s'introduit dans des siècles de simplicité ou de conquête; maison ne l'institue pas au milieu de la civilisation. Elle peut alors se conserver, mais non s'établir. Toutes les institutions qui tiennent du prestige ne sont jamais l'effet de la volonté: elles sont l'ouvrage des circonstances. Tous les terrains sont propres aux alignemens géométriques. La nature seule produit les sites et les effets pittoresques. Une hérédité, qu'on voudroit édifier sans qu'elle reposât sur aucune tradition respectable et presque mystérieuse, ne domineroit point l'imagination.. Les passions ne seroient pas désarmées; elles s'irriteroient au contraire davantage contre une inégalité subitement érigée en leur présence et à leurs dépens. Lorsque CROMWELL voulut instituer une chambre haute, il y eut révolte générale dans l'opinion d'Angleterre. Les anciens pairs refusèrent d'en faire partie, et la nation refusa de son côté de reconnoître comme pairs ceux qui se rendirent à l'invitation.20
On crée néanmoins de nouveaux nobles, objectera-t-on. C'est que l'illustration de l'ordre entier rejaillit sur eux. Mais si vous créez à la fois le corps et les membres, où sera la source de l'illustration?
Des raisonnemens du même genre se reproduisent relativement à ces assemblées, qui, dans quelques monarchies, défendent ou représentent le peuple. Le roi d'Angleterre est vénérable au milieu de son parlement; mais c'est qu'il n'est pas, nous le répétons, un simple individu; il représente aussi la longue suite des rois qui l'ont précédé; il n'est pas éclipsé par les mandataires de la nation; mais un seul homme, sorti de la foule, est d'une stature trop diminutive, et, pour soutenir le parallèle, il faut que cette stature devienne terrible. Les représentans d'un peuple, sous un usurpateur, doivent être ses esclaves, pour n'être passes maîtres. Or, de tous les fléaux politiques, le plus effroyable est une assemblée qui n'est que l'instrument d'un seul homme. Nul n'oseroit vouloir en son nom ce qu'il ordonne à ses agens de vouloir, lorsqu'ils se disent les interprètes libres du vœu national. Songez au sénat de Tibère, songez au parlement d'HENRI VIII.
Ce que j'ai dit de la noblesse s'applique également à la propriété. Les anciens propriétaires sont les appuis naturels d'un monarque légitime; ils-sont les ennemis nés d'un usurpateur. Or, je pense qu'il est reconnu que, pour qu'un gouvernement soit paisible, la puissance et la propriété doivent être d'accord. Si vous les séparez, il y aura lutte, et à la fin de cette lutte, ou la propriété sera envahie, ou le gouvernement sera renversé.
Il paroît plus facile, à la vérité, de créer de nouveaux propriétaires que de nouveaux nobles; mais il s'en faut qu'enrichir des hommes devenus puissans soit la même chose qu'investir du pouvoir des hommes qui étoient nés riches. La richesse n'a point un effet rétroactif. Conférée tout à coup à quelques individus, elle ne leur donne ni cette sécurité sur leur situation, ni cette absence d'intérêts étroits, ni cette éducation soignée, qui forment ses principaux avantages. On ne prend pas l'esprit propriétaire, aussi lestement qu'on prend la propriété. A Dieu ne plaise que je veuille insinuer ici que la richesse doit constituer un privilège! Toutes les facultés naturelles, comme tous les avantages sociaux, trouver leur place dans l'organisation politique, et le talent n'est certes pas un moindre trésor que l'opulence. Mais, dans une société bien organisée, le talent conduit à la propriété. Le corps des anciens propriétaires se recrute ainsi de nouveaux membres, et c'est la seule manière dont un changement progressif, imperceptible et toujours partiel, doive s'opérer. L'acquisition lente et graduelle d'une propriété légitime est autre chose que la conquête violente d'une propriété qu'on enlève. L'homme qui s'enrichit par son industrie ou ses facultés apprend à mériter ce qu'il acquiert: celui qu'enrichit la spoliation ne devient que plus indigne de ce qu'il ravit.
Plus d'une fois, durant nos troubles, nos maîtres d'un jour, qui nous entendoient regretter le gouvernement des propriétaires ont eu la tentation de devenir propriétaires pour se rendre plus dignes de gouverner; mais quand ils se seroient investis en quelques heures de propriétés, considérables, par une volonté qu'ils auroient appelée loi, le peuple et eux-mêmes auroient pensé que ce que la loi avoit conféré, la loi pouvoit le reprendre; et la propriété, au lieu de protéger l'institution, auroit eu continuellement besoin d'être protégée par elle. En richesse, comme en autre chose, rien ne supplée au temps.
D'ailleurs, pour enrichir les uns, il faut appauvrir les autres; pour créer de nouveaux propriétaires, il faut dépouiller les anciens. L'usurpation générale doit s'entourer d'usurpations partielles, comme d'ouvrages avancés qui la défendent. Pour un intérêt qu'elle se concilie, dix s'arment contre elle.
Ainsi donc, malgré la ressemblance trompeuse qui paroît exister entre l'usurpation et la monarchie, considérées toutes deux comme le pouvoir remis à un seul homme, rien n'est plus différent. Tout ce qui fortifie la seconde, menace la première; tout ce qui est dans la monarchie, une cause d'union, d'harmonie et de repos, est dans l'usurpation une cause de résistance, de, haine et de secousses.
Ces raisonnemens ne militent pas avec moins de force pour les républiques, quand elles ont existé long-temps. Alors elles acquièrent, comme les monarchies, un héritage de traditions, d'usages et d'habitudes. L'usurpation seule, nue et dépouillée de toutes ces choses, erre au hasard, le glaive en main, cherchant de tous côtés, pour couvrir sa honte, des lambeaux qu'elle déchire et qu'elle ensanglante en les arrachant.
CHAPITRE III. D'un rapport sous lequel l'usurpation est plus fâcheuse que le despotisme le plus absolu. [pp. 87-91]
Je ne suis point assurément le partisan du despotisme; mais s'il falloit choisir entre l'usurpation et un despotisme consolidé, je ne sais si ce dernier ne me sembleroit pas préférable.
Le despotisme bannit toutes les formes de la liberté; l'usurpation, pour motiver le renversement de ce qu'elle remplace, a besoin de ces formes; mais en s'en emparant, elle le profane. L'existence de l'esprit public lui étant dangereuse, et l'apparence de l'esprit public lui étant nécessaire, elle frappe d'une main le peuple pour étouffer l'opinion réelle, et elle le frappe encore de l'autre pour le contraindre au simulacre de l'opinion supposée.
Quand le Grand Seigneur envoie le cordon à l'un des ministres disgraciés, les bourreaux sont muets comme la victime; quand un usurpateur proscrit l'innocence, il ordonne la calomnie, pour que, répétée, elle paroisse un jugement national: le despote interdit la discussion, et n'exige que l'obéissance; l'usurpateur prescrit un examen dérisoire, comme préface de l'approbation.
Cette contrefaction de la liberté réunit tous les maux de l'anarchie et tous ceux de l'esclavage. Il n'y a point de terme à la tyrannie qui veut arracher les symptômes du consentement. Les hommes paisibles sont persécutés comme indifférons, les hommes énergiques comme dangereux; la servitude est sans repos, l'agitation sans jouissance: cette agitation ne ressemble à la vie morale que comme ressemblent à la vie physique ces convulsions hideuses qu'un art plus effrayant qu'utile imprime aux cadavres sans les ranimer.
C'est l'usurpation qui a inventé ces prétendues sanctions, ces adresses, ces félicitations monotones, tribut habituel qu'à toutes les époques, les mêmes hommes prodiguent, presque dans les mêmes mots, aux mesures les plus opposées: la peur y vient singer tous les dehors du courage pour se féliciter de la honte et pour remercier du malheur. Singulier genre d'artifice dont nul n'est la dupe! comédie convenue qui n'en impose à personne, et qui, depuis longtemps, auroit dû succomber sous les traits du ridicule! Mais le ridicule attaque tout, et ne détruit rien. Chacun pense avoir reconquis, par la moquerie, l'honneur de l'indépendance, et, content d'avoir désavoué ses actions par ses paroles, se trouve à l'aise pour démentir ses paroles par ses actions.
Qui ne sent que plus un gouvernement est oppressif, plus les citoyens épouvantés s'empresseront de lui faire hommage de leur enthousiasme de commande! Ne voyez-vous pas, à côté des registres que chacun signe d'une main tremblante, ces délateurs et ces soldats? ne lisez-vous pas ces proclamations déclarant factieux ou rebelles ceux dont le suffrage seroit négatif? qu'est-ce qu'interroger un peuple au milieu des cachots et sous l'empire de l'arbitraire, sinon demander aux adversaires de la puissance une liste pour les reconnoitre et pour les frapper à loisir?
L'usurpateur, cependant, enregistre ces acclamations et ces harangues: l'avenir le jugera sur ces monumens érigés par lui. Où le peuple fut tellement vil, dira-t-on, le gouvernement dut être tyrannique. Rome ne se prosternoit pas devant Marc-Aurèle, mais devant Tibère et Caracalla.
Le despotisme étouffe la liberté de la presse, l'usurpation la parodie. Or, quand la liberté de la presse est tout-à-fait comprimée, l'opinion sommeille, mais rien ne l'égare; quand au contraire des écrivains soudoyés s'en saisissent, ils discutent, comme s'il étoit question de convaincre, ils s'emportent, comme s'il y avoit de l'opposition, ils insultent, comme si l'on possédoit la faculté de répondre; leurs diffamations absurdes précèdent des condamnations barbares; leurs plaisanteries féroces préludent à d'illégales condamnations; leurs démonstrations nous feroient croire que leurs victimes résistent, comme en voyant de loin les danses frénétiques des sauvages autour des captifs qu'ils tourmentent: on diroit qu'ils combattent les malheureux qu'ils vont dévorer.
Le despotisme, en un mot, règne par le silence, et laisse à l'homme le droit de se taire; l'usurpation le condamne à parler, elle le poursuit dans le sanctuaire intime de sa pensée, et, le forçant à mentir à sa conscience, elle lui ravit la dernière consolation qui reste encore à l'opprimé.
Quand un peuple n'est qu'esclave, sans être avili, il y a pour lui possibilité d'un meilleur état de choses; si quelque circonstance heureuse le lui présente, il s'en montre digne: le despotisme laisse cette chance à l'espèce humaine. Le joug de Philippe II et les échafauds du duc d'Albe ne dégradèrent point les généreux Hollandais; mais l'usurpation avilit un peuple en même temps qu'elle l'opprime; elle l'accoutume à fouler aux pieds ce qu'il respectoit, à courtiser ce qu'il méprise, à se mépriser lui-même, et, pour peu qu'elle se prolonge, elle rend même, après sa chute, toute liberté, toute amélioration impossible: on renverse Commode; mais les prétoriens mettent l'empire à l'enchère, et le peuple obéit à l'acheteur.
En pensant aux usurpateurs fameux que l'on nous vante de siècle en siècle, une seule chose me semble admirable, c'est l'admiration qu'on a pour eux. César, et cet Octave qu'on appelle Auguste, sont des modèles en ce genre: ils commencèrent, par la proscription de tout ce qu'il y a voit dominent à Rome; ils poursuivirent, par la dégradation de tout ce qui restoit de noble; ils finirent, par léguer au monde Vitellius, Domitien, Héliogabale, et enfin les Vandales et les Goths.
CHAPITRE IV. Que l'usurpation ne peut subsister à notre époque de la civilisation. [pp. 91-98]
Après ce tableau de l'usurpation, il sera consolant de démontrer qu'elle est aujourd'hui un anachronisme non moins grossier que le système des conquêtes.
Les républiques subsistent de par le sentiment profond que chaque citoyen a de ses droits, de par le bonheur, la raison, le calme et l'énergie que la jouissance de la liberté procure à l'homme; les monarchies, de par le temps, de par les habitudes, de par la sainteté des générations passées. L'usurpation ne peut s'établir que par la suprématie individuelle de l'usurpateur.
Or, il y a des époques, dans l'histoire de l'espèce humaine, où la suprématie, nécessaire pour que l'usurpation soit possible, ne sauroit exister. Tel fut le période qui s'écoula en Grèce, depuis l'expulsion des Pisistratides jusqu'au règne de Philippe de Macédoine; tels furent aussi les cinq premiers siècles de Rome, depuis la chute des Tarquins jusqu'aux guerres civiles.
En Grèce, des individus se distinguent, s'élèvent, dirigent le peuple: leur empire est celui du talent, empire brillant, mais passager, qu'on leur dispute et qu'on leur enlève. Périclès voit plus d'une fois sa domination prête à lui échapper, et ne doit qu'à la contagion qui le frappe de mourir au sein du pouvoir. Miltiade, Aristide, Thémistocle, Alcibiade, saisissent la puissance et la reperdent, presque sans secousses.
A Rome, l'absence de toute suprématie individuelle se fait encore bien plus remarquer. Pendant cinq siècles, on ne peut sortir de la foule immense des grands hommes de la république; le nom d'un seul qui l'ait gouvernée d'une manière durable.
A d'autres époques, au contraire, il semble que le gouvernement des peuples appartienne au premier individu qui se présente. Dix ambitieux, pleins de talens et d'audace, avoient en vain tenté d'asservir la république romaine. II avoit fallu vingt ans de dangers, de travaux et de triomphes à César pour arriver aux marches du trône, et il étoit mort assassiné avant d'y monter. Claude se cache derrière une tapisserie, des soldats l'y découvrent: il est empereur, il règne quatorze ans.
Cette différence ne tient pas uniquement à la lassitude qui s'empare des hommes après des agitations prolongées, elle tient aussi à la marche de la civilisation.
Lorsque l'espèce humaine est encore dans un profond degré d'ignorance et d'abaissement, presque totalement dépourvue de facultés morales, et presque aussi dénuée de connoissances, et par conséquent de moyens physiques, les nations suivent, comme des troupeaux, non-seulement celui qu'une qualité brillante distingue, mais celui qu'un hasard quelconque jette en avant de la foule. A mesure que les lumières font des progrès, la raison révoque en doute la légitimité du hasard, et la réflexion qui compare aperçoit entre les individus une égalité opposée à toute suprématie exclusive.
C'est ce qui faisoit dire à Aristote qu'il n'y avoit guère de son temps de véritable royauté. « Le mérite, continuoit-il, trouve aujourd'hui des pairs, et nul n'a de vertus si supérieures au reste des hommes, qu'il puisse réclamer pour lui seul la prérogative de commander. »21 Ce passage est d'autant plus remarquable que le philosophe de Stagyre l'écrivoit sous Alexandre.
Il fallut peut-être moins de peine et de génie à Cyrus pour asservir les Perses barbares qu'au plus petit tyran d'Italie, dans le seizième siècle, pour conserver le pouvoir qu'il usurpoit. Les conseils mêmes de Machiavel prouvent la difficulté croissante.
Ce n'est pas précisément l'étendue, mais l'égale répartition des lumières, qui met obstacle à la suprématie des individus; et ceci ne contredit en rien ce que nous avons affirmé précédemment, que chaque siècle attendoit un homme qui lui servît de représentant. Ce n'est pas dire que chaque siècle le trouve. Plus la civilisation est avancée, plus elle est difficile à représenter.
La situation de la France et de l'Europe, il y a vingt ans, se rapprochoit, sous ce rapport, de celle de la Grèce et de Rome aux époques indiquées. Il existoit une telle multitude d'hommes également éclairés, que nul individu ne pouvoit tirer de sa supériorité personnelle le droit exclusif de gouverner. Aussi nul, durant les dix premières années de nos troubles, n'a pu se marquer une place à part.
Malheureusement, à chaque époque pareille; un danger menace l'espèce humaine. Comme lorsqu'on verse des flots d'une liqueur froide dans une liqueur bouillante, la chaleur de celle-ci se trouve affoiblie, de même, lorsqu'une nation civilisée est envahie par des barbares, ou qu'une masse ignorante pénètre dans son sein et s'empare de ses destinées, sa marche est arrêtée, et elle, fait des pas rétrogrades.
Pour la Grèce, l'introduction de l'influence macédonienne; pour Rome, l'aggrégation successive des peuples conquis; enfin, pour tout l'empire romain, l'irruption des hordes du nord, furent des événemens de ce genre. La suprématie des individus, et par conséquent l'usurpation, redevinrent possibles. Ce furent presque toujours des légions barbares qui créèrent des empereurs.
En France, les troubles de la révolution ayant introduit dans le gouvernement une classe sans lumières et découragé la classe éclairée, cette nouvelle irruption de barbares a produit le même effet, mais dans un degré bien moins durable, parce que la disproportion étoit moins sensible. L'homme qui a voulu usurper parmi nous, a été forcé de quitter pour un temps les routes civilisées; il est remonté vers des nations plus ignorantes, comme vers un autre siècle: c'est là qu'il a jeté les fondemens de sa prééminence; ne pouvant faire arriver au sein de l'Europe l'ignorance et la barbarie, il a conduit des Européens en Afrique, pour voir s'il réussiroit â les façonner à la barbarie et à l'ignorance; et ensuite, pour maintenir son autorité, il a travaillé à faire reculer l'Europe.
Les peuples se sacrîfioient jadis pour les individus, et s'en faisoient gloire: de nos jours, les individus sont forcés à feindre qu'ils n'agissent que pour l'avantage et le bien des peuples. On les entend quelquefois essayer de parler d'eux-mêmes, des devoirs du monde envers leurs personnes, et ressusciter un style tombé en-désuétude depuis Cambyse et Xerxès. Mais nul ne leur répond dans ce sens, et, désavoués qu'ils sont par le silence de leurs flatteurs mêmes, ils se replient, malgré qu'ils en aient, sur une hypocrisie qui est un hommage à l'égalité.
Si l'on pouvoit parcourir attentivement les rangs obscurs d'un peuple soumis en apparence à l'usurpateur qui l'opprime, on le verroit comme par un instinct confus, fixer les yeux d'avance sur l'instant où cet usurpateur tombera. Son enthousiasme contient un mélange bizarre et d'analyse et de moquerie. Il semble, peu confiant en sa conviction propre, travailler à la fois à s'étourdir par ses acclamations et à se dédommager par ses railleries, et pressentir lui-même l'instant où le prestige sera passé.
Voulez-vous voir à quel point les faits démontrent la double impossibilité des conquêtes et de l'usurpation à l'époque actuelle? Réfléchissez aux événemens qui se sont accumulés sous nos yeux durant les six mois qui viennent de s'écouler. La conquête avoit établi l'usurpation, dans une grande partie de l'Europe; et cette usurpation sanctionnée, reconnue pour légitime par ceux mêmes qui avoient intérêt à ne jamais la reconnoître, avoit revêtu toutes les formes pour se consolider. Elle avoit tantôt menacé, tantôt flatté les peuples: elle étoit parvenue à rassembler des forces immenses pour inspirer la crainte, des sophismes pour éblouir les esprits, des traités pour rassurer les consciences; elle avoit gagné quelques années, qui commençoient à voiler son origine. Les gouvernemens, soit républicains, soit monarchiques, qu'elle avoit détruits, étoient sans espoir apparent, sans ressources visibles; ils survivoient néanmoins dans le cœur des peuples. Vingt batailles perdues n'avoient pu les en déraciner: une seule bataille a été gagnée, et l'usurpation s'est vue de toutes parts mise en fuite; et, dans plusieurs des pays où elle dominoit sans opposition, le voyageur aurait peine aujourd'hui à en découvrir la trace.
CHAPITRE XVIII. Causes qui rendent le despotisme particulièrement impossible à notre époque de la civilisation. [pp. 180-84]
Les raisonnemens qu'on vient de lire sont d'une nature générale, et s'appliquent à tous les peuples civilisés, et à toutes les époques; mais plusieurs autres causes, qui sont particulières à l'état de la civilisation moderne, mettent de nos jours de nouveaux obstacles au despotisme.
Ces causes sont, en grande partie, les mêmes qui ont substitué la tendance pacifique à la tendance guerrière, les mêmes qui ont rendu impossible la transplantation de la liberté des anciens chez les modernes.
L'espèce humaine étant inébranlablement attachée à son repos et à ses jouissances, réagira toujours, individuellement et collectivement, contre toute autorité qui voudra les troubler. De ce que nous sommes, comme je l'ai dit, beaucoup moins passionnés pour la liberté politique que ne l'étoient les anciens, il peut s'ensuivre que nous négligions les garanties qui se trouvent dans les formes; mais de ce que nous tenons beaucoup plus à la liberté individuelle y il s'ensuit aussi, que dès que le fonds sera attaqué, nous le défendrons de tous nos moyens. Or, nous avons pour le défendre des moyens que les anciens n'avoient pas.
J'ai montré que le commerce rend l'action de l'arbitraire sur notre existence plus vexatoire qu'autrefois, parce que nos spéculations étant plus variées, l'arbitraire doit se multiplier pour les atteindre; mais le commerce rend en même temps l'action de l'arbitraire plus facile à éluder, parce qu'il change la nature de la propriété, qui devient par ce changement presqu'insaisissable.
Le commerce donne à la propriété une qualité nouvelle, la circulation: sans circulation, la propriété n'est qu'un usufruit; l'autorité peut toujours influer sur l'usufruit, car elle peut enlever la jouissance; mais la circulation met un obstacle invisible et invincible à cette action du pouvoir social.
Les effets du commerce s'étendent encore plus loin: non-seulement il affranchit les individus, mais, en créant le crédit, il rend l'autorité dépendante.
L'argent, dit un auteur français, est l'arme la plus dangereuse du despotisme: mais il est en même temps son frein le plus puissant; le crédit est soumis à l'opinion; la force est inutile; l'argent se cache ou s'enfuit; toutes les opérations de l'Etat sont suspendues: le crédit n'avoit pas la même influence chez les anciens; leurs gouvernemens étoient plus forts que les particuliers; les particuliers sont plus forts que les pouvoirs politiques de nos jours; la richesse est une puissance plus disponible dans tous les instans, plus applicable à tous les intérêts, et par conséquent bien plus réelle et mieux obéie; le pouvoir menace, la richesse récompense: on échappe au pouvoir en le trompant; pour obtenir les faveurs de la richesse, il faut la servir: celle-ci doit l'emporter.
Par une suite des mêmes causes, l'existence individuelle est moins englobée dans l'existence politique. Les individus transplantent au foin leurs trésors; ils portent avec eux toutes les jouissances de la vie privée; le commerce a rapproché les nations, et leur a donné des mœurs et des habitudes à peu près pareilles; les chefs peuvent être ennemis; les peuples sont compatriotes; l'expatriation, qui, chez les anciens, étoit un supplice, est facile aux modernes; et loin de leur être pénible, elle leur est souvent agréable.22 Reste au despotisme l'expédient de prohiber l'expatriation; mais pour l'empêcher, il ne suffit pas de l'interdire. On n'en quitte que plus volontiers les pays d'où il est défendu de sortir: il faut donc poursuivre ceux qui se sont expatriés; il faut obliger les Etats voisins et ensuite les Etats éloignés» les repousser. Le despotisme revient ainsi au système d'asservissement, de conquête et de monarchie universelle; c'est vouloir, comme on voit, remédier à une impossibilité par une autre.
Ce que j'affirme ici vient de se vérifier sous nos yeux mêmes: le despotisme de France a poursuivi la liberté de climat en climat; il a réussi pour un temps à l'étouffer dans toutes les contrées où il pénétroit; mais la liberté se réfugiant toujours d'une région dans l'autre, il a été contraint de la suivre si loin qu'il a enfin trouvé sa propre perte. Le génie de l'espèce humaine l'attendoit aux bornes du monde, pour rendre son retour plus honteux, et son châtiment plus mémorable.23
CHAPITRE XIX. Que l'usurpation, ne pouvant se maintenir par le despotisme, puisque le despotisme lui-même ne peut se maintenir aujourd'hui, il n'existe aucune chance de durée pour l'usurpation. [pp. 185-192]
Si le despotisme est impossible de nos jours, vouloir soutenir l'usurpation par le despotisme, c'est prêter à une chose qui doit s'écrouler, un appui qui doit s'écrouler de même.
Un gouvernement régulier se met dans une situation périlleuse, quand il aspire au despotisme: il a cependant pour lui l'habitude. Voyez combien de temps il fallut au long parlement pour s'affranchir de cette vénération, compagne de toute puissance ancienne et consacrée, qu'elle soit républicaine ou qu'elle soit monarchique. Croyez-vous que les corporations qui existent sous un usurpateur éprouveroient, à briser son joug, ce même obstacle moral, ce même scrupule de conscience? Ces corporations ont beau être esclaves: plus elles sont asservies, plus elles se montrent furieuses quand un événement vient les délivrer. Elles veulent expier leur longue servitude. Les sénateurs qui avoient voté des fêtes publiques pour célébrer la mort d'Agrippine, et féliciter Néron du meurtre de sa mère, le condamnèrent à être battu de verges et précipité dans le Tibre.
Les difficultés qu'un gouvernement régulier rencontre à devenir despotique, participent de sa régularité: elles s'opposent à ses succès, mais elles diminuent les périls que ses tentatives attirent sur lui-même. L'usurpation ne rencontre pas des résistances aussi méthodiques. Son triomphe momentané en est plus complet; mais les résistances qui se déploient enfin sont plus désordonnées; c'est le chaos contre le chaos.
Quand un gouvernement régulier, après avoir essayé des empiétemens, revient à la pratique de la modération et de la justice, tout le monde lui en sait gré. Il retourne vers un point déjà connu, qui rassure les esprits par les souvenirs qu'il rappelle. Un usurpateur, qui renonceroit à ses entreprises, ne prouveroit que de la foiblesse. Le terme où il s'arréteroit seroit aussi vague que le terme qu'il auroit voulu atteindre. Il seroit plus méprisé, sans être moins haï.
L'usurpation ne peut donc subsister, ni sans le despotisme, car tous les intérêts s'élèvent contre elle, ni par le despotisme, car le despotisme ne peut subsister. La durée de l'usurpation est donc impossible.
Sans doute le spectacle que la Fiance nous offre paroît propre à décourager toute espérance. Nous y voyons l'usurpation triomphante, armée de tous les souvenirs effrayans, héritière de toutes les théories criminelles, se croyant justifiée par tout ce qui s'est fait avant elle, forte de tous les attentats, de toutes les erreurs du passé, affichant le mépris des hommes, le dédain pour la raison. Autour d'elle se sont réunis tous les desirs ignobles, tous les calculs adroits, toutes les dégradations raffinées. Les passions, qui, durant la violence des révolutions, se sont montrées si funestes, se reproduisent sous d'autres formes. La peur et la vanité parodioient jadis l'esprit de parti dans ses fureurs les plus implacables. Elles surpassent maintenant, dans leurs démonstrations insensées, la plus abjecte servilité. L'amour-propre, qui survit à tout, place encore un succès dans la bassesse, où l'effroi cherche un asile. La cupidité paroît à découvert, offrant son opprobre comme garantie à la tyrannie. Le sophisme s'empresse à ses pieds, l'étonne de son zèle, la devance de ses cris, obscurcissant toutes les idées, et nommant séditieuse la voix qui veut le confondre. L'esprit vient offrir ses services; l'esprit, qui, séparé de la conscience, est le plus vil des instrumens. Les apostats de toutes les opinions accourent en foule, n'ayant conservé de leurs doctrines passées que l'habitude des moyens coupables. Des transfuges habiles, illustres par la tradition du vice, se glissent de la prospérité de la veille à la prospérité du jour. La religion est le porte-voix de l'autorité, le raisonnement le commentaire de la force. Les préjugés de tous les âges, les injustices de tous les pays, sont rassemblés comme matériaux du nouvel ordre social. L'on remonte vers des siècles reculés, l'on parcourt des contrées lointaines, pour composer de mille traits épars une servitude bien complète qu'on puisse donner pour modèle. La parole déshonorée vole de bouche en bouche, ne partant d'aucune source réelle, ne portant nulle part la conviction; bruit importun, oiseux et ridicule, qui ne laisse à la vérité et à la justice aucune expression qui ne soit souillée.
Un pareil état est plus désastreux que la révolution la plus orageuse. On peut détester quelquefois les tribuns séditieux de Rome, mais on est oppressé du mépris qu'on éprouve pour le sénat sous les Césars. On peut trouver durs et coupables les ennemis de Charles Ier, mais un dégoût profond nous saisit pour les créatures de Cromwel.
Lorsque les portions ignorantes de la société commettent des crimes, les classes éclairées restent intactes. Elles sont préservées de la contagion par le malheur; et comme la force des choses remet tôt ou tard le pouvoir entre leurs mains, elles ramènent facilement l'opinion, qui est plutôt égarée que corrompue. Mais lorsque ces classes elles-mêmes, désavouant leurs principes anciens, déposent leur pudeur accoutumée, et s'autorisent d'éxécrables exemples, quel espoir reste-t-il? Où trouver un germe d'honneur, un élément de vertu ? Tout n'est que fange, sang et poussière.
Destinée cruelle à toutes les époques pour les amis de l'humanité! Méconnus, soupçonnés, entourés d'hommes incapables de croire au courage, à la conviction désintéressée, tourmentés tour à tour par le sentiment de l'indignation, quand les oppresseurs sont les plus forts, et par celui de la pitié, quand ces oppresseurs sont devenus victimes, ils ont toujours erré sur la terre, en butte à tous les partis, et seuls au milieu des générations, tantôt furieuses, tantôt dépravées.
En eux repose toutefois l'espoir de la race humaine. Nous leur devons cette grande correspondance des siècles qui dépose en lettres ineffaçables contre tous les sophismes que renouvellent tous les tyrans. Par elle, Socrate a survécu aux persécutions d'une populace aveugle; et Cicéron n'est pas mort tout entier sous les proscriptions de l'infâme Octave. Que leurs successeurs ne se découragent pas! Qu'ils élèvent de nouveau leur voix! Ils n'ont rien à se faire pardonner. Ils n'ont besoin ni d'expiations ni de désaveux. Ils possèdent intact le trésor d'une réputation pure. Qu'ils osent exprimer l'amour des idées généreuses. Elles ne réfléchissent point sur eux un jour accusateur! Ce ne sont point des temps sans compensation que ceux où le despotisme, dédaignant une hypocrisie qu'il croit inutile, arbore ses propres couleurs, et déploie avec insolence des étendards dès long temps connus. Combien il vaut mieux souffrir de l'oppression de ses ennemis que rougir des excès de ses alliés! On rencontre alors l'approbation de tout ce qu'il y a de vertueux sur la terre. On plaide une noble cause, en présence du monde et secondé par les vœux de tous les hommes de bien.
Jamais un peuple ne se détache de ce qui est véritablement la liberté. Dire qu'il s'en détache, c'est dire qu'il aime l'humiliation, la douleur, le dénuement et la misère; c'est prétendre qu'il se résigne sans peine à être séparé des objets de son amour, interrompu dans ses travaux, dépouillé de ses biens, tourmenté dans ses opinions et dans ses plus secrètes pensées, traîné dans les cachots et sur l'échafaud. Car c'est contre ces choses que les garanties de la liberté sont instituées, c'est pour être préservé de ces fléaux que l'on invoque la liberté. Ce sont ces fléaux que le peuple craint, qu'il maudit, qu'il déteste. En quelque lieu, sous quelque dénomination qu'il les rencontre, il s'épouvante, il recule. Ce qu'il abhorroit dans ce que ses oppresseurs appeloient la liberté, c'étoit l'esclavage. Aujourd'hui l'esclavage s'est montré à lui sous son vrai nom, sous ses véritables formes. Croit-on qu'il le déteste moins?
Missionnaires de la vérité, si la route est interceptée, redoublez de zèle, redoublez d'efforts. Que la lumière perce de toutes parts! obscurcie, qu'elle reparoisse; repoussée, qu'elle revienne! Qu'elle se reproduise, se multiplie, se transforme! Qu'elle soit infatigable comme la persécution. Que les uns marchent avec courage, que les autres se glissent avec adresse. Que la vérité se répande, pénètre, tantôt retentissante, et tantôt répétée tout bas. Que toutes les raisons se coalisent, que toutes les espérances se raniment; que tous travaillent, que tous servent, que tous attendent.
La tyrannie, l'immoralité, l'injustice sont tellement contre nature qu'il ne faut qu'un effort, une voix courageuse pour retirer l'homme de cet abîme. Il revient à la morale par le malheur qui résulte de l'oubli de la morale. Il revient à la liberté par le malheur qui résulte de l'oubli de la liberté. La cause d'aucune nation n'est désespérée. L'Angleterre, durant ses guerres civiles, offrit des exemples d'inhumanité. Cette même Angleterre parut n'être revenue de son délire, que pour tomber dans la servitude. Elle a toutefois repris sa place parmi les peuples sages, vertueux et libres, et de nos jours nous l'avons vue, et leur modèle et leur espoir.
6.Charles Comte’s foreword to Le Censeur (1814)↩
Word length: 459]
Source
Le Censeur, ou examen des actes et des ouvrages qui tendent à détruire ou à consolider la constitution de l'état, par M. Comte. Tome premier. Nouvelle édition, revue et corrigée (Paris: Madame Marchant, 1814). (Unsigned but probably CC) Charles Comte, “Avertissement”, p. iii-vi.
Brief Bio of the Author: François-Louis-Charles Comte (1782-1837)
[François-Louis-Charles Comte (1782-1837)]
François-Louis-Charles Comte (1782-1837) was a lawyer, liberal critic of Napoleon and then the restored monarchy, and son-in-law of Jean-Baptiste Say. One of the leading liberal theorists before the 1848 revolution, he founded, with Charles Dunoyer, the journal Le Censeur in 1814 and Le Censeur européen in 1817 and was prosecuted many times for challenging the press censorship laws and criticizing the government. He came across the ideas of Say in 1817 and discussed them at length in Le Censeur européen. After having spent some time in prison he escaped to Switzerland, where he was offered the Chair of Natural Law at the University of Lausanne before he was obliged to move to England. In 1826 he published the first part of his magnum opus, the four-volume Traité de législation, which very much influenced the thought of Bastiat, and the second part, Traité de la propriété in 1834. Comte was secretary of the Académie des sciences morales et politiques and was elected a deputy representing La Sarthe after the 1830 Revolution. [DMH]
AVERTISSEMENT.
Lorsque Napoléon Bonaparte se fut emparé des rênes du gouvernement, il présenta aux Français une constitution qui leur garantissait le libre exercice de leurs droits civils et politiques, et qui aurait fait leur bonheur s'il n'avait pas eu le soin d'y introduire tous les vices qu'il crut propres à favoriser son ambition. Comme les hommes qu'il avait appelés pour la rédiger (et qu'il désigna ensuite pour la maintenir), n'avaient eu pour objet que de s'emparer de l'autorité souveraine, ils y portèrent des atteintes continuelles, et la renversèrent entièrement dès qu'ils se crurent arrivés à leur but, en proclamant que Bonaparte était la loi suprême et toujours vivante, et que le sénat lui-même était au-dessus des lois. Si un homme courageux avait alors élevé la voix pour la défense de la constitution, la police, après l'avoir fait signaler par les journaux comme un séditieux et comme un traître, l'aurait envoyé dans un des cachots où Pichegru fut étranglé.
Ce règne de violence et d'oppression a cessé, et un nouvel ordre de choses lui a succédé. La plupart des vices qui se trouvaient dans notre constitution ont disparu; mais il faut empêcher qu'ils s'y introduisent de nouveau; il faut surtout qu'elle soit respectée, et qu'elle le soit par les ministres du prince comme par le dernier des Français. Ce respect, que tous les citoyens doivent aux lois de leur pays, ne peut exister que par l'opinion publique, et l'opinion ne peut être formée que par l'éducation, ou par des écrits périodiques qui soient à la portée de tout le monde. Sous ce rapportées journalistes pourraient être d'une grande utilité; mais la haute importance qu'ils attachent à de simples discussions littéraires; l'indifférence qu'ils ont pour tout ce qui tient à la morale ou à la législation, et l'habitude de cette adulation servile que la plupart d'entre eux ont contractée sous le dernier gouvernement, ne permettent pas d'espérer qu'ils s'occuperont d'éclairer les citoyens sur leurs véritables intérêts. Comment attendre, en effet, que des hommes toujours prosternés devant la puissance, aient jamais le courage de dire la vérité et de dénoncer au public les erreurs ou les actes arbitraires d'un ministre?
Ce qu'ils ne font point, j'ose l'entreprendre. Etranger à tous les gouvernemens qui se sont succédés en France durant l'espace de vingt années, je n'ai, en écrivant, que l'intérêt qui doit animer tous les Français, celui de voir mes concitoyens obéir aux lois, respecter la morale publique, et résister à l'oppression. Que les hommes de tel ou de tel parti, de telle ou de telle secte, ne cherchent donc point dans cet ouvrage de quoi alimenter leurs passions; car ils n'y trouveront lien qui puisse leur plaire.
Tous les mois il en paraîtra quatre cahiers de trois feuilles au moins.
7.Charles Comte (?) on “The Cause of Europe’s Wars” (Dec. 1814-15)↩
Word length: 6,510]
Source
Le Censeur, ou examen des actes et des ouvrages qui tendent à détruire ou à consolider la constitution de l'état. Par MM. Comte et Dunoyer, avocats. Tome troisième. (Paris: Marchant, 1815). Charles Comte (unsigned?), “Considérations sur la situation de l’Europe, sur la cause de ses guerres, et sur les moyens d’y mettre fin,” pp. 1-41.
CONSIDÉRATIONS SUR LA SITUATION DE L'EUROPE, SUR LA CAUSE DE SES GUERRES, ET SUR LES MOYENS D'Y METTRE FIN.24
AVANT-PROPOS.
Je parlerai quelquefois de lois arbitraires, de rois despotes, de nations asservies, d'institutions barbares. Je préviens le lecteur que, je n'ai pas l'intention de désigner nos lois, ni notre roi, ni nos institutions.
Nos lois sont l'ouvrage des trois pouvoirs législatifs. Notre roi a eu la générosité de nous donner une ordonnance royale qui nous tient lieu de constitution, qu'il a promis d'observer, et qui assure notre liberté. Si nous venions à la perdre, ce ne serait que par la faute de la chambre des pairs et de celle des députés des départemens. Ils ont la faculté de proposer les lois, de les amender, de les rejeter. Si ces lois venaient à nous ôter les concessions que le roi nous a faites, il faudrait que les pairs, le premier corps de l'Etat, descendissent de leur rang; il faudrait que les membres de la chambre des députés se laissassent corrompre par la cour et par les ministres, sans craindre de perdre l'estime publique et d'encourir l'indignation de leurs concitoyens.
Je suis loin de penser qu'il en arrive ainsi; mais ce qui me paraît évident, c'est que le gouvernement marche dans un sens et l'opinion publique dans un autre. Qu'on fasse attention que l'autorité du gouvernement n'a d'autre force que la volonté générale; que le nombre des volontés particulières contraires à son autorité, sont autant de forces de moins; que quand les volontés sont partagées, l'Etat est menacé de troubles. Notre révolution a eu jusqu'ici beaucoup d'analogie avec la révolution anglaise. Nous avons eu un Cromwel, évitons d'avoir un roi Jacques. Si l'union fut toujours nécessaire, elle l'est plus que jamais, dans ce moment où l'Europe, discutant ses intérêts, peut se diviser: si la France doit choisir un parti, soyons réunis pour embrasser le même.
Je veux rechercher ici la cause des maux qui troublent quelques états de l'Europe; j'essaie de découvrir le remède et de l'indiquer à ceux qui peuvent l'appliquer. La matière que je traite me paraît intéresser tous les hommes, les rois autant que les peuples. Les progrès de l'esprit humain que la nature, irrésistible dans sa marche, a amenés, malgré tous les obstacles, la fatale expérience du passé, les craintes qu'inspire l'avenir nécessitent des changemens dans les lois et les gouvernemens. L'opinion qui gouverne le monde les prépare depuis long-temps. Si les rois étaient aussi éclairés que les hommes instruits de leur siècle, ils éviteraient les secousses, et dirigeraient eux-mêmes la civilisation de leurs peuples. Ils le devraient par zèle pour leur conservation et leur intérêt, quand même ils n'y seraient pas excités par l'amour de l'humanité et de leur devoir; mais par une fatalité funeste, ils sont loin en arrière des lumières de leur siècle. Nés pour le trône, ils ont peu communiqué avec le reste des hommes; leur éducation ne leur a donné que de fausses idées suggérées par des flatteurs ou des artisans du despotisme: la vérité ne peut parvenir jusqu'à eux; et, s'il arrive une révolution, la veille de la destruction de leur puissance, ils auront lu dans les journaux des éloges flatteurs, des adresses sollicitées ou commandées par leurs ministres; ils auront entendu autour de leur palais les applaudissemens de quelques groupes soldés; ils auront vu prosternés à leurs pieds les lâches courtisans qui, dans quelques heures, doivent les abandonner pour chercher une nouvelle idole.
Si quelques ministres ou quelques esclaves titrés lisent ces pages, ils me jugeront trop hardi d'avoir osé traiter une matière qui, disent-ils, est totalement étrangère à celui qui doit se tenir dans la basse région de l'obéissance, et ne pas se permettre de juger les institutions et les actes de l'autorité: mais ne suis-je pas homme? n'ai-je pas souffert des erreurs de nos gouvernemens et du vice de nos institutions? ne serai-je pas encore enveloppé dans les malheurs qui nous menacent? Je suis instruit par l'expérience du passé, je crains l'avenir; je le vois arriver couvert d'une teinte sombre; je le montre à mes semblables, à mes compagnons d'infortune; je voudrais persuader aux rois et aux ministres de conjurer l'orage; voilà pourquoi j'écris.
§. Ier.
Causes des guerres qui ont désolé les peuples de l'Europe.
En lisant l'histoire on trouve à chaque page des descriptions de guerres et de combats. Presque tous les hommes dont la mémoire est parvenue jusqu'à nous, sont des conquérans qui ont ravagé la terre et massacré leurs semblables. Pour un Confucius, un Minos, un Solon, on trouve cent monstres titrés du nom de héros, qui ont saccagé des villes, ravagé des campagnes, et semé au loin la terreur et la mort. Les hommes sont-ils donc destinés à se battre éternellement les uns contre les autres? Les nations ne pourront-elles jamais vivre en paix; et cette espèce d'animaux qui ose se dire exclusivement raisonnable, serait-elle la seule qui s'entregorgerait sur la terre, malgré sa raison qu'elle met toujours en avant pour établir sa supériorité?
Le lion farouche parcourt en despote les sables brûlans d'Afrique; il déchire, pour satisfaire ses besoins, les animaux d'une espèce différente, mais il épargne le lion son pareil; le tigre ne dévore pas le tigre; l'aigle, qui plane dans les airs, porte son œil perçant dans les plus sombres forêts, il fond sur sa proie, mais il respecte le nid et la famille de l'aigle son voisin. L'homme social, l'homme perfectionné par des institutions qu'il ose vanter, tantôt comme un don de la divinité, tantôt comme la plus belle des conceptions, l'homme s'arme contre l'homme son semblable; il va l'attaquer dans des pays lointains, incendie ses villes, ravage ses campagnes et le réduit à une misère désespérante. Est-ce donc à la nature qu'il faut attribuer cet excès de férocité? Aurait-elle été plus ingrate pour l'homme que pour les autres animaux? Cette fureur ne serait-elle pas au contraire le fruit amer de nos institutions et de nos gouvernemens qui nous dépravent et qui nous divisent?
Je conçois que des tribus de sauvages se fassent la guerre pour s'approprier la pêche d'un lac, la chasse d'une forêt: ils sont placés entre la guerre et la famine, ils doivent se battre ou périr. Mais nous, Français, Anglais, Allemands, Italiens, Espagnols, Russes pourquoi nous faisons-nous la guerre? La nature nous a donné à tous de quoi satisfaire abondamment nos besoins: elle nous a donné même des moyens d'échange pour augmenter mutuellement nos jouissances, et pour établir entre nous des rapports d'harmonie et d'attachement; nous aimons tous les sciences, les arts; nous nous communiquons nos idées et nos découvertes; nous lisons et nous admirons les mêmes auteurs; la même philosophie circule secrètement de Cadix jusqu'à Pétersbourg, de Naples jusqu'à Londres; d'où viennent donc les guerres qui nous divisent et qui font notre malheur?… Elles viennent de l'ambition de ceux qui nous gouvernent, elles viennent, de notre asservissement. La nature indignée punit les peuples de s'être laissés abrutir par le despotisme; elle semble leur dire: « Espèce dégénérée et abrutie, je vous avais tous également dotés, et vous avez renoncé à l'égalité dans laquelle je vous avais placés; je vous avais donné une loi naturelle, vous l'avez oubliée; vous avez abandonné la vérité pour suivre l'erreur; je vous avais donné la justice pour vous gouverner, vous l'avez chassée, et vous avez établi le despotisme sur son trône! Vous serez punis pour avoir quitté la route que je vous avais tracée. Les hommes que vous vous êtes donnés pour maîtres vous enchaîneront; ils, vous dépouilleront du fruit de vos travaux et de Voire industrie; ils vous armeront les uns contre les autres, vous vous égorgerez mutuellement pour leur ambition; ils vous abrutiront sous leur despotisme; ils vous mépriseront; ils ne vous laisseront que le partage honteux de servir leurs goûts et leur fureur. Ils vous précipiteront sans cesse dans de nouveaux malheurs, jusqu'à ce que vous assuriez la marche de la civilisation qui, dès son origine, a pris une fausse route; jusqu'à ce que vous ayez mis des lois justes, fondées sur votre nature, à la place de la volonté arbitraire d'un homme qui vous divise au lieu de vous réunir, qui vous trompe pour vous asservir, et qui vous traite enfin comme des troupeaux qu'il dépouille et qu'il égorge à sa volonté. »
§. II.
Il se prépare de nouvelles guerres aussi désastreuses que les précédentes.
Nous sortons à peine d'une guerre sanglante qui avait embrasé l'Europe, que de nouveaux nuages s'amoncèlent, que de nouvelles guerres se préparent. Elles seront aussi désastreuses, aussi terribles pour les peuples que la guerre dernière. Les souverains par une funeste expérience, ont appris à mettre en jeu tous les bras de leurs sujets. Dans les derniers siècles, ils soutenaient leurs querelles avec des troupes de dogues à figure humaine qu'ils appelaient soldats, et qui se vendaient pour ce métier ingrat et honteux; mais aujourd'hui ils armeront tous nos enfans. Nous n'aurons plus la douce espérance qu'ils pourront soutenir notre vieillesse; leurs mains ne fermeront pas nos paupières; ils finiront leurs jours loin de nous, sur des champs de bataille ou dans des cloaques pestiférés qu'on appelle hôpitaux; ils succomberont de fatigue ou de froid, et leurs corps dispersés resteront sans sépulture, exposés dans les champs ou sur les routes; ils seront la proie des animaux carnassiers.
Jadis les peuples ne risquaient dans la guerre qu'une partie de leur fortune; lorsque les souverains ne pouvaient plus trouver dans leurs états l'argent nécessaire pour l'alimenter, ils faisaient la paix, ou plutôt une trêve qui laissait à leurs sujets le loisir d'amasser par leur travail et leur industrie de nouvelles richesses, qu'ils devaient leur arracher un jour pour alimenter une nouvelle guerre. La faiblesse des armées ne permettait pas de faire de grandes invasions, les coups se portaient sur les frontières; quelques lisières de pays étaient, à la vérité, impitoyablement dévastées; mais les revers et les succès ne faisaient perdre ou gagner que quelques milles de terrain.
Aujourd'hui des armées innombrables pénètrent dans le cœur des états; pour subsister, elles pillent tout sur leur passage, laissent derrière elles de vastes déserts couverts de cadavres, de débris et de cendres. Les femmes, les vieillards, les enfans dispersés, n'ont pour refuge que les antres des forêts; et lorsqu'après le passage du torrent dévastateur, ils sortent de leur retraite pour chercher leur habitation, ils ne trouvent plus que des ruines fumantes, un air pestiféré par l'exhalaison des immondices que laissent après elles les armées nombreuses.
Peuples de l'Europe; tels sont les malheurs qui vous menacent, telle est la perspective effrayante qui se présente devant vous. Je cherche en vain quelque lueur d'espérance; l'avenir me paraît sombre et sinistre. Le seul remède contre ces maux, ce serait de donner à la civilisation une marche naturelle, de remplacer le joug arbitraire des princes par celui des lois; il n'y a que des peuples libres qui puissent vivre en paix. Lorsque tous les peuples auront adopté le gouvernement représentatif, et qu'ils auront une grande part dans leur législation, alors seulement les nations seront susceptibles de civilisation, alors elles pourront se lier entre elles par le code du droit des gens, alors l'Europe ne formera plus qu'une même famille, une seule confédération.
Avant d'unir les nations par des lois justes et égales, il faut que les hommes qui composent des nations n'obéissent eux-mêmes qu'à des lois justes et égales, fondées sur la nature et sur le vrai but de la civilisation. Aussi long-temps qu'ils seront soumis à des lois arbitraires, quel espoir y a-t-il que les souverains veuillent se soumettre au code du droit des gens! Voudront-ils reconnaître entr'eux l'égalité qu'ils ne veulent pas admettre parmi leurs sujets! Le fort voudra-t-il être juste envers le faible! Renonceront-ils à leurs projets d'ambition! Changeront-ils enfin de nature? Non, qu'on ne se livre pas à cet espoir. Ce ne sont pas les peuples qui veulent la guerre, ce sont les rois. Eh! que leur importe que leurs maîtres soient vainqueurs ou vaincus, en sont-ils moins malheureux? Une province ajoutée au royaume leur procure-t-elle quelque diminution d'impôts? La gloire, les triomphes, les monumens, sont-ils destinés à flatter l'orgueil des sujets, ou celui des princes? Ceux-ci triomphent quand les autres ont acheté la victoire aux dépens de leur fortune et dé leur sang; ils augmentent leur luxe et leurs dépenses, quand les peuples obérés se traînent dans la misère.
§. III.
Napoléon aurait pu établir la confédération d'Europe.
Un guerrier philosophe qui aurait eu dans ses mains la puissance de Napoléon aurait établi la civilisation de l'Europe sur ses véritables bases. II eût introduit des institutions sociales et des lois bienfaisantes par-tout où il a porté ses armes dévastatrices; au lieu de présenter de nouveaux fers aux peuples, il leur aurait donné la liberté. Premier magistrat de la nation française, il n'aurait pas usurpé le pouvoir absolu, il eût au contraire employé sa puissance à la rendre libre. Arrivé sur le Niémen, ce guerrier philosophe aurait proclamé la liberté de l'Europe et lui aurait donné le code du droit des nations; il aurait assigné aux peuples les limites que la nature, les mœurs et leurs intérêts semblent avoir tracées; ils ne les aurait pas traités comme de vils troupeaux qu'on livre à des bergers pour les tondre et les égorger. Il me semble entendre ce bienfaiteur de l'espèce humaine adressant ce discours aux peuples et aux rois:
« Peuples, rois de l'Europe, vous m'avez vu, jusqu'à ce jour, les armes à la main, répandre par-tout la mort et l'effroi; vous avez cru que j'étais un conquérant avide de pouvoir et de vaine gloire; vous m'avez comparé à ceux, qui, avant moi, ont ravagé la terre et n'ont laissé après eux qu'un nom abhorré; mais vous m'avez mal jugé. J'ai voulu acquérir, par la force des armes, la puissance de commander à l'Europe, non pour l'asservir, mais pour la rendre libre. Je vous ai fait la guerre pour établir un système de paix durable. J'ai formé le vaste et utile projet d'asseoir la civilisation de l'Europe sur ses véritables bases. L'art de l'imprimerie a éclairé les peuples, il leur faut une autre législation; le commerce les a rapprochés; il faut les réunir par le code du droit des gens: que la justice gouverne les nations comme les particuliers; que désormais il n'y ait plus de guerre entre nous; que les peuples aient une grande part dans leur législation, ils se soumettront de bon cœur aux lois que leurs représentans leur auront données: ils seront contens et tranquilles: les rois seront plus affermis sur leurs trônes; ils auront le pouvoir de faire le bien et non celui de faire le mal. Chaque peuple doit avoir le choix de son association politique, de ses lois, de son gouvernement. La nature semble avoir distribué les fleuves et les mers pour que les nations participent également aux avantages du commerce maritime. Si quelqu'un ose nous disputer nos droits, qu'il soit déclaré l'ennemi de l'Europe. »
Une telle conduite eût excité l'admiration des peuples, et le guerrier philosophe aurait été proclamé le bienfaiteur de l'Europe. Mais les évènemens ont été bien différens. Napoléon abusant de son pouvoir s'est attiré la haine de toutes les nations qu'il opprimait; il a été vaincu, et sa puissance s'est dissipée comme une ombre.
§. IV.
La chute de l'empire de Napoléon doit nous donner de nouvelles guerres.
L'écroulement de l'empire de Napoléon doit faire naître de nouvelles discordes. Les limites des anciens états avaient disparu; les intérêts de plusieurs peuples s'étaient confondus. Chacun veut aujourd'hui se saisir de ce qu'il regarde comme ses anciens domaines: les plus forts veulent usurper sur les plus faibles: des rois chassés ou détrônés réclament leur ancien trône, qu'ils appellent l'héritage de leurs pères: les nouveaux souverains qui s'étaient détachés de Napoléon, veulent se maintenir. Les Anglais veulent avoir un vaste état sur le continent; ils veulent conserver exclusivement la souveraineté des mers et les avantages du commerce; ils font la guerre à leurs frères d'Amérique, parce que ceux-ci veulent jouir des droits que la nature paraît avoir donnés à tous les peuples. Dans cet état de choses, peut-on espérer la paix? Les grandes puissances continentales accorderont-elles à l'Angleterre le domaine des mers et le commerce exclusif? Mais, dans ce cas, la puissance anglaise ne leur sera ni moins onéreuse, ni moins funeste que ne l'était celle de Napoléon. Peut-on se flatter que l'Angleterre renoncera à ses prétentions? Mais comment pourrait-elle soutenir son crédit et payer les intérêts de sa dette énorme?
D'ailleurs, a-t-on jamais vu qu'une puissance renonçât à ses avantages quand elle est à l'abri de toute atteinte? Si la guerre s'allume entre l'Angleterre et les souverains du continent, la première aura pour elle toute l'Italie. Le roi de Naples ne peut se maintenir qu'en s'unissant à elle. Gênes est entre ses mains; Corfou est occupé par une garnison anglaise. Les peuples de la Lombardie, mécontens, s'insurgeront quand elle voudra. Dans cette partie de l'Europe une armée de cent mille hommes combattra pour sa cause. Elle peut facilement mettre dans ses intérêts la Suède et le Dannemarck. Une armée prête à agir est rassemblée en Hollande et dans les Pays-Bas. La Turquie ne peut se maintenu en Europe que par son alliance; les Turcs s'armeront encore avec elle. En Espagne, elle soutiendra le parti des cortès, et organisera la guerre civile. En France… ! Rois de l'Europe, vous redoutiez la puissance de Napoléon, vous l'avez renversé; mais votre situation n'en est pas devenue meilleure: vous n'aurez fait que changer de domination. Votre union seule pourrait vous sauver; mais elle est impossible; l'opinion est trop divergente et les intérêts trop divisés. Il n'y a que des peuples libres qui puissent se former en confédération. L'Angleterre aura le moyen de corrompre les ministres des souverains; elle divisera leurs intérêts; les armera les uns contre les autres; nous nous battrons sur le continent; nous nous appauvrirons, tandis qu'ils seront tranquilles dans leur île et qu'ils s'enrichiront. Les peuples tomberont dans le désespoir; ils ne verront d'autre remède à leurs maux que la révolte; ils seront poussés vers la liberté par l'excès de leur misère, et ils obtiendront, par les horreurs d'une révolution, ce que leurs souverains auraient dû leur remettre par prudence et même par intérêt. Ce n'est donc que de l'excès de leur misère et de leur désespoir que les peuples peuvent attendre leur régénération sociale et la paix. O misérable condition de l'espèce humaine! le bien ne peut donc naître que de l'excès du mal!
§. V.
Il n'y a que l’Angleterre qui puisse entreprendre de réunir l'Europe en confédération.
L'Angleterre, si elle était bien inspirée, et si elle sentait ses véritables intérêts, se mettrait à la tête de la confédération de l'Europe; elle se réunirait franchement à la France, qui vient d'adopter une partie de ses institutions; aux Etats-Unis d'Amérique, qui sont libres comme elle, et qui sont ses enfans; à la Hollande, aux Pays-Bas, à la Suède, à la Norwége, à l'Italie, et à tous les peuples de l'Europe qui voudraient être libres et se soumettre aux lois de la confédération: elle devrait renoncer à son égoisme exclusif, et consentir à partager avec tous les peuples unis les avantages du commerce et des colonies. L'Angleterre éviterait par-là les malheurs que pourraient faire tomber sur elle les nations du continent, poussées par ses vexations, ses injustices et son affreuse politique, qui ne peuvent manquer de l'isoler un jour et de la séparer entièrement du reste, de l'Europe. Mais peut-on espérer qu'elle changera tout-à-coup de conduite? Cependant qu'elle pèse bien ses intérêts; et, portant ses regards sur ce qui vient de se passer, qu'elle examine le sort qu'a obtenu Napoléon pour avoir tenté de vexer et d'opprimer l'Europe; et qu'elle tremble pour sa destinée future, si elle ne sait pas être juste et généreuse. Si au contraire elle renonce au projet insensé de dominer les mers, de s'emparer de toutes les branches du commerce et de souffler la guerre en Europe par là seule vue de son intérêt, si elle veut être juste et généreuse, elle mérite l'honneur et la gloire de se placer à la tête des peuples libres confédérés; elle est la plus riche, plus puissante, la plus industrieuse; elle étend au loin ses relations: c'est elle qui a créé la véritable liberté en Europe, qui a perfectionné le système représentatif et calculé l'action des divers pouvoirs du gouvernement. Elle est libre depuis un siècle; tandis que les Français sont encore des enfans qui se traînent entre la liberté et le despotisme. Cette vérité est dure pour la nation; mais elle est trop évidente pour qu'on puisse la dissimuler.
§. VI.
Projets des papes et des jésuites, de Henri IV, de Louis XIV et de Napoléon.
Les papes et les jésuites ont osé entreprendre autrefois de réunir les nations par le lien de la religion, et de gouverner le monde par la théocratie: ils commandaient à l'opinion des nations chrétiennes, et l'opinion commandait aux rois. Mais ce lien, fondé sur la superstition, ne pouvait exister plus long-temps qu'elle. Luther l rompit, et le progrès des lumières a renversé tous ses appuis. Ainsi doivent tomber toutes les institutions qui ne sont pas fondées sur l'utilité réelle des peuples. Sous un pareil gouvernement les hommes auraient vécu en paix, comme des troupeaux de montons que des bergers font paître tranquillement, mais qu'ils tondent et qu'ils égorgent à volonté. Les peuples, abrutis par l'ignorance et la superstition, aurait traîné leur existence dans la misère au milieu des fantômes et des terreurs, sans activité, sans industrie, n'espérant de bonheur que dans la vie future. D'ailleurs, un pareil système ne pouvait s'adapter qu'aux peuples de la religion romaine, et la civilisation doit s'étendre sur tout le globe.
Henri IV avait formé le projet de réunir l'Europe; la mort l'enleva avant qu'il en eût tenté l'exécution. Il n'aurait pas réussi, parce qu'une confédération de rois est impossible, et qu'elle ne peut avoir lieu qu'entre des peuples libres qui ont un gouvernement représentatif, et qui peuvent, par ce moyen, établir hors d'eux un centre de gouvernement général représentatif qui, réunissant les vues particulières, n'ait lui-même que des vues générales.
Après ce bon roi, ont paru deux ambitieux qui ont voulu fonder la monarchie universelle; l'un est Louis XIV, l'autre Napoléon. Le premier paya son extravagance par l'humiliation de la fin de son règne: il laissa la France épuisée, et mourut sans être regretté. On sait quel sort a eu Napoléon. Les malheurs qu'il a attirés sur la France se feront sentir pendant long-temps.
§. VII.
Résultats probables du Congrès de Vienne.
Toutes les puissances de l'Europe discutent dans ce moment leurs intérêts respectifs: quel sera le résultat de leurs discussions? Pourra-t-on parvenir à s'entendre et à tomber d'accord? Chacun sans doute discutera ses intérêts particuliers, et aucun ne présentera des vues générales. La Russie, l'Autriche, la Prusse s'aggrandiront, chacune selon leur-convenance; l'Angleterre obtiendra sur le continent ce qu'elle désire pour elle et pour la Hollande, qui n'est, à proprement parler, qu'une province anglaise. Le sort de la France est décidé. L'Espagne n'a rien à demander. Les intérêts des petites puissances pourront exciter quelques discussions; on finira par les fixer. Mais les puissances continentales ne voudront-elles pas obtenir la liberté du commerce et des mers, et ne sera-ce pas une pomme, de discorde entre l'Angleterre et les puissances du continent?
Si on accorde à l'Angleterre la suprématie des mers, et par conséquent le commerce du monde, cette île, peuplée d'hommes libres, est la souveraine du globe, et toutes les autres nations ne sont que ses esclaves et les instrumens de sa fortune. Elle les divisera à son gré, les armera les unes contre les autres, selon ses intérêts, pour les affaiblir et les dominer.
Si l'Angleterre,ne voulant abandonner aucune de ses prétentions maritimes, s'attire la guerre, elle sera attaquée dans ses possessions du continent. Pour se défendre, elle formera des alliances; mais quels alliés pourra-t-elle avoir? Elle aura l'Italie, la Suède, la Norwége, le Dannemarck, le Hanovre, les Pays-Bas et la Turquie. Elle peut avoir trois grandes armées sur le continent; elle n'a rien à craindre de la France ni de l'Espagne; elle peut même ne laisser à ces deux puissances que le choix entre son alliance et la guerre civile. Je ne chercherai pas à mettre au jour quels moyens elle pourrait employer; ils sont assez connus pour que je m'abstienne de les indiquer.
§. VIII.
Quelle doit être la politique de la France et de l'Espagne.
Si la guerre vient à éclater entre l'Angleterre et les puissances du nord, l'intérêt de la France et de l'Espagne est de s'allier à l'Angleterre; mais cette alliance ne peut être durable et avantageuse à ces deux nations qu'autant qu'elle serait fondée sur une çonfédération qui aurait pour base la justice, l'égalité, la modération, et le partage des avantages du commerce et des colonies. Cependant comme une confédération ne peut exister qu'entre des peuples libres, il faut que l'Espagne adopte une constitution rapprochée de la constitution anglaise. La France a déjà à-peu-près une constitution semblable. Il ne s'agit pour elle que de la suivre et de la maintenir. En prenant ce parti, la France se releverait de son affaissement; elle reprendrait ses limites du Rhin jusqu'aux frontières des Pays-Bas, les germes de dissension se détruiraient insensiblement, nous nous occuperions de commerce et d'établissemens coloniaux. Les partisans de la liberté ne craindraient plus l'empiétement de l'autorité absolue, et nous verrions s'ouvrir devant nous un vaste horizon pour donner un libre cours à l'activité nationale. La philosophie et la liberté de la presse ne seraient plus la terreur du gouvernement; l'une dirigerait la marche de la civilisation, qui doit s'étendre peu à peu sur le globe; l'autre, en donnant un libre essor à toutes les idées, éclairerait le gouvernement et lui ferait connaître l'opinion publique que la législation doit toujours suivre de près.
§. IX.
De l'organisation d'une confédération de peuples libres.
Il n'y a que des peuples libres qui puissent se réunir en confédération: il faut encore qu'ils aient des constitutions analogues pour qu'ils puissent procéder, d'une manière uniforme, à la création du gouvernement central qui doit les tenir réunis. Je ne m'étendrai pas sur la forme que l'on doit donner à ce gouvernement ni sur le mécanisme de sa constitution; je me bornerai à dire qu'il doit être représentatif, et de même nature que les gouvernemens particuliers de chaque état confédéré. Il doit avoir la puissance de tous les états, et n'en avoir aucune d'exclusivement propre. Il doit être placé de manière à n'avoir d'autres vues que l'intérêt général de la confédération. Les états particuliers ne doivent disposer que de la force nécessaire pour faire leur police. Les lois intérieures et administives de chaque état doivent être réglées par les gouvernemens particuliers. Les affaires générales doivent être réglées par le gouvernement général. Il devrait être, sous plusieurs rapports, semblable au gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.
§. X.
Quel doit être le but de cette confédération?
Le but de la confédération doit être l'union, la paix, le bonheur, la prospérité de tous les états confédérés; car ce sont là les motifs qui sont cause de sa formation. Mais le gouvernement général doit avoir encore d'autres vues, telles que le commerce du monde, la civilisation du globe et les colonies.
Le commerce du monde peut seul entretenir l'activité, amener la richesse, faire fleurir les arts, étendre la civilisation en établissant des relations avec tous les peuples. Les colonies peuvent peupler les parties du globe qui sont encore désertes. Elles sont nécessaires pour faire écouler le surcroît de population qui résulte infailliblement de la liberté des peuples; car, voyez l'Angleterre depuis près d'un siècle que cette île jouit de la liberté, sa population s'est accrue de plusieurs millions, malgré les guerres continuelles qu'elle a soutenues, malgré les pertes de la mer. Elle a peuplé les Etats-Unis d'Amérique, le Canada, plusieurs points sur les côtes d'Afrique, les côtes de l'Inde, depuis les bouches de l'Indus jusqu'au Bengale. Elle a plusieurs colonies en Amérique et des établissemens sur les côtes d'Afrique et d'Europe.
La guerre ne doit pas être le métier des peuples libres unis; ils ne doivent la faire que pour leur défense.
La confédération devrait s'occuper des grands travaux d'une utilité générale, établir les grandes communications, ouvrir des canaux, couper des isthmes, jeter des colonies au milieu des peuples barbares, pour hâter la civilisation et étendre les relations du commerce: tel devrait être le grand but d'une confédération de peuples libres.
§. XI.
Avantages de la liberté.
En lisant l'histoire, on trouve que tous les peuples libres ont prospéré et que les gouvernemens despotiques ont dépeuplé la terre. L'Angleterre, libre depuis un siècle, a porté sa richesse et sa puissance au plus haut degré. Une population de treize millions d'hommes, qui n'occupe qu'un point sur le globe, est maîtresse du commerce du monde et dicte des lois à l'Europe. L'Amérique est libre depuis trente ans; et, dans cet intervalle, sa population s'est plus que triplée. Elle est riche et puissante et joue un grand rôle parmi les nations. La Hollande libre a pu lutter autrefois contre touts les forces d'Espagne, et contre Louis XIV qu'elle humilia. Peuples asservis, admirez le pouvoir de la liberté, et dites à vos maîtres: Pourquoi ne sommes-nous pas libres? nous serions riches et heureux!
Mais d'où vient que la liberté a tant d'influence sur la prospérité et la puissance des états? C'est que les peuples ne se multiplient que lorsqu'ils sont riches et heureux; et ils ne le deviennent que quand leur propriété et leur liberté individuelle est protégée par les lois et à l'abri des caprices de l'arbitraire.
Les peuples libres sont puissans, parce qu'ils ont une grande part dans le gouvernement; que les lois sont censé être l'expression de la volonté générale; parce que l'autorité du gouvernement étant appuyée par l'opinion de tous, peut employer la force de tous.
Dans une monarchie absolue la législation n'a d'autre force que celle qu'inspire la crainte. Les peuples peuvent être soumis, mais ils sont sans énergie, sans patriotisme. Il leur est défendu de s'occuper de la prospérité de l'Etat: obéir et se taire c'est le devoir qu'on leur prescrit. Si les lumières et les connaissances pénètrent parmi le peuple, et qu'il vienne à apercevoir les vices du gouvernement, alors on voit naître le mécontentement, l'esprit de révolte et de sédition; l'Etat se divise; le gouvernement est obligé d'employer un partie de la puissance publique pour contenir l'autre; il n.e lui reste plus de force pour sa défense extérieure. S'il est attaqué,il est vaincu.
C'est par ces raisons qu'on explique pourquoi les peuples libres de la Grèce purent résister autrefois aux attaques des rois de Perse, pourquoi la Hollande put résister aux forces d'Espagne, la Suisse aux forces autrichiennes; pourquoi, au commencement de la révolution, la France a pu résister à toutes les puissances de l'Europe; par quelles causes Napoléon a pu faire de si glandes conquêtes, et par quelle cause il est tombé si vite lorsqu'il n'a plus été soutenu par l'opinion dû la France et la volonté générale. Si les rois méditaient bien l'histoire, ils préféreraient le règne des lois au règne de l'autorité absolue.
§. XII.
Une confédération de rois serait monstrueuse. Elle est impossible.
On a parlé d'une confédération des princes du continent, qui aurait pour but la garantie mutuelle de leurs états contre toute attaque étrangère, et celle de leur trône contre les séditions et les révolutions des peuples. Mais quelle est la force qui ferait exécuter les réglemens de cette confédération? Les rois établiraient-ils un roi au-dessus d'eux pour en être le chef? Mais ce roi serait sans doute le plus puissant d'entre eux; il aurait toujours son intérêt particulier en vue, et il serait bientôt le maître des autres. D'ailleurs, une pareille monstruosité préparerait leur ruine; les peuples n'y verraient qu'une coalition contre eux. Un tel projet est trop révoltant et trop réprouvé par l'opinion du siècle. Quoi! si le roi de France traitait les Français de rebelles, parce que ceux-ci demanderaient le maintien de la constitution, des cosaques viendraient, la lance en avant, faire la police dans Paris et dans toute la France! Des esclaves viendraient river nos fers! Et si les paysans russes voulaient un jour devenir des hommes, une armée française irait les égorger chez eux! Si les janissaires faisaient tomber la tête du Grand-Seigneur, une croisade de toute l'Europe irait venger cet assassinat! Le roi très-chrétien s'engagerait à maintenir en Prusse la religion de Luther! Si une bulle du pape était rejetée en France par l'opinion, contre le vœu du roi, un prince de Prusse viendrait la publier à la tête d'une armée de luthériens! Une armée ottomane irait soutenir l'inquisition en Espagne!
Je n'en dirai pas davantage pour prouver le ridicule d'une pareille association; d'ailleurs, dans cette hypothèse, les souverains n'observeraient pas plus fidèlement leurs traités qu'ils ne l'ont fait jusqu'à ce jour.
§. XIII.
Quelle conduite devrait tenir la France si l'Angleterre ne voulait pas consentir à l'établissement de la confédération.
Cependant, quels que soient les évènemens, la France ne doit pas s'allier à l'Angleterre? si elle n'est admise au partage du commerce et des colonies; et ce n'est point par dos traités ordinaires qu'elle peut en avoir la garantie, ce n'est que par l'établissement d'une confédération de peuples libres. Sans cela, l'Angleterre, suivant sa politique trompeuse, pourrait se servir des armes de la France contre les autres puissances du continent, et refuser de tenir ses promesses si son intérêt le lui conseillait; car quel moyen aurait-on de l'y contraindre? Elle est isolée, hors d'atteinte; elle a des forces de mer supérieures à celles du monde entier. Le faible ne peut avoir de garantie contre le fort, quand il n'est pas appuyé par une puissance intermédiaire chargée de faire observer la justice.
Mais si l'Angleterre, ne voulant pas consentir à l'établissement de la confédération, vient à avoir la guerre sur le continent, quel parti doit prendre alors la France?
Elle doit ménager avec la plus grande attention les parties belligérantes, sans prendre part à leurs querelles, travailler à restaurer ses finances, munir ses arsenaux, garnir ses places fortes, établir un mode de recrutement favorable à la formation d'une armée nationale, préparer des forces imposantes, et attendre l'occasion favorable pour entrer en lice. Mais ce qui lui importe le plus, c'est de rallier tous les partis et de former un esprit public.
Mais pourquoi sommes-nous divisés, pourquoi n'avons-nous pas d'esprit public? Les ministres doivent le savoir mieux que nous. Il faut avoir émigré pour avoir suivi la ligne droite; c'est-à-dire, que les émigrés seuls ont fait leur devoir, et que dans le reste de la nation il ne se trouve que des séditieux. La liberté de la presse mettait au jour des vérités importantes: on établit la censure; et pour prouver qu'elle est dans l'esprit de l'ordonnance de réformation, on nous dit que prévenir et réprimer sont synonymes. Pouvait-on pousser à ce point le mépris et l'injure? Le gouvernement de Napoléon, était détesté à cause de son despotisme; mais ce qu'il faisait par violence, on l'a fait, depuis sa chute, par adresse. Il serait trop long de rapporter ici tous les actes du ministère qui ont choqué l'opinion; ils sont si nombreux, qu'il faudrait être aveugle pour ne pas s'apercevoir qu'on nous ramène à la monarchie absolue, et qu'on fait le procès à la révolution, c'est-à-dire, à la masse de la nation qui l'a faite; car elle n'est pas, comme on veut le faire croire, l'ouvrage d'une poignée de factieux. Ne serait-ce que quelques factieux qui auraient vaincu toute l'Europe armée contre la liberté de la France? Toute la noblesse française aurait donc lâchement fui devant quelques séditieux, en abandonnant le roi; et elle serait allée, outre Rhin, se joindre à des prussiens et à des allemands pour venir avec eux soumettre une poignée de mutins.
Mais j'en ai dit assez. Pour faire cesser le mal, il faut en détruire la cause. Que les ministres la recherchent, qu'ils consultent l'opinion publique, et qu'ils la suivent; alors le mal sera bientôt réparé; et les Français unis ne formeront plus qu'une même famille, dont le roi sera aimé comme un bon père qui traite bien tous ses enfans, sans aucune distinction; car les préférences marquées divisent l'état comme elles divisent les familles.
La France réunie sous les Bourbons et guidée par la vraie politique, celle qui tend à rapprocher les peuples et à les rendre heureux, pourrait encore prétendra un jour à la gloire immortelle de se mettre à la tête de la confédération européenne, qui seule peut entretenir la paix et préparer la civilisation de tout Je globe.
§. XIV.
Conclusion.
J'ai fait connaître la cause des guerres qui désolent l'Europe depuis tant de siècles; j'ai démontré qu'elle existe dans la forme de nos gouvernemens et dans l'autorité absolue des rois; qu'elle provient de l'état de nature dans lequel sont encore placés les peuples, qui n'ont entr'eux aucune règle de justice,et dont les différons se vident par la violence et la force.
Cet état ne peut changer que par la réforme des gouvernemens et par un grand plan de civilisation qui tienne les nations réunies; et il n'y a qu'une confédération européenne qui puisse atteindre ce but. Cet établissement merveilleux et bienfaisant qui maintiendrait le bonheur et la paix parmi les peuples, et qui répandrait promptement la civilisation sur tout le globe, doit rencontrer l'opposition de tous les souverains. Comment peut-on espérer que leur volonté arbitraire et orgueilleuse se soumette au joug de la justice et de la législation?
Si Napoléon, enfant de la révolution française, n'avait pas été entraîné par son ambition, s'il avait connu ses véritables intérêts, s'il avait été humain, il aurait régénéré l'Europe et soumis les nations à la grande civilisation qu'elles doivent atteindre un jour, mais qui probablement ne sera enfantée que par la misère et le désespoir des peuples.
On n'ose se flatter que l'Angleterre, qui est la seule capable d'opérer ce grand œuvre, veuille renoncer à son égoïsme, à sa fausse politique, et à l'avantage que lui donne, en quelque sorte, sa position de pouvoir être injuste impunément, pour partager avec d'autres peuples ce qu'on ne peut espérer de lui arracher. Préparons-nous donc à des nouvelles guerres; ne soyons pas effrayés des évènemens malheureux que l'avenir nous laisse entrevoir, puisqu'il est décidé qu'il n'y a de remède que dans l'excès de la misère et du désespoir.
Que les écrivains du siècle s'attachent à répandre dans l'opinion les idées qui doivent un jour réunir les peuples de l'Europe, et qu'ils leur montrent le port où ils seront en sûreté lorsqu'un vent favorable leur permettra de s'y réfugier.
8.Dunoyer on “Revolutions and Revolutionaries” (1815)↩
Word length: 3,980]
Source
Le Censeur, ou examen des actes et des ouvrages qui tendent à détruire ou à consolider la constitution de l'état. Par MM. Comte et Dunoyer, avocats. Tome troisième. (Paris: Marchant, 1815). D…..R (Dunoyer), "Des Révolutions en général, et des révolutionnaires actuel," pp. 42-65.
DES RÉVOLUTIONS EN GÉNÉRAL, ET DES RÉVOLUTIONNAIRES ACTUELS
Il est pour les peuples deux situations extrêmes qui semblent également déplorables; l'une est celle d'un peuple absolument stationnaire; l'autre, celle d'un peuple tout-à-fait en révolution. L'immobilité du premier est ordinairement un signe certain qu'il est retenu dans les chaînes du despotisme et de la superstition. Les mouvemens convulsifs du second indiquent assez qu'il est livré à tous les désordres de l'anarchie. Le premier a des mœurs fixes et une physionomie qui lui est propre; mais il se mêle ordinairement à ses mœurs beaucoup de préjugés funestes, et sa physionomie offre toujours quelques traits grossiers ou bizarres. Le second n'a point de préjugés; mais il n'a pas même de mœurs, et son caractère n'offre rien de solide. L'un tient fortement à ses usages les plus puérils, à ses pratiques les plus superstitieuses; l'autre ne tient pas même aux maximes les plus fondamentales de l'ordre social; l'un est aveuglément entraîné par l'habitude; l'autre ne cède qu'au mouvement déréglé de ses passions. Tous deux, au reste, sont excessivement misérables, et souvent l'on ne saurait dire quel est le plus digne de pitié.
Le parallèle que nous venons de tracer indique déjà ce qu'il faut penser des révolutions. On voit qu'un peuple peut se trouver aussi à plaindre dans un état absolu de repos qu'au sein d'une anarchie complète. Ces deux situations ont même entr'elles une grande analogie, et les révolutions extrêmes sont une suite assez naturelle de l'extrême servitude. Si jamais il se fait une révolution dans les gouvernement de l'Asie, il est assez probable qu'elle s'opérera avec une grande violence et qu'elle bouleversera tout.
Il n'est pour les peuples qu'un moyen de prévenir les grandes révolutions; c'est de se placer, en quelque sorte, dans un état de révolution permanent et sagement réglé; il n'est pour eux qu'un état de repos véritablement sûr et heureux, c'est celui auquel se mêle une grande et utile activité. Cette proposition a besoin d'être expliquée et réduite à ses justes termes.
Tous les êtres animés naissent avec le désir d'être heureux, et les facultés propres à satisfaire ce désir conservateur de leur existence. Ces facultés, dans tous les animaux, autres que l'homme, dirigées par un instinct sûr, presque à l'instant où ils reçoivent la vie, acquièrent rapidement toute la perfection dont elles sont susceptibles. Dans l'homme, au contraire, ces mêmes facultés se développent lentement et avec peine; mais elles sont susceptibles d'une perfection indéfinie; et comme de nouveaux besoins succèdent sans cesse aux jouissances nouvelles qu'elles procurent, l'homme est constamment sollicité à les exercer, à les étendre, à les fortifier, et il est ainsi conduit par l'attrait du bonheur auquel il ne cesse d'aspirer, à toute la perfection dont il est susceptible.
Ces besoins toujours renaissans de l'homme et cette aptitude à perfectionner les facultés. qu'il a reçues du ciel pour les satisfaire, doivent nécessairement entretenir un grand mouvement dans ses idées, faire naître des changemens continuels dans ses goûts, dans ses mœurs, dans ses connaissances; et l'on peut dire que, par sa nature, l'homme est entraîné dans d'éternelles révolutions.
L'objet des institutions sociales est de le placer dans un état où ces révolutions, auxquelles il est poussé par ses besoins, s'opèrent sûrement et sans secousses; dans un état où ses facultés puissent s'exercer, se déveloper et le conduire, par degré, à tout le bonheur et à toute la perfection dont il est capable. Malheureusement cette tâche est loin d'être aisée à remplir; et les lois destinées à régler la conduite de l'homme et à prévenir ces révolutions violentes dans lesquelles l'usage mal réglé de ses facultés pourrait le jeter, sont elles-mêmes sujettes à de continuelles et d'inévitables révolutions. Tout ce que la sagesse des gouvernement peut faire à cet égard, c'est encore de diriger ces révolutions de manière qu'elles s'opèrent lentement et avec le plus de fruit et le moins de violence possibles.
Or, deux conditions semblent indispensables pour cela. La première, c'est que les institutions sociales soient toujours dirigées au bien-être et à la perfection des peuples pour qui elles sont faites; et la seconde, que les gouvernemens sachent observer et suivie l'impulsion qu'elles impriment à l'esprit humain, et en corriger les défauts à mesure que l'expérience les découvre, ou qu'ils naissent des progrès du temps et des lumières. Toutefois, leur plus grand soin doit être d'apporter dans ces changemens une circonspection et des ménagemens extrêmes; car s'il est un moyen de prévenir les révolutions violentes, C'est sans doute de maintenir la sainte autorité des lois; et rien n'est plus dangereux, en voulant les corriger, que d'en affaiblir l'empire.
Malheureusement tel a rarement été le but et la marche des gouvernemens. On ne peut disconvenir qu'ils n'aient trop souvent méconnu la nature de l'homme et sa noble destination. La plupart semblent avoir considéré les peuples comme des instrumens placés dans leurs mains pour les appliquer aux fins que leur indiquaient leurs passions ou leurs caprices; et les lois qu'ils leur ont données n'ont eu souvent pour objet que de les rendre propres à ces fins particulières, presque toujours opposées à leurs véritables intérêts. Ce n'est pas tout; après avoir donné aux peuples des institutions contraires à leur bonheur, ils ont voulu que ces institutions fussent éternelles; après avoir méconnu l'intérêt des peuples, ils ont aussi méconnu la perfectibilité de l'esprit humain, et ils n'ont voulu tenir aucun compte du progrès des lumières. Ils ont défendu des institutions détestables dans leur principe, avec une ardeur et une opiniâtreté qu'on ne devrait pas mettre à défendre des institutions excellentes par leur objet, mais dont la marche du temps on des circonstances particulières auraient rendu l'utilité douteuse. Ou plutôt après avoir désavoué la raison, dans l'origine, ils n'ont pas pu la reconnaître dans ses progrès, et plus leurs lois avaient d'abord été contraires au but qu'elles auraient dû avoir, plus ils ont dû faire d'efforts pour les mettre à l'abri de toute espèce d'innovation et de réforme. Il a fallu pour cela qu'ils les environnassent d'illusions et de prestiges; et la politique a été une seconde religion, qui a eu ses dogmes, ses mystères, ses articles de foi. Ce n'était pas assez encore; comme des hommes plus éclairés et plus hardis que les autres, pouvaient arracher à certaines institutions le masque religieux dont on les avait affublées pour les rendre sacrées aux yeux des hommes, il a fallu prendre des précautions contre ce qu'ils étaient capables de tenter, et de-là l'inquisition et la censure, institutions monstrueuses, créées dans des temps de violence et de barbarie, pour arrêter les progrès des lumières, ou pour leur donner une direction conforme aux vues particulières des gouvernemens, vues trop souvent contraires aux véritables intérêts des peuples et au perfectionnement de leurs facultés. On sait tous les obstacles que ces institutions ont mis aux progrès des sciences, et la fausse direction qui a été donnée à l'esprit humain sous leur fatale influence. Les erreurs se sont tellement multipliées, elles ont jeté un si affreux désordre dans les idées des hommes, qu'une ignorance profonde eût été mille fois préférable aux fausses connaissances qu'ils avaient acquises, et aurait rendu peut-être moins difficile et moins tardive la découverte des bonnes méthodes et la naissance des véritables sciences.
Cependant tous ces obstacles n'ont pas pu arrêter la marche naturelle de l'esprit humain. Il est parvenu à rompre les barrières élevées par le despotisme et la superstition entre lui et la vérité. Il s'est avancé au milieu des bûchers de l'inquisition et des lazarets de la censure. Alors, à côté des doctrines menteuses, inventées par les gouvernemens pour enchaîner les peuples, il s'est formé des doctrines nouvelles enseignées par la raison et l'expérience, et destinées à placer l'homme dans un état de choses où ses facultés pussent se développer sans effort et sans péril. L'opinion des peuples s'est ralliée insensiblement à cet ordre d'idées; et comme les gouvernemens ont voulu en arrêter la marche au lieu de la diriger et de la suivre, il s'est établi entre eux et l'opinion de tous les hommes éclairés une lutte secrète qui a fini par produire un éclat terrible et d'effroyables déchiremens.
Nous ne nous proposons pas de signaler ici toutes les révolutions violentes qui sont nées, dans divers gouvernemens, des vices de leur constitution, et de la résistance qu'ils ont opposée à des réformes commandées par les progrès des lumières. Nous nous contenterons de dire que telle a été la cause de nos derniers orages politiques. On sait comment la révolution française avait été préparée; comment les anciennes institutions étaient insensiblement tombées dans le mépris, et comment, n'ayant plus aucun appui dans l'opinion des peuples, et n'étant défendues que par l'orgueil et la cupidité de quelques hommes, seuls intéressés à les maintenir, elles ont été renversées avec leurs défenseurs. On sait aussi comment s'était formée la puissance d'opinion qui les a détruites, et à quelles causes reculées se rattache le nouvel ordre d'idées politiques qui gouvernent aujourd'hui la France et l'Europe. Il faut remonter jusqu'à l'invention de la poudre et de l'imprimerie, jusqu'à la découvert de l'Amérique et à la réformation de Luther, pour trouver les causes premières de cette révolution dont le mouvement n'a pu être suspendu depuis. Si elle a produit des secousses violentes, affaibli la morale des peuples, renversé ou ébranlé des trônes, et fait commettre de grands crimes, il ne faut peut-être accuser de ces malheurs que l'orgueil; l'imprévoyance ou la perfidie des gouvernemens qui, au lieu de se rapprocher sagement de ses principes, d'entrer dans les voies de justice et d'humanité qu'elle avait ouvertes, de l'y retenir et de l'y conduire avec prudence et fermeté, ont d'abord fait servir tout ce qu'ils avaient de force et de ruse à arrêter sa marche, et lorsqu'ils ont désespéré de pouvoir s'en rendre maîtres, l'ont précipitée dans tous les écarts qui pouvaient la déshonorer et la rendre odieuse.
Mais il ne faut pas accuser la révolution des crimes de ses ennemis. On ne peut pas plus lui reprocher leurs fureurs qu'on ne peut imputer à la religion les massacres de la St.Barthélemy, et tous les excès auxquels le fanatisme et l'ignorance l'ont fait servir de prétexte. Les nobles et généreux principes de cette révolution n'ont pu être ni déshorés par la démagogie la plus effrénée, ni étouffés par le despotisme le plus violent. Ils ont également triomphé des royalistes et des jacobins, des Robespierre et des Bonaparte; et ils sont tellement établis dans l'esprit des peuples de l'Europe, qu'il faudrait, pour les détruire ou pour suspendre leur influence, exterminer des générations entières. La force et la justice de ces principes est aujourd'hui si généralement reconnue, que tout ce qu'il y a en Europe de princes sages et éclairés sentent la nécessité de céder à leur ascendant, et de consacrer ces maximes contre lesquelles ils s'étaient vainement ligués. Il y a trente ans que le gouvernement français aurait fait brûler par la main du bourreau un livre dans lequel on aurait osé professer les principes de liberté, d'égalité et de tolérance religieuse que consacre la charte constitutionnelle.
L'Europe devra bientôt à la révolution française de l'avoir placée dans la situation la plus propre à prévenir désormais toute révolution violente. C'est une vérité qui doit infailliblement résulter de l'établissement du système représentatif, dans le gouvernement des états qui la composent. Le lecteur verra, dans l'article qui suit immédiatement celui-ci,25 avec quelle justesse ce système s'adapte à l'étendue des lumières des peuples modernes, et à la faiblesse de leurs mœurs; comment il les fait jouir du seul genre de liberté dont ils soient jaloux et qu'ils soient capables de supporter; comment, en un mot, étant essentiellement dirigé à leur bonheur et au perfectionnement de leurs facultés, et possédant en lui-même le moyen de mettre toujours les lois en harmonie avec l'état actuel de leurs besoins et de leurs lumières, il offre au plus haut degré les deux qualités nécessaires pour prévenir les grandes révolutions. Il ne manque à ce système, pour opérer tout le bien que les peuples de l'Europe peuvent en attendre, que de passer de leurs chartes et de leurs livres dans leurs habitudes. A la vérité, il n'est point combattu par elles, mais il n'est pas non plus soutenu par elles; si elles ne lui opposent point de résistance, elles ne lui offrent qu'un faible appui: les mœurs de presque tous les peuples de l'Europe sont nulles aujourd'hui; celles qui soutenaient l'ancien ordre de choses n'existent plus; celles qui pourraient protéger les institutions nouvelles n'existent point encore; elles ne peuvent être l'ouvrage que de ces institutions elles-mêmes; et pour que ces institutions fassent naître les mœurs qui pourraient les défendre, il faut qu'elles soient religieusement maintenues. Or, il existe en France, et dans plusieurs autres états de l'Europe, un parti dont tous les efforts tendent à empêcher que les institutions nouvelles ne s'établissent.
Les révolutions qui s'opèrent dans les lois des peuples, ne sont pas toujours une suite du progrès des lumières. Elles sont plus souvent encore l'ouvrage de la violence, de l'orgueil et de l'ambition. Telles sont celles qui naissent de la conquête, lorsque le vainqueur fait recevoir ses lois au vaincu; telles sont encore celles qui peuvent être opérées an sein d'un état par quelque faction puissante qui veut renverser l'ordre établi et changer la forme du gouvernement.
Notre histoire, depuis vingt-deux ans, a offert plusieurs exemples mémorables de ce dernier genre de révolutions: telle fut celle qui substitua la république à la monarchie, et celle qui substitua le consulat à la république. Elle offre aussi plusieurs exemples de projets de révolution de la même nature: tel fut celui que forma la faction de Coblentz, de rétablir la monarchie absolue, si toutefois cette faction eût véritablement quelque projet et ne fût pas l'aveugle et déplorable instrument des ennemis de la France: tel fut ensuite celui des vendéens; et tel est aujourd'hui celui qu'on peut supposer à certains hommes de vouloir rétablir l'ancien ordre de choses.
On chercherait vainement à se dissimuler les intentions de ces mêmes hommes. Il n'est pas possible de douter qu'ils n'aient été et qu'ils ne soient toujours préoccupés de l'idée de faire revivre des institutions dès long-temps détruites. Il semble, à la vérité, que l'extravagance de ce dessein et la masse effrayante d'intérêts et d'opinions qu'il faudrait détruire pour l'exécuter, nous garantissent suffisamment qu'on n'en tentera pas l'exécution. Il est vrai de dire aussi que les fauteurs de ce projet n'ont encore osé faire aucune démonstration éclatante. Enfin, on sait bien qu'ils ne feraient impunément aucune tentative trop hardie. Mais on sait aussi que leur orgueil se nourrit des pensées les plus folles, et que leur étourderie et leur profonde ignorance ne leur permettent pas de voir le danger qu'il y aurait pour eux à vouloir les réaliser. Enfin, ce qui est bien constant, c'est ce concours d'actes ministériels qui tendent tous, d'une manière plus ou moins immédiate, à renverser la constitution; et cette persévérance des journaux du ministère à professer des principes contraires aux idées constitutionnelles.
Cependant quelques personnes ne veulent voir dans cette réunion de circonstances aucun juste sujet de crainte, et semblent croire qu'on ne doit s'inquiéter ni des actes arbitraires des ministres ni des principes séditieux de certains de leurs journaux. Que nous importent, disent-elles, les déclamations de ces journaux, si le mépris public en fait justice? Pourquoi tant nous alarmer des usurpations des ministres, s'ils ne peuvent se maintenir dans ces usurpations, et des progrès de leur autorité si leur puissance réelle diminue? Combien de fois déjà n'ont-ils pas été forcés de reculer? Ont-ils pu faire exécuter leur ordonnance sur l'observation des jours fériés? N'ont-ils pas été obligés de faire rapporter celle relative aux orphelines de la légion d'honneur et celle concernant les écoles militaires? Enfin, loin d'ajouter au pouvoir du roi, par tous leurs empiétemens, n'est-il pas vrai de dire qu'ils l'ont affaibli? Les chambres n'ont-elles pas laissé voir qu'elles étaient véritablement maîtresses, et la force n'est-elle pas du côté de l'opposition? Les entreprises des ministres nous inspirent de l'humeur et des craintes; elles ne devraient exciter que notre pitié.
Il nous semble que toutes ces considérations ne présentent rien de fort rassurant. Il est vrai que les ministres ont été plusieurs fois obligés de revenir sur leurs pas; et l'on ne saurait douter que les inquiétudes et le mécontentement qu'ils sont parvenus à exciter par leur administration irrégulière, n'aient beaucoup affaibli, depuis six mois, la puissance royale. Mais est-ce donc là un grand motif de sécurité, et peut-on se tranquilliser sur les atteintes qu'on porte à la constitution, parce qu'elles tendent à affaiblir le respect qu'on doit au roi, et le juste pouvoir dont il est nécessaire qu'il jouisse pour l'exacte et prompte exécution des lois? N'est-ce pas là, au contraire, un grave désordre de plus, et un chef capital d'accusation contre les ministres? Nous ne savons pas si la puissance des chambres s'est accrue de toute celle qu'ils ont fait perdre au roi; mais si le pouvoir réside en elles, il faut convenir qu'elles le tiennent bien caché; et il serait fort difficile de dire quand elles ont prouvé qu'elles étaient maîtresses. A la vérité, la chambre des députés s'est une fois permis de censurer le rapport fait par un ministre; mais elle s'est tellement repentie de cet acte de fermeté, qu'elle a permis ensuite à plusieurs de ses membres, et notamment à M. Lainé, de dire des choses beaucoup plus répréhensibles que celles qu'elle avait blâmées dans le discours du ministre, et qu'elle a fini par accorder plus qu'on ne lui avait demandé. Il est, au reste, de notoriété publique que les chambres ont fait jusqu'ici presque tout ce que les ministres ont voulu, et il serait difficile de voir dans cette extrême complaisance, la preuve du pouvoir qu'on leur attribue.
La puissance du roi s'est donc énervée sans que celle des chambres en soit plus affermie. La force, dit-on, est du côté de l'opposition: de quelle opposition entend-on parler? de celle des chambres? On vient de voir qu'elle est presque nulle, au moins dans ses résultats. Veut-on parler de celle de l'opinion publique? On ne peut, il est vrai, méconnaître son influence; les effets parlent, et l'on ne saurait trop se réjouir des vœux que la nation fait éclater pour le maintien des lois qui garantissent son indépendance, et de la sage résistance qu'elle a opposée à certains actes inconstitutionnels des ministres. Mais malheureusement l'habitude de l'arbitraire que nos gouvernemens nous ont fait contracter, et le peu de connaissance que nous avons de nos lois, fait que nous laissons passer, sans opposition, beaucoup d'actes contre lesquels la résistance serait non-seulement un droit, mais un devoir. Aussi les ministres, malgré les pas rétrogrades qu'ils ont plusieurs fois été contraints de faire, suivent-ils constamment la même marche; et si l'heureuse disposition des esprits peut nous inspirer quelque sécurité, la persévérance du ministère dans ses entreprises contre la constitution est faite pour exciter les plus justes alarmes.
Mais où sont, dira-t-on, les preuves de cette coupable persévérance, et comment oser douter du respect que les ministres portent à la constitution, après l'hommage éclatant qui lui a dernièrement été rendu dans leurs journaux, après qu'un écrivais aussi ministériel que M. de Châteaubriant en a pris hautement la défense, et que son ouvrage a excité parmi les journalistes du ministère des applaudissemens universels? Ces démonstrations officielles seraient sans doute fort rassurantes, si elles avaient été préparées par quelques actes d'une administration franchement constitutionnelle, et si elles offraient la preuve certaine d'un changement de principes dans la conduite des ministres; mais quelle confiance peut-on avoir dans la sincérité d'une pareille profession de foi, quand elle est démentie par ce qu'on a fait et par ce qu'on fait encore? Comment se persuader qu'on a véritablement l'intention d'observer la charte, quand, dans le temps où on lui rend hommage, on présente aux chambres des projets de lois tels que celui contre la cour de cassation; quand, en même temps, on néglige d'assurer l'inamovibilité des juges, et qu'on retient ainsi indéfiniment tous les tribunaux du royaume sous la main du gouvernement par la menace toujours active d'une épuration? quand, dans le temps où le gouvernement met tant de zèle à faire faire les lois dont il a besoin, il met tant de lenteur à faire porter celles que réclame l'intérêt de la nation et le maintien de la charte? quand, après s'être tant hâté d'enchaîner la liberté de la presse, on laisse passer six mois sans avoir assuré la responsabilité des ministres? quand on ne statue rien sur la liberté civile, ni sur la formation des colléges électoraux? quand on continue à faire prêter serment au roi et non à la constitution, aux édits et ordonnances, et non aux lois de l'état? quand on continue à distinguer les Français par des dénominations de parti; et que, selon les passions du moment, on fait, de certaines, des titres d'honneur, et d'autres, des titres de proscription? quand on élève à des Français, morts pour leurs privilèges, des monumens qui outragent la mémoire de Français morts pour la patrie?26 quand on continue à manifester le dessein d'expulser des charges publiques tous les hommes qui ont pris part à la révolution et qui ne l'ont point combattue, quels que soient d'ailleurs et leur mérite et les services qu'ils ont rendus à l'état? Que signifie à côté de pareils actes, qui sont des actes du moment, un stérile et tardif hommage rendu à la constitution? Que peuvent de vains discours contre une semblable réunion de faits, et comment pourraient-ils détruire les justes inquiétudes que ces faits sont de nature à inspirer?
Nous avons déjà fait connaître ailleurs la tactique du parti qu'on peut accuser de vouloir opérer un changement dans nos institutions nouvelles. Pour affaiblir, autant qu'il est en lui, les soupçons que sa conduite imprudente ne cesse d'éveiller, aussitôt qu'on parle de ses projets de révolution, il crie, aux jacobins, aux démagogues, et les défenseurs de la constitution sont traités de révolutionnaires et de désorganisateurs par des factieux qui veulent la détruire. Nous espérons qu'à l'avenir ce manège impudent et grossier n'eu imposera plus à personne, et que cet article ne laissera pas de doute sur la manière dont il convient d'entendre le mot révolutionnaire et d'en faire l'application. Les personnes attachées à nos nouvelles lois sont révolutionnaires, si l'on veut, dans ce sens que ces lois sont une suite de la révolution et en consacrent tous les bons principes. Ils sont aussi révolutionnaires dans ce sens, qu'ils pensent qu'on pourra, dans la suite, corriger ces mêmes lois pour en faire disparaître les défauts qu'une longue expérience y aurait fait découvrir, ou ceux qui seraient nés des progrès du temps. Mais ces révolutionnaires-là sont très-honorables et ne peuvent mériter que des éloges; tandis que les ennemis de la constitution, les hommes qui travaillent à l'affaiblir et à la détruire, et tous ceux qui voudraient renverser l'ordre établi, sont des révolutionnaires qui méritent d'être voués à l'exécration des gens de bien, de véritables factieux dignes des plus rigoureux châtimens. Nous ne devons pas craindre sans doute que ces hommes parviennent jamais à asservir la France; d'assez fortes et d'assez nombreuses considérations peuvent nous tranquilliser à cet égard: mais ils peuvent empêcher que les lois ne s'établissent, que les mœurs ne renaissent, et avec elles l'ordre et la tranquillité. Ils peuvent entretenir l'état d'incertitude, d'agitation et d'anxiété dans lequel la nation languit depuis plusieurs mois, et finir peut-être par provoquer de nouvelles crises; nous ne serons, en effet, véritablement à l'abri de toute révolution violente, que lorsque le gouvernement aura fait cesser cet état inquiétant, en se ralliant de bonne foi à ses propres institutions, et en travaillant sincèrement a l'affermissement de son ouvrage.
9.Constant on "Individual Liberty and Arbitrary Government" (1815)↩
Word Count: 3,532]
Source
Benjamin Constant, Principes de politique, applicables à tous les gouvernemens représentatifs et particulièrement a la constitution actuelle de la France (Paris: A. Eymery, Mai 1815). Chapitre XVIII, De la liberté individuelle," pp. 286-299. Chapitre XX. "Dernières Considérations," pp. 315-321.
CHAPITRE XVIII. De la Liberté individuelle.
Toutes les constitutions qui ont été données à la France garantissaient également la liberté individuelle, et sous l'empire de ces constitutions, la liberté individuelle a été violée sans cesse. C'est qu'une simple déclaration ne suffit pas; il faut des sauve-gardes positives; il faut des corps assez puissans pour employer en faveur des opprimés les moyens de défense que la loi écrite consacre. Notre constitution actuelle est la seule qui ait créé ces sauve-gardes et investi d'assez de puissance les corps intermédiaires. La liberté de la presse placée au-dessus de toute atteinte, graces au jugement par jurés; la responsabilité des Ministres, et sur-tout celle de leurs agens inférieurs; enfin l'existence d'une représentation nombreuse et indépendante, tels sont les boulevards dont la liberté individuelle est aujourd'hui entourée.
Cette liberté en effet est le but de toute association humaine; sur elle s'appuie la morale publique et privée: sur elle reposent les calculs de l'industrie; sans elle il n'y a pour les hommes ni paix, ni dignité, ni bonheur.
L'arbitraire détruit la morale: car il n'y a point de morale sans sécurité, il n'y a point d'affections douces sans la certitude que les objets de ces affections reposent à l'abri sous l'égide de leur innocence. Lorsque l'arbitraire frappe sans scrupule les hommes qui lui sont suspects, ce n'est pas seulement un individu qu'il persécute, c'est la nation entière qu'il indigne d'abord et qu'il dégrade ensuite. Les hommes tendent toujours à s'affranchir de la douleur; quand ce qu'ils aiment est menacé, ils s'en détachent, ou le défendent. Les mœurs, dit M. de Paw, se corrompent subitement dans les villes attaquées de la peste; on s'y vole l'un l'autre en mourant: l'arbitraire est au moral ce que la peste est au physique.
Il est l'ennemi des liens domestiques; car la sanction des liens domestiques, c'est l'espoir fondé de vivre ensemble, de vivre libres, dans l'asile que la justice garantit aux citoyens. L'arbitraire force le fils à voir opprimer son père sans le défendre, l'épouse à supporter en silence la détention de son mari, les amis et les proches à désavouer les affections les plus saintes.
L'arbitraire est l'ennemi de toutes les transactions qui fondent la prospérité des peuples; il ébranle le crédit, anéantit le commerce, frappe toutes les sécurités. Lorsqu'un individu souffre sans avoir été reconnu coupable, tout ce qui n'est pas dépourvu d'intelligence se croit menacé, et avec raison; car la garantie est détruite, toutes les transactions s'en ressentent, la terre tremble, et l'on ne marche qu'avec effroi.
Quand l'arbitraire est toléré, il se dissémine de manière, que le citoyen le plus inconnu peut tout-à-coup le rencontrer armé contre lui. Il ne suffit pas de se tenir à l'écart et de laisser frapper les autres. Mille liens nous unissent à nos semblables, et l'égoïsme le plus inquiet ne parvient pas à les briser tous. Vous vous croyez invulnérable dans votre obscurité volontaire; mais vous avez un fils, la jeunesse l'entraîne; un frère moins prudent que vous se permet un murmure; un ancien ennemi qu'autrefois vous avez blessé, a su conquérir quelqu'influence. Que ferez-vous alors? après avoir avec amertume blamé toute réclamation, rejeté toute plainte, vous plaindrez-vous à votre tour? Vous êtes condamné d'avance, et par votre propre conscience, et par cette opinion publique avilie que vous avez contribué vous-même à former. Céderez-vous sans résistance? Mais vous permettra-t-on de céder? N'écartera-t-on pas, ne poursuivra-t-on point un objet importun, monument d'une injustice? Vous avez vu des opprimés. Vous les avez jugé coupables: vous avez donc frayé la route où vous marchez à votre tour.
L'arbitraire est incompatible avec l'existence d'un gouvernement considéré sous le rapport de son institution; car les institutions politiques ne sont que des contrats, la nature des contrats est de poser des bornes fixes; or l'arbitraire étant précisément l'opposé de ce qui constitue un contrat, sappe dans sa base toute institution politique.
L'arbitraire est dangereux pour un gouvernement considéré sous le rapport de son action; car, bien qu'en précipitant sa marche, il lui donne quelquefois l'air de la force, il ôte néanmoins toujours à son action la régularité et la durée.
En disant à un peuple, vos lois sont insuffisantes pour vous gouverner, l'on autorise ce peuple à répondre: si nos lois sont insuffisantes, nous voulons d'autres lois; et à ces mots, toute l'autorité légitime est remise en doute: il ne reste plus que la force; car ce serait aussi croire trop à la duperie des hommes, que de leur dire: Vous avez consenti à vous imposer telle ou telle gêne, pour vous assurer telle protection. Nous vous ôtons cette protection, mais nous vous laissons cette gêne; vous supporterez, d'un côté, toutes les entraves de l'état social, et de l'autre, vous serez exposés à tous les hasards de l'état sauvage.
L'arbitraire n'est d'aucun secours à un gouvernement, sous le rapport de sa sûreté. Ce qu'un gouvernement fait par la loi contre ses ennemis, ses ennemis ne peuvent le faire contre lui par la loi, car elle est précise et formelle; mais ce qu'il fait contre ses ennemis par l'arbitraire, ses ennemis peuvent aussi le faire contre lui par l'arbitraire; car l'arbitraire est vague et sans bornes.27
Quand un gouvernement régulier se permet l'emploi de l'arbitraire, il sacrifie le but de son existence aux mesures qu'il prend pour la conserver. Pourquoi veut-on que l'autorité réprime ceux qui attaqueraient nos propriétés, notre liberté ou notre vie? Pour que ces jouissances nous soient assurées. Mais si notre fortune peut être détruite, notre liberté menacée, notre vie troublée par l'arbitraire, quels biens retirons-nous de la protection de l'autorité? Pourquoi veut-on qu'elle punisse ceux qui conspireraient contre la constitution de l'état? parce que l'on craint de voir substituer une puissance oppressive à une organisation légale. Mais si l'autorité exerce elle-même cette puissance oppressive, quel avantage conserve-t-elle? un avantage de fait pendant quelque tems peut-être. Les mesures arbitraires d'un gouvernement consolidé sont toujours moins multipliées que celles des factions qui ont encore à établir leur puissance: mais cet avantage même se perd en raison de l'arbitraire. Ses moyens une fois admis, on les trouve tellement courts, tellement commodes, qu'on ne veut plus en employer d'autres. Présentés d'abord comme une ressource extrême dans des circonstances infiniment rares, l'arbitraire devient la solution de tous les problêmes et la pratique de chaque jour.
Ce qui préserve de l'arbitraire, c'est l'observance des formes. Les formes sont les divinités tutélaires des associations humaines; les formes sont les seules protectrices de l'innocence, les formes sont les seules relations des hommes entre eux. Tout est obscur d'ailleurs: tout est livré à la conscience solitaire, à l'opinion vacillante. Les formes seules sont en évidence, c'est aux formes seules que l'opprimé peut en appeler.
Ce qui remédie à l'arbitraire, c'est la responsabilité des agens. Les anciens croyaient que les lieux souillés par le crime devaient subir une expiation, et moi je crois qu'à l'avenir le sol flétri par un acte arbitraire aura besoin, pour être purifié, de la punition éclatante du coupable, et toutes les fois que je verrai chez un peuple un citoyen arbitrairement incarcéré, et que je ne verrai pas le prompt châtiment de cette violation des formes, je dirai: ce peuple peut désirer d'être libre, il peut mériter de l'être; mais il ne connaît pas encore les premiers élémens de la liberté.28
Plusieurs n'aperçoivent dans l'exercice de l'arbitraire qu'une mesure de police; et comme apparemment ils espèrent en être toujours les distributeurs, sans en être jamais les objets, ils la trouvent très-bien calculée pour le repos public et pour le bon ordre; d'autres plus ombrageux, n'y démêlent pourtant qu'une vexation particulière: mais le péril est bien plus grand.
Donnez aux dépositaires de l'autorité executive, la puissance d'attenter à la liberté individuelle, et vous anéantissez toutes les garanties, qui sont la condition première et le but unique de la réunion des hommes sous l'empire des lois.
Vous voulez l'indépendance des tribunaux, des juges et des jurés. Mais si les membres des tribunaux, les jurés et les juges pouvaient être arrêtés arbitrairement, que deviendrait leur indépendance? Or, qu'arriverait-il, si l'arbitraire était permis contre eux, non pour leur conduite publique, mais pour des causes secrètes? L'autorité ministérielle, sans doute, ne leur dicterait pas ses arrêts, lorsqu'ils seraient assis sur leurs bancs, dans l'enceinte inviolable en apparence où la loi les aurait placés. Elle n'oserait pas même, s'ils obéissaient à leur conscience, en dépit de ses volontés, les arrêter ou les exiler, comme jurés et comme juges. Mais elle les arrêterait, elle les exilerait, comme des individus suspects. Tout au plus attendrait-elle que le jugement qui ferait leur crime à ses yeux fût oublié, pour assigner quelque autre motif à la rigueur exercée contre eux. Ce ne seraient donc pas quelques citoyens obscurs que vous auriez livrés à l'arbitraire de la police; ce seraient tous les tribunaux, tous les juges, tous les jurés, tous les accusés, par conséquent, que vous mettriez à sa merci.
Dans un pays où des ministres disposeraient sans jugement des arrestations et des exils, en vain semblerait-on, pour l'intérêt des lumières, accorder quelque latitude ou quelque sécurité à la presse. Si un écrivain, tout en se conformant aux lois, heurtait les opinions ou censurait les actes de l'autorité, on ne l'arrêterait pas, on ne l'exilerait pas comme écrivain, on l'arrêterait, on l'exilerait comme un individu dangereux, sans en assigner la cause.
A quoi bon prolonger par des exemples le développement d'une vérité si manifeste? Toutes les fonctions publiques, toutes les situations privées, seraient menacées également. L'importun créancier qui aurait pour débiteur un agent du pouvoir, le père intraitable qui lui refuserait la main de sa fille, l'époux incommode qui défendrait contre lui la sagesse de sa femme, le concurrent dont le mérite, ou le surveillant dont la vigilance lui seraient des sujets d'alarme, ne se verraient point sans doute arrêtés ou exilés comme créanciers, comme pères, comme époux, comme surveillans ou comme rivaux,. Mais l'autorité pouvant les arrêter, pouvant les exiler pour des raisons secrètes, où serait la garantie qu'elle n'inventerait pas ces raisons secrètes? Que risquerait-elle? Il serait admis qu'on ne peut lui en demander un compte légal; et quant à l'explication que par prudence elle croirait peut-être devoir accorder à l'opinion, comme rien ne pourrait être approfondi ni vérifié, qui ne prévoit que la calomnie serait suffisante pour motiver la persécution?29
Rien n'est à l'abri de l'arbitraire, quand une fois il est toléré. Aucune institution ne lui échappe. Il les annulle toutes dans leur base. Il trompe la société par des formes qu'il rend impuissantes. Toutes les promesses deviennent des parjures, toutes les garanties des pièges pour les malheureux qui s'y confient.
Lorsqu'on excuse l'arbitraire, ou qu'on veut pallier ses dangers, on raisonne toujours, comme si les citoyens n'avaient de rapports qu'avec le dépositaire suprême de l'autorité. Mais on en a d'inévitables et de plus directs avec tous les agens secondaires. Quand vous permettez l'exil, l'emprisonnement, ou toute vexation qu'aucune loi n'autorise, qu'aucun jugement n'a précédée, ce n'est pas sous le pouvoir du monarque que vous placez les citoyens, ce n'est pas même sous le pouvoir des ministres: c'est sous la verge de l'autorité la plus subalterne. Elle peut les atteindre par une mesure provisoire, et justifier cette mesure par un récit mensonger. Elle triomphe pourvu qu'elle trompe, et la faculté de tromper lui est assurée. Car, autant le Prince et les Ministres sont heureusement placés pour diriger les affaires générales, et pour favoriser l'accroissement de la prospérité de l'état, de sa dignité, de sa richesse et de sa puissance, autant l'étendue même de ces fonctions importantes leur rend impossible l'examen détaillé des intérêts des individus; intérêts minutieux et imperceptibles, quand on les compare à l'ensemble, et non moins sacrés toutefois, puisqu'ils comprennent la vie, la liberté, la sécurité de l'innocence. Le soin de ces intérêts doit donc être remis à ceux qui peuvent s'en occuper, aux Tribunaux, chargés exclusivement de la recherche des griefs, de la vérification des plaintes, de l'investigation des délits; aux Tribunaux, qui ont le loisir, comme ils ont le devoir, de tout approfondir, de tout peser dans une balance exacte; aux Tribunaux, dont telle est la mission spéciale, et qui seuls peuvent la remplir.
Je ne sépare point dans mes réflexions les exils d'avec les arrestations et les emprisonnemens arbitraires. Car c'est à tort que l'on considère l'exil comme une peine plus douce. Nous sommes trompés par les traditions de l'ancienne monarchie. L'exil de quelques hommes distingués nous fait illusion. Notre mémoire nous retrace M. de Choiseuil, environné des hommages d'amis généreux, et l'exil nous semble une pompe triomphale. Mais descendons dans des rangs plus obscurs, et transportons-nous à d'autres époques. Nous verrons dans ces rangs obscurs l'exil arrachant le père à ses enfans, l'époux à sa femme, le commerçant à ses entreprises, forçant les parens à interrompre l'éducation de leur famille ou à la confier à des mains mercenaires, séparant les amis de leurs amis, troublant le vieillard dans ses habitudes, l'homme industrieux dans ses spéculations, le talent dans ses travaux. Nous verrons l'exil uni à la pauvreté; le dénuement poursuivant la victime sur une terre inconnue, les premiers besoins difficiles à satisfaire, les moindres jouissances impossibles. Nous verrons l'exil uni à la défaveur, entourant ceux qu'il frappe de soupçons et de défiances, les précipitant dans un atmosphère de proscription, les livrant tour à tour à la froideur du premier étranger, à l'insolence du dernier agent. Nous verrons l'exil, glaçant toutes les affections dans leur source, la fatigue enlevant à l'exilé l'ami qui le suivait, l'oubli lui disputant les autres amis dont le souvenir représentait à ses yeux sa patrie absente, l'égoïsme adoptant les accusations pour apologies de l'indifférence, et le proscrit délaissé s'efforçant en vain de retenir, au fond de son âme solitaire, quelque imparfait vestige de sa vie passée.
Le gouvernement actuel est le premier de tous les gouvernemens de France, qui ait renoncé formellement à cette prérogative terrible, dans la constitution qu'il a proposée.30 C'est en consacrant de la sorte tous les droits, toutes les libertés, c'est en assurant à la nation ce qu'elle voulait en 1789, ce qu'elle veut encore aujourd'hui, ce qu'elle demande, avec une persévérance imperturbable, depuis vingt-cinq ans, toutes les fois qu'elle ressaisit la faculté de se faire entendre; c'est ainsi que ce gouvernement jetera chaque jour, dans le cœur des Français, des racines plus profondes.
CHAPITRE XX. Dernières Considérations.
Nos représentans auront à s'occuper de plusieurs des questions dont je viens de traiter dans cet ouvrage. Le Gouvernement lui-même a pris soin d'annoncer, comme je l'ai dit en commençant, que la constitution pourra être améliorée. Il est à souhaiter qu'on y procède lentement, à loisir, sans impatience, et sans vouloir devancer le tems. Si cette constitution a des défauts, c'est une preuve que les hommes les mieux intentionnés ne prévoient pas toujours les conséquences de chaque article d'une constitution. La même chose pourrait arriver à ceux qui voudraient la refondre pour la corriger. Il est facile de rendre son habitation plus commode, lorsqu'on n'y fait que des changemens partiels: ils sont d'autant plus doux qu'ils sont presqu'insensibles; mais il est dangereux d'abattre son habitation pour la rebatir, surtout lorsqu'en attendant, on n'a point d'asile.
L'étranger nous contemple, il sait que nous sommes une nation forte. S'il nous voit profiter d'une constitution, fut-elle imparfaite, il verra que nous sommes une nation raisonnable, et notre raison sera pour lui plus imposante que notre force. L'étranger nous contemple, il sait qu'à notre tête marche le premier général du siècle. S'il nous voit ralliés autour de lui, il se croira vaincu d'avance: mais divisés, nous périssons.
On a beaucoup vanté la magnanimité de nos ennemis. Cette magnanimité ne les a pas empêchés de s'indemniser des frais de la guerre. Ils nous ont ravi la Belgique et le Rhin, qu'une possession longue et des traités solemnels avaient identifiés avec la France. Vainqueurs aujourd'hui, leur magnanimité les porterait à s'indemniser de nouveau. Ils nous prendraient la Franche-Comté, la Lorraine et l'Alsace. Pourquoi les proclamations de Bruxelles seraient-elles mieux observées que les proclamations de Francfort?
L'Empereur a donné de la sincérité de ses intentions le plus incontestable gage; il a rassemblé autour de lui six cents vingt-neuf représentans de la nation, librement élus, et sur le choix desquels le Gouvernement n'a pu exercer aucune influence. Au moment de cette réunion solemnelle, il exerçait la dictature. S'il n'eût voulu que le despotisme, il pouvait essayer de la garder.
Son intérêt s'y opposait, dira-t-on. Sans doute: mais n'est-ce pas dire que son intérêt est d'accord avec la liberté? Et n'est-ce pas une raison de confiance?
Il a le premier, depuis l'assemblée constituante, convoqué en entier une représentation toute nationale. Il a respecté, même avant que la constitution ne fut en vigueur, la liberté illimitée de la presse, dont les excès ne sont qu'un plus éclatant hommage à la fermeté de sa noble résolution. Il a restitué à une portion nombreuse du peuple le droit de choisir ses magistrats.
C'est qu'aussitôt qu'il a vu le but, il a discerné la route. Il a mieux conçu qu'aucun homme, que lorsqu'on adopte un systême, il faut l'adopter complètement; que la liberté doit être entière; qu'elle est la garantie, comme la limite du pouvoir; et le sentiment de sa force l'a mis au-dessus de ces arrières pensées, doubles et pusillanimes, qui séduisent les esprits étroits, et qui partagent les âmes faibles.
Ce sont des faits, et ces faits expliquent notre conduite, à nous qui nous sommes ralliés au gouvernement actuel, dans ce moment de crise, à nous, qui, restés étrangers au maître de la terre, nous sommes rangés autour du fondateur d'une constitution libre et du défenseur de là patrie.
Quand son arrivée retentit d'un bout de l'Europe à l'autre, nous voyions en lui le conquérant du monde, et nous désirions la liberté. Qui n'eut dit en effet qu'elle aurait meilleur marché de la timidité et de la faiblesse que d'une force immense et presque miraculeuse?
Je le crus, je l'avoue, et dans cet espoir, après être demeuré dix mois sans communications avec le gouvernement qui vient de tomber, après avoir été sans cesse en opposition avec ses mesures, sur la liberté de la presse, sur la responsabilité des ministres, sur l'obéissance passive, je me rapprochai de ses alentours, lorsqu'il s'écroulait. Je leur répétais sans cesse que c'était la liberté qu'il fallait sauver, et qu'eux-mêmes ne pouvaient se sauver que par la liberté. Tel est désormais le sort de tous les gouvememens de la France. Mais ces paroles impuissantes effarouchaient des oreilles peu accoutumées à les entendre.
Quelques mots de constitution furent prononcée; mais pas une mesure nationale ne fut prise, pas une démarche franche ne vint rassurer l'opinion flottante. Tout était chaos, stupeur, confusion. C'était à qui désespérerait de la cause et l'annoncerait comme désespérée. C'est que la liberté, le vrai moyen de salut, leur était odieuse.
Ce gouvernement s'est éloigné. Que devions-nous faire? Suivre un parti qui n'était pas le nôtre, que nous avions combattu, quand il avait l'apparence de la force, dont chaque intention, chaque pensée était l'opposé de nos opinions et de nos vœux, un parti que nous avions défendu durant quelques jours, seulement comme moyen, comme passage vers la liberté? Mais désormais le but de tous nos efforts était manqué. Est-ce une monarchie constitutionnelle que nous pouvons attendre de l'étranger? Non certes. C'est ou le partage de la France, ou une administration dépendante, docile exécutrice des ordres qu'elle recevrait de lui.
Quand Jacques II quitta l'Angleterre, les Anglais déclarèrent que sa fuite était une abdication: c'est depuis cette époque qu'ils sont libres.
Non. Je n'ai pas voulu me réunir à nos ennemis, et mendier le carnage des Français pour relever une seconde fois ce qui retomberait de nouveau.
S'efforcer de défendre un Gouvernement qui s'abandonne lui-même, ce n'est pas promettre de s'expatrier avec lui: donner une preuve de dévouement à la faiblesse sans espoir et sans ressource, ce n'est pas abjurer le sol de ses pères: affronter des périls pour une cause qu'on espère rendre bonne après l'avoir sauvée, ce n'est pas se vouer à cette cause, quand, toute pervertie et toute changée, elle prend l'étranger pour auxiliaire et pour moyen le massacre et l'incendie. Ne pas fuir enfin, ce n'est pas être transfuge. Sans doute, en se rendant ce solemnel témoignage, on éprouve encore des sentimens amers. L'on apprend, non sans étonnement et sans une peine que ne peut adoucir la nouveauté de la découverte, à quel point l'estime est un lourd fardeau pour les cœurs, et combien, quand on croit qu'un homme irréprochable a cessé de l'être, on est heureux de le condamner.
L'avenir répondra; car la liberté sortira de cet avenir, quelqu'orageux qu'il paraisse encore. Alors, après avoir pendant vingt ans, réclamé les droits de l'espèce humaine, la sûreté des individus, la liberté de la pensée, la garantie des propriétés, l'abolition de tout arbitraire, j'oserai me féliciter de m'être réuni, avant la victoire, aux institutions qui consacrent tous ces droits. J'aurai accompli l'ouvrage de ma vie.
PART II. The Restoration (1815–30)
10.Béranger’s “Conversation with the Censor” (1815)↩
[Word length: 1,882]
Source
Béranger lyrique. Oeuvres complètes de P.J. de Béranger. Nouvelle édition revue par l'auteur avec tous les airs notés. Cette édition est augmentée de dix chansons nouvelles et d'une lettre de Béranger (Bruxelles: Librairie encyclopédique de Perichon, 1850). "Préface. Novembre 1815," pp. i-v.
PRÉFACE. NOVEMBRE 1815.
Pourquoi les libraires ne cessent-ils de vouloir des préfaces, et pourquoi les lecteurs ont-ils cessé de les lire? On agite tous les jours, dans de graves assemblées, une foule de questions bien moins importantes que celle-ci; et je me propose de la résoudre dans un ouvrage en trois volumes in-8, qui, si l'on en permet la publication, pourra amener la réforme de plusieurs abus très-dangereux. Forcé, en attendant, de me conformer à l'usage, je me creusais la tête depuis un mois pour trouver le moyen de dire au public, qui ne s'en soucie guère, qu'ayant fait des chansons je prends le parti de les faire imprimer. Le Bourgeois Gentilhomme, embrouillant son compliment à la belle comtesse, est moins embarrassé que je ne l'étais. J'appelai mes amis à mon aide; et l'un d'eux, profond érudit, vint il y a quelques jours m'offrir, pour mettre en tête de mon recueil, une dissertation qu'il trouve excellente, et dans laquelle il prouve que les flonfilons, les fariradondê, les tourelouribo, et tant d'autres refrains qui ont eu le privilège de charmer nos pères, dérivent du grec et de l'hébreu. Quoique je sois ignorant comme un chansonnier, j'aime beaucoup les traits d'érudition. Enchanté de cette dissertation, je me préparais à en faire mon profit, ou plutôt celui du libraire, lorsqu'un autre de mes amis, car j'ai beaucoup d'amis (c'est ce qu'il est bon de consigner ici, attendu que les journaux pourront faire croire le contraire); lorsque, dis-je, un de mes amis, homme de plaisir et de bon sens, m'apporta d'un air empressé un chiffon de papier trouvé dans le fond d'un vieux secrétaire.
" C'est de l'écriture de Collé! me dit-il du plus loin qu'il m'aperçut. J'ai confronté ce fragment avec le manuscrit des Mémoires du premier de nos chansonniers, et je vous en garantis l'authenticité. Vous verrez en le lisant pourquoi il n'a pas trouvé a place dans ces Mémoires, qui ne contiennent pas toujours des choses aussi raisonnables. "
Je ne me le fis pas dire deux fois; et je lus avec la plus grande attention ce morceau, dont le fond des idées me séduisit tellement, que d'abord je ne m'aperçus pas que le style pouvait faire douter un peu que Collé en fût l'auteur.
Malgré toutes les observations de mon ami le savant, qui tenait à ce que j'adoptasse sa dissertation, je fis sur-le-champ le projet de me servir, pour ma préface, de ce legs que le hasard me procurait dans l'héritage d'un homme qui n'a laissé que des collatéraux.
Ceux qui trouveront ce petit dialogue indigne de Collé pourront s'en prendre à l'ami qui me l'a fourni, et qui m'a assuré devoir en déposer le manuscrit chez un notaire, pour le soumettre à la confrontation des incrédules. Ces précautions prises, je le transcris ici en toute sûreté de conscience.
CONVERSATION ENTRE MON CENSEUR ET MOI. 15 JANVIER 1768.
(Je prends la liberté de substituer le nom de Collé au moi qui se trouve dans tout le dialogue.)
LE CENSEUR.
Voici, monsieur, mon approbation pour votre Théâtre de Société. II contient des ouvrages charmants.
COLLÉ.
Et mes chansons, monsieur, mes chansons, comment les avez-vous traitées?
LE CENSEUR.
Vous me trouverez sévère. Mais je ne puis vous dissimuler que le choix ne m'en paraît pas sagement fait.
COLLÉ.
Connaîtriez-vous quelque bonne chanson que j'aurais omise?
LE CENSEUR.
J'ai été, au contraire, forcé d'indiquer la suppression d'un grand nombre.
COLLÉ, feuilletant son manuscrit.
Quoi, monsieur! vous exigez que je retranche....
(Ici le papier endommagé ne permet que de deviner le titre des chansons supprimées par le censeur.)
LE CENSEUR.
Vous n'avez pas dû penser que cela passerait à la censure.
COLLÉ.
Elles ont bien passé ailleurs.
LE CENSEUR.
Raison de plus.
COLLÉ.
Pardonnez; je ne connaissais pas bien encore les raisons d'un censeur.
LE CENSEUR.
Examinons avec sang-froid les deux genres de chansons qui m'ont contraint à la sévérité. D'abord, pourquoi, dans des vaudevilles, mêlez-vous toujours quelques traits de satire relatifs aux circonstances?
COLLÉ.
Que ne me demandez-vous plutôt pourquoi je fais des vaudevilles? La chanson est essentiellement du parti de l'opposition. D'ailleurs, en frondant quelques abus qui n'en seront pas moins éternels, en ridiculisant quelques personnages à qui l'on pourrait souhaiter de n'être que ridicules, ai-je insulté jamais à ce qui a droit au respect de tous? Le respect pour le souverain paraît-il me coûter?
LE CENSEUR.
Mais les ministres, monsieur, les ministres! Si à Naples l'on peut sans danger offenser la Divinité, il n'y fait pas bon pour ceux qui parlent mal de saint Janvier.
COLLÉ.
Je le conçois: à Naples saint Janvier passe pour faire des miracles.
LE CENSEUR.
Vous y seriez aussi incrédule qu'à Paris.
COLLÉ.
Dites aussi clairvoyant.
LE CENSEUR.
Tant pis pour vous, monsieur. Au fait, de quoi se mêlent les faiseurs de chansons? Vous en pouvez convenir avec moins de peine qu'un autre: les chansonniers sont en littérature ce que les ménétriers sont en musique.
COLLÉ.
Je l'ai dit cent fois avant vous. Mais convenez, à votre tour, qu'il en est quelques-uns qui ne jouent pas du violon pour tout le monde. Plusieurs ne seraient pas indignes de faire partie de la musique dont le grand Condé se servait pour ouvrir la tranchée,31 et tous deviennent utiles lorsqu'il s'agit de faire célébrer au peuple des triomphes dont sans eux fort souvent il ne sentirait que le poids.
LE CENSEUR.
Je n'ai point oublié la jolie chanson du Port-Mahon. Monsieur Collé, ce n'est pas à vous qu'on reprochera l'anglomanie; mais cela ne suffit pas. Pourquoi, par exemple, vous être fait l'apôtre de certains principes d'indépendance qu'il vaudrait mieux combattre?
COLLÉ.
J'entends de quelles idées vous voulez parler. Combattre ces idées, monsieur! il n'y aurait pas plus de mérite à cela qu'à faire en Prusse des épigrammes contre les capucins. Ne trouvez-vous pas même que la plupart de ceux qui attaquent ces idées, qui peut-être au fond sont les vôtres, ressemblent à des aveugles qui voudraient casser les réverbères?
LE CENSEUR.
Je suis de votre avis, si vous voulez dire qu'ils frappent à côté. Mais revenons à vos chansons. Tout le monde rend justice à la loyauté de votre caractère, à la régularité de vos mœurs; et je pense qu'il sera aisé de vous convaincre du tort que vous feraient certaines gaillardises que je vous engage à faire disparaître de votre recueil.
COLLÉ.
C'est parce que je ne crains point qu'on examine mes mœurs que je me suis permis de peindre celles du temps avec une exactitude qui participe de leur licence.32
LE CENSEUR.
Vos tableaux choqueront les regards des gens rigides.
COLLÉ.
La Chasteté porte un bandeau.
LE CENSEUR.
Elle n'est pas sourde, et le ton libre de plusieurs de vos chansons peut augmenter la corruption dont vous faites la satire.
COLLÉ.
Quoi! comme l'a dit le bon la Fontaine,
Les mères, les maris, me prendront aux cheveux
Pour dix ou douze contes bleus!
Voyez un peu la belle affaire!
Ce que je n'ai pas fait, mon livre irait le faire!
LE CENSEUR.
L'autorité d'un grand homme est déplacée ici. Il ne s'agit que de bagatelles que vous pouvez sacrifier sans regret.
COLLÉ.
En avez-vous de les connaître?
LE CENSEUR.
Je ne dis pas cela.
COLLÉ.
En êtes-vous moins censeur et très-censeur?
LE CENSEUR.
Je vous en fais juge.
COLLÉ.
Eh bien! après avoir lu ou chanté en secret mes couplets les plus graveleux, les prudes n'en auront pas plus de charité, et les bigots pas plus de tolérance. Laissez à ces gens-là le soin de me mettre à l'index. Si vous leur ôtez le plaisir de crier de temps à autre, on finira par croire à la réalité de leurs vertus. Mes chansons peuvent fournir une occasion de savoir à quoi s'en tenir sur le compte de ces messieurs et de ces dames. C'est un service qu'elles rendront aux gens véritablement sages, qui, toujours indulgents, pardonnent des écarts à la gaieté, et permettent à l'innocence de sourire.
LE CENSEUR.
Hors de mon cabinet je pourrais trouver vos raisons bonnes; ici elles ne sont que spécieuses. Je vous répète donc qu'il est impossible que j'autorise l'impression des chansons que vous défendez si bien.
COLLÉ.
En ce cas, je prends mon parti. Je les ferai imprimer en Hollande sous le titre de Chansons que mon censeur n'a pas dû me passer.
LE CENSEUR.
Je vous en retiens un exemplaire.
COLLÉ.
Vous mériteriez que je vous les dédiasse.
LE CENSEUR.
Vous pouvez les adresser mieux, vous, monsieur Collé, qui avez pour protecteur un prince de l'auguste maison dont vous avez si bien fait parler le héros.
COLLÉ.
Que ne me protége-t-il contre les censeurs!
LE CENSEUR.
Et contre les feuilles périodiques!
COLLÉ.
En effet, elles sont la seconde plaie de la littérature.
LE CENSEUR.
Quelle est la première, s'il vous plaît?
COLLÉ.
Je vous le laisse à deviner, et cours chez l'imprimeur, qui m'attend.
LE CENSEUR.
Un moment. Je sais que jour par jour vous écrivez ce que vous avez dit et fait. Ne vous avisez point de transcrire ainsi notre conversation.
COLLÉ.
Vous n'y seriez point compromis.
LE CENSEUR.
Bien; mais un jour quelque écolier pourrait s'appuyer de vos arguments, et, à l'abri de votre nom, tenter de justifier...
Ici l'écriture, absolument illisible, m'a privé du reste de ce dialogue, qui n'est peut-être intéressant que pour un auteur placé dans une situation pareille à celle où Collé s'est trouvé. Malgré le soin qu'il avait pris de ne pas le joindre aux Mémoires de sa vie, ce que le censeur avait craint est arrivé; et l'écolier n'hésite point à se servir du nom de son maître, au risque d'être en butte à de graves reproches. Mon ami l'érudit m'a annoncé qu'il m'en arriverait malheur, et, pour donner du poids au pronostic, m'a retiré sa dissertation sur les flonflons. Le public n'y perdra rien. Il doit l'augmenter considérablement, et l'adresser en forme de mémoire à la troisième classe de l'Institut. Elle obtiendra peut-être plus de succès que je n'ose en espérer pour mon recueil. Le moment serait mal choisi pour publier des chansons, si la futilité même des productions n'était une recommandation, à une époque où l'on a plus besoin de se distraire que de s'occuper. Souhaitons que bientôt l'on puisse lire des poèmes épiques, sans souhaiter néanmoins qu'il en paraisse autant que chaque année voit éclore de chansonniers nouveaux.
POST-SCRIPTUM DE 1821.
Je crois inutile d'ajouter aucune réflexion à cette préface du recueil chantant que je publiai à la fin de 1815. J'ai fait depuis quelques tentatives pour étendre le domaine de la chanson. Le succès seul peut les justifier. Des amateurs du genre pourront se plaindre de la gravité de certains sujets que j'ai cru pouvoir traiter. Voici ma réponse: La chanson vit de l'inspiration du moment. Notre époque est sérieuse, même un peu triste: j'ai dû prendre le ton qu'elle m'a donné; il est probable que je ne l'aurais pas choisi. Je pourrais repousser ainsi plusieurs autres critiques, s'il n'était naturel de penser qu'on accordera trop peu d'attention à ces chansons pour qu'il soit nécessaire de les défendre sérieusement. Un recueil de chansons est et sera toujours un livre sans conséquence.
11.Béranger’s Songs about “Liberty and Politics” I (1813-1830)]
Source
Oeuvres complètes de P.-J. de Béranger. Nouvelle édition revue par l’auteur. Illustrée de cinquante-deux belles gravures sur acier entièrement in édites, d’après les dessins de MM. Charlet, A. de Lemud, Johannot, Daubigny, Pauquet, Jacques, J. Lange, Pinguilly, de Rudder, Raffet (Paris: Perrotin, 1847). 2 volumes.
LE ROI D'YVETOT. [MAI 1813] vol. 1, pp. 1-3.
Air: Quand un tendron vient en ces lieux.
Il était un roi d'Yvetot
Peu connu dans l'histoire,
Se levant tard, se couchant tôt,
Dormant fort bien sans gloire;
Et couronné par Jeanneton
D'un simple bonnet de coton,
Dit-on.
Oh! oh! oh! oh! ah! ah! ah! ah!
Quel bon petit roi c'était là!
La, la.
Il faisait ses quatre repas
Dans son palais de chaume,
Et sur un âne, pas à pas,
Parcourait son royaume.
Joyeux, simple et croyant le bien ,
Pour toute garde il n'avait rien
Qu'un chien.
Oh! oh! oh! oh! ah ! ah ! ah! ah!
Quel bon petit roi c'était là!
La, la.
Il n'avait de goût onéreux
Qu'une soif un peu vive;
Mais, en rendant son peuple heureux,
Il faut bien qu'un roi vive.
Lui-même, à table et sans suppôt,
Sur chaque muid levait un pot
D'impôt.
Oh! oh! oh! oh! ah! ah! ah! ah!
Quel bon petit roi c'était là!
La, la.
Aux filles de bonnes maisons
Comme il avait su plaire,
Ses sujets avaient cent raisons
De le nommer leur père:
D'ailleurs il ne levait de ban
Que pour tirer, quatre fois l'an,
Au blanc.
Oh! oh ! oh! oh ! ah! ah! ah! ah!
Quel bon petit roi c'était là!
La, la.
Il n'agrandit point ses états,
Fut un voisin commode ,
Et, modèle des potentats,
Prit le plaisir pour code.
Ce n'est que lorsqu'il expira
Que le peuple qui l'enterra
Pleura.
Oh! oh! oh! oh! ah ! ah ! ah ! ah!
Quel bon petit roi c'était là!
La, la.
On conserve encor le portrait
De ce digne et bon prince;
C'est l'enseigne d'un cabaret
Fameux dans la province.
Les jours de fête, bien souvent,
La foule s'écrie en buvant
Devant:
Oh! oh! oh! oh! ah! ah! ah! ah!
Quel bon petit roi c'était là!
La, la.
LA GRANDE ORGIE [1814] vol. 1, pp. 89-93.
Air: Vive le vin de Ramponneau!
Le vin charme tous les esprits:
Qu'on le donne
Par tonne.
Que le vin pleuve dans Paris,
Pour voir les gens les plus aigris
Gris.
Non, plus d'accès
Aux procès;
Vidons, joyeux Français,
Nos caves renommées.
Qu'un censeur vain
Croie en vain
Fuir le pouvoir du vin ,
Et s'enivre aux fumées.
Le vin charme tous les esprits:
Qu'on le donne
Par tonne.
Que le vin pleuve dans Paris,
Pour voir les gens les plus aigris
Gris.
Graves auteurs,
Froids rhéteurs,
Tristes prédicateurs,
Endormeurs d'auditoires;
Gens à pamphlets,
A couplets,
Changez en gobelets
Vos larges écritoires.
Le vin charme tous les esprits:
Qu'on le donne
Par tonne.
Que le vin pleuve dans Paris,
Pour voir les gens les plus aigris
Gris.
Loin du fracas
Des combats,
Dans nos vins délicats
Mars a noyé ses foudres.
Gardiens de nos
Arsenaux,
Cédez-nous les tonneaux
Où vous mettiez vos poudres.
Le vin charme tous les esprits:
Qu'on le donne
Par tonne.
Que le vin pleuve dans Paris,
Pour voir les gens les plus aigris
Gris.
Nous qui courons
Les tendrons,
De Cythère enivrons
Les colombes légères.
Oiseaux chéris
De Gypris,
Venez, malgré nos cris,
Boire an fond de nos verres.
Le vin charme tous les esprits:
Qu'on le donne
Par tonne.
Que le vin pleuve dans Paris ,
Pour voir les gens les plus aigris
Gris.
L'or a cent fois
Trop de poids.
Un essaim de grivois ,
Buvant à leurs mignonnes ,
Trouve au total
Ce cristal
Préférable au métal
Dont on fait les couronnes.
Le vin charme tous les esprits:
Qu'on le donne
Par tonne.
Que le vin pleuve dans Paris,
Pour voir les gens les plus aigris
Gris.
Enfants charmants
De mamans
Qui des grands sentiments
Banniront la folie,
Nos fils bien gros ,
Bien dispos,
Naîtront parmi les pots,
Le front taché de lie.
Le vin charme tous les esprits:
Qu'on le donne
Par tonne.
Que le vin pleuve dans Paris,
Pour voir les gens les plus aigris
Gris.
Fi d'un honneur
Suborneur!
Enfin du vrai bonheur
Nous porterons les signes.
Les rois boiront
Tous en rond;
Les lauriers serviront
D'échalas à nos vignes.
Le vin charme tous les esprits:
Qu'on le donne
Par tonne.
Que le vin pleuve dans Paris,
Pour voir les gens les plus aigris
Gris.
Raison, adieu!
Qu'en ce lieu
Succombant sous le dieu
Objet de nos louanges,
Bien ou mal mis,
Tous amis,
Dans l'ivresse endormis,
Nous rêvions les vendanges!
Le vin charme tous les esprits:
Qu'on le donne
Par tonne.
Que le vin pleuve dans Paris,
Pour voir les gens les plus aigris
Gris.
TRAITÉ DE POLITIQUE A L'USAGE DE LISE. [CENT-JOURS, MAI 1815.] vol. 1, pp. 169-171.
Air: Un magistrat irréprochable.
Lise, qui règnes par la grâce
Du dieu qui nous rend tous égaux,
Ta beauté, que rien ne surpasse,
Enchaîne un peuple de rivaux.
Mais, si grand que soit ton empire,
Lise, tes amants sont Français;
De tes erreurs permets de rire,
Pour le bonheur de tes sujets.
Combien les belles et les princes
Aiment l'abus d'un grand pouvoir!
Combien d'amants et de provinces
Poussés enfin au désespoir!
Crains que la révolte ennemie
Dans ton boudoir ne trouve accès;
Lise, abjure la tyrannie,
Pour le bonheur de tes sujets.
Par excès de coquetterie
Femme ressemble aux conquérants,
Qui vont bien loin de leur patrie
Dompter cent peuples différents.
Ce sont de terribles coquettes!
N'imite pas leurs vains projets.
Lise, ne fais plus de conquêtes,
Pour le bonheur de tes sujets.
Grâce aux courtisans pleins de zèle,
On approche des potentats
Moins aisément que d'une belle
Dont un jaloux suit tous les pas.
Mais sur ton lit, trône paisible,
Où le plaisir rend ses décrets,
Lise, sois toujours accessible,
Pour le bonheur de tes sujet!.
Lise, en vain un roi nous assure
Que, s'il règne, il le doit aux cieux,
Ainsi qu'à la simple nature
Tu dois de charmer tous les yeux.
Bien qu'en des mains comme les tiennes
Le sceptre passe sans procès,
De nous il faut que tu le tiennes,
Pour le bonheur de tes sujets.
Pour te faire adorer sans cesse,
Mets à profit ces vérités.
Lise, deviens bonne princesse,
Et respecte nos libertés.
Des roses que l'amour moissonne
Ceins ton front tout brillant d'attraits,
Et garde longtemps ta couronne,
Pour le bonheur de tes sujets.
PLUS DE POLITIQUE. [JUILLET 1815.] vol. 1, pp. 176-78.
Air: Ce jour-là, sous son ombrage.
Ma mie, ô vous que j'adore,
Mais qui vous plaignez toujours
Que mon pays ait encore
Trop de part à mes amours!
Si la politique ennuie,
Même en frondant les abus,
Rassurez-vous, ma mie;
Je n'en parlerai plus.
Près de vous, j'en ai mémoire,
Donnant prise à mes rivaux,
Des arts, enfants de la gloire,
Je racontais les travaux..
A notre France agrandie
Ils prodiguaient leurs tributs.
Rassurez-vous, ma mie;
Je n'en parlerai plus.
Moi, peureux dont on se raille,
Après d'amoureux combats,
J'osais vous parler bataille
Et chanter nos fiers soldats.
Par eux la terre asservie
Voyait tous ses rois vaincus.
Rassurez-vous, ma mie;
Je n'en parlerai plus.
Sans me lasser de vos chaînes,
J'invoquais la liberté;
Du nom de Rome et d'Athènes,
J'effrayais votre gaîté.
Quoiqu'au fond je me défie
De nos modernes Titus,
Rassurez-vous, ma mie;
Je n'en parlerai plus.
La France, que rien n'égale,
Et dont le monde est jaloux,
Était la seule rivale
Qui fût à craindre pour vous.
Mais, las! j'ai pour ma patrie
Fait trop de vœux superflus.
Rassurez-vous, ma mie;
Je n'en parlerai plus.
Oui, ma mie, il faut vous croire;
Faisons-nous d'obscurs loisirs.
Sans plus songer à la gloire,
Dormons au sein des plaisirs.
Sous une ligue ennemie
Les Français sont abattus.
Rassurez-vous, ma mie;
Je n'en parlerai plus.
MA RÉPUBLIQUE. [Date ? 1817?] vol. 1, pp. 204-5.
Air: Vaudeville de la petite Gouvernante.
J'ai pris goût à la république
Depuis que j'ai vu tant de rois.
Je m'en fais une et je m'applique
A lui donner de bonnes lois.
On n'y commerce que pour boire,
On n'y juge qu'avec gaîté;
Ma table est tout son territoire;
Sa devise est la liberté.
Amis, prenons tous notre verre:
Le sénat s'assemble aujourd'hui.
D'abord, par un arrêt sévère,
A jamais proscrivons l'ennui.
Quoi! proscrire? Ah! ce mot doit être
Inconnu dans notre cité.
Chez nous l'ennui ne pourra naître:
Le plaisir suit la liberté.
Du luxe, dont elle est blessée,
La joie ici défend l'abus;
Point d'entraves à la pensée,
Par ordonnance de Bacchus.
A son gré que chacun professe
Le culte de sa déité;
Qu'on puisse aller même à la messe:
Ainsi le veut la liberté.
La noblesse est trop abusive:
Ne parlons point de nos aïeux.
Point de titre, même au convive
Qui rit le plus ou boit le mieux.
Et si quelqu'un, d'humeur traîtresse,
Aspirait à la royauté,
Plongeons ce César dans l'ivresse,
Nous sauverons la liberté.
Trinquons à notre république,
Pour voir son destin affermi.
Mais ce peuple si pacifique
Déjà redoute un ennemi:
C'est Lisette qui nous rappelle
Sous les lois de la volupté.
Elle veut régner, elle est belle;
C'en est fait de la liberté.
LA GARDE NATIONALE. SUR SON LICENCIEMENT PAR CHARLES X. [1823-4???] vol. 1, pp. 383-85l
Air: Halte là
Pour tout Paris quel outrage!
Amis, nous v'là licenciés.
Est-ce parc' que not' courage
Brilla contre leurs alliés? (bis.)
C'est quelqu' noir projet qui perce.
Morbleu! pour nous prêter s'cours,
Il faut qu' chacun d' nous s'exerce.
Du mêm' pied partons toujours.
N' cessons pas,
Chers amis, d' marcher au pas.
Moitié d' la gard' nationale
S' composait d'anciens soldats;
Des braves d' la gard' royale
Aussi faisions-nous grand cas.
Sans l' ministère, nul doute
Qu'on eût pu nous voir quelqu' jour,
Dans not' verre, eux boir' la goutte,
Nous, marcher à leur tambour.
N' cessons pas,
Chers amis, d' marcher au pas.
Nos voix ont paru sinistres:
D' nouveau pourtant il faudra
Crier à bas les ministres,
Les jésuit' et caetera.
Pour son argent j' crois qu' la foule
A bien l' droit d' former un vœu;
N'est-c' que quand la maison croule
Qu'on permet d' crier au feu?
N' cessons pas,
Chers amis, d' marcher au pas.
Au lieu d' monter à la Chambre,
Nous aurions bien dû, je l' sens,
Des injur's de plus d'un membre
D'mander raison aux trois cents.
La Charte qu'on y tiraille
Est leur rempart; mais, au fond,
On peut franchir c'te muraille
Par les brèches qu'ils y font.
N' cessons pas,
Chers amis, d' marcher au pas.
Au château faire l' service
Sans cartouch' pour se garder;
En voir donner à chaqu' Suisse;
En arrièr' ça fait r'garder.
Qui rétrograde se blouse;
Gens d' la cour, sauf vot' respect,
Vous risquez quatre-vingt-douze
Pour ravoir quatre-vingt-sept.
N' cessons pas,
Chers amis, d' marcher au pas.
Puisqu' Mont-Rouge nous menace,
Et rêv' quelqu' Saint-Barthél'my,
Préparons-nous, quoi qu'on fasse,
A repousser l'ennemi, (bis.)
Quand vers un' perte certaine
L' navire est conduit foll'ment,
En dépit du capitaine
Faut sauver le bâtiment.
N' cessons pas,
Chers amis, d' marcher au pas.
LA LIBERTE. PREMIÈRE CHANSON FAITE A SAINTE-PÉLAGIE. [Janvier 1822] vol. 2, pp. 20-22.
Air: Chantons Lœtamini.
D'un petit bout de chaîne
Depuis que j'ai tâté,
Mon cœur en belle haine
A pris la liberté.
Fi de la liberté!
A bas la liberté!
Marchangy, ce vrai sage,
M'a fait par charité
Sentir de l'esclavage
La légitimité.
Fi de la liberté!
A bas la liberté!
Plus de vaines louanges
Pour cette déité,
Qui laisse en de vieux langes
Le monde emmaillotté!
Fi de la liberté!
A bas la liberté!
De son arbre civique
Que nous est-il resté?
Un bâton despotique,
Sceptre sans majesté.
Fi de la liberté!
A bas la liberté!
Interrogeons le Tibre;
Lui seul a bien goûté
Sueur de peuple libre,
Crasse de papauté.
Fi de la liberté!
A bas la liberté!
Du bon sens qui nous gagne
Quand l'homme est infecté,
Il n'est plus dans son bagne
Qu'un forçat révolte.
Fi de la liberté!
A bas la liberté!
Bons porte-clefs que j'aime,
Geôliers pleins de gaîté,
Par vous au Louvre même
Que ce vœu soit porté:
Fi de la liberté!
A bas la liberté!
LES ESCLAVES GAULOIS. CHANSON ADRESSÉE A MANUEL. [1824.] vol. 2, pp. 114-16.
Air: Un soldat, par un coup funeste.
D'anciens Gaulois, pauvres esclaves,
Un soir qu'autour d'eux tout donnait,
Levaient la dime sur les caves
Du maître qui les opprimait.
Leur gaîté s'éveille:
« Ah! dit l'un d'eux, nous faisons des jaloux.
» L'esclave est roi quand le maître sommeille.
» Enivrons-nous! (4 fois.)
» Amis, ce vin par notre maître
» Fut confisqué sur des Gaulois
» Bannis du sol qui les vit naître
» Le jour même où mouraient nos lois.
» Sur nos fers qu'il rouille,
» Le Temps écrit l'âge d'un vin si doux.
» Des malheureux partageons la dépouille.
» Enivrons-nous!
» Savez-vous où gît l'humble pierre
» Des guerriers morts de notre temps?
» Là plus d'épouses en prière;
» Là plus de fleurs, même au printemps.
» La lyre attendrie
» Ne redit plus leurs noms effacés tous.
» Nargue du sot qui meurt pour la patrie!
» Enivrons-nous!
» La Liberté conspire encore
» Avec des restes de vertu;
» Elle nous dit: Voici l'aurore;
» Peuple, toujours dormiras-tu?
» Déité qu'on vante,
» Recrute ailleurs des martyrs et des fous.
» L'or te corrompt, la gloire t'épouvante.
» Enivrons-nous!
» Oui, toute espérance est bannie;
» Ne comptons plus les maux soufferts.
» Le marteau de la tyrannie
» Sur les autels rive nos fers.
» Au monde en tutelle,
» Dieux tout-puissants, quel exemple offrez-vous!
» Au char des rois un prêtre vous attelle.
» Enivrons-nous!
» Rions des dieux, sifflons les sages,
» Flattons nos maîtres absolus.
» Donnons-leur nos fils pour otages:
» On vit de honte, on n'en meurt plus.
» Le Plaisir nous venge;
» Sur nous du Sort il fait glisser les coups.
» Traînons gaîment nos chaînes dans la fange.
» Enivrons-nous! »
Le maître entend leurs chants d'ivresse;
Il crie à des valets: « Courez!
» Qu'un fouet dissipe l'allégresse
» De ces Gaulois dégénérés. »
Du tyran qui gronde
Prêts à subir la sentence à genoux,
Pauvres Gaulois, sous qui trembla le monde,
Enivrons-nous!
ENVOI.
Cher Manuel, dans un autre âge
Aurais-je peint nos tristes jours?
Ton éloquence et ton courage
Nous ont trouvés ingrats et sourds;
Mais pour la patrie
Ta vertu brave et périls et dégoûts,
Et plaint encor l'insensé qui s'écrie
Enivrons-nous! (4 fois.)
LAFAYETTE EN AMERIQUE. [Date???] vol. 2, pp. 119-20.
Air: A soixante ans il ne faut pas remettre.
Républicains, quel cortége s'avance?
— Un vieux guerrier débarque parmi nous.
— Vient-il d'un roi vous jurer l'alliance?
— Il a des rois allumé le courroux.
— Est-il puissant? — Seul il franchit les ondes.
— Qu'a-t-il donc fait? — Il a brisé des fers.
Gloire immortelle à l'homme des deux mondes!
Jours de triomphe, éclairez l'univers!
Européen, partout, sur ce rivage
Qui retentit de joyeuses clameurs,
Tu vois régner, sans trouble et sans servage,
La paix, les lois, le travail et les mœurs.
Des opprimés ces bords sont le refuge:
La tyrannie a peuplé nos déserts.
L'homme et ses droits ont ici Dieu pour juge.
Jours de triomphe, éclairez l'univers!
Mais que de sang nous coûta ce bien-être!
Nous succombions; Lafayette accourut,
Montra la France, eut Washington pour maître,
Lutta, vainquit, et l'Anglais disparut.
Pour son pays, pour la liberté sainte,
Il a depuis grandi dans les revers.
Des fers d'Olmutz nous effaçons l'empreinte.
Jours de triomphe, éclairez l'univers!
Ce vieil ami que tant d'ivresse accueille,
Par un héros ce héros adopté,
Bénit jadis, à sa première feuille,
L'arbre naissant de notre liberté.
Mais, aujourd'hui que l'arbre et son feuillage
Bravent en paix la foudre et les hivers,
Il vient s'asseoir sous son fertile ombrage.
Jours de triomphe, éclairez l'univers!
Autour de lui vois nos chefs, vois nos sages,
Nos vieux soldats se rappelant ses traits;
Vois tout un peuple et ces tribus sauvages
A son nom seul sortant de leurs forêts.
L'arbre sacré sur ce concours immense
Forme un abri de rameaux toujours verts:
Les vents au loin porteront sa semence.
Jours de triomphe, éclairez l'univers!
L'Européen, que frappent ces paroles,
Servit des rois, suivit des conquérants:
Un peuple esclave encensait ces idoles;
Un peuple libre a des honneurs plus grands.
Hélas! dit-il, et son œil sur les ondes
Semble chercher des bords lointains et chers:
Que la vertu rapproche les deux mondes!
Jours de triomphe, éclairez l'univers!
12.Charles Comte and Charles Dunoyer’s foreword to Le Censeur européen (1817)↩
[Word Length: 2,025]
Source
Charles Comte and Charles Dunoyer, “Avant-propos”, Le Censeur Européen, vol. 1, 1817, pp. i-viii. Le Censeur européen, ou examen de diverses questions de droit public, et des divers ouvrages littéraires et scientifiques, considérés dans leurs rapports avec le progrès de la civilisation (Paris: bureau de l'administration, 1817-1819).
Brief Bio of the Authors: Charles Comte (1782-1837) and Charles Dunoyer (1786-1862).
[See the previous section for biographical information about Charles Comte].
[Charles Dunoyer (1786-1862)]
Barthélémy-Pierre-Joseph-Charles Dunoyer (1786-1862) was a journalist; academic (a professor of political economy); politician; author of numerous works on politics, political economy, and history; a founding member of the Société d’ économie politique (1842); and a key figure in the French classical liberal movement of the first half of the nineteenth century, along with Jean-Baptiste Say, Benjamin Constant, Charles Comte, Augustin Thierry, and Alexis de Tocqueville. He collaborated with Comte on the journal Le Censeur and Le Censeur européen during the end of the Napoleonic empire and the restoration of the Bourbon monarchy. Dunoyer (and Comte), combined the political liberalism of Constant (constitutional limits on the power of the state, representative government), the economic liberalism of Say (laissez-faire, free trade), and the sociological approach to history of Thierry, Constant, and Say (class analysis, and a theory of historical evolution of society through stages culminating in the laissez-faire market society of “industry.” His major works include L'Industrie et la morale considérées dans leurs rapports avec la liberté (1825), Nouveau traité d'économie sociale (1830), and his three-volume magnum opus, De la liberté du travail (1845). After the Revolution of 1830 Dunoyer was appointed a member of the Académie des sciences morales et politiques, worked as a government official (he was prefect of L’Allier and La Somme), and eventually became a member of the Council of State in 1837. He resigned his government posts in protest against the coup d’état of Louis Napoléon in 1851. He died while writing a critique of the authoritarian Second Empire, which was completed and published by his son Anatole in 1864. [DMH]
AVANT-PROPOS.
En 1814, un ouvrage intitulé: Le Censeur, Ou examen des actes et des ouvrages qui tendent à détruire ou à consolider la constitution de l'état, fut entrepris. Il fut publié d'abord en cahiers de trois ou quatre feuilles d'impression; mais bientôt la liberté de la presse ayant été concentrée dans les mains des ministres, excepté pour les ouvrages au-dessus de vingt feuilles, les auteurs du Censeur crurent devoir se soustraire à l'arbitraire des àgens du pouvoir, en ne publiant que des volumes de plus de vingt feuilles.
Le cinquième volume n'avait pas encore paru, lorsque Bonaparte, profitant du mécontentement des troupes, vint pour la seconde fois s'emparer de l'autorité à main armée. Comme il avait vu qu'il ne pouvait réussir dans son entreprise qu'en professant les principes pour la défense desquels les Français avaient soutenu les guerres les plus sanglantes, les auteurs du Censeur démontrèrent que sa conduite était condamnée par ses principes, et que les acclamations d'une troupe armée n'avaient pu lui conférer aucune autorité légale. Leur ouvrage fut saisi par les agens de la police; mais on fut bientôt obligé de le rendre, parce qu'on ne se trouva point dans une position à pouvoir braver impunément l'opinion publique.
Bonaparte battu par les armées de la coalition, fut forcé d'abdiquer par la chambre des représentans. Son ministre de la police, nommé chef du gouvernement provisoire, reprit le porte-feuille aussitôt que Louis XVIII eut été replacé sur le trône. Ce ministre avait contre les auteurs du Censeur de puissans motifs de vengeance: il les avait trouvé au-dessus de ses offres et de ses menaces; et de tous les crimes, c'est celui que les hommes en place pardonnent le moins. Une occasion s'offrit bientôt à lui de se venger sans péril: ce fut de les porter sur une liste de proscription. S'ils en croient les rapports qui leur ont été faits, l'occasion fut saisie; mais une personne qui n'a pas voulu se faire connaître, et qui avait plus de crédit que le noble duc, obtint la radiation de leurs noms. Si ce fait, qu'ils ne garantissent point, est exact, ils prient cette personne de recevoir ici le témoignage de leur reconnaissance. Une autre occasion se présenta peu de temps après: le septième volume du Censeur, imprimé en grand» partie pendant les cent jours, allait paraître; le même ministre le fit saisir; et plus heureux cette fois qu'il ne l'avait été sous Bonaparte, il ne fut point obligé de le rendre.33
La chambre des députés de 1815 fut convoquée; et la majorité de ses membres montrèrent tant de violence, que toute discussion raisonnable devint impossible. Ne pouvant se mettre du côté d'un parti qui, dans ses résolutions, semblait ne prendre pour guides que ses fureurs, et ne voulant pas soutenir un ministère qui se montrait beaucoup trop faible quand il défendait la justice, et beaucoup trop fort quand il attaquait les principes constitutionnels, les hommes qui ne tenaient à aucune faction, et qui n'aspiraient à aucune faveur, n'eurent rien dé mieux à faire qu'à se condamner au silence. Ce fut le parti que prirent les auteurs du Censeur.
Les passions ne sont point encore calmées; mais elles sont du moins assez contenues pour qu'on puisse paisiblement discuter des questions d'intérêt public. Les auteurs du Censeur reprennent donc leurs travaux. Toutefois en usant du droit que leur garantissent les lois de publier leur opinions, ils sentent la nécessité de donner à leurs écrite une direction nouvelle.
La marche violente que les gouvernemens ont quelquefois suivie, a pu faire croire que les dangers auxquels les libertés des peuples se trouvent exposées, venaient tous du côté des gonvernemens: cette opinion a dû diriger toutes les attentions et toutes les attaques vers les hommes en possession de l'autorité. Il est résulté de là qu'on n'a jamais vu que la partie la plus faible des dangers, et que tous les efforts qu'on a faits pour conquérir la liberté, ont presque toujours tourné au profit du despotisme. Pour qu'un peuple soit libre, il ne suffit p«» qu'il ait une constitution et des lois; il faut qu'il se trouve dans son sein des hommes qui les entendent, d'autres qui veuillent les exécuter, et d'autres qui sachent les faire respecter.
Le ministre qui a proposé une mauvaise loi, n'est pas plus blâmable que les hommes qui l'ont sollicitée, que le conseil qui l'a préparée, que les chambres qui l'ont adoptée, et que le peuple qui n'a pas vu qu'elle était mauvaise. Se plaindre dans ce cas du ministre seul, c'est une peine inutile, et quelquefois même dangereuse pour le public; puisqu'on lui inspire le désir d'un changement, sans lui faire voir comment il sera mieux. Une sentinelle qui fixerait constamment ses regards sur un seul point serait bientôt surprise; il en serait de même d'un peuple qui veillerait de la même manière à la défense de sa liberté. Ces considérations, et quelques autres qu'il est inutile de développer ici, ont engagé les auteurs du Censeur à modifier le titre qu'ils avaient pris d'abord. Les raisons suivantes les ont portés à adopter le titre qu'on lit en tête de ce volume.
Les gouvernemens comme les peuples exercent les uns sur les autres une très-grande influence: cette influence est telle aujourd'hui, qu'il est impossible qu'un peuple demeure esclave à côté d'un peuple qui sait être libre, ou qu'il maintienne sa liberté, s'il est environné de peuples soumis à des gouvernemens despotiques. Chacun se trouve donc intéressé à connaître ce qui se passe dans les états voisins, à y suivre la marche dé l'opinion, et à prévoir les événemens qui pourraient y arriver. D'ailleurs le meilleur moyen de connaître ce qu'il y a de vrai et ce qu'il y a de faux dans les idées qu'on a adoptées, est de les comparer aux opinions des autres, et de voir comment elles sont jugées loin de nous; et c'est peut être ce qui fait qu'il y a presque toujours plus d'instruction à gagner dans la conversation d'un étranger, que dans la conversation d'un compatriote. Or, un des principaux objets de cet ouvrage, est de recueillir les pensées utiles qui se publient en Europe sur les sciences morales et politiques.
Si dans le temps où les grands états de l'Europe étaient divisés en une multitude de petits états ennemis, un écrivain avait dit qu'il était, de l'intérêt de tous de rester unis; qu'en se faisant la guerre ils se ruinaient mutuellement, et qu'ils seraient tous plus riches et plus puissans s'ils mettaient un terme à leurs discordes, il aurait probablement soulevé contre lui une multitude de passions et d'Intérêts. Les chefs et les soldats auraient parlé de la gloire de leurs armes, de la noblesse du courage militaire, de la nécessité de l'entretenir par des guerres fréquentes, et sur-tout des dangers du repos et de l'oisiveté; les financiers auraient parlé de l'avantage des douanes, de l'exportation du numéraire, de la balance du commerce; les fabricans, de la nécessité des prohibitions, des primes d'encouragement, des compagnies privilégiées; enfin, tous auraient prétendu que l'intérêt de ces petits états était de rester divisés, de se tromper et de se battre.
Le temps a fait ce que la raison n'aurait pu opérer; il a détruit les passions et les préjuges qui rendaient les petits peuples ennemis les uns des autres; et celui qui proposerait aujourd'hui sérieusement d'environner chacun des départemens de la France, par exemple, d'une ligne de douanes, d'empêcher entre eux les libres communications pour assurer à chacun la balance du commerce, de mettre dans tous une partie de la population sous les armes, et de les faire battre mutuellement pour les enrichir et entretenir chez eux le courage militaire, serait sans doute envoyé dans une maison de fous. Ce qui serait une folie pour les diverses parties d'un royaume, est-il bien sensé pour les diverses parties d'un continent? L'état actuel de l'Europe présente-t-il autre chose que l'anarchie féodale établie sur de grandes bases?
Il est aisé de s'apercevoir que la plupart de» peuples d'Europe tendent à avoir des institutions sociales analogues. Les théories de gouvernement qu'on développe dans un pays peuvent donc être utiles à tous; il ne s'agit que de leur enlever ce qu'elles ont de trop particulier et de les revêtir de formules assez générales, pour que chacun, puisse en faire l'application aux cas dans lesquels il se trouve placé. Déjà les auteurs du Censeur avaient adopté cette marche, en consacrant une partie de chaque volume à des matières générales; mais cette partie se trouvait hors de l'explication du titre de l'ouvrage, et en nécessitait le changement.
En prenant le titre de Censeur Européen, ils n'ont pas formé la folle entreprise de critiquer tout ce qui se fait en Europe de condamnable; ils ont voulu seulement écrire dans un sens qui convint également à tous les peuples d'Europe, et démontrer, autant qu'il est en leur pouvoir, qu'ils ont tous le même intérêt, et que le mal qu'on fait à l'un est toujours ressenti par les autres. L'ouvrage remplira-t-il l'objet du titre? Le public en sera juge. En se restreignant dans les actes et les ouvrages qui avaient quelque rapport à la constitution de France, ils s'étaient ôté en quelque sorte la faculté de rendre compte des ouvrages qui paraissaient dans les autres pays; le nouveau titre qu'ils ont adopté leur donnant plus de latitude, ou plutôt leur imposant l'obligation de faire connaître ce qui parait de plus important en Europe, les dispensera de faire l'analyse de cette multitude d'écrits que produit l'esprit de parti, et qui sont condamnés à périr dès leur naissance.
Ils croient devoir prévenir ici leurs lecteurs qu'en parlant des peuples, des gouvernemens, des armées, des corps constitues, ils ne s'occuperont jamais que des masses, et laisseront au public le soin de faire lés exceptions. Ils n'ignorent point que dans les corps même les plus corrompus, il s'est trouvé des hommes d'un grand courage et d'une probité sévère; mais s'ils avaient pris sur eux de faire les exceptions, ils auraient pu, contre leur intention, ne pas en faire assez, et blesser des hommes dignes d'estime: ils ont donc mieux aimé laisser à chacun le soin de prendre la place qui lui serait indiquée par sa conscience.
Toute personne qui publia un écrit est légalement responsable de ce qu'il renferme. Mais il est une responsabilité morale qui, quelquefois, frappe l'auteur sans atteindre l'éditeur. Cette considération engage les auteurs du Censeur Européen à donner au public des signes auxquels il puisse reconnaître ce qui appartient à chacun d'eux. Lorsque le Censeur fut commencé, il ne parut que sous un seul nom; alors il était clair que les articles sans signature appartenaient à celui par qui l'ouvrage était publié, et que les articles signés appartenaient à ses collaborateurs. Lorsque le Censeur fut publié sous deux noms, celui des auteurs qui n'avait pas fait connaître le sien en entier, continua de signer par sa lettre initiale; l'autre laissa toujours les siens sans signature.34 A l'avenir ils suivront la même marche que par le passé.
Le Censeur Européen ne doit pas être considéré comme un ouvrage périodique; les volumes ne paraîtront point à des époques fixes, et le nombre n'en sera point indéterminé. Les matières qui y seront traitées ayant des bornes, les auteurs croient pouvoir les renfermer dans vingt volumes, qui seront terminés par une table générale des matières. L'ouvrage entier aura paru dans deux ans: les volumes paraîtront à des époques plus ou moins rapprochées, selon l'abondance ou la rareté des matériaux.
La sûreté individuelle étant détruite, les cours prévôtales étant juges des écrits, dans certaines circonstances, et une partie de la France étant occupée par des armées étrangères, les Auteurs du Censeur Européen auront-ils assez d'indépendance pour dire la vérité? Ils en auront assez, du moins ils osent s'en flatter, pour dire tout ce qu'ils jugeront utile, et pour n'être retenus que par l'intérêt de la vérité elle-même. Du reste, chacun doit voir que ce n'est plus d'un projet de loi ou d'une ordonnance que dépend le sort de l'État; le mal vient de plus loin, et il est bien plus difficile d'y porter remède.
13.Destutt de Tracy on “Society” (1817)↩
[Word Length: 3,882]
Source
Traité d’économie politique, par le comte Destutt de Tracy (Paris: Bouget et Levi, 1823. Chap. I. “De la Société”, pp. 65-80.
Brief Bio of the Author: Comte Destutt de Tracy (1754-1836)
[Antoine Destutt de Tracy (1754-1836)]
Antoine Destutt de Tracy (1754-1836) was one of the leading intellectuals of the 1790s and early 1800s and a member of the ideologues (a philosophical movement not unlike the objectivists, who professed that the origin of ideas was material–not spiritual). In his writings on Montesquieu, Tracy defended the institutions of the American Republic, and in his writings on political economy he defended laissez-faire. During the French Revolution he joined the third estate and renounced his aristocratic title. During the Terror he was arrested and nearly executed. Tracy continued agitating for liberal reforms as a senator during Napoleon’s regime. One of his most influential works was the four-volume Éléments d’idéologie (first published in 1801-15) (Tracy coined the term “ideology”). He also wrote Commentaire sur l'ésprit des lois (1819), which Thomas Jefferson translated and brought to the United States. In 1822 he published his Traité d’économie politique (1823), much admired by Jefferson and Bastiat. [DMH]
CHAPITRE PREMIER. De la Société.
L'introduction que l'on vient de lire est consacrée tout entière à examiner la génération de quelques idées très-générales, à jeter un premier coup d'œil sur la nature de ce mode de notre sensibilité que nous appelons volonté ou faculté de vouloir, et à indiquer quelques-unes de ses conséquences immédiates et universelles.
Nous y avons vu sommairement, 1° ce que sont des êtres inanimés ou insensibles, tels que beaucoup nous paraissent, qui peuvent bien exister pour les êtres sensibles qu'ils affectent, mais qui n'existent pas pour eux-mêmes, puisqu'ils ne le sentent pas; 1° ce que seraient des êtres sentans, mais sentant tout avec une indifférence telle, que de leur sensibilité il ne résulterait aucun choix, aucune préférence, aucun désir, en un mot aucune volonté; 3° ce que sont des êtres sentans et voulons comme tous les animaux que nous connaissons, et spécialement comme nous, mais isolés; 4° et enfin ce que deviennent des êtres sentans et voulans à notre manière, lorsqu'ils sont en contact et en relation avec d'autres êtres de leur espèce, semblables à eux, et avec lesquels ils peuvent correspondre pleinement.
Ces préliminaires étaient nécessaires pour que le lecteur pût bien suivre la série des idées. Mais il serait inconvenant, dans un Traité de la Volonté , de parler plus long-temps des êtres qui ne sont pas doués de cette faculté intellectuelle ; et il ne serait pas moins superflu, ayant principalement en vue 'espèce humaine, de nous occuper davantage d'êtres qui seraient sentans et voulans, mais qui vivraient isolés.
L'homme ne peut exister ainsi : cela est prouvé par le fait; car on n'a jamais vu, dans aucun coin du monde, d'animal à figure humaine, tel brut qu'il soit, qui n'ait aucune espèce de relation avec aucun autre animal de son espèce. Cela n'est pas moins démontré par le raisonnement; car un tel individu peut bien, à la rigueur, subsister quoique très-misérablement, mais il ne peut certainement pas se reproduire. Pour que l'espèce se perpétue, il faut que les deux sexes se réunissent ; il faut même que l'enfant qui est le produit de leur union reçoive long-temps les soins de ses parens ou au moins ceux de sa mère. Or, nous sommes faits de telle façon, que nous avons tous plus ou moins un penchant naturel et inné à sympathiser, c'est-à-dire que nous éprouvons tous du plaisir à faire partager nos impressions, nos affections, nos senti mens, et à partager ceux de nos semblables. Peut-être ce penchant existe-t-il plus ou moins dans tous les êtres animés; peut-être même est-il en nous, dès l'origine , une partie considérable de celui qui attire si puissamment les deux sexes l'un vers l'autre. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'ensuite il l'augmente prodigieusement : il est donc impossible que des rapprochemens que notre organisation rend inévitables ne développent pas en nous cette disposition naturelle à sympathiser, ne la fortifient pas par l'exercice, et n'établissent pas entre nous des relations sociales et morales. De plus, nous sommes encore tous faits de manière que nous portons des jugemens de ce que nous éprouvons, de ce que nous sentons, de ce que nous voyons, en un mot , de tout ce qui nous affecte; nous y distinguons des parties, des circonstances, des causes, des conséquences; et c'est là en juger. Il est donc impossible que nous ne nous apercevions pas bientôt de l'utilité que nous pouvons tirer du secours de nos semblables, de leur assistance dans nos besoins, du concours de leurs volontés et de leurs forces avec les nôtres.Nouvelle raison pour que des rapprochemens, d'abord fortuits, deviennent durables et permanens entre nous. C'est aussi ce qui est arrivé toujours et partout; c'est ce qui toujours et partout aussi a produit cette admirable et savante invention d'un langage plus ou moins perfectionné, mais toujours, à ce qu'il paraît, plus circonstancié et plus capable d'explications détaillées que celui d'aucun autre animal; c'est donc l'état social qui est notre état naturel, et celui dont nous devons uniquement nous occuper.
Je ne considérerai cependant pas ici la société sous le rapport moral; je n'examinerai pas comment elle développe, multiplie et complique toutes nos passions et nos affections, ni quels sont les nombreux devoirs qu'elle nous impose, ni d'où nait pour nous l'obligation fondamentale de respecter les conventions sur lesquelles elle repose et sans lesquelles elle ne peut subsister. Je n'envisagerai l'état social que sous le rapport économique , c'est - à - dire relativement à nos besoins les plus directs, et aux moyens que nous avons d'y pourvoir.
Maintenant, qu'est-ce donc que la société vue sous cet aspect? Je ne crains point de le dire : la société est purement et uniquement une série continuelle d'échanges; elle n'est jamais autre chose dans aucune époque de sa durée, depuis son commencement le plus informe jusqu'à sa plus grande perfection; et c'est là le plus grand éloge qu'on en puisse faire, car l'échange est une transaction admirable dans laquelle les deux contractans gagnent toujours tous deux : par conséquent la société est une suite non interrompue d'avantages sans cesse renaissans pour tous ses membres. Ceci demande à être expliqué.
D'abord la société n'est qu'une suite d'échanges: en effet, commençons par les premières conventions sur lesquelles elle est fondée. Tout homme , avant d'entrer dans l'état de société, a, comme nous l'avons vu, tous les droits et nul devoir, pas même celui de ne pas nuire aux autres, et les autres sont de même à son égard. Il est évident qu'ils rie pourraient pas vivre ensemble, si, par une convention formelle ou tacite, ils ne se promettaient pas réciproquement sûreté. Eh bien! cette convention formelle est un véritable échange. Chacun renonce à une certaine manière d'employer ses forces, et reçoit en retour le même sacrifice de la part de tous les autres. Une fois la sécurité établie par ce moyen, les hommes ont entre eux une multitude de relations qui viennent toutes se ranger sous une des trois classes suivantes. Elles consistent ou à rendre des services pour recevoir un salaire , ou à troquer une marchandise quelconque contre une autre, ou à exécuter quelque ouvrage en commun. Dans les deux premiers cas, l'échange est manifeste; dans le troisième, il n'est pas moins réel: car, quand plusieurs hommes se réunissent pour travailler en commun, chacun d'eux fait le sacrifice aux autres de ce qu'il aurait pu faire pendant ce temps-là pour son utilité particulière, et il reçoit pour équivalent sa part de l'utilité commune résultante du travail commun. Il échange une manière de s'occuper contre une autre qui lui devient plus avantageuses lui-même que ne l'aurait été la première. Il est donc vrai que la société ne consiste que dans une suite continuelle d'échanges.
Je ne prétends pas dire que les hommes ne se rendent jamais de services gratuits. Loin de moi l'idée de nier la bienfaisance, ou de la bannir de leurs cœurs; mais je dis que ce n'est point sur elle que repose toute la marche de la société, et même que les heureuses conséquences de cette aimable vertu sont bien plus importantes sous le rapport moral,35 dont nous ne parlons pas en ce moment, que sous le rapport économique qui nous occupe. J'ajoute que si 1,'on presse le sens du mot échange, et si l'on veut, comme on le doit, le prendre dans toute l'étendue de sa signification, on peut dire avec justesse, qu'un bienfait est encore un échange dans lequel on sacrifie une portion de sa propriété ou de son temps pour se procurer un plaisir moral très-vif et très-doux, celui d'obliger, ou pour s'exempter d'une peine très-affligeante, la vue de la souffrance , absolument comme l'on emploie quelque argent pour se donne» un feu d'artifice qui divertit , ou pour éloigner de soi quelque chose qui incommode.
Il est également vrai qu'un échange est une transaction dans laquelle les deux contractais gagnent tous deux. Toutes les fois que je fais librement et sans contrainte un échange quelconque, c'est que je désire plus la chose que je reçois que celle que je donne, et qu'au contraire celui avec qui je traite désire plus ce que je lui offre que ce qu'il me rend. Quand je donne mon travail pour un salaire, c'est que j'estime plus ce salaire que ce que j'aurais pu faire en travaillant pour moi-même, et que celui qui me paie prise davantage les services t(ne je lui remis que ce qu'il me donne en retour. Quand je donne une mesure de blé pour une mesure de vin , c'est que j'ai surabondamment de quoi manger, et que je n'ai pas de quoi boire; et que celui avec qui je traite est dans le cas contraire. Quand nous sommes plusieurs qui nous soumettons à faire un travail quelconque en commun, soit pour nous défendre contre un ennemi, soit pour détruire des animaux malfaisans, soit pour nous préserver des ravages de la mer, d'une inondation, d'une contagion, soit même pour faire un pont on un chemin, c'est que chacun de nous préfère l'utilité particulière qui lui en revient, à ce qu'il aurait pu faire pour lui-même pendant ce temps. Nous sommes tous satisfaits dans toutes ces espèces d'échange, chacun de nous trouve son avantage dans l'arrangement proposé.
A la vérité, il est possible que, dans un échange, un des contractait», ou même tous deux, aient tort de désirer l'affaire qu'ils consomment. Il se peut qu'ils donnent une chose que bientôt ils regretteront, pour une chose dont bientôt ils ne se soucieront plus. Il se peut aussi que l’un des deux n'ait pas obtenu , pour ce qu'il sacrifie, tout ce qu'il aurait pu prétendre, ensorte qu'il tasse une perte relative, tandis que l'autre fait un gain exagéré. Mais ce sont là des cas particuliers qui ne tiennent pas à la nature de la transaction, et il n'en est pas moins vrai qu'il est de l'essence de l'échange libre d'être avantageux aux deux parties, et que la véritable utilité de la société est de rendre possible entre nous une multitude de pareils arrangemens.
C'est cette foule innombrable de petits avantages particuliers sans cesse renaissans qui compose le bien général, et qui produit à la longue les merveilles de la société perfectionnée, et l'immense différence que l'on voit entre elle et la société informe ou presque nulle, telle qu'elle existe chez les sauvages. Il n'est pas mal d'arrêter un moment notre attention sur ce tableau, qui ne la fixe pas assez parce que nous y sommes trop accoutumés.
Qu'est-ce en effet qu'offre à nos regards un pays anciennement civilisé? Les campagnes sont défrichées et nettoyées, débarrassées des grands végétaux qui les ont couvertes originairement, purgées de plantes et d'animaux malfaisans, et disposées de tous points à recevoir les soins annuels que leur donne le cultivateur. Les marais sont desséchés; les eaux stagnantes qui y croupissaient ont cessé de remplir l'air de vapeurs pestilentielles; des issues leur ont été ouvertes, ou leur étendue a été circonscrite , et les terrains qu'elles infectaient sont devenus d'abondans pâturages ou des réservoirs utiles. Le chaos des montagnes a été débrouillé; leur base a été appropriée aux besoins de la culture; leur partie la moins accessible, jusqu'à la région des neiges éternelles, a été destinée à la nourriture de nombreux troupeaux. Les forêts, que l'on a laissées subsister, ne sont point restées impénétrables; les bêtes féroces qui s'y retiraient ont été poursuivies et presque détruites; les bois qu'elles produisent ont été extraits et conservés; on a même assujetti leur exploitation à la périodicité la plus favorable à leur reproduction, et les soins qu'on leur a donnés presque partout équivalent à une espèce de culture, et ont même été portés quelquefois jusqu'à la culture la plus recherchée. Les eaux courantes qui traversent tous ces terrains ne sont point demeurées non plus dans leur état primitif.Les grandes rivières ont été débarrassées de tous les obstacles qui s'opposaient à leur cours; elles ont été contenues par des digues et des quais, lorsque cela a été nécessaire , et leurs rivages ont été disposés de manière à former des ports commodes dans les endroits convenables. Les cours d'eaux moins considérables ont été retenus pour servir des moulins ou d'autres usines, ou détournés pour arroser des pentes qui en avaient besoin et les rendre productives. Sur toute la surface du sol il a été construit, de distance en distance, dans les positions favorables, des habitations à l'usage de ceux qui cultivent les terres et exploitent leurs produits. Ces habitations ont été entourées des clôtures et des plantations qui pouvaient les rendre plus agréables et plus utiles. Des chemins ont été pratiqués pour y arriver et en extraire les productions de la terre. Dans les points où plusieurs intérêts divers se sont trouvés réunis, et où d'autres hommes sont devenus assez nécessaires au service des cultivateurs pour pouvoir subsister du salaire de ce service, les habitations se sont multipliées et agglomérées, et ont formé des villages et des petites villes. Sur les bords des grandes rivières et sur les côtes de la mer, dans des positions où les relations de plusieurs de ces villes venaient coïncider, il s'est élevé de grandes cités qui elles-mêmes, avec le temps, ont donné naissance à une plus grande encore, laquelle est devenue leur capitale et leur centre commun, parce qu'elle s'est trouvée la mieux placée pour unir toutes les autres, et être approvisionnée et défendue par elles. Enfin toutes ces villes communiquent entre elles et avec les mers voisines et les pays étrangers, par le moyen de ports, de ponts, de chaussées, de canaux, où se déploie toute l'industrie humaine. Tels sont les objets qui nous frappent au premier aspect d'une contrée où les hommes ont exercé toute leur puissance, et qu'ils se sont appropriée de longue main.
Si nous pénétrons dans l’intérieur de leurs habitations, nous y trouvons une foule immense d'animaux utiles, élevés, nourris, domptés par l'homme, multipliés par lui à un point inconcevable; une quantité prodigieuse d'approvisionnemens de toute espèce, de denrées, de meubles, d'outils, d'instrumens, de vétemens, de matières brutes ou manufacturées, de métaux nécessaires ou précieux, enfin de tout ce qui peut servir, de près ou de loin, à la satisfaction de nos besoins. Nous y admirons surtout une population réellement étonnante, dont tous les individus ont l'usage d'un langage perfectionné, ont une raison développée jusqu'à un certain point, ont des mœurs assez adoucies et une industrie assez intelligente pour vivre en si grand nombre près les uns des autres, et parmi lesquels en général les plus dénués sont secourus, les plus faibles sont défendus. Nous remarquons avec plus de surprise encore, que beaucoup de ces hommes sont parvenus à un degré de connaissances très-difficiles à acquérir, qu'ils possèdent une infinité d'arts agréables ou utiles, qu'ils connaissent plusieurs des lois de la nature, qu'ils savent en calculer les effets et les faire tourner à leur avantage; qu'ils ont même entrevu la plus difficile de toutes les sciences, puisqu'ils sont arrivés à démêler, au moins en partie, les véritables intérêts de l'espèce en général, et en particulier ceux de leur société et de ses membres; qu'en conséquence ils ont imaginé des lois souvent justes, des institutions passablement sages, et créé une foule d'établissemens propres à répandre et à accroître encore l'instruction et les lumières; et qu'enfin , non contens d'avoir ainsi assuré la prospérité intérieure, ils ont exploré le reste de la terre, établi des relations avec les nations étrangères et pourvu à leur sûreté à l'extérieur.
Quelle immense accumulation de moyens de bienêtre! quels prodigieux résultats de la partie des travaux de nos prédécesseurs, qui n'a pas été immédiatement nécessaire à soutenir leur existence, et qui ne s'est pas anéantie avec eux! L'imagination même en est effrayée, et elle l'est d'autant plus, que plus on y réfléchit; car il faut encore considérer que beaucoup de ces ouvrages sont peu durables; que les plus solides ont été renouvelés bien des fois pendant le cours des siècles, et qu'il n'en est presque aucun qui n'exige des soins et un entretien continuel pour sa conservation. Il faut observer que, de ces merveilles, ce qui frappe nos regards n'est pas ce qu'il y a de plus étonnant. C'est la partie matérielle, pour ainsi dire, mais la partie intellectuelle, si l'on fient s'exprimer ainsi, est encore plus surprenante. Il a toujours été bien plus difficile d'apprendre et de découvrir, que d'agir en conséquence de ce que l'on sait. Les premiers pas, surtout dans la carrière de l'invention, sont d'une difficulté extrême. Le travail que l'homme a été obligé de Faire sur ses propres facultés intellectuelles, l'immensité des recherches auxquelles il a été forcé de se livrer, celles des observations qu'il a eu besoin de recueillir, lui ont coûté bien plus de peine et de temps que tous les ouvrages qu'il a pu exécuter en conséquence de ces progrès de son esprit. Il faut enfin remarquer que jamais les efforts des hommes pour l'amélioration de leur sort n'ont été à beaucoup près aussi bien dirigés qu'ils auraient pu l'être; que toujours une grande partie de la puissance humaine a été employée à empêcher les progrès de l'autre; que ces progrès ont été troubles et interrompus par tous les grands désordres de la nature et de la société, et que maintes fois peut-être tout a été perdu et détruit, même les lumières acquises, même la capacité de recommencer ce qui avait déjà été fait. Ces dernières considérations pourraient devenir décourageantes; mais nous verrons ailleurs par combien de raisons nous devons être rassurés contre la crainte de pareils malheurs à l'avenir. Nous examinerons aussi jusqu'à quel point les progrès de l'espèce prise en masse augmentent le bonheur des individus, condition nécessaire pour qu'on puisse s'en féliciter. Mais dan s ce moment, qu'il nous suffise d'avoir montré la prodigieuse puissance qu'acquièrent les hommes réunis, tandis que séparés ils peuvent à peine soutenir leur misérable existence.
Smith, si je ne me trompe, est le premier qui ait remarqué que l'homme seul fait des échanges proprement dits. Voyez l'admirable chapitre second du premier livre de son Traité des Richesses. Je regrette qu'en remarquant ce fait, il n'en ait pas recherché, plus curieusement la cause. Ce n'était pas à l'auteur de la Théorie des Sentimens moraux à regarder comme inutile de scruter les opérations de notre intelligence. Ses succès et ses fautes devaient contribuer également à lui faire penser le contraire. Malgré cette négligence, son assertion n'en est pas moins vraie. On voit bien certains animaux exécuter des travaux qui concourent à un but commun et qui paraissent concertés jusqu'à un certain point, ou se battre pour la possession de ce qu'ils désirent, ou supplier pour l'obtenir; mais rien n'annonce qu'ils fassent réellement des échanges formels. La raison en est, je pense, qu'ils n'ont pas un langage assez développé pour pouvoir faire des conventions expresses; et je crois que cela vient (comme je l'ai expliqué dans le second volume des Elémens d'Idéologie, article des Interjections, et dans le premier, à propos des signes) de ce qu'ils sont incapables de décomposer assez leurs idées pour les généraliser, pour les abstraire et pour les exprimer séparément, en détail, et soue la forme d'une proposition : d'où il arrive que celles dont ils sont susceptibles sont toutes particulières, confuses avec leurs attributs, et se manifestent en masse par des interjections qui ne peuvent rien expliquer explicitement. L'homme, au contraire, qui a les moyens intellectuels qui leur manquent, est naturellement porté à s'en servir pour faire des conventions avec ses semblables. Ils ne font point d'échanges, et il en fait: aussi lui seul a-t-il une véritable société; car le commerce est toute la société, comme le travail est toute la richesse.
On a peine à concevoir d'abord que les grands effets que nous venons de décrire puissent n'avoir pas d'autre cause que la seule réciprocité des services et la multiplicité des échanges; cependant cette suite continuelle d'échanges a trois avantages bien remarquables.
Premièrement, le travail de plusieurs hommes réunis est plus fructueux que celui de ces mêmes hommes agissant séparément. S'agit-il de se défendre? dix hommes vont résister aisément à un ennemi qui les aurait tous détruits en les attaquant 1 un après l'autre. Faut-il remuer un fardeau? celui dont le poids aurait opposé une résistance invincible aux efforts d'un seul individu cède tout de suite à ceux de plusieurs qui agissent ensemble. Est-il question d'exécuter un travail compliqué? plusieurs choses doivent être faites simultanément; l'un en fait une pendant que l'autre en fait une autre, et toutes contribuent à l'effet qu'un seul homme n'aurait pu produire. L'un rame pendant que l'autre tient le gouvernail ,et qu'un troisième jette le filet ou harponne le poisson, et la pèche a un succès impossible sans ce concours.
Secondement, nos connaissances sont nos plus précieuses acquisitions, puisque ce sont elles qui dirigent l'emploi de nos forces et le rendent plus fructueux, à mesure qu'elles sont plus saines et plus étendues. Or, nul homme n'est à portée de tout voir, et il est bien plus aisé d'apprendre que d'inventer. Mais quand plusieurs hommes communiquent ensemble , ce qu'un d'eux a observé est bientôt connu, de tous les autres, et il suffit que parmi eux il s’en trouve un fort ingénieux, pour que des découvertes précieuses deviennent promptement la propriété de tous. Les lumières doivent donc s'accroître bien plus rapidement que dans l'état d'isolement, sans compter qu'elles peuvent se conserver et par conséquent s'accumuler de générations en générations; et sans compter encore, ce qui est bien prouvé par l'étude de notre intelligence, que l'invention et l'emploi du langage et de ses signes, qui n'auraient pas lieu sans la société, fournissent à notre esprit .beaucoup de nouveaux moyens de combinaison et d'action.
Troisièmement, et ceci mérite encore attention , quand plusieurs hommes travaillent réciproquement les uns pour les autres, chacun peut se livrer exclusivement à l'occupation pour laquelle il a le plus d'avantages, soit par ses dispositions naturelles, soit par le hasard des circonstances; et ainsi il y réussira mieux. Le chasseur, le pécheur, le pasteur, le laboureur, l'artisan, ne faisant chacun qu'une chose, deviendront plus habiles, perdront moins de temps et auront plus de succès. C'est là ce que l'on appelle la division du travail, qui, dans les sociétés civilisées, est quelquefois portée à un point inconcevable , et toujours avec avantage. Les écrivains économistes ont tous attaché une importance extrême à la division du travail, et ils ont fait grand bruit de cette observation, qui n'est pas ancienne: ils ont eu raison. Cependant il s'en faut bien que ce troisième avantage de la société soit d'un intérêt aussi éminent que les deux premiers, le concours des forces et la communication des lumières. Dans Ions les genres, ce qu'il y a de plus difficile est d'assigner aux choses leur véritable valeur ; il faut pour cela les connaître parfaitement.
Concours des forces, accroissement et conservation des lumières et division du travail, voilà les trois grands bienfaits de la société, Ils se font sentir, dès son origine, aux hommes les plus grossiers; 1nais ils augmentent dans une proportion incalculable, à mesure qu'elle se perfectionne, et chaque degré d'amélioration dans l'ordre social ajoute encore à la possibilité de les accroître et d'en mieux user. L'énergie de ces trois causes de prosperité su montrera encore avec plus d'évidence, quand nous aurons vu plus en détailla manière dont se forment nos richesses.
14.Germaine de Staël on “The Love of Liberty” (1818)↩
[Word Length: 2,968]
Source
Considérations sur les principaux événemens de la Révolution françoise, ouvrage posthume de madame la baronne de Staël; publié par M. le duc de Broglie et M. le baron de Staël (Paris: Delaunay, 1818). Seconde édition. Tome troisième. Sixième partie, Chap. XII “De l’amour de la liberté”, pp. 377-391.
Brief Bio of the Author: Germaine de Staël (1766-1817)
[Germaine de Staël (1766-1817)]
Anne-Louise Germaine Necker (de Staël) (1766-1817) was the daughter of the Swiss financier Jacques Necker who was the Controller-General of France on the eve of the Revolution. She became famous in her own right as a novelist (Corinne (1807)), cultural critic (De l’Allemagne (1810)), and historian of the French Revolution (Considérations sur les principaux événements de la Révolution française (1818)). Madame de Staël (as she became known after her marriage to the Swedish diplomat Baron Staël von Holstein) became an arch critic of Napoleon and her estate at Coppet in Switzerland became a refuge for liberal critics of his régime. She was famous for her love affairs with leading figures of the day, including the classical liberal political philosopher Benjamin Constant who was infatuated with her. Staël’s political views were based upon a defence of “the principles of 1789”, republicanism, and decentralized constitutional representative government. Her first major work was on Rousseau (Letters on the Work and Character of J.-J. Rousseau (1788), which was followed by On the Influence of Passions on the Happiness of Individuals and Nations (1796), the republican inspired On the Current Circumstances which can end the Revolution (1797), On Literature considered in its Relations to Social Institutions (1800), the novel Delphine (1802), the work On Germany (1810) which so incensed Napoleon that he banned it as “un-French”, and her unfinished posthumous work of the French Revolution (1818). The later work is more than a history of the events of the Revolution or a defence of her father’s failed efforts to reform the ancien régime before it was too late, but a work of classical liberal political theory which expresses her deep-felt love of individual and political liberty. [DMH]
CHAPITRE XII. De l'amour de la liberté.
La nécessité des gouvernemens libres, c'est-à-dire, des monarchies limitées pour les grands états, et des républiques indépendantes pour les petits, est tellement évidente, qu'on est tenté de croire que personne ne peut se refuser sincèrement à reconnoître cette vérité; et cependant quand on rencontre des hommes de bonne foi qui la combattent, on voudroit se rendre compte de leurs motifs. La liberté a trois sortes d'adversaires en France: les nobles qui placent l'honneur dans l'obéissance passive, et les nobles plus avisés, mais moins candides, qui croient que leurs intérêts aristocratiques et ceux du pouvoir absolu ne font qu'un; les hommes que la révolution françoise a dégoûtés des idées qu'elle a profanées; enfin les Bonapartistes, les jacobins, tous les hommes sans conscience politique. Les nobles qui attachent l'honneur à l'obéissance passive, confondent tout-à-fait l'esprit des anciens chevaliers avec celui des courtisans des derniers siècles. Sans doute, les anciens chevaliers mouroient pour leur roi, et ainsi feraient tous les guerriers pour leurs chefs; mais ces chevaliers n'étoient nullement, comme nous l'avons dit, les partisans du pouvoir absolu: ils cherchoient eux-mêmes à entourer ce pouvoir de barrières, et mettaient leur gloire à défendre une liberté aristocratique, il est vrai, mais enfin une liberté. Quant aux nobles qui sentent que les privilèges de l'aristocratie doivent à présent s'appuyer sur le despotisme que jadis ils servoient à limiter, on peut leur dire comme dans le roman de Waverley: « Ce qui vous importe, ce n'est pas tant que Jacques Stuart soit roi, mais que Fergus Mac-Ivor soit comte. » L'institution de la pairie accessible au mérite est pour la noblesse, ce que la constitution angloise est pour la monarchie. C'est la seule manière de conserver l'une et l'autre: car nous vivons dans un siècle où l'on ne conçoit pas bien comment la minorité, et une si petite minorité, auroit un droit qui ne seroit pas pour l'avantage de la majorité. Le sultan de Perse se faisoit rendre compte, il y a quelques années, de la constitution angloise par l'ambassadeur d'Angleterre à sa cour. Après l'avoir écouté, et comme l'on va voir, assez bien compris: « Je conçois, lui dit-il, comment l'ordre de choses que vous me décrivez, convient mieux que le gouvernement de Perse à la durée et au bonheur de votre empire; mais il me semble beaucoup moins favorable aux jouissances du monarque. » C'étoit très-bien poser la question; excepté que même pour le monarque, il vaut mieux être guidé par l'opinion dans la direction des affaires publiques, que de courir sans cesse le risque d'être en opposition avec elle. La justice est l'égide de tous et de chacun; mais en sa qualité de justice cependant, c'est le grand nombre qu'elle doit protéger.
Il nous reste à parler de ceux que les malheurs et les crimes de la révolution de France ont effrayés, et qui fuient d'un extrême à l'autre, comme si le pouvoir arbitraire d'un seul était l'unique préservatif certain contre la démagogie. C'est ainsi qu'ils ont élevé la tyrannie de Bonaparte, et c'est ainsi qu'ils rendroient Louis XVIII despote, si sa haute sagesse ne l'en défendoit pas. La tyrannie est une parvenue, et le despotisme un grand seigneur; mais l'une et l'autre offensent également la raison humaine. Après avoir vu la servilité avec laquelle Bonaparte a été obéi, on a peine à concevoir que ce soit l'esprit républicain que l'on craigne en France. Les lumières et la nature des choses amèneront la liberté en France r mais ce ne sera certainement pas l'a nation qui se montrera d'elle-même factieuse ni turbulente.
Quand depuis tant de siècles toutes les âmes généreuses ont aimé la liberté; quand les plus grandes actions ont été inspirées par elle; quand l'antiquité et l'histoire des temps modernes nous offrent tant de prodiges opérés par l'esprit public -, quand nous venons de voir ce que peuvent les nations j quand tout ce qu'il y a de penseurs parmi les écrivains, a proclamé la liberté; quand on ne peut pas citer un ouvrage politique d'une réputation durable qui ne soit animé par ce sentiment; quand les beaux-arts, la poésie, les chefs-d'œuvre du théâtre, destinés à émouvoir le cœur humain, exaltent la liberté: que dire de ces petits hommes à grande fatuité, qui vous déclarent avec un accent fade et maniéré comme tout leur être, qu'il est de bien mauvais goût de s'occuper de politique, qu'après les horreurs dont on a été témoin, personne ne se soucie plus de la liberté; que les élections populaires sont une institution tout-à-fait grossière, que le peuple choisit toujours mal, et que les gens comme il faut ne sont pas faits pour aller, comme en Angleterre, se mêler avec le peuple? Il est de mauvais goût de s'occuper de politique. Eh, juste ciel! à quoi donc penseront-ils, ces jeunes gens élevés sous le régime de Bonaparte, seulement pour aller se battre, sans aucune instruction, sans aucun intérêt pour la littérature et les beaux-arts? Puisqu'ils ne peuvent avoir ni une idée nouvelle, ni un jugement sain sur de tels sujets, au moins ils seroient des hommes s'ils s'occupoient de leur pays, s'ils se croyoient citoyens, si leur vie étoit utile de quelque manière. Mais que veulent-ils mettre à la place de la politique, qu'ils se donnent les airs de proscrire? quelques heures passées dans l'antichambre des ministres, pour obtenir des places qu'ils ne sont pas en état de remplir; quelques propos dans les salons, au-dessous même de l'esprit des femmes les plus légères auxquelles ils les adressent. Quand ils se faisoient tuer, cela pouvoit aller encore, parce qu'il y a toujours de la grandeur dans le courage; mais dans un pays qui, Dieu merci, sera en paix, ne savoir être qu'une seconde fois chambellan, et ne pouvoir prêter ni lumières, ni dignité à sa patrie; c'est là ce qui est vraiment de mauvais goût. Le temps est passé où les jeunes François pou voient donner le ton à tous égards. Ils ont bien encore, il est vrai, la frivolité de jadis, mais ils n'ont plus la grâce qui faisoit pardonner cette frivolité même
Après les horreurs dont on a été témoin, disent-ils, personne ne veut plus entendre parler de liberté. Si des caractères sensibles se laissoient aller à t une haine involontaire et nerveuse, car on pourrait la nommer ainsi, puisqu'elle tient à de certains souvenirs, à de certaines associations de terreur qu'on ne peut vaincre: on leur diroit, ainsi qu'un poëte de nos jours: Qu'il ne faut pas forcer la liberté à se poignarder comme Lucrèce parce qu'elle a été profanée. On leur rappellerait que la Saint-Barthélemy n'a pas fait proscrire le catholicisme. On leur dirait enfin que le sort des vérités ne peut dépendre des hommes qui mettent telle ou telle devise sur leur bannière, et que le bon sens a été donné à chaque individu, pour juger des choses en elles-mêmes et non d'après des circonstances accidentelles. Les coupables de tout temps ont tâché de se servir d'un généreux prétexte, pour excuser de mauvaises actions; il n'existe presque pas de crimes dans le monde que leurs auteurs n'aient attribués à l'honneur, à la religion, ou à la liberté. Il ne s'ensuit pas, je pense, qu'il faille pour cela proscrire tout ce qu'il y a de beau sur la terre. En politique surtout, comme il y a lieu au fanatisme aussi-bien qu'à la mauvaise foi, au dévouement aussi-bien qu'à l'intérêt personnel, on est sujet à des erreurs funestes, quand on n'a pas une certaine force d'esprit et d'âme. Si le lendemain de la mort de Charles Ier., un Anglois, maudissant avec raison ce forfait,' eût demandé au ciel qu'il n'y eût jamais de liberté en Angleterre, certainement on auroit pu s'intéresser à ce mouvement d'un bon cœur, qui dans son émotion confondoit tous les prétextes d'un grand crime avec le crime lui-même, et auroit proscrit, s'il l'avoit pu, jusqu'au soleil qui s'étoit levé ce jour-là comme de coutume. Mais, si cette prière irréfléchie avoit été exaucée, l'Angleterre ne serviroit pas d'exemple au monde aujourd'hui, la monarchie universelle de Bonaparte pèseroit sur l'Europe, car l'Europe eût été hors d'état de s'affranchir sans le secours de cette nation libre. De tels argumens et bien d'autres pourroient être adressés à des personnes dont les préjugés même méritent des égards, parce qu'ils naissent des affections du cœur. Mais que dire à ceux qui traitent de jacobins les amis de la liberté, quand eux-mêmes ont servi d'instrumens au pouvoir impérial? Nous y étions forcés, disent-ils. Ah! j'en connois qui pourroient aussi parler de cette contrainte, et qui cependant y ont échappé. Mais, puisque vous vous y êtes laissé forcer ., trouvez bon que l'on veuille vous donner une constitution libre, où l'empire de la loi soit tel, qu'on n'exige rien de mal de vous: car vous êtes en danger, ce me semble, de céder beaucoup aux circonstances. Ils pourroient plutôt, ceux que la nature a faits résistans, ne pas redouter le despotisme; mais vous qu'il a si bien courbés, souhaitez donc que dans aucun temps, sous aucun prince, sous aucune forme, il ne puisse jamais vous atteindre.
Les épicuriens de nos jours voudroient que les lumières améliorassent l'existence physique sans exciter le développement intellectuel; ils voudroient que le tiers état eût travaillé à rendre la vie sociale plus douce et plus facile, sans vouloir profiter des avantages qu'il a conquis pour tous. On savoit vivre durement autrefois, et les rapports de la société étoient aussi beaucoup plus simples et plus fixes. Mais aujourd'hui que le commerce a tout multiplie, si vous ne donnez pas des motifs d'émulation au talent, c'est le goût de l'argent qui prendra sa place. Vous ne relèverez pas les châteaux forts; vous ne ressusciterez pas les princesses qui filoient elles-mêmes les vêtemens des guerriers; vous ne recommencerez pas même le règne de Louis XIV. Le temps actuel n'admet plus un genre de gravité et de respect, qui donnoit alors tant d'ascendant à cette cour. Mais vous aurez de la corruption, et de la corruption sans esprit, ce qui est le dernier degré où l'espèce humaine puisse tomber. Ce n'est donc pas entre les lumières et l'antique féodalité qu'il faut choisir, mais entre le désir de se distinguer, et l'avidité de s'enrichir.
Examinez les adversaires de la liberté dans tous les pays, vous trouverez bien parmi eux quelques transfuges du camp des gens d'esprit, mais en général, vous verrez que les ennemis de la liberté sont ceux des connoissances et des lumières: ils sont fiers de ce qui leur manque en ce genre, et l'on doit convenir que ce triomphe négatif est facile à mériter.
On a trouvé le secret de présenter les amis de la liberté comme des ennemis de la religion: il y a deux prétextes à la singulière injustice qui voudroit interdire au plus noble sentiment de cette terre l'alliance avec le ciel. Le premier c'est la révolution: comme elle s'est faite au nom de la philosophie, on en a conclu qu'il falloit être athée pour aimer la liberté. Certes, c'est parce que les François n'ont pas uni la religion à la liberté, que leur révolution a sitôt dévié de sa direction primitive. Il se pouvoit que de certains dogmes de l'église catholique ne s'accordassent pas avec les principes de la liberté; l'obéissance passive au pape étoit aussi peu soutenable que l'obéissance passive au roi. Mais le christianisme a véritablement apporté la liberté sur cette terre, la justice envers les opprimés, le respect pour les malheureux, enfin l'égalité devant Dieu, dont l'égalité devant la loi n'est qu'une image imparfaite. C'est par une confusion volontaire chez quelques-uns, aveugle chez quelques autres, qu'on a voulu faire considérer les privilèges de la noblesse, et le pouvoir absolu du trône, comme des dogmes de la religion. Les formes de l'organisation sociale ne peuvent toucher à la religion que par leur influence sur le maintien de la justice envers tous, et de la morale de chacun; le reste appartient à la science de ce monde.
Il est temps que vingt-cinq années, dont quinze appartiennent au despotisme militaire, ne se placent plus comme un fantôme entre l'histoire et nous, et ne nous privent plus de toutes les leçons et de tous les exemples qu'elle nous offre. N'y auroit-il plus d'Aristide, de Phocion, d'Épaminondas en Grèce; de Régulus, de Caton, de Brutus à Rome; de Tell en Suisse; d'Egmont, de Nassau en Hollande; de Sidney, de Russel en Angleterre, parce qu'un pays, gouverné long-temps par le pouvoir arbitraire, s'est vu livré pendant une révolution aux hommes que l'arbitraire même avoit pervertis? Qu'y a-t-il de si extraordinaire dans un tel événement, qu'il doive changer le cours des astres, c'est-à-dire, faire reculer la vérité qui s'avançoit avec l'histoire pour éclairer le genre humain? Et par quel sentiment public serions-nous désormais émus, si nous repoussions l'amour de la liberté? Les vieux préjugés n'agissent plus sur les hommes que par calcul, ils ne sont soutenus que par ceux qui ont un intérêt personnel à les défendre. Qui veut en France le pouvoir absolu par amour pur, c'est-à-dire pour lui-même?Informez-vous de la situation personnelle de chacun de ses défenseurs, et vous connoîtrez bien vite les motifs de leur doctrine. Sur quoi donc se fonderoit la fraternité des associations humaines, si quelque enthousiasme ne se développoit pas dans les cœurs? Qui seroit fier d'être François, si l'on avoit vu la liberté détruite par la tyrannie, la tyrannie brisée par les étrangers, et que les lauriers de la guerre ne fussent pas au moins honorés par la conquête de la liberté? Il ne s'agiroit plus que de voir lutter l'un contre l'autre l'égoïsme des privilégiés par la naissance et l'égoïsme des privilégiés par les événemens. Mais la France où seroit-elle? Qui pourroit se vanter de l'avoir servie, puisque rien ne resteroit dans les cœurs, ni des temps passés ni de la réforme nouvelle?
La liberté! répétons son nom avec d'autant plus de force, que les hommes qui devraient au moins le prononcer comme excuse, F éloignent par flatterie; répétons-le sans crainte de blesser aucune puissance respectable: car tout ce que nous aimons, tout ce que nous honorons y est compris. Rien que la liberté ne peut remuer l'âme dans les rapports de l'ordre social. Les réunions d'hommes ne seroient que des associations de commerce ou d'agriculture, si la vie du patriotisme n'excitoit pas les individus à se sacrifier à leurs semblables. La chevalerie étoit une confrérie guerrière qui satisfaisoit au besoin de dévouement qu'éprouvent tous les cœurs généreux. Les nobles étoient des compagnons d'armes qu'un honneur et un devoir réunissoient; mais depuis que les progrès de l'esprit humain ont créé les nations, c'est-à-dire, depuis que tous les hommes participent de quelque manière aux mêmes avantages, que feroit-on de l'espèce humaine sans le sentiment de la liberté? Pourquoi le patriotisme françois commenceroit-il à telle frontière et s'arrêteroit-il à telle autre, s'il n'y avoit pas dans cette enceinte des espérances, des jouissances, une émulation, une sécurité qui font aimer son pays natal par l’âme autant que par l'habitude? Pourquoi le nom de France causeroit-il une invincible émotion, s'il n'y avoit d'autres liens entre les habitans de cette belle contrée que les privilèges des uns et l'asservissement des autres?
Partout où vous rencontrez du respect pour la nature 'humaine, de l'affection pour ses semblables, et cette énergie d'indépendance .qui sait résister à tout sur la terre, et ne se prosterner que devant Dieu, là vous voyez l'homme image de son Créateur, là vous sentez au fond de l'âme un attendrissement si intime qu'il ne peut vous tromper sur la vérité. Et vous, nobles François, pour qui l'honneur étoit la liberté j vous qui, par une longue transmission d'exploits et de grandeur, déviez vous considérer comme l’élite de l'espèce humaine, souffrez que la nation s'élève jusqu'à vous; elle a aussi maintenant les droits de conquête, et tout François aujourd'hui peut se dire gentilhomme, si tout gentilhomme ne veut pas se dire citoyen.
C'est une chose remarquable en effet qu'à une certaine profondeur de pensée parmi tous les hommes, il n'y a pas un ennemi de la liberté. De la même manière que le célèbre Humbold a tracé sur les montagnes du nouveau monde les différens degrés d'élévation qui permettent le développement de telle ou telle plante, on pourroit dire d'avance quelle étendue, quelle hauteur d'esprit fait concevoir les grands intérêts de l'humanité dans leur ensemble et dans leur vérité. L'évidence de ces opinions est telle, que jamais ceux qui les ont admises ne pourront y renoncer, et, d'un bout du monde à l'autre, les amis de la liberté communiquent par les lumières, comme les hommes religieux par les sentimens, ou plutôt les lumières et les sentimens se réunissent dans l'amour de la liberté comme dans celui de l'Etre-Suprême. S'agit-il de l'abolition de la traite des nègres, de la liberté de la presse, de la tolérance religieuse, Jefferson pense comme La Fayette, La Fayette comme Wilberforce; et ceux qui ne sont plus comptent aussi dans la sainte ligue. Est-ce donc par calcul, est-ce donc par de mauvais motifs que des hommes si supérieurs, dans des situations et des pays si divers, sont tellement en harmonie par leurs opinions politiques? Sans doute il faut des lumières pour s'élever au-dessus des préjugés; mais c'est dans l'âme aussi que les principes de la liberté sont fondés: ils font battre le cœur comme l'amour et l'amitié; ils viennent de la nature, ils ennoblissent le caractère. Tout un ordre de vertus, aussi-bien que d'idées, semble former cette chaîne d'or décrite par Homère, qui, en rattachant l'homme au ciel, l'affranchit de tous les fers de la tyrannie.
15.Dunoyer on "The Politics which comes from Political Economy" (1818)↩
[Word Length: 7,458]
Source
Dunoyer, Charles, Oeuvres de Dunoyer, revues sur les manuscrits de l'auteur, 3 vols., ed. Anatole Dunoyer (Paris: Guillaumin, 1870, 1885, 1886). Vol. 3, "Politique tirée des doctrines économiques," pp. 84-104.
Original: Review of Say’s Petit volume (1818) in Le Censeur européen, Tome VII, 1818, pp. 80-126.
Jean Baptiste Say, Petit volume contenant quelques apperçus des hommes et de la société, 2e édition (Paris: Deterville, 1818).
Politique tirée des doctrines économiques.36
C'est le propre de toute science qui n'est pas encore faite, de nous induire en erreur sur les ressources qu'il est raisonnablement possible d'en attendre. Tant que la chimie ne fut que de l'alchimie, on crut pouvoir la faire servir à transmuer les métaux et à produire de l'or. Tant que la médecine ne fut que de l'empirisme, il n'y eut pas de maux qu'on ne lui attribuât le pouvoir de guérir; peu s'en fallut qu'on ne la crût capable de ressusciter les morts. Tant que la politique ne fut qu'une science occulte, on crut que le gouvernement pouvait s'appliquer utilement a tout; on crut que le corps social ne pouvait vivre et se soutenir que par son secours, comme on croyait que le corps humain ne pouvait faire ses fonctions, se développer, croître, se conserver que par l'assistance de la médecine; et la société prospéra dans les mains des médecins politiques, à peu près comme la santé du malade imaginaire fleurit et prospère dans les mains de M. Fleurant et de M. Purgon.
On est encore fort loin de savoir au juste ce que le gouvernement a véritablement mission de faire, et l'espèce de service qu'il peut rendre utilement à la société. On croit toujours qu'il est propre à tout, et il y a dans la pratique du gouvernement beaucoup plus d'empirisme qu'il n'y en avait, il y a cent cinquante ans, dans l'exercice de la médecine.
Il est fort peu de publicistes dont les écrits soient de nature à contribuer aussi puissamment que ceux de M. Say à changer un tel état de choses en éclairant les esprits sur ce point. L'influence que sont destinées à exercer sur la politique proprement dite les doctrines de l'économie politique, qu'il a le mérite d'avoir élevée parmi nous au rang des sciences morales les plus positives et les mieux faites, est véritablement immense. En attirant nos regards sur le phénomène de la production, et en nous portant à envisager ce phénomène dans toute son étendue, l'économie politique tend à nous affermir par le raisonnement dans les véritables voies de la civilisation, que nous n'avons encore suivies que par une sorte d'instinct, et dont de funestes passions nous ont trop souvent détournés. Elle nous conduit à reconnaître que tout ce qui se fait dans la société de véritablement utile au bonheur des hommes, c'est le travail qui l'opère, le travail appliqué au développement de toutes nos facultés et à la création de tous les biens que nos besoins réclament. Elle nous amène à voir combien est salutaire la direction que le travail donne a notre activité, combien est pernicieuse celle que lui impriment la recherche du pouvoir, le goût des conquêtes, toutes les passions dominatrices. Le travail détruit tout principe d'hostilité entre les hommes, il les réconcilie, il fait concorder l'intérêt de chacun avec l'intérêt de tous; il est un principe d'union et de prospérité universelles. L'esprit de domination, au contraire, divise à la fois tous les hommes; il n'élève les uns qu'en abaissant les autres; il est un principe de ruine pour tous, même pour ceux qu'il fait jouir momentanément d'une sorte de prospérité. Telle est la vérité fondamentale à laquelle conduisent les principes de l'économie politique. Or, de cette vérité généralement sentie doit résulter un grand changement dans la direction des idées. Un nouvel objet s'offre à l'activité universelle; les individus et les nations détournent insensiblement sur les choses l'action qu'ils aspiraient à exercer les uns sur les autres; le travail acquiert la considération et la dignité que perd l'esprit de domination; il devient la passion générale, l'objet fondamental de la société.
Le premier effet des doctrines économiques est donc de placer la société sur ses vrais fondements, de l'attacher à son objet véritable, le travail. Mais ce n'est pas là leur effet unique. En même temps qu'elles présentent l'industrie, considérée dans ses innombrables applications, comme l'objet naturel des associations humaines, elles enseignent les véritables intérêts des peuples industrieux; elles montrent quel est le régime qui leur serait le plus favorable, et c'est principalement sous ce rapport que leur influence sur la politique est destinée à devenir grande et utile. Elles attaquent par la base les systèmes militaire et mercantile, et surtout ce régime réglementaire qui tend à tout envahir et à tout paralyser; qui tiendrait volontiers toutes nos facultés captives; qui prétend en diriger le développement, en déterminer les opérations; décider d'avance sur toutes choses ce qu'il faut croire, ce qu'il faut pratiquer; dire comment on doit louer Dieu, comment élever ses enfants, comment écrire, comment parler, comment se taire, comment ensemencer son champ, comment fabriquer, comment faire le commerce: sorte de monstre à mille bras, qui enserre étroitement l'arbre de la civilisation, et en contrarie de toutes parts le développement et la croissance.
L'économie politique nous apprend que le premier besoin de l'industrie est d'être franche d'entraves: travailler à la régler, c'est s'évertuer à la détruire; borner le cercle de ses opérations, c'est resserrer celui de ses bienfaits. Son second besoin est de pouvoir jouir avec sécurité du fruit de ses travaux: elle est amie de la paix autant qu'ennemie de la contrainte, et l'on peut la paralyser en lui ravissant ses produits, comme en l'empêchant de produire. Liberté et sûreté, voilà donc sa devise; il ne lui faut que cela pour prospérer, mais il ne lui faut pas moins que cela; et on la voit constamment grandir ou décliner selon le degré de liberté et de sûreté dont elle jouit.
Ainsi, en même temps que les doctrines économiques nous conduisent à reconnaître quel est le véritable objet de la société, elles nous apprennent à discerner ce qui est l'objet certain des gouvernements. L'objet de la société, c'est la production considérée dans ses manifestations les plus variées et les plus étendues; celui des gouvernements, c'est, en laissant toute liberté à la production, de faire jouir les producteurs de la sûreté qui leur est indispensable. Tout ce qui tend à troubler la sûreté, voilà la matière et toute la matière de la fonction que les gouvernements doivent remplir. Leur action ne doit pas aller plus loin.
De là, dans les conceptions de la politique proprement dite, un changement fort important et qu'on ne saurait trop faire remarquer. L'action que les gouvernements doivent exercer sur la société n'est plus une action directe, mais indirecte et en quelque sorte négative. Leur tâche n'est pas de la dominer, mais de la préserver de toute domination. Ils ne sont pas chargés de lui assigner un but et de l'y conduire, mais seulement d'écarter les obstacles qui entravent plus ou moins sa marche vers le but que lui indiquent et auquel la portent sa nature et ses besoins. La société reçoit sa destination d'elle-même; elle la suit par sa propre impulsion. Les hommes qui prétendraient la diriger ressembleraient à la mouche du coche, et seraient peut-être un peu plus ridicules. Voir le mouvement de la société dans l'action des gouvernements, c'est confondre les évolutions de la mouche avec la marche du vehicule. Croire que le monde ne se meut que parce que les gouvernements décrètent, réglementent, s'agitent, c'est croire que le char ne chemine que parce que la mouche bourdonne, s'empresse, s'assied sur le nez du cocher, et demande aux chevaux le loyer de sa peine. Il est vrai que, dans la société, les chevaux paient; mais il n'en faut pas conclure que les mouches traînent le char. Tandis que quelques hommes rendent des lois, bourdonnent des harangues, font des parades, livrent des batailles, multiplient, précipitent de stériles mouvements, et pensent ainsi gouverner le monde, le genre humain, conduit par les seules lois de son organisation, peuple la terre, la rend vivante et féconde, multiplie à l'infini les produits des arts, agrandit le domaine des sciences, perfectionne toutes ses facultés, accroît tous les moyens de les satisfaire, et accomplit ainsi ses destinées. Cet immense mouvement de l'espèce humaine échappe à l'action des hommes vains qui prétendent la conduire, et ils pourraient disparaître qu'il ne serait ni suspendu ni ralenti. Il n'est donc pas au pouvoir des gouvernements de diriger, la société; tout ce dont ils sont capables, c'est de rendre sa marche un peu plus ou un peu moins facile, selon qu'ils appliquent leur puissance à fortifier ou à affaiblir les résistances qu'elle éprouve. Ce n'est que sur ces résistances qu'ils doivent agir; leur tâche est de les vaincre et n'est que cela.
Dès lors, toute action des gouvernements au delà de cet objet est une usurpation réelle; tout effort des gouvernements pour assigner une fin particulière à la société, ou pour la conduire par d'autres voies que les siennes à la fin qu'elle doit atteindre, est une véritable tyrannie. Ainsi, toute organisation dont l'objet serait de faire d'un peuple un peuple souverain, un peuple conquérant, un peuple dévot, serait également absurde et tyrannique; et toute mesure par laquelle on entreprendrait de diriger le mouvement d'un peuple industrieux vers sa destination naturelle, toute intervention des gouvernements dans le commerce, les arts, l'agriculture, la religion, les sciences, l'éducation, l'imprimerie, serait pareillement un acte de déraison et de tyrannie. Il est bien entendu que les gouvernements n'ont point à se mêler de ces choses: elles sont la matière de la société, et non celle des gouvernements. Les individus dont la société se compose, cultivent, fabriquent, commercent, écrivent, élèvent leurs enfants, honorent les dieux, au gré de leurs besoins, de leur raison, de leur conscience; et les bons gouvernements n'entrent dans ce grand mouvement de la société humaine, que pour reconnaître ce qui le trouble, et s'efforcer de le réprimer. Leur tâche est de veiller à la sûreté de tous, en prenant le moins possible sur le temps, sur les revenus, sur la liberté de chacun.
Dès lors, le meilleur gouvernement sera évidemment celui qui retranchera le moins de notre liberté, de nos moyens de vivre, et qui cependant nous fera jouir de la plus grande sûreté.
Dès lors, entre un gouvernement qui dépensera des milliards, qui multipliera les prohibitions et les gênes, et sous lequel pourtant on sera exposé à toute sorte d'avanies et de violences, et un gouvernement qui, pour quelques millions et sans presque rien ôter aux particuliers de leur liberté d'action, mettra chacun à l'abri de toute espèce d'insultes; entre le gouvernement des États-Unis, par exemple, qui, pour moins de 50 millions, et en laissant la plus grande latitude à la liberté, fera jouir douze millions d'Américains de la sûreté la plus parfaite, et tel gouvernement d'Europe qui, dans un pays de seize millions d'habitants, dépensera près de 2 milliards, s'armera de lois d'exception, chargera la liberté d'entraves, et cependant ne fera jouir les contribuables que d'une sûreté précaire, on voit à l'instant lequel remplit le mieux son objet.
Dès lors deviennent impossibles toute querelle pour le triomphe de tel ou tel chef, toute révolution pour changer de domination, toute guerre civile pour passer des mains d'un parti dans celles d'un autre. Le gros du public a enfin le bon sens de comprendre qu'il ne vaut pas mieux être exploité par des wighs que par des torys, par des ministériels que par des ultra, par des jacobins que par des bonapartistes. On se demande seulement s'il serait possible, et comment il serait possible d'être de moins en moins exploité par qui que ce soit.
Dès lors tombe toute discussion sur les diverses formes de gouvernement, qui n'aurait pas directement pour objet de rendre le gouvernement, quel qu'il soit, plus doux, moins coûteux, et tout à la fois plus favorable à la liberté et à la sûreté. Le but à atteindre n'est pas de le rendre accessible à tous, mais utile à tous. Il ne s'agit pas de savoir si les pouvoirs se balancent, mais si leur action s'exerce au profit du public. Il n'est pas question de faire que l'aristocratie, la démocratie et la royauté règnent paisiblement ensemble, mais d'empêcher que l'aristocratie, la démocratie et la royauté ne considèrent la société comme un domaine, et la possession du pouvoir comme une source de profits à dérober. L'important, enfin, n'est pas d'avoir un gouvernement intitulé monarchie ou république; car ces mots peuvent, l'un et l'autre, signifier des horreurs ou des sottises; mais ce qui importe, quelle que soit l'enseigne de la compagnie chargée de veiller à la sûreté commune, c'est qu'elle coûte peu, et qu'elle ne vexe point.
Dès lors perdent leur magie les mots de constitution, de gouvernement représentatif, etc. On conçoit la possibilité d'avoir un jury, des conseils municipaux, départementaux, nationaux, et cependant de payer fort cher pour être fort malmené. Si, par la manière dont ils sont constitués, ou par l'effet d'habiles manœuvres, ces corps se trouvent habituellement composés d'hommes appartenant aux ministres; si les moyens de contrôler les actes du gouvernement sont ainsi livrés aux mains de ses agents; si les garanties instituées pour mettre obstacle à l'arbitraire sont transformées en instruments propres à en faciliter la pratique; si l'intervention du public dans la gestion de ses propres affaires n'aboutit qu'à donner un surcroît de forces au pouvoir exécutif contre les particuliers; si le public devient ainsi malgré lui l'artisan des maux qu'il endure, s'il se met lui-même sous le régime des lois d'exception, s'il se charge lui-même d'impôts accablants, s'il se harcèle, se pille, se dévore lui-même, on conçoit que l'organisation qui tourne ainsi ses forces contre lui n'est qu'une déception cruelle, qu'elle est la plus terrible de toutes les tyrannies. Il ne suffit donc pas d'avoir un gouvernement dit représentatif, pour se trouver sous le meilleur de tous les régimes. Ce régime peut être le meilleur, il est vrai; mais il peut aussi être le pire: cela dépend tout à fait de l'usage auquel servent les forces immenses qu'il met en jeu. Il est le pire, si le pouvoir exécutif peut à son gré disposer de ces forces, et ajouter leur puissance à la sienne pour opprimer plus violemment et plus sûrement le pays. Il est le meilleur, si elles servent à modérer son action, et à réduire ses dépenses toutes les fois qu'elles passent les bornes; si elles ne lui accordent que le pouvoir strictement nécessaire au maintien de la sûreté, et laissent ainsi à la liberté toute l'extension qu'elle doit avoir.
Voilà comment les doctrines économiques, en même temps qu'elles signalent le véritable objet de la fonction que les gouvernements ont à remplir, ne permettent jamais de perdre de vue cet objet. On n'en est distrait ni par les couleurs qu'arborent les partis tour à tour victorieux, ni par les formes sous lesquelles l'action du pouvoir se manifeste, ni par l'espèce et la condition des hommes que l'autorité souveraine fait entrer en partage des emplois publics, ni par la pompe qu'étalent les chefs d'État, ni par les sentiments qu'ils affectent. En vain s'offriraient-ils aux regards entourés de monuments fastueux; en vain diraient-ils qu'ils ont fait triompher le pays, qu'ils sanctifient le peuple, qu'ils l'associent au pouvoir exercé sur lui. Ce n'est point à ces signes qu'on juge du mérite des gouvernements. On demande uniquement quelle est la sûreté dont ils font jouir les citoyens, et quels sacrifices ils leur imposent pour les préserver de tout trouble. Plus la sûreté est grande et moins leur action se fait sentir, plus on les trouve parfaits. On pense qu'ils font des progrès, à mesure qu'ils se font moins apercevoir, et que le pays le mieux gouverné serait celui où le maintien de la sûreté commune n'exigeant plus l'intervention d'une force spéciale et permanente, le gouvernement pourrait en quelque sorte disparaître, et laisser aux habitants la pleine jouissance de leur temps, de leurs revenus, de leur liberté.
Ajoutons qu'en nous faisant découvrir en quoi consiste la fonction nécessaire des bons gouvernements, les doctrines économiques nous conduisent a voir de quelle manière on peut faire faire des progrès à ceux qui ne sont pas tels qu'on les doit souhaiter. Si les gouvernements se perfectionnent à mesure qu'ils diminuent les charges et les entraves par lesquelles ils se font sentir, et s'ils peuvent rendre le poids de leur action moins sensible à mesure que le maintien de la sûreté exige un moindre développement de forces, il s'ensuit évidemment que le seul moyen de leur faire faire des progrès, c'est d'agir sur les causes qui nécessitent l'emploi de ces forces, d'épuiser en quelque sorte la matière sur laquelle doit s'exercer leur effort, de faire disparaître ce qui menace la sûreté de tous. Il serait aussi difficile d'établir un gouvernement doux dans un pays peuplé d'oisifs, d'ambitieux, de parasites, qu'il pourrait l'être d'établir un gouvernement violent et oppresseur dans un pays dont tous les habitants seraient livrés à des occupations utiles, et trouveraient dans leurs travaux des moyens assurés de bien-être et d'aisance. Le gouvernement serait violent dans le premier, par cela seul qu'il y aurait beaucoup d'hommes qui aspireraient à dominer, beaucoup qui auraient besoin d'être contenus, et il le serait, quelle que fût la forme qu'on lui donnât; car la forme ne changerait pas la matière: elle ne serait qu'une nouvelle manière de la mettre en œuvre, qu'un nouveau cadre dans lequel s'agiteraient les ambitions. Dans le second, au contraire, le gouvernement serait doux, par cela seul qu'il y aurait très-peu d'hommes qui aspireraient à exercer le pouvoir, très-peu sur qui le pouvoir aurait besoin d'être exercé, et il le serait, quelle que fût sa constitution; car la constitution du gouvernement ne changerait pas celle des hommes, et ne ferait pas qu'ils fussent disposés à exercer ou à souffrir la domination, si leurs mœurs ne les excitaient qu'au travail, et repoussaient également toute idée de domination et de servitude.
Considérez ce qui se passe aux États-Unis, où tous les hommes travaillent, où nul du moins ne peut s'élever que par le travail; où, au lieu de mendier, de solliciter, d'intriguer, de cabaler, de conspirer, chacun cherche les moyens de vivre et de prospérer dans l'emploi laborieusement productif de ses forces: le gouvernement y est si doux, qu'il est à peine sensible, et il serait bien difficile qu'il déployât une action très-étendue, car qui l'exercerait, et sur qui s'exercerait-elle? Des peuples aussi occupés, aussi heureux par le travail, n'ont besoin, pour ainsi dire, ni de gouverner, ni d'être gouvernés. Voyez l'Europe, au contraire, où tant d'hommes ne travaillent point; où l'on s'enrichit par la domination bien mieux encore que par le travail; où les sollicitations, l'intrigue, les conspirations, les efforts de toute nature pour conquérir le pouvoir tiennent une place si éminente parmi les moyens de faire fortune: les gouvernements y sont d'une dimension et d'une activité démesurées; les nations disparaissent derrière ces colosses; elles succombent sous le poids de leur action, et il serait bien difficile de les resserrer dans des cadres étroits, car que faire de cette masse d'artistes-gouvernants qu'ils mettent en œuvre, de celle qui voudrait participer à leur action, et qu'ils tiennent en échec? Le moyen d'être peu gouverné dans des contrées où tout le monde veut faire figure, et où le seul moyen d'y réussir, c'est d'être du gouvernement? On aurait beau faire, on aurait beau varier les formes du pouvoir, il est de force que son action se proportionne à la masse des ambitieux qui veulent y prendre part, ou sur lesquels il est nécessaire qu'elle s'exerce. Le seul moyen de la rendre moins sensible, c'est donc de travailler à rendre de moins en moins considérable le nombre des hommes qui vivent ou aspirent à vivre des profits que donne l'exercice de l'autorité.
Enfin, en même temps que les doctrines économiques nous conduisent à reconnaître que le seul moyen d'améliorer les gouvernements, c'est de réduire le nombre des ambitieux et des oisifs qui ont besoin de gouverner ou d'être gouvernés, elles tendent d'une manière très-directe à produire cet heureux effet; car elles attaquent l'ambition et l'oisiveté dans leur source même, dans ce qui les engendre et les alimente, dans les dépenses inutiles des gouvernements.
Il n'en faut pas douter, si, dans notre Europe, en France surtout, où il pourrait être si facile de s'honorer et de s'enrichir par d'utiles travaux, on voit tant de gens courir à la fortune par des voies nuisibles ou honteuses, tant de gens qui vivent de pouvoir ou de larcin, c'est surtout à l'excès des dépenses publiques qu'il faut attribuer ce désordre. Ce sont ces dépenses qui, en tarissant les sources naturelles de la richesse, détournent une foule d'hommes de tous les rangs des occupations honorables, et les font recourir, pour s'élever, à des expédients honteux; excitent ceux des classes inférieures à la mendicité, au vol, au vagabondage; ceux des classes plus élevées à la poursuite des emplois, à l'intrigue, aux cabales, aux factions, et peuplent ainsi la société de cette multitude d'hommes pour lesquels ou contre lesquels les gouvernements sont nécessaires. On ne saurait nier que la direction que suit cette multitude ne soit particulièrement déterminée par celle que les dépenses publiques font prendre a une portion considérable des revenus de la société. Les gens qui appartiennent par leur éducation aux rangs supérieurs de la société ne mettraient pas une si grande activité d'ambition à rechercher des emplois publics, si les impôts ne faisaient affluer l'argent du public vers ces emplois. Tant de misérables ne se feraient pas une ressource du vol, si les impôts, en épuisant les revenus des hommes qui pourraient les occuper, ne leur ravissaient pas la faculté de chercher une ressource plus honorable dans le travail. Le meilleur moyen de faire refluer toute cette cohue d'ambitieux et de malheureux vers les occupations honnêtes et utiles, de délivrer ainsi la société des hommes qui la troublent, et de restreindre par cela même la matière sur laquelle et par laquelle s'exerce l'action des gouvernements, c'est donc de réduire les dépenses publiques, de rendre insensiblement à son cours naturel l'immense portion des revenus de la société qu'elles absorbent, et de faire ainsi que le travail devienne tout à la fois le seul moyen et un moyen toujours plus assuré de bien-être et d'aisance. Or, l'influence des doctrines économiques ne peut manquer d'amener tôt ou tard ce résultat. Elles répandent, en effet, une telle lumière sur les consommations publiques; elles fournissent des moyens si sûrs et si simples d'en apprécier l'utilité, qu'il paraît impossible que le gros de la nation ne finisse pas par être frappé des effets désastreux de la plupart de celles qu'on fait à ses dépens, et qu'une fois éclairé sur ces abus, il ne réussisse pas à en obtenir le redressement.
Ainsi, la science économique nous conduit à reconnaître que l'objet de toute société civilisée, c'est le travail considéré dans toutes ses applications utiles; que l'objet unique des gouvernements doit être de veiller au repos de la société, en laissant à la liberté des individus qui la composent la plus grande latitude possible; que le meilleur gouvernement est celui qui procure le plus de sûreté aux citoyens, et qui retranche le moins de leur temps, de leurs revenus, de leur liberté; que, dès lors, les gouvernements deviennent meilleurs à mesure qu'ils rendent le poids de leur action moins sensible; que l'étendue des attributions usurpées par eux peut-être réduite à mesure que la société se civilise, à mesure que le nombre des hommes qui ont besoin de gouverner ou d'être gouvernés diminue; que le véritable moyen de diminuer le nombre de ces hommes, c'est de restreindre de plus en plus la facilité de s'enrichir par le pouvoir, d'augmenter de plus en plus, au contraire, celle de s'élever par le travail; et enfin que le meilleur moyen d'obtenir ce dernier résultat, c'est de réduire progressivement les dépenses publiques, de rendre par degrés à leur destination naturelle, aux consommations reproductives, les immenses capitaux que ces dépenses en détournent et qu'elles détruisent improductivement. Voilà les principales vérités politiques que l'économie politique met en lumière. On comprend maintenant comment cette science peut contribuer aux progrès de la société et à l'amélioration des gouvernements; et il serait difficile, en envisageant le bien immense qu'elle est destinée à produire, de ne pas éprouver quelque reconnaissance pour l'écrivain auquel nous devons de l'avoir tirée du domaine des spéculations et mise à la portée de toutes les intelligences. L'ouvrage de M. Say sur l'économie politique est, sans contredit, l'une des productions les plus éminemment utiles de ce siècle, l'une de celles qui répondent le mieux à ses besoins, et qui paraissent devoir exercer l'influence la plus salutaire sur la direction des idées des hommes de notre temps.
Le petit ouvrage du même écrivain, à l'occasion duquel nous sommes entré dans cet ordre de considérations, est loin sans doute d'avoir la même importance; cependant, il en a plus de beaucoup que ne semblerait l'annoncer son titre, et, pour ne pas sortir du sujet qui nous occupe, nous dirons qu'il renferme des vues capables de concourir aussi très-efficacement aux progrès de la société et à l'amélioration des gouvernements. La preuve de cette vérité ne se fera pas attendre.
Nous disons qu'un des meilleurs moyens de faire faire des progrès à la société, c'est de réduire les consommations publiques. Mais le moyen d'opérer cette réduction? le moyen d'obtenir que les gouvernements dépensent peu? le moyen de réformer les abus d'un mauvais gouvernement, en un mot? grande question que M. Say n'agite point dans son petit volume, mais sur laquelle une des pensées les plus judicieuses parmi toutes celles qu'il a développées dans cet ingénieux écrit, nous paraît jeter un trait éclatant de lumière.
Est-ce par des remontrances, par de justes et sévères censures qu'on peut réprimer les excès du pouvoir? Est-ce par des menaces, des révoltes, des révolutions? Est-ce enfin par des institutions destinées à le contenir dans de certaines limites? On ne s'est guère avisé jusqu'ici d'autres expédients. Le vulgaire des réformateurs, semblables à l'animal stupide qui ne sait que mordre la pierre dont il est atteint, ne connaît pas de meilleur moyen de corriger les gouverments tyranniques, que de les culbuter et de les remplacer par d'autres. Les hommes modérés, qui repoussent ces moyens violents, croient que pour faire cesser leurs excès, il suffit de leur en représenter les dangereuses conséquences. Une classe d'hommes plus habiles redoutent les révolutions, et croient faiblement au pouvoir des remontrances; mais ils ont une confiance sans bornes dans les constitutions; les constitutions sont leur grand cheval de bataille, et ils ne doutent pas que pour mettre un gouvernement dans l'impuissance de nuire, il ne suffise d'ériger autour de lui, sous le nom de chambres, de jurys, de conseils municipaux, etc., des espèces de redoutes dans lesquelles le public pourra placer des mandataires chargés de défendre ses droits. Les uns et les autres ont entre eux cela de commun que, pour corriger le pouvoir, ils ne cherchent à agir que sur le pouvoir; chacun agit à sa manière, mais tous dirigent leur action du même côté.
Est-ce là une tendance bien éclairée? Est-ce sur les gouvernements qu'il est le plus convenable d'agir, pour corriger les abus des gouvernements? Voilà la question sur laquelle la pensée que nous avons annoncée nous paraît répandre une vive lumière. L'auteur recherche en quoi consiste la moralité des ouvrages de littérature.
« Lorsque je demande, dit-il, ce qu'on entend par un ouvrage moral, on me répond que c'est un ouvrage où le vice finit par être puni, et où la vertu reçoit sa récompense. Cela paraît tout simple. Si pourtant cela ne corrigeait personne, où serait la moralité? Voyez, observez, réfléchissez. Le méchant qui est dans le monde, que pense-t-il en voyant punir son confrère le méchant du théâtre? Selon lui, c'est un sot que l'auteur a fait tomber dans un piége pour complaire à la bonhomie du public. S'il gagne quelque chose à cet exemple, c'est un peu plus d'adresse pour éviter de devenir lui-même la fable des honnêtes gens. Quant aux personnes vertueuses, lorsqu'elles voient, à la fin d'un cinquième acte, la vertu récompensée et le vice confondu, elles disent en soupirant: C'est bon pour le théâtre, ou bien pour les romans; mais ce n'est pas là l'histoire du monde. Et le monde va comme devant.
» Il est satisfaisant, j'en conviens, de voir, même en fiction, les méchants punis: cela réjouit l'âme; et j'aime l'auteur qui me procure cette petite satisfaction, à défaut d'une plus réelle; mais un littérateur habile, pour être vraiment moral, sait employer d'autres moyens.
» Voyez Molière ! s'il a gâté le métier des tartufes, pensez-vous que ce soit en faisant intervenir, au dénoûment, le grand monarque qui vient, comme un dieu dans une machine, retirer la famille d'Orgon du désastre où l'a plongée l'imbécillité de son chef? Si l'échafaud n'effraie pas les voleurs, pense-t-on que les lettres de cachet feront trembler les hypocrites? Ils savent que cette foudre ne va pas mieux que l'autre choisir de préférence les méchants. Qui peut se vanter d'avoir rencontré des hypocrites corrigés? Où trouverons-nous donc la moralité, l'utilité? La voici: on ne corrige pas les tartufes, mais on diminue le nombre des Orgons. Les fourbes disparaissent, comme toute espèce de vermine, faute d'aliments. Croyez-vous qu'il y eût moins de tartufes qu'autrefois, si nous avions autant d'imbéciles pour les écouter?
» Or, c'est une utilité morale bien réelle que celle qui résulte du chef-d'œuvre de Molière. Et remarquez que l'utilité morale ici ne vient point de ce que le méchant est puni; au contraire: il ne le serait pas, que la moralité serait bien plus forte. Qui peut nier que si Tartufe en venait à ses fins, s'il réussissait à dépouiller la famille d'Orgon, à le mettre lui-même hors de sa propre maison, et à les faire tous passer pour des calomniateurs, on ne sentît bien autrement encore le danger de laisser s'impatroniser un directeur dans sa famille? Molière n'a pas préféré ce dénoûment, non qu'il le jugeât immoral, mais probablement parce qu'il craignait que tout cela ne sortit du genre de la comédie; et la preuve, c'est qu'il a fait un dénoûment de cette espèce dans une autre comédie où l'offense n'a pas un caractère aussi grave. Il a humilié le bon sens et le bon droit; il a fait triompher le vice et l'imposture: George Dandin demande pardon à sa femme infidèle de l'avoir soupçonnée, quand ce ne sont plus seulement des soupçons qu'il a, mais une certitude. Aussi cria-t-on à l'immoralité, et l'on ne fit pas attention que si Molière eût confondu la femme au lieu du mari, sa pièce ne montrait plus les inconvénients des mariages disproportionnés et n'avait plus aucune moralité.
» Le même reproche fut fait à Voltaire au sujet de Mahomet. Les fanatiques avaient de bonnes raisons pour vouloir que Mahomet fût puni. Lorsqu'un filou est pris sur le fait et parvient à s'échapper, les autres ont soin de crier: Au voleur!
» Bien fou donc qui s'imagine, par des livres, corriger les hypocrites, les femmes galantes, les conquérants, les usurpateurs, les fourbes qui travaillent en petit, ou ceux qui travaillent en grand. Mais, par des livres, ce dont on peut se flatter, c'est de corriger leurs dupes. »37
Voilà-la pensée. On ne corrige point les tartufes; mais on diminue le nombre des Orgons. On ne corrige point les fourbes; mais on peut se flatter de corriger leurs dupes. Corrige-t-on les mauvais gouvernements? Est-ce attaquer l'arbitraire dans son principe, que de l'attaquer dans les gouvernements? Est-ce travailler à déraciner l'arbitraire, que de faire changer le pouvoir de mains, ou de le faire changer de forme? Ce sont là, avons-nous dit, les grands moyens de répression en usage. Qu'on juge maintenant de leur suffisance. On n'a qu'une demande à se faire pour cela: y a-t-il un Orgon de moins dans un pays, après qu'il a changé de chef, ou après que le gouvernement y a changé de forme? S'il s'y trouve le même nombre d'imbéciles, qu'est-ce qui empêche que le nouveau chef ne se conduise aussi mal que le précédent? Qu'est-ce qui empêche que les nouvelles formes de gouvernement ne servent, comme celles qu'elles ont remplacées, à piller, à fouler le pays?
Tel peuple crie, dans sa détresse: Oh! si nous avions un autre prince! si nous-avions François au lieu de Guillaume! Hélas! en seriez-vous plus éclairés? Que les amis de François parlent ainsi, qu'ils préfèrent son règne à celui de Guillaume, cela est fort simple: si François régnait, ils régneraient avec lui, et prendraient part à la curée. Mais vous, misérable troupeau, dont le destin est d'être la proie de tous les partis, que gagnerez-vous à un changement de chef? Si vous ne savez pas vous défendre contre le gouvernement de Guillaume, comment vous défendrez-vous contre celui de François? Encore une fois, serez-vous plus éclairés sous François que sous Guillaume? François sera moins méchant, dites-vous; et si son héritier l'est davantage, changerez-vous son héritier? Ce sera donc à n'en pas finir? Ne voyez-vous pas qu'il serait bien plus court de commencer par vous changer vous-mêmes? Peuple d'Orgons, déniaisez-vous, et vous n'aurez pas besoin de changer de maîtres. Tâchez de comprendre vos vrais intérêts, et les hommes qui vivent, et ceux qui voudraient vivre de votre sottise, disparaîtront à mesure: les fourbes, les ambitieux disparaissent, comme toute espèce de vermine, faute d'aliments.
Qu'on place à la tête des États-Unis, avec l'autorité la plus illimitée, tel grand, tel habile despote qu'on voudra; que ce despote veuille traiter les Américains comme il pourrait faire un peuple d'Europe; qu'il veuille avoir à sa discrétion l'argent et les hommes du pays. Pensez-vous que l'Amérique aura besoin de s'insurger pour empêcher cet extravagant de réaliser ses projets de domination? Ce serait lui faire une grande injure. Ces projets, contre lesquels un petit nombre d'hommes sensés s'élèveraient vainement chez vous, tomberont d'eux-mêmes chez elle. C'est que tout y manque pour l'exécution de tels desseins; c'est que, faute de matériaux, il ne s'y trouvera point d'artisans pour la tyrannie; c'est que les gens capables de sentir le prix d'un gouvernement pareil à celui que cet homme voudrait établir faisant défaut, il n'y en aura point qui veuillent risquer de lui prêter main-forte; c'est, en un mot, que cet homme ne sera soutenu par personne, et que le despote le plus obstiné sera forcé de se conduire là comme le plus sincère ami de la liberté. Le moyen que vous ayez de bons chefs, ce n'est donc pas d'en changer jusqu'à ce que vous en trouviez de tels; mais d'acquérir assez de sens, de modération, de fermeté, pour réduire les plus mauvais à l'impuissance de vous nuire.
Vous vous êtes plaints quelquefois de ce que vos princes n'avaient rien de populaire. C'étaient là des regrets bien aveugles ou bien superflus. De deux choses l'une: ou vous manquez de lumières, ou vous connaissez vos vrais intérêts. Si vous manquez de lumières, c'est un grand bonheur pour vous que vos maîtres n'aient point de popularité; car alors ils ne peuvent pas abuser de vos passions à la faveur de votre ignorance; ils vous rendent le service de vous tenir en garde contre eux-mêmes; ils prennent en quelque sorte le soin de vous dessiller eux-mêmes les yeux; et par la sincérité naïve de leur égoïsme, ils vous forcent de reconnaître où sont vos intérêts véritables. Si, au contraire, vous êtes instruits de vos vrais intérêts, que vous importe que les princes qui vous gouvernent ne soient point populaires? Ne faudra-t-il pas alors qu'ils se conduisent comme s'ils l'étaient? L'essentiel, encore une fois, ce n'est pas que vos chefs ne soient pas des tartufes, mais qu'ils ne commandent pas à des Orgons: c'est à vous de les faire ce que vous avez intérêt qu'ils soient.
S'il ne suffit pas, pour devenir libre, de se donner de nouveaux chefs, il ne suffit pas davantage de se donner de nouvelles institutions. Rien ne peut tenir lieu à un peuple de lumières et de fermeté. Les mêmes formes de gouvernement, qui sont une sauvegarde pour une nation judicieuse et forte, ne seront qu'un moyen de plus d'accabler une nation ignorante et faible. Ce que vous appelez le palladium de vos libertés, peut n'être que l'instrument de votre servitude: une garantie n'en est une que pour celui qu'elle sert à protéger. Que vous importe d'avoir une forteresse, si vous ne savez en fermer l'accès à l'ennemi, ou si les gens que vous y placez pour vous défendre ont la maladresse ou l'infamie de tirer sur vous? Mieux vaudrait pour le pays que la citadelle fut rasée: les habitants auraient moins d'insultes à souffrir. Quel mauvais gouvernement oserait, en l'absence de toute représentation nationale, ce qu'il peut oser derrière une représentation nationale dont il est le maître?
Quand, après avoir changé et rechangé la forme de votre gouvernement, vous vous trouvez encore opprimés, l'on vous voit toujours prêts à dire: C'est que l'institution est mauvaise. Si vous remontiez à la vraie source du mal, vous diriez peut-être: C'est que le bons sens est encore chez nous en minorité. Il est des peuples qu'aucune institution ne saurait préserver de la servitude; tel serait celui qui ne comprendrait pas la vraie liberté, qui n'en connaîtrait pas le prix, ou qui n'aurait pas le courage nécessaire pour la défendre. Que servirait d'avoir des assemblées bien constituées, à qui ne pourrait y envoyer que des hommes ignorants, avides, turbulents ou pusillanimes? Que servirait d'avoir une bonne loi d'élections, à qui serait incapable de faire de bons choix? Il est incontestablement des cas où un peuple se trouve au-dessous de ses institutions, et ne peut accuser que lui-même du mal qu'il leur impute. Nous pourrions peut-être, à quelques égards, nous citer pour exemple. Qui oserait affirmer que nous tirons de nos lois constitutionnelles tout le bien qu'il serait possible d'en tirer, sans même y faire le moindre changement? Qui oserait dire qu'avec plus de lumières et un plus ferme vouloir de veiller au soin de nos propres affaires, nous ne pourrions pas trouver dans ces lois, telles qu'elles sont, le moyen d'être plus libres sans être moins tranquilles? Profitons-nous de la loi électorale, par exemple, autant qu'il serait en notre pouvoir? Tous les choix, aux dernières élections, ont-ils été aussi éclairés qu'ils auraient pu l'être? On reproche au législateur d'avoir trop restreint le cercle dans lequel il est permis de choisir les représentants de la nation. Mais est-ce au législateur qu'il convient de faire des reproches, quand on voit que les électeurs ne profitent pas même de la latitude qu'il leur a donnée? quand on voit que, sur une cinquantaine de députés qu'ils avaient à élire l'année dernière, ils ont choisi trente-cinq des présidents que leur avaient envoyés les ministres, et de plus un certain nombre d'agents salariés et révocables au gré du gouvernement. Ne paraît-il pas évident que ce sont ici les électeurs qui sont en faute, et que la loi, malgré ses imperfections, se trouve néanmoins en progrès sur les lumières communes?38
Enfin, vous convenez quelquefois de la bonté des institutions; mais comme il est impossible que vous ayez tort, vous accusez le gouvernement de ne pas les respecter. La Charte renferme de bonnes dispositions, dites-vous; mais les ministres ne l'exécutent pas. Qu'est-ce à dire? sont-ce les ministres qui la violent, ou vous qui ne savez pas la défendre? sont-ce les ministres qui acceptent les lois d'exception? sont-ce les ministres qui passent à l'ordre du jour sur toutes les réclamations des citoyens contre des actes arbitraires? Ce sont les amis du ministère, dites-vous. Mais ces amis du ministère ont-ils été choisis par les ministres? Vous vous étonnez que les lois n'offrent pas toutes les garanties qu'on pourrait en attendre; c'est du contraire qu'il faudrait vous étonner. Si vous faites de mauvaises élections, il est de force que les chambres soient mauvaises; si les chambres sont mauvaises, il est tout simple que les ministres ne se gênent pas pour violer la Charte. C'est vous qui les excitez à l'arbitraire: vous les tentez par de mauvais choix, et le mal que vous leur imputez est votre ouvrage. Choisissez mieux vos défenseurs, et l'on respectera mieux vos libertés.
Mais enfin, dites-vous, quand nos choix seraient mauvais, cela justifierait-il le ministère? Pourquoi proposer des lois d'exception? Nous voulons la Charte, toute la Charte; le roi l'a jurée; les ministres doivent nous en faire jouir. Quelle candeur, quelle innocence dans ces plaintes! Les ministres doivent vous faire jouir de la Charte! mais si vous attendez la liberté des ministres, pourquoi prendre des sûretés contre eux? pourquoi des chartes? pourquoi des garanties? Vous leur faites outrage; vous perdez à leurs yeux le mérite de votre confiance; vous les intéressez à la trahir. Si, au contraire, vous croyez avoir besoin de garanties contre leur pouvoir, comment attendez-vous d'eux la liberté? Croyez-vous qu'ils vont faire valoir pour vous vos moyens de défense, et se servir de vos armes contre eux-mêmes? Il n'y a pas de milieu: vous voulez être libres par la faveur du ministère, ou malgré toute opposition possible de sa part. Dans le premier cas, vous n'avez pas besoin de charte; dans le second, c'est à vous de la faire observer, et il est peu sensé de vous plaindre qu'elle est imparfaite ou mal exécutée. Du moment que vous prenez les armes contre l'arbitraire, du moment que vous vous mettez en état de défense contre le pouvoir ministériel, vous ne devez attendre la liberté que de vous-mêmes. Il est tout simple que des ministres, et surtout des ministres que vous manifestez l'intention de contenir, veuillent avoir à leur disposition le plus d'hommes, le plus d'argent, le plus de pouvoir possible. Il est tout simple qu'au lieu de fortifier vos garanties, ils travaillent à les détruire; qu'au lieu de les faire servir à la défense de vos libertés, ils les emploient à l'accroissement de leur puissance. C'est à vous de déjouer ces desseins, d'empêcher qu'on ne se serve de vos armes pour vous battre, de tirer vous-mêmes de vos lois tout le bien que vous en attendez. Quand vous aurez la force de vous en approprier l'usage, vous ne prétendrez plus que c'est aux ministres que revient le soin de vous en faire jouir: jusque-là, il paraît au moins inutile d'élever cette prétention.
C'est donc une bien pauvre, ou du moins une bien insuffisante tactique, que de s'attaquer aux gouvernements pour devenir libre. Malheur aux amis de la liberté qui seraient réduits à attendre son salut d'un changement de ministres! Malheur à ceux qui voudraient tout devoir aux qualités des princes ou à la nature des institutions, et rien à la raison publique! Les gouvernements sont peu de chose par eux-mêmes. Les institutions n'ont de force que dans la masse des hommes qui servent de point d'appui à ceux qui veulent les faire respecter. Les mêmes lois peuvent, selon la différence des pays, servir à fonder la plus douce liberté, ou le despotisme le plus intolérable. Il faut donc répéter que nos institutions, tout imparfaites qu'elles sont, nous paraîtraient beaucoup meilleures, si nous étions plus capables d'en tirer parti; que nous aurions toujours de bons chefs, si nous avions de bons ministres; que nous aurions de bons ministres, si nous avions de bonnes chambres; que nous aurions de bonnes chambres, si nous avions de bons colléges électoraux: c'est-à-dire, si la masse des électeurs était éclairée, et si, à la modération par laquelle ils se sont déjà si honorablement distingués, ils joignaient tous le discernement et la fermeté nécessaires pour résister aux insinuations des partis, et ne jamais faire que de bons choix. L'essentiel, pour que nous ayons de bonnes chambres, de bons ministres, de bons chefs, un bon gouvernement, c'est donc que nous ayons de bons électeurs, c'est-à-dire, que le corps de la nation connaisse ses vrais intérêts, et soit en état de les défendre.
« Voilà pourquoi, continue M. Say, dont nous reprenons la pensée sur la moralité des écrits, voilà pourquoi tout ouvrage, quelles que soient sa forme et sa couleur, qu'on l'ait fait pour la scène ou pour la méditation, est utile du moment qu'il fait bien connaître l'homme et la société, du moment qu'il arrache les masques sous lesquels se déguisent le mauvais sens et les mauvaises intentions, du moment, en un mot, qu'il donne de la sagacité à la droiture. La résignation est une vertu de brebis. La vertu des hommes doit être telle qu'il convient à une créature intelligente. Je me la représente, comme faisaient les anciens, sous les traits de Minerve: noble, sereine, douce, mais armée. »
16.Benjamin Constant on “The Liberty of the Ancients and the Moderns” (1819)↩
[Word Length: 7,712]
Source
Benjamin Constant, Collection complète des ouvrages publiés sur le gouvernement représentatif et la constitution actuelle, ou Cours de politique constitutionnelle (Paris: Béchet aîné, 1820), Quatrième volume. Septième partie, “De la liberté des anciens comparée à celle des modernes, discours prononcé à l’Athénée royal de Paris,” pp. 238-274.
Brief Bio of the Author: Benjamin Constant (1767-1830)
[Benjamin Constant (1767-1830)]
Benjamin Constant (1767-1830) was a novelist, politician, and political theorist during the Napoleonic and Restoration periods. Born in Lausanne, Constant was a close friend of Germaine de Staël and accompanied her to Paris in 1795. He was a supporter of the Directory and a member of the Tribunat but came to oppose the loss of political liberty under Napoleon. He became a staunch opponent of Napoleon, but in spite of this he was approached by him during the “Hundred Days” (period between Napoleon’s return from exile on Elba to Paris on 20 March 1815 and the restoration of King Louis XVIII on 8 July 1815) to draw up a constitution for a more liberal, constitutional empire. Constant became a deputy in 1819 and continued to defend constitutional freedoms until his death. He is best known for his novel Adolphe (1807), Principes de politique applicables à tous les gouvernements (1815) (published in English by Liberty Fund), De l’esprit de conquête et de l’usurpation, dans leurs rapports à la civilization européen (1814), and Cours de politique constitutionelle (1820). [DMH]
DE LA LIBERTÉ DES ANCIENS COMPARÉE A CELLE DES MODERNES, DISCOURS PRONONCÉ A L'ATHÉNÉ ROYAL DE PARIS.
Messieurs,
Je me propose de vous soumettre quelques distinctions, encore assez neuves, entre deux genres de liberté, dont les différences sont restées jusqu'à ce jour inaperçues, ou du moins trop peu remarquées. L'une est la liberté dont l'exercice était si cher aux peuples anciens; l'autre celle dont la jouissance est particulièrement précieuse aux nations modernes. Cette recherche sera intéressante, si je ne me trompe, sous un double rapport.
Premièrement, la confusion de ces deux espèces de liberté a été parmi nous, durant des époques trop célèbres de notre révolution, la caus de beaucoup de maux. La France s'est vue fatiguer d'essais inutiles, dont les auteurs, irrités par leur peu de succès, ont essayé de la contraindre à jouir du bien qu'elle ne voulait pas, et lui ont disputé le bien qu'elle voulait.
En second lieu, appelés par notre heureuse révolution (je l'appelle heureuse, malgré ses excès, parce que je fixe mes regards sur ses résultats) à jouir des bienfaits d'un gouvernement représentatif, il est curieux et utile de rechercher pourquoi ce gouvernement, le seul à l'abri duquel nous puissions aujourd'hui trouver quelque liberté et quelque repos, a été presque entièrement inconnu aux nations libres de l'antiquité.
Je sais que l'on a prétendu en démêler des traces chez quelques peuples anciens, dans la république de Lacédémone, par exemple, et chez nos ancêtres les Gaulois; mais c'est à tort.
Le gouvernement de Lacédémone était une aristocratie monacale, et nullement un gouvernement représentatif. La puissance des rois était limitée; mais elle l'était par les Ephores et non par des hommes investis d'une mission semblable à celle que l'élection confère de nos jours aux défenseurs de nos libertés. Les éphores, sans doute, après avoir été institués par les rois, furent nommés par le peuple. Mais ils n'étaient que cinq. Leur autorité était religieuse autant que politique; ils avaient part à l'administration même, du gouvernement, c'est-à-dire, au pouvoir exécutif; et par là, leur prérogative, comme celle de presque tous les magistrats populaires dans les anciennes républiques, loin d'être simplement une barrière contre la tyrannie, devenait quelquefois elle-même une tyrannie insupportable.
Le régime des Gaulois, qui ressemblait assez à celui qu'un certain parti voudrait nous rendre, était à la fois théocratique et guerrier. Les prêtres jouissaient d'un pouvoir sans bornes. La classe militaire ou la noblesse, possédait des privilèges bien insolents et bien oppressifs. Le peuple était sans droits et sans garanties.
A Rome, les tribuns avaient, jusqu'à un certain point, une mission représentative. Ils étaient les organes de ces plébéiens que l'oligarchie, qui, dans tous les siècles, est la même, avait soumis, en renversant les rois, à un si dur esclavage. Le peuple exerçait toutefois directement une grande partie des droits politiques. Il s'assemblait pour voter les lois, pour juger les patriciens mis en accusation: il n'y avait donc que de faibles vestiges du système représentatif à Rome.
Ce système est une découverte des modernes, et vous verrez, Messieurs, que l'état de l'espèce humaine dans l'antiquité ne permettait pas à une institution de cette nature de s'y introduire ou de s'y établir. Les peuples anciens ne pouvaient ni en sentir la nécessité, ni en apprécier les avantages. Leur organisation sociale les conduisait à désirer une liberté toute différente de celle que ce système nous assure.
C'est à vous démontrer cette vérité que la lecture de ce soir sera consacrée.
Demandez-vous d'abord, Messieurs, ce que, de nos jours, un Anglais, un Français, un habitant des États-Unis de l'Amérique, entendent par le mot de liberté.
C'est pour chacun le droit de n'être soumis qu'aux lois, de ne pouvoir être ni arrêté, ni détenu, ni mis à mort, ni maltraité d'aucune manière, par l'effet de la volonté arbitraire d'un ou de plusieurs individus. C'est pour chacun le droit de dire son opinion, de choisir son industrie, et de l'exercer, de disposer de sa propriété, d'en abuser même; d'aller, de venir sans en obtenir la permission, et sans rendre compte de ses motifs ou de ses démarches. C'est, pour chacun, le droit de se réunir à d'autres individus, soit pour conférer sur ses intérêts, soit pour professer le culte que lui et ses associés préfèrent, soit simplement pour remplir ses jours ou ses heures d'une manière plus conforme à ses inclinations, à ses fantaisies. Enfin, c'est le droit, pour chacun, d'influer sur l'administration du Gouvernement, soit par la nomination de tous ou de certains fonctionnaires, soit par des représentations, des pétitions, des demandes, que l'autorité est plus ou moins obligée de prendre en considération. Comparez maintenant à cette liberté celle des anciens.
Celle-ci consistait à exercer collectivement, mais directement, plusieurs parties de la souveraineté toute entière, à délibérer, sur la place publique, de la guerre et de la paix, à conclure avec les étrangers des traités d'alliance, à voter les lois, à prononcer les jugements, à examiner les comptes, les actes, la gestion des magistrats, à les faire comparaître devant tout le peuple, à les mettre en accusation, à les condamner ou à les absoudre; mais en même temps que c'était là ce que les anciens nommaient liberté, ils admettaient comme compatible avec cette liberté collective l'assujétissement complet de l'individu à l'autorité de l'ensemble. Vous ne trouvez chez eux presque aucune des jouissances que nous venons de voir faisant partie de la liberté chez les modernes. Toutes les actions privées sont soumises à une surveillance sévère. Rien n'est accordé à l'indépendance individuelle, ni sous le rapport des opinions, ni sous celui de. l'industrie, ni surtout sous le rapport de la religion. La faculté de choisir son culte, faculté que nous regardons comme l'un de nos droits les plus précieux, aurait paru aux anciens un crime et un sacrilège. Dans les choses qui nous semblent les plus utiles, l'autorité du corps social s'interpose et gêne la volonté des individus. Terpandre ne peut chez les Spartiates ajouter une corde à sa lyre sans que les éphores ne s'offensent. Dans les relations les plus domestiques, l'autorité intervient encore. Le jeune Lacédémonien ne peut visiter librement sa nouvelle épouse. A Rome, les censeurs portent un œil scrutateur dans l'intérieur des familles. Les lois règlent les mœurs, et comme les mœurs tiennent à tout, il n'y a rien que les lois ne règlent.
Ainsi chez les anciens, l'individu, souverain presque habituellement dans les affaires publiques, est esclave dans tous ses rapports privés. Comme citoyen, il décide de la paix et de la guerre; comme particulier, il est circonscrit, observé, réprimé dans tous ses mouvements; comme portion du corps collectif, il interroge, destitue, condamne, dépouille, exile, frappe de mort ses magistrats ou ses supérieurs; comme soumis au corps collectif, il peut à son tour être privé de son état, dépouillé de ses dignités, banni, mis à mort, par la volonté discrétionnaire de l'ensemble dont il fait partie. Chez les modernes, au contraire, l'individu, indépendant dans sa vie privée, n'est même dans les états les plus libres, souverain qu'en apparence. Sa souveraineté est restreinte, presque toujours suspendue; et si, à des époques fixes, mais rares, durant lesquelles il est encore entouré de précautions et d'entraves, il exerce cette souveraineté, ce n'est jamais que pour l'abdiquer.
Je dois ici, Messieurs, m'arrêter un instant pour prévenir une objection que l'on pourrait me faire. Il y a dans l'antiquité une république où l'asservissement de l'existence individuelle au corps collectif n'est pas aussi complet que je viens de le décrire. Cette république est la plus célèbre de toutes; vous devinez que je veux parler d'Athènes. J'y reviendrai plus tard, et en convenant de la vérité du fait, je vous en exposerai la cause. Nous verrons pourquoi de tous les états anciens, Athènes est celui qui a ressemblé le plus aux modernes. Partout ailleurs, la jurisdiction sociale était illimitée. Les anciens, comme le dit Condorcet, n'avaient aucune notion des droits individuels. Les hommes n'étaient, pour ainsi dire, que des machines dont la loi réglait les ressorts et dirigeait les rouages. Le même assujétissement caractérisait les beaux siècles de la république romaine; l'individu s'était en quelque sorte perdu dans la nation, le citoyen dans la cité.
Nous allons actuellement remonter à la source de cette différence essentielle entre les anciens et nous.
Toutes les républiques anciennes étaient renfermées dans des limites étroites. La plus peuplée, la plus puissante, la plus considérable d'entre elles, n'était pas égale en étendue au plus petit des états modernes. Par une suite inévitable de leur peu d'étendue, l'esprit de ces républiques était belliqueux; chaque peuple froissait continuellement ses voisins ou était froissé par eux. Poussés ainsi parla nécessité, les uns contre les autres, ils se combattaient ou se menaçaient sans cesse. Ceux qui ne voulaient pas être conquérants ne pouvaient déposer les armes sous peine d'être conquis. Tous achetaient leur -sûreté, leur indépendance, leur existence entière, au prix de la guerre. Elle était l'intérêt constant, l'occupation presque habituelle des états libres de l'antiquité. Enfin, et par un résultat également nécessaire de cette manière d'être, tous ces états avaient des esclaves. Les professions mécaniques, et même, chez quelques nations, les professions industrielles, étaient confiées à des mains chargées de fers.
Le monde moderne nous offre un spectacle complètement opposé. Les moindres états de nos jours sont incomparablement plus vastes que Sparte ou que Rome durant cinq siècles. La division même de l'Europe en plusieurs états, est, grâces aux progrès des lumières, plutôt apparente que réelle. Tandis que chaque peuple, autrefois, formait une famille isolée, ennemie née des autres familles, une masse d'hommes existe maintenant sous différents noms, et sous divers modes d'organisation sociale, mais homogène de sa nature. Elle est assez forte pour n'avoir rien à craindre des hordes barbares. Elle est assez éclairée pour que la guerre lui soit à charge. Sa tendance uniforme est vers la paix.
Cette différence en amène une autre. La guerre .est antérieure au commerce; car la guerre et le commerce .ne sont que deux moyens différents d'atteindre le même but, celui de posséder ce que l'on désire. Le commerce n'est qu'un hommage rendu à la force du possesseur par l'aspirant à la possession. C'est une tentative pour obtenir de gré à gré ce qu'on n'espère plus conquérir par la violence. Un homme qui serait toujours le plus fort n'aurait jamais l'idée du commerce. C'est l'expérience qui, en lui prouvant que la guerre, c'est-à-dire, l'emploi de sa force contre la force d'autrui, l'expose, à diverses résistances et à divers échecs, le porte à recourir au commerce, c'est-à-dire, à un moyen plus doux et plus sûr d'engager l'intérêt d'un autre à consentir à ce qui convient à son intérêt. La guerre est l'impulsion, le commerce est le calcul. Mais par là même il doit venir une époque où le commerce remplace la guerre. Nous sommes arrivés à cette époque.
Je ne veux point dire qu'il n'y ait pas eu chez les anciens des peuples commerçants. Mais ces peuples faisaient en quelque sorte exception à la règle générale. Les bornes d'une lecture ne me permettent pas de vous indiquer tous les obstacles qui s'opposaient alors aux progrès du commerce; vous les connaissez d'ailleurs aussi bien que moi:je n'en rapporterai qu'un seul. L'ignorance de la boussole forçait les marins de l'antiquité à ne perdre les côtes de vue que le moins qu'il leur était possible. Traverser les Colonnes d'Hercule, c'est-à-dire, passer le détroit de Gilbratar, était considéré comme l'entreprise la plus hardie. Les Phéniciens et les Carthaginois, les plus habiles des navigateurs, ne l'osèrent que fort tard, et leur exemple resta long-temps sans être imité. A Athènes, dont nous parlerons bientôt, l'intérêt maritime était d'environ 60 pour %, pendant que l'intérêt ordinaire n'était que de douze, tant l'idée d'une navigation lointaine impliquait celle du danger.
De plus, si je pouvais me livrer à une digression qui malheureusement serait trop longue, je vous montrerais, messieurs, par le détail des mœurs, des habitudes, du mode de trafiquer des peuples commerçants de l'antiquité avec les autres peuples, que leur commerce même était, pour ainsi dire, imprégné de l'esprit de l'époque, de l'atmosphère de guerre et d'hostilité qui les entourait. Le commerce alors était un accident heureux: c'est aujourd'hui l'état ordinaire, le but unique, la tendance universelle, la vie véritable des nations. Elles veulent le repos, avec le repos l'aisance, et comme source de l'aisance, l'industrie. La guerre est chaque jour un moyen plus inefficace de remplir leurs vœux. Ses chances n'offrent plus ni aux individus, ni aux nations des bénéfices qui égalent les résultats du travail paisible et des échanges réguliers Chez les anciens, une guerre heureuse ajoutait en esclaves, en tributs, en terres partagées, à la richesse publique et particulière. Chez les modernes, une guerre heureuse coûte infailliblement plus qu'elle ne vaut.
Enfin, grâce au commerce, à la religion, aux progrès intellectuels et moraux de l'espèce humaine, il n'y a plus d'esclaves chez les nations européennes. Des hommes libres doivent exercer toutes les professions, pourvoir à tous les besoins de la société.
On pressent aisément, messieurs, le résultat nécessaire de ces différences.
1°. L'étendue d'un pays diminue d'autant l'importance politique qui écheoit en partage à chaque individu. Le républicain le plus obscur de Rome ou de Sparte était une puissance. Il n'en est pas de même du simple citoyen de la Grande-Bretagne ou des Etats-Unis. Son influence personnelle est un élément imperceptible de la volonté sociale qui imprime au gouvernement sa direction.
En second lieu, l'abolition de l'esclavage a en levé à la population libre tout le loisir qui résultait pour elle de ce que des esclaves étaient chargés de la plupart des travaux. Sans la population esclave d'Athènes, 20,000 Athéniens n'auraient pas pu délibérer chaque jour sur la place publique.
Troisièmement le commerce ne laisse pas comme la guerre, dans la vie de l'homme des intervalles d'inactivité. L'exercice perpétuel des droits politiques, la discussion journalière des affaires de l'Etat, les dissentions, les conciliabules, tout le cortège et tout le mouvement des factions, agitations nécessaires, remplissage obligé, si j'ose employer ce terme, dans la vie des peuples libres de l'antiquité, qui auraient langui, sans cette ressource, sous le poids d'une inaction douloureuse, n'offriraient que trouble et que fatigue aux nations modernes, où chaque individu occupé de ses spéculations, de ses entreprises, des jouissances qu'il obtient ou qu'il espère, ne veut en être détourné que momentanément et le moins qu'il est possible.
Enfin, le commerce inspire aux hommes un vif amour pour l'indépendance individuelle. Le commerce subvient à leurs besoins, satisfait à leurs désirs, sans l'intervention de l'autorité. Cette intervention est presque toujours, et je ne sais pourquoi je dis presque, cette intervention est toujours un dérangement et une gêne. Toutes les fois que le pouvoir collectif veut se se mêler des spéculations particulières, il vexe les spéculateurs. Toutes les fois que les gouvernements prétendent faire nos affaires, ils les font plus mal et plus dispendieusement que nous.
Je vous ai dit, Messieurs, que je vous reparlerais d'Athènes, dont on pourrait opposer l'exemple à quelques-unes de mes assertions, et dont l'exemple, au contraire, va les confirmer toutes.
Athènes, comme je l'ai déjà reconnu, était, de toutes les républiques grecques, la plus commerçante: aussi accordait-elle à ses citoyens infiniment plus de liberté individuelle que Rome et que Sparte. Si je pouvais entrer dans des détails historiques, je vous ferais voir que le commerce avait fait disparaître de chez les Athéniens plusieurs des différences qui distinguent les peuples anciens des peuples modernes. L'esprit des commerçants d'Athènes était pareil à celui des commerçants de nos jours. Xénophon nous apprend que, durant la guerre du Péloponèse, ils sortaient leurs capitaux du continent de l’Attique et les envoyaient dans les îles de l'Archipel. Le commerce avait créé chez eux la circulation. Nous remarquons dans Isocrate des traces de l'usage des lettres-de-change. Aussi, observez combien leurs moeurs ressemblent aux nôtres. Dans leurs relations avec les femmes, vous verrez, je cite encore Xénophon, les époux satisfaits quand la paix et une amitié décente règnent dans l'intérieur du ménage, tenir compte à l'épouse trop fragile de la tyrannie de la nature, fermer les yeux sur l'irrésistible pouvoir des passions, pardonner la première faiblesse et oublier la seconde. Dans leurs rapports avec les étrangers, on les verra prodiguer les droits de cité à quiconque se transportant chez eux avec sa famille, établit un métier ou une fabrique; enfin on sera frappé de leur amour excessif pour l'indépendance individuelle. A Lacédémone, dit un philosophe, les citoyens accourent lorsque le magistrat les appelle; mais un Athénien serait au désespoir qu'on le crût dépendant d'un magistrat.
Cependant, comme plusieurs des autres circonstances qui décidaient du caractère des nations anciennes existaient aussi à Athènes; comme il y avait une population esclave, et que le territoire était fort resserré, nous y trouvons des vestiges de la liberté propre aux anciens. Le peuple fait les lois, examine la conduite des magistrats, somme Périclès de rendre ses comptes, condamne à mort les généraux qui avaient commandé au combat des Arginuses. En même temps, l'ostracisme, arbitraire légal et vanté par tous les législateurs de l'époque; l'ostracisme, qui nous paraît et doit nous paraître une révoltante iniquité, prouve que l'individu était encore bien plus asservi à la suprématie du corps social à Athènes, qu'il ne l'est de nos jours dans aucun état libre de l'Europe.
Il résulte de ce que je viens d'exposer, que nous ne pouvons plus jouir de la liberté des anciens, qui se composait de la participation active et constante au pouvoir collectif. Notre liberté, à nous, doit se composer de la jouissance paisible de l'indépendance privée. La part que dans l'antiquité chacun prenait à la souveraineté nationale n'était point, comme de nos jours,une supposition abstraite. La volonté de chacun avait une influence réelle: l'exercice de celte volonté était un plaisir vif et répété. En conséquence, les anciens étaient disposés à faire beaucoup de sacrifices pour la conservation de leurs droits politiques et de leur part dans l'administration de l'État. Chacun sentant avec orgueil tout ce que valait son suffrage, trouvait, dans cette conscience de son importance personnelle, un ample dédommagement.
Ce dédommagement n'existe plus aujourd'hui pour nous. Perdu dans la multitude, l'individu n'aperçoit presque jamais l'influence qu'il exerce. Jamais sa volonté ne s'empreint sur l'ensemble, rien ne constate à ses propres yeux sa coopération. L'exercice des droits politiques ne nous offre donc plus qu'une partie des jouissances que les anciens y trouvaient, et en même temps les progrès de la civilisation, la tendance commerciale de l'époque, la communication des peuples entre eux, ont multiplié et varié à l'infini les. moyens de bonheur particulier.
Il s'ensuit que nous devons être bien plus attachés que les anciens à notre indépendance individuelle; car les anciens, lorsqu'ils sacrifiaient cette indépendance aux droits politiques, sacrifiaient moins pour obtenir plus; tandis qu'en faisant le même sacrifice, nous donnerions plus pour obtenir moins.
Le but des anciens était le partage du pouvoir social entre tous les citoyens d'une même patrie: c'était là ce qu'ils nommaient liberté. Le but des modernes est la sécurité dans les jouissances privées; et ils nomment liberté les garanties accordées par les institutions à ces jouissances.
J'ai dit en commençant que, faute d'avoir aperçu ces différences, des hommes bien intentionnés d'ailleurs, avaient causé des maux infinis durant notre longue et orageuse révolution. A Dieu ne plaise que je leur adresse des reproches trop sévères: leur erreur même était excusable. On ne saurait lire les belles pages de l'antiquité, l’on ne se retrace point les actions de ses grands» hommes sans ressentir je ne sais quelle émotion d'un génie particulier que ne fait éprouver rien de ce qui est moderne. Les vieux éléments d'une nature antérieure, pour ainsi dire, à la nôtre, semblent se réveiller en nous à ces souvenirs. Il est difficile de ne pas regretter ces temps où les facultés de l'homme se développaient dans une direction tracée d'avance, mais dans une carrière si vaste, tellement fortes de leurs propres forces, et avec un tel sentiment d'énergie et de dignité; et lorsqu'on se livre à ces regrets, il est impossible de ne pas vouloir imiter ce qu'on regrette. Cette impression était profonde, surtout lorsque nous vivions sous des gouvernements abusifs, qui, sans être forts, étaient vexatoires, absurdes en principes, misérables en action; gouvernements qui avaient pour ressort l'arbitraire, pour but le rapetissement de l'espèce humaine, et que certains hommes osent nous vanter encore aujourd'hui, comme si nous pouvions oublier jamais que nous avons été témoins et victimes de leur obstination, de leur impuissance et de leur renversement. Le but de nos réformateurs fut noble et généreux. Qui d'entre nous n'a pas senti son cœur battre d'espérance à l'entrée de la route qu'ils semblaient ouvrir? Et malheur encore à présent à qui n'éprouve pas le besoin de déclarer que reconnaître quelques erreurs commises par nos premiers guides, ce n'est pas flétrir leur mémoire ni désavouer des opinions que les amis de l'humanité ont professées d'âge en âge!
Mais ces hommes avaient puisé plusieurs de leurs théories dans les ouvrages de deux philosophes qui ne s'étaient pas doutés eux - mêmes des modifications apportées par deux mille ans aux dispositions du genre humain. J'examinerai peut-être une fois le système du plus illustre de ces philosophes, de Jean-Jacques Rousseau, et je montrerai qu'en transportant dans nos temps modernes une étendue de pouvoir social, de souveraineté collective qui appartenait à d'autres siècles, ce génie sublime qu'animait l'amour le plus pur de la liberté, a fourni néanmoins de funestes prétextes à plus d'un genre de tyrannie. Sans doute, en relevant ce que je considère comme une méprise importante à dévoiler, je serai circonspect dans ma réfutation, et respectueux dans mon blâme. J'éviterai, certes, de me joindre aux détracteurs d'un grand homme. Quand le hasard fait qu'en apparence je me rencontre avec eux sur un seul point, je suis en défiance de moi même; et, pour me consoler de paraître un instant de leur avis sur une question unique et partielle, j'ai besoin de désavouer et de flétrir autant qu'il est en moi ces prétendus auxiliaires.
Cependant, l'intérêt de la vérité doit l'emporter sur des considérations que rendent si puissantes l'éclat d'un talent prodigieux et l'autorité d'une immense renommée. Ce n'est d'ailleurs point à Rousseau, comme on le verra, que l'on doit principalement attribuer l'erreur que je vais combattre: elle appartient bien plus à l'un de ses successeurs, moins éloquent, mais non moins austère et mille (ois plus exagéré. Ce dernier, l'abbé de Mably, peut être regardé comme le représentant du système qui, conformément aux maximes de la liberté antique, veut que les citoyens soient complètement assujétis pour que la nation soit souveraine, et que l'individu soit esclave pour que le peuple soit libre.
L'abbé de Mably, comme Rousseau et comme beaucoup d'autres, avait, d'après les anciens, pris l'autorité du çorps social pour la liberté, et tous les moyens lui paraissaient bons pour étendre l'action de cette autorité sur cette partie récalcitrante de l'existence humaine, dont il déplorait l'indépendance. Le regret qu'il exprime partout dans ses ouvrages, c'est que la loi ne puisse atteindre que les actions. Il aurait voulu qu'elle atteignît les pensées, les impressions les plus passagères; qu'elle poursuivît l'homme sans relâche et sans lui laisser un asile où il pût échappera son pouvoir. A peine apercevait-il, n'importe chez quel peuple, une mesure vexatoire, qu'il pensait avoir fait une découverte et qu'il la proposait pour modèle: il détestait la liberté individuelle comme on déteste un ennemi personnel; et, dès qu'il rencontrait dans l'histoire une nation qui en était bien complètement privée, n'eût-elle point de liberté politique, il ne pouvait s'empêcher de l'admirer. Il s'extasiait sur les Egyptiens, parce que, disait-il, tout chez eux était réglé par la loi, jusqu'aux délassements, jusqu'aux besoins: tout pliait sous l'empire du législateur; tous les moments de la journée étaient remplis par quelque devoir; l'amour même était sujet à cette intervention respectée, et c'était la loi qui tour à tour ouvrait et fermait la couche nuptiale.
Sparte, qui réunissait des formes républicaines, au même asservissement des individus, excitait dans l'esprit de ce philosophe un enthousiasme plus vif encore. Ce vaste couvent lai paraissait l'idéal d'une parfaite république. Il avait pour Athènes un profond mépris, et il aurait dit volontiers de cette nation, la première de la Grèce, ce qu'un académicien grand seigneur disait de l'académie française: « Quel épouvantable despotisme! tout le monde y fait ce qu'il veut. » Je dois ajouter que ce grand seigneur parlait de l'académie telle qu'elle était il y a trente ans.
Montesquieu, doué d'un esprit plus observateur parce qu'il avait une tête moins ardente, n'est pas tombé tout-à-fait dans les mêmes erreurs. Il a été frappé des différences que j'ai rapportées! mais il n'en a pas démêlé la cause véritable. Les politiques grecs qui vivaient sous le gouvernement populaire ne reconnaissaient, dit-il, d'autre force que celle de la vertu. Ceux d'aujourd'hui ne nous parlent que de manufactures, de commerce, de finances, de richesses et de luxe même. Il attribue cette différence à la république et à la monarchie: il faut l'attribuer à l'esprit opposé des temps anciens et des temps modernes. Citoyens des républiques, sujets des monarchies, tous veulent des jouissances, et nul ne peut, dans l'état actuel des sociétés, ne pas en vouloir. Le peuple le plus attaché de nos jours à sa liberté avant l'affranchissement de la France, était aussi le peuple le plus attaché à toutes les jouissances de la vie; et il tenait à sa liberté surtout parce qu'il y voyait la garantie des jouissances qu'il chérissait. Autrefois, là ou il y avait liberté, l'on pouvait supporter les privations: maintenant partout où il y privations, il faut l'esclavage pour qu'on s'y résigne. Il serait plus possible aujourd'hui de faire d'un peuple d'esclaves un peuple de Spartiates, que de former des Spartiates par la liberté.
Les hommes qui se trouvèrent portés par le flot des événements à la tête de notre révolution, étaient par une suite nécessaire de l'éducation qu'ils avaient reçue, imbus des opinions antiques, et devenues fausses qu'avaient mises en honneur les philosophes dont j'ai parlé. La métaphysique de Rousseau, au milieu de laquelle paraissaient tout-à-coup comme des éclairs des vérités sublimes et des passages d'une éloquence entraînante, l'austérité de Mably, son intolérance, sa haine contre toutes les passions humaines, son avidité de les asservir toutes, ses principes exagérés sur la compétence de la loi, la différence de ce qu'il recommandait et de ce qui avait existé, ses déclamations contre les richesses et même contre la propriété, toutes ces choses devaient charmer des hommes échauffés par une victoire récente, et qui, conquérants de la puissance légale, étaient bien aises d'étendre cette puissance sur tous les objets. C'était pour eux une autorité précieuse que celle de deux écrivains qui, désintéressés dans la question et prononçant anathême contre le despotisme des hommes, avaient rédigé en axiome le texte de la loi. Ils voulurent donc exercer la force publique comme ils avaient appris de leurs guides qu'elle avait été jadis exercée dans les états libres. Ils crurent que tout devait encore céder devant la volonté collective et que toutes les restrictions aux droits individuels seraient amplement compensées par la participation au pouvoir social.
Vous savez, Messieurs, ce qui en est résulté. Des institutions libres, appuyées sur la connaissance de l'esprit du siècle auraient pu subsister. L'édifice renouvelé des anciens s'est écroulé, malgré beaucoup d'efforts et beaucoup d'actes héroïques qui ont droit à l'admiration. C'est que le pouvoir social blessait en tout sens l'indépendance individuelle sans en détruire le besoin. La nation ne trouvait point qu'une part idéale à une souveraineté abstraite valût les sacrifices qu'on lui commandait. On lui repétait vainement avec Rousseau: les lois de la liberté sont mille fois plus austères que n'est dur le joug des tyrans. Elle ne voulait pas de ces lois austères, et dans sa lassitude, elle croyait quelquefois que le joug des tyrans serait préférable. L'expérience est venue et l'a détrompée. Elle a vu que l'arbitraire des hommes était pire encore que les plus mauvaises lois. Mais les lois aussi doivent avoir leurs limites.
Si je suis parvenu, Messieurs, à vous faire partager la conviction que dans mon opinion ces faits doivent produire, vous reconnaîtrez avec moi la vérité des principes suivants.
L'indépendance individuelle est le premier besoin des modernes: en conséquence, il ne faut jamais leur en demander le sacrifice pour établir la liberté politique.
Il s'en suit qu'aucune des institutions nombreuses et trop vantées qui, dans les républiques anciennes, gênaient la liberté individuelle, n'est point admissible dans les temps modernes.
Cette vérité, Messieurs, semble d'abord superflue à établir. Plusieurs gouvernements de nos jours ne paraissent guères enclins à imiter les républiques de l'antiquité. Cependant quelque peu de goût qu'ils aient pour les institutions républicaines, il y a de certains usages républicains pour lesquelles ils éprouvent je ne sais qu'elle affection. 11 est fâcheux que ce soit précisément celles qui permettent de bannir, d'exiler, de dépouiller. Je me souviens qu'en 1802, on glissa dans une loi sur les tribunaux spéciaux un article qui introduisait en France l'ostracisme grec; et Dieu sait combien d'éloquents orateurs, pour faire admettre cet article, qui cependant fut retiré, nous parlèrent de la liberté d'Athènes, et de tous les sacrifices que les individus devaient faire pour conserver cette liberté! De même, à une époque bien plus récente, lorsque des autorités craintives essayaient d'une main timide de diriger les élections à leur gré, un journal qui n'est pourtant point entaché de républicanisme, proposa défaire revivre la censure romaine pour écarter les candidats dangereux.
Je crois donc ne pas m'engager dans une digression inutile, si, pour appuyer mon assertion, je dis quelques mots de ces deux institutions si vantées.
L'ostracisme d'Athènes reposait sur l'hypothèse que la société a toute autorité sur ses membres. Dans cette hypothèse, il pouvait se justifier, et dans un petit état, où l'influence d'un individu fort de son crédit, de sa clientelle, de sa gloire, balançait souvent la puissance de la masse, l'ostracisme pouvait avoir une apparence d'utilité. Mais parmi nous, les individus ont des droits que la société doit respecter, et l'influence individuelle est, comme je l'ai déjà observé, tellement perdue dans une multitude d'influences égales ou supérieures, que toute vexation, motivée sur la nécessité de diminuer celte influence, est inutile et par conséquent injuste. Nul n'a le droit d'exiler un citoyen, s'il n'est pas condamné légalement par un tribunal régulier, d'après une loi formelle qui attache la peine de l'exil à l'action dont il est coupable. Nul n'a le droit d'arracher le citoyen à sa patrie, le propriétaire à ses biens, le négociant à son commerce, l'epoux à son épouse, le père à ses enfants, l'écrivain à ses méditations studieuses, le vieillard à ses habitudes. Tout exil politique est un attentat politique. Tout exil prononcé par une assemblée pour de prétendus motifs de salut public, est un crime de cette assemblée contre le salut public qui n'est jamais que dans le respect des lois, dans l'observance des formes, et -dans le maintien des garanties.
La censure romaine supposait comme l'ostracisme un pouvoir discrétionaire. Dans une république dont tous les citoyens, maintenus par la pauvreté dans une simplicité extrême de mœurs, habitaient la même ville, n'exerçaient aucune profession qui détournât leur attention des affaires de l'Etat, et se trouvaient ainsi constamment spectateurs et juges de l'usage du pouvoir public, la censure pouvait d'une part avoir plus d'influence; et de l'autre, l'arbitraire des censeurs était contenu par une espèce de surveillance morale exercée contre eux. Mais aussitôt que l'étendue de la république, la complication des relations sociales et les raffinements de la civilisation, eurent enlevé à cette institution ce qui lui servait à la fois de base et de limite, la censure dégénéra même à Rome. Ce n'était donc pas la censure qui avait créé les bonnes mœurs: c'était la simplicité des mœurs qui constituait la puissance et l'efficacité de la censure.
En France,une institution aussi arbitraire que la censure serait à la fois inefficace et intolérable: dans l'état présent de la société, les mœurs se composent de nuances fines, ondoyantes, insaisissables, qui se dénatureraient de mille manières, si l'on tentait de leur donner plus de précision. L'opinion seul peut les atteindre; elle seule peut les juger, parce qu'elle est de même nature. Elle se soulèverait contre toute autorité positive qui voudrait lui donner plus de précision. Si le gouvernement d'un peuple moderne voulait,comme les censeurs de Rome, flétrir un citoyen par une décision discrétionaire, la nation entière réclamerait contre cet arrêt en ne ratifiant pas les décisions de l'autorité.
Ce que je viens de dire de la transplantation de la censure dans les temps modernes, s'applique à bien d'autres parties de l'organisation sociale, sur lesquelles on nous cite l'antiquité plus fréquemment encore, et avec bien plus d'emphase. Telle est l'éducation, par exemple; que ne nous dit-on pas sur la nécessité de permettre que le gouvernement s'empare des générations naissantes pour les façonner à son gré, et de quelles citations érudites n'appuie-t-on pas cette théorie! Les Perses, les Égyptiens, et la Gaule, et la Grèce, et l'Italie, viennent tour à tour figurer à nos regards. Eh! Messieurs, nous ne sommes ni des Perses soumis à un despote, toi des Égyptiens subjugués par des prêtres, ni des Gaulois pouvant être sacrifiés par leurs druides, ni enfin des Grecs et des Romains que leur part à l'autorité sociale consolait de l'asservissement privé. Nous sommes des modernes, qui voulons jouir chacun de nos droits, développer chacun nos facultés comme bon nous semble, sans nuire à autrui; Veiller sur le développement de ces facultés dans les enfants que la nature confie à notre affection, d'autant plus éclairée qu'elle est plus vive, et n'ayant besoin de l'autorité que pour tenir d'elle les moyens généraux d'instruction qu'elle peut rassembler, comme les voyageurs acceptent d'elle les grands chemins sans être dirigés par elle dans la route qu'ils veulent suivre. La religion aussi est exposée à ces souvenirs des autres siècles. De braves défenseurs de l'unité de doctrine nous citent les lois des anciens contre les dieux étrangers, et appuient les droits de l'église catholique de l'exemple des Athéniens qui firent périr Socrate pour avoir ébranlé le polythéisme et de celui d'Auguste qui voulait qu'on restât fidèle au culte de ses pères, ce qui fit que, peu de temps après, on livra aux bêtes les premiers chrétiens.
Défions-nous donc, Messieurs, de cette admition [admiration????] pour certaines réminiscences antiques. Puisque nous vivons dans les temps modernes, je veux la liberté convenable aux temps modernes; et puisque nous vivons sous des monarchies, je supplie humblement ces monarchies de ne pas emprunter aux républiques ancienne» des moyens de nous opprimer.
La liberté individuelle, je le répète, voilà la véritable liberté moderne. La liberté politique en est la garantie; la liberté politique est par conséquent indispensable. Mais demander aux peuples de nos jours de sacrifier comme ceux d'autrefois la totalité de leur liberté individuelle à la liberté politique, c'est le plus sûr moyen de les détacher de l'une, et quand on y serait parvenu, on ne tarderait pas à leur ravir l'autre.
Vous voyez, Messieurs, que mes observations ne tendent nullement à diminuer le prix de la liberté politique. Je ne tire point des faits que j'ai remis sous vos yeux les conséquences que quelques hommes, en tirent. De ce que les anciens ont été libres, et de ce que nous ne pouvons plus être libres comme les anciens, ils en concluent que nous sommes destinés à être es-, claves. Ils voudraient constituer le nouvel état social avec un petit nombre d'éléments qu'ils, disent seuls appropriés à la situation du monde actuel. Ces éléments sont des préjugés pour effrayer les hommes, de l'égoïsme pour les corrompre, de la frivolité pour les étourdir, des plaisirs grossiers pour les dégrader, du despotisme pour les conduire; et, il le faut bien, des connaissances positives et des sciences exactes pour servir plus adroitement le despotisme. Il serait bizarre que tel fût le résultat de quarante siècles durant lesquels l'espèce humaine a conquis plus de moyens moraux et physiques: je ne puis le penser. Je tire des différences qui nous distinguent de l'antiquité des conséquences tout opposées. Ce n'est point la garantie qu'il faut affaiblir; c'est la jouissance qu'il faut étendre. Ce n'est point à la liberté politique que je veux renoncer; c'est la liberté civile que je réclame, avec d'autres formes de liberté politique. Les gouvernements n'ont pas plus qu'autrefois le droit de s'arroger un pouvoir illégitime. Mais les gouvernements qui partent d'une source légitime ont de moins qu'autrefois le droit d'exercer sur les individus une suprématie arbitraire. Nous possédons encore aujourd'hui les droits que nous eûmes de tout temps, ces droits éternels à consentir les lois, à délibérer sur nos intérêts, à être partie intégrante du corps social dont nous sommes membres. Mais les gouvernements ont de nouveaux devoirs; les progrès de la civilisation, les changements opérés par les siècles, commandent à l'autorité plus de respect pour les habitudes, pour les affections, pour l'indépendance des individus. Elle doit porter sur tous ces objets une main plus prudente et plus légère.
Cette réserve de l'autorité, qui est dans ses devoirs stricts, est également dans ses intérêts bien entendus; car si la liberté qui convient aux modernes est différente de celle qui convenaît aux anciens, le despotisme qui était possible chez les anciens n'est plus possible chez les modernes. De ce que nous sommes souvent plus distraits de la liberté politique qu'ils ne pouvaient l'être, et dans notre état ordinaire moins passionnés pour elle, -il peut s'en suivre que nous négligions quelquefois trop, et toujours à tort, les garanties qu'elle nous assure; mais en même temps, comme nous tenons beaucoup plus à la liberté individuelle que les anciens, nous la défendrons, si elle est attaquée, avec beaucoup plus d'adresse et de persistance j et nous avons pour la défendre des moyens que les anciens n'avaient pas.
Le commerce rend l'action de l'arbitraire sur notre existence plus vexatoire qu'autrefois, parce que nos spéculations étant plus variées, l'arbitraire doit se multiplier pour les atteindre; mais le commerce rend aussi l'action de l'arbitraire plus facile à éluder, parce qu'il changé la nature de la propriété, qui devient par ce changement presque insaisissable.
Le commerce donne à la propriété une qualité nouvelle, la circulation: sans circulation, la propriété n'est qu'un usufruit; l'autorité peut toujours influer sur l'usufruit1, car élite peut enlever la jouissance; mais là circulation met un obstacle invisible et invincible à cette action du pouvoir social.
Les effets du commerce s'étendent encore plus loin: non-seulement il affranchit les individus, mais, en créant le crédit, il rend l'autorité dépendante.
L'argent, dit un auteur français, est l'arme la plus dangereuse du despotisme; mais il est en même temps son frein le plus puissant; le crédit est soumis à l'opinion; la force est inutile; l'argent se cache ou s'enfuit; toutes les opérations de l'Etat sont suspendues. Le crédit n'avait pas la même influence chez les anciens; leurs gouvernements étaient plus forts que les particuliers; les particuliers sont plus forts que les pouvoirs politiques de nos jours; la richesse est une puissance plus disponible dans tous les instants, plus applicable à tous les intérêts, et par conséquent bien plus réelle et mieux obéie; le pouvoir menace, la richesse récompense: on échappe au pouvoir en le trompant; pour obtenir les faveurs de la richesse, il faut la servie: celle-ci doit l'emporter.
Par une suite des mêmes causes, l'existence individuelle est moins englobée dans l'existence politique. Les individus transplantent au loin leurs trésors; ils portent avec eux toutes les jouissances de la vie privée; le commerce a rapproché les nations., et leur a donné des mœurs et des habitudes à peu près pareilles.: les chefs peuvent être ennemis; les peuples sont compatriotes.
Que le pouvoir s'y résigne donc; il nous faut de la liberté, et nous l'aurons; mais comme la liberté qu'il nous faut est différente de celle des anciens, il faut à cette liberté une autre organisation que celle qui pourrait convenir à la liberté antique; dans celle-ci, plus l'homme consacrait de temps et de force à l'exercice de ses droits politiques, plus il se croyait libre; dans l'espèce de liberté dont nous sommes susceptibles, plus l'exercice de nos droits politiques nous laissera de temps pour nos intérêts privés, plus la liberté nous sera précieuse.
De là vient, messieurs, la nécessité du système représentatif. Le système représentatif n'est autre chose qu'une organisation à l'aide de laquelle une nation se décharge sur quelques individus de ce qu'elle ne peut ou ne veut pas faire elle-même. Les individus pauvres font eux-mêmes leurs affaires: les hommes riches prennent des intendants. C'est l'histoire des nations anciennes et des nations modernes. Le système représentatif est une procuration donnée à un certain nombre d'hommes par la masse du peuple, qui veut que ses intérêts soient défendus, et qui néanmoins n'a pas le temps de les défendre toujours lui-même. Mais à moins d'être insensés, les hommes riches qui ont des intendants, examinent avec attention et sévérité si ces intendants font leur devoir, s'ils ne sont ni négligents, ni corruptibles, ni incapables; et pour juger de la gestion de ces. mandataires, les commettants qui ont de la prudence, se mettent bien au fait des affaires dont ils leur confient l'administration. De même, les peuples qui, dans le but de jouir de la liberté qui leur convient, recourent au système représentatif, doivent exercer une surveillance active et constante sur leurs représentants, et se réserver, à des. époques qui ne soient pas séparées par de trop longs intervalles, le droit de les écarter s'ils ont trompé leurs voeux, et de révoquer les pouvoirs dont ils auraient abusé.
Car, de ce que la liberté moderne diffère de la liberté antique, il s'en suit qu'elle est aussi menacée d'un danger d'espèce différente.
Le danger de la liberté antique était qu'attentifs uniquement à s'assurer le partage du pouvoir social, les hommes ne fissent trop bon marché des droits et des jouissances individuelles.
Le danger de la liberté moderne, c'est qu'absorbés dans la jouissance de notre indépendance privée, et dans la poursuite de nos intérêts particuliers, nous ne renoncions trop facilement à notre droit de partage dans le pouvoir politique.
Les dépositaires de l'autorité ne manquent pas de nous y exhorter. Ils sont si disposés à nous épargner toute espèce de peine, excepté celle d'obéir et de payer! Ils nous diront: quel est au fond le but de vos efforts, le motif de vos travaux, l'objet de toutes vos espérances? N'est-ce pas le bonheur?Eh bien, ce bonheur, laissez-nous faire, et nous-vous le donnerons. Non, Messieurs, ne laissons pas faire j quelque touchant que soit un intérêt si tendre, prions l'autorité de rester dans ses limites; qu'elle se borne à être juste. Nous nous chargerons d'être heureux.
Pourrions-nous l'être par des jouissances, si ces jouissances étaient séparées des garanties? Et où trouverions-nous ces garanties, si nous renoncions à la liberté politique? Y renoncer, Messieurs, serait une démence semblable à celle d'un homme qui, sous prétexte qu'il n'habite qu'un premier étage, prétendrait bâtir sur le sable un édifice sans fondements.
D’ailleurs, Messieurs, est-il donc si vrai que le bonheur, de quelque genre qu'il puisse être, soit le but unique de l'espèce humaine? En çe cas, notre carrière serait bien étroite et notre destination bien peu relevée. Il n'est pas un de nous qui, s'il voulait descendre, restreindre ses facultés morales, rabaisser ses désirs, abjurer l'activité, la gloire, les émotions généreuses et. profondes, ne pût s'abrutir et être heureux. Non, Messieurs, j'en atteste cette parti© meilleure de notre nature, cette noble inquiétude qui nous poursuit et qui nous tourmente, cette ardeur d'étendre nos lumières et de développer nos facultés; ce n'est pas au bonheur seul, c'est au perfectionnement que notre destin nous appelle; et la liberté politique est le plus puissant, le plus énergique moyen de perfectionnement que le ciel nous ait donné.
La liberté politique soumettant à tous les citoyens, sans exception, l'examen et l'étude de leurs intérêts les plus sacrés, agrandit leur esprit, anoblit leurs pensées, établit entre eux tous une sorte d'égalité intellectuelle qui fait la gloire et la puissance d'un peuple.
Aussi, voyez comme une nation grandit à la première institution qui lui rend l'exercice régulier de la liberté politique. Voyez nos concitoyens de toutes les classes, de toutes les professions, sortant de la sphère de leurs travaux habituels et de leur industrie privée, se trouver soudain au niveau des fonctions importantes que la constitution leur confie, choisir avec discernement, résister avec énergie, déconcerter la ruse, braver la menace, résister noblement à la séduction. Voyez le patriotisme pur, profond et sincère, triomphant dans nos villes, et vivifiant jusqu'à nos hameaux, traversant nos. ateliers, ranimant nos campagnes, pénétrant du sentiment de nos droits et de la nécessité des. garanties l'esprit juste et droit du cultivateur utile et du négociant industrieux, qui, savants dans l'histoire des maux qu'ils ont subis, et non. moins éclairés sur les remèdes qu'exigent ces maux, embrassent d'un regard la France entière, et dispensateurs de la reconnaissance nationale, récompensent par leurs suffrages, après trente années, la fidélité aux principes dans la personne du plus illustre des défenseurs de la liberté.39
Loin donc, Messieurs, de renoncer à aucune des deux espèces de liberté dont je vous ai parlé, il faut, je l'ai démontré, apprendre à les combiner l'une avec l'autre. Les institutions, comme le dit le célèbre auteur de l'histoire des républiques du moyen âge, doivent accomplir les destinées de l'espèce humaine; elles atteignent d'autant mieux,leur but qu'elles élèvent le plus grand nombre possible de citoyens à la plus haute dignité morale.
L'œuvre du législateur n'est point complète quand il a seulement rendu le peuple tranquille. Lors même que ce peuple est content, il reste encore beaucoup à faire. Il faut que les institutions achèvent l'éducation morale des citoyens. En respectant leurs droits individuels, en ménageant leur indépendance, en ne troublant point leurs occupations, elles doivent pourtant consacrer leur influence sur la chose publique, les appeler à concourir, par leurs déterminations et par leurs suffrages, à l'exercice du pouvoir, leur garantir un droit de contrôle et de surveillance par la manifestation de leurs opinions, et les formant de la sorte par la pratique à ces fonctions élevées, leur donner à la fois et le désir et la faculté de s'en acquitter.
17.Pierre Daunou on “Freedom of Opinion” (1819)↩
[Word Length: 7,831]
Source
Pierre Claude François Daunou, Essai sur les garanties individuelles que réclame l'état actuel de la société (Paris: Foulon, 1819). Chap. IV, "De la liberté des opinions", pp. 66-107.
Brief Bio of the Author: Pierre Daunou (1761-1840)
[Pierre Claude François Daunou (1761-1840)]
Pierre Claude François Daunou (1761-1840) was born at Boulogne-sur-Mer to a family of three generations of surgeons, Daunou was intended for that profession. After achieving great success in his studies with the Oratorians, he wanted to join the bar but his father's straightened financial circumstances precluded this. Rather out of pique, he joined the Congregation of the Oratory and became a monk, spending 15 years immersed in the humanities and theology. He then taught Latin at various seminaries, and was ordained as a priest in 1787. When the Revolution broke out in 1789 he immediately subscribed to its principles and welcomed the new social order it heralded. He identified with the ideological school, although he had some differences with Destutt de Tracy, and he championed the cause of liberty both as a historian and as a politician. Of his relatively sparse writings, his Essai sur les garanties individuelles que réclame l’état actuel de la société (1819) is undoubtedly the most important work, especially for the dissemination of liberal ideas. [RL]
CHAPITRE IV. De la liberté des opinions.
Le mot liberté a donné lieu à beaucoup de controverses, soit parmi les métaphysiciens, soit parmi les politiques. Il a deux significations très-distinctes.
D'une part, lorsqu'on dit que la volonté humaine jouit d'une parfaite liberté, on assure qu'entre deux déterminations opposées, elle a le pouvoir de prendre à son gré l'une ou l'autre , et par conséquent de résister aux motifs et aux sentimens qui l'entraînent vers celle qu'elle embrasse.
De l'autre part, quand on réclame la liberté civile, on demande qu'aucun obstacle extérieur ne vienne nous empêcher d'agir conformément aux déterminations que nous avons prises, si elles ne sont point attentatoires à la personne ou à la propriété d'autrui.
Nous n'avons point à nous occuper de la liberté envisagée dans le premier sens ou sous l'aspect métaphysique : cependant comme nous devons parler ici de la liberté des opinions, il nous importe de remarquer d'abord qu'un homme raisonnable n'a réellement point la faculté de se déterminer entre deux opinions contraires. Sans doute, avant d'embrasser l'une ou l'autre, il lui a été possible de les examiner avec plus ou moins de maturité, de considérer la question sous toutes ses faces, ou seulement sous quelques-unes. Nous n'avons que trop aussi le pouvoir de ne conformer ni nos actions ni notre langage à nos opinions, de démentir la plupart de nos pensées par notre conduite et par nos discours. Mais à ne prendre que notre pensée en elle-même, telle qu'elle est en notre conscience, après une suite donnée d'observations et de réflexions, il n'est pas vrai de dire qu'elle soit libre, qu'il dépende de nous, dans cet état déterminé de notre esprit, de penser autrement que nous ne pensons. C'est de quoi l'on convient assez, au moins à l'égard des propositions reconnues pour certaines, et dont la vérité résulte immédiatement de la nature même des termes qui les expriment, une fois qu'ils ont été bien définis et bien compris. Ce n'est point par un choix libre qu'un mathématicien juge que les trois angles d'un triangle égalent précisément deux angles droits; il n'est pas en sa puissance de concevoir une opinion contraire. Je dirai de même, quoique la matière soit moins rigoureuse, qu'en regardant Mahomet comme un imposteur, et son Alcoran comme un amas d'absurdités, j'obéis à une conviction intime dont je ne suis aucunement le maître : et s'il arrive que sur beaucoup d'autres points, l'opinion qui s'empare de moi ne me paraisse que probable , si je sens qu'il pourrait se faire qu'après des vérifications qui ne sont point à ma portée, cette opinion cédât son empire à celle qui lui est opposée; s'il peut arriver même que l'état actuel de mes connaissances me laisse tout-à-fait incertain et suspendu entre l'une et l'autre, j'ose dire encore que plus j'aurai mis de bonne foi, de raison et d'activité dans cet examen, plus je serai passif dans mes convictions , ou mes croyances, ou mes doutes. J'aurai cherché un résultat, je l'aurai rencontré , reconnu, subi ; je ne l'aurai point fait à ma guise. Peut-être me sera-t-il désagréable, mais il aura soit provisoirement, soit définitivement captivé mon intelligence.
C'est précisément parce que les opinions ne sont pas libres dans le sens métaphysique qui vient d'être expliqué, qu'elles doivent l'être dans l'autre sens, c'est-à-dire n'avoir à redouter aucune contrainte extérieure. Nous obliger ou à professer celles que nous n'avons pas, ou à dissimuler celles que nous avons, serait de la part d'un particulier une agression si étrange , que les lois l'ont à peine prévue. En ce point, les gouvernemens tyranniques ont fait plus qu'imiter les malfaiteurs vulgaires: ils ont inventé un genre de violence dont ils n'avaient presque trouvé aucun exemple dans le cours des iniquités privées. Ils ont prétendu asservir la plus indépendante des facultés humaines , celle qui nous rend industrieux et capables de progrès, celle qui meut et dirige toutes les autres. Certes! on appartient, dans ce qu'on a de plus personnel et de plus intime, au maître par qui l'on est empêché de penser et de dire ce qu'on pense. Il n'y a pas d'esclavage plus étroit que celui-là; aussi faut-il, pour y réduire un peuple, l'avoir auparavant, à force de vexations et d'artifices, plongé dans une ignorance extrême, et presque dépouillé de ces facultés intellectuelles dont il ne doit plus faire usage. S'il les conserve ou s'il les recouvre, il sentira le joug et s'efforcera de le secouer.
Dans un pays où quelques lumières ont pénétré, la tyrannie qui contraint à professer des opinions que l'on n'a pas , déprave, autant qu'il est en elle, les premières classes de la société pour tromper et enchaîner les dernières. Elle entretient, dans le monde, un commerce forcé de mensonges. Tant qu'il est ordonné à tous de faire semblant de croire ce que plusieurs ne peuvent pas croire en effet, il y a corruption ou lâcheté dans les uns, inertie ou imbécillité dans les autres, dégradation de l'espèce humaine dans la plupart. La noblesse et l'énergie des caractères tiennent plus qu'on ne pense à la franchise et à la constance des opinions. La probité peut s'être trompée et sait reconnaître ses erreurs ; mais il ne faut attendre d'elle ni complaisance, ni même trop de docilité; elle abandonne aux courtisans le talent de préconiser tout système qui vient à dominer : cette logique flexible qui sait retomber toujours juste dans les doctrines qu'il plaît aux gouvernemens de prescrire, n'est point du tout à son usage : ses pensées mûrissent et s'enracinent dans sa conscience immuable; et ses discours, fidèle et vive image de ses sentimens, ne prennent aucune teinte étrangère.
Gardons-nous toutefois de confondre ici deux choses réellement très-distinctes. Peut-être ne voudra-t-on plus nous forcer à dire ce que nous ne pensons pas: il s'agit seulement de savoir jusqu'à quel point on pourra nous interdire la manifestation de nos propres pensées. Voilà surtout la question qui se présente ici à résoudre.
Hâtons-nous de reconnaître que le langage prend quelquefois le caractère d'une action. Manifester une opinion injurieuse à une personne est un acte agressif; et celui qui en est blesse ne fait, en s'y opposant, que repousser une attaque. C'est comme des actions nuisibles au bien-être et à la sûreté des individus, quelquefois même à la tranquillité générale, que la calomnie et la simple injure doivent être sévèrement réprimées. Il est certain aussi que l'on coopère à un crime ou à un délit, lorsqu'on le conseille, lorsqu'on y excite, lorsqu'on indique les moyens de le commettre: de pareils discours sont des actes de complicité, toujours punissables s'il s'agit d'attentats entre des personnes privées, et à plus forte raison si c'est l'ordre public que l'on menace. L'acte, dans ce dernier cas, prend le nom de sédition; genre sous lequel sont comprises les provocations expresses à la désobéissance aux lois, les insultes publiquement faites aux dépositaires de l'autorité, les machinations qui tendent à renverser le système public établi. Voilà des délits ou des crimes que rien n'excuse ; voilà des espèces d'opinions qu'il n'est jamais permis d'exprimer, quand même, par le plus déplorable travers, on les aurait conçues comme vraies ou légitimes. Mais aussi, à mon avis, ce sont les seules qu'il soit juste et utile d'interdire : je tâcherai de prouver que la liberté de toutes les autres doit rester intacte, à l'abri de toute espèce d'entrave, d'empêchement préalable , de prohibition et de répression; qu'en proscrire une seule autre, vraie ou fausse, hasardée ou prouvée, saine ou non saine , innocente ou dangereuse; la condamner à tort ou à droit, comme contraire aux principes des lois, à l'esprit des institutions, aux maximes ou aux intérêts ou aux habitudes du gouvernement, c'est assujétir la pensée humaine à une tyrannie arbitraire, et mettre en interdit la raison.
Tous tant que nous sommes, nous appelons saines les doctrines que nous professons, et non saines celles qui ne sont pas les nôtres : ces mots, réduits à leur juste valeur, ne signifient jamais que cela. Non que parmi nos croyances diverges, il n'y en ait en effet de vraies et de fausses, de solides et de futiles; mais chacun de nous en fait le départ comme il l'entend, à ses risques et périls. Soutenir une proposition et la juger raisonnable, c'est une même chose; la rejeter équivaut à la déclarer mal fondée, Pour établir une distinction constante entre les bonnes et les mauvaises doctrines, il faudrait, au sein de la société, un symbole politique, historique et philosophique; ou bien une autorité chargée de proclamer au besoin, en toute matière, le vrai et le faux : peut-être aurait-on besoin à-la-fois de ces deux institutions, aussi monstrueuses l'une que l'autre.
Un corps de doctrine suppose que l'esprit humain a fait tous les progrès possibles , lui interdit tous ceux qui lui restent à faire, trace un cercle autour des notions acquises ou reçues , y renferme inévitablement beaucoup d'erreurs, en exclut beaucoup de vérités, s'oppose au développement des sciences, des arts et de toutes les industries. A quelque époque de l'histoire qu'on eût fait un pareil symbole, il aurait contenu des absurdités et repoussé des lumières qui depuis ont commencé d'éclairer le monde; et à l'égard d'une autorité qui, soit en interprétant ce symbole , soit de son propre mouvement, déciderait toutes les questions qui viendraient à s'élever, ou bien elle serait distincte du pouvoir civil, et ne tarderait point à le dominer, ou, se confondant avec lui, elle le transformerait en un absolu despotisme , à qui toutes les personnes et toutes les choses seraient livrées sans réserve.
S'il n'y a pas un corps de doctrine publique, comment saurons-nous quelles sont les opinions qu'il ne nous est pas permis de professer? Où seront puisées les décisions du tribunal ou sanhédrin chargé de nous condamner? Lors même qu'il prétendrait prouver que nous sommes tombés dans l'erreur, que ferait-il autre chose qu'opposer son opinion particulière à la nôtre? Et quelle justice humaine ou divine pourrait lui donner le droit de qualifier délit ou crime, un fait qui n'aurait été prévu par aucune loi?
Lorsqu'on recherche les causes qui ont le plus propagé et perpétué l'erreur, le plus retardé la véritable instruction des peuples, on les reconnaît toujours dans des institutions pare.Iles à celles dont je viens de parler. De soi, l'esprit humain tend à la vérité : s'il n'y arrive qu'après des écarts et à travers des illusions, jamais il ne manque de reprendre le droit chemin, pour peu que l'autorité ne s'applique pas ou ne réussisse pas à le lui fermer. Il y est rappelé par l'activité même qui a servi à l'égarer : sa marche n'est ni rapide ni directe; mais, à pas incertains et chancelans, il avance toujours, et l'on mesure avec surprise, après quelques siècles, l'espace qu'il a parcouru, quand il n'a pas été arrêté ou repoussé par la violence. 31 va perfectionnant la société, desserrant les chaînes des peuples, dessillant les yeux de leurs maîtres, et faisant jaillir, du sein des controverses éphémères qui l'exercent successivement^ d'éternels rayons de lumière.
Mais parmi les erreurs, n'y en a-t-il point de dangereuses? Oui, certes ! il y en a de telles, ou plutôt elles le sont toutes. Nulle erreur, si mince qu'elle soit, n'est indifférente : il n'en est aucune en physique, en histoire, en philosophie, en politique, en un genre quelconque, qui n'entraîne à des pratiques pernicieuses, ou l'agriculture, ou la médecine, ou d'autres arts, ou enfin l'administration publique. Toute illusion de notre esprit, toute méprise, tout mécompte, retombe en dommage sur quelque détail de la vie humaine. Un médecin qui se trompe, abrège ou tourmente les jours qu'il prétend prolonger. Les théologiens qui, au milieu du dernier siècle, déconseillaient l'inoculation ,. qui la condamnaient par des sentences, des décrets, des mandemens, erraient aux dépens de plusieurs milliers d'individus, puisqu'ils les retenaient exposés à de plus nombreuses chances de mortalité. Fallait-il imposer silence à ces théologiens? hélas! peu s'en est fallu qu'ils ne l'imposassent à leurs adversaires : car, dès qu'il y a. moyen de proscrire une doctrine, il est toujours plus probable que la fausse proscrira la vraie. Après tout, à qui appartient-il de nous interdire l'erreur? A celui qui en est exempt? il n'y a plus en Europe qu'un seul homme qui ose encore se dire infaillible. A celui qui se trompe comme nous, plus que nous peut-être? Ah! c'est ainsi que l'erreur, infirmité commune, devient une puissance publique, et que, sous prétexte de nous délivrer des illusions, on nous prive seulement des moyens de nous en guérir.
Non, la liberté des opinions n'existe pas si elle est restreinte par la condition de ne rien dire que de vrai et d'utile ; à plus forte raison, si l'on établit des doctrines qu'il ne sera pas permis de contredire , si l'on en signale d'autres qu'il sera défendu de professer, ou bien encore si, sans prendre la peine de faire aucune de ces déclarations préalables , on investit des juges du droit de condamner, selon leur bon plaisir, des pensées qu'aucune loi n'avait prohibées. En vain les législateurs ou les juges s'appliqueraient à distinguer divers ordres d'erreurs, pour n'interdire d'avance ou ne réprouver après coup que les plus périlleuses. C'est toujours là un système arbitraire qu'il serait impossible de rendre exact, qui n'admettrait aucune règle invariable et positive. On se bornera, direz-vous, à condamner ce qui contrarie les lois ou l'autorité. Ce sont encore là des expressions beaucoup trop vagues. Toute provocation directe à désobéir aux lois, toute insulte à l'autorité, est plus qu'une erreur dangereuse: c'est, comme je l'ai dit, une action criminelle. Mais ne vous conviendra-t-il pas de trouver nos pensées contraires à l'autorité, quand nous lui adresserons d'humbles conseils? contraires aux lois, quand nous y remarquerons des défauts, quand nous proposerons des réformes? si bien qu'il ne restera aucune ressource contre les abus du pouvoir, aucun remède aux plus graves erreurs des peuples, savoir, à celles qui s'introduisent et s'invétèrent dans leur législation. Bientôt, peut-être, il ne sera plus permis de raisonner sur l’état social, généralement considéré: car ces réflexions abstraites aboutiront à des applications, et ressembleront à des censures. Nous serons répréhensibles encore en louant, chez un autre peuple, un système politique contraire à celui sous lequel nous vivons; la plupart des souvenirs historiques deviendront suspects; et je ne sais trop quelle pensée restera innocente, si elle touche par quelque point aux mœurs sociales, aux institutions passées, actuelles ou futures. Cependant comment la législation a-t-elle fait quelques progrès? comment s'est-elle successivement guérie de ses erreurs les plus barbares? Pourquoi a-t-on affranchi des serfs? aboli des corvées? moins admis d'inégalité dans les partages heréditaires? presque renoncé aux tortures et à ces procédures secrètes qui, à certaines époques, commettaient peut-être plus d'homicides qu'elles n'en punissaient? Pourquoi, sinon parce qu'on a usé quelquefois du droit d'examiner les motifs et les effets des lois, d'éclairer l'autorité sur les intérêts publics, sur les siens propres?
Loin de permettre l'examen des lois de l'état, on a plus d'une fois voulu défendre toute observation sur les jugemens rendus par les tribunaux, même depuis que Voltaire a montré, par d’éclatans exemples, l'utilité de ces réclamations. Entraîné par l'intérêt que lui inspiraient les victimes, Voltaire a peu ménagé leurs juges : on peut exiger plus de réserve, ne tolérer aucun trait injurieux aux intentions, au caractère, à la personne des magistrats. Mais s'il n'était pas permis de penser qu'ils se sont trompés, et de les avertir de leurs erreurs, il n'y aurait plus aucun moyen de les garantir eux-mêmes des plus graves dangers de leurs fonctions redoutables; plus aucun tempérament à l'énorme pouvoir qu'ils exercent, quand leurs arrêts , en matière de délits ou de crimes, ne sont pas précédés d'une déclaration de véritables jurés; plus de remède à leurs préjugés et à leurs routines; nul contre-poids, enfin, à l'ascendant qu'exercent sur eux, dans les temps de troubles, les manœuvres des factions dominantes.
J'ignore aussi quel avantage on trouve à prescrire des hommages, ou un respect taciturne, pour certains dogmes politiques, particulièrement pour ceux qui concernent l'origine et les fondemens du pouvoir suprême. Il y a partout de pareils dogmes; chaque système politique a les siens : il y en a pour les républiques, soit démocratiques, soit aristocratiques; pour les monarchies, soit tempérées, soit absolues; pour les dynasties anciennes et pour les dynasties nouvelles. Les communications habituelles et rapides, aujourd'hui établies entre les pays diversement gouvernés, affaiblissent, plus qu'on ne pense, les hommages que reçoit et les anathêmes que subit chacun de ces dogmes contradictoires. Ils perdront de plus en plus, par la force coactive dont on voudra les armer, le crédit qu'ils obtiendraient peut-être d'un examen libre de leur vérité : celui de ces dogmes qui triompherait le mieux des objections, gagne le moins à s'y soustraire; vrais ou faux, constans ou douteux, clairs ou équivoques, ils établissent contre eux-mêmes le préjugé le plus fatal, en se refusant aux épreuves que toute pensée humaine a besoin de subir pour, se fixer dans les esprits. Un silence forcé est une protestation bien plutôt qu'un; consentement; et c'est prendre un déplorable moyen de propager une doctrine, que de charger des tribunaux de condamner ceux qui oseraient la révoquer en doute. Combien est chimérique l'importance que le pouvoir attache à ces articles de foi politique! La force du pouvoir est dans les bienfaits, dans les sentimens qu'il inspire, dans la vénération, la reconnaissance et l'amour que nous commandent ses lumières, sa vigilance et son équité; non assurément dans je ne sais quelle idée vague et mystérieuse qu'il prétend nous donner de son origine. C'est redescendre que de se faire idole, quand on est une puissance tutélaire et nécessaire.
Cependant après avoir prescrit des doctrines, on s'avisera bientôt de déterminer aussi des faits, et d'imposer des lois même à l'histoire : on exigera d'elle, pour les prédécesseurs d'un prince régnant, pour quelques - uns du moins, le respect qui lui est.dû à lui-même tandis qu'il règne; on la forcera d'imprimer certaines couleurs aux évènemens, aux détails, aux personnages; de conformer ses récits à des traditions privilégiées, quels que soient les résultats des recherches plus exactes qu'elle pourrait faire. On voudra retenir le passé dans les ténèbres, de peur qu'il n'en rejaillisse des lumières sur le présent; et l'on ne tiendra pas les abus actuels pour assez bien garantis, s'il est permis de signaler les égaremens ou les crimes des potentats qui ne sont plus. Leur mort n'aura point rendu aux fils, aux descendais de ceux qu'ils ont opprimés, le droit de les accuser : quelquefois six siècles ne suffiront point pour donner à la postérité le droit de juger de mauvais princes, ou même d'apprécier impartialement un bon roi; on nous défendra de mêler aux hommages dus à ses vertus, des regrets sur se erreurs, sur les désastres qu'elles ont amenés, et dont il a peut-être été lui-même l'une des innombrables victimes: viendra, après cinq cents ans, quelque autorité publique , qui le déclarera le plus éclairé des monarques, quand même il aurait subi, plus qu'aucun de ses contemporains, le joug d'une ignorance grossière et calamiteuse. A plus forte raison trouvera-t-on des délits dans tout examen libre des règnes récens ou des temps voisins du nôtre. On nous prescrira des manières de parler des maux qu'ont endurés nos pères, de ceux que nous avons soufferts nous-mêmes.
La sécurité qu'obtient la puissance par de telles prohibitions est bien trompeuse. Le plus grand péril pour elle, au sein d'un peuple qui n'est plus inculte, est d'ignorer ce qu'il pense, de se séparer de lui par une ténébreuse enceinte de courtisans, de ne lui permettre aucune plainte qu'elle puisse entendre, et de se récrier contre tous les progrès qu'elle ne veut pas faire. Elle seule rend redoutable, en y résistant, les progrès qui se font malgré elle ou à son insu: tandis qu'au contraire, de toutes les opinions particulières, librement exprimées et controversées, il ne se formerait que la plus calme, et, à tous égards, la meilleure opinion publique.
L'opinion publique est aisée à distinguer de ces opinions populaires qui dominent au sein des ténèbres, ou bien au sein des troubles civils. Il y a partout une partie plus ou moins grande de la population qui ne suit que de fort loin les progrès de l'intelligence humaine, n'est atteinte par les lumières qu'après qu'elles ont brillé sans interruption sur plusieurs siècles, et en attendant reçoit sans examen, par conséquent avec enthousiasme, les doctrines que lui prêchent les maîtres qui la subjuguent ou les factieux qui l'agitent. Amas informe de superstitions grossières ou d'exagérations licencieuses , ces opinions populaires servent d points d'appui à tous les genres de tyrannie ou d'imposture : elles sont les meilleures garanties du pouvoir arbitraire et du pouvoir usurpé, comme les lumières sont celles du pouvoir légitime.
Nos persuasions ont deux sources bien différentes, l'imagination et la raison. Il y a sûrement, dans l'organisation de l'homme, quelque chose qui le dispose à croire, en certaines circonstances, ce qu'il n'a ni vu, ni vérifié, ni même compris. Le naturel commence et l'habitude achève en nous ce goût du merveilleux, ce besoin d'erreurs que rendent quelquefois presque irrésistible les craintes , les espérances, et les autres affections ou passions qui se combinent avec lui. Quelque dangereux que soit ce penchant, tout annonce qu'il tient à l'une de nos facultés les plus nobles et les plus actives, à cette puissance de former des hypothèses hardies, et de créer des fictions brillantes ou sublimes, qui se nomme imagination, et qui, réglée par la raison, mérite le nom de génie. Mais cette raison, c'est-à-dire, la faculté d'observer, d'éprouver, de comparer , d'analyser, n'en est pas moins le seul garant de la vérité de nos pensées, comme de la sagesse de nos actions; et l'espèce d'opinion que désigne la qualification de publique, est celle qui, admettant davantage les résultats des observations précises, des expériences sûres, des raisonnemens exacts, caractérise les classes éclairées de la société.
Ne prenons pas toutefois une idée exagérée ni de la puissance, ni de la rectitude de l'opinion publique. Non, elle n'est pas toujours la reine du monde : elle a pour contrepoids les forces souvent associées des opinions vulgaires et du pouvoir arbitraire. Son ascendant, qui ne date que du moment où le leur baisse, demeure long-temps faible et ne s'accroît que par degrés. Elle ne sort pas victorieuse de toutes les luttes où elle s'engage : elle a besoin de choisir le terrain, de saisir les occasions, d'attendre et de ménager ses succès. Mais il est pourtant indubitable que, depuis un siècle, elle est en Europe une autorité.
De sa nature, elle tend à la sagesse; mais c'est par une progression fort lente. Long-temps elle conserve, dans les élémens qui la composent, une partie plus ou moins forte d'idées populaires; elle ne s'en débarrasse que peu à peu, et laisse toujours quelque intervalle entre elle et les plus nouvelles conquêtes de l'esprit humain. Le génie des sciences la précède ; et pour ne s'exposer à aucun écart, elle attend que les progrès soient bien assurés, avant de les faire elle-même. Le fruit qu'elle obtient de cette circonspection est de ne revenir jamais sur ses pas, de ne plus se replonger, pour l'ordinaire, dans les erreurs dont elle s'est une fois dégagée , et d'avancer insensiblement dans la route des véritables connaissances. Cette marche, toutefois, n'est bien constante ou bien visible que dans les temps calmes : des circonstances tumultueuses impriment à l'opinion publique des mouvemens brusques qui semblent l'entraîner fort en avant, la repousser ensuite fort en arrière. On la voit, après tout grand événement , toute commotion, toute catastrophe, s'exalter, se déprimer, s'égarer en sens divers; ou plutôt il devient difficile de la reconnaître? on prend pour elle un bruit confus, où quelques-uns de ses accens se mêlent aux clameurs des factions et des passions populaires. Ces temps là sont ceux où, plus alléguée que jamais, elle se fait le moins entendre; elle n'a plus d'organes, et se conserve silencieusement en dépôt dans les esprits sages, dans les consciences pures. Mais aussitôt que les troubles commencent à s'apaiser, elle reprend le cours paisible de ses progrès : les pas précipités, puis rétrogrades qu'elle a paru faire, sont comme non avenus; on la retrouve au point où on l'a laissée, lorsqu'éclataient les premiers orages, plus forte cependant et plus imposante, parce que le souvenir, le sentiment des maux qu'on vient d'éprouver hors de sa direction, ordonnent de la reprendre pour guide. On sait, mieux que jamais, qu'il y a du péril à faire moins et à l'aire plus qu'elle ne demande. Négliger, à de pareilles époques, de l'écouter et de la suivre , serait, de la part du pouvoir, le comble de la témérité : ce serait repousser, non pas seulement les meilleurs et les plus fidèles conseils, mais l'unique sauve-garde digne de confiance.
Avec de l'habileté ou de l'audace, on altère, on gouverne des opinions populaires: mais l'un des caractères essentiels de l'opinion publique est de se soustraire à toute direction impérieuse; elle est ingouvernable. On la peut comprimer, étouffer, anéantir peut-être : on ne saurait la régir. Vainement le pouvoir se consume à la former telle qu'il la veut, à la modifier au gré des intérêts et des besoins qu'il se donne. Le besoin, l'intérêt qu'il a réellement, est de la bien connaître toujours, et par conséquent de ne mettre aucun obstacle arbitraire à la manifestation des opinions individuelles dont elle se compose.
C'est le plus ordinairement par le langage que les hommes se communiquent leurs pensées. Les entretiens privés sont l'un des plus grands ressorts de la vie sociale; et, par leur clandestinité, par leur mobilité, par leur multitude, ils échappent d'ordinaire à la surveillance et à la contrainte, à moins qu'une tyrannie ombrageuse ne les environne de témoins mercenaires et délateurs, symptôme sûr de la plus profonde dépravation possible des gouvernans et des gouvernés. Mais l'homme a trouvé l'art de parler aux absens , de combler les distances, d'adresser à tous les lieux, et à tous les siècles, l'expression de ses pensées. Il faut nous arrêter un instant au plus simple usage de cet art, c'est-à-dire, aux lettres missives; car elles sont quelquefois l'objet d'une inquisition d'autant plus odieuse que l'infidélité s'y joint au despotisme. Transporter ces lettres n'est point assurément une fonction du pouvoir suprême; c'est un service dont auraient pu se charger des entrepreneurs particuliers , et que nous ne confions aux soins d'un gouvernement que parce que nous ne supposons pas qu'il veuille se rabaisser au niveau des messagers infidèles. Qu'on soit commissionnaire, courrier, employé, administrateur ou ministre, du moment où l'on s'offre à transmettre à leur adresse des papiers cachetés, et quand surtout on reçoit, pour ce service, un salaire fort supérieur aux frais qu'il entraîne, on s'engage évidemment à ne pas les ouvrir; et quelque dur que soit le mot de brigandage, c'est. encore le seul qui convienne, en toute hypothèse, en toute circonstance, à la violation d'un engagement si sacré. L'état de guerre même n'autorise l'ouverture des correspondances secrètes, que lorsqu'on ne s'en est pas rendu dépositaire, et qu'on les saisit dans les mains ennemies. Cependant il y a des temps où toute notion de morale, tout sentiment d'équité s'évanouit à tel point, que les gouvernans ne prennent plus la peine d'effacer les traces d'une infidélité si honteuse : ils la placent, sans façon, au nombre de leurs prérogatives; et, quand bon leur semble, ils se vantent et profitent publiquement de ces attentats. Voilà un autre symptôme de perversité, qui, tant qu'il dure, exclut tout espoir de garanties individuelles ; car ceux qui nous refusent celle que nous achetons à part, chaque fois que nous payons ou faisons payer le port d'une lettre, ne sauraient être disposés à nous en accorder aucune autre.
Mais l'art d'écrire s'est fort étendu au-delà des intérêts privés et des correspondances épistolaires. Il crée ou développe les sciences, éclaire tous les autres arts, affermit les bases, et perfectionne tous les détails de la société: il exerce sur l'opinion publique, soit qu'il la devance et la prépare, soit qu'il la propage en la proclamant, une influence toujours salutaire; car, de lui-même, il n'a de force que par les lumières qu'il répand. S'il s'égare, il ne séduit qu'un petit nombre d'hommes, ou n'inspire qu'un enthousiasme éphémère : ce n'est qu'au profit de la vérité qu'il peut opérer des impressions vives et durables sur la partie éclairée d'une nation. Il est pourtant vrai que depuis que cet art existe, et spécialement aux époques où il a le plus brillé, l'autorité, par une fatale méprise, s'est toujours tenue en état d'hostilité contre lui, l'a menacé, tourmenté, entravé, toutes les fois qu'elle n'a pu le corrompre. Quelques-uns disent que le génie doit aux persécutions son énergie et ses triomphes: j'ai peine à Croire qu'elles aient fait autant de bien à l'art d'écrire que de mal aux grands écrivains , et aux autorités imprudentes qui se sont armées contre eux. Il vaudrait mieux, pour tout le monde, que le pouvoir n'apportât aucun obstacle à des travaux essentiellement consacrés au bonheur des peuples. Ce qui est bien sûr, c'est que les anathêmes contre les auteurs ont causé beaucoup d'infortunes privées, sans arrêter le cours général des lumières. Depuis Homère jusqu'à Chénier, une longue succession d'ouvrages admirés ou censurés , approuvés ou proscrits, ont diversement étendu la raison humaine : portez vos regards sur l'histoire entière des efforts de l'autorité contre l'art d'écrire, vous verrez qu'en somme, ils n'ont abouti qu'à la dégrader et à l'affaiblir elle-même.
Il y a trois siècles et demi qu'un nouvel art est venu s'associer à celui-là, pour en disséminer indéfiniment les productions : il a couvert l'Europe de livres, et introduit les lumières dans toutes les habitations, quelquefois même dans les cabanes et jusque dans les palais. Durant les quarante premières années de l'industrie typographique, on ne songea point à l'entraver; à peine prenait-on les précautions nécessaires pour assurer aux auteurs, éditeurs et imprimeurs, la propriété de leurs travaux. Mais en 1501, un pape, qui s'appelait Alexandre VI, institua la censure des livres, défendit d'en publier aucun sans l'aveu des prélats, ordonna de saisir et brûler tout ouvrage qui n'aurait point obtenu ou qui cesserait d'obtenir cette approbation. Ce bref d'un pape, dont la mémoire est restée à jamais flétrie à bien d'autres titres, a servi et sert encore de prototype à tous les actes arbitraires, législatifs et administratifs , dirigés contre l'art d'imprimer. Ce n'est point ici le lieu de tracer une histoire détaillée de cette tyrannie; mais voici, sans distinction de pays ni d'époques, le tableau général de ses entreprises: le plus qu'elle a pu, elle a exigé que les manuscrits à livrer à l'impression fussent soumis à une censure préalable, qu'ils fussent officiellement lus, paraphés et mutilés par des censeurs à ses gages; elle y trouvait, entre autres avantages, celui de faire payer des permissions d'imprimer, ou, comme elle disait, des priviléges; et, d'ailleurs, elle se réservait la faculté de proscrire, au besoin, par des sentences subséquentes, les livres même dont elle avait formellement permis la publication, sauf à étendre l'anathème sur les censeurs qui les avaient approuvés. Pour tenir l'imprimerie et la librairie sous des chaînes encore plus étroites, on a fort souvent fixé le nombre des libraires, et surtout des imprimeurs, en imposant aux uns et aux autres des directeurs-généraux, des inspecteurs particuliers, chargés de surveiller tous les mouvemens du commerce des livres. Cet étrange régime s'est quelquefois maintenu même à des époques où l'autorité feignait de renoncer à l'examen préalable des ouvrages, contente de pouvoir, à son gré, en arrêter la publication, en confisquer les exemplaires, juger les doctrines, condamner les auteurs, et au besoin ou sans besoin, les imprimeurs et les libraires. Tantôt l’on a prétendu que le droit de réprimer les abus emportait celui de les prévenir; tantôt l'on a déclaré que la répression commencerait dès l'instant où il y aurait eu entreprise d'imprimer, et que l'auteur, ou le libraire, ou l'imprimeur qui demanderait et n'obtiendrait pas la permission de publier, aurait publié par cela même. En conséquence, on saisissait un écrit avant tout commencement de publication, et l'on traduisait l'imprimeur, le libraire, l'auteur, non devant des jurés, mais devant des juges d'un second ou troisième ordre, lesquels, selon le bon plaisir de leurs supérieurs, réprouvaient les doctrines, les théories, les systèmes, et condamnaient à une peine plus ou moins grave, à plusieurs peines à la fois, ceux qui avaient tenté de soumettre leurs opinions personnelles à l'examen du public. Enfin l'on a démenti le sens naturel des mots, bouleversé le langage, autant qu'il était nécessaire que la répression fût tout à fait équivalente à la censure préalable, ou même cent fois plus terrible. Cependant, qui le croirait? tant de moyens arbitraires n'ont pas encore rassuré ni satisfait le pouvoir : plus d'une fois il s'est réservé de plus la direction immédiate, presque la propriété de certains genres d'écrits, le droit exclusif de les autoriser, et pour ainsi dire de les faire lui-même, ou du moins d'en retrancher ce qui ne lui plairait point, d'y insérer ce qu'il voudrait; d'y publier, sans se montrer, les opinions qu'il jugerait à propos de répandre, et peut-être les injures personnelles dont il lui conviendrait d'accabler ses victimes; retenant ainsi sous sa dépendance les propriétaires et les rédacteurs de tout recueil périodique, substituant ses intérêts aux leurs, et leur responsabilité à la sienne. Sa moindre prétention a été d'exiger d'eux des cautionnemens considérables : comme s'il ne s'agissait pas d'entreprises purement privées! et comme s'il y avait lieu de demander de pareilles gages à ceux qui ne sont ni dépositaires, ni administrateurs de fonds publics, et dont la profession ne peut gravement compromettre un grand nombre de fonds particuliers!
Depuis trois cents ans qu'on use de ces diverses pratiques, quel succès en a-t-on obtenu? On a ruiné des imprimeurs et des libraires; on a tourmenté, proscrit, immolé des écrivains; on a fait expier aux talens et au génie les bienfaits qu'ils s'efforçaient de verser sur l'espèce humaine; on a brûlé des livres, des auteurs et des lecteurs : le public en a-t-il vu moins clair? a-t-on triomphé des progrès de la raison? a-t-on empêché l'essor de la pensée? a-t-on désarmé la vérité? Il n'y a pas d'apparence, puisqu'on y travaille encore. Qui ne sait que dans le cours de ces trois siècles, et surtout durant le dernier, les connaissances n'ont cessé de s'étendre et de s'épurer, l'opinion publique de s'éclairer et de s'enhardir? En frappant d'excellens ouvrages, et quelques mauvais livres, les censures ont recommandé les uns et les autres : elles seraient oubliées si elles n'étaient des titres de célébrité littéraires. C'est qu'en effet il est naturel de penser que l'autorité ne proscrit que ce qu'elle désespère de réfuter. En s'efforçant d'imposer des opinions, en ne souffrant pas qu'on les contredise, elle fait soupçonner qu'elle renonce à les établir par les voies légitimes de l'instruction. Ah! l'examen ne met point la vérité en péril : les doctrines qui sont en effet certaines ou raisonnables, le paraissent davantage après qu'on les a discutées; leur crédit n'est compromis que du moment où aucune objection contre elles n'est permise. En général, l'esprit humain ne s'assure que des choses dont il a douté, et qu'il a librement éclaircies. Des erreurs que la raison n'a point dissipées, le sont beaucoup moins encore quand une sentence les condamne : nous forcer à les dissimuler , n'est point du tout nous en guérir, c'est nous en rendre plus malades. Il en est de fort graves qui n'ont fait de progrès que parce qu'on les a juridiquement déclarées capables d'en faire. Le faible éclat qui reste à quelques livres pernicieux, n'est que la dernière lueur des bûchers jadis allumés pour les consumer.
Ainsi toutes ces prohibitions et condamnations, impuissantes contre la vérité, inutiles à l'imposture qui les prononce, n'accréditent d'autres erreurs que celles qu'il leur arrive par hasard de menacer ou de frapper. C'est donc bien gratuitement qu'on s'obstinerait à maintenir ce régime contre des garanties sacrées, contre le plus bienfaisant des arts, contre la plus précieuse des industries. Qui suivra l'histoire des entraves données à la presse depuis 1501, reconnaîtra qu'elles n'ont été imaginées que pour soutenir le caduque empire du mensonge et pour enchaîner la raison humaine : c'est un but honteux, mais un autre opprobre est de n'avoir pu l'atteindre en sacrifiant tant de victimes. Toutes les vérités, hormis celles qui seraient des injures personnelles, sont bonnes à dire : la maxime triviale qui dit le contraire, est vide de sens, ou, ce qui revient au même, elle signifie qu'il y a des ténèbres lumineuses et des sottises raisonnables. N'est-ce point à la sagesse, au bien-être, au bonheur que nous devons tendre? et pouvons-nous y être conduits autrement que par la vérité, éclairant, autant qu'il se peut, tous les pas de notre route, tous les détails de notre vie, les élémens de toutes nos connaissances, et surtout de celles dont l'ordre social est l'objet? Hélas! il n'y a que trop de vérités qui échappent encore, qui échapperont long-temps à nos regards: nous n'en sommes assurément pas assez riches pour renoncer, de gaité de cœur, à aucune de celles que nous aurions découvertes, ou que nous pourrions découvrir.
Quand ceux qui repoussent la liberté de la presse veulent être bien sincères, voici les confidences qu'ils nous font. « Les institutions actuelles, nous disent-ils , tiennent à certaines opinions qui ne supportent pas l'examen, à des préjugés utiles aux classes éminentes, contraires aux intérêts de la multitude. Soumettre ces préjugés à une discussion libre, c'est nuire à ceux qui en profitent, agiter ceux qu'ils compriment, troubler le repos des uns et des autres. De pareils débats n'amènent que discorde et désordre : du moment que le silence n'est plus imposé, c'est tout aussitôt la licence qui règne et non pas la liberté. »
Ceux qui tiennent ce langage ont une idée bien fausse de la société en général, et particulièrement des institutions actuelles. Le temps n'est plus où les établissemens politiques se fondaient sur de vains et sots préjugés: il existe en plusieurs grands états, des lois fondamentales qui donnent aux gouvernemens des bases bien plus sûres , savoir, la morale, les intérêts communs à tous les membres de la société, à toutes les familles, à toutes les classes. Ge sont même aujourd'hui les classes les plu* élevées qui ont le plus à redouter l'empire de ces préjugés qu'on leur croit si profitables. Car cet empire circonscrit leur liberté tant qu'il dure; et dès qu'il s'ébranle, leurs possessions et leur sûreté sont aussitôt compromises. Le joug des erreurs dont on n'est pas dupe devient toujours accablant : il compromet bien plus qu'il ne protège les hommes distingués; ils le supportent. avec tant d'impatience qu'ils sont les premiers à le secouer, malgré les périls particuliers qu'ils ont à courir lorsqu'il se brise; et bientôt les rangs éminens qu'ils occupent sont entraînés dans la décadence des erreurs qui semblaient les soutenir. La vérité serait en effet redoutable, si elle avait à demander le renouvellement des institutions fondamentales; mais quand il ne lui reste à réclamer que leur maintien et leur empire, sa voix est la plus pacifique qui se puisse faire entendre. Loin de provoquer des troubles, elle prévient, elle conjure les orages qui naîtraient tôt ou tard d'un désaccord funeste entre les lois constitutionnelles et les habitudes administratives. Sans contredit, si vous ne voulez aucune liberté d'industrie, aucune assurance des propriétés, aucune sûreté des personnes, il ne faut pas que la presse soit libre; mais si vous nous accordez sincèrement ces garanties, songez donc qu'il est impossible qu'elles subsistent dans un pays où la faculté de publier ses opinions resterait soumise à tant d'entraves-. Non, vous n'avez réellement intérêt à captiver nos pensées, qu'autant que vous en prendriez à disposer arbitrairement de notre industrie, de nos biens, et de nos personnes.
Vous nous parlez sans cesse de l'extrême difficulté d'une loi sur la liberté de la presse: c'est qu'en effet cette liberté est chimérique et impossible dans certaines hypothèses dont vous ne voulez pas sortir.
Elle est impossible, tant qu'il subsiste, sons des noms et des formes quelconques, une direction générale de l'imprimerie et de la libraire; tant que ces deux industries ne sont point abandonnées à leurs propres mouvemens, sauf à demeurer, comme toutes les autres, assujéties aux lois générales qui répriment les fraudes.
Elle est impossible, s'il y a, s'il peut y avoir, une censure préliminaire, un examen préalable d'un écrit, avant qu'il soit ou imprimé ou mis en vente.
Elle est impossible, s'il y a une doctrine commandée et une doctrine défendue ; et si en se trompant, en raisonnant mal sur un art ou sur une science, on court d'autres risques que d'être réfuté.
Elle est impossible, s'il n'est pas bien reconnu que l'injure, la calomnie, la provocation directe à un crime, et particulièrement à la sédition, sont les seuls délits ou crimes dont un auteur, et à son défaut le libraire ou l'imprimeur, puisse devenir juridiquement responsable.
Elle est impossible, si le mot indirect est employé dans les lois relatives à ces crimes ou à ces délits; ce mot n'ayant aucun sens précis, et ne pouvant jamais être destiné qu'à servir de prétexte à des persécutions odieuses, à des condamnations arbitraires.
Elle est impossible enfin, si des jurés, tant d'accusation que de jugement, n'interviennent pas toujours pour déterminer, reconnaître, vérifier, déclarer le fait de sédition, de calomnie ou d'injure.
Sortez une fois de ces hypothèses, et cette loi qui offre, dites-vous, tant de difficultés, vous la trouverez toute faite, si votre code pénal a bien défini les provocations séditieuses ou criminelles, la calomnie et l'injure, tant verbales qu'écrites et imprimées.
En ce qui concerne la calomnie et l'injure, ni la loi ni les jurés ne sauraient être trop sévères. Si l'on parvenait à ne laisser impuni aucun crime ou délit de ces deux genres, on rendrait aux particuliers, à l'état et aux lettres, vin service du plus haut prix : aux particuliers, dont l'honneur et le repos ne resteraient plus exposés aux attentats du premier libelliste ; a l'état, au sein duquel les satires personnelles attisent ou rallument les discordes, fomentent les révolutions, entretiennent ou renouvellent les troubles; aux lettres enfin, dont celte licence est l'opprobre, et qu'on ne saurait mieux honorer qu'en les préservant d'un si funeste et si honteux égarement. Je ne sais aucun motif d'indulgence pour l'auteur d'un écrit calomnieux ou injurieux. Qui l'obligeait à parler des personnes? quel droit avait-il sur la réputation morale d'un homme vivant? et pourquoi serait-il plus permis d'imprimer des paroles insultantes que de les proférer de vive voix dans un lieu public?
Bien loin de croire qu'on doive moins d'égards aux magistrats, aux dépositaires ou agens de l'autorité; je pense, au contraire, que les injures ou les calomnies dirigées contre des hommes publics, ont, plus ou moins, un caractère séditieux qui aggrave le délit ou le crime. La sédition est un acte directement attentatoire à l'empire des lois, au maintien du gouvernement, à l'exercice des pouvoirs. Si la puissance est usurpée ou tyrannique, la sédition ,quelque nom qu'elle prenne, est une guerre, et ceux qui l'entreprennent en courent les chances. Si la puissance est légitime, ceux qui l'attaquent commettent, contre la société entière, le plus énorme attentat. Dans tous les cas, la révolte, tramée ou consommée, est réputée crime, quand elle n'est pas victorieuse; et tous les actes, y compris les écrits ou imprimés qui ont pu y tendre ou y concourir, sont punissables.
La sédition ayant, par sa nature, un but direct et actuel, il est impossible, si l'on ne veut pas le faire exprès, d'en étendre le caractère à de simples doctrines politiques, fussent-elles erronées ou dangereuses; à des réclamations contre des abus réels ou prétendus, à des propositions de réformes ; en un mot, à des ouvrages ou opuscules purement théoriques. Des jurés ne sont point appelés à juger des systèmes: une décision doctrinale ne serait pas moins ridicule, rendue par eux, que par des docteurs de Sorbonne, des conseillers de parlemens, ou des commis de bureau. C'est au public seul qu'il est réservé de rejeter ou d'adopter des opinions particulières. Mais les jurés vérifient et déclarent les faits de sédition, comme ceux de calomnies et d'injures.40
Les crimes ou délits de la presse étant déterminés par une loi précise, il ne reste plus qu'à prendre le moyen d'atteindre immanquablement l'homme qui en devient responsable. Or, cet homme est l'auteur de l'écrit où ils sont commis; et à défaut d'un auteur nommé, connu et domicilié, c'est le libraire ou l'imprimeur. Tout ouvrage devra donc, pour être licitement publié , distribué, mis en vente, porter le nom de l'imprimeur, afin que celui-ci en réponde dans le cas où il n'aurait pas joint à son nom celui d'un libraire-éditeur , ou celui de l'auteur même; et dans le cas encore où il n'aurait indiqué, comme auteur, qu'un personnage fictif, inconnu ou sans domicile. Rien n'empêche même que l'autorité n'exige qu'après l'impression de tout livre ou opuscule, on vienne, non lui demander la permission de le publier, ce qui est par . trop absurde, mais l'avertir qu'on le publie : cette déclaration obligée et la déposition volontaire d'un exemplaire dans la principale bibliothèque publique, auront deux effets : le premier, de constater la propriété littéraire de l'auteur on du libraire ; le second, d'indiquer la personne à poursuivre, si, dans un délai limité, ou vient à découvrir qu'il y ait crime ou délit.
En un mot, poursuite et jugement, s'il y a lieu, des écrits publiés; mais nul examen préalable de ceux qui ne le sont pas encore: répression des actions criminelles, mais liberté illimitée de manifester ses opinions de vive voix, par écrit, et par la presse.
Aux époques si rares où cette liberté avait commencé de s'établir, la ressource de ses ennemis a été de la proclamer en effet illimitée, mais d'abuser de ce mot, en l'étendant jusqu'à l'impunité absolue de la calomnie et de la sédition. Bientôt celles-ci, que n'arrêtait plus aucune barrière, se sont livrées à de si révoltans excès, qu'on a, pour les prévenir, renoué , peu à peu, tous les liens qui avaient enchaîné la presse; avec cette différence néanmoins, que le pouvoir arbitraire a trouvé l'art de conserver, à son profit, la licence , en détruisant la liberté. Tandis qu'il défendait de raisonner sur des intérêts publics, il laissait compiler des dictionnaires de calomnies et d'injures personnelles. C'est qu'il importe quelquefois assez peu au despotisme que la fureur et le délire éclatent, pourvu que la raison se taise. Les désordres lui fournissent des prétextes contre elle; il n'est alarmé que du bien qu'elle voudrait faire :il redoute bien plus l'Esprit des Lois , l'Émile, l’Essai sur les moeurs des nations, que les placards d'un ligueur ou d'un frondeur. Il sait que la liberté de la presse ne serait pas seulement une garantie individuelle, qu'elle acquerrait la force d'une institution publique, et suffirait presque seule au maintien inviolable de toutes les autres garanties.
18.Dunoyer, “The Liberty of Industrious People” (1825)↩
Word length: 8,367]
Source
Charles Dunoyer, L'Industrie et la morale considérées dans leurs rapports avec la liberté (Paris: A. Sautelet et Cie, 1825), Chap. IX Du degré de liberté qui est compatible avec la vie des peuples purement industrieux” pp. 321-68.
CHAPITRE IX. Du degré de liberté qui est compatible avec la vie des peuples purement industrieux.
1. Il n'est pas d'époque, dans l'histoire de la civilisation, où l'industrie n'entre pour quelque chose dans les moyens dont l'homme fait usage pour satisfaire ses besoins. L'anthropophage ne vit pas seulement de meurtre; le nomade, seulement de rapine. Le premier se livre à la chasse, cueille des fruits, se fait une hutte, se vêtit de la peau des bêtes farouches. Le second élève des troupeaux, dresse des tentes, construit des chariots, tisse quelques étoffes grossières. Lorsque l'homme s'est fixé au sol, le travail paisible contribue à sa subsistance dans une proportion encore plus étendue. A mesure qu'il se civilise, le nombre des personnes vivant par des moyens inoffensifs devient graduellement plus considérable. Enfin, quelle que soit encore, dans le genre humain, la masse des hommes qui fondent leur existence sur le brigandage et la spoliation, il est pourtant des pays où la très grande majorité de la population vit par des moyens en général exempts de violences.41
Cependant, quoiqu'il y ait toujours plus ou moins d'industrie dans la société, il s'en faut bien que la société puisse toujours être qualifiée d'industrielle. Il ne suffit pas que quelques hommes, dans un pays, vivent des fruits de leur travail, de leurs capitaux ou de leur terres pour que l'on puisse donner au peuple qui l'habite le nom de peuple industrieux. Il ne suffirait pas même qu'une portion très considérable des habitans y fût livrée à des occupations inoffensives. Tant qu'une partie de la population reste vouée à la domination, tant qu'elle est organisée pour cette manière de vivre, et tant qu'elle est assez puissante pour tenir les classes industrieuses dans la dépendance et l'abaissement, il a beau y avoir de l'industrie dans la société, la société est féodale, despotique, elle est tout ce qu'on voudra: elle n'est pas industrielle.
2. J'appelle, politiquement parlant, peuple industrieux ou industriel, celui chez qui les classes dominatrices ont fini par se fondre dans les classes laborieuses, ou bien chez qui les classes laborieuses ont acquis un ascendant décidé sur les classes dominatrices; celui où ce n'est plus la passion du pouvoir qui règne, mais la passion du travail; où les populations, au lieu de se disputer une certaine masse de richesses existantes, appliquent simultanément leurs forces à créer des richesses nouvelles; où le travail est le seul moyen avoué de s'enrichir, et où le gouvernement lui-même a le caractère d'une entreprise d'industrie, avec la seule différence que cette entreprise, au lieu d'être faite pour le compte de personnes ou d'associations particulières, est faite de l'ordre et pour le compte de la communauté générale, qui l'adjuge à des hommes de son choix et aux prix et conditions qu'elle juge les,plus favorables.42
Les états de l'Union Anglo-Américaine nous offrent un modèle à ce qu'il semble assez exact d'une société qui a fondé son existence sur l'industrie et qui s'est organisée en conséquence. Le principe fondamental de leur institution c'est que « Tout homme qui ne possède pas une propriété/suffisante, doit avoir quelque profession, métier, commerce ou ferme qui le fasse subsister honnêtement. »43 Les Américains n'ont pas voulu que le gouvernement chez eux pût devenir un moyen de fortune. Ils ont évité de créer beaucoup d'emplois. Ils ont eu surtout la précaution de ne pas les rendre assez lucratifs pour que la foule les recherchât comme le meilleur moyen de se faire une existence; et un autre principe de leurs constitutions, c'est qu'aussitôt que les émolumens d'une charge sont assez élevés pour exciter la cupidité de plusieurs personnes, la législature doit se hâter d'en diminuer les honoraires.44
« Il y a peu d'emplois civils en Amérique, dit Franklin, et il n'y en a pas d'inutiles comme en Europe. Une naissance illustre, ajoute-t-il, est une marchandise qui ne pourrait être offerte sur un plus mauvais marché. Les habitans ne demandent pas d'un étranger qui il est, mais ce qu'il sait faire. S'il a quelque talent utile, il est accueilli; s'il exerce son talent avec succès et se conduit en homme de bien, tout le monde le respecte; mais s'il n'est qu'homme de qualité, et qu'à ce titre il prétende avoir un emploi et se mettre à la charge du public, on le rebute et on le méprise. Le laboureur et l'artisan, poursuit Franklin, sont honorés en Amérique, parce que leur travail est utile. Les habitans y disent que Dieu lui-même est un artisan, et le premier de l'univers, et qu'il est plus admiré, plus respecté à cause de la variété, de la perfection, de l'utilité de ses ouvrages qu'à cause de l'ancienneté de sa famille. Les Américains aiment beaucoup à citer l'observation d'un nègre, qui disait: Boccarora ( l'homme blanc ) fait travailler l'homme noir, le cheval, le bœuf, tout, excepté le cochon: le cochon mange, boit, se promène, dort quand il veut, et vit comme un gentilhomme. »45
Si l'on doit juger de la nation américaine par ces observations de Franklin, il est difficile de ne pas reconnaître en elle le caractère d'un peuple dont l'existence est essentiellement fondée sur l'industrie. Chez elle, tout esprit de domination est honni. Tout homme qui n'a point de propriété ne peut vivre que de son travail. Le travail est la seule ressource de quiconque vent créer, entretenir, réparer, accroître sa fortune. Le gouvernement lui-même, dépouillé de tout ce qui pourrait lui donner le caractère de la souveraineté, du domaine, n'est qu'un travail fait pour la société, par des gens délégués par elle, à un prix qu'elle-même détermine et qu'elle a soin de fixer assez bas pour que la cupidité n'attire pas 'trop de monde dans la carrière des places et ne finisse pas par faire dégénérer le gouvernement en domination. Tel est le caractère de la société en Amérique.46 Tel est celui de l'état social que j'appelle industriel. Reste à examiner de quelle liberté, dans cet état, l'homme est susceptible.
3. Si la liberté me paraît incompatible avec la domination, il ne manque pas d'écrivains qui l'ont déclarée inconciliable avec le travail. Dans les premiers âges de la société, on reprochait à l'industrie de détruire la liberté en amortissant les passions guerrières et en portant les hommes à la paix.47 Dans des temps plus avancés on lui a reproché de détruire la liberté en poussant les hommes à la guerre. Nombre d'écrivains modernes ont représenté l'état d'un peuple industrieux comme un état nécessaire d'hostilité. Le malheur d'un état commerçant, a-t-on écrit sententieusement, est d'être condamné à faire la guerre.48 Montaigne consacre un chapitre de ses Essais à prouver que, dans la société industrielle, ce qui fait le prouffit de l'un fait le dommaige de l'aultre (sic).49 Rousseau ne croit pas que, dans la société, il puisse exister d'intérêt commun. Comme Montaigne, il pense que chacun trouve son compte dans le malheur d'autrui, et dit qu'il n'est pas de profit légitime, si considérable qu'il puisse être, qui ne soit surpassé par les gains qu'on peut faire illégitimement.50 Tous les jours enfin, on entend encore soutenir que « les diverses professions industrielles ont des intérêts nécessairement opposés, et qu'il n'est pas d'habileté qui pût réunir dans un même faisceau les classes nombreuses qui les exercent. »51 Ce n'est pas tout, tandis qu'on reproche à l'industrie d'être un principe de discorde, on lui reproche encore d'être une source de dépravation; tandis qu'on l'accuse de troubler la paix, on l'accuse aussi de corrompre les mœurs.52 Enfin, comme elle n'obtient de très grands succès que par une extrême division des travaux, on lui a fait encore le reproche de resserrer l'activité des individus dans des cercles extrêmement étroits, et de borner ainsi le développement de leur intelligence:53 c'est-à-dire, qu'on l'accuse tout à la fois d'arrêter l'essor de nos facultés et d'en pervertir l'usage, tant à l'égard de nous-mêmes que dans nos rapports avec nos semblables; d'où il suivrait qu'un état social, où l'on fonde son existence sur l'industrie, est, de toute manière, défavorable à la liberté.
Je crois peu nécessaire de faire à chacune de ces objections une réponse directe. Elles seront toutes assez réfutées par la simple exposition des faits. Occupons-nous seulement de savoir comment les choses se passent, et voyons quels sont, relativement à la liberté, les effets de l'industrie.
4. Trois conditions, avons-nous dit, sont nécessaires pour que l'homme dispose librement de ses forces: la première, qu'il les ait développées; la seconde, qu'il ait appris à s'en servir de manière à ne pas se nuire; la troisième, qu'il ait contracté l'habitude d'en renfermer l'usage dans les bornes de ce qui ne nuit point à autrui.
Sans doute ces conditions ne sont pas remplies par cela seul qu'on veut donner à ses facultés une direction inoffensive. Un homme n'a pas développé ses facultés et appris à en régler l'usage parce qu'il a conçu le dessein de n'en faire désormais qu'un utile et légitime emploi. Il est très possible que d'abord il soit inhabile à s'en servir; il peut très bien ignorer aussi dans quelle mesure il en faut user pour ne faire de mal ni à soi, ni aux autres hommes. Mais si l'homme n'est pas libre par cela seul qu'il veut détourner sur les choses l'activité qu'il dirigeait auparavant contre ses semblables, il est certain qu'il peut devenir libre dans cette direction, et que ce n'est même que dans cette direction qu'il peut acquérir le degré de puissance, de moralité et de liberté dont il est naturellement susceptible.54
5. Et d'abord il est évident que c'est dans les voies de l'industrie que les facultés humaines peuvent prendre le plus de développement. Le cercle des arts destructeurs est borné de sa nature: celui des travaux inoffensifs et des arts utiles est en quelque sorte illimité. Il faut à la domination quelques hommes habiles et une multitude d'instrumens: l'industrie n'a nul besoin d'hommes aveugles; l'instruction n'est incompatible avec aucun de ses travaux; tous ses travaux, au contraire, s'exécutent d'autant mieux que les hommes qui s'y livrent ont plus d'intelligence et de lumières. Le dominateur et ses satellites vivent sur un peuple de victimes qu'ils tiennent dans la misère et l'abrutissement: l'industrie ne veut point de victimes; elle est d'autant plus florissante que tous les hommes sont en général plus riches et plus éclairés. Le dominateur enfin se nourrit de pillage, et si tous les hommes voulaient se soutenir par le même moyen, l'espèce, visiblement, serait condamnée à périr: l'industrie est essentiellement productive; elle vit de ses propres fruits, et loin dé craindre que les hommes industrieux se multiplient trop, elle voudrait voir tout le genre humain livré à des travaux utiles, et serait assurée de prospérer d'autant plus qu'il y aurait plus d'hommes utilement occupés.
L'homme, dans la vie industrielle, dirige ses forces précisément comme il convient le mieux à ses progrès. Ce genre de vie est le seul, je supplie le lecteur de le bien remarquer, où il étudie convenablement les sciences, et où les sciences servent véritablement à le rendre puissant. Dans les pays et dans les temps de domination, l'étude n'est guère qu'une contemplation oiseuse, un amusement, un frivole exercice, destiné uniquement à satisfaire la curiosité ou la vanité.55 On apporte aux recherches l'esprit le moins propre à acquérir de véritables connaissances. De plus on ne songe point à faire de ses connaissances d'utiles applications. On tient que la science déroge sitôt qu'elle est bonne à quelque chose. Le savant croirait la dégrader et se dégrader lui-même en la faisant servir à éclairer les procédés de l'art. 56 L'artiste, de son côté, se soucie peu des théories scientifiques. Il rend à la science tout le mépris dont le savant fait profession pour l'industrie; et tandis que l'industrie est exclue, comme roturière, du sein des compagnies savantes, la science est écartée des ateliers de l'industrie, comme futile, vaine et bonne tout au plus pour les livres.
Il n'en va pas ainsi dans les pays livrés à l'industrie et organisés pour cette manière de vivre. On ne voit pas là ce fâcheux divorce entre la science et l'art. L'art n'y est pas une routine; la science une vaine spéculation. Le savant travaille pour être utile à l'artiste; l'artiste met à profit les découvertes du savant. L'instruction scientifique se trouve unie généralement aux connaissances manufacturières. L'étude n'est pas un simple passe-temps, destiné à charmer les loisirs d'un peuple de dominateurs, régnant en paix sur un peuple de dociles esclaves; c'est le travail sérieux d'hommes vivant tous également des conquêtes qu'ils font sur la nature, et cherchant avec ardeur à connaître ses lois, pour les plier au service de l'humanité. On sent qu'une activité ainsi dirigée, des études ainsi faites, soutenues d'ailleurs par tout ce que peuvent leur donner de constance et d'énergie le désir de la fortune, l'amour de la gloire et l'universelle émulation, doivent imprimer aux travaux scientifiques une impulsion bien autrement sûre et puissante que les spéculations sans objet de dominateurs et d'oisifs, livrés à la vie contemplative. L'homme est ici évidemment sur le chemin de toutes les découvertes, de toutes les applications, de tous les travaux utiles.
Sans doute, le régime industriel ne peut pas faire que tout homme soit instruit de toutes choses: une condition essentielle du développement de l'industrie, c'est que ses travaux se partagent, et que chacun ne s'occupe que d'un seul ou d'un petit nombre d'objets. Mais ceci est la faute de notre faiblesse, et non point celle de l'industrie, ni celle de la séparation des travaux, qui n'est qu'une manière plus habile de mettre en œuvre nos facultés industrielles. L'effet de cette séparation, si propre à augmenter la puissance de l'espèce, n'est point, comme on l'a dit, de diminuer la capacité des individus. Sans la séparation des travaux, la puissance de l'espèce aurait été nulle, et celle des individus serait restée excessivement bornée. Chaque homme, par suite de cette séparation, est incomparablement plus instruit et plus capable qu'il ne l'eût été, si, dès l'origine, chacun avait travaillé dans l'isolement et s'était réduit à l'usage de ses seules forces individuelles. Chacun, il est vrai, n'exerce qu'un petit nombre de fonctions; mais si l'on ne sait bien qu'une chose, on a communément des idées justes d'un assez grand nombre. D'ailleurs, en n'exerçant qu'une seule industrie, on peut en mettre en mouvement une multitude d'autres: il suffit de créer un seul produit pour obtenir tous ceux dont on a besoin; et, par l'artifice de la séparation des travaux, la puissance de chaque individu se trouve en quelque sorte accrue de celle de l'espèce.
Veut-on juger si la vie industrielle est favorable au développement de nos forces? On n'a qu'à regarder ce que le monde acquiert d'intelligence, de richesse, de puissance, à mesure qu'il est plus utilement occupé; on n'a qu'à comparer les progrès qu'il fait dans les pays où l'on pille et dans ceux où l'on travaille; aux époques de domination et dans les temps d'industrie. L'Ecosse, au milieu du dernier siècle, était encore à demi barbare: comment, en moins de quatre-vingts ans, est-elle devenue un des pays de l'Europe les plus savans, les plus ingénieux, les plus cultivés? Un mot explique ce phénomène: depuis 1745, le pillage, le meurtre et les luttes d'ambition y ont cessé; on s'y battait, on y travaille; des partis contraires s'y disputaient le pouvoir, ils s'y livrent de concert à l'industrie. D'où vient que l'Amérique septentrionale fait des progrès si singuliers, si hors de proportion avec ce qu'on voit dans d'autres quartiers du globe? c'est qu'on n'y lève pas des milliards d'impôts; c'est qu'on n'y est pas occupé à garotter les populations pour les dévaliser plus à l'aise; c'est, qu'on ne s'y bat pas pour leurs dépouilles; c'est qu'au lieu de s'y disputer les places, on s'y livre universellement au travail. Supposez que, par un miracle que le temps opérera, j'espère, la même chose arrive en Europe; que les partis contraires, au lieu de rester face à face, et d'être toujours prêts à en venir aux mains, se décident enfin à tourner sur les choses l'activité meurtrière qu'ils dirigent les uns contre les autres; qu'ils convertissent leurs instrumens de guerre en outils propres au travail; que les classes laborieuses se voient ainsi délivrées des gênes et des vexations qu'elles éprouvent; qu'elles conservent les millions qu'on leur prend; que leurs ennemis deviennent leurs auxiliaires; que l'universalité des hommes enfin mettent au travail le génie ardent, l'application soutenue qu'on les a vus déployer à se nuire; supposez, dis-je, un tel miracle accompli, et vous verrez bientôt si la vie industrielle est favorable au développement des facultés humaines.
6. Non-seulement l'industrie est la voie où l'humanité peut donner le plus de développement et d'extension à ses forces, mais elle est encore celle où elle en use avec le plus de rectitude et de moralité. L'homme s'instruit naturellement dans le travail à faire un bon emploi de ses facultés relativement à lui-même. Comme il ne travaille que pour satisfaire ses besoins, il ne s'interdit aucune honnête jouissance; mais comme il ne se porte au travail que par un effort vertueux, comme il n'accroît sa fortune qu'avec beaucoup de peine, il est tout naturellement disposé à jouir avec modération des biens que lui donne l'industrie.
Il va sans dire que je parle ici du véritable industrieux et non de l'homme qui joue; de la fortune lentement amassée, comme l'est presque toujours la fortune acquise par le travail, et non de celle que peut donner, tout d'un coup, l'intrigue ou l'agiotage. Il en est de la richesse comme de toutes les forces: pour en user raisonnablement, il faut en avoir usé quelque temps; c'est un apprentissage à faire, et cet apprentissage ne se fait bien que lorsqu'on s'enrichit par degrés. Tout homme dont la fortune est très rapide, commence par faire des folies; c'est le malheur ordinaire des parvenus. Nous en voyons, Dieu merci, assez d'exemples; je sais le nom de tel traitant qui a perdu quatre cent mille francs dans une séance d'écarté: il avait besoin de cela, disait-il, pour se donner de l'émotion et se faire circuler le sang. On a vu, dans de certains salons, des joueurs à la hausse démontrer mathématiquement qu'il n'était pas possible de vivre avec soixante mille francs de rente; et telle est l'extravagance des dépenses que font les parvenus de la trésorerie et de la bourse que, pour peu que les riches d'ancienne date, cèdent au désir de l'imitation, soixante mille francs de rente seront bientôt en effet une fortune médiocre. Mais les hommes qui poussent ainsi au faste, ceux qui donnent le plus aux autres l'exemple de l'ostentation, ce sont les riches improvisés dans les tripots et les anti-chambres, et non pas les industrieux qu'un long et honnête travail a enrichis.
L'industrie, que de certains moralistes affectent de nous représenter comme une source de vices, l'industrie véritable est la mère nourricière des bonnes mœurs. Il est bien possible que les peuples industrieux soient moins rigides que certains peuples dominateurs; ils n'ont sûrement pas l'austérité des Spartiates et des Romains des premiers temps de la république; mais s'ils ne donnent pas dans le rigorisme qu'ont si souvent étalé des associations guerrières ou monacales, ils ne sont pas sujets non plus à tomber dans les mêmes dérèglemens; s'ils ne se privent de rien, ils ont pour principe de n'abuser de rien; et se tenant également loin de l'abstinence et de la débauche, de la parcimonie et de la prodigalité, ils se forment à la pratique de deux vertus privées éminemment utiles, à la tempérance et à l'économie, qui ne sont que l'usage bien réglé de nos facultés par rapport à nous-mêmes, ou l'habitude d'user de tout en ne faisant excès de rien.57
7. Enfin tandis que l'industrie nous fait contracter des habitudes privées si favorables à la conservation de nos forces, elle bannit toute violence de nos rapports mutuels.
On a cru jusqu'ici qu'il était possible de faire régner la paix entre les hommes par une certaine organisation politique, quels que fussent d'ailleurs la manière de vivre et le régime économique de la société. Les philosophes grecs commençaient toujours par poser l'esclavage en principe, et puis ils cherchaient par quel arrangement politique on pourrait assurer l'ordre public.58 Certains politiques de nos jours posent d'abord en fait que toutes les classes d'hommes ont des intérêts nécessairement opposés; que, par la nature même des choses, il n'en est pas une qui ne fonde sa prospérité sur des priviléges ou des monopoles contraires à la prospérité des autres, et ensuite ils prétendent par leur art faire vivre en paix toutes ces classes ennemies.59 D'autres nient la nécessité de cette opposition entre les intérêts des diverses classes, et soutiennent que tout le monde pourrait vivre sans le secours de la violence et de l'iniquité; toutefois, ils ne disconviennent pas qu'il n'y ait dans la société beaucoup de prétentions injustes, beaucoup de gens qui veulent aller à la fortune par de mauvais moyens; mais ils pensent qu'une habile organisation du pouvoir pourrait neutraliser tous ces vices et faire aller les choses comme s'ils n'existaient pas.60
On s'est autrefois beaucoup moqué des alchimistes: ne se pourrait-on pas moquer un peu des politiques qui prétendent établir la paix par des formes de gouvernement? les alchimistes se proposaient-ils un problème plus insoluble que ces politiques? est-il plus difficile de produire de l'or avec d'autres métaux que de parvenir, par je ne sais quelles combinaisons, à faire sortir la paix de l'esclavage, du privilége ou de toute autre manière inique de s'enrichir?
Montesquieu, qui raille si amèrement, dans ses Lettres persanes, les gens qui se ruinaient à la recherche de la pierre philosophale, me semble avoir donné dans un travers pour le moins aussi énorme quand il a prétendu faire de la liberté avec des divisions et des balances de pouvoir.61 Si les Anglais, à ses yeux, sont un peuple libre, ce n'est pas à cause de leur régime économique, et parce qu'on vit en général chez eux par des moyens exempts de violence. Il ne tient pas compte de ces causes; il ne cherche pas même si elles existent; la vraie raison pour lui de la liberté des Anglais, c'est que la puissance législative est séparée chez eux de l'exécutrice, l'exécutrice de la judiciaire; c'est que la puissance publique est divisée en trois branches qui se font mutuellement obstacle, de telle sorte qu'aucune ne peut opprimer. « Voici, dit-il, la constitution fondamentale du gouvernement anglais. Le corps législatif étant composé de deux parties, l'une enchaînera l'autre par sa faculté mutuelle d'empêcher. Toutes les deux seront liées par la puissance exécutrice, qui le sera elle-même par la législative. Ces trois puissances devraient former un repos ou une inaction; mais comme, par le mouvement nécessaire des choses, elles seront contraintes d'aller, elles seront forcées d'aller de concert. »62
Voilà, suivant Montesquieu, par quels artifices on a obtenu la liberté eu Angleterre. Je doute que Raymond Lulle et Nicolas Flamel aient jamais écrit sur l'art de transmuer les métaux quelque chose de moins raisonnable.
A l'exemple de Montesquieu, la plupart des publicistes de notre âge ont pensé que ce n'était que par une bonne distribution des pouvoirs publics qu'on empêchait les hommes de se faire mutuellement violence. L'oppression est-elle excessive en Turquie? c'est que tous les pouvoirs y sont confondus; le pouvoir est-il modéré dans la plupart des monarchies de l'Europe? c'est qu'il est partout plus ou moins divisé; pourquoi la liberté ne sortit-elle pas de la constitution de 1791? c'est que les pouvoirs y étaient mal répartis; pourquoi la convention fut-elle terroriste?c'est qu'elle réunissait tous les pouvoirs; pourquoi le directoire fit-il le 18 fructidor? c'est que, dans la constitution de l'an 3, les pouvoirs étaient trop séparés. Finalement il n'est pas un désordre public, pas une violence politique dont on ne soit toujours prêt à montrer la cause dans quelque vice organique des pouvoirs établis.
Sûrement l'organisation de ces pouvoirs est d'une grande importance; mais sûrement aussi elle n'est pas la première chose à considérer. La première chose à considérer c'est la manière dont la société pourvoit généralement à sa subsistance. Tel pourrait être, en effet, le régime économique de la société que l'organisation politique la plus savante ne parviendrait pas à y faire régner la paix. Dites, comme les philosophes grecs, qu'il faut se faire nourrir par des esclaves; dites, comme nos écrivains monarchiques, que toutes les classes de la société veulent avoir des priviléges et que chaque classe doit avoir les siens; supposez les hommes livrés à l'esprit de domination, de rapine, d'exaction, de monopole, et je défie qu'aucune habileté politique parvienne jamais à établir une paix réelle et durable parmi eux.
Il faut donc, avant tout, pour avoir la paix, convenir d'un mode d'existence avec lequel elle soit compatible. Or je dis qu'elle n'est compatible qu'avec l'industrie. Non-seulement la vie industrielle est la seule où les hommes puissent donner un grand développement à leurs facultés, une véritable perfection à leurs habitudes personnelles, elle est aussi la seule qui comporte de bonnes habitudes sociales, la seule dans laquelle il soit possible de vivre en paix.
Il y a cela, dans les pays où l'industrie est la commune ressource des hommes, qu'ils peuvent tous satisfaire leurs besoins sans se causer mutuellement aucun dommage, sans attenter réciproquement à leur liberté. Par cela même que chacun porte son activité sur les choses, il est visible que nul homme n'est opprimé. On a beau se livrer chacun de son côté à l'étude des sciences, à la pratique des arts, nul ne fait ainsi violence à personne; on peut de toutes parts entrer dans ces voies et s'y donner carrière sans crainte de se heurter; on ne s'y rencontre point, on ne s'y fait pas obstacle, même alors qu'on s'y fait concurrence. Celui qui exerce une autre industrie que moi ne me trouble point; au contraire, son travail encourage le mien; car il m'offre la perspective d'un moyen d'échange, et la possibilité de satisfaire deux ordres de besoins, en ne créant qu'une seule sorte de produits. Celui qui se livre au même travail que moi ne me trouble pas davantage; sa concurrence, loin de m'empêcher d'agir, me stimule à mieux faire; et si j'ai moins de succès que lui, je peux m'affliger de mon incapacité, mais non me plaindre de son injustice. Il n'y a donc dans la carrière des arts producteurs que des rivalités innocentes; il n'y a point d'oppresseur, point d'opprimé, et il n'est pas vrai de dire que l'on s'y trouve naturellement en état de guerre.
Toute domination disparaît des lieux où l'homme cherche uniquement dans le travail les moyens de pourvoir à sa subsistance; les rapports de maître et d'esclave sont détruits; les inégalités artificielles s'évanouissent; il ne reste entre les individus d'autre inégalité que celle qui résulte de leur nature. Un homme peut être plus heureux qu'un autre, parce qu'il peut être plus actif, plus habile, plus éclairé; mais nul ne prospère au détriment de son semblable; nul n'obtient rien que par l'échange ou la production; le bonheur de chacun s'étend aussi loin que peut le porter l'exercice inoffensif de ses forces, celui de personne ne va au-delà.
S'il n'existait aucun moyen de prospérer sans nuire, il n'y aurait, dans ce monde, ni ordre, ni paix, ni liberté praticables. Mais la proposition que tout homme vit aux dépens d'un autre, vraie dans la domination, est fausse et absurde dans l'industrie. Il est très vrai qu'en pays de tyrans et de voleurs, on ne prospère qu'eu se dépouillant les uns les autres, si tant est que l'on puisse prospérer dans de tels pays. Mais il n'en est sûrement pas de même en pays de gens qui travaillent; tout le monde ici peut prospérer à la fois. Deux laboureurs qui améliorent simultanément leur terre, deux fabricans, deux négocians, deux savans, deux artistes qui se livrent avec intelligence, chacun de leur côté, à l'exercice de leur profession, peuvent sans contredit prospérer ensemble. Ce que je dis de deux personnes on peut le dire de dix, de cent, de mille; de tous les individus d'une cité, d'une province, d'un royaume, du monde entier. Tous les peuples de la terre peuvent prospérer à la fois, et l'expérience l'atteste; car le genre humain, considéré en masse, est certainement plus riche aujourd'hui qu'il ne l'était il y a trois cents ans, et à plus forte raison qu'il ne l'était à six siècles, à douze siècles en arrière.
Il est donc vrai que, dans l'industrie, tous les hommes peuvent satisfaire leurs besoins sans se faire mutuellement violence. S'il arrive que les hommes d'une même profession, ou de professions diverses, se regardent comme ennemis, que des peuples industrieux et commerçans se font la guerre, ce n'est pas, comme dit Montaigne, parce que le proufit de l'un est le dommaige de l'aultre (sic); mais parce qu'ils ont le malheur de ne pas comprendre l'accord véritable que la nature a mis entre leurs intérêts; ce n'est pas, comme dit Rousseau, parce que leurs intérêts sont opposés, mais parce qu'ils ne voient pas qu'ils sont conformes; ce n'est pas, comme dit M. de Bonald, parce que le commerce est un état d'hostilité, mais parce qu'ils n'ont pas le véritable esprit du commerce. Voilà des vérités que le temps éclaircit tous les jours, et que ne contesteront bientôt plus ceux-là mêmes qui se croient le plus intéressés à les méconnaître.63
Ce que je dis du caractère inoffensif de l'industrie est également vrai sous quelque aspect qu'on la considère. Que les hommes, dans ce mode d'existence, agissent ensemble ou isolément, l'effet est toujours le même, et l'action collective des associations n'y est pas plus hostile que ne le sont les efforts isolés des individus.
Quelle que soit la direction générale que les hommes donnent à leurs forces, ils ne peuvent en tirer un grand parti qu'en s'associant, et en établissant entre eux une certaine subordination. Ils ont besoin de s'unir, de s'échelonner, de se subordonner pour la défense comme pour l'attaque, et pour agir sur la nature comme pour exercer l'oppression. Il y a donc, dans l'industrie comme dans la guerre, ligue, association, union d'efforts.
« Aux quatorzième et quinzième siècles, dit un auteur, tout homme qui se sentait quelque force de corps et d'ame, avide de la déployer, se livrait, sous le moindre prétexte, au plaisir de guerroyer avec un petit nombre de compagnons, tantôt pour son propre compte, tantôt pour celui d'un autre. La milice était un pur trafic; les gens de guerre se louaient de côté et d'autre, selon leur caprice et leur avantage, et traitaient pour leur service comme des ouvriers pour leur travail. Ils s'engageaient, par bandes détachées et avec divers grades, au premier chef de leur goût, à celui qui par sa bravoure, son expérience, son habileté avait su leur inspirer de la confiance; et celui-ci, de son côté, se louait avec eux à un prince, à une ville, à quiconque avait besoin de lui. »64 Voilà comme on s'associe dans le brigandage.
Il se fait dans la vie industrielle des arrangemens fort, analogues. Tout homme qui se sent quelque activité, quelque intelligence, quelque capacité pour le travail, se livre avec un certain nombre de compagnons non au plaisir honteux de piller, mais au noble plaisir de créer quelque chose d'utile. On s'engage dans une entreprise d'agriculture, de fabrique, de transport, comme on s'engageait autrefois dans une entreprise de guerre. Le fermier, l'armateur, le manufacturier ont à leur solde, comme les anciens chefs de milice, un nombre d'hommes plus ou moins grand. On voit quelquefois des chefs de manufacture soudoyer jusqu'à dix mille manœuvres. Il s'établit entre les ouvriers, les chefs d'atelier, les entrepreneurs, la même subordination qu'à la guerre, entre le chef supérieur, les officiers en sous-ordre et les soldats. Finalement on voit se former dans le régime industriel des associations encore plus nombreuses et plus variées qu'au sein de la guerre et du brigandage. Seulement l'objet de ces associations est tout autre, et les résultats, par suite, sont fort différens.
Le lecteur sait pourquoi l'on s'associe dans toute domination; prenons pour exemple le régime des priviléges: il n'y a là, comme on l'a vu, aucune agrégation qui ne se propose quelque objet inique: ces marchands sont unis pour empêcher que d'autres ne fassent le même commerce qu'eux; ces nobles, pour écarter la roture du service public, et tirer du peuple, sous forme d'impôt, ce qu'ils ne reçoivent plus à titre de redevance féodale; tous les membres de ce gouvernement, pour étendre au loin leur empire, et mettre plus de peuples à contribution; ces populations en masse, pour ouvrir à main armée des débouchés à leur commerce, et agrandir l'espace d'où elles pourront exclure la concurrence des étrangers: il s'agit pour tous de priviléges à obtenir, d'exactions à exercer, de violences à faire.
Il n'en est pas ainsi dans l'industrie: on y est également associé, mais c'est pour agir sur les choses et non pour dépouiller les hommes; c'est encore pour se défendre, ce n'est plus du tout pour opprimer. Il n'y a pas une association dont l'objet soit hostile. On est uni pour la propagation d'une doctrine, pour l'extension d'une méthode, pour l'ouverture d'un canal, pour la construction d'une route, on est ligué contre les fléaux de la nature, contre les risques de mer, contre les dangers de l'incendie ou les ravages de la grêle; mais il n'y a visiblement rien d'oppressif dans tout cela. Il ne s'agit pas ici, comme dans les anciennes corporations, d'accaparer, de prohiber, d'empêcher les autres de faire: loin que des coalitions ainsi dirigées limitent les facultés de personne, elles ajoutent à la puissance de tout le monde, et il n'est pas un individu qui ne soit plus fort par le fait de leur existence qu'il ne le serait si elles n'existaient pas. Aussi, tandis que les corporations du régime des priviléges étaient une cause toujours agissante d'irritation, de jalousie, de haine, de discorde, les associations du régime industriel sont-elles un principe d'union autant que de prospérité.65
Ce que je dis des petites associations, je dois le dire également des grandes, et de celles qui se forment pour le gouvernement, comme de celles qui se forment pour quelque objet particulier de science, de morale, de commerce. L'association chargée du service public n'a pas dans le régime industriel un caractère plus agressif que les autres. Le pouvoir n'y est pas un patrimoine; ceux qui le possèdent ne le tiennent pas de leur épée; ils ne règnent pas à titre de maîtres; ils n'exercent pas une domination; l'impôt n'est pas un tribut qu'on leur paie. Loin que la communauté leur appartienne, ils appartiennent à la communauté; ils dépendent d'elle par le pouvoir qu'ils exercent; c'est d'elle qu'ils ont reçu ce pouvoir. Le gouvernement, dans l'industrie, n'est en réalité qu'une compagnie commerciale, commanditée par la communauté et préposée par elle à la garde de l'ordre public.
La communauté, en le créant, ne se donne pas à lui; elle ne lui donne pas d'autorité sur elle; elle ne lui confère pas sur les personnes et les propriétés un pouvoir qu'elle-même n'a point: elle ne lui donne de pouvoir que contre les volontés malfaisantes, manifestées par des actes offensifs; elle ne lui permet d'agir contre les malfaiteurs qu'à raison de ces volontés et de ces actes. Du reste, chaque homme est maître absolu de sa personne, de sa chose, de ses actions, et le magistrat n'a le droit de se mêler en rien de la vie d'un citoyen tant qu'il ne trouble par aucun acte injuste l'existence d'aucun autre. Comme le pouvoir n'est pas institué en vue d'ouvrir une carrière aux ambitieux, et seulement pour créer une industrie à ceux qui n'en ont aucune, la société ne lui permet pas de s'étendre sans motifs, et d'agrandir la sphère de son action pour pouvoir multiplier le nombre de ses créatures; elle veille attentivement à ce qu'il se renferme dans son objet. D'une autre part, elle ne lui donne en hommes et en argent que les secours dont il a besoin pour remplir convenablement sa tâche. Elle regrette même d'avoir à faire un tel emploi de ses capitaux et de son activité; non que cette dépense, tant qu'il y a d'injustes prétentions à réduire, des ambitions à contenir ou des méfaits à réprimer, ne lui paraisse très utile et même très productive; mais parce qu'il vaudrait encore mieux pour elle qu'elle ne fût pas nécessaire, et qu'elle pût employer à agir sur les choses le temps et les ressources qu'elle consume à se défendre contre certains hommes. Aussi, à mesure que tous ses membres apprennent à faire un usage plus inoffensif de leurs forces, diminue-t-elle par degrés celles de son gouvernement, et ne lui laisset-elle jamais que celles dont il a besoin pour la préserver de tout trouble.
Enfin ce que je dis de l'action du gouvernement sur la société, je peux le dire également de l'action des sociétés les unes à l'égard des autres. Ces vastes agrégations n'ont pas un caractère plus hostile que toutes les associations particulières dont elles sont formées. Il serait difficile, quand les individus tournent généralement leur activité vers le travail, que les nations voulussent prospérer encore par le brigandage. Il ne s'agit pas pour elles dans le régime industriel de conquérir des trônes à leurs ambitieux, des places à leurs intrigans, des débouchés exclusifs à leur commerce. Le temps que d'autres peuples mettent à guerroyer, elles l'emploient à développer toutes leurs ressources et à se mettre en communication avec quiconque a d'utiles échanges à leur proposer. Elles souhaitent la civilisation et la prospérité de leurs voisins comme la leur propre, parce qu'elles savent qu'on ne peut avoir des relations sûres qu'avec les peuples éclairés, ni des relations profitables qu'avec les peuples riches. Elles font des vœux particuliers pour la civilisation de leurs ennemis, parce qu'elles savent encore que le seul vrai moyen de n'avoir plus d'ennemis c'est que les autres peuples se civilisent. Tous leurs efforts contre le dehors se bornent à empêcher le mal qu'on tenterait de leur faire; elles se tiennent strictement sur la défensive; elles déplorent même la triste nécessité où on les réduit de se défendre: non sans doute qu'elles soient peu sensibles à l'injure, ou qu'elles manquent de moyens pour la repousser; mais parce qu'elles savent combien sont encore funestes les guerres les plus légitimes et les plus heureuses, et combien il serait préférable pour elles et pour le monde qu'elles pussent employer à des travaux utiles le temps et les ressources que la barbarie de leurs ennemis les oblige de sacrifier à leur sûreté. Aussi, n'auraient-elles pas, malgré la supériorité de leur puissance, de plus grand désir que de pouvoir poser les armes, abandonner leurs forteresses, relâcher les liens que la nécessité de la défense a formés, laisser agir en liberté l'esprit local et l'indépendance individuelle, et consacrer en paix toutes leurs forces à ouvrir au monde de nouvelles sources de prospérité.66
Les faits rendent de ces vérités un témoignage irrécusable. Il est impossible de ne pas voir que les relations des hommes deviennent partout d'autant plus faciles et plus paisibles qu'ils approchent plus de la vie industrielle et en comprennent mieux les véritables intérêts. Ceci est surtout évident en Amérique. Il n'est besoin aux Etats-Unis, pour obtenir la paix, ni de hiérarchies factices, ni de balances du pouvoir. On ne cherche à l'établir, ni par l'opposition des intérêts contraires, ni par la soumission violente de tous les intérêts à une seule volonté. Il n'est point question de subordonner les classes laborieuses à une aristocratie militaire, cette aristocratie à des rois et les rois à un pape. Il ne s'agit pas davantage de mettre en présence la démocratie, l'aristocratie et la royauté, et de faire que ces trois forces rivales se tiennent mutuellement en respect. L'Amérique laisse à l'Europe toutes ces merveilleuses inventions de sa politique; elle tend à la paix par d'autres moyens. La paix résulte surtout de son régime économique. Il suffit en quelque sorte pour qu'elle règne que l'universalité de ses citoyens ne cherche la fortune que dans le travail et de libres échanges. Par le seul effet de cette tendance, des millions d'individus, au milieu de l'infinie diversité de leurs mouvemens, agissent sans se heurter et prospèrent sans se nuire. Ils forment les associations les plus variées; mais tel est l'objet de ces associations et la manière dont elles sont dirigées, qu'elles ne font de violence à personne et ne sauraient exciter de réclamations. Les classes ouvrières sont subordonnées aux entrepreneurs qui leur fournissent du travail, les chefs d'entreprise aux ingénieurs qui leur donnent des conseils, les ingénieurs aux capitalistes qui leur procurent des fonds: chacun se trouve placé par ses besoins dans la dépendance des hommes dont il réclame l'aide ou l'appui; mais cette subordination est toute naturelle, et n'a pas besoin pour s'établir du secours du bourreau, cet auxiliaire obligé des subordinations contre nature. Les citoyens, soumis à l'ordre public, ne sont d'ailleurs sujets de personne. Le gouvernement, chargé de réprimer les injustices des individus, peut à son tour être contenu par la société; il est comptable envers elle; et comme la vie toute laborieuse des citoyens laisse peu à faire pour le maintien de l'ordre, on ne lui donne pas assez de force pour qu'il pût s'affranchir de cette responsabilité, quand même il pourrait concevoir la pensée de s'y soustraire. Enfin, la société anglo-américaine dans son ensemble n'affecte pas plus de dominer les autres peuples que ses gouvernemens ne prétendent dominer les citoyens; on ne la voit occupée ni à envahir des territoires, ni à fonder au loin des colonies dépendantes, ni à s'ouvrir par la violence des marchés exclusifs. L'union des états, leur subordination à un centre commun, leurs milices, leur armée, leur marine militaire ont pour unique objet la sûreté du pays. Et quoique, dans ce déploiement de forces purement défensives, l'Amérique reste fort en arrière de ce qu'elle pourrait, elle va encore fort au-delà de ce qu'elle voudrait. Son désir le plus ardent serait de pouvoir être tout entière à ses affaires, à ses travaux, au soin de sa culture intellectuelle et de son perfectionnement moral; et lorsqu'un jour l'activité industrielle, devenue prédominante en Europe, y aura détruit enfin les ligues de l'ambition, elle sera heureuse sans doute de rompre celles que nous la contraignons de former pour sa défense, et de pouvoir offrir au monde le spectacle de populations innombrables, livrées sans partage aux arts de la paix.67
8. Autant donc la vie industrielle est propre, d'une part, à développer nos connaissances, et, d'un autre côté, à perfectionner nos mœurs, autant, en troisième lieu, elle est opposée à la violence, aux prétentions anti-sociales et à tout ce qui peut troubler la paix. On voit, en somme, que ce mode d'existence est celui où les hommes usent de leurs forces avec le plus de variété et d'étendue; où ils s'en servent le mieux à l'égard d'eux-mêmes; où, dans leurs relations privées, publiques, nationales, ils se font réciproquement le moins de mal. Concluons qu'elle est celle où ils peuvent devenir le plus libres, ou plutôt qu'elle est la seule où ils puissent acquérir une véritable liberté.
Long Footnote 1.
En un mot je ne nie pas qu'on ne puisse former beaucoup de prétentions injustes; mais je nie que par la nature des choses les intérêts des hommes soient opposés. Je ne nie pas non plus qu'ils ne soient opposés là où la violence a agi et troublé le cours naturel des choses; mais je dis que sans ce trouble ils ne l'eussent pas été. Par exemple, dans l'état actuel des choses, il y a en France et en Angleterre des filateurs de coton dont les intérêts sont opposés, cela n'est pas douteux. Nos filateurs, moins habiles que ceux d'Angleterre, ne pourraient se soutenir sans le secours de la violence: il faut qu'ils empêchent les filateurs anglais de nous vendre leurs produits, sans quoi force leur serait de fermer leurs manufactures. Mais qu'est-ce qui a créé ces deux classes d'intérêts ennemis? C'est précisément l'injuste faveur qu'on a faite au Français qui entreprenait de filer du coton. Sans les primes accordées à sa maladresse, à son inexpérience, à sa paresse, il ne se serait pas engagé dans une carrière où il ne pouvait soutenir la concurrence avec des hommes plus actifs ou plus habiles que lui, ou bien il s'y serait engagé avec les moyens de lutter, sans le secours honteux de l'injustice. Il serait allé en Angleterre, il s'y serait instruit avec soin des procédés de l'art qu'il voulait pratiquer; il y aurait acheté des machines, il en aurait emmené des ouvriers, et il serait ainsi parvenu à importer en France une branche d'industrie capable de s'y maintenir d'elle-même: les filateurs d'Angleterre et de France n'auraient pas maintenant des intérêts opposés.
On croit qu'il n'est possible de naturaliser une industrie étrangère dans un pays où elle n'a pas encore existé qu'en l'entourant dans ce pays, au préjudice des consommateurs indigènes et des fabricans étrangers, d'une multitude de privilèges injustes. C'est au contraire par ces privilèges qu'on parvient à l'empêcher de se naturaliser dans le pays où on veut l'introduire et où dans bien des cas elle se serait établie d'elle-même. Tel est, par exemple, d'après l'avis de l'un de nos savans les plus distingués et de nos manufacturiers les plus habiles, l'avantage de la France dans le prix de la plupart des choses nécessaires à la fabrication de la poterie, et notamment dans le prix de l'argile plastique, du kaoli, du silex calciné, et dans celui de diverses façons et de divers ustensiles, que l'on pourrait aisément en France, malgré l'infériorité d'industrie, fabriquer de la poterie fine aussi bonne que celle d'Angleterre, à meilleur marché qu'en Angleterre même. Cependant notre poterie fine, beaucoup moins bonne que celle d'Angleterre, est plus chère de vingt pour cent. D'où vient cela? Précisément de ce qu'on a prétendu faire pour l'encourager, des prohibitions qu'on lui a accordées au détriment de tout le monde. Nos fabricans, aidés des chimistes et versés dans la technologie, seraient sûrement assez instruits pour faire aussi bien que les fabricans anglais, surtout avec les avantages de position dont j'ai parlé plus haut. Mais il faudrait qu'ils se donnassent de la peine, qu'ils fissent des essais longs, quelquefois infructueux, toujours dispendieux. Or ne concourant qu'entre eux et ayant en France un débit qui leur paraît suffisant, ils n'ont aucun motif puissant de faire des efforts; ils n'ont point à craindre la concurrence étrangère; la prohibition les en affranchit; et le gouvernement, qui voulait servir l'industrie, lui a fait un tort grave en permettant aux fabricans de rester dans l'apathie.
Non-seulement donc c'est la violence qui crée les intérêts opposés, mais c'est elle aussi qui fait les ouvriers mal habiles. Si les choses avaient été laissées à leur cours naturel, si nul n'avait pu prospérer que par son travail, sans aucun mélange d'injustice et de violence, non-seulement les arts seraient plus également développés partout, mais les artisans des divers pays, plus capables de concourir ensemble, auraient des intérêts moins opposés: l'opposition entre les filateurs de France et d'Angleterre, par exemple, ne serait pas plus forte qu'entre ceux de Rouen et de Saint-Quentin.
Long Footnote 2
L'Amérique, dis-je, sera heureuse de relâcher les liens que nous l'avons contrainte de former. Ce n'est guère en effet que pour sa sûreté et à cause de l'esprit dominateur des gouvernemens d'Europe, qu'elle s'est fédérée et qu'elle reste unie. II n'y a point dans l'industrie de motifs à des coalitions aussi vastes; il n'y a point d'entreprise qui réclame l'union de dix, de vingt, de trente millions d'hommes. C'est l'esprit de domination qui a formé ces agrégations monstrueuses ou qui les a rendues nécessaires; c'est l'esprit d'industrie qui les dissoudra: un de ses derniers, de ses plus grands et de ses plus salutaires effets paraît devoir être de municipaliser le monde.
Sous son influence les peuples commenceront par se grouper plus naturellement; on ne verra plus réunis sous une même dénomination vingt peuples étrangers l'un à l'autre, disséminés quelquefois dans les quartiers du globe les plus opposés, et moins séparés encore par les distances que par le langage et les mœurs. Les peuples se rapprocheront, s'aggloméreront d'après leurs analogies réelles et suivant leurs véritables intérêts.
Ensuite, quoique formés, chacun de leur côté, d'élémens plus homogènes, ils seront! pourtant entre eux infiniment moins opposés. N'ayant plus mutuellement à se craindre, ne tendant plus à s'isoler, ils ne graviteront plus aussi fortement vers leurs centres et ne se repousseront plus aussi violemment par leurs extrémités. Leurs frontières cesseront d'être hérissées de forteresses; elles ne seront plus bordées d'une double ou triple ligue de douaniers et de soldats. Quelques intérêts tiendront encore réunis les membres d'une même agrégation, une communauté plus particulière de langage, une plus grande conformité de mœurs, l'influence de villes capitales d'où l'on a contracté l'habitude de tirer ses idées, ses lois, ses modes, ses usages; mais ces intérêts continueront à distinguer les agrégations sans qu'il reste entre elles d'inimitiés. Il arrivera, dans chaque pays, que les habitans les plus rapprochés des frontières auront plus de communications avec des étrangers voisins qu'avec des compatriotes éloignés. Il s'opérera d'ailleurs une fusion continuelle des habitans de chaque pays avec ceux des autres. Chacun portera ses capitaux et son activité là où il verra plus de moyens de les faire fructifier. Par là les mêmes arts seront bientôt cultivés avec un égal succès chez tous les peuples; les mêmes idées circuleront dans tous les pays; les différences de mœurs et de langage finiront à la longue par s'effacer. Dans le même temps, une multitude de localités, acquérant plus d'importance, sentiront moins le besoin de rester unies à leurs capitales; elles deviendront à leur tour des chefs lieux; les centres d'actions se multiplieront; et finalement les plus vastes contrées finiront par ne présenter qu'un seul peuple, composé d'un nombre infini d'agrégations uniformes, agrégations entre lesquelles s'établiront, sans confusion et sans violence, les relations les plus compliquées et tout à la fois les plus faciles, les plus paisibles et les plus profitables.
19.Comte on “Slavery: its Influence and Abolition” (1827)↩
[Word Length: 12,873]
Source
Charles Comte, Traité de législation, ou exposition des lois générales suivant lesquelles les peuples prospèrent, dépérissent ou restent stationnaire, 4 vols. (Paris: A. Sautelet et Cie, 1826-1827). Vol. 4, Chap. XV "De l'influence de l'esclavage domestique sur l'esprit et la nature l du gouvernement," pp. 299-329; chap. XXI "De l'abolition de l'esclavage domestique", pp. 460-85.
CHAPITRE XV. De l'influence de l'esclavage domestique sur l'esprit et la nature l du gouvernement.
J'ai fait observer précédemment que les peuples changent de maximes selon le point de vue sous lequel ils se considèrent; s'ils se regardent dans leurs rapports avec les individus que la force ou le hasard leur a donnés pour maîtres, ils proclament volontiers comme des principes de droit ou de morale, la liberté individuelle, la liberté des opinions, le respect du travail et des propriétés; mais s'ils se considèrent dans leurs rapports avec les individus que la violence ou la ruse leur a soumis, ils invoquent la légitimité de leurs possessions, l'inviolabilité des lois ou des forces existantes, le respect des autorités établies par la divinité elle-même; ce qui signifie toujours que ceux qui ont été les plus forts, désirent de conserver les avantages de la force, même quand elle les abandonne.
Cette double doctrine ne se manifeste nulle part d'une manière plus naïve que dans les états où il existe une classe de maîtres et une autre d'esclaves, et où les individus de la première ne sont pas complètement asservis. Un homme qui tenterait, en Amérique ou en Angleterre, une usurpation semblable à celle qu'un chef d'armée exécuta en France à la fin du dernier siècle, se verrait foudroyé de toutes parts avec les maximes des droits imprescriptibles de l'homme; mais celui qui s'armerait des mêmes maximes pour appeler à la liberté des hommes dont on dispose comme de bêtes, et qu'on traite beaucoup plus cruellement, souleverait contre lui l'opinion générale, et serait poursuivi comme un malfaiteur.
Mais c'est vainement que les possesseurs d'hommes se forment deux morales et deux justices: ils peuvent les établir dans la théorie; tôt ou tard, il faut que, dans la pratique, l'une ou l'autre règne en souveraine. Ce qui est juste et vrai est tel par lui-même ou par la nature des choses, et non par un effet des caprices de la puissance. La plus folle ou la plus insolente des prétentions serait celle d'un individu qui s'imaginerait que c'est à lui qu'il appartient de rendre une proposition fausse ou vraie, juste ou injuste, selon que cela convient à ses intérêts. Ce qui serait absurde dans un individu, est absurde dans une collection d'individus, quelque nombreuse qu'elle soit; le genre humain se leverait tout entier pour déclarer faux un axiome de géométrie, que les choses resteraient les mêmes; il y aurait seulement dans le monde une absurdité de plus; or, les vérités morales ne dépendent pas plus de nos caprices que les vérités physiques ou mathématiques. Un homme qui, par ruse ou par violence, parviendrait à s'emparer de la personne d’un autre; qui l'entraînerait de force dans sa maison ou sur son champ, où il le contraindrait à coups de fouet à travailler pour lui, ne serait pas jugé par un moraliste autrement que comme un brigand qu’il est urgent de réprimer. Si cet homme, arrivé chez lui, s’avisait d’écrire dans un registre et de proclamer, au sein de sa famille, qu’il est légitime propriétaire de la personne qu’il a ravie, qu’il a le droit de disposer d’elle selon ses caprices, et que nul ne peut, sans iniquité, mettre des bornes à ses violences, ces déclarations ni ses prétentions ne changeraient rien à la nature des faits. Ce qui, dans un individu, serait un crime, en est également un dans une multitude armée; une bande qui, au lieu de s’emparer d’une personne, s’emparerait de cinquante ou de cent, serait dans un cas semblable à celui de l'individu que j’ai déjà supposé; il n’y aurait pas d’autre différence si ce n’est que le crime serait beaucoup plus grave dans le second cas que dans le premier. Mais une nation n’est qu’une collection d’individus, et quand elle procède comme ceux que j’ai supposés, elle se trouve dans le même cas; les déclarations qu’elle fait et qu’elle écrit avec plus ou moins de solennité, que tel ou tel acte est juste, que telle ou telle possession est légitime, ne changent rien à la nature des choses. En pareil cas, la loi c’est la force; la légitimité c’est la conformité de la conduite des faibles à la volonté des plus forts. Pour apprécier l'esclavage, nous n'avons donc point à nous occuper de ce que les peuples qui l'ont établi ont écrit dans les registres de leurs délibérations; leurs résolutions et leurs écritures, même quand ils les appellent des lois, ne peuvent en changer ni la nature, ni les causes, ni les effets.
Lorsque l'esclavage domestique existe chez un peuple, et que les individus de la classe des maîtres veulent établir un gouvernement, ils doivent tenir à ceux d'entre eux auxquels ils confient les fonctions de magistrats, de chefs militaires ou d'administrateurs, à peu près le langage suivant:
1° Vous n'exercerez aucune violence sur nos personnes quand même vous en auriez la force, parce que, à notre égard, la force ne serait pas la justice; vous empêcherez qu'aucune cruauté ne soit exercée contre nous; vous réprimerez toutes les atteintes portées à notre sûreté, sans acception de personnes; vous nous écouterez tous également, et vous administrerez la justice avec impartialité, toutes les fois que nous vous adresserons nos plaintes; mais vous n'accorderez aucune protection aux hommes ou femmes que nous possédons, et s'il nous plaît d'exercer des violences ou des cruautés sur eux, vous nous prêterez main-forte en cas de besoin, parce que, à leur égard, la force et la cruauté sont la justice; non-seulement vous ne réprimerez aucune des atteintes qui pourraient être portées par nous à leur sûreté, mais, s'ils venaient se plaindre, vous ne les écouterez point, et vous ferez toujours acception de personnes; entre eux et nous, vous administrerez toujours la justice d'une manière partiale.
2° Vous protégerez la faculté dont nous prétendons jouir d'aller ou de venir à notre gré, de changer de lieu aussi souvent que cela nous conviendra; vous empêcherez surtout que nul ne nous enferme, soit chez nous, soit dans aucun autre lieu, excepté dans le cas où nous serions accusés de quelque crime contre les maîtres, et en observant les formes légales que nous aurons établies; mais vous protégerez en même temps la faculté dont nous prétendons jouir, d'empêcher les personnes que la force nous a soumises, d'aller ou de venir à leur gré, ou de changer de place lorsque cela leur convient; vous nous aiderez, en cas de besoin, à les enfermer dans tel lieu qu'il nous plaira choisir, sans que nous ayons besoin de motiver nos volontés ou d'observer aucune formalité légale.
3° Vous protégerez notre industrie et l'usage que nous entendons faire de notre intelligence et de nos membres; vous nous garantirez la faculté de suivre la profession qui conviendra le mieux à nos moyens, et de travailler ou de nous reposer selon que nous le jugerons utile à nos intérêts; mais vous protégerez aussi la faculté que nous avons, de donner aux hommes possédés par nous, l'industrie qui nous convient, et de régler l'usage de leurs facultés selon nos caprices; vous ne souffrirez point qu'ils travaillent ou se reposent selon leurs besoins; mais vous les obligerez à travailler ou à rester oisifs selon les nôtres.
4° Vous nous garantirez la faculté de manifester nos opinions, soit verbalement, soit par des écrits imprimés ou autres; vous souffrirez que chacun de nous exprime hautement ce qu'il pense, quand même nos pensées pourraient vous déplaire ou contrarier vos projets; mais vous nous garantirez, en outre, la faculté d'empêcher que les hommes qui nous sont soumis, manifestent, par aucun moyen, des opinions qui puissent nous déplaire; et s'ils contreviennent à nos défenses à cet égard, vous protégerez les châtimens arbitraires qu'il nous plaira leur infliger.
5° Vous nous garantirez la faculté d'exercer le culte religieux que nous jugerons le plus raisonnable ou le plus agréable à la Divinité, ainsi que la faculté de prier ou de nous reposer tel jour que nous aurons choisi, et vous n'userez d'aucune force pour nous imposer vos propres croyances; mais vous nous garantirez de plus la faculté de faire exercer, par les hommes qui nous sont soumis, le culte qu'il nous plaira de leur imposer, et de les empêcher de rendre à la Divinité tel hommage qui pourrait leur être commandé par leur conscience.
6° Vous ne percevrez sur nos revenus, ou sur les produits de nos travaux, que les sommes qui vous seront rigoureusement nécessaires pour une bonne administration, et vous nous rendrez un compte clair, net et public de toutes celles que vous aurez perçues et dépensées; mais, en même temps, vous protégerez la faculté que nous avons de nous approprier le fruit des travaux des hommes qui nous sont soumis, et de ne leur laisser que ce qui leur est rigoureusement nécessaire pour soutenir leur existence; car, à leur égard, les extorsions sont de la justice.
7° S'il s'élevait parmi nous, qui sommes les maîtres, des hommes qui voulussent nous soumettre à un pouvoir arbitraire, vous ferez usage de votre puissance pour les réprimer et pour nous protéger; vous les punirez suivant toute la rigueur des lois; mais, s'il s'élevait des hommes qui voulussent soustraire à notre arbitraire les individus que la force nous a soumis, vous vous souviendrez que vous êtes les protecteurs de cet arbitraire; vous livrerez aux tribunaux tout individu qui tenterait de protéger, contre nos violences, les personnes que nous possédons, pour les placer sous la protection de la justice.
8° Vous protégerez surtout la vertu de nos filles et de nos femmes, et vous punirez avec rigueur les misérables qui oseraient attenter à leurs personnes; mais vous nous protégerez aussi dans l'exercice du pouvoir arbitraire que nous entendons exercer sur les filles ou sur les femmes des hommes qui nous sont soumis; si un mari s'avisait de défendre sa femme, ou un père sa fille, contre nos entreprises; vous nous prêterez la force dont vous disposez, pour les châtier de leur témérité, et faciliter ainsi l'accomplissement de nos désirs.
« Vous jurez d'être fidèles à cette déclaration des droits de l'homme et des droits du maître; et si vous y manquez, en protégeant contre nos extorsions, contre notre violence, et même contre notre luxure, les hommes ou les femmes que la force nous a soumis, nous espérons de la sagesse et de la justice de l'Être suprême qui nous entend, qu'il vous punira de vos prévarications par des châtimens éternels. »
L'esprit humain se prête si facilement aux diverses impressions qu'on veut lui donner, et il est si difficile de se rendre raison des opinions qu'on a reçues dans l'enfance, que je conçois très-bien que des possesseurs d'hommes inculquent dans l'esprit de leurs enfans, une série de propositions contradictoires, semblables à celles dans lesquelles je viens de réduire les prétentions d'un planteur ou d'un Anglo-Américain du sud. Je conçois même qu'après avoir lu ces propositions que les colons français, hollandais et anglais, ou américains, aspirent à mettre en pratique, les uns et les autres les trouvent raisonnables et justes, précisément parce qu'elles sont absurdes. Mais c'est se tromper étrangement que de s'imaginer que les hommes règlent leur conduite par les formules qu'on leur fait réciter, et non par leurs besoins ou par leurs habitudes. Les brigands italiens et espagnols qui vont s'embusquer sur les grandes routes, pour dévaliser les voyageurs, ne sont ni des idolâtres, ni des athées; ils ont le même évangile, et une foi aussi robuste que les hommes honnêtes et industrieux qui peuplent nos grandes villes. Ils savent réciter les maximes morales et religieuses qu'on leur a apprises dès leur enfance, aussi couramment qu'un Anglo-Américain du sud peut réciter *les droits de l'homme et les droits du maître* inscrits dans les lois de son pays; cependant, leurs maximes et même leurs croyances ne suffisent pas pour mettre les voyageurs en sûreté.
Les hommes ne sont dirigés que par l'habitude et par l'exemple; quelque contradictoires que soient leurs doctrines ou leurs raisonnemens, ils se montrent dans leur conduite conséquens à ce qu'ils ont toujours pratiqué ou vu pratiquer. Ce n'est point dans les écoles ou dans les livres des législateurs, que les citoyens se forment au gouvernement; c'est dans leurs maisons et dans les relations qu'ils ont avec les individus qui les environnent. Un enfant qui, depuis sa naissance jusqu'au moment où il est parvenu à l'âge d'homme, se voit environné de maîtres et d'esclaves, observe nécessairement les relations qui existent entre les uns et les autres. Il ne voit, dans ces relations, que ce qui s'y trouve en effet, l'emploi continuel de la force contre la faiblesse; le triomphe constant des désirs et des caprices des uns, et l'abnégation complète de la volonté des autres; l'autorité au lieu de raisonnement. Il ne peut pas encore parler, qu'il a déjà pris le ton absolu et l'air impérieux d'un maître; il voit dans ses parens les membres d'un gouvernement; dans les esclaves, il voit des sujets: il a contracté les habitudes d'un despote avant même que de savoir ce que c'est que des magistrats.
Quelle est la différence qu'un homme ainsi élevé, peut voir entre les individus qu'il possède à titre d'esclaves, et les individus qui ne sont point dans l'esclavage? Il n'en est que deux, c'est la force, et le préjugé que les uns sont nés pour obéir, travailler et souffrir, et les autres pour commander et vivre dans l'oisiveté. Chaque individu libre, pour considérer tous les autres comme ses esclaves, n'a donc besoin que de se trouver investi du commandement, et de posséder des instrumens qui lui donnent sur ses égaux la force qu'il a sur ses esclaves. Or, nous verrons bientôt que ces instrumens ne peuvent être difficiles à trouver dans les pays où une partie de la population est née et élevée dans la pratique de l'arbitraire, et où l'autre partie est façonnée pour la servitude.
Un des effets les plus remarquables de l'esclavage est de mettre dans une contradiction perpétuelle les hommes qui exercent une partie de l'autorité publique, et de les condamner à approuver ou à flétrir alternativement les mêmes actions. Il faut ou qu'ils mentent sans cesse à leur conscience, ou qu'ils se flétrissent eux-mêmes dans leurs jugemens. Cette nécessité est le résultat de l'opposition qui existe entre les prétentions que forment les maîtres en leur qualité de citoyens, et celles qu'ils veulent exercer en leur qualité de possesseurs d'hommes. Afin de mieux faire comprendre ma pensée, je citerai quelques exemples.
Un individu qui possède un troupeau d'hommes ou de femmes, en emploie une partie à cultiver ses terres; il loue les autres à des gens qui lui en paient le louage. Mais, comme cela se pratique, il ne laisse aux uns et aux autres que ce qui leur est rigoureusement nécessaire pour ne pas mourir de faim; quant à lui, il vit dans l'abondance au moyen du produit de leurs travaux. Cet homme, après avoir arraché aux malheureux que la force lui a soumis, tout ce que leur travail a pu produire, va dans une cour de justice en qualité de magistrat ou même de juré. Il se place sur son siège; des ouvriers ou des artisans se présentent et demandent la condamnation d'un homme qui, après les avoir long-temps fait travailler, a refusé de leur payer leur salaire. Les faits sont constatés; les lois sont positives; le magistrat condamne l'individu amené devant lui, attendu qu'il est injuste de faire travailler les gens, et de ne pas leur payer la valeur de leur travail. La sentence prononcée, notre magistrat descend de son siège, et va dîner avec le produit d'un travail qu'il n'a payé que par des coups de fouet.
Un autre possesseur d'hommes donne à un de ses esclaves un ordre qui n'est pas assez promptement exécuté, ou bien il s'imagine que cet esclave a manifesté une opinion peu respectueuse. A l'instant, il commande qu'on le dépouille, lui fait attacher les membres à quatre piquets, et lui administre deux cents coups de fouet. L'expédition finie, et encore tout bouillant de colère, ce maître passe dans une salle de justice, et va siéger sur le banc des magistrats. Là, il attend que la force publique lui amène les malfaiteurs qui doivent être soumis à un jugement; un accusé se présente; son crime est de s'être montré trop sensible à l'injure, et d'avoir infligé un châtiment barbare à un être plus faible, qui lui avait manqué de respect. Les lois étant encore positives, le magistrat prononce la sentence; il condamne l'accusé à des peines infamantes. Le jugement prononcé, il va faire déchirer à coups de fouet les enfans et les femmes qu'il tient enchaînés.
Un troisième, pressé d'argent, s'adresse à un marchand d'esclaves; celui-ci consent à lui en acheter quelques-uns, mais il ne veut en recevoir que de jeunes. Notre possesseur va dans sa plantation; il choisit les plus beaux enfans; les arrache des bras de leurs mères ou de leurs pères, et les livre au marchand; et si les cris des parens blessent ses oreilles, il leur fait imposer silence à coups de fouet. Mais notre planteur est magistrat; quand il a réglé ses propres affaires, il faut qu'il administre la justice; il va donc prendre sa place auprès de ses collègues, et une cause importante attire son attention. Une mère dans le désespoir se présente; un misérable lui a enlevé son fils et l’a vendu au loin comme esclave; le fait est constaté, le malfaiteur est dans les mains de la justice; mais il n’est pas possible de retrouver l'enfant qui a été ravi. Le magistrat fait encore son devoir: il condamne à être pendu l’accusé qu’il sait ne pas être plus coupable que lui-même, ni que la plupart des autres possesseurs d’hommes.
Un quatrième est appelé comme magistrat ou comme juré: il doit prononcer sur une grave accusation portée contre un de ses concitoyens. Un père a dénoncé un attentat commis avec violence contre la pudeur de sa fille; il a saisi le scélérat, et il produit de nombreux témoins de son crime. Nos juges possesseurs d’hommes font encore l’application de la loi: l’accusé est condamné et pendu sans miséricorde. Mais le fait pour lequel il subit le dernier supplice n’est pas considéré comme un crime en lui-même: les témoins, les jurés et les juges eux-mêmes, après avoir condamné ou fait condamner l'accusé et avoir été les témoins de son supplice, rentreront chez eux et pourront se livrer, avec impunité, à des attentats plus graves encore que celui qu’ils viennent de punir; ils pourront les commettre contre des êtres plus faibles, et même contre leurs sœurs ou contre leurs propres filles nées dans la servitude.
Enfin, il n’est presque pas un crime, de quelque nature qu’il soit, auquel un individu ne puisse impunément se livrer en sa qualité de possesseur d’hommes, et qu’il ne puisse être appelé à punir en qualité de magistrat. De cette opposition entre la conduite, et les principes qui doivent diriger le jugement, il résulte que les sentimens moraux s'éteignent, et que la justice n’est plus qu’une force brutale, dirigée par l’orgueil et par l'intérêt des maîtres. Lorsque les mêmes dispositions se rencontrent chez tous les hommes dont un gouvernement se compose, depuis les plus humbles fonctionnaires jusqu’aux chefs de l'état, peut-il exister de la sécurité pour un seul individu? Peut-on espérer que des hommes qui se livrent habituellement chez eux à l'arbitraire, à la violence et à tous les vices, deviendront tout à coup justes, humains, désintéressés, et que ce miracle s’opérera dans leur personne, par cela seul qu’ils changeront de dénomination’?
Un des faits les mieux constatés dans les sciences morales, c’est que l'habitude d'exercer l'arbitraire en donne le besoin et en quelque sorte la passion; lorsque des hommes se sont habitués à vivre sur leurs semblables, tout autre genre de vie leur est en horreur; le travail qui s’exerce sur les choses, est tellement vil à leurs yeux , qu’il ne peut convenir qu’à des esclaves. Nous avons constaté ce fait, non par quelques observations isolées et individuelles, mais par des observations faites sur des races entières, chez les peuples de toutes les espèces, sur les principales parties du globe, et à toutes les époques de la civilisation.
Un autre fait qui n'est pas moins bien constaté que le précédent, c'est que, lorsque des possesseurs d'hommes ne peuvent pas rétablir leurs fortunes par le pillage des nations étrangères, ils ne reconnaissent pas d'autres moyens honorables de s'enrichir que le pillage de leurs propres concitoyens. Nous avons vu, en effet, que quoique les colons anglais et français eussent obtenu, pour la vente de leurs denrées, des monopoles dans des marchés très-étendus, ils étaient tous dans la détresse. Un phénomène semblable se manifesta chez les Romains, lorsque le nombre des esclaves se fut très-multiplié, et surtout lorsque l'état de paix eut concentré dans les mains du maître de l'empire les impôts levés sur les peuples vaincus. Les principaux complices de Sylla, de Catilina, de César, étaient des maîtres ruinés, qui n'avaient pas même le moyen de payer leurs dettes.
Des deux phénomènes que je fais observer ici, il en résulte un troisième qui mérite d'être remarqué; c'est la tendance de tous les maîtres à s'emparer du gouvernement. Chacun, selon sa position, aspire à obtenir un emploi qui le mette à même d'agir sur des hommes et de s'enrichir, ou de vivre du moins, s'il le peut, sans travailler. Tacite observait, de son temps, que les Romains renonçaient volontiers à la liberté, pour entrer en partage des produits que donne l'exercice du pouvoir arbitraire. Des voyageurs ont déjà observé chez les Anglo-Américains une avidité d'emplois publics, plus grande que celle que nous observons dans la plupart des états de l'Europe. S'ils avaient recherché de quels rangs sortaient les aspirans, il ne faut pas douter qu'ils n'eussent trouvé que le plus grand nombre appartenaient à des familles possédant ou ayant jadis possédé des esclaves. Il est un fait irrécusable que confirme cette observation; c'est le grand nombre d'hommes qu'ont fourni au gouvernement fédéral, les états exploités par des esclaves. L'état de Virginie seul en a fourni plus qu'aucun des états du nord, quoiqu'il leur soit de beaucoup inférieur par l'industrie, par les richesses et par les lumières. Dans les états du nord, où l'esclavage est à peu près aboli, on naît agriculteur, manufacturier, commerçant, artisan. Dans les états du sud, quand on naît possesseur d'hommes, on naît gouvernant, ou l'on n'est propre à rien.68
L'existence de l'esclavage poussant les hommes de la classe des maîtres vers les emplois du gouvernement, leur faisant un besoin de s'enrichir par ce moyen, et leur donnant en même temps les préjugés et les habitudes de l'arbitraire, il reste à voir quelles sont les ressources que présentent les diverses classes de la population aux gouvernans qui aspirent à se maintenir dans le pouvoir et à établir le despotisme.
Je dois faire observer d'abord que les mêmes mots n'ont pas, dans un pays où l'esclavage est établi, le même sens qu'ils ont dans un pays où il n'existe point d'esclaves. Lorsque des Anglo-Américains ou des planteurs de la Jamaïque, ou même des seigneurs polonais, disent que les propriétés doivent être garanties, et que nul ne doit être dépouillé des siennes sans avoir été préalablement indemnisé, ils n'attachent point à ces mots la même signification que nous. A leurs yeux, garantir les propriétés, c'est abandonner à leur arbitraire les hommes, les femmes, les enfans que la force leur a soumis; porter atteinte à la propriété, c'est mettre la population asservie à l'abri de la violence; c'est lui garantir une portion du fruit de ses travaux; c'est, en un mot, donner des limites à l'arbitraire de ses possesseurs. Cela étant entendu, on comprendra facilement comment il est de l'intérêt de la population esclave, de seconder de tous ses efforts les hommes qui aspirent à l'asservissement des maîtres.
De tous les genres de despotisme, il n'en est point de plus actif, de plus violent, de plus continu que celui qu'exerce un maître sur ses esclaves. Les violences et les extorsions qu'exerce un despote sur la masse d'une population, ne sont rien en comparaison des extorsions et des violences qu'ont exercées, de tout temps, la plupart des maîtres. Peut-on établir quelque analogie entre la plupart des sujets de Tibère et de Néron, et ces multitudes d'esclaves que les propriétaires romains faisaient travailler dans leurs champs, chargés de chaînes, stimulés à coups de bâton, privés de vêtemens, nourris d'alimens grossiers et peu abondans, et enfermés pendant la nuit dans des cavernes souterraines? Le sort des paysans de Perse n'est-il pas cent fois préférable à celui des esclaves des colonies anglaises, françaises, hollandaises ou espagnoles? L'intérêt de tous les esclaves les dispose donc à seconder tout ambitieux qui se présente pour asservir la race des maîtres, et quand même leurs efforts auraient pour résultat d'établir le gouvernement le plus tyrannique qui ait jamais existé, ce gouvernement serait pour eux un bienfait.
Entre les maîtres et les esclaves, il est une classe d'hommes pour laquelle l'asservissement des premiers est un bienfait et un progrès, c'est la classe des affranchis; les hommes de cette classe ont à gagner, de trois manières, à l'établissement d'un gouvernement absolu; d'abord, ils cessent d'être exclus des fonctions publiques, les maîtres n'ayant plus la nomination aux emplois; en second lieu, ils sont moins avilis, parce que les maîtres peuvent moins facilement les opprimer, et que le pouvoir établi au-dessus d'eux les met tous au même niveau; enfin, les maîtres peuvent moins facilement s'emparer du monopole de toutes les professions industrielles; le gouvernement, ne pouvant pas exploiter chaque individu en particulier, est obligé d'établir des impôts sur la masse de la population, et il faut qu'il accorde une sorte de protection à tout individu qui travaille.
Dans l'ancienne Rome, tous les hommes qui voulurent tenter d'établir le despotisme cherchèrent et trouvèrent un appui dans les classes de la population qui n'appartenaient ni aux maîtres, ni aux esclaves, c'est-à-dire parmi ceux qu'on désignait sous le nom de prolétaires. Nous voyons d'abord les hommes de cette classe vendre, en leur qualité de citoyens, leurs suffrages à ceux qui leur en offrent le plus d'argent. Nous les voyons ensuite s'allier à Marius, et le seconder dans toutes les mesures qui ont pour objet l'asservissement ou la destruction des maîtres. Nous les voyons bientôt après devenir les alliés de César, remplir les cadres de ses légions, et marcher avec lui à la conquête de Rome. Nous les voyons, à la mort du dictateur, s'allier à de nouveaux tyrans, et venger sur les grands, le meurtre de leur chef. Plus tard, nous les voyons s'allier à Néron, le servir de toute leur puissance, et le regretter après sa mort. Enfin, nous les voyons, sous le nom de légionnaires, rester maîtres de l'empire, le vendre au plus offrant, et le reprendre pour le vendre encore, quand le possesseur cesse de se conformer à leurs volontés.
Est-il nécessaire d'indiquer les causes de la persévérance des hommes qui ne sont ni esclaves, ni possesseurs d'esclaves, à s'allier à tous les ennemis des maîtres? N'avons-nous pas vu ceux-ci s'emparer de toutes les terres, à titre de propriétaires ou sous le nom de fermiers de la république, et les faire exploiter exclusivement par les mains des étrangers possèdes sous le nom d'esclaves? Ne les avons-nous pas vus chasser ainsi de toutes les campagnes d'Italie les cultivateurs libres et ne leur laisser aucun moyen d'existence? Ne les avons-nous pas vus s'emparer dans le sein de Rome, au moyen de leurs capitaux et de leurs esclaves, de toutes les branches d'industrie et de commerce? Ne les avons-nous pas vus flétrir d'abord et prohiber ensuite le travail exécuté par des mains libres, afin de mieux s'en assurer le monopole par les mains de leurs esclaves? Les classes libres qui correspondaient, à Rome, à nos classes laborieuses, ne pouvaient donc pas avoir d'ennemis plus redoutables ni plus cruels que les possesseurs d'hommes. La classe des maîtres, qui était, pour les individus possédés, le fléau le plus terrible, était, pour tous les individus classés sous le nom méprisant de prolétaires, un fléau non moins redoutable. Pour de tels hommes, Marius, César et Néron lui-même étaient des bienfaiteurs; car, en même temps qu'ils leur donnaient des moyens d'existence, ils détruisaient leurs ennemis.
Mais, lorsqu'il existe, au sein d'une nation, une classe aristocratique dont tous les membres cherchent à s'arracher le pouvoir, et à s'enrichir par son moyen quand ils le possèdent, une classe nombreuse qui ne possède ni propriétés, ni industrie, et une classe plus nombreuse encore qui non-seulement ne possède rien, mais qui est considérée comme la propriété de l'aristocratie, les guerres civiles qu'enfante l'habitude et l'amour de la domination, prennent un caractère d'avidité et de cruauté dont on ne peut avoir aucune idée chez les peuples qui n'ont point d'esclaves. C'est alors que tous les vices développés dans l'intérieur des familles par l'usage perpétuel de l'arbitraire, se manifestent au grand jour, et s'exercent sur la masse entière de la population; chaque chef est le représentant de tous les vices de la fraction de peuple qu’il gouverne. La haine, la vengeance, la délation mettent en mouvement une population d'esclaves ou l'affranchis; l’orgueil, l'ambition, la cruauté, l'avidité mettent les armes dans les mains des maîtres, et une population de prolétaires devient l'instrument de tout ambitieux qui veut la servir. La crainte, l'ambition, la vengeance, commandent des prescriptions qui sont toujours suivies de la confiscation des biens, et de la ruine des familles; et, d’un autre côté, le besoin de richesses et la nécessité de récompenser les misérables qui servent d'instrument, font proscrire les individus ou les familles qui ont assez de richesses pour tenter les vainqueurs. Tels sont les caractères des guerres civiles de sRomains, depuis le moment où les grands eurent acquis un grand nombre d’esclaves, jusqu’au renversement de leur empire.
Lorsque nous lisons, dans l'histoire romaine, les plaintes que forment les patriciens sur l'influence des affranchis, sur leurs délations, et sur le zèle qu’ils mettaient à servir les empereurs, nous sommes naturellement disposés à prendre parti pour les maîtres contre leurs anciens esclaves; nous ne voyons pas que c’est là le commencement de la terrible réaction des hommes asservis contre leurs oppresseurs, réaction qui avait le même but et le même principe que celle des prolétaires, et qui ne devait plus cesser que par l'extermination complète de la race des maîtres. Un affranchi pouvait avoir quelques obligations à l'individu qui lui avait rendu la liberté; ces obligations étaient analogues à celle qu’inspire un voleur, ou l'héritier d'un voleur, à l'individu auquel il restitue une partie des biens qui lui ont été volés, pouvant impunément les retenir. Mais la reconnaissance d’un affranchi ne pouvait pas plus s’étendre sur toute la classe des maîtres, que ne pourrait s'étendre sur la classe entière des voleurs la reconnaissance d’un homme auquel un bien volé aurait été restitué. Les affranchis et les esclaves formaient une nation particulière, essentiellement ennemie de la classe des maîtres; le nom même d'affranchi était une flétrissure qui ne pouvait être effacée que par là destruction de la race qui l’avait imposée.
Chez les peuples parmi lesquels aucune justice n’est établie; les vengeances individuelles ou de famille deviennent terribles et passent de génération en génération, jusqu’à ce qu’elles aient été satisfaites, ou jusqu’à ce que les races qui en sont l’objet aient été complètement détruites. C’est encore un caractère commun aux hommes de toutes les espèces, et que nous avons observé chez toutes les races et sous tous les climats. Or, les relations de maître et d’esclave, ne laissent point de place à la justice; elles en excluent jusqu’au l’idée. La vengeance qui fermente dans le sein de l’esclave, est d’autant plus énergique qu’elle est plus dissimulée, que les injustices se multiplient de jour en jour, et que chaque individu, outre ses propres outrages, est le témoin journalier de ceux qui sont faits à son père, à sa mère, à ses sœurs, à ses frères, à ses fils ou à ses filles. Quand des crimes ont été ainsi cumulés pendant des siècles, et que les obstacles qui en rendent le châtiment impossible, finissent par se rompre, faut-il s'étonner de la violence de la réaction, et de la persévérance avec laquelle les races opprimées poursuivent leurs oppresseurs?
Plusieurs des tyrans romains qui succédèrent à la république des maîtres, furent des monstres par leurs cruautés, si nous les comparons aux mœurs des peuples actuels de l'Europe; mais, si nous comparons leur conduite à l'égard des maîtres, à la conduite de ceux-ci à l'égard de leurs esclaves, nous les jugerons d'une manière moins sévère. Tibère n'a jamais manifesté à l'égard de ses sujets, les sombres défiances, l'avarice, la cruauté ni le mépris que manifestaient et que manifestent encore de nos jours les possesseurs d'hommes envers leurs esclaves. A aucune époque, ni dans aucun pays, aucun tyran n'a réduit ses sujets à l'excès de dénûment et de misère auquel étaient réduits les cultivateurs enchaînés des campagnes romaines; aucun n'a jamais fait descendre ses sujets à la condition des esclaves des colonies modernes.
Il est vrai que les sujets des despotes romains, sur lesquels pesaient les malheurs de la servitude, étaient plus nombreux que les esclaves d'un des membres de l'aristocratie; et qu'un ordre de Tibère ou de Néron frappait un plus grand nombre d'individus que l'ordre d'un riche possesseur de terres. Mais, pour juger équitablement, il faut comparer les violences, les extorsions, les cruautés de tous les maîtres, aux violences, aux extorsions, aux cruautés d'un seul despote: il faut comparer les effets du despotisme collectif des premiers, aux effets du despotisme individuel du second. Or, en faisant cette comparaison, on conçoit très-bien comment les hommes qui avaient appartenu ou qui appartenaient encore à la race asservie, cherchaient un abri sous un pouvoir qui se montrait l'ennemi des riches possesseurs d'esclaves. Les possesseurs d'hommes, pour mieux assurer leur domination, avaient soin d'abrutir leurs esclaves, d'entretenir entre eux la méfiance, d'encourager, de récompenser la délation. Lorsqu'ils eurent été asservis à leur tour, ils recueillirent le fruit de ce qu'ils avaient semé: les affranchis mirent en pratique à leur égard, les leçons qu'ils avaient reçues quand ils étaient esclaves.
Ce serait, au reste, juger d'une manière fort étroite que de s'imaginer que le despotisme ne commença, à Rome, que le jour où elle eut des empereurs; Rome eut des despotes le jour même où un homme eut la faculté de disposer d'un autre d'une manière arbitraire; le jour où un individu put impunément maltraiter, rançonner, abrutir un autre individu. Si les hommes asservis et les affranchis avaient eu leurs historiens, comme les maîtres ont eu les leurs, et si ces historiens nous avaient décrit les vices et les crimes des maîtres, l'histoire des empereurs nous paraîtrait moins horrible; nous ne trouverions sous leurs règnes que l'application en grand des doctrines établies et pratiquées sous la république.
Ainsi, dans un état où une partie de la population est possédée par l'autre à titre de propriété, nous trouvons qu'une grande partie de la classe des maîtres est naturellement disposée à envahir le pouvoir, et à s'emparer des richesses créées par d'autres; nous trouvons que la partie de la population qui ne peut vivre que de son travail et dont l'esclavage avilit ou empêche l'industrie, est également disposée à se liguer avec tout individu qui se propose d'asservir ou de détruire la race des maîtres; enfin, nous trouvons que le despotisme même le plus violent, qui affaiblit ou qui détruit le pouvoir des maîtres, est un bienfait pour les esclaves; la tendance de la masse de la population, la porte donc vers l'établissement du despotisme d'un seul, et quand le despotisme est établi, il est exercé avec la rapacité, la brutalité, la cruauté et la stupidité que mettent des maîtres dans l'exploitation de leurs esclaves.
Diverses circonstances modifient, dans les colonies européennes et chez les Anglo-Américains du sud, les effets que produit l’esclavage domestique sur l'esprit et sur la nature du gouvernement. Les colonies ne sont point indépendantes: elles reçoivent des gouverneurs et une partie de leurs magistrats et de leurs militaires, des pays auxquels elles sont soumises. Ces militaires, ces gouverneurs, ces magistrats sont nés et élevés chez les peuples qui n’admettent point l’esclavage domestique, et qui, par conséquent, peuvent ne pas avoir les vices que la servitude engendre. Par la perte complète de toute indépendance nationale, les possesseurs d’hommes des colonies évitent une partie des maux attachés à leur position. Il faut qu’ils soient possédés par un pouvoir étranger à leur pays, par un pouvoir sur lequel ils ne peuvent avoir d'influence, pour ne pas être les victimes de l’état social établi parmi eux. De là il résulte qu’ils sont tout à la- fois atteints des vices et des calamités qui appartiennent à l’esclavage et à la domination; en leur qualité de possesseurs d’hommes, ils ont les vices et les maux réservés aux despotes; en leur qualité de sujets d’un pouvoir étranger, ils ont les vices qu’imprime la servitude. Mais cet état ne saurait être éternel; la domination est une charge pesante pour les nations qui l’exercent ; elle ne durera qu’avec les erreurs qui la soutiennent et qui sont déjà bien affaiblies. Lorsqu’elle n'existera plus, la domination des maîtres les uns sur les autres se fera sentir, et l'on verra quelles en sont les conséquences.
Une seconde circonstance concourt à modifier les effets de l'esclavage; c'est la faculté qu'ont les maîtres de faire élever leurs enfans chez des nations où l'esclavage domestique est hors d'usage. En employant ce moyen, ils peuvent jusqu'à un certain point affaiblir les mauvais effets que produit sur l'intelligence et sur les mœurs, le spectacle continuel de la violence et de la servilité; mais cette ressource ne peut être employée que par des familles riches, et par conséquent elle est hors de la portée de la masse de la population.
Une troisième circonstance qui a pour effet de modifier les effets de l'esclavage, est la faculté qu'ont les hommes libres de la classe industrieuse d'émigrer chez les nations où le travail n'est point avili. L'usage de cette faculté condamne les nations esclaves à rester éternellement stationnaires; mais aussi elle délivre en partie les maîtres des dangers qu'aurait pour elle une classe nombreuse qui n'aurait ni propriétés, ni industrie. La facilité de l'émigration peut ne pas être la même dans tous les pays; elle est plus grande chez les Anglo-Américains du sud, qu'elle ne l'est dans les colonies françaises: d'où il suit que le danger n'est pas égal pour tous les possesseurs d'esclaves.
Les effets de l'esclavage sont modifiés par une quatrième circonstance chez les Anglo-Américains du sud; par l'influence qu'exercent sur eux les états du nord. Il est évident, en effet, qu'un des principaux résultats de la fédération est de prévenir, dans les états du sud, soit les usurpations de pouvoir, soit les insurrections des esclaves. La division du pays en divers états indépendans, contribue également à rendre les usurpations difficiles. Un individu qui aurait subjugué un état, pourrait n'avoir pas le moyen de subjuguer les autres.
En exposant les diverses manières dont les Anglo-Américains agissent sur les esclaves, il en est une qui paraît incroyable, tant, dans nos mœurs, elle est absurde et atroce; c'est l'interdiction absolue imposée à tous les maîtres d'apprendre à lire à leurs esclaves; un maître qui couperait les mains ou qui crèverait les yeux à un des hommes qu'il considère comme sa propriété, serait puni par les autres maîtres moins sévèrement que s'il lui avait appris à lire et à écrire. Nous ne devons pas considérer cette loi comme une atrocité gratuite; elle est une des conditions de la liberté et de la sécurité des maîtres. Nous ne concevons pas que la liberté d'un peuple puisse se maintenir, si chacun ne jouit pas de la faculté de publier ses opinions; mais nous ne concevons pas davantage que la servitude puisse se perpétuer dans un pays où la publicité règne. Les Anglo-Américains du sud, voulant rester libres, ont admis, pour tous les citoyens, la faculté illimitée de publier leurs opinions; et voulant en même temps perpétuer la servitude parmi eux, ils ont fait une loi de l'abrutissement des esclaves. Ils ont déterminé qu'ils les rendraient assez stupides pour que la liberté de la pensée ne pût contribuer en rien à leur instruction. Si les esclaves savaient lire, en effet, il se trouverait bientôt des affranchis qui sauraient écrire; et, dès ce moment, les maîtres ne pourraient plus assurer leur repos, qu'en soumettant à une censure préalable tous les écrits qui seraient publiés ou introduits sur leur territoire. Ils seraient, par conséquent, obligés de renoncer à une des portions les plus précieuses de leurs libertés, à celle qui sert de garantie à toutes les autres.69
Cependant, les Anglo-Américains sentent déjà vivement les maux attachés à l'esclavage, et ils voudraient s'en débarrasser; mais comment s'y prendre? S'ils déportent annuellement une partie de leurs esclaves, les naissances excéderont les déportations; car il faudra assurer la subsistance des déportés, et cela en réduira de beaucoup le nombre. S'ils les affranchissent, il faudra les éclairer et leur donner une industrie; alors ils se multiplieront rapidement, ils profiteront des avantages de la publicité, voudront exercer les droits des citoyens, et les maîtres les jugeront redoutables. Si, pour prévenir le danger de leur domination, les hommes de la race des maîtres renoncent à une partie de leur liberté; s'ils soumettent les écrits à une censure préalable, ils auront à craindre que, pour les opprimer, leurs gouvernemens ne cherchent un appui dans les hommes de la race affranchie.
CHAPITRE XXI. De l'abolition de l'esclavage domestique.
L'enseignement des préceptes de la morale et de la religion, et la protection des gouvernemens, seront sans influence sur le sort et sur les mœurs des esclaves, aussi long-temps que le pouvoir arbitraire restera dans les mains de leurs possesseurs. Il est même à craindre que les efforts que l'on fait pour conduire graduellement à la liberté la population asservie, ne produisent des résultats contraires à ceux que l'on se propose. En même temps, en effet, qu'on laisse sans limites le pouvoir des possesseurs d'hommes, on enseigne aux hommes possédés qu'ils ont des devoirs moraux et religieux à remplir; on leur expose un certain nombre de règles, et on les excite à les observer. Les esclaves se trouvent ainsi soumis à des lois de deux genres; à celles qui les mettent dans les rangs des choses ou des propriétés, et à celles qui les mettent aux rangs des êtres moraux. En leur qualité de choses, on leur enseigne que les lois suprêmes sont les volontés de leurs maîtres; en leur qualité de personnes,on leur enseigne que les lois suprêmes sont les préceptes de la morale et de la religion. Ces diverses lois étant dans une opposition directe les unes avec les autres, il n'est pas difficile de voir quelles sont celles qui doivent triompher dans la pratique. Je crois les missionnaires des hommes fort éloquens; mais il est une éloquence au-dessus de la leur, c'est celle des fouets de charretier déposés dans les mains des régisseurs. Ainsi, en même temps qu'on enseigne aux esclaves les devoirs de la morale, on les oblige à les violer; mieux vaudrait qu'ils les ignorassent, car ils ne prendraient pas l'habitude d'agir en sens contraire de leur croyance.
N'y aurait-il même pas une absurdité barbare à maintenir des lois qui soumettent une multitude d'hommes, d'enfans et de femmes aux volontés arbitraires d'un certain nombre de maîtres, et à leur faire enseigner en même temps qu'ils ont des devoirs à remplir indépendamment des volontés de leurs possesseurs? N'est-ce pas, par exemple, une absurdité cruelle que d'enseigner à une jeune fille que la chasteté est un devoir, et de donner, en même temps, à un être que l'usage du despotisme a dégradé, le pouvoir de la déchirer à coups de fouet jusqu'à ce qu'elle se soit prostituée? N'est-ce pas une absurdité également atroce que d'enseigner à un mari qu'il doit être le protecteur de sa femme, à un père qu'il doit être le protecteur de sa fille, et de les condamner ensuite l'un et l'autre aux supplices les plus cruels, s'ils tentent de remplir les devoirs qu'on leur a enseignés? N'est-ce par une autre absurdité d'apprendre à dés hommes que la Divinité leur a fait un devoir de se reposer tel ou tel jour de la semaine, et de donner en même temps à d'autres hommes le pouvoir de les déchirer à coups de fouet, s'ils ne travaillaient au temps défendu? Il n'y a pas de terme moyen entre l'obéissance due aux préceptes de la morale, et l'obéissance due aux volontés arbitraires du maître. Si vous enseignez à des hommes qu'ils ont des devoirs moraux ou religieux à remplir, ne laissez à aucun autre la puissance de leur en commander la violation; apprenez-leur qu'il est des cas où la résistance est permise, et lorsque ces cas se présentent, unissez-vous à eux pour résister. Si, au contraire, vous laissez à un maître les moyens de les contraindre à se conformer à ses volontés ou à ses désirs, ne leur dites pas qu'il existe pour eux des devoirs moraux ou religieux; enseignez-leur, au contraire, que le seul devoir qu'ils aient, est de se conformer en tout aux volontés de leur maître; dites-leur que l'adultère, l'inceste, le vol, l'assassinat, sont des devoirs quand ils leur sont commandés par l'individu qui les possède; alors les doctrines ne seront pas en opposition avec la conduite; on n'aura pas un plus grand nombre de vices, et l'on aura l'hypocrisie de moins!
Cependant, s'il n'est pas en la puissance des gouvernemens des métropoles de protéger la population esclave, aussi long-temps que le principe de l'esclavage existe; si l'enseignement de la morale ou de la religion est sans effet sur les mœurs, ou s'il n'a pas d'autre effet que d'habituer les hommes à agir en sens contraire de leurs pensées, comment est-il possible d'arriver à l'abolition graduelle de l'esclavage? Comment peut-on l'abolir tout à coup sans compromettre à la fois l'existence des maîtres, et même le bien-être a venir de la population asservie?
Il ne faut pas se le dissimuler; les difficultés qui se présentent sont graves, et je doute même qu'il soit possible de les éviter toutes. J'ai fait observer ailleurs qu'il est dans la nature de l'homme que tout vice et tout crime soit suivi d'un châtiment. J'ai fait voir qu'on ne peut soustraire un individu coupable à la peine qui est la conséquence naturelle de ses vices ou de ses crimes, sans faire tomber sur soi-même ou sur d'autres un châtiment beaucoup plus terrible.70 Or, de tous les faits que nous considérons comme criminels, il n'en est pas de plus graves que d'avoir dégradé une partie du genre humain, en la mettant au rang des choses; d'avoir dénié, à son égard, l'existence de tous devoirs moraux; d'avoir exercé sur elle, pendant une longue suite de générations, tous les vices et tous les crimes dont des hommes peuvent être susceptibles. Maintenant que les conséquences de cet horrible système nous pressent de toutes parts, on cherche comment on en sortira, sans en subir les conséquences; mais il est difficile d'en trouver les moyens. Il faut se hâter cependant, car l'édifice tombe en ruine de toutes parts; et plus on hésitera â prendre un parti, plus la catastrophe peut être terrible.
Les possesseurs d'hommes des colonies anglaises résistent de toute leur puissance à l'action que la métropole exerce sur eux pour adoucir le sort de leurs esclaves et les préparer à la liberté; et il est probable que, si la France et les autres nations qui possèdent encore des colonies, voulaient agir dans le même sens, elles rencontreraient les mêmes résistances. Existe-t-il des moyens de vaincre cette opposition, sans recourir à la violence? Il en est deux bien simples: le premier et le plus efficace serait l'abolition du monopole accordé aux possesseurs d'esclaves pour la vente de leurs denrées; le second serait le rappel des troupes envoyées chez eux pour seconder l'action qu'ils exercent sur leurs esclaves. Il est constaté, en effet, que les possesseurs de terres, qui font exécuter leurs travaux par des esclaves, paient la main-d'œuvre beaucoup plus cher que ceux qui font exécuter les leurs par des hommes libres. Si les premiers n'avaient la jouissance d'aucun monopole, ils seraient donc obligés, pour vendre leurs denrées, d'employer les mêmes moyens de culture que les seconds; c'est-à-dire qu'ils seraient obligés, sous peine de périr de misère, d'affranchir leurs esclaves. Il n'est pas moins évident que, s'ils étaient abandonnés à leurs propres forces, ils se livreraient moins à leurs vices, parce qu'ils auraient un peu plus de crainte des insurrections. Mais les possesseurs d'hommes ont un tel excès d'ignorance, de présomption et d'orgueil, que, s'ils étaient tout à coup livrés à eux-mêmes, il pourrait bien attirer sur eux quelque catastrophe terrible. Il est donc du devoir des métropoles de les mettre à l'abri de leurs propres folies, et de les aider à sortir de la position où ils se trouvent, sinon avec profit, du moins avec la moindre perte possible.
Il est des personnes qui portent à tous les possesseurs d'hommes un si tendre intérêt, que, pour ne pas compromettre leur repos et leurs jouissances, elles consentiraient volontiers à fermer les yeux sur les maux innombrables que la servitude enfante; mais elles doivent considérer qu'il n'y a jamais eu, pour les maîtres, de sûreté dans l'esclavage, et qu'il y en a aujourd'hui moins qu'à aucune époque. Les générations qui secondèrent l'établissement d'un tel système, dans les îles ou sur le continent d'Amérique, ont disparu, et elles ne se lèveront pas pour le défendre. Les générations qui leur ont succédé, sont plus éclairées; leurs habitudes ou leurs pratiques sont encore en arrière de leur entendement, mais c'est un désaccord qui ne saurait durer long-temps. L'Angleterre a déjà retiré l'appui qu'elle prêtait au commerce des esclaves; la France marche sur la même route; l'Espagne ne peut rien faire pour le soutenir; d'autres états du continent l'ont prohibé. En Amérique, non-seulement la traite a été prohibée, mais plusieurs des états les plus considérables ont complètement aboli l'esclavage. Les parties dans lesquelles il existe le plus d'esclaves sont environnées de toutes parts de peuples libres qui croissent en richesses, en nombre et en lumières. Au centre même, une population jadis esclave jouit d'une entière indépendance, et, par le seul fait de son existence, elle est un avertissement continuel pour les maîtres et les esclaves. Si les possesseurs d'hommes ont des dangers à courir, les plus graves naissent, non de l'abolition régulière de l'esclavage, mais de la persistance à le conserver.
Les possesseurs d'hommes et les individus qui veulent les maintenir dans leurs possessions, semblent voir dans l'abolition de l'esclavage une multitude de dangers; ceux qui aspirent à cette abolition partagent une partie de leurs craintes; mais, de part et d'autre, on semble n'être agité que de terreurs paniques, car personne n'ose préciser les faits positifs qu'on paraît redouter. Cependant, si l'affranchissement des esclaves offre des dangers, il faut savoir les considérer en face, et déterminer nettement en quoi ils consistent; c'est le seul moyen de les prévenir. Fermer les yeux afin de n'avoir pas peur, et marcher ensuite au hasard vers le but qu'on se propose, est un mauvais moyen d'éviter les faux pas.
Les hommes qui appartiennent à la race des maîtres peuvent voir dans l'abolition de l'esclavage trois dangers: ils peuvent craindre que leur existence personnelle ne soit menacée; que leurs propriétés ne soient point en sûreté, et que les affranchis refusent de travailler pour eux, ou ne se livrent au travail qu'autant qu'ils y seront forcés par la faim.
Ce dernier danger est le moins grave; mais peut-être aussi est-il celui qui est le plus à craindre, au moins pour quelque temps. Un des effets les plus infaillibles de l'esclavage est d'avilir l'action de l'homme sur les choses; dans un pays exploité par des esclaves, être libre, c'est être oisif; c'est vivre gratuitement sur le travail d'autrui. Cette manière de juger ne changera point immédiatement après l'abolition de l'esclavage; les individus de la race des maîtres continueront de voir l'avilissement dans le travail, et la noblesse dans l'oisiveté. Les affranchis jugeront d'abord comme les maîtres, et les imiteront s'ils le peuvent; s'ils n'ont pas le moyen de vivre oisifs comme eux, ils aspireront du moins à le devenir. C'est là l'histoire de toutes les populations qui ont été divisées en maîtres et en esclaves: sous ce rapport, il n'y a point de différence entre les noirs et les blancs.
Il ne faut pas croire, cependant, que cet inconvénient soit aussi grave qu'il le paraît d'abord. Dans les pays où il existe des esclaves, la journée d'un affranchi se paie deux fois plus que la journée d'un esclave. Il faut donc que le premier travaille deux fois plus que le second, ou que son travail ait deux fois plus de valeur. Dans tous les pays, le meilleur parti qu'un maître peut tirer de son esclave, est de lui laisser l'entière disposition de son temps, et d'exiger de lui une somme pour chacune de ses journées de travail. L'esclave, stimulé par l'espérance de faire des économies, travaille d'abord pour payer à son maître l'impôt établi sur lui, et il travaille ensuite pour s'entretenir et souvent même pour se racheter. L'homme qui est mû par l'espoir des récompenses, agit donc avec plus d'intelligence et d'énergie que celui qui n'est mû que par la crainte des châtimens. Un homme libre porte en lui un autre principe d'activité qui ne se trouve point dans l'esclave: c'est le désir d'avoir une famille et le besoin de la faire vivre. Un esclave n'a point à s'occuper du sort de ses enfans; son travail est sans influence sur leur destinée: c'est le maître qui doit les nourrir. Ainsi, en supposant au préjugé que l'esclavage crée contre le travail, toute l'énergie qu'il peut avoir, l'affranchissement développe des principes d'activité plus énergiques et plus continus dans leur action que les châtimens infligés par les maîtres. L'Angleterre a été soumise à un esclavage analogue à celui qui existe en Russie; aujourd'hui dix ouvriers anglais font plus de travail, dans un temps donné, que cinquante esclaves russes; tel lord anglais qui possède la même étendue de terres que tel seigneur russe, est dix fois plus riche que lui, quoiqu'il ne possède pas un esclave, tandis que le second en possède des milliers.
Un des préjugés les plus invétérés des possesseurs d'hommes, est de considérer les individus possédés comme de malfaisantes machines, qui ne vont d'une manière tolérable qu'autant qu'elles sont dirigées par une intelligence étrangère, et qui, pour ne pas être nuisibles à leurs possesseurs, ont besoin d'être enchaînées et conduites à coups de fouet. Un maître auquel on parle de l'affranchissement des esclaves, éprouve un sentiment analogue à celui que nous éprouverions nous-mêmes, si l'on nous parlait de déchaîner, au milieu d'une nombreuse population, une multitude de bêtes féroces. Ayant toujours réglé lui-même tous leurs mouvemens et puni leurs fautes selon ses caprices, il s'imagine que tout va tomber dans le désordre et la confusion, si on lui arrache son fouet. C'est là l'erreur de tous les gouvernemens arbitraires; cette erreur vient de ce qu'on attache au mot affranchissement des idées que non-seulement il ne comporte pas, mais qu'il exclut.
Qu'est-ce qu'affranchir un homme asservi? c'est tout simplement le soustraire aux violences et aux caprices d'un ou de plusieurs individus, pour le soumettre à l'action régulière de l'autorité publique; c'est, en d'autres termes, empêcher un individu qu'on appelle un maître, de se livrer impunément envers d'autres qu'on appelle des esclaves, à des extorsions, à des violences, à des cruautés. Affranchir des hommes, ce n'est pas ouvrir la porte au trouble, au désordre, c'est les réprimer; car le désordre existe partout où la violence, la cruauté, la débauche, n'ont point de frein. Le plus effroyable des désordres règne partout où la partie la plus nombreuse de la population est livrée sans défense à quelques individus, qui peuvent s'abandonner sans réserve à tous les vices et à tous les crimes, c'est-à-dire partout où l'esclavage existe. L'ordre règne, au contraire, partout où nul ne peut se livrer impunément à des extorsions, à des injures, à des violences, partout où nul ne peut manquer à ses obligations sans s'exposer à des châtimens, partout où chacun peut remplir ses devoirs sans encourir aucune peine; l'ordre, c'est la liberté.
Cela étant entendu, la question devient facile à résoudre; elle se réduit à savoir si les violences et les mauvais traitemens inspirent de la bienveillance et de la douceur, et si la protection et la justice donnent de l'énergie à la vengeance; si le père dont on outrage la fille, ou le mari dont on ravit la femme, sont moins à craindre pour le ravisseur, que n'est à craindre pour un homme inoffensif l'individu dont il respecte la famille; si l'homme qui jouit en toute sécurité de ses travaux et qui peut enrichir ses enfans par ses économies, est moins disposé à respecter les propriétés d'autrui; que celui qui se voit sans cesse ravir par la violence les produits de son travail; si celui qui pourra, sans danger, remplir tous les devoirs que la morale lui prescrit, aura des moeurs moins pures que celui qui ne peut remplir aucun devoir sans s'exposer à des châtimens cruels.
Il faut observer, en effet, qu'en échappant à l'arbitraire de son possesseur, l'homme qu'on appelle un esclave n'acquiert pas l'indépendance des sauvages; il se trouve sous l'autorité de la loi commune, et sous la puissance des magistrats; il ne peut pas plus qu'auparavant se livrer impunément» à des crimes. S'il se rend coupable de quelque délit, il en sera puni comme il l'aurait été quand il était esclave, mais la peine sera plus proportionnée à l'offense; elle sera appliquée sans partialité, sans vengeance; elle aura pour but et pour résultat la répression du mal, et non la satisfaction d'un sentiment de haine ou d'antipathie. S'il se livre à un vice, il en portera la peine bien plus infailliblement qu'il ne l'aurait portée dans l'état de servitude; l'oisiveté ou l'intempérance seront châtiées par la misère, comme le travail et l'économie seront récompensés par l'aisance ou par la richesse.
Les hommes qui se proposent l'abolition de l'esclavage, n'ont presque point à s'occuper de la population asservie. Leur action doit s'exercer bien plus sur les maîtres que sur les esclaves; elle doit avoir pour effet, non de les soumettre à des violences, mais d'empêcher qu'ils n'en exercent sur d'autres impunément. L'asservissement d'un homme à un autre n'étant pas autre chose qu'un privilège d'impunité accordé au premier pour tous les crimes dont il peut se rendre coupable à l'égard du second, l'affranchissement n'est pas autre que la révocation de ce privilège. Déclarer que, dans tel pays, l'esclavage est aboli, c'est déclarer tout simplement que les délits ou les crimes seront punis sans acception de personnes; établir ou maintenir l'esclavage, c'est accorder ou garantir des privilèges de malfaiteur. Cela est si évident que, pour abolir complètement la servitude dans tous les lieux où elle existe, il suffirait de soumettre aux dispositions des lois pénales les délits exécutés par les possesseurs d'hommes, sans faire aucune distinction entre les personnes offensées.
On craint que, si la justice est rendue à tout le monde, et si, par conséquent, les maîtres perdent le privilège de commettre des iniquités, les hommes de la race asservie ne profitent des garanties qui leur seront données; qu'ils ne se coalisent entre eux, et ne détruisent leurs anciens possesseurs, ou du moins ne les expulsent du pays. Il est très-probable que, tôt ou tard, les îles cultivées par des esclaves seront exclusivement possédées par des hommes de leur espèce; ces hommes sont de beaucoup les plus nombreux; ils peuvent se passer de leurs maîtres, et leurs maîtres ne peuvent pas se passer d'eux. Il y aura par conséquent des noirs ou des mulâtres dans les colonies, aussi long-temps qu'il y-aura des blancs; mais il n'est pas également certain qu'il y ait des blancs aussi long-temps qu'il y aura des noirs, puisque ceux-ci peuvent vivre sans les secours de ceux-là. Toutes les chances sont donc en faveur des derniers.
Mais cette révolution, dans les colonies européennes, peut s'opérer de deux manières; elle peut s'exécuter d'une manière violente et rapide comme celle qui s'est opérée à Saint-Domingue; ou bien elle peut s'exécuter d'une manière lente et progressive, et de telle sorte qu'en se retirant, les individus de la race des maîtres emportent la valeur de leurs propriétés et les moyens d'aller s'établir ailleurs; la persistance des maîtres à maintenir l'esclavage ne peut amener que la première; l'affranchissement des esclaves amènerait probablement la seconde.
Si, par suite de quelque événement extraordinaire, il y avait, en effet, une insurrection d'esclaves, leur première pensée serait d'expulser leurs maîtres, et peut-être de les exterminer. Placés entre la nécessité de conquérir leur indépendance, et le danger de périr dans les supplices, ils finiraient probablement par rester maîtres du pays; et une fois qu'ils l'auraient conquis, il ne serait pas facile de le leur enlever. Les métropoles trouvent que leurs colonies sont une charge trop lourde pour faire de grands sacrifices pour les conquérir, si elles venaient à les perdre.
La révolution qui, par suite de l'affranchissement, placerait des noirs à la tête des affaires publiques, arriverait d'une manière si lente et si insensible, qu’il n’est guère possible de prévoir l'époque à laquelle elle serait terminée. Il faudrait connaître bien peu les hommes pour s'imaginer qu’en sortant de l'esclavage le plus dégradant qui ait jamais existé, ils aspireront à commander, et s'organiseront entre eux pour s'emparer du pouvoir. Quelque nombreux qu'ils soient, comparativement à leurs maîtres, leur ignorance, leur misère, la difficulté d'acquérir aucune propriété territoriale, et l'influence des gouvernemens européens, ne permettront guère aux idées ambitieuses de germer dans leurs esprits, à moins que des violences ne les portent au désespoir. Lorsqu'une aristocratie s'est profondément enracinée dans un pays, elle se soutient pour ainsi dire par son propre poids. Les luttes ne commencent pour elle que lorsqu'il se trouve, dans les rangs des hommes jadis asservis, des individus qui, par leurs richesses ou par leurs lumières, aspirent au gouvernement. Ces luttes ne sont même dangereuses qu’autant que l'aristocratie exclut de son sein les hommes qui, par leur position, peuvent aspirer à y entrer; car, si elle absorbe les richesses ou les talens qui se développent dans les autres classes de la population, il n'y a plus de raison pour qu'elle finisse. Le petit nombre des dominateurs ne suffit pas pour amener la fin de leur empire: huit mille Mamloucks ont régné pendant des siècles sur trois ou quatre millions d'Égyptiens; et leur règne durerait encore, s'ils n'avaient pas été détruits par un pouvoir étranger.
La lutte entre les descendans des maîtres et les descendans libres des esclaves, commencera donc à se manifester lorsque les derniers auront acquis assez de richesses et de lumières pour aspirer à l'exercice des pouvoirs politiques. Il est très-probable que des électeurs d'espèce éthiopienne qui trouveraient parmi les hommes de leur race des individus capables de les bien gouverner, leur donneraient la préférence sur des blancs. Il arriverait alors ce que nous avons vu dans une ville des anciennes colonies espagnoles; les blancs cesseraient d'être appelés aux emplois publics, et leur position deviendrait tellement désagréable, qu'ils prendraient le parti d'émigrer. Mais, pour qu'un tel événement arrivât, il faudrait que l'industrie et les richesses des affranchis se fussent de beaucoup augmentées, et alors les descendans des maîtres pourraient aliéner leurs propriétés plus avantageusement qu'ils ne le pourraient aujourd'hui. Leurs terres perdront, en effet, d'autant plus de leur valeur, qu'ils mettront plus de persistance à maintenir l'esclavage; car la main-d'œuvre deviendra de plus en plus chère, et il deviendra de plus en plus à craindre que les propriétaires ne soient expulsés.
Quoi qu'il en soit de ces conjectures sur l'avenir, il est certain qu'il n'y a plus de sécurité pour les possesseurs d'hommes des colonies; que l'Angleterre lutte de toute sa puissance pour abolir l'esclavage, et que, par conséquent, la question ne porte plus que sur le moyen le plus sûr de l'abolir l'esclavage, et que, par conséquent, la question ne porte plus que sur le moyen le plus sûr de l'abolir.
Dans le système de l'esclavage, on pose en principe que la personne qu'on appelle un esclave est une chose; que cette chose appartient au propriétaire, et qu'il peut faire d'elle tout ce qu'une ordonnance de son gouvernement ne lui a pas défendu. En conséquence, on cherche à mettre des limites à la disposition de cette propriété, comme on en a mis à la disposition de toutes les autres. J'ai fait voir, dans le chapitre précédent, qu'en suivant ce système, il n'y a pas moyen d'arriver à l'abolition de l'esclavage, parce que l'arbitraire qu'on proscrit sous une forme, se montre immédiatement sous une autre. Il est aussi impossible d'arriver à la liberté en partant du principe de la servitude, qu'il est impossible d'arriver à la vérité en prenant une erreur pour la base de ses raisonnemens.
Quelque lente que soit la marche qu'on se propose de suivre dans l'abolition de l'esclavage, il est un pas qu'il faut nécessairement franchir d'une seule fois, parce que entre l'erreur et la vérité il n'y a point d'intermédiaire. Il ne faut pas partir du fait mensonger qu'un être humain est une chose, ou un quart de chose, ou un huitième de chose; il faut reconnaître franchement ce qui est, c'est-à-dire qu'il est une personne ayant des devoirs à remplir envers lui-même, envers son père, sa mère, sa femme, ses enfans, et l'humanité tout entière. Tant que ces vérités ne sont pas reconnues, il n'y a pas de progrès à faire; on ne peut qu'opposer de la force à de la force. Mais aussi, à l'instant où l'on reconnaît qu'un homme asservi est un homme, et qu'il a des devoirs moraux à remplir comme tous les autres, les positions changent; comme être moral, il devient l'égal de son maître, puisqu'il a les mêmes devoirs à remplir que lui.
En considérant ainsi les hommes qu'on appelle des esclaves et les hommes qu'on appelle des maîtres, on ne peut pas suivre le procédé qu'on emploie quand on limite les pouvoirs d'un propriétaire sur sa propriété; on ne peut pas dire que le maître peut tout ce qui ne lui est pas interdit par l'autorité publique, ou que l'esclave doit tout, excepté ce que les ordonnances du gouvernement lui ont réservé; on est obligé de déclarer, au contraire, que le maître ne peut rien exiger au-delà de ce que le gouvernement lui a positivement accordé, et que l'individu qu'on appelle un esclave, est libre sur tous les points qui n'ont pas été restreints par une disposition positive.
Ces deux manières de procéder peuvent paraître identiques ou ne différer que dans les termes; et cependant il y a entre l'une et l'autre une différence immense. Dans l'une, on reconnaît qu'il existe des devoirs moraux indépendans des caprices de la puissance; c'est la liberté qui est le principe; l'obligation envers le maître est une exception. Dans l'autre, on fait dériver tous les devoirs de la volonté des gouvernemens; c'est le despotisme, qui est le principe; l'exception, c'est la *liberté*, ou ce qu'on appelle les *libertés*, mot inventé pour rappeler aux affranchis qu'ils ne s'appartiennent que dans les parties d'eux-mêmes qui leur ont été concédées par leurs possesseurs.
La description spéciale de chacune des obligations imposées à l'homme qu'on appelle un esclave, envers l'homme qu'on appelle un maître, et la reconnaissance positive que le premier ne doit rien au second, au-delà de ce qui est décrit, sont d'une si haute importance que les possesseurs d'hommes croiraient avoir perdu la partie la plus précieuse de leur autorité, s'ils étaient obligés de spécifier ainsi chacune de leurs prétentions, et si on les réduisait, pour en exiger l'accomplissement, à suivre les formes légales.
Si chacune des obligations des esclaves était déterminée par un acte de l'autorité publique, les ministres de la religion, qui veulent les préparer à la liberté par l'enseignement de la morale, pourraient leur parler de devoirs sans les exciter indirectement à la révolte; les devoirs ne seraient bornés alors que par les obligations imposées envers les maîtres; tandis que, lorsque les obligations envers le maître restent indéfinies, il ne peut pas exister d'autres devoirs que celui d'une obéissance aveugle.71
Mais quelles sont les obligations à imposer à l'homme qu'on appelle un esclave, envers l'homme qu'on appelle un maître? Si les questions qui divisent les hommes étaient toujours résolues selon les règles de la morale, il faudrait renverser celle-ci; il ne faudrait pas demander quelles sont les obligations de l'homme possédé envers son possesseur; il faudrait demander, au contraire, quelles sont les obligations de celui-ci envers celui-là; qu'est-ce qu'il lui doit pour le travail qu'il lui a arraché, et dont il ne lui a point payé la valeur, pour les violences qu'il a exercées sur lui, ou pour les souffrances auxquelles il l'a condamné, et dont il ne l'a point indemnisé? Mais, ne devançons point notre siècle; recevons, comme une grace, l'abandon fait à l'homme faible et pauvre d'une petite part des produits de ses travaux, et considérons comme une faveur le ralentissement de l'injustice et de la violence.
Quelque élevées que soient les prétentions des possesseurs d'hommes et de leurs amis, je suppose que tous les services qu'ils prétendent leur être dus par les hommes possédés, sont appréciables en argent; un maître n'oserait réclamer ostensiblement de son esclave que des travaux; et, si l'on admet cette réclamation comme juste, il ne doit pas se plaindre qu'on est trop exigeant. Ce point étant convenu, la première mesure à prendre est de déterminer quelle est la valeur courante d'une journée de travail fait par un esclave de tel âge et de tel sexe. Il est bien probable que des individus sortiront souvent de la règle commune, et que leur travail vaudra tantôt un peu plus, et tantôt un peu moins; mais, comme nous raisonnons maintenant dans un système d'expédiens, et non sur les règles de la justice, il ne s'agit pas d'arriver à une exactitude mathématique.
Le prix d'une journée d'esclave étant fixé, le possesseur d'hommes ne peut pas se plaindre d'injustice, si l'on accorde à l'individu asservi la faculté de livrer son travail ou d'en payer la valeur. Cette alternative place en quelque sorte l'esclave dans la même position que l'homme libre; elle rétablit en lui, au moins en partie, le principe d'activité que la servitude détruit. Le prix de la journée d'un homme libre ayant, en général, deux ou trois fois la valeur de la journée d'un esclave, il est évident qu'en donnant un principe d'activité à la population, on doublerait la quantité de travail, en même temps qu'on bannirait les supplices au prix desquels on l'obtient. Les esclaves obtiendraient ainsi la facilité de se racheter et de racheter les membres de leurs familles.
Par la même raison qu'un possesseur d'hommes ne pourrait pas accuser d'injustice la mesure qui accorderait à l'esclave la faculté de livrer son travail ou d'en payer la valeur, il ne saurait se plaindre si un esclave est admis à se racheter ou à racheter sa femme et ses enfans. Les obligations imposées à un individu asservi étant appréciables en argent, rien n'est plus facile que de déterminer le prix auquel un esclave peut s'affranchir. Il suffit de calculer quel est, dans l'esclavage, le terme moyen de la vie, et de distraire des journées de travail dont ce terme se compose pour chaque individu, les jours consacrés au repos, et ceux pendant lesquels le travail peut être interrompu par des accidens ou des maladies.
Le rachat des esclaves est une des mesures auxquelles les possesseurs d'hommes sont le plus opposés. Si l'on veut connaître les raisons de leur opposition, il ne faut pas les chercher dans leurs discours; il faut observer les circonstances qui influent sur le prix des individus exposés en vente. Si l'on examine, dans un marché où des êtres humains sont vendus, quels sont les individus qui obtiennent la préférence, et dont le prix est le plus élevé, on verra que, parmi les femmes, ce sont celles qui peuvent le plus facilement allumer les passions de leurs maitres, et que, parmi les hommes, ce sont également les mieux faits et les plus beaux. La quantité de travail qu’ils peuvent exécuter n’est, en général, qu’une considération secondaire; une jeune et belle fille qui, par les traits et la couleur, se rapproche de l’espèce des maîtres, se vendra deux fois plus qu’une négresse qui sera deux fois plus forte, mais qui aura des formes et une physionomie peu agréables. Cette seule circonstance est une preuve irrécusable que les possesseurs d’hommes entendent imposer à leurs esclaves d’autres obligations que celle de travailler; mais ces obligations ne sont pas de nature à être avouées, et nous pouvons ne pas en tenir compte.
Du fait reconnu qu’un homme est un homme, et que comme tel il a des devoirs moraux à remplir, il résulte que, lorsque l'individu que nous appelons un esclave, a livré, en nature ou en argent, la quantité de travail qu’il est tenu de payer à l’individu que nous appelons un maître, il ne lui doit plus rien. Dès ce moment, il ne dépend plus que des lois générales et des magistrats; s’il se rend coupable, il doit être poursuivi et puni comme tous les hommes; si, par sa bonne conduite et par son industrie, il acquiert quelques propriétés, elles doivent lui être garanties par les mêmes autorités qui garantissent celles des maîtres; son domicile doit être inviolable comme celui de tous les autres hommes; il est le protecteur de ses enfans et de sa femme; et si sa force ne lui suffit pas pour remplir ses devoirs de père ou de mari, c’est aux magistrats à y suppléer.72
En accordant à un individu asservi la faculté de livrer à son possesseur son travail ou la valeur de ce travail, on attaque de la manière la plus puissante le préjugé qui flétrit les occupations industrielles dans les pays exploités par des esclaves, et l’on fait prendre en même temps à la population asservie des habitudes d'activité et d’économie. L’homme qui, pendant quelques années, aura travaillé et fait des épargnes pour acquérir sa liberté, continuera de travailler et de faire des épargnes quand il sera devenu libre, pour assurer son indépendance et se ménager des ressources dans sa vieillesse. L’emploi de ce moyen produirait en peu de temps des effets très-considérables; il développerait l’intelligence de la population esclave; il formerait ses mœurs et ses habitudes; il lui donnerait des moyens d’existence, et formerait, pour les possesseurs des terres, une classe d’ouvriers intelligens et laborieux. Le commerce et l’industrie des métropoles y trouveraient également leur avantage; les productions équinoxiales seraient moins chères, et les demandes des produits manufacturés se multiplieraient, parce que le nombre des consommateurs serait plus grand. Il faut ajouter que les colonies pourraient bientôt se garder elles-mêmes, et qu'elles ne seraient plus une cause de ruine pour les nations auxquelles elles sont soumises.
Je ne me suis pas proposé d'exposer, dans ce chapitre, un projet d'affranchissement; j'ai voulu seulement démontrer que le système de l'esclavage repose sur un principe diamétralement opposé au principe de la liberté, et qu'il est impossible de passer d'un régime à l'autre, si l'on n'abandonne pas complètement le principe du premier pour adopter le principe du second. Le seul fait du changement de principes, il ne faut pas se le dissimuler, est une révolution complète; et tout procédé fondé sur ce changement et suivi avec persévérance, conduira promptement à l'abolition complète de l'esclavage. Si j'ai indiqué un mode particulier d'affranchissement, ce n'est pas parce que je l'ai considéré comme le seul bon, ou comme étant complet: je ne me suis proposé que de faire voir quelques-unes des principales conséquences auxquelles on était amené par le seul fait de changement de principes. Mais tant que l'on considérera comme une vérité l'erreur grossière sur laquelle repose l'esclavage, c'est vainement qu'on se débattra contre les conséquences; on pourra, pour les arrêter ou les affaiblir, employer beaucoup de temps, de talens et même de richesses; vaincues en théorie, elles triompheront dans la pratique.
L'affranchissement des esclaves, ou, pour parler avec plus de justesse, le frein mis aux passions et au pouvoir arbitraire des possesseurs d'hommes n'est pas un phénomène tellement nouveau qu'on ne puisse pas être éclairé par l'expérience. Dans un espace de quarante années, on a vu six exemples d'un grand nombre d'esclaves affranchis en masse, sans qu'il soit jamais résulté aucun inconvénient de leur affranchissement.73 Les affranchis ont toujours eu une conduite plus régulière que les maîtres. J'en ai fait voir ailleurs les raisons.
PART III. The July Monarchy (1830–48)
20. Dunoyer on “Political Place-Seeking” (1830)↩
[Word Length: 7,670]
Source
Dunoyer, Charles, Nouveau traité d'économie sociale, ou simple exposition des causes sous l'influence desquelles les hommes parviennent à user de leurs forces avec le plus de LIBERTÉ, c'est-à-dire avec le plus FACILITÉ et de PUISSANCE (Paris: Sautelet et Mesnier, 1830), vol. 1, Cap. X, pp. 365-405.
CHAPITRE X. Liberté compatible avec la vie des peuples chez qui nulle classe n'a plus de privilèges, mais où une portion considérable de la société est emportée vers la recherche des places.
§ 1. Une grande révolution, opérée en France il y a quarante ans, y détruisit, à peu près radicalement, l'ordre social que je viens de décrire. Toutes les distinctions d'ordre furent effacées, toutes les hiérarchies artificielles abolies, toutes les influences subreptices annulées, toutes les corporations oppressives dissoutes.
Il ne faut pourtant pas dire, comme on l'a fait si souvent et si faussement, que l'on passa le niveau sur les têtes. Il ne fut sûrement pas décidé que les hommes de six pieds n'en auraient que cinq, que la vertu serait abaissée au niveau du vice, que la sottise aurait sa place à côté du génie, que l'ignorance et le dénuement obtiendraient dans la société le même ascendant que la richesse et les lumières: bien loin de chercher à détruire les inégalités naturelles, on voulut, au contraire, les faire ressortir en ôtant les inégalités factices qui les empêchaient de se produire.
C'étaient les hommes du régime précédent, c'étaient les apôtres du privilège, qui avaient été de vrais niveleurs. Dans leurs classifications arbitraires et immuables, ils ne tenaient aucun compte des prééminences réelles, et ils voulaient que l'on fût grand ou petit, bon ou mauvais, habile ou sot, par droit de naissance. C'est contre cette égalisation absurde et forcée que fut dirigée la révolution: elle brisa le niveau que des mains oppressives tenaient abaissé sur les masses; et, sans prétendre assigner de rang à personne, elle voulut que chacun pût devenir tout ce que légitimement il pourrait être, et ne fût jamais dans le droit que ce qu'il serait dans la réalité.
Le moyen qu'elle prit pour arriver à ce but était simple: il fut décidé tout uniment que nul ne pourrait être gêné dans l'usage inoffensif de ses facultés naturelles; que toutes les carrières paisibles seraient ouvertes à toutes les activités; que toutes les professions, tous les travaux, tous les services légitimes seraient livrés à la concurrence universelle. C'est en cela que consistait le nouvel ordre social qu'elle proclama.74
§ 2. Que la liberté existât virtuellement au fond d'un tel ordre de choses, c'est ce qui ne paraît pas pouvoir être mis en doute. Cet ordre nouveau permettait, en quelque sorte, aux facultés humaines de prendre un développement illimité; assurait le progrès des mœurs, par cela même qu'il assurait celui des lumières et du bien-être; il excluait enfin toute violence. Mais en même temps il froissait trop d'intérêts illégitimes pour qu'il pût aisément s'établir; et, d'ailleurs, il y avait dans les mœurs publiques une passion, parmi beaucoup d'autres, qui seule aurait suffi pour l'empêcher de se fonder, quand même il n'aurait pas rencontré dans celles qu'il comprimait une aussi grande résistance. Je veux parler de l'amour des places et de cette tendance presque universelle qu'on avait contractée de chercher l'illustration et la fortune dans le service public.
Que le public eût considéré le gouvernement, la police du pays, son administration, sa défense, comme une chose qui intéressait les citoyens, qui les regardait tous et sur laquelle il importait qu'ils eussent tous les yeux ouverts; qu'il l'eût envisagé comme une entreprise d'intérêt public, qu'il fallait adjuger aux plus dignes et aux meilleures conditions possibles, comme tous les travaux publics, ce n'est pas là qu'eût été le mal, et ce n'est pas la chose que je signale.
Mais, en pensant qu'en effet on devait, sans nulle distinction de naissance, adjuger le service public aux meilleurs citoyens et aux conditions les meilleures pour la société, chacun songeait un peu à y prendre une part directe et aux meilleures conditions pour soi; chacun, à l'imitation des classes qu'on en avait dépouillées, était assez disposé à l'envisager comme une ressource; chacun voulait y puiser quelque chose de la richesse et du lustre qu'il avait toujours répandus sur ses possesseurs. Toutes les professions étaient déclarées libres; mais c'était vers celle-là, de préférence, que se dirigeait l'activité; la tendance des idées et des mœurs était d'en faire en quelque sorte un moyen général d'existence, une carrière immense, ouverte à toutes les ambitions. Or, c'était cette tendance qui seule aurait suffi pour dénaturer le nouvel ordre social, quand toutes les passions de l'ancien régime ne se seraient pas liguées pour le détruire.75
§ 3. On sait d'où était venue cette disposition. Quoique les classes laborieuses eussent acquis diverses sortes de privilèges, la position sociale des classes gouvernantes était restée, comme je l'ai dit, incomparablement la meilleure. Leurs professions étaient celles qui conduisaient le plus sûrement et le plus rapidement à la fortune; elles étaient les seules, d'ailleurs, qui donnassent l'illustration. L'industrie, en passant dans le domaine royal, n'avait pas cessé d'être roturière: c'était déroger que de faire le commerce; il n'y avait de nobles que les travaux de service public. Ainsi l'avaient décidé les classes qui s'en étaient réservé le monopole; et, à cet égard comme à beaucoup d'autres, c'était d'elles encore que le publie recevait ses idées. Il y avait donc toute raison pour qu'on préférât le pouvoir à l'industrie: aussi la tendance avait-elle été, de tout temps, d'abandonner les professions privées pour l'exercice des fonctions publiques. Les classes laborieuses n'étaient pas encore assez avancées pour comprendre que la dignité véritable n'est pas tant dans la profession qu'on exerce que dans ce qu'où y apporte de lumières et de sentimens élevés; elles ne voyaient de gloire qu'à se rapprocher des classes dominatrices, qu'à leur appartenir, qu'à participer à leurs privilèges; il était fort peu d'hommes, parmi elles, qui ne fussent prêts à troquer contre un titre, un brevet, un emploi public, la fortune qu'ils avaient péniblement acquise dans l'exercice des professions privées; on allait de toutes parts au-devant de ces sortes d'échanges, et le pouvoir avait beau multiplier les offices, il ne suffisait qu'à grand'peine à l'empressement des solliciteurs: « Le roi, disait Colbert, ne peut pas créer une charge, que Dieu, tout aussitôt, ne crée un sot pour l'acheter. »
« Où l'abus des places s'est-il étendu plus loin qu'aujourd'hui en France? écrivait le marquis d'Argenson, il y a près d'un siècle. Tout y est emploi, tout s'en honore, et tout vit des deniers publics. Gens de finance et de robe, administrateurs, politiques, gens de cour, militaires, tout prétend satisfaire son luxe par des emplois, et des emplois très-lucratifs. Les jeunes gens ne savent que faire s'ils n'ont pas de charge. Il faut donc que tout le monde se mêle d'administration: par-là l'État est perdu. Chacun veut dominer le public, rendre service, dit-on, au public, et personne ne veut être de ce public. Les abus sensibles de cette vermine augmentent chaque jour, et tout dépérit. »76
Le marquis d'Argenson faisait ces remarques en 1735, quelques années après qu'il fut appelé au ministère. Depuis, l'abus dont il se plaignait ne fit que croître. A mesure que le tiers-état devint plus puissant et plus riche, les fonctions publiques furent plus convoitées, et chaque jour on conçut plus d'aversion et de jalousie contre les privilèges des classes qui en faisaient le monopole.
§ 4. On conçoit donc avec quelle impétuosité la multitude dut se porter vers le pouvoir, lorsque La révolution vint renverser les barrières qui en défendaient l'approche au grand nombre, et le déclarer accessible à tous.77 Il était odieux, il était criant que quelques familles eussent joui seules jusqu'alors de ses avantages. La justice voulait que tout le monde y eût part; et au lieu de le considérer, ainsi que le prescrivait la raison, comme une chose indispensable sans doute, mais naturellement onéreuse, et à laquelle il était désirable que la société n'eût à appliquer que le moins possible de son temps, de son activité et de ses ressources, on fut réduit à l'envisager comme une source commune de bénéfices, où chacun devait pouvoir aller puiser, et d'où en effet un nombre immense de personnes voulurent bientôt tirer leur subsistance.78
« Du sein du désordre et de l'anarchie, dit un publiciste, on vit sortir une nuée de petits administrateurs despotes, couverts de l'encre et de la poussière des dossiers, la plume sur l'oreille, le considérant à la bouche. Cette armée dressa ses bureaux en manière de tente sur toute la surface de la France. C'est à tort qu'on en attribue la création à Napoléon; lorsqu'il parut, elle était déjà en pleine activité... Mais Napoléon n'eut garde de détruire un ordre de choses qui servait merveilleusement la centralisation du pouvoir, et paralysait toutes les indépendances particulières. »79
Bien loin de combattre les passions ambitieuses et cupides, le chef du gouvernement s'appliqua à les enflammer; il en fit son principal moyen d'élévation et de fortune; il agit constamment comme si la nation, en proclamant l'égale admissibilité de tous les citoyens à tous les emplois, n'avait voulu qu'étendre à tous le droit de tirer sa fortune du public, qui avait été précédemment le patrimoine d'une classe. Il est vrai qu'on n'était que trop disposé à sentir ainsi l'égalité. On l'a encore été davantage après la chute de l'empire. Nous avons vu le plus libéral de nos ministères, le ministère de 1819, entreprendre de justifier l'énormité des dépenses publiques, en disant que l'égalité politique devait nécessairement enchérir le gouvernement.80 Nous avons vu les écrivains les plus recommandables excuser et presque défendre la disposition du public à prospérer par l'industrie des places. Qu'importe, après tout, semblaient-ils dire, que le personnel du gouvernement soit plus ou moins nombreux, que son action s'exerce avec plus ou moins d'intensité et d'étendue, que ses dépenses soient plus ou moins considérables, si d'ailleurs il est conforme à l'esprit de la société, si sa conduite est droite et dirigée au bien public? « La véritable économie ne se laisse pas toujours réduire en chiffres. Il y en a beaucoup à élire ses députés, à discuter ses lois, à jouir de la sûreté des personnes et des biens, de la liberté de la presse, lors même que la machine qui procure ces avantages coûte fort cher. »81
§ 5. Les objections se présentent en foule contre cette doctrine. Je vais m'attacher à une seule qui les renferme toutes. Il y a économie, dit-on, à dépenser beaucoup en frais de gouvernement, si l'on obtient, à la faveur de cette dépense, la sûreté des personnes et des biens, la liberté de l'industrie et de la pensée. Mais la question est justement de savoir si, lorsqu'un gouvernement coûte fort cher, il peut procurer ces avantages; s'il n'est pas contradictoire de vouloir à la fois être libre, et dépenser beaucoup en frais de gouvernement. C'est ce que ne se demandent pas les honorables publicistes dont je parle, et c'est pourtant ce qu'il serait essentiel d'examiner. C'est aussi la recherche que je vais faire. Mon objet ici est de savoir quelle est la liberté dont peut jouir un peuple qui a aboli tout privilège, déclaré toute profession libre, mais dont l'activité reste particulièrement tournée vers l'exercice du pouvoir, qui dépense en frais d'administration et de gouvernement une portion très-considérable de son temps, de ses capitaux, de son intelligence, de ses forces.
§ 6. J'accorderai volontiers que cette nouvelle manière d'être comporte plus de liberté que celle qui a été décrite dans mon dernier chapitre. Par cela seul que toutes les distinctions de caste y sont abolies, que nulle corporation n'y fait le monopole d'aucune sorte de travaux, que toutes les professions y sont livrées à la concurrence; il est aisé d'apercevoir que les facultés humaines y doivent prendre plus d'essor, que les mœurs y doivent devenir plus pures, qu'elles y doivent être moins violentes; que par conséquent il y doit avoir, de toute manière, plus de liberté.
L'état de la France depuis le commencement de la révolution offre de ceci des preuves éclatantes. Ce qu'elle a gagné en industrie, en lumières, en richesses, par le seul fait de l'abolition des corporations et des privilèges, et malgré les obstacles qu'ont mis à ses progrès la passion des places et le régime dispendieux et oppressif qu'il est dans la nature de cette passion de faire naître, est véritablement incalculable. Elle a donc fait, sous ce premier rapport, de grands progrès en puissance et en liberté.
En même temps que ses habitans ont acquis plus de lumières et de bien-être, ils ont pris de meilleures mœurs. C'est un fait que tout observateur impartial sera disposé à reconnaître. Il n'est pas d'homme de bonne foi qui, ayant vu les Français sous l'ancien régime, et les comparant à ce qu'ils sont devenus depuis la révolution, ne convienne qu'ils sont aujourd'hui plus occupés, plus actifs, plus soigneux de leurs affaires, mieux réglés dans leurs dépenses, moins livrés au libertinage, au faste, à la dissipation, plus capables, en un mot, de faire, par rapport à eux-mêmes, un usage judicieux et moral de leurs facultés. Ils sont donc encore, sous ce rapport, devenus beaucoup plus libres.
Enfin, ils sont devenus plus libres aussi parce qu'ils se sont fait réciproquement moins de violence, parce que des uns aux autres ils ont usé plus équitablement de leurs facultés. Il n'a plus été au pouvoir d'un homme d'empêcher qu'un autre ne pût gagner honnêtement sa vie. Nul n'a élevé la prétention de faire exclusivement ce qui ne nuisait à personne, et ce qui, par cela même, devait être permis à tous. Ce que ce changement a fait tomber d'entraves; ce qu'il a fait cesser d'oppositions, de haines, de rivalités, de procès, de guerres intestines; ce que, par cela même, il a mis de facilité et de liberté dans les actions individuelles et dans les relations sociales ne pourrait être que très-difficilement et très-imparfaitement apprécié.
Je pourrais, si je voulais insister, donner de la vérité de ces résultats des preuves de détail innombrables. Mais d'abord les progrès de notre puissance industrielle sont si patens, que nul ne songe à les contester; et, quant à ceux de nos mœurs, sont-ils moins évidens parce qu'on est plus disposé à les mettre en doute? Il est des traits auxquels on les reconnaît aisément. Que sont devenus tous ces poètes licencieux qui faisaient autrefois les délices de la meilleure compagnie? Pourquoi les Boufflers, les Parny, les Bertin, les Gentil-Bernard, les Piron, n'ont-ils pas un successeur dans nos jeunes poètes? c'est que le libertinage n'est plus de bon ton. Les liens de famille sont plus forts, plus respectés: il n'est plus plaisant de porter le désordre dans un ménage; on rit moins des maris trompés; on méprise davantage les suborneurs: qui cherche aujourd'hui à passer pour un homme à bonnes fortunes? D'une autre part, les dépenses sont plus sensées: si l'on n'a pas encore une probité politique bien sévère, si l'on n'est pas très-délicat sur les moyens de tirer de l'argent du public, du moins dissipe-t-on moins follement celui qu'on lui vole. Tout possesseur de sinécures songe à économiser; les courtisans font des épargnes; on ne bâtit plus de grands châteaux; on démolit beaucoup de ceux qui restaient. Les grands seigneurs ne traînent plus à leur suite cette nombreuse valetaille, qui débauchait par passe-temps les paysannes de leurs terres et des autres lieux où ils passaient. La dépense pour le logement, la table, les vêtemens, le service domestique, est infiniment mieux entendue. Voilà pour ce qui est des habitudes privées. Quant à la morale de relation, les progrès ne sont pas moins manifestes. On est peut-être moins cérémonieux, moins complimenteur; mais on se respecte mutuellement davantage; les hommes de tous les rangs ont plus de valeur. Surtout on méprise et on maltraite moins les classes inférieures: de beaux messieurs ne s'aviseraient pas aujourd'hui de distribuer des coups de canne à des cochers de fiacre, comme il était de bel air de le faire, et comme on le faisait impunément, à Paris, avant la révolution. On ne vit plus dans la même familiarité avec son valet de chambre; mais, si on ne le met pas dans le secret de ses faiblesses, on ne le traite pas non plus avec la même dureté. On a cessé également de faire des confidences à ses gens et de les battre: on est beaucoup plus, à tous égards, dans la mesure de la justice et des convenances envers ses inférieurs. En même temps, il y a infiniment moins de distance entre toutes les classes: personne, il y a quarante ans, n'eût osé prendre le costume d'un état supérieur au sien; un notaire n'était pas reçu dans les bonnes maisons; à peine un homme riche admettait-il son médecin à sa table; l'agent de change du trésor royal n'osait se permettre le carrosse, et allait en voiture de place, quoiqu'il fût riche à millions, etc., etc. Tout cela est bien changé. Nous sommes tous vêtus de la même manière; nous recevons tous la même éducation: le fils du prince du sang et celui du riche épicier fréquentent les mêmes écoles, et concourent pour le même prix. Aucune classe, aucune profession n'est tenue dans un état de dégradation systématique; nous ne distinguons plus les hommes que par le degré de culture. Sans doute l'homme riche ne fait pas sa société du crocheteur, du porte-faix; mais ce n'est pas que leur travail lui semble méprisable, c'est que leurs esprits sont différens, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes mœurs, le même langage. Il n'est pas d'utile profession qui ne paraisse honorable, exercée par des hommes capables de l'honorer.
Il n'est donc pas douteux que, depuis l'abolition de l'ancien régime, depuis la suppression des ordres, des corporations, des privilèges, des monopoles, on n'ait fait, en général, de ses forces un usage plus étendu et mieux réglé, et qu'on ne soit devenu par conséquent beaucoup plus libre.
§ 7. Mais, en même temps, il faut reconnaître que la convoitise des places a beaucoup diminué les effets de cette grande réforme, et en général qu'il y a dans cette passion, surtout lorsqu'elle est devenue très-commune, d'immenses obstacles à la liberté. Commençons par observer le changement qu'elle produit dans l'économie de la société, et l'ordre de choses tout nouveau qu'elle tend à substituer à l'ancien régime des privilèges.
Dans ce nouvel étal social, il n'y aura plus de classes, d'ordres, de corporations, de communautés; mais, à la place de ces agrégations diversement privilégiées, la passion que je signale va élever une administration gigantesque qui héritera de tous leurs privilèges; ce qui était affaire de corps deviendra affaire de gouvernement; une multitude de pouvoirs et d'établissemens particuliers passeront dans le domaine de l'autorité politique.82 Cet effet est naturel, il est inévitable, on l'a assez pu voir chez nous. A mesure que les passions ambitieuses ont attiré plus d'hommes vers le pouvoir, le pouvoir a graduellement étendu sa sphère. Il a multiplié non-seulement les emplois, mais les administrations. On compterait difficilement le nombre de régies qu'il a créées pour ouvrir des débouchés à la multitude toujours croissante des hommes zélés, et surtout désintéressés, qui demandaient à se vouer à la chose publique: régie des tabacs, des sels, des jeux, des théâtres, des écoles, du commerce, des manufactures, etc. Il a peu à peu étendu son action à tout; il s'est ingéré dans tous les travaux avec la prétention de les régler et de les conduire. On n'a plus trouvé sur son chemin les syndics des corporations; mais on a eu devant soi les agens de l'autorité. Dans les champs, dans les bois, dans les mines, sur les routes, aux frontières de l'État, aux barrières des villes, sur le seuil de toutes les professions, à l'entrée de toutes les carrières, on les a rencontrés partout. Le premier effet de la passion des places a été de les multiplier au-delà de toute mesure: cette passion a fait prendre à l'autorité centrale des développemens illimités.
Cet effet en a entraîné d'autres. Plus les attributions du pouvoir se sont étendues, et plus les dépenses ont dû s'élever. En même temps que le personnel de toutes les administrations s'est augmenté, les frais de tous les services se sont accrus. Il serait long de considérer ces accroissemens de dépense dans tous leurs détails; mais observons-les dans leur ensemble. C'est sûrement une chose curieuse que de suivre la filiation des lois de finance depuis le commencement de ce siècle, et de voir comment, d'un budget énorme, il est né tous les ans un budget un peu plus colossal. De 1802 à 1807, les dépenses se sont élevées de 500 millions à 720; elles ont été de 772 en 1808, de 788 en 1809, de 795 en 1810; elles ont atteint un milliard en 1811; elles l'ont passé de 30 millions en 1812, et de 150 millions en 18i3. En 1814, la France, rendue à la paix et à ses anciennes limites, n'a pas pu ne pas réduire ses frais de gouvernement; cependant, ces frais sont restés proportionnellement plus considérables, et le budget a toujours continué a suivre son mouvement de progression: de 791 millions en 1815, il a été de 884 en 1816. d'un milliard 69 millions en 1817, et a touché à 1,100 millions, en 1818. Rendu, alors, par le départ des étrangers, à des proportions moins effrayantes, il est pourtant resté beaucoup plus fort qu'il ne l'était avant leur arrivée; et, tandis qu'il ne s'était élevé qu'à 791 millions en 1815, il s'est trouvé de 845 en 1819, de 875 en 1820, de 896 en 1821, de plus de 912 en 1822, et voilà qu'il dépasse encore un milliard; c'est-à-dire que les dépenses sont redevenues aussi fortes qu'elles l'étaient en 1812, lorsque la France mettait l'Europe à contribution, qu'elle était d'un grand tiers plus étendue, qu'elle touchait à Lubeck et à Rome, qu'elle avait six cent mille hommes sous les armes, et qu'elle faisait la guerre sous Cadix et à Moscou.83
Où le chapitre des dépenses croît ainsi, on sent que celui des voies et moyens resterait difficilement stationnaire. Il n'y aura pas d'expédient dont on ne s'avise pour tâcher de soutirer tous les ans au public un peu plus d'argent. Aucune source ne paraîtra assez impure pour qu'on rougisse d'y puiser; aucun impôt, assez immoral pour qu'on craigne de le fonder ou de le maintenir. Toutes les denrées, toutes les industries, toutes les transactions, toutes les jouissances, tous les mouvemens, pour ainsi dire, seront soumis à quelque genre de rétribution. On imaginera de se faire une ressource de l'arriéré, et d'enfler ses dettes pour pouvoir accroître ses dépenses. On percevra, sous divers prétextes, des rétributions qu'aucune loi n'aura autorisées. Le génie de la fiscalité, pour surprendre les revenus du public, revêtira successivement toutes les formes. Non content d'épuiser les revenus, il se mettra, par des emprunts, à attaquer les capitaux, et l'on pourra voir, en peu d'années, croître de plusieurs milliards la dette nationale.84
Ce n'est pas tout. A mesure que les passions cupides étendront ainsi les empiétemens et les dépenses, elles voudront, pour se mettre plus à l'aise, pervertir toutes les institutions. Plus elles tendront à rendre l'administration fiscale, et plus elles seront intéressées à rendre le gouvernement despotique. On les verra, à chaque nouvelle révolution, à chaque changement de régime, s'efforcer de corrompre ou de fausser tous les pouvoirs, créer des lois d'élection frauduleuses, interdire la discussion aux corps délibérans, ôter la publicité à leurs séances, transformer les jurys en commissions, substituer des juges prévôtaux à la justice régulière, livrer l'élection des conseils généraux et municipaux aux fonctionnaires responsables, que ces conseils doivent surveiller; ne pas se donner de relâche enfin qu'elles n'aient subjugué tous les corps destinés à protéger les citoyens, et ne les aient convertis en instrumens d'oppression et de pillage.
Ajoutons, pour compléter le tableau de ce régime, qu'avec lui et par lui se fortifieront les passions qui l'engendrent, et qui sont les plus propres à le perpétuer. Plus s'agrandit la carrière des places, et plus les places sont avidement recherchées. Il arrive à cet égard ce qui arrive à l'égard de toute branche d'industrie qui vient à ouvrir de nombreux débouchés à l'activité générale: la foule se tourne naturellement de ce côté. Il y a même une raison pour qu'on se porte vers le pouvoir avec plus d'empressement qu'on ne ferait vers aucune autre profession. Il faut, pour se pousser dans les voies de l'industrie, des talens et des qualités morales qui sont loin d'être également indispensables dans les voies de l'ambition. Le hasard, l'intrigue, la faveur, disposent d'un grand nombre d'emplois. Dès lors, il n'est plus personne qui ne croie pouvoir en obtenir; le gouvernement devient une loterie dans laquelle chacun se flatte d'avoir un bon lot; il se présente comme une ressource à qui n'en a point d'autre; tous les hommes sans profession prétendent en faire leur métier, et une multitude presque innombrable d'intrigans, de désœuvrés, d'honnêtes et de malhonnêtes gens, se jettent pêle-mêle dans cette carrière, où bientôt il se trouve mille fois plus de bras qu'il n'est possible d'en employer.
Enfin, tandis que ce régime va fomenter dans tous les rangs de la société la cupidité qui l'a fait naître, il détruit partout le désintéressement et le courage qui seraient capables de le réformer. Ne cherchez ici ni esprit public, car il n'y a pas de public; ni esprit de corps, car il n'y a plus de corps; ni indépendance individuelle, car que peuvent être les individus devant le colosse formidable que l'ambition universelle a élevé? De même que tous les corps se sont fondus dans une corporation, toutes les volontés semblent s'être réduites à une seule. Il n'y a de personnalité, d'existence propre, que dans l'administration. Hors de là, rien qui vive, qui se sente, qui résiste: ni individus, ni corps constitués. N'espérez pas que des pouvoirs élevés, n'allez pas croire qu'un Tribunat, un Corps Législatif, un Sénat, mettent à défendre les intérêts du public le courage que, dans d'autres temps, les corporations les plus faibles et les plus obscures mettaient à garder leurs privilèges particuliers: l'esprit de sollicitation qui a envahi les derniers rangs de la société règne dans les ordres supérieurs avec encore plus d'empire; électeurs, députés, sénateurs, tout est descendu au rôle de client, et les postes les plus éminens ne sont envisagés que comme des positions particulières où l'intrigue a plus de chances de fortune, et où les bassesses sont mieux payées.
Voici donc ce que la passion qui a été de nos jours la plus populaire, la passion des places, tend naturellement à produire: sous le nom d'administration, je ne sais quel corps monstrueux, immense, étendant à tout ses innombrables mains, mettant des entraves à toutes choses, levant d'énormes contributions, pliant par la fraude, la corruption, la violence, tous les pouvoirs politiques à ses desseins, soufflant partout l'esprit d'ambition qui le produit, et l'esprit de servilité qui le conserve… Il ne s'agit plus que d'examiner ce que, sous l'influence de ce corps et des passions qui l'ont créé et qui le font vivre, il est possible d'avoir de liberté; ce que peuvent être l'industrie, les mœurs, les relations sociales, et, en général, toutes les choses d'où nous savons que dépend l'exercice plus ou moins libre de nos facultés.
§ 8. Je reconnaîtrai de nouveau que l'industrie est ici moins comprimée que sous le régime des privilèges: le pouvoir ne lui oppose pas autant d'entraves que lui en opposaient les corporations; il n'est pas aussi porté à resserrer ses mouvemens, et n'y met pas le même zèle. Cependant que d'obstacles ne trouve-t-elle pas encore dans ce nouvel état!
Observez d'abord que, plus ici l'esprit d'ambition est fort, et plus l'esprit d'industrie y doit demeurer faible. Ces deux esprits ne sauraient animer à la fois la même population. Ils ne diffèrent pas seulement, ils sont contraires: le goût des places exclut les qualités nécessaires au travail. On n'a pas assez remarqué à quel point l'habitude de vivre de traitemens peut détruire en nous toute capacité industrielle. J'ai vu des hommes remplis de talent et d'instruction pratique s'affecter profondément de la perte d'un emploi qui était loin de leur donner ce qu'ils auraient aisément pu gagner par l'exercice d'une profession indépendante. La possibilité de se créer une fortune par un usage actif et soutenu de leurs facultés productives ne valait pas, à leurs yeux, le traitement exigu, mais fixe et assuré, qu'ils avaient perdu. Ils ne supportaient pas l'idée d'être chargés d'eux-mêmes, de se trouver responsables de leur existence, d'avoir à faire les efforts nécessaires pour l'assurer; et avec des facultés réelles et puissantes, ils ne savaient de de quoi s'aviser pour subvenir à leurs besoins. Ils étaient comme ces oiseaux élevés dans la captivité, et qui n'ont jamais eu à s'occuper du soin de leur nourriture: si on leur donnait la liberté, ils ne sauraient comment vivre, et seraient exposés à périr au milieu des moissons.85
Le goût des places altère donc profondément les facultés industrielles du peuple qui en est infecté. Il détruit en lui l'esprit d'invention et d'entreprise, l'activité, l'émulation, le courage, la patience, tout ce qui constitue l'esprit d'industrie.
Il est, sous ce rapport, d'autant plus nuisible, qu'il domine principalement les classes supérieures, et qu'il prive ainsi les arts utiles du concours des hommes qui pourraient le plus contribuer à leur avancement.
Et il ne leur nuit pas seulement en leur enlevant le secours des classes que leur fortune et leur position sociale mettraient le mieux à même de les servir, il leur fait un tort encore plus grave, peut-être, en ce sens qu'il détourne d'eux une portion beaucoup trop considérable de la population.86
Joignez que les hommes dont il les prive sans nécessité ne sont pas seulement annulés, mais rendus nuisibles: leur activité n'est pas uniquement dérobée à l'industrie, elle est dirigée contre elle. Comme les offices nécessaires ne peuvent suffire à les occuper, il en faut créer d'inutiles, de vexatoires, dans lesquels ils ne font que gêner les mouvemens de la société, troubler ses travaux et retarder le développement de sa richesse et de ses forces.
C'est peu de leur enlever les hommes, il leur fait perdre aussi les capitaux. Chaque nouvelle création d'emplois entraîne une création correspondante de taxes nouvelles, et l'industrie, déjà privée des services des individus que l'ambition jette sans nécessité dans la carrière des places, est encore obligée de faire les fonds nécessaires pour entretenir ces individus dans leur nouvel emploi.
Notez encore que ces fonds, de même que ces individus, ne sont pas seulement perdus pour l'industrie, mais employés contre elle. Ils servent à gager non des oisifs, non des possesseurs de sinécures (il n'y aurait que moitié mal), mais des hommes à qui on veut faire gagner leur argent, et dont l'activité s'épuise en actes nuisibles; de sorte qu'elle est dépouillée de capitaux considérables, et qui contribueraient puissamment à ses progrès, pour voir, en retour, son développement contrarié de mille manières.
Enfin, comme de lui-même un tel ordre aurait quelque peine à se maintenir, il faut, pour le mettre à l'abri de toute réforme, arrêter autant que possible l'essor de la population; détruire en elle toute capacité politique, tout esprit d'association, toute aptitude à faire elle-même ses affaires; empêcher, du mieux qu'on peut, qu'elle n'apprenne à lire, qu'elle ne s'instruise, qu'elle ne parle, qu'elle n'écrive; et l'industrie, déjà très-affaiblie par l'argent qu'on lui prend et les fers qu'on lui donne, se trouve encore privée de ce que l'activité de l'enseignement, celle des débats publics et l'esprit d'association sous toutes ses formes pourraient lui communiquer de force et de liberté.
Je ne prétends point donner ici une idée complète du dommage que cause à l'industrie la fureur des places; il faudrait pour cela connaître la quantité d'hommes qu'elle détourne inutilement de ses travaux, et pouvoir dire en même temps ce que ceux-là mettent d'obstacle à l'activité de tous les autres; il faudrait savoir ce qu'ils leur enlèvent de fonds, ce qu'ils leur imposent de gênes, ce qu'ils leur font souffrir de violences; il faudrait pouvoir estimer le temps qu'ils leur font perdre, les distractions qu'ils leur causent, le découragement qu'ils leur inspirent. Tout cela n'est guère susceptible d'évaluation; mais quand je dirais que, par l'ensemble des lois fiscales et des mesures compressives que la passion que je signale a fait établir en ce pays, la puissance productive de ses habitans a été quelquefois réduite de moitié, je ne sais si je ferais une estimation bien exagérée du sous ce rapport, elle lui cause.87
§ 9. Si tel est le tort que cette passion fait aux arts, elle n'est guère moins funeste à la morale. Quand elle n'aurait d'autre effet que de retarder les progrès de la richesse et de l'aisance universelle, elle serait déjà un grand obstacle au perfectionnement des mœurs; mais elle va directement à les corrompre, parce qu'elle enseigne de mauvais moyens de s'enrichir. Des citoyens elle fait des courtisans; elle étend les vices de la cour à toute la partie de la société qui a quelque instruction et quelque activité politique; où devrait régner l'industrie elle fomente l'ambition; à l'activité du travail elle fait succéder celle de l'intrigue; un ton obséquieux, des habitudes uniformément ministérielles, se communiquent à tous les rangs de la société: flatter, solliciter, mendier, n'est plus le privilège d'une classe, c'est l'occupation de toutes; plus il y a de gens qui se vouent à ce métier, et plus, pour l'exercer avec fruit, il y faut déployer de savoir-faire: on met de l'émulation dans la bassesse; on s'évertue à s'avilir, à se prostituer. Les mœurs, sous d'autres rapports, ne sont pas meilleures; à la servilité des courtisans on joint leurs habitudes licencieuses, leur goût du faste et de la dissipation; la débauche se propage sous le nom de galanterie; le luxe accompagne la luxure; on est guidé dans ses dépenses, non par ce désir éclairé d'être mieux, c'est-à-dire plus sainement, plus commodément, plus confortablement, qui naît des habitudes laborieuses et qui les encourage, mais par le vain désir de briller, d'en imposer aux yeux: on n'aspire pas à être, mais à paraitre. Il a été aisé d'observer la plupart de ces effets du temps de l'empire, à cet âge classique de l'ambition, où l'amour des places régnait sans partage, où chacun voulait être quelque chose, et où l'on n'était quelque chose que par les places; où la recherche et l'exploitation des places étaient la principale industrie du pays, la véritable industrie nationale. On a pu voir alors, dis-je, ce que cette industrie peut mettre de frivolité, de corruption, et surtout de servilité dans les habitudes d'un peuple: notre caractère retient encore, à plus d'un égard, les fâcheuses empreintes qu'il reçut en ce temps, et il faudra plus d'une génération pour qu'elles s'effacent.
§ 10. Autant enfin la passion dont j'expose ici les effets peut introduire de dépravation dans les mœurs, autant elle porte de trouble dans les relations sociales. Où domine l'amour des places, les places ont beau se multiplier, le nombre en est très-inférieur à celui des ambitieux qui les convoitent. Dès lors, c'est à qui les aura; aucun parti ne se croit obligé d'y renoncer en faveur d'aucun autre. Bien des gens s'abstiendraient d'y prétendre, si l'on consultait pour les établir l'intérêt du public, qui en veulent leur part, comme tout le monde, du moment qu'elles n'existent que pour satisfaire les ambitions privées. « Puisque la destination du pouvoir est de faire des fortunes, il doit faire la mienne ainsi que la vôtre; s'il n'est qu'une mine à exploiter, pourquoi ne l'exploiterais-je pas aussi bien que vous? Allons, monsieur, vous avez assez rançonné le public; c'est maintenant mon tour; ôtez-vous de là que je m'y mette...; » et voilà la guerre au sujet des places. L'effet le plus inévitable du vice honteux que je dénonce, surtout quand il est devenu très-général, comme c'est ici mon hypothèse, est de faire naître des partis qui se disputent opiniâtrement le pouvoir; et, comme aucun de ces partis ne le recherche que pour l'exercer à son profit, un autre effet de la même passion est de rendre le public également mécontent de tous les partis qui s'en emparent, et de le disposer à faire cause commune avec tous ceux qui ne l'ont pas, contre tous ceux qui le possèdent.
Enfin la passion des places peut agrandir encore le cercle des discordes qu'elle suscite, et à des luttes intestines faire succéder la guerre extérieure. Mère de gouvernemens despotiques, elle donne aussi naissance à des gouvernemens conquérans: c'est elle qui a détourné notre révolution de sa fin, qui a fait dégénérer en guerres d'invasion une guerre de liberté et d'indépendance, qui a fourni des instrumens à Bonaparte pour la conquête et la spoliation de l'Europe, comme elle lui en fournissait pour le pillage et l'asservissement de la France. Il suffit qu'elle élève, en chaque pays, le nombre des ambitieux fort au-dessus de ce qu'il est possible de créer de places, pour qu'elle donne à tout gouvernement qui consent à la satisfaire un intérêt puissant à étendre sa domination, et devienne ainsi, entre les peuples, une cause très-active de dissensions et de guerres.
§11. Cette passion est donc également funeste à l'industrie, aux mœurs, à la paix, à tout ce qui facilite, affermit, étend l'exercice de nos forces. Pour apercevoir d'un coup d'œil à quel point elle lui est contraire, il n'y a qu'à considérer ce qu'elle fait perdre annuellement à l'industrie d'hommes et de capitaux; ce que, par cette dépense énorme et sans cesse renouvelée, elle apporte de retard au développement de nos richesses intellectuelles et matérielles; ce que le pernicieux emploi qu'elle fait faire de ces moyens ravis à notre culture ajoute encore d'obstacles au développement de nos facultés; comment, en arrêtant le progrès de nos idées en général, elle arrête celui de nos idées morales; comment, en nous forçant à rester pauvres, elle fait que nos goûts demeurent grossiers; quel trouble elle met dans nos relations mutuelles; combien elle soulève d'ambitions, combien elle fait naître de partis, quel aliment elle fournit à leurs haines jalouses, quelles luttes homicides elle provoque entre eux, quelle discorde elle entretient entre les citoyens et la puissance publique, quelle extension enfin elle donne quelquefois aux querelles qu'elle suscite, et comment des dissensions d'un seul pays elle peut faire des guerres européennes, universelles.
§ 12. Il y a deux manières de sortir de l'état social que cette passion a produit parmi nous. La première serait de retourner au régime des privilèges, c'est-à-dire à un état où le droit de s'enrichir par l'exercice de la domination serait, comme autrefois, le privilège d'une classe. La seconde est d'arriver au régime de l'industrie, c'est-à-dire à un état où ce droit ne serait le privilège de personne; où ni peu ni beaucoup d'hommes ne fonderaient leur fortune sur le pillage du reste de la population; où le travail serait la ressource commune, et le gouvernement un travail public, que la communauté adjugerait, comme tout travail du même genre, à des hommes de son choix, pour un prix raisonnable et loyalement débattu.
Le premier moyen est celui que l'on tente. Depuis 1815, et surtout depuis 1820, il s'agit, non de diminuer le budget, non de défaire les régies fiscales, non de réduire le nombre des emplois, mais de faire que tout cet établissement administratif, ouvrage des ambitions de tous les temps et des cupidités de tous les régimes, devienne la propriété exclusive, incommutable, des classes qui tenaient autrefois le pouvoir.88
Cette entreprise, dont beaucoup de gens s'alarment pour la liberté, me paraît, à moi, destinée à la servir. Il n'y a pas grande apparence qu'elle soit faite dans son intérêt, et je crois bien qu'à la rigueur nous pouvons nous dispenser de reconnaissance; mais je dis qu'en résultat elle la sert. Déjà, elle a commencé à produire dans nos mœurs une révolution très-salutaire. En refoulant dans la vie privée une multitude d'hommes intelligens, actifs, ardens, que la révolution avait entraînés vers le pouvoir, on a mis ces hommes dans le cas d'apprendre qu'il est quelque chose de plus noble, de plus généreux, de plus moral et même de plus fructueux que la domination: le travail. Il est impossible de ne pas voir que, depuis quelques années, il se fait à cet égard dans nos dispositions un changement considérable; que les passions ambitieuses nous travaillent moins; que les titres, les rubans, les sinécures, baissent de valeur dans nos esprits; que les arts utiles, au contraire, prennent à nos yeux plus d'importance; qu'en un mot nous cherchons davantage à prospérer par l'industrie. A mesure que nous nous affermirons dans celte manière de vivre, nous en prendrons davantage les mœurs, nous acquerrons de plus en plus les connaissances qui s'y rapportent, nous nous instruirons surtout du régime politique qu'elle requiert, et après avoir noblement renoncé aux places inutiles, le temps viendra, j'en ai l'espérance, où nous ne voudrons plus les payer. Il me paraît donc évident qu'en faisant effort pour nous ramener au régime des privilèges,89 on contribue à nous pousser vers le régime de l'industrie, et que ce nouveau mode d'existence est celui où nous conduit l'époque actuelle. Ce mouvement d'esprit public est d'un si haut intérêt qu'on me pardonnera, avant de finir ce chapitre, de m'arreter un instant encore à le constater et à en montrer le vrai caractère.
Je le répète, la réaction politique qui s'opère depuis dix ans, en France et en Europe, en amène une très-heureuse dans les mœurs. Je ne voudrais pour rien au monde approuver l'esprit qui paraît la diriger; je déplore les nombreuses infortunes particulières qu'elle a faites; mais je bénis sincèrement l'effet général qu'elle produit, effet tellement avantageux qu'il suffit, à mon sens, pour compenser amplement tout le mal que d'ailleurs elle peut faire.
La contre-révolution ne vaincra pas la révolution: la révolution est inhérente à la nature humaine; elle n'est que le mouvement qui la pousse à améliorer ses destinées, et ce mouvement est heureusement invincible. Mais la contre-révolution tend à changer le cours de la révolution; d'ambitieuse et de conquérante qu'elle était, elle la rend laborieuse; elle se dirigeait de toutes ses forces vers le pouvoir, elle la contraint à tourner son immense activité vers l'industrie. Il importe de savoir précisément en quoi ce changement consiste.
Sans doute, la pratique des arts, l'étude des sciences, la culture et le perfectionnement de nos facultés ne sont pas des choses nouvelles; mais ce qui est nouveau, c'est la manière dont on commence à envisager tout cela. Autrefois on se livrait bien au travail, mais c'était en vue de la domination; l'industrie n'était qu'un acheminement aux places; la véritable fin, la fin dernière de toute activité, c'était d'arriver aux emplois. Ce n'est pas pour cela, si l'on veut, que la révolution a été faite; mais elle a été faite avec cela: l'amour des fonctions publiques y a joué son rôle; et ce rôle n'a pas été petit, si l'on en juge par les résultats; car ce qu'elle a produit avec le plus d'abondance, ce sont des fonctions et des fonctionnaires: nous l'avons vue inonder l'Europe de soldats, de commis, de douaniers, de directeurs, de préfets, d'intendans, de gouverneurs, de rois.
Il se peut donc bien que jusqu'ici on eût pratiqué les arts; mais je dis que c'était en attendant les places, et comme moyen éloigné d'y parvenir. Le principal effet de la réaction actuelle est de changer cette tendance. Non-seulement la l'évolution est ramenée au travail par ses défaites, mais elle commence à l'envisager mieux: on n'en fait plus seulement un moyen; il devient la fin de l'activité sociale; on commence à ne plus rien voir au-delà de l'exercice utile de ses forces et du perfectionnement de ses facultés.
Je sais fort bien que cette tendance est loin d'être générale; toutes les passions qui ont gouverné la société la gouvernent plus ou moins encore. La servitude de la glèbe a conservé des partisans; les privilèges en ont encore davantage, et les sinécures infiniment plus. Mais enfin il n'y a pas moyen de se dissimuler que la tendance à l'industrie devient chaque jour plus forte et plus générale; infiniment plus de gens cherchent dans cette voie la fortune, et même l'illustration; on y applique plus de capitaux; on y porte plus de lumières; on y met davantage les sciences positives à contribution; les notions d'économie industrielle se propagent; avec elles se répand la connaissance du régime politique qui convient à l'industrie; enfin ce régime passe de la théorie dans la pratique: c'est d'après ses principes que sont constitués les États-Unis, c'est d'après ses principes que se constituent les nouvelles républiques américaines, c'est d'après ses principes que la monarchie anglaise réforme ses lois: l'Angleterre lève les prohibitions, diminue les impôts, réduit le nombre des places, fait servir le gouvernement à restreindre l'action du gouvernement, et tend ainsi à se rapprocher du régime de l'Amérique. Or, si ce régime a pu franchir l'Océan, n'y a-t-il pas quelques motifs d'espérer qu'un jour il pourra passer aussi la Manche? N'est-il pas permis de croire que la France qui a fait la révolution, après avoir renoncé aux places inutiles, ne se résignera pas toujours à les payer? Cette France ne voudra sûrement pas que tous ses efforts n'aient abouti qu'à doubler ses impôts, qu'à tripler ses entraves, qu'à lui faire payer quatre fois plus de fonctionnaires.90 Plus elle se corrigera de toute tendance à la domination, et moins elle consentira à rester tributaire d'une classe de dominateurs. Elle deviendra, j'espère, assez forte pour exiger que tout le monde vive, comme elle, par quelque utile travail; et, donnant au pouvoir son vrai titre, celui de service public, il y a lieu de penser que quelque jour elle s'arrangera pour avoir des serviteurs, et non des maîtres.
Je ne crois donc pas me tromper, quand je dis que le monde tend à la vie industrielle, et je me flatte qu'en parlant maintenant de cet état et du degré de liberté qu'il comporte, je n'aurai pas trop l'air de composer une utopie.
21.Béranger’s Songs about “Liberty and Politics” II (1830-1833)]
Source
Oeuvres complètes de P.-J. de Béranger. Nouvelle édition revue par l’auteur. Illustrée de cinquante-deux belles gravures sur acier entièrement in édites, d’après les dessins de MM. Charlet, A. de Lemud, Johannot, Daubigny, Pauquet, Jacques, J. Lange, Pinguilly, de Rudder, Raffet (Paris: Perrotin, 1847). 2 volumes.
LES CONTREBANDIERS. CHANSON ADRESSÉE A M. JOSEPH RERNARD, DÉPITÉ DU VAR, AUTEUR DU BON SENS D'UN HOMME DE RIEN (1829). [Date 1830???] vol. 2, pp. 250-54.
Air: Celte chaumière-là vaut un palais.
Malheur! malheur aux commis!
A nous, bonheur et richesse!
Le peuple à nous s'intéresse:
Il est de nos amis.
Oui, le peuple est partout de nos amis;
Oui, le peuple est partout, partout de nos amis.
Il est minuit. Ça, qu'on me suive,
Hommes, pacotille et mulets.
Marchons, attentifs au qui-vive.
Armons fusils et pistolets.
Les douaniers sont en nombre;
Mais le plomb n'est pas cher;
Et l'on sait que dans l'ombre
Nos balles verront clair.
Malheur! malheur aux commis!
A nous, bonheur et richesse!
Malheur! malheur aux commis!
A nous, bonheur et richesse!
Le peuple à nous s'intéresse:
Il est de nos amis.
Oui, le peuple est partout de nos amis;
Oui, le peuple est partout, partout de nos amis.
Camarades, la noble vie!
Que de hauts faits à publier!
Combien notre belle est ravie
Quand l'or pleut dans son tablier!
Château, maison, cabane,
Nous sont ouverts partout.
Si la loi nous condamne,
Le peuple nous absout.
Malheur! malheur aux commis!
A nous, bonheur et richesse!
Malheur! malheur aux commis!
A nous, bonheur et richesse!
Le peuple à nous s'intéresse:
Il est de nos amis.
Oui, le peuple est partout de nos amis;
Oui, le peuple est partout, partout de nos amis.
Bravant neige, froid, pluie, orage,
Au bruit des torrents nous dormons.
Ah! qu'on aspire de courage,
Dans l'air du sommet des monts!
Cimes à nous connues,
Cent fois vous nous voyez
La tête dans les nues
Et la mort sous nos pieds.
Malheur! malheur aux commis!
A nous, bonheur et richesse!
Malheur! malheur aux commis!
A nous, bonheur et richesse!
Le peuple à nous s'intéresse:
Il est de nos amis.
Oui, le peuple est partout de nos amis;
Oui, le peuple est partout, partout de nos amis.
Aux échanges l'homme s'exerce;
Mais l'impôt barre les chemins.
Passons: c'est nous qui du commerce
Tiendrons la balance en nos mains.
Partout la Providence
Veut, en nous protégeant,
Niveler l'abondance,
Éparpiller l'argent.
Malheur! malheur aux commis!
A nous, bonheur et richesse!
Le peuple à nous s'intéresse:
Il est de nos amis.
Oui, le peuple est partout de nos amis;
Oui, le peuple est partout, partout de nos amis.
Nos gouvernants, pris de vertige,
Des biens du ciel triplant le taux,
Font mourir le fruit sur sa tige,
Du travail brisent les marteaux.
Pour qu'au loin il abreuve
Le sol et l'habitant,
Le bon Dieu crée un fleuve;
Ils en font un étang.
Malheur! malheur aux commis!
A nous, bonheur et richesse!
Le peuple à nous s'intéresse:
Il est de nos amis.
Oui, le peuple est partout de nos amis;
Oui, le peuple est partout, partout de nos amis.
Quoi! l'on veut qu'uni de langage,
Aux mêmes lois longtemps soumis,
Tout peuple qu'un traité partage
Forme deux peuples d'ennemis.
Non; grâce à notre peine,
Ils ne vont pas en vain
Filer la même laine,
Sourire au même vin.
Malheur! malheur aux commis!
A nous, bonheur et richesse!
Le peuple à nous s'intéresse:
Il est de nos amis.
Oui, le peuple est partout de nos amis;
Oui, le peuple est partout, partout de nos amis.
A la frontière où l'oiseau vole,
Rien ne lui dit: Suis d'autres lois.
L'été vient tarir la rigole
Qui sert de limite à deux rois.
Prix du sang qu'ils répandent,
Là, leurs droits sont perçus.
Ces bornes qu'ils défendent,
Nous sautons par-dessus.
Malheur! malheur aux commis!
A nous, bonheur et richesse!
Le peuple à nous s'intéresse:
Il est de nos amis.
Oui, le peuple est partout de nos amis;
Oui, le peuple est partout, partout de nos amis.
On nous chante dans nos campagnes,
Nous, dont le fusil redouté,
En frappant l'écho des montagnes
Peut réveiller la liberté.
Quand tombe la patrie
Sous des voisins altiers,
Mourante elle s'écrie:
A moi, contrebandiers!
Malheur! malheur aux commis!
A nous, bonheur et richesse!
Le peuple à nous s'intéresse:
Il est de nos amis.
Oui, le peuple est partout de nos amis;
Oui, le peuple est partout, partout de nos amis.
A MES AMIS, DEVENUS MINISTRES. [after 1830???] vol. 2, pp. 255-57.
Air: [none given??]
Non, mes amis, non, je ne veux rien être;
Semez ailleurs places, titres et croix.
Non, pour les cours Dieu ne m'a pas fait naître
Oiseau craintif je fuis la glu des rois.
Que me faut-il? maîtresse à fine taille,
Petit repas et joyeux entretien.
De mon berceau près de bénir la paille,
En me créant Dieu m'a dit: Ne sois rien.
Un sort brillant serait chose importune
Pour moi, rimeur, qui vis de temps perdu.
M'est-il tombé des miettes de fortune,
Tout bas je dis: Ce pain ne m'est pas du.
Quel artisan, pauvre, hélas! quoi qu'il fasse,
N'a plus que moi droit à ce peu de bien?
Sans trop rougir fouillons dans ma besace.
En me créant Dieu m'a dit: Ne sois rien.
Au ciel, un jour, une extase profonde
Vient me ravir, et je regarde en bas.
De là, mon œil confond dans notre monde
Rois et sujets, généraux et soldats.
Un bruit m'arrive; est-ce un bruit de victoire?
On crie un nom; je ne l'entends pas bien.
Grands, dont là-bas je vois ramper la gloire,
En me créant Dieu m'a dit: Ne sois rien.
Sachez pourtant, pilotes du royaume,
Combien j'admire un homme de vertu,
Qui, regrettant son hôtel ou son chaume,
Monte au vaisseau par tous les vents battu.
De loin ma voix lui crie: Heureux voyage!
Priant de cœur pour tout grand citoyen.
Mais au soleil je m'endors sur la plage.
En me créant Dieu m'a dit: Ne sois rien.
Votre tombeau sera pompeux sans doute;
J'aurai, sous l'herbe, une fosse à l'écart.
Un peuple en deuil vous fait cortége en route;
Du pauvre, moi, j'attends le corbillard.
En vain on court où votre étoile tombe;
Qu'importe alors votre gîte ou le mien?
La différence est toujours une tombe.
En me créant Dieu m'a dit: Ne sois rien.
De ce palais souffrez donc que je sorte.
A vos grandeurs je devais un salut.
Amis, adieu. J'ai derrière la porte
Laissé tantôt mes sabots et mon luth.
Sous ces lambris près de vous accourue,
La Liberté s'offre à vous pour soutien.
Je vais chanter ses bienfaits dans la rue.
En me créant Dieu m'a dit: Ne sois rien.
LE REFUS. CHANSON ADRESSÉE Al! GÉNÉRAL SÉBASTIANI [no date. after 1830]. vol. 2, pp. 282-83.
Air: Le premier du mois de janvier.
Un ministre veut m'enrichir,
Sans que l'honneur ait à gauchir,
Sans qu'au Moniteur on m'affiche.
Mes besoins ne sont pas nombreux;
Mais, quand je pense aux malheureux,
Je me sens né pour être riche.
Avec l'ami pauvre et souffrant
On ne partage honneurs ni rang;
Mais l'or du moins on le partage.
Vive l'or! oui, souvent, ma foi,
Pour cinq cents francs, si j'étais roi,
Je mettrais ma couronne en gage.
Qu'un peu d'argent pleuve en mon trou,
Vite il s'en va, Dieu sait par où!
D'en conserver je désespère.
Pour recoudre à fond mes goussets,
J'aurais dû prendre, à son déces,
Les aiguilles de mon grand-père.
Ami, pourtant gardez votre or.
Las! j'épousai, bien jeune encor,
La Liberté, dame un peu rude.
Moi, qui dans mes vers ai chanté
Plus d'une facile beauté,
Je meurs l'esclave d'une prude.
La Liberté, c'est, Monseigneur,
Une femme folle d'honneur;
C'est une bégueule enivrée
Qui, dans la rue ou le salon,
Pour le moindre bout de galon,
Va criant: A bas la livrée!
Vos écus la feraient damner.
Au fait, pourquoi pensionner
Ma muse indépendante et vraie?
Je suis un sou de bon aloi;
Mais en secret argentez-moi,
Et me voilà fausse monnaie.
Gardez vos dons: je suis peureux.
Mais si d'un zèle généreux
Pour moi le monde vous soupçonne,
Sachez bien qui vous a vendu:
Mon cœur est un luth suspendu,
Sitôt qu'on le touche, il résonne.
22.Pierre-Jean de Béranger on his songs and liberty (1833)↩
[Word Length: 6,247]
Source
Chansons nouvelles et dernières de P. J. de Béranger: dédiées a M. Lucien Bonaparte. Tome troisième. (Paris: Perrotin, 1833). Préface, pp. 9-44.
Brief Bio of the Author: Pierre-Jean de Béranger (1780-1857)
[Pierre-Jean de Béranger (1780-1857)]
Pierre-Jean de Béranger (1780-1857) was a poet and songwriter who rose to prominence during the Restoration period with his funny and clever criticisms of the monarchy and the church, which got him into trouble with the censors who imprisoned him for brief periods in the 1820s. Béranger came from a humble background and was apprenticed to a printer at the age of 14. Through the help and patronage of Napoleon’s brother Lucien, Béranger secured a job in the offices of the Imperial University of France and began writing his songs for purely private use, many of which circulated in manuscript form thereby creating an appreciative audience. The satire of Napoleon “Le Roi d’Yvetot” [The King of Yvetot] (1813) was particularly popular. He shot to fame with his first published collection of songs and poems in 1815 (Chansons morales et autres) and two more followed in 1821 and 1825. His material was much in demand in the singing societies or “goguettes” which sprang up during the Restoration and the July Monarchy as a way of circumventing the censorship laws and the bans on political parties. After the appearance of his second volume in 1821 he was tried and convicted to 3 months imprisonment in Sainte-Pélagie. Another bout of imprisonment (this time 9 months in La Force) followed in 1828 when his 4th volume was published. Many of the figures who came to power after the July Revolution of 1830 were friends or acquaintances of Béranger and it was assumed he would be granted a sinecure in recognition of his critiques of the old monarchy, but he refused all government appointments in a stinging poem which he wrote in late 1830 called “Le Refus” [The Refusal]. At the age of 68 Béranger was overwhelmingly elected to the Constituent Assembly in April 1848 in which he sat for a brief period before resigning. He began writing as a firm supporter of Napoleon but later evolved into a more mainstream classical liberal who joined Frédéric Bastiat’s Free Trade Society and the Society of Political Economy in Paris in the 1840s. [DMH]
PRÉFACE.
Au moment de prendre congé du public, je sens avec une émotion plus profonde la reconnaissance que je lui dois; je me retrace plus vivement les marques d'intérêt dont il m'a comblé, depuis près de vingt ans que mon nom a commencé à lui être connu.
Telle a été sa bienveillance, qu'il n'eût tenu qu'à moi de me faire illusion sur le mérite de mes ouvrages. J'ai toujours mieux aimé attribuer ma popularité, qui m'est bien chère, à mes sentimens patriotiques, à la constance de mes opinions, et, j'ose ajouter, au dévouement désintéressé avec lequel je les ai défendues et propagées.
Qu'il me soit donc permis de rendre compte à ce même public, dans une simple causerie, des circonstances et des impressions qui m'ont été particulières, et auxquelles se rattache la publication des chansons qu'il a accueillies si favorablement. C'est une sorte de narration familière où il reconnaîtra du moins tout le prix que j'ai attaché à ses suffrages.
Je dois parler d'abord de ce dernier volume.
Chacune de mes publications a été pour moi le résultat d'un pénible effort. Celle-ci m'aura causé à elle seule plus de malaise que toutes les autres ensemble. Elle est la dernière; malheureusement elle vient trop tard. C'est immédiatement après la révolution de Juillet que ce volume eût dû paraître: ma modeste mission était alors terminée. Mes éditeurs savent pourquoi il ne m'a pas été permis d'achever plus tôt un rôle privé désormais de l'intérêt qu'il pouvait avoir sous le règne de la légitimité. Beaucoup de chansons de ce nouveau recueil appartiennent à ce temps déjà loin de nous, et plusieurs même auront besoin de notes.
Mes chansons, c'est moi. Aussi le triste progrès des années s'y fait sentir au fur et à mesure que les volumes s'accumulent, ce qui me fait craindre que celui-ci ne paraisse bien sérieux. Si beaucoup de personnes m'en font un reproche, quelques-unes m'en sauront gré, je l'espère; elles reconnaîtront que l'esprit de l'époque actuelle a dû contribuer, non moins que mon âge, à rendre le choix de mes sujets plus grave et plus philosophique.puis peu, un grand développement à ces questions, et sont parvenus à les rendre presque vulgaires. Je souhaite que quelques-unes de mes compositions prouvent à ces esprits élevés ma sympathie pour leur généreuse entreprise.
Les chansons nées depuis 1830 semblent en effet se rattacher plutôt aux questions d'intérêt social qu'aux discussions purement politiques. En doit-on être étonné? Une fois qu'on suppose reconquis le principe gouvernemental pour lequel on a combattu, il est naturel que l'intelligence éprouve le besoin d'en faire l'application au profit du plus grand nombre. Le bonheur de l'humanité a été le songe de ma vie. J'en ai l'obligation, sans doute, à la classe dans laquelle je suis né, et à l'éducation pratique que j'y ai reçue. Mais il a fallu bien des circonstances extraordinaires pour qu'il fût permis à un chansonnier de s'immiscer dans les hautes questions d'améliorations sociales. Heureusement une foule d'hommes, jeunes et courageux, éclairés et ardens, ont donné, depuis peu, un grand développement à ces questions, et sont parvenus à les rendre presque vulgaires. Je souhaite que quelques-unes de mes compositions prouvent à ces esprits élevés ma sympathie pour leur généreuse entreprise.
Je n'ai rien à dire des chansons qui appartiennent au temps de la Restauration, si ce n'est qu'elles sont sorties toutes faites de la prison de la Force. J'aurais peu tenu à les imprimer, si elles ne complétaient ces espèces de mémoires chantans que je publie depuis 1815. Je n'ai pas, au reste, à craindre qu'on me fasse le reproche de ne montrer de courage que lorsque l'ennemi a disparu. On pourra même remarquer que ma détention, bien qu'assez longue, ne m'avait nullement aigri: il est vrai qu'alors je croyais voir s'approcher l'accomplissement de mes prophéties contre les Bourbons. C'est ici l'occasion de m'expliquer sur la petite guerre que j'ai faite aux princes de la Famille déchue.
Mon admiration enthousiaste et constante pour le génie de l'empereur, ce qu'il inspirait d'idolâtrie au peuple, qui ne cessa de voir en lui le représentant de l'égalité victorieuse; cette admiration, cette idolâtrie, qui devaient faire un jour de Napoléon le plus noble objet de mes chants, ne m'aveuglèrent jamais sur le despotisme toujours croissant de l'empire. En 1814, je ne vis dans la chute du colosse que les malheurs d'une patrie que la république m'avait appris à adorer. Au retour des Bourbons, qui m'étaient indifférens, leur faiblesse me parut devoir rendre facile la renaissance des libertés nationales. On nous assurait qu'ils feraient alliance avec elles: malgré la Charte, j'y croyais peu; mais on pouvait leur imposer ces libertés. Quant au peuple, dont je ne me suis jamais séparé, après le dénoûment fatal de si longues guerres, son opinion ne me parut pas d'abord décidément contraire aux maîtres qu'on venoit d'exhumer pour lui. Je chantai alors la gloire de la France; je la chantai en présence des étrangers, frondant déjà toutefois quelques ridicules de cette époque, sans être encore hostile à la royauté restaurée.
On m'a reproché d'avoir fait une opposition de haine aux Bourbons; ce que je viens de dire répond à cette accusation, que peu de personnes aujourd'hui, j'en suis sûr, tiendraient à repousser, et qu'autrefois j'acceptais en silence.
Les illusions durèrent peu; quelques mois suffirent pour que chacun pût se reconnaître, et dessillèrent les yeux des moins clairvoyans; je ne parle que des gouvernés.
Le retour de l'empereur vint bientôt partager la France en deux camps, et constituer l'opposition qui a triomphé en 1830. Il releva le drapeau national et lui rendit son avenir en dépit de Waterloo et des désastres qui en furent la suite. Dans les cent-jours, l'enthousiasme populaire ne m'abusa point: je vis que Napoléon ne pouvait gouverner constitutionnellement; ce n'était pas pour cela qu'il avait été donné au monde. Tant bien que mal j'exprimai mes craintes dans la chanson intitulée la Politique de Lise, dont la forme a si peu de rapport avec le fond: ainsi que le prouve mon premier recueil, je n'avais pas encore osé faire prendre à la chanson un vol plus élevé; ses ailes poussaient. Il me fut plus facile de livrer au ridicule les Français qui ne rougissaient pas d'appeler de leurs vœux impies le triomphe et le retour des armées étrangères. J'avais répandu des larmes à leur première entrée à Paris, j'en versai à la seconde: il est peut-être des gens qui s'habituent à de pareils spectacles.
J'eus alors la conviction profonde que les Bourbons, fussent-ils tels que l'osaient encore dire leurs partisans, il n'y avait plus pour eux possibilité de gouverner la France, ni pour la France possibilité de leur faire adopter les principes libéraux, qui, depuis 1814, avaient reconquis tout ce que leur avaient fait perdre la terreur, l'anarchie directoriale et la gloire de l'empire. Cette conviction, qui ne m'a plus abandonné, je la devais moins d'abord aux calculs de ma raison qu'à l'instinct du peuple. A chaque événement je l'ai étudié avec un soin religieux, et j'ai presque toujours attendu que ses sentiments me parussent en rapport avec mes réflexions pour en faire ma règle de conduite, dans le rôle que l'opposition d'alors m'avait donné à remplir. Le peuple, c'est ma muse.
C'est cette muse qui me fit résister aux prétendus sages, dont les conseils, fondés sur des espérances chimériques, me poursuivirent maintes fois. Les deux publications qui m'ont valu des condamnations judiciaires, m'exposèrent à me voir abandonné de beaucoup de mes amis politiques. J'en courus le risque. L'approbation des masses me resta fidèle, et les amis revinrent.91
Je tiens à ce qu'on sache bien qu'à aucune époque de ma vie de chansonnier, je ne donnai droit à personne de me dire: Fais ou ne fais pas ceci; va ou ne va pas jusque-là. Quand je sacrifiai le modique emploi que je ne devais qu'à M. Arnault, et qui était alors ma seule ressource, des hommes pour qui j'ai conservé une reconnaissance profonde, me firent des offres avantageuses que j'eusse pu accepter sans rougir; mais ils avaient une position politique trop influente pour qu'elle ne m'eût pas gêné quelquefois. Mon humeur indépendante résista aux séductions de l'amitié. Aussi étais-je surpris et affligé lorsqu'on me disait le pensionné de tel ou de tel, de Pierre ou de Paul, de Jacques ou de Philippe. Si cela eût été, je n'en aurais pas fait mystère. C'est parce que je sais quel pouvoir la reconnaissance exerce sur moi, que j'ai craint de contracter de semblables obligations, même envers les hommes que j'estime le plus.92
Il en est un que mes lecteurs auront nommé d'abord: M. Laffitte. Peut-être ses instances eussent-elles fini par triompher de mes refus, si des malheurs dont la France entière a gémi n'étaient venus mettre un terme à l'infatigable générosité de ce grand et vertueux citoyen, le seul homme de nôtre temps qui ait su rendre la richesse populaire.
La révolution de Juillet a aussi voulu faire ma fortune; je l'ai traitée comme une puissance qui peut avoir des caprices auxquels il faut être en mesure de résister. Tous ou presque tous mes amis ont passé au ministère: j'en ai même encore un ou deux qui restent suspendus à ce mât de cocagne. Je me plais à croire qu'ils y sont accrochés par la basque, malgré les efforts qu'ils font pour descendre. J'aurais donc pu avoir part à la distribution des emplois. Malheureusement je n'ai pas l'amour des sinécures, et tout travail obligé m'est devenu insupportable, hors peut-être encore celui d'expéditionnaire. Des médisans ont prétendu que je faisais de la vertu. Fi donc ! je faisais de la paresse. Ce défaut m'a tenu lieu de bien des qualités; aussi je le recommande à beaucoup de nos honnêtes gens. Il expose pourtant à de singuliers reproches. C'est à cette paresse si douce, que des censeurs rigides ont attribué l'éloignement où je me suis tenu de ceux de mes honorables amis qui ont eu le malheur d'arriver au pouvoir. Faisant trop d'honneur à ce qu'ils veulent bien appeler ma bonne tête, et oubliant trop combien il y a loin du simple bon sens à la science des grandes affaires, ces censeurs prétendent que mes conseils eussent éclairé plus d'un ministre. A les en croire, tapi derrière le fauteuil de velours de nos hommes d'état, j'aurais conjuré les vents, dissipé les orages, et fait nager la France dans un océan de délices. Nous aurions tous de la liberté à revendre ou plutôt à donner, car nous n'en savons pas bien encore le prix. Eh! messieurs mes deux ou trois amis, qui prenez un chansonnier pour un magicien, on ne vous a donc pas dit que le pouvoir est une cloche qui empêche ceux qui la mettent en branle d'entendre aucun autre son? Sans doute des ministres consultent quelquefois ceux qu'ils ont sous la main: consulter est un moyen de parler de soi qu'on néglige rarement. Mais il ne suffirait pas de consulter de bonne foi des gens qui conseilleraient de même; il faudrait encore exécuter: ceci est la part du caractère. Les intentions les plus pures, le patriotisme le plus éclairé ne le donnent pas toujours. Qui n'a vu de hauts personnages quitter un donneur d'avis avec une pensée courageuse, et, l'instant d'après, revenir vers lui, de je ne sais quel lieu de fascination, avec l'embarras d'un démenti donné aux résolutions les plus sages? Oh! disent-ils, nous n'y serons plus repris! quelle galère! Le plus honteux ajoute: Je voudrais bien vous voir à ma place. Quand un ministre dit cela, soyez sûr qu'il n'a plus la tête à lui. Cependant il en est un, mais un seul, qui sans avoir perdu la tête a répété souvent ce mot de la meilleure foi du monde; aussi ne l'adressait-il jamais à un ami.
Je n'ai connu qu'un homme dont il ne m'eût pas été possible de m'éloigner, s'il fût arrivé au pouvoir. Avec son imperturbable bon sens, plus il était propre à donner de sages conseils, plus sa modestie lui faisait rechercher ceux des gens dont il avait éprouvé la raison. Les déterminations une fois prises, il les suivait avec fermeté et sans jactance. S'il en avait reçu l'inspiration d'un autre, ce qui était rare, il n'oubliait point de lui en faire honneur. Cet homme, c'était Manuel, à qui la France doit encore un tombeau.
Sous le ministère emmiellé de M. de Martignac, lorsque, fatigués d'une lutte si longue contre la légitimité, plusieurs de nos chefs politiques travaillaient à la fameuse fusion, un d'eux s'écria: Sommes-nous heureux que celui-là soit mort! C'est un éloge funèbre qui dit tout ce que Manuel vivant n'eût pas fait, à cette époque de promesses hypocrites et de concessions funestes.
Moi, je puis dire ce qu'il aurait fait pendant les Trois-Journées. La rue d'Artois, l'Hôtel-de-Ville et les barricades l'auraient vu tour à tour, délibérant ici, se battant là; mais les barricades d'abord, car son courage de vieux soldat s'y fût trouvé plus à l'aise au milieu de tout le brave peuple de Paris. Oui, il eût travaillé au berceau de notre révolution. Certes, on n'eût pas eu à dire de lui ce qu'on a répété de plusieurs, qu'ils sont comme des greffiers de mairie qui se croiraient les pères des enfans dont ils n'ont que dressé l'acte de naissance.
Il est vraisemblable que Manuel eût été forcé d'accepter une part aux affaires du nouveau gouvernement. Je l'aurais suivi, les yeux fermés, par tous les chemins qu'il lui eût fallu prendre pour revenir, bientôt sans doute, au modeste asile que nous partagions. Patriote avant tout, il fût rentré dans la vie privée sans humeur, sans arrière-pensées; à l'heure qu'il est, de l'opposition probablement encore, mais sans haine de personnes, car la force donne de l'indulgence, mais sans désespérer du pays, parce qu'il avait foi dans le peuple.
Le bonheur de la France le préoccupait sans cesse; eût-il vu accomplir ce bonheur par d'autres que lui, sa joie n'en eût pas été moins grande. Je n'ai jamais rencontré d'homme moins ambitieux, même de célébrité. La simplicité de ses mœurs lui faisait chérir la vie des champs. Dès qu'il eût été sûr que la France n'avait plus besoin de lui, je l'entends s'écrier: Allons vivre à la campagne.
Ses amis politiques ne l'ont pas toujours bien apprécié; mais survenait-il quelque embarras, quelque danger, tous s'empressaient de recourir à sa raison imperturbable, à son inébranlable courage. Son talent ressemblait à leur amitié. C'est dans les momens de crise qu'il en avait toute la plénitude, et que bien des faiseurs de phrases, qu'on appelle orateurs, baissaient la tète devant lui.
Tel fut l'homme que je n'aurais pas quitté, eût-il dû vieillir dans une position éminente. Loin de lui la pensée de m'affubler d'aucun titre, d'aucun emploi! car il respectait mes goûts. C'est comme simple volontaire qu'il eût voulu me garder à ses côtés sur le champ de bataille du pouvoir. Et moi, en restant auprès de lui, je lui aurais du moins fait gagner le temps que lui eussent pris, chaque jour, les visites qu'il n'eût pas manqué de me faire, si je m'étais obstiné à vivre dans notre paisible retraite. Aux sentimens les plus élevés s'unissaient dans son cœur les affections les plus douces; il n'était pas moins tendre ami que citoyen dévoué.
Ces derniers mots suffiront pour justifier cette digression, qui d'ailleurs ne peut déplaire aux vrais patriotes. Ils n'ont jamais plus regretté Manuel que depuis la révolution de juillet, en dépit de quelques gens qui peut-être répètent tout bas: Sommes-nous heureux que celui-là soit mort!
Il est temps de jeter un coup d'œil général sur mes chansons. Je le confesse d'abord: je conçois les reproches que plusieurs ont dû m'attirer de la part des esprits austères, peu disposés à pardonner quelque chose, même à un livre qui n'a pas la prétention de servir à l'éducation des demoiselles. Je dirai seulement, sinon comme défense, au moins comme excuse, que ces chansons, folles inspirations de la jeunesse et de ses retours, ont été des compagnes fort utiles, données aux graves refrains et aux couplets politiques. Sans leur assistance, je suis tenté de croire que ceux-ci auraient bien pu n'aller ni aussi loin ni aussi bas, ni même aussi haut; ce dernier mot dût-il scandaliser les vertus de salon.
Quelques unes de mes chansons ont été traitées d'impies, les pauvrettes! par MM. les procureurs du roi, avocats-généraux et leurs substituts, qui sont tous gens très religieux à l'audience. Je ne puis, à cet égard, que répéter ce qu'on a dit cent fois. Quand, de nos jours, la religion se fait instrument politique, elle s'expose à voir méconnaître son caractère sacré; les plus tolérans deviennent intolérans pour elle; les croyans, qui croient autre chose que ce qu'elle enseigne, vont quelquefois, par représailles, l'attaquer jusque dans son sanctuaire. Moi, qui suis de ces croyans, je n'ai jamais été jusque-là: je me suis contenté de faire rire de la livrée du catholicisme. Est-ce de l'impiété?
Enfin, grand nombre de mes chansons ne sont que des inspirations de sentimens intimes ou des caprices d'un esprit vagabond; ce sont là mes filles chéries: voilà tout le bien que j'en veux dire au public. Je ferai seulement observer encore, qu'en jetant une grande variété dans mes recueils, celles-ci ont dû n'être pas inutiles non plus au succès des chansons politiques.
Quant à ces dernières, à n'en croire même que les adversaires les plus prononcés de l'opinion que j'ai défendue pendant quinze ans, elles ont exercé une puissante influence sur les masses, seul levier qui, désormais, rende les grandes choses possibles. L'honneur de cette influence, je ne l'ai pas réclamé au moment de la victoire: mon courage s'évanouit aux cris qu'elle fait pousser. Je crois, en vérité, que la défaite va mieux à mon humeur. Aujourd'hui, j'ose donc réclamer ma part dans le triomphe de 1830, triomphe que je n'ai su chanter que long-temps après, et devant les sépultures des citoyens à qui nous le devons. Ma chanson d'adieu se ressent de ce mouvement de vanité politique, produit sans doute par les flatteries qu'une jeunesse enthousiaste m'a prodiguées et me prodigue encore. Prévoyant que bientôt l'oubli enveloppera les chansons et le chansonnier, c'est une épitaphe que j'ai voulu préparer pour notre tombe commune.
Malgré tout ce que l'amitié a pu faire; malgré les plus illustres suffrages et l'indulgence des interprètes de l'opinion publique, j'ai toujours pensé que mon nom ne me survivrait pas, et que ma réputation déclinerait d'autant plus vite qu'elle a été nécessairement fort exagérée par l'intérêt de parti qui s'y est attaché. On a jugé de sa durée par son étendue; j'ai fait, moi, un calcul différent qui se réalisera de mon vivant, pour peu que je vieillisse. A quoi bon nous révéler cela? diront quelques aveugles. Pour que mon pays me sache gré, surtout, de m'être livré au genre de poésie que j'ai jugé le plus utile à la cause de la liberté, lorsque je pouvais tenter des succès plus solides dans les genres que j'avais cultivés d'abord.
Sur le point de faire ici un examen consciencieux de ces productions fugitives, le courage m'a manqué, je l'avoue. J'ai craint qu'on ne me prît au mot lorsque je relèverais des fautes, et qu'on ne fît la sourde oreille aux cajoleries paternelles que je pourrais adresser à mes chansons; car encore faut-il bien que tout n'en soit pas mauvais. Puis, malgré la politesse des critiques à mon égard, ce serait peut-être pousser la reconnaissance trop loin que de faire ainsi leur besogne. Je le répète; le courage m'a manqué. On n'incendie guère sa maison que lorsqu'elle est assurée. Ce que je puis dire d'avance à ceux qui se font les exécuteurs des hautes œuvres littéraires, c'est que je suis complètement innocent des éloges exagérés qui m'ont été prodigués;que jamais il ne m'est arrivé de solliciter le moindre article de bienveillance: que j'ai été même jusqu'à prier des amis journalistes d'être pour moi plus sobres de louanges; que loin de vouloir ajouter le bruit au bruit, j'ai évité les ovations qui l'augmentent; me suis tenu loin des coteries qui le propagent; et que j'ai fermé ma porte aux commis-voyageurs de la renommée, ces gens qui se chargent de colporter votre réputation en province et jusque dans l'étranger, dont les revues et les magasins leurs sont ouverts.
Je n'ai jamais poussé mes prétentions plus haut que ne l'indique le titre de chansonnier, sentant bien qu'en mettant toute ma gloire à conserver ce titre auquel je dois tant, je lui devrais encore d'être jugé avec plus d'indulgence, placé par-là loin et au-dessous de toutes les grandes illustrations de mon siècle. Le besoin de cette position spéciale a toujours dû m'ôter l'idée de courir après les dignités littéraires les plus enviées et les plus dignes de l'être, quelque instance que m'aient faite des amis influens et dévoués, qui, dans la poursuite de ces dignités, me promettaient, je suis honteux de le dire, plus de bonheur que n'en a eu B. Constant, grand publiciste, grand orateur, grand écrivain. Pauvre Constant!
A ceux qui douteraient de la sincérité de mes paroles, je répondrai: Les rêves poétiques les plus ambitieux ont bercé ma jeunesse; il n'est presque point de genre élevé que je n'aie tenté en silence. Pour remplir une immense carrière, à vingt ans, dépourvu d'études, même de celle du latin, j'ai cherché à pénétrer le génie de notre langue et les secrets du style. Les plus nobles encouragemens m'ont été donnés alors. Je vous le demande: croyez-vous qu'il ne me soit rien resté de tout cela, et qu'aujourd'hui, jetant un regard de profonde tristesse sur le peu que j'ai fait, je sois disposé à m'en exagérer la valeur? mais j'ai utilisé ma vie de poëte, et c'est là ma consolation. Il fallait un homme qui parlât au peuple le langage qu'il entend et qu'il aime, et qui se créât des imitateurs pour varier et multiplier les versions du même texte. J'ai été cet homme. La Liberté et la Patrie, dira-t-on, se fussent bien passées de vos refrains. La Liberté et la Patrie ne sont pas d'aussi grandes dames qu'on le suppose: elles ne dédaignent le concours de rien de ce qui est populaire. Il y aurait, selon moi, injustice à porter sur mes chansons un jugement où il ne me serait pas tenu compte de l'influence qu'elles ont exercée. Il est des instans, pour une nation, où la meilleure musique est celle du tambour qui bat la charge.
Après tout, si l'on trouve que j'exagère beaucoup l'importance de mes couplets, qu'on pardonne au vétéran qui prend sa retraite, de grossir tant soit peu ses états de services. On pourra même observer que je parle à peine de mes blessures. D'ailleurs, la récompense que je sollicite ne fera pas ajouter un centime au budget.
Comme chansonnier, il me faut répondre à une critique que j'ai vue plusieurs fois reproduite. On m'a reproché d'avoir dénaturé la chanson, en lui faisant prendre un ton plus élevé que celui des Collé, des Panard, des Désaugiers. J'aurais mauvaise grâce à le contester, car c'est, selon moi, la cause de mes succès. D'abord, je ferai remarquer que la chanson, comme plusieurs autres genres, est tout une langue, et que, comme telle, elle est susceptible de prendre les tons les plus opposés. J'ajoute que depuis 1789, le peuple ayant mis la main aux affaires du pays, ses sentimens et ses idées patriotiques ont acquis un très grand développement; notre histoire le prouve. La chanson, qu'on avait définie l'expression des sentimens populaires, devait dès-lors s'élever à la hauteur des impressions de joie ou de tristesse que les triomphes ou les désastres produisaient sur la classe la plus nombreuse. Le vin et l'amour ne pouvaient guère plus que fournir des cadres pour les idées qui préoccupaient le peuple exalté par la révolution, et ce n'était plus seulement avec les maris trompés, les procureurs avides et la barque à Caron qu'on pouvait obtenir l'honneur d'être chanté par nos artisans et nos soldats aux tables des guinguettes. Ce succès ne suffisait pas encore; il fallait de plus que la nouvelle expression des sentimens du peuple pût obtenir l'entrée des salons pour y faire des conquêtes dans l'intérêt de ces sentimens. De là, autre nécessité de perfectionner le style et la poésie de la chanson. Je n'ai pas fait seul toutes les chansons depuis quinze ou dix-huit ans. Qu'on feuillette tous les recueils, et l'on verra que c'est dans le style le plus grave que le peuple voulait qu'on lui parlât de ses regrets et de ses espérances. Il doit sans doute l'habitude de ce diapason élevé à l'immortelle Marseillaise, qu'il n'a jamais oubliée, comme on l'a pu voir dans la grande Semaine.
Pourquoi nos jeunes et grands poëtes ont-ils dédaigné les succès que, sans nuire à leurs autres travaux, la chanson leur eût procurés? notre cause y eût gagné, et, j'ose le leur dire, eux-mêmes eussent profité à descendre quelquefois des hauteurs de notre vieux Pinde, un peu plus aristocratique que ne le voudrait le génie de notre bonne langue française. Leur style eût sans doute été obligé de renoncer, en partie, à la pompe des mots. Mais, par compensation, ils se seraient habitués à résumer leurs idées en de petites compositions variées et plus ou moins dramatiques, compositions que saisit l'instipct du vulgaire, lors même que les détails les plus heureux lui échappent. C'est là, selon moi, mettre de la poésie en dessous. Peut-être est-ce, en définitive, une obligation qu'impose la simplicité de notre langue et à laquelle nous nous conformons trop rarement. La Fontaine en a pourtant assez bien prouvé les avantages.
J'ai pensé quelquefois que si les poëtes contemporains avaient réfléchi que désormais c'est pour le peuple qu'il faut cultiver les lettres, ils m'auraient envié la petite palme qu'à leur défaut je suis parvenu à cueillir, et qui sans doute eût été durable mêlée à de plus glorieuses. Quand je dis peuple, je dis la foule; je dis le peuple d'en bas, si l'on veut. Il n'est pas sensible aux recherches de l'esprit, aux délicatesses du goût; soit! mais par-là même, il oblige les auteurs à concevoir plus fortement, plus grandement pour captiver son attention. Appropriez donc à sa forte nature et vos sujets et leurs développemens; ce ne sont ni des idées abstraites, ni des types qu'il vous demande: montrez-lui à nu le cœur humain. Il me semble que Shakespeare fut soumis à cette heureuse condition. Mais que deviendra la perfection du style? Croit-on que les vers inimitables de Racine, appliqués à l'un de nos meilleurs mélodrames, eussent empêché, même aux boulevarts, l'ouvrage de réussir? Inventez, concevez pour ceux qui tous ne savent pas lire; écrivez pour ceux qui savent écrire.
Par suite d'habitudes enracinées, nous jugeons encore le peuple avec prévention. Il ne se présente à nous que comme une tourbe grossière, incapable d'impressions élevées, généreuses, tendres. Toutefois, chez nous il y a pis, même en matière de jugemens littéraires, surtout au théâtre. S'il reste de la poésie au monde, c'est, je n'en doute pas, dans ses rangs qu'il faut l'aller chercher. Qu'on essaie donc d'en faire pour lui. Mais, pour y parvenir, il faut étudier ce peuple. Quand par hasard nous travaillons pour nous en faire applaudir, nous le traitons comme font ces rois qui, dans leurs jours de munificence, lui jettent des cervelas à la tête et le noient dans du vin frelaté. Voyez nos peintres: représentent-ils des hommes du peuple, même dans des compositions historiques, ils semblent se complaire à les faire hideux. Ce peuple ne pourrait-il pas dire à ceux qui le représentent ainsi: «Est-ce ma faute si je suis misérablement déguenillé? si mes traits sont flétris par le besoin, quelquefois même par le vice? Mais dans ces traits hâves et fatigués a brillé l'enthousiasme du courage et de la liberté; mais sous ces haillons coule un sang que je prodigue à la voix de la patrie. C'est quand mon âme s'exalte qu'il faut me peindre. Alors je suis beau;» et le peuple aurait raison de parler ainsi.
Tout ce qui appartient aux lettres et aux arts est sorti des classes inférieures, à peu d'exceptions près. Mais nous ressemblons tous à des parvenus désireux de faire oublier leur origine; ou si nous voulons bien souffrir chez nous des portraits de famille, c'est à condition d'en faire des caricatures. Beau moyen de s'anoblir, vraiment! Les Chinois sont plus sages: ils anoblissent leurs aïeux.
Le plus grand poëte des temps modernes, et peut-être de tous les temps, Napoléon, lorsqu'il se dégageait de l'imitation des anciennes formes monarchiques, jugeait le peuple ainsi que devraient le juger nos poëtes et nos artistes. Il voulait, par exemple, que le spectacle des représentations gratis fût composé des chefs-d'œuvre de la scène française. Corneille et Molière en faisaient souvent les honneurs, et l'on a remarqué que jamais leurs pièces ne furent applaudies avec plus de discernement. Le grand homme avait appris de bonne heure, dans les camps et au milieu des troubles révolutionnaires, jusqu'à quel degré d'élévation peut atteindre l'instinct des masses, habilement remuées. On serait tenté de croire que c'est pour satisfaire à cet instinct qu'il a tant fatigué le monde. L'amour que porte à sa mémoire la génération nouvelle qui ne l'a pas connu, prouve assez combien l'émotion poétique a de pouvoir sur le peuple. Que nos auteurs travaillent donc sérieusement pour cette foule si bien préparée à recevoir l'instruction dont elle a besoin. En sympathisant avec elle, ils achèveront de la rendre morale, et plus ils ajouteront à son intelligence, plus ils étendront le domaine du génie et de la gloire.
Les jeunes gens, je l'espère, me pardonneront ces réflexions que je ne hasarde ici que pour eux. Il en est peu qui ne sachent l'intérêt que tous m'inspirent. Combien de fois me suis-je entendu reprocher des applaudissemens donnés à leurs plus audacieuses innovations! Pouvais-je ne pas applaudir, même en blâmant un peu? Dans mon grenier, à leur âge, sous le règne de l'abbé Delille, j'avais moi-même projeté l'escalade de bien des barrières. Je ne sais quelle voix me criait: Non, les Latins et les Grecs même ne doivent pas être des modèles; ce sont des flambeaux: sachez vous en servir. Déjà la partie littéraire et poétique des admirables ouvrages de M. de Chateaubriand m'avait arraché aux lisières des Le Batteux et des La Harpe; service que je n'ai jamais oublié.
Je l'avoue pourtant, je n'aurais pas voulu plus tard voir recourir à la langue morte de Ronsard, le plus classique de nos vieux auteurs; je n'aurais pas voulu surtout qu'on tournât le dos à notre siècle d'affranchissement, pour ne fouiller qu'au cercueil du moyen âge, à moins que ce ne fût pour mesurer et peser les chaînes dont les hauts barons accablaient les pauvres serfs, nos aïeux. Peut-être avais-je tort, après tout. C'est lorsqu'à travers l'Atlantique il croyait voguer vers l'Asie, berceau de l'ancien monde, que Colomb rencontra un monde nouveau. Courage donc, jeunes gens! il y a de la raison dans votre audace. Mais, puisque vous avez l'avenir pour vous, montrez un peu moins d'impatience contre la génération qui vous a précédés, et qui marche encore à votre tête par rang d'âge. Elle a été riche aussi en grands talens, et tous se sont plus ou moins consacrés aux progrès des libertés dont les fruits ne mûriront guère que pour vous. C'est du milieu des combats à mort de la tribune, au bruit des longues et sanglantes batailles; dans les douleurs de l'exil; au pied des échafauds que, par de brillans et nombreux succès, ils ont entretenu le culte des Muses, et qu'ils ont dit à la barbarie: Tu n'iras pas plus loin. Et vous le savez; elle ne s'arrête que devant la gloire.
Quant à moi, qui, jusqu'à présent, n'ai eu qu'à me louer de la jeunesse, je n'attendrai pas qu'elle me crie: Arrière, bon homme! laisse-nous passer. Ce que l'ingrate pourrait faire avant peu. Je sors de la lice pendant que j'ai encore la force de m'en éloigner. Trop souvent au soir de la vie nous nous laissons surprendre par le sommeil sur la chaise où il vient nous clouer. Mieux vaudrait aller l'attendre au lit, dont alors on a si grand besoin. Je me hâte de gagner le mien, quoiqu'il soit un peu dur.
Quoi! vous ne ferez plus de chansons? Je ne promets pas cela; entendons-nous, de grâce. Je promets de n'en pas publier davantage. Aux joies du travail succèdent les dégoûts du besoin de vivre; bon gré mal gré, il faut trafiquer de la Muse: le commerce m'ennuie; je me retire. Mon ambition n'a jamais été à plus d'un morceau de pain pour mes vieux jours: elle est satisfaite, bien que je ne sois pas même électeur, et que je ne puisse espérer jamais l'honneur d'être éligible, en dépit de la révolution de Juillet, à qui je n'en veux pas pour cela. A ne faire des chansons que pour vous, dira-t-on, le dégoût vous prendra bien vite. Eh! ne puis-je faire autre chose que des couplets pour ma fête? Je n'ai pas renoncé à être utile. Dans la retraite où je vais me confiner, les souvenirs se presseront en foule. Ce sont les bonnes fortunes d'un vieillard. Notre époque, agitée par tant de passions extrêmes, ne transmettra que peu de jugemens équitables sur les contemporains qui occupent ou ont occupé la scène, qui ont soufflé les acteurs ou encombré les coulisses. J'ai connu un grand nombre d'hommes qui ont marqué depuis vingt ans; sur presque tous ceux que je n'ai pas vus ou que je n'ai fait qu'entrevoir, ma mémoire a recueilli quantité de faits plus ou moins caractéristiques. Je veux faire une espèce de Dictionnaire historique, où, sous chaque nom de nos notabilités politiques et littéraires, jeunes et vieilles, viendront se classer mes nombreux souvenirs et les jugemens que je me permettrai de porter ou que j'emprunterai aux autorités compétentes. Ce travail peu fatigant, qui n'exige ni des connaissances profondes, ni le talent de prosateur, remplira le reste de ma vie. Je jouirai du plaisir de rectifier bien des erreurs et des calomnies qu'enfante toujours une lutte envenimée; car ce n'est pas dans un esprit de dénigrement, on le conçoit, que j'ai formé ce projet. Dans une cinquantaine d'années, ceux qui voudront écrire l'histoire de ces jours féconds en événemens, n'auront à consulter, je le crains bien, que des documens entachés de partialité. Les notes que je laisserai à ma mort pourront inspirer quelque confiance, même dans ce qu'elles auront de sévère, car je ne prétends pas n'être qu'un panégyriste. Les historiens savent tant de choses, qu'ils sauront sans doute alors que j'ai eu peu à me plaindre des hommes, même des hommes puissans; que si je n'ai rien été, c'est comme d'autres sont quelque chose, je veux dire en me donnant de la peine pour cela; ils n'auront donc pas à me ranger au nombre des gens désappointés et chagrins. Ils sauront peut-être aussi que j'ai joui de la réputation d'observateur assez attentif, assez exact, assez pénétrant, et qu'enfin je m'en suis toujours plutôt pris à la faiblesse des hommes qu'à leur mauvais vouloir du mal que j'ai pu voir faire dans mon temps. Des matériaux recueillis dans cet esprit manquent trop souvent pour que les historiens à venir ne tirent pas bon parti de ceux que je laisserai. La France un jour pourra m'en savoir gré. Qui sait si ce n'est pas à cet ouvrage de ma vieillesse que mon nom devra de me survivre? Il serait plaisant que la postérité dît: Le judicieux, le grave Béranger! Pourquoi pas?
Mais voici bien des pages à la suite les unes des autres, sans trop de logique, ni surtout de nécessité. Se douterait-on, à la longueur de cette préface, que j'ai toujours redouté d'entretenir le public de moi, autrement qu'en chansons? Je crains bien d'avoir abusé étrangement du privilège que donne l'instant des adieux: il me reste pourtant encore une dette de cœur à acquitter.
Au risque d'avoir l'air de solliciter pour mes nouvelles chansons l'indulgence des journaux, mise par moi si souvent à l'épreuve, je dois témoigner ma reconnaissance à leurs rédacteurs, pour l'appui qu'ils m'ont prêté dans mes petites guerres avec le pouvoir. Ceux de mon opinion ont plus d'une fois bravé les ciseaux de la censure et les ongles de la main de justice pour venir à mon secours dans les momens périlleux. Nul doute que sans eux on ne m'eût fait payer plus chèrement la témérité de mes attaques. Je ne suis point de ceux qui oublient les obligations qu'ils ont à la presse périodique.
Je me fais un devoir d'ajouter que même les journaux de l'opinion la plus opposée à la mienne, tout en repoussant l'hostilité de mes principes, m'ont paru presque toujours garder la mesure qu'un homme convaincu a droit d'attendre de ses adversaires, surtout quand il ne s'en prend qu'à ceux qui sont en position de se venger.
J'attribue cette bienveillance si générale à l'empire qu'exerce en France le genre auquel je me suis exclusivement livré. Cela seul suffirait pour m'ôter toute envie d'accoler jamais aucun autre titre à celui de chansonnier, qui m'a rendu cher à mes concitoyens.
23.Comte on "Protecting Property against Threats from the State and Protecting Property acquired by Usurpation" (1834)↩
[Word Length: 4,678]
Source
Comte, Charles, Traité de la propriété, 2 vols. (Paris: Chamerot, Ducollet, 1834). Tome deuxième. Chap. XLII "De la garantie des propriétés de tous les genres, contre les atteintes du gouvernement et de ses agens," pp. 290-302; Chap. XLIV "De la garantie donnée aux possesseurs des biens acquis par usurpation, et des causes de cette garantie," pp. 316-325.
CHAPITRE XLII. De la garantie des propriétés de tous les genres, contre les atteintes du gouvernement et de ses agens.
Les propriétés nationales peuvent recevoir des atteintes de la part de deux classes de personnes de l'intérieur: de la part des hommes auxquels la garde ou l'administration en sont confiées, et de la part de simples particuliers. Il fout donc, pour qu'elles soient garanties, qu'il existe dans l'Etat une puissance qui prévienne ou réprime les atteintes qui peuvent être commises par les uns et par les autres, et qui ne soit pas disposée à devenir leur complice. Or, cette puissance ne peut pas être distincte de celle des propriétaires, c'est-à-dire de la nation elle-même, qui l'exerce par des délégués qu'elle choisit, ou qu'elle donne mission de choisir.
Une nation manque donc de garanties, relativement à ses propriétés, toutes les fois qu'elle est sans influence sur la nomination des fonctionnaires qui en ont la garde ou l'administration, et qu'elle ne peut ni déterminer l'emploi des choses qui lui appartiennent, ni s'en faire rendre compte. Les peuples qui sont soumis à des gouvernemens absolus, tels que la plupart de ceux de l'Europe, sont complétement privés de garanties, relativement à leurs propriétés nationales, et aux atteintes que peuvent y porter les hommes qui les administrent. Quelle est, par exemple, en Russie, en Autriche, en Italie, en Espagne, la puissance qui peut empêcher les gouvernans de détourner à leur profit particulier les propriétés nationales, ou les contraindre, soit à en prendre soin, soit à les appliquer aux besoins des vrais propriétaires, c'est-à-dire des nations?
Sous les gouvernemens aristocratiques, les classes de la population qui sont exclues de toute participation aux affaires publiques, sont privées de garanties relativement aux propriétés nationales. Il n'existe, en effet, aucun pouvoir qui empêche les membres de l'aristocratie d'appliquer aux besoins de leurs familles les biens qui ne devraient être employés qu'au profit de tous les membres de l'Etat. Aussi, dans tous les pays soumis à ce mode de gouvernement, observe-t-on qu'une bonne part des revenus nationaux est employée à faire vivre et souvent même à enrichir les possesseurs du pouvoir.
Pour les communes, de même que pour les nations, il n'y a de garantie pour leurs propriétés qu'autant qu'elles ont la faculté d'en jouir et d'en disposer, et qu'il existe dans l'Etat une puissance qui prévient ou réprime les atteintes dont elles sont ou peuvent être l'objet. Si, par violence ou par fraude, on privait un particulier de la faculté de jouir et de disposer de ses biens, on porterait évidemment atteinte à ses propriétés; et si cette privation devait être perpétuelle, l'atteinte aurait tous les caractères d'une véritable spoliation. Par la même raison, si un pouvoir quelconque s'emparait de l'administration et de la disposition des biens des communes, elles se trouveraient par ce seul fait dépouillées de leurs propriétés.
Au commencement de ce siècle, une spoliation semblable fut exécutée contre toutes les communes de France, lorsqu'un général dispersa, par la force armée la représentation nationale, et s'empara de l'autorité publique. Le simulacre de constitution qui fut publié pour donner à l'usurpation des droits des citoyens une apparence de légalité, ne disait pas un mot des propriétés des communes; mais il attribuait au chef du gouvernement ou à ses délégués la nomination de tous les officiers auxquels l'administration en était confiée, et qui pouvaient en demander compte.
Dès ce moment, il n'exista plus d'association communale proprement dite: les délégués des communes furent destitués; des hommes élus par le nouveau gouvernement se mirent à leur place; ils s'emparèrent de l'administration des biens communaux; ils en déterminèrent l'emploi selon leurs vues particulières, ou selon les ordres qui leur étaient transmis par leurs supérieurs; enfin, ils ne furent tenus de rendre compte de leur gestion qu'au pouvoir qui les avait élus ou à ses agens.
Si jamais un attentat semblable était exécuté contre les citoyens; si un général, après avoir détruit la représentation nationale et renversé le gouvernement, faisait passer dans les mains de ses délégués toutes les propriétés privées; s'il ne les rendait comptables qu'envers lui-même, quel est l'homme qui ne verrait pas dans une telle mesure une spoliation générale? La circonstance, que le possesseur du pouvoir aurait chargé ses delégués de consacrer les revenus des biens ravis à satisfaire quelques-uns des besoins des personnes qu'il aurait dépouillées, ne changerait pas la nature du fait. Il suffirait, pour que la spoliation fût complète, que les propriétaires fussent privés de la faculté de jouir et de disposer de leurs biens, et qu'ils fussent mis dans l'impuissance de jamais en demander compte. Or, il est évident que l'acte qui serait une spoliation pour une personne, en est une pour une agrégation de personnes: il n'y a de différence que dans le nombre des citoyens dépouillés, et dans l'importance de la spoliation.
Les propriétés des communes ne sont donc véritablement garanties que lorsqu'elles sont hors des atteintes particulières des fonctionnaires auxquels l'administration en est confiée, et du gouvernement ou de ses agens; lorsque les propriétaires, c'est-à-dire les membres de la commune, les font administrer par des hommes qu'ils ont choisis, et auxquels ils peuvent demander compte de leur gestion.
Il ne faudrait pas cependant assimiler à un particulier ces agrégations de personnes auxquelles on donne le nom de communes ou de nations. Un individu, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, passe par divers états, et est soumis à des règles différentes, selon qu'il est plus ou moins capable. Au moment où il vient de naître, et même plusieurs années après, il peut avoir des propriétés, et cependant sa volonté n'exerce sur elle aucune influence. Lorsqu'il est complétement développé, il jouit et dispose de ses biens, sans être soumis à aucune sorte de contrôle; sa volonté a la puissance d'une loi. Si ses facultés intellectuelles disparaissent ou s'affaiblissent considérablement, il perd la faculté de disposer de ses propriétés, ou est soumis à diverses restrictions.
Ces périodes de faiblesse et de force, d'incapacité et d'intelligence, ne se font pas remarquer, du moins de la même manière, chez ces corps que nous appelons des nations ou des communes; mais aussi l'on y trouve, à toutes les époques, un grand nombre de personnes qui ne peuvent prendre aucune part directe ou indirecte à l'administration des biens communs, et qui cependant ont à ces biens les mêmes droits que les hommes les plus capables. Les enfans, les femmes, les interdits, et ceux que leur incapacité supposée prive de l'exercice de tout droit politique, ont droit de jouir, comme tons les autres membres de l'Etat, de tous les avantages que peuvent procurer les propriétés de la commune et celles de la nation. Aucun d'eux cependant ne peut concourir à l'élection des hommes chargés de les administrer, ou d'en faire rendre compte.
Une commune, et moins encore une nation, ne peut administrer ses biens par elle-même; elle ne peut pas, non plus, examiner par elle-même la manière dont ils ont été administrés. Il faut qu'elle en confie la gestion à certains de ses membres, et qu'elle délègue à d'autres le pouvoir de vérifier les comptes de ses administrateurs. Mais, quand une commune ou une nation délègue une partie de ses pouvoirs, les élections ne se font pas à l'unanimité; ce n'est pas, non plus, à l'unanimité que les résolutions se forment dans les corps délibérans. Il y a donc toujours, soit dans une commune, soit dans une nation, un grand nombre de personnes qui n'ont pas été appelées à prendre part aux élections, ou qui ont refusé leurs suffrages aux hommes charges des affaires publiques. Il y a aussi, dans tout corps délibérant, des membres qui désapprouvent les résolutions qui y sont prises. Les hommes qui forment la minorité et ceux qui ne sont pas appelés à donner leur suffrage, soit dans les élections, soit dans les assemblées délibérantes, n'ont pas moins de droit cependant que ceux qui composent la majorité, aux propriétés communales ou nationales.
La nécessité, soit de refuser l'exercice des droits politiques à un grand nombre de personnes incapables de les exercer, soit de s'en rapporter, dans une infinité de circonstances, aux décisions de la majorité, ont fait mettre certaines restrictions, donner certaines limites à l'autorité des hommes chargés d'administrer les biens d'une commune ou d'une nation. On a senti qu'il était nécessaire de prévenir les abus que les majorités peuvent faire de leur pouvoir, et surtout de protéger les intérêts des personnes que leur âge, leur sexe ou d'autres causes, privent de toute influence dans l'administration des choses publiques. Les restrictions données aux divers pouvoirs de l'Etat, quand elles ont pour but et pour résultat la conservation des droits ou des intérêts des personnes qui ne peuvent pas se défendre, soit par elles-mêmes, soit par leurs délégués, ne sont pas des atteintes à la propriété; elles sont, au contraire, de véritables garanties. Elles sont, pour un grand nombre des membres des communes ou de l'État, ce que sont les lois relatives à la tutelle pour les enfans qui n'ont point atteint leur majorité.
Les propriétés individuelles ou de famille sont exposées aux mêmes dangers que les propriétés de l'État et des communes; elles peuvent recevoir des atteintes de la part des peuples voisins, de la part des membres du gouvernement ou de ses agens, et de la part des simples particuliers. Elles ne sont donc complétement garanties que lorsqu'il existe, au sein de la nation, des pouvoirs qui préviennent ou répriment les atteintes dont elles sont ou peuvent être l'objet, quels qu'en soient les auteurs.
La puissance qui met les propriétés nationales à l'abri des attaques de l'étranger, garantit par cela même les propriétés privées des atteintes qui pourraient venir de l'extérieur. Il peut arriver cependant qu'une propriété individuelle reçoive une atteinte, non d'une nation voisine, mais d'un homme qui fait partie de cette nation. Il peut arriver aussi qu'un étranger que les lois nationales ne peuvent atteindre, soit détenteur des biens d'un citoyen. Lorsque de tels événemens arrivent, et que la personne lésée dans ses intérêts, ne peut pas obtenir justice des juges de la personne dont elle se plaint, elle est protégée par les agens diplomatiques. L'institution de ces agens est donc une véritable garantie, même pour les simples particuliers; mais cette garantie n'est efficace qu'autant qu'elle peut, au besoin, être appuyée par une force qui sait se faire respecter.
Lorsque nous parlons des atteintes qu'un gouvernement peut porter aux propriétés privées, il faut entendre ces mots dans le sens le plus large. Ce mot gouvernement ne désigne pas seulement ici les ministres auxquels l'exécution des lois est confiée; il embrasse les principaux pouvoirs de l'Etat et leurs agens. Les propriétés peuvent recevoir des atteintes de la puissance qui fait les lois, comme de la force armée qui en assure l'exécution; des magistrats chargés de l'administration de la justice, comme des officiers dont la mission est de faire exécuter les jugemens. Les propriétés ne sont pas garanties, lorsque les législateurs chargés de voter les impôts se les partagent, sous le nom de fonctionnaires, de concert avec les ministres; et surtout lorsque la part de chacun est en raison de sa complaisance pour les agens comptables de la fortune publique.
On ne doit pas non plus perdre de vue que par le mot propriété nous n'entendons pas seulement les propriétés territoriales, ainsi que cela se pratique trop souvent; nous entendons les propriétés de tous les genres, tous les moyens d'existence qu'un individu s'est créés sans blesser les lois de la morale, et sans attentera la liberté d'autrui, ou qui lui ont été régulièrement transmis par ceux qui les avaient formés.
Un gouvernement peut porter atteinte aux propriétés des citoyens, en s'en emparant par une simple voie de fait; en imputant aux propriétaires certains délits, afin de s'approprier leurs biens par confiscation; en s'attribuant le monopole d'une industrie qui fournit des moyens d'existence à une ou à plusieurs familles; en faisant banqueroute à ses créanciers, ou, ce qui est la même chose, en se libérant de ses dettes au moyen d'une monnaie dépréciée; en s'attribuant, pour son avantage particulier, une part plus ou moins grande des revenus des citoyens; enfin y en empruntant des sommes considérables qu'il emploie dans son intérêt particulier, et dont il déclare le peuple débiteur.
Les atteintes que les gouvernemens portent aux propriétés privées sont plus ou moins brutales, plus ou moins déguisées, selon que les nations qu'ils régissent sont plus ou moins éclairées. Les gouvernemens des peuples civilisés ont renoncé aux spoliations les plus violentes; ils trouvent qu'il est plus lucratif et moins dangereux de s'approprier une part dès revenus de chacun, que de dépouiller un petit nombre de riches familles de tous leurs biens. Il n'y a plus que des gouvernement qui sont tout-à-fait barbare et qui n'entendent rien aux raffinemens de la civilisation, qui cherchent à s'enrichir par des confiscations. Si les autres n'ont pas toujours plus de probité, ils ont du moins plus d'habileté; selon le précepte du plus sage des rois, ils oppriment leurs peuples avec prudence.
Il n'est, pour une nation, qu'un moyen véritablement efficace de mettre les propriétés privées comme les propriétés publiques hors des atteintes des hommes chargés du gouvernement; c'est de s'organiser de telle manière que les malhonnêtes gens ne puissent jamais s'emparer de la direction de ses affaires, ou que du moins ils ne puissent pas la conserver, si, par ruse ou par hypocrisie, ils parviennent à s'en saisir. Un peuple qui ne pourrait pas ou qui ne saurait pas empêcher des hommes disposés à s'enrichir à ses dépens, de parvenir aux plus hauts emplois, chercherait en vain des garanties contre leur improbité; il ne saurait en trouver. L'organisation de tous les propriétaires, pour leur défense commune est, ainsi que je l'ai déjà dit, le fondement de toute véritable garantie.
Mais il ne suffit pas, pour que les propriétés soient hors des atteintes des personnes investies de l'autorité publique, que les propriétaires soient organisés et qu'ils se gouvernent par des hommes qu'ils ont choisis; il faut, de plus, que nul impôt ne puisse être exigé ni perçu, à moins que la nécessité n'en ait été constatée, et qu'il n'ait été consenti par les délégués de ceux qui doivent le payer; il fout, en troisième lieu, que les hommes qui votent les impôts, ne soient pas autorités à se les partager; il faut enfin que les fonctionnaires auxquels l'exécution des lois est confiée, et qui sont dépositaires d'une part des propriétés nationales, soient responsables, envers le public, de l'usage qu'ils ont fait de leurs pouvoirs, et que, par conséquent ils puissent être poursuivis au nom de la nation à laquelle ils ont à rendre compte.
Enfin, la troisième condition nécessaire à l'existence de la garantie, est que toute personne qui se croit lésée dans ses biens par des dépositaires du pouvoir, quel que soit leur rang, puisse les traduire devant un tribunal intègre, éclairé, indépendant. Un tribunal dont tous les membres auraient été choisis par une des parties intéressées, et qui attendraient d'elle leur avancement et leur fortune, ne serait pas toujours, pour l'autre partie, une garantie bien sûre.93
En Angleterre, où les juges sont nommés par le Roi, de même qu'en France, on croirait qu'il n'existe aucune garantie, soit pour les personnes, soit pour les propriétés, si ces délégués de la couronne étaient appelés à prononcer sur les questions qui s'élèvent entre les particuliers et le gouvernement; cependant, ces juges sont réellement inamovibles; pour eux, il n'y a pas d'avancement possible. En France, nous pensons ou du moins nous agissons différemment; c'est aux hommes que le monarque a choisis et qui attendent de lui leur avancement et leur fortune, qu'est dévolu le jugement de tous les procès qui peuvent exister entre lui et les citoyens. Cette manière de procéder est, sans doute, une garantie pour le prince; mais elle n'en est pas une pour les personnes auxquelles il lait intenter des procès par ses délégués.
CHAPITRE XLIV. De la garantie donnée aux possesseurs des biens acquis par usurpation, et des causes de cette garantie.
En exposant comment se forment les propriétés privées, et comment des familles et des nations peuvent, sans dépouiller personne de ses biens, arriver au plus haut degré de prospérité, je n'ai pas dit ou voulu faire entendre que le hommes ne se sont jamais enrichis que par les moyens que j'ai décrits. Une pareille affirmation, si je l'avais faite, aurait été démentie par l'histoire de toutes les nations du globe, et surtout par les faits que j'ai rapportés dans un autre ouvrage. Il est, en effet, chez tous les peuples, un nombre plus ou moins grand de familles qui ne doivent les richesses qu'elles possèdent qu'à des actes de violence ou de fraude. Ces familles considèrent leurs biens comme des propriétés très-légitimes, et reçoivent de l'autorité la même protection que les personnes qui ne se sont enrichies que par leur industrie. Quelquefois même, la protection qu'elles obtiennent est plus prompte et plus efficace que celle dont jouissent les autres membres de la société, surtout sous les gouvernemens qui sont fondés sur le principe de la conquête.
On peut ranger dans quatre grandes classes les acquisitions faites par la violence et la fraude: dans la première, on peut mettre celles qui s'exécutent à la suite de la conquête, quand, par exemple, une armée étrangère s'établit sur une nation industrieuse, et s'empare de ses moyens d'existence; on peut mettre dans la seconde celles qui s'exécutent à la suite des dissentions religieuses ou politiques, quand la faction la plus forte proscrit la plus faible, et confisque ses propriétés; on peut mettre dans la troisième celles qui s'opèrent par des priviléges ou des monopoles, quand, pour enrichir certaines familles, on leur attribue la faculté d'exploiter certaines branches d'industrie ou de commerce, et qu'on l'interdit à la masse de la population; enfin, on peut mettre dans la quatrième les usurpations qui se commettent individuellement, par suite des vices de la législation, soit au préjudice du public, soit au préjudice de quelques particuliers.
Il n'est aucune nation en Europe qui, à une époque plus ou moins reculée, n'ait vu commettre sur son territoire toutes sortes de spoliations. Avant l'invasion des Romains, la population était partout divisée en maîtres et en esclaves: ce qui nous prouve que déjà des peuples industrieux avaient été dépouillés par des peuples guerriers. Il est probable que partout où les armées romaines s'établirent, elles se mirent à la place des anciens conquérans, et dépouillèrent principalement les descendans des usurpateurs. Il est également probable que les peuples germaniques, qui, dans le quatrième et le cinquième siècle, renversèrent l'empire romain, se substituèrent particulièrement aux familles des conquérans qui les avaient précédés. Dans la Grande-Bretagne, par exemple, les Romains, qui avaient dépossédé les Celtes, furent ensuite dépossédés par les Saxons, lesquels le furent, quelques siècles plus tard, par les Normands. Dans tous les temps, les richesses ont subi les mêmes révolutions que le pouvoir: les hommes qui dépouillaient certaines classes de la société de leur puissance, les dépouillaient en même temps de leurs propriétés.
Les spoliations commises par des confiscations, à la suite des dissentions politiques ou religieuses, ont produit un déplacement de richesses moins considérable que ceux dont étaient jadis suivies les invasions à main armée; mais elles ont été cependant la source d'un nombre considérable de fortunes particulières. Les peuples chrétiens, avant de se diviser en sectes, et de se dépouiller les unes les autres de leurs richesses, avaient proscrit les juifs par milliers, afin de s'emparer de leurs biens. Plus tard, ce furent les biens des chrétiens dissidens qui formèrent la fortune des familles qui jouissaient d'un grand crédit. Dans d'autres occasions, les querelles entre des hommes qui se disputaient la possession du pouvoir, ont fait passer les richesses des vaincus entre les mains des vainqueurs.
Les monopoles ou les priviléges ont été, chez toutes les nations industrieuses, la source d'un grand nombre de fortunes privées. Ces moyens de s'enrichir aux dépens du public, ont été même plus souvent employés chez les peuples qui, par leurs dispositions naturelles ou par leur situation, étaient appelées à faire un grand commerce, que chez les autres. L'Angleterre et la France ont été plus opprimées par des monopoles de tous les genres que les autres nations européennes.
Quant aux fortunes acquises par des abus particuliers de pouvoir ou par les vices des lois, elles sont moins nombreuses que celles auxquelles des invasions armées ont autrefois donné naissance; mais il en existe toujours un assez grand nombre chez toutes les nations qui, pendant long-temps, ont été soumises à de mauvais gouvernemens; et comme tous les peuples connus ont passé par un tel état, il n'en est aucun où l'on ne trouve des fortunes dont la source ne soit vicieuse.
Lorsqu'une nation envahit un territoire occupé par une autre, et qu'elle s'empare de ses moyens d'existence, la population placée sur le même sol reste pendant long-temps divisée en deux castes: celle des vainqueurs et celle des vaincus. Si la première demeure séparée de la seconde, non-seulement par une différence d'origine, mais par des différences de religion et de lois, et par les mesures qu'elle prend pour empêcher que les descendans des vaincus ne deviennent propriétaires, la guerre continue entre les deux races. Les descendans des vainqueurs trouvent la garantie de leurs possessions dans leur organisation politique et militaire, et dans la division, la faiblesse et la misère des vaincus. Les grandes questions de propriété qui s'élèvent dans un tel état, ne sont ordinairement résolus que par la force, et il n'y a que des révolutions qui puissent établir le règne de la justice et de la liberté.
Si les deux populations se mêlent, si les aliénations de propriétés immobilières sont autorisées, si la classe des vaincus obtient quelques garanties pour les produits de son industrie, le travail finit par donner aux hommes laborieux la prépondérance sur ceux qui vivent dans l'oisiveté. L'aversion du travail et le goût de la dissipation, qui se rencontrent toujours dans les castes habituées à vivre sur les produits des travaux d'autrui, ne tardent pas à ruiner les familles qui s'y livrent, et qui ne peuvent pas réparer les brèches faites à leur fortune par le monopole du pouvoir. Il arrive alors que les valeurs anciennement usurpées sont graduellement consommées par ceux qui les avaient acquises, et qu'elles sont remplacées par les nouvelles valeurs auxquelles l'industrie donne naissance.
Autant les hommes sont portés, par leur tendance naturelle, à s'élever dans l'ordre social, autant ils éprouvent de répugnance à descendre ou à voir descendre leur postérité. Les mariages produisent généralement moins d'enfans dans les hauts rangs de la société, que dans les rangs inférieurs. On craint peu, dans ceux-ci, de voir déchoir sa race, tandis que dans ceux-là, cette crainte est un frein puissant. Il résulte de cette tendance que les familles qui, par préjugé de caste, méprisent le travail, et sont portées vers la dissipation, ne peuvent long-temps se perpétuer, si elles sont obligées de respecter les propriétés d'autrui. S'il était possible de suivre, pendant plusieurs siècles, la filiation des familles qui existent sur notre territoire, il est douteux qu'on y trouvât beaucoup de descendans, je ne dis pas des grandes familles romaines qui s'y étaient établies, mais des compagnons de Clovis. En supposant qu'on en trouvât quelques-unes, il est plus douteux encore qu'on pût trouver parmi les biens qu'elles possèdent une part de ceux qui furent acquis à l'époque de la conquête.
On peut faire des observations semblables sur les biens acquis par suite des confiscations qui furent la suite des proscriptions religieuses du moyen âge et du seizième siècle; les familles qui furent alors dépouillées, et celles qui s'emparèrent de leurs dépouilles, sont pour la plupart éteintes. Si quelques-unes des dernières existent encore, elles ont probablement cessé de posséder des biens qui furent autrefois injustement acquis. Il ne serait guère possible d'ailleurs de suivre à travers les révolutions religieuses ou politiques dont un vaste pays a été le théâtre, à plusieurs siècles de distance, toutes les mutations qui se sont opérées dans les propriétés, et de distinguer celles qui furent légitimes, de celles qui ne furent que des usurpations.
Lorsque les familles qui possédaient jadis une partie du territoire à titre de propriétaires, se sont éteintes, et que les mêmes terres ont donné naissance à de nouvelles familles, celles-ci les considèrent comme leurs propriétés. Les hommes, en effet, ne croient pas avoir seulement la propriété des divers objets qu'ils ont formes par leur industrie; ils se considèrent aussi comme propriétaires des choses auxquelles ils doivent eux-mêmes l'existence et sans lesquelles ils ne sauraient se conserver. Le seul fait de posséder une chose est, chez tous les peuples, un titre pour en jouir et en disposer, quand personne ne peut produire un titre préférable. Une longue et paisible jouissance à titre de propriétaire, suffit également, chez toutes les nations, pour transférer la propriété d'une chose, quand celui qui aurait pu la revendiquer, n'en a été empêché par aucun obstacle qu'il ne pût surmonter.
Ces espèces de rapports qui existent entre les hommes et les choses au moyen desquelles ils se conservent et se perpétuent, se dissolvent et périssent par la cessation de la jouissance ou par l'abandon, comme ils se forment par la possession. Il semble même que lorsqu'on a déterminé la durée du temps pendant lequel il faudrait posséder une chose pour l'acquérir irrévocablement, on ait voulu prendre pour mesure le terme moyen de la vie humaine. La famille qui, pendant trente années, a joui d'une chose à titre de propriétaire, a dû régler ses habitudes, ses besoins, ses alliances suivant l'état présumé de sa fortune. L'en dépouiller après une possession si longue, ce serait la condamner à la ruine ou même à la destruction. Celle, au contraire, qui, pendant la même durée de temps, n'a retiré d'une chose aucune espèce d'avantage, et qui n'a même pas manifesté la volonté d'en jouir, n'est condamnée à s'imposer aucune privation nouvelle, en restant dans l'état où elle a si long-temps vécu.
Quant aux biens acquis aux dépens du public, à l'aide de monopoles ou par suite des vices des lois, il serait difficile de les priver de garantie, sans porter une atteinte funeste à la sécurité de tous les propriétaires. Lorsqu'un homme a exercé, pendant un certain temps, un monopole plus ou moins lucratif, il ne serait pas possible de déterminer quelle est la part de sa fortune qu'il doit à l'exercice légitime de son industrie ou de son commerce, et quelle est la part qui doit être considérée comme le produit du privilége dont il a joui. Le bien qui pourrait être la suite de la réparation, étant réparti entre tous les membres de la société, serait imperceptible; mais le mal qui en résulterait serait immense. Nul ne pourrait plus se croire en sûreté, si chacun pouvait être appelé à rendre compte des biens qu'il aurait acquis sous une législation qui aurait manqué de justice ou de prévoyance.
Lorsqu'on observe l'origine de quelques grandes fortunes qui frappent les yeux, chez une nation qui a fait de grands progrès dans l'industrie, on peut être frappé de la manière scandaleuse dont elles ont été acquises; mais elles ne sont ni très-nombreuses, ni même très-considérables, quand on les compare à la masse des richesses que le travail a formées et qui sont légitimement possédées.
C'est par respect pour celles-ci qu'on est obligé de garantir celles-là, toutes les fois qu'on ne peut pas les atteindre par des moyens que les lois ont déterminés. La même raison qui s'oppose à ce qu'on remette en jugement un homme injustement acquitté, s'oppose à ce qu'on prive de garantie des biens qui ont déjà obtenu la protection des lois. Une nation qui parviendrait à mettre toutes les propriétés hors des atteintes, non-seulement des malfaiteurs, mais encore des membres de son gouvernement, serait déjà si heureuse, qu'il y aurait de la folie de sa part à compromettre toutes les garanties pour revenir sur le passé.
24.Stendhal on “Political Corruption and Place-Seeking” (1834)↩
[Word Length: 8,696]
Source
Stendahl, Lucien Leuwen, T. III (Paris: Le Divan, 1929). Chaps. 61-64, pp. pp. 288-324
CHAPITRE LXI
TOUT le monde voyait de plus en plus que M. Leuwen allait représenter la Bourse et les intérêts d'argent dans la crise ministérielle que tous les yeux voyaient s'élever rapidement à l'horizon et s'avancer. Les disputes entre le maréchal ministre de la Guerre et ses collègues devenaient journalières et l'on peut dire violentes. Mais ce détail se trouvera dans tous les mémoires contemporains et nous écarterait trop de notre sujet. Il nous suffira de dire qu'à la Chambre M. Leuwen était plus entouré que les ministres actuels.
L'embarras de M. Leuwen croissait de jour en jour. Tandis que tout le monde enviait sa façon d'être, son existence à la Chambre, dont il était fort content aussi, il voyait clairement l'impossibilité de la faire durer. Tandis que les députés instruits, les gros bonnets de la banque, les diplomates en petit nombre qui connaissent le pays où ils sont, admiraient la facilité et l'air de désoccupation avec lequel M. Leuwen conduisait et le grand changement de personnes la tête duquel il s'était placé, cet homme d'esprit était au désespoir de ne point avoir de projet.
- Je retarde tout, disait-il à sa femme et à son fils, je fais dire au maréchal qu'il pousse à bout le ministre des Finances, qu'il pourrait bien amener une enquête sur les quatre ou cinq millions d'appointements qu'il se donne, j'empêche le de Vaize, qui est hors de lui, de faire des folies, je fais dire à ce gros Bardoux des Finances que nous ne dévoilerons que quelques-unes des moindres bourdes de son budget, etc., etc. Mais au milieu de tous ces retards il ne me vient pas une idée. Qui est-ce qui me fera la charité d'une idée ?
- Vous ne pouvez pas prendre votre glace et vous avez peur qu'elle ne se fonde, dit madame Leuwen. Cruelle situation pour un gourmand!
- Et je meurs de peur de regretter ma glace quand elle sera fondue.
Ces conversations se renouvelaient tous les soirs autour de la petite table où madame Leuwen prenait son lichen.
Toute l'attention de M. Leuwen était appliquée maintenant à retarder la chute du ministère. Ce fut dans ce sens qu'il dirigea ses trois ou quatre dernières conversations avec un grand personnage. Il ne pouvait pas être ministre, il ne savait qui porter au ministère, et si un ministère était fait sans lui, il perdait sa position.
Depuis deux mois, M. Leuwen était extraordinairement ennuyé par M. Grandet qui, à bon compte, s'était mis à se souvenir tendrement qu'ils avaient autrefois travaillé ensemble chez M. Perregaux. M. Grandet lui faisait la cour et semblait ne pas pouvoir vivre sans le père ou le fils.
- Ce fat-là voudrait être receveur général à Paris ou à Rouen, ou vise-t-il à la pairie ?
- Non, il veut être ministre.
- Ministre, lui ? Grand Dieu répondit M. Leuwen en éclatant de rire. Mais ses chefs de division se moqueraient de lui!
- Mais il a cette importance épaisse et sotte qui plaît tant à la Chambre des députés. Au fond, ces messieurs abhorrent l'esprit. Ce qui leur déplaisait en MM. Guizot et Thiers, qu'était-ce, sinon l'esprit? Au fond, ils n'admettent l'esprit que comme mal nécessaire. C'est l'effet de l'éducation de l'Empire et des injures que Napoléon adressa à l'idéologie de M. de Tracy à son retour de Moscou.
- Je croyais que la Chambre ne voudrait pas descendre plus bas que le comte de Vaize. Ce grand homme a juste le degré de grossièreté et d'esprit cauteleux à la Villèle pour être de plain-pied et à deux de jeu avec l'immense majorité de la Chambre. Mais ce M. Grandet, tellement plat, tellement grossier, le supporteront- ils ?
— La vivacité et la délicatesse de l'esprit seraient un défaut certainement mortel pour un ministre, la Chambre de gens de l'ancien régime à laquelle M. de Martignac avait affaire eut bien de la peine à lui pardonner un joli petit esprit de vaudeville, qu'eût-ce été s'il eût joint à ce défaut cette délicatesse qui choque tant les marchands épiciers et les gens à argent ? S'il doit y avoir excès, l'excès de grossièreté est bien moins dangereux on peut toujours y remédier.
- Mais ce Grandet ne conçoit pas d'autre vertu que de s'exposer au feu d'un pis- tolet ou d'une barricade d'insurgés. Dès que, dans une affaire quelconque, un homme ne se rendra pas à un bénéfice d'argent, à une place dans sa famille ou à quelques croix, il criera à l'hypocrisie. Il dit qu'il n'a jamais vu que trois dupes en France MM. de Lafayette, Dupont de l'Eure et Dupont de Nemours qui entendait le langage des oiseaux. S'il avait encore quelque esprit, quelque instruction, quelque vivacité pour ferrailler agréablement dans la conversation, il pourrait faire quelque illusion; mais le moins clairvoyant aperçoit tout de suite le marchand de gigembre enrichi qui veut se faire duc.
C'était un homme bien autrement commun encore que M. de Vaize.
— M. le comte de Vaize est un Voltaire pour l'esprit et un Jean-Jacques pour le sentiment romanesque, si on le compare à Grandet.
C'était un homme qui, comme le M. de Castries du siècle de Louis XVI, ne concevait pas que l'on pût tant parler d'un d'Alembert et d'un Diderot, gens sans voiture. De telles idées étaient de bon ton en 1780, elles sont aujourd'hui au-dessous d'une gazette légitimiste de province et elles compromettent le parti.
Depuis le grand succès que son second discours à la Chambre avait procuré à M. Leuwen, Lucien remarqua qu'il était un tout autre personnage dans le salon de madame Grandet. Il tâchait de profiter de cette nouvelle fortune et parlait de son amour, mais, au milieu de toutes les recherches du luxe le plus cher, Lucien n'apercevait que le génie de l'ébéniste ou moins délicats du caractère de madame Grandet. Il était poursuivi par une image funeste qu'il faisait de vains efforts pour éloigner la femme d'un marchand mercier qui vient de gagner le gros lot à une de ces loteries de Vienne que les banquiers de Francfort se donnent tant de peine pour faire connaître.
Madame Grandet n'était point ce qu'on appelle une sotte, et elle s'apercevait fort bien de ce peu de succès.
- Vous prétendez avoir pour moi un sentiment invincible, lui dit-elle un jour avec humeur, et vous n'avez pas même ce plaisir à voir les gens qui précède l'amitié!
« Grand Dieu Quelle vérité funeste se dit Lucien. Est-ce qu'elle va avoir de l'esprit à mes dépens? »
Il se hâta de répondre:
- Je suis d'un caractère timide, enclin à la mélancolie, et ce malheur est aggravé par celui d'aimer profondément une femme parfaite et qui ne sent rien pour moi.
Jamais il n'avait eu plus grand tort de faire de telles plaintes c'était désormais madame Grandet qui faisait pour ainsi dire la cour à Lucien. Celui-ci semblait profiter de cette position, mais il y avait qu'il semblait s'en prévaloir surtout quand il y avait beaucoup de monde. S'il trouvait madame Grandet environnée seulement par ses complaisants habituels, il faisait des efforts incroyables pour ne pas les mépriser.
« Ont-ils tort de sentir la vie d'une façon opposée à la mienne ? Ils ont la majorité pour eux! »
Mais, en dépit de ces raisonnements fort justes, peu à peu il devenait froid, silencieux, sans intérêt pour rien.
« Comment parler de la vraie vertu, de la gloire, du beau, devant des sots qui comprennent tout de travers et cherchent à salir par de basses plaisanteries tout ce qui est délicat ?»
Quelquefois, à son insu, ce dégoût profond le servait et rachetait les mouvements impétueux qu'il avait encore quelquefois et que la société de Nancy avait fortifiés en lui au lieu de les corriger.
« Voilà bien l'homme de bon ton, se disait madame Grandet en le voyant debout devant sa cheminée, tourné vers elle et ne regardant rien. Quelle perfection pour un homme dont le grand-père peut-être n'avait pas de carrosse! Quel dommage qu'il ne porte pas un nom historique! Les moments vifs qui forment une sorte de tache dans ses manières seraient de l'héroïsme. Quel dommage qu'il n'arrive pas quelqu'un dans le salon pour jouir de la haute perfection de ses manières! »
Elle ajoutait cependant:
« Ma présence devrait le tirer de cet état normal de l'homme comme il faut, et il semble que c'est surtout quand il est seul avec moi… et avec ces messieurs (madame Grandet eût presque dit en se parlant à soi-même avec ma suite ») qu'il étale le plus de désintérêt et de politesse… S'il ne montrait jamais de chaleur pour rien, disait madame Grandet, je ne me plaindrais pas. »
Il est vrai que Lucien, désolé de s'ennuyer autant dans la société d'une femme qu'il devait adorer, eût été encore plus désolé que cet état de son âme parût et, comme il supposait ces gens-là très attentifs aux procédés personnels, il redoublait de politesse et d'attentions agréables à leur égard.
Pendant ce temps, la position de Lucien, secrétaire intime d'un ministre turlupiné par son père, était devenue fort délicate. Comme par un accord tacite, M. de Vaize et Lucien ne se parlaient presque plus que pour s'adresser des choses polies un garçon de bureau portait les papiers d'un bureau à l'autre. Pour marquer confiance à Lucien, le comte de Vaize l'accablait pour ainsi dire des grandes affaires du ministère.
« Croit-il pouvoir me faire crier grâce ? pensait Lucien, et il travailla au moins autant que trois chefs de bureau. Il était souvent à son bureau dès sept heures du matin, et bien des fois pendant le dîner faisait faire des copies dans le comptoir de son père, et retournait le soir au ministère pour les faire placer sur la table de Son Excellence. Au fond, l'Excellence recevait avec toute l'humeur possible ces preuves de ce qu'on appelle dans les bureaux du talent.
— Ceci est plus hébétant au fond, disait [Lucien] à Coffe, que de calculer le chiffre d'un logarithme qu'on veut pousser à quatorze décimales.
- M. Leuwen et son fils, disait M. de Vaize à sa femme, veulent apparemment me prouver que j'ai mal fait de ne pas lui offrir une préfecture à son retour de Caen. Que peut-il demander ? Il a eu son grade et sa croix, comme je le lui avais promis s'il réussissait, et il n'a pas réussi.
Madame de Vaize faisait appeler Lucien trois ou quatre fois la semaine, et lui volait un temps précieux pour ses paperasses.
Madame Grandet trouvait aussi des prétextes fréquents pour le voir dans la journée; et, par amitié et reconnaissance pour son père, Lucien cherchait à de ces occasions pour se donner les apparences d'un amour vrai. Il supputait qu'il voyait madame Grandet au moins douze fois la semaine.
« Si le public s'occupe de moi, il doit me croire bien épris et je suis à jamais lavé du soupçon de saint-simonisme. »
Pour plaire à madame Grandet, il marquait parmi les jeunes gens de Paris qui mettent le plus de soin à leur toilette .94
— Tu as tort de te rajeunir, lui disait son père. Si tu avais trente-six ans, ou du moins la mine revêche d'un doctrinaire, je pourrais te donner la position que je voudrais.
Tout cet ensemble de choses durait depuis six semaines, et Lucien se consolait en voyant que cela ne pouvait guère durer six semaines encore, quand, un beau jour, madame Grandet écrivit à M. Leuwen pour lui demander une heure de conversation le lendemain, à dix heures, chez madame de Thémines.
« On me traite déjà en ministre, ô position favorable! » dit M. Leuwen.
Le lendemain, madame Grandet commença par des protestations infinies. Pendant ces circonlocutions bien longues, M. Leuwen restait grave et impassible.
« Il faut bien être ministre, pensait-il, puisqu'on me demande des audiences! »
Enfin, madame Grandet passa aux louanges de sa propre sincérité. M. Leuwen comptait les minutes à la pendule de la cheminée.
« Surtout, et avant tout, il faut me taire pas la moindre plaisanterie sur cette jeune femme si fraîche, si jeune, et déjà si ambitieuse. Mais que veut-elle ? Après tout, cette femme manque de tact, elle devrait s'apercevoir que je m'ennuie. Elle a l'habitude de façons plus nobles, mais moins de véritable esprit, qu'une de nos demoiselles de l'Opéra. »
Mais il ne s'ennuya plus quand madame Grandet lui demanda tout ouvertement un ministère pour M. Grandet.
- Le roi aime beaucoup M. Grandet, ajoutait-elle, et sera fort content de le voir arriver aux grandes affaires. Nous avons de cette bienveillance du Château des preuves que je vous détaillerai si vous le souhaitez et m'en accordez le loisir.
A ces mots, M. Leuwen prit un air extrêmement froid. La scène commençait à l'amuser, il valait la peine de jouer la comédie. Madame Grandet, alarmée et presque déconcertée, malgré la ténacité de son esprit qui ne s'effarouchait pas pour peu de chose, se mit à parler de l'amitié de lui, Leuwen, pour elle…
A ces phrases d'amitié qui demandaient un signe d'assentiment, M. Leuwen restait silencieux et presque absorbé. Madame Grandet vit que sa tentative échouait.
« J'aurai gâté nos affaires, » se dit-elle. Cette idée la prépara aux partis extrêmes et augmenta son degré d'esprit.
Sa position empirait rapidement: M. Leuwen était loin d'être pour elle le même homme qu'au commencement de l'entrevue. D'abord, elle fut inquiète, puis effrayée. Cette expression lui allait bien et lui donnait de la physionomie. M. Leuwen fortifia cette peur.
La chose en vint au point de gravité que madame Grandet prit le parti de lui demander ce qu'il pouvait avoir contre elle. M. Leuwen, qui depuis trois quarts d'heure gardait un silence de mauvais présage,95 avait toutes les peines du monde en ce moment à ne pas éclater de rire.
« Si je ris, pensait-il, elle voit l'abomination de ce que je vais lui dire, et tout l'ennui qui m'assomme depuis une heure est perdu. Je manque l'occasion d'avoir le vrai tirant d'eau de cette vertu célèbre. »
Enfin, comme par grâce, M. Leuwen, qui était devenu d'une politesse désespérante, commença à laisser entrevoir que bientôt peut-être il daignerait s'expliquer. Il demanda des pardons infinis de la communication qu'il avait à dire et puis du mot cruel qu'il serait forcé d'employer. Il s'amusa à promener la terreur de madame Grandet sur les choses les plus terribles.
« Après tout, elle n'a pas de caractère, et ce pauvre Lucien aura là une ennuyeuse maîtresse, s'il l'a. Ces beautés célèbres sont admirables pour la décoration, pour l'apparence extérieure, et voilà tout. Il faut la voir dans un salon magnifique, au milieu de vingt diplomates garnis de leurs crachats, croix, rubans. Je serais curieux de savoir si, après tout, sa madame de Chasteller vaut mieux que cela. Pour la beauté physique, si j'ose ainsi parler, la magnificence de la pose, la beauté réelle de ces bras charmants, c'est impossible. D'un autre côté, il est parfaitement exact que, quoique j'aie le plaisir de me moquer un peu d'elle, elle m'ennuie, ou du moins je compte les minutes à la pendule. Si elle avait le caractère que sa beauté semble annoncer, elle eût dû me couper la parole vingt fois et me mettre au pied du mur. Elle se laisse traiter comme un conscrit qu'on mène battre en duel. »
Enfin, après plusieurs minutes de propositions directes qui portèrent au plus haut point l'anxiété pénible de madame Grandet, M. Leuwen prononça ces mots d'une voix basse et profondément émue:
- Je vous avouerai, madame, que je ne puis vous aimer, car vous serez cause que mon fils mourra de la poitrine.
« Ma voix m'a bien servi, pensa M. Leuwen. Cela est juste de ton et expressif. »
Mais M. Leuwen n'était pas fait, après tout, pour être un grand politique, un Talleyrand, un ambassadeur auprès de personnages graves. L'ennui lui donnait de l'humeur, et il n'était pas sûr de pouvoir résister à la tentation de se distraire par une sortie plaisante ou insolente.
Après ce grand mot prononcé, M. Leuwen se sentit saisi d'un tel besoin d'éclater de rire qu'il s'enfuit.96
Madame Grandet, après avoir remis le verrou porte, resta immobile près d'une heure sur son fauteuil. Son air était pensif, elle avait les yeux tout à fait ouverts, comme la Phèdre de M. Guérin au Luxembourg. Jamais ambitieux tourmenté par dix ans d'attente n'a désiré le ministère comme elle le souhaitait en ce moment.
« Quel rôle à jouer que celui de Madame Roland au milieu de cette société qui se décompose! Je ferai toutes les circulaires de mon mari, car il n'a pas de style.
» Je ne puis arriver à une belle position sans une passion grande et malheureuse, dont l'homme le plus distingué du faubourg Saint-Germain serait la victime. Ce fanal embrasé m'élèverait bien haut! Mais je puis vieillir dans ma position actuelle sans que je voie cet événement devenir un peu probable, tandis que les gens de cette sorte, non pas à la vérité de la nuance la plus noble, mais d'une couleur encore fort satisfaisante. [fort suffisante], m'environneront dès que M. Grandet sera ministre. Madame de Vaize n'est qu'une petite sotte, et elle en regorge. Les gens sages en reviennent toujours au maître du budget. »
Les raisons se présentaient en foule à l'esprit de madame Grandet pour la confirmer dans le sentiment du bonheur ministre.97 Or, c'est ce qui n'était point en question. Ce n'étaient précisément ces pensées-là qui enflammaient la grande âme de madame Roland à la veille du ministère de son mari. Mais c'est ainsi que notre siècle imite les grands hommes de 93, c'est ainsi que M. de Polignac a eu du caractère on copie le fait matériel être ministre, faire un coup d'Etat, faire une journée, un 4 prairial, un 10 août, un 18 fructidor mais les moyens de succès, mais les motifs d'action, on ne creuse pas si avant.
Mais quand il s'agissait du prix par lequel il fallait acheter tous ces avantages, l'imagination de madame Grandet la désertait, elle n'y voulait pas penser son esprit était aride. Elle ne voulait pas y consentir ouvertement, mais bien moins encore s'y refuser elle avait besoin d'une discussion oiseuse et longue pour y accoutumer son imagination. Son âme enflammée d'ambition n'avait plus d'attention à donner à cette condition désagréable, mais d'un intérêt secondaire. Elle sentait qu'elle allait en avoir des remords, non pas de religion, mais de noblesse.
« Est-ce qu'une grande dame, une duchesse de Longueville, une madame de Chevreuse, eussent donné aussi peu d'attention à la condition désagréable ? » se répétait-elle à la hâte. Et elle ne se répondait pas, tant elle pensait peu à ce qu'elle se demandait, toute absorbée qu'elle était dans la contemplation du ministère. « Combien me faudra-t-il de valets de pied ? Combien de chevaux ? »
Cette femme d'une si célèbre vertu avait si peu d'attention au service de l'habitude de l'âme nommée pudeur, qu'elle oubliait de répondre aux questions qu'elle se faisait à cet égard et, il faut l'avouer, presque pour la forme. Enfin, après avoir joui pendant trois grands quarts d'heure de son futur ministère, elle prêta quelque attention à la demande qu'elle se répétait pour la cinq ou sixième fois
« Mesdames de Chevreuse ou de Longueville y eussent-elles consenti ? — Sans doute, elles y eussent consenti, ces grandes dames. Ce qui les place au-dessous de moi sous le rapport moral, c'est qu'elles consentaient à ces sortes de démarches par une sorte de demi-passion, quand encore ce n'était pas par suite d'un penchant moins noble. [Plus physique.] Elles pouvaient être séduites, moi je ne puis l'être. (Et elle s'admira beaucoup.)98 Dans cette démarche, il n'y a que de la haute sagesse, de la prudence; je n'y attache certes l'idée d'aucun plaisir. »
Après s'être sinon rassérénée tout à fait, du moins bien rassurée de ce côté féminin, madame Grandet s'abandonna de nouveau à la douce contemplation des suites probables du ministère pour sa position dans le monde….
« Un nom qui a passé par le ministère est célèbre à jamais. Des milliers de Français ne connaissent des gens qui forment la première classe de la nation que les noms qui ont été ministres. »
L'imagination de madame Grandet pénétrait dans l'avenir. Elle peuplait sa jeunesse des événements les plus flatteurs. « Etre toujours juste, toujours bonne avec dignité, et avec tout le monde, multiplier mes rapports de toutes sortes avec la société, remuer beaucoup, et avant dix ans tout Paris retentira de mon nom. Les yeux du public sont déjà accoutumés, il y a du temps, à mon hôtel et à mes fêtes. Enfin, une vieillesse comme celle de madame Récamier, et probablement avec plus de fortune. »
Elle ne se demanda qu'un instant, et pour la forme:
« Mais M. Leuwen aura-t-il assez d'influence pour donner un portefeuille à M. Grandet? Mais, une fois que j'aurai payé le prix convenu, ne se moquera-t-il point de moi ? Sans doute il faut examiner cela, les premières conditions d'un contrat sont la possibilité de livrer la chose vendue. »
La démarche de madame Grandet était combinée avec son mari, mais elle s'abstint de rendre compte de la réponse avec la dernière exactitude. Elle entrevoyait bien qu'il n'eût pas été décidément impossible de l'amener à une façon raisonnable, et philosophique, et politique, de voir les choses, mais c'est toujours une discussion terrible, pour une femme qui se respecte. « Et, se dit-elle, il vaut bien mieux la sauter à pieds joints. »
Tout ne fut pas plaisir quand Lucien entra le soir chez elle; elle baissa les yeux d'embarras. Sa conscience lui disait:
« Voilà l'être par lequel je puis être la femme du ministre de l'Intérieur. »
Lucien, qui n'était point dans la confidence de la démarche faite par son père, remarqua bien quelque chose de moins guindé et de plus naturel, et ensuite quelques lueurs de plus d'intimité et de bonté, dans la façon d'être de madame Grandet avec lui. Il aimait mieux cette façon d'être, qui rappelait, de bien loin il est vrai, l'idée de la simplicité et du naturel, que ce que madame Grandet appelait de l'esprit brillant. Il fut beaucoup auprès d'elle ce soir-là.
Mais décidément sa présence gênait madame Grandet, car elle avait bien plus les théories que la pratique de la haute intrigue politique qui, du temps du cardinal de Retz, faisait la vie de tous les jours des Chevreuse et des Longueville. Elle congédia Lucien, mais avec un petit air d'empire et de bonne amitié qui augmenta le plaisir que celui-ci trouvait à se voir rendre sa liberté dès onze heures.
Pendant cette nuit, madame Grandet ne put presque pas dormir. Ce ne fut qu'au jour, à cinq ou six heures du matin, que le bonheur d'être la femme d'un ministre la laissa reposer. Elle eût été dans l'hôtel de la rue de Grenelle que ses sensations de bonheur eussent été à peine aussi violentes. C'était une femme attentive au réel de la vie.
Pendant cette nuit, elle eut cinq ou six petites contrariétés, par exemple elle calculait le nombre et le prix des livrées. Celle de M. Grandet était composée en partie de drap serin, lequel, malgré toutes ses recommandations, ne pouvait guère conserver sa fraîcheur plus d'un mois. Combien cette dépense, combien surtout cette surveillance allait être augmentée par grand le nombre d'habits nécessaires! Elle comptait: le portier, le cocher, les valets de pied… Mais elle fut arrêtée dans son calcul, elle avait des incertitudes sur le nombre des valets de pied.
« Demain, j'irai faire une visite adroite à madame de Vaize. Il ne faudrait pas qu'elle se doutât que je viens relever l'état de sa maison si elle pouvait faire une anecdote de cette visite, cela serait du dernier vulgaire. Ne pas savoir quel doit être l'état de maison d'un ministre! M. Grandet devrait savoir ces choses-là, mais il a réellement bien peu de tête! »
Ce ne fut qu'en s'éveillant, à onze heures, que madame Grandet pensa à Leuwen; bientôt elle sourit, elle trouva qu'elle l'aimait, qu'il lui plaisait beaucoup plus que la veille: c'était par lui que toutes ces grandeurs qui lui donnaient une nouvelle vie pouvaient lui arriver.
Le soir,99 elle rougit de plaisir à son arrivée. « Il a des façons parfaites, pensait-elle. Quel air noble! Combien peu d'empressement! Combien cela est différent d'un grossier député de province! Même les jeunes, devant moi ils sont comme des dévots à l'église. Les laquais dans l'antichambre leur font perdre la raison. »100
Chapitre LXII
PENDANT que Lucien s'étonnait, à l'hôtel Grandet, de la physionomie singulière de l'accueil qu'il recevait ce jour-là, madame Leuwen avait une grande conversation avec son mari.
- Ah mon ami, lui disait-elle, l'ambition vous a tourné la tête, une si bonne tête, grand Dieu! Votre poitrine va souffrir. Et que peut l'ambition pour vous ? Etc., etc. Est-ce de l'argent ? Est-ce des cordons ?
Ainsi parlait madame Leuwen à son mari, lequel se défendait mal.
Notre lecteur s'étonnera peut-être qu'une femme qui, à quarante-cinq ans, était encore la meilleure amie de son mari, fût sincère avec lui. C'est qu'avec un homme d'un esprit singulier et un peu fou, comme M. Leuwen, il eût été excessivement dangereux de n'être pas parfaitement naïve. Après avoir été dupe un mois ou deux, par étourderie, par laisser-aller, un beau jour toutes les forces de cet esprit vraiment étonnant se seraient concentrées, comme le feu dans un fourneau à réverbère, sur le point à l'égard duquel on voulait le tromper la feinte eût été découverte, moquée, et le crédit à jamais perdu.
Par bonheur pour le bonheur des deux époux, ils pensaient tout haut en présence l'un de l'autre. Au milieu de ce monde si menteur, et dans les relations intimes plus menteuses peut-être que dans celles de société, ce parfum de sincérité parfaite avait un charme auquel le temps n'ôtait rien de sa fraîcheur.
Jamais M. Leuwen n'avait été si près de mentir que dans ce moment. Comme son succès à la Chambre ne lui avait coûté aucun travail, il ne pouvait croire à sa durée, ni presque à sa réalité. Là était l'illusion, là était le coin de folie, là était la preuve du plaisir extrême produit par ce succès et la position incroyable qu'il avait créée en trois mois. Si M. Leuwen eût porté dans cette affaire le sang-froid qui ne le quittait pas au milieu des plus grands intérêts d'argent, il se serait dit:
« Ceci est un nouvel emploi d'une force que je possède déjà depuis longtemps. C'est une machine à vapeur puissante que je ne m'étais pas encore avisé de faire fonctionner en ce sens. »
Les flots de sensations nouvelles produites par un succès si étonnant faisaient un peu perdre terre au bon sens de M. Leuwen, et c'est ce qu'il avait honte d'avouer, même à sa femme. Après des discours infinis, M. Leuwen ne put plus nier la dette.
- Eh bien, oui, dit-il enfin, j'ai un accès d'ambition, et ce qu'il y a de plaisant, c'est que je ne sais pas quoi désirer.
- La fortune frappe à votre porte, il faut prendre un parti tout de suite. Si vous ne lui ouvrez pas, elle ira frapper ailleurs.
— Les miracles du Tout-Puissant éclatent surtout quand ils opèrent sur une matière vile et inerte. Je fais Grandet ministre, ou du moins je l'essaie.
- M. Grandet ministre! dit madame Leuwen en souriant. Mais vous êtes injuste envers Anselme! Pourquoi ne pas songer à lui ?
(Le lecteur aura peut-être oublié qu'Anselme était le vieux et fidèle valet de chambre de M. Leuwen.)
- Tel qu'il est, répondit M. Leuwen avec ce sérieux plaisant qui lui donnait tant de plaisir,101 avec ses soixante ans Anselme vaut mieux pour les affaires que M. Grandet. Après qu'on lui aura accordée un mois pour se guérir de son étonnement, il décidera mieux les affaires, surtout les grandes, où il faut un vrai bon sens, que M. Grandet. Mais Anselme n'a pas une femme qui soit au moment d'être la maîtresse de mon fils, mais en portant Anselme au ministère de l'Intérieur, tout le monde ne verrait pas que c'est Lucien que je fais ministre en sa personne.
- Ah que m'apprenez-vous ? s'écria madame Leuwen. Et le sourire qui avait accueilli l'énumération des mérites d'Anselme disparut à l'instant. Vous allez compromettre mon fils. Lucien va être la victime de cet esprit sans repos, de cette femme qui court après le bonheur comme une âme en peine et ne l'atteint jamais. Elle va le rendre malheureux et inquiet comme elle. Mais comment n'a-t-il pas été choqué par ce que ce caractère a de vulgaire ? C'est une copie continue!
Mais c'est la plus jolie femme de Paris, ou du moins la plus brillante. Elle ne peut pas avoir un amant, elle si sage jusqu'ici, sans que tout Paris ne le sache, et pour peu que cet amant ait déjà un nom un peu connu dans le monde, ce choix le place au premier rang.
Après une longue discussion qui ne fut pas sans charmes pour madame Leuwen, elle finit par convenir de cette vérité. Elle se borna à soutenir que Lucien était trop jeune pour pouvoir être présenté au public, et surtout aux Chambres, comme un homme d'affaires, un homme politique.
— Il a le tort d'avoir une tournure élégante et d'être vêtu avec grâce. Mais je compte, à la première occasion, faire la leçon là-dessus à madame Grandet… Enfin, ma chère amie, je compte avoir tout à fait chassé madame de Chasteller de ce coeur-là, et, je puis vous l'avouer aujourd'hui, elle me faisait trembler.
Il faut que vous sachiez que Lucien a un travail admirable. J'ai d'admirables nouvelles de lui par le vieux Dubreuil, sous-chef de bureau depuis mon ami Crétet, il y a vingt-neuf ans de cela. Lucien expédie autant d'affaires au ministère que trois chefs de bureau. Il ne s'est laissé gâter par aucune des bêtises de la routine que les demi-sots appellent l'usage, le trantran des affaires. Lucien les décide net, avec témérité, de façon à se compromettre peut-être, mais de manière aussi à ne pas avoir à y revenir. Il s'est déclaré l'ennemi du marchand de papier du ministère et veut des lettres en dix lignes. Malgré la leçon qu'il a eue à Caen, il opère toujours de cette façon hardie et ferme. Et remarquez que, comme nous en étions convenus, je ne lui ai jamais dit mon avis net sur sa conduite dans l'élection de M. Mairobert. Je l'ai bien défendue indirectement à la Chambre, mais il a pu voir dans mes phrases l'accomplissement d'un devoir de famille.
Je le ferai secrétaire général si je puis. Si l'on me refuse ce titre à cause de son âge, il sera du moins secrétaire général en effet, la place restera vacante, et sous le nom de secrétaire intime il en fera les fonctions. Il se cassera le cou en un an, ou il se fera une réputation, et je dirai niaisement:
J'ai fait pour lui rendre
Le destin plus doux
Tout ce qu'on peut attendre
D'une amitié tendre.
Quant à moi, je tire mon épingle du jeu. On voit que j'ai fait Grandet ministre parce que mon fils n'est pas encore de calibre à le devenir. Si je n'y réussis pas, je n'ai pas de reproches à me faire la fortune ne frappait donc pas à ma porte. Si j'emporte le Grandet, me voilà hors d'embarras pour six mois.
- M. Grandet pourra-t-il se soutenir ?
— Il y a des raisons pour, il y en a contre. Il aura les sots pour lui, il aura, je n'en doute pas, un train de maison a dépenser cent mille francs en sus de ses appointements. Cela est immense. Il ne lui manquera absolument que de l'esprit dans la discussion, et du bon sens dans les affaires.
— Excusez du peu, dit madame Leuwen.
- Au demeurant, le meilleur fils du monde. A la Chambre, il parlera comme vous savez. Il lira comme un laquais les excellents discours que je commanderai aux meilleurs faiseurs, à cent louis par discours réussi. Je parlerai. Aurai-je du succès pour la défense comme j'en ai eu pour l'attaque ? C'est ce que je suis curieux de voir, et cette incertitude m'amuse. Mon fils et le petit Coffe me feront les carcasses de mes discours de défense… Tout cela peut être fort plat, je crois bien…
…
Mais au fond elle était très choquée de la partie féminine de cet arrangement.
- Cela est de mauvais goût. Je m'étonne comment vous pouvez donner les mains à de telles choses.
- Mais, ma chère amie, la moitié de l'histoire de France est basée sur des arrangements exactement aussi exemplaires que celui-ci. Les trois quarts des fortunes des grandes familles que vous
voyez aujourd'hui si collet monté furent établies autrefois par les mains de l'amour.
- Grand Dieu! quel amour!
- Allez-vous me disputer ce nom honnête que les historiens de France ont adopté ? Si vous me fâchez, je prendrai le mot exact. De François Ier à Louis XV, le ministère a été donné par les dames, au moins aux deux tiers des vacances. Toutes les fois que notre nation n'a pas la fièvre, elle revient à ces moeurs qui sont les siennes. Et y a-t-il du mal à faire ce qu'on a toujours fait ? (C'était là la vraie morale de M. Leuwen. Pour sa femme, née sous l'Empire, elle avait cette morale sévère qui convient au despotisme naissant.)
Elle eut quelque peine à s'accoutumer à cette morale.
Chapitre LXIII
[MADAME Grandet n'avait rien de romanesque dans le caractère ni dans les habitudes, ce qui formait, pour qui avait des yeux et n'était pas ébloui par un port de reine et sa fraîcheur digne d'une jeune fille anglaise, un étrange contraste avec sa façon de parler toute sentimentale et toute d'émotion, comme une nouvelle de M. Nodier. Elle ne disait pas: Paris, mais cette ville immense. Madame Grandet, avec cet esprit si romanesque en apparence, portait dans toutes ses affaires une raison parfaite, l'ordre et l'attention d'un petit marchand de fil et de mercerie en détail.]102
Quand elle se fut accoutumée au bonheur d'être la femme d'un ministre, elle songea que M. Leuwen pouvait être égaré par la douleur de voir son fils devenir la victime d'un amour sans espoir, ou du moins se donner un ridicule, car elle ne mit jamais en question l'amour de Lucien.103 Elle ne connaissait de l'amour que les mauvaises copies chargées que l'on en voit ordinairement dans le monde, elle n'avait pas les yeux qu'il faut pour le voir là où il est et se cache. La grande question à laquelle madame Grandet revenait sans cesse était celle-ci:
« M. Leuwen a-t-il le pouvoir de faire un ministre ? C'est sans doute un orateur fort à la mode malgré sa voix presque imperceptible, c'est le seul homme que la Chambre écoute, on ne peut le nier. On dit que le roi le reçoit en secret. Il est au mieux avec le maréchal N…, ministre de la Guerre. La réunion de toutes ces circonstances constitue sans doute une position brillante, mais de là à porter le roi, cet homme si fin et si habile à tromper, à confier un ministère à M. Grandet, la distance est incommensurable! » Et madame Grandet soupirait profondément.
Tourmentée par cette incertitude qui peu à peu [en deux jours de temps] minait tout son bonheur, madame Grandet prit son parti avec fermeté et demanda hardiment un rendez-vous à M. Leuwen: [« II ne faut pas le traiter en homme »], et elle eut l'audace d'indiquer ce rendez-vous chez elle.104
…..
— Cette affaire est si importante pour nous que je pense que vous ne trouverez pas singulier que je vous supplie de me donner quelques détails sur les espérances que vous m'avez permis de concevoir.
« Ainsi, se dit M. Leuwen en souriant intérieurement, on ne discute pas le prix, mais seulement la sûreté de la livraison de la chose vendue. »
M. Leuwen, du ton le plus intime et le plus sincère:
— Je suis trop heureux, madame, de voir se resserrer de plus en plus les liens de notre ancienne et bonne amitié. Ils doivent être intimes dorénavant, et pour les amener bientôt à ce degré de douce franchise et de parfaite ouverture de coeur, je vous prie de me permettre un langage exempt de tout vain déguisement. comme si déjà vous faisiez partie de la famille.
Ici, M. Leuwen retint à grand'peine un coup d'oeil malin.
- Ai-je besoin de vous demander une discrétion absolue ? Je ne vous cache pas un fait, que d'ailleurs votre esprit profond autant que juste aura devine de reste M. le comte de Vaize est aux écoutes. Une seule donnée, un seul fait que ce ministre pourrait recueillir par un de ses cent espions, par exemple par M. le marquis de G… ou M. R… que bien vous connaissez, pourrait déranger toutes nos petites affaires. M. de Vaize voit le ministère lui échapper, et l'on ne peut lui refuser beaucoup d'activité tous les jours il a fait dix visites avant huit heures du matin. Cette heure insolite pour Paris flatte les députés, auxquels elle rappelle l'activité qu'ils avaient autrefois, quand ils étaient clercs de procureur.
M. Grandet est, ainsi que moi, à la tête de la banque, et depuis Juillet la banque est à la tête de l'Etat. La bourgeoisie a remplacé le faubourg Saint-Germain, et la banque est la noblesse de la classe bourgeoise. M. Laffite, en se figurant que tous les hommes étaient des anges, a fait perdre le ministère à sa classe. Les circonstances appellent la haute banque à ressaisir l'empire et à reprendre le ministère, par elle-même ou par ses amis… On accusait. les banquiers d'être bêtes, l'indulgence de la Chambre a bien voulu me mettre à même de prouver qu'au besoin nous savons affubler nos adversaires politiques de mots assez difficiles à faire oublier. Je sais mieux que personne que ces mots ne sont pas des raisons mais la Chambre n'aime pas les raisons, et le roi n'aime que l'argent; il a besoin de beaucoup de soldats pour contenir les ouvriers et les républicains. Le gouvernement a le plus grand intérêt à ménager la Bourse. Un ministère ne peut pas défaire la Bourse, et la Bourse peut défaire un ministère. Le ministère actuel ne peut aller loin.
— C'est ce que dit M. Grandet.
— Il a des vues assez justes; mais, puisque vous me permettez le langage de l'amitié la plus intime, je vous avouerai que sans vous, madame, je n'eusse jamais songé à M. Grandet. Je vous le dirai brutalement vous croyez-vous assez de crédit sur lui pour le diriger dans toutes les actions capitales de son ministère ? Il lui faut toute votre habileté pour ménager le maréchal (le ministre de la Guerre). Le roi veut l'armée, le maréchal peut seul l'administrer et la contenir. Or, il aime l'argent, il veut beaucoup d'argent, c'est au ministre des Finances à fournir cet argent. M. Grandet devra tenir la balance égale entre le maréchal et le ministre de l'argent, autrement il y a rupture. Par exemple, aujourd'hui les différends du maréchal avec le ministre des Finances ont amené vingt brouilles suivies de vingt raccommodements. L'aigreur des deux partis est arrivée au point de ne plus permettre de mettre en délibération les sujets les plus simples.
[L'argent est le nerf non seulement de la guerre, mais encore de l'espèce de paix armée dont nous jouissons depuis Juillet. Outre l'armée, indispensable contre les ouvriers, il faut donner des places à tout l'état-major de la bourgeoisie. Il y a- là six mille bavards qui feront de l'éloquence contre vous, si vous ne leur fermez la bouche avec une place de six mille francs.]
Le maréchal, voulant toujours de l'argent, a donc dû jeter les yeux sur un banquier pour ministre de l'Intérieur; il veut, entre nous soit dit, un homme à opposer, s'il le faut, au ministre des Finances, un homme qui comprenne les diverses valeurs de l'argent aux différentes heures de la journée. Ce banquier ministre de l'Intérieur, cet homme, qui peut comprendre la Bourse et dominer jusqu'à un certain point les manoeuvres de M. Rot[hschild] et du ministre des Finances, s'appellera-t-il Leuwen ou Grandet? Je suis bien paresseux, bien vieux, tranchons le mot. Je ne puis pas encore faire mon fils ministre, il n'est pas député, je ne sais pas s'il saura parler, par exemple depuis six mois vous l'avez rendu muet… Mais je puis faire ministre l'homme présentable choisi par la personne qui sauvera la vie à mon fils.
- Je ne doute pas de la sincérité de votre bonne intention pour nous.
— J'entends, madame vous doutez un peu, et c'est une nouvelle raison pour moi d'admirer votre sagesse, vous doutez de mon pouvoir. Dans la discussion des grands intérêts de la Cour et de la politique, le doute est le premier des devoirs et ne se trouve une injure pour aucune des parties contractantes. On peut se faire illusion à soi-même et précipiter non seulement l'intérêt d'un ami, mais son intérêt propre. Je vous ai dit que je pourrais jeter les yeux sur M. Grandet, vous doutez un peu de mon pouvoir. Je ne puis vous donner le portefeuille de l'Intérieur ou des Finances comme je vous donnerais ce bouquet de violettes. Le roi lui-même, dans nos habitudes actuelles, ne peut vous faire un tel don. Un ministre, au fond, doit être élu par cinq ou six personnes, dont chacune a plutôt le veto sur le choix des autres que le droit absolu de faire triompher son candidat car enfin n'oubliez pas, madame, qu'il s'agit de plaire tout à fait au roi, plaire à peu près à la Chambre des députés, et enfin ne pas trop choquer cette pauvre Chambre des pairs. C'est à vous, ma toute belle, à voir si vous voulez croire que je veux faire tout ce qui est en moi pour vous placer dans l'hôtel de la rue de Grenelle. Avant d'estimer mon degré de dévouement à vos intérêts, cherchez à vous faire une idée nette de cette portion d'influence que pour deux ou trois fois vingt-quatre heures le hasard a mise dans mes mains.
- Je crois en vous, et beaucoup, et admettre avec vous une discussion sur un pareil sujet n'en est pas une faible preuve. Mais de la confiance en votre génie et en votre fortune à faire les sacrifices que vous semblez exiger, il y a loin.
— Je serais au désespoir de blesser le moins du monde cette charmante délicatesse de votre sexe, qui sait ajouter tant de charmes à l'éclat de la jeunesse et de la beauté la plus achevée. Mais madame de Chevreuse, la duchesse de Longueville, toutes les femmes qui ont laissé un nom dans l'histoire et, ce qui est plus réel, qui ont établi la fortune de leur maison, ont eu quelquefois des entretiens avec leur médecin. Eh bien, moi je suis le médecin de l'âme, le donneur d'avis à la noble ambition que cette admirable position a dû placer dans votre coeur. Dans un siècle, au milieu d'une société où tout est sable mouvant, où rien n'a de la consistance, où tout s'est écroulé, votre esprit supérieur, votre grande fortune, la bravoure de M. Grandet et vos avantages personnels vous ont créé une position réelle, résistante, indépendante des caprices du pouvoir. Vous n'avez qu'un ennemi à craindre, c'est la mode vous êtes sa favorite dans ce moment, mais, quel que soit le mérite personnel, la mode se lasse. Si d'ici à un an ou dix-huit mois vous ne présentez rien de neuf à admirer à ce public qui vous rend justice en ce moment et vous place dans une situation si élevée, vous serez en péril la moindre vétille, une voiture de mauvais goût, une maladie, un rien, malgré votre âge si jeune vous placeront au rang des mérites historiques.
- Il y a longtemps que je connais cette grande vérité, dit madame Grandet avec l'accent d'humeur d'une reine à laquelle on rappelle mal à propos une défaite de ses armées, il y a longtemps que je connais cette grande vérité: la vogue est un feu qui s'éteint s'il ne s'augmente.
- Il y a une vérité secondaire non moins frappante, d'une application non moins fréquente, c'est qu'un malade qui se fâche contre son médecin, un plaideur qui se fâche contre son avocat, au lieu de réserver son énergie à combattre ses adversaires, n'est pas à la veille de changer sa position en bien.
M. Leuwen se leva.
- Ma chère belle, les moments sont précieux. Voulez-vous me traiter comme un de vos adorateurs et chercher à me faire perdre la tête ? Je vous dirai que je n'ai plus de tête à perdre, et je vais chercher fortune ailleurs.
— Vous êtes un cruel homme. Eh! bien, parlez.
Madame Grandet fit bien de ne pas continuer à faire des phrases; M. Leuwen, qui était bien plus un homme de plaisir et d'humeur qu'un homme d'affaires et surtout qu'un ambitieux, trouvait déjà ridicule de faire dépendre ses plans des caprices d'une femmelette, et cherchait dans sa tête quelque autre arrangement pour mettre Lucien en évidence.
« Je ne suis pas fait pour le ministère,
surtout qu'un ambitieux, trouvait déjà ridicule de faire dépendre ses plans des caprices d'une femmelette, et cherchait dans sa tête quelque autre arrangement pour mettre Lucien en évidence.
« Je ne suis pas fait pour le ministère, je suis trop paresseux, trop accoutumé à m'amuser, se disait-il pendant les phrases de madame Grandet, comptant trop peu sur le lendemain. Si au lieu d'avoir à déraisonner et battre la campagne devant moi, une petite femme de Paris, j'avais le roi, mon impatience serait la même, et elle ne me serait jamais pardonnée. Donc, je dois réunir tous mes efforts sur mon fils. »
- Madame, dit-il comme revenant de bien loin, voulez-vous me parler comme à un vieillard de soixante-cinq ans pour le moment ambitieux en politique, ou voulez-vous continuer à me faire l'honneur de me traiter comme un beau jeune homme ébloui de vos charmes, comme ils le sont tous ?
— Parlez, monsieur, parlez! dit madame Grandet avec vivacité, car elle était habile à lire dans les yeux la résolution des gens avec qui elle parlait, et elle commençait à avoir peur. M. Leuwen lui paraissait ce qu'il était, c'est-à-dire sérieusement impatienté.
- Il faut que l'un de nous deux ait confiance en la fidélité de l'autre.
- Eh! bien, je vous répondrai avec toute la franchise qu'à l'instant même vous présentiez comme un devoir pourquoi mon lot doit-il être d'avoir confiance ? —
- C'est la force des choses qui le veut ainsi. Ce que je vous demande, ce qui fait votre enjeu, si vous daignez me permettre cette façon de parler si vulgaire, mais pourtant si claire (et le ton de M. Leuwen perdit beaucoup de sa parfaite urbanité pour se rapprocher de celui d'un homme qui marchande une terre et qui [vient] de nommer son dernier prix),105 ce qui fait votre enjeu, madame, dans cette grande intrigue de haute ambition, dépend entièrement et uniquement de vous, tandis que la place assez enviée dont je vous offre l'achat dépend du roi, et de l'opinion de quatre ou cinq personnes, qui daignent m'accorder beaucoup de confiance, mais qui enfin ont leur volonté propre, et qui d'ailleurs, après un jour ou deux, après un échec de tribune, par exemple, peuvent ne plus vouloir de moi. Dans cette haute combinaison d'Etat et de haute ambition celui de nous deux qui peut disposer du prix d'achat, de ce que vous m'avez permis d'appeler son enjeu, doit le délivrer, sous peine de voir l'autre partie contractante avoir plus d'admiration pour sa prudence que pour sa sincérité. Celui de nous deux qui n'a pas son enjeu en son pouvoir, et c'est moi qui suis cet homme, doit faire tout ce que l'autre peut humainement demander pour lui donner des gages.106
Madame Grandet était rêveuse et visiblement embarrassée, mais plus des mots à employer pour faire la réponse que de la réponse même. M. Leuwen, qui ne doutait pas du résultat, eut un instant l'idée malicieuse de renvoyer au lendemain. La nuit eût porté conseil. Mais la paresse de revenir lui donna le désir de finir sur-le champ. Il ajouta d'un ton tout à fait familier et en abaissant le son de sa voix d'un demi-ton, avec la voix basse de M. de Talleyrand:
— Ces occasions, ma chère amie, qui font ou défont la fortune d'une maison, se présentent une fois dans la vie, et elles se présentent d'une façon plus ou moins commode. La montée au temple de la Fortune qui se présente à vous est une des moins épineuses que j'aie vues. Mais aurez-vous du caractère ? Car enfin, la question se réduit de votre part à ce dilemme: Aurai-je confiance en M. Leuwen, que je connais depuis quinze ans? Pour répondre avec sang-froid et sagesse, dites-vous: « Quelle idée avais-je de M. Leuwen et de la confiance qu'il mérite il y a quinze jours, avant qu'il fut question de ministère et de transaction politique entre lui et moi ?
- Confiance entière! dit madame Grandet avec soulagement, comme heureuse de devoir rendre à M. Leuwen une justice qui tendait à la faire sortir d'un doute bien pénible, confiance entière!
M. Leuwen dit, de l'air qu'on a en convenant d'une nécessité:
- Il faut que sous deux jours au plus tard je présente M. Grandet au maréchal.
- M. Grandet a dîné chez le maréchal il n'y a pas un mois, dit madame Grandet d'un ton piqué.
« J'ai fait fausse route avec cette vanité de femme je la croyais moins bête. »
— Certainement, je ne puis pas avoir la prétention d'apprendre au maréchal à connaître la personne de M. Grandet. Tout ce qui s'occupe à Paris de grandes affaires connaît M. Grandet, ses talents financiers, son luxe, son hôtel avant tout, il est connu par la personne la plus distinguée de Paris, à laquelle il a fait l'honneur de donner son nom. Le roi lui-même a beaucoup de considération pour lui, son courage est connu, etc., etc. Tout ce que j'ai à dire au maréchal, c'est ce traître mot: « Voilà M. Grandet, excellent financier, qui comprend l'argent et ses mouvements, dont Votre Excellence pourrait faire un ministre de l'Intérieur capable de tenir tête au ministre des Finances. Je soutiendrais M. Grandet de toutes les forces de ma petite voix. » Voilà ce que j'appelle présenter, ajouta M. Leuwen, toujours d'un ton assez vif. Si sous trois jours je ne dis pas cela, je devrai dire, sous peine de me manquer à moi-même: « Toutes réflexions faites, je me ferai aider par mon fils, si vous voulez lui donner le titre de sous-secrétaire d'Etat, et j'accepte le ministère. » Croyez-vous qu'après avoir présenté M. Grandet au maréchal je sois homme à lui dire en secret: « N'ayez aucune foi à ce que je viens de vous dire devant Grandet, c'est moi qui veux être ministre ?»
- Ce n'est pas de votre bonne foi qu'il peut être question, et vous appliquez un emplâtre à côté du trou.
Ce que vous me demandez est étrange. Vous êtes un libertin, dit madame Grandet pour adoucir le ton du discours. Votre opinion bien connue sur ce qui fait toute la dignité de notre sexe ne vous permet pas de bien apprécier toute l'étendue du sacrifice. Que dira madame Leuwen ? Comment lui cacher ce secret ?
— De mille façons, par un anachronisme, par exemple .107
- Je vous avouerai que je suis hors d'état de continuer la discussion. Daignez renvoyer la conclusion de notre entretien à demain.
— A la bonne heure! Mais demain serai-je encore le favori de la fortune ? Si vous ne voulez pas de mon idée, il faut que je m'arrange autrement et que, par exemple, je cherche à distraire mon fils, qui fait tout mon intérêt en ceci, par un grand mariage. Songez que je n'ai pas de temps à perdre. L'absence de réponse demain est un non sur lequel je ne puis plus revenir.
Madame Grandet venait d'avoir l'idée de consulter son mari.
25.Alexis de Tocqueville on “The Liberty of the Press” (1835)↩
Word length: 3,663]
Source
De la Démocratie en Amérique, par Alexis de Tocqueville. Cinquième Edition, revue et corrigée (Paris: Charles Gosselin, 1836). Tome Second, Chapitre III. “De la liberté de la presse aux États-unis,” pp. 15-29.
Brief Bio of the Author: Alexis de Tocqueville (1805-1859)
[Alexis de Tocqueville (1805-1859)]
Alexis de Tocqueville (1805-1859) was born in Paris to a family of noble lineage, he was both a social scientist and a politician. Long relegated to obscurity in France under the sway of Marxists and socialists, his work is now the subject of renewed interest as a crucial stage in the development of liberal thought. In the course of his two major works, De la démocratie en Amérique (vol. I 1835; vol. II 1840) and L’Ancien régime et la Révolution (1856), Tocqueville argued that the progress of democracy was irreversible. Using a comparative method, contrasting the cases of France and the United States, he showed that the prime characteristic of democracy was equality of conditions, which meant not that men must be equal in economic terms or that social hierarchies must be abolished, but that the notion of classes based on heredity was bound to become obsolete. [RL]
CHAPITRE III. DE LA LIBERTÉ DE LA PRESSE AUX ÉTATS-UNIS.
Difficulté de restreindre la liberté de la presse. — Raisons particulières qu'ont certains peuples de tenir à cette liberté. —La liberté de la presse est une conséquence nécessaire de la souveraineté du peuple comme on l'entend en Amérique. — Violence du langage de la presse périodique aux États-Unis. — La presse périodique a des instincts qui lui sont propres. - L'exemple des États-Unis le prouve. — Opinion des Américains sur la répression judiciaire des délits de la presse. — Pourquoi la presse est moins puissante aux Etats-Unis qu'en France.
La liberté de la presse ne fait pas seulement sentir son pouvoir sur les opinions politiques, mais encore sur toutes les opinions des hommes. Elle ne modifie pas seulement les lois, mais les mœurs. Dans une autre partie de cet ouvrage, je chercherai à déterminer le degré d'influence qu'a exercée la liberté de la presse sur la société civile aux Etats-Unis; je tâcherai de discerner la direction qu'elle a donnée aux idées, les habitudes qu'elle a fait prendre à l'esprit et aux sentiments des Américains. En ce moment, je ne veux examiner que les effets produits par la liberté de la presse dans le monde politique.
J'avoue que je ne porte point à la liberté de la presse cet amour complet et instantané qu'on accorde aux choses souverainement bonnes de leur nature. Je l'aime par la considération des maux qu'elle empêche, bien plus que pour les biens qu'elle fait.
Si quelqu'un me montrait, entre l'indépendance complète et l'asservissement entier de la pensée, une position intermédiaire où je pusse espérer me tenir, je m'y établirais peut-être; mais qui découvrira cette position intermédiaire? Vous partez de la licence de la presse, et vous marchez vers l'ordre: que faites-vous? vous soumettez d'abord les écrivains aux jurés; mais les jurés acquittent, et ce qui n'était que l'opinion d'un homme isolé devient l'opinion du pays. Vous avez donc fait trop et trop peu; il faut encore marcher, vous livrez les auteurs à des magistrats permanents; mais les juges sont obligés d'entendre avant que de condamner; ce qu'on eût craint d'avouer dans le livre, on le proclame impunément dans le plaidoyer; ce qu'on eût dit obscurément dans un écrit, se trouve ainsi répété dans mille autres. L'expression est la forme extérieure, et si je puis m'exprimer ainsi, le corps de la pensée, mais elle n'est pas la pensée elle-même. Vos tribunaux arrêtent le corps, mais l'âme leur échappe et glisse subtilement entre leurs mains. Vous avez donc fait trop et trop peu; il faut continuer à marcher. Vous abandonnez enfin les écrivains à des censeurs; fort bien! nous approchons. Mais la tribune politique n'est-elle pas libre? Vous n'avez donc encore rien fait; je me trompe, vous avez accru le mal. Prendriez-vous, par hasard, la pensée pour une de ces puissances matérielles qui s'accroissent par le nombre de leurs agents? compterez-vous les écrivains comme les soldats d'une armée? Au rebours de toutes les puissances matérielles, le pouvoir de la pensée s'augmente souvent par le petit nombre même de ceux qui l'expriment. La parole d'un homme puissant, qui pénètre seule au milieu des passions d'une assemblée muette, a plus de pouvoir que les cris confus de mille orateurs; et pour peu qu'on puisse parler librement dans un seul lieu public, c'est comme si on parlait publiquement dans chaque village. Il vous faut donc détruire la liberté de parler comme celle d'écrire; cette fois, vous voici dans le port: chacun se tait. Mais où êtes-vous arrivé? Vous étiez parti des abus de la liberté, et je vous retrouve sous les pieds d'un despote.
Vous avez été de l'extrême indépendance à l'extrême servitude, sans rencontrer, sur un si long espace, un seul lieu où vous puissiez vous poser.
Il y a des peuples qui, indépendamment des raisons générales que je viens d'énoncer, en ont de particulières qui doivent les attacher à la liberté de la presse.
Chez certaines nations qui se prétendent libres, chacun des agents du pouvoir peut impunément violer la loi sans que la constitution du pays donne aux opprimés le droit de se plaindre devant la justice. Chez ces peuples il ne faut plus considérer l'indépendance de la presse comme l'une des garanties, mais comme la seule garantie qui reste de la liberté et de la sécurité des citoyens.
Si donc les hommes qui gouvernent ces nations parlaient d'enlever son indépendance à la presse, le peuple entier pourrait leur répondre: Laissez-nous poursuivre vos crimes devant les juges ordinaires, et peut-être que nous consentirons alors à ne point en appeler au tribunal de l'opinion.
Dans les pays où règne ostensiblement le dogme de la souveraineté du peuple, la censure n'est pas seulement un danger, mais encore une grande absurdité.
Lorsqu'on accorde à chacun un droit à gouverner la société, il faut bien lui reconnaître la capacité de choisir entre les différentes opinions qui agitent ses contemporains, et d'apprécier les différents faits dont la connaissance peut le guider.
La souveraineté du peuple et la liberté de la presse sont donc deux choses entièrement corrélatives; la censure et le vote universel sont au contraire deux choses qui se contredisent et ne peuvent se rencontrer long-temps dans les institutions politiques d'un même peuple. Parmi les douze millions d'hommes qui vivent sur le territoire des Etats-Unis, il n'en est pas un seul qui ait encore osé proposer de restreindre la liberté de la presse.
Le premier journal qui tomba sous mes yeux, en arrivant en Amérique, contenait l'article suivant, que je traduis fidèlement:
« Dans toute cette affaire, le langage tenu par Jackson (le président) a été celui d'un despote sans cœur, occupé uniquement à conserver son pouvoir. L'ambition est son crime, et il y trouvera sa peine. Il a pour vocation l'intrigue, et l'intrigue confondra ses desseins et lui arrachera sa puissance. Il gouverne par la corruption, et ses manœuvres coupables tourneront à sa confusion et à sa honte. Il s'est montré dans l'arène politique comme un joueur sans pudeur et sans frein. Il a réussi; mais l'heure de la justice approche; bientôt il lui faudra rendre ce qu'il a gagné, jeter loin de lui son détrompeur, et finir dans quelque retraite où il puisse blasphémer en liberté contre sa folie; car le repentir n'est point une vertu qu'il ait été donné à son cœur de jamais connaître. » (Vincennes Gazette.)
Bien des gens en France s'imaginent que la violence de la presse tient parmi nous à l'instabilité de l'état social, à nos passions politiques, et au malaise général qui en est la suite. Ils attendent donc sans cesse une époque où la société reprenant une assiette tranquille, la presse à son tour deviendra calme Pour moi, j'attribuerais volontiers aux causes indiquées plus haut l'extrême ascendant qu'elle a sur nous; mais je ne pense point que ces causes influent beaucoup sur son langage. La presse périodique me paraît avoir des instincts et des passions à elle, indépendamment des circonstances au milieu desquelles elle agit. Ce qui se passe en Amérique achève de me le prouver.
L'Amérique est peut-être, en ce moment, le pays du monde qui renferme dans son sein le moins de germes de révolution. En Amérique, cependant, la presse a les mêmes goûts destructeurs qu'en France, et la même violence sans les mêmes causes de colère. En Amérique, comme en France, elle est cette puissance extraordinaire, si étrangement mélangée de biens et de maux, que sans elle la liberté ne saurait vivre, et qu'avec elle l'ordre peut à peine se maintenir.
Ce qu'il faut dire, c'est que la presse a beaucoup moins de pouvoir aux Etats-Unis que parmi nous. Rien pourtant n'est plus rare dans ce pays que de voir une poursuite judiciaire dirigée contre elle. La raison en est simple: les Américains, en admettant parmi eux le dogme de la souveraineté du peuple, en ont fait l'application sincère. Ils n'ont point eu l'idée de fonder, avec des éléments qui changent tous les jours, des constitutions dont la durée fût éternelle. Attaquer les lois existantes n'est donc pas criminel, pourvu qu'on ne veuille point s'y soustraire par la violence.
Ils croient d'ailleurs que les tribunaux sont impuissants pour modérer la presse, et que la souplesse des langages humains échappant sans cesse à l'analyse judiciaire, les délits de cette nature se dérobent en quelque sorte devant la main qui s'étend pour les saisir. Ils pensent qu'afin de pouvoir agir efficacement sur la presse, il faudrait trouver un tribunal qui, non seulement fût dévoué à l'ordre existant, mais encore pût se placer au-dessus de l'opinion publique qui s'agite autour de lui; un tribunal qui jugeât sans admettre la publicité, prononçât sans motiver ses arrêts, et punît l'intention plus encore que les paroles. Quiconque aurait le pouvoir de créer et de maintenir un semblable tribunal, perdrait son temps à poursuivre la liberté de la presse; car alors il serait maître absolu de la société elle-même, et pourrait se débarrasser des écrivains en même temps que de leurs écrits. En matière de presse, il n'y a donc réellement pas de milieu entre la servitude et la licence. Pour recueillir les biens inestimables qu'assure la liberté de la presse, il faut savoir se soumettre aux maux inévitables qu'elle fait naître. Vouloir obtenir les uns en échappant aux autres, c'est se livrer à l'une de ces illusions dont se bercent d'ordinaire les nations malades, alors que, fatiguées de luttes et épuisées d'efforts, elles cherchent les moyens de faire coexister à la fois, sur le même sol, des opinions ennemies et des principes contraires.
Le peu de puissance des journaux en Amérique tient à plusieurs causes, dont voici les principales:
La liberté d'écrire, comme toutes les autres, est d'autant plus redoutable qu'elle est plus nouvelle; un peuple qui n'a jamais entendu traiter devant lui les affaires de l'Etat, croit le premier tribun qui se présente. Parmi les Anglo-Américains, cette liberté est aussi ancienne que la fondation des colonies; la presse d'ailleurs, qui sait si bien enflammer les passions humaines, ne peut cependant les créer à elle toute seule. Or, en Amérique, la vie politique est active, variée, agitée même, mais elle est rarement troublée par des passions profondes; il est rare que celles-ci se soulèvent quand les intérêts matériels ne sont pas compromis, et aux Etats-Unis ces intérêts prospèrent. Pour juger de la différence qui existe sur ce point entre les Anglo-Américains et nous, je n'ai qu'à jeter les yeux sur les journaux des deux peuples. En France, les annonces commerciales ne tiennent qu'un espace fort restreint, les nouvelles mêmes sont peu nombreuses; la partie vitale d'un journal, c'est celle où se trouvent les discussions politiques. En Amérique, les trois quarts de l'immense journal qui est placé sous vos yeux sont remplis par des annonces, le reste est occupé le plus souvent par des nouvelles politiques ou de simples anecdotes; de loin en loin seulement, on aperçoit dans un coin ignoré l'une de ces discussions brûlantes qui sont parmi nous la pâture journalière des lecteurs.
Toute puissance augmente l'action de ses forces à mesure qu'elle en centralise la direction; c'est là une loi générale de la nature que l'examen démontre à l'observateur, et qu'un instinct plus sûr encore a toujours fait connaître aux moindres despotes.
En France, la presse réunit deux espèces de centralisations distinctes.
Presque tout son pouvoir est concentré dans un même lieu, et pour ainsi dire dans les mêmes mains, car ses organes sont en très petit nombre.
Ainsi constitué au milieu d'une nation sceptique, le pouvoir de la presse doit être presque sans bornes. C'est un ennemi avec qui un gouvernement peut faire des trêves plus ou moins longues, mais en face duquel il lui est difficile de vivre long-temps.
Ni l'une ni l'autre des deux espèces de centralisations dont je viens de parler n'existent en Amérique.
Les Etats-Unis n'ont point de capitale: les lumières comme la puissance sont disséminées dans toutes les parties de cette vaste contrée; les rayons de l'intelligence humaine, au lieu de partir d'un centre commun, s'y croisent donc en tous sens; les Américains n'ont placé nulle part la direction générale de la pensée, non plus que celle des affaires.
Ceci tient à des circonstances locales qui ne dépendent point des hommes, mais voici qui vient des lois: Aux Etats-Unis, il n'y a pas de patentes pour les imprimeurs, de timbre ni d'enregistrement pour les journaux; enfin la règle des cautionnements est inconnue.
Il résulte de là que la création d'un journal est une entreprise simple et facile, peu d'abonnés suffisent pour que le journaliste puisse couvrir ses frais. Aussi, le nombre des écrits périodiques ou semi-périodiques, aux États-Unis, dépasse-t-il toute croyance. Les Américains les plus éclairés attribuent à cette incroyable dissémination des forces de la presse son peu de puissance: c'est un axiome de la science politique aux États-Unis, que le seul moyen de neutraliser les effets des journaux est d'en multiplier le nombre. Je ne saurais me figurer qu'une vérité aussi évidente ne soit pas encore devenue chez nous plus vulgaire. Que ceux qui veulent faire des révolutions à l'aide de la presse, cherchent à ne lui donner que quelques puissants organes, je le comprends sans peine; mais que les partisans officiels de l'ordre établi et les soutiens naturels des lois existantes croient atténuer l'action de la presse en la concentrant, voilà ce que je ne saurais absolument concevoir. Les gouvernements d'Europe me semblent agir vis-à-vis de la presse de la même façon qu'agissaient jadis les chevaliers envers leurs adversaires: ils ont remarqué par leur propre usage que la centralisation était une arme puissante, et ils veulent en pourvoir leur ennemi, afin sans doute d'avoir plus de gloire à lui résister.
Aux États-Unis, il n'y a presque pas de bourgade qui n'ait son journal. On conçoit sans peine que, parmi tant de combattants, on ne peut établir ni discipline, ni unité d'action; aussi voit-on chacun lever sa bannière. Ce n'est pas que tous les journaux politiques de l'Union ne soient rangés pour ou contre l'administration; mais ils l'attaquent et la défendent par cent moyens divers. Les journaux ne peuvent donc pas établir aux États-Unis de ces grands courants d'opinions qui soulèvent ou débordent les plus puissantes digues. Cette division des forces de la presse produit encore d'autres effets non moins remarquables: la création d'un journal étant chose facile, tout le monde peut s'en occuper; d'un autre côté, la concurrence fait qu'un journal ne peut espérer de très grands profits; ce qui empêche les hautes capacités industrielles de se mêler de ces sortes d'entreprises. Les journaux fussent-ils d'ailleurs la source des richesses, comme ils sont excessivement nombreux, les écrivains de talent ne pourraient suffire à les diriger. Les journalistes, aux Etats-Unis, ont donc en général une position peu élevée, leur éducation n'est qu'ébauchée, et la tournure de leurs idées est souvent vulgaire. Or, en toutes choses la majorité fait loi; elle établit de certaines allures auxquelles chacun ensuite se conforme; l'ensemble de ces habitudes communes s'appelle un esprit: il y a l'esprit du barreau, l'esprit de cour. L'esprit du journaliste, en France, est de discuter d'une manière violente, mais élevée, et souvent éloquente, les grands intérêts de l'Etat; s'il n'en est pas toujours ainsi, c'est que toute règle a ses exceptions. L'esprit du journaliste, en Amérique, est de s'attaquer grossièrement, sans apprêt et sans art, aux passions dé ceux auxquels il s'adresse, de laisser là les principes pour saisir les hommes, de suivre ceux-ci dans leur vie privée, et de mettre à nu leurs faiblesses et leurs vices.
Il faut déplorer un pareil abus de la pensée; plus tard, j'aurai occasion de rechercher quelle influence exercent les journaux sur le goût et la moralité du peuple américain; mais, je le répète, je ne m'occupe en ce moment que du monde politique. On ne peut se dissimuler que les effets politiques de cette licence de la presse ne contribuent indirectement au maintien de la tranquillité publique. Il en résulte que les hommes qui ont déjà une position élevée dans l'opinion de leurs concitoyens, n'osent point écrire dans les journaux, et perdent ainsi l'arme la plus redoutable dont ils puissent se servir pour remuer à leur profit les passions populaires.108 Il en résulte surtout que les vues personnelles exprimées par les journalistes ne sont pour ainsi dire d'aucun poids aux yeux des lecteurs. Ce qu'ils cherchent dans un journal c'est la connaissance des faits; ce n'est qu'en altérant ou en dénaturant ces faits que le journaliste peut acquérir à son opinion quelque influence.
Réduite à ces seules ressources, la presse exerce encore un immense pouvoir en Amérique. Elle fait circuler la vie politique dans toutes les portions de ce vaste territoire. C'est elle dont l'œil toujours ouvert met sans cesse à nu les secrets ressorts de la politique, et force les hommes publics à venir tour à tour comparaître devant le tribunal de l'opinion. C'est elle qui rallie les intérêts autour de certaines doctrines et formule le symbole des partis; c'est par elle que ceux-ci se parlent sans se voir, s'entendent sans être mis en contact. Lorsqu'un grand nombre des organes de la presse parvient à marcher dans la même voie, leur influence à la longue devient presque irrésistible, et l'opinion publique, frappée toujours du même côté, finit par céder sous leurs coups.
Aux Etats-Unis, chaque journal a individuellement peu de pouvoir; mais la presse périodique est encore, après le peuple, la première des puissances.109
----
Que les opinions qui s'établissent sous l'empire de la liberté de la presse aux États-Unis, sont souvent pins tenaces que celles qui se forment ailleurs sous l'empire de la censure.
Aux Etats-Unis, la démocratie amène sans cesse des hommes nouveaux à la direction des affaires. Le gouvernement met donc peu de suite et d'ordre dans ses mesures. Mais les principes généraux du gouvernement y sont plus stables que dans beaucoup d'autres pays, et les opinions principales qui règlent la société s'y montrent plus durables. Quand une idée a pris possession de l'esprit du peuple américain, qu'elle soit juste ou déraisonnable, rien n'est plus difficile que de l'en extirper.
Le même fait a été observé en Angleterre, le pays de l'Europe où l'on a vu pendant un siècle la liberté la plus grande de penser et les préjugés les plus invincibles.
J'attribue cet effet à la cause même qui, au premier abord, semblerait devoir l'empêcher de se produire, à la liberté de la presse. Les peuples chez lesquels existe cette liberté, s'attachent à leurs opinions par orgueil autant que par conviction. Ils les aiment, parce qu'elles leur semblent justes, et aussi parce qu'elles sont de leur choix, et ils y tiennent, non seulement comme à une chose vraie, mais encore comme à une chose qui leur est propre.
Il y a plusieurs autres raisons encore.
Un grand homme a dit que l'ignorance était aux deux bouts de la science. Peut-être eût-il été plus vrai de dire que les convictions profondes ne se trouvent qu'aux deux bouts, et qu'au milieu est le doute. On peut considérer, en effet, l'intelligence humaine dans trois états distincts et souvent successifs.
L'homme croit fermement, parce qu'il adopte sans approfondir. Il doute quand les objections se présentent. Souvent il parvient à résoudre tous ses doutes, et alors il recommence à croire. Cette fois, il ne saisit plus la vérité au hasard et dans les ténèbres; mais il la voit face à face et marche directement à sa lumière.110
Lorsque la liberté de la presse trouve les hommes dans le premier état, elle leur laisse pendant longtemps encore cette habitude de croire fermement sans réfléchir; seulement elle change chaque jour l'objet de leurs croyances irréfléchies? Sur tout l'horizon intellectuel, l'esprit de l'homme continue donc à ne voir qu'un point à la fois; mais ce point varié sans cesse. C'est le temps des révolutions subites. Malheur aux générations qui, les premières, admettent tout-à-coup la liberté de la presse!
Bientôt cependant le cercle des idées nouvelles est à peu près parcouru. L'expérience arrive, et l'homme se plonge dans un doute et dans une méfiance universelle.
On peut compter que la majorité des hommes s'arrêtera toujours dans l'un de ces deux États: elle croira sans savoir pourquoi, ou ne saura pas précisément ce qu'il faut croire.
Quant à cette autre espèce de conviction réfléchie et maîtresse d'elle-même, qui naît de la science et s'élève du milieu même des agitations du doute, il ne sera jamais donné qu'aux efforts d'un très petit nombre d'hommes de l'atteindre.
Or, on a remarqué que, dans les siècles de ferveur religieuse, les hommes changeaient quelquefois de croyance; tandis que, dans les siècles de doute, chacun gardait obstinément la sienne. Il en arrive ainsi dans la politique, sous le règne de la liberté de la presse. Toutes les théories sociales ayant été contestées et combattues tour à tour, ceux qui se sont fixés à l'une d'elles, la gardent, non pas tant parce qu'ils sont sûrs qu'elle est bonne, que parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'il y en ait une meilleure.
Dans ces siècles, on ne se fait pas tuer si aisément pour ses opinions; mais on ne les change point, et il s'y rencontre, tout à la fois, moins de martyrs et d'apostats.
Ajoutez à cette raison cette autre plus puissante encore: dans le doute des opinions, les hommes finissent par s'attacher uniquement aux instincts et aux intérêts matériels, qui sont bien plus visibles, plus saisissables et plus permanents de leur nature que les opinions.
C'est une question très difficile à décider que celle de savoir qui gouverne le mieux, de la démocratie, ou de l'aristocratie? Mais il est clair que la démocratie gène l'un, et que l'aristocratie opprime l'autre.
C'est là une vérité qui s'établit d'elle-même et qu'on n'a pas besoin de discuter: vous êtes riche et je suis pauvre.
26.Tocqueville on "The Centralisation of State Power in America" (1835).↩
[Word Length: 5,548]
Source
Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique. Douzième édition. Revue, corrigée et augmentée d'un Avertissement et d'un Examen comparatif de la Démocratie aux États-Unis et en Suisse. (Paris: Pagnerre, 1848).
Tome premier. Chap. V. Nécessité d'étudier ce qui passe dans les États particuliers avant de parler du gouvernement de l'Union. Section: "Du pouvoir exécutif de l’État," pp. 135-37; "Des effets politiques de la décentralisation administrative aux États-Unis,” pp. 137-56.
Section: DU POUVOIR EXÉCUTIF DE L'ÉTAT [pp. 135-37]
Ce qu'est le gouverneur dans un État américain. - Quelle position il occupe vis-à-vis de la législature. - Quels sont ses droits et ses devoirs. - Sa dépendance du peuple.
Le pouvoir exécutif de l'État a pour représentant le gouverneur.
Ce n'est pas au hasard que j'ai pris ce mot de représentant. Le gouverneur de l'État représente en effet le pouvoir exécutif; mais il n'exerce que quelques uns de ses droits.
Le magistrat suprême, qu'on nomme le gouverneur, est placé à côté de la législature comme un modérateur et un conseil. Il est armé d'un véto suspensif qui lui permet d'en arrêter ou du moins d'en ralentir à son gré les mouvements. Il expose au corps législatif les besoins du pays, et lui fait connaître les moyens qu'il juge utile d'employer afin d'y pourvoir; il est l'exécuteur naturel de ses volontés pour toutes les entreprises qui intéressent la nation entière.111 En l'absence de la législature, il doit prendre toutes les mesures propres à garantir l'État des chocs violents et des dangers imprévus.
Le gouverneur réunit dans ses mains toute la puissance militaire de l'Etat. Il est le commandant des milices et le chef de la force armée.
Lorsque la puissance d'opinion, que les hommes sont convenus d'accorder à la loi, se trouve méconnue, le gouverneur s'avance à la tête de la force matérielle de l'État; il brise la résistance, et rétablit l'ordre accoutumé.
Du reste, le gouverneur n'entre point dans l'administration des communes et des comtés ou du moins il n'y prend part que très indirectement par la nomination des juges de paix qu'il ne peut ensuite révoquer.112
Le gouverneur est un magistrat électif. On a même soin en général de ne l'élire que pour un ou deux ans; de telle sorte qu'il reste toujours dans une étroite dépendance de la majorité qui l'a créé.
DES EFFETS POLITIQUES DE LA DÉCENTRALISATION ADMINISTRATIVE AUX ÉTATS-UNIS. [pp. 137-56]
Distinction à établir entre la centralisation gouvernementale et la centralisation administrative. - Aux États-Unis, pas de centralisation administrative, mais très grande centralisation gouvernementale. - Quelques effets fâcheux qui résultent aux États-Unis de l'extrême décentralisation administrative. - Avantages administratifs de cet ordre de choses. - La force qui administre la société, moins réglée, moins éclairée, moins savante, bien plus grande qu'en Europe. - Avantages politiques du même ordre de choses. - Aux États-Unis, la patrie se fait sentir partout. - Appui que les gouvernés prêtent au gouvernement. - Les institutions provinciales plus nécessaires il mesure que l'état social devient plus démocratique. - Pourquoi.
La centralisation est un mot que J'on répète sans cesse de nos jours, et dont personne, en général, ne cherche à préciser le sens.
Il existe cependant deux espèces de centralisation très distinctes, et qu'il importe de bien connaître. Certains intérêts sont communs à toutes les parties de la nation, tels que la formation des lois générales et les rapports du peuple avec les étrangers.
D'autres intérêts sont spéciaux à certaines parties de la nation, telles, par exemple, que les entreprises communales.
Concentrer dans un même lieu ou dans une même main le pouvoir de diriger les premiers, c'est fonder ce que j'appellerai la centralisation gouvernementale.
Concentrer de la même manière le pouvoir de diriger les seconds, c'est fonder ce que je nommerai la centralisation administrative.
Il est des points sur lesquels ces deux espèces de centralisation viennent à se confondre. Mais en prenant, dans leur ensemble, les objets qui tombent plus particulièrement dans le domaine de chacune d'elles, on parvient aisément à les distinguer.
On comprend que la centralisation gouvernementale acquiert une force immense quand elle se joint à la centralisation administrative. De cette manière elle habitue les hommes à faire abstraction complète et continuelle de leur volonté; à obéir, non pas une fois et sur un point, mais en tout et tous les jours. Non seulement alors elle les dompte par la force, mais encore elle les prend par leurs habitudes; elle les isole et les saisit ensuite un à un dans la masse commune.
Ces deux espèces de centralisation se prêtent un mutuel secours, s'attirent l'une l'autre; mais je ne saurais croire qu'elles soient inséparables.
Sous Louis XIV, la France a vu la plus grande centralisation gouvernementale qu'on pût concevoir, puisque le même homme faisait les lois générales et avait le pouvoir de les interpréter, représentait la France à l'extérieur et agissait en son nom. L'Etat, c'est moi, disait-il; et il avait raison.
Cependant, sous Louis XIV, il y avait beaucoup moins de centralisation administrative que de nos jours.
De notre temps, nous voyons une puissance, l'Angleterre, chez laquelle la centralisation gouvernementale est portée à un très haut degré: l'État semble s'y mouvoir comme un seul homme; il soulève à sa volonté des masses immenses, réunit et porte partout où il le veut tout l'effort de sa puissance.
L'Angleterre, qui a fait de si grandes choses depuis cinquante ans n'a pas de centralisation administrative.
Pour ma part, je ne saurais concevoir qu'une nation puisse vivre ni surtout prospérer sans une forte centralisation gouvernementale.
Mais je pense que la centralisation administrative n'est propre qu'à énerver les peuples qui s'y soumettent, parce qu'elle tend sans cesse à diminuer parmi eux l'esprit de cité. La centralisation administrative parvient, il est vrai, à réunir à une époque donnée, et dans un certain lieu, toutes les forces disponibles de la nation, mais elle nuit à la reproduction des forces. Elle la fait triompher le jour du combat, et diminue à la longue sa puissance. Elle peut donc concourir admirablement à la grandeur passagère d'un homme, non point à la prospérité durable d'un peuple.
Qu'on y prenne bien garde, quand on dit qu'un État ne peut agir parce qu'il n'a pas de centralisation, on parle presque toujours, sans le savoir, de la centralisation gouvernementale. L'empire d'Allemagne, répète-t-on, n'a jamais pu tirer de ses forces tout le parti possible. D'accord. Mais pourquoi? parce que la force nationale n'y a jamais été centralisée; parce que l'État n'a jamais pu faire obéir à ses lois générales; parce que les parties séparées de ce grand corps ont toujours eu le droit ou la possibilité de refuser leur concours aux dépositaires de l'autorité commune, dans les choses mêmes qui intéressaient tous les citoyens; en d'autres termes, parce qu'il n'y avait pas de centralisation gouvernementale. La même remarque est applicable au moyen âge ce qui a produit toutes les misères de la société féodale, c'est que le pouvoir, non seulement d'administrer, mais de gouverner, était partagé entre mille mains et fractionné de mille manières; l'absence de toute centralisation gouvernementale empêchait alors les nations de l'Europe de marcher avec énergie vers aucun but.
Nous avons vu qu'aux États-Unis il n'existait point de centralisation administrative. On y trouve à peine la trace d'une hiérarchie. La décentralisation y a été portée à un degré qu'aucune nation européenne ne saurait souffrir, je pense, sans un profond malaise, et qui produit même des effets fâcheux en Amérique. Mais aux Etats-Unis la centralisation gouvernementale existe au plus haut point. Il serait facile de prouver que la puissance nationale y est plus concentrée qu'elle ne l'a été dans aucune des anciennes monarchies de l'Europe. Non seulement il n'y a dans chaque Etat qu'un seul corps qui fasse les lois; non seulement il n'y existe qu'une seule puissance qui puisse créer la vie politique autour d'elle; mais, en général, on a évité d'y réunir de nombreuses assemblées de districts ou de comtés, de peur que ces assemblées ne fussent tentées de sortir de leurs attributions administratives et d'entraver la marche du gouvernement. En Amérique, la législature de chaque État n'a devant elle aucun pouvoir capable de lui résister. Rien ne saurait l'arrêter dans sa voie ni privilèges, ni immunité locale, ni influence personnelle, pas même l'autorité de la raison, car elle représente la majorité qui se prétend l'unique organe de la raison. Elle n'a donc d'autres limites, dans son action, que sa propre volonté. A côté d'elle, et sous sa main, se trouve placé le représentant du pouvoir exécutif, qui, à l'aide de la force matérielle, doit contraindre les mécontents à l'obéissance.
La faiblesse ne se rencontre que dans certains détails de l'action gouvernementale.
Les républiques américaines n'ont pas de force armée permanente pour comprimer les minorités; mais les minorités n'y ont jamais été réduites, jusqu'à présent, à faire la guerre, et la nécessité d'une armée n'a pas encore été sentie. L'Etat se sert, le plus souvent, des fonctionnaires de la commune ou du comté pour agir sur les citoyens. Ainsi, par exemple, dans la Nouvelle-Angleterre, c'est l'assesseur des la commune qui répartit la taxe; le percepteur de la commune la lève; le caissier de la commune en fait parvenir le produit au trésor public, et les réclamations qui s'élèvent sont soumises aux tribunaux ordinaires. Une semblable manière de percevoir l'impôt est lente, embarrassée; elle entraverait à chaque moment la marche d'un gouvernement qui aurait de grands besoins pécuniaires. En général, on doit désirer que, pour tout ce qui est essentiel à sa vie, le gouvernement ait des fonctionnaires a lui, choisis par lui, révocables par lui, et des formes rapides de procéder. Mais il sera toujours facile à la puissance centrale, organisée comme elle l'est en Amérique, d'introduire, suivant les besoins, des moyens d'action plus énergiques et plus efficaces.
Ce n'est donc pas, comme on le répète souvent, parce qu'il n'y a point de centralisation aux États-Unis, que les républiques du Nouveau-Monde périront bien loin de n'être pas assez centralisées, on peut affirmer que les gouvernements américains le sont trop; je le prouverai plus tard. Les assemblées législatives engloutissent chaque jour quelques débris des pouvoirs gouvernementaux; elles tendent à les réunir tous en elles-mêmes, ainsi que l'avait fait la Convention. Le pouvoir social, ainsi centralisé, change sans cesse de mains, parce qu'il est subordonné à la puissance populaire. Souvent il lui arrive de manquer de sagesse et de prévoyance, parce qu'il peut tout. Là se trouve pour lui le danger. C'est donc à cause de sa force même, et non par suite de sa faiblesse, qu'il est menacé de périr un jour.
La décentralisation administrative produit en Amérique plusieurs effets divers.
Nous avons vu que les Américains avaient presque entièrement isolé l'administration du gouvernement; en cela ils me semblent avoir outrepassé les limites de la saine raison; car l'ordre, même dans les choses secondaires, est encore un intérêt national.113
L'État n'ayant point de fonctionnaires administratifs à lui, placés à poste fixe sur les différents points du territoire, et auxquels il puisse imprimer une impulsion commune, il en résulte qu'il tente rarement d'établir des règles générales de police. Or, le besoin de ces règles se fait vivement sentir. L'Européen en remarque souvent l'absence. Cette apparence de désordre qui règne à la surface, lui persuade, au premier abord, qu'il y a anarchie complète dans la société; ce n'est qu'en examinant le fond des choses qu'il se détrompe.
Certaines entreprises intéressent l'État entier, et ne peuvent cependant s'exécuter, parce qu'il n'y a point d'administration nationale qui les dirige. Abandonnées aux soins des communes et des comtés, livrées à des agents élus et temporaires, elles n'amènent aucun résultat, ou ne produisent rien de durable.
Les partisans de la centralisation en Europe soutiennent que le pouvoir gouvernementale administre mieux les localités qu'elles ne pourraient s'administrer elles-mêmes: cela peut être vrai, quand le pouvoir central est éclairé et les localités sans lumières, quand il est actif et qu'elles sont inertes, quand il a l'habitude d'agir et elles l'habitude d'obéir. On comprend même que plus la centralisation augmente, plus cette double tendance s'accroît, et plus la capacité d'une part et l'incapacité de l'autre deviennent saillantes.
Mais je nie qu'il en soit ainsi quand le peuple est éclairé, éveillé sur ses intérêts, et habitué à y songer comme il le fait en Amérique.
Je suis persuadé, au contraire, que dans ce cas la force collective des citoyens sera toujours plus puissante pour produire le bien-être social que l'autorité du gouvernement.
J'avoue qu'il est difficile d'indiquer d'une manière certaine le moyen de réveiller un peuple qui sommeille, pour lui donner des passions et des lumières qu'il n'a pas; persuader aux hommes qu'ils doivent s'occuper de leurs affaires, est, je ne l'ignore pas, une entreprise ardue. Il serait souvent moins malaisé de les intéresser aux détails de l'étiquette d'une cour qu'à la réparation de leur maison commune.
Mais je pense aussi que lorsque l'administration centrale prétend remplacer complétement le concours libre des premiers intéressés, elle se trompe ou veut vous tromper.
Un pouvoir centrale, quelque éclairé, quelque savant qu'on l'imagine, ne peut embrasser à lui seul tous les détails de la vie d'un grand peuple. Il ne le peut, parce qu'un pareil travail excède les forces humaines. Lorsqu'il veut, par ses seuls soins, créer et faire fonctionner tant de ressorts divers, il se contente d'un résultat fort incomplet, on s'épuise en inutiles efforts.
La centralisation parvient aisément, il est vrai, à soumettre les actions extérieures de l'homme à une certaine uniformité qu'on finit par aimer pour elle-même, indépendamment des choses auxquelles elle s'applique; comme ces dévots qui adorent la statue oubliant la divinité qu'elle représente. La centralisation réussit sans peine à imprimer une allure régulière aux affaires courantes; à régenter savamment les détails de la police sociale; à réprimer les légers désordres et les petits délits; à maintenir la société dans un statu quo qui n'est proprement ni une décadence ni un progrès; à entretenir dans le corps social une sorte de somnolence administrative que les administrateurs ont coutume d'appeler le bon ordre et la tranquillité publique.114 Elle excelle, en un mot, à empêcher, non à faire. Lorsqu'il s'agit de remuer profondément la société, ou de lui imprimer une marche rapide, sa force l'abandonne. Pour peu que ses mesures aient besoin du concours des individus, on est tout surpris alors de la faiblesse de cette immense machine; elle se trouve tout-à-coup réduite à l'impuissance.
Il arrive quelquefois alors que la centralisation essaie, en désespoir de cause, d'appeler les citoyens à son aide; mais elle leur dit: Vous agirez comme je voudrai, autant que je voudrai, et précisément dans le sens que je voudrai. Vous vous chargerez de ces détails sans aspirer à diriger l'ensemble; vous travaillerez dans les ténèbres, et vous jugerez plus tard mon oeuvre par ses résultats. Ce n'est point à de pareilles conditions qu'on obtient le concours de la volonté humaine. Il lui faut de la liberté dans ses allures, de la responsabilité dans ses actes. L'homme est ainsi fait qu'il préfère rester immobile que marcher sans indépendance vers un but qu'il ignore.
Je ne nierai pas qu'aux Etats-Unis on regrette souvent de ne point trouver ces règles uniformes qui semblent sans cesse veiller sur chacun de nous.
On y rencontre de temps en temps de grands exemples d'insouciance et d'incurie sociale. De loin en loin apparaissent des taches grossières qui semblent en désaccord complet avec la civilisation environnante.
Des entreprises utiles qui demandent un soin continuel et une exactitude rigoureuse pour réussir, finissent souvent par être abandonnées; car, en Amérique comme ailleurs, le peuple procède par efforts momentanés et impulsions soudaines.
L'Européen, accoutumé à trouver sans cesse sous sa main un fonctionnaire qui se mêle à peu près de tout, se fait difficilement à ces différents louages de l'administration communale. En général, on peut dire que les petits détails de la police sociale qui rendent la vie douce et commode sont négligés en Amérique mais les garanties essentielles à l'homme en société y existent autant que partout ailleurs. Chez les Américains, la force qui administre l'Etat est bien moins réglée, moins éclairée, moins savante, mais cent fois plus grande qu'en Europe. Il n'y a pas de pays au monde où les hommes fassent, en définitive, autant d'efforts pour créer le bien-être social. Je ne connais point de peuple qui soit parvenu à établir des écoles aussi nombreuses et aussi efficaces; des temples plus en rapport avec les besoins religieux des habitants; des routes communales mieux entretenues. Il ne faut donc pas chercher aux Etats-Unis l'uniformité et la permanence des vues, le soin minutieux des détails, la perfection des procédés administratifs115 ce qu'on y trouve, c'est l'image de la force, un peu sauvage il est vrai, mais pleine de puissance; de la vie, accompagnée d'accidents, mais aussi de mouvements et d'efforts.
J'admettrai, du reste, si l'on vent, que les villages et les comtés des États-Unis seraient plus utilement administrés par une autorité centrale placée loin d'eux, et qui leur resterait étrangère, que par des fonctionnaires pris dans leur sein. Je reconnaîtrai, si on l'exige, qu'il régnerait plus de sécurité en Amérique, qu'on y ferait un emploi plus sage et plus judicieux des ressources sociales, si l'administration de tout le pays était concentrée dans une seule main. Les avantages politiques que les Américains retirent du système de la décentralisation me le feraient encore préférer au système contraire.
Que m'importe, après tout, qu'il y ait une autorité toujours sur pied, qui veille à ce que mes plaisirs soient tranquilles, qui vole au-devant de mes pas pour détourner tous les dangers, sans que j'aie même le besoin d'y songer si cette autorité, en même temps qu'elle ôte ainsi les moindres épines sur mon passage, est maîtresse absolue de ma liberté et de ma vie; si elle monopolise le mouvement et l'existence à tel point qu'il faille que tout languisse autour d'elle quand elle languit, que tout dorme quand elle dort, que tout périsse si elle meurt?
Il y a telles nations de l'Europe où l'habitant se considère comme une espèce de colon indifférent à la destinée du lien qu'il habite. Les plus grands changements surviennent dans son pays sans son concours; il ne sait même pas précisément ce qui s'est passé; il s'en doute; il a entendu raconter l'événement par hasard. Bien plus, la fortune de son village, la police de sa rue, le sort de son égalise et de son presbytère ne le touchent point; ils pense que toutes ces choses ne le regardent en aucune façon, et qu'elles appartiennent à un étranger puissant qu'on appelle le gouvernement. Pour lui, il jouit de ces biens comme un usufruitier, sans esprit de propriété et sans idées d'amélioration quelconque. Ce désintéressement de soi-même va si loin, que si sa propre sûreté ou celle de ses enfants est enfin compromise, an lieu de s'occuper d'éloigner le danger, il croise les bras pour attendre que la nation tout entière vienne à son aide. Cet homme, du reste, bien qu'il ait fait un sacrifice si complet de son libre arbitre, n'aime pas plus qu'un autre l'obéissance. Il se soumet, il est vrai, au bon plaisir d'un commis; mais il se plaît à braver la loi comme un ennemi vaincu, dès que la force se retire. Aussi le voit-on sans cesse osciller entre la servitude et la licence.
Quand les nations sont arrivées à ce point, il faut qu'elles modifient leurs lois et leurs mœurs, ou qu'elles périssent car la source des vertus publiques y est comme tarie on y trouve encore des sujets, mais on n'y voit plus de citoyens.
Je dis que de pareilles nations sont préparées pour la conquête. Si elles ne disparaissent pas de la scène du monde, c'est qu'elles sont environnées de nations semblables ou inférieures à elles; c'est qu'il reste encore dans leur sein une sorte d'instinct indéfinissable de la patrie, je ne sais quel orgueil irréfléchi du nom qu'elle porte, quel vague souvenir de leur gloire passée, qui, sans se rattacher précisément à rien, suffit pour leur imprimer au besoin une impulsion conservatrice.
On aurait tort de se rassurer en songeant que certains peuples ont fait de prodigieux efforts pour défendre une patrie dans laquelle ils vivaient pour ainsi dire en étrangers. Qu'on y prenne bien garde, et on verra que la religion était presque toujours alors leur principal mobile.
La durée, la gloire, ou la prospérité de la nation étaient devenues pour eux des dogmes sacrés, et en défendant leur patrie, ils défendaient aussi cette cité sainte dans laquelle ils étaient tous citoyens.
Les populations turques n'ont jamais pris aucune part à la direction des affaires de la société; elles ont cependant accompli d'immenses entreprises tant qu'elles ont vu le triomphe de la religion de Mahomet dans les conquêtes des sultans. Aujourd'hui la religion s'en va; le despotisme seul leur reste elles tombent. Montesquieu, en donnant au despotisme une force qui lui fût propre, lui a fait, je pense, un honneur qu'il ne méritait pas. Le despotisme, à lui tout seul, ne peut rien maintenir de durable. Quand on y regarde de près, on aperçoit que ce qui a fait long-temps prospérer les gouvernements absolus, c'est la religion et non la crainte.
On ne rencontrera jamais, quoi quoi fasse, de véritable puissance parmi les hommes, que dans le concours libre des volontés. Or, il n'y a au monde que le patriotisme, ou la religion, qui puisse faire marcher pendant long-temps vers un même but l'universalité des citoyens.
Il ne dépend pas des lois de ranimer des croyances qui s'éteignent; mais il dépend des lois d'intéresser les hommes aux destinées de leur pays. Il dépend des lois de réveiller et de diriger cet instinct vague de la patrie qui n'abandonne jamais le cœur de l'homme, et, en le liant aux pensées, aux passions, aux habitudes de chaque jour, d'en faire un sentiment réfléchi et durable. Et qu'on ne dise point qu'il est trop tard pour le tenter; les nations ne vieillissent point de la même manière que les hommes. Chaque génération qui naît dans leur sein est comme un peuple nouveau qui vient s'offrir à la main du législateur.
Ce que j'admire le plus en Amérique, ce ne sont pas les effets administratifs de la décentralisation, ce sont ses effets politiques. Aux États-Unis, la patrie se fait sentir partout. Elle est un objet de sollicitude depuis le village jusqu'à l'Union entière. L'habitant s'attache à chacun des intérêts de son pays comme aux siens mêmes. Il se glorifie de la gloire de la nation; dans loi succès qu'elle obtient, il croit reconnaître son propre ouvrage, et il s'en élève; il se réjouit de la prospérité générale dont il profite. Il a pour sa patrie un sentiment analogue à celui qu'on éprouve pour sa famille, et c'est encore par une sorte d'égoïsme qu'il s'intéresse a l'Etat.
Souvent l'Européen ne voit dans le fonctionnaire public que la force; l'Américain y voit le droit. On peut donc dire qu'en Amérique l'homme n'obéit jamais à l'homme, mais à la justice ou à la loi.
Aussi a-t-il conçu de lui-même une opinion souvent exagérée, mais presque toujours salutaire. Il se confie sans crainte à ses propres forces, qui lui paraissent suffire à tout. Un particulier conçoit la pensée d'une entreprise quelconque; cette entreprise eût-elle un rapport direct avec le bien-être de la société, il ne lui vient pas l'idée de s'adresser à l'autorité publique pour obtenir son concours. Il fait connaître son plan, s'offre à l'exécuter, appelle les forces individuelles au secours de la sienne, et lutte corps à corps contre tous les obstacles. Souvent, sans doute, il réussit moins bien que si l'Etat était à sa place; mais, à la longue, le résultat général de toutes les entreprises individuelles dépasse de beaucoup ce que pourrait faire le gouvernement.
Comme l'autorité administrative est placée à côté des administrés, et les représente en quelque sorte eux-mêmes, elle n'excite ni jalousie ni haine. Comme ses moyens d'action sont bornés, chacun sent qu'il ne peut s'en reposer uniquement sur elle.
Lors donc que la puissance administrative intervient dans le cercle de ses attributions, elle ne se trouve point abandonnée à elle-même comme en Europe. On ne croit pas que les devoirs des particuliers aient cessé, parce que le représentant du public vient à agir. Chacun, ait contraire, le guide, l'appuie et le soutient.
L'action des forces individuelles se joignant à l'action des forces sociales, on en arrive souvent à faire ce que l'administration la plus concentrée et la plus énergique serait hors d'état d'exécuter.116
Je pourrais citer beaucoup de faits à l'appui de ce que j'avance; mais j'aime mieux n'en prendre qu'un seul, et choisir celui que je connais le mieux. En Amérique, les moyens qui sont mis à la disposition de l'autorité pour découvrir les crimes et poursuivre les criminels, sont en petit nombre.
La police administrative n'existe pas; les passeports sont inconnus. La police judiciaire, aux Etats-Unis, ne saurait se comparer à la nôtre; les agents du ministère public sont peu nombreux, ils n'ont pas toujours l'initiative des poursuites; l'instruction est rapide et orale. Je doute cependant que, dans aucun pays, le crime échappe aussi rarement à la peine.
La raison en est que tout le monde se croit intéressé à fournir les preuves du délit et à saisir le délinquant.
J'ai vu, pendant mon séjour aux Etats-Unis, les habitants d'un comté où un grand crime avait été commis, former spontanément des comités, dans le but de poursuivre le coupable et de le livrer aux tribunaux.
En Europe, le criminel est un infortuné qui combat pour dérober sa tête aux agents du pouvoir; la population assiste en quelque sorte à la lutte. En Amérique, c'est un ennemi du genre humain, et il a contre lui l'humanité tout entière.
Je crois les institutions provinciales utiles à tous les peuples; mais aucun ne me semble avoir un besoin plus réel de ces institutions que celui dont l'état social est démocratique.
Dans une aristocratie, on est toujours sûr de maintenir un certain ordre au sein de la liberté.
Les gouvernants ayant beaucoup à perdre, l'ordre est un d'un grand intérêt pour eux.
On peut dire également que dans une aristocratie le peuple est à l'abri des excès du despotisme, parce qu'il se trouve toujours des forces organisées prêtes à résister au despote.
Une démocratie sans institutions provinciales ne possède aucune garantie contre de pareils maux.
Comment faire supporter la liberté dans les grandes choses à une multitude qui n'a pas appris à s'en servir dans les petites?
Comment résister à la tyrannie dans un pays où chaque individu est faible, et où les individus ne sont unis par aucun intérêt commun?
Ceux qui craignent la licence, et ceux qui redoutent le pouvoir absolu, doivent donc également désirer le développement graduel des libertés provinciales.
Je suis convaincu, du reste, qu'il n'y a pas de nations plus exposées à tomber sous le joug de la centralisation administrative que celles dont l'état social est démocratique.
Plusieurs causes concourent à ce résultat, mais entre autres celle-ci:
La tendance permanente de ces nations est de concentrer toute la puissance gouvernementale dans les mains du seul pouvoir qui représente directement le peuple, parce que, au-delà du peuple, ou n'aperçoit plus que des individus égaux confondus dans une masse commune,
Or, quand un même pouvoir est déjà revêtu de tous les attributs du gouvernement, il lui est fort difficile de ne pas chercher à pénétrer dans les détails de l'administration, et il ne manque guère de trouver à la longue l'occasion de le faire. Nous en avons été témoins parmi nous.
Il y a eu, dans la révolution française, deux mouvements en sens contraire qu'il ne faut pas confondre: l'un favorable à la liberté, l'autre favorable au despotisme.
Dans l'ancienne monarchie, le roi faisait seul la loi; au-dessous du pouvoir souverain se trouvaient placés quelques restes, à moitié détruits, d'institutions provinciales. Ces institutions provinciales étaient incohérentes, mal ordonnées, souvent absurdes. Dans les mains de l'aristocratie, elles avaient été quelquefois des instruments d'oppression.
La révolution s'est prononcée en même temps contre la royauté et contre les institutions provinciales. Elle a confondu dans une même haine tout ce qui l'avait précédé, le pouvoir absolu et ce qui pouvait tempérer ses rigueurs; elle a été tout à la fois républicaine et centralisante.
Ce double caractère de la révolution française est un fait dont les amis du pouvoir absolu se sont emparés avec grand soin. Lorsque vous les voyez défendre la centralisation administrative, vous croyez qu'ils travaillent en faveur du despotisme? Nullement, ils défendent une des grandes conquêtes de la révolution.117 De cette manière, on peut rester populaire et ennemi des droits du peuple; serviteur caché de la tyrannie et amant avoué de la liberté.
J'ai visité les deux nations qui ont développé au plus haut degré le système des libertés provinciales, et j'ai écouté la voix des partis qui divisent ces nations. En Amérique, j'ai trouvé des hommes qui aspiraient en secret à détruire les institutions démocratiques de leur pays. En Angleterre, j'en ai trouvé d'autres qui attaquaient hautement l'aristocratie; je n'en ai pas rencontré un seul qui ne regardât la liberté provinciale comme un grand bien.
J'ai vu, dans ces deux pays, imputer les maux de l'Etat à une infinité de causes diverses, mais jamais à la liberté communale.
J'ai entendu les citoyens attribuer la grandeur ou la prospérité de leur patrie à une multitude de raisons; mais je les ai entendus tous mettre en première ligne et classer à la tête de tous les autres avantages la liberté provinciale.
Croirai-je que des hommes naturellement si divisés qu'ils ne s'entendent ni sur les doctrines religieuses, ni sur les théories politiques, tombent d'accord sur un seul fait, celui dont ils peuvent le mieux juger, puisqu'il se passe chaque jour sous leurs yeux, et que ce fait soit erroné?
Il n'y a que les peuples qui n'ont que peu ou point d'institutions provinciales qui nient leur utilité; c'està-dire que ceux-là seuls qui ne connaissent point la chose en médisent.
NOTES
Note I.
Il existe aux Etats-Unis un système prohibitif. Le petit nombre des douaniers et la grande étendue des côtes rendent la contrebande très facile; cependant on l'y fait infiniment moins qu'ailleurs, parce que chacun travaille à la réprimer.
Comme il n'y a pas de police préventive aux États-Unis, on y voit plus d'incendies qu'en Europe; mais en général ils y sont éteints plus tôt parce que la population environnante ne manque pas de se porter avec rapidité sur le lieu du danger.
Note K.
Il n'est pas juste de dire que la centralisation soit née de la révolution française; la révolution française l'a perfectionnée, mais ne l'a point créée. Le goût de la centralisation et la manie réglementaire remontent, en France, a l'époque où les légistes sont entrés dans le gouvernement; ce qui nous reporte au temps de Philippe-le-Bel. Depuis lors, ces deux choses n'ont jamais cessé de croître. Voici ce que M. de Malhesherbes, parlant au nom de la cour des Aides, disait au roi Louis XVI, en 1775:118
« … Il restait à chaque corps, à chaque communauté de citoyens le droit d'administrer ses propres affaires droit que nous ne disons pas qui fasse partie de la constitution primitive du royaume, car il remonte bien plus haut: c'est le droit naturel, c'est le droit de la raison. Cependant il a été enlevé à vos sujets, sire, et nous ne craindrons pas de dire que l'administration est tombée à cet égard dans des excès qu'on peut nommer puérils.
« Depuis que des ministres puissants se sont fait un principe politique de ne point laisser convoquer d'assemblée nationale, on en est venu de conséquences en conséquences jusqu'à déclarer nulles les délibérations des habitants d'un village quand elles ne sont pas autorisées par un intendant; en sorte que, si cette communauté a une dépense à faire, il faut prendre l'attache du subdélégué de l'intendant, par conséquent suivre le plan qu'il a adopté, employer les ouvriers qu'il favorise, les payer suivant son arbitraire; et si la communauté a un procès à soutenir, il faut aussi qu'elle se fasse autoriser par l'intendant. Il faut que la cause soit plaidée à ce premier tribunal avant d'être portée devant la justice. Et si l'avis de l'intendant est contraire aux habitants, ou si leur adversaire a du crédit à l'intendance, la communauté est déchue de la faculté de défendre ses droits. Voilà, sire, par quels moyens on a travaillé à étouffer en France tout esprit municipal à éteindre, si on le pouvait, jusqu'aux sentiments de citoyens; on a pour ainsi dire interdit la nation entière, et on lui a donné des tuteurs. »
Que pourrait-on dire de mieux aujourd'hui, que la révolution française a fait ce qu'on appelle ses conquêtes en matière de centralisation?
En 1789, Jefferson écrivait de Paris à un de ses amis « II n'est pas de pays où la manie de trop gouverner ait pris de plus profondes racines qu'en France, et où elle cause plus de mal. » Lettres à Madisson, 28 août 1789.
La vérité est qu'en France, depuis plusieurs siècles, le pouvoir central a toujours fait tout ce qu'il a pu pour étendre la centralisation administrative il n'a jamais eu dans cette carrière d'autres limites que ses forces. Le pouvoir central né de la révolution française a marché plus avant en ceci qu'aucun de ses prédécesseurs, parce qu'il a été plus fort et plus savant qu'aucun d'eux. Louis XIV soumettait les détails de l'existence communale aux bons plaisirs d'un intendant; Napoléon les a soumis à ceux du ministre. C'est toujours le même principe, étendu à des conséquences plus ou moins reculées.
27.Gustave de Beaumont on “Slavery in America” (1835)↩
[Word Length: 18,316]
Source
Gustave de Beaumont, Marie ou L'esclavage aux États-Unis: tableau de moeurs américaines (Paris: Charles Gosselin, 1842. 5th ed.) Chap. VIII "La Révélation," pp. 59-77; Appendix A, “NOTE SUR LA CONDITION SOCIALE ET POLITIQUE DES NÈGRES ESCLAVES ET DES GENS DE COULEUR AFFRANCHIS,” pp. 221-259; and Notes.
CHAPITRE VIII. LA RÉVÉLATION.
« La Nouvelle-Angleterre, mon pays natal, n'est point la patrie de mes enfants: Georges et Marie sont nés dans la Louisiane. Hélas! plût au ciel que je n'eusse jamais quitté le lieu, de ma naissance! Mon père, négociant à Boston, fit sa fortune; à sa mort, son patrimoine se divisa également entre ses enfants, et ne suffit plus à leurs besoins. J'avais deux frères: le premier partit pour l'Inde, d'où il a rapporté de grandes richesses; le second s'est avancé dans l'Ouest: il possède aujourd'hui deux mille acres de terre et plusieurs manufactures dans l'Illinois. J'étais incertain sur le parti que je devais prendre: quelqu'un me dit: « Allez à la Nouvelle-Orléans; si « vous n'y êtes pas victime de la fièvre jaune, vous y ferez une grande fortune. L'alternative ne m'effraya pas, je suivis ce conseil. . Hélas! j'ai moins souffert d'un climat insalubre que de la corruption des hommes.
« Partout où la société se partage en hommes libres et en esclaves, il faut bien s'attendre à trouver la tyrannie des uns et la bassesse des autres; le mépris pour les opprimés, la haine contre les oppresseurs; l'abus de la force, et ]a vengeance...
« Mais, quelle terre de malédiction, ô mon Dieu! quelle dépravation dans les mœurs! quel cynisme dans l'immoralité! et quel mépris de la parole de Dieu dans une société de chrétiens!
« Cependant, sur cette terre de vices et d'impiété, mes yeux distinguèrent une jeune orpheline, innocente et belle, simple dans sa pensée, et fervente dans sa foi religieuse; elle était d'origine créole. J'unis ma destinée à celle de Thérésa Spencer. D'abord le ciel nous fut propice; la naissance de Georges et de Marie fut, en quelques années, le double gage de notre amour. J'avais fait de grandes entreprises commerciales; elles prospéraient toutes selon mes vœux. Hélas! notre bonheur fut passager comme celui des méchants! Je ne suis point impie, et la foudre du Dieu vengeur a courbé ma tête.
« Avant son mariage, Thérésa Spencer avait attiré les regards d'un jeune Espagnol, don Fernando d'Almanza, d'une famille très-riche, dont la fortune remonte au temps où la Louisiane était une colonie espagnole. Rien n'était plus séduisant que ce jeune homme; son esprit n'était point inférieur à sa naissance, et la distinction de ses manières égalait la beauté de ses traits. Cependant Thérésa l'éloigna d'elle. Je ne sais quel sens intime lui fit deviner un ennemi dans l'homme qui lui déclarait le plus tendre amour.
« Nous avons su depuis qu'il aspirait à l'aimer sans devenir son époux.
«La rigueur de Thérésa l'irrita vivement, et plus tard le spectacle de notre félicité rendit sans doute encore plus cuisantes les douleurs de sa vanité blessée, car il conçut et exécuta bientôt une détestable vengeance.
« Il répandit secrètement le bruit que Thérésa était, par sa bisaïeule, d'origine mulâtre; appuya cette allégation des preuves qui pouvaient la justifier; nomma tous les parents de Marie, en remontant jusqu'à celle dont le sang impur avait, disait-il, flétri toute une race.
« Sa dénonciation était odieuse; mais elle était vraie. La tache originelle de Thérésa Spencer s'était perdue dans la nuit des temps. A la voix de Fernando les souvenirs endormis se réveillèrent... Il y a tant de mémoire dans le cœur de l'homme pour les misères d'autrui! L'opinion publique fut tout en émoi; on fit une sorte d'enquête; les anciens du pays furent consultés, et il fut reconnu qu'un siècle auparavant, la famille de Thérésa Spencer avait été souillée par une goutte de sang noir.
« La suite des générations avait rendu ce mélange imperceptible. Thérésa était remarquable par une éclatante blancheur; et rien, dans son visage ni dans ses traits, ne décelait le vice de son origine; mais la tradition la condamnait.
« Depuis ce jour, notre vie, qui s'écoulait paisible et douce, devint amère et cruelle. Plus nous étions haut dans l'estime du monde, et plus la honte de déchoir fut éclatante. Je vis aussitôt chanceler les affections que je croyais les plus solides. Un seul ami, resté fidèle au malheur, eut à rougir de mon affection.
« Cet ami généreux, auquel vous tenez par les liens du sang, avait, je crois, comme Français, plus de philanthropie pour la race noire, et moine de préjugés contre elle, qu'il ne s'en trouve d'ordinaire chez les Américains. Lui seul, aux jours de l'infortune, me tendit une main secourable, et me préserva de l'opprobre d'une faillite. Le coup porté à ma position sociale avait en même temps ébranlé mon crédit. Les hommes de ce pays, si indulgents pour une banqueroute, furent sans pitié pour une mésalliance.!
« Cependant le mal était sans remède: je luttai contre ma fortune, parce qu'il est dans nos mœurs de ne jamais désespérer; mais l'obstacle était au-dessus d'une force humaine.
« Thérésa se reprocha cruellement des malheurs dont elle était innocente. Orpheline dès l'âge le plus tendre, elle n'avait point connu les secrets de sa famille. Sa douleur fut si profonde qu'elle n'y survécut pas; je la vis expirer dans mes bras, épuisée par ses larmes et par son désespoir.
« Quand elle fut enlevée à mon amour, elle si jeune d'années et si vieillie par le chagrin, elle si pure et si désolée, je doutai pour la première fois de la Providence et de mon courage. Ce doute était coupable; car j'ai trouvé des forces pour supporter ma misère, et le Ciel ne m'a point abandonné.
« Je quittai la Nouvelle-Orléans, où j'étais en butte à trop de mauvaises passions, et déchiré par trop de cruels souvenirs. Je me suis fixé à Baltimore, où personne ne connaît la tache de mon alliance, ni le vice dont est souillée la naissance de mes enfants.
« Depuis dix ans que j'habite cette ville, j'y ai formé de nouvelles relations; je m'y suis fait un nouveau crédit, et j'ai retrouvé la fortune sans le bonheur, qui ne saurait plus exister pour moi.
« Nous vivons ici dans une apparente tranquillité: le trouble n'est que dans nos âmes.
« Tout le monde ignore la honte de mes enfants, mais chaque jour on peut la découvrir. On nous aime, on nous honore, parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. Un seul mot d'un ennemi bien informé pourrait nous perdre: nous ressemblons au coupable que la société croit innocent, et qui n'ose accepter la considération publique, parce que trop de honte suivra la révélation de son crime.
« Georges, dont le caractère noble et fier s'indigne des injustices du monde, se croit l'égal des Américains; et, si je ne l'eusse supplié, au nom de sa sœur, qu'il aime avec passion, de garder le silence, cent fois il aurait, à la face du public, révélé sa naissance, et bravé, l'opinion.
« Au contraire, soumise à son destin et résignée, Marie cherche l'ombre et l'isolement. Tel est le secret de son aversion pour la société. Ah! certes, elle surpasse toutes les femmes de Baltimore en esprit, en talents, en bonté; mais elle n'est point leur égale.
« Je vous devais, mon jeune ami, cet aveu de notre infortune... L'hospitalité m'en faisait une loi. Vous cherchez le bonheur sur la terre; hélas! vous ne le trouverez pas parmi nous... Ailleurs, les joies du monde! ici, les chagrins et les sacrifices! »
Ainsi parla Nelson. Pendant ce récit, son visage austère parut quelquefois s'émouvoir. Georges frémissait sur son siége; sa colère muette éclatait dans ses gestes brusques et dans ses regards irrités. Marie, la tête penchée sur son sein, cachait son visage à tous les yeux.
Pour moi, j'écoutais, incertain si je saisissais bien le langage étrange dont mon oreille était frappée; cependant rien n'était obscur dans les paroles que je venais d'entendre.
Je sentis se révolter mon cœur et ma raison.
— Voilà donc, m'écriai-je, ce peuple libre qui ne saurait se passer d'esclaves! L'Amérique est le sol classique de l'égalité, et nul pays d'Europe ne contient autant de servitude! Maintenant je vous comprends, Américains égoïstes; vous aimez pour vous la liberté; peuple de marchands, vous vendez celle d'autrui!
A peine avais-je prononcé ces mots, que j'eusse voulu les rappeler à moi; car je craignais d'offenser le père de Marie.
L'indignation avait saisi mon âme. La fille de Nelson, me voyant irrité d'abord, puis rêveur, se méprit sur les sentiments dont j'étais animé.
— Ludovic, me dit-elle d'une voix à demi éteinte, pourquoi ces regrets? ne vous l'avais-je pas dit? je suis indigne de votre amour!
Je lui répondis: — Marie, vous devinez mal ce qui se passe au fond de mon cœur. Il est vrai que mes sentiments pour vous ne sont plus les mêmes: je vous sais malheureuse: mon amour s'accroît de toute votre infortune.
— Ami généreux, s'écria Georges en me tendant la main, vous parlez noblement.
Et un rayon de joie éclaira tout à coup ce front sinistre et sombre.
Cependant Nelson demeurait impassible. Quand il vit nos émotions un peu calmées, il me dit: — L'enthousiasme vous égare, mon ami; prenez garde à l'entraînement d'une passion généreuse… Hélas! si vous contemplez d'un œil moins prévenu la triste réalité, vous n'en pourrez soutenir l'aspect, et vous reconnaîtrez qu'un blanc ne saurait s'allier à une femme de couleur.
Je ne puis vous peindre le trouble que ces paroles jetaient dans mon esprit. Quelle situation étrange! à l'instant où Nelson me parlait ainsi, je voyais près de moi Marie, dont le teint surpassait en blancheur les cygnes des grands lacs.
Alors je dis: — Quelle est donc, chez un peuple exempt de préjugés et de passions, l'origine de cette fausse opinion qui note d'infamie des êtres malheureux, et de cette haine impitoyable qui poursuit toute une race d'hommes de génération en génération?
Nelson réfléchit un instant; ensuite il s'engagea entre nous une conversation, dont je puis vous rapporter exactement les ternies: elle a laissé dans ma mémoire des traces que le temps ne saurait effacer.
NELSON.
La race noire est méprisée en Amérique, parce que c'est une race d'esclaves; elle est haïe, parce qu'elle aspire à la liberté.
Dans nos mœurs, comme dans nos lois, le nègre n'est pas un homme: c'est une chose.
C'est une denrée dans le commerce, supérieure aux autres marchandises; un nègre vaut dix acres de terre en bonne culture.
Il n'existe pour l'esclave ni naissance, ni mariage, ni décès.
L'enfant du nègre appartient au maître de celui-ci, comme les fruits de la terre sont au propriétaire du sol. Les amours de l'esclave ne laissent pas plus de traces dans la société civile que ceux des plantes dans nos jardins; et, quand il meurt on songe seulement à le remplacer, comme on renouvelle un arbre utile, que l'âge ou la tempête ont brisé.119
LUDOVIC.
Ainsi, vos lois interdisent aux nègres esclaves la piété filiale, le sentiment paternel et la tendresse conjugale. Que leur reste-t-il donc de commun avec l'homme?
NELSON.
Le principe une fois admis, toutes ces conséquences en découlent: l'enfant né dans l'esclavage ne connaît de la famille que ce qu'en savent les animaux; le sein maternel le nourrit comme la mamelle d'une bête fauve allaite ses petits; les rapports touchants de la mère à l'enfant, de l'enfant au père, du frère à la sœur, n'ont pour lui ni sens ni moralité; et il ne se marie point, parce qu'étant la chose d'autrui, il ne peut se donner à personne.
LUDOVIC.
Mais comment la nation américaine, éclairée et religieuse, ne repousse-t-elle pas avec horreur une institution qui blesse les lois de la nature, de la morale et de l'humanité? Tous les hommes ne sont-ils pas égaux?
NELSON.
Nul peuple n'est plus attaché que nous ne le sommes au principe de l'égalité; mais nous n'admettons point au partage de nos droits une race inférieure à la nôtre.
A ces mots, je vis la rougeur monter au front de Georges, et ses lèvres tremblantes prêtes à laisser partir un cri d'indignation; mais il fit un effort puissant, et contint sa colère.
Je répondis à Nelson: — On croit, aux États-Unis, que les noirs sont inférieurs aux blancs; est-ce parce que les blancs se montrent, en général, plus intelligents que les nègres? Mais comment comparer une espèce d'hommes élevés dans l'esclavage, et qui se transmettent de génération en génération l'abrutissement et la misère, à des peuples qui comptent quinze siècles de civilisation non interrompue; chez lesquels l'éducation s'empare de l'enfant au berceau, et développe en lui toutes les facultés naturelles? Nous n'avons point, en Europe, les préjugés de l'Amérique, et nous croyons que tous les hommes ne forment qu'une même famille, dont tous les membres sont égaux.
NELSON.
Sans doute, l'esclavage offense la morale et la loi de Dieu! cependant ne jugez pas trop sévèrement le peuple américain: la Grèce eut ses ilotes; Rome ses esclaves; le moyen âge, les serfs; de nos jours, on a des nègres; et ces nègres, dont le cerveau est naturellement étroit, attachent peu de prix à la liberté; pour la plupart, l'affranchissement est un don funeste. Interrogez-les, tous vous diront qu'esclaves ils étaient plus heureux que libres. Abandonnés à leurs propres forces, ils ne savent pas soutenir leur existence: et il meurt dans nos villes moitié plus d'affranchis que d'esclaves.120
LUDOVIC.
II est naturel que l'esclave qui tout à coup devient libre, ne sache ni user ni jouir de l'indépendance. Pareil à l'homme dont on aurait, dès l'âge le plus tendre, lié tous les membres, et auquel on dit subitement de marcher, il chancelle à chaque pas... La liberté est entre ses mains une arme funeste, dont il blesse tout ce qui l'entoure; et, le plus souvent, il est lui-même sa première victime. Mais faut-il en conclure que l'esclavage, une fois établi quelque part, doit être respecté? Non, sans doute. Seulement il est juste de dire que la génération qui reçoit l'affranchissement n'est point celle qui en jouit: le bienfait de la liberté n'est recueilli que par les générations suivantes— Je ne reconnaîtrai jamais ces prétendues lois de la nécessité, qui tendent à justifier l'oppression et la tyrannie.
NELSON.
Je pense ainsi que vous; cependant ne croyez pas que les nègres soient traités avec l'inhumanité dont on fait un reproche banal à tous les possesseurs d'esclaves; la plupart sont mieux vêtus, mieux nourris et plus heureux que vos paysans libres d'Europe.
— Arrêtez! s'écria Georges avec violence (car en ce moment sa colère devint plus forte que son respect filial); ce langage est inique et miel! Il est vrai que vous soignez vos nègres à l'égal de vos bêtes de somme! mieux même, parce qu'un nègre rapporte plus au maître qu'un cheval ou un mulet.... Quand vous frappez vos nègres, je le sais, vous ne les tuez pas: un nègre vaut trois cents dollars .. Mais ne vantez point l'humanité des maîtres pour leurs esclaves: mieux vaudrait la cruauté qui donne la mort, que le calcul qui laisse une odieuse vie!... Il est vrai que, d'après vos lois, un nègre n'est pas un homme: c'est un meuble, une chose.... Oui, mais vous verrez que c'est une chose pensante une chose qui agite et qui remue un poignard. ... Race inférieure! dites-vous? Vous avez mesuré le cerveau du nègre, et vous avez dit: « Il n'y a place dans cette tête étroite que pour la douleur; » et vous l'avez condamné à souffrir toujours. Vous vous êtes trompés; vous n'avez pas mesuré juste: il existe dans ce cerveau de brute une case qui vous a échappé, et qui contient une faculté puissante, celle de la vengeance... d'une vengeance implacable, horrible, mais intelligente. .. S'il vous hait, c'est qu'il a le corps tout déchiré de vos coups, et l'âme toute meurtrie de vos injustices... Est-il si stupide de vous détester? Le plus fin parmi les animaux chérit la main cruelle qui le frappe, et se réjouit de sa servitude... Le plus stupide parmi les hommes, ce nègre abruti, quand il est enchaîné comme une bête fauve, est libre par la pensée, et son âme souffre aussi noblement que celle du Dieu qui mourut pour la liberté du monde. Il se soumet: mais il a la conscience de l'oppression: son corps seul obéit; son âme se révolte. II est rampant! oui... pendant deux siècles il rampe à vos pieds... un jour il se lève, vous regarde en face et vous tue. Vous le dites cruel! mais oubliez-vous qu'il a passé sa vie à souffrir et à détester! Il n'a qu'une pensée: la vengeance, parce qu'il n'a eu qu'un sentiment: la douleur.
Georges, en parlant, s'était animé d'un feu presque surnaturel, et son regard étincelait de haine et de colère.
— Mon ami, reprit froidement Nelson, croyez-vous qu'il n'en coûte pas à mon cœur déjuger comme je le fais une race à laquelle votre mère ne fut pas étrangère?
— Ah! mon père, s'éria Georges, avant d'être époux, vous étiez Américain.
Alors Marie jetant sur son frère un regard suppliant: — Georges, lui dit-elle, pourquoi ces emportements?
Puisse tournant vers Nelson: — Mon père, vous avez raison; les Américaines sont supérieures aux femmes de couleur; elles aiment avec leur raison: moi, je ne sais vous aimer qu'avec mon cœur.
Et, en prononçant ces mots, elle se jeta dans ses bras, comme pour y cacher la honte qui couvrait son visage.
Georges reprit: — Ma sœur rougit de son origine africaine .. moi, j'en suis fier. Les hommes du Nord n'ont qu'à s'enorgueillir de leur génie froid comme leur climat... nous devons, nous, au soleil de nos pères des âmes chaudes et des cœurs ardents.
Il se tut quelques instants; puis il ajouta avec un sourire amer:
— Les Américains sont un peuple libre et commerçant… mais, qu'ils y prennent garde, il leur manquera bientôt une branche d'industrie; bientôt ils perdront le privilége de vendre et d'acheter des hommes: la terre d'Amérique ne doit pas longtemps porter des esclaves.
NELSON.
Oui, je le reconnais avec joie, l'esclavage décroît chaque jour; et sa disparition entière sera l'œuvre du temps.
GEORGES.
Et si les esclaves se fatiguaient d'attendre?
NELSON.
Malheur à eux! S'ils ont recours à la violence pour devenir libres, ils ne le seront jamais; leur révolte amènerait leur destruction. Il est vrai que le nombre des noirs dans le Sud surpassera bientôt celui des blancs; mais tous les États du Centre et du Nord feraient cause commune avec les Américains du Midi, pour exterminer des esclaves rebelles... Tout appel à la force les perdrait: qu'ils aient plus de foi dans les progrès de la raison.
Déjà, dans le Nord, l'esclavage est aboli; et les États méridionaux entendent murmurer des mots de liberté. Naguère, un prompt supplice eût étouffé la voix assez hardie pour réclamer, dans le Sud, l'indépendance des nègres; aujourd'hui, cette question s'agite, en Virginie, au sein même de la législature. Il semble que, chaque année, les idées de liberté universelle franchissent un degré de latitude; le vent du nord les pousse impétueusement. En ce moment, elles traversent le Maryland: c'est la Nouvelle-Angleterre, ma patrie, qui répand dans toute l'Union ses lumières, ses mœurs et sa civilisation.
LUDOVIC.
Il y a tant de puissance dans un principe de morale éternelle!
GEORGES.
Et surtout dans l'intérêt... Savez-vous pourquoi les Américains sont tentés d'abolir la servitude? c'est qu'ils commencent à penser que l'esclavage nuit à l'industrie.
Ils voient pauvres les États à esclaves, et riches ceux qui n'en ont pas; et ils condamnent l'esclavage.
Ils se disent: L'ouvrier libre, travaillant pour lui, travaille mieux que l'esclave; et il est plus profitable de payer un ouvrier qui fait bien que de nourrir un esclave qui fait mal… Et ils condamnent l'esclavage.
Ils se disent encore: Le travail est la source de la richesse; mais la servitude déshonore le travail: les blancs seront oisifs, tant qu'il y aura des esclaves; et ils condamnent l'esclavage.
Leur intérêt est d'accord avec leur orgueil... L'émancipation des noirs ne fait des hommes libres que de nom: le nègre affranchi ne devient point pour les Américains un rival dans le commerce ou dans l'industrie. Il peut être l'une de ces deux choses: mendiant ou domestique; les autres carrières lui sont interdites par les mœurs. Affranchir les nègres aux États-Unis, c'est instituer une classe inférieure... et quiconque est blanc de pure race appartient à une classe privilégiée... La couleur blanche est une noblesse.
— Ne croyez point, mon ami, dis-je en m'adressant à Georges, que ces préjugés soient destinés à vivre éternellement! Selon les lois de la nature, la liberté d'un homme ne peut appartenir à un autre homme. Liberté! mère du génie et de la vertu, principe de tout bien, source sacrée de tous les enthousiasmes et de tous les héroïsmes, une race d'hommes serait-elle condamnée à ne se réchauffer jamais aux rayons de ta divine lumière! Vouée pour toujours à l'esclavage, elle ne connaîtrait ni les gloires du commandement ni la moralité de l'obéissance; incessamment courbée sous les fers pesants de la servitude, elle n'aurait pas la force d'élever ses bras vers le ciel; travaillant sans relâche sous l'œil de ses tyrans, il lui serait interdit de contempler à loisir le firmament si beau, si resplendissant de clartés, d'y élancer sa pensée, et de se livrer à ces admirations sublimes d'où naissent l'inspiration pour l'esprit, l'élévation pour l'âme, et pour le cœur la poésie!
Et, me tournant vers Nelson, je repris en ces termes:
— La société américaine, qui porte la plaie de l'esclavage, travaille-t-elle du moins à la guérir? et prépare-t-elle, pour deux millions d'hommes, la transition de l'état de servitude à celui de liberté?
NELSON.
Personne, hélas! n'est d'accord sur ce point. Les uns voudraient qu'on affranchît d'un seul coup tous les nègres; d'autres, qu'on déclarât libres tous les enfants à naître des esclaves. Ceux-ci disent: Avant d'accorder la liberté aux noirs, il faut les instruire; ceux-là répondent: Il est dangereux d'instruire des esclaves.
Ne sachant quel remède employer, on laisse le mal se guérir de lui-même. Les mœurs se modifient chaque jour; mais la législation n'est pas changée: la loi punit de la même peine le maître qui montre à écrire à son esclave, et celui qui le tue; et le pauvre nègre coupable d'avoir ouvert un livre encourt le châtiment du fouet.121
LUDOVIC.
Quelle cruauté! Je conçois que vous n'affranchissiez pas subitement tous les nègres; mais d'où vient que vous flétrissez de tant de mépris ceux à qui vous avez donné la liberté?
NELSON.
Le noir qui n'est plus esclave le fut, et, s'il est né libre, on sait que son père ne l'était pas.
LUDOVIC.
Je concevrais encore la réprobation qui frappe le nègre et le mulâtre, même après leur affranchissement, parce que leur couleur rappelle incessamment leur servitude; mais ce que je ne puis comprendre, c'est que la même flétrissure s'attache aux gens de couleur devenus blancs, et dont tout le crime est de compter un noir ou un mulâtre parmi leurs aïeux.
NELSON.
Cette rigueur de l'opinion publique est injuste sans doute; mais elle tient à la dignité même du peuple américain… Placé en face de deux races différentes de la sienne, les Indiens et les nègres, l'Américain ne s'est mêlé ni aux uns ni aux autres. Il a conservé pur le sang de ses pères. Pour prévenir tout contact avec ces nations, il fallait les flétrir dans l'opinion. La flétrissure reste à la race, lorsque la couleur n'existe plus.
LUDOVIC.
Dans l'état présent de vos mœurs et de vos lois, vous ne reconnaissez point de noblesse héréditaire?
NELSON.
Non sans doute. La raison repousse toute distinction qui, serait accordée à la naissance, et non au mérite personnel.
LUDOVIC.
Si vos mœurs n'admettent point la transmission des honneurs par le sang, pourquoi donc consacrent-elles l'hérédité de l'infamie? On ne naît point noble, mais on naît infâme! Ce sont, il faut l'avouer, d'odieux préjugés!
Mais enfin, un blanc pourrait, si telle était sa volonté, se marier à une femme de couleur libre?
NELSON.
Non, mon ami, vous vous trompez.'
LUDOVIC.
Quelle puissance l'en empêcherait?
NELSON.
La loi... Elle contient une défense expresse et déclare nul un pareil mariage.
LUDOVIC.
Ah! quelle odieuse loi! Cette loi, je la braverai.
NELSON.
Il est un obstacle plus grave que la loi même: ce sont les mœurs. Vous ignorez quelle est, dans la société américaine, la condition des femmes de couleur.
Apprenez (je rougis de le dire, parce que c'est une grande honte pour mon pays) que, dans toute la Louisiane, la plus haute condition des femmes de couleur libres, c'est d'être prostituées aux blancs.
La Nouvelle-Orléans est, en grande partie, peuplée d'Américains venus du Nord pour s'enrichir, et qui s'en vont dès que leur fortune est faite. Il est rare que ces habitants de passage se marient; voici l'obstacle qui les en empêche:
Chaque année, pendant l'été, la Nouvelle-Orléans est ravagée par la fièvre jaune. A cette époque, tous ceux auxquels un déplacement est possible, quittent la ville, remontent le Mississipi (sic) et l'Ohio, et vont chercher, dans les États du centre ou du Nord, à Philadelphie ou à Boston, un climat plus salubre. Quand la saison des grandes chaleurs est passée, ils reviennent dans le Sud, et reprennent place à leur comptoir. Ces migrations annuelles n'ont rien qui gêne un célibataire; mais elles seraient incommodes pour une famille entière. L'Américain évite tout embarras en se passant d'épouse, et en prenant une compagne illégitime; il choisit toujours celle-ci parmi les femmes de couleur libres; il lui donne une espèce de dot; la jeune fille se trouve honorée d'une union qui la rapproche d'un blanc; elle sait qu'elle ne peut l'épouser; c'est beaucoup à ses yeux que d'en être aimée.... Elle aurait pu, d'après nos lois, se marier à un mulâtre; mais une telle alliance ne l'eût point sortie de sa classe. Le mulâtre n'aurait d'ailleurs pour elle aucune puissance de protection; en épousant l'homme de couleur, elle perpétuerait sa dégradation; elle se relève en se prostituant au blanc. Toutes les jeunes filles de couleur sont élevées dans ces préjugés, et dès l'âge le plus tendre, leurs parents les façonnent à la corruption. Il y a des bals publics où l'on n'admet que des hommes blancs et des femmes de couleur; les maris et les frères de celles-ci n'y sont pas reçus; les mères ont coutume d'y venir elles-mêmes; elles sont témoins des hommages adressés à leurs filles, les encouragent et s'en réjouissent. Quand un Américain tombe épris d'une fille, c'est à sa mère qu'il la demande; celle-ci marchande de son mieux, et se montre plus ou moins exigeante pour le prix, selon que sa fille est plus ou moins novice. Toutcela se passe sans mystère: ces unions monstrueuses n'ont pas même la pudeur du vice qui se cache par honte, comme la vertu par modestie; elles se montrent sans déguisement à tous les yeux, sans qu'aucune infamie ni blâme s'attachent aux hommes qui les ont formées. Quand l'Américain du Nord a fait sa fortune, il a atteint son but... Un jour il quitte la Nouvelle-Orléans, et n'y revient jamais.... Ses enfants, celle qui, pendant dix ans, vécut comme sa femme, ne sont plus rien pour lui. Alors la fille de couleur se vend à'un autre. Tel est le sort des femmes de race africaine à la Louisiane.
— En disant ces mots, Nelson laissa échapper un soupir. On voyait qu'il s'était imposé une pénible contrainte, et que le sentiment d'un devoir à remplir avait seul soutenu sa voix.
Plongé dans une sombre rêverie, Georges semblait ne prêter à ce récit aucune attention Marie donnait, dans sa douleur profonde, un spectacle digne de pitié. Telle on voit, durant l'orage, une tendre fleur incliner sa tête; faible, mais pliante, elle marque, en se courbant, les coups de la tempête. . et, quand l'ouragan est loin d'elle, abattue et languissante, elle ne relève point sa tige flétrie.
Ainsi, pendant que parlait Nelson, Marie, faible femme, roseau dévoué aux orages du cœur, était agitée de mille secousses; chaque révélation lui portait un coup funeste; un instinct de pudeur lui découvrait le sens des paroles qu'elle avait entendues; elle sentait son humiliation sans la comprendre; et, avec l'innocence dans le cœur, elle portait sur son front la rougeur d'une coupable.
Pour moi, ne pouvant résister à l'émotion de cette scène, je m'écriai: — Vos mœurs et vos lois me font horreur; je ne m'y soumettrai jamais... Ah! si Marie ne craint point de se lier à ma destinée, nous quitterons ensemble ce pays de préjugés odieux; nous fuirons des contrées de servitude et de ténèbres, et nous irons vers cette terre de lumières et de liberté, vers cette Nouvelle-Angleterre qui s'avance d'un pas si ferme et si rapide dans la voie de la civilisation!
— Hélas! mon ami, répliqua Nelson, les préjugés contre la population de couleur sont, il est vrai, moins puissants à Boston qu'à la Nouvelle-Orléans; mais nulle part ils ne sont amortis.
— Eh bien! répondis-je aussitôt, ces préjugés, je les déteste et je saurai les braver! c'est une lâcheté infâme que de s'éloigner des malheureux dont l'infortune n'est point méritée!...
En ce moment Marie parut sortir de son abattement; sa paupière affaissée se releva; alors, d'une voix qui trahissait une émotion profonde: — D'où vient, me dit-elle, que vous nous plaignez, après ce que vous avez entendu? La pitié des hommes s'attache aux maux passagers; mais un malheur qui, comme le nôtre, ne doit point finir, fatigue et décourage les cœurs les plus compatissants...
Mon ami, ajouta-t-elle avec un accent presque solennel, vous ne comprenez rien à mon sort ici-bas; parce que mon cœur sait aimer, vous croyez que je suis une fille digne d'amour; parce que vous me voyez un front blanc, vous pensez que je suis pure... mais non... mon sang renferme une souillure qui me rend indigne d'estime et d'affection... Oui! ma naissance m'a vouée au mépris des hommes!... Sans doute cet arrêt de la destinée est mérité... Les décrets de Dieu, quelquefois cruels, sont toujours justes!...
Puis, me trouvant inébranlable dans mes sentiments: — Vous ne savez pas, me dit-elle, que vous vous déshonorez en me parlant? Si l'on vous voyait près de moi dans un lieu public, on dirait: Cet homme perd toute bienséance; il accompagne une femme de couleur.
Hélas! Ludovic, contemplez sans passion la triste réalité: associer votre vie à une pauvre créature telle que moi, c'est embrasser une condition pire que la mort.
N'en doutez pas, ajouta-t-elle d'une voix inspirée, c'est Dieu lui-même qui a séparé les nègres des blancs... Cette séparation se retrouve partout: dans les hôpitaux où l'humanité souffre, dans les églises où elle prie, dans les prisons où elle se repent, dans le cimetière où elle dort de l'éternel sommeil.
— Eh quoi! m'écriai-je, même au jour de la mort?...
— Oui, reprit-elle avec un accent grave et mélancolique; quand je mourrai, les hommes se souviendront que, cent ans auparavant, un mulâtre exista dans ma famille; et si mon corps est porté dans la terre destinée aux sépultures, on le repoussera de peur qu'il ne souille de son contact les ossements d'une race privilégiée... Hélas! mon ami, nos dépouilles mortelles ne se mêleront point sur lu terre; n'est-ce pas le signe que nos âmes ne seront point unies dans le ciel?...
— Cesse, m'écriai-je, ô ma bien aimée, cesse, je t'en conjure, un langage qui déchire mon cœur... Pourquoi ta honte? pourquoi tes larmes?
La honte est aux méchants qui font gémir l'innocence! Et, si tu m'aimes, la source de tes pleurs sera bientôt tarie, laisse à mon amour le soin de te protéger... Tu crains pour moi l'infamie!... Marie, tu ne sais pas combien je m'enorgueillis de toi! Tu ne comprends pas comme je serai fier de me montrer en tous lieux, paré de ton amour, de ta beauté, de ton infortune! Ah! qu'ils me jettent au visage une parole de mépris, ces nobles marchands aux armoiries brillantes, au sang pur et sans mélange! comme je jouirai de leur insolence! En Europe, que ferais-je pour toi, Marie? là on tomberait à tes genoux, ange de grâce et de bonté; chacun s'approcherait pour être béni de ton sourire, fille chaste et pure; quel homme n'envierait la gloire de protéger ton innocence et ta faiblesse? Ici l'on te repousse, on te déshonore .. Ah! que je vous rends grâces, Américains insensibles et froids, de vos mépris et de vos injustices! Par vous, celle que j'aime est abaissée... mais vous la verrez relever sa belle tête! vous lui rendrez foi et hommage, nobles seigneurs de comptoir... vos fronts basanés de race blanche s'inclineront devant la blanche fille de couleur... je vous la ferai respecter! Marie sera la première parmi vos femmes! ...
En prononçant ces mots, je me prosternai aux pieds de Marie, comme pour indiquer le culte dont je jugeais digne mon idole... La fille de Nelson pleurait de bonheur; elle prit mes mains dans ses deux mains, y laissa tomber quelques pleurs et posa sur moi sa tête, me montrant par ce signe qu'elle acceptait mon appui. Ces larmes de la faible femme tombées sur l'homme fort signifiaient sans doute que toute ma puissance ne nous préserverait pas des orages!
Cependant Georges, dont l'émotion était extrême, se jeta dans mes bras; il me serrait étroitement contre sa poitrine, seul langage que trouvât son cœur.
Nelson, impassible, conservant son attitude calme et froide au milieu des passions violentes qui nous agitaient, ressemblait à ces vieilles ruines du rivage de l'Océan qu'on voit immobiles sur la pointe d'un roc, tandis que tout croule autour d'elles, et qui demeurent debout au mépris de l'ouragan déchaîné sur leur tête et des flots en fureur mugissant à leurs pieds. Nos passions ne l'avaient point ému, et aucune de nos paroles ne l'avait irrité.
— Mon ami, me dit-il après un peu de silence, votre cœur généreux vous égare. Ma raison viendra au secours de la vôtre; vous ne savez pas quelle tâche on entreprend quand on veut combattre les préjugés de tout un peuple et demeurer dans une société dont on heurte chaque jour les opinions et les sentiments! Non, je ne consentirai point à votre union avec ma fille. Cependant je ne repousse pas à jamais vos vœux. Parcourez l'Amérique; voyez le monde dans lequel vous prétendez vivre; étudiez ses passions et ses préjugés; mesurez la force de l'ennemi que vous bravez; et lorsque vous connaîtrez le sort de la population noire dans les pays d'esclaves et dans les États même où l'esclavage est aboli, alors vous pourrez prendre une résolution éclairée. Je ne crois pas, je vous l'avoue, qu'il appartienne à une force humaine de résister aux impressions que vous allez recevoir. Mais si l'aspect d'une misère affreuse n'effraie point votre courage et ne rebute point votre cœur, croyez-vous que j'hésite à accepter pour ma chère Marie l'appui généreux que vous viendrez lui présenter?
La réponse ferme de Nelson, dont l'accent annonçait une volonté déterminée, me consterna...
— J'exige, ajouta-t-il, que vous passiez au moins six mois dans l'observation des mœurs de ce pays... Ce temps d'épreuve vous suffira sans doute.
Dans l'impatience de mon amour, je dis à Nelson: Nous sommes malheureux aux États-Unis; vos enfants, par leur naissance; vous et moi, par l'infortune de vos enfants. Quittons ce pays, allons en France. Là, nous ne trouverons point de préjugés contre les familles de couleur.
Je fus surpris de voir qu'à ces mots Georges ne donnait aucune marque d'assentiment; car l'avis que j'ouvrais me semblait devoir lui sourire; cependant il resta silencieux et rêveur. .
— Vous hésitez? lui dis-je.
— Non, répondit Georges, non... je n'hésite pas... Jamais je ne quitterai l'Amérique.
Nelson donna un signe d'approbation et Marie fit entendre un soupir.
— Je suis opprimé dans ce pays, reprit Georges; mais l'Amérique est ma patrie! N'est-on bon citoyen qu'à la condition d'être heureux?... De puissants liens m'y retiennent; le plus grand nombre y est enchaîné par des intérêts, moi j'y suis attaché par des devoirs... Il n'est pas généreux de fuir la persécution!... Ah! si j'étais seul infortuné! peut-être je fuirais... mais mon sort est celui de toute une race d'hommes... Quelle lâcheté de se retirer de la misère commune pour aller chercher seul une heureuse vie!... Et puis... le devoir n'est pas l'unique lien qui m'y enchaîne; j'y puis jouir encore de quelque bonheur. Notre abaissement ne sera pas éternel. Peut-être serons-nous forcés de conquérir par la force l'égalité qu'on nous refuse... Quel beau jour que celui d'une juste vengeance! Non, non... je ne fuirai point l'Amérique. Mais, Ludovic, ajouta-t-il, si vous devez rendre heureuse en France ma sœur, ma chère Marie, ah! partez!... malgré...
Il n'acheva pas; une larme tomba de ses yeux.
— Ah! jamais, mon frère, je ne me séparerai de toi, s'écria Marie avec tendresse.
Pendant ce temps, Nelson réfléchissait. — Dieu nous préserve, me dit-il enfin, de suivre votre conseil! Je sais quelle est en France la corruption des mœurs; et si ma fille est docile à ma voix, jamais elle ne respirera l'air infect de ces sociétés maudites, dans lesquelles la morale est sans cesse outragée, où la fidélité conjugale est un ridicule, et le vice le plus odieux une faiblesse excusable.
Je fis observer à Nelson que les mœurs des femmes, en France, n'étaient plus aujourd'hui ce qu'elles avaient été dans le dernier siècle.122 Mais, tandis que je parlais, il murmurait sourdement ces mots: — La France! terre d'impiété! terre de malédiction!
— Pour moi, reprit-il gravement, je ne quitterai point mon pays. Les Américains des États-Unis sont un grand peuple... Mes pères ont abandonné l'Europe qui les persécutait... Je ne remonterai point vers la source de leur infortune...
Alors je suppliai de nouveau Nelson de me faire grâce d'un temps d'épreuve inutile; mais ma prière fut vaine.
Appendix I. NOTE SUR LA CONDITION SOCIALE ET POLITIQUE DES NÈGRES ESCLAVES ET DES GENS DE COULEUR AFFRANCHIS.
L'existence de deux millions d'esclaves au sein d'un peuple chez lequel l'égalité sociale et politique a atteint son plus haut développement; l'influence de l'esclavage sur les mœurs des hommes libres; l'oppression qu'il fait peser sur les malheureux soumis à la servitude; ses dangers pour ceux même en faveur desquels il est établi; la couleur de la race qui fournit les esclaves; le phénomène de deux populations qui vivent ensemble, se touchent, sans jamais se confondre ni se mêler l'une à l'autre; les collisions graves que ce contact a déjà fait naître; les crises plus sérieuses qu'il peut enfanter dans l'avenir; toutes ces causes se réunissent pour faire sentir combien il importe de connaître le sort des esclaves et des gens de couleur libres des États-Unis. J'ai tâché, dans le cours de cet ouvrage, d'offrir le tableau des conséquences morales de l'esclavage sur des gens de couleur devenus libres; je voudrais maintenant présenter un aperçu de la condition sociale de ceux qui sont encore esclaves. Cet examen me conduira naturellement à rechercher quels sont les caractères de l'esclavage américain.
Après avoir exposé l'organisation de l'esclavage, je rechercherai si cette plaie sociale peut être guérie: quelle est sur ce point l'opinion publique aux États-Unis; quels moyens on propose pour l'affranchissement des noirs, et quelles objections s'y opposent; quel est enfin à cet égard l'avenir probable de la société américaine.
§ 1. Condition du nègre esclave aux États-Unis.
Il semble que rien ne soit plus facile que de définir la condition de l'esclave. Au lieu d'énumérer les droits dont il jouit, ne suffit-il pas de dire qu'il n'en possède aucun? puisqu'il n'est rien dans la société, la loi n'a-t-elle pas tout fait en le déclarant esclave? Le sujet n'est cependant pas aussi simple qu'il le paraît au premier abord; de même que, dans toutes les sociétés, beaucoup de lois sont nécessaires pour assurer aux hommes libres l'exercice de leur indépendance, de même on voit que le législateur a beaucoup de dispositions à prendre pour créer des esclaves, c'est-à-dire pour destituer des hommes de leurs droits naturels et de leurs facultés morales, changer la condition que Dieu leur avait faite, substituer à leur nature perfectible un état qui les dégrade et tienne incessamment enchaînés un corps et une âme destinés à la liberté.
Les droits qui peuvent appartenir à l'homme dans toute société régulière sont de trois sortes, politiques, civils, naturels. Ce sont ces droits dont la législation s'efforce de garantir la jouissance aux hommes libres, et qu'elle met tout son art à interdire aux esclaves.
Quant aux droits politiques, le plus simple bon sens indique que l'esclave doit en être entièrement privé. On ne fera pas participer au gouvernement de la société et à la confection des lois celui que le gouvernement et ces lois sont chargés d'opprimer sans relâche. Sur ce point, la tâche du législateur est aussi facile que sa marche est clairement tracée; les droits politiques, quelle que puisse être leur extension, constituent en tout pays une sorte de privilége. Tous les citoyens libres n'en jouissent pas; il est à plus forte raison facile d'en priver les esclaves: il suffit de ne pas les leur attribuer.
Aussi toutes les lois des États américains où l'esclavage est en vigueur se taisent sur ce point: leur silence est une exclusion suffisante.
Il n'est pas moins indispensable de dépouiller l'esclave de tous les droits civils.
Ainsi l'esclave appartenant au maître ne pourra se marier: comment la loi laisserait-elle se former un lien qu'il serait au pouvoir du maître de briser par un caprice de sa volonté? Les enfants de l'esclave appartiennent au maître, comme le croît des animaux: l'esclave ne peut donc être investi d'aucune puissance paternelle sur ses enfants. Il ne peut rien posséder à titre de propriétaire, puisqu'il est la chose d'autrui; il doit donc être incapable de vendre et d'acheter, et tous les contrats par lesquels s'acquiert et se conserve la propriété lui seront également interdits.
La loi américaine se borne, en général, à prononcer la nullité des contrats dans lesquels un esclave est partie; cependant il est des cas où elle donne à ses prohibitions l'appui d'une pénalité: c'est ainsi qu'en déclarant nuls la vente ou l'achat fait par un esclave, la loi de la Caroline du Sud prononce la confiscation des objets qui ont fait la matière du contrat.123 Le code de la Louisiane contient une disposition analogue.124 La loi du Tennessee condamne à la peine du fouet l'esclave coupable de ce fait, et à une amende l'homme libre qui a contracté avec lui.125
Du reste, quelles que soient la rigueur et la généralité des interdictions qui frappent l'esclave de mort civile, on conçoit cependant que le législateur les établisse sans beaucoup de peine. Ici encore il s'agit de droits qui tous sont écrits dans les lois. A la vérité, le principe de ces droits est préexistant à la législation qui les consacre; mais, sans les créer, la loi les proclame, et, en même temps qu'elle les reconnaît dans les hommes libres, il lui est facile de les contester à ceux qu'elle veut en dépouiller.
Jusque-là le législateur marche dans une voie où peu d'obstacles l'arrêtent. Il a sans doute fait beaucoup, puisque déjà il n'existe pour l'esclave ni patrie, ni société, ni famille; mais son œuvre n'est pas encore achevée.
Après avoir enlevé au nègre ses droits d'Américain, de citoyen, de père et d'époux, il faut encore lui arracher les droits qu'il tient de la nature même; et c'est ici que naissent les difficultés sérieuses.
L'esclave est enchaîné; mais comment lui ôter l'amour de la liberté? il n'emploiera pas son intelligence au service de l'État et de la cité; mais comment anéantir cette intelligence dont il pourrait user pour rompre ses fers? Il ne se mariera point; mais quelque nom qu'on donne à ses rapports avec une femme, ces rapports existent, on ne saurait les briser; ils forment une partie de la fortune du maître, puisque chaque enfant qui naît est un esclave de plus; comment faire qu'il y ait une mère et des enfants, un père et des fils, des frères et des sœurs, sans des affections et des intérêts de famille? en un mot, comment obtenir que l'esclave ne soit plus homme?
Les difficultés du législateur croissent à mesure que, passant de l'interdiction des droits civils à celle des droits naturels, il quitte le domaine des fictions pour pénétrer plus avant dans la réalité. Son premier soin, en déclarant le nègre esclave, est de le classer parmi les choses matérielles: l'esclave est une propriété mobilière, selon les lois de la Caroline du Sud; immobilière dans la Louisiane.
Cependant la loi a beau déclarer qu'un homme est un meuble, une denrée, une marchandise, c'est une chose pensante et intelligente; vainement elle le matérialise, il renferme des éléments moraux que rien ne peut détruire: ce sont ces facultés dont il est essentiel d'arrêter le développement. Toutes les lois sur l'esclavage interdisent l'instruction aux esclaves; non-seulement les écoles publiques leur sont fermées, mais il est défendu à leurs maîtres de leur procurer les connaissances les plus élémentaires. Une loi de la Caroline du Sud prononce une amende de cent livres sterling contre le maître qui apprend à écrire à ses esclaves; la peine n'est pas plus grave quand il les tue.126 Ainsi la perfectibilité, la plus noble des facultés humaines, est attaquée dans l'esclave, qui se trouve ainsi placé dans l'impuissance d'accomplir envers lui-même le devoir imposé à tout être intelligent de tendre sans cesse vers la perfection morale.
La loi s'efforce de dégrader l'esclave; cependant un instinct de dignité lui fait haïr la servitude; un instinct plus noble encore lui fait aimer la liberté. On l'a enchaîné; mais il brise ses fers, le voilà libre!... c'est à-dire en état de rébellion ouverte contre la société et les lois qui l'ont fait esclave.
Tous les États américains du Sud sont d'accord pour mettre hors la loi le nègre fugitif. La loi de la Caroline du Sud dit que toute personne peut le saisir, l'appréhender, et le fouetter sur-le-champ.127 Celle de la Louisiane porte textuellement qu'il est permis de tirer sur les esclaves marrons qui ne s'arrêtent pas quand ils sont poursuivis.128 Le code du Tennessee déclare que le meurtre de l'esclave sommé légalement de se représenter est une chose légitime (it is lawfull); 129 cette loi ajoute que l'esclave, dans une telle position, peut être tué impunément par toute personne quelconque, et de la manière qu'il plaira à celle-ci d'employer, sans qu'elle ait à craindre d'être pour ce fait recherchée en justice.130 Ces mêmes lois accordent des récompenses aux citoyens qui arrêtent l'esclave en liberté;131 elles encouragent les dénonciateurs, et leur paient le prix de la délation.132 La loi de la Caroline du Sud va plus loin: elle porte un châtiment terrible contre l'esclave qui a fui et contre toute personne qui l'a aidé dans son évasion; en pareil cas, c'est toujours la peine de mort qu'elle prononce.133
Toutes les forces sociales sont mises en jeu pour ressaisir le nègre échappé. Lorsque celui-ci, ayant franchi la limite des États à esclaves, touche du pied le sol d'un État qui ne contient que des hommes libres, il peut un instant se croire rentré en possession de ses droits naturels; mais son espérance est bientôt dissipée. Les États de l'Amérique du Nord, qui ont aboli la servitude, repoussent de leur sein les esclaves fugitifs, et les livrent au maître qui les réclame.134
Ainsi la société s'arme de toutes ses rigueurs et de ses droits les plus exorbitants pour s'emparer de l'esclave et le punir du sentiment le plus naturel à l'homme et le plus inviolable, l'amour de la liberté.
Maintenant, voilà l'esclave rendu à ses chaînes; on l'a châtié d'un mouvement coupable d'indépendance; désormais il ne tentera plus de briser ses fers; il va travailler pour son maître, qui est parvenu, à le dompter. Mais ici vont abonder encore les obstacles et les embarras pour le législateur et pour le possesseur de nègres. On a étouffé dans l'esclave deux nobles facultés, la perfectibilité morale et l'amour de la liberté; mais on n'a pas détruit tout l'homme.
Vainement le maître interdit à son nègre tout contact avec la société civile; vainement il s'efforce de le dégrader et de l'abrutir; il est un point où toutes ces interdictions et ces tentatives ont leur terme, c'est celui où commence l'intérêt du maître. Or, le maître, après avoir lié les membres de son esclave, est obligé de les délier, pour que celui-ci travaille; tout en l'abrutissant, il a besoin de conserver un peu de l'intelligence du nègre, car c'est cette intelligence qui fait son prix; sans elle, l'esclave ne vaudrait pas plus que tout autre bétail; enfin, quoi qu'il ait déclaré le nègre une chose matérielle, il entretient avec lui des rapports personnels qui sont l'objet même de la servitude, et l'esclave, auquel toute vie sociale est interdite, se trouve pourtant forcé, afin de servir son maître, d'entrer en relation avec un monde dans lequel, à la liberté, il n'est rien, où il n'apparaît que pour autrui, mais où on lui fait cependant supporter la responsabilité morale qui appartient aux êtres intelligents.
Ici encore l'homme se retrouve, de l'aveu même de ceux qui ont tenté de l'anéantir. Ainsi, quelle que soit la dégradation de l'esclave, il lui faut de la liberté physique pour travailler, et de l'intelligence pour servir son maître, des rapports sociaux avec celui-ci et avec le monde, pour accomplir les devoirs de la servitude.
Mais, s'il ne travaille pas, s'il désobéit à son maître, s'il se révolte, et si, dans ses rapports avec les hommes libres, il commet des délits, que faire dans tous ces cas? — on le punira. — Comment? suivant quels principes? avec quels châtiments?
C'est surtout ici que les difficultés naissent en foule pour le législateur.
La loi, qui fait l'un maître et l'autre esclave, créant deux êtres de nature toute différente, on sent qu'il est impossible d'établir les rapports de l'esclave avec le maître, ou de l'esclave avec les hommes libres, sur la base de la réciprocité; mais alors, en s'écartant de cette règle, seul fondement équitable des relations humaines, on tombe dans un arbitraire complet, et l'on arrive à la violation de tous les principes. Ainsi, le crime du maître tuant son esclave ne sera pas l'équivalent du crime de l'esclave tuant sou maître; la même différence existera entre le meurtre de tout homme libre par un esclave, et celui de l'esclave par un homme libre.
Toutes les lois des États américains portent la peine de mort contre l'esclave qui tue son maître; mais plusieurs ne portent qu'une simple amende contre le maître qui tue son esclave.135
Les voies de fait, la violence du maître sur le nègre, sont autorisées par les lois américaines;136 mais le nègre qui frappe le maître est puni de mort. La loi de la Louisiane prononce la même peine contre l'esclave coupable d'une simple voie de fait envers l'entant d'un blanc.137
Les mêmes distinctions se retrouvent dans les rapports d'esclaves à personnes libres. Ainsi, dans la Caroline du Sud, le blanc qui fait une blessure grave à un nègre encourt une amende de quarante shillings;138 mais le nègre esclave qui blesse un homme libre, est puni de mort.139 Lorsque le nègre blesse un blanc en défendant son maître, il n'encourt aucune peine; mais il subit le châtiment, s'il l'ait cette blessure en se défendant lui-même.140
Il n'existe aucune loi pour l'injure commise par un homme libre envers un esclave. On conçoit qu'un si mince délit ne mérite pas une répression; mais la loi du Tennessee prononce la peine du fouet contre tout esclave qui se permet la moindre injure verbale envers une personne de couleur blanche.141
Ces différences ne sont pas des anomalies; elles sont la conséquence logique du principe de l'esclavage. Chose étrange! on s'efforce de faire du nègre une brute, et on lui inflige des châtiments plus sévères qu'à l'être le plus intelligent. Il est moins coupable puisqu'il est moins éclairé, et on le punit davantage. Telle est cependant la nécessité: il est manifeste que l'échelle des délits ne peut être la même pour l'esclave et pour l'homme libre.
L'échelle des peines n'est pas moins différente, et, sur ce point, la tâche du législateur est encore plus difficile à remplir.
Non-seulement les gradations pénales établies pour les hommes libres ne doivent point s'appliquer pour les esclaves, parce que la société a plus à craindre de ceux qu'elle opprime que de ceux qu'elle protége; mais encore on va voir qu'il y a nécessité de changer, pour l'esclavage, la nature même des peines.
Les peines appliquées aux hommes libres par les lois américaines se réduisent à trois: l'amende, l'emprisonnement perpétuel ou temporaire, et la mort: la première, qui atteint l'homme dans sa propriété; la seconde, dans sa liberté; la troisième, dans sa vie.
On voit, tout d'abord, qu'aucune amende ne peut être prononcée contre l'esclave qui, ne possédant rien, ne peut souffrir aucun dommage dans sa propriété.
L'emprisonnement est aussi, de sa nature, une peine peu appropriée à la condition de l'esclave. Que signifie la privation de la liberté pour celui qui est en servitude? Cependant il faut distinguer ici. S'agit-il d'un emprisonnement temporaire et d'une courte durée? l'esclave redoutera peu ce châtiment; il n'y verra qu'un changement matériel de position, toujours saisi comme une espérance par celui qui est malheureux: il préférera d'ailleurs l'oisiveté à un travail pénible dont il ne tire aucun profit. A vrai dire, la peine sera pour le maître seul, privé du travail de son esclave, et dont le préjudice sera d'autant plus grand que la peine sera plus longue.
S'agit-il d'un emprisonnement à vie? on conçoit qu'une réclusion perpétuelle soit une peine grave, même pour l'esclave qui n'a point de liberté à perdre. Mais ici se présente un autre obstacle: la détention perpétuelle prive le maître de son esclave: prononcer ce châtiment contre l'esclave, c'est ruiner le maître.
L'objection est encore plus grave contre la mort. Infliger cette peine à l'esclave, c'est anéantir la propriété du maître. Ainsi, toutes les peines dont la loi se sert pour châtier les hommes libres sont inapplicables aux esclaves; la mort même, cet instrument à l'usage de toutes les tyrannies, fait ici défaut au possesseur de nègres.
Cependant on trouve souvent, dans les lois américaines relatives aux esclaves, des dispositions portant la mort et l'emprisonnement perpétuel; quelquefois même ces peines sont appliquées par les cours de justice, mais les cas en sont très rares; c'est seulement lorsque l'esclave a commis un grave attentat contre la paix publique; alors la société blessée exige une réparation; elle s'empare du nègre, le condamne à mort ou à une réclusion perpétuelle; et, comme par ce fait elle prive le maître de son esclave, elle lui en paie la valeur. « Tous esclaves, porte la loi, condamnés à mort ou à un emprisonnement perpétuel, seront payés par le trésor public, La somme ne peut excéder trois cents dollars.142 » Ici des intérêts d'une nature étrange entrent en lutte et exercent sur le cours de la justice une déplorable influence. Le maître, avant d'abandonner son nègre aux tribunaux, examine attentivement le délit, et ne le dénonce que s'il le croit capital; car l'indemnité étant à cette condition, il n'a intérêt à livrer son esclave que si celui-ci doit être condamné à mort. D'un autre côté, la société, payant le droit de se faire justice, ne l'exerce qu'avec une extrême réserve; elle épargne le sang, non par humanité, mais par économie; et, tandis que l'intérêt du maître est qu'on se montre inflexible en châtiant son nègre, celui de la société le pousse à l'indulgence. On ne voit le maître prompt à livrer son esclave que dans un seul cas: c'est lorsque celui-ci est vieux et infirme; il espère alors que la condamnation à mort du nègre invalide lui vaudra une indemnité équivalente au prix d'un bon nègre; mais la société se fient en garde contre la fraude, et, pour ne point payer l'indemnité, elle acquitte le nègre. L'esclave, dont le malheur ne touche ni la société ni le maître, ne trouve de protection que dans un calcul de cupidité.
Ce qui précède explique cette singulière loi de la Louisiane, qui porte que la peine d'emprisonnement infligée à un esclave ne peut excéder huit jours, à moins qu'elle ne soit perpétuelle. « A l'exception, dit-elle, des cas où les esclaves doivent être condamnés à un emprisonnement perpétuel, les jurys convoqués pour juger les crimes et délits des esclaves ne seront point autorisés à les emprisonner pour plus de « huit jours.143 »
L'intérêt de cette disposition est facile à saisir. L'emprisonnement temporaire, privant le maître du travail de ses nègres, et lui causant un préjudice sans compensation, est à ses yeux le pire de tous les châtiments. L'emprisonnement perpétuel enlève, il est vrai, au maître la personne de son esclave; mais en même temps la société lui en paie le prix.
On conçoit maintenant l'impossibilité d'infliger souvent aux esclaves la mort ou un long emprisonnement; car ces châtiments répétés ruineraient le maître des nègres ou la société.
Il faut cependant des peines pour punir l'esclave .... des peines sévères, dont on puisse faire usage tous les jours, à chaque instant. Où les trouver?
Voilà comment la nécessité conduit à remploi des châtiments corporels, c'est-à-dire de ceux qui sent instantanés, qui s'appliquent sans aucune perte de temps, sans frais pour le maître ni pour la société, et qui, après avoir fait éprouver à l'esclave de cruelles souffrances, lui permettent de reprendre aussitôt son travail. Ces peines sont le fouet, la marque, le pilori et la mutilation d'un membre. Encore le législateur se trouve-t-il gêné dans ses dispositions relatives à ce dernier châtiment; car il faut laisser sains et intacts les bras de l'esclave.
Telles sont, à vrai dire, les peines propres à l'esclavage; elles en sont les auxiliaires indispensables, et sans elles il périrait. Les lois américaines ont été forcées d'y recourir. Dans le Tennessee, il n'existe, outre la peine de mort, que trois châtiments: le fouet, le pilori, la mutilation. La peine portée contre le faux témoin mérite d'être remarquée: le coupable est attaché au pilori, sur le poteau duquel on cloue d'abord une de ses oreilles; après une heure d'exposition, on lui coupe cette oreille, ensuite on cloue l'autre de même, et, une heure après, celle-ci est coupée comme la première.144
Du reste, le pilori, la mutilation, la marque, ne sont point les peines les plus usitées dans les États à esclaves; elles exigent, pour leur application, des soins, font naître des embarras, et entraînent quelque perte de temps. Le fouet seul n'offre aucun de ces inconvénients; il déchire le corps de l'esclave sans atteindre sa vie; il punit le nègre sans nuire au maître: c'est véritablement la peine à l'usage de la servitude. Aussi les lois américaines sur l'esclavage invoquent-elles constamment son appui.145
Tout à l'heure nous avons vu le législateur forcé d'attribuer à l'esclave une autre criminalité qu'à l'homme libre; nous venons aussi de reconnaître qu'aucune des peines appliquées aux hommes libres ne convenait aux esclaves, et que, pour châtier ceux-ci, on est contraint de recourir aux rigueurs les plus cruelles.
Maintenant, le crime de l'esclave étant défini, et la nature des peines déterminée, qui appliquera ces peines? selon quels principes le nègre sera-t-il jugé? le verra-t-on, durant la procédure, environné des garanties dont toutes les législations des peuples civilisés entourent le malheureux accusé?
Jetons un coup d'œil sur les lois américaines, et nous allons voir le législateur conduit de nécessités en nécessités à la violation successive de tous les principes. La première règle en matière criminelle, c'est que nul ne peut être jugé que par ses pairs. On sent l'impossibilité d'appliquer aux esclaves cette maxime d'équité; car ce serait remettre entre les mains des esclaves le sort des maîtres: aussi, dans tous les cas, les hommes libres composent-ils le jury chargé de juger les esclaves;146 et ici le nègre accusé n'a pas seulement à redouter la partialité de l'homme libre contre l'esclave; il a encore à craindre l'antipathie du blanc contre l'homme noir.
C'est un axiome de jurisprudence, que tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Je trouve dans les lois de la Louisiane et de la Caroline des principes contraires:
« Si un esclave noir, dit la loi de la Louisiane, tire avec une arme à feu sur quelque personne, ou la frappe, ou la blesse avec une arme meurtrière, avec l'intention de la tuer, ledit esclave, sur due conviction d'aucun desdits faits, sera puni de mort, pourvu que la présomption, quant à cette intention, soit toujours contre l'esclave accusé, à moins qu'il ne prouve le contraire.147 »
C'est encore un principe salutaire et consacré par toutes les législations sages, qu'en matière criminelle les peines doivent être fixées par la loi. Cependant les lois américaines abandonnent en général à la discrétion du juge le châtiment de l'esclave; tantôt elles disent que, dans un cas déterminé, le juge fera distribuer le nombre de coups de fouet qu'il jugera convenable, sans fixer ni minimum ni maximum;148 une autre fois, elles laissent au juge chargé de punir le soin de choisir parmi les peines celle qui lui plaît, depuis le fouet jusqu'à la mort exclusivement. 149Ainsi voilà l'esclave livré à l'arbitraire du juge.
Mais il est un principe encore plus sacré que les précédents: c'est que nul ne peut se faire justice à soi-même, et que quiconque a été lésé par un crime doit s'adresser aux magistrats, chargés par la loi de prononcer entre le plaignant et l'accusé.
Cette règle est violée formellement par les lois de la Caroline du Sud et de la Louisiane relatives aux esclaves. On trouve dans les lois de ces deux États une disposition qui confère au maître le pouvoir discrétionnaire de punir ses esclaves, soit à coups de fouet, soit à coups de bâton, soit par l'emprisonnement;150 il apprécie le délit, condamne l'esclave et applique la peine: il est tout à la fois partie, juge et bourreau.
Telles sont et telles doivent être les lois de répression contre les esclaves. Ici les principes du droit commun seraient funestes, et les formes de la justice régulière impossibles. Faudra-t-il soumettre tous les méfaits du nègre à l'examen d'un juge? mais la vie du maître se consommerait en procès; d'ailleurs la sentence d'un tribunal est quelquefois incertaine et toujours lente. Ne faut-il pas qu'un châtiment terrible et inévitable soit incessamment suspendu sur la tête de l'esclave, et frappe dans l'ombre le coupable, au risque d'atteindre l'innocent!
La justice et les tribunaux sont donc presque toujours étrangers à la répression des délits de l'esclave; tout se passe entre le maître et ses nègres. Quand ceux-ci sont dociles, le maître jouit en paix de leurs labeurs et de leur abrutissement. Si les esclaves ne travaillent pas avec zèle, il les fouette comme des bêtes de somme. Ces peines fugitives ne sont point enregistrées dans les greffes des cours; elles ne valent pas les frais d'une enquête. Celui qui consulte les annales des tribunaux n'y trouve qu'un très-petit nombre de jugements relatif à des nègres; mais qu'il parcoure les campagnes, il entendra les cris de la douleur et de la misère: c'est la seule constatation des sentences rendues contre des esclaves.
Ainsi, pour établir la servitude, il faut non-seulement priver l'homme de tous droits politiques et civils, mais encore le dépouiller de ses droits naturels et fouler aux pieds les principes les plus inviolable.
Un seul droit est conservé à l'esclave, l'exercice de son culte; c'est que la religion enseigne aux hommes le courage et la résignation. Cependant, même sur ce point, la loi de la Caroline du Sud se montre pleine de restrictions prudentes: ainsi les nègres ne peuvent prier Dieu qu'à des heures marquées, et ne sauraient assister aux réunions religieuses des blancs. L'esclave ne doit point entendre la prière des hommes libres.151
Quel plus beau témoignagne peut-il exister en faveur de la liberté de l'homme que cette impossibilité d'organiser la servitude sans outrager toutes les saintes lois de la morale et de l'humanité?
§ II. Caractères de l'esclavage aux États-Unis.
Je viens d'exposer les rigueurs mises en usage et les cruautés employées pour fonder et maintenir l'esclavage aux États-Unis. Je pense, du reste, que, dans ces rigueurs et dans ces cruautés, il n'y a rien qui soit spécial à l'esclavage américain. La servitude est partout la même, et entraîne, en quelque lieu qu'on l'établisse, les mêmes iniquités et les mêmes tyrannies.
Ceux qui, en admettant le principe de l'esclavage, prétendent qu'il faut en adoucir le joug, donner à l'esclave un peu de liberté, offrir quelque soulagement à son corps et quelque lumière à son esprit; ceux-là me paraissent doués de plus d'humanité que de logique. A mon sens, il faut abolir l'esclavage ou le maintenir dans toute sa dureté.
L'adoucissement qu'on apporte au sort de l'esclave ne fait que rendre plus cruelles à ses yeux les rigueurs qu'on ne supprime pas; le bienfait qu'il reçoit devient pour lui une sorte d'excitation à la révolte. A quoi bon l'instruire? est-ce pour qu'il sente mieux sa misère? ou afin que, son intelligence se développant, il fasse des efforts plus éclairés pour rompre ses fers? Quand l'esclavage existe dans un pays, ses liens ne sauraient se relâcher sans que la vie du maître et de l'esclave soit mise en péril: celle du maître, par la rébellion de l'esclave; celle de l'esclave, par le châtiment du maître.
Toutes les déclamations auxquelles on se livre sur la barbarie des possesseurs d'esclaves, aux États-Unis comme ailleurs, sont donc peu rationnelles. Il ne faut point blâmer les Américains des mauvais traitements qu'ils font subir à leurs esclaves, il faut leur reprocher l'esclavage même. Le principe étant admis, les conséquences qu'on déplore sont inévitables.
Il en est d'autres qui, voulant excuser la servitude et ses horreurs, vantent l'humanité des maîtres américains envers leurs nègres; ceux-ci manquent pareillement de logique et de vérité. Si le possesseur d'esclaves était humain et juste, il cesserait d'être maître; sa domination sur ces nègres est une violation continue et obligée de toutes les lois de la morale et de l'humanité.
L'esclavage américain, qui s'appuie sur la même base que toutes les servitudes de l'homme sur l'homme, a pourtant quelques traits particuliers qui lui sont propres.
Chez les peuples de l'antiquité, l'esclave était plutôt attaché à la personne du maître qu'à son domaine; il était un besoin du luxe, et une des marques extérieures de la puissance. L'esclave américain, au contraire, tient plutôt au domaine qu'à la personne du maître; il n'est jamais pour celui-ci un objet d'ostentation, mais seulement un instrument utile entre ses mains. Autrefois l'esclave travaillait aux plaisirs du maître autant qu'à sa fortune. Le nègre ne sert jamais qu'aux intérêts matériels de l'Américain.
Jefferson, qui d'ailleurs n'est pas partisan de l'esclavage, s'efforce de prouver l'heureux sort des nègres, comparé à la condition des esclaves romains; et, après avoir peint les mœurs douces des planteurs américains, il cite l'exemple de Vedius Pollion, qui condamna un de ses esclaves à servir de pâture aux murènes de son vivier, pour le punir d'avoir cassé un verre de cristal.152
Je ne sais si la preuve offerte par Jefferson est bonne. Il est vrai que l'habitant des États-Unis serait peu sévère envers l'esclave qui briserait un objet de luxe; mais aurait-il la même indulgence pour celui qui détruirait une chose utile? Je ne sais. Il est certain, du moins, que la loi de la Caroline du Sud prononce la peine de mort contre l'esclave qui fait un dégât dans un champ.153
Je crois, du reste, qu'en effet la vie des nègres, en Amérique, n'est point sujette aux mêmes périls que celle des esclaves chez les anciens. A Rome, les riches faisaient bon marché de la vie de leurs esclaves; ils n'y étaient pas plus attachés qu'on ne tient à une superfluité de luxe ou à un objet de mode. Un caprice, un mouvement de colère, quelquefois un instinct dépravé de cruauté, suffisaient pour trancher le fil de plusieurs existences. Les mêmes passions ne se rencontrent point chez le maître américain, pour lequel un esclave a la valeur matérielle qu'on attache aux choses utiles, et qui, dépourvu d'ailleurs de passions violentes, n'éprouve à l'aspect de ses nègres, travaillant pour lui, que des instincts de conservation.
L'habitant des États-Unis, possesseur de nègres, ne mène point sur ses domaines une vie brillante et ne se montre jamais à la ville avec un cortége d'esclaves. L'exploitation de sa terre est une entreprise industrielle; ses esclaves sont des instruments de culture. Il a soin de chacun d'eux comme un fabricant a soin des machines qu'il emploie; il les nourrit et les soigne comme on conserve une usine en bon état; il calcule la force de chacun, fait mouvoir sans relâche les plus forts et laisse reposer ceux qu'un plus long usage briserait. Ce n'est pas là une tyrannie de sang et de supplices, c'est la tyrannie la plus froide et la plus intelligente qui jamais ait été exercée par le maître sur l'esclave.
Cependant, sous un autre point de vue, l'esclavage américain n'est-il pas plus rigoureux que ne l'était la servitude antique?
L'esprit calculateur et positif du maître américain le pousse vers deux buts distincts: le premier, c'est d'obtenir de son esclave le plus de travail possible; le second, de dépenser le moins possible pour le nourrir. Le problème à résoudre est de conserver la vie du nègre en le nourrissant peu et de le faire travailler avec ardeur sans l'épuiser. On conçoit ici l'alternative embarrassante dans laquelle est placé le maître qui voudrait que sou nègre ne se reposât point et qui pourtant craint qu'un travail continu ne le tue. Souvent le possesseur d'esclaves, en Amérique, tombe dans la faute de l'industriel qui, pour avoir fatigué les ressorts d'une machine, les voit se briser. Comme ces calculs de la cupidité font périr des hommes, les lois américaines ont été dans la nécessité de prescrire le minimum de la ration quotidienne que doit recevoir l'esclave, et de porter des peines sévères contre les maîtres qui enfreindraient cette disposition.154 Ces lois, du reste, prouvent le mal, sans y remédier: quel moyen peut avoir l'esclave d'obtenir justice du plus ou moins de tyrannie qu'il subit? En général, la plainte qu'il fait entendre lui attire rie nouvelles rigueurs; et lorsque par hasard il arrive jusqu'à un tribunal, il trouve pour juges ses ennemis naturels, tous amis de son adversaire.
Ainsi il me paraît juste de dire qu'aux États-Unis l'esclave n'a point à redouter les violences meurtrières dont les esclaves des anciens étaient si souvent les victimes. Sa vie est protégée; mais peut-être sa condition journalière est-elle plus malheureuse.
J'indiquerai encore ici une dissemblance: l'esclave, chez les anciens, servait souvent les vices du maître; son intelligence s'exerçait à cette immoralité.
L'esclave américain n'a jamais de pareils offices à rendre; il quitte rarement le sol, et son maître a des mœurs pures. Le nègre est stupide: il est plus abruti que l'esclave romain, mais il est moins dépravé.
§ III. Peut-on abolir l'esclavage des noirs aux Etats-Unis?
On ne saurait parler de l'esclavage sans reconnaître en même temps que son institution chez un peuple est tout à la fois une tache et un malheur.
La plaie existe aux États-Unis, mais on ne saurait l'imputer aux Américains de nos jours, qui l'ont reçue de leurs aïeux. Déjà même une partie de l'Union est parvenue à s'affranchir de ce fléau. Tous les Etats de la Nouvelle-Angleterre, New-York, la Pensylvanie, n'ont plus d'esclaves.155 Maintenant l'abolition de l'esclavage pourra-t-elle s'opérer dans le Sud, de même qu'elle a eu lieu dans le Nord?
Avant d'entrer dans l'examen de cette grande question, commençons par reconnaître qu'il existe aux États-Unis une tendance générale de l'opinion vers l'affranchissement de la race noire.
Plusieurs causes morales concourent pour produire cet effet.
D'abord, les croyances religieuses qui, aux États-Unis, sont universellement répandues.
Plusieurs sectes y montrent un zèle ardent pour la cause de la liberté humaine; ces efforts des hommes religieux sont continus et infatigables, et leur influence, presque inaperçue, se fait cependant sentir. A ce sujet, ou se demande si l'esclavage peut avoir une très-longue durée au sein d'une société de chrétiens. Le christianisme, c'est l'égalité morale de l'homme. Ce principe admis, il est aussi difficile de ne pas arriver à l'égalité sociale, qu'il paraît impossible, l'égalité sociale existant, de n'être pas conduit à l'égalité politique. Les législateurs de la Caroline du Sud sentirent bien toute la portée du principe moral dont le christianisme renferme le germe; car, dans l'un des premiers articles du code qui organise l'esclavage, ils ont eu soin de déclarer, en termes formels, que l'esclave qui recevra le baptême ne deviendra pas libre par ce seul fait.156
On ne peut pas non plus contester que le progrès de la civilisation ne nuise chaque jour à l'esclavage. A cet égard, l'Europe même influe sur l'Amérique. L'Américain, dont l'orgueil ne veut reconnaître aucune supériorité, souffre cruellement de la tache que l'esclavage imprime à son pays dans l'opinion des autres peuples.
Enfin, il est une cause morale plus puissante peut-être que toute autre sur la société américaine pour l'exciter à l'affranchissement des noirs, c'est l'opinion qui de plus en plusse répand que les États où l'esclavage a été aboli sont plus riches et plus prospères que ceux où il est encore en vigueur, et celte opinion a pour base un fait réel dont enfin on se rend compte; dans les États à esclaves, les hommes libres ne travaillent pas, parce que le travail, étant l'attribut de l'esclave, est avili à leurs yeux. Ainsi, dans ces États, les blancs sont oisifs à côté des noirs qui seuls travaillent. En d'autres termes, la portion de la population la plus intelligente, la plus énergique, la plus capable d'enrichir le pays, demeure inerte et improductive, tandis que le travail de production est l'œuvre d'une autre portion de la population grossière, ignorante, et qui fait son travail sans cœur, parce qu'elle n'y a point d'intérêt.
J'ai plus d'une fois entendu les habitants du Sud, possesseurs d'esclaves, déplorer eux-mêmes, par ce motif, l'existence de l'esclavage, et faire des vœux pour sa destruction.
On ne peut donc nier qu'aux États-Unis l'opinion publique ne tende vers l'abolition complète de l'esclavage.
Mais cette abolition est-elle possible? et comment pourrait-elle s'opérer? Ici je dois jeter un coup d'œil sur les diverses objections qui se présentent.
Première Objection. — D'abord, il est des personnes qui font de l'esclavage des nègres une question de fait et non de principe. La race africaine, disent-ils, est inférieure à la race européenne: les noirs sont donc par leur nature même destinés à servir les blancs.
Je ne discuterai pas ici la question de supériorité des blancs sur les nègres. C'est un point sur lequel beaucoup de bons esprits sont partagés; il me faudrait, pour l'approfondir, plus de lumières que je n'en possède sur ce sujet. Je ne présenterai donc que de courtes observations à cet égard.
En général, on tranche la question de supériorité à l'aide d'un seul fait: on met en présence un blanc et un nègre, et l'on dit: « Le premier est plus intelligent que le second. » Mais il y a ici une première source d'erreur; c'est la confusion qu'on fait de la race et de l'individu. Je suppose constant le fait de supériorité intellectuelle de l'Européen de nos jours: la difficulté ne sera pas résolue.
En effet, ne se peut-il pas qu'il y ait chez le nègre une intelligence égale dans son principe à celle du blanc, et qui ait dégénéré par des causes accidentelles? Lorsque, par suite d'un certain état social, la population noire est soumise pendant plusieurs siècles à une condition dégradante transmise d'âge en âge, à une vie toute matérielle et destructive de l'intelligence humaine, ne doit-il pas résulter, pour les générations qui se succèdent, une altération progressive des facultés morales, qui, arrivée à un certain degré, prend le caractère d'une organisation spéciale, et est considérée comme l'état naturel du nègre, quoiqu'elle n'en soit qu'une déviation? Cette question, que je ne fais qu'indiquer, est traitée avec de grands détails dans un ouvrage en deux volumes, intitulé: Natural and physical history of man, by Richard.
Après avoir indiqué l'erreur dans laquelle on peut tomber en assimilant deux races qui marchent depuis une longue suite de siècles dans des voies opposées, l'une vers la perfection morale, l'autre vers l'abrutissement, j'ajouterai que la comparaison des individus entre eux n'est guère moins défectueuse. Comment, en effet, demander au nègre, dont rien, depuis qu'il existe, n'a éveillé l'intelligence, le même développement de facultés qui, chez le blanc, est le fruit d'une éducation libérale et précoce?
Du reste, cette question recevra une grande lumière de l'expérience qui se fait en ce moment dans les États américains où l'esclavage est aboli. Il existe à Boston, à New-York et à Philadelphie, des écoles publiques pour les enfants des noirs, fondées sur les mêmes principes que celles des blancs; et j'ai trouvé partout cette opinion, que les enfants de couleur montrent une aptitude au travail et une capacité égales à celles des enfants blancs. On a cru longtemps, aux États-Unis, que les nègres n'avaient pas même l'esprit suffisant pour faire le négoce; cependant il existe en ce moment, dans les États libres du Nord, un grand nombre de gens de couleur qui ont fondé eux-mêmes de grandes fortunes commerciales. Longtemps même on pensa que le nègre était destiné par le Créateur à courber incessamment son front sur le sol, et on le croyait dépourvu de l'intelligence et de l'adresse qui sont nécessaires pour les arts mécaniques. Mais un riche industriel du Kentucki me disait un jour que c'était une erreur reconnue, et que les enfants nègres auxquels on apprend des métiers travaillent tout aussi bien que les blancs.
La question de supériorité des blancs sur les nègres n'est donc pas encore pure de tout nuage. Du reste, alors même que cette supériorité serait incontestable, en résulterait-il la conséquence qu'on en tire? Faudrait-il, parce qu'on reconnaîtrait à l'homme d'Europe un degré d'intelligence de plus qu'à l'Africain, en conclure que le second est destiné par la nature à servir le premier? mais où mènerait une pareille théorie?
Il y a aussi parmi les blancs des intelligences inégales: tout être moins éclairé sera-t-il l'esclave de celui qui aura plus de lumières? Et qui déterminera le degré des intelligences?...
Non, la valeur morale de l'homme n'est pas tout entière dans l'esprit; elle est surtout dans l'âme. Après avoir prouvé que le nègre comprend moins bien que le blanc, il faudrait encore établir qu'il sent moins vivement que celui-ci; qu'il est moins capable de générosité, de sacrifices, de vertu.
Une pareille théorie ne soutient pas l'examen. Si on l'applique aux blancs entre eux, elle semble ridicule; restreinte aux nègres, elle est plus odieuse, parce qu'elle comprend toute une race d'hommes qu'elle atteint en masse de la plus affreuse des misères.
Il faut donc écarter cette première objection.
Seconde Objection. — Mais d'autres disent: « Nous avons besoin de nègres pour cultiver nos terres; les hommes d'Afrique peuvent seuls, sous un soleil brûlant, se livrer, sans péril, aux rudes travaux de la culture; puisque nous ne pouvons nous passer d'esclaves, il faut bien conserver l'esclavage. »
Ce langage est celui du planteur américain qui, comme on le voit, réduit la question à celle de son intérêt personnel. A cet intérêt se mêlerait, il est vrai, celui de la prospérité même du pays, s'il était exact de dire que les États du Sud ne peuvent être cultivés que par des nègres.
Sur ce point il existe, dans le Sud des États-Unis1, une grande divergence d'opinion. Il est bien certain qu'à mesure que les blancs se rapprochent du tropique, les travaux exécutés par eux sous le soleil d'été deviennent dangereux. Mais quelle est l'étendue de ce péril? L'habitude le ferait-elle disparaître? A quel degré de latitude commence-t-il? est-ce à la Virginie ou à Louisiane? au 4c ou au 31c degré?
Telles sont les questions en litige qui reçoivent en Amérique bien des solutions contradictoires. En parcourant les États du Sud, j'ai souvent entendu dire que, si l'esclavage des noirs était aboli, c'en était fait de la richesse agricole des contrées méridionales.
Cependant il se passe aujourd'hui même dans le Maryland un fait qui est propre à ébranler la foi trop grande qu'on ajouterait à de pareilles assertions.
Le Maryland, État à esclaves, est situé entre les 38c et 39c degrés de latitude; il tient le milieu entre les États du Nord, où il n'existe que des hommes libres, et ceux du Sud, où l'esclavage est en vigueur. Or c'était, il y a peu d'années encore, une opinion universelle dans le Maryland que le travail des nègres y était indispensable à la culture du sol; et l'on eût étouffé la voix de quiconque eût exprimé un sentiment contraire. Cependant, à l'époque où je traversai ce pays (octobre, 1831 ), l'opinion avait déjà entièrement changé sur ce point. Je ne puis mieux faire connaître cette révolution dans l'esprit public qu'en rapportant textuellement ce que me disait à Baltimore un homme d'un caractère élevé, et qui tient un rang distingué dans la société américaine.
« Il n'est, me disait-il, personne dans le Maryland qui ne désire maintenant l'abolition de l'esclavage aussi franchement qu'il en voulait jadis le maintien.
« Nous avons reconnu que les blancs peuvent se livrer sans aucun inconvénient aux travaux agricoles, qu'on croyait ne pouvoir être faits que par des nègres.
« Cette expérience ayant eu lieu, un grand nombre d'ouvriers libres et de cultivateurs de couleur blanche se sont établis dans le Maryland, et alors nous sommes arrivés à une autre démonstration non moins importante: c'est qu'aussitôt qu'il y a concurrence de travaux entre des esclaves et des hommes libres, la ruine de celui qui emploie des esclaves est assurée. Le cultivateur qui travaille pour lui, ou l'ouvrier libre qui travaille pour un autre, moyennant salaire, produisent moitié plus que d'esclave travaillant pour son maître sans intérêt personnel. Il en résulte que les valeurs créées par un travail libre se vendent moitié moins cher. Ainsi telle denrée qui valait deux dollars lorsqu'il n'y avait parmi nous d'autres travailleurs que des esclaves, ne coûte actuellement qu'un seul dollar. Cependant celui qui la produit avec des esclaves est obligé de la donner au même prix, et alors il est en perte; il gagne moitié moins que précédemment, et cependant ses frais sont toujours les mêmes; c'est-à-dire qu'il est toujours forcé de nourrir ses nègres, leurs familles, de les entretenir dans leur enfance, dans leur vieillesse, durant leurs maladies; enfin, il a toujours des esclaves travaillant moins que des hommes libres.157 »
Je ne saurais non plus quitter ce sujet sans rappeler ici ce que me disait de l'esclavage des noirs un homme justement célèbre en Amérique, Charles Caroll, celui des signataires de la déclaration d'indépendance qui a joui le plus longtemps de son œuvre glorieuse.158
« C'est une idée fausse, me disait-il, de croire que les nègres sont nécessaires à la culture des terres pour certaines exploitations, telles que celles du sucre, du riz et du tabac. J'ai la conviction que les blancs s'y habitueraient facilement, s'ils l'entreprenaient. Peut-être, dans les premiers temps, souffriraient-ils du changement apporté à leurs habitudes; mais bientôt ils surmonteraient cet obstacle, et, une fois accoutumés au climat et aux travaux des noirs, ils en feraient deux fois plus que' les esclaves. »
Lorsque M. Charles Caroll me tenait ce langage, il habitait une terre sur laquelle il y avait trois cents noirs.
Je ne conclurai point de tout ceci que l'objection élevée contre le travail des blancs dans le Sud soit entièrement dénuée de fondement; mais enfin n'est-il pas permis de penser que plusieurs États du Sud qui, jusqu'à ce jour, ont considéré l'esclavage comme une nécessité, viendront à reconnaître leur erreur, ainsi que le fait aujourd'hui le Maryland? Chaque jour les communications des États entre eux deviennent plus faciles et plus fréquentes. La révolution morale qui s'est faite à Baltimore ne s'étendra-t-elle point dans le Sud? Les États du Midi, autrefois purement agricoles, commencent à devenir industriels; les manufactures établies dans le Sud auront besoin de soutenir la concurrence avec celles du Nord, c'est-à-dire de produire à aussi bon marché que ces dernières; elles seront dès-lors dans l'impossibilité de se servir longtemps d'ouvriers esclaves, puisqu'il est démontré que ceux-ci ne sauraient concourir utilement avec des ouvriers libres. Partout où se montre l'ouvrier libre, l'esclavage tombe. Enfin, ce qui demeure bien prouvé, c'est que (économiquement parlant) l'esclavage est nuisible lorsqu'il n'est pas nécessaire, et qu'il a été jugé tel par ceux qui auparavant l'avaient cru indispensable. Mais il se présente contre l'abolition de l'esclavage des objections bien autrement graves que celles du plus ou moins d'utilité dont le travail des nègres peut être pour les blancs.
Troisième Objection. — Supposez le principe de l'abolition admis, quel sera le moyen d'exécution?
Ici deux systèmes se présentent: affranchir dès à présent tous les esclaves; ou bien abolir seulement en principe l'esclavage, et déclarer libres les enfants à naître des nègres. Dans le premier cas, l'esclavage disparaît aussitôt, et, le jour où la loi est rendue, il n'y a plus dans la société américaine que des hommes libres. Dans le second, le présent est conservé; ceux qui sont esclaves restent tels; l'avenir seul est atteint; on travaille pour les générations suivantes.
Ces deux systèmes, assez simples l'un et l'autre dans leur théorie, rencontrent dans l'exécution des difficultés qui leur sont communes.
D'abord, pour déclarer libres les esclaves ou leurs descendants, l'équité exige que le gouvernement en paie le prix à leurs possesseurs: l'indemnité est la première, condition de l'affranchissement, puisque l'esclave est la propriété du maître.
Maintenant, comment opérer ce rachat?
Le gouvernement américain se trouve, dit-on, pour l'effectuer, dans la situation la plus favorable; car la dette publique des États-Unis est éteinte: or, les revenus du gouvernement fédéral sont annuellement de cent cinquante-neuf millions de francs. Sur cette somme, soixante-quatorze millions sont absorbés par les dépenses de l'administration fédérale; restent donc quatre-vingt-cinq millions qui, précédemment, étaient consacrés à l'extinction de la dette publique, et qui, maintenant, pourraient être employés au rachat des nègres esclaves.159
J'ai souvent entendu proposer ce moyen pour parvenir à l'affranchissement général; mais ici combien d'obstacles se présentent! D'abord le point de départ est vicieux; en effet, les États-Unis n'ont, il est vrai, plus de dette publique à payer; mais en même temps qu'ils se sont libérés, ils ont réduit considérablement l'impôt qui était la source de leurs revenus. Il est donc inexact de dire que le gouvernement fédéral reçoive annuellement quatre-vingt-cinq millions, qu'il pourrait appliquer au rachat des nègres.
Mais supposons qu'en effet cette somme est à sa disposition, et voyons s'il est possible d'espérer qu'il en fera l'usage qu'on propose.
Il y avait aux États-Unis, lors du dernier recensement de la population, fait en 1830, deux millions neuf mille esclaves; on en supposant qu'il faille réduire à cent dollars la valeur moyenne de chaque nègre, à raison des femmes, des enfants et des vieillards, le rachat fait à ce prix de deux millions neuf mille esclaves coûterait plus d'un milliard de francs.160 A cette somme, il faut ajouter le prix de deux cent mille esclaves au moins nés depuis 1830161, dont le rachat ajouterait une somme de cent onze millions de francs au milliard précédent. En supposant que le gouvernement fédéral put et voulût appliquer annuellement au rachat des nègres une somme annuelle de quatre-vingt-cinq millions, il ne pourrait, avec cette somme, racheter chaque année que cent soixante mille esclaves; il faudrait donc l'application de la même somme au même objet pendant quatorze années pour racheter la totalité des esclaves existants aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Ces deux millions neuf mille esclaves existant en ce moment se multiplient chaque jour, et, en supposant que leur accroissement annuel soit proportionné dans l'avenir à ce qu'il a été jusqu'à ce jour, il augmentera annuellement d'environ soixante mille: quarante-sept millions de francs seront donc absorbés chaque année, non pas pour diminuer le nombre des esclaves, mais seulement pour empêcher leur augmentation; or ces quarante-sept millions font plus de la moitié de la somme destinée au rachat.
On voit que l'étendue et la durée du sacrifice pécuniaire que le gouvernement des États-Unis aurait à s'imposer ne peuvent se comparer qu'à son peu d'efficacité: Croit-on que le gouvernement américain entreprenne jamais une semblable tâche à l'aide d'un pareil moyen?
Je ne sais si un peuple qui se gouverne lui-même fera jamais un sacrifice aussi énorme sans une nécessité urgente. Les masses, habiles et puissantes pour guérir les maux présents qu'elles sentent, ont peu de prévoyance pour les malheurs à venir. L'esclavage, qui peut, à la vérité, devenir un jour, pour toute l'Union, une cause de trouble et d'ébranlement, n'affecte actuellement et d'une manière sensible qu'une partie des États-Unis, le Sud; or, comment admettre que les pays du Nord qui, en ce moment ne souffrent point de l'esclavage, iront, dans l'intérêt des contrées méridionales, et par une vague prévision de périls incertains et à venir, consacrer au rachat des esclaves du Sud des sommes considérables dont l'emploi, fait au profit de tous, peut leur procurer des avantages actuels et immédiats. Je crois qu'espérer du gouvernement fédéral des États-Unis un pareil sacrifice, c'est méconnaître les règles de l'intérêt personnel, et ne tenir aucun compte ni du caractère américain, ni des principes d'après lesquels procède la démocratie.
Mais l'obstacle qui résulte du prix exorbitant du rachat n'est pas le seul.
Supposons que cette difficulté soit vaincue.
Quatrième Objection. — Les nègres étant affranchis, que deviendront-ils? se bornera-t-on à briser leurs fers? lés laissera-t-on libres à côté de leurs maîtres? Mais si les esclaves et les tyrans de la veille se trouvent face à face avec des forces à peu près égales, ne doit-on pas craindre de funestes collisions?
On voit que ce n'est pas assez de racheter les nègres, mais qu'il faut encore, après leur affranchissement, trouver un moyen de les faire disparaître de la société où ils étaient esclaves.
A cet égard deux systèmes ont été proposés.
Le premier est celui de Jefferson,162 qui voudrait qu'après avoir aboli l'esclavage on assignât aux nègres une portion du territoire américain, où ils vivraient séparés des blancs. On est frappé tout d'abord de ce qu'un pareil système renferme de vicieux et d'impolitique. Sa conséquence immédiate serait d'établir sur le sol des États-Unis deux sociétés distinctes, composées de deux races qui se baissent secrètement et dont l'inimitié serait désormais avouée; ce serait créer une nation voisine et ennemie pour les États-Unis, qui ont le bonheur de n'avoir ni ennemis ni voisins.
Mais, depuis que Jefferson a indiqué ce mode étrange de séparer les nègres des blancs, un autre moyen a été trouve, auquel on ne peut reprocher les mêmes inconvénients.
Une colonie de nègres affranchis a été fondée à Liberia sur la côte d'Afrique (6e degré de latitude nord163). Des sociétés philanthropiques se sont formées pour l'établissement, la surveillance et l'entretien de cette colonie qui déjà prospère. Au commencement de l'année 1834, elle contenait trois mille habitants, tous nègres libres et affranchis, émigrés des États-Unis.
Certes, si l'affranchissement universel des noirs était possible et qu'on pût les transporter tous à Liberia, ce serait un bien sans aucun mélange de mal. Mais le transport des affranchis, d'Amérique en Afrique, pourra-t-il jamais s'exécuter sur un vaste plan? Outre les frais de rachat que je suppose couverts, ceux de transport seraient seuls considérables; on a reconnu que, pour chaque nègre ainsi transporté, il en coûte 30 dollars (160 fr.), ce qui, pour 2 millions de nègres, fait une somme de 318 millions de francs à ajouter aux 1-200 millions précédents. Ainsi, à mesure qu'on pénètre dans la fond de la question, on marche d'obstacle en obstacle.
Maintenant je suppose encore résolues ces premières difficultés; j'admets que d'une part le gouvernement de l'Union serait prêt à faire, pour l'affranchissement des nègres du Sud, l'immense sacrifice que j'ai indiqué, sans que les États du Nord, peu intéressés, quant à présent, dans la question, s'y opposassent; j'admets encore qu'il existe un moyen pratique de transporter la population affranchie hors du territoire américain; ces obstacles levés, il resterait encore à vaincre le plus grave de tous; je veux parler de la volonté des États du Sud, au sein desquels sont les esclaves.
Cinquième Objection. — D'après la constitution américaine, l'abolition de l'esclavage dans les États du Sud ne pourrait se faire que par un acte émané de la souveraineté de ces Etats, ou du moins faudrait-il, si l'affranchissement des noirs était tenté par le gouvernement fédéral, que les États particuliers intéressés y consentissent.164 Or, j'ignore ce que pourront penser un jour et faire les États du Sud; mais il me paraît indubitable que, dans l'état actuel des esprits et des intérêts, tous seraient opposés à l'affranchissement des nègres, même avec la condition de l'indemnité préalable.
Il est certain d'abord que la transition subite de l'état de servitude des noirs à celui de liberté serait pour les possesseurs d'esclaves un moment de crise dangereuse.
Vainement on objecte que les nègres recevant la liberté n'ont plus de griefs contre la société ni contre leurs maîtres; je réponds qu'ils ont des souvenirs de tyrannie, et que le sort commun des opprimés est de se soumettre pendant qu'ils sont faibles, et de se venger quand ils deviennent forts; or, l'esclave n'est fort que le jour où il devient libre.
Il n'est pas vraisemblable que les Américains habitants des États à esclaves se soumettent de leur plein gré aux chances périlleuses qu'entraînerait l'affranchissement des nègres, dans la vue d'épargner à leurs arrière-neveux les dangers d'une lutte entre les deux races.
Ils le feront d'autant moins que, outre le péril attaché à cette mesure, leurs intérêts matériels en seraient lésés. Toutes les richesses, toutes les fortunes des États du Sud, reposent, quant à présent, sur le travail des esclaves; une indemnité pécuniaire, quelque large qu'on la suppose, ne remplacerait point, pour le maître, les esclaves perdus; elle placerait entre ses mains un capital dont il ne saurait que faire. Plus tard sans doute de nouvelles entreprises, de nouveaux modes d'exploitation, se formeraient; mais la suppression des esclaves serait, pour la génération contemporaine, la source d'une immense perturbation dans les intérêts matériels.
On se demande s'il est croyable qu'une génération entière se soumette à une pareille ruine pour le plus grand bien des générations futures. — Non, il est douteux même qu'elle se l'imposât en présence de dangers actuels. Rien n'est plus difficile à concevoir que l'abandon fait par une grande masse d'hommes de leurs intérêts matériels dans la vue d'éviter un péril. Le péril présent n'est encore qu'un malheur à venir: le sacrifice serait un malheur présent.
Mais, dit-on, ces objections sont évitées en grande partie, si, en déclarant libres les enfants à naître des nègres, on maintient dans la servitude les esclaves nés avant l'acte d'abolition. Dans cette hypothèse, ceux qui abolissent l'esclavage conservent leurs esclaves, et la génération qui souffre de l'affranchissement n'a point connu un état meilleur.
Ce système affaiblit sans doute les objections, mais il ne les détruit pas entièrement. N'est-ce pas jeter parmi les esclaves on principe d'insurrection que de déclarer libres les enfants à naître, tout en maintenant les pères dans la servitude? On s'efforce à grand'peine de persuader au nègre esclave qu'il n'est pas l'égal du blanc, et que cette inégalité est la source de son esclavage; que deviendra cette fiction en présence d'une réalité contraire? comment le nègre esclave obéira-t-il à côté de son enfant, investi du droit de résister?
C'est d'ailleurs attribuer aux Américains du Sud un égoïsme exagéré, que de supposer qu'en conservant intacts leurs droits, ils anéantiront ceux de leurs enfants. Autant il serait surprenant qu'ils fissent un grand sacrifice dans l'intérêt de générations futures et éloignées, autant il faudrait s'étonner qu'ils sacrifiassent à leur propre intérêt celui de leurs descendants immédiats; car le sentiment paternel est presque de l'égoïsme. On est donc sûr de trouver dans les pères autant de répugnance à prendre une mesure ruineuse pour les enfants, qu'à faire un acte qui les ruine eux-mêmes.
Ici cependant l'on m'oppose l'exemple des États du Nord de l'Union, qui ont aboli l'esclavage pour l'avenir, c'est-à-dire pour les enfants à naître, en laissant esclaves tous ceux qui l'étaient avant la loi; et l'on demande pourquoi les États du . Sud ne feraient pas de même.
A cet égard, la réponse semble facile. D'abord il est constant que l'esclavage n'a jamais été établi dans le Nord sur une grande échelle. Lorsque la Pensylvanie, New-York et les autres États du Nord, ont aboli l'esclavage, il n'y avait dans leur sein qu'un nombre minime d'esclaves. Pour ne citer qu'un exemple, New-York a aboli l'esclavage en 1799, et, à cette époque, il n'y avait que trois esclaves sur cent habitants: on pouvait affranchir les nègres, ou déclarer libres les enfants à naître, sans redouter aucune conséquence fâcheuse d'un principe de liberté jeté subitement parmi les esclaves. Les possesseurs de nègres ne formaient qu'une fraction imperceptible de la population; alors l'intérêt presque universel était qu'il n'y eut plus d'esclaves, afin que rien ne déshonorât le travail, source de la richesse. En abolissant la servitude des noirs pour l'avenir, les États du Nord n'ont fait aucun sacrifice; la majorité, qui trouvait son profit à cette abolition, a imposé la loi au petit nombre, dont l'intérêt était contraire.
Maintenant, comment comparer aux États du Nord ceux du Sud, où les esclaves sont égaux, quelquefois même supérieurs en nombre aux hommes libres, 165 et où, d'un autre côté, la majorité, pour ne pas dire la totalité des habitants, est intéressée au maintien de l'esclavage?
On voit que la dissemblance est, quant à présent, complète; mais n'est-il pas permis d'espérer dans l'avenir quelque changement dans la situation des États du Sud, et ne peut-on pas admettre qu'intéressés aujourd'hui à conserver l'esclavage, ils aient un jour intérêt à l'abolir? J'ai la ferme persuasion que tôt ou tard cette abolition aura lieu, et j'ai dit plus haut les motifs de ma conviction; mais je crois également que l'esclavage durera longtemps encore dans le Sud; et, à cet égard, il me paraît utile de résumer les différences matérielles qui rendent impossible toute comparaison entre l'avenir du Sud et ce qui s'est passé dans le Nord.
Il est incontestable que le froid des États du Nord est contraire à la race africaine, tandis que la chaleur des pays du Sud lui est favorable; dans les premiers elle languit et décroît, tandis qu'elle prospère et multiplie dans les seconds.
Ainsi la population noire, qui tendait naturellement à diminuer dans les Etats où l'esclavage est aboli, trouve, au contraire, dans le climat des pays méridionaux, où sont aujourd'hui les esclaves, une cause d'accroissement.
Dans le Nord, l'esclavage était évidemment nuisible au plus grand nombre; les habitants du Sud sont encore dans le doute s'il ne leur est pas nécessaire. L'esclavage dans le Nord n'a jamais été qu'une superfluité; il est, au moins jusqu'à présent, pour le Sud, une utilité. Il était, pour les hommes du Nord, un accessoire; il se rattache, dans le Sud, aux mœurs, aux habitudes et à tous les intérêts. En le supprimant, les États libres n'ont eu qu'une loi à faire; pour l'abolir, les États à esclaves auraient à changer tout un état social.
L'activité, le goût des hommes du Nord pour le travail, le zèle religieux des presbytériens de la Nouvelle-Angleterre, le rigorisme des quakers de la Pensylvanie, et aussi une civilisation très-avancée, tout dans les États septentrionaux tendait à repousser l'esclavage. Il n'en est point de même dans le Sud; les États méridionaux ont des croyances, mais non des passions religieuses; plusieurs d'entre eux, tels qu'Alabama, Mississipi, la Géorgie, sont à demi barbares, et leurs habitants sont, comme tous les hommes du midi, portés par le climat à l'indolence et à l'oisiveté. Ainsi l'esclavage n'est, jusqu'à présent, combattu dans le Sud par aucune des causes qui, dans le Nord, ont amené sa ruine.
Les États du Sud sont donc loin encore de l'affranchissement des Nègres.
Cependant, tout en conservant le présent, ils sont effrayés de l'avenir. L'augmentation progressive du nombre des esclaves dans leur sein est un fait bien propre à les alarmer; déjà, dans la Caroline du Sud et dans la Louisiane, le nombre des noirs est supérieur à celui des blancs,166 et la cause de l'augmentation est plus grave encore, peut-être, que le fait même; la traite des noirs avec les pays étrangers étant prohibée dans toute l'Union, non-seulement par le gouvernement fédéral, mais encore par tous les États particuliers, il s'ensuit que l'augmentation du nombre des esclaves ne peut résulter que des naissances; or, le nombre des blancs ne croissant point, dans les États du Sud, dans la même proportion que celui même des nègres, il est manifeste que, dans un temps donné, la population noire y sera de beaucoup supérieure en nombre à la population blanche.167
Tout en voyant le péril qui se prépare, les États du Sud de l'Union américaine ne font rien pour le conjurer; chacun d'eux combat ou favorise l'accroissement du nombre des esclaves, selon qu'il est intéressé actuellement à en posséder plus ou moins. Dans le Maryland, dans le district de Colombie, dans la Virginie, où commence à pénétrer le travail des hommes libres, on affranchit beaucoup d'esclaves, et on en vend autant qu'on peut aux États les plus méridionaux. La Louisiane, la Caroline du Sud, le Mississipi, la Floride, qui trouvent, jusqu'à ce jour, un immense profit dans l'exploitation de leurs terres par les esclaves, n'en affranchissent point, et s'efforcent d'en acquérir sans cesse de nouveaux. Il arrive fréquemment que, effrayés de l'avenir, ces États font des lois pour défendre l'achat des nègres dans les autres pays de l'Union. Comme je traversais la Louisiane (1832), la législature venait de rendre un décret pour interdire tout achat de nègres dans les États limitrophes; mais, en général, ces lois ne sont point exécutées. Souvent les législateurs sont les premiers à y contrevenir; leur intérêt privé de propriétaire leur fait acheter des esclaves, dont ils ont défendu le commerce dans un intérêt général.
En résumé, quand on considère le mouvement intellectuel qui agite le monde; la réprobation qui flétrit l'esclavage dans l'opinion de tous les peuples; les conquêtes rapides qu'ont déjà faites, aux États-Unis, les idées de liberté sur la servitude des noirs; les progrès de l'affranchissement qui, sans cesse, gagne du Nord au Sud; la nécessité où seront tôt ou tard les États méridionaux de substituer le travail libre au travail des esclaves, sous peine d'être inférieurs aux États du Nord; en présence de tous ces faits, il est impossible de ne pas prévoir une époque plus ou moins rapprochée, à laquelle l'esclavage disparaîtra tout à fait de l'Amérique du Nord.
Mais comment s'opérera cet affranchissement? quels en seront les moyens et les conséquences? quel sera le sort des maîtres et des affranchis? c'est ce que personne n'ose déterminer à l'avance.
Il y a en Amérique un fait plus grave peut-être que l'esclavage; c'est la race même des esclaves. La société américaine avec ses nègres se trouve dans une situation toute différente des sociétés antiques qui eurent des esclaves. La couleur des esclaves américains change toutes les conséquences de l'affranchissement. L'affranchi blanc n'avait presque plus rien de l'esclave. L'affranchi noir n'a presque rien de l'homme libre; vainement les noirs reçoivent la liberté; ils demeurent esclaves dans l'opinion. Les mœurs sont plus puissantes que les lois; le nègre esclave passait pour un être inférieur ou dégradé; la dégradation de l'esclave reste à l'affranchi. La couleur noire perpétue le souvenir de la servitude et semble former un obstacle éternel au mélange des deux races.
Ces préjugés et ces répugnances sont tels que, dans les États du Nord les plus éclairés, l'antipathie qui sépare une race de l'autre demeure toujours la même, et, ce qui est digne du remarque, c'est que plusieurs de ces États consacrent dans leurs lois l'infériorité des noirs.
On conçoit aisément que, dans les États à esclaves, les nègres affranchis ne soient pas traités entièrement comme les hommes libres de couleur blanche; ainsi on lira sans étonnement cet article d'une loi de la Louisiane, qui porte:
« Les gens de couleur libres ne doivent jamais insulter ni frapper les blancs, ni prétendre s'égaler à eux; au contraire, ils doivent leur céder le pas partout, et ne leur parler ou leur répondre qu'avec respect, sous peine d'être punis de prison, suivant la gravité des cas.168 »
On ne sera pas plus surpris de voir prohibé dans les États à esclaves tout mariage entre des personnes blanches et des gens de couleur libres ou esclaves.169
Mais ce qui paraîtra peut-être plus extraordinaire, c'est que, même dans les États du Nord, le mariage entre blancs et personnes de couleur ait été pendant longtemps interdit par la loi même. Ainsi, la loi de Massachusetts déclarait nul un pareil mariage et prononçait une amende contre le magistrat qui passait l'acte. 170 Cette loi n'a été abolie qu'en 1830.
Du reste, lorsque la défense n'est pas dans la loi, elle est toujours la même dans les mœurs; une barrière d'airain est toujours interposée entre les blancs et les noirs.
Quoique vivant sur le même sol et dans les mêmes cités, les deux populations ont une existence civile distincte. Chacune a ses écoles, ses églises, ses cimetières. Dans tous les lieux publics où il est nécessaire que toutes deux soient présentes en même temps, elles ne se confondent point; des places distinctes leur sont assignées. Elles sont ainsi classées dans les salles des tribunaux, dans les hospices, dans les prisons La liberté dont jouissent les nègres n'est pour eux la source d'aucun des bienfaits que la société procure. Le même préjugé qui les couvre de mépris leur interdit la plupart des professions. On ne saurait se faire une idée exacte des difficultés que doit vaincre un nègre pour faire sa fortune aux États-Unis; il rencontre partout des obstacles et nulle part des appuis. Aussi la domesticité est-elle la condition presque obligée du plus grand nombre des nègres libres.
Dans la vie politique, la séparation est encore plus profonde. Quoique admissibles en principe aux emplois publics, ils n'en possèdent aucun; il n'y a pas d'exemple d'un nègre ou d'un mulâtre remplissant aux États-Unis une fonction publique. Les lois des États du Nord reconnaissent en général aux gens de couleur libres des droits politiques pareils à ceux des blancs; mais nulle part on ne leur permet d'en jouir. Les gens de couleur libres de Philadelphie ayant voulu, il y a quelque temps, exercer leurs droits politiques à l'occasion d'une élection, furent repoussés avec violence de la salle où ils venaient pour déposer leurs suffrages, et il leur fallut renoncer à l'exercice d'un droit dont le principe ne leur était pas contesté. Depuis ce temps, ils n'ont point renouvelé cette prétention si légitime. Il est triste de le dire, mais le seul parti qu'ait à prendre la population noire ainsi opprimée, c'est de se soumettre et de souffrir la tyrannie sans murmure. Dans ces derniers temps, des hommes animés de l'intention la plus pure et des sentiments les plus philanthropiques ont tenté d'arriver à la fusion des noirs avec les blancs, par le moyen des mariages mutuels. Mais ces essais ont soulevé toutes les susceptibilités de l'orgueil américain et abouti à deux insurrections dont New-York et Philadelphie furent le théâtre au mois de juillet 1834. Toutes les fois que les nègres affranchis manifestent l'intention directe ou indirecte de s'égaler aux blancs, ceux-ci se soulèvent aussitôt en masse pour réprimer une tentative aussi audacieuse. Ces faits se passent pourtant dans les États les plus éclairés, les plus religieux de l'Union, et où depuis longtemps l'esclavage est aboli. Qui douterait maintenant que la barrière qui sépare les deux races ne soit insurmontable?
En général, les nègres libres du Nord supportent patiemment leur misère: mais croit-on qu'ils se soumissent à tant d'humiliations et à tant d'injustices s'ils étaient plus nombreux: ils ne forment dans les États du Nord qu'une minorité imperceptible. Qu'arriverait-il s'ils étaient, comme dans le Sud, en nombre égal ou supérieur aux blancs? Ce qui de nos jours se passe dans le Nord peut faire pressentir l'avenir du Sud. S'il est vrai que les tentatives généreuses faites pour transporter d'Amérique en Afrique les nègres affranchis ne puissent jamais conduire qu'à des résultats partiels, il est malheureusement trop certain qu'un jour les États du Sud de l'Union recéleront dans leur sein deux races ennemies, distinctes par la couleur, séparées par un préjugé invincible, et dont l'une rendra à l'autre la haine pour le mépris. C'est là, il faut le reconnaître, la grande plaie de la société américaine.
Comment se résoudra ce grand problème politique? Faut-il prévoir dans l'avenir une crise d'extermination? Dans quel temps? Quelles seront les victimes? Les blancs du Sud étant en possession des forces que donnent la civilisation et l'habitude de la puissance, et certains d'ailleurs de trouver un appui dans les États du Nord, où la race noire s'éteint, faut-il en conclure que les nègres succomberont dans la lutte, si une lutte s'engage? Personne ne peut répondre à ces questions. On voit se former l'orage, on l'entend gronder dans le lointain; mais nul ne peut dire sur qui tombera la foudre.
28.Gustave de Beaumont on “The Abolition of the Aristocracy in Ireland” (1839)↩
[Word Length: 12,683]
Source
Beaumont, L'Irlande sociale, politique et religieuse. Troisième édition (Paris: Charles Gosselin, 1839).
Vol. 1, Première partie. Chap. II, "Une mauvaise aristocratie est la cause première de tous les maux de l'Irlande. Le vice de cette aristocratie est d'être anglaise et protestante," pp. 211-220.
Vol. II. Chap. II. "Autres remèdes discutés par l'auteur. Il faut abolir lès privilèges civils, politiques et religieux de l'aristocratie," pp. 160-72; Chap. III. "Il serait mauvais de substituer une aristocratie catholique à l'aristocratie protestante.," pp. 173-79; Chap. IV. "Comment et par quels moyens il faut abolir l'aristocratie en Irlande?," pp. 180-203.
Brief Bio of the Author: Gustave de Beaumont (1802-1866)
[Gustave de Beaumont (1802-1866)]
Gustave de Beaumont (1802-1866) was a magistrate in Verseilles and then Paris during the Restoration but was able to keep his post after the July Revolution of 1830. He accompanied Alexis de Tocqueville on a nine month trip to America in 1831 to observe the American prison system for the new French government which resulted in the book The Prison System of the United States (1833). Along the way they observed and collected material which would later produce Tocqueville’s book Democracy in America (1835, 1840) and Beaumont’s book Marie , or Slavery in the United States (1835). In 1836 he married the grand daughter of the marquis de Lafayette, Clémentine, and the following year he travelled with her to Ireland which resulted in L'Irlande sociale, politique et religieuse (1839). During the 1840s he was a member of the Chamber of Deputies and continued in office after the 1848 Revolution as vice-president of the Constituent Assembly where he supported the moderate constitutional republicans. During the Second Republic he also served as ambassador to London and Vienna. He was briefly arrested along with Tocqueville for opposing the coup d’état of Louis Napoleon in December 1852. He retied soon afterwards. One of his last tasks was to edit the collected works of Tocqueville (who died in 1859) which began to appear in print in 1864. He died before he could complete the project, which was continued by Clémentine. [DMH]
Vol. I, Chapitre II. Une mauvaise aristocratie est la cause première de tous les maux de l'Irlande. - Le vice de cette aristocratie est d'être anglaise et protestante.
On vient de voir combien est malheureux l'état de l'Irlande. Le premier besoin qu'on éprouve à l'aspect de tant de misères, c'est de rechercher quelle en est la cause; et cette cause on souhaite surtout de la connaître, parce que, pour guérir le mal, il faut d'abord en savoir l'origine et la nature.
Commençons donc par dire la cause du mal, nous chercherons ensuite le remède.
On ne saurait considérer attentivement l'Irlande, étudier son histoire et ses révolutions, observer ses mœurs et analyser ses lois, sans reconnaître que ses malheurs, auxquels ont concouru tant d'accidents funestes, tant de circonstances fatales, ont eu et ont encore de nos jours, pour cause principale, une cause première, radicale, permanente, et qui domine toutes les autres; cette cause, c'est une mauvaise aristocratie.
Toutes les aristocraties fondées sur la conquête et sur l'inégalité renferment sans doute dans leur sein bien des vices; mais toutes ne contiennent pas les mêmes, et n'en possèdent point un pareil nombre.
Supposez des conquérants qui, dès que les premières convulsions de la conquête sont passées, s'efforcent d'en effacer le souvenir en se mêlant au peuple conquis, prennent son langage, adoptent une partie de ses mœurs, s'approprient presque toutes ses lois, et pratiquent la même religion; supposez que ces conquérants, formés en société féodale, ayant à lutter contre des rois puissants et oppresseurs, cherchent un auxiliaire dans la population conquise, et qu'unis désormais par un lien d'intérêt mutuel, les vainqueurs et les vaincus s'accoutument à mêler leur cause en combattant un ennemi commun; supposez que, ces luttes durant pendant des siècles, les seigneurs en querelle avec leurs rois ne manquent jamais de stipuler des droits pour le peuple en même temps qu'ils conquièrent pour eux-mêmes des priviléges; supposez enfin que ces conquérants, après avoir, par une fusion rapide avec les vaincus, fait oublier les violences de la conquête, travaillent sans relâche à racheter l'injustice de leurs priviléges par les bienfaits du patronage; que, supérieurs en rang, en richesse et en puissance politique, ils ne cessent de se montrer aussi supérieurs en talents et en vertus; que, prenant en main toutes les affaires du peuple, ils se mêlent à toutes ses assemblées, discutent tous ses intérêts, dirigent toutes ses entreprises, sacrifient la moitié de leurs revenus pour ne pas voir un seul pauvre sur leurs domaines, donnent à celui-ci des lumières, à celui-là des capitaux, accordent à tous un appui éclairé, charitable, bienveillant; que, placés à la tête d'une société commerçante, ils en comprennent admirablement le génie et les besoins; lui donnent, avec la liberté de l'industrie, toutes les libertés politiques et civiles qui sont l'âme de celle-ci; et que, pour faire à cette société de magnifiques destinées, ils lui ouvrent des comptoirs dans le monde entier, établissent pour elle des colonies florissantes, fondent pour elle de grands empires dans l'Inde, rendent ses vaisseaux souverains sur toutes les mers, et fassent toutes les nations du monde ses tributaires; et qu'enfin, après lui avoir ouvert toutes les voies de la fortune, ces mêmes hommes, abaissant la barrière qui sépare d'eux le prolétaire, disent à celui-ci: Sois riche, et tu deviendras lord. Sans doute une pareille aristocratie pourra recéler encore bien des germes d'oppression, et plus d'un principe de ruine; on comprendra cependant qu'elle puisse se maintenir longtemps forte et prospère, et que même, succédant à la conquête, et chargée de toutes les injustices du privilége féodal, elle donne au pays qu'elle tient sous son empire l'illusion, si ce n'est même la réalité, d'un gouvernement juste et national. On comprendra le règne long et brillant de l'aristocratie anglaise.
Supposez, au contraire, des conquérants qui, bien loin d'arrêter les violences de la conquête, travaillent sans relâche à les perpétuer; rouvrent cent fois les blessures du peuple conquis; au lieu de s'unir à celui-ci, s'efforcent de s'en tenir séparés; refusent tout à la fois de lui donner leurs lois et de prendre les siennes, conservent leur langage et leurs mœurs, et posent entre eux et lui la plus insurmontable barrière, en déclarant crime de haute trahison toute alliance par le sang entre les fils des vainqueurs et les descendants des vaincus; supposez qu'après s'être ainsi constitués vis-à-vis du peuple conquis comme une faction distincte par la race et par la puissance, ces conquérants viennent à être séparés de lui par une cause plus profonde encore, par la différence des religions; que, non contents de lui avoir ravi son existence nationale, ils entreprennent encore de lui enlever son culte, et qu'après avoir passé des siècles à le dépouiller de son indépendance politique, ils passent encore des siècles à lui disputer sa liberté religieuse; supposez que ces conquérants, tyrans politiques, tyrans religieux, méprisant la nation conquise à cause de sa race, la haïssant à cause de son culte, soient placés dans cette situation extraordinaire qu'il n'y ait pour eux ni intérêt à protéger le peuple ni péril à l'opprimer; alors on concevra qu'une aristocratie composée de pareils éléments ne puisse enfanter qu'égoïsme, violences, injustices d'une part, que haines, résistances, dégradation et misère de l'autre; on comprendra l'aristocratie d'Irlande.
L'aristocratie d'Angleterre, tout habile, toute nationale qu'elle est, eût peut-être été impuissante à se maintenir si, en même temps qu'elle couvre ses vices d'éclatantes vertus, elle n'eût été protégée par des accidents heureux.
Sujette, comme toutes les aristocraties dont le principe est le privilége, à abuser de sa force dans un intérêt égoïste, elle a tendu à l'excès les ressorts sur lesquels elle s'appuie, elle a concentré outre mesure entre ses mains la possession du sol, devenu le monopole d'un petit nombre; et ceux qui en Angleterre sont propriétaires forment une minorité si petite en face de tous ceux qui ne le sont pas, que la propriété y serait peut-être en péril si elle était aux yeux du peuple un objet désirable.
Mais, par un événement propice plus encore que par l'effet d'une politique sage, le sol en Angleterre n'a point encore jusqu'à ce jour excité l'envie des classes inférieures; le peuple anglais laisse à son aristocratie le monopole de la terre, parce qu'il a lui-même le monopole de l'industrie. Les domaines immenses du lord n'ont rien d'importun pour le bourgeois auquel le commerce du monde entier offre une arène sans bornes, et qui pense que s'il fait une grande fortune, il acquerra peut-être un jour, avec les terres de ce lord, son titre et ses honneurs.
L'agriculteur anglais prend peu de souci du système politique dont l'effet est de repousser des champs dans les villes les habitants des campagnes, lorsque cet agriculteur, éloigné du sol, trouve dans l'atelier des fabriques un travail aussi régulier et un meilleur salaire. C'est là, il faut le reconnaître, qu'est la grande garantie de l'aristocratie anglaise: garantie fragile et caduque qui ne durera qu'aussi longtemps que l'industrie anglaise fournira l'univers de ses produits.
L'aristocratie d'Irlande, pleine de vices dont l'aristocratie anglaise est exempte, loin d'être comme celle-ci secourue par des circonstances favorables, lutte au contraire contre des accidents funestes.
Ainsi, c'est pour l'aristocratie irlandaise un sort fatal que celui qui a placé l'Irlande à côté de l'Angleterre; car jamais cette aristocratie n'a cessé d'être anglaise de cœur, et presque d'intérêt; voilà pourquoi elle a toujours résidé et aujourd'hui encore réside plus en Angleterre qu'en Irlande, et ce fait matériel, qui la sépare le plus souvent du peuple soumis à son empire, est pour elle la source du vice le plus funeste à toute aristocratie, qui n'existe réellement qu'à la condition de gouverner. Il arrive souvent d'attribuer tous les maux de l'Irlande au défaut de résidence de l'aristocratie; mais c'est prendre une conséquence du mal pour le mal lui-même. L'aristocratie d'Irlande n'est point mauvaise, parce qu'elle s'absente; elle s'absente, parce qu'elle est mauvaise; parce que rien ne l'attache au pays, parce que nulle sympathie ne l'y retient. Pourquoi, n'aimant ni le pays ni le peuple, resterait-elle en Irlande, lorsqu'elle a près d'elle l'Angleterre qui l'invite et l'attire par le charme d'une société plus civilisée, plus élégante, et qui a le mérite d'être la patrie originaire?
En général, toute aristocratie porte en elle-même le frein qui la tempère sinon l'arrête dans ses écarts et dans son égoïsme. Il arrive d'ordinaire que celle-là même qui n'aime pas le peuple le craint, ou du moins elle a besoin de lui; elle exécute alors par calcul ce qu'elle ne fait point par sympathie. Elle n'opprime pas trop, de peur de révolter; elle ménage les forces nationales dont elle tire profit, et il peut lui arriver ainsi de paraître généreuse alors qu'elle n'est qu'habile et intéressée.
L'aristocratie irlandaise a toujours eu le malheur de ne rien craindre ni de ne rien espérer du peuple placé sous son joug; appuyée sur l'Angleterre, dont les soldats ont toujours été mis à son service, elle a pu se livrer sans réserve à sa tyrannie; les gémissements, les plaintes, les menaces du peuple n'ont jamais modéré son oppression, parce qu'il n'y avait au fond de ces clameurs populaires aucun péril pour elle. Des révoltes éclatent-elles en Irlande? l'aristocratie de ce pays ne s'en émeut point; l'artillerie anglaise est là qui foudroie les rebelles, et, quand tout est rentré dans l'ordre, l'aristocratie continue à toucher comme par le passé le revenu de ses terres.
L'aristocratie irlandaise a exercé un empire dont on ne trouve dans aucun pays un autre exemple; elle a, pendant six siècles, régné en Irlande sous l'autorité de l'Angleterre, qui lui abandonnait la moitié des avantages de la domination et lui en épargnait tous les frais. Pourvue de droits, de priviléges et de garanties constitutionnelles, elle s'est servie, pour pratiquer l'oppression, de tous les instruments de la liberté. L'Irlande a été ainsi la proie constante de deux tyrans, d'autant plus formidables qu'ils se couvraient l'un l'autre. L'aristocratie irlandaise, se considérant comme l'agent de l'Angleterre, aimait à s'absoudre ainsi de ses propres excès et de ses injustices personnelles; et l'Angleterre, dont cette aristocratie exerçait les droits, se plaisait à rejeter sur celle-ci tous les abus de la puissance.
Il est peu de pays où les gouvernants n'aient un intérêt plus ou moins grand à ce que le peuple auquel ils donnent des lois se livre aux arts du commerce et de l'industrie. De quel usage, en effet, seront pour le riche ses grands revenus, s'il ne s'en sert à acquérir les objets propres à lui faire une vie douce et commode? Et comment pourra-t-il se les procurer, si le peuple ne travaille point? Mais c'est encore une fatalité de l'aristocratie irlandaise, qu'elle est abondamment pourvue de tous les produits les plus précieux de l'art et du commerce, quoiqu'il n'existe aucune industrie en Irlande: elle a sous sa main les produits de l'industrie anglaise pour satisfaire à ses besoins et à ses fantaisies, aussi bien que des régiments armés pour assurer la rentrée de ses fermages. Elle n'a donc pas besoin pour posséder le bien-être et l'élégance d'exciter le peuple aux travaux industriels. Le commerce et l'industrie sont cependant les seules voies par lesquelles les classes inférieures peuvent sortir de leur misère. Ainsi le peuple d'Irlande, auquel la terre est inaccessible, voit entre les mains de l'aristocratie un immense privilége dont il ne possède aucun équivalent; ainsi l'aristocratie d'Irlande, qui manque de toutes les bases premières sur lesquelles repose celle d'Angleterre, est dépourvue de cette dernière condition d'existence sans laquelle l'aristocratie anglaise elle-même ne se soutiendrait peut-être pas. Elle est immobile et fermée. En principe, ses rangs sont ouverts à tous; en fait, leur accès est à peu près impossible: pour y entrer, il faut devenir riche: or, quel moyen de s'enrichir dans un pays où le commerce et l'industrie sont morts? de sorte que cette aristocratie, immobile dans sa richesse, vivant de la vie d'autrui, a pour litière une population immobile aussi dans sa misère; en Irlande la pauvreté est une caste. Enfin cette aristocratie, qu'aucun sentiment national n'attache au peuple, a le malheur d'être éloignée de lui par la différence du culte.
La sympathie religieuse est sans contredit le nœud le plus puissant qui unisse les hommes entre eux; elle n'a pas seulement le pouvoir de rapprocher les peuples; elle peut, ce qui est plus difficile encore, confondre les classes et les rangs, relever le plus humble au niveau du plus superbe, mêler le riche et le pauvre; c'est elle qui change l'aumône en charité, et qui, dépouillant le bienfait de son orgueil, la reconnaissance de sa honte, fait deux égaux du bienfaiteur et de l'obligé.
Mais, à défaut de la religion, qui unira le riche et le pauvre, l'Anglais et l'Irlandais, la race conquérante et la race des vaincus? quelle puissance les rapprochera, si la religion elle-même les sépare? et dans un pays où toutes les lois sont faites contre le pauvre au profit du riche, que sera-ce si la religion, au lieu de modérer le puissant, le fortifie, et au lieu de soutenir le faible, aide à l'écraser?
L'aristocratie d'Irlande a deux vices qui résument tous les autres: anglaise d'origine, elle n'a jamais cessé de l'être; devenue protestante, elle a eu à gouverner un peuple demeuré catholique.
Ces deux vices contiennent le principe de tous les maux de l'Irlande; là se trouve la clef de toutes ses misères, de tous ses embarras; si l'on veut examiner attentivement ce point de départ, on va voir en découler, comme des conséquences toutes naturelles, les circonstances extraordinaires dont on chercherait ailleurs vainement la cause. Ces conséquences sont de trois sortes: les unes, qu'on appellera civiles, parce qu'elles touchent aux mœurs; les autres, politiques, parce qu'elles concernent les institutions; celles-là religieuses, parce qu'elles naissent de la différence des cultes. Les premières affectent plus particulièrement les relations du riche avec le pauvre, du propriétaire avec le fermier; les secondes, les rapports réciproques des gouvernants et et des gouvernés; et les troisièmes, la situation mutuelle des protestants et des catholiques.
Vol. 2. CHAPITRE II. Autres remèdes discutés par l'auteur. — Il faut abolir lès privilèges civils, politiques et religieux de l'aristocratie.
On voit combien sont chimériques ces moyens extraordinaires de salut tentés ou proposés pour l'Irlande; une foule d'autres plans analogues pourraient être discutés ici, dont après un court examen, on reconnaîtrait bientôt la vanité.
Que faire donc en présence de l'état douloureux et formidable de l'Irlande? Comment laisser sans remèdes de tels maux et de tels périls? A quoi bon tenter des remèdes inutiles? Ce qui complique la difficulté, c'est qu'il ne suffit pas de trouver des moyens de salut bons en eux-mêmes, il faut encore en rencontrer dont l'usage soit possible. Ce n'est pas assez de découvrir le régime le plus propre à l'état de l'Irlande, il faut encore que ce régime soit du goût de l'Angleterre.
Ne convient-il pas cependant de rechercher d'abord ce que réclamerait l'intérêt abstrait de l'Irlande considérée isolément? sauf à examiner ensuite si ce qui semblerait désirable est possible; si ce qui serait à faire sera fait; si l'intérêt de l'Angleterre permet d'exécuter ce que commanderait celui de l'Irlande.
On a vu, dans les chapitres qui précèdent, tous les maux de l'Irlande et toutes ses difficultés procédant d'une même cause principale et permanente, d'une mauvaise aristocratie, d'une aristocratie dont le principe est radicalement vicieux. Quelle est la conséquence logique à déduire de ces prémisses? C'est que, pour faire cesser les misères de l'Irlande, il faudrait détruire l'aristocratie de ce pays, comme pour abolir l'effet on supprime la cause.
D'où vient l'impuissance de tous les remèdes qu'on essaie ou qu'on propose? De ce qu'aucun système de guérison ne se prend à la cause première du mal.
Ainsi on cherche dans le travail des classes pauvres un moyen d'alléger leurs immenses misères, mais on voit bientôt que l'agitation du pays et les passions du peuple contre les riches rendent impossibles les progrès de l'industrie; c'est-à-dire que le remède au mal est rendu impossible par le mal lui-même.
On voudrait se délivrer par l'émigration de quelques millions de pauvres; mais, outre que l'entreprise serait impraticable, on reconnaît bientôt que des millions de pauvres, fussent-ils enlevés comme par enchantement de la terre d'Irlande, celle-ci les verrait renaître tout à coup de ses institutions, fécondes à créer toutes sortes de misères: on reconnaît qu'agir ainsi, ce serait supprimer les effets tout en laissant la cause.
On pense que pour guérir les plaies les plus vives du pays il conviendrait de prescrire aux riches des obligations de charité envers les pauvres; mais ici encore on est ramené au principe même du mal, c'est-à-dire au coeur de l'aristocratie qui repousse la charité. Et l'on voit que, parvînt-on à guérir quelques plaies et à calmer quelques douleurs, les souffrances du pauvre renaîtraient en foule d'une source intarissable de tyrannie. C'est cette source féconde qu'il faut tarir; c'est cette cause première qu'il faut attaquer; il faut aller prendre ce mal jusque dans sa racine: tout remède appliqué à la surface ne procurera qu'un soulagement passager.
L'état social et politique de l'Irlande n'est point un état régulier; tout y accuse un vice profond. Et le désordre n'apparaît pas seulement dans les misères infinies et dans les souffrances perpétuelles de la population; il se voit jusque dans les moyens employés par celle-ci pour se délivrer de ses maux.
Qu'est-ce que cette association menant le pays à la face du gouvernement, si ce n'est l'anarchie même organisée? Et qu'est-ce qu'un pays où cette anarchie est le seul principe d'ordre? Qu'est-ce qu'une société dont la tête est l'ennemie du corps, qui lui-même est en rébellion perpétuelle contre celle-ci? dans laquelle tout riche est haï, toute loi détestée, toute vengeance légitime, toute justice suspecte? Évidemment c'est là une situation violente et anormale dans laquelle un peuple ne saurait demeurer longtemps.
On conçoit l'Irlande abattue, écrasée, foulée aux pieds pendant des siècles par son aristocratie; mais on ne comprend pas, quand l'Irlande est relevée, le peuple et l'aristocratie de ce pays se tenant en présence l'un de l'autre, celle-ci aspirant toujours à opprimer, celui-là assez fort pour combattre l'oppression sans y mettre un terme.
Quand même la nécessité de reformer l'aristocratie irlandaise ne serait pas prouvée par tout ce qui précède, un seul raisonnement suffirait peut-être pour la démontrer. Voyez en effet l'alternative: si on la laisse subsister il faut de deux choses l'une: ou la soutenir contre le peuple, ou laisser le peuple la renverser.
Dans le premier cas il faut s'établir l'instrument de toutes les passions de cette aristocratie, de ses cupidités comme de ses haines, continuer à mettre l'artillerie anglaise au service de chaque propriétaire qui ne peut se faire payer de ses fermiers, et soumettre à des lois arbitraires et terribles tout comté irlandais dans lequel on verra des pauvres attaquer violemment les riches et leurs propriétés: et en conscience l'aristocratie irlandaise peut-elle exiger, peut-elle souhaiter cette sanguinaire protection?
Dans le second cas, c'est-à-dire si on prend fait et cause pour le peuple contre elle, ou, ce qui est la même chose, si on laisse faire celui-ci, l'aristocratie, privée de l'appui sans lequel elle ne saurait exister, se trouve livrée sans défense aux plus cruelles représailles; elle tombe pieds et poings liés entre les mains d'un ennemi plein de ressentiments, sujette à toutes les vengeances et à toutes les fureurs d'un parti victorieux; et dans ce cas l'on se demande s'il ne serait pas plus humain de la détruire que de lui laisser une pareille vie.
Cette destruction juste, nécessaire, serait singulièrement facile en Irlande.
D'abord elle serait aidée de toute la puissance du sentiment national. En Angleterre où l'aristocratie est encore si puissante et je dirai presque si populaire, on ne se doute guère des sentiments que le peuple irlandais éprouve pour la sienne.
A peu près contentes de leur sort, les basses classes d'Angleterre ne discutent point les priviléges du riche; si j'osais, je dirais qu'elles en jouissent: elles voient avec une sorte d'orgueil ces grandes existences, ces superbes domaines, ces parcs, ces châteaux, splendides résidences de l'aristocratie; et elles se disent que, s'il n'y avait pas des rangs inférieurs, ces opulences glorieuses, ces splendeurs nationales n'existeraient pas. Qu'on rie de cet indigent enthousiaste du bonheur des riches: j'y consens; il est cependant beau pour une aristocratie d'avoir inspiré de pareils sentiments. En général, le pauvre anglais voit le riche sans envie, ou au moins sans haine. Si parfois il l'attaque, c'est sans amertume, et alors il se prend bien plus au principe qu'à l'homme; le plus hostile à l'aristocratie montre un profond respect pour l'aristocrate; tout en blâmant le privilége politique il s'incline devant le lord; et quand il affecte de mépriser la naissance, il honore encore la fortune. L'Angleterre, folle de liberté, d'égalité ne se soucie guère.
Au contraire, en Irlande, où les lois n'ont jamais été pour les riches et pour les pauvres que des instruments d'oppression et de résistance, la liberté a moins de prix et l'égalité en a plus. Il y a, sans doute, en Irlande trop d'esprit anglais pour que la liberté y soit absolument méprisée et l'égalité tout à fait comprise; mais le peuple est poussé vers celle-ci par les plus puissants instincts. A la vérité, il n'y a encore dans son amour pour elle rien de philosophique ni de rationnel. Le sentiment qu'il en a est encore indéfini dans son âme comme l'idée qu'il s'en fait est vague dans son esprit: c'est pourtant la passion qui semble destinée à saisir fortement son cœur, et qui sans doute le domine déjà secrètement. L'égalité est dans tous ses besoins, si elle n'est déjà dans ses principes. Et déjà il aime ardemment l'égalité en ce sens que l'inégalité lui est odieuse, et établie au profit de tous ceux qu'il déteste. Je ne sais s'il a pour la démocratie un goût éclairé; mais très-certainement il hait l'aristocratie et ses représentants. Chose remarquable! En Angleterre, au milieu d'institutions féodales, singulièrement mêlées de démocratie, un bon gouvernement a fait naître l'habitude, le respect, quelquefois la passion même de l'aristocratie. En Irlande, des institutions aristocratiques sans mélange ont, sous l'influence d'une politique funeste, développé des sentiments, des instincts et des besoins démocratiques inconnus en Angleterre.
La destruction de l'aristocratie, qui en Irlande serait populaire, y serait facile aussi: car, en même temps que dans ce pays la démocratie s'élève, l'aristocratie s'y voit partout en déclin.
Cette aristocratie n'a jamais été douée d'une grande force organique.
Ce qui, en Angleterre, la rend surtout puissante, c'est l'union qui règne dans tous les éléments dont elle se compose: la grande propriété, la haute industrie, l'Église, l'Université, les corporations municipales, la médecine, le barreau, les arts et métiers, forment dans ce pays une association compacte, dont tous les membres n'ont qu'un intérêt, qu'une passion, qu'un but commun qui est la conservation de leurs priviléges.
Rien de pareil n'a pu jamais exister en Irlande.
Si l'on excepte l'Université qui est liée à l'Église par un nœud si étroit et si naturel, qu'elles sont comme deux sœurs, tous les éléments aristocratiques n'y sont unis entre eux que par les chaînes les plus fragiles.
Il y a bien une sympathie naturelle entre les grands propriétaires du sol et les ministres de l'Église anglicane: même religion, mêmes passions, mêmes intérêts politiques. Repoussés par les mêmes haines, ils sont enclins à se rapprocher comme des proscrits qui se rencontrent sur la terre d'exil. Mais leurs rapports n'ont point cette régularité qui seule fait naître une union réelle et solide; ni les uns ni les autres ne résident habituellement en Irlande, ils ne s'y rencontrent que par accident, ils s'y voient comme on se voit à l'étranger; c'est une liaison passagère qui, quelque sincère qu'on la suppose pendant qu'elle existe, ne laisse point de traces.
Les grandes richesses de l'Église sont d'ailleurs, pour les propriétaires, un sujet de jalousie et une occasion de discorde. Nous avons vu ailleurs avec quelle émulation hommes d'église et laïques pressurent le peuple, et comment les exactions de ceux-ci nuisent à ceux-là. Le fermier paie mal le propriétaire à cause de la dîme qu'il doit au ministre; celui-ci recouvrerait sa dîme moins péniblement si le propriétaire n'exigeait pas un trop haut fermage. Ces rivaux d'extorsion sont cependant des alliés politiques, et, après s'être imputé mutuellement les misères du pays, la famine, les crimes, la désolation générale, ils reprennent un langage ami; mais leur union assez apparente pour que la tyrannie de chacun nuise à l'un et à l'autre, n'est pas assez profonde pour qu'il en résulte une force commune aux deux.
L'appui que retire l'aristocratie de ses autres auxiliaires est encore plus faible et plus incertain.
Les corporations municipales, ses plus fidèles alliées, sont tombées, dès longtemps, dans un état de discrédit et d'ignominie, qui rend douteux le bienfait de leur assistance; et les abus dont elles sont souillées impriment au pouvoir qu'elles soutiennent une tache qui nuit plus à celle-ci que leur zèle ne peut lui servir. Ces corporations n'ont d'ailleurs jamais eu la force que donnent en Angleterre de grandes richesses. Jadis elles avaient, comme protestantes, le monopole presque absolu du commerce et de l'industrie; mais pendant tout le temps que dura ce monopole, l'industrie irlandaise fut sacrifiée à celle de l'Angleterre. Le privilége leur valait ainsi peu d'avantages. Afin de le conserver, elles étaient forcées de se mettre à la merci de l'Angleterre, dont elles acceptaient le joug pour pouvoir imposer le leur. Aujourd'hui elles sont complètement affranchies du lien anglais; mais on a vu précédemment comment, depuis son émancipation, l'industrie irlandaise crée plus de fortunes démocratiques que de richesses amies du privilége.
Nous avons vu plus haut aussi les classes moyennes catholiques s'emparant du barreau, jadis ami de l'aristocratie protestante. Ainsi, de tous côtés, cette aristocratie est faible, divisée et menacée dans le peu de force qui lui reste. Il n'existe, à vrai dire, de vie aristocratique que dans un seul corps, celui des propriétaires du sol. Là seulement on peut trouver quelque accord dans les vues, quelques procédés réguliers, quelque durée dans l'union; et encore les plus riches, c'est-à-dire ceux qui pourraient donner à leur corps le plus de puissance, sont-ils en général hors du pays.
Enfin, le plus grand nombre des propriétaires irlandais est récemment tombé dans un état de détresse et d'abaissement qui mérite d'être considéré.
On a vu la description des maux qu'endurent les pauvres agriculteurs d'Irlande; il y aurait aussi un triste tableau à présenter de la misère des riches de ce pays. C'est un fait incontestable que le plus grand nombre des propriétaires ont d'immenses embarras dans leurs fortunes. Le poids de leurs dettes les écrase, leurs domaines sont chargés d'hypothèques. Beaucoup d'entre eux, débiteurs d'intérêts égaux ou supérieurs à leurs revenus, sont réduits à la nue-propriété de leurs terres. J'ai vu tel domaine de cinquante mille acres rapportant cinq cent mille francs de rente, sur lequel il ne restait pas au propriétaire la jouissance d'un revenu de dix mille francs. Rien n'est plus fréquent que de voir installés, sur les grandes propriétés, des gardiens judiciaires, chargés de percevoir, au profit des créanciers, les fermages dus au propriétaire, et dont celui-ci a été dépouillé soit par une sentence de la justice, soit par une transaction volontaire.
Cette détresse des propriétaires irlandais, qui va toujours croissant, tient à plusieurs causes: la première de toutes, c'est leur propre incurie. Ils ont, pendant des siècles, rejeté sur des agents et sur des middlemen l'ennui de leurs affaires d'Irlande; et un jour ils s'aperçoivent que ces affaires ont été mal conduites, et que leur fortune, au lien de s'accroître, a décliné. Une autre raison, c'est leur cupidité aveugle, qui, en rendant leurs fermiers misérables, est devenue pour eux-mêmes une cause d'appauvrissement. Et puis, comme ils sont véritablement en état de guerre avec la population, celle-ci leur cause sans cesse de grands dommages, sans autre avantage pour elle que le plaisir de leur nuire. On se fait difficilement une idée de la quantité de bestiaux qui, chaque année, sont tués méchamment ou mutilés sur les terres des riches, de bois et d'édifices qui sont brûlés, de prairies qui sont bêchées et retournées, d'arbres qui sont coupés par pur esprit de vengeance. Je vois qu'en 1833 il s'est commis dans la province de Munster plus d'attentats en vue de préjudicier aux propriétaires que dans le but de procurer un profit aux auteurs du crime. Ainsi, au milieu de tous les délits, je ne trouve que cinquante-neuf vols, mais je remarque cent soixante-dix-huit attentats dictés par ces instincts de violence brutale et vindicative, et qui ruinent le propriétaire sans enrichir le fermier.171 J'ai dit que rien, dans l'intérêt des classes pauvres, ne peut remplacer la sympathie des riches; il faut ajouter que rien, pour le riche, ne peut suppléer la sympathie du pauvre; et quand le pauvre huit le riche, il n'y a point de loi si dure, point de cour martiale, point de supplices, qui puissent l'empêcher de travailler à la ruine de celui-ci.
Enfin, l'indigence des riches irlandais a une dernière cause, de date plus récente. Durant la guerre de la France avec l'Europe, et notamment de 1800 à 1810, l'Angleterre ayant été, pour sa subsistance, réduite presque entièrement aux ressources de son territoire, l'Irlande, qui a toujours été son grenier d'abondance, le devint plus que jamais. Les produits agricoles de l'Irlande furent, en conséquence, si recherchés que leur prix s'accrut outre mesure. Cet état de choses se continuant d'année en année, les propriétaires, dont les terres donnaient à leurs fermiers des fruits d'une valeur double ou triple, se hâtèrent d'élever le prix des baux dans la même proportion; et, ne prévoyant point que cet accroissement de fortune, si agréable à leur orgueil, cesserait avec l'accident qui l'avait fait naître, ils établirent les dépenses de leur maison sur cette base fragile.
Tant que dura le blocus continental, l'aristocratie d'Irlande fut magnifique et prospère, et le peuple lui-même souffrit moins; mais la paix étant rendue au monde, le marché irlandais fut privé de son monopole, les produits de la terre perdirent leur valeur exagérée, et la fortune de tous les propriétaires fut subitement réduite. Cependant, en dépit de ce revers qui leur enlevait la moitié de leurs revenus, les riches ne diminuèrent point leurs dépenses.
Il est dans la nature des aristocraties de ne pouvoir décliner; elles sont bâties sur un piédestal dont la vanité est la base: or, la vanité cesserait d'être elle-même, si elle consentait à se ternir ou à s'abaisser. Une pareille résignation est surtout impossible à une aristocratie d'argent; car le rang se mesurant sur la fortune, qui voudra s'humilier en s'avouant moins riche?
Les grands seigneurs irlandais n'eussent jamais consenti à se rapetisser d'une ligne; et, continuant à vivre dans le même luxe avec des fortunes moindres, les uns sont arrivés à une ruine complète, les autres y marchent rapidement; et, plutôt que de réformer dans leur domestique un cheval ou un laquais, vont tomber du haut de leur faste dans l'extrême indigence. C'est une faiblesse très-familière à l'homme de ne pouvoir supporter l'approche d'une infortune légère dont l'heure est fixée, et de s'avancer résolument vers un malheur immense, inévitable, mais dont le jour n'est pas marqué. L'aristocratie exagère tous les vices comme toutes les vertus qui procèdent de l'orgueil.
Quels que soient les maux de l'aristocratie irlandaise, on ne trouve guère de larmes pour les déplorer. Et pourquoi s'affligerait-on de voir décrépit le corps dont la fin est nécessaire? Abandonnée à elle-même, cette aristocratie périrait peut-être. Mais la laissera-t-on, infirme et impotente, languir des années, des siècles même, et s'éteindre dans une lente agonie au milieu des violences qu'elle excitera, des misère qu'elle fera naître et des malédictions qu'elle entendra jusqu'à sa dernière heure? Non. Sa caducité, loin de la protéger, la condamne; elle ne peut plus être, pour le peuple irlandais, qu'un sanglant fantôme de gouvernement; et sans doute elle ne se relèvera pas au milieu des coups terribles qui lui sont portés, lorsque, dans les temps de paisible tyrannie, elle est tombée si bas. Elle n'est donc plus qu'un fléau et un obstacle, qu'il faut se hâter de faire disparaître.
CHAPITRE III. Il serait mauvais de substituer une aristocratie catholique à l'aristocratie protestante.
Ce n'est pas seulement l'aristocratie protestante qu'il paraît absolument nécessaire d'abolir en Irlande, c'est toute espèce d'aristocratie. Rien ne serait plus funeste que d'édifier une aristocratie catholique sur les ruines de l'aristocratie protestante. Je l'ai dit plus haut, les classes moyennes qui s'élèvent dans ce pays n'ont pas de plus grand écueil à redouter que le penchant qui les porterait à saisir les priviléges de l'aristocratie, après en avoir dépouillé celle-ci. Ce danger est, sans nul doute, sinon dans le présent, du moins dans l'avenir. Mais il ne suffit pas d'énoncer comme un péril certain cette possibilité d'une aristocratie catholique; il faut encore dire pourquoi cette chance est un mal.
Il est sans doute permis de penser que si la classe supérieure, maîtresse du sol et du pouvoir, était catholique, beaucoup des oppressions qui pèsent sur les catholiques cesseraient ou seraient adoucies; mais alors quel serait le sort des quinze cent mille protestants qui sont épars sur le sol de l'Irlande? Ne risqueraient-ils pas d'encourir, de la part d'une aristocratie ennemie de leur culte, les persécutions que les catholiques reçoivent aujourd'hui des protestants? Ce ne serait, à vrai dire, que substituer à une tyrannie une autre tyrannie; et alors autant vaudrait peut-être laisser subsister celle qui est.
Jusqu'à quel point, d'ailleurs, une aristocratie catholique pourrait-elle, en Irlande, être bienfaisante pour les catholiques eux-mêmes? Pense-t-on qu'elle fût généreuse, libérale, sympathique avec le peuple? N'offrirait-elle pas au clergé catholique de dangereux appâts, et ne risquerait-elle pas, en l'attirant à elle, de lui enlever plus de force qu'il n'en conserve en restant uni au peuple? Mais d'abord, avant d'interroger l'avenir, consultons le passé.
Nous avons vu précédemment que, dans la mêlée des confiscations politiques, un petit nombre de familles catholiques sauvèrent leurs propriétés et leurs titres. Il y a donc eu constamment en Irlande un échantillon d'aristocratie catholique. Or, de quel secours a-t-elle été pour la population professant le même culte qu'elle?
Pendant tout le temps des persécutions protestantes, persécutée elle-même, elle songea bien plus à s'en préserver qu'à en garantir le peuple; et l'on ne saurait guère lui en infliger le blâme. Comme riche, elle avait tout à craindre de la tyrannie protestante, qui s'en prenait plus aux biens qu'aux croyances. Elle s'efforçait donc de ne donner à ses ennemis politiques aucun ombrage, et, pour cela il lui fallait n'offrir à ses amis aucune protection. Elle vivait, sans éclat et sans bruit, sur ses domaines miraculeusement sauvés, et s'abstenait de témoigner aux catholiques des basses classes une sympathie dangereuse. Il ne faut point demander aux hommes des dévouements supérieurs à l'humanité. Le riche catholique qui, en dépit des exclusions politiques attachées à son culte, y demeurait fidèle, n'était-il pas dans le devoir?
Mais si l'aristocratie catholique ne pouvait guère faire plus, faisait-elle assez pour qu'il s'établît entre elle et le peuple ces rapports de bienveillance d'une part et de respect de l'autre, qui forment le lien aristocratique entre le riche et le pauvre? Non, assurément. Aussi ne voit-on se former aucune étroite alliance entre les catholiques riches et les pauvres pendant tout le dix-huitième siècle, à l'époque où la persécution commune semblait devoir les réunir. Outre la prudence, qui éloignait le riche du pauvre, il y avait aussi un reste d'orgueil de race qui s'opposait à leur intime union, le peu de riches catholiques échappés aux confiscations étant des Anglais d'origine, accoutumés à mépriser comme Irlandais leurs coreligionnaires.
Mais cette vieille aristocratie catholique d'Irlande ne se borna pas à refuser au peuple toute protection politique et sociale. Tous les monuments historiques font foi que le plus souvent elle-même opprima ceux qu'elle était peut-être excusable de ne pas défendre. Elle n'échappa point aux passions égoïstes qui animaient les propriétaires protestants, et se montrant aussi dure et aussi avide que ceux-ci envers ses fermiers, elle s'attira bientôt les mêmes inimitiés. Il est bien difficile pour un propriétaire de ne pas chercher à retirer de son domaine un revenu proportionné à celui que ses voisins obtiennent de leurs terres. Quoi qu'il en soit, les riches catholiques faisant peser sur les classes inférieures une oppression sociale toute pareille à celle qu'exerçaient les propriétaires protestants, le peuple n'eut point à distinguer entre les uns et les autres; il les confondit dans sa haine, et s'en prit, dans ses cruelles vengeances, aussi bien aux riches catholiques qu'aux protestants. C'est ce qui explique pourquoi les coups des White-Boys frappèrent tout autant sur les premiers que sur les seconds. Ces violences populaires achevèrent d'éloigner du peuple l'aristocratie catholique, déjà indifférente; et c'est ainsi que, pendant tout le cours de ces sauvages représailles du pauvre contre le riche, celui-là fut laissé seul à ses fureurs.
Toutefois, quand l'Irlande catholique secoue ses chaînes et proclame hautement sa volonté d'être libre, on voit cette aristocratie catholique paraître quelque peu sur la scène; non qu'elle se présente d'elle-même: on va la chercher. On a besoin d'elle; car, comment former une entreprise quelconque, si un lord n'y préside pas? Alors elle donne l'appui qu'elle n'ose refuser.172 Mais cette alliance n'est que de peu de durée. Un jour la population catholique d'Irlande est assez hardie pour vouloir envoyer au roi George III une humble adresse exprimant les vœux du pays; la pétition se prépare; le peuple s'assemble, s'agite, essaie sa voix et ses forces. A l'aspect de ces mouvements, l'aristocratie catholique d'Irlande se voit compromise si elle reste unie au peuple: elle se sépare de lui. Ceci se passait en 1791. Cependant le mouvement national continue; la retraite de l'aristocratie catholique apprend au peuple à se passer d'elle; un plébéien173 prend le timon des affaires; des victoires sont remportées, des échecs essuyés; on passe à travers de terribles crises et d'effroyables orages; et lorsque après tant d'épreuves le triomphe du peuple est bien définitivement assuré, on voit l'aristocratie catholique reparaître;174 elle revient à la cause populaire abandonnée dans des temps malheureux, aspire vainement à la diriger, et, placée aujourd'hui entre un pouvoir protestant qu'elle déteste, et le peuple catholique dont elle craint les écarts, elle n'a d'autre ressource que de s'effacer entièrement; elle se dissimule en Irlande ou s'en va.
Je doute que de pareils antécédents puissent être le point de départ d'une bonne aristocratie.
Et ce point de départ aura, quoi qu'on fasse, sur toute la suite une grande influence. L'aristocratie qui pourrait s'établir naîtrait, il est vrai, en grande partie d'une source nouvelle, indiquée plus haut; mais le présent ne se sépare point ainsi du passé, et soit que l'aristocratie qui s'élèverait des classes moyennes se rattachât à l'antique rameau de l'aristocratie catholique, soit qu'elle se posât sur le tronc pourri de l'aristocratie protestante, elle recevrait toujours des traditions funestes et un malheureux héritage.
Cette espèce de mépris instinctif et héréditaire qu'en Irlande le riche éprouve pour tout ce qui est pauvre et inférieur; le préjugé qui, même chez les catholiques riches, fait de ce mépris un signe de bon ton et d'élégance; l'opinion si répandue que le riche a le droit d'opprimer le pauvre et de le fouler aux pieds impunément; telles sont les traditions auxquelles toute aristocratie nouvelle, en Irlande, aura bien de la peine à se soustraire.
De tels écueils fussent-ils évités, il en est d'autres auxquels cette aristocratie n'échapperait pas: alors même qu'elle ne mériterait point les haines de sa devancière, elle ne les exciterait pas moins; car le peuple en Irlande a aussi sa tradition, qui est de croire à l'égoïsme de tous les riches et au droit pour le pauvre de les détester.
Ces sentiments mutuels du pauvre et du riche ne sont pas sans doute, en Irlande, gravés a jamais dans les âmes; s'il en était ainsi, il faudrait désespérer de ce pays et de son avenir: car, quelques réformes qu'on y fasse, des riches s'y rencontreront toujours parmi le peuple. Mais il est impossible que de tels préjugés, scellés dans des torrents de sang et dans des siècles d'oppression, ne se perpétuent pas longtemps, et ils seront d'autant plus vivaces que les nouveaux riches retiendront plus des titres, des priviléges, des honneurs de l'aristocratie qui s'éteint.
Si les riches peuvent jamais, en Irlande, se réconcilier avec le pauvre, c'est en cessant de paraître devant celui-çi environnés des signes sous lesquels s'est montrée à lui, pendant des siècles, une aristocratie odieuse. C'est peut-être aussi pour eux-mêmes le seul moyen de perdre de funestes habitudes d'oppression et de tyrannie.
Ce ne serait donc pas assez de détruire l'aristocratie protestante, il faut encore abolir le principe même de l'aristocratie en Irlande, pour qu'à la place de celle qui sera supprimée il ne s'en établisse pas une autre. Il faut, après avoir abattu l'institution existante, balayer ses ruines, et préparer l'emplacement propre à recevoir un autre édifice.
CHAPITRE IV. Comment et par quels moyens il faut abolir l'aristocratie en Irlande?
Lorsque je dis qu'il faut détruire l'aristocratie d'Irlande et l'extirper jusqu'à sa racine, je n'entends point par là une destruction violente et sanguinaire.
Je ne suis point de l'avis de ceux qui pensent que, pour établir dans un pays l'ordre, la prospérité et l'union, il faut commencer par égorger quelques milliers de personnes, exiler ceux qu'on ne tue pas, prendre les propriétés des riches, les donner aux pauvres, etc., etc. Je repousse tout d'abord de pareils moyens comme iniques, et ne m'enquiers point s'ils seraient nécessaires. Je crois, sans examen, qu'ils ne sont pas nécessaires, parce qu'ils ne sont pas justes et qu'ils sont atroces. C'est, à mes yeux, un procédé vicieux, quand une injustice se présente à réformer, de commencer par en commettre une autre, et de faire un mal certain et présent en vue d'un bien à venir et douteux. Je me défie de ces moyens criminels que le but doit sanctifier, et qui, le but étant manqué, ne laissent que le crime à celui qui les emploie; ou, pour mieux dire, je ne crois point que des moyens criminels puissent jamais devenir honnêtes. D'ailleurs, il me répugne d'admettre que l'injustice et la violence profitent jamais aux nations ou aux individus. J'estime trop le progrès de l'humanité pour croire utile à sa cause les excès qui la déshonorent. Tel grand forfait semble hâter la liberté, qui, après lui avoir imprimé un élan d'un jour, l'arrête peut-être pour des siècles; et alors même qu'il serait prouvé qu'une iniquité est avantageuse à la génération présente, je ne croirais point que celle-ci eût le droit de charger les générations suivantes d'une infaillible expiation.
J'entends l'abolition de l'aristocratie irlandaise, en ce sens qu'on la prive de son pouvoir politique et de ses priviléges civils, dont elle ne s'est servie que pour opprimer le peuple; qu'on lui enlève ses priviléges civils, qui n'ont été pour elle qu'un moyen de satisfaire son égoïsme, et qu'on abatte sa prédominance religieuse, qui, lorsque même qu'elle n'engendre plus les persécutions, en perpétue le souvenir.
SECTION PREMIÈRE. Ce qu'il faut faire pour abolir les privilèges politiques de l'aristocratie. — Nécessité de centraliser.
Pour détruire le pouvoir politique de l'aristocratie, il faudrait lui ôter l'application quotidienne des lois, comme on l'a privée précédemment du pouvoir de les faire. Il faudrait, par conséquent, ruiner de fond en comble le système administratif et judiciaire qui repose sur l'institution, des juges dé paix et sur l'organisation des grands jurys, tels qu'ils sont constitués aujourd'hui. Et d'abord, pour exécuter cette destruction, il faudrait centraliser le pouvoir.
S'il est, en général, difficile de concevoir toute fondation d'un gouvernement nouveau, sans le secours d'une autorité centrale qui commence par détruire le régime existant, l'assistance de ce pouvoir central semble surtout indispensable lorsque, avant d'édifier une société nouvelle, il y a une aristocratie à reverser. Quel moyen, en effet, d'atteindre cette multitude infinie de petites puissances éparses ça et là sur le sol, toutes ces existences locales, toutes ces influences individuelles propres à l'aristocratie, si ce n'est en concentrant toute la force publique sur un seul point, duquel on abatte toutes les sommités condamnées et toutes les supériorités rebelles?
Dans les pays où existe la meilleure aristocratie, le bras central qui s'étend sur elle pour la frapper est, en général, agréable au plus grand nombre. C'est assez dire combien serait populaire en Irlande une centralisation puissante établie pour la ruine d'une aristocratie détestée, et contre laquelle la haine politique se confond dans la haine religieuse.
Plus on considère l'état de l'Irlande, et plus il semble qu'à tout prendre un gouvernement central fortement constitué serait, du moins pour quelque temps, le meilleur que puisse avoir ce pays. Une mauvaise aristocratie existe, qu'il est urgent de détruire. Mais à qui remettre le pouvoir qu'on va retirer de ses mains? — Aux classes moyennes? — Elle ne font que de naître en Irlande. L'avenir leur appartient; mais ne compromettront-elles pas cet avenir, si la charge de mener la société est confiée dès aujourd'hui à leurs mains inhabiles et à leurs violentes passions?
Telle est aujourd'hui en Irlande la situation des partis, que l'on ne peut obtenir quelque justice des pouvoirs politiques, si on les laisse à l'aristocratie protestante, et que l'on ne saurait guère en espérer davantage, si on les donne aussitôt à la classe moyenne catholique qui s'élève.
Ce qu'il faudrait à l'Irlande, ce serait une administration forte, supérieure aux partis, à l'ombre de laquelle les classes moyennes pussent grandir, se développer et s'instruire, pendant que l'aristocratie croulerait et que ses derniers vestiges disparaîtraient;.
Il y a là une grande œuvre à accomplir, et dont la tâche s'offre au gouvernement anglais.
Lorsque j'indique la centralisation comme moyen de réformer en Irlande là société politique, j'ai hâte d'expliquer sur ce point ma pensée tout entière.
Je suis bien loin, assurément, de considérer comme salutaire en lui-même le principe absolu de toute centralisation. Il est tel gouvernement central qui me paraîtrait mille fois pire que l'aristocratie elle-même. Le vice principal de celle-ci est de restreindre, par le patronage, le nombre des existences individuelles; mais un pouvoir central, unique, qui fait tout et dirige tout, ne diminue pas seulement la vie politique des citoyens, il l'anéantit.
Ce pouvoir ne serait ni tyrannique, ni oppresseur, il se tiendrait dans la limite des lois, respectant les passions et les intérêts populaires, que je ne l'en trouverais pas moins mauvais; car il annulerait toujours l'existence politique des individus. Or, de même que la meilleure éducation est celle qui développe chez l'homme son intelligence et multiplie ses forces morales, de même les meilleures institutions sont celles qui lui attribuent le plus de droits civils et de facultés politiques. Plus il y aura chez un peuple de personnes habiles à se conduire, à diriger leur famille, leur commune, la province, l'État, plus il y aura dans ce pays de vie politique, et plus la valeur de chacun sera accrue.
Alors même qu'on me prouverait que ce pouvoir central, unique, homme, assemblée, ministre ou commis, ferait mieux que tous les individus ensemble l'affaire de leur commune, de leur province, du pays entier, je n'en serais pas moins d'avis qu'il est mauvais d'enlever à ceux-ci le soin de ces divers intérêts; parce qu'à mes yeux il s'agit bien moins de leur faire une vie matériellement douce et commode, que d'agrandir, par les intérêts politiques, le domaine offert dans ce monde à leur âme et à leur intelligence. Ce n'est donc point une forme définitive de gouvernement que j'indique ici pour l'Irlande.
Autant un gouvernement tout central me paraît aujourd'hui nécessaire à ce pays, autant il me semblerait malheureux pour lui de le conserver longtemps. L'extrême centralisation est plutôt un violent remède, qu'une institution; elle n'est pas un état, mais un accident; c'est une arme puissante dans le combat, et qu'il faut déposer après la lutte, sous peine de se blesser à son tranchant ou de plier sous son poids. Elle excelle surtout à détruire; et alors même qu'elle crée quelque chose, elle ne sait point le conserver. C'est une phase par laquelle passent les peuples qui ont besoin, avant d'édifier une société nouvelle, de balayer les débris de l'ancienne, et dont ils doivent se hâter de sortir, dès que l'œuvre de transition est consommée. Malheureusement il n'est pas toujours facile de congédier cet auxiliaire, alors qu'on n'a plus besoin de lui; et la société peut trouver un germe de mort dans la cause qui l'a sauvée. Là est le péril. Ce danger est si grand, qu'un peuple ne doit le courir que s'il y avait pour lui un péril encore plus grave à ne s'y pas exposer. Il a le choix à faire entre la chance de ne pouvoir détruire un gouvernement mauvais sans le secours de la centralisation, et le risque de ne pouvoir, cette destruction étant faite, se débarrasser de l'instrument qui l'a exécutée. Mais c'est parce qu'en Irlande le renversement de l'aristocratie est le premier et le plus urgent besoin, qu'il faut, pour l'abattre, prendre l'instrument le plus puissant, quoique le plus périlleux.
Il n'entre, du reste, ni dans mon désir, ni dans mon plan, d'expliquer la forme et le mécanisme de la centralisation qui conviendrait à l'Irlande, et dont je me borne à reconnaître en principe l'utilité passagère pour ce pays; je ne hasarderai sur ce sujet qu'une seule idée pratique.
C'est que, pour organiser en Irlande un gouvernement central puissant, il faudrait de plus en plus resserrer le lien d'union qui attache l'Irlande à l'Angleterre, rapprocher le plus possible Dublin de Londres, et faire de l'Irlande un comté anglais.
Tout, aujourd'hui, conspire à rendre ce but facile à saisir. Nous ne sommes plus au temps où des semaines, quelquefois des mois de voyage, séparaient l'Irlande de l'Angleterre.
Un jour, sous le règne de Henri VIII, on vit le parlement d'Irlande, privé depuis longtemps de toutes nouvelles d'Angleterre, confirmer, par un décret, le mariage du roi avec Anne Boleyn, et, le lendemain, par suite de l'arrivée du courrier, prononcer solennellement la nullité de ce mariage.175 Le parlement d'Irlande, s'il existait de notre temps, et qu'un tyran lui demandât un acte de bassesse, ne serait point ainsi exposé à déplaire au maître, tout en se montrant servile.
Grâce aux perfectionnements de la navigation et des routes, vingt-une heures seulement séparent Dublin de Londres. L'Irlande est plus près du parlement anglais que l'Ecosse et le pays de Galles. Chose étrange! malgré une distance de deux mille lieues, l'Angleterre est aujourd'hui moins lourde l'Amérique que ne l'était, il y a cinquante ans, l'Irlande séparée d'elle seulement par un étroit canal. Ces merveilleuses créations de l'industrie humaine qui sont destinées à changer les rapports sociaux, non-seulement d'homme à homme, mais encore de peuple à peuple, exerceront sur l'Irlande leur première influence; car la route de Londres à Dublin est, en Europe, la première grande distance de terre et de mer que la vapeur ait abrégée. D'où vient donc que l'Irlande continue à avoir chez elle un gouvernement distinct du gouvernement anglais, un pouvoir exécutif spécial, des administrations particulières et locales? Ce gouvernement établi dans son sein l'éloigne de l'Angleterre, dont elle ne saurait être trop rapprochée. Les Anglais, qui viennent en Irlande pour gouverner ce pays, sont moins puissants pour combattre l'aristocratie irlandaise que s'ils restaient en Angleterre. Il est mauvais d'aller vivre au milieu de ceux qu'on ne peut abattre d'un seul coup. Toute administration anglaise dans l'un de ces cas: ou elle subit les influences de l'aristocratie qu'elle doit attaquer; ou, si elle les repousse, elle encourt des attaques contre lesquelles elle est moins forte à Dublin qu'à Londres.
On ne conteste point que l'Irlande ait besoin d'un gouvernement spécial; et s'il y a nécessité de la soumettre à un régime législatif autre que celui de l'Angleterre, il faut bien aussi des agents particuliers pour appliquer des règles différentes d'administration. Mais, ceci étant admis, l'on ne voit' pas ce qui aujourd'hui empêcherait de placer le siège du gouvernement irlandais dans la première ville de l'empire britannique.
D'autres considèrent la vice-royauté de Dublin et la cour qui l'environne comme propres à tempérer la violence des partis et à les diviser quand elles ne les amortissent pas. Mais cette opinion a-t-elle quelque fondement?
Le seul moyen, pour une cour, d'être brillante, c'est d'appeler à elle l'aristocratie du pays. Or, cette aristocratie, exclusive de sa nature, étant maîtresse du terrain, ne souffrira pas qu'on mêle dans ses rangs des gens de classe inférieure; et alors de quelle fusion et de quelle harmonie cette cour sera-t-elle la source? Supposons maintenant que le chef de cette cour à Dublin ait reçu du gouvernement dont il est l'agent le mandat de combattre l'aristocratie d'Irlande: comment pourra-t-il la convier à ses fêtes, ou s'abstenir de le faire? S'il la convoque, il la trompe; et l'offense, s'il la laisse dans l'oubli. Et alors même qu'il tentera de l'attirer, celle-ci, mortellement atteinte dans son orgueil, et menacée dans ses intérêts, se tiendra à l'écart, affectera de mépriser une cour qu'elle appellera vulgaire et bourgeoise, et refusera de s'associer à des plaisirs dont elle n'entendra cependant pas le bruit sans les regretter!
Une cour à Dublin créerait les partis, s'ils n'existaient pas.
La Réforme de la vice-royauté et l'abolition des administrations locales d'Irlande ne sont sans doute que des changements de forme. Mais ce sont des moyens pratiques indispensables pour exécuter les réformes politiques dont ce pays a besoin. Il faut de toute nécessité que, pendant la période de transition où se trouve l'Irlande, ceux qui la gouvernent soient placés absolument en dehors d'elle, de ses mœurs, de ses passions; il faut que son gouvernement cesse complètement d'être irlandais; il faut qu'il soit entièrement, non pas anglais, mais remis à des Anglais.
SECTION II. Ce qu'il faut faire pour abolir en Irlande les privilèges civils de l'aristocratie. Nécessité de rendre le peuple propriétaire.
Ce serait peu que d'attaquer l'aristocratie irlandaise dans ses pouvoirs politiques; c'est surtout à sa puissance sociale qu'il s'en faut prendre. Quelque révolution qui s'opère dans un pays, la société reste à peu près la même, si, dans le temps qu'on y altère les institutions politiques, on n'y modifie pas aussi les lois civiles. Les lois politiques changent avec les passions et la fortune des partis qui se succèdent au pouvoir. Les lois civiles, dans lesquelles sont engagés une multitude d'intérêts, ne changent pas. Voyez les deux plus grandes révolutions qui, durant les derniers siècles, aient ébranlé le monde: 1649 en Angleterre, 1789 en France. Dans les deux pays, la foudre populaire gronde d'un bruit à peu près égal; même enthousiasme des réformateurs, même passion de nivellement; dans l'ordre politique, tout est renversé, brisé, foulé aux pieds; ici et là on démolit le monde existant pour édifier sur ses ruines im monde nouveau, un monde idéal où la justice, la raison, la vérité, seront seules souveraines; et les deux pays s'égarent à peu près de même, l'un avec sa philosophie, l'autre avec sa religion; ils semblent se copier mutuellement dans leurs élans, dans leurs illusions et dans leurs misères; chacun offre son holocauste de sang royal; chacun a son anarchie et son despotisme, celui-ci son Napoléon, celui-là son Cromwell, et chacun revient à son passé, l'un vers ses Stuarts, l'autre vers ses Bourbons; la similitude semble parfaite entre les deux époques et entre les deux peuples, si ce n'est qu'en France il y a plus de gloire, et en Angleterre moins de sang.
D'où vient cependant que le jour où les deux peuples se retrouvent à leur point de départ, le premier a complètement changé de face, tandis que le second reparaît tout semblable à lui-même?
A peine Charles II a-t-il ressaisi la couronne royale, que la société anglaise, sortie un instant de son lit, y rentre tout entière: rien ne reste plus de la révolution; douze années de réformes, de violences, de coups d'État, ont passé comme une tempête dont un jour tranquille suffit pour effacer la trace. En France, au contraire, en dépit de la forme politique, qui s'efforce de reproduire la vieille société, un autre peuple se révèle; que cette forme s'appelle république, empire ou royauté, n'importe! la France monarchique de 1789 est devenue démocratique et ne cessera plus de l'être.
Pourquoi cette différence si grande dans les effets quand les causes paraissent semblables? C'est qu'en Angleterre, au plus fort de la destruction politique, les réformateurs ne touchèrent point aux lois civiles. Ils frappaient la royauté et laissaient intact le droit d'aînesse; tandis qu'en France le changement se fit tout à la fois dans l'ordre civil et dans l'ordre politique; la réforme sociale y précéda même les grandes crises révolutionnaires. Les lois qui abolissaient les servitudes féodales de la terre, celles qui substituaient dans les successions l'égalité au privilège, avaient toutes été décrétées quand la république le fut. Ces lois s'attaquaient au cœur même de la société, à ce qu'il y a de plus immuable chez un peuple, le sol et la famille. La république a passé, les lois civiles sont restées. Celles-ci avaient tout de suite atteint le fond, l'autre n'avait qu'effleuré le pays, non comme la brise qui passe, mais comme la faux qui tranche, et qui pourtant reste à la surface. Ce serait donc une vaine entreprise que de dépouiller l'aristocratie irlandaise de son autorité politique, si en même temps on ne lui enlevait les privilèges civils qui sont comme l'âme de sa puissance. Il y a, en Irlande, des plaies sociales qu'il importe encore plus de guérir que tous ses maux politiques. Ce qui est essentiel, c'est de rétablir l'harmonie , non-seulement entre les gouvernants et les sujets, mais entre les classes qui travaillent et celles qui possèdent la richesse. Ce qu'il faut arrêter avant tout , c'est la guerre que livre à la société le prolétaire, dont la misère profonde mérite tant de pitié, et dont les passions recèlent tant de périls. Il y a une démocratie mauvaise, c'est celle qui est hostile aux fortunes que crée le travail; mais il existe aussi une bonne démocratie, c'est celle qui combat les fortunes que le privilège seul conserve. Or, ce sont des lois de privilège, telles que les substitutions et le droit d'aînesse, qui, en Angleterre comme en Irlande, concentrent dans les mains de l'aristocratie la possession de toute la richesse territoriale. Le monopole que ces lois établissent est doublement funeste par le mal qu'il fait et par le bien qu'il empêche; il enchaîne le sol dans des mains indolentes et égoïstes, auxquelles il ne prête qu'une force pernicieuse, et empêche la terre de tomber au pouvoir de ceux qui, en la fécondant, s'enrichiraient au profit de tous. Il ne préserve pas toujours de leur ruine des propriétaires aveugles ou insensés, et il forme un obstacle insurmontable à ce que le peuple aborde la propriété foncière. Et cependant peut-on voir l'Irlande et son immense population agricole, sans reconnaître que le vrai remède à la misère du peuple serait qu'au lieu d'être fermier, il devînt propriétaire?
L'Angleterre montre mieux qu'aucun autre pays, comment, avec une bonne aristocratie, la population agricole peut être heureuse sans acquérir jamais la propriété du sol; tandis que l'Irlande prouve qu'il existe des contrées où le peuple est absolument misérable dans la condition de fermier.
Il est difficile d'imaginer un pays où la propriété soit aussi mal distribuée qu'en Irlande. En Angleterre, de grandes fermes, établies sur de vastes domaines, emploient peu de cultivateurs; mais ce petit nombre y vit heureux. En France, où la propriété est divisée à l'infini, l'agriculteur est le plus souvent propriétaire, et les fermes, quand il en a, sont assez grandes pour que la condition du fermier ne soit point à déplorer. En Irlande, les propriétés sont grandes comme en Angleterre, et les fermes aussi divisées que les propriétés le sont en France; en d'autres termes, ce pays réunit les abus de la grande propriété sans aucun de ses avantages, avec tous les inconvénients de la petite culture dont il n'a rien pris de ce qui en rachète les vices.
Il arrive souvent aux économistes anglais d'invoquer l'exemple de la pauvre Irlande pour prouver combien est funeste en France l'extrême division du sol. Cependant une pareille comparaison ne peut être qu'une source d'erreurs; car il n'existe, dans la distribution agraire des deux pays, qu'une similitude apparente. La terre y est, à la vérité, dans l'un comme dans l'autre, également chargée d'agriculteurs; mais là commence et finit l'analogie, puisqu'en France tous ces petits agriculteurs sont les maîtres des parcelles de terre qu'ils occupent, tandis qu'en Irlande ils n'en sont que les fermiers.
De ce qu'on voit en Irlande des cultivateurs bien malheureux sur le petit coin de terre où s'élève leur pauvre cabane, on conclut qu'en France la même indigence est le sort de quiconque n'occupe sur le sol qu'un aussi étroit espace; rien pourtant n'est moins logique. C'est pour lui, c'est à son profit seul que l'agriculteur français arrose de ses sueurs cette terre dont tous les fruits lui sont assurés; tandis que le colon irlandais sème pour autrui, recueille des moissons dont il ne goûte jamais, et a le plus souvent épuisé le sol quand il en a tiré le prix de fermage qu'il est tenu de payer au maître. Qui ne voit que, dans le premier cas, une égale quantité de terre peut satisfaire les besoins de celui auquel, dans le second, elle sera nécessairement insuffisante? Qui ne comprend que sur cette modique parcelle l'un pourra être heureux et libre, par les mêmes causes qui feront l'autre nécessairement dépendant et misérable?
C'est une objection souvent élevée contre la division du sol, que, ce partage ne s'arrêtant jamais, la propriété foncière finira par arriver à un tel degré de fractionnement, que chaque parcelle ne sera plus pour son possesseur qu'un bien stérile, et pour la société composée de pareils propriétaires qu'une cause générale d'appauvrissement; mais ces craintes ne sont-elles pas exagérées ou chimériques? Ne voyons-nous pas le morcellement de la terre en France s'arrêter au point où il cesse d'être utile; plus restreint là où le sol a moins de prix, plus développé partout où une moindre étendue représente une égale valeur?176 Quand le propriétaire n'a plus d'intérêt à conserver une terre devenue trop modique, tantôt il la vend à un propriétaire voisin, tantôt il l'afferme; le plus souvent il la cultive lui-même, et dans ce cas, quelque petite qu'elle soit, il trouve son profit à la garder; seulement, comme les soins qu'il donne à son champ ne pourraient pas plus l'occuper toute l'année que les produits de ce champ le nourrir, il a coutume de joindre à ses travaux agricoles l'exercice de quelque autre industrie. La plupart des petits propriétaires français sont tout à la fois cultivateurs de leur propre domaine et ouvriers pour autrui; ceux-ci simples journaliers; ceux-là, vignerons; les uns, petits marchands dans le village; les autres, artisans.
Mais la terre ainsi divisée, broyée, et livrée, pour sa culture, aux mains les plus débiles, ne perd-elle pas de sa richesse et de sa fécondité?
Je ne discuterai point cette question tant controversée du mérite relatif de la grande et de la petite culture. On soutient, je le sais, qu'un grand domaine produit plus proportionnellement que plusieurs petites terres d'égale étendue, parce que le grand possesseur a dans ses mains des capitaux et des procédés qui ne sont pas à la portée des petits propriétaires; mais, je n'ignore pas non plus qu'à cela l'on répond qu'au défaut de capital pécuniaire chacun de ces petits occupants du sol dépense sur la parcelle dont il a la propriété absolue une somme d'activité et d'énergie personnelle plus grande que n'en peut fournir un ouvrier salarié; que tous travaillant ainsi pour eux-mêmes, et sous l'influence d'un égoïsme fécond, parviennent à force de zèle et d'industrie, à tirer de leurs terres autant, si ce n'est plus, que n'en obtiendrait un propriétaire unique, obligé d'employer les bras d'autrui; qu'il n'y a point à regretter cet emploi d'une force plus grande pour produire un résultat pareil dans les pays où l'activité du peuple, si elle ne s'appliquait pas au sol, ne se porterait point ailleurs; qu'enfin ces petits cultivateurs, obligés à des efforts supérieurs pour atteindre un but égal, ne sont point à plaindre, parce qu'ils trouvent dans l'intérêt et la passion de la propriété une source intarissable de vigueur qui leur rend plus léger un plus lourd fardeau. L'expérience des temps modernes a montré quelle différence de prix il y a entre le travail de l'ouvrier libre et celui de l'esclave; on ne sait pas encore de combien l'emporte le travail du cultivateur propriétaire sur celui de l'ouvrier libre.
Quoi qu'il en soit, et laissant l'examen de cette grande question aux économistes, je me borne à dire que si les avantages économiques de la division du sol sont douteux, son bienfait social et politique n'est pas incertain.
Consultez tous ceux qui en France ont vu la condition du peuple telle qu'elle était avant 1789: tous vous diront qu'aujourd'hui elle est infiniment plus heureuse qu'elle ne l'était autrefois: et quelle a été la cause principale de ce changement subit? C'est que le peuple est devenu propriétaire. Mais nous n'avons pas besoin, pour nous convaincre de cette vérité, de recueillir les traditions du siècle passé. Regardons seulement ce qui se passe sous nos yeux; qui de nous n'est frappé de la révolution qui s'opère soudainement dans toute l'existence de l'homme du peuple qui n'était pas propriétaire et qui le devient?
Le sol est, en France, la suprême ambition des classes ouvrières. Le domestique, le journalier agricole, l'ouvrier manufacturier ne travaillent qu'en vue d'acquérir un petit coin de terre; et celui qui atteint le but tant désiré devient non seulement matériellement plus heureux, mais il s'accroît aussi moralement. En même temps qu'il couvre son corps de vêtements meilleurs et prend une nourriture plus saine, il conçoit de lui-même une plus haute idée; il sent que désormais il compte dans son pays; errant jadis de commune en commune, de ville en ville, il était peu intéressé à vivre honnêtement, et courait peu de périls dans une existence reprochable. Ici on ne lui savait pas de gré des années régulières passées ailleurs; là on ignorait les improbités qui ailleurs l'avaient flétri. Mais, depuis qu'il s'est attaché à la terre , il sait que tout lui sera compté; de ce moment il veille sur lui-même, car il souffrira toute sa vie d'une action mauvaise, comme il est sûr aussi de jouir toujours d'une bonne œuvre. Il est aussi plus moral, parce qu'il est plus indépendant. En général, il prend une compagne en même temps qu'il achète une terre; et bientôt, au sein des affections domestiques, il apprend l'ordre, l'économie, la prévoyance: meilleur comme homme, il vaut mieux aussi comme citoyen; la patrie a pris à ses yeux un corps sensible: la patrie, n'est-ce pas la terre? Désormais il a place sur son sein. Vainement on me prouverait que par le fractionnement de la propriété on obtient du sol moins de produits à plus de frais: je répondrais que je ne sais point le moyen de couvrir la surface d'un pays d'habitants plus heureux, plus indépendants, plus amis du sol et plus intéressés à le défendre.
Si, en France, l'acquisition du sol a été pour le peuple un si grand progrès, de quels bienfaits elle serait la source pour le peuple irlandais! En devenant propriétaires, les basses classes de France ont passé d'une situation supportable à un état meilleur; celles d'Irlande franchiraient d'un seul bond tout l'espace qui sépare un sort heureux de la plus misérable condition.
Plus on considère l'Irlande, ses besoins et ses difficultés de toutes sortes, et plus on est porté à penser que ce changement dans l'état de sa population agricole serait le vrai remède à ses maux.
Tant que l'Irlandais ne sera que fermier, vous le verrez toujours indolent et misérable. De quelle énergie voulez-vous que soit doué le pauvre agriculteur qui sait que, s'il améliore sa ferme, son fermage sera tout aussitôt augmenté, et que, dût-il centupler les fruits de sa terre, il n'en aura jamais une plus large part; qui prend sa ferme à un si haut prix, que l'année la plus propice il ne saurait acquitter toute sa dette; qui voit toujours suspendu sur sa tète cet arriéré comme une menace incessante, dont le sens manifeste est que si, à la prochaine récolte, il ramasse quelques gerbes inespérées, cette bonne chance sera perdue pour lui? Supposez-le, au contraire, propriétaire des deux ou trois acres dont il n'a que la ferme: avec quelle ardeur il remuera cette terre, qui rendra un fruit à chacune de ses sueurs! De quels efforts ne sera-t-il point capable, lorsqu'il verra une récompense à la suite de. chaque travail, un progrès au bout de chaque sillon?
Il est permis d'espérer que le jour où il y aurait en Irlande de petits propriétaires, la plupart des misères du pays cesseraient. Cette fatale concurrence dont les petites fermes sont l'objet, et qui n'est pas moins funeste aux grands propriétaires qu'aux petits cultivateurs, disparaîtrait aussitôt; car, partout où le peuple possède rigoureusement de quoi vivre sur sa propre terre, il ne se fait fermier d'autrui qu'à des conditions avantageuses. Le riche, cessant d'avoir le monopole de la terre, celle-ci n'encourrait plus l'anathème du pauvre; et d'ailleurs le petit propriétaire, qui couvre de son corps son champ et sa cabane, n'aurait rien à craindre des attaques dont, en Irlande, le sol est l'objet.
L'Angleterre fait de grands efforts aujourd'hui pour tirer l'Irlande de sa redoutable misère: toutes les théories sont invoquées, toutes les intelligences supérieures sont en travail, tous les moyens sont essayés, depuis la charité qui donne du pain au pauvre, jusqu'au système de l'émigration qui l'exile de sa patrie. Tout ces systèmes violents ou factices ne seront point efficaces. Qu'on y réfléchisse bien, et l'on verra que la terre sur laquelle le peuple vit aujourd'hui si pauvre, peut seule rendre sa condition meilleure. C'est en vain qu'on veut sauver l'Irlande par l'industrie: l'Irlande est essentiellement agricole, et elle est telle, précisément parce que l'Angleterre est essentiellement industrielle. Il faut de toute nécessité que le peuple y trouve sur la terre un sort plus heureux, ou qu'il se résigne à rester éternellement misérable: or, puisqu'il est profondément malheureux comme fermier, la seule chance qui lui reste n'est-elle pas de devenir propriétaire?
J'aurais mille autres raisons pour appuyer cette opinion: je m'arrête cependant. Si un lecteur anglais trouve mes arguments incomplets, je le prie de considérer que tout autre qu'un Anglais les jugera peut-être surabondants.
Mais s'il est vrai que le peuple d'Irlande soit destiné à languir dans une affreuse détresse aussi longtemps qu'il ne parviendra pas à la propriété du soi, comment arrivera-t-il à ce but?
Des publicistes graves et distingués ont donné à la difficulté une solution que je ne puis accepter; admettant la nécessité du principe que je viens d'établir, ils voudraient qu'on déclarât purement et simplement propriétaires ceux qui aujourd'hui ne sont que fermiers.177 Ceci n'est point de la discussion, mais de la révolution. Je me suis expliqué plus haut sur la nature des procédés par lesquels s'opèrent les réformes sociales et politiques. Pour être bons, à mes yeux, il faut à ces procédés une condition première; c'est qu'ils soient conformes à la morale et à la justice: or, s'il est moins cruel de dépouiller un propriétaire de son domaine que de lui arracher la vie, la spoliation est tout aussi injuste que le meurtre, et, sous ce rapport, tout aussi haïssable. On suppose, fort gratuitement, que le parlement anglais légitimerait par un décret cette révolution agraire. Mais d'abord la dépossession des riches au profit des pauvres ne serait pas plus équitable, parce qu'elle s'exécuterait au nom des lois. Vainement on alléguerait que les possesseurs actuels du sol irlandais l'ayant usurpé, il est juste de le reprendre sur eux. Quel droit actuellement existant tiendrait contre cet examen du passé? Et quels propriétaires déclarerait-on usurpateurs? Seront-ce seulement les descendants des compagnons de Guillaume III? Mais alors on ne rentrera que dans une bien petite partie des terres. Y ajoutera-t-oh les soldats de Cromwell et les aventuriers venus en Irlande au temps de la république? Mais alors pourquoi n'y pas joindre les colons anglais de Jacques Ier, même ceux d'Elisabeth?
Depuis le seizième siècle, la propriété en Irlande a mille fois changé de mains, non-seulement dans le choc des révolutions, mais encore par l'effet des échanges. Ira-t-on dépouiller de ses domaines tout détenteur, à quelque titre que ce soit, même celui qui les aura acquis de ses deniers sous la protection des lois? Mais alors l'Irlande est jetée dans la plus effroyable perturbation; et le désordre atteindra sans distinction l'ancien propriétaire et le nouveau riche, le catholique et le protestant, l'industriel qui vient d'acheter une terre comme celui qui tient la sienne d'un héritage, le marchand auquel une propriété a été donnée en hypothèque aussi bien que le propriétaire lui-même. D'ailleurs on comprend bien comment avec un pareil système les pauvres cesseraient d'être indigents; mais on ne voit pas ce que deviendraient les riches, qui sans doute ne demeureraient pas spectateurs froids et impassibles de leur ruine, et qui, s'ils ne soufflaient le feu de la guerre civile dans le pays, se hâteraient sans doute de le quitter: de sorte que, tous les propriétaires ayant disparu, il ne resterait plus en Irlande que de grossiers paysans devenus les maîtres. Singulier moyen d'avancer la civilisation de l'Irlande, de rendre la paix à un pays déchiré par six cents ans de discordes civiles, de ranimer le sentiment du droit chez un peuple qui l'a perdu!
Pour moi, il me paraît si important de ne point troubler la conscience publique par la violation des droits, et de ne point ébranler la société en agitant le sol, que je repousse également le système de ceux qui voudraient qu'on distribuât aux pauvres irlandais les deux ou trois millions d'acres de terres incultes qui sont en Irlande. Il faudrait, pour leur faire ce don, commencer par les prendre à ceux qui les ont: or, à mes yeux, toute atteinte à la propriété est un mauvais moyen d'économie politique.
Ne peut-on donc, par des voies douces, équitables et légitimes, arriver au but qu'on se propose, et qui cesse d'être désirable, si, pour l'atteindre, il faut employer l'injustice?
Que faut-il au bas peuple d'Irlande? Acquérir la propriété du sol, mais non l'obtenir par des violences iniques; il faut, non le faire propriétaire, mais l'aider à le devenir; il faut, pour qu'il atteigne le but, qu'on lui donne le moyen. Or, c'est ce moyen qui lui manque aujourd'hui. Il est dans l'impossibilité absolue d'acquérir la propriété du sol, non-seulement parce qu'il est pauvre, mais surtout parce qu'en Irlande, comme en Angleterre, il n'existe que de grandes terres, inabordables à toute petite fortune; parce que, dans ces deux pays, les lois civiles, faites au profit de l'aristocratie, tendent constamment à la concentration du sol dans un moindre nombre de mains, et s'opposent invinciblement à la division du sol; parce qu'en un mot ces lois placent la terre hors du commerce. Cet état de la terre, inaccessible au peuple, est le véritable obstacle à vaincre; c'est, de tous les priviléges de l'aristocratie, le plus important à détruire; et sa gravité est telle que je crois devoir en faire l'objet d'un examen plus approfondi. Ce sera le sujet du chapitre suivant.
29.Victor Schoelcher on “The Immediate Abolition of Slavery” (1842)↩
[Word Length: 6,539]
Source
Victor Schoelcher, Des colonies françaises. Abolition immédiate de l'esclavage (Paris: Pagnerre, 1842).
CHAPITRE XXIII. ÉMANCIPATION GÉNÉRALE ET IMMÉDIATE, pp. 366-81
CHAPITRE XXIV. RÉSUMÉ. pp. 382-87.
CHAPITRE XXIII. ÉMANCIPATION GÉNÉRALE ET IMMÉDIATE.
Tout moyen partiel est mauvais, parce qu'il est partiel. — Il n'y a pas de transition qui puisse paralyser les embarras du passage de la servitude à la liberté. — Une certaine perturbation est inévitable. — L'affranchissement en masse peut seul permettre d'enseigner à des esclaves les devoirs de l'homme libre. — Les nègres sont aussi préparés pour l'indépendance, qu'ils le peuvent être. - L'affranchissement en masse et immédiat n'est pas un moyen sans dangers; c'est de tous les moyens celui qui en a le moins. — Il rend toute résistance impossible, il fait cesser l'incertitude et l'agitation qui ruinent aujourd'hui les colonies. — Révoltes continuelles des esclaves. — Les créoles eux-mêmes et les autorités, avouent que la société coloniale est en périt.
Nous croyons avoir démontré le néant des moyens partiels et transitoires. Nous croyons avoir prouvé par l'exposition vraie des choses, que toute tentative de juste-milieu pour parvenir à briser les fers de l'esclave est incompatible avec l'existence de la société coloniale telle qu'elle est maintenant. La complète anarchie d'idées qui règne parmi les créoles dés qu'ils abordent cette question, confirme notre opinion. Si pour rendre la liberté due aux nègres on croyait devoir s'arrêter au principe d'un régime intermédiaire, si pour obtenir l'assentiment désiré et désirable des colons, on les chargeait d'indiquer ce régime, nous posons en fait qu'il n'en est pas un qui put réunir une majorité respectable, à moins que ce ne soit la prolongation de l'esclavage sous un autre nom.
Nous sommes convaincu de l'importance que l'on doit mettre à obtenir l'acquiescement des créoles; un des plus grands malheurs qui put arriver à l'abolition serait qu'elle les eut pour adversaires déclarés. Nous l'avons déjà dit et nous ne demandons pas mieux que de le répéter! La réforme ne se fera avec toutes les chances d'une réussite facile, qu'étayée de leur concours, mais nous en sommes également persuadés, ce concours on ne pourra l'obtenir qu'en les soumettant à la nécessité fatale du succès. Aussi n'hésitons-nous pas à proclamer dangereux et funeste tout régime intermédiaire. Dangereux, parce que l'on ne saurait rien toucher à l'esclavage sans mettre aussitôt en péril le droit et l'autorité du maître, funeste parcequ'il ne peut être comme l'apprentissage britannique, qu'un esclavage continué.
Cette demi liberté, après les hautes espérances que la proclamation du principe fait concevoir aux nègres, ces distinctions composées, difficiles à saisir pour des esprits incultes, ces incertitudes de leur position, tout cela est pour eux une cause de mécontentement. Servitude déguisée, l'état mixte, comme nous le disait M. Salvage Martin, d'Antigues, « est bien plutôt la préparation de la fainéantise libre que du travail volontaire. » Il engendre mille tiraillemens, d'où naissent les colères et les rancunes. Il n'y a de bien possible, il n'y a d'initiation possible au bien, ni dans la servitude ni dans aucune situation analogue.
Plus nous analysons l'orgueil des propriétaires et la susceptibilité des esclaves, plus nous nous assurons que l'on trouvera tout avantage à en finir d'un seul coup, et à se donner vis-à-vis des nègres le mérite d'une libéralité sans condition, par un vaste affranchissement sans réticences. Les termes moyens ne sont propres qu'à tout aigrir, tout envenimer, en ne rendant personne heureux de son sort. Ne touchez pas à la servitude ou donnez la liberté complète: sachez renoncer à l'une ou accepter l'autre. Point de classe intermédiaire, point d'affranchis d'état, point de moitié de citoyens, cela détruit l'homogénéité que doit avoir une société pour marcher de ferme allure, cela ne sert qu'à susciter des collisions, provoquer mille petites lois spéciales, multiplier les complications, les écritures, les bureaux, les commis. Et tout ce mal! pour aboutir en définitive à la solution de continuité que l'on redoute, et à laquelle il faudra cependant toujours arriver un jour ou l'autre dans quelque lointain avenir qu'on veuille la rejeter. Ne craignons pas de nous répéter pour faire passer notre idée dans l'esprit de lecteur: tout mode d'affranchissement partiel nous semble mauvais essentiellement, surtout parce qu'il n'atteint pas le but cherché, car, pour prolongés que soient les atermoiemens, ils doivent avoir une fin, et à l'époque de cette fin on devra toujours subir le choc que l'on veut en vain amortir.
C'est la préoccupation ou l'on est de vouloir conjurer les premiers momens de perturbation qui suggère des termes dilatoires; il serait plus raisonnable de s'avouer nettement à soi et aux autres qu'il n'y a pas de transition praticable, et qu'on se doit résigner à l'ébranlement qui suit les grandes secousses dans les choses politiques comme dans les choses naturelles.
II est puéril de s'obstiner à méconnaître cette nécessité fatale, il serait indigne d'un écrivain de bonne foi de la dissimuler, et nous y répugnons d'autant plus, que ne fut-elle point inévitable, nous nous croirions en droit d'examiner si les maux qu'entraînerait une réforme forcée seraient pires que la prolongation, même déterminée, du crime qu'elle effacerait.
Cette perturbation, pourquoi ne pas l'envisager face à face afin d'en prévenir les plus dangereux effets? Quelque soin qu'on y donne, quelque retardement qu'on y apporte, à quelqu'époque et à quelque génération que l'on s'adresse, le jour ou l'on fera passer des hommes de la non liberté à la liberté, des désordres prendront place. Lorsque vos fils sortent du collège, vous ne pouvez les retenir, ils vous échappent. Pendant un an, deux, trois ans, les voilà qui fuient les livres, courent la ville, inventent toutes sortes d'étranges plaisirs, s'abandonnent à la fougue de leurs passions; et quand ces émancipés qui viennent d'achever leur philosophie, qui ont lu Socrate dans Platon et Xenophon, qui savent Homère par cœur, se livrent ainsi à la première furie de l'affranchissement, vous voulez que des esclaves n'aient pas aussi leurs jours d'ivresse! Folie et injustice. Nous vous disons, nous, que pour aller du Havre à la Martinique il faut traverser les mers, et que cherchassiez-vous mille ans à construire un chemin pour y arriver par terre, vous ne le trouverez pas.
Certainement l'émancipation ébranlera les colonies, mais il faut que l'émancipation soit. La révolte sanglante les ébranlerait bien davantage. Plus il est difficile de changer les bases d'une société, plus il y a de raisons pour en essayer l'entreprise législativement, et ne pas laisser tout faire à la violence.
En définitive, abolir l'esclavage, c'est opérer une révolution, sans aucun doute. Dites-nous seulement: en est-il une dans les annales du monde qui se soit accomplie aussi pacifiquement que celle dont les colonies anglaises viennent d'être témoins? La nôtre aura ses difficultés comme la leur; mais en présence de sa nécessité, c'est un fait dont chacun se peut réjouir d'avance jusqu'au fond de l'âme, qu'elle n'aura pas de dangers.
La raison et l'humanité voulant l'abolition, il n'est pas sensé d'en grossir les embarras, car on doit les subir, et ils s'agrandiront à mesure que l'on reculera: il serait sage au contraire de calculer les moyens propres à les paralyser et à diriger des forces qui deviendront d'autant plus terribles qu'on les aura plus comprimées. — Il se condamne à l'immobilité, celui qui cherche les moyens d'opérer la réforme sans aucune secousse. Ce n'est pas la faute des esclaves si on les a changés en brutes, et le temps ne saurait applanir des difficultés qui tiennent à la nature des choses. Fût-il possible d'initier des ilotes, on n'obtiendrait d'autre résultat que d'en faire des hommes raisonneurs, inquiets, mal disposés à l'engourdissement obligé de leur condition. L'expérience de l'apprentissage chez les Anglais a prouvé qu'aucune mesure d'amélioration n'était applicable à des esclaves ou demi-esclaves.
Pour tout dire, ces préparations que l'on sollicite et dont nous avons démontré plus haut l'impossibilité radicale, ne sont que des pièges tendus à la crédulité des âmes candides. Sauf d'honorables exceptions, nous estimons qu'il n'y a pas une une entière bonne foi de la part des créoles à demander qu'on mette les nègres en état de jouir de la liberté avant de la leur accorder. Voyez en effet: ils prétendent d'un côté qu'il est utile de préparer leurs esclaves comme l'Angleterre avait préparé les siens, 178 et de l'autre ils s'efforcent de démontrer que les noirs anglais ne font rien du tout. En bonne logique, quelle conclusion tirer de là, sinon que l'institution est sans bénéfice ou que la demander est un échappatoire. Nous soutiendrons toujours, nous, que l'affranchissement en masse peut seul permettre d'enseigner à un esclave les devoirs d'un citoyen. C'est là une science pour laquelle on ne saurait faire d'étude au fond de l'obscurité nécessaire des cases à nègres. Apprendre la liberté à un être qui reste hors de la liberté! autant vaudrait tâcher d'apprendre la natation à un enfant sans le mettre dans l'eau. Vouloir créer les vertus de l'homme libre dans l'homme esclave, c'est rechercher l'effet sans la cause.
Que parlez-vous du danger qu'il y aurait pour eux-mêmes à les livrer à leurs propres instincts? Prétendez-vous donc absolument les comparer à ces animaux domestiques qui ne savent plus trouver leur pâture, lorsqu'un accident les rend aux bois. Est-ce que les nègres anglais que leurs maîtres présentaient aussi comme hors d'état de gravir la rude échelle de la civilisation, ne vivent pas très bien? Le Code noir comptait si peu sur l'esclave, qu'il n'avait pas voulu s'en rapporter à lui du soin de sa subsistance, il défendait à l'habitant de se décharger de l'obligation d'y pourvoir. Aujourd'hui néanmoins, presque partout dans les colonies françaises, ce sont les nègres qui se nourrissent eux-mêmes avec le samedi. Les maîtres ont implicitement confessé que la très grande majorité de leurs serfs ne sont pas aussi dénués de l'esprit de prévoyance qu'on le dit maintenant. Puisque le nègre sait se nourrir dans l'esclavage, la responsabilité de la vie n'est donc pas au-dessus de ses forces, il a donc le sentiment de l'avenir et les facultés d'économie qu'on lui refuse? Bien mieux, il préfère le samedi à l'ordinaire; l'initiative ne l'effraie donc pas?
La situation morale des noirs, telle quelle est, nous paraît suffisamment avancée pour qu'il n'y ait aucun danger à les nommer citoyens. Ils se feront à leurs droits en les pratiquant, à leurs devoirs en les remplissant, de même que les bourgeois français deviennent bons jurés en exerçant les hautes fonctions du jury. Leur aptitude à comprendre l'indépendance ne peut se développer que dans l'indépendance.
De l'aveu de la commission de la Guadeloupe, « les déclamations des abolitionistes ont donné aux nègres des espérances dont il faut tenir compte ».179 Il n'y a pas d'autre manière de régler ce compte que de leur donner la liberté: et croyez-nous, ils y sont aussi préparés qu'on le puisse être, car ils la désirent, ils l'attendent; car ils la veulent. Nous ne connaissons pas de meilleure préparation que celle-là, ni rien qui aille mieux contre les allégations de leurs ennemis. Quant au reste, ne craignez rien, les puissans moyens de la civilisation, les cinq Codes et quelques mesures spéciales fourniront les forces nécessaires pour maintenir l'ordre et conduire les affranchis, peu à peu, sans danger pour eux-mêmes ni pour personne, à la connaissance des obligations et à la jouissance des prérogatives de l'homme.
Abandonner aujourd'hui au terrible courant de notre monde anarchique des gens esclaves hier, nous ne disons pas que ce soit un moyen sans inconvéniens de les rendre à l'indépendance, nous disons comme publiciste et comme philantrope, que c'est de tous les moyens celui qui a le moins d'inconvéniens. Qu'il faille accomplir une telle œuvre avec avec calme, avec modération: en détruisant le désordre servile qu'il faille assurer l'ordre libre et se garder d'imprudence, nous en sommes d'avis, mais que l'on puisse mettre quelque chose entre la servitude et la liberté, nous ne le croyons plus.
Et ici encore, que l'on me permette deux mots d'explication personnelle. Cette opinion que je manifeste, je ne l'ai pas prise parce qu'elle est la plus facile à prendre et dispense des peines d'une élaboration. Je ne m'enferme pas dans les hauteurs commodes de l'abstraction, je ne crois ni au droit divin, ni à toutes ces lois primordiales que chacun tourne à sa fantaisie, et dans lesquelles nos adversaires aux théories providentielles ont trouvé la servitude noire et blanche écrite tout au long. Ce n'est point d'un zèle fanatique que ma philantropie reçoit ses inspirations, ce n'est point d'enthousiasme que je demande l'abolition spontanée, ce n'est point pour obéir au principe sacré, qu'ému d'un désir passionné, je veux inflexiblement soumettre à l'heure même la société à ce principe, quelque déchirement qu'elle en puisse éprouver. De longues réflexions m'ont amené là, je ne suis pas arrivé du premier coup à l'émancipation immédiate et absolue. Dans la brochure de 1833, dont j'ai cité des extraits, je proposais un demi-siècle d'apprentissage. — Si je demande aujourd'hui la libération spontanée, c'est qu'en étudiant les choses, j'ai acquis la conviction que le problème de la conciliation du travail et de la liberté se peut résoudre avec moins de danger par cette voie que par toute autre.
L'élargissement en masse de tous les pauvres captifs noirs ne nous ravit pas seulement par son caractère d'immense charité, il se présente à nos yeux avec tous les avantages politiques et matériels d'une entreprise pratique. Il coupe court aux tâtonnemens douloureux, aux vains projets, à ce qu'il y a de faux, de malaisé, de précaire dans les situations mixtes. Il prévient ces inimitiés de l'apprentissage que l'épreuve faite aux West-Indies a dévoilées, et dont les suites troublent encore dans les îles de la Grande Bretagne les premiers jours de la liberté réelle. Fait accompli, irrévocable, absolu, sans retour, il ne laisse plus de prise aux résistances, chacun est intéressé à le voir triompher, à lui faire porter les meilleurs fruits, à en extraire toutes les vertus, à étouffer les répugnances qui pourraient ralentir sa marche ascensionnelle. Plus d'opposition possible de la part des uns, plus de discours agitateurs de la part des autres, plus de fluctuations. Les nègres sont heureux, il ne leur reste aucun sujet valable de plainte, leurs maîtres sortent du provisoire, les voilà enfin fixés, ils peuvent bâtir sur un terrain solide. La propriété coloniale rentrée dans le droit commun devient inattaquable, et acquiert une sécurité que maintenant elle a perdue à jamais. Les créoles cessent de trembler pour le lendemain, car ils peuvent faire eux-mêmes leur lendemain, ils deviennent forcément les meilleurs auxiliaires de l'émancipation, car ils ont un intérêt véritable à ce qu'elle réussisse, et les abolitionistes deviennent les meilleurs aides des créoles, car ils ont un intérêt de conscience et de morale à ce que la grande œuvre prospère.
Qu'on le remarque bien encore, il ne faudra pas plus de force, il n'en coûtera pas plus d'argent pour fonder un ordre définitif, que pour soutenir un mode intermédiaire. L'affranchissement simultané a de plus l'immense avantage de réhabiliter la terre d'un seul coup; il emporte ce préjugé contre la culture qui, autrement, voue toujours les libres successifs à l'oisiveté. Le travail agricole n'étant plus le signe de la servitude, l'émancipé n'a plus à craindre de déroger en s'y livrant.
Les colons par leurs inquiétudes, témoignent suffisamment de la mauvaise position ou ils se trouvent. Ils n'osent plus dire qu'il faut garder indéfiniment l'esclavage, et ils ne veulent pas entrer franchement dans l'émancipation. Ils se plaignent qu'on les tient depuis longues années dans un élat qui ressemble à l'agonie, et ils veulent toujours temporiser: puis lorsqu'avec la lenteur que la France gouvernementale met dans toutes choses, ils voient la commission de la chambre ajourner le fameux rapport Tocqueville, le ministère nommer une autre commission pour examiner des faits retournés sous toutes leurs faces depuis quinze ans, et enfin cette commission elle-même s'ajourner du mois de juillet au mois de janvier, et du mois de janvier on ne sait à quand pour recueillir des documens; ils s'écrient satisfaits: « Encore du temps de gagné. » Aveugles que vous êtes, c'est du temps perdu. Ne voyez-vous pas qu'au milieu de ces trances le mouvement a cessé. Tout le monde hésite, personne n'ose plus rien entreprendre, rien préparer, rien réparer même. Les bâtimens tombent en ruine, et la valeur des propriétés s'avilit sous l'incessante menace d'un changement qui effraye la majorité. L'état commercial subit ces tristes influences, le crédit s'altère chaque jour davantage, les embarras passés tournent à l'indigence: les nègres s'impatientent, les irritations croissent, les passions s'enveniment, les évasions augmentent, les procès scandaleux se multiplient, enfin la possibilité d'une guerre avec les Anglais complète l'infortune de cette société malheureuse, placée entre les misères du présent ou les inquiétudes de l'avenir, et livrée à l'agitation maladive qu'éprouvent les populations dans l'attente d'un grand événement.
Nous espérons, pour le bonheur des colonies, que la session qui vient de s'ouvrir amènera quelque chose de définitif. La question de la liberté des noirs demande à être promptement résolue: la régénération des îles en dépend. L'incertitude pour les masses comme pour les individus, est pire que la mort. Les colons sensés désirent que l'on en finisse. Si l'on ne fait rien, ils l'ont dit eux-mêmes, nous avons rapporté leurs paroles, tout est à craindre des ateliers en fermentation, si l'on s'arrête à quelqu'un des projets de juste-milieu, le malaise qui ronge les colonies ne cessera pas de les troubler; on reviendra immédiatement aux interminables discussions d'aujourd'hui, et l'avenir sera de nouveau mis en jeu. Les vrais abolitionistes, ceux qui veulent changer autre chose que des mots, ceux qui ne se paient pas de phrases dogmatiques, ne croiraient pas le but atteint, et en continueraient la poursuite avec l'animation que donne un premier succès. Entre la France et l'esclavage il y a un combat à outrance: la France ne quittera les armes que le jour ou les noirs seront véritablement libres. Pour noire compte, telle est l'ardeur de notre foi, que nous ne nous contenterons jamais d'une réparation à demi.
Il ne s'agit plus de savoir si les nègres sont mûrs pour la liberté, ni de discuter métaphysiquement s'ils sont « naturellement subordonnés à la tutelle du blanc, » 180 s'ils sont « propres à jouir de la vie sans appartenir aux blancs; » il s'agit de leur donner la liberté qu'ils veulent, la liberté qu'il est équitable de leur rendre. Il ne s'agit plus d'examiner s'ils sont dignes des droits politiques, il s'agit de les en investir, parce qu'ils sont capables de s'en emparer eux-mêmes si l'on différait, et cela montre assez qu'ils le méritent. Quoiqu'on ait pu faire pour les abrutir, ils ont crû dans l'esclavage pour l'indépendance, et si on ne les émancipait pas de bonne grâce, ils ne tarderaient guère à s'émanciper tout seuls.
Les esclaves comprennent. Et les colons le savent bien, l'esclavage est un volcan prêt à ébranler leur société, comme ces feux souterrains qui font encore trembler leur terre. Oui, vous le savez, vous vivez dans l'inquiétude tout en ne voulant point avouer vos craintes, le mot liberté vous fait frémir, la terreur est à l'ordre du jour sur l'émancipation; vous mettez à l'index celui qui prononce une parole libérale: aussi, je vous l'ai dit, plus d'un parmi vous cachent le fond de leur pensée, plus d'un savent qu'il faut en finir, et ne confessent point leur vérité. Vous vous trompez les uns les autres... vous êtes en péril.
C'est qu'on aura beau reconnaître la douceur du régime actuel des esclaves, il y a dans la servitude le fouet, la contrainte, l'abstraction de tous sentimens intellectuels, l'impuissance de tout développement moral. Sous son masque, sans grimace douloureuse, on voit constamment percer l'invincible désir de l'indépendance, et de temps à autres se manifeste le brutal réveil de l'homme, réveil d'esclave avec l'empoisonnement dans l'ombre et la révolte au grand jour, la révolte sans la guerre, la révolte hideuse, accompagnée de l'incendie et de l'assassinat. Il ne s'écoule jamais dix années sans que les noirs, malgré la décomposition des plus nobles facultés humaines que la servitude opère dans leur âme, ne protestent par quelque violence contre leur prétendu assentiment volontaire à l'état où on les maintient. — Voyez à la Martinique seule, et sans remonter plus haut que 1811. Cette année-là, sous la domination des Anglais, révolte. En 1822, révolte; vingt nègres du Carbet croient le moment opportun, ils tuent, ils brûlent, et sept d'entre eux paient de la vie leur espoir intempestif de secouer le joug. Vers celte époque, le poison fait tant de ravages qu'on en vient aux exécutions d'une cour prévôtale. En 1823, révolte; c'est la célèbre affaire dite des hommes de couleur, d'où sortent les noms de MM. Fabien et Bissette, pour entrer à jamais dans l'histoire coloniale. En février 1831, révolte: la conjuration est générale, elle éclate au cri de liberté ou la mort! — Les meilleurs ateliers y prennent part, l'incendie est sur le point de triompher, un moment d'hésitation chez les insurgés arrête la guerre civile qui commence, les troupes s'emparent des plus coupables: deux blancs, l'un créole, l'autre européen, l'un négociant, l'autre géreur, sont compromis, accusés, traduits devant la cour d'assises181 avec cinquante prévenus, et bientôt Vingt-trois esclaves marchent à la potence avec un courage héroïque en criant: Vive la liberté!182 Vers 1833, révolte encore: nouvelle tentative des hommes de couleur et nouvelle répression. Mais qui peut dire que les maîtres et la garnison seront toujours les plus forts? qui ne se rappelle qu'un parti d'esclaves de l'antiquité tint long-temps contre les Lucullus, les Pompée, et mît le grand empire romain à deux doigts de sa perte? — En trente ans, quatre, cinq insurrections de nègres! Si chez nous les vraies émeutes sont si rares, jugez ce qu'il faut d'exaspération à des esclaves pour arriver jusqu'à l'emploi de la force ouverte! Les assassinats légaux n'empêchent pas le flot de la liberté de se soulever à de longs intervalles, et d'entraîner toujours dans son impitoyable courant quelques-uns de ceux qui sont assez fous pour vouloir faire digue.
Appelons la liberté, la consolante liberté, cherchons par tous les moyens imaginables à l'établir pacifiquement; elle seule peut délivrer le XIXe siècle de ces cruautés, de ces empoisonnemens et de ces massacres juridiques qui le déshonorent.
Les colons se vantent beaucoup de la tranquillité des îles, et la présentent comme un témoignage du bien-être des nègres. On ne peut nier le calme dont ils parlent ici, et notre surprise a été grande, avec les idées que nous apportions, de voir leur parfaite quiétude au milieu de leurs nombreux esclaves. Mais il est permis de penser que les deux mille hommes de troupes réglées, entretenues dans chaque colonie, outre la milice et la gendarmerie, ne sont pas étrangers à ce calme extraordinaire:183 la barbarie d'une législation dont les arrêts punissent l'esclave qui lève la main sur son maître, comme le fils qui frappe son père, doit encore être comptée avec l'influence du préjugé, pour justifier les esclaves. C'est aussi sur des lois terribles qu'avaient établi leur repos, les Anciens vivant en paix au milieu de leurs esclaves, comme au milieu d'ennemis. Ce n'est assurément là qu'une paix de surface, et ils le sentent comme nous, ces hommes qui livrent pendant deux ans les ateliers aux fureurs d'une cour prévôtale, et se croient obligés d'offrir au dieu de leur sécurité des hécatombes de seize, dix184 et vingt-trois têtes!
L'effet singulièrement opposé que les derniers bruits de guerre ont produit sur les Antilles françaises et anglaises donne à juger d'une manière très nette des différences de l'état libre à l'état esclave. Chez nous on fit beaucoup de préparatifs, on se mit vigoureusement en défense, et l'on regarda plus d'une fois du côté des cases à nègres en secouant la tête. Chez nos voisins, rien. Et comme nous paraissions choqué de cette tranquillité: « Tout le monde ici, nous fut-il répondu, est intéressé à défendre le pays, nous n'avons point d'esclaves à craindre; vous aurez bien assez à faire, vous, avec les vôtres. »
Loin de nous la pensée mauvaise de vouloir acquérir l'abolition par la peur, de semer dans les esprits des craintes mal fondées, mais il n'est que trop vrai, la paix actuelle de nos îles, n'est due qu'à la persuasion où sont les esclaves qu'on s'occupe d'eux et qu'ils seront bientôt libres. Les hommes doués d'une oreille assez fine pour entendre ce qui se dit tout bas dans les cases à nègres, savent qu'il faut prendre garde. Les maîtres eux-mêmes en nous reprochant l'agitation qui existe dans les ateliers, annoncent explicitement un danger. — Que l'on ne nous accuse pas de juger la situation des colonies avec nos instincts d'abolitioniste, nous ne sommes pas les seuls à les croire en péril, ce n'est pas légèrement, sans doute, qu'un membre du conseil colonial de la Martinique, M. A. Fortier, a osé dire: « La société coloniale offre aujourd'hui l'image de l'anarchie la plus complète, cette anarchie s'est formulée plusieurs fois en incendies et en révoltes; l'autorité a rétabli l'ordre, mais l'anarchie n'en existe pas moins, elle s'est réfugiée dans tous les cœurs, elle se montre à la moindre occasion. »185 Encore une fois que l'on y songe, les craintes que nous manifestons ne sont point celles d'un homme préoccupé de certaines idées. Il nous est facile de prouver que les nécessités de la position n'échappent pas aux créoles de bon sens. On vient d'entendre M. Fortier de la Martinique, voici maintenant ce que je trouve dans un mémoire qu'un habitant propriétaire de la Guadeloupe m'a fait l'honneur de m'envoyer. « Ainsi l'intérêt même des colonies réclame une solution immédiate de la question, cette solution ne peut être contraire à l'émancipation, si elle l'était, si la chambre des députés prononçait cet arrêt: l'abolition est indéfiniment ajournée, elle donnerait un signal de troubles et de désordres. La population esclave, dans l'attente de l'événement qui lui est annoncé, que le sentiment de la justice qu'elle porte en elle lui fait pressentir, frustrée dans ses espérances, éclaterait peut-être, et les terribles manifestations de sa colère seraient les conséquences de cette imprudente décision. » Ecoutez maintenant un délégué des blancs de Bourbon: » La sourde fermentation qui se manifeste au sein des populations coloniales annonce que l'équilibre n'y existe plus. L'esclavage s'en va, il est condamné par l'opinion, et de cet état des esprits à la violence, il n'y a qu'un pas. Cette opinion a besoin d'être aidée et dirigée dans sa marche, si l'on ne veut pas exposer les colonies à toutes les éventualités de convulsions sociales. »186
Les autorités elles-mêmes proclament tout haut que le moment est venu. Le gouverneur de Bourbon, dans son discours d'ouverture au conseil colonial (27 avril 1840), a dit: » L'ordre public, d'accord avec l'humanité, exige que l'on s'occupe d'améliorer le sort d'une partie de la population. » Enlevez à ces paroles les voiles obscurs du langage officiel, et il vous restera « si vous ne voulez pas que la tranquillité publique soit compromise, affranchissez les esclaves. »
Il faut donc en finir, il est temps. Et les demi-mesures, on le voit, seraient plus dangereuses qu'utiles.
Les nègres, comme l'a dit M. Gilland, ouvrier serrurier, pour les prolétaires:187 Les nègres « ne demandent pas à souffrir moins, ils demandent à ne plus souffrir du tout. »
Quand nous songeons à tous les dangers qui entourent la propriété coloniale si l'on persistait à vouloir simplement modifier l'esclavage, nous sommes tenté d'affirmer que notre proposition d'émancipation immédiate contient seule les conditions de salut pour les colonies livrées aujourd'hui aux troubles d'une propriété réprouvée, et menacées dans un avenir prochain des catastrophes qui sont la fin de toutes violences.
Travaillons vite, travaillons sans relâche à cette œuvre de salut commun. Les nègres deviendront chaque jour plus faciles à remuer, plus impatiens du joug, à mesure qu'ils seront moins ignorans. Quelqu'abrutis qu'ils soient encore, le sentiment qu'ils ont acquis de leur misère est devenu un écueil pour la paix des colonies; ils perçoivent confusément leur abjection et s'en indignent.
Donnez, donnez ce que vous devez pour qu'on ne vous l'arrache pas; ne laissez point accomplir par les voies sanglantes de la violence ce que la justice et la raison peuvent faire avec profit pour tous. Le feu couve, il n'est pas éteint.
L'émancipation, telle que nous la comprenons, sera peut-être plus facile encore que nous ne pensons nous-même, elle s'opérerait à l'heure présente avec d'autant moins de désordre que tout le monde, maîtres et esclaves attendent une résolution grave de la métropole.
On peut donner à ces vastes inquiétudes une issue favorable, heureuse, fortunée. Mais que l'on proclame le maintien de ce qui est, et elles auront certainement une issue ruineuse, sanglante, lamentable. Spectre de Saint-Domingue, sors de tes rouges linceuls, lève-toi et viens attester nos dernières paroles, pour épouvanter « ce peuple au col dur, » qui refuse d'écouter notre appel pacifique.
CHAPITRE XXIV. RÉSUMÉ.
Si comme le disent les colons on ne peut cultiver les Antilles qu'avec des esclaves, il faut renoncer aux Antilles.— La raison d'utilité de la servitude pour la conservation des colonies est de la politique de brigands. — Une chose criminelle ne doit pas être nécessaire. — Périssent les colonies plutôt qu'un principe. — Il n'est pas vrai que le travail libre soit impossible sous les tropiques.
De tous les moyens qui se présentent pour opérer le changement que doit indispensablement subir l'état social de nos îles, et pour donner à leur existence une autre base que la servitude, celui qui offre le plus de chances favorables est donc, à notre avis, l'émancipation en masse pure et simple. Cette émancipation a pour elle la convenance, l'utilité, l'opportunité; ses résultats immédiats seront pour les nègres faits libres; la probabilité de ses heureuses conséquences finales doit fixer le colon sur la réalité de ses avantages.
Établir l'ordre au milieu de la cohue momentanée des nouveaux libres n'est point ce qui nous embarrasse. La contenance admirablement calme et douce des huit cent mille affranchis de l'Angleterre ne peut laisser de ce côté aucune crainte dans les esprits sérieux et de bonne foi; leur conduite a fait évanouir le lugubre fantôme des massacres que l'on prédisait pour le saint jour de la liberté. Organiser le travail nous paraît être la seule, la grande difficulté! A ce sujet, avant d'aller plus loin, nous avons besoin de dire un mot sur l'ensemble de la question.
La commission du conseil colonial de Bourbon a dit: « Le travail libre sera toujours impossible a obtenir sous les tropiques. »188
La commission du conseil colonial de la Guyane française a dit: « Le travail libre est une chimère aux colonies, parce que le climat qui énerve l'homme, favorise sa paresse en lui offrant sans effort de sa part tout ce qui peut suffire à ses besoins. »189
La commission du conseil colonial de la Guadeloupe a dit: « Le travail cessera dans les colonies, sitôt qu'il deviendra facultatif. »190
La commission du conseil colonial de la Martinique a dit: « C'est notre conviction profonde, notre foi sincère qu'il est impossible de maintenir sans l'esclavage un travail fructueux sur nos habitations. »191
Si l'on devait croire à l'infaillibilité des conseils coloniaux et à la rigidité de leurs formules, toute discussion serait inutile, il y aurait après de tels arrêts une seule chose à répondre: « Puisque l'on ne peut obtenir de sucre tropical qu'au moyen de l'esclavage, il faut renoncer au sucre tropical: puisque les colonies ne peuvent être cultivées que par des esclaves, il faut renoncer aux colonies, à moins toutefois que vous tous partisans de la servitude vous ne consentiez à prendre la place des nègres par dévouement au sucre et aux colonies. Soumettez-vous volontairement au travail forcé, si vous le jugez utile pour fournir des marchandises d'encombrement à la marine de votre patrie; mais n'espérez point que les honnêtes gens vous permettent plus long-temps d'y obliger des hommes qui s'inquiètent fort peu que votre marine et votre patrie aillent bien ou mal, par la raison qu'ils n'y ont aucun profit. »
Ce n'est pas là du tout l'opinion des planteurs. Au contraire, la chaleur des Antilles et ses influences énervantes étant données, ils en tirent la conclusion que les colonies ne pouvant être cultivées volontairement, il est juste d'y appliquer les nègres par voie de contrainte. C'est quelque chose, nous l'avouons, qui dépasse la portée de notre tolérance et de notre sang-froid, qu'un raisonnement aussi sauvage. Voyez-vous ces quinze à vingt mille hommes blancs qui viennent soutenir devant le monde entier que leur prospérité est attachée à la misère et à l'avilissement de deux cent soixante mille hommes noirs!!! Celui qui prétend avoir le droit de garder des hommes en servitude, parce qu'on ne trouverait pas de bras libres pour planter des cannes, et celui qui soutiendrait qu'on a le droit de voler parce qu'on n'a pas d'argent, sont à nos yeux deux fous ou deux scélérats absolument pareils.
Lorsque j'arrive à réduire ce droit à son expression la plus concrète, lorsque m'isolant par abstraction du monde matériel et me retirant dans le monde intellectuel, je me représente que de deux hommes l'un se dit le maître de l'autre, maître de sa volonté, de ses mouvemens, de son travail, de sa vie, de son cœur, cela me donne tantôt un fou rire, et tantôt des vertiges de rage.
Que l'esclavage soit ou ne soit pas utile, il faut le détruire; une chose criminelle ne doit pas être nécessaire. La raison d'impossibilité n'a pas plus de valeur pour nous que les autres, parce qu'elle n'a pas plus de légitimité. Si l'on dit une fois que ce qui est moralement mauvais peut être politiquement bon, l'ordre social n'a plus de boussole et s'en va au gré de toutes les passions des hommes. La violence commise envers le membre le plus infime de l'espèce humaine affecte l'humanité entière; chacun doit s'intéresser à l'innocent opprimé, sous peine d'être victime à son tour, quand viendra un plus fort que lui pour l'asservir. La liberté d'un homme est une parcelle de la liberté universelle, vous ne pouvez touchera l'une sans compromettre l'autre tout à la fois.
Autant que qui que soit nous apprécions la haute importance politique et industrielle des colonies, nous tenons compte des faits, nous n'ignorons pas la valeur attribuée à ce qui se passe autour de nous, et cependant c'est notre cri bien décidé, pas de colonies si elles ne peuvent exister qu'avec l'esclavage. L'esclavage viole le principe de la liberté, principe qui n'est pas seulement une convention faite entre les hommes, mais aussi une vérité naturelle parvenue à son évidence; la liberté en effet renferme à la fois le bien matériel et le bien moral, c'est-à-dire la destinée suprême de l'homme. Liberté, c'est équité, comme a dit lord Coke, le l'Hôpital de l'Angleterre. Le principe de liberté étant donc juste sous toutes les faces, il doit être souverain, absolu, despotique. C'est pourquoi nous qui aimons mieux nous passer de sucre que d'abandonner nos sentimens d'humanité, nous le déclarons, et cela avec toute la gravité qu'un homme puisse mettre à se prononcer, nous acceptons dans son entière portée un mot célèbre, et nous disons, nous aussi: « Périssent les colonies plutôt qu'un principe. » Oui, car un principe en socialisme c'est le cerveau en physiologie, c'est l'axe en mécanisme; sans principes respectés il n'y a plus d'ordre, plus de société, plus rien, il ne reste qu'anarchie, violence, misère, chaos et dissolution.
Nous savons tout ce que les gens qui ne voient qu'un seul côté des choses, ont débité et débiteront encore contre cette pensée d'une forme abstraite, mais les injures ne sont pas des raisons, et leurs faux jugemens eussent-ils pu nous émouvoir, nous avions de quoi nous rassurer. Bien avant la Convention, dès 1765, les encyclopédistes avaient dit ce qu'elle n'a fait que répéter. « On dira peut être que les colonies seraient bientôt ruinées si l'on y abolissait l'esclavage des nègres. Mais quand cela serait, faut-il conclure de là que le genre humain doit être horriblement lésé pour nous enrichir ou fournir à notre luxe? Il est vrai que les bourses des voleurs de grand chemin seraient vides, si le vol était absolument supprimé: mais les hommes ont-ils le droit de s'enrichir par des voies cruelles et criminelles? Quel droit a un brigand de dévaliser les passans? A qui est-il permis de devenir opulent aux dépens de ses semblables? Non!... que les colonies européennes soit donc détruites plutôt que de faire tant de malheureux. »192
Ne veut-on reconnaître l'autorité de l'Encyclopédie, que l'on prenne le Dictionnaire théologique de l'abbé Bergier, et l'on y pourra lire ce qui suit à l'article Nègre. — « Il n'est pas possible, dit-on, de cultiver les îles autrement que par des esclaves, dans ce cas il vaudrait mieux renoncer aux colonies qu'à l'humanité. La justice, la charité universelle et la douceur sont plus nécessaires à toutes les nations que le sucre et le café. » Quelle différence y a-t-il entre ces mots et ceux de Robespierre? Et l'abbé Bergier n'était point un révolutionnaire, c'était un homme sans passion politique, très bon, très savant, zélé défenseur de la religion catholique, et, de plus, fort ennemi des philosophes. A ce que nous venons de rapporter il ajoute ensuite avec une grande pénétration: « Mais tout le monde ne convient point de l'impossibilité prétendue de se passer du travail des nègres. Lorsque les Grecs et les Romains faisaient exécuter par leurs esclaves ce que font chez nous les chevaux et les bœufs, ils imaginaient et disaient que l'on ne pouvait faire autrement. »
En définitive, tous les sophismes du monde ne peuvent aller contre le droit. Les nègres doivent être libres, parce que c'est justice. Si lorsqu'ils seront libres ils ne veulent pas cultiver au-delà de leurs besoins, comme on l'assure, de deux choses l'une, ou il faut les remplacer au moyen de l'émigration par une population qui ayant déjà des besoins acquis travaillera pour les satisfaire,193 ou il faut rendre les îles à la nature qui ne les a pas faites pour l'homme, puisqu'il ne lui est pas possible de les exploiter sans user de violence envers quelques-uns de ses semblables. Il y a bien encore assez de sol en friche sur le globe, pour ne pas peupler celui qui ne le veut pas être. Tout en admirant l'humanité dans les prodigieux travaux qui ont transformé en terre-ferme les marais de la Hollande, nous avons grande pitié de la folie qui est venue venue la épuiser tant de force et de génie.
Mais que tous ceux qui comprennent l'immense valeur politique et industrielle des colonies se rassurent, les nègres voudront et les blancs pourront travailler. Alors que l'on n'aura plus à craindre de montrer aux noirs des blancs la houe à la main, ils se mêleront ensemble sur les champs des Antilles et de leur union, on verra sortir une activité nouvelle.
Les colonies ne doivent pas périr, elles ne périront pas, leur prospérité peut aller de front avec l'indépendance; c'est dans l'indépendance que sera leur plus grande prospérité. Il n'est pas vrai que le travail libre soit impossible sous les tropiques, il ne s'agit que de savoir déterminer les moyens de l'obtenir; et comme il n'est rien qu'il ne soit donné à l'homme de faire dans les limites de sa nature, on ne peut douter que cela soit possible. Toute la question pour nous se réduit donc là: ORGANISER LE TRAVAIL LIBRE.
Dans le chapitre suivant on verra ce que nous proposons pour atteindre ce grand but.
30.Dunoyer on "The Proper Role of Government and the Danger of Political Speculators" (1845)↩
[Word Length: 6,212]
Source
Charles Dunoyer, De la liberté du travail, ou simple exposé des conditions dans lesquelles les force humaines s'exercent avec le plus de puissance (Paris: Guillaumin, 1845). 3 vols. Vol. III, Liv. IX, Chap. VII "Suite des arts qui travaillent à la formation des habitudes morales. - Du gouvernement. [Extracts]
Section 1. - Objet propre du gouvernement. pp. 348-57.
Section 4. - En quoi consiste le talent et la spéculation dans l'art du gouvernement. pp. 375-386.
CHAPITRE VII. SUITE DES ARTS QUI TRAVAILLENT A LA FORMATION DES HABITUDES MORALES. — DU GOUVERNEMENT.
[Section 1. - Objet propre du gouvernement. pp. 348-57]
Après tout ce qui a déjà été dit, dans le cours de cet ouvrage, du rôle que le gouvernement est appelé à remplir dans la société en général et dans chacun des arts qu'elle embrasse en particulier, je n'aurai pas besoin, je pense, de beaucoup d'efforts pour faire comprendre quel est son objet et sa nature.
Quelle que soit l'extension qu'ont prise en réalité ses attributions, et surtout celle que des théories exorbitantes ont essayé, dans ces derniers temps, de leur donner, il n'y a pas à se faire d'illusion sur sa véritable tâche.
Indubitablement cette tâche est spéciale; elle est circonscrite, et elle se distingue nettement de celle de tous les autres arts qui entrent dans l'économie de la société.
A considérer les choses, sinon en fait, du moins en principe, le gouvernement n'a foncièrement à jouer le rôle ni d'exploiteur de mines, ni d'agent du voiturage, ni de manufacturier, ni d'agriculteur, ni de médecin, ni d'artiste, ni de maître d'école ou d'instituteur, ni de ministre du culte, ni d'aucun des arts qui entrent avec lui dans l'économie sociale, et dont nous venons de décrire la nature, l'influence et les moyens d'action. Il a, comme eux tous, sa tâche particulière: il est essentiellement le gardien de la paix, le protecteur de l'ordre, le créateur et le conservateur des bonnes relations, le formateur des habitudes de justice, d'équité, de sociabilité qui les font naître; et, pour faire naître ces bonnes habitudes, il dit, sur toutes choses, les mauvaises actions qu'il faudra s'interdire, et veille à la répression des actions défendues; c'est-à-dire qu'il remplit dans ce but les fonctions de législateur et d'exécuteur de la loi, et que, pour assurer l'exécution de la loi, il fait l'office tout à la fois de surveillant, d'officier de police, d'agent du ministère public, de magistrat instructeur, de juge, de juge civil et de juge criminel, d'agent de la force publique, etc.
A ces titres, il régit, si l'on veut, tous les arts; mais il ne les régit que d'une manière indirecte. Il ne lui appartient de les gouverner ni en s'en emparant et en se plaçant à leur tête, ni en en livrant le monopole à des classes ou à des corporations privilégiées, ni en les mettant en tutelle et en les soumettant à la censure préalable et à la direction arbitraire de ses propres agents: il ne lui appartient de les gouverner qu'en réprimant le mal que peuvent faire ceux qui les pratiquent et tout ce qui est de nature à pousser à ce mal, c'est-à-dire l'inattention, l'imprévoyance, les incuries, les témérités qui peuvent y conduire.
A vrai dire, le gouvernement, du moins dans les pays où les hommes s'appartiennent, n'a d'action directe à exercer que contre les prétentions injustes et les actions malfaisantes, et encore les seules mauvaises actions qu'il soit chargé de redresser sont celles qui atteignent autrui; car il n'est pas dans sa mission d'empêcher celles par lesquelles on ne fait de mal qu'à soi-même, et il ne lui appartient pas plus de régler les mœurs que de gouverner les arts: il n'est appelé à réprimer les penchants vicieux que dans les actions nuisibles à autrui par lesquelles ils se manifestent. Il se distingue en cela très sensiblement des autres arts qui travaillent à la formation des habitudes morales; car ceux-ci nous exercent à l'accomplissement, sans distinction, de tous nos devoirs moraux, tandis que le gouvernement n'a mission de nous former, lui, qu'à l'accomplissement de nos devoirs sociaux, et parmi ceux-ci même il n'est chargé de nous enseigner que ceux qui sont légalement obligatoires: il n'intervient point pour nous forcer à l'accomplissement de ceux qui ne sont obligatoires que moralement, tels que les simples devoirs de charité, de bienveillance, de politesse: il laisse ce soin à l'éducation proprement dite et à la religion.
Il se distingue aussi des autres arts qui concourent à la formation des habitudes morales par sa manière particulière d'agir; car si l'action qu'il exerce a une sphère moins étendue, elle est, d'un autre côté, bien plus forte et plus réprimante; et tandis que l'éducation n'a qu'un droit très limité de punir, que la religion se borne à menacer de peines à subir dans un autre monde, que l'une et l'autre n'agissent en quelque sorte que par les voies du conseil et de la persuasion, il agit, lui, par voie de contrainte, et est armé par la société de toute la force nécessaire, pour que ses ordres et ses défenses aient un résultat assuré. Il arrête matériellement les désordres, il châtie les mauvaises actions, il termine les différends, il procure l'exécution des contrats: c'est là son action immédiate; et c'est par la manière dont il exerce cette action, par l'usage qu'il fait des moyens de contrainte dont il est armé, par l'intelligence, la justice et la fermeté modérée avec lesquelles il réprime les actions malfaisantes et les prétentions injustes, qu'il entretient ou qu'il fait naître la paix dans les relations, et qu'il dresse à la longue les citoyens aux bonnes habitudes de la vie civile.
Il est si vrai que le gouvernement ne peut gouverner que d'une manière indirecte, et seulement en réprimant les mauvaises actions et les prétentions injustes, que du moment qu'il veut faire autre chose et gouverner directement les arts ou les mœurs de la société, il va contre l'objet même que sa mission lui assigne, et devient inévitablement une cause de perturbation.
Qui ne sent, par exemple, tout ce qu'il serait exposé à rencontrer de résistances et à fomenter de désordres, s'il allait se mettre en tête de devenir le régulateur direct des mœurs? Qui ne sait tout ce qu'il a causé de trouble partout où il l'a tenté, et qui supporterait aujourd'hui parmi nous que, se mettant à la place du directeur spirituel ou du père de famille, il voulût s'ingérer encore, comme il l'a fait si longtemps, dans le gouvernement des choses qui n'intéressent que la morale personnelle; prescrire, par exemple, l'accomplissement de certains devoirs purement religieux, la célébration des jours fériés, l'observance des jeûnes, la fréquentation des sacrements? qu'il prétendit, comme il l'a fait encore, ordonner la continence dans le mariage en temps de carême; régler la dépense qu'il serait permis de faire en bâtiments, en meubles, en repas, en ajustements?194 N'est-il pas évident que tout cela est hors de ses attributions véritables, et que loin de rendre, par de telles règles, la société plus paisible et mieux ordonnée, il ne ferait, en les établissant et en en voulant forcer l'observation, qu'y provoquer de graves et inévitables désordres?
Qui n'aperçoit également qu'il devient une cause de trouble en s'ingérant abusivement dans le réglement des arts, en prétendant les gouverner d'une manière directe, en s'emrant des uns, en en livrant d'autres au monopole de classes indûment favorisées, en en soumettant un plus grand nombre à la tutelle plus ou moins gênante d'une foule d'administrateurs? Qui supposera qu'il pût mettre beaucoup d'arts en régie, comme il fait les postes, les tabacs, l'enseignement, sans soulever de sérieuses et très légitimes résistances? Qu'il pût rétablir les anciennes corporations, comme il en a établi quelques-unes, sans faire revivre toutes les divisions et les querelles qu'elles suscitaient? Que la censure préalable et la formalité de l'autorisation à laquelle restent encore soumises tant d'industries ne soient de nature a provoquer les réclamations les plus sensées et les plus justes? Que les réglements restrictifs auxquels sont assujétis, en particulier, dans les rapports de peuple à peuple, les mouvements de l'art des transports, n'aient fait naître de très nombreuses et très graves complications?
Il est vrai qu'après avoir créé ces complications, ce serait un désordre nouveau que de n'en pas tenir compte, et d'agir comme si elles n'existaient pas. Mais c'est assurément un très grand mal que de les avoir fait naître; et il est si vrai que par là les gouvernements ont divisé, ont brouillé, ont mis dans la société des ferments de trouble et de discorde, que le meilleur et le plus grand moyen qu'ils auront, pendant longtemps, d'arriver à l'ordre et de parvenir à pacifier, à simplifier, à faciliter les relations, ce sera de corriger leur propre ouvrage, de revenir des écarts où ils sont tombés, et de se placer, vis-a-vis de tous les arts, dans une situation plus juste et plus naturelle, de les gouverner moins, c'est-à-dire d'une manière moins directe, de renoncer à l'insupportable prétention de les organiser, de les arranger, de régler leurs mouvements, et en les laissant davantage à leur propre impulsion, de se borner, de plus en plus, à les gouverner en réprimant les faits dommageables et punissables que peuvent commettre ceux qui les pratiquent. Encore une fois leur tâche essentielle se réduit à cela.
Il y a, au surplus, un infaillible moyen de discerner ce qu'il leur appartient de faire, et ce qui est en dehors de leurs véritables attributions; car les fonctions qui leur sont propres ont ce caractère spécial qu'elles ne sauraient jamais tomber dans le domaine de l'activité privée, tandis que l'activité privée prend toujours plus ou moins part aux travaux qu'ils ont usurpés sur elle.
Ainsi il ne viendrait assurément à l'esprit de personne de demander la liberté de faire la loi, de l'appliquer, de rendre la justice, d'établir et de lever des impôts, etc.; tandis que nul ne croit faire une chose exorbitante, au moins en pays de liberté, en revendiquant, par exemple, le droit de pratiquer tel culte de son choix, ou bien le droit de se livrer à l'exercice de l'enseignement, et de fait, tout le monde participe plus ou moins à l'exercice de ces arts, ou de ces ministères, comme on voudra les appeler; arts qui ne sauraient jamais revêtir le caractère d'une magistrature, et qui sont demeurés et deviendront de plus en plus des travaux particuliers, encore bien que, par abus, on les ait fait entrer plus ou moins dans le domaine de la puissance publique.
Le départ est ainsi aisé à faire entre ce qui est réellement et ce qui n'est réellement pas du domaine de l'autorité. Ce qui est de son domaine, c'est tout ce qui fait partie des attributs de la souveraineté, et que nul, en particulier, ne saurait élever la prétention de faire; et ce qui, au contraire, ne fait pas naturellement partie de ses attributions, c'est ce que tout le monde peut réclamer et réclame en effet la liberté de faire. Il y a, entre les pouvoirs qui lui appartiennent et ceux qui appartiennent aux particuliers, toute la différence qui existe entre des professions privées et des magistratures publiques. Elle seule a le droit d'exercer des magistratures, et elle n'a le droit de s'emparer d'aucune profession; elle n'a même le droit d'en gouverner directement aucune, et il ne lui appartient de les gouverner qu'en réprimant les faits nuisibles et les prétentions injustes de leurs agents.
Que si, du reste, après ces explications, il restait encore des doutes sur le véritable objet du gouvernement et sur les limites naturelles de sa puissance, il suffirait, je pense, pour achever de les dissiper, d'ouvrir le Code politique des nations les moins arriérées, et d'en examiner avec quelque attention les dispositions fondamentales. Quelque imparfaite qu'ait été la rédaction de ces lois, les plus capitales de toutes, on y a pourtant déterminé avec plus ou moins d'intelligence et de soin ce que la puissance publique ne pourrait pas faire, et l'on peut voir qu'il y a été stipulé notamment qu'elle serait obligée de respecter la personne et la propriété de chacun, et, parmi les propriétés, la plus indisputable de toutes, celle des facultés et la liberté de les appliquer à toutes sortes d'arts et de travaux paisibles. On lui a sans doute laissé le droit ou plutôt imposé le devoir d'empêcher l'usage abusif qu'on pourrait faire de ses forces: c'est précisément pour cela qu'elle est instituée: c'est la raison même de son existence; mais si on l'a chargée de réprimer l'abus, c'était uniquement dans l'intérêt de l'usage, c'est-à-dire pour qu'il ne fût permis à personne de le troubler, et il tombe sous le sens, qu'on n'a pu vouloir l'autoriser à faire elle-même le mal qu'elle était expressément chargée d'interdire à tous.
On a dit que restreindre à ce point la tâche de l'autorité souveraine, ce serait limiter infiniment trop ses attributions; que cette autorité n'aurait rien a faire, si elle n'était chargée que du maintien de l'ordre et de la paix, de l'administration de la justice, de l'entretien des bonnes relations, de la formation des citoyens aux habitudes de la vie sociale; qu'on avait pu soutenir ces choses-là du temps de la Restauration, et sous un gouvernement qui s'était laissé subjuguer par des tendances anti-nationales, mais qu'une telle prétention était insoutenable sous un gouvernement national; qu'un gouvernement national ne pouvait être chargé de trop de choses; que sa mission véritable était de conduire toutes les affaires de la société, de se mêler directement à tous ses travaux, de se montrer le promoteur habile et actif de toutes les grandes entreprises, etc.
Je n'essaierai pas de dire ce qu'ont fait de mal ces théories, reproduites à satiété depuis la révolution de 1830; ce qu'elles ont fomenté de corruption, ce qu'elles ont préparé de difficultés à l'avenir, ce qu'elles ont semé de germes de trouble, ce qu'elles ont mis notamment de confusion dans les idées, et à quel point elles ont altéré le peu d'intelligence qu'on avait acquis durant la Restauration des véritables attributions de l'État, attributions dont tous les bons esprits alors s'efforçaient de se former des idées justes, et dont le sentiment depuis semble s'être entièrement perdu. Je me borne à faire remarquer combien est destitué de sens le motif sur lequel ces théories se fondent, et ce qu'il y a d'absurde à dire que les attributions de l'État, limitées ainsi qu'il a été dit plus haut, seraient infiniment trop restreintes.
On ne prend pas garde que le travail de cette limitation, qui ne saurait s'opérer sans son concours, sera déjà pour lui une tâche immense, et qu'il ne parviendra à accomplir qu'avec infiniment de temps, de soins et d'efforts.195
On ne sent pas suffisamment d'ailleurs combien sa tâche, alors même que déjà elle aurait été ainsi transformée, serait encore considérable, et quel travail ce sera, dans tous les temps, que le maintien, au sein d'une liberté croissante, d'un ordre toujours plus exact; que le soin de faire naître et d'entretenir entre les hommes des relations de plus en plus perfectionnées; qu'une habile et active administration, en un mot, de la justice civile et pénale, et, avant tout, qu'une juste et intelligente détermination de ce qui doit être permis et de ce qui doit être défendu.
Cette tâche, qu'on trouve si simple, exigerait bien des améliorations dans la plupart de nos codes, et l'on ne prend pas garde combien, à beaucoup d'égards, ils l'ont encore imparfaitement remplie; combien notamment ils renferment de preuves que le législateur n'a pas suffisamment connu les lois économiques de la société et les conditions naturelles de son développement; combien à cet égard il s'est glissé d'erreurs dans nos lois civiles;196 combien nos lois administratives apportent de restrictions indues à la liberté du travail; combien, au milieu de tant de gênes inutiles, il manque encore à l'ordre de désirables garanties; combien finalement il reste d'imperfections dans le départ qui a été fait du tien et du mien, du bien et du mal, des choses à autoriser ou à interdire, dans le choix des formes destinées à régler l'application de la loi au fait, dans celui des peines employées à réprimer les faits punissables et à corriger les penchants anti-sociaux. Il est certainement permis de dire que dans beaucoup de ces choses il n'y a encore, à bien des égards, que des à peu près, et que l'art de gouverner les hommes, qui semble avancé quand on songe à la rudesse et à la grossièreté de ses débuts, est encore dans un état d'enfance, comparé à ce qu'il est susceptible de devenir, et à ce qu'il deviendra de plus en plus sans doute, à mesure que le gouvernement, dont l'activité s'est fourvoyée dans tant de fausses directions, concentrera davantage cette activité, sollicitée aujourd'hui par tant d'objets étrangers à ses attributions véritables, sur l'objet essentiel qui devrait l'occuper, c'est-à-dire sur le soin si grave, si compliqué et si étendu de réprimer les faits nuisibles, de corriger les penchants anti-sociaux, de former, en un mot, les habitudes qui doivent présider aux relations.
….
[Section 4. - En quoi consiste le talent et la spéculation dans l'art du gouvernement. pp. 375-386]
Et d'abord nous allons reconnaître aisément qu'il n'est pas d'art où soient plus hautement réclamés les divers ordres de talents qui constituent le génie des affaires, et en premier lieu le talent du spéculateur.
S'il est un art, en effet, où l'on ait été possédé du démon de la spéculation, depuis un demi-siècle surtout, et au milieu des passions ambitieuses ou cupides que nos révolutions ont soulevées, cet art est certainement la politique. Non-seulement il n'en est pas où l'on ait spéculé davantage, mais il n'en est pas où les spéculations aient été habituellement plus irréfléchies et aient abouti plus fréquemment à des résultats déplorables. Qui pourrait compter dans les pays libres de l'Europe les échecs qu'ont essuyés les partis, seulement depuis cinquante ans? Qui pourrait dire ce qu'il a été fait régulièrement ou irrégulièrement de tentatives de réformes, et combien en noterait-on qui aient été menées habilement et heureusement à fin? Quelles séries de mécomptes, de déboires, d'entreprises avortées, de mystifications cruelles? Quel était l'objet proposé, et quels ont été, la plupart du temps, les résultats obtenus? Combien de violences n'est-il pas sorti d'entreprises destinées à mieux assurer les droits de tous? Quels désordres ne sont pas nés de spéculations qui visaient à rendre les relations plus justes, plus régulières et plus paisibles? Que de projets qui devaient hâter le cours de la prospérité générale, et qui n'ont amené que des déprédations et des destructions? Et quels n'ont pas été les retours des révolutions même les plus heureuses? Quelle peine les plus triomphantes n'ont-elles pas eu à trouver un milieu où elles pussent se fixer? Quand s'arrêteront et à quoi s'arrêteront celle de l'Amérique espagnole et celle de l'Espagne? Combien, chez nous, même, où, dès le début, on avait peut-être plus d'avance, n'y a-t-il pas eu, depuis cinquante ans, de changements de régime; et maintenant que nous semblons être parvenus à un régime plus stable, quelle instabilité encore dans les ministères et dans les majorités qui les appuient, et comment ne pas reconnaître ce qu'il reste d'incertitude dans nos principes, quand on songe que, depuis la révolution de 1830, nous avons eu treize ministères en dix ans, tandis qu'en quatre-vingt-sept ans l'Angleterre n'en a eu que vingt-quatre?197 Enfin, dans les réformes de détail qu'on a entreprises, combien d'erreurs encore et de lacunes et d'incorrections? Combien de choses mal commencées et qu'il a fallu reprendre en sous œuvre? Combien de choses qu'on croyait avoir terminées, de choses décrétées et redécrétées, et qui sont toujours à faire ou a refaire?
Et veut-on savoir d'où sont venues toutes ces déceptions? de ce que les spéculateurs politiques spéculaient mal; de ce que les réformes qu'ils tentaient de faire n'étaient presque jamais convenablement et suffisamment préparées. Ces spéculateurs ne savaient pas assez combien ils avaient de choses à considérer, combien ils avaient de précautions à prendre, et quelle distance il y a trop souvent dans leur art des vérités consacrées par la théorie aux vérités devenues susceptibles d'application? Les spéculateurs politiques ont ordinairement le tort de croire que tout ce qui est vrai en droit pourrait être immédiatement traduit en fait, ou, plus brièvement, que tout ce qui est vrai est praticable. Ils font profession de penser que les idées les plus justes sont nécessairement les plus communes; que les plus avancées sont par cela même les plus généralement reçues; que le public, en fait de lois, a la science infuse; qu'une multitude d'hommes, médiocrement instruits en particulier, doivent naturellement former un peuple intelligent, pris en masse; que la volonté générale ne peut pas errer; qu'on ne saurait, en conséquence, reconnaître trop de droits à la généralité des habitants d'un pays; qu'il suffit de leur attribuer de grands pouvoirs, pour être sûr qu'ils en feront un bon usage; qu'on perfectionne toujours l'autorité en en généralisant l'exercice, et que le vrai moyen de l'avancer est de la faire descendre; que d'ailleurs, alors même qu'une nation est peu avancée, on peut suppléer aisément par l'émotion à ce qui lui manque de lumières, la moraliser en l'exaltant, lui donner des vertus par ordonnance, suppléer aux mœurs par les lois, neutraliser les vices du fond par l'adresse et la subtilité des formes, et, alors même qu'elle serait dominée par le plus âpre égoïsme, la constituer de si bonne sorte, qu'elle agisse comme si elle n'était déterminée que par la considération désintéressée du bien général.198
C'est ainsi que les spéculateurs raisonnent. Et quels exemples n'out-ils pas donné, de nos jours, de ces divers écarts? Quelles espérances, depuis un demi-siècle, n'a-t-on pas fondé sur l'extension des droits politiques, abstraction faite de l'aptitude naturelle et de l'expérience acquise des populations? Que n'a-t-on pas attendu des déclarations de droits? Quelle foi n'a-t-on pas placée dans l'artifice des formes constitutionnelles? N'est-il pas vrai qu'on fait dépendre, avant tout, l'amélioration des pouvoirs publics de l'appel d'un plus grand nombre de citoyens à l'électorat, à l'éligibilité, et en général d'une participation plus étendue des populations à l'exercice des divers pouvoirs que le gouvernement embrasse? N'est-il pas vrai qu'en accusant les gouvernements de demeurer en arrière, on vise toujours davantage à faire partir le mouvement des réformes des classes les moins avancées? N'est-il pas vrai qu'on croit à la possibilité de suppléer par des artifices d'organisation à ce qu'il peut leur manquer de lumières et d'expérience? N'est-ce pas ainsi qu'on procède à peu près partout depuis cinquante ans? Les peuples de l'Amérique espagnole n'avaient-ils pas cru fermement qu'il leur suffisait de décréter chez eux les constitutions des États-Unis pour y établir des gouvernements pareils à ceux de l'Amérique septentrionale, et avaient-ils songé le moins du monde à la différence morale des situations? Enfin, ne tombe-t-on pas plus ou moins partout dans des erreurs du même genre, et quand on tient en général si peu compte du véritable état des populations, faut-il s'étonner des graves échecs qui sont au bout de tant de folles entreprises?
Le vice fondamental de la plupart de ces spéculations est de ne pas distinguer suffisamment ce qui peut être désirable en droit de ce qui en fait est praticable, ou ce qui est praticable maintenant de ce qui ne le sera que dans un avenir plus ou moins éloigné.
Les réformateurs qui demandent l'extension des droits politiques se fondent sur des banalités presque toujours excellentes en principe, théoriquement très vraies, mais qui, dans la plupart des cas, sont sans application possible, ou du moins actuellement possible. Comment croire, par exemple, à la nécessité actuelle parmi nous d'une extension des droits politiques, quand, dans les élections politiques, les plus importantes de toutes, il manque habituellement un nombre si considérable d'électeurs? quand le nombre des absents est encore plus grand dans les élections inférieures? Et comment croire qu'en abaissant le cens on trouverait plus de zèle, lorsqu'il est officiellement établi qu'à mesure que le cens s'abaisse, l'indifférence s'accroît?
D'un autre côté, les réformateurs qui désirent voir les pouvoirs publics libéralement et habilement organisés,expriment à leur tour un vœu qui est théoriquement fort raisonnable; mais ce qui est infiniment moins sensé, c'est de croire qu'une certaine organisation des pouvoirs publics suffirait pour neutraliser les vices des éléments dont on les aurait formés. Réunissez beaucoup d'hommes, disait Franklin, et vous réunirez inévitablement avec eux ce qu'ils peuvent avoir d'ignorance, de passions, de vices, de travers d'esprit de toute espèce. Nulle habileté politique ne pourrait faire instantanément d'un peuple ce qu'il n'est pas. Plus on lui donnerait des institutions libérales, et plus au contraire il s'y montrerait tel qu'il est. Il n'est pas d'artifice, d'organisation, l'expérience l'a assez prouvé, qui eût le pouvoir de lui épargner une sottise ou une violence que ses instincts ou le calcul mal éclairé de ses intérêts le pousseraient à commettre. Quoi de plus juste, théoriquement parlant, que la demande de l'abolition de l'esclavage, et quoi de plus libéral, d'un autre côté, que les constitutions des États-Unis? A-l-il été néanmoins au pouvoir de ces constitutions d'assurer aux abolitionistes l'exercice de leur incontestable droit, ou même de préserver leur sûreté, et n'ont-ils pas été impunément poursuivis, traqués, lapidés, d'un bout de l'Union à l'autre? Je ne cite que cet exemple, et j'en pourrais citer des milliers. Une libérale organisation des pouvoirs publics, en principe fort désirable, ne répond à elle seule de rien, et les spéculations sur la forme de ces pouvoirs, abstraction faite de la nature des éléments dont ils sont formés, sont le leurre le plus grossier qu'il soit possible de présenter à des hommes raisonnables.
Enfin, les spéculateurs politiques qui veulent faire servir les pouvoirs constitués à la réforme de tel abus ou à l'établissement de tel principe, peuvent, en cela sans doute, entreprendre une chose excellente théoriquement. Mais si l'abus attaqué n'est pas suffisamment ruiné dans les intelligences, ou si le principe qui doit prendre sa place n'y est pas suffisamment établi, il n'y aura guère pour les auteurs de cet essai de réforme prématurée de chances de succès possible, et l'entreprise, excellente en théorie, avortera très probablement à l'application.
Qu'il s'agisse donc d'élargir la base des pouvoirs publics, de les mieux organiser, ou d'en faire les applications plus éclairées et plus libérales, il ne suffit pas de rechercher, comme les novateurs politiques, ce qui est désirable en principe, il faut tenir le plus grand compte de ce qui est praticable en fait.
Il semble en vérité qu'on n'ait jamais remarqué à quel point diffèrent ces deux ordres de recherches. Il faut pourtant prendre garde que les procédés de l'esprit n'y sont nullement pareils. Et en effet, tandis que le théoricien qui cherche ce qui est vrai, fait abstraction de toutes les circonstances, le praticien, pour arriver à la vérité, c'est-a-dire pour discerner ce qui est réellement praticable, est obligé, lui, de tenir compte de toutes les circonstances, et d'examiner quelles sont, des vérités que la théorie enseigne, celles qui ne rencontreraient pas trop de résistance dans les faits.
Sûrement les deux espèces de recherches sont fort essentielles, et si un spéculateur sensé doit tenir compte avec le plus grand soin de la situation actuelle de la société, et ne rien tenter au-delà de ce que sa situation comporte, il ne doit pas se préoccuper avec moins d'attention et de sollicitude de sa fin, de ses tendances générales et des lois naturelles de son développement.
Rien, je l'avoue, ne me paraît moins digne d'un praticien éclairé et prévoyant que de parler légèrement des vérités de théorie, que de les reléguer parmi ces vérités qui ne sont bonnes que pour les livres, qui ne valent rien pour la conduite des affaires, et de ne consentir à leur rendre hommage en principe qu'à condition de n'en jamais tenir compte en fait; à peu près comme ces honnêtes débiteurs qui ne mettent un certain empressement à reconnaître leur dette qu'à condition qu'on se tiendra ainsi pour satisfait, et qu'on ne poussera jamais l'exigence jusqu'à vouloir que la dette soit payée.
Non: un homme d'État avisé ne rend pas seulement hommage aux saines théories; il tend encore, autant du moins qu'il le peut avec sûreté, à se rapprocher des directions qu'elles indiquent; il n'a accompli entièrement sa lâche que lorsqu'il a travaillé avec une égale sincérité à démêler les vérités applicables et à en préparer de loin l'application.
Mais notons bien et proclamons avec fermeté qu'il ne doit procéder à l'application des vérités, même les plus saines, alors surtout qu'elles n'ont pas été éprouvées, qu'avec une extrême réserve et en ménageant les transitions avec le plus grand art.
Il n'y a d'hommes d'État complètement dignes de ce nom que ceux qui joignent à beaucoup de lumières encore plus d'expérience, et qui, théoriciens émérites, sont, en outre, des hommes d'exécution très habiles et très exercés.
Un réformateur politique a deux tâches essentielles à remplir: préparer la société à tous les biens désirables, faire actuellement le bien possible. Mais s'il doit toujours tendre au mieux désirable, il ne doit jamais tenter actuellement que le bien réellement préparé.
Le comble de la démence serait de proposer à un gouvernement sage de se placer à la tête des esprits novateurs. Un gouvernement ne peut gouverner qu'avec les idées qui gouvernent, avec des idées qui aient acquis une grande et incontestable majorité: n'est-ce pas assez dire qu'il ne pourrait rien avec des idées nouvelles, et qu'il doit s'en éloigner avec soin? Un gouvernement doit se tenir loin des nouveautés, même alors qu'elles sont justes, et uniquement parce qu'elles sont des nouveautés. De ce que des idées universellement reçues aujourd'hui ont été des paradoxes autrefois, n'ayons pas la folie d'inférer qu'il pourrait gouverner par des paradoxes. Son devoir, au contraire, est d'écarter les idées paradoxales, même les plus heureuses, jusqu'à ce qu'elles aient eu la gloire de devenir des lieux communs, et d'attendre que les principes justes, mais nouveaux, professés par quelques esprits d'élite isolés, soient passés à l'état de persuasion générale.
En d'autres termes, c'est au milieu des idées qui dominent qu'est la vrai place de toute domination. C'est là que lui commande de se tenir, non-seulement la prudence, mais encore, notons-le bien, la justice. La justice, en effet, ne veut pas que la minorité gouverne. En vain alléguerait-elle la bonne foi et la fermeté de ses convictions: la majorité, autrement impressionnée qu'elle, pourrait se dire et être en effet tout aussi fermement convaincue, et elle aurait en outre l'avantage si décisif d'être la majorité.
En vain encore la minorité remarquerait-elle que la raison a toujours commencé par être en minorité: on lui ferait cette réponse péremptoire que de ce que la raison commence toujours par être en minorité, il ne s'ensuit pas que la minorité a toujours raison; on lui dirait que si la minorité a raison c'est à elle de le faire voir, en tâchant a force de bon sens, de bons arguments, de zèle, de patience, de désintéressement, de courage, de persévérance, de faire passer le grand nombre de son côté; on lui dirait enfin que, fût-elle la raison même, la minorité ne mérite d'avoir raison qu'après s'être fait reconnaître pour ce qu'elle est, après s'être rendue familière aux intelligences, après avoir convaincu les moins éclairées et les plus défiantes de la justesse et de la pureté de ses vues, après avoir lentement, péniblement, laborieusement conquis la majorité.
C'est faute de vouloir se plier à ces règles élémentaires de bon sens et de justice, et parce qu'ils s'obstinent à en suivre de tout opposées; parce qu'ils refusent de distinguer ce qui est vrai de ce qui est praticable; parce qu'il leur convient de tenir pour praticable tout ce qu'ils trouvent leur compte à faire passer pour vrai; parce qu'ils ne veulent pas se donner le temps de vérifier, de mûrir leurs idées, de les accréditer, d'en préparer sagement l'application; parce qu'ils ne songent qu'à forcer la marche des choses, qu'à faire des surprises à l'opinion, qu'à exalter au lieu d'instruire, qu'à remplacer les voies lentes de l'examen et de la discussion par les entreprises héroïques et les procédés expéditifs; c'est, en un mot, parce qu'ils spéculent mal, déplorablement mal, que tant de spéculateurs politiques échouent. Je reconnais volontiers qu'il n'est pas d'art où l'on voie tant de désappointements, de déconvenues, de désastres, de forces perdues, d'entreprises avortées; mais on avouera qu'il n'en est pas où l'on se livre à plus de spéculations folles et que si les échecs y sont innombrables, ils y sont, en outre, presque toujours mérités.
Reconnaissons donc que s'il est un talent dont le besoin s'y fasse sentir, c'est celui que dans tous les arts nous avons placé en première ligne, le talent de la spéculation, c'est-à-dire le talent de discerner les choses qu'on peut raisonnablement entreprendre, les idées justes qu'on peut chercher à accréditer, et, parmi les idées justes plus ou moins accréditées, celles qui sont devenues assez familières, qui ont obtenu un assentiment assez ferme, assez éclairé, assez général, pour qu'on puisse, sans injustice et sans imprudence, essayer de les convertir en lois.
Autant il en faut dire de cette autre partie du génie des affaires que nous désignons par le nom de talents administratifs. Il n'est personne qui ne sache à quel point ces talents sont nécessaires au succès de toute réforme, au triomphe de toute nouvelle loi. C'est peu de ne décréter que des choses justes, sensées et tenues à bon droit pour praticables, il faut encore savoir en préparer habilement la mise en action. La réforme la mieux conçue échoue, si elle n'est organisée avec une certaine intelligence et convenablement pratiquée. Combien d'excellentes innovations qu'on a rendues vaines, dans tous les temps, par la maladresse ou la négligence de la mise en œuvre? Qu'importerait de proclamer la liberté la plus légitime, si l'on dédaignait de prévoir les délits qu'elle pourra servir à commettre, et de décider comment il sera pourvu à la répression de ces délits, ou bien si, ces précautions ayant été prises, on négligeait de s'en servir et même de faire matériellement les dispositions nécessaires pour cela? Que pouvait devenir la liberté, qu'on a quelque temps tolérée, des représentations théâtrales, en l'absence de toute disposition faite pour en réprimer les excès? Que serait devenue la liberté de la presse sans les lois qui ont été rendues pour forcer les écrivains à en modérer l'usage, et sans l'ensemble des mesures qui ont été prises pour réaliser l'exécution de ces lois? Je n'insiste pas sur une vérité naturellement évidente. Le premier besoin de tout réformateur est, sans doute, de ne rien précipiter, de spéculer toujours avec sagesse; mais une autre condition, non moins indispensable au succès de ses réformes, c'est qu'elles soient bien administrées.
Me permettra-t-on d'ajouter qu'au talent de l'administrateur il est essentiel qu'il réunisse, ainsi que tout autre entrepreneur, celui du comptable, pris dans une acception très élevée, et qu'il doit savoir apprécier avec un haut discernement le produit et la dépense? La proposition, singulière en apparence, est au fond essentiellement vraie. Il n'y a pas à en douter, le spéculateur politique, ainsi que tout autre spéculateur, ne doit pas seulement être en état de juger si la chose qu'il veut entreprendre répond à un besoin réel de la société, et avoir en outre le talent de la mettre en œuvre, il faut aussi qu'il soit capable de juger si le produit vaudra ses frais. La réforme à laquelle il songe aurait, il le croit, de bons effets; la majorité des hommes instruits en jugent de même, et ils la désirent ainsi que lui. En est-ce assez pour l'entreprendre? Peut-être non. Si, pour opérer ce changement, en apparence si désirable, il y avait encore de forts obstacles à surmonter, s'il fallait s'engager dans des luttes longues et peut-être meurtrières, risquer la vie d'un bon nombre de citoyens, troubler la paix de beaucoup d'autres, interrompre le cours paisible des idées, éveiller dans les cœurs les passions haineuses, diviser peut-être pour longtemps diverses classes de la société, il se pourrait que la réforme parût chère: il faut qu'il soit en état de l'apprécier; il le faut, même alors que les esprits y sembleraient le mieux préparés, et qu'il ne croirait pas avoir de si tristes résultats à craindre; il est bon, dans tous les cas, qu'il sache ouvrir à l'entreprise un compte intelligent et régulier qui fasse connaître ce qu'elle coûte et ce qu'elle rapporte, non pas seulement en francs et en centimes, bien que ce côté du compte ne soit nullement à dédaigner, mais en toute sorte de biens et de maux; qu'il sache la créditer de tous les avantages qu'elle procure, la débiter de tous les inconvénients qu'elle entraîne; et se mettre, par cette sorte de comptabilité morale en partie double, en état de l'apprécier sous tous les rapports, de juger par où elle réussit et par où elle pèche, en quoi elle mérite d'être maintenue et dans quels points elle aurait besoin d'être rectifiée.
Tous les talents qui constituent le génie des affaires, celui du spéculateur, celui du comptable, celui de l'administrateur, trouvent ainsi l'application la plus directe dans l'art élevé qui a pour mission spéciale de régler les relations, de former les habitudes sociales, et sont le premier ordre de moyens dont le gouvernement ait besoin pour agir avec sécurité et avec puissance, notamment pour procéder à la réforme des divers pouvoirs qui le constituent.
…
31.Bastiat on "Refuting Economic Fallacies I: Petition of the Candle-makers" (1845)↩
[Word Length: 1,504]
Source
Frédéric Bastiat, Sophismes économiques. Première série. 4e Édition (Paris: Guillaumin, 1851). 1e édition 1845. Chap. VII. ""Pétitions des fabricants de chandelles…", pp. 83-90. This essay was first published in the Journal des Économistes, October 1845
VII. Pétitions
Des Fabricants De Chandelles, Bougies, Lampes, Chandeliers, Réverbères, Mouchettes, Éteignoirs, et des Producteurs de Suif, Huile, Résine, Alcool, et généralement de tout ce qui concerne l'éclairage.
A MM. les membres de la Chambre des Députés,
« Messieurs,
« Vous êtes dans la bonne voie. Vous repoussez les théories abstraites; l'abondance, le bon marché vous louchent peu. Vous vous préoccupez surtout du sort du producteur. Vous le voulez affranchir de la concurrence extérieure, en un mot, vous voulez réserver le marché national au travail national.
«Nous venons vous offrir une admirable occasion d'appliquer votre... comment dirons-nous? votre théorie? non, rien n'est plus trompeur que la théorie; votre doctrine? votre système? votre principe? mais vous n'aimez pas les doctrines, vous avez horreur des systèmes, et, quant aux principes, vous déclarez qu'il n'y en a pas en économie sociale; nous dirons donc votre pratique, votre pratique sans théorie et sans principe.
« Nous subissons l'intolérable concurrence d'un rival étranger placé, à ce qu'il paraît, dans des conditions tellement supérieures aux nôtres, pour la production de la lumière, qu'il en inonde notre marché national à un prix fabuleusement réduit; car, aussitôt qu'il se montre, notre vente cesse, tous les consommateurs s'adressent à lui, et une branche d'industrie française, dont les ramifications sont innombrables, est tout à coup frappée de la stagnation la plus complète. Ce rival, qui n'est autre que le soleil, nous fait une guerre si acharnée, que nous soupçonnons qu'il nous est suscité par la perfide Albion (bonne diplomatie par le temps qui court!), d'autant qu'il a pour cette île orgueilleuse des ménagements dont il se dispense envers nous.
« Nous demandons qu'il vous plaise faire une loi qui ordonne la fermeture de toutes fenêtres, lucarnes, abat-jour, contre-vents, volets, rideaux, vasistas, œils-de-bœuf, stores, en un mot, de toutes ouvertures, trous, fentes et fissures par lesquelles la lumière du soleil a coutume de pénétrer dans les maisons, au préjudice des belles industries dont nous nous flattons d'avoir doté le pays, qui ne saurait sans ingratitude nous abandonner aujourd'hui à une lutte si inégale.
« Veuillez, Messieurs les députés, ne pas prendre notre demande pour une satire, et ne la repoussez pas du moins sans écouler les raisons que nous avons à faire valoir à l'appui.
« Et d'abord, si vous fermez, autant que possible, tout accès à la lumière naturelle, si vous créez ainsi le besoin de lumière artificielle, quelle est en France l'industrie qui, de proche en proche, ne sera pas encouragée?
« S'il se consomme plus de suif, il faudra plus de bœufs et de moutons, et, par suite, on verra se multiplier les prairies artificielles, la viande, la laine, le cuir, et surtout les engrais, cette base de toute richesse agricole.
« S'il se consomme plus d'huile, on verra s'étendre la culture du pavot, de l'olivier, du colza. Ces plantes riches et épuisantes viendront à propos mettre à profit cette fertilité que l'élève des bestiaux aura communiquée à notre territoire.
« Nos landes se couvriront d'arbres résineux. De nombreux essaims d'abeilles recueilleront sur nos montagnes des trésors parfumés qui s'évaporent aujourd'hui sans utilité, comme les fleurs d'où ils émanent. Il n'est donc pas une branche d'agriculture qui ne prenne un grand développement.
« Il en est de même de la navigation: des milliers de vaisseaux iront à la pèche de la baleine, et dans peu de temps nous aurons une marine capable de soutenir l'honneur de la France et de répondre à la patriotique susceptibilité des pétitionnaires soussignés, marchands de chandelles, etc.
«Mais que dirons-nous de l'article Paris? Voyez d'ici les dorures, les bronzes, les cristaux en chandeliers, en lampes, en lustres, en candélabres, briller dans de spacieux magasins auprès desquels ceux d'aujourd'hui ne sont que des boutiques.
« Il n'est pas jusqu'au pauvre résinier, au sommet de sa dune, ou au triste mineur au fond de sa noire galerie, qui ne voie augmenter son salaire et son bien-être.
« Veuillez y réfléchir, Messieurs; et vous resterez convaincus qu'il n'est peut-être pas un Français, depuis l'opulent actionnaire d'Anzin jusqu'au plus humble débitant d'allumettes, dont le succès de notre demande n'améliore la condition.
« Nous prévoyons vos objections, Messieurs; mais vous ne nous en opposerez pas une seule que vous n'alliez la ramasser dans les livres usés des partisans de la liberté commerciale. Nous osons vous mettre au défi de prononcer un mot contre nous qui ne se retourne à l'instant contre vous-mêmes et contre le principe qui dirige toute votre politique.
« Nous direz-vous que, si nous gagnons à cette protection, la France n'y gagnera point, parce que le consommateur en fera les frais?
« Nous vous répondrons:
«Vous n'avez plus le droit d'invoquer les intérêts du consommateur. Quand il s'est trouvé aux prises avec le producteur, en toutes circonstances vous l'avez sacrifié. — Vous l'avez fait pour encourager le travail, pour accroitre le domaine du travail. Par le même motif, vous devez le faire encore.
«Vous avez été vous-mêmes au-devant de l'objection. Lorsqu'on vous disait: Le consommateur est intéressé à la libre introduction du fer, de la houille, du sésame, du froment, des tissus. — Oui, disiez-vous, mais le producteur est intéressé à leur exclusion. — Eh bien, si les consommateurs sont intéressés à l'admission de la lumière naturelle, les producteurs le sont à son interdiction.
« Mais, disiez-vous encore, le producteur et le consommateur ne font qu'un. Si le fabricant gagne par la protection, il fera gagner l'agriculteur. Si l'agriculture prospère, elle ouvrira des débouchés aux fabriques. — Eh bien! si vous nous conférez le monopole de l'éclairage pendant le jour, d'abord nous achèterons beaucoup de suifs, de charbons, d'huiles, de résines, de cire, d'alcool, d'argent, de fer, de bronzes, de cristaux, pour alimenter notre industrie, et, de plus, nous et nos nombreux fournisseurs, devenus riches, nous consommerons beaucoup et répandrons l'aisance dans toutes les branches du travail national.
« Direz-vous que la lumière du soleil est un don gratuit, et que repousser des dons gratuits ce serait repousser la richesse môme sous prétexte d'encourager les moyens de l'acquérir?
« Mais prenez garde que vous portez la mort dans le cœur de votre politique; prenez garde que jusqu'ici vous avez toujours repoussé le produit étranger parce qu'il se rapproche du don gratuit, et d'autant plus qu'il se rapproche du don gratuit. Pour obtempérer aux exigences des autres monopoleurs, vous n'aviez qu'un demi-motif; pour accueillir notre demande, vous avez un motif complet, et nous repousser précisément en vous fondant sur ce que nous sommes plus fondés que les autres, ce serait poser l'équation: + X + = — ; en d'autres termes, ce serait entasser absurdité sur absurdité.
« Le travail et la nature concourent en proportions diverses, selon les pays et les climats, à la création d'un produit. La part qu'y met la nature est toujours gratuite; c'est la part du travail qui en fait la valeur et se paye.
«Si une orange de Lisbonne se vend à moitié prix d'une orange de Paris, c'est qu'une chaleur naturelle et par conséquent gratuite fait pour l'une ce que l'autre doit à une chaleur artificielle et partant coûteuse.
« Donc, quand une orange nous arrive de Portugal, on peut dire qu'elle nous est donnée moitié gratuitement, moitié à titre onéreux, ou, en d'autres termes, à moitié prix relativement à celles de Paris.
« Or, c'est précisément de cette demi-gratuité (pardon du mot) que vous arguez pour l'exclure. Vous dites: Comment le travail national pourrait-il soutenir la concurrence du travail étranger quand celui-là a tout à faire, et que celui-ci n'a à accomplir que la moitié de la besogne, le soleil se chargeant du reste? — Mais si la demi-gratuité vous détermine à repousser la concurrence, comment la gratuité entière vous porterait-elle à admettre la concurrence? Ou vous n'êtes pas logiciens, ou vous devez, repoussant la demi-gratuité comme nuisible à notre travail national, repousser a fortiori et avec deux fois plus de zèle la gratuité entière.
« Encore une fois, quand un produit, houille, fer, froment ou tissu, nous vient du dehors et que nous pouvons l'acquérir avec moins de travail que si nous le faisions nous-mêmes, la différence est un don gratuit qui nous est conféré. Ce don est plus ou moins considérable, selon que la différence est plus ou moins grande. Il est du quart, de moitié, des trois quarts de la valeur du produit, si l'étranger ne nous demande que les trois quarts, la moitié, le quart du payement. Il est aussi complet qu'il puisse l'être, quand le donateur, comme fait le soleil pour la lumière, ne nous demande rien. La question, et nous la posons formellement, est de savoir si vous voulez pour la France le bénéfice de la consommation gratuite ou les prétendus avantages de la production onéreuse. Choisissez, mais soyez logiques; car, tant que vous repousserez, comme vous le faites, la houille, le fer, le froment, les tissus étrangers, en proportion de ce que leur prix se rapproche de zéro, quelle inconséquence ne serait-ce pas d'admettre la lumière du soleil, dont le prix est à zéro, pendant toute la journée?»
32.Bastiat on "Refuting Economic Fallacies II: The Economic Benefits of a Negative Railway" (1845)↩
[Word Length: 277]
Source
Frédéric Bastiat, Sophismes économiques. Première série. 4e Édition (Paris: Guillaumin, 1851). 1e édition 1845. Chap. XVII. "Un chemin de fer négatif," pp. 138-39.
XVII. Un chemin de fer négatif.
J'ai dit que lorsque, malheureusement, on se plaçait au point de vue de l'intérêt producteur, on ne pouvait manquer de heurter l'intérêt général, parce que le producteur, en tant que tel, ne demande qu'efforts, besoins et obstacles.
J'en trouve un exemple ramarquable dans un journal de Bordeaux.
M. Simiot se pose cette question:
Le chemin de fer de Paris en Espagne doit-il offrir une solution de continuité à Bordeaux?
Il la résout affirmativement par une foule de raisons que je n'ai pas à examiner, mais par celle-ci, entre autres:
Le chemin de fer de Paris à Bayonne doit présenter une lacune à Bordeaux, afin que marchandises et voyageurs, forcés de s'arrêter dans cette ville, y laissent des profits aux bateliers, porte-balles, commissionnaires, cosignataires, hôteliers, etc.
Il est clair que c'est encore ici l'intérêt des agents du travail mis avant l'intérêt des consommateurs.
Mais si Bordeaux doit profiter par la lacune, et si ce profit est conforme à l'intérêt public, Angoulème, Poitiers, Tours, Orléans, bien plus, tous les points intermédiaires, Ruffec, Châtellerault, etc., etc., doivent aussi demander des lacunes, et cela dans l'intérêt général, dans l'intérêt bien entendu du travail national, car plus elles seront multipliées, plus seront multipliés aussi les consignations, commissions, transbordements, sur tous les points de la ligne. Avec ce système, on arrive à un chemin de fer composé de lacunes successives, à un chemin de fer négatif.
Que MM. les protectionistes le veuillent ou non, il n'en est pas moins certain que le principe de la restriction est le même que le principe des lacunes: le sacrifice du consommateur au producteur, du but au moyen.
33.Bastiat on “Free Trade” (1846-1848)↩
[Word Length: 6,805]
Source
Oeuvres complètes de Frédéric Bastiat, mises en ordre, revues et annotées d’après les manuscrits de l’auteur. Ed. Prosper Paillottet and biographical essay by Roger de Fontenay. (Paris: Guillaumin, 2nd ed. 1862-64). Tome deuxième: Le Libre-Échange (1862)
Articles from Le Libre-Échange:
1. Association pour la Liberté des Échanges "Déclaration," 10 mai 1846 [pp. 1-4].
1."Bornes que s'impose l'Association pour la liberté des échanges," 3 Janvier 1847. [pp.7-11].
2.17. “Le parti démocratique et le Libre-Échange,” 14 Mars 1847. [pp. 93-100].
63. "Le Maire d'Énios," 6 Février 1848. [pp. 418-29].
Association pour la Liberté des Échanges "Déclaration," 10 mai 1846, Le Libre-échange .
Au moment de s'unir pour la défense d'une grande cause, les soussignés sentent le besoin d'exposer leur croyance; de proclamer le but, la limite, les moyens et l'esprit de leur association.
L'échange est un droit naturel comme la PROPRIÉTÉ. Tout citoyen, qui a créé ou acquis un produit, doit avoir l'option ou de l'appliquer immédiatement à son usage, ou de le céder à quiconque, sur la surface du globe, consent à lui donner en échange l'objet de ses désirs. Le priver de cette faculté, quand il n'en fait aucun usage contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, et uniquement pour satisfaire la convenance d'un autre citoyen, c'est légitimer une spoliation, c'est blesser la loi de la justice.
C'est encore violer les conditions de l'ordre; car quel ordre peut exister au sein d'une société où chaque industrie, aidée en cela par la loi et la force publique, cherche ses succès dans l'oppression de toutes les autres!
C'est méconnaître la pensée providentielle qui préside aux destinées humaines, manifestée par l'infinie variété des climats, des saisons, des forces naturelles et des aptitudes, biens que Dieu n'a si inégalement répartis entre les hommes que pour les unir, par l'échange, dans les liens d'une universelle fraternité.
C'est contrarier le développement de la prospérité publique; puisque celui qui n'est pas libre d'échanger ne l'est pas de choisir son travail, et se voit contraint de donner une fausse direction à ses efforts, à ses facultés, à ses capitaux, et aux agents que la nature avait mis à sa disposition.
Enfin c'est compromettre la paix entre les peuples, car c'est briser les relations qui les unissent et qui rendront les guerres impossibles, à force de les rendre onéreuses.
L'Association a donc pour but la LIBERTÉ DES ÉCHANGES.
Les soussignés ne contestent pas à la société le droit d'établir, sur les marchandises qui passent la frontière, des taxes destinées aux dépenses communes, pourvu qu'elles soient déterminées par la seule considération des besoins du Trésor.
Mais sitôt que la taxe, perdant son caractère fiscal, a pour but de repousser le produit étranger, au détriment du fisc lui-même, afin d'exhausser artificiellement le prix du produit national similaire et de rançonner ainsi la communauté au profit d'une classe, dès cet instant la Protection ou plutôt la Spoliation se manifeste; et c'est là le principe que l'Association aspire à ruiner dans les esprit et à effacer complétement de nos lois, indépendamment de toute réciprocité et des systèmes qui prévalent ailleurs.
De ce que l'Association poursuit la destruction complète du régime protecteur, il ne s'ensuit pas qu'elle demande qu'une telle réforme s'accomplisse en un jour et sorte d'un seul scrutin. Même pour revenir du mal au bien et d'un état de choses artificiel à une situation naturelle, des précautions peuvent être commandées par la prudence. Ces détails d'exécution appartiennent aux pouvoirs de l'État; la mission de l'Association est de propager, de populariser le principe.
Quant aux moyens qu'elle entend mettre en œuvre, jamais elle ne les cherchera ailleurs que dans des voies constitutionnelles et légales.
Enfin l'Association se place en dehors de tous les partis politiques.199 Elle ne se met au service d'aucune industrie, d'aucune classe, d'aucune portion du territoire. Elle embrasse la cause de l'éternelle justice, de la paix, de l'union, de la libre communication, de la fraternité entre tous les hommes; la cause de l'intérêt général, qui se confond, partout et sous tous les aspects, avec celle du Public consommateur.
3. "Bornes que s'impose l'Association pour la liberté des échanges," Le Libre-Échange, 3 Janvier 1847. [pp.7-11]
Nous appelons l'impartiale et sérieuse attention du lecteur sur les limites que nous déclarons très-hautement imposer à notre action.
Certes, si nous courions après un succès de vogue, nous nous bornerions à crier: liberté! liberté! sans nous embarrasser dans des distinctions subtiles et risquer de consumer de longues veilles à nous faire comprendre. Mais ces subtilités, nous les avons regardées en face; nous nous sommes assurés qu'elles sont dans la nature des choses et non dans notre esprit. Dès lors, aucune considération ne nous induira à rejeter la difficile tâche qu'elles nous imposent.
Croit-on que nous ne sentions pas tout ce que, en commençant, nous aurions de force si nous nous présentions devant le public avec un programme d'un seul-mot: Liberté? Si nous demandions l'abolition pure et simple de la douane, ou si du moins, ainsi que cela a eu lieu en Angleterre, nous posions comme ultimatum la radiation totale et immédiate d'un article bien impopulaire du tarif?
Nous ne le faisons pas néanmoins. Et pourquoi? Parce que nous mettons nos devoirs avant nos succès. Parce que nous sacrifions, volontairement, et les yeux bien ouverts, un moyen certain de popularité à ce que la raison signale comme juste et légitime, acceptant d'avance toutes les lenteurs, tous les travaux auxquels cette résolution nous expose.
La première limite que nous reconnaissons à la liberté des transactions, c'est l'honnêteté. Est-il nécessaire de le dire? et ces hommes ne se découvrent-ils pas, ne laissent-ils pas voir qu'ils nous cherchent des torts imaginaires, ne pouvant nous en trouver de réels, qui nous accusent d'entendre par liberté le droit de tout faire, le mal comme le bien, — de tromper, frelater, frauder et violenter?
Le mot liberté implique de lui-même absence de fraude et de violence; car la fraude et la violence sont des atteintes à la liberté.
En matière d'échanges, nous ne croyons pas que le gouvernement puisse se substituer complétement à l'action individuelle, dispenser chacun de vigilance, de surveillance, avoir des yeux et des oreilles pour tous. Mais nous reconnaissons que sa mission principale est précisément de prévenir et réprimer la fraude et la violence; et nous croyons même qu'il la remplirait d'autant mieux, qu'on ne mettrait pas à sa charge d'autres soins qui, au fait, ne le regardent pas. Comment voulez-vous qu'il perfectionne l'art de rechercher et punir les transactions déshonnétes, quand vous le chargez de la tâche difficile et, nous le croyons, impossible, de pondérer les transactions innocentes, d'équilibrer la production et la consommation?
Une autre limite à la liberté des échanges, c'est l'IMPOT. Voilà une distinction, ou si l'on veut une subtilité à laquelle nous ne chercherons pas à échapper.
Il est évident pour tous que la douane peut être appliquée à deux objets fort différents, si différents que presque toujours ils se contrarient l'un l'autre. Napoléon a dit: La douane ne doit pas être un instrument fiscal, mais un moyen de protection. —Renversez la phrase, et vous avez tout notre programme.
Ce qui caractérise le droit protecteur, c'est qu'il a pour mission d'empêcher l'échange entre le produit national et le produit étranger.
Ce qui caractérise le droit fiscal, c'est qu'il n'a d'existence que par cet échange.
Moins le produit étranger entre, plus le droit protecteur atteint son but.
Plus le produit étranger entre, plus le droit fiscal atteint le sien.
Le droit protecteur pèse sur tous et profite à quelques-uns.
Le droit fiscal pèse sur tous et profite à tous.
La distinction n'est donc point arbitraire. Ce n'est pas nous qui l'avons imaginée. En l'acceptant nous ne faisons pas une concession, un pas rétrograde. Dès le premier jour, nous avons dit dans notre manifeste: « Les soussignés ne contestent pas à la société le droit d'établir, sur les marchandises qui passent la frontière, des taxes destinées aux dépenses communes, pourvu qu'elles soient déterminées par la seule considération des besoins du trésor. »
Pour rendre notre pensée plus claire, nous comparerons la douane à l'octroi.
Le tarif de l'octroi peut être plus ou moins bien conçu. Mais enfin chacun comprend qu'il a pour but exclusif l'impôt. Si un propriétaire parisien, qui aurait des arbres dans l'enclos de son hôtel, venait dire au conseil municipal: « Quadruplez, décuplez, centuplez le droit d'entrée sur les bûches, prohibez-les même, afin que je tire un meilleur parti de mon bois; et si, les bûches n'arrivant plus du dehors, vous perdez une partie de vos recettes, frappez un impôt sur le peuple pour combler le vide. » N'est-il pas clair que cet homme voudrait enter sur l'octroi un nouveau principe, une nouvelle pensée; — qu'il chercherait à le faire dévier de son but; et ne serait-il pas naturel qu'une société se formât dans Paris pour combattre cette prétention, sans pour cela s'élever contre le tarif fiscal de l'octroi, sans le juger, sans même s'en occuper.
Cet exemple montre quelle est l'attitude que la Société du libre-échange entend garder à l'égard des impôts.
Cette attitude est celle de la neutralité.
Ainsi que nous l'avons dit dans notre manifeste, nous aspirons à ruiner la protection dans les esprits, afin qu'elle disparaisse de nos lois.
Vouloir en outre détruire la douane fiscale, ce serait nous donner une seconde mission toute différente de la première. Ce serait nous charger de juger les impôts, dire ceux qu'il faut supprimer, par quoi il faut les remplacer.
Certes aucun de nous ne renonce au droit sacré de scruter et combattre au besoin telle ou telle taxe. Nous trouvons même naturel que des associations se forment dans ce but. Mais ce n'est pas le nôtre. En tant qu'association, nous n'avons qu'un adversaire, c'est le principe restrictif qui s'est enté sur la douane et s'en est fait un instrument.
On nous demande: Pourquoi, dans ce cas, demander le libre-échange et non l'abolition du régime des douanes?
Parce que nous ne regardons pas l'impôt en lui-même comme une atteinte à la liberté.
Nous demandons la liberté de l'échange comme on demandait la liberté de la presse, sans exclure qu'une patente dût être payée par l'imprimeur.
Nous demandons la liberté de l'échange comme on demande le respect de la propriété, sans refuser d'admettre l'impôt foncier.
On nous dit: Quand la douane, à vos yeux, cesse-t-elle d'être fiscale pour commencer à être protectrice?
Quand le droit est tel que, s'il était diminué, il donnerait autant de revenu.
On insiste et l'on dit: Comment reconnaître dans la pratique ce point insaisissable?
Eh! mon Dieu, c'est bien simple, avec de la bonne volonté. Que l'opinion soit amenée à comprendre, c'est-à-dire à repousser la protection, et le problème sera bientôt résolu. Il n'y a pas de ministres de finances qui n'y donne la main. La difficulté, la seule difficulté est de faire qu'il soit soutenu par l'opinion publique.
17. “Le parti démocratique et le Libre-Échange,” 14 Mars 1847. [pp. 93-100].
Quand nous avons entrepris de défendre la cause de la liberté des échanges, nous avons cru et nous croyons encore travailler principalement dans l'intérêt des classes laborieuses, c'est-à-dire de la démocratie, puisque ces classes forment l'immense majorité de la population.
La restriction douanière nous apparaît comme une taxe sur la communauté au profit de quelques-uns. Cela est si vrai qu'on pourrait y substituer un système de primes qui aurait exactement les mêmes effets. Certes, si, au lieu de mettre un droit de cent pour cent sur l'entrée du fer étranger, on donnait, aux frais du trésor, une prime de cent pour cent au fer national, celui-ci écarterait l'autre du marché tout aussi sûrement qu'au moyen du tarif.
La restriction douanière est donc un privilége conféré par la législature, et l'idée même de démocratie nous semble exclure celle de privilége. On n'accorde pas des faveurs aux masses, mais, au contraire, aux dépens des masses.
Personne ne nie que l'isolement des peuples, l'effort qu'ils font pour tout produire en dedans de leurs frontières ne nuise à la bonne division du travail. Il en résulte donc une diminution dans l'ensemble de la production, et, par une conséquence nécessaire, une diminution correspondante dans la part de chacun au bien-être et aux jouissances de la vie.
Et s'il en est ainsi, comment croire que le peuple en masse ne supporte pas sa part de cette réduction? comment imaginer que la restriction douanière agit de telle sorte, que, tout en diminuant la masse des objets consommables, elle en met plus à la portée des classes laborieuses, c'est-à-dire de la généralité, de la presque totalité des citoyens? Il faudrait supposer que les puissants du jour, ceux précisément qui ont fait ces lois, ont voulu être seuls atteints par la réduction, et non-seulement en supporter leur part, mais encore encourir celle qui devait atteindre naturellement l'immense masse de leurs concitoyens.
Or, nous le demandons, est-ce là la nature du privilége? Sont-ce là ses conséquences naturelles?
Si nous détachons de la démocratie la classe ouvrière, celle qui vit de salaires, il nous est plus impossible encore d'apercevoir comment, sous l'influence d'une législation qui diminue l'ensemble de la richesse, cette classe parvient à augmenter son lot. On sait quelle est la loi qui gouverne le taux des salaires, c'est la loi de la concurrence. Les industries privilégiées vont sur le marché du travail et y trouvent des bras précisément aux mêmes conditions que les industries non privilégiées. Cette classe de salariés, qui travaillent dans les forges, les mines, les fabriques de drap et de coton, n'ont donc aucune chance de participer au privilége, d'avoir leur quote-part dans la taxe mise sur la communauté. — Et quant à l'ensemble des salariés, puisqu'ils offrent sur le marché un nombre déterminé de bras, et qu'il y a sur ce même marché moins de produits qu'il n'y en aurait sous le régime de la liberté, il faut bien qu'ils donnent plus de travail pour une rémunération égale, ou plus exactement, autant de travail pour une moindre rémunération en produits; — à moins qu'on ne prétende qu'on peul tirer d'un tout plus petit des parts individuelles plus grandes.
Forts de cette conviction, nous devions nous attendre à rallier à notre cause les organes de la démocratie. Il n'en a pas été ainsi; et ils croient devoir faire à la liberté des échanges une opposition acerbe, aigre, empreinte d'une couleur haineuse aussi triste que difficile à expliquer. Comment est-il arrivé que ceux qui se posent, devant le pays, comme les défenseurs exclusifs des libertés publiques, aient choisi entre toutes une des plus précieuses de l'homme, celle de disposer du fruit de son travail, pour en faire l'objet de leur ardente opposition?
Assurément, si les meneurs actuels du parti démocratique (car nous sommes loin d'étendre à tout le parti nos observations) soutenaient systématiquement la restriction douanière, comme chose bonne en soi, nous ne nous reconnaîtrions pas le droit d'élever le moindre doute sur leurs intentions. Les convictions sincères sont toujours respectables, et tout ce qu'il nous resterait à faire, ce serait de ramener ce parti à nos doctrines en les appuyant de démonstrations concluantes. Tout au plus, nous pourrions lui faire observer qu'il a tort de se croire placé en tête des opinions libérales, puisqu'en toute sincérité, il juge dangereuse et funeste la liberté même qui est la plus immédiate manifestation de la société, la liberté d'échanger.
Mais ce n'est point là la position qu'ont prise les organes du parti démocratique. Ils commencent par reconnaître que la liberté des échanges est vraie en principe. Après quoi, ce principe vrai, ils le contrarient dans son développement, et ne perdent pas une occasion de le poursuivre de leurs sarcasmes.
Par cette conduite, le parti démocratique nous pousse fort au delà d'une simple discussion de doctrine. Il nous donne le droit et de lui soupçonner des intentions qu'il n'avoue pas et de rechercher quelles peuvent être ces intentions.
En effet, qu'on veuille bien suivre par la pensée tout ce qu'implique cette concession: La doctrine du libre-échange est vraie en principe.
Ou cela n'a aucun sens, ou cela veut dire: La cause que vous défendez est celle de la vérité, de la justice et de l'utilité générale. La restriction est un privilége arraché à la législature par quelques-uns aux dépens de la communauté. Nous reconnaissons qu'elle est une atteinte |à la liberté, une violation des droits de la propriété et du travail, qu'elle blesse l'égalité des citoyens devant la loi. Nous reconnaissons qu'elle devrait nous être essentiellement antipathique, à nous qui faisons profession de défendre plus spécialement la liberté,l'égalité des droits des travailleurs.
Voilà le sens et la portée de ces mots: Vous avez raison en principe; ou ils ne sont qu'une stérile formule, une précaution oratoire, indigne d'hommes de cœur et de chefs de parti.
Or, quand des publicistes ont fait une telle déclaration, et qu'on les voit ensuite ardents à étouffer non par le raisonnement, ils n'en ont plus le droit, mais par l'ironie et le sarcasme, le principe dont ils ont proclamé la justice et la vérité, nous disons qu'ils se placent dans une position insoutenable, qu'il y a dans cette tactique quelque chose de faux et d'anormal, une déviation des règles de la polémique sincère, une inconséquence dont nous sommes autorisés à rechercher les secrets motifs.
Qu'il n'y ait pas ici de malentendu. Nous sommes les premiers à respecter dans nos antagonistes le droit de se former une opinion et de la défendre. Nous ne nous croyons pas permis, en général, de suspecter leur sincérité, pas plus que nous ne voudrions qu'ils suspectassent la nôtre. Nous comprenons fort bien qu'on puisse, par une vue, selon nous, fausse ou incomplète du sujet, adopter systématiquement le régime protecteur, quelque opinion politique que l'on professe. A chaque instant nous voyons ce système défendu par des hommes sincères et désintéressés. Quel droit avons nous de leur supposer un autre mobile que la conviction? Quel droit avons-nous à opposer à des écrivains comme MM. Ferrier, Saint-Chamans, Mathieu de Dombasle, Dezeimeris, autre chose que le raisonnement?
Mais notre position est toute différente à l'égard des publicistes qui commencent par nous accorder que nous avons raison en principe. Eux-mêmes nous interdisent par là de raisonner, puisque la seule chose que nous puissions et voulions établir par le raisonnement, c'est justement celle-là, que nous avons raison en principe, en laissant à ce mot son immense portée.
Or, nous le demandons à tout lecteur impartial, quelle que soit d'ailleurs son opinion sur le fond de la question, les journaux qui montrent l'irritation la plus acerbe contre un principe qu'ils proclament vrai, qui se vantent d'être les défenseurs des libertés publiques et proscrivent une des plus précieuses de ces libertés, tout en reconnaissant qu'elle est de droit commun comme les autres, qui étalent tous les jours dans leurs colonnes leur sympathie pour le pauvre peuple, et lui refusent la faculté d'obtenir de son travail la meilleure rémunération, ce qui est d'après eux-mêmes le résultat de la liberté, puisqu'ils la reconnaissent vraie en principe, ces journaux n'agissent-ils pas contre toutes les règles ordinaires? Ne nous réduisent-ils pas à scruter le but secret d'une inconséquence aussi manifeste? car enfin, on a un but quand on s'écarte aussi ouvertement de cette ligne de rectitude, en dehors de laquelle il n'y a pas de discussion possible.
On dira sans doute qu'il est fort possible d'admettre sincèrement un principe et d'en juger avec la même sincérité l'application inopportune.
Oui, nous en convenons, cela est possible, quoique à vrai dire il nous soit difficile d'apercevoir ce qu'il y a d'inopportun à restituer aux classes laborieuses la faculté d'accroître leur bien-être, leur dignité, leur indépendance, à ouvrir à la nation de nouvelles sources de prospérité et de vraie puissance, à lui donner de nouveaux gages de sécurité et de paix, toutes choses qui se déduisent logiquement de cette concession, vous avez raison en principe.
Mais enfin, quelque juste, quelque bienfaisante que soit une réforme, nous comprenons qu'à un moment donné elle puisse paraître inopportune à certains esprits prudents jusqu'à la timidité.
Mais si l'opposition, que nous rencontrons dans les meneurs du parti démocratique, était uniquement fondée sur une imprudence excessive, sur la crainte de voir se réaliser trop brusquement ce règne de justice et de vérité auquel ils accordent leur sympathie en principe, on peut croire que leur opposition aurait pris un tout autre caractère. Il est difficile de s'expliquer, même dans cette hypothèse, qu'ils poursuivent de leurs sarcasmes amers les hommes qui, selon eux, défendent la cause de la justice et les droits des travailleurs, et qu'ils s'efforcent de mettre au service de l'injustice et du monopole l'opinion égarée de cette portion du public sur laquelle ils exercent le plus spécialement leur influence, et qui a le plus à souffrir des priviléges attaqués.
De l'aveu du parti démocratique (aveu impliqué dans cette déclaration: Vous avez raison en principe), la question du libre-échange a mis aux prises la justice et l'injustice, la liberté et la restriction, le droit commun et le privilége. En supposant même que ce parti, saisi tout à coup d'un esprit de modération et de long animité assez nouveau, nous considère comme des défenseurs trop ardents de la justice, de la liberté et du droit commun, est-il naturel, est-ce une chose conséquente à ses précédents, à ses vues ostensibles, et à sa propre déclaration, qu'il s'attache, avec une haine mal déguisée, à ruiner notre cause et à relever celle de nos adversaires?
De quelque manière donc qu'on envisage la ligne de conduite adoptée par les meneurs du parti démocratique dans ce débat, on arrive à cette conclusion qu'elle a été tracée par des motifs qu'on n'avoue pas. Ces motifs, nous ne les connaissons pas, et nous nous abstiendrons ici de hasarder des conjectures. Nous nous bornerons à dire que, selon nous, les publicistes auxquels nous faisons allusion sont entrés dans une voie qui doit nécessairement les déconsidérer et les perdre aux yeux de leur parti. Se lever ouvertement ou jésuitiquement contre la justice, le bien général, l'intérêt vraiment populaire, l'égalité des droits, la liberté des transactions, ce n'est pas un rôle que l'on puisse mener bien loin, quand on s'adresse à la démocratie et qu'on se dit démocrate. Et la précaution oratoire qu'on aurait prise, de se déclarer pour le principe, ne ferait que rendre l'inconséquence plus évidente et le dénoûment plus prochain.
63. "Le Maire d'Énios," 6 Février 1848. [pp. 418-29].
C'était un singulier Maire que le maire d'Énios. D'un caractère... Mais il est bon que le lecteur sache d'abord ce que c'est qu'Énios.
Énios est une commune de Béarn placée...
Pourtant, il semble plus logique d'introduire d'abord monsieur le Maire.
Bon! me voilà bien empêché dès le début. J'aimerais mieux avoir l'algèbre à prouver que Peau d'âne à conter.
O Balzac! ô Dumas! ô Suë! ô génies de la fiction et du roman moderne, vous qui, dans des volumes plus pressés que la grêle d'août, pouvez dévider, sans les embrouiller, tous les fils d'une interminable intrigue, dites-moi au moins s'il vaut mieux peindre le héros avant la scène ou la scène avant le héros.
Peut-être me direz-vous que ce n'est ni le sujet ni le lieu, mais le temps qui doit avoir la priorité.
Eh bien donc, c'était l'époque où les mines d'asphalte...
Mais je ferai mieux, je crois, de compter à ma manière. Énios est une commune adossée du côté du midi à une montagne haute et escarpée, en sorte que l'ennemi (c'est de l'échange que je parle), malgré sa ruse et son audace, ne peut, comme on dit en stratégie, ni tomber sur ses derrières, ni le prendre à revers.
Au nord, Énios s'étale sur la croupe arrondie de la montagne dont un Gave impétueux baigne le pied gigantesque.
Ainsi protégé, d'un côté par des pics inaccessibles, de l'autre par un torrent infranchissable, Énios se trouverait complétement isolé du reste de la France, si messieurs des ponts et chaussées n'avaient jeté au travers du Gave un pont hardi, dont, pour me conformer au faire moderne, je suis tenté de vous donner la description et l'histoire.
Cela me conduirait tout naturellement à faire l'histoire de noire bureaucratie: je raconterais la guerre entre le génie civil et le génie militaire, entre le conseil municipal, le conseil général, le conseil des ponts et chaussées, le conseil des fortifications et une foule d'autres conseils; je peindrais les armes, qui sont des plumes, et les projectiles, qui sont des dossiers. Je dirais comment l'un voulait le pont en bois, l'autre en pierre, celui-ci en fer, celui-là en fil de fer; comment, pendant cette lutte, le pont ne se faisait pas; comment ensuite, grâce aux sages combinaisons de notre budget, on commença plusieurs années de suite les travaux en plein hiver, de manière à ce qu'au printemps il n'en restât plus vestige; comment, quand le pont fut fait, on s'aperçut qu'on avait oublié la route pour y aboutir; ici, fureur du maire, confusion du préfet, etc. Enfin, je ferais une histoire de trente ans, trois fois plus intéressante par conséquent que celle de M. Louis Blanc. Mais à quoi bon? Apprendrais-je rien à personne?
Ensuite qui m'empêcherait de faire, en un demi-volume, la description du pont d'Énios, de ses culées, de ses piles, de son tablier, de ses garde-fous? N'aurais-je pas à ma disposition toutes les ressources du style à la mode, surtout la personnification? Au lieu de dire: On balaye le pont d'Énios tous les matins, je dirais: Le pont d'Énios est un petit maître, un dandy, un fashionable, un lion. Tous les matins son valet de chambre le coiffe, le frise, car il ne veut se montrer aux belles tigresses du Béarn, qu'après s'être assuré, en se mirant dans les eaux du Gave, que sa cravate est bien nouée, ses bottes bien vernies et sa toilette irréprochable. — Qui sait? On dirait peut-être du narrateur, comme Géronte de Damis: Vraiment il a du goût!
C'est selon ces règles nouvelles que je me propose de raconter, dès que j'aurai fait rencontre d'un éditeur bénévole à qui cela convienne. En attendant, je reprends la manière de ceux qui n'ont à leur disposition que deux ou trois petites colonnes de journal.
Figurez-vous donc Énios, ses vertes prairies, au bord du torrent, et, d'étage en étage, ses vignes, ses champs, ses pâturages, ses forêts et les sommets neigeux de la montagne pour dominer et fermer le tableau.
L'aisance et le contentement régnaient dans la commune. Le Gave donnait le mouvement à des moulins et à des scieries; les troupeaux fournissaient du lait et de la laine; les champs, du blé; la cour, de la volaille; les vignes, un vin généreux; la forêt, un combustible abondant. Quand un habitant du village était parvenu à faire quelques épargnes, il se demandait à quoi il valait mieux les consacrer, et le prix des choses le déterminait. Si, par exemple, avec ses économies il avait pu opter entre fabriquer un chapeau ou bien élever deux moutons, dans le cas où de l'autre côté du Gave on ne lui aurait demandé qu'un mouton pour un chapeau, il aurait cru que faire le chapeau eût été un acte de folie; car la civilisation, et avec elle le Moniteur industriel, n'avaient pas encore pénétré dans ce village.
Il était réservé au maire d'Énios de changer tout cela. Ce n'est pas un maire comme un autre que le maire d'Énios: c'était un vrai pacha.
Jadis, Napoléon l'avait frappé sur l'épaule. Depuis, il était plus Napoléoniste que Roustan, et plus Napoléonien que M. Thiers.
« Voilà un homme, disait-il, en parlant de l'empereur; celui-là ne discutait pas, il agissait; il ne consultait pas, il commandait. C'est ainsi qu'on gouverne bien un peuple. Le Français surtout a besoin d'être mené à la baguette. »
Quand il avait besoin de prestations pour les routes de sa commune, il mandait un paysan: Combien dois-tu de corvées (on dit encore corvées dans ce pays, quoique prestations soit bien mieux). — Trois, répond le paysan. — Combien en as-tu déjà fait? — Deux. — Donc il t'en reste deux à faire. — Mais, monsieur le Maire, deux et deux font — Oui, ailleurs, mais...
Dans le pays béamois,
Deux et deux font trois;
et le paysan faisait quatre corvées, je veux dire prestations.
Insensiblement, M. le maire s'était habitué à regarder tous les hommes comme des niais, que la liberté de l'enseignement rendrait ignorants, la liberté religieuse athées, la liberté du commerce gueux, qui n'écriraient que des sottises avec la liberté de la presse, et feraient contrôler les fonctions par les fonctionnaires avec la liberté électorale. «Il faut organiser et mener toute cette tourbe, » répétait-il souvent. Et quand on lui demandait: « Qui mènera?» — « Moi, » répondait-il fièrement.
Là où il brillait surtout, c'était dans les délibérations du conseil municipal. Il les discutait et les votait à lui tout seul dans sa chambre, formant à la fois majorité, minorité et unanimité. Puis il disait à l'appariteur:
« C'est aujourd'hui dimanche? — Oui, monsieur le Maire.
— Les municipaux iront chanter vêpres? — Oui, monsieur le Maire.
— De là ils se rendront au cabaret? — Oui, monsieur le Maire.
— Ils se griseront? — Oui, monsieur le Maire.
— Eh bien, prends ce papier. — Oui, monsieur le Maire.
— Tu iras ce soir au cabaret. — Oui, monsieur le Maire.
— A l'heure où l'on y voit encore assez pour signer.
— Oui, monsieur le Maire.
— Mais où l'on n'y voit déjà plus assez pour lire. — Oui, monsieur le Maire.
—Tu présenteras à mes braves municipaux cette pancarte ainsi qu'une plume trempée d'encre, et tu leur diras, de ma part, de lire et de signer. — Oui, monsieur le Maire.
— Ils signeront sans lire et je serai en règle envers mon préfet. Voilà comment je comprends le gouvernement représentatif. »
Un jour, il recueillit dans un journal ce mot célèbre: La légalité nous tue. Ah! s'écria-t-il, je ne mourrai pas sans avoir embrassé M. Viennet.
Il est pourtant bon de dire que, quand la légalité lui profitait, il s'y accrochait comme un vrai dogue. Quelques hommes sont ainsi faits; ils sont rares, mais il y en a. Tel était le maire d'Énios. Et maintenant que j'ai décrit et le théâtre et le héros de mon histoire, je vais la mener bon train et sans digressions.
Vers l'époque où les Parisiens allaient cherchant dans les Pyrénées des mines d'asphalte, déjà mises en actions au capital d'un nombre indéfini de millions, M. le maire donna l'hospitalité à un voyageur qui oublia chez lui deux ou trois précieux numéros du Moniteur industriel … Il les lut avidement, et je laisse à penser l'effet que dut produire sur une telle tête une telle lecture. Morbleu! s'écria-t-il, voilà un gazetier qui en sait long. Défendre, empêcher, repousser, restreindre, prohiber, ah! la belle doctrine! C'est clair comme le jour. Je disais bien, moi, que les hommes se ruineraient tous, si on les laissait libres de faire des trocs! Il est bien vrai que la légalité nous tue quelquefois, mais souvent aussi c'est l'absence de légalité. On ne fait pas assez de lois en France, surtout pour prohiber. Et, par exemple, on prohibe aux frontières du royaume, pourquoi ne pas prohiber aux frontières des communes? Que diable, il faut être logique.
Puis, relisant le Moniteur industriel, il faisait à sa localité l'application des principes de ce fameux journal. Mais cela va comme un gant, disait-il, il n'y a qu'un mot à changer; il suffit de substituer travail communal à travail national.
Le maire d'Enios se vantait, comme M. Chasseloup-Laubat, de n'être point théoricien; aussi, comme son modèle, il n'eut ni paix ni trêve qu'il n'eût soumis tous ses administrés à la théorie (car c'en est bien une) de la protection.
La topographie d'Énios servit merveilleusement ses projets. Il assembla son conseil (c'est-à-dire il s'enferma dans sa chambre), il discuta, délibéra, vota et sanctionna un nouveau tarif pour le passage du pont, tarif un peu compliqué, mais dont l'esprit peut se résumer ainsi:
Pour sortir de la commune, zéro par tête.
Pour entrer dans la commune, cent francs par tête.
Cela fait, M. le maire réunit, cette fois tout de bon, le conseil municipal, et prononça le discours suivant que nous rapporterons en mentionnant les interruptions.
« Mes amis, vous savez que le pont nous a coûté cher; il a fallu emprunter pour le faire, et nous avons à rembourser intérêts et principal; c'est pourquoi je vais frapper sur vous une contribution additionnelle.
Jérôme. Est-ce que le péage ne suffit plus?
— Un bon système de péage, dit le maire d'un ton doctoral, doit avoir en vue la protection et non le revenu. — Jusqu'ici le pont s'est suffi à lui-même, mais j'ai arrangé les choses de manière à ce qu'il ne rapportera plus rien. En effet, les denrées du dedans passeront sans rien payer, et celles du dehors ne passeront pas du tout.
Mathurin. Et que gagnerons-nous à cela?
— Vous êtes des novices, reprit le maire; et déployant devant lui le Moniteur industriel, afin d'y trouver réponse au besoin à toutes les objections, il se mit à expliquer le mécanisme de son système, en ces termes:
Jacques, ne serais-tu pas bien aise de faire payer ton beurre un peu plus cher aux cuisinières d'Énios?
— Cela m'irait, dit Jacques.
— Eh bien, pour cela, il faut empêcher le beurre étranger d'arriver par le pont. Et toi, Jean, pourquoi ne fais-tu pas promptement fortune avec tes poules?
— C'est qu'il y en a trop sur le marché, dit Jean.
— Tu comprends donc bien l'avantage d'en exclure celles du voisinage. Quant à toi, Guillaume, je sais que tu as encore deux vieux bœufs sur les bras. Pourquoi cela?
— Parce que François, avec qui j'étais en marché, dit Guillaume, est allé acheter des bœufs à la foire voisine.
— Tu vois bien que s'il n'eût pu leur faire passer le pont, tu aurais bien vendu tes bœufs, et Énios aurait conservé 5 ou 600 francs de numéraire.
Mes amis, ce qui nous ruine, ce qui nous empêche au moins de nous enrichir, c'est l'invasion des produits étrangers.
N'est-il pas juste que le marché communal soit réservé au travail communal?
Soit qu'il s'agisse de prés, de champs ou de vignes, n'y a-t-il pas quelque part une commune plus fertile que la nôtre pour une de ces choses? Et elle viendrait jusque chez nous nous enlever notre propre travail! Ce ne serait pas de la concurrence, mais du monopole; mettons-nous en mesure, en nous rançonnant les uns les autres, de lutter à armes égales.
Pierre, le sabotier. En ce moment, j'ai besoin d'huile, et on n'en fait pas dans notre village.
— De l'huile! vos ardoises en sont pleines. Il ne s'agit que de l'en retirer. C'est là une nouvelle source de travail, et le travail c'est la richesse. Pierre, ne vois-tu pas que cette maudite huile étrangère nous faisait perdre toute la richesse que la nature a mise dans nos ardoises?
Le maître d'école. Pendant que Pierre pilera des ardoises, il ne fera pas de sabots. Si, dans le même espace de temps, avec le même travail, il peut avoir plus d'huile en pilant des ardoises qu'en faisant des sabots, votre tarif est inutile. Il est nuisible si, au contraire, Pierre obtient plus d'huile en faisant des sabots qu'en pilant des ardoises. Aujourd'hui, il a le choix entre les deux procédés; voire mesure va le réduire à un seul, et probablement au plus mauvais, puisqu'on ne s'en sert pas. Ce n'est pas tout qu'il y ait de l'huile dans les ardoises, il faut encore qu'elle vaille la peine d'être extraite; et il faut, de plus, que le temps ainsi employé ne puisse être mieux employé à autre chose. Que risquez-vous à nous laisser la liberté du choix? »
Ici, les yeux de M. le maire semblèrent dévorer le Moniteur industriel pour y chercher réponse au syllogisme; mais ils ne l'y rencontrèrent pas, le Moniteur ayant toujours évité ce côté de la question. M. le maire ne resta pas court pour cela. Il lui vint même à l'esprit le plus victorieux des arguments: « Monsieur le régent, dit-il, je vous ôte la parole et vous destitue. »
Un membre voulut faire observer que le nouveau tarif dérangerait beaucoup d'intérêts, et qu'il fallait au moins ménager la transition. — La transition! s'écria le maire, excellent prétexte contre les gens qui réclament la liberté; mais quand il s'agit de la leur ôter, ajouta-l-il avec beaucoup de sagacité, où avez-vous entendu parler de transition?
Enfin, on alla aux voix, et le tarif fut voté à une grande majorité. Cela vous étonne? Il n'y a pas de quoi.
Remarquez, en effet, qu'il y a plus d'art qu'il ne semble dans le discours du premier magistrat d'Énios.
N'avait-il pas parlé à chacun de son intérêt particulier? De beurre à Jacques le pasteur, de vin à Jean le vigneron, de bœufs à Guillaume l'éleveur? N'avait-il pas constamment laissé dans l'ombre l'intérêt général?
Cependant, ses efforts, son éloquence municipale, ses conceptions administratives, ses vues profondes d'économie sociale, tout devait venir se briser contre les pierres de l'hôtel de la Préfecture.
M. le préfet, brutalement, sans ménagement aucun, cassa le tarif protecteur du pont d'Énios.
M. le maire, accouru au chef-lieu, défendit vaillamment son œuvre, ce noble fruit de sa pensée fécondée par le Moniteur industriel. Il en résulta, entre les deux athlètes, la plus singulière discussion du monde, le plus bizarre dialogue qu'on puisse entendre; car il faut savoir que M. le préfet était pair de France et fougueux protectionniste. En sorte que tout le bien que M. le préfet disait du tarif des douanes, M. le maire s'en emparait au profit du tarif du pont d'Énios; et tout le mal que M. le préfet attribuait au tarif du pont, M. le maire le retournait contre le tarif des douanes.
« Quoi! disait M. le préfet, vous voulez empêcher le drap du voisinage d'entrer à Énios!
— Vous empêchez bien le drap du voisinage d'entrer en France.
— C'est bien différent, mon but est de protéger le travail national.
— Et le mien de protéger le travail communal.
— N'est-il pas juste que les Chambres françaises défendent les fabriques françaises contre la concurrence étrangère?
— N'est-il pas juste que la municipalité d'Enios défende les fabriques d'Énios contre la concurrence du dehors?
— Mais votre tarif nuit à votre commerce, il écrase les consommateurs, il n'accroît pas le travail, il le déplace. Il provoque de nouvelles industries, mais aux dépens des anciennes. Comme vous l'a dit le maître d'école, si Pierre veut de l'huile, il pilera des ardoises; mais alors il ne fera plus de sabots pour les communes environnantes. Vous vous privez de tous les avantages d'une bonne direction du travail.
— C'est justement ce que les théoriciens du libre-échange disent de vos mesures restrictives.
— Les libre-échangistes sont des utopistes qui ne voient jamais les choses qu'au point de vue général. S'ils se bornaient à considérer isolément chaque industrie protégée, sans tenir compte des consommateurs ni des autres branches de travail, ils comprendraient toute l'utilité des restrictions.
— Pourquoi donc me parlez-vous des consommateurs d'Énios?
— Mais, à la longue, votre péage nuira aux industries mêmes que vous voulez favoriser; car, en ruinant les consommateurs, vous ruinez la clientèle, et c'est la richesse de la clientèle qui fait la prospérité de chaque industrie.
— C'est encore là ce que vous objectent les libre-échangistes. Ils disent que vouloir développer une branche de travail par des mesures qui lui ferment les débouchés extérieurs, et qui, si elles lui assurent la clientèle du dedans, vont sans cesse affaiblissant cette clientèle, c'est vouloir bâtir une pyramide en commençant par la pointe.
— Monsieur le maire, vous êtes contrariant, je n'ai pas de compte à vous rendre, et je casse la délibération du conseil municipal d'Énios. »
Le maire reprit tristement le chemin de sa commune, en maugréant contre les hommes qui ont deux poids et deux mesures, qui soufflent le chaud et le froid, et croient très-sincèrement que ce qui est vérité et justice dans un cercle de cinq mille hectares, devient mensonge et iniquité dans un cercle de cinquante mille lieues carrées. Comme il était bonhomme au fond: J'aime mieux, se dit-il, la loyale opposition du régent de la commune, et je révoquerai sa destitution.
En arrivant a Énios, il convoqua le conseil pour lui annoncer d'un ton piteux sa triste déconvenue. Mes amis, dit-il, nous avons tous manqué notre fortune. M. le préfet, qui vote chaque année des restrictions nationales, repousse les restrictions communales. Il casse votre délibération et vous livre sans défense à la concurrence étrangère. Mais il nous reste une ressource. Puisque l'inondation des produits étrangers nous étouffe, puisqu'il ne nous est pas permis de les repousser par la force, pourquoi ne les refuserions-nous pas volontairement? Que tous les habitants d'Énios conviennent entre eux de ne jamais rien acheter au dehors.
Mais les habitants d'Énios continuèrent à acheter au dehors ce qu'il leur en coûtait plus de faire au dedans; ce qui confirma de plus en plus M. le maire dans cette opinion, que les hommes inclinent naturellement vers leur ruine quand ils ont le malheur d'être libres.
34.Bastiat's "Utopian Dream of Political and Economic Reform" (1847)↩
[Word Length: 2,187]
Source
Frédéric Bastiat, Sophismes économiques. Deuxième série (Paris: Guillaumin, 1848). Chap. XI. - L'Utopiste, pp. 101-111. This essay was first published in Le Libre-Échange, 17 janvier, 1847.
XI. - L'Utopiste
— Si j'étais ministre de Sa Majesté!...
— Eh bien, que feriez-vous?
— Je commencerais par.... par...., ma foi, par être fort embarrassé. Car enfin, je ne serais ministre que parce que j'aurais la majorité; je n'aurais la majorité que parce que je me la serais faite; je ne me la serais faite, honnêtement du moins, qu'en gouvernant selon ses idées.... Donc, si j'entreprenais de faire prévaloir les miennes en contrariant les siennes, je n'aurais plus la majorité, et si je n'avais pas la majorité, je ne serais pas ministre de Sa Majesté.
— Je suppose que vous le soyez et que par conséquent la majorité ne soit pas pour vous un obstacle; que feriez-vous?
— Je rechercherais de quel côté est le juste.
— Et ensuite?
— Je chercherais de quel coté est l'utile.
— Et puis?
— Je chercherais s'ils s'accordent ou se gourment entre eux.
— Et si vous trouviez qu'ils ne s'accordent pas?
— Je dirais au roi Philippe:
Reprenez votre portefeuille.
— La rime n'est pas riche et le style en est vieux;
Mais pourtant je conviens que cela vaut bien mieux
Que ces transactions dont le bon sens murmure,
Et que l'honnêteté parle là toute pure.
Mais si vous reconnaissez que le juste et l'utile c'est tout un?
— Alors, j'irai droit en avant.
— Fort bien. Mais pour réaliser l'utilité par la justice, il faut une troisième chose.
— Laquelle? ...
— La possibilité.
— Vous me l'avez accordée.
— Quand?
— Tout à l'heure.
— Comment?
— En me concédant la majorité.
— Il me semblait aussi que la concession était fort hasardée, car enfin elle implique que la majorité voit clairement ce qui est juste, voit clairement ce qui est utile, et voit clairement qu'ils sont en parfaite harmonie.
— Et si elle voyait clairement tout cela, le bien se ferait, pour ainsi dire, tout seul.
— Voilà où vous m'amenez constamment: à ne voir de réforme possible que par le progrès de la raison générale.
— Comme à voir, par ce progrès, toute réforme infaillible.
— A merveille. Mais ce progrès préalable est lui-même un peu long. Supposons-le accompli. Que feriez-vous? car je suis pressé de vous voir à l'œuvre, à l'exécution, à la pratique.
— D'abord, je réduirais la taxe des lettres à 10 centimes.
— Je vous avais entendu parler de 5 centimes.
— Oui; mais comme j'ai d'autres réformes en vue, je dois procéder avec prudence pour éviter le déficit.
— Tudieu! quelle prudence! Vous voilà déjà en déficit de 30 millions.
— Ensuite, je réduirais l'impôt du sel à 10 fr.
— Bon! vous voilà en déficit de 30 autres millions. Vous avez sans doute inventé un nouvel impot?
— Le Ciel m'en préserve! D'ailleurs, je ne me flatte pas d'avoir l'esprit si inventif.
— Il faut pourtant bien., ah! j'y suis. Où avais-je la tête? Vous allez simplement diminuer la dépense. Je n'y pensais pas.
— Vous n'êtes pas le seul. — J'y arriverai, mais pour le moment, ce n'est pas sur quoi je compte.
— Oui-dà! vous diminuez la recette sans diminuer la dépense, et vous évitez le déficit?
— Oui, en diminuant en même temps d'autres taxes.
(Ici l'interlocuteur, posant l'index de la main droite sur son sinciput, hoche la tête, ce qui peut se traduire ainsi: il bat la campagne.)
— Par ma foi! le procédé est ingénieux. Je verse 100 francs au trésor, vous me dégrevez de 5 francs sur le sel, de 5 francs sur la poste; et pour que le trésor n'en reçoive pas moins 100 francs, vous me dégrevez de 10 francs sur quelqu'autre taxe?
— Touchez-là; vous m'avez compris.
— Du diable si c'est vrai! Je ne suis pas même sur de vous avoir entendu.
— Je répète que je balance un dégrèvement par un autre.
— Morbleu! j'ai quelques instants à perdre: autant vaut que je vous écoute développer ce paradoxe.
— Voici tout le mystère: je sais une taxe qui vous coûte vingt francs et dont il ne rentre pas une obole au trésor; je vous fais remise de moitié et fais prendre à l'autre moitié le chemin de l'hôtel de la rue de Rivoli.
— Vraiment! vous êtes un financier sans pareil. Il n'y a qu'une difficulté. En quoi est-ce, s'il vous plaît, que je paie une taxe qui ne va pas au trésor?
— Combien vous coûte cet habit?
— 100 francs.
— Et si vous eussiez fait venir le drap de Verviers, combien vous coûterait-il?
— 80 francs.
— Pourquoi donc ne l'avez-vous pas demandé à Verviers?
— Parce que cela est défendu.
— Et pourquoi cela est-il défendu?
— Pour que l'habit me revienne à 100 francs au lieu de 80.
— Cette défense vous coûte donc 20 francs?
— Sans aucun doute.
— Et où passent-ils, ces 20 francs?
— Et où passeraient-ils? Chez le fabricant de drap.
— Eh bien! donnez-moi 10 francs pour le trésor, je ferai lever la défense, et vous gagnerez encore 10 francs.
— Oh! oh! je commence à y voir clair. Voici le compte du trésor: il perd 5 francs sur la poste, 5 sur le sel, et gagne 10 francs sur le drap. Partant quitte.
— Et voici votre compte à vous: Vous gagnez 5 francs sur le sel, 5 francs sur la poste et lO francs sur le drap.
— Total, 20 francs. Ce plan me sourit assez. Mais que deviendra le pauvre fabricant de draps?
— Oh! j'ai pensé à lui. Je lui ménage des compensations, toujours au moyen de dégrèvements profitables au trésor; et ce que j'ai fait pour vous à l'occasion du drap, je le fais pour lui à l'égard de la laine, de la houille, des machines, etc.; en sorte qu'il pourra baisser sou prix sans perdre.
— Mais êtes-vous sûr qu'il y aura balance?
— Elle penchera de son côté. Les 20 francs que je vous fais gagner sur le drap, s'augmenteront de ceux que je vous économiserai encore sur le blé, la viande, le combustible, etc. Cela montera haut; et une épargne semblable sera réalisée par chacun de vos trente-cinq millions de concitoyens. Il y a là de quoi épuiser les draps de Verviers et ceux d'Elbeuf. La nation sera mieux vêtue, voilà tout.
— J'y réfléchirai; car tout cela se brouille un peu dans ma tête.
— Après tout, en fait de vêtements, l'essentiel est d'être vêtu. Vos membres sont votre propriété et non celle du fabricant. Les mettre à l'abri de grelotter est votre affaire et non la sienne! Si la loi prend parti pour lui contre vous, la loi est injuste, et vous m'avez autorisé à raisonner dans l'hypothèse que ce qui est injuste est nuisible.
— Peut-être me suis-je trop avancé; mais poursuivez l'exposé de votre plan financier.
— Je ferai donc une loi de douanes.
— En deux volumes in-folio?
— Non, en deux articles.
— Pour le coup, on ne dira plus que ce fameux axiome: « Nul n'est censé ignorer la loi, » est une fiction. Voyons donc votre tarif.
— Le voici:
Art. 1er Toute marchandise importée paiera une taxe de 5 p. % de la valeur.
— Même les matières premières?
— A moins qu'elles n'aient point de valeur.
— Mais elles en ont toutes, peu ou prou.
— En ce cas, elles paieront peu ou prou.
— Comment voulez-vous que nos fabriques luttent avec les fabriques étrangères qui ont les matières premières en franchise!
—Les dépenses de l'État étant données, si nous fermons cette source de revenus, il en faudra ouvrir une autre: cela ne diminuera pas l'infériorité relative de nos fabriques, et il y aura une administration de plus à créer et à payer.
— Il est vrai; je raisonnais comme s'il s'agissait d'annuler la taxe et non de la déplacer. J'y réfléchirai. Voyons votre second article? ...
— Art. 2. Toute marchandise exportée paiera une taxe de 5 p. % de la valeur.
— Miséricorde! monsieur l'Utopiste. Vous allez vous faire lapider, et au besoin je jetterai la première pierre.
— Nous avons admis que la majorité est éclairée.
— Éclairée! soutiendrez-vous qu'un droit de sortie ne soit pas onéreux?
— Toute taxe est onéreuse; mais celle-ci moins qu'une autre.
— Le carnaval justifie bien des excentricités. Donnez-vous le plaisir de rendre spécieux, si cela est possible, ce nouveau paradoxe.
— Combien avez-vous payé ce vin?
— Un franc le litre.
— Combien l'auriez-vous payé hors barrière?
— Cinquante centimes.
— Pourquoi cette différence?
— Demandez-le à l'octroi qui a prélevé dix sous dessus.
— Et qui a établi l'octroi?
— La commune de Paris, afin de paver et d'éclairer les rues.
— C'est donc un droit d'importation. Mais si c'étaient les communes limitrophes qui eussent érigé l'octroi à leur profit, qu'arriverait-il?
— Je n'en paierais pas moins 1 fr. mon vin de 50 c, et les autres 50 c. paveraient et éclaireraient Montmartre et les Batignoles.
— En sorte qu'en définitive c'est le consommateur qui paie la taxe?
— Cela est hors de doute.
— Donc, en mettant un droit à l'exportation, vous faites contribuer l'étranger à vos dépenses.
— Je vous prends en faute, ceci n'est plus de la justice.
— Pourquoi pas? Pour qu'un produit se fasse, il faut qu'il y ait dans le pays de l'instruction, de la sécurité, des routes, toutes choses qui coûtent. Pourquoi l'étranger ne supporterait-il pas les charges occasionnées par ce produit, lui qui, en définitive, va le consommer?
— Cela est contraire aux idées reçues.
— Pas le moins du monde. Le dernier acheteur doit rembourser tous les frais de production directs ou indirects.
— Vous avez beau dire, il saute aux yeux qu'une telle mesure paralyserait le commerce et nous fermerait des débouchés.
— C'est une illusion. Si vous payiez cette taxe en sus de toutes les autres, vous avez raison. Mais si les 100 millions prélevés par cette voie dégrèvent d'autant d'autres impôts, vous reparaissez sur les marchés du dehors avec tous vos avantages, et même avec plus d'avantages, si cet impôt a moins occasionné d'embarras et de dépenses.
— J'y réfléchirai. — Ainsi, voilà le sel, la poste et la douane réglés. Tout est-il fini là?
— A peine je commence.
— De grâce, initiez-moi à vos autres utopies.
— J'avais perdu 60 millions sur le sel et la poste. La douane me les fait retrouver; mais elle me donne quelque chose de plus précieux.
— Et quoi donc, s'il vous plaît?
— Des rapports internationaux fondés sur la justice, et une probabilité de paix qui équivaut à une certitude. Je congédie l'armée.
— L'armée tout entière?
— Excepté les armes spéciales, qui se, recruteront volontairement comme toutes les autres professions. Vous le voyez, la conscription est abolie.
— Monsieur, il faut dire le recrutement.
— Ah! j'oubliais. J'admire comme il est aisé, en certains pays, de perpétuer les choses les plus impopulaires en leur donnant un autre nom.
— C'est comme les droits réunis, qui sont devenus des contributions indirectes.
— Et les gendarmes qui ont pris nom gardes municipaux.
— Bref, vous désarmez le pays sur la foi d'une utopie.
— J'ai dit que je licenciais l'armée et non que je désarmais le pays. J'entends lui donner au contraire une force invincible.
— Comment arrangez-vous cet amas de contradictions?
— J'appelle tous les citoyens au service.
— Il valait bien la peine d'en dispenser quelques-uns pour y appeler tout le monde.
— Vous ne m'avez pas fait ministre pour laisser les choses comme elles sont. Aussi, à mon avénement au pouvoir, je dirai comme Richelieu: « Les maximes de l'Etat sont changées. » Et ma première maxime, celle qui servira de base à mon administration, c'est celle-ci: Tout citoyen doit savoir deux choses: pourvoir à son existence et défendre son pays.
— Il me semble bien, au premier abord, qu'il y a quelque étincelle de bon sens là-dessous.
— En conséquence, je fonde la défense nationale sur une loi en deux articles:
Art. 1er. Tout citoyen valide, sans exception, restera sous les drapeaux pendant quatre années, de 21 à 25 ans, pour y recevoir l'instruction militaire.
— Voilà une belle économie! vous congédiez 400 mille soldais et vous en faites dix millions.
— Attendez mon second article.
Art. 2. A moins qu'il ne prouve, à 21 ans, savoir parfaitement l'école de peloton.
— Je ne m'attendais pas à cette chute. Il est certain que pour éviter quatre ans de service, il y aurait une terrible émulation, dans notre jeunesse, à apprendre le par le flanc droit et la charge en douze temps. L'idée est bizarre.
— Elle est mieux que cela. Car enfin, sans jeter la douleur dans les familles, et sans froisser l'égalité, n'assure-t-elle pas au pays d'une manière simple et peu dispendieuse, 10 millions de défenseurs capables de défier la coalition de toutes les armées permanentes du globe?
— Vraiment, si je n'étais sur mes gardes, je finirais par m'intéresser à vos fantaisies.
L'utopiste s'échauffant: Grâce au Ciel, voilà mon budget soulagé de 200 millions! Je supprime l'octroi, je refonds les contributions indirectes, je...
— Eh! monsieur l'utopiste!
L'utopiste s'échauffant de plus en plus: Je proclame la liberté des cultes, la liberté d'enseignement. Nouvelles ressources. J'achète les chemins de fer, je rembourse la dette, j'affame l'agiotage.
— Monsieur l'utopiste!
—Débarrassé de soins trop nombreux, je concentre toutes les forces du gouvernement à réprimer la fraude, distribuer à tous prompte et bonne justice, je....
— Monsieur l'utopiste, vous entreprenez trop de choses, la nation ne vous suivra pas!
— Vous m'avez donné la majorité.
— Je vous la retire.
— A la bonne heure! alors je ne suis plus ministre, et mes plans restent ce qu'ils sont, des UTOPIES.
35.Bastiat, “The Physiology of Plunder” (January, 1848)↩
[Word Length: 5,976]
Source
Sophismes économique. Série II (Janvier 1848), republished in Oeuvres complètes de Frédéric Bastiat, mises en ordre, revues et annotées d’après les manuscrits de l’auteur. Ed. Prosper Paillottet and biographical essay by Roger de Fontenay. (Paris: Guillaumin, 2nd ed. 1862-64, 7 vols.). Tome quatrième: Sophismes économiques. Petits pamphlets I (1863), pp. 127-48.
I. — Physiologie De La Spoliation.200
Pourquoi irais-je m'aheurter à cette science aride, l'Economie politique?
Pourquoi? — La question est judicieuse. Tout travail est assez répugnant de sa nature, pour qu'on ait le droit de demander où il mène.
Voyons, cherchons.
Je ne m'adresse pas à ces philosophes qui font profession d'adorer la misère, sinon en leur nom, du moins au nom de l'humanité.
Je parle à quiconque tient la Richesse pour quelque chose. — Entendons parce mot, non l'opulence de quelques-uns, mais l'aisance, le bien-être, la sécurité, l'indépendance, l'instruction, la dignité de tous.
II n'y a que deux moyens de se procurer les choses nécessaires à la conservation, à l'embellissement et au perfectionnement de la vie: la Production et la Spoliation.
Quelques personnes disent: La Spoliation est un accident, un abus local et passager, flétri par la morale, réprouvé par la loi, indigne d'occuper l'Économie politique.
Cependant, quelque bienveillance, quelque optimisme que l'on porte au cœur, on est forcé de reconnaître que la Spoliation s'exerce dans ce monde sur une trop vaste échelle, qu'elle se mêle trop universellement à tous les grands faits humains pour qu'aucune science sociale, et l'Économie politique surtout, puisse se dispenser d'en tenir compte.
Je vais plus loin. Ce qui sépare l'ordre social de la perfection (du moins de toute celle dont il est susceptible), c'est le constant effort de ses membres pour vivre et se développer aux dépens les uns des autres.
En sorte que si la Spoliation n'existait pas, la société étant parfaite, les sciences sociales seraient sans objet.
Je vais plus loin encore. Lorsque la Spoliation est devenue le moyen d'existence d'une agglomération d'hommes unis entre eux par le lien social, ils se font bientôt une loi qui la sanctionne, une morale qui la glorifie.
Il suffit de nommer quelques-unes des formes les plus tranchées de la Spoliation pour montrer quelle place elle occupe dans les transactions humaines.
C'est d'abord la Guerre. — Chez les sauvages, le vainqueur tue le vaincu pour acquérir au gibier un droit, sinon incontestable, du moins incontesté.
C'est ensuite L'Esclavage. — Quand l'homme comprend qu'il est possible de féconder la terre par le travail, il fait avec son frère ce partage: « A toi la fatigue, à moi le produit.
Vient la Théocratie. — « Selon ce que tu me donneras ou me refuseras du ce qui t'appartient, je t'ouvrirai la porte du ciel ou de l'enfer. »
Enfin arrive le Monopole. — Son caractère distinctif est de laisser subsister la grande loi sociale: Service pour service, mais de faire intervenir la force dans le débat, et par suite, d'altérer la juste proportion entre le service reçu et le service rendu.
La Spoliation porte toujours dans son sein le germe de mort qui la tue. Rarement c'est le grand nombre qui spolie le petit nombre. En ce cas, celui-ci se réduirait promptement au point de ne pouvoir plus satisfaire la cupidité de celui-là, et la Spoliation périrait faute d'aliment.
Presque toujours c'est le grand nombre qui est opprimé, et la Spoliation n'en est pas moins frappée d'un arrêt fatal.
Car si elle a pour agent la Force, comme dans la Guerre et l'Esclavage, il est naturel que la Force à la longue passe du côté du grand nombre.
Et si c'est la Ruse, comme dans la Théocratie et le Monopole, il est naturel que le grand nombre s'éclaire, sans quoi l'intelligence ne serait pas l'intelligence.
Une autre loi providentielle dépose un second germe de mort au cœur de la Spoliation, c’est celle-ci:
La Spoliation ne déplace pas seulement la richesse, elle en détruit toujours une partie.
La Guerre anéantit bien des valeurs.
L'Esclavage paralyse bien des facultés.
La Théocratie détourne bien des efforts vers des objets puérils ou funestes.
Le Monopole aussi fait passer la richesse d'une poche à l'autre; mais il s'en perd beaucoup dans le trajet.
Cette loi est admirable. — Sans elle, pourvu qu'il y eût équilibre de force entre les oppresseurs et les opprimés, la Spoliation n'aurait pas de terme. — Grâce à elle, cet équilibre tend toujours à se rompre, soit parce que les Spoliateurs se font conscience d'une telle déperdition de richesses, soit, en l'absence de ce sentiment, parce que le mal empire sans cesse, et qu'il est dans la nature de ce qui empire toujours de finir.
Il arrive en effet un moment où, dans son accélération progressive, la déperdition des richesses est telle que le Spoliateur est moins riche qu'il n'eût été en restant honnête.
Tel est un peuple à qui les frais de guerre coûtent plus que ne vaut le butin.
Un maître qui paie plus cher le travail esclave que le travail libre.
Une Théocratie qui a tellement hébété le peuple et détruit son énergie qu'elle n'en peut plus rien tirer.
Un Monopole qui agrandit ses efforts d'absorption à mesure qu'il y a moins à absorber, comme l'effort de traire s'accroît à mesure que le pis est plus desséché.
Le Monopole, on le voit, est une Espèce du Genre Spoliation. Il a plusieurs Variétés, entre autres la Sinécure, le Privilége, la Restriction.
Parmi les formes qu'il revêt, il y en a de simples et naïves. Tels étaient les droits féodaux. Sous ce régime la masse est spoliée et le sait. Il implique l'abus de la force et tombe avec elle.
D'autres sont très-compliquées. Souvent alors la masse est spoliée et ne le sait pas. Il peut même arriver qu'elle croie tout devoir à la Spoliation, et ce qu'on lui laisse, et ce qu'on lui prend, et ce qui se perd dans l'opération. Il y a plus, j'affirme que, dans la suite des temps, et grâce au mécanisme si ingénieux de la coutume, beaucoup de Spoliateurs le sont sans le savoir et sans le vouloir. Les Monopoles de cette variété sont engendrés par la Ruse et nourris par l'Erreur. Ils ne s'évanouissent que devant la Lumière.
J'en ai dit assez pour montrer que l'Économie politique a une utilité pratique évidente. C'est le flambeau qui, dévoilant la Ruse et dissipant l'Erreur, détruit ce désordre social, la Spoliation. Quelqu'un, je crois que c'est une femme, et elle avait bien raison, l'a ainsi définie: C'est la serrure de sûreté du pécule populaire.
Commentaire.
Si ce petit livre était destiné à traverser trois ou quatre mille ans, à être lu, relu, médité, étudié phrase à phrase, mot à mot, lettre à lettre, de génération en génération, comme un Koran nouveau; s'il devait attirer dans toutes les bibliothèques du monde des avalanches d'annotations, éclaircissements et paraphrases, je pourrais abandonner à leur sort, dans leur concision un peu obscure, les pensées qui précèdent. Mais puisqu'elles ont besoin de commentaire, il me paraît prudent de les commenter moi-même.
La véritable et équitable loi des hommes, c'est: Échange librement débattu de service contre service. La Spoliation consiste à bannir par force ou par ruse la liberté du débat afin de recevoir un service sans le rendre.
La Spoliation par la force s'exerce ainsi: On attend qu'un homme ait produit quelque chose, qu'on lui arrache, l'arme au poing.
Elle est formellement condamnée par le Décalogue: Tu ne prendras point.
Quand elle se passe d'individu à individu, elle se nomme vol et mène au bagne; quand c'est de nation à nation, elle prend nom conquête et conduit à la gloire.
Pourquoi cette différence? Il est bon d'en rechercher la cause. Elle nous révélera une puissance irrésistible, l'Opinion, qui, comme l'atmosphère, nous enveloppe d'une manière si absolue, que nous ne la remarquons plus. Car Rousseau n'a jamais dit une vérité plus vraie que celle-ci: « Il faut beaucoup de philosophie pour observer les faits qui sont trop près de nous. »
Le voleur, par cela même qu'il agit isolément, a contre lui l'opinion publique. Il alarme tous ceux qui l'entourent. Cependant, s'il a quelques associés, il s'enorgueillit devant eux de ses prouesses, et l'on peut commencer à remarquer ici. la force de l'Opinion; car il suffit de l'approbation de ses complices pour lui ôter le sentiment de sa turpitude et même le rendre vain de son ignominie.
Le guerrier vit dans un autre milieu. L'Opinion qui le flétrit est ailleurs, chez les nations vaincues; il n'eu sent pas la pression. Mais l'Opinion qui est autour de lui l'approuve et le soutient. Ses compagnons et lui sentent vivement la solidarité qui les lie. La patrie, qui s'est créé des ennemis et des dangers, a besoin d'exalter le courage de ses enfants. Elle décerne aux plus hardis, à ceux qui, élargissant ses frontières, y ont apporté le plus de butin, les honneurs, la renommée, la gloire. Les poètes chantent leurs exploits et les femmes leur tressent des couronnes. Et telle est la puissance de l'Opinion, qu'elle sépare de la Spoliation l'idée d'injustice et ôte au spoliateur jusqu'à la conscience de ses torts.
L'Opinion, qui réagit contre la spoliation militaire, placée non chez le peuple spoliateur, mais chez le peuple spolié. n'exerce que bien peu d'influence. Cependant, elle n'est pas tout à fait inefficace, et d'autant moins que les nations se fréquentent et se comprennent davantage. Sous ce rapport, on voit que l'étude des langues et la libre communication des peuples tendent à faire prédominer l'opinion contraire à ce genre de spoliation.
Malheureusement, il arrive souvent que les nations qui entourent le peuple spoliateur sont elles-mêmes spoliatrice s. quand elles le peuvent, et dès lors imbues des mêmes préjugés.
Alors, il n'y a qu'un remède: le temps. Il faut que les peuples aient appris, par une rude expérience, l'énorme désavantage de se spolier les uns les autres.
On parlera d'un autre frein: la moralisation. Mais la moralisation a pour but de multiplier les actions vertueuses. Comment donc restreindra-t-elle les actes spoliateurs quand ces actes sont mis par l'Opinion au rang des plus hautes vertus? Y a-t-il un moyen plus puissant de moraliser un peuple que la Religion? Y eut-il jamais Religion plus favorable à la paix et plus universellement admise que le Christianisme? Et cependant qu'a-t-on vu pendant dix-huit siècles? On a vu les hommes se battre non-seulement malgré la Religion, mais au nom de la Religion même.
Un peuple conquérant ne fait pas toujours la guerre offensive. Il a aussi de mauvais jours. Alors ses soldats défendent le foyer domestique, la propriété, la famille, l'indépendance, la liberté. La guerre prend un caractère de sainteté et de grandeur. Le drapeau, bénit par les ministres du Dieu de paix, représente tout ce qu'il y a de sacré sur la terre; on s'y attache comme à la vivante image de la patrie et de l'honneur; et les vertus guerrières sont exaltées au-dessus de toutes les autres vertus. — Mais le danger passé, l'Opinion subsiste, et, par une naturelle réaction de l'esprit de vengeance qui se confond avec le patriotisme, on aime à promener le drapeau chéri de capitale en capitale. Il semble que la nature ait préparé ainsi le châtiment de l'agresseur.
C'est la crainte de ce châtiment, et non les progrès de la philosophie, qui retient les armes dans les arsenaux, car, on ne peut pas le nier, les peuples les plus avancés en civilisation font la guerre, et se préoccupent bien peu de justice quand ils n'ont pas de représailles à redouter. Témoin l'Hymalaya, l'Atlas et le Caucase.
Si la Religion a été impuissante, si la philosophie est impuissante, comment donc finira la guerre?
L'Economie politique démontre que, même à ne considérer que le peuple victorieux, la guerre se fait toujours dans l'intérêt du petit nombre et aux dépens des masses. Il suffit donc que les masses aperçoivent clairement cette vérité. Le poids de l'Opinion, qui se partage encore, pèsera tout entier du côté de la paix.201
La Spoliation exercée par la force prend encore une autre forme. On n'attend pas qu'un homme ait produit une chose pour la lui arracher. On s'empare de l'homme lui-même; on le dépouille de sa propre personnalité; on le contraint au travail; on ne lui dit pas: Si tu prends cette peine pour moi, je prendrai cette peine pour toi, on lui dit: A toi toutes les fatigues, à moi toutes les jouissances. C'est l'Esclavage, qui implique toujours l'abus de la force.
Or, c'est une grande question de savoir s'il n'est pas dans la nature d'une force incontestablement dominante d'abuser toujours d'elle-même. Quant à moi, je ne m'y fie pas, et j'aimerais autant attendre d'une pierre qui tombe la puissance qui doit l'arrêter dans sa chute, que de confier à la force sa propre limite.
Je voudrais, au moins, qu'on me montrât un pays, une époque où l'Esclavage a été aboli par la libre et gracieuse volonté des maîtres.
L'Esclavage fournit un second et frappant exemple de l'insuffisance des sentiments religieux et philanthropiques aux prises avec l'énergique sentiment de l'intérêt. Cela peut paraître triste à quelques Écoles modernes qui cherchent dans l'abnégation le principe réformateur de la société. Qu'elles commencent donc par réformer la nature de l'homme.
Aux Antilles, les maîtres professent de père en fils, depuis l'institution de l'esclavage, la Religion chrétienne. Plusieurs fois par jour ils répètent ces paroles: « Tous les hommes sont frères; aimer son prochain, c'est accomplir toute la loi. » — Et pourtant ils ont des esclaves. Rien ne leur semble plus naturel et plus légitime. Les réformateurs modernes espèrent-ils que leur morale sera jamais aussi universellement acceptée, aussi populaire, aussi forte d'autorité, aussi souvent sur toutes les lèvres que l'Évangile? Et si l'Evangile n'a pu passer des lèvres au cœur par-dessus ou à travers la grande barrière de l'intérêt, comment espèrent-ils que leur morale fasse ce miracle?
Mais quoi! l'Esclavage est-il donc invulnérable? Non; ce qui l'a fondé le détruira, je veux dire l'Intérêt, pourvu que, pour favoriser les intérêts spéciaux qui ont créé la plaie, on ne contrarie pas les intérêts généraux qui doivent la guérir.
C'est encore une vérité démontrée par l'Economie politique, que le travail libre est essentiellement progressif et le travail esclave nécessairement stationnaire. En sorte que le triomphe du premier sur le second est inévitable. Qu'est devenue la culture de l'indigo par les noirs?
Le travail libre appliqué à la production du sucre en fera baisser de plus en plus le prix. A mesure, l'esclave sera de moins en moins lucratif pour son maître. L'esclavage serait depuis longtemps tombé de lui-même en Amérique, si, en Europe, les lois n'eussent élevé artificiellement le prix du sucre. Aussi nous voyons les maîtres, leurs créanciers et leurs délégués travailler activement à maintenir ces lois, qui sont aujourd'hui les colonnes de l'édifice.
Malheureusement, elles ont encore la sympathie des populations du soin desquelles l'esclavage a disparu; par où l'on voit qu'encore ici l'Opinion est souveraine.
Si elle est souveraine, même dans la région de la Force, elle l'est à bien plus forte raison dans le monde de la Ruse. A vrai dire, c'est là son domaine. La Ruse, c'est l'abus de l'intelligence; le progrès de l'opinion, c'est le progrès des intelligences. Les deux puissances sont au moins de même nature. Imposture chez le spoliateur implique crédulité chez le spolié, et l'antidote naturel de la crédulité c'est la vérité. Il s'ensuit qu'éclairer les esprits, c'est ôter à ce genre de spoliation son aliment.
Je passerai brièvement en revue quelques-unes des spoliations qui s'exercent par la Ruse sur une très-grande échelle.
La première qui se présente c'est la Spoliation par ruse théocratique.'
De quoi s'agit-il? De se faire rendre en aliments, vêtements, luxe, considération, influence, pouvoir, des services réels contre des services fictifs.
Si je disais à un homme: — « Je vais te rendre des services immédiats, » — il faudrait bien tenir parole; faute de quoi cet homme saurait bientôt à quoi s'en tenir, et ma ruse serait promptement démasquée.
Mais si je lui dis: — « En échange de tes services, je te rendrai d'immenses services, non dans ce monde, mais dans l'autre. Après cette vie, tu peux être éternellement heureux ou malheureux, et cela dépend de moi; je suis un être intermédiaire entre Dieu et sa créature, et puis, à mon gré, Couvrir les portes du ciel ou de l'enfer. » — Pour peu que cet homme me croie, il est à ma discrétion.
Ce genre d'imposture a été pratiqué très en grand depuis l'origine du monde, et l'on sait à quel degré de toute-puissance étaient arrivés les prêtres égyptiens.
Il est aisé de savoir comment procèdent les imposteurs. Il suffit de se demander ce qu'on ferait à leur place.
Si j'arrivais, avec des vues de cette nature, au milieu d'une peuplade ignorante, et que je parvinsse, par quelque acte extraordinaire et d'une apparence merveilleuse, à me faire passer pour un être surnaturel, je me donnerais pour un envoyé de Dieu, ayant sur les futures destinées des hommes un empire absolu.
Ensuite, j'interdirais l'examen de mes titres; je ferais plus: comme la raison serait mon ennemi le plus dangereux, j'interdirais l'usage de la raison même- au moins appliquée à ce sujet redoutable. Je ferais de cette question, et de toutes celles qui s'y rapportent, des questions tabou, comme disent les sauvages. Les résoudre, les agiter, y penser même, serait un crime irrémissible.
Certes, ce serait le comble de l'art de mettre une barrière tabou à toutes les avenues intellectuelles qui pourraient conduire à la découverte de ma supercherie. Quelle meilleure garantie de sa durée que de rendre le doute même sacrilége?
Cependant, à cette garantie fondamentale, j'en ajouterais d'accessoires. Par exemple, pour que la lumière ne pût jamais descendre dans les masses, je m'attribuerais, ainsi qu'à mes complices, le monopole de toutes les connaissances, je les cacherais sous les voiles d'une langue morte et d'une écriture hiéroglyphique, et, pour n'être jamais surpris par aucun danger, j'aurais soin d'inventer une institution qui me ferait pénétrer, jour par jour, dans le secret de toutes les consciences.
Il ne serait pas mal non plus que je satisfisse à quelques besoins réels de mon peuple, surtout si, en le faisant, je pouvais accroître mon influence et mon autorité. Ainsi les hommes ont un grand besoin d'instruction et de morale: je m'en ferais le dispensateur. Par là je dirigerais à mon gré l'esprit et le cœur de mon peuple. J'entrelacerais dans une chaîne indissoluble la morale et mon autorité; je les représenterais comme ne pouvant exister l'une sans l'antre, en sorte que si quelque audacieux tentait enfin de remuer une question tabou, la société tout entière, qui ne peut se passer de morale, sentirait le terrain trembler sous ses pas, et se tournerait avec rage contre ce novateur téméraire.
Quand les choses en seraient là, il est clair que ce peuple m'appartiendrait plus que s'il était mon esclave. L'esclave maudit sa chaîne, mon peuple bénirait la sienne, et je serais parvenu à imprimer, non sur les fronts, mais au fond des consciences, le sceau de la servitude.
L'Opinion seule peut renverser un tel édifice d'iniquité; mais par où l'entamera-t-elle, si chaque pierre est tabou? — C'est l'affaire du temps et de l'imprimerie.
A Dieu ne plaise que je veuille ébranler ici ces croyances consolantes qui relient cette vie d'épreuves à une vie de félicités! Mais qu'on ait abusé de l'irrésistible pente qui nous entraîne vers elles, c'est ce que personne, pas même le chef de la chrétienté, ne pourrait contester. Il y a, ce me semble, un signe pour reconnaître si un peuple est dupe ou ne l'est pas. Examinez la Religion et le prêtre; examinez si le prêtre est l'instrument de la Religion, ou si la Religion est l'instrument du prêtre.
Si le prêtre est l'instrument de la Religion, s'il ne songe qu'à étendre sur la terre sa morale et ses bienfaits, il sera doux, tolérant, humble, charitable, plein de zèle; sa vie reflétera celle de son divin modèle; il prêchera la liberté et l'égalité parmi les hommes, la paix et la fraternité entre les nations; il repoussera les séductions de la puissance temporelle, ne voulant pas faire alliance avec ce qui a le plus besoin de frein en ce monde; il sera l'homme du peuple, l'homme des bons conseils et des douces consolations, l'homme de l'Opinion, l'homme de l'Evangile.
Si, au contraire, la Religion est l'instrument du prêtre, il la traitera comme on traite un instrument qu'on altère, qu'on plie, qu'on retourne en toutes façons, de manière à en tirer le plus grand avantage pour soi. Il multipliera les questions tabou; sa morale sera flexible comme les temps, les hommes et les circonstances. Il cherchera à en imposer par des gestes et des attitudes étudiés; il marmottera cent fois par jour des mots dont le sens sera évaporé, et qui ne seront plus qu'un vain conventionalisme. Il trafiquera des choses saintes, mais tout juste assez pour ne pas ébranler la foi en leur sainteté, et il aura soin que le trafic soit d'autant moins ostensiblement actif que le peuple est plus clairvoyant. Il se mêlera des intrigues de la terre; il se mettra toujours du côté des puissants à la seule condition que les puissants se mettront de son côté. En un mot, dans tous ses actes, on reconnaîtra qu'il ne veut pas faire avancer la Religion par le clergé, mais-le clergé par la Religion; et comme tant d'efforts supposent un but, comme ce but, dans cette hypothèse, ne peut être autre que la puissance et la richesse, le signe définitif que le peuple est dupe, c'est quand le prêtre est riche et puissant.
Il est bien évident qu'on peut abuser d'une Religion vraie comme d'une Religion fausse. Plus même son autorité est respectable, plus il est à craindre qu'on ne pousse loin l'épreuve. Mais il y a bien de la différence dans les résultats. L'abus insurge toujours la partie saine, éclairée, indépendante d'un peuple. Il ne se peut pas que la foi n'en soit ébranlée, et l'affaiblissement d'une religion vraie est bien autrement funeste que l'ébranlement d'une Religion fausse.
La Spoliation par ce procédé et la clairvoyance d'un peuple sont toujours en proportion inverse l'une de l'autre, car il est de la nature des abus d'aller tant qu'ils trouvent du chemin. Non qu'au milieu de la population la plus ignorante, il ne se rencontre des prêtres purs et dévoués, mais comment empêcher la fourbe de revêtir la soutane et l'ambition de ceindre la mitre? Les spoliateurs obéissent à la loi malthusienne: ils multiplient comme les moyens d'existence; et les moyens d'existence des fourbes, c'est la crédulité de leurs dupes. Ou a beau chercher, on trouve toujours qu'il faut que l'Opinion s'éclaire. Il n'y a pas d'autre Panacée.
Une autre variété de Spoliation par la ruse s'appelle fraude commerciale, nom qui me semble beaucoup trop restreint, carne s'en rend pas coupable seulement le marchand qui altère la denrée ou raccourcit son mètre, mais aussi le médecin qui se fait payer des conseils funestes, l'avocat qui embrouille les procès, etc. Dans l'échange entre deux services, l'un est de mauvais aloi; mais ici, le service reçu étant toujours préalablement et volontairement agréé, il est clair que la Spoliation de cette espèce doit reculer à mesure que la clairvoyance publique avance.
Vient ensuite l'abus des services publics, champ immense de Spoliation tellement immense que nous ne pouvons y jeter qu'un coup d'œil.
Si Dieu avait fait de l'homme un animal solitaire, chacun travaillerait pour soi. La richesse individuelle serait en proportion des services que chacun se rendrait à soi même.
Mais l'homme étant sociable, les services s'échangent les uns contre les autres, proposition que vous pouvez, si cela vous convient, construire à rebours.
Il y a dans la société des besoins tellement généraux; tellement universels, que ses membres y pourvoient en organisant des services publics. Tel est le besoin de la sécurité. On se concerte, on se cotise pour rémunérer en services divers ceux qui rendent le service de veiller à la sécurité commune.
Il n'y a rien là qui soit en dehors de l'Economie politique: Fais ceci pour moi, je ferai cela pour toi. L'essence de la transaction est la même, le procédé rémunératoire seul est différent; mais cette circonstance a une grande portée.
Dans les transactions ordinaires chacun reste juge soit du service qu'il reçoit, soit du service qu'il rend. Il peut toujours ou refuser l'échange ou le faire ailleurs, d'où la nécessité de n'apporter sur le marché que des services qui se feront volontairement agréer.
Il n'en est pas ainsi avec l'Etat, surtout avant l'avénement des gouvernements représentatifs. Que nous ayons ou non besoin de ses services, qu'ils soient de bon ou de mauvais aloi, il nous faut toujours les accepter tels qu'il les fournit et les payer au prix qu'il y met.
Or, c'est la tendance de tous les hommes de voir par le petit bout de la lunette les services qu'ils rendent, et par le gros bout les services qu'ils reçoivent; et les choses iraient bon train si nous n'avions pas, dans les transactions privées, la garantie du prix débattu.
Cette garantie, nous ne l'avons pas ou nous ne l'avons guère dans les transactions publiques. — Et cependant, l'Etat, composé d'hommes (quoique de nos jours on insinue le contraire), obéit à l'universelle tendance. Il veut nous servir beaucoup, nous servir plus que nous ne voulons, et nous faire agréer comme service vrai ce qui est quelquefois loin de l'être, et cela, pour nous imposer en retour des services on contributions.
L'Etat aussi est soumis à la loi malthusienne. Il tend à dépasser le niveau de ses moyens d'existence, il grossit en proportion de ces moyens, et ce qui le fait exister c'est la substance des peuples. Malheur donc aux peuples qui ne savent pas limiter la sphère d'action de l'Etat. Liberté, activité privée, richesse, bien-être, indépendance, dignité, tout y passera.
Car il y a une circonstance qu'il faut remarquer, c'est celle-ci: Parmi les services que nous demandons à l'Etat, le principal est la sécurité. Pour nous la garantir, il faut qu'il dispose d'une force capable de vaincre toutes les forces, particulières ou collectives, intérieures ou extérieures, qui pourraient la compromettre. Combinée avec cette fâcheuse disposition que nous remarquons dans les hommes à vivre aux dépens des autres, il y a là un danger qui saute aux yeux.
Aussi, voyez sur quelle immense échelle, depuis les temps historiques, s'est exercée la Spoliation par abus et excès du gouvernement? Qu'on se demande quels services ont rendus aux populations et quels services en ont retirés les pouvoirs publics chez les Assyriens, les Babyloniens, les Egyptiens, les Romains, les Persans, les Turcs, les Chinois, les Russes, les Anglais, les Espagnols, les Français? L'imagination s'effraie devant cette énorme disproportion.
Enfin, on a inventé le gouvernement représentatif et, à priori, on aurait pu croire que le désordre allait cesser comme par enchantement.
En effet, le principe de ces gouvernements est celui-ci:
« La population elle-même, par ses représentants, décidera la nature et l'étendue des fonctions qu'elle juge à propos de constituer en services publics, et la quotité de la rémunération qu'elle entend attacher à ces services. »
La tendance à s'emparer du bien d'autrui et la tendance à défendre son bien étaient ainsi mises en présence. On devait penser que la seconde surmonterait la première.
Certes, je suis convaincu que la chose réussira à la longue. Mais il faut bien avouer que jusqu'ici elle n'a pas réussi.
Pourquoi? par deux motifs bien simples: les gouvernements ont eu trop, et les populations pas assez de sagacité.
Les gouvernements sont fort habiles. Ils agissent avec méthode, avec suite, sur un plan bien combiné et constamment perfectionné par la tradition et l'expérience. Ils étudient les hommes et leurs passions. S'ils reconnaissent, par exemple. qu'ils ont l'instinct de la guerre, ils attisent, ils excitent ce funeste penchant. Ils environnent la nation de dangers par l'action de la diplomatie, et tout naturellement ensuite, ils lui demandent des soldats, des marins, des arsenaux, des fortifications: souvent même ils n'ont que la peine de les laisser offrir; alors ils ont des grades, des pensions et des places à distribuer. Pour cela, il faut beaucoup d'argent; les impôts et les emprunts sont là.
Si la nation est généreuse, ils s'offrent à guérir tous les maux de l'humanité. Ils relèveront, disent-ils, le commerce, feront prospérer l'agriculture, développeront les fabriques, encourageront les lettres et les arts, extirperont la misère, etc., etc. Il ne s'agit que de créer des fonctions et payer des fonctionnaires.
En un mot, la tactique consiste à présenter comme services effectifs ce qui n'est qu'entraves; alors la nation paie non pour être servie, mais desservie. Les gouvernements, prenant des proportions gigantesques, finissent par absorber la moitié de tous les revenus. Et le peuple s'étonne de travailler autant, d'entendre annoncer des inventions merveilleuses qui doivent multiplier à l'infini les produits et... d'être toujours Gros-Jean comme devant.
C'est que, pendant que le gouvernement déploie tant d'habileté, le peuple n'en montre guère. Ainsi, appelé à choisir ses chargés de pouvoirs, ceux qui doivent déterminer la sphère et la rémunération de l'action gouvernementale, qui choisit-il? Les agents du gouvernement. Il charge le pouvoir exécutif de fixer lui-même la limite de son activité et de ses exigences. Il fait comme le Bourgeois gentilhomme, qui, pour le choix et le nombre de ses habits, s'en remet... à son tailleur.202
Cependant les choses vont de mal en pis, et le peuple ouvre enfin les yeux, non sur le remède (il n'en est pas là encore), mais sur le mal.
Gouverner est un métier si doux que tout le monde y aspire. Aussi les conseillers du peuple ne cessent de lui dire: Nous voyons tes souffrances et nous les déplorons. Il en serait autrement si nous te gouvernions.
Cette période, qui est ordinairement fort longue, est celle des rébellions et des émeutes. Quand le peuple est vaincu, les frais de la guerre s'ajoutent à ses charges. Quand il est vainqueur, le personnel gouvernemental change et les abus restent.
Et cela dure jusqu'à ce qu'enfin le peuple apprenne à connaître et à défendre ses vrais intérêts. Nous arrivons donc toujours à ceci: Il n'y a de ressource que dans le progrès de la Raison publique.
Certaines nations paraissent merveilleusement disposées à devenir la proie de la Spoliation gouvernementale. Ce sont celles où les hommes, ne tenant aucun compte de leur propre dignité et de leur propre énergie, se croiraient perdus s'ils n'étaient administrés et gouvernés en toutes choses. Sans avoir beaucoup voyagé, j'ai vu des pays où l'on pensé que l'agriculture ne peut faire aucun progrès si l'Etat n'entretient des fermes expérimentales; qu'il n'y aura bientôt plus do chevaux, si l'Etat n'a pas de haras; que les pères ne feront pas élever leurs enfants on ne leur feront enseigner que des choses immorales, si l'Etat ne décide pas ce qu'il est bon d'apprendre, etc., etc. Dans un tel pays, les révolutions peuvent se succéder rapidement, les gouvernants tomber les uns sur les autres. Mais les gouvernés n'en seront pas moins gouvernés à merci et miséricorde (car la disposition que je signale ici est l'étoffe même dont les gouvernements sont faits), jusqu'à ce qu'enfin le peuple s'aperçoive qu'il vaut mieux laisser le plus grand nombre possible de services dans la catégorie de ceux que les parties intéressées échangent à prix débattut.203
Nous avons vu que la société est échange des services. Elle ne devrait être qu'échange de bons et loyaux services. Mais nous avons constaté aussi que les hommes avaient un grand intérêt et, par suite, une pente irrésistible à exagérer la valeur relative des services qu'ils rendent. Et véritablement, je ne puis apercevoir d'autre limite à cette prétention que la libre acceptation ou le libre refus de ceux à qui ces services sont offerts.
De là il arrive que certains hommes ont recours à la lc i pour qu'elle diminue chez les autres les naturelles prérogatives de cette liberté. Ce genre île spoliation s'appelle Privilége ou Monopole. Marquons-en bien l'origine et le caractère.
Chacun sait que les services qu'il apporte dans le marché général y seront d'autant plus appréciés et rémunérés qu'ils y seront plus rares. Chacun implorera donc l'intervention de la^ loi pour éloigner du marché tous ceux qui viennent y offrir des services analogues, — ou. ce qui revient au même, si le concours d'un instrument est indispensable pour que le service soit rendu, il en demandera à la loi la possession exclusive.204
Cette variété de Spoliation étant l'objet principal de ce volume, j'en dirai peu de chose ici, et me bornerai à une remarque.
Quand le monopole est un fait isolé, il ne manque pas d'enrichir celui que la loi en a investi. Il peut arriver alors que chaque classe de travailleurs, au lieu de poursuivre la chute de ce monopole, réclame pour elle-même un monopole semblable. Cette nature de Spoliation, ainsi réduite en système, devient alors la plus ridicule des mystifications pour tout le monde, et le résultat définitif est que chacun croit retirer plus d'un marché général appauvri de tout.
Il n'est pas nécessaire d'ajouter que ce singulier régime introduit en outre un antagonisme universel entre toutes les classes, toutes les professions, tous les peuples; qu'il exige une interférence constante, mais toujours incertaine de l'action gouvernementale; qu'il abonde ainsi dans le sens des abus qui font l'objet du précédent paragraphe; qu'il place toutes les industries dans une insécurité irrémédiable, et qu'il accoutume les hon:mes à mettre sur la loi. et non sur eux-mêmes, la responsabilité de leur propre existence. Il serait difficile d'imaginer une cause plus active de perturbation sociale.205
Justification.
On dira: «Pourquoi ce vilain mot: Spoliation? Outre qu'il est grossier, il blesse- il irrite, il tourne contre vous les hommes calmes et modérés, il envenime la lutte. »
Je le déclare hautement, je respecte les personnes; je crois à la sincérité de presque tous les partisans de la Protection; et je ne me reconnais le droit de suspecter la probité personnelle, la délicatesse, la philanthropie de qui que ce soit. Je répète encore que la Protection est l'œuvre, l'œuvre funeste, d'une commune erreur dont tout le monde, ou du moins la grande majorité, est à la fois victime et complice. — Après cela je ne puis pas empêcher que les choses ne soient ce qu'elles sont.
Qu'on se figure une espèce de Diogène mettant la tête hors de son tonneau, et disant: « Athéniens, vous vous faites servir par des esclaves. N'avez-vous jamais pensé que vous exerciez sur vos frères la plus inique des spoliations? »
Ou encore, un tribun parlant ainsi dans le Forum: « Romains, vous avez fondé tous vos moyens d'existence sur le pillage successif de tous les peuples. »
Certes, ils ne feraient qu'exprimer une vérité incontestable. Faudrait-il en conclure qu'Athènes et Rome n'étaient habitées que par de malhonnêtes gens? que Socrate et Platon, Caton et Cincinnatus étaient des personnages méprisables?
Qui pourrait avoir une telle pensée? Mais ces grands hommes vivaient dans un milieu qui leur était la conscience de leur injustice. On sait qu'Aristote ne pouvait pas même se faire l'idée qu'une société pût exister sans esclavage.
Dans les temps modernes, l'esclavage a vécu jusqu'à nos jours sans exciter beaucoup de scrupules dans l'âme des planteurs. Des armées ont servi d'instrument à de grandes conquêtes, c'est-à dire à de grandes spoliations. Est-ce à dire qu'elles ne fourmillent pas de soldats et d'officiers, personnellement aussi délicats, plus délicats peut-être qu'on ne l'est généralement dans les carrières industrielles; d'hommes à qui la pensée seule d'un vol ferait monter le rouge au front, et qui affronteraient mille morts plutôt que de descendre à une bassesse?
Ce qui est blâmable ce ne sont pas les individus, mais le mouvement général qui les entraîne et les aveugle, mouvement dont la société entière est coupable.
Il en est ainsi du Monopole. J'accuse le système, et non point les individus; la société en masse, et non tel ou tel de ses membres. Si les plus grands philosophes ont pu se faire illusion sur l'iniquité de l'esclavage, à combien plus forte raison des agriculteurs et des fabricants peuvent-ils se tromper sur la nature et les effets du régime restrictif?
36.Bastiat on "Refuting Economic Fallacies III: A Small Play about Protection" (January, 1848)↩
[Word Length: 3,451]
Source
Frédéric Bastiat, Sophismes économiques. Deuxième série (Paris: Guillaumin, 1848). Chap. XIII. - "La Protection ou les Trois Échevins," pp. 134-49. The second collection of Economic Sophisms appeared in January 1848.
XIII. - La Protection ou les Trois Échevins.
Démonstration en quatre tableaux.
PREMIER TABLEAU.
(La scène le passe dans l'hotel de l'Echevin Pierre. La fenêtre donne sur un beau parc; trois personnages sont attablés près d'un bon feu.)
PIERRE. Ma foi! vive le feu quand Gaster est satisfait. Il faut convenir que c'est une douce chose. Mais hélas! que de braves gens, comme le Roi d'Yvetot,
Soufflent, faute de bois,
Dans leurs doigts.
Malheureuses créatures! le Ciel m'inspire une pensée charitable. Vous voyez ces beaux arbres, je les veux abattre et distribuer le bois aux pauvres.
PAUL et JEAN. Quoi! gratis?
PIERRE. Pas précisément. C'en serait bientôt fait de mes bonnes œuvres, si je dissipais ainsi mon bien. J'estime que mon parc vaut vingt mille livres; en l'abattant, j'en tirerai bien davantage.
PAUL. Erreur. Votre bois sur pied a plus de valeur que celui des forêts voisines, car il rend des services que celui-ci ne peut pas rendre. Abattu, il ne sera bon, comme l'autre, qu'au chauffage, et ne vaudra pas un denier de plus la voie.
PIERRE. Oh! oh! Monsieur le théoricien, vous oubliez que je suis, moi, un homme de pratique. Je croyais ma réputation de spéculateur assez bien établie, pour me mettre à l'abri d'êre taxé de niaiserie. Pensez-vous que je vais m'amuser à vendre mon bois au prix du bois flotté?
PAUL. Il le faudra bien.
PIERRE. Innocent! Et si j'empêche le bois flotté d'arriver à Paris?
PAUL. Ceci changerait la question. Mais comment vous y prendrez-vous?
PIERRE. Voici tout le secret. Vous savez que le bois flotté paie à l'entrée dix sous la voie. Demain je décide les Echevins à porter le droit à 100, 200, 300 livres, enfin, assez haut pour qu'il n'en entre pas de quoi faire une bûche. — Eh! saisissez-vous? — Si le bon peuple ne veut pas crever de froid, il faudra bien qu'il vienne à mon chantier. On se battra pour avoir mon bois, je le vendrai au poids de l'or, et cette charité bien ordonnée, me mettra à même d'en faire d'autres.
PAUL. Morbleu! la belle invention! elle m'en suggère une autre de même force.
JEAN. Voyons, qu'est-ce? La philanthropie est-elle aussi en jeu?
PAUL. Comment avez-vous trouvé ce beurre de Normandie?
JEAN. Excellent.
PAUL. Eh! eh! il me paraissait passable tout à l'heure. Mais ne trouvez-vous pas qu'il prend à la gorge? J'en veux faire de meilleur à Paris. J'aurai quatre ou cinq cents vaches; je ferai au pauvre peuple une distribution de lait, de beurre et de fromage.
PIERRE et PAUL. Quoi! charitablement?
PAUL. Bah! mettons toujours la charité en avant. C'est une si belle figure que son masque même est un excellent passe-port. Je donnerai mon beurre au peuple, le peuple me donnera son argent. Est-ce que cela s'appelle vendre?
JEAN. Non, selon le bourgeois gentilhomme; mais appelez-le comme il-vous plaira, vous vous ruinerez. Est-ce que Pans peut lutter avec la Normandie pour l'élève des vaches?
PAUL. J'aurai pour moi l'économie du transport.
JEAN. Soit. Mais encore en payant le transport les Normands sont à même de battre les Parisiens.
PAUL. Appelez-vous battre quelqu'un, lui livrer les choses à bas prix?
JEAN. C'est le mot consacré. Toujours est-il que vous serez battu, vous.
PAUL. Oui, comme Don Quichotte. Les coups retomberont sur Sancho. Jean, mon ami, vous oubliez l'octroi.
JEAN. L'octroi! qu'a-t-il à démêler avec votre beurre?
PAUL. Dès demain, je réclame protection; je décide la commune à prohiber le beurre de Normandie et de Bretagne. Il faudra bien que le peuple s'en passe, ou qu'il achète le mien, et à mon prix encore.
JEAN. Par là sembleu, Messieurs, votre philanthropie m'entraîne.
On apprend à hurler, dit l'autre, avec les loups,
Mon parti est pris. Il ne sera pas dit que je suis Echevin indigne. Pierre, ce feu pétillant a enflammé votre âme; Paul, ce beurre a donné du jeu aux ressorts de votre esprit; eh bien! je sens aussi que cette pièce de salaison stimule mon intelligence. Demain, je vote et fais voter l'exclusion des porcs, morts ou vifs; cela fait, je construis de superbes loges en plein Paris,
Pour l'animal immonde aux Hébreux défendu.
Je me fais porcher et charcutier. Voyons comment le bon peuple lutécien évitera de venir s'approvisionner à ma boutique.
PIERRE. Eh, Messieurs, doucement, si vous renchérissez ainsi le beurre et le salé, vous rognez d'avance le profit que j'attendais de mon bois.
PAUL. Dame! ma spéculation n'est plus aussi merveilleuse, si vous me rançonnez avec vos bûches et vos jambons.
JEAN. Et moi, que gagnerai-je à vous faire surpayer mes saucisses, si vous me faites surpayer les tartines et les falourdes?
PIERRE. Eh bien! voilà-t-il pas que nous allons nous quereller? Unissons-nous plutôt. Faisons-nous des concessions réciproques. D'ailleurs, il n'est pas bon de n'écouter que le vil intérêt; l'humanité est là, ne faut-il pas assurer le chauffage du peuple?
PAUL. C'est juste. Et il faut que le peuple ait du beurre à étendre sur son pain.
JEAN. Sans doute. Et il faut qu'il puisse mettre du lard dans son pot au feu.
ENSEMBLE. En avant la charité! vive la philanthropie! à demain! à demain! nous prenons l'octroi d'assaut.
PIERRE. Ah! j'oubliais. Encore un mot: c'est essentiel. Mes amis, dans ce siècle d'égoïsme, le monde est méfiant; et les intentions les plus pures sont souvent mal interprétées. Paul, plaidez pour le bois; Jean, défendez le beurre, et moi je me voue au cochon local. Il est bon de prévenir les soupçons malveillants.
PAUL et JEAN ( en sortant ). Par ma foi! voilà un habile homme!
SECOND TABLEAU.
Conseil des Échevins.
PAUL. Mes chers collègues, il entre tous les jours des niasses de bois à Paris, ce qui eu fait sortir des masses de numéraire. De ce train, nous sommes tous ruinés en trois ans, et que deviendra le pauvre peuple? (bravo! ) Prohibons le bois étranger. — Ce n'est pas pour moi que je parle, car de tout le bois que je possède, on ne ferait pas un curedents. Je suis donc parfaitement désintéressé dans la question. (Bien, bien.!) Mais voici Pierre qui a un parc, il assurera le chauffage à nos concitoyens, qui ne seront plus sous la dépendance des charbonniers de l'Yonne. Avez-vous jamais songé au danger que nous courons de mourir de froid, s'il prenait fantaisie aux propriétaires des forêts étrangères de ne plus porter du bois à Paris? Prohibons donc le bois. Par là nous préviendrons l'épuisement de notre numéraire, nous créerons l'industrie bûcheronne, et nous ouvrirons à nos ouvriers une nouvelle source de travail et de salaires (applaudissements.)
JEAN. J'appuie la proposition si philanthropique, et surtout si désinteressée, ainsi qu'il le disait lui-même, de l'honorable préopinant. Il est temps que nous arrêtions cet insolent laisser passer, qui a amené sur notre marché une concurrence effrénée, en sorte qu'il n'est pas une province un peu bien située, pour quelque production que ce soit, qui ne vienne nous en inonder, nous la vendre à vil prix, et détruire le travail parisien. C'est à l'État à niveler les conditions de production par des droits sagement pondérés, à ne laisser entrer du dehors que ce qui y est plus cher qu'à Paris, et à nous soustraire ainsi à une lutte inégale. Comment, par exemple, veut-on que nous puissions faire du lait et du beurre à Paris, en présence de la Bretagne et de la Normandie? Songez donc, Messieurs, que les Bretons ont la terre meilleur marché, le foin plus à portée, la main-d'œuvre à des conditions plus avantageuses. Le bon sens ne dit-il pas qu'il faut égaliser les chances par un tarif d'octroi protecteur? Je demande que le droit sur le lait et le beurre soit porté à 1,000 p. 100, et plus s'il le faut. Le déjeuner du peuple en sera un peu plus cher, mais aussi comme ses salaires vont hausser! nous verrons s'élever des étables, des laiteries, se multiplier des barates, et se fonder de nouvelles industries. — Ce n'est pas que j'aie le moindre intérêt à ma proposition. Je ne suis pas vacher, ni ne veux l'être. Je suis mu par le seul désir d'être utile aux classes laborieuses (mouvement d'adhésion).
PIERRE. Je suis heureux de voir dans cette assemblée des hommes d'Etat aussi purs, aussi éclairés, aussi dévoués aux intérêts du peuple ( bravo). J'admire leur abnégation, et je ne saurais mieux faire que d'imiter un si noble exemple. J'appuie leur motion, et j'y ajoute celle de prohiber les porcs du Poitou. Ce n'est pas que je veuille me faire porcher ni charcutier; en ce cas, ma conscience me ferait un devoir de m'abstenir. Mais n'est-il pas honteux, Messieurs, que nous soyons tributaires de ces paysans Poitevins, qui ont l'audace de venir jusque sur notre propre marché, s'emparer d'un travail que nous pourrions faire nous-mêmes? qui, après nous avoir inondés de saucisses et de jambons, ne nous prennent peut-être rien en retour? En tous cas, qui nous dit que la balance du commerce n'est pas en leur faveur et que nous ne sommes pas obligés de leur payer une solde en argent? N'est-il pas clair que si l'industrie poitevine s'implantait à Paris, elle ouvrirait des débouchés assurés au travail parisien? — Et puis, Messieurs, n'est-il pas fort possible, comme le disait si bien M. Lestiboudois, que nous achetions le salé poitevin, non pas avec nos revenus, mais avec nos capitaux? Où cela nous mènerait-il? Ne souffrons donc pas que des rivaux avides, cupides, perfides, viennent vendre ici les choses à bon marché, et nous mettre dans l'impossibilité de les faire nous-mêmes. Echevins, Paris nous a donné sa confiance, c'est à nous de la justifier. Le peuple est sans ouvrage, c'est à nous de lui en créer, et si le salé lui coûte un peu plus cher, nous aurons du moins la conscience d'avoir sacrifié nos intérêts à ceux des masses, comme tout bon échevin doit faire (tonnerres d'applaudissements).
UNE VOIX. J'entends qu'on parle beaucoup du pauvre peuple, mais sous prétexte de lui donner du travail, on commence par lui enlever ce qui vaut mieux que le travail même, le bois, le beurre et la soupe.
PIERRE, PAUL et JEAN. Aux voix! aux voix! à bas les utopistes, les théoriciens, les généralisateurs. Aux voix! aux voix! (Les trois propositions sont admises. )
TROISIÈME TABLEAU.
Vingt ans après.
JACQUES BONHOMME, ET SON FILS.
LE FILS. Père, décidez-vous, il faut quitter Paris. On n'y peut plus vivre. L'ouvrage manque et tout y est cher.
LE PÈRE. Mon enfant, tu ne sais pas ce qu'il en coûte d'abandonner le lieu qui nous a vu naître.
LE FILS. Le pire de tout est d'y périr de misère.
LE PÈRE. Va, mon fils, cherche une terre plus hospitalière. Pour moi je ne m'éloignerai pas de cette fosse où sont descendus ta mère, tes frères et tes sœurs. Il me tarde d'y trouver enfin auprès d'eux le repos qui m'a été refusé dans cette ville de désolation.
LE FILS. Du courage, bon père, nous trouverons du travail à l'étranger, en Poitou, en Normandie, en Bretagne. On dit que toute l'industrie de Paris se transporte peu à peu dans ces lointaines contrées.
LE PÈRE. C'est bien naturel. Ne pouvant plus nous vendre du bois et des aliments, elles ont cessé d'en produire au delà de leurs besoins; ce qu'elles ont de temps et de capitaux disponibles, elles le consacrent à faire elles-mêmes ce que nous leur fournissions autrefois.
LE FILS. De même qu'à Paris on cesse de faire de beaux meubles et de beaux vêtements, pour planter des arbres, élever des porcs et des vaches. Quoique bien jeune, j'ai vu de vastes magasins, de somptueux quartiers, des quais animés sur ces bords de la Seine, envahis maintenant par des prés et des taillis.
LE PÈRE. Pendant que la province se couvre de villes, Paris se fait campagne. Quelle affreuse révolution. Et il a suffit de trois Échevins égarés, aidés de l'ignorance publique, pour attirer sur nous cette terrible calamité.
LE FILS. Contez-moi cette histoire, mon père.
LE PÈRE. Elle est bien simple. Sous prétexte d'implanter à Paris trois industries nouvelles et de donner ainsi de l'aliment au travail des ouvriers, ces hommes firent prohiber le bois, le beurre et la viande. Ils s'arrogèrent le droit d'en approvisionner leurs concitoyens. Ces objets s'élevèrent d'abord à un prix exorbitant. Personne ne gagnait assez pour s'en procurer, et le petit nombre de ceux qui pouvaient en obtenir, y mettant tous leurs profits, étaient hors d'état d'acheter autre chose; toutes les industries par cette cause s'arrêtèrent à la fois, d'autant plus vite que les provinces n'offraient non plus aucuns débouchés. La misère, la mort, l'émigration commencèrent à dépeupler Paris.
LE FILS. Et quand cela s'arrêtera-t-il?
LE PÈRE. Quand Paris sera devenu une forêt et une prairie.
LE FILS. Les trois Échevins doivent avoir fait une grande fortune?
LE PÈRE. D'abord, ils réalisèrent d'énormes profits; mais à la longue ils ont été enveloppés dans la misère commune.
LE FILS. Comment cela est-il possible?
LE PÈRE. Tu vois cette ruine, c'était un magnifique hôtel entouré d'un beau parc. Si Paris eût continué à progresser, maître Pierre en tirerait plus de rentes qu'il ne vaut aujourd'hui en capital.
LE FILS. Comment cela se peut-il puisqu'il s'est débarrassé de la concurrence?
LE PÈRE. La concurrence pour vendre a disparu, mais la concurrence pour acheter disparaît aussi tous les jours et continuera de disparaître jusqu'à ce que Paris soit rase campagne et que le taillis de maître Pierre n'ait pas plus de valeur qu'une égale superficie de taillis dans la forêt de Bondy. C'est ainsi que le monopole, comme toute injustice, porte en lui-même son propre châtiment.
LE FILS. Cela ne me semble pas bien clair, mais ce qui est incontestable c'est la décadence de Paris. N'y a-t-il donc aucun moyen de renverser cette mesure inique que Pierre et ses collègues firent adopter il y a vingt ans?
LE PÈRE. Je vais te confier mon secret. Je reste à Paris pour cela; j'appellerai le peuple à mon aide. Il dépend de lui de replacer l'octroi sur ses anciennes bases, de le dégager de ce funeste principe qui s'y est enté dessus et y a végété comme un fungus parasite.
LE FILS. Vous devez réussir dès le premier jour.
LE PÈRE. Oh! l'œuvre est au contraire difficile et laborieuse. Pierre, Paul et Jean s'entendent à merveille. Ils sont prêts à tout plutôt que de laisser entrer le bois, le beurre et la viande à Paris. Ils ont pour eux le peuple même qui voit clairement le travail que lui donnent les trois industries protégées, qui sait à combien de bûcherons et de vachers elles donnent de l'emploi, mais qui ne peut avoir une idée aussi précise du travail qui se développerait au grand air de la liberté.
LE FILS. Si ce n'est que cela, vous l'éclairerez.
LE PÈRE. Enfant, à ton âge on ne doute de rien. Si j'écris, le peuple ne lira pas; car, pour soutenir sa malheureuse existence, il n'a pas trop de toutes ses heures. Si je parle, les Échevins me fermeront la bouche. Le peuple restera donc longtemps dans sou funeste égarement; les partis politiques qui fondent leurs espérances sur ses passions s'occuperont moins de dissiper ses préjugés que de les exploiter. J'aurai donc à la fois sur les bras les puissants du jour, le peuple et les partis. Oh! je vois ira orage effroyable prêt à fondre sur la tête de l'audacieux qui osera s'élever contre une iniquité si enracinée dans le pays.
LE FILS. Vous aurez pour vous la justice et la vérité.
LE PÈRE. Et ils auront pour eux la force et la calomnie. Encore, si j'étais jeune! niais l'âge et la souffrance ont épuisé mes forces.
LE FILS. Eh bien, père, ce qui vous en reste, consacrez-le au service de la patrie. Commencez cette œuvre d'affranchissement et laissez-moi pour héritage le soin de l'achever.
QUATRIÈME TABLEAU.
L'agitation.
JACQUES BONHOMME. Parisiens, demandons la réforme de l'octroi; qu'il soit rendu à sa première destination. Que tout citoyen soit LIBRE d'acheter du bois, du beurre et de la viande où bon lui semble.
LE PEUPLE. Vive, vive la LIBERTÉ!
PIERRE. Parisiens, ne vous laissez pas séduire à ce mot. Que vous importe la liberté d'acheter si vous n'en avez pas les moyens? et comment en aurez-vous les moyens si l'ouvrage vous manque? Paris peut-il produire du bois à aussi bon marché que la forêt de Bondy? de la viande à aussi bas prix que le Poitou? du beurre à d'aussi bonnes conditions que la Normandie? si vous ouvrez la porte à deux battants à ces produits rivaux, que deviendront les vachers, les bûcherons et les charcutiers? Ils ne peuvent se passer de protection.
LE PEUPLE. Vive, vive la PROTECTION!
JACQUES. La protection! mais vous protége-t-on, vous, ouvriers? ne vous faites-vous pas concurrence les uns aux autres? que les marchands de bois souffrent donc la concurrence à leur tour. Ils n'ont pas le droit d'élever par la loi le prix de leur bois, à moins qu'ils n'élèvent aussi, par la loi, le taux des salaires. N'êtes-vous plus ce peuple amant de l'égalité?
LE PEUPLE. Vive, vive l'ÉGALITÉ!
PIERRE. N'écoutez pas ce factieux, nous avons élevé le prix du bois, de la viande et du beurre, c'est vrai; mais c'est pour pouvoir donner de bons salaires aux ouvriers. Nous sommes mus par la charité.
LE PEUPLE. Vive, vive la CHARITÉ!
JACQUES. Faites servir l'octroi, si vous pouvez, à hausser les salaires, ou ne le faites pas servir à renchérir les produits. Les Parisiens ne demandent pas la charité, mais la justice.
LE PEUPLE. Vive, vive la JUSTICE!
PIERRE. C'est précisément la cherté des produits, qui amènera par ricochet la cherté des salaires.
LE PEUPLE. Vive, vive la CHERTÉ!
JACQUES. Si le beurre est cher, ce n'est pas parce que vous payez chèrement les ouvriers; ce n'est pas même que vous fassiez de grands profits, c'est uniquement parce que Paris est mal placé pour cette industrie, parce que vous avez voulu qu'on fît à la ville ce qu'on doit faire à la campagne, et à la campagne ce qui se faisait à la ville. Le peuple n'a pas plus de travail, seulement il travaille à autre chose. Il n'a pas plus de salaires, seulement il n'achète plus les choses à aussi bon marché.
LE PEUPLE. Vive, vive le BON MARCHÉ!
PIERRE. Cet homme vous séduit par ses belles phrases. Posons la question dans toute sa simplicité. N'est-il pas vrai que si nous admettons le beurre, le bois, la viande, nous en serons inondés? nous périrons de pléthore. Il n'y a donc d'autre moyen, pour nous préserver de cette invasion de nouvelle espèce, que de lui fermer la porte, et pour maintenir le prix des choses que d'en occasionner artificiellement la rareté.
QUELQUES VOIX FORT RARES. Vive, vive la RARETÉ!
JACQUES. Posons la question dans toute sa vérité. Entre tous les Parisiens, on ne peut partager que ce qu'il y a dans Paris; s'il y a moins de bois, de viande, de beurre, la part de chacun sera plus petite. Or il y en aura moins si nous les repoussons, que si nous les laissons entrer. Parisiens, il ne peut y avoir abondance pour chacun, qu'autant qu'il y a abondance générale.
LE PEUPLE. Vive, vive ABONDANCE!
PIERRE. Cet homme a beau dire, il ne vous prouvera pas que vous soyez intéressés à subir une concurrence effrénée.
LE PEUPLE. A bas, à bas la CONCURRENCE!
JACQUES. Cet homme a beau déclamer, il ne vous fera pas goûter les douceurs de la restriction.
LE PEUPLE. A bas, à bas la RESTRICTION!
PIERRE. Et moi je déclare que si l'on prive les pauvres vachers et porchers de leur gagne-pain, si on les sacrifie à des théories, je ne réponds plus de l'ordre public. Ouvriers, méfiez-vous de cet homme. C'est un agent de la perfide Normandie, il va chercher ses inspirations à l'étranger. C'est un traître, il faut le pendre.
Le peuple garde le silence.
JACQUES. Parisiens, tout ce que je dis aujourd'hui, je le disais il y a vingt ans lorsque Pierre s'avisa d'exploiter l'octroi à son profit et à votre préjudice. Je ne suis donc pas un agent des Normands. Pendez-moi si vous voulez, mais cela n'empêchera pas l'oppression d'être oppression, Amis, ce n'est ni Jacques ni Pierre qu'il faut tuer, mais la liberté si elle vous fait peur, ou la restriction si elle vous fait mal.
LE PEUPLE. Ne pendons personne et affranchissons tout le monde.
PART IV. The Second Republic (1848–52)
37.Bastiat on “The February Revolution” (March 1848)↩
[Word Length: 4,885]
Source
Frédéric Bastiat, "Funestes Illusions. Les Citoyens Font Vivre L'état, L'état Ne Peut Faire Vivre Les Citoyens." Journal des Économistes, no. 76, Mars 1848, Tome 19, pp. 323-33.
"Funestes Illusions. Les Citoyens Font Vivre L'état, L'état Ne Peut Faire Vivre Les Citoyens."
Il m'est quelquefois arrivé de combattre le Privilége par la plaisanterie. C'était, ce me semble, bien excusable. Quand quelques-uns veulent vivre aux dépens de tous, il est bien permis d'infliger la piqûre du ridicule au petit nombre qui exploite et à la masse exploitée.
Aujourd'hui, je me trouve en face d'une autre illusion. Il ne s'agit plus de priviléges particuliers, il s'agit de transformer le privilége en droit commun. La nation tout entière a conçu l'idée étrange qu'elle pouvait accroître indéfiniment la substance de sa vie, en la livrant à l'État sous forme d'impôts, afin que l'État la lui rende en partie sous forme de travail, de profits et de salaires. On demande que l'État assure le bien-être à tous les citoyens; et une longue et triste procession, où tous les ordres de travailleurs sont représentés, depuis le roide banquier jusqu'à l'humble blanchisseuse, défile devant le grand organisateur pour solliciter une assistance pécuniaire.
Je me tairais s'il n'était question que de mesures provisoires, nécessitées et en quelque sorte justifiées par la commotion de la grande révolution que nous venons d'accomplir; mais ce qu'on réclame, ce ne sont pas des remèdes exceptionnels, c'est l'application d'un système. Oubliant que la bourse des citoyens alimente celle de l'État, on veut que la bourse de l'État alimente celle des citoyens.
Ah! ce n'est pas avec l'ironie et le sarcasme que je m'efforcerai de dissiper cette funeste illusion; car, à mes yeux
du moins, elle jette un voile sombre sur l'avenir; et c'est là, je le crains bien, l'écueil de notre chère République.
D'ailleurs, comment avoir le courage de s'en prendre au peuple, s'il ignore ce qu'on lui a toujours défendu d'apprendre, s'il nourrit dans son cœur des espérances chimériques qu'on s'est appliqué à y faire naître?
Que faisaient naguère et que font encore les puissants du siècle, les grands propriétaires, les grands manufacturiers? Ils demandaient à la loi des suppléments de profits, au détriment de la masse. Est-il surprenant que la masse, aujourd'hui en position de faire la loi, lui demande aussi un supplément de salaires? Mais, hélas! il n'y a pas au-dessous d'elle une autre masse d'où cette source de subventions puisse jaillir. Le regard attaché sur le pouvoir, les industriels s'étaient transformés en solliciteurs. Faites-moi vendre mieux mon blé! faites-moi tirer un meilleur parti de ma viande! Élevez artificiellement le prix de mon fer, de mon drap, de ma houille! Tels étaient les cris qui assourdissaient la Chambre privilégiée. Est-il surprenant que le peuple victorieux se fasse solliciteur à son tour! Mais, hélas! si la loi peut, à la rigueur, faire des largesses à quelques privilégiés, aux dépens de la nation, comment concevoir qu'elle fasse des largesses à la nation tout entière?
Quel exemple donne en ce moment même la classe moyenne? On la voit obséder le gouvernement provisoire et se jeter sur le budget comme sur une proie. Est-il surprenant que le peuple manifeste aussi l'ambition bien humble de vivre au moins en travaillant?
Que disaient sans cesse les gouvernants? A la moindre lueur de prospérité, ils s'en attribuaient sans façon tout le mérite; ils ne parlaient pas des vertus populaires qui en sont la base, de l'activité, de l'ordre, de l'économie des travailleurs. Non, cette prospérité, d'ailleurs fort douteuse, ils s'en disaient les auteurs. Il n'y a pas encore deux mois que j'entendais le ministre du commerce dire: « Grâce à l'intervention active du gouvernement, grâce à la sagesse du roi, grâce au patronage des sciences, toutes les classes industrielles sont florissantes. » Faut-il s'étonner que le peuple ait fini par croire que le bien-être lui venait d'en haut comme une manne céleste, et qu'il tourne maintenant ses regards vers les régions du pouvoir? Quand on s'attribue le mérite de tout le bien qui arrive, on encourt la responsabilité de tout le mal qui survient.
Ceci me rappelle un curé de notre pays. Pendant les premières années de sa résidence, il ne tomba pas de grêle dans la commune; et il était parvenu à persuader aux bons villageois que ses prières avaient l'infaillible vertu de chasser les orages. Cela fut bien tant qu'il ne grêla pas; mais, à la première apparition du fléau, il fut chassé de la paroisse. On lui disait: C'est donc par mauvaise volonté que vous avez permis à la tempête de nous frapper?
La République s'est inaugurée par une semblable déception. Elle a jeté cette parole au peuple, si bien préparé d'ailleurs à la recevoir: «Je garantis le bien-être à tous les citoyens. » Et puisse cette parole ne pas attirer des tempêtes sur notre patrie!
Le peuple de Paris s'est acquis une gloire éternelle par son courage.
Il a excité l'admiration du monde entier par son amour pour l'ordre public, son respect pour tous les droits et toutes les propriétés.
Il lui reste à accomplir une tâche bien autrement difficile, il lui reste à repousser de ses lèvres la coupe empoisonnée qu'on lui présente. Je le dis avec conviction, tout l'avenir de la République repose aujourd'hui sur son bon sens. Il n'est plus question de la droiture de ses intentions, personne ne peut les méconnaître; il s'agit de la droiture de ses instincts. La glorieuse révolution qu'il a accomplie par son courage, qu'il a préservée par sa sagesse, n'a plus à courir qu'un danger: la déception; et contre ce danger, il n'y a qu'une planche de salut: la sagacité du peuple.
Oui, si des voix amies avertissent le peuple, si des mains courageuses lui ouvrent les yeux, quelque chose me dit que la République évitera le gouffre béant qui s'ouvre devant elle; et alors quel magnifique spectacle la France donnera au monde! Un peuple triomphant de ses ennemis et de ses faux amis, un peuple vainqueur des passions d'autrui et de ses propres illusions!
Je commence par dire que les institutions qui pesaient sur nous, il y a à peine quelques jours, n'ont pas été renversées, que la République, ou le gouvernement de tous par tous, n'a pas été fondé pour laisser le peuple (et par ce mot j'entends maintenant la classe des travailleurs, des salariés, ou ce qu'on appelait des prolétaires) dans la même condition où elle était avant.
C'est la volonté de tous, et c'est sa propre volonté, que sa condition change.
Mais deux moyens se présentent, et ces moyens ne sont pas seulement différents, ils sont, il faut bien le dire, diamétralement opposés.
L'école qu'on appelle économiste propose la destruction immédiate de tous les priviléges, de tous les monopoles, la suppression immédiate de toutes les fonctions inutiles, la réduction immédiate de tous les traitements exagérés, une diminution profonde des dépenses publiques, le remaniement de l'impôt, de manière à faire disparaître tous ceux qui pèsent sur les consommations du peuple, qui enchaînent ses mouvements et paralysent le travail. Elle demande, par exemple, que l'octroi, l'impôt sur le sel, les taxes sur l'entrée des subsistances et des instruments de travail, soient sur-le-champ abolis.
Elle demande que ce mot liberté, qui flotte avec toutes nos bannières, qui est inscrit sur tous nos édifices, soit enfin une vérité.
Elle demande qu'après avoir payé au gouvernement ce qui est indispensable pour maintenir la sécurité intérieure et extérieure, pour réprimer les fraudes, les délits et les crimes, et pour subvenir aux grands travaux d'utilité nationale, LE PEUPLE GARDE LE RESTE POUR LUI.
Elle assure que mieux le peuple pourvoira à la sûreté des personnes et des propriétés, plus rapidement se formeront les capitaux.
Qu'ils se formeront avec d'autant plus de rapidité, que le peuple saura mieux garder pour lui ses salaires, au lieu de les livrer, par l'impôt, à l'État.
Que la formation rapide des capitaux implique nécessairement la hausse rapide des salaires, et par conséquent l'élévation progressive des classes ouvrières en bien-être, en indépendance, en instruction et en dignité.
Ce système n'a pas l'avantage de promettre la réalisation instantanée du bonheur universel; mais il nous parait simple, immédiatement praticable, conforme à la justice, fidèle à la liberté, et de nature à favoriser toutes les tendances humaines vers l'égalité et la fraternité. J'y reviendrai après avoir exposé et approfondi les vues d'une autre école, qui paraît en ce moment prévaloir dans les sympathies populaires.
Celle-ci veut aussi le bien du peuple; mais elle prétend le réaliser par voie directe. Sa prétention ne va à rien moins qu'à augmenter le bien-être des masses, c'est-à-dire accroître leurs consommations tout en diminuant leur travail; et, pour accomplir ce miracle, elle imagine de puiser des suppléments de salaires soit dans la caisse commune, soit dans les profits exagérés des entrepreneurs d'industrie.
C'est ce système dont je me propose de signaler les dangers.
Qu'on ne se méprenne pas à mes paroles. Je n'entends pas ici condamner l'association volontaire. Je crois sincèrement que l'association fera faire de grands progrès en tous sens à l'humanité. Des essais sont faits en ce moment, notamment par l'administration du chemin du Nord et celle du journal la Presse. Qui pourrait blâmer ces tentatives? Moi-même, avant d'avoir jamais entendu parler de l'école sociétaire, j'avais conçu un projet d'association agricole destiné à perfectionner le métayage. Des raisons de santé m'ont seules détourné de cette entreprise. Mes doutes ont pour objet, ou, pour parler franchement, ma conviction énergique repousse de toutes ses forces cette tendance manifeste, que vous avez sans doute remarquée, qui vous entraîne aussi peut-être, à invoquer en toutes choses l'intervention de l'État, c'est-à-dire la réalisation de nos utopies, ou, si l'on veut, de nos systèmes, avec la contrainte légale pour principe, et l'argent du public pour moyen.
On a beau inscrire sur son drapeau Association volontaire, je dis que lorsqu'on appelle à son aide la loi et l'impôt, l'enseigne est aussi menteuse qu'elle puisse l'être, puisqu'il n'y a plus alors ni association ni volonté.
Je m'attacherai à démontrer que l'intervention exagérée de l'État ne peut accroître le bien-être des masses, et qu'elle tend au contraire à le diminuer;
Qu'elle efface le premier mot de notre devise républicaine, le mot liberté;
Que si elle est fausse en principe, elle est particulièrement dangereuse pour la France, et qu'elle menace d'engloutir, dans un grand et irréparable désastre, et les fortunes particulières, et la fortune publique, et le sort des classes ouvrières, et les institutions, et la République.
Je dis, d'abord, que les promesses de ce déplorable système sont illusoires.
Et, en vérité, cela me semble si clair, que j'aurais honte de me livrer à cet égard à une longue démonstration, si des faits éclatants ne me prouvaient que cette démonstration est nécessaire.
Car quel spectacle nous offre le pays?
A l'Hôtel-de-Ville la curée des places, au Luxembourg la curée des salaires. Là, ignominie; ici, cruelle déception.
Quant à la curée des places, il semble que le remède serait de supprimer toutes les fonctions inutiles, de réduire le traitement de celles qui excitent la convoitise; mais on laisse cette proie tout entière à l'avidité de la bourgeoisie, et elle s'y précipite avec fureur.
Aussi qu'arrive-t-il? Le peuple, de son côté, le peuple des travailleurs, témoin des douceurs d'une existence assurée sur les ressources du public, oubliant qu'il est lui-même ce public, oubliant que le budget est formé de sa chair et de son sang, demande, lui aussi, qu'on lui prépare une curée.
De longues députations se pressent au Luxembourg, et que demandent-elles? L'accroissement des salaires, c'est-à-dire, en définitive, une amélioration dans les moyens d'existence des travailleurs.
Mais ceux qui assistent personnellement à ces députations, n'agissent pas seulement pour leur propre compte. Ils entendent bien représenter toute la grande confraternité des travailleurs qui peuplent nos villes aussi bien que nos campagnes.
Le bien-être matériel ne consiste pas à gagner plus d'argent. Il consiste à être mieux nourri, vêtu, logé, chauffé, éclairé, instruit, etc., etc.
Ce qu'ils demandent donc, en allant au fond des choses, c'est qu'à dater de l'ère glorieuse de notre révolution, chaque Français appartenant aux classes laborieuses ait plus de pain, de vin, de viande, de linge, de meubles, de fer, de combustible, de livres, etc., etc.
Et, chose qui passe toute croyance, plusieurs veulent en même temps que le travail qui produit ces choses soit diminué. Quelques-uns même, heureusement en petit nombre, vont jusqu'à solliciter la destruction des machines.
Se peut-il concevoir une contradiction plus flagrante?
A moins que le miracle de l'urne de Cana ne se renouvelle dans la caisse du percepteur, comment veut-on que l'État y puise plus que le peuple n'y a mis? Croit-on que, pour chaque pièce de cent sous qui y entre, il soit possible d'en faire sortir dix francs? Hélas! c'est tout le contraire. La pièce de cent sous que le peuple y jette tout entière n'en sort que fort ébréchée, car il faut bien que le percepteur en garde une partie pour lui.
En outre, que signifie l'argent? Quand il serait vrai qu'on peut puiser dans le Trésor public un fonds de salaires autre que celui que le public lui-même y a mis, en serait-on plus avancé? Ce n'est pas d'argent qu'il s'agit, mais d'aliments, de vêtements, de logement, etc.
Or, l'organisateur qui siége au Luxembourg a-t-il la puissance de multiplier ces choses par des décrets? ou peut-il faire que, si la France produit 60 millions d'hectolitres de blé, chacun de nos 36 millions de concitoyens en reçoive 3 hectolitres, et de même pour le fer, le drap, le combustible?
Le recours au Trésor public, comme système général, est donc déplorablement faux. Il prépare au peuple une cruelle déception.
On dira sans doute: « Nul ne songe à de telles absurdités. Mais il est certain que les uns ont trop en France, et les autres pas assez. Ce à quoi l'on vise, c'est à un juste nivellement, à une plus équitable répartition. »
Examinons la question à ce point de vue.
Si l'on voulait dire qu'après avoir retranché tous les impôts qui peuvent l'être, il faut, autant que possible, faire peser ceux qui restent sur la classe qui peut le mieux les supporter, on ne ferait qu'exprimer nos vœux. Mais cela est trop simple pour des organisateurs; c'est bon pour des économistes.
Ce qu'on veut, c'est que tout Français soit bien pourvu de toutes choses. On a annoncé d'avance que l'État garantissait le bien-être à tout le monde; et la question est de savoir s'il y a moyen de presser assez la classe riche, en faveur de la classe pauvre, pour atteindre ce résultat.
Poser la question, c'est la résoudre; car, pour que tout le monde ait plus de pain, de vin, de viande, de drap, etc., il faut que le pays en produise davantage; et comment pourrait-on en prendre à une seule classe, même à la classe riche, plus que toutes les classes ensemble n'en produisent?
D'ailleurs, remarquez-le bien: il s'agit ici de l'impôt. Il s'élève déjà à un milliard et demi. Les tendances que je combats, loin de permettre aucun retranchement, conduisent à des aggravations inévitables.
Permettez-moi un calcul approximatif.
Il est fort difficile de poser le chiffre exact des deux classes; cependant on peut en approcher.
Sous le régime qui vient de tomber, il y avait 250 mille électeurs. A quatre individus par famille, cela répond à un million d'habitants, et chacun sait que l'électeur à 200 francs était bien près d'appartenir à la classe des propriétaires malaisés. Cependant, pour éviter toute contestation, attribuons à la classe riche, non-seulement ce million d'habitants, mais seize fois ce nombre. La concession est déjà raisonnable. Nous avons donc seize millions de riches et vingt millions sinon de pauvres, du moins de frères qui ont besoin d'être secourus. Si l'on suppose qu'un supplément bien modique de 25 cent. par jour est indispensable pour réaliser des vues philanthropiques plus bienveillantes qu'éclairées, c'est un impôt de cinq millions par jour ou près de deux milliards par an, nous pouvons même dire deux milliards avec les frais de perception.
Nous payons déjà un milliard et demi. J'admets qu'avec un système d'administration plus économique on réduise ce chiffre d'un tiers: il faudrait toujours prélever trois milliards. Or, je le demande, peut-on songer à prélever trois milliards sur les seize millions d'habitants les plus riches du pays?
Un tel impôt serait de la confiscation, et voyez les conséquences. Si, en fait, toute propriété était confisquée à mesure qu'elle se forme, qui est-ce qui se donnerait la peine de créer de la propriété? On ne travaille pas seulement pour vivre au jour le jour. Parmi les stimulants du travail, le plus puissant peut-être, c'est l'espoir d'acquérir quelque chose pour ses vieux jours, d'établir ses enfants, d'améliorer le sort de sa famille. Mais si vous arrangez votre système financier de telle sorte que toute propriété soit confisquée à mesure de sa formation, alors, nul n'étant intéressé ni au travail ni à l'épargne, le capital ne se formera pas; il décroîtra avec rapidité, si même il ne déserte pas subitement à l'étranger; et, alors, que deviendra le sort de cette classe même que vous aurez voulu soulager?
J'ajouterai ici une vérité qu'il faut bien que le peuple apprenne.
Quand dans un pays l'impôt est très-modéré, il est possible de le répartir selon les règles de la justice et de le prélever à peu de frais. Supposez, par exemple, que le budget de la France ne s'élevât pas au delà de cinq à six cents millions. Je crois sincèrement qu'on pourrait, dans cette hypothèse, inaugurer l'impôt unique, assis sur la propriété réalisée (mobilière et immobilière).
Mais lorsque l'État soutire à la nation le quart, le tiers, la moitié de ses revenus, il est réduit à agir de ruse, à multiplier les sources de recettes, à inventer les taxes les plus bizarres, et en même temps les plus vexatoires. Il fait en sorte que la taxe se confonde avec le prix des choses, afin que le contribuable la paye sans s'en douter. De là les impôts de consommation, si funestes aux libres mouvements de l'industrie. Or quiconque s'est occupé de finances sait bien que ce genre d'impôt n'est productif qu'à la condition de frapper les objets de la consommation la plus générale. On a beau fonder des espérances sur les taxes somptuaires, je les appelle de tous mes vœux par des motifs d'équité, mais elles ne peuvent jamais apporter qu'un faible contingent à un gros budget. Le peuple se ferait donc complétement illusion s'il pensait qu'il est possible, même au gouvernement le plus populaire, d'aggraver les dépenses publiques, déjà si lourdes, et en même temps de les mettre exclusivement à la charge de la classe riche.
Ce qu'il faut remarquer, c'est que, dès l'instant qu'on a recours aux impôts de consommation (ce qui est la conséquence nécessaire d'un lourd budget), l'égalité des charges est rompue, parce que les objets frappés de taxes entrent beaucoup plus dans la consommation du pauvre que dans celle du riche, proportionnellement à leurs ressources respectives.
En outre, à moins d'entrer dans les inextricables difficultés des classifications, on met sur un objet donné, le vin, par exemple, un impôt uniforme, et l'injustice saute aux yeux. Le travailleur, qui achète un litre de vin de 50 c. le litre, grevé d'un impôt de 50 c., paye 100 pour 100. Le millionnaire, qui boit du vin de Lafitte de 10 francs la bouteille, paye 5 pour 100.
Sous tous les rapports, c'est donc la classe ouvrière qui est intéressée à ce que le budget soit réduit à des proportions qui permettent de simplifier et égaliser les impôts. Mais pour cela il ne faut pas qu'elle se laisse éblouir par tous ces projets philanthropiques, qui n'ont qu'un seul résultat certain: celui d'exagérer les charges nationales.
Si l'exagération de l'impôt est incompatible avec l'égalité contributive, et avec cette sécurité indispensable pour que le capital se forme et s'accroisse, elle n'est pas moins incompatible avec la liberté.
Je me rappelle avoir lu dans ma jeunesse une de ces sentences si familières à M. Guizot, alors simple professeur suppléant. Pour justifier les lourds budgets, qui semblent les corollaires obligés des monarchies constitutionnelles, il disait: La liberté est un bien si précieux qu'un peuple ne doit jamais la marchander. Dès ce jour, je me dis: M. Guizot peut avoir des facultés éminentes, mais ce serait assurément un pitoyable homme d'État.
En effet, la liberté est un bien très-précieux et qu'un peuple ne saurait payer trop cher. Mais la question est précisément de savoir si un peuple surtaxé peut être libre, s'il n'y a pas incompatibilité radicale entre la liberté et l'exagération de l'impôt.
Or, j'affirme que cette incompatibilité est radicale.
Remarquons, en effet, que la fonction publique n'agit pas sur les choses, mais sur les hommes; et elle agit sur eux avec autorité. Or l'action que certains hommes exercent sur d'autres hommes, avec l'appui de la loi et de la force publique, ne saurait jamais être neutre. Elle est essentiellement nuisible, si elle n'est pas essentiellement utile.
Le service de fonctionnaire public n'est pas de ceux dont on débat le prix, qu'on est maître d'accepter ou de refuser. Par sa nature, il est imposé. Quand un peuple ne peut faire mieux que de confier un service à la force publique, comme lorsqu'il s'agit de sécurité, d'indépendance nationale, de répression des délits et des crimes, il faut bien qu'il crée cette autorité et s'y soumette.
Mais s'il fait passer dans le service public ce qui aurait fort bien pu rester dans le domaine des services privés, il s'ôte la faculté de débattre le sacrifice qu'il veut faire en échange de ces services, il se prive du droit de les refuser; il diminue la sphère de sa liberté.
On ne peut multiplier les fonctionnaires sans multiplier les fonctions. Ce serait trop criant. Or, multiplier les fonctions, c'est multiplier les atteintes à la liberté.
Comment un monarque peut-il confisquer la liberté des cultes? En ayant un clergé à gages.
Comment peut-il confisquer la liberté de l'enseignement? En ayant une université à gages.
Que propose-t-on aujourd'hui? De faire le commerce et les transports par des fonctionnaires publics. Si ce plan se réalise, nous payerons plus d'impôts, et nous serons moins libres.
Vous voyez donc bien que, sous des apparences philanthropiques, le système qu'on préconise aujourd'hui est illusoire, injuste, qu'il détruit la sécurité, qu'il nuit à la formation des capitaux et, par là, à l'accroissement des salaires, enfin, qu'il porte atteinte à la liberté des citoyens.
Je pourrais lui adresser bien d'autres reproches. Il ma serait facile de prouver qu'il est un obstacle insurmontable à tout progrès, parce qu'il paralyse le ressort même du progrès, la vigilance de l'intérêt privé.
Quels sont les modes d'activité humaine qui offrent le spectacle de la stagnation la plus complète? Ne sont-ce pas précisément ceux qui sont confiés aux services publics? Voyez l'enseignement. Il en est encore où il en était au moyen âge. Il n'est pas sorti de l'étude de deux langues mortes, étude si rationnelle autrefois, et si irrationnelle aujourd'hui. Non-seulement on enseigne les mêmes choses, mais on les enseigne par les mêmes méthodes. Quelle industrie, excepté celle-là, en est restée où elle en était il y a cinq siècles?
Je pourrais accuser aussi l'exagération de l'impôt et la multiplication des fonctions de développer cette ardeur effrénée pour les places qui, en elle-même et par ses conséquences, est la plus grande plaie des temps modernes. Mais l'espace me manque, et je confie ces considérations à la sagacité du lecteur.
Je ne puis m'empêcher, cependant, de considérer la question au point de vue de la situation particulière où la révolution de Février a placé la France.
Je n'hésite pas à le dire: si le bon sens du peuple, si le bon sens des ouvriers ne fait pas bonne et prompte justice des folles et chimériques espérances que, dans une soif désordonnée de popularité, on a jetées au milieu d'eux, ces espérances déçues seront la fatalité de la République.
Or elles seront déçues, parce qu'elles sont chimériques. Je l'ai prouvé. On a promis ce qu'il est matériellement impossible de tenir.
Quelle est notre situation? En mourant, la monarchie constitutionnelle nous laisse pour héritage une dette dont l'intérêt seul grève nos finances d'un fardeau annuel de trois cents millions, sans compter une somme égale de dette flottante.
Elle nous laisse l'Algérie, qui nous coûtera pendant longtemps cent millions par an.
Sans nous attaquer, sans même nous menacer, les rois absolus de l'Europe n'ont qu'à maintenir leurs forces militaires actuelles pour nous forcer à conserver les nôtres. De ce chef, c'est cinq à six cents millions à inscrire au budget de la guerre et de la marine.
Enfin, il reste tous les services publics, tous les frais de perception, tous les travaux d'utilité nationale.
Faites le compte, arrangez les chiffres comme vous voudrez, et vous verrez que le budget des dépenses est inévitablement énorme.
Il est à présumer que les sources ordinaires des recettes seront moins productives, dès la première année de la révolution. Supposez que le déficit qu'elles présenteront soit compensé par la suppression des sinécures et le retranchement des fonctions parasites.
Le résultat forcé n'en est pas moins qu'il est déjà bien difficile de donner actuellement satisfaction au contribuable.
Et c'est dans ce moment que l'on jette au milieu du peuple le vain espoir qu'il peut, lui aussi, puiser la vie dans ce même trésor, qu'il alimente de sa propre vie!
C'est dans ce moment, où l'industrie, le commerce, le capital et le travail auraient besoin de sécurité et de liberté pour élargir la source des impôts et des salaires, c'est dans ce moment que vous suspendez sur leur tête la menace d'une foule de combinaisons arbitraires, d'institutions mal digérées, mal conçues, de plans d'organisation éclos dans le cerveau de publicistes, pour la plupart étrangers à cette matière!
Mais qu'arrivera-t-il, au jour de la déception, et ce jour doit nécessairement arriver?
Qu'arrivera-t-il quand l'ouvrier s'apercevra que le travail fourni par l'État n'est pas un travail ajouté à celui du pays, mais soustrait par l'impôt sur un point pour être versé par la charité sur un autre, avec toute la diminution qu'implique la création d'administrations nouvelles?
Qu'arrivera-t-il quand vous serez réduit à venir dire au contribuable: Nous ne pouvons toucher ni à l'impôt du sel, ni à l'octroi, ni à la taxe sur les boissons, ni à aucune des inventions fiscales les plus impopulaires; bien loin delà, nous sommes forcés d'en imaginer de nouvelles?
Qu'arrivera-t-il quand la prétention d'accroître forcément la masse des salaires, abstraction faite d'un accroissement correspondant de capital (ce qui implique la contradiction la plus manifeste), aura désorganisé tous les ateliers, sous prétexte d'organisation, et forcé peut-être le capital à chercher ailleurs l'air vivifiant de la liberté?
Je ne veux pas m'appesantir sur les conséquences. Il me suffit d'avoir signalé le danger tel que je le vois.
Mais quoi! dira-l-on, après la grande révolution de Février, n'y avait-il donc rien à faire? n'y avait-il aucune satisfaction à donner au peuple? Fallait-il laisser les choses précisément au point où elles étaient avant? N'y avait-il aucune souffrance à soulager?
Telle n'est pas notre pensée.
Selon nous, l'accroissement des salaires ne dépend ni des intentions bienveillantes, ni des décrets philanthropiques. Il dépend, et il dépend uniquement de l'accroissement du capital. Quand dans un pays, comme aux États-Unis, le capital se forme rapidement, les salaires haussent et le peuple est heureux.
Or, pour que les capitaux se forment, il faut deux choses: sécurité et liberté. Il faut de plus qu'ils ne soient pas ravis à mesure par l'impôt.
C'est là, ce nous semble, qu'étaient la règle de conduite et les devoirs du gouvernement.
Les combinaisons nouvelles, les arrangements, les organisations, les associations devaient être abandonnés au bon sens, à l'expérience et à l'initiative des citoyens. Ce sont choses qui ne se font pas à coups de taxes et de décrets.
Pourvoir à la sécurité universelle en rassurant les fonctionnaires paisibles, et, par le choix éclairé des fonctionnaires nouveaux, fonder la vraie liberté par la destruction des priviléges et des monopoles, laisser librement entrer les subsistances et les objets les plus nécessaires au travail, se créer, sans frais, des ressources par l'abaissement des droits exagérés et l'abolition de la prohibition, simplifier tous les rouages administratifs, tailler en plein drap dans la bureaucratie, supprimer les fonctions parasites, réduire les gros traitements, négocier immédiatement avec les puissances étrangères la réduction des armées, abolir l'octroi et l'impôt sur le sel, et remanier profondément l'impôt des boissons, créer une taxe somptuaire, telle est, ce me semble, la mission d'un gouvernement populaire, telle est la mission de notre république.
Sous un tel régime d'ordre, de sécurité et de liberté, on verrait les capitaux se former et vivifier toutes les branches d'industrie, le commerce s'étendre, l'agriculture progresser, le travail recevoir une active impulsion, la main-d'œuvre recherchée et bien rétribuée, les salaires profiter de la concurrence des capitaux de plus en plus abondants, et toutes ces forces vives de la nation, actuellement absorbées par des administrations inutiles ou nuisibles, tourner à l'avantage physique, intellectuel et moral du peuple tout entier.
38.Ambroise Clément, "De la spoliation légale” (1848)↩
[Word Length: 5,259]
Source
Ambroise Clément, "De la spoliation légale," Journal des économistes, 1e juillet 1848, Tome 20, no. 83, pp. 363-74.
Brief Bio of the Author:
DE LA SPOLIATION LÉGALE
Parmi les progrès que l'opinion publique aurait à faire , en France, pour arriver à une saine appréciation des intérêts généraux, il en est un, surtout, qui nous semble désirable et urgent, ce serait qu'elle se fixât, avec plus de précision qu'elle ne l'a fait jusqu'ici, surtout ce qui constitue la spoliation ou le vol. La confusion qui existe à cet égard dans les esprits nous paraît être l'une des principales causes du défaut d'accord sur la nature des réformes qu'il convient d'apporter dans nos institutions, et de la faveur qu'obtiennent trop facilement, parmi nous, certains systèmes subversifs de tout ordre social régulier.
Nous nous proposons de donner, dans cet article , quelques indications propres à dissiper la confusion que nous signalons, et à faire reconnaître le VOL sous les diverses formes qu'il peut affecter; et comme la notion du vol ne peut être complète sans une idée précise de la chose sur laquelle il s'exerce , nous commencerons par rappeler les principaux caractères de la Propriété.
La Propriété est le but et le fruit du Travail; elle est composée de toutes les utilités de création humaine, qui, à l'état d'instruments de production ou de produits immédiatement applicables à nos besoins, forment le fondement de notre existence.
C'est le travail qui fonde toutes les propriétés, même celle du sol, car, la puissance productive du sol inculte est si faible, qu'une lieue carrée de terrain suffit à peine pour fournir la subsistance la plus grossière à un seul individu, tandis que la même étendue, bien cultivée , peut faire vivre dans l'abondance plus de 1,500 personnes. On peut donc admettre que le travail a produit, tout au moins, 1,499 parties sur 1,500 de la propriété territoriale actuelle.
Si, à l'état sauvage et pastoral, les propriétés territoriales sont possédées collectivement par la peuplade ou la tribu, c'est, d'abord, para: qu'aucun individu en particulier n'y a ajouté son travail, et, ensuite, parce que l'indivision de la propriété du sol est une conséquence forcée de la manière dont les peuples chasseurs ou pasteurs pourvoient à leur subsistance. A l'état agricole et de civilisation avancée, il y a bien encore quelques propriétés possédées en commun et destinées à certains besoins collectifs des communes, des province» ou de l'Etat , mais ce n'est là qu'une portion relativement peu considérable des propriétés, dont la masse, dans cette situation , est toujours plus ou moins divisée entre les familles.
Chez une population qui, depuis longtemps, aurait été régie selon les règles de la justice et d'une saine économie politique, les propriétés actuelles de chaque famille seraient la représentation exacte des valeurs qu'elle aurait épargnées sur les produits légitimes de son travail, ou de celles provenant d'une semblable source, qu'elle aurait reçues de ses ascendants.
La propriété individuelle, ainsi formée et conservée, est absolument inattaquable au point de vue de l'équité, puisqu'elle est entièrement due au travail et à l'épargne des familles qui en jouissent, et qu'elle n'existerait pour personne si elles ne l'eussent fondée de toutes pièces.
L'expérience de tous les peuples témoigne que la propriété se forme et s'accumule d'autant plus rapidement que le travail est plus éclairé et plus libre, et que la faculté de jouir et de disposer de ses produits est mieux garantie à chacun. Cette garantie doit être l'objet principal des lois et des services publics.
Le Vol est la violation de la propriété. Ses formes sont extrêmement variées, mais on peut toujours le reconnaître à ce caractère, qu'il prive de tout ou partie de la propriété ceux qui l'ont créée par le travail, ou à qui elle a été librement transmise par ses fondateurs, pour la donner à d'autres qui n'y ont aucun de ces titres.
Les effets généraux du vol sont d'affaiblir, ou même de supprimer entièrement, selon qu'il est plus ou moins pratiqué, les motifs du travail et de l'épargne, et, par conséquent, d'empêcher la formation des propriétés; il décourage les habitudes d'activité et de prévoyance en les privant de leur récompense naturelle; il développe, au contraire, la paresse, l'intempérance et tous les vices générateurs de la misère; il tend ainsi à la dégradation progressive de l'espèce humaine et à son anéantissement total.
Le vol s'accomplit à l'aide de la force ou de moyens frauduleux; il peut être pratiqué directement par des individus isolés, ou indirectement, par l'intermédiaire des gouvernements, c'est-à-dire des personnes qui disposent de l'autorité et des forces publiques.
Dans le premier cas, celui où les voleurs agissent sans la complicité des gouvernements, les effets du vol sont généralement bornés, parce que la puissance publique, la résistance individuelle et la réprobation générale s'unissent pour l'arrêter.
Dans le second cas, celui où le vol s'accomplit par l'intermédiaire de l'Etat, ses effets sont incomparablement plus désastreux et plus durables, non-seulement parce qu'il est alors appuyé par la force publique, mais parce que la sanction légale qu'on lui donne, tend à le faire considérer, par ceux qui en profitent, comme l'exercice d'un droit légitime, et qu'avec le temps, il finit par être accepté comme tel par ceux-là même qu'il dépouille.
Parmi les vols qui s'accomplissent sous la direction ou avec l'assentiment des gouvernements, il en est où la force matérielle est seule employée, et que l'on ne cherche pas à dissimuler; tels sont ceux que l'on a longtemps pratiqués par la guerre, lorsqu'elle était suivie de la spoliation des vaincus ou de leur assujettissement à l'état d'esclave ou de serf.
Les autres vols légaux, c'est-à-dire opérés ou permis par l'autorité publique, s'appuient, indépendamment de la force matérielle, sur des préjugés que les spoliateurs s'efforcent d'entretenir autant que possible, ou sur de fausses notions des intérêts communs.
Nous allons citer quelques exemples de ces spoliations, en indiquant les erreurs d'opinion qui tendent à en dissimuler le véritable caractère.
Vols aristocratiques.
Ce sont ceux opérés au profit de certaines classes de la population, qui s'arrogent des attributions héréditaires sur le produit du travail des autres classes: tels étaient, en France, avant 1789, les droits seigneuriaux; telles sont encore les spoliations plus ou moins déguisées que comportent, dans la plupart des Etats de l'Europe, les priviléges nobiliaires. Ces vols sont des restes de la conquête et du servage. Ils se perpétuent longtemps après que la force n'est plus du côté des spoliateurs, parce qu'un long usage et l'ignorance des masses les ont consacrés comme des droits.
Vols monarchiques.
Ce sont ceux appuyés sur la pensée que les monarques sont, de droit divin, préposés au gouvernement des peuples, et qu'ils peuvent, en conséquence, légitimement disposer, selon leur volonté, des personnes et des biens de leurs sujets. C'est là ce qui faisait dire à Louis XIV, l'Etat, c'est moi! et c'est ce qui l'affranchissait de tout scrupule lorsque, pour l'entretien de son faste, de ses courtisans, de ses maîtresses et de ses bâtards, il mettait la nation au pillage.
Dans les monarchies constitutionnelles, où les délégués d'une partie plus ou moins nombreuse de la population participent au pouvoir, les vols monarchiques sont moins illimités que sous les gouvernements despotiques, sans cesser, néanmoins, d'être considérables. On attribue au souverain et à sa famille, sous les noms de liste civile, de biens de la couronne, d'apanages, etc., une part des propriétés publiques et du revenu de l'Etat, généralement assez importante pour qu'elle pût faire vivre dans l'aisance douze ou quinze mille familles, et l'on motive l'exagération outrée de ces dotations, sur la convenance de maintenir l'éclat, la grandeur du trône; d'où résulte ensuite une autre convenance, non moins onéreuse, celle de doter richement tous les fonctionnaires qui entourent ou approchent le monarque. Ce personnage est pourtant censé ne pouvoir rendre aucun service au pays, puisqu'il est de principe dans les monarchies représentatives, qu'il ne peut être responsable de rien, et qu'il doit s'abstenir absolument de gouverner. Il n'est donc là que pour recevoir et consommer les richesses que la nation lui fournit et pour lui donner, en retour, le spectacle, apparemment fort nécessaire, de la splendeur du trône.
Vols réglementaires.
Cette classe de vols légaux comprend de nombreuses espèces; nous nous bornerons à signaler les principales.
Les vols réglementaires s'accomplissent par la violation de la liberté des travaux et des transactions; ils sont généralement motivés sur la prétention de faire servir l'autorité publique à la direction et au perfectionnement de l'industrie ou de certaines branches de travaux.
Les anciennes corporations de métiers, les maîtrises et jurandes organisaient la vol réglementaire sur une grande échelle. On ne pouvait exercer que très-peu de professions sans être membre de ces associations et sans se conformer à leurs règlements; or, les corporations décidaient seules du refus ou de l'admission des nouveaux membres; elles pouvaient donc, à leur gré, restreindre la concurrence, élever les prix de leurs produits et rançonner les consommateurs. D'un autre côté, elles privaient les travailleurs non affiliés et les associés qui auraient voulu s'écarter des règles adoptées, du libre exercice de leurs facultés industrielles, leur faisant perdre ainsi les valeurs, souvent considérables, qu'ils auraient pu en retirer. Les dissidents étaient accablés de difficultés et de procès, avec d'autant plus d'acharnement, qu'ils manifestaient plus d habileté, que les corporations avaient plus à redouter leur concurrence, et la société perdait fréquemment, par ces obstacles à tout progrès, le bénéfice d'inventions nouvelles ou de services supérieurs.
Ce régime a été aboli, chez nous, en très-grande partie, par la Révolution de 1789; cependant il nous en reste des traces dans le pouvoir que s'est attribué le gouvernement de régir certaines professions, d'en soumettre l'exercice à son autorisation préalable et de limiter le nombre des personnes qui peuvent s'y livrer; telles sont les professions de courtier, d'agent de change, de notaire, d'avoué, d'imprimeur, de libraire, etc., etc. Les tarifs de salaires ou d'honoraires imposés à quelques-unes de ces professions n'empêchent nullement les titulaires de faire payer leurs services plus qu'ils ne valent réellement, c'est-à-dire plus qu'ils n'obtiendraient sous un régime de libre concurrence; la preuve de cette exaction se trouve dans la valeur vénale qui s'attache au titre conférant la faculté d'exercer les professions dont il s'agit.
De tous les vols réglementaires que nos institutions font encore peser sur nous , les plus considérables et les plus désastreux sont ceux consacrés par l'application du système prétendu protecteur de l'industrie nationale.
Ce système consiste à fermer, autant que possible, le marché national aux produits étrangers, en imposant à leur importation des prohibitions absolues, ou des taxes assez élevées pour être prohibitives.
Le but prétendu du système protecteur est de conserver et de développer, dans le pays, des industries que l'on croit hors d'état de soutenir la concurrence étrangère, et d'assurer ainsi aux nationaux une quantité de travail dont on suppose qu'ils seraient privés si cette concurrence était admise.
Un accroissement de travail n'est pas, dans tous les cas, une augmentation de richesses. Le travail n'est un avantage qu'en raison de ce qu'il produit, et le but à poursuivre est moins de multiplier les travaux que de les rendre plus productifs; mais en supposant qu'il en soit autrement, il est facile de s'assurer que le régime protecteur, bien loin d'accroître la quantité du travail national, la réduit au contraire considérablement. On sait que les capitaux sont l'aliment indispensable du travail, que plus un pays en possède et plus il peut fournir d'occupation à sa population; or, on comprend de suite que des industries protégées contre la concurrence étrangère, à cause de l'infériorité relative de leurs résultats, ne sauraient constituer un emploi des fonds productifs bien favorable à l'accumulation des capitaux: cette accumulation s'accomplit en effet d'autant plus rapidement que la production est plus avantageuse, plus abondante, qu'elle laisse chaque année, sous toutes les formes, des excédants de valeurs plus considérables. Il est bien évident, par exemple, que si nous voulions consacrer des services productifs valant un franc à faire mûrir, dans le nord de la France, une orange que le commerce avec le midi de l'Europe peut nous procurer par d'autres services productifs valant dix centimes, nous serions dans une fort mauvaise voie pour accroître nos capitaux. Le régime protecteur, cependant, ne fait pas autre chose. Il nous force à nous procurer chèrement, par de certains travaux, ce que la liberté des échanges nous ferait obtenir à bon marché par d'autres travaux; il restreint ainsi, autant qu'il est en lui, l'importance de nos épargnes, et, par conséquent, la quantité de travail qu'elles peuvent alimenter.
Voici d'autres résultats du régime protecteur:
1° En privant les industries protégées du stimulant de la concurrence étrangère, il tend à maintenir leur infériorité relative, en tout ce qui tient à des causes modifiables, et, par exemple, à l'imperfection des procédés industriels; il retarde ainsi leurs progrès.
2° En provoquant les représailles, ou la réciprocité des entraves douanières, il restreint les débouchés et, par conséquent, les développements de toutes les industries vraiment nationales, c'est-à-dire, de celles qui rencontrent dans chaque pays des avantages spéciaux, de meilleures conditions de succès qu'elles n'en trouvent ailleurs; il borne ainsi l'usage que nous pourrions faire des forces naturelles très-variées que la Providence a inégalement réparties entre les diverses contrées, et il prive toutes les nations de la faculté de donner à leurs fonds productifs l'emploi le plus avantageux pour tous.
3° En empêchant, autant que possible, le mélange d'intérêts qu'amènerait le libre développement des relations commerciales entre les peuples, il les prive du moyen le plus puissant d'assurer la paix générale et de s'affranchir des énormes sacrifices que leur imposent les armées permanentes.
4° Enfin, le système protecteur permet à une partie des producteurs nationaux, particulièrement aux grands propriétaires fonciers et aux grandes entreprises manufacturières, d'élever les prix de leurs produits bien au-dessus de ceux que déterminerait la concurrence générale des producteurs de toutes les nations, et de grever ainsi la masse des consommateurs d'une charge annuelle dont l'importance, d'après des évaluations fixées au plus bas, dépasse, en France, le montant de toutes les contributions perçues par l'État.
Nous bornerons là nos observations quant aux vols réglementaires, et nous ne dirons rien des spoliations de la même espèce projetées depuis la révolution de Février, telles, par exemple, que celles qu'aurait réalisées le système d'association d'ouvriers développé au Luxembourg par M. Louis Blanc; nous espérons que le bon sens de la population a définitivement fait justice de ces monstruosités, et qu'il préservera la société de l'abîme affreux où les utopistes de celte détestable école voudraient l'entraîner.
Vols industriels.
Nous désignons ainsi certaines spoliations qui, sans être précisément sanctionnées par la loi, rentrent cependant dans la catégorie des vols légaux, en ce sens que l'autorité publique, chargée de protéger la propriété, manque à leur égard à cette mission, en les tolérant plus ou moins ouvertement.
Les économistes ont donné la dénomination de commerce de spéculation à des opérations consistant à acheter des produits dans les moments où ils sont surabondants pour les revendre lorsqu'ils deviennent plus rares; ce sont là des actes légitimes et dont l'effet utile est d'empêcher, dans une certaine mesure, que le prix des produits s'écarte beaucoup de sa moyenne générale; mais dans le langage usuel, on comprend sous la désignation de spéculations commerciales un grand nombre d'opérations n'ayant nullement ce caractère et qui, souvent, ne sont que des déplacements de richesses, opérés à l'aide du mensonge et de la fraude, c'est-à-dire de véritables vols.
Les procédés employés dans ces spéculations sont très-diversifiés; en voici quelques exemples:
Des spéculateurs se concertent pour acquérir et revendre ensuite un établissement industriel, une usine, une concession de mines, etc.; tout compte fait, leur acquisition leur coûte cent mille francs, et en réalité, elle ne vaut pas davantage. Cependant, ils divisent cette propriété en actions, ils publient des annonces mensongères sur le revenu qu'elle est susceptible de produire; puis, à l'aide de divers moyens de captation, de certaines manœuvres de Bourse bien connues des gens du métier, ils parviennent à placer toutes ces actions à des prix qui doublent, triplent et quelquefois décuplent la valeur vénale de l'objet qu'elles représentent, réalisant ainsi, en quelques jours, des gains énormes aux dépens des acquéreurs de leurs actions.
Le jeu effréné qui s'établit dans les Bourses de commerce sur le prix des effets publics et de certaines classes de denrées ou marchandises, ou même sur des titres qui ne représentent rien, comme les promesses d'actions dans une entreprise dont la fondation est éventuelle, constitue un genre d'opération non moins immoral et non moins désastreux que celui que nous venons d'indiquer; il enrichit les spéculateurs les moins scrupuleux en ruinant les autres; il nuit au commerce régulier en donnant lieu à des fluctuations artificielles dans le prix des objets sur lesquels il opère, et en retenant, pour un emploi stérile, des masses de capitaux; il tend à détourner l'activité de la population de l'industrie utile, en ouvrant à la cupidité une voie qui paraît offrir des chances de gains rapides et considérables, sans exiger aucun labeur.
On a dit avec vérité que la faillite, qui, autrefois, était une honte, était aujourd'hui devenue un art, un moyen de vivre largement, ou même de s'enrichir aux dépens d'autrui. S'il est encore des négociants que la situation de failli accable, désespère et pousse quelquefois au suicide, ils ne forment que de rares exceptions. La plupart, après avoir fait accepter 10 ou 15 pour 100 à leurs créanciers, paraissent jouir d'une parfaite tranquillité d'âme, et ils n'admettraient pas facilement qu'ils aient pu perdre ainsi aucun titre à la considération publique. Cette profonde altération de la sévérité de la conscience permet à beaucoup d'entrepreneurs d'industrie, qui opèrent principalement sur des capitaux empruntés, de vivre avec un luxe croissant, et d'absorber, chaque année, par leurs dépenses personnelles, beaucoup plus qu'ils ne produisent; ils continuent de la sorte, couvrant leurs déficits avec de nouveaux emprunts, jusqu'au moment où, ne pouvant plus cacher leur situation, ils viennent exposer leurs malheurs à ceux qu'ils ont dépouillés.
D'autres, encouragés par l'impunité, à peu près complète, assurée à ce genre de vols, arrangent leurs affaires, leurs mariages ou autres actes de famille, de manière à ne rien posséder en propre, tout en paraissant jouir d'une certaine fortune; puis, abusant du crédit fondé sur cette apparence, ils exploitent, sous diverses formes, la confiance qu'ils ont surprise; ils emmagasinent, par exemple, des marchandises ou denrées qu'ils n'ont pas payées, les vendent à perte, afin de les écouler plus rapidement (au grand préjudice de leurs concurrents de bonne foi), puis ils détournent le produit de ces ventes, en ayant soin de simuler, autant que possible, dans leurs écritures, des pertes ou des emplois fictifs de capitaux. Arrivant ainsi à la faillite, après quelques années, ils vont jouir ailleurs de ce qu'ils ont extorqué.
Ceci n'est malheureusement pas une supposition gratuite; le nombre des faillites frauduleuses, de cette façon ou d'une autre, est très considérable; et si, néanmoins, il en est peu qui donnent lieu à des poursuites, c'est, d'une part, parce que les créanciers, généralement absorbés par d'autres affaires, préfèrent presque toujours l'arrangement immédiat le plus onéreux aux embarras et aux lenteurs qu'entraînent les procès, et, d'autre part, parce que les magistrats, ne trouvant pas, dans les mœurs publiques, une réprobation bien énergique à l'égard des faillis, ne remplissent leur devoir, sous ce rapport, que très-imparfaitement.
Parmi les diverses espèces de vols industriels, l'une des plus dangereuses nous paraît être celle qui procède par l'accaparement plus ou moins complet de certaines branches de production, par la fondation de monopoles artificiels.
Alors même que les institutions n'apporteraient aucune entrave à la liberté des travaux, la concurrence ne serait pas, pour cela, absolument illimitée; son extension est plus ou moins bornée, dans chaque genre de production, par la nature des choses, par l'impossibilité de fournir à tous des instruments de production, ou de les diviser, sans perte, au delà de certaines limites. Dans l'industrie agricole l'extension de la concurrence est limitée à ce que comporte l'étendue du territoire national; dans l'industrie des mines, elle est bornée par le nombre et l'importance des gisements que renferme ce territoire; dans toutes les industries indistinctement, la concurrence peut être plus ou moins restreinte par la concentration ou la réduction du nombre des entreprises.
Les restrictions de concurrence opérées par ce dernier moyen ne sont légitimes qu'autant que la concentration amène, dans le prix de revient des produits, un abaissement dont profitent les consommateurs; lorsqu'elle n'offre pas cet avantage et qu'elle tend seulement à monopoliser les travaux au profit exclusif des entrepreneurs, elle devient un moyen de rançonner à la fois les consommateurs et es ouvriers; elle est alors très-nuisible à la société, et l'autorité publique doit y apporter des obstacles sérieux.
Nous avons, chez nous, un assez grand nombre d'exemples de concentrations d'entreprises industrielles ayant ce dernier caractère. Les manufactures de glaces de Saint-Gobain et de Saint-Quirin sont parvenues, en ruinant ou en achetant les entreprises rivales, à fonder un monopole qui leur permet aujourd'hui de vendre leurs produits à 40 pour 100 au-dessus des prix que pourraient établir des fabriques de moyenne importance; quelques entreprises de forges sont arrivées, par les mêmes procédés, à établir dans plusieurs parties de la France de semblables monopoles; les mines de houille d'Anzin, d'abord partagées en plusieurs concessions qui devaient former autant d'entreprises rivales, sont devenues la propriété d'une seule compagnie qui, au moyen de ce monopole, a pu réaliser, en maintenant ses ouvriers dans une misère extrême, d'énormes bénéfices; une concentration plus importante encore a été opérée récemment par la compagnie des mines de la Loire, qui a réuni en une seule entreprise plus de soixante exploitations rivales, dont quelques-unes étaient déjà considérables; la fondation de ce monopole offrait une telle perspective de bénéfices, à prélever sur les consommateurs ou les ouvriers, qu'elle a permis à la compagnie de porter tout à coup, presque au décuple, la valeur vénale des mines réunies; certains spéculateurs, en vendant des parts d'intérêts qui, avant cette réunion, avaient à peine une valeur reconnue de 100 mille francs, ont pu réaliser, en quelques mois, un bénéfice de 900 mille francs.
L'accaparement des moyens de production, en vue de la fondation de monopoles, est déjà proscrit par nos lois, mais ces lois n'ont jamais été appliquées aux monopoleurs puissants.
De scandaleuses fortunes ont été usurpées, en France, surtout pendant les quinze dernières années, par les moyens que nous venons de signaler; elles ont justement excité l'indignation de la partie honnête de la population, et c'est vainement que l'autorité publique de l'époque chercherait à dissimuler sa déplorable faiblesse, ou sa connivence, sous le prétexte que la répression de ces spoliations aurait porté atteinte à la liberté des transactions, ou que la culpabilité des moyens par lesquels elles ont été accomplies ne pouvait être constatée sans de grandes difficultés; la liberté des transactions ne saurait jamais légitimement comporter la liberté du vol, sous quelque forme qu'il se produise, et quant aux difficultés de la répression, on en surmonte tous les jours de plus grandes dans la poursuite de délits moins importants; l'impunité des spoliations dont ii s'agit n'a eu d'autre cause que la démoralisation, malheureusement trop réelle, de l'autorité publique.
Vols à prétentions philanthropiques.
Nous n'avons pu trouver une dénomination moins singulière pour désigner la classe de vols légaux dont nous allons nous occuper.
Malgré les nombreuses imperfections de mœurs qui existent encore dans les sociétés actuelles, on ne saurait méconnaître que les sentiments de bienveillance, de pitié, de commisération pour la souffrance, sont plus vifs et plus universels de nos jours, qu'ils ne l'ont jamais été; cela est suffisamment prouvé par un grand nombre de faits, notamment, par la multiplicité croissante des Sociétés libres de bienfaisance et par l'abondance des dons volontaires que l'on recueille chaque fois qu'il s'agit de soulager des populations frappées par l'inondation, l'incendie ou d'autres fléaux. La charité légale, c'est-à-dire, opérée par le gouvernement au moyen des contributions publiques, est donc moins nécessaire aujourd'hui qu'à aucune autre époque, et nous pensons qu'elle pourrait être supprimée, sans qu'il y eût moins d'infortunes soulagées.
Venir au secours de nos frères en humanité, lorsque nous les voyons en proie au besoin et à la souffrance, n'est pas un acte qui nous paraisse devoir être imposé ni accompli par l'autorité publique, car, en se substituant à la bienfaisance privée, elle la rend, en apparence, beaucoup moins nécessaire, et, sans pouvoir jamais la remplacer avantageusement, elle tend à la supprimer.
La somme de tous les secours publics distribuée chaque année en France, est assurément fort inférieure à celle librement employée par la bienfaisance privée et par la multitude des Associations charitables indépendantes du gouvernement; or, il est certain que ces derniers secours seraient incomparablement plus abondants encore, s'ils n'étaient restreints par la pensée que les malheureux peuvent s'adresser aux établissements publics. La charité légale n'accroît donc pas l'abondance des secours, et il est, au contraire, fort probable qu'elle la réduit considérablement.
Maintenant, qu'arrivera-t-il, si l'on cherche à réaliser les imprudentes déclarations faites, à l'issue de la révolution de Février, au sujet du droit à l'assistance, ou au travail, que l'Etat devrait garantir à tous? N'est-il pas évident que l'application de semblables principes, si elle était praticable, tendrait à anéantir absolument la charité privée, à éteindre, avec le temps, tous les sentiments de bienveillance et de commisération?
Et d'un autre côté, si l'assistance publique n'est plus éventuelle, si elle devient un droit pour tous ceux qui pourront la réclamer, si chacun est déchargé par l'Etat de la responsabilité de sa propre existence et de celle de sa famille, quelle large voie n'ouvre-t-on pas à la propagation de tous les vices générateurs de la misère et à la multiplication progressive des classes malheureuses et parasites! Dès que l'assistance est un droit assuré, il n'y a plus de motifs pour ne pas s'abandonner à toutes les impulsions de l'imprévoyance et de la paresse: pourquoi se fatiguer, pourquoi chercher à acquérir ou à développer des facultés utiles, pourquoi restreindre ses besoins, pourquoi s'abstenir de former de nouvelles et nombreuses familles, lorsqu'on a, dans tous les cas, le droit de réclamer à la société des moyens suffisants de subsistance? Avec le plein exercice d'un semblable droit, il est bien évident que la population parasite s'accroîtra tous les jours aux dépens de la population productive, et que la position des pourvoyeurs devenant de plus en plus intolérable, leurs émigrations dans le camp des assistés suivront une marche progressive; la société entière se trouvera-bientôt ainsi dans le cas de réclamer le droit à l'assistance; il restera alors à savoir comment l'Etat pourra lui garantir ce droit.
Concluons que nul ne saurait avoir le droit de vivre aux dépens d'autrui, et que les vues philanthropiques de nos modernes réformateurs n'auraient d'autre résultat que de substituer aux aristocraties brodées dont nous sommes délivrés, une aristocratie indigente qui ne serait pas moins oppressive pour les vrais travailleurs.
Vols administratifs.
Toutes les fonctions gouvernementales ou administratives qui n'ont pas le caractère d'un service utile à la nation, et tous les services utiles, mais compliqués plus qu'il n'est nécessaire, ou rémunérés au delà de leur valeur, constituent une spoliation au préjudice de la masse des contribuables et au profit des classes qui puisent leurs moyens d'existence dans les revenus publics.
La tendance à vivre aux dépens d'autrui, en occupant une place, n'est pas nouvelle parmi nous; l'historien de Louis XI écrivait, il y a trois siècles et demi, que les Français de son temps n'avaient souci de rien, sinon d'offices et états, que trop bien ils savaient faire valoir; et, en 1819, Paul-Louis Courier, rapportant ce propos, ajoutait: « Les choses ont peu changé; seulement cette convoitise des offices et états (curée autrefois réservée à nobles limiers) est devenue plus âpre encore depuis que tous y peuvent prétendre. Quelque multiplié que paraisse aujourd'hui le nombre des emplois, qui ne se compare plus qu'aux étoiles du ciel et aux sables de la mer, il n'a pourtant nulle proportion avec celui des demandeurs, et.on est loin de pouvoir contenter tout le monde. »
Cette plaie, depuis Courier, n'a cessé de s'agrandir; on estime qu'à partir seulement de 1830, le nombre des emplois publics s'est accru de plus de cent mille; la France compte aujourd'hui, proportion gardée de la population, dix fois plus de fonctionnaires que l'Angleterre et trente fois plus que les Etats-Unis, et malgré le classement de cette armée des parasites, l'essaim des solliciteurs non pourvus s'accroît tous les jours; en ce moment même il menace de tout envahir, car il a recruté les classes ouvrières qui viennent, à leur tour, presser l'Etat de s'emparer des ateliers, afin qu'il puisse leur distribuer, au lieu de salaires, des emplois et des traitements. Mais, au nom de Dieu, lorsque nous serons tous fonctionnaires ou employés du gouvernement, et qu'en cette qualité, travaillant peu et dépensant beaucoup plus que nous ne pourrons y apporter, qui donc comblera le déficit? Qui donc remplira ce trésor chaque année?
Il est tenu de s'arrêter sur cette pente fatale et de se demander si une révolution dirigée contre l'abus de la puissance gouvernementale doit, logiquement, avoir pour résultats l'agrandissement de cette puissance, l'extension de ses attributions.
Lorsque les fondateurs de l'Union américaine eurent à déterminer les attributions du gouvernement central, ils se préoccupèrent bien plus des abus possibles du pouvoir, que des avantages que l'on pourrait espérer de son action en en reculant les limites, et leur juste défiance ne fut pas écartée par la pensée que ce pouvoir devait, comme chez nous en ce moment, émaner du suffrage universel; ils savaient que des hommes appelés à exercer l'autorité, quelque faible que fût leur part de l'imperfection commune et de quelque source que leur vînt la puissance, ne manqueraient pas d'en abuser si elle était étendue au delà du besoin; ils connaissaient, d'ailleurs, tout le prix de la liberté, et comprenaient fort bien qu'elle est plus limitée et plus précaire à mesure que l'on restreint, au profit de l'autorité publique, la sphère de l'activité individuelle; en conséquence, ils procédèrent à la composition de la tâche du gouvernement, pour ainsi dire, par voie de réduction, lui enlevant tout ce qui parut pouvoir être laissé sans danger à l'activité individuelle, et limitant ses attributions à ce qui était strictement nécessaire pour le maintien de l'indépendance nationale et de l'ordre intérieur. C'est ainsi qu'ils fondèrent l'organisation politique la plus simple, la plus économique et, en même temps, la plus efficace que l'on connaisse! Une liberté aussi étendue que possible, une sécurité complète, et soixante-treize ans d'une prospérité inouïe et progressive, ont été les fruits de cette sage organisation.
Dans la même durée, le régime politique de la France a été changé onze fois sans que nous soyons encore arrivés à des institutions rationnelles, à rien qui puisse inspirer pour l'avenir une véritable sécurité.
Tant que nous verrons dans le gouvernement autre chose qu'un moyen d'assurer le développement libre et régulier de toutes les facultés utiles, en garantissant de toute violence et de toute atteinte l'exercice de ces facultés et les biens qu'elles procurent légitimement, tant que nous voudrons y voir une puissance ayant mission de tout conduire, de diriger et l'industrie, et l'enseignement, et les cultes religieux, et les intérêts matériels des communes et des provinces, etc., en un mot, de commander l'action de la société, au lieu de se borner à en protéger le libre développement, nos révolutions successives n'amèneront aucune amélioration réelle et ne porteront que de mauvais fruits; nos institutions se compliqueront tous les jours davantage, les races parasites qui vivent aux dépens des véritables producteurs se multiplieront de plus en plus, et le gouffre des spoliations administratives s'agrandira sans cesse.
39.Coquelin on “Free Banking” (1848)↩
[Word Length: 8,625]
Source
Charles Coquelin, Du crédit et des banques (Paris: Guillaumin, 1848).
Préface, pp. i-iv.
Chapter Premier. Introduction, 1. "Réflexions préliminaires," pp. 1-7.
Chap. VII. Des crises commerciales. — Unité et multiplicité des banques. — Privilège et liberté. [pp. 206-64.]
§ I. — Unité Et Multiplicité Des Banques. pp. 206-212
§ II. — Opérations D'une Banque Privilégiée. — Enfantement de la crise. pp. 212-229
[cut § III. -- La Crise De 1846-47 En France., § IV. — Les Crises Commerciales En Angleterre., pp.229-49]
§ V. — La Liberté Des Banques. [p.250-55]
[cut § VI. — La Crise De 1837 Aux États-unis., pp. 255-64]
PRÉFACE.
Jamais peut-être des causes plus graves et plus pressantes n'ont recommandé à l'attention de notre pays toutes les questions qui se rattachent au développement du crédit et de la richesse publique. Depuis plusieurs mois déjà, la France est sans commerce, sans industrie, sans travail. Cette déplorable situation ne peut durer. Quand on prétend que le retour seul de la confiance pourra l'améliorer, on s'abuse sur l'avenir comme sur le présent: on méconnaît les obstacles réels que nos institutions et nos lois opposent au développement de la production; on méconnaît aussi les germes de désordre qui fermentent encore au sein de la société et qui la troubleront longtemps. Après 1830, il a fallu trois années et plus pour remettre la France dans ce qu'on vent bien appeler son état normal, c'est-à-dire dans une situation semblable à celle des dernières années de la restauration. Sous une république démocratique, où le peuple est naturellement, et avec raison, plus exigeant, il faudra dix années peut-être, si des réformes salutaires ne lui viennent en aide, pour la ramener au point où elle était avant la dernière révolution.
Est-ce là d'ailleurs un résultat si désirable? La prospérité des dix-huit années qui viennent de s'écouler serait-elle par hasard le dernier terme de nos vœux? Que l'on compare cette situation du peuple français depuis la paix à celle du peuple anglais seulement, ou mieux encore à celle du peuple américain. C'est un bien-être véritable d'un côté, et une misère relative de l'autre. Osera-t-on dire que la France doit se contenter éternellement d'un tel partage, qu'elle n'ait rien à faire pour l'améliorer?
Améliorer cette situation, voilà donc la grande tâche que doivent s'imposer nos gouvernants et nos législateurs. Ils n'y failliraient pas sans péril. Il ne s'agit point de voter des subventions, qui ne font que couvrir les plaies et envenimer le mal au lieu de le guérir; encore moins de proclamer le droit au travail ou le droit à l'assistance, erreurs déplorables, contre-sens funestes, qui ne tendent à rien moins qu'à faire de la France un vaste dépôt de mendicité; il s'agit de réformer les abus dont notre ordre social est dévoré, d'affranchir le travail, encore esclave, quoi qu'on en dise, et de sauver l'industrie en lui permettant de se sauver elle-même.
Parmi les mesures propres à faire renaître le travail en ranimant l'industrie et le commerce, il n'y en a point de plus efficaces que celles qui tendront à l'établissement du crédit. On l'a dit souvent, et on ne saurait trop le redire, le crédit est l'âme du commerce; sans le crédit point de commerce, et sans le commerce, point de travail. Qu'on s'applique donc à ranimer, ou plutôt à faire naître le crédit, qui n'a jamais été malheureusement fort étendu en France. Il ne faut pour cela, d'ailleurs, ni de grands efforts, ni surtout des mesures excentriques, qui manqueraient certainement tout leur effet. Une seule chose est nécessaire, la liberté; non point cette liberté menteuse dont on prétend que l'industrie jouit depuis longtemps, mais une liberté véritable, qui n'ait point à compter avec le monopole.
La liberté des banques: voilà le principal remède à la détresse commerciale dont la France est affligée. C'est la conclusion à laquelle j'arrive dans cet écrit. Ce n'est pourtant pas un ouvrage de circonstance que j'ai entendu faire. Déjà j'avais eu occasion de proclamer et de soutenir le même principe dans un travail publié dans la Revue des deux Mondes, en 1842. Seulement les circonstances actuelles en rendent l'adoption plus nécessaire et plus urgente.
Quoique l'ouvrage que je livre aujourd'hui au public ne soit que le développement d'un premier essai publié en 1842, il s'y trouve pourtant un grand nombre de points de vue entièrement nouveaux. Les principes y sont d'ailleurs exposés dans tout leur jour, et appuyés, je crois, sur des preuves de fait irrésistibles.
CHAPITRE PREMIER. INTRODUCTION. [extract]
§ I. — RÉFLEXIONS PRÉLIMINAIRES.
L'industrie, dans sa marche progressive, s'avance sur deux lignes parallèles. D'un côté, elle crée les instruments du travail, invente ou perfectionne les procédés mécaniques, dompte les éléments, soumet les agents naturels à sa puissance: c'est le progrès matériel ou physique; de l'autre, elle développe les facultés humaines, tantôt par l'union des forces, tantôt par la séparation des tâches; elle active par d'heureuses combinaisons la circulation des capitaux et la distribution des produits; elle encourage enfin le travail en multipliant autour de lui les conditions d'ordre, de garantie et de sécurité: c'est le progrès moral ou social. Si l'on cherche quels sont aujourd'hui les derniers termes du progrès matériel, on trouve en première ligne les machines à vapeur, les chemins de fer et ces ingénieux mécanismes qui ont porté si haut l'industrie des tissus. En cherchant sur la ligne parallèle les institutions qui marquent le dernier terme du progrès moral ou social, on s'arrête naturellement aux sociétés par actions, parmi lesquelles on distingue les compagnies d'assurances, et, par-dessus tout, les banques.
Il serait difficile de dire dans laquelle de ces deux voies l'humanité a fait les plus brillantes conquêtes. Certes, on peut rester en admiration devant les prodiges accomplis par la vapeur depuis un demi-siècle, et l'on s'étonne avec raison en considérant par la pensée tout ce que l'invention si simple des chemins de fer promet dans un avenir prochain. Mais que faut-il penser de cet ingénieux système des actions sans lequel toute grande entreprise serait inabordable à l'homme, de cette heureuse combinaison des assurances qui permet aux individus de se donner carrière en corrigeant pour eux les caprices du hasard, des banques enfin, qui mettent aux mains des travailleurs les capitaux, sans lesquels toute leur activité se consumerait en efforts stériles?
Toutefois le préjugé public n'attribue pas à ces deux genres de découvertes une importance égale. En général, les progrès qui s'accomplissent dans l'ordre moral sont moins appréciés que ceux qui se renferment dans l'ordre matériel. Ceux-ci, sans être plus réels,, sont bien plus apparents et plus sensibles. Ils se laissent, pour ainsi dire, toucher au doigt; ils se mesurent à l'œil, et leurs résultats, facilement supputâmes en chiffres, peuvent se calculer avec une rigueur mathématique. Les autres ont un caractère plus intime ou plus latent: l'influence s'en fait plutôt sentir qu'elle ne se manifeste; elle échappe à tout calcul rigoureux; elle s'exerce d'ailleurs dans des régions où l'œil du vulgaire ne pénètre pas. Aussi les progrès matériels ont-ils été presque toujours aisément compris, acceptés avec empressement et poursuivis avec ardeur, tandis qu'on a vu trop souvent les autres, ou faiblement goûtés, ou même entièrement méconnus.
C'est surtout par rapport aux banques que cette vérité devient sensible. Il suffit de parcourir leur histoire pour s'assurer de leur incomparable puissance et reconnaître les immenses services qu'elles ont rendus. Par elles, un pays pauvre, l'Ecosse, a pu fleurir tout à coup, malgré les résistances d'un sol ingrat, et les exigences tracassières d'une législation partiale, qui n'était pas faite par lui ni pour lui. Par elles encore, les Américains du Nord ont conquis tout un monde sur le désert, et ce monde nouveau, qu'ils venaient d'arracher comme au néant, ils l'ont élevé à un degré de splendeur commerciale que les contrées les plus anciennement florissantes n'ont pas connu. C'est à ses banques, bien plus qu'à ses avantages physiques, que l'Angleterre doit la prépondérance qu'elle a conquise en Europe et l'immense prospérité dont elle jouit. Que n'auraient pas fait ailleurs ces merveilleuses institutions, si presque partout des lois imprévoyantes n'en avaient ou altéré le principe ou comprimé l'essor? Dans les pays mêmes où, corrompues dans leur essence et perverties dans leur action, elles n'ont eu qu'une existence passagère et ruineuse, elles ont laissé des traces brillantes de leur passage, et leur puissance a éclaté jusque dans les désordres qui ont suivi leur chute. Cependant quelle froideur générale quand par hasard le sort de ces institutions s'agite! L'opinion, si prompte à s'alarmer quand un misérable intérêt pécuniaire est en péril, pourvu que cet intérêt pécuniaire soit réductible en chiffres, s'émeut à peine, quand on vient à mettre en question l'existence même des banques, ou les conditions fondamentales de leur organisation.
Sans aller bien loin, on peut en trouver parmi nous quelques exemples. En 1840, lorsqu'il fut question de renouveler le privilége de la banque de France, on s'en souvient peut-être, les Chambres n'accordèrent au grand sujet qu'elles avaient à débattre qu'une attention douteuse. Le monopole de la banque, ce monopole monstrueux, qui ferme au profit d'un établissement privilégié toutes les voies régulières du crédit, ne fut pas un seul instant mis en question. On ne songea pas même à étendre la sphère d'action de cet établissement unique. Si quelques modifications furent proposées ça et là dans son assiette ou dans son mécanisme, elles furent toutes successivement écartées par un ordre du jour dédaigneux. Enfin, après quelques jours d'une discussion fort incomplète, sur la foi de quelques assertions lancées au hasard par un ministre, on jugea que tout était pour le mieux en France, et le débat fut clos sans avoir rien produit. Tout récemment encore, n'avons-nous pas vu le gouvernement provisoire supprimer d'un seul trait de plume toutes nos banques départementales, sans que, ni alors ni depuis, personne se soit enquis des motifs ou des conséquences de ce grand coup d'autorité.
On peut dire, il est vrai, que depuis la révolution de février la question du crédit est à l'ordre du jour, et elle remue, en effet, bien des têtes. Mais, hélas! dans quel tourbillon d'idées s'agite-t-elle? Au lieu d'en chercher la solution dans le jeu régulier des banques commerciales, il semble que tous ceux qui s'en occupent ne tendent, à l'envi les uns des autres, qu'à enfanter des projets fabuleux. Les moyens connus, déjà pratiqués avec succès, avec éclat, sont dédaignés par ces esprits aventureux, qui ne se plaisent que dans les voies excentriques et ne savent caresser que des chimères. Ainsi, malgré l'intérêt réel qui s'attache depuis quelque temps à l'idée générale du crédit, les banques commerciales, véritables nourricières du crédit, n'en restent pas moins frappées d'une indifférence complète.
Il ne faut pas, du reste, en accuser seulement l'erreur du vulgaire, car cette cruelle indifférence est le partage même des hommes éclairés. Il faudrait plutôt en accuser la science, qui n'a pas su assigner aux banques leur véritable place. I1 semble qu'il y ait dans le jeu de ces institutions quelque chose de mystérieux qui échappe à l'examen et ne se laisse pas soumettre à l'analyse. Ce qui est sûr, c'est que la science n'a pas encore su rendre un compte satisfaisant de leur action. Cherchez, en effet, dans les travaux des économistes, et vous n'y trouverez rien qui explique par des raisons décisives, je ne dirai pas les immenses bienfaits des banques, car ces bienfaits, on les conteste, mais l'étonnante et incontestable influence qu'elles ont exercée dans tous les temps.
Pourtant les opérations qui constituent le commerce de banque n'offrent rien par elles-mêmes de très-compliqué dans la pratique. Il est probable qu'à l'origine elles ont été imaginées sans effort, sans grand travail d'esprit. Le seul maniement des affaires les a suggérées à des hommes simples, qui n'avaient d'autre science que la science vulgaire du commerçant. Aussi se sont-elles introduites dans le monde sans date certaine et sans nom d'auteur. Mais ces mêmes opérations, si faciles à concevoir, à imaginer, à pratiquer, qui, dès le principe, n'ont pas arrêté un seul instant les esprits les moins subtils, présentent encore aujourd'hui, quand on les considère dans leurs relations avec le commerce en général, un problème épineux contre lequel vient échouer toute la pénétration des plus savants économistes. Phénomène étrange, dont on admettrait à peine l'existence si l'on n'en retrouvait ailleurs des exemples! Pareille chose se remarque à propos du langage. Le peuple, qui crée les langues et qui les forme, ne les comprend pas; du moins ne sait-il pas se rendre compte des lois qui les gouvernent. En créant les mots, il les rapporte à l'ensemble avec un instinct sûr, et ces rapports, qu'il a établis lui-même, il n'en a pas conscience. Il connaît la langue pour son usage, il la pratique, il la manie comme un instrument docile; mais ce même instrument dont il se sert tous les jours sans effort, et qui est son ouvrage, renferme des mystères dont il n'a pas la clef. C'est par un contraste semblable que la raison du commerce échappe au commerçant. Ainsi va l'homme dans la plupart de ses voies; il marche d'un pas ferme et sûr, guidé tantôt par le sentiment de ses besoins, tantôt par le fil d'une analogie secrète, et quand ensuite, faisant un retour sur lui-même, il interroge ses œuvres, il n'en comprend plus le sens: il s'étonne de ne plus même retrouver la trace de ses pas dans la route qu'il vient de parcourir.
……
CHAPITRE VII. Des crises commerciales. — Unité et multiplicité des banques. — Privilège et liberté.
§ 1. — Unité Et Multiplicité Des Banques.
Comme l'établissement des banques a été jusqu'à présent suivi presque partout de perturbations commerciales plus ou moins graves, devenues, dans certains pays, en quelque sorte périodiques, on est en général porté à croire que ces accidents funestes sont un résultat inévitable de leur institution.
Par une conséquence assez naturelle de cette première idée, on suppose aussi que la multiplication de ces établissements ne pourrait tendre qu'à engendrer des commotions plus fortes. Si une seule banque, instituée, par exemple, à Paris ou à Londres, avec un privilége spécial, et agissant sous le contrôle du gouvernement, devient déjà, même malgré elle, par ses émissions de billets et ses escomptes, la cause ou l'occasion de tant de cruels désastres, que sera-ce de plusieurs banques établies côte à côte, et opérant en concurrence dans le même lieu? A coup sûr elles s'efforceront, à l'envi les unes des autres, d'imprimer au commerce cette excitation fébrile dont l'expérience a révélé tant de fois tous les dangers. Alors le délire de la spéculation, la folie de outre-commerce (over-trade), qui vient de temps à autre emporter toutes les têtes, deviendra l'état normal du pays. On marchera donc de crise en crise, de chute en chute, jusqu'à la ruine finale du crédit public et de tous les établissements privés. Aussi frémit-on à la seule pensée de voir le privilége de la banque se diviser pour s'étendre à de nouvelles institutions du même ordre. Quant à l'idée de proclamer la liberté absolue de ces institutions, de permettre à qui voudrait d'en établir à son gré d'autres semblables, elle paraîtrait à bien des gens une monstrueuse folie.
Que dirait-on cependant s'il était prouvé, en principe et en fait, que c'est précisément dans le privilége exclusif de la banque que tout le mal réside; que les crises commerciales n'ont pas en général d'autre source que celle-là, et que l'unique remède à y apporter est dans cette liberté même que l'on repousse.
Ce n'est pas, il est vrai, ce que disait, en 1840, M. Thiers, alors président du conseil des ministres, dans la discussion relative au renouvellement du privilége de la banque de France. Au dire de ce ministre, l'expérience avait prouvé que deux ou plusieurs banques ne pouvaient pas, sans un immense danger, opérer concurremment dans la même ville, que cette concurrence était pour le pays et pour elles-mêmes une source de graves embarras, et leur devenait presque toujours mortelle. Mais j'ai beau chercher dans l'histoire, je ne vois pas sur quels faits cette assertion s'appuie. Il est fâcheux que M. Thiers n'ait pas jugé à propos de dire dans quel pays du monde l'expérience avait prouvé ce qu'il avançait: je n'en connais pas un où elle n'ait prouvé tout le contraire.
Déjà dès le dernier siècle, Adam Smith, qui n'était pourtant pas enthousiaste des banques, avait remarqué que les établissements fondés en Ecosse étaient devenus plus fermes, plus solides, plus réguliers dans leur marche, à mesure que le nombre s'en était accru dans le pays. « La sûreté du public, dit-il, bien loin de diminuer, n'a fait qu'augmenter par la multiplication récente des compagnies de banque dans les deux royaumes unis de l'Angleterre et de l'Ecosse, événement qui a donné l'alarme à tant de monde.206 » Et pourtant, les banques établies dans l'Angleterre proprement dite, étaient alors constituées sur un très-mauvais principe, puisqu'en vertu de la loi de 1708, encore en vigueur à cette époque, elles ne pouvaient pas compter plus de six associés, ce qui ne leur permettait pas d'acquérir toute l'ampleur nécessaire à de pareilles institutions.
Ce qui s'est passé dans la suite en Angleterre, et surtout en Ecosse, n'a fait que confirmer ces justes prévisions.
En aucun lieu du monde les banques ne fonctionnent avec autant de régularité, avec autant de sécurité pour le public et pour elles-mêmes,que dans cette partie des Etats-Unis que l'on désigne ordinairement sous le nom de Nouvelle-Angleterre, et qui se compose des six états suivants: Rhode-Island, Massachusets, Maine, New-Hampshire, Vermont et Connecticut. Or, nulle part la liberté n'est plus grande quant à l'institution des banques, et nulle part aussi le nombre de ces établissements n'est plus considérable, eu égard à l'importance de la population. En 1830, d'après les tableaux dressés à cette époque par M. Gallatin, ancien ministre des Etats-Unis, on comptait dans cette partie de l'Union américaine 172 banques pour une population totale de 1,862,000 âmes. C'est, en moyenne, une banque pour 10,825 habitants. Entre ces six états, il y en a même deux, Rhode Island et Massachusets, qui se distinguent par une tolérance plus grande, à tel point qu'il n'y existe à proprement parler de restriction d'aucune espèce. Dans le Massachusets, il n'y en a pas d'autre qu'un droit de 1 p. 100 perçu au profit de l'État sur le capital effectif des banques; dans Rhode-Island, cet impôt même n'existe pas. En conséquence, le nombre de ces établissements y est, toute proportion gardée, encore plus considérable qu'ailleurs, car on en trouve un pour environ 6,200 habitants; et il est remarquable que ces deux états sont précisément ceux dont la population a le moins souffert des commotions funestes qui ont plusieurs fois ébranlé tout le monde commerçant.
Dans Rhode-Island en particulier, on peut dire que les banques pullulent. On n'en comptait pas, en 1830, moins de 47,207 pour une population de 97,000 âmes, ce qui donne le résultat presque fabuleux d'une banque pour 2,064 habitants.208 A ce compte, et en suivant la proportion, il n'en faudrait pas moins de 16,000 pour la France entière. Eh bien! avec ce développement sans limites des institutions de crédit, croit-on par hasard que ce petit pays soit affecté plus qu'un autre de ces maladies morales qui provoquent les crises? Loin de là, il en est, au contraire, particulièrement exempt. Le crédit y est assurément très-large, le capital fort abondant, le travail facile, la production active; aussi peut-on dire que la population y recueille la plus grande somme de bien-être matériel dont il ait encore été donné à l'homme de jouir; mais la spéculation ne s'y emporte guère à de dangereux excès. Le commerce y est très-entreprenant, mais très-réglé; et dans ses entreprises même les plus hardies, il ne s'égare jamais hors des limites du possible. La circulation des banques notamment y est plus mesurée, plus châtiée, plus correcte, s'il est permis de le dire, qu'elle ne l'est dans aucun lieu du monde. Que si le commerce y a été parfois troublé dans son cours, c'est uniquement parce qu'il ressentait, sans pouvoir y échapper entièrement, le contre-coup des crises dont le siége était ailleurs.
Il n'est donc pas vrai que la multiplicité des banques soit une source de désordres. C'est, au contraire, un correctif. Où est-ce, en effet, que les perturbations commerciales ont toujours commencé à se produire? C'est à Londres, c'est à Paris, où il existe des banques armées de priviléges exclusifs. Voilà leurs siéges ordinaires. C'est toujours là qu'on les voit éclore, pour étendre ensuite leurs ravages au loin. Quelquefois, il est vrai, l'Union américaine y a bien apporté sa large part, alors surtout qu'elle avait aussi une banque centrale munie de priviléges particuliers, et que, dans la plupart des états dont elle se compose, les restrictions étaient nombreuses: mais il est hors de doute que les principaux foyers de ces désordres sont toujours en premier lieu Londres, et en second lieu Paris.
Ce que l'expérience révèle à cet égard, je vais lâcher de l'expliquer. On va voir comment l'exercice du privilége conduit d'une manière presque inévitable à l'enfantement de crises périodiques. Par ce que j'aurai à dire sur ce sujet, on comprendra mieux aussi le caractère de ces perturbations, dont on se fait en général une idée fausse. Pour mettre cette pensée dans tout son jour, on me permettra de me servir d'abord d'une hypothèse; c'est-à-dire de raisonner abstractivement sur une banque quelconque armée d'un privilége exclusif, afin de montrer comment, par la seule force du privilége dont elle jouit, elle enfante nécessairement une crise commerciale. Il me restera à faire voir ensuite, par le tableau des principales crises qui se sont produites en Angleterre, en France et aux Etats-Unis, jusqu'à quel point cette hypothèse concorde avec la réalité.
§ II. — Opérations D'une Banque Privilégiée. — Enfantement de la crise.
Supposons que, dans la ville capitale d'un grand pays, une banque privilégiée se forme avec un capital réalisé de 60 millions. Sa mission est de faire des avances au commerce sous diverses formes, et particulièrement en escomptant les effets solides qui lui sont présentés.
Si elle n'opérait qu'avec son propre capital, elle pourrait le prêter tout entier. Dans ce cas, à supposer qu'elle le prêtât à 4 p. 100 sur bonnes garanties, de manière à éviter toute chance de perte, elle obtiendrait comme produit brut de son capital 2,400,000.
Déduisant pour frais de gestion ... 300,000.
Il resterait comme produit net ... 2,100,000.
Ce qui ne laisserait qu'un dividende de 3 1 /2 p.c. à distribuer entre ses actionnaires.
Mais une telle manière d'opérer serait aussi peu fructueuse pour la banque que pour le public, et comme elle possède la faculté d'émettre des billets payables au porteur et à vue, en d'autres termes, des billets de circulation, elle en use. Au lieu donc d'escompter les effets de commerce exclusivement avec du numéraire, elle donne en échange ses propres billets. De ces billets, admettons d'abord qu'il en reste dans la circulation pour une valeur égale au capital de la banque, c'est-à-dire, 60 millions. Ses avances s'accroissent d'autant, non pas cependant de la somme entière. Pour faire face au payement des billets qui se présentent, elle est tenue maintenant de garder ordinairement en caisse une partie de son capital, par exemple, une somme de 20 millions. Dans cette situation, voici comment se règle le compte de ses avances et de ses bénéfices:
Avances en numéraire ... 40,000,000
En billets ... 60,000,000
Total ... 100,000,000
Intérêt à 4 p.c ... 4,000,000
Déduisant pour frais ... 500,000
Reste ... 3,600,000
ou 5 et 8/10M p.c. du capital.
Cependant l'émission des billets de la banque, en augmentant la somme de ses avances au commerce, n'a pas laissé d'exercer quelque influence sur la distribution du capital: elle a rendu disponible une partie du numéraire qui avait auparavant ce même emploi. La banque, en se mettant en concurrence avec les capitalistes qui prêtaient leurs fonds au commerce, soit directement, soit par l'intermédiaire des banquiers, a déplacé leurs capitaux. Sans doute, la somme totale des avances faites au commerce a augmenté, mais non pas dans la proportion de cet accroissement. D'ailleurs, les escompteurs particuliers ne peuvent pas prêter aux mêmes conditions que la banque; et celle-ci, même à égalité de conditions, aura toujours la préférence sur eux. Il y a donc ici une certaine masse de capitaux qui se déplace et qui doit chercher ailleurs son emploi. Que devient-elle? le voici. Une partie se porte à la bourse, pour y chercher un placement sur les rentes publiques, dont naturellement le taux s'élève; une autre partie s'applique à l'achat des bons du trésor et de toutes les valeurs publiques qui offrent une certaine sécurité. Néanmoins, comme la somme de ces valeurs n'est pas élastique, qu'elle n'augmente pas au gré de la demande, il reste toujours une certaine quantité de capitaux disponibles qui cherchent en vain leur placement. Parmi les propriétaires de ces capitaux, un certain nombre, n'en trouvant pas l'emploi sur l'heure, ou ne jugeant pas les emplois actuels assez avantageux, déposent leur argent à la banque en attendant une occasion. Ainsi, l'encaisse métallique de la banque se grossit par le dépôt d'une partie des fonds qu'elle a déplacés: il s'élève alors, par exemple, de 20 millions à 50, dont 30 millions appartiennent aux déposants.
Qu'on veuille bien suivre pas à pas le progrès de ce déplacement; on verra qu'il doit aboutir, par un enchaînement rigoureux de conséquences, à une crise inévitable.
Fortifiée, en apparence du moins, par cet apport, de capitaux étrangers, dont la somme demeure, en temps ordinaire, assez constante, et ne voulant pas voir languir dans l'inaction tout ce numéraire inutile, la banque augmente ses avances au commerce. Elle fait plus: elle engage 10 millions de son propre capital, soit en rentes sur l'Etat, soit sur d'autres valeurs de même sorte, qui lui rapportent, comme les escomptes, un intérêt de 4 p. 100. Son encaisse se réduit alors à 40 millions, dont 10 seulement lui appartiennent. Néanmoins, son crédit et son influence venant à grandir en proportion du roulement des capitaux entre ses mains, elle se trouve en mesure de faire des émissions de billets plus larges, et les porte, par exemple, à 100 millions: circulation supposée très-normale, puisque, dans ce cas, elle n'est à l'encaisse métallique que dans le rapport de 2 1/2 à 1.
Dans celte situation, voici le compte de la banque: Elle a placé, tant en avances au commerce qu'en rentes sur l'État, savoir:
En numéraire … 50,000,000
En billets … 100,000,000
Total … 150,000,000
Intérêts à 4 p. 100 … 6,000,000
A déduire pour frais … 600,000
Reste … 5,400,000
ou 9 p. 100 du capital.
Cependant la nouvelle émission de billets faite par la banque, et l'abondance toujours croissante de ses avances au commerce, ont augmenté de nouveau la masse du numéraire disponible et la difficulté des placements. La concurrence entre les capitalistes, grands ou petits, devient chaque jour plus vive, sans que de nouvelles occasions se présentent pour utiliser leurs fonds. Leur embarras se trahit déjà par quelques placements irréguliers. L'afflux des capitaux augmente à la bourse; la rente s'élève et l'intérêt baisse; l'agiotage commence à s'en mêler, et le jeu absorbe une partie des fonds inoccupés: le reste va chercher un refuge à la banque, en attendant une meilleure chance; la masse des dépôts s'élève de 50 millions à 80.
Pour compléter ce tableau, il faudrait ajouter qu'à mesure que la masse des fonds disponibles augmente chez les particuliers, elle augmente ordinairement aussi entre les mains de l'Etat; en sorte que le trésor public, qui est en compte courant avec la banque, lui verse dans le même temps d'assez notables excédants. On peut cependant omettre cette circonstance, qui n'est pas absolument nécessaire à nos calculs.
Une fois que la somme des dépôts confiés à sa garde s'élève à ce point, considérant qu'au lieu de diminuer elle grossit toujours, la banque se croit dispensée de rien garder de son propre capital. Aussi le place-t-elle tout entier, soit en rentes, soit en bons du trésor, faisant ainsi concurrence aux capitalistes dans la seule voie qui leur reste et avec leurs propres fonds. La voilà donc n'opérant plus, dans ses prêts et ses escomptes, qu'avec les fonds d'autrui. Son encaisse néanmoins s'élève à 80 millions, non compris les fonds déposés par le trésor public. Dans cette situation, pourquoi n'élèverait-elle pas de nouveau ses émissions? Elle les porte donc de 150 millions à 200: chiffre toujours très-normal, puisqu'il n'est à l'encaisse effectif que dans le rapport de 2 1/2 à 1.
Voici, dans ce cas, le compte de ses placements et de ses bénéfices:
En numéraire ... 60,000,000
En billets ... 200,000,000
Total ... 260,000,000
Intérêts à 4 p. 100 ... 10,400,000
Déduisant pour frais ... 800,000
Reste ... 9,600,000
ou 16 p. 100 du capital.
Une chose frappera d'abord dans ce système: c'est la révoltante inégalité qu'il engendre. Pendant que les actionnaires de la banque, sans courir aucune chance sérieuse, perçoivent des dividendes de 16 p. 100,209 les malheureux capitalistes, dont la banque emploie les fonds pour son usage, ne perçoivent rien du tout; ou, s'ils trouvent ailleurs, après beaucoup de peines et de démarches, quelque placement aventureux, ils ne recueillent, au milieu de beaucoup de chances de perte, que de très-maigres intérêts. Ai-je besoin de dire aussi que ce système nourrit l'agiotage, les jeux de bourse, en ôtant tout autre emploi aux capitaux? Mais ce qui doit nous occuper avant tout, c'est le danger imminent qu'un tel état de choses fait naître.
Lorsque les émissions de la banque sont arrivées à un certain degré, la masse des capitaux disponibles et cherchant un placement devient énorme; non pas, il est vrai, dans toute l'étendue du pays, car il n'existe pas de moyens réguliers pour les y répartir, mais dans tout le rayon sur lequel la banque agit, et particulièrement dans la ville même où elle siége. Il s'y manifeste un engorgement tel, qu'on ne sait plus littéralement que devenir avec ses fonds. Les capitalistes, petits ou grands, se battent sur place; toutes les valeurs publiques s'avilissent; la bourse nage dans l'or. Par une conséquence naturelle, l'afflux des dépôts à la banque augmente toujours. On pourrait donc étendre plus loin ces hypothèses: supposer, par exemple, des émissions de 250 millions, comme celles de la banque de France, ou de 400 millions et plus, comme celles de la banque de Londres; mais à quoi bon? Ce qui précède suffit pour montrer la tendance irrésistible des faits, et on en entrevoit déjà les conséquences. Quand les choses sont arrivées à ce point, on peut dire à coup sûr que le moment de la crise approche.
Comment se fait-il, dira-t-on, que tout ce numéraire surabondant ne s'écoule pas à l'étranger? Entendons-nous. Il s'en écoule certainement une grande partie, mais comment? Ce n'est pas par le canal des capitalistes auxquels appartient le droit d'en disposer, car ces capitalistes, occupés seulement à chercher autour d'eux un placement pour leurs épargnes, n'ont aucune relation avec l'étranger; c'est par le canal du commerce, auquel il a été prêté par la banque. Voici, d'ailleurs, comment cet écoulement au dehors s'opère, sans que les commerçants mêmes s'en doutent. Par suite de l'abondance du numéraire sur place, la demande des marchandises augmente et les prix s'élèvent. Ces prix devenant ainsi, pour un temps, un peu supérieurs aux prix étrangers, l'exportation des marchandises indigènes diminue et l'importation des marchandises étrangères augmente. Les différences sont payées en monnaie,210 jusqu'à ce que le trop-plein en numéraire effectif ait cessé.
Considérée en elle-même, cette exportation du numéraire ne serait point un mal; loin de là, ce serait un bienfait réel. Au lieu de garder inutilement dans ses mains toute cette masse de monnaie stérile, le commerce irait la convertir au dehors en matières brutes, en instruments de travail, en marchandises de toutes les sortes, qui viendraient s'ajouter au capital productif du pays. Quoi de plus favorable à l'accroissement du bien-être général! Malheureusement, dans l'hypothèse où nous sommes placés, ce numéraire exporté reste dû aux capitalistes, qui l'ont déposé en compte courant à la banque ou entre les mains de leurs banquiers particuliers; il peut être réclamé par eux à toute heure, et il le sera certainement un jour, si quelque grande occasion de placement vient à s'offrir. Alors il faudra le rappeler de plus loin, et on peut concevoir avec quels embarras. Ainsi, cette exportation qui, faite dans d'autres conditions, serait une source de grands avantages, devient ici l'occasion d'un grand péril.
Quoi qu'il en soit, on voit bien que l'écoulement de ce numéraire au dehors ne change rien à la situation, en ce sens qu'il ne diminue pas la somme des placements à faire. Si les capitalistes n'ont pas effectivement ce numéraire entre leurs mains, ils sont toujours censés l'avoir, soit dans les caves de la banque, où ils peuvent le reprendre à volonté, soit dans les caisses de leurs banquiers, d'où ils peuvent le retirer également à très-courts termes. Ils n'en sont donc pour cela ni moins embarrassés, ni moins pressants. Ainsi, loin que l'émigration du numéraire ait corrigé en cela le trop-plein qui se faisait sentir, elle n'a fait qu'y ajouter un danger de plus.
Il y a un moment, en effet, où l'engorgement des capitaux devient tel sur la place, qu'il faut bien qu'on leur trouve un emploi à tout prix. Les détenteurs ne peuvent pas se résigner éternellement à n'en toucher aucun intérêt, ou à ne percevoir, au moyen d'un placement éventuel et précaire, que des intérêts dérisoires de 2 1/2 à 3 p. 100. Ils appellent donc à grands cris ces débouchés qu'ils ne trouvent pas. Alors, c'est tout simple, les faiseurs de projets leur viennent en aide, et le génie de la spéculation s'éveille.
On a coutume de se récrier bien fort en pareil cas, et contre les inventeurs de projets, et contre ceux qu'on appelle leurs dupes. Comme de raison, les directeurs de la banque sont toujours les premiers à
donner l'exemple de ce toile général. De bonne foi cependant, si le tableau que je viens de tracer est exact, un tel état de choses peut-il se prolonger sans terme, en s'aggravant toujours? La banque ne demanderait pas mieux sans doute, elle dont les bénéfices s'accroissent sans cesse, et qui fait, pour ainsi dire, argent de tout; mais il n'en saurait être de même de ceux qu'elle déshérite. Et quant aux spéculateurs, dont les capitalistes suivent la voie, sont-ils donc si coupables eux-mêmes de céder à tant d'invitations pressantes qu'on leur adresse?
On imagine donc des plans gigantesques pour ouvrir de larges débouchés à tous ces fonds inoccupés. Le premier venu donne le branle, et tout le reste suit. De toutes parts de grandes entreprises sont projetées, tantôt pour l'exploitation de mines de houille, tantôt pour la construction d'un vaste réseau de chemins de fer, quelquefois pour le défrichement de terres incultes, ou bien encore, si c'est en Angleterre que la scène se passe, pour l'exploitation en grand des mines d'or ou d'argent du Nouveau-Monde. Tous ces projets sont accueillis avec transport. Il n'est pas alors d'entreprise si grande dont on s'effraye; au contraire, les plus vastes, les plus hardies sont celles qui ont le plus de chances de succès, parce qu'elles répondent le mieux au vrai besoin de la situation. Les listes de souscription s'ouvrent et se remplissent en un clin d'œil. Tout le monde s'y porte: les capitalistes, parce qu'ils sont trop heureux de trouver enfin ce débouché tant attendu; les industriels et les commerçants, par esprit d'imitation, et parce que les facilités qu'ils ont trouvées jusque-là pour l'escompte de leurs billets, leur permettent de détourner quelque argent de leur commerce. Bientôt donc les sociétés sont constituées et les appels de fonds commencent. Alors apparaît le revers de la médaille, et de toutes parts les embarras surgissent.
Aussitôt que les appels de fonds commencent, chacun se hâte de rappeler ses capitaux. Celui-ci court à la banque où il les tenait en réserve; celui-là chez son banquier où ils ne lui rapportaient que de très-médiocres intérêts. Le banquier, dont la caisse se vide, s'adresse lui-même, pour la remplir, au réservoir commun, la banque, soit en rappelant une partie des fonds qu'il y avait en compte courant, soit en présentant à l'escompte un plus grand nombre de billets. Ainsi, l'encaisse métallique de la banque est entamé de toutes parts. Un premier mois, on en retire dix millions; un second mois, dix autres; un troisième mois, autant; puis encore, et toujours, de manière que cette réserve si large se fond à vue d'œil. Pour comble de malheur, c'est toujours dans le même temps que les besoins de l'État augmentent, parce qu'il éprouve la réaction de la disette qui se manifeste ailleurs. Le trésor public retire donc ses dépôts en même temps que les particuliers. De 200 millions, en comprenant les fonds de l'Etat, l'encaisse métallique de la banque tombe à 60, à 40, à 30, et peut-être au-dessous, en quelques mois. Hier, il excédait de beaucoup le tiers de ses obligations: situation brillante, où il y avait même exubérance de force, pléthore. Aujourd'hui, il n'en égale plus le neuvième; car la banque doit encore 30 millions de dépôts et 250 millions de billets: situation tout à fait anormale, impossible à maintenir, et qui appelle à grands cris de prompts remèdes.
Voici donc, en résumé, la marche ordinaire de ces événements.
D'abord, les avances que la banque fait au commerce, soit par l'escompte de ses effets, soit de toute autre manière, vont croissant d'année en année, et naturellement on voit grossir aussi ses bénéfices. Cependant, cette abondance des escomptes déplace une portion correspondante des capitaux des particuliers, et comme, en raison du privilége exclusif dont la banque jouit, les détenteurs de ces capitaux ne sont pas maîtres de les employer comme elle, la masse des fonds inoccupés s'accroît toujours. Par une conséquence assez naturelle, l'afflux du numéraire dans les caveaux de la banque et dans les caisses des banquiers particuliers s'accroît aussi; l'encaisse métallique présente un chiffre de plus en plus satisfaisant à l'œil. De ces fonds inoccupés qu'on lui confie, la banque se sert plus ou moins pour étendre encore ses opérations et augmenter ses bénéfices, soit en les employant directement, soit en détournant pour d'autres usages son propre capital devenu inutile. Ainsi naît une situation forcée, où la banque opère uniquement avec les fonds d'autrui, dont elle ne paye d'ailleurs aucun intérêt. Un moment vient enfin où les capitalistes, grands et petits, se lassent de ne rien tirer de leur argent et la spéculation s'éveille. De grandes entreprises sont projetées. Quelles entreprises? peu importe; c'est ici que les circonstances peuvent varier à l'infini: quant au résultat, il est toujours le même. Le retrait des fonds déposés commence; la banque se trouve prise au dépourvu, et une crise désastreuse éclate.
Que fera cependant la banque pour en sortir?
Dans les premiers temps, elle essaye de faire tête à l'orage. Elle multiplie ses escomptes, tant parce qu'on lui présente en réalité, comme on vient de le voir, un plus grand nombre d'effets, que parce qu'elle espère satisfaire par ce moyen les nouveaux besoins qui se révèlent. Elle émet aussi un plus grand nombre de billets: mais, comme la circulation en a déjà tout ce qu'elle en peut contenir, elle les rejette: à peine émis, ces billets se présentent au remboursement, et contribuent avec tout le reste à diminuer la réserve qui décline toujours. L'alarme se répand dans le public, et la banque commence à trembler pour elle-même. Elle pourrait vendre des rentes; mais elle les vendrait nécessairement en baisse. En effet, toutes les valeurs ont fléchi parce que la demande est moindre. Hier, chaque portion de capital créait deux acheteurs, le propriétaire de ce capital et la banque qui s'en servait en attendant. Aujourd'hui, ils ont disparu l'un et l'autre: il y a deux acheteurs de moins et un vendeur de plus. Ainsi tous les fonds baissent rapidement: déjà même la bourse a vu quelques désastres. Le moyen de songer à vendre quelque 50 à 60 millions de rentes dans un pareil moment! Il faut donc recourir aux expédients. Heureuse la banque si, dans cette situation critique, elle trouve à point nommé un souverain étranger qui la débarrasse de ses rentes, ou une banque d'un Etat voisin qui lui vienne en aide par un prêt, ou enfin quelque amas de vieilles pièces démonétisées, ou de lingots oubliés dans un coin, qu'elle puisse immédiatement convertir en numéraire.
Quand le cercle des expédients a été épuisé sans succès, et c'est le cas ordinaire, on en vient enfin au grand, au suprême remède. On prend une résolution désespérée. La banque resserre tout à coup ses escomptes, soit en élevant brusquement le taux de l'intérêt, soit en refusant une grande partie des effets qu'on lui présente. C'est le coup de grâce pour le commerce. Alors la mine éclate et le sol se couvre de ruines. La débâcle est générale. Les entreprises nouvelles, commencées sous de si brillants auspices, avortent, parce que les versements s'arrêtent: les avances faites, les travaux commencés sont perdus. En même temps un grand nombre de maisons anciennes s'écroulent: toutes les autres sont ébranlées. C'est un désarroi universel.
Pour la banque cependant, le remède employé est efficace. Il semble d'abord qu'elle devrait être entraînée dans le commun naufrage. Mais non: il n'y a de sacrifiés que les malheureux qui avaient étendu leurs opérations sur la foi des crédits accordés par elle, et qui avaient cru pouvoir compter sur la continuité de son appui. Dès l'instant que tout est par terre, entreprises nouvelles et maisons anciennes, les capitalistes, désabusés de leurs rêves, voyant tout chanceler autour d'eux, n'osant plus se fier à rien ni à personne, se hâtent de ramasser les débris de leur avoir, et les rapportent à la banque, dont la haute position peut seule les rassurer. N'est-ce pas là l'établissement unique, l'établissement privilégié, que le gouvernement protége? Auquel avoir confiance, si ce n'est en celui-là? Ainsi l'accumulation des dépôts recommence,pour aboutir, quelques années plus tard, aux mêmes résultats. On conçoit cependant que si, dans un pareil moment, il survenait quelque grande commotion politique, la banque pourrait se voir entraînée elle-même, à moins que, pour réparer ses fautes, on ne l'autorisât à suspendre ses payements en numéraire, en donnant à ses billets un cours forcé.
Voilà donc les conséquences naturelles de ce système d'une banque privilégiée. Son premier fruit est une révoltante inégalité dans la répartition des bénéfices; son dernier résultat, une catastrophe. Il donne tout aux uns et rien aux autres; il dépouille ceux-ci pour enrichir ceux-là: et loin de compenser ce vice profond en offrant au public une sécurité plus grande, il l'environne, au contraire, de piéges et de périls. Il trompe le commerce, en ne l'excitant aujourd'hui que pour l'abandonner demain: il l'induit dans des opérations qu'il ne lui permet pas ensuite de soutenir, et par là il l'expose à d'incalculables pertes. Système odieux, inqualifiable, qu'un pays civilisé aurait honte d'avoir supporté un seul moment s'il en comprenait bien tous les abus.
Si l'on demande maintenant comment la liberté d'instituer de nouvelles banques pourrait faire disparaître tous ces inconvénients, il me semble que la réponse est simple. Du jour où, par l'effet des émissions de la première banque, il y aurait sur la place une certaine quantité de capitaux disponibles, les propriétaires de ces capitaux se réuniraient pour former une seconde banque et partager les bénéfices de l'autre, en entreprenant le même commerce. Dès lors cesserait, et l'inégalité que nous remarquions tout à l'heure dans la répartition des bénéfices, et le danger d'un engorgement sur place, aussi bien que celui du retrait subit des dépôts.
Les avances faites au commerce seraient à peu de chose près les mêmes, sinon plus considérables: il y aurait seulement cette différence essentielle, que les capitaux étant désormais prêtés par ceux à qui ils appartiennent, ils ne seraient plus sujets à ces rappels désastreux, qui sont la ruine de toute industrie honnête. Mais avant de faire ressortir les conséquences de ce nouvel ordre de choses, j'ai besoin de montrer, par l'exemple de l'Angleterre et de la France, que tout ce qui précède n'est pas une hypothèse gratuite.
-----
[cut § III. -- La Crise De 1846-47 En France., § IV. — Les Crises Commerciales En Angleterre., pp.229-49]
-----
§ V. — La Liberté Des Banques. [p.250-55]
En présence de tous les faits qui précèdent, que faut-il penser et dire de ces hommes aveugles et chagrins, qui s'en vont répétant parmi nous que les souffrances de nos sociétés actuelles dérivent de la tyrannie du capital? Cette formule a-t-elle un sens quelconque dans leur bouche? Et si elle a un sens, quel est-il? Certes, les maux sont grands dans la société qui nous entoure; mais n'est-il pas puéril de les attribuer à une prétendue tyrannie que le capital exercerait sur le travail? Où sont les circonstances par où cette prétendue tyrannie se révèle? Il n'est guère de l'essence du capital d'opprimer le travail, sans lequel il ne peut rien, et qu'il doit, au contraire, suivre et rechercher avec empressement dans toutes ses voies. En fait d'ailleurs, cela n'est pas. Ce qui est vrai plutôt, c'est que, dans l'état de choses dont je viens de tracer un tableau fidèle, le capital est lui-même affreusement opprimé par un monopole inique. Cette vérité s'applique d'ailleurs, remarquons-le bien, aux petits capitaux tout aussi bien qu'aux grands, et il ne faut pas oublier que l'ouvrier, l'homme de peine, devient lui-même capitaliste, aussitôt que le fruit de ses épargnes commence à s'accumuler entre ses mains. Nos socialistes seraient donc plus près du vrai s'ils attribuaient les maux de la société actuelle à la tyrannie exercée sur le capital; mais alors ils seraient forcés de convenir que ce qu'ils appellent la bourgeoisie, en souffre bien autant que ce qu'ils appellent le peuple, et cet aveu dérangerait peut-être leurs calculs.
La tyrannie exercée sur les capitaux de tous les genres; voilà donc le caractère distinctif du régime que je viens d'analyser. Il en résulte, en temps ordinaire, pour les détenteurs de ces capitaux, des pertes d'intérêts, pour le pays, des embarras cruels, une paralysie funeste d'une grande partie du fonds social, une stagnation habituelle dans les affaires, et au moindre effort pour en sortir, une catastrophe. Que si le travail souffre de cet état de choses, ce qui n'est pas douteux, c'est qu'il subit forcément, même à son insu, le contre-coup de tous les désordres dont le capital est affecté.
Est-il nécessaire de dire maintenant comment la liberté des banques apporterait un remède certain à tous ces maux. On a déjà pu le comprendre par tout ce qui précède. Supposez qu'en 1844, ou en 1845, il eût été permis d'établir une seconde banque à Paris. Elle aurait recueilli, pour composer son fonds social, une bonne partie des capitaux alors oisifs dans les caves de la banque de France, ou dans les caisses des banquiers particuliers. L'escompte des effets de commerce n'eût pas diminué pour cela, au contraire, puisque les deux banques l'auraient effectué concurremment. Ainsi les affaires, loin de se ralentir, auraient pu prendre un plus rapide essor. Seulement, comme une bonne partie des fonds alors inoccupés aurait trouvé là son emploi, la spéculation sur les chemins de fer eût été peut-être moins ardente. Dans tous les cas, la nouvelle banque n'ayant à rendre compte à personne des fonds prêtés par elle, puisque ces fonds auraient été les siens, aurait pu laisser cette spéculation s'épanouira l'aise, sans en redouter aucunement les suites. Quant à la première banque, privée d'une notable partie des dépôts qu'on lui confie, puisque ces dépôts seraient allés chercher leur placement dans la nouvelle, elle aurait senti dès cette époque la nécessité de rappeler son propre capital, alors presque entièrement absorbé en achat de rentes. Au lieu donc d'opérer presque exclusivement avec les capitaux d'autrui, elle aurait fait valoir les siens. Par là, elle eût été prémunie d'avance contre la crise future. Dans cette situation, la spéculation sur les chemins de fer, la disette même des céréales, auraient pu survenir sans causer le moindre ébranlement.
Si l'établissement d'une seconde banque n'avait pas suffi, ce qui est très-probable, pour absorber les capitaux dormants, il s'en serait formé une troisième, qui eût encore mieux raffermi la position. Les escomptes se seraient étendus sans aucun doute, au grand avantage de l'industrie et du commerce, mais sans danger pour le pays. Les trois banques instituées étant forcées de se restreindre chaque jour davantage à l'emploi de leurs propres fonds, la possibilité d'une crise se serait éloignée de plus en plus. Chacune pourtant aurait ajouté quelque chose à ses ressources propres en émettant une certaine quantité de billets; mais, à moins qu'on n'eût abaissé le chiffre des coupures de ces billets, la circulation totale n'aurait pas grossi pour cela; car c'est le public qui règle cette circulation, et elle ne s'élève pas au gré des banques, comme les tableaux précédents l'attestent. Ainsi, le commerce et l'industrie auraient pu se donner carrière, sans qu'on eût à redouter aucune perturbation. Il va sans dire pourtant que la banque actuelle aurait vu diminuer ses bénéfices. Après l'établissement d'une première banque rivale, elle aurait vu ses produits se réduire, non pas de moitié, puisque la somme totale des escomptes aurait pu augmenter, mais peut-être d'un tiers, par exemple, de 16 p. 100 à 10. Après l'établissement d'une seconde banque rivale, ces mêmes bénéfices se seraient peut-être réduits à 7 ou 8 p. 100; une quatrième aurait pu les réduire à 5 ou 6, taux d'intérêt encore fort respectable, et que la plupart des capitalistes seraient trop heureux d'obtenir, s'ils pouvaient les percevoir sans travail et sans danger.
Si l'on demande où s'arrêterait cette multiplication des banques, la réponse sera simple. Elle s'arrêterait au moment où les bénéfices obtenus par ce moyen ne seraient plus supérieurs à ceux qu'on peut obtenir dans d'autres directions.
Pour achever de peindre ce nouveau régime, il y aurait quelques autres circonstances à mentionner. Il est hors de doute, par exemple, que du jour où plusieurs banques opéreraient concurremment dans le même lieu, elles s'efforceraient d'attire à elles les capitaux dormants, en leur offrant l'appât d'un intérêt. Par là, l'afflux des dépôts augmenterait. Toutes les sommes maintenant oisives et dispersées dans tant de lieux différents, comme les épargnes des rentiers, les fonds de caisse des négociants, même une partie des fonds actuellement déposés dans les caisses d'épargne, et surtout les sommes qui excèdent le maximum fixé par ces institutions, viendraient chercher dans les banques un placement accidentel ou permanent. Il en résulterait un meilleur emploi du capital social; ce serait, en outre, pour les banques elles-mêmes, une nouvelle source de bénéfices, en ce qu'elles prêteraient ces fonds au commerce à un taux d'intérêt un peu supérieur à celui qu'elles serviraient aux déposants. Cependant, si la liberté était entière, jamais la masse totale des dépôts n'excéderait certaines limites. Par cela même que l'intérêt payé sur les sommes confiées aux banques ne serait pas égal à celui que percevraient leurs actionnaires, tous ceux qui pourraient se séparer de leurs fonds pour un certain temps, aimeraient mieux les convertir en actions que de les laisser à l'état de dépôts. Ainsi, ou la banque qui les aurait reçus à ce dernier titre consentirait à les recevoir en accroissement de son capital propre, ou bien, lorsque la masse en deviendrait assez considérable, on aviserait à former une nouvelle banque pour leur donner un meilleur emploi. Par là, l'inégalité choquante que l'on a remarquée tout, à l'heure entre les déposants et les actionnaires tendrait chaque jour à s'effacer, en même temps que disparaîtrait toute chance possible de grave perturbation.
Je reviendrai, au surplus, sur ce sujet après avoir exposé dans leurs principales conditions les divers systèmes de banque établis en France, en Angleterre, en Ecosse et aux Etats-Unis. En ce moment, pour compléter ce qui précède, il me reste à indiquer brièvement les causes de la terrible crise qui a éclaté en 1837 dans ce dernier pays.
---
[cut § VI. — La Crise De 1837 Aux États-unis., pp. 255-64]
40.Garnier, Tocqueville, Faucher, Wolowski, and Bastiat on “The Right to Work” (1848)↩
[Word Length: 27,340]
Source
Joseph Garnier, Le droit au travail à l'Assemblée nationale. Recueil complet de tous les discours prononcés dans cette mémorable discussion par MM. Fresneau, Hubert Delisle, Cazalès, Gaulthier de Rumilly, Pelletier, A. de Tocqueville, Ledru-Rolin, Duvergier de Hauranne, Crémieux, M. Barthe, Gaslonde, de Luppé, Arnaud (de l'Ariège), Thiers, Considerant, Bouhier de l'Ecluse, Martin-Bernard, Billault, Dufaure, Goudchaux, et Lagrange (texts revue par les orateurs), suivis de l'opinion de MM. Marrast, Proudhon, Louis Blanc, Ed. Laboulaye et Cormenin; avec des observations inédites par MM. Léon Faucher, Wolowski, Fréd. Bastiat, de Parieu, et une introduction et des notes par M. Joseph Garnier (Paris: Guillaumin, 1848).
Garnier, "Introduction", pp. VII-XXIV.
IV. Discours de M. de Tocqueville, pp. 99-113.
Opinions diverse.
II Opinion de M. Léon Faucher, pp. 328-356.
III. Opinion de M. L. Wolowski, pp. 357-68.
V. Opinion de M. Frédéric Bastiat, pp. 373-76.
[Garnier] INTRODUCTION. [20 novembre 1848]
La Révolution de Février n'a pas été faite pour le Droit au travail. — Le Droit au travail des Socialistes n'a rien de commun avec le Droit du travail proclamé par Turgot. — Signification variable donnée à la formule par les Socialistes.— Analogie du Droit à l'assistance avec le Droit au travail. — Historique de ce droit.
I.
La'Révolution de Février s'est faite, comment et pourquoi? C'est inutile à raconter ici. Peut-être serais-je fort embarrassé de le faire: seulement je dois dire, pour l'avoir constaté dans les rues, en les parcourant comme tant d'autres, que la foule encombrant les places publiques n'est point arrivée, les premiers jours, avec les formules du Droit au travail ou de la Garantie du travail. On les lui a apprises; et encore n'ont-elles jamais été répétées bien clairement par elle. Ce n'est même qu'au bout de quelques jours que les étendards des députations, allant à l'Hôtel-de-Ville, portaient la formule plus connue d'Organisation du travail, et remplaçant une plus ancienne formule un peu usée, celle d'Association. Plus tard, lors de la fameuse manifestation du 16 avril, organisée par les délégués des ouvriers à la Commission du Luxembourg et par les menées de quelques clubs, on lisait sur les drapeaux: Organisation du travail par l'association, et abolition de l'exploitation de l'homme par l'homme. Ce n'est que plus tard encore, en juin, lorsque l'Assemblée nationale s'occupait de guérir la plaie des ateliers nationaux, que l'on mit en avant la formule du Droit au travail, formule qui n'a été définitivement vulgarisée qu'après les sanglantes journées de juin, pendant lesquelles le gros des insurgés ne l'invoquait même pas; car on lisait à peu près exclusivement sur leurs drapeaux (quand il y avait quelque chose, ce qui était rare): Vive la République démocratique et sociale! ou bien la formule des ouvriers Lyonnais en 1834: Vivre en travaillant ou mourir en combattant, laquelle était un cri de désespoir et nullement la réclamation d'un droit: car, dans ce cas, les ouvriers Lyonnais l'auraient positivement dit: les classes ouvrières n'ayant pas précisément l'habitude de biaiser à propos de leurs demandes.
Cette filiation n'est pas sans importance. En la traçant ici, je veux exprimer que l'agitation et la préoccupation publiques, en faveur du prétendu Droit au travail, ne sont pour rien dans la Révolution de Février, quoiqu'on ait dit dans la presse et à la tribune, que le mouvement qui a amené le changement de forme du Gouvernement n'avait pas pour principe la conquête d'un droit nouveau ou qui serait plus explicitement reconnu; que les revirements de l'opinion tenaient bien à un mécontentement ayant sa source dans la non-satisfaction de plusieurs besoins économiques et sociaux,211 mais qu'ils avaient des causes immédiates, plus particulièrement personnelles et politiques; et en définitive que le Socialisme s'est glissé subrepticement, comme on l'a dit, dans les plis du drapeau de la République. En d'autres termes, quand on a crié: Vive la République! tout le monde a accepté cette forme de Gouvernement, comme celle qui, par son élasticité, pouvait mieux s'allier avec la réforme des abus gouvernementaux et les progrès de la civilisation; et personne, si ce n'est une imperceptible minorité, n'a cru que République fût synonyme de Socialisme. On a eu beaucoup de peine à faire pénétrer dans la masse cette notion élémentaire, que par République il faut entendre le suffrage universel appliqué à l'élection d'un pouvoir exécutif temporaire et d'un pouvoir législatif également temporaire; comment cette masse aurait-elle fait une Révolution pour installer le Socialisme, qu'elle ne connaissait même pas de nom?212
Nous venons d'expliquer comment la formule du Droit au travail est entrée dans le domaine des discussions publiques et des difficultés les plus ardues de la politique, artificiellement, c'est-à-dire par les efforts de quelques socialistes en tête desquels on doit certainement placer M. Louis Blanc: cherchons maintenant à comprendre ce qu'elle veut dire; car, bien qu'elle ait largement contribué à mettre le pays en combustion, on est loin de bien s'entendre sur le sens de sa signification.
II.
Que comprennent les socialistes par le Droit au travail? Est ce le droit pour tous les citoyens de travailler de leurs bras, de leur intelligence, d'exercer leur industrie, leur profession, conformément à leur aptitude, à leur capacité, à leur goût, à leurs facultés, à leurs moyens? Alors le Droit au travail, ce serait simplement la Liberté du travail, ou bien encore le Droit au travail que Turgot proclamait dans ses mémorables édits de 1776: liberté du travail dont les économistes réclament l'application franche et complète; que la Constituante a proclamée en partie, et à laquelle les gouvernements subséquents ont de nouveau mis des entraves.
Turgot, ce type de l'homme de bien, du philosophe politique, de l'économiste aux affaires, mettait dans la bouche de Louis XVI les paroles suivantes:213
« Louis, etc. Nous devons à tous nos sujets de leur assurer la jouissance pleine et entière de leurs droits; nous devons surtout cette protection à cette classe d'hommes qui, n'ayant de propriété que leur travail et leur industrie, ont d'autant plus le besoin et le droit d'employer, dans toute leur étendue, les seules ressources qu'ils aient pour subsister...
» Dieu, en donnant à l'homme des besoins, en lui rendant nécessaire la ressource du travail, a fait du droit de travailler la propriété de tout homme, et cette propriété est la première, la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes.
» Nous regardons comme un des premiers devoirs de notre justice, et comme un des actes les plus dignes de notre bienfaisance, d'affranchir nos sujets de toutes les atteintes portées à ce droit inaliénable de l'humanité. Nous voulons en conséquence abroger ces institutions arbitraires, qui ne permettent pas à l'indigent de vivre de son travail; qui repoussent un sexe à qui sa faiblesse a donné plus de besoins et moins de ressources, et qui semblent, en le condamnant à une misère inévitable, seconder la séduction et la débauche; qui éteignent l'émulation et l'industrie, et rendent inutiles les talents de ceux que les circonstances excluent de l'entrée d'une communauté; qui privent l'État et les arts de toutes les lumières que les étrangers y apporteraient; qui retardent le progrès de ces arts, par les difficultés multipliées que rencontrent les inventeurs auxquels différentes communautés disputent le droit d'exécuter des découvertes qu'elles n'ont point faites; qui, par les frais immenses que les artisans sont obligés de payer pour acquérir la faculté de travailler, par les exactions de toute espèce qu'ils essuient, par les saisies multipliées pour de prétendues contraventions, par les dépenses et les dissipations de tout genre, par les procès interminables qu'occasionnent entre tontes ces communautés leurs prétentions respectives sur l'étendue de leurs privilèges exclusifs, surchargent l'industrie d'un impôt énorme, onéreux aux sujets, sans aucun fruit pour l'État; qui enfin, par la facilité qu'elles donnent aux membres des communautés de se liguer entre eux, de forcer les membres les plus pauvres à subir la loi des riches, deviennent un instrument de monopole, et favorisent des manœuvres dont l'effet est de hausser au-dessus de leur proportion naturelle les denrées les plus nécessaires à la subsistance du peuple.
» Nous ne serons point arrêté dans cet acte de justice, par la crainte qu'une foule d'artisans n'usent de la liberté rendue à tous pour exercer des métiers qu'ils ignorent, et que le public ne soit inondé d'ouvrages mal fabriqués. La liberté n'a point produit ces fâcheux effets dans les lieux où elle est établie »
Est-ce cette doctrine que les socialistes résument dans leur formule? Est-ce la condamnation des anciens droits féodaux perçus par la noblesse ou le clergé? Est-ce la condamnation des corporations, des jurandes et des maîtrises? Est-ce la suppression des inégalités, des monopoles, des priviléges, des réglements inutiles ou abusifs, de la tyrannie bureaucratique, de l'intervention administrative, des prohibitions et des tarifs réglementaires qui se sont glissés ou perpétués dans nos lois, et qui enchaînent à la fois le travail agricole, le travail industriel, le travail commercial, le travail intellectuel et scientifique? en un mot, le Droit au travail, est-ce l'application du principe de Liberté et d'Égalité dans le domaine du travail?
Si telle était la signification du Droit au travail, assurément il n'y aurait pas eu nécessité d'une nouvelle formule. Pour l'exprimer, il n'y aurait eu qu'à reprendre la formule de Turgot, ou bien ce mot si connu depuis 89: la Liberté. Mais les socialistes entendent bien autre chose, en vérité! Ils entendent tout le contraire. Il y en a parmi eux qui rêvent des organisations analogues aux corporations. Loin de demander le développement de la liberté du travail et la cessation de toute réglementation administrative ou bureaucratique, ils proposent la suppression de toute liberté et une réglementation universelle qu'ils décorent du nom pompeux d'organisation. Que leur parlez-vous d'exceptions, de priviléges, de monopoles, de prohibitions, de hauts tarifs! Ils disent qu'il n'y a point assez d'entraves, que l'industrie et le commerce sont trop libres, et que tout va mal parce que, sur beaucoup de points, la Révolution de 89 a proclamé le laisser-passer en commerce, le laisser-faire en industrie, la concurrence enfin: abominable laisser-faire que les disciples de Quesnay n'appliquaient, il est vrai, qu'à l'ordre commercial ou industriel, et que les socialistes affectent de critiquer dans l'ordre moral, afin de rendre leurs adversaires à la fois plus ridicules et plus odieux.214
Si les socialistes repoussent la liberté du travail, ils repoussent aussi l'égalité dans le travail. L'égalité, c'est encore la concurrence: la concurrence, ils l'ont dit sur tous les tons, est cause des trois quarts des maux de la société, des falsifications, des sinistres commerciaux, des faillites, de la baisse des salaires, de la misère, de la prostitution, du vol, et de je ne sais combien d'autres crimes encore.
Le Droit au travail, est-ce le droit de jouir des fruits de son travail ? est-ce, en d'autres termes, le droit de propriété? Tout aussi peu; car ce droit, personne ne le conteste, si ce ne sont les socialistes eux-mêmes, si ce n'est surtout l'école d'un socialiste éminent plus nouvellement arrivé à la connaissance du public, qui a été jusqu'à nier le droit à la propriété et notamment le droit à la jouissance des fruits de la propriété du travail accumulé, c'est-à-dire du Capital.
Mais, qu'est-ce donc que le Droit au travail?
III.
Nous venons de dire ce que n'est pas le Droit au travail; pour dire ce qu'il est, il nous faudra encore faire d'interminables éunmérations.
La formule a été et est employée par plusieurs espèces de socialistes plus ou moins avérés, plus ou moins complets, plus ou moins francs, plus ou moins honteux:
1 ° Ceux qui prennent les mots pour ce qu'ils disent, ceux qui nomment les choses par leur nom, et
Appellent chai un chat, et Rollet un fripon;
Rollet, pour eux c'est le Capital.
2° Ceux qui comprennent ou feignent de comprendre comme les précédents, mais manquent de bonne foi ou de courage;
3° Ceux qui par irréflexion, ignorance, ou par conception incomplète, donnent à la formule un sens qu'elle n'a réellement pas; qui ne croient pas que les populations aient une logique inexorable; qui croient au contraire qu'il est possible de les satisfaire par des clauses jésuitiques, identiques ou ambiguës, à l'instar de l'article 14 de la charte de Louis XVIII.
Un jour M. Proudhon (M. Proudhon est le type de la première espèce), discutant avec M. Goudchaux au sein du comité des finances, lui dit: « Oh! mon Dieu, monsieur Goudchaux, si vous me passez le droit au travail, je vous cède le droit de propriété. » Ces paroles ont eu quelque retentissement: elles ont été prises pour une trahison par tous les socialistes qui ne pensent pas qu'il soit politique de dire la vérité. Ces paroles furent prises pour une extravagance par les socialistes de la troisième catégorie; et ainsi s'expliquent tous les lardons lancés de la tribune, par une foule de socialistes inconséquents, à M. Proudhon, le plus franc d'entre eux.215 M. Proudhon avait raison: si l'on admet le droit au travail, il faut renoncer au droit de propriété. Ce n'est pas là un axiome de scélérat, c'est un raisonnement très-vrai et très-sain. M. Proudhon n'admet pas le droit de propriété, mais il admet le droit au travail; il est simplement logique. D'autres admettent le droit de propriété et le Droit au travail; mais ils ne peuvent échapper à la qualification de fourbes qu'en acceptant celle d'inconséquents.
Le Droit au travail des uns est si bien un droit à la propriété des autres, qu'il ne se conçoit pas sans cette corrélation. Je demande du travail à la société représentée par une autorité quelconque; avec quoi celle-ci peut-elle occuper mes bras, fournir des avances à mon industrie? avec un Capital. Comment cette société peut-elle se procurer ce Capital? par l'impôt. Or, qu'est-ce que l'impôt, si ce n'est un prélèvement sur la propriété des autres? y a-t-il besoin d'insister sur cette évidence? Cependant, c'est parce que la propriété des uns passe par la phase d'impôt et salarie des percepteurs et des intermédiaires, avant d'alimenter le travail des autres, que beaucoup de gens se laissent prendre au sophisme. A leurs yeux, il semblerait que l'impôt est un produit spontané de l'État, être réputé supérieur et mystérieux, mais qui, en fait de subsides, se borne très-simplement à demander aux contribuables ce qu'on réclame de lui.
Il est vrai que ceux à qui on fait toucher la chose du doigt peuvent répondre que l'impôt ou la propriété de ceux-ci, destiné à faire travailler ceux-là, sera consacré à des emplois productifs capables de rembourser et au delà cette espèce d'emprunt forcé; ils peuvent répondre que leurs systèmes d'organisation donneront ces résultats, et ici il faudrait m'arrêter sur les plans des divers communismes, sur ceux du fouriérisme et autres. Je me borne à dire que le jour où on me montrera quelque part des phalanstères et des communautés, des monastères ou des combinaisons d'association quelconques en prospérité, et les populations libres empressées d'y accourir, ce jour je trouverai naturel et inutile qu'on mette dans la Constitution une promesse facile à tenir et qui n'aura plus le moindre danger, car alors les hommes sauront bien que le Droit au travail des uns est le sacrifice de l'avoir des autres; car, à cette époque, ce partage sera tout à fait de leur goût, et fera partie de la nature humaine dès lors totalement changée. J'ajouterai que pour mon compte je verrais avec plaisir porter au budget, et exceptionnellement, une somme destinée à faire les avances de quelques phalanstères ou communautés, afin de mettre les auteurs de systèmes en demeure.
Je ne m'arrêterai pas aux socialistes de la seconde espèce qui comprennent la formule et qui en enveloppent le sens dans des circonlocutions littéraires, sentimentales et politiques, et suffisamment insidieuses pour faire prendre le change aux auditeurs inexercés. Convaincre, n'est pas leur affaire; ce qu'il leur faut, c'est agiter; sauf, quand le flot des passions les a poussés en avant, à se tirer de la difficulté par quelques-unes des roueries que l'histoire se charge d'enregistrer, et qui réapparaissent le lendemain des révolutions avec une périodicité semblable à celle des phénomènes ordinaires du ciel.
Il n'y a rien à faire avec les gens de cette espèce, si ce n'est de travailler à empêcher les populations de devenir leurs dupes. Il n'y a rien à faire non plus avec les socialistes de la première espèce: leur conclusion est le travail de tout un système d'idées; il leur a été prescrit de tenter des efforts surhumains pour mener leurs plans à réalisation, pour les faire pratiquer jusqu'à ce que l'expérience les condamne et qu'ils soient abandonnés de leurs partisans. A tout prendre, ce sont des natures utiles; et il y a une incommensurable différence entre ceux qui parcourent le champ de la pensée, même pour s'y égarer et égarer les autres, et ceux qui abusent sciemment de l'ignorance des masses. Les uns sont les pionniers de la civilisation; les autres en sont les fléaux.
Les variétés des socialistes de la troisième espèce, des socialistes sans principes arrêtés, sans boussole, sont infinies, et les définitions qu'ils ont données du Droit au travail sont également innombrables. Chacun d'eux, niant le droit absolu, est obligé de s'accrocher à un point quelconque de l'échelle de relation, les uns plus haut, les autres plus bas; mais leurs propositions ne résistant pas à l'épreuve d'un raisonnement tant soit peu serré, ils sont forcés de se rallier au Droit au travail proprement dit, ou de nier ce droit, à moins qu'ils ne s'échappent par un véritable saut de mouton, par une inconséquence. Plusieurs des orateurs de cette catégorie, incapables de formuler nettement en quoi consiste le Droit au travail, en ont été réduits à dire qu'ils demandaient l'insertion de la formule dans la Constitution, sauf à l'expliquer plus tard.
Nous avons entendu dire à M. Ledru-Rollin:216 « Quand je demande le Droit au travail, que voulé-je? Que vous l'inscriviez dans une Constitution qui apparemment sera durable. Le peuple ne se soulève pas tous les jours pour faire des chartes. Or, quand vous inscrirez le Droit au travail, vous ne serez pas forcés de l'organiser le lendemain. »
Nous avons entendu dire à M. Billault:217 « Écrivons dans notre Constitution ce principe dont la formule nous obligera à étudier, à nous ingénier… Ce pays-ci, malheureusement, se passionne trop souvent pour les mots, sans même trop bien se rendre compte des choses; tenez compte, Citoyens, de cette prédisposition. Ce redoutable mot du Droit au travail est devenu dans le mouvement de la Révolution une sorte de bannière; le Gouvernement provisoire y a donné comme une consécration. »
Je pourrais prendre dans ce volume plusieurs autres citations semblables, et je dis que des législateurs qui ont des convictions si peu arrêtées devraient être mis en charte privée comme les jurés anglais, jusqu'à ce qu'ils se soient prononcés plus catégoriquement. Les populations, celles surtout qui n'ont pas été façonnées par l'étude aux subtilités de l'argumentation et du langage, donnent toujours aux mots un sens précis. On avait dit et répété solennellement aux populations qu'on donnerait du travail à chaque citoyen; on leur avait dit que cette garantie était un droit, et lorsqu'on a été obligé de revenir sur ses pas, d'avouer qu'on n'avait pas de ressources, qu'on avait promis plus qu'on ne pouvait tenir, elles se sont crues trompées, et elles ont pris les armes pour porter aux affaires ceux des hommes politiques qui continuaient à leur promettre l'accomplissement de leurs illusions.218 La masse a si bien pris au sérieux les doctrines qu'on lui a prêchées, que vous avez vu des paysans ignorants travailler de force sur le champ d'autrui et exiger leur salaire avec violence!219 Il n'y a eu, je crois, qu'un procès semblable en police correctionnelle; mais tout le monde pourrait citer de nombreux cas analogues à celui qui est arrivé à Lunel, et que les circonstances ont mis à l'abri des poursuites.
Mais, voulez-vous savoir combien MM. Ledru-Rollin, Billault et autres, s'abusent en croyant qu'on leur donnera le temps de chercher? lisez le discours prononcé, dans la séance même où M. Ledru-Rollin a pris la parole, par M. Pelletier, l'élu des ouvriers lyonnais. M. Pelletier disait: « Nous ne pouvons dire au peuple que nous ne demandons pas mieux que de lui consacrer son Droit au travail et de le rendre heureux; mais que, ne sachant pas comment lui en procurer ni l'organiser, et redoutant le socialisme, qui prétend que cela est possible, nous le lui supprimons; le peuple vous répondrait: « Si vous ne savez rien faire de neuf, rentournez-vous, et faites place à d'autres. » (Rires.) Messieurs, il y a assez d'hommes capables dans cette enceinte pour résoudre cette question: il s'agit tout simplement de les consulter. » M. Pelletier, comme on le voit, prenait au sérieux la formule et les hommes qui l'invoquent, je ne sais ce que la discussion lui a appris à cet égard; mais ce que je veux répéter, c'est qu'il est très-déplorable de mettre en avant, dans les déclarations publiques, des promesses vagues dont on se réserve d'étudier plus tard la possibilité, ou d'éluder le sens et la portée à l'aide d'interprétations judaïques. C'est là un indigne procédé que les masses punissent tôt au tard par des violences, et auquel la majorité de l'Assemblée n'a pas voulu s'associer. En agissant ainsi, elle a rempli un impérieux devoir.
IV.
Je raisonne autrement que M. Louis Blanc;220 mais je pense comme lui, et avec Malthus (M. Louis Blanc serait bien étonné d'être en communion d'idées avec cet affreux Malthus!), que le droit à l'assistance n'est autre chose que le droit au travail, et que la proclamation de ce droit engage la société dans des difficultés, dans des impossibilités tout à fait semblables à celles qui dérivent du droit au travail. Qui dit Droit, dit que celui qui a ce droit, que celui à qui l'assistance est due, peut sommer la société et le gouvernement qui la représente de lui donner cette assistance. Or, comment payer cette assistance due? Par l'impôt: — et l'impôt, encore une fois, est-ce autre chose que la propriété? Ainsi, droit au travail, droit à l'assistance, droit à la propriété d'autrui, sont au fond synonymes. Les Anglais l'ont bien compris. Une fois le principe posé dans la loi des pauvres, ils en ont accepté toutes les conséquences pratiques, jusqu'à ce que l'expérience leur ait ouvert les yeux, et les ait engagés à rebrousser chemin; ce qu'ils ont déjà tenté par la réforme de 1834, et ce qu'ils ont beaucoup de peine à réaliser. Or, savez vous jusqu'où allaient ces conséquences? Dans la séance des communes du 15 décembre 1830, un député, M. Watmann, signalait cinquante familles de la Cité qui avaient été obligées de vendre leur mobilier pour acquitter la taxe des pauvres: En 1834, année à partir de laquelle le Parlement a mis quelques restrictions au droit à l'assistance, la taxe des pauvres a coûté six millions de livres, ou près de 140 millions de francs.221 Mais le chiffre de la dépense n'est que le moindre des arguments; et, bien que je ne veuille et que je ne puisse pas traiter la question ici, je rappellerai que la taxe des pauvres a produit pour résultats généraux: la multiplication des pauvres, l'imprévoyance des populations, leur démoralisation, et finalement la baisse des salaires, le pauvre faisant entrer en ligne de compte le revenu assuré qu'il touche du bureau de charité.
C'est là un immense fait acquis à l'économie politique, et que reconnaissait très-bien un orateur de cette partie de l'Assemblée nationale, la Montagne, qui, faute de logique et de réflexions suffisantes, fait du socialisme sans le savoir. M. Mathieu (de la Drôme) disait: « Votez! oui, votez le droit à l'assistance pour l'homme valide au lieu du droit au travail, et je vous affirme que l'histoire dira un jour que vous avez voté l'abaissement, la dégradation, la démoralisation de la première nation du monde! » Bien n'est plus vrai que ces paroles; toutefois je ne m'explique pas que celui qui les a prononcées soit partisan du droit au travail.
Il y a donc identité entre le droit au travail et le droit à l'assistance; mais l'Assemblée nationale se serait plus facilement laissé imposer le second que le premier: d'abord parce qu'on est plus familiarisé avec le second; ensuite parce qu'il paraissait plus facile à restreindre dans les limites du possible. Toufois, elle a eu le sentiment vague de l'identité que nous venons d'indiquer, et elle a, sur la proposition de sa commission, tourné la difficulté en ne proclamant pas le droit du pauvre à l'assistance; mais le devoir de la société à l'assister, et elle a ajouté que ce devoir social serait subordonné à ses ressources.
On a dit à ce sujet qu'il y a des devoirs qui ne correspondent pas à des droits; on a dit, par exemple, que l'homme a devant Dieu le devoir de faire la charité, d'assister son semblable, et que le pauvre n'a pas le droit d'exiger l'exercice de cette vertu.222 Assurément cela est vrai; mais je ferai remarquer qu'on mêle ici deux choses tout à fait différentes: une Constitution politique ne peut point commander les devoirs de l'ordre religieux, sous peine de faire trébucher la nation dans des abîmes; ce qu'elle doit seulement prescrire, c'est la justice, la plus stricte justice, sans doute; mais, cependant rien que la plus stricte justice. Que puis-je devoir à mon semblable, absolument parlant? Rien. — Mon devoir est de ne pas lui nuire; et à ce devoir correspond son droit d'exiger que je ne lui nuise pas.
M. Cormenin fait cette demande: « Chrétiens, hommes libres, mes amis, mes égaux, mes frères, laisserez-vous cette âme sans morale, cet esprit sans culture, ce corps sans subsistance? Les laisserez-vous tous trois mourir dans la personne d'un égal, d'un homme libre, d'un frère? Voyons, les laisserez-vous mourir? répondez.223 » — Je ne m'occupe ici que de la subsistance, et je réponds qu'il ne s'agit pas de savoir si je serai assez peu charitable pour laisser mourir mon semblable de faim, lorsque je pourrai faire autrement; mais bien de savoir si l'homme qui a faim a le droit strict d'exiger de moi sa nourriture. — A M. Cormenin, éveillant en moi le sentiment religieux, humanitaire, je réponds que je ne laisserai pas mourir mon semblable; mais je l'embarrasserais fort si je lui demandais «à mon tour dans quelle limite je dois religieusement partager avec lui.... — A M. Cormenin, président de la commission de Constitution, je réponds qu'en admettant par hypothèse que ma propriété n'est pas le fruit d'un privilége manifeste, opposé aux lois positives en vigueur, je n'en dois la plus petite parcelle à qui que ce soit: sinon ce n'est plus ma propriété; c'est celle de ceux à qui je la dois et dans la limite de mon devoir.
C'est donc selon moi une erreur préjudiciable, que d'avoir proclamé que la société doit l'assistance à tous les citoyens nécessiteux dans les limites de ses ressources. Que la société donne à quelques nécessiteux, sans engagement de sa part, rien de mieux! mais si la Constitution s'engage à donner à tous les citoyens nécessiteux en temps de crise, elle promet ce qu'elle ne peut tenir; elle habitue les populations à compter sur la providence sociale qui est la plus marâtre des providences, au lieu de compter sur l'énergie propre et individuelle qui est la seule force véritable, vis interna rerum, que Dieu ait établie. Heureux si la société, l'association générale, parvenait à maintenir la sécurité et la justice à l'abri desquelles tous les citoyens développent librement et le mieux possible leurs facultés, leur industrie; à l'abri desquelles ils peuvent le mieux satisfaire le plus de besoins en faisant le moins d'efforts.
Si on me disait que j'oublie dans cette appréciation que le devoir de l'assistance a été limité par les ressources, je répondrais qu'il ne manquera jamais d'hommes de parti qui persuaderont aux plus pauvres et aux plus nombreux, qu'avec telle ou telle combinaison gouvernementale, avec telle ou telle politique, les ressources se multiplieraient.224 Cet amendement, cette échappatoire des ressources est un danger de plus.
Ce biais du devoir social remplaçant le droit individuel, on l'a également employé pour la question du travail. L'article 13 énumère, non sans danger pour l'avenir, les moyens par lesquels la société, c'est-à-dire le gouvernement qui la représente, doit favoriser et encourager (la Constitution dit, pour atténuer: la société favorise et encourage ) le développement du travail. Ces moyens sont: l'enseignement primaire gratuit, l'éducation professionnelle, l'égalité des rapports entre le patron et l'ouvrier, les institutions de prévoyance et de crédit, les associations volontaires, et l'établissement par l'État, les départements et les communes, de travaux publics propres à employer les bras inoccupés. La Constitution dit ensuite que la société fournit l'existence aux enfants abandonnés, aux infirmes et aux vieillards sans ressources et que leurs familles ne peuvent secourir.
Ces promesses peuvent nous mener loin si on veut les tenir. Qu'a-t-on entendu par l'égalité des rapports entre le patron et l'ouvrier, par les institutions de prévoyance et de crédit? Dieu seul le sait. Vous verrez que d'aucuns diront que la Constitution proscrit la tyrannie du capital, qu'elle proclame l'égalité des salaires, la gratuité du prêt, etc. Et qu'est-ce encore que cette promesse de travaux aux bras inoccupés, sinon une cachette d'où l'on pourra tirer, sans de trop grands efforts de logique, le droit au travail? — Puisque la Constitution déclare que la société doit du travail aux bras inoccupés, constatez que mes bras sont inoccupés et donnez-moi du travail, ou bien je vous prends en flagrant délit de mensonges. — Voilà ce que pourront dire et ce que diront malheureusement un trop grand nombre d'hommes.
En résumé, on a promis plus qu'on ne peut tenir; on a signé une convention dont on ne comprend pas bien la portée; on a suivi en partie le conseil de MM. Ledru-Rollin et Billault; on a inscrit dans la Constitution des droits et des devoirs qu'on n'expliquera, qu'on ne comprendra, qu'on n'appliquera que plus tard; si tant est qu'on arrive à les formuler nettement.
V.
Nous avons dit, en commençant, notre sentiment sur la manière dont la formule de la Garantie du travail, qui n'est autre que celle du Droit au travail retourné, s'est produite en février. M. Louis Blanc avoue dans sa dernière brochure225 qu'elle a été imposée par la force; d'autres témoins parlent de fusils mis en joue. Nous ne nions pas ces faits; mais nous maintenons que ces violentes manifestations avaient été suscitées (l'histoire dira par qui), et que, dans la foule stationnant sur la place de Grève, un très-petit nombre d'hommes savaient ce qui se passait à la tête des députations qui pénétraient à l'Hôtel-de-Ville, et venaient imposer leur volonté ou la volonté de ceux qui les poussaient. Qu'il y ait eu violence ou non, l'histoire reprochera à ceux dont la conscience a été violentée, de n'avoir pas su protester plus tôt et mieux, et de n'avoir compris le danger des promesses illusoires qu'après six mois de déplorables expériences.
Si maintenant on recherche l'origine de cette formule, on voit que l'école phalanstérienne en réclame l'invention. M. Victor Hennequin, qui, dans cette école, prend rang après M. Considérant, revendiquait dernièrement, au banquet donné à l'occasion de l'anniversaire de Fourier, la priorité pour ce socialiste, en citant, à l'appui de son opinion, le passage suivant de la Théorie de l'Unité universelle, qui date de près de trente ans.
L'Ecriture nous dit que Dieu condamna le premier homme et sa postérité à travailler à la sueur de leur front: mais il ne nous condamna pas à être privés du travail d'où dépend notre subsistance. Nous pouvons donc, en fait de droits de l'homme, inviter la philosophie et la civilisation à ne pas nous frustrer de la ressource que Dieu nous a laissée comme pis aller et châtiment, et à nous garantit au moins le droit au genre de travail auquel nous avons été élevés.
« … Nous avons donc passé des siècles à ergoter sur les droits de l'homme, sans songer à reconnaître le plus essentiel, celui du travail, sans lequel les autres ne sont rien. Quelle honte pour les peuples qui se croient habiles en politique sociale! Ne doit-on pas insister sur une erreur si ignominieuse, pour étudier l'esprit humain et étudier le mécanisme sociétaire qui va rendre à l'homme tous ses droits naturels, dont la civilisation ne peut ni garantir ni admettre le principal, le droit au travail. »
M. Considérant discutait la formule ex professo, il y a dix ans, dans un article de la Phalange,226 qu'il a reproduit tout récemment en brochure sous le titre: Du droit de propriété et du droit au travail.227 Enfin, depuis quelques années, la Démocratie pacifique, journal quotidien des fouriéristes, a repris le thème sur tous les tons, et sous différentes appellations, notamment sous celle de droit à un minimum de salaire.
Cependant cette formule n'apparaissait que rarement ailleurs dans le langage politique, et elle était loin de jouir de la même faveur que celle de l'Association ou de l'Organisation du travail, la première vulgarisée surtout par l'école saint-simonnienne; la seconde, dont tout l'honneur revient, si honneur il y a, à M. Louis Blanc.228
On ne la trouve pas, ce me semble, dans le pamphlet de ce dernier écrivain, sur l'Organisation du travail, publié en 1840;229 on ne la trouve pas non plus dans des éditions postérieures, celle de 1845, par exemple, la plus récente que j'aie sous les yeux; et ce fait suffit pour pouvoir affirmer qu'elle n'a été que depuis très-peu de temps mise en circulation. A tout prendre, il me semble bien que c'est le premier projet de la Constitution qui lui a donné la vogue, à la suite de laquelle sont arrivés les débats dans les bureaux de la Chambre, dans la presse et à la tribune. Dès ce moment le droit dont M. Considérant serait non pas tout à fait le père230 (comme a dit M. Duvergier de Hauranne à la tribune), mais le père nourricier, a été successivement adopté, avec des significations diverses, non-seulement par l'extrémité de l'Assemblée nationale peuplée de montagnards ou de socialistes purs, mais encore par des groupes où se trouvent des hommes de nuances diverses, tels que MM. Lamartine, Crémieux, Billault, etc.
La majorité de la commission de Constitution a certainemen commis une faute, en se laissant imposer dans sa première rédaction une formule qui devait être vague aux yeux du plus grand nombre, et dangereuse aux yeux de ceux qui étaient un peu versés dans les questions économiques.231 Plus tard, les partisans du droit au travail se sont prévalus de cette faiblesse, et ont présenté l'opposition que la déclaration de ce droit rencontrait dans les bureaux et à l'Assemblée comme une réaction contre le progrès, tandis qu'il n'y avait au fond que plus de réflexion et une intelligence plus rationnelle des conditions du progrès. Au reste, le rapprochement de deux dates explique tout. Le premier projet de la Constitution a été lu le 20 juin; le second, qui a été rédigé après la discussion dans les bureaux, a été lu le 29 août. Entre ces deux époques les discordes civiles avaient vieilli nos représentants de plusieurs années.
Nous ne parlons ici que de la formule du droit nouveau qu'où a dit être la cause et le but de la Révolution de Février, et que nous croyons avoir été parfaitement inconnu et n'avoir pris, nous le répétons, quelque consistance pour le public qu'à l'approche des débats de la Constitution. Car, enfin, est-il possible qu'une révolution soit faite au nom d'un droit qui ne serait pas connu, formulé, proclamé par la masse? Le 22 février, le 23, le 24, demandait-on le droit au travail?
Maintenant nous avouons que l'idée socialiste à laquelle se rattache cette formule est très-ancienne, mais beaucoup plus ancienne qu'on ne le suppose. M. Considérant et M. Victor Hennequin peuvent la retrouver chez tous les publicistes qui se sont mépris sur le rôle et le pouvoir réel des gouvernements. La célèbre controverse qui s'éleva vers la fin du dernier siècle entre Malthus et Godwin n'avait pas d'autre point de depart; et Quesnay répondait déjà aux socialistes de son temps: « Le droit naturel de tous à tout, se réduit au droit de l'homme aux choses dont il peut obtenir la jouissance; il est semblable au droit de chaque hirondelle à tous les moucherons qui voltigent, mais qui, dans la réalité, se borne à ceux qu'elle peut saisir. » Ce qui veut dire qu'avec la liberté tout homme n'a droit qu'au travail disponible concurremment avec les autres hommes; ce qui réduit à néant le droit au travail comme on l'entend.
Au reste, tout le monde sait que l'idée du droit à l'assistance, dont le droit au travail n'est qu'une répétition en d'autres termes, remonte très haut, et a été de bonne heure le résultat d'une fausse interprétation politique de la morale religieuse du Christ. Nous disons fausse interprétation, parce que si le Christ a toujours recommandé aux riches de partager, au nom de leur intérêt futur, il a aussi formellement nié le droit des pauvres à exiger le superflu des riches. C'est pour ne pas faire cette simple distinction qu'une foule de catholiques four voyés sont conduits à un charitisme qui aboutit forcément au communisme.232
Joseph Garnier.
----------
IV. DISCOURS DE M. DE TOCQUEVILLE.233
Citoyens Représentants, vous n'attendez pas de moi, si je ne me trompe, que je réponde à la dernière partie du discours que vous venez d'entendre. Elle contient l'énonciation d'un système complet et compliqué auquel je n'ai pas mission d'opposer un autre système.
Mon but, dans ce moment, est uniquement de discuter l'amendement en faveur duquel, ou plutôt à propos duquel l'orateur précédent vient de parler.
Quel est cet amendement? quelle est sa portée? quelle est sa tendance, suivant moi, fatale? C'est cela que j'ai à examiner.
Un mot d'abord sur le travail de la commission.
La commission, comme vous l'a dit le précédent orateur, a eu, en effet, deux rédactions; mais au fond elle n'a eu et ne continue à avoir qu'une seule pensée. Elle avait d'abord eu une première formule. Les paroles qui ont été prononcées à cette tribune et ailleurs, et mieux que les paroles, les faits lui ont démontré que cette formule était une expression incomplète et dangereuse de sa pensée; elle y a renoncé, non pas à la pensée, mais à la forme.
Cette formule est reprise. C'est en face d'elle que nous nous trouvons en ce moment placés.
On met les deux rédactions en présence; soit. Comparons l'une à l'autre, à la lumière nouvelle des faits.
Par sa dernière rédaction, la commission se borne à imposer à la société le devoir de venir en aide, soit par le travail, soit par le secours proprement dit, et dans les mesures de ses ressources, à toutes les misères: en disant cela, la commission a voulu sans doute imposer à l'État un devoir plus étendu, plus sacré que celui qu'il s'était imposé jusqu'à présent; mais elle n'a pas voulu faire une chose absolument nouvelle: elle a voulu accroître, consacrer, régulariser la charité publique; elle n'a pas voulu faire autre chose que la charité publique. L'amendement, au contraire, fait autre chose, et bien plus; l'amendement, avec le sens que les paroles qui ont été prononcées, et surtout les faits récents lui donnent, l'amendement qui accorde à chaque homme en particulier le droit général, absolu, irrésistible, au travail, cet amendement mène nécessairement à l'une de ces conséquences: ou l'État entreprendra de donner à tous les travailleurs qui se présenteront à lui l'emploi qui leur manque, et alors il est entraîné peu à peu à se faire industriel; comme il est l'entrepreneur d'industrie qu'on rencontre partout, le seul qui ne puisse refuser le travail, et celui qui d'ordinaire fait travailler le moins, il est invinciblement conduit à se faire le principal et bientôt, en quelque sorte, l'unique entrepreneur de l'industrie. Une fois arrivé là, l'impôt n'est plus le moyen de faire fonctionner la machine du gouvernement, mais le grand moyen d'alimenter l'industrie. Accumulant ainsi dans ses mains tous les capitaux des particuliers, l'État devient enfin le propriétaire unique de toutes choses. Or, cela c'est le communisme. (Sensation.)
Si, au contraire, l'État veut échapper à la nécessité fatale dont je viens de parler; s'il veut, non plus, par lui-même et par ses propres ressources, donner du travail à tous les ouvriers qui se présentent, mais veiller à ce qu'ils en trouvent toujours chez les particuliers, il est entraîné fatalement à tenter cette réglementation de l'industrie qu'adoptait, si je ne me trompe, dans son système, l'honorable préopinant. Il est obligé de faire en sorte qu'il n'y ait pas de chômage; cela le mène forcément à distribuer les travailleurs de manière à ce qu'ils ne se fassent pas concurrence, à régler les salaires; tantôt à modérer la production, tantôt à l'accélérer; en un mot, à se faire le grand et unique organisateur du travail. (Mouvement.)
Ainsi, bien qu'au premier abord la rédaction de la commission et celle de l'amendement semblent se toucher, ces deux rédactions mènent à des résultats très-contraires; ce sont comme deux routes qui, partant d'abord du même point, finissent par être séparées par un espace immense: l'une aboutit à une extension de la charité publique; au bout de l'autre, qu'aperçoit-on? le socialisme. (Marques d'assentiment.)
Ne nous le dissimulons pas, on ne gagne rien à ajourner des discussions dont le principe existe au fond même de la société, et qui, tôt ou tard, apparaissent d'une manière ou d'une autre, tantôt par des paroles et tantôt par des actes, à la surface. Ce dont il s'agit aujourd'hui, ce qui se trouve à l'insu peut-être de son auteur, mais ce que je vois du moins pour mon compte, avec la clarté du jour qui m'éclaire, au fond de l'amendement de l'honorable M. Mathieu, c'est le socialisme... (Sensation prolongée. — Murmures à gauche.)
Oui, Messieurs, il faut que tôt ou tard cette question du socialisme, que tout le monde redoute et que personne, jusqu'à présent, n'ose traiter, arrive enfin à cette tribune; il faut que cette Assemblée la tranche. Il faut que nous déchargions le pays du poids que cette pensée du socialisme fait peser, pour ainsi dire, sur sa poitrine; il faut que, à propos de cet amendement, et c'est principalement pour cela, je le confesse, que je suis monté à cette tribune, la question du socialisme soit tranchée; il faut qu'on sache, que l'Assemblée nationale sache, que la France tout entière sache si la Révolution de Février est ou non une Révolution socialiste. (Très-bien!)
On le dit, on le répète; combien de fois, derrière les barricades de juin, n'ai-je point entendu sortir ce cri: Vive la République démocratique et SOCIALE? Qu'entend-on par ces mots? Il s'agit de le savoir; il s'agit surtout que l'Assemblée nationale le dise. (Agitation à gauche.)
L'Assemblée peut croire que mon intention n'est pas d'examiner devant elle les différents systèmes qui, tous, peuvent être compris sous ce même mot, le socialisme. Je veux seulement tâcher de reconnaître, en peu de mots, quels sont les traits caractéristiques qui se retrouvent dans tous ces systèmes, et voir si c'est cette chose qui porte cette physionomie et ces traits que a Révolution de Février a voulus.
Si je ne me trompe, Messieurs, le premier trait caractéristique de tous les systèmes qui portent le nom de socialisme, est un appel énergique, continu, immodéré, aux passions matérielles de l'homme. (Marques d'approbation.)
C'est ainsi que les uns ont dit: « qu'il s'agissait de réhabiliter la chair;234 » que les autres ont dit: « qu'il fallait que le travail, même le plus dur, ne fût pas seulement utile, mais agréable;235 » que d'autres ont dit qu'il fallait « que les hommes fussent rétribués, non pas en proportion de leur mérite, mais en proportion de leurs besoins,236 » et enfin, que le dernier des socialistes dont je veuille parler est venu vous dire ici que le but du système socialiste, et, suivant lui, le but de la Révolution de Février avait été de procurer à tout le monde une consommation illimitée.237
J'ai donc raison de dire, Messieurs, que le trait caractéristique et général de toutes les écoles socialistes est un appel énergique et continu aux passions matérielles de l'homme.
Il y en a un second, c'est une attaque tantôt directe, tantôt indirecte, mais toujours continue, aux principes mêmes de la propriété individuelle. Depuis le premier socialiste qui disait, il y a cinquante ans, que la propriété était l'origine de tous les maux de ce monde,238 jusqu'à ce socialiste que nous avons entendu à cette tribune et qui, moins charitable que le premier, passant de la propriété au propriétaire, nous disait que la propriété était un vol,239 tous les socialistes, tous, j'ose le dire, attaquent d'une manière ou directe ou indirecte la propriété individuelle. (C'est vrai! c'est vrai!) Je ne prétends pas dire que tous l'attaquent de cette manière franche, et, permettez moi de le dire, un peu brutale, qu'a adoptée un de nos collègues; mais je dis que tous, par des moyens plus ou moins détournés, s'ils ne la détruisent pas, la transforment, la diminuent, la gênent, la limitent, et en font autre chose que la propriété individuelle que nous connaissons, et qu'on connaît depuis le commencement du monde. (Marques très-vives d'assentiment.)
Voici le troisième et dernier trait, celui qui caractérise surtout à mes yeux les socialistes de toutes les couleurs, de toutes les écoles: c'est une défiance profonde de la liberté, de la raison humaine; c'est un profond mépris pour l'individu pris en lui-même, à l'état d'homme; ce qui les caractérise tous, c'est une tentative continue, variée, incessante, pour mutiler, pour écourter, pour gêner la liberté humaine de toutes les manières; c'est l'idée que l'Etat ne doit pas seulement être le directeur de la société, mais doit être, pour ainsi dire, le maître de chaque homme; que dis-je? son maître, son précepteur, son pédagogue240 (très-bien!); que, de peur de le laisser faillir, il doit se placer sans cesse à côté de lui, au-dessus de lui, autour de lui, pour le guider, le garantir, le maintenir, le retenir; en un mot, c'est la confiscation, comme je le disais tout à l'heure, dans un degré plus ou moins grand, de la liberté humaine (nouvelles marques d'assentiment); à ce point que, si, en définitive, j'avais à trouver une formule générale pour exprimer ce que m'apparaît le socialisme dans son ensemble, je dirais que c'est une nouvelle formule de la servitude. (Très-vive approbation.)
Vous voyez, Messieurs, que je ne suis pas entré dans le détail des systèmes: j'ai peint le socialisme par ses traits principaux, ils suffisent pour le faire reconnaître; partout où vous les verrez, soyez sûrs que le socialisme est là, et partout où vous verrez le socialisme, soyez sûrs que ces traits se retrouvent.
Eh bien, Messieurs, qu'est-ce que tout cela? Est-ce, comme on l'a prétendu tant de fois, la continuation, le complément légitime, le perfectionnement de la Révolution française? est-ce, comme on l'a dit tant de fois, le complément, le développement naturel de la démocratie? Non, Messieurs, ce n'est ni l'un ni l'autre; rappelez-vous, Messieurs, la Révolution française; remontez à cette origine terrible et glorieuse de notre histoire moderne. Est-ce donc en parlant, comme le prétendait hier un orateur, aux sentiments matériels, aux besoins matériels de l'homme, que la Révolution française a fait les grandes choses qui l'ont illustrée dans le monde? Croyez-vous donc que c'est en parlant de salaire, de bien-être, de consommation illimitée, de satisfaction sans bornes des besoins physiques …
M. Mathieu (de la Drôme). Je n'ai rien dit de semblable.
M. de Tocqueville. Croyez-vous que ce soit en parlant de telles choses qu'elle a pu éveiller, qu'elle a animé, qu'elle a mis sur pied, poussé aux frontières, jeté au milieu des hasards de la guerre, mis en face de la mort une génération tout entière? Non, Messieurs, non; c'est en parlant de choses plus hautes et plus belles, c'est en parlant de l'amour de la patrie, de l'honneur de la patrie; c'est en parlant de vertu, de générosité, de désintéressement, de gloire, qu'elle a fait ces grandes choses; car, après tout, Messieurs, soyez-en certains, il n'y a qu'un secret pour faire faire de grandes choses aux hommes: c'est de faire appel aux grands sentiments. (Très-bien! très-bien!)
Et la propriété, Messieurs, la propriété? Sans doute la Révolution française a fait une guerre énergique, cruelle à un certain nombre de propriétaires; mais, quant au principe même de la propriété individuelle, elle l'a toujours respecté, honoré; elle l'a placé dans ses Constitutions au premier rang. Aucun peuple ne l'a plus magnifiquement traité; elle le grave sur le frontispice même de ses lois.
La Révolution française a fait plus; non-seulement elle a consacré la propriété individuelle, mais elle l'a répandue; elle y a fait participer un plus grand nombre de citoyens. (Exclamations diverses. — C'est ce que nous demandons!)
Et c'est grâce à cela, Messieurs, qu'aujourd'hui nous n'avons pas à craindre les conséquences funestes des doctrines que les socialistes viennent répandre dans le pays, et jusque dans cette enceinte; c'est parce que la Révolution française a peuplé ce pays de France de 10 millions de propriétaires, qu'on peut, sans danger, laisser vos doctrines se produire à la tribune; elles peuvent sans doute désoler la société, mais, grâce à la Révolution française, elles ne prévaudront pas contre elle et ne détruiront pas. (Très-bien!)
Et enfin, Messieurs, quant à la liberté, il y a une chose qui me frappe, c'est que l'ancien régime, qui sans doute, sur beaucoup de points, il faut le reconnaître, était d'une autre opinion que les socialistes, avait cependant, en matière politique, des idées moins éloignées d'eux qu'on ne pourrait le croire. Il était bien plus près d'eux, à tout prendre, que nous. L'ancien régime, en effet, professait cette opinion, que la sagesse seule est dans l'Etat, que les sujets sont des êtres infirmes et faibles qu'il faut toujours tenir par la main, de peur qu'ils ne tombent ou ne se blessent; qu'il est bon de gêner, de contrarier, de comprimer sans cesse les libertés individuelles; qu'il est nécessaire de réglementer l'industrie, d'assurer la bonté des produits, d'empêcher la libre concurrence. L'ancien régime pensait, sur ce point, précisément comme les socialistes d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a pensé autrement, je vous prie? la Révolution française.
Messieurs, qu'est-ce qui a brisé toutes ces entraves qui de tous côtés arrêtaient le libre mouvement des personnes, des biens, des idées? Qu'est-ce qui a restitué à l'homme sa grandeur individuelle, qui est sa vraie grandeur, qui? La Révolution française elle-même. (Approbation et rumeurs.) C'est la Révolution française qui a aboli toutes ces entraves, qui a brisé toutes ces chaînes que vous voudriez sous un autre nom rétablir; et ce ne sont pas seulement les membres de cette Assemblée immortelle, l'Assemblée constituante, de cette Assemblée qui a fondé la liberté, non-seulement en France, mais dans le monde; ce ne sont pas seulement les membres de cette illustre Assemblée, qui ont repoussé ces doctrines de l'ancien régime, ce sont encore les hommes éminents de toutes les Assemblées qui l'ont suivi: c'est le représentant même de la dictature sanglante de la Convention. Je lisais encore l'autre jour ses paroles; les voici:
« Fuyez, disait Robespierre, fuyez la manie ancienne... » Vous voyez qu'elle n'est pas nouvelle. (Sourires.) « Fuyez la manie ancienne de vouloir trop gouverner; laissez aux individus, laissez aux familles le droit de faire librement tout ce qui ne nuit pas à autrui; laissez aux communes le droit de régler elles-mêmes leurs propres affaires; en un mot, rendez à la liberté des individus tout ce qui lui a été illégitimement ôté, ce qui n'appartient pas nécessairement à l'autorité publique. » (Sensation.)
Eh quoi! Messieurs, tout ce grand mouvement de la Révolution française n'aurait abouti qu'à cette société, que nous peignent avec délices les socialistes; à cette société réglementée, réglée, compassée, où l'Etat se charge de tout, où l'individu n'est rien, où la société agglomère en elle-même, résume en elle-même toute la force, toute la vie, où le but assigné à l'homme est uniquement le bien-être; cette société où l'air manque, où la lumière ne pénètre presque plus? Quoi! ce serait pour cette société d'abeilles ou de castors, pour cette société plutôt d'animaux savants que d'hommes libres et civilisés, que la Révolution française aurait été faite? C'est pour cela que tant d'hommes illustres seraient morts sur les champs de bataille ou sur l'échafaud, que tant de sang glorieux aurait inondé la terre? c'est pour cela que tant de passions auraient été excitées, que tant de génies, tant de vertus auraient paru dans le monde?
Non, non, j'en jure par ces hommes qui ont succombé pour cette grande cause; non, ce n'est pas pour cela qu'ils sont morts; c'est pour quelque chose de plus grand, de plus sacré, de plus digne d'eux et de l'humanité! (Très-bien!) S'il n'y avait eu que cela à faire, la Révolution était inutile, l'ancien régime perfectionné y aurait suffi. (Mouvement prolongé.]
Je disais tout à l'heure que le socialisme prétendait être le développement légitime de la démocratie; je ne chercherai pas, moi, comme ont essayé de le faire plusieurs de nos collègues, quelle est l'étymologie vraie de ce mot Démocratie. Je ne parcourrai pas, comme on le faisait hier, le jardin des racines grecques, pour savoir d'où vient ce mot. (On rit.) Je chercherai la démocratie où je l'ai vue, vivante, active, triomphante, dans le seul pays du monde où elle existe, où elle a pu fonder jusqu'à présent, dans le monde moderne, quelque chose de grand et de durable, en Amérique. (Chuchottements.)
Là, vous verrez un peuple où toutes les conditions sont plus égales qu'elles ne le sont, même parmi nous; où l'état social, les mœurs, les lois, tout est démocratique; où tout émane du peuple et y rentre, et où cependant chaque individu jouit d'une indépendance plus entière, d'une liberté plus grande que dans aucun autre temps ou dans aucune autre contrée de la terre; un pays essentiellement démocratique, je le répète, la seule démocratie qui existe aujourd'hui dans le monde, les seules républiques vraiment démocratiques que l'on connaisse dans l'histoire. Et dans ces républiques, vous cherchez vainement le socialisme. Non-seulement les théories des socialistes ne s'y sont pas emparées de l'esprit public, mais elles ont joué un si petit rôle dans les discussions et dans les affaires de cette grande nation, qu'elles n'ont pas même eu le droit de dire qu'on les y craignait.
L'Amérique est aujourd'hui le pays du monde où la démocratie s'exerce le plus souverainement, et c'est aussi celui où les doctrines socialistes, que vous prétendez si bien d'accord avec la démocratie, ont le moins de cours; le pays, dans tout l'univers, où les hommes qui soutiennent ces doctrines auraient certainement le moins d'avantage à se présenter. Pour mon compte, je ne verrais pas, je l'avoue, un très-grand inconvénient à ce qu'ils allassent en Amérique; mais je ne leur conseille pas, dans leur intérêt, de le faire. (Rires bruyants.)
Un membre. On vend leurs biens dans ce moment-ci.241
M. de Tocqueville. Non, Messieurs, la démocratie et le socialisme ne sont pas solidaires l'un de l'autre. Ce sont choses non-seulement différentes mais contraires. Serait-ce par hasard que la démocratie consisterait à créer un gouvernement plus tracassier, plus détaillé, plus restrictif que tous les autres, avec cette seule différence qu'on le ferait élire par le peuple et qu'il agirait au nom du peuple? Mais alors, qu'auriez-vous fait? sinon donner à la tyrannie un air légitime qu'elle n'avait pas, et de lui assurer ainsi la force et la toute-puissance qui lui manquait. La démocratie étend la sphère de l'indépendance individuelle, le socialisme la resserre. La démocratie donne toute sa valeur possible à chaque homme, le socialisme fait de chaque homme un agent, un instrument, un chiffre. La démocratie et le socialisme ne se tiennent que par un mot, l'égalité; mais remarquez la différence: la démocratie veut l'égalité dans la liberté, et le socialisme veut l'égalité dans la gêne et dans la servitude. (Très-bien! très-bien!)
Il ne faut donc pas que la Révolution de Février soit sociale: s'il ne le faut pas, il importe d'avoir le courage de le dire; si elle ne doit pas l'être, il faut avoir l'énergie de venir le proclamer hautement, comme je le fais moi-même ici. Quand on ne veut pas la fin, il ne faut pas vouloir les moyens; si on ne veut pas le but, il ne faut pas entrer dans la voie qui y mène. On vous propose aujourd'hui d'y entrer.
Il ne faut pas suivre cette politique qu'indiquait jadis Babœuf, ce grand-père de tous les socialistes modernes. (Rires d'approbation.) Il ne faut pas tomber dans le piége qu'il indiquait lui-même, ou plutôt qu'indiquait en son nom son historien, son ami, son élève, Buonarotti. Ecoutez ce que disait Buonarotti, cela mérite d'être écouté, même après cinquante ans.
Un membre. Il n'y a pas ici de babouvistes.242
M. de Tocqueville. « L'abolition de la propriété individuelle et l'établissement de la grande communauté nationale était le dernier but de ses travaux (de Babœuf). Mais il se serait bien gardé d'en faire l'objet d'un ordre le lendemain du triomphe; il pensait qu'il fallait se conduire de manière à déterminer le peuple entier à proscrire la propriété individuelle par besoin et par intérêt. »
Voici les principales recettes dont il comptait se servir. (C'est son panégyriste qui parle.) « Etablir, par les lois, un ordre public dans lequel les propriétaires, tout en gardant provisoirement leurs biens, ne trouveraient plus ni abondance, ni plaisir, ni considération; où forcés de dépenser la plus grande partie de leurs revenus en frais de culture et en impôts, accablés sous le poids de l'impôt progressif, éloignés des affaires, privés de toute influence, ne formant plus dans l'Etat qu'une classe suspecte d'étrangers, ils seraient forcés d'émigrer en abandonnant leurs biens, ou réduits à sceller de leur propre adhésion l'établissement de la communauté universelle. » (On rit.)
Voilà, Messieurs, le programme de Babœuf; je désire de tout mon cœur que ce ne soit pas celui de la République de Février; non, la République de Février doit être démocratique, mais elle ne doit pas être socialiste...
Une voix à gauche. Si! (Non! non! — Interruption.)
M. de Tocqueville. Et si elle n'est pas socialiste, que sera-t-elle donc?
Un membre à gauche. Royaliste!
M. de Tocqueville, se tournant de ce côté. Elle le deviendrait peut-être si on vous laissait faire (vive approbation); mais elle ne le deviendra pas.
Si la Révolution de Février n'est pas socialiste, que sera-t-elle donc? Est-elle, comme beaucoup de gens le disent et le croient, un pur accident? Ne doit-elle être qu'un pur changement de personnes ou de lois? Je ne le crois pas.
Lorsque, au mois de janvier dernier, je disais, au sein de la Chambre des députés, en présence de la majorité d'alors, qui murmurait sur ses bancs, par d'autres motifs, mais de la même manière qu'on murmurait sur ceux-ci tout à l'heure... (Très-bien! très-bien!)
(L'orateur désigne la gauche.)
Je lui disais: « Prenez-y-garde, le vent des révolutions s'est élevé; ne le sentez-vous pas? Les révolutions s'approchent; ne les voyez-vous pas? Nous sommes sur un volcan. » Je disais cela; le Moniteur en fait foi. Et pourquoi le disais-je?... (Interruption à gauche.)
Avais-je la faiblesse d'esprit de croire que les révolutions s'approchaient, parce que tel ou tel homme était au pouvoir, parce que tel ou tel incident de la vie politique agitait un instant le pays? Non, Messieurs. Ce qui me faisait croire que les révolutions approchaient; ce qui, en effet, a produit la Révolution, était ceci: je m'apercevais que, par une dérogation profonde aux principes les plus sacrés que la Révolution française avait répandus dans le monde, le pouvoir, l'influence, les honneurs, la vie, pour ainsi dire, avaient été resserrés dans des limites tellement étroites d'une seule classe, qu'il n'y avait pas un pays dans le monde qui présentât un seul exemple semblable; même dans l'aristocratique Angleterre, dans cette Angleterre que nous avions alors si souvent le tort de prendre pour exemple et pour modèle; dans l'aristocratique Angleterre, le peuple prenait une part, sinon complétement directe, au moins considérable, quoique indirecte, aux affaires; s'il ne votait pas lui-même (et il votait souvent), il faisait du moins entendre sa voix; il faisait connaître sa volonté à ceux qui gouvernaient; ils étaient entendus de lui et lui d'eux.
Ici, rien de pareil. Je le répète, tous les droits, tout le pouvoir, toute l'influence, tous les honneurs, la vie politique tout entière étaient renfermés dans le sein d'une classe extrêmement étroite; et au-dessous, rien!
Eh bien! voilà ce qui me faisait croire que la Révolution était à nos portes. Je voyais que dans le sein de cette petite classe privilégiée, il arrivait ce qui arrive toujours à la longue dans les petites aristocraties exclusives, il arrivait que la vie publiques s'éteignait, que la corruption gagnait tous les jours, que l'intrigue prenait la place des vertus publiques, que tout s'amoindrissait, se détériorait.
Voilà pour le haut.
Et dans le bas que se passait-il? Plus bas que ce qu'on appelait alors le pays légal, le peuple proprement dit, le peuple, qui était moins maltraité qu'on ne le dit ( car il faut être juste surtout envers les puissances déchues ), mais auquel on pensait trop peu; le peuple vivant, pour ainsi dire, en dehors de tout le mouvement officiel, se faisait une vie qui lui était propre: se détachant de plus en plus par l'esprit et par le cœur de ceux qui étaient censés le conduire, il livrait son esprit et son cœur à ceux qui naturellement étaient en rapport avec lui, et beaucoup d'entre ceux-là étaient ces vains utopistes dont nous nous occupions tout à l'heure, ou des démagogues dangereux.
C'est parce que je voyais ces deux classes, l'une petite, l'autre nombreuse, se séparant peu à peu l'une de l'autre; remplies, l'une, de jalousie, de défiance et de colère; l'autre, d'insouciance, et quelquefois d'égoïsme et d'insensibilité; parce que je voyais ces deux classes marchant isolément et en sens contraires, que je disais, et que j'avais le droit de dire: Le vent des révolutions se lève, et bientôt la Révolution va venir. (Très-bien!)
Est-ce pour faire quelque chose d'analogue à cela que la Révolution de Février a été faite? Non, Messieurs, je ne le crois pas; autant qu'aucun de vous, je crois le contraire, je veux le contraire, je le veux non-seulement dans l'intérêt de la liberté, mais encore dans l'intérêt de la sécurité publique.
Je n'ai pas travaillé moi, je n'ai pas le droit de le dire, je n'ai pas travaillé à la Révolution de Février; je l'avoue: mais cette Révolution faite, je veux qu'elle soit une Révolution sérieuse, parce que je veux qu'elle soit la dernière. Je sais qu'il n'y a que les Révolutions sérieuses qui durent; une Révolution qui ne produit rien, qui est frappée de stérilité dès sa naissance, qui ne fait rien sortir de ses flancs, ne peut servir qu'à une seule chose, à faire naître plusieurs Révolutions qui la suivent. (Approbation.)
Je veux donc que la Révolution de Février ait un sens, un sens clair, précis, perceptible, qui éclate au dehors, que tous puissent voir.
Et quel est ce sens? je l'indique en deux mots: La Révolution de Février doit être la continuation véritable, l'exécution réelle et sincère de ce que la Révolution française a voulu; elle doit être la mise en œuvre de ce qui n'avait été que pensé par nos pères. (Vif assentiment.)
M. Ledru-Rollin. Je demande la parole.
M. de Tocqueville. Voilà ce que la Révolution de Février doit être, ni plus, ni moins. La Révolution française avait voulu qu'il n'y eût plus de classes, non pas dans la société; elle n'avait jamais eu l'idée de diviser les citoyens, comme vous le faites, en propriétaires et en prolétaires. Vous ne retrouverez ces mots chargés de haines et de guerres dans aucun des grands documents de la Révolution française. La Révolution a voulu que, politiquement, il n'y eût pas de classes; la Restauration, la Royauté de Juillet ont voulu le contraire. Nous devons vouloir ce qu'ont voulu nos pères.
La Révolution avait voulu que les charges publiques fussent égales, réellement égales pour tous les citoyens; elle y a échoué. Les charges publiques sont restées dans certaines parties inégales: nous devons faire qu'elles soient égales; sur ce point encore, nous devons vouloir ce qu'ont voulu nos pères et exécuter ce qu'ils n'ont pas pu. (Très-bien!)
La Révolution française, je vous l'ai déjà dit, n'a pas eu la prétention ridicule de créer un pouvoir social qui fît directement par lui-même la fortune, le bien-être, l'aisance de chaque citoyen, qui substituât la sagesse très-contestable des gouvernements à la sagesse pratique et intéressée des gouvernés; elle a cru que c'était assez remplir sa tâche que de donner à chaque citoyen des lumières et de la liberté. ( Très-bien!)
Elle a eu cette ferme, cette noble, cette orgueilleuse croyance que vous semblez ne pas avoir, qu'il suffit à l'homme courageux et honnête d'avoir ces deux choses, des lumières et de la liberté, pour n'avoir rien de plus à demander à ceux qui le gouvernent.
La Révolution a voulu cela; elle n'a eu ni le temps, ni les moyens de le faire. Nous devons le vouloir et le faire.
Enfin, la Révolution française a eu le désir, et c'est ce désir qui l'a rendue non-seulement sacrée, mais sainte, aux yeux des peuples, elle a eu le désir d'introduire la charité dans la politique; elle a conçu des devoirs de l'Etat envers les pauvres, envers les citoyens qui souffrent, une idée plus étendue, plus générale, plus haute qu'on ne l'avait eue avant elle. C'est cette idée que nous devons reprendre, non pas, je le répète, en mettant la prévoyance et la sagesse de l'Etat à la place de la prévoyance et de la sagesse individuelle, mais en venant réellement et efficacement, par les moyens dont l'Etat dispose, au secours de tous ceux qui souffrent, au secours de tous ceux qui, après avoir épuisé toutes leurs ressources, seraient réduits à la misère si l'Etat ne leur tendait pas la main.
Voilà ce que la Révolution française a voulu faire; voilà ce que nous devons faire nous-mêmes!
Y a-t-il du socialisme?
A gauche. Oui! oui! Il n'y a que cela.243
M. de Tocqueville. Non! non!
Non, il n'y a pas de socialisme, il y a de la charité chrétienne appliquée à la politique; il n'y a rien là ... (Interruption.)
M. le Président. Vous ne vous entendez pas; c'est clair comme le jour; vous n'avez pas la même opinion: vous monterez à la tribune; mais n'interrompez pas.
M. de Tocqueville. Il n'y a rien là qui donne aux travailleurs un droit sur l'État; il n'y a rien là qui force l'Etat à se mettre à la place de la prévoyance individuelle, à la place de l'économie, de l'honnêteté individuelle; il n'y a rien là qui autorise l'Etat à s'entremettre au milieu des industries, à leur imposer des réglements, à tyranniser l'individu pour le mieux gouverner, ou, comme on le prétend insolemment, pour le sauver de lui-même; il n'y a là que du christianisme appliqué à la politique.
Oui, la Révolution de Février doit être chrétienne et démocratique; mais elle ne doit pas être socialiste. Ces mots résument toute ma pensée, et je termine en les prononçant. (Très-bien! très-bien!)
-----------------
OPINIONS DIVERSES.
II. OPINION DE M. LÉON FAUCHER.244
Le socialisme est maudit à cette heure. On l'accuse, non sans raison, des haines, des dissensions et des troubles qui déchirent le pays. Toute société a ses plaies; malheur à qui les envenime! malheur à qui change la plainte en cri de guerre! ce n'est pas avec du sang humain ni en les couvrant de ruines que l'on peut féconder les semences du progrès.
Je distingue cependant entre les organes de ces doctrines, et je ne confonds pas les penseurs avec les agitateurs. Les écrivains qui vont à la recherche des terres inconnues de l'utopie, ont leur côté utile. Ils nous signalent du moins les écueils contre lesquels ils se brisent; à défaut de leurs leçons, leur exemple avertit la foule, et leurs exagérations même empêchent qu'on ne perde de vue la vérité. J'ajoute qu'en poursuivant l'idéal, ils rencontrent quelquefois le réel. L'école Saint-Simonienne, à travers les folies de son organisation théocratique, a mis en relief un principe qu'était trop portée à oublier une époque révolutionnaire, celui de l'autorité. Dégageons le système de Fourier de l'attraction passionnelle et de toutes les excentricités de la théorie sociétaire, et nous trouverons qu'il a eu le mérite de faire ressortir ce que vaut et ce que peut l'association, pour un peuple chez lequel la propriété et les capitaux se morcellent au point de tomber en poussière.
Mais il n'en est pas de même des agitateurs du socialisme; et contre ceux-là, l'opinion publique peut, à bon droit, s'armer de toute sa sévérité. Ces hommes, quoi qu'on ait dit, ne sont ni des martyrs ni des apôtres. Ce n'est pas la foi qui les pousse à mettre le feu au monde. L'ambition, qui suppose une certaine élévation d'esprit et de courage, a moins de part à leurs excès que la vanité. Ils veulent être les chefs et les héros de la foule: que leur importe de prêcher le vrai ou le faux, pourvu qu'on les élève sur le pavois? Le Christianisme, ce manteau d'emprunt qu'ils cherchent à ramener, pour la couvrir, sur la hideuse nudité de leurs doctrines, est plus loin encore de leur cœur que de leurs lèvres. Leur parole ne respire que l'envie, la haine et la révolte. La première conception qui éclot dans leur cerveau, avant de l'avoir éprouvée à la pierre de touche des faits, avant même de l'avoir mûrie, ils en font une bannière autour de laquelle ils convoquent et rallient tous les mécontents qui veulent monter à l'assaut du pouvoir d'abord, et bientôt de la société elle-même.
Je sais que la plupart de ces prédicateurs d'anarchie protestent de leurs intentions pacifiques; mais la logique populaire va droit et vite. Il ne faut pas assembler le peuple dans les clubs pour lui dire que l'ordre social est radicalement mauvais, si l'on veut qu'il laisse les pavés en place et qu'il n'élève pas des barricades; il ne faut pas présenter tous les jours, dans les journaux et dans les pamphlets, le riche comme l'ennemi du pauvre, si l'on veut que le pauvre se résigne à respecter la propriété. Les nuances des divers systèmes que le socialisme fait pulluler, échappent à la foule. Les disciples de Saint-Simon et ceux de Fourier ont labouré, depuis 1830, de leurs missions, la capitale et les provinces. Cette propagande active, énergique, a t-elle porté quelques fruits pour les écoles qui l'entreprenaient? Nullement: les rares adeptes ralliés à grand'peine ne sont que des individualités glanées çà et là, par exception, dans les rangs de la classe moyenne. Quant aux ouvriers admis à ces enseignements, ils n'en rapportent que la haine de toute hiérarchie et qu'un parti pris contre la propriété. Saint-Simon et Fourier, en se manifestant aux rangs inférieurs de la société, n'ont fait que frayer les voies et que fournir des recrues au communisme.
Le socialisme ressemble à ces épidémies qui épargnent les tempéraments robustes et qui ne frappent que les constitutions délabrées. C'est à la faveur des époques calamiteuses qu'il s'infiltre dans les esprits. Pour ne pas repousser cette vision du mal, il faut que l'homme soit plongé dans le désespoir et dans la misère. S'il était plus heureux, s'il jouissait de toute sa raison, il chasserait avec horreur le spectre qui vient l'obséder. Le socialisme ne s'est pas adressé à la population de nos campagnes; comment prêcher, en effet, le partage des biens, avec quelque espoir de succès, à des cultivateurs que la première Révolution a presque tous appelés à la possession du sol? Et quel genre d'intérêt peuvent avoir les doctrines de Babœuf pour cette légion sans fin de propriétaires?
C'est au milieu des ouvriers qui habitent les grandes villes ou qui font mouvoir l'industrie manufacturière que le socialisme s'est implanté. Paris et Lyon, gangrenés avant le reste du pays, sont devenues les grands foyers d'où rayonnait cette active, et dissolvante propagande. Elle a commencé par les industries de luxe, là où les ouvriers, tout en obtenant des salaires exceptionnels, se trouvaient exposés à de plus fréquents chômages, où l'intermittence de la main d'oeuvre laissait plus de place aux mauvaises passions et à l'oisiveté. Elle s'est étendue plus tard, et de proche en proche, aux puissantes industries de la laine et du coton, à Rouen, à Elbeuf, à Lille, à Roubaix, à Saint Quentin, à Reims, à Troyes, à Mulhouse, pour aller en dernier lieu soulever jusqu'au centre du Limousin une population semi-agricole. On fanatise tous ces hommes attachés auparavant au travail et au devoir, en faisant apparaître, à leurs yeux que l'on éblouit, un monde imaginaire, dans lequel l'égalité des droits entraîne le partage égal des biens.
Je ne suis pas de ceux qui nient les souffrances du peuple. Je reconnais que la puissance mécanique, en développant les ressources de l'industrie, amène de violents déchirements dans l'ordre social. La vapeur fait, comme le canon, ses trouées dans les masses. Le travail manufacturier ne peut pas, sans déplacer quelques existences, envahir l'espace qui semblait réservé sans partage, il y a un demi-siècle, à la culture des champs. Tout régime de transition est un régime de malaise. Nous souffrons de l'encombrement des villes, de l'inégalité et de l'irrégularité des salaires, des chômages et des abus du travail.
Cependant le mal, au moment où a éclaté la Révolution de Février, était loin de s'accroître. Malgré l'inertie du Gouvernement, la prévoyance sociale versait déjà ses enseignements et ses bénédictions sur les classes laborieuses. Les caisses d'épargnes, recueillant jour par jour les centimes économisés par le pauvre, avaient placé plus de 350 millions sur l'État. On multipliait les écoles, les salles d'asile et les crèches. Il ne manquait guère plus qu'une bonne loi sur le travail des enfants, des associations de secours mutuels instituées sur une plus large échelle, et une caisse de retraite organisée en faveur des vétérans de l'industrie et de l'agriculture, pour faire participer aux progrès du bien-être les derniers rangs de la population comme les premiers.
On a représenté, sous un aspect tantôt trop sombre et tantôt trop riant, la condition actuelle des salaires. Sans rien exagérer, je crois pouvoir dire que les salaires ont éprouvé une hausse générale, non seulement, ce qui serait trop évident, depuis le dernier siècle, mais même et surtout depuis vingt ans. A prendre pour terme de comparaison la journée du manœuvre, on trouvera une augmentation moyenne de vingt à vingt-cinq pour cent dans les campagnes ainsi que dans les villes. A ne considérer que l'industrie manufacturière, le nombre des ouvriers qui gagnaient depuis 3 francs jusqu'à 10 francs par jour, est certainement plus que doublé. En même temps que le champ du travail s'étendait, les ressources se multipliaient pour la famille; au salaire de l'homme fait, s'ajoutaient celui de la femme et celui de l'enfant. Le revenu moyen de l'ouvrier assisté des siens, dans les manufactures, excédait de beaucoup le traitement des commis et des employés inférieurs de l'administration. Ainsi, le niveau des conditions s'est élevé; et la distance, que l'éducation met encore entre les rangs, n'indique déjà plus nécessairement une inégalité de richesses.
Je sais que la concurrence a réduit, dans certains cas, les salaires exceptionnels, ceux des fileurs, par exemple, dans les industries du coton et de la laine. Mais, en revanche, l'industrie métallurgique et celle des machines assurent une haute paie aux ouvriers habiles; et qu'importe que quelques lignes s'abaissent, si, pour l'ensemble du travail dans le pays, la perspective peut se prendre à un point de vue plus élevé? En général, les blessés et les éclopés, que le progrès de l'industrie a laissés sur sa route; les malheureux, tels que les tisseurs à la main et les peigneurs de laine, qui voient la rétribution de leur labeur opiniâtre diminuer d'année en année, sont les ouvriers dont les efforts ne se trouvent pas associés à ceux de la puissance mécanique et qui appartiennent à des industries condamnées à se transformer ou à périr. Voilà ce qui fait la misère de la Saxe, des Flandres, de quelques cantons de la Picardie, de l'Alsace et du pays de Caux. Il n'y a rien de plus bienfaisant pour l'homme que le contact des machines et des forces motrices. Leur intervention relève le travail en même temps qu'elle l'enrichit. Pendant que le tisserand, courbé quinze à seize heures par jour sur son métier, ne gagne souvent que 75 c, une femme obtient 1 f. 25 c. à 1 f. 50 c. pour une journée de douze heures employée à surveiller presque sans fatigue deux métiers à tisser que la vapeur fait mouvoir. Dans le premier cas, l'ouvrier n'atteint pas au salaire moyen d'une femme; dans lé second, la femme reçoit le salaire d'un homme, et gagne autant qu'un journalier des environs de Paris.
Le progrès a même été quelquefois trop rapide: car les ouvriers ne se conduisent pas autrement que les capitalistes, et quand le bien leur vient trop vite, au lieu de le faire servir à l'aisance de la famille, ils le dissipent en folles dépenses ou en orgies. Ainsi, la construction simultanée de plusieurs grandes lignes de chemins de fer, en développant outre mesure les travaux de terrassement, a provoqué une hausse soudaine et considérable de la main-d'œuvre. Un bon terrassier peut aujourd'hui gagner de 3 fr. 50 c. à 5 fr. par jour; et il est presque sans exemple que les ouvriers, que l'on attire de leurs villages en doublant ou même en triplant leurs salaires habituels, comprennent l'utilité, la nécessité de l'épargne. Il sort de là des bandes ou hordes nomades qui vont chercher fortune d'un bout à l'autre du territoire, campant pêle-mêle au pied des travaux, et qui ne connaissent plus ni religion, ni mœurs ni famille, ni patrie. On en dirait autant des ouvriers mécaniciens, qui construisent, réparent ou dirigent les machines. Ces hommes, simples forgerons ou chauffeurs la veille, deviennent tout à coup les privilégiés, les grands seigneurs de l'industrie. Ce qu'il y a d'aléatoire dans leur existence de parvenus les emporte; la plupart se montrent bientôt fainéants, dissolus, impatients de toute discipline; c'est parmi eux que la révolte va prendre ses chefs.
L'accroissement des salaires depuis vingt ans est donc un fait général et incontestable. Pendant que les ressources de l'ouvrier s'augmentaient, le prix des objets de première nécessité tendait à décroître. Le blé ne coûte pas certainement plus cher aujourd'hui qu'avant la Révolution de 1789; et les étoffes se vendent à plus bas prix. Il n'y a guère que la viande et le vin, auxquels nos lois de douanes et d'octroi attachent une cherté artificielle; mais la liberté peut effacer, pour peu que l'on s'y prête, le mal qu'ont fait les taxes excessives et le système protecteur. Au demeurant, les conditions matérielles de l'existence n'ont pas sensiblement changé: rien ne vient restreindre pour l'ouvrier le bénéfice qui résulte de l'accroissement du salaire; il peut obtenir une plus grande somme de jouissances, avec la même somme de travail. Le travail, comme la propriété, a donc acquis une nouvelle valeur: il semble que le progrès du temps ait ajouté un autre capital à celui que représentent les forces de l'homme.
Le mal tient aujourd'hui à ce que, malgré l'accroissement du salaire, l'équilibre existe rarement entre les salaires et les besoins. Le revenu des classes laborieuses a eu beau s'élever, les besoins ont monté plus vite. Ce qui eût suffi pour répandre l'aisance parmi tous ces ménages dans un temps régulier, s'est trouvé insuffisant pour une époque de révolution. L'ouvrier a voulu être honoré en même temps que rétribué, et il a pris pour la considération les signes extérieurs qui s'y trouvent habituellement joints, une certaine atmosphère de dépense, de confort et même de luxe.
Ajoutez qu'après les exigences de l'estomac sont venues celles de l'esprit. L'ouvrier veut lire, connaître, penser et s'associer à ceux qui pensent comme lui. Il est pour ainsi dire initié à une double existence, et ses prétentions s'étendent avec l'horizon qu'il embrasse. Au reste, il y a bien des degrés dans cette aspiration universelle vers le mieux. Un ouvrier anglais ne pourrait pas vivre en France avec le salaire d'un ouvrier français. La même différence existe chez nous entre l'ouvrier des villes et celui des campagnes, et dans les villes, entre ceux des différentes industries.
C'est ce défaut d'harmonie entre l'ambition de l'ouvrier et ses ressources quotidiennes qui constitue la principale difficulté de notre époque. Voilà le mal que la Révolution de Février est venue aggraver, en apprenant à des hommes que l'on mettait en possession de l'égalité réelle des droits, à rêver l'égalité chimérique des conditions. Que dis-je l'égalité. Les meneurs du peuple ont renversé pour lui la pyramide sociale? La qualité d'ouvrier est devenue un titre de noblesse, dont bien des gens se sont affublés pour surprendre le suffrage du pouvoir ou celui des électeurs. Napoléon décorait Jacquart; l'Angleterre enrichissait Arkwrigt. Nos républicains de la veille, peu contents d'honorer les hommes utiles, les ont arrachés à ce qu'ils savaient pour les atteler à ce qu'ils ne savaient pas. Ils ont voulu faire de Jacquart un Mirabeau ou un Richelieu. Après avoir mis la société aux pieds de la classe laborieuse, après avoir fait descendre le Gouvernement sur la place publique, après avoir donné des armes aux ouvriers, et après avoir organisé la force armée comme une bande de conspirateurs, le tentateur s'est adressé à des passions plus avides et plus grossières. Il a dit aux salariés: « Le salaire est le dernier vestige du servage et doit disparaître à son tour. Plus de patrons, plus de maîtres! Les entrepreneurs qui possèdent aujourd'hui le capital d'exploitation sont un rouage inutile dans l'industrie. L'Etat rachètera de leurs mains ces instruments de travail qu'ils seront trop heureux de céder à vil prix dans leur détresse; puis, tout cela vous sera remis à la condition de vous associer les uns avec les autres, et de faire un partage égal des produits: à votre tour, vous serez les maîtres, vous serez Rois. Les biens de ce monde, ces créations de votre activité et de votre intelligence, vont enfin vous appartenir. » Le peuple a cru à ces promesses trompeuses. Il s'est laissé enivrer de cet opium délirant du communisme; et lorsqu'au réveil il n'a plus trouvé que la faim toute nue à sa porte, il s'est rué de désespoir sur l'ordre social.
La révolte a été comprimée, mais les cœurs demeurent ulcérés, et les intelligences perverties. La difficulté n'existe plus au même degré dans les choses; mais elle tient encore aux personnes. Comment substituer la conciliation à la haine, et faire succéder le travail au combat? Au foyer de notre civilisation, l'ouvrier peut, il est vrai, venir s'asseoir désormais sans renverser les dieux domestiques. La première Révolution, en lui restituant la liberté du travail, avait rendu accessibles pour lui la propriété et la richesse; le mouvement de Février, en étendant à tous le droit de suffrage, joint à ces vastes perspectives celle plus vaste encore du pouvoir. Cela fait, la dette de la société française envers chacun de ses membres se trouve assurément acquittée sans réserve. Mais comment faire apprécier à des hommes, pour lesquels le socialisme dépouillait la terre en espérance, les avantages plus modestes de la réalité?
Le socialisme a été vaincu dans les rues, il reste à le dompter par la controverse. Ce que la force a commencé, la raison maintenant doit l'achever. L'ennemi, ce n'est plus la foule ameutée et retranchée derrière les barricades: ce sont les préventions, les sophismes, les préjugés que le mouvement de Février a fait germer dans les intelligences. Il nous reste encore à confondre les principes détestables dont les insurgés de juin bourraient leurs fusils. Parmi ces aberrations révolutionnaires, je n'en connais pas de plus dangereuse ni de plus subversive, que celle qui se cache sous la bannière si légitime en apparence du droit au travail.
Le droit au travail a été foudroyé du haut de la tribune. Mais le lendemain de cette victoire, comme si l'on avait peur ou honte de la consacrer par un texte législatif, l'Assemblée nationale adoptait, par voie d'amendement à l'article VIII du préambule, une déclaration qui donne gain de cause aux socialistes: le droit à l'existence était substitué au droit au travail. Tout cet appareil de discussion déployé contre un préjugé, dont les événements avaient fait un péril, n'aboutissait qu'à une stérile modification de la formule. Je n'ai pas trouvé place dans ce débat; je viens le reprendre et le continuer devant l'opinion publique.
Les théoriciens, qui proclament le droit au travail, prennent volontairement ou à leur insu, pour point de départ, ce sophisme de Rousseau s'écriant: « Tout est bien sortant des mains de l'Auteur des choses; tout dégénère entre les mains de l'homme. » Ils supposent un état de nature préexistant à la société, et un contrat par lequel les hommes, en fondant l'ordre social, auraient réservé certains droits inhérents et essentiels à l'existence. Ce contrat est une pure fiction. Il n'y a rien d'antérieur ni de supérieur à la société; car, en dehors de la société, l'existence de l'homme est impossible. L'échelle sociale comprend des degrés infinis, depuis l'état sauvage jusqu'à la civilisation la plus avancée. Mais l'exploration du globe a démontré que, dans aucune contrée, l'homme et la famille ne luttaient isolément pour la satisfaction de leurs besoins et pour le développement de leurs forces; que les tribus les moins policées et les plus misérables avaient encore un langage, des traditions, des principes, un gouvernement.
L'homme et la société ont la même date ainsi que la même origine. L'homme ne peut se développer qu'au sein de la société, il n'y apporte rien que des facultés en germe, et il reçoit tout d'elle: ses droits découlent du même principe que ses devoirs. L'individu trouve dans les droits d'autrui la limite des siens, et leur garantie dans les devoirs qui sont imposés à chacun de ses semblables. Les droits comme les devoirs ne sont que l'expression des rapports que l'état social, que la destinée ici-bas fait naître entre les hommes.
L'individu n'a donc pas pu réserver, au moment où la société le saisit, un prétendu droit à l'existence. Il y entre faible et nu, soutenu par la famille et protégé par l'Etat, jusqu'à ce qu'il ait appris à voler de ses propres ailes. Parvenu à l'âge d'homme, il voit la limite de ses droits se prolonger et ses facultés s'étendre, à mesure que le pouvoir de la société elle-même grandit. Les lumières, la liberté, la richesse, sont autant de progrès de l'état social, auxquels chacun de ses membres participe. Quant à l'existence, elle est d'autant plus assurée aux individus que la communauté est plus riche, plus éclairée et plus forte.
Prenez les peuples chasseurs ou même les peuples pasteurs, qui ont besoin pour vivre d'immenses espaces et qui habitent le désert sans l'animer. La famine, contre laquelle ils luttent péniblement tous les jours, emporte souvent des tribus entières. Dans un état de civilisation moins imparfait, au moyen âge, en Europe, malgré les largesses des couvents, la difficulté des communications ainsi que le défaut de commerce et d'industrie rendaient mortel pour la population des serfs le moindre déficit dans les récoltes. Au dix-huitième siècle, le souvenir de ces effroyables calamités pesait encore si fortement sur l'esprit public, que l'immortel Turgot eut à faire des prodiges de raison pour rendre la liberté au commerce des grains en France. De nos jours, au contraire, la prévoyance humaine a d'inépuisables trésors pour réparer ces désastres. Le commerce transporte les céréales, de la contrée qui a obtenu des moissons surabondantes, dans celle que l'inclémence des saisons a frappée d'une stérilité relative et temporaire. L'industrie, à son tour, redouble d'activité pour payer, avec les produits des manufactures, les produits du sol. En un mot, la famine, qui s'élevait il n'y a pas longtemps chez nous, qui s'élève encore aujourd'hui dans l'Inde, sous la tutelle des Anglais, aux proportions d'une calamité publique, n'est plus désormais, pour les peuples policés de l'Europe, qu'un accident qui sert à éprouver la force et la bonté des institutions. En 1847, quoique le déficit de la récolte ait été au moins d'un cinquième, et quoique l'hectolitre de blé ait valu jusqu'à 53 francs, c'est-à-dire quatre fois son prix normal, pas un seul individu n'est mort de faim en France.
Il semble donc assez oiseux de rechercher quels peuvent être les droits de l'individu à l'existence dans la société, quand on voit que les progrès mêmes de la société ont pour effet d'aplanir les difficultés et de multiplier les moyens de vivre. Que sert d'examiner s'il y a dans l'arsenal des facultés humaines, quelque chose qui s'appelle le droit au travail, lorsque la liberté du travail est pleinement garantie, et lorsque chacun jouit du fruit de son travail sans contestation ni réserve? Enfin, pourquoi disputer sur le droit à l'assistance, autre forme de cette action que l'on veut donner à l'homme contre la société, dans un temps où la prévoyance sociale, plus attentive et plus puissante qu'elle ne l'a jamais été, s'étudie à réparer les accidents de la fortune, sans énerver la prévoyance et sans éteindre l'activité des individus?
Cependant on insiste, on méconnaît le monde, tel qu'il est, afin d'avoir un prétexte pour se réfugier dans un monde idéal; on divise la société en deux classes, ceux qui n'ont pas et ceux qui possèdent; à chacune de ces classes on met une arme à la main, comme s'il devait en résulter l'équilibre des forces: on dresse le droit au travail contre le droit de propriété. L'expression la plus subtile de cette théorie se trouve dans un écrit de M. Considérant, dont M. Ledru-Rollin a porté les conclusions à la tribune. En voici les principaux traits.
« L'espèce humaine est placée sur la terre pour y vivre et pour s'y développer; l'espèce est donc usufruitière de la surface du globe.... Or, sous le régime qui constitue la propriété dans toutes les nations civilisées, le fonds commun, sur lequel l'espèce tout entière a plein droit d'usufruit, a été envahi; il se trouve confisqué par le petit nombre à l'exclusion du grand nombre. Eh bien! n'y eût-il, en fait, qu'un seul homme exclu de son droit à l'usufruit du fonds commun par la nature du régime de la propriété, cette exclusion constituerait à elle seule une atteinte au droit, et le régime de la propriété qui la consacrerait serait certainement injuste, illégitime.
» Le sauvage jouit, au milieu des forêts et des savanes, des quatre droits naturels: Chasse, Pèche, Cueillette, Pâture. Telle est la première forme du droit.
» Dans toutes les sociétés civilisées, l'homme du peuple, le prolétaire, n'hérite de rien et ne possède rien, est purement et simplement dépouillé de ses droits; on ne peut donc pas dire que le droit primitif ait ici changé de forme, puisqu'il n'existe plus. La forme a disparu avec le fonds.
» Or, quelle serait la forme, sous laquelle le droit pourrait se concilier avec les conditions d'une société industrieuse? La réponse est facile.
» Dans l'état sauvage, pour user de son droit, l'homme est obligé d'agir. Les travaux de la pêche, de la chasse, de la cueillette, de la pâture, sont les conditions de l'exercice de son droit. Le droit primitif n'est donc que le droit à ces travaux.
» Eh bien! qu'une société industrieuse, qui a pris possession de la terre et qui enlève à l'homme la faculté d'exercer à l'aventure et en liberté, sur la surface du sol, ses quatre droits naturels; que cette société reconnaisse à l'individu, en compensation de ces droits, dont elle le dépouille, le DROIT AU TRAVAIL: alors, en principe et sauf application convenable, l'individu n'aura plus à se plaindre. En effet, son droit primitif était le droit au travail exercé au sein d'un atelier pauvre, au sein de la nature brute; son droit actuel serait le même droit exercé dans un atelier mieux pourvu, plus riche, où l'activité individuelle doit être plus productive.
» La condition sine qua non pour la légitimité de la propriété est donc que la société reconnaisse au prolétaire le DROIT AU TRAVAIL, et qu'elle lui assure au moins autant de moyens de subsistance, pour un exercice d'activité donné, que cet exercice eût pu lui en procurer dans l'état primitif.
» Or, l'ouvrier, qui n'a pas de travail, a-t-il aujourd'hui le droit d'aller dire au maire de sa commune, au préfet de son département, à un représentant de la société enfin: « Il n'y a plus pour moi de travail à l'atelier, où j'étais engagé;» ou bien: « Le salaire est venu tellement bas qu'il n'est plus suffisant pour assurer ma subsistance; je viens donc réclamer de vous du travail, à un taux de salaire tel que mon sort puisse être jugé préférable à celui d'un sauvage, libre dans ses bois? » Non.
» Non-seulement ce droit n'est pas reconnu, non-seulement il n'est pas garanti par des institutions sociales; mais encore la société dit au prolétaire, spolié par elle du premier, du plus sacré de tous les droits, de son droit de propriété à l'usufruit de la terre, elle lui dit: « Trouve du travail, SI TU LE PEUX, et si tu ne le peux pas, meurs de faim, en respectant la propriété d'autrui. » La société pousse encore la dérision jusqu'à DÉCLARER COUPABLE l'homme qui ne peut pas trouver du travail, qui ne peut pas trouver à vivre. Chaque jour, nous jetons en prison des malheureux coupables de mendicité, de vagabondage, c'est-à-dire coupables de n'avoir ni subsistance, ni asile, ni moyen de s'en procurer.
» Le régime de la propriété, dans toutes les nations civilisées, est donc injuste au premier chef, il est fondé sur la conquête, sur une prise de possession qui n'est qu'une usurpation permanente, tant qu'un ÉQUIVALENT des droits naturels n'est pas donné à ceux qui sont exclus, en fait, de l'usage du sol. Ce régime, en outre, est extrêmement dangereux, attendu que dans les nations où l'industrie, la richesse et le luxe sont très-développés, les prolétaires ne peuvent manquer tôt ou tard de se prévaloir de cette spoliation pour bouleverser la société. »245
M. Thiers a fait justice, par le ridicule, de cette belle théorie, quand il a demandé si les insurgés de juin, que l'on transporterait à Madagascar ou à la Guyane, dans les contrées où existent encore les quatre prétendus droits primitifs de pêche, de chasse, de cueillette et de pâture, droits qui ont péri, dit-on, dans la société civilisée, se trouveraient heureux de ce retour à l'état sauvage, et s'ils n'accuseraient pas, au contraire, de barbarie le pouvoir qui leur aurait imposé ainsi l'abandon avec l'exil. On en peut dire autant des ouvriers qui jouissent de leur liberté. Le plus misérable d'entre eux n'échangerait pas son sort contre l'existence des Jaoways ou des Osages. Cela prouve du moins que, si la société a dépouillé l'homme de quelque droit qu'il tenait de la nature, elle lui a donné en échange des biens d'une plus grande valeur.
Un droit primitif, naturel, est quelque chose qui appartient non pas à un homme, non pas à une génération, non pas à un peuple, mais à tous les peuples, à chaque génération, et à chaque individu. Il y a plus, les droits vraiment naturels à l'homme sont ceux dont le progrès même de la civilisation facilite et développe l'exercice, tels que la liberté de la pensée et celle de l'industrie. Partout, au contraire, où vous apercevrez une tendance décroissante dans l'individu comme dans l'espèce, tenez pour certain qu'elle vient non d'un droit inhérent à notre nature, mais d'un de ces accidents qui signalent la forme variable des sociétés.
Les générations, dans leur course à travers l'histoire, ne transmettent à celles qui doivent leur succéder ni fictions, ni chimères. Je ne trouve écrit dans aucune tradition ce dédoublement du droit de propriété qu'imagine l'école de Fourier, et aux termes duquel tout homme, en naissant, aurait droit à l'usufruit de la terre brute. Et ce n'est pas sans raison que la religion et la philosophie se taisent également sur ce point. La terre, en effet, a-t-elle jamais existé à cet état de capital primitif indépendant de toute valeur créée par le travail de l'homme? N'est-ce pas là une pure abstraction conçue par l'esprit en dehors des réalités historiques? Qui nous apprendra jusqu'où remonte la civilisation? Y a-t il un coin de terre qui ne porte la trace de l'homme et que ses sueurs, dans un âge ou dans un autre, n'aient fécondé?
Pour que tout individu, en naissant, se trouvât virtuellement investi d'un droit utile d'usufruit sur le sol, de ce droit représenté, selon M. Considérant, par la faculté de chasser, de pêcher, de cueillir et de paître, il faudrait que la terre, dans cet état primitif que le disciple de Fourier suppose, pût nourrir, sous la forme de tribus de chasseurs ou de pécheurs, non pas seulement quelques rares individus dispersés dans d'immenses déserts, comme les Indiens de l'Amérique, mais encore des nations aussi nombreuses et aussi étroitement agglomérées que la France et que l'Angleterre. Or, tout le monde sait que, dans l'état nomade, une lieue carrée de terrain est nécessaire pour faire vivre un homme; tandis que le même espace, dans les contrées qui sont parvenues à un haut degré de culture, suffit pour nourrir quinze cents à deux mille habitants. Qu'est-ce donc qu'une faculté qui ne peut s'exercer qu'au sein du désert, et en vertu de laquelle, ce qui suffit à peine à l'existence d'un seul homme serait légué à ses descendants pour être partagé entre mille, deux mille, en autant de parts qu'en ferait, en s'étendant, la fécondité de l'espèce? Et l'école phalanstérienne n'abuse-t-elle pas ici de ces dons de l'imagination qui multiplie les figures sans ajouter pour cela aux réalités?
Non, il n'existe pas un droit naturel à la possession de la terre brute. Le sol appartient légitimement à celui qui se l'approprie par le travail. Le travail crée la propriété, il la crée à toujours en marquant les choses de l'empreinte de l'homme. C'est l'activité humaine, appliquée aux forces de la nature, qui donne naissance aux capitaux. Voilà, dans l'ordre mobilier comme dans l'ordre immobilier, la source vraie de la richesse. La chasse, la pèche et les autres procédés de l'état sauvage, ne sont que des moyens d'appropriation imparfaits et éphémères. Ils supposent déjà une certaine action de l'homme sur la nature; c'est le début du travail dans la société. Les tribus nomades se partagent le sol: chacune a son territoire, qui appartient ainsi à la communauté, avant de se distribuer entre les familles et entre les individus. Plus tard, la culture naît, et avec la culture les héritages. Plus l'homme met le sol en valeur, et plus aussi la propriété, en se développant, jette des racines profondes. C'est entre les mains de l'homme que la terre devient un capital. L'homme tire en quelque sorte ce capital de lui-même; car les capitaux ne sont que du travail accumulé. Il possède donc à juste titre ce qu'il a produit et ce qu'ont produit ses pères. Les capitaux immobiliers et les capitaux mobiliers, tout procède de l'activité humaine; les rapporter à une autre origine, c'est mettre la fable à la place des faits.
Ce qu'il fallait dire, ce qui est vrai, c'est que l'on ne doit pas considérer la propriété comme un fait purement individuel. L'influence et le pouvoir de la société concourent évidemment à la former, avec l'action, avec le travail de l'homme. La société est dans les mains de l'individu, comme un levier à l'aide duquel il soulève et déplace des fardeaux, dont le poids, sans cela, excéderait ses forces. La puissance publique le protége, lui donne cette sécurité qui est le premier instrument du travail, et sans laquelle le travail serait impossible. Il va puiser au fonds commun des traditions et des lumières. Enfin, il n'a d'intérêt à produire que parce que la société ouvre un marché à ses produits.
Le droit de propriété est donc individuel et social à la fois. La propriété n'est possédée et ne se transmet légitimement, qu'à la condition de payer à l'Etat une redevance, un tribut que l'impôt représente. En vertu du même titre, dans les contrées où de vastes espaces restent encore à défricher, l'Etat met un prix à la concession des terres; car ces terres ont déjà la valeur que leur communiquent le voisinage de la civilisation et la tutelle exercée par le pouvoir.
Au reste, à mesure que la propriété privée se consolide et s'étend, on voit grandir le domaine public, la propriété indivise, le patrimoine du peuple entier, la richesse qui est commune à tous, et dont chacun peut jouir à tout instant. Les moyens de communication et de transport se multiplient; la police, les travaux publics, les écoles, les bibliothèques, les monuments, tout concourt à rendre l'existence plus sûre, plus facile et plus agréable. Chacun a véritablement sa part dans le trésor public, trésor qui ne s'épuise pas, qui s'accroît plutôt, et dont l'Etat n'est que le dispensateur pour l'utilité générale. Plus de privilégiés, plus de parias, et, quoi que l'on en dise, plus de prolétaires; ce qui vaut mieux que le droit de vivre, tout le monde a le droit de cité.
Ainsi, la civilisation, je crois l'avoir démontré, donne beaucoup plus à l'individu, en propriété commune, qu'elle ne pourrait lui avoir enlevé en propriété privée. Ajoutons que le propriétaire, dans la société moderne, ne possède pas et ne produit pas pour lui seul. La propriété ressemble à ces arbres dont chaque branche, parvenue au terme de sa croissance, retombe sur le sol, y pénètre et pousse de nouveaux rejetons devant elle. La propriété engendre et multiplie la propriété. Elle rend les capitaux, les instruments du travail de jour en jour plus accessibles. Elle ente l'industrie sur l'agriculture, le commerce sur l'industrie, et le crédit sur le commerce. Cette expansion de la richesse fait que l'on n'a plus besoin pour posséder des procédés barbares de la confiscation, de la spoliation et de la guerre. Le salaire attend le travail; du salaire nait l'épargne, et l'épargne trouve le marché de la propriété toujours ouvert.
Dans le système de M. Considérant, la propriété territoriale aurait seule des obligations, et se trouverait seule grevée du droit à l'usufruit du sol; car il laisse en dehors la propriété mobilière, monde nouveau qui égale, s'il ne l'excède pas, l'étendue de l'ancien monde. Le capital mobilier obtiendrait ainsi un privilége inexplicable, et ne devrait rien à la société. Des principes qui admettent de pareilles exceptions, ne sont pas des principes. Non, la société n'a pas à expier la propriété qui est la condition même de l'ordre; et le droit de propriété ne saurait avoir pour corollaire, pour contre-poids, ni pour compensation, le droit au travail.
On le voit, le droit de propriété n'a pas pour correctif le droit au travail. Il reste à démontrer que le droit au travail est la négation et conduit, ainsi que M. Proudhon l'a reconnu lui-même, à la destruction de la propriété.
Par un décret en date du 25 février, le Gouvernement provisoire avait déclaré que « la République s'engageait à garantir du travail à tous les citoyens et l'existence de l'ouvrier par le travail. » Le premier projet de Constitution, celui qui fut soumis à la discussion préparatoire des bureaux, portait, à l'article 7:
« Le droit au travail est celui qu'a tout homme de vivre en travaillant.
» La société doit, par les moyens productifs et généraux dont elle dispose et qui seront organisés ultérieurement, fournir du travail aux hommes valides qui ne peuvent s'en procurer autrement. »
Pour compléter ce système, la commission de Constitution avait proclamé en même temps le droit à l'instruction et le droit à l'assistance. La société allait ainsi substituer son action et sa responsabilité à celles de l'individu et de la famille: elle prenait l'homme au berceau et le conduisait jusqu'à la tombe, pourvoyant en chemin à toutes ses nécessités, depuis l'éducation jusqu'au salaire, ouvrant en un mot à toutes les créatures humaines, selon leur âge, la crèche, l'asile, l'école, l'atelier et l'hôpital.
Depuis, la Commission, éclairée par les événements de juin, a voulu atténuer la portée de cet article. Elle a cru qu'en changeant la forme du principe on pouvait échapper aux conséquences. Mais la première rédaction, reprise par voie d'amendement, à servi à établir le débat. C'est le droit au travail que l'on a attaqué et défendu dans l'enceinte de l'Assemblée nationale; c'est le droit au travail qu'invoquaient, aux élections dernières, les partisans de MM. Raspail, Cabet et Thoré; c'est le droit au travail qu'une foule égarée a pris pour évangile et pour cri de guerre. Voilà le danger, voilà l'ennemi qu'il faut aborder de front.
Le droit au travail diffère essentiellement, comme M. Dufaure l'a fait remarquer, de tous les droits dont les Constitutions ont pour objet de protéger, de garantir le libre exercice. Toutes ces facultés, en effet, sont inhérentes à l'homme; chaque individu peut les exercer et les développer dans la sphère de sou action personnelle; c'est une puissance qu'il n'emprunte pas, qu'il tire de lui-même, et qu'il demande seulement à la société de faire respecter en lui. La liberté de penser, la liberté d'écrire, la liberté de travailler et de posséder sont dans ce cas.
Il ne faut pas confondre le droit au travail, cette prétention des socialistes, avec le droit de travailler, cette propriété de tout homme, dont Turgot a dit, avec raison, « qu'elle était la première, la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes. » Le droit de travailler n'est pas autre chose que la liberté qui appartient à chaque individu de faire, de son intelligence, de ses bras et de son temps, l'emploi qu'il juge le plus profitable; le droit au travail est une action que l'on donne à l'individu contre la société tout entière ou contre une partie de cette société. On crée en même temps, selon l'expression de M. Dufaure, un droit et une obligation. On suppose un contrat entre l'individu et la société, aux termes duquel la société devrait l'existence à chacun de ses membres, contrat non synallagmatique et qui n'engagerait qu'une des parties. Car tandis que l'État devrait fournir aux individus, sur leur demande, les moyens de travailler, il ne serait pas armé du pouvoir de les contraindre à chercher dans le travail leur subsistance habituelle. On proclamerait ainsi la supériorité de la force, du droit personnel sur le droit social. L'individu deviendrait le maître, le tyran; et la société, le serviteur, l'esclave.
M. Dufaure n'a rien dit de trop, le droit au travail est une servitude que l'on impose à la communauté tout entière, dans l'intérêt de quelques-uns, de plusieurs, de ceux qui pourraient être tentés de s'en prévaloir. En admettant cette action de l'individu contre la société, on met nécessairement deux intérêts en présence et en lutte. Supposez que la société résiste; le procès alors se change en combat. C'est de part et d'autre un appel aux armes: on a recours à la force pour interpréter le droit. Les insurgés de Lyon, en 1832, avait arboré sur leur bannière cette devise du désespoir: « Vivre en travaillant, ou mourir en combattant. » L'article VIII ne reproduisait que la première moitié du Credo populaire; les événements ont remis en lumière l'autre moitié: ni la logique, ni la force des choses ne permet de les séparer. Quand on donne un droit, une action aux individus contre la société, on prépare, et même l'on justifie la révolte. On relève, suivant une parole qui ne visait pas à être aussi prophétique, l'étendard de Spartacus; on le relève au sein d'un peuple qui ne connaît plus ni séparation de castes, ni différence de rangs; on proclame la guerre sociale entre des membres de la même famille politique, entre des frères.
Supposons au contraire que la société se résigne, et qu'acceptant le droit au travail elle soit prête à épuiser toutes les conséquences pratiques du principe. Il faut voir où cela conduit.
Décréter le droit au travail, c'est constituer l'État en pourvoyeur de toutes les existences, en assureur de toutes les fortunes, en entrepreneur de toutes les industries. Le droit au travail, c'est le droit au capital, c'est le droit au salaire, c'est le droit à l'aisance; c'est la créance la plus étendue dont on puisse armer les individus contre le trésor public. Quand on descend au fond d'un pareil système, le partage des biens paraît mille fois préférable; car la communauté des biens met du moins celui qui possède sur la même ligne que celui qui ne possède pas: elle ne prélève la part du pauvre que sur celle du riche, et se borne à faire une répartition nouvelle des capitaux ainsi que des revenus existants. Le droit au travail va bien au delà; c'est une main mise non-seulement sur ce qui est, mais encore sur ce qui peut être; c'est la communauté non-seulement de la richesse acquise, mais des forces qui produisent, une servitude perpétuelle imposée aux chefs de la société dans l'intérêt des prolétaires nombreux que la République prend à sa solde.
« Le droit au travail, je l'ai dit ailleurs,246 suppose l'existence permanente, la puissance indéfinie de la production, quelles que soient les circonstances et quelle que puisse être l'organisation de la société. Quelle valeur aurait en effet un principe que l'on placerait en dehors des régions du possible? Or, il n'existe pas d'état social qui assure la permanence ni la régularité de la production. Qu'une crise commerciale survienne, ou qu'un ralentissement quelconque dans la consommation rende l'offre supérieure à la demande, et vous verrez un certain nombre d'ateliers suspendre ou diminuer leur activité. L'industrie, comme l'année solaire, a ses saisons, et la moisson du travail, comme celle des fruits de la terre, a ses années de stérilité ainsi que ses années d'abondance.
» La prévoyance de l'homme tient en réserve, pour ces moments difficiles, les capitaux accumulés par l'épargne, mais elle ne rend pas à volonté l'impulsion à la puissance qui produit, et elle ne crée pas le travail d'un coup de sa baguette. L'homme peut toujours employer son intelligence et ses bras; mais le mouvement est autre chose que le travail...
» Le travail, c'est l'emploi utile des forces; on le reconnaît à ses produits ...
» Pour créer à volonté la production, il faudrait être en mesure de développer la consommation et d'en reculer devant soi les limites; car les produits les plus nécessaires n'ont de valeur que par l'usage que l'on en fait. Que servirait, par exemple, d'entasser des montagnes de blé ou des troupeaux de bœufs dans une ville déserte, et à quoi bon les richesses du Mexique dans des circonstances où un kilogramme d'argent ne procurerait pas une once de pain? Si les difficultés devaient cesser, quand on a dit que l'ouvrier a droit au travail, la recette serait bien simple; l'État n'aurait qu'à fournir des fonds aux ateliers qui seraient au moment de s'arrêter et qu'à ordonner aux fabricants de produire. Mais ce n'est pas tout de fabriquer, il faut vendre, il faut trouver des acheteurs pour les marchandises que l'on crée, et non ajouter à l'encombrement stérile des dépôts; il ne faut pas que la production augmente précisément lorsque le marché se ferme ou se restreint. Ajouter, en pareil cas, à la masse des produits, c'est les avilir. Pour soulager les souffrances du présent, on lègue ainsi de nouveaux embarras à un avenir très-prochain. L'on retarde enfin l'heure où, après avoir liquidé leurs désastres passés, le commerce et l'industrie vont se remettre en marche. »
Les socialistes partent encore d'une autre supposition qui n'est pas moins extravagante que la première. Ils établissent un dualisme entre l'individu et la société. Loin de considérer la société comme la réunion de toutes les forces et comme l'ensemble de toutes les intelligences, ils en font un être de raison, une puissance à part, une personne fantastique, une espèce de fée qui aurait des trésors cachés et des facultés sans limites. Chacun lui demande autre chose et plus que ce qu'il apporte lui-même dans la communauté. Dans l'idéal socialiste, l'État donne toujours et ne reçoit jamais. On ne veut pas comprendre qu'il n'est riche que par la richesse individuelle, qu'il ne produit que par le travail de tous et de chacun, enfin que sa puissance est le résultat du nombre et du concert des volontés. En un mot, on oublie que, si l'arbre social peut porter des feuilles et des fruits, c'est à condition de plonger ses racines dans le sol et d'y puiser la sève nourricière.
Prenons cependant le droit au travail comme la dot de tout homme qui ne possède rien. Admettons pour un instant la fiction qui investit l'État d'une chimérique omnipotence. Comment va-t-il remplir les obligations que l'on fait peser sur lui?
Le système veut que tout individu qui ne trouvera pas l'emploi de son intelligence ou de ses bras, ou bien à qui l'emploi qu'il en aura trouvé ne fournira pas les moyens de vivre, soit fondé à s'adresser au Gouvernement pour obtenir de lui le travail qui lui manque ou même une occupation lucrative à la place d'un travail peu productif. Ainsi, l'État devra employer tous les ouvriers inoccupés et combler l'insuffisance du salaire. Il faudra qu'il supplée les lacunes de la demande et qu'il fournisse les instruments du travail.
Dans notre organisation sociale, lorsqu'un chômage prolongé vient arrêter les manufactures, ou quand l'agriculture est surchargée de bras, l'Etat, les départements et les communes ouvrent des ateliers de charité. On appelle les indigents à faire des terrassements ou à empierrer les routes. Tous ceux qui possèdent se saignent des quatre veines pour fournir, par leurs contributions, cette demi-solde aux ouvriers licenciés par l'industrie. Mais sous le régime du droit au travail, les choses ne pourraient pas se passer de la sorte. L'ouvrier, armé d'un titre absolu, ne se contenterait pas du travail que la société aurait choisi et préparé pour lui; il exigerait le travail auquel il se croirait propre et qui lui promettrait une rémunération plus abondante; il voudrait suivre sa profession, et dans les conditions les plus favorables; en déterminant le genre d'emploi, il en fixerait aussi le prix. Il ne s'informerait ni de la situation du marché ni de celle du trésor. Le salaire, devenant pour lui comme une créance, une rente sur l'Etat, garderait un niveau invariable. Il faudrait changer, pour le fournir, les conditions de la société.
Dans son admirable discours sur le droit au travail, M. Thiers a exprimé incidemment une opinion dont les socialistes pourraient s'armer contre lui et qui étonne venant d'un esprit aussi éminemment pratique.
Il admet que l'État tienne en réserve pour les moments de chômage, pour les temps de crise, indépendamment des grands travaux d'ordre public, une certaine somme de commandes à distribuer à l'industrie. Cela ne serait pas bon et ne paraît guère possible. L'État, comme tous les autres consommateurs, n'achète ou ne produit qu'à mesure que les besoins de la consommation se révèlent; ses dépenses sont annuelles comme ses revenus; il les proportionne aux nécessités politiques. Dans le système indiqué par M. Thiers, on réserverait l'activité des travaux et la masse des approvisionnements pour des temps calamiteux qui pourraient ne pas coïncider avec les plus grandes exigences du service. On commanderait du drap et de la toile pour habiller un million de soldats, quand on n'aurait pas trois cent mille hommes sous les armes. On entasserait ainsi, dans les dépôts de l'État, des marchandises qui représenteraient des capitaux considérables; et l'on perdrait, pendant de longues années, l'intérêt de ces capitaux. Il en serait de même des travaux publics. Pour être en mesure de les développer en temps de crise, on devrait entretenir, pendant les années de prospérité, un état-major nombreux, doubler et tripler tous les cadres. Il faudrait créer d'abord une multitude de sinécures, pour en tirer ensuite, dans les moments difficiles, les éléments d'un service actif. Je ne connais pas de système moins rationnel, ni, en tous cas, plus mortel aux finances publiques.
Mais ce qui me frappe principalement, c'est que l'on appellerait ainsi l'État à faire les plus grands efforts et les plus grands sacrifices, dans les circonstances où ses ressources diminuent avec celles de tout le monde. On lui demanderait d'ajouter trois ou quatre cents millions aux dépenses, précisément lorsque l'impôt direct multiplierait les non-valeurs, que les revenus indirects iraient se réduisant, et lorsque, même en payant huit à dix pour cent d'intérêt, il ne trouverait pas à emprunter. En un mot, et pour me servir d'une expression que M. Thiers a fait accepter, on demanderait les largesses du riche à un trésor qui ne serait plus que le trésor du pauvre.
Avec l'organisation actuelle de la société, l'État n'a qu'un moyen de donner du travail aux ouvriers nécessiteux et valides; c'est d'improviser, sur certains points du territoire, des ateliers de travaux publics. Quelle que soit la profession des travailleurs sans emploi, il n'a pour eux que ce refuge. C'est le seul expédient qui lui permette d'imprimer encore quelque moralité à l'aumône. Mais y a-t-il un grand nombre d'hommes qui puissent y trouver un emploi réel et profitable de leurs bras? Ce système ne consacre-t-il pas la plus effrayante inégalité dans l'aumône? N'est-il pas inventé uniquement dans l'intérêt des journaliers habitués à manier la pioche et à remuer la terre? N'est-il pas à peu près stérile pour les ouvriers des professions sédentaires, tels que les tailleurs, les cordonniers et les bijoutiers; et ne devient-il pas un supplice pour les ouvriers de l'intelligence, pour ceux que nous avons vus inscrits en grand nombre sur les contrôles des ateliers nationaux?
On affronte volontairement le plus redoutable péril, toutes les fois que l'on forme de grandes agglomérations d'ouvriers, sans avoir la certitude de pouvoir leur offrir un régime et un prix de travail qui les satisfassent. La difficulté de discipliner les hommes rassemblés s'accroît alors du mécontentement qui fermente dans leurs rangs. Le mal commence par l'inaction, pour aboutir à la révolte. La France et l'Angleterre en ont fait presque simultanément la plus triste expérience. On sait que le Gouvernement Britannique, après avoir réuni jusqu'à huit cent mille ouvriers sur les chantiers destinés aux travaux des routes en Irlande, se vit contraint de dissoudre ces brigades de mendiants qui refusaient tout travail et qui chassaient les ingénieurs à coups de pierre. De ce côté du détroit, il n'y a pas d'ateliers communaux, depuis la proclamation de la République, qui n'ait engendré au moins une émeute, et cela en épuisant, jusqu'au dernier centime, les ressources produites par les contributions tant volontaires que forcées. Que dire des ateliers nationaux de la capitale, qui ne soit contenu dans la sanglante leçon de juin?
Le droit au travail entraine l'organisation du travail: il n'y a pas de place, dans une société libre et qui s'appartient, pour cette aristocratie des prolétaires. Tant que le capital et la propriété compteront pour quelque chose, ils protesteront contre la servitude que l'on veut faire peser sur eux. Il faut donc démolir les remparts de la civilisation, pour y introduire cette machine de guerre; il faut transformer la société, il faut remplacer la liberté par le monopole, et l'action des individus par celle de l'État. Plus de propriété, plus d'héritage. L'État doit tout posséder, tout produire, tout distribuer. C'est lui qui donnera le travail et qui répartira la richesse. La théocratie industrielle, que prêchaient les disciples de Saint-Simon, voilà le rêve à réaliser. Nous remontons à l'Inde et à l'Egypte.
Le droit au travail n'a pas de sens ni de valeur, s'il ne veut pas dire que tout individu, s'adressant à l'État pour obtenir de l'emploi, aura droit au genre d'emploi auquel il est propre; que le laboureur pourra demander qu'on lui confie une charrue à conduire et des terres à cultiver; que le tailleur recevra une commande de vêtements; que l'on donnera au mécanicien une locomotive à construire; que le peintre sera chargé de décorer les palais ou les églises; que l'historien trouvera des auditeurs pour ses leçons ou des lecteurs pour ses écrits. Cela suppose évidemment que l'État est le maître de régler, comme il l'entend, ou comme la foule l'entend pour lui, la production et la consommation, le loyer du capital, la durée du travail et le taux des salaires; qu'il n'y a pas d'autre propriétaire, d'autre capitaliste, d'autre entrepreneur d'industrie et de commerce que lui dans la société.
Avoir droit au travail, c'est avoir droit au salaire, à un salaire qui assure l'existence de l'ouvrier; et, comme les besoins de l'existence varient avec les situations, avec les individus, c'est avoir droit à un salaire que l'ouvrier déterminera lui-même. Sous le régime de la liberté industrielle, il n'appartient à personne de fixer le taux des salaires, qui suivent les fluctuations du marché, et qui obéissent à une loi économique supérieure à la volonté du patron comme à celle de l'ouvrier. Il faut donc que la liberté soit supprimée et que la concurrence cesse, pour faire naître cette possibilité d'un minimum à déterminer dans le prix du travail. Evidemment il n'y a que le monopole dans les mains de l'État qui donne la possibilité de mettre ainsi aux voix le salaire.
Avoir droit au salaire, c'est avoir droit aux instruments du travail, au capital, au crédit. L'armée des travailleurs, pas plus que celle des soldats, ne peut se passer d'officiers qui la conduisent. Ces officiers se produisent et se forment eux-mêmes, avec le liberté de l'industrie; ce sont les capitalistes, les manufacturiers, les ingénieurs, les administrateurs, les commis et les contre-maîtres. On n'arrive que par le mérite, par les services rendus, par l'expérience, à ces postes enviés et disputés du commandement. Mais du moment où l'individu a le droit absolu d'exiger qu'on l'emploie dans la sphère de son aptitude, il peut demander aussi qu'on le place dans les conditions les plus favorables pour tirer parti de son intelligence et de ses forces. Si l'État commandite simplement l'industrie, le candidat voudra recevoir sa part de cette rosée fécondante du capital; et si l'État a converti la société en un vaste atelier dont il se réserve la direction, le candidat aura la prétention d'être rangé, non parmi les plus humbles agents du travail, mais parmi les hauts ou tout au moins parmi les moyens fonctionnaires.
On le voit, le droit au travail dans les individus suppose nécessairement le monopole du travail dans les mains de l'État. Nous remontons à l'enfance des sociétés. On traite l'homme émancipé, parvenu à l'âge de la liberté, de la force et des lumières, comme les peuples encore ignorants consentaient à être traités par le pouvoir qui les mettait en tutelle. Il s'agit de renverser tous les procédés à l'aide desquels la civilisation a marché jusqu'à présent dans le monde. On veut nous mener par la démocratie au despotisme, et au monopole par le suffrage universel. Tout ce que l'Assemblée constituante de 1789 a irrévocablement fondé, l'on vient demander a l'Assemblée constituante de 1848 de l'abroger et de le détruire. Voilà comment le socialisme interprète et respecte les traditions augustes de la liberté.
En dehors de l'organisation du travail, qui-est l'absurde et qui serait l'impossible, le droit au travail se convertit en un simple droit à l'assistance. Sous cette forme atténuée et pourtant dangereuse encore, un vote solennel l'a reconnu. Mais il est toujours à propos de revendiquer les vrais principes.
Le droit est une chose certaine, et le pouvoir une chose incertaine: il y a de la témérité à établir un rapport direct entre ces deux termes dans l'ordre social. La société ne fera pas ce que la Providence n'a pas voulu faire. Dieu a permis la souffrance et la misère, l'Etat le mieux ordonné ne les supprimera pas. Le progrès de l'aisance générale est incontestable; il s'est accru, il s'accroîtra et nos efforts doivent tendre à l'accroître; mais n'allons pas rêver l'âge d'or.
La société doit, dans la mesure de ses ressources et dans les limites que la sagesse autorise, venir au secours des malheurs individuels; car, la prévoyance de chacun n'exclut pas la prévoyance commune. Gardons-nous cependant de convertir le devoir de la société en un droit pour l'individu. Quand on pose, dans ces termes, une question de droit, l'on pose une question de violence. Si vous dites que tous ceux qui ont à se plaindre de leur sort ont le droit de puiser au fonds commun de l'assistance, vous reconnaissez qu'ils peuvent prendre la société à partie. Vous légitimez la révolte.
Le droit à l'assistance doit infailliblement amener à la longue la démoralisation des individus, l'affaiblissement et la ruine de l'État.
Une loi d'Elisabeth le proclame et a donné naissance à la taxe des pauvres. La taxe des pauvres en Angleterre se conçoit. Elle représente à peine l'équivalent de la spoliation exercée par le riche contre le pauvre, par le Normand contre le Saxon, sur la plus grande échelle. L'aristocratie s'est partagé le sol par droit de conquête; elle a confisqué à son profit exclusif les biens communaux et les biens des églises; enfin, elle se décharge du poids de l'impôt sur les classes laborieuses, et se réserve le patronage ainsi que les positions lucratives du Gouvernement. Ne devait-elle pas une compensation, un dédommagement à ce peuple qu'elle avait exclu de tous les biens de ce monde? La taxe des pauvres a été cette indemnité.
On connaît les mauvais résultats du système.
En 1832, au moment où l'excès du mal détermina une tentative de réforme, l'entretien des pauvres coûtait à l'Angleterre proprement dite et au pays de Galles plus de sept millions sterling (environ 176 millions de francs) par année. C'était à peu près trois fois la charge que représente le principal de l'impôt foncier en France. Encore quelques accroissements dans la taxe, et le revenu du propriétaire, la rente du sol y aurait passé. Cependant les pauvres ne s'enrichissaient pas, en ruinant, en dévorant les riches; car la misère et la dégradation s'étendaient insensiblement au pays tout entier. On donnait l'assistance à la place du travail ou pour servir de supplément au salaire. Quand les paroisses employaient elles-mêmes les pauvres, le travail n'é tait qu'une dérision. Il en résultait, d'une part, que les ouvriers assistés par les paroisses tombaient dans l'indolence et dans la débauche, se reposant sur la société du soin de les nourrir, et considérant l'aumône qu'ils recevaient comme l'acquit d'une dette; de l'autre, que les ouvriers libres, et qui voulaient ne devoir qu'au travail leur existence ainsi que celle de leur famille, ayant à subir la concurrence des travailleurs soudoyés par la charité publique, voyaient le taux des salaires baisser, et qu'ils se trouvaient ainsi amenés malgré eux, par l'insuffisance de la rémunération qu'obtenait leur labeur quotidien, à solliciter l'assistance de la paroisse. En outre, comme les secours étaient proportionnés au nombre des personnes dans chaque famille inscrite, les pauvres avaient intérêt à contracter des mariages prématurés et irréfléchis; car leur revenu s'accroissait avec le nombre de leurs enfants. L'immoralité n'avait plus de frein; car tous les enfants nés hors mariage tombaient à la charge de la société.
La réforme de 1834 mit un terme provisoire à cet abus de l'aumône officielle. On donna pour correctif au droit à l'assistance le devoir du travail. L'administration des secours publics fut autorisée à retenir dans les dépôts de mendicité et à mettre à la tâche toute personne valide qui demanderait des secours. Les maisons de charité ou de travail (work-houses) devinrent autant de maisons de force. La femme fut séparée du mari, et la mère de l'enfant. Pour rendre aux pauvres le goût du travail, on s'efforça de les dégoûter de l'aumône. La prospérité du pays et l'activité de l'industrie venant en aide, on obtint ainsi une économie considérable dans le service des secours publics: en 1837, l'entretien des pauvres, malgré l'accroissement de la population, ne coûtait guère plus de quatre millions sterling (100 millions de francs). Une épargne annuelle de trois millions avait été le résultat immédiat de la réforme.
Mais, depuis quelques années, le paupérisme a repris en Angleterre une marche ascendante. La dépense s'est accrue d'environ un million sterling (25 millions de francs). Le nombre des pauvres secourus présente un accroissement encore plus considérable. En effet, si l'on tient compte du progrès de la population, l'on trouvera que la proportion qui était, en 1840, de sept pauvres 7/10 sur cent habitants, représentait en 1847 dix pauvres 1/10. Les maisons de travail ne renfermaient pas alors moins de 265,037 mendiants. Mais la recrudescence de cette épidémie se manifeste principalement par les progrès effrayants du vagabondage; une seule maison de charité, dans la ville de Londres, qui n'avait admis que 767 pauvres non domiciliés dans le cours de l'année 1837, en a reçu 1376 en 1840, 6,308 en 1846, et 11,574 en 1847.
Ainsi, le paupérisme naît de la taxe des pauvres. La misère, quand on met à côté le droit aux secours publics, cesse d'être un accident pour passer à l'état chronique. C'est un ulcère que l'on entretient. L'Angleterre en a fait et en fait encore chaque jour la triste expérience. N'importons pas en France un système qui, dans un pays moins riche et moins aristocratique, aurait encore de plus funestes résultats. La division des fortunes nous a épargné jusqu'à présent ces contrastes affligeants entre l'extrême pauvreté et l'extrême richesse. Ne dispensons personne de l'économie et de la prévoyance, là où personne ne peut se dispenser du travail.
C'est un axiome reçu en Angleterre, dans un gouvernement dont la propriété est la base essentielle, que la propriété a des devoirs aussi bien que des droits.247 Jusqu'où vont ces devoirs et quelle en est la nature? Celui qui possède doit-il nourrir, entretenir, et en un mot prendre à sa charge celui qui ne possède pas? Est-ce là une servitude de la richesse? La propriété y périrait. L'on conçoit que, dans un gouvernement despotique, le maître soit responsable de l'esclave, et que le seigneur féodal ait à nourrir ses serfs; car il y a là une sorte d'obligation réciproque: le serf a le droit de recevoir des aliments du propriétaire, parce que le propriétaire a droit au travail du serf. Mais émanciper les travailleurs de la glèbe, et hypothéquer en même temps la propriété à leur subsistance, cela impliquerait contradiction, cela serait de l'injustice.
Le lien social unit les hommes entre eux par une dépendance mutuelle. Mais en rendant cette dépendance trop étroite, en tendant la chaîne sans mesure, on risque fort de la briser. Il ne faut pas immoler l'individu à la société ni la société à l'individu. Écartons, avec une égale vigilance, avec un égal empressement, le communisme et l'égoïsme. Que la charité ne cesse pas d'être un devoir moral; mais n'en faisons pas une obligation légale. Que personne, en France, ne puisse mourir et ne meure de faim, en présence de la richesse dont le niveau s'élève tous les jours, et de la production qui déborde; mais que cette humanité secourable, que cette providence sociale soit le fait des mœurs plutôt que des lois. Laissons au riche son mérite qui consiste à soulager à propos la souffrance, et au pauvre sa dignité qui est de supporter le malheur: tout système de gouvernement ou d'administration est mauvais, qui tend à supprimer la vertu dans ce monde.
M. Thiers a demontré que le droit au travail détruirait l'émulation entre les travailleurs, c'est-à-dire le principe qui porte un homme à faire mieux que d'autres, qui est la source du progrès pour la société et de la richesse pour les individus. M. Dufaure a établi que le droit à l'assistance annihilait la prévoyance, c'est-à-dire le principe sur lequel repose l'avenir de chaque individu, aussi bien que l'avenir de la société. « Quand l'ouvrier, a dit l'éloquent orateur, aura pris une fois l'habitude de travailler comme on travaille pour l'État, avec un salaire assuré, infaillible; quand il aura pris cette habitude, le goût du travail s'en ira peu à peu. Il tombera dans l'indolence, dans l'oisiveté et dans tous les vices qui en sont la conséquence. Il y a plus, il donnera cet exemple à ses enfants; vous aurez dans le pays une aristocratie de familles indolentes, que l'État salariera, qui augmentera chaque jour, qui ira en croissant; qui, d'un côté, ruinera la société, et qui, d'un autre côté, verra peu à peu amortir son courage, énerver toutes ses forces viriles, corrompre ses meilleurs instincts, en un mot, qui cessera bientôt d'être digne de porter ce beau nom de Français, qu'il vaut mieux lui laisser avec tout son honneur. »
Le droit au travail et le droit à l'assistance ne sont, dans la pensée des socialistes qui mettent ces grands mots en avant, que des moyens de changer la distribution des fortunes. L'État n'a pas qualité pour cela; les lois qui règlent la répartition de la richesse dans le monde social sont, comme celle du mouvement dans le monde physique, supérieures à l'action du pouvoir public. C'est la gravitation qui entraîne invinciblement toutes les volontés et toutes les intelligences. L'État doit veiller à ce que les charges de la société soient également réparties entre tous ses membres dans la proportion des fortunes: il lui appartient de lever les obstacles qui arrêtent ou qui gênent le développement des lumières et de la production. Il ne doit jamais oublier que s'il est la force collective, s'il représente l'association des individus, il n'en est pas l'absorption.
Et, après tout, quel est le but? que veut-on faire? Quand on proclame le droit au travail et le droit à l'assistance, on espère, à l'aide de cette main mise sur les résultats accumulés de la production, sur les capitaux de toute nature, extirper et rendre impossible la pauvreté... Passe encore pour en diminuer l'étendue, pour en atténuer les effets; mais porter ses vues au delà, c'est en quelque sorte condamner la Providence. Le mal existe sur la terre: il est la conséquence de la liberté humaine. L'homme peut se tromper dans ses calculs, négliger ses devoirs, se relâcher de ses efforts, méconnaître ses intérêts véritables; il faut qu'au bout de toutes les fautes, le châtiment apparaisse. Et le châtiment, dans ce monde, c'est matériellement la perte de la richesse; c'est, au moral, la perte de l'estime de ses concitoyens. La crainte de perdre des biens aussi précieux est le seul frein qui retienne l'homme sur la pente; le désir de les acquérir est le véritable stimulant qui éveille et qui développe son énergie. Le progrès naît des difficultés; la civilisation est sortie comme la Hollande du sein des flots. En retranchant la pauvreté de ce monde, on retrancherait le travail; et la loi du travail est la loi même de l'existence.
Léon Faucher.
---------
III. OPINION DE M. L. WOLOWSKI.248
La plus grande question de la société moderne, la question du travail, a été abordée devant l'Assemblée nationale avec autant de netteté que de vigueur. Les paroles prononcées par les orateurs éminents qui ont pris part à ce débat, répondent suffisamment aux attaques passionnées et perfides dirigées contre les résolutions inscrites dans la Constitution. Jamais peut-être l'esprit de parti n'a montré une hostilité plus systématique, ni fait preuve d'une plus audacieuse injustice. Si nous nous en rapportions aux déclamations ardentes à l'aide desquelles on a essayé d'égarer le bon sens des masses, l'Assemblée nationale aurait fait preuve d'une inhumaine dureté; elle aurait condamné les ouvriers à mourir de faim, elle leur aurait dénié la faculté de vivre en travaillant, en effaçant du préambule de la Constitution ces mots sacramentels: Le droit au travail.
Ceux qui travestissent ainsi la pensée du législateur se gardent bien d'ajouter qu'en écartant une expression vague, élastique, sorte de pavillon suspect qui couvrait toute sorte de marchandises, l'Assemblée nationale a voulu remplacer des mots vides de sens par un engagement précis, formel, qui reporte la question sur le terrain sérieux de la pratique, et qui substitue des actes tutélaires à de vaines déclamations. Au lieu d'énoncer le droit au travail, la Constitution s'occupe des moyens propres à multiplier les occupations productives.
Si les promoteurs du droit au travail ont réussi à faire illusion sur la portée de leur doctrine et sur les résolutions législatives qui ont condamné celle-ci, c'est à l'aide d'un malentendu habilement exploité. Ils se sont posés comme seuls défenseurs du pauvre ouvrier; ils ont fait sonner bien haut les mots de garantie de la subsistance par le travail. La question était autre; les aspirations de ceux qui ont combattu une rédaction vicieuse et ambiguë, se rapprochaient bien mieux du but assigné à nos efforts communs, de cette amélioration morale et matérielle du sort des travailleurs, qui constitue la suprême mission de la société actuelle.
Personne ne songe à éluder ce grand problème: il préoccupe à juste titre toutes les intelligences. Loin de subir un échec dans la discussion de la Constitution, il a été dégagé d'une phraséologie fausse et parasite, et il a marché vers une solution rationnelle.
Les défenseurs du droit au travail l'ont présenté comme synonyme de l'extinction de la misère; c'est là de leur part une précaution étrange, qui aboutit à une funeste erreur. Le droit au travail, tel qu'ils se sont accordés à le présenter, depuis M. Ledru-Rollin jusqu'à M. Billault, se borne à être ce droit à l'existence par le travail qu'a réclamé aussi M. de Lamartine; cette garantie alimentaire qui empêche de mourir de faim.
Ce prétendu droit s'est tellement amoindri et effacé dans la discussion; il est tellement descendu à une sorte de recours extrême, sollicité propter vitam, en faveur des travailleurs nos frères, qu'il a perdu le caractère élevé dont on essayait vainement de le parer; loin de supposer l'extinction de la misère, il en établit, au contraire, la permanence, puisqu'il borne l'ambition du législateur, non pas à faire vivre l'ouvrier dans une honnête aisance, non pas à multiplier pour ce dernier les jouissances intellectuelles et matérielles, mais à l'empêcher de mourir de faim au moyen d'une ration mesurée.
Si le droit au travail n'est que cela, ce n'est rien; de tout temps on a invoqué la providence de la société pour fournir aux malheureux des moyens d'existence alimentaire; de tout temps on a pratiqué le secours dont quelques hommes voudraient faire un si pompeux étalage; mais on l'a pratiqué comme devoir social, comme acte de prévoyance et d'administration éclairée. Les ateliers de charité, employés par Turgot dans le Limousin à faire construire des routes par les ouvriers privés momentanément d'occupation, étaient-ce autre chose que cette assistance, sous la condition du travail, à laquelle se réduit, en dernière analyse, la théorie du droit au travail développée devant l'Assemblée?
Tout État, sagement gouverné, s'emploiera dans la mesure du possible à procurer du travail aux bras valides, car il ne refusera jamais le pain nécessaire à l'existence.
Mais la véritable mission de la société consiste à rendre de plus en plus rare ce recours extrême de l'individu, qui dénote l'absence d une occupation régulière et productive. C'est en activant le développement industriel, de manière à ouvrir une carrière convenable au labeur individuel que l'État remplira véritablement sa tâche. Pour que le travailleur grandisse en dignité et en bien-être, il faut que l'occasion de réclamer ce prétendu droit au travail, dont on voulait le doter, ne se présente jamais. Y recourir, c'est dénoncer la souffrance; et quelque paradoxale que paraisse cette expression, nous nous en servirons, car nous la croyons profondément vraie: proclamer le droit au travail, c'est proclamer l'éternité de la misère.
Mais, si quelques orateurs ont diminué la portée de l'expression pour laquelle ils demandaient droit de cité dans la Constitution, des écrivains, plus logiques et plus hardis, tiraient la conséquence du principe, ainsi posée. Pour eux, le droit au travail est synonyme de cette autre formule célèbre: l'organisation du travail; ils veulent substituer à la spontanéité humaine un mécanisme plus ou moins compliqué, et confisquent la liberté au profit d'un vaste panthéisme industriel. Ceux-là au moins, s'ils se trompent, conçoivent une pensée plus haute de la destinée de l'homme, et cette pensée nous la partageons, tout en différant profondément au sujet des moyens propres à la réaliser. L'idéal, en effet, ce n'est point une sorte de régime protecteur de la misère, qui maintiendrait les pauvres dans leur pauvreté. Il faut les en faire sortir, et, comme l'a dit Ricardo, aucun plan pour secourir la pauvreté ne mérite attention, s'il ne tend à mettre les pauvres en état de se passer de secours.
Que ceux qui ont défendu le droit au travail le sachent ou l'ignorent, ils sont coupables d'une étrange méprise, ou bien ils ont caressé une périlleuse chimère. S'ils se bornent à vouloir que l'Etat remplisse le rôle de corps de réserve de la société, en tendant une main secourable aux malheureux, ils n'innovent rien, et la société sera d'autant plus parfaite, que ce recours extrême sera plus rarement exercé. Mais ils laissent supposer autre chose, et là est le danger; ils ouvrent libre carrière à tous les rêves, à toutes les déceptions. Quand on proclame le droit au travail, il faut, pour ne point mentir à la logique, garantir à chacun, non pas un travail dérisoire de manœuvre, mais le travail suivant l'aptitude développée, l'exercice de la profession à laquelle chacun appartient. Mettez donc une pioche entre les mains de l'artiste, de l'orfévre, du médecin, de l'ébéniste, du sculpteur? Ils repousseront avec raison cette application étrange d'un principe qui ne se laisse pas ainsi défigurer du moment où il est accepté. Si le droit existe, il faut qu'il reçoive une application normale; il ne peut entrer dans la Constitution que tête haute et non en se baissant, en s'amoindrissant, de manière à disparaître au milieu d'une amère ironie. Il faut donc que l'État exerce toutes les industries, c'est-à-dire qu'il les absorbe toutes, et qu'un vaste atelier national dévore tous les ateliers privés: autrement le prétendu droit au travail sera sans virtualité, il expirera devant l'impossible, ou bien il subira dans la pratique une transformation singulière, qui le fera dégénérer en une simple assistance obtenue sous les conditions du travail.
Avec le droit au travail, dans son acception véritable, plus de liberté, plus de propriété, plus de spontanéité, et, partant, plus de cet épanouissement progressif de la civilisation, qui mène l'homme à l'accomplissement de ses destinées.
L'Assemblée nationale a bien fait de repousser une fraude qui aboutit au néant, ou qui recèle des tempêtes. Elle a bien fait de proclamer un devoir social, dans la limite des ressources de l'État, au lieu d'un droit individuel, dont la revendication téméraire conduisait forcément à la destruction de l'ordre social, ou à un mensonge.
Si le droit au travail ne signifie point organisation du travail, distribution assurée des occupations d'après les aptitudes de chacun, et par conséquent constitution d'un immense atelier social sur les débris de l'industrie libre, ce droit n'est rien; si c'est cela, en voulez-vous?
A notre sens, la mission de l'État est autrement favorable à l'amélioration progressive du sort des travailleurs. Rendre le travail productif, et le développer; relever le travailleur en complétant sa liberté et non en la supprimant, le doter de l'instruction et d'un ensemble de lois équitables et d'institutions auxiliaires qui tendront à fortifier le principe fondamental de notre constitution industrielle, telle est la tâche de la société!
Gardons-nous d'abandonner la voie glorieusement ouverte par Turgot, et tracée par la grande Révolution de 1789. La liberté a beau paraître un sujet passé de mode, elle est devenue, comme l'air que nous respirons, un élément indispensable de l'existence; c'est parce que nous en jouissons, que nous sommes trop portés à oublier les immenses services qu'elle nous a rendus.
« Dieu, en donnant à l'homme des besoins, en lui rendant nécessaire la ressource du travail, a fait du droit de travailler la propriété de tout homme, et cette propriété est la première, la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes. — Nous regardons comme un des premiers devoirs de notre justice d'affranchir nos sujets de toutes les atteintes portées à ce droit inaliénable de l'humanité. » Telle est la charte du travail émancipé, tracée de la main de Turgot, dans le préambule du célèbre édit de 1776. Des réglements absurdes, oppressifs, tyranniques, déniaient à l'homme le droit de travailler; Turgot les a brisés, et la Révolution les a définitivement détruits. Aujourd'hui que ces entraves ont disparu, il ne s'agit pas de se mettre en quête du droit au travail, qui existe comme le droit de vivre, du moment où personne n'en restreint l'exercice; il s'agit d'asseoir les droits des travailleurs sur la base de la justice et sur l'égalité des rapports.
Pour y arriver, il faut toujours se souvenir de l'homme, ce pivot de la production et de la distribution des richesses. Aucune amélioration sérieuse ne saurait s'accomplir, si elle ne trouve pas son point de départ dans l'amélioration de l'homme. Il faut mûrir son intelligence et sa moralité; il faut tenir sa prévoyance en éveil, en retrempant le ressort de l'activité individuelle; alors on pourra espérer de grands résultats. Liberty and property, liberté et propriété, c'est le cri de guerre des Anglais, répété avec admiration par Voltaire; garantir la liberté de chacun, et ouvrir à tous l'accès de la propriété, c'est le but suprême de l'Etat.
La propriété, dirons-nous avec M. de Lamartine, est expansible, et corrigible; expansible, au moyen de l'accroissement indéfini du capital, cette émanation directe de l'homme, cette réserve du travail de la veille, qui facilite et accroît la production du lendemain. Dans un beau mouvement d'éloquence, Danton comparait l'homme doté du bienfait de la propriété au géant de la Fable, dont les forces doublaient, alors qu'il touchait la terre. Mais aujourd'hui, on le sait, la propriété, ce n'est pas seulement le sol transformé par le travail et doté d'une fécondité nouvelle; les hommes ne sont pas condamnés à s'abattre tous, comme une volée d'oiseaux, sur cet élément primitif de la richesse, et à s'y disputer leur pâture. La propriété mobilière grandit sans cesse à côté de la propriété immobilière, dont la fertilité s'accroît; la propriété est expansible à l'infini, et il viendra un jour où tout citoyen en aura conquis une portion par son activité et son intelligence.
La propriété est corrigible; elle ne saurait dégénérer en abus, en oppression, si ceux dont on respecte le droit de propriété, droit sacré et fondamental, respectent dans autrui le droit non moins sacré d'appropriation. Ouvrez le vaste horizon de la liberté commerciale, et tout service s'échangera loyalement contre un service équivalent.
L'association volontaire tient ses cadres ouverts pour les combinaisons les plus variées et les plus fécondes; elle n'est pas un simple mécanisme, elle est avant tout une idée, un sentiment; elle ne peut pousser des racines profondes qu'au milieu d'une société éclairée et morale. N'est-il pas permis de penser qu'elle grandira chaque jour au milieu de la société française?
Tels sont les caractères du développement des travaux productifs auxquels ne manque point le baptême d'une éducation virile. La liberté ne peut appartenir qu'aux pays laborieux et éclairés, où les citoyens savent s'aguerrir à porter la responsabilité de leur sort; car liberté oblige. Ces hommes repoussent les moyens de tutelle qui énervent, et puisent leur énergie féconde dans une fière indépendance. On n'a pas besoin de leur donner le droit au travail, car ils ne descendront pas à cette abdication de leur personnalité; ils sauront se garantir de ce degré de dénûment qui fait invoquer l'assistance de l'État; singulier droit que celui dont l'exercice est un signe de détresse et une marque de sujétion!
Nous ne sommes pas de ceux qui regardent l'administration publique comme un ulcère; à nos yeux la fonction de l'État ne consiste pas uniquement à protéger la liberté; il n'est pas seulement un bouclier, il est aussi un levier. Si aucun acte de contrainte, de violence ne peut modifier l'expression du rapport entre l'offre et la demande, qui détermine la rémunération du travailleur, aussi bien que le prix de tous les produits, l'Etat peut agir sur les deux termes du rapport, il peut accroître le travail demandé par l'impulsion donnée à toutes les occupations productives, par l'essor du crédit et l'extension des voies de communication; il peut améliorer la qualité du travail offert par l'instruction. Son rôle n'aboutit point à cette abstention commode, à ce dolce far niente, que les uns ont utilisé, que les autres ont dénoncé comme l'expression pratique de la doctrine des économistes.
Sous prétexte de présenter le tableau fidèle de cette doctrine, on en crayonne trop souvent une spirituelle caricature. Que disait Quesnay? « Laissons faire tout ce qui n'est nuisible ni aux bonnes mœurs, ni à la liberté, ni à la propriété, ni à la sûreté de personne. Laissons vendre tout ce qu'on a pu faire sans délit. » Certes, ces maximes sont dignes du philosophe qui fit imprimer de la main de Louis XV ces belles paroles:
« Pauvres paysans, pauvre royaume; pauvre royaume, pauvre souverain. » Elles font appel à l'énergie individuelle, première source de la production, sans déshériter l'Etat des droits légitimes qu'il exerce dans l'intérêt général.
Ces droits de surveillance, de contrôle et d'impulsion deviennent surtout d'une application indispensable, quand il s'agit de l'homme. Si le travail est une marchandise, personne ne méconnaîtra que c'est une marchandise d'une espèce particulière, car on ne saurait la garder, l'emmagasiner; elle s'évapore, quand elle n'est point utilisée.
Si un entrepreneur particulier peut l'oublier, s'il tient peu de compte de l'ouvrier renvoyé de la fabrique, il en est autrement de l'entrepreneur général, de la société, qui ne saurait expulser aucun de ses membres, ni méconnaître les devoirs d'humanité et de sage prévoyance.
Aujourd'hui, surtout, ces devoirs apparaissent d'une manière éclatante. L'ancienne société ne se préoccupait que des produits industriels; elle en réglait le mode de fabrication, la qualité, la façon; la société moderne est pénétrée d'une autre sollicitude, elle s'inquiète du sort fait au producteur. Elle environne celui ci de celte protection positive, dont l'article 13 de la Constitution a résumé les traits principaux, et qui remplace la stérile proclamation du droit au travail mal compris, faussement interprété, par des garanties et des institutions efficaces.
La société protége l'enfance dans les salles d'asile et dans les écoles; elle dote les citoyens de ce précieux instrument de travail, qui est la culture de l'intelligence; elle intervient par le crédit, par les voies de communication, par les lois, qui garantissent la sécurité et la loyauté des transactions, par l'impôt et en favorisant le développement de l'association active, qui féconde la production, et de l'association passive, qui se traduit en institutions d'assurances.
Enfin la démocratie industrielle rencontre son levier le plus puissant dans l'épargne, qui appelle tous les enfants de la grande famille aux bienfaits de la propriété; de l'épargne qui portera tous ses fruits, du jour où l'on saura marier le profit du travail industriel au progrès du travail agricole, en alimentant le crédit foncier, au moyen des réserves accumulées par les déposants.
Nous venons d'indiquer très-rapidement, au moyen de quelques jalons, le vaste champ de la protection positive de l'Etat, telle que nous en réclamons l'exercice, au lieu de ce droit au travail, bon comme arme de guerre pour ceux qui veulent renverser, stérile comme conception pratique quand on voudrait le faire servir à l'amélioration morale, matérielle et intellectuelle du sort des travailleurs.
Nous nous trompons; par malheur, ce principe n'est pas seulement stérile, il est funeste; il pourrait, s'il était pris au sérieux, tarir la source du progrès. Où se trouve cet accroissement de richesse, dont on promène aux yeux de la foule le séduisant mirage? Dans le travail persévérant, vigoureux, dont la doctrine que nous combattons détruit les principaux leviers, l'énergie individuelle et la prévoyance. L'homme est, il doit demeurer membre actif de la société, et non se transformer en rouage inerte d'un vaste mécanisme. Sa force acquiert le plus haut degré de puissance, quand elle obtient le plus haut degré de liberté; et confisquer l'initiative industrielle ou l'amortir, c'est oublier que la société est la somme des individus qui la composent, et qu'il n'est pas de progrès possible en dehors de la marche progressive de chacune des unités qui s'agglomèrent dans ce vaste total.
Nous avons combattu un système dégradant, car nous voulons une amélioration réelle dans le sort de tous ceux qui souffrent; nous ne nous contentons point d'une vaine étiquette. La proclamation du droit au travail dispenserait l'homme d'une partie de cette activité pénétrante qu'il met à la recherche des travaux productifs; la masse de ceux-ci ne pourrait donc que se restreindre, et l'on se heurterait contre cette bizarre conséquence, que la proclamation du droit au travail diminuerait les moyens de travailler.
Comment se fait-il que l'on veuille déserter cette noble confiance dans la liberté, qui a fait la puissance des immortels auteurs de la Révolution? Il faut le reconnaître, la liberté de l'industrie, a un grand tort; elle a fonctionné depuis plus d'un demi-siècle, et comme il n'est point chose si grande et si belle qui ne projette quelque ombre, oublieux et ingrats, nous ne songeons pas à bénir les merveilleuses conquêtes que la liberté nous a permis d'accomplir, nous nous attachons à relever minutieusement les erreurs et les vices inséparables de toute œuvre humaine.
Un écrivain d'une rare finesse d'esprit, Rivarol, disait, en parlant de certains hommes de lettres ou prétendus tels: « C'est sans doute un grand avantage que de n'avoir rien fait, mais il ne faudrait pas en abuser. » Ces paroles ne s'appliqueraient-elles point, avec quelque justesse, à certains socialistes? Ils ne parlent de la liberté, de la concurrence, qu'en fulminant des condamnations terribles, des accusations violentes: croient-ils donc que leurs systèmes ne donneraient que de l'or pur au creuset de l'expérience? Qu'ils se montrent moins sévères pour cette pauvre liberté qui a le malheur d'avoir passé par les épreuves de la vie pratique, et de révéler à tous les regards, à côté d'admirables vertus, des imperfections dont rien sur cette terre ne saurait demeurer exempt.
Sans doute il est des souffrances cruelles auxquelles de prompts remèdes doivent être appliqués; sans doute la société ne saurait retirer une main protectrice aux pauvres et aux indéfendus. Mais ce devoir social, que la Constitution proclame hautement, ne saurait être envisagé comme une créance de l'individu; il se refuse à des exigences impossibles, et une fois qu'il est accompli, il n'apparaît point comme la réalisation d'une dette, mais comme un bienfait qui fait naître la dette de la reconnaissance. Autre chose est réclamer un droit, autre chose concevoir la juste attente d'un service, attente que la société ne trompera jamais.
Ces principes concordent avec les plus nobles aspirations de la nature humaine; ils tendent vers un but élevé, la réalisation de plus en plus complète de la liberté, source première de toute vertu et de tout bien-être. Ils ne s'attachent pas uniquement à la proclamation du droit, mais ils donnent les moyens de l'exercer.
Le but social est de multiplier les moyens de travail, de manière à ce que chacun rencontre la fonction à laquelle l'appelle son aptitude, et qu'il obtienne, au moyen de l'application libre de ses facultés, des moyens d'existence. En soulevant les interprétations erronées, périlleuses, auxquelles donne lieu cette formule obscure: le droit au travail, on risque de détruire le travail productif, et, par malheur, nous ne sommes point là en présence d'une simple hypothèse.
Le droit au travail émane d'une idée fausse; l'homme ne recherche pas le travail, qui est la peine, mais le produit, qui en est la récompense. Avoir le droit au travail, ont dit depuis longtemps des ouvriers d'une intelligence remarquable, c'est avoir le droit de faire sa corvée. Ce que nous devons rechercher, ce que la République doit développer, ce sont les droits du travail, qui assureront une bonne répartition d'une production plus abondante.
Ces droits, l'économie politique les a depuis longtemps proclamés et défendus; cette science sans entrailles est consacrée tout entière à préparer les moyens pratiques d'amélioration qui, après avoir émancipé l'ouvrier des entraves de l'ancien régime, l'amèneront à l'indépendance éclairée, apanage des citoyens d'un pays libre. Il n'est pas un écrit des maîtres de cette science tant calomniée, qui ne respire le plus sincère amour de ceux qui souffrent; qui ne tende à réprimer toute spoliation, à raviver les sentiments d'équité et de légitime rémunération. Si c'est un crime que de vouloir créer des hommes libres de nom et de fait, et non des masses inertes, l'économie politique en est coupable; elle ne se contente point de mots sonores, et c'est pour cela qu'elle n'a pas accepté le droit au travail, cette formule d'autant plus retentissante qu'elle est plus vide. Elle se contente humblement de rechercher le mode suivant lequel la richesse commune peut être le plus promptement accrue et le plus équitablement répartie.
Deux doctrines sont en présence: l'une tend à absorber l'individu dans la masse, à faire abdiquer l'esprit de prévoyance, à effacer la personnalité; l'autre veut dégager les travailleurs de toute espèce de servitude. L'homme sera-t il une machine, ou sera-t-il maître de lui-même? Telle est la question que l'économie politique a hardiment résolue dans le sens de la liberté. Elle veut émanciper l'homme; aussi se retire-t-elle de cette atmosphère de tutelle qui nourrit l'imprévoyance et la faiblesse; elle veut accroître la puissance de l'homme sur la nature; aussi l'invite-t-elle à multiplier les lumières et les capitaux, c'est-à-dire les organes extérieurs que l'intelligence cultivée sait s'adjoindre pour dominer de plus en plus la matière; en un mot, elle vise à rendre le travail abondant et productif, et à augmenter la part qui doit revenir au travailleur; car c'est l'accroissement du profit recueilli par l'application des forces humaines, qui est à ses yeux le signe infaillible du progrès. Si c'est là une utopie, elle est au moins grande et généreuse, car elle prend son point d'appui dans la liberté de l'esprit humain, dont la liberté de l'industrie n'est que la manifestation matérielle, comme la liberté de la pensée en est la manifestation morale.
Au moment où nous tracions ces lignes, M. Proudhon publiait un nouvel écrit sur le droit au travail et le droit de propriété. Nous n'avons nullement l'intention de le suivre dans la démonstration de ce double principe, que la propriété étant la négation du droit au travail, et le droit au travail la négation de la propriété, ces deux droits doivent désormais coexister, afin de faire sortir de leur antinomie nécessaire l'harmonie sociale.
Nous dirons seulement qu'en veillant au développement de l'intelligence, de l'activité, de la prévoyance et des travaux productifs, l'art. 13 de la Constitution ne crée point des concurrents à la propriété, concurrents occupés à la démolir; il lui crée, au contraire, des auxiliaires: car il étend le domaine de l'industrie humaine, ce sol nouveau, illimité, que le travail ajoute à l'espace borné de la terre, et il rend l'accès de la propriété plus facile aux hommes de bonne volonté.
Le problème se résume toujours en ces termes: Faut-il détruire la propriété en promenant partout le niveau destructeur, et en faisant jouer la mine du droit au travail; ou bien faut-il tendre à universaliser la propriété? Selon que la société s'engagera dans l'une ou l'autre voie, elle marchera vers l'égalité dans le bien-être, ou vers l'égalité dans la misère et la souffrance.
L. Wolowski.
-------
V. Opinion de M. Frédéric Bastiat.249
Mon Cher Gaunier,
Vous me demandez mon opinion sur le droit au travail et vous paraissez surpris que je ne l'aie pas manifestée à la tribune de l'Assemblée nationale. Mon silence a tenu uniquement à ce que, quand j'ai demandé la parole, trente de mes collègues l'avaient retenue avant moi.
Si l'on entendait par droit au travail le droit de travailler (qui implique le droit de jouir du fruit de son travail), il ne saurait y avoir de doute. Quant à moi, je ne crois pas avoir jamais écrit deux lignes qui n'ait eu pour but de le défendre.
Mais par droit au travail on entend le droit qu'aurait l'individu d'exiger de l'État, et par force, au besoin, de l'ouvrage et un salaire. Sous aucun rapport cette thèse bizarre ne me semble pouvoir supporter l'examen.
D'abord, l'État a-t il des droits et des devoirs autres que ceux qui préexistent déjà dans les citoyens? J'ai toujours pensé que sa mission était de protéger les droits existants. Par exemple, même abstraction faite de l'État, j'ai le droit de travailler, de disposer du fruit de mon travail. Mes compatriotes ont des droits égaux, et nous avons, en outre, celui de les défendre même par la force. Voilà pourquoi la communauté, la force commune, l'État peut et doit nous protéger dans l'exercice de ces droits. C'est l'action collective et régulière substituée à l'action individuelle et désordonnée, et celle-ci est la raison d'être de celle-là.
Mais ai-je le droit d'exiger par force d'un de mes concitoyens qu'il me fournisse de l'ouvrage et des salaires? Ce droit serait évidemment distinct de son droit de propriété. Et si je ne l'ai pas; si aucun des citoyens qui composent la communauté ne l'a pas davantage, comment lui donnerons-nous naissance en l'exerçant les uns à l'égard des autres par l'intermédiaire de l'État? Quoi! Pierre n'a pas le droit d'exiger par force que Paul lui fournisse du travail et des salaires; mais si tous deux, à frais communs, instituent une force commune, Pierre a le droit d'invoquer cette force, de la tourner contre Paul, afin que celui-ci soit forcé de lui fournir de l'ouvrage? Par la création de cette force commune, le droit au travail est né pour Pierre et le droit de propriété est mort pour Paul! Quelle confusion! quelle logomachie!
Ensuite, il faut qu'on soit parvenu à pervertir singulièrement l'esprit des ouvriers pour leur faire croire que ce prétendu droit leur offre quelque ressource et quelques garanties. On leur montre toujours l'État comme un père de famille, un tuteur qui a des trésors inépuisables et à qui il ne manque qu'un peu de générosité! N'est-il pas bien évident cependant que si l'État, afin de faire travailler Pierre, prend cent francs à Paul, Paul aura cent francs de moins pour faire travailler Jacques? Les choses se passeront exactement comme si Pierre eût exercé directement à l'égard de Paul ce prétendu droit, ou plutôt cette oppression. L'intervention de l'État aura pu être commode pour vaincre les résistances; elle peut même rendre le droit d'oppression spécieux et faire taire la conscience; mais elle ne change pas la nature des choses. La propriété de Paul n'en a pas moins été violée, et s'il y a quelque chose de clair au monde, c'est que la classe ouvrière prise dans son ensemble n'aura pas plus d'ouvrage pour la valeur d'une obole. C'est vraiment une chose triste que les hommes d'intelligence en soient réduits, au xixe siècle, à combattre cette puérilité qui nous fait tenir les yeux toujours ouverts à l'ouvrage que l'État distribue avec l'argent des contribuables, et toujours fermés à l'ouvrage que les contribuables distribueraient eux-mêmes si l'État ne leur eût pas pris cet argent!
Enfin, quand les ouvriers voudront y réfléchir, ils s'apercevront que le droit au travail serait pour eux l'inauguration de la misère. L'existence de ce droit a pour collectif nécessaire la non-existence du droit de propriété. Pour s'en convaincre, il suffit de faire abstraction un instant de l'intervention de l'Etat, et de se demander ce qui arriverait si nous exercions directement ce prétendu droit les uns envers les autres: il est bien clair que la notion même de propriété serait anéantie. Or, sans propriété il n'y a pas de formation possible de capital, et sans formation de capital il n'y a pas d'ouvrage possible pour les ouvriers. Le droit au travail, c'est donc, en résumé, la misère universelle poussée jusqu'à la destruction. Le jour où ou l'a seulement mis en discussion, le travail a diminué pour les ouvriers dans une proportion énorme; le jour où il serait promulgué, il n'y aurait plus de travail que pendant le court espace de temps nécessaire pour que l'État pût consommer la destruction de tous les capitaux.
Frédéric Bastiat.
41.Gustave de Molinari on “The Private Production of Security I” (February 1849)↩
[Word Length: 5,569]
Source
Gustave de Molinari, "De la production de la sécurité," in Journal des Economistes, Vol. XXII, no. 95, 15 February, 1849), pp. 277-90.
De la production de la sécurité250
Il y a deux manières de considérer la société. Selon les uns, aucune loi providentielle, immuable, n'a présidé à la formation des différentes associations humaines; organisées d'une manière purement factice par des législateurs primitifs, elles peuvent être, en conséquence, modifiées ou refaites par d'autres législateurs, à mesure que la science sociale progresse. Dans ce système le gouvernement joue un rôle considérable, car c'est au gouvernement, dépositaire du principe d'autorité, qu'incombe la tâche de modifier, de refaire journellement la société.
Selon les autres, au contraire, la société est un fait purement naturel; comme la terre qui la supporte, elle se meut en vertu de lois générales, préexistantes. Dans ce système, il n'y a point, à proprement parler, de science sociale; il n'y a qu'une science économique qui étudie l'organisme naturel de la société et qui montre comment fonctionne cet organisme.
Quelle est, dans ce dernier système, la fonction du gouvernement et son organisation naturelle, voilà ce que nous nous proposons d'examiner.
I.
Pour bien définir et délimiter la fonction du gouvernement, il nous faut rechercher d'abord ce que c'est que la société et quel est son objet.
À quelle impulsion naturelle obéissent les hommes en se réunissant en société? Ils obéissent à l'impulsion ou, pour parler plus exactement, à l'instinct de la sociabilité. La race humaine est essentiellement sociable. Comme les castors et, en général, comme les espèces animales supérieures, les hommes sont portés d'instinct à vivre en société.
Quelle est la raison d'être de cet instinct?
L'homme éprouve une multitude de besoins à la satisfaction desquels sont attachées des jouissances et dont la non-satisfaction lui occasionne des souffrances. Or, seul, isolé, il ne peut pourvoir que d'une manière incomplète, insuffisante à ces besoins qui le sollicitent sans cesse. L'instinct de la sociabilité le rapproche de ses semblables, le pousse à se mettre en communication avec eux. Alors s'établit, sous l'impulsion de l'intérêt des individus ainsi rapprochés, une certaine division au travail, nécessairement suivie d'échanges; bref, on voit se fonder une organisation; moyennant laquelle l'homme peut satisfaire à ses besoins, beaucoup plus complétement qu'il ne le pourrait en demeurant isolé.
Cette organisation naturelle se nomme la société.
L'objet de la société, c'est donc la satisfaction plus complète des besoins de l'homme; le moyen, c'est la division du travail et l'échange.
Au nombre des besoins de l'homme, il en est un d'une espèce particulière et qui joue un rôle immense dans l'histoire de l'humanité, c'est le besoin de sécurité.
Quel est ce besoin?
Soit qu'ils vivent isolés ou en société, les hommes sont, avant tout, intéressés à conserver leur existence et les fruits de leur travail. Si le sentiment de la justice était universellement répandu sur la terre ; si, par conséquent, chaque homme se bornait à travailler et à échanger les fruits de son travail, sans songer à attenter à la vie ou à s'emparer, par violence ou par ruse, des fruits du travail des autres hommes; si chacun avait, en un mot, une instinctive horreur pour tout acte nuisible à autrui, il est certain que la sécurité existerait naturellement sur la ferre, et qu'aucune institution artificielle ne serait nécessaire pour la fonder. Malheureusement il n'en est point ainsi. Le sentiment de la justice semble n'être l'apanage que de certaines natures élevées, exceptionnelles. Parmi les races inférieures, il n'existe qu'à l'état rudimentaire. De là, les innombrables atteintes portées depuis l'origine du monde, depuis l'époque de Caïn et Abel, à la vie et à la propriété des personnes.
De là aussi, la fondation d'établissements ayant pour objet de garantir à chacun la possession paisible de sa personne et de ses biens.
Ces établissements ont reçu le nom de gouvernements.
Partout, au sein des peuplades les moins éclairées, on rencontre un gouvernement, tant est général et urgent le besoin de sécurité auquel un gouvernement pourvoit.
Partout, les hommes se résignent aux sacrifices les plus durs plutôt que de se passer de gouvernement, partant de sécurité , et l'on ne saurait dire qu'en agissant ainsi, ils calculent mal.
Supposez, en effet ; qu'un homme se trouve incessamment menacé dans sa personne et dans ses moyens d'existence, sa première et sa plus constante préoccupation ne sera-t elle pas de se préserver des dangers qui l'environnent? Cette préoccupation, ce soin, ce travail absorberont nécessairement la plus grande partie de son temps, ainsi que les facultés les plus énergiques et les plus actives de son intelligence. Il ne pourra, en conséquence, appliquer à la satisfaction de ses autres besoins qu'un travail insuffisant, précaire et une attention fatiguée.
Alors même que cet homme serait obligé d'abandonner une partie très-considérable de son temps, de son travail à celui qui s'engagerait à lui garantir la possession paisible de sa personne et de ses biens, ne gagnerait-il pas encore à conclure le marché?
Toutefois, son intérêt évident n'en serait pas moins de se procurer la sécurité au plus bas prix possible.
II.
S'il est une vérité bien établie en économie politique, c'est celle-ci:
Qu'en toutes choses, pour toutes les denrées servant à pourvoir à ses besoins matériels ou immatériels, le consommateur est intéressé à ce que le travail et l'échange demeurent libres, car la liberté du travail et de l'échange ont pour résultat nécessaire et permanent un maximum d'abaissement dans le prix.
Et celle-ci:
Que l'intérêt du consommateur d'une denrée quelconque doit toujours prévaloir sur l'intérêt du producteur.
Or, en suivant ces principes, on aboutit à cette conclusion rigoureuse:
Que la production de la sécurité doit, dans l'intérêt des consommateurs de cette denrée immatérielle, demeurer soumise à la loi de la libre concurrence.
D'où il résulte:
Qu'aucun gouvernement ne devrait avoir le droit d'empêcher un autre gouvernement de s'établir concurremment avec lui, ou d'obliger les consommateurs de sécurité de s'adresser exclusivement à lui pour cette denrée.
Cependant, je dois dire qu'on a, jusqu'à présent, reculé devant cette conséquence rigoureuse du principe de la libre concurrence.
Un des économistes qui ont étendu le plus loin l'application du principe de liberté, M. Charles Dunoyer, pense « que les fonctions des gouvernements ne sauraient jamais tomber dans le domaine de l'activité privée.251 »
Voilà donc une exception claire, évidente, apportée au principe de la libre concurrence.
Cette exception est d'autant plus remarquable, qu'elle est unique. Sans doute, on rencontre des économistes qui établissent des exceptions plus nombreuses à ce principe; mais nous pouvons hardiment affirmer que ce ne sont pas des économistes purs. Les véritables économistes s'accordent généralement à dire, d'une part, que le gouvernement doit se borner à garantir la sécurité des citoyens; d'une autre part, que la liberté du travail et de l'échange doit être, pour tout le reste, entière, absolue.
Mais quelle est la raison d'être de l'exception relative à la sécurité? Pour quelle raison spéciale la production de la sécurité ne peut-elle être abandonnée à la libre concurrence? Pourquoi doit-elle être soumise à un autre principe et organisée en vertu d'un autre système?
Sur ce point, les maîtres de la science se taisent, et M. Dunoyer, qui a clairement signalé l'exception, ne recherche point sur quel motif elle s'appuie.
III.
Nous sommes, en conséquence, amenés à nous demander si cette exception est fondée, et si elle peut l'être aux yeux d'un économiste.
Il répugne à la raison de croire qu'une loi naturelle bien démontrée comporte aucune exception. Une loi naturelle est partout et toujours, ou elle n'est pas. Je ne crois pas, par exemple, que la loi de la gravitation universelle, qui régit le monde physique, se trouve en aucun cas et sur aucun point de l'univers suspendue. Or, je considère les lois économiques comme des lois naturelles, et j'ai autant de foi dans le principe de la division du travail et dans le principe de la liberté du travail et de l'échange que j'en puis avoir dans la loi de la gravitation universelle. Je pense donc que si ces principes peuvent subir des perturbations, en revanche, ils ne comportent aucune exception.
Mais, s'il en est ainsi, la production de la sécurité ne doit pas être soustraite à la loi de la libre concurrence; et, si elle l'est, la société tout entière en souffre un dommage.
Ou ceci est logique et vrai, ou les principes sur lesquels se fonde la science économique ne sont pas des principes.
IV.
Il nous est donc démontré à priori, à nous qui avons foi dans les principes de la science économique, que l'exception signalée plus haut n'a aucune raison d'être, et que la production de la sécurité doit, comme toute autre, être soumise à la loi de la libre concurrence.
Cette conviction acquise, que nous reste-t-il à faire? Il nous reste à rechercher comment il se fait que la production de la sécurité ne soit point soumise à la loi de la libre concurrence, comment il se fait qu'elle soit soumise à des principes différents.
Quels sont ces principes?
Ceux du monopole et du communisme.
Il n'y a pas, dans le monde, un seul établissement de l'industrie de la sécurité, un seul gouvernement qui ne soit basé sur le monopole ou sur le communisme.
A ce propos nous ferons, en passant, une simple remarque.
L'économie politique réprouvant également le monopole et le communisme dans les diverses branches de l'activité humaine , où elle les a jusqu'à présent aperçus, ne serait-il pas étrange, exorbitant qu'elle les acceptât dans l'industrie de la sécurité?
V.
Examinons maintenant comment il se fait que tous les gouvernements connus soient soumis à la loi du monopole, ou organisés en vertu du principe communiste.
Recherchons d'abord ce qu'on entend par monopole et par communisme.
C'est une vérité d'observation que plus les besoins de l'homme sont urgents, nécessaires, plus considérables sont les sacrifices qu'il consent à s'imposer pour les satisfaire. Or, il y a des choses qui se trouvent abondamment dans la nature, et dont la production n'exige qu'un très-faible travail; mais qui, servant à apaiser ces besoins urgents, nécessaires, peuvent en conséquence acquérir une valeur d'échange hors de toute proportion avec leur valeur naturelle. Nous citerons comme exemple le sel. Supposez qu'un homme ou une association d'hommes réussisse à s'attribuer exclusivement la production et la vente du sel, il est évident que cet homme ou cette association pourra élever le prix de cette denrée bien au-dessus de sa valeur, bien au-dessus du prix qu'elle aurait sous le régime de la libre concurrence.
On dira alors que cet homme ou cette association possède un monopole, et que le prix du sel est un prix de monopole.
Mais il est évident que les consommateurs ne consentiront point librement à payer la surtaxe abusive du monopole; il faudra les y contraindre, et pour les y contraindre, il faudra employer la force.
Tout monopole s'appuie nécessairement sur la force.
Lorsque les monopoleurs cessent d'être plus forts que les consommateurs exploités par eux, qu'arrive-t-il?
Toujours, le monopole finit par disparaître, soit violemment, soit à la suite d'une transaction amiable. Que met-on à la place?
Si les consommateurs ameutés, insurgés, se sont emparés du matériel de l'industrie du sel, il y a toutes probabilités qu'ils confisqueront à leur profit cette industrie, et que leur première pensée sera, non pas de l'abandonner à la libre concurrence, mais bien de l'exploiter, en commun, pour leur propre compte. Ils nommeront, en conséquence, un directeur ou un comité directeur de l'exploitation des salines, auquel ils alloueront les fonds nécessaires pour subvenir aux frais de la production du sel; puis, comme l'expérience du passé les aura rendus ombrageux, méfiants; comme ils craindront que le directeur désigné par eux ne s'empare de la production pour son propre compte, et ne reconstitue à son profit, d'une manière ouverte ou cachée, l'ancien monopole, ils éliront des délégués, des représentants chargés de voter les fonds nécessaires pour les frais de production, d'en surveiller l'emploi, et d'examiner si le sel produit est également distribué entre tous les ayants droit. Ainsi sera organisée la production du sel.
Cette forme d'organisation de la production a reçu le nom de communisme.
Lorsque cette organisation ne s'applique qu'à une seule denrée, on dit que le communisme est partiel.
Lorsqu'elle s'applique à toutes, les denrées, on dit que lé communisme est complet.
Mais que le communisme soit partiel ou complet, l'économie politique ne l'admet pas plus que le monopole, dont il n'est que l'extension.
VI.
Ce qui vient d'être dit du sel n'est-il pas visiblement applicable à la sécurité ; n'est-ce pas l'histoire de toutes les monarchies et de toutes les républiques?
Partout, la production de la sécurité à commencé par être organisée en monopole, et partout, de nos jours, elle tend à s'organiser en communisme. Voici pourquoi.
Parmi les denrées matérielles ou immatérielles nécessaires à l'homme, aucune, si ce n'est peut-être le blé, n'est plus Indispensable, et ne peut, par conséquent, supporter une plus forte taxe de monopole.
Aucune, non plus, ne peut aussi aisément tomber en monopole.
Quelle est, en effet, la situation des hommes qui ont besoin de sécurité? C'est la faiblesse. Quelle est la situation de ceux qui s'engagent è leur pro-' curer cette sécurité nécessaire? C'est la forcé. S'il en était autrement, si les consommateurs de sécurité étaient plus forts que les producteurs , ils n'emprunteraient évidemment point leur secours.
Or, si les producteurs de sécurité sont originairement plus forts que les consommateurs, ne peuvent-ils pas aisément imposer à ceux-ci !e régime du monopole?
Partout, à l'origine des sociétés, on voit donc les races les plus fortes, les plus guerrières, s'attribuer le gouvernement exclusif des sociétés; partout on volt ces races s'attribuer, dans certaines circonscriptions plus ou moins étendues, selon leur nombre et leur force, le monopole de la sécurité.
Et, ce monopole étant excessivement profitable par sa nature même, partout on voit aussi les race» investies du monopole de la sécurité se livrer à des luttes acharnées, afin d'augmenter l'étendue de leur marché, le nombre de leurs consommateurs forcés, partant la quotité de leurs bénéfices.
La guerre était la conséquence nécessaire, inévitable de l'établissement du monopole de la sécurité.
Comme une autre conséquence inévitable, ce monopole devait engendrer tous les autres monopoles.
En examinant la situation des monopoleurs de la sécurité, les producteurs des autres denrées ne pouvaient manquer de reconnaître que rien ail monde n'était plus avantageux c|Ue le monopole. Ils devaient, en conséquence, être tentés, à leur tour, d'augmenter par le même procédé les bénéfices de leur industrie. Mais pour accaparer, au détriment des consommateurs, le monopole de la denrée qu'ils produisaient, que leur fallait-il? II leur fallait la force. Or, cette force, nécessaire pour comprimer les résistances des consommateurs intéressés, ils ne la possédaient point. Que firent-ils ? Ils l'empruntèrent, moyennant finances, à ceux qui la possédaient. Ils' sollicitèrent et obtinrent, au prix de certaines redevances, le privilège exclusif d'exercer leur industrie dans certaines circonscriptions déterminées. L'octroi de ces privilèges rapportant de bonnes sommes d'argent aux producteurs de sécurité, le monde fut bientôt couvert de monopoles. Le travail et l'échange furent partout entravés, enchaînés, et la condition des masses demeura la plus misérable possible.
Cependant, après de longs siècles de souffrances, les lumières s'étant peu à peu répandues dans le monde, les masses qu'étouffait ce réseau de privilèges commencèrent à réagir contre les privilégiés, et à demander la liberté, c'est-à-dire la suppression des monopoles.
Il y eut alors de nombreuses transactions. En Angleterre, par exemple, que se passa-t-il? La race qui gouvernait le pays et qui se trouvait organisée en compagnie (la féodalité), ayant à sa tête un directeur héréditaire (le roi), et un Conseil d'administration également héréditaire (la Chambre des lords), fixait, à l'origine, au taux qu'il lui convenait de fixer, le prix de la sécurité dont elle avait lé monopole: Entre les producteurs de sécurité et les consommateurs il n'y avait aucun débat. C'était le régime du bon plaisir. Mais, à la suite des temps, les consommateurs, ayant acquis la conscience de leur nombre et de leur force, se soulevèrent contre le régime de l'arbitraire pur, et ils obtinrent de débattre avec les producteurs le prix de la denrée. A cet effet, ils désignèrent des délégués qui se réunirent en Chambre des communes, afin de discuter la quotité de l'impôt, prix de la sécurité. Ils obtinrent ainsi d'être moins pressurés. Toutefois, les membres de la Chambre des communes étant nommés sous l'influence immédiate des producteurs de sécurité, le débat n'était pas franc, et le prix de la denrée continuait à dépasser sa valeur naturelle. Un jour, les consommateurs ainsi exploités s'insurgèrent contre les producteurs et les dépossédèrent de leur industrie. Ils entreprirent alors d'exercer eux-mêmes cette industrie et ils choisirent dans ce but un directeur d'exploitation assisté d'un Conseil. C'était le communisme se substituant au monopole. Mais la combinaison ne réussit point, et, vingt ans plus tard, le monopole primitif fut rétabli. Seulement les monopoleurs eurent la sagesse de ne point restaurer le régime du bon plaisir; ils acceptèrent le libre débat de l'impôt, en ayant soin, toutefois, de corrompre incessamment les délégués de la partie adverse. Ils mirent à la disposition de ces délégués divers emplois de l'administration de la sécurité, et ils allèrent même jusqu'à admettre les plus influents au sein de leur Conseil supérieur. Rien de plus habile assurément qu'une telle conduite. Cependant les consommateurs de sécurité finirent par s'apercevoir de ces abus, et ils demandèrent la réforme du Parlement. Longtemps refusée, la réforme fut enfin conquise, et, depuis cette époque, les consommateurs ont obtenu un notable allégement de leurs charges.
En France, le monopole de la sécurité, après avoir, de même, subi des vicissitudes fréquentes et des modifications diverses, vient d'être renversé pour la seconde fois. Comme autrefois en Angleterre, on a substitué à ce monopole exercé d'abord au profit d'une caste, ensuite au nom d'une certaine classe de la société, la production commune. L'universalité des consommateurs, considérés comme actionnaires, ont désigné un directeur chargé, pendant une certaine période, de l'exploitation, et une assemblée chargée de contrôler les actes du directeur et de son administration.
Nous nous contenterons de faire une simple observation au sujet de ce nouveau régime.
De même que le monopole de la sécurité devait logiquement engendrer tous les autres monopoles, le communisme de la sécurité doit logiquement engendrer tous les autres communismes.
En effet, de deux choses l'une:
Ou la production communiste est supérieure à la production libre, ou elle ne l'est point?
Si oui, elle l'est non-seulement pour la sécurité, mais pour toutes choses.
Si non, le progrès consistera inévitablement à la remplacer par la production libre.
Communisme complet ou liberté complète, voilà l'alternative!
VII.
Mais se peut-il concevoir que la production de la sécurité soit organisée autrement qu'en monopole ou en communisme? Se peut-il concevoir qu'elle soit abandonnée à la libre concurrence?
A cette question les écrivains dits politiques répondent unanimement: Non.
Pourquoi? Nous allons le dire.
Parce que ces écrivains, qui s'occupent spécialement des gouvernements, ne connaissent pas la société; parce qu'ils la considèrent comme une œuvre factice, que les gouvernements ont incessamment mission de modifier ou de refaire.
Or, pour modifier ou refaire la société, il faut nécessairement être pourvu d'une autorité supérieure à celle des différentes individualités dont elle se compose.
Cette autorité qui leur donne le droit de modifier ou de refaire à leur guise la société, de disposer comme bon leur semble des personnes et des propriétés, les gouvernements de monopole affirment la tenir de Dieu lui-même; les gouvernements communistes, de la raison humaine manifestée dans la majorité du peuple souverain.
Mais cette autorité supérieure, irrésistible, les gouvernements de monopole et les gouvernements communistes la possèdent-ils véritablement? Ont-ils, en réalité, une autorité supérieure à celle que pourraient avoir des gouvernements libres? Voilà ce qu'il importe d'examiner.
VIII.
S'il était vrai que la société ne se trouvât point naturellement organisée; s'il était vrai que les lois en vertu desquelles elle se meut dussent être incessamment modifiées ou refaites, les législateurs auraient nécessairement besoin d'une autorité immuable, sacrée. Continuateurs de la Providence sur la terre, ils devraient être respectés presque à l'égal de Dieu. S'il en était autrement, ne leur serait-il pas impossible de remplir leur mission? On n'intervient pas, en effet, dans les affaires humaines, on n'entreprend pas de les diriger, de les régler, sans offenser journellement une multitude d'intérêts. A moins que les dépositaires du pouvoir ne soient considérés comme appartenant à une essence supérieure ou chargés d'une mission providentielle, les intérêts lésés résistent.
De là la fiction du droit divin.
Cette fiction était certainement la meilleure qu'on pût imaginer. Si vous parvenez à persuader à la foule que Dieu lui-même a élu certains hommes ou certaines races pour donner des lois à la société et la gouverner, nul ne songera évidemment à se révolter contre ces élus de la Providence, et tout ce que fera le gouvernement sera bien fait. Un gouvernement de droit divin est impérissable.
A une condition seulement, c'est que l'on croie au droit divin.
Si l'on s'avise, en effet, de penser que les conducteurs de peuples ne reçoivent pas directement leurs inspirations de la Providence même, qu'ils obéissent à des impulsions purement humaines, le prestige qui les environne disparaîtra, et l'on résistera irrévérencieusement à leurs décisions souveraines, comme on résiste à tout ce qui vient des hommes, à moins que l'utilité n'en soit clairement démontrée.
Aussi est-il curieux de voir avec quel soin les théoriciens du droit divin s'efforcent d'établir la surhumanité des races en possession de gouverner les hommes.
Écoutons, par exemple, M. Joseph de Maistre:
« L'homme ne peut faire de souverains. Tout au plus il peut servir d'instrument pour déposséder un souverain et livrer ses Etals à un autre souverain déjà prince. Du reste, il n'a jamais existé de famille souveraine dont on puisse assigner l'origine plébéienne. Si ce phénomène paraissait, ce serait une époque du monde.
«... Il est écrit: C'est moi qui fais les souverains. Ceci n'est point une phrase d'église, une métaphore de prédicateur; c'est la vérité littérale, simple et palpable. C'est une loi du monde politique. Dieu fait les rois, au pied de la lettre. Il prépare les races royales, il les mûrit au milieu d'un nuage qui cache leur origine. Elles paraissent ensuite couronnées de gloire et d'honneur; elles se placent.252 »
D'après ce système, qui incarne la volonté de la Providence dans certains hommes et qui revêt ces élus, ces oints d'une autorité quasi-divine, les sujets n'ont évidemment aucun droit; ils doivent se soumettre, sans examen, aux décrets de l'autorité souveraine, comme s'il s'agissait des décrets de la Providence même.
Le corps est l'outil de l'âme, disait Plutarque, et l'âme est l'outil de Dieu. Selon l'école du droit divin, Dieu ferait choix de certaines âmes et s'en servirait comme d'outils pour gouverner le monde.
Si les hommes avaient foi dans cette théorie, rien assurément ne pourrait ébranler un gouvernement de droit divin.
Par malheur, ils ont complètement cessé d'y avoir foi.
Pourquoi?
Parce qu'un beau jour ils se sont avisés d'examiner et de raisonner, et qu'en examinant, en raisonnant, ils ont découvert que leurs gouvernants ne les gouvernaient pas mieux qu'ils n'auraient pu le faire eux-mêmes, simples mortels sans communication avec la Providence.
Le libre examen a démonétisé la fiction du droit divin, à ce point que les sujets des monarques ou des aristocraties de droit divin ne leur obéissent plus qu'autant qu'ils croient avoir intérêt à leur obéir.
La fiction communiste a-t-elle eu meilleure fortune?
D'après la théorie communiste, dont Rousseau est le grand-prêtre, l'autorité ne descend plus d'en haut, elle vient d'en bas. Le gouvernement ne la demande plus à la Providence, il la demande aux hommes réunis, à la nation une, indivisible et souveraine.
Voici ce que supposent les communistes, partisans de la souveraineté du peuple. Ils supposent que la raison humaine a le pouvoir de découvrir les meilleures lois, l'organisation la plus parfaite qui conviennent à la société ; et que, dans la pratique, c'est à la suite d'un libre débat entre des opinions opposées que ces lois se découvrent; que s'il n'y a point unanimité, s'il y a partage encore après le débat, c'est la majorité qui a raison, comme renfermant un plus grand nombre d'individualités raisonnables (ces individualités sont, bien entendu, supposées égales, sinon l'échafaudage croule); en conséquence, ils affirment que les décisions de la majorité doivent faire loi, et que la minorité est tenue de s'y soumettre, alors même qu'elles blesseraient ses convictions les plus enracinées et ses intérêts les plus chers.
Telle est la théorie; mais, dans la pratique, l'autorité des décisions de la majorité a-t-elle bien ce caractère irrésistible, absolu qu'on lui suppose ? Est-elle toujours, en tous cas, respectée par la minorité? Peut-elle l'être? Prenons un exemple.
Supposons que le socialisme réussisse à se propager parmi les classes ouvrières des campagnes, comme il s'est déjà propagé parmi les classes ouvrières des villes; qu'il se trouve, en conséquence, à l'état de majorité dans le pays, et que, profitant de cette situation, il envoie à l'Assemblée législative une majorité socialiste et nomme un président socialiste ; supposez que cette majorité et ce président, investis de l'autorité souveraine, décrètent, ainsi que le demandait M. Proudhon, la levée d'un impôt de trois milliards sur les riches, afin d'organiser le travail des pauvres, est-il probable que la minorité se soumettra paisiblement à cette spoliation ini~ que et absurde, mais légale, mais constitutionnelle?
Non sans doute, elle n'hésitera pas à méconnaître l'autorité de la majorité et à défendre sa propriété.
Sous ce régime, comme sous le précédent, on n'obéit donc aux dépositaires de l'autorité qu'autant qu'on croit avoir intérêt à leur obéir.
Ce qui nous conduit à affirmer que le fondement moral du principe d'autorité n'est ni plus solide ni plus large, sous un régime de monopole ou de communisme, qu'il ne pourrait l'être sous un régime de liberté.
IX.
Supposez néanmoins que les partisans d'une organisation factice, monopoleurs ou communistes, aient raison; que la société ne soit point naturellement organisée, et qu'aux hommes incombe incessamment la tâche de faire et de défaire les lois qui la régissent, voyez dans quelle lamentable situation se trouvera le inonde. L'autorité morale des gouvernants ne s'appuyant, en réalité, que sur l'intérêt des gouvernés, et ceux-ci ayant une naturelle tendance à résistera tout ce qui blesse leur Intérêt, il faudra que la force matérielle prête incessamment secours à l'autorité méconnue.
Monopoleurs et communistes ont, du reste, parfaitement compris cette nécessité.
Si quelqu'un, dit M. de Maistre, essaye de se soustraire à l'autorité des élus de Dieu, qu'il soit livré au bras séculier, que le bourreau fasse son office.
Si quelqu'un méconnaît l'autorité des élus du peuple, disent les théoriciens de l'école de Rousseau, s'il résiste à une décision quelconque de la majorité, qu'il soit puni comme criminel envers le peuple souverain, que l'échafaud en fasse justice.
Ces deux écoles, qui prennent pour point de départ l'organisation factice, aboutissent donc nécessairement au même terme, à la TERREUR.
X.
Qu'on nous permette maintenant de formuler une simple hypothèse.
Supposons une société naissante : les hommes qui la composent se mettent à travailler et à échanger les fruits de leur travail. Un naturel instinct révèle à ces hommes que leur personne, la terre qu'ils occupent et cultivent, les fruits de leur travail, sont leurs propriétés, et que nul, hors eux-mêmes, n'a le droit d'en disposer ou d'y toucher. Cet instinct n'est pas hypothétique, il existe. Mais l'homme étant une créature imparfaite, il arrive que ce sentiment du droit de chacun sur sa personne ou sur ses biens ne se rencontre pas au même degré dans toutes les âmes, et que certains individus attentent par violence ou par ruse aux personnes ou aux propriétés d'autrui.
De là, la nécessité d'une industrie qui prévienne ou réprime ces agressions abusives de la force ou de la ruse.
Supposons qu'un homme ou une association d'hommes vienne et dise:
Je me charge, moyennant rétribution, de prévenir ou de réprimer les attentats contre les personnes et les propriétés.
Que ceux donc qui veulent mettre à l'abri de toute agression leurs personnes et leurs propriétés s'adressent à moi.
Avant d'entrer en marché avec ce producteur de sécurité, que feront les consommateurs?
En premier lieu, ils rechercheront s'il est assez puissant pour les protéger.
En second lieu, s'il offre des garanties morales telles qu'on ne puisse redouter de sa part aucune des agressions qu'il se charge de réprimer.
En troisième lieu, si aucun autre producteur de sécurité, présentant des garanties égales, n'est disposé à leur fournir cette denrée à des conditions meilleures.
Ces conditions seront de diverses sortes.
Pour être en état de garantir aux consommateurs pleine sécurité pour leurs personnes et leurs propriétés, et, en cas de dommage, de leur distribuer une prime proportionnée à la perte subie, il faudra, en effet:
1° Que le producteur établisse certaines peines contre les offenseurs des personnes et les ravisseurs des propriétés, et que les consommateurs acceptent de se soumettre à ces peines, au cas où ils commettraient eux-mêmes des sévices contre les personnes et les propriétés;
2° Qu'il impose aux consommateurs certaines gênes, ayant pour objet de lui faciliter la découverte des auteurs de délits;
3° Qu'il perçoive régulièrement, pour couvrir ses frais de production ainsi que le bénéfice naturel de son industrie, une certaine prime, variable selon la situation des consommateurs, les occupations particulières auxquelles ils se livrent, l'étendue, la valeur et la nature de leurs propriétés.
Si ces conditions, nécessaires à l'exercice de cette industrie, conviennent aux consommateurs, le marché sera conclu; sinon les consommateurs ou se passeront de sécurité, ou s'adresseront à un autre producteur.
Maintenant si l'on considère la nature particulière de l'industrie de la sécurité, on s'apercevra que les producteurs seront obligés de restreindre leur clientèle à certaines circonscriptions territoriales. Ils ne feraient évidemment pas leurs frais s'ils s'avisaient d'entretenir une police dans des localités où ils ne compteraient que quelques clients. Leur clientèle se groupera naturellement autour du siège de leur industrie. Ils ne pourront néanmoins abuser de cette situation pour faire la loi aux consommateurs. En cas d'une augmentation abusive du prix de la sécurité, ceux-ci auront, en effet, toujours la faculté de donner leur clientèle à un nouvel entrepreneur, ou à l'entrepreneur voisin.
De cette faculté laissée au consommateur d'acheter où bon lui semble la sécurité, naît une constante émulation entre tous les producteurs, chacun s'efforçant, par l'attrait du bon marché ou d'une justice plus prompte, plus complète, meilleure, d'augmenter sa clientèle ou de la maintenir.253
Que le consommateur ne soit pas libre, au contraire, d'acheter de la sécurité où bon lui semble, et aussitôt vous voyez une large carrière s'ouvrir à l'arbitraire et à la mauvaise gestion. La justice devient coûteuse et lente, la police vexatoire, la liberté individuelle cesse d'être respectée, le prix de la sécurité est abusivement exagéré, inégalement prélevé, selon la force, l'influence dont dispose telle ou telle classe de consommateurs, les assureurs engagent des luttes acharnées pour s'arracher mutuellement des consommateurs; on voit, en un mot, surgir à la file tous les abus inhérents au monopole ou au communisme.
Sous le régime de la libre concurrence, la guerre entre les producteurs de sécurité cesse totalement d'avoir sa raison d'être. Pourquoi se feraient-ils la guerre? Pour conquérir des consommateurs? Mais les consommateurs ne se laisseraient pas conquérir. Ils se garderaient certainement de faire assurer leurs personnes et leurs propriétés par des nommes qui auraient attenté, sans scrupule, aux personnes et aux propriétés de leurs concurrents. Si un audacieux vainqueur voulait leur imposer la loi, ils appelleraient immédiatement à leur aide tous les consommateurs libres que menacerait comme eux cette agression, et ils en feraient justice. De même que la guerre est la conséquence naturelle du monopole, la paix est la conséquence naturelle de la liberté.
Sous un régime de liberté, l'organisation naturelle de l'industrie de la sécurité ne différerait pas de celle des autres industries. Dans- les petits cantons un simple entrepreneur pourrait suffire. Cet entrepreneur léguerait son industrie à son fils, ou la céderait à un autre entrepreneur. Dans les cantons étendus, une compagnie réunirait seule assez de ressources pour exercer convenablement cette importante et difficile industrie. Bien dirigée, cette compagnie pourrait aisément se perpétuer, et la sécurité se perpétuerait avec elle. Dans l'industrie de la sécurité, aussi bien que dans la plupart des autres branches de la production, ce dernier mode d'organisation finirait probablement par se substituer au premier.
D'une part, ce serait la monarchie, de l'autre la république; mais la monarchie sans le monopole, et la république sans le communisme:
Des deux parts ce serait l'autorité acceptée et respectée au nom de l'utilité, et non l'autorité imposée par la terreur.
Qu'une telle hypothèse puisse se réaliser, voilà sans doute ce qui sera contesté. Mais, au risque d'être qualifiés d'utopistes, nous dirons que cela n'est pas contestable, et qu'un attentif examen des faits résoudra de plus en plus, en faveur de la liberté, le problème du gouvernement, de même que tous les autres problèmes économiques. Nous sommes bien convaincus, en ce qui nous concerne, que des associations s'établiront un jour pour réclamer la liberté de gouvernement, comme il s'en est établi pour réclamer la liberté du commerce.
Et nous n'hésitons pas à ajouter qu'après que ce dernier progrès aura été réalisé, tout obstacle factice à la libre action des lois naturelles qui régissent le monde économique ayant disparu, la situation des différents membres de la société deviendra la meilleure possible.
42.Gustave de Molinari on “The Liberty of Government” (mid-1849)↩
[Word Length: 7,637]
Source
Gustave de Molinari, Les Soirées de la Rue Saint-Lazare; Entretiens sur les lois économiques et défense de la propriété (Paris: Guillaumin, 1849). “Onzième Soirée,” pp. 303-337.
Brief Bio of the Author: Gustave de Molinari (1819-1912)
[Gustave de Molinari (1819-1912)]
Gustave de Molinari (1819-1912) was born in Belgium but spent most of his working life in Paris, becoming the leading representative of the laissez-faire school of classical liberalism in France in the second half of the nineteenth century. His liberalism was based upon the theory of natural rights (especially the right to property and individual liberty), and he advocated complete laissez-faire in economic policy and the ultra-minimal state in politics. During the 1840s he joined the Société d’économie politique and was active in the Association pour la liberté des échanges. During the 1848 revolution he vigorously opposed the rise of socialism and published shortly thereafter two rigorous defenses of individual liberty in which he pushed to its ultimate limits his opposition to all state intervention in the economy, including the state's monopoly of security. During the 1850s he contributed a number of significant articles on free trade, peace, colonization, and slavery to the Dictionnaire de l'économie politique (1852-53) before going into exile in his native Belgium to escape the authoritarian regime of Napoleon III. He became a professor of political economy at the Musée royale de l'industrie belge and published a significant treatise on political economy (Cours d'économie politique, 1855) and a number of articles opposing state education. In the 1860s Molinari returned to Paris to work on the Journal des debats, becoming editor from 1871 to 1876. Toward the end of his long life Molinari was appointed editor of the leading journal of political economy in France, the Journal des économistes (1881-1909). Some of Molinari’s more important works include Les Soirées de la rue Saint-Lazare (1849), L'Évolution économique du dix-neuvième siècle: Théorie du progrès (1880), and L'Évolution politique et la révolution (1884). [DMH]
ONZIÈME SOIRÉE
SOMMAIRE: Du gouvernement et de sa fonction.254—Gouvernements de monopole et gouvernements communistes.—De la liberté de gouvernement.—Du droit divin.—Que le droit divin est identique au droit au travail.—Vices des gouvernements de monopole.—La guerre est la conséquence inévitable de ce système.—De la souveraineté du peuple.—Comment on perd sa souveraineté.—Comment on la recouvre.—Solution libérale.—Solution communiste.—Gouvernements communistes.—Leurs vices.—Centralisation et décentralisation.—De l’administration de la justice.—Son ancienne organisation.—Son organisation actuelle.—Insuffisance du jury.—Comment l’administration de la sécurité et celle de la justice pourraient être rendues libres.—Avantages des gouvernements libres.—Ce qu’il faut entendre par nationalité.
Le Conservateur.
Dans votre système d’absolue propriété et de pleine liberté économique, quelle est donc la fonction du gouvernement?
L’Économiste.
La fonction du gouvernement consiste uniquement à assurer à chacun la conservation de sa propriété.
Le Socialiste.
Bon, c’est l’État-gendarme de J.-B. Say.
A mon tour, j’ai une question à vous faire:
Il y a aujourd’hui, dans le monde, deux sortes de gouvernements: les uns font remonter leur origine à un prétendu droit divin.....
Le Conservateur.
Prétendu! prétendu! c’est à savoir.
Le Socialiste.
Les autres sont issus de la souveraineté du peuple. Lesquels préférez-vous?
L’Économiste.
Je ne veux ni des uns ni des autres. Les premiers sont des gouvernements de monopole, les seconds sont des gouvernements communistes. Au nom du principe de la propriété, au nom du droit que je possède de me pourvoir moi-même de sécurité, ou d’en acheter à qui bon me semble, je demande des gouvernements libres.
Le Conservateur.
Qu’est-ce à dire?
L’Économiste.
C’est-à-dire, des gouvernements dont je puisse, au gré de ma volonté individuelle, accepter ou refuser les services.
Le Conservateur.
Parlez-vous sérieusement?
L’Économiste.
Vous allez bien voir. Vous êtes partisan du droit divin, n’est-il pas vrai?
Le Conservateur.
Depuis que nous vivons en république, j’y incline assez, je l’avoue.
L’Économiste.
Et vous vous croyez un adversaire du droit au travail?
Le Conservateur.
Si je le crois? mais j’en suis sûr. J’atteste.....
L’Économiste.
N’attestez rien, car vous êtes un partisan avoué du droit au travail.
Le Conservateur.
Mais encore une fois, je.....
L’Économiste.
Vous êtes partisan du droit divin. Or le principe du droit divin est absolument identique au principe du droit au travail.
Qu’est-ce que le droit divin? C’est le Droit que possèdent certaines familles au gouvernement des peuples. Qui leur a conféré ce droit? Dieu lui-même. Lisez plutôt les Considérations sur la France, et la brochure sur le Principe générateur des Constitutions politiques, de M. Joseph de Maistre:
“L’homme ne peut faire de souverain, dit M. de Maistre. Tout au plus il peut servir d’instrument pour déposséder un souverain, et livrer ses États à un autre souverain déjà prince. Du reste, il n’a jamais existé de famille souveraine dont on puisse assigner l’origine plébéienne. Si ce phénomène paraissait, ce serait une époque du monde.
..... Il est écrit: C’est moi qui fais les souverains. Ceci n’est point une phrase d’église, une métaphore de prédicateur; c’est la vérité littérale, simple et palpable. C’est une loi du monde politique. Dieu fait les rois, au pied de la lettre. Il prépare les races royales, il les nourrit au milieu d’un nuage qui cache leur origine. Elles paraissent ensuite couronnées de gloire et d’honneur; elles se placent.”255
Ce qui signifie que Dieu a investi certaines familles du droit de gouverner les hommes, et que nul ne peut les priver de l’exercice de ce droit.
Or, si vous reconnaissez à certaines familles le droit exclusif d’exercer cette espèce particulière d’industrie qu’on appelle le gouvernement, si, encore, vous croyez avec la plupart des théoriciens du droit divin, que les peuples sont tenus de fournir, soit des sujets à gouverner, soit des dotations, en guise d’indemnités de chômages aux membres de ces familles,—et cela pendant toute la durée des siècles,—êtes-vous bien fondé à repousser le Droit au travail? Entre cette prétention abusive d’obliger la société à fournir aux ouvriers le travail qui leur convient, ou une indemnité suffisante, et cette autre prétention abusive d’obliger la société à fournir aux ouvriers des familles royales un travail approprié à leurs facultés et à leur dignité, un travail de gouvernement, ou une Dotation à titre de minimum de subsistances, où est la différence?
Le Socialiste.
En vérité, il n’y en a aucune.
Le Conservateur.
Qu’importe! si la reconnaissance du droit divin est indispensable au maintien de la société.
L’Économiste.
Les socialistes ne pourraient-ils pas vous répondre que la reconnaissance du droit au travail n’est pas moins nécessaire au maintien de la société? Si vous admettez le droit au travail pour quelques-uns, ne devez-vous pas l’admettre pour tous? Le droit au travail est-il autre chose qu’une extension du droit divin?
Vous dites que la reconnaissance du droit divin est indispensable au maintien de la société. Comment donc se fait-il que tous les peuples aspirent à se débarrasser des monarchies de droit divin? Comment se fait-il que les vieux gouvernements de monopole soient les uns ruinés, les autres sur le point de l’être?
Le Conservateur.
Les peuples sont saisis de vertige.
L’Économiste.
Voilà un vertige bien répandu! Mais, croyez-moi, les peuples ont de bonnes raisons pour se débarrasser de leurs vieux dominateurs. Le monopole du gouvernement ne vaut pas mieux qu’un autre. On ne gouverne pas bien, et surtout on ne gouverne pas à bon marché, lorsqu’on n’a aucune concurrence à redouter, lorsque les gouvernés sont privés du droit de choisir librement leurs gouvernants. Accordez à un épicier la fourniture exclusive d’un quartier, défendez aux habitants de ce quartier d’acheter aucune denrée chez les épiciers voisins, ou bien encore de s’approvisionner eux-mêmes d’épiceries, et vous verrez quelles détestables drogues l’épicier privilégié finira par débiter et à quel prix! Vous verrez de quelle façon il s’engraissera aux dépens des infortunés consommateurs, quel faste royal il étalera pour la plus grande gloire du quartier... Eh bien! ce qui est vrai pour les services les plus infimes ne l’est pas moins pour les services les plus élevés. Le monopole d’un gouvernement ne saurait valoir mieux que celui d’une boutique d’épiceries. La production de la sécurité devient inévitablement coûteuse et mauvaise lorsqu’elle est organisée en monopole.
C’est dans le monopole de la sécurité que réside la principale cause des guerres qui ont, jusqu’à nos jours, désolé l’humanité.
Le Conservateur.
Comment cela?
L’Économiste.
Quelle est la tendance naturelle de tout producteur, privilégié ou non? C’est d’élever le chiffre de sa clientèle afin d’accroître ses bénéfices. Or, sous un régime de monopole, quels moyens les producteurs de sécurité peuvent-ils employer pour augmenter leur clientèle?
Les peuples ne comptant pas sous ce régime, les peuples formant le domaine légitime des oints du Seigneur, nul ne peut invoquer leur volonté pour acquérir le droit de les administrer. Les souverains sont donc obligés de recourir aux procédés suivants pour augmenter le nombre de leurs sujets: 1° acheter à prix d’argent des royaumes ou des provinces; 2° épouser des héritières apportant en dot des souverainetés ou devant en hériter plus tard; 3° conquérir de vive force les domaines de leurs voisins. Première cause de guerre!
D’un autre côté, les peuples se révoltant quelquefois contre leurs souverains légitimes, comme il est arrivé récemment en Italie et en Hongrie, les oints du Seigneur sont naturellement obligés de faire rentrer dans l’obéissance ce bétail insoumis. Ils forment dans ce but une sainte alliance et ils font grand carnage des sujets révoltés, jusqu’à ce qu’ils aient apaisé leur rébellion. Mais si les rebelles ont des intelligences avec les autres peuples, ceux-ci se mêlent à la lutte, et la conflagration devient générale. Seconde cause de guerre!
Je n’ai pas besoin d’ajouter que les consommateurs de sécurité, enjeux de la guerre, en payent aussi les frais.
Tels sont les avantages des gouvernements de monopole.
Le Socialiste.
Vous préférez donc les gouvernements issus de la souveraineté du peuple. Vous mettez les républiques démocratiques au-dessus des monarchies et des aristocraties. A la bonne heure!
L’Économiste.
Distinguons, je vous prie. Je préfère les gouvernements issus de la souveraineté du peuple. Mais les républiques que vous nommez démocratiques ne sont pas le moins du monde l’expression vraie de la souveraineté du peuple. Ces gouvernements sont des monopoles étendus, des communismes. Or, la souveraineté du peuple est incompatible avec le monopole et le communisme.
Le Socialiste.
Qu’est-ce donc à vos yeux que la souveraineté du peuple?
L’Économiste.
C’est le droit que possède tout homme de disposer librement de sa personne et de ses biens, de se gouverner lui-même.
Si l’homme-souverain a le droit de disposer, en maître, de sa personne et de ses biens, il a naturellement aussi le droit de les défendre. Il possède le droit de libre défense.
Mais chacun peut-il exercer isolément ce droit? Chacun peut-il être son gendarme et son soldat?
Non! pas plus que le même homme ne peut être son laboureur, son boulanger, son tailleur, son épicier, son médecin, son prêtre.
C’est une loi économique, que l’homme ne puisse exercer fructueusement plusieurs métiers à la fois. Aussi voit-on, dès l’origine des sociétés, toutes les industries se spécialiser, et les différents membres de la société se tourner vers les occupations que leurs aptitudes naturelles leur désignent. Ils subsistent en échangeant les produits de leur métier spécial contre les divers objets nécessaires à la satisfaction de leurs besoins.
L’homme isolé jouit, sans conteste, de toute sa souveraineté. Seulement ce souverain, obligé d’exercer lui-même toutes les industries qui pourvoient aux nécessités de la vie, se trouve dans un état fort misérable.
Lorsque l’homme vit en société, il peut conserver sa souveraineté ou la perdre.
Comment perd-il sa souveraineté?
Il la perd lorsqu’il cesse, d’une manière totale ou partielle, directe ou indirecte, de pouvoir disposer de sa personne et de ses biens.
L’homme ne demeure complétement souverain que sous un régime de pleine liberté. Tout monopole, tout privilége est une atteinte portée à sa souveraineté.
Sous l’ancien régime, nul n’ayant le droit de disposer librement de sa personne et de ses biens, nul n’ayant le droit d’exercer librement toute industrie, la souveraineté se trouvait étroitement limitée.
Sous le régime actuel, la souveraineté n’a point cessé d’être atteinte par une multitude de monopoles et de priviléges, restrictifs de la libre activité des individus. L’homme n’a pas encore pleinement recouvré sa souveraineté.
Comment peut-il la recouvrer?
Deux écoles sont en présence, qui donnent à ce problème des solutions tout opposées: l’école libérale et l’école communiste.
L’école libérale dit: Détruisez les monopoles et les priviléges, restituez à l’homme son droit naturel d’exercer librement toute industrie et il jouira pleinement de sa souveraineté.
L’école communiste dit, au contraire: Gardez-vous d’attribuer à chacun le droit de produire librement toutes choses. Ce serait l’oppression et l’anarchie! Attribuez ce droit à la communauté, à l’exclusion des individus. Que tous se réunissent pour organiser en commun toute industrie. Que l’État soit le seul producteur et le seul distributeur de la richesse.
Qu’y a-t-il au fond de cette doctrine? On l’a dit souvent: il y a l’esclavage. Il y a l’absorption et l’annulation de la volonté individuelle dans la volonté commune. Il y a la destruction de la souveraineté individuelle.
Au premier rang des industries organisées en commun figure celle qui a pour objet de protéger, de défendre contre toute agression la propriété des personnes et des choses.
Comment se sont constituées les communautés dans lesquelles cette industrie s’exerce, la nation et la commune?
La plupart des nations ont été successivement agglomérées par les alliances des propriétaires d’esclaves ou de serfs et par leurs conquêtes. La France, par exemple, est un produit d’alliances et de conquêtes successives. Par les mariages, par la force ou la ruse, les souverains de l’Ile de France étendirent successivement leur autorité sur les différentes parties des anciennes Gaules. Aux vingt gouvernements de monopole qui occupaient la surface actuelle de la France, succéda un seul gouvernement de monopole. Les rois de Provence, les ducs d’Aquitaine, de Bretagne, de Bourgogne, de Lorraine, les comtes de Flandres, etc., firent place au roi de France.
Le roi de France était chargé du soin de la défense intérieure et extérieure de l’État. Cependant il ne dirigeait pas seul la défense ou police intérieure.
Chaque seigneur châtelain faisait originairement la police de son domaine; chaque commune, affranchie de vive force ou à prix d’argent de l’onéreuse tutelle de son seigneur, faisait la police de sa circonscription reconnue.
Communes et seigneurs contribuaient, dans une certaine mesure, à la défense générale.
On peut dire que le roi de France avait le monopole de la défense générale, et que les seigneurs châtelains et les bourgeois des communes avaient celui de la défense locale.
Dans certaines communes, la police était sous la direction d’une administration élue par les bourgeois de la cité, dans les principales communes des Flandres par exemple. Ailleurs, la police s’était constituée en corporation comme la boulangerie, la boucherie, la cordonnerie, en un mot comme toutes les autres industries.
En Angleterre, cette dernière forme de la production de la sécurité a subsisté jusqu’à nos jours. Dans la cité de Londres, la police était naguère encore entre les mains d’une corporation privilégiée. Et chose singulière! cette corporation refusait de s’entendre avec les polices des autres quartiers, si bien que la Cité était devenue un véritable lieu de refuge pour les malfaiteurs. Cette anomalie n’a disparu qu’à l’époque de la réforme de sir Robert Peel.256
Que fit la Révolution française? Elle déposséda le roi de France du monopole de la défense générale, mais elle ne détruisit pas ce monopole; elle le remit entre les mains de la nation, organisée désormais comme une immense commune.
Les petites communes dans lesquelles se divisait le territoire de l’ancien royaume de France continuèrent de subsister. On en augmenta même considérablement le nombre. Le gouvernement de la grande commune eut le monopole de la défense générale, les gouvernements des petites communes exercèrent, sous la surveillance du pouvoir central, le monopole de la défense locale.
Mais on ne se borna pas là. On organisa encore dans la commune générale et dans les communes particulières d’autres industries, notamment l’enseignement, les cultes, les transports, etc., et l’on établit sur les citoyens divers impôts pour subvenir aux frais de ces industries ainsi organisées en commun.
Plus tard, les socialistes, mauvais observateurs s’il en fut jamais, ne remarquant point que les industries organisées dans la commune générale ou dans les communes particulières, fonctionnaient plus chèrement et plus mal que les industries laissées libres, demandèrent l’organisation en commun de toutes les branches de la production. Ils voulurent que la commune générale et les communes particulières ne se bornassent plus à faire la police, à bâtir des écoles, à construire des routes, à salarier des cultes, à ouvrir des bibliothèques, à subventionner des théâtres, à entretenir des haras, à fabriquer des tabacs, des tapis, de la porcelaine, etc., mais qu’elles se missent à produire toutes choses.
Le bon sens public se révolta contre cette mauvaise utopie, mais il n’alla pas plus loin. On comprit bien qu’il serait ruineux de produire toutes choses en commun. On ne comprit pas qu’il était ruineux de produire certaines choses en commun. On continua donc de faire du communisme partiel, tout en honnissant les socialistes qui réclamaient à grands cris un communisme complet.
Cependant les conservateurs, partisans du communisme partiel et adversaires du communisme complet, se trouvent aujourd’hui divisés sur un point important.
Les uns veulent que le communisme partiel continue à s’exercer principalement dans la commune générale; ils défendent la centralisation.
Les autres réclament, au contraire, une plus large part d’attributions pour les petites communes. Ils veulent que celles-ci puissent exercer diverses industries, fonder des écoles, construire des routes, bâtir des églises, subventionner des théâtres, etc., sans avoir besoin de l’autorisation du gouvernement central. Ils demandent la décentralisation.
L’expérience a montré les vices de la centralisation. L’expérience a prouvé que les industries exercées dans la grande commune, dans l’État, fournissent des produits plus chers et plus mauvais que ceux de l’industrie libre.
Mais est-ce a dire que la décentralisation vaille mieux? Est-ce à dire qu’il soit plus utile d’émanciper les communes, ou, ce qui revient au même, de leur permettre d’établir librement des écoles et des institutions de bienfaisance, de bâtir des théâtres, de subventionner des cultes, ou même encore d’exercer librement d’autres industries?
Pour subvenir aux dépenses des services dont elles se chargent, que faut-il aux communes? Il leur faut des capitaux. Ces capitaux où peuvent-elles les puiser? Dans les poches des particuliers, non ailleurs. Elles sont obligées, en conséquence, de prélever différents impôts sur les habitants de la commune.
Ces impôts consistent généralement aujourd’hui dans les centimes additionnels ajoutés aux contributions payées à l’État. Toutefois certaines communes ont obtenu aussi l’autorisation d’établir autour de leurs limites une petite douane sous le nom d’octroi. Cette douane, qui atteint la plupart des industries demeurées libres, augmente naturellement beaucoup les ressources de la commune. Aussi les autorisations d’établir un octroi sont-elles fréquemment demandées au gouvernement central. Celui-ci ne les accorde guère, et en cela il agit sagement; en revanche il permet assez souvent aux communes de s’imposer extraordinairement, autrement dit, il permet à la majorité des administrateurs de la commune d’établir un impôt extraordinaire que tous les administrés sont obligés de payer.
Que les communes soient émancipées, que, dans chaque localité, la majorité des habitants ait le droit d’établir autant d’industries qu’il lui plaira, et d’obliger la minorité à contribuer aux dépenses de ces industries organisées en commun; que la majorité soit autorisée à établir librement toute espèce de taxes locales, et vous verrez bientôt se constituer en France autant de petits États différents et séparés qu’on y compte de communes. Vous verrez successivement s’élever, pour subvenir aux taxes locales, quarante-quatre mille douanes intérieures sous le nom d’octrois; vous verrez, pour tout dire, se reconstituer le moyen âge.
Sous ce régime, la liberté du travail et des échanges sera atteint et par les monopoles que les communes s’attribueront de certaines branches de la production, et par les impôts qu’elles prélèveront sur les autres branches pour alimenter les industries exercées en commun. La propriété de tous se trouvera à la merci des majorités.
Dans les communes où prédomine l’opinion socialiste, que deviendra, je vous le demande, la propriété? Non seulement la majorité lèvera des impôts pour subvenir aux dépenses de la police, de la voirie, du culte, des établissements de bienfaisance, des écoles, etc., mais elle en lèvera aussi pour établir des ateliers communaux, des magasins communaux, des comptoirs communaux, etc. Ces taxes locales, la minorité non socialiste ne sera-t-elle pas obligée de les payer?
Sous un tel régime, que devient donc la souveraineté du peuple? Ne disparaît-elle pas sous la tyrannie du plus grand nombre?
Plus directement encore que la centralisation, la décentralisation conduit au communisme complet, c’est-à-dire à la destruction complète de la souveraineté.
Que faut-il donc faire pour restituer aux hommes cette souveraineté que le monopole leur a ravie dans le passé; et que le communisme, ce monopole étendu, menace de leur ravir dans l’avenir?
Il faut tout simplement rendre libre les différentes industries jadis constituées en monopoles, et aujourd’hui exercées en commun. Il faut abandonner à la libre activité des individus les industries encore exercées ou réglementées dans l’État ou dans la commune.
Alors l’homme possédant, comme avant l’établissement des sociétés, le droit d’appliquer librement, sans entrave ni charge aucune, ses facultés à toute espèce de travaux, jouira de nouveau, pleinement, de sa souveraineté.
Le Conservateur.
Vous avez passé en revue les différentes industries encore monopolisées, privilégiées ou réglementées, et vous nous avez prouvé, avec plus ou moins de succès, que ces industries devraient être-laissées libres pour l’avantage commun. Soit! je ne veux pas revenir sur un thème épuisé. Mais est-il possible d’enlever à l’État et aux communes le soin de la défense générale et de la défense locale.
Le Socialiste.
Et l’administration de la justice donc?
Le Conservateur.
Oui, et l’administration de la justice. Est-il possible que ces industries, pour parler votre langage, soient exercées autrement qu’en commun, dans la nation et dans la commune.
L’Économiste.
Je glisserais peut-être sur ces deux communismes-là si vous consentiez bien franchement à m’abandonner tous les autres; si vous réduisiez l’État à n’être plus désormais qu’un gendarme, un soldat et un juge. Cependant, non!...car le communisme de la sécurité est la clef de voûte du vieux édifice de la servitude. Je ne vois d’ailleurs aucune raison pour vous accorder celui-là plutôt que les autres.
De deux choses l’une, en effet:
Ou le communisme vaut mieux que la liberté, et, dans ce cas, il faut organiser toutes les industries en commun, dans l’État ou dans la commune.
Ou la liberté est préférable au communisme, et, dans ce cas, il faut rendre libres toutes les industries encore organisées en commun, aussi bien la justice et la police que l’enseignement, les cultes, les transports, la fabrication des tabacs, etc.
Le Socialiste.
C’est logique.
Le Conservateur.
Mais est-ce possible?
L’Économiste.
Voyons! S’agit-il de la justice? Sous l’ancien régime, l’administration de la justice n’était pas organisée et salariée en commun; elle était organisée en monopole, et salariée par ceux qui en faisaient usage.
Pendant plusieurs siècles, il n’y eut pas d’industrie plus indépendante. Elle formait, comme toutes les autres branches de la production matérielle ou immatérielle, une corporation privilégiée. Les membres de cette corporation pouvaient léguer leurs charges ou maîtrises à leurs enfants, ou bien encore les vendre. Jouissant de ces charges à perpétuité, les juges se faisaient remarquer par leur indépendance et leur intégrité.
Malheureusement ce régime avait, d’un autre côté, tous les vices inhérents au monopole. La justice monopolisée se payait fort cher.
Le Socialiste.
Et Dieu sait combien de plaintes et de réclamations excitaient les épices. Témoin ces petits vers qui furent crayonnés sur la porte du Palais de Justice après un incendie:
Un beau jour dame Justice Se mit le palais tout en feu Pour avoir mangé trop d’épice.
La justice ne doit-elle pas être essentiellement gratuite? Or, la gratuité n’entraîne-t-elle pas l’organisation en commun?
L’Économiste.
On se plaignait de ce que la justice mangeait trop d’épices. On ne se plaignait pas de ce qu’elle en mangeait. Si la justice n’avait pas été constituée en monopole; si, en conséquence, les juges n’avaient pu exiger que la rémunération légitime de leur industrie, on ne se serait pas plaint des épices.
Dans certains pays, où les justiciables avaient le droit de choisir leurs juges, les vices du monopole se trouvaient singulièrement atténués. La concurrence qui s’établissait alors entre les différentes cours, améliorait la justice et la rendait moins chère. Adam Smith attribue à cette cause les progrès de l’administration de la justice en Angleterre. Le passage est curieux et j’espère qu’il dissipera vos doutes:
“Les honoraires de cour paraissent avoir été originairement le principal revenu des différentes cours de justice en Angleterre. Chaque cour tâchait d’attirer à elle le plus d’affaires qu’elle pouvait, et ne demandait pas mieux que de prendre connaissance de celles mêmes qui ne tombaient point sous sa juridiction. La cour du banc du roi, instituée pour le jugement des seules causes criminelles, connut des procès civils, le demandeur prétendant que le défendeur, en ne lui faisant pas justice, s’était rendu coupable de quelque faute ou malversation. La cour de l’échiquier, préposée pour la levée des dossiers royaux et pour contraindre à les payer, connut aussi des autres engagements pour dettes, le plaignant alléguant que si on ne le payait pas, il ne pourrait payer le roi. Avec ces fictions, il dépendait souvent des parties de se faire juger par le tribunal qu’elles voulaient, et chaque cour s’efforçait d’attirer le plus de causes qu’elle pouvait au sien, par la diligence et l’impartialité qu’elle mettait dans l’expédition des procès. L’admirable constitution actuelle des cours de justice, en Angleterre, fut peut-être originairement, en grande partie le fruit de cette émulation qui animait ces différents juges, chacun s’efforçant à l’envi d’appliquer à toute sorte d’injustices, le remède le plus prompt et le plus efficace que comportait la loi.”257
Le Socialiste.
Mais, encore une fois, la gratuité n’est-elle pas préférable?
L’Économiste.
Vous n’êtes donc pas revenu encore de l’illusion de la gratuité. Ai-je besoin de vous démontrer que la justice gratuite coûte plus cher que l’autre, de tout le montant de l’impôt, prélevé pour entretenir les tribunaux gratuits et salarier les juges gratuits. Ai-je besoin de vous démontrer encore que la gratuité de la justice est nécessairement inique, car tout le monde ne se sert pas également de la justice, tout le monde n’a pas également l’esprit processif? Au reste, la justice est loin d’être gratuite sous le régime actuel, vous ne l’ignorez pas.
Le Conservateur.
Les procès sont ruineux. Cependant pouvons-nous nous plaindre de l’administration actuelle de la justice? L’organisation de nos tribunaux n’est-elle pas irréprochable?
Le Socialiste.
Oh! oh! irréprochable. Un Anglais que j’accompagnai un jour à la cour d’assises, sortit de la séance tout indigné. Il ne concevait pas qu’un peuple civilisé permit à un procureur du roi ou de la république, de faire de la rhétorique pour demander une condamnation à mort. Cette éloquence, pourvoyeuse du bourreau, lui faisait horreur. En Angleterre, on se contente d’exposer l’accusation; on ne la passionne pas.
L’Économiste.
Ajoutez à cela les lenteurs proverbiales de nos cours de justice, les souffrances des malheureux qui attendent leur jugement pendant des mois, et quelquefois pendant des années, tandis que l’instruction pourrait se faire en quelques jours; les frais et les pertes énormes que ces délais entraînent, et vous vous convaincrez que l’administration de la justice n’a guère progressé en France.
Le Socialiste.
N’exagérons rien, toutefois. Nous possédons aujourd’hui, grâce au ciel, l’institution du jury.
L’Économiste.
En effet, on ne se contente pas d’obliger les contribuables à payer les frais de la justice, on les oblige aussi à remplir les fonctions de juges. C’est du communisme pur: Ab uno disce omnes. Pour moi, je ne pense pas que le jury vaille mieux pour juger, que la garde nationale, une autre institution communiste! pour faire la guerre.
Le Socialiste.
Pourquoi donc?
L’Économiste.
Parce qu’on ne fait bien que son métier, sa spécialité, et que le métier, la spécialité d’un juré n’est pas d’être juge.
Le Conservateur.
Aussi se contente-t-il de constater le délit, et d’apprécier les circonstances dans lesquelles le délit a été commis.
L’Économiste.
C’est-à-dire d’exercer la fonction la plus difficile, la plus épineuse du juge. C’est cette fonction si délicate, qui exige un jugement si sain, si exercé, un esprit si calme, si froid, si impartial que l’on confie aux hasards du tirage au sort. C’est absolument comme si l’on tirait au sort les noms des citoyens qui seront chargés, chaque année, de fabriquer des bottes ou d’écrire des tragédies pour la communauté.
Le Conservateur.
La comparaison est forcée.
L’Économiste.
Il est plus difficile, à mon avis, de rendre un bon jugement que de faire une bonne paire de bottes ou d’aligner convenablement quelques centaines d’alexandrins. Un juge parfaitement éclairé et impartial est plus rare qu’un bottier habile ou un poëte capable d’écrire pour le Théâtre-Français.
Dans les causes criminelles, l’inhabileté du jury se trahit tous les jours. Mais on ne prête, hélas! qu’une médiocre attention aux erreurs commises en cour d’assises. Que dis-je? on regarde presque comme un délit de critiquer un jugement rendu. Dans les causes politiques, le jury n’a-t-il pas coutume de prononcer selon la couleur de son opinion, blanc ou rouge, plutôt que selon la justice? Tel homme qui est condamné par un jury blanc ne serait-il pas absous par un jury rouge, et vice versâ?
Le Socialiste.
Hélas!
L’Économiste.
Déjà les minorités sont bien lasses d’être jugées par des jurys appartenant aux majorités. Attendez la fin...
S’agit-il de l’industrie qui pourvoit à la défense intérieure et extérieure? Croyez-vous qu’elle vaille beaucoup mieux que celle de la justice? Notre police et surtout notre armée ne nous coûtent-elles pas bien cher pour les services réels qu’elles nous rendent?
N’y a-t-il enfin aucun inconvénient à ce que cette industrie de la défense publique soit aux mains d’une majorité?
Examinons.
Dans un système où la majorité établit l’assiette de l’impôt et dirige l’emploi des deniers publics, l’impôt ne doit-il pas peser plus ou moins sur certaines portions de la société, selon les influences prédominantes? Sous la monarchie, lorsque la majorité était purement fictive, lorsque la classe supérieure s’arrogeait le droit de gouverner le pays à l’exclusion du reste de la nation, l’impôt ne pesait-il pas principalement sur les consommations des classes inférieures, sur le sel, sur le vin, sur la viande, etc.? Sans doute, la bourgeoisie payait sa part de ces impôts, mais le cercle de ses consommations étant infiniment plus large que celui des consommations de la classe inférieure, son revenu s’en trouvait, en définitive, beaucoup plus légèrement atteint. A mesure que la classe inférieure, en s’éclairant, acquerra plus d’influence dans l’État, vous verrez se produire une tendance opposée. Vous verrez l’impôt progressif, qui est tourné aujourd’hui contre la classe inférieure, être retourné contre la classe supérieure. Celle-ci résistera sans doute de toutes ses forces à cette tendance nouvelle; elle criera, avec raison, à la spoliation, au vol; mais si l’institution communautaire du suffrage universel est maintenue, si une surprise de la force ne remet pas, de nouveau, le gouvernement de la société aux mains des classes riches à l’exclusion des classes pauvres, la volonté de la majorité prévaudra, et l’impôt progressif sera établi. Une partie de la propriété des riches sera alors légalement confisquée pour alléger le fardeau des pauvres, comme une partie de la propriété des pauvres a été trop longtemps confisquée pour alléger le fardeau des riches.
Mais il y a pis encore.
Non seulement la majorité d’un gouvernement communautaire peut établir, comme bon lui semble, l’assiette de l’impôt, mais encore elle peut faire de cet impôt l’usage qu’elle juge convenable, sans tenir compte de la volonté de la minorité.
Dans certains pays, le gouvernement de la majorité emploie une partie des deniers publics à protéger des propriétés essentiellement illégitimes et immorales. Aux États-Unis, par exemple, le gouvernement garantit aux planteurs du sud la propriété de leurs esclaves. Cependant il y a, aux États-Unis, des abolitionnistes qui considèrent, avec raison, l’esclavage comme un vol. N’importe! le mécanisme communautaire les oblige à contribuer de leurs deniers au maintien de cette espèce de vol. Si les esclaves tentaient un jour de s’affranchir d’un joug inique et odieux, les abolitionnistes seraient contraints d’aller défendre, les armes à la main, la propriété des planteurs. C’est la loi des majorités!
Ailleurs, il arrive que la majorité, poussée par des intrigues politiques ou par le fanatisme religieux, déclare la guerre à un peuple étranger. La minorité a beau avoir horreur de cette guerre et la maudire, elle est obligée d’y contribuer de son sang et de son argent. C’est encore la loi des majorités!
Ainsi qu’arrive-t-il? C’est que la majorité et la minorité sont perpétuellement en lutte, et que la guerre descend parfois de l’arène parlementaire dans la rue.
Aujourd’hui c’est la minorité rouge qui s’insurge. Si cette minorité devenait majorité, et si, usant de ses droits de majorité, elle remaniait la constitution à sa guise, si elle décrétait des impôts progressifs, des emprunts forcés et des papiers-monnaie, qui vous assure que la minorité blanche ne s’insurgerait pas demain?
Il n’y a point de sécurité durable dans ce système. Et savez-vous pourquoi? Parce qu’il menace incessamment la propriété; parce qu’il met à la merci d’une majorité aveugle ou éclairée, morale ou immorale, les personnes et les biens de tous.
Si le régime communautaire, au lieu d’être appliqué comme en France à une multitude d’objets, se trouvait étroitement limité comme aux États-Unis, les causes de dissentiment entre la majorité et la minorité étant moins nombreuses, les inconvénients de ce régime seraient moindres. Toutefois ils ne disparaîtraient point entièrement. Le droit reconnu au plus grand nombre de tyranniser la volonté du plus petit pourrait encore, en certaines circonstances, engendrer la guerre civile.
Le Conservateur.
Mais, encore une fois, on ne conçoit pas comment l’industrie qui pourvoit à la sécurité des personnes et des propriétés pourrait être pratiquée si elle était rendue libre. Votre logique vous conduit à des rêves dignes de Charenton.
L’Économiste.
Voyons! ne nous fâchons pas. Je suppose qu’après avoir bien reconnu que le communisme partiel de l’État et de la commune est décidément mauvais, on laisse libres toutes les branches de la production, à l’exception de la justice et de la défense publique. Jusque-là point d’objection. Mais un économiste radical, un rêveur vient et dit: Pourquoi donc, après avoir affranchi les différents emplois de la propriété, n’affranchissez-vous pas aussi ceux qui assurent le maintien de la propriété? Comme les autres, ces industries-là ne seront-elles pas exercées d’une manière plus équitable et plus utile si elles sont rendues libres? Vous affirmez que c’est impraticable. Pourquoi. D’un côté, n’y a-t-il pas, au sein de la société, des hommes spécialement propres, les uns à juger les différends qui surviennent entre les propriétaires et à apprécier les délits commis contre la propriété, les autres à défendre la propriété des personnes et des choses contre les agressions de la violence et de la ruse? N’y a-t-il pas des hommes que leurs aptitudes naturelles rendent spécialement propres à être juges, gendarmes et soldats. D’un autre côté, tous les propriétaires indistinctement n’ont-ils pas besoin de sécurité et de justice? Tous ne sont-ils pas disposés, en conséquence, à s’imposer des sacrifices pour satisfaire à ce besoin urgent, surtout s’ils sont impuissants à y satisfaire eux-mêmes ou s’ils ne le peuvent à moins de dépenser beaucoup de temps et d’argent?
Or s’il y a d’un côté des hommes propres à pourvoir à un besoin de la société, d’un autre côté, des hommes disposés à s’imposer des sacrifices pour obtenir la satisfaction de ce besoin, ne suffit-il pas de laisser faire les uns et les autres pour que la denrée demandée, matérielle ou immatérielle, se produise, et que le besoin soit satisfait?
Ce phénomène économique ne se produit-il pas irrésistiblement, fatalement, comme le phénomique physique de la chute des corps?
Ne suis-je donc pas fondé à dire que si une société renonçait à pourvoir à la sécurité publique, cette industrie particulière n’en serait pas moins exercée? Ne suis-je pas fondé à ajouter qu’elle le serait mieux sous le régime de la liberté qu’elle ne pouvait l’être sous le régime de la communauté?
Le Conservateur.
De quelle manière?
L’Économiste.
Cela ne regarde pas les économistes. L’économie politique peut dire: si tel besoin existe, il sera satisfait, et il le sera mieux sous un régime d’entière liberté que sous tout autre. A cette règle, aucune exception! mais comment s’organisera cette industrie, quels seront ses procédés techniques, voilà ce que l’économie politique ne saurait dire.
Ainsi, je puis affirmer que si le besoin de se nourrir se manifeste au sein de la société, ce besoin sera satisfait, et qu’il le sera d’autant mieux que chacun demeurera plus libre de produire des aliments ou d’en acheter à qui bon lui semblera.
Je puis assurer encore que les choses se passeront absolument de la même manière si, au lieu de l’alimentation, il s’agit de la sécurité.
Je prétends donc que si une communauté déclarait renoncer, au bout d’un certain délai, un an par exemple, à salarier des juges, des soldats et des gendarmes, au bout de l’année cette communauté n’en posséderait pas moins des tribunaux et des gouvernements prêts à fonctionner; et j’ajoute que si, sous ce nouveau régime, chacun conservait le droit d’exercer librement ces deux industries et d’en acheter librement les services, la sécurité serait produite le plus économiquement et le mieux possible.
Le Conservateur.
Je vous répondrai toujours que cela ne se peut concevoir.
L’Économiste.
A l’époque où le régime réglementaire retenait l’industrie prisonnière dans l’enceinte des communes, et où chaque corporation était exclusivement maîtresse du marché communal, on disait que la société était menacée chaque fois qu’un novateur audacieux s’efforçait de porter atteinte à ce monopole. Si quelqu’un était venu dire alors qu’à la place des malingres et chétives industries des corporations, la liberté mettrait un jour d’immenses manufactures fournissant des produits moins chers et plus parfaits, on eût traité ce rêveur de la belle manière. Les conservateurs du temps auraient juré leurs grands dieux que cela ne se pouvait concevoir.
Le Socialiste.
Mais voyons! Comment peut-on imaginer que chaque individu ait le droit de se faire gouvernement ou de choisir son gouvernement, ou même de n’en pas choisir... Comment les choses se passeraient-elles en France, si, après avoir rendu libres toutes les autres industries, les citoyens français annonçaient de commun accord, qu’ils cesseront, au bout d’une année, de soutenir le gouvernement de la communauté?
L’Économiste.
Je ne puis faire que des conjectures à cet égard. Voici cependant à peu près de quelle manière les choses se passeraient. Comme le besoin de sécurité est encore très grand dans notre société, il y aurait profit à fonder des entreprises de gouvernement. On serait assuré de couvrir ses frais. Comment se fonderaient ces entreprises? Des individualités isolées n’y suffiraient pas plus qu’elles ne suffisent pour construire des chemins de fer, des docks, etc. De vastes compagnies se constitueraient donc pour produire de la sécurité; elles se procureraient le matériel et les travailleurs dont elles auraient besoin. Aussitôt qu’elles se trouveraient prêtes à fonctionner, ces compagnies d’assurances sur la propriété appelleraient la clientèle. Chacun s’abonnerait à la compagnie qui lui inspirerait le plus de confiance et dont les conditions lui sembleraient le plus favorables.
Le Conservateur.
Nous ferions queue pour aller nous abonner. Assurément, nous ferions queue!
L’Économiste.
Cette industrie étant libre on verrait se constituer autant de compagnies qu’il pourrait s’en former utilement. S’il y en avait trop peu, si, par conséquent, le prix de la sécurité était surélevé, on trouverait profit à en former de nouvelles; s’il y en avait trop, les compagnies surabondantes ne tarderaient pas à se dissoudre. Le prix de la sécurité serait, de la sorte, toujours ramené au niveau des frais de production.
Le Conservateur.
Comment ces compagnies libres s’entendraient-elles pour pourvoir à la sécurité générale?
L’Économiste.
Elles s’entendraient comme s’entendent aujourd’hui les gouvernements monopoleurs et communistes, parce qu’elles auraient intérêt à s’entendre. Plus, en effet, elles se donneraient de facilités mutuelles pour saisir les voleurs et les assassins, et plus elles diminueraient leurs frais.
Par la nature même de leur industrie, les compagnies d’assurances sur la propriété ne pourraient dépasser certaines circonscriptions: elles perdraient à entretenir une police dans les endroits où elles n’auraient qu’une faible clientèle. Dans leurs circonscriptions elles ne pourraient néanmoins opprimer ni exploiter leurs clients, sous peine de voir surgir instantanément des concurrences.
Le Socialiste.
Et si la compagnie existante voulait empêcher les concurrences de s’établir?
L’Économiste.
En un mot, si elle portait atteinte à la propriété de ses concurrents et à la souveraineté de tous... Oh! alors, tous ceux dont les monopoleurs menaceraient la propriété et l’indépendance se lèveraient pour les châtier.
Le Socialiste.
Et si toutes les compagnies s’entendaient pour se constituer en monopoles. Si elles formaient une sainte-alliance pour s’imposer aux nations, et si fortifiées par cette coalition, elles exploitaient sans merci les malheureux consommateurs de sécurité, si elles attiraient à elles par de lourds impôts la meilleure part des fruits du travail des peuples?
L’Économiste.
Si, pour tout dire, elles recommençaient à faire ce que les vieilles aristocraties ont fait jusqu’à nos jours... Eh! bien, alors, les peuples suivraient le conseil de Béranger:
Peuples, formez une Sainte-Alliance Et donnez-vous la main.
Ils s’uniraient, à leur tour, et comme ils possèdent des moyens de communication que n’avaient pas leurs ancêtres, comme ils sont cent fois plus nombreux que leurs vieux dominateurs, la sainte-alliance des aristocraties serait bientôt anéantie. Nul ne serait plus tenté alors, je vous jure, de constituer un monopole.
Le Conservateur.
Comment ferait-on sous ce régime pour repousser une invasion étrangère?
Le Socialiste. [rather L’Économiste]258
Quel serait l’intérêt des compagnies? Ce serait de repousser les envahisseurs, car elles seraient les premières victimes de l’invasion. Elles s’entendraient donc pour les repousser et elles demanderaient à leurs assurés un supplément de prime pour les préserver de ce danger nouveau. Si les assurés préféraient courir les risques de l’invasion, ils refuseraient ce supplément de prime; sinon, ils le payeraient, et ils mettraient ainsi les compagnies en mesure de parer au danger de l’invasion.
Mais de même que la guerre est inévitable sous un régime de monopole, la paix est inévitable sous un régime de libre gouvernement.
Sous ce régime, les gouvernements ne peuvent rien gagner par la guerre; ils peuvent, au contraire, tout perdre. Quel intérêt auraient-ils à entreprendre une guerre? serait-ce pour augmenter leur clientèle? Mais, les consommateurs de sécurité étant libres de se faire gouverner à leur guise, échapperaient aux conquérants. Si ceux-ci voulaient leur imposer leur domination, après avoir détruit le gouvernement existant, les opprimés réclameraient aussitôt le secours de tous les peuples....
Les guerres de compagnie à compagnie ne se feraient d’ailleurs qu’autant que les actionnaires voudraient en avancer les frais. Or, la guerre ne pouvant plus rapporter à personne une augmentation de clientèle, puisque les consommateurs ne se laisseraient plus conquérir, les frais de guerre ne seraient évidemment plus couverts. Qui donc voudrait encore les avancer?
Je conclus de là que la guerre serait matériellement impossible sous ce régime, car aucune guerre ne se peut faire sans une avance de fonds.
Le Conservateur.
Quelles conditions une compagnie d’assurances sur la propriété ferait-elle à ses clients?
L’Économiste.
Ces conditions seraient de plusieurs sortes.
Pour être mises en état de garantie aux assurés, pleine sécurité pour leurs personnes et leurs propriétés, il faudrait:
1° Que les compagnies d’assurances établissent certaines peines contre les offenseurs des personnes et des propriétés, et que les assurés consentissent à se soumettre à ces peines, dans le cas où ils commettraient eux-mêmes des sévices contre les personnes et les propriétés.
2° Qu’elles imposassent aux assurés certaines gênes ayant pour objet de faciliter la découverte des auteurs de délits.
3° Qu’elles perçussent régulièrement pour couvrir leurs frais une certaine prime, variable selon la situation des assurés, leurs occupations particulières, l’étendue, la nature et la valeur des propriétés à protéger.
Si les conditions stipulées convenaient aux consommateurs de sécurité, le marché se conclurait, sinon les consommateurs s’adresseraient à d’autres compagnies ou pourvoiraient eux-mêmes à leur sécurité.
Poursuivez cette hypothèse dans tous ses détails, et vous vous convaincrez, je pense, de la possibilité de transformer les gouvernements monopoleurs ou communistes en gouvernements libres.
Le Conservateur.
J’y vois bien des difficultés encore. Et la dette, qui la payerait?
L’Économiste.
Pensez-vous qu’en vendant toutes les propriétés aujourd’hui communes, routes, canaux, rivières, forêts, bâtiments servant à toutes les administrations communes, matériel de tous les services communs, on ne réussirait pas aisément à rembourser le capital de la dette? Ce capital ne dépasse pas six milliards. La valeur des propriétés communes en France s’élève, à coup sûr, bien au delà.
Le Socialiste.
Ce système ne serait-il pas la destruction de toute nationalité? Si plusieurs compagnies d’assurances sur la propriété s’établissaient dans un pays, l’Unité nationale ne serait-elle pas détruite?
L’Économiste.
D’abord, il faudrait que l’Unité nationale existât pour qu’on pût la détruire. Or, je ne puis voir une unité nationale dans ces informes agglomérations de peuples que la violence a formées, que la violence seule maintient le plus souvent.
Ensuite, on a tort de confondre ces deux choses, qui sont naturellement fort distinctes: la nation et le gouvernement. Une nation est une lorsque les individus qui la composent ont les mêmes mœurs, la même langue, la même civilisation; lorsqu’ils forment une variété distincte, originale de l’espèce humaine. Que cette nation ait deux gouvernements ou qu’elle n’en ait qu’un, cela importe fort peu. A moins toutefois que chaque gouvernement n’entoure d’une barrière factice les régions soumises à sa domination, et n’entretienne d’incessantes hostilités avec ses voisins. Dans cette dernière éventualité, l’instinct de la nationalité réagira contre ce morcellement barbare et cet antagonisme factice imposés à un même peuple, et les fractions désunies de ce peuple tendront incessamment à se rapprocher.
Or, les gouvernements ont jusqu’à nos jours divisé les peuples afin de les retenir plus aisément dans l’obéissance; diviser pour régner, telle a été, de tous temps, la maxime fondamentale de leur politique. Les hommes de même race, à qui la communauté de langage offrait un moyen de communication facile, ont énergiquement réagi contre la pratique de cette maxime; de tous temps ils se sont efforcés de détruire les barrières factices qui les séparaient. Lorsqu’ils y sont enfin parvenus, ils ont voulu n’avoir qu’un seul gouvernement afin de n’être plus désunis de nouveau. Mais, remarquez bien qu’ils n’ont jamais demandé à ce gouvernement de les séparer des autres peuples... L’instinct des nationalités n’est donc pas égoïste, comme on l’a si souvent affirmé; il est, au contraire, essentiellement sympathique. Que la diversité des gouvernements cesse d’entrainer la séparation, le morcellement des peuples, et vous verrez la même nationalité en accepter volontiers plusieurs. Un seul gouvernement n’est pas plus nécessaire pour constituer l’unité d’un peuple, qu’une seule banque, un seul établissement d’éducation, un seul culte, un seul magasin d’épiceries, etc.
Le Socialiste.
Voilà, en vérité, une solution bien singulière du problème du gouvernement!
L’Économiste.
C’est la seule solution conforme à la nature des choses.
43.Joseph Garnier, Victor Hugo, Frédéric Bastiat on "Peace and Disarmament" (August 1849)↩
[Word Length: 9,963]
Source
Joseph Garnier, Congrès des amis de la paix universelle Réuni à Paris en 1849. Compte-rendu, séances des 22, 23, 24 Aout; - Résolutions adoptées; discours de Mm. Victor Hugo, Visschers, Rév. John Burnett; Rév. Asa Mahan, de l'Ohio; Henri Vincent, de Londres; Ath. Coquerel; Suringar, d'Amsterdam; Francisque Bouvet, Émile de Girardin; Ewart, membre du Parlement; Frédéric Bastiat; Richard Cobden, Elihu Burritt, Deguerry; Amasa Walker, de Massachussets; Ch. Hindley, membre du Parlement, etc., etc.; Compte-rendu d'une visite au Président de la République, de trois meetings en Angleterre; statisique des membres du congrès, etc.; Précédé d'une Note historique sur le mouvement en faveur de la paix, par M. Joseph Garnier. (Paris: Guillaumin, 1850). Extracts by Garnier, Hugo, Bastiat, and Cobden.
Brief Bio of the Author: Frédéric Bastiat (1801-1850)
[Frédéric Bastiat (1801-1850)]
Frédéric Bastiat (1801-1850) was a pivotal figure in French classical liberalism in the mid-19th century. He suddenly emerged from the south west province of Les Landes to assume leadership of the fledgling French free trade movement in 1844 which he modelled on that of Richard Cobden’s Anti-Corn Law League in England. Bastiat then turned to a brilliant career as an economic journalist, debunking the myths and misconceptions people held on protectionism in particular and government intervention in general, which he called “sophisms” or “fallacies” [Economic Sophisms. Part I (1846), Economic Sophisms. Part II (1848)]. When revolution broke out in February 1848 Bastiat was elected twice to the Chamber of Deputies where he served on the powerful Finance Committee where he struggled to bring government expenditure under control. He confounded his political opponents with his consistent libertarianism: on the one hand he denounced the socialists for their economic policies, but took to the streets to prevent the military from shooting them during the riots which broke out in June 1848. In the meantime he was suffering from a debilitating throat condition which severely weakened him and led to his early death on Christmas Eve in 1850. Knowing he was dying, Bastiat attempted to complete his magnum opus on economic theory, his Economic Harmonies (1850). In this work he showed the very great depth of his economic thinking and made advances which heralded the Austrian school of economics which emerged later in the century. Bastiat to the end was an indefatigable foe of political privilege, unaccountable monarchical power, the newly emergent socialist movement, and above all, the vested interests who benefited from economic protectionism. He was a giant of 19th century classical liberalism. Other important works include Cobden and the League (1845), Property and Plunder (1848), The State (1848), Damn Money! (1849), What is Seen and What is Not Seen (1850), and The Law (1850). [DMH]
Joseph Garnier, "Note historique sur le mouvement en faveur de la paix". [pp. iii-viii]
L'agitation en faveur de la paix, qui a pris, depuis quelques années, un développement si remarquable, a été inspirée par les guerres qui ont ensanglanté l'Europe au commencement de ce siècle. C'est aux Etats-Unis et en Angleterre, au sein de la laborieuse et bienveillante secte des quakers, que l'idée de la paix universelle a trouvé ses premiers propagateurs ardents et dévoués. Le mouvement s'est transmis à leurs coreligionnaires des deux pays, et peu à peu on a vu y prendre successivement part des philanthropes éclairés, des pasteurs d'églises protestantes, des poètes éminents, des économistes, des membres du clergé catholique, des publicistes et des hommes d'Etat, parmi lesquels il nous suffira de nommer M. Richard Cobden, l'illustre chef de la ligue dont les efforts ont provoqué la réforme économique et financière en Angleterre, et si puissamment contribué, non-seulement à la prospérité de son pays, mais encore à la paix du monde.
Le Congrès de Paris a montré aux yeux de l'observateur attentif l'importance de ce mouvement, qui tend à mettre enfin en pratique les vérités déposées dans le cœur des hommes par la religion, prouvées à leur raison par la philosophie, démontrées conformes à leurs intérêts individuels ou nationaux, comme à ceux de l'humanité tout entière, par l'économie politique. Dès ce moment, l'utopie de l'abbé de Saint-Pierre commence à être prise au sérieux: un sentiment encore vague, mais cependant très-positif, semble dire aux populations, malgré les guerres récentes, ou plutôt à cause de ces guerres, que le temps est venu de songer à l'affermissement définitif de la paix. Déjà, parmi les hommes politiques qui ont la prétention de diriger les affaires de ce monde, il en est qui se demandent si le remède à bien des complications, à bien des misères, ne se trouve pas en partie dans la renonciation complète et absolue à l'ambition, à la conquête, à l'intervention armée; dans la solution des différends internationaux par la voie pacifique; dans la diminution des dépenses de guerre et de marine: toutes choses qui, après avoir été « le rêve d'un homme de bien », finiront par constituer le gros sens commun des nations.
Le mouvement des amis de la paix date de 1814, époque à laquelle un homme par eux vénéré, le docteur Noah Worcester, des Etats-Unis, publia un examen du système de la guerre: Solemn review of the custom of the war. Peu de temps après, en août 1815, au retentissement du canon de Waterloo, quelques lecteurs de cet écrit fondèrent la première Association des amis de la paix, the New-York peace Society, et presque simultanément des Sociétés analogues dans les Etats de l'Ohio et du Massachussets.
Dans cette même année 1815, un journal anglais, the Philanthropist, publiait un article dans les mêmes sentiments que l'écrit de Worcester, et préludait à la formation de la Société de la paix de Londres (11 juin 1816), qui célébrait en mai dernier, dans un meeting public, son trente-quatrième anniversaire. Chose digne de remarque, c'est qu'il est à peu près certain que ces Sociétés se formèrent, celle-là en Amérique, celle-ci en Angleterre, sans que l'une ait eu connaissance de l'autre. Ce phénomène est assez commun dans l'histoire du progrès humain. Longtemps une idée fermente d'une manière latente dans l'humanité, et puis, un beau jour, on la voit surgir et se manifester presque en même temps par l'initiative de quelques hommes d'élite.
Ces deux Sociétés mères une fois fondées, leur action se porta sur la création de plusieurs autres Sociétés correspondantes; des meetings eurent pour objet d'en faire connaître l'existence et les principes; des concours furent ouverts; des milliers de brochures ou traités furent distribués; des missionnaires parcoururent de temps en temps différents pays. Le célèbre docteur Bowring a été de ce nombre.
Les nobles sentiments qui avaient dirigé les fondateurs de cette Société inspirèrent aussi à quelques hommes de bien la création de la Société de la morale chrétienne à Paris, en 1821, au sein de laquelle fut constitué plus tard, en 1841, un Comité de la paix. En 1830, M. de Sellon, un des citoyens les plus estimables et les plus respectés de la Suisse, établit aussi une Société à Genève, et éleva une colonne sur les bords du lac Léman, en souvenir de cet heureux événement.
Un petit nombre d'autres Sociétés prirent naissance sur quelques autres points en Europe. A Paris, ce ne fut qu'en 1847 que MM. Francisque Bouvet, Ziegler et d'autres songèrent à en fonder une spécialement consacrée à la grande question de la paix; mais leurs efforts se sont trouvés, dès le début, arrêtés par l'agitation politique et la suspension du droit de réunion.
Les Amis de la Paix eurent l'idée de faire un Congrès à Londres, en 1843. Des délégués de toutes les Sociétés d'Irlande, d'Ecosse et d'Angleterre se rendirent à cette réunion présidée par M. Ch. Hindley, membre du Parlement. Il en vint aussi des Etats-Unis. Un seul Français y assistait, c'était M. Larochefaucault-Liancourt, président de la Société de la morale chrétienne. Dans ce Congrès, on adopta la proposition d'une adresse à tous les gouvernements civilisés, pour les prier d'introduire dans leurs traités une clause par laquelle ils s'engageraient, en cas de dissentiment, à s'en rapporter à la médiation d'une ou de plusieurs puissances amies. Cette adresse fut présentée notamment au roi Louis-Philippe, qui fit un excellent accueil aux délégués du Congrès. « La paix, leur dit-il, est le besoin de tous les peuples, et, « grâce à Dieu, la guerre coûte beaucoup trop aujourd'hui pour s'y engager souvent, et je suis persuadé qu'un jour viendra où, dans le monde civilisé, on ne la fera plus. » Au mois de janvier 1844, la même adresse fut présentée au président des Etats-Unis par M. Beckwith, secrétaire de la Société de paix d'Amérique. Le président fit remarquer aux délégués que la tendance naturelle des gouvernements populaires était de maintenir la paix. « Que le peuple soit instruit, dit-il, et « qu'il jouisse de ses droits, et il demandera la paix, comme indispensable à sa prospérité. »
Cette manifestation donna une nouvelle force à l'action des Amis de la Paix tant en Angleterre qu'aux Etats-Unis. Dans ce dernier pays, venait de se révéler un de ces apôtres que la foi pénètre et qui font pénétrer la foi chez les autres hommes. Elihu Burritt quittait le métier de forgeron pour se livrer à l'étude et consacrer ensuite sa vie à la propagation des sentiments de fraternité qui débordaient son âme.
La propagande écrite et parlée d'Elihu Burritt communiqua encore une vie nouvelle aux Amis de la Paix des Etats-Unis; et lorsqu'il vint en Europe, en 1848, rattacher par de nouveaux liens les paisibles confédérés de l'Amérique avec ceux de l'ancien monde, il donna au mouvement cette impulsion qui a appelé l'attention du monde entier.
Accueilli avec enthousiasme par les Amis de la Paix de l'Angleterre, M. Elihu Burritt, en compagnie de M. Henri Richard, non moins dévoué que lui à cette grande cause, se rendirent à Paris dans le printemps de 1848 pour organiser au sein de notre capitale un Congrès semblable à celui qui avait eu lieu à Londres en 1843. L'état de la France, et surtout les journées de Juin, les firent renoncer à ce projet et les engagèrent à convoquer les Amis de la Paix à Bruxelles, où ils trouvèrent la bienveillance empressée du gouvernement, celle de M. Rogier, ministre de l'intérieur, en particulier, et le dévouement de M. Visschers, conseiller aux mines.
Ce second Congrès de la paix eut lieu les 20, 21 et 22 septembre, sous la présidence de M. Visschers, dans la salle de la Société royale de la grande Harmonie. Cent soixante délégués anglo-américains, dont trente dames, vinrent d'Angleterre pour y assister. Ils avaient à leur tête le vénérable M. Joseph Sturge, un des hommes qui ont le plus contribué par leur influence, leurs efforts et leur bourse à l'émancipation des esclaves. Après une remarquable discussion à laquelle prirent part MM. Ewart, membre du Parlement, Henri Vincent, de Londres, Suringar, d'Amsterdam, Roussel, de Bruxelles, Francisque Bouvet, représentant à l'Assemblée constituante de France, etc., la réunion adopta quatre propositions principales relatives: à la condamnation de la guerre, à l'établissement d'une juridiction suprême pour les nations, à la rédaction d'un Code international et au désarmement général.
Ces résolutions furent présentées le 30 octobre suivant, par une députation du Congrès, à lord John Russell, premier ministre de la Grande-Bretagne. Lord John Russell applaudit beaucoup à la pensée qui avait présidé à la formation du Congrès de la paix, et insista sur ce point, que si, en cas de différend avec une nation, celle-ci proposait à la Grande-Bretagne d'en référer à un arbitrage, le gouvernement anglais croirait toujours de son devoir de prendre en sérieuse considération une semblable demande.259
Il est vrai que depuis lord Palmerston n'a pas tenu la promesse de son collègue; mais il est vrai aussi, et c'est là un symptôme bien consolant pour les amis de la civilisation, que la plus grande partie de l'opinion publique l'a vivement blâmé, et qu'il aurait été obligé de quitter son portefeuille s'il n'avait été protégé par le besoin généralement compris de maintenir intacte l'administration actuelle. On ne saurait trop le répéter, aujourd'hui la masse du peuple anglais veut sincèrement la paix. Elle comprend tout ce qu'il y a eu d'horrible pour l'humanité en général, et de désastreux pour elle en particulier, dans la politique suivie par son gouvernement à la fin du dernier siècle et au commencement de celui-ci.260 A l'appui de cette assertion, nous citerons l'accueil enthousiaste que reçoivent les Amis de la Paix, soit dans leurs meetings spéciaux, soit dans ceux où l'on s'occupe des réformes financières et des moyens de diminuer les charges publiques, soit dans ceux qui ont pour but de détourner les citoyens de souscrire les emprunts qui alimentent les passions et les préjugés guerriers, soit enfin dans ceux où la population de la Grande-Bretagne a été appelée contre la conduite barbare de quelques agents du gouvernement dans les mouvements insurrectionnels qui ont récemment éclaté à Ceylan et dans les îles Ioniennes.
Les membres du Congrès de Bruxelles s'ajournèrent à Paris pour l'année suivante. Dans le courant de juin 1849, MM. Elihu Burritt et M. Henri Richard, secrétaire de la Société de la paix de Londres, arrivèrent à Paris pour préparer le futur Congrès. Ils reçurent un excellent accueil de la part des membres de la Société de la morale chrétienne, de la Société d'économie politique, de la Société d'économie charitable, et des notabilités de la presse et du gouvernement. Bien que le droit de réunion fût encore suspendu, par suite de l'état de siège, M. Dufaure, ministre de l'intérieur, s'empressa de donner son autorisation au Congrès. Grâce à leurs efforts, auxquels ils voulurent associer l'auteur de cette note, toutes choses se trouvèrent disposées pour le Congrès.
Le 22 août, à midi, le Congrès s'ouvrait dans la jolie salle Sainte-Cécile (Chaussée d'Antin), qui avait été artistement ornée pour la circonstance. Derrière le bureau du président et autour de l'enceinte réservée aux Amis de la Paix, on avait disposé en faisceaux fraternels les drapeaux de la France, de l'Angleterre, des Etats-Unis, de la Belgique, de la Hollande, etc. La réunion, composée, en grande partie, des délégués des Sociétés des Amis de la Paix de l'Angleterre, des Etats-Unis et des autres nations étrangères, présentait l'aspect le plus pittoresque. On y distinguait les quakers à leur habit noir au collet relevé, à leurs chapeaux aux larges bords, et mieux encore, à leur physionomie fine et bienveillante. Dans les tribunes, on remarquait aussi quelques jolis visages de quakeresses, emprisonnés dans d'énormes chapeaux gris, dépourvus de tout ornement. Les places réservées aux visiteurs étaient envahies par une affluence considérable. On comptait dans la salle vingt-trois délégués américains, vingt-un des Etats-Unis, un de Montréal, un de Guatemala; parmi eux se trouvaient deux anciens esclaves; un de ces délégués avait fait plus de sept cents lieues dans les terres, pour venir s'embarquer à New-York. Les membres anglais du Congrès, la plupart délégués par des villes ou des réunions convoquées à cet effet, étaient au nombre de plus plus de trois cents. On comptait deux cent trente Français, vingt-trois Belges, et un petit nombre de Suédois, d'Allemands, d'Italiens, d'Espagnols. Dans l'enceinte réservée au public, se pressaient plus de deux mille personnes, dont trois cents visiteurs anglais venus spécialement pour le Congrès, en compagnie des délégués.
Cette assemblée a fait l'admiration de ceux qui y ont assisté; le retentissement que ses discussions produisirent fut grand dans Paris, et étonna singulièrement ceux qui n'avaient voulu d'abord voir dans cette manifestation qu'une excentricité de philanthropes.
La presse reproduisit tout au long ces discussions; et avec les magnifiques discours de Victor Hugo, de Richard Cobden, du pasteur Athanase Coquerel, du R. John Burnett, de l'abbé Deguerry, de Henri Vincent, cet ancien contre-maître de Manchester devenu un des hommes les plus éloquents de l'Angleterre, et de l'éminent publiciste Émile de Girardin, etc., la parole de pais circula dans le monde entier, et jeta dans toutes les âmes des semences fécondes que l'avenir verra lever.
Le Congrès de Paris a renouvelé, en les pressant encore davantage, les vœux du Congrès de Bruxelles, déjà émis par des centaines de meetings, en Amérique et au delà de la Manche, savoir: « Que, la paix pouvant seule garantir les intérêts moraux et matériels des peuples, le devoir de tous les gouvernements est de soumettre à un arbitrage les différends qui s'élèvent entre eux, et de respecter les décisions des arbitres qu'ils auront choisis; — Qu'il est utile d'appeler l'attention immédiate de tous les gouvernements sur la nécessité d'entrer, par une mesure générale et simultanée, dans un système de désarmement, afin de réduire les charges des Etats et en même temps faire disparaître une cause permanente d'inquiétude et d'irritation entre les peuples; — Et qu'il est temps de préparer l'opinion publique, dans tous les pays, à la formation d'un Congrès des nations, dont l'unique objet serait la rédaction de lois internationales et la constitution d'une Cour suprême à laquelle seraient soumises toutes les questions qui touchent aux droits et aux devoirs réciproques des nations. » En outre, le Congrès, renfermant plusieurs hommes pratiques, a énergiquement repoussé les emprunts et les impôts destinés à alimenter les guerres d'ambition et de conquête. S'il n'a pas compris dans sa réprobation toutes les autres guerres, c'est que la majorité, composée d'étrangers, a voulu éviter qu'il fût fait allusion aux événements du moment, et notamment à l'intervention armée de la France à Rome.
Le Congrès a recommandé à tous ses membres de travailler, dans leurs pays respectifs, à faire disparaître, et par une meilleure éducation de la jeunesse, et par toute autre voie, les préjugés politiques et les haines héréditaires qui ont été si souvent causes de guerres désastreuses. Il a adressé la même invitation à tous les ministres des cultes revêtus de la sainte mission de nourrir les sentiments de concorde parmi les hommes, ainsi qu'aux divers organes de la presse qui agit si puissamment sur le développement de la civilisation. Enfin il a fait des vœux pour le perfectionnement des voies de communication internationale, pour l'extension de la réforme postale, pour la généralisation des mêmes types de poids, de mesures et de monnaies, pour la multiplication des Sociétés de la paix, qui seraient appelées à correspondre entre elles.
On s'est étonné que le Congrès n'ait pas compris dans ses vœux la réforme des tarifs qui ont été la cause directe ou indirecte de tant de guerres; mais la réunion n'a pas voulu que la discussion se fixât sur les questions commerciales, afin d'éviter tout prétexte aux diatribes des prohibitionnistes, qui auraient signalé dans le Congrès de la paix le cheval de Troie du libre échange.
On demande souvent quel résultat pratique pourra être obtenu par l'influence de ces associations et de ces Congrès. Mais n'est-ce pas déjà un grand et admirable résultat d'avoir réuni fraternellement des représentants éminents de la France, de l'Angleterre, des Etats-Unis, de la Hollande et de l'Allemagne, ces nations naguère ennemies? N'est-ce pas un admirable résultat d'avoir fait applaudir l'idée de la paix dans le principal foyer de l'esprit de la guerre? N'est-ce pas un admirable résultat que l'acclamation de l'archevêque de Paris comme président d'une assemblée, composée en grande partie de quakers et do protestants? Lorsque l'opinion sera gagnée à la cause de la paix, les gouvernements ne pourront plus faire la guerre, et cette grande cause de barbarie et de misère ne pèsera plus sur l'humanité. Or, le Congrès de Paris a exercé sur l'opinion une influence notoire, et par conséquent il a atteint le résultat le plus important et le plus pratique qu'il pût souhaiter d'atteindre.
Mais ce qui prouve que les Amis de la Paix ne sont pas aussi utopistes qu'on pense, et que tous les hommes sérieux dans la politique avouent tout bas que le système suivi jusqu'à ce jour des nombreuses armées, des grandes flottes, des gros budgets, des dettes progressives, ne peut durer; c'est qu'après avoir épuisé les forces ou irrité les populations au sujet d'un différend, ils ont recours à des espèces d'arbitrages, et finissent par où les Amis de la Paix leur conseillent de commencer!
Déjà les pouvoirs publics ont eu leur attention éveillée sur les questions agitées au Congrès de la paix, et plus d'une fois ils ont écouté avec intérêt des propositions d'arbitrage et de désarmement. En 1844, la législature de l'Etat de Massachussets a déclaré solennellement que l'arbitrage devait remplacer le duel entre les nations, et a invité le Congrès de l'Union à prendre l'initiative de la formation d'un Congrès universel. Cette proposition était introduite, il y a deux ans, par M. Amos Turk, au sein de la Chambre des représentants, et par M. Francisque Bouvet, au sein de l'Assemblée Constituante de France. En 1849 (juin) une motion analogue de M. Richard Cobden, appuyée de mille pétitions couvertes de deux cent mille signatures, était soutenue par soixante-dix-neuf voix (sur 255): soixante-dix-neuf voix au sein de l'Assemblée politique la plus pratique, dans laquelle il n'y avait eu, il y a dix ans, que 14 voix en faveur de la motion de M. Villiers pour la réforme des lois céréales obtenue en 1846! Quant à la question des armements et des dépenses ruineuses qu'ils entraînent, elle s'impose d'elle-même à tous les gouvernements et à toutes les Assemblées publiques, au moins une fois l'an, quand il s'agit de compter avec le contribuable.
En résumé, les seuls arguments qu'on oppose aux Amis de la Paix sont tirés de la force des préjugés et de la difficulté de les vaincre. Eh bien! grâce à Dieu, l'histoire de l'humanité prouve que les préjugés ne sont pas éternels.
Joseph Garnier.
Congrès à Paris des Amis de la paix universelle. Première séance. Mercredi 22 août 1849. - Présidence de M. Victor Hugo. [extract pp. 1-5]
Bien que la séance du Congrès ne dût commencer qu'à midi, il y avait dès onze heures une affluence considérable dans la salle, à tel point que le tapissier n'a pas eu, ce jour-là, le temps de disposer convenablement tous les sièges. Plusieurs personnes sans carte attendaient dans la cour de l'hôtel et même dans la rue de la Chaussée-d'Antin où stationnaient quelques officiers de police.
A midi précis les membres du Comité d'organisation, réunis chez M. Coquerel, se sont rendus à la salle Sainte-Cécile qui est très-rapprochée de son domicile.
Aux membres du Comité présents, MM. Francisque Bouvet, Coquerel, l'abbé Deguerry, Victor Hugo, Ch. Hindley, Visschers, Ewart, Cobden, le Rév. Richard, Joseph Sturge, E. Burritt, Joseph Garnier, s'étaient joints plusieurs autres membres du Congrès.
Lorsque les membres du Comité se présentent sur la plate-forme, ils sont accueillis par des hurrahs et des applaudissements réitérés.
M. Joseph Garnier, chargé des fonctions de secrétaire, monte à la tribune; un silence profond s'établit.
Messieurs, dit-il, c'est comme secrétaire du Comité d'organisation et par ses ordres que je me présente le premier à cette tribune. Je dois d'abord vous donner connaissance des noms des membres du Congrès présents ou adhérents. Deux listes de membres ont été faites; une qui contient les noms des membres américains et anglais; une autre qui contient les noms des membres qui se sont fait inscrire au secrétariat du Congrès, et qui renferme les noms des membres français et ceux de quelques membres des autres pays, présents ou adhérents.
MM. Richard, Burritt et moi allons successivement donner connaissance au Congrès de ces diverses listes.
M. Richard lit, au milieu des applaudissements, la liste des plus notables membres de la délégation anglaise, ainsi que celle des villes d'Angleterre qui ont voulu être représentées au Congrès.
M. Elihu Burritt paraît également à la tribune pour donner connaissance des noms des délégués américains qui ont traversé les mers pour prendre part aux travaux du Congrès. A sa vue, les hurrahs et les applaudissements éclatent de toutes parts.
M. Joseph Garnier lit ensuite une partie de la liste des membres, dressée au secrétariat du Congrès. Plusieurs voix demandent l'impression de la seconde partie de cette liste.
L'orateur continuant: Messieurs, pour faciliter aux membres du Congrès l'installation de l'Assemblée et pour éviter la perte d'un temps très-précieux, le Comité, sur le désir de beaucoup d'entre vous, m'a chargé de vous donner connaissance du bureau qui présidera à vos travaux, s'il obtient votre assentiment. (Approbation générale.)
Messieurs, le Comité d'organisation vous propose pour président M. Victor Hugo, représentant du peuple à l'Assemblée législative de France. (Bravos et applaudissements prolongés.)
Le Comité d'organisation vous propose pour vice-présidents:
Pour la France: MM. l'abbé Deguerry, curé de la Madeleine, et M. le pasteur Athanase Coquerel, représentant du peuple. (Les bravos et les applaudissements recommencent.)
Pour l'Angleterre: M. Richard Cobden et M. Charles Hindley, membres du Parlement. (Toute la salle se lève, les chapeaux et les mouchoirs s'agitent de toutes parts; on entend plusieurs fois au milieu des applaudissements, les cris: Hip! hip! hip! Hurrah!)
Pour la Belgique: M. Auguste Visschers, conseiller des mines, président du dernier Congrès tenu à Bruxelles. (Vifs applaudissements.)
Pour la Hollande: M. Suringar, vice-président du Congrès de1 Bruxelles; pour l'Allemagne: M. le docteur Carové, d'Heidelberg. (Nouveaux applaudissements.)
Pour les Etats-Unis: M. Amasa Walker, de la législature de Massachussets, et M. Durkee, membre du Congrès de l'Union, qui a fait sur le continent américain sept cents lieues pour venir s'embarquer à New-York et se rendre au milieu de vous. (Applaudissements et bravos prolongés.)
Les membres du bureau prennent place; les applaudissements recommencent.
M. Visschers. Messieurs, pour compléter le bureau, nous avons l'honneur de vous proposer pour secrétaires:
MM. Elihu Burritt, Joseph Garnier, Henri Richard et 2iegler. (Bravo! bravo! Applaudissements;)
M. Victor Hugo, président, se lève. (Profond silence.)
Messieurs, beaucoup d'entre vous viennent des points du globe les plus éloignés, le cœur plein d'une pensée religieuse et sainte. Vous comptez dans vos rangs des publicistes, des philosophes, des ministres des cultes chrétiens, des écrivains éminents, plusieurs de ces hommes considérables, de ces hommes publics et populaires qui sont les lumières de leur nation. ( Applaudissements. ) Vous venez ajouter aux principes qui dirigent aujourd'hui les hommes d'Etat, les gouvernants, les législateurs, un principe supérieur. Vous venez tourner en quelque sorte le dernier et le plus auguste feuillet de l'Evangile, celui qui impose la paix aux enfants du même Dieu, et, dans cette ville qui n'a encore décrété que la fraternité des citoyens, vous venez proclamer la fraternité des hommes. ( Bravo! bravo! )
Soyez les bienvenus !...
Messieurs, cette pensée religieuse, la paix universelle, toutes les nations liées entre elles d'un lien commun, l'Evangile pour loi suprême, la médiation substituée à la guerre, cette pensée religieuse est-elle une pensée pratique? Cette idée sainte est-elle une idée réalisable? Beaucoup d'esprits positifs, comme on dit aujourd'hui, beaucoup d'hommes politiques vieillis dans le maniement des affaires, répondent non. Moi, je réponds avec vous, je réponds sans hésiter, je réponds: oui ( Applaudissements ), et je vais essayer de le prouver tout à l'heure.
Je vais plus loin; je ne dis pas seulement: c'est un but réalisable, je dis: c'est un but inévitable; on peut en retarder ou en hâter l'avènement, voilà tout.
La loi du monde n'est pas et ne peut pas être distincte de la loi de Dieu. Or, la loi de Dieu, ce n'est pas la guerre, c'est la paix. ( Applaudissements. ) Les hommes ont commencé par la lutte, comme la création par le chaos. (Bravo! bravo! ) D'où viennent-ils? De la guerre; cela est évident. Mais où vont-ils? A la paix; cela n'est pas moins évident.
Quand vous affirmez ces hautes vérités, il est tout simple que votre affirmation rencontre la négation; il est tout simple que votre foi rencontre l'incrédulité; il est tout simple que dans cette heure de nos troubles et de nos déchirements, l'idée de la paix universelle surprenne et choque presque comme l'apparition de l'impossible et de l'idéal; il est tout simple que l'on crie à l'utopie; et, quant à moi, humble et obscur ouvrier dans cette grande œuvre du dix-neuvième siècle, j'accepte cette résistance des esprits sans qu'elle m'étonne ni me décourage. Est-il possible que vous ne fassiez pas détourner les têtes et fermer les yeux dans une sorte d'éblouissement, quand, au milieu des ténèbres qui pèsent encore sur nous, vous ouvrez brusquement la porte rayonnante de l'avenir ? ( Applaudissements. )
Messieurs, si quelqu'un, il y a quatre siècles, à l'époque où la guerre existait de commune à commune, de ville à ville, de province à province, si quelqu'un eût dit à la Lorraine, à la Picardie, à la Normandie, à la Bretagne, à l'Auvergne, à la Provence, au Dauphiné, à la Bourgogne: un jour viendra où vous ne vous ferez plus la guerre, un jour viendra où vous ne lèverez plus d'hommes d'armes les uns contre les autres, un jour viendra ou l'on ne dira plus: les Normands ont attaqué les Picards, les Lorrains ont repoussé les Bourguignons; vous aurez bien encore des différends à régler, des intérêts à débattre, des contestations à résoudre, mais savez-vous ce que vous mettrez à la place des hommes d'armes, savez-vous ce que vous mettrez à la place des gens de pied et de cheval, des canons, des fauconneaux, des lances, des piques, des épées? vous mettrez une petite boite de sapin que vous appellerez l'urne du scrutin, et de cette boite il sortira, quoi? une assemblée! une assemblée en laquelle vous vous sentirez tous vivre, une assemblée qui sera comme votre âme à tous, un concile souverain et populaire, qui décidera, qui jugera, qui résoudra tout en loi, qui fera tomber le glaive de toutes les mains, et surgir la justice dans tous les cœurs; qui dira à chacun: Là finit ton droit, ici commence ton devoir; bas les armes! vivez en paix! ( Applaudissements. ) Et ce jour-là vous vous sentirez une pensée commune, des intérêts communs, une destinée commune; vous vous embrasserez, vous vous reconnaîtrez fils du même sang et de la même race; ce jour-là vous ne serez plus des peuplades ennemies, vous serez un peuple; vous ne serez plus la Bourgogne, la Normandie, la Bretagne, la Provence, vous serez la France; vous ne vous appellerez plus la guerre, vous vous appellerez la civilisation!
Si quelqu'un eût dit cela à cette époque, messieurs, tous les hommes sérieux et positifs, tous les gens sages, tous les grands politiques d'alors se fussent écriés: « Oh! le songeur! Oh! le rêve-creux ! Comme cet homme connaît peu l'humanité! Que voilà une étrange folie et une absurde chimère! » — Messieurs, le temps a marché, et il se trouve que ce rêve, cette folie, cette chimère, c'est la réalité.
Et, j'insiste sur ceci, l'homme qui eût fait cette prophétie sublime eût été déclaré fou par les sages, pour avoir entrevu les desseins de Dieu!
Eh bien! vous dites aujourd'hui, et je suis de ceux qui disent avec vous tous, nous qui sommes ici, nous disons à la France, à l'Angleterre, à la Prusse, à l'Autriche, à l'Espagne, à l'Italie, à la Russie, nous leur disons:
Un jour viendra où les armes vous tomberont des mains, à vous aussi; un jour viendra où la guerre paraîtra aussi absurde et sera aussi impossible entre Paris et Londres, entre Pétersbourg et Berlin, qu'elle serait impossible et qu'elle paraîtrait absurde aujourd'hui entre Rouen et Amiens, entre Boston et Philadelphie. Un jour viendra où, vous France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous joindrez étroitement dans une unité supérieure, et vous constituerez la fraternité européenne, absolument comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace, toutes nos provinces , se sont fondues dans la France. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autres champs de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage universel des peuples, par le vénérable arbitrage d'un grand sénat souverain, qui sera à l'Europe ce que le Parlement est à l'Angleterre, ce que la Diète est à l'Allemagne, ce que l'Assemblée législative est à la France! ( Applaudissements. ) Un jour viendra où l'on montrera un canon dans les Musées comme on y montre aujourd'hui un instrument de torture, en s'étonnant que cela ait pu être! (Rires et bravos.) Un jour viendra où l'on verra ces deux groupes immenses, les Etats-Unis d'Amérique, les Etats-Unis d'Europe (Applaudissements), placés en face l'un de l'autre, se tendant la main par-dessus les mers, échangeant leurs produits, leur commerce, leur industrie, leurs arts, leurs génies, défrichant le globe, colonisant les déserts, améliorant la création sous le regard du Créateur, et combinant ensemble, pour en tirer le bien-être de tous, ces deux forces infinies, la fraternité des hommes et la puissance de Dieu.
Et ce jour-là, il ne faudra pas quatre cents ans pour l'amener, car nous vivons dans un temps rapide, nous vivons dans le courant d'événements et d'idées le plus impétueux qui ait encore entraîné l'humanité, et, à l'époque où nous sommes, une année fait parfois l'ouvrage d'un siècle. ( Très-bien ! )
Et Français, Anglais, Belges, Allemands, Russes, Slaves, Européens, Américains, qu'avonsnous à faire pour arriver le plus tôt possible à ce grand jour? Nous aimer. ( Applaudissements. )
( M. Victor Hugo énumère ensuite les dépenses énormes que la crainte de la guerre a occasionnées en trente années de paix. On a tenu sur pied, en Europe, près de deux millions d'hommes, et dépensé, en trente ans, la somme de 128 milliards pour se préparer à la guerre qui ne venait pas, et l'on n'a pas vu les révolutions qui arrivaient. En donnant un emploi productif à cette somme, n'aurait-on pas pu prévenir un danger plus réel et plus sérieux que celui de la guerre, le danger de la misère, cause incessante des révolutions? )
Messieurs, a continué l'éloquent orateur, ne désespérons pas pourtant. Au contraire, espérons plus que jamais! Ne nous laissons pas effrayer par des commotions momentanées, secousses nécessaires peut-être des grands enfantements. Ne soyons pas injustes pour le temps où nous vivons; ne voyous pas notre époque autrement qu'elle n'est. C'est une prodigieuse et admirable époque, après tout, et le dix-neuvième siècle sera, disons-le hautement, la plus grande page de l'histoire. Comme je vous le rappelais tout à l'heure, tous les progrès s'y révèlent et s'y manifestent à la fois, les uns amenant les autres: chute des animosités internationales, effacement des frontières sur la carte et des préjugés dans les cœurs, tendance à l'unité, adoucissement des mœurs, élévation du niveau de l'enseignement et abaissement du niveau des pénalités, domination des langues les plus littérairés c'est-à-dire les plus humaines; tout se meut en même temps, économie politique, sciences, industrie, philosophie, législation, et converge au même but, la création du bien-être et de la bienveillance, c'est-à-dire, et c'est là pour ma part le but auquel je tendrai toujours, extinction de la misère au dedans, extinction de la guerre au dehors. ( Applaudissements. )
Oui, je le dis en terminant, l'ère des révolutions se ferme, l'ère des améliorations commence. Le perfectionnement des peuples quitte la forme violente pour prendre la forme paisible; le temps est venu où la Providence va substituer à l'action désordonnée des agitateurs l'action religieuse et calme des pacificateurs.
Désormais, le but de la politique grande, de la politique vraie, le voici: faire reconnaître toutes les nationalités, restaurer l'unité historique des peuples, et rallier cette unité à la civilisation par la paix, élargir sans cesse le groupe civilisé, donner le bon exemple aux peuples encore barbares, substituer les arbitrages aux batailles; enfin, ceci résume tout, faire prononcer par la justice le dernier mot que l'ancien monde faisait prononcer par la force.
Messieurs, je le dis en terminant, et que cette pensée nous encourage, ce n'est pas d'aujourd'hui que le genre humain est en marche dans cette voie providentielle. Dans notre vieille Europe, l'Angleterre a fait le premier pas, et par son exemple séculaire, elle a dit aux peuples: « Vous êtes libres. » La France a fait le second pas, et elle a dit aux peuples: « Vous êtes souverains. »
Maintenant, faisons le troisième pas, et tous ensemble, France, Angleterre, Belgique, Allemagne, Italie, Europe, Amérique, disons aux peuples: « Vous êtes frères! » (Sensation vive. Sur un signal de M. Cobden, les membres du Congrès anglais et américains se lèvent et agitent leurs chapeaux et leurs mouchoirs en poussant les trois cheers britanniques: Hip! hip! hip! hurrah! etc. )
….
Deuxième séance. Jeudi, 23 août 1849. - Présidence de M. Victor Hugo. [extract pp. 24-28]
…
M. Ewart, membre du Parlement, vice-président du Congrès de Bruxelles. (Applaudissements.)
( L'honorable membre, qui s'exprime en français, s'élève contre l'abus des armements. )
A quoi nous servirait, dit-il, de prêcher les doctrines de la paix, si nous continuions à suivre dans la pratique les tendances de la guerre? Nous fermons le temple de Janus, mais, en même temps, nous fortifions ses murailles avec du canon. Soyons donc logiques et pratiques, et réduisons notre appareil militaire et naval. Est-ce que la puissance réelle d'une nation se trouve dans ses arsenaux? N'est-elle pas bien plutôt dans son commerce, dans ses manufactures, dans son capital? Quel pays peut avoir, en cas de guerre, la marine militaire la plus considérable? N'est-ce pas celui qui possède le plus grand nombre de steamers à l'usage du commerce? La France n'a pas su développer encore autant que les Etats-Unis et l'Angleterre les éléments de puissance et de prospérité, dont elle dispose; mais il faut espérer qu'elle ne demeurera pas plus longtemps en retard. - On vous l'a dit déjà, le peuple anglais n'est pas l'ennemi du peuple français, quoique naguère on ait pu appliquer à nos deux pays ce vers de Virgile sur la rivalité de Carthage et de Rome.
Liltora littoribus contraria, fluctibus undae, Arma armis.
Mais le temps est venu où la mer qui nous séparait ne doit plus servir qu'à nous unir. Permettez-moi de citer à ce propos les paroles d'un homme qui passait pour être l'ennemi de la France, je veux parler de M. Pitt. Dans son discours sur le traité de commerce de 1787, M. Pitt niait énergiquement « que la France dut être considérée comme l'ennemie naturelle de l'Angleterre. Son esprit répugnait à accepter cette idée. Il la regardait comme monstrueuse et absurde. Une supposition semblable, ajoutait-il, n'est fondée ni sur l'expérience de l'histoire, ni sur la condition naturelle de l'homme. Elle implique l'existence d'une malignité diabolique dans la nature humaine.
( M. Ewart déclare qu'il n'a pas une grande confiance dans les unions diplomatiques qu'il qualifie d'unions sur le papier.)
C'est l'union des peuples qu'il faut cimenter, dit-il. N'avons-nous pas, inscrits sur nos cartes du Congrès, ces vers de votre immortel Béranger?
Peuples, formez une sainte alliance Et donnez-vous la main.
Et permettez-moi de citer aussi, en terminant, quelques vers d'un de nos poètes écossais, Burns, qui semble avoir devancé la pensée de Béranger.
Prious, prions pour qu'arrive bientôt, Comme il doit arriver, ce jour Où, sur toute la surface du monde, L'homme sera un frère pour l'homme.
( Applaudissements. )
M. Bastiat, représentant du peuple. (L'orateur est accueilli avec des applaudissements réitérés. )
Messieurs, notre excellent et savant collègue, M. Coquerel, nous parlait tout à l'heure de cette maladie cruelle dont la France est travaillée, le scepticisme. Elle est le fruit de nos révolutions sans issue, de nos entreprises sans résultats, et de ce torrent de projets visionnaires qui a envahi notre politique. J'espère que ce mal sera passager, et, en tous cas, je ne sais rien de plus propre à le guérir que le spectacle imposant que j'ai maintenant devant les yeux; car si je considère le nombre et l'importance des hommes qui me font l'honneur de m'écouter, si je tiens compte qu'un grand nombre d'entre eux n'agissent pas en leur nom, mais au nom des villes et des provinces qui les ont délégués à ce Congrès, je n'hésite pas à dire que la cause de la paix réunit aujourd'hui dans cette assemblée plus de force religieuse, intellectuelle et morale, plus d'influence réelle qu'aucune autre cause quelconque n'en pourrait rassembler autour d'elle sur aucun point du globe. Oui, c'est là un grand et magnifique spectacle, et je ne crois pas que le soleil eu ait jamais éclairé de semblable. Voici des hommes qui ont traversé l'Atlantique; d'autres ont abandonné en Angleterre de vastes entreprises; d'autres encore ont quitté le sol tremblant de l'Allemagne ou les paisibles terres de la Hollande et de la Belgique. Paris est leur rendez-vous. Et qu'y viennent-ils faire? Sont-ils attirés par la cupidité, la vanité ou la curiosité, ces trois moteurs auxquels on a coutume d'attribuer les actions des fils d'Adam? Non, ils viennent, poussés par l'espoir de réaliser du bien pour l'humanité, les yeux bien ouverts sur les difficultés de l'entreprise, et sachant qu'ils ne travaillent pas pour eux-mêmes, mais au profit des générations futures. Hommes de dévouement et de foi, soyez les bienvenus sur cette terre de France. La foi est contagieuse comme le scepticisme. Mon pays ne vous fera pas défaut; lui aussi apportera son tribut à votre généreuse entreprise. (Applaudissements.)
(L'orateur s'attache à développer cette pensée, que, dans l'état actuel des esprits en France et en Europe, on né peut compter sur l'ordre intérieur si l'on n'égalise pas les charges entre les citoyens. Il prouve que l'égalité des charges est incompatible avec certains impôts très-productifs; que l'on ne saurait abolir les impôts que par le désarmement; d'où il conclut que le désarmement est la seule garantie de l'ordre intérieur aussi bien que de la paix extérieure. Après cette démonstration, l'orateur poursuit ainsi: )
J'ai prononcé le mot désarmement. Certes, c'est l'objet de nos vœux universels. Et cependant, par une de ces contradictions inexplicables du cœur humain, je suis sûr qu'il ne manque pas de personnes, tant en France qu'en Angleterre, qui le verraient réaliser avec peine. Que deviendrai!, diraient-elles, notre prépondérance? Consentirons-nous à perdre cette influence que nous avons acquise comme grande et puissante nation? O illusion fatale! Etrange interprétation des mots! Eh quoi! les grandes nations n'exercent-elles d'influence que par les canons et les baïonnettes? Est-ce que l'Angleterre ne doit pas son influence à son industrie, à son commerce, à sa richesse, à l'exercice de ses antiques et libres institutions? Est-ce qu'elle ne la doit pas surtout à ces gigantesques efforts que nous lui avons vu faire, avec tant de persévérance et de sagacité, pour réaliser le triomphe de quelques grands principes, tels que la liberté de la presse, l'extension des franchises électorales, l'émancipation catholique, l'abolition de l'esclavage, la liberté du commerce?
C'est par de tels exemples, j'ose le dire, que l'Angleterre exercera ce genre d'influence qui n'entraîne à sa suite ni désastres, ni haines, ni représailles, qui n'éveille d'autres sentiments que ceux de l'admiration et de la reconnaissance. Et quant à mon pays, je suis fier de le dire, il possède d'autres sources et de plus pures sources d'influence que celle des armes. Que dis-je? celle-ci pourrait être contestée, si l'on pressait la question et si l'on mesurait l'influence aux résultats. Mais ce qui ne peut être contesté, ce qu'on ne peut nous enlever, c'est l'universalité de notre langue, l'éclat incomparable de notre littérature, le génie de nos poètes, de nos philosophes, de nos historiens, de nos romanciers et même de nos feuilletonistes, le dévouement de nos patriotes. La France doit son influence à celte chaîne non interrompue de grands hommes qui commence à Montaigne, Descartes, Pascal, et passant par Bossuet, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, n'ira pas se perdre, grâce au Ciel, dans la tombe de Chateaubriand. Oh! que ma patrie ne craigne pas de perdre son influence tant que son sol sera capable de produire ce noble fruit qu'on nomme le génie, qu'on rencontre toujours du côté de la liberté et de la démocratie. Et en ce moment même, mes frères, vous qui êtes nés sous d'autres cieux et parlez une autre langue, ne voyez-vous pas toutes les illustrations de mon pays s'unir à vous pour le triomphe de la paix universelle? Ne sommes-nous pas présidés par ce grand et noble poète qui a eu la gloire et le privilège d'entraîner toute une génération dans les voies d'une littérature renovée? Ne déplorons-nous pas l'absence d'un autre poète orateur, à l'intelligence puissante, au noble cœur, qui, j'en suis sûr, regrette autant de ne pouvoir élever sa voix parmi nous, que nous regrettons de ne pas l'entendre? N'avons-nous pas emprunté à notre chansonnier ou plutôt à notre barde national notre touchante devise? ( Applaudissements. )
Ne comptons-nous pas dans nos rangs cet infatigable et courageux publiciste qui n'a pas attendu votre présence ici pour mettre au service de la non-intervention absolue l'immense publicité qu'il a su créer et la grande influence dont il dispose? Et n'avons-nous pas, parmi nous, des ministres de la religion chrétienne? ( Applaudissements. ) Au sein de cette illustre galerie, permettez-moi de réclamer une humble place pour mes frères en économie politique; car, messieurs, je crois sincèrement qu'aucune science n'apportera à la cause de la paix un contingent plus précieux. La religion et la morale ne cherchent pas si les intérêts humains sont entre eux harmoniques ou antagoniques. Elles disent aux hommes: « Vivez en paix, que cela vous soit profitable ou nuisible, car c'est votre devoir.» L'économie politique intervient et ajoute: « Vivez en paix, car vos intérêts sont harmoniques, et l'antagonisme apparent qui vous met souvent les armes à la main est une grossière erreur. » Sans doute, ce serait un noble spectacle de voir les hommes réaliser la paix aux dépens de leurs intérêts. Mais, pour qui connaît la faiblesse de notre nature, il est consolant de penser que l'Intérêt et le Devoir ne sont pas des forces hostiles, et le cœur se repose avec confiance dans cette maxime: Cherchez d'abord la justice, le reste vous sera donné par surcroît. (Applaudissements.)
M. Le Président. La parole est à M. Richard Cobden. Toute l'Assemblée se lève et fait longtemps retentir la salle de ses bravos et de ses hurrahs.
M. Cobden ( lisant en français, lorsque le calme est rétabli):
Je me joins de tout mon cœur au vœu exprimé par un des précédents orateurs en faveur d'une langue universelle; cependant je ne puis me défendre d'une crainte. Ne s'élèvera-t-il pas une terrible dispute, même parmi les amis de la paix, sur la question de savoir lequel prévaudra des mille dialectes qui se partagent le monde, et des océans d'encre ne seront-ils pas répandus avant que cette question préalable soit décidée? (Rires.—Adhésion.)
En attendant, laissons donc chacun jouir paisiblement de sa syntaxe et de son dictionnaire. (Rires.—Applaudissements.)
Sous cette réserve, et me rappelant que je suis dans la capitale de la France, je m'en remets entièrement à l'urbanité traditionnelle d'un auditoire parisien, et je me hasarde à lui adresser quelques mots en français boiteux, plutôt que de me rendre coupable, même en matière de langage, d'un acte d'intervention étrangère. (Rires et bravos.)
Après tout ce qui a été dit, et si bien dit, par les éloquents orateurs qui ont parlé avant moi, je ne crois pas devoir rien ajouter aux considérations générales qui vous ont été présentées. Mais je désire appeler votre attention sur la manière dont les forces militaires ont été accrues par les gouvernements de France et d'Angleterre, dans un triste sentiment de rivalité et de défiance.
Je ne parle ici que de ce qui concerne nos marines respectives et la défense de nos côtes, car nous ne prétendons nullement vous égaler en ce qui touche l'armée de terre. Ne prenez pas l'alarme, monsieur le président, je n'enfreindrai pas cette sage disposition du règlement du Congrès qui interdit toute allusion à la politique du jour. (Rires.)
Malheureusement, mes récriminations remontent à bien des années en arrière, impliquent plusieurs ministères, dans les deux pays, et les gouvernements actuels doivent être ici exonérés de toute responsabilité en ces matières. (Très-bien!)
Pendant les treize dernières années, nous n'avons cessé, des deux côtés du détroit, d'accroître notre marine, d'ajouter à la défense de nos côtes, de creuser de nouveaux bassins de construction, et de nouveaux ports de refuge. La quille d'un vaisseau de ligne n'a pas été plutôt posée à Brest que le marteau commence à résonner à Portsmouth. (Rires.)
Une nouvelle forge ne souffle pas à Cherbourg qu'aussitôt l'étincelle ne jaillisse d'une nouvelle enclume à Plymouth, et réciproquement. La conséquence a été que la dépense de nos marines s'est accrue de 50 pour 100 en temps de paix. (Nouvelle hilarité.)
Ma première objection à ce système est sa suprême folie. (Rires.—Très-bien ! ) Car, lorsque les deux pays augmentent dans la même proportion leurs forces navales, ni l'un ni l'autre ne gagne au changement, et le résultat est une perte sèche égale au montant de l'accroissement. (Très-bien !)
Ma seconde objection s'adresse à son extrême hypocrisie! Car en même temps que ces armements grossissaient d'année en année sous nos yeux, nos cabinets respectifs ne cessaient d'échanger les assurances de la plus franche et cordiale amitié. (Rires et bravos.)
S'il y avait quelque sincérité et quelque vérité au fond de ces démonstrations, où donc était la nécessité de tant de vaisseaux en mer et de tant de forts sur nos côtes? Un homme, à moins d'être fou, ne se revêt pas d'armes offensives et défensives au milieu de ses amis. (Rires.)
Mais ma plus grande objection contre ces grands armements, c'est qu'ils tendent à exciter de dangereuses animosités entre les peuples, à perpétuer la crainte, la haine, le soupçon, passions qui, un jour ou l'autre, cherchent instinctivement leur satisfaction dans la guerre. (Applaudissement.)
Et c'est là le motif pour lequel le Congrès désire, dans les termes de la motion qui nous est soumise, amener les nations à un système de désarmement simultané.
Et maintenant, comment atteindrons-nous ce résultat? Il y a un moyen, c'est d'enseigner à nos gouvernements respectifs ce petit problème arithmétique, que, dans les temps passés du moins, ils semblent toujours avoir ignoré, à savoir, que si deux nations, en temps de paix, ont un armement donné, comme, par exemple, six, elles ne seraient pas relativement moins fortes, en réduisant de part et d'autre cet armement à trois, ou même en désarmant complètement. (Applaudissements.)
Mais nous, contribuables de France ou d'Angleterre, nous reconnaîtrions au poids de nos poches qu'il y a une immense différence. (Rires.)
Ne nous laissons cependant pas aller à l'illusion de croire que nous enseignerons facilement cette petite leçon d'arithmétique à nos gouvernements.
Je parle d'après une longue expérience, quand je dis qu'il n'y a pas d'hommes plus durs à apprendre que les hommes d'Etat de profession. (Rires. — Très-bien ! ) Ils sont en général si dominés par la routine et si pleins de leur propre mérite, qu'ils comprennent à grand'peine qu'aucune sagesse puisse exister, si ce n'est celle qui rayonne de leurs bureaux. Croyez-vous qu'ils prendront en grande considération les avis émanés de ce Congrès? Oh! bien au contraire, et, en ce moment même, j'en suis sûr, ils se rient de nous, nous traitent d'utopistes, de théoriciens et de rêveurs.
Et pourtant, il y a dans les résultats de leurs systèmes, au point de vue financier, de quoi les rendre plus modestes. (Nouveaux rires d'adhésion.) Je m'adresse aux gouvernements de l'Europe, et je leur demande: Pouvez-vous continuer votre système financier pendant dix ans encore? Tous, peut-être à une exception près, doivent répondre: Non. Donc, est-ce une chose si utopique de la part de ce Congrès d'attirer leur attention sur ce gouffre qui, de leur aveu, est béant devant eux; de les avertir que le danger d'un désastre financier qu'ils perdent de vue, est plus imminent que celui d'une invasion extérieure, contre laquelle ils se pourvoient avec tant de diligence? (Bravos.)
Ainsi, même à ce point de vue financier, le moins élevé de tous ceux qu'on peut faire valoir, vous êtes justifiés aux yeux du monde pour avoir fondé ce Congres des nations. Certes, il était temps que l'opinion publique intervint, et les hommes qui, dans ces temps difficiles, sont chargés du gouvernement des nations, devraient sincèrement vous remercier de ce que, en vous donnant la main par-dessus l'Atlantique et la Manche, vous avez facilité un désarmement également exigé par tous les principes d'humanité et de politique intelligente. (Applaudissements et hurrahs prolongés )
M. Le Président met aux voix la résolution en discussion, qui est adoptée dans ces termes:
« II. — Il est utile d'appeler l'attention de tous les gouvernements sur la nécessité d'entrer, par une mesure générale et simultanée, dans un système de désarmement, afin de réduire les charges des Etats, et en même temps faire disparaître une cause permanente d'inquiétude et d'irritation entre les peuples. »
Personne ne se lève à la contre-épreuve. (Applaudissements. )
...
Après le Congrès. Le déjeuner à Verseilles. - Soirées. - Visite à M. le prédient de la République. [extract pp. 48-50]
On lit dans le Journal des Economistes du 15 septembre 1849:
« Le lendemain, les membres du Congrès de la paix ont été invités à la soirée du ministre des affaires étrangères, et le lundi suivant on a fait jouer tout exprés pour eux les grandes eaux de Versailles et de Saint-Cloud. MM. Cobdon et John Scoble ont été invités aussi à un dîner chez M. Passy, ministre des finances, avec quelques membres de la Société d'économie 'politique. Enfin, M. Emile de Girardin a terminé ces fêtes en donnant une somptueuse soirée aux Amis de la paix. Chez M. de Tocqueville, ministre des affaires étrangères et chez M. de Girardin, la variété et le laisser-aller des toilettes formaient un assez piquant contraste avec le formalisme accoutumé et un peu banal des réceptions et des soirées ordinaires.
« A Versailles, un déjeuner improvisé a été donné par les délégués anglais aux délégués américains dans la fameuse salle du Jeu de Paume. M. Cobden, qui présidait, a dit à ses compatriotes, aux délégués des Etats-Unis, du Canada et des autres pays, combien ils avaient tous à se réjouir de la manière flatteuse dont ils ont été reçus en France par la population et par le gouvernement, ainsi que du succès obtenu par le Congrès. Tous ont applaudi de bon cœur aux paroles de l'illustre orateur. Après lui, plusieurs Américains, qui n'avaient point été entendus au Congrès, ont prononcé quelques mots bien sentis, et, avec cette parole honnête, digne et convaincue qui a surtout frappé chez ces honorables visiteurs. Nous avons entendu M. Elihu Burritt: au son de cette voix douce et plaintive, à la vue de cette figure calme et inspirée, nous avons pu nous représenter ces hommes de la primitive Eglise, qui marchaient devant eux, sans regarder les obstacles, et passionnaient les masses à force de simplicité, de courage et de dévouement. Afin de témoigner aux délégués, qui sont venus des rives du Saint-Laurent et du Mississipi pour assister au Congrès de la paix, toute la gratitude qu'ils méritent, il leur a été distribué à chacun un exemplaire de la Bible en trés-petit format. Ce souvenir, touchant à plus d'un titre, a paru leur faire le plus grand plaisir, et ils ont manifesté leur reconnaissance par des paroles très-chaleureuses et très-sympathiques. Les membres du Congrès de la paix n'ont pas appris sans émotion qu'ils étaient dans une salle à laquelle se rattache un des plus grands faits de notre histoire, et dont la physionomie ne semble pas avoir beaucoup changé depuis. En voyant quelques-uns de ces orateurs avec leur costume sévère et l'ancien habit à la française, parler en tenant un livre d'une main et en s'appuyant de l'autre sur une petite table, nous nous sommes rappelé celte célèbre Assemblée du tiers Elat et la belle figure de Cailly lisant la protestation historique. »
Conformément à la décision du Congrès, le bureau demanda audience à M. le président de la République pour déposer entre ses mains la série des résolutions adoptées dans la session de 1849.
La députation se composait de M. Victor Hugo, représentant du peuple et président du Congrès de la paix, de M. Charles Hindley, membre du Parlement anglais, Auguste Visschers, président du Congrès de Bruxelles, Suringar d'Amsterdam, de Cormenin, conseiller d'Etat, Deguerry, curé de la Madeleine, Emile de Girardin, le docteur Carové d'Heidelberg, Ziégler et Joseph Garnier. M. le président de la République s'entretint longtemps avec ces messieurs des conditions et des possibilités d'un désarmement simultané chez les principales nations et des avantages nombreux qui en résulteraient pour les finances, l'industrie, le bien-être, la moralité et la tranquillité des populations. M. le président de la République répéta plus d'une fois qu'il appelait de tous ses vœux le moment où il serait possible de ne plus entretenir un effectif aussi lourd. Ce fut MM. Victor Hugo et de Girardin qui soutinrent surtout la conversation avec M. le président de la République.
M. Victor Hugo remit d'abord au président copie des résolutions votées par le Congrès, et lui exprima ensuite avec beaucoup de dignité combien des manifestations de cette nature répondaient, de nos jours, aux véritables besoins des populations, et servaient les gouvernements eux-mêmes, en préparant l'opinion publique à des réformes sans lesquelles la paix du monde ne cesserait pas d'être troublée. Les rêveurs, les poètes, dit-il à M. le président, ce sont ceux qui prêchent et vous conseillent la politique et les systèmes de paix armée; les hommes positifs, ce sont ceux qui, comme nous, viennent vous affirmer que si le neveu du plus grand homme de guerre est appelé à jouer un beau rôle dans notre pays, c'est en travaillant efficacement à l'affermissement de la paix.
Les gouvernements sont dans l'absolue nécessité d'entrer dans la voie du désarmement. Pour rétablir l'équilibre dans les finances de la France, il faut choisir entre une forte réduction dans les dépenses de l'armée ou l'établissement de nouveaux impôts excessivement impopulaires. Tous les gouvernements, en général, doivent opter, dans un avenir prochain, entre un désarmement ou la banqueroute.
M. Em. de Girardin cita les sommes que la France a à payer seulement pour son armée et sa dette publique. Il insista sur les observations de M. Victor Hugo, en montrant l'insuffisance des mesures proposées par le gouvernement pour rétablir l'équilibre entre les dépenses et les recettes.
M. le président reconnut qu'il était urgent d'entrer dans une voie de réduction de l'armée; mais, selon lui, le moment n'était pas encore venu: l'état de l'Europe, les dernières agitations de la France y mettaient un obstacle.
M. Visschers fit alors observer quel était le secours que les Congrès et les Sociétés de la paix pouvaient prêter aux gouvernements, en éclairant les populations sur leurs véritables intérêts, et en favorisant l'éducation populaire. Les gouvernements, à l'envi, renchérissent sur leurs dépenses militaires; la France est le pays dont les habitants sont les plus guerriers; c'est à elle de montrer l'exemple d'un système qui sera bientôt suivi partout.
M. Hindley exposa le succès toujours croissant, en Angleterre, des idées proposées par les Amis de la Paix. L'alliance entre la France et l'Angleterre assurera la paix du monde, en même temps que le désarmement sera pour ces deux puissances une source de bien-être pour leur industrie et leur commerce.
M. le président de la République s'entretint encore avec les divers membres de la députàtion; et il s'informa de M. Richard Cobden, qu'il n'apercevait pas parmi les personnes présentes.
Avant que la députàtion se retirât, MM. Hindley et Visschers remercièrent le président de l'accueil que le gouvernement avait fait aux délégués et aux visiteurs étrangers: tous ont emporté de leur visite, dirent-ils, une haute idée de la grandeur de la France, de l'aménité de ses habitants et de la bienveillance de son gouvernement.
Appendix V. - Résolutions adoptées par le Congrès de la Paix de Paris [pp. 62-63]
Les résolutions suivantes ont été adoptées par le Congrès, dans les mêmes termes que les avait arrêtées, la veille, un Comité auquel avaient assisté MM. Cobden, Visschers, Richard, Burritt, J. Scoble, Joseph Cooper, Francisque Bouvet, Coquerel, Cormenin, Victor Hugo, Joseph Garnier, etc.
Le recours aux armes étant un usage condamné par la religion, la morale, la raison, l'humanité, c'est pour tous les hommes un devoir et un moyen de salut de rechercher et d'adopter les mesures propres à amener l'abolition de la guerre; et les amis de la paix universelle, réunis à Paris les 22, 23 et 24 août en congrès, ont émis les vœux suivants:
I. La paix pouvant seule garantir les intérêts moraux et matériels des peuples, le devoir de tous les gouvernements est de soumettre à un abritrage les différends qui s'élèvent entre eux, et de respecter les décisions des arbitres qu'ils auront choisis.
II. Il est utile d'appeler l'attention de tous les gouvernements sur la nécessité d'entrer, par une mesure générale et simultanée, dans un système de désarmement, afin de réduire les charges des Etals et en même temps faire disparaître une cause permanente d'inquiétude et d'irritation entre les peuples.
III. Le Congrès recommande à tous les Amis de la paix de préparer l'opinion publique, dans leurs pays respectifs, à la formation d'un Congrès des nations, dont l'unique objet serait la rédaction de lois internationales et la constitution d'une Cour suprême à laquelle seraient soumises toutes les questions qui touchent aux droits et aux devoirs réciproques des nations.
IV. Le Congrès réprouve les emprunts et les impôts destinés à alimenter des guerres d'ambition et de conquête.
V. Le Congrès recommande à tous ses membres de travailler, dans leurs pays respectifs, à faire disparaître, et par une meilleure éducation de la jeunesse, et par toute autre voie, les préjugés politiques et les haines héréditaires qui ont été si souvent causes de guerres désastreuses.
VI. Le Congrès adresse la même invitation à tous les ministres des cultes revêtus de la sainte mission de nourrir les sentiments de concorde parmi les hommes; ainsi qu'aux divers organes de la presse qui agit si puissamment sur le développement de la civilisation.
VII. Le Congrès fait des vœux pour le perfectionnement des voies de communication internationale, pour l'extension de la réforme postale, pour la généralisation des mêmes types de poids, de mesures et de monnaies, pour la multiplication des Sociétés de la paix qui seraient appelées à correspondre entre elles.
VIII. Le Congrès décide que son Bureau est chargé de rédiger une adresse à tous les peuples, de porter les vœux de la réunion à la connaissance des gouvernements, et d'en remettre spécialement une minute entre les mains de M. le président de la République française.
44.Dunoyer on the “République démagogico-socialiste” (1849)↩
[Word Length: 6,036]
Source
Charles Dunoyer , La révolution du 24 février (Paris: Guillaumin, 1849. Livre VI: Résultats de l'essai de république démagogico-socialiste qui a été tenté par la révolution, pp. 125-146.
Livre VI: Résultats de l'essai de république démagogico-socialiste qui a été tenté par la révolution
L'effet le plus immédiat de cette tentative n'en a pas été, à beaucoup près, l'effet le plus grave.
Sans doute la désertion des ateliers particuliers, provoquée par l'ouverture des ateliers nationaux et par l'offre d'un salaire sans travail sérieux, a été par elle-même un grand mal. Elle a, en effet, déterminé sur-le-champ la dislocation, au moins partielle, d'un assez grand nombre d'établissements, et commencé cette désorganisation générale du régime économique établi, que les novateurs regardaient comme un préliminaire indispensable de l'exécution de leurs projets.
Mais cet effet, quelque désastreux qu'il fût, ne saurait être comparé à celui qui s'est manifesté bientôt après, à mesure que la désertion s'est accrue dans les ateliers particuliers, que se sont peuplés les ateliers nationaux, et que s'est développée cette armée de politiques désœuvrés et violents, que sa position, sa nature, son organisation livraient tout entière à l'influence de la démagogie et du socialisme, et qui allait devenir dans leurs mains un instrument si dangereux.
A la vue de cette force redoutable et croissante, évidemment destinée à appuyer les desseins monstrueux qui s'annonçaient, et dont le gouvernement se montrait à moitié complice, l'alarme est entrée dans les esprits; on a cru à la possibilité d'immenses désordres, de sauvages tentatives de spoliation, de confusion, de guerre, de dissolution sociale; et ces craintes, chaque jour plus accréditées par les faits dont on était témoin, ont produit des effets chaque jour plus graves.
Quand les entrepreneurs d'industrie n'auraient pas été amenés à suspendre leurs travaux par la désertion des ouvriers, par la violence et l'exagération de leurs demandes, ils s'y seraient déterminés d'eux-mêmes et par la seule appréhension de ce qui semblait devoir arriver. Mais ils y ont été forcés bientôt par une cause plus impérieuse encore, par la nécessité, c'est-à-dire par la rapide cessation des demandes et par l'interruption presque soudaine du mouvement commercial.
Cette interruption a été la suite de la terreur que l'on venait de faire naître. Sitôt que cette terreur d'un nouveau caractère a commencé à se propager, les étrangers opulents établis dans le royaume, et ceux, en beaucoup plus grand nombre, qui le visitaient seulement en qualité de touristes, ont songé immédiatement à le quitter, et ont pris, de toutes parts, le chemin des frontières. En même temps, les familles riches ou aisées du pays se sont mises en devoir de réformer leur maison et de couper court immédiatement à la partie la moins nécessaire de leurs dépenses. Non seulement on a renoncé immédiatement aux dépenses de luxe, qui, dans l'état de trouble où venait de tomber la société, et au milieu de l'invasion barbare qu'elle était menacée de subir, ne pouvaient plus avoir le moindre attrait, mais on a songé même à se réduire sur les plus nécessaires. Chacun, par un sentiment de prudence peut-être exagéré, mais naturel, a voulu réserver ses ressources pour les cas extrêmes. Loin de céder au besoin d'acheter, on a réalisé ce qu'on a pu de sa fortune, et visé à faire argent de tout. Un bon nombre de maisons riches renvoyaient une partie de leurs gens et se défaisaient à vil prix de leurs chevaux et de leurs équipages. Une multitude d'autres portaient à la Monnaie leur argenterie et l'échangeaient au poids contre du numéraire. L'Hôtel des Monnaies, pour suffire aux demandes de cette nature, n'a pas eu à livrer, pendant quelque temps, moins de deux cent mille francs par jour. Au milieu de la stupeur qui régnait, on a vu, en quelques instants, la circulation s'arrêter et l'argent monnayé disparaître.
On sent quel a dû être l'effet de ce mouvement général et presque subit. La demande s'arrêtant, la vente a dû forcément cesser, et, avec la vente des produits créés, la création de produits nouveaux. Le marchand, gardant en magasin ses marchandises, n'a plus eu de commandes à faire au fabricant, le fabricant au producteur de matières premières ni à l'ouvrier qu'il chargeait de les façonner. Non seulement il a fallu renoncer à tenter des affaires nouvelles, mais on a commencé par ne pouvoir faire honneur aux affaires anciennes. La vente et le travail s'arrêtant, il est devenu presque impossible de réaliser les rentrées sur lesquelles on avait compté, et de faire honneur par suite aux engagements qu'on avait pris. Le marchand a manqué au fabricant, le fabricant au banquier, le banquier à ceux qui lui avaient confié leurs épargnes, et ainsi de suite, presque sans fin. Il n'y a pas eu, à vrai dire, un ordre de travailleurs, à commencer naturellement par ceux dont les services ou les produits étaient le moins indispensables, qui, de proche en proche, n'aient été atteints, et dont la souffrance n'ait immédiatement été ressentie par toutes les industries enchaînées à la sienne, surtout par les agents directs de son propre travail, et, en particulier par ceux dont les ressources étaient le plus limitées et le plus précaires, par les ouvriers. Les familles innombrables dont l'existence se liait à quelque branche du travail universel ont vu disparaître ainsi subitement les sources de leur bienêtre. Le sort des capitalistes a suivi celui des travailleurs; la condition des propriétaires n'a pas été plus digne d'envie que celle des possesseurs de capitaux; il n'y a guère eu personne qui n'ait senti dans ses mains ses ressources se fondre, et la crise a été marquée surtout par une dépréciation immédiate de toutes les valeurs, des terres, des capitaux, des rentes, des offices publics, des professions, des talents, des facultés de toute espèce. L'État, à son tour, n'a pas tardé à ressentir le contrecoup de cet appauvrissement universel; et, tandis qu'il avait à pourvoir à des besoins nouveaux beaucoup plus étendus, aux exigences de nouvelles et innombrables ambitions, à l'alimentation de l'armée d'ouvriers que le socialisme et la démagogie recrutaient sous ses yeux pour procéder à une rénovation sociale, il a vu tarir rapidement ses sources de revenu les plus abondantes; il s'est laissé entraîner à manquer aux engagements les plus sérieux, et il a finalement recouru, pour remédier aux maux de la situation, à des expédients qui ont été une extrême aggravation du mal pour tout le monde.
Il n'est pas une de ces énonciations générales que ne justifient des masses de faits particuliers.
Veut-on, par exemple, se faire une idée des réductions qu'avait subies partout le travail? Il n'y a qu'à se rappeler les nouvelles que les journaux, au fort de la crise, donnaient de tous nos grands foyers d'industrie. Il n'en était pas un d'où l'on n'annonçât la fermeture complète ou partielle d'une multitude d'établissements. Une enquête industrielle faite dans les départements de l'est a appris qu'en Alsace il avait fallu renvoyer la moitié des ouvriers de presque toutes les fabriques, et, en ne gardant que la moitié de son monde, réduire de douze à neuf les heures de travail, dans un certain nombre d'établissements, et, dans d'autres, ne travailler que quatre jours par semaine. Il résulte des premières données fournies par une autre enquête industrielle, que la chambre de commerce de Paris exécute en ce moment avec les soins les plus minutieux, que, dans certains quartiers de la capitale, le nombre des ouvriers occupés avait baissé de moitié. D'autres supputations ont conduit à penser que la masse du travail parisien et des produits de ce travail avait subi dans le cours de l'année une réduction des sept onzièmes. A Lyon, l'interruption du travail a été telle que presque tout ce qu'il y avait en ville de soies teintes a été expédié à l'étranger, au lieu d'être employé sur place, et que, dans le cours de mai, par exemple, il en a été exporté autant qu'on en exportait, précédemment, dans le cours d'une année entière. Veut-on un autre indice des réductions que le travail avait subies? Tandis que Lyon a exporté ses matières premières au lieu de les travailler, d'autres matières importantes, employées par l'industrie du pays, ont été importées, en 1848, dans une quantité infiniment moindre que les années précédentes. Il résulte des relevés de la douane que, dans les six premiers mois de cette année 1848, il n'a été importé pour le travail intérieur que 5,221quintaux métriques de bois d'acajou, tandis qu'on en avait importé 23,696 quintaux dans les six premiers mois de 1847, et 25,221 dans les six premiers mois de 1846; qu'il n'a été importé que 182,685 quintaux métriques de coton ou laine, tandis que, dans les six premiers mois de 1847, il en était entré 220,813, et, dans les six premiers mois de 1846, 326,139; qu'il n'a été demandé au dehors que 284,123 quintaux métriques de fonte, tandis que, dans le premier semestre de 1847, il en était entré 512,155 quintaux. D'autres documents officiels ont fait connaître depuis que, dans le cours entier de cette même année 1848, la masse de la houille importée pour les besoins de l'industrie nationale est tombée de 21 millions de quintaux métriques à 17 millions ; la masse de la fonte de 959 mille quintaux à 456 mille; la masse de bois d'acajou de 46 mille à 8 mille; la masse de laine de 138 mille à 80 mille; celle du fil de chanvre et de lin de 19 mille à 4 mille; celle de la soie de 15 mille quintaux à 7 mille. Enfin un dernier témoignage plus éclatant encore de l'extrême proportion dans laquelle a été réduit le travail est dans la masse des ouvriers qui ont dû sortir des ateliers, et qui se sont trouvés sans ouvrage. La désertion, il est vrai, avait commencé par être calculée et volontaire; mais elle a bientôt fini par être forcée, et il résulterait de certaines observations qui ont été faites à la tribune par un ancien ministre des finances du gouvernement provisoire qu'il n'y avait pas hors des ateliers, au plus fort de la crise, moins de cinq cent mille ouvriers désoccupés. Les ateliers nationaux de Paris n'en comptaient pas à eux seuls, un moment a été, moins de cent vingt-cinq mille.
Les suspensions de payement et les banqueroutes indéfiniment multipliées qui ont suivi cette interruption du travail et de la vente n'ont pas été un fait général moins notoire et qu'aient justifié des faits particuliers moins nombreux. Si l'impression de ces faits a pu s'affaiblir dans quelques esprits; si elle n'y est pas suffisamment entretenue par le discrédit qui règne encore et par la difficulté qu'il y a toujours d'être payé, il ne faut, pour l'y ranimer, que rappeler ces terribles bulletins de la Bourse de Paris, qui, du commencement de mars à la fin d'avril 1848, n'avaient cessé d'annoncer des catastrophes commerciales. Dès le 10 mars, les caisses Gouin, Baudon, Ganneron avaient succombé. La chute de ces comptoirs avait été précédée de celle des maisons de banque les plus importantes, et, chaque jour, cet ordre capital d'établissements avait eu à enregistrer quelque désastre nouveau. Après les faillites des banquiers, étaient venues celles des négociants et des chefs de fabrique. On avait vu, à Paris, les maisons livrées à certaines branches de commerce, jusqu'alors des plus fructueuses et des mieux établies, donner l'exemple d'une liquidation presque générale; et, dans beaucoup d'autres genres de négoce, les maisons les mieux famées, obligées de s'arrêter dans la voie de sacrifices auxquels elles ne voyaient pas de terme, entrer également en liquidation. La débâcle était devenue à peu près universelle; et, quoique le marché de Paris fût de tous le plus bouleversé, les nouvelles qu'on y recevait des autres grands centres manufacturiers et commerciaux n'étaient guère plus satisfaisantes. Pour se faire une idée de l'étendue de cette subversion et de cette généralité de l'état de faillite où était tombé le commerce, il suffit de remarquer qu'il commençait à peine, au bout de douze mois, à se relever du discrédit qui l'avait frappé alors; que, très récemment encore, il ne se faisait, pour ainsi dire, d'affaires qu'au comptant; qu'il n'y avait pas de maisons assez sûres pour voir accepter au loin leur papier, et que, pour faire toucher une somme à l'étranger ou sur quelque point éloigné du territoire, il fallait l'y envoyer en argent, comme aux époques les plus barbares et les plus reculées.
La profonde dépréciation des valeurs n'a pas été un résultat général, moins frappant, ni moins bien établi que les précédents, du discrédit soudain qui a suivi l'essai de république démagogico-socialiste. Cette dépréciation était inévitable, et il serait permis de croire que les auteurs et fauteurs de l'essai l'avaient fait entrer dans leurs calculs: puisqu'ils s'étaient réservé d'exproprier pour cause d'utilité publique, et au profit des classes ouvrières, les ateliers dont la désertion des ouvriers aurait fait tomber la valeur. Mais elle devait s'étendre à tout. Elle était la conséquence nécessaire de l'état d'inaction où l'on était tombé et qui venait de frapper, jusqu'à un certain point, de stérilité les fonds productifs de quelque espèce qu'ils fussent. Elle est également résultée des projets subversifs qui sont venus menacer plus ou moins toutes les propriétés. Elle est venue enfin de la nécessité où tant de gens se sont trouvés de vendre et de réaliser le plus qu'ils pouvaient de leurs ressources. Les besoins pressants des uns; l'inquiétude, la peur, le désespoir des autres, leur faisant successivement lâcher pied, ont amené l'avilissement des prix de toutes choses, des meilleures valeurs, comme des plus mauvaises, et les ont fait descendre à des taux où elles n'avaient pas été depuis la chute de l'Empire et le temps de nos plus grands revers. On n'avait peut-être jamais vu les effets publics subir des oscillations si brusques et si violentes. En moins de sept semaines, les rentes 5 p. cent avaient subi une dépréciation de 67 francs, et étaient tombées de 117 francs à 50 fr. Les actions de la Banque, une des valeurs du pays les plus accréditées et les plus fermes étaient tombées de 3,200 francs à 990 fr. Les propriétés foncières de toute nature perdaient la moitié de leur prix ; elles n'avaient, pour ainsi dire, plus de cours et avaient absolument cessé de se vendre. On a calculé, à la date du 12 avril, quarante-sept jours après la révolution, que la perte éprouvée à la Bourse sur les rentes, les actions de la Banque et les chemins de fer s'élevait à peu près à 4 milliards, à 3 milliards 749 millions. Il a été fait, vers le même temps, sur la dépréciation des valeurs immobilières, des supputations qui, tout exactes qu'il y avait lieu de les croire, semblaient fabuleuses, tant elles étaient élevées. On peut affirmer hardiment que la double invasion que la France eut à subir, en 1814 et 1815, de la part de toutes les armées de la coalition, que les innombrables déprédations qui purent être commises alors sur son territoire, que la rançon énorme qu'elle eut à payer pour son affranchissement n'avaient pas attaqué sa fortune , n'avaient pas altéré ses ressources au point où l'a fait, en quelques semaines, après février, la prise de possession du pays par la république démocratico-socialiste. Mieux eût valu pour elle, sans contredit, l'irruption de nouvelles hordes de cosaques. Ces populations à demi-sauvages n'auraient pas été poussées sur son sol par des instincts aussi anti-sociaux, par des passions aussi destructives; elles n'y auraient pas à ce point ruiné toutes choses; elles ne s'y seraient pas attaquées avec cette fureur stupide à tous les principes vitaux de la société.
Ce que l'appauvrissement général, résultat presque immédiat de l'invasion du démagogisme socialiste, a produit pour tout le monde d'embarras, de gêne, de souffrance, est un autre fait, hélas! qui, pendant longtemps , n'a été que trop justifié pour chacun de nous par l'expérience de chaque jour. Tandis que l'ouvrier, même en se contentant d'un salaire réduit, ne trouvait plus d'ouvrage, et se voyait obligé, s'il ne voulait périr, d'opter entre l'humiliation de l'aumône et les douleurs cruelles de l'expatriation, le marchand ne vendait pas pour se nourrir et payer le loyer de sa boutique; le fabricant travaillait à peine le nombre d'heures nécessaires pour conserver ses meilleurs ouvriers; le capitaliste se voyait remboursé en monnaie de faillite des fonds qu'il avait confiés à l'industrie, et laissait chômer ceux qu'il s'était abstenu de placer pour échapper au danger de les perdre. On a vu les banquiers tomber, les mains pleines de valeurs qui étaient de l'or la veille, et qui n'ont plus été le lendemain que du papier. Il a fallu que l'État subventionnât extraordinairement les théâtres et distribuât à une multitude de gens de lettres et d'artistes des secours en argent, qu'en des temps moins déplorables la dignité de leur profession ne leur eût pas permis de recevoir, et surtout de solliciter. Les propriétaires enfin ne pouvaient ni toucher leurs loyers ou fermages, ni vendre leurs propriétés , ni emprunter sur première hypothèque à un intérêt de 9 ou 10 p. 100. Souffrir était devenu l'occupation universelle. C'était là, surtout, le travail forcé, la dure tâche de la portion de la classe ouvrière dont l'égarement et les prétentions violentes avaient amené cette situation , qui n'avait gâté celle de ses chefs qu'en aggravant surtout la sienne, et qui était réduite à expier plus cruellement que personne, comme une inexorable justice le voulait, des maux qui étaient surtout son ouvrage, et dont elle ne pouvait accuser, après elle-même, que les fous dangereux et les pervers dont elle avait consenti à accepter les directions.
Complice de ces directions fatales, au moins tant que le gouvernement provisoire a duré, l'État ne pouvait manquer de ressentir, comme les particuliers, l'effet de la détresse qui a suivi l'essai de république démocratique et sociale, et si, faute de lumières ou de courage, il a pu souffrir que des insensés troublassent l'action naturelle du travail et des transactions, le châtiment ne s'est pas fait attendre. Les preuves de ce châtiment sont venues se dérouler, en chiffres éloquents et sévères, dans les livres de perception du fisc. Le travail et les transactions s'arrêtant, les perceptions indirectes auxquelles donne lieu leur activité ont dû immédiatement se ralentir. Dès le premier mois qui a suivi l'essai d'organisation socialiste, dès le mois de mars, les perceptions du timbre, de l'enregistrement , des droits réunis et de la douane, ont baissé de plus de quatorze millions. Le mois suivant, elles ont baissé de plus de 17. En mai, la baisse a été plus forte encore, et telle a été, dans les neuf premiers mois de l'année, l'inactivité du travail, des transactions et des relations commerciales, que le Moniteur, rendant compte, à la date du 11 octobre, de l'état des revenus indirects, pendant les trois premiers trimestres et les comparant aux perceptions de 1847, durant la période correspondante, a dû avouer une perte de plus de 102 millions. La réduction sur le seul produit des droits d'enregistrement a été de près de 38 millions. Elle a été de près de 8 sur le timbre, de très près de 20 sur les douanes. Le surplus de la perte est venu de réductions dans le produit des impôts de consommation, du sel, du sucre, des tabacs, des boissons. Obligé de prévoir que cette décroissance des revenus indirects continuerait encore, on a estimé que le déficit, à la fin de l'année, ne serait pas de moins de 140 à 145 millions, et, comme il y avait tous les ans une augmentation régulière de 23 à 30 millions, qui ferait également défaut, il a fallu porter la perte' entière à environ 175 millions, et elle n'a guère, en effet, été inférieure que de bien peu à cette forte somme.261 D'un autre côté, on a dû prévoir qu'il y aurait dans le produit des contributions directes, des patentes surtout, des surcroîts de non-valeurs, que le comité des finances de l'Assemblée nationale n'estimait pas à moins de 20 millions; plus, dans le produit des forêts, une réduction supérieure à 12 millions.262 De sorte que le résultat pour l'État de l'essai de république démocratique et sociale allait se trouver, à la fin de l'année, et au milieu de l'accroissement de toutes les dépenses, une réduction totale, dans les recettes ordinaires, de plus de 208 millions. C'était là la part de l'État dans les effets ressentis par tous de la morne inaction qu'il avait eu l'habileté de produire, et de la détresse universelle qui avait immédiatement suivi cette inaction.
Ajoutez que ces maux, déjà si grands, ont été fort aggravés par la nature des expédients dont on a usé pour y porter remède.
En présence des pertes énormes qu'éprouvait le Trésor et de la rapide décroissance de ses perceptions indirectes, ce qu'il y avait, financièrement, de mieux à faire, c'était, sans contredit, d'agir sur les causes qui tarissaient ainsi les sources jusqu'alors si abondantes de ces perceptions, de renoncer au système qui venait d'arrêter si brusquement et avec un si déplorable succès la marche des affaires, et, en s'appliquant de toutes ses forces à restituer aux personnes, à la propriété, aux transactions, aux entreprises industrielles, la sécurité et la liberté qu'elles avaient perdues, de rendre au travail son activité et aux perceptions du fisc leur ancienne abondance. Mais qu'at-on fait, au lieu de suivre une marche si clairement indiquée? On n'a pas pris une mesure qui n'abondât plus ou moins dans le sens des inventions socialistes qui étaient en train de tout perdre. On a demandé à l'impôt direct ce que ne donnaient plus les contributions indirectes, et on a empiré par de nouvelles charges l'état d'une population dont, en arrêtant le travail, on venait de réduire tous les revenus. En haine de la propriété, on s'est attaqué surtout à la propriété foncière, la moins féconde et la plus maltraitée de toutes, et on a accru de 45 p. 100 les charges dont elle était déjà grevée. On a décrété d'aliéner des biens domaniaux qui, dans l'état de dépréciation où l'on avait fait tomber toutes choses, ne pouvaient être vendus qu'à vil prix. On a imaginé, contre tout droit, de faire payer à qui la demanderait la permission de défricher des bois, et l'on s'est attribué 25 et 50 p. 100 de la plus value qu'un homme donnerait à son bien en en transformant ainsi la culture. On a conçu l'idée de mettre la main, sous prétexte d'utilité publique, et, en réalité, dans un but de fiscalité et de pure spéculation financière, sur de certaines classes de propriétés, telles que mines, canaux, chemins de fer, entreprises d'assurances, dont on se réserverait d'indemniser comme on pourrait les possesseurs, et, en menaçant ainsi ces propriétés, déjà fort amoindries parla dépréciation qu'avaient subie toutes choses, on a contribué d'une manière toute spéciale à en faire baisser encore la valeur. On a, le plus qu'on a pu, grevé les capitaux, comme les propriétés, de nouvelles charges, et, par exemple, on a imaginé de frapper d'une taxe de 1 p. 100 les placements d'argent sur hypothèque, ceux qui, d'ordinaire , donnent l'intérêt le plus bas et le plus mal servi. Au crédit naturel, qu'on avait détruit, on a entrepris de suppléer par un crédit factice, dont les contribuables devaient faire les frais; et, aux banques particulières, qu'on avait réduites à la douloureuse nécessité de faillir, on a substitué des comptoirs d'escompte, dont la dépense a été mise, pour les deux tiers, à la charge des villes et du Trésor, c'est-à-dire des contribuables, et l'État, pour sa part, et tout obéré qu'il était, n'a pas affecté à cette dépense moins de 60 millions, qu'il a dû prendre sur le surcroît de 45 p. 100 qu'il venait d'ajouter aux quatre contributions directes. Au lieu de ranimer le travail réel, qui ne demandait, pour reprendre son activité, que d'être rendu à ses conditions naturelles, on a multiplié, à grands frais, le travail apparent, et un ministre des travaux publics a avoué naïvement qu'il avait accru le plus qu'il avait pu, ne croyant sans doute pouvoir mieux faire, le nombre de ces ateliers nationaux, dont le nom rappelle tant de souvenirs sinistres. Plutôt que de ne pas pourvoir à la dépense de ces ateliers de trouble et de sédition, on a failli à des engagements sacrés, on a fait une banqueroute partielle aux porteurs de bons du Trésor, on a manqué aux dépositaires si intéressants des caisses d'épargne, et, en compromettant ces établissements aux yeux des classes ouvrières, on a couru le risque de ruiner dans leur esprit un des moyens les plus féconds de moralisation et de bien-être qui leur eût jamais été offert. Par une infidélité d'un autre genre, on a mis la main sur les fonds versés dans les établissements tontiniers, et, quand les statuts de ces établissements leur prescrivaient, de la manière la plus impérieuse, de convertir immédiatement en rentes les dépôts qu'ils recevaient, on a prétendu se faire de ces dépôts une ressource, et on a contraint les établissements dépositaires à en verser le montant dans les caisses de l'État. Pour soulager le commerce de la détresse où on l'avait fait tomber, et qui le mettait dans l'impuissance de faire honneur à ses engagements, on n'a vu rien de plus simple que de le dispenser, par des ajournements successifs, de remplir ses obligations; on a multiplié les décrets de surséance, on les a généralisés, et on n'a pas paru comprendre qu'en soulageant ainsi les débiteurs, on ne faisait que transporter à leurs créanciers les embarras cruels dont on voulait les affranchir, on mettait ceux-ci dans la dure nécessité de faillir à leur tour à leurs promesses, et l'on autorisait tout le monde à demander d'être dispensé de tenir ses engagements. Il y a eu, pour venir au secours des gens en souffrance, un feu croisé de propositions, qui n'avaient toutes pour résultat que de déplacer le mal, de l'aggraver en le déplaçant, de le faire tomber surtout sur la masse des contribuables, et de rendre, en définitive, tout le monde plus malheureux. Loin de réussir par ces artifices violents à remplacer les ressources détruites, celles qui résultaient auparavant de l'activité naturelle de la société, on les a diminuées encore; on a accru l'appauvrissement universel, et les perceptions du Trésor s'en sont tellement ressenties, qu'à une certaine époque, un des ministres des finances de la révolution, M. Goudchaux, a dû convenir que les recettes journalières étaient inférieures d'un million aux dépenses à effectuer. Voilà ce qu'on a obtenu des expédients employés pour corriger l'effet des premières entreprises socialistes. Loin de remédier aux désastreux résultats de ces entreprises, on n'a fait, on le voit assez, que les aggraver et accroître notablement les pertes et les souffrances de tout le monde.
Enfin, pour qu'il ne manquât rien à ces maux, pour en perpétuer la durée et les rendre, s'il se pouvait, irremédiables, ceux qui les avaient provoqués, les promoteurs de la démagogie et du socialisme, se sont efforcés d'en fausser l'explication, d'en détourner la responsabilité de leurs doctrines et de les rapporter à des causes qui n'étaient pas les vraies.
C'est ainsi, par exemple, qu'ils se sont appliqués à les représenter comme un des effets qui accompagnent nécessairement tout changement violent de régime, et comme n'offrant rien qui les distinguât de ceux qui s'étaient manifestés à la suite de la révolution de Juillet; — qu'au lieu de les attribuer, comme le bon sens prescrivait de le faire, à la subversion du régime économique établi, on a voulu les faire considérer comme un effet naturel de ce régime, et on a soutenu effrontément qu'il n'y avait dans la crise dont nous étions les témoins et les victimes rien qui ne fût le résultat lamentable et forcé de la constitution actuelle du travail ; — qu'enfin on a prétendu prouver, d'un autre côté, que cette crise déplorable avait été léguée par la monarchie à la république et qu'elle était le résultat du mal qu'avaient fait à la France dix-sept années de dilapidations.
Heureusement il n'y avait là rien sur quoi le public le plus inattentif et le moins avisé pût consentir à prendre le change, et l'on a facilement saisi le côté faux et insidieux de ces misérables explications.
Comment, en effet, et en premier lieu, aurait-on pu admettre que les désastres éprouvés étaient la suite de l'inquiétude et du trouble que traîne à sa suite toute révolution, si personne, en effet, ne faisait rien qui pût troubler la révolution nouvelle, et d'où eût-on pu dire que le trouble lui venait? Était-ce de dehors? Les puissances étrangères avaient manifesté dès les premiers moments la ferme intention où elles étaient de ne la point inquiéter, et d'ailleurs elles étaient entourées chez elles d'assez graves difficultés pour qu'elles ne pussent pas songer à lui susciter des obstacles. Était-ce de dedans? Elle avait été faite, sinon avec le concours ostensible, au moins à la très grande satisfaction du parti légitimiste. Elle obtenait les bénédictions du clergé. Le parti conservateur et en général les amis de la dernière dynastie, loin de la combattre, se résignaient, si elle voulait être libérale et modérée, à accepter le régime qu'elle fonderait, et lui donnaient les signes les moins équivoques de tolérance et de bonne volonté. Les seuls troubles qui l'ont suivie sont donc ceux qui lui ont été suscités par elle-même, par ses entreprises anarchiques et anti-sociales, par sa subversion et les ruines qu'elle a causées; et, loin de pouvoir attribuer ces désastres aux résistances qu'elle a rencontrées, il est de notoriété universelle qu'elle n'a commencé à rencontrer de résistance que lorsqu'il a été visible qu'elle tendait à tout bouleverser.
Il n'est pas plus aisé d'attribuer les maux qui nous ont assaillis depuis qu'elle est faite au travail individuel, à l'émulation des travailleurs, à la concurrence, et en général à la constitution naturelle de la société. Ce n'est pas d'hier, en effet, que cette constitution existe; elle s'est développée avec notre état social ; elle en a suivi les phases ; elle en a fomenté les progrès, et c'est à mesure qu'elle s'est perfectionnée que la société est devenue puissante et prospère, et que s'est accru le nombre des familles heureuses et aisées. En Angleterre, aux États-Unis, où elle est beaucoup plus parfaite qu'en France, où le travail et les transactions jouissent d'infiniment plus de liberté, la prospérité commune est infiniment plus grande. Il a suffi chez nous que son existence fût menacée pour que la richesse et le bien-être de tous subissent une altération immédiate et profonde; et ç'a été seulement à la suite de la révolution et depuis les essais de république démagogico-socialiste qu'on a vu notre prospérité, jusque-là croissante, arrêtée tout à coup et remplacée par l'appauvrissement universel. Comment, en présence de ces faits, avoir la hardiesse d'attribuer, avec l'espoir de tromper quelqu'un, la misère qui, après février, est venue nous assaillir à la liberté économique et de fonder sur le socialisme de légitimes espérances de prospérité?
Enfin, bien que l'extension, déjà exorbitante, qu'avaient prise sous la monarchie les dépenses publiques pût être l'objet d'un blâme sérieux et fondé, il n'est pas plus possible de trouver dans ce fait que dans les précédents une explication tant soit peu raisonnable de la crise que nous subissons. Si la monarchie avait mis infiniment trop dé choses à sa charge et donné à ses dépenses beaucoup trop d'extension, il est juste de reconnaître que la paix solide, que la sécurité profonde, que la liberté relativement étendue dont elle nous faisait jouir avaient imprimé à tous les travaux une activité et fait prendre à la richesse publique un développement qui avaient fort élevé le chiffre de ses perceptions ordinaires, et qui lui avaient permis par cela même d'accroître beaucoup celui de ses dépenses sans excès de témérité. Je sais bien qu'elle aurait pu laisser le pays dans une situation plus simple, et le Trésor public grevé de services moins déplorablement multipliés et infiniment moins dispendieux. Il eût été sans contredit fort à souhaiter, pour sa sûreté, comme pour la nôtre, qu'elle n'assumât pas sur elle la responsabilité de tant de choses, et qu'au lieu de prendre à son compte et de constituer en régies publiques, pour se procurer des moyens d'influence proportionnés à l'étendue des agressions et des sollicitations dont elle était assaillie, tant de travaux et de services qu'elle aurait dû laisser dans le domaine de l'activité universelle et privée, elle tendît sagement à se décharger sur cette activité de ces services exorbitants qu'elle s'était attribués contre toute raison et toute prudence, qu'elle avait usurpés contre toute honnêteté et toute justice. Mais enfin, quelles que fussent les attributions qu'elle s'était données, et les dépenses qui s'en étaient suivies, elle était, par les raisons que j'ai dites, à peu près en mesure de pourvoir à ces dépenses. C'est un fait que les hommes les plus compétents en matière de finances ont établi de manière à fermer la bouche à ses détracteurs les moins scrupuleux; et si le pouvoir qui lui a succédé avait su maintenir, comme elle, les conditions d'activité et de prospérité sociales à qui elle était redevable de l'étendue de ses ressources; s'il n'avait pas, par une lâche adhésion aux entreprises de la démagogie et du socialisme, commis la double extravagance de tarir la source des revenus du trésor et tout à la fois d'augmenter beaucoup les dépenses publiques, il ne se serait pas mis aux expédients, ainsi qu'il l'a fait, et il ne se serait pas vu réduit, au milieu de la profonde stagnation où il venait de plonger les affaires et de l'énorme décroissement qu'il avait fait subir à ses revenus indirects, à la nécessité de faire ce que n'avaient fait, depuis plus de quarante ans, aucune des monarchies qui l'avaient précédé, c'est-à-dire à essayer de grever le pays d'une série de taxes nouvelles, et à le charger, en effet, de nouveaux impôts très durs.
Encore un coup, ce n'est donc pas aux dépenses de la monarchie, quelque abusivement exagérées qu'elles pussent être, qu'il faut attribuer les maux de toute espèce que nous avons soufferts depuis seize mois, et l'interminable crise financière et commerciale que nous traversons : c'est au régime que nous avons subi d'abord, qui s'est efforcé de se maintenir ou de se relever ensuite, et qui, en exagérant encore ces dépenses, déjà outrées, en s'évertuant à pousser plus loin le système d'accaparement et de concentration qui les rendait inévitables, n'a su déployer d'habileté que pour détruire les moyens naturels que la monarchie avait d'y pourvoir, et pour ruiner le peu de principes libéraux qu'elle avait le bon sens de maintenir et auxquels elle était redevable de ses immenses ressources. Tous les résultats désastreux qui viennent d'être signalés n'ont eu pour cause, en réalité, que l'essai de république socialiste qui est venu, systématiquement et de propos délibéré, s'attaquer à ces principes et battre en brèche toutes les défenses naturelles de la société, tous ses moyens de conservation, de prospérité et de puissance.
Ce que cet essai a causé de mal à tous, et non seulement aux classes contre lesquelles il était dirigé, mais à celles particulièrement en faveur desquelles on le prétendait fait, et même aux auteurs et complices de l'entreprise, est évident à tous les regards et de notoriété profondément sentie pour tout le monde. Qu'on me cite, je ne dirai pas une classe de propriétaires et de capitalistes, cela est tout simple et peut être pour les auteurs un sujet de satisfaction, mais une classe de travailleurs quelconque à laquelle il n'ait affreusement nui! Qu'on veuille bien considérer à quel point il a nui surtout à la classe de travailleurs la moins heureuse, à celle, dont il devait, disait-on, relever la condition et adoucir le sort! Qu'on fasse le dénombrement des malheureux ouvriers qu'il a fait périr dans d'odieuses luttes! Qu'on voie la masse de ceux qu'il a fait condamner à la transportation; la masse plus grande de ceux qu'il a mis dans la cruelle nécessité de s'expatrier, de se déporter eux-mêmes, et celle plus grande encore de ceux dont il a détruit le travail ou qu'il a forcés de se résigner à de dures et inévitables réductions de salaire! Qu'on cherche enfin, pour les placer en présence de tant de maux, ceux qui en ont été les principaux artisans, et qu'on leur demande ce qu'ils ont recueilli de leur entreprise, je ne dirai pas de gloire, mais seulement de considération et d'honorable notabilité!
45.Frédéric Bastiat on “The State” (1849)↩
[Word Length: 3,889]
Source
Frédéric Bastiat, L'état: Maudit argent (Paris: Guillaumin, 1849). "L'État," pp. 5-23.
L’ÉTAT
Je voudrais qu'on fondât un prix, non de cinq cents francs, mais d'un million, avec couronnes, croix et rubans, en faveur de celui qui donnerait une bonne, simple et intelligible définition de ce mot: l'ÉTAT.
Quel immense service ne rendrait-il pas a la société!
L'ÉTAT! Qu'est-ce? où est-il? que fait-il? que devrait-il faire?
Tout ce que nous en savons, c'est que c'est un personnage mystérieux, et assurément le plus sollicité, le plus tourmenté, le plus affairé, le plus conseillé, le plus accusé, le plus invoqué et le plus provoqué qu'il y ait au monde.
Car, Monsieur, je n'ai pas l'honneur de vous connaître, mais je gage dix contre un que depuis six mois vous faites des utopies, et, si vous en faites, je gage dix contre un que vous chargez l'ÉTAT de les réaliser.
Et vous, Madame, je suis sûr que vous désirez du fond du cœur guérir tous les maux de la triste humanité, et que vous n'y seriez nullement embarrassée, si l'ÉTAT voulait seulement s'y prêter.
Mais, hélas! le malheureux, comme Figaro, ne sait ni qui entendre, ni de quel côté se tourner. Les cent mille bouches de la presse et de la tribune lui crient a la fois:
« Organisez le travail et les travailleurs.
Extirpez l'égoïsme.
Réprimez l'insolence et la tyrannie du capital.
Faites des expériences sur le fumier et sur les œufs.
Sillonnez le pays de chemins de fer.
Irriguez les plaines.
Boisez les montagnes.
Fondez des fermes-modèles.
Fondez des ateliers harmoniques.
Colonisez l'Algérie.
Allaitez les enfants.
Instruisez la jeunesse.
Secourez la vieillesse.
Envoyez dans les campagnes les habitants de villes.
Pondérez les profits de toutes les industries.
Prêtez de l'argent, et sans intérêt, à ceux qui en désirent.
Affranchissez l'Italie, la Pologne et la Hongrie.
Elevez et perfectionnez le cheval de selle.
Encouragez l'art, formez-nous des musiciens et des danseuses.
Prohibez le commerce et, du même coup, créez une marine marchande.
Découvrez la vérité et jetez dans nos têtes un grain de raison. L'Etat a pour mission d'éclairer, de développer, d'agrandir, de fortifier, de spiritualiser et de sanctifier l'âme des peuples. »
— «Eh! Messieurs, un peu de patience, répond l'ÉTAT, d'un air piteux.
« J'essayerai de vous satisfaire, mais pour cela il me faut quelques ressources. J'ai préparé des projets concernant cinq ou six impôts tout nouveaux et les plus bénins du monde. Vous verrez quel plaisir on a à les payer. »
Mais alors un, grand cri s'élève: « Haro! haro! le beau mérite de faire quelque chose avec des ressources! Il ne vaudrait pas la peine de s'appeler l'ÉTAT. Loin de nous frapper de nouvelles taxes, nous vous sommons de retirer les anciennes. Supprimez:
L'impôt du sel.
L'impôt des boissons;
L'impôt des lettres;
L'octroi;
Les patentes;
Les prestations. »
Au milieu de ce tumulte, et après que le pays a changé deux ou trois fois son ÉTAT pour n'avoir pas satisfait a toutes ces demandes, j'ai voulu faire observer qu'elles étaient contradictoires. De quoi me suis-je avisé, bon Dieu! ne pouvais-je garder pour moi cette malencontreuse remarque?
Me voilà discrédité à tout jamais; et il est maintenant reçu que je suis un homme sans cœur et sans entrailles, un philosophe sec, un individualiste, un bourgeois, et, pour tout dire en un mot, un économiste de l'école anglaise ou américaine.
Oh! pardonnez-moi, écrivains sublimes, que rien n'arrête, pas même les contradictions. J'ai tort, sans doute, et je me rétracte de grand cœur. Je ne demande pas mieux, soyez-en sûrs, que vous ayez vraiment découvert, en dehors de nous, un être bienfaisant et inépuisable, s'appelant l'ÉTAT, qui ait du pain pour toutes les bouches, du travail pour tous les bras, des capitaux pour toutes les entreprises, du crédit pour tous les projets, de l'huile pour toutes les plaies, du baume pour toutes les souffrances, des conseils pour toutes les perplexités, des solutions pour tous les doutes, des vérités pour toutes les intelligences, des distractions pour tous les ennuis, du lait pour l'enfance et du vin pour la vieillesse, qui pourvoie à tous nos besoins, prévienne tous nos désirs, satisfasse toutes nos curiosités, redresse toutes nos erreurs, répare toutes nos fautes, et nous dispense tous désormais de prévoyance, de prudence, de jugement, de sagacité, d'expérience, d'ordre, d'économie, de tempérance et d'activité.
Eh! pourquoi ne le désirerais-je pas? Dieu me pardonne, plus j'y réfléchis, plus je trouve que la chose est commode, et il me tarde d'avoir, moi aussi, à ma portée, cette source intarissable de richesses et de lumières, ce médecin universel, ce trésor sans fond, ce conseiller infaillible que vous nommez l'ÉTAT.
Aussi je demande qu'on me le montre, qu'on me le définisse, et c'est pourquoi je propose la fondation d'un prix pour le premier qui découvrira ce phénix. Car enfin, on m'accordera bien que cette découverte précieuse n'a pas encore été faite, puisque, jusqu'ici, tout ce qui se présente sous le nom d'ÉTAT, le peuple le renverse aussitôt, précisément parce qu'il ne remplit pas les conditions quelque peu contradictoires du programme.
Faut-il le dire? je crains que nous ne soyons, à cet égard, dupes d'une des plus bizarres illusions qui se soient jamais emparées de l'esprit humain.
L'homme répugne à la Peine, à la Souffrance. Et cependant il est condamné par la nature à la Souffrance de la Privation, s'il ne prend pas la Peine du Travail. Il n'a donc que le choix entre ces deux maux. Comment faire pour les éviter tous deux? Il n'a jusqu'ici trouvé et ne trouvera jamais qu'un moyen: c'est de jouir du travail d'autrui; c'est de faire en sorte que la Peine et la Satisfaction n'incombent pas à chacun selon la proportion naturelle, mais que toute la peine soit pour les uns et toutes les satisfactions pour les autres. De là l'esclavage, de là encore la spoliation, quelque forme qu'elle prenne: guerres, impostures, violences, restrictions, fraudes, etc., abus monstrueux, mais conséquents avec la pensée qui leur a donné naissance. On doit haïr et combattre les oppresseurs, on ne peut pas dire qu'ils soient absurdes.
L'esclavage s'en va, grâce au Ciel, et, d'un autre côté, cette disposition où nous sommes â défendre notre bien, fait que la Spoliation directe et naïve n'est pas facile. Une chose cependant est restée. C'est ce malheureux penchant primitif que portent en eux tous les hommes a faire deux parts du lot complexe de la vie, rejetant la Peine sur autrui et gardant la Satisfaction pour eux-mêmes. Reste à voir sous quelle forme nouvelle se manifeste cette triste tendance.
L'oppresseur n'agit plus directement par ses propres forces sur l'opprimé. Non, notre conscience est devenue trop méticuleuse pour cela. Il y a bien encore le tyran et la victime, mais entre eux se place un intermédiaire qui est l'État, c'est-a-dire la loi elle-même. Quoi de plus propre à faire taire nos scrupules et, ce qui est peut-être plus apprécié, à vaincre les résistances? Donc, tous, à un titre quelconque, sous un prétexte ou sous un autre, nous nous adressons à l'État. Nous lui disons: « Je ne trouve pas qu'il y lait entre mes jouissances et mon travail une proportion qui me satisfasse. Je voudrais bien, pour établir l'équilibre désiré, prendre quelque peu sur le bien d'autrui. Mais c'est dangereux. Ne pourriez-vous me faciliter la chose? ne pourriez-vous me donner une bonne place? ou bien gêner l'industrie de mes concurrents? ou bien encore me prêter gratuitement des capitaux que vous aurez pris à leurs possesseurs? ou élever mes enfants aux frais du public? ou m'accorder des primes d'encouragement? ou m'assurer le bien-être quand j'aurai cinquante ans? Par ce moyen j'arriverai à mon but en toute quiétude de conscience, car la loi elle-même aura agi pour moi et j'aurai tous les avantages de la spoliation sans en avoir ni les risques ni l'odieux!
Comme il est certain d'un côté que nous adressons tous à l'État quelque requête semblable, et que, d'une autre part, il est avéré que l'État ne peut procurer satisfaction aux uns sans ajouter au travail des autres, en attendant une autre définition de l'État, je me crois autorisé à donner ici la mienne. Qui sait si elle ne remportera pas le prix? La voici:
L'ÉTAT, c'est la grande fiction â travers laquelle TOUT LE MONDE s'efforce de vivre aux dépens de TOUT LE MONDE.
Car aujourd'hui, comme autrefois, chacun, un peu plus, un peu moins, voudrait bien profiter du travail d'autrui. Ce sentiment, on n'ose l'afficher, on se le dissimule à soi-même; et alors que fait-on? On imagine un intermédiaire, on s'adresse à l'ÉTAT, et chaque classe tour à tour vient lui dire: « Vous qui pouvez prendre loyalement, honnêtement, prenez au public, et nous partagerons. » Hélas! l'État n'a que trop de pente à suivre le diabolique conseil; car il est composé de ministres, de fonctionnaires, d'hommes enfin, qui, comme tous les hommes, portent au cœur le désir et saisissent toujours avec empressement l'occasion de voir grandir leurs richesses et leur influence. L'État comprend donc bien vite le parti qu'il peut tirer du rôle que le public lui confie. Il sera l'arbitre, le maître de toutes les destinées; il prendra beaucoup, donc il lui restera beaucoup à lui-même; il multipliera le nombre de ses agents, il élargira le cercle de ses attributions; il finira par acquérir des proportions écrasantes.
Mais, ce qu'il faut bien remarquer, c'est l'étonnant aveuglement du public en tout ceci. Quand des soldats heureux réduisaient les vaincus en esclaves, ils étaient barbares, mais ils n'étaient pas absurdes. Leur but, comme le nôtre, était de vivre aux dépens d'autrui; mais, comme nous, ils ne le manquaient pas. Que devons-nous penser d'un peuple où l'on ne paraît pas se douter que le pillage réciproque n'en est- pas moins pillage parce qu'il est réciproque, qu'il n'en est pas moins criminel parce qu'il s'exécute légalement et avec ordre; qu'il n'ajoute rien au bien-être public; qu'il le diminue au contraire de tout ce que coûte cet intermédiaire dispendieux que nous nommons l'ÉTAT?
Et cette grande chimère, nous l'avons placée, pour l'édification du peuple, au frontispice de la Constitution. Voici les premiers mots du préambule:
« La France s'est constituée en République pour... appeler tous les citoyens à un degré toujours plus élevé de moralité, de lumière et de bien-être. » .
Ainsi, c'est la France ou l'abstraction qui appelle les Français ou les réalités à la moralité, au bienêtre, etc. N'est-ce pas abonder dans le sens de cette bizarre illusion qui nous porte à tout attendre d'une autre énergie que la nôtre? N'est-ce pas donner à entendre qu'il y a à côté et en dehors des Français un être vertueux, éclairé, riche, qui peut et doit verser sur eux ses bienfaits? N'est-ce pas supposer, et certes bien gratuitement, qu'il y a entre la France et les Français, entre la simple dénomination abrégée, abstraite, de toutes les individualités et ces individualités mêmes, des rapports de père à fils, de tuteur à pupille, de professeur à écolier? Je sais bien qu'on dit quelquefois métaphoriquement: la patrie est une mère tendre. Mais pour prendre en flagrant délit d'inanité la proposition constitutionnelle, il suffit de montrer qu'elle peut être retournée, je ne dirai pas sans inconvénient, mais même avec avantage. L'exactitude souffrirait-elle si le préambule avait dit:
« Les Français se sont constitués en République pour appeler la France à un degré toujours plus élevé de moralité, de lumière et de bien-être. »
Or, quelle est la valeur d'un axiome où le sujet et l'attribut peuvent chasser-croiser sans inconvénient? Tout le monde comprend qu'on dise: la mère allaitera l'enfant. Mais il serait ridicule de dire: l'enfant allaitera la mère.
Les Américains se faisaient une autre idée des relations des citoyens avec l'État, quand ils placèrent en tête de leur Constitution ces simples paroles:
« Nous, le peuple des États-Unis, pour former une union plus parfaite, établir la justice, assurer la tranquillité intérieure, pourvoir à la défense commune, accroître le bien-être général et assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité décrétons, etc. »
Ici point de création chimérique, point d'abstraction à laquelle les citoyens demandent tout. Ils n'attendent rien que d'eux-mêmes et de leur propre énergie.
Si je me suis permis de critiquer les premières paroles de notre Constitution, c'est qu'il ne s'agit pas, comme on pourrait le croire, d'une pure subtilité métaphysique. Je prétends que cette personnification de l'ÉTAT a été dans le passé et sera dans l'avenir une source féconde de calamités et de révolutions.
Voila le Public d'un côté, l'État de l'autre, considérés comme deux être distincts, celui-ci tenu d'épandre sur celui-la, celui-la ayant droit de réclamer de celui-ci le torrent des félicités humaines. Que doit-il arriver?
Au fait, l'État n'est pas manchot et ne peut l'être. Il a deux mains, l'une pour recevoir et l'autre pour donner, autrement dit la main rude et la main douce. L'activité de la seconde est nécessairement subordonnée a l'activité de la première. A la rigueur, l'État peut prendre et ne pas rendre. Cela s'est vu et s'explique par la nature poreuse et absorbante de ses mains qui retiennent toujours une partie et quelquefois la totalité de ce qu'elles touchent. Mais ce qui ne s'est jamais vu, ce qui ne se verra jamais, et ne se peut même concevoir, c'est que l'État rende au public plus qu'il ne lui a pris. C'est donc bien follement que nous prenons autour de lui l'humble attitude de mendiants. Il lui est radicalement impossible de conférer un avantage particulier à quelques-unes des individualités qui constituent la communauté, sans infliger un dommage supérieur à la communauté entière.
ll se trouve donc placé, par nos exigences, dans un cercle vicieux manifeste.
S'il refuse le bien qu'on exige de lui, il est accusé d'impuissance, de mauvais vouloir, d'incapacité. S'il essaye de le réaliser, il est réduit a frapper le peuple de taxes redoublées, à faire plus de mal que de bien, et à s'attirer, par un autre bout, la désaffection générale.
Ainsi, dans le public deux espérances, dans le gouvernement deux promesses: beaucoup de bienfaits et pas d'impôts. Espérances et promesses qui, étant contradictoires, ne se réalisent jamais.
N'est-ce pas la la cause de toutes nos révolutions? Car entre l'État qui prodigue les promesses impossibles, et le public qui a conçu des espérances irréalisables, viennent s'interposer deux classes d'hommes: les ambitieux et les utopistes. Leur rôle est tout tracé par la situation. Il suffit à ces courtisans de popularité de crier aux oreilles du peuple: « Le pouvoir te trompe; si nous étions à sa place, nous te comblerions de bienfaits et t'affranchirions de taxes.»
Et le peuple croit, et le peuple espère, et le peuple fait une révolution.
Ses amis ne sont pas plutôt aux affaires, qu'ils sont sommés de s'exécuter. «Donnez-moi donc du travail, du pain, des secours, du crédit, de l'instruction, des colonies, dit le peuple, et cependant, selon vos promesses, délivrez.moi des serres du fisc. »
L'État nouveau n'est pas moins embarrassé que l'État ancien, car, en fait d'impossible, on peut bien promettre, mais non tenir. Il cherche à gagner du temps, il lui en faut pour mûrir ses vastes projets. D'abord il fait quelques timides essais: d'un côté, il étend quelque peu l'instruction primaire; de l'autre, il modifie quelque peu l'impôt des boissons (1830). Mais la contradiction se dresse toujours devant lui: s'il veut être philanthrope, il est forcé de rester fiscal, et s'il renonce à la fiscalité, il faut qu'il renonce aussi a la philanthropie.
Ces deux promesses s'empêchent toujours et nécessairement l'une l'autre. User du crédit, c'est-a-dire dévorer l'avenir, est bien un moyen actuel de les concilier; on essaye de faire un peu de bien dans le présent aux dépens de beaucoup de mal dans l'avenir. Mais ce procédé évoque le spectre de la banqueroute qui chasse le crédit. Que faire donc? Alors l'État nouveau prend son parti en brave; il réunit des forces pour se maintenir, il étouffe l'opinion, il a recours à l'arbitraire, il ridiculise ses anciennes maximes, il déclare qu'on ne peut administrer qu'à la condition d'être impopulaire; bref, il se proclame gouvernemental.
Et c'est là que d'autres courtisans de popularité l'attendent. Ils exploitent la même illusion, passent par la même voie, obtiennent le même succès, et vont bientôt s'engloutir dans le même gouffre.
C'est ainsi que nous sommes arrivés en Février. A cette époque, l'illusion qui l'ait le sujet de cet article avait pénétré plus avant que jamais dans les idées du peuple, avec les doctrines socialistes. Plus que jamais, il s'attendait à ce que l'État, sous la forme républicaine, ouvrirait toute grande la source des bienfaits et fermerait celle de l'impôt. « On m'a souvent trompé, disait le peuple, mais je veillerai moi-même à ce qu'on ne me trompe pas encore une fois. »
Que pouvait faire le gouvernement provisoire? Hélas! ce qu'on fait toujours en pareille conjoncture: promettre, et gagner du temps. Il n'y manqua pas, et pour donner à ses promesses plus de solennité il les fixa dans des décrets. «Augmentation de bien-être, diminution de travail, secours, crédit, instruction gratuite, colonies agricoles, défrichements, et en même temps réduction sur la taxe du sel, des boissons, des lettres, de la viande, tout sera accordé... vienne l'Assemblée nationale. »
L'Assemblée nationale est venue, et comme on ne peut réaliser deux contradictions, sa tâche, sa triste tache s'est bornée à retirer, le plus doucement possible, l'un après l'autre, tous les décrets du gouvernement provisoire.
Cependant, pour ne pas rendre la déception trop cruelle, il a bien fallu transiger quelque peu. Certains engagements ont été maintenus, d'autres ont reçu un tout petit commencement d'exécution. Aussi l'administration actuelle s'efforce-t-elle d'imaginer de nouvelles taxes.
Maintenant je me transporte par la pensée à quelques mois dans l'avenir, et je me demande, la tristesse dans l'âme, ce qu'il adviendra quand des agents de nouvelle création iront dans nos campagnes prélever les nouveaux impôts sur les successions, sur les revenus, sur les profits de l'exploitation agricole. Que le Ciel démente mes pressentiments, mais je vois encore là un rôle à jouer pour les courtisans de popularité.
Lisez le dernier Manifeste des Montagnards, celui qu'ils ont émis a propos de l'élection présidentielle. ll est un peu long, mais, après tout, il se résume en deux mots: L'État doit beaucoup donner aux citoyens et peu leur prendre. C'est toujours la même tactique, ou, si l'on veut, la même erreur.
«L'État doit gratuitement l'instruction et l'éducation à tous les citoyens. »
ll doit:
« Un enseignement général et professionnel approprié, autant que possible, aux besoins, aux vocations et aux capacités de chaque citoyen. »
Il doit:
« Lui apprendre ses devoirs envers Dieu, envers les hommes et envers lui-même; développer ses sentiments, ses aptitudes et ses facultés, lui donner enfin la science de sou travail, l'intelligence de ses intérêts et la connaissance de ses droits.»
Il doit:
« Mettre à la portée de tous, les lettres et les arts, le patrimoine de la pensée, les trésors de l'esprit, toutes les jouissances intellectuelles qui élèvent et fortifient l'âme. »
Il doit:
« Réparer tout sinistre, incendie, inondation, etc. (cet et cætera en dit plus qu'il n'est gros) éprouvé par un citoyen. » .
Il doit:
« Intervenir dans les rapports du capital avec le travail et se faire le régulateur du crédit. »
Il doit:
« A l'agriculture des encouragements sérieux et une protection efficace. »
Il doit:
« Racheter les chemins de fer, les canaux, les mines », et sans doute aussi les administrer avec cette capacité industrielle qui le caractérise.
Il doit:
« Provoquer les tentatives généreuses, les encourager et les aider par toutes les ressources capables de les faire triompher. Régulateur du crédit, il commanditera largement les associations industrielles et agricoles, afin d'en assurer le succès. »
L'État doit tout cela, sans préjudice des services auxquels il fait face aujourd'hui; et, par exemple, il faudra qu'il soit toujours à l'égard des étrangers dans une attitude menaçante; car, disent les signataires du programme: «Liés par cette solidarité sainte et par les précédents de la France républicaine, nous portons nos vœux et nos espérances au delà des barrières que le despotisme élève entre les nations: le droit que nous voulons pour nous, nous le voulons pour tous ceux qu'opprime le joug des tyrannies; nous voulons que notre glorieuse armée soit encore, s'il le faut, l'armée de la liberté. »
Vous voyez que la main douce de l'État, cette bonne main qui donne et qui répand, sera fort occupée sous le gouvernement des Montagnards. Vous croyez peut-être qu'il en sera de même de la main rude, de cette main qui pénètre et puise dans nos poches?
Détrompez-vous. Les courtisans de popularité ne sauraient pas leur métier s'ils n'avaient l'art, en montrant la main douce, de cacher la main rude.
Leur règne sera assurément le jubilé du contribuable.
« C'est le superflu, disent-ils, non le nécessaire que l'impôt doit atteindre. »
Ne sera-ce pas un bon temps que celui où, pour nous accabler de bienfaits, le fisc se contentera d'écorner notre superflu?
Ce n'est pas tout. Les Montagnards aspirent à ce que « l'impôt perde son caractère oppressif et ne soit plus qu'un acte de fraternité. »
Bonté du ciel! je savais bien qu'il est de mode de fourrer la fraternité partout, mais je ne me doutais pas qu'on la pût mettre dans le bulletin du percepteur.
Arrivant aux détails, les signataires du programme disent:
« Nous voulons l'abolition immédiate des impôts qui frappent les objets de première nécessité, comme le sel, les boissons, et cætera.
« La réforme de l'impôt foncier, des octrois, des patentes.
« La justice gratuite, c'est-à-dire la simplification des formes et la réduction des frais. » ( Ceci a sans doute trait au timbre. )
Ainsi, impôt foncier, octrois, patentes, timbre, sel, boissons, postes, tout y passe. Ces messieurs ont trouvé le secret de donner une activité brûlante à la main douce de l'État tout en paralysant sa main rude.
Eh bien, je le demande au lecteur impartial, n'est-ce pas la de l'enfantillage, et de plus de l'enfantillage dangereux? Comment le peuple ne ferait-il pas révolution sur révolution, s'il est une fois décidé il ne s'arrêter que lorsqu'il aura réalisé cette contradiction: «Ne rien donner a l'État et en recevoir beaucoup! »
Croit-on que si les Montagnards arrivaient au pouvoir, ils ne seraient pas les victimes des moyens qu'ils emploient pour le saisir?
Citoyens, de tous les temps deux systèmes politiques ont été en présence, et tous les deux peuvent se soutenir par de bonnes raisons. Selon l'un, l'État doit beaucoup faire, mais aussi il doit beaucoup prendre. D'après l'autre, sa double action doit se faire peu sentir. Entre ces deux systèmes il faut opter. Mais quant au troisième système, participant des deux autres, et qui consiste à tout exiger de l'État sans lui rien donner, il est chimérique, absurde, puéril, contradictoire, dangereux. Ceux qui le mettent en avant, pour se donner le plaisir d'accuser tous les gouvernements d'impuissance et les exposer ainsi à vos coups, ceux-la vous flattent et vous trompent, ou du moins ils se trompent eux-mêmes.
Quant à nous, nous pensons que l'État, ce n'est ou ce ne devrait être autre chose que la force commune instituée, non pour être entre tous les citoyens un instrument d'oppression et de spoliation réciproque, mais, au contraire, pour garantir à chacun le sien, et faire régner la justice et la sécurité.
46.Bastiat on “The Seen and the Unseen: The Broken Window” (1850)↩
[Word Length: 1,212]
Source
Oeuvres complètes de Frédéric Bastiat, mises en ordre, revues et annotées d’après les manuscrits de l’auteur. Ed. Prosper Paillottet and biographical essay by Roger de Fontenay. (Paris: Guillaumin, 1st ed. 1854-55). "Introduction" et "I. La Vitre cassée", pp. 336-40.
Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas.263
Dans la sphère économique, un acte, une habitude, une institution, une loi n’engendrent pas seulement un effet, mais une série d’effets. De ces effets, le premier seul est immédiat; il se manifeste simultanément avec sa cause, on le voit. Les autres ne se déroulent que successivement, on ne les voit pas; heureux si on les prévoit.
Entre un mauvais et un bon Économiste, voici toute la différence: l’un s’en tient à l’effet visible; l’autre tient compte et de l’effet qu’on voit et de ceux qu’il faut prévoir.
Mais cette différence est énorme, car il arrive presque toujours que, lorsque la conséquence immédiate est favorable, les conséquences ultérieures sont funestes, et vice versâ. - D’où il suit que le mauvais Économiste poursuit un petit bien actuel qui sera suivi d’un grand mal à venir, tandis que le vrai Économiste poursuit un grand bien à venir, au risque d’un petit mal actuel.
Du reste, il en est ainsi en hygiène, en morale. Souvent, plus le premier fruit d’une habitude est doux, plus les autres sont amers. Témoin: la débauche, la paresse, la prodigalité. Lors donc qu’un homme, frappé de l’effet qu’on voit, n’a pas encore appris à discerner ceux qu’on ne voit pas, il s’abandonne à des habitudes funestes, non-seulement par penchant, mais par calcul.
Ceci explique l’évolution fatalement douloureuse de l’humanité. L’ignorance entoure son berceau; donc elle se détermine dans ses actes par leurs premières conséquences, les seules, à son origine, qu’elle puisse voir. Ce n’est qu’à la longue qu’elle apprend à tenir compte des autres.264 Deux maîtres, bien divers, lui enseignent cette leçon: l‘Expérience et la Prévoyance. L’expérience régente efficacement mais brutalement. Elle nous instruit de tous les effets d’un acte en nous les faisant ressentir, et nous ne pouvons manquer de finir par savoir que le feu brûle, à force de nous brûler. A ce rude docteur, j’en voudrais, autant que possible, substituer un plus doux: la Prévoyance. C’est pourquoi je rechercherai les conséquences de quelques phénomènes économiques, opposant à celles qu’on voit celles qu’on ne voit pas.
I. La Vitre cassée.
Avez-vous jamais été témoin de la fureur du bon bourgeois Jacques Bonhomme, quand son fils terrible est parvenu à casser un carreau de vitre? Si vous avez assisté à ce spectacle, à coup sûr vous aurez aussi constaté que tous les assistants, fussent-ils trente, semblent s’être donné le mot pour offrir au propriétaire infortuné cette consolation uniforme: « A quelque chose malheur est bon. De tels accidents font aller l’industrie. Il faut que tout le monde vive. Que deviendraient les vitriers, si l’on ne cassait jamais de vitres? »
Or, il y a dans cette formule de condoléance toute une théorie, qu’il est bon de surprendre flagrante delicto, dans ce cas très-simple, attendu que c’est exactement la même que celle qui, par malheur, régit la plupart de nos institutions économiques.
A supposer qu’il faille dépenser six francs pour réparer le dommage, si l’on veut dire que l’accident fait arriver six francs à l’industrie vitrière, qu’il encourage dans la mesure de six francs la susdite industrie, je l’accorde, je ne conteste en aucune façon, on raisonne juste. Le vitrier va venir, il fera sa besogne, touchera six francs, se frottera les mains et bénira dans son cœur l’enfant terrible. C’est ce qu’on voit.
Mais si, par voie de déduction, on arrive à conclure, comme on le fait trop souvent, qu’il est bon qu’on casse les vitres, que cela fait circuler l’argent, qu’il en résulte un encouragement pour l’industrie en général, je suis obligé de m’écrier: halte-là! Votre théorie s’arrête à ce qu’on voit, elle ne tient pas compte de ce qu’on ne voit pas.
On ne voit pas que, puisque notre bourgeois a dépensé six francs à une chose, il ne-pourra plus les dépenser à une autre. On ne voit pas que s’il n’eût pas eu de vitre à remplacer, il eût remplacé, par exemple, ses souliers éculés ou mis un livre de plus dans sa bibliothèque. Bref, il aurait fait de ses six francs un emploi quelconque qu’il ne fera pas.
Faisons donc le compte de l’industrie en général.
La vitre étant cassée, l’industrie vitrière est encouragée dans la mesure de six francs; c’est ce qu’on voit.
Si la vitre n’eût pas été cassée, l’industrie cordonnière (ou toute autre) eût été encouragée dans la mesure de six francs; c’est ce qu’on ne voit pas.
Et si l’on prenait en considération ce qu’on ne voit pas, parce que c’est un fait négatif, aussi bien que ce que l’on voit, parce que c’est un fait positif, on comprendrait qu’il n’y a aucun intérêt pour l’industrie en général, ou pour l’ensemble du travail national, à ce que des vitres se cassent ou ne se cassent pas.
Faisons maintenant le compte de Jacques Bonhomme.
Dans la première hypothèse, celle de la vitre cassée, il dépense six francs, et a, ni plus ni moins que devant, la jouissance d’une vitre.
Dans la seconde, celle où l’accident ne fût pas arrivé, il aurait dépensé six francs en chaussure et aurait eu tout à la fois la jouissance d’une paire de souliers et celle d’une vitre.
Or, comme Jacques Bonhomme fait partie de la société, il faut conclure de là que, considérée dans son ensemble, et toute balance faite de ses travaux et de ses jouissances, elle a perdu la valeur de la vitre cassée.
Par où, en généralisant, nous arrivons à cette conclusion inattendue: « la société perd la valeur des objets inutilement détruits, » - et à cet aphorisme qui fera dresser les cheveux sur la tête des protectionistes: «Casser, briser, dissiper, ce n’est pas encourager le travail national, » ou plus brièvement: « destruction n’est pas profit. »
Que direz-vous, Moniteur industriel, que direz-vous, adeptes de ce bon M. de Saint-Chamans, qui a calculé avec tant de précision ce que l’industrie gagnerait à l’incendie de Paris, à raison des maisons qu’il faudrait reconstruire?
Je suis fâché de déranger ses ingénieux calculs, d’autant qu’il en a fait passer l’esprit dans notre législation. Mais je le prie de les recommencer, en faisant entrer en ligne de compte ce qu’on ne voit pas à côté de ce qu’on voit.
Il faut que le lecteur s’attache à bien constater qu’il n’y a pas seulement deux personnages, mais trois dans le petit drame que j’ai soumis à son attention. L’un, Jacques Bonhomme, représente le Consommateur, réduit par la destruction à une jouissance au lieu de deux. L’autre, sous la figure du Vitrier, nous montre le Producteur dont l’accident encourage l’industrie. Le troisième est le Cordonnier (ou tout autre industriel) dont le travail est découragé d’autant par la même cause. C’est ce troisième personnage qu’on tient toujours dans l’ombre et qui, personnifiant ce qu’on ne voit pas, est un élément nécessaire du problème. C’est lui qui nous fait comprendre combien il est absurde de voir un profit dans une destruction. C’est lui qui bientôt nous enseignera qu’il n’est pas moins absurde de voir un profit dans une restriction, laquelle n’est après tout qu’une destruction partielle. - Aussi, allez au fond de tous les arguments qu’on fait valoir en sa faveur, vous n’y trouverez que la paraphase de ce dicton vulgaire: « Que deviendraient les vitriers, si l’on ne cassait jamais de vitres? »265
47.Michel Chevalier on “The Protectionist System” (1852)↩
[Word Length: 2,490]
Source
Michel Chevalier, Examen du système commercial connu sous le nom de système protecteur, (Paris: Guillaumin, 1852). Chap. III “De L'argument Des Protectionistes Qui Tend A écarter La Liberté bu Commerce En Parquant La Liberté Dans La Politique.”, pp. 10-18.
Brief Bio of the Author: Michel Chevalier (1806-87)
[Michel Chevalier (1806-87)]
Michel Chevalier (1806-87) was a liberal economist and alumnus of the École polytechnique and a Minister under Napoleon III. Initially a Saint-Simonist, he was imprisoned for two years (1832-33). After a trip to the United States, he published Lettres sur l’Amérique du Nord (1836), Histoire et description des voies de communications aux Etats-Unis et des travaux d’art qui en dependent (1840-41), and Cours d’économie politique (1845–55). He was appointed to the chair of political economy at the Collège de France in 1840 and became a senator in 1860. He was an admirer of Bastiat and Cobden and played a decisive role in the free trade treaty signed between France and England in 1860 (Chevalier was the signatory for France, while Cobden was the signatory for England). [DMH]
CHAPITRE III. De L'argument Des Protectionistes Qui Tend A écarter La Liberté bu Commerce En Parquant La Liberté Dans La Politique.
Les protectionistes, quand on leur signale ces atteintes si graves à la liberté, croient se tirer d'affaire en disant que l'on confond deux choses parfaitement distinctes.
La liberté de produire, de vendre et se pourvoir à son gré d'articles de consommation, n'a, suivant eux, rien de commun avec cette liberté après laquelle le genre humain soupire, et qu'il s'applique à acquérir depuis l'origine des sociétés par ses efforts sur lui-même et sur le monde. L'objet après lequel court le genre humain, selon eux, c'est la liberté politique; celle-là seule est digne d'envie, seule elle mérite d'occuper la pensée des hommes d'Etat. Le reste, mais particulièrement la liberté dans ses rapports avec l'industrie et le négoce,
... ne vaut pas l'honneur d'être nommé.
Dégageons l'idée que recèle cet argument protectioniste. Il signifie que le côté industriel de la vie des peuples, l'agriculture, les manufactures, le négoce, est quelque chose d'essentiellement subalterne, dont les hommes d'Etat, dépositaires des intérêts généraux de la société, ne sont tenus d'avoir souci que dans la mesure dont ils s'accommodent. Produire, vendre et acheter, fi donc l cela sent mauvais, cela n'a rien à faire avec la liberté. Au contact de ces objets impurs, elle se flétrirait. On peut bien faire à l'industrie l'honneur de la prendre pour instrument, de lui presser les mamelles pour les vider; mais, pour son régime, elle doit se plier aux convenances de la politique: elle n'est qu'une esclave, et ne doit qu'obéir.
Il y a cela, il y a tout cela au fond de cette distinction qu'on prétend établir entre la liberté du travail et de l'industrie266 et la liberté politique. Les personnes qui raisonnent comme nous venons de le dire se placent, sans le vouloir et sans en avoir conscience probablement, au point de vue où se mettaient les hommes politiques et les philosophes de la Grèce ou de Rome quand ils traitaient des professions industrielles. Les plus grands esprits de ces temps-là, Aristote, Platon, Cicéron, enchérissaient l'un sur l'autre dans leur dédain pour tout ce qui se rattache aux intérêts industriels. C'était chose vile à leurs yeux, et pourquoi? Parce que les plus grands esprits ne peuvent s'empêcher d'être de leur temps. Les objets qui aujourd'hui sont produits dans les manufactures, étaient obtenus alors dans l'intérieur de la maison par des êtres vils, les esclaves. C'étaient ces mêmes esclaves qui cultivaient le sol. Il s'agissait bien de la liberté du travail, de la liberté du producteur! Le chef de famille faisait travailler son monde comme il lui plaisait; le fouet était le stimulant de l'atelier. Le commerce, qui est l'industrie des échanges, existait à peine, parce que chacun des patriciens faisait produire chez lui à peu près tout ce qu'il lui fallait pour lui et les siens, et le peu de trafic qu'il y avait était entre les mains d'étrangers ou de gens d'un rang inférieur.
Ce dédain pour l'industrie, et pour tout ce qui en dépend, fut, de même que l'abaissement des classes vouées aux arts utiles, transmis par l'antiquité au moyen âge, par celui-ci aux monarchies absolues qui s'établirent sur les ruines de la féodalité, ce qui, pour le continent européen, nous conduit jusqu'en 1789. Ici, je n'ai pas à examiner si, sous l'influence active de la doctrine chrétienne, il ne s'opérait pas un travail interne qui modifiait peu à peu en l'adoucissant l'oppression sous laquelle vivaient les classes industrieuses. Je prends les phénomènes extérieurs, les points les plus tangibles de la législation et des mœurs; constamment jusques en 1789, où le tiers-état s'affranchit, j'y vois le tableau que nous offre l'histoire, c'est la politique superposant, de la façon la plus altière, ses combinaisons, son bon plaisir aux besoins de l'industrie et aux intérêts des classes par lesquelles l'industrie existait: tel est le fond de l'ancien régime, avec lequel nous en avons fini pour toujours, s'il plaît à Dieu.
Les hommes qui, de nos jours, tentent de tracer une démarcation protonde parmi les faits sociaux, de manière à exclure l'industrie en totalité ou en partie des bienfaits de la liberté, sont donc, sans le savoir ou le vouloir, les continuateurs et les plagiaires du passé dans ce qu'il a de plus réprouvé pour les modernes, dans ce qu'il offre de plus impossible de nos jours. Ils empruntent aux siècles qui ne sont plus la tradition malfaisante des préjugés de caste. Ils parlent la langue qui convenait à un patricien romain, eu égard à ses esclaves ou à la plèbe dans laquelle se rangeait alors un nombre considérable d'hommes libres de nom; tout au moins celle qui eût été à sa place dans la bouche d'un seigneur du moyen âge en présence des serfs ses vassaux, ou d'un talon rouge de l'Œil-de-Bœuf par rapport aux roturiers.
Pour bien apprécier la valeur qu'a acquise pour les modernes la liberté du travail et de l'industrie, dont la liberté commerciale proprement dite est un des éléments indispensables et inséparables, il est bon de mesurer sous un autre aspect la supériorité de la civilisation actuelle sur celle des temps passés, et quelques-unes des conditions mêmes de cette supériorité. Dans la société antique la liberté civile n'existait pas; le patricien lui-même, tout investi qu'il était des prérogatives du despotisme à l'égard de ses esclaves, de ses enfants, ne l'avait pas légalement ou n'en possédait que des fragments. Elle n'était pas compatible avec le génie de la civilisation antique. Pour une multitude d'actes à l'égard desquels, dans les États de l'Europe occidentale, le dernier des citoyens est libre, c'est-à-dire n'a de compte à rendre en ce monde qu'à sa conscience et à l'opinion publique, l'homme de la civilisation antique était enchaîné par la loi. Les conditions de l'existence lui étaient tracées par des règlements minutieux entre lesquels il fallait cheminer comme entre des murailles à pic. Le législateur se méfiant, et je ne dis pas qu'alors ce fût sans raison, de la sagesse individuelle, y substituait la sienne propre. La législation était donc réglementaire à outrance. Pendant la durée du régime féodal et, jusqu'à un certain point, jusqu'à l'époque dont la nôtre est l'héritière immédiate, la civilisation conserva le génie réglementaire. La civilisation actuelle, au contraire, s'est placée sous l'égide de la liberté civile; c'est son signe distinctif et sa gloire. La liberté civile est le fruit et la récompense de l'éducation successive qu'a reçue le genre humain depuis l'origine des tempe, et dont la doctrine chrétienne a formé le couronnement; c'est la constatation de l'aptitude à se conduire soi-même, dont aujourd'hui l'individu s'est investi; c'est la reconnaissance de la rectitude relative à laquelle est parvenu le jugement de chacun dans l'appréciation du bien et du mal; c'est à la fois la mesure et la sanction de la puissance d'initiative qu'ont acquise les caractères, de la solidité à laquelle sont élevées les âmes; c'est la preuve que le sentiment du devoir a pénétré toutes les couches de la société. Le progrès de la liberté civile implique tout cela.
La liberté civile est chère aux hommes de notre temps; tous les peuples de l'Europe la veulent, et ils l'obtiennent lambeau par lambeau, à mesure qu'ils s'en montrent dignes. Il est dans les desseins évidents de tous les gouvernements, même de ceux qui n'ont que de l'antipathie pour la liberté politique, de la décerner aux populations. L'empereur de, Russie, dont le système de gouvernement exclut la liberté politique, travaille sans relâche à rendre ses sujets dignes de la liberté civile; c'est une couronne dont il leur dispense peu à peu les fleurons.
Mais en quoi consiste-t-elle cette liberté civile, l'honneur de la civilisation moderne, le plus beau joyau peut-être que le genre humain ait rapporté de son pèlerinage à travers les siècles? Ce n'est pas seulement la liberté de penser et la liberté de conscience, ce n'est pas seulement la liberté de la personne ou liberté individuelle et le respect du domicile, la fibre défense des accusés et le jugement par le jury; c'es pour chacun de nous un droit général et vaste, celui d'employer tant pour le bien de la société que pour le sien propre, ses facultés intellectuelles et morales, et ses moyens matériels d'action, capitaux et forces, conformément à sa vocation et à sa pensée. Voilà le droit dont l'homme est investi ou doit l'être du moment qu'on lui reconnaît la liberté civile. Et comment contester que la liberté du travail et de l'industrie, le libre exercice des professions, la liberté dans les transactions si variées, si multiples, qui ont pour objet de réunir, de combiner, de purifier, de rapprocher de notre nature et du lieu où nous sommes, d'approprier à nos besoins de toute espèce les ressources que le Créateur a dispersées autour de nous sur toute la surface du globe, fasse partie intégrante de la liberté civile, en soit un lot considérable? On ne peut supprimer quelqu'une des libertés spéciales dont le faisceau forme ce que la Constitution de 1848 appelle la liberté du travail et de l'industrie, sans affaiblir les autres, sans les dénaturer, sans les rendre plus ou moins illusoires, sans porter au bloc de la liberté civile un coup funeste.
Si l'industrie était dans la société quelque chose d'accessoire ou d'infime, je comprendrais qu'on traitât sommairement les libertés spéciales dont se compose la liberté du travail, et que des hommes d'État s'en fissent litière pour l'accomplissement de leurs desseins. Mais l'industrie humaine n'est pas, comme celle du castor et de la fourmi, l'effet d'un étroit et misérable instinct; elle procède de notre raison; c'est de l'esprit humain qu'elle tire son éclat et sa force; elle est le triomphe de l'esprit humain sur la nature. Elle n'a pas seulement pour objet de contenter de grossiers appétits, elle donne satisfaction aux besoins de notre intelligence comme à ceux de notre corps. Quand de bonnes pensées et de pieux sentiments président à l'emploi de ses fruits, if lui est donné de contribuer puissamment à élever la condition de l'homme et le niveau de la société sous tous les rapports. L'industrie est une institution dont la prospérité, la grandeur et la bonne organisation importent à l'avancement général de la civilisation; l'idée de lui interdire l'usage de la liberté est chimérique; et si quelque homme, qui affecte d'être libéral dans ses discours, conçoit ou favorise une idée pareille, on peut en être certain, son libéralisme est de mauvais aloi.
Dans les pays où la victoire du principe démocratique est consommée, la liberté du travail et de l'industrie a une raison d'être de plus qu'ailleurs. Du moment que le grand nombre, la majorité numérique dont autrefois le législateur ne tenait pas de compte, possède le droit de cité, du moment que les fils des esclaves, gagnant leurs grades un à un à la sueur de leur front, après avoir été serfs, après avoir érigé les communes et composé le tiers-état, sont devenus des citoyens égaux à qui que ce soit devant une loi impartiale, l'industrie a été réhabilitée, car c'est elle qui occupe le grand nombre et en remplit l'existence presque en entier. Il était tout simple que le soleil de la liberté ne luisît pas pour elle tant qu'elle était une occupation servile; mais désormais elle doit jouir des rayons de cet astre vivifiant. La liberté du travail et de l'industrie, qui, je le répète, implique la liberté du commerce avec bien d'autres choses, est ainsi un des besoins les plus impérieux pour la société. C'est une nécessité politique aussi bien qu'une nécessité sociale.
Ce n'est pas moi qui médirai jamais de la liberté politique; je suis convaincu que c'est un bien des plus enviables. Les nations s'y sont préparées par degrés et continuent encore ce laborieux apprentissage. La liberté politique est une dignité; encore un peu de temps, et les nations qui ne sauraient pas s'en rendre digues et la conserver, se verront reléguées loin des premiers rangs, quelque rôle qu'autrefois elles aient joué dans l'histoire. Or, sous quel aspect se présente-t-elle quand il s'agit de l'immense majorité des hommes? Sans doute elle offre une carrière aux intelligences supérieures qui, unies à de beaux caractères, font les grands hommes; mais, pour l'immense majorité, l'exercice de la liberté politique, c'est-à-dire le droit de participer aux élections, de faire partie de la garde nationale et du jury, et de contrôler les actes du gouvernement par des discours et des écrits, est un accident, presque un dérangement dans la vie; un dérangement qu'on n'accepte volontiers que parce qu'on y voit le moyen de couvrir les libertés spéciales dont l'ensemble constitue la liberté civile. Pour l'homme d'Etat méritant ce nom, ou pour le tribun qui veut jouer un rôle même en troublant l'Etat, la liberté politique est un but; pour l'immense majorité des hommes, elle n'est qu'un moyen, et c'est la liberté civile qui est le but.
Ces observations ont pour objet de relever au niveau qui lui est propre la liberté civile, et par conséquent la liberté du travail et de l'industrie, dont encore une fois la liberté commerciale n'est qu'un des aspects. S'il nous reste des doutes, consultons l'histoire contemporaine, l'histoire de la liberté. Le grand mouvement intellectuel du dix-huitième siècle, dont la conséquence fut la révolution française de 1789, dans l'orbite de laquelle toute l'Europe se trouve entraînée aujourd'hui, avait pour objet, dans la pensée des philosophes ses promoteurs, la revendication des libertés diverses que porte dans son giron la liberté civile, bien plus que l'établissement de la liberté politique, et c'est de cette manière que la philosophie du dix-huitième siècle put compter parmi ses disciples ou ses apôtres des souverains fort absolus du point de vue politique, le grand Frédéric, l'impératrice Catherine, Joseph II. Parmi les libertés ardemment désirées du public et exaltées par les philosophes, la liberté du travail occupe une place éminente. Chez nous, à peine le philosophe Turgot est-il ministre qu'il abolit les corvées, supprime les corporations privilégiées des arts et métiers, et établit la liberté du commerce des grains à l'intérieur. L'un des premiers soins de l'Assemblée constituante fut de décréter la liberté du travail. Turgot est un des partisans les plus déclarés qu'ait eus jamais la liberté du commerce international, parce que, à ses yeux, elle se confond avec la liberté du travail. La Constituante de 1789 fit à la liberté du commerce une belle place dans son tarif des douanes.
C'est une loi générale qu'on peut vérifier chez tous les peuples de l'Europe: l'extension de la liberté civile s'est constamment manifestée, entre autres signes, par l'agrandissement de la liberté du travail, et l'augmentation de la liberté du travail a toujours impliqué le développement de la liberté du commerce. Tenter de dérober la France à l'observation de cette loi, est une entreprise insensée; c'est se mettre en révolte contre la nature môme des choses.
48.Guillaumin and Clément on “The State of Political Economy in France” (1852-53)↩
Word Count: Preface (1,868) and Introduction (10,550).]
Source
Dictionnaire de l'Économie Politique, ed. Charles Coquelin and Charles Guillaumin (Paris: Guillaumin, 1852), vol. 1, pp. Préface by Guillaumin (editor), pp. v-viii. Introduction by Ambroise Clément, pp. ix-xxvii (Août 1853).
PRÉFACE DE L'ÉDITEUR (Guillaumin)
Chaque science compte un certain nombre de Dictionnaires plus ou moins étendus; l'Économie politique seule n'en avait pas encore qui répondît aux besoins de ceux qui veulent la consulter et s'éclairer de ses lumières. C'est cette lacune que nous sommes venus combler, et le brillant accueil qu'a obtenu notre livre, tant en France qu'à l'étranger, nous est un témoignage que nous avons produit une œuvre aussi vivement désirée qu'elle est digne, à tous égards, des écrivains éminents qui ont bien voulu s'associer à nous.
Pour s'éclairer sur toutes les questions qui touchent à l'ordre économique, pour se former une opinion raisonnée, les bons ouvrages ne manquent pas: un grand nombre de traités généraux, complets ou élémentaires, offrent aujourd'hui l'ensemble des notions qu'il importe à tout homme de posséder; mais la forme didactique de ces ouvrages ne présente pas les avantages de la forme alphabétique si propre aux recherches, si utile pour les personnes qui ne sont pas familiarisées avec les ouvrages techniques, ou pour celles qui n'ont pas le temps de se livrer à une étude spéciale.
Le Dictionnaire de l'Économie politique est donc le complément indispensable des traités fondamentaux que possède la science. Tous nos efforts ont tendu à ce que, malgré le nombre des auteurs et les diverses nuances de leurs opinions, ce fût toujours la même doctrine générale qui prévalût, afin que notre livre pût servir de guide au lecteur, à travers l'océan des doctrines contradictoires qui se sont produites surtout de nos jours. Aussi est-ce avec intention que nous lui avons donné le titre de Dictionnaire de l'Économie 'politique au lieu de celui de Dictionnaire d'Économie politique.
Nous venons de dire que l'Économie politique ne possédait pas jusqu'à présent de Dictionnaire qui satisfît à ses besoins. En effet, rien d'analogue à ce que nous voulions faire et à ce que nous avons fait n'avait été tenté, soit en France, soit ailleurs. Le Dictionnaire d'Économie politique de Ganilh267 n'a été qu'un essai bien incomplet, et dont il serait superflu de démontrer l'insuffisance; le Répertoire général d'Économie politique268, publié à La Haye il y a peu d'années, se compose d'articles empruntés à divers traités ou publications périodiques, et l'auteur n'a d'ailleurs pas eu la prétention de faire un livre de doctrine. C'est là ce qui nous a donné confiance dans le succès de notre entreprise, suçcès dont nos amis eux-mêmes avaient douté en présence des difficultés de l'opération et de l'incertitude de ses résultats commerciaux.
Mais le Dictionnaire réduit aux seuls mots de la science ne suffisait pas à notre désir; il nous eût semblé incomplet s'il n'avait offert en même temps la Bibliographie des ouvrages et la Biographie des auteurs qui les ont écrits.
C'est pour la première fois que l'Économie politique aura une bibliographie complète, méthodiquement disposée à la fois par ordre de matières et par noms d'auteurs, et dans laquelle les hommes d'étude, les administrateurs, et tous ceux qui ont des indications à chercher, pourront puiser les renseignements les plus nombreux et les plus précis.269
Pour accomplir cet immense travail, il a fallu compulser page par page, colonne par colonne, les dix volumes de la France littéraire de M. Quérard , les cinq volumes de la Littérature contemporaine qui font suite à cet ouvrage et les Tables de la Bibliographie générale de la France. Nous avons en outre mis à contribution la Biographie universelle de Michaud, la Biographie des contemporains, la Collection des Economistes italiens de Custodi; une bibliographe des Économistes espagnols, par M. de Bona y Ureta270; les notes Bibliographiques de M. R. de La Sagra, les Biographies allemandes de Ersch, Kaiser, Hinrichs; le Dictionnaire de la conversation, de Brockhaus; le Dictionnaire des sciences de l'Etat (Staats-Lexicon), par Rotteck et Welcker; les Archives d'Économie politique de Rau et le Journal des sciences de l'État, de Tubingue, et surtout la Bibliographie tout à fait spéciale de M. Mac Culloch intitulée: Literature of Political Economy.
Confiées d'abord à M. Ath. Gros, aujourd'hui bibliothécaire à Draguignan, la biographie et la bibliographie ont été continuées, à partir de la lettre B, par M. Maurice Block, sous-chef du bureau de la statistique générale de la France, qui a rédigé un nombre considérable d'articles, recueilli les notes biographiques et bibliographiques, et traduit en français les titres d'ouvrages publiés en langues étrangères. D'autres collaborateurs ont aussi pris part à ce travail: MM. A. Clément, Baudrillart, Gustave de Molinari, Maurice Monjean, et notamment M. Joseph Garnier, auquel nous devons un grand nombre d'articles biographiques et bibliographiques où l'on reconnaît son goût pour l'érudition et la connaissance qu'il a de la littérature économique. — Nous avons la satisfaction de penser que les lecteurs nous tiendront particulièrement compte des efforts qui ont été faits pour cette partie spéciale de notre Dictionnaire, dans laquelle une foule d'ouvrages, plus ou moins oubliés, ont été remis eu lumière, un grand nombre d'erreurs et inexactitudeses ont été redressées, et où les Économistes érudits pourront constater plus d'une remarquable découverte.
Dans les articles bibliographiques, soit par noms d'auteurs, soit par ordre de matières, nous avons généralement classé les ouvrages selon l'ordre chronologique de leur publication; et nous avons mis tous nos soins à en reproduire les titres exactement et complètement. A la suite de chaque titre nous avons ajouté, pour les ouvrages les plus importants ou les plus remarquables à divers égards, des notes explicatives et des appréciations sur leur contenu; pour cela nous avons également fait de nombreux emprunts à la Bibliographie de M. Blauqui, à celle de M. MacCulloch, aux articles de critique écrits depuis douze ans dans le Journal des Économistes et à d'autres publications ayant une certaine autorité; mais pour les écrivains encore vivants nous avons cru devoir nous borner, par des raisons de convenance qui se comprendront facilement, à ne donner, pour la Biographie, que des indications sommaires sans aucune réflexion, et pour la Bibliographie, que des appréciations empruntées à d'autres ouvrages; car quelque sincère qu'eût été notre désir d'impartialité, il nous eût été difficile de dire toutes choses dans une juste mesure, avec fidélité et indépendance. A cet égard, on nous avait quelquefois conseillé de nous abstenir entièrement. Nous n'avons point jugé à propos de suivre cet avis; une grande partie des ouvrages économiques étant dus à la plume d'hommes encore vivants, notre œuvre, sans les détails qui concernent ces ouvrages et ces écrivains, eut été vraiment incomplète; et nous avons pu remarquer que les courtes notices biographiques que nous avons publiées ont été accueillies avec un vif intérêt.
Le Dictionnaire que nous publions aujourd'hui était depuis longtemps en projet et nous n'en avions différé la mise à exécution que parce qu'il nous fallait trouver, pour lui en confier la direction scientifique, un écrivain pouvant, par la nature de ses occupations, s'y dévouer complètement, et capable, soit par ses connaissances, soit par sou caractère, d'imprimer à l'œuvre une direction acceptée par ses savants collaborateurs. Ces conditions, nous avons eu le bonheur de les rencontrer successivement dans M. Ambroise Clément et feu Charles Coquelin. M. A. Clément, disciple de J.-B. Say, auteur d'un remarquable ouvrage sur les causes de l'indigence, un des collaborateurs les plus appréciés du Journal des Économistes, dont la personne et le caractère ont inspiré à tous nos amis la plus profonde estime, a dù quitter Paris pour aller reprendre en province une position administrative, bien au-dessous de ses talents. Il avait toutefois préparé, pour la plupart des articles, un programme qui a constamment servi, sinon de guide absolu, au moins d'utile indication pour nos collaborateurs.
Charles Coquelin avait mis au service du Dictionnaire les brillantes qualités font la nature l'avait doué et la science profonde qu'il avait acquise: une vaste mémoire, une raison sûre, une grande facilité de travail, une connaissance complète des chefs-d'œuvre de l'Économie politique, un grand respect pour les fondateurs de la science, une saine appréciation des théories et une remarquable connaissance de l'industrie et des faits en général.
Après sa mort, si regrettable pour la science, notre œuvre commune a pu s'achever facilement, grâce à la direction qui lui avait été imprimée dès le principe, et aidé comme nous l'avons été par les conseils et les avis de nos savants collaborateurs. Qu'il nous soit permis de citer dans ce nombre M. Horace Say, qui, par son savoir et par son zèle pour tout ce qui touche à l'Économie politique, est si digne du nom qu'il porte.
On trouvera naturel, sans doute, qu'après le succès de cet ouvrage l'éditeur revendique ici pour siens l'idée et le plan du livre qui constitue un de ses principaux titres à l'estime et à l'affection que veulent bien lui témoigner les amis de la science en général et les collaborateurs du Dictionnaire en particulier. Cette nouvelle publication est d'ailleurs le complément d'une collection de travaux dont il avait conçu le projet après avoir publié le Dictionnaire du Commerce, collection qui forme un ensemble dont toutes les parties se lient entre elles, et qui comprend le Journal des Économistes, la Collection des principaux Économistes, l'Annuaire de l'Économie politique et de la Statistique, le Dictionnaire de l'Économie politique et enfin la Bibliothèque des Économistes contemporains, vers laquelle nous allons maintenant diriger principalement nos efforts.
GUILLAUMIN.
Paris, ce 10 septembre 1853.
Afin que le lecteur puisse juger d'un seul coup d'oeil l'ensemble des matières contenues dans notre Dictionnaire, nous l'avons fait suivre de la Table des principaux articles avec les noms des auteurs en regard, et d'une autre Table de toutes les biographies, donnant aussi les noms des rédacteurs.
Nous avons pensé qu'il serait agréable aux souscripteurs du Dictionnaire de posséder les portraits des Économistes les plus éminents, de ceux auxquels la science doit le plus. Nous avons tenu à ce que ces portraits, tous gravés sur acier et d'une ressemblance authentique, fussent dignes par le fini de l'exécution de ceux dont ils reproduisent les traits.
Les portraits, au nombre de huit, sont ceux de:
FR. QUESNAY, gravé par Outhwaite, d'après le beau portrait de François, célèbre graveur du dernier siècle.
AD. SMITH, gravé par Bossellmann, d'après le seul portrait authentique que l'on connaisse.
MALTHUS, par madame Fournier, d'après la belle gravure anglaise de J. Linnell.
TURGOT, par L. Massard, d'après la photographie de la statue qui orne la salle des séances du palais du Luxembourg.
J.-B. SAY, par Hopwood, d'après le beau tableau peint par Decaisne et appartenant à M. Horace Say.
SISMONDI, par Eug. Gervais, d'après le portrait du célèbre graveur Toschi.
ROSSI, par Eug. Gervais, d'après une photographie de l'admirable buste de Tenerani, que possède la famille.
FR. BASTIAT, par madame Fournier, d'après une épreuve au daguerréotype.
EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS.
Les abréviations Bl. et M. C. indiquent les bibliographies de MM. Blanqui et Mac Culloch citées plus haut. — Barb. indique Manuel de librairie de M. Barbier. — Biogr. univ. la Biographie universelle publiée par MM. Michaud. — Fr. litt. et Q. la France littéraire, par M. Quérard. — Quelques collaborateurs ont signé à diverses reprises avec leurs initiales: ce sont MM. Ambroise Clément, A. C. —Ath. Gros, G. A. —Charles Coquelin, Ch. C. — Courcclle Seneuil, C. S. — Gustave de Molinari, G. de M. — Horace Say, H. S. — Joseph Garnier, Jph G. — Jules de Vroil, J. V. — Maurice Block, M. B. — Jacques de Valserre, J. de V.
INTRODUCTION. (Ambroise Clément)
I.
Dans les recherches scientifiques comme dans l'industrie, la division des travaux est l'une des conditions essentielles du progrès. Il est donc raisonnable de faire, de chacun des divers ordres de phénomènes auxquels s'appliquent ces recherches, l'objet d'une science distincte et circonscrite, autant du moins que peut le permettre la nature des faits à étudier.
On a souvent reproché à la science dont ce Dictionnaire est destiné à exposer et développer les principes, de n'avoir pas su fixer les limites de son domaine, ou de les avoir souvent franchies pour porter ses investigations sur certains ordres de faits appartenant à d'autres sciences sociales, et par exemple, à la politique, à la législation, à la morale. Mais ces reproches, bien qu'ils aient quelquefois été formulés par d'éminents esprits, et par des Économistes eux-mêmes, paraissent résulter d'idées un peu confuses sur la nature ou les rapports des phénomènes sociaux en général; car, pour peu qu'on y réfléchisse, on reconnaît bientôt que ces phénomènes sont trop étroitement liés entre eux pour que l'on puisse en diviser l'étude par des limites infranchissables, et qu'aucune des sciences sociales ne saurait être complètement exposée sans quelques explorations sur le domaine des autres.
« Il ne serait pas possible à l'Économie politique, par exemple, de nous faire voir quelles sont les causes de l'augmentation ou de la diminution des richesses, si celle restait étrangère au domaine de la législation, si elle n'exposait pas les effets d'une multitude de lois, de règlements, de traités, relatifs aux monnaies, au commerce, aux manufactures, aux établissements de banque et aux relations commerciales des nations. À son tour, le savant qui s'occupe de législation ne traiterait des lois que d'une manière très-imparfaite s'il ne montrait pas l'influence qu'elles c ont sur l'accroissement, la distribution ou la diminution des richesses... Il est également impossible que le savant qui décrit les institutions civiles ou politiques d'un peuple, et le moraliste qui recherche les causes des vices ou des vertus de ce peuple, ne passent pas alternativement l'un sur le territoire de l'autre.271 »
Les sciences morales sont liées entre elles, non-seulement par les rapports intimes qui existent entre les divers ordres de phénomènes qu'elles ont mission de faire connaître, mais encore par un but commun que nous croyons pouvoir légitimement leur assigner, et qui n'est autre que de mettre le plus possible en lumière les véritables intérêts des sociétés. Tout ce que l'on peut établir quant à leurs caractères distinctifs, c'est que, dans la poursuite de ce but commun, chacune d'elles est appelée à s'occuper de tel ordre de phénomènes sociaux plus particulièrement que de tous les autres, sans pouvoir toutefois négliger entièrement ces derniers. Ainsi la politique et la législation ont plus particulièrement pour objet ce qui concerne l'organisation des sociétés au point de vue de la défense nationale ou de la protection des personnes et des propriétés: elles ont à rechercher et à déterminer les limites qu'il convient de poser à la liberté individuelle dans l'intérêt de la liberté de tous, les règles de la justice à appliquer aux différends qui surviennent entre les particuliers, etc.; mais elles ne sauraient nettement distinguer les intérêts des sociétés sous ces divers rapports qu'en s'appuyant sur les lumières fournies par l'Économie politique et par la morale. Ainsi encore la morale, en recherchant quelles sont les habitudes ou les principes de conduite privée et publique les plus favorables au perfectionnement de l'homme et des sociétés, ne saurait fournir à cet égard des indications sûres sans tenir compte des vérités de l'ordre économique. Ainsi enfin l'Économie politique, en concentrant plus spécialement ses investigations sur les phénomènes par lesquels se produisent, se distribuent et se consomment les richesses, ne saurait négliger l'influence qu'exercent sur les phénomènes de cet ordre les institutions politiques, la législation et les mœurs, qu'en se renfermant dans de stériles abstractions.
Cette connexité des sciences sociales empêchera toujours que l'on puisse donner de chacune d'elles en particulier une définition qui la renferme dans une circonscription exclusive et rigoureusement déterminée; car, encore une fois, on ne pourrait lui interdire toute excursion au delà des limites qu'on lui aurait assignées, qu'à la condition de la mutiler. Cela est, d'ailleurs, aussi vrai de la Législation, de la Politique ou de la Morale que de l'Économie politique. Mais, si l'on ne peut circonscrire absolument le champ d'exploration de chacune de ces sciences, il est facile de les distinguer par la spécialité de leur but, et celle de l'Économie politique a été déterminée avec une précision suffisante: elle est, ainsi que nous venons de l'indiquer, de faire connaître dans leur nature, leurs causes et leurs résultats les phénomènes de la production, de la distribution et de la consommation des richesses, en se tenant aux caractères généraux de ces phénomènes et sans entrer, par exemple, dans l'examen des procédés techniques des diverses productions; elle est encore et surtout de nous éclairer le plus possible sur les conditions sociales qui sont favorables ou nuisibles, soit à la fécondité de la production générale, soit à l'équitable répartition des produits, soit à leur emploi avantageux.
Si c'est là, en effet, la tâche spéciale de l'Économie politique, — et nous pensons qu'il serait difficile de le contester, — on reconnaîtra qu'il serait peu utile de lui chercher d'autres définitions; elle se trouve ainsi suffisamment distinguée des autres sciences sociales, sans que le champ de ses investigations ait d'autres limites que celles au delà desquelles elle ne trouverait plus aucun secours utile pour le convenable accomplissement de sa mission. Nous croyons donc pouvoir nous abstenir de plus longs développements sur ce point, pour passer à d'autres considérations.
II.
Sous le régime auquel l'enseignement public a été soumis par nos gouvernements, la propagation des connaissances acquises en Économie politique n'a pu s'opérer qu'avec une excessive lenteur. Aussi notre pays est-il au rang de ceux où ces connaissances sont le moins répandues, non-seulement parmi les masses populaires, mais dans les classes plus ou moins lettrées, où le grand nombre n'a aucune notion de cette science et ne se doute seulement pas de l'importance des problèmes qu'elle est appelée à résoudre. Cependant les études qu'elle embrasse sont assurément, de tous les travaux dé l'esprit, ceux qui devraient le plus généralement exciter l'intérêt; car leurs résultats sont destinés à exercer sur le sort des populations l'influence la plus considérable et la plus salutaire: aucun autre ordre d'études ne saurait offrir aux sociétés autant de lumières propres à les guider dans les voies d'une civilisation réelle, et à leur faire éviter celles qui conduisent à la décadence et à la ruine.
L'histoire de nos révolutions politiques depuis soixante ans est pleine d'enseignements de nature à confirmer la vérité de ces assertions. Assurément, chez un peuple moins étranger que le nôtre aux vérités économiques, l'état de l'opinion n'aurait pas permis d'égarer l'activité nationale dans les voies rétrogrades et ruineuses où elle s'est laissé si souvent entraîner à partir de 1793; si l'opinion, générale eût été moins arriérée ou moins faussée sous ce rapport, l'essor libéral et vraiment civilisateur de 1789 ne se serait point fourvoyé dans les folles ou déplorables directions où il ne tarda pas à s'engager; on n'aurait pas vu, par exemple, une nation qui voulait fonder son existence sur le travail libre s'efforcer de se donner les opinions et les mœurs d'antiques sociétés, qui fondaient la leur sur la guerre, la spoliation et l'esclavage; plus tard, les dispositions guerrières qu'avait provoquées le besoin de la défense nationale, n'auraient pas dégénéré en esprit de conquête et de domination; nous ne nous serions point engoués de cette gloire militaire qui consiste dans le succès obtenu par les armes, quel qu'en soit le but et dût-il en résulter un pas en arrière vers la barbarie; sentiment sauvage et aveugle dont l'exaltation a, plus que toute autre cause, retardé les progrès moraux et politiques de l'Europe; nous n'aurions pas vu les lois de maximum, l'émission désordonnée des assignats, le système continental, le commerce par licences, etc., et toute cette suite de mesures désastreuses ou absurdes qui décélaient l'ignorance la plus complète des intérêts des sociétés, ou un souverain mépris pour ces intérêts. Mais l'écueil dont les lumières de l'Économie politique auraient pu surtout nous préserver si elles eussent été plus répandues, c'est l'établissement de ce système gouvernemental et administratif qui, multipliant les attributions de l'autorité publique au point de tout subordonner à ses directions, semble vouloir anéantir l'initiative et la puissance individuelles pour ne laisser subsister que la puissance collective; système qui, n'ayant cessé de s'aggraver depuis trente ans, tend à substituer de plus en plus l'activité nuisible à l'activité utile, en détournant les facultés et les efforts d'un nombre toujours croissant d'individus, de l'exploitation des choses vers celle des hommes eux-mêmes; qui, en chargeant nos gouvernements d'une responsabilité aussi illimitée que leurs attributions, devient la cause principale de leur instabilité et de l'insécurité qui en est la suite; qui, enfin, a paru sur le point d'atteindre dans ces derniers temps son extrême limite, en présentant comme une question à résoudre l'accaparement de tous les travaux par l'État et l'avènement d'un communisme universel.
Et il ne faudrait pas croire que ces dernières aberrations économiques fussent le résultat d'une ignorance particulière aux sectes socialistes: sous ce rapport, les partis se disant conservateurs ne se sont pas montrés plus généralement éclairés. S'ils ont résisté aux tendances qui poussaient à convertir les travaux restés plus ou moins libres en services publics, à étendre encore les régies gouvernementales, à affaiblir de plus en plus l'initiative et la responsabilité individuelles, ce n'est pas que le système en lui-même leur inspirât aucune répugnance, ni que leurs opinions fussent basées sur des principes fort différents de ceux de leurs adversaires; car ils avaient admis ou professé avant ces derniers que l'intervention de l'État n'a pas de limites assignables, et qu'il appartient aux gouvernements de diriger l'activité sociale dans tous ses développements; seulement, en adoptant ce pernicieux principe, ils entendaient rester seuls maîtres d'en déterminer les applications. Toutefois, et pour le besoin du moment, ils s'appuyaient alors volontiers sur les vérités proclamées par l'Économie politique; ils professaient avec elle qu'il n'y a de production féconde et de répartition équitable des produits que dans la liberté du travail et des transactions; que chacun doit avoir la responsabilité de son sort, et que, si les instincts du cœur comme les lumières de la raison commandent d'aider les malheureux autant qu'on le peut, nul n'a le droit de se décharger sur autrui du soin de se procurer du travail ou des moyens d'existence; que l'autorité publique a pour mission de protéger la personne, la liberté et les biens de tous, mais qu'il ne saurait lui appartenir de disposer des facultés de chacun et de ce qu'elles produisent, de prendre aux uns pour donner aux autres, de soustraire, de par la loi, les paresseux, les dissipateurs, les parasites, aux mauvaises conséquences de leur conduite, pour faire retomber ces conséquences sur ceux qui suivent une conduite opposée.
Mais ces vérités si claires s'obscurcissaient tout à coup à leurs yeux dès qu'il s'agissait d'en faire la moindre application aux abus constitués. S'ils se déclaraient partisans de la liberté du travail, c'était sous condition de ne pas toucher au régime qui exclut cette liberté d'une multitude de professions monopolisées ou réglementées. S'ils n'admettaient pas que l'État dût prendre aux uns pour donner aux autres, ils n'en étaient pas plus disposés à tolérer que l'on contestât la légitimité des subventions des primes, des garanties exceptionnelles accordées sur les produits des contributions publiques à un grand nombre d'entreprises jouissant de leur appui à un titre quelconque. S'ils flétrissaient les parasites, c'était sans préjudice du parasitisme dévorant qu'ils avaient eux-mêmes créé en poussant à l'exagération des attributions et des dépenses gouvernementales. S'ils s'élevaient fortement contre la prétention de l'autorité du moment de diriger l'application des fonds productifs du pays et d'empêcher chacun de disposer librement de ses facultés et des fruits de son travail, ils ne défendaient pas avec moins d'énergie la législation commerciale qui, au moyen des prohibitions douanières et des droits prohibitifs, produit précisément ces deux résultats.
Ainsi les uns réclamaient les privilèges, les secours et les largesses de l'État en faveur des classes ouvrières dans lesquelles ils cherchaient un appui; les autres n'en voulaient que pour ceux qui se trouvaient nantis. L'Économie politique n'en aurait voulu pour personne, l'une de ses conclusions étant qu'il faut laisser à chacun ce qui lui appartient et ne jamais se servir de l'autorité ou de la loi pour dépouiller les uns au profit des autres. Très-hostile aux spoliations légales, sous quelque forme qu'elles se déguisent et sous quelque drapeau qu'elles s'abritent, elle devait déplaire à la fois à tous ceux qui s'en disputent le bénéfice; aussi a-t-elle été successivement proscrite par les deux camps opposés. Après la tentative faite en 1848 pour subordonner son enseignement au point de vue de l'organisation (arbitraire) du travail, est venue, en 1850, celle d'un conseil général de l'agriculture, des manufactures et du commerce, qui prétendait imposer aux professeurs d'Économie politique l'obligation de coordonner leurs leçons au point de vue de la législation commerciale actuelle de la France, c'est-à-dire de manière à justifier ic système protecteur ou prohibitif.
Mais l'Économie politique ne doit être enseignée qu'à un seul point de vue, celui de la nature des choses exactement observée, et il est bien évident que l'on ne pourrait imposer d'autres bases à son enseignement sans en faire tout autre chose qu'une science: car les sciences ne comportent pas de conclusions préconçues; celles auxquelles elles arrivent ne sont que des résultats de la connaissance des faits et de leurs rapports. Il ne serait assurément pas plus absurde d'exiger que l'astronomie fût enseignée au point de vue du système de Ptolémée, que de prétendre faire servir l'enseignement de l'Économie politique à la justification du système protecteur ou de tout autre système arrêté d'avance et indépendamment des résultats de l'observation.
III.
Parmi les formes diverses que peut comporter l'exposition de l'Économie politique, celle du Dictionnaire parait des plus favorables à la propagation rapide de ses principales notions. Il est un grand nombre d'individus, appelés à s'occuper d'intérêts publics ou collectifs, qui, pour remplir leur mission le mieux possible, trouveraient dans les notions dont il s'agit de précieuses directions, et qui néanmoins s'abstiennent de les acquérir, parce qu'ils ne le pourraient qu'en consacrant beaucoup de temps et d'attention à l'étude des traités méthodiques. Un Dictionnaire complet et bien conçu, en leur permettant de fractionner cette étude, de choisir à volonté les questions auxquelles la marche des affaires ou des événements viendrait imprimer un intérêt d'opportunité, pourra les initier peu à peu aux vérités économiques et leur inspirer le désir d'en connaître l'ensemble.
D'un autre côté, ceux qui se sont livrés à cette élude sans en faire une occupation constante, ou sans y revenir fréquemment, conservent difficilement le souvenir de tous les principes et de leur enchaînement, en sorte qu'ils sont parfois embarrassés en présence de difficultés ou d'objections qui n'ont le plus souvent aucune importance réelle. Le secours d'un Dictionnaire pourra leur permettre de ressaisir promptement les notions nécessaires aux solutions cherchées.
Un semblable ouvrage nous parait donc susceptible d'être plus souvent consulté que les traités méthodiques et de recevoir ainsi une utilité plus usuelle et plus générale. Mais était-il possible, dans l'état actuel de la science, de faire un bon Dictionnaire d'Économie politique? La tentative n'était-elle pas prématurée? Les travaux antérieurs sur cette matière ont-ils constitué un ensemble de principes suffisant pour expliquer toute la série des phénomènes économiques et résoudre théoriquement les nombreuses questions qui s'y rattachent? Chaque principe et chaque solution ont-ils été amenés au degré d'évidence nécessaire pour que l'on puisse les exposer avec la concision que réclame la forme du Dictionnaire? Nous espérons qu'au jugement des hommes compétents, l'ensemble de l'œuvre collective que nous publions paraîtra répondre d'une manière satisfaisante à ces questions. Malheureusement les juges véritablement compétents en Économie politique sont peu nombreux, et le sont moins encore en France que dans plusieurs autres pays. Cette science n'est guère connue de la plupart de nos hommes d'État, de nos administrateurs, de nos publicistes, que par les attaques intéressées ou inintelligentes dont elle a été l'objet depuis vingt ans. Ils partagent d'ailleurs généralement lés préventions soigneusement entretenues contre elle par toutes les cupidités qui croient avoir quelques raisons de redouter sa lumière, et, lorsqu'ils ne vont pas jusqu'à la proscrire comme une utopie dangereuse, ils se plaisent à la classer au nombre des systèmes purement hypothétiques. Les moins hostiles, sans contester la vérité de ses théories, lui dénient toute portée pratique. Quelques-uns cependant veulent bien accorder que plusieurs de ces théories devront être appliquées un jour; mais ils reculent l'époque de leur application à un point décourageant pour les générations actuelles, et cela non-seulement pour laisser à l'opinion générale le temps de se modifier dans le sens des réformes à accomplir, mais parce qu'un ajournement à long terme leur semble nécessaire pour compléter et mieux assurer les bases de la science, qui ne leur paraissent pas encore suffisamment établies.
Malgré le respect que nous inspirent les fondateurs de l'Économie politique, nous sommes loin de penser que de nouvelles investigations ne puissent ajouter à l'utilité de leurs travaux, ou même rectifier ce qu'il peut y avoir eu d'incomplet ou d'erroné dans quelques-unes de leurs vues. Comme toutes les autres branches des connaissances humaines, l'Économie politique est indéfiniment perfectible; mais nous avons la conviction qu'elle est aujourd'hui assez avancée pour ne laisser sur ses principes essentiels aucun doute légitime, et que les vérités expriméés par ces principes ne seront pas plus ébranlées par les recherches ou les découvertes ultérieures que ne l'ont été les éléments de la géométrie ou les lois de la gravitation universelle par les travaux de Lagrange ou de Laplace. Nous croyons pouvoir affirmer que, de toutes les sciences qui ont l'homme ou les sociétés pour sujet, l'Économie politique est la plus positive et la moins incomplète; qu'elle est incomparablement plus avancée que la politique proprement dite, plus que ce que l'on enseigne de nos jours sous le nom de philosophie, plus encore que les sciences de la législation et de la morale, et que sans elle on ne peut faire ni politique, ni philosophie, ni législation, ni morale utiles et vraies.
On signale dans les écrits des Économistes certaines dissidences que l'on exagère autant que possible afin d'en conclure que rien dans leurs principes n'est suffisamment arrêté; mais on s'abstient de rappeler la foule des vérités sur lesquelles ils s'accordent absolument. Ou bien, pour trouver des contradicteurs, on accorde complaisamment la qualification d'Économistes à des écrivains qui n'y ont aucun titre; on s'abstient encore de remarquer, qu'il n'est pas une seule science qui n'ait été, même les mathématiques pures, et ne soit encore à quelques égards l'objet de dissentiments plus ou moins profonds entre ceux qui s'en occupent. Les différents ordres de faits ou de phénomènes qu'embrassent respectivement la géologie, la physique, la zoologie, la chimie, etc., n'ont-ils pas été, sur plusieurs points, appréciés diversement par les savants qui les ont observés? et s'est-ou jamais avisé de conclure de ces dissidences que les sciences dont il s'agit étaient problématiques et sans principes certains? D'où vient donc que l'Économie politique, tout aussi riche qu'elles on vérités constatées, n'obtient pas à beaucoup près le même crédit? Cela tient surtout à deux causes qu'il importe de rappeler.
En premier lieu, les principaux objets des études économiques, — le travail, l'échange, la valeur, le capital, etc., étaient le sujet des préoccupations universelles longtemps avant que la science fût fondée, et la généralité des hommes s'en occupe encore aujourd'hui sans comprendre le besoin de ses directions; il est donc tout simple qu'un grand nombre de personnes aient pu se croire compétentes pour se former une opinion sur toutes les questions que peuvent soulever des objets qui leur sont aussi familiers. Or ces opinions, basées sur des vues trop incomplètes des phénomènes économiques, de leurs conséquences plus ou moins éloignées et des rapports qui les lient entre eux, devaient le plus souvent s'écarter des vérités qu'une étude approfondie et généralisée peut seule permettre de saisir; mais une fois adoptées, elles n'en ont pas moins résisté aux démonstrations scientifiques avec la ténacité ordinaire des préjugés.
En second lieu, la législation économique des sociétés s'étant formée en l'absence de toute véritable notion scientifique, et en conformité des préjugés régnants, la science n'a pu découvrir et dénoncer les vices de celte législation sans alarmer de nombreux intérêts, légalement fondés sur l'erreur ou l'injustice.
L'Économie politique devait donc réunir contre elle, indépendamment des opinions préconçues, l'hostilité active et persévérante des intérêts illégitimes qu'elle peut menacer: tels sont les principaux obstacles qui, en entretenant parmi nous les doutes réels ou affectés sur la certitude ou l'efficacité de ses principes, retardent la propagation et par suite l'application des salutaires vérités qu'elle a mises en lumière.
Mais ces obstacles s'affaibliront. Les intérêts injustement fondés que l'Économie politique peut alarmer sont infiniment moins nombreux et moins importants dans leur masse que les intérêts légitimes qu'elle est destinée à servir: à mesure que ceux-ci s'éclaireront davantage, ils lui prêteront un appui plus énergique, et un jour viendra où elle acquerra par ce concours une force irrésistible.
Ce jour est déjà venu pour l'Angleterre, où les principales vérités économiques ont pénétré dans l'opinion des masses, et où elles sapent et démolissent avec une facilité inespérée des abus qu'avaient enracinés des habitudes séculaires et que soutenaient des intérêts puissants.
Aux États-Unis, le profond bon sens de Franklin et des autres fondateurs de l'Union avait pour ainsi dire devancé les théories économiques. Les institutions de ce pays, — à part celles dos États où l'esclavage est encore admis, — semblent avoir été inspirées par les plus saines doctrines de la science; aucune autre nation n'a su renfermer aussi complètement l'action de l'autorité publique dans ses limites rationnelles, ni fonder des institutions qui laissent autant de liberté au travail et aux transactions et qui protègent aussi bien les développements de l'activité utile, en donnant aussi peu de prise ou d'aliment à l'activité nuisible.
L'opinion publique, au surplus, commence à se prononcer dans le même sens en Belgique, en Piémont, dans plusieurs parties de l'Allemagne et de l'Italie; l'enseignement de l'Économie politique y a une place notable dans l'instruction publique. Il en est de même en Espagne et en Russie. La France est de tous les États de l'Europe celui qui, dans les vingt dernières années, a le moins participé à ce mouvement civilisateur; mais elle y sera entraînée, plus tôt peut-être que ne le pensent ceux qui s'efforcent de la maintenir au dernier rang sous ce rapport, par l'exemple des nations plus avancées ou par l'excès même des abus dont elle subirait les conséquences si elle persistait longtemps encore à lutter aussi imprudemment qu'elle l'a fait jusqu'ici contre les vérités économiques.
IV.
Afin de justifier ce que nous avons dit du degré d'avancement de l'Économie politique et de la grandeur de sa mission, nous allons rappeler quelques-unes des vérités qu'elle enseigne, sans toutefois nous écarter de la ligne des considérations générales, et en nous abstenant de développements qui ont leur place dans les articles de ce Dictionnaire.
Si la création terrestre fût restée dans son état primitif, les hommes n'auraient pu ni se multiplier, ni progresser dans aucun sens: ils ne formeraient que de faibles peuplades dispersées dans les forêts et vivant de proie à la manière de diverses espèces d'animaux; peut-être même auraient-ils fini par disparaître devant les difficultés exceptionnelles de leur existence originaire. Mais ils avaient été doués d'une merveilleuse faculté, celle d'agir sur la plupart des êtres de la création de manière à les approprier de plus en plus à leurs besoins; et c'est par l'exercice de cette faculté, par les prodigieux développements qu'avec le temps elle a reçus de l'accumulation des moyens de travail et des découvertes successives de l'intelligence, que notre race est véritablement devenue maîtresse du globe, qu'elle a pu couvrir de ses essaims toutes les contrées habitables, et élever les conditions de son existence physique, intellectuelle et morale à la hauteur où nous les voyons aujourd'hui chez les nations les plus avancées.
C'est cette puissante faculté que désigne, en Économie politique, le mot industrie; l'exercice de l'industrie est indiqué par le mot travail; les résultats du travail, consistant en utilités de toute espèce applicables à nos besoins, se nomment produits, et les produits, conservés ou accumulés, composent les richesses.
Bien que les richesses n'aient jamais cessé d'être ardemment recherchées, les travaux qui les créent sont loin d'avoir toujours été honorés par l'opinion. Les peuples les plus fameux de l'antiquité, et ceux-là même que notre enseignement public offre encore pour modèles à la jeunesse des écoles, ont longtemps jugé incomparablement plus noble et plus méritoire de dépouiller les travailleurs des richesses qu'ils avaient produites, que de s'appliquer eux-mêmes à leur production. Ces peuples n'estimaient que les occupations stériles ou spoliatrices, et principalement celles que comportent la guerre et l'exercice de la domination; quant aux travaux producteurs, ils étaient généralement l'objet de leur dédain, et rien ne leur semblait plus avilissant que de s'y livrer. Ce singulier mépris de l'emploi de la plus haute et de la plus admirable de nos facultés s'est maintenu à travers les siècles, en s'affaiblissant peu à peu, jusqu'à des temps voisins du nôtre, et il n'est point encore entièrement effacé chez toutes les classes des populations européennes.
Il appartenait à l'Économie politique de réhabiliter complètement le travail producteur; et elle l'a fait de la manière la plus éclatante, en démontrant, d'une part, qu'il est la source de toutes les richesses; le véritable fondement de l'existence des sociétés, l'agent principal de la civilisation, la condition essentielle de tout progrès, de toute prospérité; d'autre part, que c'est à lui désormais que les populations intelligentes devront attacher l'estime et la considération usurpées par l'activité spoliatrice, et qu'elles ne sauraient trop s'appliquer à distinguer celle-ci sous les formes diverses qu'elle emprunte, afin de la flétrir de tout le mépris, de toute la honte qu'elle a si longtemps déversés sur l'activité productive.
Nous avons dit que l'un des objets de l'Économie politique était de faire connaître les conditions sociales favorables ou nuisibles à la fécondité de la production et à l'équitable répartition des richesses. Or ces conditions se rapportent principalement, soit au degré de liberté assuré à l'industrie par les institutions, soit à la manière dont le produit général du travail est distribué. Nous allons indiquer sommairement les conclusions de la science sur ces deux points fondamentaux.
En premier lieu, la liberté du travail et des transactions est une des conditions essentielles de la fécondité de la production: d'une part, parce qu'elle laisse à chacun la faculté de suivre les inspirations de son intérêt personnel dans le choix du genre d'occupation auquel sa position, ses goûts ou ses aptitudes particulières lui permettent de se livrer avec le plus de fruit, et que, tout bien considéré, l'intérêt personnel est généralement en ceci le guide le plus sûr ou le moins faillible; d'autre part, parce qu'elle maintient dans toutes les branches du travail producteur une concurrence aussi étendue que la nature des choses peut le comporter, et que la concurrence est incontestablement le stimulant le plus puissant de l'activité et du perfectionnement des travaux.
Tout ce qui, dans les institutions sociales, restreint cette liberté est par conséquent nuisible à la fécondité de la production, et tel est le caractère que l'on peut sûrement assigner, par exemple, aux monopoles légaux réservant soit à des corporations privilégiées, soit aux gouvernements, la faculté exclusive d'exercer certains travaux ou professions; — aux règlements par lesquels l'autorité publique prétend diriger la marche de certaines branches d'activité productive; — aux restrictions légales apportées à la faculté d'échanger et qui restreignent nécessairement, en même temps, la faculté de travailler, etc.
En second lieu, nos facultés industrielles variant en nature et en puissance d'un individu à l'autre et leur fécondité étant généralement proportionnée à l'activité de leur application, cette activité ne pouvant avoir de mobile plus puissant que l'intérêt personnel, il est facile de concevoir que le seul mode de distribution juste et efficace des utilités qu'elles produisent consiste simplement à laisser et à garantir à chacun la jouissance et la libre disposition, ou en d'autres termes la propriété, du fruit de ses travaux.
Toute perturbation apportée dans celte distribution naturelle des produits, soit par la violence, soit par la fraude, soit par le défaut de lumières, constitue une évidente injustice, puisqu'elle prive les uns de ce qu'ils ont produit pour l'attribuer à d'autres; en même temps elle diminue l'étendue ou la sécurité des jouissances qui sont le but général de tous les efforts, d'où résulte inévitablement une réduction dans l'activité et dans la puissance des facultés productives.
Pour que la propriété puisse se former et les richesses s'accroître, le travail ne suffit pas, car ses résultats peuvent être plus ou moins rapidement consommés; il faut y joindre l'épargne, que l'on ne saurait provoquer sans garantir à chacun, non-seulement la jouissance personnelle, mais l'entière et libre disposition de ce qu'il a produit, comprenant avant tout la faculté de le transmettre à ses enfants, à sa famille, aux personnes qui lui sont chères. Sans cette condition, les stimulants du travail perdraient considérablement de leur énergie et les accumulations seraient incomparablement moins importantes; chacun se trouverait excité à consommer pendant sa vie tout ce qu'il aurait pu acquérir; les générations se succéderaient sans que l'une transmît à l'autre aucune réserve agrandie; les anciennes accumulations tendraient, au contraire, à se réduire de plus en plus, et l'industrie, bientôt privée de capitaux, deviendrait impuissante.
A la vérité, cette faculté de transmission des propriétés amène, avec le temps, de nombreuses inégalités dans la position des familles. Mais lorsque la propriété et les libertés productives sont complètement garanties, l'inégalité des fortunes ne peut provenir, sauf de rares exceptions, que de l'inégalité des productions et des accumulations dues à ceux qui les possèdent; elle n'est ainsi que la consécration de la justice: les familles qui, pendant deux ou plusieurs générations, auront apporté dans toute leur conduite une activité bien dirigée, une prévoyance éclairée, une sage économie, sont justement récompensées par l'aisance à laquelle elles parviennent ainsi; celles qui suivent une conduite opposée et dont les membres s'abandonnent à la paresse, à l'intempérance, aux diverses habitudes vicieuses, sont justement punies par la misère qui finit inévitablement par les atteindre, et de laquelle il importe qu'elles ne puissent se relever qu'à force de se bien conduire. Il est utile, indispensable au perfectionnement de la vie humaine qu'il en soit ainsi, et un régime social qui, soit pour maintenir la prééminence de certaines classes de la population sur toutes les autres, soit pour établir entre toutes les classes une égalité forcée, empêcherait les conséquences naturelles des bonnes et des mauvaises habitudes de retomber principalement sur ceux qui s'y livrent serait également funeste dans les deux cas.
L'expérience confirme pleinement ces résultats théoriques. L'histoire de tous les temps et de tous les peuples prouve que les sociétés sont d'autant plus prospères et plus perfectionnées qu'elles garantissent mieux, par leurs mœurs et par leurs institutions, les libertés productives et la propriété contre les atteintes infiniment variées dans leurs formes qui peuvent leur être portées par l'activité spoliatrice. C'est là la principale condition à laquelle paraît avoir été lié jusqu'ici le sort des populations; celles qui l'ont le mieux observée sont les plus avancées sous tous les rapports essentiels; celles qui l'ont le moins respectée sont les plus arriérées et les plus misérables. Si quelques peuples anciens ont pu obtenir passagèrement un certain degré de prospérité matérielle en s'écartant de celte condition, en fondant leur existence sur la guerre, la rapine ou l'esclavage; si, au sein même de chaque nation, certaines classes ont pu s'organiser de manière à asservir les autres et à vivre à leurs dépens, ce n'a été qu'en faisant le malheur du grand nombre, en soulevant des haines générales, et en développant parmi les populations ou les classes dominatrices une corruption qui a toujours entraîné leur déchéance et leur ruine.
D'un autre côté, les tentatives faites pour maintenir parmi les sociétés humaines une égalité factice fondée sur des communautés de travaux et de biens, ont toutes misérablement échoué, parce que, ne tenant pas compte des inégalités naturelles qui existent entre les hommes, et traitant les facultés supérieures à l'égal des plus infimes, elles ont détruit le stimulant indispensable de l'intérêt personnel et abaissé toutes les activités au niveau des moins intelligentes et des moins fécondes.
« Les maux qui pèsent sur une nation, a dit à ce sujet le profond publiciste que nous avons déjà cité, sont donc toujours également graves, soit qu'une partie de la population s'approprie les produits des travaux de l'autre, soit que les individus dont elle se compose aspirent à établir entre eux une égalité de biens et de maux. Il résulte de là que l'inégalité entre les individus dont un peuple se compose est une loi de leur nature; qu'il faut, autant qu'il est possible, éclairer les hommes sur les causes et sur les conséquences de leurs actions; mais que la position la plus favorable à tous les genres de progrès est celle où chacun porte les peines de ses vices, et où nul ne peut ravir à un autre les fruits de ses vertus ou « de ses travaux.272 »
Les lumières de l'Économie politique ont seules pu compléter les connaissances nécessaires à cette importante démonstration, et elles ont en même temps fourni une foule de notions indispensables pour reconnaître à travers toutes les complications sociales, dans les institutions, les lois, les actes privés ou collectifs, l'existence, souvent dissimulée et parfois difficile à dévoiler, de cette activité perverse qui s'applique sans cesse à s'approprier les fruits de l'activité productive.
------
L'une des parties les plus positives et les plus utiles de l'Économie politique est celle qui rend compte des phénomènes sociaux par lesquels s'accomplit l'échange général des produits ou des services.
Il est assez connu que la division ou plutôt la spécialisation des professions ou des travaux est une des causes principales de la puissance de l'industrie, qui, sans cette condition, serait tout à fait hors d'état de pourvoir aux besoins si nombreux et si divers des sociétés civilisées. Or cette condition oblige chaque travailleur à s'adonner à la production d'objets uniformes, alors que ses besoins réclament des produits variés, et elle entraîne ainsi la nécessité de l'échange.
A l'état rudimentaire, l'échange consiste dans le troc direct des objets les uns contre les autres; mais l'inefficacité de ce mode se manifeste à mesure que les besoins se développent et que les objets à échanger se multiplient et se spécialisent davantage. Les populations sentent alors la nécessité d'adopter un intermédiaire uniforme et dont les qualités soient telles que chacun se montre disposé à l'accepter comme équivalent dans les transactions; cet intermédiaire , quelle qu'en soit la nature, constitue la monnaie dès qu'il est généralement admis. Les monnaies formées d'or et d'argent sont devenues d'un usage universel; la longue habitude de tout évaluer par elles, d'y voir l'équivalent de tous les produits, les a fait considérer pendant longtemps comme la richesse par excellence, ou même comme l'unique richesse, et de là sont nés une multitude de préjugés et d'erreurs qui, par suite du défaut de vulgarisation des notions de l'Économie politique, tiennent encore une grande place dans l'opinion générale.
C'est sur cette fausse idée de la richesse que l'on a fondé l'opinion, encore admise par un grand nombre de publicistes et d'hommes d'État, que les impôts ne sauraient être une cause d'appauvrissement pour le pays qui les supporte, par la raison que l'argent perçu est rendu au pays par les dépenses des gouvernements; c'est le même préjugé qui fait encore écrire tous les jours que l'achat des produits exotiques constitue un tribut payé à l'étranger. La même erreur sert aussi de fondement au système de la balance du commerce, suivant lequel chaque peuple aurait à considérer comme un gain l'excédant de ses exportations sur ses importations, tandis qu'il devrait compter comme une perte tout surplus dans les valeurs importées sur celles exportées, attendu que dans les deux cas la différence étant probablement soldée en monnaie, et la monnaie étant supposée la seule richesse, peut seule constituer la perte ou le gain.
Rien n'est plus rigoureusement exact que les démonstrations de l'Économie politique sur ces différents points; elle a fait voir clairement que l'or et l'argent, loin de composer toute la richesse, n'en constituent partout qu'une très-faible partie (ils ne forment probablement pas le cinquantième de la masse totale des valeurs accumulées). La valeur des monnaies est due, au surplus, comme celle de tout autre produit, à leur utilité d'abord, comme moyen de faciliter les échanges, et ensuite aux frais qu'il faut faire pour les obtenir. La quantité de monnaie contre laquelle s'échange couramment un hectolitre de blé a autant de valeur que cette quantité de blé; mais elle n'en a pas davantage, et rien n'autorise à penser que l'une de ces valeurs soit plus précieuse que l'autre. Il y a même de fortes raisons de croire que, pour un peuple considéré dans son ensemble, les accumulations de richesse sous forme de monnaie sont moins avantageuses que sous toute autre forme. Car la monnaie se distingue essentiellement de tous les autres produits en ce qu'elle sert à nos besoins, non point, comme ces derniers, proportionnellement à sa quantité, mais uniquement en raison de sa valeur; or la valeur de la monnaie s'abaisse nécessairement dans tout pays où sa quantité est considérablement accrue. Il n'y a donc aucun motif raisonnable pour engager un peuple à préférer la monnaie à tous autres produits de même valeur. — Il est aussi absurde de dire que nous payons tribut aux étrangers en leur achetant des produits, qu'il le serait de considérer le consommateur de pain comme tributaire du boulanger et celui-ci comme tributaire du marchand de farine. Le système de la balance du commerce n'est pas autre chose qu'une sottise; car il est ridicule de prétendre qu'une nation perd lorsque dans son commerce avec les étrangers elle reçoit plus de valeurs qu'elle n'en livre en échange, et qu'elle gagne, au contraire, lorsqu'elle livre plus en échange de moins. Les différences entre les valeurs importées et exportées sont généralement compensées entre les diverses nations par l'application de la dette des unes au payement de la créance des autres au moyen des lettres de change, et il arrive rarement qu'il y ait des soldes considérables à fournir en monnaie; mais, alors même qu'il en serait autrement, on ne pourrait en tirer aucune induction quant au gain ou à la perte donnée par les opérations. Il est fort probable que, si les états des douanes donnaient exactement les valeurs importées et exportées, ils présenteraient partout des excédants d'importation, attendu que ces excédants sont indispensables pour fournir les profits des négociants, qui ne tarderaient pas à abandonner le commerce s'il ne donnait pas plus de profits que de pertes. — Enfin les contribuables ne sauraient admettre sans un excès de niaiserie que les gouvernements leur restituent les impôts en en dépensant le montant, attendu que, si l'argent prélevé pour ces dépenses est reversé dans le pays, ce n'est qu'en échange de produits ou de services dont la valeur est ou doit être la même.
Les indications de la science ne sont pas moins sûres en ce qui concerne l'usage des billets de banque remplissant jusqu'à un certain point l'office de monnaie. Elle montre que ces billets, n'étant pas autre chose que des titres de créance, n'ajoutent absolument rien aux richesses existantes, et que leur unique fonction consiste à faire passer la faculté de disposer d'une portion de ces richesses d'une personne à une autre. Cette fonction est aussi celle de la monnaie métallique; mais il y a entre celle-ci et les billets de banque, ou autres titres de même nature, celte différence essentielle que la monnaie d'or ou d'argent porte en elle-même le gage de sa valeur, tandis que le gage que les billets représentent ou sont censés représenter peut ne pas exister. Il reste vrai toutefois que, lorsque ceux-ci sont généralement acceptés avec confiance, ils suppléent plus ou moins à la monnaie réelle, et peuvent ainsi procurer une économie importante de métaux précieux, en même temps qu'ils constituent un instrument d'échanges d'un très-facile emploi.
Mais ces avantages sont chèrement achetés toutes les fois que l'émission des billets n'est pas sagement mesurée et que leur remboursement en monnaie métallique à toute réquisition n'est point suffisamment assuré. Il en résulte alors une extension exagérée et dommageable du crédit. Celui dont jouissent les banques, poussé à se répandre par la facilité de multiplier les escomptes en multipliant les émissions, passe avec leurs billets à une multitude de personnes qui n'en obtiendraient pas autrement et qui s'en servent le plus souvent, non pour créer, mais pour dissiper des richesses. Il en résulte encore que l'abondance progressive de cet intermédiaire des échanges le déprécie de plus en plus, bien que les billets conservent la même valeur nominale, ce qui entraîne une hausse factice dans le prix des produits et des services, et de désastreuses perturbations dans toutes les transactions, au moins lorsque les billets ont un cours forcé.
En exposant ces principes, l'Économie politique ne tend nullement à proscrire un convenable emploi des titres dont il s'agit, comme moyen de faciliter les échanges et le crédit; elle a pour objet de prémunir les populations contre les dangers d'un emploi exagéré ou imprudent, et contre les illusions auxquelles elles se laissent trop souvent entraîner à cet égard.
Après avoir ainsi fait connaître la nature et les véritables fonctions des monnaies ou de leurs signes représentatifs, il restait à l'Économie politique, pour donner une intelligence complète des lois naturelles sous l'action desquelles s'opère l'échange général des produits ou des services, à assigner les conditions qui déterminent le taux de la valeur de chacun d'eux, et elle est encore parvenue à poser sur ce point des principes certains.
Tous les objets de nos besoins ne sont pas susceptibles d'être échangés. Il en est an grand nombre, tels que la lumière et la chaleur du soleil, l'air respirable, etc., que la nature fournit à tous et dont nous jouissons sans efforts et sans avoir rien à céder en retour; tandis que les autres, ne pouvant être obtenus qu'à l'aide des facultés ou des efforts personnels, constituent des propriétés privées qui, hors les cas de donation, de succession, etc., ne se cèdent pas volontairement pour rien. La qualité qui distingue les objets échangeables de ceux qui ne le sont pas est ce que l'on entend en Économie politique par le mot valeur. La valeur est plus ou moins grande dans les différents objets, et elle peut se mesurer dans chacun d'eux par la quantité de tout autre objet valable qu'il peut faire obtenir en échange. La monnaie étant l'intermédiaire général des échanges, le taux de la valeur de chaque produit ou de chaque service s'exprime ordinairement par une quantité de monnaie déterminée, et cette expression du taux de la valeur par la monnaie se nomme prix.
En général, la différence de prix entre deux objets valables d'espèces diverses provient de la différence de leurs frais de production, c'est-à-dire de la différence entre les valeurs des services ou des produits qu'il a fallu consacrer à la création de chacun d'eux. On comprend qu'en admettant une entière liberté de travaux et de transactions, le prix d'une espèce d'objets ne pourrait longtemps se maintenir fort au-dessus des frais de production, parce que l'avantage exceptionnel qu'on trouverait à les produire amènerait une concurrence qui ferait bientôt baisser les prix; et, d'un autre côté, il est bien évident qu'une production qui ne donnerait que de la perte ne serait pas longtemps continuée dans de telles conditions; sa quantité serait réduite jusqu'à ce que les prix eussent été relevés tout au moins au niveau des frais.
Ces conditions sous-entendues, le prix courant des produits ou des services dépend du rapport existant entre les quantités offertes et demandées de chacun d'eux: si l'offre augmente plus que la quantité demandée, le prix s'abaisse; si la demande s'accroît dans une proportion plus forte que la quantité offerte, le prix s'élève.
Telle est la loi générale qui préside à la détermination du taux respectif de la valeur de produits ou de services différents.
Cette loi permet au travail libre de maintenir — beaucoup mieux que ne saurait le faire aucun régime arbitraire — dans chacune des branches si multipliées et si diverses de l'activité industrielle une constante proportionnalité entre la quantité de chaque classe de produits et l'étendue du besoin qui la réclame, ou de la demande que l'on en fait. Car, si la demande est dépassée par la quantité produite, la surabondance est aussitôt signalée par l'abaissement du prix, et alors la production se restreint; et si, au contraire, celle-ci ne suffit pas à l'étendue de la demande, l'élévation du prix signale cette insuffisance et amène bientôt un accroissement dans la quantité produite.
Il résulte encore de cette loi que le prix des services industriels s'abaisse inévitablement si ces services sont plus offerts que demandés; et, comme les services les plus accessibles à la concurrence, les plus susceptibles d'être surabondamment offerts, sont en général ceux des ouvriers des classes les plus pauvres, l'Économie politique en conclut que ces ouvriers ont le plus grand intérêt à user de prudence et de retenue avant et pendant le mariage, pour ne pas accroître inconsidérément leur nombre, et par suite l'offre de services déjà trop dépréciés.
Une autre conséquence de cette loi féconde est que la multiplication des capitaux tend à abaisser le prix de leur service et à les rendre ainsi de plus en plus accessibles à ceux qui peuvent les employer reproductivement; et, comme le travail des ouvriers est d'autant plus demandé, par conséquent d'autant mieux payé que les capitaux sont plus abondants, l'Économie politique en conclut encore que les classes ouvrières sont puissamment intéressées à la multiplication des capitaux, et par suite à tout ce qui peut la favoriser: à l'activité et au progrès de l'industrie, à l'abondance des accumulations ou des épargnes, et surtout au maintien de la sécurité publique, condition indispensable de la conservation et de l'accroissement des capitaux.
L'une des plus belles et des plus solides théories qui soient sorties de l'étude des phénomènes sociaux par lesquels s'accomplit l'échange général des produits ou des services, est celle des débouchés, si admirablement formulée par J.-B. Say. Il résulte de cette théorie que ce qui s'échange en définitive, ce sont des produits contre d'autres produits; par conséquent, tout produit est un moyen d'échange, un débouché pour les autres; d'où il suit que les débouchés sont d'autant plus étendus et d'autant plus avantageux pour chaque branche de travail en particulier que la production a été plus généralement abondante dans toutes les branches; d'où il suit encore que les industries diverses ont des intérêts solidaires, l'une d'elles ne pouvant être en état de prospérité ou de souffrance sans que les autres s'en ressentent plus ou moins. On sait, d'ailleurs, depuis longtemps que les campagnes sont intéressées à la prospérité des villes comme celles-ci le sont à la prospérité des campagnes, parce que les unes et les autres trouvent alors un placement plus facile et plus avantageux de leurs produits respectifs; mais les mêmes liaisons d'intérêt s'étendent à toutes les branches d'industrie, et elles se manifestent également dans les relations commerciales de nation à nation. Lorsqu'un peuple est en voie de progrès et de prospérité, tous ceux avec lesquels il est en position de faire des échanges en profitent, soit à cause de l'abondance des débouchés qu'il leur offre, soit par suite du bon marché des produits qu'il peut leur fournir; c'est ainsi que le développement prodigieux de l'Union américaine a profité à nos diverses branches d'industrie, au point que la ruine de ce pays, si elle était possible, serait aujourd'hui un véritable fléau pour une grande partie de notre population. Les nations sont donc solidaires dans la bonne comme dans la mauvaise fortune; leur intérêt est d'accroître de plus en plus, en multipliant leurs échanges, les services qu'elles peuvent se rendre mutuellement, et non de chercher à s'affaiblir et à se nuire, comme une politique aveugle les y a poussées trop longtemps.
C'est en s'appuyant sur ces vérités, et en invoquant en même temps le respect dû à la propriété, que l'Économie politique réclame la liberté du commerce international, liberté qui aurait pour résultats de faire participer tous les peuples aux avantages naturels très-diversifiés que Dieu a inégalement répartis dans les différentes contrées du globe, d'étendre le réseau des intérêts qui lient déjà les nations civilisées, malgré tous les obstacles législatifs opposés à leurs relations, au point d'établir entre elles une solidarité aussi manifeste que celle qui unit les diverses provinces d'un même État, et de rendre les guerres internationales aussi impopulaires et aussi impraticables qu'elles le seraient aujourd'hui entre les diverses parties de la France.
------
L'Économie politique a perfectionné la morale en fournissant de solides bases d'appréciation pour un grand nombre de sentiments, d'actions et d'habitudes que le préjugé avait mal classés. Ce sont d'importants progrès en morale que la complète réhabilitation du travail producteur, et l'acquisition d'un ensemble de notions positives permettant de distinguer sûrement l'activité utile de l'activité nuisible et de faire à l'une et à l'autre la juste part qui leur revient dans l'estime publique. La démonstration de la solidarité qui unit les intérêts des diverses fractions du genre humain constitue encore un immense progrès moral; car, en faisant ressortir toute l'absurdité des haines et des rivalités nationales; en montrant que ce sont là des sentiments aveugles et indignes d'hommes civilisés , bien que l'ignorance et le charlatanisme politique les aient souvent décorés du nom de patriotisme, elle a considérablement affaibli dans l'esprit des classes les plus influentes les dispositions qui poussent à la guerre, et préparé ainsi pour l'avenir l'abandon du système des grandes armées permanentes, l'une des causes les plus puissantes de la misère des populations, et par conséquent de toutes les défaillances, de tous les désordres moraux que cette misère entraîne à sa suite. Un autre perfectionnement important que la morale devra aux lumières répandues par l'Économie politique, consiste dans les moyens que fournit celle-ci pour apprécier justement le mérite relatif des différents emplois que l'on peut faire de la richesse. C'est ainsi, par exemple, que la prodigalité et le faste, si souvent préconisés, parce qu'on les confondait avec la générosité ou le désintéressement, et surtout parce qu'on les supposait favorables à l'activité de l'industrie, ont été définitivement reléguées par les démonstrations économiques au nombre des habitudes funestes et par conséquent vicieuses; tandis que l'économie, trop souvent décriée comme un indice d'égoïsme ou d'avarice, et aussi parce que l'on supposait que les valeurs épargnées étaient un aliment enlevé au travail, a été définitivement rangée parmi les habitudes les plus utiles à l'humanité et par conséquences plus vertueuses. L'Économie politique a rendu tout à fait évidente une vérité qui semble encore généralement ignorée de la plupart de nos hommes publics: c'est que l'habitude du faste ou des dépenses de luxe, bien loin de fournir plus d'aliments à l'industrie ou au travail, tend au contraire à la destruction, à l'anéantissement de ce qui peut les maintenir en activité; c'est qu'une valeur épargnée et consommée reproductivement dans une opération industrielle procure aux classes laborieuses infiniment plus de travail et de moyens d'existence que ne peut leur en offrir une valeur égale consommée improductivement dans un repas, un bal, une fête ou autre dépense du même genre: attendu que, dans le premier cas, la valeur consommée offre le même emploi aux travailleurs autant de fois qu'elle se reproduit, ce qui peut aller à l'infini; tandis que, consommée improductivement, elle disparait pour toujours après avoir offert, les mêmes moyens de travail une fois seulement.
Un des progrès les plus considérables que les sciences morales devront aux recherches des Économistes consiste dans le perfectionnement de la notion de la liberté.
La liberté est depuis longtemps l'objet des tendances d'une grande partie des populations européennes; mais elles la recherchent par une sorte d'instinct et sans discerner nettement ni ce qui la constitue, ni les conditions nécessaires à son maintien et à ses développements. Il était réservé à l'Économie politique de démontrer que la liberté est l'équivalent de la puissance effective, et que nous devenons plus libres à mesure que nous réussissons soit à étendre notre empire sur les agents naturels, soit à mieux subordonner notre propre activité aux directions qui peuvent lui donner le plus de puissance; c'est ainsi que nous parvenons à réduire de plus en plus les obstacles qui s'opposent à la satisfaction et à l'extension de nos besoins, à l'emploi fructueux et au perfectionnement de nos facultés physiques, intellectuelles ou morales, en un mot à l'amélioration et à la diffusion de la vie humaine.
Ces obstacles se rencontrent soit dans les choses, soit dans les hommes. L'industrie a pour mission de surmonter les premiers, et c'est ainsi qu'elle est parvenue, par exemple, à asservir et multiplier les races d'animaux qui nous sont utiles en restreignant le développement de celles qui nous sont nuisibles, — à substituer, sur une grande partie de la terre, aux diverses espèces de végétaux qui la couvraient sans utilité pour nous, celles qui peuvent le mieux satisfaire nos besoins, — à vaincre les difficultés que les fleuves, les montagnes, l'immensité des mers, opposaient aux relations entre les diverses nations, etc., etc. Quant aux obstacles provenant de l'homme lui-même, — de son ignorance, de ses passions, de sa cupidité, de son penchant à asservir et dominer ses semblables, — l'industrie n'est point étrangère à leur atténuation, mais elle n'y concourt qu'indirectement et en fournissant les moyens indispensables pour que les lumières puissent s'accroître et se propager. — Quoi qu'il en soit, les obstacles de ce dernier ordre s'affaiblissent à mesure que nous apprenons à mieux prévoir toutes les conséquences prochaines ou éloignées de nos actions ou de nos habitudes, et à mieux conformer notre conduite aux indications de cette prévoyance, — à mesure aussi que les sentiments de dignité et de justice se répandent, que chacun se sent mieux disposé à résister courageusement à toute violence, à toute injuste atteinte contre sa personne ou sa propriété, et à respecter scrupuleusement les mêmes droits chez autrui.
Il résulte de l'ensemble de ces conditions que la liberté des nations grandit à mesure qu'elles deviennent plus industrieuses, plus éclairées et plus morales; qu'elle est ainsi proportionnelle au degré de leur avancement sous ces divers rapports, et que c'est en vain qu'elles aspireraient à être plus libres que ne le comporte l'état de leur industrie, de leurs lumières et de leurs mœurs.273
Depuis 1789, la nation française s'est trouvée plusieurs fois maîtresse de son établissement gouvernemental, et, bien que ses tendances les plus générales fussent pour la liberté, les fausses notions qu'elle avait adoptées sur ce point ne lui ont pas permis de réussir à fonder des institutions propres à atteindre le but. La plupart de nos hommes politiques ont toujours considéré les institutions gouvernementales commes les principaux et presque les seuls organes de la vie des sociétés, comme les forces dont elles doivent attendre l'impulsion et subir la direction dans tous les modes de leur activité: préoccupés de l'exemple de certains personnages que nos historiens se plaisent à signaler comme de grands hommes d'État, parce qu'ils sont parvenus à faire dominer leur volonté ou leurs vues personnelles, quelque absurdes et quelque désastreuses qu'elles aient été le plus souvent; — influencés, parfois à leur insu, par des réminiscences classiques sur les institutions des Grecs et des Romains, sur les systèmes législatifs de Lycurgue, de Solon, etc., ou par des notions non moins propres à les égarer, puisées dans des écrits tels que ceux de Montesquieu, de Rousseau, de Mably, de Raynal, etc., ils n'ont vu dans les sociétés civilisées que des corps incapables de vivre et de prospérer par eux-mêmes; ils n'ont pas compris que leur existence et leurs progrès dépendent avant tout d'efforts individuels dont les principes sont en nous-mêmes et non dans la législation ou dans l'action de l'autorité publique, efforts que la Providence a rendus d'autant plus puissants pour assurer le bien général qu'ils sont moins contrariés par les lois d'invention humaine et que chacun les exerce avec plus de liberté dans tout ce qui ne porte pas atteinte à la liberté d'autrui; qu'en conséquence, la mission rationnelle du législateur n'est pas de conduire les hommes, de diriger leur activité, mais de les préserver de toute injuste atteinte dans leur personne ou dans leurs intérêts, de garantir à chacun la libre disposition des facultés qui lui sont inhérentes et de ce qu'elles produisent.
C'est en ce sens que les populations des États du nord de l'Union américaine comprennent la liberté politique; elles la font consister surtout dans une indépendance des facultés et des activités individuelles aussi complète que possible, c'est-à-dire uniquement subordonnée, pour chaque individu pris en particulier, à la condition de respecter les mêmes droits chez tous les autres. La liberté n'a jamais été entendue ainsi par nos hommes politiques, même par ceux qui faisaient profession d'appartenir à l'opinion libérale; ceux-ci jugeaient la liberté suffisamment établie dès que la puissance législative, à laquelle ils donnaient mission de diriger la société sur tous les points, avait son origine dans le suffrage de la majorité de la population, et que les règles qu'elle imposait étaient communes à tous; pourvu que cette puissance leur parût être l'expression de la volonté la plus générale, ils n'hésitaient pas à lui sacrifier la liberté individuelle. Il est à remarquer, au surplus, que, lorsque des changements politiques sont venus substituer à la volonté générale, pour la formation du pouvoir législatif, la volonté d'une fraction plus ou moins restreinte de la population, ou même celle d'un seul homme, l'omnipotence du législateur n'a pas été plus contestée qu'auparavant.
Sous l'empire de pareilles idées, renforcées en France, et dans d'autres pays qui ont tort de nous imiter, par une disposition universelle à l'exercice de la domination et à la recherche des emplois publics comme moyens d'existence ou de fortune, il était inévitable que l'action du gouvernement ne tendît sans cesse à s'accroître. Dès que l'on attribuait au législateur, quel qu'il fût, une mission illimitée, il devait avoir continuellement à ajouter aux prescriptions, aux règles nécessaires pour faire marcher la société selon ses vues. Aussi les hommes que la succession des événements a investis tour à tour de ce suprême mandat en ont-ils usé si largement que l'on compte par centaines de mille le nombre des lois ou des règlements qu'ils nous ont imposés depuis soixante ans.
C'est ainsi que notre système gouvernemental et administratif a acquis des proportions colossales et sans exemple jusqu'ici dans aucun pays du monde; qu'il a étendu successivement son action, ses règlements, ses entraves, à presque toutes les branches d'activité, en restreignant leurs développements et leur fécondité proportionnellement à ce qu'il enlevait à leur liberté; que, pour suffire à l'immensité des attributions qu'il comporte, il a multiplié les services et les emplois publics au point de faire vivre une très-grande partie de la population sur le produit des contributions, et de pousser ainsi au développement des races parasites demandant à vivre de la même manière, jusqu'à en faire une force subversive des plus dangereuses et l'une des principales causes d'agitation et de désordre qui rendent chez nous la sécurité si précaire.
L'Économie politique étudie et analyse tous les éléments de perturbation que renferme un semblable régime; elle en montre les fâcheux résultats; elle en signale le remède, qui consiste principalement à réduire et à simplifier l'action gouvernementale par la restitution à l'activité privée du libre exercice de toutes les branches de travaux qui, par leur nature, sont hors des attributions rationnelles de l'autorité publique, et que nos gouvernements ont voulu diriger, monopoliser ou réglementer.
Dans un pays comme le nôtre, où tant de gens sont possédés de la manie de gouverner leurs semblables, renseignement de pareilles doctines [doctrines?] devait susciter à l'Économie politique une multitude d'adversaires. Les partis qui recherchent l'exercice du pouvoir, l'armée des gens en place, l'armée plus nombreuse encore de ceux qui aspirent à être places, et tous les réformateurs qui ont inventé un plan quelconque de refonte sociale, devaient se réunir contre une science qui menace de soustraire un jour la société aux soins trop multipliés qu'ils veulent absolument lui prodiguer. Aussi est-ce à cette partie de ses doctrines qu'elle a dû la plupart des attaques dont elle a été l'objet.
Nous avons essayé de résumer, dans un cadre fort restreint, des vérités et des doctrines que l'on trouvera exposées avec tous les développements nécessaires dans les diverses parties du Dictionnaire. Ce résumé est loin, sans doute, d'être complet; mais nous croyons qu'il indique fidèlement les bases principales et les tendances de la science; il nous semble d'ailleurs qu'il justifie suffisamment l'assertion que l'Économie politique est dès à présent une des sciences les plus positives et les plus avancées, et celle de toutes, assurément, dont la propagation importerait le plus au progrès de la civilisation, au bien-être et au perfectionnement moral des sociétés.
On ne saurait raisonnablement contester le haut degré d'avancement d'une science, lorsque, dans l'ordre des phénomènes qu'elle embrasse, elle prouve qu'elle est en mesure d'annoncer d'avance avec précision les conséquences ultérieures des faits qui se produisent. Or l'Économie politique a été soumise dans ces derniers temps à une double épreuve de ce genre. Tous ceux qui ont suivi les publications des Économistes français depuis douze ans, et tous ceux qui voudront prendre la peine de parcourir ces publications, ont pu ou pourront facilement se convaincre que l'avortement complet de toutes les tentatives faites en 1848 par le socialisme pour réaliser ses plans d'organisation du travail, ses systèmes d'association, de crédit, de nivellement des positions, etc., y avait été très-fréquemment et très-positivement annoncé plusieurs années à l'avance. D'un autre coté, l'Angleterre a, depuis peu de temps, profondément modifié sa législation économique dans le sens expressément indiqué par les principes de la science. C'était là une épreuve des plus solennelles et dont les résultats étaient attendus avec anxiété par le grand nombre, mais avec une confiance absolue par les Économistes. On sait que cette confiance a été justifiée sur tous les points de la manière la plus éclatante, et que les résultats annoncés se sont produits dans une mesure plus large encore qu'on ne l'avait présumé.
Il faudrait désespérer d'amener au bon sens une population dont les préjuges et les erreurs résisteraient à de semblables démonstrations; aussi nous aimons à penser qu'elles ne sauraient beaucoup tarder à entraîner d'heureuses modifications dans les opinions économiques qui, jusqu'à ce jour, ont prévalu dans notre pays, et que ceux d'entre nous qui connaissent les vérités de la science, qui se sont voués à leur propagation, et qui sont pénétrés de l'ardente conviction du bien qu'elles pourraient produire, ne seront pas réduits pendant longtemps encore, en voyant l'impuissance de leurs efforts et de leur dévouement, à répéter douloureusement cette protestation de la vérité méconnue: E pur si muove!
Ambroise Clément (Août 1853).
49.Léon Faucher on “Property” (1852/3)↩
[Word Length: 13,585]
Source
Léon Faucher, "Propriété" in Dictionnaire de l'Économie Politique, ed. Charles Coquelin and Charles Guillaumin (Paris: Guillaumin, 1852-53), 2 vols. Vol. 2, pp. 460-473.
Brief Bio of the Author: Léon Faucher (1803-1854)
[Léon Faucher (1803-54)]
Léon Faucher (1803-54) was a journalist, writer, and deputy for the Marne who was twice appointed minister of the interior. He became an active journalist during the July Monarchy writing for Le Constitutionnel, and Le Courrier français and was one of the editors of the Revue des deux mondes and the Journal des économistes. Faucher was appointed to the Académie des sciences morales et politiques in 1849 and was active in L’Association pour la liberté des échanges. He wrote on prison reform, gold and silver currency, socialism, and taxation. One of his better-known works was Études sur l’Angleterre (1856). [DMH]
Propriété
PROPRIÉTÉ. — I. Droit de propriété. — L'Économie politique recherche les principes qui président à la formation et à la distribution de la richesse. Elle suppose l'existence de la propriété, dont elle a fait son point de départ; c'est pour elle une de ces vérités premières qui se manifestent dès l'origine des sociétés, que l'on trouve partout marquées du sceau du consentement universel, et que l'on accepte comme des nécessités de l'ordre civil et de la nature humaine, sans songer à les discuter.
Lisez les pères de la doctrine économique: ils gardent un silence a peu près uniforme sur cette grande question. Le chef et l'oracle des physiocrates, le docteur Quesnay, qui comprenait cependant et qui fait ressortir l'importance sociale de la propriété, ne s'occupe de la définir que dans un traité de droit naturel. Turgot, homme d'État, philosophe et économiste, Turgot qui, dans son écrit sur la distribution des richesses, a éclairé d'une vive lumière les origines de la propriété, n'en examine nulle part le principe, le droit ni les formes. Le maître des maîtres, l'auteur de la Richesse des nations, Adam Smith, en fait à peine mention, ne soupçonnant pas sans doute qu'il y eût là matière à controverse. Cette dispute, Jean-Baptiste Say la juge vaine et sans objet pour la science. « Le philosophe spéculatif, dit-il au chapitre XIV de son livre, peut s'occuper à chercher les vrais fondements du droit de propriété; le jurisconsulte peut établir les règles qui président à la transmission des choses possédées; la science politique peut montrer quelles sont les plus sûres garanties de ce droit; quant à l'Économie politique, elle ne considère la propriété que comme le plus puissant encouragement à la production des richesses; elle s'occupera peu de ce qui la fonde et la garantit. » Et ailleurs (livre second, chap. IV): « Il n'est pas nécessaire, pour étudier la nature et la marche des richesses sociales, de connaître l'origine des propriétés ou leur légitimité. Que le possesseur actuel d'un fonds de terre ou celui qui le lui a transmis l'aient eu à titre de premier occupant, ou par une violence, ou par une fraude, l'effet est le même par rapport au revenu qui sort de ce fonds. »
A l'époque à laquelle écrivait Jean-Baptiste Say, le problème qui absorbait et qui agitait les esprits, c'était la production de la richesse. Le monde européen se sentait pauvre, commençait à comprendre la fécondité du travail et aspirait à l'opulence. Le crédit prenait son essor, le commerce s'étendait malgré la guerre; la puissance manufacturière, se développant rapidement, annonçait déjà les merveilles qui l'ont signalée depuis. La production sous ses diverses formes était la grande affaire du temps. Cette marée montante entraînait tout avec elle, la population, le travail, la fortune. Chacun marchait dans un espace ouvert, ayant le but devant les yeux, et ne s'arrêtant pas pour faire un retour sur sa propre situation ou sur celle des autres. La propriété des choses semblait alors une sorte de fonds commun auquel tout le monde, avec un peu d'effort, pouvait abondamment puiser, et qui se reproduisait sans cesse. Qui aurait eu la pensée de mettre le droit en question? Le silence des Économistes ne faisait que traduire l'indifférence raisonnée de l'opinion publique.
Plus tard, la population s'étant accrue dans tous les États de l'Europe, la valeur des terres et le taux des salaires ayant généralement augmenté, la fortune mobilière, grâce aux progrès du commerce et de l'industrie, égalant, ou peu s'en faut, le capital foncier, et la concurrence, qui embrassait tous les genres de travail et de placement, réduisant pour chacun les profits ainsi que les débouchés de l'activité humaine, le problème de la distribution de la richesse a repris le premier rang. Le nombre des pauvres a paru se multiplier avec celui des riches. On a pu croire un moment que la civilisation industrielle tendait à exagérer l'inégalité qui existe naturellement entre les hommes. Dans cette période de transition qui dure encore, il s'est formé des sectes pour prêcher aux mécontents de l'ordre social on ne sait quel avenir, dont l'abolition ou la transformation de la propriété était le premier degré.
A la faveur des révolutions politiques, ces doctrines funestes, qui dominaient d'abord souterrainement en quelque sorte jusqu'à ce qu'elles eussent endurci les cœurs et corrompu les esprits, ont fini par faire irruption dans les rues de nos cités; les arguments déployés contre la société ont servi à bourrer les fusils et à aiguiser les baïonnettes de la révolte. Il a fallu d'abord défendre l'ordre social par les armes. Et maintenant, économistes, philosophes ou jurisconsultes, nous comprenons tous que notre devoir est de démontrer, de manière à convaincre les plus incrédules, qu'ayant pour nous la force, nous avons aussi la raison et le droit.
C'est donc à la lumière des événements que le programme de l'Économie politique s'est agrandi.; Sa place est marquée aujourd'hui dans la discussion des origines et des litres de la propriété. Il faut qu'elle intervienne en s'appuyant sur l'observation des faits, tout comme la philosophie en exposant et en commentant les principes. Le socialisme, en attaquant les bases de l'ordre social, met toutes les sciences en demeure de contribuer, chacune pour sa part, à le défendre!
II. Opinions des philosophes et des jurisconsultes sur la propriété. — Jusqu'à nos jours, la question avait été abandonnée aux philosophes et aux jurisconsultes. Il ne faut pas méconnaître l'utilité de leurs travaux; ils ont préparé le terrain et frayé les voies à l'Économie politique. Quand ils n'ont pas complètement observé et exposé la nature des choses, ils l'ont du moins entrevue. C'est Cicéron qui, en indiquant que la terre devenait le patrimoine de chacun par l'occupation, a constaté que celui qui portait atteinte à ce droit d'appropriation violait la loi de la société humaine. Plus tard Sénèque, tout en exagérant, selon les idées de son temps, le domaine de la souveraineté, a reconnu que la propriété était un droit individuel. Ad reges potestas omnium pertinet, ad singulos proprietas.
Cependant on ferait fausse roule si l'on allait chercher dans les écrits des philosophes et des jurisconsultes, soit une théorie complète de la propriété, soit même une définition exacte. Grotius, qui figure au premier rang parmi les docteurs du droit naturel et du droit des gens, a donné en quelques lignes une histoire de la propriété dans laquelle le communisme pourrait puiser des arguments. Selon cet auteur, après la création, Dieu conféra au genre humain un droit général sur toutes choses. « Cela faisait, dit-il, que chacun pouvait prendre pour son usage ce qu'il voulait et consommer ce qu'il était possible de consommer... Les choses durèrent ainsi jusqu'à ce que le nombre des hommes, aussi bien que celui des animaux, s'étant augmenté, les terres, qui étaient auparavant divisées en nations, commencèrent à se partager par familles; et parce que les puits sont d'une très-grande nécessité dans les pays secs et qu'ils ne peuvent suffire à un très-grand nombre, chacun s'appropria ce dont il put se saisir... »
Ch. Comte fait remarquer que les publicistes de celle école, Wolf, Puffendorf et Burlamaqui se sont bornés à paraphraser les idées de Grotius. Tous ont supposé que, dans l'origine des sociétés, les hommes, pour satisfaire leurs besoins, n'avaient qu'à prendre ce qui se trouvait sous leurs mains, que la terre produisait sans travail, et que l'appropriation n'était autre chose que l'occupation ou la conquête.
Montesquieu n'a pas mieux compris le rôle que joue le travail dans la formation de la propriété individuelle: « Comme les hommes, dit-il au livre XXVI de l'Esprit des Lois, ont renoncé à leur indépendance naturelle pour vivre sous des lois politiques, ils ont renoncé à la communauté naturelle des biens pour vivre sous des lois civiles. Les premières lois leur acquirent la liberté; les secondes, la propriété. » Montesquieu, le seul publiciste depuis Aristote qui ait entrepris de fonder sur l'observation les lois de l'ordre social, n'avait pourtant constaté chez aucun peuple, si primitif qu'il fût, celte prétendue communauté des biens qui dérive, suivant lui, de la nature. Les tribus les plus sauvages, dans l'antiquité comme dans les temps modernes, avaient la notion très-distincte du tien et du mien. Partout la propriété et la famille ont servi de base à l'ordre, et la loi n'a fait que consacrer en les exprimant des rapports déjà établis.
Blackstone ne va pas plus loin que Montesquieu, dont l'opinion se rattache du reste au système de J.-J. Rousseau sur l'état de nature, et se trouve continuée jusqu'à nos jours par un des plus illustres commentateurs du code civil, M. Toullier. Bentham lui-même, cet écrivain qui avait rompu plus que tout autre avec les opinions reçues de son temps, déclare que la propriété n'existe pas naturellement et qu'elle est conséquemment l'ouvrage de la loi. « La propriété, dit-il dans son Traité de législation, n'est qu'une base d'attente: l'attente de retirer certains avantages de la chose qu'on dit posséder, en conséquence des rapports où l'on est déjà placé vis-à-vis d'elle; il n'est point d'image, point de peinture, point de trait visible qui puisse exprimer ce rapport qui constitue la propriété. C'est qu'il n'est pas matériel, mais métaphysique; il appartient tout entier à la conception de l'esprit. L'idée de la propriété consiste dans une attente établie, dans la persuasion de pouvoir retirer tel ou tel avantage, selon la nature du cas. Or cette persuasion, cette attente ne peuvent être que l'ouvrage de la loi. Je ne puis compter sur la jouissance de ce que je regarde comme mien que sur la promesse de la loi qui me le garantit. La propriété et la loi sont nées ensemble et mourront ensemble. Avant les lois, point de propriété; ôtez les lois, toute propriété cesse. »
C'est quelque chose pour les propriétaires que cette assurance que leur donne Bentham, que la propriété ne périra qu'avec la loi. Comme les sociétés humaines ne peuvent pas se passer de lois et que la fin de la loi serait la fin de la société, on voit que la propriété peut compter sur une longue existence. Au reste, Bentham, à l'exemple de Montesquieu, a confondu la notion de la propriété avec celles des garanties que la propriété reçoit des lois civiles et politiques, garanties justement représentées par l'impôt. La meilleure réfutation de la théorie de Bentham se trouve dans quelques passages de Ch Comte,274 qu'il n'est pas inutile de reproduire.
« Si les nations ne peuvent exister qu'au moyen de leurs propriétés, il est impossible d'admettre qu'il n'y a point de propriété naturelle, à moins de reconnaître qu'il n'est pas naturel pour les hommes de vivre et de se perpétuer.
« Il est très vrai qu'il n'est point d'image, point de peinture, point de trait visible qui puisse représenter la propriété en général; mais on ne peut pas conclure de là que la propriété n'est pas matérielle, mais métaphysique, et qu'elle appartient tout entière à la conception de l'esprit. Il n'y a pas non plus de trait visible à l'aide duquel on puisse représenter un homme en général, parce que, dans la nature, il n'y a que des individus, et ce qui est vrai pour les hommes, l'est aussi pour les choses.
« Les individus, les familles, les peuples existent au moyen de leurs propriétés; ils ne sauraient vivre de rapports métaphysiques ou de conceptions de l'esprit. Il y a dans une propriété quelque chose de plus réel, de plus substantiel qu'une base d'attente. On en donne une idée fausse, ou du moins très incomplète, quand on les définit comme un billet de loterie, qui est aussi une base d'attente.
« Suivant Montesquieu et Bentham, c'est la loi civile qui donne naissance à la propriété, et il est évident que l'un et l'autre entendent par la loi civile les déclarations de la puissance publique, qui déterminent les biens dont chacun peut jouir et disposer. Il serait peut-être plus exact de dire que ce sont les propriétés qui ont donné naissance aux lois civiles; car on ne voit pas quel besoin pourrait avoir de lois et de gouvernement une peuplade de sauvages chez laquelle il n'existerait aucun genre de propriété. La garantie des propriétés est sans doute un des éléments essentiels dont elles se composent; elle en accroît la valeur, elle en assure la durée. On commettrait cependant une grave erreur si l'on s'imaginait que la garantie seule compose toute la propriété; c'est la loi civile qui donne la garantie, mais c'est l'industrie humaine qui donne naissance aux propriétés. L'autorité publique n'a besoin de se montrer que pour les protéger, pour assurer à chacun la faculté d'en jouir et d'en disposer.
« S'il était vrai que la propriété n'existe ou n'a été créée que par les déclarations et par la protection de l'autorité publique, il s'ensuivrait que les hommes qui, dans chaque pays, sont investis de la puissance législative, seraient investis de la faculté de faire des propriétés par leurs décrets, et qu'ils pourraient, sans y porter atteinte, dépouiller les uns au profit des autres: ils n'auraient pas d'autres règles à suivre que leurs désirs ou leurs caprices. »
L'école écossaise, à partir de Locke jusqu'à Reid et à Dugald-Stewart, est la première qui ait donné une définition à peu près exacte du droit de propriété; de même que l'école physiocratique était la seule, avant 1789, qui en eût compris l'importance et qui en eût fait ressortir l'influence bienfaisante sur l'économie des sociétés. Mais, à l'époque de la révolution française, ces leçons n'avaient pas encore rectifié les idées de tout le monde; car Mirabeau disait à la tribune de l'assemblée constituante: « Une propriété particulière est un bien acquis en vertu des lois. La loi seule constitue la propriété, parce qu'il n'y a que la volonté politique qui puisse opérer la renonciation de tous et donner un titre commun, un garant à la jouissance d'un seul. » Un des jurisconsultes qui ont le plus contribué à la rédaction du code civil, Tronchet, partageait alors cette opinion, et déclarait que « c'est l'établissement seul de la société, ce sont les lois conventionnelles qui sont la véritable source du droit de propriété. »
Il n'y a pas loin de Mirabeau à Robespierre écrivant dans sa déclaration des droits: « La propriété est le droit qu'a chaque citoyen de jouir de la portion de biens qui lui est garantie par la loi. » Et il n'y a pas loin de Robespierre à Babœuf, qui veut que la terre soit la propriété commune de tous, c'est-à-dire qu'elle n'appartienne à personne. Mirabeau, qui prétend que le législateur confère la propriété, admet par cela même qu'il peut la retirer; et Robespierre, qui réserve expressément la part de l'État dans la propriété, et qui réduit le propriétaire au rôle d'usufruitier en lui refusant la faculté de disposer, de tester, est le précurseur direct et immédiat du communisme.
Je sais bien que la Convention a donné, dans la déclaration des droits qui sert de préambule à la constitution de 1793, une définition très rassurante et très saine du droit de propriété. L'article 16 porte: « Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie; » et l'article 19 y ajoute une garantie que toutes les constitutions postérieures ont reproduite: « Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »
Mais la Convention réservait sans doute l'application de ces belles maximes, comme l'abolition de la peine de mort, pour les temps de paix; car aucun gouvernement ne porta de plus graves atteintes au droit de propriété. La confiscation et les décrets sur le maximum, sans compter la multiplication des assignats et la banqueroute, signalèrent sa domination sauvage, et si elle rendit la France victorieuse et terrible au dehors, au dedans elle la ravagea et l'épuisa. La Convention pensait évidemment, avec Saint-Just, que « celui qui s'est montré l'ennemi de son pays n'y peut être propriétaire. » Elle traitait les nobles et les prêtres comme Louis XIV avait traité les protestants fugitifs à la suite de la révocation de l'édit de Nantes. Elle reprenait, au profit de l'Étal républicain, cette théorie d'origine féodale, d'après laquelle le souverain, le roi, avait le domaine direct et suprême des biens de ses sujets.
C'est M. Troplong qui a fait remarquer275 la concordance des doctrines démagogiques sur la propriété avec les maximes du despotisme: « Tout ce qui se trouve dans l'étendue de nos États,dit Louis XIV dans ses instructions au Dauphin, de quelque nature qu'il soit, nous appartient au même titre; vous devez être bien persuadé que les rois sont seigneurs absolus et ont naturellement la disposition pleine et libre de tous les biens qui sont possédés, aussi bien par les gens d'Église que par les séculiers, pour en user en tout comme de sages économes. » Mettez cette souveraineté absolue dans les mains d'une république socialiste, et elle conduira certainement aux mesures que réclamait dans les lignes suivantes Gracchus Babœuf: « Le sol d'un État doit assurer l'existence à tous les membres de cet État. Quand, dans un État, la minorité des sociétaires est parvenue à accaparer dans ses mains les richesses foncières et industrielles, et que par ce moyen elle tient sous sa verge et use du pouvoir qu'elle a de faire languir dans le besoin la majorité, on doit reconnaître que cet envahissement n'a pu se faire qu'à l'abri des mauvaises institutions du gouvernement; et alors ce que l'administration ancienne n'a pas fait dans le temps pour prévenir l'abus ou pour le réprimer à sa naissance, l'administration actuelle doit le faire pour rétablir l'équilibre qui n'eût jamais dû se perdre, et l'autorité des lois doit opérer un revirement qui tourne vers la dernière raison du gouvernement perfectionné du contrat social: Que tous aient assez, et qu'aucun n'ait trop. »
Enfin l'ère du code civil se lève sur la France et sur l'Europe. Alors pour la première fois, la puissance publique expose et consacre les vrais principes en matière de propriété. Voici dans quels termes l'orateur du conseil d'État, M. Portalis, s'exprimait devant le Corps législatif: « Le principe du droit de propriété est en nous: il n'est point le résultat d'une convention humaine ou d'une loi positive. Il est dans la constitution même de notre être et dans nos différentes relations avec les objets qui nous environnent. Quelques philosophes paraissent étonnés que l'homme puisse devenir propriétaire d'une portion du sol, qui n'est pas son ouvrage, qui doit durer plus que lui et qui n'est soumise qu'à des lois qu'il n'a pas faites. Mais cet étonnement ne cesse-t-il pas si l'on considère tous les prodiges de la main-d'œuvre, c'est-à-dire tout ce que l'industrie de l'homme peut ajouter à l'ouvrage de la matière?
« Oui, législateurs, c'est par notre industrie que nous avons conquis le sol sur lequel nous existons; c'est par elle que nous avons rendu la terre plus habitable, plus propre à devenir notre demeure. La tâche de l'homme était pour ainsi dire d'achever le grand art de la création.... Méfions-nous des systèmes dans lesquels on ne semble faire de la terre la propriété de tous, que pour se ménager le prétexte de ne respecter le droit de personne. »
Le Code civil (articles 544 et 545), recueillant et résumant les principes déposés dans les constitutions antérieures, définit la propriété « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu que l'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements. » Charles Comte a fait observer avec raison que cette définition s'appliquait à l'usufruit presque aussi bien qu'à la propriété. La définition du Code civil pèche par un autre côté; elle ne limite pas le pouvoir, qui est abandonné au législateur et même à l'administration, de réglementer l'usage de la propriété. Par cela même la propriété manque de garanties; elle n'est pas défendue contre l'arbitraire. La loi peut interdire au propriétaire de semer toute espèce de graines, d'y planter des vignes ou des arbres, d'y élever aucune construction, de la vendre, de l'échanger, de la donner. En un mot, le monopole égyptien y trouverait place aussi bien que la liberté française. Par bonheur, la pratique législative et les mœurs corrigent les témérités du texte légal.
Le Code civil déclare la propriété inviolable. A l'exemple des Constitutions de 1791,4793 et 1795, il décide que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Mais est-il bien vrai, comme le pense M. Troplong, que l'État, en promulguant ces dispositions, ne se soit réservé que les droits attachés au commandement politique? A-t-on mis ainsi la propriété à l'abri des atteintes du pouvoir public, aussi bien que des usurpations des individus? Voilà justement le côté faible du Code civil. Ses auteurs ont posé des principes dont ils n'ont pas déduit toutes les conséquences. En déclarant la propriété inviolable, ils ne l'ont pourtant mise à l'abri ni du séquestre administratif ni de la confiscation.
L'empereur Napoléon disait au conseil d'Étal, le 18 septembre 1809: « La propriété est inviolable. Napoléon lui-même, avec les nombreuses armées qui sont à sa disposition, ne pourrait s'emparer d'un champ. Car violer le droit de propriété dans un seul, c'est le violer dans tous... » Voilà d'admirables paroles, mais les actes n'y répondaient pas. Les garanties politiques manquaient sous l'Empire à la propriété, réduite aux garanties de la loi civile. Le gouvernement impérial avait conservé la confiscation comme une arme de guerre contre les ennemis de l'intérieur. L'honneur de la supprimer était réservé à la charte de 1814. Mais les puissances du Nord n'ont pas suivi l'exemple de la France. La confiscation défigure encore aujourd'hui le droit européen. En Autriche et en Russie, le gouvernement se réserve la faculté de dépouiller de leurs biens, pour cause d'opinion, les propriétaires qui ont encouru sa disgrâce. La propriété n'est pas mieux garantie que la liberté. Elle se voit en butte aux atteintes des socialistes d'en haut, comme aux attaques des socialistes d'en bas.
III. Origine, caractère et progrès de la propriété. — Pourquoi la plupart des philosophes et des jurisconsultes ont-ils mal connu et mal défini la propriété? D'où vient que l'origine et la nature d'une institution qui tient une aussi grande place dans l'ordre social ne se révèlent à nous avec quelque clarté que depuis la fin du dernier siècle? Comment se fait-il que les plus beaux génies, s'attachant à cette étude, n'aient trop souvent inventé que des théories dont le plus humble propriétaire ne pourrait pas s'accommoder dans la pratique de chaque jour? C'est que le phénomène qu'ils observaient et qu'ils décrivaient a plus d'une fois changé de face. La propriété a participé au progrès général de la civilisation: en même temps, elle a suivi une loi de développement qui lui était propre. Elle a marché comme la liberté, comme l'industrie et comme les arts dans le monde; elle a passé par des âges divers et successifs, à chacun desquels a dû correspondre une différente théorie.
La distinction du tien et du mien est aussi vieille que l'espèce humaine. Dès que l'homme a eu le sentiment de sa personnalité, il a dû chercher à l'étendre aux choses qui tombaient sous sa main. Il s'est approprié le sol et les produits du sol, les animaux et leur croît, le fruit de son activité et les œuvres de ses semblables. La propriété existe chez les peuples pasteurs aussi bien que parmi les nations parvenues au plus haut point de la richesse agricole et de l'industrie; mais elle existe à d'autres conditions. L'occupation du sol a commencé par être annuelle avant d'être viagère, et elle a été viagère dans la personne du tenancier avant de devenir héréditaire et en quelque sorte perpétuelle. Elle a appartenu à la tribu avant d'appartenir à la famille, et elle a été le domaine commun de la famille avant de prendre le caractère individuel. Les poëtes, qui sont les premiers historiens, attestent cette transformation graduelle des héritages.
Ce qui distingue profondément le monde ancien du monde moderne, c'est que la propriété s'acquérait trop souvent autrefois par la conquête, tandis qu'aujourd'hui elle a pour base essentielle le travail. Non-seulement, dans l'antiquité et dans le moyen âge, les individus comme les peuples s'enrichissaient par l'usurpation, mais les hommes libres dédaignaient l'industrie, et le sol était cultivé par des esclaves. La force des armes, qui était le titre le plus sur à la possession des domaines, procurait aussi les instruments de la production. Comment aurait-on sondé la nature et embrassé l'horizon de la propriété, à une époque où le conquérant s'arrogeait tantôt le droit de vendre les vaincus comme des bêtes de somme, tantôt celui de les attacher à la glèbe; où les hommes étaient traités comme des choses; où le travail passait d'abord par l'épreuve de l'esclavage, ensuite par celle du servage, avant de devenir l'honneur des hommes libres et la richesse des nations?
Ce n'est pas tout. La propriété, en subissant des évolutions analogues à celles de la liberté, s'est étendue et multipliée, et a, pour ainsi parler, envahi l'espace. Au début de la civilisation, ce que l'homme possède est bien peu de chose, des troupeaux, quelques ustensiles grossiers, â peine un coin de terre qui produise des grains, au milieu d'un steppe désert; il ne s'est approprié encore presque aucun des agents naturels. Les peuples agriculteurs, qui succèdent aux tribus de pasteurs, ont bientôt décuplé et centuplé la propriété, qui s'attache alors peu à peu à la surface du globe. Mais il n'appartient qu'aux nations habiles dans l'industrie et dans le commerce de la porter à son plus haut développement. A mesure que la terre s'individualise en quelque sorte, et que chaque parcelle tombe dans le domaine d'un propriétaire qui la féconde de ses capitaux et de ses sueurs, ceux qui se trouvent en dehors de ce partage du sol ne sont pas pour cela exclus de la propriété. En effet, les capitaux naissent de l'accumulation. La propriété mobilière se greffe sur la propriété foncière. Il se forme des trésors accessibles à tout le monde, dont chacun peut avoir sa part et qu'il peut augmenter à l'aide du travail. Un hectare de terre, qui vaut peut-être 10 francs en Algérie et 25 francs dans l'ouest des Étals-Unis, se vend couramment de 500 francs à 5 mille francs dans l'Europe occidentale. Malgré le prix élevé qu'une agriculture perfectionnée ne tarde pas à donner aux propriétés rurales, ou n'exagérerait pas en affirmant qu'aujourd'hui la richesse mobilière en Angleterre et en France surpasse de beaucoup la valeur incorporée au sol.
Ajoutons qu'à mesure que la civilisation avance, chaque citoyen voit s'accroitre et s'étendre la propriété commune dont il jouit au même titre que tous les autres membres de l'État. Les routes, les canaux, les chemins de fer, les écoles, les hospices et autres établissements publics sont incomparablement plus nombreux et mieux administrés qu'ils ne l'étaient il y a un quart de siècle. Que serait-ce si, remontant le cours de l'histoire, nous comparions la somme de jouissances et de facultés que la société mettait à la disposition de ses membres dans les républiques de la Grèce et de Rome, et celle qui leur est réservée de nos jours? Assurément le plus modeste de nos ouvriers ne voudrait pas se trouver exposé aux misères ni aux humiliations qui attendaient les prolétaires de l'antiquité dans l'agora ou dans le forum. C'est donc avec raison que M. Thiers, en rappelant que la propriété est un fait universel, affirme en même temps qu'elle est un fait croissant.
Écoutons cet auteur exposant l'origine et la marche de la propriété dans les temps historiques:
« Chez tous les peuples, quelque grossiers qu'ils soient, on trouve la propriété comme un fait d'abord, et puis comme une idée, idée plus ou moins claire suivant le degré de civilisation auquel ils sont parvenus, mais toujours invariablement arrêtée. Ainsi le sauvage chasseur a du moins la propriété de son arc, de ses flèches et du gibier qu'il a tué. Le nomade, qui est pasteur, a du moins la propriété de ses tentes, de ses troupeaux. Il n'a pas encore admis celle de la terre, parce qu'il n'a pas jugé à propos d'y appliquer ses efforts. Mais l'Arabe, qui a élevé de nombreux troupeaux, entend bien en être le propriétaire et vient en échanger les produits contre le blé qu'un autre Arabe, déjà fixé sur le sol, a fait naître ailleurs. Il mesure exactement la valeur de l'objet qu'il donne contre la valeur de celui qu'on lui cède, il entend bien être propriétaire de l'un avant le marché, propriétaire du second après. La propriété immobilière n'existe pas encore chez lui. Quelquefois seulement, on le voit pendant deux ou trois mois de l'année se fixer sur des terres qui ne sont à personne, y donner un labour, y jeter du grain, le recueillir, puis s'en aller en d'autres lieux... Sa propriété dure en proportion de son travail. Peu à peu cependant le nomade se fixe et devient agriculteur, car il est dans le cœur de l'homme d'aimer à avoir son chez lui... Il finit par choisir un territoire, par le distribuer en patrimoines où chaque famille s'établit, travaille, cultive pour elle et pour sa postérité. De même que l'homme ne peut laisser errer son cœur sur tous les membres de la tribu et qu'il a besoin d'avoir à lui sa femme, ses enfants qu'il aime, soigne, protège, sur lesquels se concentrent ses craintes, ses espérances, sa vie enfin, il a besoin d'avoir son champ qu'il cultive, plante, embellit à son goût, enclôt de limites, qu'il espère livrer à ses descendants couvert d'arbres qui n'auront pas grandi pour lui, mais pour eux. Alors à la propriété mobilière du nomade succède la propriété immobilière du peuple agriculteur; la seconde propriété croit, et avec elle des lois compliquées, il est vrai, que le temps rend plus justes, plus prévoyantes, mais sans en changer le principe. La propriété, résultant d'un premier effet de l'instinct, devient une convention sociale, car je protège votre propriété pour que vous protégiez la mienne.
« A mesure que l'homme se développe, il devient plus attaché à ce qu'il possède, plus propriétaire en un mot. A l'état barbare, il l'est à peine; à l'état civilisé, il l'est avec passion. On a dit que l'idée de la propriété s'affaiblissait dans le monde. C'est une erreur de fait. Elle se règle, se précise et s'affermit, loin de s'affaiblir. Elle cesse par exemple de s'appliquer à ce qui n'est pas susceptible d'être une chose possédée, c'est-à-dire à l'homme; et dès ce moment l'esclavage cesse. C'est un progrès dans les idées de justice, ce n'est pas un affaiblissement de la propriété... Chez les anciens, la terre était la propriété de la république; en Asie, elle est celle du despote; dans le moyen âge, elle était celle des seigneurs suzerains. Avec le progrès des idées de liberté, en arrivant à affranchir l'homme, on affranchit sa chose; il est déclaré, lui, propriétaire de sa terre, indépendamment de la république, du despote ou suzerain. Dès ce moment, la confiscation se trouve abolie. Le jour où on lui a rendu l'usage de ses facultés, la propriété s'est individualisée davantage; elle est devenue plus propre à l'individu lui-même, plus propriété qu'elle n'était. »276
Il y a une autre observation, et celle-là rentre plus directement dans le domaine de l'Économie politique. C'est que plus la propriété s'accroit, se fortifie, se trouve respectée, plus les sociétés prospèrent. « Tous les voyageurs, dit encore M. Thiers, ont été frappés de l'état de langueur, de misère et d'usure dévorante des pays où la propriété n'était pas suffisamment garantie. Allez en Orient, où le despotisme se prétend propriétaire unique, ou, ce qui revient au même, remontez au moyen âge, et vous verrez partout les mêmes traits: la terre négligée, parce qu'elle est la proie la plus exposée à l'avidité de la tyrannie et réservée aux mains esclaves qui n'ont pas le choix de leur profession; le commerce préféré comme pouvant échapper plus facilement aux exactions; dans le commerce, l'or, l'argent, les joyaux recherchés comme les valeurs les plus faciles à cacher; tout capital prompt à se convertir en ces valeurs, et quand il se résout à se donner, se concentrant dans les mains d'une classe proscrite, laquelle, affichant la misère, vivant dans des maisons hideuses au dehors, somptueuses au dedans, opposant une constance invincible au maître barbare qui veut lui arracher le secret de ses trésors, se dédommage en lui faisant payer l'argent plus cher et se venge ainsi de la tyrannie par l'usure. »277
Voilà donc les racines de la propriété dans l'histoire. Et quant au droit, on pourrait dire que l'universalité du fait suffit pour l'établir. Si la propriété était quelque chose d'accidentel pour la société humaine, si l'institution était née chez un peuple insulaire et formait une exception à la coutume générale, je concevrais qu'on lui demandât de produire ses titres; mais il tombe sous le sens que les hommes ont dû avoir le droit de faire ce qu'ils ont fait de tout temps et dans tous les lieux habités. Le consentement universel est un signe infaillible de la nécessité, et par conséquent de la légitimité d'une institution.
Mais le droit peut se prouver indépendamment de là raison historique. « L'homme, dit M. Thiers, a une première propriété dans sa personne et ses facultés; il en a une seconde moins adhérente à son être, mais non moins sacrée, dans le produit de ces facultés, qui embrasse tout ce qu'on appelle les biens de ce monde, et que la société est intéressée au plus haut point à lui garantir, car, sans cette garantie, point de travail; sans travail, pas de civilisation, pas même le nécessaire, mais la misère, le brigandage et la barbarie.»278 Cette définition n'est ni assez absolue ni complète. M. Thiers semble placer uniquement dans le travail les fondements de la propriété. Sans doute il en est la source la plus légitime, mais il n'est pas la seule, ni surtout la première en date. Dans les commencements de l'état social, l'homme s'appropria le sol par l'occupation avant de se l'assimiler par le labeur de ses bras. Partout la conquête de la terre sur l'homme ou sur les animaux, la prise de possession, en un mot, a précédé la culture. Un territoire appartient à une peuplade, à une tribu collectivement, avant de se répartir entre ses divers membres. C'est là ce que l'école appelle le droit du premier occupant, droit qui s'explique par le fait même d'une prise de possession opérée sans obstacle et par le pouvoir de défendre, de protéger et par conséquent d'approprier le sol occupé.
A côté des hommes qui acquièrent leurs biens par l'occupation ou par le travail, il est des nations, il est des individus qui ont usurpé ce qu'ils possèdent par la fraude ou par la violence. Les lois et la force publique mise au service des lois font justice de l'usurpation là où leur pouvoir s'étend et obtient à la fois l'obéissance et le respect. Mais il arrive, et l'histoire en fournit des exemples fréquents, que la propriété, qui procède de cette source impure, se transmet ensuite paisiblement de génération en génération, donne lieu à un nombre infini de contrats et devient la base des fortunes. Doit-on, après tous ces faits accomplis, rechercher, en vue d'une condamnation, l'origine des patrimoines? ou plutôt l'intérêt social ne commande-l-il pas de légitimer les transactions subséquentes en passant l'éponge sur le point de départ? Cet état de choses a donné naissance au système de la prescription, qui est la véritable sauvegarde de la propriété. « Aucune transaction ne serait possible, dit encore M. Thiers, aucun échange ne pourrait avoir lieu, s'il n'était acquis qu'après un certain temps celui qui détient un objet le détient justement et peut le transmettre. Figurez-vous quel serait l'état de la société, quelle acquisition serait sûre, dès lors faisable, si on pouvait remonter au douzième et au treizième siècle, et vous disputer une terre, en prouvant qu'un seigneur l'enleva à son vassal, la donna à un favori ou à un de ses hommes d'armes, lequel la vendit à un membre de la confrérie des marchands, qui la transmit lui-même, de mains en mains, à je ne sais quelle lignée de possesseurs plus ou moins respectables! Il faut bien qu'il y ait un terme fixe où ce qui est, par cela seul qu'il est, soit déclaré légitime et tenu pour bon, sans quoi voyez quel procès s'élèverait sur toute la surface du globe! »
Il convient d'ajouter cependant que la conquête et l'usurpation ne sont pas un fait constant ni exclusif, quoique l'on puisse le supposer en voyant dominer par les armes, sur la scène du monde, tantôt les Assyriens, tantôt les Perses, tantôt les Grecs, tantôt les Romains et tantôt les Barbares du Nord, qui se dépossédaient successivement les uns les autres. Non, la violence n'a pas marqué l'origine de toutes les propriétés. M.Thiers, après avoir avancé, contre le témoignage de l'histoire bien comprise et bien interprétée, que toute société présentait au début ce phénomène de l'occupation plus ou moins violente, explique à merveille, dans les lignes qui suivent, comment il se fait que la plus grande partie des propriétés foncières dérivent du travail:
« Le monde civilisé n'est pas une vaste usurpation, et, malgré les barbaries du régime féodal, malgré les bouleversements de là révolution de 1789, la propriété foncière remonte en France, et pour la plus grande partie, à l'origine la plus pure. Les champs que les Romains enlevèrent aux Gaulois étaient peu considérables, car le sol était à peine cultivé, et il ressemblait aux forêts que les Américains concèdent aujourd'hui aux Européens. Les Barbares le trouvèrent dans un état peu différent. Mais c'est surtout pendant les siècles qui ont suivi, et sous le régime féodal, que le défrichement a commencé et s'est continué sans interruption; ce qu'indique le nom de roture, venant de ruptura, donné à toute propriété qui avait le défrichement pour origine. Toute terre roturière venait par conséquent du travail le plus respectable, et c'était le plus grand nombre; car beaucoup de terres anoblies avec le temps, à cause, de celui qui les possédait, avaient commencé par être des terres roturières. Depuis, sous une longue suite de rois, d'excellentes lois avaient rendu la transmission régulière, et le commerce, lorsqu'il voulait acquérir des domaines fonciers, les achetait à beaux deniers comptants des possesseurs roturiers ou nobles. Nous pouvons donc, nous autres Français, posséder nos terres en pleine tranquillité de conscience, fussions-nous même acquéreurs de biens nationaux; car, en définitive, on paya ces biens avec la monnaie que l'Étal lui-même donnait à tout le monde, que tout le monde était obligé d'accepter de ses débiteurs, et enfin, quelques scrupules restant à la restauration, elle a consacré 800 millions à les dissiper. »279
La propriété entraine l'inégalité des conditions dans l'étal social, et l'inégalité des conditions n'est elle-même que le reflet des différences que la nature a mises entre les hommes. Tous les hommes n'ont pas la même force musculaire, ni le même degré d'intelligence, une égale aptitude, ni une égale application au travail. Par cela seul qu'il en existe de plus forts, de plus habiles, et, s'il faut le dire aussi, de plus heureux que d'autres, il y en a qui marchent d'un pas plus rapide et plus sûr dans les voies de la richesse. La propriété n'aggrave pas ces irrégularités naturelles, mais elle les traduit en caractères durables et leur donne un corps. Dans l'origine, celui qui cultive mieux possède davantage. Quel intérêt la société aurait-elle à l'empêcher? Le plus habile et le plus robuste cultivateur, en enrichissant sa famille, augmente la somme générale des produits et enrichit par conséquent la société. L'égalité des conditions, le partage égal des propriétés et l'égalité des salaires sont trois formes d'une même idée, qui revient à dire que le plus fort ne doit pas produire plus que le plus faible, et que la pensée de l'homme éclairé doit s'abaisser au niveau de celle de l'homme ignorant; ce serait limiter la production, comprimer l'intelligence, étouffer dans leurs germes les lettres, les sciences et les arts.
Le droit de posséder a pour conséquence nécessaire le droit de disposer des biens que l'on possède, et de les transmettre soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, de les échanger, de les vendre, de les donner entre-vifs ou par testament, et finalement de les laisser en héritage. La propriété implique l'hérédité. L'homme est ainsi fait qu'il veut se survivre à lui-même. Le soin de sa propre conservation s'étend à celle de la famille; il travaillerait beaucoup moins pour lui s'il ne travaillait en même temps pour les siens. La propriété, réduite à l'usufruit, n'aurait que la moitié de sa valeur pour les individus et de son utilité sociale.
Cette pensée est exprimée dans de très-belles pages, que j'aime mieux emprunter ici que chercher à refaire: « L'homme n'ayant que lui-même pour but s'arrêterait au milieu de sa carrière; dès qu'il aurait acquis le pain de sa vieillesse, et, de peur de produire l'oisiveté du fils, vous auriez commencé par ordonner l'oisiveté du père! Mais est-il vrai d'ailleurs qu'en permettant la transmission héréditaire des biens, le fils soit forcément un oisif dévorant dans la paresse et dans la débauche la fortune que son père lui léguera? Premièrement le bien, dont vivra l'oisiveté supposée de ce fils, que représente-t-il après tout? un travail antérieur, qui aura été celui du père; et, en empêchant le père de travailler pour obliger le fils a travailler lui-même, tout ce que vous gagnerez, c'est que le fils devra faire ce que n'aura pas fait le père. Il n'y aura pas eu un travail de plus. Dans le système de l'hérédité, au contraire, au travail illimité du père se joint le travail illimité du fils, car il n'est pas vrai que le fils s'arrête parce que le père lui a légué une portion plus ou moins considérable de biens. D'abord il est rare qu'un père lègue à son fils le moyen de ne rien faire. Ce n'est que dans le cas de l'extrême richesse qu'il en est ainsi. Mais ordinairement, dans la plupart des professions, ce n'est qu'un point de départ plus avancé dans la carrière que le père ménage à son fils en lui léguant son héritage. Il l'a poussé plus loin, plus haut; il lui a donné de quoi travailler avec de plus grands moyens, d'être fermier quand lui n'a été que valet de ferme, ou d'équiper dix vaisseaux quand lui ne pouvait en équiper qu'un, d'être banquier quand il ne fut que petit escompteur, ou bien de changer de carrière, de s'élever de l'une à l'autre, de devenir notaire, médecin, avocat, d'être Cicéron ou Pitt, quand il ne fut lui-même que simple chevalier comme le père de Cicéron, ou cornette de régiment comme le père de M. Pitt.
« De même qu'il songeait à ses enfants et à cette idée devenait infatigable, son fils songe aussi à ses propres enfants, et à cette idée devient infatigable à son tour. Dans le système de l'interdiction de l'hérédité, le père se serait arrêté, et le fils également. Chaque génération bornée dans sa fécondité, comme une rivière dont on retient les eaux par un barrage, n'aurait donné qu'une partie de ce qu'elle avait en elle, et se serait interrompue au quart, à la moitié du travail dont elle était capable. Dans le système de l'hérédité des biens, au contraire, le père travaille tant qu'il peut, jusqu'au dernier jour de sa vie; le fils qui était sa perspective en trouve une pareille dans ses enfants, et travaille pour eux comme on a travaillé pour lui, ne s'arrête pas plus que ne s'est arrêté son père, et tous, penchés vers l'avenir comme un ouvrier sur une meule, font tourner, tourner sans cesse cette meule d'où s'échappent le bien-être de leurs petits-enfants, et non-seulement la prospérité des familles, mais celle du genre humain. »280
En dépit des progrès de la civilisation, le vieux monde présente encore, sur quelques points, des types des phases diverses que la propriété a parcourues. En comparant les peuples entre eux, tout observateur peut reconnaître que leur prospérité est en raison directe de l'extension et des garanties qu'ils donnent au droit de propriété. L'Orient est immobile et semble frappé de stérilité; l'Occident, qui se prête à toutes les combinaisons du génie humain, accumule et multiplie les richesses. Voyez les tribus arabes: elles vivent, comme au temps de Moïse et de Mahomet, campées sur le sol qu'elles partagent annuellement entre leurs membres, n'étendant pas la propriété au delà des fruits d'une récolte, faisant métier du pillage et toujours en danger d'être dépouillées. Ont-elles conquis un pouce de terre sur le désert? n'ont-elles pas, au contraire, en devenant de plus en plus misérables, dévasté ou laissé dévaster presque sans ressource une grande partie de l'Asie et de l'Afrique, là où germèrent des moissons abondantes, où s'établirent de puissants royaumes, et où brillèrent de superbes cités? Prenez ensuite les contrées dans lesquelles la propriété se trouve de fait ou de droit limitée à l'usufruit: la Turquie, la Perse et l'Inde; le sol est fécond, le climat invite à la production, et pourtant les produits sont misérables. Les populations vivent dans la pauvreté et dans l'ignorance. Le défaut de moralité égale l'absence de sécurité. La société parait constamment chanceler sur sa base; elle n'a pas en elle la force de résistance, et elle manque de point d'appui. En Europe enfin, où la propriété est héréditaire, la richesse et les lumières semblent être échues à chaque peuple, dans la proportion des garanties plus ou moins complètes dont il entoure la transmission des héritages. La Russie, avec d'immenses étendues de pays et avec une population de soixante millions d'hommes, ne pourrait pas payer la moitié du budget que supporte aisément la Grande-Bretagne; et dans les contrées soumises encore au régime de la confiscation, telles que la Gallicie autrichienne et le royaume de Pologne, les terres, à qualité égale, ne valent pas la moitié de ce qu'elles valent en France, en Belgique ou en Hollande.
Ainsi, l'hérédité est nécessaire à la propriété, comme la propriété elle-même à l'ordre social; c'est l'hérédité qui, en permettant l'accumulation des richesses, crée le capital et féconde par là le travail des hommes. Les lois de tous les peuples libres et industrieux la consacrent; mais elle est tellement indispensable au développement de la famille et à la marche des sociétés, que si elle n'était pas la conséquence invincible de la nature humaine et de l'étal social, si elle n'existait pas en un mol, il faudrait l'inventer.
IV. Des objections que l'on élève contre le principe de la propriété. — Les objections que l'on élève contre le principe de la propriété s'adressent soit au droit, soit au fait même. L'adversaire en titre de la propriété, M. Proudhon, est obligé de reconnaître qu'en s'étendant elle se rapproche de l'idéal de la justice: « Autrefois la noblesse et le clergé ne contribuaient aux charges de l'État qu'à titre de secours volontaires et de dons gratuits; leurs biens étaient insaisissables même pour dettes, tandis que le roturier, accablé de tailles et de corvées, était harcelé sans relâche tantôt par les percepteurs du roi, tantôt par ceux des seigneurs et du clergé. Le mainmortable, placé au rang des choses, ne pouvait ni tester, ni devenir héritier; il en était de lui comme des animaux, dont les services et le croît appartiennent au maître par droit d'accession. Le peuple voulut que la condition de propriétaire fût la même pour tous; que chacun put jouir et disposer librement de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie... Le peuple n'inventa pas la propriété, mais comme elle n'existait pas pour lui, au même titre que pour les nobles et les tonsurés, il décréta l'uniformité de ce droit. Les formes acerbes de la propriété, la corvée, la mainmorte, la maîtrise, l'exclusion des emplois ont disparu: le mode de jouissance a été modifié: le fond de la chose est demeuré le même. »281
Mais ces progrès, qui sont liés à ceux de la civilisation, ne fléchissent pas l'hostilité de M. Proudhon, il en conteste le principe. La propriété, suivant lui, n'est pas de droit naturel: elle ne se fonde ni sur l'occupation ni sur le travail.
«Puisque tout homme, dit cet auteur, a droit d'occuper par cela seul qu'il existe, et qu'il ne peut se passer pour vivre d'une matière d'exploitation et de travail; et puisque, d'autre part, le nombre des occupants varie continuellement par les naissances et les décès, il s'ensuit que la quotité de matière à laquelle chaque travailleur peut prétendre est variable comme le nombre des occupants; par conséquent, que l'occupation est toujours subordonnée à la population; enfin que la possession, en droit, ne pouvant jamais demeurer fixe, il est impossible en fait qu'elle devienne propriété. »282
Pour faire tomber ce paradoxe, il suffit d'en contester le point de départ. Les prérogatives du l'individu et de l'espèce ne renferment pas plus de droit naturel à l'occupation que de droit naturel au travail. Sans doute, au milieu des espaces vacants, celui qui occupe le premier un champ ou une prairie, qui l'enclôt de limites, qui se l'approprie, en devient le possesseur légitime; mais ce n'est pas en vertu d'un titre de possession inhérent à chaque homme, c'est parce que le sol n'appartenait auparavant à personne, et parce que, en marquant cette terre de son empreinte, il ne lèse aucun droit antérieur.
« Un homme, dit M. Proudhon, à qui il serait interdit de passer sur les grands chemins, de s'arrêter dans les champs, de se mettre à l'abri dans les cavernes, d'allumer du feu, de ramasser des baies sauvages, de cueillir des herbes et de les faire bouillir dans un morceau de terre cuite, cet homme-là ne pourrait vivre. Ainsi, la terre, comme l'eau, l'air et la lumière, est un objet de première nécessité dont chacun doit user librement, sans nuire à la jouissance d'autrui; pourquoi donc la terre est-elle appropriée? » Voilà une thèse qui pourrait avoir son bon côté dans l'état sauvage. La théorie de M. Proudhon ferait fortune auprès d'une peuplade de chasseurs. Mais, dans une société industrieuse et policée, elle n'est plus qu'un écho tardif et décoloré des déclamations de Jean-Jacques. Les hommes aujourd'hui ne vivent plus de baies sauvages ni d'herbes ramassées dans les champs; ils ne sont plus réduits à demeurer dans les cavernes ni à préparer des aliments grossiers dans des vases de terre cuite. La civilisation leur a procuré des biens qui compensent et au delà les prétendus droits naturels de cueillette, de chasse et de pêche; et le plus modeste ouvrier, au dix-neuvième siècle, est mieux logé, mieux vêtu et mieux nourri que ne pourrait certainement l'être, avec son droit à la communauté de la terre, l'homme-type de M. Proudhon.
Après avoir soutenu que l'occupation ne pouvait pas servir de base à la propriété, M. Proudhon récuse également les titres du travail. Charles Comte avait dit: « Un espace de terre déterminé ne peut produire des aliments que pour la consommation d'un homme pendant une journée: si le possesseur, par son travail, trouve moyen de lui en faire produire pour deux jours, il en double la valeur. Cette valeur nouvelle est son ouvrage, sa création; elle n'est ravie à personne; c'est sa propriété. » M. Proudhon répond: « Je soutiens que le possesseur est payé de sa peine et de son industrie par la double récolte, mais qu'il n'acquiert aucun droit sur le fonds. Que le travailleur fasse les fruits siens, je l'accorde; mais je ne comprends pas que la propriété des produits emporte celle de la matière. Le pêcheur qui, sur la même côte, sait prendre plus de poisson que ses confrères, devient-il par cette habileté propriétaire des parages où il pêche? L'adresse d'un chasseur fut-elle jamais regardée comme un titre de propriété sur le gibier d'un canton? La parité est parfaite: le cultivateur diligent trouve dans une récolte abondante et de meilleure qualité la récompense de son industrie; s'il a fait sur le sol des améliorations, il a droit à une préférence comme possesseur; jamais, en aucune façon, il ne peut être admis à présenter son habileté de cultivateur comme un litre à la propriété du sol qu'il cultive. Pour transformer la possession en propriété, il faut autre chose que le travail, sans quoi l'homme cesserait d'être propriétaire, dès qu'il cesse d'être travailleur: or, ce qui fait la propriété, d'après la loi, c'est la possession immémoriale, incontestée, en un mot, la prescription: le travail n'est que le signe sensible, l'acte matériel par lequel l'occupation se manifeste. »
Comme sources de la propriété, l'occupation et le travail se complètent l'un par l'autre. La possession n'aurait assurément rien de bien durable, si la culture ne venait la consacrer, en révélant et en mettant en action les forces productives du sol; et, quant au travail, il n'implique pas nécessairement la propriété, puisqu'un fermier qui a dépensé des capitaux considérables à l'amélioration du sol qu'il tient à bail, s'il peut réclamer une compensation, des dommages-intérêts, n'acquiert pas pour cela un droit de propriété sur ce domaine. Voilà ce qui est vrai, voilà ce que l'on peut dire, sans tomber dans l'exagération. Mais prétendre que le possesseur qui a cultivé un champ et qui, en le cultivant, a bonifié le sol, a augmenté le capital que le sol représente, n'a droit qu'aux fruits de l'année, c'est là une erreur manifeste. Et à qui voulez-vous qu'appartienne cette terre améliorée? Y aura-t-on incorporé un capital, un valeur nouvelle pour que cette valeur devienne la proie du premier venu? En ce cas, personne ne voudra plus travailler; car le véritable encouragement au travail, c'est la certitude de récolter ce que l'on a semé, et le capital comme les produits.
M. Proudhon reconnaît que le cultivateur, qui a fait des améliorations sur le sol, a droit à une préférence comme possesseur. Voilà donc déjà une circonstance, et le cas se présente souvent, où la propriété, pour parler la langue de son livre, cesse d'être un vol. Mais il faut aller plus loin. Sans doute le propriétaire n'a pas besoin de cultiver pour conserver son droit; mais le travail ajoute aux titres de propriété et les rend encore plus respectables. Or, le possesseur qui cultive, même sans ajouter par la culture à la valeur de la terre, se relâcherait bien vite de son ardeur pour le travail s'il n'en devait retirer que le produit d'une récolte. L'agriculture est née de la permanence de la propriété, et, sans les garanties que les lois attachent à la possession, elle ne ferait aucun progrès. M. Proudhon n'a qu'à voir ce que deviennent les meilleures terres entre les mains des tribus nomades, parmi lesquelles on ne gratte le sol que pour en obtenir la maigre récolte de l'année.
Mais, dira-t-on, la terre ainsi concédée à perpétuité est séquestrée peu à peu, envahie, et les derniers venus se trouvent exposés à voir les deux hémisphères entièrement occupés par les héritiers des premiers qui ont occupé le sol ou de ceux qui l'ont arraché, soit par violence, soit par fraude, à ses premiers possesseurs. Quand cela serait, le malheur ne nous semblerait pas très-grand. La terre, grâce aux progrès de l'industrie, n'est plus la seule richesse. Celui qui ne possède pas un champ peut acheter une maison, fonder une manufacture, prendre un intérêt dans une entreprise de transport. La propriété, en supposant qu'elle ne suffit plus pour tous sous la forme territoriale, s'offrirait abondamment sous des formes nouvelles. L'appropriation antérieure du sol, au lieu de dépouiller les races futures, tend donc à les enrichir.
Mais de très bons esprits n'admettent pas cette prétendue confiscation du sol au détriment des derniers venus. M. Thiers présente sur ce point des considérations décisives que j'essayerai de résumer... « Certains ingénieurs ont pensé qu'il y avait de la houille dans les entrailles de la terre pour un millier d'années, tandis que d'autres au contraire ont cru qu'il n'y en avait pas à brûler, au train dont va l'industrie, pour plus de cent ans. Faudrait-il par hasard s'abstenir d'en user, de peur qu'il n'en restât point pour nos neveux?... La société qui ne permettrait pas la propriété foncière, de crainte qu'un jour toute la surface de la terre ne fût envahie, serait tout aussi extravagante. Rassurons-nous. Les nations de l'Europe n'ont pas encore cultivé les unes le quart, les autres le dixième de leur territoire, et il n'y a pas la millième partie du globe qui soit occupée. Les grandes nations connues ont toutes fini jusqu'ici, n'ayant encore défriché qu'une très petite portion de leur sol. Elles avaient traversé la jeunesse, l'âge mûr, la vieillesse; elles avaient eu le temps de perdre leur caractère, leur génie, leurs institutions, tout ce qui fait vivre, avant d'avoir, non pas achevé, mais un peu avancé la culture de leur territoire.
« Après tout, l'espace n'est rien. Souvent, sur la plus vaste étendue de terre, les hommes trouvent de la difficulté à vivre, et souvent au contraire ils vivent dans l'abondance sur la plus étroite portion de terrain. Un arpent de terre en Angleterre ou en Flandre nourrit cent fois plus d'habitants qu'un arpent dans les sables de la Pologne ou de la Russie. L'homme porte avec lui la fertilité; partout où il parait, l'herbe pousse, le grain germe. C'est qu'il a sa personne et son bétail, et qu'il répand partout où il se fixe l'humus fécondant. Si donc on pouvait imaginer un jour où toutes les parties du globe seraient habitées, l'homme obtiendrait de la même surface dix fois, cent fois, mille fois plus qu'il n'en recueille aujourd'hui. De quoi, en effet, peut-on désespérer quand on le voit créer de la terre végétale sur les sables de la Hollande? S'il en était réduit au défaut d'espace, les sables du Sahara, du désert d'Arabie, du désert de Cobi se couvriraient de la fécondité qui le suit; il disposerait en terrasses les flancs de l'Atlas, de l'Himalaya, des Cordillères, et vous verriez la culture s'élever jusqu'aux cimes les plus escarpées du globe, et ne s'arrêter qu'à ces hauteurs où toute végétation cesse.
« Cette surface du globe, que l'on dit envahie, ne manquera pas aux générations futures, et en attendant elle ne manque pas aux générations présentes; car de toutes parts on offre de la terre aux hommes: on leur en offre en Russie, sur les bords du Borysthène, du Don et du Volga; en Amérique, sur les bords du Mississipi, de l'Orénoque et de l'Amazone; en France, sur les côtes d'Afrique, chargées autrefois de nourrir l'empire romain. Mais les émigrants n'en acceptent pas toujours, et quand ils acceptent, si l'on n'ajoute rien au don du sol, ils vont mourir sur ces terres lointaines. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la surface qui manque, mais la surface couverte de constructions, de plantations, de clôtures, de travaux d'appropriation. Or, tout cela n'existe que lorsque des générations antérieures ont pris la peine de tout disposer pour que le travail des nouveaux venus fût immédiatement productif. »
On le voit, la terre, malgré l'extension qu'a prise la propriété, ne manque pas à l'homme. C'est la propriété bien assise, entourée de garanties et devenue héréditaire qui rend le sol habitable et productif. Ajoutez que, sous l'influence de ce régime, le sort du cultivateur s'améliore plus rapidement encore que celui du propriétaire. C'est surtout au travail que profite la propriété.
V. Du communisme et du socialisme. — Les adversaires de la propriété se partagent en sectes qui la nient d'une manière absolue, et en sectes qui, sans afficher la prétention de la détruire, veulent en transformer la nature ou en corriger les effets. Celles-ci ont proposé divers systèmes, tels que l'association des travailleurs, le droit au travail et la banque d'échange; celles-là tendent plus ou moins directement à la communauté des biens et par conséquent des familles, et ont joui seules, dans les temps de commotions politiques ou sociales, d'une sorte de popularité.
Cette popularité se conçoit. Le peuple n'a qu'un petit nombre d'idées, et il lui faut des idées simples; il est logicien avant tout. Vous pouvez surprendre et abuser des esprits cultivés, mais peu assurés d'eux-mêmes, avec les rêveries de Saint-Simon ou de Fourier; mais si vous dites aux masses que nul n'a le droit d'occuper le sol et que la propriété individuelle est une usurpation, elles ne s'arrêteront pas à moitié chemin; elles ne se contenteront pas d'abolir l'hérédité ou de rechercher les moyens de rendre le travail attrayant, et elles iront droit à la conclusion légitime qu'entraîne la négation de la propriété, à savoir la communauté des biens.
Dans la crise révolutionnaire que nous venons de traverser, les ouvriers et les paysans, que les prédications du socialisme avaient égarés, ne suivaient ni le drapeau de M. Considérant ni celui de M. Proudhon, ils étaient simplement communistes. Les disciples de Fourier n'ont trouvé personne qui consentit, après l'expérience de Condé-sur-Vègre, à leur apporter, pour la reconstruction du phalanstère, son capital et ses bras. Owen au contraire dans la Grande-Bretagne et M. Cabet en France ont recruté sans peine des hommes qui s'aventuraient même au delà des mers pour réaliser l'utopie antisociale, qui allaient mourir de misère à la Nouvelle-Harmonie ou dans la république icarienne.
En dehors de ces tentatives récentes, il existe plusieurs agrégations d'hommes, dans lesquelles on a cherché à introduire, quoique imparfaitement et sous des formes diverses, la communauté des biens. Je ne parlerai pas des communautés religieuses, dans lesquelles on s'interdit également l'accumulation du capital et la reproduction de l'espèce. Celles-là évidemment sont des exceptions et des anomalies placées en dehors du monde, qui ne peuvent servir de type à aucun ordre social; elles accomplissent, comme on l'a fait remarquer, le suicide chrétien. C'est une manière de mourir avant le temps; ce n'est pas un mode de vivre. Il existe à la vérité en Russie des communes dans lesquelles chaque année on partage à nouveau les terres cultivables entre les habitants; mais ceux-ci disposent comme ils l'entendent de la récolte qu'ils ont semée, et chacun demeure propriétaire de sa maison, de ses bestiaux, ainsi que de son capital d'exploitation. C'est la tradition de la vie nomade se continuant dans la vie sédentaire. Encore ce système ne peut-il durer quelque temps, l'amélioration du sol étant sans intérêt pour le laboureur, et devenant par conséquent impossible, qu'à la condition d'une population stationnaire ou dont le surplus serait absorbé par l'émigration.
Tous les exemples de communisme dont l'histoire dépose n'ont abouti qu'à des essais incomplets, informes et éphémères. Tels qu'ils sont, ils prouvent, en face des sociétés fondées sur la propriété et qui celles-là prospèrent, qu'aucun ordre n'a pu s'établir sur la base contre nature de la communauté des biens.
Au reste, un état social mixte ne se conçoit pas. Ou il faut que l'homme travaille pour lui-même et acquière ainsi la propriété, ou il faut qu'il travaille pour la communauté qui, recueillant les fruits de son travail, se chargera de pourvoir à ses besoins. Dans ce dernier système, l'homme ne peut mettre en réserve et individualiser ni ses intérêts ni ses affections. La communauté des biens conduit nécessairement à la communauté des femmes. « Ou tout en propre, ou rien, dit avec raison M. Thiers; alors rien, ni le pain, ni la femme, ni les enfants; tout en commun, le travail et la jouissance. »
Le communisme détruit la personnalité humaine, la liberté, le travail et la famille.
Le communisme supprime la liberté. Pour éviter les mauvaises chances à l'homme, de peur qu'il ne rencontre la pauvreté en courant après la richesse, on l'oblige à travailler pour la communauté qui lui distribue la nourriture, les vêlements et un abri; mais c'est à condition d'humilier sa volonté devant la volonté commune, de faire abnégation de son jugement et de ses penchants, de suivre littéralement l'ordre qui lui est donné, d'être mathématicien quand il voudrait cultiver la poésie ou l'histoire, d'être tisserand ou forgeron quand il voudrait labourer les champs; enfin de se laisser opprimer en tout temps par une égalité grossière. On traite ainsi l'espèce humaine comme une ruche d'abeilles ou comme un rassemblement de castors. On oublie que l'homme suit naturellement, non pas un instinct irrésistible et fatal, mais une loi morale à laquelle il conforme librement ses actes; que la liberté consiste à pouvoir se tromper et à pouvoir souffrir; que c'est là ce qui élève notre nature au-dessus de celle des animaux; et que, pour supprimer la liberté individuelle, il faudrait pouvoir annuler la responsabilité.
Le communisme détruit le travail; car il décourage l'ouvrier en éloignant le but que l'ouvrier veut atteindre. L'homme qui exécute une tâche a besoin de croire, en y consacrant toutes ses facultés, qu'il obtiendra une rémunération proportionnée à ses efforts; il y mettrait la main bien mollement s'il pouvait craindre qu'un ouvrier moins habile ou moins laborieux reçût le même salaire. Or l'égalité des salaires est la conséquence inévitable de la communauté. Ce n'est pas tout: dans la communauté, le mobile du travail manque. On ne compte ni son temps ni sa peine quand on s'efforce de produire pour soi ou pour sa famille. Mais en sera-t-il de même quand il faudra produire pour cet être de raison qu'on appelle la société? La plus simple connaissance du cœur humain enseigne que, si le législateur a raison de généraliser et d'élever la notion du devoir, il ne saurait trop individualiser celle des mobiles intéressés. Vous pouvez dire à un citoyen: « Va te faire tuer pour ton pays! » Vous seriez mal reçu à lui dire: « Veille et prodigue tes forces pour enrichir la société. » Dans les sociétés où la propriété est admise et où le travail profite à celui qui s'y livre, e'est tout au plus si l'on parvient à procurer du pain à tout le monde; mais une société communiste, endormant le zèle et glaçant les facultés de ses membres, ne tarderait pas à mourir de faim. Les tribus qui vivent à l'état sauvage, dans les savanes de l'Amérique ou dans les steppes de l'Asie, mettent à peu près toutes choses en commun; aussi, quand la famine vient les frapper, peu s'en faut que les races ne s'éteignent.
La famille n'est pas seulement un centre d'affections, embrassant la destinée de l'homme depuis le berceau jusqu'à la tombe, elle est aussi un groupe d'intérêts. Le communisme, en détruisant les intérêts, tend à ébranler les affections qui s'y rattachent. Abolissez les limites de la propriété, et vous effacez, ou peu s'en faut, les limites de la famille. Dans le régime de la communauté, un mari qui aime sa femme, un père qui chérit ses enfants, ne pouvant absolument rien pour eux, est soumis à une torture de tous les instants. La communauté encourage, engendre même l'indifférence des parents pour les enfants et des enfants pour les parents. Elle étouffe ou glace les sentiments, pour ne laisser de place qu'aux appétits.
Les monstruosités du communisme s'ajustent les unes aux autres. C'est un édifice hideux à voir et inhospitalier pour l'homme, mais dont toutes les parties se rapportent du moins à un plan d'ensemble. C'est une société fantastique, si l'on veut, et placée dans les conditions de l'absurde, mais enfin une société nouvelle qui aspire à supplanter la vieille société. Le socialisme, au contraire, dans les variations infinies qu'affecte l'esprit de secte, n'est qu'un communisme inconséquent. Il laisse subsister la société actuelle en cherchant à y introduire des éléments qu'elle repousse et des germes de mort. Les socialistes admettent la propriété, mais ils attaquent le capital, la concurrence et la liberté de disposer, les conditions, en un mot, en dehors desquelles la propriété n'a rien de durable.
Tous les systèmes dont on nous a donné le spectacle peuvent se ramener, comme je l'ai déjà indiqué, à trois principaux: l'association des ouvriers entre eux, la banque d'échange ou la réciprocité des services, et le droit au travail. Chacun de ces systèmes est entré, à un moment donné, dans le domaine de la pratique. A la faveur d'une révolution formidable qui avait détendu les ressorts du gouvernement, ils ont franchi violemment le terrain d'un débat contradictoire pour introduire dans la région des faits un commencement de domination. De là vient que nous pouvons les juger non-seulement sur l'infériorité de leurs arguments, mais sur l'avortement de leur fortune.
J'ai traité ailleurs la question du droit au travail,283 et je me bornerai à rappeler ici que M. Proudhon, en disant: « Donnez-moi le droit au travail, et je vous abandonne la propriété, » en a prononcé la condamnation la plus sévère.
Dans le système de l'association, qui a été consacré non-seulement par des réunions libres d'ouvriers, mais par des prêts d'argent faits par l'État, l'on se proposait de soustraire les ouvriers à ce que l'on appelait alors la tyrannie du capital, et le travail aux effets de la concurrence.
Une association de capitalistes se conçoit; car le capital est le levier à l'aide duquel, dans les régions de l'industrie et dans celles du crédit, on soulève les montagnes. Un concert d'intérêts entre des capitalistes et des entrepreneurs d'industries ou des directeurs du travail semble tout aussi naturel; car il y a là des forces diverses qui viennent concourir au même but, et dont chacune ajoute à la puissance des autres. A la rigueur et dans des circonstances exceptionnelles, un effet utile peut résulter de la réunion du capital et du talent avec le travail mécanique, suivant la formule de Saint-Simon. Mais agglomérer des ouvriers et les associer entre eux, c'est méconnaître la vraie matière de l'association qui suppose la combinaison de forces diverses.
Les machines les plus ingénieuses et les plus puissantes ont besoin d'un moteur. Le travail humain a deux moteurs dont il ne saurait se passer, le capital et l'intelligence. Il y a folie à prétendre que l'on peut supprimer sans inconvénient, soit dans l'industrie, soit dans l'agriculture, l'intervention des capitalistes et celle des entrepreneurs, des patrons. Les associations d'ouvriers se donnent un gérant par l'élection; mais l'élection est le plus mauvais de tous les moyens pour découvrir la capacité, et l'investiture que l'on reçoit de ses égaux ne confère ni les lumières ni l'expérience. En outre on ne conduit bien et l'on ne fait prospérer une entreprise qu'avec le stimulant et avec les inspirations de l'intérêt privé. Les associations d'ouvriers les mieux dirigées ont manqué visiblement de cet instinct commercial qui développe les affaires, qui en éclaire et qui en assure la marche. Une réunion d'ouvriers travaillant sans l'assistance des patrons, c'est le travail sans direction, une machine sans moteur, la révolte des bras contre la tête, et, pour tout dire, l'anarchie.
Toute industrie a besoin d'un capital; car c'est le capital qui fournit les outils, le fonds de roulement et les matières premières. Or les ouvriers n'ont que leurs bras à mettre en commun. Il faut que le capital leur vienne de quelque part; ils le demanderont certainement à l'État, s'ils ne le reçoivent pas librement des capitalistes. L'État cependant n'est riche que de la richesse commune. Le trésor public se forme du produit des contributions acquittées par chaque citoyen. Le gouvernement n'a pas le droit de s'en servir pour commanditer certaines combinaisons, une classe de citoyens au détriment des autres. Au fond, l'État, prêtant ou donnant le capital à des ouvriers associés, deviendrait un véritable entrepreneur d'industrie. Ce serait lui qui ferait concurrence aux capitalistes et aux patrons avec les fonds de tout le monde. Il n'y a qu'un pas d'un pareil régime au monopole, à la communauté; et ce pas serait bientôt franchi.
Il convient de remarquer encore que le système de l'association entre ouvriers, qui a été imaginé dans l'intérêt des ouvriers des grandes industries, ne saurait convenir à ceux de l'agriculture qui occupe en France vingt-quatre millions d'hommes. Ainsi l'État commettrait une injustice, il ferait de plus une détestable spéculation, et il la ferait dans l'intérêt de quatre à cinq cent mille personnes, que les doctrines socialistes ont perverties et constituées, d'une manière à peu près permanente, à l'état d'hostilité contre l'ordre public.
Reste le système de la réciprocité, la Banque du peuple: ce système n'est pas une innovation; il se compose de deux éléments déjà éprouvés, qui ont fait couler beaucoup de sang et de larmes, le maximum et les assignats. L'auteur a voulu recommencer l'expérience sur nouveaux frais. Il a ouvert, dans un moment où la passion politique venait à son aide, la souscription à la Banque du peuple. Mais ce peuple, qui verse des millions à la caisse d'épargne, est resté indifférent devant les promesses du banquier de l'échange, et n'a pas trouvé deux cent mille francs à lui offrir: en attendant l'influence de la contrainte, la combinaison sous la forme spontanée et libre a complètement échoué. L'établissement est mort d'inanition, avant d'expirer sous le ridicule.
Examinons cependant le système, comme s'il était encore à expérimenter. M. Proudhon prétend décréter le bon marché et supprimer le numéraire; à ce prix, tous les maux de l'humanité seront guéris, et nous entrerons dans un âge de bonheur sans mélange, que j'appellerais volontiers l'âge d'or, par une réminiscence classique, sans l'horreur de M. Proudhon pour l'emploi des métaux précieux.
Mais comment opérer le bon marché de toutes choses, et comment amener le monde à répudier de lui-même l'usage de l'argent? Il s'agit de réduire par une décision de la puissance législative tous les revenus, tels que loyers de maisons, fermages de terres, intérêts de capitaux, salaires de toute nature; puis cela fait, et par voie de compensation, l'on diminuera d'une quantité proportionnelle la valeur des choses. Le prix des consommations s'affaiblissant en même temps et au même degré que les salaires, il y aura une sorte de réciprocité. Mais quel sera le résultat, et quel but veut-on atteindre? Évidemment cette combinaison doit avorter. Car il ne dépend ni du pouvoir qui représente la société, ni des individus qui la composent, de fixer arbitrairement le prix des choses. On peut rogner par un décret le traitement des fonctionnaires publics, et c'est une besogne dont la révolution de février s'est acquittée à la satisfaction, je pense, des niveleurs égalitaires. Mais on ne détermine à volonté ni la valeur des services ni celle des objets de consommation. Le travail et les matériaux du travail se payent plus ou moins cher sur le marché, selon qu'ils sont plus ou moins demandés. Il n'y a pas de décret qui permette d'éluder l'inflexible loi du rapport de l'offre à la demande. Mais en supposant l'impossible, que gagnerait-on au succès du système? Si les salaires sont réduits dans la proportion exacte de la réduction opérée sur le prix des choses, on ne s'en trouvera ni bien ni mal, car il n'y aura rien de changé. Personne n'en sera ni plus riche ni plus pauvre. La somme des jouissances restera la même ainsi que celle des besoins. Ce sera pour ainsi dire le mouvement sur place; on aura pris une grande peine, on aura fait mouvoir tous les rouages de la machine sociale, pour accomplir une opération qui est un pur jeu de l'esprit.
Après le bon marché, vient l'échange. Il s'agit de créer une vaste banque qui ait pour gage la production entière du pays, comme la dette publique et comme l'impôt. Cette banque sera ouverte à tout travailleur qui, sur sa demande, en recevra le papier dont il a besoin. Le papier de la banque ayant cours, comme le numéraire que l'on prétend remplacer, le travailleur pourra se procurer ainsi les moyens de produire et de jouir. C'est le crédit universel, le crédit fait à tout le monde, à ceux qui produisent comme à ceux qui ne produisent pas, aux incapables comme aux habiles, aux paresseux comme aux ouvriers diligents, et aux fripons comme aux gens honnêtes. C'est le crédit offert indistinctement aux premiers venus; car le système s'est interdit de refuser, et au premier refus, le papier d'échange aurait tous les inconvénients que l'on reproche au numéraire. Une banque, fondée sur de tels principes, n'aurait ni le droit ni le pouvoir de limiter ses émissions, elle succomberait bientôt à une dépréciation inévitable. M. Proudhon s'indignait comme d'une injure d'un rapprochement entre la banque d'échange et les assignats. Il avait tort; ce sont les inventeurs des assignats qui auraient le droit de se plaindre. Les assignats, en effet, ayant une hypothèque spéciale, offraient, jusque dans l'abîme de la dépréciation, une valeur quelconque au porteur. Les bons d'échange, hypothéqués sur la foi publique, dans un gouvernement socialiste, au milieu du discrédit général et de la ruine universelle, ne représenteraient plus rien.
En voilà bien assez, pour un travail qui doit être sommaire, sur les divers systèmes que l'on oppose à la propriété. Ces systèmes ont fait bien du mal. Quelques-uns, après avoir commencé par être des rêves, ont fini par être des crimes. Au lieu de remuer des idées, de prétendus réformateurs ont secoué sur le monde la torche qui allume les appétits et qui échauffe les passions. On a troublé ainsi, pour longtemps peut-être, les esprits en Europe; mais on n'a pas ébranlé, quoi qu'où ait dit et quoi qu'on ait entrepris, au milieu de la tourmente sociale, les fondements inébranlables de la propriété. Les socialistes de nos jours ne feront pas ce que les jacques au moyen âge et les anabaptistes au seizième siècle n'ont pas pu faire. Comme toutes les institutions qui servent de base à l'ordre social, la propriété est en progrès. Elle marche, elle s'étend, et elle comble chaque jour de ses bienfaits ceux-là mêmes qui la maudissent. Il n'y a de moralité et de richesse que là où la propriété se trouve solidement assise et fortement garantie: c'est les yeux fixés sur le passé de la propriété, que l'Économie politique en proclame le principe et en défend l'avenir.
Léon Faucher.
Bibliographie.
La question de la propriété se trouve discutée dans la plupart des traités généraux d'Économie politique, ainsi qu'on l'a vu dans le cours de cet article. Nous signalerons en outre les ouvrages suivants:
An Essay towards a general history of feudal property in Great Britain. — [Essai d'une histoire de la propriété féodale en Angleterre), par John Dalrymple. Londres, 1757, in-8, 1759, in-12.
Considerations on the polity of entrails in a nation. — [Considérations sur le droit de succession], par John Dalrymple. Edimbourg, 1765, in-8.
An Essay on the right of property in land, with respect to the foundation in the law of nature; its present establishment by the municipal laws of Europe, etc. — (Essai sur le droit de propriété territorial, considéré au point de vue du droit naturel, des lois municipales, etc., etc.). Anonyme (par M. Ogilvie). Londres, sans date, 1786, 1 vol. in 8.
De la propriété dans ses rapports avec le droit politique, par le marquis Germain Garnier. Paris, 1792, 1 vol. in-18.
Du droit d'aînesse, par M. Dupin aîné. Paris, 1826, in-8.
Traité de la propriété, par Ch. Comte. Paris, Chamerot, Ducollet. 1834, 2 vol. in-8.
Ueber das Recht des Besitzes.— (Du droit de propriété), par M. de Savigny, Ire édit., 1803. 6e édit. Giessen, 1837, in-8.
Etudes d'Économie politique sur la propriété territoriale, par H. Gustave Du Puynode. Paris, Joubert,1840, 1 vol. in-8.
Qu'est-ce que la propriété? ou Recherche sur le principe du droit et du gouvernement, par P.-J. Proudhon, 1er mémoire. Paris, Prévot, 1841, 1 vol. in-12.
Lettre à M. Blanqui, sur la propriété, 2e mémoire. Paris, le même, 1 vol. in-12.
Avertissement aux propriétaires, ou Lettre à M. Considérant sur une défense de la propriété. Paris, Garnier frères, 1 vol. in-12.
De la propriété et de son principe, par Jules Lebastier. Paris, comptoir des Impr.-Unis, 1844, 1 vol. in-8.
Propriété et loi, par Frédéric Uastiat. Paris, Guillaumin et compagnie, 1848,in-16.
Les Soirées de la rue Saint Lazare, Rechercha sur les lois économiques et défense de la propriété, par M. G. de Molinari. Paris, Guillaumin et comp., 1849, in-18.
De la propriété, par M. Thiers. Paris, Paulin, 1849, 1 vol. in-8. Réimprimé en partie, en 2 petits vol. in-16, dans la collection des Petits traités publiés par l'Académie da sciences morales et politiques.
Libération de la propriété, ou Réforme de l'administration des impôts indirects et des hypothèques, par le marquis d'Audiffret. Paris, Garnier frères, 1850, brochure in-8.
50.Jean-Gustave Courcelle-Seneuil on “Sumptuary Laws” (1852)↩
[Word Length: 2,550]
Source
Jean-Gustave Courcelle-Seneuil, "Lois somptuaires," DEP vol. 2, pp. 103-05.
Dictionnaire de l’Économie Politique, contenant l’exposition des principes de la science, l’opinion des écrivains qui ont le plus contribué à sa fondation et à ses progrès, la Bibliographie générale de l’économie politique par noms d’auteurs et par ordre de matières, avec des notices biographiques et une appréciation raisonnée des principaux ouvrages, publié sur la direction de MM. Charles Coquelin et Guillaumin (Paris: Librairie de Guillaumin et Cie, 1852-1853), 2 vols. Volume 1: A-I; Volume 2: J-Z.
Brief Bio of the Author: Jean-Gustave Courcelle-Seneuil (1813-1892)
[Jean-Gustave Courcelle-Seneuil (1813-1892)]
Jean-Gustave Courcelle-Seneuil (1813-1892) studied law, worked in the metallurgy business, was an editor of the Journal des Économistes, served briefly as the Director of Education in Duclerc’s government during the 1848 revolution, before seeking a kind of voluntary exile after 1851 by accepting a professorship in political economy in Santiago, Chile from 1852-1862. He returned to France in 1863, became a Conseiller d’État in 1879, and worked at the École normale supérieure de Paris from 1881-1883. In 1882 was was elected to the Academy of Moral and Political Sciences. His scholarly interests included banking and credit, numerous works on economic theory, a constitutional investigation of the impact of the French Revolution, and the translation into French of works by J.S. Mill, William Graham Sumner, and Adam Smith. See especially the Traité théorique et practique d’économie politique, 2 vols. (1856), Études sur la science sociale (1862). [DMH]
LOIS SOMPTUAIRES.
Lois destinées a réprimer ou à modérer les dépenses des particuliers.
Il y en a eu dans presque toutes les républiques anciennes et dans la plupart des États modernes.
Les républiques anciennes étaient fondées, on le sait, sur l'égalité des conditions. Dès que cette égalité était altérée dans une certaine mesure, l'existence même de l'État se trouvait en péril. Les législateurs recouraient alors, pour conjurer le danger, aux lois agraires, aux lois somptuaires, aux lois en faveur du mariage, aux lois qui ordonnaient l'emploi des hommes libres aux travaux des champs. Toutes ces lois, si diverses par la nature des objets auxquels elles s'appliquaient, étaient inspirées par une même pensée et tendaient au même but: prévenir l'anéantissement de la population libre, dans laquelle les armées nationales se recrutaient.
Ces lois, qui aujourd'hui nous paraissent bizarres, montrent à quel point les anciens avaient sur la liberté des idées différentes des nôtres, et combien leur état social était différent de celui qui existe chez nous.
« Les Romains, dit Plutarque, ne croyaient pas qu'on dût laisser à chaque particulier la liberté de se marier, d'avoir des enfants, de choisir un genre de vie, de faire des festins, enfin de suivre ses désirs et ses goûts, sans être soumis au jugement et à l'inspection de personne. Persuadés que c'est dans ces actions privées, plutôt que dans la conduite publique et politique, que se manifestent les actions des hommes, ils avaient créé deux magistrats chargés de veiller sur les mœurs, de les réformer et de les corriger, afin que personne ne se laissât entraîner hors du chemin de la vertu, dans celui de la volupté, et n'abandonnât les institutions anciennes et les usages reçus. »
Mais la censure établie à Rome n'était qu'une forme particulière donnée à l'exercice d'un droit que l'antiquité tout entière reconnaissait à l'État. On pensait qu'en défendant l'usage des objets de luxe, on réprimerait l'avidité des grands, et que l'on modérerait la consommation générale de la société; qu'on en ralentirait l'appauvrissement; qu'on empêcherait les hommes de la classe moyenne de tomber dans l'indigence, d'où ils ne pouvaient sortir par le travail; car il faut bien se rappeler le principe fondamental des républiques militaires: le travail y déshonorait. L'opinion excusait le patricien romain d'avoir empoisonné et assassiné; elle ne lui aurait pas pardonné d'exercer un commerce ou un métier. De là tout un système économique artificiel et contre nature.
A Rome, on trouve des dispositions somptuaires dans la loi même des Douze Tables. « Ne façonnez point, dit-elle, le bois qui doit servir au bûcher des morts. N'ayez point de pleureuses qui se déchirent les joues, point d'or, point de couronnes. » Jamais on n'obéit à ces défenses. La loi Oppia, portée presque aussitôt après l'établissement du tribunat, défendait aux matrones d'avoir plus d'une demi-once d'or, de porter des vêtements de couleur variée, et de se servir de voitures dans Rome. Bientôt, dès l'an 195 avant notre ère, l'abrogation de cette loi fut demandée, et appuyée par une émeute de femmes décrite par Tite-Live. Malgré l'opposition de Caton qui, dans son discours, montra le rapport intime qui liait cette loi aux lois agraires, l'abrogation fut décrétée.
Quatorze ans plus tard, sous l'inspiration du même Caton, fut promulguée la loi Orchia pour limiter la dépense des tables. Vingt ans après, la loi Fannia fut portée dans le même but. Elle fixait la dépense de table a 51 centimes par tête pour les jours ordinaires, à 1 fr. 53 pour dix jours par mois, et à 6 fr. 10 pour les jours de fêtes et de jeux. Défense d'admettre à sa table plus de trois convives étrangers, excepté trois fois par mois, les jours de foire et de marché; défense de servir aux repas aucun oiseau, si ce n'est une seule poule non engraissée; défense de consommer par an plus de quinze livres de viande fumée, etc. Bientôt le luxe des tables franchit ces limites étroites, et Sylla, Crassus, César, Antoine, portèrent successivement contre la gourmandise de nouveaux décrets.
Il est vrai que, par une rencontre singulière, la plupart de ces hommes qui faisaient des lois contre le luxe des tables ont marqué dans l'histoire par leurs excès. L'infamie des festins de Sylla, de Crassus, d'Antoine, a retenti jusqu'à nous à travers les siècles et, si César fut moins adonné a la gourmandise que ces personnages fameux, il n'apporta pas moins de luxe dans les repas. Cette circonstance même prouve bien que tous ces hommes d'État, quel que fut le parti auquel ils tenaient, quels que fussent leurs goûts personnels, considéraient les lois somptuaires comme un remède politique en quelque sorte appliqué à un peuple malade. Ce n'était pas par respect pour les mœurs, par honnêteté privée, par vertu qu'ils recouraient aux lois somptuaires; c'était pour conserver, s'il était encore possible, la race italienne, qui disparaissait rapidement sous la double action du paupérisme et des guerres civiles.
Mais ce n'est point par des lois dédaignées de ceux mêmes qui les font, par des moyens matériels, que l'on peut régler les dépenses privées; c'est par l'opinion publique, par la religion, par les mœurs. Lorsque l'opinion publique est corrompue au point d'honorer le vol et de mépriser le travail; lorsque toute religion est détruite; lorsqu'il est honorable parmi les grands de manger et de boire outre mesure, de vomir pour manger de nouveau, les lois ne sauraient avoir aucune puissance. Aussi le luxe des tables fit-il encore, chose incroyable, des progrès sous les empereurs.
Les empereurs donc firent aussi des lois somptuaires, en même temps qu'ils offraient le spectacle des excès les plus scandaleux. Quelques-uns d'entre eux cependant donnèrent mieux que des lois, de grands exemples de sobriété et d'abstinence, mais sans résultat, sans pouvoir arrêter la société sur la pente où elle se précipitait. Il est aussi impossible de régler l'usage des richesses acquises par la conquête et le vol que celui des richesses acquises par le jeu.
Les lois somptuaires furent inutiles dans toute l'antiquité. Tantôt éludées, tantôt ouvertement méprisées, elles n'arrêtèrent point les progrès du luxe, et ne retardèrent point la ruine des républiques militaires fondées sur l'égalité. Il nous semble toutefois que J.-B. Say les a traitées avec un peu trop de dédain dans le passage suivant, où il fait bien ressortir d'ailleurs la différence des lois somptuaires de l'antiquité et des lois somptuaires des États modernes:
« On a fait des lois somptuaires pour borner la dépense des particuliers chez les anciens et chez les modernes; on en a fait sous des gouvernements républicains et sous des gouvernements monarchiques. On n'avait point en vue la prospérité de l'État; car on ne savait point, on ne pouvait point savoir encore si de telles lois influent sur la richesse générale... On leur donnait pour prétexte la morale publique, partant de cette supposition que le luxe corrompt les mœurs; mais le véritable motif n'a presque jamais été celui-là non plus. Dans les républiques, les lois somptuaires ont été rendues pour complaire aux classes pauvres, qui n'aimaient pas à être humiliées par le luxe des riches. Tel fut évidemment le motif de cette loi des Locriens qui ne permettait pas qu'une femme se fit accompagner dans la rue par plus d'un esclave. Tel fut encore celui de la loi Orchia à Rome, loi demandée par un tribun du peuple, et qui limitait le nombre des convives que l'on pouvait admettre à sa table. Dans la monarchie, au contraire, les lois somptuaires ont été l'ouvrage des grands, qui ne voulaient pas être éclipsés par la bourgeoisie. Tel fut, on n'en peut douter, le motif de cet édit de Henri II qui défendit les vêtements et les souliers de soie à d'autres qu'aux princes et aux évêques. »
Il y avait, pour l'établissement des lois somptuaires dans l'antiquité, d'autres motifs que le désir de complaire aux classes pauvres, et dans les monarchies féodales, ces lois ont eu d'autres causes que la jalousie des grands. Ces monarchies, elles aussi, étaient une création artificielle fondée « sur des institutions anciennes et des usages reçus; » ces institutions, ces usages, tendaient à immobilier les propriétés dans les mêmes familles, à fixer les rangs pour jamais, et, si l'antiquité avait ses lois agraires dans le sens de l'égalité, la société féodale, il ne faut pas l'oublier, avait les siennes dans le sens de l'inégalité et de la hiérarchie.
L'avénement de la richesse mobilière et du luxe troubla profondément les sociétés féodales, où tout était fondé sur la prééminence de la propriété noble par excellence, la propriété foncière. Un système de culture et d'aménagement agricole établi sur la tradition ne permettait pas à la noblesse d'augmenter ses revenus, tandis que les profits du commerce, de la navigation, de l'industrie, et la possession des capitaux mobiliers élevaient la classe moyenne. Le luxe de cette classe, qui s'empressa d'imiter le train des grands, troublait l'harmonie de la société; il dérangeait une hiérarchie hors de laquelle on ne voyait que désordre. De là les lois somptuaires qui distinguaient les classes par leurs costumes comme on distingue dans une armée les grades par les uniformes.
La vanité des grands appela peut-être les lois somptuaires des peuples modernes, comme la jalousie des classes inférieures avait applaudi à celles des anciennes républiques. Mais, dans l'antiquité comme dans les monarchies féodales, le législateur s'inspira de la raison d'Etat, du désir d'empêcher des innovations qu'il considérait comme fatales.
Du moment où les roturiers venaient proposer aux nobles la concurrence du luxe, du moment où ils venaient rivaliser d'éclat avec eux; il était évident que, si on laissait la carrière ouverte à un tel concours, la richesse finirait par l'emporter sur la naissance dans l'opinion des peuples, sur la noblesse elle-même. Or, comme les monarchies féodales étaient établies sur le droit de race, tout ce qui pouvait diminuer l'autorité de ce droit tendait à renverser la constitution de l'État. Ceux mêmes qui ne voyaient pas bien clairement la portée du luxe bourgeois, et qui, bourgeois eux-mêmes, ne pouvaient en être blessés, sentaient cependant que ce luxe troublait l'ordre établi et appuyaient les lois somptuaires.
Ces lois ont donc été de tout temps inspirées par le désir d'arrêter un mouvement irrésistible et résultant de la force même des choses, du développement désordonné peut-être, mais logique, de l'activité humaine. Aussi ont-elles été impuissantes, et toujours éludées par une sorte de conspiration tacite et générale de tous les citoyens, sans que personne osât, pût en blâmer le principe, sans que l'on songeât même à contester le moins du monde sur ce point le pouvoir du législateur.
Il faut bien se rappeler, en effet, que dans les monarchies modernes le pouvoir législatif n'était guère moins étendu que dans l'antiquité. On ne reconnaissait pas à tout homme le droit de travailler, et bien moins encore le droit de travailler à sa convenance: à plus forte raison prétendait-on que le roi tînt, comme on disait, une police exacte dans son royaume, et ne permit pas à une classe d'empiéter sur l'autre, de changer le rang qui lui était assigné par l'ancienne coutume.
« Ledit seigneur roi, lisons-nous dans une ordonnance de l577,deuement informé que la grande superfluité de viande qui se fait ès nopces, festins et banquets, apporte la cherté de volailles et gibiers, veult et entend que l'ordonnance sur ce faicte soit renouvellée et gardée, et pour la continuation d'icelle, soient punis des peines y apposées tant ceux qui font tels festins que les maistres d'hostel qui les dressent et conduisent, et les cuisiniers qui y servent. —Que toute sorte de volaille et gibbier apportez aux marchez seront veuz et visitez par les jurez poulailliers, en présence des officiers de la police et bourgeois commis à icelle, qui assisteront ausdicts marchez et feront faire par lesditz jurez rapport à la police, etc. Les poulailliers ne pourront habiller et larder viandes, et telles les exposer en vente, etc. Seront pareillement tenus les passans vivre selon l'ordonnance du roy, sans l'outrepasser, sur peine de semblables amendes pécuniaires que dict est cy-dessus contre l'hostellier, de façon que de gré à gré, ne de commun consentement, ne pourra être contrevenu à l'ordonnance. »
Le monde vit aujourd'hui dans un ordre d'idées diffèrent, et lorsque nous lisons les ordonnances de nos rois, nous ne les trouvons pas moins étranges que les lois antiques: il nous semble qu'elles s'appliquent à un état social où tout travailleur soit fonctionnaire, comme dans l'empire de Constantin. Ces ordonnances sont pourtant l'histoire d'hier, l'histoire de la veille de la révolution française, et nous traînons encore de lourds fragments de la chaîne sous laquelle gémissaient nos pères.
Mais les idées et les sentiments ont de bien loin devancé les faits: nous avons peine a comprendre l'intervention du gouvernement dans l'intérieur des familles, dans les contrats qui n'intéressent que les particuliers. Quant au luxe, il ne déclasse rien dans une société nivelée, et il ne peut nuire beaucoup si la loi du travail est respectée, si la rapine ne peut devenir un moyen d'acquérir la propriété.
Depuis la révolution, on n'a fait en France aucune loi somptuaire, et cependant le luxe de vêtements qui distinguait auparavant les classes nobiliaires a disparu. Un duc s'habille comme le premier venu, et il serait montré au doigt s'il cherchait à se distinguer par un costume différent des autres. Telle est la loi somptuaire de notre temps. Quiconque chercherait à se singulariser par des vêtements particuliers ou par un genre de vie exceptionnel, serait aussitôt noté, non comme un citoyen dangereux, mais comme un personnage ridicule. L'opinion a subi toute une révolution.
Les dépenses particulières augmentent cependant, et elles suivent même une progression assez rapide. Toutefois elles ne peuvent s'écarter beaucoup de l'égalité; les prodigalités vaines ne sauraient être un titre de gloire dans une société où la loi du travail est reconnue, et celui qui veut s'y livrer, quelque riche qu'il soit, est obligé par l'opinion à porter, dans ses plus grands excès même, une certaine pudeur.
Les lois somptuaires ne peuvent plus être proposées de notre temps. N'en faisons pas honneur à notre sagesse, à notre supériorité prétendue sur les anciens; reconnaissons seulement, et c'est en ceci que consiste le progrès, que le principe constitutif de la société est changé: le monde se meut sur une autre base.
Lorsque le peuple romain eut, au mépris des observations de Caton, abrogé la loi Oppia contre le luxe des femmes, Caton, devenu censeur, essaya de la faire revivre sous une autre forme: il comprit dans le cens, c'est-à-dire dans l'évaluation du bien des citoyens, les bijoux, les voitures, les parures des femmes et des jeunes esclaves, pour une somme décuple du prix qu'ils avaient coûté, et les frappa d'un impôt de 3 pour 1,000 ou 3 pour 100 du prix réel. Il substitua l'impôt somptuaire à la loi somptuaire.
Les modernes ont fait comme Caton: après que les lois somptuaires ont été tombées en désuétude, ils ont établi des impôts sur les consommations de luxe. L'Angleterre a des taxes sur les voitures, sur les domestiques, sur les armoiries, sur la poudre à poudrer; nous avons chez nous l'impôt sur les cartes à jouer. Devant l'économie politique, ces taxes sont irréprochables; mais elles produisent peu au trésor, et n'ont sur les consommations et les mœurs à peu près aucune influence. (Voyez LUXE.)
51.Joseph Garnier on “The Cost of Collecting of Taxes” (1852)↩
[Word Length: 551]
Source
Joseph Garnier, "Frais de perception ou de recouvrement," DEP vol. 1, pp. 807-08.
Dictionnaire de l’Économie Politique, contenant l’exposition des principes de la science, l’opinion des écrivains qui ont le plus contribué à sa fondation et à ses progrès, la Bibliographie générale de l’économie politique par noms d’auteurs et par ordre de matières, avec des notices biographiques et une appréciation raisonnée des principaux ouvrages, publié sur la direction de MM. Charles Coquelin et Guillaumin (Paris: Librairie de Guillaumin et Cie, 1852-1853), 2 vols. Volume 1: A-I; Volume 2: J-Z.
Brief Bio of the Author: Joseph Garnier (1813-81)
[Joseph Garnier (1813-1881)]
Joseph Garnier (1813-81) was a professor, journalist, politician, and activist for free trade and peace. He came to Paris in 1830 and came under the influence of Adolphe Blanqui, who introduced him to economics and eventually became his father-in-law. Garnier was a pupil, professor, and then director of the École supérieure de commerce de Paris, before being appointed the first professor of political economy at the École des ponts et chaussées in 1846. Garnier played a central role in the burgeoning free-market school of thought in the 1840s in Paris. He was one of the founders of L’Association pour la liberté des échanges and the chief editor of its journal, Libre échange; he was active in the Congrès de la paix; he was one of the founders along with Guillaumin of the Journal des économistes, of which he became chief editor in 1846; he was one of the founders of the Société d’économie politique and was its perpetual secretary; and he was one of the founders (with Bastiat) of the 1848 liberal broadsheet Jacques Bonhomme. Garnier was acknowledged for his considerable achievements by being nominated to join the Académie des sciences morales et politiques in 1873 and to become a senator in 1876. He was author of numerous books and articles, among which include Introduction à l’étude de l’Économie politique (1843); Richard Cobden, les ligueurs et la ligue (1846); and Congrès des amis de la paix universelle réunis à Paris en 1849 (1850). He edited Malthus’s Essai sur le principe de population (1845); Du principe de population (1857); and Traité d’économie politique sociale ou industrielle (1863). [DMH]
FRAIS DE PERCEPTION OU DE RECOUVREMENT.
Ce sont les dépenses que nécessitent la rentrée des impôts, les salaires des agents et l'entretien des administrations chargées de ce soin. Ils comprennent tous les frais de régie ou d'exploitation des impôts et des revenus publics. Ils représentent la différence qu'il y a entre les sommes qui parviennent au trésor et celles qui sortent de la poche des contribuables. La diminution de cette différence doit être le résultat d'un bon système de contribution; elle dépend donc d'une bonne assiette des impôts, d'une administration régulière, entendue et perfectionnée. Elle est, à beaucoup d'égards, l'expression de l'ordre et de la justice qui règne dans les finances.
On trouve dans J.-B. Say (Cours, VIIIe partie, chap. VI) les indications suivantes: « Je lis dans un mémoire de H. Hennet, premier commis des finances, qu'en 1813 la France, composée alors de 130 départements, pour toucher 170 millions de l'enregistrement et des domaines, faisait payer 240 millions par les contribuables, c'est-à-dire 70 millions de frais de perception ou 41 p. 100. » « Avant Sully, les frais de recouvrement se montaient à 500 pour 100; et maintenant, en Angleterre (Say écrivait en 1829), sur l'ensemble des recettes, ils ne s'élèvent guère qu'à 5 pour 100. »
A ce compte, depuis 1813 la perception de la contribution de l'enregistrement et des domaines s'est singulièrement perfectionnée; car, pour 86 départements seulement, elle ne coûte guère plus de 5 pour 100. Le chiffre donné pour l'époque antérieure à Sully semble beaucoup exagéré si l'on se reporte au curieux livre de Froumenteau (le Secret des finances, 1580, premier livre, p. 142), qui porte le total de la recette pendant une période de trente et un ans, finissant au 31 décembre 1580, à 1,453 millions de livres, dont 927 seulement étaient entrées au trésor royal; différence, 526 millions ou 57 pour 100.
Necker, dans son Administration des finances (1785, chap. III), ne portait la totalité des frais de recouvrement, sur une recette de 5S7 millions 1/2, montant à 585 millions avec les corvées et les frais de contrainte et de saisie, et formant l'universalité des impositions de la France, qu'à 58 millions ou 11 3/5 pour 100. Un calcul d'Eugène Daire, sur les résultats du budget de 1842 (Annuaire de l'Écon. polit. de 1844, p. 84), fait ressortir la somme des frais de perception à 132 millions sur une recette brute de 1,132 millions, et nette de 1 milliard, soit à 13 1/5 pour 100 de la somme entrée effectivement au trésor pour les besoins publics.284 A ce compte et sous ce rapport l'administration actuelle des finances de France ne différerait pas de celle d'avant la révolution, si Necker disait juste.
Une remarque à faire, c'est qu'en général les frais de recouvrement pour les impôts par exploitation et vente d'un produit (les tabacs, par exemple), sont plus élevés que ceux qu'exigent les impôts dits indirects, perçus sur des objets de consommation générale, et que ces derniers frais sont plus élevés que les frais des contributions dites directes ou demandées sur la terre, le mobilier, les portes et fenêtres, le revenu, etc.
Il est établi au mot FERMIERS GÉNÉRAUX que les frais de perception par les fermes étaient, avant la révolution, plus élevés que ceux des impôts recouvrés par régie. (V. FERMIERS GÉNÉRAUX.)
52.Joseph Garnier on “Laissez Faire, Laissez Passer” (1852-53)↩
[Word Length: 526]
Source
Joseph Garnier, "Laissez faire, laissez passer" in the Dictionnaire de l'Économie Politique, ed. Charles Coquelin and Charles Guillaumin (Paris: Guillaumin, 1852), 2 vols. Vol. II, p. 19.
Brief Bio of the Author: Joseph Garnier (1813-81)
[See the biography of Garnier above.]
LAISSEZ FAIRE, LAISSEZ PASSER
LAISSEZ FAIRE, LAISSEZ PASSER. Ces deux formules, qui reviennent fréquemment dans les abaissions économiques, politiques, sociales et socialistes ont été mises en circulation par les physiocrates. Sous leur plume comme dans leur bouche, Laissez faire voulait dire simplement laissez travailler, et Laissez passer signifiait laissez échanger; en d'autres termes, les physiocrates, en parlant ainsi, réclamaient la liberté du travail et la liberté du commerce. (Voy. ces deux articles.)
Ces deux locutions n'ont pas eu d'autre sens depuis sous la plume ou dans la bouche des économistes; mais les partisans de la réglementation sous toutes les formes, socialistes, protectionnistes, administrateurs interventionistes, ont souvent affecté de croire qu'elles étaient l'expression de la liberté de tout faire, non-seulement en économie, mais en morale, en politique, en religion. Un écrivain de nos jours, M. Jobard, émet depuis quinze ans la même assertion dans toutes ses brochures, et va jusqu'à dire que par Laissez faire et Laissez passer les économistes entendent « la libre déprédation. » Rappeler une pareille interprétation, c'est la combattre suffisamment aux yeux des hommes sérieux qui étudient et qui ne ferment point les yeux pour ne pas voir, et ne se bouchent point les oreilles pour ne pas comprendre. Les économistes n'appliquent pas leur axiome à la morale ou à la politique, ou à la religion, dont ils ne s'occupent nullement en tant qu'économistes, mais seulement à ce qui touche à l'activité et à l'industrie humaines; ils ne prétendent pas qu'on laisse tout faire et qu'on laisse tout passer, mais simplement qu'on laisse travailler et qu'on laisse échanger les fruits du travail sans entraves et sans mesures préventives, sous la garantie des lois répressives des actes portant atteinte à la propriété et au travail d'autrui.
Dupont de Nemours raconte comme suit l'origine de ces formules dans sa préface à l'éloge de Gournay par Turgot : « M. de Gournay, fils de négociant, et ayant été longtemps négociant lui-même, avait reconnu que les fabriques et le commerce ne pouvaient fleurir que par la liberté et par la concurrence, qui dégoûtent des entreprises inconsidérées, et mènent aux spéculations raisonnables; qui préviennent les monopoles, qui restreignent à l'avantage du commerce les gains particuliers des commerçants, qui aiguisent l'industrie, qui simplifient les machines, qui diminuent les frais onéreux de transport et de magasinage, qui font baisser le taux de l'intérêt, et d'où il arrive que les productions de la terre sont à la première main achetées le plus cher qu'il soit possible au profit des cultivateurs, et revendues en détail le meilleur marché qu'il soit possible au profit des consommateurs, pour leurs besoins et leurs jouissances. Il en conclut qu'il ne fallait jamais rançonner ni réglementer le commerce. Il en tira cet axiome : Laissez faire et Laisses passer. »
Mais il paraîtrait que cet axiome avait été inspiré par une réponse faite longtemps avant à Colbert, s'enquérant des mesures favorables à prendre dans l'intérêt du commerce, et dont la justesse avait frappé les amis et les disciples de Quesnay. « On sait, dit Turgot, dans l'éloge de Gournay, déjà cité, le mot de M. Legendre à M. Colbert: « Laissez-nous faire, » à quoi plus tard Quesnay ajoutait : « Ne pas trop gouverner. »
53.Ambroise Clément on “Private Charity” (1852)↩
[Word Length: 1,355]
Source
Ambroise Clément, "Bienfaisance privée," DEP vol. 1, pp. 162-63. Dictionnaire de l’Économie Politique, contenant l’exposition des principes de la science, l’opinion des écrivains qui ont le plus contribué à sa fondation et à ses progrès, la Bibliographie générale de l’économie politique par noms d’auteurs et par ordre de matières, avec des notices biographiques et une appréciation raisonnée des principaux ouvrages, publié sur la direction de MM. Charles Coquelin et Guillaumin (Paris: Librairie de Guillaumin et Cie, 1852-1853), 2 vols. Volume 1: A-I; Volume 2: J-Z.
Brief Bio of the Author: Ambroise Clément (1805-86)
[Ambroise Clément (1805-86)]
Ambroise Clément (1805-86) was an economist and secretary to the mayor of Saint-Étienne for many years. Clément was able to travel to Paris frequently to participate in political economy circles. In the mid 1840s he began writing on economic matters and so impressed Guillaumin that the latter asked him to assume the task of directing the publication of the important and influential Dictionniare de l’économie politique, in 1850. Clément was a member of the Société d’économie politique from 1848, a regular writer and reviewer for the Journal des économistes, and was made a corresponding member of the Académie des sciences morales et politiques in 1872. He wrote the following works: Recherches sur les causes de l’indigence (1846); Des nouvelles Idées de réforme industrielle et en particulier du projet d’organisation du travail de M. Louis Blanc (1846); La crise économique et sociale en France et en Europe (1886); as well as an early review of Bastiat’s Economic Harmonies for the Journal des économistes (1850), in which he praised Bastiat’s style but criticized his position on population and the theory of value. Two works which deserve special note are the article on “spoliation” (plunder), “De la spoliation légale,” Journal des économistes, vol. 20, no. 83, 1er juillet 1848, which he wrote in the heat of the June Days uprising in Paris, and the two volume work on social theory wich has numerous “Austrian” insights, Essai sur la science sociale. Économie politique - morale expérimentale - politique théorique (Paris: Guillaumin, 1867), 2 vols. [DMH]
BIENFAISANCE PRIVÉE.
Les économistes repoussent la charité légale comme produisant incomparablement plus de mal que de bien. Cela a suffi pour faire accuser leurs doctrines de préconiser l'égoïsme, d'étouffer les sentiments de bienveillance, de rabaisser la générosité, le dévouement, etc. Heureusement ces accusations sont aussi stupides qu'odieuses, et il n'est pas difficile de le démontrer.
Nous examinerons d'abord les arguments mis en avant par deux des plus éminents défenseurs de l'assistance légale, MM. de Lamartine et Thiers.
M. de Lamartine a écrit dans Le conseiller du Peuple:
« La fraternité et la charité sont-elles des vertus? Oui. Donc la société elle-même doit exercer ces deux vertus; donc la société ne doit pas, comme le prétendent les économistes, qui n'ont pour religion que l'arithmétique, se désintéresser de ces grands devoirs et laisser faire et passer la misère et la mort. »
M. Thiers, dans son rapport à l'Assemblée législative sur l'assistance publique, invoque les mêmes considérations:
« Si l'individu a des vertus, la société ne peut-elle pas en avoir? La réponse, suivant nous, n'est pas douteuse. Il ne faut pas voir dans l'État un être froid, insensible, sans cœur. La collection des membres composant la nation, de même qu'elle peut être intelligente, courageuse, polie, pourra être humaine, bienfaisante, aussi bien que les individus eux-mêmes. »
Qu'est-c que la société? Si c'est la collection des membres composant la nation, il est clair que cette collection réunira la somme de toutes les vertus possédées par chacun des individus qui la composent. Si l'on entend personnifier cette collection pour en faire cet être de raison qu'on nomme la société, l'État, il sera absurde d'attribuer à cet être, qui n'existe pas, une action indépendante de celle de l'ensemble des individus composant la nation. Si, enfin, on entend par société ou État ce qui constitue le gouvernement, la question est entièrement changée; il ne faut plus demander si la charité étant une vertu pour l'individu, elle n'est pas également une vertu pour la société, mais s'il est juste, moral et avantageux de faire exercer la charité par le gouvernement, ou même s'il est possible que le gouvernement exerce véritablement la charité. Or, c'est ce que nous nions, et c'est ici surtout que se révèle le sophisme qui a abusé M. de Lamartine et tous les partisans sincères de l'assistance légale. Il est bien évident, en effet, que la charité et la fraternité ne sont des vertus que lorsqu'elles sont libres et spontanées chez ceux qui les exercent; la charité légale, et par conséquent forcée, n'est pas une vertu, c'est un impôt; or, un sacrifice imposé aux uns en faveur des autres par la contrainte perd évidemment tout caractère de charité; ce n'est pas le législateur qui en a le mérite, car il ne lui en coûte que de déposer une boule dans une urne; c'est encore moins le pouvoir exécutif ou le collecteur des impôts, puisque, au lieu de donner, ils retiennent une partie du don pour le salaire de leur service; ce n'est pas non plus le contribuable, puisqu'il ne paye qu'à son corps défendant. Où donc trouver dans ce cas les conditions dont la réunion peut seule caractériser la charité: une inspiration bienveillante suivie, chez celui gui l'éprouve, d'un sacrifice volontaire? N'est-ce pas une singulière charité que celle dont les actes ne s'accomplissent qu'à l'aide du percepteur, des huissiers et des gendarmes?
Ces économistes qui, selon M. de Lamartine, n'ont pour religion que l'arithmétique, se sont toujours montrés pénétrés d'une commisération pour les souffrances de leurs semblables tout aussi vive, tout aussi profonde que celle qu'il peut ressentir lui-même, et si l'on scrutait la vie des plus illustres d'entre eux, celle des Quesnay, des Turgot, des Malthus, celle de Smith, de J.-B. Say, de Charles Comte, etc., on y reconnaîtrait une suite d'actes de noble désintéressement, de dévouement à la vérité, à la justice et aux classes malheureuses, dignes d'être offerts en exemple à tous les hommes animés d'une véritable philanthropie.
Les économistes se préoccupent surtout des moyens de procurer à tous une exacte justice et d'atténuer la misère en agissant sur les causes qui la produisent; mais ils savent que les moyens préventifs ne suffiront jamais pour l'anéantir, qu'il y aura toujours dans les sociétés un grand nombre d'individus absolument incapables de s'approprier des produits suffisants pour échapper aux souffrances qu'entraîne l'indigence, et dont la subsistance ne pourra être assurée qu'au moyen de produits crées par d'autres; qu'en conséquence les sentiments de pitié, de bienveillance, de charité, seront toujours indispensables, et qu'on ne saurait leur donner trop de force et de sollicitude lorsqu'il s'agit du soulagement d'infortunes non méritées.
Mais les économistes nient que la charité légale soit un moyen efficace d'entretenir et de développer ces sentiments; ils sont convaincus, au contraire, qu'elle tend sans cesse à les affaiblir, à les effacer, en diminuant en apparence leur nécessité, en ajoutant aux suggestions de l'égoïsme des prétextes plausibles pour combattre les impulsions généreuses; ils sont convaincus que la charité exercée individuellement ou par associations libres serait d'autant plus étendue et plus puissante, que l'État interviendrait moins dans la réunion et la distribution des secours; que cette intervention tend à supprimer le principal stimulant de la charité et la condition qui peut le mieux assurer son efficacité, en détruisant les rapports directs du bienfaiteur et de l'obligé; que, par cette intervention, les individus assistés ne sont tenus à la reconnaissance qu'envers la loi, c'est-à-dire envers personne, et qu'en rendant l'assistance obligatoire pour ceux qui la donnent, on dispose naturellement ceux qui la reçoivent à la considérer comme un droit; que dès lors l'assistance perd tout caractère d'incertitude ou d'éventualité et que les classes pauvres, s'habituant à y compter, s'abandonnent de plus en plus à l'imprévoyance, à la paresse et aux autres vices générateurs de la misère; qu'ainsi la charité légale engendre plus de maux qu'elle ne saurait en soulager.
La charité consiste à s'intéresser aux infortunes d'autrui et à s'imposer des sacrifices pour les atténuer. Lorsqu'elle s'exerce librement, volontairement, elle ne peut offrir aucun danger; les sacrifices se proportionnent généralement aux ressources de ceux qui les font, et nul ne pouvant y compter positivement, ils n'ont pas l'inconvénient d'amoindrir l'effet préventif des sanctions pénales naturellement attachées à l'inconduite, aux habitudes génératrices de la misère. Mais si la charité est imposée par la loi, à quelle limite les sacrifices s'arrêteront-ils? Quelle portion des sanctions pénales dont nous venons de parler laissera-t-elle subsister? Cela dépendra des opinions, des dispositions, du caprice du législateur. M. de Lamartine, par exemple, voulait engager l'État à ouvrir pour âOO millions de travaux publics; mais M. Louis Blanc entendait plus largement la fraternité légale; il voulait que tous les ateliers, toutes les usines fussent expropriés par l'État, pour être mis à la disposition des ouvriers associés. Un autre jour, Barbès et Sobrier, « considérant que la fraternité n'est pas un vain mot et qu'elle doit se manifester par des actes, » 285 décrétaient l'imposition de un milliard d'impôts sur les capitalistes au profit des travailleurs. II est évident que ce principe de fraternité ou d'assistance légale une fois admis, ses conséquences n'ont pas de limites positivement assignables, et qu'elles peuvent aller graduellement jusqu'à dépouiller la moitié de la population au profit de l'autre moitié.
Tels sont les motifs qui ont engagé les économistes à repousser la charité légale et à combattre toutes les mesures qui tendraient à lui donner plus d'extension qu'elle n'en a déjà pris chez nous; mais bien loin qu'ils veuillent par là affaiblir les sentiments de bienveillance, ou restreindre la bienfaisance exercée librement, ils prétendent, au contraire, leur donner plus d'intensité et d'étendue, car ils soutiennent que l'intervention de la loi, loin de rendre les sources de la charité plus abondantes, tend inévitablement à les tarir. L'économie politique n'approuve la régie de l'État ni dans l'exercice de la charité, ni dans les services de l'enseignement, ni dans ceux des cultes, ni dans les travaux industriels; elle soutient et elle prouve que, sans la malheureuse prétention de nos gouvernements de diriger ces diverses branches de l'activité sociale, nous serions plus charitables, plus religieux, mieux instruits et plus industrieux.
54.Horace Say on “The Division of Labour” (1852)↩
[Word Length: 2,454]
Source
Horace Say, "Division du travail," DEP vol. 1, pp. 567-69.
Dictionnaire de l’Économie Politique, contenant l’exposition des principes de la science, l’opinion des écrivains qui ont le plus contribué à sa fondation et à ses progrès, la Bibliographie générale de l’économie politique par noms d’auteurs et par ordre de matières, avec des notices biographiques et une appréciation raisonnée des principaux ouvrages, publié sur la direction de MM. Charles Coquelin et Guillaumin (Paris: Librairie de Guillaumin et Cie, 1852-1853), 2 vols. Volume 1: A-I; Volume 2: J-Z.
Brief Bio of the Author: name (dates)
[name (dates)]
DIVISION DU TRAVAIL.
Le partage des occupations est une conséquence naturelle de la vie des hommes en société. C'est, en outre, un élément de force productive et de développement intellectuel. Dans l'enfance des sociétés, chaque individu, chaque famille, fabrique avec difficulté et d'une manière imparfaite les objets à son usage; le plus sage, le vieillard de la tribu, conserve dans sa tête le trésor, encore bien faible, des connaissances acquises, et tâche de le transmettre par la parole à ceux qui doivent lui survivre. Mais, que les peuplades grandissent et se perfectionnent, et bientôt elles arrivent à sanctionner et fortifier le droit de propriété de chacun sur le fruit de ses œuvres, elles comprennent l'utilité des échanges librement consentis, et dès lors chacun peut se vouer aux occupations pour lesquelles il se sent le plus propre. Il produit, dans la branche de travaux à laquelle il se consacre ainsi, plus de résultats, plus de choses que ce qui lui en est personnellement nécessaire; il lui manque, d'un autre coté, tout ce qu'il ne peut faire par lui-même, et l'échange vient lui fournir le moyen de rétablir l'équilibre; il donne ce qu'il a en excédant contre ce qui lui manque et troque ainsi les services qu'il peut rendre contre ceux dont il a besoin.
Lorsque les peuples deviennent encore plus nombreux et plus éclairés, la division des travaux se prononce de plus en plus. Certains individus se vouent alors à la chasse, à la pêche, à la culture du sol, d'autres aux travaux manufacturiers; il en est encore qui s'adonnent exclusivement à la culture de l'intelligence; ceux-là découvrent les lois de la nature, que Dieu a mises à la disposition des hommes, à charge par eux de les chercher et de trouver ensuite les moyens d'en faire une application utile; par là ils concourent, pour leur part, d'une manière efficace, à la production des richesses, sur l'ensemble desquelles vit la société.
Dans chacune des branches de la production, le partage des attributions s'étend et se ramifie; les cultures s'adaptent à la nature du sol et aux circonstances atmosphériques dans lesquelles les terres sont placées; là se cultivent les céréales, ailleurs la vigne; ici on se livre à l'élève des bestiaux, et ces différents produits s'échangent ensuite entre eux, aussi bien que contre les articles fabriqués.
Dans les industries qui transforment les matières premières en produits manufacturés, la division des occupations est bientôt poussée plus loin encore; l'un travaille le fer, l'autre le bois; d'autres transforment le lin, le chanvre, le coton, en fils et en tissus.
Pour faciliter les échanges, une grande industrie se développe encore, c'est celle qui se charge de mettre tous les produits à la portée des consommateurs, soit par le transport d'un lieu dans un autre, soit par la simple division sur place des marchandises en quantités proportionnées aux besoins individuels; c'est le commerce. Là encore la division des occupations ne tarde pas à s'introduire; ce ne sont pas les mêmes commerçants qui s'occupent des transports maritimes et des transports par voie de terre ou sur les fleuves; ce ne sont pas les mêmes marchande qui vendent l'épicerie, la quincaillerie ou les tissus. Pour faciliter les opérations commerciales, il se crée, en outre, des agents intermédiaires: des banquiers, des agents de change, des courtiers.
On le voit, la division du travail est à la fois une conséquence et une cause du développement des peuples et des progrès qu'ils font dans toutes les branches des connaissances humaines. Elle tend constamment à s'étendre et n'est arrêtée que par le défaut d'étendue même du marché, c'est-à-dire par la limite que les besoins de la population posent à l'écoulement possible de chaque nature de produits.
Dans les campagnes éloignées, où l'on se livre à de grandes cultures, ceux qui travaillent aux champs soignent ensuite, auprès de leurs chaumières, quelques légumes pour leur usage; tandis qu'aux environs des grandes villes, des maraîchers font leur unique profession de cultiver les plantes potagères et les fruits; souvent même ils se livrent à une seule branche du jardinage; il en est qui soignent exclusivement les fleurs et même une seule espèce de fleurs.
Dans un village où la consommation est peu étendue, l'industrie commerciale ne peut se diviser; on y trouve souvent une seule boutique, celle de l'épicier, qui vend en même temps le sucre, le café et la chandelle, la mercerie, des clous, des plumes, de l'encre et du papier; tandis que dans les villes chacune de ces branches devient l'objet d'entreprises commerciales différentes, dont chacune prend même souvent une grande importance. C'est ainsi que s'ouvrent, dans une capitale, de vastes magasins où l'on vend seulement du thé, ou des bougies ou du chocolat.
Mais c'est surtout dans l'industrie manufacturière que la division des occupations a permis d'arriver à de merveilleux résultats, et que son influence est devenue incomparable quant à l'augmentation des valeurs produites. Aussi les premiers économistes qui ont examiné avec un esprit d'analyse le grand mécanisme de la production des richesses ont-ils été des l'abord frappés de ce grand phénomène.
Adam Smith en fait le point de départ de ses Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. « Les plus grandes améliorations, dans la puissance productive du travail, dit-il en commençant son livre, et la plus grande partie de l'habileté, de l'adresse et de l'intelligence avec laquelle il est dirigé ou appliqué, sont dues, a ce qu'il semble, à la division du travail. » Et pour faire comprendre la portée de cette observation, il arrive immédiatement à présenter l'exemple d'une manufacture d'épingles, et montre quelle différence immense il y aurait, entre les résultats du travail d'un homme isolé, qui voudrait fabriquer lui-même des épingles de toute pièce, et ceux que chaque homme obtient dans une manufacture, où le travail est convenablement divisé entre des ouvriers d'aptitudes diverses. Là, ce n'est pas le même homme qui tire le fil de laiton, qui le dresse, qui le coupe, qui aiguise les pointes; c'est un ouvrier spécial qui prépare le bout à recevoir la tête; et cette tête d'épingle est elle-même l'objet de deux ou trois opérations différentes. Il faut ensuite blanchir les épingles; enfin le piquage du papier et l'encartage sont encore des travaux distincts. C'est ainsi que l'important travail de faire une épingle est partagé en dix-huit opérations, lesquelles, dans certaines fabriques, sont remplies par autant de mains diverses. La manufacture qu'avait visitée Adam Smith était, dit-il, peu importante et assez mal outillée; elle occupait seulement dix ouvriers, et l'on y produisait cependant par jour 48 milliers d'épingles, soit en moyenne 4,800 épingles par ouvrier. En présence d'une pareille production, et elle serait bien plus forte encore aujourd'hui à raison des progrès réalisés depuis le temps où Smith écrivait, que seraient les résultats auxquels arriverait l'individu qui voudrait à lui seul fabriquer des épingles; à peine peut-être, à la suite d'un travail pénible, en ferait-il une vingtaine par jour.
J.-B. Say a pris ensuite l'exemple d'une fabrique de cartes à jouer, et il n'est aucune branche de l'industrie où l'on ne puisse ainsi constater l'immense accroissement de productions qui résulte de la mise en commun des efforts individuels par la division des occupations.
Si Smith avait fait remonter plus haut son esprit d'analyse, il aurait pu montrer que bien d'autres opérations partielles s'étaient réparties entre différents travailleurs pour amener à sa perfection ce petit produit de l'industrie humaine, dont la valeur est si minime, et qu'on appelle une épingle. Il aurait pu appeler l'attention sur le travail du mineur, qui amène à la surface du sol le minerai de cuivre, sur celui d'un mineur d'origine et de mœurs différentes, qui, dans une autre partie du monde peut-être, a dû extraire le minerai d'étain, nécessaire pour les alliages et pour le blanchiment de l'épingle. Mais, outre les travaux nécessaires pour amener ces métaux au degré de pureté qu'ils doivent avoir, il a fallu de plus les transporter par eau et par terre jusqu'à la porte de la fabrique d'épingles. Combien d'opérations diverses partagées entre un nombre infini de travailleurs, n'a pas nécessitées la construction seule du navire employé au transport de l'étain, d'un port de l'Inde en Angleterre! Et la boussole qui a été consultée pour diriger ce navire à travers les mers, combien a-t-il fallu de temps et d'observations diverses, séparées entre un grand nombre d'individus, pour que l'humanité fût en possession de cette découverte! L'imagination s'effraye de l'étendue des recherches qu'il faudrait faire pour montrer ainsi tous les travaux qui ont été nécessaires pour amener à sa perfection le moindre des produits quelconques, dans l'une des brandies de l'industrie manufacturière de nos sociétés modernes.
Pour en revenir à l'accroissement de force productive qui résulte dans une manufacture de la division du travail, Adam Smith l'attribue à trois causes: d'abord la plus grande habileté acquise par chaque ouvrier dans un travail simple et souvent répété; ensuite l'économie du temps qui serait perdu en passant d'un travail à un autre; enfin, la facilité donnée à l'esprit, constamment tendu vers un seul but, pour inventer des procédés plus rapides, ou même des machines qui viennent suppléer au travail humain.
Il est hors de doute que les deux premières de ces causes ont un grand effet; l'économie du temps est précieuse en industrie, elle porte à la fois sur le travail individuel de l'ouvrier et sur les capitaux employés dans l'entreprise, les intérêts en sont moins lourds lorsque la rentrée en devient plus prompte.
Quant à l'invention des moyens expéditifs et des machines qui peuvent suppléer au travail humain, la séparation des occupations y conduit sans doute, et l'on cite plus d'un perfectionnement en mécanique dû aux ouvriers mêmes, dont l'invention nouvelle a permis d'économiser et de remplacer le travail. On se plaît à raconter qu'un jeune garçon chargé dans l'origine de tourner, au moment voulu, un robinet de l'une des premières machines à vapeur mise en mouvement, n'avait pas tardé à s'apercevoir qu'une ficelle, attachée à un certain bras du mécanisme, le remplaçait sans inconvénient; il en avait profité pour aller jouer aux billes, et l'invention avait été immédiatement régularisée et appliquée par le mécanicien. Il faut toutefois reconnaître que ce n'est pas seulement à la division des occupations dans l'intérieur des manufactures que sont dues les grandes et nombreuses découvertes faites successivement dans les arts et les sciences. L'honneur en revient plutôt au partage des occupations entre tous les hommes; c'est à cela, c'est à la puissance que peuvent acquérir les esprits, lorsqu'ils s'appliquent à un seul genre d'études, que sont dus les plus grands progrès, c'est-à-dire la découverte de toutes les lois de la nature, et la combinaison des moyens à employer pour en faire l'application au service de l'homme.
Les avantages de la division du travail pour la production des richesses sont donc incontestables; mais pour faire ombre au tableau on n'a pas manqué de signaler les inconvénients qui peuvent en être la suite. Le plus saillant, celui qui était particulièrement de nature à frapper les esprits généreux, est l'effet que peut avoir sur le développement moral de l'ouvrier cette attribution d'un travail simple, toujours le même et incessamment répété. C'est une triste chose, a-t-on dit, pour celui qui touche à la fin de sa carrière de reconnaître que sa vie entière a été consacrée à faire des têtes d'épingles. Ceux qui présentent l'inconvénient de la division sous cette forme dramatique sont, en partie du moins, injustes envers l'humanité. L'homme ne doit pas ainsi être personnifié dans le seul travail, objet de sa profession; en même temps qu'ouvrier il est membre d'une famille, il est citoyen; en dehors du labeur qu'il donne en échange des services qu'il a besoin lui-même qu'on lui rende, il participe à tous les avantages de la grande société au milieu de laquelle il vit; il profite pour sa part de tous les progrès qui se font autour de lui. Dans toutes les professions le travailleur a des instants de repos, et c'est surtout par l'emploi qu'il sait donner à ses moindres moments de loisir que l'homme se perfectionne et arrive à jouir des avantages généraux qui lui sont offerts. Un travail régulier et constamment le même n'éteint pas nécessairement l'intelligence, et le graveur qui pâlit pendant un an ou deux sur la même planche de cuivre ou d'acier pour produire un chef-d'œuvre, ne vit pas uniquement dans les hachures régulières que son burin place à côté les unes des autres.
Ce serait, du reste, rétrécir la question de la division du travail que de la voir et de l'étudier dans l'enceinte seulement d'une manufacture; elle n'est pas moins curieuse à observer dans les petites fabriques d'une grande ville comme Paris. Là, les occupations et les travaux ne sont pas seulement divisés entre les ouvriers, mais encore entre un grand nombre de petits entrepreneurs d'industries travaillant chacun avec un petit capital, dirigeant à leur compte une entreprise et occupant un ou deux ouvriers avec un apprenti. Un seul petit objet de la fabrique parisienne est souvent ainsi le produit de la coopération successive de plusieurs entrepreneurs. Ainsi, la boite d'un nécessaire à ouvrage pour femme est faite par un ébéniste; chacune des pièces qui doivent la garnir est faite par un entrepreneur distinct, un tourneur, un coutelier, un graveur-ciseleur, etc.; et enfin un autre fabricant, sous le titre de garnisseur, réunit tout et dispose l'intérieur du nécessaire. Dans la fabrication des fleurs artificielles, la séparation d'attributions des ouvriers et des entrepreneurs est poussée tout aussi loin. La fabrication de ce qu'on nomme les préparations pour fleurs est très étendue et donne lieu à des entreprises importantes; des fabricants spéciaux font les couleurs, les matrices, gaufrent les étoffes, font les étamines, les graines et les autres accessoires, et tons ces entrepreneurs livrent leurs produits, comme matières préparées, aux monteurs de fleurs; parmi ceux-ci encore, les uns ne font que les boutons, d'autres montent seulement les rosés, d'autres encore des fleurs pour deuil, et ainsi de suite à l'infini. Cette grande division des travaux amène un remarquable bon marché dans les prix, en même temps qu'une grande perfection dans l'exécution. On peut remarquer aussi que dans cette population ouvrière si nombreuse, où chacun a une attribution de travail si peu étendue, la vivacité d'esprit et d'intelligence se développe beaucoup plus que dans les professions où les travaux sont moins partagés.
C'est ainsi que la division du travail facilite et étend considérablement la production; mais elle est en même temps un puissant moyen d'investigation et de développement pour les connaissances humaines, et son influence mérite d'être étudiée par les philosophes, en même temps que par les économistes.
PART V. The Second Empire (1852–70)
55.Augustin Thierry on “The Birth of the Bourgeoisie” (1853)↩
[Word Length: 6,272]
Source
Augustin Thierry, Essai sur l’histoire de la formation et des progrès du Tiers État suivi de deux fragments du recueil des monuments inédits de cette histoire (Paris: Furne et Ce, 1853). Chap. I “Extinction de l’esclavage antique - Fusion des races - Naissance de la Bourgeoisie du moyen âge”, pp. 1-23.
Brief Bio of the Author: Augustin Thierry (1795-1856)
[Augustin Thierry (1795-1856)]
Jacques-Nicolas Augustin Thierry (1795-1856) was a pioneering historian who is famous for his classical liberal class analysis of history and his extensive use of archival records in researching and writing this history. He began as the personal assistant to Saint-Simon (1814-1817) before joining Charles Comte and Charles Dunoyer on their journal Le Censeur européen. It was here that he learned to analyze history using the social and economic theories developed by Comte and Dunoyer via the work of Jean-Baptiste Say. Thierry became interested in the ruling elites which governed nations, how they came to power (often through conquest as the Normans did of Saxon England), and the gradual emergence of free institutions such as the medieval communes and the Third Estate. He was favoured by Guizot and other political leaders of the July Monarchy who encouraged his archival research with an appointment to the Académie des inscriptions et belles lettres (1830) and the editorship of a massive collection of documents published as Recueil des monuments inédits de l’histoire du Tiers état (1850-1870). His collected writings from Le Censeur européen were later published as Dix ans d’études historiques (1834). His other works include Histoire de la conquête de l’Angleterre par les Normands (1825), Lettres sur l’histoire de France (1827), and Essai sur l’histoire de la formation et des progrès du Tiers état (1850). [DMH]
CHAPITRE PREMIER. EXTINCTION DE L'ESCLAVAGE ANTIQUE. — FUSION DES RACES. — NAISSANCE DE LA BOURGEOISIE DU MOYEN AGE.
Sommaire: Rôle historique du tiers état. — Origine de notre civilisation moderne. — La société gallo-romaine et la société barbare. — Les villes et les campagnes; déclin des unes, progrès dans les autres. — Réduction de l'esclavage antique au servage de la glèbe. — Fin de la distinction des races. — Réaction des classes urbaines contre le régime seigneurial. — Formes de municipalité libre. — Naissance de la bourgeoisie. —Influence des villes sur les campagnes.
Il n'y a plus de tiers état en France. le nom et la chose ont disparu dans le renouvellement social de 1789; mais ce troisième des anciens ordres de la nation, le dernier en date et le moindre en puissance, a joué un rôle dont la grandeur, longtemps cachée aux regards les plus pénétrants, apparaît pleinement aujourd'hui. Son histoire, qui désormais peut et doit être faite, n'est au fond que l'histoire même du développement et des progrès de notre société civile, depuis le chaos de mœurs, de lois et de conditions qui suivit la chute de l'empire romain, jusqu'au régime d'ordre, d'unité et de liberté de nos jours.286 Entre ces deux points extrêmes, on voit se poursuivre à travers les siècles la longue et laborieuse carrière par laquelle les classes inférieures et opprimées de la société gallo-romaine, de la société gallo-franke et de la société française du moyen âge, se sont élevées de degré en degré jusqu'à la plénitude des droits civils et politiques, immense évolution qui a fait disparaître successivement du sol où nous vivons toutes les inégalités violentes ou illégitimes, le maître et l'esclave, le vainqueur et le vaincu, le seigneur et le serf, pour montrer enfin à leur place un même peuple, une loi égale pour tous, une nation libre et souveraine.
Tel est le grand spectacle que présente notre histoire au point où la Providence l'a conduite, et là se trouvent pour nous, hommes du XIXe siècle, de nobles sujets de réflexion et d'étude. Les causes et les phases diverses de ce merveilleux changement sont de tous les problèmes historiques celui qui nous touche le plus; il a été depuis vingt-cinq ans l'objet de recherches considérables; et c'est à en préparer la solution qu'est destiné un recueil que je commence,287 mais dont l'étendue exige une suite d'efforts trop longue pour la vie d'un seul homme. Venu le premier de ceux qui mettront la main à cette œuvre, je n'ai vu qu'une partie des innombrables documents que j'ai pour tâche de rassembler; il serait téméraire à moi de vouloir deviner quelle signification doit avoir leur ensemble aux yeux de la science à venir, et je ne l'essaierai pas. Je me bornerai à présenter quelques aperçus provisoires, à marquer, selon mes propres études et l'état de la science contemporaine, les époques les plus distinctes et les points de vue les plus saillants de ce qui sera un jour l'histoire complète de la formation, des progrès et du rôle social du tiers état.
C'est de la dernière forme donnée aux institutions civiles et politiques de l'Empire, de celle qui eut Constantin pour auteur, que procède ce qu'il y a de romain dans nos idées, nos mœurs et nos pratiques légales; là sont les origines premières de notre civilisation moderne. Cette ère de décadence et de ruine pour la société antique fut le berceau de la plupart des principes ou des éléments sociaux, qui, subsistant sous la domination des conquérants germains, et se combinant avec leurs traditions et leurs coutumes nationales, créèrent la société du moyen âge, et, de là, se transmirent jusqu'à nous. On y voit la sanction chrétienne s'ajoutant à la sanction légale pour donner une nouvelle force à l'idée du pouvoir impérial, type de la royauté des temps postérieurs;288 l'esclavage attaqué dans son principe, et miné sourdement ou transformé par le christianisme; enfin le régime municipal, tout oppressif qu'il était devenu, s'imprégnant d'une sorte de démocratie par l'élection populaire du Défenseur et de l'évêque. Quand vint sur la Gaule le règne des Barbares, quand l'ordre politique de l'empire d'Occident s'écroula, trois choses restèrent debout, les institutions chrétiennes, le droit romain à l'état d'usage, et l'administration urbaine. Le christianisme s'imposa aux nouveaux dominateurs, le droit usuel maintint parmi les indigènes les mœurs et les pratiques de la vie civile, et la municipalité, gardienne de ces pratiques, les entoura en leur prêtant, comme une garantie de durée, la force de son organisation.
Après la fin des grandes luttes du IVe et du Ve siècle, soit entre les conquérants germains et les dernières forces de l'empire, soit entre les peuples qui avaient occupé différentes portions de la Gaule, lorsque les Franks sont restés seuls maîtres de ce pays, deux races d'hommes, deux sociétés qui n'ont rien de commun que la religion, s'y montrent violemment réunies, et comme en présence, dans une même agrégation politique. La société gallo-romaine présente, sous la même loi, des conditions très-diverses et très-inégales; la société barbare comprend, avec les classifications de rangs et d'états qui lui sont propres, des lois et des nationalités distinctes. On trouve dans la première des citoyens pleinement libres, des colons, ou cultivateurs attachés aux domaines d'autrui, et des esclaves domestiques privés de tous les droits civils; dans la seconde, le peuple des Franks est partagé en deux tribus ayant chacune sa loi particulière;289 d'autres lois, entièrement différentes, régissent les Burgondes, lesGoths et les autres populations teutoniques soumises de gré ou de force à l'empire frank, et, chez toutes aussi bien que chez les Franks, il y a au moins trois conditions sociales: deux degrés de liberté et la servitude. Entre ces existences disparates, la loi criminelle du peuple dominant établissait, par le tarif des amendes pour crime ou délit contre les personnes, une sorte de hiérarchie, point de départ du mouvement d'assimilation et de transformation graduelle qui, après quatre siècles écoulés du Ve au Xe, fit naître la société des temps féodaux. Le premier rang dans l'ordre civil appartenait à l'homme d'origine franke et au Barbare vivant sous la loi des Franks; au second rang était le Barbare vivant sous sa loi originelle; puis venait l'indigène libre et propriétaire, le Romain possesseur, et, au même degré, le Lite ou colon germanique; puis le Romain tributaire, c'est-à-dire le colon indigène; puis enfin l'esclave sans distinction d'origine.290
Ces classes diverses que séparaient, d'un côté, la distance des rangs, de l'autre, la différence des lois, des mœurs et des langues, étaient loin de se trouver également réparties entre les villes et les campagnes. Tout ce qu'il y avait d'élevé, à quelque titre que ce fut, dans la population gallo-romaine, ses familles nobles, riches, industrieuses, habitaient les villes, entourées d'esclaves domestiques; et, parmi les hommes de cette race, le séjour habituel des champs n'était que pour les colons demi-serfs et pour les esclaves agricoles. Au contraire, la classe supérieure des hommes de race germanique était fixée à la campagne, où chaque famille libre et propriétaire vivait sur son domaine du travail des lites qu'elle y avait amenés, ou des anciens colons qui en dépendaient. Il n'y avait de Germains dans les villes qu'un petit nombre d'officiers royaux et des gens sans famille et sans patrimoine, qui, en dépit de leurs habitudes originelles, cherchaient à vivre en exerçant quelque métier.
La prééminence sociale de la race conquérante s'attacha aux lieux qu'elle habitait, et, comme on l'a déjà remarqué, passa des villes aux campagnes.291 Il arriva même que, par degrés, celles-ci enlevèrent aux autres la tête de leur population, qui, pour s'élever plus haut et se mêler aux conquérants, imita autant qu'elle put leur manière de vivre. Cette haute classe indigène, à l'exception de ceux qui parmi elle exerçaient les fonctions ecclésiastiques, fut en quelque sorte perdue pour la civilisation; elle inclina de plus en plus vers les mœurs de la barbarie, l'oisiveté, la turbulence, l'abus de la force, l'aversion de toute règle et de tout frein. Il n'y eut plus de progrès possible dans les cités de la Gaule pour les arts et la richesse; il n'y resta que des débris à recueillir et à conserver. Le travail de cette conservation, gage d'une civilisation à venir, fut, de ce moment, la tâche commune du clergé et des classes moyenne et inférieure de la population urbaine.
Pendant que la barbarie occupait ou envahissait toutes les sommités de l'ordre social, et que, dans les rangs intermédiaires, la vie civile s'’arrêtait ou déclinait graduellement, au degré le plus bas, à celui de la servitude personnelle, un mouvement d'amélioration, déjà commencé avant la chute de l'empire, continua et se prononça de plus en plus. Le dogme de la fraternité devant Dieu et d'une même rédemption pour tous les hommes, prêché par l'Église aux fidèles de toute race, émut les cœurs et frappa les esprits en faveur de l'esclave, et de là vinrent soit des affranchissements plus nombreux, soit une conduite plus humaine de la part des maîtres, Gaulois ou Germains d'origine. En outre, ces derniers avaient apporté de leur pays, où la vie était rude et sans luxe, des habitudes favorables à un esclavage tempéré. Le riche barbare était servi par des personnes libres, par les fils de ses proches, de ses clients et de ses amis; le penchant de ses mœurs nationales, contraire à celui des mœurs romaines, le portait à reléguer l'esclave hors de sa maison, et à l'établir, comme laboureur ou comme artisan, sur une portion de terre à laquelle il se trouvait fixé, et dont il suivait le sort dans l'héritage et dans la vente.292 L'imitation des mœurs germaines par les nobles gallo-romains fit passer beaucoup d'esclaves domestiques de la ville à la campagne, et du service de la maison au travail des champs. Ainsi casés, comme s'expriment les actes des VIIIe et IXe siècles,293 leur condition devint analogue, bien que toujours inférieure, d'un côté à celle du lite germanique, de l'autre à celle du colon romain.
L'esclavage domestique faisait de la personne une chose, et une chose mobilière; l'esclave attaché à une portion de terre entrait dès lors dans la catégorie des immeubles; en même temps que cette dernière classe, celle des serfs proprement dits s'accroissait aux dépens de la première, la classe des colons et celle des lites durent s'augmenter simultanément, par toutes les chances de ruine et de mauvaise fortune qui, à une époque de troubles continuels, affectaient la condition des hommes libres. De plus, ces deux ordres de personnes, que distinguaient non-seulement des différences légales, mais encore la diversité d'origine, tendirent à se rapprocher l'un de l'autre, et à confondre par degrés leurs caractères essentiels. Ce fut, avec le rapprochement opéré dans les hautes régions sociales entre les Gaulois et les Germains, le premier pas vers la fusion des races, qui devait, après cinq siècles, produire une nation nouvelle.
Au cœur même de la société barbare, ce qui avait primitivement fait sa puissance et sa dignité, la classe des petits propriétaires, diminua et finit par s'éteindre en tombant sous le vasselage ou dans une dépendance moins noble qui tenait plus ou moins de la servitude réelle. Par un mouvement contraire, les esclaves domiciliés sur quelque portion de domaine et incorporés à l'immeuble, s'élevèrent, à la faveur de cette fixité de position et d'une tolérance dont le temps fit un droit pour eux, jusqu'à une condition très-voisine de l'état de lite et de l'état de colon devenus eux-mêmes, sous des noms divers, à peu près identiques. Là se fit la rencontre des hommes libres déchus vers la servitude, et des esclaves parvenus à une sorte de demi-liberté. Il se forma ainsi, dans toute l'étendue de la Gaule, une masse d'agriculteurs et d'artisans ruraux, dont la destinée fut de plus en plus égale, sans être jamais uniforme, et un nouveau travail de création sociale se fit dans les campagnes pendant que les villes étaient stationnaires ou déclinaient de plus en plus. Cette révolution lente et insensible se lia, dans sa marche graduelle, à de grands défrichements du sol exécutés sur l'immense étendue de forêts et de terrains vagues qui, du fisc impérial, avaient passé dans le domaine des rois franks, et dont une large part fut donnée par ces rois en propriété à l'Église et en bénéfice à leurs fidèles.
L'Église eut l'initiative dans cette reprise du mouvement de vie et de progrès; dépositaire des plus nobles débris de l'ancienne civilisation, elle ne dédaigna point de recueillir, avec la science et les arts de l'esprit, la tradition des procédés mécaniques et agricoles. Une abbaye n'était pas seulement un lieu de prière et de méditation, c'était encore un asile ouvert contre l'envahissement de la barbarie sous toutes ses formes. Ce refuge des livres et du savoir abritait des ateliers de tout genre, et ses dépendances formaient ce qu'aujourd'hui nous appelons une ferme modèle;294 il y avait là des exemples d'industrie et d'activité pour le laboureur, l'ouvrier, le propriétaire. Ce fut, selon toute apparence, l'école où s'instruisirent ceux des conquérants à qui l'intérêt bien entendu fit faire sur leurs domaines de grandes entreprises de culture ou de colonisation, deux choses dont la première impliquait alors la seconde.
Sur chaque grande terre dont l'exploitation prospérait, les cabanes des hommes de travail, lites, colons ou esclaves, groupées selon le besoin ou la convenance, croissaient en nombre, se peuplaient davantage, arrivaient à former un hameau. Quand ces hameaux se trouvèrent situés dans une position favorable, près d'un cours d'eau, à quelque embranchement de routes, ils continuèrent de grandir, et devinrent des villages où tous les métiers nécessaires à la vie commune s'exerçaient sous la même dépendance. Bientôt, la construction d'une église érigeait le village en paroisse, et par suite la nouvelle paroisse prenait rang parmi les circonscriptions rurales.295 Ceux qui l'habitaient, serfs ou demi-serfs attachés au même domaine, se voyaient liés l'un à l'autre par le voisinage et la communauté d'intérêts; de là naquirent, sous l'autorité de l'intendant unie à celle du prêtre, des ébauches toutes spontanées d'organisation municipale, où l'Église reçut le dépôt des actes qui, selon le droit romain, s'inscrivaient sur les registres de la cité. C'est ainsi qu'en dehors des municipes, des villes et des bourgs, où subsistaient, de plus en plus dégradés, les restes de l'ancien état social, des éléments de rénovation se formaient pour l'avenir, par la mise en valeur de grands espaces de terre inculte, par la multiplication des colonies de laboureurs et d'artisans, et par la réduction progressive de l'esclavage antique au servage de la glèbe.
Cette réduction, déjà très-avancée au IXe siècle, s'acheva dans le cours du Xe. Alors disparut la dernière classe de la société gallo-franke, celle des hommes possédés à titre de meubles, vendus, échangés, transportés d'un lieu à l'autre comme toutes les choses mobilières. L'esclave appartint à la terre plutôt qu'à l'homme; son service arbitraire se changea en redevances et en travaux réglés; il eut une demeure fixe, et, par suite, un droit de jouissance sur le sol dont il dépendait.296 Ce fut le premier trait par où se marqua dans l'ordre civil l'empreinte originale du monde moderne; le mot serf prit de là son acception définitive; il devint le nom générique d'une condition mêlée de servitude et de liberté, dans laquelle se confondirent l'état de colon et l'état de lite, deux noms qui, au Xe siècle, se montrent de plus en plus rares et disparaissent totalement. Ce siècle où vint aboutir tout le travail social des quatre siècles écoulés depuis la conquête franke, vit se terminer par une grande révolution la lutte intestine des moeurs romaines et des mœurs germaniques. Celles-ci l'emportèrent définitivement, et de leur victoire sortit le régime féodal, c'est-à-dire une nouvelle forme de l'État, une nouvelle constitution de la propriété et de la famille, le morcellement de la souveraineté et de la juridiction, tous les pouvoirs publics transformés en priviléges domaniaux, l'idée de noblesse attachée à l'exercice des armes, et celle d'ignobilité à l'industrie et au travail.
Par une singulière coïncidence, l'établissement complet de ce régime est l'époque où finit dans la Gaule franke la distinction des races, où disparaissent, entre Barbares et Romains, entre dominateurs et sujets, toutes les conséquences légales de la diversité d'origine. Le droit cesse d'être personnel et devient local; les codes germaniques et le code romain lui-même, sont remplacés par des coutumes; c'est le territoire, non la descendance, qui distingue les habitants du sol gaulois; enfin, au lieu de nationalités diverses, on ne trouve plus qu'une population mixte à laquelle l'historien peut donner dès lors le nom de Française. Cette nouvelle société, fille de la précédente, s'en détacha fortement par sa physionomie et ses instincts; son caractère fut de tendre au fractionnement indéfini sous le rapport politique, et à la simplification sous le rapport social. D'un côté, les seigneuries, États formés au sein de l'État, se multiplièrent: de l'autre il y eut effort continu et en quelque sorte systématique pour réduire toutes les conditions à deux classes de personnes: la première, libre, oisive, toute militaire, ayant, sur ses fiefs grands ou petits, le droit de commandement, d'administration et de justice; la seconde, vouée à l'obéissance et au travail, soumise plus ou moins étroitement, sauf l'esclavage, à des liens de sujétion privée.297 Si les choses humaines arrivaient toujours au but que marque leur tendance logique, tout reste de vie civile se serait éteint par l'invasion d'un régime qui avait pour type la servitude domaniale. Mais ce régime, né dans les campagnes sous l'influence des mœurs germaniques, rencontra dans les villes, où se continuait obscurément la tradition des mœurs romaines, une répugnance invincible et une force qui plus tard, réagissant elle-même, éclata en révolutions.
La longue crise sociale qui eut pour dernier terme l'avénement de la féodalité, changea, dans toutes les choses de l'ordre civil et politique, la jouissance précaire en usage permanent, l'usufruit en propriété, le pouvoir délégué en privilége personnel, le droit viager en droit héréditaire. Il en fut des honneurs et des offices comme des possessions de tout genre; et ce qui eut lieu pour la tenure noble se fit en même temps pour la tenure servile. Selon la remarque neuve et très-judicieuse d'un habile critique des anciens documents de notre histoire, « le serf soutint contre son maître la lutte soutenue par le vassal contre son seigneur, et par les seigneurs contre le roi. »298 Quelque grande que fût la différence des situations et des forces, il y eut, de ces divers côtés, une même tentative, suivie de succès analogues.
Au VIIIe siècle, les serfs de la glèbe pouvaient être distribués arbitrairement sur le domaine, transférés d'une portion de terre à l'autre, réunis dans la même case ou séparés l'un de l'autre, selon les convenances du maître, sans égard aux liens de parenté, s'il en existait entre eux; deux siècles plus tard, on les voit tous casés par familles; leur cabane et le terrain qui l'avoisine sont devenus pour eux un héritage. Cet héritage, grevé de cens et de services, ne peut être ni légué ni vendu, et la famille serve a pour loi de ne s'allier par des mariages qu'aux familles de même condition attachées au même domaine. Les droits de mainmorte et de formariage restèrent au seigneur comme sa garantie contre le droit de propriété laissé au serf. Tout odieux qu'ils nous paraissent, ils eurent, non-seulement leur raison légale, mais encore leur utilité pour le progrès à venir. C'est sous leur empire que l'isolement de la servitude cessa dans les campagnes, remplacé par l'esprit de famille et d'association, et qu'à l'ombre du manoir seigneurial, se formèrent des tribus agricoles, destinées à devenir la base de grandes communautés civiles.
En lisant avec attention les chartes et les autres documents historiques, on peut suivre, du commencement du IXe siècle à la fin du Xe, les résultats successifs de la prescription du sol entre les mains de ceux qui le cultivaient; on voit le droit du serf sur sa portion de terre naître, puis s'étendre et devenir plus fixe à chaque nouvelle génération. A ce changement qui améliore par degrés l'état des laboureurs et des artisans ruraux, se joint dans la même période l'accélération du mouvement qui, depuis trois siècles, changeait la face des campagnes, par la formation de villages nouveaux, l'agrandissement des anciens et l'érection d'églises paroissiales, centres de nouvelles circonscriptions à la fois religieuses et politiques. Des causes extérieures et purement fortuites contribuèrent à ce progrès; les dévastations des Normands et la crainte qu'elles inspiraient firent ceindre de murailles et de défenses les parties habitées des grands domaines; d'un côté, elles multiplièrent les châteaux, de l'autre, elles accrurent beaucoup le nombre des bourgs fortifiés.
La population laborieuse et dépendante s'aggloméra dans ces lieux de refuge, dont les habitants passèrent alors de la vie rurale proprement dite à des commencements plus ou moins grossiers de vie urbaine. Le régime purement domanial s'altéra par le mélange de certaines choses ayant le caractère d'institutions publiques; pour le soin de la police et le jugement des délits de peu d'importance, les villageois servirent d'aides et d'assesseurs à l'intendant, et cet officier, pris parmi eux et de même condition qu'eux, devint une sorte de magistrat municipal. Ainsi, du droit de propriété joint à l'esprit d'association, sortirent pour ces petites sociétés naissantes les premiers éléments de l'existence civile; l'instinct du bien-être qui ne se repose jamais les conduisit bientôt plus avant. Dès le commencement du XIe siècle, les habitants des bourgs et des bourgades, les villains, comme on disait alors, ne se contentaient plus de l'état de propriétaires non libres, ils aspiraient à autre chose; un besoin nouveau, celui de se décharger d'obligations onéreuses, d'affranchir la terre, et avec celle-ci les personnes, ouvrit devant eux une nouvelle carrière de travaux et de combats.
Parmi les notions qui à cette époque formaient ce qu'on peut nommer le fonds des idées sociales, il y avait, en regard de la liberté noble, toute de privilége, dérivée de la conquête et des mœurs germaniques, l'idée d'une autre liberté, conforme au droit naturel, accessible à tous, égale pour tous, à laquelle on aurait pu donner, d'après son origine, le nom de liberté romaine. Si ce nom était hors d'usage,299 la chose elle-même, c'est-à-dire l'état civil des personnes habitant les anciennes villes municipales, n'avait point encore péri. Tout menacé qu'il était par la pression toujours croissante des institutions féodales, on le retrouvait dans ces villes, plus ou moins intact, et, avec lui, comme signe de sa persistance, le vieux titre de citoyen. C'est de là que venait, pour les villes de fondation récente, l'exemple de la communauté urbaine, de ses règles et de ses pratiques, et c'est là que s'adressait, pour trouver des encouragements et une espérance, l'ambition des hommes qui, sortis de la servitude, se voyaient parvenus à mi-chemin vers la liberté.
Quels étaient, au Xe siècle, dans les cités gallo-frankes, la puissance et le caractère du régime municipal? La solution de ce problème est l'un des fondements de notre histoire; mais l'on ne peut encore la donner précise et complète. Un point se trouve mis hors de doute, c'est qu'alors la population urbaine joignait à sa liberté civile immémoriale, une administration intérieure, qui, depuis les temps romains et par différentes causes, avait subi de grands changements. Ces modifications très-diverses et, pour ainsi dire, capricieuses quant à la forme, avaient, pour le fond, produit partout des résultats analogues. Le régime héréditaire et aristocratique de la curie s'était, par une suite d'altérations progressives, transformé en gouvernement électif, et, à différents degrés, populaire. La juridiction des officiers municipaux outrepassait de beaucoup ses anciennes limites; elle avait pris des accroissements considérables en matière civile et criminelle. Entre le collége des magistrats et le corps entier des citoyens, on ne voyait plus, existant de droit, une corporation intermédiaire; tous les pouvoirs administratifs procédaient uniquement de la délégation publique, et leur durée se trouvait, en général, réduite au terme d'un an. Enfin, par suite de la haute influence que dès l'époque romaine les dignitaire's de l'Église possédaient sur les affaires intérieures des villes, le Défenseur, magistrat suprême, était tombé sous la dépendance de l'évêque; il était devenu à son égard un subalterne, ou avait disparu devant lui; révolution opérée sans aucun trouble, par la seule popularité de l'épiscopat, et dont la pente naturelle tendait à constituer, au détriment de la liberté civile et politique, une sorte d'autocratie municipale.300
Une certaine confusion s’introduisant peu à peu dans les idées sur la source de l'autorité et de la juridiction urbaines, on cessa de voir nettement de qui elles émanaient, si c'était du peuple ou de l'évêque. Une lutte sourde commença dès lors entre les deux principes de la municipalité libre et de la prépondérance épiscopale; puis la féodalité vint, et agit de toute sa force au profit de ce dernier principe. Elle donna une nouvelle forme au pouvoir temporel des évêques; elle appliqua au patronage civique, dégénéré en quasi-souveraineté, les institutions et tous les priviléges delà seigneurie domaniale. Le gouvernement des municipes, en dépit de son origine, se modela graduellement sur le régime des cours et des châteaux. Les citoyens notables devenaient vassaux héréditaires de l'église cathédrale, et, à ce titre, ils opprimaient la municipalité ou en absorbaient tous les pouvoirs. Les corporations d'arts et métiers, chargées par abus de prestations et de corvées, tombaient dans une dépendance presque servile. Ainsi, la condition faite aux hommes de travail sur les domaines des riches et dans les nouveaux bourgs qu'une concession expresse n'avait pas affranchis, tendait, par le cours même des choses, à devenir universelle, à s'imposer aux habitants, libres jusque-là, des anciennes villes municipales.
Il y eut des cités où la seigneurie de l'évêque s'établit sans partage et resta dominante; il y en eut où le pouvoir féodal fut double, et se divisa entre la puissance ecclésiastique et celle de l'officier royal, comte ou vicomte. Dans les villes qui furent le théâtre plus ou moins orageux de cette rivalité, l'évêque, sentant le besoin d'une alliance politique, se détacha moins de la municipalité libre ou se replia sur elle. Il lui prêta son appui contre les envahissements du pouvoir laïque; il se fit conservateur du principe électif, et ce concours, s'il n'arrêta pas la décadence municipale, devint plus tard un moyen de réaction civile et de rénovation constitutionnelle. Le Xe siècle et le siècle suivant marquent, pour la population urbaine, le dernier terme d'abaissement et d'oppression; elle était, sinon la classe la plus malheureuse, du moins celle qui devait souffrir le plus impatiemment le nouvel état social, car elle n'avait jamais été ni esclave ni serve, elle avait des libertés héréditaires et l'orgueil que donnent les souvenirs. La ruine de ces institutions, qui nulle part ne fut complète, n'eut point lieu sans résistance; et quand on remue à fond les documents de notre histoire, on y rencontre, antérieurement au XIIe siècle, la trace d'une lutte bourgeoise contre les pouvoirs féodaux. C'est durant cette ère de troubles et de retour à une sorte de barbarie, que s'opéra la fusion, dans un même ordre et dans un même esprit, de la portion indigène et de la portion germanique des habitants des villes gauloises, et que se forma entre eux un droit commun, des coutumes municipales, composées à différents degrés, suivant les zones du territoire, d'éléments de tradition romaine et de débris des anciens codes barbares.
Cette crise dans l'état de la société urbaine, reste vivant du monde romain n'était pas bornée à la Gaule; elle avait lieu en Italie avec des chances bien meilleures pour les villes de ce pays, plus grandes, plus riches, plus rapprochées l'une de l'autre. C'est là que dans la dernière moitié du XIe siècle, à la faveur des troubles causés par la querelle du sacerdoce et de l'empire, éclata le mouvement révolutionnaire qui, de proche en proche ou par contre-coup, fit renaître, sous de nouvelles formes et avec un nouveau degré d'énergie, l'esprit d'indépendance municipale. Sur le fonds plus ou moins altéré de leurs vieilles institutions romaines, les cités de la Toscane et de la Lombardie construisirent un modèle d'organisation politique, où le plus grand développement possible de la liberté civile se trouva joint au droit absolu de juridiction, à la puissance militaire, à toutes les prérogatives des seigneuries féodales. Elles créèrent des magistrats à la fois juges, administrateurs et généraux; elles eurent des assemblées souveraines où se décrétaient la guerre et la paix; leurs chefs électifs prirent le nom de Consuls.301
Le mouvement qui faisait éclore et qui propageait ces constitutions républicaines, ne tarda pas à pénétrer en Gaule par les Alpes et par la voie de mer. Dès le commencement du XIIe siècle, on voit la nouvelle forme de gouvernement municipal, le consulat, apparaître successivement dans les villes qui avaient le plus de relations commerciales avec les villes d'Italie, ou le plus d'affinité avec elles par les mœurs, l'état matériel, toutes les conditions de la vie civile et politique. Des villes principales où elle fut établie, soit de vive force, soit de bon accord entre les citoyens et le seigneur, la constitution consulaire s'étendit par degrés aux villes de moindre importance. Cette espèce de propagande embrassa le tiers méridional de la France actuelle, pendant que, sous une zone différente, au nord et au centre du pays, la même impulsion des esprits, les mêmes causes sociales, produisaient de tout autres effets.
A l'extrémité du territoire, sur des points que ne pouvait atteindre l'influence italienne, un second type de constitution, aussi neuf, aussi énergique, mais moins parfait que l'autre, la commune jurée, naquit spontanément par l'application faite au régime municipal d'un genre d'association dont la pratique dérivait des moeurs germaines.302 Appropriée à l'état social, au degré de civilisation et aux traditions mixtes des villes de la Gaule septentrionale, cette forme de municipalité libre se propagea du nord au sud, en même temps que l'organisation consulaire se propageait du sud au nord. Des deux côtés, malgré la différence des procédés et des résultats, l'esprit fut le même, esprit d'action, de dévouement civique et d'inspiration créatrice. Les deux grandes formes de constitution municipale, la commune proprement dite303 et la cité régie par des consuls, eurent également pour principe l'insurrection plus ou moins violente, plus ou moins contenue, et pour but l'égalité des droits et la réhabilitation du travail. Par l'une et par l'autre, l'existence urbaine fut non-seulement restaurée, mais renouvelée; les villes acquirent la garantie d'un double état de liberté; elles devinrent personnes juridiques selon l'ancien droit civil, et personnes juridiques selon le droit féodal; c'est-à-dire qu'elles n'eurent pas simplement la faculté de gérer les intérêts de voisinage, celle de posséder et d'aliéner, mais qu'elles obtinrent de droit, dans l'enceinte de leurs murailles, la souveraineté que les seigneurs exerçaient sur leurs domaines.
Les deux courants de la révolution municipale, qui marchaient l'un vers l'autre, ne se rencontrèrent pas d'abord; il y eut entre eux une zone intermédiaire, où l'ébranlement se fit sentir sans aller jusqu'à la réforme complète, au renouvellement constitutionnel. Dans la partie centrale de la Gaule, d'anciens municipes, des villes considérables, s'affranchirent du joug seigneurial par des efforts successifs, qui leur donnèrent une administration plus ou moins libre, plus ou moins démocratique, mais ne tenant rien ni de la commune jurée des villes du Nord, ni du consulat des villes du Midi. Quelques-unes reproduisirent dans le nombre de leurs magistrats électifs des combinaisons analogues à celles qu'avait présentées le régime des curies gallo-romaines; d'autres affectèrent dans leur constitution un mode uniforme, le gouvernement de quatre personnes choisies chaque année par la généralité des citoyens, et exerçant le pouvoir administratif et judiciaire seules ou avec l'assistance d'un certain nombre de notables.304 Il y avait là des garanties de liberté civile et de liberté politique; mais quoique ces villes, moins audacieuses en fait d'innovation, eussent réussi à dégager de ses entraves le principe de l'élection populaire, l'indépendance municipale y demeura sous beaucoup de rapports faible et indécise; la vigueur et l'éclat furent pour les constitutions nouvelles, pour le régime consulaire et la commune jurée, suprême expression des instincts libéraux de l'époque.
Cette révolution complète, à laquelle échappèrent de vieilles cités municipales, pénétra sous l'une ou l'autre de ses deux formes dans beaucoup de villes de fondation postérieure aux temps romains. Quelquefois même, quand la cité se trouvait côte à côte avec un grand bourg né sous ses murs, il arriva que ce fut dans le bourg, et pour lui seul, que s'établit soit le consulat, soit le régime de l'association jurée.305 Alors, comme toujours, l'esprit de rénovation souffla où il voulut, sa marche sembla réglée sur certains points, et sur d'autres capricieuse; ici il rencontra des facilités inespérées, là des obstacles inattendus l'arrêtèrent. Les chances furent diverses et le succès inégal dans la grande lutte des bourgeois contre les seigneurs; et non-seulement la somme des garanties arrachées de force ou obtenues de bon accord ne fut point la même partout, mais, jusque sous les mêmes formes politiques, il y eut pour les villes différents degrés de liberté et d'indépendance. On peut dire que la série des révolutions municipales du XIIe siècle offre quelque chose d'analogue au mouvement qui, de nos jours, a propagé en tant de pays le régime constitutionnel.306 L'imitation y joua un rôle considérable; la guerre et la paix, les menaces et les transactions, l'intérêt et la générosité eurent leur part dans l'événement définitif. Les uns, du premier élan, arrivèrent au but, d'autres, tout près de l'atteindre, se virent ramenés en arrière; il y eut de grandes victoires et de grands mécomptes, et souvent les plus nobles efforts, une volonté ardente et dévouée, se déployèrent sans aucun fruit ou n'aboutirent qu'à peu de chose.307
Au-dessus de la diversité presque infinie des changements qui s'accomplissent au XIIe siècle dans l'état des villes grandes ou petites, anciennes ou récentes, une même pensée plane, pour ainsi dire, celle de ramener au régime public de la cité tout ce qui était tombé par abus ou vivait par coutume sous le régime privé du domaine. Cette pensée féconde ne devait pas s'arrêter aux bornes d'une révolution municipale; en elle était le germe d'une série de révolutions destinées à renverser de fond en comble la société féodale, et à faire disparaître jusqu'à ses moindres vestiges. Nous sommes ici à l'origine du monde social des temps modernes; c'est dans les villes affranchies, ou plutôt régénérées, qu'apparaissent, sous une grande variété de formes, plus ou moins libres, plus ou moins parfaites, les premières manifestations de son caractère. Là se développent et se conservent isolément des institutions qui doivent un jour cesser d'être locales, et entrer dans le droit politique ou le droit civil du pays. Par les chartes de communes, les chartes de coutumes et les statuts municipaux, la loi écrite reprend son empire; l'administration, dont la pratique s'était perdue, renaît dans les villes, et ses expériences de tous genres, qui se répètent chaque jour dans une foule de lieux différents, servent d'exemple et de leçon à l'État. La bourgeoisie, nation nouvelle dont les mœurs sont l'égalité civile et l'indépendance dans le travail, s'élève entre la noblesse et le servage, et détruit pour jamais la dualité sociale des premiers temps féodaux. Ses instincts novateurs, son activité, les capitaux qu'elle accumule, sont une force qui réagit de mille manières contre la puissance des possesseurs du sol, et, comme aux origines de toute civilisation, le mouvement recommence par la vie urbaine.
L'action des villes sur les campagnes est l'un des grands faits sociaux du XIIe et du XIIIe siècle; la liberté municipale, à tous ses degrés, découla des unes sur les autres, soit par l'influence de l'exemple et la contagion des idées, soit par l'effet d'un patronage politique ou d'une agrégation territoriale. Non-seulement les bourgs populeux aspirèrent aux franchises et aux priviléges des villes fermées, mais, dans quelques lieux du nord, on vit la nouvelle constitution urbaine, la commune jurée, s'appliquer, tant bien que mal, à de simples villages ou à des associations d'habitants de plusieurs villages.308 Les principes de droit naturel qui, joints aux souvenirs de l'ancienne liberté civile, avaient inspiré aux classes bourgeoises leur grande révolution, descendirent dans les classes agricoles, et y redoublèrent, par le tourment d'esprit, les gênes du servage et l'aversion de la dépendance domaniale. N'ayant guère eu jusque-là d'autre perspective que celle d'être déchargés des services les plus onéreux, homme par homme, famille par famille, les paysans s'élevèrent à des idées et à des volontés d'un autre ordre; ils en vinrent à demander leur affranchissement par seigneuries et par territoires, et à se liguer pour l'obtenir. Ce cri d'appel au sentiment de l'égalité originelle: Nous sommes hommes comme eux,309 se fit entendre dans les hameaux et retentit à l'oreille des seigneurs, qu'il éclairait en les menaçant. Des traits de fureur aveugle et de touchante modération signalèrent cette nouvelle crise dans l'état du peuple des campagnes; une foule de serfs, désertant leurs tenures, se livraient par bandes à la vie errante et au pillage; d'autres, calmes et résolus, négociaient leur liberté, offrant de donner pour elle, disent les chartes, le prix qu'on voudrait y mettre.310 La crainte de résistances périlleuses, l'esprit de justice et l'intérêt, amenèrent les maîtres du sol à transiger, par des traités d'argent, sur leurs droits de tout genre et leur pouvoir immémorial. Mais ces concessions, quelque larges qu'elles fussent, ne pouvaient produire un changement complet ni général; les obstacles étaient immenses, c'était tout le régime de la propriété foncière à détruire et à remplacer; il n'y eut point à cet égard de révolution rapide et sympathique comme pour la renaissance des villes municipales; l'œuvre lut longue, il ne fallut pas moins de six siècles pour l'accomplir.
56.Tocqueville on “The Centralisation of the State in France” (1856)↩
[Word Length: 10,743]
Source
Alexis de Tocqueville, L'Ancien Régime et la Révolution (Paris: Michel Lévy frères, 1856). Livre II, Chap. II. "Que la centralisation administrative est une institution de l'ancien régime, et non pas l'oeuvre de la Révolution ni de l'Empire, comme on le dit," pp. 49-63; Chap. III. "Comment ce qu'on appelle aujourd'hui la tutelle administrative est une institution de l'ancien régime," pp. 65-80; Chap. V. "Comment la centralisation avait pu s'introduire ainsi au milieu des anciens pouvoirs et les supplanter sans les détruire", pp. 89-94; Chap. XIX. "Comment une grande révolution administrative avait précédé la révolution politique, et des conséquences que cela eut", pp. 295-310 [extract pp. 307-10].
LIVRE II. CHAPITRE II. Que la centralisation administrative est une institution de l'ancien régime, et non pas l'oeuvre de la Révolution ni de l'Empire, comme on le dit.
J'ai entendu jadis un orateur, dans le temps où nous avions des assemblées politiques en France, qui disait, en parlant de la centralisation administrative: « Cette belle conquête de la Révolution, que l'Europe nous envie. » Je veux bien que la centralisation soit une belle conquête, je consens à ce que l'Europe nous l'envie, mais je soutiens que ce n'est point une conquête de la Révolution. C'est, au contraire, un produit de l'ancien régime, et, j'ajouterai, la seule portion de la constitution politique de l'ancien régime qui ait survécu à la Révolution, parce que c'était la seule qui pût s'accommoder de l'état social nouveau que cette Révolution a créé. Le lecteur qui aura la patience de lire attentivement le présent chapitre trouvera peut-être que j'ai surabondamment prouvé ma thèse.
Je prie qu'on me permette d'abord de mettre à part
ce qu'on appelait les pays d'état, c'est-à-dire les provinces qui s'administraient, ou plutôt avaient l'air de s'administrer encore en partie elles-mêmes.
Les pays d'état, placés aux extrémités du royaume, ne contenaient guère que le quart de la population totale de la France, et, parmi eux, il n'y en avait que deux où la liberté provinciale fût réellement vivante. Je reviendrai plus tard aux pays d'état, et je montrerai jusqu'à quel point le pouvoir central les avait assujettis eux-mêmes aux règles communes.311
Je veux m'occuper principalement ici de ce qu'on nommait dans la langue administrative du temps les pays d'élection, quoiqu'il y eût là moins d'élections que nulle part ailleurs. Ceux-là enveloppaient Paris de toute part; ils se tenaient tous ensemble, et formaient le cœur et la meilleure partie du corps de la France.
Quand on jette un premier regard sur l'ancienne administration du royaume, tout y paraît d'abord diversité de règles et d'autorité, enchevêtrement de pouvoirs. La France est couverte de corps administratifs ou de fonctionnaires isolés qui ne dépendent pas les uns des autres, et qui prennent part au gouvernement en vertu d'un droit qu'ils ont acheté et qu'on ne peut leur reprendre. Souvent leurs attributions sont si entremêlées et si contiguës qu'ils se pressent et s'entre-choquent dans le cercle des mêmes affaires.
Des cours de justice prennent part indirectement à la puissance législative; elles ont le droit de faire des règlements administratifs qui obligent dans les limites de leur ressort. Quelquefois elles tiennent tête à l'administration proprement dite, blâment bruyamment ses mesures et décrètent ses agents. De simples juges font des ordonnances de police dans les villes et dans les bourgs de leur résidence.
Les villes ont des constitutions très-diverses. Leurs magistrats portent des noms différents, ou puisent leurs pouvoirs à différentes sources: ici un maire, là des consuls, ailleurs des syndics. Quelques-uns sont choisis par le roi, quelques autres par l'ancien seigneur ou le prince apanagiste; il y en a qui sont élus pour un an par leurs concitoyens, et d'autres qui ont acheté le droit de gouverner ceux-ci à perpétuité.
Ce sont là les débris des anciens pouvoirs; mais il s'est établi peu à peu au milieu d'eux une chose comparativement nouvelle ou transformée, qui me reste à peindre.
Au centre du royaume et près du trône s'est peu à peu formé un corps administratif d'une puissance singulière, et dans le sein duquel tous les pouvoirs se réunissent d'une façon nouvelle, le conseil du roi.
Son origine est antique, mais la plupart de ses fonctions sont de date récente. Il est tout à la fois: cour suprême de justice, car il a le droit de casser les arrêts de tous les tribunaux ordinaires; tribunal supérieur administratif: c'est de lui que ressortissent en dernier ressort toutes les juridictions spéciales. Comme conseil du gouvernement, il possède en outre, sous le bon plaisir du roi, la puissance législative, discute et propose la plupart des lois, fixe et répartit les impôts. Comme conseil supérieur d'administration, c'est à lui d'établir les règles générales qui doivent diriger les agents du gouvernement. Lui-même décide toutes les affaires importantes et surveille les pouvoirs secondaires. Tout finit par aboutir à lui, et de lui part le mouvement qui se communique à tout. Cependant il n'a point de juridiction propre. C'est le roi qui seul décide, alors même que le conseil semble prononcer. Même en ayant l'air de rendre la justice, celui-ci n'est composé que de simples donneurs d'avis, ainsi que le dit le parlement dans une de ses remontrances.
Ce conseil n'est point composé de grands seigneurs, mais de personnages de médiocre ou de basse naissance, d'anciens intendants et autres gens consommés dans la pratique des affaires, tous révocables.
Il agit d'ordinaire discrètement et sans bruit, montrant toujours moins de prétentions que de pouvoir. Aussi n'a-t-il par lui-même aucun éclat; ou plutôt il se perd dans la splendeur du trône dont il est proche, si puissant qu'il touche à tout, et en même temps si obscur que c'est à peine si l'histoire le remarque.
De même que toute l'administration du pays est dirigée par un corps unique, presque tout le maniement des affaires intérieures est confié aux soins d'un seul agent, le contrôleur général.
Si vous ouvrez un almanach de l'ancien régime, vous y trouvez que chaque province avait son ministre particulier; mais, quand on étudie l'administration dans les dossiers , on aperçoit bientôt que le ministre de la province n'a que quelques occasions peu importantes d'agir. Le train ordinaire des affaires est mené par le contrôleur général; celui-ci a attiré peu à peu à lui toutes les affaires qui donnent lieu à des questions d'argent, c'est-à-dire l'administration publique presque tout entière. On le voit agir successivement comme ministre des finances, ministre de l'intérieur, ministre des travaux publics, ministre du commerce.
De même que l'administration centrale n'a, à vrai dire, qu'un seul agent à Paris, elle n'a qu'un seul agent dans chaque province. On trouve encore, au dix-huitième siècle, de grands seigneurs qui portent le nom de gouverneurs de province. Ce sont les anciens représentants, souvent héréditaires, de la royauté féodale. On leur accorde encore des honneurs, mais ils n'ont plus aucun pouvoir. L'intendant possède toute la réalité du gouvernement.
Celui-ci est un homme de naissance commune, toujours étranger à la province, jeune, qui a sa fortune à faire. Il n'exerce point ses pouvoirs par droit d'élection, de naissance ou d'office acheté; il est choisi par le gouvernement parmi les membres inférieurs du conseil d'État et toujours révocable. Séparé de ce corps, il le représente, et c'est pour cela que, dans la langue administrative du temps, on le nomme le commissaire départi. Dans ses mains sont accumulés presque tous les pouvoirs que le conseil lui-même possède; il les exerce tous en premier ressort. Comme ce conseil, il est tout à la fois administrateur et juge. L'intendant correspond avec tous les ministres; il est l'agent unique, dans la province, de toutes les volontés du gouvernement.
Au-dessous de lui, et nommé par lui, est placé dans chaque canton un fonctionnaire révocable à volonté, le subdélégué. L'intendant est d'ordinaire un nouvel anobli; le subdélégué est toujours un roturier. Néanmoins il représente le gouvernement tout entier dans la petite circonscription qui lui est assignée, comme l'intendant dans la généralité entière. Il est soumis à l'intendant, comme celui-ci au ministre.
Le marquis d'Argenson raconte, dans ses Mémoires, qu'un jour Law lui dit: « Jamais je n'aurais cru ce que j'ai vu quand j'étais contrôleur des finances. Sachez que ce royaume de France est gouverné par trente intendants. Vous n'avez ni parlement, ni états, ni gouverneurs; ce sont trente maîtres des requêtes commis aux provinces de qui dépendent le malheur ou le bonheur de ces provinces, leur abondance ou leur stérilité. »
Ces fonctionnaires si puissants étaient pourtant éclipsés par les restes de l'ancienne aristocratie féodale et comme perdus au milieu de l'éclat qu'elle jetait encore; c'est ce qui fait que, de leur temps même, on les voyait à peine, quoique leur main fût déjà partout. Dans la société, les nobles avaient sur eux l'avantage du rang, de la richesse et de la considération qui s'attache toujours aux choses anciennes. Dans le gouvernement, la noblesse entourait le prince et formait sa cour; elle commandait les flottes, dirigeait les armées; elle faisait, en un mot, ce qui frappe le plus les yeux des contemporains et arrête trop souvent les regards de la postérité. On eût insulté un grand seigneur en lui proposant de le nommer intendant; le plus pauvre gentilhomme de race aurait le plus souvent dédaigné de l'être. Les intendants étaient à ses yeux les représentants d'un pouvoir intrus, des hommes nouveaux, préposés au gouvernement des bourgeois et des paysans, et, au demeurant, de fort petits compagnons. Ces hommes gouvernaient cependant la France, comme avait dit Law et comme nous allons le voir.
Commençons d'abord par le droit d'impôt, qui contient en quelque façon en lui tous les autres.
On sait qu'une partie des impôts était en ferme: pour ceux-là, c'était le conseil du roi qui traitait avec les compagnies financières, fixait les conditions du contrat et réglait le mode de la perception. Toutes les autres taxes, comme la taille, la capitation et les vingtièmes, étaient établies et levées directement par les agents de l'administration centrale ou sous leur contrôle tout-puissant.
C'était le conseil qui fixait chaque année par une décision secrète le montant de la taille et de ses nombreux accessoires, et aussi sa répartition entre les provinces. La taille avait ainsi grandi d'année en année, sans que personne en fût averti d'avance par aucun bruit.
Comme la taille était un vieil impôt, l'assiette et la levée en avaient été confiées jadis à des agents locaux, qui tous étaient plus ou moins indépendants du gouvernement, puisqu'ils exerçaient leurs pouvoirs par droit de naissance ou d'élection, ou en vertu de charges achetées. C'étaient le seigneur, le collecteur paroissial, les trésoriers de France, les élus. Ces autorités existaient encore au dix-huitième siècle; mais les unes avaient cessé absolument de s'occuper de la taille, les autres ne le faisaient plus que d'une façon très-secondaire et entièrement subordonnée. Là même, la puissance entière était dans les mains de l'intendant et de ses agents; lui seul, en réalité, répartissait la taille entre les paroisses, guidait et surveillait les collecteurs, accordait des sursis ou des décharges.
D'autres impôts, comme la capitation, étant de date récente, le gouvernement n'y était plus gêné par les débris des vieux pouvoirs; il y agissait seul, sans aucune intervention des gouvernés. Le contrôleur général, l'intendant et le conseil fixaient le montant de chaque cote.
Passons de l'argent aux hommes.
On s'étonne quelquefois que les Français aient supporté si patiemment le joug de la conscription militaire à l'époque de la Révolution et depuis; mais il faut bien considérer qu'ils y étaient tous pliés depuis longtemps. La conscription avait été précédée par la milice, charge plus lourde, bien que les contingents demandés fussent moins grands. De temps à autre on faisait tirer au sort la jeunesse des campagnes, et on prenait dans son sein un certain nombre de soldats dont on formait des régiments de milice où l'on servait pendant six ans,
Comme la milice était une institution comparativement moderne, aucun des anciens pouvoirs féodaux ne s'en occupait; toute l'opération était confiée aux seuls agents du gouvernement central. Le conseil fixait le contingent général et la part de la province. L'intendant réglait le nombre d'hommes à lever dans chaque paroisse; son subdélégué présidait au tirage, jugeait les cas d'exemption, désignait les miliciens qui pouvaient résider dans leurs foyers, ceux qui devaient partir, et livrait enfin ceux-ci à l'autorité militaire. Il n'y avait de recours qu'à l'intendant et au conseil.
On peut dire également qu'en dehors des pays d'état tous les travaux publics, même ceux qui avaient la destination la plus particulière, étaient décidés et conduits par les seuls agents du pouvoir central.
Il existait bien encore des autorités locales et indépendantes qui, comme le seigneur, les bureaux de finances, les grands voyers, pouvaient concourir à cette partie de l'administration publique. Presque partout ces vieux pouvoirs agissaient peu ou n'agissaient plus du tout: le plus léger examen des pièces administratives du temps nous le démontre. Toutes les grandes routes, et même les chemins qui conduisaient d'une ville à une autre, étaient ouverts et entretenus sur le produit des contributions générales. C'était le conseil qui arrêtait le plan et fixait l'adjudication. L'intendant dirigeait les travaux des ingénieurs, le subdélégué réunissait la corvée qui devait les exécuter. On n'abandonnait aux anciens pouvoirs locaux que le soin des chemins vicinaux, qui demeuraient dès lors impraticables.
Le grand agent du gouvernement central en matière de travaux publics était, comme de nos jours, le corps des ponts et chaussées. Ici tout se ressemble d'une manière singulière, malgré la différence des temps. L'administration des ponts et chaussées a un conseil et une école; des inspecteurs qui parcourent annuellement toute la France; des ingénieurs qui résident sur les lieux et sont chargés, sous les ordres de l'intendant, d'y diriger tous les travaux. Les institutions de l'ancien régime, qui, en bien plus grand nombre qu'on ne le suppose, ont été transportées dans la société nouvelle, ont perdu d'ordinaire dans le passage leurs noms alors même qu'elles conservaient leurs formes; mais celle-ci a gardé l'un et l'autre: fait rare.
Le gouvernement central se chargeait seul, à l'aide de ses agents, de maintenir l'ordre public dans les provinces. La maréchaussée était répandue sur toute la surface du royaume en petites brigades, et placée partout sous la direction des intendants. C'est à l'aide de ces soldats, et au besoin de l'armée, que l'intendant parait à tous les dangers imprévus, arrêtait les vagabonds, réprimait la mendicité et étouffait les émeutes que le prix des grains faisait naître sans cesse. Jamais il n'arrivait, comme autrefois, que les gouvernés fussent appelés à aider le gouvernement dans cette partie de sa tâche, excepté dans les villes, où il existait d'ordinaire une garde urbaine dont l'intendant choisissait les soldats et nommait les officiers.
Les corps de justice avaient conservé le droit de faire des règlements de police et en usaient souvent; mais ces règlements n'étaient applicables que sur une partie du territoire, et, le plus souvent, dans un seul lieu. Le conseil pouvait toujours les casser, et il les cassait sans cesse, quand il s'agissait des juridictions inférieures. De son côté, il faisait tous les jours des règlements généraux, applicables également à tout le royaume, soit sur des matières différentes de celles que les tribunaux avaient réglementées, soit sur les mêmes matières qu'ils réglaient autrement. Le nombre de ces règlements, ou, comme on disait alors, de ces arrêts du conseil, est immense, et il s'accroît sans cesse à mesure qu'on s'approche de la Révolution. Il n'y a presque aucune partie de l'économie sociale ou de l'organisation politique qui n'ait été remaniée par des arrêts du conseil pendant les quarante ans qui la précèdent.
Dans l'ancienne société féodale, si le seigneur possédait de grands droits, il avait aussi de grandes charges. C'était à lui à secourir les indigents dans l'intérieur de ses domaines. Nous trouvons une dernière trace de cette vieille législation de l'Europe dans le code prussien de 1795, où il est dit: « Le seigneur doit veiller à ce que les paysans pauvres reçoivent l'éducation. Il doit, autant que possible, procurer des moyens de vivre à ceux de ses vassaux qui n'ont point de terre. Si quelques-uns d'entre eux tombent dans l'indigence, il est obligé de venir à leur secours. »
Aucune loi semblable n'existait plus en France depuis longtemps. Comme on avait ôté au seigneur ses anciens pouvoirs, il s'était soustrait à ses anciennes obligations. Aucune autorité locale, aucun conseil, aucune association provinciale ou paroissiale n'avait pris sa place. Nul n'était plus obligé par la loi à s'occuper des pauvres des campagnes; le gouvernement central avait entrepris hardiment de pourvoir seul à leurs besoins.
Tous les ans le conseil assignait à chaque province, sur le produit général des taxes, certains fonds que l'intendant distribuait en secours dans les paroisses. C'était à lui que devait s'adresser le cultivateur nécessiteux. Dans les temps de disette, c'était l'intendant qui faisait distribuer au peuple du blé ou du riz. Le conseil rendait annuellement des arrêts qui ordonnaient d'établir, dans certains lieux qu'il avait soin d'indiquer lui-même, des ateliers de charité où les paysans les plus pauvres pouvaient travailler moyennant un léger salaire. On doit croire aisément qu'une charité faite de si loin était souvent aveugle ou capricieuse, et toujours très-insuffisante.
Le gouvernement central ne se bornait pas à venir au secours des paysans dans leurs misères; il prétendait leur enseigner l'art de s'enrichir, les y aider et les y forcer au besoin. Dans ce but il faisait distribuer de temps en temps par ses intendants et ses subdélégués de petits écrits sur l'art agricole, fondait des sociétés d'agriculture, promettait des primes, entretenait à grands frais des pépinières dont il distribuait les produits. Il semble qu'il eût été plus efficace d'alléger le poids et de diminuer l'inégalité des charges qui opprimaient alors l'agriculture; mais c'est ce dont on ne voit pas qu'il se soit avisé jamais.
Quelquefois le conseil entendait obliger les particuliers à prospérer, quoi qu'ils en eussent. Les arrêts qui contraignent les artisans à se servir de certaines méthodes et à fabriquer de certains produits sont innombrables; et comme les intendants ne suffisaient pas à surveiller l'application de toutes ces règles, il existait des inspecteurs généraux de l'industrie qui parcouraient les provinces pour y tenir la main.
Il y a des arrêts du conseil qui prohibent certaines cultures dans des terres que ce conseil y déclare peu propres. On en trouve où il ordonne d'arracher des vignes plantées, suivant lui, dans un mauvais sol, tant le gouvernement était déjà passé du rôle de souverain à celui de tuteur.
CHAPITRE III. Comment ce qu'on appelle aujourd'hui la tutelle administrative est une institution de l'ancien régime.
En France, la liberté municipale a survécu à la féodalité. Lorsque déjà les seigneurs n'administraient plus les campagnes, les villes conservaient encore le droit de se gouverner. On en rencontre, jusque vers la fin du dix-septième siècle, qui continuent à former comme de petites républiques démocratiques, où les magistrats sont librement élus par tout le peuple et responsables envers lui, où la vie municipale est publique et active, où la cité se montre encore fière de ses droits et très-jalouse de son indépendance.
Les élections ne furent abolies généralement pour la première fois qu'en 1692. Les fonctions municipales furent alors mises en offices, c'est-à-dire que le roi vendit, dans chaque ville, à quelques habitants, le droit de gouverner perpétuellement tous les autres.
C'était sacrifier, avec la liberté des villes, leur bien-être; car si la mise en office des fonctions publiques a
eu souvent d'utiles effets quand il s'est agi des tribunaux, parce que la condition première d'une bonne justice est l'indépendance complète du juge, elle n'a jamais manqué d'être très-funeste toutes les fois qu'il s'est agi de l'administration proprement dite, où on a surtout besoin de rencontrer la responsabilité, la subordination et le zèle. Le gouvernement de l'ancienne monarchie ne s'y trompait pas: il avait grand soin de ne point user pour lui-même du régime qu'il imposait aux villes, et il se gardait bien de mettre en offices les fonctions de subdélégués et d'intendants.
Et ce qui est bien digne de tous les mépris de l'histoire, cette grande révolution fut accomplie sans aucune vue politique. Louis XI avait restreint les libertés municipales parce que leur caractère démocratique lui faisait peur; Louis XIV les détruisit sans les craindre. Ce qui le prouve, c'est qu'il les rendit à toutes les villes qui purent les racheter. En réalité, il voulait moins les abolir qu'en trafiquer, et, s'il les abolit en effet, ce fut pour ainsi dire sans y penser, par pur expédient de finances; et, chose étrange, le même jeu se continue pendant quatre-vingts ans. Sept fois, durant cet espace, on vend aux villes le droit d'élire leurs magistrats, et, quand elles en ont de nouveau goûté la douceur, on le leur reprend pour le leur revendre. Le motif de la mesure est toujours le même, et souvent on l'avoue. « Les nécessites de nos finances, est-il dit dans le préambule de l'édit de 1722, nous obligent à chercher les moyens les plus sûrs de les soulager. » Le moyen était sûr, mais ruineux pour ceux sur qui tombait cet étrange impôt. « Je suis frappé de l'énormité des finances qui ont été payées dans tous les temps pour racheter les offices municipaux, » écrit un intendant au contrôleur général en 1764. « Le montant de cette finance employé en ouvrages utiles aurait tourné au profit de la ville, qui, au contraire, n'a senti que le poids de l'autorité et des priviléges de ces offices. » Je n'aperçois pas de trait plus honteux dans toute la physionomie de l'ancien régime!
Il semble difficile de dire aujourd'hui précisément comment se gouvernaient les villes au dix-huitième siècle; car, indépendamment de ce que l'origine des pouvoirs municipaux change sans cesse, comme il vient d'être dit, chaque ville conserve encore quelques lambeaux de son ancienne constitution et a des usages propres. Il n'y a peut-être pas deux villes en France où tout se ressemble absolument; mais c'est là une diversité trompeuse, qui cache la similitude.
En 1764, le gouvernement entreprit de faire une loi générale sur l'administration des villes. Il se fit envoyer par ses intendants des mémoires sur la manière dont les choses se passaient alors dans chacune d'elles. J'ai retrouvé une partie de cette enquête, et j'ai achevé de me convaincre en la lisant que les affaires municipales étaient conduites de la même manière à peu près partout. Les différences ne sont plus que superficielles et apparentes; le fond est partout le même.
Le plus souvent le gouvernement des villes est confié à deux assemblées. Toutes les grandes villes sont dans ce cas et la plupart des petites.
La première assemblée est composée d'officiers municipaux plus ou moins nombreux suivant les lieux. C'est le pouvoir exécutif de la commune, le corps de ville, comme on disait alors. Ses membres exercent un pouvoir temporaire et sont élus, quand le roi a établi l'élection ou que la ville a pu racheter les offices. Ils remplissent leur charge à perpétuité moyennant finance, lorsque le roi a rétabli les offices et a réussi à les vendre, ce qui n'arrive pas toujours; car cette sorte de marchandise s'avilit de plus en plus à mesure que l'autorité municipale se subordonne davantage au pouvoir central. Dans tous les cas ces officiers municipaux ne reçoivent pas de salaire, mais ils ont toujours des exemptions d'impôts et des priviléges. Point d'ordre hiérarchique parmi eux; l'administration est collective. On ne voit pas de magistrat qui la dirige particulièrement et en réponde. Le maire est le président du corps de la ville, non l'administrateur de la cité.
La seconde assemblée, qu'on nomme l'assemblée générale, élit le corps de ville, là où l'élection a lieu encore, et partout elle continue à prendre part aux principales affaires.
Au quinzième siècle, l'assemblée générale se composait souvent de tout le peuple; cet usage, dit l'un des mémoires de l'enquête, était d'accord avec le génie populaire de nos anciens. C'est le peuple tout entier qui élisait alors ses officiers municipaux; c'est lui qu'on consultait quelquefois; c'est à lui qu'on rendait compte. A la fin du dix-septième siècle, cela se rencontre encore parfois.
Au dix-huitième siècle, ce n'est plus le peuple lui-même agissant en corps qui forme l'assemblée générale. Celle-ci est presque toujours représentative. Mais ce qu'il faut bien considérer, c'est que nulle part elle n'est plus élue par la masse du public et n'en reçoit l'esprit. Partout elle est composée de notables, dont quelques-uns y paraissent en vertu d'un droit qui leur est propre; les autres y sont envoyés par des corporations ou des compagnies, et chacun y remplit un mandat impératif que lui a donné cette petite société particulière.
A mesure qu'on avance dans le siècle, le nombre des notables de droit se multiplie dans le sein de cette assemblée; les députés des corporations industrielles y deviennent moins nombreux ou cessent d'y paraître. On n'y rencontre plus que ceux des corps; c'est-à-dire que l'assemblée contient seulement des bourgeois et ne reçoit presque plus d'artisans. Le peuple, qui ne se laisse pas prendre aussi aisément qu'on se l'imagine aux vains semblants de la liberté, cesse alors partout de s'intéresser aux affaires de la commune et vit dans l'intérieur de ses propres murs comme un étranger. Inutilement ses magistrats essayent de temps en temps de réveiller en lui ce patriotisme municipal qui a fait tant de merveilles dans le moyen âge: il reste sourd. Les plus grands intérêts de la ville semblent ne plus le toucher. On voudrait qu'il allât voter, là où on a cru devoir conserver la vaine image d'une élection libre: il s'entête à s'abstenir. Rien de plus commun qu'un pareil spectacle dans l'histoire. Presque tous les princes qui ont détruit la liberté ont tenté d'abord d'en maintenir les formes: cela s'est vu depuis Auguste jusqu'à nos jours; ils se flattaient ainsi de réunir à la force morale que donne toujours l'assentiment public les commodités que la puissance absolue peut seule offrir. Presque tous ont échoué dans cette entreprise, et ont bientôt découvert qu'il était impossible de faire durer longtemps ces menteuses apparences là où la réalité n'était plus.
Au dix-huitième siècle le gouvernement municipal des villes avait donc dégénéré partout en une petite oligarchie. Quelques familles y conduisaient toutes les affaires dans des vues particulières, loin de l'œil du public et sans être responsables envers lui: c'est une maladie dont cette administration est atteinte dans la France entière. Tous les intendants la signalent; mais le seul remède qu'ils imaginent, c'est l'assujettissement toujours plus grand des pouvoirs locaux au gouvernement central.
Il était cependant difficile d'y mieux réussir qu'on ne l'avait déjà fait; indépendamment des édits qui de temps à autre modifient l'administration de toutes les villes, les lois particulières à chacune d'elles sont souvent bouleversées par des règlements du conseil non enregistrés, rendus sur les propositions des intendants, sans enquête préalable, et quelquefois sans que les habitants de la ville eux-mêmes s'en doutent.
« Cette mesure, » disent les habitants d'une ville qui avait été atteinte par un semblable arrêt, « a étonné tous les ordres de la ville, qui ne s'attendaient à rien de semblable. »
Les villes ne peuvent ni établir un octroi, ni lever une contribution, ni hypothéquer, ni vendre, ni plaider, ni affermer leurs biens, ni les administrer, ni faire emploi de l'excédant de leurs recettes, sans qu'il intervienne un arrêt du conseil sur le rapport de l'intendant. Tous leurs travaux sont exécutés sur des plans et d'après des devis que le conseil a approuvés par arrêt. C'est devant l'intendant ou ses subdélégués qu'on les adjuge, et c'est d'ordinaire l'ingénieur ou l'architecte de l'État qui les conduit. Voilà qui surprendra bien ceux qui pensent que tout ce qu'on voit en France est nouveau.
Mais le gouvernement central entre bien plus avant encore dans l'administration des villes que cette règle même ne l'indique; son pouvoir y est bien plus étendu que son droit.
Je trouve dans une circulaire adressée vers le milieu du siècle par le contrôleur général à tous les intendants: « Vous donnerez une attention particulière à tout ce qui se passe dans les assemblées municipales. Vous vous en ferez rendre le compte le plus exact et remettre toutes les délibérations qui y seront prises, pour me les envoyer sur-le-champ avec votre avis. »
On voit en effet par la correspondance de l'intendant avec ses subdélégués que le gouvernement a la main dans toutes les affaires des villes, dans les moindres comme dans les plus grandes. On le consulte sur tout, et il a un avis décidé sur tout; il y règle jusqu'aux fêtes. C'est lui qui commande, dans certains cas, les témoignages de l'allégresse publique, qui fait allumer les feux de joie et illuminer les maisons. Je trouve un intendant qui met à l'amende de 20 livres des membres de la garde bourgeoise qui se sont absentés du Te, Deum.
Aussi les officiers municipaux ont-ils un sentiment convenable de leur néant.
« Nous vous prions très-humblement, Monseigneur, » écrivent quelques-uns d'entre eux à l'intendant, « de nous accorder votre bienveillance et votre protection. Nous tâcherons de ne pas nous en rendre indignes par notre soumission à tous les ordres de Votre Grandeur. » « Nous n'avons jamais résisté à vos volontés, Monseigneur, » écrivent d'autres, qui s'intitulent encore magnifiquement Pairs de la ville.
C'est ainsi que la classe bourgeoise se prépare au gouvernement et le peuple à la liberté.
Au moins, si cette étroite dépendance des villes avait préservé leurs finances! mais il n'en est rien. On avance que sans la centralisation les villes se ruineraient aussitôt: je l'ignore; mais il est certain que, dans le dix-huitième siècle, la centralisation ne les empêchait pas de se ruiner. Toute l'histoire administrative de ce temps est pleine du désordre de leurs affaires.
Que si nous allons des villes aux villages, nous rencontrons d'autres pouvoirs, d'autres formes; même dépendance.
Je vois bien des indices qui m'annoncent que dans le moyen âge les habitants de chaque village ont formé une communauté distincte du seigneur. Celui-ci s'en servait, la surveillait, la gouvernait; mais elle possédait en commun certains biens dont elle avait la propriété propre; elle élisait ses chefs, elle s'administrait elle-même démocratiquement.
Cette vieille constitution de la paroisse se retrouve chez toutes les nations qui ont été féodales et dans tous les pays où ces nations ont porté les débris de leurs lois. On en voit partout la trace en Angleterre, et elle était encore toute vivante en Allemagne il y a soixante ans, ainsi qu'on peut s'en convaincre en lisant le code du grand Frédéric. En France même, au dix-huitième siècle, il en existe encore quelques vestiges.
Je me souviens que, quand je recherchais pour la première fois, dans les archives d'une intendance, ce que c'était qu'une paroisse de l'ancien régime, j'étais surpris de retrouver, dans cette communauté si pauvre et si asservie, plusieurs des traits qui m'avaient frappé jadis dans les communes rurales d'Amérique, et que j'avais jugés alors à tort devoir être une singularité particulière au Nouveau-Monde. Ni l'une ni l'autre n'ont de représentation permanente, de corps municipal proprement dit; l'une et l'autre sont administrées par des fonctionnaires qui agissent séparément, sous la direction de la communauté tout entière. Toutes deux ont, de temps à autre, des assemblées générales où tous les habitants, réunis dans un seul corps, élisent leurs magistrats et règlent les principales affaires. Elles se ressemblent, en un mot, autant qu'un vivant peut ressembler à un mort.
Ces deux êtres si différents dans leurs destinées ont eu, en effet, même naissance.
Transportée d'un seul coup loin de la féodalité et maîtresse absolue d'elle-même, la paroisse rurale du moyen âge est devenue le township de la Nouvelle-Angleterre. Séparée du seigneur, mais serrée dans la puissante main de l'État, elle est devenue en France ce que nous allons dire.
Au dix-huitième siècle, le nombre et le nom des fonctionnaires de la paroisse varient suivant les provinces. On voit par les anciens documents que ces fonctionnaires avaient été plus nombreux quand la vie locale avait été plus active; leur nombre a diminué à mesure qu'elle s'est engourdie. Dans la plupart des paroisses du dix-huitième siècle ils sont réduits à deux: l'un se nomme le collecteur, l'autre s'appelle le plus souvent le syndic. D'ordinaire ces officiers municipaux sont encore élus ou sont censés l'être; mais ils sont devenus partout les instruments de l'État plus que les représentants de la communauté. Le collecteur lève la taille sous les ordres directs de l'intendant. Le syndic, placé sous la direction journalière du subdélégué de l'intendant, le représente dans toutes les opérations qui ont trait à l'ordre public ou au gouvernement. Il est son principal agent quand il s'agit de la milice, des travaux de l'État, de l'exécution de toutes les lois générales.
Le seigneur, comme nous l'avons déjà vu, reste étranger à tous ces détails du gouvernement; il ne les surveille même plus; il n'y aide pas; bien plus, ces soins par lesquels s'entretenait jadis sa puissance lui paraissent indignes de lui, à mesure que sa puissance elle-même est mieux détruite. On blesserait aujourd'hui son orgueil en l'invitant à s'y livrer. Il ne gouverne plus; mais sa présence dans la paroisse et ses priviléges empêchent qu'un bon gouvernement paroissial puisse s'établir à la place du sien. Un particulier si différent de tous les autres, si indépendant, si favorisé, y détruit ou y affaiblit l'empire de toutes les règles.
Comme son contact a fait fuir successivement vers la ville, ainsi que je le montrerai plus loin, presque tous ceux des habitants qui possédaient de l'aisance et des lumières, il ne reste en dehors de lui qu'un troupeau de paysans ignorants et grossiers, hors d'état de diriger l'administration des affaires communes. « Une paroisse, » a dit avec raison Turgot, « est un assemblage de cabanes et d'habitants non moins passifs qu'elles. »
Les documents administratifs du dix-huitième siècle sont remplis de plaintes que font naître l'impéritie, l'inertie et l'ignorance des collecteurs et des syndics de paroisses, Ministres, intendants, subdélégués, gentils-hommes même, tous le déplorent sans cesse; mais aucun ne remonte aux causes.
Jusqu'à la Révolution, la paroisse rurale de France conserve dans son gouvernement quelque chose de cet aspect démocratique qu'on lui avait vu dans le moyen âge. S'agit-il d'élire des officiers municipaux ou de discuter quelque affaire commune: la cloche du village appelle les paysans devant le porche de l'église; là, pauvres comme riches ont le droit de se présenter. L'assemblée réunie, il n'y a point, il est vrai, de délibération proprement dite ni de vote; mais chacun peut exprimer son avis, et un notaire requis à cet effet et instrumentant en plein vent recueille les différents dires et les consigne dans un procès-verbal.
Quand on compare ces vaines apparences de la liberté avec l'impuissance réelle qui y était jointe, on découvre déjà en petit comment le gouvernement le plus absolu peut se combiner avec quelques-unes des formes de la plus extrême démocratie, de telle sorte qu'à l'oppression vienne encore s'ajouter le ridicule de n'avoir pas l'air de la voir. Cette assemblée démocratique de la paroisse pouvait bien exprimer des vœux, mais elle n'avait pas plus le droit de faire sa volonté que le conseil municipal de la ville. Elle ne pouvait même parler que quand on lui avait ouvert la bouche; car ce n'était jamais qu'après avoir sollicité la permission expresse de l'intendant, et, comme on le disait alors, appliquant le mot à la chose, sous son bon plaisir, qu'on pouvait la réunir. Fût-elle unanime, elle ne pouvait ni s'imposer, ni vendre, ni acheter, ni louer, ni plaider, sans que le conseil du roi le permît. Il fallait obtenir un arrêt de ce conseil pour réparer le dommage que le vent venait de causer au toit de l'église ou relever le mur croulant du presbytère. La paroisse rurale la plus éloignée de Paris était soumise à cette règle comme les plus proches. J'ai vu des paroisses demander au conseil le droit de dépenser 25 livres.
Les habitants avaient retenu, d'ordinaire, il est vrai, le droit d'élire par vote universel leurs magistrats; mais il arrivait souvent que l'intendant désignait à ce petit corps électoral un candidat qui ne manquait guère d'être nommé à l'unanimité des suffrages. D'autres fois il cassait l'élection spontanément faite, nommait lui-même le collecteur et le syndic, et suspendait indéfiniment toute élection nouvelle. J'en ai vu mille exemples.
On ne saurait imaginer de destinée plus cruelle que celle de ces fonctionnaires communaux. Le dernier agent du gouvernement central, le subdélégué, les faisait obéir à ses moindres caprices. Souvent il les condamnait à l'amende; quelquefois il les faisait emprisonner; car les garanties qui, ailleurs, défendaient encore les citoyens contre l'arbitraire, n'existaient plus ici. « J'ai fait mettre en prison, dit un intendant en 1750, quelques « principaux des communautés qui murmuraient, et j'ai fait payer à ces communautés la course des cavaliers de la maréchaussée. Parce moyen elles ont été facilement matées. » Aussi les fonctions paroissiales étaient-elles considérées moins comme des honneurs que comme des charges auxquelles on cherchait par toutes sortes de subterfuges à se dérober.
Et pourtant ces derniers débris de l'ancien gouvernement de la paroisse étaient encore chers aux paysans, et aujourd'hui même, de toutes les libertés publiques, la seule qu'ils comprennent bien, c'est la liberté paroissiale. L'unique affaire de nature publique qui les intéresse réellement est celle-là. Tel qui laisse volontiers le gouvernement de toute la nation dans la main d'un maître regimbe à l'idée de n'avoir pas à dire son mot dans l'administration de son village: tant il y a encore de poids dans les formes les plus creuses!
Ce que je viens de dire des villes et des paroisses, il faut l'étendre à presque tous les corps qui avaient une existence à part et une propriété collective.
Sous l'ancien régime comme de nos jours, il n'y avait ville, bourg, village, ni si petit hameau en France, hôpital, fabrique, couvent ni collége, qui pût avoir une volonté indépendante dans ses affaires particulières, ni administrer à sa volonté ses propres biens. Alors comme aujourd'hui, l'administration tenait donc tous les Français en tutelle, et si l'insolence du mot ne s'était pas encore produite, on avait du moins déjà la chose.
CHAPITRE V. Comment la centralisation avait pu s'introduire ainsi au milieu des anciens pouvoirs et les supplanter sans les détruire.
Maintenant, récapitulons un peu ce que nous avons dit dans les trois chapitres qui précèdent: un corps unique, et placé au centre du royaume, qui réglemente l'administration publique dans tout le pays; le même ministre dirigeant presque toutes les affaires intérieures; dans chaque province, un seul agent qui en conduit tout le détail; point de corps administratifs secondaires ou des corps qui ne peuvent agir sans qu'on les autorise d'abord à se mouvoir; des tribunaux exceptionnels qui jugent les affaires où l'administration est intéressée et couvrent tous ses agents. Qu'est ceci, sinon la centralisation que nous connaissons? Ses formes sont moins marquées qu'aujourd'hui, ses démarches moins réglées, son existence plus troublée; mais c'est le même être. On n'a eu depuis à lui ajouter ni à lui ôter rien d'essentiel; il a suffi d'abattre tout ce qui s'élevait autour d'elle pour qu'elle apparût telle que nous la voyons.
La plupart des institutions que je viens de décrire ont été imitées depuis en cent endroits divers; mais elles étaient alors particulières à la France, et nous alIons bientôt voir quelle grande influence elles ont eue sur la révolution française et sur ses suites.
Mais comment ces institutions de date nouvelle avaient-elles pu se fonder en France au milieu des débris de la société féodale?
Ce fut une œuvre de patience, d'adresse et de longueur de temps, plus que de force et de plein pouvoir. Au moment où la Révolution survint, on n'avait encore presque rien détruit du vieil édifice administratif de la France; on en avait, pour ainsi dire, bâti un autre en sous-œuvre.
Rien n'indique que, pour opérer ce difficile travail, le gouvernement de l'ancien régime ait suivi un plan profondément médité à l'avance; il s'était seulement abandonné à l'instinct qui porte tout gouvernement à vouloir mener seul toutes les affaires, instinct qui demeurait toujours le même à travers la diversité des agents. Il avait laissé aux anciens pouvoirs leurs noms antiques et leurs honneurs, mais il leur avait peu à peu soustrait leur autorité. Il ne les avait pas chassés, mais éconduits de leurs domaines. Profitant de l'inertie de celui-ci, de l'égoïsme de celui-là, pour prendre sa place; s'aidant de tous leurs vices, n'essayant jamais de les corriger, mais seulement de les supplanter, il avait fini par les remplacer presque tous, en effet, par un agent unique, l'intendant, dont on ne connaissait pas même le nom quand ils étaient nés.
Le pouvoir judiciaire seul l'avait gêné dans cette grande entreprise; mais là même il avait fini par saisir la substance du pouvoir, n'en laissant que l'ombre à ses adversaires. Il n'avait pas exclu les parlements de la sphère administrative; il s'y était étendu lui-même graduellement de façon à la remplir presque tout entière. Dans certains cas extraordinaires et passagers, dans les temps de disette, par exemple, où les passions du peuple offraient un point d'appui à l'ambition des magistrats, le gouvernement central laissait un moment les parlements administrer et leur permettait de faire un bruit qui souvent a retenti dans l'histoire; mais bientôt il reprenait en silence sa place, et remettait discrètement la main sur tous les hommes et sur toutes les affaires.
Si l'on veut bien faire attention à la lutte des parlements contre le pouvoir royal, on verra que c'est presque toujours sur le terrain de la politique, et non sur celui de l'administration, qu'on se rencontre. Les querelles naissent d'ordinaire à propos d'un nouvel impôt; c'est-à-dire que ce n'est pas la puissance administrative que les deux adversaires se disputent, mais le pouvoir législatif, dont ils avaient aussi peu de droits de s'emparer l'un que l'autre.
Il en est de plus en plus ainsi, en approchant de la Révolution. A mesure que les passions populaires commencent à s'enflammer, le parlement se mêle davantage à la politique, et comme, dans le même temps, le pouvoir central et ses agents deviennent plus expérimentés et plus habiles, ce même parlement s'occupe de moins en moins de l'administration proprement dite; chaque jour, moins administrateur et plus tribun.
Le temps, d'ailleurs, ouvre sans cesse au gouvernement central de nouveaux champs d'action où les tribunaux n'ont pas l'agilité de le suivre; car il s'agit d'affaires nouvelles sur lesquelles ils n'ont pas de précédents et qui sont étrangères à leur routine. La société, qui est en grand progrès, fait naître à chaque instant des besoins nouveaux, et chacun d'eux est pour lui une source nouvelle de pouvoir; car lui seul est en état de les satisfaire. Tandis que la sphère administrative des tribunaux reste fixe, la sienne est mobile et s'étend sans cesse avec la civilisation même.
La Révolution qui approche, et commence à agiter l'esprit de tous les Français, leur suggère mille idées nouvelles que lui seul peut réaliser; avant de le renverser, elle le développe. Lui-même se perfectionne comme tout le reste. Cela frappe singulièrement quand on étudie ses archives. Le contrôleur général et l'intendant de 1780 ne ressemblent plus à l'intendant et au contrôleur général de 1740; l'administration est transformée. Ses agents sont les mêmes, un autre esprit les meut. A mesure qu'elle est devenue plus détaillée, plus étendue, elle est aussi devenue plus régulière et plus savante. Elle s'est modérée en achevant de s'emparer de tout; elle opprime moins, elle conduit plus.
Les premiers efforts de la Révolution avaient détruit cette grande institution de la monarchie'; elle fut restaurée en 1800. Ce ne furent pas, comme on l'a dit tant de fois, les principes de 1789 en matière d'admitration [ed: administration?] publique qui ont triomphé à cette époque et depuis, mais bien au contraire ceux de l'ancien régime qui furent tous remis alors en vigueur et y demeurèrent.
Si l'on me demande comment cette portion de l'ancien régime a pu être ainsi transportée tout d'une pièce dans la société nouvelle et s'y incorporer, je répondrai que, si la centralisation n'a point péri dans la Révolution, c'est qu'elle était elle-même le commencement de cette révolution et son signe; et j'ajouterai que, quand un peuple a détruit dans son sein l'aristocratie, il court vers la centralisation comme de lui-même. Il faut alors bien moins d'efforts pour le précipiter sur cette pente que pour l'y retenir. Dans son sein tous les pouvoirs tendent naturellement vers l'unité, et ce n'est qu'avec beaucoup d'art qu'on peut parvenir à les tenir divisés.
La révolution démocratique, qui a détruit tant d'institutions de l'ancien régime, devait donc consolider celle-ci, et la centralisation trouvait si naturellement sa place dans la société que cette révolution avait formée qu'on a pu aisément la prendre pour une de ses œuvres.
CHAPITRE XIX. Comment une grande révolution administrative avait précédé la révolution politique, et des conséquences que cela eut.
[possible cut from pp. 295-307 - include conclusion pp. 307-310]
Rien n'avait encore été changé à la forme du gouvernement que déjà la plupart des lois secondaires qui règlent la condition des personnes et l'administration des affaires étaient abolies ou modifiées.
La destruction des jurandes et leur rétablissement partiel et incomplet avaient profondément altéré tous les anciens rapports de l'ouvrier et du maître. Ces rapports étaient devenus non-seulement différents, mais incertains et contraints. La police dominicale était ruinée; la tutelle de l'État était encore mal assise, et l'artisan, placé dans une position gênée et indécise, entre le gouvernement et le patron, ne savait trop lequel des deux pouvait le protéger ou devait le contenir. Cet état de malaise et d'anarchie, dans lequel on avait mis d'un seul coup toute la basse classe des villes, eut de grandes conséquences, dès que le peuple commença à reparaître sur la scène politique.
Un an avant la Révolution, un édit du roi avait bouleversé dans toutes ses parties l'ordre de la justice; plusieurs juridictions nouvelles avaient été créées, une multitude d'autres abolies, toutes les règles de la compétence changées. Or, en France, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer ailleurs, le nombre de ceux qui s'occupaient, soit à juger, soit à exécuter les arrêts des juges, était immense. A vrai dire, toute la bourgeoisie tenait de près ou de loin aux tribunaux. L'effet de la loi fut donc de troubler tout à coup des milliers de familles dans leur état et dans leurs biens, et de leur donner une assiette nouvelle et précaire. L'édit n'avait guère moins incommodé les plaideurs, qui, au milieu de cette révolution judiciaire, avaient peine à retrouver la loi qui leur était applicable et le tribunal qui devait les juger.
Mais ce fut surtout la réforme radicale que l'administration proprement dite eut à subir en 1787 qui, après avoir porté le désordre dans les affaires publiques, vint émouvoir chaque citoyen jusque dans sa vie privée.
J'ai dit que, dans les pays d'élection, c'est-à-dire dans près des trois quarts de la France, toute l'administration de la généralité était livrée à un seul homme, l'intendant, lequel agissait non-seulement sans contrôle, mais sans conseil.
En 1787, on plaça à côté de cet intendant une assemblée provinciale qui devint le véritable administrateur du pays. Dans chaque village, un corps municipal élu prit également la place des anciennes assemblées de paroisse, et, dans la plupart des cas, du syndic.
Une législation si contraire à celle qui l'avait précédée, et qui changeait si complétement, non-seulement l'ordre des affaires, mais la position relative des hommes, dut être appliquée partout à la fois, et partout à peu près de la même manière, sans aucun égard aux usages antérieurs ni à la situation particulière des provinces; tant le génie unitaire de la Révolution possédait déjà ce vieux gouvernement que la Révolution allait abattre.
On vit bien alors la part que prend l'habitude dans le jeu des institutions politiques, et comment les hommes se tirent plus aisément d'affaire avec des lois obscures et compliquées, dont ils ont depuis longtemps la pratique, qu'avec une législation plus simple qui leur est nouvelle.
Il y avait en France, sous l'ancien régime, toutes sortes de pouvoirs qui variaient à l'infini, suivant les provinces, et dont aucun n'avait de limites fixes et bien connues, de telle sorte que le champ d'action de chacun d'eux était toujours commun à plusieurs autres. Cependant, on avait fini par établir un ordre régulier et assez facile dans les affaires; tandis que les nouveaux pouvoirs, qui étaient en plus petit nombre, soigneusement limités et semblables entre eux, se rencontrèrent et s'enchevêtrèrent aussitôt les uns dans les autres au milieu de la plus grande confusion, et souvent se réduisirent mutuellement à l'impuissance.
La loi nouvelle renfermait d'ailleurs un grand vice, qui seul eût suffi, surtout au début, pour en rendre l'exécution difficile: tous les pouvoirs qu'elle créait étaient collectifs.
Sous l'ancienne monarchie, on n'avait jamais connu que deux façons d'administrer: dans les lieux où l'administration était confiée à un seul homme, celui-ci agissait sans le concours d'aucune assemblée; là où il existait des assemblées, comme dans les pays d'état ou dans les villes, la puissance exécutive n'était confiée à personne en particulier; l'assemblée non-seulement gouvernait et surveillait l'administration, mais administrait par elle-même ou par des commissions temporaires qu'elle nommait.
Comme on ne connaissait que ces deux manières d'agir, dès qu'on abandonna l'une, on adopta l'autre. Il est assez étrange que, dans le sein d'une société si éclairée, et où l'administration publique jouait déjà depuis longtemps un si grand rôle, on ne se fût jamais avisé de réunir les deux systèmes, et de distinguer, sans les disjoindre, le pouvoir qui doit exécuter de celui qui doit surveiller et prescrire. Cette idée, qui paraît si simple, ne vint point; elle n'a été trouvée que dans ce siècle. C'est pour ainsi dire la seule grande découverte en matière d'administration publique qui nous soit propre. Nous verrons la suite qu'eut la pratique contraire, quand, transportant dans la politique les habitudes administratives, et obéissant à la tradition de l'ancien régime tout en détestant celui-ci, on appliqua dans la Convention nationale le système que les états provinciaux et les petites municipalités des villes avaient suivi, et comment de ce qui n'avait été jusque-là qu'une cause d'embarras dans les affaires, on fit sortir tout à coup la Terreur.
Les assemblées provinciales de 1787 reçurent donc le droit d'administrer elles-mêmes, dans la plupart des circonstances où, jusque-là, l'intendant avait seul agi; elles furent chargées, sous l'autorité du gouvernement central, d'asseoir la taille et d'en surveiller la perception, d'arrêter quels devaient être les travaux publics à entreprendre et de les faire exécuter. Elle eut sous ses ordres immédiats tous les agents des ponts et chaussées, depuis l'inspecteur jusqu'au piqueur des travaux. Elle dut leur prescrire ce qu'elle jugeait convenable, rendre compte de leur service au ministre, et proposer à celui-ci les gratifications qu'ils méritaient. La tutelle des communes fut presque entièrement remise à ces assemblées; elles durent juger en premier ressort la plus grande partie des affaires contentieuses, qui étaient portées jusque-là devant l'intendant, etc.; fonctions dont plusieurs convenaient mal à un pouvoir collectif et irresponsable, et qui d'ailleurs allaient être exercées par des gens qui administraient pour la première fois.
Ce qui acheva de tout brouiller fut qu'en réduisant ainsi l'intendant à l'impuissance on le laissa néanmoins subsister. Après lui avoir ôté le droit absolu de tout faire, on lui imposa le devoir d'aider et de surveiller ce que l'assemblée ferait; comme si un fonctionnaire déchu pouvait jamais entrer dans l'esprit de la législation qui le dépossède et en faciliter la pratique!
Ce qu'on avait fait pour l'intendant, on le fit pour son subdélégué. A côté de lui, et à la place qu'il venait d'occuper, on plaça une assemblée d'arrondissement qui dut agir sous la direction de l'assemblée provinciale et d'après des principes analogues.
Tout ce qu'on connaît des actes des assemblées provinciales créées en 1787, et leurs procès-verbaux mêmes, apprennent qu'aussitôt après leur naissance elles entrèrent en guerre sourde et souvent ouverte avec les intendants, ceux-ci n'employant l'expérience supérieure qu'ils avaient acquise qu'à gêner les mouvements de leurs successeurs. Ici, c'est une assemblée qui se plaint de ne pouvoir arracher qu'avec effort des mains de l'intendant les pièces qui lui sont les plus nécessaires. Ailleurs, c'est l'intendant qui accuse les membres de l'assemblée de vouloir usurper des attributions que les édits, dit-dl, lui ont laissées. Il en appelle au ministre, qui souvent ne répond rien ou doute; car la matière lui est aussi nouvelle et obscure qu'à tous les autres. Parfois l'assemblée délibère que l'intendant n'a pas bien administré, que les chemins qu'il a fait construire sont mal tracés ou mal entretenus; il a laissé ruiner des communautés dont il était le tuteur. Souvent ces assemblées hésitent au milieu des obscurités d'une législation si peu connue; elles s'envoient au loin consulter les unes les autres et se font parvenir sans cesse des avis. L'intendant d'Auch prétend qu'il peut s'opposer à la volonté de l'assemblée provinciale, qui avait autorisé une commune à s'imposer; l'assemblée affirme qu'en cette matière l'intendant n'a plus désormais que des avis, et non des ordres, à donner, et elle demande à l'assemblée provinciale de l'Ile-de-France ce que celle-ci en pense.
Au milieu de ces récriminations et de ces consultations, la marche de l'administration se ralentit souvent et quelquefois s'arrête: la vie publique est alors comme suspendue. « La stagnation des affaires est complète, » dit l'assemblée provinciale de Lorraine, qui n'est en cela que l'écho de plusieurs autres; « tous les bons citoyens s'en affligent. »
D'autres fois, c'est par excès d'activité et de confiance en elles-mêmes que pèchent ces nouvelles administrations; elles sont toutes remplies d'un zèle inquiet et perturbateur qui les porte à vouloir changer tout à coup les anciennes méthodes et corriger à la hâte les plus vieux abus. Sous prétexte que désormais c'est à elles à exercer la tutelle des villes, elles entreprennent de gérer elles-mêmes les affaires communales; en un mot, elles achèvent de tout confondre en voulant tout améliorer.
Si l'on veut bien considérer maintenant la place immense qu'occupait déjà depuis longtemps en France l'administration publique, la multitude des intérêts auxquels elle touchait chaque jour, tout ce qui dépendait d'elle ou avait besoin de son concours; si l'on songe que c'était déjà sur elle plus que sur eux-mêmes que les particuliers comptaient pour faire réussir leurs propres affaires, favoriser leur industrie, assurer leurs subsistances, tracer et entretenir leurs chemins, préserver leur tranquillité et garantir leur bien-être, on aura une idée du nombre infini de gens qui durent se trouver personnellement atteints du mal dont elle souffrait.
Mais ce fut surtout dans les villages que les vices de la nouvelle organisation se firent sentir; là, elle ne troubla pas seulement l'ordre des pouvoirs, elle changea tout à coup la position relative des hommes et mit en présence et en conflit toutes les classes.
Lorsque Turgot, en 1775, proposa au roi de réformer l'administration des campagnes, le plus grand embarras qu'il rencontra, c'est lui-même qui nous l'apprend, vint de l'inégale répartition des impôts; car comment faire agir en commun et délibérer ensemble sur les affaires de la paroisse, dont les principales sont l'assiette, la levée et l'emploi des taxes, des gens qui ne sont pas tous assujettis à les payer de la même manière, et dont quelques-uns sont entièrement soustraits à leurs charges? Chaque paroisse contenait des gentilshommes et des ecclésiastiques qui ne payaient point la taille, des paysans qui en étaient en partie ou en totalité exempts, et d'autres qui l'acquittaient tout entière. C'était comme trois paroisses distinctes, dont chacune eût demandé une administration à part. La difficulté était insoluble.
Nulle part, en effet, la distinction d'impôts n'était plus visible que dans les campagnes; nulle part la population n'y était mieux divisée en groupes différents et souvent ennemis les uns des autres. Pour arrivera donner aux villages une administration collective et un petit gouvernement libre, il eût fallu d'abord y assujettir tout le monde aux mêmes impôts et y diminuer la distance qui séparait les classes.
Ce n'est point ainsi qu'on s'y prit lorsqu'on entreprit enfin cette réforme en 1787. Dans l'intérieur de la paroisse, on maintint l'ancienne séparation des ordres et l'inégalité en fait d'impôt qui en était le principal signe, et néanmoins on y livra toute l'administration à des corps électifs. Cela conduisit sur-le-champ aux conséquences les plus singulières.
S'agit-il de l'assemblée électorale qui devait choisir les officiers municipaux: le curé et le seigneur ne purent y paraître; ils appartenaient, disait-on, à l'ordre de la noblesse et à celui du clergé; or c'était, ici, principalement le tiers état qui avait à élire ses représentants.
Le conseil municipal une fois élu, le curé et le seigneur en étaient, au contraire, membres de droit; car il n'eût pas semblé séant de rendre entièrement étrangers au gouvernement de la paroisse deux habitants si notables. Le seigneur présidait même ces conseillers municipaux qu'il n'avait pas contribué à élire, mais il ne fallait pas qu'il s'ingérât dans la plupart de leurs actes. Quand on procédait à l'assiette et à la répartition de la taille, par exemple, le curé et le seigneur ne pouvaient pas voter. N'étaient-ils pas tous deux exempts de cet impôt? De son côté, le conseil municipal n'avait rien à voir à leur capitation; elle continuait à être réglée par l'intendant, d'après des formes particulières.
De peur que ce président, ainsi isolé du corps qu'il était censé diriger, n'y exerçât encore indirectement une influence contraire à l'intérêt de l'ordre dont il ne faisait pas partie, on demanda que les voix de ses fermiers n'y comptassent pas; et les assemblées provinciales, consultées sur ce point, trouvèrent cette réclamation fort juste et tout à fait conforme aux principes. Les autres gentilshommes qui habitaient la paroisse ne pouvaient entrer dans ce même corps municipal roturier, à moins qu'ils ne fussent élus par les paysans, et alors, comme le règlement a soin de le faire remarquer, ils n'avaient plus le droit d'y représenter que le tiers-état.
Le seigneur ne paraissait donc là que pour y être entièrement soumis à ses anciens sujets, devenus tout à coup ses maîtres; il y était leur prisonnier plutôt que leur chef. En rassemblant ces hommes de cette manière, il semblait qu'on eût eu pour but moins de les rapprocher que de leur faire voir plus distinctement en quoi ils différaient et combien leurs intérêts étaient contraires.
Le syndic était-il encore ce fonctionnaire discrédité dont on n'exerçait les fonctions que par contrainte, ou bien sa condition s'était-elle relevée avec la communauté dont il restait le principal agent? Nul ne le savait précisément. Je trouve en 1788 la lettre d'un certain huissier de village qui s'indigne qu'on l'ait élu pour remplir les fonctions de syndic. « Cela, dit-il, est contraire à tous les priviléges de sa charge. » Le contrôleur général répond qu'il faut rectifier les idées de ce particulier, « et lui faire comprendre qu'il devrait tenir à honneur d'être choisi par ses concitoyens, et que d'ailleurs les nouveaux syndics ne ressembleront point aux fonctionnaires qui portaient jusque-là le même nom, et qu'ils doivent compter sur plus d'égards de la part du gouvernement. »
D'autre part, on voit des habitants considérables de la paroisse, et même des gentilshommes, qui se rapprochent tout à coup des paysans, quand ceux-ci deviennent une puissance. Le seigneur haut justicier d'un village des environs de Paris se plaint de ce que l'édit l'empêche de prendre part, même comme simple habitant, aux opérations de l'assemblée paroissiale. D'autres consentent, disent-ils, « par dévouement pour le bien public, à remplir même les fonctions de syndic. »
C'était trop tard. A mesure que les hommes des classes riches s'avancent ainsi vers le peuple des campagnes et s'efforcent de se mêler avec lui, celui-ci se retire dans l'isolement qu'on lui avait fait et s'y défend. On rencontre des assemblées municipales de paroisses qui se refusent à recevoir dans leur sein le seigneur; d'autres font toute sorte de chicanes avant d'admettre les roturiers mêmes, quand ils sont riches. « Nous sommes instruits, » dit l'assemblée provinciale de basse Normandie, « que plusieurs assemblées municipales ont refusé d'admettre dans leur sein les propriétaires roturiers de la paroisse qui n'y sont pas domiciliés, bien qu'il ne soit pas douteux que ceux-ci ont droit d'en faire partie. D'autres assemblées ont même refusé d'admettre les fermiers qui n'avaient pas de propriétés sur leur territoire.»
Ainsi donc, tout était déjà nouveauté, obscurité, conflit dans les lois secondaires, avant même qu'on eût encore touché aux lois principales qui réglaient le gouvernement de l'État. Ce qui en restait debout était ébranlé, et il n'existait pour ainsi dire plus un seul règlement dont le pouvoir central lui-même n'eût annoncé l'abolition ou la modification prochaine.
[end cut, continue below pp. 307-310]
Cette rénovation soudaine et immense de toutes les règles et de toutes les habitudes administratives qui précéda chez nous la révolution politique, et dont on parle aujourd'hui à peine, était déjà pourtant l'une des plus grandes perturbations qui se soient jamais rencontrées dans l'histoire d'un grand peuple. Cette première révolution exerça une influence prodigieuse sur la seconde, et fit de celle-ci un événement différent de tous ceux de la même espèce qui avaient eu lieu jusque-là dans le monde, ou de ceux qui y ont eu lieu depuis.
La première révolution d'Angleterre, qui bouleversa toute la constitution politique de ce pays et y abolit jusqu'à la royauté, ne toucha que fort superficiellement aux lois secondaires et ne changea presque rien aux coutumes et aux usages. La justice et l'administration gardèrent leurs formes et suivirent les mêmes errements que par le passé. Au plus fort de la guerre civile, les douze juges d'Angleterre continuèrent, dit-on, à faire deux fois l'an la tournée des assises. Tout ne fut donc pas agité à la fois. La révolution se trouva circonscrite dans ses effets, et la société anglaise, quoique remuée à son sommet, resta ferme dans son assiette.
Nous avons vu nous-mêmes en France, depuis 89, plusieurs révolutions qui ont changé de fond en comble toute la structure du gouvernement. La plupart ont été très-soudaines et se sont accomplies par la force, en violation ouverte des lois existantes. Néanmoins le désordre qu'elles ont fait naître n'a jamais été ni long ni général; à peine ont-elles été ressenties par la plus grande partie de la nation, quelquefois à peine aperçues.
C'est que, depuis 89, la constitution administrative est toujours restée debout au milieu des ruines des constitutions politiques. On changeait la personne du prince ou les formes du pouvoir central, mais le cours journalier des affaires n'était ni interrompu ni troublé; chacun continuait à rester soumis, dans les petites affaires qui l'intéressaient particulièrement, aux règles et aux usages qu'il connaissait; il dépendait des pouvoirs secondaires auxquels il avait toujours eu l'habitude de s'adresser, et d'ordinaire il avait affaire aux mêmes agents; car, si à chaque révolution l'administration était décapitée, son corps restait intact et vivant; les mêmes fonctions étaient exercées par les mêmes fonctionnaires; ceux-ci transportaient à travers la diversité des lois politiques leur esprit et leur pratique. Ils jugeaient et ils administraient au nom du roi, ensuite au nom de la république, enfin au nom de l'empereur. Puis, la Fortune faisant refaire à sa roue le même tour, ils recommençaient à administrer et à juger pour le roi, pour la république et pour l'empereur, toujours les mêmes et de même; car que leur importait le nom du maître? Leur affaire était moins d'être citoyens que bons administrateurs et bons juges. Dès que la première secousse était passée, il semblait donc que rien n'eût bougé dans le pays.
Au moment où la Révolution éclata, cette partie du gouvernement qui, quoique subordonnée, se fait sentir tous les jours à chaque citoyen et influe de la manière la plus continue et la plus efficace sur son bien-être, venait d'être entièrement bouleversée: l'administration publique avait changé tout à coup tous ses agents et renouvelé toutes ses maximes. L'Etat n'avait pas paru d'abord recevoir de cette immense réforme un grand choc; mais tous les Français en avaient ressenti une petite commotion particulière. Chacun s'était trouvé ébranlé dans sa condition, troublé dans ses habitudes ou gêné dans son industrie. Un certain ordre régulier continuait à régner dans les affaires les plus importantes et les plus générales que personne ne savait déjà plus ni à qui obéir, ni à qui s'adresser, ni comment se conduire dans les moindres et les particulières qui forment le train journalier de la vie sociale.
La nation n'étant plus d'aplomb dans aucune de ses parties, un dernier coup put donc la mettre tout entière en branle et produire le plus vaste bouleversement et la plus effroyable confusion qui furent jamais.
57.Henri Baudrillart on “Political Economy” (1857) ↩
[Word Length: 3,960]
Source
Henri Baudrillart, Manuel d’économie politique (Paris: Guillaumin, 1857). Chap. II “Définition et méthode de l’économie politique,” pp. 8-10; Chap. III “Principes philosophiques de l’économie politique,” pp. 11-22.
Brief Bio of the Author: Henri Baudrillart (1821-1892)
[Henri Baudrillart (1821-1892)]
Henri Baudrillart (1821-1892) was a professor of political economy at the Collège de France (where he worked with Michel Chevalier), the editor of the Journal des Économiste between 1855 and 1864, was elected to the Academy of Moral and Political Sciences in 1863, and then appointed professor of political economy at the École nationale des ponts et chaussées in 1881. His major works include Manuel d’économie politique (1857) and Études de philosophie morale et de l’économie politique, 2 vols. (1858). In addition to writing articles for the Journal des Économistes, he wrote for the Constitutionnel, the Journal des Débats, and the Revue des Deux Mondes. He also contributed articles to the Dictionnaire de l’Économie Politique (1852), the Nouveau Dictionnaire d’Économie Politique (1891), and the Dictionnaire général de la Politique (1873). His scholarly interests ranged broadly over the history of economic thought, the relationship between economics and moral philosophy, educational issues, and the history and economics of French agriculture. [DMH]
CHAPITRE II. DÉFINITION ET MÉTHODE DE L'ÉCONOMIE POLITIQUE.
Nous avons suivi, pour établir la légitimité de l'économie politique, la marche méthodique qui consiste à aller du concret à l'abstrait et du connu à l'inconnu. Nous sommes arrivés ainsi à constater qu'elle a un objet déterminé, observable, réductible à certaines lois. Il resterait maintenant à la définir avec plus de rigueur. Nous devons reconnaître que c'est encore, dans l'état de la science, une tâche pleine de difficultés. Les limites rigoureuses de l'économie politique sont toujours un objet de controverse. Quelques écrivains y font rentrer toutes les espèces de travaux et de fonctions, et tous les genres de richesses, appelant de ce dernier nom tous les biens, même ceux de l'esprit et du cœur. Les autres n'y placent que ce qui est directement du domaine des intérêts matériels, tout en tenant compte de l'influence que l'état des idées, des connaissances, des habitudes et les rapports des administrés avec le gouvernement, exercent sur cette dernière nature d'intérêts. Telle est la manière dont particulièrement Adam Smith, dans son grand ouvrage sur la Richesse des Nations, Jean-Baptiste Say, dans son Traité, Sismondi, Malthus et récemment M. John Stuart Mill, dans leurs Principes, Droz, dans son Économie politique, Rossi, dans son Cours, ont entendu la science économique, avec des nuances diverses qui n'altèrent pas l'unité de leur point de vue.
En nous réservant de revenir sur cette question controversée, nous définirons dès à présent l'économie politique, la science qui a pour objet la manière dont la richesse se produit, s'échange, se distribue et se consomme. Or, comme rien de tout cela n'a liéu sans travail et sans échange, et comme, d'un autre côté, aucun de ces travaux et de ces échanges ne s'opère au hasard, il s'ensuit que les lois qui président au travail et à l'échange forment le véritable champ de la science économique.
On voit combien cette définition diffère de celle que M. de Sismondi, dans un ouvrage d'ailleurs remarquable à tant de titres, malgré les erreurs qu'il renferme,312 adonnée de la science économique, quand il affirme que « le bienêtre physique de l'homme, autant qu'il peut être l'ouvrage de son gouvernement, est l'objet de l'économie politique. » Une pareille définition, par elle-même fort inexacte, a en outre le tort grave de fournir des armes à ces sectes qui nourrissent le commun dessein, à travers toutes leurs dissidences, de mettre l'industrie et le commerce entre les mains de l'État omnipotent. L'économie politique s'inspire de la donnée opposée. Loin de requérir l'action de l'État en tant que producteur direct et distributeur de la richesse sociale, elle enseigne que le bien-être est le fruit du travail libre soumis dans sa marche à des conditions qu'il n'appartient à aucun pouvoir humain ni de décréter ni d'abroger. Là gît la principale différence qui la sépare, d'une part, du vieux système réglementaire, et, d'autre part, du socialisme moderne dans la plupart des formes qu'il a revêtues.
Il importe, d'ailleurs, de distinguer, au point de vue de la méthode, l'économie politique en elle-même de son objet pratique. M. Droz a pu dire qu'à ce dernier point de vue le but que se propose l'économie politique, c'est de « rendre l'aisance aussi générale qu'il est possible.313 » Rien n'est plus vrai. Mais il serait à craindre qu'en perdant de vue la distinction essentielle de la science et de l’art, on ne tombât dans les mille détails d'organisation qui ne sont point l'affaire de l'économiste, mais de l'administrateur. Il serait à craindre aussi que le jugement prévenu du public ne rendit l'économie politique responsable de ses assertions en ce qu'elles peuvent avoir de sévère relativement à la condition du genre humain, ainsi que cela a eu lieu à propos de Malthus et du principe de population dont on a fait un grief contre les économistes. Le seul objet de la science est de connaître, et le seul reproche qui puisse lui être fait, c'est d'avoir mal observé. De même, s'il est vrai quelle consiste uniquement dans les vérités qui résultent de l'étude d'un sujet quelconque, dans l'observation de certains phénomènes et de leurs rapports, ce n'est point à elle, c'est à l’art, « collection de maximes ou préceptes pratiques dont l'observance conduit à faire avec succès une chose quelle qu'elle soit314 », qu'il appartient de tenir compte des résistances et des exceptions, et de passer de la théorie à la pratique. L'art est justiciable de la prudence, la science ne l'est que de la vérité.
CHAPITRE III. PRINCIPES PHILOSOPHIQUES DE L’ÉCONOMIE POLITIQUE.
Comme toutes les sciences morales et politiques, celle à laquelle cet ouvrage est consacré a ses fondements dans la nature humaine. C'est l'homme qui produit, distribue, échange et consomme la richesse. Il est par son activité le point de départ des faits économiques comme producteur, et il en est le centre comme consommateur par la satisfaction des besoins. Il importe donc de se former une idée de la constitution de l'homme lui-même. L'expérience a trop souvent démontré le danger des idées fausses sur ce point fondamental. De même qu'une bonne théorie économique importe à la solution des questions sociales, de même une bonne théorie morale importe pour asseoir sur des bases plus étendues et plus profondes une théorie économique satisfaisante.
Nous ne dirons rien que la vue la plus sommaire de la nature humaine ne justifie, rien que chacun rie puisse facilement vérifier, en affirmant que l'homme est un être soumis à des besoins, libre et responsable, sociable, perfectible.
Insistons un peu sur ces prolégomènes. En les tirant au clair, nous éviterons le reproche si souvent adressé à la science économique de matérialisme et d'empirisme étroit: nous verrons qu'elle se rattache dans l'homme à ce qu'il y a de plus noble comme de plus essentiel; nous constaterons enfin qu'elle n'est que la mise en œuvre des éléments de sa nature, et la contre-épreuve des principes les plus élevés de la morale.
I.
L'homme est soumis à des besoins. Le besoin est comme le fonds de notre nature. Sans lui nous ne saurions même comprendre la vie d'un être sensible et borné. Sans doute le besoin est un assujettissement pénible, et pourtant personne n'ignore que la multiplicité des besoins est le signe de la supériorité des espèces: elles jouissent et souffrent sur plus de points à mesure qu'elles s'élèvent dans l'échelle des êtres, c'est-à-dire qu'elles vivent plus complétement. L'animal a plus de besoins que la plante, l'éléphant en a plus que l'huître. Le civilisé, au sein de l'espèce humaine, en éprouve plus que le sauvage. Ces besoins qui répondent à la triple fin de l'homme, physique, intellectuelle, morale, veulent être satisfaits, les uns sous peine de cruelles douleurs et même sous peine de mort, les autres sous peine d'un moindre développement qui est aussi un grand mal, quoiqu'il ne soit pas toujours aussi vivement senti. « L'âme est un feu qu'il faut nourrir, et qui s'éteint, s'il ne s'augmente, » a dit Voltaire avec autant de bon sens que d'esprit. Bornons-nous à affirmer que par la souffrance qui les accompagne et par l'espoir du bien-être qui suit leur satisfaction, les besoins sont l'indispensable aiguillon de l'activité humaine.
L’intérêt personnel naît du besoin. Quelques philosophes, comme Bentham, ont eu le tort de voir dans ce motif l'unique principe de toutes nos actions. Ce n'est que par des subtilités qui répugnent au sens commun aussi bien qu'à une analyse exacte des éléments de la nature humaine qu'on ramène à l'intérêt personnel la bienveillance, l'amour, la pitié, La sympathie n'a rien de commun avec le calcul. C'est aussi par de purs jeux de mots que l'on prétend faire du devoir, de l’obligation morale, c'est-à-dire du sacrifice de l'intérêt lui-même, une autre sorte de calcul.jMais si l'intérêt n'est pas le seul mobile des actions humaines, il y joue un rôle incontestable aussi bien que légitime. L'amour de soi, cet instinct indestructible de tous les êtres organisés, revêt chez l'homme un caractère supérieur de réflexion, de moralité, d'obligation même, que la religion a consacré en condamnant le découragement, le suicide, et en faisant de l'espérance une des trois grandes vertus qu'elle recommande. Sans l'intérêt personnel, point de ressort moral, point de prévoyance, point de travail, point d'épargne, point d'invention; la civilisation s'arrête et la vie même s'éteint.
On fera une distinction pleine d'à-propos, comme explication et comme justification de ce principe de l'économie politique, en remarquant que l'intérêt ne saurait être confondu avec l’égoïsme, qui va jusqu'à sacrifier les autres à soi. Renfermé dans ses justes limites, l'intérêt est d'une admirable fécondité pour le bien, non-seulement privé, mais général. Il en est autrement de l'égoïsme qui le plus souvent engendre de déplorables conséquences économiques. On peut dire qu'en général l'intérêt bien entendu tend à rapprocher les hommes et que l'égoïsme tend à les diviser. C'est l'intérêt qui a fait naître l'échange. C'est l'égoïsme qui produit toutes les usurpations.
Nous montrerons, en parlant de la consommation, comment le besoin, en devenant immodéré, immoral, conduit au désordre économique.
On voit par là que l'économie politique, en reconnaissant dans le besoin un fait originel et nécessaire, sur lequel elle s'appuie, n'a rien de commun avec la trop fameuse théorie qui s'en tient à cette maxime: A chacun suivant ses besoins, comme s'il suffisait d'avoir des besoins pour avoir des droits, comme si le désir que chacun peut avoir d'élégantes demeures, de mets exquis et de toutes les commodités de la vie, autorisait suffisamment à les réclamer, comme si l'homme avait un titre quelconque sur quoi que ce soit au monde sans l'avoir gagné. Le besoin n'est pas tout. Il n'est que la condition du développement économique, le stimulant de tout travail; le vrai .principe de ce développement est dans la liberté.
II.
La liberté a bien des formes, elle a bien des degrés, mais considérée dans son fonds, elle repose sur ce fait unique et merveilleux, le libre arbitre. Ce n'est que par la plus radicale inconséquence que la philosophie du dernier siècle, par quelques-uns de ses plus célèbres organes, a pu revendiquer toutes les libertés et mettre en doute celle de l'homme intérieur, dans laquelle toutes les autres ont leur point de départ.
Le véritable attribut distinctif de l'homme consiste dans cette liberté, éclairée par la raison, qui s'atteste à la conscience et que tout suppose dans les jugements portés par les hommes et sur eux-mêmes et sur les autres. L'univers est un composé de forces. La seule force libre et raisonnable, c'est l'homme lui-même. On pourrait le définir une activité libre servie par des organes, l'intelligence elle-même n'étant que le premier organe de cette activité. Engagée au milieu d'un système de forces fatales, qui tendent à l'opprimer, la liberté réagit contre elles, d'abord pour les conjurer, ensuite pour les plier à son usage. Cette lutte régulièrement poursuivie, dont la liberté humaine est le principe, les agents naturels les auxiliaires, et la satisfaction des besoins le but, on la nomme l'Industrie.
On conçoit que la liberté, chez un être imparfait comme l'homme, implique des chances d'erreur et une certaine somme de mal. Sans doute Dieu pouvait supprimer chez lui le libre arbitre et se borner à lui donner la perfection restreinte de l'abeille et du castor, qui, depuis le commencement, exécutent leurs ouvrages avec l'infaillibilité de l'instinct. Il ne l'a pas voulu. Il a jugé à propos que l'homme fût le fils de ses œuvres, et une condamnation, qui est elle-même un titre de supériorité sur le reste des êtres créés, l'oblige à « gagner son pain à la sueur de son front. » Toute vérité découverte est le fruit d'un travail, d'un effort. Il en est de même de toutes les autres applications de la libre activité de l'homme. Si la liberté humaine se refuse à l'effort, ou si elle agit mal, il en résulte pour l'homme des privations, des souffrances. La loi de la liberté, c'est de se développer en se conformant aux prescriptions de la raison. La sanction de cette loi, c'est la responsabilité, qui attache la récompense aux efforts bien gouvernés et la peine à l'inertie ou au désordre.
La liberté et la responsabilité sont, pour ainsi dire, l’âme même de l'économie politique. Le travail, qui n'est que l'application suivie et régulière de l'activité, est libre par essence comme la source dont il émane. Mais il est souvent opprimé en fait: une telle oppression constitue une violation évidente des lois de la nature humaine; elle ôte à l'homme le seul moyen légitime qu'il ait de subsister, de se développer. Travailler est une nécessité et un devoir; ce doit donc être un droit. Ainsi en jugeaitTurgot, lorsqu'il plaçait en tête de l'édit qui abolit les corporations, ces mémorables paroles qui sont comme la préface et le résumé de l'économie politique: « Dieu, en donnant à l'homme des besoins et en lui rendant nécessaire la ressource du travail, a fait du droit de travailler la propriété de tout homme, et cette propriété est la première, la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes. » Il suit de là que chacun doit travailler à ses riques et périls, sans mettre à la charge d'autrui le sacrifice et l'effort, pour se réserver les produits de cet effort et les fruits de ce sacrifice. C'est ce qui fait que l'esclavage, dont l'effet est de mettre tout le travail d'un côté, et de l'autre tous les produits du travail, est une injustice si révoltante; c'est ce qui fait aussi qu'en vertu d'une admirable harmonie de l'utile et du juste, ce travail est moins productif que le travail libre. Des deux stimulants en effet que nous avons nommés plus haut, la crainte de la souffrance et le désir du bien-être, la première cause seule agit sous la forme des menaces et des châtiments, la seconde est anéantie. Mais l'esclavage, qui est la plus destructive atteinte portée à la liberté et à la responsabilité, n'est pas le seul dommage qu'elles puissent recevoir. Entre leur anéantissement radical et leur entier respect, leur plein développement, il y aune multitude de degrés intermédiaires par lesquels le monde a passé, et qu'il n'a pas achevé d'épuiser encore, même dans notre Europe occidentale, cette patrie, avec l'Amérique du Nord, de la civilisation la plus haute et la plus complète à laquelle il ait été jusqu'à présent donné à l'homme de s'élever.
III.
La sociabilité, cet autre attribut distinctif par lequel Aristote définit l'homme315, ne résulte pas moins de l'observation de la nature humaine. Sans le concours de ses semblables, l'individu ne peut rien et n'est rien, physiquement et moralement. La sympathie, une sympathie irrésistible, rapproche les membres de la famille humaine, et l'intérêt cimente ensuite leur union. La famille est la forme inévitable et primitive de la sociabilité: sans la société, le langage indispensable non-seulement à l'expression, mais au développement de la pensée et à celui de l'homme tout entier, n'aurait pas été créé. Niera-t-on que la sociabilité soit un instinct impérieux de notre nature? Qu'on voie ce que fait le système pénitentiaire. Pour punir celui qui s'est mis contre elle en révolte, la société recourt à ce moyen aussi simple qu'infaillible, elle l'isole. Il s'est trouvé même que ce supplice avait dépassé son attente, et que, pour ne pas devenir une cruauté plus barbare que la peine de mort, il doit être tempéré par quelque adoucissement. L'hypothèse de l'isolement comme état primitif de l'humanité, si commune au dernier siècle, n'est que le rêve de la philosophie en délire. Un tel rêve n'a pu naître que dans une société pleine d'abus et de corruption, qui semblait, à des esprits extrêmes violemment ramenés en arrière vers un âge d'or chimérique, condamner l'existence de la société même. Pourtant cette hypothèse, toute vaine qu'elle est, a exercé une funeste influence sur les diverses branches des sciences sociales. En s'appliquant à la politique, la philosophie du dix-huitième siècle a trop envisagé l'homme comme un être indépendant, purement personnel, ayant des droits qu'il tient de la nature, tandis que ses devoirs ne lui viendraient que de conventions souscrites. L'idée de l'homme isolé, au dix-huitième siècle, se retrouve partout: en métaphysique, c'est l'homme-statue de Condillac; en morale, c'est l'homme égoïste d'Helvétius; en politique, c'est l'homme sauvage de J.-J. Rousseau, cet homme d'avant la propriété et d'avant la société, qui consent à se faire sociable, comme s'il ne l'était pas naturellement. Suivant la juste et profonde remarque qui en a été faite316, cette tendance à voir dans l'homme le côté individuel plus que le côté sociable a eu dans les idées et jusque dans les lois un contre-coup fâcheux, et peut-être l'économie sociale, dans ses théories et dans ses applications, n'a-t-elle pas toujours su se défendre, même au dix-neuvième siècle, de cette pente sur laquelle avait glissé le dix-huitième.
Au reste, pour mériter le reproche d'individualisme excessif, qui lui a été adressé par les écoles socialistes, il faudrait que l'économie politique manquât à sa propre nature. Son nom même (Politikon, en grec, signifie social) suppose l'existence de la société. L'expression économique de la sociabilité, c'est l'échange. Plus l'homme devient sociable, en vertu de causes religieuses, morales, politiques, qui dominent la civilisation économique elle-même et qui lui impriment tel ou tel caractère, plus il multiplie ses échanges. Sous les formes diverses qu'il revêt, échange d'idées, échange de sentiments, l'échange est le lien unique de la société; il en est un des principaux sous sa forme spécialement industrielle. Sans trop faire violence au langage, peut-être peut-on dire que certains animaux travaillent; on peut aller peut-être jusqu'à prétendre que la fourmi capitalise; mais ils n'échangent point. L'échange, c'est la sociabilité en action, la solidarité humaine rendue visible et palpable, habituelle comme le besoin et familière comme l'habitude. L'économie politique se propose comme but pratique de rendre les échanges nombreux, faciles, purs de fraude. En demandant la liberté de la production, elle demande, comme une conséquence nécessaire, la liberté de l'échange; car la production qui, chez les peuples civilisés, et d'autant qu'ils le sont davantage, ne s'opère elle-même qu'à l'aide d'une série d'échanges, ne saurait être libre quand l’échange est entravé.
Il serait facile de montrer la sociabilité avec la solidarité qui en résulte, se faisant jour encore sous d'autres formes plus spéciales dans le monde économique, so^s celle de la division, du travail, qui n'est que la coopération de plusieurs travailleurs ou groupes de travailleurs à une même œuvre, c'est-à-dire une véritable association, sous celle des assurances, sous celle de l'impôt, sous celle du crédit. Mais nous craindrions d'anticiper sur les développements nombreux que recevront ces idées: sociabilité, solidarité. L'échange, posé en tête de l'économie politique, résume tout le reste. Il n'y pas un seul fait économique qui ne suppose ce fait et qui ne s'y ramène.
IV.
L'homme est enfin perfectible; cela résulte de ce que nous vénons de dire. A quoi nous serviraient notre liberté, notre responsabilité, le secours de nos semblables, si ce n'est à nous perfectionner, et, avec notre être intérieur, à perfectionner aussi notre condition?317 La loi de cette liberté, de cette responsabilité humaine, de cette sociabilité, considérée, soit en elle-même à titre de sentiment, soit dans ses formes, c'est de se développer sans cesse. Ce développement, mis à la charge de l'homme qui en est à la fois l'auteur et l'objet, mesure tous les progrès de l'ordre moral et de l'ordre matériel.
Et d'abord, il faut le reconnaître, les besoins obéissent à une loi de développement. À peine a-t-il réalisé le bien, l'homme vise au mieux. Il aime aussi la diversité; il l'aime à ce point que le goût de la nouveauté figure lui-même au nombre de ses besoins les plus impérieux. Prenez les besoins les plus matériels comme les plus intellectuels, vous verrez qu'ils vont sans cesse se développant. C'est un mal, sans doute, quand l'homme est conduit par là aux raffinements de la mollesse et de la volupté. Mais, à titre de loi générale, c'est un bien. Grâce à cette loi, ses besoins matériels, qui ne se contentent plus d'une satisfaction grossière comme chez les sauvages et chez les barbares, suscitent une foule d'industries qui contribuent à la force et au charme de la civilisation. Ses besoins spirituels deviennent aussi plus exigeants. Le besoin de savoir devient une passion véritable. Le besoin d'aimer devient plus délicat. Le besoin du beau se raffine et s'exalte; il enfante les chefs-d'œuvre de l'art; il se mêle à quelque degré à toutes les créations, même les plus humbles, de l'industrie. Le besoin religieux enfin va se spiritualisant sans cesse davantage. Cette expansibilité des besoins, qui impose à l'homme de nouveaux motifs de vertu, en le soumettant à des tentations plus nombreuses, lui crée aussi de nouveaux mobiles d'action. Sans elle, l'activité humaine s'endormirait; les sociétés seraient stationnaires; le mot de progrès ne présenterait plus aucun sens.
La liberté et la responsabilité, de même que les besoins, dont elles règlent l'essor, obéissent à la loi du progrès. La vie de l'individu est un combat dont le perfectionnement est le but. L'histoire de l'humanité est de même un long apprentissage de la liberté, qui apprend sans cesse, à travers bien des tâtonnements et des erreurs, à éclairer et à assurer sa marche. L'homme moderne est plus libre que l'homme antique du joug de l'État. L'esclavage qui asservissait autrefois l'immense majorité n'est plus qu'une exception flétrie par l'opinion et dès lors, dans un temps plus ou moins prochain, condamnée à disparaître de la surface du globe. Le caractère ultra-préventif des législations s'est généralement effacé. Le but marqué à l'éducation, non d'ailleurs suffisamment atteint encore, il s'en faut, c'est de fortifier chez l'individu le ressort de la responsabilité et de lui apprendre à faire de sa liberté un emploi intelligent et judicieux. Notre révolution de 1789 a été la proclamation officielle et la mise en pratique, dans la plus grande partie des institutions, de ces principes qui se traduisent par la liberté de conscience, par la liberté de travail, par l'égalité civile. En abolissant les religions d'État, tout aussi bien que les jurandes et les maîtrises, elle a replacé l'individu dans l'exercice de ses droits, sous l'égide de ce sentiment viril de la responsabilité dont se défiaient les anciens législateurs, et qui s'est trouvé au sortir d'une longue minorité soumis aux épreuves du nouveau régime politique et industriel pour s'y aguerrir et s'y développer.
De son côté, sous l'influence du christianisme, qui proclame la fraternité de tous les hommes, rachetés du sang d'un même Dieu, et sous celle des idées philosophiques, la sociabilité s'est étendue. La séparation en castes a disparu. L'égalité, écrite dans les lois, pénètre de plus en plus dans les mœurs et rapproche les conditions. La société économique, qui, grâce au commerce, a toujours été plus vaste que la société politique confinée dans la nation, étend de plus en plus ses limites aux frontières mêmes de la terre habitée, par le développement des échanges internationaux, l'un des effets les plus marqués et désormais l'une des causes les plus puissantes de l'effacement des haines de peuple à peuple.
Telles sont les données essentielles que l'économie politique emprunte à une vue impartiale de la nature humaine contemplée en elle-même ou étudiée dans le développement de son histoire et qu'on peut appeler indifféremment, suivant le point de vue auquel on se place, principes de la civilisation chrétienne, principes de la philosophie, principes de la révolution française. Nous verrons mieux encore par ce qui suivra comment le travail, le capital, le commerce, le crédit, etc., en un mot les diverses parties de l'économie politique se trouvent être, sans qu'il y ait besoin d'aucun parti pris pour les ramener à ces notions primordiales, leur justification éclatante et leur constante application.
58.Molinari on "The Different Kinds of Property and Liberty" (1863)↩
[Word Length: 6,793]
Source
Gustave de Molinari, Cours d'Économie politique. 1st edition 1855. 2nd revised and enlarged edition (Bruxelles et Leipzig: A Lacroix, Ver Broeckoven; Paris: Guillaumin, 1863).Tome I: La production et la distribution des richesses, Quatrième leçon: “La Valeur et la Propriété.” pp. 107-31.
QUATRIÈME LEÇON. LA VALEUR ET LA PROPRIÉTÉ
Définition de la propriété. — Qu'elle est un rapport de justice entre la valeur et ceux qui l'ont produite, reçue ou acquise. — Que toute altération de ce rapport engendre une nuisance économique. — Raison de ce phénomène. — Analyse de la propriété. — La propriété considérée dans son objet, la valeur. — Des formes sous lesquelles la valeur s'incarne; — des valeurs personnelles, immobilières et mobilières. — Comment les valeurs périssent. — Comment des valeurs périssables peuvent constituer des capitaux impérissables. — Des chances de plus value et des risques de moins value. — La propriété considérée dans son sujet, le propriétaire. — En quoi consiste le droit de propriété. — Libertés dans lesquelles ce droit se ramifie. — De la capacité nécessaire pour l'exercer. — De la tutelle nécessitée par le défaut de capacité des propriétaires. —De l'effet des restrictions opposées à l'exercice du droit de propriété. — Des risques auxquels ce droit est assujetti et des servitudes qu'ils nécessitent. — Des formes du droit de propriété; — de la propriété commune, individuelle et collective. — Du monopole et de la concurrence.
Le phénomène de la valeur engendre celui de la propriété. La propriété c'est le rapport de justice existant entre la valeur et ceux qui l'ont créée, reçue ou acquise. L'étude de ce rapport fait l'objet de la science du droit. Nous n'aurions donc pas à nous en occuper dans un cours d'économie politique si le droit, tel que les hommes le conçoivent et l'appliquent, autrement dit le droit positif, était, partout et toujours, l'incarnation du droit naturel, c'est à dire de la justice; si, d'autre part, jamais aucune atteinte n'y était portée; si, en conséquence, la production et la distribution des valeurs n'étaient point influencées tant par les déviations du droit positif que par les infractions que les hommes régis par ce droit imparfait commettent à la justice.
Malheureusement, le droit positif n'a encore été dans aucune société la pure incarnation de la justice, et celle-ci, à moins de supposer que les hommes arrivent un jour à la perfection morale, ne sera jamais une règle de conduite universellement et constamment obéie. Si le droit positif tend, sous l'influence du progrès, à se rapprocher du droit naturel, il est loin encore d'être arrivé à s'y confondre; et quoique les hommes soient doués d'un sens particulier qui leur donne l'intuition même du droit et qui porte les noms de conscience, de sens moral ou de sentiment de la justice, ce sens particulier demeure, faute de vigueur native, et, plus souvent, faute de culture, fort obtus chez le plus grand nombre. D'ailleurs, il a rarement pour auxiliaires des forces morales suffisantes pour assujettir et dominer les appétits inférieurs et les passions excessives de l'âme humaine. De là les innombrables et incessantes infractions commises à la justice, soit par le manque d'une vue assez claire pour la discerner, soit par le défaut d'une énergie morale assez puissante pour la faire observer. De là aussi l'indispensable nécessité d'un appareil destiné à assurer le règne du droit positif, si imparfait qu'il soit.
Maintenant, voici un phénomène que l'expérience nous révèle: c'est que toute atteinte portée à la justice soit en vertu du droit positif, soit au mépris et en violation de ce droit, engendre une nuisance économique, laquelle arrête ou ralentit la production des valeurs ou, ce qui revient au même, la multiplication des richesses. Partout et toujours, le développement de la production est en raison de la somme de justice incarnée dans la loi et dans les mœurs; partout et toujours, la diminution de la justice entraine une diminution proportionnelle dans la production.
Que si nous voulons avoir la raison de ce phénomène, que si nous voulons savoir pourquoi toute atteinte portée à la propriété, c'est à dire au rapport de justice existant entre la valeur et ceux qui l'ont créée, reçue ou acquise, a pour effet de ralentir ou de diminuer la production, nous devons achever d'étudier la valeur, non seulement dans les éléments qui la constituent, mais encore dans les formes sous lesquelles elle s'incarne et dans les destinations qu'elle reçoit.
Récapitulons d'abord les notions que nous a fournies l'analyse des éléments constitutifs de la valeur.
Le premier, c'est l'utilité, c'est à dire la qualité qu'ont naturellement les choses ou qui leur est donnée artificiellement de satisfaire à nos besoins.
Lorsque les choses sont naturellement utiles, c'est à dire lorsqu'elles peuvent servir, sans aucun changement de forme, de temps ou de lieu, à la satisfaction de nos besoins, lorsqu'elles existent, de plus, en quantité illimitée, lorsqu'elles ne sont rares à aucun degré, lorsque nous pouvons, en conséquence, les consommer sans avoir été préalablement obligés de les produire, elles ne constituent point des valeurs. Ce sont de simples utilités gratuites.
Mais les choses naturellement utiles et d'une abondance illimitée, autrement dit les utilités gratuites, sont l'exception. Généralement, l'utilité doit être créée, produite, et elle ne peut l'être que par une mise en œuvre des forces et des matériaux dont l'homme dispose. L'immense majorité des choses utiles servant à réparer et à augmenter nos forces physiques, intellectuelles et morales n'existent que par le fait de la production; elles demeurent, en conséquence, plus ou moins rares, et elles constituent des valeurs.
Il entre donc deux éléments, non seulement distincts, mais contraires, dans la composition de la valeur: l'un, l'utilité, se résume en un pouvoir de réparation et d'augmentation des forces dont l'homme dispose et qu'il applique à la satisfaction de ses besoins; l'autre, la rareté, implique au contraire, nécessairement, une dépense de ces mêmes forces. Cette dépense constitue les frais d'acquisition de l'utilité; elle se proportionne aux difficultés qu'il faut vaincre pour la créer ou l'obtenir.
Or, si l'utilité se résume, en dernière analyse, en une certaine quantité de forces assimilables, et si l'assimilation ou la consommation de ces forces procure une jouissance; si, d'une autre part, la rareté, impliquant une certaine somme de difficultés à vaincre, nécessite une dépense de forces et cause une peine, qu'en doit-il résulter? C'est que la valeur, qui est composée d'utilité et de rareté, ne peut être produite qu'à la condition que les forces acquises que contient l'utilité soient attribuées, au moins en partie, à celui qui a surmonté les difficultés et dépensé les forces nécessaires pour les acquérir, ou bien encore qu'à la condition que la jouissance impliquée dans l'utilité soit attribuée à celui qui s'est donné la peine, qu'implique à son tour la rareté.
Si cette condition n'était point observée, si celui qui a dépensé de la force ou du pouvoir ne recevait en échange aucune portion de la force ou du pouvoir qu'il a créé, la production des valeurs deviendrait impossible, car nul ne peut dépenser des forces sans en récupérer, nul ne peut produire sans consommer. Enfin, si aucune partie de la jouissance ne revenait à qui s'est donné la peine, il n'existerait aucun motif pour produire.
Ce motif, ou, pour nous servir de l'expression consacrée, cet intérêt réside tout entier dans la possession de l'utilité produite ou d'une utilité équivalente. Lorsque le producteur peut s'attribuer toute cette utilité, l'intérêt qu'il a à la, créer est à son maximum. Cet intérêt diminue, au contraire, à mesure que la part d'utilité qui lui est attribuée devient plus faible; il tombe à zéro lorsque cette part devient nulle.
Comment peut-on attribuer au producteur l'utilité contenue dans la valeur? En lui attribuant cette valeur même, c'est à dire en lui en garantissant la propriété. Maître de la valeur, il pourra user à sa guise de l'utilité qui s'y trouve contenue.
Que si maintenant l'on veut savoir jusqu'où doit aller cette garantie, il faut savoir jusqu'où va la valeur. Il faut rechercher dans quelles choses elle s'incarne, quelle est la nature, la forme, l'étendue et la durée de ces choses. Il faut, puisque la valeur est l'objet de la propriété, connaître exactement la valeur si l'on veut correctement garantir la propriété.
D'abord, on peut écarter du domaine de la propriété, toutes les choses qui ne sont ni pourvues de valeur ni susceptibles d'en acquérir. En revanche, il faut y comprendre toutes les valeurs, quelles que soient les formes sous lesquelles elles se trouvent incarnées.
Ces formes de la valeur, et, par conséquent, de la propriété, peuvent être ramenées à trois grandes catégories. On distingue: les valeurs personnelles, immobilières et mobilières, faisant l'objet d'autant de catégories correspondantes de propriétés.
La valeur incarnée dans les personnes fait l'objet de la propriété personnelle. Cette valeur réside, d'une part, dans l'utilité que l'on peut tirer des personnes, considérées comme agents productifs, en employant leurs forces ou leurs aptitudes physiques, morales et intellectuelles; d'une autre part, dans leur rareté, ou, ce qui revient au même, dans la limitation de leur nombre, ce qui implique la nécessité de les produire et de les entretenir, moyennant une dépense plus ou moins considérable. Tous les hommes constituent des valeurs, — valeurs essentiellement inégales comme leurs forces ou leurs aptitudes naturelles et acquises, — et, par conséquent aussi, des propriétés. Seulement, tandis que les uns s'appartiennent à eux-mêmes et sont qualifiés de libres, les autres sont appropriés en tout ou en partie à des maîtres, et sont qualifiés d'esclaves, de serfs ou de sujets. Les hommes libres, aussi bien que les esclaves, ont une valeur; mais comme ils ne se vendent point, cette valeur n'est pas aussi facile à constater. On peut toutefois la reconnaître et l'exprimer, en calculant le taux et la durée des profits ou des salaires que tout individu maître de lui-même retire de l'exploitation ou de la location de ses facultés personnelles, et se rendre compte ainsi de la valeur d'une population libre aussi bien que d'une population esclave.
Les valeurs incarnées dans les personnes et faisant l'objet des propriétés personnelles sont susceptibles comme les autres d'augmentation et de diminution. Elles peuvent être augmentées, d'un côté, par l'accroissement de l'utilité qui les constitue, par une éducation et un apprentissage qui développent les forces et les aptitudes productives de l'individu, d'un autre côté, par une augmentation de la rareté qui forme leur second élément constitutif, c'est à dire par une diminution du nombre des individualités productives relativement aux emplois qui leur sont ouverts, ou, ce qui revient au même, par une augmentation des emplois qui leur sont ouverts relativement à leur nombre.
Les valeurs incarnées, ou, pour nous servir de l'expression anglaise, investies dans toutes les choses qui ne sont point susceptibles d'être déplacées, telles que les fonds de terre, les bâtiments, etc., font l'objet de la propriété immobilière. Cette propriété ne réside point, comme on est trop généralement disposé à le croire, dans la matière des immeubles, mais dans la valeur qui s'y trouve incarnée. Ainsi la propriété d'un fonds de terre ne réside point dans le sol, auquel cas il serait impossible d'en déterminer les limites; mais dans la valeur du sol, appliqué à telle ou telle destination productive. Une valeur minière, par exemple, peut se créer sous le sol indépendamment de la valeur agricole qui se crée à la surface. Ces deux valeurs peuvent coexister et coexistent en formant des propriétés différentes, et leurs confins sont à la limite des éléments utiles à chacune des entreprises de production qui leur donnent naissance.
Enfin, la valeur investie dans toutes les choses susceptibles d'être mobilisées fait l'objet de la propriété mobilière.
On a voulu, dans ces derniers temps, créer une quatrième catégorie de propriété, nous voulons parler de la propriété intellectuelle, appliquée aux produits de l'invention, de la science, de la littérature et de l'art. Mais les valeurs créées par la production dite intellectuelle peuvent être rattachées aux catégories précédentes. Dans le cas d'une mine, par exemple, la valeur créée par le découvreur s'incarne dans un immeuble. Dans le cas d'une machine, d'un livre ou d'une œuvre d'art, la valeur créée par l'inventeur, l'homme de lettres ou l'artiste s'incarne dans un objet mobilier. Dans le cas d'un procédé, la valeur créée s'incarne dans une capacité productive et constitue une valeur personnelle. Toutefois, ces valeurs ont, dans leur mode d'existence et de transmission, des caractères particuliers qui pourraient motiver l'établissement d'une catégorie à part.
Née avec la valeur, la propriété périt avec elle. Nous savons comment les valeurs naissent et sous quelles formes elles s'incarnent; voyons maintenant comment elles périssent.
Elles périssent par la destruction de l'utilité ou de la rareté des choses dans lesquelles elles sont contenues. Si une chose pourvue de valeur perd son utilité soit par voie de consommation, soit, au contraire, parce qu'elle cesse de répondre à un besoin, sa valeur périt. De même, si cette chose après avoir existé seulement en quantité limitée vient à se produire en quantité illimitée, si elle cesse d'être rare à quelque degré, sa valeur périt encore. On pourrait dresser un tableau de la longévité des valeurs, depuis celle de la leçon du professeur, qui périt au moment même où elle est produite, jusqu'à celle de l'or dont la durée est presque illimitée. Entre ces limites extrêmes de longévité, viennent se placer toutes les valeurs que crée et multiplie incessamment l'industrie humaine prise dans son acception la plus large, les valeurs incarnées dans les hommes, — libres ou esclaves, — dans les bêtes de somme, dans les terres, les bâtiments, les machines, les outils, les marchandises de toute sorte, les livres, les objets d'art. La longévité moyenne des valeurs est, en définitive, assez courte; et s'il est des produits ou des œuvres dont la valeur traverse les siècles, le plus grand nombre n'a qu'une valeur limitée à quelques années, quelques mois ou même quelques jours.
Cependant, au moyen de ces valeurs essentiellement périssables, on constitue des capitaux qui ne périssent point, ou, du moins, qui subsistent bien longtemps après que les valeurs qui ont servi à les constituer ont été anéanties. Cette propriété qu'ont les valeurs, si éphémères qu'elles soient, d'engendrer des capitaux durables tient à ce qu'elles sont échangeables.
Comment un capital formé de valeurs éphémères mais échangeables peut subsister d'une manière indéfinie, voilà ce dont il importe de se rendre bien compte.
On crée des valeurs en vue de jouir de l'utilité qu'elles contiennent ou qu'elles peuvent procurer. Mais cette jouissance, on peut la recueillir de différentes manières: directement ou indirectement, immédiatement ou médiatement. Ainsi, on crée une valeur sous forme de blé. On consomme ce blé, on en détruit l'utilité, partant la valeur. Voilà une jouissance obtenue directement par la consommation de l'utilité, entraînant la destruction de la valeur que l'on a créée.
Cependant, au lieu de consommer directement le blé, on peut l'échanger contre d'autres produits, en se servant ainsi de la valeur du blé pour se procurer d'autres utilités que celles que le blé contient. Supposons qu'on l'échange contre de la monnaie. On peut conserver cette monnaie à titre de capital ou l'échanger contre d'autres choses, produits ou services. Lorsque ce second échange est accompli, on obtient indirectement la satisfaction en vue de laquelle on a créé la valeur.
Tantôt aussi, la consommation est immédiate, et tantôt elle s'effectue au bout d'un espace de temps plus ou moins long. Si la leçon du professeur, par exemple, est consommée dès qu'elle est produite, la plupart des produits se conservent plus ou moins longtemps avant d'être consommés ou usés, et ils constituent des accumulations de valeurs ou des capitaux. Que ces capitaux ne se détruisent point, aussi longtemps que les valeurs, dont ils sont formés, demeurent échangeables, cela se conçoit aisément. Si mon capital est investi dans un chargement d'oranges, il périra ou sera diminué promptement, en admettant que je ne réussisse point à échanger la valeur de ce chargement contre une valeur égale ou plus considérable. En revanche, si cet échange est possible, si j'échange mon chargement d'oranges contre une certaine somme de monnaie, celle-ci contre d'autres marchandises, etc., etc., mon capital pourra acquérir une durée indéfinie.
Aussi longtemps donc que la valeur peut être échangée; aussi longtemps qu'on peut substituer ainsi à des valeurs investies sous une forme éphémère d'autres valeurs investies sous une forme durable, les capitaux composés de la réunion de ces valeurs échangeables peuvent non seulement se conserver, mais encore s'accroître et former, par là même, des propriétés essentiellement durables, quoique toute propriété périsse avec la valeur qui en fait l'objet.
Nous avons vu plus haut que les valeurs ont une longévité naturelle, dont la durée moyenne est assez bornée. Dans le cours de leur existence, elles sont soumises par le fait des circonstances ambiantes à des chances de plus value d'une part, à des risques de moins value et de destruction accidentelle d'une autre part.
Ces chances et ces risques varient selon la nature des choses dans lesquelles ces valeurs sont incarnées, selon qu'il s'agit de valeurs personnelles, mobilières ou immobilières. Tantôt, ils ne peuvent être prévus, et, s'il s'agit de risques, évités; tantôt, et le plus souvent, au contraire, ils peuvent être prévus et approximativement calculés. Dans ce cas, les chances de plus value s'escomptent et les risques de moins value ou de destruction de la valeur, s'assurent.
On peut les partager d'abord en deux grandes catégories: ceux qui sont produits par l'action des forces déréglées de la nature, tremblements de terre, inondations, intempéries, etc., et ceux qui proviennent du fait de l'homme. Cette dernière catégorie comporte encore deux divisions: ceux qui sont conformes au droit et ceux qui sont contraires au droit.
L'homme ayant pouvoir de créer et de détruire des valeurs, c'est à dire d'augmenter ou de diminuer la quantité des valeurs existantes, doit exercer par là même une action inévitable sur les valeurs ambiantes. Ainsi, tout homme qui fonde une entreprise industrielle augmente la demande, partant la valeur des bâtiments, des ustensiles, des matériaux et du travail nécessaires à son industrie, tandis qu'en accroissant l'offre des produits de cette industrie, il en diminue la valeur. Tout homme, — et cet exemple est plus saisissant encore, — qui invente ou applique un nouveau procédé, une nouvelle machine, etc., occasionne une révolution dans les valeurs ambiantes, personnelles, mobilières et immobilières, en fournissant aux unes une plus value parfois énorme, en faisant en revanche subir aux autres une moins value qui peut aller jusqu'à la destruction totale de la valeur. Qu'un chemin de fer, par exemple, vienne à être établi dans un pays qui avait été jusqu'alors sillonné seulement par des routes ordinaires, on verra ces deux phénomènes de la moins value d'une part, de la plus value de l'autre se manifester d'une manière simultanée. Les routes concurrentes et tous les établissements qui subsistaient de leur exploitation, tels qu'auberges, relais de postes, etc., subiront une moins value par le fait du déplacement de la circulation des voyageurs et des marchandises. En revanche, tous les capitaux personnels, mobiliers ou immobiliers, placés dans la sphère d'activité du chemin de fer, recevront une plus value grâce à l'augmentation de débouché qui en résultera pour les produits agricoles ou industriels, pour les services personnels, etc. Il en est ainsi de tous les progrès accomplis dans n'importe quelle branche d'industrie. Quand les métiers à filer et à tisser à la mécanique ont été substitués aux métiers à filer et à tisser à la main, la valeur investie dans les anciens métiers a été presque anéantie et celle du personnel qui les faisait mouvoir a été fortement diminuée. En revanche, les industries, les instruments et les matériaux propres à la fabrication des nouveaux métiers, les matériaux des industries dans lesquelles ils ont été introduits et dont ils ont provoqué le développement, le personnel de ces industries, enfin les consommateurs des produits économiquement fabriqués au moyen de ces engins perfectionnés en ont reçu une plus value. La différence entre la moins value infligée aux uns et la plus value ajoutée aux autres constitue le bénéfice du progrès, et elle demeure acquise, d'une manière permanente, à l'humanité.
On a été plus loin et l'on a affirmé que les ouvriers employés aux anciennes machines n'éprouvaient aucun dommage par le fait de l'introduction des nouvelles. C'était commettre une exagération analogue à celle qui aurait consisté à dire que les anciennes machines elles-mêmes ne subissaient aucune moins value, sous l'influence du même fait. Car les ouvriers fileurs ou tisserands à la main, par exemple, perdaient tout au moins la valeur de l'apprentissage qui leur avait été nécessaire pour faire fonctionner les métiers désormais mis au rebut. Pourrait-on affirmer cependant que ces ouvriers eussent quelque droit d'empêcher l'adoption des machines qui leur causaient ce dommage? ou bien encore de réclamer de ceux qui faisaient usage des nouveaux métiers une compensation pour la moins value infligée à leurs facultés productives? Non, à coup sûr. S'il est dans la nature du progrès d'engendrer d'un côté une moins value dont quelques-uns souffrent, il engendre d'un autre côté une plus value toujours supérieure à la moins value. Qu'en résulte-t-il? C'est que dans une société en voie de progrès, chacun reçoit incessamment, et, le plus souvent, sans s'en apercevoir, sous la forme d'un accroissement de sa valeur personnelle ou de ses valeurs immobilières et mobilières, une part de la plus value qu'engendre tout progrès accompli. Cette plus value, à la vérité, il ne la reçoit point gratis, il l'achète au prix du risque de moins value que contient également tout progrès. Mais comme le risque de perte est toujours et nécessairement inférieur à la chance de gain, il bénéficie de la différence. Dédommager de la perte causée par un progrès particulier ceux qui bénéficient des avantages résultant du progrès général, cela reviendrait à augmenter artificiellement la part des uns, en leur procurant; aux dépens des autres, les avantages du progrès sans en déduire les risques. Sans doute, le risque de perte s'agglomère, tandis que la chance de gain se dissémine, et un seul progrès, dont ils ont eu à subir la moins value, a pu causer aux fileurs et aux tisserands à la main an dommage supérieur au bénéfice qu'ils avaient retiré de cent autres progrès; mais rien n'empêche de recourir à l'assurance pour disséminer aussi les risques. En admettant donc que l'assurance vînt à se généraliser en cette matière, tous les membres de la société recevraient, en échange de la prime qu'ils auraient payée pour s'assurer contre le risque d'un progrès spécial, une plus value toujours supérieure, constituant leur part de dividende dans le progrès général. L'excédant de cette part de gain sur la prime du risque, formerait le bénéfice net que chacun retirerait de l'ensemble des progrès accomplis.
Mais il existe une seconde catégorie de risques de moins value ou de destruction de la valeur, provenant du fait de l'homme: ce sont ceux qu'il inflige aux valeurs ambiantes, personnelles, mobilières et immobilières, en sortant des limites de son droit. Ces risques se traduisent en des nuisances spéciales auxquelles ne correspond et que ne rachète aucun profil général. Il existe des industries absolument nuisibles, telles que le brigandage et le vol, qui détruisent les valeurs ambiantes ou les empêchent de se multiplier, et qu'il importe en conséquence d'extirper; il en existe aussi, et en bien plus grand nombre, qui, tout en ayant un caractère d'incontestable utilité, contiennent cependant des nuisances: telles sont les industries qualifiées de dangereuses, insalubres ou incommodes; celles-ci doivent ou se placer et se comporter de façon que la nuisance qu'il est dans leur nature de causer n'inflige point de dommage à autrui, ou fournir pour ce dommage une compensation suffisante.
Les industries nuisibles donnent lieu à une branche particulière des assurances, la plus ancienne de toutes, et qui a pour objet la production de la sécurité ou, ce qui revient au même, la destruction ou la police des nuisances.318
En résumé, la valeur, objet de la propriété, s'incarne dans les personnes et dans les choses. Elle périt avec elles, mais, grâce à la qualité qu'elle a d'être échangeable, elle sert d'étoffe à des capitaux dont la durée est indéfinie. Dans le cours de son existence, elle est soumise, soit par le fait de la nature, soit par le fait de l'homme, à des risques de moins value et de destruction accidentelle, mais elle possède, en revanche, des chances de plus value. Certains d'entre ces risques naissent de l'exercice légitime et nécessaire de l'activité humaine, et ils ne peuvent donner lieu qu'à de simples assurances; certains autres, au contraire, impliquent une atteinte portée au droit d'autrui, et il est juste et nécessaire de les supprimer ou de les écarter, en fournissant une compensation à ceux qui en souffrent aux frais de ceux qui les infligent.
Telle est la propriété considérée dans son objet, la valeur. Comme elle n'est, d'après la définition que nous en avons donné, qu'un rapport, — rapport de justice existant entre la valeur et ceux qui l'ont créée, reçue ou acquise, — nous avons à la considérer aussi dans son sujet, celui qui possède.
L'homme qui possède des valeurs est investi du droit naturel d'en user et d'en disposer selon sa volonté. Les valeurs possédées peuvent être détruites ou conservées, transmises à titre d'échange, de don ou de legs. A chacun de ces modes d'usage, d'emploi ou de disposition de la propriété correspond une liberté.
Énumérons ces libertés dans lesquelles se ramifie le droit de propriété.
Liberté d'appliquer directement les valeurs créées ou acquises à la satisfaction des besoins de celui qui les possède, ou liberté de consommation.
Liberté de les employer à produire d'autres valeurs, ou liberté de l'industrie et des professions.
Liberté de les joindre à des valeurs appartenant à autrui pour en faire un instrument de production plus efficace, ou liberté d'association.
Liberté de les échanger dans l'espace et dans le temps, c'est à dire dans le lieu et dans le moment où l'on estime que cet échange sera le plus utile, ou liberté des échanges.
Liberté de les prêter, c'est à dire de transmettre à des conditions librement débattues la jouissance d'un capital ou liberté du crédit.
Liberté de les donner ou de les léguer, c'est à dire de transmettre à titre gratuit les valeurs que l'on possède, ou liberté des dons et legs.
Telles sont les libertés spéciales ou, ce qui revient au même, tels- sont les droits particuliers dans lesquels se ramifie le droit général de propriété.
Maintenant, si nous considérons ce droit dans son usage, nous trouverons qu'il existe deux catégories de propriétaires:
1° Ceux qui sont pourvus d'une capacité morale et intellectuelle suffisante pour user utilement des valeurs qu'ils ont créées, reçues ou acquises.
2° Ceux qui ne possèdent point cette capacité; ceux qui sont incapables d'user et de disposer utilement de la propriété, et qui n'en pourraient faire, en conséquence, qu'un usage dommageable à eux-mêmes et aux autres.
Il convient de remarquer toutefois que la capacité d'user et de disposer utilement de la propriété n'existe point d'une manière absolue. Quelles que soient la moralité et l'intelligence d'un propriétaire, il est toujours exposé à faire un mauvais usage de sa propriété. Mais, selon qu'il en use bien ou mal, sa richesse augmente ou diminue; selon qu'il existe dans une société plus ou moins de capacité à bien user de la propriété, elle s'enrichit ou demeure misérable.
Lorsque cette capacité n'existe point, on met le propriétaire en tutelle. Le tuteur use et dispose de la propriété, sauf à rendre compte à qui de droit de l'usage qu'il en a fait. Tantôt la tutelle est complète, lorsqu'il s'agit des enfants et des aliénés par exemple; tantôt elle est partielle, lorsqu'il s'agit des femmes. Tantôt encore elle est volontaire, tantôt, et plus souvent, elle est imposée. L'esclavage est la forme primitive et grossière de la tutelle imposée à des classes ou à des races incapables de bien user de la propriété. Que cette forme de la tutelle soit vicieuse et surannée, la réaction qui s'est universellement produite contre l'esclavage l'atteste suffisamment, mais que la tutelle elle-même ait cessé d'être nécessaire, pour les individualités inférieures de certaines races ou même de toutes les races, voilà ce que nul n'oserait affirmer. La suppression de la tutelle, sous sa forme barbare et primitive de l'esclavage, n'implique pas nécessairement la suppression de toute tutelle, et aussi longtemps qu'il existera des hommes enfants, quelle que soit la couleur de leur peau, il y aura lieu de leur donner et, au besoin, de leur imposer des tuteurs.
En admettant que cette question préalable soit résolue, c'est à dire que les seules individualités capables d'user et de disposer de la propriété (que cette propriété se trouve sous la forme de valeurs personnelles, mobilières ou immobilières), soient investies du droit d'en user et d'en disposer, il s'agit de savoir si les différentes libertés que contient ce droit, liberté de la consommation, liberté de l'industrie, liberté d'association, liberté de l'échange, liberté du prêt, des donations et des legs, doivent être restreintes ou laissées entières.
Pour résoudre cette question, nous n'avons qu'à nous reporter aux conditions de la création des valeurs. Si, comme nous l'avons démontré, la création de toute valeur occasionne une dépense de forces et une peine, nul ne crée volontairement des valeurs qu'à la condition de récupérer une force supérieure à celle qu'il a dépensée, une jouissance plus grande que la peine qu'il s'est donné. Mais si l'on ne peut user et disposer librement des valeurs que l'on possède, si cette liberté d'user ou de disposer de la valeur est supprimée ou diminuée, l'utilité contenue dans la valeur et en vue de laquelle elle a été acquise, se trouve supprimée ou diminuée et la valeur avec elle. Tout retranchement à la liberté d'user ou de disposer des valeurs, de les consommer, de les employer, de les échanger, de les donner, de les léguer, en un mot, toute servitude imposée aux propriétaires, en ce qui concerne l'usage et la disposition de leurs propriétés, se traduit en une moins value, et diminue d'autant leur intérêt à créer, à conserver et à multiplier les valeurs.
Cependant, le propriétaire peut être intéressé, soit pour conserver son droit sur la valeur qui lui appartient, soit pour préserver cette valeur d'un risque de destruction quelconque, à sacrifier une partie de la valeur possédée ou même une partie du droit de propriété pour assurer la conservation du restant. Lorsqu'il s'agit simplement de préserver d'un risque de destruction la valeur possédée, il suffit ordinairement d'abandonner, sous la forme d'une prime, une partie de cette valeur à un assureur quelconque, sans se dessaisir d'aucune partie du droit d'oser ou de disposer du restant. Mais il en est autrement, lorsqu'il s'agit de sauvegarder le droit de propriété même contre les atteintes de la violence ou de la fraude. Presque toujours, en ce cas, un retranchement du droit est nécessaire, une servitude doit être jointe à la prime d'assurance. Supposons, par exemple, qu'il s'agisse de préserver un pays du risque d'une invasion étrangère, il pourra être nécessaire d'établir sur certains points du territoire des places fortes ou des camps retranchés. Autour de ces lieux de défense, l'expérience technique de l'art militaire a démontré encore la nécessité d'établir un rayon de servitudes, dans lequel il est interdit de planter et de bâtir, afin que les abords de la place ne soient point obstrués par des plantations et des constructions, propres à servir d'abris à l'ennemi. Ces servitudes, en restreignant la liberté de l'emploi des valeurs appropriées, leur infligent une moins value. Elles peuvent néanmoins être très légitimement établies, s'il est reconnu qu'elles sont nécessaires à la défense commune. Seulement, dans ce cas, il est juste que la communauté des assurés, dans l'intérêt de laquelle elles sont établies, en paye les frais, en fournissant aux propriétaires dont les biens sont frappés de servitudes, une indemnité égale à la moins value que subissent ces biens. Supposons encore qu'il s'agisse de combattre et d'écarter, à l'intérieur, les risques de spoliation et de destruction qui menacent les propriétés, risques d'assassinat, de vol, d'escroquerie, etc.; il pourra être nécessaire que chacun se soumette à certaines servitudes spéciales, requises pour rendre efficace la répression de ces sévices: telle est, par exemple, la servitude de l'incarcération, c'est à dire la privation de la liberté personnelle pendant la durée d'une instruction judiciaire, etc., etc. Mais ces servitudes qui diminuent le droit de propriété aussi bien que les primes d'assurances qui diminuent les valeurs possédées, doivent être réduites au minimum indispensable pour garantir la propriété. Il en est ainsi lorsque les assurances sont libres, c'est à dire lorsque le propriétaire, grevé d'un risque, est le maître ou de s'assurer contre le risque ou de le supporter lui-même, ou bien encore de choisir entre les assureurs. Mais les assurances libres sont d'une date récente; l'assurance obligatoire et monopolisée n'a pas cessé d'être la règle, au moins pour les risques provenant du fait de l'homme; en conséquence, les primes et les servitudes qu'elle exige sont demeurées partout excessives.
Après avoir examiné en quoi consiste le droit de propriété, dans quels droits ou dans quelles libertés il se ramifie, les conditions nécessaires à son exercice et les servitudes qu'il comporte, nous avons à jeter un coup d'œil sur les fermes qu'il affecte. On peut ramener ces formes à trois grandes catégories. La propriété peut être commune, individuelle ou collective.
Ces formes de la propriété n'ont rien d'arbitraire; elles sont déterminées partout et toujours par la nature et l'état d'avancement de la production. La propriété commune apparaît la première au moins pour les valeurs immobilières. Les domaines de chasse, les pêcheries sont possédés en commun par les tribus qui vivent de leur exploitation. En revanche, les produits provenant de cette exploitation, le poisson et le gibier sont partagés entre les chasseurs et les pêcheurs, en proportion de la valeur du concours de chacun, et ils deviennent alors des propriétés individuelles. Lorsque l'agriculture prit naissance, les exploitations se morcelèrent, et la propriété individuelle devint alors la forme prédominante. Cette forme domine encore de nos jours, quoique les progrès des instruments et des méthodes de la production nous conduisent rapidement à une période où la propriété collective prévaudra à son tour. Comme il faut, de plus en plus, pour produire, la réunion et la coopération d'immenses capitaux, sous forme de valeurs personnelles, mobilières et immobilières, la propriété des valeurs appliquées à la production ou, ce qui revient au même, des capitaux doit devenir, de plus en plus aussi, collective ou actionnaire. La propriété collective n'est, à la bien considérer, qu'une transformation progressive de la propriété commune, avec laquelle elle conserve de notables analogies. C'est ainsi qu'un chemin de fer, par exemple, est la propriété commune d'une « tribu » plus ou moins nombreuse d'actionnaires, qui n'en peuvent disposer que collectivement. Chacun reçoit dans le produit de l'exploitation une part proportionnée à la valeur de son apport, et cette part seule devient sa propriété individuelle. En résumé, on peut dire que la propriété collective, qui répond à un état avancé de l'industrie humaine, n'est autre chose que la communauté librement spécialisée, conformément aux besoins de la production divisée.
La communauté primitive qui se retrouve encore dans les propriétés dites nationales, provinciales ou communales, tend ainsi à disparaître pour faire place à la communauté spécialisée, — ceci en vertu de la loi même qui détermine la spécialisation progressive des industries ou la division du travail.
Si les formes, de la propriété dépendent de la nature et de l'état d'avancement de la production, si tel état de la production comporte la propriété commune, tel autre la propriété individuelle, tel autre enfin la propriété collective ou communauté spécialisée, on comprend qu'aucune forme de la propriété ne puisse être arbitrairement imposée, sans occasionner un dommage, une nuisance à la société. Vouloir restaurer, dans l'état présent de la production, la communauté primitive aux dépens de la propriété individuelle, ce serait, en admettant que la chose fût praticable, faire rétrograder la production jusqu'à l'époque où les hommes vivaient des produits de la chasse, de la pêche, de la cueillette des fruits ou de la vaine pâture. Vouloir, au contraire, perpétuer la propriété individuelle, en la protégeant au moyen d'obstacles artificiels opposés à la formation de la propriété collective, ce serait enrayer le développement progressif de la production et ralentir ainsi la multiplication des richesses. Il importe, en définitive, de laisser la propriété s'établir toujours sous sa forme naturelle, c'est à dire sous la forme que commandent la nature et l'état d'avancement de la production, en se bornant à la garantir aussi complétement que possible sous cette forme.
Enfin, il nous reste à examiner les rapports économiques de la propriété de chacun avec la propriété d'autrui. Ces rapports se résument dans l'échange et dans le prêt, lequel n'est, en dernière analyse, qu'un échange accompli dans le temps. Sous un régime de production spécialisée, toutes les valeurs appropriées sont incessamment échangées par ceux qui les possèdent ou qui en ont loué l'usage. Ces échanges s'opèrent sous l'empire de deux sortes de circonstances ou de deux états différents de la propriété: sous l'empire du monopole ou de la concurrence.
Le monopole apparaît lorsque des valeurs personnelles, mobilières ou immobilières sont possédées par un seul individu ou par un petit nombre d'individus, tandis que les valeurs contre lesquelles elles s'échangent sont possédées par un grand nombre. Alors il peut arriver et il arrive fréquemment que les monopoleurs restreignent leur offre de manière à élever le prix courant d'un produit bien au dessus de son prix naturel et à s'attribuer ainsi un bénéfice de surcroit, autrement dit une rente.
Le monopole peut être de deux sortes: naturel ou artificiel.
Le monopole est naturel lorsque, d'une part, la quantité existante des valeurs monopolisées est inférieure à la demande; lorsque, d'une autre part, aucun obstacle artificiel n'empêche les consommateurs de se les procurer où bon leur semble. Ainsi, un artiste pourvu d'un talent extraordinaire possède un monopole naturel. De même, les propriétaires de certaines terres particulièrement fertiles ou propres à la production de denrées rares jouissent encore d'un monopole naturel. Mais le monopole naturel procurant des bénéfices extraordinaires, ces bénéfices agissent comme une prime d'encouragement pour la découverte ou la formation de fonds analogues. Plus cette prime est élevée, plus l'encouragement qu'elle offre a la concurrence est considérable et moins, en conséquence, le monopole est durable. Tel est encore le cas pour les inventions et les œuvres de la littérature ou de l'art. Lorsque ceux qui les ont créées ou acquises profitent de leur monopole naturel pour en surélever le prix, la production des œuvres similaires est stimulée de tout le montant de la rente qu'ils s'attribuent. Non seulement le monopole attire ainsi la concurrence, mais encore il arrive fréquemment, dans le cas des inventions, par exemple, que l'invention nouvelle, hâtée par l'abus du monopole naturel de l'ancienne, anéantisse complétement la valeur de celle-ci.
Le monopole est artificiel lorsqu'un individu ou une collection d'individus ont seuls le droit d'offrir sur un certain marché une catégorie quelconque de produits ou de services, ou, ce qui revient au même, lorsque les autres propriétaires sont soumis, au profit des monopoleurs, à une diminution de leur droit de disposer de leurs produits ou de leurs services, lorsque le droit des uns est étendu aux dépens du droit des autres, de manière à constituer, d'un côté, un privilège auquel correspond, d'un autre côté, une servitude. Dans ce cas, les monopoleurs peuvent réaliser des bénéfices d'autant plus considérables que le produit ou le service monopolisé peut être, d'une part, plus aisément raréfié, et qu'il a, d'une autre part, un caractère d'utilité plus prononcé. Lorsque c'est une denrée nécessaire à la vie, le prix en peut être porté, par la diminution des quantités offertes, à an taux meurtrier. Aussi, dans ce cas, le gouvernement qui concède ou garantit le monopole prend-il soin, le plus souvent, de le limiter, en établissant un maximum, c'est à dire un niveau au dessus duquel le prix du produit ou du service monopolisé ne peut être porté. Mais ce maximum est ordinairement éludé, et, quand même il ne l'est point, il permet aux monopoleurs de vendre ou de prêter leurs produits ou leurs services à usure, c'est à dire en s'attribuant, aux dépens des consommateurs, une rente en sus du profit naturel et nécessaire de leur industrie.
La concurrence existe, au contraire, lorsque le nombre des propriétaires de produits ou de services échangeables n'est point limité, et lorsque ces produits ou ces services eux-mêmes peuvent être produits d'une manière illimitée. Dans ce cas, qu'arrive-t-il? C'est que ces produits ou ces services sont toujours offerts sur le marché ou tendent toujours à l'être dans la proportion la plus utile. En effet, lorsqu'ils sont offerts en quantité insuffisante, la loi des quantités et des prix agit promptement pour attribuer à ceux qui les offrent une rente en sus du profit nécessaire, et cette rente agit comme une prime pour attirer la concurrence; lorsqu'ils sont, au contraire, offerts avec excès, le phénomène opposé se manifeste, et c'est ainsi, comme nous le verrons plus loin, que l'ordre et la justice tendent incessamment et d'eux-mêmes à s'établir sous le régime de la concurrence.
59.Édouard Laboulaye on “Individual Liberties” (1863)↩
[Word Length: 4,616]
Source
Édouard Laboulaye, Le parti libéral.. Son programme et son avenir, (Paris: Charpentier, 1863). Première partie, III. “Des libertés individuelles. Liberté a) de la personne; b) des actions; c) des biens,” pp. 13-38. [Extracts, pp. 13-6; pp. 21-4; pp. 27-8; pp. 31-4.]
Brief Bio of the Author: Édouard Laboulaye (1811-1883)
[Édouard Laboulaye (1811-1883)]
Édouard Laboulaye (1811-1883) was born in Paris and obtained a law degree in 1833. The breadth of the subject matter he embraced is impressive. He published works on the history of law, he edited ancient texts, he translated several works, he penned stories and satires, and he wrote about the philosophers of his day. But until mid-century he devoted himself primarily to the law, and he published several studies on the subject. In 1845 he was elected to the Académie des sciences morales et politiques, and four years later he became a professor of comparative law at the Collège de France. He was a great admirer of the United States, and indeed it was he who arranged the gift of the Statue of Liberty, the work of his friend Bartholdi. Some of his important works include, Histoire des États-Unis d’Amérique, 3 vols (1854), Le parti libéral (1863), L’État et ses limites (1863), and La république constitutitionnelle (1871). [RL]
III. DES LIBERTÉS INDIVIDUELLES. Liberté a) de la personne; b) des actions; c) des biens,
La première en date de ces libertés, puisqu'elle est la condition de toutes les autres, c'est la liberté individuelle proprement dite, c'est-à-dire le droit qui appartient à tout homme de disposer comme il l'entend de sa personne et de ses biens, pourvu qu'il n'envahisse ni la personne ni les biens d'autrui. Cette liberté est complexe; elle comprend trois éléments qu'il est aisé de distinguer: la liberté corporelle, le libre jeu de notre activité intellectuelle, et enfin le libre emploi de la propriété et du capital qui sont le fruit de notre activité. En d'autres termes, nous avons à nous notre personne, notre travail et nos biens. Il est nécessaire d'insister sur cette triple division; car trop souvent le législateur s'imagine qu'il n'a plus rien à faire pour la liberté individuelle quand il n'en a rendu qu'un lambeau.
Entendue au premier sens, la liberté individuelle est pour tout citoyen non accusé le droit d'agir sans avoir rien à craindre de la police, et d'être maître dans sa maison, comme- le baron féodal était roi dans son château. La loi veille à la porte du citoyen anglais, la justice seule a le droit d'en franchir le seuil. Pour l'accusé, la liberté individuelle est le droit d'être tenu pour innocent et respecté comme tel jusqu'à la condamnation. C'est, en outre, le droit d'être jugé par des magistrats inamovibles ou par le jury, en vertu de lois qui à l'avance ont défini le crime et réglé la procédure et la peine. Voilà les principes de 89, principes reconnus par toutes les constitutions modernes; mais qu'il y a loin de ces déclarations solennelles à la triste vérité des faits!
Dans un pays libre que doit être la police? L'auxiliaire et la servante de la justice; rien de plus. C'est la justice seule qui, hors le cas de flagrant délit, doit la mettre en mouvement. Chez nous, au contraire, la police n'est-elle pas un pouvoir indépendant et irresponsable? Ne fait-elle pas pour son propre compte des perquisitions, des saisies, des arrestations? L'article 75 de la constitution de l'an VIII n'est-il pas un rempart qui met les agents de l'autorité à l'abri des plaintes les plus légitimes? Quel recours le citoyen a-t-il contre les erreurs de l'administration? — Tout cela, dira-t-on, se fait en vertu de lois qui ne sont pas abrogées; prenez-vous-en à la République, au premier Empire, ou à la Restauration. — Soit; c'est de l'arbitraire légal; en est-ce moins de l'arbitraire? S'imagine-t-on que toutes les lois de violence et de peur qui sont entassées dans le Bulletin des lois, à la honte des gouvernements qui les ont rendues, puissent changer la nature des choses et les règles éternelles de l'équité? Qu'est-ce que le règne de la liberté, sinon le règne de la justice et de l'égalité? Dès qu'un homme est maître de faire arrêter qui bon lui semble, par mesure de police, pour cause de salut public ou de sûreté générale, grands mots qui n'ont pour objet que de cacher la violation du droit commun, le gouvernement est arbitraire. Qu'importe la sagesse ou la modération du ministre s'il peut à tout moment disposer de ma personne? La liberté n'est pas seulement un fait, c'est un droit. On n'est pas libre quand on ne l'est que par la grâce et sous le bon plaisir d'autrui.
Notre Code d'instruction criminelle est un adoucissement de l'ordonnance de 1670, qui elle-même £ modifié l'ordonnance de 1539; mais toutes ces altérations n'ont pu corriger le vice essentiel d'une procédure inquisitoriale empruntée aux plus mauvaises lois du despotisme romain. Tant qu'il est resté en France quelque débris du vieil esprit germanique, les formes criminelles ont ressemblé à celles de l'Angleterre. Dans nos anciennes coutumes, le bourgeois est jugé publiquement et par ses pairs. Ce sont les Valois, ces princes tyranniques et détestables, qui ont imposé au pays l'odieuse procédure qui jusqu'à la révolution a conservé le titre de procédure extraordinaire, tache originelle d'une institution étrangère au libre esprit français. Nous en avons chassé le secret de l'audience et la question; nous y avons introduit la publicité, le jury, les circonstances atténuantes, trois excellentes choses, quoi qu'en disent des criminalistes passionnés, qui prennent la cruauté pour la justice; mais, malgré tout, le principe de cette procédure est mauvais et contraire à la liberté. La loi anglaise, faite en vue du citoyen, voit dans l'accusé un innocent; la loi française, faite en vue de l'État, présume le crime et non pas_ l'innocence. C'est cette présomption qu'il faut renverser.
Qu'on ne m'oppose pas de belles paroles sur la sainteté de la justice et l'impassible vertu du magistrat; je connais d'Aguesseau, et j'ai lu plus d'un discours de rentrée; il ne s'agit point ici des mots, mais des choses. Si l'accusé est présumé innocent, pourquoi la prison préventive est-elle prodiguée? Pourquoi la liberté sous caution n'est-elle qu'une rare exception? En Angleterre, aux États-Unis, la liberté sous caution est de droit pour les délits; elle peut même être accordée en cas de crime. Est-il possible qu'en deux pays, le même principe donne des résultats contraires?
Si le prévenu est présumé innocent, pourquoi le force-t-on de s'accuser lui-même? Qu'est-ce que le secret, sinon une torture physique et morale pour arracher de force un aveu? N'a-t-on pas vu la femme Doise se reconnaître coupable d'un parricide, qu'elle n'avait pas commis, pour échapper à un cachot meurtrier et sauver la vie de l'enfant qu'elle portait dans son sein? Qu'est-ce que ces interrogatoires multipliés, ces piéges, ces finesses dont certains magistrats ont quelquefois le tort de se glorifier en cour d'assises? Si le prévenu est présumé innocent, d'où vient qu'à l'audience le ministère public, et quelquefois le président, le prend, avec lui et avec l'avocat, sur un ton de rigueur et de menace? D'où vient surtout que l'accusé n'est pas libre d'interroger à sa façon les témoins et de les mettre en contradiction avec eux-mêmes? S'il essaye de les démentir tandis qu'ils déposent, on lui répond d'ordinaire que c'est là de la discussion; on lui ferme la bouche au moment où de ses paroles peut dépendre son salut. Tout cela n'existe point chez les peuples libres; le prévenu n'a point à craindre le secret; il n'est forcé ni de s'accuser ni de se justifier avant l'audience; le ministère public n'a pas plus de droit sur les témoins que n'eu a le défenseur; enfin, le président, impassible et muet, sans autre soin que celui de la police de l'audience, est reconnu par l'usage comme le protecteur naturel de l'accusé. On s'est bien gardé de le charger d'un résumé oratoire qui, si impartial que soit ou que veuille être le magistrat, a toujours ce grave défaut d'enlever le dernier mot au prévenu et de lui ravir le privilége suprême de la faiblesse et de la misère, le droit d'attendrir ceux qui vont disposer de sa liberté, et peut-être de sa vie.
Qu'on ne voie pas dans ces paroles une critique de la magistrature française; rien n'est plus loin de ma pensée. Ce ne sont pas les hommes que j'attaque, ce sont les institutions. Je n'imagine pas qu'un juge anglais soit plus éclairé, plus sage ni plus respectable qu'un président de cour d'assises; mais le rôle que la loi attribue au magistrat n'est pas le même dans les deux pays. En France, le président représente l'État, intéressé à la punition du crime; en Angleterre, ce n'est qu'un arbitre placé entre l'accusation et la défense; son impartialité est absolue. De là, dans les deux pays, une façon toute différente d'entendre un même devoir; mais, selon moi, la vieille coutume d'Angleterre, issue des forêts de la Germanie, a mieux compris la sainteté de la justice que ne l'a fait la loi française, sortie d'une source empoisonnée.
Le gouvernement a senti le besoin d'une réforme criminelle; il faut l'encourager dans cette voie. C'est une bonne chose que d'abréger la prison préventive pour une foule de petits délits correctionnels, mais il ne faut pas en rester là. Nous avons plus d'un emprunt à faire à nos voisins, sans danger pour la paix publique et au grand profit de la liberté. La question pénitentiaire est à l'étude; c'est un problème de la plus haute importance. Il faudrait aussi s'occuper de la surveillance qui, selon moi, en éternisant une faute expiée, prévient moins de crimes qu'elle n'en cause. Il faudrait enfin supprimer et au plus tôt la loi de sûreté générale; c'est une loi qui n'est plus de notre temps; je n'en dirai pas davantage.
Un autre élément de la liberté individuelle, c'est le libre emploi de notre activité. La reconnaissance de ce droit naturel est encore une des conquêtes de 1789. Jusque-là on ne doutait guère que le prince, père et tuteur de ses peuples, n'eût le devoir de les conduire; le meilleur roi était celui qui traitait ses sujets comme des enfants et leur laissait le moins de liberté. Ouvrez une histoire de France, vous y verrez tout au long l'éloge de Colbert, qui a, dit-on, fait naître le commerce et l'industrie en multipliant les corporations, les priviléges, les monopoles, les prohibitions; c'est-à-dire en donnant tout à quelques favoris, au préjudice du grand nombre. Ce sont les physiocrates, c'est Quesnay êt Turgot, ce sont leurs disciples qui ont eu le mérite de proclamer la maxime, qui est devenue la devise de la société moderne: laissez faire, laissez passer. Appliquée au commerce et à l'industrie, cette maxime, qu'on a souvent critiquée sans prendre la peine de la comprendre, est d'une vérité et d'une justice parfaites. Laissez faire, c'est-à-dire laissez chaque homme user honnêtement, et comme il l'entendra, des facultés qu'il a reçues de Dieu; c'est là un droit naturel au premier chef, le droit de vivre en travaillant. Laissez passer, c'est-à-dire n'arrêtez pas les échanges. Si Dieu a créé des climats divers, et des productions aussi variées que les climats, c'est pour faire de l'humanité un seul peuple, uni par la communauté des besoins et des intérêts. Arrêter l'échange, c'est gêner le travail; gêner le travail, c'est gêner la vie; qui peut donner à l'État ce droit étrange d'appauvrir ses sujets et de les faire mourir de faim?
— C'est dans l'intérêt général, dira-t-on, que l'État interdit ou favorise certaines industries. De la hauteur où il est placé, il voit ce qui échappe à l'individu; sa sagesse pourvoit à la fois aux besoins du public et aux besoins des particuliers.
— C'est là, répondrai-je, une des vieilles erreurs qui nous ont fait le plus de mal. La sagesse de l'État est une chimère; où donc prend-on ces sages administrateurs, sinon parmi ce peuple qu'à l'avance on déclare incapable et fou? Consultez l'expérience. Les hommes qui forment l'administration, si habiles et si clairvoyants qu'on les suppose, en savent toujours moins que l'intérêt particulier. Partout où l'État intervient, il empêche le travail de s'établir, ou, ce qui n'est pas moins nuisible, il favorise le développement de certaines industries qui ne sont pas viables. Que l'État fasse régner la paix et la sécurité, son rôle est rempli; dès qu'il sort de sa sphère, il porte le désordre et le trouble dans la société. Il n'y a de disette que dans les pays où l'État se mêle de régler les approvisionnements; les peuples les plus misérables sont toujours les plus protégés. Chacun pour soi et Dieu pour tous, c'est le principe du monde moderne, principe aussi vrai en économie politique, qu'il est faux dans le domaine de la charité.
— A quoi bon discuter sur ce point? dira-t-on. N'est-ce pas la gloire du gouvernement impérial que d'avoir arboré le drapeau de la liberté commerciale? Oubliez-vous le traité avec l'Angleterre, la liberté de la boucherie, et celle de la boulangerie?
— Non, j'applaudis à ces réformes; et de la première, je ne critique que la façon. Qu'un traité de commerce d'une telle portée puisse être conclu sans l'aveu des Chambres, c'est sans doute chose légale, puisqu'un sénatus-consulte l'autorise; mais, selon moi, il n'est ni sage ni politique d'user rigoureusement d'un tel pouvoir. Ceux qui profilent du traité n'en ont guère de reconnaissance; ceux qui en souffrent s'en prennent au gouvernement. En pareil cas, pourquoi ne pas alléger la responsabilité en la partageant? Si on ne consulte pas les représentants du pays sur une question qui touche à tant d'intérêts, et qui peut ruiner des villes entières, sur quoi les consultera-t-on?
Mais, laissant ceci de côté, je dirai que si le gouvernement a beaucoup fait, il lui reste encore plus à faire. 11 y a en France des gênes et des monopoles qu'il faut effacer de nos lois.
Par exemple, qu'est-ce que l'inscription maritime? Qu'est-ce qu'un régime qui oblige tout marin à rester jusqu'à cinquante ans sous la main de l'État; et qui en même temps interdit à tout citoyen de se faire homme de mer, sous peine de tomber dans cette étrange servitude? L'intérêt de la marine ne peut justifier un tel envahissement de la liberté individuelle, une si flagrante inégalité. L'État gagne-t-il quelque chose à ce privilége énorme? Non; il ne serait pas difficile de montrer qu'en Angleterre, comme en Amérique, ce qui multiplie.les matelots, c'est la liberté.
Qu'est-ce que le délit de coalition reproché aux ouvriers qui refusent d'accepter les conditions que le patron leur impose? Que la loi punisse la violence, les menaces, l'intimidation, cela est juste; mais le fait de s'entendre paisiblement pour régler le prix du travail, quel crime est-ce là? Est-ce que la main-d'œuvre n'est pas une marchandise comme une autre? Faut-il un privilége pour celui qui l'achète, une incapacité pour celui qui la vend? Quel est le motif de cette loi, qui irrite singulièrement les ouvriers? L'amour de la tranquillité publique, je n'en vois pas d'autre. On a voulu avoir à tout prix la paix dans l'atelier. Mais cet intérêt ne peut justifier un tel affaiblissement de la liberté individuelle; et d'ailleurs cet intérêt prétendu n'existe point. L'Angleterre a aboli la loi des coalitions; cette abolition, prononcée par respect pour les principes, a excité une inquiétude très-vive. Tant que les coalitions avaient été proscrites, on avait vu des agitations terribles; qu'arriverait-il quand la loi permettrait aux ouvriers de s'entendre et de se réunir? Le résultat est connu; patrons et ouvriers, également maîtres de leur droit et ne comptant que sur eux-mêmes, finissent toujours par s'accorder. Les grèves sont rares, les coalitions ont à peu près disparu. La loi était impuissante à réduire les intérêts blessés, la liberté a dénoué le nœud que la force n'a jamais pu trancher.
Quant aux monopoles, chacun reconnaît que c'est chose mauvaise; on ne discute plus sur le principe. Le monopole favorise l'oisiveté ou la négligence de celui qui en profite, il décourage et mécontente celui qu'il exclut; c'est, en outre, un impôt inutile dont l'État ne profite pas, dont le travailleur porte toute la charge: voilà des vérités qui traînent partout; cela n'empêche point que les monopoles ne soient nombreux en France. C'est le reste de cette vieille et fausse théorie qui fait de l'État un tuteur infaillible, et condamne le citoyen à vieillir dans une perpétuelle minorité.
A eu juger par le prix auquel se vendent les charges, le monopole des agents de change coûte à la place de Paris des sommes énormes. Que sont cependant les agents de change, sinon des courtiers de spéculation et de jeu? Qui peut justifier ce privilège exorbitant, et dont ne profitent ni l'État ni les citoyens? L'Angleterre n'a point d'agents de change en titre d'office, voit-on que les fonds publics en souffrent ou que la spéculation y languisse? A quoi sert le monopole des courtiers? Ce n'est pas au commerce, qui s'en plaint; ce n'est pas au public, qui en paye inutilement les frais; ce n'est pas à l'État qui n'y a aucun intérêt. A quoi bon des facteurs pour vendre aux enchères les œufs et la marée? A quoi bon des commissaires-priseurs patentés pour adjuger des porcelaines ou du vieux linge? Les notaires sont des officiers publics qui donnent aux actes un caractère authentique, les huissiers et les greffiers sont des agents de la justice; je comprends que le nombre de ces fonctionnaires soit limité, ce qui ne veut pas dire que j'approuve les offices vendus à prix d'argent; mais pourquoi faire de la pratique un monopole et l'attribuer à des avoués? Ce n'est là. qu'un souvenir de l'ancien régime; il y a des charges d'avoué parce qu'il y avait des charges de procureur. C'est pousser trop loin le respect de la tradition. Est-ce qu'un avoué est un personnage public? N'est-il pas, comme l'avocat, le simple mandataire du client particulier qui le choisit? Dans les deux cas, n'y a-t-il pas même raison de décider en faveur de la liberté?
On oppose, je le sais, un intérêt public, la nécessité d'une surveillance qui protége les plaideurs et évite les abus. Mais quel monopole ne peut-on pas justifier avec le même argument? L'esprit de notre temps, l'esprit de liberté veut que chacun s'occupe de ses propres affaires et veille à ses intérêts; je ne vois pas pourquoi il y aurait une exception pour les plaideurs. Je ne demande pas l'anarchie; des conseils de discipline ont maintenu à un haut degré l'honneur de la profession d'avocat; ils suffiraient également pour interdire la pratique à des fripons déclarés.
Que dire du monopole de l'imprimerie, de la librairie et des journaux? Ce n'est pas seulement la liberté industrielle qui en souffre; c'est la société tout entière qui est arrêtée et gênée dans le développement de son intelligence et de sa vie. Je laisse cette question, sur laquelle je reviendrai plus loin; mais que de monopoles on pourrait citer encore! Qu'est-ce, par exemple, que le monopole des théâtres? N'est-il pas étrange que la ville de Paris impose ses administrés pour construire à leurs frais des théâtres somptueux qu'elle loue à son profit, tandis que rien n'est plus aisé que de trouver des spéculateurs qui construisent des théâtres à leurs risques et périls? Notez que la politique et la morale n'ont rien à faire ici; la faculté d'ouvrir un théâtre n'emporte en rien l'abolition de la censure dramatique. Le monopole gêne la liberté industrielle sans prétexte et sans raison.
Qu'est-ce encore que tous ces monopoles qui se multiplient à vue d'œil dans les grandes villes: monopoles du gaz, de l'eau, des omnibus, des voitures de place, et que sais-je? Tout cela c'est une réduction de la concurrence, c'est-à-dire une atteinte au travail libre, un privilége coûteux dont la cité ou les habitants payent les frais. Les monopoles commencent d'ordinaire par une réduction; c'est au nom du bon marché qu'on les établit; mais, chose étrange! quand on les supprime, il se trouve toujours qu'ils ont été ruineux pour le public. Il serait temps de s'arrêter dans cette voie. De tous les principes de 1789, celui qui doit porter le moins d'ombrage à un gouvernement qui favorise les classes laborieuses, c'est assurément la liberté du travail-, cette liberté est incompatible avec le monopole, de quelque beau nom qu'on décore cet envahissement du domaine individuel.
Reste un dernier élément de la liberté individuelle: la libre disposition de la propriété et du capital. La propriété est le fruit de notre activité, et c'est parce que ce fruit nous appartient, que nous sommes laborieux, économes et moraux. Les anciens déclaraient l'esclave incapable de vertu parce qu'il n'avait rien à lui et ne s'appartenait pas à lui-même; c'est une vue qui ne manque pas de vérité. L'extrême misère est corruptrice, l'extrême richesse l'est aussi, et par la même raison; toutes deux n'attendent rien du travail et de l'économie. La force de la cité est dans les classes moyennes, qui vivent du labeur de leur esprit ou de leurs mains; c'est pourquoi un des plus grands intérêts de l'État est de protéger la propriété, et de lui garantir une entière sécurité.
En est-il ainsi en France? Non; depuis 1789 l'idée de propriété a faibli. Aux premiers jours de la révolution, par haine de la féodalité, ou par une fausse notion de l'antiquité grecque et romaine, on n'a vu dans la propriété qu'un privilége social, que l'État pouvait régler ou réduire à son gré. Cette théorie est visible dans le discours de Mirabeau, sur le droit de succession; je ne parle ni des déclamations de Robespierre, ni des rêveries de Babœuf. Depuis trente ans les écoles socialistes ont attaqué la propriété et le capital, comme autant de monopoles destructifs du travail et de l'égalité. Ces attaques n'ont pas été sans influence sur le législateur. J'en citerai pour exemple l'augmentation des droits fiscaux sur les successions. 11 semble à beaucoup de gens que si la propriété est respectable, l'héritage ne l'est guère, au moins en ligne collatérale, et que la société gagnerait à l'abolition de ce privilége; c'est une illusion fatale à la liberté.
La propriété, quand on remonte à son origine, n'est autre chose que le produit de notre activité, une création de richesses qui n'a rien pris à personne, qui par conséquent ne doit rien à personne, et n'appartient qu'à celui qui la crée ou à ses descendants, car c'est pour eux qu'il travaille. On croit que c'est la société qui enrichit le propriétaire; c'est une erreur; tout au contraire, c'est le propriétaire qui enrichit la société. Il suffit d'un instant de réflexion pour s'assurer de cette vérité trop méconnue.
On sait qu'en Algérie il y a des terres publiques, non cultivées, que l'État vend à bas prix. Prenons un hectare de cette terre, infestée par le palmier nain. Que rapporte-t-il? Rien. Que vaut-il? Ce qu'on en peut retirer par adjudication aux enchères; dix ou quinze francs peut-être. Une fois que l'État a encaissé cette somme, il a reçu le prix du fonds, il n'a plus rien à prétendre sur le sol. Maintenant avec un labeur opiniâtre, une dépense de temps et de peine qu'on évalue à trois cents francs par hectare, ce colon arrache le palmier nain, il laboure, il sème, il récolte. Voilà une propriété créée; à qui appartient-elle? A l'individu seul, car seul il l'a faite ce qu'elle est. La société a-t-elle enrichi le propriétaire? Non, elle ne lui a rien donné. Le propriétaire a-t-il enrichi la société? Oui, car dans ce qui n'était qu'un désert stérile, il y a aujourd'hui du blé produit, du bétail nourri, des bras employés.— Sans la protection de l'État, dira-t-on, cette culture n'était pas possible. — Soit, mais le service qu'il rend, l'État se le fait payer par l'impôt. Reste donc toujours au compte du propriétaire la valeur qu'il a créée.
Qu'il s'agisse d'une maison, d'une usine, d'une machine, d'un outil, d'un capital quelconque, le droit est toujours le même: l'œuvre appartient à l'ouvrier. Elle est à lui, parce qu'elle est le produit de son travail et de son économie, parce qu'il l'a véritablement enfantée à la sueur de son front, et que sans lui elle n'existerait pas. D'où l'on voit que liberté et propriété se tiennent comme l'arbre et le fruit; l'une est le labour, l'autre est la récolte. Toucher à l'une, c'est toucher à l'autre, et les tuer toutes deux du même coup. Consultez l'expérience. Quels sont les pays libres? Ceux qui respectent la propriété. Quels sont les pays riches? Ceux qui respectent la liberté!
Suivant donc qu'on regardera la propriété comme un monopole accordé par l'État à quelques privilégiés, ou comme une création individuelle, la législation, la constitution, la société tout entière, auront un aspect différent. Si la propriété est considérée comme une invention de la loi, elle sera odieuse ainsi que le sont tous les monopoles, le capitaliste sera dénoncé comme le spoliateur de ceux qui n'ont rien, et l'État se croira libéral en fixant le taux de l'intérêt, en établissant le maximum, en poursuivant les accapareurs, en grevant d'impôts les terres, les capitaux, les successions, sans voir qu'en blessant la propriété, c'est la liberté même qu'il atteint. Si, au contraire, la propriété et le capital sont considérés comme des richesses créées par l'individu, et apportées par lui dans la société qui en profite, la propriété sera un droit sacré pour tous, et le législateur la respectera comme une autre forme de la liberté. Dans la première de ces deux sociétés, il y aura haine chez le pauvre, crainte chez le riche, violence et fiscalité chez l'administration, misère partout. Dans la seconde, c'est le travail qui régnera; il sera à la fois fructueux et honoré. Propagées et secondées l'une par l'autre, la Richesse et la Liberté descendront jusqu'aux dernières couches du peuple, et y porteront avec elles la véritable émancipation, celle qui affranchit l'homme de l'ignorance et du dénûment.
Quel est de ces deux régimes celui qui prévaut en France? Ni l'un ni l'autre, nous sommes tiraillés entre les deux. Mais, il faut bien le dire, si l'économie politique ramène les esprits au respect de la propriété, nos lois sont jalouses et despotiques. On y retrouve, plus ou moins affaiblies, mais toujours reconnaissables, deux idées fausses et funestes; l'une que Louis XIV nous a léguée, c'est le domaine éminent de l'État, l'autre qui nous vient de Rousseau, de Mably et de leur école, c'est que la propriété est contre nature, et que l'hérédité est un privilége social. De là cette théorie singulière de quelques légistes, qui font de l'impôt une part de la propriété, et de l'État le copropriétaire de toutes les terres. De là ces énormes droits de mutation, au moyen desquels, à chaque changement de propriétaire, l'État prend pour lui quelque chose comme le dixième du fonds. De là ces droits de succession qui ruinent périodiquement le capital, et l'empêchent de se former. Le véritable intérêt de la société, c'est que les propriétés circulent, et que les capitaux se multiplient; la loi fiscale gêne la transmission, et quand elle remet la terre à l'héritier, c'est en le grevant d'une dette si lourde, que trop souvent elle jette le petit propriétaire dans les mains de l'usurier. Tout cela est un mal sans mélange, tout cela vient de ce qu'on a séparé l'idée de propriété et l'idée de liberté; tout cela doit cesser le jour où l'on comprendra que dans le domaine économique la liberté, c'est le moyen de production, la propriété en espérance, et que la propriété, c'est le fruit de la liberté, ou, si l'on veut, la liberté réalisée.
En traitant de la liberté individuelle je n'ai rien dit de la liberté de la presse, ou du droit que tout homme a de parler et de multiplier sa parole par l'impression. Ce n'est point que je considére ce droit comme étant moins individuel, ni moins essentiel que les autres; c'est le premier de tous; mais la liberté de la presse a un caractère singulier qui lui assigne une place à part dans notre étude, Elle est à la fois un droit individuel, un droit social, et la garantie suprême de toutes les libertés publiques et privées. C'est là ce qui en fait l'outil nécessaire de la civilisation moderne. Sans lui elle n'y a de sécurité pour aucun droit: mais avec ce seul levier on remplacerait ou plutôt on relèverait toutes les libertés. Cette force universelle est ce qu'on n'a pas assez remarqué dans la liberté de la presse. C'est ce qui me décide à traiter cette question en dernier, car elle suppose la connaissance de toutes les autres; j'en parlerai donc plus loin au chapitre des garanties.
60.Louis Wolowski and Émile Levasseur on “Property” (1864)↩
[Word Length: 10,716]
Source
Louis Wolowski and Émile Levasseur, “Propriété” dans Dictionnaire générale de la politique par Maurice Block avec la collaboration d’hommes d’état, de publicistes et d’écrivains de tous les pays. Paris: O. Lorenz. 1st ed. 1863-64), vol. 2, pp. 682-93.
Brief Bio of the Author
PROPRIÉTÉ.319
Propriété et famille, deux idées dont l'attaque et la défense ont armé depuis un demi-siècle des légions d'écrivains; des systèmes récents fondés sur des erreurs anciennes, mais rajeunis par les émotions populaires qu'ils excitaient, les ont en vain ébranlées, dénaturées, quelquefois même niées; ces idées expriment des faits nécessaires, qui, sous des formes diverses, se sont produits et se produiront dans tous les temps; aussi peuvent-elles être regardées à juste titre comme les principes fondamentaux de toute société politique parce que d'elles dérivent en grande partie les deux principaux objets dont s'occupent les lois sociales, à savoir les droits de l'homme sur les choses et les devoirs envers ses semblables.
Droit de propriété. — Si l'homme acquiert des droits sur les choses, c'est qu'il est à la fois actif, intelligent et libre; par son activité, il se répand sur la nature extérieure, par son intelligence, il la domine et l'assouplit à ses usages; par sa liberté il établit entre lui et elle la relation de cause à effet et il la fait sienne.
La nature n'a pas pour l'homme la prévoyante tendresse que supposaient les philosophes du dix-huitième siècle et que rêvaient avant eux les poètes de l'antiquité en décrivant l'âge d'or. Elle ne prodigue pas ses trésors pour faire couler aux mortels une vie facile dans l'abondance et l'oisiveté; au contraire, elle est âpre, et ne livre ses richesses qu'au prix de labeurs incessants; elle malmène ceux qui n'ont pas assez de force ou d'intelligence pour la dompter, et quand on considère les races primitives que les arts de la civilisation n'avaient pas encore élevées au-dessus d'elle, l'on peut se demander, avec Pline, si elle ne s'est pas montrée plus marâtre que mère. Abandonnée à elle-même, la terre présente ici des déserts, là des marécages ou d'inextricables forêts; les parties les plus fertiles sont d'ordinaire les moins accessibles, parce que, situées dans les vallées, elles sont envahies par des eaux croupissantes et empestées par les miasmes qui s'en exhalent ou hantées par des bêtes malfaisantes qui y cherchent leur pâture; les plantes vénéneuses croissent parmi les plantes nourricières, sans qu'aucun signe extérieur les distingue au regard, ni que l'instinct nous avertisse comme il avertit les animaux. Les meilleurs fruits eux-mêmes n'ont encore, pour la plupart, qu'une saveur grossière avant que la culture en ait corrigé l'amertume. Sans doute l'homme peut vivre, et il a vécu, au milieu de cette nature indifférente ou hostile; mais il y vivrait timide et craintif comme les biches des forêts, isolé ou groupé en petits troupeaux, et perdu dans les espaces immenses où sa frêle existence ne serait qu'un accident dans la vie luxuriante des êtres organisés; il ne se sentirait pas chez lui et il se trouverait en effet comme un étranger sur une terre qu'il n'aurait pas façonnée à sa volonté et où il ne serait ni le plus agile à la course, ni le mieux protégé contre le froid, ni le plus armé pour la lutte.
Ce qui le distinguerait déjà des autres êtres, même dans cet état de profonde barbarie, ce sont les divines puissances de l'âme dont il a été doté. Quelque engourdies qu'elles fussent encore, elles lui auraient appris, sans aucun doute, à sortir de sa nudité et de sa faiblesse; dès les premiers temps, elles lui auraient suggéré les moyens d'armer sa main d'une hache de pierre, semblable à celles qui, enfouies dans les dépôts calcaires d'un autre âge, nous racontent aujourd'hui les misérables débuts de notre race sur le globe, elles lui auraient enseigné à protéger son corps contre le froid avec la dépouille des ours et de garantir son gîte et sa famille contre les attaques des animaux féroces en disposant une grotte à son usage ou en bâtissant une cabane au milieu des eaux, non loin des bords d'un lac. Mais déjà l'homme aurait laissé sur la matière quelque empreinte de sa personnalité, et le règne de la propriété aurait commencé.
Quand les siècles se sont écoulés et que les générations ont accumulé leurs travaux, quelle est, dans un pays civilisé, la motte de terre, quelle est la feuille qui ne porte cette empreinte? Dans la ville nous sommes enveloppés par les œuvres de l'homme; nous marchons sur un pavé uni ou sur une chaussée battue; ce sont les hommes qui ont assaini le sol autrefois bourbeux, qui ont, des flancs d'une colline située loin d'ici, détaché le grès ou le caillou qui le recouvre. Nous habitons des maisons: ce sont des hommes qui ont extrait les pierres de la carrière, qui les ont taillées, qui ont amenuisé le bois, c'est la pensée d'un homme qui a coordonné les matériaux et fait un édifice de ce qui était auparavant roche et forêt. Dans la campagne, c'est encore l'action de l'homme qui est partout présente; des hommes ont défriché le sol et des générations de laboureurs l'ont ameubli et engraissé, les travaux de l'homme ont endigué les rivières et créé la fertilité là où les eaux n'apportaient que la désolation; aujourd'hui l'homme va jusqu'à peupler les fleuves, à diriger la croissance des poissons et il prend possession de l'empire des eaux. Nous récoltons le blé, notre principale nourriture. Où le trouve-t-on à l'état sauvage? Le blé est une plante domestique, une espèce transformée par l'homme pour les besoins de l'homme. Les arbres, originaires des pays les plus divers, ont été rassemblés, greffés, modifiés par l'homme pour l'ornement des jardins, les plaisirs de la table ou les travaux de l'atelier. Les animaux eux-mêmes, depuis le chien, compagnon de l'homme, jusqu'au bétail élevé pour la boucherie, ont été façonnés sur des types nouveaux qui s'éloignent sensiblement du plan primitif de la nature. Partout on devine une main puissante qui a pétri la matière et une volonté intelligente qui l'a tournée, suivant un plan uniforme, à la satisfaction des besoins d'un même être. La nature a reconnu son maître et l'homme sent qu'il est chez lui. Cette nature a été appropriée par lui à son service; elle est devenue sa chose propre; elle est sa propriété.
Cette propriété est légitime; elle constitue pour l'homme un droit aussi sacré que l'est le libre exercice de ses facultés. Elle est à lui parce qu'elle est sortie tout entière de lui-même et qu'elle n'est en quelque sorte qu'une émanation de son être. Avant lui il n'y avait guère que de la matière, depuis lui et par lui il y a de la richesse échangeable, c'est-à-dire des objets ayant, par une industrie quelconque, fabrication, manutention, extraction ou simplement transport, acquis une valeur. Depuis le tableau d'un grand maître, qui est peut-être de tous les produits matériels celui dans lequel la matière joue le moindre rôle, jusqu'à la voie d'eau que le porteur puise à la rivière et apporte au consommateur, les richesses, quelles qu'elles soient, n'acquièrent leur valeur que par des qualités communiquées, et ces qualités sont des portions de l'activité, de l'intelligence, de la force humaine; le producteur, comme le dit spirituellement M. Fr. Passy, a vraiment payé de sa personne. Il en a laissé quelque fragment dans la chose qui est ainsi devenue une richesse et qui peut dès lors être considérée comme un prolongement des facultés de l'homme agissant sur la nature extérieure. En sa qualité d'être libre, il s'appartient à lui-même; or la cause, c'est-à-dire la force productrice, c'est lui; l'effet, c'est-à-dire la richesse produite, c'est encore lui. Qui oserait lui contester son titre de propriété si nettement marqué du cachet de sa personnalité?
Des auteurs ont essayé de fonder le principe de la propriété sur le droit de premier occupant. C'est une vue étroite: l'occupation est un fait et non pas un principe. Elle est un des signes par lesquels se manifeste la prise de possession, mais elle ne suffit pas à la valider devant le philosophe ou le légiste. Qu'un homme aborde sur une terre déserte et dise: « Aussi loin que s'étend ma vue, depuis ce rivage jusqu'aux collines qui bordent là-bas l'horizon, cette terre est à moi »; nul n'acceptera une pareille occupation pour un titre sérieux de propriété. Mais que le même homme s'établisse sur le plus fertile coteau, s'y bâtisse une cabane, défriche les champs environnants, et la possession de la partie effectivement occupée deviendra un droit, parce que l'homme aura fait acte de propriétaire, c'est-à-dire y aura empreint avec son travail le cachet de sa personnalité. Le droit des gens met à cet égard une différence entre les particuliers et les États; ce qu'il refuse à ceux-là, il l'accorde à ceux-ci, et il reconnaît la validité d'une prise de possession sommaire qui ne lèse aucun droit antérieur. C'est que l'occupation est d'une tout autre nature: l'une ayant pour objet le domaine utile, l'autre la souveraineté, qui implique seulement une protection générale; la preuve est que dans les sociétés modernes la souveraineté passe souvent d'un État à un autre sans que la propriété change de mains.
Montesquieu écrivait: «Comme les hommes ont renoncé à leur indépendance naturelle pour vivre sous les lois politiques, ils ont renoncé à la communauté naturelle des biens pour vivre sous des lois civiles. Ces premières lois leur acquièrent la liberté; les secondes, la propriété.320 » Bentham développait la même pensée: « La propriété et la loi sont nées ensemble et mourront ensemble. Avant les lois, point de propriété; ôtez les lois, toute propriété cesse.321 » C'était encore une vue étroite. Montesquieu et Bentham, pour n'envisager qu'un côté de la question, glissaient sur la pente d'une erreur bien dangereuse; car elle conduisait à cette conséquence, que si la loi avait fait la propriété, la loi pouvait la défaire, et elle ruinait le fondement même que les auteurs se proposaient de poser. Il est évident que la propriété est née avant la loi, comme avant la formation de toute société régulière, puisqu'il y a eu appropriation d'une certaine partie de la matière dès que l'homme a existé et a commencé, pour subsister, à étendre sa main et son intelligence autour de lui. La propriété et la famille ont été la raison d'être et non la conséquence des sociétés, et les lois qui, suivant la belle définition mise par Montesquieu lui-même en tête de son ouvrage, «sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses»; les lois ont consacré ce rapport nécessaire qui s'établit entre l'homme et la matière, mais elles n'ont pas créé un rapport qui eût été factice et accidentel. Ce qui est vrai, c'est que, sans la loi, la propriété n'a pas de garanties contre les entreprises de la force, et qu'elle manque de sécurité et de solidité. Mais quel est le droit dont l'exercice soit assuré hors de l'état social?
Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a certaines formes de propriété qui n'auraient pu se produire sans la protection des lois sociales, c'est qu'une civilisation avancée et un bon gouvernement ont pour effet d'élargir le cercle dans lequel peut se mouvoir avec sécurité l'activité humaine et qu'ils étendent, par conséquent, le champ de la propriété. Ce qui est vrai enfin, c'est que, dans un certain nombre de cas particuliers où le droit naturel ne fournit pas de lumières suffisantes, la loi décide et détermine ainsi un droit positif de propriété qu'elle aurait peut-être pu déterminer autrement, parce qu'il importe, dans une société bien organisée, que rien, en pareille matière, ne demeure dans le vague, livré au caprice de l'arbitraire. Mais il faut se garder de confondre une forme ou un cas particulier du droit avec le principe même du droit.
C'est donc à la personne humaine, créatrice de toute richesse, qu'il faut revenir; c'est sur la liberté qu'il convient de fonder le principe de la propriété, et si l'on veut savoir à quel signe on la reconnaît, nous répondrons que c'est par le travail que l'homme imprime sa personnalité sur les choses. C'est le travail qui défriche la terre et d'une lande inoccupée fait un champ approprié; c'est le travail qui, d'une forêt vierge, fait un bois régulièrement aménagé; c'est le travail, ou plutôt c'est une série de travaux exécutés par une succession souvent très-nombreuse d'ouvriers, qui de la graine fait sortir le chanvre, du chanvre le fil, du fil l'étoffe, de l'étoffe le vêtement, qui convertit l'informe pyrite recueillie dans la mine en un bronze élégant qui orne une place publique et redit à tout un peuple la pensée d'un artiste. C'est le travail qui est le signe distinctif de la propriété; il en est la condition, il n'en est pas le principe, lequel remonte à la liberté de l'âme humaine.
La propriété, manifestée par le travail, participe des droits de la personne dont elle est l'émanation; comme elle, elle est inviolable tant qu'elle ne pousse pas son expansion jusqu'à venir se heurter contre un autre droit; comme elle, elle est individuelle, parce qu'elle a son origine dans l'indépendance de l'individu et que, quand plusieurs ont coopéré à sa formation, le dernier possesseur a racheté avec une valeur, fruit de son travail personnel, le travail de tous les collaborateurs qui l'avaient précédé: c'est ce qui a lieu pour la plupart des objets manufacturés. Quand la propriété a passé par vente ou par héritage d'une main dans une autre, ses conditions n'ont pas changé; elle est toujours le fruit de la liberté humaine manifestée par le travail, et le détenteur a les mêmes titres que le producteur qui l'a saisi de son droit.
Les violences, les confiscations, la fraude, les conquêtes ont plus d'une fois troublé l'ordre naturel de la propriété et mêlé leurs impures origines à la source pure du travail. Mais elles n'ont pas altéré le principe. Le vol qui enrichit un heureux coquin empêche-t-il que le travail soit nécessaire à la production de la richesse? D'ailleurs il ne faut pas exagérer à plaisir la portée de ces dérogations à la loi générale. On a dit que si on pouvait remonter à l'origine de toutes les propriétés foncières, on n'en trouverait pas une qui ne fût entachée de quelqu'un de ces vices, peut-être, sur le sol de notre vieille Europe que tant d'invasions ont foulé et successivement occupé dans les temps anciens et au moyen âge. Mais jusqu'où faudrait-il remonter à travers les siècles? Si loin que pour les quatre-vingt-dix-neuf centièmes des propriétés on ne peut le dire que par une simple conjecture fondée sur les probabilités de l'histoire. Nos lois ont établi la prescription trentenaire (voy.), d'abord parce qu'il est nécessaire, pour donner quelque solidité à la propriété, de ne pas la laisser sous le coup d'une éternelle revendication, ensuite parce qu'une longue possession est déjà un titre et qu'un homme qui pendant une génération a, par lui-même ou par ses fermiers, enfoui un travail continu sur un même sol, a fait pour ainsi dire la chose sienne. Or qu'est-ce que cette courte prescription légale à côté de la longue prescription des siècles et comment oserait-on contester à des propriétaires la légitimité de leur droit sur telles terres aujourd'hui richement cultivées, couvertes de fermes et d'usines, sous prétexte qu'un Franc du quatrième siècle en a expulsé un Gaulois qui y faisait paître ses troupeaux? Sur le sol se sont accumulées des richesses immobilières qui en ont parfois centuplé la valeur et dont l'origine et la transmission sont également légitimes. Hors du sol, ont grandi les richesses mobilières qui forment aujourd'hui une grande partie du patrimoine de nos sociétés, et ces richesse, fruit du travail moderne, sont pour la plupart pures des souillures de la force brutale. La guerre n'est plus de noire temps un moyen d'existence; elle est plutôt une cause de ruine; les conquérants aspirent à usurper la souveraineté, mais ils respectent la propriété. Les sociétés qui se sont établies dans le nouveau monde, en Amérique et en Australie, se sont fondées pour la plupart par les défrichements des pionniers qui ont fait la terre et qui l'ont léguée à leurs enfants. Là, dans les nombreux cantons où l'on n'a pas eu à lutter contre les tribus sauvages, peu ou point de violence, même dans l'occupation du sol. En somme, si l'on considère l'ensemble de la propriété, quelle petite place occupe l'exception à côté de la loi, la violence à côté du travail!
Utilité sociale de la propriété. — Ce qui est juste est toujours utile. La propriété a un tel caractère d'utilité sociale qu'il ne saurait exister de société sans propriété, et qu'il n'y a pas de société florissante sans propriété individuelle. Aussi, quand on a voulu fonder la propriété sur l'utilité, les arguments ne manquaient certes pas; mais l'utilité dont il faut tenir grand compte en matière politique est, nous l'avons dit, un effet et non un principe, et il faut se contenter de dire que les excellents effets de la propriété corroborent la légitimité du droit. «L'homme, dit M. Thiers, a une première propriété dans sa personne et ses facultés; il en a une seconde moins adhérente à son être, mais non moins sacrée, dans le produit de ces facultés qui embrasse tout ce qu'on appelle les biens de ce monde et que la société est intéressée au plus haut point à lui garantir; car, sans cette garantie, point de travail; sans travail, pas de civilisation, pas même le nécessaire, mais la misère, le brigandage et la barbarie.322 » On ne saurait imaginer une société entièrement dépourvue de la notion de propriété; mais on peut en concevoir ou en trouver dans l'histoire, chez lesquelles la propriété soit à l'état rudimentaire, et on constate sans peine qu'un pareil état est bien, comme le dit M. Thiers, la misère et la barbarie. L'homme n'est pas un dieu; le travail, qui est un exercice salutaire pour l'âme et pour le corps, est en même temps une peine; ce n'est qu'au prix d'un effort que l'homme réalise sa pensée dans la matière, et le plus souvent il ne ferait pas cet effort qui lui coûte s'il n'y était encouragé par la double pensée de produire un effet utile et de jouir lui-même de l'utilité produite. Qui prendrait le soin d'abattre, d'équarrir, de diviser en planches un arbre, s'il savait que le lendemain un sauvage s'en emparerait pour faire du feu ou même pour se construire une cabane? L'activité n'aurait pas de but, parce qu'elle n'aurait pas de récompense assurée; elle se replierait en elle-même, comme le colimaçon qu'un obstacle extérieur menace, et ne se hasarderait au dehors que pour la satisfaction des besoins les plus immédiats ou la création des propriétés les plus faciles à défendre, pour la chasse du gibier, pour la fabrication d'un arc ou d'une hache. Dans les sociétés qui se sont déjà élevées à un certain degré de civilisation, mais qui n'ont pas un respect suffisant de la propriété, cette seule imperfection sociale suffit pour entraver le progrès et pour maintenir pendant des siècles les hommes à un niveau d'abaissement d'où il faut, pour émerger, des efforts inouïs, et surtout la connaissance du droit. «Tous les voyageurs, dit-il ailleurs, ont été frappés de l'état de langueur, de misère et d'usure dévorante des pays où la propriété n'est pas suffisamment garantie. Allez en Orient où le despotisme se prétend propriétaire unique, ou, ce qui revient au même, remontez au moyen âge, et vous verrez partout les mêmes traits; la terre négligée, parce qu'elle est la proie la plus exposée à l'avidité de la tyrannie et réservée aux mains esclaves qui n'ont pas le choix de leur profession; le commerce préféré comme pouvant échapper plus facilement aux exactions… » Tableau sombre, mais qui a été longtemps et qui est encore sur une grande partie de notre globe la véritable peinture de l'humanité. Que la propriété, au contraire, soit pleinement reconnue, respectée, garantie sous ses diverses formes, l'homme ne craindra pas de laisser son activité rayonner dans tous les sens. L'image de la société sera tout autre: au lieu de maigres et rares arbrisseaux sans branchages, on aura le spectacle d'une forêt de chênes immenses, étendant au loin leurs rameaux et montrant des troncs d'autant plus vigoureux qu'ils aspireront l'air et la vie par plus de pores. Loin de se nuire, les hommes se soutiennent les uns les autres par leur développement individuel. Car la propriété n'est pas un fonds commun déterminé d'avance qui diminue de la quantité que chacun s'approprie; c'est, comme nous, l'avons dit, une création de la force intelligente qui réside dans l'homme; chaque création s'ajoute aux créations antérieures et, mettant daDS le commerce une force nouvelle, facilite les créations ultérieures. La propriété de l'un, loin de limiter pour les autres la possibilité de devenir propriétaires, accroît donc au contraire cette possibilité; elle est le stimulant le plus énergique de la production, le pivot du progrès économique, et, quand la nature des choses n'en aurait pas fait un droit antérieur à toute convention, les lois humaines l'auraient établie, comme l'institution la plus éminemment utile au bien-être et à la moralité des peuples.
Histoire de la propriété. — On conçoit que quoique le principe de la propriété soit un, il n'ait pas été compris et appliqué de la même manière dans tous les temps et dans tous les pays. Il en est de ce droit comme de la plupart des droits naturels qui demeurent longtemps ensevelis dans la barbarie et qui peu à peu émergent avec le progrès de la civilisation. Nous tendons aujourd'hui vers la plénitude du droit de propriété, et les nations les plus avancées de l'Europe et du Nouveau-Monde paraissent n'être pas très-éloignées de l'idéal que nous concevons. Mais combien de siècles a-t-il fallu pour le dégager des nécessités ou des ignorances du passé? Les sauvages de l'Amérique qui ne cultivaient pas la terre, n'avaient pas la notion de la propriété foncière; la coutume ne consacrait le droit de possession que pour les objets mobiliers; la terre était commune; c'était un vaste champ de chasse et de pêche ouvert à tous les gens de la tribu, mais défendu avec un soin jaloux contre les empiétements des tribus voisines. Quand ils cultivaient et formaient, comme au Pérou et au Mexique, des sociétés plus savamment organisées, ils devaient nécessairement tenir compte de l'appropriation de la terre, mais leurs idées ne s'élevaient pas encore à la propriété individuelle. « Personne, dit Robertson en parlant du Pérou, n'avait un droit de propriété exclusive sur la portion qui lui était attribuée. Il la possédait seulement pour une année. A l'expiration de ce terme, on faisait une nouvelle division selon le rang, le nombre et les besoins de la famille. Toutes ces terres étaient cultivées par un travail commun de tous les membres de la communauté....323 » Au Mexique, les grands avaient des propriétés individuelles, mais, ajoute-t-il, «le gros de la nation possédait les terres d'une manière très-différente. A chaque district était attribuée une certaine quantité de terres proportionnée au nombre des familles qui le formaient. Ces terres étaient cultivées par le travail de toute la communauté. Leur produit se portait dans un magasin commun et se partageait entre les familles selon les besoins respectifs.324 » Les nations primitives ne paraissent pas s'être élevées beaucoup plus haut dans la conception de l'idée de propriété. Chez les peuples pasteurs de l'Orient, la propriété, composée principalement d'objets mobiliers et de bestiaux, fut presque toute aux mains du père de famille, du patriarche, du chef de tribu; ce sont les mœurs des Arabes, et nous les retrouvons aujourd'hui, à côté de nous, dans l'Algérie où la terre appartenant en commun aux membres d'un même douar ou village, est distribuée entre eux par le caïd. Le même système, remontant du chef de famille au prince, a concentré toute la propriété entre les mains des despotes de l'Orient, et énervé le progrès de ces belles contrées en coupant les racines de l'activité individuelle. La loi juive, dans le but de maintenir la propriété dans les mêmes tribus et dans les mêmes familles, avait imaginé l'annulation des dettes mobilières tous les sept ans et la restitution des terres aliénées tous les quarante-neuf ans, au grand jubilé: loi qui parait d'ailleurs avoir été assez mal observée. En Grèce, Sparte et Athènes marquaient deux tendances contraires, l'une mutilant et supprimant presque le droit de propriété, pour façonner le citoyen au gré de l'État, l'autre assurant, malgré certaines restrictions, la liberté civile; mais il est facile de voir de quel côté incline la préférence de ses philosophes. Même dans les lois où il essaye de faire de la politique pratique, Platon s'exprime ainsi: «Je vous déclare, en ma qualité de législateur, que je ne vous regarde pas, ni vous ni vos biens, comme étant à vous-mêmes, mais comme appartenant à votre famille, et toute votre famille, avec ses biens, comme appartenant encore plus à l'État.325 » Rome, tout en consacrant plus solennellement que la plupart des autres États de l'antiquité, la propriété territoriale, ne l'avait garantie qu'à ses seuls citoyens et l'avait concentrée dans les mains du père de famille; la conquête d'ailleurs était encore au nombre des principaux modes d'acquisition et avait donné naissance à d'immenses domaines de l'État (ager publicus) et aux lois agraires; pendant l'empire, les jurisconsultes, sous l'influence des idées nouvelles que propagèrent la philosophie stoïcienne et la religion chrétienne, s'appliquèrent à dégager les personnes trop étroitement serrées dans les nœuds de la famille et la propriété gagna à ce progrès de la liberté. Mais au moyen âge, la féodalité s'appesantit lourdement sur la terre; confondant les idées de propriété et de souveraineté, elle fit, du possesseur du sol, le maître des choses et des personnes, lia les unes et les autres par une multitude de liens, les serfs à la glèbe, les seigneurs au fief, enlaça la société dans un vaste réseau de servitudes réciproques. La propriété mobilière, longtemps étouffée par ces systèmes divers, ne se produisit qu'avec timidité, sous l'abri du privilège, dans les corporations d'arts et métiers; les règlements des princes ne la protégèrent qu'en la tenant sous une étroite tutelle; cependant elle grandit peu à peu et ses développements commencèrent même à être assez rapides quand les découvertes de Christophe Colomb et de Vasco de Gama eurent ouvert au commerce maritime les grandes routes de l'Océan. Mais à cette époque, la puissance absolue des rois s'élevait sur les ruines de la féodalité dans les principaux États de l'Europe occidentale, et si la propriété en fait se dégageait quelque peu de ses étreintes, en droit elle changeait de maître sans acquérir plus d'indépendance. Louis XIV, qui peut être regardé comme le représentant le plus illustre et le plus convaincu du pouvoir absolu, écrivait pour l'instruction du dauphin: « Tout ce qui se trouve dans l'étendue de nos États, de quelque nature qu'il soit, nous appartient au même titre. Vous devez être bien persuadé que les rois sont seigneurs absolus et ont naturellement la disposition pleine et libre de tous les biens qui sont possédés, aussi bien parles gens d'Église que parles séculiers, pour en user en tout, comme de sages économes. » Environ un siècle après, en 1809, un autre souverain, non moins absolu, disait dans une séance du conseil d'État: « La propriété est inviolable, Napoléon lui-même, avec les nombreuses armées qui sont à sa disposition, ne pourrait s'emparer d'un champ, car violer le droit de propriété dans un seul, c'est le violer dans tous… » Ses actes n'étaient pas tous parfaitement conformes à sa théorie; néanmoins cette déclaration montre quel progrès avait fait en France, du dix-septième au dix-neuvième siècle, l'idée de propriété. C'est que le dix-huitième avait passé entre les deux époques, et quoiqu'il n'eût pas lui-même une idée nette du caractère sacré de la propriété, puisqu'il la fondait sur l'utilité et la loi et la faisait dériver d'une prétendue communauté primitive, cependant il avait secoué le joug des servitudes féodales et du droit divin des rois; il avait plaidé la cause de la liberté et la révolution avait fait triompher cette cause en émancipant l'homme, la terre et le travail; la propriété pouvait se produire sous ses principales formes.
Des objections contre la propriété. — La propriété triomphait avec la liberté dont elle est une des formes. C'était justement le temps où elle allait avoir à se défendre contre les adversaires les plus malveillants. Ceux-ci l'attaquèrent au nom d'une prétendue égalité; jaloux de voir de grandes fortunes s'étaler à côté de grandes misères, ils crurent follement que priver des fruits de leur travail ceux qui les avaient légitimement acquis, c'était encourager le travail et soulager la misère. La Convention, guidée par des principes tout autres que ceux de la Constituante, glissa plus d'une fois sur cette pente et, après la Convention, Gracchus Babœuf recueillit et exagéra sur ce point les doctrines de la Montagne dont il fit le communisme moderne: «Quand, dans un État, dit-il, la minorité des sociétaires est parvenue à accaparer dans ses mains les richesses foncières et industrielles et que par ce moyen elle tient sous sa verge et use du pouvoir qu'elle a de faire languir dans le besoin la majorité, on doit reconnaître que cet envahissement n'a pu se faire qu'à l'abri des mauvaises institutions du gouvernement, et alors ce que l'administration ancienne n'a pas fait dans le temps pour prévenir l'abus ou pour le réprimer à sa naissance, l'administration actuelle doit le faire pour rétablir l'équilibre qui n'eût jamais dû se perdre et l'autorité des lois doit opérer un revirement qui tourne vers la dernière raison du gouvernement perfectionné du Contrat social: que tons aient assez, qu'aucun n'ait trop.» Il y avait eu dans tous les temps des esprits qui avaient rêvé la communauté des biens et qui avaient pu le faire d'autant mieux que la propriété individuelle était de leur temps moins étendue et moins fortement établie. Platon avait écrit sa République; Campanella, sa Cité du Soleil; Thomas Morus, son Utopie; Fénelon, sa Bétique et son Gouvernement de Salenie; mais ils avaient fait de la philosophie spéculative plus que de la politique, et s'étaient surtout proposé de tracer aux hommes un idéal de vertu: conception fausse, mais néanmoins plus désintéressée que celle des communistes modernes. Ceux-ci ont pour objet principal la jouissance; leurs théories se sont éveillées au spectacle de la richesse qui grandissait rapidement dans la société moderne, mais en répandant ses faveurs d'une manière inégale, puisqu'elle les proportionnait au travail, à l'intelligence, au capital de chacun et aux circonstances de la production: ils ont voulu que les moins favorisés eussent une plus forte part sans avoir une plus lourde charge de travail, et ils n'ont pas imaginé de meilleur moyen que de limiter ou de confisquer le capital, c'est-à-dire la propriété qui est le levier du travail.
Les saint-simoniens, pour atteindre ce but, se proposaient d'organiser un sacerdoce puissant, composé des hommes les plus capables dans la science, les arts et l'industrie. Ce sacerdoce aurait donné le branle à toute la société; le prêtre aurait été « la loi vivante »; il n'y aurait plus eu ni empereur ni pape; il y aurait un père « disposant de tous les capitaux et de tous les produits et les distribuant à chacun selon ses mérites ». Ils arrivaient à cette conséquence que « tout bien est bien d'Église » et que toute profession est une fonction religieuse. Ils ne voyaient pas que la propriété est la rémunération même du travail qu'ils préconisaient et le fruit de l'épargne sans laquelle le travail, privé de capitaux, est réduit à l'impuissance; ils ne voyaient pas que l'hérédité est la conséquence et l'extension de la propriété et, sous prétexte d'accroître la richesse sociale, richesse qui, faute d'être ménagée et renouvelée par la puissance de l'intérêt individuel, se serait fondue insensiblement entre les mains de leur grand prêtre, ils aboutissaient à un immense despotisme; pour poursuivre l'ombre du bien-être, ils auraient compromis sans le savoir le bien-être réel et ils n'hésitaient pas à sacrifier sciemment la liberté, le plus important de tous les biens dans une société d'hommes civilisés. Voilà ou conduisait le premier des systèmes hostiles à la propriété.
Celui de Fourier datait à peu près de la même époque, c'est-à-dire du Consulat. Mais il n'eut de retentissement qu'après le grand éclat que jeta le saint-simonisme au commencement du règne de Louis-Philippe. Fourier n'est pas à proprement parler un communiste; il proclame la liberté et il accepte le capital. Mais, en fait, il enferme l'une et l'autre dans un système d'exploitation commune qui les mutile; il n'y a plus qu'une liberté, c'est celle de se livrer sans contrainte à la diversité de ses appétits, il n'y a plus qu'une propriété, ce sont les actions du phalanstère. Est-ce là véritablement la liberté, celle qui, ayant pour guide une volonté ferme et pour garant la responsabilité, dirige les forces de l'homme vers un but déterminé? Est-ce véritablement la propriété, c'est-à-dire la possession pleine et entière des choses diverses que l'homme s'est appropriées par le travail? (Voy. Socialisme.)
Le plus récent adversaire de la propriété est M. Proudhon, qui, dans un pamphlet célèbre, a repris un paradoxe de Brissot: la propriété, c'est le vol. M. Proudhon ne reconnaît ni dans l'occupation, ni dans le travail des raisons suffisantes pour légitimer la propriété. « Puisque tout homme, dit-il, a droit d'occuper par cela seul qu'il existe et qu'il ne peut se passer pour vivre d'une matière d'exploitation et de travail; et puisque, d'autre part, le nombre des occupants varie continuellement par les naissances et les décès, il s'ensuit que la quantité de matière à laquelle chaque travailleur peut prétendre est variable comme le nombre des occupants; par conséquent, que l'occupation est toujours subordonnée à la population; enfin que la possession en droit ne pouvant jamais demeurer fixe, il est impossible en fait qu'elle devienne propriété. » Ailleurs, répondant à l'argument de Ch. Comte qui voit un titre de propriété dans la plus-value obtenue par le possesseur lorsque celui-ci, grâce à son travail, a tiré la subsistance de deux personnes d'une terre qui n'en nourrissait qu'une, M. Proudhon ajoute: « Je soutiens que le possesseur est payé de sa peine et de son industrie par la double rente, mais qu'il n'acquiert aucun droit sur le fonds. Que le travailleur fasse les fruits siens, je l'accorde, mais je ne comprends pas que la propriété des produits emporte celle de la matière. » Cette concession met déjà hors de litige toute la propriété mobilière, laquelle se compose tout entière de fruits que le travailleur a faits siens et qu'il n'a pas consommés. Reste la propriété immobilière ou pour mieux dire la très-minime portion de la valeur immobilière qui n'est pas un fruit du travail, un capital mobilier enfoui dans le sol et confondu avec lui. Or, nul économiste ne soutient que tout homme, en venant au monde, ait droit à une part de ce sol et surtout à une part égale à celle des autres, située dans le pays même où il est né. L'occupation est un fait et non un droit; elle peut donner naissance à un droit quand, ayant eu lieu sur un terrain encore inoccupé, elle est consacrée par le travail, voilà tout. La société garantit les droits des individus, c'est son premier devoir; dans le système de M. Proudhon elle commettrait la double faute, et de vouloir leur faire trop de bien en cherchant à leur constituer une fortune, et de leur faire trop de mal en dépouillant les uns d'un droit logiquement antérieur à elle-même, pour doter les autres d'un bienfait gratuit.
Droit de tester et hérédité. — Si la propriété est juste et utile, il faut qu'elle soit complète, c'est-à-dire qu'elle emporte non-seulement le droit de jouir, mais le droit de disposer. C'est la définition du Code civil (art. 544): « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, » définition juste que le Code a malheureusement obscurcie par une restriction vague et susceptible d'interprétations funestes au droit même de propriété.326 Aussi le propriétaire doit-il pouvoir librement prêter, vendre, donner, et par conséquent léguer son bien. Si la propriété est une création de l'homme, une sorte d'émanation de lui-même, une extension de sa personne dans l'espace, pourquoi cette extension n'aurait-elle pas lieu également dans le temps? Comment la matière perdrait-elle l'empreinte humaine qui fait sa valeur, parce que la force intelligente qui la lui avait communiquée a cessé d'imprimer cette empreinte sur d'autres parcelles de la matière? La statue de bronze cesse-t-elle d'être la création de l'artiste parce que le moule a été brisé? L'essence de la propriété change-t-elle parce que le propriétaire est mort? Un instant avant, il pouvait disposer, il pouvait vendre, donner, et l'acte de sa volonté, vente ou donation, aurait eu de pleins effets, des effets durables, qui lui auraient indéfiniment survécu; un instant après, les dispositions qu'il aurait prises depuis de longues années peut-être, seraient, par cela seul qu'elles ne devaient être exécutées qu'à l'ouverture de son testament, nulles de toute nullité. Si la chose est bien à lui, et s'il a pu la veille en saisir par acte authentique un donataire, il ne pourrait pas par un acte non moins authentique en saisir virtuellement un héritier; le premier serait un droit, le second serait un abus. Certes il y aurait là une contradiction qui répugne au bon sens et que le droit naturel repousse. Il est absurde de croire à la propriété et de nier le droit de tester. La pensée de l'homme s'étend dans l'avenir comme elle s'étend dans l'espace, et il serait étrange, lorsque l'instinct apprend même aux insectes à préparer des aliments et un abri convenable à une postérité qu'ils ne verront pas, que le seul être libre de la création n'ait pas le pouvoir de songer à ceux qu'il laissera après lui, de travailler pour eux et de pouvoir dire comme le vieillard de Lafontaine:
« Mes arrière-nevenx me devront cet ombrage. »
Ce qui est juste est utile, avons-nous dit; le droit de tester a la sanction de l'utilité. Sans propriété il n'y a pas de travail; mais sans possibilité de transmission, il n'y a pour ainsi dire plus de travail fructueux, plus d'entreprises à échéance lointaine, plus d'accumulation de capitaux et la famille est privée du principal lien de continuité qui retient ses membres au foyer domestique. Bien peu d'hommes en effet continueraient jusqu'au dernier jour une vie d'efforts s'ils savaient que tout à coup la mort leur ravirait non-seulement le droit de jouir, mais celui de faire des heureux et de goûter en quelque sorte dans leurs enfants enrichis par leurs sueurs le bien-être qu'ils n'ont jamais eu le loisir de savourer par eux-mêmes; ils préféreraient la consommation à l'épargne et la société serait privée d'un de ses plus précieux instruments de progrès économique. On comprend que ces arguments s'appliquent aussi à l'hérédité, mais nous n'avons pas à développer davantage notre pensée, la matière étant traitée aux mots Hérédité et Testament.
Propriété foncière. — Il y a plusieurs espèces de propriétés parce qu'il y a plusieurs espèces de choses que l'activité humaine approprie à la satisfaction de nos besoins. Le mode d'appropriation diffère comme l'objet: de là, la nécessité de lois distinctes pour régir des propriétés distinctes. La terre n'est pas, dans l'ordre des temps, la première chose que l'homme se soit appropriée, puisque l'archéologie et l'histoire nous le montrent partout chasseur avant d'être agriculteur; mais c'était un état de barbarie grossière dont il a commencé à sortir pour former des groupes sociaux dès qu'il a commencé à s'attacher à la terre, et c'est ainsi que la constitution de la propriété foncière date des premières lois civiles et des premières sociétés. Elle a été la première richesse dont les législateurs aient eu à s'occuper et elle est restée pendant bien des siècles la plus importante. Il y a cent ans, les premiers économistes proclamaient encore avec Quesnay que la terre est la source unique de toute richesse. Aussi a-t-elle joué un grand rôle dans la politique. Elle donnait non-seulement la richesse, mais la puissance; le patriciat à Rome a été fort, tant qu'il a tenu dans ses mains la plus grande partie des terres; le moyen âge, dans toute l'Europe occidentale, a eu un tel respect de la terre qu'il a fait, au mépris de la liberté humaine, du propriétaire un souverain et un maître. Mais toute grandeur a ses servitudes; la terre a dû à celte haute estime d'être entourée de nombreuses garanties contre la fraude ou la violence, mais aussi d'être surchargée de règlements et de chaînes de toute sorte. Ses droits de souveraineté sont presque partout tombés; mais dans beaucoup de pays elle jouit encore de certains privilèges légaux et dans tous elle a une importance qui la fait rechercher.
En France, de 1815 à 1848, le droit électoral était attaché au payement d'un certain chiffre de contributions directes, et, sous la Restauration, la Chambre des députés et les ordonnances de juillet 1830 avaient même voulu ne tenir compte pour le cens électoral que de la contribution foncière; la Chambre se proposait de rétablir d'une manière indirecte une aristocratie de grands propriétaires. Depuis 1848, la propriété ne sert pas à obtenir un droit politique, mais elle a toujours de grands attraits, car les terres se vendent toujours plus cher que les propriétés mobilières, proportionnellement au revenu qu'elles produisent; c'est qu'on aime la terre pour elle-même; on aime à dire: «mon champ, ma maison, » à posséder quelque coin sur ce globe où l'on puisse se croire chez soi, à recueillir des fruits qu'on n'ait pas achetés; à répandre en quelque sorte plus ostensiblement sa personnalité sur la matière et à jouir de l'influence morale que peut donner cette richesse étalée à tous les regards; c'est qu'enfin, quoi qu'il arrive au milieu des révolutions de la politique et des perturbations du commerce, la terre subsiste, que, dans les pays où la confiscation est abolie, le revenu peut faire défaut, mais le fonds ne saurait échapper au propriétaire, et que, loin de s'amoindrir comme la plupart des capitaux, la valeur de ce fonds ne fait d'ordinaire que s'accroître avec le temps. Mais dans la plupart des pays aussi, la transmission de ce genre de propriété a été entourée de formalités d'autant plus nombreuses qu'on a voulu lui donner plus de solidité, et quelquefois ces formalités, précautions excessives d'un autre âge, pèsent sur la propriété foncière et nuisent à la liberté des transactions. (Voy. Enregistrement.)
Propriété souterraine. — Un article spécial étant consacré à cette matière, nous devons nous borner à y renvoyer. (Voy. plus loin.)
Propriété mobilière. — La terre et tout ce qui par nature ou par destination est attaché à la terre forme la propriété foncière; tout ce qui au contraire n'est pas attaché à la terre, est propriété mobilière. La distinction est réelle et facile à saisir, quoique la limite, comme celles de la plupart des classifications de la science humaine, manque de précision et ait besoin d'être déterminée arbitrairement par la loi. La propriété mobilière a été la première à naître, la dernière à se développer. On peut dire que l'humanité était encore plongée dans la plus profonde barbarie lorsqu'il n'y avait que des biens mobiliers, des arcs et des haches de pierre. On peut dire aussi que quand les biens fonciers et les biens mobiliers coexistent, la civilisation est d'autant plus avancée que ceux-ci occupent une place plus importante dans l'inventaire général de la richesse publique. Non-seulement ils portent plus complètement l'empreinte de la personnalité humaine et sont presque toujours plus dégagés de la matière que les biens-fonds, mais seuls, ils peuvent satisfaire à la diversité de nos besoins. La terre est la source; mais la matière qui en sort est déjà un meuble sur lequel s'exerce la multiple industrie de l'homme; cette industrie compose, décompose, transforme la matière et en fait la grande majorité des choses qui se vendent et s'achètent, tout ce qui se consomme et une bonne partie de ce qui se conserve, denrées, produits fabriqués et capitaux. Sous cette dernière forme, les biens meubles sont comme une rosée féconde qui, sortie de la terre, retombe sur la terre et la fertilise; plus ils sont abondants, plus la propriété immobilière donne de produits et acquiert de valeur. Longtemps la propriété mobilière a tenu dans la législation comme dans la richesse des peuples une place beaucoup moindre que la propriété immobilière; aussi a-t-elle été en général moins protégée, et souvent dans l'antiquité, elle a été opprimée ou méprisée. Dans les contrées de l'Orient soumises au régime des castes, les artisans et les marchands étaient toujours rangés après les agriculteurs; à Rome le commerce était interdit aux sénateurs et Cicéron ne croyait pas « qu'une noble pensée pût jamais naître dans une boutique. » Au moyen âge, les juifs qui ne pouvaient s'élever à la possession des biens-fonds étaient honnis autant pour leurs richesses mobilières que pour leur religion. Aujourd'hui ces préjugés sont tombés; la propriété mobilière occupe une large place dans les codes des nations modernes, et chaque année, pour ainsi dire, ses développements l'ont porter sur elle de nouvelles lois; elle a même peut-être gagné au dédain des temps passés d'être moins surchargée de traditions, moins entravée parle formalisme de la vieille jurisprudence, et d'être, comme il convient à une fille de l'esprit moderne, plus dégagée et plus libre dans ses allures.
Cette liberté, qui est loin d'être dans tous les pays aussi complète qu'on pourrait le désirer, tend à s'accroître par l'abaissement des tarifs douaniers, par la levée des prohibitions, par les facilités légales données à la vente et à la transmission, etc.
Propriété industrielle. — Immeubles et meubles embrassent l'universalité des choses matérielles que l'homme s'approprie; ils n'épuisent pas l'idée de propriété. Si le droit de propriété est le droit qu'a l'homme de faire respecter hors de lui-même sa libre activité s'imposant aux choses, cette activité peut non-seulement donner des produits matériels, mais des moyens de produire, des modes particuliers plus économiques, plus rapides, plus parfaits. L'homme ne produit qu'à l'aide d'instruments; chaque instrument, que ce soit un moulin, une charrue, un couteau ou un paquebot, est de la matière appropriée, immeuble ou meuble; mais la forme, qu'est-elle? La galère antique était composée de bois, de fer et de chanvre; le clipper moderne est encore du bois, du fer et du chanvre, et pourtant quelle différence! La locomotive est comme le chariot une machine roulante; mais quelle différence! Ces différences existent non dans la nature ou la quantité de matière, mais dans la forme, c'est-à-dire dans l'idée, source première de toute production. C'est l'idée qui a conduit la main de l'ouvrier et donné de la valeur à telle partie de la matière; mais la même idée peut conduire une autre main et se communiquer sans s'épuiser jamais à un nombre indéfini de portions de la matière; une fois comprise et saisie par l'intelligence, elle se traduit par l'application libre de l'esprit à la matière. Il n'en est pas de l'idée comme de la matière. Le chanvre que j'ai récolté, filé et tissé, est devenu ma toile et ne redeviendra jamais une tige sauvage de chanvre que le premier venu pourra s'approprier; il porte maintenant, et il conservera, jusqu'à sa complète destruction, le caractère indélébile de propriété individuelle, propriété complète et exclusive. L'idée que j'ai eue de diviser et d'utiliser ainsi les brins de chanvre, un autre pourra l'avoir; un autre l'aura très-certainement quelque jour sans avoir besoin de me dérober mon invention, par un effort de son intelligence semblable à celui que la mienne a fait. Cet autre ne saurait s'approprier ma toile sans commettre un vol; mais, de mon côté, je ne saurais m'approprier l'idée de tisser sans restreindre la libre expansion de ses facultés et porter atteinte à son droit. L'invention ne constitue donc pas une propriété complète et exclusive; elle constitue seulement, en faveur du premier qui la produit sous une forme pratique, un droit de priorité que la loi consacre et récompense par un privilège temporaire. Des économistes ont demandé que l'invention fût érigée en propriété perpétuelle; c'était méconnaître la différence essentielle qui existe entre la matière et l'idée; c'est, en faussant la nature des choses, violer un droit sous prétexte d'en faire mieux respecter un autre, et entraîner le législateur dans une inextricable complication de prétendues propriétés à sauvegarder. Certains économistes ont demandé et demandent encore la suppression du privilège temporaire, parce que, disent-ils, aucune invention n'appartient en propre à son auteur; parce que toute invention n'est qu'un perfectionnement, et, par conséquent, un fruit de la civilisation, qui a germé et s'est développé peu à peu dans un grand nombre de têtes avant de mûrir dans une, et qui d'ordinaire mûrit à peu près au même temps dans plusieurs tètes, comme des fruits de la saison; le privilège même temporaire, ajoutent-ils, est excessif, et pour favoriser une invention, on étouffe ou on retarde cent autres inventions qui allaient éclore; c'est oublier que l'inventeur, en apportant le premier une idée que la société eût attendue encore pendant un certain temps, lui a apporté pour ce temps au moins un surcroît d'utilité, et lui a rendu un service qu'elle a le devoir de rémunérer. Or, quelle rémunération peut être proportionnée au service aussi exactement que le privilège donné à l'inventeur de vendre lui-même, au prix qu'y voudront bien mettre les acheteurs, durant ce même temps ou durant un nombre d'années estimé à peu près équivalent, ce surcroit d'utilité? Si le privilège n'existait pas, les efforts souvent longs et coûteux qu'aurait faits l'inventeur seraient peine perdue, car le lendemain du jour où il aurait produit son idée, des rivaux, plus riches ou moins épuisés par l'effort de l'invention, la mettraient aussitôt en pratique comme lui, et, semblables à des coureurs qui se seraient fait porter jusqu'au milieu du stade sur les épaules des autres, ils commenceraient sans fatigue la seconde partie de la course et obtiendraient injustement, dans une lutte inégale, la palme du vainqueur. La législation de la plupart des peuples modernes s'est tenue entre ces deux extrêmes; elle a consacré le droit de priorité et respecté la liberté d'invention en donnant aux inventeurs le privilège temporaire; elle a créé le brevet d'invention. Le mode d'application et la durée varient: cinq ans en Prusse, dix ans au plus en Russie, à Bade, dans le Hanovre, le Wurtemberg; quatorze ans en Angleterre et aux États-Unis, avec possibilité, dans certains cas, de le proroger de sept années; quinze ans en France, en Hollande, en Autriche, en Bavière, en Suède, en Espagne, en Portugal, en Italie; vingt ans en Belgique. Quelquefois le gouvernement soumet la demande à un examen préalable et cherche à s'assurer si l'invention est réelle; plus souvent le gouvernement, plus sage, s'abstient d'intervenir dans une matière aussi délicate, délivre sans garantie un brevet à qui le demande, et laisse aux tiers qui pourraient se croire lésés par une usurpation le soin de faire valoir eux-mêmes leurs droits (c'est le système français). Ici on n'a qu'une forme de brevet, le brevet d'invention que peuvent prendre indistinctement les nationaux et les étrangers; là on admet le brevet d'invention proprement dit, le brevet de perfectionnement, qui consiste à améliorer une invention déjà faite (en réalité, toute invention, nous l'avons dit, n'est qu'un perfectionnement), et le brevet d'importation, qui consiste à introduire dans un pays une invention déjà appliquée dans un autre pays.
Le brevet d'invention est de date récente; l'antiquité et le moyen âge ne l'ont pas connu; la première, parce qu'elle faisait trop peu de cas de l'industrie; la seconde, parce que l'industrie, organisée en corporations, y était exploitée dans une sorte de communauté de procédés qui excluait l'appropriation individuelle. Le brevet d'invention est contemporain de l'émancipation du travail; le dix-septième et le dix-huitième siècle n'en avaient eu qu'une idée confuse dans les privilèges royaux. En Angleterre, il date du statut de 1623; aux États-Unis, de l'acte du 21 février 1793; en France, des lois des 7 janvier et 25 mai 1791, modifiées et refondues dans la loi du 5 juillet 1844; en Russie, de l'ukase du 17 juin 1812, du moment où ce pays venait de séparer ses destinées politiques et industrielles de celles de laFrance; en Prusse, de 1815; en Hollande et en Belgique, de 1817; en Autriche, de 1820, c'est-à-dire du mouvement à la fois national et libéral qui a suivi eu Allemagne les grandes guerres de l'Empire; en Espagne, de 1820, c'est-à-dire du rétablissement momentané du gouvernement constitutionnel.
Propriété littéraire et artistique. — A mesure que l'homme s'élève par la civilisation, il semble qu'il se dégage de la matière et que la propriété prenne un caractère en quelque sorte plus spiritualiste. Au commencement, la propriété immobilière domine; puis la propriété mobilière grandit et devient sa rivale; dans les temps modernes, apparaît la propriété industrielle, propriété de l'idée appliquée à la transformation de la matière; enfin, la propriété intellectuelle, propriété de l'idée appliquée aux lettres et aux arts, c'est-à-dire aussi peu mêlée de matière qu'il est possible de l'être aux choses sensibles. Ce n'est pas qu'il n'y ait eu de tout temps des auteurs et des inventeurs, de même qu'il y a eu phénomène de propriété mobilière dès que le premier homme a étendu sa main pour cueillir un fruit; mais ce n'est qu'avec les siècles que ces phénomènes ont pris une importance assez grande pour s'élever au rang d'institutions et que les sociétés ont été assez éclairées pour comprendre le droit d'où ils émanent, et assez puissantes pour le protéger d'une manière efficace. Plus la matière est subtile, plus il faut, pour la saisir, un mécanisme délicat et perfectionné.
Mais à mesure que la propriété est plus spiritualisée, la limite devient plus difficile à observer et pourtant il importe de ne pas confondre la force productrice avec le produit, sous peine d'enchaîner dans tous le principe intérieur de la libre activité dont on se proposerait de protéger la conséquence extérieure ou l'extension au profit d'un seul ou de quelques-uns. De là le débat qui s'est engagé il y a quelques années entre les économistes au sujet de la propriété intellectuelle.
Les uns veulent que la propriété des œuvres de l'intelligence soit complète, perpétuelle, que l'auteur d'un livre ou d'une statue possède à tout jamais, puisse vendre, aliéner, transmettre indéfiniment à ses ayants droit non-seulement le volume imprimé ou le bloc de marbre travaillé, mais la forme même sous laquelle sa pensée s'est matérialisée, c'est-à-dire le droit d'imprimer les mêmes phrases, de produire les mêmes découvertes ou démonstrations scientifiques, de rendre les mêmes pensées, si elles ont un caractère suffisamment personnel, de reproduire par le ciseau, le burin ou quelque procédé, les mêmes linéaments. C'est le système qu'ont soutenu entre autres, MM. Laboulaye, Frédéric Passy, Modeste, Paillottet.
Ce système qui parait s'appuyer fortement sur le principe même de la propriété, ne manque pas de grandeur, mais il présente des difficultés pratiques que ses auteurs ne sauraient dissimuler. La jouissance temporaire n'existe que pour une partie des œuvres de l'intelligence. Copernic a montré scientifiquement que la terre tournait; c'est une admirable découverte. En pouvait-il avoir la propriété ou même la jouissance temporaire et pouvait-on contraindre tous les auteurs à lui payer une redevance ou à croire et à écrire que la terre était immobile? Cette idée avait une valeur, puisqu'on achète les livres qui sont inspirés par elle, tandis qu'on a mis au rebut ceux qui s'appuyaient sur les vieux préjugés. Quant à Copernic, il n'y a peut-être pas aujourd'hui cent personnes par siècle qui lisent son traité, et la dernière édition de ses œuvres, faite sumptu publico, a beaucoup plus coûté qu'elle ne rapportera, tandis qu'on vend chaque année pour plusieurs centaines de mille francs des ouvrages élémentaires ou autres, qui procèdent des découvertes de Copernic et de Newton. Newton et Leibnitz découvrent le calcul des fluxions; auront-ils, eux et leurs héritiers, le monopole de ce procédé de l'esprit humain qui a doublé la puissance des mathématiques et qui leur a permis d'atteindre à des résultats dont les conséquences pratiques sont incalculables. On discute sur les générations spontanées; M. Peuchet a fait de curieuses expériences en faveur de ce système; M. Pasteur en a fait de plus curieuses et de plus décisives par lesquelles il démontre victorieusement que les animalcules proviennent, non de la décomposition spontanée de la matière organique, mais de germes flottant dans l'atmosphère et placés en présence de celte matière. Ai-je droit d'écrire que je suis partisan de l'un ou de l'autre système, sans acheter l'autorisation de M. Peuchet ou de M. Pasteur? Les savants ne l'entendent certainement pas ainsi: ils travaillent, ils découvrent, ils produisent leurs découvertes pour les répandre, les faire accepter du plus grand nombre et les faire entrer par la publicité et la persuasion dans le grand trésor des connaissances humaines: c'est déjà, non une raison péremptoire, mais un préjugé contre la propriété exclusive de ces découvertes. La vraie raison, existe dans la nature même de ces découvertes, qui, quoique susceptibles de mille applications matérielles, sont abstraites, et appartiennent au domaine de l'intelligence et pour ainsi dire de la foi; on croit ou on ne croit pas, mais une croyance ne saurait être appropriée, parce qu'elle est la manière d'être de l'âme et que nul, au nom de la libre expansion de son individu, ne peut venir mettre la main dans l'âme de son voisin et exercer une saisie sur ses croyances.
C'est le point de départ de ceux qui avec MM. Wolowski, Renouard, de Lavergne, V. Foucher, Dupuit, etc., contestent le droit de propriété intellectuelle. « On a confondu, dit M. Wolowski, le droit personnel de produire avec le droit réel au produit. L'homme est essentiellement une force libre, disposant d'elle-même; ne pas lui permettre d'appliquer, de reproduire ce qu'il s'est assimilé par une opération de son intelligence, c'est l'asservir... L'œuvre intellectuelle ne vaut qu'autant qu'elle s'empare des intelligences, qu'elle s'y grave, qu'elle les féconde. L'idée est à qui l'a conquise, la forme à qui s'en est emparé d'une manière assez complète pour la faire renaître; le droit d'imiter est contemporain du droit de créer, c'est ainsi que l'humanité marche; l'homme est et doit rester libre. » — « La propriété intellectuelle comme la propriété matérielle ne donne qu'un droit, c'est le droit au produit; elle ne saurait enlever le droit à la reproduction qui n'est pas dans le créateur de l'œuvre, mais dans l'intelligence libre de tous les hommes. Si l'œuvre de l'esprit ne peut obtenir une récompense matérielle qu'en imposant un veto sur le travail d'autrui, on ne trouve point là un de ces droits naturels préexistants aux lois et que les lois ne font que reconnaître et consacrer; c'est au contraire une servitude imposée au principe de l'indépendance du travail dirigé par la pensée, de la libre application des facultés humaines. » Les adversaires de la perpétuité déclarent que si le fondement de la propriété est la possession de soi-même, l'objet et la manifestation de la propriété consistent dans l'occupation: or on n'occupe pas une idée; on n'en a la jouissance qu'en la produisant, et dés qu'elle est produite, on n'en a plus la possession exclusive. « Les idées, dit M. Renouard, se communiquent et circulent sans se détruire ni s'amoindrir en circulant, nul de ceux qui se les assimilent ne les ôte à ceux de qui il les tient. » Le droit de l'auteur, ils le voient moins dans l'œuvre que dans la gloire d'avoir créé l'œuvre. « Ce qui est propre à l'auteur, c'est le cachet individuel imprimé sur l'œuvre, qui attache la gloire du nom du créateur au produit de la pensée. Mais ce droit lui est tellement propre qu'il ne peut ni l'aliéner ni le transmettre. » Ils contestent l'utilité socialr d'un droit absolu; car les grands écrivains et les grands artistes sont guidés dans leurs travaux par d'autres sentiments que celui du gain: fort heureusement pour l'humanité; car le gain ne récompense que rarement le génie et il le fait presque toujours avec parcimonie; si les grands hommes n'avaient pas d'autre mobile, la société se verrait le plus souvent privée de leur puissant concours; quant aux fabricants de livres et d'objets d'art, ils sont désintéressés dans la question, car leur marchandise n'a de valeur que pendant un temps d'ordinaire très-limité. « Le droit de propriété littéraire proprement dit, ajoute encore M. Wolowski, est immatériel comme la création intellectuelle; il appartient éternellement à l'auteur dont la gloire illumine le front; mais le droit de copie appartient à toutes les intelligences libres qui perçoivent l'idée et la forme et qui la reproduisent à leur tour.
« Dans ce conflit de deux droits égaux, on arrive forcément à un compromis; notre législation actuelle le ménage de manière à concilier tous les intérêts; elle est d'accord avec la pratique universelle des nations qui a partout résolu ce problème dans le même sens. » Partout en effet on réserve à l'auteur la propriété exclusive sa vie durant, et, après sa mort, on accorde à ses héritiers un droit de jouissance pendant un certain nombre d'années: cinq ans au Chili, sept ans en Angleterre, dix ans au Brésil et au Mexique, quinze ans en Italie, vingt ans en Belgique, en Hollande et en Suéde; trente ans dans la plus grande partie de l'Allemagne. Aux États-Unis, le privilège est de vingt-huit ans à partir du jour de la publication, et à l'expiration il est prolongé jusqu'à quarante-deux ans en cas de survie de l'auteur, de la veuve ou de ses enfants. En France, la loi du 19 juillet 1793 déclare que le droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages ou d'en céder la propriété en tout ou en partie appartient durant leur vie entière aux auteurs d'écrits en tout genre, compositeurs de musique, peintres et dessinateurs; le décret de 1810 garantit la même propriété à la veuve pendant sa vie, si les conventions matrimoniales lui en donnent le droit et aux enfants pendant vingt ans; la loi du 8 juin 1854 a porté cette jouissance à trente ans; une commission, instituée en 1861, s'est prononcée pour la légitimité du principe de la propriété littéraire, mais reculant devant les difficultés pratiques de la perpétuité, a demandé seulement l'extension à cinquante ans de la jouissance exclusive en faveur des héritiers.
Que conclure de ce débat? Deux points sont hors de litige: 1° l'idée ne saurait être appropriée; 2° la matière peut l'être. Mais que dire de la forme qui est l'incarnation de l'idée dans la matière? Qu'elle participe de l'un et de l'autre; que l'auteur peut la revendiquer, parce qu'il la reconnaît à des signes sensibles; que le premier venu peut se l'assimiler parce qu'elle est de la nature des choses que l'intelligence saisit, et qu'une fois qu'elle l'a saisie elle peut la produire comme sienne: c'est ainsi que nous reproduisons les vérités mathématiques et en général les sciences du raisonnement. L'intelligence ne saisit pas tout un ouvrage de manière à le rééditer, tout un tableau de manière à le copier fidèlement, peut-être; mais à quelle limite finit l'imitation légitime et commence le plagiat condamnable? On pourrait donner à un auteur un droit perpétuel sur son œuvre; mais il faudrait, dès le jour de la publication, laisser toute liberté à l'imitation légitime. Or comment savoir quand l'imitation est légitime ou, pour mieux dire, quand la reproduction partielle est le fruit spontané d'une assimilation naturelle? Il y a évidemment là deux droits contradictoires auxquels il est malaisé de faire leur part: de là, comme pour le brevet d'invention, mais pour des raisons quelque peu différentes, la nécessité d'un compromis et d'une limite mise à la jouissance exclusive ou plutôt d'une limite mise à la protection légale qui assure cette jouissance; limite qui peut varier et qu'il est bon de placer assez loin pour assurer à l'auteur une large rémunération de son travail, mais qui ne peut être portée à l'infini sous peine d'opprimer, comme matière d'invention, le droit de tous pour constituer le privilège d'un seul.
61.Julie Daubié on “The Equality of Women” (1866).↩
Word length: 18,658]
Source
Julie-Victoire Daubié, La femme pauvre au XIX. siècle (Paris: Guillaumin et cie, 1866). Chap. X “Réponse à quelques objections,” pp. 395-447.
CHAPITRE X. RÉPONSE A QUELQUES OBJECTIONS.
« Sexe toujours esclave ou tyran, que l'homme opprime ou qu'il adore, et qu'il ne peut pourtant rendre heureux ni l'être qu'en le laissant égal à lui. »
(Rousseau, Le lévite d'Éphraïm.)
L'exposition que j'ai faite dans le cours de ce travail de la condition actuelle de la femme du peuple, suffirait pour lever un grand nombre des objections qu'on oppose à l'amélioration de son sort; cependant comme l'actualité et la vitalité de cette question capitale lui donnent d'une part des enthousiastes fanatiques et de l'autre des détracteurs acharnés, il n'est pas inutile de rappeler les arguments de nos antagonistes et de leur donner une réfutation directe.
1re Objection. — Des droits égaux pour les deux sexes seraient contraires à la loi naturelle, sociale et religieuse; ils mettraient souvent l'homme sous la dépendance de la femme, et froisseraient nos mœurs qui répugnent à la voir travailler. Il y a donc impiété, scandale, immoralité et extravagance à vouloir changer les conditions de son existence actuelle.
Pour démontrer tout d'abord que l'égalité des deux sexes n'est pas contraire à la loi naturelle, il suffit d'envisager les impossibilités prétendues que le créateur oppose à l'égalité des des droits revendiqués ici.
On nous objecte d'ordinaire la constitution plus faible et plus maladive de la femme, son intelligence moins grande, etc.
Sans aucun doute, la constitution physique de la femme moins forte que celle de l'homme lui interdit une foule de travaux propres à celui-ci; mais c'est précisément cette infériorité physique qui impose à la société l'obligation d'accorder une plus grande initiative à la jeune fille dans les travaux auxquels elle se montre apte; cependant, nous voyons les hommes envahir les occupations du sexe; non contents de les avoir usurpées par une instruction spéciale et exclusive, ils s'insurgent même contre les quelques privilégiées qui y cherchent un gagne-pain honorable, et c'est cette femme plus faible que l'homme qui doit accomplir les plus ingrats et les plus meurtriers travaux de l'industrie pour les besoins de sa subsistance personnelle et de celle des enfants repoussés par leur père. Nous savons, hélas! que, dans les travaux corporels, la tâche la plus rude est trop souvent réservée à la femme, et que son labeur incessant ne la met pas à l'abri de la misère dans les maladies qui sont la suite d'un excès de fatigue. Dans nos villes encore, c'est la femme qui balaie d'ordinaire les rues, charge les tombereaux d'immondices, traîne des voitures, porte des fardeaux accablants, remue des odeurs fétides pour chercher un misérable salaire dans la vente d'un chiffon d'étoffe ou de papier maculé. La fille du peuple ne trouve pas même un instant à donner aux devoirs de la maternité, et doit souvent rester debout pour mettre ses enfants au monde. On est douloureusement surpris en recensant tous les accouchements que la misère étale sur nos voies publiques, et les scènes navrantes qui attristent jusqu'au pavé de nos rues, lorsque des nouveaux-nés sont relevés morts à côté de leurs mères agonisantes de besoin et de dénûment. Paris voit quelquefois jusqu'à trois de ces délivrances en un seul jour.
Pour les travaux qui réclament surtout de l'assiduité, même surcharge de la femme; une seule des administrations qui l'occupent a-t-elle abrégé son labeur quotidien par égard pour sa constitution plus faible? Que dis-je, ne savons-nous pas que l'État lui-même multiplie le travail des-femmes en diminuant leur salaire; qu'il ne leur épargne, dans les fonctions publiques, aucun fatigant service de nuit, et ne leur donne nul auxiliaire dans le but de les soulager. Et dans l'enseignement! ces femmes qu'on trouve si frêles, si maladives lorsqu'on ne veut pas les occuper, pourquoi semble-t-on les croire de fer dès qu'on leur a laissé un chétif emploi? Ne savons-nous plus quelle est la position respective de l'homme et de la femme dans l'instruction primaire et secondaire? D'un côté l'arbitraire et l'oppression; de l'autre une hiérarchie, une protection budgétaire qui ménage les forces, dispense le repos et le travail, en assurant une retraite. Quoique les deux sexes soient contribuables au même titre, le budget qui n'a prévu aucune des maladies ni des infirmités nombreuses de la femme, a eu la politesse de croire à sa jeunesse éternelle pour se dispenser de lui accorder une retraite dans l'instruction secondaire. Aussi les institutrices nombreuses qui végètent dans notre enseignement seraient fort à plaindre si elles avaient les indispositions fréquentes attachées à des chaires importantes qu'on peut faire gérer par suppléance.
Il est assez étrange, en vérité, comme je l'ai fait remarquer déjà, qu'on n'objecte point la faible constitution des femmes pour les emplois où on les trouve nécessaires à l'agrément de la société, comme les professions théâtrales. Cependant les femmes, nous le répétons, sont impropres à une foule de travaux trop pénibles, et les devoirs de la maternité, les soins domestiques absorbent en outre leur temps; concluons donc qu'au lieu de leur enlever le travail sédentaire et de les accabler sous le faix de l'enfant, il faut leur faire de meilleures conditions de subsistance, et donner une valeur économique aux travaux du foyer en établissant une solidarité étroite entre toute paternité et toute maternité. J'aurais grand désir d'envoquer à mon tour la fréquence des maladies du sexe dans le but d'obtenir cette protection sociale; mais, hélas! nous savons que nos associations de secours mutuels avaient prétexté les nombreuses maladies des femmes pour les repousser impitoyablement, et qu'il a fallu que la statistique leur vînt en aide en prouvant qu'elles ne sont ni plus malades, ni plus maladives, ni par conséquent plus onéreuses que l'homme. Du reste, l'objection tirée de l'infériorité des forces physiques de la femme ne peut nous arrêter plus longtemps, puisque je réclame pour elle un travail plus lucratif et moins meurtrier qu'il ne l'est actuellement.
En passant sur l'infériorité physique du sexe, on insiste sur son infériorité intellectuelle; la nature, dit-on, afin de confondre les prétentions féminines trop hautaines, a marqué la supériorité de l'homme dans le siége même de l'intelligence, et a donné des dimensions plus larges et un plus grand volume à son cerveau qu'à celui de la femme.
Pour réfuter ce raisonnement matérialiste, je pourrais faire remarquer que le degré d'intelligence ne dépend nullement du volume des lobes cérébraux, et que le cerveau de Mme de Staël pesait neuf onces de moins que celui de l'homme le plus vulgaire; j'aurais à ajouter que les femmes donnent souvent des marques de supériorité dans les épreuves où elles sont admises à concourir avec l'homme, et que, d'après différents rapports des recteurs du département de la Seine, les aspirantes au brevet d'enseignement primaire, beaucoup plus capables que les aspirants, sont reçues dans une proportion double; que les écoles primaires de jeunes filles, à Paris, ont une instruction plus avancée que celle des jeunes gens. J'aurais droit d'affirmer encore qu'il est impossible de juger des forces intellectuelles de chaque sexe dans les carrières où ils n'ont pas la même protection; pour mon propre compte, je récuserais des accusateurs qui prétendraient tirer de mon incapacité personnelle et relative des arguments en faveur de leur thèse, car je ne veux pas être jugée en dehors des éléments de temps, de travail, de développement intellectuel et d'initiative sociale qui m'ont manqué par là même que je suis femme. Néanmoins, je réponds simplement que l'égalité de nature n'est pas une condition indispensable de l'égalité de droits; car dans toutes les théories générales sur les aptitudes naturelles de chaque sexe, il ne peut y avoir que deux opinions en présence; celle de leur égalité et celle de leur infériorité respectives; dans la première hypothèse, l'égalité de nature appelle l'égalité de droits; dans la seconde, l'infériorité féminine nécessite une protection particulière; pour une course où des concurrents s'efforceraient d'atteindre à un but, il n'est pas d'usage de charger d'entraves celui qui paraît le moins agile et le moins robuste.
Dès que la femme réclame d'abord sa part de devoirs sociaux pour arriver à la conquête de ses droits, si elle se trouve incapable de les conquérir, elle sera punie seule de son incapacité originelle. D'ailleurs ces thèses générales qui déclarent à priori un sexe supérieur, égal ou inférieur à l'autre, n'offrent rien de rigoureux, car la nature a semé la variété dans les intelligences comme dans les feuilles des arbres et dans les épis des guérets; il est de toute évidence que si l'on compare les individus dans une même famille, on trouve tantôt le mari et la femme, les frères et les sœurs supérieurs ou inférieurs l'un à l'autre en capacité intellectuelle. Le seul devoir des sociétés est de développer les aptitudes, d'encourager les volontés. Il n'est pas nécessaire de sortir du sexe masculin pour trouver des capacités très-diverses dans des emplois semblables. Sur les bancs d'une école, que d'échelons entre les intelligences. Que de degrés entre nos aspirants au barreau, entre nos médecins, nos professeurs illustres ou obscurs? Nul ne peut donc dénier les droits de la femme lorsqu'il serait prouvé que, son incapacité originelle ne lui permet jamais de dépasser le médiocre. Je crois que les discussions sur l'égalité de nature doivent être subordonnées à l'égalité de droits seule capable de donner essor à toutes les facultés, et je pourrais invoquer à l'appui de cette assertion les pays où la liberté a prodigieusement développé la capacité native de la femme. En tous cas, il est fort heureux que notre centralisation administrative n'ait pas eu la direction particulière de notre estomac; en nous tenant à la diète, elle nous aurait sans doute prouvé par l'argument sans réplique du fait que nous ne pouvons pas plus partager les aliments, les mets et la table de l'homme que ses études.
La loi naturelle serait respectée seulement si le travail était dispensé à la femme d'après ses aptitudes et ses goûts, tandis que notre état social fausse au contraire partout cette loi naturelle; telle famille a des fils médiocres, débauchés qui, pour obéir aux convenances habituelles, doivent traîner dix ans leurs incapacités sur les bancs d'un collége, et arriver de chute en chute devant nos jurys d'examen, à obtenir une fonction importante, où ils augmenteront le nombre déjà si considérable de ces nullités qui n'ont, comme les zéros, que des valeurs relatives; mais les filles, fussent-elles dotées de toute l'intelligence qui manque à leurs frères, n'ont droit à aucun emploi social. Cependant cette loi mystérieuse de la nature qui transmet souvent par la filiation les aptitudes et le caractère d'un sexe à l'autre, paraît surtout dans les affinités intellectuelles, et si, comme on l'a remarqué, souvent les hommes supérieurs sont d'ordinaire fils de leur mère, ou peut affirmer que les femmes éminentes sont étonnamment les filles de leurs pères. Notre société qui établit à priori de si grandes lignes de démarcations entre les sexes, est donc fort loin d'imiter la nature.
Si nous abordons la question religieuse relativement à l'infériorité de la femme, nous trouvons dans la religion naturelle l'action bienfaisante d'une providence divine qui, en conviant toutes ses créatures au grand banquet de la vie, leur donne le monde à se partager d'après leurs aptitudes; mais la question change de face si nous nous plaçons sur le terrain des religions positives, dogmatiquement intolérantes qui s'anathématisent à l'envi et se réunissent pour nous accabler de leurs pierres confraternelles. Il me serait permis de décliner cette autorité des religions dogmatiques dans une question qui se base sur le raisonnement et se limite à l'intérêt de l'économie sociale. Cependant, comme toute religion véritable doit reposer sur la morale naturelle, nous allons considérer d'après celle-ci les livres qui se disent exclusivement dépositaires de la parole de Dieu; nous les trouvons au nombre de six seulement; nous les nommons Védas, Kings, Zend-Avesta, Coran, Bible et Évangile. Pour la discussion actuelle il suffit d'examiner la Bible et l'Évangile qui règlent les croyances de la majorité des Français, dans nos trois cultes tolérés du judaïsme, du catholicisme et du protestantisme.
Lorsque nous parlons de l'égalité de droits pour les sexes, certaines personnes nous lancent à la tête des Bibles si lourdes qu'on les croirait doublées de Corans et de Talmuds, et nous objectent l'antique anathème sorti de l'Éden contre l'homme qui doit manger son pain à la sueur de son visage, et contre la femme condamnée à la soumission envers lui; néanmoins les Livres saints ne me gênent pas plus dans la question du salaire des femmes, qu'ils n'embarrassèrent les astronomes orthodoxes aujourd'hui devant le mouvement de la terre; si la malédiction qui condamne l'homme au travail a été proférée pour lui seul, il doit nourrir la femme du fruit de ses labeurs; sinon l'égalité des deux sexes ressort de cet anathème même; car, compris ensemble dans le châtiment, ils doivent le subir sous une loi commune. Dans la Genèse je lis en outre que la femme a été donnée à l'homme par Dieu comme un être semblable à lui. La soumission de la femme à son mari est mieux écrite dans le code français du xixe siècle que dans la Bible, et cependant il faut l'affranchir des passions de l'homme hors du mariage beaucoup plus encore que dans le mariage.
Je ne ferai pas remarquer que l'Esprit-Saint ayant toujours eu des hommes pour secrétaires, les textes de la Bible, commentés de mille manières, me laisseraient dans la discussion un champ aussi vaste qu'aux nombreuses sectes dissidentes qui s'anathématisent en son nom avec une intolérance plus ou moins zélée. Cependant si je considère les prescriptions morales de la Bible, de l'Évangile et de la théologie, relatives aux rapports des sexes, je les trouve conformes à celles que je voudrais voir introduire dans notre Code; notre civilisation me semble frappée au cœur parce qu'elle combat à la fois la morale naturelle et la morale religieuse écrite dans les livres du croyant. Si j'engage donc la femme à parturire liberos in dolore, selon l'anathème biblique, je supplie la société d'accorder toujours au fruit de ses entrailles la protection que leur accorda l'Évangile quand il vint racheter les faibles de la fange du paganisme. Ce devoir paternel changeant les conditions économiques de la société ôtera à la question du salaire des femmes une partie de la terrible actualité qu'elle a de nos jours. Quel code fut donc aussi plus rédempteur des opprimés que le code évangélique? Les paroles mêmes qui consacrent l'union de l'homme et de la femme dans l'Évangile, le non jam duo sed una caro, n'impliquent-ils point des natures qui ne peuvent être que différemment égales? Partout Jésus appelle à lui les femmes, les enfants, les faibles et les opprimés; il n'est pour eux qu'indulgence, amour et miséricorde. Sans établir aucune démarcation entre les sexes, le Christ leur a prêché les mêmes devoirs dans un même code de morale; il les admet à la même communion et à la même immortalité; comment ose-t-on faire intervenir l'Évangile, triomphe d'humanité, de justice et de liberté, pour priver la femme de salaire et de droits? L'Évangile' ne punit-il donc point sévèrement le mauvais serviteur qui a enfoui le talent confié, et le Créateur, donnant un but d'activité à toutes ses créatures, peut-il être complice des sociétés qui condamnent les faibles à l'inaction, à la misère et à la dépravation? J'ai relu tous nos évangélistes sans y trouver une seule lettre de blâme contre l'égalité civile que notre Code admet si bien en théorie. Le christianisme, dès sa naissance, a pratiqué les prescriptions du Christ, en confiant une foule d'emplois dans l'Église aux femmes; nos grands papes ont favorisé leur plus haut développement intellectuel; aujourd'hui encore, malgré les passions et les mœurs qui défigurent l'Évangile, si l'égalité des sexes est proclamée quelque part, c'est sur le terrain religieux. Partout ils se réunissent à la même Église, étudient le même catéchisme, reçoivent les mêmes instructions dans des réunions communes où ils discutent ensemble des questions métaphysiques et théologiques très-ardues; ces prônes, ces conférences, ces catéchismes de persévérance, où l'on aborde sur la nature de Dieu et de l'âme des considérations que n'eussent point dédaigné les sages de l'antiquité, sont souvent beaucoup mieux suivis, mieux compris, mieux goûtés, mieux jugés même par les jeunes filles que parles jeunes gens.
Lorsque l'ouvrière et la servante conservent encore quelques lueurs d'intelligence, sous le poids du travail qui les écrase dans nos villes; lorsqu'elles apprécient et respectent leur dignité, c'est qu'elles ont retenu la philosophie de leur catéchisme.
D'autres antagonistes, qui n'ont pu me battre à coup d'Évangiles, cherchent à me battre à coup d'épitres, et l'apôtre des Gentils, qui se faisait tout à tous pour les gagner tous à J.-C., saint Paul est continuellement dans la bouche de certains ergoteurs qui le citent à tort et à travers. Pourtant, je leur dénie encore que saint Paul, quoi qu'il ait pu dire contre la femme, ait eu en vue la réduction de ses droits au salaire, lors même qu'il était ravi jusqu'au troisième et quatrième ciel. Saint Paul se proclamant l'apôtre des Gentils, devait, dès qu'il se fait tout à tous, accorder de larges concessions à ces maris grognons et païens qui, ne pouvant se dépouiller du vieil homme, apportaient dans le christianisme naissant des allures d'omnipotence familières aux hommes corrompus des sociétés dégénérées et trouvaient bon d'aller à l'escalade du paradis sur le dos de leurs femmes.
Saint Paul écrivait en outre pour des congrégations particulières de chrétiens; il leur donne des conseils différents qui doivent être appliqués selon les temps et les lieux: saint Paul est l'apôtre qui me semble le plus conciliateur, car il savait admirablement diversifier sa doctrine selon les circonstances. Si je voulais opposer verset à verset, j'aurais saint Paul avec moi plus souvent que mes adversaires. N'est-ce pas lui qui a dit et répété: La femme a la même dignité morale que l'homme;327 comme lui, elle doit se consacrer au service du Seigneur;328 si elle est inférieure à l'homme en force, elle le surpasse en foi et en amour.
L'antiquité avait déclaré la femme inférieure. L'Israélite remerciait Dieu de l'avoir fait naître homme. Platon rendait aussi grâces aux dieux de l'avoir créé plutôt homme que femme, libre plutôt qu'esclave, Grec plutôt que barbare; mais voici venir l'apôtre Paul, le citoyen romain qui est devenu publicain par amour du Christ, rédempteur des faibles. Dès que son vieil orgueil pharisaïque a été terrassé sur le chemin de Damas, il proclame l'égalité de tous les membres de la famille humaine dans le corps du Christ, et il ne fait qu'une antithèse contre la superbe platonique, en poussant ce cri sublime d'émancipation pour l'humanité entière: « Il n'y a plus de Juif, ni de Grec; il n'y a plus d'esclaves ni d'hommes libres; il n'y a plus d'hommes ni de femmes, mais une immense unité en J.-C. »329
Si saint Paul déclare le mari chef de l'épouse, il lui donne les mêmes devoirs, les mêmes espérances et la même responsabilité morale. Il flétrit également la prostitution des deux sexes, et rappelle aux Corinthiens que celui qui se joint à une prostituée est un seul corps avec elle. En lisant les Pères, nous voyons encore que le christianisme fut le véritable émancipateur de la femme, parce qu'il la considéra au point de vue de l'humanité et non à celui du sexe. Sa soumission à son mari, dit saint Chrysostôme, est celle d'une personne libre, égale à l'homme par le rang qu'elle occupe. Saint Grégoire de Nysse tire l'égalité des sexes de leurs vertus semblables, de leurs combats égaux et de leurs espérances identiques pour l'éternité. Théodoret, d'accord avec la tradition, reconnaît aux deux sexes les mêmes facultés intellectuelles. Saint Jérôme aussi (Vie de sainte Fabiola) proclamait l'égalité des sexes en disant: « Les empereurs lâchent la bride à l'impudicité des hommes, mais chez nous, ce qui est commandé aux femmes est commandé aux hommes; dans des conditions égales, l'obligation est égale pour eux. » La réhabilitation de la femme et de l'enfant se trouve dans ces paroles de saint Jérôme qui reconnaît les mêmes obligations morales aux deux sexes, et l'on peut dire que quoique le christianisme n'ait proclamé aucun droit de la femme, il l'a rendue à sa dignité en la ramassant dans le bourbier de la prostitution romaine où elle mangeait un pain souillé, pour l'asseoir aux agapes fraternelles, lui rendre les doux noms de sœur, de fille, d'épouse, de mère et de vierge en échange de celui de courtisane; il a appris ainsi aux réformateurs de tous les âges que les droits de la femme et de l'enfant ne peuvent être que la résultante des devoirs de l'homme.
L'égalité des sexes ressort, du reste, comme nous l'avons vu, de l'unité et de l'indissolubilité du mariage prêchées par le christianisme, car l'union de l'homme et de la femme serait impossible et leur conjonction passagère, le communisme de l'amour, deviendrait la vérité sociale, dans l'hypothèse de l'infériorité de la femme, à qui les lois devraient imposer moins de devoirs qu'à l'homme.
Si j'ai ouvert la Bible, l'Évangile, les épîtres et les Pères, c'est parce que je savais qu'ils ne me condamneraient point; j'ai hâte néanmoins de me retirer de ce terrain brûlant recouvert d'une cendre trompeuse, où l'on peut discuter éternellement sans avancer d'une ligne, et sans démordre d'un iota; pour ne parler que de notre dernière dissidence de communion, catholiques et protestants, après plus de trois cents ans de lutte, ont entassé des montagnes de polémiques et de controverses qui pourraient atteindre la lune, et ils croient toujours que chacun d'eux a interprété raisonnablement la Bible; divisés de doctrine, comme au premier jour de leur lutte, ils étonnent encore le monde par l'âpreté de leurs discussions, par l'ardeur de leur intolérance; et l'on veut que nous concilions toutes les opinions en une page d'écrit et en un quart d'heure; c'est en vérité nous faire un honneur trop grand ou chercher un prétexte admirable de nous couper les vivres en attendant la concordance des religions et des philosophies. J'aime mieux penser que la femme aura conquis ses droits sociaux avant l'époque où il n'y aura plus qu'un troupeau et un pasteur, une foi et un baptême.
On peut faire encore rentrer dans la catégorie des objections précédentes, certains anathèmes philosophiques contre l'infériorité féminine; des réformateurs, qui se donnent comme apôtres de l'avenir et prédicateurs d'un dogme nouveau, ne tirent pas seulement notre infériorité de l'inspection de notre méprisable petit crâne; elle est, selon eux, une conséquence de toute notre organisation. Des équations plus ou moins révolutionnaires prouvent par A+B que la somme de l'intelligence étant, je suppose, vingt-sept pour l'homme, ne peut être que quinze, dix, etc., pour la femme. J'avoue que cette science ténébreuse est si profonde pour moi, qu'elle semble résider dans un puits, et si je ne comprends rien à ce raisonnement sublime, c'est sans doute parce que mon intelligence est à zéro quand celle du philosophe se trouve en pleine ébullition; il est fort heureux que le respect de tous les droits et de toutes les aspirations ne réclame pas d'aussi hauts calculs. Du reste, la question des droits sociaux des femmes froisse trop d'intérêts pour ne point avoir de contradicteurs, lorsque toutes les sciences et tous les dieux ont leurs athées, et tous les pouvoirs leurs adversaires. Les femmes, mises en possession de leur liberté civile, ne prétendent nullement voir l'univers à leurs pieds, ni usurper les emplois que leur incapacité native leur interdit. Nos antagonistes, pourtant, après avoir créé un petit monstre féminin aussi hideux que les rêves de leur imagination bizarre, et travesti la femme au physique comme au moral, lui feraient volontiers chausser des bottes à l'écuyère pour nous terrifier davantage, et nous la présenter en nous disant triomphalement: Voilà la femme de votre société future. Eh bien, j'ai l'outrecuidante audace de croire qu'elle vaudrait celle de la société actuelle; en tous cas, je pense que les sociétés doivent être aussi libérales que la nature qui produit et laisse vivre des monstres. La saine logique ne permet pas non plus de s'insurger contre des théories dont on n'a pas fait l'application, et qui ont l'avantage immense de ne pouvoir empirer l'état des choses.
Après avoir invoqué ces objections, relativement à l'infériorité personnelle de la femme, certains théoriciens nous montrent l'ordre social tout entier menacé par son indépendance, qu'ils affectent de considérer comme la subalternisation du mari.
Pour montrer que l'indépendance de la femme ne peut opérer la dépendance de l'homme, il est nécessaire de rappeler la distinction que j'ai établie au début de ce travail, entre la femme riche et la femme pauvre, et de montrer que l'homme ne saurait se rendre plus dépendant de la femme qu'en acceptant d'elle une position par le mariage mercenaire. Cependant, nous voyons sans cesse des époux commandités par leurs épouses dans des charges importantes, et ils ne se croient nullement dépendants et opprimés. Que dis-je, notre corruption du sens moral nous montre des unions exécrables où le conjoint n'épouse une grosse dot que pour en employer les intérêts à entretenir nos courtisanes dans leur élégante supériorité, et l'on voit tel homme vanter l'indissolubilité du lien conjugal, parce qu'il la trouve avantageuse aux débauches du mari. Tous ces prétendus esclaves courent après leur dépendance et trouvent leur joug fort léger; nous pouvons donc nous tranquilliser sur la servitude de l'homme en songeant que s'il se soumet à la femme ce sera à la manière d'Henri IV, qui se mettait à la merci, du Parlement avec l'épée au côté. Le mari pauvre trouvant des ressources dans le travail intelligent de son épouse, et contractant un mariage de convenance personnelle, ne me paraît pas plus opprimé que celui qui vit des revenus d'une dot. Il suffit, du reste, de parcourir l'histoire pour montrer que l'infériorité de la femme atteste la barbarie ou la décadence des sociétés. La jeune Spartiate ne justifia-t-elle point, par son patriotisme et son énergie, l'influence que lui donnaient les lois et les institutions. Lorsque les étrangères étonnées disaient à ces superbes Lacédémoniennes: Il n'y a que vous qui commandiez aux hommes; c'est, répondaient-elles avec orgueil, parce qu'il n'y a que nous qui enfantions des hommes. On pourrait demander encore si c'est dans la vertueuse république de Rome, ou dans son empire décrépit d'immoralité, qu'il faut chercher le véritable type de la mission sociale du sexe.
Que devinrent les femmes de la Grèce et de Rome quand le despotisme et la licence eurent établi leur trône sur ces terres de liberté, et y appesantirent leur sceptre de fer? Je laisse la réponse à Bernardin de Saint-Pierre. « Dans tout pays, dit-il, D où la vertu ne règne pas, les femmes sont très-malheureuses, elles étaient très-heureuses autrefois dans les vertueuses républiques de la Grèce et de l'Italie; elles y décidaient du sort des États: aujourd'hui esclaves dans les mêmes lieux, la plupart d'entre elles sont obligées de se prostituer pour vivre. »330
D'autres raisonneurs qui, au lieu de se constituer les dieux de l'avenir, veulent bien se dire les hommes du présent, prétendent qu'il n'y aurait plus de lien entre les sexes, si la femme pouvait vivre de son travail sans le secours de l'homme, car il est peu probable, disent-ils, qu'elle consentirait à abjurer son indépendance, pour accepter la subalternité du mariage.
J'avoue humblement que je me faisais une plus haute idée de l'amabilité masculine, et que je comptais davantage sur la loi naturelle qui attache la femme à l'homme; on ne s'aime déjà plus guère dans le monde actuel, mais il paraît qu'on ne s'aimera plus du tout dans le monde futur. Je ne pensais nullement que la femme, pour contracter mariage, dût être obligée de subir un mari comme un mal nécessaire, et les faits viennent à l'appui de mes assertions, puisque les femmes qui se marient de nos jours sont celles, qui avaient trouvé, au préalable, une indépendance personnelle dans le patrimoine ou par le salaire. Malheureusement ou heureusement, nous n'en sommes plus aux théories dans cette question, et avons épuisé jusqu'à la lie la coupe amère de l'expérience relativement à la protection que l'homme accorde à la femme.331
Tout esprit éclairé et observateur peut se convaincre que notre individualisme ne connaissant ni veuves, ni orphelins, ni épouse qui n'apporte des ressources au ménage, appelle une existence indépendante pour la femme.
En dehors des immunités dont jouit le célibat immoral de l'homme, le célibataire moral ou non est favorisé pour tous les emplois; nos administrations particulières craignent les pères de famille et ne leur accordent aucun avantage particulier; le budget redoute les veuves et les orphelins; le mariage est interdit au soldat; l'État annonçant l'intention de peupler nos colonies, fait appel aux gendarmes célibataires et refuse à priori tout homme marié, etc. — Dans un tel milieu social, si la femme parvenait à s'affranchir, par le salaire, du joug des passions de l'homme, elle ne serait plus à vendre et à acheter comme un vil animal; la chair humaine augmenterait sur le marché; voilà le véritable dénoûment de la question. A-t-elle lieu de faire frémir la morale et l'économie politique?
Quel mépris implicite des liens de la famille dans le choix des emplois qu'on a réservés aux femmes! Ils arrachent sans considération ni respect la mère à ses enfants; ils enlèvent la jeune fille au foyer, l'épouse au soin de son intérieur.
La nourrice mercenaire et illettrée se trouve transplantée dans nos villes, et demeure quelquefois des années entières sans relation avec les siens, sans donner un sourire à son enfant élevé au biberon, pendant qu'elle verse la santé et la vie à un nourrisson étranger. Quelles garanties, quels dédommagements la société accorde-t-elle à cette femme, contrainte de gagner son pain au détriment de sa propre famille? Elle se trouve dans la condition des servantes ordinaires et le droit de l'expulser ad libitum, après huit jours d'avertissement préalable, est une des clauses de l'engagement fait avec elle. Hé quoi, a-t-on oublié que la femme sans patrimoine ou sans occupation lucrative ne trouve des moyens de subsistance ni au foyer, ni hors du foyer? Ne se rappelle-t-on plus ces loteries matrimoniales où des centaines de jeunes filles se cotisent pour former une dot destinée à tirer un mari de l'urne du sort conjuré contre toutes les autres? D'un autre côté, les jeunes gens si fréquents dans le demi-monde, sont tellement rares dans les bals de bonne compagnie, où les jeunes filles abondent, que notre caractère léger et satirique a exprimé cette pénurie par des charges de ce genre: un jeune cavalier qui transpire, dans les soirées dansantes, se loue, dit-on, vingt francs; un qui ne transpire point quarante francs. Un vieux monsieur chauve et décoré, pour orner l'embrasure d'une fenêtre vaut cinquante francs de location. Bien loin donc que l'indépendance des femmes les éloigne du mariage, les faits prouvent qu'elle les y amènera; les vœux perpétuels sont abolis, du reste, à l'exception du vœu récent des trente mille templiers de la garde impériale.332
D'ailleurs, je n'ai pas besoin de répéter qu'il ne s'agit pas d'occuper davantage les femmes, mais de les faire travailler mieux, et par conséquent moins qu'elles ne travaillent actuellement, car plus le travail est intelligent, mieux il est rétribué.
Aux États-Unis, l'initiative individuelle, le développement de l'intelligence de la jeune fille, la font rentrer au sein de la famille lorsqu'elle s'est acquis une dot; la responsabilité sévère pesant, dans ce pays, sur la paternité naturelle, qui n'a pas voulu devenir civile et légale, ne laisse en outre aucun enfant à la charge de la femme, et ne permet jamais qu'elle trouve un oppresseur dans aucun homme.
Certaines personnes prétendent que le travail des femmes n'est point dans nos mœurs, et les faits établissent que la dépression de leur salaire est le résultat de la concurrence qu'elles se font dans leurs emplois restreints et souvent meurtriers. Il nous est donc nécessaire de distinguer de nouveau entre le sexe des femmes riches et celui des femmes pauvres, pour concilier ces opinions diverses.
Les femmes, dans toutes les carrières qui leur restent aujourd'hui accessibles, sont, dit-on, quatre fois plus nombreuses que les hommes; donc leur salaire doit être logiquement réduit des trois quarts, d'après les lois de l'offre et de la demande. Voilà, en effet, la condition où l'injustice sociale réduit trop souvent la femme du peuple.
Cependant, si nous sortons de cette classe pour considérer les femmes riches, ou celles d'une classe moyenne qui vit dans la gêne, nous sommes obligés de convenir qu'effectivement le travail des femmes n'est point dans nos mœurs et qu'un grand nombre parmi elles s'en trouvent déshonorées.
En fournissant, par une initiative éclairée, des moyens honorables de subsistance aux jeunes filles, nous pourrons combattre le travers qui fait rougir d'un emploi celles même qui n'ont aucune ressource. Quant à la femme riche, sa morgue aristocratique s'évanouira avec nos fortunes rapides et scandaleuses, attestant un régime social aussi détestable que celui qui fit la ruine de la France au xviie siècle.
En attendant cette réforme, la femme du monde ignore actuellement plus souvent les détails de son intérieur que le dernier de ses serviteurs à gage. La vie des trois quarts des riches héritières de nos villes se passe à des caquets, pour ne pas dire à des cancans de salons; à des ouvrages futiles qui leur donnent une contenance; à des messes, à des vêpres, à des saluts et des quêtes, où elles font admirer leurs grâces; à des spectacles, où il est de bon goût d'aller bâiller en loge, à des promenades où l'on étale ses attraits en calèche découverte, pour rivaliser avec la courtisane; à des soirées où l'on fait briller ses joyaux; à des jeux où l'on perd la subsistance d'une famille, etc. Une meilleure répartition de la richesse publique, opérée par l'association et par les devoirs de tout père à l'égard de tout enfant, fera, sans nul doute, disparaître tôt ou tard ces scandales en ramenant la femme à ses occupations naturelles; car nos femmes du peuple, quoique surchargées par un travail meurtrier, remplissent beaucoup mieux leurs devoirs d'épouses et de mères que nos mondaines opulentes.
Dans les campagnes, on voit les mères allaiter leurs enfants et les bercer dans les sillons fertilisés par leurs sueurs, tandis que ces occupations si indispensables de la riche héritière, ses plaisirs de bon goût et de bon ton lui interdisent les devoirs de la maternité, comme ils les lui imposaient, quand Rousseau, les mettant à la mode, eut rendu aux enfants la mamelle de leurs mères.
Si la femme du monde est trop esclave des préjugés pour allaiter ses enfants, l'ouvrière de nos faubourgs urbains, qu'un ingrat travail éloigne du logis, franchit plusieurs fois le jour de longues distances pour remplir ce devoir sacré; en général, nous trouvons les devoirs de la maternité mieux compris et mieux remplis par la femme occupée que par la femme oisive. Dans les conditions actuelles de la richesse publique, nous n'avons donc pas à nous inquiéter, de celle-ci: si son opulence peut lui tenir lieu de beauté, de naissance, d'instruction, de talents et même de vertus; si, telle qu'elle est, elle convient aux apôtres du foyer qui l'ont épousée pour jouir des revenus de sa dot et des honneurs de son illustration sociale, ils peuvent lui laisser, j'y souscris de grand cœur, sa triste réputation, son ignorance proverbiale;333 qu'ils continuent, si c'est leur bon plaisir, à en faire un automate sachant jouer du piano comme l'automate de Vaucanson du galoubet; qu'ils la présentent comme une poupée qu'on ajuste, qu'on montre et qu'on enferme le moment d'après; quant à la femme pauvre, elle n'appartient à personne; nul n'a le droit de la dégrader dans la dépendance, la misère et le vice; c'est un être pensant dont il faut cultiver l'âme.
Cette culture appelle des droits égaux pour tous au développement physique, intellectuel et moral, avec une législation qui ne permette jamais au débauché de corrompre la fille du peuple, sans porter la responsabilité de ses actes; cette considération m'amène à demander à mes antagonistes ce qu'ils entendent par l'éducation du cœur, la seule, disent-ils, qui soit nécessaire à la femme. Pour moi, si je cherche cette éducation du cœur, je la trouve dans les écoles privées ou publiques ouvertes, sous la protection de la police, par les étudiants plus ou moins officiels de nos closeries de fleurs variées. Les femmes qui vont chercher le développement de leur cœur dans les institutions de ce genre, qu'on leur ouvre gratuitement partout, sont précisément celles qui manquent de cette forte instruction qu'il faut payer dans nos écoles professionnelles, et dont l'État exclut les jeunes personnes. L'éducation du cœur, hélas! elle n'est pas très-lucrative pour la fille du peuple, à qui elle laisse tout au plus les bribes du déjeuner de l'étudiant auquel elle s'est louée.
Le cœur est si voisin de l'estomac! Il ne faut pas perdre de vue l'importance de celui-ci. Or, c'est pour éluder cette terrible question de subsistance dans un ordre social qui charge la femme du fardeau de ses besoins, et de ceux de l'enfant, qu'on nous poétise tant de sottes phraséologies sur l'éducation des jeunes filles.
L'éducation du cœur pour la fille du peuple, savez-vous ce que c'est? Demandez-le à ce budget spécial que solde l'immoralité publique.
Par éducation du cœur, veut-on dire que les femmes riches seules auront le droit de visiter les malades, de consoler les affligés, de patroniser les orphelinats, de vider leur bourse au profit de l'indigence, etc. Si nous voulons généraliser cette propension du sexe au dévouement, ce zèle pour les bonnes œuvres, il faut, comme on voit, subordonner encore l'éducation du cœur à celle de l'estomac, et soit que nous considérions isolément la femme, soit que nous la contemplions dans les générations malingres qui sortent de ses flancs chétifs, il faudra partout et toujours arriver à cette conclusion suprême: de l'huile dans la lampe. L'examen seul de l'objection dit à qui il faut renvoyer les épithètes d'impies, de scandaleuses, d'immorales et d'extravagantes dont certaines personnes gratifient si charitablement mes assertions.
2e Objection. Pourquoi sonner si fort le tocsin au sujet du salaire des femmes; ne font-elles pas en France ce quelles font dans toute l'Europe, et nos lois égalitaires ne les mettent-elles pas au-dessus des femmes du monde entier?
C'est déplacer beaucoup la question que de la transporter hors de France, lorsque mes considérations ont embrassé la position de la Française seule; il m'est facile pourtant d'accepter cette objection sur le terrain où on la place, et de démontrer que l'oppression qui pèse chez nous sur la femme du peuple est inconnue à toutes les nations qui ont établi des liens de solidarité entre la paternité, la maternité et l'enfance; c'est mon éternelle question de constitution de la famille, sur laquelle je n'ai plus à revenir, car je l'ai épuisée suffisamment pour faire comprendre que toute l'économie sociale est changée selon que les devoirs de tout père envers tout enfant sont facultatifs ou obligatoires; quelles que soient l'éducation professionnelle de la femme et sa capacité, les conditions de subsistance ne sont plus les mêmes pour elle si l'enfant né hors mariage est à sa charge au lieu de rester à celle du père.
Rappelons donc en quelques mots que l'Europe a su se préserver de notre centralisation oppressive et de notre immoralité irresponsable. Des pays comme l'Allemagne garantissent la masse du peuple de l'extrême indigence, loin de ces grands centres qui, en résumant toutes les merveilles d'une civilisation, en résument aussi toutes les dégradations et toutes les hontes.
L'Allemagne, en général, ayant laissé aux femmes les emplois qui leur appartiennent, se trouvé beaucoup plus avancée que nous relativement aux moyens pratiques de les émanciper par le travail.334 La vie de famille est, en Allemagne surtout, le palladium de toute femme sans appui qui trouve même momentanément à des foyers étrangers l'accueil cordial d'une hospitalité primitive. Il suffit, du reste, d'examiner la position respective des institutrices allemandes et françaises pour se convaincre de notre déchéance devant le droit au salaire.
L'enseignement complétement séculier dans l'Allemagne protestante, offre aux jeunes filles de nombreuses professions et une carrière assurée à laquelle les sujets manquent souvent. Les Allemands, pour remédier à cette pénurie d'institutrices, ont créé des diaconesses dont la maison mère est à Kaiserswerth, mais cette institution qui remonte à trente-cinq années, a fourni, à grand'peine, cinq à six cents sujets à toute l'Allemagne, parce que les mariages y sont trop nombreux, comme l'affirmait une des supérieures de l'établissement. La Prusse seule, avec sa population si inférieure à la nôtre, compte plus d'élèves que la France dans ses écoles; en dehors de ses 31 mille écoles primaires, entretenues par l'État et les provinces, elle subventionne cent quarante-six institutions supérieures de demoiselles; si ce pays ne possède que sept écoles normales d'institutrices, c'est parce que les sujets manquent à ces établissements trop vastes pour leur destination. Cette disette d'institutrices nécessite souvent la réunion des sexes dans les mêmes écoles.335
Parmi les nombreux établissements que l'Allemagne compte pour la protection des femmes, il faut citer celui de Hambourg, où les jeunes pensionnaires, par une cotisation annuelle, entretiennent une caisse de prévoyance qui donne droit d'asile dans l'institution à celles d'entre elles qui y sont rappelées par des revers de fortune.
L'Autriche a une foule d'institutions analogues, et la seule ville de Vienne qui entretient cinquante-neuf ouvroirs de jeunes filles, ne prélève que le cinquième de leur salaire pour l'achat des matières de confection; le reste, versé dans une caisse d'épargne, y fructifie jusqu'au jour où on remet sa quote-part à chaque jeune personne au sortir de l'apprentissage.
Il suffit de rappeler les institutions de la Russie et de l'Espagne pour la protection des orphelins et des enfants trouvés, pour nous convaincre que nous sommes loin de relever les faibles comme ces nations.
Quant à l'Angleterre, elle combat son paupérisme par la justice, la morale absolue, l'idée du devoir qui préside aux rapports des sexes, et par des associations innombrables qui viennent en aide aux veuves et aux orphelins.
Les caisses d'épargne beaucoup plus vulgarisées en Angleterre qu'en France, y ont une organisation meilleure, car, en dehors de l'intérêt du dépôt, elles accordent la faculté d'acheter une annuité qui commence lorsque l'acquéreur le désire, et pour le nombre d'années qu'il détermine. Tout individu qui, de vingt à trente ans, dépose chaque mois cinq schellings dans une de ces caisses, reçoit, à l'âge de soixante ans, une pension viagère répondant à 510 de nos francs. Les femmes et les mineures trouvent une protection toute particulière pour la gestion de leurs biens. placés sous la sauvegarde des cours d'équité; ces institutions veillent aux intérêts de leurs pupilles, prennent en main leur cause, dirigent l'emploi de leur fortune, lorsqu'elles redoutent la mauvaise gérance de maris dissipateurs ou de tuteurs infidèles.
Les fonds ainsi protégés s'élèvent à la valeur d'un milliard.
L'énumération seule des institutions que l'Angleterre possède pour le patronage des jeunes ouvrières serait fatigante; il suffit de dire qu'elle compte plus de douze mille sociétés amicales, et que les trois royaumes réunis ont près de trente-quatre mille associations comprenant environ moitié de la population adulte de la Grande-Bretagne; ces associations, dont le revenu est de plus de cent vingt-cinq millions, possèdent un capital accumulé qui dépasse trois cents millions.336
Les mœurs anglaises entourent, en outre, d'une considération et d'un respect si particuliers la femme isolée, qu'un grand nombre de femmes renoncent au mariage pour jouir d'une indépendance plus complète.
L'Angleterre encore a eu l'honneur d'être la première prédicatrice de l'émancipation des femmes par le travail; elle leur assure une position honorable dans son enseignement complétement séculier; elle leur a créé l'imprimerie Victoria, sous le patronage de la reine, qui subventionne aussi un journal (le Victoria-Magazine) destiné à rechercher les moyens les plus pratiques d'améliorer leur sort. L'Angleterre emploie les femmes aux télégraphes électriques, leur ouvre des cours de photographie, leur prépare des écoles de médecine, etc.
Le gouvernement anglais très-sympathique à ces innovations, en leur donnant toute l'initiative désirable, semble craindre la position fausse des pouvoirs qui se traînent à la remorque de l'opinion au lieu de la diriger.
On pourrait m'objecter néanmoins que l'Angleterre ne nous le cède pas en immoralité, et que Londres, à titre de capitale de la débauche, est la digne émule de Paris, mais c'est de ce triste aveu que j'ai tiré, au début de ce travail, une preuve nouvelle de la dégradation de la femme par l'oppression et la misère, en rappelant que l'Angleterre, qui a forfait à la justice, en subit le terrible châtiment; les enfants nus et affamés de la plaintive Irlande implorent souvent en vain de leur dominatrice des vêtements et du pain, et les jeunes Irlandaises ramassées parles pourvoyeurs de débauche, forment avec les Françaises les quatre cinquièmes des prostituées de Londres.
La Suède est aussi avancée que l'Angleterre dans la voie de l'émancipation des femmes par le travail. Le salaire des institutrices suédoises varie de 700 à 900 rixdales (le rixdale vaut 1 fr. 40). La Suède s'occupe encore très-activement d'étendre les droits civiques des femmes et de leur créer de nouveaux emplois dans l'enseignement public et dans la médecine. Une proposition soumise à la Diète est ainsi conçue: « Considérant que le droit d'admission aux fonctions et emplois auxquels les femmes peuvent être jugées aptes à prendre part, doit désormais leur être accordé quand elles font preuve des connaissances et de l'habileté nécessaires; considérant, en conséquence, qu'on doit leur concéder le droit de passer l'examen aux écoles supérieures, comme de faire partie du corps enseignant de l'Université, et de leur faire passer les examens des facultés autres que celles de théologie, les États du royaume expriment le désir que Sa Majesté veuille bien prendre les mesures nécessaires pour modifier dans ce sens l'état de choses actuel. »337 Si nous nous rappelons en outre qu'en dehors de ses lois rigoureuses contre la séduction, cette civilisation protége les faibles au point de défendre aux maîtres de renvoyer leurs servantes pour cause de grossesse, et de considérer comme infanticide toute exposition d'enfant suivie de mort, nous saurons assez qu'en s'appuyant sur la famille comme sur un bouclier invulnérable, elle peut éluder tous les problèmes sociaux et économiques qui, comme d'autres sphinx, menacent de nous dévorer, si nous ne leur donnons une solution rationnelle.
Je n'ai pas encore à parler de la Suisse, sortie depuis si peu de temps des voies de la justice et de la morale dans les lois qui règlent les rapports des sexes; ses mœurs reflètent du reste celles des trois nations dont ses habitants parlent l'idiome.
L'Italie (je parle de l'ancienne) est regardée d'ordinaire comme la patrie du célibat forcé; pourtant on ne trouve aucune civilisation qui redoute et qui combatte autant qu'elle le célibat séculier, même volontaire. Nul royaume ne possède un aussi grand nombre d'institutions dotales; ignorant si la révolution italienne a respecté ces œuvres philanthropiques, je passe à la ville de Rome où Pie IX a conservé dans toute leur intégrité les fondations que les papes ont faites de temps immémorial en faveur des jeunes filles de leurs États; malgré la pénurie de ses finances, le pape actuel les défend contre des spoliations sacriléges, et Rome, une des villes les plus infectées de prostitution au moyen âge, a pu se moraliser au point d'avoir moins que nous à gémir sur la prostitution clandestine, quoiqu'elle garde, en dépit de la corruption qu'y a semée notre garnison, si lourdement protectrice, l'audace vertueuse de repousser la maison de tolérance.
A Rome, nulle de ces mesures arbitraires qui attristent Paris, parce que Rome protége, par ses lois et par ses établissements, la pauvreté contre la séduction, et que ses mesures préventives de la prostitution de la femme lui permettent de n'employer aucun moyen discrétionnaire pour la punir.
Différents papes ont attaché leur nom à la protection des jeunes filles; Léon X fonda aussi un établissement en faveur des femmes malheureuses en ménage; quoique détourné de son but primitif, il porte encore le nom des mal maritate.
Pie II recueillait toutes les jeunes filles à marier qui se trouvaient sans appui, et les faisait sortir trois fois l'année pour les désigner au choix des jeunes gens au milieu des fleurs et des pompes d'une procession solennelle. Dans la seule année 1667, soixante-quinze mariages se firent ainsi. Innocent X substitua des distributions de dot à ces mariages processionnels, et Benoît XIV voulut qu'à chaque tirage de loterie, cinq jeunes filles prélevassent leur dot sur le gain des cinq numéros sortants.
Divers établissements de bienfaisance et ateliers industriels, prennent aussi à Rome le patronage des femmes de tout âge; on y élève jusqu'à onze cents jeunes filles, dont cent reçoivent chaque année une dot de six cents francs à leur sortie. Lorsque les mariages sont moins nombreux, les fonds capitalisés permettent d'élever les dots jusqu'à près de quatre mille francs, et de les accorder à toute fille pauvre élevée ou non dans les établissements publics; l'œuvre seule de l'Annonciade consacre tous les ans quinze mille écus à cette destination, et Rome, dont la population est environ dix fois moindre que celle de Paris, dote et marie quatre cents jeunes filles chaque année. Cette ville, ai-je dit, repousse comme une horreur indicible la nécessité, la moralisation et le progrès que nous trouvons dans la maison de tolérance; et au lieu de consumer comme nous ses ressources à entretenir des dispensaires pour les filles inscrites; à poursuivre sous le spécieux prétexte d'hygiène publique, la satisfaction et la sécurité des débauchés, Rome entretient l'asile connu sous le nom de Pia casa di carità per le familie pericolanti; on y reçoit les jeunes filles de douze à dix-huit ans, que des inclinations perverses, l'exemple de parents vicieux, la pauvreté ou le manque d'appui pourraient faire succomber.
Rome possède en outre, comme préservatif de la prostitution, l'archi-hôpital de Saint-Roch qui admet toute victime de la séduction, riche ou pauvre, lui garde un religieux silence, élève ses enfants à la Pia casa di Santo-Spirito, et arrache ainsi, chaque année, près de cent femmes au crime ou au déshonneur.
Pour que la jeune fille pauvre, qui se trouve sans gîte la nuit, ne soit point ramassée, comme chez nous, par les agents de la police, ou recrutée par les pourvoyeurs de débauche, Rome a aussi les Ospizie et case di ricovero. A l'asile San Luigi Gonzagua, la femme reçoit gratuitement un lit et trouve une soupe à son réveil.
Les veuves pauvres sont de même à Rome l'objet d'une protection spéciale. Plusieurs établissements les recueillent ou les patronnent pour leur procurer du travail.
Une institution que nous avons perdue,338 s'occupe encore à Rome de la défense gratuite des faibles devant les tribunaux, où elle soutient spécialement les intérêts des pauvres veuves, ainsi que ceux des filles misérables. Dans toutes les villes d'Italie, sans en excepter Rome, les supérieures et les directrices de ces institutions nombreuses sont choisies parmi les séculières.
Quelles que soient les destinées futures du gouvernement pontifical, l'histoire le glorifiera de la protection éclairée qu'il accorde à la famille; protection qui, au nom de la morale, de la justice et de l'humanité, refuse de s'appuyer sur la force brutale, et répugne à créer une armée nationale pour ne pas imposer un célibat, même temporaire, à quelques Italiens; certes, l'appréciation des droits de l'homme est saine; le respect pour l'humanité est grand dans une nation qu'on nous dit livré à un monachisme étroit et démolisateur et qui ne compte pas une seule union concubinaire; ses mœurs sont-elles oui ou non préférables au cynisme de nos moines soldats, et à la licence de nos classes dirigeantes comme de nos populations ouvrières.
Ce regard sommaire sur l'Europe suffit à nous démontrer qu'aucune civilisation n'y est rongée par le chancre de l'immoralité irresponsable qui dévore la nôtre; me fût-il prouvé que l'Europe est aussi immorale que nous, je ne verrais à son immoralité responsable aucune des conséquences sociales et économiques qui nous entraînent sur une pente si fatale; il faut excepter toutefois de cette appréciation les pays qui se régissent d'après notre Code, comme la Belgique; la liberté de la presse et le gouvernement constitutionnel y imposent, il est vrai, une espèce de responsabilité aux fonctionnaires, et une certaine décence de mœurs aux classes dirigeantes; néanmoins les immunités de la séduction et du concubinage y ont produit un tel paupérisme et une telle démoralisation; la prostitution y est mise à un tel rabais par les femmes sans ressources, que cet horrible métier ne peut plus même assurer leur subsistance.
Dans cette revue européenne, j'ai omis la Turquie que je n'oublie point cependant, mais j'ai à répéter à son sujet ce que j'ai affirmé déjà; la pluralité simultanée ou successive des femmes est moins funeste, tempérée par des lois, que laissée à des caprices et à des appétits rejetant tout devoir et tout frein; la législation qui ne permet de contracter des devoirs qu'envers une seule femme et les enfants qu'elle met au monde est infâme, si elle ne poursuit point par de grandes sévérités ses infracteurs; elle a, en cas de tolérance du vice, la promiscuité pour conséquence fatale.
Le disciple de Mahomet qui doit chaque année au pauvre le dixième du revenu de son bien, ne connaît pas la séduction; la Turquie qui abhorre la prostitution, n'a de filles publiques dans une seule ville que pour l'usage des chiens de chrétiens.
La polygamie imposant des devoirs au mari, envers toute épouse, et au père envers tout enfant, préserve les pays musulmans de la dégradation où nous faisons tomber la femme du peuple, accablée sous le fardeau de la maternité. Dans les pays de civilisation avancée comme l'Europe, où les exigences de la vie matérielle permettent à peine au mari d'entretenir une seule épouse, la polygamie est plutôt une exception qu'une règle; elle se concentre dans les hautes classes, à l'usage de quelques hommes riches, encore fait-elle sur eux tomber une certaine déconsidération, car le sultan actuel a montré naguère son adhésion au progrès en cherchant à extirper complétement la polygamie des mœurs; il a inauguré son règne par l'abolition de son harem; ces considérations suffiraient à prouver que la famille est plus fortement constituée en Turquie qu'en France; aucune femme turque ne peut descendre l'échelle des dégradations que nous voyons parcourir à nos femmes du peuple comme à leurs enfants; cette assertion se confirme par l'observation des faits et par l'autorité d'une foule de voyageurs et d'historiens; en Turquie, dit l'un de ceux-ci, « la femme d'un homme riche a vraiment peu sujet de se plaindre de son sort. Loin d'être captive, comme on la suppose parmi nous, elle circule librement dans son char doré attelé d'une -couple de bœufs; elle se promène sur l'eau, dans son élégant caïque, le long des charmants rivages du Bosphore; elle règne dans le harem comme sur le cœur de son époux, et Métastase aurait pu lui dire: Siete schiava ma regnate nella vestrà servitù. »339
Quant à la femme du peuple, elle est beaucoup plus souvent en Turquie l'épouse unique d'un seul mari qu'en France; comme l'époux a toujours, dans ce mariage légitime et légal, des devoirs auxquels il est libre de se soustraire chez nous, les esprits sensés peuvent se demander où est le progrès, où est la décadence.
Je sais bien que si je partais de la sainteté de la morale évangélique pour considérer la simultanéité légale des femmes, je ne pourrais établir de parallèle, mais en partant de notre promiscuité libre d'abjurer tout devoir, je ne puis m'empêcher de conclure qu'elle nous ravale au-dessous de tous les peuples qui font rentrer dans une légalité quelconque les rapports de l'homme avec la femme et l'enfant. Cet examen peut nous convaincre que notre imparfaite organisation de la famille jette dans le prolétariat, dans le vagabondage, dans le travail homicide, dans les lupanars et dans les bagnes plus de deux millions de femmes et d'enfants à qui les lois européennes accordent l'éducation et le repos avec l'assistance paternelle dans la famille.
Puisque mes antagonistes m'ont fait parcourir le monde à la recherche de la dignité de la femme et des droits de l'enfant, je demande à sortir de la promiscuité française et de la polygamie asiatique; je leur citerai encore une fois les États-Unis, dont j'ai eu si souvent déjà à invoquer les lois et les mœurs en faveur de la liberté humaine; tous les efforts de la démocratie américaine tendent à faire du mariage l'expression des mœurs sociales; loin de baser comme nous les rapports des sexes sur le droit laissé à l'homme de tromper la femme hors de la famille, ou à celle-ci de tromper l'homme dans la famille, les États-Unis ont établi la pondération la plus équitable des droits et des devoirs, par l'action qu'ils laissent dans le mariage au mari contre l'épouse, et hors du mariage à la fille séduite, et à ses enfants.
Pour comprendre les conditions de la vraie liberté, il suffit de lire le discours adressé par le président Johnson aux nègres affranchis, et le règlement qu'il leur donne. Quelques énergumènes, imbus des fausses idées d'une civilisation fausse comme la nôtre, promettaient aux nègres un paradis terrestre dans l'émancipation qui leur permettrait une vie licencieuse, et cherchaient même à les rendre libres en agissant sur la couleur de leur peau qu'on leur proposait de lessiver, mais M. Johnson qui s'entend mieux aux conditions de la liberté véritable, pour en connaître la pratique plus que la théorie, enseigne leurs devoirs aux nouveaux citoyens qu'il a mission de racheter d'une promiscuité, d'un concubinage aussi hideux que ceux qui dévorent nos classes ouvrières; il leur promet le bonheur dans l'ordre, l'économie, la modération des désirs et la moralité.
« La liberté, ajoute-t-il dans son discours de 1865, n'est pas une abstraction; c'est une réalité qui ne consiste point dans la paresse et l'incapacité; elle ne consiste pas non plus à faire tout ce qui plaît, à avoir le droit de courir les cabarets de bas étages et autres lieux suspects. La franchise et la liberté ne signifient pas que les gens doivent vivre dans la licence; elles signifient simplement qu'ils doivent être industrieux, vertueux, probes dans toutes leurs relations sociales. Appliquez vous au développement de vos propres talents, de votre propre intelligence et de vos qualités morales; que ce soit là votre règle de conduite; adoptez un système de moralité. Abstenez-vous de vivre dans la licence… Il est une chose que vous devez estimer et placer au-dessus de tout; c'est le contrat solennel du mariage, avec toutes ses conséquences.
« Celui qui a le plus de talent, de vertu, d'intelligence et de connaissances, celui-là doit être au pinacle, sans égard à sa couleur. »
L'Évangile tint-il un autre langage, quand il vint réagir contre la polygamie juive et la promiscuité romaine? Qu'on ne croie pas que ces paroles soient de ces lettres mortes qui retentissent trop souvent à nos oreilles dans les manifestes où nos gouvernants prononcent les mots vagues de moralité et de justice. Les nègres doivent s'élever'à la dignité et à la liberté des blancs; ils doivent partager leurs prérogatives en acceptant les devoirs qui font aujourd'hui de cette race anglo-saxonne l'institutrice du monde entier; afin de les conduire à ce but, M. Johnson leur trace un code de morale pratique qui prouve la plus profonde connaissance du cœur humain et des besoins sociaux pour la protection nécessaire à la femme et à l'enfant.340
C'en serait fait des États-Unis, et ils auraient déjà sombré dans l'anarchie ou le despotisme si cette lie de l'univers qui s'y déverse, si cette population nègre qui y prend droit de cité, pouvaient vivre dans les immunités que la France accorde à tous les hommes immoraux.
Cette solidarité étroite de la paternité, de la maternité et de l'enfance aux États-Unis y attache tellement l'épouse au foyer que, malgré l'initiative sociale laissée à la jeune fille dans toutes les carrières, la concurrence des femmes n'a aucune influence sensible sur la réduction du salaire des hommes; voilà les lois égalitaires telles que je les comprends et telles que je les invoque pour la dignité de l'individu et le salut de la France.
Cet examen comparatif nous montre qu'aucune des civilisations modernes n'est travaillée par les causes de dissolution qu'introduisent chez nous nos atteintes permanentes à l'ordre moral; cherchons donc des préceptes et des exemples chez les nations qui ont su établir la meilleure harmonie entre le droit et le devoir; il faut nous souvenir surtout que c'est nous qui avons traduit souvent en langage intelligible les bégaiements de l'humanité; s'il est beau le privilége que nous avons eu de semer l'idée dans l'univers, il nous impose aussi une haute responsabilité morale, car les grands peuples ont des obligations aussi étroites que les grands hommes. Que d'autres nations nous priment pour leur milice et leur industrie; qu'elles nous dominent par la force matérielle et brutale, si nous ressaisissons notre noble empire sur les esprits, si le monde intellectuel nous prend de nouveau pour arbitre de sa gravitation, si la France enfin, patrie mère des idées généreuses, reste le fanal qui tour à tour illumine ou incendie le monde.
3e Objection. — Les femmes du peuple opposeront elles-mêmes des obstacles à l'amélioration de leur sort, parce qu'elles. partagent les préjugés dont elles sont victimes, ou qu'elles préfèrent vivre dans la dépravation; des réformes partielles ont échoué déjà; dans l'enseignement même, la maison de Saint-Denis, richement dotée par l'État pour l'éducation des femmes sans fortune, est une preuve accâblante contre elles.
Je n'ai plus besoin de répéter que le manque de liberté et d'initiative pour la jeune fille, bornant ses carrières et ne lui permettant pas de se livrer aux travaux de son choix, lui fait souvent partager les préjugés des femmes riches contre le travail. C'est donc un devoir d'autant plus impérieux pour la société de lui donner toute l'initiative désirable. Quant à la dépravation, elle est le fruit des lois et des mœurs qui rendent la fille du peuple le point de mire de toutes les exploitations; il est impossible qu'elle aille en sécurité chercher son pain quotidien à un foyer étranger tant que le législateur n'aura point prévenu ses chutes par la responsabilité de l'homme. L'instruction des femmes du peuple est livrée, du reste, presque exclusivement aux religieuses par les écoles primaires et les orphelinats, mais il serait insensé d'accuser ses principes devant ses chutes, qui sont souvent une conséquence forcée de sa position sociale. Si la femme doit rester vouée au célibat, à l'indigence, à la dépravation parce qu'elle est née sans patrimoine et qu'elle ne peut suffire à ses besoins personnels; si elle doit continuer à succomber sous le faix de l'enfant dans ces conditions, il faut rouvrir les cloîtres asiles et y enfermer d'office les futures victimes de la séduction. La femme sera opprimée dans la société tant que nous aurons une morale à l'usage de chaque sexe, ou plutôt tant que la loi morale n'aura d'autre sanction que les caprices des passions de l'homme.
On rencontre dans nos villes une foule de jeunes filles éloignées de leurs parents et occupées de six heures du matin à dix heures du soir dans des magasins ou dans des ateliers industriels; elles sont en outre chargées de travaux serviles, comme le nettoyage des magasins, le factage et les commissions en ville; leur rétribution annuelle est de deux cents à deux cent cinquante francs, avec une alimentation débilitante qui les affame au lieu de les nourrir. En hiver on les contraint à travailler le dimanche jusqu'au dîner; en été, le maître et le patron ferment les portes de l'atelier pour aller à la campagne, et abandonnent brutalement sur le pavé ces jeunes filles qui doivent se suffire à elles-mêmes pendant les jours fériés: Nourrissez-vous comme vous pourrez, leur a-t-on dit avant le départ, nous ne vous devons rien dès que vous ne travaillez pas. Si la vente va bien, on se félicite devant elles du bon résultat de l'inventaire, et, à la moindre crise industrielle, on leur mesure les vivres avec une nouvelle parcimonie; des réclamations adressées sur la nature, la qualité ou la quantité de leurs mets, sur le chiffre de leur traitement, suffisent à faire expulser des jeunes filles qui, pour me servir des expressions de ces industriels, sont trop heureuses d'avoir à manger.
Voilà cependant les femmes dépravées qu'on accuse si elles succombent à toutes les séductions qui les entourent, ou si, éblouies par l'existence dorée de la courtisane, elle préfèrent l'oisiveté opulente à cet ingrat travail. Indépendance donc, justice et liberté pour la femme comme pour l'homme; solidarité morale, et les êtres faibles deviendront assez forts pour se soustraire à des influences perverses, et notre société ne commettra peut-être plus l'inconséquence d'exiger la régularité de conduite des misérables enfants qu'elle pousse de tous côtés à l'inconduite, et nous ne chercherons plus sans doute la solution de cet admirable problème: des hommes débauchés et des femmes chastes.
Le même abandon social a produit, pour les élèves de SaintDenis, les tristes effets dont on accuse si injustement leur éducation. Cette maison est tombée dans un tel décri qu'un bruit populaire recensait, sous notre dernier règne, vingt de ses anciennes élèves parmi les prisonnières de Saint-Lazare. Une enquête ouverte à ce sujet par le gouvernement, démontra la fausseté de cette assertion, qui n'en reste pas moins une attestation accablante de la position faite par la société à la femme sans fortune; c'est à grand tort qu'on accuse l'éducation de Saint-Denis, en prétendant que les jeunes filles y prennent des goûts au-dessus de leur position; c'est bien plutôt la société qui, à leur sortie, les déclasse, faute de leur assurer des moyens honorables de subsistance, car la maison de Saint-Denis n'est ouverte qu'aux filles des militaires de grades supérieurs à partir de celui de capitaine; ces jeunes filles, isolées, résument la position des femmes pauvres, déclassées par l'éducation et devenues aptes à des emplois qu'on leur refuse. Quelle que soit la supériorité de l'éducation reçue à Saint-Denis, il est impossible qu'une jeune fille, souvent orpheline et toujours pauvre, dès qu'elle est boursière, puisse subsister honorablement dans une société où la dot est la condition préalable et souvent exclusive du mariage, et où la femme qui n'a qu'une aiguille pour ressource, végète dans la misère. Avant de jeter notre pierre aux élèves de Saint-Denis, il faudrait savoir quels moyens de subsistance ont refusés celles d'entre elles qui se dégradent dans l'oisiveté ou dans le vice.
La formule invariable du serment imposé à la surintendante de Saint-Denis, montre que le gouvernement ne s'est pas encore rendu compte du changement opéré depuis Napoléon Ier dans l'existence des femmes sans fortune. « Je jure, dit-elle, d'être fidèle à l'Empereur, de remplir les obligations qui me sont prescrites, et de ne me servir de l'autorité qui m'est confiée que pour former des élèves attachées à leur religion, à l'Empereur et à leurs parents; d'être pour chaque élève une seconde mère, et de les préparer, par l'exemple des bonnes mœurs et du travail, aux devoirs d'épouse vertueuse et de bonne mère de famille qu'elles seront appelées un jour à remplir. »
L'éducation de Saint-Denis n'ayant en vue que la vie domestique, considère uniquement la future intendante de maison; le programme comprend les occupations de la mère de famille, l'art culinaire, les travaux même de la buanderie; les élèves confectionnent leurs robes et cousent tout le linge nécessaire à l'établissement.341
Avant de savoir coudre les robes il faut, ce me semble, savoir gagner de quoi les acheter, dès qu'on est sans fortune; si l'État cherche à faire subsister par les travaux de couture les filles de ses plus hauts fonctionnaires, il peut être assuré qu'elles resteront en butte à mille exploitations dans le monde, lors même qu'elles auraient remporté le prix de couture à SaintDenis, car à Paris, les hommes, plus nombreux que les femmes dans les travaux de confection, les souffrent à peine pour concurrentes, et la France compte plus d'hommes qui manient l'aiguille que l'épée. On voit en conséquence des inégalités révoltantes de position entre les anciennes élèves de Saint-Denis, riches pensionnaires dotées par leurs familles et les pauvres boursières de l'institution. Celles-ci, admises de six à douze ans, conservent leur bourse jusqu'à dix-huit ans seulement, elles se trouvent sans ressources à l'époque où il faudrait les doter ou leur ouvrir une carrière.
Tandis que l'État assure une position honorable ou un brillant avenir à ses boursiers, il inscrit deux mille francs au budget de la Légion d'honneur pour les boursières qui sortent de ses institutions; ce misérable subside est réparti d'ordinaire entre cent à cent cinquante jeunes filles, tellement dénuées qu'elles ne peuvent payer leurs frais de voyage au départ. A dater de ce moment, nul patronage, nulle tutelle; la société ne s'inquiète plus de ces malheureuses orphelines que pour leur jeter la pierre si la tête leur tourne dans la voie périlleuse où elle les a placées. Ah! ce n'était pas ainsi qu'agissait Napoléon Ier, qui se préoccupait de l'avenir social de ces jeunes filles, et qui, dans son despotisme moralisateur, allait jusqu'à imposer à ses hauts fonctionnaires des unions avec les filles pauvres de ses généraux.342
Les boursières de Saint-Denis qui contractent actuellement mariage, se trouvent souvent encore dans une position plus fausse que celles qui brillent parmi nos courtisanes; en général elles épousent des ouvriers qui n'ont pas leur culture intellectuelle et morale, et avec lesquels elles n'ont aucun rapport d'éducation et de goûts, aucune idée commune. L'histoire de ces boursières sans fortune, rendues à la société, est quelquefois lugubre.
Une de ces jeunes filles, élevée ainsi aux frais de l'État, dans une succursale de Saint-Denis, venait d'y terminer son éducation quand son père mourut: comme elle se trouvait sans ressources, elle fut obligée d'aller chercher un asile chez une unique parente, blanchisseuse à Boulogne. La jeune fille, pour ne point être à charge, y partagea les travaux de l'établissement; après un an de séjour, elle écrivit à sa bienfaitrice: « ....J'ai lutté longtemps contre la pensée du suicide; il n'y avait que ce moyen de ne pas déshonorer le nom de mon père.
« Je vous l'avoue à ma honte, je rougissais de ma condition; malgré moi je rêvais un sort plus heureux…
« J'aurais pu, au prix de mon déshonneur, réussir à briller comme tant d'autres, dans le monde, que je désirais connaître, j'ai mieux aimé, dans la crainte de faillir un jour, me résigner à mourir vertueuse. A l'heure où vous recevrez cette lettre, la Seine aura enseveli dans ses eaux celle qui vous demande une larme, une prière. »343
Notre société n'est-elle pas seule coupable de la mort de cette jeune fille, pour l'avoir laissée sans aucune indépendance possible, entre l'alternative de la honte et du désespoir? Évoquons donc sans cesse ces ombres plaintives, ces spectres hideux, et qu'ils viennent comme le fantôme de Banquo troubler toutes les fêtes de leurs immolateurs.
Le sort des élèves de Saint-Denis mérite, comme on le voit, l'attention la plus sérieuse; cette maison a beaucoup décliné depuis Napoléon Ier; elle avait alors une dotation annuelle de neuf cent mille francs qui répondent aujourd'hui à un chiffre beaucoup plus élevé, ainsi que l'ancien traitement de neuf mille francs de ses professeurs. Saint-Denis comptait quatre succursales que le gouvernement des Bourbons fit fermer en partie.
Le déclin continua sous le gouvernement de Juillet, et si l'on en croit M. de Cormenin, les orphelines de la Légion d'honneur furent indignement spoliées, comme je l'ai dit déjà, par des fonctionnaires corrompus.
Timon s'exprime ainsi à ce sujet: « Avec Lafitte et Périer, ces anatomistes de budgets, ces chercheurs, ces investigateurs, ces fouilleurs, ces discuteurs de fonds secrets et déguisés, il n'a plus été possible, comme on s'en plaignait en ce temps-là, de faire glisser l'entretien d'une fille de l'Opéra dans les dépenses des orphelines de la Légion d'honneur. »344
Maintenant que les filles d'Opéra ne bénéficient plus d'aucun virement de budget, ni d'aucune liste civile, et que tous nos hauts fonctionnaires emploient leurs traitements à moraliser la femme et à élever l'enfant, ne pourrait-on pas venir en aide aux boursières de l'État par quelques-unes des réformes suivantes:
1° Admettre plus d'une pensionnaire boursière dans les familles pauvres qui comptent trois et quatre filles;
2° Offrir un asile dans la maison aux anciennes pensionnaires qui ne pourraient suffire à leurs besoins personnels dans la société;
3° Doter lés élèves pauvres et orphelines, ou leur créer des moyens de subsistance par une bonne instruction professionnelle et artistique; les protéger à leur sortie par le patronage bienveillant et éclairé que Mme de Maintenon accordait autrefois aux élèves de Saint-Cyr.345
L'école maternelle, fondée il y a quelques années par l'Impératrice, a accueilli un grand nombre de jeunes orphelines qui doivent y séjourner dix ans. Je ne sais si elles y reçoivent une instruction spéciale, mais il est à craindre que cet établissement n'offre des résultats aussi tristes que celui de Saint-Denis, si les nombreuses jeunes personnes qu'il va rendre à la société n'y trouvent aucun avenir.
4e Objection. Le sort des femmes ne peut s'améliorer que par l'abolition du mariage mercenaire; les travaux de l'industrie leur suffiront ensuite.
J'ai assez fait voir que l'homme sans fortune ne peut supporter seul les charges de la famille, pour n'avoir plus à développer cette considération.
Je me trouvais un jour avec des jeunes gens accompagnés de trois charmantes jeunes filles leurs parentes. Les jeunes hommes interrogés sur leurs projets d'avenir, répondirent ouvertement qu'ils se marieraient dès qu'ils trouveraient des femmes dotées, et se plaignirent de la difficulté où on est de les rencontrer aujourd'hui.
Autrefois cet aveu, en pareille réunion, eut paru aussi déplacé qu'inconvenant, et néanmoins je dois avouer que je le trouvai très-naturel en considérant la position individuelle des membres de ce cercle, dont le travail était l'unique ressource. L'un d'eux, militaire, avec trois mille francs de solde, contractait des dettes, et ne faisait nulle difficulté d'avouer que le célibat lui paraîtrait préférable au mariage, s'il n'était obligé d'épouser une dot pour remédier à la pénurie de ses finances. Les autres jeunes gens, employés de bureaux, recevaient un traitement de douze à dix-huit cents francs par an. Je compris que leur conversation était l'expression fidèle d'une nécessité sociale, bien plus que celle de sentiments naturels, car aucun d'eux ne pouvait raisonnablement songer aux jeunes filles présentes. Dans cette classe, une foule d'hommes sont condamnés au célibat par la pauvreté, parce qu'il leur est aussi impossible de trouver une femme riche que d'en épouser une pauvre.
Concluons donc de nouveau que dans cet état de nos lois et de nos mœurs, l'abolition de la dot serait celle du mariage même dont elle est la base unique; si le contrat social qui unit les sexes doit toujours rester une question d'argent, il serait bon de permettre aux héritières opulentes d'épouser autant de maris qu'elles pourront en doter, sinon les moyens d'arriver à l'indépendance par le travail doivent être aussi équitablement répartis entre les sexes que le sont le patrimoine et le capital. Certaines personnes, regardant comme très-fâcheuse la centralisation qui paralyse toute initiative chez la femme, croient que la liberté de l'industrie est un dédommagement suffisant pour elle; j'ai réfuté assez, je pense, cette assertion dans tout le cours de mon travail, pour ne pas y donner ici des développements nouveaux; je rappellerai seulement que tous les progrès sociaux constitueront une oppression pour la femme, tant que ses intérêts étant distincts de ceux de l'homme, elle restera exclue des écoles professionnelles et que ses concurrents profiteront pour se coaliser contre son salaire des libertés qu'on leur octroie. Les faits affligeants qui se sont produits à cet égard dans nos sociétés de secours mutuels et dans nos grèves, restent l'attestation la plus douloureuse de la dissolution des liens de la famille; je crois que de pareils exemples d'injustice et de licence ne pourraient se trouver chez les peuples où une solidarité étroite unit la paternité, la maternité et l'enfance.
Le préjugé qui repousse la femme des fonctions publiques et ne lui laisse qu'un droit illusoire dans l'exercice de la médecine et des arts, l'exclut de même presque toujours de la direction des établissements industriels. Les exceptions ne rentrent pas dans mon sujet, puisqu'elles sont fournies par des femmes qui d'ordinaire administrent leurs biens patrimoniaux. Nous savons que le bon goût de notre époque exige que des mains masculines aunent les dentelles dans les magasins somptueux de nos quartiers élégants.
Si la femme, du reste, peut vivre sans protection dans l'industrie, pourquoi l'homme s'y donne-t-il celle du crédit, de l'instruction et des capitaux?
Après avoir reçu l'instruction professionnelle dans des écoles fermées au sexe, des jeunes hommes sans fortune ne font-ils pas tous les jours de vastes entreprises qu'ils soutiennent en épousant des femmes riches? Il n'est pas rare même de rencontrer des employés actifs à qui un patron cède son négoce avec sa fille. Qu'on mette une femme pauvre dans une semblable position, et qu'on me dise à quelle condition elle trouvera un homme riche pour commanditer ses spéculations.
La justice impartiale et bienveillante de nos jurys d'exposition délivre, il est vrai, de nombreuses médailles ou mentions honorables aux femmes, mais l'État, non content de les expulser de ses écoles, leur refuse d'ordinaire, comme je l'ai fait remarquer au début de ce travail, les brevets d'invention qu'elles sollicitent.346
C'est ainsi qu'on trouve les hommes à la tête des maisons d'industrie féminine reposant sur un capital considérable, et que la femme n'a plus assez de crédit pour être coiffeuse.
Les femmes sont exclues de même, ainsi que nous l'avons vu, de l'expertise dans les tribunaux de commerce, et les conseils de prud'hommes où les experts portent un jugement relatif aux contestations les plus vétilleuses sur les travaux les plus délicats des industries féminines.
Mais l'industrie eût-elle des emplois à offrir à toutes les femmes obligées de pourvoir seules à leur subsistance personnelle et à celle de l'enfant, il ne s'ensuivrait pas que la société ne doive point respecter leurs aptitudes et leurs goûts aussi variés que ceux des hommes. Imitons donc la nature qui a diversifié les vocations et les talents, et respectons le droit de toute intelligence, quel que soit le sexe où elle s'incarne.
5e Objection. L'égalité effective des droits respectifs de l'homme et de la femme au salaire, offre le grave inconvénient de donner aux hommes la position gênée d'où l'on cherche à tirer les femmes, car leur empiétement sur les occupations féminines est la preuve la plus convaincante de la difficulté ou de l'impossibilité qu'ils ont de vivre dans les emplois autrefois propres à leur sexe.
L'empiétement de l'homme dans les emplois féminins a été surabondamment constaté, et j'en ai indiqué les principales causes; l'application sévère des lois morales retiendrait à ses foyers une grande partie de la population, et l'association du capital et du travail donnerait de larges moyens de subsistance à la foule qui végète dans la misère. Les travaux propres à fixer l'homme dans les communes rurales tiennent à une protection plus efficace de l'agriculture, et à une meilleure répartition des ressources intellectuelles. Dans l'ancienne France, si le régime féodal était aussi contraire aux intérêts de l'agriculture qu'à ceux de l'industrie, les lois générales favorisaient de préférence l'agriculture. Les impôts étaient si modiques au xiiie siècle que ceux de certaines terres ne peuvent plus s'apprécier aujourd'hui, vu l'avilissement du numéraire.
Les commissaires enquesteurs de saint Louis parcouraient en son nom les provinces pour y dresser la liste des laboureurs indigents et infirmes, dont le roi assurait la subsistance.
Ses successeurs dégrevèrent ensuite de tout impôt les cultivateurs chargés de famille. Henri III, Charles IX, Henri IV, Louis XIII ont attaché leurs noms à la protection du sol.
Louis XIV aussi confirma par l'édit de 1666, des pensions aux laboureurs chargés d'une nombreuse famille.
L'agriculture, que les soins de Sully avaient élevée à un si haut degré de prospérité, souffrit beaucoup, au xviie et au xviiie siècle, des développements de l'industrie et de l'absentéisme de la haute noblesse; cependant le gentillâtre sans fortune qui croyait déroger en acceptant un emploi public ou industriel, continua à cultiver les terres de ses pères et resta fidèle à son manoir; un de nos écrivains célèbres a pu dire: « La noblesse et la terre semblaient s'être épousées en France, comme l'aristocratie et la mer s'épousaient à Venise. »
A la Révolution, les législateurs se préoccupèrent beaucoup de l'agriculture. Notre nouvelle constitution, disaient les législateurs de 1789, en attirant le père de famille dans les campagnes, présente de si grands avantages à l'agriculture, qu'elle ne peut se ressentir de l'absence des moines; notre organisation sociale lui portera plus de secours qu'elle n'en réclamera.
La Révolution décréta, en effet, des secours pour les agriculteurs invalides, et accorda de grands encouragements à la culture du sol, afin d'acquitter disait-elle, une dette envers les créanciers de l'État et d'arroser l'arbre à sa racine; mais après s'être consumée à la défense patriotique du territoire national, elle périt en léguant le soc de la charrue à Napoléon Ier qui le convertit en sabre.
Cependant l'Empereur, à la fin de son règne, reposa son œil d'aigle sur les terres en friche qu'il chercha à féconder. Les propriétés communales, représentant en, 1813 un capital de 370 millions, produisaient huit à neuf millions de revenus seulement.347
Les Bourbons et Louis-Philippe payèrent ensuite, comme de coutume, l'agriculture de promesses, mais ils songèrent si peu à les tenir que, sous le gouvernement de Juillet, la septième partie du territoire était inculte en France et qu'on y comptait sept millions d'hectares de terres vaines et vagues.348 Cet état de choses fit pousser de nombreux cris d'alarmes en 1848 sur l'abandon de notre sol; Pierre Leroux évalua alors à la chambre jusqu'à douze millions d'hectares nos terres incultes.349
Cet aperçu succinct suffit à démontrer l'urgence d'une impulsion à donner à la culture du sol. Sans doute le gouvernement actuel la protége, si l'on compare son action à celle des gouvernements antérieurs, mais on peut affirmer que cette action est nulle si l'on considère l'infériorité que notre organisation sociale laisse à l'agriculture. L'enseignement agricole a-t-il reçu jusqu'à présent autant d'encouragements que l'enseignement professionnel, que l'étude du latin et du grec? Comptons-nous autant de fermes-écoles que de colléges? Encore une partie de nos institutions agricoles ont-elles été fondées par l'initiative privée, comme l'Institut de Roville et la ferme expérimentale, œuvres de Mathieu de Dombasle. Après soixante ans de promesses et d'essais, nous ne savons pas seulement protéger l'agriculture; nous nous demandons quelle est l'utilité des fermes-écoles; l'État en est venu à faire un champ de manœuvres militaires de la ferme-école de Versailles, et la plaine féconde de Satory est foulée aux pieds des chevaux de manége. Lorsque le fils du cultivateur obtient protection sociale, n'est-ce pas aussi pour traduire, à grand renfort de contre-sens, l'agriculture des Géorgiques ou d'Hésiode?
On ne peut nier que la science agricole n'exige des études préalables comme les professions industrielles ou artistiques; cependant tout y est laissé à la routine et à l'arbitraire, quoique l'agriculture occupe un beaucoup plus grand nombre de bras que l'industrie, qui a presque exclusivement des représentants dans nos conseils généraux et dans nos dignités sociales.
On ne pourra parler de protection sérieuse pour l'agriculture tant qu'elle ne sera pas dégrevée de cet écrasant impôt qui, par la conscription et l'exonération militaire, lui enlève en moyenne soixante-six hommes sur cent; il est prouvé qu'un très-petit nombre de ces villageois retournent au foyer pour y reprendre leurs anciens travaux, et parmi les cultivateurs qui veulent conserver leurs fils, on en voit bon nombre qui se sont appauvris pour payer trois mille francs d'exonération militaire. D'un autre côté, l'agriculture qui supporte la plus grande partie des charges publiques, reçoit à peu près le cent huitième de notre budget; elle y est inscrite pour un million ou douze cent mille francs, y compris la rétribution du personnel employé à lui distribuer les centimes qu'on lui accorde.350
Ces fonds destinés à l'encouragement de l'agriculture paraissent dérisoires, surtout si on les met en regard des sept cent millions de budget de notre paix armée et des emprunts que nécessitent nos guerres. On se demande aussi avec tristesse si nos progrès dans l'art de tuer, si les conquêtes qu'il fait chaque jour sur l'art de nourrir, sont le dernier mot de la civilisation.
Oserait-on encore parler de la protection donnée à l'agriculture devant les subventions de nos théâtres et la création ruineuse du nouvel Opéra, lorsque notre sollicitude pour la subsistance de quelques millions de cultivateurs et l'alimentation de trente-six millions de Français n'approche pas de celle que nous accordons dans une seule ville à l'amusement d'un petit nombre d'opulents oisifs et d'étrangers corrupteurs qui ne retrancheraient cependant rien à leurs plaisirs s'ils étaient chargés de payer intégralement les danseuses qu'ils consomment.
Le régime militaire, si contraire aux développements de la vraie, civilisation, est tellement à l'ordre du jour que les fils d'empereurs sont réduits à naître caporaux.
Quand l'industrie avait besoin d'encouragements en France, les enfants de nos rois exerçaient une profession mécanique, et notre siècle les baptise troupiers. Est-ce donc un grand progrès d'entendre crier pour deux sous, sur la voie publique, le portrait du prince impérial dans son costume de caporal de la garde, et de chercher le front de cet intéressant enfant déguisé sous un affreux bonnet de sapeur, qui semble écraser sa pensée naissante, et en faire un automate ébahi devant la supériorité du pantalon rouge. Oh! qu'il vaudrait mieux voir cet enfant peint en jaquette, le rateau à la main, s'exercer dans le jardin des Tuileries à un art qui lui ferait tenir à honneur de présider plutôt les fêtes de l'agriculture que les revues militaires, et de tenir lui-même le manche de la charrue, comme l'empereur de la Chine. Lorsqu'on n'a qu'un fils, dont le choix de carrière n'est pas borné, il est regrettable qu'on le classe parmi les caporaux.
Pour les honneurs sociaux, nous voyons la même primauté accordée par le budget à l'art de détruire sur l'art de nourrir. Les décorations, les médailles et les pensions militaires absorbent chaque année une forte somme; mais la médaille créée naguère pour l'agriculture est purement honorifique, quoique nos paysans prisent fort peu lés honneurs sans profit.
Nous marcherons seulement, je crois, dans la voie du vrai progrès quand nos agriculteurs trouveront autant d'écoles gratuites et spéciales que nos soldats; quand ils auront comme eux, ou plutôt avant eux, la préséance dans nos musées, dans nos établissements publics; quand nos chemins de fer feront au transport de leurs denrées les mêmes remises qu'aux produits industriels, et à leurs déplacements les 75 pour cent de rabais que les soldats reçoivent pour leurs voyages d'agrément, si moralisateurs d'ordinaire.
L'agriculture pourrait peut-être de cette manière lutter à armes égales contre l'industrie, et le manche de la charrue s'ennoblirait comme la garde de l'épée.
Si nous considérons l'état de l'agriculture en Europe, nous comprendrons mieux encore l'insuffisance de la protection que nous lui accordons; sur un même espace de territoire, nous produisons deux fois moins de blé et quatre fois moins de viande que la Belgique, l'Allemagne et l'Angleterre. Tandis que nous laissons en jachère des terrains dont certaines parties offrent sept et huit pieds d'humus, l'Angleterre change en fermes productives les plus arides bruyères de l'Ecosse, et par la fécondation de son territoire ingrat, elle nous montre quelles ressources nous offre un sol beaucoup plus étendu et plus fertile; quel parti nous pourrions tirer de cette Algérie, autrefois grenier de Rome, où, selon l'expression satirique de nos voisins d'outre-Manche, nous ne faisons pousser actuellement que des sabres.
Fénelon va jusqu'à affirmer que la terre mieux cultivée nourrirait cent fois plus d'hommes qu'elle n'en nourrit,351 mais le morcellement ou plutôt l'émiettement de notre sol, s'opposera aux progrès de l'agriculture, tant que l'association des bras et des capitaux ne permettra point aux exploiteurs du sol d'arriver au bien-être et à l'indépendance qu'offrent un grand nombre de carrières industrielles et artistiques.352
L'Autriche souffrait comme nous du morcellement indéfini de la terre, de l'exubérance des solliciteurs sans emploi et de l'affluence trop grande des sujets dans les carrières intellectuelles; le gouvernement, qui se préoccupa vivement de cet état de choses, accorda une faveur marquée à l'instruction agricole sur l'instruction classique, et bientôt les médecins trouvèrent des malades, les avocats des clients; chaque homme une place et chaque place un homme.353
Dans l'état de division de notre sol, il est clair que le possesseur de quelques-unes de ces parcelles territoriales ne peut vivre du produit de leur exploitation, et qu'un grand nombre de cultivateurs et de mercenaires ne sont employés que temporairement à la culture. D'un autre côté, la culture exige un matériel plus ou moins dispendieux; des mercenaires au temps des récoltes, du bétail toute l'année, un vaste emplacement pour les denrées, etc. Il faut cultiver sur une assez grande échelle déjà pour donner un emploi constant à ces matériaux de travail, dont la valeur seule suffirait à construire, dans nos villes, des établissements industriels beaucoup plus lucratifs, et soumis à bien moins de hasards que les vicissitudes des saisons n'en apportent à l'agriculture. Si l'on compare les fortunes rapides créées par l'industrie et l'agiotage au faible revenu de la terre; la parcimonie, la sobriété, l'activité incessantes du laboureur qui déchire les entrailles du sol, à l'opulente oisiveté d'un parvenu qui, après avoir été chercher fortune à la ville, étale devant ses compatriotes sa morgue et sa supériorité, on comprend la priorité que notre organisation sociale donne à l'industrie sur l'agriculture dans la répartition de la richesse publique. Le prix de la main-d'œuvre qui a subi une hausse excessive dans nos campagnes, vu la rareté des bras, est devenu très-nuisible à l'agriculture, sans que cette élévation de salaire offre aux mercenaires les mêmes avantages que l'industrie urbaine, car le travail agricole se trouve soumis à des chômages longs et certains; il est à peine assuré dans les temps de fenaison, de moisson, et pour quelques contrées, dans ceux de vendange; la stagnation est complète en hiver, surtout depuis que les mécaniques ont supprimé le battage du grain au fléau.
Quoique l'agriculture ait pris part à la prospérité publique, la position des petits fermiers, des modestes propriétaires est surtout digne d'une attention sérieuse, depuis que l'élévation du prix de la main-d'œuvre les met souvent dans l'impossibilité de satisfaire à leurs engagements. Ainsi, selon qu'on considère la grande culture ou la petite, tout est vrai dans les peintures opposées que l'on fait du progrès ou de la décadence de notre agriculture. Les orateurs des comices agricoles invoquent souvent le portrait que fit Labruyère des laboureurs de son temps, pour montrer qu'aucun trait de ce sombre tableau ne peut s'appliquer aux habitants de nos riches campagnes; néanmoins il n'est nullement impossible de rencontrer aujourd'hui, même sans les chercher, ces animaux farouches, mâles et femelles qu'a vus Labruyère; ils habitent encore nos contrées pauvres et montagneuses; ils ne se trouvent pas, il est vrai, parmi les gros bonnets du village qui ont remporté un prix ou une mention honorable au comice agricole; ni parmi ceux qui, ayant cinq francs pour y payer leur écot au dîner, dogmatisent dans le haut bout de la table; ni peut-être dans la classe des valets de ferme qui, ce jour-là, se sont endimanchés et ont profité d'une occasion prévue depuis six mois pour laver leurs mains crasseuses dans le baquet de leurs chevaux; mais j'irai chercher, à la campagne, avec Labruyère, n'importe à quel jour et à quelle heure, ce mercenaire ou ce fermier qui, sur une propriété de trois, de deux cents et de cent cinquante francs même de redevance annuelle, doit subvenir à l'entretien d'une nombreuse famille. Je contemplerai quelques-uns de ces deux millions six cent mille ménages, comprenant environ treize millions d'individus, qui se font chaque année un revenu moyen de cinquante francs pur l'exploitation de leurs propriétés, et je les trouverai tout aussi noirs, livides et bridés du soleil, attachés à la terre qu'ils fouillent et remuent avec une opiniâtreté invincible, qu'ils l'étaient il y a deux cents ans; ils ont, comme alors, une voix articulée, et quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face humaine; en effet, ils sont hommes. Je veux bien, sur la foi du moraliste, leur supposer cette parenté avec le genre humain, car je n'ai pu saisir le sens d'une seule de leurs paroles; ils m'ont parlé un patois bas-breton, auvergnat, périgordin, alsacien aussi intelligible que celui de l'orang-outang.
Allons dans leurs étroites chaumières remuer la paille humide qui leur sert de couche; contemplons ce rustre qui dort avec ses bœufs et partage leur litière souillée; goûtons ce composé terreux de seigle et d'avoine que ces êtres appellent du pain, et nous pourrons terminer avec le moraliste de mauvaise humeur, en disant: Ils se retirent la nuit dans des tanières, où ils vivent de pain noir, d'eau et de racines; ils épargnent aux autres hommes la peine de semer, de labourer et de recueillir pour vivre, et méritent ainsi de ne pas manquer de ce pain qu'ils ont semé.
Si l'on voulait, du reste, opposer tableau à tableau, on se convaincrait que le portrait du cultivateur, fait en 1814 par l'abbé Grégoire, peut être le pendant de celui de Labruyère. « On voit, dit-il, souvent ceux qui font croître les moissons en proie à la misère; ceux qui fournissent aux riches le pain blanc, réduits à manger le son, et ceux qui cultivent la vigne, réduits à s'abreuver d'eau. »
Nous savons que, depuis cette époque, si on a fait beaucoup de promesses au laboureur, on lui a encore envoyé un plus grand nombre d'avertissements et de contraintes, afin de lui arracher par l'impôt le fruit de ses sueurs. Pour résumer la question, on peut dire qu'aucune loi n'empêchera jamais l'homme d'aller où son intérêt l'attire, et son intérêt l'éloignera des campagnes tant que des conditions meilleures de subsistances ne seront pas attachées à la culture du sol. Il ne faut pas se dissimuler toutefois que le bien-être de l'agriculture tient à la réforme de nos mœurs, qui cherchent aujourd'hui les' spéculations hasardeuses, les jouissances hâtives, seules capables de satisfaire des besoins factices. Il en fut de même dans l'empire romain, quoique différents empereurs, très préoccupés du sort des campagnes, eussent cédé toutes les terres incultes de l'Italie et des provinces à ceux qui s'engageaient à les défricher, et les eussent exempté d'impôts et de redevances pendant dix ans. La corruption des mœurs faisant fuir dans les villes la vie austère des villages, les descendants des Cincinnatus et des Régulus abandonnèrent la culture du sol à des mains mercenaires; alors la terre, selon l'expression énergique de Pline, ressentant cet affront, ne multiplia plus sa force productive dès qu'elle eut perdu ses honneurs.
L'infériorité relative de l'agriculture, le faible rapport des capitaux qu'elle emploie, ont vivement préoccupé les hommes qui s'occupent d'économie sociale; J.-B. Say entre autres, déplore de voir que les 90 millions du fonds capital de la Banque de France, aient été absorbés par des guerres ruineuses, tellement stériles que la restitution des capitaux de la Banque repose sur le bon vouloir du gouvernement.
Si ces sommes, dit-il, avaient été prêtées aux agriculteurs français qui se seraient chargés d'améliorer les terres et de s'acquitter par annuité de leur dette, ces rentrées annuelles de fonds auraient fourni les moyens de fertiliser chaque année de nouvelles terres.354
L'économiste précité voudrait voir aussi le taux commun des fermages comprendre une espèce de garantie, de prime d'assurance payée par le propriétaire au fermier, lorsqu'il éprouve des dommages par suite de fléaux naturels, comme la grêle et la gelée, ou des calamités sociales, comme la guerre, les réquisitions, les impôts.355
Il est de fait que l'étude des meilleurs moyens de venir en aide à l'agriculture est fort digne de toute la sollicitude des économistes; la plus grande partie des terres improductives appartient aux communes, car nous avons des communes rurales fort riches en territoire; elles en laissent une partie en jachère et livrent l'autre aux habitants qui ne savent pas l'utiliser ou la ruinent à qui mieux jusqu'à l'extinction de la jouissance temporaire qu'on leur a concédée; ceux d'entre eux qui ne peuvent exploiter par eux-mêmes laissent à leur tour le champ en friche parce qu'ils ne peuvent point supporter les frais de culture et d'ensemencement par intermédiaires.
L'enquête faite par l'État en 1860, nous a appris que nos communes possèdent près de cinq millions d'hectares de terrains estimés à un milliard six cent vingt millions, parmi lesquels près de trois millions d'hectares se composent de marais, de terres vaines et vagues, de landes, de bruyères et de pâtures. Ces terrains sont estimés à cent francs l'hectare et leur revenu à huit millions de francs, ce qui donne une moyenne de moins de trois francs de rapport par hectare.
Nos préfets ont fait depuis cette époque des appels aux conseils d'arrondissements pour leur demander leur avis sur la meilleure utilisation de ces biens, mais la question est encore pendante; elle ne pourra avoir de solution favorable tant que la centralisation administrative paralysera l'élan de l'initiative municipale, car les moyens de fécondation sont aussi variés que la nature du sol et que l'aptitude des habitants; ces moyens se présenteraient d'eux-mêmes si l'intérêt individuel ou municipal était en jeu. Ici, il faudrait boiser tel coteau; là, tel sol sablonneux propre à la culture de la pomme de terre deviendrait d'un grand rapport, vu la valeur que ce tubercule, même gâté, acquiert dans la fécule pour les opérations industrielles. Ailleurs, l'agglomération des terrains permettrait de construire des fermes, d'employer ici l'irrigation et plus loin le drainage. Malheureusement nous trouvons partout la main de l'État, dans les dunes de Gascogne, dans la Sologne, dans les Landes, etc.; son action sera funeste s'il ne cède pas les terrains pour livrer le travail à des défricheurs isolés, car en général les entreprises gouvernementales sont fort mal conduites, parce qu'elles nécessitent trop d'agents et entraînent des frais considérables. L'action universelle, d'un pouvoir qui ne saurait aviser à tout, est surtout fâcheuse sous les gouvernements absolus, contraints quelquefois de donner Tibère pour successeur à Auguste; si l'impulsion de l'État vient à manquer à un moment donné, les peuples, qui ont désappris l'initiative personnelle, ressemblent à des paralytiques incapables de se donner du mouvement dès que les bras étrangers leur retirent leur appui. Toutefois l'action de l'État deviendrait bienfaisante s'il livrait des terres à fertiliser à nos soldats qui exécutent tant de marches et de contremarches inutiles.
Les économistes ont déjà calculé que l'État, en s'imposant des avances onéreuses pour l'utilisation des biens communaux, emploiera environ trois mille ans pour rendre à la culture trois millions d'hectares de terres vaines et vagues, s'il en fait défricher un millier par an.356
A côté de ces biens communaux, bon nombre de terres en friche appartiennent à des particuliers, et les landes attristent l'œil jusque dans les environs de Paris. C'est surtout dans les terrains de nos départements montagneux ou de nos pays pauvres, comme la Bretagne, qu'on trouve un grand nombre de terres à défricher; l'exploitation de la grande propriété y commence, mais la petite reste encore inculte, lorsque les propriétaires sont trop pauvres pour faire les frais d'amélioration.
Je demandais à un propriétaire breton, qui déplorait de voir une si grande partie de sa province en friche, quels seraient les meilleurs moyens d'en généraliser la culture» Dès que l'action de l'État, me répondit-il, est admise, et que l'expropriation, loin d'être prévue et réglée par les lois, comme aux États-Unis, reste une mesure administrative, l'État peut inviter le propriétaire d'un sol en friche à le cultiver ou à le vendre, sinon la loi d'expropriation pour cause d'utilité publique doit frapper les récalcitrants, car l'expropriation est plus nécessaire pour la fertilisation des campagnes que pour l'alignement des villes.
Quelles que soient les applications qu'on donne à cette idée, il est à désirer que des capitalistes et des actionnaires oisifs n'entrent pas seuls dans les associations agricoles, où les terres ainsi cédées pourraient être livrées directement à des travailleurs intelligents, que le Crédit foncier aiderait de ses avances. Les progrès généraux de l'agriculture tiennent donc à la régénération des mœurs et à l'association des travailleurs; mais le droit de tester laissé au père de famille peut seul, comme je l'ai démontré, combattre d'une manière efficace le morcellement de la propriété privée qui se trouve grevée de charges à chaque partage nouveau.
Une protection éclairée de l'agriculture hâterait l'avénement de cette sainte époque de fraternité des peuples, où le sabre sera converti en faucille; où ces milliers de jeunes gens qui, enrégimentés en temps de paix avec la mission sociale de corrompre les villes et de porter leur infection dans les villages, seront enrôlés et soldés pour l'art de féconder les guérets, et recevront dans les fermes-écoles, au milieu des plaines fertilisées par leurs sueurs, les encouragements et les honneurs sociaux conquis presque exclusivement aujourd'hui sur ces champs de carnage où triomphe la mort.357
Une autre cause de désertion des campagnes et de malaise social, tient à l'accumulation dans nos grandes villes et à Paris surtout, des éléments de science disséminés autrefois dans les couvents. Leurs riches bibliothèques ont été, à la Révolution, enrichir les cités; il arrive ainsi que le savant laborieux, le compilateur intelligent, l'auteur qui doit s'éclairer par des recherches, ne peuvent trouver leurs matériaux d'étude que dans les centres populeux.
De là, les hommes qui vivent de la vie intellectuelle subissent le séjour des villes ou y aspirent. Voltaire nous apprend au contraire, qu'il alla s'enfermer, au fond des Vosges, pour jouir de la précieuse bibliothèque de Senones qui, plus tard encore, fit quitter à M. de Narbonne la ville de Strasbourg, sa résidence militaire. Si donc une protection éclairée de l'agriculture, la création de la vie morale et intellectuelle dans nos campagnes y amenaient plus d'aisance avec moins de dépravation, nous verrions l'industrie de la librairie y prendre une extension considérable et occuper un grand nombre de bras dans nos petites villes de province.
Cette répartition équitable de la richesse publique, donnant à tous une plus grande part à la consommation générale, laisserait un vaste champ aux industries d'objets indispensables, et leur permettrait d'occuper une foule d'ouvriers. Ainsi que de bonnetiers, de sabotiers, de tanneurs et de cordonniers en mouvement, si tous les Français qui sont réduits à marcher pieds nus pouvaient acheter des chaussures! Ne craignons donc pas l'excès de population, lorsque les trois quarts du globe sont à défricher; gardons-nous de redouter le nombre des citoyens actifs et vertueux, dont le patriotisme est un bouclier invulnérable contre les traits des ennemis.
On m'a opposé une foule d'autres objections qui prouvent une ignorance si complète des conditions économiques dans lesquelles la femme se trouve, que je crois inutile de les réfuter directement, parce que je m'occupe beaucoup plus du sexe qu'on opprime que dé celui qu'on adore.
Mentionnons toutefois les antagonistes qui me reprochent mes sympathies pour le cloître asile, repaire d'immoralité, refuge de victimes, et me demandent si je regrette ces personnes se dérobant dans une oisiveté stérile aux obligations imposées par le monde à toute femme qui sait comprendre et remplir sa mission.
Je sais que les annales des couvents ne sont pas fort édifiantes au xviie et au xviiie siècle surtout, parce que l'ambition, le luxe et la mode y avaient remplacé la foi, la vocation et l'amour de l'étude qui précipitèrent tant de grandes âmes dans les cloîtres pendant la' barbarie du moyen âge. Bassompierre, dans ses mémoires, ne nous montre pas des mœurs très-austères en nous donnant quelques anecdotes sur la vie de ses cousines dames, coadjutrices et abbesses. Racine, dans son histoire de Port-Royal, ne nous présente point non plus comme un modèle l'abbesse de Maubuisson, sœur de M"me Gabrielle d'Estrées.
Les amateurs de scandale peuvent même assister à l'accouchement d'une abbesse, raconté de la manière la plus plaisante, la plus originale et la moins charitable possible par le duc de Saint-Simon; s'ils y tiennent, je leur chercherai le volume et la page; lorsque nous l'aurons lue ensemble, je maintiendrai que, malgré les anciens abus, la position de la femme sans fortune était plus morale et blessait moins la justice au-XVIIIe siècle qu'au xixe.
Cette assertion signifie-t-elle que je regrette l'ordre de choses disparu? Je suis si loin de le réclamer, que je demande précisément, comme mes antagonistes, que la société donne des obligations et des devoirs à la femme dans les carrières de son choix. D'ailleurs, il faut montrer surtout dans l'ancien cloître des richesses enlevées à la femme par la centralisation qui ne lui en a fourni aucun dédommagement, au moment même où une nouvelle organisation sociale la chargeait du soin de sa subsistance personnelle et de celle de l'enfant. Il n'est pas besoin d'une grande pénétration pour comprendre qu'un régime semblable est faux, et partant impossible, parce qu'il détruit toute pondération entre le devoir des forts et le droit des faibles. Si donc les richesses accumulées par la libéralité de l'ancienne France, pour la dotation des jeunes filles et pour leur subsistance dans le cloître, eussent été respectées par l'État, elles alimenteraient aujourd'hui, dans chaque département, de nombreuses écoles professionnelles, des sociétés de patronage propres à préserver la France de la décadence où la précipite son injustice.
En énumérant les objections opposées à l'amélioration du sort de la femme, il ne faut point passer sous silence les nombreuses sympathies que lui accordent les esprits généreux, les hommes éminents qui ont montré toute la gravité de la question en réclamant l'égalité de salaire devant l'égalité de services. Ces nobles protestations parties de si haut contre l'oppression des faibles, étoufferont toutes les protestations hostiles et resteront l'immortel honneur de notre siècle.358
Quoique j'eusse aimé à terminer par des paroles de gratitude, je m'arrêterai cependant sur un autre genre d'objection qui met en cause le gouvernement actuel, et prétend que sa solidarité avec Napoléon Ier doit le rendre hostile à l'émancipation féminine. A ce sujet, quelques personnes croient avoir tout dit, en citant la réponse cavalière de Napoléon Ier à Mme de Staël, sur la mission sociale de la femme.
Comme je traite une question de justice et d'humanité, indépendante de toutes les formes de pouvoir, j'avoue que je n'ai pas songé qu'un moment fût plus opportun qu'un autre pour élever la voix.
Si je cherche même à appliquer au sujet que je traite la fameuse réponse de Napoléon Ier, je trouve parmi les femmes perdues et tombées, celles qui ont suivi trop à la lettre les vues de l'Empereur sur leur mission, et nous savons combien il fut indulgent pour elles en traînant la maternité aux gémonies et en les accablant sous le faix de l'enfance dans le Code qui consacre leur ruine.
Un examen de l'état social au commencement du siècle nous a démontré que notre prolétariat, résultat surtout de l'oppression de la femme et de l'enfant, n'existait pas sous Napoléon Ier, parce que des circonstances exceptionnelles retardèrent les funestes effets du manque de solidarité morale entre les sexes; nous avons vu ce prolétariat naître des guerres de l'Empereur, qui laissèrent, à l'époque de sa déchéance, un grand nombre de veuves, d'orphelins sans appui, et de filles nécessiteuses sans espoir de mariage.
Cette plaie sociale fut même invoquée contre l'Empereur à sa chute; la municipalité parisienne s'exprimait ainsi à ce sujet, dans une proclamation aux habitants de Paris: « Que nous parle-t-on de ses victoires passées! quel bien nous ont fait ces funestes victoires? La haine des peuples, les larmes de nos familles, le célibat forcé de nos filles, la ruine de toutes les fortunes, le veuvage prématuré de nos femmes, le désespoir des pères et des mères, à qui, d'une nombreuse postérité, il ne reste plus la main d'un enfant pour leur fermer les yeux. »359
En ce qui concerne la centralisation, il nous a fallu rétrograder encore jusqu'à Napoléon Ier afin de trouver les droits enlevés depuis cette époque, à la femme dans les emplois publics et dans notre enseignement secondaire.
Quant aux besoins individuels qui se manifestèrent sous son règne, Napoléon Ier soulagea avec générosité, et sans acception de sexe, tous ceux qu'il connut. L'histoire constatera sa munificence à l'égard des orphelines de la Légion d'honneur, et la liste de ses bienfaits envers les femmes serait longue à épuiser. Aux Cent Jours encore, pendant cette immortelle étape des Tuileries à Waterloo et à Sainte-Hélène, Napoléon Ier voulut, dit M. Villemain, assurer par ses bienfaits le repos et la dignité de vieillesse de Mme de Narbonne, pour les années qui lui restaient à vivre.360
Afin de comprendre la grandeur de cette noble préoccupation, au moment" où la couronne chancelait sur la tête de Napoléon Ier, il faut se rappeler que Mme de Narbonne avait manifesté les sentiments les plus hostiles pour l'Empereur et son gouvernement; elle était si connue par son opposition systématique à Napoléon qu'il avait été forcé de dire à M. de Narbonne: Il n'est pas bon pour mon service que vous voyiez trop souvent votre mère, on m'assure qu'elle ne m'aime pas. Mais Mme de Narbonne, qui venait de perdre son fils, était plongée dans l'affliction, et l'Empereur oublia ses ressentiments, s'oublia lui-même pour la secourir et la réduire au silence par ses bienfaits.361
Si nous devons rester dans le système funeste qui concentre toutes les écoles d'art, de sciences et de lettres entre les mains de l'État, il est de toute évidence que la centralisation, sans faire acception des sexes, doit favoriser toutes les intelligences et toutes les aptitudes, sous peine de fausser l'initiative individuelle, et par conséquent les lois de l'économie sociale. C'est sur ce point de vue, je crois, qu'il faut attirer l'attention des législateurs et des gouvernants qui ne comprennent pas encore toute la gravité de la question de subsistance des femmes, dont la solution est dans ces lois justes et ces mœurs équitables, appui des trônes en même temps que soutien des faibles. Si donc l'application des lois immuables de cette justice naturelle devait être entravée quelque temps encore par des préjugés étroits et hostiles, nous n'en fixerions pas moins avec confiance l'œil sur l'avenir, en nous disant que les gouvernements sont éphémères comme toutes les œuvres des hommes, tandis que la vérité est éternelle comme tout ce qui émane de Dieu.
Les conquêtes glorieuses que nous avons à faire sur la misère, sur l'immoralité et le vice tiennent presque toutes aux graves questions soulevées ici; s'il devait donc venir, s'il était réellement venu ce gouvernement qui veut exclusivement le bien, s'il dirigeait ses efforts incessants vers la diminution des crimes qui contristent notre civilisation, si ses mesures énergiques et sa législation protectrice préservaient les faibles des spéculations les plus hideuses, s'il rachetait de la mort la maternité et l'enfance en protégeant jusque dans le sein des mères le tendre fruit de leurs entrailles; hommes de tous les partis, vous le salueriez de vos acclamations sympathiques; chantres de l'avenir, vous porteriez sa gloire aux âges les plus reculés; drapeaux de toutes les couleurs, vous vous inclineriez avec respect devant lui, car il serait la personnification de la justice, de la liberté, de la morale; il hâterait l'avénement de ce règne de Dieu que nous invoquons tous.
Mon Dieu, que votre règne arrive!
FIN.
62.Clément on "Complete Liberty of Education" (1867)↩
[Word Length: 5,128]
Source
Ambroise Clément, Essai sur la science sociale. Économie politique, morale expérimentale, politique théorique, (Paris: Guillaumin, 1867). Volume 2.
Troisième partie. La politique théorique.
Chapitre IV. Libertés de l'enseignement et de la presse.
III. — EXAMEN COMPARATIF DES CONSÉQUENCES DE LA RÉGIE DE L'ENSEIGNEMENT PAR L'AUTORITÉ, ET DES RÉSULTATS PROBABLES DE LA LIBERTÉ. pp. 363-79.
III. — EXAMEN COMPARATIF DES CONSÉQUENCES DE LA RÉGIE DE L'ENSEIGNEMENT PAR L'AUTORITÉ, ET DES RÉSULTATS PROBABLES DE LA LIBERTÉ.
Les résultats généraux de la direction de l'enseignement par l'État, telle qu'elle fonctionne en France, sont assurément, — nous l'avons assez montré dans le cours de cet ouvrage, — des moins satisfaisants sous tous les rapports; non-seulement les programmes imposés à l'enseignement secondaire et supérieur, répondent aussi mal que possible aux besoins actuels des sociétés avancées, et faussent déplorablement la culture intellectuelle des classes les plus influentes de notre population; mais encore, ce que l'enseignement officiel peut renfermer d'utile, ne fait aucun progrès et ne se répand que très-lentement.
Ainsi, par exemple, quels fruits retirons-nous de l'immense appareil administratif que nous avons organisé pour l'instruction primaire, et des sacrifices que cette organisation impose aux familles, aux communes et à l'État? La moitié à peu près de notre population reste sans aucune notion de la lecture, de l'écriture et de l'arithmétique, et un cinquième à peine possède ces notions à un degré suffisant pour en faire d'utiles applications. N'est-ce pas là un résultat véritablement désespérant?
Lorsque l'on veut expliquer un aussi triste insuccès, on se garde bien de l'attribuer aux vices du régime: on allègue l'insuffisance du nombre des écoles, — les grandes distances que, dans la plupart de nos communes rurales, les enfants ont à parcourir pour s'y rendre, — l'ignorance ou l'indifférence de la masse de nos cultivateurs qui, non-seulement ne veulent pas payer la rétribution scolaire, alors même qu'ils en ont la possibilité, mais refusent de se priver de l'aide de leurs enfants dès que ceux-ci sont en âge de leur rendre le moindre service. On ne voit à cette situation d'autres remèdes que l'extension aussi considérable que possible du régime établi, la multiplication des écoles communales et des instituteurs brevetés, et quelques centaines de millions à ajouter aux contributions publiques, afin de rendre l'instruction primaire gratuite et obligatoire sur tous les points du pays.
De semblables propositions obtiennent facilement chez nous une grande popularité, tant nos institutions, et surtout notre système d'enseignement, nous ont façonnés à nous prêter à l'absorption indéfinie de l'action individuelle par celle de l'État, et même à la provoquer, à l'étendre à tout propos. Ainsi, nous nous apercevons que la régie gouvernementale de l'instruction primaire ne donne généralement que de pitoyables résultats: ce serait pour le bon sens une raison décisive de ne plus croire à l'efficacité de cette régie et d'y substituer la liberté; mais le bon sens nous paraît chose trop simple et trop vulgaire, et nous raisonnons tout autrement. En reconnaissant qu'ici la régie gouvernementale ne vaut rien et qu'elle le prouve depuis assez longtemps par ses œuvres, nous concluons sans hésiter qu'il faut renforcer cette régie, lui confier une part décuple de nos ressources, et l'armer de moyens de contrainte, de pénalités pécuniaires ou personnelles contre les chefs de famille qui n'enverraient pas régulièrement et pendant tout le temps voulu, leurs enfants aux écoles publiques.
Cependant il est fort probable que si, en cherchant les moyens de répandre l'instruction élémentaire beaucoup plus que ne l'a fait jusqu'ici la gestion de l'autorité, on eût songé à la liberté, on aurait facilement reconnu que le premier et le le plus efficace de ces moyens, consisterait à affranchir absolument de toute entrave, de toute restriction ou prescription légale, les arrangements à intervenir entre ceux qui veulent donner cette instruction et ceux qui veulent l'obtenir pour eux ou pour leur enfants.
Il n'y a pas, comme on le dit, chez la grande majorité des habitants de nos campagnes, non plus que chez celle des ouvriers des villes, mauvais vouloir ou indifférence relativement à l'instruction primaire; mais insuffisance de ressources et besoin de l'aide des enfants en âge de faire un service utile; il est vrai, d'ailleurs, que, pour les premiers, la plupart des enfants se trouvent trop éloignés du siége des écoles actuelles.
Les obstacles étant tels, quelles seraient, en dehors de l'assistance, les conditions les plus propres à les réduire? Ne serait-ce pas, d'abord, la plus grande modicité possible du prix des leçons? Ensuite, la libre fixation, entre les instituteurs et les familles, des époques, jours et heures où ces leçons pourraient être données, sans exclusion des jours de dimanche et de fête, ni des longues soirées de la moitié de l'année; enfin, la faculté, pour les instituteurs, de remplir leur mission soit au domicile des élèves, en s'y transportant successivement aux heures convenues, soit, — là où ils pourraient en réunir un nombre suffisant sans trop de déplacement, — dans des locaux affectés à cette destination?
Et que faudrait-il pour obtenir de semblables conditions? Pas autre chose que la liberté, c'est-à-dire, la faculté, affranchie de toute obligation d'autorisation préalable, pour tout individu, homme ou femme, voulant exercer l'enseignement, par intervalles, accidentellement ou pendant toute l'année, d'enseigner ce qu'il sait ou croit savoir, à tous autres individus, — enfants, adolescents, adultes, de l'un ou de l'autre sexe, ou même des deux sexes réunis, lorsque les familles le jugeraient convenable, dans les lieux, dans les temps et aux prix convenus entre les intéressés. Une telle liberté, reconnue et garantie à tous également, suffirait pour que l'enseignement élémentaire fût mis à la portée de toutes les familles, autant qu'il est possible d'y parvenir avec leurs propres ressources, et pour développer rapidement, chez les instituteurs, sous le stimulant d'une concurrence illimitée, toutes les aptitudes de nature à améliorer leurs services.
Si l'on doutait qu'un enseignement élémentaire placé dans de semblables conditions eût des chances de se propager largement et rapidement en France, ou qu'il se trouvât un nombre suffisant d'individus disposés à s'y vouer temporairement ou constamment, on pourrait consulter, sur ces deux points, les inspecteurs de l'instruction primaire; on en obtiendrait l'aveu que, pendant longtemps, ils ont été principalement occupés à poursuivre, à traquer les instituteurs et institutrices qui, dans les campagnes, les villages, même dans les villes, exerçaient comme nous venons de l'indiquer, sans brevet ni examen préalable, — et que cette mission emploie encore aujourd'hui une part notable de leur activité. Il paraît fort probable que le nombre des instituteurs des deux sexes ainsi empêchés, n'est pas moins considérable que celui des instituteurs en fonctions; en sorte que le premier effet de la liberté serait de doubler le nombre des personnes s'occupant à enseigner à lire, à écrire ou à compter.
Mais, dira-t-on, un enseignement élémentaire donné dans de pareilles conditions, serait assurément du degré le plus infime. En vérité, les résultats produits par lès dix-neuf vingtièmes de nos écoles officielles ou réglementées, ne sont pas de nature à motiver une grande exigence à cet égard, et nous attendrions beaucoup mieux de la liberté; il faudrait, en effet, que cette force salutaire, si féconde en merveilleux résultats dans tous les autres travaux. perdît absolument toute sa vertu dans ceux de l'enseignement, pour que son œuvre ne se montrât pas bientôt très-supérieure à celle de la réglementation.
Mais rien n'autorise à croire qu'elle n'eût pas, dans cette branche d'activité, toute la fécondité qu'elle montre dans les autres. La liberté rendrait à l'énergie individuelle tout son ressort, toutes les ressources, en quelque sorte infinies, qu'elle renferme virtuellement et qui ne sauraient se manifester tant qu'elle reste enchaînée; les instituteurs brevetés ne tarderaient pas à apporter dans leurs services des améliorations que le régime actuel leur interdit, et à en concevoir beaucoup d'autres dont ils ne se doutent pas aujourd'hui. Parmi les individus hors d'état maintenant d'obtenir un brevet, beaucoup développeraient en eux, par l'exercice, des aptitudes spéciales qui les rendraient propres à telle ou telle partie de l'enseignement, tout aussi bien ou mieux que ne le sont généralement les instituteurs actuellement autorisés; bref, la liberté et la concurrence élèveraient les services de chacun d'eux à toute la valeur qu'ils sont capables de leur donner, et les applications, les combinaisons de ces services, seraient adaptées le mieux possible aux convenances, extrêmement diverses et variables, de ceux qui ont à les recevoir. Aussi, croyons-nous pouvoir affirmer, en toute assurance, qu'avant dix années d'application du régime d'entière liberté que nous indiquons, le nombre des individus des deux sexes et de tout âge, recevant en France l'instruction élémentaire, serait incomparablement plus considérable qu'il ne l'est aujourd'hui, et qu'en somme, cet enseignement serait mieux entendu et plus fructueux que ne l'est, en moyenne, celui distribué par le régime actuel.
On dira peut-être encore que l'abandon de l'enseignement élémentaire par l'autorité le placerait infailliblement dans les mains des congrégations religieuses, des membres ou des agents de l'autorité catholique. Encore une fois nous entendons que la liberté des cultes devrait accompagner celle de l'enseignement, et avec cette condition, laissant les membres des différents clergés sans assistance ou faveurs spéciales de l'autorité, sans autre influence et autres ressources que celles qu'ils pourraient librement obtenir, par les voies légitimes de la persuasion, de la confiance inspirée aux familles, leur émulation, si elle se portait vers l'enseignement élémentaire, ne nous paraîtrait point à redouter, et nous y verrions au contraire un utile auxiliaire pour la propagation et le progrès de cet enseignement. En réclamant la liberté, nous n'entendons la priver d'aucun concours de nature à la rendre plus fructueuse; si elle est exclusive de celui de l'État ou de l'autorité, elle ne l'est nullement de celui de la société, et nous verrons plus loin, en traitant de l'assistance charitable, comment cette assistance pourrait venir en aide aux développements de l'enseignement libre du premier degré.
Avec la liberté, les divisions et les combinaisons actuelles de l'enseignement ne se maintiendraient probablement pas longtemps; elles tendraient davantage à se conformer à l'état des besoins chez les diverses classes de la population. La sphère de l'enseignement primaire, par exemple, c'est-à-dire, de l'instruction destinée au grand nombre, pourrait s'étendre, comme elle l'a fait en Angleterre et dans l'Union américaine, à une partie des matières comprises dans notre enseignement secondaire, et donner place, en outre, à des études sur les éléments essentiels d'autres branches d'instruction qui, jusqu'ici, n'ont pas eu place dans nos écoles, telles que la morale expérimentale. l'hygiène, l'économie politique, — des notions sur les institutions, les lois principales du pays, sur l'agriculture théorique, les arts manufacturiers, le commerce, etc.
De nombreux établissements libres pourraient être affectés à l'enseignement primaire ainsi grandi, surtout si, pour en faciliter la création dans les bourgs, les petites villes, partout où se trouverait une agglomération de population suffisante pour entretenir au moins une de ces écoles, on rendait facultative aux familles et aux instituteurs, la réunion des deux sexes dans un même établissement, réunion généralement pratiquée dans les écoles des États-Unis, le pays du monde où les rapports entre l'un et l'autre sexe sont le plus empreints de décence, de confiance et de convenance, précisément parce que l'on s'applique à les rendre tels de bonne heure, et que l'on comprend l'erreur grossière d'un système d'éducation, qui maintient le plus possible les filles et les garçons étrangers les uns aux autres jusqu'à l'âge où l'effervescence de la jeunesse, que n'ont point disciplinée des habitudes contractées dès l'enfance et constamment entretenues, peut rendre dangereuses leurs premières relations.
Notre enseignement secondaire ne produit pas de meilleurs fruits que celui des degrés inférieurs. S'appliquant surtout aux études latines, il ne parvient à former, de l'aveu des professeurs, qu'un très-petit nombre de latinistes sérieusement instruits, à peine deux ou trois pour cent du nombre total des jeunes gens ayant passé par nos lycées ou nos colléges; — et si tel est le résultat, quant à la partie des études la plus cultivée, à celle qui absorbe la plus grande part du travail des professeurs et des élèves, on peut juger de ce qu'il doit être quant aux autres études, pratiquées beaucoup plus superficiellement.
En général, les élèves qui ont suivi avec quelque succès toutes les parties de l'enseignement secondaire, pleins de sentiments puisés aux sources de l'antiquité grecque et romaine, ou dans les autres notions philosophiques, historiques ou morales qu'ils reçoivent, sortent des établissements avec de grandes prétentions au savoir, et des dispositions répulsives ou dédaigneuses pour les différents labeurs de la production générale, trop humbles ou trop vulgaires à leurs yeux pour répondre à la noblesse de leurs aspirations; ce qui les attire surtout, c'est la gloire, la gloire littéraire, artistique, et plus généralement, celle que l'on peut acquérir par les armes ou celle que peut donner la domination; ils sont parfaitement préparés à admirer ou à poursuivre toutes les fausses grandeurs; mais ils n'ont à peu près rien appris de ce qu'il leur importerait le plus de savoir pour remplir dignement une mission utile dans la société où ils sont appelés à vivre; car, ils sont aussi étrangers à son organisation, à ses institutions, à ses besoins, à ses travaux, que le seraient d'anciens Romains de la République ou de l'Empire, ou d'anciens Grecs de Sparte ou d'Athènes, s'ils pouvaient revivre parmi nous; aussi la plupart d'entre eux, contraints par les nécessités de leur position de s'occuper de choses qui n'ont plus le moindre rapport avec les objets de l'enseignement qu'on leur a donné, ou reconnaissant que la vie réelle réclame de tout autres préoccupations, oublient-ils plus ou moins, après quelques années, ce qu'ils avaient retenu de cet enseignement.
Ce sont là des faits avérés, incontestables, connus de tout le monde, ce qui n'empêche pas qu'il y ait à peu près unanimité pour maintenir le régime qui les produit.
Nos facultés de lettres et de sciences, principalement consacrées à la littérature, à la philosophie, à l'histoire, etc., constituent plutôt un prétexte à amplifications oratoires qu'un enseignement sérieux; car, elles n'ont pour ainsi dire point d'élèves, point d'auditeurs assidus et réguliers, si ce n'est le très-petit nombre de ceux qui se proposent de remplacer un jour les professeurs actuels; la masse des autres auditeurs se renouvelle sans cesse; bien peu suivent un cours particulier dans l'objet d'acquérir les connaissances que l'on peut y puiser; ils vont d'un cours à l'autre, à leurs moments perdus, et, comme à un spectacle, un moyen de distraction.
Il n'en est point ainsi sans doute des facultés de droit, de médecine ou de théologie: leurs enseignements sont nécessairement suivis par tous ceux qui se destinent aux professions qu'ils concernent, et que l'on ne peut exercer sans avoir obtenu les grades de licencié ou de docteur; mais il est à croire qu'un enseignement libre donnerait de meilleurs fruits en moins de temps.
Avec des professeurs nommés, rétribués, dirigés en partie par l'autorité dont ils attendent leur avancement, et soustraits ainsi au stimulant de la concurrence, — si nécessaire à l'amélioration des services, — l'apprentissage des professions dont il s'agit est fort long, comme l'était sous notre ancien régime réglementaire l'apprentissage des ouvriers ou artisans; aujourd'hui, et sous un régime de liberté, la formation de ces derniers à des aptitudes généralement plus perfectionnées, plus difficiles à acquérir qu'elles ne l'étaient vers le milieu du XVIIe siècle, n'exige pas, en moyenne, la moitié du temps qu'on y consacrait alors; il est donc probable que le même régime, appliqué à l'acquisition des connaissances et des aptitudes nécessaires aux professions de médecin, d'avocat, de légiste, etc., n'aurait pas moins d'efficacité.
Il est assez remarquable que l'ancienne Rome n'a point eu d'école publique de droit, placée sous la direction de l'autorité, et que ces jurisconsultes, dont les travaux ont fourni la plupart des principes et des règles du droit commun à toutes les législations civiles de l'Europe, s'étaient formés par un enseignement libre.
La régie gouvernementale de l'enseignement du droit paraît avoir, en France, un autre résultat fâcheux; c'est de rendre la science du droit théorique ou rationnel, à peu près stationnaire. Il serait, en effet, difficile de signaler chez nous aucun progrès important accompli par cette science dans le cours du présent siècle, et si de nouvelles lumières se sont produites à cet égard, c'est en dehors et presque toujours en contradiction des tendances de l'enseignement officiel; nous pensons que la stérilité de celui-ci tient, en grande partie, à ce que les doctrines philosophiques qu'il donne pour base au droit théorique, réprouvent et rejettent l'étude ou la recherche des intérêts communs, tandis qu'il ne saurait avancer réellement qu'en raison des lumières nouvelles acquises sur ces intérêts.
De tous nos établissements d'instruction publique, le plus vanté, — et à fort juste titre à beaucoup d'égards, — est l'École polytechnique, principalement destinée à former des ingénieurs. Cependant, ici encore, il y aurait mieux à attendre de la liberté. L'École polytechnique forme surtout des théoriciens avancés dans les parties transcendantes des sciences mathématiques, mais ne recevant que fort tardivement l'instruction, l'expérience pratique, si indispensable et si féconde dans presque tous les travaux qu'ils sont appelés à diriger, et à laquelle les écoles d'application ne les préparent que très-imparfaitement.
Les ingénieurs anglais ou américains, formés dans des écoles entièrement libres, ne sont peut-être pas d'aussi savants théoriciens que les nôtres; mais quelle différence, quelle supériorité dans la fécondité de leurs services! Il n'est pas une seule des grandes inventions modernes tenant à la science ou à l'art de l'ingénieur, qui ne doive leur être attribuée pour la plus grande part; c'est à eux que sont dus exclusivement, ou en majeure partie, les machines et bateaux à vapeur, le macadamisage des routes, les ponts suspendus, les chemins de fer, la locomotive, le télégraphe électrique, etc., etc., et si des Français ont participé à quelques-unes de ces créations, ce ne sont point des ingénieurs officiels; ainsi l'importation des ponts suspendus, le premier chemin de fer à grande section établi chez nous, — celui de Saint-Étienne à Lyon, — et l'invention du système tabulaire des locomotives, sont dus à M. Seguin aîné, qui n'a point passé par l'école polytechnique; l'invention de l'hélice, le métier Jacquart, etc., sont les œuvres de simples artisans.
Cette absence ou cette stérilité relative du génie d'invention chez nos ingénieurs officiels, tient sans doute à leur position de fonctionnaires qui, aussi longtemps qu'ils ne la délaissent pas pour s'attacher aux entreprises privées, les soustrait au stimulant de la concurrence; mais elle tient aussi à la nature de l'enseignement qu'ils reçoivent, et au trop long retard apporté à leur instruction pratique qui, en Angleterre et aux États-Unis, débute et se développe en même temps que l'enseignement théorique.
Il est certain que la liberté d'enseignement ferait naître une multitude d'établissements d'instruction de genres différents, répondant aux divers ordres de connaissances ou d'aptitudes réclamées par les besoins sociaux; elle créerait et développerait, dans la mesure exacte de ces besoins, des écoles destinées à former des ingénieurs, des médecins, des avocats ou des légistes, des instituteurs ou professeurs pour les diverses branches de l'enseignement, des ministres pour les différentes communions, et toutes les autres écoles professionnelles dont l'utilité est déjà reconnue, ou pourrait se faire sentir à l'avenir.
Chacun de ces établissements aurait pour intérêt dominant, pour tendance constante, de devenir aussi prospère que possible, et comme cette prospérité dépendrait de la réputation obtenue, que celle-ci dépendrait à son tour de la valeur reconnue, librement appréciée par les intéressés, des services rendus, — comme, d'un autre côté, aucun obstacle aux innovations ne gênerait plus l'amélioration progressive de ces services, et que la concurrence ferait à tous une obligation rigoureuse de la continuité de ces progrès, — on peut être assuré que l'instruction deviendrait dans ces établissements, aussi bien entendue, et aussi développée qu'il est utile et possible de l'obtenir, et qu'elle ne tarderait pas à se montrer très-supérieure à celle distribuée par le régime actuel. Avec la liberté, les établissements mal régis, ou ne dormant que des services inférieurs, ne resteraient pas longtemps debout, tandis que les mieux dirigés verraient grandir leur réputation et leur clientèle, d'où l'on peut conclure que les certificats délivrés par ces derniers aux élèves qu'ils auraient formés, constitueraient de meilleurs titres à la confiance du public, que les brevets ou grades que l'on confère aujourd'hui.
« Du moment que l'instruction serait libre, écrivait, il y a près d'un demi-siècle un éminent publiciste, la prospérité de toute école étant subordonnée à la manière dont ses professeurs rempliraient leur tàche, chaque école aurait l'intérêt le plus pressant à surveiller la conduite de ses professeurs, à stimuler leur courage, et à proportionner le salaire de chacun à l'étendue des services qu'elle en recevrait. Dès lors, nul professeur ne pouvant rien obtenir que par le travail, et pouvant obtenir d'autant plus qu'il travaillerait davantage, il s'établirait, entre les hommes qui suivraient la carrière de l'instruction, une émulation de zèle et d'activité des plus favorables au progrès de l'enseignement. L'effet de cette utile rivalité ne se bornerait pas là. Elle aurait encore l'avantage de constater sûrement les divers degrés de capacité des hommes qui se voueraient à l'enseignement, et de les mettre chacun à leur place. »362
Même pour la culture développée des sciences et de la littérature, pour ce que l'on nomme le haut enseignement, la régie de l'autorité nous paraît incomparablement moins favorable au développement normal, aux bonnes directions des facultés intellectuelles et morales, que ne le serait la liberté.
Celle-ci amènerait assurément à consacrer moins de services à l'étude du latin, du grec, de l'hébreu, du sanscrit, du chinois, etc., mais elle en destinerait davantage à l'enseignement des langues des différents peuples avec lesquels nous avons le plus de relations ou de rapports.
Elle restreindrait peut-être le développement immense, et tout à fait disproportionné aux besoins, que l'on imprime depuis longtemps aux études historiques et archéologiques; mais elle pourrait tirer de l'étude des faits sociaux des temps modernes, à partir surtout du XVe ou du XVIe siècles, dès enseignements plus vrais, plus utiles, et de meilleures leçons que nous n'en obtenons de nos professeurs officiels d'histoire.
Elle ne tarderait probablement pas à laisser de côté la philosophie transcendante que l'on nous enseigne depuis cinquante ans, — sorte de voyage à travers un monde de nuages, où l'on ne rencontre que de faibles et décevantes lueurs, fourvoyant la plupart de ceux qui l'explorent dans les directions les plus opposées; mais elle pourrait y substituer un enseignement philosophique moins prétentieux et plus salutaire, en s'appliquant aux développements d'une science fort délaissée jusqu'ici, bien que l'on puisse y trouver une lumière de nature à contribuer, plus que tout autre, à l'amélioration des civilisations: la morale expérimentale.
En supprimant les enseignements trompeurs; en restreignant plus ou moins ceux qui ne sont que stériles ou peu fructueux, la liberté pourrait développer et répandre beaucoup plus ceux de nature à éclairer progressivement les intérêts, ou à grandir la puissance de l'homme sur la nature; tels sont ceux que comprennent l'économie politique, la science du droit théorique ou des principes de la législation, les sciences naturelles et les sciences mathématiques.
Mais pour que les conditions normales de la concurrence ne fussent pas altérées, pour que la liberté pût développer toute la puissance et toute la fécondité qui sont virtuellement en elle, il faudrait absolument que l'État cessât d'enseigner; et, à part peut-être les écoles spéciales militaires, nous ne voyons aucun motif valable pour maintenir sous ses directions aucun établissement d'instruction.
Le stimulant de la concurrence nous paraît si radicalement indispensable pour assurer à cet ordre de travaux tous les progrès qu'il comporte, qu'à notre avis, il n'est pas de considération qui dut prévaloir contre la nécessité de le maintenir dans toute sa force.
Aussi pensons-nous que, malgré la supériorité relative du régime de l'enseignement aux États-Unis, les conditions de gratuité qu'on y a généralement établies pour l'instruction primaire dans les écoles publiques, en défrayant celles-ci sur le produit des impôts, ne sont pas favorables aux progrès de cette branche si importante de l'enseignement; elles tendent, en effet, à supprimer la concurrence des écoles privées, qui ne sauraient fonctionner gratuitement et ne sont point admises au partage du fonds commun affecté à l'enseignement; s'il s'en établit néanmoins, ce ne peut-être qu'à cause de l'insuffisance des écoles publiques, ou parce que celles-ci ne répondent pas à tous les besoins; mais, dans de telles conditions, ces entreprises privées ne sauraient avoir qu'une existence précaire, et il n'est pas à croire que beaucoup d'hommes de valeur soient disposés à s'y engager; d'un autre côté, les directeurs et professeurs des écoles publiques, placés dans la situation des fonctionnaires, ont des traitements dont l'importance ne dépend plus exclusivement de la valeur des services rendus par l'établissement, librement et directement débattue avec ceux qui les reçoivent; tous les effets salutaires de la concurrence se trouvent donc ainsi considérablement affaiblis.
En général, l'enseignement, comme tout autre service, doit être payé par ceux qui le reçoivent, et si, néanmoins, une commune, une association charitable, veulent procurer le bienfait de l'instruction primaire aux familles trop pauvres pour en supporter les frais, ce n'est point en créant une école communale, ou défrayée d'avance sur un fonds commun, et devant altérer aussitôt les conditions normales de la concurrence et de la liberté, qu'elles devraient y pourvoir, mais en distribuant à ces familles des bons d'école, que celles-ci remettraient aux instituteurs élémentaires de leur choix, et qui seraient ensuite acquittés, par la caisse municipale ou celle de l'association, entre les mains de ces instituteurs.
Des motifs du même ordre nous portent à penser que les universités, telles qu'elles existent en Allemagne et en Angleterre, c'est-à-dire, des corporations instituées pour une durée illimitée, et pouvant s'enrichir par une longue suite de dons, de legs ou de fondations diverses, — s'écartent également du régime normal de l'enseignement, en ce qu'elles tendent à affaiblir, ou même à supprimer le stimulant de la concurrence.
Ces établissements sont le plus souvent pourvus de différents priviléges; mais alors même qu'ils n'en auraient aucun autre que celui de disposer à leur gré des richesses accumulées par les dotations antérieures, ils constitueraient des institutions plus nuisibles qu'utiles aux progrès réels de l'enseignement, parce que ces richesses les dispensent d'autant plus des efforts nécessaires à l'amélioration des services, qu'elles sont plus considérables, et parce qu'elles leur permettent néanmoins de conserver une grande existence, soit en appelant dans leur sein les professeurs les plus réputés, — lesquels une fois pourvus de gros traitements, plus ou moins indépendants du nombre de leurs élèves, n'apportent plus beaucoup d'efforts à l'accomplissement de leur mission, — soit même en distribuant à leurs élèves, sous certaines conditions, comme on le voit dans les universités anglaises, des rémunérations, des pensions ou d'autres avantages qui, joints aux bourses fondées, suffisent pour leur conserver une clientèle considérable, au préjudice d'autres établissements, fournissant peut-être un meilleur enseignement, mais n'ayant de ressources que celles produites par les rétributions obtenues de leurs élèves, et impuissants à s'imposer de pareils sacrifices.
Quels sont d'ailleurs les résultats les plus apparents de ces institutions? Qu'ont produit, par exemple, les universités tant vantées de l'Allemagne? A part des travaux historiques ou archéologiques dont les résultats, les conclusions, restent en général plus ou moins hypothétiques, et n'ont pas, en tout cas, une importance capitale pour les générations actuelles, leur œuvre la plus considérable consiste dans ce vaste ensemble d'enseignements prétendus philosophiques, ou métaphysiques, n'ayant engendré jusqu'ici qu'un véritable cahos intellectuel, sans le moindre rayon de lumière nouvelle et salutaire, et qui, en dernier lieu, ont abouti au scepticisme absolu, à la négation de la raison humaine, à la confusion de la vérité et de l'erreur, etc.
Quant aux vieilles universités anglaises d'Oxford, de Cambridge, à celles de Dublin, de Durham, etc., les résultats qu'elles donnent, pour être différents de ceux des universités allemandes, ne paraissent pas bien plus satisfaisants: leur obstination à maintenir intacts leurs vieux statuts, à perpétuer le règne ou la prédominance absolue de l'enseignement gréco-romain, à servir les tendances antilibérales de l'aristocratie et de l'Église privilégiée, les abus singuliers qui s'y sont développés, enfin, la stérilité ou les mauvaises directions de leurs services, — résultats ou abus déjà implicitement et finement signalés, au dernier siècle, par Adam Smith, — commencent à soulever assez généralement contre elles l'opinion éclairée du pays; c'est du moins ce que l'on peut conclure des réformes tentées par le parlement en 1854, 1856 et 1858, et de tout ce que la discussion de ces réformes a dévoilé sur l'importance et le mauvais emploi des ressources des universités dont il s'agit.
Il ne paraît donc pas que le régime des corporations soit moins défavorable que la gestion des gouvernements à l'amélioration des services de l'enseignement, aux bonnes directions et aux développements bienfaisants de cet ordre de travaux; d'où il suit que, s'il y a lieu de laisser toute la liberté possible aux associations ayant l'enseignement pour objet, il ne conviendrait pas, en général, de sanctionner par la force légale la conversion de ces associations en corporations.
En considérant combien les opinions que nous avons exposées à l'appui d'une liberté entière de l'enseignement, diffèrent de ce qui existe en France, et de la généralité des idées reçues sur ces matières, nous ne pouvons guère douter que nos propositions ne paraissent d'abord inadmissibles, et en tout cas, subversives de tout ordre régulier, — de nature à désorganiser l'enseignement, à compromettre sa continuation, à exposer les populations à retomber dans les ténèbres de l'ignorance, etc. Mais nous restons fermement convaincu qu'un examen attentif disposera tout esprit droit, non subjugué par d'inflexibles préjugés, à reconnaître que ces propositions tendent simplement à substituer à une organisation vicieuse, destructive de toute émulation féconde, opposée à toute innovation et, par suite, à tout perfectionnement et à tout progrès, — de nature, en un mot, à retenir perpétuellement l'enseignement dans les voies les plus fausses, une autre organisation incomparablement mieux entendue, plus fructueuse, plus propre à développer, à féconder les facultés, les aptitudes de ceux qui se livrent à la carrière de l'enseignement, à les tenir constamment prêts à mettre leurs services en harmonie avec le développement général des lumières et des besoins, et à accroître progressivement la puissance utile de ces services.
Cette dernière organisation, qui s'établit naturellement et d'elle-même, en l'absence de tout régime artificiel, et de toute institution plus ou moins entachée de privilége ou de monopole, est celle de la liberté.
Quant aux effet immédiats du changement de régime, — qui ne sera d'ailleurs praticable, en France, que lorsque l'opinion générale aura été suffisamment gagnée à la liberté de l'enseignement et à celle des cultes, — nous nous bornerons à faire observer que l'avénement de la liberté ne détruirait ni les professeurs, ni les directeurs, ni le matériel ou les locaux d'enseignement de nos écoles spéciales, de nos facultés, de nos lycées, colléges, écoles normales, écoles primaires, etc.; seulement tous ces établissements seraient rendus à l'indépendance, au droit commun, et, au lieu de servir l'État, le gouvernement, une autorité ou une corporation quelconques, ils devraient s'appliquer à servir les familles, dont ils auraient à attendre tous leurs moyens d'existence et de succès, exactement proportionnés alors à la valeur, librement appréciée, qu'ils réussiraient à faire reconnaître à leurs services.
63.Frédéric Passy on “Peace and War” (1867).↩
[Word Length: 13,441]
Source
Frédéric Passy, Conférence sur la paix et la guerre, faite à l'École de médecine de Paris, le 21 mai 1867 (Paris: Guillaumin, 1867).
Speech at the Conference sur la paix et la guerre
Mesdames, Messieurs,
« D'après des évaluations que nous considérons comme plutôt inférieures que supérieures à la réalité, l'Europe entretient, en temps de paix, un effectif de 3,815,847 hommes, et inscrit à son budget une somme de trois milliards et demi, ou 32 % du total de ses dépenses, pour subvenir aux frais de cette armée colossale.
» Supposons un instant que, par suite d'une entente entre les puissances intéressées, un désarmement s'opère dans la proportion de moitié.
» Immédiatement, 1,907,924 hommes de 20 à 35 ans, constituant l'élite de la population de cet âge, sont rendus aux travaux de la paix, et une économie de un milliard 600 millions est réalisée sur l'ensemble des budgets européens. Avec cette somme, l'Europe peut ajouter à son réseau actuel (150,000 francs en moyenne le prix du kilomètre à une voie), 10,000 kilomètres de voies ferrées; elle peut, en une seule année, compléter son réseau de voies de terre de toute catégorie; elle peut doter toutes ses communes, et même toutes les sections de ses communes, d'une école primaire.
» Ces grandes améliorations une fois réalisées, l'Europe peut, si elle entend conserver la même somme à son budget, rappliquer à la réduction progressive de sa dette. L'intérêt annuel de cette dette étant aujourd'hui d'environ 2 1/3 milliards, et cet intérêt, capitalisé au taux moyen de 4°'0, représentant un capital de 57 1/2 milliards, elle pourrait être éteinte (en ne mettant pas le compte des intérêts composés), en 30 années environ. Si, au contraire, les pays intéressés entendaient appliquer les 1,600 millions ainsi économisés à la suppression ou à la réduction des impôts qui pèsent le plus sur la production et la consommation, quel allègement pour les populations! quel essor nouveau donné à toutes les transactions!
» Nous avons dit que 1,907,924 hommes à la fleur d l'âge seraient rendus aux arts de la paix. Il y aurait encore dans ce fait heureux une cause efficace de prospérité pour l'Europe. En effet, en ne portant qu'à 2 francs le salaire moyen quotidien de ces 2 millions de travailleurs, et en supposant que le salaire représente le cinquième de la valeur produite, cette pacifique armée, désormais enrégimentée sous la bannière du travail, créerait une valeur quotidienne de 20 millions, et annuelle de 7 1/2 milliards.
» Ce n'est pas tout: une quantité considérable de capitaux, aujourd'hui employés à la fabrication des objets nécessaires à l'équipement et à l'armement de ces 2 millions d'hommes, deviendrait disponible et pourrait être appliquée à d'autres branches, incomparablement plus utiles, de l'industrie nationale.363
» En négligeant un instant les considérations économiques, nous signalerons l'avantage pour le pays d'entretenir dans l'habitude et le goût du travail un nombre considérable d'adultes que la vie de garnison condamne aujourd'hui à l'oisiveté et à ses funestes conséquences. Nous signalerons encore l'intérêt pour l'ordre, pour la morale publique, de maintenir les liens de famille que brise plus ou moins complétement l'absence, pendant six à sept années, de ces deux millions d'enfants enlevés annuellement, par le recrutement, au foyer domestique. »
Ces paroles, Messieurs, que j'ai tenu à lire pour les livrer textuellement à vos réflexions, ne sont pas de moi, je me hâte de le dire; elles sont extraites d'un recueil grave et sérieux, auquel j'ai cru bon de les emprunter pour commencer, autant que possible, avec calme une oeuvre toute de calme et d'apaisement. Je les ai puisées dans le Journal de la Société de Statistique du mois de Novembre 1866.
Je les ai puisées là, parce que le Journal de Statistique et un recueil autorisé, un recueil impartial; et qu'il ne saurait être, comme je l'aurais été probablement en parlant de mon chef, accusé d'avoir enflé à plaisir, pour les besoins de la cause, les chiffres douloureux que j'étais dans la nécessité de vous présenter. Je les ai puisées là, surtout, parce qu'elles sont antérieures à la crise que nous venons de traverser, — j'ose à peine dire, dont nous venons de sortir; — et qu'il est par conséquent impossible de soupçonner en elles la moindre préoccupation des difficultés politiques actuelles.
Or, ce n'est pas une question passagère et restreinte, c'est une question d'intérêt universel et permanent; c'est une question non de parti, mais de principe — la question générale de la paix et de la guerre, — que je me propose d'examiner devant vous ce soir. Et pour traiter convenablement cette grande question, la seule, je le répète, que je doive et que je veuille aborder ici, il importe avant tout d'écarter, autant qu'il dépend de nous de le faire, les impressions trop récentes ou trop particulières qui seraient de nature à troubler la liberté et l'impartialité de notre jugement.
Ces paroles, d'ailleurs, posent parfaitement la question. Elles la posent comme elle doit être posée, dans toute son étendue, attaquant le mal de la guerre ailleurs que dans ses redoublements et ses excès, et ne séparant pas, comme on le fait trop souvent, ce repos trompeur qu'on appelle la paix armée de la lutte ouverte et sanglante qui trop souvent en sort, et qu'évidemment la paix armée suppose et attend toujours.
Elles posent la question dans ses termes à la fois économiques et moraux; comme une question de richesse, mais aussi comme une question de liberté, comme une question d'ordre, comme une question de moralité, de dignité et de justice.
C'est bien ainsi, Messieurs, qu'aux yeux du moraliste, du philosophe, du chrétien, de l'économiste, le débat se présent; et c'est ainsi que, dans ces quelques instants, malheureusement bien courts pour une telle tâche, je vais essayer de l'aborder devant vous.
Ai-je besoin, en vérité, de vous dire dans quel esprit? Ai-je besoin de faire pressentir ce que sera ma conclusion? Non, vraiment. Quel que soit le point de vue auquel on se place, comme chrétien, comme philosophe, comme économiste, comme moraliste, la conclusion est la même; il est impossible de ne pas se prononcer contre la guerre et en faveur de la paix. La guerre, disait il y a quelques jours à peine, aux applaudissements de tous ses collègues, l'honorable président de la Société des Economistes,364 « la guerre gaspille Le passé, ruine le présent, grève et retarde l'avenir. »
Ce sont là des crimes qui, aux yeux d'un économiste, sont irrémissibles, et qu'un moraliste ne peut pas pardonner davantage.
Et pourtant, Messieurs, vous le savez comme moi, la guerre a ses apologistes, elle a ses admirateurs, ses enthousiastes même. Il ne manque pas de gens qui n'hésitent pas à proclamer qu'elle est le plus grand, le plus noble emploi des facultés humaines. Et dans certains cas, je l'accorde, cela peut être vrai, Oui, lorsqu'il s'agit de défendre ou de recouvrer l'indépendance de son pays, assurément, cela est vrai; lorsqu'il s'agit, comme l'a fait Jeanne Darc, de se lever pour repousser l'envahisseur, ou, comme Léonidas aux Thermopyles, de se placer en travers de son chemin et de fermer de son corps le passage qui ouvre le sol de la patrie, oh! alors la guerre peut être, et elle est le plus grand, le plus noble, le plus magnifique emploi de la vie, car elle en est l'abandon le plus complet, le sacrifice par excellence au premier des devoirs, le dévouement absolu et sans réserve à une cause sainte.
Mais ces généreux enthousiasmes de la guerre sainte, de la guerre inévitable, on les étend malheureusement trop souvent, - qui l'ignore? - à la guerre générale et aux exploits de la guerre. Ce n'est plus seulement la lutte pour la liberté, c'est la lutte quelle qu'elle soit: ce n'est plus seulement la guerre de la légitime défense, c'est la guerre agressive, la guerre d'expansion, la guerre de conquête, la guerre pour la guerre, qu'on entoure de celte admiration sonore que nous connaissons tous; car tous, plus ou moins, nous en avons été bercés.
C'est, Messieurs, cette admiration sonore et irréfléchie qu'il faut juger. Il faut savoir, une bonne fois, ce qu'il y a sous toutes ces formules; avec lesquelles on entraîne les hommes les uns contre les autres; il faut savoir qui a tort, qui a raison, de ceux qui bénissent la guerre, ou de ceux qui la maudissent. Et pour le savoir, il n'y a qu'une chose a faire, c'est de passer rapidement en revue les éloges les plus habituellement décernés à la guerre, et de voir ce qu'ils valent; c'est de calculer ce que la guerre coûte et ce qu'elle rapporte; — j'entends ce qu'elle coûte de toutes façons: en argent, en hommes, en dignité, en liberté, en bien-être, — afin de savoir à quel prix sont achetés (quand elle est heureuse) ses triomphes si souvent trompeurs et éphémères.
On a dit, je le sais bien, que la gloire ne se pèse pas dans la même balance quo les autres intérêts humains, et qu'on ne saurait lui faire son bilan comme à un failli.
Et pourquoi pas, si ce bilan est, en effet, un bilan de faillite? A moins, peut-être, que l'énormité d'un passif ne le mette au-dessus des lois ordinaires do la justice et du bon sens.
Avançons donc sans crainte, et voyons d'abord ce que coûte la guerre.
« Ce que coûte la guerre? Mais nous venons de le voir, » allez-vous me répondre; « nous venons de le voir dans le substantiel résumé qui a servi d'introduction à cet entretien. »
Oui, Messieurs, nous venons de le voir en partie, mais en partie seulement, quoi que vous en ayez pu penser; et le Journal de la Société de statistique, avec ses chiffres effrayants, est loin de vous avoir tout dit.
Ces dépenses si énormes qui y figurent, ce sont les dépenses directes; celles qui sont avouées par les budgets; celles qui se lisent en toutes lettres dans les comptes officiels. Mais à côté de ces dépenses publiques et ostensibles, il y en a bien d'autres, auxquelles on ne songe pas. Il y a l'argent de poche, dépensé sous mille formes par les soldats, et dont nul ne sait le compte. Il y a les sommes payées par ceux qui ne veulent pas servir pour s'acheter des remplaçants; il y a les logements chez l'habitant qui, dans bien des cas, sont une lourde charge pour la population qui les supporte; il y a enfin, ce qu'on oublie presque toujours, les dépenses faites par les villes et les départements pour les casernes et le reste; il y a les bâtiments et les espaces improductifs: forteresses, emplacements consacrés aux exercices militaires, zones de terrains soumis à une servitude plus ou moins étroite et rigoureuse, et soustraits par suite à la construction et à la spéculation, ou dépréciés par la menace permanente de la guerre ou des exigences du génie militaire.
Lorsqu'on fait le compte de toutes ces dépenses (qui ne figurent pas aux budgets), c'est au double, à peu près, qu'il faut porter le chiffre de tout-à-l'heure. Du moins, M. P. Larroque, qui a fait ce compte avec soin dans un très-savant ouvrage sur la Guerre et les armées permanentes,365 arrive-t-il, pour une époque déjà relativement ancienne, à plus de cinq milliards au lieu du chiffre alors admis de deux: cinq milliard dont trois, vous le voyez, en depenses méconnues, oubliées, ignorées, mais réelles pourtant, et qui, pour être ignorées, n'en pèsent pas moins lourdement sur la richesse publique et privée,
Et ces charges, Messieurs, ne l'oublions pas, ces charge que je viens d'indiquer trop rapidement, ce ne sont encore que les charges de la guerre qui ne se fait pas,366 mais qui pourrait se faire; ce sont les charges de ce qu'on appelle le pied de paix, - de paix armée, il est vrai, de paix attendant la guerre, et préparant la guerre.
Qu'est-ce donc, lorsque cette lugubre attente se réalise, et lorsque réellement la guerre se fait?
Quand la guerre se fait, Messieurs, on ne compte plus; on dépense et on tue, et le sang et la richesse coulent à l'envi comme de l'eau.
Voulez-vous, cependant, pour ce qui est de l'argent, vous faire une idée des sacrifices? Voyez, au cours ou au lendemain de toute guerre, par combien d'emprunts il faut remettre, tant bien que mal, en équilibre les budgets, Rappelez-vous cette dette européenne de 57 milliards; presque tout vient de la guerre. L'Angleterre seule, qui a tenu ses comptes avant nous, estime à presque moitié de ce chiffre les dépenses de sa longue lutte avec la France nouvelle.
Pour ce qui est des sacrifices d'hommes, feuilletez, je vous prie, les pages même les plus glorieuses, hélas! de nos guerres; parcourez les annales des différents pays auxquels, les uns ou les autres, nous appartenons; lisez nos bulletins, tantôt de victoire et tantôt do défaite; et dans ces bulletins, de quelque latitude qu'ils soient datés, quelques événements qu'ils rapportent, en quelque langue qu'ils soient écrits, il y a un même et invariable article que vous retrouverez toujours, c'est l'article des morts et des blessés: ici 10,000, là 20,000, là 30,000, là 50,000, et quelquefois davantage. Cinquante mille morts! Cinquante mille hommes qui, la veille, qui, le matin même, étaient la fleur de la population de leur patrie, et qui, le son, gisent étendus dans la poussière sanglante ou sur la paille humide de l'ambulance, les uns sans vie, les autres pis encore, mutilés, estropiés, agonisants, et maudissant avec des imprécations et des blasphèmes ceux-là mêmes que, dans l'enivrement de leurs espérances, ils acclamaient le matin.
Voilà, Messieurs, ce que l'histoire nous montre. Mais ce n'est pas assez de le voir en gros, il faut le comprendre; et pour cela il faut pénétrer dans cette foule innommée qui ne nous apparaît d'abord que comme un ensemble indifférent. Il faut personnaliser et individualiser cette foule en la décomposant.
Il faut mettre des noms, des noms de pères, de fils, d'époux, de fiancés, sur chacune de ces figures déjà méconnaissables peut-être. Il faut se dire que chacun de ces morts ou de ces mourants avait un pays, un village, une famille, et se transporter par la pensée et par le cœur dans ce village et dans cette famille, pour se rendre compte du malheur qui frappe non pas une nation prise en bloc, mais chacun des innombrables foyers d'affection et de tendresse qui, par leur réunion, constituent une nation.
Ce n'est pas tout encore, Messieurs; et après avoir décomposé, il faut recomposer. Il faut se dire que, quelque effrayant, quelque lugubre que soit ce défilé funèbre des bulletins de défaites et de victoires, il ne suffit pas, cependant, si nous n'en faisons pas la récapitulation générale, si nous ne regardons pas en face le terrible total auquel il aboutit, si nous n'en venons pas jusqu'à nous dire, par exemple, que dans les guerres de nos pères, dans les grandes guerres de la Révolution et de l'Empire, les discordes civiles ou nationales ont enlevé à l'Europe non pas des centaines de mille hommes, mais Des Millions, Plusieurs Millions, Huit ou Dix. Millions peut-être. (Mouvement.)
Je comprends que cette assertion vous étonne; et c'est ce qui prouve combien nous sommes loin, en général, de connaître l'étendue de nos maux, combien il importe de les mesurer, par conséquent; veuillez donc écouter quelques chiffres:
Pour les guerres de la Révolution proprement dites, je ne garantis aucun nombre; les bases précises manquent en partie; je puis dire seulement qu'on évalue assez généralement, - ce sont notamment les chiffres de sir Francis d'Ivernois, - à 1,500,000 morts environ les pertes des seuls Français.
De 1805 à 1814, c'est différent, on a des données positives. Il y a eu, pendant ceUe période, des états régulièrement tenus, et l'on connait exactement les pertes de la France. Le total, pour la France actuelle, - la France telle qu'elle était avant les dernières annexions, - a été, d'après les relevés officiels, fourni à un membre éminent de ma famille,367 en présence de personnages encore vivants,368 dans une commission de l'ancienne chambre des Députés, par l'ancien directeur général de la conscription sous le premier empire, M. d'Hargenvillers en personne. Ce total ne s'est pas élevé à moins de 1,750,000 hommes, plus de 170,000 morts par année!
Ajoutez à cela, comme il le faut bien, les pertes des alliés, qu'on ne ménageait pas plus que les Français, apparemment; puis celles des ennemis (les vaincus perdent toujours plus de monde que les vainqueurs); et dites si le chiffre effroyable que j'avançais tout à l'heure, presque en tremblant, vous paraît encore exagéré. Vous pouvez le comparer d'ailleurs, si vous le voulez, aux pertes des dernières guerres; guerres terribles, c'est vrai, mais guerres courtes et rapides, et dans lesquelles tant de progrès avaient été réalisés, II faut le reconnaître, pour le bien-être, l'hygiène et le soin des hommes.
La guerre de Crimée, à elle seule, a certainement couté à l'humanité (en outre d'une dizaine de milliards), plus d'un demi-million d'hommes, Les morts pour l'armée française ont atteint 95,000; et les Russes ont avoué, pour leur part, une perle de 300,000 hommes au moins. A quoi il faut ajouter !es pertes des Anglais,369 des Piémontais et des Turcs, dont je n'ai pas les états sous les yeux.
Une chose qu'on ne saurait trop redire à l'occasion de ces chiffres, c'est que ce qui tombe dans les batailles n'est jamais, par rapport à l'ensemble, qu'une faible et très-faible proportion. Ainsi, pour ce chiffre de 95,000 hommes perdus par l'armée française, on possède un admirable travail; c'est celui du docteur Chenu,370 qui a suivi les hommes un à un, depuis leur départ jusqu'à leur retour, et même après leur rentrée dans leurs foyers, lorsqu'ils y étaient revenus blessés ou malades, afin de constater rigoureusement les effets de la guerre.
On ne trouve dans ce relevé que 20,000 hommes ayant péri sous les coups de l'ennemi. Le reste, 75,000, est mort de maladie ou d'épuisement: 18,000 étaient à l'hôpital avant le premier coup de feu; les souffrances, les privations, le froid ont moissonné les autres, ou les ont préparés à une mort prématurée. Telles sont les longues traces que la guerre laisse après elle, et qui en prolongent les funestes effets bien au-delà du temps et du lieu où elle se fait.
Voulez-vous maintenant un exemple des dimensions qu'atteignent parfois les désastres? Voici un discours prononcé à Versailles, en 1860, sur la tombe d'un excellent vieillard que j'ai beaucoup connu, d'un ancien intendant militaire, intimement lié avec ma famille. Dans ce discours, sorti de la bouche d'un autre intendant militaire encore vivant, je lis le passage suivant: « Il faisait partie de cette belle armée de Saint-Domingue, qui compta 58,000 hommes sous 20 généraux: armée que le fer, le feu, la fièvre jaune et la plus horrible famine réduisirent à 321 braves qui ne revirent peut-être pas tous la France. Celui auquel nous rendons les derniers devoirs, ajoutait M. l'intendant militaire Bouché, était peut-être le dernier survivant de cette héroïque armée. »
Voilà, Messieurs, ce que c'est que la guerre, lorsqu'au lieu de la regarder par le côté de la lorgnette qui montre les victoires et les triomphes, on la regarde par le côté qui montre les morts, les dévastations et les larmes; lorsqu'on songe aux familles désolées, aux arbres coupés, aux moissons détruites, aux maisons incendiées; lorsqu'on en fait, en un mot, — c'est une expression qui est à sa place ici, — la triste et douloureuse anatomie. Voilà ce que c'est que la guerre, et, par conséquent, la gloire militaire!
Aussi ne suis-je pas surpris de ce qui arriva à un autre de mes amis, plus jeune celui-là, et n'ayant vu de ses yeux ni la victoire, ni ce que coûte la victoire.
C'était le fils d'un colonel du premier Empire; et pendant sa jeunesse (à celle époque où les anciens officiers de l'Empire, fort injustement traités trop souvent, se consolaient volontiers du présent en songeant au passé), il n'avait guère entendu parler que de gloire et de lauriers; si bien que la guerre était pour lui la plus belle chose du monde, Quel fut son étonnement lorsque, arrivé à Paris, chez un oncle qui avait fait les mêmes campagnes que son père, mais qui les avait faites à un autre titre, - c'était un chirurgien militaire,- il rencontra des impressions toutes contraires!
Parlait-il décorations, mises à l'ordre du jour, entrées triomphales dans les villes soumises, l'oncle répondait: jambes coupées, bras cassés, têtes fracassées; sans oublier le typhus, la dyssenterie et le reste. Il y revint tant, que le jeune homme, malgré l'ardeur et l'impétuosité de sa vive nature, finit par s'apercevoir que du colonel ou du chirurgien, celui qui avait raison, ce n'était pas le colonel, c'était le chirurgien. (Applaudissements.)
Mais je ne veux pas insister sur ces détails, qui nous entraîneraient trop loin; peut-être, si le temps ne me fait pas défaut, y reviendrai-je avant de nous séparer.
Pour le moment, mon désir est de suivre méthodiquement et, autant qu'il dépendra de mon émotion et de la vôtre, tranquillement, l'ordre des déductions de mon sujet.
Je reprends donc le thème des admirateurs de la guerre.
La guerre, disent-ils, est pour les peuples une des conditions nécessaires de la puissance; elle leur procure des conquêtes, des agrandissements, des richesses; elle assure leur indépendance. Ne faut-il pas maintenir son rang parmi les nations, et veiller à l'équilibre des forces, sans lequel il n'y a plus de sécurité?
Ajoutez les débouchés commerciaux à ouvrir ou à conserver, les compatriotes à protéger, le drapeau à faire respecter, le prestige du nom national à sauvegarder. Ajoutez surtout les vertus mâles et énergiques à développer et à entretenir.
Voilà. si je ne me trompe, en peu de mots, à peu près ce que l'on dit de plus plausible et de plus fort à l'appui de l'esprit militaire et de la nécessité de n'y pas renoncer en en répudiant trop la Guerre.
Eh bien, Messieurs, bien rapidement, trop rapidement, un mot sur chacun de ces points.
La guerre, dit-on, est un moyen d'accroître la puissance nationale; les grands armements donnent à un peuple de la confiance en lui-même; ils lui font sentir sa force, et lui assurent le respect des autre peuples.
La guerre accroître la puissance des peuples! Eh! bon Dieu! mais qu'est-ce donc que la guerre, lorsqu'elle n'est pas inévitable, lorsqu'elle n'est pas le résultat de l'une de ces tristes, mais nobles obligations dont je parlais tout-à-l'heure; qu'est-ce que la guerre pour la guerre, je vous le demande, sinon une saignée qu'on se fait volontairement à soi-même aux quatre membres?
Et ces armements sans limites, dont peu à peu l'émulation s'est étendue sur l'Europe entière comme une épidémie, est-ce donc autre chose qu'une dîme prélevée chaque année sur la jeunesse, sur les forces, sur les capitaux et sur les revenus des populations?
Singulière manière de se fortifier et de s'enrichir, en vérité! Vous voulez, dites-vous, être assurés d'avoir toutes vos ressources sous la main au jour du besoin? Gardez-les donc en vue de ce jour, au lieu de les gaspiller inconsidérément à l'envi les uns des autres dans une rivalité puérile, d'où peut, à toute heure, sortir la désolation et la ruine. Par crainte d'un mal éventuel, vous vous infligez sans relâche à vous-même un mal certain. Vraiment, l'on n'a pas eu tort de le dire, il y a longtemps déjà: « Cette prétendue prudence est de la plus haute imprudence. »
On vous parle de conquêtes, je le sais; ou quand on n'en prononce pas directement le nom, on le sous-entend, Il est beau de s'agrandir, vous dit-on, d'étendre sa domination ou sa suzeraineté sur les autres contrées. C'est la preuve de la vitalité d'une nation; et toute race qui n'est pas atteinte de décrépitude est naturellement expansive.
Est-ce bien sûr, ou, du moins, est-cil bien sous cette forme que doit se produire le besoin d'expansion qui, en effet, caractérise les fortes races?
Et quel est donc, quand on interroge sérieusement l'histoire, quand on ne se laisse pas aller aux enivrements et aux éblouissements de l'apparence, quand on ne s'arrête pas aux premières promesses de succès, si souvent éphémères et trompeuses; quel est le peuple auquel ses conquêtes aient réellement donné plus de richesse, de bonheur, et de liberté durables?
Il se trouve ici, peut-être, et je l'espère, des personnes appartenant à diverses nations. Ai-je besoin de leur dire qu'il ne saurait entrer dans ma pensée de les blesser en quoi que ce soit dans leurs sentiments et leurs affections? Mais voyons, franchement, à quoi les conquêtes de ces nations leur ont-elles servi?
Est-ce que la Pologne a porté bonheur à la Russie? Est-ce que l'Irlande a porté bonheur à l'Angleterre? Est-ce que l'Italie a porté bonheur à l'Autriche? Est-ce que nous n'avons pas tous lus dans une leUre célèbre écrite au nom de la France, - la lettre de l'Empereur au sujet des évènements de Syrie, - que l'Algérie, jusqu'à présent, n'avait fait que prendre à la France « le plus pur de son sang et de son or?» Est-ce que l'Espagne enfin, l'Espagne dans les Etats de laquelle le soleil ne se couchait jamais, n'est pas tombée, dans l'espace d'une vie d'homme, dans la pauvreté et dans l'abaissement le plus complet; réduite, après avoir tenu pour ainsi dire le monde sous son sceptre et sous son glaive, à quelques vaisseaux désemparés pour marine, à quelques milliers d'hommes, - des bandes plutôt que des soldats, pour armée; sans industrie, sans agriculture, sans finances; quoiqu'elle eût encore une partie de l'Amérique en sa puissance, au moins nominale, et quoiqu'elle eût pressuré cette riche contrée jusqu'à en faire disparaître la population presque entière?
Elle aurait pu, cette malheureuse Amérique, par la culture et par le commerce, devenir pour l'Espagne une source merveilleuse de prospérité; l'Espagne a cru, en la subjuguant, en l'asservissant, en la dévastant, en y portant l'implacable exploitation de l'esclavage, y trouver la puissance et la richesse sans travail: elle n'y a trouvé que la pauvreté et la ruine! Elle commence enfin à le comprendre aujourd'hui; et nous avons entendu, il y a peu d'années, un des hommes les plus distingués de la Péninsule proclamer, dans les termes les plus énergiques, devant le Parlement de son pays, que c'était l'Amérique qui avait perdu la puissance espagnole.
Et à supposer qu'il en pût être autrement, d'ailleurs, est-ce que la grandeur, je dis la vraie grandeur, pour un peuple, peut consister à dominer les autres? Est-ce que la richesse, la vraie richesse, est celle qu'on obtient en pressurant le travail des autres, en levant sur eux des tributs par la force, à travers leurs malédictions perpétuelles et au prix d'inquiétudes chaque jour renaissantes?
Non, la vraie richesse, c'est celle que l'on crée et que l'on mérite. La vraie grandeur, c'est celle que l'on se fait à soi-même par sa dignité et par ses vertus.
Ce qui fait les grandes nations, savez-vous ce que c'est? Ce ne sont pas quelques explosions tumultueuses qui étonnent un moment le monde et bientôt le soulèvent; ce sont les oeuvres que ces nations accomplissent dans leur sein, pour elles-mêmes et par elles-mêmes. Une société est ce que la font les individus qui la composent; et quand elle compte beaucoup d'hommes véritablement dignes de ce nom, d'hommes qui travaillent, qui produisent, qui s'enrichissent, qui se moralisent, qui s'élèvent et s'illustrent de tous côtés par l'industrie, par la science, par la littérature, par les arts; alors, étant formée d'éléments réellement grands à divers degrés, elle est et elle peut se dire, sans crainte de se tromper, une grande nation. (Applaudissements.)
Mais l'équilibre! maïs la sécurité!
L'équilibre! Oh! c'est un grand mot que celui-là, je le sais; mais, qu'y a-t-il sous ce grand mot? Ecoutez. Dans les Sophismes économiques de cet esprit charmant et fin qui se nommait Bastiat, il y a un dialogue entre un percepteur et un vigneron que je recommande à ceux d'entre vous qui ne le connaitraient pas.
M. Lasouche, le percepteur, réclame à Jacques Bonhomme, le vigneron, six des vingt tonneaux qu'à force de peine et de soins celui-ci est parvenu à récolter; et Jacques Bonhomme s'étonne que M. Lasouche ait besoin de lui prendre tant de ces tonneaux, dont chaque goutte représente pour lui une goutte de sueur.
Entre autres choses, et après lui avoir expliqué qu'il faut un premier tonneau pour payer l'intérêt des dettes, « provenant de cartouches qui ont fait jadis la plus belle fumée du monde; » puis un second pour assurer les services publics, ce à quoi le brave campagnard n'a garde de faire d'objection; - il cherche à lui faire comprendre que ce n'est pas trop d'un troisième et d'un quatrième pour « son contingent aux frais de l'armée et de la marine: » car il faut bien, lui dit-il, « maintenir l'équilibre des forces européennes. » - « Eh! mon Dieu! » reprend le pauvre homme, à qui la guerre a déjà pris deux fils qu'il aimait tendrement, « l'équilibre serait le même si l'on réduisait les forces de moitié... ou des trois quarts. Nous conserverions nos enfants et nos revenu. Il ne faudrait que s'entendre. » - « Oui, réplique son interlocuteur, mais on ne s'entend pas.» - « C'est ce qui m'abasourdit, ajoute le malheureux père, car enfin chacun en souffre. »
Hélas! oui, tout le monde en souffre,et tout le monde le sent. Mais il en est, à ce qu'il paraît, de cette coûteuse rivalité comme de celle du luxe; ou plutôt n'est-elle pas précisément le plus déplorable et le plus ruineux des luxes? C'est à qui en fera le plus, et nul ne veut se laisser dépasser par son voisin. A ce compte, il n'y a pas de raison pour qu'on s'arrête jamais, et tout finira par la banqueroute universelle.
Oh! je sais bien ce qu'on dit: c'est encore comme pour la toilette et le reste. « On ne demanderait pas mieux que d'être raisonnable; mais il faut commencer, et l'on ne peut vraiment pas se faire montrer au doigt, en étant. raisonnable tout seul. Ce serait dangereux, de plus; et pour déposer son équipage de combat, il faudrait être assuré que les autres ne garderont pas le leur. » La question est délicate, et je ne la discuterai pas ici, bien que je l'aie fait plus d'une fois ailleurs tout à loisir. Voici seulement quelques lignes d'un article de journal qui, ce matin même, par un heureux hasard, s'est trouvé sous ma main, et qui peul-être ne vous paraîtra pas hors de propos.
« Je suis de votre avis, la France ne doit pas s'effacer. Mais serait-ce donc s'effacer que d'oser accomplir ce qu'aucun autre Etat n'oserait risquer de faire avant qu'elle en ait pris l'initiative, initiative plus audacieuse en apparence qu'en réalité? Serait-ce donc s'effacer que de mettre avec soi, devant soi, derrière soi, à côté de soi, tous les peuples désabusés de la gloire de la conquête, rassasiés de haine et désaltérés de sang, n'ayant plus d'autre soif que celle du travail, de l'épargne, du bien-être et du savoir? » (Mouvement.)
Messieurs, la justice m'oblige à dire que le passage que je viens de lire est extrait du journal la Liberté, de l'année dernière.371
Voilà pour l'équilibre. Pour ce qui est de la sécurité, il me semble qu'il y a un vieux proverbe qui dit que qui sème le vent récolte la tempête; et que tous les peuples, jusqu'aux plus grands, doivent savoir à quoi s'en tenir sur le genre de sécurité que procure le système de la défiance et de la menace permanente. N'ont-ils pas tous, à leurs dépens, appris que la victoire est changeante, et que l'invasion appelle l'invasion? Qu'ont-ils gagné à ce triste jeu? Et à quoi bon, s'ils ne veulent pas revoir les mêmes emportements avec les mêmes conséquences, ne se parler jamais que la main sur le pommeau de l'épée et le pistolet au poing?
Mais les débouchés? dit-on. Est-ce qu'il ne faut pas, pour être riche, aujourd'hui surtout, avoir des relations commerciales au dehors, et pour cela pouvoir envoyer sans crainte ses négociants et les produits de ses diverses industries jusque dans les régions les plus éloignées? Est-ce qu'il ne faut pas se pourvoir de marchés, s'assurer des points de relâche, s'ouvrir des ports qui, peut-être, ne s'ouvriraient pas d'eux-mêmes, ou dans lesquels on ne trouverait pas de garanties suffisantes si l'on n'avait derrière soi une force assez puissante pour imposer lé respect?
Messieurs, ce que je vais dire étonnera peut-être bien des personnes; mais, avant tout, il faut être franc, et je le serai. Je déclare donc que je suis convaincu, quant à moi, et depuis longtemps, qu'on prête à la force beaucoup plus de mérites qu'elle n'en a, et qu'en particulier le canon n'est pas le moyen le meilleur pour ouvrir les marchés... ni même les âmes. J'admets, certes, que l'on veuille faire triompher la civilisation de la barbarie; mais il faut que ce soit un triomphe véritable; et un tel triomphe, ce n'est pas par la terreur, c'est par les lumières, par les capitaux, par l'exemple qu'il peut s'obtenir. La route paraît plus longue, sans doute, mais croyez bien qu'elle est en réalité plus courte; car, si lents qu'y soient les pas, et si faible que soit chacun de ces pas, chacun du moins est fait pour toujours: tandis que cette trouée violente par laquelle vous pénétrez au cœur d'une région nouvelle, comme un boulet à travers la coque d'un navire, peut se refermer bientôt sur vous, ou n'être autre chose, hélas! que l'ouverture d'une voie d'eau qui vous engloutira avec votre prise. Les nations européennes, les nations chrétiennes, les nations qui marchent à la tête de la civilisation en toutes choses, et qui s'en vantent, aiment à aller promener leurs pavillons jusqu'aux extrémités du monde; et trop souvent, au nom de la supériorité de leur civilisation, elles se croient tout permis à l'égard des peuples qu'elles déclarent arriérés. Elles ont mieux à faire, j'ose le leur dire, et ce n'est pas la première fois que je le dis.372 Elles ont à donner le bon exemple à ces peuples, et pour cela, à commencer par se montrer plus sages, plus modérées, plus patientes qu'eux au besoin. Elles ont à respecter leurs traditions, leurs mœurs, leurs croyances, leurs préjugés même, jusqu'à ce que, peu à peu, la persuasion puisse agir sur eux pour les éclairer. Ce sont des hommes comme nous, après tout; et nous ne sommes pas toujours nous-mêmes exempts de bizarreries et d'erreurs. Assurément, nous trouverions fort étrange qu'un barbare quelconque, puisque barbare l'on dit, vînt chez nous ridiculiser et fouler aux pieds à tout propos nos usages; qu'il fît ses ablutions au milieu de nos appartements, ou égorgeât ses victimes en pleine rue. Il me paraît tout aussi naturel, je l'avoue, qu'un habitant du lointain Orient, un Indien ou un Japonais, par exemple, trouve mal appris le Français, ou, si vous le voulez, l'Anglais qui, exprès pour faire acte de supériorité, affecte de promener ses bottes crottées sur des lapis ou des paillassons sur lesquels on ne doit marcher que les pieds nus et lavés, qui inflige à dessein à sa personne ou à son habitation une humiliation ou une souillure peut-être ineffaçable, ou qui même, poussant l'abus de la force jusqu'à lui donner l'apparence du droit, l'oblige à consentir, sur l'échange de ses monnaies ou de ses denrées, des conditions constamment dolosives et léonines. De là à la révolte, il n'y a qu'un pas, et c'est ainsi que se préparent les Vêpres Siciliennes ou les insurrections de l'Inde. Pour avoir des relations avantageuses, ou simplement agréables, avec d'autres hommes, la première chose à faire est de leur en faire espérer à eux-mêmes de l'agrément ou du profit, et par conséquent de nouer et de conserver avec eux de bons rapports. « On ne prend pas les mouches avec du vinaigre, » dit-on vulgairement; on ne prend pas davantage les sauvages avec de mauvais procédés et des coups de bâton. On s'étonne de ce que coûtent trop souvent les colonies et du peu qu'elles produisent. Je le crois bien. A la façon dont on s'y prend, il semble qu'on n'ait autre chose en vue que de semer des difficultés et des animosités; et souvent, en effet, l'on en vient à exterminer, de guerre lasse, les habitants pour garder le pays. Les négociants, quand ils sont laissés à eux-mêmes, s'y prennent autrement. Quelques échanges; un objet, fût-ce la plus simple verroterie, qui n'a pas de prix en Europe, mais qui en a là-bas, et contre lequel les indigènes sont heureux de se défaire de ce qu'ils possèdent et qui nous paraît à nous désirable; de bons traitements, de bons exemples, des procédés de culture, de science, de médecine, des enseignements moraux, du respect, de la dignité, de la probité, en un mot, voilà, à mon avis, comment on ouvre des débouchés, et surtout comment on les conserve. Tout le reste n'est que duperie, quelle qu'en soit parfois l'apparence.
Mais c'est là peut-être ce qu'on appelle une théorie; une opinion formée loin des faits et désavouée par tous les hommes qui connaissent les faits? En aucune façon; et ces jours derniers encore je recevais une brochure extrêmement bien faite que vient de publier l'un des principaux négociants de Hambourg,373 sur le projet de créer une marine militaire pour l'Allemagne. L'une des raisons alléguées est, comme vous le pensez bien, la nécessité de protéger le commerce allemand. Or, l'auteur de cette note s'élève contre le projet précisément dans l'intérêt du commerce, et au nom de sa longue et haute expérience. Il représente que le jour où les négociants allemands se sentiraient, comme d'autres, plus ou moins assurés d'être soutenus habituellement par la force, ils deviendraient infailliblement moins sages, moins modérés, moins prudents, feraient des affaires moins sûres, se tiendraient moins soigneusement à l'écart des complications et des difficultés locales, et perdraient ainsi peu à peu ce renom de probité, de loyauté, do douceur qui les garantit mieux que toutes les protections des gouvernements. Ce renom est tel, parait-il, que l'on a vu des armateurs anglais, et des armateurs de premier ordre, le préférer à la réputation du puissant pavillon de leur nation, et se préoccuper des moyens de faire passer leurs navires sous le pavillon allemand. Leur raison était que ce pavillon, n'étant pas protégé par une marine militaire, n'est pas exposé non plus aux coups destinés à celle-ci.374
Vous voyez que nous pouvons passer outre à cet argument des débouchés, et que le commerce est hors de cause.
Faut-il parler longuement, après cela, de l'essor que donne, dit-on, l'art militaire à tout ce qui touche aux sciences et à l'industrie? Parlerai-je de l'esprit militaire et des vertus qu'il engendre?
Oui, l'art militaire a suscité, de nos jours surtout, de grands travaux; et nous pouvons tous, jusqu'à un certain point au moins, nous en rendre compte. Nous n'avons qu'à parcourir ce terrain, qui s'appelait hier le Champ de Mars, et qui désormais, si nous savions lui donner son vrai nom, devrait s'appeler le Champ de la Paix, pour contempler, au milieu des merveilles de la science appliquée à l'art de produire, des échantillon, merveilleux aussi, des progrès de la science appliquée à l'art de détruire. Je reconnais le talent des hommes qui ont combiné ou fabriqué ces engins; mais je ne puis, quant à moi, en apprécier également l'emploi. Je ne puis me résigner à penser que la science n'ait autre chose à faire que de s'épuiser à résoudre ce terrible défi de la plaque au boulet, ou du boulet à la plaque; qu'à poser et reposer sans cesse, sans jamais le résoudre, ce monotone problème: sera-ce la plaque qui résistera ou le boulet qui percera? Tant il y a crue tout est toujours à refaire; et qu'aussitôt qu'à force d'étude, d'efforts et de dépense on est arrivé à réaliser un type au niveau des difficultés de la veille, on doit s'attendre à voir le lendemain ce type mis au rebut, parce qu'un pas nouveau de la science l'aura rendu inutile en le dépassant.
Je ne puis croire non plus que l'industrie ait besoin, pour connaître et employer ses forces, de ce terrible stimulant des grands engins de guerre à construire. Il y a, Dieu merci, assez d'autres buts qui sollicitent les efforts de l'industrie; il y a assez de choses pour lesquelles les hommes ont besoin de leurs ressources, de leur intelligence, de leurs forces.
Est-ce qu'il n'y a pas (je le rappelais tout-à-l'heure) encore bien des lacunes dans notre réseau des voies de terre ou de fer? Est-ce qu'il n'y a pas des montagnes à percer, des marais à assainir, des déserts à fertiliser, des plaines, — que dis-je? — des contrées entières d'où la mort s'exhale incessamment, et sur lesquelles, si la vie de l'homme s'y appliquait utilement, la vie pourrait germer et fleurir demain? Est-ce qu'il n'y a pas à renouveler la face du monde sur tous les continents? Est-ce que les neuf dixièmes de la terre habitable n'appellent pas, depuis des siècles et des siècles, l'hôte attendu qui doit y faire surgir la fécondité sous ses pas? Est-ce qu'il n'y a pas là des choses immenses à faire, des expéditions gigantesques à accomplir, des luttes à soutenir, des éléments à dompter? Est-ce qu'il n'y a pas enfin, au prix de mille veilles et de mille dangers, mille et mille secrets à ravir à la science? Ah! l'on parle de gloire; c'en est une que celle-là, ce me semble, et une gloire qui vaut bien l'autre. On parle de courage: mais quand un savant, comme Dulong, blessé dans une première expérience, la recommence au risque de sa vie, et la recommence seul jusqu'à ce qu'il ait réussi, afin de ne pas laisser échapper un progrès qu'il croit pouvoir assurer à la science; qui donc oserait dire qu'il n'a pas déployé un courage, pour ne pas parler d'autre chose, égal, pour le moins, à la plus sublime et à la plus énergique bravoure du champ de bataille? Le médecin en temps d'épidémie, la sœur de charité à l'hôpital, ont du courage aussi, j'imagine, et du meilleur. Ce n'est pas, croyez-le bien, pour déprécier le courage militaire: mais le courage du chimiste qui expose froidement sa vie dans un laboratoire; le courage du voyageur qui, comme Livingstone, affronte pour l'humanité toutes les menaces d'un continent inconnu; le courage du navigateur qui, comme l'anglais Franklin, après avoir parcouru les mers avec des hommes qu'il tient fascinés sous la puissance de sa volonté, passe un ou plusieurs hivers aux dernières extrémités des latitudes boréales, perdu dans des régions inconnues, sans être en droit d'espérer seulement qu'on sache jamais où et comment il aura péri, et qui demeure inébranlable avec les siens dans ces solitudes de glaces et de neige, parce que c'est son devoir, et qu'on ne discute pas avec le devoir; ce courage, je le maintiens, peut être mis en parallèle, — sans craindre la comparaison, — avec le plus vaillant héroïsme du soldat à qui l'on dit: « Va te faire tuer, » et qui y va. (Vifs applaudissements.)
Encore une fois, Messieurs, il ne peut entrer dans ma pensée de méconnaître ce qu'il y a souvent de grand, de généreux, de sublime, non-seulement dans la guerre nécessaire, et par suite légitime, dans la guerre défensive; mais dans la guerre même que je désavoue, dans la guerre d'agression, alors que, détournant nos regards des ambitions ou des erreurs qui la déchaînent, nous les reportons sur les hommes qui, en la faisant, n'ont d'autre pensée que celle de servir leur pays et de faire leur devoir. Oui, assurément, l'officier que son général fait sortir des rangs pour lui dire, comme je viens de le rappeler: « Vous prendrez tant d'hommes de bonne volonté, vous irez à tel endroit, et vous vous ferez tuer jusqu'au dernier; » l'officier à qui on dit cela, et qui répond simplement: « Oui... » ce qui y va; cet homme, je le proclame, et les soldats qui marchent sciemment avec lui à la mort, sont admirables; et il ne peut y avoir d'ennemi de la guerre assez aveugle pour leur refuser une admiration sincère. Mais cela justifie-t-il la guerre, qui se fait un jeu de tels sacrifices? Ce ne sont pas les hommes, ce sont les choses que je me permets d'attaquer devant vous; et je n'ai, pour me faire bien comprendre, qu'une chose à faire, c'est de vous renvoyer à une réflexion de M. de Tocqueville, qui se présente invinciblement en ce moment à ma pensée: « Il n'y a rien de plus triste, dit Tocqueville, que les grandes vertus mal employées. » (Nouveaux applaudissements.)
Ceci dit, Messieurs, et justice rendue aux hommes, qu'il me soit permis de continuer à être juste, s'est-à-dire sévère pour les choses. Qu'après avoir reconnu aussi bien des qualités, bien des mérites, bien des vertus qui accompagnent souvent l'état militaire, lorsque cet état est exercé par des hommes généreux et d'un esprit élevé, ou lorsque, s'il s'agit d'hommes plus vulgaires, il est (passez-moi l'expression) pris à dose modérée,... il me soit permis d'ajouter qu'il n'en est pas toujours de même quand la dose est trop forte. Ainsi la tenue, l'exactitude, la discipline, la propreté, l'habitude de la règle, celle du commandement net ou de l'obéissance précise, sont assurément de bonnes choses,des choses dont tous les hommes, je ne le nie pas, auraient plus ou moins besoin de faire l'apprentissage, et qui font trop défaut, peut-être bien, à plus d'un parmi nous qui n'a pas eu l'occasion de faire cet apprentissage. Mais, de même que je n'hésite pas à dire cela, parce que cela est vrai, de même j'ajoute, parce que cela est vrai aussi, que l'excès est voisin de l'usage, et que la discipline militaire, quand on en abuse, engendre presque fatalement, d'un côté, des habitudes de commandement impérieux, despotique, minutieux, de l'autre, des habitudes d'obéissance aveugle, passive (le mot est consacré), qui ne sont pas excessives peut-être au service, étant donné le système, mais qui assurément sont excessives en dehors des rangs, excessives pour l'humanité prise en général, et fatales au ressort du caractère comme à l'indépendance du jugement. C'est un régime bon à subir en passant peut-être pour apprendre à se plier à un but commun; mais funeste quand il pèse, comme un poids qui ne peut plus être soulevé, sur la vie entière d'un grand nombre d'hommes.
Je n'insiste pas, et je ne m'arrête pas à faire ressortir ce qu'il y a de dangereux, à bien des égards, précisément dans cet esprit de corps qui tend à constituer plus ou moins une nation armée au milieu d'une nation qui ne l'est pas.
Il y a d'autres dangers, dont les militaires intelligents sont les premiers à se plaindre, dans la prolongation d'un régime qui tend a désintéresser les hommes de la vie commune, de la vie régulière, et régulièrement occupée. Ce n'est pas, je pense, s'ériger en moraliste trop rigoureux, que de gémir sur tant d'existences inutiles en grande partie à la société, improductives, oisives, et quelquefois pis qu'oisives et improductives! Comment ne rappellerais-je pas, ou plutôt comment ne nous rappellerions-nous pas tous que l'habitude prolongée de la vie commune, de la vie de caserne et de garnison, forcément imposée à un si grand nombre d'hommes, n'est pas une bonne chose pour la morale!
J'entendais dire dernièrement, — je ne sais si c'est vrai, bien qu'on me l'ait assuré, mais il importe peu, après tout, que ce soit vrai ou non, — on me disait donc que, dans une ville voisine, un certain nombre de femmes s'étaient mises à signer une pétition pour qu'une contribution extraordinaire fût imposée aux hommes qui ne se marieraient pas... (Sourires). — Traduisez; cela veut dire tout simplement: « on demande des maris! » (Hilarité générale) Mais des maris, il y en a 4 ou 500,000 sur la surface du pays, qui n'auraient pas demandé mieux pour la plupart, croyez-le bien, que de faire souche de pères de famille. Franchement, c'est autrement que la pétition devrait être tournée; et si j'avais l'honneur de connaître les gracieuses pétitionnaires, je les engagerais à en changer quelque peu le texte dans le sens des idées que j'essaye de développer devant vous.
Honorons donc, encore une fois, oui, honorons franchement les véritables vertus militaires: mais ne craignons pas que ces vertus disparaissent et s'affaiblissent, si nous faisons dans nos moeurs une plus large place aux vertus de la famille. Ne craignons pas que l'homme qui se sera habitué à travailler tous les jours pour nourrir une femme, pour élever des enfants, se trouve incapable, à un moment donné, de faire un effort pour les défendre. Il aura été un ouvrier exact et consciencieux dans un atelier, un contre-maître honnête et poli, un chef d'industrie soucieux du bien-être et de la dignité des hommes qu'il emploie; il aura, en d'autres termes, connu et rempli son devoir de chaque jour, Vienne maintenant le jour exceptionnel où il faudra faire appel à ces vertus extraordinaires, à ces sacrifices héroïques que peut exiger parfois le salut de la patrie; ce même homme saura, soyez-en assurés, remplir encore son devoir ce jour-là, et ne faillira pas à sa tâche. J'ose dire qu'il le remplira d'autant mieux. Ce n'est pas quand on est en quelque façon détaché du sol de la patrie, c'est lorsqu'on y tient par de puissantes racines, par ses intérêts, par ses affections, par toutes les fibres de l'intelligence et du coeur: c'est alors qu'on se sent animé, pénétré, transporté de cet irrésistible élan de patriotisme qui a, je le répète, soulevé dans sa retraite le coeur héroïque et simple de Jeanne Darc, de Jeanne Darc qui détestait la guerre, parce qu'elle avait vu de son village les maux de la guerre, et qui donnait son sang en refusant de verser le sang des autres. C'est alors, encore une fois, que l'on n'hésite pas à faire, s'il y a lieu, aux envahisseurs de son pays la réponse de Léonidas, la seule, je le déclare, qu'avouent la raison, la justice et le véritable patriotisme : « Viens les prendre. » Que voulez- vous? Vous voulez nos armes, nos richesses, notre territoire; venez les prendre, nous vous attendons. (Bravos.) Oui, Messieurs, le vrai patriotisme, c'est celui-là; c est le patriotisme tranquille, le patriotisme paisible, le patriotisme de la paix; c'est le patriotisme sans haine, mais non sans amour; c'est le patriotisme qui n' en veut à personne, mais qui ne se courbe devant personne, et qui, de même qu'il respecte sincèrement les droits des autres nations, entend faire respecter ses droits par les autre nations.
Dieu soit loué! c'est celui-là qui tend à prévaloir de plus en plus parmi nous. A mesure que les relations humaines s'étendent davantage, l'affection s'étend, elle aussi. L'homme, en portant plus loin ses regards et ses pas, ne cesse pas de tenir d'abord à ce qui le touche de plus près, à son foyer, à sa famille, à son village; il n'abdique pas l'attachement spécial au sol qui l'a vu naitre: mais il commence, par l'intelligence, et bientôt par l'amour, à dépasser les limites de sa province, et peu à peu les frontières mêmes de son pays. Les peuples, mêlés en quelque sorte par les sciences, par les arts, par les langues elles-mêmes, unis par les chemins de fer, par le télégraphe, et par tous ces les moyens qui, à toute heure, les font pénétrer pour ainsi dit au coeur les uns des autres, les peuples commencent, suivant une expression d'une énergique justesse, à former un réseau vivant dont toutes les mailles se tiennent, dont toutes les veines sont inextricablement enlacées. Et voici que « ce puissant et vivant réseau ne peut plus et ne veut plus se laisser déchirer »375 ou découper au gré de la violence ou du caprice. - Et à mesure que ce sentiment se développe, les relations se multiplient. Et de plus en plus tombent et s'évanouissent les défiances et les haines. Et de plus en plus les peuples sentent qu'ils ne doivent pas seulement se respecter, qu'ils doivent s'aimer; qu'ils doivent grandir ensemble pour s'assister dans leurs sueurs et non leur sang, pour féconder de concert la terre qui les porte. Ils sentent que leur ennemi commun, c'est l'esprit de violence et de destruction; et la guerre et tout ce qui se rapporte à la guerre leur apparaît comme une perturbation insensée, comme l'obstacle par excellence à l'essor nécessaire de la race humaine, à son accroissement en nombre et en qualité.
Mais ici, précisément, je rencontre une objection fréquemment répétée par des gens graves. Il y a des gens, - des gens graves, encore une fois, - qui n'hésitent pas à déclarer qu'il faut de temps en temps une bonne guerre pour débarrasser le pays du superflu de la population: c'est une saignée à opérer à peu près périodiquement pour empêcher l'humanité de mourir de pléthore ou d'ennui. Oh! je leur accorde volontiers: si c'est un mérite; incontestablement il n'y a rien au-dessus de la guerre pour refouler la vie, vous en avez vu toute-à-l'heure des exemples. Que diriez-vous pourtant si j'affirmais devant vous, c'est-à-dire, si je prouvais que, même en temps de paix, même sous le règne le plus tranquille de la paix... armée, la guerre continue son oeuvre destructive; qu'elle enlève à la population non pas seulement par les non-valeurs, mais par la mort, un nombre considérable de ses membres?
Je me suis permis, il y a bientôt deux ans, d'émettre cette assertion que 50 millions d'hectolitres de blé détruits par l'eau ou par le feu, 50 mille hommes enlevés par une épidémie (telle que le choléra qui nous arrivait alors), ne seraient pas pour l'Europe une perte comparable à celle que lui inflige annuellement le régime de dépenses militaires et d'armements exagérés auxquels elle est soumise. Accordez-moi, je vous prie, quelques minutes pour rappeler ces chiffres; ils sont assez curieux.
L'hectolitre de blé n'a pas, depuis bien longtemps, vous le savez, dépassé 30 francs; c'est même un prix qu'on peut appeler exceptionnel. 50 millions d'hectolitres de grains, en temps de cherté, représenteraient donc au plus 1,500 millions de francs. Vous avez vu, tout à l'heure, combien il s'en faut que ce chiffre de 1,500 millions soit équivalent à celui des dépenses avouées, officielles, qu'imposent aux budgets des nations leurs armements actuels: à plus forte raison est-il bien au-dessous des sacrifices réels.
Quant aux pertes d'hommes, j'ouvre un livre émané d'un médecin militaire justement célèbre, et dont la parole fait autorité. Les médecins militaires, je dois le dire, sont généralement assez sévères pour les conséquences hygiéniques et autres du régime militaire;376 cela tient peut-être à ce qu'ils sont particulièrement à même de les apprécier. Voici donc ce que dit, dans son grand ouvrage sur l'Hygiène publique et privée, M. le docteur Michel Lévy, médecin en chef de l'expédition de Crimée, et di recteur de l'hôpital militaire du Val-de-Grâce.
« Chez les hommes de 25 à 30 ans, la proportion annuelle des décès est de 1,25 pour 100; et dans les bons pays, elle atteint à peine 1 pour 100, Or, M. de Benoiston de Château-neuf a troué qu'elle était pour l'armée de 2,25. Ce chiffre est d'autant plus disproportionné, qu'il est fourni par des hommes choisis... » - c'est-à-dire par des hommes pour lesquels, dans la vie ordinaire, les chances naturelles de mort étaient exceptionnellement faibles. Encore la disproportion apparente est-elle fort au-dessous de la disproportion réelle; car la moyenne générale se trouve accrue par les décès militaires, et elle excède, par conséquent, le chiffre vrai de la mortalité purement civile. D'où vient cette différence énorme?
«... De la nostalgie, des suicides, des duels, des excès? De tout cela sans doute, et pour une part trop grande. » Ce ne sont là cependant, au dire de M. Michel Levy, que des influences secondaires: les principales sont, — avec « les erreurs des conseils de révision, » qui ont pour résultat d'imposer à des constitutions ordinaires des épreuves extraordinaires, — les brusques mutations de climat, et les fatigues qu'amènent à leur suite les exercices journaliers, les manœuvres, les parades, les veilles fréquentes, c'est-à-dire une dépense de forces qui excède souvent la mesure de la constitution et celle de la réparation alimentaire... A la spontanéité de l'individu, à la société naturelle de la famille, à la variété des travaux professionnels, succèdent la rigidité de la discipline, l'association factice et forcée de la caserne, l'immuable série des exercices et des corvées de garnison. L'organisme ne s'adapte à de tels changements que par un effort énergique et profond. Depuis l'heure des premières contraintes, des premières bouffées de nostalgie, jusqu'au jour de nivellement complet et d'uniforme aspect de toutes les individualités humaines qu'un hasard de répartition a groupées sous le même numéro de régiment, il se passe en elles des troubles, des ébranlements, des souffrances qui peuvent se comparer aux modifications imposées au colon, depuis son débarquement dans une contrée tropicale, jusqu'à l'époque où il ne se distingue presque plus des indigènes par les caractères de son extériorité. A coup sûr, la révolution organique et physique qui s'opère dans les années d’Acclimatation Militaire » (remarquez ce mot), « n'est pas moins orageuse ni moins profonde que celle de l'adaptation à un milieu atmosphérique très-différent dit milieu natal. »
Voilà certes un tableau tracé de main de maître, et l'on ne dira pas que c'est un tableau de fantaisie. Voilà la perturbation que cache aux regards, sous sa régularité extérieure et son calme apparent, cette vie militaire que l'on se plait à représenter comme favorable à la santé et à la force des hommes. Voilà son influence, ne l'oublions pas, non point dans ces pays arriérés où le soldat, pour jamais enlevé à sa famille et à son village, n'est qu'u ne machine vivante qui marche sous le knout, mais en France, mais dans le pays où les goûts militaires sont le plus développés, la gaïté la plus vive, au milieu des soins incontestables par lesquels on s'efforce d'assurer le bien-être des hommes, et avec cet espoir d'avancement et ce respect relatif de la dignité humaine que l'égalité civile assure plus ou moins à tous!
Prenez maintenant pour base ce pays exceptionnel; faites, d'après lui, le calcul de la mortalité spéciale aux soldats, et vous trouverez, pour un total de 4 millions d'hommes, que cette augmentation de 1,23 pour 100 donne précisément par année 50,000 décès en plus, c'est-à-dire 50,000 décès pour cause de service militaire. 50,000 décès, ne nous lassons pas de le redire, d'hommes choisis, d'hommes pris parmi les plus forts, les plus énergiques, les mieux trempés. Le résultat, c'est l'appauvrissement continu. Le résultat, - je vous demande pardon de la comparaison, - c'est de faire, par rapport à la race humaine, précisément le contraire de ce que l'on fait lorsqu'on veut améliorer et fortifier les races d'animaux; c'est d'éliminer, pour la reproduction régulière et normale de l'humanité, tout ce qu'il y a de plus sain, de plus vigoureux, de plus énergique, et de laisser, ou, pour mieux dire, de forcer cette reproduction il se faire principalement avec les éléments les plus faibles ou les plus avariés. - Voilà le résultat.
Et cependant, je tiens à le dire encore, quoique je l'aie déjà indiqué: la population ne surabonde pas, elle fait défaut. La terre nous manque, dit-on; non, ce n'est pas la terre qui manque aux hommes, ce sont les hommes qui, partout, manquent à la terre. Des hommes pour ravager et détruire, il y en aura toujours trop; il n'y en aura jamais assez pour travailler et produire. La terre demande des sueurs, et vous persistez à l'arroser de sang. Tant pis pour vous, après cela, si elle ne suffit pas à vos exigences. Comme on fait son sort, on le subit; et la richesse, le bien-être, la civilisation, on l'a dit avec une saisissante énergie, sont des plantes qui croissent et se développent quand elles sont arrosées de sueur, mais qui s'arrêtent et se flétrissent dès que le sang touche leurs racines.
Que serait-ce donc, Messieurs, si, profitant de l'inévitable émotion qu'inspirent de tels sujets, je mettais devant vous, après le relevé des morts et des ruines, le spectacle, le véritable spectacle des souffrances, des misères, des mutilations et des plaies hideuses par lesquelles la guerre fait son oeuvre; si je présentais à vos yeux, dans toute son horreur, le tableau, la photographie, pour ainsi parler, d'un champ de carnage? Cette photographie, il y a un livre. que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être, qui réellement la met sous nos yeux; c'est Un souvenir de Solférino. En vérité, je ne sais si j'oserais, sans crainte de voir vos coeurs faiblir et de sentir moi-même faiblir le mien, essayer de citer ici quelques-unes de ces pages navrantes. Et dans ce livre, pourtant, il n'y a pas la moindre trace de déclamation; pas un mot pour l'effet, pas de mise en scène, pas de phrases, pas, pour ainsi dire, de réflexions: la vérité, rien que la vérité; la vérité telle que l'a vue, telle que l'a consignée, presque comme un procès-verbal, un spectateur qui a eu le courage de regarder et de raconter.
Ce spectateur, vous le savez, ne s'est pas borné à regarder et à raconter. Sur le champ de bataille, à l'ambulance, dans ces granges ou ces églises transformées en charnier, où se trouvaient entassés côte à côte les ennemis de la veille, exhalant ensemble leurs plaintes et leurs cris de désespoir, il a, avec une admirable présence d'esprit, aidé de quelques volontaires comme lui, porté de son mieux le secours et la consolation. Puis, frappé de l'insuffisance de ce qui se fait encore dans ce sens, épouvanté de l'abandon dans lequel restent fatalement une grande partie des blessés de chaque nation, de l'hésitation des habitants à les recueillir, de leur promptitude à s'en débarrasser, à les dépouiller, à les achever quelquefois, il a voulu, par un grand effort, porter un remède efficace à tant de maux. Il ne s'est pas attaqué directement à la guerre, qui cause ces maux; non, il a été au plus pressé, au soulagement des blessés et des malades. Il a fait appel à la pitié, à l'émotion de ceux-là même qui font ou ordonnent la guerre; et une oeuvre d'assistance et de fraternité internationales pour les blessés, une oeuvre qu'a consacrée en 1864 un traité, le traité de Genève, et à laquelle ont successivement adhéré, à leur honneur, tous les gouvernements de l'Europe, est sortie de ses efforts. Désormais, du moins, en attendant mieux, les blessés, les hôpitaux, les ambulances et le personnel infirmier tout entier, à quelque nation qu'ils appartiennent, sont sacrés pour toutes les nations. Voilà ce qu'a fait M. H. Dunant.
Allez maintenant au Champ de Mars; et là, sous un abri qui porte, si je ne me trompe, un pavillon neutre, vous verrez une admirable réunion des moyens de secourir les blessés, exposée à nos regards par les soins de cette Association internationale dont je viens de parler. C'est à merveille! Mais après cela retournez-vous, et vous apercevrez de toutes parts, sous les divers pavillons qui se sont, pour un moment, réunis et groupés pour l'œuvre de charité commune, d'autres engins propres à chaque nation. Ces engins sont ceux à l'aide desquels se font les maux que l'on guérit, que l'on soulage, quand on le peut, au moyen des premiers.
Quel contraste! Mais quel enseignement aussi! Je ne sais si je me trompe: mais, lorsque le regard s'est promené d'un endroit à l'autre, lorsqu'il a vu comment on soulage les blessés et comment on les frappe, il me semble qu'il y a une réflexion toute simple qui monte à l'esprit comme une évidence: c'est que sans le mal on n'aurait pas besoin du remède. C'est que le plus certain et le plus facile de tous les secours à porter aux blessés, c'est de ne pas faire de blessés. La conclusion logique de l'œuvre des infirmiers internationaux, c'est donc la suppression des massacres internationaux. Cette conclusion, je ne m'en cache pas, j'espère qu'elle est venue à l'esprit de beaucoup comme au mien; et j'espère qu'avant peu, elle sera comprise de la majeure partie de l'humanité: oui, avant peu, je l'affirme, les hommes sauront ce qu'ils se doivent, non seulement d'individu à individu, mais de nation à nation, de respect, de bienveillance, d'affection. Ils sauront que, si la vie est sacrée dans chaque homme, elle est sacrée aussi dans chaque nation; et que, si le meurtre isolé est justement réprouvé par la conscience universelle, à plus forte raison doit être réprouvée cette grande et fatale « organisation de l'homicide qui s'appelle la guerre. » Alors, on ne verra plus de ces agressions sans cause, sans prétexte bien souvent, qui, pendant trop longtemps, ont été glorifiées, qui, de temps à autre, le sont encore. Alors, quand nous lirons, dans nos plus célèbres historiens, le récit de quelques-uns de ces égorgements qu'excusent, je le reconnais, qu'expliquent du moins l'entraînement des combats, la fureur et l'espèce d'enivrement qui montent à la tête des hommes exaltés par l'effort, et auquel nous n'échapperions probablement pas plus que d'autres, si nous étions à leur place; quand nous lirons ces détails épouvantables et qu'à la suite nous trouverons plus d'admiration que de compassion, nous ne pourrons nous défendre d'un étonnement parfois sévère pour tant d'aveuglement et d'indulgence. « Scènes terribles, » dit tranquillement un illustre auteur, après avoir rappelé les villes pillées, les habitants égorgés, et tout le reste des crimes immondes que se permet une soldatesque irritée et victorieuse, « scènes terribles, dont l'aspect serait intolérable si le génie, si héroïsme déployés n'en rachetaient l'horreur, et si la gloire, cette lumière qui embellit tout, ne venait les envelopper de ses rayons éblouissant! » Non, cette lumière ne nous éblouira plus; elle nous éclairera, et en nous faisant mieux voir les suites da la guerre, elle nous fera plus hautement détester la guerre. (Applaudissements.)
Et l'on dit, Messieurs, que la guerre est divine! Divine! Je vais vous dire ce qu'elle est, ou plutôt je vais vous le faire dire par le bon sens en personne, par Franklin, aux yeux duquel, vous le savez, il n'y avait jamais eu « ni bonne guerre, ni mauvaise paix. » Franklin, à diverses occasions, a posé par avance sous une forme piquante une foule de questions que notre siècle résout ou que résoudront les siècles suivants; la guerre esL du nombre. Dans une de ces boutades, voici ce qu'il raconte: « Un jeune ange de distinction, envoyé pour la première fois en mission sur la terre, avait reçu pour guide un vieux génie. Ils arrivèrent au-dessus des mers de la Martinique, précisément le jour où se livrait une bataille opiniâtre entre les flottes de Rodney et de Grasse. Lorsqu'à travers des nuages de fumée, il vit le feu des canons, les ponts couverts de membres mutilés, de corps morts ou mourants, les vaisseaux coulant à fond, s'embrasant ou sautant en l'air, et ce qui restait de l'équipage s'entrégorgeant avec fureur: « Sot étourdi, dit-il à son guide avec colère, vous ne savez ce que vous faites; vous vous chargez de ma conduire sur la terre, et vous m'amenez en enfer. » - « Non, répondit le génie, je ne me suis pas trompé; nous sommes réellement sur la terre. et ce sont des hommes que vous voyez. Les démons ne se traitent jamais les uns les autres d'une manière aussi barbare; ils ont plus de jugement, et de ce que les hommes nomment orgueilleusement humanité. » -.. Franchement, est-ce être trop exigeant que de souhaiter que l'enfer n'ait pas toujours cet avantage sur la terre? (Mouvement.)
Mais c'en est assez, Messieurs; détournons les yeux de ce triste spectacle; n'en imposons pas plus longtemps la fatigue à nos regards. Tournons-nous vers l'avenir, bien plutôt; et, après avoir vu les maux qu'ont infligés jusqu'ici à l'humanité le faux honneur, l'intérêt mal entendu et le patriotisme mal compris, consolons-nous par l'espérance de temps meilleurs; que promettent au monde le véritable honneur, la véritable gloire, la véritable richesse, la véritable force, et aussi, je le répète à dessein, le véritable patriotisme. Et si l'on bafoue, par hasard, cette espérance en la traitant d'utopie; si l'on nous dit que jamais les hommes ne cesseront d'avoir des passions, d'être sujets à des entraînements pleins d'aveuglement, et par conséquent exposés à s'égorger et à se nuire, répondons, Messieurs, que nul ne cannait l'avenir, que nul ne peut se charger de garantir la sagesse d'autrui, - pas même, hélas! la sienne propre, - mais qu'il y a une chose au moins qui est certaine, c'est que là est le but, l'idéal, le devoir, en un mot: or, s'il ne nous est pas donné de réaliser entièrement cet idéal et d'atteindre ce but en bannissant à jamais la violence de la terre, nous pouvons nous en rapprocher au moins comme s'en sont rapprochés nos prédécesseurs; et c'est quelque chose, ce me semble, si, à leur suite, nous faisons un pas nouveau vers l'union et la justice. Rappelons que ce n'est que d'hier que ces grandes idées sont sorties du cabinet des penseurs et des philanthropes, et qu'au siècle dernier ils étaient rares, bien rares, les hommes qui osaient murmurer à l'oreille ce qu'en ce moment nous crions sur les toits. Un seul peut-être, alors, avait hardiment arboré le drapeau de la paix; c'était cet homme de bien qui, pendant sa vie tout entière (et une longue vie), ne s'est occupé que de prêcher aux hommes et aux nations le respect et l'affection mutuels, l'abbé de Saint-Pierre. Que lui en est-il revenu? Il s'est vu brutalement exclure de l'Académie française pour avoir osé blâmer les guerres de Louis XIV, ces guerres d'ambition et de faste qu'avaient trop souvent célébrées les Boileau et les Bossuet,377 et que le grand roi lui-même à son lit de mort, sentait peser si lourdement sur sa conscience. Il a passé auprès des honnêtes gens, ses contemporains, pour une espèce de maniaque bienfaisant; et ça a été à, jusqu'à nos jours, à peu près, le seul renom qui soit resté à sa mémoire.
Aujourd'hui, Messieurs, on commence à l'apprécier autrement; et, sans croire peut-être encore à la réalisation prochaine de la paix perpétuelle du bon abbé, les hommes les plus sérieux ne craignent pas de donner à ses idées une attention de plus en plus marquée. Les moyens de substituer aux violentes décisions de la force un arbitrage plus équitable et plus doux occupent tous les esprits; et ce ne sont plus seulement les écrivains et les rêveurs, ce sont les diplomates, ce sont les souverains eux-mêmes, qui mettent en avant, à chaque menace nouvelle, la grande mesure d'un congrès européen de la paix.378 Aujourd'hui, de toutes les parties du monde, les voix les plus puissantes s'élèvent pour protester à l'envi contre les sauvages déchirements de la guerre, pour appeler de leurs bénédictions et de leurs vœux l'ère féconde de la paix; et les noms les plus distingués dans les lettres, dans les sciences, dans les arts, dans la religion, dans la philosophie, dans la politique même, viennent tour à tour se ranger sous cette bannière, obscure et méprisée naguère, et qui demain sera saluée par les acclamations unanimes du genre humain. En verité, si l'heure ne me pressait, il ne me serait que trop facile de justifier ici ces paroles et de multiplier devant vous les témoignages.
Je ne le ferai pas, je n'irai pas rechercher péniblement mes preuves à travers l'histoire, et je ne remonterai pas jusqu'à la païenne antiquité. Il y a un mot cependant que je veux lui emprunter, c'est le mot d'Horace, ce mot qui dit tout: « La guerre détestée des mères, Bella, matribus detestata. »
Ce mot, à quinze siècles de distance, on le retrouve, mais en action cette fois, sous la plume d'un homme d'une autre trempe qu'Horace, du malheureux et immortel auteur de
Don Quichotte, de l'héroïque combattant de Lépante, de l'indomptable esclave d'Alger. Cet homme, d'un si merveilleux génie eL d'un si grand caractère, cet homme qui, estropié et captif, osait tramer dans la servitude le magnifique dessein de rendre à la liberté les chrétiens, ses frères, en s'emparant du repaire des pirates; cet homme qui avait fait la guerre et qui l'avait jugée, nous a laissé, dans son poème de Numance détruite, le tableau de ce que ses yeux: avaient contemplé: il a mis en scène la Guerre en personne, la Guerre suivie du lugubre cortége de la Faim, de la Maladie, de la Fureur et de la Rage; et c'est une mère, une mère expirant sur le cadavre de son nouveau-né pendant à son sein tari, qui jette avec sou dernier souffle ce cri terrible: Maudite, maudite guerre!
Maudite guerre! c'est le cri de la conscience, humaine, Messieurs; et les hommes même qui ont le plus fait la guerre, ceux qui, dans l'inévitable entraînement de l'action, s'y sont le plus complu pet-être, n'ont pu, par moments, empêcher ce cri de retentir à leurs oreilles. Louis XIV, je le l'appelais à l'instant, disait à son petit-fils, au moment des dernières réflexions: « J'ai trop aimé la guerre. » Et Napoléon, qui déjà, dix ans auparavant, après les journées de Rivoli et de Mantoue, avait écrit à l'archiduc Charles cette lettre mémorable dans laquelle il parle avec tant de dédain de « la triste gloire qui peut revenir des succès militaires; » Napoléon, en 1807, après avoir parcouru le champ de bataille d'Eylau, ne pouvait dissimuler l'impression qu'il avait ressentie à la vue de ce monstrueux entassement de morts et de mourants. Dans son bulletin officiel, il inscrivait ces lignes: « Ce spectacle est bien fait pour inspirer aux princes l'amour de la paix et l'horreur de la guerre! » Plus tard, à Sainte-Hélène, il disait encore: « Ils m'ont cloué à la guerre. » A cette époque, pourtant, quelque terrible qu'il fût, le carnage n'était pas ce qu'il est devenu depuis, et l'on ne soupçonnait pas encore cette puissance effroyable de destruction grâce à laquelle, si l'on s'abandonnait vraiment à sa fureur, l'humanité serait fauchée de ce monde en une saison.
Voulez-vous entendre, après cela, les poètes et le triste ou mélodieux concert de leurs plaintes et de leurs espérances? C'est Voltaire, nous montrant un jour dans Candide, en traits grossiers et repoussants comme la réalité, tout le cortége d'horreurs qui accompagne ou suit le déchaînement de la lutte, et jetant, un autre jour, en deux vers célèbres, l'anathème à ceux qui appellent sur le monde ces fléaux:
Exterminez, grand Dieu, de la terre où nous sommes.
Quiconque avec plaisir répand le sang des hommes.
C'est André Chénier, le doux et courageux jeune homme, écrivant cette belle apostrophe trop peu connue:
Chassez de vos autels, juges vains et frivoles,
Ces héros conquérants, meurtrières idoles,
Tous ces grands noms, enfants des crimes, des malheurs.
De massacres fumants, teints de sang et de pleurs:
Venez tomber aux pieds de plus pures images.
C'est Lamartine, improvisant, en face de l'exaltation de
deux grandes nations, sa vigoureuse Marseillaise de la
Paix, et rappelant au monde, qui trop souvent l'oublie,
« qu'en s'éclairant, » il doit « s'élever à l'unité: »
Et pourquoi nous haïr et mettre entre les races
Ces bornes ou ces eaux qu'abhorre l'œil de Dieu?
...
Nations, mot pompeux pour dire barbarie,
L'amour s'arrête-t-il ou s'arrêtent vos pas?
Déchirez ces drapeaux; une autre voix vous crie:
L'égoïsme et la haine ont seuls une patrie,
La fraternité n'en a pas.
C'est Béranger, enfin, chantant, lui aussi, l'hymne de la
fraternité du genre humain; l'hymne des temps nouveaux:
Humanité, règne, voici ton âge
Que nie en vain la voix des vieux échos;
Déjà les vents, au bord le plus sauvage,
De la pensée ont semé quelques mots.
Paix au travail, paix au sol qu'il féconde.
Que par l'amour les hommes soient unis;
Plus près des cieux qu'ils replacent le monde;
Que Dieu nous dise: Enfants, je vous bénis!
Que de noms encore, « de toute race, de toute langue et de toute nation, » philosophes, penseurs, théologiens, se pressent en foule dans ma mémoire, comme pour apporter leur autorité à cette grande cause! Je n'en cite plus que trois, pris dans les trois parties de l'Europe, en quelque sorte.
Au centre, le plus grand et le plus populaire génie de l'Allemagne moderne, Gœthe, écrit dans sa vieillesse ces lignes mémorables: « En général, la haine nationale offre ce caractère particulier que vous la trouverez toujours plus intense, plus violente, à mesure que vous descendrez l'échelle intellectuelle. Mais il est un degré où elle disparaît complètement, où l'on est sympathique au bonheur ou à l'infortune du peuple voisin, comme si c'étaient des compatriotes. Tel était le degré de culture qui convenait à mon caractère, le point auquel j'avais depuis longtemps pris position, avant d'avoir atteint ma soixantième année. »
Au midi, le chef et l'organe de la religion catholique, le pape, le pape actuel… ému par les premières menaces de la guerre de Crimée, non-seulement exhale en termes touchants sa compassion pour ceux qui vont tomber loin de leurs foyers; mais il ajoute cette déclaration expresse, et que l'on n'a pas en général, à ce qu'il me semble, assez remarquée:
« Il faut que la guerre disparaisse et soit chassée de la face de la terre. » IL FAUT, entendez-vous cette parole, vous qui, au nom de je ne sais quel détachement égoïste et couard, prétendez désintéresser des choses d'ici-bas le chrétien et le prêtre, et allez jusqu'à leur faire un crime d'invoquer tout haut le Dieu de justice et de paix?
Et au nord, en Angleterre, un des plus illustres et des plus véhéments champions de la ligue anglaise, le grand orateur J.-W. Fox, montrant, dans la liberté commerciale et dans les relations plus fréquentes qu'elle entraîne, autant de liens qui doivent unir les hommes en leur faisant sentir à quel point ils sont nécessaires les uns aux autres, répétait, aux acclamations de plusieurs milliers d'auditeurs, ces belles paroles du grand poète écossais Burns: « Prions, prions pour qu'il vienne bientôt, comme il doit venir, ce jour où, sur toute la surface de la terre, tout homme sera pour tout homme un frère. » Oui, prions pour qu'il vienne, ce jour, prions et agissons.
On l'a dit, Messieurs, on l'a dit avec raison; c'est là la grande oeuvre, la grande croisade de notre temps, la croisade pacifique, la croisade de la paix. Ce n'est plus avec l'épée, c'est contre l'épée qu'il faut se lever; c'est contre l'épée qu'il faut pousser ce cri qui entraînait jadis l'Europe tout entière hors de chez elle, et qui, aujourd'hui, la rassièra sur elle-même: Dieu le veut.
Oui, Dieu le veut, et l'histoire, quoi qu'on en dise, atteste que telle est bien la loi du progrès. L'humanité, redisons-le à ceux qui croient que rien ne peut changer, a commencé par se déchirer jusque dans les derniers de ses membres; elle forme aujourd'hui de grandes et vastes communautés au sein desquelles l'ordre est habituel au moins; elle finira, suivant sa destinée, par former une seule et même famille. Le monde sera un jour, il sera bientôt, si nous savons le vouloir, cette belle et large table de famille que prédisait, il y a plus de quatorze siècles, en termes si magnifiques, le plus grand des orateurs de l'Eglise d'Orient, saint Jean Chrysostôme, alors qu'il montrait les hommes, comme des enfants sous les yeux du Père commun, se passant de main en main à la ronde tous les dons répandus, avec la diversité des climats et des terrains, sur les points les plus différents du globe.
Voilà l'idéal, Messieurs, l'idéal qui peut, qui doit se réaliser, qui déjà a commencé à se réaliser. Voilà ce que verront nos enfants; voilà, si je puis employer cette image, l'arbre sous lequel, plus heureux que nous, ils se reposeront un jour. Cet arbre, quelques efforts que nous puissions faire, nous n'en verrons, sachons-le bien, ni les dernières fleurs, ni les derniers fruits, mais nous en pouvons voir au moins la première verdure; car il est, sachons-le bien aussi, déjà planté et enraciné à l'heure où nous parlons. A nous d'en assurer et d'en hâter la croissance par nos efforts; à nous de le transmettre, à ceux qui nous suivront, plus affermi et plus prospère; à nous de redire enfin, pour leur bonheur, pour le nôtre, pour notre honneur surtout, en appliquant aux besoins nouveaux de notre âge le vieux cri des âges précédents: Dieu le veut! Dieu le veut! et nous le ferons. (Longs et unanimes applaudissements.)
PART VI. The Third Republic (1871 onwards)
64."T.S." on the "Emancipation of Women under Socialism and Liberalism" (1873)↩
[Word Length: 11,302]
Source
Mme "T.S.", "L'Emancipation de la femme considérée dans ses rapports avec le socialisme et l'économie politique," Journal des Économistes, Octobre 1873, T. 32, pp. 5-29.
L'ÉMANCIPATION DE LA FEMME CONSIDÉRÉE DANS SES RAPPORTS AVEC LE SOCIALISME ET L'ÉCONOMIE POLITIQUE379
Il est presque universellement admis aujourd'hui, que l'émancipation des femmes appartient par son essence même, aux doctrines socialistes et ultra-radicales, et qu'elle forme une part intégrale de leur programme. Ses nombreux adversaires, quel que soit le parti politique ou la nuance d'opinion auxquels ils adhèrent, sont unanimes sur ce point et affirment qu'elle ne peut être obtenue qu'au moyen d'une réorganisation totale de la société, d'un cataclysme général. Cette opinion est tellement enracinée, la conviction que l'émancipation des femmes, l'abolition de la propriété et la liquidation sociale sont des anneaux indissolubles d'une même chaîne d'idées et les diverses faces d'une même utopie, a pénétré si profondément les esprits, qu'il peut sembler bien téméraire d'oser affirmer et de vouloir démontrer le contraire. Toutefois, les axiomes aveuglément acceptés par la masse comme des vérités incontestables ne sont pas toujours exempts d'erreurs, et il est arrivé plus d'une fois que les plus grandes autorités scientifiques n'ont pas été à l'abri des préjugés en vogue et ont servi des causes injustes. Lorsqu'il s'agit de rechercher la vérité, il ne faut se laisser arrêter par aucune considération, ni par le prestige de noms illustres, ni par la crainte de choquer l'opinion reçue. Sur ce terrain, ce n'est pas le pavillon qui couvre la marchandise, c'est la marchandise en elle-même qu'il importe d'examiner et d'apprécier.
C'est en Allemagne que l'effectif de guerre dirigé contre l'émancipation des femmes est le plus formidable, tant par le nombre que par le zèle qu'il apporte dans la lutte; hommes politiques, historiens, économistes, tous sont animés de la même ardeur et s'accordent à combattre la liberté des femmes conjointement avec le socialisme, se servant des mêmes armes contre eux et les confondant dans la même haine et la même condamnation. MM. Roscher et Schaffle, dans leur cours d'économie politique, M. Froebel, dans sa brochure intitulée: Les erreurs du socialisme, et enfin M. Sybel dans un opuscule spécialement consacré à cette question, sont unanimes dans la réprobation qu'ils lui jettent, et la classent sans hésitation aucune, au nombre des chimères socialistes, des tentatives insensées tendant à supprimer les lois naturelles de l'organisme social.
Mais, tandis que les adversaires des femmes sont tous d'accord à ce sujet, l'attitude de leurs soi-disant auxiliaires ne laisse pas que de causer quelque surprise. Les socialistes interpellés si vigoureusement sur ce qu'on assure être un dogme fondamental de leur foi, restent muets et indifférents, tandis que les défenseurs qui surgissent de temps en temps à cette cause décriée, appartiennent à des groupes politiques tout opposés et n'ayant rien de commun avec le socialisme. Quelle est la cause de cet étrange phénomène et comment se fait-il que les adhérents d'une doctrine défendent si mollement un des points les plus importants de leur foi?
Avant d'analyser cette question et d'examiner les motifs sur lesquels on range la liberté des femmes parmi les utopies socialistes, il faut nous entendre sur ce terme. Chacun sait ce que veut dire le mot liberté; il a été si souvent et si soigneusement défini, qu'il serait puéril d'y revenir, s'il n'était généralement admis que les termes et les définitions changent de sens lorsqu'on les applique aux femmes. Ainsi, dans son acception usuelle, la liberté personnelle veut dire le droit de disposer de sa personne et de ses actions autant qu'on n'empiète pas sur la liberté d'autrui, mais, appliquée aux femmes, sa signification change du tout au tout. En ce cas, elle devient synonyme d'immoralité, d'abolition de la famille, enfin elle représente les notions les plus diverses, à l'exception de celle qui lui est propre. Et ce n'est pas la liberté seule qui a ce sort; elle le partage avec bien d'autres termes, avec les principes les plus élémentaires de l'économie politique, tels que la division du travail, la concurrence, etc., ainsi que nous le verrons plus loin.
Nous avouons que, malgré tout ce que ces interprétations spéciales à l'usage des femmes, peuvent avoir d'ingénieux, nous ne croyons pas devoir en user, et nous demandons la permission à nos lecteurs de conserver à chaque objet le nom qui lui est propre, sans prendre en considération le sens auquel on l'applique. Par conséquent, nous nous servirons du terme liberté dans son sens général, et nous comprendrons sous le mot émancipation le recouvrement de cette liberté, tout comme s'il s'agissait d'hommes et non de femmes.
Cela étant posé, nous voudrions examiner d'abord si l'émancipation des femmes appartient réellement aux doctrines socialistes, nous rendre compte ensuite des caractères distinctifs de l'argumentation employée par ses adversaires, et éclaircir enfin la situation actuelle de la question, ainsi que sa marche probable dans l'avenir.
I.
Quels sont les traits distinctifs des écoles socialistes et quel est le but qu'elles poursuivent? D'un côté, elles nient l'existence de lois naturelles régissant les sociétés humaines, et elles croient à la possibilité de leur réorganisation sur d'autres bases; de l'autre, elles réclament cette réorganisation au nom de la justice, en vue d'un régime plus équitable à établir. L'objet suprême auquel elles visent, c'est l'égalité, l'uniformité du travail, des salaires et de la consommation. Il est évident qu'il n'y a rien de plus contraire à l'uniformité que la liberté, et que ces deux principes doivent forcément se trouver en opposition. On sait que la nature a horreur de l'uniformité et qu'il est impossible de trouver deux familles, et même deux êtres humains absolument identiques; la liberté doit nécessairement accroître les inégalités naturelles, et toute tentative de les amoindrir et de les supprimer ne peut se faire qu'à ses dépens. C'est de là que provient l'antagonisme du socialisme et de l'économie politique, la dernière étant le champion le plus valeureux de la liberté, tandis que le premier s'est constitué celui de l'égalité. L'idéal des économistes est la liberté individuelle, la faculté accordée à chacun de se développer, de produire et de jouir selon ses aptitudes, ses goûts et ses besoins, tandis que celui des socialistes est le nivellement artificiel des individus en faveur d'une notion abstraite d'équité. Les premiers prétendent qu'il est nuisible de s'immiscer dans les rapports économiques et d'en troubler le libre jeu, pendant que les seconds sont constamment à la recherche de formules magiques, douées de la puissance de rendre les hommes égaux et heureux à la fois, et dont la condition indispensable est une réglementation des plus strictes, capable de faire plier sous son joug de fer toutes les inégalités physiques, intellectuelles et morales, que produit incessamment la nature. Ce régime idéal qu'ils veulent fonder ne peut se réaliser qu'à condition de sacrifier les volontés individuelles au bien-être de la communauté, et même, il n'y a pas une seule des réformes demandées par ce parti qui n'exige un sacrifice pareil. S'agit-il de l'égalité des salaires? Il faut que l'ouvrier habile et diligent renonce à son surplus pour se contenter de la moyenne que peut gagner l'ouvrier médiocre. Est-il question de la gratuité du crédit? Il faut que le capitaliste ou le propriétaire renonce au revenu que lui donne l'intérêt ou le loyer perçu. Demande-t-on l'abolition de l'héritage? Il faut que le père de famille ou le possesseur d'une fortune soit privé du droit de disposer de sa propriété après sa mort. Veut-on fonder un phalanstère? Il est nécessaire que tous ses membres abjurent leur initiative propre et se plient à la discipline imposée. En un mot, c'est toujours et partout le même phénomène: toute amélioration ne s'obtient qu'aux dépens de sacrifices imposés à une partie de la société.
Ensuite, la nécessité de ces sacrifices engendre à son tour celle d'un déploiement de forces à employer, en vue de les obtenir et suggère l'idée du bouleversement de l'ordre établi. Pour défendre aux hommes de travailler à leur guise et de jouir du produit de leur travail, il faut avoir des armes puissantes à son service et entreprendre une œuvre de destruction gigantesque. Ainsi donc, l'objet du socialisme est d'inaugurer l'égalité entre les hommes, et cette égalité exigeant le sacrifice des volontés individuelles, ses moyens d'action sont la violence et la contrainte.
Si cela est vrai, et si le socialisme vise à l'égalité aux dépens de la liberté, comment l'émancipation des femmes ou la revendication de leur liberté peut-elle appartenir à son code? C'est ici que commence cette équivoque dans les termes, cette transformation des locutions reçues, à laquelle nous avons fait allusion plus haut, et qui revient chaque fois que la cause des femmes est abordée par ses adversaires. Oui, nous dit-on, l'émancipation des femmes est du socialisme, parce qu'elles demandent l'égalité vis-à-vis des hommes, et que, par conséquent, elles réclament le nivellement artificiel entre les deux sexes et s'en prennent à la nature elle-même qu'elles veulent réformer.
Un moment de réflexion suffit à prouver à tout esprit impartial qu'on prend plaisir ici à confondre les notions les plus simples, l'égalité naturelle avec le nivellement artificiel: s'il est insensé de vouloir rendre tous les hommes également forts, également actifs et intelligents, il n'est que juste de leur permettre également à tous de faire l'emploi le plus lucratif de leurs forces et de leurs talents, de disposer du produit de leur travail, et de diriger leur vie selon leur convenance, autant qu'ils ne portent préjudice à personne. Réclamer l'abolition de castes ou de corporations privilégiées n'est pas demander un nivellement artificiel, quoique ce soit aussi revendiquer l'égalité, et l'économie politique a depuis longtemps marqué la limite qui sépare le privilége du droit naturel. Il est vrai que la liberté de la femme comprend son égalité à l'égard de l'homme; mais quelle espèce d'égalité est-ce? La même exactement que demanderaient des hommes dont le travail rencontrerait des entraves dans les préjugés nationaux ou les monopoles industriels, et cette réclamation serait-elle hostile à la liberté, aux lois naturelles et économiques? En accuserait-on les auteurs de faire cause commune avec les socialistes, de vouloir le bouleversement de l'ordre établi? Et cependant, cette même déduction, qui paraîtrait si criante s'il s'agissait d'hommes, se fait tous les jours par les publicistes les plus renommés et est acceptée comme une vérité incontestable parce qu'il est question de femmes. L'égalité naturelle, produit de la liberté, est identifiée à l'égalité artificielle, cherchée par les socialistes et combattue avec les mêmes armes.
Ecoutons ce que dit à ce sujet M. Froebel, auteur d'un traité fort estimé sur la politique et d'autres ouvrages:
« Le bonheur de l'amour consiste dans l'inégalité, et cela pas autant dans l'inégalité physique que dans la diversité intellectuelle des sexes. Il serait inutile d'énoncer des vérités aussi simples, si notre époque n'abondait en phénomènes découlant de leur négation. Des femmes insensées s'imaginent servir leur sexe en essayant de supprimer, ne fût-ce qu'en apparence, la différence entre la situation de l'homme et la femme, tandis que des philosophes, qui ne doivent ce titre qu'à la propagation du dilettantisme, n'ont pas honte de se mettre à la tête de ces folies féminines. »380
M. Froebel n'est pas seul à se servir de ces arguments. MM. Roscher et Schaffle, quoique économistes, y ont également recours, en y joignant quelques autres. Voilà ce que nous dit le premier: « Ce qu'on appelle aujourd'hui l'émancipation des femmes ne pourrait qu'aboutir à la dissolution de la famille et par là rendre à la femme le plus déplorable service. Qu'on la rende d'une manière absolue l'égale de l'homme et que la concurrence seule décide de la suprématie du sexe, et il est fort à craindre que l'on ne voie bientôt revenir cet état d'oppression, sous lequel la femme a longtemps gémi chez les peuples arriérés. »381
M. Schaffle, connu en Allemagne pour ses idées ultra-libérales et progressistes, n'en laisse rien paraître dans cette question, et se trouve en accord parfait avec les publicistes cités.
« L'émancipation de la femme et sa concurrence avec les hommes, dit-il, loin de lui procurer la véritable égalité, ne la mèneraient qu'à la ruine morale et économique. La femme a besoin d'être entretenue par l'homme à l'époque de la gestation, des couches et de l'allaitement de son enfant. »382
Ces passages venant de la part d'économistes font naître des réflexions fort sérieuses. Ce n'est plus l'égalité seule dont le sens est interverti, c'est toute une série de principes les plus élémentaires de l'économie politique qui sont renversés, et cela dans des manuels consacrés à la propagation de cette science. La liberté et la concurrence, nous dit-on, conduisent à l'oppression et à la ruine économique, et il faut l'intervention de la loi et du pouvoir pour s'en garantir. Mais, si cela est vrai, ce sont donc des principes fort malfaisants de leur nature, et les bureaucrates d'un côté, les socialistes de l'autre, ont bien raison de leur faire la guerre.
Si la liberté et la concurrence sont incapables d'assurer l'harmonie économique, si elles mettent en péril toute une moitié du genre humain, ce seul fait ne suffit-il pas pour inspirer une défiance légitime à leur égard? Lorsqu'on nous affirme d'un côté qu'il est inutile et même pernicieux de protéger le travail et l'industrie nationale contre l'étranger, que tout privilége et tout monopole sont des entraves à l'accroissement de la richesse publique, que la concurrence, en augmentant le nombre des travailleurs, et par conséquent en multipliant la production, est également profitable à tous, et qu'on proclame en même temps qu'on ne peut lui laisser le soin d'assurer l'existence des femmes, que son résultat direct est en ce cas de causer la ruine et d'engendrer l'oppression, que doit-on penser de ces contradictions? Comment peut-on espérer convaincre les socialistes de l'immuabilité de lois, que leurs défenseurs eux-mêmes déclarent être aussi variables dans leurs effets? De quel droit s'élever contre les côtés pernicieux de la réglementation, lorsqu'on voit en elle son unique appui dans une question aussi grave que celle des rapports économiques entre les deux sexes?
C'est ainsi qu'une première erreur entraîne à sa suite une série de fausses déductions, qui vont bientôt former un dédale inextricable. Ne pouvant démontrer que l'égalité naturelle était l'égalité artificielle, qu'elle était attentatoire à la liberté, les adversaires des femmes ont été obligés par la force des choses à changer d'armes, et à sacrifier cette liberté, dont ils font leur idéal, en jetant dans le même gouffre les lois économiques les plus absolues. Entrés en lice contre le socialisme et n'en trouvant pas les signes accoutumés, les économistes ont imperceptiblement changé de place avec l'ennemi, et troqué leur arsenal économique contre le sien. En effet, les socialistes ont-ils jamais affirmé autre chose, si ce n'est que la libre concurrence aboutit à la ruine et à l'oppression, et qu'il est urgent d'y porter remède? Ne disent-ils pas aussi qu'il ne faut pas laisser les inégalités naturelles se produire librement, qu'il faut régler d'avance les occupations et le rôle de chaque membre de la société? N'est-ce pas de point en point ce que professent les économistes, tels que MM. Roscher et Schaffle, lorsqu'ils prétendent placer sous un même niveau toutes les femmes, et délimiter d'avance la sphère de leur activité? De quel côté y a-t-il la tendance d'imposer l'égalité, de niveler artificiellement? Est-ce de celui où l'on désire que tous les êtres humains, quel que soit leur sexe, aient le droit de disposer librement de leurs actions et de leurs capacités, ou de celui où l'on prétend fixer jusque dans ses moindres détails le rôle, les occupations et les particularités morales et intellectuelles de toute une moitié du genre humain?
Après avoir renié les principes, on défigure les faits. A lire les passages cités, ne croirait-on pas que le travail des femmes est un phénomène inconnu dans notre société, et qu'il est question de l'introduire. Les femmes, à l'époque où elles deviennent mères, nous dit-on, ont besoin d'être soutenues par l'homme. Ce fait n'empêche pas, cependant, un nombre considérable d'entre elles de manquer de ce soutien; et comment peut-il être invoqué pour limiter la sphère de leur activité? Un nombre considérable de femmes travaillent aujourd'hui malgré cette particularité de leur nature, et il nous semble difficile de comprendre en quoi leur situation empirerait, si elles disposaient de débouchés plus larges et pouvaient prétendre à des professions plus lucratives; pourquoi cesseraient-elles d'être entretenues par l'homme aux époques où leur nature le requiert, dans les cas où cela se pratique actuellement?
Revenons à notre comparaison entre l'émancipation des femmes et le socialisme. Nous avons vu que les réformes demandées par ce dernier reposent sur le sacrifice des volontés individuelles; en est-il de même pour les femmes? Est-ce aux dépens d'autrui qu'elles veulent acquérir leur liberté? Si on allait déclarer d'emblée leur égalité civile et politique avec les hommes, et lever les restrictions légales qui gênent leur travail, ce fait diminuerait-il d'un iota la somme de liberté existante dans le monde, et empiéterait-il sur le libre arbitre des classes et des individus? Nous avons vu ensuite que la réalisation des rêveries socialistes demande le bouleversement de l'ordre établi; au contraire, pour concéder la liberté aux femmes, non-seulement il n'est besoin de rien détruire, mais encore cette façon de procéder leur serait particulièrement nuisible. Ce n'est pas une reconstruction de l'ordre social qu'elles demandent, c'est la participation à cet ordre. Peut-on accuser ceux qui demandent l'abolition d'un monopole industriel, de vouloir la destruction de l'industrie? Les femmes ne veulent rien changer à l'organisation de la société; elles prétendent uniquement à jouir des bénéfices de cette organisation à l'égal des hommes, et à être gouvernées par les mêmes lois économiques qui régissent ces derniers. Où sont donc les points de contact de cette juste demande avec le socialisme?
Mais nous dit-on, et ici nous touchons à l'argument fondamental dirigé contre la liberté des femmes, cette liberté est un phénomène contre nature, et elle équivaut à l'abolition de la famille, un des dogmes essentiels du socialisme. Nous avouons que cet argument nous semble manquer de clarté; qu'est-ce qui est anti-naturel, est-ce le fait que les femmes travaillent en dépit de leur constitution physique, ou est-ce celui qu'elles fassent concurrence à l'homme dans les carrières lucratives? L'appel qu'on fait constamment à leurs particularités physiologiques semble marquer qu'il s'agit du premier point, tandis que d'autres signes indiquent qu'on a en vue le second. Il est vrai qu'il est difficile d'affirmer que le travail est un acte contre nature pour la femme, en face des masses énormes qui y sont astreintes; mais en ce cas, de quel droit lui oppose-t-on sa constitution physique lorsqu'il s'agit d'occupations mieux rémunérées? Pourquoi le fait qu'une femme met au monde des enfants et les allaite ne l'empêche-t-il pas d'être maîtresse d'école dans un village, et forme-t-il un obstacle insurmontable à ce qu'elle soit professeur dans un collége? Pourquoi lui permet-il de travailler aux champs et à l'usine, et lui défend-il de surveiller ces travaux ou de gérer cette usine? Pourquoi lui permet-il d'être télégraphiste ou distributrice de lettres aux bureaux de poste, et lui interdit-il d'occuper des emplois plus élevés et mieux rétribués dans ces mêmes hiérarchies? Pourquoi ne l'empêche-t-il pas d'être sage-femme et l'empêcherait-il de devenir médecin? Il n'est que trop évident, à la moindre analyse, que ce n'est pas dans la nature qu'il faut aller chercher les motifs de cette anomalie, et que ses lois ne sont que des prétextes spécieux dont on colore les vraies causes de cet état de choses.
Enfin, il est difficile de concevoir par quel saut de la pensée, on joint deux propositions aussi dissemblables que la liberté des femmes et l'abolition de la famille. Si l'homme; étant libre, cherche à former une famille, pourquoi la femme libre y serait-elle moins disposée? La liberté dont jouit l'homme ne l'empêche pas de reconnaître les devoirs qu'il s'impose en se mariant; pourquoi ceux de la femme lui paraîtraient-ils moins sacrés, lorsqu'elle cesserait d'être considérée comme mineure par la loi, et qu'elle pourrait librement choisir sa vocation? La famille étant un phénomène naturel, est-il besoin de garantir son existence par des restrictions au libre arbitre des femmes? Dira-t-on que l'ambition entraînera les femmes à déserter leur foyer domestique, ou que les hommes ne voudront plus du mariage une fois qu'ils auront affaire à des êtres aussi libres qu'eux? Mais s'il se trouve réellement des femmes douées d'aptitudes assez remarquables pour réussir dans la vie publique, et dépourvues en même temps du sentiment de leurs devoirs directs, ce cas ne sera probablement pas assez fréquent pour inspirer des inquiétudes sérieuses, et d'ailleurs aucune loi ne serait assez puissante pour forcer ces femmes à remplir leurs devoirs. N'y a-t-il pas mille autres moyens d'y échapper, et s'il est défendu de travailler et de gagner, ne peut-on pas employer son énergie à dépenser et à consommer? Entre ces deux issues, il y a cependant une différence: lorsqu'une femme néglige ses devoirs pour une autre sphère d'activité, au moins y a-t-il quelque compensation au mal qu'elle fait, tandis que si elle les néglige pour se livrer au plaisir de la dépense, il en résulte une perte sèche pour la société.
D'un autre côté, cette liberté peut-elle réellement effrayer les hommes de bien? L'usage qu'on fait de l'autorité conjugale est-il assez fréquent dans les classes aisées, pour qu'il soit si difficile d'y renoncer? Au fond, elle ne profite qu'aux mauvais sujets, qu'à ceux qui en abusent, et elle ressemble sous ce rapport aux passeports, qui ont été institués en vue de poursuivre les malfaiteurs, et dont le résultat le plus clair est de molester les honnêtes gens. Les maris qui ont vraiment à se plaindre de leurs femmes préfèrent tout souffrir que de recourir à la loi, et cette dernière ne protége que ceux qu'on aurait dû réprimer.
Nous avons dit que les adversaires de la liberté des femmes tâchent de baser leurs objections sur les lois de la nature et de prouver qu'elle est en contradiction avec ces lois. Voyons si leur manière de voir est réellement plus conforme à la nature et quel est l'idéal qu'ils opposent à l'émancipation des femmes.
II
Les auteurs que nous avons cités jusqu'ici n'effleurent que légèrement la question qui nous occupe, et si leur opinion n'en est pas moins nettement tranchée, elle n'est pas suffisamment motivée dans ses détails, et prête plus aux conjectures que nous ne le voudrions. En revanche, nous avons devant nous une brochure de M. Sybel, entièrement consacrée à ce sujet, où nous trouverons les lumières nécessaires pour élucider les points restés dans l'obscurité jusqu'ici.
M. Sybel commence par protester contre la calomnie d'après laquelle la situation actuelle des femmes se rapprocherait de la servitude, et justifierait la revendication de leur liberté, et, comme preuve, il nous trace la peinture suivante du mariage:
« Les époux se donnent mutuellement leur main et leur cœur, nous dit-il, c'est-à-dire leur corps et leur âme. Ces rapports constitueraient la servitude la plus honteuse, s'ils n'étaient le résultat d'un amour libre, profond et éternel. Ces deux êtres ont la volonté de n'en former qu'un seul et à jamais, sinon l'homme serait malhonnête et la femme déshonorée. De ce fait primordial, l'union des personnes, découle naturellement le fait secondaire, la fusion de toutes leurs relations antérieures, de leur fortune, de leurs affaires, de leurs liens d'amitié. Avant d'exercer quelque action en dehors de la maison, la volonté individuelle des époux doit être fondue dans une détermination commune; leur propriété s'est également fondue en une seule, en ce sens qu'elle doit être employée exclusivement au bénéfice commun et non individuel de chacun d'eux. »
Ce préambule paraît excessivement libéral, car il n'y est question que des obligations mutuelles des époux; nous allons voir tout à l'heure par quel procédé les deux volontés doivent se fondre en une seule, et ne s'exercer au dehors que dans une détermination commune.
« La vie de famille, continue notre auteur, comme toute communauté humaine, est régie par la loi suprême de la division du travail. Pour ce qui regarde les époux, la division de leur travail, et conséquemment leur situation juridique est, une fois pour toutes, déterminée par la nature, sans que la volonté humaine, les talents personnels ou les progrès du temps y puissent changer quelque chose. Ce fait si simple et si décisif, c'est que dans le mariage les hommes sont pères, tandis que les femmes sont mères. Tout est dit par là.
« Il incombe donc à l'homme de représenter la famille au dehors, d'être le protecteur et le guide de la jeune mère, de fournir à la ménagère active les moyens d'entretien. C'est à lui de poser un fondement solide à la maison qu'elle gère, de la protéger dans le combat de la vie avec les armes du droit, et de lui procurer la nourriture et le respect dans le tumulte du monde. Tout ce qu'il fait, il le fait pour sa femme, mais, comme c'est lui qui porte la responsabilité de ce qu'il ne se fasse rien que de juste et d'utile dans la famille, et que la femme ne peut pas s'en charger à cause de ses devoirs maternels, c'est lui aussi qui doit avoir voix décisive en dernière instance. A cause de ce simple motif, qui est immuable comme la division des soins paternels et maternels, c'est l'homme qui est le chef de la famille, et c'est la femme qui est l'âme de la maison.
« Dans un bon mariage, l'homme raffermit l'intelligence de la femme par son jugement logique, tandis que la femme, par la droiture de son instinct, devient la conscience de son mari. L'homme se rend maître du monde et par conséquent de la maison, par la discussion et le raisonnement; mais la femme, de par sa connaissance instinctive des hommes, guide son seigneur et maître, et Dieu nous garde que cette influence nous fasse défaut en son temps et lieu! »383
Ainsi donc, comme d'un côté il ne peut exister deux volontés dans un ménage, et que de l'autre, la voix décisive appartient à l'homme, il faut avouer que la marge accordée à la liberté de la femme y est bien grande, et bien faite pour nous convaincre de l'excellence de la thèse défendue par M. Sybel; en effet, elle est libre de se conformer à l'opinion et à la volonté de son mari, que lui faut-il de plus? Le second l'ait qui frappe dans le tableau poétique de cet Éden conjugal, c'est le luxe de réglementation qui y règne jusque dans ses moindres détails, c'est combien tout y est soigneusement prévu et fixé d'avance. La loi suprême de la division du travail n'y régit pas seulement les occupations des époux, elle délimite encore leur sphère intellectuelle et morale; c'est le mari à qui il incombe de déterminer ce qui est juste et utile, c'est lui qui a le monopole du jugement logique et du raisonnement, tandis que la femme ne possède que la droiture de l'instinct, une connaissance intuitive des hommes. Si on s'enquiert de la cause qui rend ces catégories intellectuelles et morales aussi immuables que la situation juridique des époux, la réponse est péremptoire: c'est parce que les femmes sont mères d'une autre façon que les hommes sont pères. » Nous en demandons pardon à M. Sybel, mais ce fait si simple et si décisif à son avis, ne nous semble pas aussi lucide qu'il le dit. Sur quoi est fondée l'assurance que l'accouchement et l'allaitement exercent une influence aussi tranchée sur l'intelligence, et détruisent nommément la faculté du raisonnement et de la logique? La physiologie a-t-elle fait cette découverte, et la science l'a-t-elle comptée comme une loi de la nature?
M. Sybel affirme ensuite que la situation juridique des époux est déterminée, une fois pour toutes, par la nature, sans que la volonté humaine, les talents personnels où les progrès du temps puissent se modifier, et ici encore, sa pensée véritable nous échappe. Autant que nous sachions, on ne donne le nom de loi immuable de la nature qu'à une série de phénomènes identiques, ne souffrant pas d'exceptions. Ainsi, lorsqu'on dit que la mortalité est une de ces lois immuables, ou qu'on range dans ce nombre la succession des saisons, c'est parce que ces phénomènes se reproduisent toujours de la même manière et qu'on ne peut citer aucune exception à ces règles. Or, peut-on affirmer qu'il n'existe pas de couples mariés, dans notre état de civilisation, où la division de travail et les rapports des époux ne soient complètement opposés à la peinture de M. Sybel? N'en trouve-t-on pas où la femme travaille et pourvoit à l'entretien de la famille, tandis que le mari se livre à la fainéantise et à la débauche, où la femme possède et inculque à ses enfants la notion du juste et de l'utile, tandis que le père de famille ne connaît que celle de l'égoïsme ou de l'immoralité? N'en voit-on pas d'autres où le mari manque de caractère et d'intelligence, et où le jugement logique et le raisonnement sont du domaine exclusif de la femme? Enfin, n'y en a-t-il pas un nombre infini où les deux époux sont également obligés de travailler, de se guider et de se préserver dans le tumulte du monde? Comment concilier ces faits si simples et si décisifs avec les lois immuables proclamées par M. Sybel? Et comment peuvent-ils se produire et se multiplier en dépit de ces lois? D'un autre côté, si nous trouvons dans le présent un si grand nombre d'exceptions à ces lois, pouvons-nous affirmer que leur action, si impuissante aujourd'hui, empêchera toute modification des rapports conjugaux dans l'avenir? Il est possible, toutefois, que M. Sybel n'ait eu en vue que les classes aisées de la société, et que ce soit uniquement vis-à-vis d'elles que la nature devienne immuable; qu'elle tolère dans les classes inférieures le labeur manuel, et ne réserve ses rigueurs que pour les couples plus fortunés. En ce cas, il serait curieux de savoir le cens qu'elle exige pour devenir immuable. Quelle est la position sociale ou l'état de fortune où commence son action, et passé quelle limite d'aisance la volonté humaine et les talents personnels ne peuvent-ils rien changer à la situation des époux?
Et ici surgit encore un problème des plus curieux: si la cause de la subordination des femmes et de leur manque de logique tient uniquement à l'acte qui les rend mères, qu'en est-il de celles qui n'ont pas d'enfants? Sont-elles capables de raisonner, de distinguer le juste et l'utile?
Lorsque, après avoir considéré la situation des femmes dans le mariage, M. Sybel consacre son attention à celles d'entre elles qui n'ont pas eu la chance d'entrer dans l'Éden conjugal, et d'être guidées par le jugement logique de l'homme, et qui sont obligées de demander au travail leurs moyens d'existence, il apporte, dans cette étude, la même conception de la nature féminine et les mêmes principes que dans la première. Nous n'y retrouvons plus, il est vrai, le phénomène primordial des particularités physiologiques, mais, en revanche, le fait secondaire qui en découle, l'absence de logique y occupe la première place et sert de fil conducteur dans le labyrinthe confus de permissions et d'interdictions, nécessitées par le travail des femmes.
Voici quelle est la règle générale à suivre, nous dit l'auteur: « Plus une profession s'éloigne du labeur machinal et inconscient, plus elle exige de raisonnement logique, et moins elle est appropriée au travail des femmes. Ce n'est que grâce à un génie personnel hors ligne qu'une femme peut entrer en lice avec un homme, et, en ce cas même, elle court le danger de perdre ce tact et ce sentiment innés dont elle est douée, et qui forment le plus grand charme de son sexe.
« Tandis qu'une femme poète nous présente un phénomène naturel et charmant, on a le frisson en entendant nommer un avocat, un littérateur ou un publiciste féminin. La cause en est toujours la même: l'exercice de ces professions exige une dialectique consciente et méthodique, et ces propriétés sont en contradiction avec la constitution normale de la femme. Le charme propre à son sexe disparaît, tandis que nous ne pouvons avoir qu'une confiance médiocre dans son œuvre anti-naturelle.
« Il n'y aurait aucun profit, ni pour l'État, ni pour les femmes elles-mêmes, à leur conférer des droits politiques ou à les admettre aux fonctions publiques. En revanche, il serait absurde de mettre des entraves à leur coopération dans l'industrie, l'art et la littérature; l'unique stipulation que devrait y apporter la loi, et qui découle de la nature même du mariage, c'est que la femme mariée ne puisse entreprendre aucun métier, ni profession, sans l'adhésion de son mari ».384
Cette nouvelle classification du travail des femmes est bien faite pour inspirer le désir d'en pénétrer les motifs. Nous voyons d'abord que tout ce qui demande un raisonnement logique ou une dialectique méthodique doit être interdit aux femmes, tandis que tout travail inconscient leur sera permis, cette dernière catégorie comprenant l'art et la poésie. Sans nous arrêter à analyser si ces derniers domaines peuvent réellement être cultivés d'une façon tout inconsciente, et ne demandent pas une certaine dose de raisonnement et de logique, il est curieux de connaître les causes de cette division. Pourquoi une femme ne pêche-t-elle pas contre sa nature en faisant de la poésie, et commet-elle une action anti-naturelle en écrivant un article de journal? Evidemment, parce que le premier de ces travaux est du goût de M. Sybel, tandis que le second lui donne le frisson. Quelque égard que nous ayons pour les sensations de l'illustre historien allemand, et supposant même que ce goût ne lui soit pas tout à fait personnel, qu'il soit partagé par des centaines, voire même des milliers de ses compatriotes, des préférences et des antipathies de ce genre constituent-elles un motif suffisant pour entraver la liberté d'autres êtres humains, quel que soit leur sexe? Toute restriction légale dans le choix du travail ou de la profession faite a priori, s'adressant à telle ou telle catégorie de personnes, en raison de leur naissance et sans égard à leur œuvre, est un attentat à la liberté individuelle, et demande, pour être justifiée, des causes plus sérieuses que des goûts ou des frissons de qui que ce soit.
Ces mesures restrictives ne sont pas non plus justifiables par la simple affirmation, que les femmes manquent de logique; existe-t-il une statistique comparée de la logique masculine et féminine, et a-t-on jamais essayé de l'établir?
Toutefois, l'arbitraire de ces classifications le cède encore de beaucoup à la dernière clause que met M. Sybel à ses concessions, l'adhésion formelle du mari à tout travail de sa femme. Quelle serait la raison d'être d'une loi pareille, et quels abus serait-elle appelée à réprimer? Il est évident qu'elle aurait pour but d'empêcher les femmes mariées de négliger leurs devoirs de famille, mais si la loi se mêle de prohiber tout ce qui est contraire à ces devoirs, pourquoi se bornerait-elle à ce seul cas? N'est-il pas également pernicieux, pour la famille, qu'une femme passe toutes ses nuits au bal? N'est-il pas souvent dangereux de mettre les enfants en nourrice, de les confier à des servantes tandis qu'on fait des voyages? etc., etc. Pourquoi ne pas défendre ces pratiques ainsi que bien d'autres?
Il est clair que cette loi serait inutile pour le but qu'elle serait appelée à atteindre, mais cela serait son moindre inconvénient, et elle deviendrait bien décidément malfaisante entre les mains de ceux qui voudraient en faire une arme d'exploitation et d'oppression. La nécessité, pour une femme mariée, d'embrasser un métier ou une profession, est le plus souvent engendrée par l'incapacité ou le mauvais vouloir de son mari; est-il juste que, réduite à demander à son travail les moyens d'entretenir sa famille, elle voie s'ajouter, aux obstacles qu'elle devra vaincre, celui d'obtenir le consentement de son mari?
Nous avons mentionné plus haut l'inefficacité des passeports: cette même institution peut encore nous servir à élucider le cas qui nous occupe. En Russie, c'est le mari qui donne le passeport à sa femme, en l'absence duquel elle ne peut élire domicile nulle part. Eh bien! voici ce qu'il en advient. Les classes aisées ne font que rarement usage de ce droit, mais, en revanche, dans le peuple, il devient un moyen fréquent d'extorsion. Les mauvais ouvriers, les soldats, s'en servent pour vendre a leurs femmes le droit au travail, et leur imposent de fortes redevances qu'ils vont dépenser au cabaret. Aussi, au moment où les hommes politiques, en Allemagne, demandent à la loi de nouvelles rigueurs envers les femmes, songe-t-on sérieusement, en Russie, à abolir les abus existants, et ce privilége des maris est mis à l'étude, de concert avec le problème de l'abolition des passeports.
Telle est l'argumentation de M. Sybel dans ses traits principaux, tels sont les principes sur lesquels il établit la situation de la femme dans le mariage et les conditions de son travail, l'asservissement de sa volonté et de son intelligence d'un côté, et sa renonciation à tout ce qui demande de la logique de l'autre. Ces principes, l'auteur les appuie sur la nature et ses immuables lois, mais nous avons pu nous convaincre que ce qu'il appelle de ce nom ce ne sont pas les phénomènes réels se produisant sous nos yeux, mais un régime idéal, rêvé par lui; sa nature n'est pas la nature concrète et objective, comme disent les Allemands, mais c'est une nature abstraite et éminemment subjective à M. Sybel, de même que les lois immuables qu'il proclame ne sont pas celles qui existent, mais celles qui devraient exister à son avis. Cette nature chimérique qu'il nous retrace fait songer aux peintures de la nature idéale de Fourier, et, s'il faut tout dire, nous avouons que rêve contre rêve, nous préférons celui du travail attrayant à l'Eden conjugal prêché par M. Sybel, au moins le trouvons-nous plus réalisable; le nombre des travaux est si immense dans le monde et leur sphère si multiple, qu'à la rigueur chacun pourrait trouver celui qui lui convient, tandis que jamais cette pauvre nature, si maltraitée par M. Sybel, ne se plierait à produire l'uniformité exigée pour ses unions modèles, jamais on ne parviendrait à lui prescrire ce partage des qualités et des aptitudes d'après une recette voulue.
Qu'on nous permette encore une réflexion sur ces particularités physiologiques auxquelles les adversaires de la liberté des femmes reviennent toujours et sur lesquelles on bâtit tant de systèmes de réglementation divers. Il est notoire, en effet, que la nature physique et physiologique de la femme diffère de celle de l'homme, mais pourquoi ce fait entrai ne-t-il nécessairement l'uniformité dans la vocation, les aptitudes et les goûts de la femme, tandis qu'il ne produit pas le même résultat chez l'homme? Les hommes étant tous égaux sous ce rapport, diffèrent sous tous les autres, et comportent la plus grande variété de capacités et de qualités; pourquoi en serait-il autrement des femmes, et leurs fonctions physiologiques les placeraient-elles toutes à un même niveau intellectuel et moral? Cette conception n'est-elle pas bien plus contraire à la nature que la liberté engendrant la diversité? Et lequel des deux partis en présence, celui des adversaires ou celui des défenseurs de l'émancipation des femmes se rapproche-t-il davantage des utopies socialistes et égalitaires?
Dans son intéressant ouvrage sur le Travail des femmes au XIXe siècle, M. Paul Leroy-Beaulieu réfute victorieusement les arguments des philanthropes qui voudraient interdire aux femmes l'accès de la grande industrie. Il analyse minutieusement les trois principes sur lesquels reposerait cette prohibition, et il combat tour à tour la foi à l'omnipotence de l'Etat dans l'organisation de la société, l'adoption de la famille comme unité primaire de l'état social, et la notion du préjudice causé aux hommes par la concurrence du travail des femmes. Ce qu'il dit sur l'erreur de considérer la famille avant l'individu ne s'applique pas uniquement au travail des manufactures, mais à une sphère bien plus vaste. S'il est vrai que l'Etat n'a que des droits bornés, si son rôle, relativement aux individus, est presque négatif, s'il ne peut leur imposer les idées ou les mœurs qu'il affectionne, ni les contraindre aux pratiques qu'il juge les plus rationnelles, si ses attributions s'arrêtent au sanctuaire de la volonté humaine, où il n'a le droit d'intervenir que si cette volonté déréglée empiète sur les volontés similaires,385 comment peut-il entreprendre de déterminer les emplois auxquels il faut admettre les femmes et ceux dont il faut les exclure? Si M. Paul Leroy Beaulieu ne lui reconnaît pas le droit d'interdire aux femmes le rude labeur de l'usine, sur quoi est basé celui de leur interdire l'accès aux professions libérales? Est-ce sur l'urgence de ne pas porter atteinte à la famille, de protéger la faiblesse de la femme? Mais ici encore, l'auteur se prononce catégoriquement: « La femme,386 dit-il, n'est pas une créature incomplète, inférieure; adulte, elle possède devant la loi des droits égaux aux droits de l'homme; ayant comme lui la capacité d'acquérir, elle a comme lui la capacité de travailler. Plus faible physiquement que l'homme, rien ne démontre qu'elle lui soit moralement ou intellectuellement inférieure. » Et plus loin, nous lisons: « La famille, quelle que soit son importance sociale, n'est pas chez nous l'élément primaire de la société: cet élément primaire, c'est l'individu seul qui le constitue. »
Si cela est vrai, cela le devient-il moins lorsqu'il s'agit de carrières intellectuelles que de travail manuel, et des maximes aussi absolues peuvent-elles varier selon les diverses espèces de travail? Si l'individu doit être considéré avant la famille, cela ne s'applique-t-il pas également à toutes les classes de la société et à toutes les espèces d'activité?
Enfin, si la concurrence de la femme, loin d'être nuisible, n'est qu'utile dans les branches les plus encombrées de la production, ne serait-elle pas moins préjudiciable encore dans celles qui demandent des aptitudes spéciales et un apprentissage long et compliqué? « La concurrence des femmes et des hommes est une concurrence naturelle, affirme encore M. Paul Leroy-Beaulieu, «et nul n'a le droit d'y porter atteinte, ou de la supprimer, pour élever la rémunération du travail des hommes».387 Par conséquent, nul n'a le droit, en se basant sur de prétendues lois de la nature, ou en réalité sur ses préjugés et ses goûts personnels, de circonscrire la limite de leur travail et des carrières qu'elles peuvent embrasser. Voilà des déductions bien autrement simples et décisives que ne le sont les lois immuables découvertes par M. Sybel; et quel contraste entre les idées claires et logiques de M. Paul Leroy-Beaulieu et la rhétorique ampoulée non-seulement de l'historien allemand, mais encore des économistes célèbres de ce pays, tels que MM. Roscher et Schaffle! Mais on sait que les mauvaises causes aiment à se parer de phrases sonores, et où en trouve-t-on plus que chez les socialistes?
III.
Après avoir considéré les armes dont se servent les adversaires de l'émancipation des femmes, jetons un coup d'œil sur le genre de défense qu'elle trouve auprès de ses soi-disant auxiliaires, les socialistes et les partis avancés. Il est vrai que ce terme se retrouve dans la plupart des systèmes socialistes, qu'il est question de l'émancipation des femmes dans les phalanstères de Fourier, les colonies modèles d'Owen, dans la nouvelle religion de Saint-Simon, mais est-ce bien dans l'acception générale du mot liberté qu'il est employé par les socialistes? Evidemment non, puisque la notion de la liberté individuelle est en contradiction avec l'essence même de leurs doctrines. Aussi, ce qu'ils appellent émancipation des femmes n'est que la destruction des bases établies de la famille et un asservissement bien plus complet que leur situation actuelle. Les restrictions que les lois et les mœurs leur imposent aujourd'hui ne sont rien en comparaison de la servitude qui leur écherrait en partage dans cette société nouvelle, qui prétend les délivrer: obligées de renoncer à la vie de famille, à l'éducation de leurs enfants, au respect de soi-même, elles deviendraient véritablement esclaves, et il faudrait bien peu de discernement pour consentir à échanger l'objet réel contre un vain mot. Il est vrai qu'elles seraient égales aux hommes, mais il faut être aveugle pour ne pas s'apercevoir que cette égalité serait celle de la servitude et non celle de la liberté. Décréter l'abolition de la famille et la promiscuité des sexes, ce n'est pas élargir les droits des femmes, c'est les resserrer, au contraire, en leur enlevant leur vocation la plus chère, en les réduisant à l'état animal.
Telle était la conception de la liberté des femmes, professée par les fondateurs des écoles socialistes. Quant à leurs continuateurs actuels, ils semblent peu se préoccuper de cette question et ne pas la trouver aussi grave que veulent bien le faire accroire leurs adversaires. Au moins, ne peut-on signaler aucun écrit de quelque importance émanant de cette école, et consacré à la défense des droits de la femme. Tout au contraire, parmi ses organes les plus radicaux, on en voit qui déclarent catégoriquement y renoncer, et on peut citer comme exemple les États-Unis d'Europe, qui ont bien décidément éliminé cette question de leur programme. De même, lorsqu'il en est question dans les réunions publiques,388 ce n'est que comme d'une question peu importante, et les dames elles-mêmes, qui essayaient la force de leur éloquence dans ces réunions, — témoin Mme Paul Minek, — préfèrent l'employer réfuter les arguments usés contre l'exploitation de l'homme par l'homme, et semblent plus en peine de rétablir l'équité des salaires que d'assurer la liberté de leur sexe. Si ce dernier point était réellement aussi grave pour les réformateurs de la société que le prétendent leurs ennemis, jouerait-il un rôle aussi secondaire dans leurs discussions et dans leur propagande? Il est évident, au contraire, qu'il s'est faufilé dans leur programme d'une manière toute fortuite, et qu'il n'a pas d'autre signification pour eux que de recruter le plus grand nombre d'auxiliaires dans un moment donné, de même que les chefs de bandes ameutées commencent toujours par ouvrir les prisons à tous les détenus, sauf, après la victoire, à faire justice de ceux qui ne sont pas de leur avis. Il est absurde de supposer que des partis, dont le but consiste à faire ployer tous les membres de la société sous le joug le plus rigoureux, puissent ou veuillent faire exception pour le sexe féminin, et la plus simple réflexion suffit à démontrer que ces promesses ne sont qu'un leurre, et ne pourraient jamais être réalisées.
Il n'y a peut-être pas de pays au monde où la polémique à propos des droits de la femme ait tant occupé la presse et l'opinion publique qu'en Russie, et comme les passions politiques y jouent un bien moindre rôle que partout ailleurs, et qu'elle y a été confinée dans le domaine de la théorie, il est curieux de voir la marche qu'elle y a suivie. Au début, les organes avancés s'en sont emparés comme leur appartenant de droit, et ont énoncé a ce sujet les professions de foi les plus chaleureuses. Toutefois, les partis modérés et libéraux ayant à leur tour épousé la même cause avec non moins de zèle, et s'étant efforcés de démontrer qu'elle se rattachait étroitement à leurs idées générales, les progressistes se sont ravisés et en sont venus à se demander si leur ardeur ne les avait pas entraînés trop loin, s'ils étaient restés bien conséquents avec eux-mêmes. Les Annales de la Patrie, un des deux organes russes les plus avancés, résolut un jour de s'en expliquer catégoriquement, et offrit à ses lecteurs une profession de foi assez curieuse, dont nous demandons la permission de citer quelques passages, marquant l'évolution capitale, à laquelle nous avons fait allusion plus haut. Il faut observer ici, que les réticences et les expressions un peu vagues de cet article sont nécessitées en Russie par les rigueurs de la censure, mais il nous semble que, malgré les précautions prises, la tendance s'en dégage assez clairement pour ne pas laisser de doute sur les points capitaux. D'un autre côté, il nous faut prévenir nos lecteurs, que, si la couleur politique de l'article est assez atténuée pour éviter les poursuites légales, on ne peut en dire autant de ses procédés polémiques; nous avons essayé d'en atténuer la crudité sans la supprimer entièrement, pour ne pas enlever à l'article sa couleur locale. En voici donc les passages les plus caractéristiques:
«Voyons la question des femmes; au temps du George-Sandisme cette question, quoique placée plus bas sous quelques rapports, l'était incontestablement plus haut sous d'autres. Il s'agissait alors de la liberté dans l'amour, et les femmes cherchaient de nouvelles combinaisons sociales, elles voulaient soumettre les deux sexes à de nouveaux principes. Aujourd'hui, c'est le droit au travail qui a remplacé la liberté de l'amour, mais à ce degré plus élevé, la question se résout d'une façon bien moins satisfaisante. Pour me faire mieux comprendre, j'aurai recours à une comparaison: autrefois, il s'agissait d'un problème d'arithmétique; aujourd'hui, c'est d'un problème d'algèbre qu'il s'agit. Et je ne dis pas que l'arithmétique soit supérieure à l'algèbre, mais j'affirme que la solution du premier problème valait mieux que celle du second. Les partisans actuels des femmes s'efforcent de prouver leur capacité à occuper les emplois dévolus jusqu'ici aux hommes seuls, et leur droit à l'égalité vis-à-vis de ces derniers. Ces thèmes sont assez ingrats, car qu'a-t-on gagné après avoir démontré qu'une femme est un être humain et qu'elle est capable de s'occuper de médecine ou de toute autre science? Cela n'empêche pas les ennemis des femmes de les traquer de plus belle et de continuer la campagne commencée. Pourquoi la continuent-ils? Ils prétendent que l'émancipation des femmes ébranle les bases de la société; mais où est-il cet ébranlement, lorsque les femmes aspirent à devenir agents de police, à l'instar de miss Newmen? Il est évident que, loin d'ébranler les bases, elles ne songent qu'à les fortifier. Quel gibier chassez-vous donc, messieurs les traqueurs, et à qui destinez-vous vos piéges grossiers? Il est clair qu'on est dans les ténèbres et qu'on ne reconnaît plus les siens dans la bagarre. Le fait, que les femmes sont admises comme télégraphistes, sténographes, médecins, et que dans l'avenir, elles pourront devenir juges, avocats, etc., est acclamé avec triomphe par les uns et considéré comme le pire des maux par les autres; quelle position doit adopter ici un homme, qui ne désire pas persécuter d'un côté, et qui ne veut détacher aucune question spéciale du grand problème social de l'autre?
«Un tel homme dira: il m'est agréable de voir dans la femme, non une poupée, mais un être humain comme moi; il m'est agréable de savoir que les forces qui se perdaient autrefois s'utilisent au profit de la société. Je regrette que les femmes rencontrent des obstacles sur cette voie, et je trouve ces obstacles d'autant plus étranges de la part des traqueurs, que les forces féminimes ne demandent pas seulement à servir la société en général, mais veulent être employées au profit de la forme déterminée de la société, que les traqueurs croient de leur devoir de défendre. Si la question, telle qu'elle se pose aujourd'hui, est résolue en faveur des femmes, il peut en résulter quelques améliorations partielles dans l'ordre établi, mais cet ordre lui-même ne peut en subir aucune atteinte; il n'y a donc aucun sujet de joie pour nous, ni d'affliction pour les traqueurs. Il en serait autrement si la question des femmes n'était pas isolée, si les femmes apportaient avec elles de nouvelles combinaisons économiques, ou de nouveaux principes politiques. En ce cas, je le comprends, les traqueurs auraient raison de les poursuivre, et les adhérents à certaines doctrines d'y mettre toute leur âme. Mais nous ne voyons rien de pareil. Quant à moi, il m'est complètement indifférent que ce soit un homme ou une femme qui expédie mon télégramme, qui sténographie mon procès, qui m'accuse et me défende devant le tribunal, qui fouille mon logement pour soupçon de crime politique. Je sais seulement que dans la société actuelle, il existe nombre de professions pour lesquelles il serait à désirer que les candidats diminuassent au lieu de s'accroître. C'est pourquoi je ne puis mettre mon âme dans cette question. Il ne faut pas oublier qu'elle n'est qu'une partie du problème appelé le prolétariat intellectuel qui, à son tour, n'est qu'un chapitre de la grande question sociale. Je dis donc aux femmes: instruisez-vous, obtenez le droit au travail, travaillez. Mais lorsque vous aurez achevé votre éducation, je verrai à quoi vous emploierez votre savoir; lorsque vous aurez obtenu le droit au travail, je verrai comment vous l'organiserez et les commandes de qui vous remplirez. C'est justement parce que vous êtes des êtres humains tout comme les hommes, que vous êtes également sujettes à l'erreur, et que vous pouvez servir une cause injuste. J'espère que beaucoup d'entre vous partageront mes opinions. Celles-là, je les acclame d'avance, pas seulement en qualité de femmes, mais comme mes collaborateurs, professant la même foi que moi, aimant ce que j'aime et détestant ce que je déteste. Mais je sais aussi que beaucoup d'entre vous seront mes ennemis les plus acharnés, d'autant plus dangereux qu'elles apporteront plus de zèle et d'intelligence dans leur œuvre. Ceci ne peut me réjouir et cependant je vous dis, instruisez-vous, travaillez. Voilà ce qu'aurait dit un homme n'appartenant pas à la corporation des traqueurs, et qui ne voudrait isoler aucune des questions du vaste domaine social ».389
Ces paroles ne disent-elles pas aussi clairement que le permet la censure: nous trouvons l'ordre établi inique et mauvais et notre objet est de le reconstruire sur de nouvelles bases; si les femmes veulent nous aider dans cette œuvre, nous nous ferons les champions de leur liberté; autrement cette liberté ne peut que nous être indifférente et même hostile. On y voit poindre, en outre, une défiance des plus marquées à l'endroit de leur concours, une crainte fondée sur l'expérience, qu'elles se serviraient de leur liberté pour consolider les bases de la société, au lieu de les ébranler. Ce parti commence à entrevoir également, qu'élever le niveau de l'instruction des femmes est un mauvais moyen pour les convertir à ses chimères, et quand l'expérience aura fortifié ces prévisions, il finira par se déclarer franchement hostile à cette émancipation qu'il avait défendue sans avoir réfléchi à ses conséquences.
Plus la question en litige s'éclaircira en théorie et en pratique, plus les tendances socialistes s'y montreront contraires; et lorsque tout le monde s'accordera à reconnaître que la liberté a les mêmes propriétés et les mêmes traits distinctifs, à quelque sexe qu'elle s'applique, qu'elle n'a pas plus une tendance égalitaire qu'elle n'est synonyme d'immoralité, le gouffre qui sépare les deux doctrines deviendra de plus en plus profond et infranchissable.
IV
Il est temps de nous résumer. Nous avons vu d'abord que les adversaires de l'émancipation des femmes l'accusent d'être en communauté avec les doctrines socialistes et perturbatrices de l'ordre établi, et après avoir analysé les motifs sur lesquels est appuyée cette accusation, nous avons pu nous convaincre de sa fausseté. Nous avons pu constater qu'elle reposait d'un côté sur un malentendu dans les termes, sur la confusion entre l'égalité naturelle, produite par la liberté, avec le nivellement artificiel, et de l'autre, sur une conception erronée des lois de la nature.
Nous avons vu ensuite que l'argumentation dirigée contre l'émancipation des femmes est en contradiction flagrante avec les principes les plus élémentaires de l'économie politique et du libéralisme, qu'en niant l'influence bienfaisante de la libre division du travail, de la concurrence, de la responsabilité individuelle, et en y substituant la foi à l'intervention du pouvoir et à la réglementation sous toutes ses formes, on se rapproche tantôt des tendances bureaucratiques et protectionnistes, tantôt et le plus souvent des procédés socialistes; de même que les socialistes, on renonce à l'analyse des faits, à la connaissance des phénomènes réels pour la remplacer par des chimères et des pages d'éloquence; comme eux, on est plein de mépris pour les véritables lois de la nature, on s'efforce d'en supprimer la diversité infinie pour la soumettre à une uniformité et à une égalité qui lui répugne, en nivelant non-seulement les occupations, mais encore les qualités morales et intellectuelles de toute une moitié du genre humain.
Nous avons vu enfin, que les soi-disant auxiliaires des femmes en sont au fond les ennemis les plus dangereux, et qu'ils commencent eux-mêmes à pressentir l'hétérogenéité de ce point de leur programme avec leur objet principal.
Quelle est donc la conclusion à tirer de tous ces faits réunis? Faut-il croire que la liberté des femmes étant basée sur les mêmes principes et suivie des mêmes résultats que celle des hommes, il n'y ait pas de diversité entre les deux sexes? Ce serait évidemment une absurdité. Il est plus que probable que la diversité physique qui existe entre eux, a quelque corrélation intellectuelle et morale, que les aptitudes et les goûts des femmes ne sont pas absolument identiques à ceux des hommes, et qu'il existe une division du travail naturelle entre les sexes. Seulement, et toute la question se résume en ceci, comment trouver le moyen de fixer la ligne de démarcation sans risquer de commettre les erreurs les plus grossières et les plus préjudiciables à la société? De quel guide se servir, pour préciser exactement ce qui convient à chacun des deux sexes ce qui doit leur être permis et prohibé, sans se laisser entraîner par ses préférences personnelles, sans se fonder sur le plaisir que vous procure une femme poète, ou le frisson que vous donne une femme publiciste? Lorsqu'il s'agit d'émettre des lois, chacun est plus ou moins enclin à fonder son opinion sur son expérience personnelle, et comme cette dernière est forcément restreinte, à étendre à des groupes entiers les observations faites dans un petit cercle. Les législateurs ressemblent alors à ces voyageurs superficiels, qui après avoir parcouru à la vapeur un pays étranger, jugent les caractères et les mœurs de ses habitants sur quelques exemplaires rencontrés par hasard; mais à cette différence près, que le mal fait par des récits faux et incomplets est bien insignifiant en comparaison de celui que peuvent produire des règlements injustes et des entraves à la liberté humaine.
Ces difficultés sont si grandes et si inextricables, qu'à notre avis, l'unique moyen de résoudre équitablement le problème, c'est de s'en remettre à la liberté et de ne s'y immiscer sous aucun rapport. Que la femme ait les mêmes droits que l'homme, que son travail ne rencontre d'obstacle légal dans aucune sphère, et la vraie différence des sexes s'accusera avec une précision bien plus grande qu'elle ne peut le faire sous le régime actuel de réglementation et de mesures préventives. Si le monopole de la logique, que M. Sybel confère si généreusement à l'homme, sans toutefois nous en offrir un spécimen bien remarquable lui-même, est un monopole naturel, comme il l'affirme, il acquerra encore plus de force sous un régime de liberté et suffira à garantir l'autorité conjugale, tandis que la femme se convaincra mieux qu'elle ne peut le faire par les arguments de l'auteur, que ses particularités physiologiques l'empêchent de discerner le juste et l'utile et l'obligent à se contenter d'un labeur inconscient et de la connaissance instinctive des hommes.
Enfin, si la liberté ramène, en effet, l'état d'oppression dont menace les femmes M. Roscher, cette expérience ne pourra que leur être utile; après avoir éprouvé sur elles-mêmes les funestes conséquences de la concurrence avec les hommes, elles demanderont à retourner à l'ordre actuel, qui gagnera à ne plus être troublé par leurs réclamations et leurs plaintes. De quelque côté donc que nous envisagions le régime de la liberté, il ne peut qu'être avantageux à tous les partis, à l'exception de ceux qui nient les lois naturelles régissant l'organisme de la société.
Quant à ceux qui craignent que cette liberté n'amène un cataclysme général, aucun argument ne pourra les rassurer et il n'y a que l'expérience qui puisse calmer leurs terreurs. Chaque fois qu'il s'est agi d'abolir un privilége, on a vu non-seulement les personnes directement intéressées à sa conservation, mais celles mêmes qui n'avaient rien à y perdre, s'en effrayer outre mesure et croire à un ébranlement de la société. Et cependant, ces priviléges que la routine avait appris à considérer comme les fondements de l'édifice social, ont été abolis l'un après l'autre, sans que cet édifice en ait souffert. Le mouvement de notre civilisation est éminemment démocratique, et le principe de l'égalité civile et de la libre division du travail gagne tous les jours du terrain; l'émancipation des femmes en est le résultat direct et inévitable.
Quel en sera le résultat pratique? C'est ce qui est très-difficile à prévoir dans les détails, mais il est évident que les effets d'une réforme pareille seraient très-lents à se produire, et que ce n'est que graduellement que les femmes pourraient user de la liberté qui leur serait accordée. Cette lenteur et cette gradation donneraient le temps aux esprits de s'habituer à ce qui paraît étrange aujourd'hui, seulement parce que c'est inusité. Bien des pratiques passeraient alors insensiblement dans les mœurs et ne choqueraient plus les idées reçues. Aujourd'hui, par exemple, on trouve tout naturel que les femmes se vouent à l'état d'institutrice, et cependant si c'était une profession qui leur fût fermée, ne pourrait-on pas démontrer péremptoirement, en se servant des mêmes arguments dont on use dans d'autres cas, qu'elle est incompatible avec leurs particularités physiologiques? Ne pourrait-on pas alléguer qu'il serait imprudent de confier des élèves à une femme, qui peut devenir mère, et qu'il lui serait impossible de remplir des devoirs de ce genre? Nous savons tous ce qui en est en pratique, et que les femmes qui embrassent cette profession acceptent en même temps la condition de ne pouvoir être ni épouses, ni mères; nous savons aussi que les candidates à cet emploi sont bien plus nombreuses que les places offertes, et ce fait influe-t-il sur l'existence de la famille? Pourquoi donc cette dernière serait-elle plus menacée, si quelques-unes de ces femmes choisissaient un travail qui leur conviendrait mieux et contribuaient ainsi à élever le salaire des institutrices?
D'ailleurs, quelques tempéraments qu'on admette en pratique, quels que soient les égards qu'on ait pour les intérêts engagés, il faut que les principes soient clairement posés en théorie, et aujourd'hui les hommes libéraux voient s'élever devant eux le dilemme suivant il leur faut croire à la liberté et admettre ses effets bienfaisants sans faire de différence entre les sexes, ou bien, ne plus s'élever contre l'omnipotence de l'Etat, les priviléges et les monopoles. S'ils ne veulent pas se séparer de leurs doctrines les plus chères, il leur faudra assigner le point précis où leurs principes absolus cessent d'agir, où l'État devient compétent à imposer les idées et les mœurs qu'il affectionne, à marquer la limite exacte où l'individu cesse d'être l'élément primaire de la société, et où la concurrence de l'homme et de la femme, d'utile qu'elle était, devient malfaisante.
Pour ce qui regarde les adversaires déclarés de la liberté des femmes, ils devront également, pour rester conséquents, leur interdire tout travail et demander que l'Etat entretienne à ses frais celles qui manqueront de soutiens naturels. Si l'Etat déclare que la vie de la famille est leur unique vocation et qu'il leur défende le domaine du travail lucratif, il n'est que juste qu'il songe à leur entretien, s'il ne peut leur garantir le mariage.
Il faut choisir entre ces deux issues, et surtout, il faut mettre fin à ce combat dans les ténèbres, à cette équivoque dans les mots qui met la confusion dans les rangs et embrouille les questions les plus claires. Il est inutile de confondre plus longtemps l'émancipation des femmes avec le socialisme et de l'attaquer sous ce déguisement; elle en est l'opposé de même que toute autre liberté, et il faut que ses ennemis aient le courage de l'avouer enfin. Qu'on l'attaque loyalement et en face, sans chercher à donner le change au public, ignorant le fond des doctrines qu'on confond à plaisir sous ses yeux, et ce sera déjà un grand pas de fait. La liberté ne manque pas de mauvais côtés; n'est-il pas suffisant de les relever, sans avoir recours à des équivoques de mots et sans intervertir les faits? C'est le moins qu'on puisse demander à la nombreuse phalange des adversaires des femmes, y compris les autorités scientifiques qui ne dédaignent pas de descendre dans l'arène et de rompre une lance en faveur du sexe privilégié.
KKK.S.
65.Molinari on "The Evolution of the Modern State" (1884).↩
[Word Length: 13,674]
Source
Gustave de Molinari, L'évolution politique et la révolution (Paris: C. Reinwald, 1884). Chapitre VII "La politique intérieure des États modernes," pp. 191-237.
CHAPITRE VII. La politique intérieure des États modernes
I. Aperçu rétrospectif de la constitution des États de l'ancien régime et de leurs conditions d'existence. — II. Le communisme politique. — Causes de son infériorité. — Conséquences de son établissement. A l'extérieur: recrudescence artificielle de l'état de guerre et aggravation de ses maux. A l'intérieur: détérioration des différentes parties de la gestion de l'État. 1° Exclusion des étrangers du personnel des services publics; 2° Extension progressive des attributions du gouvernement; 3° Extension et détérioration de la tutelle gouvernementale; 4° Restrictions opposées à l'exercice des libertés nécessaires au self government; 5° Impuissance et corruption de l'opinion publique; 6° Résultats.
I. Aperçu rétrospectif de la constitution des Etats de l'ancien régime. — En étudiant la fondation et la constitution des Etats politiques, nous avons constaté qu'ils n'étaient autre chose que des entreprises instituées, comme toutes les entreprises, dans le but de réaliser un profit. Aussitôt que la création du matériel de l'agriculture et de la petite industrie eut rendu profitable l'exploitation régulière d'un territoire meublé de ses habitants, on vit des associations se former pour entreprendre cette branche d'industrie, qui était alors et devait être longtemps encore la plus lucrative de toutes: les promoteurs de ces entreprises s'adjoignaient un personnel suffisant, avec l'outillage et les approvisionnements nécessaires, en stipulant la part de chacun dans les résultats éventuels de l'entreprise et ils organisaient ce personnel conformément au but qu'il s'agissait d'atteindre, comme on organise un atelier quelconque. Ils formaient une armée avec laquelle ils effectuaient la conquête du domaine qu'ils convoitaient, puis, cette opération achevée et le partage fait entre les coparticipants, ils constituaient un gouvernement chargé de défendre le domaine conquis contre la concurrence des autres sociétés politiques, de l'agrandir au besoin à leurs dépens et de l'exploiter de manière à en tirer le plus gros profit possible. Nous avons constaté encore qu'après le partage du domaine entre les membres de la société conquérante, le chef de la hiérarchie militaire, duc, roi ou empereur, devenu le chef héréditaire du gouvernement, s'était appliqué à absorber dans l'intérêt de sa maison les parts de souveraineté, autrement dit de propriété politique, échues à ses co-associés, et qu'à la fin du XVIIIe siècle, par suite de ce travail d'absorption, les Etats de l'Europe appartenaient, sauf en Allemagne, à un petit nombre de « maisons politiques » qui les exploitaient à leur profit et s'efforçaient de les agrandir aux dépens des maisons concurrentes.
Dans toute cette période de l'existence des Etats politiques, la nécessité principale à laquelle ceux qui les possédaient et les exploitaient avaient à pourvoir, c'était de se défendre contre la concurrence étrangère et, subsidiairement, de se fortifier et de s'agrandir aux dépens de leurs concurrents. Tel était l'objet de leur politique extérieure. Cette politique avait pour instruments la diplomatie et la guerre. Conclure des alliances politiques en vue d'augmenter les forces de l'État dans la prévision d'une guerre de défense ou de conquête, sauf, le résultat atteint, à se défaire de ses alliés, parfois pour en prendre d'autres parmi ses ennemis de la veille; semer habilement la division parmi ses concurrents, fomenter entre eux des querelles et des guerres propres à les affaiblir, contracter des unions matrimoniales avantageuses, principalement au point de vue des successions: voilà quelle était la mission de la diplomatie, mais cette mission n'était, en dernière analyse, qu'une préparation à la guerre. C'était la guerre, c'est-à-dire la mise en œuvre de la force organisée, qui décidait des destinées des Etats. C'était principalement par la guerre qu'ils s'agrandissaient ou s'amoindrissaient et qu'ils finissaient par périr, absorbés par un concurrent plus habile et plus fort. La grande et incessante préoccupation des propriétaires exploitants des Etats politiques, — associations constituées sous forme de républiques ou de féodalités, maisons royales ou impériales, — était, en conséquence, d'avoir toujours prêtes des forces et des ressources suffisantes pour soutenir une guerre quand ils venaient à y être exposés, ou pour l'engager quand ils jugeaient le moment opportun. Bref, dans un État de l'ancien régime, tout était subordonné aux nécessités de la politique extérieure, car la grandeur et l'existence même de l'État en dépendaient immédiatement.
La situation extérieure de l'État influait de deux manières sur sa politique intérieure. D'abord la présence d'une concurrence toujours menaçante obligeait l'association ou la maison qui le possédait à le gérer de façon à en tirer la plus grande somme possible de forces et de ressources applicables à la guerre. Si elle le gérait mal, si elle laissait la division et le désordre s'y introduire, si elle épuisait les populations assujetties, elle diminuait les éléments de sa puissance et augmentait par là même le risque qu'elle courait de succomber dans une lutte extérieure, et d'être ainsi dépouillée du domaine qui lui fournissait ses moyens d'existence. Ensuite, l'état de guerre, surtout à l'époque où le risque qu'il faisait courir à la civilisation était à son maximum d'élévation, où les forces du monde barbare n'avaient pas cessé de balancer celles du monde civilisé, l'état de guerre nécessitait un ensemble de mesures d'ordre et de précaution analogues à celles qui constituent le régime d'une ville en état de siège.
Dans une ville en état de siège, tout est subordonné aux nécessités de la défense. Le commandant de la place est investi de pouvoirs extraordinaires; il soumet les habitants à une discipline particulière et il leur impose des servitudes de toute sorte: il réglemente la plupart des manifestations de l'activité privée, interdit les réunions et les associations qui lui paraissent dangereuses, pourvoit aux approvisionnements, défend la sortie des subsistances et des articles nécessaires à la défense, etc., etc. Si l'on apprécie ces mesures sans tenir compte des nécessités de l'état de siège, elles paraîtront, sans aucun doute, oppressives et contraires aux principes les mieux établis de l'économie politique; en revanche, elles se justifieront, au moins en grande partie, — car l'état de siège peut être surchargé de rigueurs inutiles et de règlements nuisibles, — si l'on tient compte de la présence de l'ennemi, de l'interruption ou de la difficulté des communications avec le dehors et de la situation anormale qui en résulte. Cela est si vrai que la population de la ville assiégée ou simplement exposée à un siège, consciente du danger qu'elle court et des mesures de précaution qu'il nécessite, consent volontairement à se soumettre aux gênes, aux servitudes et aux charges de l'état de siège, et qu'elle en réclame le maintien aussi longtemps qu'elle se croit menacée, parfois même après que le péril a disparu. Voilà ce qu'il ne faut pas oublier, quand on étudie la gestion intérieure des États de l'ancien régime dans ses différentes branches, la police, l'administration et les finances.
La plus importante de ces branches était la police, et principalement la police politique. La maison ou l'association propriétaire n'avait pas seulement à redouter une dépossession partielle ou totale causée par la guerre extérieure, elle avait à se prémunir aussi contre les compétitions dynastiques, les révoltes, les conspirations et les divisions intérieures, et ces périls se trouvaient naturellement aggravés par la présence et les machinations des concurrents du dehors, qui s'efforçaient d'en profiter. C'est pourquoi la police et la justice avaient pour premier objet de prévenir et de réprimer les attentats contre l'autorité du souverain et la sûreté de l'Etat, les crimes dits de lèse-majesté ou de haute trahison. On se préoccupait beaucoup moins des atteintes portées à la vie et à la propriété des particuliers et on les punissait avec moins de sévérité. Sans doute, l'intérêt bien entendu du souverain, propriétaire exploitant de l'Etat, lui commandait de les réprimer comme aussi de se garder lui-même d'en donner l'exemple, car l'insuffisance de la sûreté pour les personnes et les propriétés empêchait ou ralentissait le développement de la production et, par conséquent, du revenu qu'il en tirait; mais cette conséquence du défaut de sécurité était moins saisissante et on la rattachait rarement d'ailleurs à sa véritable cause. A peu près au même rang que les atteintes portées à l'autorité du souverain figuraient celles qui étaient dirigées contre la religion de l'État. De même que les hommes de guerre préservaient l'État des agressions du dehors, les hommes d'Église maintenaient chez les populations le sentiment de l'obéissance au souverain, élu du Seigneur, monarque par la « grâce de Dieu », et assuraient sa domination au dedans. Ils demandaient naturellement, en échange de ce service, à être protégés contre les cultes concurrents qui menaçaient de supplanter le leur et de leur enlever, avec leur clientèle, leurs moyens d'existence. Si deux ou plusieurs cultes rivaux avaient pu subsister en paix dans le même État, en enseignant à leurs ouailles le respect de l'autorité du souverain, celui-ci aurait pu sans inconvénient autoriser la liberté des cultes; mais il n'en était pas ainsi. L'esprit de tolérance n'existait ni chez les orthodoxes ni chez les hérétiques. Les uns et les autres s'efforçaient de supprimer une concurrence qui leur portait dommage et, quand le gouvernement refusait de protéger leur monopole, ils soulevaient les populations ou même ils allaient chercher un appui à l'étranger. La prohibition des cultes concurrents paraissait donc nécessaire au maintien de l'ordre intérieur et à la sûreté de l'Etat. C'est pourquoi, sauf en Hollande où la pratique de la concurrence commerciale avait habitué les esprits à la concurrence religieuse, cette prohibition était universelle. Les nécessités de l'ordre intérieur combinées avec les périls du dehors commandaient encore d'empêcher toute agrégation de forces de se constituer, dans un but quelconque, sans l'autorisation du souverain et en dehors de son contrôle. On ne pouvait souffrir non plus que des doctrines, ayant pour tendance d'affaiblir, directement ou indirectement, l'autorité du souverain et de contester ses droits, se répandissent parmi ses sujets, et voilà pourquoi, lorsque les merveilleux instruments de propagande de l'imprimerie et de la presse eurent été créés, on vit s'établir ou se renforcer les pénalités contre les libelles politiques ou religieux et se généraliser le régime de la censure.
Les mêmes nécessités impliquaient, dans une mesure plus ou moins étendue, la réglementation de l'industrie et du commerce. Comme nous l'avons remarqué dans la première partie de cet ouvrage (voir L'Évolution économique, chap. vu), l'imperfection ou le défaut des moyens de communication, joint à l'insuffisance de la sécurité, limitait les marchés, de manière à y empêcher l'action régulatrice de la concurrence; en d'autres termes, la plupart des branches de la production constituaient autant de « monopoles naturels ». Il pouvait être nécessaire, en l'absence du régulateur naturel de la concurrence, de limiter artificiellement le pouvoir des détenteurs de ces monopoles par l'établissement d'un maximum du prix et d'une réglementation de la fabrication quand la coutume n'y suffisait pas. 390 L'administration avait aussi, parmi ses attributions les plus importantes, l'approvisionnement des articles nécessaires à la défense de l'Etat et à la subsistance des populations dans le cas fréquent où la guerre venait interrompre les communications avec le dehors. Il pouvait être opportun à ce point de vue d'encourager la production à l'intérieur du fer, des subsistances, des vêtements, et le système protecteur, qui n'est plus de nos jours qu'un coûteux et malfaisant anachronisme, avait alors pleinement sa raison d'être. Il fallait encore que l'administration s'occupât des pauvres, des mendiants, des vagabonds et, en général, des individus dépourvus de moyens d'existence, dont la multiplication était une cause d'affaiblissement pour l'État. Il fallait enfin que les finances de l'Etat fussent administrées de manière à donner le produit le plus élevé possible, tout en excitant le moindre mécontentement, et c'est dans ce but que l'on avait diversifié les impôts et créé notamment les impôts indirects, qui incorporaient la taxe au prix des articles de consommation de telle façon que l'on ne pouvait l'en distinguer.
Telles étaient les nécessités qui déterminaient les règles et les procédés de la gestion et de la politique intérieure des Etats de l'ancien régime. C'étaient les règles et les procédés qui convenaient à un régime d'état de siège. Aussi longtemps que les populations des États en voie de civilisation se trouvèrent exposées aux invasions des barbares, elles subirent sans se plaindre les charges et les servitudes de ce régime; mais à mesure que les dangers qui menaçaient la sécurité des personnes et des propriétés allaient en s'affaiblissant, à mesure que les communications avec le dehors devenaient plus sûres et plus faciles, elles supportaient moins patiemment un régime qui, après avoir été nécessaire, devenait inutile et nuisible. Elles réclamèrent alors des garanties contre le pouvoir arbitraire du souverain et surtout contre le droit qu'il s'attribuait de les taxer suivant son bon plaisir; elles réclamèrent encore la liberté pour les manifestations de leur activité, restreintes par des nécessités qui avaient disparu ou étaient en voie de disparaître.
Si les maisons ou les associations propriétaires des Etats politiques avaient eu une notion claire du progrès et de ses exigences, elles auraient sans aucun doute modifié leur gestion et leur politique intérieure, à mesure que se modifiait la situation extérieure de leurs Etats, à mesure que la sécurité s'étendait, que les guerres devenaient plus rares et elles auraient peu à peu supprimé le régime maintenant suranné de l'état de siège. Cependant les dangers extérieurs qui avaient motivé l'existence de ce régime n'avaient pas disparu aussi complètement que se l'imaginaient ceux qui l'attaquaient, en contestant même qu'il eût jamais été nécessaire; en outre, des intérêts puissants, intérêts de l'aristocratie politique et militaire, du clergé privilégié, des industriels, des artisans et des marchands investis du monopole du marché intérieur, s'opposaient à la réforme du régime existant. De là une lutte qui a abouti en France à la dépossession violente de la maison propriétaire de l'État politique, ailleurs au transfert à l'amiable de la gestion effective de l'État aux mandataires de la nation.
Au premier abord, il semblerait que cette solution dût être la plus avantageuse à la nation. Lorsque l'État était la propriété particulière d'une maison ou d'une association, celle-ci l'exploitait à son profit exclusif comme toute autre entreprise, et son intérêt était d'en tirer le profit le plus élevé possible. Sans s'inquiéter des charges et des maux de tout genre que la guerre imposait aux populations, elle faisait la guerre en vue d'agrandir son domaine, et tel était l'objectif constant de sa politique extérieure. A l'intérieur, elle se préoccupait avant tout de conserver intacte la propriété de ce domaine et le droit de l'exploiter sans partage: enfin elle faisait payer cher les services dont elle se réservait le monopole, sans s'appliquer à en améliorer la qualité. Bref, sa politique intérieure était tout entière conduite en vue de l'accroissement de ses profits. N'était-il pas naturel de croire que le moyen le plus efficace de mettre fin à cette exploitation, c'était d'exproprier la maison propriétaire de l'Etat, ou tout au moins de l'obliger à en remettre la gestion aux mandataires de la nation? N'était-ce pas le chemin le plus court pour arriver au régime de paix et de liberté, que la suprématie désormais acquise du monde civilisé sur le monde barbare et la généralisation progressive de la concurrence industrielle avaient rendu possible? D'une part, la guerre ayant cessé d'être une nécessité et ne se perpétuant plus que dans l'intérêt de la petite caste aristocratique qui en vivait, les nations ou leurs mandataires ne pouvaient manquer de s'accorder pour y mettre fin, en faisant l'économie des énormes dépenses de sang et d'argent qu'elle occasionnait et des maux dont elle était la source. Leur politique extérieure serait nécessairement dirigée vers la paix. D'une autre part, et grâce à l'établissement de la paix, du développement des moyens de communication et des progrès de la concurrence, elles pourraient supprimer les entraves de l'état de siège et établir dans toutes les branches de l'activité humaine un régime de complète liberté; enfin, elles concentreraient leurs efforts vers l'amélioration et la réduction des frais des services publics: aux gouvernements belliqueux, oppressifs et coûteux de l'ancien régime, elles substitueraient des gouvernements pacifiques, libéraux et à bon marché. Tel serait l'objectif de leur politique extérieure et intérieure.
Cet objectif n'a pas été atteint. L'expropriation de la maison propriétaire de l'Etat au profit de la nation, ou la remise à l'amiable de la gestion de cette propriété aux mandataires de la nation, n'a pas eu pour résultats de faire succéder dans les relations internationales la politique de paix à la politique de guerre, encore moins de diminuer à l'intérieur les frais de la gestion gouvernementale et d'en améliorer les services.
C'est qu'il en est des phénomènes économiques comme des phénomènes astronomiques: ils présentent le plus souvent des apparences, contraires à la réalité. Qui n'aurait cru que le soleil tourne autour de la terre? Qui ne croirait que les nations ont intérêt à posséder et à gérer elles-mêmes leur gouvernement? Quoi! l'Etat était la propriété d'une maison qui l'exploitait à son profit exclusif, qui s'attribuait tous les bénéfices de l'exploitation comme s'il s'était agi d'une fabrique ou d'une ferme. Ne devait-on pas croire qu'en faisant passer entre les mains de la nation, c'est-à-dire de l'ensemble des consommateurs politiques, cette exploitation lucrative, qui procurait à la « maison » propriétaire et à ses auxiliaires des revenus plantureux, on transférerait au nouveau propriétaire tous les bénéfices que s'attribuait l'ancien, sans parler de ceux que devait inévitablement produire une gestion améliorée, conformément aux progrès des sciences politiques? C'était l'apparence, et on conçoit qu'elle ait séduit des hommes qui n'étaient pas plus avancés en économie politique qu'on ne l'était en astronomie avant Copernic et Galilée. Mais comment se fait-il que la réalité ait été contraire à l'apparence? Comment s'expliquer que les nations n'aient point gagné à devenir propriétaires de l'Etat politique et à le gérer elles-mêmes?
II. Le communisme politique. Causes de son infériorité. Conséquences de son établissement. — Cela tient à l'infériorité économique du communisme national en comparaison de la propriété patrimoniale ou corporative. L'Etat, confisqué à son ancien propriétaire, était devenu la propriété commune de tous les membres de la nation; mais appartenant à tout le monde, c'était comme s'il n'appartenait plus à personne. Chacun, n'en ayant qu'une part pour ainsi dire infinitésimale, n'avait plus aussi, ou ne croyait plus avoir qu'un intérêt infinitésimal à s'occuper de sa gestion, à laquelle d'ailleurs l'immense majorité des nouveaux propriétaires n'entendait absolument rien, et sur laquelle la minorité qui croyait s'y entendre avait, à de rares exceptions près, les idées les plus fausses. De là la formation des partis politiques en vue d'exploiter cette propriété d'un « incapable » et la lutte qui ne manqua pas d'éclater entre ces partis, pour la conquête ou la conservation de ce riche domaine, chacun s'efforçant de faire prévaloir le type de gouvernement le plus propre à lui assurer la gestion de l'Etat. C'était, pour le parti aristocratique et clérical, la monarchie de l'ancien régime; pour le parti libéral, recruté dans la bourgeoisie riche ou aisée, la monarchie constitutionnelle à suffrage limité; pour le parti radical, la république avec le suffrage universel.
Ces deux derniers types subsistent aujourd'hui à peu près seuls, et nous en avons analysé le mécanisme. Dans la monarchie constitutionnelle, la gestion gouvernementale est concédée à perpétuité, au nom de la nation qui conserve la nu propriété de l'État, à une maison politique, dont le chef reçoit une rétribution fixe. Une minorité déclarée politiquement capable et composée, comme dans les sociétés industrielles, des gros actionnaires de la communauté, intervient seule, à l'exclusion des petits actionnaires, dans la gestion de l'Etat. Les partis se recrutent dans cette minorité investie des droits politiques et s'efforcent incessamment d'y conquérir ou d'y conserver la majorité, qui leur assure la possession du pouvoir. Mais l'expérience a attesté partout que la minorité investie des droits politiques abuse de son monopole pour satisfaire ses intérêts aux dépens de ceux du reste de la communauté, et il en est résulté une réaction qui a emporté en France et emportera probablement ailleurs la monarchie constitutionnelle avec le monopole électoral. La république, appuyée sur le suffrage universel, qui lui succède d'habitude, est caractérisée par l'attribution directe et entière de la gestion gouvernementale à l'association politique qui possède la majorité électorale et parlementaire aussi longtemps qu'elle réussit à la conserver.
L'infériorité économique de ces deux types de gouvernement à base communiste, en comparaison des monarchies patrimoniales ou des républiques oligarchiques d'autrefois, tient à ce que celles-ci étaient propriétaires à perpétuité de l'Etat et, à ce titre, intéressées au plus haut point à sa bonne gestion, dont elles recueillaient les profits et supportaient les pertes, tandis que dans les gouvernements modernes, livrés à l'exploitation précaire et à court terme des partis, ceux-ci, comme les tenants at will d'une exploitation agricole, n'ont aucun intérêt à ménager les ressources du domaine qu'ils exploitent. Leur intérêt est au contraire d'en tirer le plus gros profit possible dans le moment de leur jouissance, d'autant mieux qu'ils n'ont pas à craindre d'avoir à supporter les pertes provenant d'une gestion imprudente et incapable: c'est la nation propriétaire qui est responsable des engagements de tout genre et particulièrement des dettes que ceux qui la gouvernent contractent en son nom. Sous l'ancien régime, cette responsabilité retombait tout entière sur la maison ou l'association propriétaire de l'Etat; la nation n'en supportait légalement aucune part et les créanciers de l'Etat n'avaient contre elle aucun recours; sa responsabilité n'était ni matériellement ni moralement engagée; l'État pouvait faire banqueroute sans entacher le moins du monde l'honneur des « consommateurs politiques » ni diminuer leur crédit.
Dira-t-on qu'une monarchie constitutionnelle et héréditaire est perpétuelle comme l'étaient les monarchies patrimoniales de l'ancien régime? Mais la Constitution n'accorde au roi aucun des droits essentiels afférents à la propriété; ces droits sont exercés par l'état-major du parti qui a réussi à s'emparer du pouvoir; en outre, le roi pourvu d'un salaire fixe n'est que bien faiblement intéressé à la gestion économique de l'État. Que les dépenses publiques dépassent les recettes, que la dette de l'Etat aille grossissant, peu lui importe! Son revenu n'en est pas atteint. Quant aux partis politiques, nous venons de voir qu'ils sont encore moins intéressés à la gestion économique des affaires publiques. Vivant du budget ou aspirant à en vivre, n'ont-ils pas intérêt à le grossir? En revanche, la nation, à défaut du roi et des partis n'est-elle pas intéressée au plus haut point à la bonne gestion de son établissement politique? Sans aucun doute; mais possède-t-elle la capacité nécessaire pour intervenir utilement dans cette gestion? Il arrivait aussi, sous l'ancien régime, qu'un roi fût au-dessous de sa tâche; seulement son règne était temporaire, tandis que celui de la nation est perpétuel. On peut prétendre, à la vérité, que les nations finiront par acquérir la capacité nécessaire pour se gouverner d'une manière conforme à leurs intérêts, mais ce n'est là qu'une espérance que les faits n'ont pas encore justifiée. En attendant, de deux choses l'une: ou l'on n'accorde le droit d'intervention dans la gestion de l'État qu'à une minorité réputée politiquement capable, et l'expérience atteste que cette minorité a pour tendance inévitable de servir son intérêt particulier aux dépens de celui du reste de la nation, en protégeant ses profits industriels, en augmentant le nombre des emplois civils et militaires, etc., etc.; ou le droit d'intervenir dans la gestion de l'Etat appartient à tout le monde, et alors l'intérêt de chacun à y participer est trop faible, en même temps que la capacité politique moyenne de cette masse est trop basse pour que sa participation soit suffisamment active et éclairée. Dans les deux cas, le contrôle que la nation exerce ou est supposée exercer sur la gestion du parti en possession du gouvernement est insuffisant ou vicieux. C'est comme si un mineur ignorant et passionné était appelé à contrôler la gestion d'un tuteur, intéressé à grossir ses frais de tutelle. Voilà pourquoi les nations modernes n'ont point gagné à exproprier les maisons ou les associations propriétaires des Etats politiques pour se mettre à leur place.
Ce n'est pas à dire certes qu'elles n'eussent point de griefs sérieux contre l'ancien régime, surtout dans la dernière période de son existence. Aussi longtemps que la guerre était demeurée une fatalité historique, aussi longtemps que l'existence du monde civilisé avait été menacée par l'ascendant du monde barbare, les nécessités de la défense avaient prévalu sur toutes les autres, et quels que fussent les sacrifices matériels et moraux qu'elles imposassent à la multitude, ces sacrifices n'égalaient point les dommages que lui aurait causés la destruction de l'Etat politique, entraînant sa propre destruction. D'ailleurs, la concurrence politique et militaire à laquelle les différents États étaient exposés d'une manière presque continue obligeait les propriétaires exploitants de ce genre d'entreprises à améliorer leur gestion afin de développer les forces et les ressources nécessaires pour y faire face. La situation a changé lorsque les invasions barbares ont cessé d'être à craindre, lorsque la civilisation a pris le dessus, grâce au perfectionnement du matériel de guerre. Alors, la pression de la concurrence extérieure s'est affaiblie et, avec elle la nécessité d'une gestion économique de l'État. Dans les derniers temps de l'ancien régime, cette pression était devenue tout à fait insuffisante. Une convention tacite, à défaut de traités formels, assurait les différentes maisons souveraines de l'Europe contre les risques d'une dépossession totale, en sorte qu'elles n'étaient plus au même degré qu'autrefois intéressées à la bonne gestion de leurs domaines politiques; d'un autre côté, leurs pouvoirs n'étaient plus limités; elles pouvaient, à leur gré, maintenir et même aggraver les charges, les servitudes et les gênes qui pesaient sur les populations, et qui paraissaient à celles-ci d'autant plus insupportables qu'elles n'étaient plus motivées par un péril sérieux. Bref, le monopole intérieur que possédaient les propriétaires exploitants des Etats politiques n'était plus corrigé alors ni par une concurrence extérieure, active et permanente, ni par les garanties que les consommateurs avaient possédées au moyen âge et que l'agrandissement et l'unification des États leur avaient ravies, et il devenait de plus en plus lourd. On s'explique donc qu'il ait fini par paraître insupportable, et qu'on ait cru que le moyen le plus efficace de remédier à ses abus consistait à le détruire en transférant à la nation la propriété et la gestion de l'État. Mais on ne prévoyait pas qu'aux maux du monopole allaient succéder ceux du communisme politique, et que ceux-ci ne tarderaient pas à dépasser ceux-là.
C'est dans ce régime de communisme politique qu'il faut chercher la cause de la recrudescence de l'état de guerre, à une époque où la guerre entre peuples civilisés a cessé d'être une nécessité pour devenir la pire des « nuisances ». C'est encore au communisme politique qu'il faut attribuer le gaspillage barbare de vies et de ressources qui caractérise les guerres modernes et l'énormité des dettes qui en sont la conséquence. Quand les États politiques étaient des propriétés particulières, le propriétaire avait intérêt à ne pas achever d'épuiser ses ressources et de grever l'avenir en s'obstinant dans une entreprise malheureuse. Il faisait la paix aussitôt que la guerre cessait de lui présenter des chances raisonnables de succès. Son intérêt le défendait contre les entraînements de l'orgueil et de l'amour-propre. Il n'en est pas ainsi dans les Etats livrés au communisme politique. Les partis qui occupent le pouvoir à titre précaire n'ont aucun intérêt à ménager les forces et les ressources de l'Etat. Au contraire! Ils se font plutôt un mérite de les prodiguer. Ils engagent une guerre en n'écoutant que leurs intérêts de parti, qu'ils ne manquent d'identifier avec l'intérêt national, et ils la poursuivent, même quand toutes les chances raisonnables de succès sont épuisées, ne fût-ce que pour garder plus longtemps le pouvoir et sans s'inquiéter de l'effroyable déperdition de forces et de ressources qui en résultera pour la nation. Que leur importe! Ils ne s'occupent que du présent dont ils sont les maîtres; ils n'ont aucun intérêt à ménager un avenir qui appartiendra peut-être à d'autres.
C'est encore au communisme politique qu'il faut attribuer l'accroissement progressif des dépenses publiques, le développement anormal des attributions de l'État, la gestion arriérée et routinière de tous les services qui lui appartiennent, sans oublier sa tendance à restreindre les libertés politiques et économiques, à une époque où la suprématie acquise et incontestable des peuples civilisés et l'expansion de la concurrence industrielle commanderaient au contraire d'en finir avec le régime de l'état de siège international, de supprimer les douanes et toutes les autres entraves à la production et à la circulation des marchandises et des idées, de réduire les dépenses et la tutelle gouvernementales. Comme nous allons nous en assurer en passant en revue les différentes parties de la gestion des États modernes, c'est le communisme politique qui a empêché cette gestion de s'améliorer quand il ne l'a pas fait rétrograder, comme il a enrayé l'évolution pacifique de leur politique extérieure.
§ 1. Recrutement du personnel des services publics. Exclusion des étrangers. Comme tout autre entrepreneur d'industrie, le souverain, propriétaire exploitant d'un Etat politique de l'ancien régime, était intéressé au plus haut point à la gestion économique de ce domaine qui lui appartenait en propre et à perpétuité, qu'il exploitait pour son compte, à ses frais et risques et dont les bénéfices constituaient ses moyens d'existence. Or, la première condition d'une gestion économique, c'est le bon recrutement du personnel. Quoique les souverains, surtout dans la période de décadence de l'ancien régime, subissent trop souvent les influences du favoritisme et du népotisme, ils ne souffraient point qu'on limitât leur droit de recruter suivant leur convenance leur personnel politique, militaire et administratif. Ils prenaient leurs officiers, leurs fonctionnaires et employés de tout ordre où ils les trouvaient en meilleure qualité et au meilleur marché, sans s'inquiéter de la nationalité ni même de la religion, comme n'ont pas cessé de le faire les autres entrepreneurs d'industrie. Grâce à leur situation prépondérante, ils pouvaient même beaucoup mieux que les particuliers résister à l'esprit de monopole, affublé d'un déguisement patriotique ou religieux, qui a poussé, partout et de tous temps, les indigènes ou les orthodoxes à exiger qu'on leur réservât les emplois lucratifs à l'exclusion des étrangers ou des schismatiques. C'est ainsi que les rois de France allaient chercher en Allemagne, en Suisse, en Ecosse et en Irlande, des hommes de guerre, généraux, officiers et soldats; en Italie, des ministres, des administrateurs et des financiers, et qu'ils avaient réussi, grâce à ce système intelligent et libéral de recrutement, à constituer une armée et une administration modèles.391 L'avènement du communisme politique a eu, au contraire, pour premier résultat de faire exclure absolument les étrangers des fonctions publiques réservées désormais aux seuls nationaux. Cependant il était bien clair que l'intérêt général de la nation, c'est-à-dire de l'ensemble des consommateurs des services publics, exigeait plus encore que sous l'ancien régime que ces services fussent produits en bonne qualité et à bon marché. Il n'était pas moins clair qu'une des conditions indispensables pour arriver à ce résultat, c'était la faculté de recruter librement le personnel politique, militaire et administratif sur un marché illimité, sans distinction de nationalité, de race, de couleur ou de religion. Tel était l'intérêt de la nation consommatrice des services publics, mais tel n'était point l'intérêt des associations politiques qui se disputaient le gouvernement ou, ce qui revient au même, les revenus et les autres avantages que la possession et l'exploitation du gouvernement procurent. Leur intérêt était, pour nous servir de l'expression américaine, de mettre à la disposition de leurs associés ou de leurs co-intéressés le « butin » gouvernemental le plus considérable possible. Quoique les politiciens dissimulent d'habitude leurs convoitises sous les apparences d'un patriotisme brûlant, quoiqu'ils se déclarent prêts en toute occasion à sacrifier sur l'autel de la patrie leur vie, leur fortune et le reste, l'expérience démontre qu'en fait l'industrie politique ne diffère pas des autres et qu'elle n'attire qu'en raison des profits qu'elle donne ou qu'elle promet. Protéger leurs associés ou leurs co-intéressés contre la concurrence étrangère, de manière à leur réserver le monopole de ces profits, sans rechercher si ce monopole serait avantageux ou nuisible à la nation, telle devait être et telle a été la première préoccupation des partis politiques, à l'époque où le transfert de la propriété de l'Etat à la nation a mis le gouvernement à leur discrétion. C'est ainsi qu'au régime de la libre concurrence internationale pour le recrutement du personnel des services publics a succédé le régime prohibitif, comme un des premiers fruits du communisme politique. Cependant, il convient de remarquer que ce changement ne s'est pas produit seulement dans les pays où la propriété de l'Etat a été transférée à la nation, et qu'on peut le constater encore dans ceux où l'ancien régime a continué de subsister, en Russie par exemple. Dans ceux-ci, il est le résultat de la décadence et de la corruption d'un état de choses qui a cessé d'être en harmonie avec les conditions actuelles d'existence des sociétés. N'ayant plus à subir un risque permanent de dépossession, assuré d'ailleurs de toucher un revenu suffisant et au delà pour satisfaire ses besoins et ses fantaisies, par suite de l'absence de tout frein à ses dépenses, le souverain a cessé d'être stimulé à gérer son Etat d'une manière économique et il cède sans résistance aux convoitises de la classe influente qui vit de l'exploitation des fonctions publiques. Elle a fini même par lui persuader, en s'appuyant sur l'exemple des nations réputées plus avancées, que l'intérêt des fonctionnaires se confond avec l'intérêt général, et que c'est faire une œuvre essentiellement patriotique que d'appliquer le système prohibitif aux services publics, en les réservant aux nationaux.
Mais le système protecteur en cette matière n'a pas seulement été dirigé contre les étrangers, il l'a été aussi contre les classes de la population les moins pourvues d'influence politique. Les « partis », surtout dans les pays où le suffrage est limité, se recrutent principalement parmi les classes supérieures et moyennes. En conséquence ils se sont appliqués, sous l'impulsion consciente ou inconsciente de leur intérêt, à leur réserver la meilleure part du butin gouvernemental, en écartant ou en diminuant la concurrencé de la multitude. Dans ce but, qu'a-t-on fait? On a subordonné de plus en plus l'accès des carrières alimentées par le budget à la condition d'un séjour réglementaire dans des institutions spéciales, dont les programmes sont surchargés d'études inutiles ou même nuisibles. En allongeant la durée et en augmentant les frais des études, on rend moins accessibles à la foule les situations pour lesquelles elles sont exigées. On pourrait croire, au premier abord, que l'institution prétendue démocratique des bourses d'études sert de correctif à ce système qui multiplie les diplômes et tend à constituer un mandarinat à la manière chinoise. Mais la collation des bourses d'études n'a pas manqué de devenir une affaire de parti: on les attribue généralement aux familles en possession d'une influence politique, auxquelles on donne ainsi les moyens d'élever à prix réduit les candidats aux places rétribuées par le budget ou aux carrières qui y aboutissent. Grâce à ces applications ingénieuses du système de la protection, les familles politiques accaparent les fonctions publiques au détriment de celles qui pourraient leur faire concurrence et de la masse des consommateurs des services publics, intéressés à ce que le marché d'approvisionnement de ces services soit aussi étendu que possible.
§ 2. Extension progressive des attributions du gouvernement. -— Il ne suffisait pas d'exclure les étrangers des fonctions publiques et d'en rendre l'accès difficile aux classes dépourvues d'influence politique, il importait encore d'augmenter le butin gouvernemental, afin de pouvoir rétribueras membres et les soutiens du parti, et les détourner de porter leurs services et leur influence aux partis concurrents. Delà, l'accroissement inévitable et irrésistible des attributions du gouvernement et, par conséquent, des dépenses publiques.
En cela encore, le nouveau régime est économiquement inférieur à celui auquel il a succédé. Comme nous l'avons remarqué, le souverain de l'ancien régime, en sa qualité de propriétaire exploitant de l'état politique, était, aussi bien que tout autre propriétaire, directement intéressé à réduire au minimum les frais de la gestion de son domaine. C'est pourquoi il s'efforçait de la simplifier et d'en élaguer les branches parasites, au moins quand il entendait bien son intérêt et quand il subissait suffisamment la pression de la concurrence extérieure. Il ne se réservait que deux sortes de services: 1° ceux dont il pouvait, sans grande peine, tirer de gros profits, tels que la vente du sel et la fabrication de la monnaie; encore avait-il fini par reconnaître qu'il lui était plus avantageux de les affermer que de les exploiter lui-même; 2° ceux qui concernaient la sûreté de sa personne et de sa propriété, la conservation et l'agrandissement de son domaine; encore le système économique de l'affermage avait-il été introduit jusque dans la formation des armées. Il ne se préoccupait guère des autres services et il abandonnait volontiers aux particuliers, aux corporations, aux communes ou aux paroisses, le soin de pourvoir à la sécurité des personnes et des propriétés privées, à l'éducation, aux institutions charitables, aux moyens de communication, excepté quand il s'agissait de routes militaires et, en général, à tous les besoins physiques et moraux des populations. Il ne s'occupait que de son affaire, laquelle consistait à préserver son domaine politique de la concurrence du dehors et à l'agrandir aux dépens de ses concurrents, enfin à l'exploiter de manière à en tirer la plus grande somme de profits, en évitant de toucher au capital. Toutefois, nous avons remarqué encore que, dans la période de décadence de l'ancien régime, lorsque les propriétaires des Etats politiques eurent cessé d'être exposés à un risque permanent et imminent de dépossession, leur gestion intérieure se relâcha peu à peu et se chargea de branches parasites, comme il arrive à toute exploitation qui n'est point soumise dans la mesure nécessaire à la pression de la concurrence. Aussi reprochait-on aux monarchies de l'ancien régime de coûter trop cher, et se proposait-on surtout, en les renversant, de les remplacer par des « gouvernements à bon marché ».
Mais cet idéal économique, il n'y avait qu'un moyen de le réaliser, c'était de simplifier la machine gouvernementale, en diminuant le nombre et l'importance des services publics alimentés par l'impôt. On a vu, au contraire, depuis que les nations ont été affranchies du joug de leurs anciens maîtres, ces services se multiplier et se développer tous les jours.
Ce n'est point cependant de dessein prémédité que les partis politiques qui se disputent la gestion de l'État augmentent ses attributions et ses dépenses. Non! ils inscrivent même généralement et de bonne foi dans leurs programmes la diminution des dépenses publiques, mais aussitôt qu'ils arrivent aux affaires, ils subissent la nécessité impérieuse
de satisfaire leurs partisans comme aussi de ne pas désespérer leurs adversaires. Les prétextes ne manquent pas, au surplus, pour justifier le développement des attributions de l'Etat: on invoque l'accroissement des besoins qui naissent des progrès mêmes de la civilisation et l'impuissance de l'industrie privée à satisfaire quelques-uns des plus importants, la nécessité en matière d'enseignement de sauvegarder les jeunes générations contre les entreprises des ennemis de la « civilisation moderne », ou bien encore, s'il s'agit des chemins de fer, la nécessité de préserver le public de l'avidité des compagnies maîtresses d'un « monopole naturel ». Examinons brièvement ce que valent ces prétextes plus ou moins spécieux.
Il est évident qu'à mesure que la richesse augmente, grâce aux progrès de l'outillage et des méthodes de la production, — et jamais ces progrès n'ont été aussi considérables qu'à notre époque, — on voit les besoins se développer sans qu'il soit nécessaire d'ailleurs de les y aider. On veut être mieux nourri, mieux vêtu, mieux logé, habiter des villes mieux éclairées, plus propres et plus saines, goûter des jouissances intellectuelles plus variées et plus raffinées. Ce développement des besoins sous l'influence de l'accroissement de la richesse est particulièrement visible, dans ce qu'il a parfois d'excessif et de vicieux, chez les ouvriers incultes qui s'élèvent à la condition d'entrepreneurs et s'enrichissent. Leurs appétits matériels et plus encore les besoins de leur vanité croissent pour ainsi dire à vue d'oeil; ils ne possédaient même pas le nécessaire, ils ne se refusent maintenant aucune des jouissances du luxe. Ils ont des habitations somptueuses à la ville et à la campagne, une table plantureusement servie, leurs femmes ne portent que les étoffes les plus chères, leurs enfants apprennent le latin avec le grec; bref, les besoins de ces enrichis progressent du même pas que leur richesse et parfois d'un pas plus rapide; le cercle de leurs consommations s'élargit en peu de temps d'une manière démesurée. Ce qui est vrai pour des individus isolés ne l'est pas moins pour la collection de ces individus: plus une société s'enrichit, plus ses besoins se développent; mais s'ensuit-il que l'intervention du gouvernement soit nécessaire pour leur donner satisfaction? Il est facile de se convaincre, au contraire, que cette intervention ne peut être que perturbatrice et nuisible. Si nous examinons, en effet, les sociétés même les moins avancées, nous constaterons que c'est par l'initiative privée et libre qu'il est pourvu au plus grand nombre des besoins de leurs membres, que ceux de ces besoins auxquels il est satisfait d'autorité par l'intervention du gouvernement et le grossier mécanisme de l'impôt sont, en comparaison, de peu d'importance. L'initiative privée n'est pas impuissante même dans les pays où elle est le moins active. Supposons donc que le gouvernement avec ses annexes provinciales ou communales n'intervienne pas pour construire des voies de communication, transporter des lettres et des dépêches télégraphiques, ouvrir des écoles, subventionner des théâtres, créer des musées et des bibliothèques, qu'arrivera-t-il? C'est qu'à mesure que le besoin de ces divers produits ou services croîtra, on verra croître parallèlement les profits que l'on peut réaliser en les produisant. Un moment arrivera où le besoin non encore satisfait venant à dépasser en intensité ceux auxquels il est déjà pourvu par les industries existantes, le profit que l'on trouvera à le servir dépassera, à son tour, le niveau commun. Alors, par une impulsion irrésistible, les intelligences et les capitaux seront attirés dans cette direction et le nouveau besoin sera satisfait dans le moment et dans la mesure où il peut l'être utilement.392 Utilement, disons-nous, car en voulant y pourvoir plus tôt et plus amplement, que ferait-on? On détournerait les intelligences et les capitaux des industries qui alimentent les besoins de première nécessité pour les appliquer à des besoins moins sentis, moins urgents. On renchérirait la subsistance, le vêtement et les autres articles produits librement, pour créer ou faire artificiellement baisser de prix, aux dépens des consommateurs de ces articles nécessaires, des produits ou des services dont ils sentent moins vivement le besoin. On prétend, à la vérité, que les consommateurs (que l'on estime d'ailleurs capables de gouverner leur état politique) sont incapables de gouverner sainement leur vie privée et qu'en admettant qu'on leur laissât à cet égard une liberté entière, ils ne s'imposeraient des sacrifices que pour satisfaire leurs appétits les plus grossiers et même leurs vices les plus immondes. Nous n'affirmerons pas certes que tous les membres des sociétés civilisées soient capables de gouverner utilement leur vie et nous sommes d'avis même qu'un régime de tutelle est aujourd'hui et sera encore longtemps nécessaire à un trop grand nombre d'entre eux, comme il l'a été de tous temps; seulement, l'expérience démontre, ainsi que nous le verrons tout à l'heure, que le gouvernement est le plus incapable et le plus coûteux des tuteurs. Mais n'est-il pas superflu de remarquer que l'intérêt général des consommateurs n'est invoqué ici que pour la forme, et même que les « politiciens » obéissent à des mobiles diamétralement opposés à celui-là en transformant le gouvernement en entrepreneur ou en bailleur de fonds de toute sorte d'industries? Ce à quoi ils visent avant tout, c'est à augmenter le nombre des emplois, des situations et des faveurs dont ils disposent; c'est encore à acquérir ou à conserver l'appui des classes influentes, en leur aidant à satisfaire gratis ou à prix réduit des besoins que la multitude ressent à un moindre degré. La différence entre les frais de production des services adaptés à ces besoins et le prix auquel on les met sur le marché est fournie par l'impôt et elle constitue, en dernière analyse, une subvention ou un tribut payé aux classes politiquement influentes par la généralité des contribuables.
On argue aussi de l'impuissance de l'initiative des individus ou des collectivités libres quand il s'agit d'entreprises dépassant, selon la formule consacrée, les forces de l'industrie privée. Cette raison pouvait être fondée à l'époque où les gouvernements, obéissant à des motifs tirés des nécessités de leur sécurité, à laquelle celle de la nation était liée, refusaient d'autoriser la constitution de grandes agrégations de forces; mais, depuis que la guerre a cessé d'être une fatalité inévitable et qu'aucune raison sérieuse ne peut plus, en conséquence, être opposée à la création et à l'extension indéfinies des associations libres, depuis que l'invention des actions et des obligations permet de réunir, avec une facilité extraordinaire, les capitaux les plus considérables, il n'existe plus d'entreprises dépassant les forces de l'industrie privée; partant, il n'y a plus de besoins qui ne puissent être satisfaits sans l'intervention de l'État, dans le moment et dans la mesure où il est utile de les satisfaire. Ce qui est vrai, c'est que les gouvernements continuent, sous un prétexte ou sous un autre, à faire systématiquement obstacle à la constitution des grandes entreprises par voie d'association libre, soit en limitant la durée de la société et en l'obligeant ainsi à déduire de ses dividendes annuels les frais d'amortissement de son capital, soit en lui imposant des règlements et un maximum qui constituent pour elle un supplément artificiel de charges ou un empêchement à réaliser toute la somme de profits que l'entreprise pourrait fournir. Ces profits étant ainsi rabaissés au-dessous du niveau commun, les intelligences et les capitaux évitent de s'engager dans des entreprises qui ne sont point suffisamment rémunératrices. On ne manque pas alors de déclarer que l'initiative privée est impuissante à pourvoir à un besoin d'intérêt général et le gouvernement s'en charge à sa place, ou bien encore il comble, au moyen d'une subvention ou d'un monopole, l'insuffisance artificielle des profits après l'avoir créée lui-même. On peut citer comme exemple à l'appui les entreprises de chemins de fer, auxquelles la plupart des gouvernements imposent des directions peu productives de préférence à d'autres, ou des cahiers des charges compliqués et onéreux, pour satisfaire des exigences électorales et fournir de l'occupation aux ingénieurs officiels et aux bureaucrates du « ministère des travaux publics ».
En résumé, si l'on remonte à la cause originaire qui détermine l'extension des attributions du gouvernement, on finit toujours par découvrir un motif politique, savoir la nécessité de grossir le « butin » qui sert à rétribuer les membres ou les auxiliaires des associations organisées en vue de l'exploitation de l'État.
§ 3. Extension et détérioration de la tutelle gouvernementale. — Sous l'ancien régime, le souverain propriétaire perpétuel de l'Etat et, comme tel, intéressé au plus haut point à la conservation et au développement des forces et des ressources de la nation, d'où il tirait les siennes, s'appliquait sous l'influence de cet intérêt, surtout quand la pression de la concurrence politique venait s'y joindre, à les préserver de toute atteinte extérieure ou intérieure, et à favoriser tout ce qui pouvait contribuer à les accroître. Il était le tuteur ou le protecteur naturel de l'intérêt général. C'était une tutelle intéressée, mais par là même aussi soigneuse et efficace qu'elle pouvait l'être. L'état de guerre rendait cette tâche non seulement indispensable, mais encore singulièrement compliquée; les marchés étant resserrés par la quasi-permanence du risque de guerre, la plupart des branches de l'activité humaine constituaient, comme nous l'avons remarqué, autant de monopoles naturels. Il fallait donc que le souverain, tuteur intéressé de l'intérêt général, opposât, à défaut de la concurrence, une limite au pouvoir des détenteurs de ces monopoles ou que les administrations locales, sous sa dépendance, s'en chargeassent à sa place. La nécessité de cette protection des intérêts des consommateurs était d'autant plus urgente et mieux motivée que les propriétaires exploitants des monopoles naturels formaient des associations ou des corporations plus puissantes, ou qu'ils produisaient des articles plus nécessaires à la vie. De là, le système réglementaire, la limitation du taux de l'intérêt, du prix du pain et des autres articles de nécessité, les règlements de fabrication, les mesures protectrices des ouvriers dans les ateliers, quand la « coutume » n'y pourvoyait point avec une efficacité suffisante. Cette réglementation n'était pas toujours intelligente, quoiqu'elle s'inspirât le plus souvent de la coutume, qu'elle se bornait à sanctionner; en tout cas, elle était un modérateur bien imparfait en comparaison de la concurrence, mais elle n'en eut pas moins sa raison d'être et son utilité en l'absence de cette dernière, aussi longtemps que les marchés demeurèrent resserrés par l'état de guerre. De là encore, la nécessité de protéger contre une concurrence intermittente et accidentelle, dans les courts intervalles de paix, les industries qui fournissaient des articles indispensables à la défense de l'Etat et aux besoins les plus urgents des populations.
Cependant, à mesure que les marchés s'étendaient grâce à l'accroissement de la sécurité et au développement progressif des moyens de communication, à mesure que l'état de paix tendait davantage à se substituer à l'état de guerre, la tutelle des consommateurs et des industries cessait d'avoir sa raison d'être. Après avoir été nécessaire lorsque la concurrence ne pouvait pas agir, elle devenait nuisible en entravant son action. A la vérité, les monopoles naturels n'ont pas encore entièrement disparu, et nous assistons à une recrudescence artificielle de l'état de guerre; mais la concurrence et la paix n'en sont pas moins devenues la règle chez les peuples civilisés, le monopole et la guerre l'exception. Il semblerait donc que la réglementation et la protection eussent dû disparaître graduellement. Nous les avons vus au contraire reprendre une nouvelle vigueur depuis l'avènement du communisme politique. Sous prétexte que certaines industries, particulièrement importantes, nommément celles qui s'appliquent à la circulation des valeurs, des marchandises et des hommes, les banques d'émission et les chemins de fer, échappent par leur nature à l'action de la concurrence, on l'a limitée ou même absolument empêchée et on a greffé un monopole artificiel sur un monopole naturel, plus ou moins authentique. Quant à la protection de l'industrie contre la concurrence étrangère, on sait à quel point elle s'est aggravée et généralisée, bien qu'elle soit moins justifiable encore que la réglementation des «monopoles naturels ». Elle est devenue le plus puissant instrument d'exploitation et de rapine qui ait été jamais mis en œuvre pour enrichir des intérêts particuliers aux dépens de l'intérêt général. A quelle cause faut-il attribuer cette extension et cette corruption de la tutelle gouvernementale? A l'époque de la décadence de l'ancien régime, elle s'expliquait par l'alliance des intérêts engagés dans les monopoles avec les influences de cour, tandis que l'affaiblissement de la concurrence politique au dehors et la destruction des garanties qui limitaient le pouvoir discrétionnaire du souverain en matière d'impôts rendaient celui-ci de plus en plus indifférent aux atteintes portées à l'intérêt général. Plus tard, elle s'est expliquée par l'alliance des mêmes intérêts monopoleurs et protectionnistes avec les partis politiques, bien moins intéressés encore à défendre l'intérêt général et permanent de la nation, toujours prêts au contraire à le sacrifier à l'intérêt immédiat et temporaire de leur domination.
Si la protection des consommateurs dans l'âge économique des monopoles et celle des industries dans les intermittences de l'état de,siège international ont perdu leur raison d'être depuis que la concurrence est devenue généralement possible et que la guerre a cessé d'être une nécessité, il en est autrement de la tutelle qui a pour objet de remédier à l'incapacité du self government individuel. Celle-ci apparaît, au contraire, comme plus nécessaire que jamais depuis que tous les membres des sociétés civilisées sont devenus libres et, par conséquent, responsables de leur destinée, depuis encore que la crise suscitée par la transformation de la machinery de la production a augmenté les risques qui pèsent sur toutes les existences. Sous l'ancien régime, l'esclavage, le servage, les corporations industrielles ou religieuses, enserraient dans leurs bras rudes et grossiers, mais tutélaires, la grande majorité de la population dont ils diminuaient à la fois la liberté et la responsabilité. Après la disparition ou la suppression trop souvent hâtive de ces formes primitives de la tutelle, tous les membres des sociétés civilisées, quels que fussent leur degré d'intelligence ou de moralité et leur situation matérielle, ont été appelés également à se gouverner eux-mêmes. Qu'en est-il résulté? Quel usage les classes émancipées ont-elles fait de leur liberté? Comment ont-elles rempli les obligations dans lesquelles se résumait leur responsabilité? N'ayant qu'une notion obscure et incertaine des conditions nouvelles de leur existence et des devoirs qui leur étaient désormais imposés, elles ont cédé à toutes les impulsions de leurs appétits; on les a vues se multiplier sans prévoyance, s'abandonner à la paresse, à l'ivrognerie, à la débauche, exploiter à outrance le travail de leurs enfants et de leurs femmes, laisser sans secours leurs infirmes, leurs malades et leurs vieillards. C'est qu'il ne suffit pas, comme on l'a supposé trop légèrement, d'être libre pour être ou même pour devenir capable d'user utilement de la liberté. Le gouvernement de soi-même exige des qualités et des aptitudes qui n'existent qu'à l'état de germes chez l'immense majorité des créatures humaines et qui ne se développent qu'à la longue par la sélection, l'éducation et l'expérience. Même dans les régions supérieures de la société, où la culture est raffinée et la vie facile, bien peu d'hommes se montrent capables de gouverner leur vie sans nuire à eux-mêmes et à autrui. Comment ne rencontrerait-on pas encore un plus grand nombre d'incapables du self government dans la multitude qui possède à peine les premiers éléments de la culture intellectuelle et morale, et qui est exposée à toutes les difficultés et à tous les périls de la lutte pour l'existence? Une tutelle destinée à suppléer à l'insuffisance de leur self government est donc aujourd'hui, comme elle l'était jadis, nécessaire à l'immense majorité des hommes. Certes, l'ancienne tutelle économique et religieuse était grossière et défectueuse, et l'on conçoit qu'elle ait fini par devenir insupportable à ceux qui la subissaient d'autorité sans qu'il leur fût possible de s'y soustraire; mais l'expérience a attesté qu'il ne suffisait pas de supprimer l'esclavage, le servage, les corporations et les couvents, qu'il eût fallu encore les remplacer.
Malheureusement, au lieu de procéder, dans cette affaire vitale, par voie de transformation ou d'évolution, qu'a-t-on fait? On s'est acharné à détruire l'ancienne tutelle forcée non seulement sans rien mettre à la place, mais encore en faisant systématiquement obstacle à la reconstitution d'une tutelle libre. On a condamné la multitude, incapable de se gouverner elle-même, au self government obligatoire. Le résultat a été un débordement des maux provenant de la misère et du vice. A défaut d'une autre, il a bien fallu alors recourir à la tutelle gouvernementale. Cette tutelle s'est exercée de deux manières: par voie de répression et d'assistance. Des pénalités rigoureuses ont été établies contre les vagabonds et les mendiants, dont le nombre s'était progressivement accru depuis l'abolition de la servitude; puis, en présence de l'insuffisance de la répression, il a bien fallu multiplier les hôpitaux, les hospices et les autres institutions de bienfaisance; enfin, distribuer aux pauvres des secours réguliers. La charité publique a été ainsi introduite dans tous les pays où le self government avait succédé à la servitude. Plus tard encore, on a senti la nécessité de protéger les enfants et les femmes contre l'imprévoyance et la cupidité de leurs tuteurs naturels et l'on a fait des lois pour réglementer leur admission dans les manufactures et limiter la durée de leur travail. Bref, la tutelle gouvernementale a été se développant de plus en plus, et les philanthropes d'abord, les socialistes d'Etat ensuite, n'ont pas manqué d'en provoquer continuellement l'extension. Cependant, l'expérience n'en a déjà que trop montré l'insuffisance et les vices: la charité publique ne soulage la misère qu'en augmentant le nombre des pauvres, les lois sur le travail des enfants et des femmes ne remédient à l'abus du travail sur un point que pour l'aggraver sur d'autres, etc., etc. C'est que la tutelle, qu'elle s'applique soit à des enfants, soit à des hommes, est un art et même un art des plus difficiles et des plus compliqués, et que les gouvernements, surtout depuis l'avènement du communisme politique, n'ont point un intérêt suffisant à s'y appliquer. Sans doute, les maux qui résultent du mauvais self government de la multitude sont une cause d'appauvrissement pour la nation, d'affaiblissement, peut-être même de subversion pour l'Etat; mais en quoi est-ce que cela touche les partis qui se disputent la possession et l'exploitation précaire du gouvernement? Pour eux, les mesures et les institutions destinées à soulager la misère ou à venir en aide aux « classes laborieuses » ne sont guère autre chose que des moyens d'acquérir de la popularité quand ils sont dans l'opposition, d'augmenter le nombre des places et des situations dont ils peuvent disposer pour récompenser des services politiques, quand ils sont au pouvoir. Aussi n'existe-t-il aucun domaine dont la gestion coûte plus cher et soit plus remplie d'abus que celle du « patrimoine des pauvres » .393 D'ailleurs, en admettant même que le gouvernement s'efforçât de remplir avec conscience son rôle de tuteur des incapables du self government, le pourrait-il? Cette tâche ne dépasserait-elle pas sa capacité et ses ressources? En attendant, si l'on étudie l'ensemble des institutions, des lois et règlements de tout genre qui constituent la tutelle gouvernementale des pauvres et des incapables, et le régime de « l'assistance publique », on se convaincra que ce n'est pas sans raison que les économistes les accusent d'aggraver les maux qu'ils ont pour objet de guérir ou tout au moins de diminuer.
4. Restrictions et prohibitions opposées aux libertés nécessaires à l'exercice du « self government» . — Nous venons de dire que le régime du self government obligatoire a été appliqué également à toutes les classes de la société. Ce régime se compose, avons-nous besoin de le rappeler, de deux parties constituantes: la liberté d'agir et la responsabilité des actes. Or, tandis que la responsabilité a été imposée dans toute son étendue à tout le monde, il en a été autrement de la liberté. Sous l'influence des intérêts particuliers avec lesquels les partis politiques étaient obligés de compter, la liberté des uns a été agrandie aux dépens de la liberté des autres, la responsabilité demeurant la même pour tous. En accordant, par exemple, un monopole à une banque, on augmente artificiellement la liberté des bénéficiaires de ce monopole et on diminue celle de leurs concurrents et du public; en protégeant une industrie par l'exclusion de la concurrence étrangère, on augmente la liberté des industriels protégés aux dépens de celle des consommateurs, sans parler des industriels étrangers. On rend ainsi plus facile le self government des uns et plus difficile celui des autres.
Mais c'est surtout en ce qui touche la gestion de l'État que la liberté des gouvernants a été agrandie aux dépens de celle des gouvernés. On conçoit qu'un souverain de l'ancien régime ne consentît point volontiers à accorder à ses sujets la liberté d'examiner et de critiquer les actes de sa gestion. N'était-il pas propriétaire de l'État et, à ce titre, maître de le gouverner selon son bon plaisir? L'exploitation de l'État était une entreprise privée et, de nos jours encore, n'est-il pas interdit au public d'examiner et de critiquer la gestion des entreprises privées? On juge apparemment que la concurrence industrielle et commerciale donne aux consommateurs une garantie suffisante contre la tendance naturelle des entrepreneurs à abaisser la qualité de leurs produits ou de leurs services et à en élever le prix. Peut-être en était-il de même à l'époque où la concurrence politique, dans sa pleine activité, obligeait les souverains à exploiter leur domaine de la manière la plus conforme à l'intérêt général. Mais lorsque la concurrence politique vint à s'affaiblir, les souverains auraient certainement trouvé avantage à suppléer à l'insuffisance du stimulant de la concurrence en autorisant le libre examen de leur gestion. Cependant, on s'explique, en tenant compte de leurs traditions et des habitudes d'esprit qu'elles avaient créées, que cet examen leur ait paru intolérable, et qu'ils aient rigoureusement limité, en ce qui concernait les affaires de l'État, la liberté de la parole et de la presse. Mais cet interdit, qui se comprenait encore s'il ne se justifiait plus dans les monarchies de l'ancien régime, pouvait-on invoquer une raison ou un prétexte quelconque pour le maintenir lorsque la nation est devenue propriétaire de l'État? La nation n'est-elle pas visiblement intéressée à ce que tous les actes de la gestion gouvernementale soient soumis à l'examen le plus complet et au contrôle le plus sévère? N'est-elle pas intéressée même à ce qu'on puisse critiquer librement le système de cette gestion, qu'il soit monarchique ou républicain, et en provoquer la réforme ou l'abandon au profit d'un autre? Comment donc se fait-il qu'il n'existe encore qu'un bien petit nombre de pays, parmi ceux qui se qualifient de « libres », où la liberté de se réunir, de s'associer, de fonder des publications ayant pour objet d'examiner et de critiquer les actes du gouvernement, de provoquer la réforme ou le changement des institutions politiques, soit entière et indiscutée? Comment se fait-il qu'en France, en particulier, ces libertés qu'un politicien illustre qualifiait de nécessaires, — non sans les avoir, en son temps, quelque peu mutilées,394 — n'aient existé que d'une manière intermittente et incomplète depuis que la nation est devenue propriétaire de l'État, et que leur avenir soit loin d'être assuré? Comment se fait-il, pour tout dire, que les mandataires de la nation se permettent de lui refuser le plein exercice de la liberté d'examiner et de contrôler, par la parole ou la presse, une gestion dont elle est responsable? Cela tient à ce que les partis considèrent les libertés politiques non au point de vue de l'intérêt de la nation, mais au point de vue de leur intérêt de parti. Ils s'en accommodent volontiers quand ils sont dans l'opposition, parce qu'elles leur servent alors à renverser le parti en possession du gouvernement; mais quand, à leur tour, ils arrivent au pouvoir, ils s'efforcent de briser ou de fausser ces armes dont ils ont éprouvé l'efficacité. Ils interdisent les associations politiques, opposent des entraves fiscales et autres à la publication des journaux qui leur sont hostiles, favorisent et subventionnent (bien entendu, avec l'argent des contribuables) les feuilles à leur dévotion. Ils ne se comportent, au surplus, pas autrement à l'égard des libertés non politiques: selon qu'elles leur sont plus ou moins avantageuses, ils les déclarent « vraies » ou « fausses », utiles ou nuisibles, ils les défendent ou les combattent. C'est ainsi que la liberté de l'enseignement est communément attaquée par les libéraux et défendue par les cléricaux, tandis que la liberté des cultes a pour champion le parti libéral et pour adversaire le parti clérical. En résumé, le critérium d'appréciation des libertés qui sont les instruments nécessaires du self government n'est point l'intérêt général et permanent de la nation, c'est l'intérêt contingent et actuel du parti gouvernant ou aspirant à gouverner, et voilà pourquoi le communisme politique n'a pas plus procuré la liberté aux nations « affranchies du joug des tyrans » qu'il ne leur a donné la paix.
§ 5. Impuissance et corruption de l'opinion publique. — Quoiqu'une nation ne puisse, en vertu de la nature des choses, gérer elle-même son État, elle est cependant, en sa qualité de propriétaire, investie de la souveraineté politique, et son opinion doit finir par prévaloir dans la gestion des affaires publiques. Les partis politiques seraient obligés de la gouverner de la manière la plus conforme à son intérêt, si elle avait la notion claire de cet intérêt et la ferme volonté de l'imposer. Mais il suffit de jeter un coup d'œil sur les éléments constitutifs des nations modernes, sans excepter les plus avancées en civilisation, pour se convaincre de l'incapacité et de l'impuissance de l'opinion publique en matière de gouvernement.
Les nations les plus civilisées se composent d'abord d'une multitude qui possède à peine les premiers éléments des connaissances humaines et n'a qu'une idée confuse de la nature et des fonctions d'un gouvernement. Absorbée par le soin laborieux des nécessités de la vie, incapable, à cause de la nature encore purement physique de son travail, de se livrer à des spéculations intellectuelles, cette multitude ne sait pas et ne peut pas savoir en quoi consiste l'intérêt général et, encore moins, quelle politique il faut suivre pour s'y conformer. Ce qui domine chez elle, c'est une haine instinctive de l'étranger, suite naturelle de l'état de guerre, et un sentiment de défiance et d'antipathie jalouse à l'égard des classes supérieures qui l'ont courbée de tous temps sous leur joug, à quoi il faut ajouter communément une vanité puérile. A ses yeux, la nation à laquelle elle appartient est la première du monde, et ce travers naïf, les gouvernements, maîtres, pour la plupart, de l'instruction publique, n'ont pas manqué de le caresser et de le développer pour en tirer profit. Les favoris de cette multitude ignorante et vaniteuse sont les hommes qui ont vaincu et humilié les étrangers, les despotes qui abaissent toutes les classes de la société sous la même servitude, ou les démagogues qui flattent ses appétits et ses passions, en lui promettant à la fois d'améliorer son sort et de faire descendre les classes supérieures à son niveau. C'est pourquoi son intervention dans la politique a pour résultats invariables de livrer le gouvernement à des catégories de politiciens de plus en plus basses et, finalement, d'introniser la dictature du sabre.
Les classes moyennes et supérieures sont assurément plus capables d'intervenir dans la gestion des affaires publiques; mais si leur opinion est plus éclairée que celle de la multitude, en revanche elle est faussée par des intérêts en opposition avec l'intérêt général. Comment ces classes, qualifiées de dirigeantes et, en tout cas, influentes, sont-elles composées? En premier lieu, de familles en possession de fournir l'état-major politique, les fonctionnaires de l'administration et les officiers de l'armée et qui, vivant en grande partie du budget, sont naturellement intéressées à l'accroissement des dépenses publiques. Ces familles politiques, administratives et militaires ne peuvent notamment que gagner à la guerre, et c'est pourquoi elles sont particulièrement chatouilleuses en matière d'honneur national et vibrantes de patriotisme. En second lieu, les classes dirigeantes se composent d'industriels, de propriétaires fonciers et autres, d'hommes appartenant aux professions libérales, gens raisonnablement intelligents et instruits, mais, pour le plus grand nombre, absorbés par le soin de leurs affaires privées et fort peu soucieux de l'intérêt public. S'il leur arrive de s'occuper de politique, c'est presque toujours en vue de satisfaire leur intérêt particulier aux dépens de l'intérêt général. Si l'on cherche, parmi les nations les plus civilisées, combien il y a d'hommes dont l'opinion, en matière de gestion gouvernementale, soit saine, raisonnée et surtout désintéressée, on se trouvera en présence d'une infime minorité. Comment donc l'intérêt général pourrait-il prévaloir? Dira-t-on que l'opinion publique s'éclaire et se rectifie par les discussions du Parlement, des meetings et de la presse? Mais, sauf peut-être en Angleterre et aux Etats-Unis, ces discussions, quand il ne s'agit point d'une affaire de parti, n'attirent qu'un bien petit nombre d'auditeurs ou de lecteurs. L'opinion de chacun est presque toujours faite d'avance; elle est déterminée par des intérêts de situation ou des traditions de famille, lesquelles sont, à leur tour, fondées sur des intérêts, et il est bien rare qu'elle se modifie, à moins que l'intérêt auquel on obéit d'une façon consciente ou inconsciente ne vienne à changer. Les journaux et les orateurs qui font profession d'agir sur l'opinion sont-ils plus dégagés des entraves et de la corruption de l'intérêt particulier? Sauf de bien rares exceptions, ils sont enrégimentés dans les partis politiques et tenus, avant tout, de défendre l'intérêt du parti. S'ils se plaçaient exclusivement au point de vue de l'intérêt général, où trouveraient-ils des auditeurs et des lecteurs?
Dans ces conditions, l'opinion publique ne saurait opposer un obstacle sérieux à la tendance naturelle et irrésistible des partis à augmenter le butin dont ils vivent. Sans doute, cette impuissance a ses degrés. L'opinion publique est plus forte en Angleterre, par exemple, qu'en Italie, en Espagne ou en Grèce; mais, nulle part, en Angleterre pas plus qu'ailleurs, on n'a vu encore cette infime minorité, qui possède la capacité et les connaissances requises pour apprécier sainement l'intérêt général, et dont le jugement n'est point faussé ou adultéré par quelque intérêt particulier, réussir à faire prévaloir son opinion dans la gestion des affaires publiques. L'établissement du free trade en Angleterre est peut-être le seul exemple que l'on puisse citer dans ce siècle, d'une réforme, complètement conforme à l'intérêt de la nation, qui ait été imposée aux partis politiques par l'opinion publique. Encore a-t-il fallu, pour faire tomber la citadelle des lois céréales, d'une part que l'intérêt d'un groupe puissant de manufacturiers s'accordât avec l'intérêt général; d'une autre part, que la classe moyenne, à laquelle le reform bill venait de rendre accessibles les hautes situations politiques et administratives, vît dans l'abolition du régime de la protection un moyen d'affaiblir la puissance de l'aristocratie au profit de la sienne. Tel a été, au surplus, le résultat du free trade combiné avec le reform bill. Mais, chose digne de remarque, l'élargissement de la classe pourvue du droit électoral, loin d'améliorer l'opinion publique, comme on s'y attendait, a contribué à la détériorer. Aussi longtemps que la puissance politique avait été presque entièrement monopolisée par l'aristocratie, l'opinion de la classe moyenne n'avait été que faiblement viciée par des intérêts de parti. Les situations budgétaires qui auraient pu tenter la bourgeoisie britannique étant hors de sa portée, elle n'avait aucun intérêt à l'accroissement du butin gouvernemental. Au contraire, comme ce butin était en grande partie fourni par elle, tandis qu'il était presque entièrement consommé par l'aristocratie, elle était intéressée à le diminuer, et si son opinion n'était point assez puissante pour faire prévaloir une politique d'économie et de paix, elle agissait du moins dans ce sens. Il en a été autrement depuis qu'elle a acquis des droits politiques qui lui permettent d'exiger sa part dans la distribution du butin. Elle est devenue moins pacifique et on a vu grandir rapidement, en Angleterre comme sur le continent, la tendance à la multiplication des attributions de l'Etat, partant à l'augmentation des dépenses publiques. Les doctrines de l'école de Manchester sont en baisse auprès de cette bourgeoisie politicienne. Aux États-Unis, où les partis politiques se recrutent dans la multitude investie du suffrage universel, la tendance à l'augmentation des dépenses publiques est encore plus marquée. Partout, en un mot, sous le régime du communisme politique et à mesure que ce régime s'approche davantage de l'idéal rêvé par les théoriciens du suffrage universel, l'intérêt général est de moins en moins protégé par l'opinion publique.
§ 6. Résultats. Si l'on considère les effets des progrès de la machinery de la guerre et de la production, si l'on observe que ces progrès ont eu pour résultats d'enlever toute raison d'être à la guerre entre les peuples civilisés en assurant leur prépondérance sur le monde barbare, et d'élargir les marchés de toutes les industries en les rendant accessibles, d'une manière permanente, à la concurrence, on arrivera à cette conclusion que la politique extérieure et intérieure que commande aujourd'hui l'intérêt général de toutes les nations civilisées est une politique de paix au dehors, de liberté au dedans; qu'il y a lieu, en conséquence, de réduire les armements au minimum nécessaire pour assurer contre le monde barbare la sécurité des confins de la civilisation, et de diminuer l'intervention du gouvernement dans toutes les branches de l'activité humaine; en un mot, que le rôle des gouvernements adaptés à l'ère nouvelle de la grande industrie devrait être de garantir la sécurité des personnes et des propriétés, ce qu'ils peuvent faire désormais à peu de frais et, pour le reste, de laisser faire. Des gouvernements pacifiques, libéraux, partant à bon marché, voilà ce que demande l'intérêt général des nations civilisées.
Comment il est arrivé que les gouvernements aient suivi, depuis la transformation progressive du matériel de la guerre et de l'industrie, une marche précisément opposée à celle-là, c'est un phénomène qui s'explique, pour les gouvernements de l'ancien régime, par l'affaiblissement successif de la concurrence politique. Lorsque la guerre qui était le mode d'action de cette concurrence eut cessé d'être continue pour devenir un accident temporaire, lorsqu'elle eut cessé, en même temps, d'avoir pour conséquence ordinaire la dépossession des propriétaires d'États et la ruine de leurs domaines, l'intérêt des souverains à gouverner leurs Etats de manière à en porter au plus haut point les forces et les ressources, autrement dit à les gouverner conformément à l'intérêt général de leurs sujets, auquel le leur était lié en leur qualité de propriétaires permanents de l'État, cet intérêt alla s'affaiblissant et s'obscurcissant. La suppression du droit de consentir l'impôt, suite de l'unification trop vantée des États, en permettant au souverain de rejeter sur ses sujets les conséquences de sa mauvaise gestion sans les ressentir directement lui-même, contribua encore à le rendre indifférent au bon gouvernement de son domaine politique. On vit alors les intérêts et les convoitises des classes ou des coteries en possession d'une influence dans l'entourage du souverain prévaloir de plus en plus sur l'intérêt général, les dépenses s'accroître, les privilèges et les sinécures se multiplier, et, du même coup, se ralentir et se corrompre les pratiques de l'administration. A la longue, le mal s'aggrava au point de provoquer la subversion de l'ancien régime et l'attribution de la propriété de l'Etat à la nation elle-même, en substituant à la propriété patrimoniale ou corporative le « communisme national », comme base de la constitution et de la gestion politiques.
On supposait que la nation, devenue propriétaire, et par là même maîtresse souveraine de l'État, ne manquerait pas de le gérer de la manière la plus conforme à son intérêt, c'est-à-dire à « l'intérêt général ». Seulement, pour que cette hypothèse pût devenir une réalité, il aurait fallu non seulement que la nation possédât une capacité politique qu'elle n'avait pas, mais encore que la nature même des choses ne s'opposât point à ce qu'une communauté composée de plusieurs millions d'hommes s'occupât activement de la gestion de l'État comme de toute autre entreprise. Aussi qu'est-il arrivé? C'est que des sociétés en participation constituées sous le nom de partis politiques, ont exploité cette propriété d'un mineur incapable. Quel est l'intérêt de ces associations exploitantes? Cet intérêt consiste à tirer de la gestion de l'État le profit le plus élevé possible, et, pour obtenir ce résultat, elles n'ont qu'une voie à suivre, c'est d'augmenter le budget, et par conséquent d'adopter la politique extérieure et intérieure la plus propre à le grossir, de perpétuer la politique de guerre, de multiplier les attributions du gouvernement, de façon à porter au maximum les rétributions et les autres avantages à partager entre les membres du parti et à distribuer dans la classe au sein de laquelle il s'est constitué et dont l'appui lui est nécessaire pour s'emparer de la gestion de l'État et la garder. Si un parti était assuré de conserver cette gestion à perpétuité, peut-être serait-il intéressé à ménager les forces et les ressources de la nation, à ne point surcharger l'avenir de dettes écrasantes et épuisantes; mais cette sécurité de possession n'existe point, un parti est incessamment exposé à être dépossédé par l'un ou l'autre de ses concurrents. Il n'a donc qu'un faible intérêt à ménager un avenir sur lequel il ne peut compter que pour une part éventuelle et incertaine. Ajoutons que plus sa possession est précaire et contestée, plus il est intéressé à augmenter les dépenses d'où il tire ses profits, plus aussi il fait d'efforts et impose à la nation de sacrifices pour se maintenir au pouvoir. Identifiant son intérêt particulier avec l'intérêt national, il estime naturellement que la nation ne doit reculer devant aucun sacrifice d'hommes, d'argent et de liberté pour le conserver à la direction des affaires et en écarter ses concurrents. Non seulement il ne se fait point scrupule de l'obliger à lui livrer à discrétion son sang et son argent, mais encore il s'en fait gloire! En présence de ces associations, solidement organisées et intéressées à accroître leurs profits à ses dépens, que peut faire la nation? Elle ne peut se débarrasser d'un parti que pour se livrer à un autre, non moins intéressé à l'exploiter. A la vérité, si elle avait la notion claire de son intérêt et la volonté ferme de le faire prévaloir, elle finirait bien par imposer aux partis une politique extérieure et intérieure conforme à « l'intérêt général »; mais nous avons constaté que ni cette notion claire ni cette volonté ferme n'existent même chez les nations les plus avancées en civilisation, et rien n'annonce qu'elles les posséderont de sitôt. Cela étant, faut-il s'étonner si les intérêts de parti prévalent de plus en plus sur l'intérêt général; si, au lieu d'une politique de paix et de liberté les nations sont condamnées à subir une politique de guerre, de monopole, d'intervention et de réglementation, si les gouvernements vont se détériorant et renchérissant chaque jour davantage au lieu de s'améliorer et de coûter moins cher.
Mais sur qui retombe, en définitive, ce fardeau de plus en plus lourd? Sur la nation. Et comment se traduit-il en fait? Par une augmentation progressive de la quantité de travail que chacun est obligé de fournir, journellement, pour subvenir à ses besoins et à ceux de l'État. C'est une remarque de M. Stuart Mill qu'en dépit de l'énorme économie de travail réalisée par l'introduction des machines, la quantité qui en est fournie par les peuples civilisés n'a pas diminué. On pourrait soutenir même qu'elle a augmenté, si l'on tenait compte de la suppression des jours fériés et de l'assujettissement au travail des enfants en plus grand nombre et à un âge plus tendre. D'un autre côté, on peut constater que la multitude n'a pas vu s'augmenter les fruits de son activité dans la proportion de l'accroissement de la productivité de l'industrie. A quoi cela peut-il tenir, si ce n'est à ce fait que le travail de la nation a été soumis à une dime croissante de dépenses obligatoires, improductives ou nuisibles? Supposons qu'on dépense un milliard pour gouverner une nation quand cent millions suffiraient, les neuf cents millions qui constituent la différence ne vont-ils pas en déduction du revenu de chacun ou en augmentation de la somme de travail qu'il est obligé de s'imposer pour se procurer ce revenu? Où huit heures lui auraient suffi pour obtenir la même somme de moyens de satisfaction de ses besoins, il est obligé d'en fournir dix, douze ou quatorze. En outre, en faisant même abstraction de l'utilité ou de la nocuité de ses services comparés à ceux des autres industries, il est facile de s'assurer que la partie de la nation qui vit du budget travaille, toute proportion gardée, moins que celle qui alimente le budget. Or ce que celle-là fournit en moins, il faut bien que celle-ci le fournisse en plus. Il n'est pas un bureaucrate ou un fonctionnaire quelconque, dont la cote de travail demeure au-dessous de la moyenne, qui ne contribue à élever au-dessus de cette moyenne la cote de travail d'un coopérateur de l'industrie privée. Que l'on réfléchisse maintenant aux inégalités plus ou moins inévitables de la répartition des charges publiques, et l'on ne s'étonnera pas si les dépenses improductives ou nuisibles que nécessite une politique contraire à l'intérêt général augmentent de plusieurs heures par jour la quantité de travail que la généralité des contribuables est obligée de produire pour vivre. Ce n'est pas tout. Aux dépenses improductives d'un budget passé à l'état de « butin » viennent se joindre les charges résultant des monopoles, des faveurs et des protections accordés aux intérêts affiliés aux partis politiques ou avec lesquels ceux-ci sont obligés de compter. Ce n'est rien exagérer, par exemple, que d'évaluer à deux heures par jour le surcroît de charges que le système protecteur impose à la généralité des consommateurs. Ajoutez-y l'obstacle qu'une réglementation surannée oppose aux entreprises et aux progrès dont l'effet naturel est d'accroître la productivité du travail et de permettre par conséquent de se procurer la même somme de jouissances en échange d'une moindre somme d'efforts; ajoutez-y le gaspillage des forces et des ressources d'une partie de la population par suite de l'insuffisance et des vices de la tutelle gouvernementale; ajoutez-y la raréfaction du capital qui a été, depuis les temps primitifs, l'auxiliaire indispensable du travail, mais auquel l'avènement de la grande industrie a donné un surcroît d'importance, et dont les emprunts des États ou des villes écrèment la production annuelle, tandis que les impôts qui pèsent sur les revenus, matière première de l'épargne, en ralentissent la formation; n'oubliez pas que la raréfaction détermine le renchérissement, c'est-à-dire l'augmentation de la part du capital au détriment de celle du travail, l'exhaussement de l'intérêt, du loyer, des profits et des dividendes aux dépens des salaires et des profits du travail intellectuel et matériel, et que cette cause de dépression de la part des travailleurs dans les résultats de la production agit avec une intensité extraordinaire, sous l'empire de la loi naturelle des quantités et des prix. Ajoutez-y enfin l'influence de la crise du progrès, crise sensiblement aggravée par la persistance d'une politique en contradiction avec le nouvel état économique des sociétés, et vous vous expliquerez que l'introduction des machines n'ait pas diminué le fardeau du labeur quotidien des peuples civilisés. C'est que les dépenses improductives que ce labeur est obligé d'acquitter se sont augmentées dans une proportion plus forte que sa productivité ne s'est accrue. On s'explique ainsi le mécontentement qui a gagné les classes de la population sur lesquelles pèse le plus lourdement ce fardeau, et qui les rend trop aisément accessibles aux utopies socialistes et aux excitations révolutionnaires.
66.Yves Guyot on “Colonial Policy” (1885)↩
[Word Length: 10.015]
Source
Yves Guyot, “La politique coloniale,” Journal des économistes, no. 1 Janvier 1885, T XXIX, pp. 7-37.
LA POLITIQUE COLONIALE
I. Les affirmations. — II. Étendue des colonies françaises. — III. « L'expansion de la race française ». — IV. Le climat torride. — V. La population française dans les colonies françaises du climat torride. — VI. La population française dans les colonies du climat chaud. — VII. L'émigration horizontale et l'émigration verticale. — VIII. Les « débouchés à notre industrie ». — IX. Le prix de revient. — X. Au profit des concurrents. — XI. Le pacte colonial. — XII. « Pas de débouchés ni de marine sans colonies». — XIII. « Notre mission civilisatrice » — XIV. Conclusions.
I. — Sous ce vocable: la Politique coloniale, les hommes d'Etat, la presse, le public, entassent des affirmations, des phrases toutes faites, des sentences dogmatiques; je me propose, dans les pages suivantes, de les remplacer par des faits.
On dit: « La politique coloniale est indispensable à l'expansion de la race française ». C'est possible, mais on a tort de croire que cette simple déclaration soit suffisante pour résoudre la question.
On dit: « La politique coloniale est indispensable pour ouvrir des débouchés à notre commerce. » C'est possible: mais quels débouchés lui a-t-elle ouverts? Jusqu'ici, à qui a profité cette politique? A nous ou à nos concurrents?
On dit: « Elles doivent être une source de richesses pour la France ». On n'indique pas leur prix de revient ni leur produit.
On dit: « La politique coloniale nous incombe comme un devoir, au nom de la mission civilisatrice des races supérieures à l'égard des races inférieures. » Soit; mais qui nous a donné cette mission? Où est notre mandat? Quelle est la nature de ce mandat? De quelle manière avons-nous compris, jusqu'à présent, notre « mission civilisatrice »? Quels résultats les races inférieures ont-elles obtenus de leur contact avec les races supérieures?
On dit: « La politique coloniale fait partie de nos traditions nationales; elle est indispensable à la grandeur de notre patrie, à notre considération dans le monde ». C'est possible; l'histoire doit nous donner sans doute quelques renseignements sur ce point. Il n'est donc pas inutile d'examiner si les faits sont en rapport avec cette affirmation.
Enfin, par ce mot « la politique coloniale », on entend en France la prise de possession d'un coin quelconque d'un territoire quelconque par la France, avec coups de canon, batailles et toutes les conséquences de la guerre; une occupation directe avec un gouverneur, soit civil, soit militaire, des soldats, des vaisseaux, des fonctionnaires, un budget greffé sur celui de la mère-patrie. Il s'agit de savoir si tous les peuples ont prêté le même sens à ces mots « la politique coloniale »; si l'acception que nos gouvernants, la presse, l'opinion publique, nous en donnent est la bonne; s'il n'y en a pas d'autres, et si la véritable politique coloniale ne consisterait pas à faire précisément le contraire de tout ce qu'on a fait et de ce qu'on fait à présent sous ce titre.
Tels sont les divers points que nous allons passer rapidement en revue.
II. — Quelle est d'abord la superficie de nos colonies?
Les établissements français dans l'Inde, réunis, comprennent une superficie de 49.000 hectares, équivalant à la surface du département de la Seine qui, comme étendue, est de beaucoup le plus petit des départements français. Il ne faudrait pas juger de l'importance de Pondichéry et de Chandernagor par la longueur et la sonorité de ces noms. Nous avons à Calicut « une loge occupée par un gardien ». De même à Surate, et ailleurs.
La Cochinchine compte 5.900.000 hectares, la plupart marécageux, représentant environ l'étendue de neuf départements français. Le Cambodge, sur lequel nous exerçons un protectorat plus ou moins réel, compte pour 8.000.000 d'hectares. Les partisans de l'expédition du Tonkin disent qu'il a 17 millions d'hectares, seulement il s'agit de les occuper. Voilà notre empire colonial en Asie,
En Afrique, nous avons, à l'orient, l'île de la Réunion, de 251.000 hectares, moins que le tiers de la superficie de la Corse, qui est de 874.000 hectares; Sainte-Marie de Madagascar, de 15.500 hectares, un peu moins que l'arrondissement de Sceaux; Nossi-Bé, de 13.600 hectares; Mayotte, de 30.000 hectares; Obock, qui n'est qu'un point.
Sur la côte occidentale, les annexions de M. de Brazza sont encore à l'état vague; au Gabon, le chef Louis nous céda, en 1842, une partie du territoire sur la rive droite du fleuve de ce nom; on estimait la superficie de cet établissement, avec celui de la Côte-d'Or, à 20.000 hectares; les optimistes donnent 25 millions d'hectares au Sénégal; l'Annuaire du Bureau des longitudes ne lui donne que 3 millions d'hectares; sa limite à l'intérieur de l'Afrique manque de précision. Il en est de même pour l'Algérie: le Tell compte environ 14 millions d'hectares; ensuite on peut étendre sa frontière méridionale jusqu'à El Goléah. Les chiffres officiels donnent une superficie de 41 millions 800 mille hectares, les quatre cinquièmes de celle de la France qui a 52 millions 800 mille hectares; seulement, on vient de condamner récemment en police correctionnelle pour escroquerie un M. M..., qui s'était avisé d'offrir à des gogos les mirages du Sahara. La Tunisie compte une douzaine de millions d'hectares avec des incertitudes analogues.
Tel est notre empire colonial en Afrique. Aux Antilles, la Martinique a la surface de l'arrondissement de Fougères, 98.702 hectares; la Guadeloupe, 82.000 hectares; ses dépendances, 23.000 hectares.
En Amérique, la Guyane a une longueur de 500 kilomètres de côtes; la profondeur en est indéterminée: les documents officiels lui donnent 7.700.000 hectares.
Dans l'Océanie, notre plus grande colonie est la Nouvelle-Calédonie, que des imprudents comparent à l'Australie: celle-ci a une superficie égale aux 4/5es de celle de l'Europe; la Nouvelle-Calédonie a 1.600.000 hectares, un peu moins que la superficie des trois départements réunis: le Finistère, le Morbihan et les Côtes-du-Nord.
Les îles Marquises comprennent onze îlots représentant 12.400 hectares; la superficie de Taïti est de 104.000 hectares, ce qui représente a peu près la superficie de l'arrondissement de Calvi, quelque chose comme le sixième de la Corse.
En groupant l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, la Guyane, la Cochinchine, le Cambodge, en leur donnant les plus larges limites, on arrive à 800 mille kilomètres, 900 mille si vous voulez, moins du double de la France.
La surface des terres des cinq parties du globe est de 136 millions de kilomètres carrés; la superficie de la France et de ses colonies est petite, surtout quand nous comparons ses possessions à celles du Royaume-Uni qui n'a lui-même que 314.000 kilomètres carrés, mais dont les colonies ou les protectorats s'étendent sur une surface de plus de 22 millions de kilomètres carrés. Cette grandeur nous humilie. Nous nous trouvons à l'égard de l'Angleterre dans la situation d'un petit propriétaire à l'égard d'un grand. Nous sommes jaloux de ce vaste domaine, et nous voulons en avoir un semblable à lui opposer, à tout prix. Nous ne calculons plus, nous n'écoutons que la passion. Nous aspirons à des annexions, dont nous examinons seulement l'étendue, sans nous inquiéter de la qualité. Nous négligeons, en même temps, d'examiner les conditions spéciales qui ont fait de l'Angleterre la plus grande puissance coloniale du globe. Nous ne savons pas distinguer les côtés positifs et les côtés factices de cette puissance; nous croyons que toutes ses colonies sont un débouché pour sa population et que, sans elles, elle n'aurait pas de commerce.
Nous jugeons toutes ces choses d'après nos sentiments, d'après des idées préconçues, et non après examen.
III. — Les partisans de la « politique coloniale » déclarent que son principal but est de multiplier les Français sur tous les points du globe, et avec eux, la langue française, les idées françaises, la civilisation française. « Que deviendra la France, dans un siècle, si elle n'a pas essaimé au dehors? Les Anglo-Saxons couvrent le globe. Ils seront bientôt cent millions. Nous, resterons-nous avec 36 millions de Français sur nos 52 millions d'hectares? Nous tomberons au rang d'une puissance de second ordre, nous deviendrons une espèce de Suisse. Enfin, en expédiant au dehors une partie de notre population, nous faisons le vide en France, et comme la nature a horreur du vide, il sera immédiatement rempli ».
Voilà l'argument dans toute sa force. Il s'appelle « l'expansion de la race française ».
Les auteurs et les vulgarisateurs de cette locution comprennent sous ce titre « la race française », tous les gens vivant entre Hendaye et Dunkerque, Vintimille et Brest, si différents qu'ils puissent être, non seulement d'origine, mais encore de mœurs, de caractère, d'intellect. Qu'importe! J'accepte leur expression dans ce sens, sans m'occuper autrement de sa précision. Nous avons eu un « empire colonial » dont on parle tant; nous en possédons encore des débris; quel est le nombre des Français qui s'y sont conservés, répandus, développés?
IV. — Prenez la carte des climats que le Dr Rochard a publiée395 et qui est devenue classique. Il donne pour limites Nord et Sud du climat torride les deux lignes isothermes + 25; au climat chaud les deux lignes isothermes de + 25 à + 15; au climat tempéré les deux lignes + 15 à + 5; au climat froid de + 5 à — 5; au climat glacial les sommets des deux pôles.
Des cinq parties du monde, seule l'Europe est préservée du climat torride. En Asie, il couvre l'Arabie jusqu'au nord de Médine, la Perse au sud de Chiraz, le Bélouchistan, l'Hindoustan, l'Indo-Chine, le Tonkin. En Afrique, à l'occident, la Sénégambie, la Guinée, le Congo; au centre, le Sahara, le Fezzan et le Soudan; à l'est, la région qui s'étend du tropique du Cancer, 26 degrés latitude nord, à l'embouchure du Zambèse, y compris Madagascar et les îles voisines, y sont soumis.
Dans l'Amérique du nord, il s'étend sur le Mexique, l'Amérique centrale, les Antilles; dans l'Amérique du sud sur la Colombie, les Guyanes, le nord de la Bolivie et une partie du Brésil.
En Océanie, il comprend les îles de la Sonde, les Philippines, les Célèbes, les Moluques, le nord de l'Australie, les archipels des Carolines, des Navigateurs, les îles de la Société, les Marquises.
Le climat torride est surtout remarquable par la constance et l'uniformité des influences atmosphériques. Il compte deux saisons, la saison des pluies ou hivernale et la saison sèche ou belle saison. Dans le cloud ring des Anglais, le « pot-au-noir » des marins français, les alizés accumulent toutes les vapeurs recueillies à la surface de l'Océan; elles se condensent dans les hautes régions et, se déplacent à la suite du soleil; c'est lorsque le soleil est au zénith, c'est-à-dire en été, que ces nuées crèvent en ondées torrentielles qui donnent au pluviomètre jusqu'à 0m,28 et plus en une heure, et comme moyenne annuelle dans l'Inde, deux à trois mètres, à la Réunion plus de quatre mètres, tandis qu'à Paris, de 1851 à 1881, cette moyenne n'a pas dépassé 521 millimètres.
Alors sous l'ardeur du soleil, l'air se sature de vapeur d'eau; cette humidité, divisée en molécules à l'infini, pénètre partout, s'oppose à l'évaporation des sécrétions de la peau, envahit les voies pulmonaires.
C'est le moment le plus redoutable où s'abattent sur l'indigène, mais surtout sur l'européen, les fièvres de toutes natures, devenant de suite pernicieuses avec toutes leurs séries d'accidents. Après les fièvres, la dysenterie permanente, la colique sèche. L'européen n'échappe jamais aux maladies de foie. Souvent il est atteint d'hématurie. Il tombe dans l'anémie, devient irritable, incapable de tout travail intellectuel et perd la mémoire. S'il est prédisposé à la phthisie, elle prend aussitôt une forme galopante. Des maladies de peau de toutes sortes appartiennent au climat torride; il produit aussi la mouche hominivore et quelques insectes qui peuvent vous tuer, sans compter ses serpents venimeux et ses animaux féroces.
Tous ces fléaux sont peu de chose auprès du choléra à l'état endémique et de la fièvre jaune.396
Or, toutes nos colonies, sauf l'Algérie et la Nouvelle-Calédonie, sont situées dans le climat torride. Nous allons examiner comment « la race française » a résisté à son influence.397
V. — Nous occupons Pondichéry depuis deux siècles; le total de la population est de 273.000 habitants, sur lesquels il n'y a que 1.660 européens, dont il faut déduire les fonctionnaires et les soldats; et qui dit européen ne dit pas Français. De 1856 à 1864, on y a constaté un excédent de 300 naissances pour 246 décès; dans les autres périodes on trouve 34 décès pour 28 naissances.
A Karikal, de 1849 à 1856, la population blanche a donné 15 naissances pour 22 décès.
Notre première intervention en Cochinchine date de 1779; elle compte actuellement une population de 1.825 Français et de 139 étrangers, de 1.483.000 indigènes et de 64.027 asiatiques étrangers. D'après le Dr Thorel, aucune localité de la basse Cochinchine n'est exempte de l'infection palustre qui ne disparaît que vers 2.000 mètres d'altitude.
Le Dr Morice, qui est mort victime de ce climat, le Dr Mondière, constatent que la mortalité des troupes y est de neuf à dix pour cent; elle est due dans la proportion des trois cinquièmes à la dysenterie.
La femme européenne succombe presque toujours dans ses couches. Le nombre des mariages à Saigon, en 1880, s'est élevé à sept pour les européens: il y a eu 46 naissances et 102 décès.398 Le Dr Maget considère que les européens ne doivent pas séjourner plus de deux ans au Tonkin.399
Ces faits indiquent que nos établissements d'Asie ne peuvent pas contribuer beaucoup à « l'expansion de la race française ».
La Réunion est occupée, d'une manière à peu près constante, par les Français, depuis 1638.
En 1872, la population était de 193.000 habitants; en 1882, elle n'est plus que de 170.518 habitants: différence, près de 23.000.
Pour la moyenne quinquennale de 1877 à 1881, le nombre des naissances a été de 4.492, celui des décès de 6.378, différence 1.886. Cette différence a un peu diminué en 1882, le nombre des décès a été seulement de 5.351, le nombre des naissances de 4.647: différence, 694.
Sainte-Marie-de-Madagascar compte 7.189 habitants, sur lesquels une centaine de blancs. En 1722, Carpeau de Saussay la surnommait le « cimetière des Français, parce qu'il n'y a aucun navire qui n'y laisse bon nombre de personnes pour peu de séjour qu'il y fasse ».
Nossi-Bé compte une centaine d'européens; en quarante ans, les fonctions de chef de service de santé ont été remplies par trente-neuf médecins.
La population européenne de Mayotte, en 1881, comptait 4 naissances et 22 décès.
En 1872, le Sénégal avait une population de 210.000 habitants; en 1873, il y avait une augmentation de 3.368 et une diminution de 14.537: perte, 11.169. Les renseignements pour 1880 donnent 191.000 habitants; différence sur le chiffre de 1872, 20.000; ceux de 1882 accusent encore une nouvelle diminution: 189.000, avec un excédent de décès sur les naissances de 525.
Mais ce serait une grande erreur de croire que ces chiffres représentent la population colonisatrice; ils ne représentent que les indigènes, auxquels il faut ajouter une population de 2.000 individus, fonctionnaires et soldats. Cependant on comptait, paraît-il, en 1872, 655 colons, tant Portugais qu'Anglais et Français. Le Dr Corre estime qu'à Saint-Louis il y a 280 créoles blancs qui résisteraient, mais sans se reproduire. En 1881, il y avait 6.600 électeurs inscrits; mais quelles sont leurs origines diverses? Les documents officiels sont muets.
La mortalité y est, pour les fonctionnaires, de 7.7 0/0; pour les médecins, de 18.5 0/0. Les Turcos ne résistent même pas au climat. Les statistiques de 1843 à 1847 donnent pour les européens 391 décès pour 100 naissances. Pour l'ensemble de la population, la statistique de 1882 donne 573 naissances, 1.098 décès; différence, 525.
Tous les médecins qui ont fait des monographies sur le Sénégal, le Dr Gestin, le Dr Bérenger-Féraud, déclarent qu'il ne s'y trouve pas un seul européen qui ne souffre de l'hypochondre droit. Un fonctionnaire, observant les conditions hygiéniques les plus strictes, ne peut pas résister plus de trois ans dans l'intérieur du pays; à Saint-Louis, quatre, cinq, huit ans au grand maximum.
En dehors de l'impaludisme, de la dysenterie, de l'hépatite, la fièvre jaune vient de temps en temps frapper les européens dans une effrayante proportion; deux fois, dans ces dernières années, en 1878 et en 1881, elle s'est abattue sur le Sénégal. Les européens ont été atteints dans la proportion de 80 0/0; la mortalité a été de 46 0/0.
Le climat de la côte de Guinée est si terrible qu'il a mauvaise réputation au Sénégal; à Lagos, en six ans, sur 80 blancs on compte 48 décès.
Au Gabon, le chiffre de la population indigène n'est pas connu; le document officiel dit simplement: « Sur le littoral occupé par l'élément européen, la population s'élève à environ 200 têtes, presque tous Portugais. »
La moitié des européens qui ont fait partie de l'expédition Brazza (mars 1883-avril 1884) subiront toute leur vie les conséquences de leur séjour à l'Ogooué. Ils ont laissé cinq morts derrière eux; mais ils ont contracté cette langueur énervante si caractéristique qu'elle a recule nom « d'anémie du Gabon ». Ces renseignements n'indiquent pas que ces colonies d'Afrique doivent plus contribuer que nos colonies d'Asie à « l'expansion de la race française ».
La Martinique comprend 166.988 habitants; les statistiques ne distinguent pas entre les blancs, les mulâtres et les nègres; mais Rochoux prétend qu'il n'y a pas de créole de la neuvième génération de père et de mère sans croisement avec du sang européen. Pendant tout le dix-huitième siècle, les colons ne se sont maintenus que par l'immigration. Malgré cette précaution, en 1848, ils n'étaient plus qu'au nombre de 9.500. La population de couleur augmentait, au contraire, par une natalité de 37 pour 1000. Les Drs Nielly et Rey, en raison de l'expérience du passé et de leur expérience personnelle, disent que « la population de couleur seule augmente par les naissances ». Il suffirait d'une épidémie de fièvre jaune pour mettre en question l'existence même de notre race.400
Dans les cinq années de 1877 à 1881, la moyenne des décès a été de 4.591 et la moyenne des naissances de 5.493, donnant un excédent de naissances de 902; il est vrai qu'en 1882, il y a eu un excédent de décès de 193. Mais cet excédent des naissances, fût-il beaucoup plus considérable, ne contribuerait pas à « l'expansion de la race française », à moins qu'on étende aux nègres ce mot si élastique.
A la Guadeloupe, autant qu'on peut le savoir, les nègres sont dans la proportion de 32 0/0; les métis dans la proportion de 62 0/0; mais la population de couleur ne peut même pas s'y acclimater. Le chiffre de la population a augmenté de 136.000 en 1873 à 159.715 en 1882, mais par l'immigration et non par la natalité: car l'excédent des décès est constant.
La moyenne annuelle pour les cinq années 1877-1881 a été de: naissances, 4.361; décès, 5.003; excédent des décès, 642. En 1882, il a été de 636.
Quant à la Guyane, elle a une réputation sinistre parfaitement justifiée; le docteur Crevaux, parlant de cette région, disait que « la vie végétale y tuait la vie animale ». Le docteur Orgéas, dans une monographie qui a obtenu le prix de médecine navale en 1881, donne des chiffres effrayants: de 1852 à 1857, il y a des pénitenciers, comme Saint-Augustin, où la mortalité s'est élevée jusqu'à 44,1 O/O. La mortalité annuelle fut de 16,62; dans les plus mauvais pénitenciers de France et de Corse, elle n'arrive pas à 6.
On essaya des mariages administratifs entre convicts et femmes expédiées ad hoc par les sœurs de Saint-Joseph; la natalité, mort-nés compris, ne fut que de 0,96 0/0, tandis qu'elle est de près de 3 en France. Sur 379 enfants, nés depuis le mois d'avril 1861 jusqu'au 17 janvier 1882, 238 sont morts: c'est une proportion de 62,79 0/0. Le docteur Orgéas conclut: « Un enfant né en France a plus de chance d'arriver à l'âge de trente ans qu'un enfant né au Maroni n'a de chance d'arriver à l'âge de deux ans ».
Ces faits prouvent que les Antilles et la Guyane ne semblent pas devoir jouer un rôle fort utile pour « l'expansion de la race française. »
En Océanie, Taïti et Moorea contiennent 974 Français, 591 Européens; les Marquises, 71 Français et 60 Européens.
Ces faits prouvent que le Français ne peut ni s'acclimater ni se reproduire dans le climat torride. Comment donc les colonies que nous y établissons pourraient-elles contribuer à « l'expansion de la race française »? Elles n'ont jusqu'à présent servi que de cimetières à nos soldats et à nos marins. — Mais les Anglais? — Eh bien! les Anglais sont comme les Français. Ils ne peuvent pas plus s'acclimater dans l'Inde et en Afrique que les autres Européens.
D'après le recensement de 1881, la population totale de l'Inde est de 253.891.000 personnes; sur ce chiffre, 85.444 personnes, dont 75.456 du sexe masculin et 12.088 du sexe féminin, sont d'origine anglaise; 56.646 sont des soldats; il reste donc moins de 20.000 Anglais civils. Si on ajoute à ce chiffre les autres Européens nés dans l'Inde, on arrive au total de 142.612. Le chiffre des Européens est à celui des indigènes comme 1 est à 1.770. Les Anglais ont essayé de faire des mariages entre leurs soldats et des femmes anglaises. Le résultat a été aussi nul que ceux qui ont été tentés au Maroni. « On n'a jamais pu, dit le major général Bagnold, élever assez d'enfants mâles pour recruter le corps des tambours et des fifres. »
Les Hollandais ne se reproduisent pas plus à Java.
Au point de vue de « l'expansion de la race française », il faut donc considérer comme des non-valeurs toutes nos colonies situées dans le climat torride; et elles le sont toutes, sauf l'Algérie et la Nouvelle-Calédonie, qui sont situées dans le climat chaud.
VI. — Cette dernière ne pourra jamais offrira l'émigration française un large débouché. Les trois départements de France dont elle égale la superficie comptent 1.600.000 habitants. La Nouvelle-Calédonie serait saturée avec un million. En attendant, sa population civile compte 2.500 personnes; les officiers, employés et leurs familles forment un total de 1.040; les libérés sont au nombre de 2.300; les transportés, de 7.000. Il y a 30 ou 40.000 Canaques qu'on refoule et qui disparaissent.
Reste donc l'Algérie. Elle est à moins de quarante heures de Marseille. Sa proximité semblait devoir opérer une telle attraction qu'en 1832, le gouvernement craignait que toute la France ne s'y déversât et prenait une décision « pour empêcher une immigration trop nombreuse et spontanée ». Depuis, il a été si complètement rassuré sur ce danger, qu'il a essayé par toutes sortes de moyens d'organiser et de provoquer cette immigration.
En 1848, le Moniteur déclare que « l'Algérie était destinée à résoudre le problème social; qu'il suffisait d'en frapper le sol du pied pour en faire sortir les moissons, les herbes potagères et les arbres à récolte, vignes, oliviers, mûriers ». On prit 50 millions aux contribuables français pour en doter 12.000 privilégiés; mais le ministre de la guerre avouait que le chiffre de 2.500 fr., que représentait ce partage, n'était pas exact et qu'en réalité chaque colon revenait à 8.000 fr.
Les ouvriers naïfs qui, sur la foi du Moniteur, s'imaginaient que les moissons en Algérie poussaient sans travail et instantanément, éprouvèrent une amère déception en constatant le contraire. La désertion et la mutinerie dévorèrent les villages; une commission d'enquête les visita et, sans oser tracer le véritable tableau de la situation dans laquelle elle les avait trouvés, en revint avec cette conclusion: « qu'à l'avenir il ne serait plus fondé de villages agricoles en Algérie ».
On continua cependant à essayer de pousser à l'immigration par d'autres moyens. En 1857, selon le colonel Ribourt, on accorda 80.000 passages gratuits: il y eut 70.000 retours. En 1871, l'Assemblée nationale crut presque compenser la perte de l'Alsace et de la Lorraine en attribuant aux Alsaciens-Lorrains 100.000 hectares. Sur 159.000 optants, 3.261 seulement s'embarquèrent pour l'Algérie; les 155.000 autres avaient une méfiance justifiée.
L'installation des 900 familles qui s'étaient laissé séduire coûtait 6 millions de francs, soit 6.888 fr. par famille pour les maisons et l'assistance, sans compter beaucoup d'autres faux frais.
Ces ouvriers de fabrique, habitués à la vie des villes, à la bière, à la forte nourriture, ne s'acclimatèrent pas. Les documents officiels n'enregistrent jamais les insuccès. Mais M. Guynemer, visitant les villages deux ans après, n'y trouvait plus que 2.000 habitants. La plupart, dès le premier jour, avaient mangé leurs poules et leurs brebis, s'étaient servi des portes et des fenêtres en guise de bois de chauffage. Les plus tenaces empruntèrent sur leur concession, la firent cultiver par des Arabes et, au bout des cinq ans exigés pour qu'ils en devinssent propriétaires, la vendirent et disparurent.401
M. d'Haussonville, dans une étude sur la Colonisation officielle, a opposé à cet échec les succès obtenus par la Société dont il était le président. Malheureusement, ses succès n'ont pas été beaucoup plus brillants; à d'Haussonvillers, c'est presque la misère.
« Au village d'Aïn-Yagout, sur vingt-huit lots donnés, il reste trois familles comprenant en tout quatre habitants. A Fontaine-Claude, sur vingt-neuf lots, il reste trois familles comprenant en tout huit habitants; une seule maison a été construite. A Aïn-Mazuéla, il reste quatre familles comprenant six habitants, et il n'y a pas une seule maison construite. A Aïn-Yzar, livré à la colonisation en 1830 et qui comporte dix lots, il n'y a pas encore un seul habitant. De même à Beni-Addi, sur la route de Constantine à Biskra, se trouve un de ces villages dont il ne reste plus que des ruines ».402
M. Tirman constatait dans son État de l'Algérie au 31 décembre 1882 que, depuis 1871, le nombre des familles installées sur les 12.270 lots établis lors de la création des centres, a été de 10.030. De ces 10.000 familles, il n'y en a plus que 5.000 à résider sur leurs concessions. Le fameux projet des 50 millions fondait 300 centres qu'il partageait mathématiquement en deux portions égales: 150 sur les territoires possédés, 150 sur les territoires expropriés; chaque centre devait avoir 50 feux.
Cette symétrie est admirable sur le papier. Mais tous les villages étaient-ils également propres à la culture? Pouvaient-ils tous être impunément habités par des Français?
Il faut le dire: l'administration a commis des crimes en donnant certaines concessions. Le malheureux arrive de Bourgogne ou du Limousin avec sa femme, ses enfants, ses épargnes; on l'expédie prendre possession du lot qu'il a obtenu par faveur, et il se trouve entre deux alternatives: ou sa concession a de l'eau, alors il a la fièvre; ou sa concession n'a pas d'eau, alors il meurt de faim.
J'ai vu de ces villages abandonnés par leurs habitants ruinés, laissant souvent derrière eux la tombe de leur femme et de leurs enfants. Quelques-uns s'entêtent, s'obstinent, ne sachant où aller, tombés dans le fatalisme musulman et livrant leur vie à un hasard providentiel.
L'épouvante a revêtu certains de ces lieux maudits de noms sinistres. Sur la ligne de Constantine à Bône, on vous montre avec effroi: Cayenne! Ceux où la fièvre s'abat sur vous et vous étreint ne sont pas les pires; on peut la combattre avec le sulfate de quinine; les défrichements terminés, les arbres grandis, elle s'évanouit peu à peu; mais les villages, brûlés par le soleil, sans une source pour les rafraîchir, sont condamnés à la misère implacable.
On répète partout que, d'après le recensement de 1881, le chiffre de la population française est en Algérie de 233.100 têtes; mais on oublie de déduire de ce chiffre l'armée de terre, 41.626 hommes; l'armée de mer, 581 hommes (chiffres du recensement).
En réalité, tous ces efforts multipliés n'ont abouti qu'à amener 195.000 Français en Algérie. Sur ces 195.000 Français, les fonctionnaires, agents et employés de tout ordre, payés par l'État, les départements et les communes, avec leurs familles, arrivent au chiffre de 35.113. Nous n'avons pas le détail du clergé européen. Il faut ajouter les pensionnés et retraités réfugiés à la solde de l'État, 7.465. Les chemins de fer ne sont établis qu'avec les subsides de la métropole. Leurs employés sont en réalité des employés payés par les contribuables français. Ce ne sont pas des colons. Ce personnel monte à 16.260.
Ces 60.000 individus n'ont pas fait de l'émigration gratuite et spontanée. Restent donc 135.000 Français dont il faudrait déduire les médecins de colonisation et un certain nombre de professions analogues.
Sur ces 135.000 Français, 29.455 sont des concessionnaires qui ont coûté à l'État 59.836.000 francs, soit 2.031 francs par tête.403
Parmi les commissionnaires et marchands en gros, beaucoup sont entrepreneurs de transports pour l'armée, fournisseurs militaires: parasites indirects du budget de l'État.
S'il n'y avait pas 50.000 hommes de troupes en Algérie, la moitié des hôteliers et cafetiers, qui comptent un personnel de 29.509 personnes, disparaîtrait.
En nous enfermant dans les limites les plus modestes, nous pouvons retrancher des 105.060 Français, non subventionnés directement ou indirectement par le gouvernement, un chiffre de 5.000 enfants assistés, mendiants, vagabonds, filles publiques, etc.
Restent donc moins de 100.000 Français habitant l'Algérie, avec leurs propres ressources, à leurs frais et vivant de leur propre travail et de leur propre initiative.
En divisant par 4, chiffre d'une famille peu prolifique, vous aboutissez à ce résultat: 25.000 Français producteurs.
Le chiffre de l'effectif des troupes de terre donne: 1875, 60.000 hommes; 1879, 55.937; 1880, 52.762; 1881, 81.250. Le jour du recensement seulement il a été inférieur à 50.000. Prenons ce dernier chiffre comme moyenne.
Supposez une gravure représentant un laboureur gardé par deux soldats, un à chaque bout de son sillon. Vous riez et vous criez: « C'est une caricature! » Pas du tout: c'est le tableau exact de l'Algérie. Le chiffre 25.000 colons, multiplié par celui de 2 soldats, égale 50.000!
Bastiat était au-dessous de la vérité quand il représentait chaque colon gardé par un soldat.
L'Algérie, dans ces conditions, a-t-elle profité « à l'expansion de la race française? » Combien de soldats tués, blessés, morts de la fièvre, anémiés pour la vie, rhumatisants, devenus des non-valeurs en rentrant dans la vie civile, de 1830 à 1884? Nous n'en aurons jamais le compte exact.
Quoique l'Algérie ne soit pas sous le climat torride, la mortalité y est pour les Français de 29 pour 1.000, tandis qu'elle n'est en France que de 22.
La natalité des Français, quoique plus forte qu'en France (33,3 pour 1.000 au lieu de 26), est moindre que celle des Israélites, qui est de 53; moindre que celle des Espagnols, qui est de 39; moindre que celle des Maltais et des Italiens.
Si la natalité des Français est plus considérable qu'en France, la mortalité des enfants compense cette différence. Pour 1.000 survivants à chaque âge, voici le nombre des décès annuels:
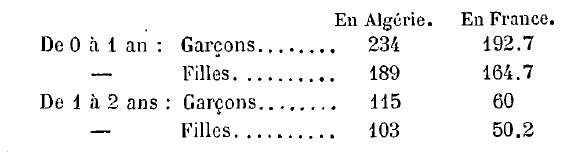
Dans la première année, la différence est dejà considérable; mais, pour la seconde année, les chances de mortalité de l'enfant français né et élevé en Algérie sont presque du double de celle du petit Français né et élevé en France.404 (Dr Ricoux.)
Nous avons enfoui dans ce sol plus de 10 milliards; son soleil a fondu des armées, et nous sommes arrivés à ce résultat que la population européenne étrangère y égale la population française: 190.000 contre 195.000!
Sur ce chiffre, les Espagnols comptent pour 112.000, les Italiens pour 31.000, les Anglo-Maltais pour 15.400. Par la faute, probablement, de notre législation, il n'y a en moyenne que 280 naturalisations par an, moins de 2 pour 1.000.
Une expression a caractérisé cette situation: l'Algérie aux étrangers!
L'histoire de l'Algérie a prouvé l'impuissance des séductions de l'émigration officielle. Tout l'effort s'est porté vers le refoulement des indigènes; ils ont résisté; leur population, au lieu de diminuer, s'accroît: 2.842.500 en 1881 contre 2.172.000 en 1872 et 2.416.000 en 1876. Les théoriciens et les praticiens de la politique coloniale présentaient l'Algérie comme une colonie de peuplement pour les Français: elle est devenue une colonie de peuplement pour les Kabyles et les Arabes, les Espagnols, les Italiens et les Anglo-Maltais.
VII. — Tel est le résultat de la politique coloniale au point de vue de « l'expansion de la race française ». De 1862 à 1867, une somme de 430.000 francs était inscrite au budget des colonies pour le passage des émigrants; elle est tombée à 59.000 francs, faute d'emploi. Le ministère de l'intérieur donne aussi des passages gratuits pour l'Algérie; une somme de 1.171.300 francs est proposée au budget de 1885 pour la création de nouveaux centres en Algérie. Malgré toutes ces incitations et ces encouragements, le Français se montre réfractaire. Il ne veut pas émigrer. Il faut bien avouer qu'il a raison de ne pas se laisser séduire par les incitations du gouvernement, de la presse officieuse, des ouvrages subventionnés; au lieu du paradis terrestre promis, il trouverait le cimetière. Quant à l'Algérie, il a de la méfiance, et il a encore raison. S'il n'est pas du Midi, il ne s'y acclimatera pas, n'y fera pas souche. Comme l'a très bien montré le D' Bertillon,405 l'homme n'est pas si aisément cosmopolite qu'on l'imagine. Il n'est susceptible que du petit acclimatement, surtout lorsque du Nord il descend vers les pays chauds.
Les publicistes et les hommes d'État qui parlent de l'expansion de la race anglo-saxonne oublient de remarquer que son accroissement se fait dans des pays ayant à peu près les mêmes conditions climatériques que la nation mère. La plus grande partie des États-Unis et du Canada sont compris entre les isothermes +15 et + 5, le climat tempéré. Le Nord seul de l'Australie est placé sous le climat torride; la Tasmanie, la Nouvelle-Zélande sont placées sous le climat tempéré.
En un mot, il faut distinguer entre les courants que suit l'émigration: si l'émigration s'étend entre les mêmes isothermes, elle peut faire le tour du globe, sans autre limite que son point de départ; si l'émigration a lieu perpendiculairement à l'équateur, elle ne peut se faire que pas à pas, par étapes rapprochées; encore, jusqu'à présent, l'européen ne peut-il s'acclimater au delà du 20° degré de latitude nord ou sud.406 Nous avons choisi l'émigration verticale, tandis que les Anglo-Saxons choisissaient l'émigration horizontale. Voilà pourquoi ils se répandent dans le monde par les États-Unis, le Canada, l'Australie, et pourquoi nous dépérissons dans nos colonies.
Les gens ne vont pas fonder des colonies de peuplement sans motifs d'émigration: persécutions, misère, excès de population. Quand le Palatinat, qui compte 137 habitants par kilomètre carré, a une émigration de 6,4 pour 1.000, il est tout naturel que la France, qui ne compte pas 70 habitants par kilomètre carré, ne fournisse qu'un émigrant. Les fanatiques de la politique coloniale se plaignent qu'en France la population augmente trop lentement, et ils demandent en même temps qu'elle s'en aille à l'étranger. N'y a-t-il pas là une contradiction?
Ils invoquent, pour la justifier, la formule que Guillard appelait: l'équation des subsistances. Elle repose sur cette vieille idée que la nature a horreur du vide. Un vide se fait dans la population, aussitôt pères et mères n'ont plus qu'une préoccupation: le remplir. D'après cette théorie, rien ne serait utile à l'augmentation de la population comme un bon choléra et une bonne guerre. Un de ces jours, nous entendrons des protectionnistes qui déclareront qu'il est nécessaire de faucher les hommes, comme on coupe les cheveux pour les faire repousser.
Tandis que le gouvernement fait tant d'efforts pour jeter les Français hors de France, il leur défend d'en sortir avant l'âge de 40 ans sous peine d'être considérés comme déserteurs. C'est un peu tard.
VIII. — Quels débouchés « la politique coloniale » a-t-elle ouverts et est-elle susceptible d'ouvrir à notre commerce?
Je prends le Tableau du commerce en 1883, le dernier paru: les chiffres officiels donnent pour l'ensemble du commerce spécial 8.256 millions, dont 4.804 millions d'importation et 3.451 millions d'exportation. Voici, suivant l'ordre d'importance, les principaux pays de destination:
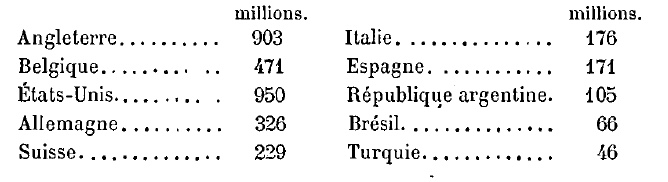
Voici, suivant l'ordre d'importance, le chiffre un peu majoré de nos exportations dans nos diverses colonies:
Algérie 154.500.000
Martinique 13.700.000
Guadeloupe 12.400.000
Sénégal 8.600.000
Réunion 7.800.000
Cochinchine 7.200.000
Guyane française 5.000.000
Saint-Pierre et Miquelon 4.100.000
Nouvelle-Calédonie, Taïti et Nouka-Hiva. 6.000.000
Côte occidentale d'Afrique 2.500.000
Possessions françaises dans l'Inde 500.000
Mayotte, Nosi-Bé, Madagascar 300.000
Total 222.600.000
Sur un total d'exportation de 3.500 millions, en chiffres ronds, 222 millions!
Quand nous vendons pour 1 franc à nos colonies, nous vendons pour 15 francs aux autres pays du globe; quand nous vendons pour 1 franc à nos colonies, nous vendons pour près de 5 francs en Angleterre; quand nous vendons pour 1 franc à nos colonies, nous vendons pour plus de 2 francs à la petite Belgique; quand nous vendons pour 1 franc à nos colonies, nous vendons pour un chiffre supérieur à la Suisse.
IX. — Pour avoir le compte exact du bénéfice que rapportent à la mère-patrie les colonies, il faut voir ce qu'elles ont coûté et ce qu'elles coûtent tous les jours.
Nous ne parlons pas des guerres auxquelles elles ont servi de prétextes dans le passé: le décompte en serait effroyable.
Nous ne parlons même pas des guerres qui ont servi à leur établissement; le total des importations de France en Algérie serait loin de représenter l'intérêt des milliards qui y ont été engloutis, sans compter la valeur des vies humaines qui y ont été consommées.
Mais, actuellement, les « Algériens » disent que l'Algérie se suffit à peu près à elle-même. Ne chicanons pas sur les détails. Tous reconnaissent également que les frais de force armée doivent rester à la charge de la mère-patrie. Or, nous entretenons en Algérie 50.000 hommes, qui représentent une dépense de 50 millions par an.
Pour quelle part comptent, dans la consommation des 154 millions d'importation, ces 50.000 hommes et tous les fonctionnaires, agents, concessionnaires, qui n'ont qu'une vie factice aux dépens des contribuables de la mère-patrie! Il y a des rails, des machines importées de France en Algérie: mais n'est-ce pas grâce aux garanties d'intérêts de la France? Le mouvement de la navigation n'est-il pas entretenu à l'aide d'une subvention? Quand on veut avoir le chiffre des bénéfices que les colonies peuvent rapporter à la métropole, il faut examiner un à un tous ces artifices de comptabilité. Pour les autres colonies, c'est encore pis.
Le Sénégal importe pour 7 millions de marchandises; au budget ordinaire, il coûte 3.610.000 francs, sans compter le service pénitentiaire, la solde et les frais de passage de la garnison et des fonctionnaires, la subvention aux Messageries maritimes. Ces importations sont destinées à l'armée et aux fonctionnaires. Il faut ajouter 4.760.000 francs d'avances à la Compagnie du chemin de fer de Dakar à Saint-Louis; 3.110.000 francs pour le haut Sénégal. Le budget est plus élevé que le commerce et nous sommes encore bien heureux d'en être quittes à ce prix; l'amiral Jauréguiberry avait demandé, en 1880, 120 millions pour le chemin de fer.
La Cochinchine est la plus prospère de nos colonies, elle subvient à toutes les dépenses de la justice, des troupes indigènes qui, dans les autres possessions, sont supportées par la métropole; elle verse au budget une subvention de deux millions. Mais elle est inscrite au ministère de la marine pour une somme de 4.798.000 francs, non compris la solde et les frais de passage de la garnison et d'un certain nombre de fonctionnaires, la subvention des Messageries maritimes. Elle a importé, en 1882, pour 5 millions de francs; en 1883, pour 8.900.000 francs de marchandises françaises. Comparez maintenant le bénéfice au prix de revient; et je ne parle pas de toutes les expéditions qu'elle a coûtées, et de la guerre du Tonkin et de la guerre de Chine qu'elle nous a values!
Le budget ordinaire des colonies, Algérie non comprise, est de 26 millions, de 34 millions avec le service pénitentiaire; les troupes d'infanterie et d'artillerie de marine, entretenues en vue des colonies, comptent 26.000 hommes, total: 60 millions. Les importations totales de la France dans les colonies, Algérie déduite, sont de 68 millions!
Mais ce budget ordinaire est toujours complété par des crédits supplémentaires et un budget extraordinaire.
Nos colonies sont un débouché, non pas pour notre industrie et notre commerce, mais pour l'argent des contribuables.
Le gouvernement, toujours prévoyant, fait des colonies pour ouvrir des débouchés à nos produits; mais, avec la logique qui le caractérise, il les ferme aussitôt. Au Gabon, les indigènes demandent de la poudre et des fusils; le gouvernement interdit de leur en vendre. Puis il dit à nos fabricants, à nos commerçants: Voilà un débouché. De quoi? Des soieries de Lyon? mais ces gens vont tout nus. Des draps d'Elbœuf? ils étoufferaient. De nos porcelaines? ils se contentent de la moitié d'une noix de coco. De nos rails, de nos locomotives? Oui, avec l'argent de la France.
De deux choses l'une: Quand vous allez fonder une colonie quelque part, vous vous trouvez — ou en face d'un peuple d'une civilisation développée; alors il faut le conquérir, l'assujettir, et cette colonie ne sert de débouché qu'à la vie de nos soldats, de nos marins, à nos arsenaux et à notre argent; — ou en face de peuples comme les Canaques ou les nègres du Sénégal et du Congo; ils n'ont pas besoin de nos produits, et en auraient-ils besoin, ils n'ont pas un pouvoir d'achat suffisant pour se les procurer.
X. — Il y a un autre point: c'est que toutes les colonies que nous pourrons établir à grands renforts de millions et de morts d'hommes, ouvriront toujours un débouché à l'Angleterre, à la Suisse, à l'Allemagne, supérieur à celui qu'il nous procurera.
Les colons que nous faisons à si grands frais, les administrateurs, les fonctionnaires qui forment notre principale population coloniale, achètent les produits étrangers qui leur sont livrés à meilleur compte. Quand nous fabriquons péniblement des colonies et des protectorats, c'est au profit du commerce de nos concurrents les plus acharnés, non au nôtre. Les faits le constatent.
Nous sommes ici obligé de prendre les chiffres de 1882, les derniers publiés pour toutes nos colonies, sauf les îles du Pacifique, la Cochinchine et l'Algérie.
Importations de France … 51.300.000
— des colonies françaises … 8.500.000
— de l'étranger … 65.500.000
Exportations pour la France … 121.300.000
— pour les colonies … 8.600.000
— pour l'étranger … 42.300.000
Le sous-secrétariat du ministère des colonies vient de publier, avec une hâte qui ne lui est pas habituelle, le tableau du commerce de la Cochinchine en 1883.
Le chiffre de nos importations en Cochinchine était de 5 millions de francs en 1882; il s'est élevé à 8.300.000 francs en 1883. Il est probable que les dépenses faites par la France pour l'expédition du Tonkin n'ont pas été étrangères à cette augmentation. Les exportations de la colonie en France ont été de 1.600.000 francs. Les importations de l'étranger en Cochinchine ont été de 65.800.000 francs. Les exportations de la Cochinchine à l'étranger ont été de 78 millions de francs.
Des chiffres concernant les premières colonies, il résulte que les exportations sont plus considérables des colonies en France qu'à l'étranger, mais que les importations de France dans les colonies sont moins considérables que celles de l'étranger. Pour les partisans de la balance du commerce, cet argument devrait être décisif: ce sont cependant eux qui sont, en général, partisans de la politique coloniale.
Des chiffres concernant la Cochinchine, il résulte qu'elle achète pour 8 francs à l'étranger quand elle achète pour 1 franc à la France; qu'elle vend pour 50 francs à l'étranger quand elle vend pour l franc à la France.
Voici la situation du commerce de l'Algérie, par rapport à la France et à l'étranger:
1882. Importation totale … 255.800.000
— de la France … 165.500.000
— de l'étranger … 90.400.000
Exportation totale … 177.000.000
— pour la France … 97.600.000
— 'pour l'étranger … 79.600.000
L'étranger n'a pas eu les frais de conquête et n'a pas les frais de colonisation et de garde de l'Algérie; son bénéfice est clair; le nôtre ne l'est pas.
Nous nous sommes donné beaucoup de mal en 1860 pour ouvrir la porte de la Chine. On la représentait pompeusement, dans les discours officiels, comme un marché de 400 millions d'hommes, qui allaient absorber des quantités considérables de nos marchandises.
En 1882, au bout de 22 ans, elle nous achetait pour 2.900.000 francs. En revanche, elle nous vendait pour 88 millions de marchandises. La guerre, qui devait donner un débouché à nos produits, avait eu pour unique résultat de donner un débouché aux produits chinois.
Je cite ce fait parce qu'il va nous indiquer le résultat fatal auquel doit aboutir pour nous toute notre « politique coloniale ».
Rappelons ce principe d'économie politique: les produits s'échangent contre des produits.
Donc, il est impossible à une nation d'acheter 88 millions de marchandises avec 2 millions. Les Chinois, si naïfs qu'ils soient, ne sont pas disposés à faire un pareil marché de dupe. Comment ce résultat peut-il donc se produire?
Voyez, d'un autre côté, le commerce de l'Angleterre avec la France en 1883: Importations de l'Angleterre en France: 696 millions; exportations de France en Angleterre: 903 millions. Nous ne sommes pas assez naïfs non plus pour donner à l'Angleterre 200 millions de marchandises de plus qu'elle ne nous en donne.
Voici comment se fait la balance. D'abord elle s'effectue, dans une certaine mesure, par des retours qui proviennent des placements de capitaux anglais en France.
Puis, l'Angleterre importe en Chine, soit directement, soit de Hong-Kong, soit des Indes ou de ses autres possessions, pour 480 millions de francs; elle paye la différence qui existe entre ses importations et ses exportations dans son commerce européen avec nous, en faisant pour nous en Orient des achats et des transports. En d'autres termes: je vends pour 100.000 francs à John Bull, mais je n'ai besoin en retour que de 75.000 francs de marchandises qu'il peut me donner. Comment se fera le solde? En numéraire? En intérêt de prêt antérieur? Peut-être pour une petite proportion; mais pour la plus grande partie, voici comment notre compte s'établit: si je n'ai besoin que pour 75.000 francs des marchandises de John Bull, en revanche j'ai encore besoin pour 20.000 francs de la soie que vend un Chinois; lui ne veut pas de mes produits, mais il a besoin de trois choses que John Bull peut lui fournir: de l'opium, des cotonnades à meilleur marché que les miennes, des armes de guerre que je ne peux pas fabriquer librement.
Alors je dis à John Bull: — Achetez de la soie au Chinois pour les
20.000 francs que je vous dois, et comme vous transportez plus rapidement et à meilleur marché que je ne pourrais le faire, apportez-la moi.
L'opération faite, notre compte se balance, et si une seule opération ne suffit pas, nous la répétons. D'où cette conclusion:
Si nous ne pouvons pas offrir aux consommateurs étrangers, acquis de gré ou de force, à nos colons expédiés et entretenus à grands frais, les objets dont ils ont besoin à meilleur marché que nos concurrents, c'est à ceux-ci et non à nous-mêmes que nos expéditions et nos colonies ouvrent des débouchés.
XI. — Il n'y a qu'un seul moyen d'empêcher ce résultat, c'est le retour au vieux système du pacte colonial: pour les produits coloniaux, privilèges sur le marché français et obligation d'y être conduits; pour les produits français, monopole sur le marché colonial; exclusion de tout pavillon étranger pour les transports entre les colonies et la mère-patrie et vice versa. La loi de 1861 brisa le vieux régime; le sénatus-consulte de 1866 donna au conseil général de chaque colonie la faculté d'établir les tarifs des taxes et contributions de toute nature, nécessaires à l'acquittement des dépenses des colonies; les tarifs d'octroi de mer sur les objets de toute provenance; les tarifs de douane sur les produits étrangers.
Les protectionnistes déclarent que ce sénatus-consulte est l'abomination de la désolation et demandent le retour à l'ancien régime.407 Ils n'oublient que ceci: en ruinant les colonies, ils n'augmenteraient pas nos débouches, puisqu'ils détruiraient leur pouvoir d'achat; ils n'enrichiraient que les contrebandiers. Ils provoqueraient aussi chez les colons un vif désir d'abandonner une mère-patrie qui les traiterait de cette manière et de se déclarer indépendants ou de se mettre sous la protection d'une puissance qui leur laisserait leur autonomie.
Ce serait une singulière manière de développer « notre empire colonial »!
XII. — « Sans colonies, il n'y a pas de débouchés. » Voilà l'affirmation. Voici les faits:
La Suisse est un petit peuple dont la population équivaut à celle du département de la Seine. Il n'a ni richesses minérales, ni ports. Une partie de son sol est remplie de montagnes inhabitables, à travers lesquelles il est obligé de se frayer des passages pénibles. Les tableaux de douane ne donnent que les quantités; mais M. René Lavollée, dans une étude qu'il vient de communiquer à l'Académie des sciences morales et politiques, estime à 960 millions la valeur annuelle de ses exportations, tandis que la France n'a qu'une exportation de 3.500 millions. La différence de la population entre les deux pays est de 13, la différence de l'exportation est de moins de 3!
Pour que le taux des exportations françaises et suisses, relativement à la population, fût égal, la France devrait exporter 11 milliards et demi au lieu de 3 milliards et demi.
Dira-t-on que ce sont ses colonies qui ont ouvert ces débouchés à la Suisse? Elle n'en a pas une.
Seulement, au lieu de payer 90 fr. d'impôts, chacun de ses habitants paye 17 fr.; au lieu de se donner le luxe de guerres européennes, d'expéditions en Asie, en Afrique, en Océanie, de coups d'Etats, d'insurrections, de révolutions, d'une administration centralisée et payée fort cher pour empêcher quiconque de faire quoi que ce soit sans autorisation de l'autorité, la Suisse est en république depuis un certain nombre de siècles, est une fédération de petits Etats autonomes, est en possession de la liberté de la presse, de réunion, d'association, de la liberté économique; toutes choses dont la plupart nous ont manqué jusqu'à ces derniers temps, dont certaines nous manquent encore.
Mais la marine? Oui. Nous reconnaissons que la Suisse ne brille pas par là. Sa puissance navale n'est guère connue que par l'amiral suisse de la Vie parisienne.
Mais il y a un autre petit peuple qui n'a pas de colonies et qui, cependant, a une marine: c'est la Norvège, qui compte moins de 2 millions d'habitants, moins que Paris. Sa marine à voiles a un tonnage nominal de 1.459.000 tonneaux, tandis que celle de la France, en dépit de ses primes, n'a un tonnage que de 642.000 tonnes. Sa marine à vapeur compte pour 95.000 tonneaux; celle de la France, avec toutes les subventions données sous divers prétextes aux compagnies de navigation à vapeur, a seulement 278.000 tonneaux. Le pouvoir de transport de la marine norvégienne est de 1.730.000 tonnes; celui de la marine française est de 2.032.000. Le pouvoir de transport de la Norvège est de 95 tonnes pour 100 habitants, celui de la France est de 5. Relativement à l'ensemble des marines de tous les pays du globe, le pouvoir de transport de la Norvège est de 4 pour 0/0, celui de la France seulement de 4,7.
Dira-t-on que ce sont les colonies de la Norvège qui ont fait sa marine? Elle n'en a pas. Elle a une puissante marine, parce qu'elle navigue à bon marché. Tout est là.
Un peuple ne peut avoir de débouchés qu'à une condition: c'est de fabriquer à meilleur marché que ses concurrents les objets qui sont demandés par les consommateurs.
Un peuple ne peut avoir de marine qu'à la condition de faire des transports moins chers, plus sûrs, plus réguliers et plus rapides que ses concurrents.
En un mot, la puissance d'expansion des produits d'un pays se mesure à l'intensité et au bon marché de sa production intérieure.
D'où cette conclusion: c'est que la « politique coloniale » étant très onéreuse et chargeant la production d'un pays de lourds frais et de graves risques, aboutit à un résultat diamétralement opposé au but qu'elle prétend poursuivre: au lieu d'ouvrir des débouchés, elle les ferme.
XIII.— « Notre mission civilisatrice? » Ceux qui en parlent le plus haut s'indignent contre le mot « classes dirigeantes». Ils n'admettent aucune aristocratie à l'intérieur; mais ils affirment qu'il y a des peuples aristocrates qui sont chargés de gouverner de gré ou de force les autres.
Les « peuples les plus avancés en évolution » font d'abord sentir aux autres les bienfaits de la civilisation à coups de canon et de fusil. Après leur avoir montré leur supériorité à l'aide de ces moyens persuasifs, ils leur prouvent leur justice en les dépossédant, en prenant leurs biens, leurs fruits, leurs troupeaux et leurs femmes. Dans cette lutte, ce n'est pas l'homme supérieur qui élève l'homme inférieur; c'est l'homme inférieur qui ramène l'autre à un type plus bas.
L'Algérie a surtout enseigné à notre armée l'art de faire des razzias, de brûler les récoltes et les oliviers, de marcher à l'aventure, sans se garder, et de se faire battre par la Prusse.
En revanche, le rapport de M. Etienne pour le budget de 1885 constate que sur les 2.800.000 indigènes qui occupent l'Algérie, 2.000 enfants seulement fréquentent les écoles françaises. Le vainqueur et le vaincu vivent côte à côte dans une haine réciproque: le premier trouvant qu'il n'a jamais assez dépouillé le second; celui-ci entretenu dans sa haine du passé par les injustices présentes et les menaces constantes pour l'avenir. Le projet des 50 millions rejetait 10.000 Kabyles, hommes des montagnes, véritables auvergnats, dans le Sahara. La commission des centres ne dissimulait pas qu'une telle mesure provoquerait une insurrection. Les Algériens prudents demandaient pour exécuter le projet qu'on ajoutât 30.000 hommes de troupes aux 59.000 existant. Ces faits suffisent pour montrer de quelle manière la civilisation profite de notre présence en Algérie. En profite-t-elle beaucoup plus au Sénégal et au Gabon? Le général Millot disait, devant la commission de la Chambre des députés, que «depuis 1874, le Tonkin était ruiné». Or, 1874 est précisément la date du traité qui lui a imposé notre protectorat!
XIV.— Je résume cette étude parles conclusions suivantes:
1° Au point de vue de l'émigration. Les Français ne veulent pas émigrer dans nos colonies et ils ont raison. Toutes, sauf l'Algérie et la Nouvelle-Calédonie, sont situées dans le climat torride où l'Européen ne peut ni s'acclimater ni se reproduire.
2° Au lieu d'essayer de provoquer des courants d'émigration factice, il faut les laisser à eux-mêmes. Les Basques et les Français du Sud-Ouest n'ont pas eu besoin des encouragements du gouvernement français pour aller à la Plata fonder un noyau de plus de 100.000 de nos compatriotes.
3° La France ne peut fonder des colonies de peuplement, parce que sa population n'est pas assez dense pour avoir une puissance de rayonnement; parce que les territoires qu'elle possède n'y sont pas propres, soit parce qu'ils sont déjà occupés par une population indigène nombreuse, comme l'Algérie, soit parce que leur climat est fatal aux Européens.
4° Comme débouchés au commerce français, nos colonies sont loin de rapporter non seulement les intérêts de leur prix de revient antérieur, mais même leur coût annuel.
5° Il faut en revenir au système que les Portugais établirent sur la côte d'Afrique; ils n'essayèrent ni de peupler, ni de conquérir; ils fondèrent des comptoirs qui servent encore de jalons aux Européens.
Dans l'Inde, malgré les conseils d'un de leurs vice-rois, ils voulurent devenir conquérants, ils furent perdus.
Les Hollandais faisaient des contrats avec des marchands indigènes sans établir de dispendieuses factoreries.
Quand sir Thomas Broë fut envoyé en ambassade auprès du grand Mogol, en 1613, il disait aux Anglais: « N'ayez pas de port, ne quittez pas la mer. » S'ils avaient suivi cette politique, ils auraient économisé beaucoup d'hommes et d'argent.
6° Le commerce extérieur d'une nation est en raison du bon marché et de l'intensité de sa production intérieure. Exemple: la Suisse.
La seule manière de développer notre commerce extérieur est non pas de gaspiller des millions et des armées dans des aventures coloniales, mais de pratiquer la politique du bon marché et du libre-échange.
7° Si le libre-échange existait, les peuples européens ne se disputeraient pas la possession du reste du globe et s'entendraient pour établir la sécurité de comptoirs commerciaux internationaux. Avec le libre-échange et une juridiction assurant la sécurité des contrats, il est à peu près indifférent qu'une terre appartienne à tel ou tel groupe ethnique, parlant telle ou telle langue.
Le groupe ethnique doit s'améliorer par métissage et instruction et, dans aucun cas, ne doit être détruit.
Les peuples européens se sont entendus pour supprimer la traite: pourquoi ne s'entendraient-ils pas pour suivre à l'égard des peuples autochtones des autres parties du monde une politique internationale n'ayant qu'un seul but: établir des moyens de circulation et la sécurité des Européens au milieu d'eux?
Ces lignes étaient écrites quand nous avons appris que la Conférence africaine, tenue dans le pays protectionniste qui s'appelle l'Allemagne, a déclaré la liberté complète du commerce sur les territoires du Congo et du Niger, occupés par la Commission internationale; la liberté de navigation sur ces deux fleuves; la neutralisation de ces territoires.408 C'est là un acte international de premier ordre. Nous n'avons qu'un regret, c'est que la France n'en ait pas pris l'initiative. Cette initiative lui aurait rendu en honneur et en influence européenne une partie de ce que les colonies lui ont coûté. L'Angleterre a adhéré pour les territoires qu'elle possède à ces conventions. En sa qualité de pays libre-échangiste, elle eût dû faire mieux: elle eût dû être la promotrice de cette nouvelle manière, pour les peuples européens, d'étendre leurs rapports réciproques dans les autres continents.
La conquête pacifique du globe est la seule possible pour les 150 ou 200 millions d'hommes qui se prétendent à la tête de la civilisation. Auraient-ils la prétention d'exterminer les 12 ou 1300 millions restants qu'ils n'y parviendraient pas. Les Indiens, les Arabes ont prouvé leur force de résistance. La Perse et l'Egypte ont dévoré successivement tous leurs conquérants.
Aux procédés d'extermination, il faut substituer le croisement et la fusion. Dans toute la zone torride, les métis seuls réussissent. D'après le Dr Jourdanet, au Mexique, sur huit millions d'habitants, six sont des métis d'Espagnols et de femmes indiennes. Juarez appartenait à cette race. A la Martinique, le sang mêlé, en dehors du pur noir, seul résiste et se reproduit.
Dans la question coloniale, il est utile de tenir compte de ce facteur qu'on néglige trop en matière sociale: le temps. Au lieu de procéder par conquêtes, à grand fracas, il faut procéder lentement, par infiltration.
C'est la manière de surmonter toutes les difficultés avec les populations autochtones. N'avons-nous pas l'exemple de Penn? Il conclut, en 1621, avec les Peaux rouges, un traité qui dura plus d'un demi-siècle et fut rompu non par leur faute, mais par celle des Anglo-Saxons.
Cet exemple ne suffit-il pas pour prouver que nous pouvons vivre en paix avec les indigènes, mais à une condition: c'est qu'au lieu de leur montrer dans chaque occasion notre mépris, notre haine, notre brutalité, notre rapacité, nous fassions comme les quakers et leur enseignions la douceur, l'urbanité, la politesse et leur apportions la sécurité de cette chose après laquelle, depuis que l'homme est un animal sociable, il ne cesse de clamer: la justice!
« La politique coloniale», telle que l'entendent les hommes d'Etat, est une des formes du protectionnisme: elle met à la disposition de quelques individus l'argent des contribuables, le sang des marins et des soldats, l'ensemble des forces nationales qui ne doivent être employées qu'à la sécurité de la patrie. L'expérience du passé nous prouve que ces privilégiés ont le plus souvent été ruinés, quand ils n'ont pas été tués par leurs privilèges.
L'ironie perpétuelle de la politique protectionniste est d'aboutir toujours au résultat opposé à celui qu'elle se propose. Notre politique coloniale en est une des manifestations. Il est donc logique qu'elle ait les mêmes effets. Elle allume un feu d'artifice pour cuire un œuf; et au milieu de toutes ses flammes, de tous ses soleils, de tous ses éblouissements, de sa fumée, elle casse l'œuf, sans le cuire.
YVES GUYOT.
67.Molinari on “Why Politicians will not support Free Trade Ideas in the Chamber” (1886)↩
[Word Length: 8,078]
Source
Gustave de Molinari, Conversations sur le commerce des grains et la protection de l'agriculture (Nouvelle édition) (Paris: Guillaumin, 1886). Seconde Partie: Temps d'abondance. Troisième conversation. La protection du travail. Conclusion, pp. 274-310.
TROISIEME CONVERSATION: LA PROTECTION DU TRAVAIL. — CONCLUSION.
SOMMAIRE: Les achats du gouvernement à l'étranger. — La protection du travail. — Nécessité logique de taxer l'importation, des ouvriers étrangers. — Les effets de la protection. — Comment elle finit par être funeste à ceux qu'elle favorise.— L'Etat et sa mission. — Responsabilité des classes gouvernantes. — Ce qu'il y a à faire et à ne pas faire dans l'intérêt de l'agriculture. — Pourquoi les protectionnistes et les collectivistes sont réfractaires à l'économie politique.
(Le café du Rat mort. Intérieur ancien style. Bourgeois du quartier, politiciens et artistes en herbe).
LE PROTECTIONNISTE (en costume de soirée, pardessus élégant).
On dira ce qu'on voudra. C'est un scandale. Oh! les bureaux! les bureaux!
L’ÉCONOMISTE.
Voyons, expliquez-vous! Qu'est-ce qui est un scandale?
LE PROTECTIONNISTE.
Eh! mais, la routine des bureaux. Je leur ai dit leur fait, à la Chambre.
L’ÉCONOMISTE.
Que leur avez-vous dit? De quoi s'agissait-il?
LE PROTECTIONNISTE.
Il s'agissait des approvisionnements de la guerre et de la marine. Figurez-vous qu'en ce moment même, où l'agriculture est en détresse, les départements de la guerre et de la marine font des achats de grains à l'étranger. J'ai interpellé les ministres qui ont balbutié des explications embarrassées.
L’ÉCONOMISTE.
Qu'ont-ils dit?
LE PROTECTIONNISTE.
Ils se sont excusés en disant qu'on avait pris pour règle d'acheter au meilleur marché; qu'on ne s'occupait pas de la provenance. J'ai répliqué. Je les ai fait rougir de leur manque de patriotisme et ça été un tonnerre d'applaudissements.
L’ÉCONOMISTE.
Je vous félicite sincèrement de votre succès. Mais est-ce en l'honneur du Rat mort que vous avez endossé votre habit et ce superbe pardessus?
LE PROTECTIONNISTE.
Non! je vais en soirée. Vous admirez mon pardessus. Vous avez raison. C'est souple, c'est léger, et d'un bon marché étonnant. Je l'ai acheté à Londres.
L’ÉCONOMISTE.
Ah!
LE PROTECTIONNISTE.
Oui, je me fais habiller en Angleterre. C'est bécarre!
L’ÉCONOMISTE.
Bécarre?
LE PROTECTIONNISTE.
On voit bien que vous n'êtes pas dans le mouvement. Vous n'êtes pas au courant du progrès de la langue. Être bécarre, c'est être à la mode, mieux qu'à la mode, et avec cela sérieux, anglais.409 J'ai mon tailleur à Londres, et j'achète mes gants à Bruxelles. Voyez plutôt. Des gants moulés sur les doigts, solides et moins chers qu'à Paris.
L’ÉCONOMISTE.
L'industrie parisienne souffre beaucoup en ce moment; elle traverse une crise pénible, et peut-être dangereuse. On congédie les ouvriers.
LE COLLECTIVISTE (qui vient d'arriver).
A qui le dites-vous? Mon patron vient de me renvoyer, sous le prétexte que l'ouvrage ne va pas... et pourtant il continue à employer un tas d'ouvriers belges, italiens, et même des allemands.., parce qu'ils ont consenti à une réduction de salaires, tandis que moi, j'ai refusé de me laisser exploiter. Quand en finirons-nous avec ces vils exploiteurs?
LE PROTECTIONNISTE.
Je vous plains et je suis sensible aux souffrances de l'industrie parisienne. Mais que puis-je faire pour les soulager? C'est l'affaire du gouvernement.
L’ÉCONOMISTE.
Il me semble que c'est un peu aussi la vôtre.
LE PROTECTIONNISTE.
Je ne suis pas député de Paris.
L’ÉCONOMISTE.
Mais encore? Vous trouvez mauvais que le gouvernement achète des blés à l'étranger, et vous ne vous faites pas scrupule d'acheter vos habits à Londres et vos gants à Bruxelles. Si vous vous faisiez habiller à Paris et si les autres « bécarres » suivaient votre exemple, est-ce que cela ne soulagerait pas les souffrances de l'industrie parisienne?
LE PROTECTIONNISTE.
Ce n'est pas la même chose. Je suis un simple particulier, et j'ai bien le droit de faire mes achats où bon me semble. Je n'ai à consulter que mes propres convenances, tandis que le gouvernement...
L’ÉCONOMISTE.
...Doit consulter celles des propriétaires fonciers.
LE PROTECTIONNISTE.
Tandis que le gouvernement doit acheter des blés français pour nourrir les soldats et les marins français. C'est une question de patriotisme.
L’ÉCONOMISTE.
Eh bien! n'est-ce pas âne question de patriotisme, quand on est Français et, qui plus est, député français, d'acheter des habits et des gants français?
LE PROTECTIONNISTE.
Pas le moins du monde. C'est une affaire de mode et... d'économie domestique. J'achète mes habits et mes gants où ils sont les plus beaux, les plus solides et les moins chers. Si j'agissais autrement, on dirait que je dilapide mes revenus, que je suis incapable de gérer ma fortune. Mes beaux-frères l'ont déjà dit sous le prétexte que j'avais des bontés pour une danseuse italienne. Ils seraient bien capables de me faire interdire.
L’ÉCONOMISTE.
Vous avez des bontés pour une danseuse italienne, vous achetez des habits anglais et des gants belges, et vous n'avez pas de remords?
LE PROTECTIONNISTE.
Aucun.
L’ÉCONOMISTE.
Cela prouve que vous avez une conscience libre-échangiste et des opinions protectionnistes.
LE PROTECTIONNISTE.
Mes opinions n'ont rien à voir dans mes achats.
L’ÉCONOMISTE.
Ni dans vos bontés.
LE PROTECTIONNISTE.
Ni dans mes bontés! Ne suis-je pas majeur et libre? N'ai-je pas le droit de consulter mes intérêts dans mes achats et mes sympathies dans... mes bontés. Tandis que le gouvernement, lui, a des devoirs.
L’ÉCONOMISTE.
Sans aucun doute. Le gouvernement a des devoirs envers les contribuables, c'est-à-dire envers la généralité des Français. Lé premier de tous, c'est de ne pas augmenter inutilement leurs charges, déjà assez lourdes, pour favoriser des intérêts particuliers; c'est, par conséquent, d'acheter les blés dont il a besoin où ils sont au meilleur marché, fût-ce à New-York, à Chicago ou à Odessa, comme vous achetez vos habits à Londres, vos gants à Bruxelles et vos plaisirs... en Italie.
LE PROTECTIONNISTE.
Vous êtes un terrible homme. Vous mettez de la logique partout.
L’ÉCONOMISTE.
Cela ne vaut-il pas mieux que de n'en mettre nulle part?
Mais revenons-en, si vous le voulez bien, à notre dernière conversation.
LE PROTECTIONNISTE.
J'aime autant cela. Que nous disiez-vous donc? Ah! vous prétendiez que les droits protecteurs de l'agriculture renchérissaient artificiellement les nécessités de la vie, le pain et la viande, et qu'ils constituaient une taxe prélevée sur la généralité des consommateurs au profit des propriétaires fonciers!
L’ÉCONOMISTE.
Grands et moyens. Car les petits propriétaires n'y gagnent rien, au contraire.
LE PROTECTIONNISTE.
Grands et moyens, si vous voulez. Mais vous avez oublié d'ajouter que les consommateurs de pain et de viande sont, en grande majorité, des salariés et que le taux des salaires est déterminé par le prix des subsistances. Si le pain et la viande haussent de prix, les salaires hausseront dans la même proportion. Les ouvriers sont donc absolument désintéressés dans la question.
LE COLLECTIVISTE.
C'est vrai. C'est la loi d'airain, comme l'a si bien nommée Lassalle. L'exploitation capitaliste abaisse les salaires au minimum de subsistances.
L’ÉCONOMISTE.
Combien gagnez-vous dans votre état de peintre-décorateur?
LE COLLECTIVISTE.
Combien je gagnais plutôt, avant que mon exploiteur ne m'ait mis à la porte? 10 francs par jour. Il voulait me réduire à 8 francs. Les Belges et les Italiens ont accepté la réduction. Moi j'ai refusé, mais me voilà sur le pavé.
L’ÉCONOMISTE.
Eh bien! 10 francs et même 8 francs, n'est-ce pas quelque chose de plus qu'un minimum de subsistance?
LE COLLECTIVISTE.
Peut-être, mais nous sommes des artistes, nous autres.
L’ÉCONOMISTE.
Cela ne fait rien à l'affaire. Si vos patrons avaient le pouvoir que vous leur attribuez de fixer à leur gré le taux des salaires, ne l'abaisseraient-ils pas au-dessous de 10 francs et même de 8?
LE COLLECTIVISTE.
Parbleu! mais ils ne trouveraient pas d'ouvriers.
L’ÉCONOMISTE.
Et quand le pain et la viande viennent à hausser, est-ce qu'ils ont l'habitude d'augmenter vos salaires en proportion?
LE COLLECTIVISTE.
Ils n'ont garde. Ils n'augmentent nos salaires que lorsqu'ils ne peuvent faire autrement, lorsqu'ils ne trouvent pas assez d'ouvriers à exploiter.
L’ÉCONOMISTE.
C'est-à-dire lorsque la demande de travail dépasse l'offre. C'est la formule de Cobden: Quand deux ouvriers courent après un maître, le salaire baisse; quand deux maîtres courent après un ouvrier, le salaire hausse. Il s'agit donc de savoir si le renchérissement du pain et de la viande augmente ou diminue la demande de travail.
LE PROTECTIONNISTE.
Tout est là.
L’ÉCONOMISTE.
Parfaitement. Eh bien! que nous ont appris vos propres statistiques? Elles nous ont appris que la production agricole s'est plus développée et, par conséquent, qu'elle a demandé plus de travail sous le régime de la liberté qu'elle ne l'avait fait auparavant sous le régime de la protection. Mais si le travail n'est pas plus demandé ou s'il est moins offert, les salaires ne hausseront pas, et le renchérissement sera à la charge des ouvriers. C'est un impôt qui sera prélevé à raison de 26 francs par tête sur la grande classe des travailleurs et perçu par une minorité de propriétaires français. Bref, c'est un impôt sur le salaire au profit de la rente du sol.
LE COLLECTIVISTE.
Tant mieux!
LE PROTECTIONNISTE.
Tant mieux! C'est vous qui dites: Tant mieux!
LE COLLECTIVISTE.
Oh! je sais bien ce que je dis. D'abord, cela fera mûrir là poire... Ensuite, cela vous obligera à protéger le travail national.
LE PROTECTIONNISTE.
Mais est-ce que nous faisons autre chose? C'est notre spécialité de protéger le travail national.
LE COLLECTIVISTE.
Distinguons. Vous protégez les profits des entrepreneurs d'industrie et les rentes des propriétaires, en taxant à l'entrée les produits étrangers, mais vous vous gardez bien de protéger les salaires des ouvriers.
LE PROTECTIONNISTE.
En taxant les produits étrangers, nous protégeons les salaires aussi bien que les profits et les rentes.
LE COLLECTIVISTE.
Allons donc! Est-ce que vos industriels et vos propriétaires protégés se privent d'employer des Italiens, des Belges, des Allemands, qui viennent nous faire une concurrence au rabais? J'en sais quelque chose. Est-ce juste? Si l'on empêche l'entrée des produits dans l'intérêt des industriels et des propriétaires, ne devrait-on pas empêcher l'entrée du travail dans l'intérêt des ouvriers? Mais vous vous moquez bien des ouvriers, vous autres! Vous vous qualifiez de protecteurs du travail national; vous êtes les complices de ceux qui l'exploitent.
LE PROTECTIONNISTE.
Voyons, du calme! Ne nous fâchons pas. Quelle influence voulez-vous que la concurrence d'une poignée d'ouvriers étrangers puisse exercer sur les salaires des millions de travailleurs français? C'est insignifiant. C'est une goutte d'eau dans l'Océan.
LE COLLECTIVISTE.
Une goutte d'eau! Dites plutôt une inondation.
L’ÉCONOMISTE.
Ce n'est ni une goutte d'eau ni une inondation. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'importation du travail étranger est au moins égale à celle des blés.
LE PROTECTIONNISTE.
Par exemple! C'est trop fort.
L’ÉCONOMISTE.
Consultons encore une fois la statistique officielle. Elle nous apprend, d'une part, que la France importe en moyenne une quantité de céréales et de viandes égale au dixième de sa production. Elle nous apprend, d'une autre part, qu'il y a en France un million d'étrangers. Sauf un nombre relativement peu considérable d'oisifs fixés pour la plupart à Paris, d'industriels et de propriétaires, ces étrangers sont des ouvriers. Bien peu d'entre eux ont amené leur famille, presque tous sont dans la force de l'âge. Ce n'est rien exagérer de dire que ce million d'étrangers résidant en France fournit 7 à 800,000 travailleurs en pleine activité. Or, combien compte-t-on d'ouvriers actifs dans l'ensemble des branches de notre agriculture et de notre industrie? A peine 6 millions. Vous voyez donc que l'inondation du travail étranger est plus forte encore que celle dès blés. D'où il est bien permis de conclure que si l'importation du blé fait baisser les rentes des propriétaires fonciers, celle du travail exerce une influence analogue sur les salaires des ouvriers.
LE COLLECTIVISTE.
Cela ne peut pas être contesté. Je viens encore d'en avoir la preuve à mes dépens. Du reste, nos frères les ouvriers américains ont déjà compris, — ils sont en avance sur nous, — la nécessité de se protéger contre la concurrence du travail au rabais. Ils ont fait prohiber le travail chinois.
LE PROTECTIONNISTE.
Quoi! Vous voudriez traiter les Belges, les Suisses, les Italiens et les Allemands comme les Américains traitent les Chinois. Et la fraternité des peuples, qu'en faites-vous?
LE COLLECTIVISTE.
La fraternité des peuples, c'est une balançoire (se reprenant), un régime capitaliste. Oh! je ne dis pas, quand les États aristocratiques et bourgeois seront remplacés par des collectivités ouvrières, quand le sol sera nationalisé, quand le capital sera muselé, quand l'infâme concurrence aura fait place à l'association...
L’ÉCONOMISTE.
Par un grand A.
LE COLLECTIVISTE.
Par l'association des collectivités, collectivées dans l'humanité, alors les peuples pourront fraterniser; mais, en attendant, ma foi, tant pis! Chacun pour soi! Que tous ces meurt-de-faim étrangers, qui viennent manger notre pain et faire baisser nos salaires, restent chez eux. (Au protectionniste): Tenez, faisons un marché! Nous vous passerons la protection des rentes et des profits, si vous voulez nous passer la protection des salaires.
LE PROTECTIONNISTE.
C'est à voir. Quelles protections démanderiez-vous? Pas la prohibition, comme pour les Chinois, au moins?
LE COLLECTIVISTE.
Oh! non; nous ne sommes pas si exigeants. Vous avez voté, il y a quelques mois, 25 francs par tête de boeuf, et vous allez doubler ce droit.
LE PROTECTIONNISTE.
Probablement, et ce sera encore bien insuffisant.
LE COLLECTIVISTE.
Eh bien! un ouvrier vaut bien un boeuf. Nous ne demandons pas davantage; 50 francs, c'est de la protection dans les prix doux.
LE PROTECTIONNISTE.
Je ne dis pas non. Je consulterai mes collègues. Pourtant, vous n'avez pas à vous plaindre, vous autres ouvriers. Les salaires ont doublé depuis vingt ans.
LE COLLECTIVISTE.
Comme le prix de la viande. Est-ce que cela vous empêche de protéger le bétail?
LE PROTECTIONNISTE.
Vous avez raison. C'est une question à creuser.
L’ÉCONOMISTE.
Savez-vous bien, mes bons amis, ce que vous creusez en ce moment? Vous creusez la fosse de l'industrie française.
LE PROTECTIONNISTE.
Vous avez la plaisanterie lugubre, mais respectable aussi.
L’ÉCONOMISTE.
Oh! je ne songe pas à plaisanter. Écoutez plutôt. Savez-vous à combien s'élève le commerce extérieur de la France?
LE PROTECTIONNISTE.
Je n'ai pas la mémoire des chiffres; mais tout le monde sait que notre commerce extérieur est en pleine décadence. Nous sommes débordés par la concurrence. Les Allemands s'emparent de nos marchés.
L’ÉCONOMISTE.
N'exagérons rien.
Le commerce d'exportation de la France s'élève annuellement de 3 milliards et 1/2 à 4 milliards de francs; il s'agit du commerce spécial, consistant dans les articles de production française; il s'est élevé en 1875 à 3,892 millions, il est descendu de quelques centaines de millions dans les années suivantes, mais il était encore, l'année dernière (1884), de 3,524 millions. Cette somme se répartit sous forme de rentes, de profits, d'intérêts et de salaires; en d'autres termes, sous forme de revenus, entre tous les Français qui ont contribué à la production, au transport et au commerce des articles exportés. Quelle est la proportion de la population qui trouve ainsi ses moyens d'existence dans la production des articles que la France fournit à l'étranger? La statistique, en sa qualité de science officielle et bureaucratique, ne nous donne à cet égard que des renseignements assez vagues, mais qui peuvent suffire à la rigueur pour un calcul approximatif. Il y a quarante ans environ, M. Michel Chevalier évaluait à 63 centimes par jour le revenu moyen des Français. En supposant que ce chiffre se soit augmenté de moitié, sous l'influence des progrès de l'industrie et malgré l'aggravation croissante des impôts, et, qu'il ait été porté à 1 franc par jour, on trouve que 3 millions 1/2 ou 4 millions d'individus, propriétaires, capitalistes, entrepreneurs d'industrie et ouvriers, tirent leur revenu ou leurs moyens d'existence de la portion de la production française qui est exportée et consommée à l'étranger. C'est le dixième de la population. Mais celte proportion générale varie beaucoup quand on l'examine dans le détail. Il y a encore un certain nombre de branches de la production, et ce sont les plus arriérées, qui né contribuent point ou qui contribuent pour peu de chose à l'exportation; il y en a d'autres, au contraire, — telles sont les branches les plus importantes de l'industrie manufacturière et des industries d'art, qui exportent le tirs ou même la moitié de leur production à l'étranger. Nous voyons, par exemple, dans la Statistique de la France de notre savant collaborateur, M. Maurice Block, qu'en 1872 l'industrie de la laine exportait pour 345 millions sur une production totale évaluée à 1,200 millions, soit à peu près un tiers, et que l'exportation de l'industrie de la soie s'élevait à 438 millions sur une production totale de 900 millions, soit à peu près la moitié; ce qui veut dire qu'un tiers de la population occupée à l'industrie de la laine et la moitié de la population occupée à l'industrie de la soie dépendent absolument du débouché extérieur pour leurs moyens d'existence.
En quoi consiste ce débouché extérieur duquel dépend la subsistance de 3 à 4 millions de Français, au plus bas mot, et à quelles conditions pouvons-nous le conserver et l'accroître, voilà ce qu'il s'agit maintenant d'examiner. Il se divise en deux parties d'importance fort inégale: le marché colonial et le marché étranger. Le marché colonial nous appartient; nous pouvons en exclure les produits étrangers qui font concurrence aux nôtres et nous venons, en effet, d'essayer de les en exclure en rétablissant le vieux régime des droits différentiels dans la plupart de nos colonies. Malheureusement, ce marché qui est à nous n'a qu'une valeur commerciale tout à fait insignifiante en comparaison du marché étranger. Sur une exportation totale de 3,574 millions en 1882, nos colonies, l'Algérie comprise, n'ont absorbé que pour 227 millions de nos produits agricoles ou industriels, à peine un quinzième! Si les droits différentiels accroissent ce chiffre d'un quart, ce sera beaucoup. On peut, à la vérité, augmenter à coups de canon l'étendue do notre domaine colonial; on peut conquérir Madagascar, le Congo, le royaume de Siam et même le Tonkin, mais les coups de canon coûtent très cher et l'industrie de la conquête est devenue terriblement aléatoire. Il nous faudra selon toute apparence dépenser au moins 1 milliard en employant ce procédé, pour augmenter d'une cinquantaine dé millions notre débouché colonial. Autant vaudrait distribuer ces 50 millions sous forme de pensions à nos industriels et à nos ouvriers. Cela leur serait plus agréable et ne nous reviendrait pas plus cher.
Le marché étranger est donc le seul qui ait une importance sérieuse; il a, de plus, l'avantage de ne rien coûter aux contribuables, à part l'entretien de quelques consuls; enfin, il est indéfiniment extensible. Son élasticité est même véritablement merveilleuse; il y a cinquante ans, il n'absorbait pas plus de 500 millions de nos produits (510 millions en 1834); il en absorbe aujourd'hui sept fois davantage, et, grâce aux progrès incessants de l'industrie et des moyens de communication, il pourrait bien continuer à suivre la même progression d'ici à un demi-siècle. Mais c'est à la condition expresse et formelle que nous parvenions à y conserver notre place, car le marché étranger est un marché de concurrence et il n'est pas en notre pouvoir d'en exclure nos rivaux à coups de tarifs différentiels. Nous n'avons qu'un moyen, un seul! de nous y maintenir, c'est.de produire aussi bien et à aussi bas prix que nos concurrents, et cette nécessité est devenue aujourd'hui plus que jamais urgente et inévitable.
Il y a cinquante ans, lorsque le commerce dû monde était encore dans l'enfance, en comparaison de ce qu'il est devenu depuis l'avènement dé la navigation à vapeur et des chemins de fer, nous n'avions que bien peu de rivaux pour nos articles d'exportation. C'étaient en grande partie des articles de luxe, de goût et d'art, dont nous possédions en quelque sorte le monopole depuis des siècles. Mais ce monopole fructueux, nos concurrents ont entrepris, comme c'était leur droit, de nous l'enlever. On fabrique aujourd'hui des articles de mode, de fantaisie et d'art en Angleterre, en Belgique, en Autriche et même en Allemagne, presque aussi bien qu'en France, ou tout au moins la différence d'habileté et de goût est bien moindre qu'elle ne l'était il y a un demi-siècle. En outre, ce sont les articles à la portée du grand nombre, les articles à bon marché qui ont pris peu à peu le dessus dans le commerce d'exportation, même dans le nôtre. Ces articles communs n'étaient qu'un appoint dans nos exportations d'autrefois; aujourd'hui, ils en forment la masse et les articles de luxe ne sont plus qu'un appoint.
Cela étant, la question de l'exportation se résout de plus en plus en une question de prix de revient. Produire à bon marché, au meilleur marché possible, voilà la grande affaire et le seul moyen de soutenir la concurrence internationale. Mais on ne peut produire à bon marché qu'à la condition que les agents et les éléments de la production ne soient point renchéris par des impôts excessifs payés à l'État ou à des privilégiés. Or, nous avons été obligés, à la suite des malheureux événements de 1870, de multiplier et d'augmenter les impôts et, depuis, nous avons pris plus que de raison l'habitude des grosses dépenses. L'exposé des motifs d'une proposition de réforme financière, émanée de la minorité de la Chambre, nous apprend que « chaque Français paye pour les seules dépenses de l'État un sixième environ de plus qu'en 1876; au lieu de 69f,77, il paye aujourd'hui à l'État 80f,92 ». Bref, le peuple français est aujourd'hui le plus taxé de l'univers et, par conséquent, celui dont les « prix de revient » sont les plus surélevés du chef de l'impôt. Cependant, malgré tout, nos industries d'exportation ont réussi à accroître d'abord, puis à conserver à peu près intacte leur place sur les marchés étrangers. De 1869 à 1875, en dépit de la guerre et de l'augmentation des impôts, nos exportations ont monté de 3,074 millions à 3,872 millions, et si elles ont faibli plus tard, c'est en grande partie sous l'influence de causes générales, qui ont agi sur le commerce extérieur des autres nations comme sur le nôtre. Il faut sans doute faire honneur de ce résultat à l'intelligence et aux habitudes laborieuses de nos industriels et de nos ouvriers, mais il convient d'en attribuer aussi une bonne part à la politique commerciale inaugurée en 1860. C'est grâce à cette politique de dégrèvement que nos industries d'exportation ont pu abaisser leur prix de revient de manière à neutraliser l'effet de l'augmentation d'impôts nécessités par la guerre. Les industriels l'ont si bien compris qu'ils se sont opposés de toute leur énergie en 1872 au rétablissement des droits sur les matières premières et à l'abandon de la politique libérale.
...Aujourd'hui, le vent a tourné et nous sommes en pleine réaction protectionniste. On a rétabli les droits sur les céréales et le bétail; on va les augmenter de nouveau. On a demandé et on demande encore le rétablissement des droits sur la laine et sur les bois. Les ouvriers, de leur côté, réclament l'exclusion des ouvriers étrangers. Où nous conduira cet appétit furieux et contagieux de protection? Il nous conduira au renchérissement des subsistances, des matières premières ou du travail, c'est-à-dire à l'augmentation du prix de revient de toutes les industries. Or, nos industries d'exportation ne soutiennent déjà qu'à grand'peine la concurrence de leurs rivales de l'Angleterre, de la Belgique, de l'Allemagne sur les marchés étrangers. Si vous augmentez encore leur fardeau, pourront-elles continuer à la soutenir? Quelle que soit la vigueur généreuse d'un cheval de course, ne finira-t-il pas par être battu si l'on augmente constamment son excédent de poids? Un moment viendra où, malgré tous ses efforts et toute l'habileté de son jockey, il sera distancé. Nous avons déjà perdu du terrain dans l'arène de la concurrence internationale. Nous en perdrons encore. Et n'oublions pas en quoi se traduit toute diminution de notre exportation. Elle se traduit en une perte de moyens d'existence pour la portion de notre population qui vit du débouché étranger et, par contre-coup, pour toutes les autres. Quand nos exportations baissent de 100 millions, cela signifie qu'il y a en France 100 millions de revenus de moins. — Cela signifie que 100,000 Français sont privés des moyens d'existence qu'ils tiraient de la mise en oeuvre de leur capital et de leur travail engagés dans les industries d'exportation. Voilà où nous conduit la politique du renchérissement. Avais-je tort de vous dire qu'en poursuivant cette politique dans l'intérêt prétendu de l'agriculteur et des ouvriers, vous creusez la fosse de l'industrie française?
Et je n'ai pas tout dit. Croyez-vous que cette décadence inévitable de nos industries d'exportation, sous le régime du renchérissement, n'intéresse ni les agriculteurs ni les propriétaires ni les ouvriers? Si des milliers d'industriels, de capitalistes et d'ouvriers viennent à subir une perte totale ou même une simple diminution des revenus qui les faisaient vivre, est-ce qu'ils n'achèteront pas moins de produits agricoles? Vous me répondrez que, riche ou pauvre, on a toujours besoin de manger. Soit, mais si l'on ne peut rien économiser sur la quantité des aliments, on économise sur la qualité. On mange moins de viande, et après s'être habitué au pain blanc, comme l'ont fait les ouvriers des villes et même des campagnes depuis l'avènement de la politique libérale de 1860 et la suppression de l'échelle mobile, on revient au pain noir. Croyez-vous que cela fasse l'affaire des propriétaires d'herbages et de terres à blé? Nous aurons beau importer moins de bétail et de froments étrangers, la consommation de la viande et du pain blanc diminuera dans une proportion encore plus forte, et les rentes des propriétaires fonciers retomberont aux taux où elles étaient aux belles époques de la protection, lorsque la viande était un mets de luxe et que la population des campagnes était au régime du pain de seigle, des châtaignes bouillies, et des galettes de sarrazin. Nous importerons moins de travail; les ouvriers Belges, Italiens, Allemands resteront chez eux ou iront ailleurs, mais le rétrécissement de nos débouchés, en diminuant la demande du travail, fera baisser les salaires de nos ouvriers dans une proportion autrement désastreuse que ne le fait aujourd'hui la concurrence des ouvriers étrangers. Voilà où aboutit la politique qui protège les uns aux dépens dés autres. Elle aboutit à l'appauvrissement général.
LE PROTECTIONNISTE.
Je n'avais pas envisagé la question à ce point de vue, je l'avoue.
L’ÉCONOMISTE.
Oh! il y a encore autre chose! Ce n'est pas seulement la décadence de notre industrie et l'appauvrissement de nos populations qui est en cause; c'est l'existence même de la société française.
LE PROTECTIONNISTE.
On dit ces choses-là à la tribune, mais entre nous, voyons, cela ne prend pas. Cela dépasse le but. Il est possible que le protectionnisme ait ses inconvénients. Ce n'est pas une panacée, soit! Mais à qui ferez-vous croire qu'il puisse compromettre l'existence de la société?
L’ÉCONOMISTE.
Vous êtes-vous jamais rendu compte du rôle de l'État dans la société?" L'État moderne a une puissance énorme. C'est un mécanisme ingénieux et formidable. Ceux qui l'ont entre leurs mains disposent de la vie et de la propriété de tous les Français, au moyen de la loi et de l'impôt. Aucun individu ne peut échapper à ses atteintes à moins de fuir à l'étranger, de réaliser sa fortune et de l'emporter avec lui. Cette puissance presque surhumaine, l'imagination du peuple l'agrandit encore, elle attribue à l'État le pouvoir de remédier à tous les maux de l'humanité. L'État est devenu un Dieu! Mais s'il n'a pas tout le pouvoir qu'on lui prête, il en a assez, pour faire beaucoup de bien et beaucoup de mal. S'il protège la liberté et la propriété de chacun, s'il sauvegarde tous les droits, ceux du pauvre à l'égal de ceux du riche, ceux du riche à l'égal de ceux du pauvre, la justice et l'ordre règnent dans la société, et la condition morale et matérielle de tous va s'améliorant et s'élevant. Chacun travaille d'un coeur content pour tous, et tous travaillent pour chacun, sans se plaindre des inévitables inégalités sociales, sachant qu'elles répondent à des inégalités naturelles. Mais si l'État jette dans un des plateaux de la balance des intérêts le lourd glaive qui lui a été confié pour mettre la force au service dé la justice; s'il favorise les uns aux dépens des autres; s'il enrichit ceux-là en dépouillant ceux-ci, oh! alors la situation change. Les privilégiés de l'État deviennent un objet d'envie et de haine, et un jour arrive où ils sont emportés dans une tourmente de colère. L'État leur échappe, trop souvent, hélas! pour tomber dans des mains moins expérimentées et même moins honnêtes, qui l'exploitent, comme l'ont fait leurs devanciers, jusqu'à ce qu'une nouvelle révolution le leur enlève. Aujourd'hui, quelle est la situation? Après bien des vicissitudes, les classes supérieure et moyenne ont repris possession de l'État, et elles en usent à leur gré. Mais c'est une possession bien précaire, et qui sait si demain l'État ne tombera point entre les mains des nouvelles couches de la démocratie? Eh bien! si les classes qui possèdent encore cette puissante machine à produire la justice et l'ordre s'en servent comme d'un instrument d'exploitation; si elles emploient la «loi » et la force qui est au service de la loi, à grossir leurs revenus aux dépens de ceux des autres classes, qu'arrivera-t-il? Il arrivera, croyez-le bien, que leur exemple sera suivi, et retourné contre elles sans qu'elles aient le droit dé s'en plaindre. Vous avez, leur dira-t-on, dépensé sans compter, vous avez, en moins de cinquante ans, triplé le volume du budget de l'État pour vous y caser à l'aise; vous avez été plus loin; vous avez osé faire ce que n'ont jamais osé vos devanciers de l'ancien régime, vous avez taxé les matériaux mêmes de la vie, le pain et la viande, pour faire monter vos rentes, sans avoir même le besoin pour excuse, car vous êtes là classe riche ou aisée; à notre tour maintenant!
LE COLLECTIVISTE.
C'est cela! à notre tour!
L’ÉCONOMISTE.
... Nous allons vous imiter. Nous nous servirons de l'État comme vous et contre vous. Vous avez taxé la multitude à votre profit, nous allons vous taxer au profit de la multitude. Nous allons établir l'impôt progressif, nous allons nationaliser le sol...
LE PROTECTIONNISTE.
Mais ce sera là ruine universelle et l'anéantissement de la société! le retour à la barbarie!
L’ÉCONOMISTE.
Sans doute.
LE PROTECTIONNISTE.
Mais c'est impossible.
L’ÉCONOMISTE.
En êtes-vous sûr? Dans un pays qui a vu 93, la confiscation des biens de la noblesse, les assignats, le maximum, les échafauds dressés en permanence et plus tard la commune, qu'est-ce qui est impossible? On avait alors les Jacobins, nous avons aujourd'hui les collectivistes et les anarchistes qui valent bien les Jacobins.
LE COLLECTIVISTE.
Qui valent mieux, Dieu merci. Les Jacobins étaient des bourgeois.
L’ÉCONOMISTE.
C'est un grand avantage de posséder l'État, mais c'est aussi une grande et lourde responsabilité. Vous avez beau fermer les yeux pour ne pas lavoir. Elle est là, elle existe, et chacune de vos fautes, chacun des manquements à vos devoirs de justice en alourdit le poids. Et voilà ce qui m'indigne et ce qui m'effraye dans la légèreté avec laquelle vous votez ces lois de privilège. Qu'est-ce que cela peut faire, dites-vous, d'augmenter de quelques centimes le prix du pain et de la viande? On ne s'en aperçoit même pas. Et sait-on comment se forment les ouragans qui font sombrer les navires les plus confortablement aménagés? C'est à peine si on aperçoit des points noirs à l'horizon, quelques heures avant la catastrophe. Prenons garde aux points noirs!
LE PROTECTIONNISTE.
Les problèmes économiques sont difficiles à résoudre, j'en conviens.
L’ÉCONOMISTE.
Et vous pourriez ajouter qu'en aucune matière, il faut moins se fier aux apparences. Vous voterez une loi de protection, en vue de remédier à l'avilissement du prix, La baisse s'arrête, — quand elle s'arrête, ce qui n'arrive pas toujours, et vous vous félicitez de ce résultat, mais il y a des conséquences ultérieures que vous n'apercevez pas, et qui transforment votre remède en poison.
LE PROTECTIONNISTE.
Il faut pourtant bien faire quelque chose. Quand je suis malade, je fais appeler mon médecin. S'il se contentait de me tâter le pouls et de m'engager à prendre patience, sans se donner là peine d'envoyer une ordonnance au pharmacien, est-ce que je serais satisfait? Je congédierais ce médecin ignorant et sans coeur pour ses malades, et j'en ferais appeler un autre.
L’ÉCONOMISTE.
Vous préféreriez donc qu'il vous ordonnât des remèdes qui aggraveraient le mal?
LE PROTECTIONNISTE.
Non, à coup sûr. Mais au moins je voudrais connaître la nature de ma maladie, et savoir ce qu'il y a à faire pour la guérir.
L’ÉCONOMISTE.
Croyez-vous que le gouvernement connaît mieux que les agriculteurs eux-mêmes les causes de leurs maux, et les remèdes les plus efficaces pour les guérir? Votre médecin peut en savoir plus long que vous sur vos maladies. C'est sa spécialité de les étudier et d'essayer de les guérir. Mais est-ce la spécialité du gouvernement de connaître l'agriculture?
LE PROTECTIONNISTE.
Il l'enseigne.
L’ÉCONOMISTE.
Ce n'est pas une raison pour la connaître.
LE PROTECTIONNISTE.
Alors à quoi peut bien servir un ministère de l'agriculture?
L’ÉCONOMISTE.
Je n'en sais rien. Et vous, le savez-vous?
LE PROTECTIONNISTE.
Un ministère de l'agriculture sert à faire fleurir l'agriculture.
L’ÉCONOMISTE.
Et si l'agriculture ne fleurit pas, c'est donc la faute du ministère de l'agriculture?
LE PROTECTIONNISTE.
Il y est certainement pour quelque chose. Pourquoi n'encourage-t-il pas l'agriculture?
L’ÉCONOMISTE.
Avec quoi peut-il l'encourager?
LE PROTECTIONNISTE.
Avec des subventions et des faveurs.
L’ÉCONOMISTE.
Des faveurs! S'il s'agit dé rubans, je n'ai rien à dire. C'est inoffensif ou à peu près. Cela fait pousser la vanité, qui est une mauvaise herbe, mais qui ne nuit pas au bétail; S'il s'agit de protection et de privilèges, oh! c'est différent. Les protections et les privilèges ne sont accordés aux uns qu'aux dépens des autres, et ils finissent, comme j'ai essayé de vous le faire voir, par être nuisibles aux protégés et aux privilégiés eux-mêmes. S'il s'agit de subventions, c'est la même chose. On ne peut mettre de l'argent dans les poches des agriculteurs sans le prendre dans les poches des contribuables. Et croyez-vous que si le gouvernement avait moins de goût pour l'argent des contribuables dont une bonne moitié sont des agriculteurs, s'il leur en laissait davantage, ils ne sauraient comment l'employer? J'en connais qui sont forcés d'économiser jusque sur la nourriture. Ils se nourriraient mieux s'ils payaient moins d'impôts, et cela encouragerait l'agriculture.
LE PROTECTIONNISTE.
A votre avis, il n'y a donc rien à faire?
L’ÉCONOMISTE.
Il y a d'abord et avant tout à ne pas faire. Il y a des mesures qu'il ne faut pas prendre et des lois qu'il ne faut pas voter. Il ne faut pas voter des lois de renchérissement, parce qu'elles sont injustes et parce qu'elles sont nuisibles; parce que le protectionnisme est un poison pour le corps social comme la strychnine est un poison pour le corps humain. Et il faut avoir le courage de le dire. Il faut déclarer une fois pour toutes aux agriculteurs plus ou moins authentiques qui demandent à être protégés, qu'on ne les protégera pas. Quand ils en seront bien convaincus, ils chercheront eux-mêmes les remèdes à leurs maux, et ils sont bien capables — aussi capables que le gouvernement lui-même — de les trouver. Ils s'apercevront qu'ils payent de gros impôts non seulement à l'État, mais encore aux industriels protégés, aux propriétaires de charbonnages et de hauts fourneaux, aux fabricants de machines et même aux filateurs de colon. Ils demanderont au gouvernement d'être plus économe de leurs deniers et, au besoin, ils l'exigeront. Ils lui déclareront, en même temps, que s'ils consentent à payer des impôts à l'État qui garantit leurs propriétés et leur liberté, il ne leur plaît pas d'en payer aux industriels, qui ne leur garantissent rien du tout. Ils s'apercevront enfin qu'ils ont, eux aussi, quelque chose à faire pour se mettre en état de soutenir là concurrence étrangère; ils s'informeront, et ils apprendront qu'on a inventé depuis cinquante ans toutes sortes de machines qui économisent le travail agricole et toutes sortes d'engrais qui augmentent la fécondité de la terre; qu'en employant ces machines et ces engrais-là ils pourraient produire à meilleur marché et davantage; qu'au lieu d'obtenir en moyenne 15 hectolitres par hectare, ils pourraient en obtenir 20 comme en Belgique et même 30 comme en Angleterre. Ce qui équivaudrait à une protection naturelle de 50 p. 100 et davantage, et ce qui serait plus sûr qu'une protection artificielle de 25 p. 100. Voilà ce que feraient les agriculteurs pour se protéger eux-mêmes, et voilà ce qu'il y a à faire.
LE PROTECTIONNISTE.
Vous avez raison, et je vous avoue, en toute humilité, que vos arguments ont fait une vive impression sur moi. Ils me paraissent sans réplique.
L’ÉCONOMISTE.
Enfin, je vous ai converti, et je vous avoue, à mon tour, que cela me comble de joie. Vous ne voterez pas la loi?
LE PROTECTIONNISTE.
N'allons pas si vite. Vous m'avez impressionné, voilà tout, et c'est bien assez. Si vous m'aviez converti, cela me gênerait beaucoup et cela ne vous servirait pas à grand'chose.
L’ÉCONOMISTE.
Que voulez-vous dire? Je ne comprends pas.
LE PROTECTIONNISTE.
Malgré votre science, il y a bien des choses, mon respectable ami, que vous ne comprenez pas. Vous ne vous rendez pas compte dé la situation d'un député et des devoirs particuliers qu'elle lui impose. Pourquoi les électeurs nous donnent-ils leurs voix? Parce qu'ils ont confiance en nous; parce qu'ils supposent que nous défendrons leurs intérêts, ou, si vous voulez — c'est une concession que je vous fais — ce qu'ils croient être leurs intérêts.
Il est possible qu'ils se trompent. C'est leur affaire, ce n'est pas la nôtre. Mes électeurs sont protectionnistes. Ils m'ont envoyé à la Chambre pour défendre la protection, et voter une augmentation des droits sur les céréales et le bétail. Si je me laissais convertir à vos doctrines — qui me paraissent certainement respectables et même vraies, c'est encore une concession que je vous fais— si je passais dans le camp du libre-échange, si je votais contre l'augmentation des droits, quelle serait ma situation vis-à-vis de mes électeurs? N'auraient-ils pas le droit de m'accuser d'avoir trompé leur confiance? Ne commettrais-je pas un acte d'indélicatesse, je dirai plus, de félonie politique? Vous me direz, peut-être que je pourrais donner ma démission. C'est vrai; mais si je donnais ma démission sur une question qu'ils considèrent comme capitale, je ne serais pas réélu. Vous me direz encore que le malheur ne serait pas grand. C'est possible! Mais mon avenir n'en serait pas moins compromis d'une manière irrémédiable. Ma carrière politique serait brisée. Sans doute, je possède quelque fortune et je puis me passer, Dieu merci! de mon indemnité parlementaire. Tous mes collègues n'en sont pas là. Mais j'ai le goût de la politique et, sans me flatter, je crois avoir les aptitudes nécessaires pour y réussir. Ne commettrais-je pas un acte d'insanité, presque un acte coupable; ne manquerais-je pas à tous mes devoirs envers moi-même, si je brisais ma carrière au début? Ne serait-ce pas commettre un véritable suicide? Que dirait ma famille, que diraient mes amis? Ma famille! N'ai-je pas aussi des devoirs à remplir envers elle? Elle est nombreuse, ma famille, et tous mes parents ne sont pas riches. Je suis leur providence. J'ai déjà obtenu une recette pour mon oncle et placé trois de mes cousins dans les bureaux. Il m'en resté encore quatre à pourvoir, et il m'en arrive tous les jours dé nouveaux. S'ils apprenaient que j'ai donné ma démission, pour un motif incompréhensible — car certes ils ne le comprendraient pas, et personne ne le comprendrait, excepté vous! — ne me traiteraient-ils pas de mauvais parent? Ne doit-on pas faire quelques sacrifices à sa famille, surtout à une époque comme la nôtre, où l'esprit de famille s'en va? Et mes électeurs, puis-je les laisser à la merci de mon concurrent, un intrigant de la plus vile espèce, un ambitieux sans principes et sans talent, qui exploitera sa position pour refaire sa fortune endommagée par le krack, qui fera beaucoup de promesses et qui n'en tiendra aucune? On dit que le niveau de la représentation du pays va s'abaissant tous lès jours. Il faut l'empêcher de s'abaisser davantage, en ne fournissant pas à de pareils hommes l'occasion d'y entrer. C'est un devoir patriotique. Voilà pourquoi je ne puis pas, je ne dois pas donner ma démission, et pourquoi aussi je dois m'abstenir de tout ce qui pourrait m'obliger, en conscience, à la donner. C'est une règle de conduite dont un bon député ne doit pas se départir. Je ne dis pas que ce soit toujours facile. Quand on étudie une question sous toutes ses faces, comme nous venons de le faire, on peut être tenté de changer d'opinion. Il faut avoir le courage de résister à la tentation. Il faut savoir faire abnégation de sa propre pensée, de ses propres convictions, et c'est quelquefois un sacrifice bien pénible, j'en conviens. Seulement, quand on sait se conduire, quand on est un homme à la fois consciencieux et pratique comme je me flatte de l'être, on évite de se placer dans cette alternative désagréable. On n'a pas d'opinions préconçues et on s'abstient d'approfondir les questions. On consulte ses électeurs, on sait ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, et on vote! Comme cela, on n'a pas de scrupule à se faire, et on est réélu.
L’ÉCONOMISTE.
C'est commode! Mais si les électeurs se trompent, s'ils entendent mal leurs intérêts et si leurs erreurs peuvent avoir des conséquences funestes pour le pays et pour eux-mêmes, votre devoir n'est-il pas de les éclairer? C'est un devoir patriotique.
LE PROTECTIONNISTE.
Permettez. Je me plais à croire que vous ne doutez pas de mon patriotisme. Je suis patriote avant tout. Je le prouverais au besoin. Aucun sacrifice ne me coûtera pour le prouver. Que le gouvernement nous demande demain d'envoyer un million d'hommes à la frontière et de voter un emprunt d'un milliard, de deux milliards, de trois milliards pour soutenir l'honneur et les intérêts de la patrie, je les voterai sans marchander. Mais mon patriotisme est raisonnable, et je dirai plus, il est modeste. Je n'ai pas la prétention d'imposer mon opinion à mes électeurs et de lutter contre le courant irrésistible de la démocratie. A quoi sert d'ailleurs de lutter contre le courant? A quoi cela vous a-t-il servi? Vous avez passé votre vie à n'être pas de l'avis dé tout le monde. Vous l'avez usée à propager des doctrines impopulaires; à quoi êtes-vous arrivé? Je suis fâché de vous le dire, vous n'êtes arrivé à rien. Vous écrivez dès lettres, et je veux le croire, de bons livres; qui est-ce qui les a lus? Qui est-ce qui-s'avise de les lire? Pas même vos confrères; ils ne lisent que les leurs! Vos travaux, vos efforts, vos luttes n'ont servi ni aux autres ni à vous-même. Et pourquoi? Parce que vous vous êtes obstiné à remonter le courant au lieu de le descendre.
L’ÉCONOMISTE.
Et si le courant nous conduit à un abîme?
LE PROTECTIONNISTE.
Bah! il y met le temps. Il y a bel âge qu'on nous dit que nous courons aux abîmes. Oh! je conviens que nous ne sommes pas des modèles de sagesse et d'économie, d'économie surtout! Les États modernes sont des prodigues; ils écrasent les populations sous le poids des charges militaires et autres, les impôts ne leur suffisent pas, quoiqu'ils les augmentent tous les jours; en moins d'un siècle, ils ont accumulé plus de 100 milliards de dettes; ils sacrifient l'intérêt général aux intérêts égoïstes des classes dominantes, et ils s'exposent à des catastrophes, je vous l'accorde. Mais à qui la faute?
L’ÉCONOMISTE.
Croyez-vous que les États ne seraient pas gouvernés avec plus de sagesse et d'économie et que l'avenir ne nous réserverait pas moins de périls, si l'intérêt général était mieux défendu?
LE PROTECTIONNISTE.
Si l'intérêt général n'est pas mieux défendu, c'est sa faute. L'intérêt général ne paye pas, comme disent les américains. L'intérêt général est insolvable. A-t-il jamais fait nommer un député? Parlez-moi des intérêts particuliers. Ils sont actifs, ceux-là, ils se remuent et ils payent, et ils élisent! N'est-il pas naturel, n'est-il pas juste qu'ils l'emportent sur l'intérêt général, qui est impotent et avare? N'est-ce pas conforme au principe même de la concurrence, qui est l'arche sainte de l'économie politique? Que cela finisse mal, c'est possible, mais qu'est-ce que cela nous fait? Nous n'y serons plus.
L’ÉCONOMISTE.
La France y sera.
LE PROTECTIONNISTE.
La France en a vu bien d'autres. Nos pères ont fait une révolution qui a ébranlé la société jusque dans ses fondements, mais à laquelle tout le monde — excepté peut-être quelques esprits grincheux et rétrogrades — tout le monde, dis-je, s'accorde à attribuer tous nos progrès. Nos fils en feront une autre, qui ne sera peut-être pas moins féconde.
LE COLLECTIVISTE.
Qui le sera davantage. Ce sera une révolution sociale.
LE PROTECTIONNISTE.
Elle sera ce qu'elle voudra. Cela ne nous regardé pas. Notre affaire à nous, c'est de faire nos affaires et celles de nos électeurs. C'est de suivre le courant, sans avoir la prétention de le diriger et encore moins de le remonter. C'est d'être de notre temps, et de lâcher d'y vivre et d'y bien vivre. C'est d'être des hommes pratiques, et non des songe-creux. Et voilà pourquoi, mon respectable ami, vous ne m'avez pas converti et ne me convertirez pas.
(Regardant à sa montre.) Dix heures. On m'attend à l'Éden. Adieu et sans rancune. Vous m'avez donné une leçon d'économie politique. Je vous en ai donné une autre, d'économie pratique. Parlant, quittes! (Il s'en va.)
LE COLLECTIVISTE.
Opportuniste! Jouisseur! Crevé! Bourgeois! Joli député! Et voilà les hommes qui sont investis de la mission sacrée du législateur. Je ne comprends pas vraiment que vous ayez pris la peine de donner une leçon d'économie politique à ce valet dé la bourgeoisie.
L’ÉCONOMISTE.
Au moins vous a-t-elle profité, à vous? Vous ai-je converti?
LE COLLECTIVISTE.
Moi! Ah! non, par exemple. Je vous ai écouté par politesse, et je n'ai pas voulu vous contredire à cause de votre âge, mais l'économie politique est une science bourgeoise, et je ne suis pas un bourgeois, je m'en vante! J'ai été candidat-ouvrier aux dernières élections.
L’ÉCONOMISTE.
Eh bien! en quoi est-ce que cela vous empêcherait d'être de mon avis sur les questions du renchérissement du pain et de la viande? Est-ce que cette question-là n'intéresse pas le peuple?
LE COLLECTIVISTE.
J'ai signé le programme du parti ouvrier, et je n'ai pas besoin de vous dire qu'il n'est pas question de la protection ou du libre échange dans ce programme. Nous ne perdons pas notre temps à de pareilles futilités. Nous avons mieux à faire. Nous avons à préparer la révolution sociale.
Je veux bien convenir cependant que vos arguments auraient pu faire une certaine impression sur mon esprit si je n'avais pas eu des devoirs à remplir envers le peuple. Mais mettez-vous à ma place! Que diraient les camarades s'ils apprenaient que je suis converti à l'économie politique? Ils diraient que je suis entré dans la police. Je serais exclu du parti, et il ne pourrait plus être question de ma candidature au conseil municipal. Cela me fait souvenir qu'on m'attend à la réunion électorale du groupe de la Panthère de Montmartre. Adieu. Une dernière recommandation. Ne dites pas que vous me connaissez. Cela nuirait à ma candidature et à mon avenir politique.
L’ÉCONOMISTE.
Soyez tranquille. Je serais désolé de nuire à votre candidature et à votre avenir politique.
LE COLLECTIVISTE.
Merci. (Il s'en va.)
L’ÉCONOMISTE.
Voilà des conversions difficiles à faire. J'ai perdu mon temps et ma peine. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière. Mais qui sait où va une parole de vérité — une parole inutile — que le vent emporte? Elle est portée à travers l'espace et le temps jusqu'à ce qu'elle rencontre une terre préparée pour la recevoir. Alors elle germe... Nous sommes trop pressés. Le progrès n'avance pas en ligne droite. C'est comme dans le tunnel du Saint-Gothard. Il y a des moments où on revient sur ses pas. Nous sommes dans un de ces moments-là. Nous reculons, donc y nous avançons.
FIN.
68.Hippolyte Taine on “Abusive Government Intervention” (1890)↩
[Word Length: 3,860]
Source
Hippolyte Taine, Les origines de la France contemporaine. Le Régime moderne. Tome I (Paris: Hachetter, 1891, cinquième édition) (1st edition 1890). Livre deuxième: Formation et charactères du nouvel état; Chapitre II, pp. 141-154.
Brief Bio of the Author: Hippolyte Adolphe Taine (1828-1893)
[Hippolyte Adolphe Taine (1828-1893)]
Hippolyte Adolphe Taine (1828-1893). Historian and philosopher, born at Vouzier, Taine excelled in his studies at the Lycée Condorcet and entered the École Normale Supérieure in 1848. Although his first works dealt with literary criticism, he was also attracted to psychology (individual and group), as exemplified in his Essai sur Tite-Live (1856) and his Histoire de la literature anglaise, 4 vols. (1864) works in which he developed what he claimed to be a scientific method. No doubt influenced by the events of 1870, Taine turned to political questions in his Origines de la France contemporaine, 4 vols. (1875-1893). Despite some objections as to his attention to historical detail, the fact remains that Taine, whose name is above all associated with conservatism, offered a critique of Jacobinism and the Commune of Paris that was quite in keeping with the liberal tradition. Distrustful of democracy, and in favour of a minimalist State dominated by elites, he was well regarded by Charles Maurras and Paul Bourget. [RL]
CHAPITRE II
I. Service principal rendu par la puissance publique. — Elle est un instrument. — Loi commune a tous les instruments. — Instruments mécaniques. — Instruments physiologiques. — Instruments sociaux. — La perfection d'un instrument croit avec la convergence de ses effets. — Une orientation exclut les autres. — H. Application de cette loi à la puissance publique. — Effet général de son ingérence. — 111. Elle fait le contraire de son office. — Ses empiétements sont des attentats contre les personnes et les propriétés. — IV. Elle fait mal l'office des corps qu'elle supplante. — Cas où elle confisque leur dotation et se dispense d'y suppléer. — Cas où elle violente ou exploite leur mécanisme. — Dans tous les cas, elle est un substitut mauvais ou médiocre. — Raisons tirées de sa structure comparée à celle des autres corps. — V. Autres conséquences. — A la longue, les corps supprimés ou atrophiés ne repoussent plus. — Incapacité sociale et politique contractée par les individus. — En quelles mains tombe alors la puissance publique. — Appauvrissement et dégradation du corps social.
I
Quel est le service que la puissance publique rend au public? — Il en est un principal, la protection de la communauté contre l'étranger, et des particuliers les uns contre les autres. — Évidemment, pour rendre ce service, il lui faut, dans tous les cas, les outils indispensables, à savoir une diplomatie, une armée, une flotte et des arsenaux, des tribunaux civils et criminels, des prisons, une gendarmerie et une police, des impôts et des percepteurs, une hiérarchie d'agents et de surveillants locaux, qui, chacun à sa place et dans son emploi, concourent tous à produire l'effet requis. — Évidemment encore, pour appliquer ces outils, il lui faut, selon les cas, telle ou telle constitution, tel ou tel degré de ressort et d'énergie: selon l'espèce et la gravité du péril extérieur ou intérieur, il convient qu'elle soit divisée ou concentrée, pourvue ou affranchie de contrôle, libérale ou autoritaire. Contre son mécanisme, quel qu'il soit, il n'y a pas lieu de s'indigner d'avance. A proprement parler, elle est un grand engin dans la communauté humaine, comme telle machine industrielle dans une usine, comme tel appareil organique dans le corps vivant. Si l'œuvre ne peut être faite que par l'engin, acceptons l'engin et sa structure: qui veut la fin veut les moyens. Tout ce que nous pouvons demander, c'est que les moyens soient adaptés à la fin, en d'autres termes, que les myriades de pièces, grandes ou petites, locales ou centrales, soient déterminées, ajustées et coordonnées en vue de l'effet final et total auquel elles coopèrent de près ou de loin.
Mais, simple ou composé, tout engin qui travaille est assujetti à une condition: plus il devient propre à une besogne distincte, plus il devient impropre aux autres; à mesure que sa perfection croît, son emploi se restreint. — Partant, si l'on a deux instruments distincts appliqués à deux besognes distinctes, plus ils deviennent parfaits chacun dans son genre, plus leurs domaines se circonscrivent et s'opposent: à mesure que chacun d'eux devient plus capable de remplir son emploi, il devient plus incapable de remplir l'emploi de l'autre; à la fin, ils ne peuvent plus se suppléer; et cela est vrai, quel que soit l'instrument mécanique, physiologique ou social. — Au plus bas degré de l'industrie humaine, le sauvage n'a qu'un outil: avec son caillou tranchant ou pointu, il tue, il brise, il fend, il perce, il scie, il dépèce; le même instrument suffit, tellement quellement, aux services les plus divers. Ensuite viennent la lance, la hache, le marteau, le poinçon, la scie, le couteau, chacun d'eux plus adapté à un service distinct et moins efficace hors de cet office: on scie mal avec un couteau, et l'on coupe mal avec une scie. Plus tard apparaissent les engins très perfectionnés et tout à fait spéciaux, la machine à coudre et la machine à écrire: impossible de coudre avec la machine à écrire, ou d'écrire avec la machine à coudre. — Pareillement, au plus bas de l'échelle organique, quand l'animal n'est qu'une gelée homogène, informe et coulante, toutes ses parties sont également propres à toutes les fonctions: indifféremment et par toutes les cellules de son corps, l'amibe peut marcher, saisir, avaler, digérer, respirer, faire circuler ses liquides, expulser ses déchets et reproduire son espèce. Un peu plus haut, dans le polype d'eau douce, le sac intérieur qui digère et la peau extérieure qui sert d'enveloppe peuvent encore, à la rigueur, échanger leurs fonctions: si l'on retourne l'animal comme un gant, il continue à vivre; devenue interne, sa peau fait l'office d'estomac; devenu externe, son sac digestif fait l'office d'enveloppe. Mais, plus on monte, plus les organes, compliqués par la division et la subdivision du travail, divergent, chacun de son côté, et répugnent à se remplacer l'un l'autre: chez un mammifère, le cœur n'est plus bon qu'à pousser le sang, et le poumon qu'à rendre au sang de l'oxygène; impossible à l'un d'eux de faire l'ouvrage de l'autre; entre les deux domaines, la structure trop particulière du premier et la structure trop particulière du second interposent une double barrière infranchissable.— Pareillement enfin, au plus bas de l'échelle sociale, plus bas que les Andamans et les Fuégiens, on entrevoit une humanité inférieure, où la société n'est qu'un troupeau; à l'intérieur du troupeau, point d'associations distinctes en vue de buts distincts; il n'y a pas même de famille, au moins permanente; nul engagement mutuel du mâle et de la femelle, rien que la rencontre des sexes. Par degrés, dans cet amas d'individus tous égaux et semblables, des groupes partiels s'ébauchent, se forment et se séparent: on voit apparaître des parentés de plus en plus précises, des ménages de plus en plus fermés, des foyers de plus en plus héréditaires, des équipes de pêche, de chasse ou de guerre, de petits ateliers de travail; si le peuple est conquérant, il s'établit des castes. A la fin, dans le corps social élargi et profondément organisé, on trouve des communes, des provinces, des églises, des hôpitaux, des écoles, des corporations et des compagnies de toute espèce et grandeur, temporaires ou permanentes, volontaires ou involontaires, c'est-à-dire une multitude d'engins sociaux construits avec des personnes humaines, qui, par intérêt personnel, contrainte et habitude, ou par inclination, conscience et générosité, coopèrent, d'après un statut exprimé ou tacite, pour effectuer, dans l'ordre matériel ou spirituel, telle ou telle œuvre déterminée: en France, aujourd'hui, nous comptons, outre l'État, quatre-vingt-six départements, trente-six mille communes, quatre Églises, quarante mille paroisses, sept ou huit millions de familles, des millions d'ateliers agricoles, industriels ou commerciaux, des instituts de science et d'art par centaines, des établissements de charité et d'éducation par milliers, des sociétés de bienfaisance, de secours mutuels, d'affaires ou de plaisirs par centaines de mille, bref, d'innombrables associations de toute espèce, dont chacune a son objet propre, et, comme un outil ou un organe, exécute un travail distinct.
Or, en cette qualité d'outil ou d'organe, elle est soumise à la loi commune: plus elle excelle dans un rôle, plus elle est médiocre ou mauvaise dans les autres rôles; sa compétence spéciale fait son incompétence générale. C'est pourquoi, chez un peuple civilisé, aucune d'elles ne peut bien suppléer aucune des autres. « Très probablement, une académie de peinture qui serait aussi une banque exposerait de très mauvais tableaux et escompterait de très mauvais billets. Selon toute vraisemblance, une compagnie du gaz qui serait en môme temps une société d'éducation enfantine élèverait mal les enfants et éclairerait mal les rues.410 » — C'est qu'un instrument, quel qu'il soit, outil mécanique, organe physiologique, association humaine, est toujours un système de pièces dont les effets convergent vers une fin; peu importe que les pièces soient des morceaux de bois et de métal, comme dans l'outil, des cellules et des fibres, comme dans l'organe, des intelligences et des âmes, comme dans l'association; l'essentiel est la convergence de leurs effets; car, plus ces effets sont convergents, plus l'instrument est capable d'atteindre une fin. Mais, par cette convergence, il est tout entier orienté dans une direction, ce qui l'exclut des autres: il ne peut pas opérer à la fois dans deux sens différents; impossible d'aller à droite et, en même temps, d'aller à gauche. Si quelque instrument social, construit en vue d'un service, entreprend de faire par surcroît le service d'un autre, il fera ma4 son office propre et son office usurpé. Des deux œuvres qu'il exécute, la première nuit à la seconde et la seconde à la première. Ordinairement, il finit par sacrifier l'une à l'autre, et, le plus souvent, il les manque toutes les deux.
II
Suivons les effets de cette loi, lorsque c'est la puissance publique qui, par delà sa tâche principale et première, entreprend une tache différente et se substitue aux autres corps pour faire leur service, lorsque l'État, non content de protéger la communauté et les particuliers contre l'agression extérieure ou intérieure, se charge par surcroît de gouverner le culte, l'éducation ou la bienfaisance, de diriger les sciences ou les beaux-arts, de conduire l'œuvre industrielle, agricole, commerciale, municipale, provinciale ou domestique. — Sans doute, auprès de tous les corps autres que lui-môme, il peut intervenir; c'est son droit et aussi son devoir; il y est tenu par son office môme, en sa qualité de défenseur des personnes et des propriétés, pour réprimer, à l'intérieur du corps, la spoliation et l'oppression, pour y faire observer le statut, pour y maintenir chaque membre dans ses droits fixés par le statut, pour y juger, d'après ce statut, les conflits qui peuvent s'élever entre les administrateurs et les administrés, entre le gérant et les actionnaires, entre les desservants et les desservis, entre les fondateurs morts et leurs successeurs vivants. A cet effet, il leur prête ses tribunaux, ses huissiers et ses gendarmes, et il ne les prête qu'à bon escient, après avoir examiné et adopté le statut. Cela aussi est une obligation de son office: son mandat l'empêche de mettre la puissance publique au service d'une entreprise de spoliation ou d'oppression; il lui est interdit d'autoriser un contrat de prostitution ou d'esclavage, à plus forte raison une société de brigandage ou d'insurrection, une ligue armée ou prête à s'armer contre la communauté, contre une portion de la communauté, contre lui-même. Mais, entre cette intervention légitime par laquelle il maintient des droits et l'ingérence abusive par laquelle il usurpe des droits, la limite est visible, et il franchit cette limite lorsque, à son emploi de justicier ajoutant un second office, il régit ou il défraie un autre corps.411 En ce cas, deux séries d'abus se déroulent: d'une part, l'État fait le contraire de son premier office; d'autre part, il s'acquitte mal de son emploi surajouté.
III
Car d'abord, pour régir un autre corps, par exemple l'Église, tantôt il nomme les chefs ecclésiastiques, comme sous l'ancienne monarchie, après l'abolition de la Pragmatique Sanction, par le concordat de 1516; tantôt, comme l'Assemblée nationale en 1791, sans nommer les chefs, il invente une nouvelle façon de les nommer; en d'autres termes, il impose à l'Église une discipline nouvelle, contraire à son esprit ou même à ses dogmes. Parfois même, poussant plus loin, il réduit les corps à n'être que des branches de sa propre administration et transforme leurs chefs en fonctionnaires révocables, dont il commande et conduit tous les actes: tels, sous l'Empire et la Restauration, le maire et les conseillers dans la commune, les professeurs et proviseurs dans l'Université. Encore un pas, et l'invasion s'achève: naturellement, quand il entreprend un nouveau service, il est tenté, par ambition ou précaution, par préjugé ou théorie, de s'en réserver ou d'en déléguer le monopole; avant 1789, il y en avait un au profit de l'Église catholique par l'interdiction des autres cultes, et il y en avait un au proût de chaque communauté d'arts et de métiers par l'interdiction du travail libre; après 1800, il y en eut un au profit de l'Université, par les entraves et gênes de toute espèce imposées à l'ouverture et à la tenue des écoles privées. — Or, par chacune de ces contraintes, l'État empiète sur le domaine de la personne. Plus il étend ses empiétements, plus il ronge et réduit le cercle d'initiatives spontanées ou d'actions indépendantes qui est la vie propre de l'individu. Si, conformément au programme jacobin, il pousse à bout ses ingérences,412 il absorbe en soi toutes les vies individuelles: désormais il n'y a plus dans la communauté que des automates manœuvres d'en haut, des résidus infiniment petits de l'homme, des âmes mutilées, passives et, pour ainsi dire, mortes. Institué pour préserver les personnes, l'Étal les a toutes anéanties. — Même effet à l'endroit des propriétés, s'il défraie es autres corps. Car, pour les défrayer, il n'a d'autre argent que celui des contribuables; en conséquence, par la main de ses percepteurs, il leur prend cet argent dans leur poche. Bon gré mal gré, tous indistinctement, ils payent une taxe supplémentaire pour un service supplémentaire, même quand ce service ne leur profite pas ou leur répugne. Si je suis catholique dans un État protestant ou protestant dans un État catholique, je paie pour une religion qui me semble fausse et pour une Église qui me semble malfaisante. Si je suis sceptique et libre penseur, indifférent ou hostile aux religions positives, aujourd'hui, en France, je paie pour alimenter quatre cultes qui me semblent inutiles ou nuisibles; si je suis provincial ou paysan, je paie pour entretenir l'Opéra, où je n'irai jamais, Sèvres et les Gobelins, dont je ne verrai jamais une tapisserie ou un vase. — En temps de calme, l'extorsion se déguise; mais, en temps de troubles, elle s'étale à nu. Sous le gouvernement révolutionnaire, des bandes de percepteurs à piques s'abattaient sur les villages et y faisaient des razzias comme en pays conquis413: saisi à la gorge et maintenu avec accompagnement de bourrades, le cultivateur voyait enlever les grains de son grenier, les bestiaux de son étable; « tout cela prenait lestement le chemin de la ville », et autour de Paris, sur un rayon de quarante lieues, les départements jeûnaient pour nourrir la capitale. Avec des formes plus douces, c'est une exaction pareille qui s'accomplit sous un gouvernement régulier, lorsque l'État, par la main d'un percepteur décent, en redingote, puise dans nos bourses un écu de trop pour un office qui n'est pas de son ressort. Si, comme l'État jacobin, il s'arroge tous les offices, il vide la bourse jusqu'au fond: institue pour préserver les propriétés, il les confisque toutes. — Ainsi, à l'endroit des propriétés comme à l'endroit des personnes, quand la puissance publique se propose un autre objet que leur garde, non seulement elle outrepasse son mandat, mais elle agit au rebours de son mandat.
IV
Considérons maintenant l'autre série d'abus et la façon dont l'État fait le service des corps qu'il a supplantés. — En premier lieu, il y a des chances pour que, tôt ou tard, il s'y dérobe; car ce nouveau service est plus ou moins coûteux, et, tôt ou tard, lui semble trop coûteux. — Sans doute, il a promis de le défrayer; parfois même, comme la Constituante et la Législative, ayant confisqué les revenus qui l'alimentaient, il en doit l'équivalent; il est tenu, par contrat, de suppléer aux sources locales ou spéciales qu'il s'est appropriées ou qu'il a taries, de fournir en échange une prise d'eau sur le grand réservoir central, qui est le Trésor public. —Mais, si, dans ce réservoir, les eaux baissent, si l'impôt arriéré n'y déverse plus régulièrement son afflux, si la guerre y ouvre une large brèche, si la prodigalité et l'incapacité des gouvernants y multiplient les lézardes et les fuites, il ne s'y trouve plus d'argent pour les services accessoires et secondaires; l'État, qui s'en est chargé, s'en dispense: on a vu, sous la Convention et sous le Directoire, comment, ayant pris les biens de tous les corps, provinces, communes, instituts d'éducation, d'art et de science, églises, hospices et hôpitaux, il s'est acquitté de leur office; comment, après avoir été spoliateur et voleur, il est devenu insolvable et s'est déclaré failli; comment son usurpation et sa banqueroute ont ruiné, puis anéanti tous les autres services; comment, par le double effet de son ingérence et de sa désertion, il a détruit en France l'éducation, le culte et la bienfaisance; pourquoi, dans les villes, les rues n'étaient plus balayées ni éclairées; pourquoi, dans les départements, les routes se défonçaient et les digues s'effondraient; pourquoi les écoles étaient vides ou fermées; pourquoi, dans l'hospice et l'hôpital, les enfants trouvés mouraient, faute de lait, les infirmes faute de vêtements ou de viande, les malades faute de bouillon, de médicaments et de lits.414
En second lieu, même quand l'État respecte ou fournit la dotation du service, par cela seul qu'il le régit, il y a des chances pour qu'il le pervertisse. — Presque toujours, lorsque les gouvernants mettent la main sur une institution, c'est pour l'exploiter à leur profit et à son détriment: ils y font prévaloir leurs intérêts ou leurs théories; ils y importent leurs passions; ils y déforment quelque pièce ou rouage essentiel; ils en faussent le jeu, ils en détraquent le mécanisme; ils font d'elle un engin fiscal, électoral ou doctrinal, un instrument de règne ou de secte. — Tel, au XVIIIe siècle, l'état-major ecclésiastique que l'on connaît415, évêques de cour, abbés de salon, appliqués d'en haut sur leur diocèse ou sur leur abbaye, non résidents, préposés à un ministère qu'ils n'exercent pas, largement reniés pour être oisifs, parasites de l'Église, outre cela, mondains, galants, souvent incrédules, étranges conducteurs d'un clergé chrétien, et qu'on dirait choisis exprès pour ébranler la foi catholique chez leurs ouailles et la discipline monastique dans leurs couvents. — Tel, en 1791416, le nouveau clergé constitutionnel, intrus, schismatique, superposé à la majorité orthodoxe, pour lui dire une messe qu'elle juge sacrilège, et pour lui administrer des sacrements dont elle ne veut pas.
En dernier lieu, même quand les gouvernants ne subordonnent pas les intérêts de l'institution à leurs passions, à leurs théories, à leurs intérêts propres, même quand ils évitent de la mutiler et de la dénaturer, même quand ils remplissent loyalement et de leur mieux le mandat surérogatoire qu'ils se sont adjugé, infailliblement ils le remplissent mal, plus mal que les corps spontanés et spéciaux auxquels ils se substituent; car la structure de ces corps et la structure de l'État sont différentes. — Unique en son genre, ayant seul l'épée, agissant de haut et de loin, par autorité et contrainte, l'État opère à la fois sur le territoire entier, par des lois uniformes, par des règlements impératifs et circonstanciés, par une hiérarchie de fonctionnaires obéissants qu'il maintient sous des consignes strictes. C'est pourquoi il est impropre aux besognes qui, pour être bien faites, exigent des ressorts et des procédés d'une autre espèce. Son ressort, tout extérieur, est insuffisant et trop faible pour soutenir et pousser les œuvres qui ont besoin d'un moteur interne, comme l'intérêt privé, le patriotisme local, les affections de famille, la curiosité scientifique, l'instinct de charité, la foi religieuse. Son procédé, tout mécanique, est trop rigide et trop borné pour faire marcher les entreprises qui demandent à l'entrepreneur le tact alerte et sûr, la souplesse de main, l'appréciation des circonstances, l'adaptation changeante des moyens au but, l'invention continue, l'initiative et l'indépendance. Parlant, l'État est mauvais chef de famille, mauvais industriel, agriculteur et commerçant, mauvais distributeur de travail et des subsistances, mauvais régulateur de la production, des échanges et de la consommation, médiocre administrateur de la province et de la commune, philanthrope sans discernement, directeur incompétent des beaux-arts, de la science, de l'enseignement et des cultes417. En tous ces offices, son action est lente ou maladroite, routinière ou cassante, toujours dispendieuse, de petit effet et de faible rendement, toujours à côté et au delà des besoins réels qu'elle prétend satisfaire. C'est qu'elle part de trop haut et s'étend sur un cercle trop vaste. Transmise par la filière hiérarchique, elle s'y attarde dans les formalités et s'y empêtre dans les paperasses. Arrivée au terme et sur place, elle applique sur tous les terrains le même programme, un programme fabriqué d'avance, dans le cabinet, ' tout d'une pièce, sans le tâtonnement expérimental et les raccords nécessaires, un programme qui, calculé par à peu près, sur la moyenne et pour l'ordinaire, ne convient exactement à aucun cas particulier, un programme qui impose aux choses son uniformité fixe, au lieu de s'ajuster à la diversité et à la mobilité des choses, sorte d'habit-modèle, d'étoffe et de coupe obligatoires, que le gouvernement expédie du centre aux provinces, par milliers d'exemplaires, pour être endossé et porté, bon gré mal gré, par toutes les tailles, en toute saison.
V
Bien pis, non seulement dans ce domaine qui n'est pas le sien, l'État travaille mal, grossièrement, avec plus de frais et moins de fruit que les corps spontanés, mais encore, par le monopole légal qu'il s'attribue ou par la concurrence accablante qu'il exerce, il tue ces corps naturels, ou il les paralyse, ou il les empêche de naître; et voilà autant d'organes précieux qui, résorbés, atrophiés, ou avortés, manquent désormais au corps total. — Bien pis, encore si ce régime dure et continue à les écraser, la communauté humaine perd la faculté de les reproduire: extirpés à fond, ils ne repoussent plus; leur germe lui-même a péri. Les individus ne savent plus s'associer entre eux, coopérer de leur propre mouvement, par leur seule initiative, sans contrainte extérieure et supérieure, avec ensemble et longtemps, en vue d'un but défini, selon des formes régulières, sous des chefs librement choisis, franchement acceptés et fidèlement suivis. Confiance mutuelle, respect de la loi, loyauté, subordination volontaire, prévoyance, modération, patience, persévérance, bon sens pratique, toutes les dispositions de cœur et d'esprit sans lesquelles aucune association n'est efficace ou même viable, se sont amorties en eux, faute d'exercice. Désormais la collaboration spontanée, pacifique et fructueuse, telle qu'on la rencontre chez les peuples sains, est hors de leur portée; ils sont atteints d'incapacité sociale, et, par suite, d'incapacité politique. — De fait, ils ne choisissent plus leur constitution, ni leurs gouvernants: ils les subissent, bon gré, mal gré, tels que l'accident ou l'usurpation les leur donne; chez eux, la puissance publique appartient au parti, à la faction, à l'individu assez osé, assez violent pour la prendre et la garder de force, pour l'exploiter en égoïste et en charlatan, a grand renfort de parades et de prestiges, avec les airs de bravoure ordinaire, et le tintamarre des phrases toutes faites sur les droits de l'homme et le salut public. Elle-même, cette puissance centrale, n'a sous la main, pour recevoir ses impulsions, qu'un corps social appauvri, inerte et flasque, capable seulement de spasmes intermittents ou de raidissements artificiels sur commande, un organisme privé de ses organes secondaires, simplifié à l'excès, d'espèce inférieure ou dégradée, un peuple qui n'est plus qu'une somme arithmétique d'unités désagrégées et juxtaposées; bref, une poussière ou une boue humaine. — A cela conduit l'ingérence de l'État. Il y a des lois dans le monde moral comme dans le monde physique; nous pouvons bien les méconnaître, mais nous ne pouvons pas les éluder. Elles opèrent tantôt pour nous, tantôt contre nous, à notre choix, mais toujours de même et sans prendre garde à nous; c'est à nous de prendre garde à elles; car les deux données qu'elles assemblent en un couple sont inséparables: sitôt que la première apparaît, inévitablement la seconde suit.
69.Paul Leroy-Beaulieu on “The Definition of the State” (1890)↩
[Word Length: 4,719]
Source
Paul Leroy-Beaulieu, L’État moderne et ses fonctions (Paris: Guillaumin, 1890). Livre premier: L’État, la société et l’individu. - La genèse des fonctions de l’état. . Chapitre V: Définition de l’état. - La genèse de ses fonctions,” pp. 38-54.
Brief Bio of the Author: Paul Leroy-Beaulieu (1843-1916)
[Paul Leroy-Beaulieu (1843-1916)]
Paul Leroy-Beaulieu (1843-1916) came from a well-connected Orléanist family in Paris and became an influential economist and journalist. He studied law in Paris before doing further study in Bonn and Berlin. In 1872 he was appointed a professor at the École libre des sciences politiques and later went on to the Collège de France where he was made a professor of political economy in 1880. It was during this period that he founded L’Économiste française in 1873 which came to rival the more orthodox classical liberal Journal des Économistes (founded 1842). Leroy-Beaulieu made a name for himself with a number of works during the late 1860s and 1870s on social questions, such as the working class (De l’État moral et intellectual des poulations ouvrières (1868) and La Question ouvrière au XIXe siècle (1872)) and women (Le Travail des femmes au XIXe siècle (1873)). But much more controversial was his prize-winning work De la Colonisation chez les peuples modernes (1874) which alienated mainstream political economists with its support for French colonial expansion. In two later works he returned to a more anti-statist position in his critique of socialism (Le Collectivisme: Examen critique du nouveau socialisme (1884)) and the expanding bureaucratic state (L’État moderne et ses fonctions (1890)). [DMH]
CHAPITRE V. DÉFINITION DE L'ÉTAT. — LA GENÈSE DE SES FONCTIONS.
Les humbles commencements de l'État, page 38. — Les deux fonctions primitives: organe directeur de la tribu contre l'étranger, organe d'un droit coutumier élémentaire, page 39. — Troisième fonction, postérieure: contribution au développement social, page 39.
L'organisme de l'État est essentiellement coercitif: la double conatrinte des lois et des impôts; pouvoir législatif ou réglementaire et pouvoir fiscal, page 40. — L'État se manifeste aux peuples civilisés sous la forme d'une trinité: autorité nationale, autorité provinciale, autorité municipale, page 41.
Genèse des fonctions de l'État, page 41. — Des attributions qui semblent aujourd'hui inhérentes à l'État lui sont tardivement échues, exemple du service de sécurité intérieure, page 41. — La plasticité sociale fait naitre spontanément les organes qui sont indispensables à la société, page 42. — Un léger degré d'insécurité vaut encore mieux qu'un excès de réglementation, page 43.
C'est le principe de la division du travail qui a investi définitivement l'État de diverses fonctions jusque-là remplies par les groupements spontanés et libres, page 44. — Parfois la plasticité de la société réagit contre les fautes de l'État en abandonnant ses organes pour retourner à d'autres qu'elle crée spontanément, page 45. — La plupart des lois n'ont été à l'origine que des consécrations de coutumes nées instinctivement, page 45. — Le droit commercial a une origine toute privée, page 45. — Nombre d'entreprises qui semblent répugner à l'initiative privée et qui ont été accomplies par elle avec éclat, page 46. — Historiquement les associations libres ont prêté leur concours à l'État pour des services dévolus à ce dernier; les fermiers d'impôts, page 48.
L'Etat est absolument dépourvu de l'esprit d'invention, page 49. — Presque tous les progrès humains se rapportent à des« individualités sans mandat », page 49. — Toute collectivité hiérarchique est incapable d'esprit d'invention, page 49. — Exemples divers de la stérilité d'invention de l'État, page 50. — L'État est un organe critique, un organe de coordination, de généralisation, de vulgarisation, page 53. — L'État n'est pas la plus haute personnalité, page 54. — L'État est surtout un organe de conservation, page 54.
Qu'est-ce que l'État? Question assez embarrassante à résoudre. On connaît la belle conférence de M. Renan sur ce thème: Qu'est-ce qu'une nation? La nature et l'essence de l'État ne sont pas moins difficiles à démêler.
Il ne faut pas chercher la réponse dans une conception purement philosophique. L'examen seul des faits historiques, de l'évolution humaine, l'étude attentive chez les divers peuples de la façon dont vit, se meut et progresse la société, peuvent permettre de discerner avec quelque netteté l'État concret, très divers, d'ailleurs, suivant les pays et suivant les temps.
Comme pour toutes les choses humaines, les commencements de l'État sont bien humbles. Dans le passé le plus reculé, l'État, c'est l'organe directeur de la tribu se défendant contre l'étranger; c'est aussi l'organe d'un certain droit élémentaire, d'un ensemble de règles simples, traditionnelles, coutumières, pour le maintien des rapports sociaux.
Le service de défense à l'extérieur, celui de la justice au dedans, voilà les deux fonctions absolument essentielles, irréductibles, de l'État. Dieu me garde de dire qu'elles suffisent à un peuple civilisé, comme certains économistes forcenés l'ont prêché longtemps! On verra dans le courant de ces études que, pour empêcher l'État de se disperser à l'infini, je ne lui fais pas moins une large part.
Les deux services que je viens d'indiquer sont, toutefois, les seuls sans lesquels on ne peut concevoir l'État comme existant. Chacun d'eux, le second surtout, celui de justice, le Rechtszweck des Allemands, est, d'ailleurs, susceptible de singulières extensions, d'un détail chaque jour accru, de tâches qui finissent par devenir énormes. Au fur et à mesure que la société s'émancipe, se complique et s'agrandit, qu'elle quitte la sauvagerie pour la barbarie, puis celle-ci pour la civilisation, une autre mission finit par échoir à l'État, c'est de contribuer, suivant sa nature et ses forces, sans empiéter aucunement sur les autres forces ni en gêner l'action, au perfectionnement de la vie nationale, à ce développement de richesse ou de bien-être, de moralité et d'intellectualité que les modernes appellent le progrès. C'est ici qu'on court le risque d'étranges exagérations.
Nous parlons d'une contribution, d'un concours, d'une aide, nullement d'une direction, d'une impulsion, d'une absorption. L'État qui joue un rôle principal, quand il s'agit de la défense de la société contre l'étranger ou du maintien de la paix entre les citoyens, ne joue plus qu'un rôle accessoire lorsqu'il s'agit de l'amélioration des conditions sociales. Mais, si accessoire qu'il soit, ce rôle reste important, et très peu de gouvernements savent convenablement s'en acquitter.
L'État concret, tel que nous le voyons fonctionner dans tous les pays, est un organisme qui se manifeste par deux caractères essentiels, qu'il possède toujours et qu'il est seul à posséder: le pouvoir d'imposer par voie de contrainte à tous les habitants d'un territoire l'observation d'injonctions connues sous le nom de lois ou dérèglements administratifs: le pouvoir, en outre, de lever, également par voie de contrainte, sur les habitants du territoire, des sommes dont il a la libre disposition.
L'organisme de l'État est donc essentiellement coercitif: la contrainte se manifeste sous deux formes, les lois et les impôts. Le pouvoir législatif ou réglementaire et le pouvoir fiscal, l'un et l'autre accompagnés de contrainte, soit effective, soit éventuelle, c'est là ce qui distingue l'État.
Que l'organisme qui possède ces pouvoirs soit central ou qu'il soit local, c'est toujours l'État. Les autorités provinciales, les autorités municipales, détenant, par délégation ou par transmission lointaine, le pouvoir réglementaire et le pouvoir fiscal, sont tout aussi bien l'État que l'organisme central.
L'État se manifeste, chez la généralité des peuples civilisés, sous la forme d'une trinité: les autorités nationales, les autorités provinciales et les autorités municipales. Aussi, en étudiant le rôle et la mission de l'État, doit-on tout aussi bien parler des provinces et des municipalités que du gouvernement national. Les abus aujourd'hui sont peut-être encore plus criants de la part de la manifestation la plus humble de l'État, la commune, que de la part de la manifestation supérieure, le gouvernement.
Quelle est la légitime et l'utile sphère d'action des pouvoirs publics de toute nature, c'est-à-dire de ceux qui ont la contrainte à leur service? c'est ce que nous cherchons à discerner. Si l'on ne peut répondre à cette question par une formule absolument générale et simple, il est possible, en étudiant les divers services sociaux dans leur développement historique et dans leur situation présente, d'indiquer quelques-unes des limites que l'État, sous ses trois formes, doit respecter.
Les auteurs s'épuisent à indiquer à priori les fonctions essentielles et les fonctions facultatives de l'État. La plupart de ces classifications sont arbitraires.
Il est impossible d'arriver théoriquement à une démarcation fixe entre la sphère de l'État et celle des sociétés libres ou des individus. Les deux sphères se pénètrent souvent l'une l'autre, et elles se déplacent.
L'histoire et l'expérience prouvent que, à travers les âges, des fonctions qui sont aujourd'hui considérées comme faisant partie de l'essence même do l'État lui sont tardivement échues, que, tout au moins, elles ont été remplies partiellement pendant longtemps par des particuliers et les associations qu'ils formaient. La société est un être plastique, qui jouit d'une merveilleuse facilité à s'adapter au milieu, à créer les organes qui sont indispensables à sa conservation ou à son progrès. On ne peut considérer comme fausse la doctrine d'Herbert Spencer, que toute institution convenable pour l'accomplissement des fonctions sociales collectives éclôt spontanément. Cette pensée semble vraie dans une très large mesure, quand la société est abandonnée à sa plasticité naturelle et qu'elle n'est pas écrasée par la force autoritaire, par l'appareil de contrainte qu'on nomme l'État.
Quoi de plus naturel que d'identifier le service de sécurité avec la notion de l'État? L'expérience prouve, cependant, que des sociétés ont pu vivre, même se développer et grandir, imparfaitement et lentement, il est vrai, sans que l'État se souciât beaucoup de la sécurité ou qu'il eût les moyens de la procurer au pays. L'insécurité est, sans doute, un mal terrible, le plus décourageant pour l'homme: avec l'insécurité, il n'existe plus aucun rapport certain, parfois aucun rapport probable, entre les efforts ou les sacrifices des hommes et la fin pour laquelle ils consentent à ces sacrifices et font ces efforts. On ne sait plus si au semeur appartiendra la moisson. Non seulement le travail et l'économie cessent d'être des moyens sûrs d'acquérir, mais la violence en devient un plus sûr.
La plasticité de la société, dans les temps anciens ou dans les temps troublés, résistait à ce mal. On se mettait sous la protection d'un brigand, plus loyal que d'autres; on faisait avec lui un abonnement. De là vient le grand rôle que jouèrent les brigands dans les temps anciens et chez les peuples primitifs: certains d'entre eux étaient regardés, non plus comme des dévastateurs, mais comme des protecteurs. Les grands hommes de l'antiquité grecque et de presque toutes les antiquités sont souvent des brigands réguliers, corrects, fidèles à leur parole. Au moyen âge, on retrouve fréquemment une situation analogue. Les petits propriétaires d'alleux cherchent un appui en se plaçant sous le patronage de seigneurs plus puissants et deviennent, soit leurs vassaux, soit même leurs serfs, par choix.
Au commencement des temps modernes, ces sortes d'organisations libres et spontanées, en dehors de l'État, pour procurer aux hommes une sécurité relative, n'ont pas entièrement disparu. En Espagne, l'association célèbre, la sainte Hermandad, qui finit par être odieuse et ridicule, mais qui, dans les premiers temps de son existence, rendit des services précieux; en Flandre, en Italie, les sociétés de métiers ou autres, avaient souvent le même objet: procurer de la sécurité, soit à leurs membres, soit au public.
Ces combinaisons des âges primitifs ou troublés laissent encore certaines traces: en Angleterre et aux États-Unis, les constables spéciaux, dans le Far-West américain surtout les lyncheurs, sont les héritiers intermittents de toutes ces associations libres faites en vue de la sécurité.
Ainsi, même ce premier besoin, tout à fait élémentaire, qui nous paraît aujourd'hui ne pouvoir être satisfait que par l'intervention directe et ininterrompue de l'État, a pu l'être autrefois par des procédés moins commodes, dans une mesure moins complète, par l'action des particuliers ou des sociétés libres.
L'insécurité est pour une société une cause de lenteur dans son développement; elle ne la fait pas nécessairement rétrograder. L'oppression seule amène inévitablement le recul. Si les pachas turcs et le personnel qu'ils commandent se contentaient de protéger médiocrement les vies et les biens, si, du moins, ils n'étaient pas assujettis à des changements fréquents et qu'ils pussent mettre quelque régularité dans leurs exactions, la Turquie ne dépérirait pas. Le dépérissement est dû à l'action, non seulement brutale, mais épuisante, d'oppresseurs instables. La simple insécurité aurait des effets moins graves.
Il ne faut, certes, pas en conclure que, dans les sociétés modernes, le premier devoir de l'État ne doive pas être de garantir la sécurité; mais il est utile d'indiquer que, dans le cours de l'histoire, la plasticité de la société a pu, pour la satisfaction relative de ce besoin primordial, suppléer l'inertie de l'État par des organisations spéciales qu'elle créait spontanément. Il est bon aussi d'ajouter que, même dans le temps présent, pour un très grand nombre de transactions, un léger degré d'insécurité vaut encore mieux qu'un excès de réglementation.
Ce qui a investi définitivement l'État, d'une manière constante et exclusive, de ce service de la sécurité, c'est le principe de la division du travail.
L'économie politique a singulièrement éclairé toute l'histoire humaine et même l'histoire naturelle, quand elle a donné tant de relief, sous la plume d'Adam Smith, au principe de la division du travail. C'est ce grand principe économique qui a constitué successivement la plupart des fonctions de l'État.
Une foule de tâches, que la société souple et libre ne serait pas incapable de remplir par elle-même, qu'elle a même remplies pendant des siècles, sont échues graduellement à l'État, parce qu'il peut s'en acquitter mieux, plus économiquement, plus complètement, avec moins de frais et d'efforts.
Ainsi, telle ou telle fonction spéciale et définitive s'est constituée avec netteté, s'est détachée de la société pour échoir à l'État, quand les conditions modifiées de celle-là et de celui-ci ont fait qu'il devenait plus expédient que telle ou telle tâche fût exercée par une force générale coercitive que par des forces particulières et intermittentes. Ceux qui, sur les confins du Far-West, lynchent les criminels, n'ont ni le temps, ni les conditions d'esprit nécessaires pour s'acquitter toujours convenablement de leur tâche; des juges permanents valent mieux. De même pour les constables spéciaux, pour les pompiers volontaires, pour ces balayeurs spontanés que l'on voit encore à Londres; des escouades moins nombreuses, mais permanentes, de gens professionnels, remplissent mieux ces offices.
C'est donc le principe de la division du travail qui, inconsciemment appliqué, a fait passer à l'État certaines fonctions que la société exerçait instinctivement et que l'État organise avec réflexion.
Cette sorte de départ qui se fait graduellement entre les attributions de l'État et celles de la société libre a pour objet de laisser aux individus plus de temps pour leurs tâches privées, tout en organisant mieux certains services. Aussi doit-on considérer comme des esprits rétrogrades ceux qui nous proposent de revenir au jury civil, aux tribunaux d'arbitres; à moins, toutefois, qu'on ne veuille voir dans ces tendances une réaction salutaire contre les abus que l'État a introduits dans l'accomplissement des tâches dont il s'est chargé; la plasticité de la société réagirait alors contre ces fautes de l'État en abandonnant les organes qu'il a institués pour retourner à d'autres qu'elle crée spontanément.
On pourrait pousser très loin cet aperçu historique de la genèse des fonctions de l'État. Ainsi, le pouvoir législatif que l'État s'est attribué en certaines matières, comme les questions commerciales, ne lui a pas toujours été dévolu: il ne lui est échu que tard et par morceaux; il a été d'abord exercé par les individus et les sociétés libres; la fécondité inventive du commerce avait découvert certains procédés ingénieux, la lettre de change, le billet à ordre, bien d'autres encore, les marchés à termes sous toutes leurs formes, les combinaisons à primes, etc.; la coutume avait réglé l'emploi de tous ces moyens; les usages commerciaux eurent ainsi une origine spontanée successive; l'État finit par y mettre la main, s'en emparer, les généraliser, les perfectionner parfois, souvent aussi les déformer.
Il faut donc condamner la superficialité de ces philosophes qui, habitant les nues et apercevant confusément sur cette terre l'État en possession de certains instruments, s'imaginent que c'est lui qui les a créés, et jettent des cris de Jérémie quand on leur parle de la fécondité d'invention des associations privées.
Non seulement le droit commercial a cette origine spontanée, mais encore les agents généraux et protecteurs du commerce, les consuls, étaient d'abord les syndics de certaines communautés de négociants; ils devinrent plus tard des fonctionnaires publics; la juridiction commerciale a passé par les mêmes vicissitudes.
Dans presque tous les ordres de l'activité humaine, on aperçoit des groupements libres d'individus se chargeant à l'origine d'organiser divers services d'intérêt général, que l'État ensuite, au bout de bien des siècles parfois, régularise.
Ainsi pour la viabilité: dans un intérêt militaire, les États, soit anciens, soit modernes, ont exécuté, avant le xviiie siècle, quelques rares chaussées. Ils s'acquittaient par là non pas d'une fonction économique, mais d'une fonction stratégique. Les associations privées faisaient le reste: les bacs, les ponts créés par ces confréries spéciales, qui, dans le Midi notamment, étaient appelées pontifices, les routes à péage en Angleterre et dans bien d'autres contrées, les ponts à péage aussi, instruments primitifs si l'on veut, mais qui ont de longtemps précédé les travaux publics accomplis au moyen d'impôts, les ports mêmes et les docks, œuvres de compagnies, fondés et entretenus suivant le principe rigoureusement commercial, toutes ces créations spontanément écloses ont laissé encore aujourd'hui, surtout dans la Grande-Bretagne et, par un singulier contraste, dans quelques pays primitifs, des traces intéressantes. La seule route qui existe en Syrie, celle de Beyrouth à Damas, est l'œuvre et la propriété, suffisamment rémunératrice, d'une compagnie privée, d'une société française.
Des entreprises qui, par leur caractère encore plus éminemment désintéressé, semblent répugner à l'initiative privée, ont cependant, bien des fois, été accomplies par elle avec un éclatant succès. Stuart Mill classait encore parmi les œuvres qui revenaient de droit et de fait à l'Etat les explorations scientifiques. Pourrait-il se prononcer ainsi aujourd'hui? Même il y a trente ans, il eût dû se montrer plus circonspect. Il oubliait que le doyen et le plus remarquable peut-être des voyageurs de l'Europe moderne, Marco Polo, était un fils et neveu de négociants, qui accompagna son père et son oncle dans un voyage de commerce à la cour du grand khan des Mogols, et de là se répandit dans toute l'Asie. 11 ignorait surtout notre incomparable Caillié, qui, sans aucunes ressources et aucun appui, traversa, au début de ce siècle, le coin redoutable de l'Afrique nord-occidentale, du Sénégal au Maroc, en passant par Tombouctou, tournée hasardeuse qui ne fut refaite qu'un demi-siècle après par un jeune voyageur allemand.
Stuart Mill encore ne pouvait pressentir que la première traversée d'outre en outre de l'Afrique, de la mer des Indes à l'Atlantique, serait accomplie par un aventurier libre, que subventionnèrent ces forces nouvelles, deux grands journaux, l'un américain, l'autre anglais.
Dieu me garde de prétendre que l'Etat, en Espagne, en Portugal, en Angleterre, en France, plus récemment ailleurs, n'ait pas puissamment aidé aux voyages de découvertes et à la prise de possession du monde! Ce que je veux démontrer, c'est que, parmi les attributions que certains théoriciens étourdis revendiquent pour lui comme un monopole, il en est beaucoup qui ont pu et qui peuvent encore être exercées de la façon la plus heureuse par les groupements libres, soit des hommes riches, soit des hommes instruits, soit des hommes dévoués, soit des hommes curieux, soit de ceux qui mettent en commun une parcelle de richesse, de dévouement, d'instruction et de curiosité.
Bien loin que l'État soit à l'origine de toutes les grandes œuvres d'utilité générale, on constate, au contraire, historiquement, que les associations libres ont constamment prêté leur outillage à l'État pour les services les plus incontestablement dévolus à ce dernier.
L'État pendant longtemps, beaucoup d'États même aujourd'hui, dans une certaine mesure encore l'État français, n'ont pas su ou ne savent pas faire rentrer leurs impôts. De là ces compagnies privées, ces fermes qui se chargeaient de recouvrer les contributions sous l'empire romain, dans la vieille France, sous nos yeux encore pour certaines taxes en Espagne, en Roumanie, en Turquie, hier en Italie et en Espagne, que dis-je! dans beaucoup de communes françaises, qui trouvent plus économique d'affermer leurs droits d'octrois que de les percevoir elles-mêmes.
L'exposé historique auquel nous nous sommes livré laisse sans doute subsister une grande difficulté: puisque la plupart des attributions, aujourd'hui considérées comme essentielles à l'État, ne lui ont pas appartenu primitivement, qu'elles sont restées longtemps dans la main de particuliers ou d'associations libres, qu'elles ne sont échues à l'État que graduellement par la lente application du principe de la division du travail, la grande collectivité, armée du pouvoir de contrainte, étant plus capable de les généraliser que les petites collectivités spontanées et variables qui ne possèdent guère que le pouvoir de persuasion, comment fixer, soit dans le présent, soit dans l'avenir, la limite des attributions de l'État? Ce même exposé historique, cependant, va nous y aider en nous faisant mieux connaître les caractères généraux de l'État.
La première observation dont il est impossible de n'être pas pénétré, c'est que l'État est absolument dépourvu de l'esprit d'invention.
L'État est une collectivité rigide, qui ne peut agir qu'au moyen d'un appareil compliqué, composé de rouages nombreux, subordonnés les uns aux autres; l'État est une hiérarchie, soit aristocratique, soit bureaucratique, soit élective, où la pensée spontanée est assujettie, par la nature des choses, à un nombre prodigieux de contrôles. Une pareille machine ne peut rien inventer.
L'État, en effet, n'a rien inventé et n'invente rien. Tous les progrès humains ou presque tous se rapportent à des noms propres, à ces hommes hors cadre que le principal ministre du second empire appelait « des individualités sans mandat. »
C'est par « les individualités sans mandat » que le monde avance et se développe: ce sont ces sortes de prophètes ou d'inspirés qui représentent le ferment de la masse humaine, naturellement inerte.
Toute collectivité hiérarchisée est, d'ailleurs, incapable d'invention. Toute la section de musique de l'Académie des beaux-arts ne pourra produire une sonate acceptable; toute celle de peinture, un tableau de mérite; un seul homme, Littré, a fait un dictionnaire de premier ordre bien avant les quarante de l'Académie française.
Qu'on ne dise pas que l'art et la science sont des œuvres personnelles et que les progrès sociaux sont des œuvres communes; rien n'est plus inexact. Les procédés sociaux nouveaux demandent une spontanéité d'esprit et de cœur qui ne se rencontre que chez quelques hommes privilégiés. Ces hommes privilégiés sont doués du don de persuasion, non pas du don de persuader les sages, mais de celui de gagner les simples, les natures généreuses, parfois timides, disséminées dans la foule. Un homme d'initiative, parmi les 40 millions d'habitants d'un pays, trouvera toujours quelques audicieux qui croiront en lui, le suivront, feront fortune avec lui ou se ruineront avec lui. Il perdrait son temps à vouloir convaincre ces bureaux hiérarchisés qui sont les lourds et nécessaires organes de la pensée et de l'action de l'État.
Aussi, voyez combien stérile, au point de vue de l'invention, est cet être que certains étourdis représentent comme le cerveau de la société. L'État, tous les États, ont d'abord et par-dessus tout une vocation militaire: ils représentent avant tout la défense du pays. C'est donc les États, leurs fonctionnaires, qui devraient, semble-t-il, faire la généralité des inventions et des applications relatives à la guerre, à la marine, à la rapidité des communications. Il n'en est rien.
C'est à un moine, ce n'est pas à l'État, qu'on rapporte l'invention de la poudre à canon. Dans notre siècle, c'est un simple chimiste, appartenant au pays le plus pacifique de l'Europe, le Suédois Nobel, qui invente la dynamite. Michel Chevalier, en juillet 1870, attire l'attention du gouvernement impérial sur ce formidable explosif; pendant le second siège de Paris, M. Barbe, depuis ministre de l'agriculture, prie M. Thiers d'employer cette substance nouvelle; ces deux gouvernements, si différents par les hommes et par les principes, ne prêtent aucune attention à ces propositions.
Il en va des découvertes de la marine comme de celles de la guerre; le marquis de Jouffroy, en 1776, fait naviguer sur le Doubs le premier bateau à vapeur: il demande des encouragements au ministre Calonne, qui le repousse. Mauvais ministre, dira-t-on; mais, dans la série nombreuse des ministres de tout pays, il s'en trouve au moins autant de mauvais ou de médiocres que de bons. C'est à un grand homme du moins, à un vrai grand homme, Napoléon, que, un quart de siècle après, s'adresse Fulton, et ce grand homme d'État considère ses essais comme des enfantillages. Si l'État dédaigne la vapeur et est lent à l'appliquer, ce n'est pas lui non plus qui invente ou qui applique le premier l'hélice. L'inventeur Sauvage passe d'une maison de dettes dans une maison de fous.
Pour les communications publiques, il en est de même. Trois petits chemins de fer fonctionnent en France, à la fin de la restauration, créés par l'initiative privée, sans subvention d'aucune sorte; l'État met une dizaine d'années à discuter sur le meilleur régime des voies ferrées, et, par ses tergiversations, ses absurdes exigences, il retarde d'autant, comme nous le montrerons plus tard, le développement du réseau ferré dans notre pays.
La drague à couloir de M. Lavalley avait creusé depuis dix ans le canal de Suez, qu'on commençait à peine à l'introduire dans les travaux de ports exécutés par l'État français. Ni les câbles sous-marins, ni les percements d'isthmes, ni aucune des principales œuvres qui changent la face du monde, ne sont dus à l'État ou aux États.
Les téléphones se répandent dans toutes les administrations privées avant que l'État s'en occupe. Ensuite plusieurs États les veulent confisquer. De môme, pour la lumière électrique dont, par ses niaises exigences, le conseil municipal de Paris retarde de dix ans la propagation dans cette ville.
L'État moderne affecte une prédilection pour l'instruction: ce sont des particuliers qui créent l'École centrale des arts et manufactures; ce sont des industriels qui instituent les écoles de commerce de Mulhouse, de Lyon, du Havre.
L'État, dans un rare moment d'initiative, veut fonder une école d'administration; il n'y réussit pas. Un simple particulier crée l'École libre des sciences politiques, et lui gagne en quelques années, dans les deux mondes, une éclatante renommée.
L'État se lasse des anciens procédés d'instruction qu'il avait empruntés à une société privée, celles des jésuites, et il se prend d'engouement pour l'œuvre d'une autre société privée, celle de l'École Monge; il veut aussitôt en généraliser les principes sur tout le territoire.
Ce n'est pas que nous voulions contester les services que l'État rend d'autre part, les perfectionnements de détail que plusieurs de ses ingénieurs ou de ses savants introduisent ou répandent. Certes, l'État a à son service des hommes distingués, des hommes éminents; la plupart, cependant, quand ils en ont l'occasion, préfèrent quitter l'administration officielle où l'avancement est lent, pédantesque, assujetti au népotisme ou au gérontisme, pour entrer dans les entreprises privées, qui placent immédiatement les hommes au rang que leur assignent leurs talents et leurs mérites.
Comment en serait-il autrement? L'esprit, comme dit l'Écriture, souffle où il veut. La sagesse moderne a traduit cette grande pensée par cette autre formule: Tout le monde a plus d'esprit que Voltaire. Ce n'est pas dans les cadres réguliers, prudemment combinés, que s'enferme l'esprit d'invention; il choisit dans la foule ceux dont il veut faire une élite.
En disant que l'État manque essentiellement de la faculté d'invention et de l'aptitude à l'application prompte des découvertes, nous n'avons pas l'intention de le dénigrer, de l'offrir en pâture aux sarcasmes. Nous constatons simplement sa nature, qui a des mérites différents, opposés.
Au point de vue social aussi, l'État ne sait rien découvrir: ni la lettre de change, ni le billet à ordre, ni le chèque, ni les opérations multipliées des banques, ni le clearing house, ni les assurances, ni les caisses d'épargne, ni ces divers modes ingénieux de salaire que l'on appelle participation aux bénéfices, ni les sociétés coopératives, ne sortent de la pensée ou de l'action de l'État: toutes ces combinaisons ingénieuses surgissent du milieu social libre.
Qu'est donc l'État? Ce n'est pas un organe créateur, loin delà. C'est un organe critique, un organe de généralisation, de coordination, de vulgarisation. C'est surtout un organe de conservation.
L'État est un copiste, un amplificateur; dans ses copies et ses adaptations des entreprises privées, il a bien des chances de commettre quelques erreurs ou de multiplier à l'infini celles qui se trouvaient dans l'original dont il s'éprend.
Il intervient après les découvertes, et il peut alors leur prêter un certain concours. Mais il peut aussi les étouffer: dans l'intervention de l'État, qui peut être parfois bienfaisante, il y a toujours à craindre cet élément capricieux, brutal, accapareur, ce quia nominor leo. Il possède, en effet, un double pouvoir, qui est une terrible force, la contrainte légale et la contrainte fiscale.
De ce que l'État est ainsi absolument destitué de la faculté d'invention, de ce qu'il possède seulement, dans des mesures très variables, l'esprit d'assimilation et de coordination, il résulte que l'État ne peut être le premier agent, la cause principale du progrès dans la société humaine; il ne saurait jouer le rôle que d'un auxiliaire, d'un agent de propagation, qui risque toutefois, par une présomption maladroite, de se transformer en un agent de perturbation.
Il descend ainsi du trône où on voulait l'élever.
Il en résulte encore que l'État n'est pas la plus haute personnalité, ainsi que le prétend M. de Stein; c'est la plus vaste personnalité, non la plus haute, puisque le plus merveilleux attribut de l'homme, l'invention, lui fait défaut.
Avant d'entrer dans le détail des tâches dont s'occupe la trinité de l'État — pouvoir central, pouvoir provincial, pouvoir communal, — il nous a semblé utile de réfuter ces erreurs et de poser ces principes. La mission de l'État en deviendra plus claire.
70.Yves Guyot on “The Tyranny of Socialism” (1893)↩
[Word Length: 8,792]
Source
Yves Guyot, La Tyrannie Socialiste (Paris: Ch. Delagrave, 1893). Livre II, Chapitres I-XII, pp. 35-79.
Brief Bio of the Author: Yves Guyot (1843-1928)
[Yves Guyot (1843-1928)]
Yves Guyot (1843-1928) was one of the leading French laissez-faire economists at the end of the 19th and in the early 20th century. He began his career as editor of several Republican newspapers and journals in the late 1860s and early 1870s when France was wracked by the turmoil of the Paris Commune and Franco-Prussian War. In the Third Republic he was elected to the Paris Municipal Council and in 1885 to the national Chamber of Deputies. In 1889 he was appointed Minister of Public Works. He was active in classical liberal economic circles as editor of the Journal des Économistes (in 1910 he took over when Molinari retired), president of the Paris Société des Économistes, a member of the British Cobden Club and the Royal Statistical Society, and a member of the American Academy of Political and Social Sciences. Among his many interests were taxation policy and opposition to socialism in all its forms. [DMH]
LIVRE II. SOPHISMES SOCIALISTES
Ayant constaté que le programme socialiste, loin d'être un progrès ne représente qu'une regression vers des types de civilisations antérieures et inférieures, il nous reste à nous demander à l'aide de quels sophismes, par suite de quelles erreurs de méthode, les auteurs de ce programme peuvent le présenter, les disciples s'y rallier avec une passion jalouse et farouche.
Nous empruntons l'énumération de ces sophismes aux déclarations de principes des congrès de Gotha et d'Erfurt que nous avons reproduits plus haut, afin qu'on ne puisse pas nous accuser de défigurer les idées socialistes pour les réfuter plus facilement. Nous sommes toutefois obligés d'y ajouter quelques-unes des maximes, plus ou moins explicitement empruntées aux socialistes français de 1848, et qui sont devenues des arguments courants.
CHAPITRE PREMIER. Travail et richesse.
Emprunt à M. de Saint-Cricq.— Confusion. — Le travail n'est qu'un moyen. — La loi du moindre effort. — Définition du capitaal. — Capital fixe et capital circulant. — Définition de la valeur.
Nous trouvons en tête du programme de Gotha cette phrase:
« Le travail est la source de toute richesse et de toute civilisation, et comme un travail profitable à tous n'est possible que par la société... »
Cette phrase semble empruntée au vocabulaire protectionniste et tout particulièrement à M. de Saint-Cricq: « Le travail constitue la richesse d'un peuple. » Les protectionnistes de la Restauration aussi bien que ceux de nos jours font la même confusion que s'ils confondaient l'outil avec le produit. Si le travail constituait la richesse d'un peuple, il suffirait de faire du travail pour le travail et on s'enrichirait indéfiniment. Or, des faits quotidiens nous démontrent que le travail le plus acharné peut être improductif et que bien Ion d'enrichir celui qui s'y livre, il peut le laisser ruiné et épuisé. Le travail représente l'effort: et la loi du moindre effort, vraie en matière économique comme en linguistique, pousse l'homme à employer son travail pour diminuer son travail dans la suite. S'il construit des outils, des barques, des routes, des ponts, c'est afin, une fois cet effort considérable accompli et qui devient de plus en plus considérable comme le prouve le puissant outillage de nos jours, d'obtenir plus aisément un certain nombre de services. Et qu'est-ce que ces outils, depuis la pierre, la hache, le marteau jusqu'à l'appareil le plus puissant et le plus perfectionné, sinon le capital?
Le capital, c'est l'homme augmenté de tous les agents naturels qu'il a soumis à son usage.
Nous disons, contrairement à certains économistes qui font de la terre un capital spécial:
Est capital, toute utilité appropriée par l'homme.
De plus nous distinguons deux sortes de capitaux. Les uns, comme la maison, le champ, le marteau, la charrue, la turbine, le navire, etc. ne peuvent nous donner d'utilité qu'à la condition de rester maison, champ, marteau, de ne pas changer de caractère.
Les autres, au contraire, comme la houille pour celui qui a un foyer à chauffer, le blé pour le meunier, la farine pour le boulanger, toutes les matières premières en un mot, y compris les aliments qui sont le combustible de l'homme, ne produisent d'utilité pour ceux qui les emploient qu'à la condition de se transformer. De même le produit, pour le fabricant ou pour le marchand, ne lui procure d'utilité qu'à la condition de se transformer en monnaie ou autre valeur.
Il y a donc deux sortes de capitaux.
Le capital fixe est toute utilité dont le produit ne change pas l'identité.
Le capital circulant est toute utilité dont le produit change l'identité.
Ou autrement:
Le capital fixe, c'est l'outil.
Le capital circulant, c'est la matière première et le produit.418
Et qu'est-ce que la valeur: C'est le rapport de l'utilité possédée par un individu aux besoins d'un autre individu.
CHAPITRE II. Des limites de la société collectiviste.
La société. — Qu'est-ce?— Est-ce toute l'humanité?— A quels groupes s'appliquent les programmes collectivistes? — Credo quia absurdum.
Le programme de Gotha dit:
Comme un travail profitable à tous n'est possible que par la société, c'est à la société, c'est-à-dire tous ses membres que doit appartenir le produit général du travail, avec obligation pour tous de travailler.
La société? mais qu'est-ce que la société? quelle est cette société? est-ce l'humanité tout entière?
On serait en droit de le croire d'après votre formule: « L'affranchissement du travail exige la transmission des instruments du travail de la société tout entière.. » Tout entière? vous entendez bien: et en effet, il doit bien s'agir de la société tout entière, car autrement il y aurait des déshérités du bonheur commun, des privilégiés et des spoliés.
Mais alors cette organisation engloberait le Mogol errant du désert de Gobi, le Fuégien de la Terre de feu, le Touareg du Sahara, les nègres de l'Afrique centrale et les Papous de la Nouvelle-Guinée; et ils auraient leur part dans la distribution « du produit général du travail. »
Si le socialiste prétend que je lui fais dire des absurdités, je lui réponds que je ne les lui prête pas, mais que je les lui emprunte et que l'interprétation logique de son texte est bien celle que je viens de donner.
Soit, j'accepte que l'ambition des socialistes de Gotha soit plus modeste et qu'ils aient mis le mot « société » seulement par hypocrisie pour ne pas se servir du mot « Etat ». Mais je leur pose cette question: qu'est-ce que « la société » dont vous parlez? Votre société est-elle l'expression géographique et politique désignant un groupe d'êtres humains dont le nombre et la situation sur la mappemonde ont été déterminés par les hasards des guerres? L'Allemagne est-elle une société homogène dans votre conception collectiviste, malgré les traditions particularistes de ses provinces? Allez-vous constituer une seule société collectiviste en Autriche, avec ses Allemands, ses Hongrois, ses Tchèques, ses Polonais? Le Danemark constitue-t-il une société collectiviste? et la Russie dans l'étendue de ses frontières, du détroit de Behring à la Baltique, doit-elle se charger « d'imposer à chacun de ses 113 millions d'habitants la tâche à faire » et de lui donner ensuite « la part nécessaire à la satisfaction de ses besoins raisonnables? »
Ce problème, que les socialistes de Gotha et d'Erfurt aussi bien que les socialistes français se gardent d'aborder, vaut cependant la peine qu'on s'y arrête; car si le communisme est possible pour un couvent, il devient un autre problème quand il s'agit de l'appliquer à des millions et à des millions d'êtres, n'ayant ni le même degré de civilisation, ni les mêmes habitudes, ni la même conception de la vie.
Nous signalons, en passant, ces petites difficultés, mais nous savons bien qu'elles n'arrêteront pas les fanatiques du collectivisme. Credo quia absurdum, a dit Tertullien.
CHAPITRE III. La loi de l'offre et de la demande.
Abroger la loi de l'offre et de la demande. — La responsabilité de Newton. — Définition de la loi de l'offre et de la demande. — Son universalité. — Son application au travail. — Le travail est une marchandise — La grève est un accaparement de travail. — La loi de l'offre et de la demande et le travail, d'après Cobden.
Aux yeux du collectiviste, ces difficultés sont évidemment des quantités négligeables à l'égard du but qu'il s'agit d'atteindre: — la suppression de la loi de l'offre et de la demande.
Un jour, dans une réunion électorale, quelqu'un me reprocha amèrement d'être partisan de cette loi. Il se figurait, le brave homme, que la loi de l'offre et de la demande était inscrite au Bulletin des lois et que je l'avais votée...
Mais je croyais qu'il était seul imbu de cette idée, quand dernièrement parlant de cette loi à plusieurs socialistes, l'un d'eux me dit;
— Alors, vous ne voulez donc pas l'abroger, cette loi abominable!
De ces deux faits, je suis bien obligé de conclure que non seulement l'ignorance des principes économiques, mais même de l'idée d'une loi scientifique, est beaucoup plus grande que je ne l'imaginais: constatation qui doit nous rendre pleins d'indulgence pour les erreurs que nous voyons proférer chaque jour, mais qui, en même temps, nous donne le droit d'inviter ceux qui parlent avec tant de mépris des vils économistes et présentent avec tant d'assurance des plans de bouleversement social, à commencer par apprendre l'A, B, C, des questions qu'ils traitent.
La loi de l'offre et de la demande n'a été promulguée dans aucun code. Elle est autrement puissante. Elle s'impose à l'homme d'une manière aussi implacable que la faim et que la soif. Il y obéit, qu'il le veuille ou non, alors même qu'il s'imagine la violer. Si le socialiste excommunie et injurie l'économiste qui formule cette loi, il devrait aussi rendre Newton responsable de toutes les tuiles qui tombent sur la tête des passants, et déclarer que si. un malheureux, en se jetant par la fenêtre, se tue, c'est de la faute des physiciens qui ont déterminé et enseignent la loi de la pesanteur.
Puisqu'il y a encore tant de gens qui ignorent la loi de l'offre et de la demande, il est utile de la rappeler.
L'offre est le désir pour un individu, en échange dus utilités qu'il possède, de se procurer des utilités d'une autre nature.
La demande est le désir, joint aux moyens d'achat, de se procurer une utilité quelconque.
La valeur d'une utilité est en raison inverse de F offre et en raison directe de la demande. »
Quand il y a plus d'offres d'une marchandise que de demandes de cette même marchandise, les prix baissent. Ils augmentent dans le cas contraire.
Je demande au socialiste qui veut abroger la loi de l'offre et de la demande, s'il peut citer un fait qui la contredit. Quand il a vu offrir des blés, des vins, du bois, des machines en plus grande quantité que les consommateurs n'en demandaient, en a-t-il vu les prix s'élever ou baisser?
Que font les protectionnistes quand ils demandent des tarifs de douanes pour arrêter tel ou tel produit à la frontière? Ils font acte de foi à la loi de l'offre et de la demande. Car ils ont pour but de raréfier l'offre, de manière à relever les prix des objets qu'ils veulent protéger.
Tu as beau, socialiste, maudire la loi de l'offre et de la demande; non seulement, tu l'appliques, tous les jours, dans les achats qui sont nécessaires à ton existence, quand tu marchandes pour ton vin, ton pain, ta viande, ton loyer, tes vêtements, mais tu l'appliques encore quand tu es vendeur au lieu d'être acheteur.
Le Socialiste. — Allons donc! je ne suis jamais vendeur, puisque je n'ai rien à vendre.
L'économiste. — Quand tu livres ton travail, que fais-tu donc? N'exiges-tu pas un salaire? Ne fais-tu pas un contrat verbal ou écrit qui s'appelle le contrat de louage? Tu vends ton travail comme l'épicier vend son sel, son café et son sucre, comme le boulanger vend son pain, comme le boucher vend sa viande.
Le Socialiste. — Ce n'est pas la même chose, je ne livre pas un objet.
L'économiste. — Non, mais tu rends un service. Le chemin de fer qui te transporte d'un endroit à un autre ne te livre pas un objet non plus, mais il te rend un service. Le médecin qui te soigne, l'avocat qui plaide pour toi, perçoivent un salaire parce qu'ils te rendent un service. Tu loues ta force, musculaire ou intellectuelle, moyennant une rémunération. C'est le louage de force et d'habileté professionnelle que nous appelons le contrat de travail. C'est une marchandise comme une autre qui subit, comme tous les objets ou services qui font l'objet de contrats et d'obligations, la loi de l'offre et de la demande.
Le Socialiste. — Quand tu me répéterais cela sur tous les tons, tu ne me convertiras pas, puisque je te dis que je ne l'admets pas.
L'économiste. — Et si je te prouve que tu es le premier, non seulement à reconnaître que le travail est une marchandise soumise à la loi de l'offre et de la demande, mais encore à exiger, quelquefois même par la violence, que tous le reconnaissent?
Le Socialiste. — Ce serait difficile.
L'économiste. — Tu veux supprimer le travail des femmes, supprimer les apprentis ou au moins en restreindre le nombre, renvoyer au delà de la frontière les ouvriers étrangers, n'est-ce pas?
Le Socialiste. — Oui.
L'économiste. — Chacune de ces propositions est un hommage à la loi de l'offre et de la demande: car chacune d'elles a pour objet de diminuer l'offre du travail et, par conséquent, d'en faire augmenter le prix.
Le Socialiste. — Il me faut d'autres raisons pour me convaincre.
L'économiste. — Es-tu partisan de la loi de 1864 qui a permis aux ouvriers de faire grève? Voudrais-tu revenir au régime antérieur?
Le Socialiste. — Non. Ça ne se demande pas. La grève est un droit.
L'économiste. — Eh bien! Que fais-tu quand tu fais grève? Tu retires ton travail du marché. Tu dis à ton patron: Si vous voulez acheter mon travail, il faudra que vous le payiez plus cher. Si tu es habile, tu choisis le moment où il en a le plus besoin pour lui dicter tes conditions Ce que tu es, le sais-tu? Tu es un accapareur!
Le Socialiste. — Par exemple?
L'économiste. — Qu'est-ce qu'un accapareur? C'est un spéculateur qui retire du marché des blés, des vins, du coton, pour faire la hausse sur le prix de ces marchandises et attend pour les vendre que la hausse se soit produite. Toi aussi tu refuses ton travail, tu le gardes pour toi, tu l'accapares pour en faire monter la valeur; et, que tu veuilles en convenir ou non, tu appliques la loi de l'offre et de la demande
Cobden a formulé d'une manière pittoresque la manière dont agissent la loi de l'offre et de la de mande en matière de salaire.
« Le salaire monte, a-t-il dit, quand deux patrons courent après un ouvrier, il baisse quand deux ouvriers courent après un patron. »
On pourra essayer, par des moyens plus ou moins violents, par toutes sortes de combinaisons plus ou moins ingénieuses, par des lois plus ou moins habiles, inscrites dans nos codes, de fausser cette loi de l'offre et de la demande à l'égard du travail, on ne la changera jamais, parce qu'elle est immuable: toutes les fois qu'il n'y aura pas demande de travail, le meilleur ouvrier sera obligé d'accepter du travail à prix réduit; toutes les fois qu'il y aura demande de travail, forcément le salaire augmentera.
CHAPITRE IV. La « loi d'airain » des salaires.
Vous voulez aussi la maintenir. — Sa formule vient de Turgot. — Très atténuée. —Erronée.— Lassalle l'a prise à Ricardo. — Le texte exact de Ricardo. —Cette loi est fausse. — Cause d'élévation et de baisse du taux des salaires. — Lé fonds des salaires — Erreurs. — C'est le consommateur qui règle le taux des salaires. — Le capitaine fait que l'avance du salaire.— Si la loi d'airain était exacte, dans un même milieu, tous les salaires devraient être égaux.— Loi d'airain! évocation classique.— Les protectionnistes et la loi d'airain.— Moyen de faire baisser les salaires.— Le salaire des ouvriers dépend de la quantité du travail. — Définition du salaire. — Le salaire est un forfait.
Le même socialiste qui me reprochait de ne pas vouloir « abroger » la loi de l'offre et de la demande ajouta:
— Vous voulez sans doute aussi maintenir la loi d'airain des salaires.
— Non, répondis-je.
— Ah! ah I reprit-il triomphant, vous n'osez pas la soutenir celle-là!
— Je l'ose d'autant moins qu'elle n'existe pas, précisément parce que la loi de l'offre et de la demande existe.
— Cette loi! cependant tous les socialistes en parlent.
— Eh! ce ne sont même pas les socialistes qui l'ont inventée. Lassalle a pris cette idée à Turgot et à Ricardo, en lui donnant, pour les besoins de sa polémique, un sens absolu.
Turgot419 commence par reconnaître que le travail est soumis à la loi de l'offre et de la demande: « Le simple ouvrier, qui n'a que ses bras et son industrie, n'a rien qu'autant qu'il parvient à vendre aux autres sa peine. Il la vend plus ou moins cher: mais ce prix plus ou moins haut ne dépend pas de lui seul. »
Turgot énonce là une vérité incontestable: car jamais le prix d'un objet ou d'un service ne dépend d'une seule personne: le prix est un rapport entre deux convenances, entre deux besoins, celui de vendre et celui d'acheter: un individu ne se vend pas à soi-même une marchandise pas plus qu'il ne peut acheter son propre travail.
Turgot continue en disant: « Ce prix résulte de l'accord qu'il fait avec celui qui paye son travail. Celui-ci paye le moins cher qu'il peut. »
Les socialistes auront beau récriminer: ce sont là encore des vérités que les constatations ne feront que rendre. plus solides, comme les coups de marteau donnent plus de cohésion et plus de solidité à l'acier.
Le consommateur veut acheter le meilleur marché possible, vendre le plus cher possible. Le consommateur et le producteur de travail n'échappent pas à cette loi générale.
Turgot, d'après l'expérience de son temps, alors que florissaient ces corporation, maîtrises et jurandes qu'il abolit et qui ressuscitèrent après sa chute pour être définitivement supprimées quinze ans plus tard par l'Assemblée nationale, continuait: « Comme il a choix entre un grand nombre d'ouvriers, il préfère celui qui travaille à meilleur marché. Les ouvriers sont donc obligés de baisser le prix à l'envi les uns des autres. En tout genre de travail, il doit arriver et il arrive en effet que le salaire de l'ouvrier se borne à ce qui lui est nécessaire pour lui procurer sa subsistance. »
Turgot considère que l'offre du travail est supérieure à la demande; il en conclut que le travail tombe à un prix égal à la subsistance.
Comment a-t-il pu établir l'exactitude de ce rapport? Comment pouvait-t-il justifier cette équation? Est-ce que, même de son temps, la subsistance de tous les Français était égale? Et maintenant, regardons autour de nous. Est-ce que la subsistance de l'Irlandais qui se contente de pommes de terre, du paysan bas breton pour qui une galette de blé noir, frottée d'une tête de sardine salée, est un régal, est comparable à celle de l'ouvrier anglais ou de l'ouvrier de Paris?
Turgot considérait son affirmation comme une conséquence de la loi de l'offre et de la demande puisqu'il la basait sur cette prémisse, que l'offre de travail dépassant toujours la demande, le consommateur de travail pouvait toujours l'obtenir au prix le plus bas. Mais immédiatement, il l'infirmait; car il en exceptait l'agriculteur « avec qui la nature ne marchande point pour l'obliger à se contenter du nécessaire absolu, » et « qui peut avec le superflu que la nature lui accorde, en plus ou au delà du salaire de ses peines, acheter le travail des autres membres de la société. Il est donc l'unique source des richesses... »
Que nous révèlent ces lignes? C'est que Turgot a voulu prouver la supériorité du travail agricole sur tout autre travail; et, à son époque, la thèse n'était pas difficile à justifier. Tous les physiocrates prétendaient que la seule richesse venait de la terre, et parce que, d'une observation incomplète, ils en sont arrivés à cette erreur, s'ensuit-il que l'erreur de Turgot relative au prix de la main-d'œuvre soit une vérité, même si elle a été reprise par Ricardo?
C'est à cet économiste anglais420 que Lassalle l'emprunte: « D'après Ricardo, dit-il, la moyenne du salaire du travail est fixée d'après les besoins indispensables à la vie. » Lassalle a altéré le texte de Ricardo, beaucoup moins affirmatif. « Le prix naturel du travail, dit Ricardo421, est celui qui fournit aux ouvriers en général le moyen de subsister et de perpétuer leur espèce sans accroissement ni diminution. Le prix naturel du travail dépend donc du prix des subsistances et de celui des choses nécessaires ou utiles à l'entretien de l'ouvrier et de sa famille. »
Ricardo ajoutait encore, comme atténuation à cette proposition: « On aurait tort de croire que le prix naturel des salaires est absolument fixe et constant, même en les estimant en vivres et autres articles de première nécessité. Il varie à différentes époques dans un même pays et il est très différent dans des pays divers. L'ouvrier anglais regarderait son salaire comme très au-dessous du taux naturel et insuffisant pour maintenir sa famille, s'il ne lui permettait d'acheter d'autre nourriture que des pommes de terre et de n'avoir pour demeure qu'une misérable hutte de terre. »
Voilà ce que dit Ricardo. Il y a loin de là à la formule absolue que lui a prêtée Lassalle et dont il a fait « la loi d'airain des salaires. »
Elle n'est vraie ni comme minimum ni comme maximum.
Elle n'est pas vraie comme minimum: car si l'employeur n'a pas besoin de main-d'œuvre, il ne s'occupera pas de la nécessité de la subsistance du travailleur; il ne l'occupera pas et ne le payera pas.
Elle n'est pas vraie comme maximum: car l'employeur paye le travailleur, non d'après les convenances de celui-ci, mais d'après l'usage qu'il peut faire de son travail, d'après la demande qui lui est faite des produits qu'il livre. En réalité, ce n'est ni l'employeur, ni le travailleur qui règlent le prix du travail: c'est un troisième personnage qu'on a l'habitude d'oublier et qui s'appelle le consommateur.
Que l'employeur produise un objet qui ne réponde pas à des besoins ou qui, par son prix, soit hors de la portée des besoins qu'il pourrait satisfaire, il ne pourra pas donner de salaires, ni au-dessus ni au-dessous du prix des subsistances à des travailleurs, par cette bonne raison qu'il ne pourra pas produire et, par conséquent, qu'il n'emploiera personne.
Si l'employeur produit des objets très demandés, et qui ne pourront être faits que par un nombre de travailleurs limités, les travailleurs pourront exiger une rémunération très élevée.
Certains économistes avaient imaginé « un fond des salaires, » une somme disponible dans la société pour la rémunération des travailleurs: il n'en est rien. Les salaires ne dépendent pas du capital que peuvent posséder les employeurs. Ce capital ne manquerait pas d'être vite absorbé et dévoré, s'il devait faire face aux salaires.
Les salaires sont payés parle client de l'industriel, par l'acheteur de blé ou d'avoine pour l'agriculteur, de fer ou d'acier, pour le métallurgiste, de coton ou de laine, pour le manufacturier en étoffes. Le producteur ne fait que l'avance du salaire comme il ne fait que l'avance de l'impôt. Celui qui paye en dernier ressort, c'est le consommateur: et le salaire varie d'après ses besoins et non d'après la volonté de l'employeur.
Que les dentelles de Calais cessent de plaire aux dames qui en font usage, et les salaires des ouvriers denteliers tombent à zéro; qu'elles leur plaisent, ils ont des appointements de chefs de bureau.
Que la mode abandonne les soieries, les salaires de l'ouvrier lyonnais, si habile qu'il soit, tomberont, et ne remonteront que lorsque les dames de France, d'Angleterre, des Etats-Unis feront de nouveau appel à ses produits.
Comment les socialistes qui font de « la loi d'airain des salaires », un article de foi, ne se sont-ils pas demandé si elle existe, pourquoi tous les salaires, dans un même milieu, ne sont-ils pas égaux entre tous les travailleurs?Le prix du pain et de la viande, pour un ouvrier typographe, n'est pas plus élevé que pour un manœuvre; pour un mineur que pour un laboureur; pour un ciseleur que pour un terrassier. Comment donc, si « la loi d'airain » est vraie, ont-ils des salaires inégaux? Et si vous y croyez, socialistes de la Bourse du travail, comment se fait-il donc que vous acceptez les distinctions établies dans la Série de la ville de Paris et, au lieu de demander un taux uniforme et égal pour tous, admettez-vous que le servant du maçon ait un salaire inférieur au ravaleur? Dans les mines, en 1890, le piqueur gagnait 5 fr.04, l'ouvrier d'état 4 fr. 41, le manœuvre au fond 3 fr. 58 et à l'extérieur 3 fr. 21? Le Congrès de Tours a beau demander l'égalité des salaires: qu'il la fasse donc accepter par le ravaleur ou par le piqueur!
« La loi d'airain des salaires » n'a jamais été qu'une métaphore. Pourquoi « d'airain? » pourquoi pas de bronze? pourquoi pas « d'acier »?Elle serait plus inflexible. Serait-ce parce qu'Hésiode422 a fait la race d'airain, violente et farouche. 0 puissance de la métaphore qui prouve combien les socialistes ont l'esprit classique, dans l'acception que donnait Taine à ce terme,et sont prêts à se payer de mots! Ils croient que cette évocation est une loi économique, quoique Liebneckt cependant l'ait, au congrès de Halle (1890), fait reléguer dans le bric à brac des antiquailles.
Mais nous avons entendu des protectionnistes (mars 1887) invoquer cette prétendue loi d'airain comme un argument en faveur des droits sur les blés et la viande. — Du moment, disaient-ils, que le salaire correspond au prix des subsistances, il suffit d'élever le prix des subsistances pour faire monter le salaire. — Voilà la question sociale résolue. D'après les partisans de cette thèse ingénieuse, les salaires des ouvriers anglais auraient été plus élevés sous le régime des corn, laws que depuis le régime de la liberté! Ils ne s'aperçoivent pas que ce système est, au contraire, le plus propre à faire baisser les salaires: car plus les subsistances sont chères, plus le consommateur doit y consacrer une part importante de ses ressources, et toute cette part de ressources devient indisponible pour les autres objets: il y a donc diminution de demande des objets fabriqués; par conséquent, il y a pour la main-d'œuvre diminution de ressources, et, comme résultat, baisse des salaires.
Car.il faut toujours en revenir aux principes suivants.
Le salaire des ouvriers dépend de la quantité du travail demandé. Quand il n'y a pas de travail, le salaire tombe; le salaire augmente, quand il y a augmentation de travail. Pour élever le salaire, il n'y a donc qu'un seul moyen: ouvrir des débouchés, multiplier l'activité industrielle et commerciale du pays.
En définitive, qu'entend-on par salaire?
Le salaire un est forfait. L'ouvrier qui offre son travail à un commerçant, à un entrepreneur, lui fait le raisonnement suivant: « Je vous livre tant de travail..., vous courez, il est vrai, les risques de l'entreprise..., vous êtes obligé de faire des avances de capitaux..., vous pouvez gagner tant ou perdre..., cela m'importe peu..., je fais mon travail, je vous le livre à un prix de x, vous devez me le payer, quoi qu'il arrive. Qu'il vous rapporte des bénéfices, qu'il vous occasionne des pertes, cela ne me regarde pas. »
Un contrat à forfait entre patrons et ouvriers: tel est, le véritable caractère du salaire. C'est en le reconnaissant qu'on arrive à dissiper les équivoques et à éviter toutes les discussions oiseuses et venimeuses.
CHAPITRE V. Le salaire intégral.
Le patron parasite. — Moyen de faire fortune. — Hypothèses erronées.
D'après les socialistes de l'école de Karl Marx tout patron est un voleur, et ils le prouvent en disant:
— Si, après avoir fait une paire de souliers, je veux la racheter pour le prix qui m'a été payé, cela m'est impossible. La part de bénéfice est prélevée sur mon salaire. Le patron me vole. C'est un parasite qui vit à mes dépens.
Le socialiste compte ce que prélève le patron sur le salaire de chaque ouvrier; et par ce calcul, il établit qu'il suffit d'avoir beaucoup d'ouvriers pour avoir de gros bénéfices.
Si l'industrie était réduite à cette donnée si simple, il suffirait d'y engager des capitaux et d'embaucher le plus grand nombre d'ouvriers possible pour y faire fortune à coup sûr.
Si les socialistes voulaient bien se donner la peine d'examiner les faits dont ils parlent, ils se seraient demandé pourquoi il y a des industriels qui se ruinent et d'autres qui prospèrent.
Mais les socialistes supposent que le prix des matières premières est toujours le même et qu'il n a aucune difficulté à les acheter dans de bonnes conditions.
Ils supposent également que les produits s'écoulent continuellement et régulièrement, sans difficulté, un taux toujours uniforme.
Ils suppriment enfin les éléments de l'industrie, le taux de l'intérêt des capitaux engagés, l'amortissement de l'outillage, et comme ils ne voient pas le patron à un métier, ils supposent qu'il n'est qu'un fainéant, car ils comptent pour rien le travail de direction sans lequel l'usine ou la manufacture n'existerait pas.
CHAPITRE VI. A chacun selon ses besoins.
Quelle est la mesure des besoins? — Les capacités et les besoins. — Le salaire devrait être en raison inverse de la capacité.
C'est une formule qui a remplacé « à chacun selon ses œuvres. »
Mais quelle est la mesure des besoins? ils sont aussi indéfinis que la capacité de désirs de l'homme. Chacun peut rêver tous les paradis terrestres à son gré. Il faudra donc que la société, par un moyen quelconque, les lui procure... Ce ne sera pas le régime de l'égalité.
Mais soit, ce n'est pas ce que veulent dire ceux qui se servent de cette formule qui, comme la plupart des formules socialistes, aboutit à l'absurde dès qu'on en tire les conséquences logiques. Ils entendent que les salaires ne doivent pas être établis selon les capacités, mais selon les besoins.
Nous avons déjà montré que les salaires ne dépendaient ni du patron, ni de l'ouvrier, mais du pouvoir d'achat du consommateur.
Si on calculait les salaires d'après les besoins, ce serait l'ouvrier le plus incapable qui devrait avoir le plus fort salaire.
Un malheureux est atteint de bronchite chronique; il a besoin de salaires d'autant plus élevés qu'il est malade; qu'il lui faudrait des aliments de premier choix, en abondance, des réconfortants de toutes sortes, la possibilité de gagner assez en quelques jours pour pouvoir se reposer ensuite. Où ce malheureux trouvera-t-il jamais non [seulement des salaires plus élevés, mais des salaires aussi élevés qu'un ouvrier habile et en bonne santé?
Le salaire sera toujours proportionné à la capacité productive de l'ouvrier et non à ses besoins.
CHAPITRE VII. La suppression du salaire.
Abolition nécessaire du salariat. — Moyens d'y arriver. — Procédés employés. — L'agrément d'être patron. — Tu l'auras voulu, George Dandin!
Le Socialiste, triomphant. — Ce que tu viens de dire condamme le salaire: car tu viens de reconnaître qu'il ne pouvait tenir compte des besoins. Le patron laissera donc mourir d'inanition le malheureux bronchiteux dont tu parlais. C'est de la barbarie. Il n'y a qu'un remède: supprimer le salaire. M. Lafargue a raison quand il dit à M. Millerand: « Tant [que vous n'aurez pas aboli le salariat, vous n'aurez rien fait. »
L'économiste.— Et alors tu crois que la suppression du salaire donnerait du travail à ce malheureux et qu'il trouverait plus facilement à vivre? Est-ce que sa faculté productive en serait augmentée?
Le Socialiste. — Les autres travailleraient pour lui.
L'économiste. — C'est ce qui a lieu déjà: et le rôle de l'assistance publique est de venir au secours des malheureux qui ne peuvent vivre par leur travail.Mais ceci est une tout autre question qui n'a de rapport avec la production que le poids dont elle la charge. Elle est en dehors de la fixation du,taux des salaires.
Le Socialiste. — C'est pour cela qu'il faut le supprimer. Pour les vrais socialistes, pas de doute sur ce point. Il y a unanimité. Le salaire, c'est le vol patronal. Karl Marx l'a prouvé. La suppression du salaire! Tant qu'elle ne sera pas obtenue, il n'y a rien de fait!
L'économiste. — Eh bien! tes amis et toi, vous travaillez parfaitement, en ce moment, à cette suppression et vous y arriverez certainement, mais d'une autre manière que tu ne l'imagines.
En attendant le grand bouleversement final,le patron doit s'attendre tous les jours avoir la législation intervenir dans ses affaires et en changer les conditions. Par la suppression du travail de nuit des femmes, on a diminué la puissance de production et alourdi l'amortissement de certaines manufactures de plus d'un tiers, ce qui est une singulière manière de favoriser l'accès de l'industrie aux petits capitaux et de développer notre puissance industrielle. La loi sur l'assurance obligatoire en cas d'accidents va encore ajouter une nouvelle surcharge au poids déjà si lourd que l'industriel doit supporter en France, ce qui lui permettra sans doute de lutter plus aisément contre la concurrence étrangère. Il est, en outre, soumis à toutes sortes d'inspections qu'on veut encore multiplier, et la majorité de la Chambre des députés a adopté la loi Bovier-Lapierre en vertu de laquelle tout patron qui renverra un ouvrier syndiqué passera en police correctionnelle, comme un vagabond, et sera condamné à l'amende et à la prison. Le congrès de Tours demande qu'il soit soumis à la surveillance d'inspecteurs, élus par les ouvriers, et qu'il soit puni « s'il a fait travailler plus de huit heures et au-dessous des tarifs des syndicats. » Les ouvriers, membres des conseils de prudhommes, prêtent le serment de toujours condamner les patrons, érigeant en doctrine la partialité en matière de justice. Les patrons sont obligés de supporter, dans leurs ateliers, la présence de gens qui n'ont que des injures et des paroles de haine contre eux. Ils ont la perpétuelle inquiétude de la grève, qu'ils ne peuvent prévenir par aucun moyen; et une fois déclarée, ils sont en butte à des menaces de mort. Ils doivent faire évader leurs femmes et leurs enfants: le moindre risque qu'ils courent, c'est le pillage et le bris d'une partie de leur matériel. Des députés viennent se mettre à la tête des grévistes pour protéger ces désordres. Les ministres, les préfets interviennent et ont peur qu'on ne les accuse de favoriser les patrons. Si quelque magistrat fait son devoir en poursuivant des coupables de droit commun, à la première occasion, on s'empresse de les gracier, et les criminels reviennent en triomphateurs. Si le patron se ruine, il perd non seulement ses capitaux, ceux de ses commanditaires, mais il est encore déshonoré et devient une misérable épave. S'il s'enrichit, il entend dénoncer sa fortune dans certains journaux, dans des réunions, à la tribune et on lui promet qu'on saura bien lui faire rendre gorge.
Crois-tu que, dans ces conditions, la position des patron soit si pleine d'attraits qu'elle doive disposer beaucoup d'hommes à engager leurs capitaux et leur existence dans l'industrie? Est-elle donc si tentante que les parents d'un jeune homme, entrant dans la vie,doivent l'encouragera jouer cette terrible partie? Et alors si les jeunes gens actifs et énergiques, ayant ou pouvant se procurer des capitaux, sont éloignés de l'industrie par les exigences socialistes, sais-tu que tu arriveras parfaitement à ton but, mon cher socialiste?oui, les salaires seront supprimés, parce qu'il n'y aura plus de patrons pour en donner, parce qu'il n'y aura plus d'usines pour t'employer, parce que tu auras beau offrir ton travail, personne ne se trouvera pour l'acheter... Et tu l'auras voulu, George Dandin!
CHAPITRE VIII. Les machines.
La haine des machines. — Caractère de la machine. — Son influence sur le salaire. — Augmente la capacité productrice de l'homme. — Augmente le nombre des emplois. — Arkwright et son métier. — Les chemins de fer et les diligences. — La valeur de l'homme est en raison de la puissance de l’outil.
Les machines! on les a représentées comme devant jeter tous les ouvriers dans la misère. Proudhon n'at-il pas été jusqu'à demander que l'on enfermât les nouveaux modèles pendant plusieurs années au conservatoire des Arts et Métiers avant d'en permettre l'emploi! Des foules en délire n'ont-elles pas voulu détruire les chemins de fer?
On ne va pas jusque-là, maintenant, mais enfin, on récrimine encore.
Peut-on nier aujourd'hui les services que nous rendent les machines? Les chemins de fer ne [sont-ils pas préférables aux diligences?
Les machines, c'est tout ce qui est en plus de nos mains et de nos ongles... C'est le perfectionnement de l'outil; or, la valeur de l'homme est en raison de la puissance de l'outil.
Si les gens qui prétendent que les machines sont une cause d'abaissement des salaires avaient raison, les salaires devraient être plus bas dans notre siècle qu'au siècle dernier.
Quand l'emploi d'une machine vient, à un moment donné, déplacer la main-d'œuvre, il peut, en effet, y avoir une crise locale. Mais cette crise ne sera que temporaire. C'est la crise de toute croissance, de toute transformation; c'est l'effort qui s'attache à toute lutte. Il n'y a pas de progrès sans déplacement d'intérêts: c'est la conséquence, aussi bien au point de vue du capital qu'à celui du travail, de toutes les évolutions économiques qui peuvent se produire dans l'humanité.
Lorsqu'une machine s'introduit dans une industrie, elle peut provoquer une dépression partielle et enlever à des ouvriers le travail auquel ils étaient habitués, les forcer à chercher ailleurs leurs moyens d'existence; c'est ainsi qu'un nouveau produit tue un produit ancien, comme les couleurs dérivées de la houille se sont substituées à la garance. Ce que nous devons considérer en retour, c'est l'augmentation de l'utilité générale.
Examinons la question au point de vue des salaires.
Un manœuvre, qui traîne une brouette, va, avec cette brouette, déplacer dans sa journée quelques mètres cubes de terre. Forcément, son salaire ne peut prélever sur l'ensemble de son travail qu'une somme extrêmement minime relativement au nombre de mètres cubes qu'il déplace.
Un mécanicien de chemin de fer peut, dans un train de marchandises, traîner 70 wagons de 10 tonnes chacun et parcourir dans sa journée 300 ou 400 kilomètres. Il est évident que le salaire du mécanicien, qui sera le double, le triple, le quadruple du salaire du manœuvre, sera minime relativement à la valeur du service qu'il rend. Ce même mécanicien peut conduire un train de 24 wagons de voyageurs; il est certain qu'il n'exercera qu'un prélèvement très faible relativement à la valeur du transport. Il peut toucher facilement un salaire de 3, 4 à 5.000 francs, sans compter d'autres avantages.
Il serait absolument impossible à un industriel, à un entrepreneur de terrassement de donner un pareil salaire à l'ouvrier dont le travail, pour prendre notre exemple, consiste uniquement à traîner une brouette.
Retenez bien ceci: plus une machine est capable d'efforts puissants, plus les ouvriers qui y sont attachés peuvent recevoir un salaire élevé, parce que le taux de leur salaire diminue relativement à l'effet utile de la machine. Ainsi, l'ouvrier mineur qui se sert de la dynamite pour extraire de la houille peut recevoir un salaire plus élevé que s'il ne pouvait l'extraire qu'avec son pic. Contrairement aux assertions de Lassalle et aux préjugés courants, tout instrument qui augmente la production a une influence heureuse et féconde sur le salaire.
En 1760, quand Arkwright prit son premier brevet d'invention pour sa machine à filer, il y avait alors en Angleterre 5.200 fileuses au petit rouet et 2.700 tisseurs, en tout 7.900 personnes employées à la filature.
Des coalitions se formèrent contre sa machine, parce qu'on prétendait que sa généralisation allait enlever le pain aux ouvriers.
Savez-vous combien il y a aujourd'hui d'ouvriers employés dans les filatures anglaises? 500.000! Donc loin de diminuer le nombre des fileurs, les machines l'ont augmenté dans la proportion de cent pour un. Les chemins de fer ont ruiné les diligences, c'est vrai: mais aujourd'hui les employés des compagnies de chemins de fer, sont au nombre de 230.000!
J.-B. Say a fait une démonstration frappante de la plus-value que les machines donnent au travail.
Supposons que 300.000 francs soient employés dans une manufacture: un tiers en matières premières et deux tiers en salaires. Le manufacturier trouve une machine qui économise la moitié des salaires. Laissera-t-il improductif les 100.000 francs économisés? Non, il diminuera le prix de ses produits proportionnellement, — par conséquent il en augmentera la consommation, et cette augmentation provoquera l'activité de son usine, donc une nouvelle demande de main-d'œuvre. S'il ne peut employer cette somme à son usine, il la déposera dans une banque, il l'emploiera en commandite, et ce capital, ainsi disponible, servira à provoquer de nouvelles entreprises qui réclameront une augmentation de l'effort humain.
On peut dire: la valeur de l'homme est en raison de la puissance de l'outil.
CHAPITRE IX. L'excès de production.
Forces productives trop grandes. — La production surabonde. — Personne ne s'en aperçoit. — Au contraire. — Ce n'est pas le désir de consommer gui fait défaut, c'est le pouvoir de consommer. — D'où provient la pléthore momentanée et limitée de certains produits.
Cependant en dépit des faits que nous venons de citer, le manifeste du congrès d'Erfurt dit: « L'outil se transforme en machine... Toujours plus considérable devient l'armée des ouvriers superflus. — Les forces productives de la société sont devenues trop grandes. »
Ce ne sont point les socialistes qui ont inventé ces récriminations, elles sont dues aux protectionnistes lui, depuis plus de trois quarts de siècle, ne cessent de pousser ce cri: la production surabonde! S'ils avaient pu réaliser leurs desiderata, ils l'auraient arrêtée au chiffre où elle se trouvait vers 1820 et l'auraient même fait rétrograder. Eu serions-nous mieux?
Le Délégué. — Il y a excès de production.
L'économiste. — Tu crois? considères-tu que de1 souliers sont utiles?
Le Délégué. — Oui.
L'économiste. — Ta femme, tes enfants, toi, vous n'êtes jamais obligés d'économiser sur la chaussure?
Le Délégué. — Hélas! si.
L'économiste. — Tu vois donc bien que la chaussure ne surabonde pas, puisque tu n'as pas autant de souliers que tu le voudrais.
Le Délégué. — C'est parce que mon salaire es insuffisant.,
L'économiste. — En un mot, tu voudrais bien être plus riche.
Le Délégué. — Oui.
L'économiste. — Pour te procurer des souliers en plus grand nombre.
Le Délégué. — Oui.
L'économiste.—Et il ne s'agit pas seulement de souliers. Tu économises aussi sur tes vêtements. Tu n'as pas autant de linge qu'il te serait utile. Enfin, sur ta table, on est obligé de calculer la quantité de viande que l'on mange; le vin est rationné; ton logement n'est pas aussi confortable que tu le désirerais. Et de quoi te plains-tu si amèrement, sinon de ce que tes ressources ne sont pas suffisantes pour tes besoins?
Le Délégué. — C'est vrai.
L'économiste. — Il y a beaucoup de gens qui ont des revenus supérieurs aux tiens et qui répètent aussi sur tous les tons; — Que je voudrais bien être riche! La dame voudrait bien une robe de soie de plus, les jeunes filles de nouvelles toilettes. La production ne surabonde donc pas, pour cette dame, ni pour ces jeunes filles, puisque leurs besoins dépassent leur puissance de les satisfaire. La production ne surabonderait que si chacun était si bien rassasié que personne n'eût plus rien à désirer: chimère évidente, car la capacité du désir est illimitée.
Le Délégué. — Vous parlez de choses de luxe.
L'économiste. — Tu appelles du luxe plus de viande et plus de vin?... Mais crois-tu que les chaussettes soient du luxe pour les hommes?
Le Délégué. — Elles sont considérées comme telles pour les militaires.
L'économiste. — Cela prouve que l'armée qui est cependant un si bel exemple d'organisation collectiviste... ne présente peut-être pas l'idéal du confort. Mais crois-tu que les bas soient du luxe pour les femmes? crois-tu que les mouchoirs de poche soient du superflu? Penses-tu que la chemise doive être reléguée parmi les objets inutiles?
Le Délégué. — Parbleu! non.
L'économiste. — Eh bien! sur les 350 millions d'habitants qui peuplent l'Europe crois-tu que tous aient des mouchoirs de poche, des chaussettes, des bas, des chemises en quantité suffisante? Il y en a pour qui ces objets sont encore un luxe. Et sur les 110 à 120 millions d'habitants des deux Amériques, combien n'en usent pas encore! Si nous passons aux 200 millions d'habitants de l'Afrique, aux 800 millions de l'Asie, aux 40 millions de l'Océanie, nous constatons que sur les 1.500 millions d'êtres humains, en chiffres ronds, qui s'agitent sur la surface de la terre, il n'y en a pas 300 millions, moins d'un sur cinq, qui aient une nourriture régulière, des vêtements et une habitation représentant ce qui est pour toi le minimum de confort indispensable! Et tu dis que la production surabond quand la grande majorité de l'humanité est encore dans la misère la plus noire, et n'a ni chemises, n bas, ni chaussettes, ni mouchoirs de poche!
Le Délégué.— Cependant les manufactures de Manchester sont encombrées. Celles de la Seine-Inférieure et des Vosges ne trouvent pas à écouler leurs produits.
L'Économiste.— Pourquoi? parce que les gens qui ont besoin de ces produits n'ont pas de produits à livrer en échange. Ce n'est pas le désir de consommer qui fait défaut, c'est le pouvoir de consommer. Et qu'est-ce que le pouvoir de consommer, sinon le pouvoir d'échanger des produits contre d'autres produits. Ce qui fait la pléthore des marchandises sur un point, ce n'est pas l'excès de production de cette marchandise, — pourvu qu'elle corresponde à un besoin, — c'est l'impossibilité pour ceux qui le voudraient, de se la procurer. Ce n'est pas de l'excès de production dont il faut se plaindre, mais de l'insuffisance de production qui empêche l'échange des équivalents.
En un mot, la pléthore de certains capitaux circulants sur un point ne provient pas de leur abondance, mais de la rareté de leurs équivalents, résultant soit du coût de la production de ceux-ci; soit des obstacles naturels, comme l'espace; artificiels, comme le protectionnisme et le fisc.
CHAPITRE X. Les crises économiques.
Elles proviennent d'un excès de consommation. — L'agriculteur et la mauvaise récolte. — La crise des chemins de fer. — Répercussion.
Cette fois, ce n'est plus seulement le délégué à la Bourse du travail, le disciple de Lassalle, de Karl Marx qui m'interrompt. C'est toute personne parlant d'économie politique; et les hommes qui en parlent, sans l'avoir jamais étudiée, sont aussi nombreux que ceux qui donnent des conseils médicaux à leurs parents et à leurs amis. On me dit:
— Vous ne nierez pas que les crises commerciales ne soient dues à un excès de production.
— Je le nie!
— Vous gâtez votre thèse.
— Je ne soutiens pas une thèse: je démontre des vérités, et je vais vous prouver que les crises économiques ne sont pas dues à un excès de production, mais à un excès de consommation.
Le blé ne vient pas tout seul dans un champ. Il y faut de la main-d'œuvre qui se paye, le travail de chevaux dont l'entretien et la nourriture sont coûteux,, des engrais et amendements, de la semence, enfin toutes choses ayant une valeur. Si la récolte est bonne, il y a remboursement de toutes ces dépenses, plus une certaine rémunération qui est le profit de l'agriculteur.
Quand par suite d'accidents, sa récolte n'est pas suffisante pour compenser les avances qu'il a faites, alors, il a commis un excès de consommation: et il n'a pas de produits à échanger contre des machines agricoles, contre des habits, des chaussures, des attelages, etc. Il consomme moins de produits manufacturés, parce qu'il n'a pas le pouvoir de les acheter.
Voilà l'origine d'un grand nombre de crises économiques; et le déficit qui les provoque est le contraire de l'excès de production.
De même, à quoi était due, par exemple, la grande crise des chemins de fer aux Etats-Unis? On a englouti dans des travaux de terrassement, dans les percements de montagnes, dans la construction de viaducs, dans la pose de millions de tonnes de rails, des capitaux considérables. Ces capitaux ont perdu leur pouvoir d'achat. Jusqu'au moment où l'usage de ces voies l'aura reconstitué, il y a eu excès de consommation: et par conséquent crise, crise qui se répercute sur les usines et manufactures qui, elles aussi, ont fait des excès de consommation en outillage, en achats de matières premières, en payement de main-d'œuvre, relativement aux débouchés qui se ferment devant elles.
CHAPITRE XI. Le bon marché.
Contradiction. —L'évolution économique. — Augmenter toujours la production. — Pas de crainte d'excès.
— Oui, mais il y a d'autres crises, dit-on, des crises qui résultent du bas prix des marchandises, de leur trop grande abondance. Ainsi n'a-t-on pas été obligé de mettre un droit de 8 francs sur les blés pour rehausser le prix des blés français, autrement l'agriculteur ne trouvait plus son compte à cultiver? Oui, la préparation de la récolte était bien un excès de consommation; car le bas prix de sa marchandise ne lui permettait pas de récupérer ses avances.
Mais quel est donc le remède, en dehors du droit de 5 francs, que lui proposent les sociétés d'agriculture, les ministres de l'agriculture et tous ceux qui parlent, plus ou moins officiellement et avec plus ou moins d'autorité au nom de l'agriculteur? ne lui indiquent-ils pas des amendements, de meilleures semences, de nouveaux modes de culture qui tous doivent avoir pour résultat, s'ils réussissent, d'augmenter la production du blé, de la faire passer de 15 ou 16 hectolitres par hectare à 30 ou 40, d'augmenter l'excès de production et d'en avilir le prix! Avez-vous entendu un agriculteur dire: le remède, ce serait de diminuer le rendement du blé à l'hectare?
Non. Tous ont proposé de diminuer le prix de revient de la production, mais comment? en augmentant cette production!
Tous, en un mot, ont proposé d'avilir le prix du blé, au moment même où par des tarifs de douanes, ils essayaient de faire de la cherté. Cette contradiction ne montre-t-elle pas que, malgré tous les sophismes, là est l'évolution économique: toujours produire à meilleur marché et par conséquent augmenter toujours l'excès de production — en admettant qu'il y ait jamais excès de production de blé, quand, dans l'univers, il y a tant de centaines de millions d'êtres humains qui ne mangent pas à leur appétit!
CHAPITRE XII. Jeu de dupe.
L'art de diminuer la production. — Heures de travail. — Fermer les débouchés. — Et la porte au nez. — Machine à produire et machine à vendre. — Singulière fraternité. — Double choc pour le travailleur. — Capacité de crédulité. — Ingratitude.
Je sais, socialiste, que tu es plus logique et que tu t'ingénies à diminuer la production par plusieurs procédés.
D'abord en réduisant la journée de travail à huit heures,tu t'imagines diminuer la production. Mais pourquoi ne demandes-tu pas l'anéantissement des 5 millions de chevaux vapeur qui représentent l'effort de plus de 100 millions d'hommes? Tu n'oses. Je t'accuse de transiger. Tu n'as pas le courage d'aller jusqu'au bout de tes conceptions. Et puis pourquoi huit heures? pourquoi pas deux? pourquoi pas une? pourquoi pas zéro? la diminution de la production serait encore bien plus effective — et pour ton plus grand dommage, malheureux.
Mais si tu réduis ta production, tu augmentes le prix de revient; donc tu fermes les débouchés de ton produit: et par conséquent, tu supprimes du travail pour toi et tes camarades. Ta. malice consiste à te fermer au nez la porte de l'atelier, de l'usine et de la manufacture. Ce n'est pas plus pour son agrément que pour le tien que l'industriel produit des objets pour l'usage des autres et non pour le sien. S'il organise une machine à produire, c'est parce qu'il espère bien qu'il aura une machine à vendre supérieure; et tu veux supprimer cette dernière en augmentant le prix de revient de la marchandise que tu fais. Si tu ne veux pas que la marchandises sorte, alors pourquoi entrerais-tu dans l'atelier? qu'y ferais-tu?
Non, seulement tu te mets ainsi dans cette situation mauvaise comme producteur, mais tu te mets aussi dans une situation mauvaise comme consommateur. Vraiment, tu as une singulière manière de manifester tes sentiments démocratiques, en voulant faire de la cherté. Qui frappe-t-elle donc? sinon tes frères les travailleurs, et leurs femmes et leurs enfants, puisqu'avec la même somme, ils pourront se procurer moins d'objets. Tu commences par prouver ta fraternité à leur égard en réclamant la gêne pour eux, mais tes camarades te témoigent les mêmes sentiments altruistes, en demandant que tu subisses également les effets de cette politique économique. Vraiment tes docteurs et toi, vous avez une étrange façon de comprendre tes intérêts.
Dans cette politique, tu es frappé sur la joue droite comme producteur, et sur la joue gauche comme consommateur. Si tu dis: Amen, cela ne prouvera pas la douceur de ton caractère, mais ta capacité de crédulité.
Réfléchis donc que s'il y a quelqu'un qui aies tout à gagner au bon marché, c'est toi.
Tu en profites d'abord comme travailleur: car plus il y a de produits à échanger contre leurs équivalents, plus la consommation grandit: par conséquent, la demande de travail ne cesse pas d'augmenter et ton salaire de s'élever.
Tu en profites ensuite comme consommateur: et à salaire égal, tu peux te procurer plus d'objets à ta convenance. Quand avec 10 francs de salaire, tu peux acheter une paire de souliers que tu aurais payés autrefois vingt francs, ton salaire vaut le double.
Lorsque tu te fais protagoniste de la cherté, tu continues à jouer les George Dandin.
Ingrat! depuis plus d'un demi-siècle, tu n'as pas cessé d'être le favori de cette loi de l'offre et de la demande contre laquelle tu fulmines tes anathèmes!
71.André Liesse on "State Socialism" (1894)↩
[Word Length: 6,837]
Source
André Liesse, La question sociale (La vie nationale. Bibliothèque des sciences sociales & politiques) (Paris: Léon Chailley, 1894). Chap. IV "Solutions des socialistes d'État", pp. 95-112; Chap. V "Solutions des socialistes d'État (Suite). Quelques exemples" pp. 113-26.
CHAPITRE IV. Solutions des socialistes d'État.
Définitions. — Le socialiste d'État et le socialiste proprement dit. — La propriété individuelle conservée en principe. — L'intervention de l'État. — Classification. — Conséquences de l'extension des interventions de l'État. — Le danger budgétaire. — Le déplacement des inégalités. — Une forme de concurrence multipliée: l'intrigue.
Il est assez difficile de définir ce que l'on entend par socialisme d'État. Pourtant, le socialiste d'État n'est point une espèce rare. On en trouve un peu partout, à des degrés divers. Les uns le sont par sentiment — ce sont les plus nombreux; — les autres par système. Tous invoquent l'État, providence inépuisable.
Dans le langage courant, socialiste d'État et interventionniste sont synonymes. Néanmoins le mot interventionniste n'est pas suffisant pour expliquer ce que c'est qu'un socialiste d'État. En effet, à moins de supprimer tout gouvernement, il faut bien admettre que l'État intervienne et soit chargé de certaines attributions générales. Un économiste libertaire, qui n'est point partisan du socialisme d'État, même sous sa forme la plus adoucie, reconnaît la nécessité d'un pouvoir chargé de faire respecter les contrats, la liberté des individus et leur sécurité. C'est là un minimum d'intervention, assurément, mais c'est toujours une intervention. Je viens d'indiquer, à la fin du dernier chapitre, par quels programmes identiques les socialistes possibilistes se reliaient aux socialistes d'État. Socialiser, ou faire services publics, les transports, la Banque de France, l'industrie houillère, etc., réglementer le travail et la durée du travail, forcer l'État et les employeurs à constituer des caisses de retraites et d'assurances aux employés, accorder des subventions, etc., etc., tels sont les points principaux du programme maximum des socialistes d'État. On voit quelles nuances se dessinent entre l'État « juge et gendarme » et l'État chargé d'une partie de l'industrie, puis réglementant le reste des industries privées dans le but d'empêcher les forts d'écraser les faibles.
Mais ce qui différencie le socialiste d'État du socialiste proprement dit, c'est que le premier affirme son respect pour la propriété privée et l'initiative individuelle. Ce respect est assurément fort limité, puisque le socialiste d'État limite la propriété privée et l'initiative individuelle; néanmoins il prétend laisser une concurrence libre assez forte pour stimuler le zèle de l'État. Car l'État est pour lui le grand juge ès questions sociales. Aussi en fait-il une sorte de réalité objective dans laquelle il place toute sa confiance. Jamais aux plus croyants, cependant, l'État-Dieu n'est apparu.
Le socialisme d'État n'a point manqué de théoriciens. Les socialistes de la chaire l'ont enseigné en Allemagne, et ont pu croire, un temps, au succès scientifique de leurs doctrines. La mode s'en est allée, et puis les socialistes purs, concurrence redoutable, lui ont porté le dernier coup. Ils n'ont pas eu de peine à démontrer que ce socialisme hybride ne résolvait rien, au fond, et qu'il ne faisait que déplacer les inégalités, comme nous allons le voir. Malgré qu'ils usent beaucoup eux-mêmes de l'État, dans leurs projets de réformes, les socialistes proprement dits assurent n'avoir pour l'État qu'une tendresse temporaire. L'État pour eux est une sorte de forme monarchique destinée à disparaître quand régnera l'universelle compréhension de la solidarité humaine. Cependant, ils entendent user de la contrainte pour établir tout d'abord l'égalité des conditions, et conserver l'autorité de l'État, absolument nécessaire pour résoudre le problème social à la façon dont ils le posent.
Le socialiste d'État garde au contraire une foi entière en son idole. La plupart du temps cette foi est inconsciente. Elle semble aussi, au premier abord, assez naturelle. L'État n'est-il pas la puissance supérieure qui, dans sa forme écrite, la loi, et dans sa forme exécutive, le gouvernement, intervient chaque jour, au nom des intérêts sociaux? En partant de cette notion, et en interprétant l'expression « intérêt social » suivant sa fantaisie, on arrive à faire agir l'État, sans plus raisonner, à propos de tout. Les innombrables propositions de loi dues à « l'initiative parlementaire » sont une preuve que de toutes les religions, la religion du socialisme d'État est la seule en progrès. Si donc la théorie du socialisme d'État est scientifiquement très en baisse, il n'en est pas ainsi de son succès auprès des hommes politiques, et de sa mise en application.
Car si la théorie de l'État-Providence423 — entité métaphysique — est entourée de beaucoup d'obscurité, les ressources ou impôts, levés au nom de l'État, ont, eux, par contre, une réalité trop facilement appréciable. Or la force et l'extension du socialisme d'État tiennent à l'augmentation de la richesse générale qui offre une proie fiscale assez facile en certains pays, et permet de faire croître les budgets.
On comprend donc qu'il y ait beaucoup de socialistes d'État, et qu'il soit assez difficile de dire où s'arrête le programme minimum de cette catégorie de réformateurs. Nous connaissons le programme maximum — esquissé plus haut — programme qui relie les avancés du socialisme d'État aux possibilistes modérés. Mais où commence le socialiste d'État? Tout dépend évidemment des idées que l'on a, et sur les attributions nécessaires, et sur les attributions facultatives de l'État et sur celles qui sont absolument dévolues aux particuliers. La ligne de séparation n'existe donc pas bien nettement définie. Il y a une zone neutre. Elle s'étend du libertaire qui réduit les attributions de l'État au minimum, c'est-à-dire à la justice, à la sécurité et à la confection de grands travaux publics, et va — sans les comprendre bien entendu — jusqu'à ceux qui voudraient voir l'État entrepreneur d'industrie, et le font intervenir pour régler les rapports entre employeurs et employés par des lois générales visant à détruire le principe de la liberté du travail. On ne peut donc classer absolument, dans la catégorie des socialistes d'État, les partisans de certaines attributions à l'État: telles que la gestion des postes et des télégraphes, de l'Assistance publique limitée aux besoins réels, etc. Il y a, en cette matière, une question de mesure. On ne peut, en effet, passer d'un régime de réglementation à un régime de liberté, brusquement, et sans évoluer. Il faut que l'apprentissage de la liberté se fasse progressivement. Cette zone neutre n'en présente pas moins la grosse inconnue de l'avenir en ce qui regarde les tendances de la politique économique.
Cette zone neutre s'étend plus ou moins, suivant le degré de puissance productive et d'activité économique d'une société. Dans une nation où sont établies — et appliquées réellement — la liberté du travail et l'égalité devant la loi, où les individus ont de plus en plus la perception du mécanisme de la concurrence, de ses avantages et de ses désavantages, est socialiste d'État celui qui fait intervenir l'État dans le contrat de prestation de travail. S'il s'agissait, au contraire, d'une nation où les conditions du développement libre de l'activité n'existeraient pas, ne serait point forcément socialiste d'État, celui qui admettrait une intervention vieille déjà, non parvenue au degré d'évolution nécessaire pour la supprimer.
Ces distinctions sont utiles pour juger des solutions — il est plus exact de dire des remèdes — recommandés et appliqués par les socialistes d'État. Le dosage de ces remèdes varie, en effet, avec chaque groupe, chaque individu, et aussi trop souvent, hélas! avec les intérêts électoraux. Il suffit de parcourir la liste interminable des vœux émis par les conseils généraux, vœux tendant presque tous à l'intervention de l'État, pour se faire une idée du nombre toujours croissant des socialistes de cette catégorie.
Le socialiste d'État n'a point, en matière sociale, la prétention de résoudre complètement le problème, d'anéantir les inégalités par l'organisation d'un milieu nouveau. Il se prétend plus « pratique » que les théoriciens du socialisme ou de l'économie politique, et assure qu'au moyen de l'intermédiaire « État » il est possible d'arriver à une diminution assez grande de l'inégalité des conditions. Son instrument, nous l'avons déjà dit, est l'impôt. Par l'impôt, l'État, grand justicier, prend à ceux qui possèdent des richesses pour adoucir le sort de ceux qui n'en ont pas. Il considère volontiers l'ouvrier comme un mineur qu'il faut protéger contre les exigences des employeurs, et pour lequel il faut toujours prévoir l'avenir.
Il le prend à sa naissance (déclaration de mise en nourrice), le surveille en nourrice; le suit comme apprenti dans l'atelier industriel (réglementation du travail); voudrait faire l'État assureur pour les accidents qui peuvent lui survenir; et enfin appuie de toutes ses forces la création d'une caisse des retraites subventionnée obligatoirement par l'État et les employeurs.
On pourrait donc diviser les socialistes d'État en trois grandes classes, par ordre décroissant d'action interventionniste.
Dans la première se trouvent tous ceux qui remettraient à l'État l'exploitation et l'administration des chemins de fer, des mines, de la banque d'émission, et de certaines autres grandes industries ou services communaux; ces socialistes, à plus forte raison, sont partisans des autres interventions.
La seconde classe — la plus nombreuse — comprend des esprits moins aventureux. Ils se défient de l'État entrepreneur. Ils le voudraient surtout paternel, et plutôt contrôleur. Ils ont grande confiance dans l'inspection du travail, dans les réglementations minutieuses, et volontiers chargeraient l'État de gérer — avec toutes sortes de précautions — une caisse des retraites générale pour la vieillesse.
A la troisième classe enfin appartiennent les timides qui ne demandent point à l'État d'intervenir par ses fonctionnaires, mais bien par des subsides ou des subventions à des sociétés. Ce sont eux aussi qui, parfois, réclament des avantages spéciaux dans les adjudications de travaux publics pour les associations ouvrières, etc.
Mais ces distinctions approximatives établies, il n'en demeure pas moins vrai que les remèdes préconisés par les socialistes d'État sont tous de même essence, et se résolvent, en définitive, par une augmentation des dépenses budgétaires. Ces remèdes sont d'ailleurs des remèdes empiriques; ils n'opèrent point par eux-mêmes et exigent une appréciation, un diagnostic et un dosage. Qui donc appliquera cette thérapeutique sociale? L'État, ainsi que nous l'avons dit, est une entité qui n'a rien d'objectif. Il est représenté — surtout dans les pays où n'existe pas la monarchie absolue — par un personnel politique mobile et très changeant. Les lois, étroitement interventionnistes, exigent la rédaction de longs règlements d'administration publique. Les fonctionnaires chargés d'assurer l'exécution de ces lois ont, eux aussi, à tenir compte d'une quantité considérable de questions incidentes au cours de l'application. L'État s'émiette ainsi, se disperse en une foule d'intermédiaires424 qui vivent de la vie humaine avec leurs passions, leurs préjugés, leurs intérêts. Déjà lorsqu'ils sont chargés de veiller à l'exécution de règlements généraux qui n'atteignent pas directement les particuliers, ils éprouvent des difficultés insurmontables, ou se laissent entraîner par leur propre intérêt à trahir l'intérêt de l'État. Quelle efficacité peut donc avoir leur action, lorsqu'elle s'exerce sur la vie intime des individus, sur des intérêts immédiats, réveillas, excités encore par la curée offerte?
L'État, comme les divinités hindoues, possède une foule de bras. De ce que ces bras parviennent à prélever et à percevoir l'impôt sur toutes les formes de la richesse, on en a conclu qu'il pouvait, de même, opérer une distribution avec la même facilité. Il n'en est rien. Des injustices nombreuses sont commises; les inégalités se déplacent au profit de personnes plus intrigantes ou plus habiles dans l'art de se faire protéger. La loi devient aussi souvent un moyen de tyrannie entre les mains de ceux qui l'appliquent. Puis les situations changent, les progrès industriels modifient chaque jour la vie industrielle. Il faudrait à chaque matière nouvelle, à chaque progrès réalisé refaire le règlement. L'histoire des lois interventionnistes prouve combien elles deviennent rapidement surannées et de quelle mince efficacité elles sont en beaucoup de cas.
On en a un exemple dans la loi sur le travail en Angleterre, rédigée pour la première fois par Robert Peel, le père du baronnet, vers le commencement de 1802. Depuis ce temps, la loi a été remaniée en 1815, en 1819, en 1825, en 1833, retouchée nombre de fois en ses règlements pour aboutir à la loi du 27 mai 1878, qui est loin de donner les résultats réels qu'on en attendait. En France la loi de 1874 a présenté les mêmes inconvénients. Remaniée, elle est devenue la loi du 2 novembre 1892, dans laquelle on introduisit des journées de travail de durée différente pour les femmes et les enfants. Depuis on a reconnu l'impossibilité, pour les établissements industriels, d'occuper ensemble des hommes adultes travaillant douze heures, des femmes ne travaillant que onze heures, et des enfants ne consacrant que dix heures au travail. On est revenu sur ces dispositions et l'on a unifié la durée de la journée du travail industriel pour les adultes, les enfants et les femmes en la fixant à onze heures. Mais, on le voit clairement, il a fallu procéder, ici, par voie de réglementation uniforme, ce qui est contraire à l'esprit lui-même du socialisme d'État, dont le but est de faire des distinctions afin d'avantager les faibles.
Mais une des conséquences les plus funestes de l'intervention de l'État est de faire disparaître la responsabilité individuelle, principalement en ce qui regarde le contrat de travail. L'entrepreneur gêné par une réglementation étroite est enclin à rejeter sur l'État toute la responsabilité dont il était forcé auparavant d'assumer tout au moins une partie. Les résultats de la loi Plimsoll425 en sont — parmi cent autres lois — une preuve convaincante. La loi Plimsoll fut imaginée en Angleterre dans le but de protéger la vie des marins contre le danger que leur faisaient courir des armateurs, trop portés à diminuer, par des moyens les plus condamnables, le prix du fret, en employant, par exemple, des navires mal construits ou trop chargés. Aucune intervention, assurément, ne paraissait mieux fondée; aucune ne pouvait être dictée par un sentiment plus louable. Or, il résulte des travaux de M. Chamberlain et des enquêtes faites par le Board of Trade, que cette loi a présenté plus d'inconvénients que d'avantages. Elle a, en effet, supprimé complètement la garantie de responsabilité — si restreinte qu'elle fût — des armateurs. Cette responsabilité, du reste, sans loi interventionniste, pouvait être rendue, par une sévère administration de la justice, plus réelle et plus efficace. La loi Plimsoll, en outre, n'a pu être intégralement appliquée par suite du contrôle plein de détails et de difficultés qu'elle exigeait. Il eût fallu, pour la faire observer dans sa lettre, une armée de fonctionnaires; et encore les résultats probables étaient-ils loin, même en ce cas, d'être ceux que l'on espérait.
Car, ainsi que nous l'avons fait remarquer plus haut, l'État entité métaphysique est représenté par une grande quantité de rouages, qui, eux, sont tellement objectifs et matériels qu'ils finissent par causer une entière déperdition de la force de réglementation. « L'action de l'État, dit excellemment M. Léon Say,426 est une force, les agents de l'État sont un mécanisme dont les frottements absorbent une partie et quelquefois la totalité de la force. Ceux qui veulent employer la force que développe l'action de l'État, deviennent le plus souvent des utopistes, parce qu'ils se désintéressent des méthodes d'application et comptent pour rien les intermédiaires, c'est-à-dire les pertes que subissent toujours les forces dans leur transmission. C'est ce qui arrive à la plupart de ceux qui préconisent l'emploi des forces naturelles, comme les vents, les marées, les chutes d'eau, parce qu'elles s'offrent à l'homme avec une apparence de gratuité. Ils deviennent de purs utopistes quand ils ne tiennent pas compte des dépenses nécessaires pour capter ces forces, ni des pertes d'énergie qu'on ne peut éviter au cours de la transmission. »
Et puis une réglementation en appelle une autre. Une fois entré dans cette voie, il est difficile de limiter l'action de l'État. C'est un engrenage dans lequel, peu à peu, disparaît la liberté du travail et l'initiative individuelle. Aussi les socialistes d'État sont-ils des auxiliaires précieux pour les socialistes proprement dits, pour ceux tout au moins qui croient à une évolution sociale lente, passant, avant d'aboutir au collectivisme, par la période des services publics.
Cet enchaînement des interventions successives et de plus en plus profondes s'explique très logiquement. L'État, par exemple, donne des subventions à des sociétés plus ou moins libres, mais s'administrant elles-mêmes par des membres qu'elles délèguent. Nous supposons que ces sociétés ont pour but la mutualité ou encore la coopération sous toutes ses formes. Or, il se peut très bien que les chefs de ces associations abusent de l'inexpérience des associés ou de leur ignorance, et administrent, à leur fantaisie et suivant leur intérêt particulier, les fonds provenant des cotisations et de l'État. En cette circonstance, l'État devrait laisser faire et se contenter d'améliorer les lois réglant la responsabilité de ces administrateurs. Mais point. En vertu du principe sur lequel s'appuient les socialistes d'État, l'État doit intervenir pour protéger les associés qui se trouvent lésés par leurs délégués. N'est-ce pas son rôle d'État, son devoir de protecteur? Il deviendra bientôt contrôleur et pour peu qu'on démontre l'inefficacité de sa surveillance, se transformera facilement en administrateur.
Dans tous les cas, quel que soit son degré d'intervention, il ne fait que déplacer les inégalités, et presque toujours de façon très injuste. Le socialiste d'État ne considère pas, en effet, l'impôt comme une contribution levée dans le but d'assurer seulement l'exercice des attributions nécessaires de l'État (justice, police, défense du territoire, travaux publics, etc.), mais en outre comme un moyen de corriger, dans certaines limites, l'inégalité des conditions. Or, si l'on a fait de très belles maximes sur la manière d'asseoir et de prélever l'impôt, on n'a jamais pu, en pratique, les appliquer bien exactement. La répartition des charges présente des difficultés très grandes et qui sont dans la nature des choses. Les services que rend l'État à chaque particulier ne peuvent être appréciés; ils ne font point l'objet d'un contrat précis, d'un échange de services. D'où la nécessité de faire un bloc des dépenses de l'État, du département, de la commune, et de les répartir sur les contribuables suivant des procédés divers, plus ou moins conformes aux principes de justice et de proportionnalité. La qualité d'ailleurs que les États, toujours à court d'argent, demandent à l'impôt, est la facilité et la rapidité de perception. Il semble donc que plus on lève de contributions, plus on tende à commettre des injustices. Mais nous ne sommes là qu'à la première phase de l'intervention, celle où le contribuable, quoique bien désarmé, peut se défendre et essayer de faire valoir ses droits. La seconde phase de l'opération présente encore plus de difficultés. Ainsi que nous l'avons montré, l'action-force de l'État se perd peu à peu par la transmission. L'administration chargée de la distribution des secours ou des subventions, par exemple, absorbe une grande partie des fonds destinés à diminuer les inégalités.427 Ce sont aussi les plus influents, les plus intrigants qui obtiennent les faveurs de l'État. Car quels moyens peut-on employer pour distinguer ceux qui auraient droit à ces largesses de ceux qui ne les méritent pas?
On ne fait ainsi que remplacer la concurrence économique par une autre concurrence se manifestant sous la pire de toutes les formes: l'intrigue, et développant les plus mauvaises passions. Plus logique, le socialiste proprement dit s'essaie à supprimer toute concurrence en égalisant tout travail, et toute distribution des produits de ce travail. Le socialiste d'État ne tient aucun compte de cette force, la concurrence, ou, du moins, croit pouvoir la diriger au gré de ses désirs et ne fait que créer des mœurs déplorables, et au point de vue politique, et au point de vue économique. Le socialisme d'État enlève toute confiance en l'initiative individuelle, supprime l'émulation économique, consacre les injustices les plus flagrantes sous le couvert d'une prétendue justice sociale, et fait des peuples de mendiants. L'instrument dont il se sert, l'impôt, est, en outre, un instrument de ruine pour la fortune publique. L'accroissement des budgets n'a pas seulement pour cause les dépenses de guerre, mais aussi des lois, dites protectrices, dont l'application entraîne de grosses dépenses souvent plus élevées qu'on ne le prévoit lorsqu'on les vote.
Si nous nous sommes peut-être un peu plus étendu sur la critique des remèdes préconisés par les socialistes d'État que sur celle des solutions présentées par les socialistes proprement dits, c'est qu'ici nous avons, sous les yeux, la mise en pratique du système et ses résultats. Ce ne sont plus des hypothèses, des conceptions et des constructions a priori, mais des faits. Le socialisme d'État est très répandu, parce que, en face des cas cruels d'inégalité des conditions, il est l'idée première qui germe dans l'esprit de tout homme habitué à considérer l'État comme la source de toute force et de toute justice.
Il nous reste, maintenant, après ces aperçus généraux, et avant d'entrer dans l'examen de quelques applications de ce socialisme hybride, à définir une catégorie d'interventionnistes que, le plus souvent, on classe parmi les nombreuses variétés du socialisme d'État.
Le protectionniste est-il réellement un socialiste d'État ? Si l'on s'en tient à la formule interventionniste, il rentre bien dans les conditions qui font le socialiste d'État. Car, lui aussi, entend corriger une inégalité — qu'il appelle inégalité des conditions économiques — par l'intervention de l'État et la création de droits dits compensateurs. Il a du reste les autres caractères du socialiste d'État: il admet une économie politique nationale, il n'est point internationaliste au point de vue de l'échange des produits et prétend défendre l'intérêt général. Seulement il existe une différence entre le socialiste d'État tout court et le protectionniste. Le socialiste d'État intervient au nom des déshérités de la vie, et pour cela réglemente le travail; le protectionniste intervient au nom de son intérêt propre, qu'il présente comme étant l'intérêt général. Le premier voudrait protéger le travail, le second entend protéger son capital. Assurément le protectionniste s'intitule assez souvent défenseur du travail national. Il soutient que, sans les droits de douane, son industrie n'existerait pas et qu'alors, les ouvriers qu'il emploie seraient sans pain. Il prétend donc résoudre, de cette façon, la question sociale, tout au moins envisagée comme actuelle. Mais la différence — nullement théorique — la plus certaine, c'est que l'intervention de l'État se trouve être le plus souvent efficace à l'endroit du protectionniste, tandis qu'elle est plutôt nuisible aux ouvriers. Sur un point encore, les protectionnistes se séparent volontiers des socialistes d'État. Ils ne sont point partisans d'exclure les ouvriers étrangers, de leur interdire l'entrée du pays; pas plus que, conséquemment, ils n'admettraient une loi fixant un minimum de salaire ou réglementant la journée de travail. Leur moyen d'action est le même que celui des socialistes d'État quand ils se font donner des primes. La prime vient de l'impôt régulièrement levé. Mais l'intervention de l'État se manifeste pour eux de façon plus puissante par le droit de douane.
Nous avons montré dans le chapitre II, livre Ie, comme quoi les salaires ne se trouvaient point nécessairement protégés par les droits de douane. Nous ne reviendrons pas sur ce point, d'autant plus que les protectionnistes ne s'occupent de la question sociale qu'en ce qui leur est utile pour l'application de leur théorie spéciale. Ils n'acceptent point l'appellation de « socialistes d'État », et verraient avec effroi leurs industries expropriées par ce même État.
Bien loin de tendre à diminuer l'inégalité des conditions, les droits de douane l'augmentent. De là une conséquence qui se produit d'ailleurs pour le socialisme d'État: c'est que chacun désire être protégé.428 Il est bien évident qu'à la limite si tout le monde était protégé, personne ne le serait. L'inégalité des conditions demeurerait. Elle serait aggravée par ce fait que les derniers placés dans la série des inégalités seraient plus malheureux qu'auparavant.
CHAPITRE V. Solutions des socialistes d'État (Suite). Quelques exemples.
Examen de quelques remèdes proposés par les socialistes d'État. — Leurs points communs avec les socialistes proprement dits. — La journée de travail. — Le crédit par l'État. — Nationalisation des mines, chemins de fer, etc. — L'extension sans limites de l'assistance publique.
Le programme maximum des socialistes d'État, de ceux qui confinent aux socialistes possibilistes, comprend les réformes suivantes, que nous choisissons parmi les plus caractéristiques. Certaines de ces mesures interventionnistes sont acceptées par les socialistes purs pour des raisons quelque peu différentes souvent de celles données par les socialistes d'État.
1° Réduction légale de la journée de travail; maximum de la durée de cette journée, huit heures.
2° Crédit par l'État (nationalisation de la Banque de France).
3° Assurances en général: caisses des retraites, accidents, etc.
4° Les mines et les chemins de fer à l'État qui les exploiterait.
5° Extension indéfinie de l'assistance publique.
Journée de huit heures. — La limitation légale de la journée de travail est, comme on le sait, recommandée par les socialistes d'État de tous les pays où se sont développés les progrès industriels. Toutes les écoles socialistes proprement dites ont fixé cette limitation à huit heures. Le but économique de la réduction de la journée de travail, est de permettre à un plus grand nombre d'ouvriers de travailler. Ce serait un remède contre les chômages. En dehors de cette considération, les socialistes voient, surtout, un avantage dans cette mesure: les trois-huit leur permettent de se mieux connaître, de s'unir, de faire de la propagande. Ce temps de huit heures est, du reste, un maximum. Les Trades-Unions australiennes le fixeraient à six heures, M. Hyndmann à quatre heures, M. J. Noble, de New-York, à deux heures, etc. Mais les socialistes d'État ne descendent pas en général au-dessous de huit heures.
Nous n'entrerons pas dans l'analyse des causes qui rendent la journée de huit heures impraticable pour toutes les industries et pour les différents pays. Cette « égalisation » n'a cure ni du « milieu » ni de la latitude, ni des races, ni de la nature des produits fabriqués — ce qui est contraire à tout esprit scientifique. Elle fait aussi bon marché de cette grosse inconnue que nous avons signalée plusieurs fois: les mouvements de la population. Nous ferons remarquer, cependant, que cette « égalisation » tend à rendre les inégalités encore plus grandes sous son apparence de nivellement. Le travail est, en effet, chose complexe. Divers éléments ou forces se combinent pour le produire: force musculaire, force mentale, force morale, hérédité, habitude ou entraînement, etc. Deux individus travaillant, huit heures chacun, pour fabriquer le même produit, dépenseront des forces très inégales. Si donc la journée est réduite, l'avantage est pour celui qui est habile, qui peut, sans fatigue, produire en huit heures assez pour que l'entreprise y trouve son compte, tout en maintenant le salaire d'une journée de dix à onze heures. Le faible y perdra. Ou il travaillera avec plus de peine, pour produire autant en huit heures qu'en dix heures, ou il travaillera selon ses forces et gagnera moins.
La journée de huit heures, pas plus que de toute autre durée, n'est nullement repoussée par les économistes lorsqu'elle est la conséquence d'une entente conclue entre ouvriers et employeurs, lorsqu'elle produit des résultats avantageux pour la production en général, c'est-à-dire pour les uns et les autres. La journée de travail tend à diminuer. Elle a baissé dans les houillères où elle ne dépasse guère neuf heures. Les perfectionnements mécaniques sont la raison principale de cette diminution et aussi la capacité technique plus élevée des ouvriers.
En tout cas une fixation uniforme de la journée de travail appelle une réglementation internationale, puisque la nation qui adopterait cette réforme diminuerait, selon toutes probabilités, sa puissance productive, en regard d'une autre nation qui ne modifierait pas sa législation sur ce point. De là un gros obstacle.
De plus, un corollaire de la fixation uniforme de la journée de travail à huit heures, serait la fixation d'un minimum de salaire. Cette dernière intervention de l'État supprimerait l'entreprise privée. On voit, ainsi, que les socialistes d'État, quoique affirmant leur respect pour la propriété privée et l'initiative individuelle, sont logiquement entraînés vers l'appropriation communiste.
Le crédit par l'État. — Le crédit par l'État n'est pas chose nouvelle. Il a été prôné par les socialistes de 1848. Proudhon voulait une banque du Peuple avec crédit gratuit. Les socialistes d'État d'aujourd'hui ne vont pas si loin. Ils se prétendent plus « pratiques » et conserveraient un intérêt avec taux réduit. L'État banquier ferait crédit aux associations ouvrières, aux syndicats ouvriers ou agricoles, etc.
La proposition peut étonner par ce temps d'abondance des capitaux et de baisse du taux de l'intérêt. Il semblerait que ceux qui offrent du crédit suffisent à pourvoir ceux qui sont capables d'en bénéficier. Tout observateur, s'il n'est pas soumis à l'esprit de système, constate que c'est bien plus l'emprunteur sérieux, apte à se servir productivement des capitaux à lui prêtés, qui manque, que le prêteur de bonne volonté. Comme l'on peut s'assurer par des faits journaliers de l'influence qu'exerce, sur ce point, l'initiative privée, nous nous bornerons, ici, à montrer en quelques lignes, que le crédit aux mains de l'État est la plus dangereuse des utopies, parce qu'elle est susceptible d'un commencement d'exécution.
Devenu prêteur public, l'État serait représenté par des personnes chargées de mesurer la solvabilité des solliciteurs. Que seraient ces délégués? Des fonctionnaires ou tout au moins des hommes choisis par le pouvoir exécutif, soit, par le gouvernement. Or, on peut juger de l'influence qu'aurait, en ces matières toutes financières cependant, la politique par le rôle qu'elle joue en ce moment dans le pillage des budgets. Et que de difficultés ne surgiraient pas lorsqu'il faudrait faire payer les débiteurs en retard, lorsqu'une crise surgirait et servirait de prétexte à des prorogations d'échéances dangereuses par contrecoup pour le Trésor!
Puis, dans le but de combler les pertes subies, l'État aurait recours à des impôts nouveaux ou à des surtaxes. Il déplacerait injustement les inégalités, prenant à celui qui aurait pu acquérir quelque richesse au milieu de toutes ces réglementations et malgré les difficultés d'action de l'initiative privée, pour couvrir les fautes des imprévoyants et des incapables.
L'autre moyen, l'émission de billets de banque, toujours par l'État, ne vaudrait pas mieux. Ce droit d'émission livré aux fantaisies de la politique, exclusivement accordé à l'État, deviendrait bientôt un moyen de masquer les déficits budgétaires et de fabriquer des « capitaux » pour tenter les expériences les plus extravagantes. Les preuves historiques de ce fait abondent. Même pour les banques qui ne sont pas absolument banques d'État, nous voyons ce phénomène presque inévitable se produire, lorsque les gouvernements aux abois s'entendent, avec ces établissements trop complaisants, pour dissimuler leurs fautes financières, ou les gaspillages qu'ils sont impuissant à enrayer. L'exemple des Banques d'Italie, de la Banque de Grèce, de ces fabriques de papier-monnaie, suffit pour ouvrir les yeux aux moins clairvoyants.
Assurances en cas d'accidents et Caisses de retraites. — Il faudrait des volumes pour étudier dans leurs détails ces modes d'intervention. A première vue ils séduisent parce qu'ils ne paraissent pas introduire dans l'entreprise privée l'action directe de l'État, et aussi parce que le but poursuivi est très élevé et bien susceptible de faire fléchir la théorie non interventionniste. Malheureusement cette intervention, comme toutes celles issues de la théorie du socialisme d'État, ne peut être limitée. Si elle est prudente, elle n'a point d'efficacité et donne des résultats opposés à ceux que l'on en attendait. C'est ce que nous montre l'histoire de la Caisse des retraites pour la vieillesse fondée en 1850 et dont les bases ont été modifiées en 1886. Peu d'ouvriers ont fait à cette institution des dépôts directs. En réalité, ce sont les sociétés de secours mutuels et les grandes compagnies de transports ainsi que les grosses entreprises qui versent à cette caisse. On en a tiré cette conclusion, qu'il serait nécessaire de faire intervenir l'État, non seulement comme administrateur chargé de capitaliser les fonds versés, et de diriger les opérations, mais encore comme pourvoyeur de la caisse. La loi consacrant ce système obligerait aussi l'entrepreneur à verser obligatoirement, dans certaines conditions, sa quote-part du capital constitutif. Ces mesures sont recommandées comme indispensables pour créer une retraite qui ne soit pas dérisoire en faveur des ouvriers impuissants ou inaptes à se créer des ressources pour leur vieillesse.
On voit combien l'intervention s'étend. Au rôle de multiplicateur des pains que l'État avait pris, en se chargeant de capitaliser et d'administrer les fonds des déposants, on ajoute, aujourd'hui, celui de contribuer, avec l'employeur, à la constitution du capital. Quoi qu'on fasse, le budget se trouve derrière toutes ces combinaisons. Soit que le taux de capitalisation fixé par la loi soit trop élevé par rapport au taux réel des capitaux sur le marché et mette ainsi la Caisse en perte, soit que l'État fournisse des subsides, on a recours au budget. Or, rien n'est moins sûr pour l'avenir, en ce qui regarde les ouvriers, que ces charges si lourdes qui pèseraient sur l'État, charges aggravées encore par les fonds toujours croissants des caisses d'épargne.
Les caisses pour accidents sont de la même nature que les caisses de retraites. On applique depuis quelques années, en Allemagne, le système de la contribution des patrons, des ouvriers et de l'État, soit dans la constitution des fonds, soit dans la surveillance de cette institution. Or, les discussions du dernier Congrès des accidents du travail, tenu à Milan, montrent que l'expérience est loin d'avoir réussi. En France une tentative d'assurance agricole fut faite sous l'Empire avec des conditions qui en faisaient une application du socialisme d'État. Elle échoua piteusement.429
Mais le point important à considérer est celui de la variation des salaires sous l'influence des charges imposées aux employeurs. Si ces charges multiples (retraites, accidents, secours, etc.) sont de nature à élever le prix de revient des produits, il se peut très bien que l'incidence de ces charges soit supportée par l'ouvrier qui alors subirait une diminution de salaire. La mesure corrélative serait donc la fixation d'un salaire minimum. Mais fixer un minimum de salaire, c'est détruire l'entreprise privée et la vie industrielle, c'est déplacer injustement aussi les inégalités, et préparer la venue du communisme, seule application logique du socialisme.
Les mines et les chemins de fer de l'État. — En ce qui concerne les chemins de fer la mise en pratique du système de l'administration par l'État est effectuée en divers pays sur des réseaux d'ensemble (Belgique, Prusse, etc.) et en France, sur un réseau spécial limité à une région du pays. En Prusse, les résultats d'abord favorables ont été suivis d'insuccès. L'État, pour diminuer ses frais d'exploitation, a même été, un moment, obligé d'acheter des charbons anglais. Voici d'ailleurs la conclusion d'un article de M. Alfred Mange, publié dans la Revue des deux Mondes,430 sur « l'Exploitation des chemins de fer de la Prusse depuis leur rachat par l'État » : « Au point de vue financier, les chemins de fer ont donné à l'État des excédents de recettes considérables. Au lieu d'employer ces excédents conformément au programme de 1879, partie à un amortissement sérieux de la dette des chemins de fer, partie à des améliorations de tarifs et de service, partie enfin à la constitution d'une réserve en prévision des mauvaises années, on les a déversés largement dans le budget général. Peu à peu les recettes du chemin de fer sont devenues l'élément primordial, essentiel des ressources du Trésor, élément qui, par son caractère variable et aléatoire, a apporté le trouble et l'instabilité dans le budget. Pendant un certain nombre d'années le produit net des voies ferrées a été croissant; on a fait état de ces plus-values comme si elles étaient définitivement acquises et elles ont servi de prétexte à l'augmentation continuelle des dépenses de l'État. Puis les mauvaises années sont venues, la diminution des recettes du chemin de fer a entraîné le déficit du budget, et la nécessité d'atténuer autant que possible ce déficit a imposé l'obligation d'apporter la plus grande parcimonie dans l'exploitation du réseau et de se montrer plus réservé que jamais en matière de réforme. »
Le Zeitung der Vereins431 a publié une étude de statistique comparée sur les dépenses supportées par les lignes de l'État et les compagnies privées en Allemagne, d'où il résulte que les lignes de l'État, toute proportion gardée, occupent un personnel deux fois plus important que celui des lignes exploitées par les Compagnies privées. Les salaires moyens sont les mêmes dans les deux cas, car la dépense par kilomètre sur les lignes de l'État est aussi à peu près le double de celle faite sur les lignes des Compagnies. Le trafic sur les lignes de l'État est plus élevé que celui qui s'opère sur les lignes des Compagnies, mais on ne peut soutenir qu'un trafic double exige un personnel double. Et si l'on compare, en ce qui regarde les recettes, le rendement du réseau français des Compagnies à celui du réseau prussien, on verra que si celui de la Prusse, presque égal en longueur au réseau français, est un peu inférieur au point de vue des recettes brutes, notre réseau est en définitive mieux administré. Pour 18891e coefficient d'exploitation du réseau français était de 7 p. 100 inférieur au coefficient prussien; en 1890 cette différence s'élevait à 12 p. 100.
En France, le réseau de l'État paraît rapporter des bénéfices évalués en 1893 à 7.981.000 francs. Ce résultat n'est qu'apparent, car, dans ces comptes ne figure pas le service du capital de premier établissement. Ce capital, évalué au minimum à 700 millions et au maximum à 1 milliard, se trouve perdu dans la masse de la dette nationale. Si l'on tient compte des intérêts qu'il coûte, on voit que le bénéfice se transforme en déficit. Les résultats généraux de l'exploitation des Compagnies et de l'État peuvent être comparés au moyen des coefficients respectifs d'exploitation. Voici celui de 1893 pour l'État: 78,54.432 Ceux des grandes Compagnies sont: Nord, 50,8; Est, 60,3; Ouest, 57,6; Orléans, 51,2; P.-L.-M. (réseau principal), 48,5; Mont-Cenis, 61,4; Midi, 51,6.433
L'exploitation des mines, encore plus aléatoire peut-être que celle des chemins de fer, offrirait les mêmes inconvénients. En Westphalie, l'État exploite des mines et l'on a fait argument, à cet égard, des bénéfices qu'elles donnent au budget. Mais on oublie généralement que l'État, en Westphalie, traite durement ses ouvriers, qu'il leur donne des salaires inférieurs aux salaires des mineurs français, et réalise ainsi son gain sur les salariés. Le rapport sur la situation des mineurs en Allemagne, présenté au Congrès international des mineurs, tenu à Berlin (mai 1894), contient l'historique de la grève importante du bassin de la Sarre. Or, parmi les exploiteurs, l'État prussien est signalé comme le plus féroce, dans ce rapport rédigé par un socialiste.
Ainsi, ou l'État entrepreneur abandonne les principes premiers de la direction des entreprises, ou il les applique et parfois sans mesure, alors il devient le plus dur des employeurs.
Mais il n'en va pas toujours comme dans les mines de l'État prussien — État monarchique où règnent l'autorité et la discipline militaire. Le service des chemins de fer, dans le même pays, nous prouve que quand l'État n'est pas un dur exploitant, il devient sans mesure mauvais entrepreneur.
Extension indéfinie de l'Assistance publique. — L'extension exagérée de l'Assistance publique est un des modes d'intervention préconisés par les socialistes d'État. Certes, l'administration de l'Assistance publique par les pouvoirs constitués, État, départements, communes, se justifie amplement — bien qu'on puisse envisager comme susceptibles de rendre des services sérieux, les fondations particulières.
Elle n'en présente pas moins un double danger lorsqu'on l'étend outre mesure. Elle contribue alors à augmenter le nombre des assistés, des non-valeurs, par les avantages qu'elle offre, et le discernement difficile des misères réelles. La loi des pauvres en Angleterre n'a pas produit d'autres effets, malgré l'institution des Workhouses. Herbert Spencer a signalé dans l'Individu contre l'État, les conséquences de cette intervention abusive des pouvoirs publics. Elle grève enfin lourdement les budgets d'État, ou locaux, au détriment de contribuables souvent moins fortunés que les assistés.434
On tend d'ailleurs à rendre l'Assistance publique obligatoire. Pour légitimer cette idée, on part de ce principe (très acceptable si on limite sagement son application) que la Société a le devoir d'exercer l'assistance. Puis, on ajoute, qu'à ce « devoir » de la Société, correspond un « droit » pour l'individu « et un droit qui ne reconnaît par de limites ». C'est ainsi que s'exprimait M. le Dr Rochard, inspecteur général de l'Assistance publique, au cours d'un rapport présenté au Congrès d'assistance en 1889. Et il ajoutait qu'il était utile de rappeler « qu'il y a chez nous, 20 millions de personnes réduites au régime du salariat, c'est-à-dire, auxquelles d'une façon générale, l'épargne est positivement interdite à raison de leurs ressources ».
Ces tendances sont très nettes. On voit où nous conduiraient ces théories: à faire des administrations de l'État, un vaste ensemble d'Assistance publique. En proclamant le droit à l'assistance pour les vieillards indigents, les infirmes sans ressources et les enfants abandonnés, la Révolution française n'entendait pas faire de la France un hospice général.
En résumé, les remèdes des socialistes d'État, dont nous venons d'examiner rapidement, dans leurs effets, les principaux types, ne peuvent apporter quelque soulagement aux individus — soulagement le plus souvent peu en rapport avec l'argent dépensé — qu'au détriment d'un grand nombre d'autres personnes aussi intéressantes que la majorité des personnes assistées. De plus, ils offrent l'inconvénient de certains médicaments, comme la morphine, par exemple, et cessent bientôt de produire leur effet. Il faut continuellement augmenter leur dose, jusqu'à complet épuisement des ressources disponibles.
Nous n'avons pas besoin de rappeler, en outre, la détestable dépression morale produite par une assistance publique de plus en plus élargie et — par suite de son extension - de moins en moins bien administrée.
72.Yves Guyot on “The Rule of Law and the Dreyfus Affair” (1897)↩
[Word Length: 2,993]
Source
Yves Guyot, La révision du procès Dreyfus: faits et documents juridiques (Paris: P. V. Stock, 1898).
1. Reprint of letter written by Guyot in November 1897. Introduction, pp. 7-11.
2. Annexes: "Appel aux républicains libéraux", pp. 169-174.
Introduction
L'AFFAIRE DREYFUS
I
Un officier de l'état-major est accusé de trahison. Il se trouve que cet officier était le premier israélite qui arrivât à l'état-major. On le juge à huis clos. Il est déclaré coupable de trahison et condamné.
Sur quelles preuves? Sur un bordereau. Qu'est-ce que ce bordereau? On en fait grand mystère tout d'abord, puis on finit par la connaître.
Où l'a-t-on trouvé? Alors on raconte qu'il a pour provenance la corbeille d'un ambassadeur. Si on objecte qu'il est bien invraisemblable qu'un ambassadeur abandonne aux chiffonniers des pièces de ce genre, des gens vous disent mystérieusement:— « Ce n'est pas là la vérité. Et ils vous indiquent une provenance beaucoup plus extraordinaire. »
Ce premier point établi de cette manière, si on demande — « Qui prouve que cette pièce soit du capitaine Dreyfus? L'on vous répond: — Il y a des experts en écriture qui ont affirmé que l'écriture était déguisée, mais qu'elle était bien la même. »
Si vous dites:
— « Alors il a été condamné sur une expertise en écriture faite sur une seule pièce, on vous répond:
— Non! il y a eu une autre pièce qui n'a pas été communiquée à l'audience, que la défense a ignorée, mais qui a été communiquée au Conseil dans la chambre des délibérations. »
Alors, si vous croyez que nous avons un code, que nous avons des lois, qu'il y a des principes juridiques qui doivent être respectés, vous faites timidement cette objection:
— C'est de la justice à l'orientale! Dans la France du XIXe siècle, un siècle après la Révolution, sous la République, ce n'est pas possible!
Toutes ces explications vous laissent dans l'angoisse. Il n'y a pas eu de preuve nette, évidente, claire, qui prouve que le condamné est coupable. Cette angoisse devient d'autant plus grande que le condamné est juif, qu'il y a des gens, dignes de vivre au XVIe siècle, qui ont ressuscité l'antisémitisme et qu'ils semblent considérer comme une victoire cette condamnation.
Cependant, nul, excepté quelques personnes, n'a de documents pour se faire une conviction. Il en résulte que nous nous inclinons devant la chose jugée, sans conviction ni pour ni contre.
II
Un jour, on annonce que M. Scheurer-Kestner croit que Dreyfus n'est pas coupable.
Aussitôt, l'opinion publique s'agite, M. Gabriel Monod, professeur de l'Ecole des Hautes Etudes, ancien élève de l'Ecole des Chartes, déclare qu'il partage cette conviction.
M. Bernard Lazare publie une brochure.
M. Bernard Lazare s'appuie sur des preuves morales si fortes qu'elles puissent être, elles ne peuvent pas provoquer la revision du procès.
Il s'appuie sur des contre-expertises en écriture. Alors les partisans de la condamnation disent:
— Quelle valeur ont-elles?
On peut répondre que si les contre-expertises en écriture n'ont pas de valeur, les expertises n'en ont pas davantage. Voilà une demi-douzaine d'experts de différents pays qui infirment une expertise; vous dites qu'ils se trompent tous; soit; mais pourquoi n'y en aurait-il eu qu'un seul à ne pas se tromper? Si vous déclarez que six experts sont suspects, pourquoi déclarez-vous un expert infaillible?
On peut conclure que si les expertises en écritures peuvent être aussi faillibles, il eût peut-être été du devoir du gouvernement de ne pas engager une action d'une telle gravité sur la seule opinion d'un expert en écriture.
Si vous croyez qu'elle est suffisante pour justifier une condamnation, vous devez croire que l'opinion d'une demi-douzaine d'experts est suffisante pour provoquer une revision.
III
Parmi les experts en écriture, j'en connais deux, M. Bertillon et M. Crépieux-Jamin.
M. Bertillon est convaincu de la culpabilité du capitaine, M. Crépieux-Jamin dit le contraire.
M. Bertillon a inventé l'anthropométrie, il est arrivé à des résultats très remarquables.
J'ai eu occasion de voir M. Crépieux-Jamin faire des expériences de graphologie. Il a été prodigieux. Il déshabillait un homme sur la seule vue de son écriture de la manière la plus complète. C'est évidemment un observateur de premier ordre.
M. Crépieux-Jamin était un antisémite passionné, un ami de Drumont. S'il y avait eu doute, évidemment le doute, dans son esprit, n'eût pas profité à Dreyfus.
IV
Mais, enfin, nous restons perplexes, et, à coup sûr, il faut autre chose.
Or, M. Scheurer-Kestner affirme non seulement qu'il a la conviction que le capitaine Dreyfus est innocent, mais qu'il a des preuves de cette innocence, et la plus évidente de toutes, c'est qu'il connaît le véritable coupable.
La Liberté a cité hier un nom. M. Scheurer-Kestner a écrit une lettre à cet ancien officier pour déclarer qu'il était en dehors du débat, mais il maintient que, pendant que Dreyfus est à l'île du Salut, il y a un coupable qui est en liberté.
Evidemment, la parole de M. Scheurer-Kestner |mérite l'attention.
Les antisémites ne peuvent pas accuser M. Scheurer-Kestner d'être juif. Il est protestant.
Ils ne peuvent pas dire que s'il prend en main la question Dreyfus, il y a quelque intérêt. Il n'a pas besoin de faire du bruit autour de son nom. Vice-président du Sénat, il n'a pas d'ambition.
Riche, on ne peut pas l'accuser d'être victime d'une corruption pécuniaire. Enfin, on ne peut pas soupçonner cet Alsacien d'être porté à l'indulgence pour un traître.
Si cet homme quitte la sérénité de son existence pour prendre en main une cause qui déchaîne tant de haines et de fureurs contre lui, il faut reconnaître qu'il ne peut être guidé par d'autre mobile que l'amour de la vérité et de la justice.
V
Chacun éprouve un sentiment d'angoisse tel que je déclare qu'il est à souhaiter, non seulement pour notre pays, mais pour la civilisation du XIXe siècle, pour la justice, qu'on puisse produire des preuves plus probantes que celles qu'on a données jusqu'ici de la culpabilité de Dreyfus.
Oui, il est à souhaiter que Dreyfus soit bien le véritable coupable, car si, sous la pression d'un ministre de la guerre voulant se faire décerner des brevets de patriotisme par certains journaux, un conseil de guerre, ne voulant pas être soupçonné de quelque tiédeur, a condamné un officier innocent; si, pour les causes qui ont fait condamner cet officier, il y avait cette considération qu'il était israélite; qu'il fallait empêcher les officiers juifs d'arriver à l'état-major, s'il y avait au fond de cette affaire des passions et des jalousies de races et de religions: c'est une chose épouvantable!
S'il y a eu conspiration contre un innocent, pour sauver le véritable coupable, c'est effroyable.
Mais il y aurait encore quelque chose de plus épouvantable: c'est que, si ces faits s'était produits, on s'acharnât à les nier; c'est qu'on continuât à frapper l'innocent pour n'avoir pas à reconnaître son innocence ou à trouver le véritable coupable.
VI
Pour que la France sorte de ce cauchemar, il est nécessaire qu'on aille jusqu'au bout. M. Scheurer-Kestner n'est pas homme à se dérober.
M. Scheurer-Kestner a déclaré qu'il avait saisi le gouvernement de documents qui lui permettaient de faire une enquête. Il est nécessaire que l'on sache si le gouvernement a cru devoir procéder à l'enquête demandée.
Le 17 novembre, j'ajoutai:
M. Mathieu Dreyfus ayant dénoncé nettement un ancien officier, le ministre de la guerre a déclaré qu'il ouvrait une instruction.
Nous espérons que cette instruction sera conduite dans des conditions d'impartialité qui ne laissent de doute à personne.
Parce que M. Walsin-Esterhazy a été zouave pontifical, ce n'est pas une raison pour qu'il soit coupable; ce n'est pas une raison pour qu'il soit innocent.
Nous n'imiterons pas les Drumont et autres journalistes de même acabit qui ne veulent d'autre preuve à la culpabilité de Dreyfus que sa qualité de juif.
APPEL AUX REPUBLICAINS LIBÉRAUX
I
Que faites-vous? Que font vos associations dans cette redoutable affaire Dreyfus?
Quelques-uns d'entre vous parlent et agissent: et vous n'osez ni les désavouer ni les approuver.
Je sais ce que beaucoup pensent et disent; c'est que cette affaire est soulevée dans un moment bien gênant pour nombre de candidats.
Sans doute, il eût été plus commode pour les situations prises qu'elle ne se présentât qu'après les élections. Mais vous ne pouvez pas obtenir ce retard. Elle existe comme le boulangisme existait en 1889, comme le Panama et le socialisme existaient en 1893. Il ne dépend pas de vous d'ajourner cette question, mais il dépend de vous de la supprimer.
Je sais que, pour la supprimer, il faut que vous preniez parti et que votre parti soit énergique; mais les groupes politiques n'existent pas, ne s'affirment pas, ne s'imposent pas à un pays en esquivant les questions délicates; ce n'est pas en évitant les difficultés qu'ils peuvent agir; c'est en les abordant avec franchise et netteté.
Que vous jugiez inopportun le moment où a été soulevée la question de l'affaire Dreyfus, libre à vous: mais ce que vous avez à décider aujourd'hui, c'est l'attitude que doit prendre le parti républicain libéral.
II
Quoi! disent beaucoup d'entre vous, est-ce que toutes les autres questions vont disparaître devant celle-là? De quoi s'agit-il donc? D'un officier condamné pour crime de trahison, il y a trois ans. Quelques-uns ajoutent qu'il était peu sympathique. Quelques-uns osent même dire: — Il est bien fâcheux qu'on ne l'ait pas fusillé ou qu'il ne soit pas mort! on en serait débarrassé.
Ceux qui parlent ainsi, avec cette férocité tranquille, ont un aussi grand mépris pour l'expérience en matière politique que pour la justice.
Il ne leur appartient pas, quelque vifs que soient leurs désirs, d'enlever la préoccupation de l'affaire Dreyfus à l'opinion publique et de la reléguer dans l'ombre.
Eh! sans doute, Dreyfus, ce n'est qu'un individu. Peu de chose. Actuellement, après ses trois ans de déportation dans l'île du Diable, c'est un homme perdu. Il n'est plus que le fantôme du jugement de 1894. Sous ce rapport, vous avez aussi complète satisfaction que s'il était mort, mais il est d'autant plus redoutable. C'est une abstraction: il représente l'entité de la justice.
Ce n'est pas seulement dans le moment présent, qu'incarnée ainsi dans un nom, elle absorbe toutes les autres questions. Vous la voyez apparaître dans l'histoire, à certains moments, avec une grandeur qui domine toute une époque.
Dans le XVIIIe siècle, on continuait encore à l'égard des protestants les procédés employés au lendemain de la révocation de l'édit de Nantes. Jusqu'en 1780, il y avait des femmes enfermées à la tour de Constance, à Aiguës-Mortes, qui n'avaient pas commis d'autres crimes que celui d'appartenir à la religion réformée. Cependant l'histoire passe, en les mentionnant à peine; mais elle s'arrête sur le nom d'un obscur marchand de Toulouse, Calas, parce que ce nom représente un crime judiciaire!
Calas fut roué et son cadavre fut brûlé; est-ce que cette exécution empêcha le procès en revision et sa réhabilitation? Ils se trompent fort ceux qui croient que de pareils morts ne survivent pas à leurs exécuteurs.
Autre fait. Certes depuis un siècle, en France, il y a eu de terribles holocaustes.
Napoléon a fait massacrer deux millions de Français. On ne le lui reproche pas. Ils servent même de piédestal à sa gloire; mais il y a un mort qui surgit toujours entre lui et ses plus fanatiques admirateurs: c'est le duc d'Enghien, parce que son jugement n'a été qu'une parodie de la justice.
Pierre Vaux, dont on vient de réhabiliter la mémoire, était peu de chose aussi. Il a été condamné, il y a près d'un demi-siècle; il est mort au bagne il y a plus de vingt ans. Y en a-t-il un de vous qui n'ait pas considéré sa réhabilitation comme un acte de flétrissure pour la magistrature impériale, qui s'était acharnée à maintenir sa condamnation, malgré la preuve de son innocence?
Prenez garde que le spectre de Dreyfus ne soit attaché aussi lui au gouvernement républicain! Je plains les hommes qui peuvent porter d'un cœur léger une pareille responsabilité, qui est peu de chose aujourd'hui en comparaison de ce qu'elle sera dans l'avenir.
III
Déjà ceux d'entre vous qui voudraient supprimer cette question reconnaissent la profonde division qu'elle provoque dans le pays. Vous êtes obligés de constater que pour la revision du procès se trouvent les juifs et les protestants. Ces deux catégories de personnes sont-elles donc quantité négligeable? Ne tenez-vous pour rien un pareil déchirement dans la conscience d'un pays? Partagez-vous la haine dédaigneuse que montrent pour les Alsaciens les adversaires de la revision? Est-ce de cette manière que vous entendez maintenir les liens qui nous unissent encore avec nos compatriotes des provinces qui nous ont été arrachées par la guerre de 1870?
A ces trois catégories de personnes, en dehors de toute question de religion ou de race, vous devez en ajouter une autre: — C'est la plus grande partie de l'élite intellectuelle de la France.
Tous les hommes qui ont quelque notion, je ne dirai pas de droit, mais de méthode, ne peuvent admettre que, dans notre civilisation actuelle, une condamnation ait été prononcée dans les conditions où l'a été celle de Dreyfus.
M. le ministre de la guerre parlait de l'étranger, dans son discours du 13 janvier. Il avait bien raison; car c'est quelque chose pour une nation d'avoir un bon renom dans le monde. Eh bien! lisez tous les journaux sérieux, interrogez vos amis à l'étranger et vous trouverez partout l'élite intellectuelle des autres peuples frappée d'une stupéfaction douloureuse en voyant « cette justice à la française », locution qui se répand, comme nous disons nous-mêmes: « justice à la turque ».
IV
Si beaucoup d'entre vous se sont abstenus, si quelques-uns ont voté contre, la plupart d'entre vous ont voté, le 13 janvier, un ordre du jour ainsi conçu: « La Chambre, comptant que le gouvernement saura prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la campagne entreprise contre l'honneur de l'armée... »
Que signifie cet ordre du jour? Implique-t-il que le gouvernement va déposer un projet de loi interdisant aux citoyens de parler de l'armée et renvoyant les publicistes qui auraient cette audace devant les conseils de guerre, comme en Espagne?
Prenez garde: le nom du signataire de cet ordre du jour aurait dû vous rappeler des souvenirs récents. C'est M. de Mun. Il était, en 1889, membre du comité chargé de répartir les fonds et de distribuer les candidatures dans le formidable assaut livré à la République par les monarchistes, les cléricaux et les boulangistes.
Si nous avions eu, pendant la période où Boulanger était ministre de la guerre, une loi comme celle qu'implique l'ordre du jour du 13 janvier, on l'aurait invoquée, sous prétexte de défendre l'honneur de l'armée, contre ceux qui osaient attaquer le général, importé des républiques espagnoles. Plus d'un parmi vous aurait été condamné, au nom de « l'honneur de l'armée » et la France eût été livrée dans le silence à l'homme au cheval noir.
Si Boulanger est mort, le péril n'est pas conjuré. Vous voyez aujourd'hui s'agiter autour de la question Dreyfus les mêmes hommes.
Quand le chef de cabinet du chef de l'état-major est à la recherche d'un défenseur, à qui va-t-il s'adresser? à l'homme du boulangisme, à M. Henri Rochefort. Quel est l'autre organe officiel de ceux qui veulent supprimer la question Dreyfus? C'est la Libre Parole, qui avait pour président de son conseil d'administration M. Odelin, fidéi-commissaire des jésuites, et qui a pour rédacteur en chef M. Drumont, l'homme malfaisant qui a introduit en France la politique de haine qui s'appelle l'antisémitisme.
A ces deux là, ajoutez quelques journalistes, la plupart frappés de tares notoires; et voilà les défenseurs de l'honneur de l'armée qui, si l'ordre du jour de M. de Mun arrivait à la pratique, auraient seuls qualité pour parler en France, tandis que nous, nous serions réduits au silence!
Y en a-t-il un seul, parmi vous, républicains libéraux, qui puissiez comprendre la liberté de cette manière? Et cependant voilà à quelles conséquences aboutirait l'ordre du jour du 13 janvier.
Vous ne pouvez pas vous engager dans une pareille voie: il faut que vous choisissiez. Aujourd'hui l'indifférence n'est permise à personne. Vous ne pouvez pas vous désintéresser de la question. Il fut commode à Ponce Pilate de se laver les mains du meurtre de Jésus; mais des hommes politiques ne peuvent imiter cette indifférence. Il y a un fait évident:
— Ou Dreyfus n'a été condamné que sur le bordereau et l'acte d'accusation; et alors il a été condamné sans preuves.
— Ou Dreyfus a été condamné sur une pièce secrète non versée à la procédure; et alors sa condamnation est illégale!
Vous, républicains libéraux, quelle doit être votre première préoccupation, sinon l'administration d'une bonne justice, le respect de la loi!
De quel droit, avec quelle autorité, pouvez-vous imposer le respect de la loi aux anarchistes, à tous les partisans de la révolution sociale, s'ils peuvent vous répondre:
« Par raison d'Etat, pour les convenances d'un certain nombre de chefs militaires, vous avez montré votre mépris de la loi; vous avez tenu pour bon un jugement illégal: vous avez employé toutes vos forces pour en maintenir les effets, alors que vous ne pouviez plus avoir de doute sur son caractère; de quel droit exigeriez-vous donc de nous le respect de la loi? »
Vous auriez tort de dédaigner une pareille riposte; car les partis ne sont forts que par leur logique: ils périssent par leurs inconséquences.
C'est pourquoi, vous qui ne pouvez avoir de force que par le respect de la justice, vous devez vous dégager de toute complicité avec la violation de la loi commise: vous ne devez pas vous laisser arracher une revision qui s'impose.
— Admettez-vous qu'il puisse y avoir en France des pouvoirs publics qui aient le droit de mépriser la loi?
Quels sont donc ceux d'entre vous, législateurs, qui oseriez répondre: — Oui!
Et c'est cependant la réponse logique que vous devrez faire, si vous ne prenez vous-mêmes, si le gouvernement que vous soutenez ne prend pas l'initiative de la revision du procès Dreyfus.
Yves Guyot.
73.Gustave de Molinari on "The Political Economy of Militarism and a plan for a League of Neutral States" (1898)↩
[Word Length: 12,541]
Source
Molinari, Grandeur et décadence de la guerre (Paris: Guillaumin, 1898).
II. - Décadence de la guerre.
Chapitre III. "Les Changements opérés dans la constitution des États depuis la fin du XVIIIe siècle," pp. 99-112.
Chapitre VI. "Le Bilan des guerres des États modernes. La Paix armée," pp. 142-50.
Chapitre VII. "Les Chances de paix et les risques de guerre, " pp. 151-59.
Chapitre X. "Position du problème de la paix. - Comment ce problème pet être résolu," pp. 187-99.
III. - Appendice. Note P. La ligue des neutres. "Projet d'association pour L'établissement d'une Ligue des Neutres" (Publié par le Times, 28 juillet 18870 pp. 265-76.
CHAPITRE III. LES CHANGEMENTS OPÉRÉS DANS LA CONSTITUTION DES ÉTATS DEPUIS LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE
En quoi le nouveau régime diffère de l'ancien. — L'appropriation de l'État à la nation. — Droits qui en dérivent. — Déclarations et constitutions qui proclament ces droits. — Les deux objectifs visés par les constitutions. — Les droits et les garanties des gouvernés. — Que les constitutions ont effacé à cet égard la distinction entre les classes gouvernantes et les classes gouvernées. — Qu'elles ont établi un lien théorique entre les services de l'État et les charges qui servent à les rétribuer, et déclaré que les charges doivent être proportionnées aux services et réduites au stricte nécessaire, mais qu'elles ont laissé subsister l'ancien système d'impôts. — Pourquoi ce double objectif n'a pas été atteint.
Qu'une nation peut posséder son État, mais non le gouverner.— Que l'État est resté, sous le nouveau régime, ce qu'il était sous l'ancien: une entreprise, et qu'il doit être constitué et gouverné comme une entreprise. — Comment le gouvernement a été organisé dans les États modernes. — Les partis politiques qui ont surgi sous le nouveau régime, quoique les constitutions n'aient pas prévu leur existence. — Qu'ils ont pour objectif la conquête de l'État et les bénéfices qu'elle procure. — Qu'ils sont organisés comme des armées. - Conditions auxquelles ils peuvent obtenir la victoire. — Le corps électoral et les mobiles auxquels obéissent les catégories sociales qui le constituent. — Que chaque catégorie obéit à son intérêt particulier et immédiat, quand même cet intérêt est en opposition avec l'intérêt général et permanent de la nation. — Que chaque catégorie est représentée par un parti qu'elle oblige à servir son intérêt particulier. — Que les partis ont, en outre, un intérêt commun, qui consiste à augmenter les attributions de l'État et les excite à étendre sa domination.
En quoi le nouveau régime diffère-t-il de l'ancien et quelle influence les traits par lesquels il s'en différencie peuvent-ils exercer sur la solution de la question de la paix ou de la guerre? Voilà ce qu'il s'agit maintenant d'examiner.
Le caractère essentiel de l'ancien régime, c'était, comme nous l'avons vu, l'appropriation de l'État à une société d'hommes forts, dont les pouvoirs avaient fini par se concentrer dans une maison ou une oligarchie, qui le gouvernait ou pour mieux dire qui avait la mission et le devoir de le gouverner dans l'intérêt général et permanent de cette société propriétaire de l'État. Le changement que les réformes ou les révolutions politiques ont accompli en Angleterre, dans les Pays-Bas, dans les colonies de l'Amérique du Nord, en France, et plus tard, dans la presque totalité des États civilisés, a consisté à attribuer à la nation dans les monarchies constitutionnelles un droit de co-propriété, à la vérité non défini, de l'État, dans les républiques, un droit de propriété complet, et, comme conséquence, le droit souverain de gouverner l'État conformément à l'intérêt général et permanent de la nation. Ce changement de régime a été consigné dans des bills ou des déclarations de droits et dans des constitutions accordées par l'ancien souverain ou rédigées et votées par les délégués de la nation devenue souveraine. Les constitutions, qu'elles se soient formées successivement sans avoir été codifiées dans un acte spécial, comme la constitution britannique, ou qu'elles aient été improvisées la suite d'une révolution comme la plupart de celles des autres Étals, comprennent deux parties bien distinctes, l'une concernant les droits et les garanties des gouvernés, l'autre l'organisation du gouvernement.
Dans le cours des siècles, à mesure que le péril de destruction qui menaçait les nations en voie de civilisation s'était affaibli et que la condition matérielle et morale des classes assujetties s'était améliorée, elles avaient obtenu des garanties de diverses sortes contre l'abus du pouvoir des maîtres de l'État. Des coutumes s'étaient établies qui limitaient notamment le taux des redevances et des charges auxquelles elles étaient soumises; des droits concernant l'exercice de leur activité et la propriété de ses fruits leur avaient été concédés et garantis sous forme de privilèges. Ces droits et ces garanties, les constitutions les généralisèrent et les complétèrent, en effaçant les distinctions entre la classe des propriétaires de l'État et les classes assujetties. Cependant, l'ancien système des impôts fut partout conservé: en France par exemple, on le rétablit presque intégralement, en se bornant à en changer les dénominations après avoir vainement entrepris de l'abolir;435 mais tandis qu'il n'existait sous l'ancien régime aucun lien entre les charges que les propriétaires de l'État imposaient à leurs sujets et les services qu'ils leur rendaient, les constitutions établirent ce lien, sinon en fait du moins en théorie. L'impôt ne devait plus être désormais une dîme prélevée sur les sujets, en vertu du pouvoir discrétionnaire et souverain de leurs maîtres et n'ayant pour limite que leur capacité de la fournir; il devait être la rétribution des services de l'État, et chacun devait y contribuer dans la mesure des biens qu'il possédait et que l'État avait pour mission de sauvegarder contre toute agression intérieure ou extérieure. Ce n'était plus un impôt, c'était une contribution. Enfin, la nation maintenant propriétaire de l'État était intéressée à rendre ses services aussi efficaces que possible et à en réduire les frais au taux le plus bas, en avisant aux moyens les plus propres d'obtenir ce double résultat.
Mais la nation ne pouvait gouverner elle-même son établissement politique. La nature des choses s'y opposait. Sous le nouveau régime comme sous l'ancien, l'État restait une entreprise, et la plus importante de toutes. L'État employait un personnel nombreux, civil et militaire, préposé aux fonctions que comportait sa nature et son objet, la sécurité intérieure et extérieure, sans parler des services accessoires qui pouvaient à tort ou à raison lui être confiés plutôt qu'à d'autres entreprises. Comme les actionnaires d'une société industrielle, la multitude des membres d'une nation devenue, entièrement ou partiellement, propriétaire de l'État, ne pouvait le gérer et le gouverner que par des délégués. On sait comment les constitutions ont pourvu à cette nécessité. Elles ont conféré à un corps électoral, composé d'une portion plus ou moins considérable de la nation, le droit d'élire les délégués au gouvernement de l'État. Ceux-ci ont, de concert avec le chef de l'ancienne maison gouvernante ou d'une nouvelle dont ils faisaient choix dans les monarchies, et, en vertu de la pleine souveraineté qui leur était déléguée dans les républiques, constitué le pouvoir dirigeant, mais en lui imposant, sous peine de déchéance, l'obligation de se conformer dans tous ses actes à la volonté de la majorité de leur délégation; cette majorité représentant celle du corps électoral, et celle-ci, la majorité de la nation, les unes et les autres supposées les plus capables de gouverner l'État conformément à l'intérêt général et permanent de la nation. Tel est, dans ses traits essentiels, le mécanisme du gouvernement de la généralité des États modernes.
Ce mécanisme, les réformateurs ou les révolutionnaires qui ont institué le nouveau régime étaient convaincus qu'il atteindrait pleinement son but. L'expérience a malheureusement démontré qu'ils lui attribuaient une efficacité qu'il n'avait pas. Si la qualité des services des gouvernements s'est améliorée dans quelque mesure, — encore cette amélioration n'a-t-elle pas été générale — le prix dont les nations les paient s'est élevé dans une proportion bien supérieure à l'élévation de leur qualité, et, pour nous en tenir à l'objet spécial de cette étude, au lieu d'assurer la paix entre les peuples civilisés, à une époque où elle est devenue possible et nécessaire, les gouvernements ont prolongé et menacent même de perpétuer l'état de guerre.
Si nous examinons les causes de ce double échec, nous trouverons que la première réside dans l'importance de l'État, dans le pouvoir et les avantages qu'il est dans sa nature de procurer à ceux qui en ont la gestion. C'est par millions que se comptent ses fonctionnaires dans les grands États, c'est par milliards que se chiffre son budget. Cela étant, le gouvernement de cette entreprise colossale, du moment où il est devenu accessible à tous les membres de la nation, a été l'objet de l'ambition de tous ceux qui croyaient avoir des chances suffisantes d'y atteindre. Ils ont formé dans ce but des associations que l'on a désignées sous le nom de partis politiques et qui ne différent de celles des conquérants primitifs que par les procédés dont elles font usage pour arriver à leur but, savoir: la conquête, l'occupation et l'exploitation de l'État. Comment s'organisent-elles et procèdent-elles?
Pas plus que le but qu'elles poursuivent, leur organisation ne diffère de celle des anciennes sociétés conquérantes. Ce sont de véritables armées qui sont commandées par un chef ou un comité de chefs avec un état-major et des soldats; leur but c'est la conquête de l'État en vue des moyens d'existence et de la situation supérieure que peuvent leur procurer les fonctions publiques. Comme l'avouait cyniquement aux États-Unis, un chef de parti, le général Jackson, les fonctions publiques constituent le butin du vainqueur. Seulement, à la différence des anciennes sociétés conquérantes, ce but intéressé que poursuivent les partis politiques, ils le dissimulent avec soin: s'ils veulent s'emparer du pouvoir ou le conserver quand ils l'ont conquis, si, dans les luttes qu'ils soutiennent contre les partis concurrents, ils ont recours à la violence, à la ruse, à la corruption, c'est parce que la nation est intéressée à leur victoire, et que sa prospérité ou même son existence en dépend; c'est parce que le triomphe de leurs concurrents aurait pour elle les conséquences les plus funestes. C'est pour la préserver de ce péril qu'ils luttent et sacrifient, au besoin, sans hésiter leurs intérêts à ceux de la patrie. D'habitude, ils affichent un programme renfermant les promesses les plus séduisantes, et en particulier celle d'une amélioration radicale des services de l'État, en même temps qu'une diminution sensible des impôts qui servent à les rétribuer. Quelquefois ces promesses sont sincères, mais il ne dépend pas d'eux de les tenir. Quand la victoire est remportée, quand l'État est tombé entre les mains de l'armée conquérante, il faut bien en rétribuer les chefs et les soldats. Au lieu donc d'améliorer les services, on multiplie les emplois,436 au lieu de diminuer les charges publiques on les augmente. Cette hypocrisie qui caractérise la conduite des partis politiques des États modernes leur est commandée par les conditions même de la lutte. Les anciennes sociétés conquérantes n'avaient pas besoin d'y recourir parce qu'elles n'avaient point à compter avec l'opinion de la multitude assujettie. Il en est autrement dans les pays où les sujets d'autrefois sont devenus les propriétaires de l'État, où, en vertu de la constitution, ils exercent un droit souverain attaché à cette propriété comme à toute autre, celui de choisir les mandataires chargés de la gérer en leur nom et pour leur compte. C'est du vote du corps électoral que dépend l'issue de la lutte entre le parti en possession du gouvernement de l'État et les partis concurrents qui s'efforcent de le lui enlever. C'est la majorité du corps électoral qu'il s'agit de conquérir pour remporter la victoire. C'est donc aux intérêts et aux passions des éléments prépondérants du corps électoral qu'il faut s'adresser.
Si l'on veut se rendre compte des mobiles qui déterminent le choix des mandataires chargés de gouverner l'État dans un pays constitutionnel, il faut considérer d'abord l'état intellectuel et moral de la nation, ensuite la composition du corps électoral.
Comme les individus dont elles se composent, les nations sont essentiellement inégales en capacité intellectuelle et morale. Mais, même dans celles qui occupent les échelons supérieurs de l'intelligence et de la moralité, la capacité qui dépasse la connaissance de l'intérêt particulier de l'individu, de sa famille et de son industrie, pour s'étendre à celle de l'intérêt de la nation, et à plus forte raison de l'humanité, ne se rencontre que rarement et elle est, plus rarement encore, accompagnée d'un sentiment moral qui agisse pour subordonner l'intérêt particulier et actuel de l'individu à l'intérêt général et permanent de la communauté. Or, comme nous l'avons remarqué, toute société se compose de catégories ou de classes dont les intérêts sont immédiatement opposés bien qu'ils s'accordent dans le cours du temps. En Europe, la classe aristocratique et propriétaire issue de la conquête, qui est demeurée jusqu'à la fin du XVIIIe siècle en possession du monopole presque exclusif des fonctions gouvernantes, civiles et militaires, était immédiatement intéressée à des annexions territoriales qui agrandissaient son débouché. Elle recourait à la guerre pour satisfaire cet intérêt immédiat sans rechercher si les bénéfices qu'elle retirait d'un agrandissement de territoire compensaient ou non les charges et les dommages croissants que la guerre infligeait à la nation, et sans se demander si ces charges et ces dommages ne devaient point à la longue déterminer la décadence de l'Etat et par conséquent la sienne. Quoiqu'elle ait perdu aujourd'hui sa situation privilégiée, elle possède encore une part plus ou moins considérable des fonctions supérieures, civiles et surtout militaires, et son intérêt particulier et immédiat l'incline à la continuation d'un état de guerre devenu cependant de plus en plus contraire à l'intérêt général. De même, la classe des entrepreneurs d'industrie a des intérêts immédiatement opposés, d'une part, à ceux des consommateurs, d'une autre part, à ceux des ouvriers. Elle est intéressée à élever le prix des produits qu'elle vend aux uns et à abaisser le prix du travail qu'elle loue aux autres. Cependant, à considérer son intérêt dans le cours du temps, il s'accorde avec celui des consommateurs et des ouvriers, en ce que l'appauvrissement de ceux-là et l'affaiblissement des facultés productives de ceux-ci ne peut manquer d'entraîner sa propre ruine. Sous l'excitation de son intérêt immédiat, elle n'en a pas moins employé partout son influence à édifier un double système de protection contre les consommateurs et les ouvriers, qui n'est, comme nous le verrons plus loin, autre chose qu'une forme de l'état de guerre. De même enfin, la classe ouvrière qui tire ses moyens d'existence de la location de son travail est immédiatement intéressée à employer son influence à faire prévaloir quelque système qui augmente sa part dans les résultats de la production, au détriment de la classe des entrepreneurs et des capitalistes leurs commanditaires.
En résumé donc, chez le plus grand nombre, pour ne pas dire chez la presque généralité des individus qui constituent les différentes classes entre lesquelles se partage une nation, la considération de l'intérêt particulier et immédiat l'emportant sur celle de l'intérêt général et permanent de la communauté, chacune de ces classes ou de ces catégories d'individus est naturellement inclinée à accorder son appui au parti qui lui promet de mettre la puissance de l'organisme de l'État à son service pour faire prévaloir son intérêt sur ceux des autres classes de la communauté, avec lesquels il se trouve en opposition.
Cela étant, la composition du corps électoral a une importance facilement appréciable. S'il se recrute seulement dans la classe supérieure et moyenne, les partis qui se disputent la possession du gouvernement seront exclusivement les serviteurs des intérêts particuliers et immédiats de cette classe; s'il descend dans la multitude, un parti se crééra pour servir de même ses intérêts en échange de son vote.
Mais si divergents ou opposés que soient les intérêts dont ils sont les organes, les partis n'en ont pas moins un intérêt commun, c'est d'augmenter le volume et l'importance de cette entreprise dont ils se disputent la possession, et qui fournit à ceux qui la possèdent, à leurs tenants et aboutissants, des moyens d'existence faciles et une influence que ne confèrent pas les autres entreprises. Dans tous les Etats modernes, sauf dans le petit nombre de ceux où l'ancien régime a continué de subsister, il s'est formé une nouvelle classe gouvernante et qui tend même, comme celle qu'elle a remplacée, à devenir héréditaire: c'est la classe des politiciens. Or, qu'ils soient conservateurs, libéraux, radicaux ou socialistes, les politiciens tirent leurs moyens d'existence ou aspirent à les tirer du budget de l'État. Ils sont, suivant une expression pittoresque, des mangeurs de taxes. Quand même donc les nécessités de la lutte pour la conquête de l'État ne les obligeraient point à augmenter le butin destiné à rétribuer les services électoraux, ils seraient intéressés à développer l'entreprise qui leur sert de débouché, et cet intérêt devient plus pressant à mesure que leur population s'accroît, soit par la natalité, soit par l'afflux des recrues que l'instruction distribuée par l'État rend incapables d'exercer toute autre profession ou industrie. Mais le débouché de l'État ne peut s'augmenter que de deux manières: par l'extension de ses fonctions aux dépens des autres entreprises, ou par l'agrandissement de son domaine territorial, autrement dit, par la guerre. Selon les circonstances, la classe gouvernante a recours à l'un ou à l'autre de ces deux procédés, en obéissant en cela à son intérêt particulier et immédiat, sans rechercher plus que ne le font les autres catégories sociales s'il s'accorde ou non avec l'intérêt général et permanent de la nation.
Que conclure de là, sinon que le nouveau régime de gouvernement des États n'est pas plus favorable à l'établissement de la paix que ne l'était l'ancien. Au fond, ces deux régimes diffèrent moins, même dans les pays où ils semblent le plus distants, que ne le supposent les théoriciens politiques. Nous en aurons la preuve en passant en revue les gouvernements des principaux États civilisés, et nous pourrons, en analysant les intérêts qui y prédominent, nous expliquer pourquoi la guerre a subsisté et menacé de subsister longtemps encore après avoir perdu sa raison d'être.
CHAPITRE VI. LE BILAN DES GUERRES DES ÉTATS MODERNES. LA PAIX ARMÉE.
Le passif de l'état de guerre. — Difficulté de faire le compte des frais et dommages causés par la guerre. — Les pertes et les dépenses directes. — Les dommages indirects. — Accroissement progressif des dettes et des budgets des États civilisés depuis le commencement du siècle. — L'augmentation des effectifs militaires. — L'impôt du sang et la charge qu'il impose. — L'actif de l'état de guerre. — Débouché qu'il procure au personnel de la hiérarchie militaire et civile. — Que la multitude gouvernée n'en tire aucun profit appréciable. — Élévation progressive du risque de guerre et augmentation correspondante de l'appareil d'assurance de la paix armée. — Causes qui contribuent à aggraver ce risque. — La politique coloniale. — La politique protectionniste. — L'absorption des petits États par les grands. — Que le risque de guerre et les armements qu'il suscite sont portés actuellement?i leur maximum.
Des statisticiens ont entrepris de faire le compte de ce qu'ont coûté, en hommes et en capitaux, les guerres qui ont désolé le monde civilisé depuis la fin du XVIIIe siècle. Ces estimations sont toutefois inévitablement incomplètes, car elles ne peuvent s'appliquer qu'aux pertes d'hommes et aux dépenses extraordinaires occasionnées directement par la guerre. Il est impossible d'évaluer les dommages indirects que cause la crise industrielle, commerciale et financière qu'elle engendre, et qui va s'étendant et s'aggravant à mesure que se multiplient les relations internationales. On ne peut pas davantage faire le compte de ce que coûtent aux nations les fluctuations et la dépréciation finale du papier-monnaie, auquel les gouvernements recourent d'habitude dans les moments où ils ne pourraient se procurer, par la voie ordinaire des emprunts, les ressources nécessaires pour continuer la guerre. Mais si toutes les évaluations sont, en cette matière, forcément inexactes et incomplètes, on peut cependant, en examinant la situation des budgets et des dettes publiques des États civilisés, se faire une idée du fardeau dont les guerres modernes ont chargé les nations. Dans l'ensemble des budgets des États de l'Europe, les dépenses militaires et navales et le service de la dette absorbent plus des deux tiers des recettes, et le total des dettes accumulées depuis un siècle et contractées presque exclusivement pour subvenir à des dépenses de guerre dépasse 130 milliards.437 Pour subvenir à cet énorme accroissement de charges, les gouvernements ont été obligés de multiplier les impôts, et ils ont eu principalement recours aux impôts indirects, plus faciles à faire accepter parce qu'on ne les voit pas. Pour ne parler que de la France, cette catégorie d'impôts qui ne fournissait qu'environ un tiers du total des recettes sous l'ancien régime en fournit aujourd'hui les deux tiers. Sans doute, les progrès extraordinaires de l'industrie ont augmenté dans des proportions considérables la richesse des nations; elles peuvent supporter aujourd'hui des charges qui les auraient écrasées, il y a un siècle; mais il n'est pas moins vrai qu'au lieu de s'abaisser, le tantième que les gouvernements prélèvent sur les revenus des nations va s'élevant tous les jours, et qu'il tend de plus en plus à absorber, comme sous le régime de l'esclavage, le produit net de leur industrie. La charge de l'impôt du sang ou du service obligatoire s'est élevée dans une proportion plus forte encore. Ceci à une époque où le péril des invasions de barbares qui pouvait seul justifier les sacrifices imposés aux peuples pour assurer leur sécurité a complètement cessé d'exister.
Encore faut-il ajouter que le montant de ces impôts, destinés à assurer une sécurité qui n'est plus menacée, ne constitue qu'une partie de la charge et des dommages qu'ils infligent. La perception des droits de douane et des autres taxes indirectes nécessite des restrictions et des gênes qui entravent le développement de la production. Quant à l'impôt du sang, outre la perte et les dommages qu'il cause directement en prélevant sur le travail une dime stérile, il atteint la vitalité même des nations en enlevant à la reproduction ses agents les plus vigoureux, dans l'âge où ils y sont particulièrement aptes, pour les livrer aux périls et à la corruption de la prostitution la plus basse.
En présence de cet énorme passif d'impôts, de dettes et de dommages de tous genres, — dans lequel nous n'avons pas compris les souffrances physiques et morales qu'il est dans la nature de la guerre de causer, qu'avons-nous à placer à l'actif de la continuation de l'état de guerre? Quels bénéfices les nations civilisées en ont-elles retirés depuis un siècle?
Ici, apparaît l'opposition immédiate d'intérêts qui existe entre les gouvernants et les gouvernés. Si l'on considère l'intérêt particulier et actuel des classes gouvernantes des États civilisés, on devra reconnaître que ces classes ont bénéficié de la continuation de l'état de guerre, — quoique l'établissement d'un régime de paix leur eût été, selon toute apparence, encore plus avantageuse. Il a fourni un débouché assuré sinon lucratif, — au moins dans les emplois inférieurs de la hiérarchie, — aux familles dans lesquelles se recrute, de génération en génération, la plus grande partie, on pourrait dire même la presque totalité des fonctionnaires militaires et civils. Il a augmenté le prestige des souverains et des politiciens qui ont conservé le pouvoir illimité de disposer des ressources des contribuables et même d'hypothéquer leurs ressources futures pour entreprendre des guerres en opposition manifeste avec l'intérêt général et permanent de la nation. Nous venons de donner un court aperçu de ce qu'elles ont coûté à la communauté civilisée. Quels progrès matériels et moraux ont-elles suscités? Le compte en serait facile à faire, et ce compte se solderait presque invariablement par un déficit supplémentaire. Dans toute l'Europe, les guerres de la Révolution et de l'Empire ont retardé la réforme de l'ancien régime, en investissant les chefs d'état du pouvoir dictatorial que la guerre nécessite et en leur permettant d'ajourner les réformes demandées par leurs peuples. C'est seulement après un long intervalle de paix que l'opinion est devenue assez forte pour les obliger à compter avec elle. Si ces guerres et celles qui les ont suivies ont favorisé un certain nombre d'intérêts, plus ou moins recommandables, elles ont retardé le développement général de la richesse et de la civilisation.
Enfin, en sus des frais qu'elles ont coûtés et des dommages qu'elles ont causés pendant leur durée, ces guerres ont rendu la paix de plus en plus précaire: en d'autres termes, elles ont élevé le taux du risque de guerre.
« Le risque de guerre, remarquions-nous dans un de nos précédents ouvrages, 438 surélevé par la Révolution et l'Empire, redescendit et tomba même à son point le plus bas de 1815 à 1830. La révolution de 1830 le fit remonter de plusieurs points, sous l'influence de la crainte que les passions et les intérêts belliqueux ne vinssent à reprendre le dessus en France, mais la politique résolument pacifique du roi Louis-Philippe le fit ensuite redescendre de nouveau. On pourrait, au surplus, dresser un tableau très approximativement exact de ses fluctuations en notant les fluctuations en sens contraire de la Bourse, à chacun de ses mouvements. Il s'est relevé brusquement en 1848, mais c'est du rétablissement de l'Empire que date son mouvement presque constamment ascentionnel. Depuis la guerre de 1870, ce mouvement de hausse s'est encore accentué, quoiqu'on puisse signaler de nombreuses fluctuations dans son développement.
« A mesure que le risque de guerre s'est élevé, l'appareil nécessaire pour y pourvoir a reçu un accroissement correspondant: la servitude militaire, d'abord limitée, en fait, à la classe inférieure de la population, a été étendue à toutes les classes, chaque pays s'est entouré d'une ceinture de fortifications, comme au moyen âge chaque seigneurie, et les budgets de la paix armée se sont élevés à un taux que n'atteignaient pas auparavant les budgets mêmes de la guerre ».
Cette élévation progressive du risque de guerre n'est pas toutefois causée uniquement par la guerre elle-même.
Parmi les causes qui l'ont suscitée, il faut signaler, en premier lieu, la multiplication des occasions de conflits depuis que le développement extraordinaire des moyens de communication et des relations commerciales a rapproché les peuples et internationalisé les intérêts, depuis encore que les gouvernements des États civilisés ont entrepris de soumettre à leur domination les régions du globe occupées par les peuples inférieurs ou moins avancés. Ces conflits sont fomentés tantôt par la jalousie qu'inspire aux nations les moins capables de tirer parti de leurs acquisitions territoriales, le succès de celles qui se montrent plus aptes à mener à bien leurs entreprises de colonisation, tantôt par l'esprit de monopole qui suscite les relèvements et les guerres de tarifs, en vouant à la ruine les populations de plus en plus nombreuses auxquelles les débouchés extérieurs fournissent leurs moyens d'existence. Ces confiscations de clientèle que votent tous les jours des politiciens aux gages d'intérêts influents, entretiennent entre les peuples les passions haineuses que les guerres du passé avaient créées, en envenimant les difficultés qui naissent de leur rapprochement et de la multiplicité croissante de leurs rapports, et elles fournissent ainsi aux chefs d'États ou aux partis politiques qui croient tirer profit d'une guerre, l'occasion de la provoquer en invoquant l'intérêt ou l'honneur national. En second lieu, l'absorption, opérée à la suite des guerres de la Révolution et de l'Empire, d'une foule de petits États qui servaient, en quelque sorte, de tampons entre les grandes puissances, a eu pour effet, sinon de rendre les guerres plus fréquentes, au moins d'en aggraver les risques et les conséquences. L'Europe est actuellement partagée entre six grandes puissances, dont aucune n'est séparée d'une rivale, et chez la plupart desquelles les intérêts attachés à la conservation de l'état de guerre l'emportent en influence sinon en volume sur les intérêts pacifiques. Comment le contact immédiat d'intérêts belliqueux n'aurait-il pas élevé le risque de guerre et déterminé l'accroissement de l'appareil d'assurance nécessaire pour le couvrir? Chaque fois qu'une de ces grandes puissances a développé ou perfectionné ses armements, les autres se sont crues obligées de suivre son exemple. Chaque fois encore qu'une guerre a éclaté, en aggravant le risque de nouvelles ruptures de la paix par les passions haineuses et les désirs de revendication ou de revanche qu'il est dans la nature de la guerre de susciter, l'appareil d'assurance de ce risque a été renforcé. Les choses en sont venues au point, depuis que la guerre franco-allemande en a élevé le taux au maximum, que les armements ont fini par être portés aussi au maximum que comportent les ressources de chaque puissance, en personnel et en matériel, et les possibilités de l'impôt. Les petits États, même ceux que leur neutralité semblait devoir protéger, ont cru, non sans raison peut-être, qu'ils ne pouvaient se dispenser d'imiter les grands. C'est ainsi que l'Europe est devenue une vaste place de guerre, hérissée de fortifications formidables, et qu'elle tient sur pied, en temps de paix, des armées dix fois plus nombreuses que celles qui suffisaient jadis à la préserver des invasions des Barbares.
Sous ce régime de paix armée à outrance, il serait, comme on va le voir, téméraire d'affirmer que les chances de paix doivent l'emporter sur les risques de guerre.
CHAPITRE VII. LES CHANCES DE PAIX ET LES RISQUES DE GUERRE
État actuel de l'Europe. — Les grandes puissances et les États secondaires. — Les États neutres. — Le Concert Européen. — Que le pouvoir de décider de la paix ou de la guerre est concentré entre les mains des grandes puissances. — Leur partage actuel en deux groupes. — Les chances de paix sous ce régime. — Chances provenant du risque de dépossession du gouvernement à la suite d'une guerre malheureuse, — de la situation financière des États, — de l'accroissement des frais de la guerre et des charges qu'il nécessite. — Insuffisance de ces freins pour arrêter la poussée des intérêts belliqueux. — Facilités que le développement du crédit apporte à l'action de ces intérêts. — Les banques transformées en trésors de guerre. — Le papier-monnaie. — Le service militaire obligatoire. — Appréciation du pouvoir de résistance des intérêts pacifiques. — Que ces intérêts ne se sont pas accrus dans une proportion supérieure à celle des intérêts belliqueux. — En revanche, que les dommages causés par la guerre aux classes industrieuses se sont accrus en raison des progrès de l'industrie.
Si l'on veut se rendre compte des chances de paix et des risques de guerre au moment où nous sommes, il faut examiner la situation politique des États qui ont le pouvoir de déchaîner la guerre et évaluer l'influence qu'y possèdent sur la direction des affaires publiques les intérêts pacifiques et les intérêts belliqueux.
En Europe, les médiatisations, les annexions et les unifications ont successivement réduit, comme dans les autres branches de l'activité humaine, le nombre des petits établissements politiques au profit des grands. On en comptait plusieurs centaines au siècle dernier, il en reste aujourd'hui à peine une vingtaine. Ce sont, en premier lieu, les grandes puissances, la France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, l'Italie, la Russie et l'Angleterre, en second lieu, les États moyens ou petits: la Scandinavie (Suède et Norvège, politiquement unies pour leurs relations extérieures), le Danemark, la Hollande, la Belgique, la Suisse, l'Espagne, le Portugal, les États Balkaniques, la Turquie et la Grèce; parmi ces puissances secondaires la Belgique et la Suisse forment une catégorie particulière d'États neutres auxquels il est interdit de faire la guerre, sauf dans le cas où leur neutralité viendrait à être violée. En fait le maintien de la paix de l'Europe dépend exclusivement des grandes puissances. Elles constituent ce que l'on a nommé le concert Européen, et chaque fois qu'un différend surgit entre deux États secondaires, elles s'efforcent de se mettre d'accord pour le résoudre et au besoin pour imposer la solution qu'elles jugent équitable et utile. Parfois, elles laissent s'engager la lutte, comme il est arrivé récemment dans le cas de guerre gréco-turque, sauf à intervenir pour empêcher le vainqueur d'abuser de sa victoire et pour régler les conditions de la paix. Ce droit d'intervention qu'elles se sont attribué dans l'intérêt de la communauté européenne, — car il ne peut avoir un autre fondement, — elles l'ont même exercé à l'égard de l'une d'elles, à l'issue de la guerre turco-russe en revisant et en modifiant les conditions du traité de San-Stefano. Elles auraient pu reviser de même le traité de Francfort, et il est permis de regretter qu'elles ne s'en soient point avisées.
Ces grandes puissances qui décident souverainement de la paix ou de la guerre en Europe sont actuellement partagées en deux groupes: l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie, formant la triple alliance, la France et la Russie constituant la double alliance, l'Angleterre demeurant isolée. Ces deux alliances ont été conclues uniquement dans l'intérêt de la défense commune des États qui y sont compris, s'il faut ajouter foi aux déclarations formelles de leurs auteurs, et l'isolement de l'Angleterre attesterait au besoin, le caractère essentiellement pacifique de sa politique extérieure. Ajoutons qu'en toute occasion les souverains et les hommes d'État qui dirigent les affaires des grandes puissances ont affirmé solennellement leur ferme volonté de conserver la paix. Personne n'ayant l'intention de la rompre, il semblerait qu'elle fût assurée à jamais, et l'on pourrait se demander pourquoi ces mêmes chefs d'État s'appliquent constamment à renforcer des appareils de guerre dont aucun d'entre eux n'a l'intention de se servir, pourquoi ils font plier leurs peuples sous le fardeau des dépenses militaires en invoquant la nécessité de se défendre puisque personne ne veut attaquer.
Mais les déclarations pacifiques, si solennelles et même si sincères qu'elles soient, n'offrent que de faibles garanties de paix. N'est-ce pas après que ces paroles rassurantes: l'Empire, c'est la paix, eurent été prononcées, que s'est ouverte la série des guerres du second Empire? C'est l'examen de la puissance comparée des intérêts belliqueux et des intérêts pacifiques qui peut seul permettre d'apprécier, d'une manière approximative, les chances de paix et les risques de guerre.
Les chances de paix résident d'abord dans l'intérêt que les gouvernements eux-mêmes peuvent avoir à la maintenir. Le premier de ces intérêts est celui de leur propre conservation. Si une guerre heureuse a pour effet d'augmenter la puissance et le prestige d'un gouvernement, en revanche une guerre malheureuse peut, comme il est arrivé en France, provoquer une révolution qui l'emporte. Ce risque de dépossession est toutefois fort inégal. En Russie, en Allemagne, en Autriche-Hongrie, en Angleterre, où les maisons souveraines ont une existence séculaire et où des intérêts considérables sont attachés à leur conservation, elles semblent n'avoir rien à redouter, actuellement du moins, de l'issue malheureuse d'une guerre. Il en est autrement en Italie, où la monarchie unitaire de fraîche date n'est pas solidement enracinée, et en France où la république l'est encore moins.
Une garantie plus générale de paix semblerait devoir résider dans la situation financière des États, dans le poids de leurs dettes et l'énormité des dépenses qu'implique l'augmentation du prix de revient de la guerre, à une époque où les armées se composent non plus de milliers mais de millions d'hommes et où elles mettent en œuvre un matériel dont le coût s'est augmenté avec la puissance. Mais l'expérience démontre que les charges éventuelles qu'une guerre peut ajouter à celles que la nation supporte déjà n'exercent qu'une faible influence sur les décisions de son gouvernement. Ce supplément de charges n'atteint pas, d'une manière immédiate et sensible, les gouvernants eux-mêmes; il n'a pas pour effet de diminuer la liste civile des souverains et les appointements des fonctionnaires civils et militaires. S'il a pour résultat inévitable d'affaiblir et d'appauvrir la nation qui leur fournit leurs moyens d'existence, et de compromettre ainsi l'avenir de leur propre descendance, ce résultat ne se produit qu'à la longue; et quand même ils en auraient la vague prévision, suffirait-elle pour arrêter la poussée des intérêts et des passions qui les entraînent à la guerre? L'insuffisance des ressources dont les gouvernements peuvent disposer actuellement pour la guerre serait, sans aucun doute, plus efficace. Mais la guerre trouve aujourd'hui, dans le développement des institutions de crédit et dans le régime monétaire des peuples civilisés, des ressources extraordinaires et toujours prêtes qui lui faisaient défaut autrefois. Avant de s'engager dans l'aventure d'une guerre, les souverains du passé étaient obligés d'accumuler non sans peine un « trésor » et de demander à leurs sujets un supplément de subsides; ils ne pouvaient que rarement et à des conditions onéreuses recourir à l'emprunt. Il n'en est plus ainsi à présent. Les gouvernements n'ont plus besoin d'accumuler des trésors de guerre. Seul, le gouvernement allemand a eu recours à cette pratique surannée, en mettant en réserve dans la forteresse de Spandau une somme de 120 millions de marks, prise sur l'indemnité de 5 milliards payée par la France. Les banques d'État ou les banques privilégiées mettent au service de la guerre des sommes bien autrement considérables. Au lieu de conserver seulement en métal la somme reconnue nécessaire, soit le tiers au plus du montant de leur circulation fiduciaire, ces banques, que l'État dirige ou privilégie et qu'il pourvoit d'un gouverneur à sa dévotion, entassent, sous la pression avouée ou non du gouvernement, une encaisse métallique presque égale au montant de leurs billets, en renchérissant ainsi, sans nécessité, les frais et le prix de leurs services de prêt ou d'escompte.439 En cas de guerre, les gouvernements ne se font aucun scrupule de mettre la main sur ces trésors qu'ils n'ont pas pris la peine d'accumuler eux-mêmes, en autorisant les banques à suspendre leurs paiements en espèces. Ils peuvent encore, après avoir épuisé ces stocks métalliques, recourir au papier-monnaie, soit en l'émettant directement, soit en obligeant les banques à multiplier leurs émissions. Sans doute, ces émissions surabondantes ont pour effet de déprécier la circulation, mais cette dépréciation ne devient sensible qu'après que le papier a expulsé entièrement la monnaie métallique, et, en attendant, elles peuvent fournir d'abord une somme égale au montant de la monnaie expulsée, ensuite une autre somme égale à la différence du pouvoir d'acquisition du papier déprécié et de la monnaie métallique qu'il remplace. Enfin, les gouvernements dont le crédit est le plus solide peuvent encore continuer, pendant la guerre, à contracter des emprunts, sauf à les payer plus cher que d'habitude. Grâce à ces divers expédients, ils peuvent se dispenser de recourir à des augmentations d'impôts qui ne manqueraient pas de soulever la résistance énergique de l'opinion et ne fourniraient d'ailleurs qu'un supplément de recettes d'une insuffisance presque ridicule. Les grandes puissances européennes trouveraient ainsi, en cas de guerre, des ressources immédiates qu'il est permis d'évaluer sans exagération, à une cinquantaine de milliards. D'un autre côté, le service obligatoire universalisé leur fournirait sur l'heure dix ou douze millions de soldats. Ce n'est donc pas l'insuffisance des ressources en argent et en hommes qui pourrait empêcher les intérêts belliqueux de transformer l'Europe en un vaste champ de bataille.
Cela étant, il s'agit de savoir quelle résistance ils pourraient rencontrer dans les intérêts pacifiques. Les éléments dont il faut tenir compte pour calculer la puissance possible de cette résistance sont d'abord le volume des intérêts pacifiques, ensuite le montant des dommages que la guerre peut leur causer, et par conséquent l'intensité et l'étendue du mouvement d'opinion que l'appréhension de ce dommage peut provoquer.
Le développement extraordinaire de la production depuis un siècle a déterminé un accroissement correspondant de la population qui vit du produit de ses capitaux et de son travail. Mais si cette population, qui est appelée à supporter, de génération en génération, le fardeau de la guerre, s'est considérablement accrue, on peut en dire autant de celle des fonctionnaires militaires et civils, à laquelle la guerre n'inflige aucun dommage et procure au contraire un supplément de profits, de pouvoir et d'influence. On ne saurait affirmer que la proportion qui existait sous l'ancien régime entre ces deux catégories sociales se soit sensiblement modifiée. Si elle a subi un changement, c'est plutôt à l'avantage de la population qui vit du budget que de celle qui l'alimente.
Mais si l'on ne peut pas dire que les intérêts pacifiques se soient accrus dans une proportion plus forte que les intérêts belliqueux, nous allons voir que la guerre leur est infiniment plus dommageable qu'elle ne l'était avant l'extension moderne des débouchés de la production industrielle et agricole et la transformation progressive de son matériel, en un mot qu'elle est devenue de plus en plus incompatible avec les conditions actuelles d'existence des classes industrieuses.
CHAPITRE X. POSITION DU PROBLÈME DE LA PAIX. — COMMENT CE PROBLÈME PEUT ÊTRE RÉSOLU.
Progrès qui ont rendu possible la solution du problème de la paix. — Comment la constitution d'un organisme collectif de garantie de la sécurité des nations supprimerait la plus grande partie du risque de guerre. — Que le droit de la guerre d'où ce risque procède a d'abord été absolu. — Servitudes et obligations qu'il imposait aux neutres. — Qu'il a été successivement limité sous l'influence de l'intérêt des neutres et des belligérants eux-mêmes. — Qu'il n'en a pas moins eu des effets de plus en plus nuisibles aux neutres. — Que la guerre ayant cessé d'être utile, ceux-ci ont acquis le droit d'intervenir pour l'empêcher. — Aperçu historique du droit d'intervention. — Qu'il s'est exercé d'abord pour maintenir l'équilibre des puissances. — La Sainte-Alliance. — Le Concert européen. — Deux modes d'application du droit d'intervention. — La Ligue des neutres. — L'association générale des États civilisés. — Conséquence de ce progrès: diminution énorme des frais de garantie de la sécurité extérieure des nations. — Pourquoi on ne peut s'attendre à sa réalisation prochaine.
Si, comme nous avons essayé de le démontrer, la guerre a été l'agent nécessaire de la production de la sécurité, — sans laquelle l'espèce humaine n'eût pu s'élever à la civilisation, — si les progrès qu'elle a suscités à la fois dans l'art de la destruction et dans celui de la production ont assuré, d'une manière définitive, les peuples civilisés contre le risque d'une destruction ou d'un recul causé par des invasions de barbares, si elle a été remplacée dans son office de propulseur du progrès par une autre forme, plus efficace et moins onéreuse, de la concurrence, si elle est désormais incompatible avec les nouvelles conditions d'existence que le développement de l'industrie et l'internationalisation des échanges ont faites aux sociétés civilisées, si, après leur avoir été utile, elle leur est devenue nuisible, enfin s'il est en leur pouvoir, sinon de supprimer complètement cette nuisance dans l'état actuel du monde, du moins de la réduire au minimum en cessant de se faire la guerre entre elles, la solution du problème de la paix n'apparaît plus comme une pure utopie, elle devient la plus désirable des réalités.
Posé dans ces limites, le problème de la paix implique seulement la suppression de la portion du risque de guerre afférente aux rapports des États civilisés. Mais cette portion est, de beaucoup, la principale et celle qui nécessite les neuf dixièmes au moins de l'énorme appareil d'assurance qui absorbe une part croissante des revenus des peuples civilisés et alourdit continuellement le fardeau de leurs dettes.
Supposons, en effet, que les États grands et petits qui appartiennent à notre civilisation en Europe et dans le reste du monde n'aient plus à redouter d'autres attaques que celles des peuples qui échappent encore à leur domination, mais qui sont notoirement incapables de leur opposer une résistance sérieuse, supposons que la paix s'établisse sous la garantie d'une puissance collective, supérieure à toutes les puissances isolées, dans l'enceinte de cette immense communauté qui occupe déjà la plus grande partie du globe, il est évident que le risque extérieur contre lequel elle aura à se prémunir n'aura plus qu'une faible importance et qu'il suffira pour couvrir ce risque d'un appareil d'assurance réduit au minimum.
Il s'agit donc de savoir d'abord s'il est possible d'instituer un organisme collectif qui garantisse d'une manière sûre et permanente la paix entre les nations civilisées, ensuite en quoi devrait consister cet organe d'assurance de la paix.
Nous allons voir que cette solution du problème de la paix, si éloignée qu'elle nous paraisse encore, a été préparée de longue main par les progrès qui ont successivement limité le droit de la guerre.
Fondé sur l'intérêt des sociétés guerrières, lequel s'est accordé avec l'intérêt général de l'espèce aussi longtemps que la guerre a été l'agent nécessaire de l'établissement de la sécurité, le droit de la guerre a commencé par être absolu et illimité. A l'origine et pendant une longue durée de siècles, les coutumes, dont l'ensemble constitue le droit des gens, ont mis les vaincus complètement à la merci des vainqueurs, et jusqu'à nos jours elles ont imposé aux neutres à l'égard des belligérants des obligations qui dépassent beaucoup en nombre et en importance les obligations des belligérants à l'égard des neutres. Cela tenait à ce que la guerre était l'industrie des sociétés les plus fortes et leur fournissait leurs moyens d'existence, soit par la destruction et le pillage ou l'asservissement et l'exploitation des plus faibles. Toute restriction au droit que la guerre conférait sur la vie et la propriété des vaincus, tout empêchement au plein exercice de ce droit de la part des tiers, toute intervention de ceux-ci en faveur de l'un ou l'autre des belligérants était reprouvée comme pourraient l'être aujourd'hui les atteintes à la liberté de l'industrie et à l'exercice loyal de la concurrence. Car les sociétés qui vivaient de la guerre étaient intéressées, d'une part, à recueillir tous les profits qu'il était dans sa nature de procurer, d'une autre part, à empêcher que la balance des forces et les chances de l'emporter dans la lutte ne fussent pas troublées par l'intervention ou les secours d'un tiers, - ce qui aurait dérangé toutes les prévisions et faussé tous les calculs qui les déterminaient à s'engager dans une entreprise de pillage ou de conquête. Or il ne faut pas oublier que les tiers, spectateurs d'une guerre, se transformaient fréquemment en acteurs. On découvre ainsi la raison d'être des sacrifices humains offerts aux Divinités des premiers âges, des servitudes et des obligations imposées aux neutres et acceptées par eux sans résistance: interdiction de fournir aux belligérants du personnel et du matériel de guerre, en comprenant même dans le matériel les approvisionnements de subsistances, servitudes restrictives du commerce des neutres, telles que le blocus des ports et des côtes, défense de faire transporter leurs marchandises par un navire ennemi ou de laisser transporter sur leurs navires les marchandises ennemies, etc., etc., le tout sous peine de confiscation ou d'indemnités proportionnées au dommage causé. Ces servitudes et ces obligations étaient, au surplus, fort peu onéreuses à l'époque où le commerce ne franchissait que rarement les frontières de chaque pays, et où les intérêts qui les commandaient dépassaient singulièrement en importance et en influence ceux qui les subissaient et auxquels elles portaient dommage.
C'est l'intérêt des belligérants eux-mêmes et plus tard celui des neutres, qui ont déterminé la limitation successive du droit de la guerre, en attendant que l'intérêt de la communauté civilisée en commande la suppression.
Au lieu de massacrer leurs prisonniers et de les offrir en holocauste à leurs divinités, les belligérants ont fini par trouver plus d'avantage à les restituer moyennant rançon ou à les échanger, en tenant compte de la différence de valeur, signalée par le rang ou le grade des captifs. C'est, de même, leur intérêt qui les a portés à respecter la vie et la propriété des populations inoffensives et à épargner les villes ouvertes, l'expérience leur ayant appris que leurs approvisionnements étaient mieux assurés et leurs opérations moins entravées, lorsqu'ils s'abstenaient d'user dans toute sa brutalité du droit de la guerre à l'égard des habitants désarmés d'un pays envahi. Cependant, il faut remarquer que chaque fois que les belligérants trouvent plus d'avantage à massacrer leurs prisonniers, à détruire les propriétés privées ou à les livrer au pillage, ils ne s'en font point faute. Telle est, même de nos jours, la manière d'agir accoutumée des peuples qui se qualifient de civilisés dans leurs luttes avec ceux auxquels ils prétendent apporter les bienfaits de la civilisation.
Les servitudes et les obligations imposées aux neutres en vertu du droit de la guerre ont été de même allégées à mesure que le développement du commerce international les leur a rendues plus dommageables. Les nations qui s'en trouvaient particulièrement atteintes se sont liguées à diverses reprises pour en exiger la réforme, et elles l'ont obtenue sur plusieurs points: les belligérants ont renoncé au droit de saisir les marchandises neutres à bord d'un navire ennemi et les marchandises ennemies à bord d'un navire neutre; le blocus des ports et des côtes n'a été reconnu qu'à la condition d'être effectif, et l'on a limité, dans quelque mesure, le nombre des articles déclarés contrebande de guerre.440 Au surplus, l'internationalisation du crédit, qui a suivi celle du commerce, a rendu, en grande partie, caduques ou illusoires les défenses faites aux neutres de fournir des secours aux belligérants; si l'on peut leur défendre de vendre aux États en guerre des fusils, des canons et des explosifs, il est devenu pratiquement impossible de leur interdire toute participation aux emprunts qui fournissent les capitaux avec lesquels se produisent ou s'achètent les fusils, les canons et les explosifs.441
Malgré ces réformes limitatives du droit de la guerre, l'exercice de ce droit est devenu de plus en plus nuisible pour les neutres. Nous avons signalé déjà les dommages que la guerre de la sécession américaine a infligés aux populations auxquelles l'industrie cotonnière fournit leurs moyens d'existence et la crise générale qu'a fait éclater la guerre franco-allemande. Qu'une guerre mette aux prises les puissances qui font partie de la Double et de la Triple-Alliance, les neutres en subiront dans le monde entier le contre-coup et les dommages. C'est par milliards que se compteront les pertes causées par l'interruption de leur commerce et la baisse de leurs valeurs, et par millions les entrepreneurs, les employés et les ouvriers que la crise de guerre privera de leurs moyens d'existence.
Or si la guerre a cessé d'être utile à la communauté civilisée depuis que les progrès combinés des arts de la destruction et de la production l'ont mise à l'abri des invasions des barbares, si les dommages croissants qu'elle cause aux neutres ne peuvent plus être justifiés par aucune raison d'utilité générale ou de force majeure, — car toute guerre entre peuples civilisés dépend de leur volonté intelligente et peut, en conséquence, être évitée, — les neutres ont le droit soit de réclamer une indemnité pour ces dommages, soit d'intervenir et de se liguer pour empêcher la guerre qui en est la source.
Ce droit d'intervention et de coalition n'a pas été exercé seulement par les neutres pour obtenir la réforme des servitudes imposées à leur commerce, il l'a été et n'a pas cessé de l'être par les puissances assez fortes pour s'en prévaloir, qui ont jugé que la guerre et ses résultats étaient en opposition avec leurs intérêts. Il a été invoqué, à l'origine, pour empêcher un État d'acquérir une supériorité de forces, menaçante pour la sécurité et l'indépendance des autres; il a été mis en œuvre contre la domination envahissante de la Maison d'Autriche et plus tard contre celle de l'empire Napoléonien; il a servi de base à la Sainte-Alliance et à la constitution, d'ailleurs intermittente et précaire, du Concert européen.
Les puissances qui ont usé et qui continuent d'user du droit d'intervention ne se préoccupaient point, à la vérité, de savoir si l'intérêt particulier auquel elles obéissaient était ou non conforme à l'intérêt général de la communauté civilisée. Les interventions et les coalitions, destinées à défendre l'équilibre européen contre un agrandissement excessif qui menaçait de le rompre, étaient provoquées uniquement par l'intérêt des coalisés. La Sainte-Alliance, inspirée d'abord par un sentiment religieux et humanitaire, n'a pas tardé à se transformer en une assurance mutuelle contre le risque des révolutions. Le Concert européen, qui comprend actuellement les grandes puissances à l'exclusion des petites, intervient moins pour empêcher la guerre que pour reviser celles des conditions de la paix qui lui paraissent de nature à accroître d'une manière dangereuse pour les autres États la puissance du vainqueur, comme dans le cas de la revision du traité de San-Stefano ou du règlement des conditions de la paix entre la Turquie et la Grèce. Mais, quels que soient les mobiles auxquels obéissent ceux qui l'exercent, le droit d'intervention se fonde, en dernière analyse, sur l'intérêt commun des nations, et l'on conçoit qu'il puisse s'étendre et finir par se superposer entièrement au droit de la guerre, lorsqu'il sera devenu évident que la guerre entre les peuples civilisés est désormais contraire à l'intérêt général et permanent de la civilisation.
Ce progrès peut s'accomplir de deux manières, soit par l'association et l'intervention des nations les plus intéressées à la conservation de la paix, et la constitution, en Europe d'abord, d'une ligue des neutres qui joindrait ses forces à celles de la Double ou de la Triple-Alliance dans le cas où l'une ou l'autre de ces puissances associées prendrait l'initiative d'une rupture de la paix, et qui rendrait, par là même, la guerre impossible;442 soit par un accord et une association de toutes les puissances, qui prendraient l'engagement de remettre la solution de leurs différends à un tribunal, dont les verdicts seraient sanctionnés par une force collective supérieure à celle de l'État ou des États contre lesquels le verdict aurait été prononcé, et les contraindrait au besoin à s'y soumettre. Mais dans l'un et l'autre cas, — et selon toute apparence la constitution d'une association permanente de la paix serait déterminée par l'intervention d'une Ligue des neutres, — dans l'un et l'autre cas, disons-nous, les énormes armements que nécessite le risque d'une guerre entre les États civilisés pourraient être réduits aux proportions de l'appareil de défense destiné à garantir la sécurité extérieure de la communauté civilisée, ce qui impliquerait une diminution des neuf dixièmes et davantage de l'ensemble des budgets de la guerre.443
Tel est le progrès qu'imposera l'incompatibilité de plus en plus manifeste qui existe entre l'état de guerre et les nouvelles conditions d'existence des sociétés civilisées. Mais est-ce à dire que ce progrès doive s'accomplir aussi prochainement que le souhaitent les amis de la paix? Si l'on examine et si l'on compare la puissance de la classe immédiatement intéressée au maintien de l'état de guerre et au coûteux appareil qu'il nécessite, à celle des classes bien autrement nombreuses mais politiquement moins influentes qui sont intéressées à la conservation de la paix et au désarmement, on demeure malheureusement convaincu que ce sera seulement à la suite des effroyables désastres d'une nouvelle et grande guerre que les intérêts pacifiques pourront prendre le dessus et exiger des gouvernements la création d'un organisme de la paix.
III. - Appendice. Note P. [p. 196]. — La ligue des neutres. [Molinari’s Introduction]
Il y a plus de quarante ans que l'auteur de ce livre a lancé dans la circulation l'idée de la constitution d'une Ligue des neutres, ayant pour objet d'assurer la paix. Cette idée, il l'a formulée et successivement développée dans une série d'articles publiés par l'Économiste belge, et de lettres adressées au Times, au Pensiero, etc., reproduites et commentées par un grand nombre de journaux. Toutefois, il doit convenir qu'aucun mouvement d'opinion ne s'est prononcé encore dans ce sens, et que les « sociétés des amis de la paix » se sont bornées jusqu'à présent à réclamer l'intervention de la force morale de l'opinion et le recours à l'arbitrage pour empêcher la guerre. L'auteur, tout en rendant hommage à leur généreuse propagande, se sépare d'eux sur ce point. Il ne croit pas que la force morale suffise pour établir la paix entre les États, pas plus qu'elle ne suffit pour la faire régner entre les individus; il est d'avis, en un mot, que la justice, pour être obéie, a besoin d'être appuyée sur la force.
Voici quelques-unes de ses publications relatives à la « Ligue des neutres »:
…
III. — Projet d'association pour L'établissement d'une Ligue des neutres.444
La situation actuelle de l'Europe est de nature à inspirer les craintes les plus sérieuses aux amis de la paix. Depuis la funeste guerre de 1870, cette situation s'est continuellement aggravée. Quoique la France ait manifesté, à diverses reprises, son attachement à la politique de la paix, l'Allemagne, devenue une nation essentiellement militaire, a été sur le point, en 1875 et au commencement de 1887, de déchaîner de nouveau la guerre, en vue d'assurer les résultats acquis par la campagne 1870-71 et sanctionnés par le traité de Francfort. En présence de cette éventualité redoutable et de la menace qu'elle contient pour la sécurité générale, toutes les nations ont augmenté leurs armements et les ont portés finalement à un point qui n'avait jamais été atteint, même aux époques des grandes invasions barbares. L'Europe continentale est devenue un vaste camp. Les effectifs militaires qu'elle maintient sur pied en pleine paix s'élèvent au chiffre énorme de 3,860,000 hommes. En temps de guerre, ils peuvent être porte's à 12,455,000. L'entretien de ces effectifs, sans compter les frais de construction des forteresses et de la réfection périodique du matériel que nécessite le perfectionnement continu des instruments d'attaque et des appareils de défense, absorbe annuellement une somme de 4,600 millions de francs. Les revenus ordinaires des États n'y peuvent pas suffire, et depuis 1870, les dettes des nations européennes se sont élevées, sous l'influence de cette cause, de 75 milliards à 115. Mais l'accroissement du risque de guerre et la multiplication des armements qui en a été la conséquence n'ont pas seulement augmenté les charges militaires et fiscales qui accablent les populations; ils ont causé un autre mal, à la fois moral et économique, non moins menaçant peut être pour l'avenir. Ils ont réveillé les haines nationales que la paix et le développement des relations commerciales avaient assoupies et provoqué une réaction protectionniste qui tend à exclure du marché de chaque pays, avec les produits du travail, les travailleurs eux-mêmes. A la fin d'un siècle marqué par tant d'inventions merveilleuses qui ont rapproché les peuples et rendu les régions les plus reculées du globe accessibles à la civilisation, l'étranger redevient ce qu'il était aux époques d'isolement et de barbarie: un ennemi.
Les choses en sont arrivées à ce point qu'on s'est demandé si la guerre elle-même ne serait pas préférable au régime ruineux et démoralisateur de la paix armée. Il en serait ainsi peut-être si une conflagration européenne devait avoir pour conséquence la suppression ou tout au moins l'abaissement du risque de guerre et le désarmement. Malheureusement, l'expérience nous apprend que la guerre n'engendre pas la paix, mais la guerre. Toute lutte entre deux nations contient, quelle qu'en soit l'issue, le germe d'une guerre future. Ce germe grandit pendant la trêve que l'épuisement de leurs forces et de leurs ressources a imposée aux adversaires; il se développe et porte tôt ou tard ses fruits empoisonnés. La guerre de 1870 a augmenté la somme des haines politiques qui existaient auparavant en Europe. Comment la guerre future, en mettant aux prises des peuples en proie à une animosité devenue plus violente, contribuerait-elle à les réconcilier? Elle les conduira probablement à la banqueroute, elle ne les conduira pas au désarmement.
Ce n'est donc pas à la guerre qu'il faut demander l'établissement d'un régime de « paix désarmée ». Ce régime, serait-il possible de l'instituer, en se bornant, comme le veut l'International arbitration and peace association, à créer un tribunal pour vider les différends des États sans mettre à la disposition de ce tribunal la force nécessaire pour faire exécuter ses verdicts? De bienveillants amis de la paix continuent à nourrir cette illusion philanthropique, mais sans réussir à la propager. Le bon sens public se refuse à croire que des puissances animées de passions hostiles et disposant d'armements formidables se résignent bénévolement à accepter les décisions d'un tribunal investi d'une autorité purement morale: soit qu'il s'agisse des nations ou des individus, il ne croit pas à l'efficacité d'une justice sans gendarmes. Aussi les Sociétés de la paix ne recrutent-elles aujourd'hui que de rares adhérents, en dépit de l'ardeur convaincue de leurs dignes promoteurs et quoique le besoin de la paix soit de plus en plus ressenti par la généralité des classes industrieuses, qui supportent le lourd fardeau des armements, en attendant les calamités de la guerre. C'est que le bon sens pratique du public lui enseigne qu'on n'arrête pas le cours d'un torrent avec une toile d'araignée, et que la force morale ne peut avoir raison de la force matérielle qu'à la condition de lui opposer une force matérielle supérieure.
Mais peut-on, dans l'état présent des choses en Europe, mettre au service de la paix une force matérielle suffisante pour empêcher la guerre? La constitution d'une telle force serait elle conforme au droit des gens, et, d'une autre part, y a t-il en Europe des États assez intéressés au maintien de la paix pour constituer et mettre en œuvre, à leurs frais et risques, cet instrument de pacification?
Le droit des gens reconnaît aux États le droit de faire la guerre; mais comme tous les droits, le droit de la guerre est limité par le droit d'autrui. Un État n'a, pas plus qu'un simple individu, le droit d'infliger un dommage à autrui, même en poursuivant un but qu'il considère comme légitime. Or, à cet égard, les progrès de l'industrie et du commerce ont complètement changé la situation des États belligérants vis-à-vis des neutres. Jusqu'à une époque relativement récente, le commerce extérieur des États civilisés et le placement des capitaux à l'étranger n'ont eu qu'une faible importance: chaque pays produisait lui-même la presque totalité des articles de sa consommation et employait ses capitaux exclusivement dans ses propres entreprises. En 1613, par exemple, la valeur totale des importations et des exportations de l'Angleterre et du pays de Galles ne dépassait pas 4,628,000 liv. st., et un siècle plus tard, le commerce extérieur de toutes les nations européennes n'égalait pas en importance le commerce actuel de la petite Belgique. Le prêt international des capitaux était moins développé encore que le commerce des marchandises. On ne trouvait guère qu'en Hollande des capitalistes disposés à confier leurs fonds à des gouvernements étrangers et encore moins à les aventurer dans des affaires industrielles au delà des frontières de leur pays ou même de leur province.
Il résultait de là que lorsqu'une guerre venait à éclater entre deux États, elle ne faisait subir aux populations des Etats neutres qu'un dommage partiel et insignifiant. Une guerre entre la France et l'Espagne ou l'Allemagne n'affectait pas beaucoup plus les intérêts de l'Angleterre que n'aurait pu le faire une guerre entre la Chine et le Japon.
La guerre avait alors un caractère purement local et les dommages qu'il est dans sa nature de causer ne dépassaient que par exception les limites des pays et même des localités qui en étaient le théâtre. Les progrès de la machinerie industrielle et, en particulier, des moyens de communication ont créé, sous ce rapport, un ordre de chose entièrement nouveau. Le commerce des marchandises et le prêt des capitaux se sont, depuis un demi-siècle surtout, progressivement accrus et internationalisés. Le commerce extérieur des peuples civilisés, qui n'atteignait pas deux ou trois milliards il y a deux siècles, dépasse actuellement quatre-vingts milliards, et c'est également par dizaines de milliards que se chiffre le prêt des capitaux à l'étranger. Dans chaque pays, une portion de plus en plus nombreuse de la population dépend, pour ses moyens d'existence et sa subsistance, de ses relations avec l'étranger, soit qu'il s'agisse de l'exportation des produits de son industrie ou du prêt de ses capitaux, qui lui fournissent, sous forme de salaires, de profits ou d'intérêts, les revenus avec lesquels elle achète les objets de sa consommation, soit qu'il s'agisse de l'importation des denrées nécessaires à sa subsistance. En France, c'est environ le dixième de la population qui se trouve ainsi immédiatement dépendante de l'étranger; en Belgique, la proportion s'élève au tiers et elle ne doit pas être en Angleterre bien éloignée de ce chiffre.
Aussi longtemps que la paix subsiste, on ne peut que s'applaudir de ce développement et de cet entrecroisement des relations internationales, car ils se traduisent par une augmentation progressive de bien-être et de civilisation; mais qu'une guerre vienne à éclater parmi les peuples civilisés, aussitôt ce qui était un bien pour tous devient un mal pour chacun. Sans parler des frais extraordinaires d'armement que le soin de leur sécurité inflige aux neutres, ils sont atteints, quoi qu'ils fassent, et par la crise que toute grande guerre déchaîne sur le marché des capitaux, et par l'interruption ou la diminution de leur commerce avec les belligérants. Qu'on se rappelle, pour ne citer qu'un seul exemple, les désastres et la misère effroyables que la guerre de la Sécession américaine a occasionnés dans tous les centres manufacturiers auxquels les Étals du Nord fournissaient la matière première de leur industrie! C'est que la guerre n'est plus comme autrefois une nuisance locale, c'est qu'elle atteint les intérêts des neutres presqu'autant que ceux des belligérants; en un mot, c'est qu'à une époque où, en dépit de toutes les barrières, le commerce a lié et solidarisé de plus en plus les intérêts des peuples, la guerre est devenue une nuisance générale.
Cela étant, les neutres n'ont-ils pas le droit d'empêcher cette nuisance de se produire? En vain, un gouvernement belliqueux invoquerait-il, à l'encontre de ce droit nouveau, issu des progrès de l'industrie et de la civilisation, l'antique droit de la guerre; comme il n'est plus en son pouvoir d'exercer ce droit sans causer aux neutres un dommage qu'aucune indemnité ne suffirait à compenser, les neutres peuvent, en invoquant à leur tour l'intérêt légitime de leur conservation, lui en interdire l'exercice. Que deux duellistes s'en aillent vider leur querelle dans un endroit écarté, où leurs pistolets ne peuvent atteindre personne, il n'y aura pas grand inconvénient à leur permettre d'exercer librement leur « droit de la guerre »; mais qu'ils s'avisent de se tirer des coups de revolver dans un carrefour populeux, les passants, à défaut de la police, ne seront-ils pas pleinement autorisés à empêcher ce mode d'exercice du droit de la guerre, en raison du danger auquel il les expose? Il en est ainsi de la guerre entre les États: les neutres n'avaient qu'un faible intérêt à l'empêcher lorsqu'elle ne leur causait qu'un dommage insignifiant; on pouvait même leur en contester le droit; mais ce droit n'est-il pas devenu manifeste depuis que la guerre ne peut plus se faire sans mettre en péril les intérêts et l'existence même d'une portion de plus en plus nombreuse de leurs populations?
Il importe de remarquer encore qu'en exerçant leur droit d'interdire des guerres devenues, par le fait du progrès, nuisibles à la communauté civilisée tout entière, les neutres auraient pour eux non seulement l'opinion de leurs propres populations, mais encore celle de l'immense majorité des populations vivant de l'agriculture, de l'industrie et du commerce dans les pays entraînés à la guerre. Ce n'est pas, en effet, le peuple lui-même qui est appelé à décider de la justice et de la nécessité d'une guerre à laquelle tous les citoyens sont contraints aujourd'hui à participer de leur sang et de leur argent; celte décision appartient à un petit nombre d'hommes politiques et de chefs militaires, dont les intérêts sont étrangers à ceux de l'industrie: souvent même elle appartient à un seul homme, et ce n'est rien exagérer de dire que la paix du monde est actuellement à la merci de trois ou quatre personnages, souverains ou ministres, qui possèdent le pouvoir de déchaîner, du jour au lendemain, le fléau de la guerre, et, en le déchaînant, de causer à la communauté civilisée, en y comprenant les neutres, sur lesquels ils n'ont cependant aucune juridiction, des maux et des dommages sans nombre. Ce pouvoir exorbitant, les despotes les plus absolus des époques de barbarie ne l'ont pas possédé; les nations indépendantes et libres de notre époque de civilisation sont obligées de le subir, faute de s'accorder pour y mettre un frein.
Cet accord pour maintenir un état de paix commandé par l'intérêt général et conforme aux vœux de l'immense majorité des populations réputées les plus belliqueuses, cet accord que le développement croissant des relations internationales rend de plus en plus nécessaire, n'y a-t-il pas lieu de le réaliser avant qu'une guerre, qui s'annonce comme plus sanglante et destructive qu'aucune des guerres précédentes, vienne à éclater? Les États qui en prendront l'initiative n'auront-ils pas rendu à l'humanité et à la civilisation le plus signalé des services? Et cette initiative, n'est-ce pas aux nations auxquelles la guerre peut causer aujourd'hui la plus grande somme de dommages, soit en atteignant leurs intérêts économiques, soit en menaçant leur indépendance politique, qu'il convient de la demandre? Telle est, au premier de ces points de vue, l'Angleterre; tels sont, au second, les petits États du continent, la Hollande, la Belgique, la Suisse et le Danemark.
En inaugurant dans le monde la politique du libre échange, l'Angleterre a, sinon créé, du moins avancé et développé l'état nouveau de dépendance mutuelle des peuples pour la satisfaction économique de leurs besoins. Au début de cette politique, en 1826, son commerce extérieur ne s'élevait qu'à 79,426,000 livres sterling; soixante ans après, en 1886, il montait à 561,744,000 livres sterling. Il avait septuplé. Dans le même intervalle, les capitaux anglais s'étaient répandus dans le monde entier pour créer des chemins de fer, des lignes de navigation, des entreprises industrielles de tout genre à l'avantage réciproque des emprunteurs et des prêteurs; mais si cette politique de free trade et d'internationalisation croissante des intérêts a contribué à augmenter, dans des proportions inattendues et extraordinaires, le bien-être des populations, elle a rendu l'Angleterre plus dépendante des autres nations. Une circonstance spéciale a accru encore cette dépendance: c'est que les articles d'importation de l'Angleterre consistent principalement en denrées alimentaires. L'abolition des corn laws a permis aux Anglais de se procurer, par l'échange de leurs produits industriels contre les produits agricoles de l'étranger, la plus grande partie de leur nourriture à meilleur marché qu'ils ne pourraient l'obtenir en la produisant eux-mêmes. Sur 35 millions d'habitants du Royaume-Uni, environ 20 millions sont nourris de viande, blé, légumes, fruits, etc., provenant de l'étranger, et plusieurs millions d'Anglais tirent leurs revenus des industries dont les produits servent à acheter économiquement cette subsistance de la majorité de la population. Aussi longtemps que la paix subsiste dans le monde civilisé, cet état de choses ne présente que des avantages; il permet au peuple anglais de dépenser moins de travail que tout autre peuple pour se procurer les nécessités de la vie; mais qu'une guerre éclate, qu'une partie des marchés de vente et d'approvisionnement de l'Angleterre viennent à se fermer ou simplement à se rétrécir, de quels revenus vivront les ouvriers de Manchester, de Glasgow, Birmingham, etc., qui produisent les articles avec lesquels s'achètent à l'étranger les denrées alimentaires? De quoi se nourrira la multitude des consommateurs auxquels l'étranger cessera de pouvoir fournir son contingent habituel de subsistances? C'est là, on le sait, l'argument capital que les fair traders opposent au free trade; mais, au point actuel de développement de l'industrie britannique, ne serait-il pas impossible et chimérique de retourner en arrière, en réduisant la production des cotonnades, des lainages, des fers, des machines, etc., aux besoins du marché du Royaume-Uni et de ses colonies? Le danger que signalent les fair traders n'en est moins réel. Plus un pays dépend de l'étranger pour ses revenus et sa subsistance, plus grands sont les dommages et les périls auxquels la guerre l'expose. La conclusion de ce fait, ce n'est pas qu'il faut revenir à la politique commerciale en vigueur avant l'avènement de la vapeur et du free trade, c'est qu'il faut compléter et assurer la politique du free trade en garantissant la paix. Et c'est, par là même, à l'Angleterre, qui a inauguré la politique du free trade, qu'il appartient de prendre l'initiative d'une politique destinée à empêcher la guerre.
Aux intérêts économiques que la guerre met en péril se joint, pour les petits États du continent, la Hollande, la Belgique, la Suisse et le Danemark, un intérêt politique de premier ordre: l'intérêt de leur indépendance ou tout au moins de l'intégrité de leurs frontières. Les petits États n'ont rien à gagner à une guerre européenne, au contraire; car l'expérience atteste que c'est presque toujours à leurs dépens que se concluent les arrangements territoriaux auxquels aboutissent les guerres entre les grands États.
Supposons maintenant que l'Angleterre, en s'appuyant d'une part sur le droit des gens, d'une autre part, sur des intérêts communs, particulièrement menacés par une nouvelle guerre européenne, s'associe avec les petits États continentaux que nous venons de nommer pour constituer une Ligue des neutres, et voyons de quelle force militaire pourra disposer cette Ligue. En temps de paix, l'effectif militaire des cinq États est de 453,432 hommes, dont 200,785 pour l'Angleterre et 252,647 pour la Hollande, la Belgique, la Suisse et le Danemark. En temps de guerre, il peut être porté à 1,095,223 hommes.445 A cette armée de plus d'un million de soldats se joindrait, par l'union des flottes de l'Angleterre, de la Hollande et du Danemark, la marine militaire la plus puissante qui existe; enfin, pour mettre en œuvre ce colossal instrument de coercition, la Ligue aurait à son service les ressources financières d'une nation qui possède le premier crédit du monde. En admettant qu'un nouveau conflit vienne à se produire entre deux des grandes puissances continentales, l'Allemagne, la France, l'Autriche ou la Russie, n'est-il pas certain que la Ligue, en unissant ses forces à celles de l'État menacé d'une agression, comme l'a été la France en 1875 et au commencement de 1887, comme pourrait l'être toute autre puissance, lui assurerait la victoire? Cette intervention d'un pouvoir pacificateur, disposant d'une force égale, sinon supérieure à celle de la plus grande puissance militaire du continent, et secondé moralement par l'opinion universelle, ne guérirait-elle pas les États les plus belliqueux de la tentation de troubler désormais la paix du monde?
Mais s'il était bien avéré qu'aucun État, si puissant qu'il soit, ne peut plus troubler la paix sans s'exposer à avoir affaire à une force supérieure à la sienne, qu'arriverait-il? Il se produirait alors dans l'Europe moderne le même phénomène qui s'est produit à la fin du moyen âge au sein des États où le souverain est devenu assez fort pour contraindre les seigneurs à observer la paix: les plus puissants et les plus ambitieux ont désarmé, après avoir éprouvé à leurs dépens qu'ils ne pouvaient désormais troubler la paix sans s'exposer à un rude et inévitable châtiment. Chacun se trouvant protégé par une puissance supérieure à celle des plus puissants, les propriétaires de châteaux forts ont comblé leurs fossés pour y semer du blé et les villes se sont débarrassées des enceintes fortifiées dans lesquelles elles étouffaient ou les ont transformées en promenades. De même, les puissances actuellement les plus agressives finiraient par désarmer si, chaque fois qu'elles emploieraient leurs armements h menacer la paix, elles rencontraient des armements plus forts employés à la défendre.
Garantir la paix entre les peuples civilisés et provoquer ainsi le désarmement en rendant les armements inutiles, tel serait le but de l'institution de la Ligue des neutres.
Cette Ligue, les gouvernements ne prendront pas d'eux-mêmes, est-il nécessaire de le dire? l'initiative de l'établir. La pression de l'opinion seule pourra les y déterminer. C'est pourquoi nous nous adressons à l'opinion en fondant une « Association pour l'établissement d'une Ligue des neutres ». Cette Association aura pour objet spécial et limité de provoquer en Angleterre, en Hollande, en Belgique, en Suisse et en Danemark, par des publications et des meetings, une agitation qui exerce sur les gouvernements une pression assez énergique pour les décider à constituer entre eux la Ligue, tout en la laissant ouverte aux autres États. Ce but atteint, l'Association se dissoudra, comme s'est dissoute, après l'abolition des lois-céréales, son aînée, la Ligue du free trade, dont elle se propose de compléter l'œuvre de liberté et de paix.
74.Gustave de Molinari on “Governments of the Future” (1899)↩
[Word Length: 5,182]
Source
Gustave de Molinari, Esquisse de l’organisation politique et économique de la Société future (Paris: Guillaumin, 1899). II: L’État de paix, chapitres III-VI, pp. 69-100.
Brief Bio of the Author: Gustave de Molinari (1819-1912)
[See the biography of Molinari above.]
CHAPITRE III. La constitution libre des gouvernements et leurs attributions naturelles.
La souveraineté politique découlait, comme nous l'avons vu, du droit de propriété. La société guerrière qui avait fondé un établissement politique en s'emparant d'un territoire et en assujettissant sa population était propriétaire des hommes et des choses, et pouvait en user à son gré. Les nécessités de la conservation de l'État, sous la pression de la concurrence politique et guerrière, ayant fait concentrer l'exercice de la souveraineté entre les mains d'un chef héréditaire, il put dire comme Louis XIV: l'État, c'est moi. S'il octroyait à ses sujets certains droits, tels que le droit de travailler, d'échanger, de léguer et certaines garanties de propriété et de liberté, c'était de sa libre volonté et il était toujours le maître de les leur reprendre. Il se réservait, en tout cas, un droit illimité de réquisition sur leur vie, leur propriété et leur liberté, sauf à n'en user qu'autant qu'il le jugeait nécessaire pour le salut ou simplement pour le bien de l'État. Ce droit illimité, afférent à la souveraineté, a passé à la nation dans les États modernes et elle le délègue à son gouvernement. Il avait sa raison d'être dans le risque illimité de destruction ou de dépossession auquel la concurrence politique et guerrière exposait la société propriétaire d'un État, et cette raison d'être, quoique singulièrement affaiblie depuis que la conquête n'implique plus qu'un simple changement de sujétion et un dommage plutôt moral que matériel, subsiste néanmoins et continuera de subsister aussi longtemps que les nations seront obligées de recourir à la force pour se préserver d'une agression ou faire prévaloir, dans leurs différends, ce qu'elles considèrent comme leur droit.
Mais supposons que leur sécurité et leurs droits cessent d'être menacés, supposons qu'une assurance collective vienne à remplacer pour les nations l'assurance isolée comme elle l'a remplacée pour les individus, aussitôt la situation change, le risque illimité qu'implique la guerre disparaît et avec lui la nécessité de conférer au gouvernement chargé de garantir la sécurité de la nation un droit illimité de réquisition sur la vie, la propriété et la liberté individuelles. Dans ce nouvel état des choses, les charges et les servitudes que le service de la sécurité nationale impose à l'individu n'ont plus rien d'incertain et d'aléatoire; on peut les évaluer et les fixer car ce service se réduit:
1° A participer à l'assurance de la communauté civilisée contre les agressions des hordes barbares ou des États appartenant à une civilisation inférieure et demeurés en dehors de l'assurance collective. Or, la prépondérance que les nations civilisées ont acquise, grâce à l'accroissement extraordinaire de leur puissance destructive et productive, est telle que le risque qu'elles peuvent courir de ce chef est devenu insignifiant et qu'il suffirait d'une centaine de mille hommes pour préserver de toute atteinte les frontières du monde civilisé;
2° A maintenir sur pied, au service de la collectivité, un contingent de forces suffisant pour assurer l'exécution des verdicts de la justice internationale, dans le cas où l'État contre lequel la sentence aurait été rendue refuserait de s'y soumettre et recourrait à la force pour l'aire prévaloir ce qu'il croirait être son droit. Mais une association ayant pour objet d'assurer collectivement la sécurité des nations exigerait de chacune la renonciation au droit de juger dans sa propre cause et d'exécuter ses verdicts par la force. Cette renonciation est déjà imposée à tous les membres de la nation comme une condition sine qua non de la garantie de leur sécurité. Le plus grand nombre d'entre eux s'y soumettent: seuls, les malfaiteurs et les duellistes s'y dérobent, les premiers, parce qu'ils obéissent aveuglément à leur cupidité ou à des passions qui ne peuvent se satisfaire qu'aux dépens d'autrui, les seconds parce qu'ils estiment que la justice collective ne leur fournit pas une réparation adaptée à certaines offenses. Sans reconnaître à ceux-ci un droit qui serait la négation du sien, le pouvoir chargé de la sécurité publique en tolère généralement l'exercice. Il se livre, en revanche, à la poursuite incessante des malfaiteurs, et il assure, à la vérité d'une manière imparfaite, la vie et la propriété individuelles au moyen d'une police relativement peu nombreuse. Des États civilisés ne pourraient être assimilés à des malfaiteurs, mais peut-être des instincts belliqueux et quelque fausse notion de l'honneur national les pousseraient-ils à se comporter comme des duellistes. Dans ce cas, il y aurait lieu de recourir à la force collective pour leur remettre en mémoire leur renonciation au droit de se faire justice eux-mêmes, et les obliger à conserver la paix. Toutefois, la puissance de la collectivité dépassant celle de ses membres les plus puissants, ce recours cesserait bientôt d'être nécessaire. Alors chacun des États associés pourrait congédier le contingent de forces destiné à assurer l'exécution des arrêts dela justice internationale, la puissance morale de l'opinion suffirait. La garantie de la sécurité extérieure et de la paix intérieure de la communauté civilisée n'exigerait plus qu'une contribution minime et toujours décroissante, imposée aux membres des États associés.
Or, du moment où l'intérêt supérieur de la conservation de la nation cesserait de commander l'attribution au gouvernement d'un droit illimité sur la vie, la propriété et la liberté individuelles, il deviendrait possible d'établir une limite exacte et infranchissable entre les droits du gouvernement et ceux de l'individu. Cette limite serait déterminée et marquée, comme nous Talions voir, parla nature et les conditions nécessaires de la production des services publics.
Quels sont ces services? Qu'est-ce qui les différencie de ceux que l'individu demande à l'industrie privée?
Les services qui constituent les attributions naturelles des gouvernements sont de deux sortes: généraux et locaux. Les premiers sont du ressort du gouvernement proprement dit, les seconds appartiennent aux administrations provinciales et communales. Le service principal qui incombe au gouvernement consiste dans l'assurance de la sécurité extérieure et intérieure de la nation et de l'individu. Ce qui caractérise ce service et le différencie de ceux de l'industrie privée, c'est qu'il est naturellement collectif. Un appareil de guerre assure toute la population d'un pays contre le péril d'une invasion étrangère, et un poste de police garantit la sécurité de tous les habitants d'un quartier, comme une digue protège contre l'inondation tous les riverains d'un fleuve. Cela étant, il est juste et nécessaire que les consommateurs de ces services naturellement collectifs en paient, collectivement aussi, les frais, en proportion de la valeur des biens garantis. Si l'un d'entre eux se refusait à fournir sa quote-part de ces frais, ce serait aux dépens des autres assurés dont la contribution devrait être augmentée d'autant. Mais nous n'avons pas besoin de dire que ce caractère de collectivité n'appartient qu'à un petit nombre d'articles. Tandis qu'un poste de police procure de la sécurité à l'ensemble des habitants d'un quartier, il ne suffit pas d'établir une boulangerie pour apaiser leur faim. C'est que le pain, comme les autres aliments, les vêtements, etc., etc., est un article de consommation naturellement individuelle, et la sécurité un article de consommation naturellement collective.
En supposant donc que la sécurité extérieure des nations civilisées soit assurée par leurs forces associées au lieu de l'être par leurs forces isolées, les fonctions naturelles et essentielles de leurs gouvernements se réduiront: 1° à participer à la défense commune de l'association et au maintien de la paix entre ses membres; 2° à pourvoir à l'assurance de la sécurité intérieure et aux autres services naturellement collectifs.
CHAPITRE IV. La constitution libre des gouvernements et leurs attributions naturelles (suite).
Comment et à quelles conditions les gouvernements pourront-ils pourvoir au maintien de la paix internationale et à la production de la sécurité intérieure, voilà ce qu'il s'agit maintenant d'examiner.
Du moment où les nations seront libérées de la servitude que leur impose encore l'état de guerre, où leurs parties constitutives pourront se séparer pour former de nouveaux groupements ou constituer des États autonomes, les risques de révolution et de guerre civile qui naissent d'une union forcée d'éléments hétérogènes et incompatibles disparaîtront, et avec eux les motifs ou les prétextes d'un appel à une intervention étrangère. L'association des États n'aura donc à s'occuper que des dissentiments et des procès qui pourront survenir entre ses membres, à en saisir les tribunaux institués ad hoc, lesquels appliqueront à la solution de ces différends et de ces procès les mêmes principes de droit qu'ils appliquent à ceux qui se produisent entre les individus, enfin à sanctionner au besoin par la force les arrêts de la justice internationale. Ainsi se trouvera assurée, avec un maximum d'efficacité et un minimum de frais, la sécurité extérieure des nations associées.
La production de la sécurité intérieure implique des conditions analogues et qui dérivent de la nature de ce service.
Nous les avons ainsi résumées dans une de nos premières publications:
« Pour être en état de garantir aux consommateurs pleine sécurité pour leurs personnes et leurs propriétés, et, en cas de dommage, de leur distribuer une somme proportionnée à la perte subie, il faut:
« 1° Que le producteur établisse certaines peines contre les offenseurs des personnes et les ravisseurs des propriétés, et que les consommateurs acceptent de se soumettre à ces peines, au cas où ils commettraient eux-mêmes des sévices contre les personnes et les propriétés;
« 2° Qu'il impose aux consommateurs certaines gênes, ayant pour objet de lui faciliter la découverte des auteurs de délits.
« 3° Qu'il perçoive régulièrement, pour couvrir ses frais de production ainsi que le bénéfice naturel de son industrie, une certaine prime, variable selon la situation des consommateurs, les occupations particulières auxquelles ils se livrent, l'étendue, la valeur et la nature de leurs propriétés. »446
A quoi il faut ajouter l'interdiction de juger dans sa propre cause et de se faire justice soi-même.
La production de la sécurité intérieure exige donc un ensemble de lois, un « code » spécifiant et définissant les atteintes aux personnes et aux propriétés avec les pénalités nécessaires pour les réprimer ainsi que d'autres lois établissant les servitudes et les charges non moins nécessaires pour rendre cette répression possible.
L'exécution de ces lois et conditions de la production d'un service indispensable à la conservation de toute société, nécessite encore:
1° L'institution d'une justice ayant en premier lieu pour mission d'ordonner la recherche des auteurs présumés des délits et des crimes commis contre les personnes et les propriétés, de constater s'ils sont innocents ou coupables, et, dans le cas de culpabilité, de leur appliquer les pénalités édictées par le code; en second lieu, de juger les différends et les procès;
2° L'institution d'une police chargée de la découverte et de la poursuite des auteurs des délits et des crimes; ensuite, de l'exécution des pénalités répressives.
Telles sont les différentes parties de l'organisme de la production de la sécurité intérieure et les conditions de son fonctionnement. Cet organisme nécessaire existe déjà au sein des sociétés les plus voisines de l'animalité, mais on sait combien il est demeuré imparfait, môme chez les plus avancées en civilisation. La cause de son imperfection n'est pas difficile à découvrir: elle réside dans l'état de guerre et les conditions d'existence qu'il a faites aux gouvernements, producteurs de sécurité.
Investis de l'exercice du pouvoir souverain de la société propriétaire d'un territoire conquis et de la population qui le meublait, le gouvernement ne devait aucun service de sécurité ou autre à cette population appropriée, pas plus qu'un propriétaire de bétail n'en doit à ses bœufs ou à ses moutons. Mais il y avait cette différence entre une population appropriée à la suite d'une conquête ou du transfert de la propriété d'un territoire par héritage, achat ou échange, et un troupeau de bœufs et de moutons, qu'on pouvait craindre qu'elle ne se révoltât contre ses maîtres, tandis qu'on n'avait pas à redouter une révolte du bétail. Le gouvernement de la société propriétaire de l'État pouvait craindre encore qu'il ne se formât au sein même de cette société des complots pour lui enlever le pouvoir. Le soin de sa sûreté qu'il ne séparait point de celle de l'État lui-même, lui commandait donc de pourvoir, avant tout, à ce double péril. Il y pourvoyait d'abord, en plaçant sous sa dépendance l'appareil de la justice aussi bien que de la police et en lui assignant pour fonction principale la répression des atteintes à sa domination, la découverte des menées de ses rivaux et la surveillance des actes et même des paroles des mécontents; ensuite, en interdisant de constituer sans son autorisation tout groupement de forces qui aurait pu devenir un foyer de résistance ou de révolte, en soumettant à son contrôle les associations qu'il autorisait, en limitant leur durée et en se réservant toujours le droit de les dissoudre. Cependant, si sa sécurité était la première et la plus constante de ses préoccupations, il lui importait aussi de garantir dans quelque mesure la vie et la propriété individuelles, car l'absence de cette garantie empêchait tout développement des industries dans lesquelles l'État puisait ses revenus. Mais c'était là, surtout pour les gouvernements dont l'existence était précaire, un objet secondaire. Ce qui l'attesterait au besoin, c'est que les pénalités établies pour assurer la sécurité des détenteurs et des agents du pouvoir souverain étaient bien autrement rigoureuses que celles qui avaient simplement pour objet de garantir la vie et la propriété des sujets.
Lorsque les nations eurent cessé d'être appropriées à une société ou à une maison souveraine, on put croire que cet état de choses allait changer du tout au tout. Le gouvernement que la nation, maintenant en possession d'elle-même, instituait ou acceptait lui devait les services pour lesquels elle s'imposait les charges et les servitudes nécessaires, il devait encore s'appliquer à les améliorer et à en réduire les frais. Mais l'état de guerre continuant de subsister, la sécurité de la nation continuait aussi à passer avant celle de l'individu et, au lieu de diminuer de prix, elle coûtait de plus en plus cher à mesure que s'accroissait la puissance productive et destructive des nations entre lesquelles pouvaient chaque jour éclater des conflits. D'un autre côté, sous le nouveau régime plus encore que sous l'ancien, la possession devenue précaire du pouvoir est l'objet de compétitions ardentes et peu scrupuleuses sur le choix des moyens de l'atteindre. Le gouvernement doit donc aviser à se protéger lui-même avant de s'occuper de la protection des gouvernés. Enfin, les partis qui se bornent à employer les moyens légaux pour s'emparer du pouvoir ou pour le conserver sont obligés de grossir incessamment ce qu'on pourrait appeler le fonds des salaires politiques, c'est-à-dire le nombre des emplois, partant, des attributions de l'État. Constamment préoccupés d'assurer la sécurité de la nation, plus préoccupés encore du soin de garantir la leur, chargés d'ailleurs de fonctions multiples et disparates, les gouvernements modernes peuvent de moins en moins suffire à leur tâche, et l'on s'explique ainsi l'imperfection grossière du service qui est en réalité aujourd'hui le plus important de tous: la protection de la vie et de la propriété individuelles.
Mais supposons que l'état de paix succède à l'état de guerre, que la sécurité extérieure des nations soit assurée par leur association collective et qu'elles puissent en conséquence se constituer librement, que les gouvernements soient réduits à leurs attributions naturelles, on verra se réaliser, sous l'impulsion de la concurrence, dans la production de ce service essentiel, des progrès qui sembleraient aujourd'hui chimériques.
Dans ce nouvel état des choses, une première question se posera, celle de savoir s'il est plus avantageux pour une nation d'entreprendre elle-même la production de la sécurité dont elle a besoin ou d'en charger une « maison » ou une compagnie possédant les ressources et la capacité techniques qu'exige ce genre d'industrie. L'expérience ayant suffisamment démontré l'infériorité économique de la production dite en régie, on peut prévoir que la nation contractera de préférence, par l'entremise de délégués ou autrement, avec la maison ou la compagnie qui lui offrira les conditions les plus avantageuses et les garanties les plus sûres pour la fourniture de cet article de consommation naturellement collective.
Ces conditions ne différeront, théoriquement du moins, de celles du régime actuel de production de la sécurité que sur un point, mais sur un point essentiel, savoir: l'obligation imposée à l'assureur de payer aux assurés, victimes des atteintes à la vie ou à la propriété, des indemnités proportionnées au dommage causé, sauf recours aux auteurs de ces atteintes. Encore cette condition ne serait-elle pas entièrement nouvelle. Dans l'état actuel de la législation, le droit à une indemnité est reconnu aux victimes d'un pillage. Les gouvernements des États civilisés exigent, en vertu du même principe, une indemnité dans le cas d'un assassinat ou même d'un sévice moindre commis sur un de leurs sujets dans un pays appartenant à une race inférieure ou réputée telle, tout en s'abstenant de l'accorder chez eux. On appréciera toute l'importance de cette condition si l'on songe qu'elle intéressera plus qu'aucune autre les gouvernements à perfectionner leur appareil de recherche et de répression des atteintes à la vie et à la propriété individuelles.
Quant aux conditions qui concernent le prix de la sécurité et les servitudes qu'elle nécessite, elles différeront d'un pays à un autre, selon le degré de moralité et de civilisation de la population, selon encore les difficultés plus ou moins grandes de la répression. En ce qui concerne le jugement des délits et des crimes, l'assureur et la collectivité assurée seront également intéressés à ce qu'il émane d'une justice éclairée et impartiale. Comme le constatait Adam Smith, la concurrence a déjà résolu ce problème.447 Il n'est pas douteux que des compagnies judiciaires pleinement indépendantes et concurrentes le résoudront de même dans l'avenir.
CHAPITRE V. La constitution libre des gouvernements et leurs attributions naturelles (suite).
En possession d'un pouvoir illimité sur la personne et les biens de leurs sujets, les gouvernements de l'ancien régime étaient naturellement tentés d'abuser de ce pouvoir. Ils en abusaient pour satisfaire leur intérêt immédiat et celui de la société politique et guerrière dont ils étaient les mandataires. Mais si ces deux intérêts les excitaient à augmenter les charges et servitudes de la multitude assujettie, ils ne les poussaient point à s'emparer des industries d'où elle tirait ses moyens d'existence et les leurs. Cela tenait surtout à ce que l'oligarchie propriétaire de l'État limitait communément son débouché aux fonctions gouvernantes, militaires et civiles. Elle n'avait, en conséquence, aucun intérêt à s'emparer d'industries réputées inférieures et qui l'étaient, en effet, dans cette période de l'existence de l'humanité. Elle pressait seulement sur le gouvernement pour le déterminer à agrandir, par la conquête de nouveaux territoires et de nouveaux sujets, le débouché qui lui était propre. Les gouvernements de l'ancien régime n'empiétaient donc que rarement sur le domaine de l'activité privée. S'ils se réservaient la production de certains articles, tels que la monnaie, le sel, le tabac, c'était uniquement dans un but fiscal; encore, ces monopoles, ne les exerçaient-ils pas eux-mêmes; ils les affermaient comme la plupart des autres impôts, l'expérience leur ayant démontré que l'affermage était plus productif que la régie.
Cet état de choses a complètement changé depuis que l'extension de la sécurité, et les progrès de l'industrie et du commerce qui en ont été la conséquence, ont fait surgir une classe moyenne, nombreuse et puissante, qui participe au gouvernement, et dont l'influence politique est même devenue prépondérante chez les nations les plus avancées. C'est principalement au sein de cette classe que se recrutent les partis qui se disputent la possession du gouvernement. De plus, c'est un fait d'observation que dans les pays mêmes où l'ancienne oligarchie propriétaire de l'État a conservé la prépondérance, où elle continue à fournir la grande majorité du personnel politique, militaire et administratif, ses intérêts ont changé de nature et se sont rapprochés de ceux de la classe moyenne. Les progrès qui ont rendu les guerres plus coûteuses et moins productives, partant plus rares, ayant diminué les profits qu'elle en tire, elle a dû chercher des compensations à cette perte par l'accroissement de ses revenus fonciers, sa participation aux entreprises industrielles et son accession à des fonctions qu'elle dédaignait auparavant. Les partis politiques recrutés dans ces deux classes n'ont pu conquérir le pouvoir ou le conserver qu'à la condition de se mettre au service de leurs intérêts ou de ce qu'elles croyaient être leurs intérêts. Aux propriétaires fonciers et aux industriels ils ont fourni des protections et des subventions en échange de leurs votes, à tous les fils de famille qui manquaient de l'énergie nécessaire pour se créer une situation par eux-mêmes, des fonctions publiques, civiles ou militaires. De là le poids énorme et toujours croissant dont le militarisme, l'étatisme et le protectionnisme accablent la multitude qui en supporte les frais.
Essayons de donner une idée de ce que lui coûte l'abus du pouvoir illimité que possèdent les gouvernements sur la vie et la propriété individuelles et qu'ils mettent au service des classes dont ils dépendent. Si l'on considère les deux gros chapitres des budgets de la généralité des États civilisés, ceux de la guerre et de la dette, on constate, non sans surprise, qu'ils absorbent les deux tiers des revenus publics. Sans doute, il faut, sous le régime actuel de l'assurance isolée, que chaque nation se prémunisse contre le risque de guerre, mais n'est-il pas manifeste que la prime qu'elle paie de ce chef dépasse le risque? Si des millions d'hommes sont soumis en Europe à la servitude militaire, n'est-ce pas surtout parce que les armées offrent un débouché avantageux aux professionnels qui se recrutent, pour le plus grand nombre, dans les familles influentes de l'aristocratie et de la bourgeoisie? Et la plupart des guerres qui ont ravagé inutilement le monde depuis un siècle ont-elles été entreprises pour satisfaire à la demande de la foule laborieuse qui fournit, qu'elle le veuille ou non, le sang et l'argent nécessaires pour les soutenir? Que l'on calcule enfin ce que coûte le renchérissement des produits et des services que les gouvernements ont enlevés au domaine de l'activité privée: postes, chemins de fer, télégraphes, téléphones, etc., etc., et celui que cause la protection des rentes des propriétaires fonciers, des profits ou des dividendes des entrepreneurs d'industrie et de leurs commanditaires, on trouvera que l'ensemble des frais directs et indirects de gouvernement absorbe au moins la moitié des revenus de la multitude qui vit du produit de son travail quotidien. Sous le régime du servage, elle travaillait trois jours par semaine pour le seigneur; elle travaille aujourd'hui tout autant pour le gouvernement et ses soutiens privilégiés, quoique les services qu'elle reçoit en échange valent à peine une demi-journée!
Cependant, à mesure que la concurrence internationale ira se développant et fera sentir davantage sa pression dans toutes les parties du marché des échanges, la nécessité de mettre fin à ce système de renchérissement deviendra plus urgente. Sous peine de succomber dans la lutte et de disparaître, les nations concurrentes seront obligées de réduire les attributions de l'État au lieu de les accroître et, finalement, de se borner à charger le gouvernement de la production des services naturellement collectifs de la sécurité intérieure et extérieure.
A ces services qui sont du ressort du gouvernement de l'État se joignent ceux qui appartiennent .aux sous-gouvernements des provinces et des communes. Comme le gouvernement de l'État, et sous la pression des mêmes influences, ces sous-gouvernements augmentent continuellement leurs attributions aux dépens de l'activité privée, et le fardeau de leurs budgets locaux s'ajoute à celui du budget général. Ils ne possèdent point, à la vérité, un pouvoir illimité sur la liberté et la propriété individuelles, mais les limites de leur pouvoir ne sont point marquées, et son extension n'est arrêtée, dans quelque mesure, que par le veto du gouvernement de l'État qui les tient dans une dépendance plus ou moins étroite. Seulement, ce veto, il ne l'applique guère que lorsqu'il juge que le pouvoir local empiète sur le sien, et ce que l'on désigne sous le nom de « libertés communales » n'est autre chose que la latitude qu'il laisse aux sous-gouvernements de réglementer la liberté et de taxer la propriété individuelle. En réalité, le domaine des gouvernements locaux est fort étroit, il ne s'étend qu'à un petit nombre de services naturellement collectifs, tels que l'établissement et l'entretien de la voirie, le pavage, l'éclairage, l'enlèvement des immondices, etc., (on n'y doit même pas comprendre la police qui est plutôt du ressort du gouvernement de l'État), et ces différents services locaux, comme les services généraux de la sécurité intérieure et extérieure, peuvent être effectués avec plus d'efficacité et d'économie par des entreprises spéciales que par le gouvernement provincial ou communal lui-même.448
CHAPITRE VI. La sujétion et la souveraineté individuelle.
L'appropriation des plus faibles par les plus forts a été, comme nous l'avons vu, une nécessité inhérente à l'état de guerre. Ils fallait que ceux-ci fussent intéressés à protéger ceux-là plutôt qu'à les dépouiller et à les massacrer, et cet intérêt ils ne pouvaient le trouver que dans l'appropriation. Grâce à un ensemble de progrès matériels et moraux et par une série de transitions, l'approprié, esclave ou serf, devint son propre propriétaire, mais s'il était affranchi de la domination d'un maître, il demeurait assujetti comme membre d'une société, d'une nation, à celle du pouvoir chargé par cette société ou cette nation de la préserver du risque de destruction ou d'asservissement qu'impliquait l'état de guerre et investi, à ce titre, d'un droit illimité sur la vie, la liberté et la propriété de ses membres. Cette servitude sans limites annulait, en fait, la souveraineté individuelle. Car l'individu avait beau être déclaré maître souverain de sa vie et de ses biens, il était à la merci du pouvoir investi d'un droit qui primait le sien. C'est pourquoi les individus libérés de cette servitude personnelle, et constituant des nations réputées libres, avisèrent de bonne heure aux moyens de se défendre contre l'abus de ce droit. Ils chargèrent d'abord des mandataires d'en contrôler l'exercice; ils allèrent ensuite jusqu'à en dépouiller l'oligarchie propriétaire de l'État pour se l'attribuer à eux-mêmes, et en conférer l'exercice à leurs mandataires. Mais ces précautions sont demeurées vaines. L'abus a persisté, autant même dans les pays où le droit illimité sur la vie et la propriété de l'individu appartient à la nation et est exercé par ses mandataires, sous un régime de suffrage universalisé, que dans ceux où il n'a pas cessé d'être concentré entre les mains du chef héréditaire de l'oligarchie propriétaire de l'État.
Le seul remède à cet abus consisterait à limiter la servitude qui pèse sur la souveraineté individuelle et l'annule; mais ce remède est incompatible avec l'état de guerre. Aussi longtemps que subsistera le risque illimité qu'implique l'état de guerre, il sera nécessaire que le pouvoir responsable de la sécurité de la nation conserve un droit illimité sur la vie et les biens de ses membres.
Mais que l'état de paix vienne à succéder à l'état de guerre, que la sécurité des nations civilisées soit garantie par un pouvoir collectif, émané d'elles, aussitôt la situation change. Ce pouvoir possédant une prépondérance assez grande, sinon pour supprimer le risque de guerre au moins pour le réduire dans des proportions telles qu'il suffise d'une faible prime pour subvenir aux frais de la sécurité collective, la servitude illimitée à laquelle l'individu était assujetti cesse d'avoir sa raison d'être. Elle est remplacée par une servitude limitée à l'obligation de fournir une quote-part minime de la prime d'assurance, part toujours réductible jusqu'à ce que l'extension de la civilisation la rende inutile.
La souveraineté individuelle, voilà donc quelle est, en dernière analyse, la base des institutions politiques de la société future. La souveraineté n'appartient plus à une société propriétaire d'un territoire et d'une population esclave ou sujette, ou à une sorte d'entité idéale héritière de l'établissement politique de sa devancière et investie, comme elle, d'un droit illimité sur la vie, la liberté et la propriété individuelles. Elle appartient à l'individu lui-même. Il n'est plus un sujet, il est son maître, son propre souverain, et il est libre de travailler, d'échanger les produits de son travail, de les prêter, de les donner, de les léguer, etc., suivant sa convenance. Il peut employer à son gré les forces et les matériaux dont il dispose à la satisfaction de ses besoins physiques, intellectuels et moraux. Cependant, quelques-uns d'entre ces besoins ne peuvent, en raison de leur nature particulière, être satisfaits isolément, tel est le besoin de sécurité. Que font les individus, consommateurs de sécurité? Ils s'associent et forment une collectivité assez nombreuse pour y pourvoir d'une manière à la fois économique et efficace. Ils choisissent des mandataires qu'ils chargent de traiter, en faisant appel à la concurrence, avec une entreprise, — maison ou société, — réunissant les aptitudes et les capitaux nécessaires à la production de ce service d'assurance. Comme toute autre assurance, celle de la vie, de la liberté et de la propriété individuelles implique des conditions de deux sortes: conditions de prix (paiement d'une prime destinée à couvrir les frais de production de la sécurité avec adjonction d'un profit), conditions techniques (imposition aux assurés des servitudes indispensables à la production de ce service). Ces conditions sont librement débattues entre les mandataires de la collectivité des consommateurs et les entrepreneurs de cette sorte d'assurance. Lorsque l'accord se fait avec l'un d'entre eux, les conditions du marché sont spécifiées dans un contrat, conclu pour un terme plus ou moins long, à la convenance des parties. Il en va de même pour les autres besoins natuturellement collectifs, besoins locaux de voirie, de salubrité, etc. La collectivité qui éprouve ces besoins contracte elle-même, si elle est peu nombreuse, ou élit des mandataires qui contractent en son nom, avec une entreprise capable de produire le service dont elle a reconnu la nécessité. Dans ces différents cas, l'individu exerce collectivement sa souveraineté, soit par des mandataires, soit par lui-même, tandis qu'il l'exerce isolément pour la généralité de ses autres besoins.
L'office des mandataires se réduit à la conclusion des contrats; cet office rempli, leur mandat expire. Cependant, il peut être nécessaire de surveiller l'exécution de ces contrats et d'en modifier les termes quand l'expérience en a montré les défauts ou les lacunes, ou bien encore quand des faits nouveaux apportent quelque changement dans les conditions d'existence de la société. Une délégation permanente des consommateurs de services collectifs peut donc avoir sa raison d'être. Mais il se peut aussi que l'observation des clauses du contrat soit suffisamment garantie par la surveillance de la presse ou des associations librement instituées dans ce but, et que ces clauses n'aient pas besoin d'être modifiées. Dans ce cas, une représentation officielle des consommateurs serait inutile et la collectivité nationale pourrait en faire l'économie.
Si, comme il y a apparence, la production de chacun des services naturellement collectifs était entreprise par une société, celle-ci s'organiserait et se comporterait comme toute autre société industrielle; elle aurait son conseil d'administration, son directeur chargé d'exécuter les décisions du Conseil et des assemblées générales auxquelles il serait publiquement rendu compte de ses opérations.
Ainsi se résoudrait économiquement le problème de la constitution et de la mise en œuvre des services du gouvernement sous un régime d'assurance collective de la paix.
75.Gustave de Molinari on “The Achievements of the 19th Century” (1901)↩
[Word Length: 5,184]
Source
Gustave de Molinari,"Le XIXe siècle", Journal des Économistes, Janvier 1901, pp. 5-19.
Brief Bio of the Author: Gustave de Molinari (1819-1912)
[See the biography of Molinari above.]
LE XIXe SIÈCLE
I
Le trait caractéristique du siècle qui vient de finir, ce qui le distingue de tous ceux qui l'ont précédé, c'est le développement extraordinaire de la puissance productive de l'homme. Par la conquête et l'asservissement des forces mécaniques et chimiques, ajoutées ou substituées à sa force physique dans l'œuvre de la production, il a pu augmenter, dans des proportions qui eussent semblé autrefois invraisemblables, les matériaux de la vie. On aura une idée de ce progrès, accompli surtout dans la seconde moitié du siècle, en consultant les tableaux de l'accroissement de la richesse aux Etats-Unis, c'est-à-dire dans le pays où l'industrie est arrivée à son plus haut point de productivité. Tandis qu'en 1850 la richesse de l'Union américaine n'était évaluée qu'à 7 milliards 135 millions de dollars, soit à 308 dollars par tète, elle s'élevait, d'après le dernier recensement de 1900, à 90 milliards, soit à 1.180 dollars par tête. Dans la dernière décade seule, l'augmentation avait été de 35 milliards, — une somme de richesses plus considérable, au dire du Dr Powers, que celle que le continent américain tout entier avait pu accumuler depuis la découverte de Christophe Colomb jusqu'au commencement delà guerre de la Sécession. Il y a sans doute quelque chose à rabattre dans cette statistique américaine, et nous devons confesser, en toute humilité, que la richesse de l'Europe n'a pas fait depuis un demi-siècle une aussi prodigieuse enjambée; mais nous pouvons conjecturer, d'après les chiffres du rendement des impôts, sans parler-d'autres indices, que dans tous les pays où le vieil outillage de la production industrielle et agricole a été transformé et renouvelé, la richesse s'est accrue dans une proportion au moins double de celle de l'augmentation de la population, malgré les charges et les obstacles de tous genres que les vices et l'ignorance des gouvernements aussi bien que ceux des gouvernés opposent à son développement naturel et régulier.
On s'expliquera ce phénomène,si l'on songe à la somme énorme de travail à bon marché que nous ont procurée l'invention et les perfectionnements successifs de la machine à vapeur. On estime au plus bas mot que le travail d'un cheval-vapeur équivaut à celui de 10 hommes449. Or, la statistique officielle nous apprend que le nombre des chevaux-vapeur s'est élevé en France de 60.000 en 1840 à 6.300.000 en 1897. C'est donc une somme de travail égal à celle de 63 millions d'hommes qui a été mise au service de l'industrie française. Et non seulement ce travail est plus économique de toute la différence du prix de la houille, nourriture de la machine, et de celui de l'alimentation végétale ou animale de l'homme, mais encore il développe une puissance et obtient des résultats qu'aucun déploiement de forces humaines ne pourrait atteindre. On aurait beau accumuler une niasse de travail humain décuple de celle de la machine d'un train express, c'est à peine si l'on obtiendrait une vitesse dix fois moindre. Et en supposant que des milliers d'hommes échelonnés à portée de la voix fussent employés à transmettre un message, leur travail serait impuissant à rivaliser de vitesse avec celui du télégraphe, tout en contant des milliers de fois plus cher.
Mais l'accroissement de la quantité des produits et des services qui constituent la richesse n'a pas été le seul ni peut-être même le plus important résultat de la transformation de la machinerie de l'industrie; elle en a eu deux autres d'une portée supérieure, en élevant la nature du travail réservé à l'homme dans l'œuvre de la production, et en étendant avec la sphère des échanges celle de la solidarité humaine.
Les machines ne fournissent qu'un travail matériel dont les opérations doivent être dirigées ou tout au moins surveillées par l'intelligence de l'homme. Si elles le dispensent d'un effort physique, elles exigent une application constante de sa force intellectuelle et elles engagent souvent au plus haut degré sa responsabilité morale. Un conducteur de locomotive et un aiguilleur, par exemple, ne dépensent dans leur journée qu'une faible somme de force physique, mais leur attention doit être appliquée sans relâche à l'opération qui leur est confiée. Si leur intelligence n'y est pas suffisamment tendue, s'ils n'ont qu'à un faible degré le sentiment de leur responsabilité, ce défaut d'application a leur devoir peut causer la perte de centaines de vies, sans parler des dommages purement matériels. Mais l'exercice de l'intelligence et de la responsabilité ont pour effet naturel de développer les facultés mises en œuvre, et c'est ainsi que le niveau intellectuel et moral des ouvriers qui dirigent ou surveillent le travail des machines apparaît dans toutes les branches d'industrie que le progrès a touchées comme manifestement supérieur à celui des simples manœuvres qui font l'office de machines.
Le progrès industriel n'a donc pas eu seulement pour effet d'augmenter la quantité des produits, il a élevé, pour ainsi dire, la qualité dus producteurs. Il a eu encore un autre effet, non moins bienfaisant, c'est d'étendre et de multiplier les liens de solidarité entre les hommes. Dans les siècles qui ont précédé le nôtre, la sphère de la solidarité ne dépassait guère les frontières des Etats. Les membres de chaque nation formaient une société d'assurance mutuelle contre le risque d'invasion et de pillage, quand ils n'étaient pas eux-mêmes envahisseurs et pillards. S'ils étaient intéressés à la prospérité les uns des autres, ils ne l'étaient point à celle des membres des autres nations. Ils avaient, au contraire, intérêt à la diminution des forces et des ressources des peuples avec lesquels ils étaient continuellement en guerre. Cet état de choses a changé, la solidarité a succédé à l'antagonisme, lorsque les échanges ont associé les intérêts des individus appartenant à des nations différentes.Or, c'est l'accroissement de la productivité de l'industrie quia provoqué en la nécessitant l'extension de la sphère des échanges. Lorsque le travail, assisté par une machinerie de plus en plus puissante, — et pour emprunter un exemple au rapport de Michel Chevalier sur l'Exposition de 1867, lorsque l'introduction du moteur circulaire a porté de 80 à 480.000 le nombre de mailles qui peuvent être confectionnées en une minute dans la fabrication des tricots, — le marché local a cessé de suffire à cette production exubérante, il a fallu agrandir son débouché, et il en a été ainsi dans toutes les industries où le travail à la machine se substituait au travail à la main. Alors, pour répondre à ce besoin d'extension des marchés s'est produite une demande extraordinaire de progrès des moyens de communication. Les inventeurs, utilisant les découvertes de la science, se sont appliqués à satisfaire à cette demande; la vapeur, puis l'électricité ont été employées à surmonter l'obstacle des distances. 780.000 kilomètres de chemins de fer, 1.800.000 kilomètres de lignes télégraphiques, construits presque en totalité dans la seconde moitié du siècle, des lignes de navigation à vapeur qui établissent des communications régulières entre les parties les plus éloignées du globe ont commencé l'œuvre de l'unification des marchés des produits, des capitaux et du travail.
Malgré les obstacles que cette extention de la sphère des échanges a rencontrés dans les intérêts attachés à l'ancien état des choses, elle se poursuit avec une force d'impulsion irrésistible, et on peut déjà en apprécier la portée finale en comparant l'état de développement des rapports économiques des nations au début et à la fin du siècle.
Nous n'avons que des données partielles et incertaines sur le commerce extérieur des nations civilisées dans les siècles précédents; nous savons seulement que le commerce de l'Angleterre en 1800 n'atteignait pas 2 milliards de francs450 et que celui des autres nations réunies s'élevait à peine à ce chiffre; en sorte que le commerce du monde civilisé tout entier ne dépassait pas le commerce actuel de la Belgique. M. Levasseur l'évaluait dernièrement à 87 milliards pour la période 1894-95,451 c'est-à-dire qu'il aurait au moins vingtuplé dans le cours du siècle. Le commerce international des capitaux ne s'est pas moins développé que celui des produits. La statistique ne nous fournit, à la vérité, aucune donnée sur la production du capital dans la période qui a précédé l'avènement de la grande industrie, et elle ne nous renseigne encore que d'une manière approximative sur son importance actuelle. M. Robert Giffen a évalué à 200 millions sterl. — 5 milliards de francs— le montant de l'épargne annuelle du RoyaumeUni, ce qui est peut-être excessif. Mais on peut affirmer avec certitude que la productivité de l'épargne s'est accrue avec celle de l'industrie, et on sait que les pays où la production des capitaux s'est particulièrement développée, l'Angleterre, la France, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, en fournissent des quantités croissantés au reste du monde. La transformation de l'outillage de la production industrielle et agricole, sans oublier celle du matériel de guerre, maritime et terrestre, en a demandé des quantités énormes, surtout dans!e dernier quart de siècle. Seule, la construction des chemins de fer en a absorbé environ 200 milliards. Mais,non moins que l'exportation des produits, celle des capitaux crée et multiplie les liens de solidarité entre les peuples. Les pays importateurs de capitaux sont intéressés à la prospérité de ceux qui les produisent, afin de les obtenir en abondance et à bon marché, les pays exportateurs le sont plus encore à celle de leurs débiteurs.
Le développement de la production, déterminé par la création d'une machinerie à la fois plus puissante et plus économique, a élargi aussi, quoique dans une proportion moindre, les débouchés du travail. La population s'est accrue dans la mesure de l'extension de son débouché; elle a doublé en Europe dans le cours du xixe siècle, et elle a fourni, en outre, à l'émigration un contingent qui a dépassé en une seule année celui qu'elle lui fournissait auparavant en un siècle. De 10.000 individus en 1820, l'émigration s'est élevée à 871.000 en 1887 et,en l'espace de quatre-vingts ans, elle n'a pas porté moins de 15 millions d'hommes de race blanche dans les autres parties du globe. Ces émigrants ont fécondé par leur travail et acquis au domaine de la civilisation d'immenses régions, dont les ressources naturelles demeuraient improductives; ils ont fait souche de peuples nouveaux, approvisionné l'Europe de matières premières et de denrées alimentaires, agrandi les débouchés de son industrie et étendu, avec la sphère de l'échange, celle de la solidarité des intérêts.
Telle a été l'œuvre capitale du xixe siècle, et la meilleure part de son actif. A des Etats isolés et politiquement hostiles, il a commencé à substituer des nations économiquement unies par les liens de plus en plus nombreux et serrés de l'échange. Et cette extension de la sphère de l'échange a eu, en même temps, pour résultat d'internationaliser le progrès lui-même. Toutes les nations se trouvant désormais en concurrence, leurs industries sont obligées de s'assimiler tous les progrès réalisés ailleurs, sous peine d'être exclues du marché général, et même de leur propre marché. Au commencement du siècle ces progrès qui multipliaient les produits en abaissant les frais de la production étaient,pour ainsi dire, le monopole de l'Angleterre. Après s'être efforcés de se protéger contre eux, par les barrières de la douane, les industriels du continent ont compris la nécessité de les imiter, et c'est ainsi que les produits manufacturés de la France, de la Suisse et, en dernier lieu, de l'Allemagne, ont réussi, grâce au stimulant de la concurrence britannique, à dépasser en quantités croissantes les frontières du marché national.
Aujourd'hui a surgi un nouveau concurrent, l'industrie américaine, armée de machines-outils qui abaissent encore les prix de revient, demain surgira peut-être la concurrence chinoise, dont la bienfaisante influence s'ajoutera à celle de la concurrence américaine pour provoquer en Europe un mouvement de réforme des impedimenta politiques, fiscaux, protectionnistes, qui élèvent artificiellement le prix des matériaux de la vie.
Avons-nous besoin d'ajouter que des siècles se passeront avant que l'humanité soit exposée à produire plus qu'elle ne peut consommer. Malgré l'essor que la conquête d'un contingent colossal de forces naturelles est en train d'imprimer à sa capacité productive, l'humanité est encore pauvre, très pauvre, et il faudra que sa production annuelle soit au moins décuplée pour lui assurer une modeste aisance.
Mais c'est seulement par l'extension de l’organisme de la production et de l'échange que le travail, assisté des forces de la nature, pourra satisfaire avec une abondance de plus en plus grande les besoins, encore aujourd'hui si incomplètement desservis, de la consommation. Or cet organisme est d'une sensibilité extrême, et à mesure qu'il s'étend et solidarise des intérêts plus nombreux dans les différentes parties du globe, les causes de perturbation, telles que les guerres et les autres calamités dues aux vices et à l'ignorance des gouvernements et des individus, qui se manifestent sur un point du marché agrandi des échanges, se répercutent sur fous les autres. Ces causes de désordre et de ruine n'ont pas cessé de se multiplier et même de s'aggraver dans le cours du siècle, et, en regard des progrès qui constituent son actif, elles ont produit un passif qui a absorbé, sinon la totalité, au moins une part trop considérable de cet actif de progrès.
II
Il semblerait que l'accroissement extraordinaire du commerce international, en développant entre les peuples la solidarité des intérêts et en augmentant, parla même, le besoin de la paix, eût dû rendre les guerres plus rares. On pouvait d'autant plus se bercer de cette espérance que les progrès de l'industrie augmentaient chaque jour le nombre et la richesse de la classe dirigeante de la production et lui valaient une part d'influence plus considérable dans le gouvernement des Etats. Cependant, il n'en a pas été ainsi. Les guerres n'ont pas été moins nombreuses au xixe siècle, et elles ont été bien autrement destructives et coûteuses qu'elles ne l'avaient été au xviiie.
Nous ne possédons pas le compte des vies humaines que la guerre a consommées depuis les dernières années du règne de Louis XIV jusqu'à la Révolution française, mais c'est le porter fort haut que de l'évaluer à un million. Les armées étaient alors peu nombreuses et les difficultés du recrutement obligeaient les généraux à ménager la vie de leurs soldats. La Révolution a changé cet état de choses en mettant à la disposition des chefs des armées républicaines ou impériales un nombre illimité de réquisitionnâmes ou de conscrits. Ils ont obtenu ainsi un avantage décisif sur leurs adversaires, accoutumés aux pratiques de l'ancien système, et l'on sait que Moreau qualifiait Napoléon de vainqueur à raison de 10.000 hommes par heure. Le peu de développement du crédit public obligeait de même les gouvernements à limiter leurs armements, et à conclure la paix aussitôt que leur trésor était épuisé. La faible augmentation des dettes publiques dans le cours du xviiie siècle nous fournit à cet égard une indication positive. D'après une statistique dressée par Dudley-Baxter, elles ne se seraient accrues que de ô milliards dans la période de 1715 à 1793;452 mais, à dater de cette époque,on voit l'industrie destructive de la guerre prendre un essor plus prodigieux encore que celui des industries productives. Les guerres de la Révolution et de l'Empire consommèrent environ 5 millions d'hommes; et ce compte s'est particulièrement accru dans la seconde moitié du siècle. En additionnant les victimes de la guerre depuis la Révolution, on est arrivé au monstrueux total de 9.840.000, près de 120 millions pour les pays appartenant à notre civilisation. La consommation des capitaux a progressé plus rapidement encore que celle des hommes. En sus des dépenses couvertes annuellement par l'impôt, la guerre et la paix armée, autrement dit la préparation à la guerre, ont participé pour cent milliards, au plus bas mot, à l'augmentation des dettes publiques dans le cours du siècle.
Cependant, ce qui était jadis la raison d'être de la guerre a cessé d'exister. Aussi longtemps que les peuples civilisés ont été menacés de destruction ou tout au moins de dépossession par les invasions des barbares, la guerre a été une nécessité. Car il fallait bien s'assurer contre un péril toujours imminent et inévitable.
Mais grâce aux progrès du matériel et de l'art de la destruction— et ces progrès n'ont pas été, pour le dire en passant, moins utiles que ceux du matériel et des arts de la production — ce péril a disparu. Les peuples civilisés envahissent au contraire et s'approprient les régions occupées par leurs anciens envahisseurs. La guerre ne s'impose plus a eux. Elle dépend de leur volonté.
Il s'agit donc de savoir s'ils ont encore intérêt à la vouloir. Cet intérêt existait sans aucun doute pour les aristocraties qui trouvaient dans la conquête d'un Etat ou d'une province un supplément de serfs ou de sujets qui leur fournissaient, parles corvées, les redevances ou les impôts, un supplément de revenus. Mais que peut bien rapporter la conquête de la province ou do l'Etat le plus riche à une nation qui demande ses moyens de subsistance non plus au pillage ou à l'exploitation du travail de ses esclaves, de ses serfs ou de ses sujets, mais à la culture de son sol et à la pratique honnête de son industrie? L'expérience de toutes les guerres qui ont ravagé le monde dans le cours de ce siècle n'a-t-elle pas attesté qu'elles ont coûté aux vainqueurs plus qu'elles ne leur ont rapporté? Comment donc s'expliquer que des êtres pourvus de raison et sachant compter continuent à pratiquer une industrie qui travaille à perte? Ce serait là sans doute un phénomène inexplicable, et une aberration du ressort des médecins aliénistes si les producteurs — chefs d'industrie, capitalistes et ouvriers qui paient les frais de toutes les guerres, possédaient dans le gouvernement des nations une influence prépondérante. Mais,en dépit des révolutions, des unifications et des constitutions politiques qui ont eu pour objet d'affranchir les nations de l'exploitation d'une caste nationale ou étrangère, la forme de leurs gouvernements seule a changé, le fond est demeuré le même. Les intérêts particuliers n'ont pas cessé de se coaliser pour faire la loi à l'intérêt général. Et dans toute l'Europe les intérêts engagés dans la conservation de l'étal de guerre, intérêts militaires et politiques, sont demeurés prépondérants. Les armées et les fonctions publiques qui étaient sous l'ancien régime l'unique débouché de la classe gouvernante, n'ont pas cessé d'être considérées comme supérieures aux autres emplois de l'activité humaine. Elles attirent encore de préférence les rejetons de l'ancienne classe dominante avec les parvenus de la nouvelle, et constituent un puissant faisceau d'intérêts, aussi bien dans la plupart des républiques que dans les monarchies. Or, la guerre étant aujourd'hui comme elle l'était jadis une source de profits e d'honneurs pour les militaires professionnels, il est naturel qu'ils y poussent. « Connaissez-vous bien mon armée, disait Napoléon? Cest un chancre qui me dévorerait, si je ne lui donnais de la pâture! »453
Cette pâture, les détenteurs du pouvoir, chefs d Etats et politiciens, sont d'autant plus disposés à la lui donner que la guerre fait taire les oppositions et ajourne, sauf à les aggraver plus tard, les difficultés intérieures. On s'explique donc que la guerre ait survécu aux périls qui menaçaient la civilisation, et il y a grande apparence qu'elle leur survivra aussi longtemps que cette industrie destructive disposera d'une influence politique supérieure à celle des industries productives qui en supportent les frais et les dommages. On s'explique aussi que l'accroissement extraordinaire de la productivité de l'industrie, en augmentant la richesse et la puissance des nations, ait déterminé un développement correspondant des appareils de guerre. Du moment où le risque de guerre subsiste et peut échoir du jour au lendemain, sous la pression d'intérêts qui demandent une pâture, il faut bien s'armer contre ce risque, opposer à l'ennemi une puissance destructive au moins égale à la sienne et, par conséquent, l'augmenter dans la proportion des forces et des ressources que créent et développent les progrès de l'industrie. Cette proportion, le régime de la paix armée l'a certainement atteinte aujourd'hui en Europe, s'il ne l'a point dépassée.
Ces énormes effectifs que nécessite le régime de la paix armée ne peuvent, d'ailleurs, sous peine de se rouiller, demeurer toujours inactifs. Un chômage trop prolongé détériore les ateliers de la destruction aussi bien que ceux de la production. La guerre est nécessaire à la santé des armées. Aussi enseigne-t-on dans les écoles militaires que chaque génération doit avoir la sienne. Mais les dettes publiques se sont tellement alourdies et le prix de revient d'une guerre entre des nations égales en puissance s'est tellement accru, qu'il est devenu de plus en plus difficile de donner satisfaction aux professionnels de l'art. Qu'a-t-on fait? On a remplacé, dans ce dernier quart de siècle, les guerres, désormais trop coûteuses entre les nations civilisées, par des guerres de conquête, d'exploitation ou de rapine, en dehors du domaine de la civilisation. Les gouvernements européens se sont partagé l'Afrique et ils mettent aujourd'hui la Chine au pillage, sous prétexte d'ouvrir de nouveaux débouchés à l'industrie et de faire participer les nègres, sans oublier les Chinois, aux bienfaits de notre civilisation. Mais il suffit d'additionner et de comparer les frais de conquête et de conservation des colonies, des protectorats et des zones d'influence avec les profits qu'en tirent l'industrie et le commerce, pour être édifié sur la valeur de ce prétexte. La conquête, l'assujettissement, l'exploitation fiscale et protectionniste n'ont pas la vertu d'étendre les débouchés de l'industrie et du commerce. Ils contribuent plutôt à les resserrer en augmentant les charges que les budgets de la guerre, de la marine et des colonies l'ont peser sur toutes les branches de la production. Quant à la civilisation, est-ce bien par le massacre et le pillage qu'on peut en faire apprécier les bienfaits aux « Barbares »?
Aux frais d'armement hors de toute proportion avec les besoins réels de sécurité des peuples civilises, aux guerres engagées pour donner satisfaction à des intérêts de caste, de parti ou de dynastie, il faut ajouter, dans la colonne du passif du xixe siècle, une augmentation continue du prix des services sur lesquels les gouvernements l'ont main basse aux dépens de l'activité privée, et les frais d'un système de prétendue protection de l'industrie qui ne rétribue aucun service.
Les révolutions et les réformes politiques qui ont eu pour objet d'enlever aux oligarchies nobiliaires et cléricales de l'ancien régime le monopole du gouvernement des nations n'ont eu. en fait, d'autres résultats que d'étendre successivement ce monopole, et de conférer ainsi à une classe de plus en plus nombreuse le pouvoir et l'influence naturellement attachés à la possession de l'Etat. Les fonctions qui servaient de débouchés à l'ancienne classe gouvernante n'ont plus suffi à la nouvelle. 11 a fallu les multiplier pour satisfaire à l'accroissement de la demande. L'extension des attributions de l'Etat est devenue par conséquent une nécessité politique. En vain, les économistes, gens naïfs et incapables d'apprécier ce genre de nécessité, se sont évertués à démontrer que les produits et les services de l'Etat reviennent plus cher aux consommateurs que ceux de l'industrie privée; que les fonctionnaires de l'Etat sont plus mal recrutés, moins laborieux et moins serviables que ceux des entreprises particulières, rien n'y a fait. Sous la pression irrésistible des influences électorales et autres, l'Etat a étendu ses attributions et multiplié ses fonctionnaires, et les petits Etats municipaux, départementaux ou provinciaux ont suivi partout l'exemple du grand. Pour ne citer que la France, le nombre des fonctionnaires publics de tout ordre s'y est élevé, dans le cours du siècle, de 60.000 à 400.000, et l'étatisme va, de même, se propageant dans les autres pays, sans excepter l'Angleterre, à mesure que l'extension de la classe gouvernante augmente la demande des places.
Aux bénéfices provenant du monopole des fonctions publiques se joignaient, sous l'ancien régime, ceux des privilèges en matière d'impôts et des redevances féodales. Ces privilèges et ces redevances, après avoir été abolis sous leurs anciennes formes, ont peu à peu reparu, sous d'autres formes adaptées aux intérêts dominants. Les impôts indirects et les monopoles qui pèsent principalement sur les couches politiquement les moins influentes de la population, et qui ne figuraient en France que pour un tiers dans le budget des recettes, ont atteint successivement la proportion des deux tiers. Les droits de douane que le traité de 1780 avait abaissés, sous l'influence des doctrines libérales, propagées en Angleterre par l'école d'Adam Smith, en France par celle de Quesnay et de Turgot,ont été relevés, d'abord à titre d'instruments de guerre, ensuite d'instruments de protection et mis au service des intérêts politiquement influents. Ils ont remplacé, pour les grands propriétaires terriens, les redevances féodales et ont été étendus aux détenteurs de la propriété industrielle coalisés avec eux.
Cette coalition s'est rompue en Angleterre, et les intérêts agrariens réduits à leurs propres forces ont succombé sous l'effort de la Ligue contre les lois céréales. La multitude, exonérée du tribut qu'elle payait aux intérêts privilégiés, a pu augmenter sa consommation des articles de nécessité et de confort, tout en accroissant son épargne, et l'industrie britannique,encouragée par le développement de la consommation et stimulée par la concurrence, a pris un essor merveilleux.454
L'exemple de l'Angleterre a été suivi d'abord par les autres nations et on a pu croire, un moment, qu'une nouvelle ère de liberté et de paix allait s'ouvrir pour le monde. Mais l'illusion a été courte. Les intérêts militaristes et protectionnistes n'ont pas tardé à reprendre le dessus. La guerre de la Sécession américaine, en donnant la victoire aux Etats protectionnistes, leur a permis d'élever le tarif au gré de leurs appétits. La guerre franco-allemande, en provoquant, avec une recrudescence du militarisme, l'accroissement général des budgets de la guerre, a obligé les gouvernements à demander à leurs parlements un complément de ressources. La coalition protectionniste a trouvé cette occasion favorable pour se reformer et mettre à prix son concours.
Les tarifs de douane ont été relevés dans le double intérêt de la fiscalité et de la protection. En Allemagne, en Italie, en France les droits sur les articles de première nécessité, le pain et la viande, ont été exhaussés de manière à en élever les prix d'un tiers ou de moitié, dans l'intérêt des propriétaires fonciers, tandis que d autres exhaussements de tarifs sur les matériaux des vêtements, d? l'ameublement, des transports, fournissaient,avec l'adjonction d'un système de primes, la part de leurs alliés, les propriétaires d'industries, aux dépens de la généralité des consommateurs et des contribuables. Aux impôts que ceux-ci doivent à l'Etat s'ajoutent les impôts qu'ils ne doivent pas, et qui ne sont, en réalité, autre chose que les vieilles redevances féodales transformées et modernisées.
On s'explique donc que l'augmentation extraordinaire de la richesse,déterminée par une merveilleuse efflorescence de progrès, n'ait pas accru d'une manière équivalente le bien-être des peuples civilisés. L'incapacité et les vices des gouvernements, le militarisme, l'étatisme, le protectionnisme ont dévoré une forte part de cette plus-value de l'industrie. L'ignorance et l'insuffisance morale des individus émancipés de l'onéreuse tutelle de la servitude, mais encore incapables de supporter tout le poids de la responsabilité attachée à la liberté, en ont détruit ou stérilisé une autre part. Il faut bien le dire. La multitude qui vivait au jour le jour du produit de son travail ne possédait ni la capacité, ni les ressources nécessaires pour mettre en pleine valeur son capital de forces productives. Comme le constatait Adam Smith, l'ouvrier dépourvu d'avances se trouvait vis-à-vis de l'employeur dans une situation inégale, qu'aggravait la défense de remédier à cette inégalité par l'association. D'un autre côté, il avait à faire le difficile apprentissage de la liberté, il devait régler et contenir ses besoins actuels en prévision des nécessités futures, pourvoir aux accidents et aux chômages, remplir toutes ses obligations envers lui-même et envers les êtres dont il était responsable. Doit-on s'étonner s'il n'a point suffi à cette tâche, si, avec un salaire débattu dans des conditions inégales et diminué par les charges des impôts qu'il devait et celles des impôts qu'il ne devait pas, il a trop souvent succombé sous le faix, et si, en même temps que croissait la richesse, se propageaient la misère et la dégradation morale?
Ces maux qui ont accompagné la transformation de l'industrie et l'émancipation des classes ouvrières, les économistes se sont appliqués aies rattachera leurs véritables causes, et à réclamer les réformes propres à y remédier. Mais ces réformes se heurtent à des intérêts puissants et intraitables, et elles n'ont point d'ailleurs une efficacité immédiate et radicale. Los socialistes ont eu plus de succès en attribuant eu bloc les souffrances de la multitude à un pouvoir mystérieux et redoutable qu'ils ont désigné et stigmatisé sous le nom de tyrannie du capital. Cette tyrannie, ils convient les masses ouvrières à la renverser, en employant le procédé expéditif d'une révolution sociale. La révolution faite les socialistes autoritaires, collectivistes ou communistes, se proposent de charger l'Etat de réorganiser la société; les socialistes anarchistes, au contraire, veulent abolir l'État, mais les uns elles autres s'accordent sur un point essentiel: la confiscation du capital.
Et telle est la solution de la question sociale qui lient le record de la popularité à l'aurore du xxe siècle.
III
Le xixe siècle lègue à son successeur un héritage de milliardaire. Aucun de ses prédécesseurs n'a autant grossi la fortune qu'il avait reçue. Mais s'il a agrandi son domaine et augmenté dans des proportions auparavant inconnues la somme de ses richesses immobilières et de ses valeurs mobilières, il laisse cet énorme héritage fortement grevé de dettes. Il lègue aussi à ses héritiers, sans parler des vices communs à tous les siècles, et dont il ne s'est guère appliqué à se corriger, des habitudes enracinées et aggravées de dissipation et de gaspillage.
Le xxe siècle continuera sans aucun doute à accroître la productivité de l'industrie et à multiplier la richesse. Ses savants, ses inventeurs, ses industriels, ses capitalistes, ses ouvriers ne chômeront point, ils travailleront sans relâche à augmenter la somme des matériaux de la civilisation et du bien-être. Mais il est malheureusement permis de craindre que l'œuvre de ces artisans laborieux de la production ne continue aussi à être contrariée, par l'aveugle égoïsme des intérêts, que ses fruits ne soient, comme d'habitude, détournés de leur destination utile, et employés à des fins nuisibles.
Pendant que la science et l'industrie multiplient la richesse, le militarisme, 1’étatisme et le protectionnisme, en attendant le socialisme, s'associent pour la détruire, et en épuiser la source. Les recettes que le travail annuel des nations fournit au budget des gouvernements ne suffisent plus à leurs dépenses. C'est en grevant le travail des générations futures qu'ils rétablissent l'équilibre. Les dettes publiques de l'Europe ont doublé dans la seconde moitié du siècle. En suivant la même progression, elles atteindront pour le moins 400 milliards en l'an 2000. Quels que soient les progrès de la production, ce fardeau ne dépassera-t-il pas les forces des producteurs? Souhaitons donc — et c'est le vœu le plus utile que nous puissions adresser à notre descendance —, que le xxe siècle n'excelle pas seulement, comme son devancier, à produire de la richesse, mais qu'il apprenne à la mieux employer.
[Table from footnote]
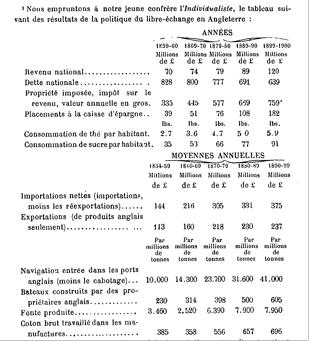
76. Gustave de Molinari on “The Prospects for the 20th Century” (1902)↩
[Word Length: 3,415]
Source
Gustave de Molinari, "Le XXe siècle", Journal des Économistes, Janvier 1902, pp. 5-14.
LE XXe SIÈCLE
I
Le caractère particulier du xixe siècle, disions-nous dans notre revue de l'année dernière, ce qui le distingue de tous les siècles qui l'ont précédé, c'est une augmentation prodigieuse de la puissance productive de l'homme, en d'autres termes, de sa capacité de créer de la richesse. Mais comme il arrive d'habitude aux nouveaux enrichis, les peuples dont la fortune s'est subitement accrue grâce à une efflorescence extraordinaire de progrès matériels, n'ont pas acquis en même temps la capacité morale nécessaire pour en gouverner honnêtement et utilement l'emploi. Ils ont donné le spectacle des appétits grossiers et des vices des parvenus. Les classes en possession de la machine à faire les lois s'en sont servis pour satisfaire leurs intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général : le militarisme, l'étalisme et le protectionnisme se sont joints pour détourner de leur destination utile, détruire ou stériliser les fruits du progrès. Chose à peine croyable! à mesure que s'est amoindrie l'utilité des couteux appareils de guerre que l'ancien régime avait légués au nouveau, on les a renforces et développés au lieu de les réduire. Tandis que les progrès de la puissance destructive, allant de pair avec ceux de la puissance productive, assuraient d'une manière définitive les nations civilisées contre le risque des invasions des barbares, et que, d'une autre part, la guerre cessait d'être un mode avantageux d'acquisition de la richesse pour devenir une cause d'endettement et de ruine, les armements prenaient des proportions de plus en plus formidables, et la guerre dévorait, dans le cours du xix" siècle, dix fois plus d'hommes et de capitaux que dans aucun des siècles antérieurs. De même, tandis que le développement de l'esprit d'entreprise et d'association permettait d'abandonner désormais à l'initiative libre des individus les travaux et les services d'intérêt public, on a vu l'Etat empiéter chaque jour davantage sur le domaine de l'activité privée, et remplacer l'émulation féconde des industries de concurrence par l'onéreuse routine de ses monopoles. Moins l'intervention de l'Etat est devenue utile, plus s'est étendue la lèpre de l'Etatisme! Enfin, tandis que la multiplication et le perfectionnement merveilleux des moyens de transport, à l'usage des agents et des matériaux de la production, égalisaient partout les conditions d'existence de l'industrie, et, en mettant en communication constante les marchés de consommation auparavant isolés, enlevaient sa raison d'être originaire au régime de la protection, l'esprit de monopole des classes gouvernantes et légiférantes exhaussait et multipliait les barrières du protectionnisme.
A en juger par ses débuts, le xxe siècle suivra sous ce triple rapport l'exemple de son devancier. Pendant l'année qui vient de finir, les dépenses des gouvernements de l'ensemble des pays civilisés se sont augmentées comme d'habitude,et cette augmentation a porté, comme d'habitude aussi, sur les moins utiles. Nulle part, les services de la justice et de la police qui intéressent la sécurité des individus ne reçoivent une allocation proportionnée aux risques auxquels sont exposées la vie et la propriété de chacun. Aussi ne voit-on nulle part s'abaisser le taux de ces risques et l'industrie des malfaiteurs de toute espèce demeure-t-elle aussi florissante que jamais. Quoique les risques extérieurs qui peuvent menacer la vie et la propriété individuelles, du fait des invasions étrangères, soient devenus à peu près nuls depuis que l'expérience a démontré que toute guerre coûte aujourd'hui plus qu'elle ne rapporte, les budgets de la guerre et de la marine ne cessent point de s'accroître. Ils s'accroissent en raison non de l'augmentation mais de la diminution des risques qu'ils ont pour objet de couvrir. Tous les jours, on met sur les chantiers des cuirassés qui reviennent à une trentaine de millions au bas mot, et qui ne serviront qu'à de fastueuses et vaines parades. A cet égard, l'Espagne a donné un exemple caractéristique. Loin de réduire du montant des frais de garde des colonies qu'elle a perdues les budgets de ses armées de terre et de mer, et de réaliser ainsi une économie indispensable à ses finances délabrées, elle les a augmentés, ses politiciens, — les libéraux aussi bien que les conservateurs, — ayant déclaré « intangibles » ces dépenses désormais inutiles. Quant au budget de la protection qui se superpose au budget de l'Etat, il n'a pas cessé davantage de s'épanouir. En France, la commission des douanes a continué activement à compléter et à perfectionner le tarif Méline, les primes à la marine marchande ont été renouvelées sauf un léger correctif, le régime des admissions temporaires u été modifié dans un sens restrictif etc. etc., en Suède les droits sur les denrées agricoles et la plupart des produits de l'industrie ont été aggravés, en Hollande même, le régime traditionnel de la liberté commerciale est sérieusement menacé par les appétits protectionnistes, en Allemagne, le gouvernement, dominé par une féodalité agrarienne, a présenté au Reichstag un projet de tarif destiné à élever le taux de la rente du sol aux dépens du salaire du travail.
Comment les nations civilisées peuvent-elles consentir à supporter cette politique de gaspillage et de privilège qui a plus que triplé en cinquante ans le chiffre de leurs dettes455, multiplié et alourdi les impôts qu'elles doivent et ceux qu'elles ne doivent pas? On s'explique ce phénomène, d'ailleurs peu flatteur pour leur moralité et leur intelligence, quand on examine de près leurs éléments constitutifs. Elles se composent au moins pour les neuf dixièmes d'individus, préoccupés uniquement de leurs intérêts particuliers et immédiats, ignorants ou insouciants des intérêts généraux et permanents de la nation, à plus forte raison de l'humanité. Dans les pays tels que la Russie où la multitude des gouvernés est privée des droits politiques qu'elle est. au surplus, incapable d'exercer, le gouvernement se trouve entre les mains d'une classe mi-bureaucratique, mi-propriétaire et industrielle qui lire la plus grosse part de ses revenus du budget de l'Etal el du budget de la protection. Dans les pays dits constitutionnels où les gouvernés sont en nombre plus ou moins considérable pourvus du droit électoral, la grande majorité use de ce droit pour en tirer un profit quelconque ou s'abstient d'en user. A la condition de favoriser les intérêts les plus influents, le gouvernement peut impunément sacrifier ou négliger les autres. Or les intérêts les plus influents sont précisément ceux de la classe dans laquelle se recrutent les hauts fonctionnaires civils et militaires qui demandent leurs moyens d'existence au budget de l'Etat, les propriétaires fonciers et les industriels qui se partagent le budget de la protection. Comment.donc cette classe budgétivore ne pousserait-elle pas à l'augmentation continue des dépenses dont elle profite, et n'emploierait-elle pas à les multiplier la puissance de l'Etat dont elle dispose?
Et remarquons que la puissance de l'Etat, investie dans l'appareil gouvernemental, s'est singulièrement accrue sous l'influence des progrès des moyens de mobilisation de ses forces et de ses ressources. Cette puissance esl telle qu'elle délie toutes les résistances individuelles el donne aux gouvernements modernes une capacité d'oppression des minorités bien supérieure à celle des gouvernements de l ancien régime. Quand un souverain d'autrefois entrait en possession d'une province, soit par la guerre, soit par héritage, il se gardait prudemment de toucher aux institutions particulières de ses nouveaux sujets. Il respectait leurs coutumes et leur langue. Lorsque Louis XIV s'empara de l'Alsace, il s'abstint même de changer son régime douanier. L'Alsace demeura une province dite d'étranger effectif et, comme telle, affranchie des charges du tarif protectionniste de Colbert. 11 n'en esl plus -ainsi de nos jours. Les gouvernements usenl sans ménagement du droit du plus fort vis-à-vis des populations qui tombent sous leur domination. C'est ainsi que !e gouvernement russe, méconnaissant ses engagements formels, a assujetti la Finlande au régime autocratique du resle de l'Empire, et que le gouvernement allemand a interdit aux Danois du Schleswig et aux Polonais de la Posnanie l'usage de leur langue maternelle, en sanctionnant cette prohibition aussi inepte qu'odieuse par l'abus le plus insolent et le plus brutal de la force.
II
Malgré la rapidité avec laquelle se développe le budget de l'Étal, il pourrait cependant être bientôt dépassé par le budget de la protection grâce au perfectionnement que l'esprit de monopole a apporté au mécanisme protectionniste par l'invention et la propagation des trusts, des cartels et des syndicats.
Les trusts aux États-Unis, les cartels en Allemagne, les syndicats et les comptoirs de vente en France sont, avec des différences d'organisation, constitués en vue d'un double objet, l'un de diminuer les frais de la production et de l'échange des produits, l'autre, d'élever les prix au niveau des droits protecteurs et de les y maintenir, en supprimant la concurrence intérieure, de manière à procurer aux industries protégées la totalité du bénéfice de la protection. En effet, l'expérience a démontré qu'il ne suffit pas d'exclure du marché intérieur les produits concurrents de l'étranger pour exhausser de tout le montant des droits, les prix au-dessus du taux du marché général: qu'il arrive même, lorsque les droits portés à un taux prohibitif procurent d'emblée des bénéfices extraordinaires aux industries protégées,que l'esprit d'entreprise et les capitaux s'y portent avec surabondance, en déterminant une surproduction et une baisse qui ramènent les prix au taux du marché général et les font parfois tomber au-dessous. Alors, aux bénéfices plantureux de la première heure succèdent des pertes ruineuses. La chute des entreprises les moins solides dégage,à la vérité, le marché de l'excédent de la production et relève les prix, mais ce relèvement, en attirant de nouveau l'esprit d'entreprise et les capitaux, détermine un retour de la baisse.
Le régime de la protection engendre ainsi un état permanent d'instabilité, dans lequel à une période de hausse provoquée par l'exclusion de la concurrence extérieure succède une série de mouvements alternatifs de rétraction et d'expansion de la concurrence intérieure. Dans les périodes de rétraction les prix peuvent s'élever de tout le montant des droits, et s'il s'agit de denrées de première nécessité, être portés à un taux de famine. Les droits jouent alors entièrement et les producteurs réalisent la totalité des bénéfices possibles de la protection. Dans les périodes d'expansion, au contraire, les droits cessent de jouer, les producteurs vendent à perle et se ruinent. C'est, disons-nous, pour prévenir ces fluctuations désastreuses, élever et stabiliser les prix au niveau des droits protecteurs, que les industriels américains ont entrepris de supprimer la concurrence intérieure, en constituant des trusts qui fusionnent les entreprises concurrentes de la même industrie. Dans quelques cas, ils ont complètement atteint leur but : la Standard Oil Co. et le Sugar trust fournissent la presque totalité du pétrole et du sucre consommés aux Etats-Unis et sont, en fait, maîtres du marché. Le dernier et le plus colossal des trusts, l’United States Steel Co. constitué au mois de mars dernier par la réunion de huit groupes d'entreprises, commande de même le marché des branches principales de la métallurgie. Ce trust monstrueux est formé au capital de 1.100 millions de dollars, et l'ensemble des capitaux des trusts est évalué à 7 milliards de dollars, soit 35 milliards de francs. Les cartels allemands, les syndicats français, syndicat des sucres, comptoir métallurgique à Longwy et autres, sont loin d'avoir atteint le développement des trusts, mais tous, trusts, cartels, syndicats, poursuivent le même objectif, qui est de s'assurer intégralement les bénéfices de la protection en empêchant la concurrence intérieure de troubler le jeu des droits protecteurs.
En Allemagne et en France ces tentatives encore partielles de monopolisation du marché n'ont pas sérieusement ému l'opinion publique. Il en a été autrement aux Etals-Unis. Comme d'habitude, c'est au gouvernement que l'opinion alarmée a eu recours pour défendre les intérêts menacés parla surpression de la concurrence intérieure. Dans la plupart des Etats de l'Union, des lois ont été faites pour empêcher la formation des trusts ou limiter leur pouvoir, mais ces lois, qui avaient pour défaut commun de faire obstacle au développement légitime et utile des entreprises sont demeurées impuissantes contre les manœuvres de l'esprit de monopole : aux combinaisons interdites par les lois, les trusts ont substitué des formes d'association inattaquables. Rien ne serait plus facile cependant que de leur porter un coup mortel : au lieu de faire des lois pour les réglementer, il suffirait de défaire la loi, qui a limité artificiellement la concurrence, en entourant le marché intérieur d'une muraille douanière. Le fondateur du trust des sucres n'a-t-il pas attesté, lui-même, l'efficacité de ce remède en avouant que le tarif est le « père des trusts? »
Mais les tarifs de douane, soit qu'on les considère comme des instruments de fiscalité ou de protection sont défendus par des intérêts puissants. Ils fournissent partout une portion notable des ressources qui alimentent le militarisme et l'étatisme, et la totalité de la dime que le protectionnisme prélève sur la généralité des consommateurs et des contribuables. L'Angleterre seule a enlevé à son tarif tout caractère protectionniste, mais son exemple n'a été suivi que d'une manière momentanée, et on n'oserait affirmer que la réforme bienfaisante dont elle est redevable aux Cobden, aux Robert Peel, aux Gladstone, soit pleinement assurée contre un retour offensif du protectionnisme allié à l'impérialisme.
III
Cependant, il serait injuste de rendre les classes gouvernantes responsables de tous les maux qui affligent nos sociétés, ainsi que le font d'habitude les socialistes. Une part de ces maux, et peut-être la plus grosse part, a sa source dans l'incapacité et l'immoralité du gouvernement de l'individu par lui-même. Le budget de la débauche et de l'ivrognerie,par exemple, atteint, s'il ne le dépasse point, dans le plus grand nombre des pays civilisés, le budget du militarisme.Mais,quel que soit le point de partage de la responsabilité des erreurs et des vices du gouvernement de la société et du gouvernement de l'individu, ces erreurs et ces vices causent invariablement une déperdition des richesses qui se répercute sur les classes les moins capables d'en supporter le dommage. De là un malaise et un mécontentement qui semblent, au premier abord, inexplicables, à une époque où des progrès de toute sorte permettent à l'homme d'acquérir les matériaux de la vie en échange d'une somme de plus en plus réduite de travail et de peine.
C'est de ce malaise et de ce mécontentement succédant à des espérances excessives et prématurées qu'est né le socialisme.
A ses débuts, dans la première partie du siècle dernier, le socialisme apparaît sous la forme de simples utopies, conçues par des esprits bienveillants et chimériques. Sans tenir aucun compte des conditions naturelles d'existence de la société, les SaintSimon, les Fourier et leurs émules rêvent de la reconstruire sur un plan nouveau, mais ils ne songent point à en appeler à la force pour réaliser leurs utopies. Us sont convaincus qu'il suffira de les propager à la manière des apôtres, pour les faire adopter sans résistance, car ce qu'ils apportent à l'humanité c'est le bonheur universel. D'ailleurs, où trouveraient-ils la force nécessaire pour les imposer? Ils la demanderaient en vain aux classes en possession du pouvoir et de la richesse.Quant à la multitude disséminée en groupes peu nombreux et sans liens dans les ateliers de la petite industrie, celte multitude à l'état amorphe ne pouvait leur fournir aucun point d'appui dans la première moitié du xix' siècle. Privée de tout droit politique, elle ne comptait point dans l'Etat.
Mais dans la seconde moitié du siècle, la situation a changé du tout au tout. La grande industrie a rassemblé dans ses ateliers des milliers de travailleurs, que la transformation et la multiplication des moyens de communication a contribué encore à rapprocher, les lois sur les coalitions ont été abolies et les droits politiques sont descendus dans les couches inférieures de la société : au suffrage restreint qui en conférait le monopole aux classes supérieure et moyenne, a succédé le suffrage universel. Dans ce nouvel état des choses, la classe la plus nombreuse et la plus pauvre, comme la nommait Saint-Simon, a cessé d'être une poussière sans consistance pour devenir une masse compacte et en voie de s'organiser. Elle a fourni au socialisme le point d'appui qui lui manquait à ses débuts. A son tour, il s'est transformé pour s'adapter à l'état d'esprit de sa clientèle. Cet état d'esprit ne diffère point de celui des classes supérieure et moyenne el comment serait-il plus éclairé et plus moral? Imbue à leur exemple de la doctrine héritée de l'époque où la guerre était le mode le plus lucratif d'acquisition de la richesse, où, par conséquent, le profit de l'un faisait le dommage de l'autre, la démocratie ouvrière est naturellement convaincue qu'elle ne peut s'enrichir qu'on dépouillant les riches. En conséquence, ce qu'elle demande a la loi, c'est de confisquer le capital ou tout au moins de le mettre à la merci du travail. Le collectivisme a répondu à cette demande. En vain, les classes encore en possession du pouvoir de faire la loi s'efforcent aujourd'hui de parer à ce danger, en offrant au cerbère de la démocratie le gâteau des lois dites ouvrières, loi limitative de la durée du travail, en attendant la loi du minimum du salaire, loi reportant sur les employeurs la responsabilité des accidents, naturellement afférente aux employés, loi imposant aux patrons et à l'Etat une part du fardeau des pensions ouvrières, etc., etc., ces offrandes de la peur n'ont pas la vertu de détourner la clientèle du collectivisme, car il lui promet la totalité des biens dont l'Etat bourgeois ne lui offre qu'une part; encore n'est il pas bien certain que cette part ne lui aura point été reprise par la répercussion des lois naturelles qui régissent l'impôt et le salaire.
IV
Aux deux partis qui se sont disputé pendant le cours du xixe siècle la possession de l'Etat et la confection des lois, l'un, le parti conservateur recruté principalement dans la classe gouvernante de l'ancien régime, l'autre, le parti libéral issu de la bourgeoisie, enrichie par l'industrie, se joint maintenant un troisième parti, représentant la classe ouvrière investie des droits politiques : le parti socialiste. Il semble même que ces trois partis doivent bientôt se réduire à deux. Ne voyons-nous pas le parti libéral se dissoudre partout, et ses éléments constitutifs s'unir suivant l'affinité de leurs intérêts au parti conservateur ou au parti socialiste? On peut donc prévoir que la lutte pour la possession de l'Etat et la confection des lois, qui s'est poursuivie dans le cours du xix« siècle entre le parti conservateur et le parti libéral se poursuivra au xx" entre le parti conservateur et le parti socialiste. On peut prévoir aussi que cette lutte ne sera pas moins ardente, et selon toute apparence moins stérile que ne l'a été sa devancière, et qu'elle engendrera la même série de révolutions, de coups d état, avec le dérivatif sanglant des guerres étrangères et des expéditions coloniales, qui ont constitué ce qu'on pourrait appeler le passif de la civilisation du xixe siècle.
Si ces prévisions auxquelles conduit, il faut bien le dire, l'enchaînement logique des faits devaient se réaliser, elles justifieraient le pessimisme qui a succédé à l'optimisme des premiers temps du nouveau régime politique et économique. Il est en effet trop évident que la lutte pour la possession du gouvernement ne pourra que croître en violence et que le jour où le parti socialiste aura le pouvoir de faire la loi,il en usera avec moins de discrétion que le parti soi-disant libéral et réformateur dont il est en train de recueillir l'héritage. Il taillera dans le vif de la propriété et de la liberté individuelles. Il brisera ou faussera les ressorts du mécanisme délicat de la production des matériaux de la vie... Mais n'est-il pas permis d'espérer que l'échec inévitable des tentatives de réorganisation artificielle de la société, et le surcroît de misère et de souffrances dont elles seront suivies,feront naître une conception plus saine du rôle de la loi et détermineront la création d'un parti anti-socialiste aussi bien qu'anti-protectionniste. Nous n'ignorons pas que la constitution d'un parti qui n'aurait à offrir à ses officiers et à ses soldats ni « places », ni protections ou subventions, ni bureaux de tabac,pourrait, au premier abord,sembler une entreprise chimérique. On connaît le mot du président Jackson : aux vainqueurs les dépouilles! Pourquoi lutterait-on s'il n'y avait pas de dépouilles, se disent les politiciens de l'école de Jackson ; mais, ne leur en déplaise, il y a encore, il y aura toujours des hommes disposés à servir gratis une bonne cause, et c'est pourquoi nous ne désespérons pas de voir se fonder, au xxe siècle, un parti qui a manqué au xixe : le parti du moindre gouvernement.
77.Vilfredo Pareto on "The Circulation of Elites and Socialism" (1902)↩
[Word Length: 4,996]
Source
Vilfredo Pareto, Les Systèmes socialistes (Paris: V. Giard & E. Brière, 1902). 2 vols. Vol. 1, Selections from "Introduction," pp. 1-73.
INTRODUCTION
Dessein de l'ouvrage. — Le point de vue scientifique. — Influence du sentiment. — Il doit demeurer étranger à la science. — Résumé de quelques principes de physiologie sociale. — La distribution de la richesse. — Les hiérarchies sociales. — La succession des élites. — Décadence des élites. — Les aristocraties doivent se renouveler constamment. — Un simple retard dans la circulation des élites a une influence funeste sur la société. — Les élites peuvent venir du dehors ou être produites dans la société. — Elles proviennent principalement des classes agricoles et sont le produit d'une sélection rigoureuse. — Comment le phénomène de circulation des élites se présente à la conscience des hommes. — En général, le phénomène objectif et le phénomène subjectif diffèrent. — L'histoire et la sociologie doivent du dernier déduire le premier. — Les hommes, fort souvent, n'ont pas conscience des forces qui les poussent à agir. — Un grand nombre de leurs actions n'ont pas leur source dans le raisonnement. — Mais les hommes aiment à se figurer qu'elles en dépendent. — Ils trouvent des causes imaginaires. — Nous traiterons toutes les questions au point de vue objectif et au point de vue subjectif. — La théorie matérialiste de l'histoire. —Son insuffisance. — Mouvement ondulé, rythmique. — Exemple. — Il ne faut pas confondre la forme, éminemment variable, avec le fond, beaucoup plus persistant, des sentiments. — L'élite qui veut chasser une autre du pouvoir se pose souvent en défenseur des opprimés. — Mais à peine arrivée au pouvoir, elle les opprime à son tour. — Illusions à ce sujet. — L'invasion des sentiments humanitaires est souvent un signe qui annonce la décadence d'une élite. — Le droit se réalise par la force. — Exemple d'un cas concret de la succession des élites. Source des sentiments socialistes. — Les sentiments des classes inférieures. — Les sentiments des classes supérieures. — Les idées scientifiques.
[cut pp. 2-8] [include pp. 8-15 below]
Les mêmes individus n'occupent pas les mêmes places dans les mêmes figures que, par hypothèse, nous venons de tracer. Il serait, en effet, évidemment absurde d'affirmer que les individus qui occupent les couches supérieures, dans la figure qui représente la distribution du génie mathématique ou poétique, sont les mêmes que ceux qui occupent les couches supérieures, dans la figure qui donne la distribution de la richesse. Cette différente distribution par rapport aux qualités morales, ou réputées telles, et par rapport à la richesse a donné lieu à des déclamations sans fin. Pourtant il n'y a rien là que de très compréhensible. Les qualités d'un saint François d'Assise, par exemple, sont tout autres que celles d'un Krupp. Les gens qui achètent des canons d'acier ont besoin d'un Krupp et non d'un saint François d'Assise.
Mais si l'on dispose les hommes selon leur degré d'influence et de pouvoir politique et social, en ce cas, dans la plupart des sociétés, ce seront, au moins en partie, les mêmes hommes qui occuperont la même place dans cette figure et dans celle de la distribution de la richesse. Les classes dites supérieures sont aussi généralement les plus riches.
Ces classes représentent une élite, une aristocratie456 (dans le sens étymologique: âptaxoc = meilleur). Tant que l'équilibre social est stable, la majorité des individus qui les composent apparaît éminemment douée de certaines qualités, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, qui assurent le pouvoir.
Il est un fait d'une extrême importance pour la physiologie sociale et c'est que les aristocraties ne durent pas. Elles sont toutes frappées d'une déchéance plus ou moins rapide. Nous n'avons pas à rechercher ici les causes de ce fait,457 il nous suffit de constater son existence, non seulement pour les élites qui se perpétuent par l'hérédité, mais aussi, bien qu'à un moindre degré, pour celles qui se recrutent par cooptation.
La guerre est une cause puissante d'extinction des élites belliqueuses.458 Le fait a été connu de tout temps et l'on a même été tenté de considérer cette cause comme étant la seule qui faisait disparaître ces élites. Mais cela n'est pas. Même au sein de la paix la plus profonde, le mouvement de circulation des élites continue, même les élites qui n'éprouvent aucune perte par la guerre disparaissent, et souvent assez promptement. Il ne s'agit pas seulement de l'extinction des aristocraties par l'excès des morts sur les naissances mais aussi de la dégénération des éléments qui les composent.459 Les aristocraties ne peuvent donc subsister que par l'élimination de ces éléments et l'apport de nouveau. Il y a là un processus semblable à celui qui s'observe chez l'animal vivant, lequel ne subsiste qu'en éliminant certains éléments et en les remplacent par d'autres, qu'il assimile. Si cette circulation est supprimée, l'animal meurt, il est détruit. Il en est même pour l'élite sociale et si la destruction peut en être plus lente, elle n'en est pas moins sûre.
Un simple retard dans cette circulation peut avoir pour effet d'augmenter considérablement le nombre d'éléments dégénérés que renferment les classes qui possèdent encore le pouvoir et d'augmenter, d'autre part, le nombre d'éléments de qualité supérieure que renferment les classes sujettes. En ce cas l'équilibre social devient instable; le moindre choc, qu'il vienne de l'extérieur ou de l'intérieur, le détruit. Une conquête ou une révolution viennent tout bouleverser, porter au pouvoir une nouvelle élite, et établir un nouvel équilibre, qui demeurera stable pendant un temps plus ou moins long.
MM. Ammon et de Lapouge spécifient trop lorsqu'ils veulent nous donner les caractères anthropologiques de ces élites, de ces eugéniques, et les identifier avec les dolichocéphales blonds. Pour le moment, ce point demeure obscur, et de longues études sont encore nécessaires avant de pouvoir décider si les qualités psychiques des élites se traduisent par des caractères extérieurs, anthropométriques, et pour pouvoir connaître quels sont précisément ces caractères.
Pour les sociétés contemporaines, en Europe, la conquête par des races eugéniques étrangères a perdu toute importance, depuis les dernières grandes invasions des barbares, et n'existe plus. Mais rien n'indique qu'elle ne puisse encore apparaître dans l'avenir. Si les sociétés européennes devaient se modeler sur l'idéal cher aux éthiques, si l'on parvenait à entraver la sélection, à favoriser systématiquement les faibles, les vicieux, les paresseux, les mal adaptés, les « petits et les humbles », comme les nomment nos philanthropes, aux dépens des forts, des hommes énergiques, qui constituent l'élite, une nouvelle conquête de nouveaux « barbares » ne serait nullement impossible.
Actuellement, dans nos sociétés, l'apport des nouveaux éléments, indispensables à l'élite pour subsister vient des classes inférieures et principalement des classes rurales.460 Celles-ci sont le creuset où s'élaborent, dans l'ombre, les futures élites. Elles sont comme les racines de la plante dont l'élite est la fleur; cette fleur passe et se fane, mais elle est bientôt remplacée par une autre, si les racines ne sont pas atteintes.
Le fait est certain, les causes n'en sont pas encore bien connues. Pourtant il paraît fort probable que la sélection rigoureuse qui s'exerce dans les classes inférieures, surtout pour les enfants, a une action des plus importantes.461 Les classes riches ont peu d'enfants et les sauvent presque tous, les classes pauvres ont beaucoup d'enfants et perdent en grand nombre ceux qui ne sont pas particulièrement robustes et bien doués. C'est la même raison pour laquelle les races perfectionnées des animaux et des plantes sont très délicates en comparaison des races ordinaires. Pourquoi les chats d'Angora sont-ils des animaux bien plus délicats que les chats de gouttière? Parce qu'ils sont entourés de soins; on tâche de sauver tous les petits de la portée d'une chatte d'Angora, tandis que de la portée d'une malheureuse chatte ordinaire, errante et famélique, ne se sauvent que les petits qui sont doués d'une excellente santé. Les soins dont le blé est entouré depuis un grand nombre de siècles ont rendu cette plante incapable de résister à la concurrence vitale: le blé sauvage n'existe pas.
Les éthiques qui veulent persuader les classes riches de nos sociétés à avoir beaucoup d'enfants, les humanitaires qui voulant, avec raison, éviter certains modes de sélection, ne songent point à les remplacer par d'autres, travaillent, sans s'en rendre compte, à l'affaiblissement de la race, à sa déchéance. Si les classes riches, dans nos sociétés, avaient beaucoup d'enfants, il est probable qu'elles les sauveraient presque tous, même les plus malingres et les moins bien doués, de la augmenterait d'autant les éléments dégénérés dans les classes supérieures et retarderait l'ascension de l'élite provenant des classes inférieures. Si la sélection n'exerçait plus ses effets dans les classes inférieures, celles-ci cesseraient de produire des élites et la qualité moyenne de la société s'abaisserait considérablement.
Il est moins facile d'expliquer pourquoi, parmi les classes inférieures, ce sont surtout les classes rurales qui paraissent avoir le privilège de produire des sujets de choix.462 Il y a d'ailleurs un grand nombre de phénomènes analogues pour les plantes et pour les animaux et qui tout en étant bien constatés demeurent inexplicables. Tel est, par exemple, celui de la nécessité d'employer la semence du lin de Riga pour produire certaines qualités de lin. La semence du blé qui, cultivé en Toscane, donne la paille dite de Florence, vient de la Romagne et dégénère rapidement. Les plus beaux bulbes de jacinthes se tirent de la Hollande et dégénèrent dans d'autres pays.
Il se peut que le fait même que les classes rurales développent leurs muscles et laissent reposer leur cerveau ait précisément pour effet de produire des individus qui pourront laisser reposer leurs muscles et faire travailler excessivement leur cerveau. En tout cas la vie rurale paraît éminemment propre à produire les réserves que dévore la vie excessivement active des grands centres civilisés.
La décadence des élites qui se recrutent par cooptation, ou par quelque autre mode semblable, a des causes différentes et en partie obscures. A propos de ces élites, l'exemple qui vient immédiatement à l'esprit est celui du clergé catholique. Quelle décadence profonde a subi cette élite du IXe siècle au XVIIIe siècle! Ici l'hérédité n'est pour rien dans le phénomène. La décadence a son origine dans le fait que l'élite, pour se recruter, choisissait des sujets d'une qualité de plus en plus médiocre. En partie cela provient de ce que cette élite perdait de vue peu à peu son idéal, était de moins en moins soutenue par la foi et l'esprit de sacrifice; en partie cela provient aussi de circonstances extérieures: de ce que d'autres élites surgissaient et enlevaient à l'élite en décadence les sujets de choix. La proportion de ces sujets au reste de la population variant fort peu, s'ils se portent d'un côté ils font défaut de l'autre; si le commerce, l'industrie, l'administration, etc., leur offrent un large débouché, ils manqueront nécessairement à quelque autre élite, par exemple au clergé.
Ce phénomène des nouvelles élites, qui, par un mouvement incessant de circulation, surgissent des couches inférieures de la société, montent dans les couches supérieures, s'y épanouissent et, ensuite, tombent en décadence, sont anéanties, disparaissent, est un des principaux de l'histoire, et il est indispensable d'en tenir compte pour comprendre les grands mouvements sociaux.
[cut pp. 15-34 - Roman history examples] [include below pp. 34-41]
Le mouvement de circulation, qui porte les élites, nées des couches inférieures, au sommet, et qui fait descendre et disparaître les élites au pouvoir, est le plus souvent voilé par plusieurs faits. D'abord, comme il est en général assez lent, ce n'est qu'en étudiant l'histoire d'une longue période de temps, de plusieurs siècles, par exemple, qu'on peut percevoir le sens général et les grandes lignes de ce mouvement. L'observateur contemporain, celui qui ne porte ses regards que sur une courte période de temps, n'aperçoit que les circonstances accidentelles. Il voit des rivalités de castes, l'oppression d'un tyran, des soulèvements populaires, des revendications libérales, des aristocraties, des théocraties, des ochlocraties; mais le phénomène général, dont ce ne sont là que des aspects particuliers, lui échappe souvent entièrement.
Parmi les illusions qui se produisent ainsi, il en est quelques-unes qui, étant particulièrement fréquentes, méritent d'être notées.
Pour éviter que l'influence du sentiment, à laquelle il est bien difficile de se soustraire quand il s'agit d'un cas concret, ne vienne obscurcir notre raisonnement, exprimons-nous d'une manière abstraite. Soit A l'élite au pouvoir, B celle qui cherche à l'en chasser, pour y arriver elle-même, C le reste de la population, comprenant les inadaptés, les hommes auxquels l'énergie, le caractère, l'intelligence, font défaut, et qui, en somme, sont ce qui reste lorsqu'on met à part les élites. A et B sont des chefs, c'est sur C qu'ils comptent pour se procurer des partisans, des instruments. Les C seuls seraient impuissants, c'est une armée sans chefs, ils n'acquièrent d'importance que quand ils sont guidés par A ou par B. Fort souvent, presque toujours, ce sont les B qui se mettent à leur tête, les A s'endormant dans une fausse sécurité ou méprisant les C. D'ailleurs ce sont les B qui peuvent mieux leurrer les C, précisément parce que, n'ayant pas le pouvoir, leurs promesses sont à plus longue échéance. Parfois pourtant les A tachent d'enchérir sur les B, espérant de pouvoir contenter les C pur des concessions apparentes sans trop en faire de réelles. Si les B prennent peu à peu la place des A, par une lente infiltration, si le mouvement de circulation sociale n'est pas interrompu, les C sont prives des chefs qui pourraient les pousser à la révolte et l'on observe une période de prospérité. Les A lâchent généralement de s'opposer à cette infiltration, mais leur opposition peut être inefficace et n'aboutir qu'à une bouderie sans conséquence.
Si l'opposition est efficace, les B ne peuvent emporter la position qu'en livrant bataille, avec l'aide des C. Quand ils auront réussi et qu'ils occuperont le pouvoir, une nouvelle élite D se formera et jouera, à leur égard, le même rôle qu'ils ont joué par rapport aux A; et ainsi de suite.
La plupart des historiens ne voient pas ce mouvement. Ils décrivent le phénomène comme si c'était la lutte d'une aristocratie ou d'une oligarchie, toujours la même, contre un peuple, aussi toujours le même. Or, en fait: 1° i1 s'agit d'une lutte entre une aristocratie et une autre. 2° L'aristocratie au pouvoir change constamment; celle d'aujourd'hui étant remplacée, après un certain laps de temps, par ses adversaires.
Lorsque les B arrivent au pouvoir, et qu'ils remplacent une élite A en pleine décadence, on observe généralement une période de grande prospérité. Certains historiens en donnent tout le mérite au « peuple », c'est-à-dire aux C. Ce qu'il y a de vrai dans cette observation est seulement que les classes inférieures produisent de nouvelles élites; quant à ces classes inférieures elles-mêmes, elles sont incapables de gouverner, et l'ochlocratie n'a jamais abouti qu'à des désastres.
Mais, plus considérable que l'illusion des hommes qui; voient les choses de loin, est celle des hommes qui se trouvent entraînés par le mouvement et qui y prennent une part active. Beaucoup de B s'imaginent de bonne foi qu'ils poursuivent, au lieu d'un avantage personnel pour eux ou leur classe, un avantage pour les C, et qu'ils luttent simplement pour ce qu'ils appellent la justice, la liberté, l'humanité. Cette illusion agit aussi sur les A. Plusieurs d'entre eux trahissent les intérêts de leur classe, croyant combattre pour la réalisation de ces beaux principes et pour venir en aide aux malheureux C, tandis qu'en réalité leur action a uniquement pour effet d'aider les B à s'emparer du pouvoir, et à faire, ensuite, peser sur les C un joug souvent plus dur que celui des A.
Les personnes qui finissent par se rendre compte de ce résultat accusent parfois d'hypocrisie soit les B, soit les A, qui affirmaient n'être guidés que par le désir d'aider les C, mais c'est généralement à tort et beaucoup de ces B comme de ces A sont irréprochables au point de vue de la sincérité.
Un signe qui annonce presque toujours la décadence d'une aristocratie est l'invasion des sentiments humanitaires et de mièvre sensiblerie qui la rendent incapable de défendre ses positions.463 Il ne faut pas confondre la violence avec la force. La violence accompagne souvent la faiblesse. On voit des individus et des classes qui ont perdu la force de se maintenir au pouvoir se rendre de plus en plus odieux par leur violence en frappant à tort et à travers. Le fort ne frappe que lorsque cela est absolument nécessaire, mais alors rien ne l'arrête. Trajan était fort et n'était pas violent; Caligula était violent et n'était pas fort.
Lorsqu'un être vivant perd les sentiments qui, en des circonstances données, lui sont nécessaires pour soutenir la lutte pour la vie, c'est un signe certain de dégénération, car l'absence de ces sentiments va entraîner, dans un avenir plus ou moins proche, l'extinction de l'espèce. L'être vivant qui craint de rendre coup pour coup et de répandre le sang de son adversaire se met, par là même, à la merci de cet adversaire. Le mouton a toujours trouvé un loup prêt à le dévorer, et si maintenant il échappe à ce danger, c'est simplement parce que l'homme le réserve pour sa pâture. Tout peuple qui aura l'horreur du sang au point de ne pas savoir se défendre deviendra tôt ou tard la proie de quelque peuple belliqueux. Il n'est peut-être pas, sur notre globe, un seul pied de terre qui n'ait été conquis par le glaive et où les peuples qui l'occupent ne se soient maintenus par la force. Si les nègres étaient plus forts que les Européens, ce seraient les nègres qui se partageraient l'Europe, et non les Européens, l'Afrique. Le « droit » que prétendent avoir les peuples qui s'octroyent le titre de « civilisé » de conquérir d'autres peuples, qu'il leur plaît d'appeler « non-civilisés », est tout à fait ridicule, ou pour mieux dire ce droit n'est autre que la force. Tant que les Européens seront plus forts que les Chinois, ils leur imposeront leur volonté, mais si les Chinois devenaient plus forts que les Européens, les rôles seraient renversés, et il n'est nullement probable que des déclamations humanitaires puissent jamais être opposées avec quelque efficacité à une armée.
De même, dans la société, le droit pour être une réalité a besoin de la force. Qu'il se développe spontanément ou qu'il soit l'œuvre d'une minorité, il ne peut être imposé aux dissidents que par la force. L'utilité de certaines institutions, les sentiments qu'elles inspirent, préparent leur établissement, mais pour qu'elles deviennent un fait accompli, il est bien évident qu'il faut que ceux qui veulent ces institutions aient le pouvoir de les imposer à ceux qui ne les veulent pas. Anton Menger s'imagine prouver que notre droit actuel doit être changé parce qu'il « repose presque exclusivement sur des relations traditionnelles fondées sur la force »; mais tel est le caractère de tous les droits qui ont existé, et si celui que désire notre auteur devient jamais une réalité, ce sera uniquement parce que, à son tour, il aura pour lui la force; s'il ne l'a pas, il demeurera toujours à l'état de rêve. Le droit a commencé par la force d'individus isolés, il se réalise maintenant par la force de la collectivité, mais c'est toujours la force.464
Il ne faut pas, ainsi qu'on le fait souvent, opposer, quant au succès d'un changement d'institutions, la persuasion à la force. La persuasion n'est qu'un moyen de se procurer la force. On n'a jamais persuadé tous les membres, sans exception, d'une société; on a persuadé seulement, pour s'assurer du succès, une partie de ces hommes: la partie qui a la force, soit parce qu'elle est la plus nombreuse, soit pour toute autre raison.
C'est par la force que les institutions sociales s'établissent, c'est par la force qu'elles se maintiennent.
Toute élite qui n'est pas prête à livrer bataille, pour défendre ses positions, est en pleine décadence, il ne lui reste plus qu'à laisser sa place à une autre élite ayant les qualités viriles qui lui manquent. C'est pure rêverie, si elle s'imagine que les principes humanitaires qu'elle a proclamés lui seront appliqués: les vainqueurs feront résonner à ses oreilles l'implacable vae victis. Le couperet de la guillotine s'aiguisait dans l'ombre quand, à la fin du siècle dernier, les classes dirigeantes françaises s'appliquaient à développer leur « sensibilité ». Cette société oisive et frivole, qui vivait en parasite dans le pays, parlait, dans ses soupers élégants, de délivrer le monde de « la superstition et d'écraser l'infâme », sans se douter qu'elle-même allait être écrasée.
Parallèlement au phénomène de succession des élites, on en observe un autre, d'une grande importance, chez les peuples civilisés. La production des biens économiques va en augmentant, grâce surtout à l'accroissement des capitaux mobiliers, dont la quantité moyenne, par tête d'habitant, est un des plus sûrs indices de civilisation et de progrès. Le bien-être matériel se répand ainsi de plus en plus. D'autre part, les guerres étrangères et les guerres civiles, devenant une industrie de moins en moins lucrative, vont en diminuant de nombre et d'intensité. Par conséquent, les mœurs s'adoucissent et la morale s'épure. En dehors des vaines agitations des politiciens, s'accomplit ainsi ce que M. G. de Molinari a nommé « la révolution silencieuse »,465 c'est-à-dire la lente transformation et l'amélioration des conditions sociales. Ce mouvement est entravé, parfois arrêté, par les gaspillages du socialisme d'Etat, par les lois protectionnistes de tout genre, mais il n'en est pas moins réel, et toutes les statistiques des peuples les plus civilisés en portent la trace.
Après avoir noté l'importance qu'a dans l'histoire le fait de la succession des élites, il ne faut pas tomber en une erreur qui n'est que trop fréquente, et prétendre tout expliquer par cette seule cause. L'évolution sociale est extrêmement complexe; nous pouvons y distinguer plusieurs courants principaux, et vouloir les réduire à un seul est une entreprise téméraire, du moins pour le moment. Il faut, en attendant, étudier ces grandes classes de phénomènes et tâcher de découvrir leurs rapports.
L'étude générale, que nous venons de faire, sur la succession des élites sera utilement complétée par l'examen de quelques cas concrets.
[cut pp. 41-58] [include material pp. 58-62]
Nous devons encore répéter, car de toute part les faits nous reconduisent à cette observation, que les historiens souvent ne voient ces événements qu'à travers le voile de leurs passions et de leurs préjugés, nous décrivant comme un combat pour la conquête de la liberté une simple lutte de deux élites concurrentes. Ils croient et veulent nous faire croire que l'élite, qui en réalité cherche à s'emparer du pouvoir pour en user et en abuser tout autant que celle qu'elle veut déposséder, n'est mue qui par le pur amour du prochain, ou, si l'on veut faire usage de la phraséologie de notre époque, par le désir du bien «des petits et des humbles». Ce n'est que lorsqu'ils veulent combattre certains adversaires que ces historiens finissent par découvrir la vérité, au moins en ce qui concerne ces adversaires. C'est ainsi que Taine perce à jour les déclamations des jacobins et nous montre les cupides intérêts qu'elles recouvraient. De même Jean Janssen nous montre des dissensions théologiques qui ne sont que le voile très transparent d'intérêts exclusivement terrestres. Son ouvrage décrit d'une façon remarquable comment les nouvelles élites, quand elles arrivent au pouvoir, traitent leurs alliés de la veille, « les petits et les humbles », qui se trouvent simplement avoir changé de joug.466 De même encore, de nos jours, les socialistes ont fort bien vu que la révolution de la fin du XVIIIe siècle avait simplement mis la bourgeoisie a la place de l'ancienne élite, et ils ont même considérablement exagéré le poids de l'oppression des nouveaux maîtres, mais ils croient sincèrement qu'une nouvelle élite de politiciens tiendra mieux ses promesses que celles qui se sont succédé jusqu'à ce jour. Du reste, tous les révolutionnaires proclament, successivement, que les révolutions passées n'ont abouti en définitive qu'à duper le peuple; c'est seulement celle qu'ils ont en vue qui sera la vraie révolution.467 « Tous les mouvements historiques — disait, en 1848, le Manifeste du parti communiste — ont été, jusqu'ici, des mouvements de minorités au profit de minorités. Le mouvement prolétaire est le mouvement spontané de l'immense majorité au profit de l'immense majorité. » Malheureusement, cette vraie révolution, qui doit apporter aux hommes un bonheur sans mélange, n'est qu'un décevant mirage, qui jamais ne devient une réalité; elle ressemble à l'âge d'or des millénaires; toujours attendue, toujours elle se perd dans les brumes de l'avenir, toujours elle échappe à ses fidèles au moment même où ils croient la tenir.
Le socialisme a certaines causes qui se trouvent dans presques toutes les classes de la société et d'autres qui diffèrent selon les classes.
Parmi les premières il faut mettre les sentiments qui poussent les hommes à compatir aux maux de leurs semblables et à y chercher un remède. Ce sentiment est des plus respectables et des plus utiles pour la société, dont, à proprement parler, il est le ciment.
Aujourd'hui presque tout le monde adule les socialistes, parce qu'ils sont devenus puissants; mais le temps n'est pas loin où beaucoup de personnes ne les estimaient guère plus que des malfaiteurs. Rien n'est plus faux qu'un tel point de vue. Les socialistes jusqu'à présent n'ont certes pas été moralement inférieurs aux membres des partis « bourgeois», surtout de ceux qui se servent de la loi pour prélever des tribus sur les autres citoyens, et qui constituent ce qu'on peut appeler le « socialisme bourgeois ». Si les « bourgeois» étaient animés du même esprit d'abnégation et de sacrifice en faveur de leur classe que le sont les socialistes en faveur de la leur, le socialisme serait loin d'être aussi menaçant qu'il l'est actuellement. La présence de la nouvelle élite dans ses rangs est précisément attestée par les qualités morales que ses adeptes déploient, et qui leur a permis de traverser victorieusement les rudes épreuves de nombreuses persécutions.
[cut pp. 62-71] [include below pp. 71-73]
Une autre source du socialisme des élites se trouve dans l'intérêt d'une partie de leurs membres. Aucune classe sociale n'est homogène, il y a toujours dans son sein des rivalités, et un des partis qui se forme ainsi peut chercher son point d'appui dans les classes inférieures. C'est là un phénomène très général. Presque toutes les révolutions ont eu pour chefs des membres dissidents d'une élite.
A un certain point du progrès des doctrines et des religions, elles deviennent un moyen de se procurer des avantages dans la société, et bien des conversions ne sont plus alors qu'une affaire d'intérêt. Le socialisme ne pouvait échapper à cette règle générale, et, en quelques pays, il est devenu une carrière, à laquelle on se prépare par des études et des exercices appropriés.468 Parmi les individus qui suivent cette voie, les uns n'aspirent qu'à obtenir ainsi les faveurs du gouvernement, d'autres veulent prendre place parmi les législateurs ou au moins parmi les membres des administrations locales. Les grèves sont d'excellentes occasions d'avancement pour les politiciens, comme les guerres pour les militaires.
Tant que le christianisme fut persécuté, ce n'était, en général, que les personnes capables de sacrifier leurs intérêts à leurs convictions qui se convertissaient. C'est ce qui arrive de nos jours pour le socialisme, dans les pays où il est persécuté. A peine le christianisme devint la religion dominante, il attira des gens pour lesquels la religion était avant tout affaire d'intérêt.469 Et il en est aussi de même, maintenant, en certains pays, pour le socialisme.
En outre, il arrive souvent que lorsque une doctrine a beaucoup d'adhérents, quand certains sentiments sont très répandus, des personnes pensent qu'il est habile de faire servir cette doctrine ou ces sentiments à leurs fins, d'en respecter la forme tout en changeant le fond. Un exemple des plus remarquables est celui d'Auguste, qui établit le principat à Rome, en respectant l'apparence de la forme républicaine. L'évolution des religions présente aussi beaucoup d'exemples de ce genre. Au commencement et pendant la première moitié du XIXe siècle les classes supérieures lâchèrent d'étouffer l'idée socialiste, actuellement elles tâchent de s'en servir. Il sera bientôt difficile de trouver quelqu'un qui ne se dise pas socialiste. Il y a un socialisme chrétien ou protestant, un autre catholique, un socialisme à la Tolstoï, plusieurs genres de socialismes éthiques, un socialisme d'Etat républicain, un autre démagogique, un autre monarchiste, un autre, en Angleterre surtout, impérialiste, des socialismes anarchistes, des socialismes littéraires d'espèces variées. Le roman et la comédie résolvent les plus graves problèmes économiques, dans le sens socialiste s'entend. Quand cet engoûment sera passé, il est probable que bien des produits de notre littérature paraîtront aussi ridiculement vides de sens que nous paraissent actuellement certaines déclamations sentimentales de la fin du XVIIIe siècle.
Ce n'est pas seulement l'intérêt, le calcul, qui poussent les hommes à se faire les partisans d'une doctrine, c'est aussi l'esprit d'imitation, et bien d'autres causes, parmi lesquelles on ne saurait oublier, dans le cas qui nous occupe, l'existence de ce qu'on a appelé un prolétariat intellectuel. Toutes ces circonstances réunies produisent un courant extrêmement fort et qui entraîne tout ce qui se trouve sur son passage.Le socialisme scientifique naît du besoin de donner une forme scientifique aux aspirations humanitaires. Il faut tenir compte qu'à notre époque la forme scientifique est devenue à la mode, comme l'était autrefois la forme religieuse. Très important au point de vue des doctrines, le socialisme scientifique l'est beaucoup moins au point de vue pratique. Jamais la science n'a remué ni enthousiasmé les masses.
Le socialisme paraît, jusqu'à présent, avoir exercé une action plus considérable sur les classes supérieures que sur les classes inférieures de la société. Ce n'est pas le hasard qui fait que partout, en Europe, les chefs socialistes se recrutent principalement parmi la bourgeoisie. Les théoriciens du socialisme ne sortent pas des classes ouvrières.
L'affaiblissement, chez les classes supérieures, de tout esprit de résistance, et, bien plus, les efforts persévérants qu'elles font, sans en avoir conscience, pour accélérer leur propre ruine, est un des phénomènes les plus intéressants de notre époque; mais il est loin d'être exceptionnel; l'histoire en fournit plusieurs exemples et en fournira probablement encore, tant que durera la circulation des élites, c'est-à-dire aussi loin que peuvent s'étendre nos prévisions dans l'avenir.
Céligny (Genève), le 30 novembre 1901.
Vilfredo Pareto.
78.Émile Faguet on “Why the French People are not Liberals” (1903)↩
[Word Length: 6,906]
Source
Emile Faguet, Le Libéralisme (Paris: Société française d'imprimerie et de librairie, 1903). Chap. XIX "Pourquoi les français ne sont pas libéraux," pp. 307-37.
CHAPITRE XIX. POURQUOI LES FRANÇAIS NE SONT PAS LIBÉRAUX
J'ai dit que la France est un des pays les moins libres du monde et les moins libéraux de l'univers. J'ai suffisamment, je crois, prouvé la première de ces propositions au chapitre précédent. Il me reste à m'expliquer sur la seconde. Il y a bien longtemps qu'à propos de Voltaire, le plus absolutiste des hommes, j'ai dit qu'il représentait admirablement l'esprit français, « le libéralisme n'étant pas français ». De fait, je ne crois pas avoir, de ma vie, rencontré un Français qui fût libéral. Le Français est homme de parti avant tout, et homme de parti très passionné, et il ne souhaite rien au monde, après le succès de ses affaires particulières, que le triomphe de son parti et l'écrasement des autres.
— Tout comme Voltaire!
— Oui, avec moins d'esprit le plus souvent. Même quand il est patriote, ce qui se rencontre, il lui est impossible de voir le progrès, le développement et la grandeur de la France ailleurs que dans le triomphe de son parti. Il lui est impossible de voir tout cela dans l'établissement et l'affermissement et le règne pacifique de la liberté. Il s'écrie tout de suite: « Mais, dans liberté, le parti que je déteste ne serait pas opprimé, et alors que deviendrait la France? » En conséquence de quoi, à quel parti qu'il appartienne, de la liberté il a terreur et horreur.
C'est en exploitant cet état d'esprit, c'est en mettant à profit ce penchant invincible, que les gouvernements ont toujours obtenu autant de despotisme qu'ils ont voulu. Les gouvernements monarchiques, Empire et Restauration, ont dit à leurs partisans: « La liberté, je n'en suis pas ennemi, je la voudrais peut-être; mais songez qu'elle profiterait aux républicains, que les républicains en profiteraient! » Il suffisait. Ils étaient aussi despotiques qu'ils le désiraient, quelquefois plus.
Le gouvernement semi-absolutiste, semi-libéral, de 1830, disait à ses partisans et disait à la France entière: « La liberté, je la désire tellement que j'en suis le représentant ici-bas; j'en suis le fils, j'en suis l'esprit et j'en voudrais être le père. Mais songez qu'elle profiterait aux cléricaux, que les cléricaux en profiteraient. » Il suffisait. La liberté était toujours saluée, honorée, proclamée, adorée et ajournée.
Une bonne formule, du reste, avait été trouvée. Comme une partie considérable des Français, sinon la majorité, est anticléricale, sans que j'aie jamais pu arriver à savoir pourquoi; et comme elle ne le sait pas non plus, ce n'est pas à elle qu'il faut le demander; mais enfin, comme elle est anticléricale, les gouvernements républicains qui ont succédé aux gouvernements monarchiques ont dit à satiété à la France: « La République, c'est la liberté. Vive la liberté! Vive la liberté sous toutes ses formes et dans toutes ses applications! Vivent toutes les libertés! Vivent les droits de l'homme! ... Seulement, prenez garde! La liberté commencerait par profiter aux cléricaux, et les premiers bénéficiaires de la liberté, ce seraient les cléricaux. Voulez-vous cela? Non, n'est-ce pas? Non certes. Alors ajournons la liberté jusqu'au moment où il n'y aura plus de cléricaux. C'est la solution. Vive la liberté! Mais pour quelques siècles encore la République sera despotique. »
L'anticléricalisme est devenu ainsi un admirable prétexte aux gouvernements les plus passionnés, à les entendre, pour la liberté, pour être tout aussi despotiques que les autres, sinon davantage et avec l'admiration attendrie d'une moitié de la France; car on disait, car on dit: « Quel bon gouvernement! Il brûle pour la liberté; il la respire; il est fils de 1789 et de 1793; il fait afficher les Droits de l'homme; mais il est si justement effrayé du péril clérical, qu'il fait violence à tous ses sentiments et que, la mort de l'âme, il est aussi despotique que le Premier Empire. »
Le prétexte servira longtemps; il est même assez probable qu'il servira toujours.
La raison en est que les Français préféreront toujours, de parti à parti, l'écrasement de leurs adversaires à la liberté, et aimeront toujours mieux être privés de la liberté que non pas que leur adversaire en jouisse, même quand ils sont libéraux au fond, ce que, du reste, et c'en est la marque, ils ne sont pas du tout.
Regardez-les, aux temps où nous sommes. On peut compter parmi eux quatre partis principaux: les socialistes, les républicains radicaux, les républicains progressistes, les nationalistes. Aucun de ces quatre partis n'est libéral.
Les socialistes sont des égalitaires. Au point de vue du principe d'égalité ils sont les vrais héritiers et les vrais fils de la Révolution française, et comme le principe de liberté a été abandonné par tout le monde, ils sont les vrais fils et les vrais héritiers de la Révolution française. Ils sont les seuls qui acceptent et qui veulent dans toutes leurs conséquences et dans toutes leurs applications les deux idées qui ont seules subsisté entre toutes les idées de la Révolution: égalité, souveraineté nationale. Ils veulent l'égalité réelle, l'égalité des biens possédés, soit individuellement, soit, et plutôt, collectivement, en quoi ils sont de bon sens, et ils veulent un gouvernement qui maintienne énergiquement et éternellement cette égalité réelle et qui partage également entre tous le bien de tous et le produit du travail égal de tous. Il n'y a pas un atome de liberté dans leur conception ni dans leur programme. Leur gouvernement serait le plus despotique de tous les despotismes connus. Le gouvernement des Jésuites au Paraguay donne seul une idée approximative de ce que serait le leur.
Les républicains radicaux seront libéraux quand les socialistes seront au pouvoir; mais, pour le moment, étant au pouvoir, ils sont, naturellement, absolutistes. Leur conception de la société est celle-ci: Il n'y a que l'Etat. L'Etat a tous les droits. L'Etat, dans la pratique, c'est la moitié plus un des électeurs qui votent. Cette moitié plus un fait tout ce qu'elle veut. L'individu n'a aucun droit; la minorité, même considérable, même moitié des votants moins un, n'a aucun droit. Les droits de l'homme n'existent pas. Du reste, il est de l'intérêt de l'Etat que l'Etat seul pense, parle et agisse et que « l'unité morale » de la nation se fasse ainsi. Toute compression, toute oppression de l'individu isolé qui a la prétention de penser, de parler, d'enseigner ou d'agir, est donc dans l'intérêt de l'Etat et par conséquent légitime. Toute répression, compression, oppression et suppression d'une collectivité quelconque qui ne serait pas l'Etat, et qui serait ainsi un Etat dans l'Etat, est donc dans l'intérêt de l'Etat et par conséquent légitime.
Il n'y a pas un atome de liberté dans cette conception ni dans ce programme, et même il ne respire que la terreur et l'horreur de toute liberté. Sauf l'égalité des biens possédés, ce programme est aussi despotique que celui des socialistes.
Je ferai remarquer, du reste, que les radicaux, qui, seulement par procédé électoral et pour lutter avec les socialistes en rivalisant avec eux, s'intitulent déjà radicaux-socialistes, seront forcés de devenir socialistes réellement. Car la fortune, ou simplement la propriété individuelle même la plus modeste, est une limite à l'omnipotence de l'Etat. On n'obtient pas, on ne peut pas obtenir la même docilité, la même servitude, la même obéissance passive à la « moitié plus un », d'un homme qui possède quelque chose que d'un homme qui ne possède rien. J'ai vingt fois fait remarquer qu'un homme qui possède est un Etat dans l'Etat, tout comme une congrégation, et seulement dans des proportions moins vastes. Les radicaux seront donc amenés peu à peu par les résistances qu'ils rencontreront, autant, du reste, qu'ils y seront poussés par leur clientèle, à se faire réellement socialistes. Les radicaux sont des étatistes. L'étatiste est un homme qui est en train de devenir socialiste, et s'il meurt sans l'être, c'est qu'il n'a pas assez vécu pour le devenir. Il n'y a pas plus de liberté dans la conception radicale que dans la conception socialiste; il n'y a pas plus de liberté dans le programme radical que dans le programme socialiste; il n'y a pas plus de libéralisme dans l'esprit d'un radical que dans l'esprit d'un socialiste.
Le parti républicain progressiste a des velléités libérales, d'abord parce qu'il n'est pas au pouvoir, ensuite parce que, réellement, il a, à l'égard de la liberté et des droits de l'homme, quelque tendresse, quelque souci, quelque inquiétude ou quelques remords. C'est un parti très honnête. Malheureusement il est la mollesse même, la faiblesse même, la timidité même et la pusillanimité même, ce qui fait qu'il est la nullité même.
Cela tient à ce qu'il est conservateur et que son vrai fond est le conservatisme. Or le conservateur français est un être singulier. Il n'est pas conservateur de certains principes généraux qu'il croit justes, de certaines traditions générales qu'il croit bonnes. Point du tout. Il est conservateur de ce qui existe, le jugeât-il détestable. « Cela existe, il ne faut le détruire. Cela est acquis. Il ne faut pas revenir sur cela. » Il en résulte que tout pas en avant que le radicalisme fait dans le sens du radicalisme, les progressistes s'y opposent d'abord et s'y résignent ensuite. Ils s'y opposent d'abord vivement et s'y résignent ensuite mélancoliquement, mais sans retour. Toutes les conquêtes radicales ont été combattues par les progressistes et respectées et conservées par les progressistes. « Cela est acquis. Il ne faut pas revenir sur cela. »
A ce compte, la France deviendrait gouvernement collectiviste, avec proscription de toute espèce de liberté, athéisme obligatoire, et communauté des biens et des femmes, les progressistes diraient: « C'est fâcheux; mais c'est acquis. Ne revenons pas là-dessus. Pas de mouvement en arrière. Mais, par exemple, n'allons pas plus loin. »
Ajoutez à cela ce qui en est, du reste, une conséquence et ce qui est une forme du même tour de caractère: une répugnance presque invincible à renverser un ministère, quel qu'il soit. Lui aussi existe, lui aussi est acquis. Deux fois, trois fois peut-être, au cours du ministère Waldeck-Rousseau, les progressistes ont pu renverser le ministère Waldeck-Rousseau, seulement en s'abstenant de voter. Deux fois, trois fois peut-être, ils l'ont sauvé, en votant pour lui. En général ils ne votaient contre lui que quand ils étaient bien sûrs qu'il n'en aurait pas moins la majorité. Ils votaient contre lui pour le désapprouver, mais non point pour l'empêcher de nuire, ni surtout pour l'empêcher d'être. Ils ne votaient contre lui que quand leur vote devait être de nul effet; mais quand leur épée pouvait faire du mal, non seulement ils ne la tiraient pas, mais ils couraient au secours de leur adversaire. Cela quelques mois avant les élections. Un gouvernement ne peut pas avoir de compétiteurs plus utiles, d'adversaires plus officieux, ni d'ennemis plus dévoués.
Ce n'est pas que les progressistes aimassent véritablement le ministère Waldeck-Rousseau; non certes; mais il existait, il était dès lors une institution nationale, quelque chose à quoi un conservateur ne touche pas sans un frisson religieux et ne voit pas ébranler sans, quoique le détestant, s'empresser à le soutenir.
Et enfin toutes les bonnes dispositions libérales du parti progressiste sont paralysées par la terreur où il est continuellement de passer pour clérical. — Comme il est modéré, il a toujours peur qu'on ne lui dise: « Pourquoi êtes-vous modéré si ce n'est parce que, au fond, vous êtes clérical et pour pouvoir ménager le clergé, sous prétexte de modération? Vous êtes des cléricaux déguisés. » — Comme il est un peu libéral, il a toujours peur qu'on ne lui dise: « Pourquoi êtes-vous libéral si ce n'est parce que, au fond, vous êtes clérical? Puisque les libertés ne peuvent profiter en France qu'aux cléricaux, quiconque est libéral est clérical. Vous êtes libéraux, donc vous êtes cléricaux. Vous êtes des cléricaux masqués. Mais on vous reconnaît sous le masque. Non? Vous n'êtes pas cléricaux? Prouvez-le donc en étant oppresseurs et en déchirant les Droits de l'homme. Il n'y a que cette preuve qui soit sûre. C'est la pierre de touche. »
A ce raisonnement tout le libéralisme des progressistes s'écroule tout d'une pièce. Il n'y a pas un progressiste qui reste libéral dès qu'il a le soupçon qu'on le soupçonne d'être suspect de cléricalisme. Or on l'en soupçonne toujours.
Pour ces raisons le parti progressiste peut avoir au cœur un certain libéralisme platonique; mais il ne peut pas compter comme parti libéral. J'ajoute qu'il ne peut pas compter comme parti, étant données la mollesse de son tempérament et l'infirmité de sa complexion. Il est destiné à disparaître à bref délai. En attendant, personne ne peut compter sur lui ni avoir confiance en lui, excepté, un peu, le parti radical.
Le nationalisme est le seul parti libéral qui existe en France. Il est libéral. Il réclame la liberté individuelle, la liberté de la parole et de la presse, la liberté d'association, la liberté d'enseignement, l'indépendance de la magistrature. On ne peut guère être plus libéral que cela. Voilà un parti libéral. Seulement il est composé uniquement, à très peu près, de bonapartistes, de royalistes et de cléricaux. Il est composé du personnel du 24 mai 1873 et du 16 mai 1877. Ces très honorables citoyens ne peuvent point n'être pas très suspects de n'être libéraux que parce qu'ils sont en minorité et de n'être libéraux que comme le sont toutes les minorités, c'est-à-dire jusqu'à nouvel ordre. Il est possible qu'ils aient été convertis, qu'ils aient rencontré le chemin de Damas et qu'ils soient devenus, non seulement sincèrement libéraux, mais encore foncièrement libéraux, libéraux ne varientur; mais il est un peu plus probable qu'ils sont des libéraux de circonstance et des libéraux provisoires.
Parlons brutalement: ils seraient vainqueurs, qu'ils recommenceraient le 24 mai et le 16 mai et qu'ils auraient pour ministre de l'Instruction un M. de Cumont et pour ministre de l'Intérieur un M. de Fourtou. ll y a peu de fond à faire sur le libéralisme de gens dont les uns ont les maximes du gouvernement du Second Empire et les autres les maximes du gouvernement du Syllabus. M. Gabriel Monod dit très bien aux radicaux: « Vous pratiquez le Syllabus retourné; mais c'est parfaitement le Syllabus. » Il dit juste; mais s'il n'y a pas de raison de se fier à ceux qui chaussent le Syllabus à l'envers, il n'y en a pas plus de s'abandonner à ceux qui le chaussent à l'endroit.
Pour être juste, il faut toujours entrer dans le détail et faire des distinctions. Il y a des éléments libéraux dans le parti nationaliste. Il y a dans ce parti quelques républicains libéraux qui sont bien forcés de marcher avec les gens qui, seuls en France, ont pour le moment une attitude libérale. Ces républicains libéraux nationalistes sont très dignes d'estime et c'est pour eux que je vote quand je peux, puisqu'ils représentent à peu près les deux seules choses auxquelles je tienne, l'idée de patrie et les droits de l'homme. Mais ils sont très peu nombreux et je ne voudrais pas tomber dans le ridicule de voir des suspects partout; mais enfin je doute, non pas qu'ils ne soient libéraux, mais encore qu'ils soient libéraux radicaux et libéraux intransigeants. Si je leur disais par exemple: La liberté comme en Amérique avec les seules restrictions que nous imposent les nécessités de la défense extérieure? je doute, vraiment je doute qu'ils me répondissent: Oui. Enfin ce serait à voir.
Il y a encore, comme élément de libéralisme dans le parti national, quelques royalistes franchement et intelligemment libéraux. J'en connais qui le sont dans une mesure très appréciable. J'en connais qui sont pour la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Or ce n'est pas mon seul criterium, mais c'est un de mes critères. Comme pour le radical la pierre de touche à connaître le bon, le vrai républicain, c'est l'anticléricalisme: « Etes-vous anticlérical? — Oui. — Vous êtes républicain »; de même une de mes pierres de touche à reconnaître le libéral, c'est le fait d'accepter la séparation de l'Eglise et de l'Etat; aucun républicain n'en veut, ni aucun bonapartiste, ni aucun clérical, ni quasi aucun royaliste.
Il y a donc des éléments de libéralisme dans le parti national, mais qui sont faibles et qui sont noyés. On ne peut pas refuser ses sympathies à un parti qui se trouve, par le hasard des circonstances, représenter les Droits de l'homme menacés; mais on ne peut pas s'empêcher de se dire que le libéralisme du parti national doit être surtout dans sa façade. Un libéral ne peut être nationaliste que sous bénéfice d'inventaire.
La question, j'entends la question de résistance au despotisme radical, est posée autrement par quelques esprits très bons et même de tout premier ordre. Dans une lettre au président du congrès des Associations catholiques de province, un homme de très haute pensée et du plus noble caractère, M. Ferdinand Brunetière, disait ceci (3 juin 1902): « Je voudrais mettre en garde les Associations catholiques contre le « parlementarisme » tel qu'on le conçoit désormais à la Ligue de la Patrie française; protester contre l'illusion de ceux qui semblent croire qu'ils triompheront, avec un vague libéralisme, de l'action combinée du jacobinisme et de la franc-maçonnerie; faire observer qu'entre francs-maçons d'une part et catholiques de l'autre, à l'heure actuelle, en France comme ailleurs, un tiers parti ne pourrait représenter qu'une coalition d'intérêts matériels, ou moins encore que cela, je veux dire des divisions de personnes; et ajouter que ceux-là sont aveugles qui ne voient pas que, le programme de nos adversaires étant de « déchristianiser » la France, nous fuyons le combat et nous livrons la patrie si nous feignons de croire que la lutte est ailleurs; conclure enfin que l'idée religieuse est la condition ou plutôt le fondement de ce qu'on enveloppe sous le nom de Droits de l'homme. »
Il y a, comme dans tout ce qu'écrit M. Ferdinand Brunetière, autant d'idées et d'idées importantes que de lignes dans cette a position de la question ». Il faut détailler et procéder par ordre.
En théorie, d'abord, je reconnais qu'il est parfaitement vrai que l'idée religieuse est le fondement de ce qu'on enveloppe sous le nom de droits de l'homme. C'est certainement le christianisme qui a fondé les droits de l'homme; je l'ai assez répété, et ce qui m'assure davantage, c'est que Taine l'avait dit avant moi, et ce qui m'assure plus encore, c'est que Montesquieu l'avait dit bien avant Taine. Au fond, si les radicaux ont horreur des Droits de l'homme, c'est d'abord parce qu'ils sont despotistes de doctrine et despotiques de tempérament; mais c'est aussi parce qu'à travers les Droits de l'homme ils poursuivent le christianisme qui les a fondés et qui les a jetés à travers le monde. Cela me paraît parfaitement juste.
En pratique aussi, si l'on se place sur le terrain de lutte et de bataille, la question est bien posée. Il est évident qu'en fait «la lutte » est entre le jacobinisme avec ses alliés imprudents (protestants, juifs, etc.) d'une part, et d'autre part le catholicisme avec ses alliés d'un jour, libéraux, modérés, etc., qui se trouvent avec le monde catholique, simplement parce qu'ils sont contre les jacobins. D'accord. Et rien ne prouve précisément combien en France il y a peu de libéraux qui soient libéraux par libéralisme, qui soient libéraux parce qu'ils sont libéraux, comme cette nécessité où les voilà, s'ils veulent lutter, s'ils veulent faire quelque chose, de se ranger parmi des hommes ou à côté d'hommes qui ne sont pas libéraux le moins du monde, encore que fils de ceux qui ont enseigné les Droits de l'homme à l'univers.
Mais que les nécessités de la lutte soient telles, ce n'est pas du tout une raison pour renoncer au libéralisme, surtout si, au lieu d'être un « vague libéralisme », dont, certes, je ne voudrais pas, il est un libéralisme très précis. Ce n'est pas du tout une raison pour dire: « Il n'y a plus de libéraux. Il n'y a plus que des catholiques et des jacobins. Il ne doit plus être question de libéralisme. Il ne doit plus être question que de jacobinisme et de catholicisme. »
Jamais, pour mon compte, je ne dirai cela. Je dirai toujours: « La liberté, c'est la vérité. C'est la vérité sociale, du moins aux temps modernes; et pour mille raisons que j'ai dites, les temps anciens ne peuvent pas revenir. La liberté, c'est la condition du développement normal de l'individu; et la liberté c'est la condition du développement normal de la nation. Je suis libéral. Un point; c'est tout. En pratique, quand c'est dans la personne des républicains, des radicaux, des jacobins, des socialistes, des protestants, des juifs que la liberté est violée, je suis à gauche; quand c'est dans la personne des royalistes, des bonapartistes, des catholiques et des cléricaux que la liberté est violée, je suis à droite. »
Et j'ai raison même en pratique; car je sais bien que je suis seul; mais si j'êtais plusieurs, si j'étais nombreux, je formerais un parti qui, tantôt se plaçant dans le plateau de droite, tantôt dans celui de gauche, empêcherait la balance de pencher ni d'un côté ni de l'autre et maintiendrait le fléau droit; qui protégerait toujours ceux, quelconques, en qui la liberté serait violée, ou plutôt qui protégerait, maintiendrait, défendrait, sauverait toujours la liberté et la liberté seule.
Ce « tiers parti » que M. Brunetière suspecte ou qu'il raille, s'il existait, ce ne serait pas un parti, ce serait une ligue pour l'intérêt de chacun et pour le droit de chacun, et pour l'intérêt public et pour le droit public; et ce serait une ligue contre les partis, en ce sens qu'elle serait toujours pour le parti qui serait inoffensif étant vaincu et contre le parti qui serait redoutable et détestable étant vainqueur, tous les partis, quand ils sont vainqueurs, devenant immédiatement redoutables et détestables. Ce parti ne serait pas un tiers parti, ce serait un contre-parti.
C'est précisément ce parti qui devrait exister et qu'on devrait souhaiter qui existât, et qui fût nombreux, et qui fût bien organisé, et qui fût fort. Il devrait y avoir en France un parti des Droits de l'homme; non pas cette « Ligue des Droits de l'homme » qui était si peu d'accord sur les principes et qui s'était si peu entendue même sur la signification de son titre que, quand la liberté de l'enseignement a été en question, elle s'est demandé de quel côté elle était, et qu'une partie de ses membres a été pour et une autre contre, et qu'elle a été infiniment ridicule; mais un parti des Droits de l'homme fermement attaché aux idées maîtresses de la Révolution; partant de l'idée de liberté, et la mettant au-dessus de tout; acceptant l'idée d'égalité et l'idée de souveraineté nationale dans la mesure où l'application de ces deux idées n'entamera pas et ne lésera par la liberté, c'est-à-dire, disons-le franchement, dans une mesure restreinte, mais encore considérable; admettant la souveraineté nationale et le droit du peuple à choisir son gouvernement, mais n'admettant jamais que ce droit allât jusqu'au droit de despotisme; admettant l'égalité des droits, l'égalité devant la loi et devant la justice, l'égalité d'admissibilité aux emplois publics, mais n'admettant jamais « l'égalité réelle », c'est-â-dire la défense faite à l'individu de se développer, de s'agrandir et d'acquérir, c'est-à-dire le despotisme encore; tenant les Déclarations droits de l'homme, malgré quelques contradictions facilement résolubles, pour sa charte et voulant qu'elles fissent partie de la Constitution et qu'une magistrature, qui serait indépendante, refusât d'appliquer et eût le droit de refuser d'appliquer toute loi qui serait manifestement contraire à leur texte.
Ce parti, qui serait tout simplement le parti républicain, si parti républicain veut dire parti des idées républicaines, serait en même temps le parti national, parce qu'il mettrait l'intérêt général au-dessus de tout intérêt de parti, de coterie, de syndicat ou de confession, et parce que, comme nation libre, il mettrait la France à la hauteur des Etats-Unis et au-dessus du Royaume-Uni, et parce que, comme nation forte, il la mettrait très haut, créant « l'unité morale » dans la liberté, au lieu d'essayer en vain de la créer par l'oppression; sans que je puisse voir que, d'aucune façon, maintenant un gouvernement très fort relativement à l'étranger, il affaiblît la patrie en tant que nation et en tant que camp fortifié.
Ce parti n'existe pas, et je viens de montrer qu'aucun des partis qui se partagent les citoyens français n'est libéral en son ensemble. Les éléments mêmes de ce parti n'existent pas, et je crois bien qu'il n'y a pas de libéraux en France. « On croit, dit spirituellement M. Gustave Le Bon, qu'il y a plusieurs partis en France; c'est une erreur. Il n'y en a qu'un: c'est l'Etatisme. Tous les Français sont étatistes. » A ce compte la fameuse unité morale devrait exister; seulement, si tous les Français sont étatistes, chacun veut l'Etat pour lui et au service de ses intérêts et de ses passions; et cela ne fait qu'un seul parti en théorie, mais en fait beaucoup en pratique.
M. Le Bon n'en a pas moins raison, et tous les Français sont étatistes, et il n'y en a point qui soient libéraux. Je crois presque que je suis le seul libéral français, et encore je ne suis pas sûr de moi. Proudhon disait gaiement: « Je rêve d'une république où je serais guillotiné comme conservateur. » Moi, je rêve d'une république où je serais proscrit... mais elle ne proscrirait personne... où je serais méprisé et maudit comme insuffisamment libéral.
Il est très évident que l'avènement de cette république est très éloigné.
Pourquoi les Français ne sont-ils pas du tout libéraux, c'est une chose qui vaut qu'on l'examine.
Il faut songer d'abord que le Français est un peu Latin, et, quoique je pense qu'au xxe siècle il ne faut attacher presque aucune importance aux questions de races, tant les races se sont mélangées, encore est-il que la race est quelque chose, et, de plus, ce n'est pas ici une question de race. Quand je dis que le Français est Latin, j'entends dire qu'il a été constitué comme peuple par les Latins, qu'ils ont laissé sur lui leur empreinte, et que, longtemps après la disparition de la domination romaine, les légistes, d'esprit tout romain, de tradition toute romaine, ont donné à ce peuple le tour d'esprit qu'il n'est pas bien étonnant qu'il ait gardé. L'empire romain, l'impérialisme romain, l'étatisme romain est au fond de tout le droit romain, dont la législation française est sortie. Ne remarquez-vous point que, si l'on peut faire quelque distinction au point de vue du libéralisme et de l'étatisme entre Français et Français, le Français du Midi est plus étatiste que le Français du Nord? Le radicalisme est surtout une fleur du Midi. Le Nord est la patrie des droits de l'homme, le Midi est la patrie des droits de l'Etat. Il se peut que ce soit parce que le Midi a été plus pénétré de Latins et d'esprit latin que le Nord et parce qu'il a été pendant des siècles pays de droit romain, pendant que le reste était pays de droit coutumier. Il faut certainement tenir compte dans une certaine mesure, sinon de la race, car, après tout, nous sommes bien peu Latins de race, du moins de l'influence si longtemps prolongée chez nous, du peuple qui a fait de nous un peuple.
Il faut songer ensuite que nous sommes monarchistes. Nous le sommes profondément, parce que nous l'avons été pendant huit cents ans. Cela ne se dépouille pas en quelques années. Nous sommes monarchistes. Nous n'avons pas de plus grand plaisir, après le théâtre peut-être, que de voir un roi. Quand il en passe un par chez nous, fût-il de troisième grandeur, nous sommes ravis. Il ne nous dérange pas. C'est nous qui nous dérangeons considérablement pour aller le voir. Nous ne pouvons pas nous passer de quelque chose ou de quelqu'un qui ressemble à Louis XIV.
Quand nous avons secoué une monarchie devenue détestable par sa manière d'administrer le pays, il y eut deux phases. D'abord nous sommes restés royalistes, nous avons conservé le loyalisme personnel. Nous avons inventé la « démocratie royale » de 1789-1791, c'est-à-dire une égalité civile et politique et un système parlementaire, sous un roi, sous le roi héréditaire. Nous tenions au roi. Il n'y avait pas cent républicains en France en 1790.
Ensuite, quand nous nous sommes détachés du roi considéré comme traître au pays, nous sommes devenus républicains, mais si monarchistes encore que nous avons entendu par république une simple transposition de la monarchie. Tout ce qui était au roi, nous l'avons simplement donné au peuple; tout ce qui était de roi, nous l'avons fait de peuple, et il n'en a été que cela. L'omnipotence royale est devenue l'omnipotence populaire, la souveraineté nationale; l'omniscience royale est devenue l'omniscience populaire et cette idée que le gouvernement choisi par le peuple doit penser, croire et dogmatiser par tout le monde; l'omnipossession royale est devenue l'omnipossession populaire et cette idée que tout le territoire français appartient à tous les Français; et en un mot, la théorie du bon plaisir royal est devenue la théorie du bon plaisir populaire. Il est impossible d'être républicains d'une manière plus parfaitement monarchique. — Entre temps nous avons rédigé les Déclarations des Droits de l'homme; mais je doute que les Déclarations des Droits de l'homme aient jamais été prises fort au sérieux, et en tous cas soient jamais descendues trop profondément dans les esprits.
Monarchistes restés foncièrement monarchistes, nous faisons de la république monarchique; c'est-à-dire que nous nommons un gouvernement, et voilà qui est républicain; mais ce gouvernement nommé, nous croyons facilement, ou nous aimons à croire, ou nous nous résignons à croire qu'il a tous les droits de Louis XIV ou de Pierre le Grand, et voilà qui n'est plus du tout républicain; mais vous voyez bien les raisons pourquoi c'est très français.
Songez encore que nous sommes depuis trois siècles un pays très centralisé, qu'infiniment de choses qui pourraient être faites privément sont faites en France par l'Etat, par les fonctionnaires de l'Etat, qu'il y a en France plus de fonctionnaires qu'en aucun pays du monde, que par conséquent l'Etat, par sa seule organisation, aune extraordinaire importance, influence, puissance en toutes choses, qu'il dispose de places à donner, de faveurs à accorder et de places et de faveurs à promettre, en nombre infini. Par conséquent le Français, par simple souci de son intérêt matériel, est facilement amené à cette idée, à ce projet: conquérir l'Etat, l'avoir à soi: « Si j'étais le gouvernement! » Le moyen? Le moyen c'est d'être membre d'un parti qui aura la majorité, puisque l'Etat en France c'est le parti qui a la majorité. De là des partis, qui ne sont que des syndicats pour la conquête de l'Etat, et qui, quand ils l'ont conquis, ne songent qu'à l'exploiter à leur profit, puisqu'ils ne l'ont conquis que pour cela, et ne songent pas sans doute à l'amoindrir ou à le désarmer et sont plus étatistes et plus antilibéraux que jamais.
« La République est une dépouille », comme dit Montesquieu. Quand on ne considère l'Etat que comme une dépouille, on ne le partage qu'entre amis. C'est tout naturel. Mais la raison de tout cela, c'est que l'Etat, trop centralisé, trop muni de places à donner et de faveurs à distribuer, trop fort, trop grand, trop riche, était précisément quelque chose qui valait la peine d'être conquis et d'être transformé en dépouille. L'Etat en France est la toison d'or. Il faudrait trop de vertu aux Français pour ne pas mettre le cap sur cette toison-là, surtout quand l'expédition ne demande ni grande science nautique ni grand courage.
Ajoutez que les éducations religieuses des Français les prédisposent assez bien depuis quatre siècles à l'étatisme. J'ai dit, avec M. Brunetière, avec Taine, avec Montesquieu, que le Christianisme était le fondement même, le premier fondement des Droits de l'homme, et je tiens cela pour une des vérités les plus incontestables qui soient. Mais il est juste d'ajouter que le christianisme a un peu changé depuis ses origines. Les Français sont catholiques ou protestants. Les catholiques plus ou moins persécutés, molestés, tracassés ou inquiétés depuis une centaine d'années, sont devenus assez libéraux ou ont quelques tendances libérales, comme tous ceux qui ne sont pas au pouvoir; mais ils n'en sont pas moins les fils d'hommes à qui leur Eglise avait enseigné et prescrit l'obéissance sous toutes les formes et de tous les côtés, l'obéissance spirituelle du côté de Rome ou tout au moins du côté de leur évèque, l'obéissance matérielle du côté de Versailles. Quelques sympathies qu'on puisse avoir pour les catholiques, surtout en ce temps-ci, on ne peut pas considérer l'Eglise catholique comme une école de libéralisme, ni confondre absolument le Syllabus avec la Déclaration des Droits de l'homme.
Or les Français ont été dressés pendant plusieurs siècles par l'esprit de la Politique tirée de l'Ecriture sainte et par l'esprit du Syllabus. Il est difficile qu'il ne leur en reste pas quelque chose.
Les protestants, ayant été persécutés pendant deux siècles, ont été libéraux ou ont cru l'être pendant deux siècles. C'est dans l'ordre. Mais ils n'en sont pas moins les fils de Calvin, c'est-à-dire de l'homme qui est le type même du despotisme et de l'antilibéralisme et qui, à certains égards, et précisément au point de vue qui nous occupe, est parfaitement antichrétien. Car c'est le christianisme qui a établi la distinction entre le temporel et le spirituel et qui a soustrait le spirituel à l'Etat, et qui, en ce faisant, a fondé les droits de la conscience humaine et les droits de l'homme. Et c'est précisément Calvin qui a eu pour conception sociale la parfaite union, connexion et confusion du pouvoir civil et du pouvoir ecclésiastique, qui des délits civils a fait des péchés et des péchés a fait des délits civils, qui a fondé un despotisme civil et un despotisme ecclésiastique exercés par le même gouvernement, qui en cela est revenu, par delà le christianisme, à l'antiquité romaine et même l'a dépassée de beaucoup en rigueur, qui, donc, a donné la théorie et l'exemple du gouvernement le plus épouvantablement despotique que le monde ait eu le bonheur de voir.
Les protestants français sont les fils de Calvin; il est difficile qu'il ne leur en reste pas quelque chose.
— Mais Calvin, ce n'est que Calvin!
— Pardon; mais les maîtres du protestantisme, à commencer par Jurieu et à continuer par les autres, plus obscurs, mais formant une tradition continue jusqu'à Burlamaqui et Jean-Jacques Rousseau, ont tous été libéraux en ce sens qu'ils étaient pour la souveraineté du peuple et pour l'absolu despotisme du peuple. Vous savez parfaitement que le Contrat social est de Jurieu. C'est Jurieu qui a dit le premier peut-être, en tous cas le premier à ma connaissance: « Le peuple est la seule autorité qui n'ait pas de raison à donner pour justifier ses actes. » Tous les docteurs protestants sont, en politique, des républicains radicaux. Ils ont inventé le jacobinisme. Ils ont inventé la transposition républicaine de la théorie monarchique. Ils ont, deux cents ans avant la Révolution française, dénié le despotisme au roi, il est vrai; mais pour l'attribuer au peuple, il est plus vrai encore. De Jurieu à Robespierre, par Burlamaqui et Rousseau, il y a une tradition constante de jacobinisme. Il est difficile qu'il n'en reste pas aux protestants de 1900 quelque chose. Et, de fait, j'entends dire par-ci par-là qu'il leur en reste énormément.
Ce qui fait que je n'aime pas les protestants, c'est qu'en général ils sont ultra-catholiques.
Elevés et dressés depuis trois cents ans par les catholiques et les protestants, il est malaisé aux Français d'être des libéraux très fervents. Ils n'ont pas cela dans le sang.
Voilà quelques-unes des raisons pourquoi les Français ont encore à faire leur éducation de libéralisme; voilà quelques unes des raisons pourquoi ils sont aptes surtout, parce qu'ils y sont habitués, à subir le despotisme et encore plus, comme il est naturel, à l'exercer.
Et c'est ici que se présente, décidément, l'objection que le lecteur n'est pas sans avoir vu poindre depuis le commencement de ce volume et qui doit le préoccuper: chaque peuple, non seulement a le gouvernement qu'il mérite et, cela posé, les Français n'ont pas à se plaindre; mais encore chaque peuple est plus à son aise que sous un autre, sous le gouvernement qu'il préfère, qu'il désire et qui est en rapport avec son caractère.
Cela est vrai; et il est bien certain que les Français, sauf exception, ne souffrent point de la servitude et se trouvent plus confortables sous un gouvernement despotique que sous un gouvernement libéral; mais en politique, comme en beaucoup d'autres choses, ce n'est pas son goût qu'il faut consulter, c'est son intérêt.
Moi aussi je ne serais pas fâché, en consultant mes goûts et mes passions, d'appartenir à un parti: cela donne de l'appui et de l'assiette; on ne se sent pas isolé; on se sent encadré, associé, engrené; cela flatte et cela rassure; cela caresse au dedans de nous « tout ce qui pousse l'homme à se mettre en troupeau »; — je ne serais pas fâché, d'autre part, d'appartenir au parti qui aurait la majorité: on se dit qu'on est l'Etat, qu'on est la République, qu'on est le pays; que les autres ne sont que des émigrés à l'intérieur, ou plutôt qu'ils sont une quantité négligeable et méprisable; qu'ils ne sont rien du tout; c'est très savoureux; — je ne serais pas fâché de faire des lois contre tous ceux qui me déplairaient et de déclarer, et dans la loi, qu'il n'y a pas de liberté ni de droit commun pour celui de mes compatriotes, quel qu'il soit d'ailleurs, qui n'a pas la même opinion que moi sur la Révolution française ou sur l'immortalité de l'âme; — je ne serais pas fâché de prendre ma part des places et faveurs dont dispose le gouvernement et d'en distribuer leur part, largement mesurée, à mes amis, politiques et autres, à charge de me revaloir cela comme bons électeurs. J'aimerais assez tout cela.
Mais il s'agit de savoir si tout cela est de mon intérêt, c'est-à-dire de l'intérêt général; car il n'y a de véritable intérêt pour chacun, il n'y a d'intérêt permanent, durable, solide et en définitive réel pour chacun, que l'intérêt général. Or j'ai cru démontrer, et l'histoire, tant ancienne que moderne, et les faits les plus éloignés et les plus récents le démontrent beaucoup mieux que moi, que le despotisme ruine très rapidement les peuples, les mène très vite à un état de langueur et de dépérissement dont ils ne peuvent plus se relever; qu'en particulier le despotisme modern style, c'est-à-dire, dans un pays prétendu libre, la domination d'un parti, la domination d'un syndicat politique qui vit de l'Etat et qui, en asservissant les autres, tarit les sources de l'activité individuelle et collective dont profiterait l'Etat, est un gouvernement qui ampute et qui mutile la nation plus qu'une guerre malheureuse ne pourrait faire, est un gouvernement qui fait descendre le pays chaque année d'un cran dans l'échelle comparative des nations, tant au point de vue financier qu'au point de vue politique.
Désirer cet état de choses, c'est antipatriotique, le subir volontiers c'est un oubli du patriotisme. L'acceptation de la servitude, la facilité à la servitude, c'est la misère physiologique d'un peuple; c'est la diathèse d'un peuple qui ne tient plus beaucoup à vivre, ou qui n'en a plus la force, ou qui en a oublié les moyens.
Eh bien, il faut un peu se forcer soi-même. Il faut faire violence à ses goûts en considération de son intérêt. Il faut se dire un peu tous les matins que la servitude est une chose agréable, quand on en a l'appétit, mais que la liberté est une chose utile.
C'est le cas de l'homme qui aime à rester dans son lit le matin, mais qui finit par se persuader qu'il a le plus grand intérêt à se lever de bonne heure. Il finit par prendre cette dernière habitude, peut-être en maugréant à chaque aurore; mais il prend cependant cette habitude. Il aimera toujours se lever tard; mais il se lèvera toujours de bonne heure.
Les peuples qui ont le goût de la servitude peuvent très bien devenir libéraux de cette façon-là. Sans doute, ceux qui aiment la liberté par goût auront toujours sur eux quelque avantage, mais moins qu'on ne pourrait croire, la « seconde nature », parce qu'elle vient de la volonté, étant souvent plus forte que la première.
Je souhaite que les Français fassent cet effort; je souhaite qu'à se persuader que le libéralisme étant simplement la mise en valeur de toutes les forces nationales, si grandes chez eux, ils se persuadent qu'à vouloir être libres et à le devenir parce qu'ils le voudront, ils seront forts et reprendront leur ancien rôle et leur ancien rang dans le monde. S'ils se pénétraient de cette idée, je serais moins inquiet que je ne suis; parce que, s'ils se soucient peu d'être libres, ils aiment à être forts et grands. Qu'ils soient persuadés qu'ils ne seront forts que s'ils sont libres, et les voilà sur le bon chemin.
On a assez vu que je ne l'espère pas beaucoup. Mais il faut toujours faire comme si on espérait. Il est permis de n'avoir pas d'espoir; mais il est défendu de faire comme si l'on n'en avait pas. C'est pour cela que j'ai écrit ce petit livre. C'est pour cela que, très probablement, j'en écrirai d'autres. Pardonnez-moi de finir sur une menace.
Août-Septembre 1902,
Last Words: Pessimism about the Future of Peace and Liberty (1911)
79.Gustave de Molinari’s “Last Words” (1911)↩
[Word Length: 3,337]
Source
G. de Molinari, Ultima verba: mon dernier ouvrage (Paris: V. Giard & E. Brière, 1911). "Préface," pp. i-xvii.
PREFACE
Presque arrivé aux limites de la vie humaine — je suis maintenant dans ma 92e année — je vais publier mon dernier ouvrage. Il concerne tout ce qui a rempli ma vie: la liberté des échanges et la paix. Mais quoique la sphère de la paix se soit prodigieusement élargie et que les souverains prodiguent les démonstrations pacifiques, ces idées fondamentales sont partout en baisse. Pourtant il semblait vers le milieu du XIXe siècle qu'elles dussent désormais régir le monde civilisé. Le roi Louis-Philippe ne disait-il pas dans sa réponse à une députation « que la guerre coûtait trop cher et qu'on ne la ferait plus ».
Ces dispositions pacifiques avaient des antécédents: Henri IV endoctriné par Sully avait déclaré qu'il n'y aurait plus de guerre entre les prince chrétiens. Au XVIIIe siècle, l'abbé de Saint-Pierre s'était fait le bienfaisant propagateur des idées pacifiques et l'abbé Coyer engageait la noblesse à adopter un état plus lucratif quo le métier des armes. Telle était alors la force du mouvement pacifique que Turgot votait sans hésiter le maintien de la paix avec l'Angleterre, en dépit des velléités belliqueuses de la jeune noblesse, qui allait aider à conquérir l'indépendance des possessions anglaises d'Amérique. A la fin des hostilités, sous l'influence des physiocrates, et peut-être d'Adam Smith, le traité de 1786 lia la France et l'Angleterre par une convention qui serait aujourd'hui considérée comme un triomphe libre-échangiste.
---
Mais la Révolution devait bientôt ajourner pour longtemps l'application des principes de paix et de liberté. Après vingt-cinq années de guerre, les puissances européennes célébraient au Congrès de Vienne le retour de la paix générale et réduisaient à deux milliards la somme de leur appareil de guerre. — Elles ne devaient pas tarder à l'augmenter: les dépenses militaires et navales atteignent aujourd'hui, dans l'ensemble des pays civilisés, plus de douze milliards en pleine paix. Le budget de la France, qui à la veille de la Révolution était d'environ cinq cent millions, dépasse aujourd'hui quatre milliards dont la majeure partie est employée à préparer la guerre ou à solder les dettes laissées par les guerres antérieures. — Mais le milieu du XIXe siècle a vu surgir une recrudescence de l'esprit militaire; les conflits se sont multipliés: on a vu éclater les guerres d'Italie, de Crimée, austro-allemande, de Sécession, répression do la révolte des Sicks aux Indes, guerre franco-allemande, russo-turque, italo-abyssine, turco-grecque, hispano-américaine, russo-japonaise et marocaine qui ont éloigné les grandes espérances que les Congrès et les Ligues contre la guerre avaient fait concevoir. Les manifestations pacifiques dont le souverain de Russie avait pris l'initiative n'ont pas empêché les grandes puissances de décupler leurs armements. Et cependant la sécurité s'est considérablement accrue. I1 n'y a plus guère de peuples qui demandent à la guerre l'augmentation de leurs ressources. Au contraire, les nations victorieuses, aussi bien que les vaincues, voient s'aggraver leur dette. Autrefois la guerre était profitable à ceux qui l'entreprenaient, s'ils étaient vainqueurs, car ils conquéraient des provinces pu des royaumes qui augmentaient d'une manière permanente les bénéfices de la guerre, témoin la conquête de l'Angleterre par les Normands. Mais cette situation a changé; il n'est aucune guerre qui profite à ceux qui l'entreprennent, même s'ils sont vainqueurs: les profits qu'ils en retirent sont inférieurs à ce que vaudrait l'échange de leurs produits contre ceux d'une contrée réputée ennemie. C'est ainsi qu'il en a coûté à l'Allemagne une somme supérieure aux cinq milliards que lui avait rapporté le conflit avec la France: les armements auxquels l'a entraînée la crainte d'une revanche ont beaucoup dépassé les profits de l'annexion d'une province et de la contribution de guerre. N'oublions pas que les bénéfices en ont été perçus par une classe peu nombreuse de la population, alors que le fardeau de l'impôt a été alourdi pour les autres.
Cependant depuis près d'un demi-siècle les intérêts militaires ont toujours paru prendre une prépondérance de plus en plus grande. C'est une contradiction qui tient à ce que, dans l'ensemble des nations, les gouvernements et la classe sur laquelle ils s'appuient de préférence sont ou se croient intéressés à l'état do guerre. Il est évident que la situation des classes influentes n'a pas été amoindrie par la guerre: même en Amérique la guerre de Sécession qui avait ruiné les provinces vaincues a occasionné aux provinces du Nord et aux industriels dé l'Est vainqueurs une recrudescence de protectionnisme qui a abouti au régime des trusts et engendré les milliardaires. En Allemagne, la classe militaire a vu sa puissance augmenter par l'accroissement des budgets de la guerre et de la marine, et les industriels ont exhaussé leurs bénéfices grâce aux tarifs protecteurs, mais la masse a vu enchérir ses denrées alimentaires et s'accumuler les emprunts dont elle doit, en définitive, payer les frais sans cesse croissants. Aussi les classes dominantes ont-elles intérêt à conserver la propriété des masses gouvernées qui leur fournissent la plupart des revenus militaires ou civils dont elles vivent.
---
Si, à l'encontre de ce que l'on espérait au début de ma carrière, en ces premières années du XXe siècle on peut constater le progrès des sentiments belliqueux dans les classes supérieures, on doit remarquer aussi que, dans ce même intervalle, le protectionnisme s'est étendu sur tout le monde civilisé, à l'exception de l'Angleterre restée jusqu'ici libre-échangiste. Cependant je demeure toujours un ferme partisan de la paix et de la liberté. Ce qui me fait croire à leur triomphe final c'est que des progrès de tout genre ont multiplié les échanges et diminué ainsi le coût de la vie tandis que là guerre a pour résultat de l'enchérir. Il y a ainsi entre la guerre et la paix une différence fondamentale. On ne peut pas dire que la guerre travaille gratis, même si elle est victorieuse, tandis que l'échange augmente quand même les profits des deux parties. Ce qui redouble mes espérances, c'est que depuis un siècle la face du monde a été modifiée: innombrables inventions, grâce auxquelles la richesse s'est développée et multipliée, ont ajouté à l'agrément de l'existence. La guerre empêche la richesse de s'accroître; elle a pour effet d'augmenter les frais de production tandis que les inventions ont généralement pour but de les abaisser. Cependant les inventions n'ont pas seulement pour résultat de rendre la vie meilleure, au contraire elles ont aussi perfectionné l'art de la guerre: fusils et canons ont augmenté leur portée destructive, on a ajouté aux anciens de nouveaux engins destructifs: torpilles, sous-marins, dirigeables et aéroplanes même, dynamite et autres explosifs. Enfin chaque jour apporte son perfectionnement dans l'art d'anéantir ses semblables et les fruits de leur activité, on sorte que les inventions qui ont pour objet de détruire pourraient bien dépasser celles qui concourent à améliorer le sort de l'humanité; les peuples seront ainsi obligés, s'ils ne se resaisissent promptement, de supporter le coût croissant de la guerre et de ses préparatifs. Le pourront-ils longtemps?
Durant une assez longue période après la fin des guerres du premier Empire, le monde avait joui de la paix. On avait donc alors quelque raison de croire que la guerre cesserait de ravager le monde. Les Congrès de la paix commençaient à se multiplier. La liberté des échanges trouvait aussi d'ardents protagonistes. En Angleterre les réformes de M. Huskisson faisaient prévoir la disparition du protectionnisme, celles auxquelles Richard Cobden et Robert Peel ont attaché leur nom annonçaient sa fin prochaine. On pouvait se flatter de l'espoir que la civilisation aurait pour auxiliaire la paix et la liberté et que de cette époque daterait la cessation de l'hostilité des peuples. Les révolutions et les guerres ne tardèrent pas â faire rompre la paix et reparaître le protectionnisme. Les tarifs des douanes ont continué à séparer les nations, et même on peut craindre l'accroissement et l'extension du régime protecteur.
---
Cependant depuis plus d'un demi-siècle une véritable efflorescence a commencé à changer la face du monde. Dans le cours de ma longue existence j'ai vu naître les chemins de fer dont le réseau atteint actuellement un million de kilomètres. Des vapeurs traversent aujourd'hui les océans. L'électricité transmet les pensées du monde entier. La photographie est devenue l'auxiliaire des relations. Dans mon enfance on n'écrivait qu'avec des plumes d'oie; on ne connaissait pas plus les plumes métalliques que les timbres-postes ou la bougie, le gaz venait à peine de naître. Des milliers d'inventions facilitent la vie. Même les fruits de l'intelligence étaient alors moins nombreux et commençaient seulement à se répandre dans les masses. L'état mental actuel des esprits est à peine comparable à ce qu'il était à la veille du commencement du XIXe siècle. Mais l'état moral de l'humanité est inférieur à celui de son intelligence. De là, la grande crise dans laquelle se débattent aujourd'hui lés sociétés en voie de civilisation. On pourrait presque les comparer à ces gens auxquels les hasards de la loterie procurant soudainement un million ont modifié du jour au lendemain leur existence matérielle sans rien changer à leur état intellectuel: la plupart de ces gagnants ne songent qu'à améliorer leur bien-être matériel, quand ils ne se livrent pas aux pires jouissances, mais leur moralité reste la même, si même elle ne s'abaisse pas. C'est pourquoi l'on peut presque dire que le progrès de la civilisation s'est plutôt ralenti que précipité, car il dépend à la fois de l'intelligence et de là moralité.
---
A peu près au même moment que cette efflorescence des inventions est apparu le socialisme.
C'est une tendance devenue universelle de renverser les gouvernements pour leur substituer un régime égalitaire. Le socialisme ne trouve, en somme, une absolue résistance que dans les classes dont il bouleverse les moyens d'existence. Jusqu'à présent il n'a pas découvert un système propre à remplacer l'ancien régime sous lequel l'humanité à vécu, quelques diverses qu'en aient été les formes. Il a suscité des révolutions et des guerres civiles et selon tout apparence il en suscitera encore d'autres.
Mais quel est le régime préconisé par le socialisme? Né de l'ensemble des souffrances que les peuples ont éprouvées du fait de leurs dominateurs, ils en voient le remède dans la propriété d'eux-mêmes. Ils travaillent, en conséquence, à expulser leurs dominateurs et à les remplacer par un gouvernement issu d'eux-mêmes: c'est ainsi qu'est né le gouvernement parlementaire ou constitutionnel. Et dans l'ignorance des lois naturelles par lesquelles la Providence gouverne les hommes en se bornant à en prescrire l'observation, -ils ont institué des lois multiples, plus souvent nuisibles qu'utiles à ceux qu'ils voulaient protéger. C'est pourquoi le socialisme, dans l'ensemble de ses systèmes, en admettant qu'il réussisse à les installer, aboutirait à la ruine des sociétés. Et les chefs d'Etats, monarchistes ou républicains, quels que soient les mobiles auxquels ils obéissent, ont tort de leur céder, même s'ils sont poussés par les sentiments les plus purs et les plus élevés tels que ceux de la philanthropie.
Sans qu'il y paraisse, le régime parlementaire et constitutionnel aboutit au socialisme car de socialisme n'est autre chose que l'appropriation de tous les moyens de se procurer des richesses, y compris la direction de la société. Le régime constitutionnel et parlementaire est demeuré la propriété des classes supérieures qui se sont enrichies et possèdent la plus grande partie des moyens de subsistance. C'est pourquoi elles sont dénommées classe capitaliste et sont plus que jamais l'objet d'une envieuse considération. Mais le socialisme veut s'emparer de la richesse existante. La lutte entre le socialisme et le capitalisme est donc éternelle. Cependant, il est avéré que dès que les socialistes deviennent capitalistes, ils changent d'opinion et deviennent à leur tour les défenseurs du capital. Ils cèdent le moins possible au socialisme et c'est ainsi qu'on a pu dire, en modifiant les termes, qu'un jacobin ministre n'est pas nécessairement un ministre jacobin.
La direction de l'Etat est l'objet du régime parlementaire auquel presque tous les anciens maîtres des Etats se sont ralliés en considérant les avantages matériels qu'ils y trouvent.
La Révolution a simplement changé l'apparence du régime qui jusque-là avait été dominant. Les monarques étaient jusqu'alors considérés comme les propriétaires de leurs peuples; la Révolution a changé nominalement cet état de choses: les peuples devenus propriétaires d'eux-mêmes sont désormais chargés de se gouverner. Ils ont d'abord élaboré une constitution édictant leurs droits et leurs devoirs. Mais ils sont incapables de se conduire, et, en fait, ce régime n'est autre que la domination d'une classe sur la multitude. Cette domination d'une classe gouvernante peu nombreuse excite l'opposition de la masse exclue du gouvernement. Aussi, bien qu'il n'y ait qu'une classe qui exerce lé pouvoir et une opposition, comme il y a une masse électorale à peu près illimitée, on a vu se multiplier les partis avides de gouverner. Mais, que ce soit monarchie ou république, on peut constater la cherté progressive du gouvernement car la classe bureaucratique qui en dépend s'est prodigieusement accrue. Le gouvernement à bon marché semble plus que jamais devenir une utopie puisque le régime constitutionnel augmente encore ainsi les frais du gouvernement belliqueux et protectionniste quoiqu'il les reporte souvent, sur les générations futures en les laissant responsables de ses emprunts et de ses dettes.
On s'imagine communément que ce régime est le plus parfait possible, pourtant on remarque de nombreux symptômes de décadence même chez les peuples les plus avancés en civilisation. Nous croyons qu'il sera perfectionné comme l'a été la machine à vapeur et le métier à tisser. Et déjà l'on peut conjecturer ce que seront ces progrès en voyant quelles évolutions ont subies les entreprises financières ou industrielles. Mais si le perfectionnement du régime constitutionnel est possible, il peut aussi être retardé à cause du grand nombre d'individus incapables qui remplissent les devoirs électoraux. Nous ne parlons pas de l'extension aux femmes du droit de vote, que nous ne souhaitons pas, bien que nous soyons tout l'opposé d'un antiféministe, parce que plus il y aura d'électeurs, plus les résultats seront mauvais. Et ce n'est pourtant pas déjà brillant. Si l'on regarde d'un peu près les faits et gestes des représentants du peuple, on aperçoit partout leur inconséquence: En Espagne les uns consentent à laisser fusiller Ferrer sous prétexte qu'il enseignait une morale contraire à celle du gouvernement, qui n'en a pas, et les autres sous prétexte de libéralisme, rompent avec le Pape à propos d'associations religieuses qui conviennent à certains partis mais non à tous. En France ils ont confisqué des biens et prononcé le bannissement de religieux et religieuses qui enseignaient une doctrine qui leur déplaisait; pour accomplir ce travail ils se sont adjugé individuellement quinze mille francs par an! En Belgique, nous avons été témoin d'une enquête libérale dirigée contre les pauvres femmes qui faisaient donner à leurs enfants l'enseignement congréganiste, le résultat a été d'amener le parti clérical au pouvoir, où il se maintient depuis vingt-six ans malgré la rancune d'une partie des électeurs mécontents de le voir monopoliser places et faveurs du gouvernement pour ses créatures au détriment de l'industrie et du commerce qui en font les frais. En Allemagne, les représentants du peuple se montrent les humbles serviteurs du gouvernement qui opprime les anciens sujets du Danemark et les Polonais obligés à un service militaire et à des impôts qu'ils ne doivent pas. En Russie, la Douma a accepté le transfert au peuple des charges et emprunts de là guerre avec le Japon et a, en outre, ratifié le despotisme infligé aux Juifs, aux Polonais et aux Irlandais. En Amérique, les représentants du peuple ont ratifié la confiscation des intérêts des vaincus des Etats du Sud au profit des industriels protectionnistes du Nord et de l'Est qui en ont profité pour accaparer les industries protégées, d'où découlent les trusts avec les milliardaires, et remplacé l'esclavage par le mépris et le lynchage des noirs. Leurs politiciens sont pour la plupart tellement décriés que les honnêtes gens ne veulent pas les recevoir... et le malheur est qu'en nombre d'autres pays ils commencent aussi à glisser sur cette pente. En Italie ils ont augmenté le fardeau des impôts dans des proportions telles que l'émigration s'y est développée d'une façon intense. En Angleterre des scènes de pugilat se sont produites en plein Parlement de même qu'en Autriche-Hongrie où les antisémites se livrent à leurs fureurs et les diverses nationalités à leurs disputes pour la prééminence dans la direction des affaires de l'Empire, ne retrouvant un peu d'accord que lorsqu'il s'agit de s'emparer du bien d'autrui comme l'annexion de la Bosnie-Herzégovine, par exemple. En Turquie, ne voit-on pas aussi une petite coterie, sorte de comité directeur, s'efforcer de faire prévaloir les intérêts du « turquisme » au lieu de régir équitablement ceux de toutes les populations qui forment l'ensemble du pays. Tels ont été quelques-uns des faits et gestes des représentants du peuple sous le régime qualifié de constitutionnel.
Mais on peut se figurer un régime supérieur au régime constitutionnel. Et ce régime, modelé sur là constitution naturelle de l'industrie, sera énormément simplifié. Déjà les compagnies de transport, les institutions financières, les sociétés industrielles et commerciales ont un conseil d'administration dont les opérations sont surveillées par des délégués des actionnaires et aussi par ces derniers qui se réunissent une fois l'an, parfois deux, pour examiner les affaires, prendre les décisions utiles et ratifier les comptes. Ils participent aux travaux de l'assemblée suivant le nombre d'actions qu'ils possèdent. Une partie du conseil d'administration est nommée par le fondateur de l'entreprise, la ratification des autres nominations est réservée aux actionnaires après proposition du président et du Conseil. Les membres de ces conseils sont généralement rééligibles et restent en fonctions leur vie durant. Ils diffèrent peu en cela des ministres de l'ancien régime monarchique, témoin Colbert, tandis que ceux du régime constitutionnel sont devenus d'une mobilité excessive, selon l'état des partis qui se partagent les parlements. — Dans les entreprises privées, les assemblées nomment un président qui est le principal directeur des opérations de l'affaire et reçoit des appointements supérieurs à ceux des autres conseillers, sans être cependant excessifs. Ces appointements ne se comptent que par milliers de francs tandis que ceux des monarques constitutionnels, issus dé l'ancien régime, se comptent par millions. Tel est le progrès politique que nous avons en vue et qui sera suivi de tous les autres.
On pourrait objecter que la plupart des assemblées parlementaires travaillent activement et font des lois auxquelles tous les peuples de la monarchie ou de la république sont soumis bien qu'elles soient seulement l'oeuvre d'une partie du parlement. Mais on compte les lois utiles, à peine une seule sur une centaine, et les décrets d'un conseil d'administration seraient plus efficaces quoiqu'ils soient issus de la même source, savoir, de la généralité des actionnaires c'est-à-dire du suffrage universel. L'avènement du socialisme a sensiblement augmenté le nombre des lois car les socialistes ignorent en quoi consistent les lois naturelles; ils sont convaincus que celles qu'ils fabriquent sont supérieurement faites et ils en exigent l'application rigoureuse. Dans ce but leurs ministres multiplient les fonctionnaires. Mais à peu près toutes les lois inspirées par le socialisme sont faites pour une certaine classe d'hommes à laquelle elles semblent profiter bien qu'elles leur soient nuisibles. Car tout ce qui change la destination de la fortune de l'ensemble des contribuables est loin d'être toujours favorable à la richesse publique. En faisant passer les ressources dés classes favorisées de la fortuné en des mains moins capables ou plus dispendieuses et en augmentant lès dépenses militaires, le protectionnisme et le fonctionnarisme, la richesse diminuera et les dettes s'accroîtront jusqu'à ce que le pays ne puisse plus en supporter le fardeau. Peut-être est-ce ainsi que, selon toute apparence et malgré le développement progressif de la civilisation, se perdront les Etats les plus florissants. C'est de cette sorte qu'a péri le monde romain, bien autrement civilisé que la nuée des barbares qui l'entourait. Les vices intérieurs et les dépenses excessives écraseront la civilisation actuelle comme les Barbares l'ont écrasée, dans l'antiquité. Ce sera un nouveau mode de destruction non moins certain et aussi complet que le précédent.
Endnotes
1 Il y a peut-être quelque inexactitude métaphysique dans cette distinction de sensations et d'idées. Les idées, sous un certain rapport, sont aussi des sensations combinées, prolongées, conservées, rappelées, séparées de l'action des objets extérieurs, dissemblables, en un mot, des sensations premières et instantanées; mais c'est pour exprimer cette dissemblance, le plus positivement et le plus brièvement possible, que nous appelons les unes sensations proprement dites, et les autres idées.
2 On peut diviser la carrière de l'espèce humaine en trois parties:
Partie constatée,
Partie douteuse,
Partie inconnue.
Elle ne revient jamais sur la partie constatée. Lorsqu'on croit qu'elle rétrograde, c'est qu'elle s'agite dans la partie douteuse qui a une certaine latitude. A mesure qu'elle avance, la partie douteuse devient constatée, la partie inconnue devient douteuse.
3 [Editor’s note: Translation from Marcel Gauchet's edition of Constant: Virgile, Enéide, II, 291-92: "Si Pergame pouvait être défendue par un bras, le mien l'aurait encore défendue."
4 Cette 3e partie du plan n'a pas été exécutée.
5 On peut, en généralisant davantage, se représenter, si l'on veut, une terre comme une grande machine au moyen de laquelle nous fabriquons du blé, machine que nous remontons en la cultivant. On peut encore se représenter un troupeau comme une machine à faire de la viande ou de la laine.
6 Sans restreindre pour un temps et dans certains endroits l'emploi des nouveaux procédés et des nouvelles machines, ce qui serait une violation de la propriété acquise par l'invention et l'exécution des machines, une administration bienveillante peut préparer d'avance de l'occupation pour les bras inoccupés, soit en formant, à ses frais, des entreprises d'utilité publique, comme un canal, une route, un grand édifice; soit en provoquant une colonisation, une translation de population d'un lieu dans un antre. L'emploi des bras qu'une machine laisse sans occupation est d'autant plus facile, que ce sont pour l'ordinaire des bras accoutumés au travail.
7 Il peut sembler paradoxal, mais il n'est pas moins vrai que la classe ouvrière est, de toutes, la plus intéressée au succès des procédés qui épargnent la main-d'œuvre, parce que c'est elle, c'est la classe indigente qui jouit le plus du bas prix des marchandises, et souffre le plus de leur cherté.
8 On voit, au 20e chant de l'Odissée, que douze femmes étaient journellement occupées à moudre le grain nécessaire à la consommation du palais d'Ulysse, et ce palais n'est pas représenté comme étant plus considérable que la maison d'un particulier opulent de nos jours.
9 (2) Depuis la 3e édition de cet ouvrage, M. de Sismondi a publié un livre intitulé: Nouveaux principes d'Économie politique, dans lequel il insiste (livre VII, ch. 7) sur les inconvéniens que présente l'introduction des machines qui suppléent au travail de l'homme. Cet estimable écrivain, trop frappé des inconvéniens passagers, méconnaît les avantages durables des machines, et semble même être demeuré étranger aux principes d'Économie politique qui établissent ces mêmes avantages d'une manière rigoureuse. Voyez l'Epitome qui suit cet ouvrage, aux mots: Frais de production; Revenus; Richesses.
10 Beccaria, dans un cours public d'économie politique qu'il fit à Milan en 1769, avait, dès avant la publication de l'ouvrage de Smith, remarqué que la séparation des travaux était favorable à la multiplication des produits. Voici ses expressions: Ciascuno prova coll' esperienza, che applicando la mano e l'ingegne sempre allo stesso genere di opere e di prodotti, egli più facili, più abondanti, e migliori ne trova i resultati, di quello che se ciascuno isolatamente le cose tuttea se necessarie soltanto facesse: Onde altri pascono le pecore, altri ne cardano le lane, altri le tessono; chi çoltiva biade, chi ne fa il pane, chi veste, chi fabbrica agli agricoltori e lavoranti, crescendo e concatenandosi le arti, e dividendosi in tal maniera per la comune e privata utilità gli uomini in varie classi e condizioni. « Chacun sait, par sa propre expérience, qu'en appliquant ses mains et son esprit toujours au même genre d'ouvrage et de produits, il obtient des résultats plus faciles, plus abondans et meilleurs que si chacun terminait seul les choses dont il a besoin. C'est pour cette raison que ce ne sont pas les mêmes personnes qui font paître les brebis, qui cardent la laine, qui la tissent: les uns cultivent le blé, les autres font le pain, d'autres font des vêtemens, ou bien des constructions pour les agriculteurs, pour les artisans; et c'est ainsi que s'enchaînent et se multiplient les arts, et que les hommes se séparent en diverses: conditions pour l'utilité publique et particulière. »
11 Mais si l'on doit à la séparation des travaux plusieurs découvertes importantes dans les arts, on ne lui doit pas les produits qui ont résulté, et qui résulteront à jamais de ces découvertes. On doit la multiplication de ces produits à la puissance productive des agens naturels, quelle que soit l'occasion par où l'on est venu à savoir les employer. Voyez le chapitre 4 de ce Livre I.
12 Le bas prix du sucre, à la Chine, vient probablement en partie de ce que l'agriculteur ne se mêle pas de l'extraction du sucre hors de la canne. Cette opération se fait par des manipulateurs ambulans, qui, munis d'un appareil peu dispendieux, vont offrir leur service d'habitations en habitations. Voyez Macartney, tome IV, page 198.
13 (1) Non-seulement nos marchés de campagne indiquent que la consommation de certains objets est languissante, mais il suffit de les parcourir pour voir combien le nombre des produits qu'on y vend est borné, et leur qualité grossière. Dans ce qui est au-delà des produits ruraux du canton, on n'y voit guère que quelques outils, quelques étoffes, quelques merceries et quincailleries des qualités les plus inférieures. Dans un état de prospérité plus avancé, on y verrait quelques-unes des choses qui contribuent à satisfaire aux besoins d'une vie un peu plus raffinée: des meubles plus commodes et moins dépourvus d'élégance; des étoffes plus fines et plus variées; quelques denrées de bouche un peu plus chères, soit par leur préparation, soit par la distance d'où elles seraient amenées, quelques objets d'instruction ou d'amusement délicats, des livres autres que des livres de dévotion on des almanachs de sorcier, etc. etc. Dans un état encore plus avancé, la consommation de toutes ces choses serait assez courante, assez étendue pour qu'on y trouvàt des. boutiques constamment ouvertes et assorties en ces différons genres. On voit en quelques parties de l'Europe des exemples de ce degré de richesse, notamment dans quelques cantons de l'Angleterre, de la Hollande et de l'Allemagne.
14 On ne voit, pas, en général, dans l'agriculture,, des entreprises aussi considérables que dans le commerce et les manufactures. Un fermier ou un propriétaire ne font pas valoir ordinairement plus de 4 à 500 arpens; exploitation qui, pour l'importance des capitaux et la grandeur des produits, n'excède pas celles d'un négociant et d'un manufacturier médiocres. Cela tient à plusieurs causes, et principalement à l'étendue du théâtre qu'exige cette industrie; à l'encombrement de ses produits qui ne peuvent pas être rentrés de trop loin au chef-lieu de l'entreprise, ni aller chercher des débouchés trop distans; à la nature même de l'industrie, qui ne permet à l'entrepreneur d'établir aucun ordre constant et uniforme, et qui exige de lui une suite de jugemens partiels, en raison de la différence des cultures, des assolemens, des engrais, de la variété des occupations d'un même ouvrier, laquelle dépend de la marche des saisons, des vicissitudes même du temps, etc.
15 C'est aussi le sentiment de Locke
16 II y a un esprit de parti absurde et une ignorance profonde à vouloir réduire à des termes simples la question de la république et de la monarchie: comme si la première n'étoit que le gouvernement de plusieurs, et la seconde celui d'un seul. Réduite à ces termes, l'une n'assure point le repos, l'autre ne garantit point la liberté. Y ayoit-il du repos à Rome sous Néron, sous Domitien, sous Héliogabale, à Syracuse sous Denys, en France sous Louis XI, ou sous Charles IX? Y avoit-il de la liberté sous les décemvirs, sous le long parlement, sous la convention ou même le directoire? L'on peut concevoir un peuple gouverné par des hommes qui paroissent de son choix, et ne jouissant d'aucune liberté, si ces hommes forment une faction dans l'Etat, et si leur puissance est illimitée. On peut aussi concevoir un peuple soumis à un chef unique, et ne goûtant aucun repos, si ce chef n'est contenu ni par la loi ni par l'opinion. D'un autre côté, une république pourroit se trouver tellement organisée que l'autorité y fût assez forte pour maintenir l'ordre, et quant à la monarchie, pour ne citer qu'un exemple, qui osera nier qu'en Angleterre, depuis cent vingt ans, l'on n'ait joui de plus de sureté personnelle et de plus de droits politiques que n'en procurèrent jamais à la France ses essais de république, dont les institutions informes et imparfaites disséminoient l'arbitraire et multiplioient les tyrans?
Que de questions de détail, d'ailleurs, dont chacune seroit nécessaire à examiner! La monarchie est-elle la même chose, suivant que son établissement remonte à des siècles reculés, ou date d'une époque récente; suivant que la famille régnante est de temps immémorial sur le trône, comme les descendans de Hugues Capet, ou qu'étrangère par son origine, elle a été appelée à la couronne par le vœu du peuple, comme en Angleterre, en 1688, ou qu'elle est enfin tout-à-fait nouvelle, et sortie, par d'heureuses circonstances de la foule de ses égaux; suivant encore que la monarchie est accompagnée d'une ancienne noblesse héréditaire, comme dans presque tous les Etats de l'Europe, ou qu'une seule famille s'élève isolément, et se voit forcée de créer à la hâte une noblesse sans aïeux; suivant que cette noblesse est féodale, comme en Allemagne, purement honorifique, comme elle l'étoit en France; ou qu'elle forme une sorte de magistrature, comme la chambre des pairs, etc., etc.?
17 Pédarète, eh sortant d'une assemblée, dont il avoit inutilement sollicité les suffrages, dit: Je rends grâces aux Dieux de ce qu'il y a dans ma patrie trois cents citoyens meilleurs que moi.
18 Esprit des lois. VIII I.
19 Ce que j'écrivois ici ne s'applique qu'au système que j'examinois alors; c'est-à-dire, à l'hypothèse d'un usurpateur détruisant toutes les institutions anciennes pour leur substituer des institutions créées par un seul. La révolution qui vient de s'opérer répond à plusieurs de mes objections. Pour ce qui regarde la noblesse, par exemple, la combinaison de l'ancienne et de la nouvelle est une heureuse et libérale idée. La première donnera à la seconde le lustre de l'antiquité; et celle-ci, composés heureusement en grande partie d'hommes couverts de gloire, apporte en dot l'éclat des triomphes militaires. Dans ce cas, comme dans presque toutes les difficultés qu'elle avoit à combattre, la constitution actuelle les a surmontées habilement, et a conservé tout ce qui étoit bon dans un régime dont l'ensemble d'ailleurs étoit détestable. Pour juger mon ouvrage, il ne faut pas oublier qu'il est écrit et publié depuis quatre mois: je voyois alors le mal, et je ne pouvois prévoir le bien.
20 Un pamphlet publié contre la prétendue chambre haute du temps de Cromwell est une preuve remarquable de l'impuissance de l'autorité dans les institutions de ce genre. v. a reasonable speech made by a worthy member of parliament in the house of commons, concerning the other house. March, 1659.
21 Aristot. Polit. V. 10.
22 Quand Cicéron disoit: pro quâ patiiâ mori,et cui nos totos dedere, et in quâ nostra omnia ponere, et quasi consecrare debemus, c'est que la patrie contenoit alors tout ce qu'un homme avoit de plus cher. Perdre sa patrie, c'étoit perdre sa femme, ses enfans, ses amis, toutes ses affections, et presque toute communication et touts jouissance sociale: l'époque de ce patriotisme est passé; ce que nous aimons dans la patrie, comme dans la liberté, c'est la propriété de nos biens, la sécurité, la possibilité du repos, de l'activité, de la gloire, de mille genres de bonheur. Le mot de patrie rappelle à notre pensée plutôt la réunion de ces biens, que l'idée topographique d'un pays particulier. Lorsqu'on, nous les enlève chez nous, nous les allons chercher au dehors.
23 J'aime à rendre justice au courage et aux lumières d'un de mes collègues, qui a imprimé, il y a quelques années, sous la tyrannie, la vérité que je développe ici, mais en l'appuyant de preuves d'un genre différént de celles que j'allègue, et qui ne pouvoient se publier alors. « Dans l'état actuel de la civilisation, et dans le système commercial sous lequel nous vivons, tout pouvoir public doit être limité, et un pouvoir absolu ne peut subsister. » GANILH., Hist. du Revenu public, I. 419.
24 Article communiqué.
25 "Du système representatif," pp. 66-111.
26 (Que pourrait dire le gouvernement si quelqu'un ouvrait une souscription pour élever aux républicains qui périrent à Quiberon, en combattant les émigrés, un monument pareil à celui par lequel il veut consacrer la mémoire de ces derniers? Que pourrait-il dire encore si les officiers de l'armée, justement indignés de voir donner par nos journaux ministériels, le titre d'officiers à des chouans, à des vendéens, se qualifiaient, eux, officiers républicains ou sans-culottes?
27 Réactions politiques. Paris, 1797, pag- 85—87.
28 Discours au Cercle Constitutionnel, en 1798.
29 De la Respons. des Ministr. p. 78—80.
30 Art. 61. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ni exilé que dans les cas prévus par la loi.
31 Le grand Condé ouvrit la tranchée devant Lérida au sou des violons et des hautbois.
32 Plusieurs de ces raisonnements se retrouvent dans une notice piquante et spirituelle placée en tête du recueil complet des chansons de Collé, publié par M. Auger, censeur, et membre de l'Académie française.
33 Un autre ministre a depuis revendique l'honneur de cette saisie; c'est une gloire qu'on n'entend point lui contester.
34 Il existe cependant, dans les volumes qui ont été publies, cinq on six articles qui ne lui appartiennent pas, et qui, par oubli, n'ont point été signés. Trois ou quatre du quatrième volume appartiennent à son collaborateur.
35 En déveoppant et provoquant le sympathie.
36 Sous ce titre, nous insérons ici un article extrait du tome VIIe (1818) du Censeur européen, écrit à l'occasion de la seconde édition de l'opuscule de J.-B. Say intitulé, Petit volume contenant quelques aperçus des hommes et de la société. Les deux premiers alinéa seulement sont tirés d'un autre article fort court de notre auteur, publié dans le tome XIIe (1819) du Censeur européen, sous ce titre: De quelques dispositions des lois du 28 avril 1816 et du 21 avril 1819 sur les douanes.
37 Le lecteur trouvera l'opuscule d'où ce fragment est extrait dans le volume intitulé, Œuvres diverses de J.-B. Say, p. 663 à 716 (Collection des principaux économistes); Paris, Guillaumin, 1848.
38 On ne devinerait certainement pas combien les anciens et les nouveaux collèges électoraux ont choisi de députés parmi les agents du gouvernement; combien, dans une mesquine représentation de deux cent quarante ou deux cent cinquante membres, il se trouve d'hommes dépendant, par leurs fonctions, du ministère. Il y en a plus de vingt, plus de quarante, plus de quatre-vingts, plus de cent: il y en a cent vingt; et encore ne comptons-nous pas dans ce nombre les juges, les hommes décorés, titrés, pensionnés, qui se trouvaient parmi les élus, et que nous considérons, dans ce calcul, comme des hommes indépendants par leur position. Assurément nous sommes loin de vouloir rien insinuer contre le caractère personnel des cent vingt fonctionnaires amovibles qui se trouvent à la Chambre des députés. Mais est-il bien sage, nous le demandons encore une fois, de remettre le contrôle de l'administration aux subordonnés de l'administration? Est-il convenable de confier à des préfets la surveillance du ministère de l'intérieur; d'envoyer des receveurs-généraux pour vérifier les comptes du ministre des finances; de charger des colonels et des procureurs du roi de poursuivre, s'il y a lieu, les ministres de la guerre ou de la justice? Le bon sens montre que cela est absurde; le fait le prouve encore mieux peut-être. Qu'on prenne la peine d'examiner comment la Chambre est divisée, quels sont les hommes qui se trouvent derrière le banc des ministres, qui votent perpétuellement avec eux, qui crient impitoyablement « l'ordre du jour! » à toutes les pétitions, et l'on verra l'avantage qu'il y a de choisir ses députés parmi les hommes liges du ministère.
39 M. de Lafayette, nommé député par la Sarthe.
40 On répugne à faire mention d'un autre genre de mauvais livres; et peut-être qu'en effet il ne serait pas nécessaire de le désigner dans les lois d'un peuple libre, au sein duquel des institutions sages et garantissantes amèneraient la noblesse des sentimens et la pureté des mœurs : les livres obscènes ne se répandent que chez les peuples dégradés par des habitudes serviles. On pourrait, d'ailleurs, trouver quelques difficultés à caractériser assez bien cette espèce de livres, pour en distinguer certaines productions peu sévères, où les grâces de l'expression semblent tempérer la licence des idées : La Fontaine, Voltaire, Parny et d'autres écrivains en ont publié de pareilles; et quelle que soit la rigueur des jugemens qu'on en voudra porter, il est certainement devenu impossible d'en empêcher aujourd'hui la circulation. Mais l'Italie, au seizième siècle, en a vu naître d'abominables, qui, bien que prohibées, circulaient fort à l'aise sous les yeux des prélats, quelquefois entre leurs mains, et dont il a été fait, en d'autres langues, des copies infâmes. C'est un désordre qui ne saurait être toléré dans un pays policé. Il faut que l'autorité puisse immédiatement empêcher l'exposition publique et la distribution de ces turpitudes, mais sans qu'il en résulte aucune poursuite judiciaire contre les personnes, à moins que celles-ci ne réclament expressément contre la saisie : en ce cas, ce serait encore à des jurés qu'il appartiendrait de reconnaître le fait de l'obscénité; et sur leur déclaration, les distributeurs seraient condamnés à de très-fortes amendes.
41 Je dis, en général, parce que ces moyens ne sont encore presque nulle part complètement purs. Quelle est en effet, même dans les pays de l'Europe les plus civilisés, la classe d'hommes qui ne profite pas, directement ou indirectement, de quelque privilège, de quelque monopole, de quelque prohibition injuste? Qui peut se rendre le témoignage que la violence ne contribue en rien à augmenter le revenu de ses fonds productifs? Cela ne serait possible que dans un ordre de choses où rien ne limiterait la concurrence; et nous sommes sûrement fort éloignés d'un tel état.
42 La société adjugeant le» gouvernement à des hommes de son choix! cela serait-il praticable? la société peut-elle agir, collectivement? voudriez-vous qu'elle mît le gouvernement à l'enchère? La société ne peut pas agir collectivement; mail elle peut agir par des délégués, et rien sûrement n'empêcherait que, par l'intermédiaire de ses délégués, elle n'accordât ou ne retirât sa confiance à tel parti d'hommes d'état, à telle coalition ministérielle, actuellement en possession du pouvoir ou aspirant à l'obtenir. Non-seulement cela est praticable, mais cela se pratique tous les jours.
43 Constit. de Pensilvanie, art. 36.
44 Constit. de Pensilvanie, art. 36. — Ces idées, observe Franklin (QEuvr. mor. et polit.), ont été plus ou moins adoptées, dans l'origine, par tous les états de l'Union.
45 OEuvres morales et polit., t. II, p. 157.
46 Peut-être cependant est-ce à l'insu de la nation américaine. On pourrait croire, à de certains traits, qu'elle n'a pas la conscience de son état et sait mal le secret de sa prospérité. Nous voyons des législateurs de Géorgie invoquer en faveur de l'esclavage l'autorité des Grecs et des Romains, et faire à l'état social d'une partie de l'Amérique l'injure de le comparer à celui de peuples voués à la guerre et à la domination. —On a été chercher dans l'ancienne Rome le nom qu'il fallait donner à l'hôtel du congrès, et les délégués d'un peuple d'artisans et de laboureurs ont voulu siéger au Capitole, comme le sénat du peuple-roi. —En Amérique, comme en Europe, les jeunes gens n'apprennent guère, jusqu'à vingt ans, que du grec et du latin. — Les réputations militaires l'emportent, à ce qu'il paraît, sur la gloire purement civile, et la mémoire de Whasington (sic) est entourée de plus d'hommages que celle de Franklin. —Tout cela ne semblerait pas prouver que l'Amérique comprenne bien sa manière d'être. En faut-il conclure que son état n'est pas ce que je dis? Non, il faut dire seulement que son état vaut mieux que les idées qu'elle semble s'en faire.
47 C'est le reproche que lui font tous les politiques de l'antiquité, et c'est par-là qu'ils prétendent justifier l'exclusion de la cité de la plupart des hommes livrés à des professions industrielles.
48 Bonald, Réflexions sur l'intér. gêner. de l'Europe, p. 46
49 Liv. I, ch. 21.
50 Disc, sur l'inég., les notes, note 9.
51 Journal des Débats du 9 décembre 1820, col. 4. Il est peu d'écrits de l'école monarchique dans lesquels on ne retrouve la même idée. Elle sert de base à tous les raisonnemens par lesquels on a prétendu prouver la nécessité de diviser la société en corporations et en ordres.
52 C'est l'accusation banale que lui adressent la plupart des publicistes de l'école monarchique, et beaucoup de moralistes chrétiens, surtout dans la communion catholique. Des écrivains d'un autre ordre, des philosophes, et notamment Rousseau, lui ont intenté le même procès.
53 Voy. dans le spirituel ouvrage intitulé Raison et Folie, un morceau remarquable sur l'influence morale de la division du travail. Voy. aussi M. Say, qui, dans les dernières éditions de son Traité d'éc. pol., liv. i,ch. 8, s'est laissé entraîner par les idées spécieuses quoique peu fondées, à mon avis, de M. Lémontey.
54 On voit clairement quel est mon objet. En parlant de l'industrie et de la vie industrielle, je ne veux pas dire que l'acquisition de la richesse soit l'unique objet digne de l'activité humaine (qui eut jamais une telle pensée!); ce que je veux dire, c'est que ce mode d'existence est le seul vraiment favorable, non-seulement au progrès de la richesse, mais à celui des sciences, des arts, des mœurs, de la justice et de tout ce qui donne la liberté. C'est cette proposition qu'il faut combattre, quand on veut faire le procès à ce qu'on a semblé vouloir flétrir du nom d'industrialisme; et comme, en définitif, l'humanité ne vit que de deux manières, par le brigandage ou par le travail, considérés l'un et l'autre dans leurs innombrables modes, ceux qui ne trouveraient pas la vie industrielle assez noble accepteraient, par cela même, l'obligation de prouver que le brigandage est plus conforme à la dignité de l'homme et plus favorable à ses progrès.
55 Voy. ch. VI.
56 L'étude des sciences, chez les anciens, ne passait pour libérale qu'autant qu'on s'abstenait de les appliquer et de les faire servir à quelque chose d'utile (Aristote, Polit., liv. 8, ch. 2, §. 3). Il paraît qu'à cet égard nous ne sommes pas encore bien guéris des préjugés de la barbarie. On a vu récemment, dit-on, quelques membres de l'un des premiers corps savans de l'Europe refuser de se donner pour collègues des hommes très distingués comme savans, parce que ces hommes avaient le malheur d'être aussi très distingués comme artistes.
57 Les sectes de stoïciens, les moralistes ascétiques, ne se montrent guère que dans les pays de domination, et aux époques où il ne reste plus qu'à consumer dans le faste et la débauche les biens qu'on a acquis par le brigandage. La morale devient tout à la fois moins relâchée et moins absurdement sévère dans les pays et dans les temps d'industrie. On ne voit là ni des Néron, qui se livrent sans pudeur aux plus sales crapules, ni des Sénèque qui s'indignent puérilement contre les hommes qui ont inventé de conserver la glace et de boire frais quand il fait chaud (Quest. naturelles, liv. 4, ch. 13). On réserve son indignation pour les vices qui énervent les hommes, qui les dégradent, qui détruisent leurs facultés ou épuisent leurs ressources, et l'on se permet d'ailleurs tous les plaisirs dont il ne peut résulter de mal ni pour soi ni pour les autres. Voilà comment la vie industrielle agit sur les mœurs.
Nous avons si peu étudié ce mode d'existence que nous ne sommes pas encore très habiles à en démêler les effets. Un journal, voulant défendre l'industrie contre le reproche que lui font des déclamateurs ascétiques de corrompre les moeurs, dit qu'il y a quelque chose de profondément moral dans la conquête de la nature par l'homme. On est surpris de trouver une explication si peu satisfaisante dans un écrit aussi distingué que le Globe (Voy. n° 145, p. 748). Il n'y a ni moralité ni immoralité à faire des conquêtes sur la nature; mais l'homme qui veut s'enrichir par ce moyen ne peut se passer d'activité, d'application, d'ordre, d'économie, de frugalité, etc.; et voilà comment l'industrie influe utilement sur la morale.
58 C'est ce que fait Platon; c'est aussi ce que fait Aristole: « Une cité, pour être complète et parfaite, commence par dire Aristote, doit être composée d'hommes libres et d'esclaves» (Pol., liv. i, ch. 2, §. I). Il ajoute que les hommes libres doivent être affranchis de tous les soins qu'exige la satisfaction des besoins de première nécessité {Ib., liv. 2, ch. 6, §. 2). II dit encore que les seules occupations dignes d'un homme libre sont l'exercice du pouvoir et la vie contemplative ou l'étude des sciences libérales (liv. 7, ch. 3, §. I, et liv. 8, ch. 2, §. 3). Puis il cherche quelle est la forme de gouvernement la plus propre à tenir en paix de tels hommes. Il n'avait pas étudié, pour résoudre ce problème, moins de cent cinquante-huit constitutions, suivant quelques écrivains, et moins de deux cent cinquante, selon d'autres. Il aurait pu en étudier bien davantage sans être plus capable de trouver une bonne solution: la question était tout bonnement insoluble.
59 C'est la prétention des écrivains monarchiques. « La subdivision de nos sociétés modernes en tant d'états et de métiers divers produit trop d'intérêts opposés, disent-ils, pour qu'aucune habileté révolutionnaire puisse les réunir dans un faisceau solide. Etablissez la liberté du commerce,-vous aurez contenté l'armateur qui veut parcourir sans gêne la vaste étendue de la mer; vous plairez au consommateur qui veut acheter à bon marché de bonnes marchandises; mais comment ferez-vous partager leurs sentimens par ce fabricant qui fonde son débit sur l'exclusion des concurrences étrangères? Partout la liberté et le monopole sont en présence dans le monde industriel, comme l'égalité et le privilège dans le monde politique. C'est donc uniquement par des illusions, par des fables, par des bruits mensongers qu'on peut enrégimenter ces intérêts contraires sous un étendard commun ; pour se désunir ils n'ont qu'à se regarder. » (Journal des Débats du 9 décembre 1820.) Le remède que l'auteur de ces paroles propose à cette opposition, c'est d'enrégimenter tous les intérêts analogues, de les armer et de leur donner le moyen de défendre leurs prétentions exclusives, qu'il appelle les intérêts permanens et généraux de la société. Il prétend fonder l'ordre en constituant, en rendant permanente et indestructible l'anarchie que lui-même vient de signaler.
60 C'est la prétention de l'école libérale.
61 Voy. l'Esprit des Lois.
62 Esprit des Lois, liv. II, ch. 6.
63 [See long footnote 1 at the end of the chapter.]
64 Recueil périodique de Goethe sur l'Art et l'antiquité, 2e vol., 3e cahier, exam. du comte de Carmagnole. Voyez cette pièce, traduite de l'italien par M. Fauriel.
65 Les corporations divisaient les hommes de tous les métiers, sans créer pour l'industrie aucune force nouvelle. Les associations, au contraire, créent pour le travail des forces immenses, sans produire entre les hommes aucune inimitié.
66 De cette passion des peuples industrieux pour la paix, on a conclu qu'ils devaient être peu disposés à repousser les agressions étrangères; c'est la conclusion contraire qu'il aurait fallu tirer: plus ils sentent le besoin de la paix, et plus ils doivent être disposés à repousser toute attaque. Il est très vrai que les hommes sont moins farouches dans les temps d'industrie qu'aux époques de domination. Les vertus sauvages, comme l'observe très bien Malthus, ne viennent qu'où elles sont nécessaires; or, à mesure que l'on pourvoit à sa subsistance par des moyens moins hostiles, la sûreté générale devenant plus grande, chacun peut sans péril déposer une partie de sa férocité. Mais de ce que dans l'industrie on est moins exposé à l'insulte, suit-il qu'on soit plus d'humeur à la souffrir? non sans doute. L'énergie humaine n'est pas détruite; elle a seulement moins d'occasions de s'exercer, ou pour mieux dire elle s'attaque à d'autres obstacles.
On fait à la vie industrielle un autre reproche: il est vrai, dit-on, que, dans l'industrie, les hommes sont moins opposés, mais ils sont aussi moins fortement unis. On ne voit plus de ces liaisons indissolubles, de ces dévoûmens mutuels et absolus qui donnaient tant de vie et d'intérêt aux âges barbares. Sans doute, les peuples industrieux ne sont pas unis par le désir d'attaquer, mais ils peuvent l'être encore par le besoin de se défendre; et quand ce besoin viendrait à cesser, quand ils n'auraient plus d'ennemis à craindre, les motifs ne manqueraient pas encore à leur union: ils seraient unis comme parens, comme amis; ils seraient unis par le plaisir de se trouver ensemble; ils seraient unis par l'avantage qui résulte pour chacun du rapprochement de plusieurs; ils ne seraient plus unis pour résister aux hommes; mais ils le seraient encore pour agir sur la nature.
67 [See long footnote 2 at the end of the chapter.]
68 « La *dynastie virginienne*, comme on l'a appelée, je crois avec raison, est un sujet de plainte dans toutes les autres parties de l'Amérique. Cet état a fourni quatre des cinq présidens, et un grand nombre d'occupans de tous les autres emplois du gouvernement. » Fearon, 6th report, p. 293.
Quand la Louisiane a été abandonnée aux États Unis, les Anglo-Américains se sont jetés avec tant d'avidité sur les emplois publics qui y ont été créés, qu'ils les ont exclusivement occupés, quoiqu'ils n'en connussent ni la langue ni les lois. Robin, tome II, ch. LV, p. 387.
L'avidité des emplois publics n'est pas un vice particulier à une époque ou à une nation. C'est un mal qui peut être le résultat d'un grand nombre de causes; voici, je crois, les principales:
1° L'existence de l'esclavage, ou les préjuges nés d'un tel état;
2° Le monopole, de la part du gouvernement, d'un nombre plus ou moins grand de professions privées, transformées en emplois publics;
4° Une grande facilité de parvenir aux emplois, sans frais et sans capacité;
5° La sécurité attachée aux fonctions publiques, ou l'inviolabilité des fonctionnaires;
6° Des salaires ou des honneurs sans proportion aux travaux à exécuter;
7° L'insécurité attachée à l'exercice des fonctions privées, et les vexations auxquelles sont exposées les personnes qui les exercent.
69 Les Hollandais établis aux Moluques emploient un moyen analogue pour maintenir leurs sujets dans la servitude. « Ils se gardent bien, dit Labillardière, de leur apprendre leur langue maternelle, afin de n'en être pas entendus lorsqu'ils conversent entre eux. » Voyage à la recherche de La Pérouse, ch. VOOO, tome I, page 355.
C'est par des motifs analogues que les prêtres d'Égypte employaient, entre eux, un langage inintelligible pour la population qu'ils avaient assujetie.
Les druides, dont le pouvoir n'était guère moins absolu que celui des prêtres d'Égypte, employaient aussi, suivant le témoignage de César, une langue que le peuple ne pouvait pas comprendre.
70 Voyez le tome I, liv. II, ch.II.
71 La même opposition de principes se trouve quelquefois dans les gouvernemens: ceux qui ont pour principe la force ou le despotisme, prétendent qu'il leur est permis de se livrer, envers les hommes et leurs propriétés, à toutes les actions qu'ils ne se sont pas positivement interdites; ceux, au contraire, qui ont pour principe la morale et la liberté, reconnaissent qu'ils ne peuvent exercer, sur les hommes ou sur leurs biens, que les actions que des lois spéciales leur ont positivement permises.
72 Les banques d'épargnes, si utiles aux familles des classes ouvrières, seraient indispensables à des esclaves auxquels il serait permis de se racheter. Il faudrait même qu'elles présentassent des garanties tellement fortes qu'elles fussent capables de vaincre la méfiance naturelle à des esclaves.
73 T. Clarkson's Thoughts on the necessity of improving the condition of the slaves, p. 15, 16, 17.
74 Il n'y a que cet ordre déraisonnable, on ne saurait trop le répéter. Ce n'est que par le libre concours de tous les citoyens à tous les genres de services que les hommes parviennent à se classer, ainsi que le demandent la justice et l'utilité commune. Il ne peut y avoir de rangs déterminés d'avance qu'entre les diverses classes d'individus qui doivent concourir à une entreprise quelconque, partout où il faut qu'il existe une certaine subordination pour que le service se fasse, dans une manufacture, dans une administration, dans une armée. Mais établir des rangs entre les membres de la société en général est une chose absolument impossible. Rien, de moins stable que la grandeur, le talent, la moralité, la richesse et toutes les qualités qui pourraient motiver d'abord un pareil arrangement. Ces qualités se déplacent sans cesse; et vouloir assigner d'avance et à perpétuité un certain rang à de certaines familles, ce serait prendre une décision dont les motifs pourraient cesser presque aussitôt que la décision aurait été prise.
75 J'espère que ceci ne donnera lieu à aucune équivoque. On voit assez ce que je blâme. Ce que je blâme, ce n'est pas l'activité politique, comme quelques personnes ont paru le croire; ce n'est pas la disposition à surveiller la gestion des intérêts généraux de la société; ce n'est pas même le désir de devenir l'homme d'affaires de la société; pourvu que ce soit de son consentement et à des conditions librement débattues avec elle ou avec ses délégués loyalement élus: le vice politique que je signale, c'est la disposition à vivre des ressources du public, à accepter des places sans être sûr qu'elles lui sont utiles, et des honoraires sans trop examiner si, dans un marché libre et éclairé, il consentirait à donner des services qu'on prétend lui rendre le prix que l'on consent à en recevoir.
76 Mémoires inédits.
77 C'est ce qu'ont fait toutes nos constitutions, depuis celle de 1791, jusqu'à la charte de 1814 et à l'acte additionnel de 1815. Il n'est pas un de ces pactes sociaux dans lequel n'ait été expressément stipulée l'égale admissibilité de tous les citoyens à toutes les fonctions publiques; tandis qu'il n'en est pas un, si j'ai bonne mémoire, où l'on ait consacré le libre exercice des professions privées: preuve malheureusement trop claire que, jusqu'à ces derniers temps, on à plus tenu à la faculté de parvenir aux places qu'à celle de n'être pas gêné dans son travail.
78 Je ne voudrais pourtant pas dire que la révolution fut entreprise dans des vues d'ambition. Je crois que ce qu'on voulait avant toute chose, c'était la réforme des abus; mais je crois aussi qu'à cette haine généreuse contre les abus se joignait, dans l'esprit public, une propension très-ancienne et très-forte à parvenir aux places; penchant que la destruction de beaucoup d'industries privées, la défaite et l'émigration des classes anciennement gouvernantes, la nécessité de reformer un gouvernement, celle de défendre la révolution, et d'autres circonstances encore, excitèrent bientôt au plus haut degré.
79 M. Alex, de Laborde, De l'Esprit d'association, p. 43, prem. édit.
80 Voir, dans le Moniteur du mois de juin 1819, séances de la Chambre des députés, les discours de MM. Decazes et de Saint-Aulaire, dans la partie de la discussion du budget relative aux traitemens des préfets. — L'égalité politique multiplie sans doute le nombre des citoyens actifs; mais de ce qu'il y a plus de citoyens, il ne s'ensuit pas que le gouvernement doive coûter davantage.
81 M. Guizot, Des moyens de gouvernement et d'opposition.
82 C'est ainsi, par exemple, qu'après avoir détruit les corps enseignans et les collèges particuliers, on a créé des écoles publiques avec une direction centrale à Paris, et que les hommes livrés à l'enseignement, d'hommes privés qu'ils étaient, sont devenus des fonctionnaires. Il serait aisé de citer d'autres exemples, et de montrer comment, par l'effet de la passion dominante, une multitude d'états particuliers ont été transformés en offices publics.
83 Un publiciste allemand, Frédéric Gentz, a entrepris d'expliquer et de justifier les rapides progrès que font les dépenses de gouvernement dans, toutes les contrées de l'Europe, et surtout dans les contrées riches. «Cet accroissement, dit-il, tient au progrès même de la richesse, qui, en même temps qu'elle crée une multitude de. nouveaux besoins, fait hausser le prix de toutes les marchandises. Chaque homme veut dépenser davantage, et, avec la même quantité d'argent, à peine peut-il avoir la moitié de ce, qu'il obtenait il y a cinquante ans. Le gouvernement, comme personne collective, se trouve dans la même position que les individus. A. l'exemple de tout ce qui l'environne, il faut qu'il étende la sphère de ses dépenses, et d'année en année, il est obligé de payer plus cher tous les objets de son immense consommation. » ( Essai sur l'administration des finances et de la richesse de la Grande-Bretagne, p. 12 à 22. )
Ces remarques, toutes spécieuses qu'elles sont, ne justifient point l'extrême accroissement des dépenses publiques. S'il y a des raisons pour qu'elles augmentent, des raisons bien meilleures devraient les faire diminuer. Il n'est point exact de dire d'abord que tout augmente de valeur. Le progrès des arts a fait baisser au contraire le prix de bien des choses. Ensuite, on ne peut nier que le gouvernement, qui est aussi un art, ne fût, comme tous les autres, si on le voulait, susceptible de se simplifier, et par cela même de devenir moins cher. Toute manière de faire la police et d'administrer la justice n'est pas également bonne. A cet égard, comme à tout autre, les méthodes seraient certainement très-susceptibles d'amélioration. Joignez que les besoins publics dont je viens de parler, les besoins de police et de justice, deviennent, à mesure que nous nous civilisons, plus faciles à satisfaire: il faut sûrement moins de peine et de dépense pour maintenir l'ordre au sein d'un peuple laborieux et cultivé qu'au milieu d'une troupe de barbares. Enfin il est une multitude de choses, cela devient chaque jour plus patent, que l'autorité pourrait, avec grand profit pour le public, abandonner aux efforts de l'activité particulière.
Ainsi, en admettant que les services politiques, comme tous les autres, doivent être mieux rétribués aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a cinquante ans, il y aurait encore de bonnes et nombreuses raisons pour que les dépenses publiques dussent baisser; et si, tout au contraire, elles s'élèvent, cela tient, comme je le dis, au penchant dépravé qui pousse les populations à prendre part aux exactions exercées sur elles, à la sottise qui leur fait souffrir ces exactions alors même qu'elles n'y peuvent point participer, et à la disposition toute naturelle de vieux gouvernemens corrompus à profiter de nos erreurs et de nos vices pour maintenir et accroître de vieux abus.
84 Au mois d'avril 1814, la dette publique était, en compte rond, de 61 millions; maintenant elle est de 207. Elle s'est donc accrue de 146 millions qui, au taux où est aujourd'hui la rente, font une dette capitale de près de 3 milliards et demi, dont la France a été grevée depuis quinze ans. Il est juste d'observer que cet accroissement provient presque tout du fait des administrations précédentes.
85 On a d'étranges preuves de cette aversion que des hommes accoutumés à ne pas s'inquiéter du soin de leur subsistance, ont pour tout changement d'état qui mettrait ce soin à leur charge. A ce prix, des esclaves eux-mêmes n'accepteraient pas toujours la liberté. De 1807 à 1811, on a voulu affranchir en Prusse tout ce qu'il y avait de paysans qui étaient restés serfs; et, chose singulière! cet acte de justice et d'humanité a été froidement accueilli de la classe d'hommes qu'il intéressait le plus. Beaucoup de paysans ont mieux aimé demeurer serfs que de perdre ce qu'ils appelaient l'appui de leur seigneur, et de sortir d'une position où leur existence était sûrement très-misérable, mais où elle était pourtant assurée. ( Voy. le Globe du 27 février 1817.)
86 Non-seulement, par l'effet de ce penchant, on a créé chez nous le plus d'administrations qu'on a pu, mais l'on s'est arrangé pour que, dans chaque administration, il y eût le plus d'emplois possible. L'égalité voulant que tout le monde participât aux bénéfices du pouvoir, on a pensé qu'il fallait moins rétribuer les fonctionnaires et créer un plus grand nombre de fonctions. C'est ainsi qu'on a porté le nombre des juges à cinq ou six mille, et borné à 60 louis le traitement de la plupart de ces officiers publics. Il n'est pas une branche du service public, en France, qui ne rende témoignage de ces efforts pour multiplier les places. Cela s'aperçoit surtout dans l'armée: « Je demande, observait M. Casimir Perrier ( Chambre des députés, séance du a juin 1826 ), quelle est notre situation militaire: elle est, dit-on, de deux cent trente et un mille cinq cent soixante hommes, y compris les enfans de troupes, musiciens, tambours, etc., pour lesquels nous dépensons 190,308,027 fr. Sur ce nombre d'hommes, il y a dix-sept mille huit cent sept officiers et cinquante et un mille quarante-cinq sons-officiers, total soixante-huit mille huit cent cinquante-deux. Il nous reste cent cinquante-neuf mille six cent cinquante-sept soldats, ce qui fait à peu près un officier ou sous-officier pour deux hommes. »
87 Les taxes, observe un écrivain anglais, font beaucoup moins de bien à l'aristocratie qu'elles sont destinées à enrichir, qu'elles ne font de mal à ceux qui les paient. L'aristocratie ne reçoit pas la cinquième partie des dépenses extravagantes que nous faisons pour nos flottes, nos armées, nos colonies. Un régiment de cavalerie, par exemple, ne lui est avantageux que pour son état-major; mais indépendamment des frais de cet état-major, et pour qu'il existe, il faut aussi que nous supportions la dépense des chevaux et des simples soldats, qui est bien plus considérable. Les vaisseaux de guerre ne sont bons pour l'aristocratie qu'à cause des places d'amiraux, de vice-amiraux, de capitaines, etc.; mais les frais de construction et d'entretien de chaque vaisseau sont énormes pour le peuple. Il en est de même des colonies, qui ne profitent aux privilégiés qu'à cause des places de gouverneurs et des autres emplois administratifs ou militaires des établissemens coloniaux.
Au fond le moyen le plus économique d'entretenir l'aristocratie serait de lui faire des pensions, etc....» (Rev. Britan., t. 10, p. 197 et suiv. )
88 Je dois observer que ceci a été écrit sous le ministère de M. de Villèle. Je laisse au lecteur le soin de juger jusqu'à quel point ces remarques, sous l'administration présente, peuvent paraître encore fondées. On assurait, sous le précédent ministère, que la grande propriété était intéressée pour 300 millions dans la levée des contributions publiques, et qu'elle tirait 60 fr. du trésor pour chaque écu qu'elle y versait (Labbey de Pompières, Chambre des députés, séance du 13 juillet 1821 ). J'ignore jusqu'à quel point ces proportions ont varié depuis.
89 Je répète ce qui a été écrit sous un autre ministère.
90 En 1791 le budget des dépenses n'excédait guère 500 millions; le nombre des emplois et des employés était infiniment moins considérable; il nous restait quelques libertés municipales que nous avons perdues; nombre d'industries et de professions privées étaient moins qu'aujourd'hui dans la dépendance de l'autorité publique.
91 Par un rapprochement singulier, dont je m'honore, ces deux condamnations me réunirent en prison à M. Cauchois-Lemaire, ex-proscrit, écrivain encore plus intempestif que moi, c'est-à-dire plus courageux et par conséquent aussi plus abandonné des uns et plus maltraité des autres.
92 J'ai cependant reçu un service pécuniaire à cette époque. Lorsque j'étais à la Force, en 1829, une souscription fut ouverte pour payer mon amende et les frais de justice. Malgré tous les efforts de mes jeunes amis de la société Aide-toi, le Ciel t'aidera, la souscription ne fut pas remplie entièrement, grâce aux mêmes personnes qui avaient empêché la réélection de Manuel en 1824. Je n'ai point su quelle somme il manquait; mais je n'ai pu ignorer que l'un de nos plus recommandables citoyens, M. Bérard, chez qui la souscription était ouverte, m'acquitta envers le fisc. Ce service, au reste, doit me sembler de peu d'importance, comparé à ceux de tout genre que m'a rendus l'amitié de M. Bérard.
93 Quand Bonaparte s'empara du pouvoir, il inséra dans sa constitution une disposition qui défendait de traduire en justice un agent du gouvernement, à moins que la poursuite n'eût été autorisée par le Conseil-d'État. Cette disposition, que la restauration conserva, et qui n'a pas encore été abrogée, suffirait pour rendre illusoires toutes les garanties.
94 Dire: c'est un homme à la mode du jour.
95 Dogged.
96 Il faut laisser le demi-jour. La peine de comprendre ôtera l'indécence pour les sots. Autrement, je dirais: Après avoir fait comprendre en des termes si honnêtes que si elle voulait courir la chance de voir son mari ministre, il fallait commencer par faire le bonheur de Lucien, M. Leuwen n'y put tenir: il s'enfuit.
97 Elle se dit de Lucien: C'est un être bon,fort amoureux, mais qui a peur de moi.
98 Elle se glorifie de ce qui fait la pauvreté de son âme.
99 C'est le second soir.
100 Donner quelque chose d'humain, quelques détails vrais (et les placer près du commencement) aux personnages odieux, comme le comte de Vaize et Mme Grandet autrement, j'en ferai, ils seront, sans que je m'en doute, de simples mannequins à abominations ministérielles, comme les personnages de M. le Préfet de M. Lamothe-Langon.
101 Humour. Définition de l'humour qui me vient [1835] le sérieux qui donne du plaisir à qui s'en sert.
102 En note Stendhal indique que ce portrait devra être reporté dans la première partie: Nancy, à la scène du bal ou le lecteur doit voir Mme Grandet pour la première fois. On sait que cette présentation n'a pas eu lieu. N.D.L.E
103 Pour le comique, examiner si Mme Grandet doit croire si fermement que Lucien l'aime.
104 1. [Scène à faire. — Position des deux interlocuteurs M. Leuwen promet un ministère et veut que Mme Grandet se donne à Lucien avant que l'Ordonnance ne soit dans le Moniteur. Mme Grandet, avec toute l'honnêteté de paroles possible (là est la source de comique), dit: « Je me donnerai bien, la difficulté n'est pas là mais me donnerez-vous un ministère ? Mais ferez-vous mon mari ministre ? Une fois que je me serai attachée à M. votre fils, le ministère peut tarder.»
La forme est tout, et je ne veux pas me donner la peine de faire le dialogue avant d'être sur que j'emploierai cette scène.
Le fond raisonnable est que M. Leuwen lui dit « Prenez des informations. Demandez si je puis, oui ou non, disposer probablement d'un ministère. J'avoue qu'il n'y a de sûr que ce qui est dans le Moniteur: or, cette certitude, je ne puis pas vous l'offrir. D'ailleurs, la difficulté serait la même une fois le nom de M. Grandet dans le Moniteur, seulement elle changerait de côté, vos paroles d'à présent, ce serait alors à moi à les prononcer. Vous pourriez peut-être oublier votre pitié pour les souffrances de mon fils. »
On s'ajourne. Mme Grandet prend des informations il en résulte que dans le cas de dislocation du ministère actuel M. Leuwen a les plus grandes chances d'être ministre de l'Intérieur ou de faire nommer qui il voudra à cette place, car sans lui dans les premiers moments le ministère n'aurait pas la majorité à la Chambre. Il est bien possible qu'après deux mois le roi se moque de M. Leuwen et le force, par des dégoûts, à demander sa démission.
Elle s'assure que M. Leuwen est de bonne foi avec elle. (Mais comment ?)
Enfin, elle consent à prendre Lucien pour amant.
Scènes de Mme Grandet avec Lucien pendant les cinq jours que dure la négociation que nous venons d'indiquer. Comique]
105 M. Leuwen doit-il prendre la petite rouerle de détail d'employer exprès des mots choquants pour la délicatesse de Mme Grandet? Je penche pour oui.
106 Ennoblir tout ceci ou le parterre siffle; c'est le joint de la cuirasse. Civita-Vecchia, 31 janvier [1835]. - Ne pas trop ennoblir; c'est assez bien ainsi. 11 février.
107 [« MmeGrandet est l'amie de mon fils depuis deux mois avant que le ministère ne menaçât ruine. »]
108 Ils n'écrivent dans les journaux que dans les cas rares où ils veulent s'adresser au peuple et parler en leur propre nom: lorsque, par exemple, ou a répandu sur leur compte des imputations calomnieuses, et qu'ils désirent rétablir la vérité des faits.
109 Note A. C'est en avril 1704 que parut le premier journal Américain. Il fut publié à Boston. Voy. Collection de la société historique de Massachusetts , vol. 6, pag. 66.
On aurait tort de croire que la presse périodique ait toujours été entièrement libre en Amérique; on a tenté d'y établir quelque chose d'analogue à la censure préalable et au cautionnement.
Voici ce qu'on trouve dans les documens législatifs du Massachusetts, à la date du 14 janvier 1722.
Le comité nommé par l'assemblée générale (le corps législatif de la province), pour examiner l'affaire relative au journal intitulé New England courant ( lequel était rédigé par le célèbre Francklin, « pense que la tendance dudit journal est de tourner la religion en dérision, et de la faire tomber dans le mépris; que les saints auteurs y sont traités d'une manière profane et irrévérencieuse; que la conduite des ministres de l'Évangile y est interprétée avec malice; que le gouvernement de Sa Majesté y est insulté, et que la paix et la tranquillité de cette province sont troublées par ledit journal; en conséquence, le comité est d'avis qu'on défende à James Francklin, l'imprimeur et l'éditeur, de ne plus imprimer et publier à l'avenir ledit journal ou tout autre écrit, avant de les avoir soumis au secrétaire de la province. Les juges de paix du canton de Suffolck seront chargés d'obtenir du sieur Francklin un cautionnement qui répondra de sa bonne conduite pendant l'année qui va s'écouler. »
La proposition du comité fut acceptée et devint loi, mais l'effet en fut nul. Le journal éluda la défense en mettant le nom de Benjamin Francklin au lieu de James Francklin au bas de ses colonnes, et l'opinion acheva de faire justice de la mesure.
110 Encore je ne sais si cette conviction réfléchie et maîtresse d'elle élève jamais l'homme au degré d'ardeur et de dévouement qu'inspirent les croyances dogmatiques.
111 Dans la pratique, ce n'est pas toujours le gouverneur qui exécute les entreprises que la législature a conçues; il arrive souvent que cette dernière, en même temps qu'elle vote un principe, nomme des agents spéciaux pour en surveiller l'exécution.
112 Dans plusieurs États, les juges de paix ne sont pas nommés par le gouverneur.
113 L'autorité qui représente l'État, lors même qu'elle n'administre pas elle-même, ne doit pas, je pense, se dessaisir du droit d'inspecter l'administration locale. Je suppose par exemple, qu'un agent du gouvernement, placé à poste fixe dans chaque comté, pût déférer au pouvoir judiciaire des délits qui se commettent dans les communes et dans le comté; l'ordre n'en serait-il pas plus uniformément suivi sans que l'indépendance des localités fut compromise? Or, rien de semblable n'existe en Amérique. Au-dessus des cours des comtés, il n'y a rien et ces cours ne sont, en quelque sorte, saisies que par hasard de la connaissance des délits administratifs qu'elles doivent réprimer.
114 La Chine me paraît offrir le plus parfait emblème de l'espèce de bien-être social que peut fournir une administration très centralisée aux peuples qui s'y soumettent. Les voyageurs nous disent que les Chinois ont de la tranquillité sans bonheur, de l'industrie sans progrès, de la stabilité sans force, et de l'ordre matériel sans moralité publique. Chez eux, la société marche toujours assez bien, jamais très bien. J'imagine que quand la Chine sera ouverte aux Européens ceux-ci y trouveront le plus beau modèle de centralisation administrative qui existe dans l'univers.
115 Un écrivain de talent qui, dans une comparaison entre les finances des Etats-Unis et celles de la France, a prouvé que l'esprit ne pouvait pas toujours suppléer à la connaissance des faits, reproche avec raison aux Américains l'espèce de confusion qui règne dans leurs budgets communaux, et après avoir donné le modèle d'un budget départemental de France, il ajoute: « Grâce à la centralisation, création admirable d'un grand homme, les budgets municipaux, d'un bout du royaume à l'autre, ceux des grandes villes comme ceux des plus humbles communes, ne présentent pas moins d'ordre et de méthode. » Voilà certes un résultat que j'admire; mais je vois la plupart de ces communes françaises, dont la comptabilité est si parfaite, plongées dans une profonde ignorance de leurs vrais intérêts, et livrées à une apathie si invincible, que la société semble plutôt y végéter qu'y vivre; d'un autre côte, j'aperçois dans ces mêmes communes américaines, dont les budgets ne sont pas dressés sur des plans méthodiques, ni surtout uniformes, une population éclairée, active, entreprenante; j'y contemple la société toujours en travail. Ce spectacle m'étonne; car à mes yeux le but principal d'un bon gouvernement est de produire le bien-être des peuples et non d'établir un certain ordre au sein de leur misère. Je me demande donc s'il ne serait pas possible d'attribuer à la même cause la prospérité de la commune américaine et le désordre apparent de ses finances, la détresse de la commune de France et le perfectionnement de son budget. En tous cas, je me défie d'un bien que je trouve mêlé à tant de maux, et je me console aisément d'un mal qui est compensé par tant de bien.
116 See Note I below.
117 See Note K below.
118 Voyez Mémoires pour servir l'histoire du droit public de la France en matière d'impôts, p. 654 imprimés à Bruxelles, en 1779.
119 Voyez à la fin du volume la note sur la condition sociale et politique des nègres esclaves et des gens de couleur affranchis.
120 Note for page 65. « Il meurt moitié plus d'affranchis que d'esclaves. » Ce fait est constant. Ainsi, durant les années 1828, 1829 et 1830, il est mort à Baltimore un nègre libre sur vingt-huit nègres libres, et un esclave sur quarante-cinq nègres esclaves. [2] [2] V. Emerson, Medical statistic, p. 28, Reports of the health office of Baltimore.
121 Voyez à la fin du volume la note sur la condition sociale et politique des nègres esclaves et des gens de couleur affranchis.
122 Note to Page 76. — « Mœurs des femmes en France.... » C'est une opinion fort répandue aux États-Unis que les mœurs sont encore, en France, ce qu'elles étaient dans le xviie siècle: un grand nombre croient que le vice y est toujours à la mode, et que le temps s'y passe en galanteries, en intrigues de salons et en frivolités. Cette opinion des Américains est due surtout à l'influence de quelques romanciers anglais fort lus aux États-Unis, et qui, ne connaissant eux-mêmes la France que par les livres, sont en retard d'un demi-siècle. C'est ainsi qu'un écrivain anglais très-distingué, l'auteur de Pelham, mettant en scène deux Français de nos jours, les fait par1er comme avant la révolution; ils ne se disent pas un mot sans s'appeler: « Cher baron, cher marquis. »
123 V. Brevard's Digest of South Carolina, v° Slaves, p. 258.
124 V. Digeste des lois de la Louisiane, 1828, v° Code noir, § 38.
125 V. Statute Laws of Tennessee, 1851, v° Slaves, p. 316 et 318 Lois de 1788 et de 1819.
126 And wheras the having of slaves taught to wrile, or suffering them to be employed in writing, may be attended with great inconveniencies; be it inacted, that all and every person and persons whatsoever, who shall hereafter teach or cause any slave or slaves to be taught to write, every such person shall, for every offense, forfeit the sum of one hundred pounds current money. (V. Brevard's Digest, t. II, v° Slaves, § 53.)
And if any person shall, on a sudden heat and passion, or by undue correction kill his own slave or the slave of any other person, he shall forfeit the sum of three hundred and fifty pounds current money. And in case any person or persons shall wilfully cut out the tongue, put out the eye, castrate, or cruelly scald, burn or deprive any slave of any limb or member, or shall inflict any other cruel punishment, other than by whipping, or beating with a horse-whip, cowskin, switch, or small stick, or by puting irons on, or confining or imprisoning such slave; every such person shall for every such offence forfeit the sum of one hundred pounds current money. ( V. ibid., § 45. )
127 V. Brevard's Digest, t. II, v° Slaves, § 12, p 231.
128 V. Digeste des lois de la Louisiane, Code noir, t. 1, § 35.
129 V. Lois du Tennessee, 1831, t. 1, p. 321.
130 For any reason whatsoever and by such ways and means as he or she shall think fit. (V. Lois du Tennessee, 1831, t. I, p. 321. )
131 V. Lois de la Louisiane, Code noir, art. 27 et 36, t. I, p. 229. — Lois du Tennessee, t. 1, p. 321, § 28. — Lois de la Caroline du Sud, Brevard's Digest, t. II, p. 232, § 46.
132 Lois de la Caroline du Sud, ibid.,p. 236, § 31.
133 V. Brevard's Digcst, § 59, 60, 61 et 62, t. II, p. 245. Dans la Louisiane et dans le Tennessee, lorsqu'un esclave fugitif est arrêté, si son maître ne le réclame pas dans un délai fixé, on le met en vente sur la place publique; ou l'adjuge au plus offrant et dernier enchérisseur. Le prix de la vente sert à payer les frais de geôle et de justice. (Lois de la Louisiane, Code noir, § 29; et lois du Tennessee, t. I, p. 323. )
134 No person held to service or labour in one state under the laws thereof, escaping into another, shall in consequence of any law or regulation therein, be discharged from such service or labour may be due. (V. Constitution des États-Unis, art. 4, sect. 2, § 3. — V. aussi les statuts révisés de l'État de New-York, t. Il, chap. 9, titre 1er, § 6. — Pensylvania, Purdon's Digest. )
135 V. Lois de la Caroline du Sud, Brevard's Digest, § 43 et 45, t.II, v° Slaves, p. 240.
136 V. ibid., § 45.
137 V. Digest des lois de la Louisiane, loi du 21 février 1814, t. 1, p. 244.
138 Environ 50 fr.
139 Brevard's Digest, v° Slaves, §13 et 28, p. 231 et 235. V. aussi lois de la Louisiane, v° Code noir, § 15.
140 V. 28, ibid.
141 V. Statute laws of Tennessee, v° Slaves, t. 1, p. 315, loi de 1806.
142 V. Digeste des lois de ta Louisiane, v° Code noir, t. 1, p. 248, et aussi Lois de la Caroline, Brevard's Digest, v° Slaves, t. II, § 23.
143 V. Digeste des lois du 1a Louisiane, loi du 10 mars 1816, § 6, t. I, p. 246.
144 V. Statute laws of Tennessee, t. I, v° Slaves, p. 315.
145 V. Brevard's Digest, v° Slaves. Lois de la Louisiane, v° Code noir. Lois du Tennessee, v° Slaves.
146 V. Lois du Tennessee, t. I, v° Slaves, p. 346. — Brevard's Digest, v° Slaves. — Louisiane, Code noir.
147 Digeste de la Louisiane, acte du 19 mars 1806, sect. 3, t. I, p. 246. — Dans toute contestation entre un maître qui prétend droit sur un nègre et celui-ci qui se prétend libre, la présomption est contre le nègre, sauf à lui à prouver qu'il n'est pas esclave. — V. Caroline du Sud. Brevard's Digest, v° Slaves, § 7, p. 230, t. II.
148 V. Statute laws of Tennessee, v° Slaves, t. 1, p 383.
149 V. Lois de la Caroline du Sud, v° Slaves, t. II, § 28 et 34. —Voici l'expression générale de ces lois: « Shall suffer such corporal punishment not extending to life or limb as the justices of the peace or the free-holders shall, in their discretion, think fit. » V. aussi Digeste de la Louisiane, loi de 1807, t.1, p. 238.
150 V. Lois de la Caroline, Brevard's Digest, v° Slaves, § 45. — Et Digeste de la Louisiane, v° Code noir, § crimes et délits, sect. 16, t.1.
151 V. Lois de la Caroline du Sud, Brevard's Digest, v° Slaves, § 100.
152 V. Notes sur la Virginie, Thomas Jefferson.
153 V. Brevard's Digest, t, II, p. 233, § 20.
154 Lois de a Caroline, Brevard's Digest, v° Slaves, § 46, t. II, p. 244. - Lois de la Louisiane, Code noir, art. 1er, sect. 3, t. I, p 220 — Lois du Tennessee, t. I, v° Slaves, p. 321.
155 V. Table statistique à la suite de la note.
156 Lois de la Caroline du Sud, Brevard's Digest, t. II, v° Slaves, § 3, p.229.
157 Il n'existe dans le Maryland qu'une seule branche de culture pour laquelle on peut encore sans préjudice employer des esclaves, c'est celle du tabac. Celte culture, qui exige une infinité de soins minutieux, réclame un nombre immense de bras: des femmes, des enfants suffisent pour cet objet: le point important, c'est d'en avoir un grand nombre, et les familles de nègres, en général si nombreuses, remplissent celle condition. Du reste, les nègres sont encore utiles pour celle culture, mais non indispensables; la culture du tabac serait également bien faite par les blancs. On peut dire seulement que, faite par des esclaves, elle procure encore un bénéfice, tandis qu'elle a cessé d'être profitable appliquée aux autres industries agricoles.
158 J'ai vu M. Charles Caroll à la fin de 1831, et l'année suivante il n'était plus. Il est mort le 10 novembre 1832, âgé de quatre-vingt-seize ans.
159 V. National Calendar, 1833, v° Public revenues and expenditures.
160 200,900,000 dollars ou 1,064,770,000 fr.
161 Je dis 200,000 au moins, car on peut voir à la table statistique que la population esclave dans toute l'Union s'accroît de 30 p. 100 tous les dix ans. Or, il s'est écoulé déjà quatre années depuis le recensement qui a constaté le nombre de 2,009,000 esclaves.
162 Notes sur la Virginie, p. 119.
163 Voyez, sur l'origine et les progrès de celte colonie, les rapports annuels de la société de colonisation.
164 V. Constitution des États-Unis. Les pouvoirs du congres sont limités aux cas énoncés dans la constitution. Parmi ces cas énumérés dans la section 8, ne se trouve point le droit d'abolir l'esclavage dans les États où il est établi; plusieurs articles de la constitution reconnaisses même formellement la servitude, entre autres le § 3 de la section 2, art. 4. Enfin, l'art. 10 du supplément à la constitution dit que tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément attribués au gouvernement général des Étals-Unis sont réservés aux États particuliers.
165 V. à la fin de la note la table statistique.
166 Table statistique à la fin de l'Appendice.
167 A la vérité, les États du Sud, tels que la Louisiane, la Caroline du Sud, le Mississipi, où se fait remarquer le plus grand accroissement des noirs, achètent des esclaves dans les États voisins, Tennessee, Kenlucky, Virginie, Maryland. C'est une cause d'augmentation indépendante de la multiplication résultant des naissances. Mais ce qui prouve que cette source d'accroissement n'est point la seule, c'est que, dans les États voisins, le nombre des esclaves augmente aussi; et ceux même où il diminue, tels que la Virginie, le Maryland, etc., ne le voient point décroître dans la proportion où il augmente ailleurs. V. Table statistique.
168 V. Digeste des luis de la Louisiane, t. I, p. 231.
169 V. Statute laws of Tennessee, t. 1, p. 220.
170 V. General laws of Massachusetts, t. I, p. 259.
171 G. Lewis, Irish Disturbances, p. 444.
172 En 1773.
173 John Keogh, fils d'un marchand.
174 En 1825.
175 Lingard History of England, t. VI, chap. v en 1525.
176 M. Léon Faucher a, en 1836, publié une petite brochure intitulée: État et Tendance de la Propriété en France, où sont très-bien signalées les causes du fractionnement progressif du sol et la limite où ce morcellement doit s'arrêter, sous peine de devenir funeste. Celte brochure présente sur ce sujet beaucoup de considérations neuves et de faits importants.
177 Entr'autres le célèbre Von Raumer, professeur d'histoire à l'Université de Berlin, dans son ouvrage intitulé L'Angleterre en 1835. Il dit en propres termes qu'il faut abolir tous les baux à ferme existant en Irlande, et métamorphoser les fermiers en propriétaires. V. Lettre LII. Son livre a été traduit en français. M. de Sismondi exprime une opinion analogue dans son remarquable ouvrage intitulé Études sur l'Economie politique, t. I, p. 331 et suiv. Il voudrait que le droit des propriétaires irlandais fût converti en un droit à une rente perpétuelle; et il établit, en principe, que le droit du législateur, à régler les conditions du contrat de culture et à apporter pour cela des limites au droit de propriété, ne saurait être révoqué en doute.
178 Dans notre ouvrage sur les colonies anglaises, on verra que les nègres anglais n'étaient pas plus instruits que les nôtres, et que les planteurs anglais disaient d'eux identiquement ce que les planteurs français disent encore des leurs.
179 Rapport de M. Chazelles.
180 M. Virey, Diction. des sciences médicales, article HOMME.
181 Voici comment l'un des accusés, raconte l'arrestation de ses nègres accusés avec lui: « Ils furent garottés avec une telle force, que les cordes leur coupèrent la peau. On les conduisit à la geôle ou leur innocence ne fut pas si longue à établir que celle de leur maître. Après neuf jours employés à les interroger, on les rendit à la liberté; mais dans quel état!... Presque tous malades, furent conduits à mon hôpital; les soins les plus assidus bornèrent la mortalité à quatre. Ils succombèrent à la maladie qu'ils avaient gagnée dans le cloaque ou on avait amassé cent créatures humaines. » (La vérité sur les événemens, etc.)
182 Le blanc qui comparut dans cette affaire (l'autre s'était sauvé) fut acquitté. Encore de la justice coloniale! On pend les soldats, on absous le chef! Ou le chef était coupable, ou les soldats ne l'étaient pas.
183 « Nous ne comprenons pas la peur que l'on veut bien éprouver pour nous. Que l'on nous donne deux mille hommes de troupes avec une bonne gendarmerie, que l'on n'attaque pas le respect de notre puissance morale, et je maintiens que nous n'avons rien à craindre. » (M. Guignod.)
184 Dix nègres furent pendus à la Martinique le 4 décembre 1813, par suite d'un arrét du conseil supérieur, en date du 30 novembre.
185 Lettres sur l'esclavage.
186 Considérations sur le système colonial.
187 Ruche Populaire, journal des ouvriers.
188 Séance du 6 février 1839.
189 Séance du 21 novembre 1838.
190 Rapport de M. Chazelles, 1841.
191 Séance du 31 octobre 1838.
192 Encyclopédie, article Traite des nègres.
193 Ou a vu longuement exposés dans notre introduction les motifs qu'il y a de croire à la possibilité d'établir, sans aucun danger pour eux, des cultivateurs blancs sur les terres coloniales. En tout état de cause, nous sommes fermement persuadé qu'une émigration bien réglée d'Europe aux îles serait aussi utile pour l'Europe et les iles que pour les émigrans.
194 V. dans le Dictionnaire de police de De la Marre, et dans le Recueil général des anciennes lois françaises, tout ce qui est relatif à l'ancienne législation somptuaire et au règlement des mœurs.
195 V. ce qui a été dit à ce sujet, t. I, p. 329 et suiv.
196 V., à ce sujet, dans les Mémoires de l'Acad. des sciences morales et politiques, t. II, p. 261, un excellent travail de M. Rossi. Si le code civil a pu fournir matière à de telles remarques, on sent combien les autres branches de notre législation, et en particulier notre législation administrative, seraient plus propres encore à provoquer de semblables réflexions.
197 En 87 ans, c'est-à-dire de 1754 à 1841. V. dans les Débats du 5 septembre 1841, la liste chronologique de ces vingt-quatre ministères.
198 Il faut, disait l'abbé Sieyès, que, dans la décadence même des mœurs politiques, lorsque l'égoisme parait gouverner toutes les âmes, il faut, dis-je, que, même dans ces longs intervalles, l'assemblée d'une nation soit tellement constituée, que les intérêts particuliers y restent isolés, et que le vœu de la pluralité y soit toujours conforme au bien général. CET EFFET EST ASSUR´E SI LA CONSTITUTION EST SUPPORTABLE. [Qu'est-ce que le Tiers-État? p. 208, Paris, 1822.)
199 L'année suivante, l'auteur commentait ainsi cette phrase:
« Est-il possible de penser de même sur la liberté commerciale et de différer en politique? »
Il nous suffirait de citer des noms d'hommes et de peuples pour prouver que cela est très-possible et très-fréquent.
Le problème politique, ce nous semble, est celui-ci:
« Quelles sont les formes du gouvernement qui garantissent le mieux et au moindre sacrifice possible à chaque citoyen sa sûreté, sa liberté et sa propriété? »
Certes, on peut ne pas être d'accord sur les formes gouvernementales qui constituent le mieux cette garantie, et être d'accord sur les choses mêmes qu'il s'agit de garantir.
Voilà pourquoi il y a des conservateurs et des hommes d'opposition parmi les libre échangistes. Mais, par cela seul qu'ils sont libre-échangistes, ils s'accordent en ceci: que la liberté d'échanger est une des choses qu'il s'agit de garantir.
Ils ne pensent pas que les gouvernements, n'importe leurs formes, aient mission d'arracher ce droit aux uns pour satisfaire la cupidité des autres, mais de le maintenir à tous.
Ils sont encore d'accord sur cet autre point qu'en ce moment l'obstacle à la liberté commerciale n'est pas dans les formes du gouvernement, mais dans l'opinion.
Voilà pourquoi l'Association du libre-échange n'agite pas les questions purement politiques, quoique aucun de ses membres n'entende aliéner à cet égard l'indépendance de ses opinions, de ses votes et de ses actes. »
Extrait du Libre-échange, du 14 novembre 1847. (Note de l'éditeur.)
200 La seconde série des Sophismes économiques, dont plusieurs chapitres avaient figuré dans le Journal des Économistes et le journal le Libre Echange, parut à la fin de janvier 1848.
201 Voy., tome I, la lettre adressée au président du Congres de la paix à Francfort. (Note de l'éditeur.)
202 Voy., au tome I, la lettre adressée a M. Larnac, et au tome V, les Incompatibilités parlementaires. (Note de l'éditeur.)
203 V. au présent tome, l'Etat, la Loi, et au tome VI, le chapitre xvii, Services privés et services publics. (Notye de l'éditeur.)
204 Pour la distinction entre les monopoles véritables et ce qu'on a nommé les monopoles naturels, voir, au chap. v du tome VI, la note qui accompagne l'exposé de la doctrine d'Adam Smith sur la valeur. (Note de l'éditeur.)
205 Cette cause de perturbation, l'auteur devait bientôt assister à son développement et la combattre avec énergie. V. ci-après l'Etat, puis, au tome II, Funestes illusions et, au tome VI, les dernières pages du chap. iv. (Note de t'éditeur.)
206 Richesse des nations, liv. II, chap. 2.
207 Ce nombre doit avoir augmenté depuis 1830, comme dans tout le reste de l'Union, où it avait été déjà plus que doublé en 1838.
208 Il ne faut pas croire pour cela que le capital de ces banques soit insignifiant. Il s'élevait en 1830, pour toutes les banques réunies de Rhode-lsland, à 6,118,000 dollars (33,000,000 francs), chiffre considérable eu égard à la population, et qui donne, en moyenne, pour chacun de ces établissements, situés pour la plupart dans de fort petites localités, un capital de 702,900 fr. Si l'on ajoute à cela qu'à cette époque, la banque centrale, dite des États-Unis, étendait encore ses-ramifications dans Rhode-Island comme dans toute la Nouvelle-Angleterre, on pourra se faire une idée de l'action que les banques y exerçaient. Par les chiffres qui précèdent, on pourra juger aussi de la richesse incomparable de ce petit pays.
209 [1] (1) Il faudrait faire quelques légères déductions pour compenser les pertes; mais, à moins d'un événement extraordinaire, ces pertes ne seront jamais considérables, car une banque privilégiée exige toujours deux garanties pour une.
210 C'est dans cette situation que le change avec l'étranger devient, comme l'on dit, défavorable; circonstance dont le parlement anglais s'est beaucoup préoccupé, sans la bien comprendre, lors de la présentation du bill de 1844 relatif à la limitation des émissions des banques, et dont sir Robert Peel a singulièrement abusé auprès de la partie ignorante de la chambre des communes. En fait, ce change défavorable est un symptôme de prospérité croissante; aussi ne se manifeste-t-il que dans les belles années. Il est très-vrai cependant qu'en raison du monopole de la banque, et du crédit tout artificiel que ce monopole engendre, ce symptôme de prospérité actuelle devient presque toujours le signe avant-coureur de quelque grand désastre.
211 Et non socialistes; bien que les socialistes soient bientôt parvenus à jeter la confusion dans les sens des deux mots. Social veut dire qui a trait à la société. Socialiste signifie qui a trait à la société, d'une certaine manière, de la manière de MM. Louis Blanc, Considérant, Cabet, Proudhon et quelques autres.
212 Je ne parle pas de quelques sociétés d'ouvriers travaillées par les écoles socialistes; je parle de la masse de la population de Paris. La vérité de mon assertion pour le reste de la France, Lyon et quelques grands centres exceptés, ne saurait être contestée.
213 Exposé des motifs de l'édit portant suppression des Jurandes, donné à Versailles en février 1770, enregistré le 12 mars, malgré le parlement, en lit de justice.
214 Ce qu'il y a de singulier, c'est que ce reproche perfide part souvent de l'école fouriériste, qui se plaint précisément que la morale actuelle comprime trop les passions, et qui prétend avoir les moyens de les laisser faire toutes avec profit pour l'individu et la société.
215 Je fais mes réserves pour un article sur les Malthusiens dans lequel M. Proudhon faisait vraiment de la polémique de broussailles.
216 Voir son discours, p. 113.
217 Voir son discours, p. 250.
218 Voir, aux Notes finales, une lettre de M. Proudbon sur l'excusabilité de l'insurrection de juin.
219 Voir, aux Notes finales, un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier contre des cultivateurs qui ont travaillé sur un champ qui ne leur appartenait pas.
220 Voir son opinion, p. 385.
221 L'an d'après, cette dépense était encore de plus de 100 millions de francs. Elle était, en 1845, la dernière année dont j'aie les chiffres sous les yeux, de 130 millions.
222 Voyez l'écrit remarquable de M. Cousin, Justice et Charité.
223 Voir un extrait de son pamphlet, p. 378.
224 De nos jours n'a-t-on pas mis au nombre des ressources: le défrichement des terres incultes, les assignais, l'organisation du travail, le crédit par l'État, etc.?
225 Droit au travail, réponse à M. Thiers.
226 Journal mensuel de l'école fouriériste, mai 1839.
227 Juillet 1848.
228 Voir quelques notes d'explication et d'histoire au sujet des principales formules socialistes, que j'ai insérées dans le J. des Économistes, t. xx, p. 375, juillet 1848.
229 Chose curieuse, M. Louis Blanc donne pour remède à la situation ce conseil: « Assurez du travail; » mais jamais la formule du Droit au travail ne se rencontre sous sa plume.
230 M. Cormenin réclame aussi sa part de paternité. Voy. son opinion, p. 378.
231 M. Considérant disait, le 6 juillet, dans la préface de la brochure citée plu3 haut: « Le droit au travail, admis à l'unanimité par la commission de Constitution, est fortement contesté dans les bureaux. »
232 Les Anglais pratiquent le droit à l'assistance depuis trois siècles. La taxe des pauvres si bien caractérisée par M. Mathieu (de la Drôme), socialiste fort peu logique, et par M. Louis Blanc qui l'appelle une colossale extravagance (Organisation du travail, p. 55, 4e édit., 1845) remonte à 1563 selon les uns, et même au xive siècle, au temps d'Edouard III, selon les autres.
En France nos deux premières Constitutions le proclament.
On lit dans la déclaration de la Constitution de 1791 ( 3-14 septembre ):
Il sera créé et organisé un établissement général de secours publics, pour élever les enfants abandonnés, soulager les pauvres infirmes, et fournir du travail aux pauvres valides qui n'auraient pas pu s'en procurer.
On lit dans la déclaration de la Constitution de 1793 (24 juin):
Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler.
La Constitution de 91 promettait en outre l'enseignement primaire gratuit, celle de 93 promettait de mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens.
On ne lit plus rien de semblable dans la déclaration de la Constitution de l'an III ( 5 fructidor. — 22 août 1795).
233 M. de Tocqueville (Manche), membre de l'Académie des sciences morales et politiques et de l'Académie française, auteur de plusieurs écrits, et entre autres d'un ouvrage intitulé: La Démocratie en Amérique, appartenait à l'ancienne gauche. A ces débuts parlementaires, M. de Tocqueville s'était joint à M. Janvier et à M. Sauzet, pour former, avec M. de Lamartine, le noyau d'un parti progressif que la presse désigna sous le nom du parti social. Cette association ne fut pas continuée. Depuis, M. de Tocqueville a maintes fois donné de lui l'idée d'une intelligence à la fois élevée et positive. Il a pris part aux discussions sur le système pénitentiaire. Il a fait, l'année dernière, un très-lumineux rapport sur l'Algérie. Son discours contre les socialistes est remarquable par la précision et la clarté. La fin seulement nous paraît mal définie et un peu nuageuse. M. de Tocqueville a 45 ans.
234 Les Saint-Simoniens.
235 Les Phalanstériens.
236 Les Communistes.
237 M. Proudhon. L'orateur interprète mal ici l'assertion de M. Proudhon. M. Proudhon a invoqué, dans son fameux discours du 31 juillet (à propos de sa banque d'échanges, contre la propriété et en réponse à M. Thiers), un principe économique incontestable, à savoir que la puissance de consommation dans la société, comme dans l'individu, est infinie, et que l'obstacle au développement du travail n'est pas dans la consommation. Il ne s'agit pas ici d'une jouissance à la Gargantua, et, d'autre part, cela n'a rien de commun avec la Révolution de Février.
238 Rousseau.
239 M. Proudhon.
240 Allusion aux universitaires
241 Allusion à l'essai communiste que font actuellement les partisans de M. Cabet dans le Texas. M. Cabet a démenti cette nouvelle.
242 Il y a des communistes avoués, et des communistes qui le sont sans le savoir.
243 Ces voix de la Gauche avaient un peu raison, si ce n'est pour le fonds, au moins pour la forme. Il est à regretter que M. de Tocqueville n'ait pas ajouté quelques mots de plus pour expliquer ce qu'il entend par la charité dans la politique, et qui doit être bien différent de la charité légale.
244 Représentant de la Marne. M. Léon Faucher avait été député, par l'opposition du collège de Reims, à la dernière Chambre. En très-peu de temps, il y avait pris rang parmi les notabilités, par ses discours sur les questions financières et économiques: il est aujourd'hui un des représentants qui traitent avec plus d'autorité ces matières à l'Assemblée nationale. Déjà il a prononcé de remarquables discours à propos du décret sur les heures de travail et sur le crédit foncier, et il a fait un excellent rapport sur divers projets d'assignats hypothécaires.
M. Léon Faucher est né à Limoges, le 8 septembre 1804. M. Léon Faucher, avant d'être député, avait établi sa réputation par des écrits nombreux et par sa collaboration assidue dans le Constitutionnel, le Temps, le Courrier Français qu'il a rédigés en chef, la Revue des deux Mondes, le Journal des Economistes. M. Léon Faucher a publié un volume sur la Réforme des prisons; un Mémoire sur l'or et l'argent; un volume, l'Union du Midi, sur un projet d'association de douanes entre la France, la Belgique, la Suisse et l'Espagne; deux volumes à'Etudes sur l'Angleterre (1845). M. Léon Faucher, travailleur infatigable, sait mener de front ses occupations de publiciste, de représentant et d'administrateur du chemin de fer de Strasbourg. Il a pris une part très-énergique aux travaux de l'association pour la liberté des échanges. Il fait partie de la Société d'économie politique.
245 Théorie du Droit de Propriété et du Droit au Travail, par V. Considérant, 3e édition.
246 Du Système de M. Louis Blanc, 1 volume in-18. Avril 1848.
247 Property Has its duties as well as its rights.
248 M. Louis Wolowski a été nommé représentant par les électeurs de la Seine, desquels il s'est surtout fait connaître par ses écrits dans le Siècle, et les leçons de législation industrielle qu'il professe au Conservatoire des arts et métiers depuis 1839. M. Wolowski a publié de nombreux écrits de législation et d'économie politique dans le Journal des Économistes et la Revue de Législation qu'il a fondée et qu'il dirige depuis 1834. Il a récemment publié un volume d'Études d'Économie politique et de Statistique. M. Wolowski a surtout attaché son nom à la question du crédit foncier. C'est à lui, en partie, que l'on doit la connaissance des institutions qui fonctionnent en Allemagne et en Pologne.
M. L. Wolowski est né le 31 août 1810, à Varsovie, en Pologne. Son père était député à la diète. Il a fait ses études à Paris. En 1831, après l'insurrection de Pologne, il fut attaché à l'ambassade du gouvernement national de son pays à Paris; et il est resté dans notre patrie où il a reçu des lettres de naturalisation. M. Wolowski est avocat à la Cour d'appel, correspondant de la Commission centrale de statistique de Bruxelles, membre de la Société d'Économie politique de Paris, de l'Académie de Naples, docteur en droit de la faculté de Heidelberg, et docteur en économie politique de la faculté de Tubingue.
Laborieux et actif, M. Wolowski est un de ceux qui ont le plus et le mieux travaillé à la propagation des principes de liberté commerciale.
249 M. FrédéricBastiat, nommé représentant du département des Landes, a exercé les fonctions de juge de paix à Mugron. Il est depuis plusieurs années membre du conseil général. M. Bastiat s'est d'abord fait connaître par ses articles dans le Journal des Économistes, qu'il a ensuite publiés sous le titre de Sophismes Economiques; par sa traduction des discours des Ligueurs de Manchester, et pour la part qu'il a prise à la lutte des libres échangistes, en 1846 ut 1847. Il a été nommé membre correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques; il est de la Société d'économie politique. M. Frédéric Bastiat est né à Bayonne en 1801, dans une famille de négociants. Argumentateur ingénieux, écrivain original, il s'est fait une brillante réputation, bien que son premier écrit n'ait paru dans le Journal des Économistes qu'en octobre 1844.
250 Bien que cet article puisse paraître empreint d'utopie dans ses conclusions, nous croyons, néanmoins, devoir le publier pour attirer l'attention des économistes et des publicistes sur une question qui n'a encore été traitée que d'une manière accidentelle et qui doit, néanmoins, à l'époque où nous sommes, être abordée avec plus de précision. Tant de gens exagèrent la nature et les attributions du gouvernement, qu'il est devenu utile de formuler strictement la circonscription hors de laquelle l'intervention de l'autorité cesse d'être tutélaire et profitable pour devenir anarchique et tyrannique. (Note du rédacteur en chef.)
251 Dans son remarquable livre De la liberté du travail, t. III, p. 353, éd. Guillaumin.
252 Du principe générateur des constitutions politiques. — Préface.
253 Adam Smith, dont l'admirable esprit d'observation s'étendait à toutes choses, remarque que la justice a beaucoup gagné, en Angleterre, à la concurrence que se faisaient les différentes Cours:
« Les honoraires de Cour, dit-il, paraissent avoir été originairement le principal revenu des différentes Cours de justice eu Angleterre. Chaque Cour lâchait d'attirer à elle le plus d'affaires qu'elle pouvait, et ne demandait pas mieux que de prendre connaissance de celles même qui ne tombaient point sous sa juridiction. La Cour du Banc du roi, instituée pour le jugement des seules causes criminelles, connut des procès civils, le demandeur prétendant que le défendeur, en ne lui faisant pas justice, s'était rendu coupable de quelque faute ou malversation. La Cour de l'Échiquier, préposée pour la levée des deniers royaux et pour contraindre à les payer, connut aussi des autres engagegements (sic) pour dettes, le plaignant alléguant que, si on ne le payait pas, il ne pourrait payer le roi. Avec ces fictions, il dépendait souvent des parties de se faire juger par le tribunal qu'elles voulaient, et chaque Cour s'efforçait d'attirer le plus de causes qu'elle pouvait au sien, par la diligence et l'impartialité qu'elle mettait dans l'expédition des procès. L'admirable constitution actuelle des Cours de justice, en Angleterre, fut peut-être originairement, en grande partie, le fruit de cette émulation qui animait ces différents juges, chacun d'eux s'efforçant à l'envi d'appliquer à toute sorte d'injustice le remède le plus prompt et le plus efficace que comportait la loi.» (De la Richesse des nations, livre V, chap. Ier.)
254 Pendant longtemps, les économistes ont refusé de s’occuper non seulement du gouvernement, mais encore de toutes les fonctions purement immatérielles. J.-B. Say a fait entrer, le premier, cette nature de services dans le domaine de l’économie politique, en leur appliquant la dénomination commune de produits immatériels. En cela, il a rendu à la science un service plus considérable qu’on ne suppose:
“L’industrie d’un médecin, dit-il, et, si l’on veut multiplier les exemples, d’un administrateur de la chose publique, d’un avocat, d’un juge, qui sont du même genre, satisfont à des besoins tellement nécessaires, que, sans leurs travaux, nulle société ne pourrait subsister. Les fruits de ces travaux ne sont-ils pas réels? Ils sont tellement réels qu’on se les procure au prix d’un autre produit matériel, et que, par ces échanges répétés, les producteurs de produits immatériels acquièrent des fortunes.—C’est donc à tort que le comte de Verri prétend que les emplois de princes, de magistrats, de militaires, de prêtres, ne tombent pas immédiatement dans la sphère des objets dont s’occupe l’économie politique.” (J.-B. Say. Traité d’Économie politique, l. 1, chap. XIII.)
255 Du Principe générateur des Constitutions politiques.—Préface.
256 Voir les Études sur l’Angleterre, de M. Léon Faucher.
257 De la Richesse des Nations, liv. 5, chap. Ist.
258 [Editor: the original text states that this is the “Socialiste” who is speaking, but the context suggests it should be the “Economiste”.]
259 Voir le compte-rendu publié à Bruxelles. Broch. in-8", 1849; chez Guillaumin.
260 Voir plus loin le compte-rendu de trois meetings considérables, à Londres, Manchester et Birmingham.
261 Le rapport du comité des finances de l'Assemblée constituante sur le projet du budget rectifié de 1848, fixe cette perte à 173 millions 540 mille francs. Voir la page 74.
262 Voir le rapport précité, pages 70 et 75.
263 Ce pamphlet, publié en juillet 1850, est le dernier que Bastiat ait écrit. Depuis plus d’un an, il était promis au public. Voici comment son apparition fut retardée. L'auteur en perdit le manuscrit lorsqu’il transporta son domicile de la rue de Choiseul à la rue d'Alger. Après de longues et inutiles recherches, il se décida à recommencer entièrement son œuvre, et choisit pour base principale de ses démonstrations des discours récemment prononcés à l'Assemblée nationale. Cette tâche finie, il se reprocha d’avoir été trop sérieux. j'eta au feu le second manuscrit et écrivit celui que nous réimprimons. (Note de l’éditeur Paillottet.)
264 V. le chap. xx du tome VI. (Note de l'éditeur.)
265 V. au tome IV, le chap. XX de la 1er série des Sophismes, p. 100 et suiv. [Note de l'éditeur.]
266 J'emploie ici les mots liberté du travail et de l'industrie, parce que ce sont les termes mêmes de la Constitution, art. XIII.
Par ce qui précède, on a déjà vu que par le mot d'industrie je n'entends pas seulement les manufactures, ainsi qu'on le fait quelquefois; j'y comprends les divers modes de l'activité humaine qui ont pour objet direct de produire de la richesse, c'est-à-dire d'adapter la nature à nos besoins. L'industrie, entendue ainsi, embrasse l'agriculture et le commerce, aussi bien que les fabriques.
267 Voyez GANILH.
268 Voyez SANDELIN.
269 [1] Jusqu'à présent la bibliographie économique consistait dans une courte liste des principaux ouvrages qui accompagne la Théorie des richesses sociales de Skarbeck, dans celle dont M. Blanqui a fait suivre son Histoire de l''Economie politique, déjà beaucoup plus étendue, et remarquable par de piquantes annotations; et enfin dans celle de M. Mac Culloch (Literature of Political economy), beaucoup plus étendue encore, très estimable à tous égards par les savantes appréciations do l'auteur, mais loin d'être aussi complète que la nôtre.
270 Clave de los Economistas. Madrid, 1850, in-8 de 70 pages.
271 Traité de législation, par Charles Comte, tome I, pages 31 et 33.
272 Traité de législation, par Charles Comte, première édition, tome IV, page 536.
273 [1] Cette belle et importante démonstration, que nous n'avons pu qu'indiquer ici, est donnée de la manière la plus complète et la plus satisfaisante dans le grand ouvrage de M. Ch. Dunoyer, De la liberté du travail.
274 Traité de la propriété, chap. 48.
275 De la Propriété d'après le code civil. (Collection des Petits traités publiée par l'Académie des sciences morales et politiques.)
276 De la propriété.
277 De la propriété, livre I, chap. 5.
278 ibid.
279 De la propriété, livre I, chap. 12.
280 De là propriété, par H. Thiers, livre I, chap. 10.
281 Qu'est-ce que la propriété?
282 Qu'est-ce que la propriété?
283 Voyer, dans le Dictionnaire, l'article Droit au travail.
284 Necker indique la proportion de 10 4/3, et Daire celle du 11 2/3, parce que l'un et l'autre la calculent sur la recette brute; mais il est plus juste de la calculer sur la recette nette, déduction faite des frais. Dans cette moyenne de 11 2/3 ou 11,66 que donne Daire, les contributions directes sont portées à 3,79; l'enregistrement et les domaines à 4,95, le timbre à 2,94, les forêts à 15,62, les douanes et sels à 13,81, les contributions indirectes et poudres à 16,55, les tabacs à 27,36, les postes à 55,32. Déjà en 1773 la perception de l'accise ne coûtait pas plus de 5 1/2 0/0 en Angleterre. V. Adam Smith, 1. V, ch. II.
285 Préambule d'un projet de décret de Sobrier.
286 Je ne veux pas dire que la société civile en France n'ait reçu des deux autres ordres aucun élément de progrès, je veux dire seulement que la série de ses progrès se marque, avant tout, par les changements successifs arrivés dans la condition des différentes classes d'hommes qui, du XIVe siècle à 1789, ont porté ensemble le nom collectif de tiers état.
287 Le Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiers état, faisant partie de la Collection de documents inédits sur l'Histoire d» France, publiée par les soins du Ministre de l'instruction publique. Voyez ci-après Appendice Ier.
288 Selon le droit romain, la souveraineté des empereurs dérivait du peuple par delégation perpétuelle; selon le christianisme, elle venait de Dieu. C'est ce dernier principe qui, depuis le règne de Constantin, fit prévaloir l'hérédité dans les successions impériales. Voyez le Mémoire de mon frère Amédée Thierry sur l'Administration centrale dans l'empire romain. Revue de législation et de jurisprudence; septembre 1843.
289 La loi des Franks saliens ou loi salique, et la loi des Franks ripuaires, ou loi des Ripuaires.
290 Si quis ingenuus hominem Francum aut Barbarum occiderit, qui lege salica vivit, VIII M. den., qui faciunt sol. cc, culpabilis judicetur. ( Leg. salic, tit. XLIII, § I, apud Script, rer. gallic. et francic., t. IV, p. 220. ) — Si quis ingenuus hominem ingenuum Ripuarium interfecerit, cc. sol. culp. jud. (Leg. Ripuar., tit. VII, ibid., p. 237. ) — Si quis Ripuarius advenam Francum interfecerit, cc. sol. culp. jud. — Si quis Ripuarius advenam Alamannum seu Fresionem vel Bajuvarium aut Saxonem interfecerit, CLX sol. culp. jud. (Ibid., tit. XXXVI, § 1, II et IV, p. 241.) — Si Romanus homo possessor, id est qui res in pago ubi commanet proprias possidet, occisus fuerit, is qui eum occidisse convincitur IV M. den., qui faciunt sol. c., culp. jud. (Leg. salie, t. XLIII, § VII, ibid., p. 220.) — Si quis Ripuarius advenam Romanum interfecerit, c. sol. multetur. (Leg. Ripuar., tit. XXVI, § III, ibid., p. 241.) — Si vero Romanus vel Lidus... occisus fuerit... (Leg. salic, tit. XLIII, § IV, ibid., p. 220.) — Qui Lidum occident c. sol. componat... (Caroli Magni capitul., anni DCCCXIII, ibid., t. V, p. 688.) — Si quis Romanum tributarium occident, M DCCC den., qui faciunt sol. XLV, culp. jud. (Leg. salic, tit. XLIII, § VIII, ibid., t. IV, p. 220.) — Si quis servum alienum occident, aut vendiderit vel ingenuum dimiserit, H CCC den., qui faciunt sol. XXXV, culp. jud. (Ibid., tit. XI, § III, p. 209.)
291 Histoire de la civilisation en France, par M. Guizot, 3e édit., t. IV, p. 224.
292 Voyez le Rapport de M. Michelet sur le concours du prix d'histoire ayant pour sujet celle question: Causes qui ont amené l'abolition de l'esclavage (Mémoires de l'Académie des sciences morales et politiques, I. III, p. 655).— Voyez aussi les Dissertations jointes par M. Pardessus à son Recueil des textes de la loi salique, dissertations IVe et VIIe.
293 Voyez la nouvelle édition du Glossaire de Du Cange, par M. Hcnschel, t. II, p. 214, au mot Casati.
294 Voyez le Mémoire de M. Mignet sur cette question: Comment l'ancienne Germanie est entrée dans la société civilisée de l'Europe occidentale. Mémoires de l'Académie des sciences morales et politiques, t. Ill, p. 673.
295 Voyez trois dissertations de M. le comte Beugnot sur les Municipalités rurales en France. Revue française, août, septembre et octobre 1838.
296 Voyez le Mémoire de MM. Wallon et Yanoski sur les causes qui ont amené l'abolition de l'esclavage, travail couronné en 1839 par l'Académie des sciences morales et politiques.
297 Lex humana duas indicit conditiones: Nobilia et servus simili non lege tenentur. ...
Hi bellatores, tulorcs ecclcsiaium,
Defendunt vulgi majores atque minores,
Cunclos et sese parili sic more tuentur.
Allera servorum divisio conditionum,
Hoc gcnus alllictum nil possidet absque labore...
(Adalberonis carmen ad Robertum regem, apud Script, rer. gall. et francic, 1. X, p. 69.)
298 M. Guérard, Prolégomènes du cartulaire de l'abbaye de Saint-Père de Chartres. Collection des cartulaires de France, t. I, p. XL. — Voyez le grand travail du même auteur sur la condition des personnes et des terres, depuis les invasions des Barbares jusqu'à l'institution des communes, ouvrage placé en tête de l'édition du Polyptique d'Irminon, abbé de Saint-Germain-des-Près.
299 On ne l'employait, au Xe siècle, que dans la langue du droit ecclésiastique, où les mots Libertas romana signifiaient l'immunité au moyen de laquelle une abbaye, avec ses domaines, était soustraite à la juridiction ordinaire, et relevait seulement de l'église de Rome.
300 La qualification de seigneur, Dominus, Domnus, fui donnée aux évêques dans leurs villes bien avant les temps féodaux. Un acte passé en 804 devant la curie d'Angers, présente comme synonymes les titres de Defensor et de Vice-domus; on lit d'abord: Adstante vir laudabile Wifredo defensore, vet cuncta curia.. et à la fin Signum Wifredo vice-domo. Voyez Martène, Amplissima collectio, p. 58 et 59.
301 Voyez les Considérations sur l'Histoire de France, en tête des Récits des temps mérovingiens, chap. VI.
302 Voyez les Considérations sur l'Histoire de France, chap. VI, p. 164 et suiv., in-8o, 1832.
303 Ce mot n'avait point dans le moyen âge la généralité de sens que nous lui prêtons aujourd'hui; il désignait d'une manière spéciale, la municipalité constituée par association et par assurance mutuelle sous la foi du serment. Voyez les Considérations sur l'Histoire de France, chap. VI, p. 174 et suiv.
304 Les dix prud'hommes d'Orléans et de Chartres semblent une réminiscence du rôle que jouaient les dix premiers sénateurs, Decemprimi, Decaproti, dans la municipalité romaine. Le gouvernement de quatre prud'hommes, qui fut celui de Bourges et de Tours, jouit d'une grande faveur sur une bande de territoire prolongée de l'est à l'ouest dans la Touraine, le Berry, le Nivernais, la Bourgogne et la Franche-Comté.
305 On peut citer, pour le premier cas, Périgueux el le Puy-Saint-Front; pour le second, Tours et Châteauneuf.
306 Voy. les Lettres sur l'Histoire de France, lettre XIV.
307 Voyez l'Histoire de la commune de Vézelay, Lettres sur l'Histoire de France, lettres XXII, XXIII, XXIV.
308 Voyez les Lettres de Philippe-Auguste, données sous les dates de 1184, 1l85, 1186, 1196, 1205, 1216 et 1221. (Recueil des Ordonn. des rois de France, t. XI, p. 231, 237, 245, 277, 291, 308 et 313.)
309 Nus sumes homes cum il sunt,
Tex membres avum cum il unt,
Et altresi granz cors avum,
Et altretant sofrir poüm;
Ne nus faut fors cuer sulement.
( Wace, Roman de Rou, t.I, p. 306.)
310 Eodem anno [1183], in provincia Biluricensi, interfecta sunt septem millia Cota rellorum ... et co amplius, ab incolis illius terrae in unum contra Dei inimicos confœderalis. lsti terram regis vastando paedas ducebant ... (Rigordis, De Gestis Philippi Augusti, apud Script, rer. gallic. et francic, t. XVII, p. 11.) — Omnes homines nostri de corpore, tam masculi quam femine, qui habitant in terra nostra de Stempensi, et illi etiam qui de ea tenent et possident, ubicumque commorantes, astrinxcrunt se nobis, per sacramentum a singulis sigillatim corporaliter prestitum et receptum, quod si servitutis opprobrium ab eis tolleremus, libertatis beneficium eis et filiis suis tam natis quam nascituris impendentes, quascumque redhibitiones, et sibi et haeredibus ipsorum et terrae nostrae vellemus imponere, ipsi gratanter recipcrent firmiter observarent, et in nullo penilus contrairent. (Charte du chapitre de Sainte-Croix d'Orléans, confirmée par lettres de Louis VIII [1224]; Recueil des Ordonn. des rois de France, t. XI, p. 322.)
311 Voyez l'appendice.
312 Nouveaux principes d'économie politique ou de la richesse dans ses rapports avec la population, par Simonde de Sismondi, liv. 1er, chap. II, Histoire de la Science.
313 Économie politique ou principes de la science des richesses, par J. Droz, liv. Ier, ch. I.
314 Destutt de Tracy.
315 Politique d'Aristote, liv. 1er, ch. 1. Tout ce chapitre de l'admirable ouvrage d'Aristote est consacré au développement de cette proposition. Voir la traduction de M. Barthélemy Saint-Hilaire.
316 Par M. Michel Chevalier. Le célèbre professeur a cité plus d'une fois dans son cours le décret de 1791 qui, en abolissant les corporations, interdit aux maîtres et aux ouvriers de se réunir pour leurs prétendus intérêts communs; décret qui révèle sans doute la défiance naturelle qu'inspirait la crainte du retour des corporations, mais dont l'esprit général remonte à une cause supérieure. Cet esprit se retrouve encore en partie dans notre législation, peu favorable à l'association. M. Michel Chevalier est revenu souvent sur la nécessité de distinguer et de combiner ces deux éléments de la nature humaine, l'élément personnel et l'élément sociable. Si cette distinction que nous introduisons ici paraît à quelques personnes exacte et féconde, c'est au savant économiste que nous sommes heureux d'en rapporter le mérite. On trouvera dans plusieurs des discours d'ouverture de M. Michel Chevalier, et particulièrement dans son beau discours sur le Progrès (Cours d'écon. polit., Ier vol., 2e édit.), les vues les plus justes et les plus élevées relativement à ces deux attributs et à leur développement.
317 Sur cette double face de la civilisation, dont l'une répond au développement intérieur et individuel, l'autre au développement extérieur et social, voir l'admirable leçon sur la civilisation qui ouvre le cours de M. Guizot.
318 Voir au sujet de cette industrie, les Soirées de la rue Saint-Lazare, chapitre XI, et les Questions d'économie politique et de droit public. De la production de la sécurité, t. II, p. 245.
319 Au moment où nous commencions la rédaction de cet article, une indisposition sérieuse ne nous a point permis d'y consacrer tout le temps nécessaire. Notre ami, M. Levasseur, a bien voulu nous aider de son précieux concours; la forme donnée a l'expression dépensées qui nous sont communes, lui appartient. L. W.
320 Esprit des lois, liv. XXVI, ch. xv.
321 Bentham, Traité de législation.
322 M. Thiers, De la propriété, liv. I, ch. v.
323 Robertson, Histoire de l'Amérique, trad. Sicard, liv. VII.
324 Robertson, Histoire de l'Amérique, trad. Sicard, liv. VII.
325 Lois, liv. XI.
326 « Pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les réglements. » (Art. 544.)
327 Ad Corinth., chap. vii, 4, 14, 16.
328 Ad Romanos., chap. xvi, 1, 16. Ad Galat, III, 28.
329 Épitre aux Galates, chap. III, v. 28.
330 Études de la Nature, Éducation.
331 Paris compte 306,000 ouvriers et 111,000 ouvrières, quoique cette ville ait plus de 312,000 femmes dans cette classe, où les épouses qui vivent du salaire de leur mari sont l'exception. Si nous cherchons les 200,000 femmes qui font la différence entre ces deux nombres, nous les trouvons dans la position inférieure de la domesticité, dans l'indigence et la dégradation; les veuves pauvres soit de concubinaires, de séducteurs et même de maris vivants ou morts sont déjà au nombre de plus de 100,000; les soins de la maternité privent souvent ces femmes de toute ressource, et quoique les ouvrières soient employées dans une proportion trois fois moindre que les ouvriers à Paris, leur salaire n'y atteint pas moitié de celui des hommes. Voilà cependant les femmes contre lesquelles nos coalitions ouvrières lancent leur interdit au nom des libertés économiques!
332 On sait que les soldats de la garde de l'Empereur ne peuvent contracter mariage.
333 Une Anglaise auteur a dit quelque part: «La Française ne voyage pas; elle n'écrit point ses voyages, parce qu'elle ne sait ni lire ni écrire. »
334 Le 16 octobre 1865 a eu lieu à Leipzig la réunion préparatoire du congrès des femmes qui se propose de réunir les forces des femmes ouvrières; l'Allemagne compte 5 millions de femmes aptes au travail, qui, par une moyenne hebdomadaire de 3 thalers de gain, arriveraient à gagner 750 millions de thalers par an. Mille femmes peuvent y embrasser la profession de pharmaciens. La Prusse, dont la population est beaucoup moindre que la nôtre, emploie près de 6,000 ouvrières à ses manufactures de tabac.
335 Une jeune institutrice prussienne, avant de se fixer dans un village reculé de la Prusse orientale, avait été apprendre l'anglais à Londres, et vint à Paris pour se perfectionner dans la connaissance du français exigée ou mentionnée pour la remise du diplôme. Elle m'affirmait fièrement que ce titre de capacité lui donnerait droit, dès son arrivée au pays natal, à un emploi public qui lui assurerait un avenir, et ajoutait que nos institutrices, sans occupation et sans pain, conquerraient les mêmes droits en allant prendre leurs degrés en Prusse.
336 Les institutrices anglaises munies de diplômes reçoivent 1,550 francs par an, et près de 900 francs si elles n'ont pas de diplômes.
L'Angleterre a des associations pour secourir les orphelins et les veuves de médecins, de chirurgiens, des attachés de bureau, des avoués (attorneys), des légistes, etc. — Les sociétés navales de bienfaisance, non contentes d'entretenir à domicile les veuves pauvres, ouvrent des asiles aux orphelins adultes, et des écoles aux filles d'officiers de marine. Tous les receveurs de poste doivent accepter les épargnes que le peuple confie aux caisses de l'État.
337 Correspondance de Stockholm, 7 février 1866, publiée par le Moniteur.
338 Une ordonnance de Charles V (novembre 1364), exige que les actes et pièces de procédure qui concernent les pauvres soient expédiées gratis et le plus prompte ment possible. Vers le xve siècle, un particulier faisait à Nîmes une fondation en faveur du défenseur des veuves et des orphelins.
339 L'empire ottoman illustré, par MM. Léon Gallibert et C. Pellé.
340 Toute cohabitation regardée comme mariage légitime, impose au père les mêmes devoirs à l'égard de ses enfants, et le concubinage est sévèrement puni. Le nègre affranchi qui retrouve deux épouses, l'une d'ont il a des enfants, et l'autre dont il n'en a pas eu, est tenu de reconnaître pour épouse légitime la mère de ses enfants; il ne peut contracter un nouveau mariage du vivant d'une ancienne femme; l'affranchi qui épouse une femme avec des enfants, doit pourvoir à leur entretien pendant leur minorité, etc...
341 En Piémont, les élèves de l'asile royal pour les filles de militaires accomplissent tous les travaux de l'établissement qui n'a pas de domestiques.
342 Napoléon Ier créa de brillantes positions à plusieurs élèves de Mme Campan; après les avoir mariées à ses généraux, il disait avec satisfaction à Sainte-Hélène: J'ai fait beaucoup de mariages, et j'aurais voulu en faire des milliers d'autres.
343 Brierre de Boismont, Du suicide et de la folie suicide, Paris, 1856.
344 Timon, Livre des orateurs, 12e édition.
345 Un parallèle entre l'ancienne maison de Saint-Cyr et la maison actuelle de Saint-Denis ne serait pas à l'avantage de notre époque. Après avoir donné une éducation savante à ses filles, jusque dans des jeux comme les échecs, avec lequel elle les familiarisait, Mme de Maintenon s'occupait de créer une position aux élèves conservées dans la maison jusqu'à l'âge de vingt ans; elle leur quêtait même des dots près du roi; elle en fit demander aux États d'Artois, de Bourgogne et de Languedoc, se plaignant partout que les gendres manquassent à ses filles. La maîtresse générale des classes était chargée d'exposer la position de chaque jeune fille et de faire valoir ses intérêts. C'était une espèce de procureur, selon le nom que M"e de Maintenon elle-même lui donnait. Outre les soixante mille francs de dotation annuelle accordés par Louis XIV aux élèves de Saint-Cyr, de riches abbayes étaient réservées à celles d'entre elles qui préféraient la vie religieuse. Mme de Maintenon faisait célébrer elle-même les mariages des orphelines à Saint-Cyr ou chez Chamillard, et comblait de présents les nouvelles épousées, en faisant apposer la signature du roi sur le contrat de mariage. Deux a trois mille jeunes filles furent élevées ainsi à Saint-Cyr dans l'espace de cent ans; elles se dispersèrent dans toute la France et laissèrent partout la trace de leurs talents et de leurs vertus, réalisant le vœu de Mme de Maintenon qui leur disait: Qu'on voie partout et toujours que vous avez été élevées à Saint-Cyr.
346 Quand le gouvernement voulut encourager, en 1848, les associations ouvrières, il leur avança près de trois millions, sur lesquels une maison de lingerie tenue par des femmes, reçut quinze mille francs.
347 Voir dans M. Thiers, Histoire du Consulat et de l'Empire, 15e volume, p. 281 et suivantes, le projet qu'eut Napoléon Ie' d'aliéner ces biens, et, dans le 16e volume, p. 200, la suite donnée à cette mesure.
348 Des moyens propres à généraliser en France le système pénitentiaire, par M. Bérenger, de l'Institut.
349 Moniteur universel du 31 août 1848.
350 Le budget do l'agriculture s'élevait à onze cent mille francs en 1858.
351 Fénelon, Traité de l'existence de Dieu.
352 La France compte cent vingt-cinq millions de ces parcelles territoriales, qui sont, pour ainsi dire, des miettes de terre. Il existe des parcelles d'un revenu de cinq centimes, qui supposent moins d'un centime d'impôt. D'autres parcelles, dont la mise à prix est de 6 à 10 francs, nécessitent quelquefois 110 francs pour une acquisition régulière, parce qu'il faut presque toujours solder des purges hypothécaires pour devenir acquéreur. La petite propriété en France est grevée par titres hypothécaires ou chirographaires.
353 Michel Chevalier, Essais de politique industrielle.
354 Cours d'Économie politique, t. Ier, p. 480. On partage surtout le regret de J. B. Say en pensant que les actes de Napoléon Ier ont contrarié ses vues, car il classait ainsi la prospérité de la nation: « De l'agriculture, âme de l'Empire, disait-il, doit sortir l'industrie ou l'aisance et par suite, le commerce extérieur, surabondance de l'agriculture et de l'industrie. »
355 J.-B. Say, Cours d'Économie politique, 2e vol., p. 119.
356 Je connais une commune rurale importante et très riche en territoire qui, pour livrer à une exploitation fructueuse ses forêts, ses terrains, ses carrières, ses sablières, ainsi que ceux des communes voisines, et faciliter leurs transactions commerciales, réclame avec insistance une gare, sans l'obtenir, quoiqu'elle s'offre à faire tous les frais de création.
357 L'Empereur a accorde 2 millions à une caisse de crédit agricole, mais au lieu de venir en aide aux laboureurs, elle leur fournit des prêts à 10 et à 11 p. 100, en servant un intérêt de 17 p. 100 à ses actionnaires. Depuis 60 ans, les produits de l'agriculture ont augmenté de 30 p. 100, tandis que, dans la même période, les valeurs industrielles se sont élevées d'un milliard à 50. (Sénat, séance du 10 février 1866.)
358 « La femme docteur ès-lettres ou ès-sciences, médecin, avocat, juré, juge, semblera une conception ridicule aux gens irréfléchis dont le premier mouvement est de se moquer de ce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Pour moi, je n'admets de limites en pareille matière que celles que la nature invincible pose; mais je dis que la femme deviendra dans la société tout ce qu'elle sera capable et digne d'être. » (Rapport lu dans là séance publique de l'Académie de Lyon, du 21 juin 1859, par M. J. Morin.)
359 Cité par Lamartine, Histoire de la Restauration, t. Ier.
360 Villemain, Souvenirs contemporains d'histoire et de littérature, t. 1er.
361 Quoique la Révolution eut exclu les femmes de la régence (séance du 23 mars 1791), Napoléon Ier, au moment de partir pour une lutte suprême, confia la régence de son vaste empire à une jeune femme inexpérimentée qu'il faisait assister à ses conseils et initiait lui-même aux affaires. Napoléon 1er donnait le gouvernement des duchés à des femmes; Élisa Bonaparte, nommée par lui grande duchesse de Toscane, régna sur la Méditerranée; il transporta de même à la fille de Duroc le duché de Frioul, ainsi que tous les biens qu'il avait concédés à son père. Il dota la fille d'Eugène du duché de Galliera, appartenant à son domaine privé avec le palais de Bologne, dont il la créa princesse.
Parmi les nombreux secours qu'il accorda aux femmes, on trouve déjà sur le champ de bataille des Pyramides la réclamation du général Bonaparte en faveur de la veuve du citoyen Larrey; une pension à la sœur de Robespierre; de grandes largesses aux duchesses d'Orléans et de Bourbon.
Napoléon Ier secourut la dernière représentante de la famille Duguesclin; il vint en aide à la veuve de Bailly, président de l'Assemblée constituante au Jeu-de-Paume.
Il éleva, pour Mme Portalis, à 20,000 francs la pension civile dont le maximum avait été fixé à 10,000 francs par la Constituante, et à 6,000 par le Consulat; il assura généreusement l'existence de Mme Dillon, sœur du premier officier tué dans nos guerres civiles, et lui remit une somme de 24,000 francs avec une pension annuelle de 6,000. En 1813 même, Napoléon, après avoir épuisé toutes ses économies, envoya sur sa cassette, une pension de 24,000 francs à une dame qui avait perdu sa fortune et lui fit payer quatre ans d'avance.
Après Austerlitz, l'Empereur accorda des pensions aux veuves de tous les militaires tombés sur le champ de bataille et adopta leurs enfants qu'il fit élever aux frais de l'État. Il avait formé le projet d'annexer aux maisons de Saint-Denis et d'Ëcouen des asiles et des hospices pour les veuves de militaires et les femmes âgées, etc. — Parmi les nombreux mariages qu'il favorisa, on peut citer ceux des rosières de Saint-Malo auxquelles il accordait tous les ans une somme de 600 francs en leur choisissant un mari dans les régiments victorieux, etc.
362 Charles Dunoyer, Censeur européen, t. VI, p. 96.
363 Pour donner le texte dans son intégrité, nous rétablissons ici le paragraphe suivant que nous avons omis dans notre lecture. « Enfin, le maintien dans leurs foyers de 2 millions de jeunes gens aurait pour effet certain d'amener, an moins temporairement, une baisse notable du prix de la main-d'oeuvre, et d'imprimer ainsi un vif élan à la production sous toutes ses formes.» Nous avons cru devoir passer ce paragraphe, parce que, à notre avis, la conséquence qui s'y trouve énoncée est au moins douteuse, et que nous voulions éviter de compliquer une lecture déjà longue de rectifications qui l'eussent encore allongée. Une baisse de la main-d'oeuvre ne peut être que le résultat d'une différence dans le rapport entre le capital et le travail disponibles. En rendant dès soldats aux ateliers et aux champs, on rendrait à ceux-ci l'argent qui est dépensé pour ces soldats au régiment. Il n'y a donc pas de raison de prédire une baisse des salaires; loin de là, et c'est bien tant mieux, à ce qu'il nous semble. (Note d. M. F. Passy.)
364 M. Renouard, Voir le compte-rendu de la séance du 5 Mai.
365 La Guerre et les armées permanentes, ouvrage couronna par le Comité du Congrès de la Paix de Londres. - Guillaumin et cie, 1856.
366 Voir dans les Mélanges économiques de M. F. Passy, l'étude intitulée: Les maux naturels et les maux artificiels.
367 M. Hippolyte Passy. Voir pour tous ces détails les Leçons d'Economie Politique de M. Frédéric Passy, t. II, 26e leçon.
368 M. Guizot, notamment.
369 A la fin du terrible hiver de Crimée, ils étaient réduits de 60,000 environ à 15,000; voir Couturier de Vienne, Les forces militaires des principales puissances de l'Europe, p, 120, ouvrage très curieux d'un ancien militaire.
370 L'Académie des sciences a décerné à ce travail hors ligne le grand prix de statistique.
371 Numéro du 29 Juillet 1866. - Dans le même article, M. E. dé Girardin écrivait encore ce qui suit: « Le Jour n'est peut-être pas loin où, mis en communication journalière entre eux par les chemins de fer, la navigation à vapeur et les fils électriques, les peuples, qui déjà n'ont plus de haines sauvages les uns contre les autres, s'indigneront de ces tueries qui font que le penseur se demande si l'homme qui se prétend civilisé n'est pas au-dessous de la bête fauve dans l'échelle de la création. »
372 V. notamment la conférence sur la Liberté commerciale, dans le IVe volume du Cours d'Économie industrielle, fait en 1866, à l'Ecole Turgot.
373 M. Wichmann, Cette brochure se trouva à la librairie Guillaumin.
374 Nous aurions pu ajouter que la Suisse, qui n'a pas de marine, fait un commerce d'exportation proportionnellement supérieur à celui de l'Angleterre. Voir encore notre leçon sur la Liberté commerciale.
375 Le R.P. Gratry, Méditation sur la Paix, pour le xxxie jour du Mois de Marie.
376 Nous regrettons de n'avoir pu citer entre autres une page saisissante du docteur Bonnafont.
377 Notons cependant les vers de Boileau sur Alexandre: « Heureux si, de son temps, pour de bonnes raisons, La Macédoine eût eu des petites-maisons, etc. » Et ce magnifique et vigoureux passage de Bossuet, dans lequel se trouve manifestement sa véritable pensée: « Les César, les Alexandre, et tous ces autres ravageurs de provinces que nous appelons conquérants, Dieu ne les envoie sur la terre que dans sa fureur. »
378 Il est inutile sans doute de rappeler la fameuse proposition de 1863, pour soumettre les difficultés alors pendantes en Europe, à « la puissance morale d'un arbitrage européen. » Mais il ne l'est peut-être pas de faire remarquer que cette idée, que beaucoup de personnes ont considérée comme un expédient de circonstance, se retrouve formellement exprimée, vingt ans auparavant, dans les Idées Napoléoniennes.
379 Ueber die Emancipation der Frauen, par Heinrich u. Sybel, Bonn. 1870. — Die Irrthumer des Socialismus, par Julius Frœbel. Leipzig. 1870. — Principes d'économie politique, par M. Guillaume Rocher, tome second. — Histoire de la. population. Lehrbuch der Nationalœkonomie, par le Dr Albert Schaffle, Tubingen, 1867. — Le travail des femmes au XIXe siècle, par M. Paul Leroy-Beaulieu, Paris. 1873. — Annales de la Patrie, revue mensuelle russe, mars 1873.
380 Irrthumer des Socialismus, p. 8.
381 Principes d'économie politique, tome second, p. 319.
382 Lehrbuch der Nationalœkonomie, p. 370.
383 Ueber die Emancipation der Frauen, Bonn, 1870.
384 Ueber die Emancipation der Frauen, p. 12.
385 Travail des femmes, p. 195.
386 Id., p. 200.
387 Id., p. 203.
388 Voir Le mouvement socialiste, de M. de Molinari.
389 Annales de la Patrie, mars 1873.
390 Voir l'Évolution économique, ch. VII, p. 225.
391 Parmi les étrangers qui ont pris du service dans l'armée française sous l'ancien régime et qui figurent sur la liste des maréchaux, on peut citer: Jacques Trivulzio, 1500-1518; Teodoro Trivulzio, neveu de Jacques, 1526-1531; Robert Steuart, 1515-1543; Robert III de la Marck, 1526-1537; Robert IV, 1547-1556; Pierre Strozzi, 1554-1558; Honorât de Savoie, 1572-1586; d'Ornano dit Corso, 1596-1610; Concino, marquis d'Ancre, 1614-1617; Turenne (comte de Sedan, le comté de Sedan ne fut réuni à la France qu'en 1641); Josias, comte de Rantzau, 1645-1650; Schulemberg, 1658-1671; marquis d'Asfeldt, 1734-1743; Cereste Brancas, 1743; d'Isenghien, 1741: Maurice de Saxe, 17471755; Thomas Ch. O'Brien, vicomte de Clare, 1757-1761; de Croy Solre, 1783-1788; Luckner, 1791-1793.
Dans les emplois civils, nous nous bornerons à citer, pour ne pas allonger cette note, les noms célèbres de Mazarin, Law et Necker.
D'après le dénombrement de 1772, l'armée française possédait sur un effectif de 210,000 hommes (pied de paix) 27,348 hommes d'infanterie étrangère sans compter la cavalerie.
Infanterie suisse, 11 régiments. 12,232 hommes.
Gardes suisses, 2,348 —
Infanterie allemande, 8 régiments. 8,512 —
Infanterie irlandaise, italienne, etc. 8 — 4,256 —
Le Père Daniel. Abrégé de l'histoire de la milice française.
392 Voir notre Cours d'économie politique, t. I, 3° leçon: la Valeur et le prix.
393 M. le docteur Armand Després, chirurgien à l'hôpital de la Charité de Paris, affirme que, avec leurs immeubles, biens-fonds et capitaux placés, les hôpitaux de France possèdent encore aujourd'hui plus de 2 milliards 1/2.
Cette fortune colossale, qui représente 125 millions de revenus, sert à soigner en moyenne 410,000 malades par année. De ce chiffre il convient de retrancher le budget des enfants et des vieillards assistés, qui s'élève actuellement à 40 millions environ. Restent 85 millions pour 410,000 malades, c'est-à-dire que chaque maladie traitée revient à plus de 200 francs. A ce compte, les 220,000 malades des Sociétés de secours mutuels dépenseraient 44 millions, tandis qu'ils en coûtent 16 (année 1879). Et encore cette somme comporte des indemnités payées aux malades pour un total de 5,246,000 fr. et des secours aux veuves et aux orphelins pour 525,000 fr., allocations que ne fait pas l'hôpital. De sorte que les 220,000 malades des Sociétés de secours mutuels coûtent réellement 10 millions en soins de médecin et de pharmacien, c'est-à-dire qu'à ce taux, les 85 millions de l'administration hospitalière pourraient, sans un centime de subvention, servir à soulager 1,870,000 malades au lieu des 410,000 qu'elle secourt.
394 Comme la plupart des hommes politiques, même les plus libéraux M. Thiers n'avait qu'un goût médiocre pour la liberté de la presse. Quant à la liberté des associations, elle constituait à ses yeux un empiétement dangereux sur la souveraineté.
« Savez-vous bien, disait-il avec sa vivacité pittoresque, ce que c'est que d'accorder à une réunion d'hommes la faculté de s'associer politiquement, — et certes, ceux-là s'associent bien politiquement qui marchent à l'assaut de tout ce qui constitue les bases de la société, — c'est leur déléguer toute la puissance de la société; c'est leur accorder une portion de la souveraineté. Et je vais vous le démontrer en quelques mots. Examinez ce que c'est que le gouvernement, en quoi consiste-t-il? Voyez le nombre de ceux qui le composent et voyez où est sa force? Cent mille fonctionnaires peut-être, quelque cent mille soldats. Que sont ces cinq cent mille individus en présence d'un peuple composé de plus de trente millions d'habitants?
« Ce n'est rien comme force numérique, comme force matérielle.
« Qu'est-ce qui fait donc la force du gouvernement? C'est son organisation, c'est le concert avec lequel il agit, c'est la faculté de donner des ordres et d'être obéi, c'est la puissance de réunir à Lyon, à un instant, dix mille soldats, un préfet, des généraux, de faire la même chose s'il le faut à Marseille, à Bordeaux ou ailleurs, tandis que, en même temps, le gouvernement agit à Paris avec le même ensemble, avec la même vigueur. Sa force est dans son organisation, dans son concert, dans cette vigueur d'ensemble, résultat de l'association. Et cette faculté, qui renferme toute la puissance sociale, vous la délégueriez à quelques individus sans mission, sans caractère, qui veulent renverser l'État?... C'est livrer la puissance sociale au premier venu qui voudra s'en emparer.
« Remarquez, Messieurs, quel a toujours été le travail des comploteurs, de tous ceux qui par des conspirations, ou publiques ou secrètes, ont voulu renverser l'État? Leur but a été d'arriver à cette organisation, à ce concert du gouvernement lui-même, de s'associer pour correspondre d'un bout de la France à l'autre, pour qu'au même signal, au même instant, le désordre éclatât à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, à Paris. C'est donc la force sociale, celle qu'ils ont mis tous leurs soins à usurper, que vous leur livreriez vous-mêmes, de votre propre volonté. Eh! Messieurs, c'est la doctrine la plus antisociale, la plus subversive... »
Le malheur, c'est qu'en cette matière comme en bien d'autres, le pouvoir des gouvernements est limité. Ils peuvent interdire les associations publiques, mais les sociétés secrètes bravent leurs défenses, et elles sont bien autrement attrayantes et dangereuses, précisément parce qu'elles sont défendues.
395 Dict. encyclopédique des sciences médicales, 1868, art. Climat.
396 V. Proust. Traité d'hygiène. — Dr Bordier. La colonisation scientifique. Géographie médicale. — Lombard. La climatologie. — Nielly. Hygiène des Européens dans les pays intertropicaux. — Dr Jousset. De l'acclimatement. 1884. Voir aussi les Archives de médecine navale.
397 La plupart des chiffres que je cite sont empruntés aux Tableaux de la population etc. (publication officielle).
398 Les colonies françaises en 1883, 2e édit., 1884 (publication officielle).
399 Archives de médecine navale, mai 1881.
400 Dr Maurice Nielly. Hygiène des Européens dans les pays intertropicaux, 1884. — Dr Rey. Études sur la Martinique, 1881.
401 L'Algérie et les questions algériennes, par Ernest Mercier. In-8, 1883.
402 Procès-verbaux du conseil supérieur de l'Algérie.
403 Exposé de la situation de l'Algérie au 31 décembre 1882, par M. Tirman.
404 Annules de démographie, mars 1882. Démographie de l'Algérie, 1880.
405 Art. Acclimatement. Dict. encycl. des sciences médicales.
406 Voir pour le développement des civilisations dans le sens de la latitude, le remarquable ouvrage de M. Paul Mougeolle, la Statique des civilisations.
407 Enquête sur le régime commercial des colonies françaises, 1877.
408 Le Temps, 3 décembre 1884.
409 Voici comment le Figaro, journal bécarre, définît le bécarre: « Un homme est « bécarre » quand il se met en habit à partir de six heures et demie du soir et qu'il voit le monde. Le « bécarre » a des souliers pointus, un pantalon étriqué, le gilet blanc très ouvert. Il ne porte qu'un seul gant, à la main gauche, et il n'a point de bijoux. Le « bécarre» est gourmé, très droit, très sérieux, très anglais et très sanglé. Il a un col de chemise très haut et très empesé, une cravate blanche à noeud extrêmement court. Il doit avoir des bouts de favoris ras, descendant au niveau du lobe de l'oreille; il a des moustaches. La barbe lui est interdite. Le « bécarre » ne soupe pas: il se couche de bonne heure pour se lever de bonne heure, afin d'être au bois, à cheval, dès le premier matin. Il n'est pas « bécarre » d'être gai et expansif.
«La concentration est le signe distinctif du « bécarre ». A table, il est « bécarre M de ne pas servir ses voisines. Ne s'occuper que de soi et parler peu constituent la bonne attitude du « bécarre ». Le jeune « bécarre » dédaigne le veston et la jaquette. C'est tout au plus s'il revêt ces vêtements peu distingués dans la matinée. Dès midi il est en redingote, celle-ci courte, serrée et boutonnée. Il est « bécarre » de porter un pardessus, également, étroit et court, qui laisse dépasser les basques de l'habit. Le « bécarre » a les cheveux ras; les plus hardis essayent une raie sur le côté, mais on sent que c'est une raie parasite, difficile, plutôt supportée qu'acceptée. Le « bécarre « s'amuse peu. Quand il est lancé, il imite la voix de Baron, lequel est, en ce moment, le plus « bécarre » des acteurs.de Paris ».
410 Macaulay's Essays, Gladstone on Church and State. — Ce principe, d'une importance capitale et d'une fécondité extraordinaire, peut être appelé principe des spécialités. Il a d'abord été établi pour les machines et pour les ouvriers par Adam Smith. Macaulay l'a étendu, des machines, aux associations humaines. Milne Edwards en a fait l'application aux organes dans toute la série animale. Herbert Spencer l'a développé largement pour les organes physiologiques et pour les associations humaines dans ses Principes de biologie et dans ses Principes de sociologie. J'ai essayé ici de montrer les trois branches parallèles de ses conséquences, et, de plus, leur racine commune, qui est une propriété constitutive et primordiale, inhérente à tout instrument.
411 Cf. la Révolution, III, livre II, ch. II. On y Irai le des empiétements de l'État et de leurs conséquences pour l'individu. Il s'agit ici de leurs conséquences pour les corps. — Lire, sur le même sujet, Gladstone on Church and State, par Macauiay, et The Man versus the State, par Herbert Spencer, deux essais où la rigueur du raisonnement et l'abondance des illustrations sont admirables.
412 La Révolution, III, 455.
413 La Révolution, III, 371.
414 La Révolution, III, 462, 447.
415 L'Ancien Régime, 82, 83, 97, 98, 155, 156, 382.
416 La Révolution, I, p. 231 et suivantes.
417 Exemples pour l'Angleterre dans les Essais de Herbert Spencer intitulés Over-legislation et Representative. Government. Exemples pour la France dans la Liberté du travail, par Charles Dunoyer (1845). Ce dernier ouvrage contient, par anticipation, presque toutes les idées de Herbert Spencer; il n'y manque guère que les illustrations physiologiques.
418 V. Menier. Impôt sur le capital. — Yves Guyot: La Science économique. La monnaie est également un capital circulant.
419 Sur la formation et la distribution des richesses, § VI.
420 Né en 1778, mort en 1823.
421 Principes d'économie politique, ch. IV.
422 Les travaux et les jours.
423 Pour Hégel l'État était « divin ».
424 Les fonctionnaires sont actuellement en France au nombre de 202.000 — résultats statistiques du dénombrement de 1891. (Ministère du commerce.)
425 Le Socialisme d'État, par M. Léon Say, p. 17.
426 Ibid., p. 19.
427 Voir dans notre 2e partie le chap. sur l'assistance publique.
428 La protection s'étend déjà à un nombre considérable de produits. Le tarif de 1892 compte 720 espèces de produits dont près de 700 sont protégés. Depuis cette époque, d'autres droits ont été demandés sur d'autres produits.
429 Voir un Essai de socialisme d'État sous Napoléon III, par Alfred Thomereau, dans sa brochure les Assurances agricoles.
430 1er mai 1893.
431 Du 19 novembre 1893: cité dans Journal des Économistes, février 1894, par M. Emmanuel Ratoin.
432 Rapp. de M. Jacqmin, 1893.
433 Rapp. de M. Cornudet (Garant. d'intérêts, 1893).
434 En Angleterre sur un budget 212.909.000 francs affecté aux pauvres en 1886, dans lequel ne se trouvaient pas comprises l'Écosse et l'Irlande, 139.487.000 francs seulement ont été aux pauvres, soit 65,75 p. 100, 15,97 p. 100 étaient affectés aux frais du personnel et 18.28 p. 100 aux frais d'administration autres que ceux du personnel, et à différentes autres dépenses. (Voir, en outre, dans notre IIme partie, le chap. sur l'Assistance publique.)
435 Appendice. Note D. Le rétablissement et le démarquage des impôts de l'ancien régime en France.
436 Appendice. — Note E. Le fonctionnarisme en France.
437 Appendice. Note K. L'augmentation progressive des dépenses de guerre et des dettes publiques en Europe.
438 Comment se résoudra la question sociale, p. 192.
439 Appendice. Note L. Les encaisses des banques transformées en trésors de guerre.
440 Appendice. Note O. Les lois de la guerre. Une lettre de M. de Moltke et la réponse de M. Bluntschli.
441 Voir: Les progrès réalisés dans les coutumes de la guerre. Journal des Economistes, août et septembre 1854. Reproduit dans les Questions d'économie politique et de droit public, t. II, p. 277.
442 Appendice. Note B. La ligue des neutres. [This is included as part of this chapter. See below]
443 Si l'on examine la valeur des services que les gouvernements rendent aux nations et si on la compare au prix dont elles les paient, sous forme d'impôts directs et indirects fournis tant au gouvernement lui-même qu'aux catégories privilégiées dont il protège les intérêts aux dépens des autres, on sera frappé de l'écart énorme qui existe entre cette valeur et ce prix. L'article principal qu'une nation demande à son gouvernement, c'est la sécurité. Or cet article, assurément de première nécessité, — car, lorsqu'il fait défaut, chacun n'étant plus assuré de jouir des fruits de son travail et de sa peine, cesse de travailler ou ne travaille plus que le moins possible, — cet article, disons-nous, pourrait être produit, dans l'ensemble des pays civilisés, à nu prix singulièrement réduit, tandis qu'il va, au contraire, renchérissant tous les jours.
La sécurité des États civilisés est exposée à deux risques, dont l'un peut être supprimé, c'est celui qui résulte du maintient de l'état de guerre entre eux, tandis que l'autre, celui qui résulte du danger des agressions des peuples demeurés en dehors du domaine de la civilisation subsistera aussi longtemps que ce danger. Mais il faut remarquer que l'un et l'autre se sont successivement affaiblis. La guerre entre les peuples civilisés n'entraîne plus aujourd'hui le massacre, le pillage et l'asservissement des vaincus, mais seulement une occupation temporaire, pendant laquelle la vie et la propriété de la population civile sont généralement respectées, ou bien encore, au pis aller, une annexion, qui n'implique qu'un simple changement — lequel n'est même pas toujours une aggravation — du régime politique et fiscal, sous lequel elle vit. A la vérité, les gouvernements modernes, à la différence de leurs prédécesseurs, s'ingénient à rendre ce changement de moins en moins supportable, en imposant leur législation et même leur langue aux pays annexés, mais les conséquences de la conquête ne s'en sont pas moins adoucies avec les progrès de la civilisation. Quant au risque des aggressions ou des invasions des peuples barbares, il s'est progressivement abaissé et il est devenu presque une quantité négligeable depuis que les progrès de l'art de la destruction et des industries productives qui lui fournissent les ressources nécessaires, ont assuré la prépondérance des peuples civilisés. Si donc le risque de guerre venait à être supprimé dans leur domaine, — et c'est là un progrès qu'il dépend d'eux de réaliser, — la garantie de la sécurité de la civilisation n'exigerait certainement pas une dépense annuelle de plus d'une centaine de millions.
444 Publié par le Times, 28 juillet 1887.
445 Effectifs Militaires
Temps de paix. - Temps de guerre.
Angleterre 200,783 - 607,690 (a)
Hollande 51,709 - 131,709 (b)
Belgique 47,290 - 103,860
Danemark 36,469 - 50,469
Suisse 117,179 - 201,225
453,432 - 1,095,223
(a) Non compris l'armée de l'Inde.
(b) Non compris l'armée des Indes hollandaises.
446 La production de la sécurité. Journal des Économistes, n° du 15 février 1849. Reproduit dans les Questions d'économie politique et de droit public, t. II, p. 245.
447 Les honoraires de cour, dit Adam Smith (Richesse des Nations, liv. V, chap. paraissent avoir été originairement le principal revenu des différentes cours de justice en Angleterre. Chaque cour tâchait d'attirer à elle le plus d'affaires qu'elle pouvait, et ne demandait pas mieux que de prendre connaissance de celles mêmes qui ne tombaient point sous sa juridiction. La cour du banc du roi, instituée pour le jugement des seules causes criminelles, connut des procès civils, le demandeur prétendant que le défendeur, en ne lui faisant pas justice, s'était rendu coupable de quelque faute ou malversation. La cour de l'Échiquier, préposée pour la levée des dossiers royaux et pour contraindre à les payer, connut aussi des autres engagements pour dettes, le plaignant alléguant que, si on ne le payait pas, il ne pourrait payer le roi. Avec ces fictions, il dépendait souvent des parties de se faire juger par le tribunal qu'elles voulaient, et chaque cour s'efforçait d'attirer le plus de causes qu'elle pouvait au sien, par la diligence et l'impartialité qu'elle mettait dans l'expédition des procès. L'admirable constitution actuelle des cours de justice, en Angleterre, fut peut-être originairement, en grande partie, le fruit de cette émulation qui animait ces différents juges, chacun s'efforçant à l'envi d'appliquer, a toutes sortes d'injustices, le remède le plus prompt et le plus efficace que comportait la loi.
448 Voir Les lois naturelles de l'économie politique, chap. xiv. La constitution naturelle des gouvernements. La commune. La province. L'État.
449 L'homme ne peut, dans les meilleures conditions possibles, effectuer on dix heures qu’un travail de 220.000 kilogrammètres. En une heure, une machine de 1 cheval-vapeur fait 270.000 kilogrammètres, soit plus qu'un homme en dix heures. On peut donc, avancer qu'il faut, en général, 10 hommes pour faire le travail d'une machine de 1 cheval-vapeur. (Henri De Parville. Causeries scientifiques).
450 30.570.000 liv. st. à l'importation et 43.152.000 liv. st. à l'exportation.
451 L'influence des voies de communication au xixe siècle, par E. Levasseur, p. 12.
452 D'après les recherches de M. Dudley-Baxter (dans son ouvrage National Debts), recherches qui sont, il est vrai, en partie conjecturales pour les périodes un peu éloignées de nous, l'ensemble des dettes nationales des pays civilisés montait, en 1715, à 7 milliards 500 millions de francs. Eu 1793, l'ensemble des dettes publiques des contrées de notre groupa de civilisation y compris les Etats-Unis et l'Inde anglaise, s'élevait à 12 milliards et demi de francs: l'Angleterre devait à elle seule plus de la moitié de cette somme. De 1793 à 1820, les dettes nationales s'accrurent infiniment plus que dans les quatre-vingts années précédentes: l'ensemble,à la dernière de ces dates, peut être évalué à 38 milliards de francs dont 2.3 milliards pour la seule dette anglaise. De 1820 à 1848, le monde jouit d'une paix profonde. Aussi les engagements des nations ne s'élevaient-ils, en 1848, qu'à 43 milliards environ. La Révolution de 1848, les guerres du second Empire, etc., ont porté cette somme à 97.774.000.000 de francs en 1870. On peut estimer enfin que l'ensemble des dettes des nations plus ou moins civilisées dépasse actuellement 130 milliards. (paix Leroy-Beaulieu, Traité de la science des finances, T. II. chap. XIV. Les dettes des grands Etats).
453 Henri Welschlinger. Journal des Débats, 11 juillet 1900.
454 Nous empruntons à notre jeune confrère l'Individualiste, le tableau suivant des résultats de la politique du libre-échange en Angleterre: [see illustration at the end of this section]. Or accumulé: De 1858 à 1899 le total de» importations nettes d'or s'est élevé à £ 148.000.000 ou 3.700.000.000 de francs. 1 livre sterling ou £ = 25 francs. 1 livre anglaise vaut 497 grammes. (*) Ce dernier chiffre aurait même été plus fort; mais des changements fiscaux récents ont exempté d'impôts certains petits revenus.
455 Dans notre chronique du mois de mai dernier, nous avons reproduit une communication de lord Avebury à la Société de statistique sur l'augmentation énorme et continue des dettes publiques. De 42 milliards en 1848 les dettes de» Etats civilisés ont monté à 117 milliards en 1873, à 128 milliards en 1888 et à 160 milliards en 1898. La plus forte part, on pourrait dire la presque totalité de ce» dettes, a servi à alimenter la guerre ou cette préparation à la guerre qui a pris le nom de paix armée. D'après lord Avebury, les dépenses militaires et navales des grandes puissances européennes se sont augmentées depuis vingt ans dans les proportions suivantes:
456 Il y a de bonnes observations sur les élites dans Conscience et volonté sociales de J. Novicow.
457 Voir entre autres, le chap. xxx de la Ie partie de l'excellent ouvrage de Otto Ammon, L'ordre social. Tout cet ouvrage mérite d'être lu et médité avec soin.
458 Aristote, [Greek - Athen. Polit.], 26, note qu'à Athènes, au temps des réformes d'Ephiate, le parti au pouvoir avait été fort réduit par la guerre, chaque campagne amenant la mort de deux ou trois mille membres de cette élite. La guerre des deux roses, en Angleterre, faucha largement l'aristocratie.
Déjà du temps de Théognis de Mégare, on voit une élite qui surgit et une autre qui décline. Comme à Florence au Moyen Age, en France au XVIIIe siècle, etc., c'était une élite de nouveaux riches. « L'homme bien-né — dit Théognis — ne refuse pas d'épouser la fille d'un homme de race intérieure, si elle a beaucoup d'argent » (185-186). « La richesse mêle les races — [Greek phrase] » (190). Boccace, VII, 22, nous montre un Georges Dandin florentin, marchand enrichi, qui avait épousé une femme de l'ancienne élite.
459 Cela a été connu de tout temps, aussi bien par les littérateurs que par les savants. Jacoby (cité par de Lapouge, Les selections sociales, p. 474) « a démontré que toute aristocratie finit par la débilité, la névrose ou l'aliénation ». Il y a de l'exagération en cela, mais il y a aussi un fonds de vérité.
Le T. XIIe du Bulletin de l'institut international de statistique, contient une importante étude de M. P. E. Fahlbeck sur la noblesse suédoise. Il donne la table suivante de survie des familles: [the table has been omitted]
Il conclut que, pour la noblesse suédoise, on n'a pas observé les symptômes suivants de dégénérescence: difformités, alcoolisme, névrose, folie, « à un plus haut degré que dans la population entière. Les fondateurs des familles nobles ont formé en général une sélection sociale; et quoique leur progéniture n'ait pas hérité de leurs qualités naturelles éminentes, elle ne montre point, d'autre part, des traces de dégénérescence que nous avons mentionnées. La dégénérescence qu'on peut observer dans les races nobles suédoises a trait uniquement à la fécondité. Celle ci va en diminuant et avec elle aussi la vitalité des enfants... Ses causes ne peuvent s'expliquer que d'une manière purement hypothétique; on peut les voir dans un excès de travail pour le cerveau et les nerfs en général, ou dans des habitudes plus raffinées... le même genre de dégénérescence ne se montre-t-il pas toujours et partout dans toutes les classes supérieures ? »
460 Otto Ammon, loc. cit., p. 210, de la trad. franc.: « L'ascension des classes inférieures et, en dernière analyse, de la classe rurale, la disparition des classes supérieures sont deux phénomènes étroitement corrélatifs dans le corps social. » Plus loin, p. 2l5: « Le fonctionnement régulier de la machine sociale a pour condition que les couches sociales inférieures continuent à fournir réellement les matériaux nécessaires au renouvellement des classes supérieures. Si ces matériaux venaient à manquer, l'organisation même la plus parfaite ne serait d'aucun secours. » On ne saurait mieux dire.
461 Voir chap. x.
462 Otto Ammon, loc. cit., p. 209: « On voit ainsi la grande importance de la classe rurale pour l'Etat et la société. La classe rurale doit, en dernière analyse, subvenir au recrutement de toutes les autres classes, incapables de se maintenir par elles-mêmes. » Il faut pourtant ajouter que l'industrie moderne donne aussi, en Angleterre et en Amérique, des classes d'ouvriers susceptibles de produire des élites, telles que celle des ouvriers des Trade-Unions.
463 Renan, L'église chrét., p.:96: « Tout le monde s'améliorait... le soulagement de ceux qui souffrent devenait le souci universel. . A la cruelle autocratie romaine se substituait une aristocratie provinciale de gens honnêtes voulant le bien. La force et la hauteur du monde antique se perdaient; on devenait bon, doux, patient, humain. Comme il arrive toujours, les idées socialistes profitaient de cette largeur d'idées et faisaient leur apparition... »
Taine, L'ancien régime, p. 242: « A la fin du XVIII° siècle, dans la classe élevée et même dans la classe moyenne, on avait horreur du sang; la douceur des mœurs et le rêve idyllique avaient détrempé la volonté militante. Partout, les magistrats oubliaient que le maintien de la société et de la civilisation est un bien infiniment supérieur à la vie d'une poignée de malfaiteurs et de fous, que l'objet primordial du gouvernement, comme de la gendarmerie, est la préservation de l'ordre par la force. »
Le Bon, Psych. du social., p. 384: « ... Les adversaires des nouveaux barbares ne songent qu'à parlementer avec eux, et à prolonger un peu leur existence par une série de concessions, qui ne font qu'encourager ceux qui montent à l'assaut contre eux et provoquer leur mépris. »
Ce n'est pas le hasard qui réunit ainsi ces trois citations.
464 Sir Henry Sumner Maine, Etudes sur l'hist. des inst. prim., trad., franc., p. 337, dit qu'aux yeux des auteurs primitifs du progrès juridique, « celui qui était censé avoir pour lui le bon droit, c'était celui qui affrontait, pour obtenir satisfaction, des périls multipliés, qui se plaignait à l'assemblée du peuple, qui demandait à grands cris justice au roi, siégeant à la porte de la cité ». Parlant de l'ancien droit de l'Islande, p. 51, il dit que « l'absence de toute sanction est souvent l'une des plus grandes difficultés qui s'oppose à l'intelligence du droit brehon. » C'était aux parties à exécuter elles-mêmes l'arrêt. R. von Jhering nous fait voir aussi, dans le droit romain, « une époque où la partie réalise elle-même son droit ». Sir Henry Sumner Maine, Etudes sur l'anc. droit et la cout. prim., trad. franc., p. 521: « Le respect de leurs prescriptions [des cours de justice] est tellement passé dans nos mœurs... que les tribunaux ont rarement besoin de recourir à la contrainte matérielle, pour se faire obéir... Sans doute la force est toujours au service du droit, mais on la tient en réserve, sous une forme pour ainsi dire condensée, qui permet de la soustraire aux regards. »
465 Comment se résoudra la question sociale, Paris, 1896.
466 Cet auteur, II, p. 608, trad. franc., cite une chanson faite après la révolte des paysans:
On nous avait dit: Vous deviendrez riches,
Vous serez heureux, considérés!
On nous avait promis cent félicités;
C'est ainsi qu'on nous a égarés!
Sommes-nous devenus riches?
Oh! que Dieu ait pitié de nous!
Le peu que nous avions, nous l'avons perdu!
C'est maintenant que nous sommes pauvres!
On pourra peut-être chanter encore quelque chose de semblable après la révolution sociale qui se prépare actuellement.
De Goncourt, Hist. de la soc. franc. pendant le Directoire, p. 394: » La voilà réalisée par les destins moqueurs, au delà même de la pensée du prophète, la prophétie de Dumouriez, « qu'une nouvelle aristocratie allait remplacer celle de la monarchie »... Qu'un petit avocat à brevet ait amassé quinze ou dix-huit millions, que le républicain, père de quatre enfants, mette dans la corbeille de mariage d'une de ses filles huit cent mille livres; que, sortant du Directoire, le républicain emporte pour ses galas futurs un service de porcelaine de douze mille livres... » Ces sensibles humanitaires s'entendaient à jouir de la vie.
Ph. Buonabroti, Conspiration pour l'égalité dite de Babœuf, se plaint fort du joug que la nouvelle élite jacobine avait imposé au peuple, p. 48: « Dès que le gouvernement révolutionnaire fut passé entre les mains des égoïstes, il devint un véritable fléau public. Son action... démoralisa tout; elle rappela le luxe, les mœurs efféminées et le brigandage; elle dissipa le domaine public... C'était au maintien de l'inégalité et à l'établissement de l'aristocratie que tendaient évidemment, à cette époque, les efforts du parti dominant. » p. 66: « Après le combat du 13 vendémiaire, ceux que l'amour de l'égalité avait menés à la victoire, sommèrent les chefs de cette journée de tenir la promesse qu'ils avaient faite de rétablir les droits du peuple: ce fut en vain.»
Si les amis de Buonarrotti étaient arrivés au pouvoir, d'autres auraient dit d'eux ce que Buonarroti dit des gens qui gouvernaient, ce que Jules Guesde dit des socialistes arrivés au pouvoir en 1900.
467 Il faudrait un volume- pour citer tous les exemples. En voici un des plus récents. P. Kropotkine, La conquête du pain, Paris, 1894, p. 65: « Si la prochaine révolution doit être une révolution sociale, elle se distinguera des soulèvements précédents, non seulement par son but, mais aussi par ses procédés... Le peuple se bat pour renverser l'ancien régime: il verse son sang précieux. Puis, après avoir donné le coup de collier, il rentre dans l'ombre. Un gouvernement composé d'hommes plus ou moins honnêtes se constitue, et c'est lui qui se charge d'organiser. »
468 Voyez G. Ferrero, L'Europa giovane.
469 Tout le monde connaît ce que dit Ammien Marcellin, XXVII, 3, à propos de l'élection de l'évêque de Rome: « Je ne m'étonne pas, quand je considère l'importance de cette dignité, à Rome, que les compétiteurs la recherchent aussi avidement. Celui qui l'obtient est sûr de s'enrichir des larges oblations des matrones, etc. » Une constitution de Julien, Cod. Theod., XII, 1, 50, ordonne de ramener à la curie les décurions qui tentaient de s'y soustraire en devenant membres du clergé.