Gustave de Molinari,
L’évolution économique du XIXe siècle: théorie du progrès (1880)
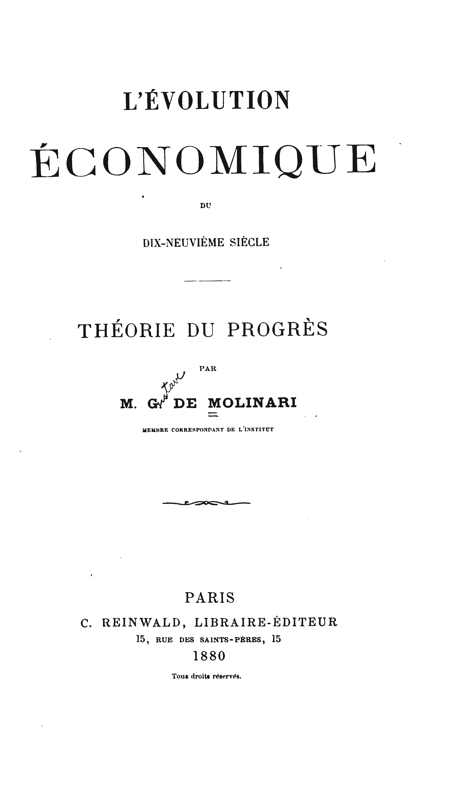 |
 |
This is an e-Book from The Digital Library of Liberty & Power <davidmhart.com/liberty/Books> |
Source
Gustave de Molinari, L’évolution économique du XIXe siècle: théorie du progrès (Paris: C. Reinwald 1880).
Editor's Note
Date created: 12 April, 2021
Revised: 7 Dec., 2022
To make this edition useful to scholars and to make it more readable, I have done the following:
- I have inserted the page numbers of the original edition
- I have not split a word if it has been hyphenated across a new page (this will assist in making workd searches)
- I have inserted unique paragraph ID numbers in the text
- I have retained the spaces which separate sections of the text
- I have created a "blocktext" for large quotations
- I have placed the footnotes at the end of the book
TABLE DES MATIÈRES.
- Préface i
- PREMIÈRE PARTIE. La grande industrie et la concurrence.
- SECONDE PARTIE. Développement historique de l'évolution.
- Chapitre V. Mécanisme du gouvernement de l'homme et de la société. 139
- — VI. Le passé 174
- — VII. - (suite) 206
- — VIII. Le présent 253
- — IX. L'avenir. — La production 309
- — X. — La distribution 344
- — XI. — La consommation 385
- — XII. Conclusion 439
- Notes.
PREFACE
[i]
Supposons que les expositions périodiques de l'industrie, au lieu de dater d'un siècle à peine, remontent à un millier d'années, et que nous possédions la série des comptes rendus illustrés de ces exhibitions des produits du travail de l'homme, nous ne trouverions, surtout dans la galerie des outils et des machines, que bien peu de changements jusque vers la fin du dix-huitième siècle. Le rouet de la fileuse demeurait tel qu'il était au temps où la chaste Lucrèce méritait ce compliment du poète:
Elle vécut chez elle et fila de la laine.
Le métier du tisserand battait comme à l'époque où Aristote disait que l'esclavage serait nécessaire jusqu'à ce que la navette marchât seule; la charrue n'avait guère été perfectionnée depuis Triptolème et l'on n'avait pas dépassé les Romains dans l'art de construire des routes. Mais voici tout à coup que le [ii] mouvement succède à l'immobilité, et qu'en moins d'un siècle un nouveau matériel, d'une puissance extraordinaire, s'improvise et prend la place de l'antique outillage. La machine à vapeur fait son apparition bientôt suivie de celle des métiers mécaniques, puis viennent les bateaux à vapeur, les chemins de fer, la télégraphie électrique, les machinesoutils, les locomobiles et les machines agricoles : on sème, on moissonne, on bat le grain par des procédés mécaniques et on commence à labourer à la vapeur. Aucune branche de travail n'échappe à l'invasion irrésistible du progrès, et cette transformation de la machinery de la production en détermine une autre, non moins considérable, dans l'économie des entreprises : la manufacture remplace le petit atelier, et les ressources individuelles ne pouvant plus suffire à l'établissement et à la mise en œuvre de l'outillage colossal de la nouvelle industrie, on a recours à l'association des capitaux et au crédit; on invente l'action et l'obligation au porteur : en moins d'un demi-siècle, la seule industrie des chemins de fer détermine la création de près de 100 milliards de valeurs mobilières. L'accroissement de la puissance des moyens de production et de transport élargit les débouchés, et, malgré les obstacles que leur oppose un régime économique suranné, les échanges internationaux qui se comptaient naguère par millions se chiffrent maintenant par milliards. Cet agrandissement de la sphère des échanges substitue la [iii] concurrence au monopole et établit entre les peuples une dépendance et une solidarité réciproques. Les conditions d'existence des sociétés sont changées. Une ère nouvelle a commencé dans l'histoire du monde.
Quelle impression une transformation si prodigieuse et, en même temps, si inattendue, car, à part quelques rêveurs, nul ne l'avait prévue, a-t-elle faite sur les esprits? Cette impression a été singulièrement confuse, et, en tous cas, très mélangée. La classe lettrée qui donnait le ton aux autres avait puisé dans l'étude de l'antiquité un certain mépris pour les arts matériels, et il lui répugnait de croire que des changements, si importants qu'ils fussent, dans la manière de fabriquer les étoffes, de fondre le fer, d'extraire le charbon, et même de transporter les hommes et les marchandises, pussent exercer une influence déterminante sur les destinées de l'homme. D'ailleurs, il ne semblait pas que ces changements fussent possibles, en dehors d'une sphère assez bornée. On était bien convaincu, par exemple, que l'agriculture échapperait toujours, en vertu de sa nature particulière, à l'action du progrès industriel, et, au moment où nous écrivons, on considère encore généralement comme une utopie l'idée de mobiliser la propriété foncière. A la veille du premier voyage du Sirius. les savants démontraient l'impossibilité de l'application de la vapeur à la navigation transatlantique, et les hommes politiques les plus éminents n'attribuaient pas aux chemins de fer beaucoup plus [iv] d'importance qu'aux montagnes russes. Les âmes religieuses s'effrayaient volontiers de l'encouragement que l'augmentation de la production allait donner aux appétits matériels, et elles n'étaient pas éloignées d'attribuer à l'influence du démon les progrès de la science et de l'industrie. Dans un mandement demeuré célèbre, l'archevêque de Besançon n'affirmait-il pas que les chemins de fer avaient été inventés pour punir les aubergistes qui donnaient à manger gras le vendredi? Si, dans les couches supérieures de la société, on appréciait avec tant de légèreté, et parfois d'une manière si étrange, les merveilleuses productions du génie des inventeurs, comment la foule des ignorants leur aurait-elle assigné leur véritable portée? Comment les ouvriers, que les métiers mécaniques privaient de leur travail accoutumé et dont la concurrence commençait par abaisser les salaires, n'auraient-ils pas brisé les machines et maudit la concurrence? Comment, enfin, les socialistes auraient-ils pu faire écouter leurs critiques et populariser leurs systèmes s'ils ne les avaient point accommodés à l'ignorance et aux préjugés de la multitude?
Il importe cependant, au plus haut point, que l'on ne se méprenne point sur la valeur et la portée d'un ensemble de phénomènes qui ont déjà profondément modifié les conditions d'existence des sociétés et qui sont destinés, selon toute apparence, à les modifier davantage encore. L'opinion est une force, et quoiqu'elle n'ait point, sur l'arrangement des choses [v] humaines et la direction des sociétés, l'influence toute puissante que ses courtisans lui attribuent, elle possède une sphère d'action qui va s'étendant chaque jour; elle peut retarder des progrès nécessaires en s'obstinant à conserver des institutions vieillies, ou bien encore en s'engouant pour des idées fausses et en s'efforçant de les appliquer jusqu'à ce que l'expérience en ait fait justice; elle peut, au contraire, en accordant son appui à des vérités nouvelles, hâter l'avènement d'un meilleur état de choses. Supposons, par exemple, qu'elle acquière une notion plus exacte du progrès industriel et de ses conséquences, qu'elle le considère, non seulement comme le véhicule indispensable du bien-être matériel, mais encore comme la condition sine quâ non du progrès moral; supposons que la concurrence, tant calomniée, lui apparaisse sous son vrai jour, à la fois comme le stimulant énergique et nécessaire de la production et le régulateur, merveilleusement simple et efficace, de la distribution de la richesse; supposons, enfin, que l'opinion sache, d'une manière positive, où est la vérité et où est l'erreur, en matière de progrès économique, ne mettra-t-elle pas toujours la puissance dont elle dispose au service de la vérité, au lieu de la mettre, comme elle le fait trop souvent, au service de la routine ou de l'utopie?
Analyser l'ensemble des phénomènes de l'Évolution à laquelle nous assistons; en étudier le développement et la direction, sans oublier les perturbations [vi] auxquelles ils ont donné lieu, montrer les changements qu'ils ont déterminés dans les conditions d'existence de l'homme et de la société, et en déduire ceux qu'ils sont destinés à déterminer encore, à mesure que l'Évolution avancera dans son cours; réconcilier ainsi avec le progrès ceux qui le redoutent, faute de le connaître, ramener ceux qui le cherchent sur une fausse piste, voilà la tâche que nous nous sommes proposée. Nous ajouterons que cette tâche ne pouvait guère être entreprise plus tôt, car c'est seulement depuis trente ou quarante ans que l'on a commencé à voir se produire quelques-uns des phénomènes les plus considérables de l'Évolution économique — la transformation des moyens de communication, la multiplication des valeurs mobilières, le développement du commerce international, l'unification des marchés — et qu'il a été possible d'en apprécier les conséquences.
Dans la première partie de cette étude[1] nous avons analysé la grande industrie et la concurrence, puis nous avons examiné les premiers effets de l'apparition de ces deux phénomènes, en essayant de les rattacher à leurs causes. Dans la seconde partie, nous nous sommes proposé, à la fois, de rechercher les origines de l'Évolution et d'esquisser le nouvel ordre de choses qu'elle est destinée à établir.
[vii]
Sans doute, au point où en est aujourd'hui la science, on ne saurait prédire la marche des sociétés comme on prédit celle des astres. Cependant, nous sommes déjà en mesure d'affirmer, en nous appuyant sur des données positives, que l'humanité ne retournera pas en arrière et qu'elle n'ira pas davantage où les socialistes, les communistes et les nihilistes ont la prétention de la conduire. Elle suit sa voie et il ne dépend d'aucun système et d'aucun homme de l'en faire dévier, car le mouvement auquel elle obéit est la résultante de tous les progrès qu'elle a accomplis depuis son origine.
I. LA GRANDE INDUSTRIE ET LA CONCURRENCE
CHAPITRE I. La grande Industrie.↩
Transformation du matériel et des procédés de la production sous l'influence de l'application de la science à l'industrie. — Que cette transformation est encore à ses débuts. — Qu'elle se poursuivra jusqu'à ce que la force physique de l'homme ait été entièrement remplacée par des moteurs mécaniques ou des agents chimiques. — Conséquences de cette transformation.
Après être demeuré presque stationnaire pendant des milliers d'années, le matériel de la production a commencé à se transformer, grâce à l'application de la science à l'industrie. Cette transformation date déjà de plusieurs siècles: on pourrait dire qu'elle a débuté par l'invention des armes à feu, qui a renouvelé le matériel de guerre, mais c'est depuis l'invention de la machine à vapeur qu'elle s'est accélérée, en s'étendant successivement à la plupart des branches de l'industrie humaine : bornons-nous à citer, parmi les plus importantes, les industries textiles et, en particulier, la fabrication des étoffes de coton et de laine, la métallurgie, l'extraction de la houille, les transports [2] par terre et par eau (chemins de fer et bateaux à vapeur), la télégraphie, l'imprimerie, dont les presses, mues par la vapeur, ont récemment centuplé la puissance, la fabricacation des machines et des outils, etc., etc. Dans la production agricole, la transformation du matériel et des méthodes a commencé plus tard, mais elle va se développant chaque jour; l'agriculture est entrée à son tour dans les voies de la grande industrie; on peut en dire autant des établissements, des procédés et des instruments servant à la circulation et aux échanges; le crédit et le commerce se sont établis sur un plan plus vaste; bref, presque aucune des branches du travail humain n'est demeurée stationnaire. Cependant, cette transformation en est encore à ses débuts. Jusqu'où sera-t-elle poussée? On peut affirmer qu'elle ne s'arrêtera, dans les ramifications de plus en plus nombreuses de la production, qu'au point où, dans l'opération productive, un moteur mécanique ou un agent chimique cesse de pouvoir suppléer à l'action d'une force intelligente; mais ce point est beaucoup plus éloigné qu'on ne l'avait supposé d'abord. Combien de machines ou de procédés chimiques exécutent des œuvres qui paraissaient naguère exclusivement du ressort de l'intelligence! En tous cas, l'expérience nous autorise pleinement à affirmer que, dans toutes les fonctions et opérations où la force physique de l'homme est employée comme moteur, elle peut être remplacée par un agent mécanique ou un procédé chimique, de manière à ne laisser à l'homme qu'une besogne de direction ou de surveillance. Or, si l'on considère l'état actuel d'avancement de l'ensemble des branches de la production, on se convaincra qu'une multitude infinie de progrès sont encore à réaliser ou à propager avant que cet objectif soit atteint, mais, d'un autre côté, il est permis d'affirmer aussi qu'il peut être atteint et qu'il le sera.
[3]
Quelles sont les conséquences de ce grand phénomène? Ces conséquences sont nombreuses et diverses. Nous nous contenterons d'examiner les plus importantes, au double point de vue économique et social. On peut les résumer ainsi : 1° augmentation de la puissance productive de l'homme; 2° transformation et élévation de la nature du travail productif; 3° changement de la proportion requise du travail et du capital dans la production; 4° agrandissement et transformation du mécanisme des entreprises; 5° extension illimitée de la sphère des échanges impliquant la solidarisation indéfinie des intérêts; 6° généralisation de la concurrence, devenue à la fois le régulateur de la production et de la distribution de la richesse.
Essayons d'en donner une idée, par une analyse aussi succincte que possible.
I. — Augmentation de la puissance productive de l'homme. — En quoi la force mécanique est supérieure à la force physique de l'homme comme moteur de la production. — Exemples: la mouture du blé, la machine à coudre, l'imprimerie, la locomotion, la photographie. — Tendance égalitaire du progrès industriel.
Lorsque l'homme était réduit à demander sa subsistance aux industries primitives de la récolte ou, pour nous servir de l'expression consacrée, de la cueillette des fruits naturels du sol, de la chasse et de la pèche, la nécessité de pourvoir aux premiers besoins de la vie et de se défendre avec des armes grossières contre les animaux et les hommes de proie, absorbait presque entièrement son activité. Sa puissance productive était alors au minimum. Les découvertes et les inventions qui ont successivement donné naissance à l'agriculture et aux premiers arts l'ont accrue dans une proportion considérable, en mettant à son service des forces et des agents productifs empruntés à la nature. Cependant, dans cette seconde période de l'industrie humaine, la force physique de l'ouvrier [4] n'en est pas moins demeurée, dans le plus grand nombre des branches de l'activité sociale, le principal moteur de la production. Or, cette force est à la fois coûteuse et bornée. En comparant les frais de production de la force physique dans les contrées où la subsistance et l'entretien de l'homme considéré et employé comme une simple bête de somme coûtent le moins cher, à ceux de la force mécanique dans les régions où elle peut être produite dans les conditions les plus économiques, on trouve qu'un kilogrammètre de force provenant de la consommation de substances végétales ou animales revient à un prix incomparablement plus élevé qu'un kilogrammètre de force obtenue par la mise en œuvre d'une chute d'eau ou par l'emploi d'une machine alimentée au moyen du bois et du charbon de terre.[2] En outre, la force mécanique peut être produite et appliquée sur un point donné en plus grande quantité et avec plus d'intensité que ne peut l'être la force physique. Quelques milliers de portefaix pourront bien transporter autant de marchandises et de voyageurs qu'une locomotive, mais non point avec une vitesse égale. La substitution de la force mécanique à la force physique n'a donc pas seulement augmenté en quantité la puissance productive de l'homme, elle l'a augmentée encore en intensité et en efficacité.
Depuis la naissance de la civilisation, c'est-à-dire depuis l'avènement de l'agriculture et des premiers arts, cette substitution d'une force productive supérieure et à bon marché à une force inférieure et chère, s'est opérée [5] graduellenient et presque sans interruption. On peut certainement constater un progrès marqué à cet égard en comparant l'outillage des antiques civilisations de l'Inde, de l'Assyrie et de l'Egypte, à celui de l'Europe civilisée, au commencement du dix-huitième siècle. Cependant, dans un grand nombre de branches de travail, et surtout dans la plus importante de toutes, l'agriculture, le changement est demeuré presque insignifiant : à la fin, aussi bien qu'au début de cette immense période qui constitue l'ère de la petite industrie, le travail physique apparaît comme le principal moteur de la production. Il en a été autrement depuis l'apparition de la machine à vapeur, et de cette multitude d'inventions mécaniques et d'applications chimiques qui ont ouvert l'ère de la grande industrie : à dater de ce moment, la substitution de la force mécanique à la force physique s'est opérée avec une rapidité progressive, et ce mouvement ne s'arrêtera, selon toute apparence, que lorsque celle-ci aura complètement cédé la place à celle-là. C'est pourquoi on est fondé à dire que l'avènement de la grande industrie marque dans la vie de l'humanité une évolution pour le moins aussi importante que celle qui a eu pour point de départ la création de l'agriculture et des premiers arts, se substituant aux procédés rudimentaires à l'aide desquels les hommes des âges primitifs pourvoyaient à l'entretien de leur existence.
M. Michel Chevalier s'est occupé spécialement, comme on sait, de la différence de productivité de l'industrie humaine dans ces deux périodes, et cette différence est énorme. Il l'évalue de 1 à 150 pour la mouture du blé, et à un chiffre plus élevé pour la filature et le tissage des étoffes. La fabrication des tricots fournit un exemple plus saisissant encore : une femme, habile à tricoter à la main, fait 80 mailles par minute; avec le métier circulaire, elle peut en faire 480,000 : la progression est de 1 à [6] 6,000. Citons enfin l'exemple de la machine à coudre: « D'après MM. Wheeler et Wilson, de New-York, il faudrait, pour confectionner une chemise d'homme quatorze heures vingt-six minutes du travail d'une couturière; il suffit d'une heure seize minutes avec la machine. Celle-ci faisant 640 points à la minute dans la toile fine, une ouvrière n'en fait que 23, vingt-huit fois moins. » [3]
Ces exemples, que nous pourrions aisément multiplier, suffisent pour montrer dans quelle énorme proportion s'est accrue la puissance productive dans les branches d'industrie que le progrès a transformées. Il serait intéressant toutefois de calculer aussi exactement que possible cet accroissement dans chacune. On s'expliquerait mieux alors le développement extraordinaire de la production, depuis un siècle, dans les pays où la grande industrie s'est implantée. On pourrait se rendre compte aussi, en considérant les branches de travail, encore si nombreuses, qui ont été à peine touchées par le progrès, de l'accroissement possible de production, et, par conséquent, de richesse qui reste à réaliser et qui se réalisera à mesure que s'accomplira la nouvelle évolution industrielle.
Quoique bien des causes agissent de nos jours pour ralentir cette évolution, sinon pour l'arrêter — guerres, révolutions, système prohibitif, crises de tous genres — elle poursuit son cours avec une accélération continue de mouvement, elle le poursuit à la fois en avançant et en s'étendant. Dans les pays qui tiennent la tête de la civilisation industrielle, le nombre des inventions et des découvertes nouvelles s'augmente chaque année — la statistique des brevets suffirait, au besoin, pour l'attester à défaut d'autres témoignages;[4] — ce qui veut dire que la [7] petite industrie cède de plus en plus la place à la grande, tandis que, d'une autre part, on voit cet outillage perfectionné s'imposer aux nations les moins avancées, et même à celles qui paraissaient vouées à une immobilité séculaire.
Dégageons maintenant le résultat essentiel de ce phénomène. Ce résultat, déjà suffisamment visible, c'est l'accession progressive de tous les membres des sociétés humaines, y compris les plus humbles, aux biens et aux jouissances de la civilisation, demeurés, jusqu'à nos jours, le monopole d'une faible minorité; c'est l'universalisation de ces biens et de ces jouissances, allant de pair avec leur accroissement spécifique. C'est une pyramide dont la base s'élargit en même temps que sa hauteur s'accroît. Citons encore quelques exemples. Avant l'invention de l'imprimerie, en admettant que tous les membres des sociétés civilisées eussent éprouvé le besoin d'une culture intellectuelle, il eût été impossible de multiplier les manuscrits de façon à mettre à la disposition de cette multitude les matériaux de l'instruction. A plus forte raison, n'auraiton pu leur fournir tous les jours, et pour ainsi dire à toute heure, des informations sur les faits et les événements qui se produisent dans les diverses régions du globe. [8] Cette double impossibilité, l'imprimerie et la presse, aidées des chemins de fer, de la poste et du télégraphe, l'ont fait disparaître. Déjà, nous pouvons constater que, dans les pays où la grande majorité de la population sait lire: aux États-Unis, en Suisse, en Allemagne, l'imprimerie suffit, et au delà, pour subvenir au besoin généralisé de la lecture. La presse, de son côté, est outillée de manière à alimenter la consommation la plus étendue : informations politiques, économiques, commerciales, scientifiques, artistiques, etc.; elle fournit en abondance, et à un bon marché extraordinaire, tout ce qui peut intéresser l'esprit ou piquer la curiosité. C'est l'alimentation intellectuelle rendue quotidienne et universalisée. Sous le rapport de la quantité, la production intellectuelle, aidée du puissant instrument de propagation que l'industrie perfectionnée a mis à son service, peut suffire dès à présent à tous les besoins; quant à la qualité, elle dépend de l'état du goût, des mœurs du consommateur; elle commence naturellement par être très basse; elle se raffine à mesure que le goût se purifie et que les mœurs se polissent. — Avant l'invention et la multiplication des bateaux à vapeur et des chemins de fer, les voyages, surtout à de longues distances, étaient le privilège presque exclusif des classes riches et de leur domesticité. Aujourd'hui, ils sont à la portée des classes les plus pauvres. En outre, quelque grande que fût sa fortune, un voyageur ne pouvait, il y a un siècle, dépasser 15 ou 20 kilomètres à l'heure; maintenant riches et pauvres indistinctement voyagent à raison de 40, 50 et 60 kilomètres. Avant l'établissement de la poste aux lettres, ceux-là seulement qui avaient les moyens de voyager eux-mêmes ou d'expédier des messagers, pouvaient entretenir des relations régulières avec leurs parents, leurs amis ou leurs clients éloignés. Grâce à la poste, les rapports se sont à la fois régularisés et généralisés, [9] et la réforme postale a donné toute son efficacité à cet instrument de communication. Un ouvrier anglais reçoit maintenant une lettre d'Australie pour une somme insignifiante, et en moins de temps qu'il n'en fallait, il y a un siècle, à un lord pour recevoir, à Londres, un message venant d'Ecosse ou d'Irlande. Depuis l'invention de la télégraphie électrique, le progrès est devenu, sous ce rapport, encore bien autrement saisissant et décisif. Moyennant une somme relativement modique, et qui sera un jour réduite autant que l'a été la taxe des lettres par la reforme de Rowland Hill, riches et pauvres peuvent recevoir des nouvelles dans un espace de temps cent fois, mille fois moindre que celui dans lequel les plus puissants monarques de la terre, servis par les plus agiles courriers, recevaient les leurs. — Avant l'invention de la photographie, les privilégiés de la fortune pouvaient seuls obtenir la reproduction de leur image, encore cette reproduction péchait-elle toujours, sinon par le mérite artistique, du moins par la fidélité. La photographie l'a mise à la portée du grand nombre, en la perfectionnant à l'avantage de tous.
Si nous appliquions le même procédé d'analyse aux innombrables inventions et découvertes qui sont à l'œuvre, principalement depuis un siècle, pour transformer le matériel de la production, nous arriverions toujours au même résultat, savoir à l'accroissement de la productivité de l'industrie, impliquant l'accession possible de tous les membres des sociétés civilisées aux biens et jouissances réservés auparavant à une petite minorité.
Aussi, a-t-on pu dire avec raison que la tendance naturelle du progrès industriel est à l'égalité. Cependant, si le progrès élève la condition de la majorité, ce n'est pas en abaissant celle de la minorité. Au contraire! La part de la minorité dans les fruits du progrès s'accroît moins que celle de la majorité, mais elle s'accroît. Pour reprendre [10] l'exemple que nous avons cité, l'ouvrier qui reçoit une dépêche télégraphique se trouve, en ce qui concerne la transmission des nouvelles, élevé au même niveau que le millionnaire; mais la situation du millionnaire s'en trouve-t-elle amoindrie? Non, elle s'est améliorée, puisque le télégraphe lui apporte les nouvelles avec plus de célérité que ne pouvaient le faire les agents de transmission dont il se servait auparavant. L'ouvrier a gagné à ce progrès plus que le millionnaire, mais celui-ci y a gagné de son côté. On peut donc affirmer que l'augmentation de la puissance productive de l'homme, déterminée par la transformation progressive de l'industrie, a pour conséquence naturelle de diminuer l'inégalité des conditions, tout en les élevant.
II. — Transformation et élévation de la nature du travail productif.— Que le progrès industriel exonère l'homme de la servitude du travail physique pour lui demander seulement le concours de son intelligence et de ses facultés morales. — Exemples : l'industrie des transports, le métier des armes et la guerre. — Que les armes à longue portée exigent chez le soldat moins de courage physique et plus de force morale. — Augmentation de la responsabilité résultant de l'agrandissement du matériel de la production. — Conséquences de l'élévation de la nature du travail. — Développement des facultés intellectuelles et morales.
Le travail à l'aide duquel l'homme pourvoit à sa subsistance et à son entretien commence par être d'une nature presque exclusivement physique, l'intelligence n'y intervient que dans une proportion très faible. Si une certaine dose d'intelligence est nécessaire pour découvrir le gibier, en apprenant à connaître ses habitudes, il faut surtout de la force musculaire pour l'atteindre et le frapper, du coup d'œil et de la dextérité avec l'art de lui tendre des pièges. La force et la ruse, voilà les qualités qu'utilisait principalement le chasseur, armé d'un épieu ou d'un arc, et ces qualités ne diffèrent pas, d'une manière sensible, de celles que déploient les animaux carnassiers. Lorsque [11] l'agriculture et les premières industries apparaissent, c'est encore la force physique qui demeure le grand moteur de la production. Sans doute, la direction des travaux productifs exige alors l'application de l'intelligence. Les hommes qui répandaient la fécondité dans la région du Tigre et de l'Euphrate et dans la péninsule de l'Inde, en y établissant d'immenses et ingénieux réseaux d'irrigation, qui réglaient les inondations du Nil, qui construisaient les palais et les édifices de Ninive, de Babylone, de Thèbes, de Karnak, mettaient en œuvre leurs facultés intellectuelles; mais cette classe dirigeante de la production a été, dès l'origine, ce qu'elle est restée de nos jours : une infime minorité en comparaison de la multitude qui obéissait à ses ordres et exécutait ses plans.
Maintenant, de quelle façon procède le progrès? Il procède, comme nous l'avons constaté plus haut, par la substitution successive, et de plus en plus complète, du travail des agents mécaniques ou chimiques au travail physique de l'homme, en ne laissant finalement à celui-ci que des fonctions de direction et de surveillance. Or, en vertu de leur nature propre, ces fonctions exigent presque exclusivement la mise en œuvre des pouvoirs de l'intelligence, et elles n'utilisent que d'une manière accessoire la force des muscles. Si l'on étudie à ce point de vue les différentes industries que le progrès a jusqu'à présent, et à des degrés divers, transformées, on obtiendra invariablement ce résultat : remplacement, dans les travaux productifs, de l'effort physique par l'effort intellectuel dirigeant l'emploi de forces mécaniques ou chimiques. Dans l'industrie de la locomotion, par exemple, ce phénomène est particulièrement sensible, et nous avons eu l'occasion de le signaler ailleurs en analysant la part du travail dans la production:
« Si nous examinons, disions-nous, l'industrie de la [12] locomotion à ses différentes périodes de développement, nous serons surpris de l'étendue et de la portée des transformations que le travail, dont elle exige le concours, a subies sous l'influence du progrès. A l'origine, c'est l'homme lui-même qui transporte les fardeaux en mettant en œuvre sa force musculaire. Il en est encore ainsi dans certaines parties de l'Inde, où les bras et les épaules des coulis sont les seuls véhicules en usage pour transporter les voyageurs aussi bien que les marchandises. Mais l'industrie de la locomotion vient à progresser. L'homme dompte le cheval, l'âne, le chameau, l'éléphant, et il les assujettit à porter des fardeaux; il invente encore la charrette, la voiture, le navire. Aussitôt, la nature du travail requis pour le transport des hommes et des marchandises se modifie. La force musculaire ne suffit plus; elle ne joue même plus qu'un rôle secondaire dans l'industrie des transports; le premier rôle appartient désormais à l'adresse et à l'intelligence. Il faut plus d'adresse et d'intelligence que de force physique pour guider un cheval, un âne, un chameau, un éléphant, pour conduire une voiture ou une charrette, pour diriger un navire. Survient enfin un dernier progrès. La vapeur est appliquée à la locomotion. La locomotive, avec ses longues files de wagons, se substitue au cheval, à la charrette, à la diligence; le bateau à vapeur prend la place des navires à voiles. La fonction du travailleur dans l'industrie des transports acquiert, par suite de cette nouvelle transformation, un caractère intellectuel plus prononcé. Les employés des chemins de fer ont à déployer plus d'intelligence et moins de force physique que les voituriers, messagers, etc., qu'ils ont remplacés. Dans l'industrie des transports par eau, l'intervention de la vapeur a supprimé l'outillage humain qui était employé à manœuvrer l'appareil moteur des navires, les mâts, les voiles, les cordages, etc. A cet appareil, qui nécessitait [13] encore l'application d'une certaine quantité de force musculaire, la vapeur substitue une machine dont les servants, chauffeurs ou mécaniciens, n'ont guère à faire œuvre que de leur intelligence » .[5]
Si nous passons de l'industrie des transports aux industries textiles, nous constaterons le même phénomène. La filature à la main demandait, avant tout, l'application de la force physique de l'ouvrier et de l'ouvrière, avec une très faible dose d'attention. Le métier à filer self acting n'exige, au contraire, de l'ouvrier aucun effort physique; en revanche, il est obligé d'avoir l'esprit constamment alerte et tendu pour surveiller le travail de la machine. Le tricot à la main est une opération que l'habitude rend purement machinale, mais qui implique une dépense continue, quoique minime, de force musculaire. La machine à tricoter remplace le travail physique par un travail mécanique bien autrement productif, en demandant à l'ouvrière chargée de la diriger une tension nerveuse au lieu d'un effort des muscles. On peut en dire autant de la couture à la mécanique substituée à la couture à la main. A la vérité, les machines à coudre, généralement en usage, sont mises en mouvement par le pied de l'ouvrière pesant sur une pédale; mais ce moteur physique commence à être remplacé, dans les ateliers à couture, par un moteur mécanique. Dans l'industrie du tissage, même transformation. Le métier à tisser à la main était mû par le pied de l'ouvrier, dont le bras lançait la navette. Dans le tissage à la mécanique, l'ouvrier se borne à diriger et à surveiller le travail de la machine.
Même changement encore dans la nature des travaux de l'agriculture sous l'influence des machines et des procédés de la grande industrie. On ne pourrait pas citer une seule [14] opération agricole dans laquelle le progrès industriel n'ait diminué la part du travail physique au profit de celle du travail intellectuel. Manier la bêche, conduire la charrue, faucher, vanner et battre le grain sont des opérations qui exigent une dépense considérable et presque exclusive de force musculaire; le corps s'y fatigue plus que l'esprit. Labourez, moissonnez, videz les épis à la vapeur, et votre personnel agricole n'aura plus qu'à diriger et à surveiller le travail des agents mécaniques, avec un minimum de dépense de force physique. Aucune transformation de la machinery de la production ne fait exception à cette loi. Si l'effort musculaire n'est pas supprimé complètement, il est amoindri, et l'on peut même mesurer l'étendue du progrès accompli par la diminution de la quantité de force physique requise.
Sans doute, dans la grande majorité des branches de la production, la part du travail physique est demeurée prépondérante; mais les industries encore en retard se tranformeront à leur tour, on peut même affirmer que leur transformation est inévitable, puisque l'homme, considéré comme un simple moteur, est inférieur, sous le double rapport de la puissance et du bon marché, aux moteurs mécaniques. Sa supériorité réside seulement dans son intelligence, qu'aucune machine ne peut emprunter, et, comme il n'est point d'opération productive qui puisse s'effectuer sans direction ni surveillance, il faudra toujours joindre au matériel le plus parfait un personnel pourvu de l'intelligence et des connaissances ou de la pratique spéciales, nécessaires pour le mettre en œuvre. En dernière analyse, le progrès consiste à demander de plus en plus à ce personnel l'espèce de concours qu'il peut seul apporter — celui de sa force intellectuelle — et, comme nous le verrons tout à l'heure aussi, de ses facultés morales, tout en réduisant au minimum la coopération de [15] sa force physique, que la force mécanique remplace avec une économie notoire et une efficacité incomparable.
Nous ne connaissons, disons-nous, aucune industrie qui fasse exception à cette loi. Nous opposera-t-on le métier des armes et la guerre? En jetant un simple coup d'œil sur les tranformations du matériel de guerre, nous nous apercevrons que le rôle de la force musculaire et des autres qualités physiques a progressivement diminué dans les combats, tandis que celui de l'intelligence et la force morale n'a cessé de croître.
A l'origine, les hommes se battent avec des massues, des lances ou des javelots, et ils se joignent le plus souvent corps à corps; les luttes guerrières ont un caractère purement physique, et les combats des hommes ne diffèrent pas sensiblement de ceux des animaux : le plus fort, le plus agile, le plus rusé obtient la victoire. Telles sont les qualités qui distinguent particulièrement les héros d'Homère, et qui constituent dans cet âge reculé les éléments de la valeur militaire. On pourrait remarquer, à ce propos, que la valeur est également composée d'utilité et de rareté, soit qu'il s'agisse des travaux de la guerre ou de ceux de la paix. La valeur d'un homme de guerre est le produit des qualités à la fois utiles et rares, qu'il déploie dans la lutte; elle dépend, aussi bien que celle des agents productifs, de l'accumulation plus ou moins grande de ces qualités. — Mais voici que les armes qui frappent à distance : l'arc, la fronde, l'arbalète, puis les armes à feu, sont inventées. Aussitôt, les qualités nécessaires à l'homme de guerre changent de nature. La prépondérance originaire de la force et même du courage physique s'efface à mesure que les armes de jet acquièrent une importance plus marquée en comparaison des autres. A cet égard, l'introduction des armes à feu a été un événement décisif. Au moyen âge, époque où l'art militaire avait subi, [16] comme tous les autres arts, l'influence rétrograde des invasions barbares, la lance, l'épée, la masse d'armes étaient, comme au temps d'Homère, les armes favorites des hommes de guerre, que leurs lourdes armures préservaient d'ailleurs presque entièrement des atteintes des flèches et des autres projectiles. La force et le courage physiques étaient, à cette époque, les qualités militaires les plus prisées, parce qu'elles étaient les plus utiles. Ne fallait-il pas, avant tout, être fort pour supporter le poids de l'armure, manier la lance et asséner de grands coups d'épée ou de masse d'armes? Tout change à l'apparition des armes à feu. On abandonne les armures, qui ne résistent ni au boulet, ni même à la balle; l'arme blanche est reléguée au second plan et, avec elle, la force et le courage purement physiques. Le soldat, dans cette nouvelle phase de l'art militaire, n'a plus à exécuter les efforts violents que comporte la lutte corps à corps : tirer un coup de fusil ou de canon est une opération qui exige une certaine précision de coup d'œil et du sang-froid, mais ce n'est pas un travail de force. Ce changement dans les qualités nécessaires au soldat s'accentue davantage à mesure que le matériel et les procédés de la guerre se perfectionnent. On a soutenu, nous ne l'ignorons pas, que l'introduction des armes à longue portée a diminué, dans les combats, le rôle du courage. C'est précisément le contraire qui est la vérité: le courage est aujourd'hui, plus qu'il ne l'a jamais été, la maîtresse qualité de l'homme de guerre; seulement il a changé de nature.
Constatons d'abord que les armes à longue portée ont déjà rendu et rendront de moins en moins fréquentes les luttes corps à corps, dans lesquelles la force, l'adresse et le courage physiques jouent naturellement le premier rôle. En revanche, leur emploi exige des qualités d'un ordre plus élevé. Sans doute, le soldat doit posséder [17] encore assez de vigueur pour résister aux intempéries et à la fatigue des longues marches, quoique les chemins de fer lui épargnent maintenant l'obligation de franchir les grandes distances; — ce n'est plus à pied, c'est en wagon que les armées des nations civilisées se rendent aujourd'hui sur le théâtre de la guerre; en outre, les nouveaux fusils sont moins lourds que les anciens. Mais les éléments constitutifs de la valeur militaire se sont modifiés. En premier lieu, l'emploi utile des armes perfectionnées exige, à un plus haut degré que celui de l'ancien matériel, l'application des facultés intellectuelles et morales du soldat. Le fusil à tir rapide et à longue portée est une arme délicate en comparaison du vieux fusil; il doit être entretenu avec plus de soin; il exige encore de la part de celui qui le manie, plus de jugement et de possession de soi-même : la rapidité du tir ne dépendant plus du temps nécessaire pour charger le fusil, il faut que le soldat soit assez maître de lui pour éviter d'épuiser sans résultats, par un tir précipité et mal calculé, sa provision de cartouches. La tactique spéciale dont ce nouveau matériel a déterminé l'adoption, savoir l'éparpillement en tirailleurs choissisant eux-mêmes leurs positions et leurs abris, comporte enfin, beaucoup plus que la formation en lignes, la mise en œuvre de l'intelligence unie au sang-froid, lequel est un produit de la force morale. En second lieu, les armes de précision et à longue portée ont singulièrement aggravé le risque auquel le soldat est exposé, et les circonstances mêmes dans lesquelles ce risque est couru. Les anciens fusils portaient à 200 mètres au plus, et le rayon des servitudes, déterminé par le maximum de portée du canon, avait été fixé, du temps de Vauban, à 540 mètres; en outre, canons et fusils manquaient de précision dans le tir. Aujourd'hui, les fusils portent à 1,200 mètres et les canons à 5 ou 6 kilomètres, avec une [18] précision de tir vraiment merveilleuse. Ajoutons — circonstance bien propre à frapper les imaginations — qu'on a affaire le plus souvent à un ennemi invisible. Si l'on veut s'emparer de ses positions — et tel est l'objectif de tout combat — on demeure, pendant tout le temps nécessaire pour franchir le rayon quintuplé ou même décuplé du tir des armes de guerre, exposé à son feu, devenu en outre plus précis et par conséquent plus meurtrier. S'il s'agit, au contraire, d'une position à défendre, il faut — chose peut-être plus difficile encore — supporter, impassible, le feu d'un ennemi qu'on ne voit pas, sans avoir l'excitation que procure la marche en avant et le spectacle de la bataille. Le courage physique demeure ici insuffisant : le sentiment du devoir seul peut avoir toute l'efficacité indispensable pour maintenir le soldat à son poste. Bref, c'est aujourd'hui, plus que jamais, aux armées dont le moral est le mieux trempé, qu'appartient la victoire. Tel est aussi le secret de l'incomparable supériorité du soldat européen sur le guerrier sauvage. La force et le courage physiques du Peau-Rouge, par exemple, sont égaux à ceux du soldat européen, sur lequel il l'emporte par l'agilité et la ruse, mais il possède à un moindre degré la force morale, qui maintient le moindre détachement de soldats civilisés compacte et immobile en présence du danger. Le cavalier Peau-Rouge est capable de se lancer bride abattue sur l'ennemi, comme faisaient les Mame- lucks sur les bataillons carrés de Kléber, mais cet élan fougueux du courage physique, qui venait se briser alors contre l'impassibilité du courage moral, n'aurait-il pas encore moins de chances de l'emporter, maintenant que le courage moral est armé de fusils portant à 1,200 mètres? En revanche, les Peaux Rouges les plus braves sont incapables de soutenir en rase campagne un feu continu; ils ne tardent pas à se débander et à prendre la fuite.
[19]
Ces observations suffisent, croyons-nous, pour démontrer que dans les travaux de la guerre comme dans ceux de la paix, le progrès a pour résultat de réléguer au second plan la force et les autres qualités physiques pour mettre au premier l'intelligence et la force morale.
Signalons enfin une particularité importante de l'agrandissement du matériel de la production : c'est qu'il implique chez l'ouvrier un accroissement corrélatif de responsabilité. Le simple portefaix n'encourt généralement qu'une faible responsabilité, la valeur moyenne du fardeau qu'un homme peut porter n'étant pas bien considérable. De même, le conducteur d'un chariot ou d'une voiture ne peut compromettre, par son incurie et sa maladresse, qu'un petit nombre d'existences, perdre ou gâter qu'une quantité relativement insignifiante de marchandises. Il en est autrement du conducteur d'un train ou même d'un simple aiguilleur; ils peuvent, parle moindre relâchement d'attention ou de surveillance, exposer la vie de centaines de voyageurs et causer la perte d'une valeur de plusieurs millions. Plus la machine, dirigée ou surveillée, est puissante, plus la responsabilité de celui qui la surveille ou la dirige est étendue. Or, la responsabilité implique tout un ensemble de qualités ou de forces morales en activité. Quand ces qualités font défaut ou ne sont point suffisamment actives, quand le travailleur n'a pas le sentiment de la responsabilité qui pèse sur lui ou manque de la vigueur morale nécessaire pour la supporter dans toute son étendue, son attention se relâche, faiblit, la locomotive déraille et le convoi est en morceaux.
Mais cette substitution progressive du travail intellectuel et moral au travail physique, qui apparaît comme la conséquence naturelle de la transformation du matériel et des procédés de l'industrie, est grosse à son tour de conséquences non moins nécessaires et d'une portée [20] considérable. L'homme se développe conformément à la nature de son activité. Si cette activité est purement ou principalement physique, ce qui dominera en lui, c'est la vie physique, et on s'efforcera en vain de le transformer en une créature intelligente et morale. S'il fait, de génération en génération, l'œuvre d'une bête de somme, son niveau intellectuel et moral ne pourra guère, quoi qu'on fasse pour l'instruire et le moraliser, dépasser celui d'une bête de somme. L'esclave, qui passait sa vie à tourner la meule ne devait pas différer sensiblement à cet égard du cheval de manège. De nos jours enfin on observe, entre le manœuvre, l'ouvrier terrassier, le valet de charrue et, en général, les ouvriers agricoles, auxquels on demande presque exclusivement de la force musculaire, et les ouvriers des grandes manufactures, qui travaillent des nerfs plutôt que des muscles, une inégalité intellectuelle des plus marquées. Cette inégalité a visiblement sa source dans la différence des travaux auxquels ils se livrent, et c'est en vain qu'on essayerait de la combler en leur donnant, aux uns et aux autres, la même somme d'instruction. L'instruction n'a de prise que sur l'intelligence, et celle-ci ne se développe qu'à la condition d'être incessamment exercée. Transformez le travail physique en travail intellectuel, et l'intelligence de l'ouvrier croîtra par l'exercice, comme le font les muscles; elle demandera alors à être alimentée, la nourriture de l'esprit deviendra pour l'ouvrier un besoin naturel comme la nourriture du corps. D'où il est permis de conclure que la condition préalable à remplir, pour généraliser avec fruit l'instruction, c'est de transformer la machinery de la production. Aussi longtemps que le travail physique demeurera prédominant, l'éducation intellectuelle et morale de la multitude ne réalisera, quoi qu'on fasse, que des progrès insignifiants : c'est la machine qui est doublement le [21] véhicule de la civilisation dans les masses, d'abord en ce qu'elle permet de multiplier et de mettre à leur portée les produits qui sont les matériaux mêmes de la civilisation, ensuite parce que, en substituant à une activité purement physique une activité intellectuelle et morale, elle élargit la sphère de ce qu'on pourrait appeler les consommations civilisatrices.
Nous n'ignorons pas que nous allons ici à rencontre de préjugés généralement répandus. On vante, par exemple, les travaux de la campagne et, entre tous, ceux de la petite culture, que l'on voudrait généraliser, au nom même du progrès, tandis que l'on n'a pas assez d'anathèmes pour le travail « abrutissant » des grandes manufactures. On accuse la division du travail et les machines d'avoir réduit l'ouvrier lui-même à la condition d'une simple machine. C'est une erreur aussi complète que celle qui consiste à mettre le courage des héros d'Homère et des hommes de guerre du moyen âge au-dessus de celui du soldat des armées modernes. Que l'on accuse l'excès de la durée du travail manufacturier d'affaiblir l'ouvrier, et même de l'abrutir, soit! Si simple que paraisse la besogne de direction ou de surveillance à laquelle se livre l'ouvrier attaché à une machine, elle exige une tension d'esprit qu'il est dangereux de prolonger à l'excès. L'intelligence surmenée s'use comme le corps et plus vite que le corps. Mais la grande industrie n'implique point fatalement l'abus du travail. Parce que cet abus existe, il ne s'ensuit pas qu'il soit nécessaire. En rendant le travail plus productif, la grande industrie permet au contraire, et permettra de plus en plus, d'en abréger la durée. On peut donc admettre que le travail manufacturier cessera un jour d'être excessif, et alors les résultats qu'il produit déjà, au point de vue du développement intellectuel de l'ouvrier, résultats dont il est impossible de n'être point [22] frappé, ne deviendront-ils pas plus sensibles encore et plus décisifs?
Une dernière conséquence de cette transformation des facultés demandées à l'ouvrier, dans une industrie en progrès, c'est une sélection qui fera vraisemblablement disparaître les individualités les moins propres à s'adapter aux conditions nouvelles du travail, c'est-à-dire les moins richement douées, intellectuellement et moralement, tandis que les autres se multiplieront en accumulant, de génération en génération, les qualités que le perfectionnement de la machinery de la production aura rendues particulièrement utiles.
III. — Changement de la proportion requise du travail et du capital dans la production. — Que le progrès industriel augmente, dans chacune des branches de la production, la proportion nécessaire du capital en diminuant celle du travail. — Compensation résultant de l'accroissement de la production. — Augmentation énorme de la demande du capital depuis l'avènement de la grande industrie. — Estimation de la production annuelle du capital. — Développement nécessaire des forces morales qui contribuent à la production du capital.
Une autre conséquence du progrès industriel, c'est de modifier la proportion des deux facteurs de la production: le capital et le travail. Nous donnons ici au capital sa définition la plus étendue. Nous y comprenons, non seulement les agents naturels appropriés, c'est-à-dire la terre, sol et sous-sol, mais encore les aptitudes et les connaissances que le travailleur est tenu d'acquérir pour devenir le coopérateur utile de la production. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les industries que le progrès a transformées pour s'assurer que la proportion du capital, par rapport au travail, s'y est incessamment augmentée sous l'influence du perfectionnement des machines, des procédés et des méthodes. Prenons encore pour exemple l'industrie de la locomotion. Au temps où l'homme [23] lui-même était l'unique véhicule de cette industrie, elle n'exigeait que la plus faible proportion possible de capital; il lui suffisait de l'avance nécessaire pour couvrir au jour le jour les frais de subsistance et d'entretien du porteur ou du messager. Telle on peut l'observer encore, dans ses branches arriérées, à Constantinople, où le hammal n'a pour capital que ses robustes épaules; à Paris, où l'Auvergnat y joint ses crochets. Mais l'homme s'assujettit le cheval, le bœuf, l'âne, le chameau, l'éléphant; il invente le chariot, la voiture, la diligence. Aussitôt la proportion du capital augmente. Désormais il faut investir dans l'industrie des transports un capital croissant, fixe ou circulant, d'une part, sous forme de routes, d'abris, d'animaux et de véhicules de toute sorte; d'une autre part, sous forme de subsistances et de matériaux d'entretien. La proportion du travail humain requise pour transporter un certain poids à une distance déterminée se trouve, au contraire, sensiblement réduite. Enfin, la vapeur vient à être appliquée à la locomotion. A partir de ce moment, le capital exigé par l'industrie des transports s'accroît dans une proportion énorme. Les routes ordinaires cessent de suffire : il faut construire des chemins spéciaux, garnis de rails, dont l'établissement et l'entretien exigent une application de capital dépassant singulièrement celle qui suffisait aux routes ordinaires; il faut y joindre des gares, des remises, des ateliers de réparation, avec un matériel considérable de locomotives et de wagons. Le personnel nécessaire pour mettre en œuvre ce matériel perfectionné est relativement moins nombreux que celui qui desservait l'ancien matériel, mais il coûte davantage à former. Une entreprise de chemins de fer a besoin du concours d'un personnel d'administrateurs, d'ingénieurs, de mécaniciens instruits et habiles, dont l'instruction professionnelle et l'apprentissage représentent un capital [24] supérieur à celui qui se trouvait investi dans l'ancien personnel des entrepreneurs de roulage, des charretiers, des conducteurs de chevaux ou de mulets. On peut constater le même phénomène dans toutes les autres industries. Si nous comparons, à ce point de vue, les armées modernes à leurs devancières, nous serons frappés de la masse croissante de capital qu'elles exigent — les contribuables en savent quelque chose — à mesure que le matériel de guerre se perfectionne. Le nombre des soldats n'a pas diminué, il n'a même pas cessé de s'accroître, quoiqu'on puisse contester l'efficacité de cet accroissement illimité, qui nous ramène au temps où le grand roi jetait sur la Grèce des millions d'hommes, assujettis comme aujourd'hui au service général et obligatoire, mais le capital que représente le matériel desservi par un millier de soldats — canons, fusils, projectiles perfectionnés — sans parler du capital professionnel, ne s'est-il pas accru encore davantage? n'est-il pas décuple de celui qui suffisait jadis au même nombre d'hommes? Si nous comparions le matériel naval du commencement du siècle à celui d'aujourd'hui, la différence nous paraîtrait plus saisissante encore. On s'occupera quelque jour de mesurer exactement le changement que le progrès amène dans la proportion des agents productifs, en même temps qu'il transforme la nature du travail, mais, en attendant, l'observation la plus sommaire démontre que le progrès a pour résultat invariable d'augmenter, dans chaque industrie, la proportion du capital relativement à celle du travail.
Quelles conséquences découlent de ce phénomène? En faut-il conclure que l'introduction des machines et des procédés perfectionnés a pour résultat de réduire l'étendue du débouché du travail? S'il en était ainsi la populalation devant nécessairement se proportionner, et se proportionnant en effet toujours, au nombre des emplois [25] disponibles, elle ne manquerait pas de diminuer à mesure que la petite industrie cède la place à la grande. Cependant, l'expérience ne ratifie point cette conclusion. Nous voyons, au contraire, que c'est dans les pays où le mouvement progressif de l'industrie est le plus rapide et le plus général, aux États-Unis et en Angleterrre, que la population s'augmente le plus vite. D'où vient donc cette contradiction apparente? On peut aisément se l'expliquer. Il est certain que le progrès en transformant une industrie diminue la quantité de travail qui y est appliquée; d'où il semblerait résulter que le débouché qu'elle offre aux travailleurs devrait se trouver amoindri; mais, comme le résultat final de tout progrès est d'abaisser avec les frais de la production le prix de la chose produite, les consommateurs réalisent une économie égale à cet abaissement de prix. Cette économie, ils l'emploient en partie — ordinairement pour la plus faible partie — à augmenter leur consommation de ce produit devenu moins cher, et pour le reste à se procurer d'autres produits ou services, dont le débouché se trouve agrandi d'autant, ce qui provoque un accroissement proportionnel de la demande du capital et du travail. Le débouché particulier que l'industrie transformée offrait au travail peut se trouver rétréci, mais d'autres débouchés s'étendent ou se créent ailleurs de manière à former compensation. On va plus loin, et l'on affirme que l'industrie transformée elle-même ouvre au travail un débouché plus étendu : comme exemple à l'appui, on se plaît à citer l'industrie de la filature et du tissage en Angleterre; seulement, on néglige de remarquer que cette industrie a remplacé, non seulement en Angleterre, mais encore au dehors, la filature et le tissage à la main, en s'emparant de la clientèle des fileurs et des tisserands d'autres contrées moins avancées.
Il n'en est pas moins vrai que le progrès industriel ne [26] réduit d'un côté le débouché du travail que pour l'augmenter d'un autre. Les choses continueront à se passer ainsi, selon toute apparence, aussi longtemps que le progrès industriel se produira dans un état de société où tous les besoins ne seront pas entièrement satisfaits, où, par conséquent, une économie procurée dans la satisfaction de l'un permettra aux autres de se satisfaire d'une manière plus complète. Cela n'empêche pas qu'en modifiant la proportion des agents productifs dans les branches d'industrie qu'il transforme, et en changeant du même coup la nature du travail, le progrès ne cause des souffrances cruelles. Tous les tisserands à la main, que le progrès a laissés sans ouvrage, n'étaient pas propres à exercer d'autres métiers ni même à s'adapter au tissage transformé; tous ne trouvaient pas d'ailleurs, sur place, l'équivalent du débouché qui leur était enlevé. Mais ces souffrances particulières, qu'il eût été d'ailleurs possible d'atténuer plus qu'on ne l'a fait, ne peuvent être mises en balance de l'augmentation du bien-être général et de l'élévation de la nature du travail, impliquant celle de la condition du travailleur.
Nous venons de dire que le progrès, tout en diminuant la proportion du travail relativement à celle du capital dans chaque industrie, n'amoindrit pas cependant le débouché général du travail. Peut-on dire qu'il l'augmente? A cet égard, on ne peut faire que de simples conjectures. D'un côté, le progrès industriel, en rendant possible la mise en valeur des régions du globe qui étaient demeurées auparavant presque inaccessibles à l'homme civilisé — telle était la vallée du Mississipi, par exemple — a étendu le débouché du travail et, avec lui, le rayon dans lequel la population peut se multiplier; mais, d'un autre côté, il est douteux que, dans les contrées telles que la Chine et certaines parties de l'Europe, les Flandres et la Lombardie, [27] où la petite industrie est fortement agglomérée et où elle est unie à la petite culture, l'évolution progressive élargisse ce débouché. Nous inclinons même à croire que l'introduction et la généralisation de la grande industrie manufacturière et agricole dans ces pays, où la petite industrie est particulièrement concentrée, y diminuerait la masse des emplois disponibles et, avec elle, la densité de la population.
Mais si l'on peut contester que le progrès industriel étende, d'une manière générale, le débouché du travail et encourage l'accroissement de la population, en revanche, ce qui n'est pas contestable, c'est qu'il a étendu, dans une proportion énorme, le débouché des capitaux et encouragé leur multiplication. En effet, tout progrès ayant, comme nous l'avons constaté, pour premier résultat d'augmenter la quantité de capital requise pour la production, le débouché ouvert aux capitaux n'a cessé de croître depuis l'avènement de la grande industrie. Certaines inventions, celle des chemins de fer, par exemple, ont principalement contribué à cette extension extraordinaire du débouché des capitaux. On estime à près de 90 milliards la quantité de capital que ces instruments perfectionnés de communication ont absorbée depuis quarante ans.[6] Or, il est bien clair que le développement et l'entretien des anciens moyens de transport — en admettant que les [28] chemins de fer n'eussent pas été inventés — n'auraient pas absorbé, dans le même intervalle, le quart de cette somme. Le débouché des capitaux s'est donc accru, du seul chef de l'invention des chemins de fer, d'au moins 1 milliard par an depuis quarante ans.
Cet accroissement extraordinaire de la demande du capital en a naturellement stimulé la production, de manière à élever l'offre au niveau de la demande. Quoique les données statistiques soient, à cet égard, fort incomplètes; quoique nous ne connaissions que d'une façon tout à fait approximative le montant de la production des capitaux dans les principaux pays civilisés; quoique nous sachions moins sûrement encore ce qu'elle était aux époques antérieures, nous pouvons affirmer qu'elle s'est accrue parallèlement à la consommation; ce qui le prouve, c'est que le prix des capitaux — le taux de l'intérêt et du loyer — ne paraît pas s'être élevé, en moyenne, depuis un siècle.
La statistique — en sa qualité de science officielle — ne nous fournit, disons-nous, que des données insuffisantes sur l'importance de la récolte annuelle du capital dans le monde civilisé. Nous connaissons cependant les principaux pays producteurs de capitaux comme nous connaissons les pays producteurs de blé : nous savons que l'Angleterre, la France, la Belgique, la Hollande, la Suisse, l'Allemagne, auxquels on peut joindre, de l'autre côté de l'Océan, les États de la Nouvelle-Angleterre, sont les grands foyers de la production des capitaux; que non seulement ils en produisent assez pour leurs besoins, sans cesse grandissants, mais encore qu'ils en approvisionnent le reste du monde. On a évalué à environ 10 milliards l'importance annuelle de leur capitalisation, mais cette estimation n'a et ne peut avoir rien de précis.[7] En effet, [29] une partie seulement de la récolte annuelle du capital, aussi bien que de la récolte de blé, est mise au marché. [30] L'autre partie demeure entre les mains des producteurs, soit qu'ils la conservent inactive, soit qu'ils l'appliquent à leur propre industrie, ou bien encore elle est investie dans un emploi quelconque sans avoir passé par le marché. On ne peut donc se rendre compte de son importance réelle. Il est plus facile d'apprécier la valeur de celle qui est mise au marché. On peut faire le compte de la quantité de capital que les gouvernements et les entreprises particulières viennent puiser annuellement sur le marché général, et, en remontant à trente ou quarante années seulement, on peut constater que cette quantité s'est progressivement accrue. On peut malheureusement constater aussi que, dans cet intervalle, les gouvernements ont été les grands consommateurs du capital mis au marché, et, quand on se reporte aux emplois auxquels ils l'ont appliqué, on peut ajouter qu'ils en ont été les grands destructeurs. En se rappelant que les dettes des États européens, dettes provoquées presque exclusivement par la guerre, se sont augmentées de près de 100 milliards depuis un demi-siècle,[8] en estimant, d'une autre part, à 10 milliards la récolte actuelle du capital dans les pays producteurs, on arrive à cette conclusion qu'un quart au moins de cette récolte est [31] annuellement gaspillé, comme le serait le blé qu'on laisserait dévorer par les charançons; d'où il résulte que le développement des industries productives et, par conséquent, la multiplication du bien-être et des consommations civilisatrices se trouvent ralentis dans une proportion équivalente. Telle est, cependant, l'impulsion que le progrès a donnée à l'industrie, qu'elle n'a point cessé de grandir, bien qu'on lui enlevât régulièrement, tant par le recrutement volontaire des capitaux que par le recrutement forcé des hommes, la fleur du panier de ses agents productifs. Combien son développement eût été plus ample si cette double soustraction de forces productives n'avait pas eu lieu!
Cette augmentation extraordinaire du débouché du capital, déterminée par l'avènement de la grande industrie, n'a pas seulement des conséquences économiques, elle a encore des conséquences morales. Le production du capital a grandi en raison de l'accroissement de son débouché, et elle est destinée, selon toute apparence — puisqu'il n'est pas admissible que le progrès industriel s'arrête — à grandir encore dans une progression de plus en plus rapide. Or, comment se produit le capital? Il est, comme on sait, le fruit du travail de l'homme et de son esprit d'économie. En d'autres termes, il est le surplus économisé de la production annuelle. La fécondité de la production du capital dépend donc : d'une part, du nombre et de l'élévation des profits de l'industrie; de l'autre, de l'activité et de la généralité de l'épargne. C'est dans les pays qui ont pris l'initiative de la transformation industrielle, où, par conséquent, la production s'est le plus étendue et ramifiée, que l'on recueille la plus grande masse de profits; quant à l'activité de l'épargne, elle dépend du tempérament particulier des populations, de leur esprit d'ordre, de leur prévoyance, de leur sobriété, en d'autres termes, de leurs forces morales.
[32]
Mais il en est des forces morales comme des forces physiques : elles se développent par l'exercice. Si, comme nous l'avons démontré, l'évolution industrielle, à laquelle nous assistons, implique la nécessité d'une quantité croissante de capital, les forces, à l'aide desquelles le capital se produit, devront nécessairement croître; c'est ainsi que le progrès de l'industrie provoque le développement de l'intelligence et des facultés morales de l'homme en leur assignant un rôle de plus en plus considérable dans la production.
CHAPITRE II. La grande Industrie (suite).↩
I. — Changements que la grande industrie provoque dans les dimensions, la forme et le gouvernement des entreprises. — Limites naturelles des entreprises. — Qu'elles sont extensibles et que le progrès industriel a pour effet de les étendre. — Substitution nécessaire des entreprises collectives aux entreprises individuelles. — Supériorité des premières. — Causes de cette supériorité. — Division des fonctions dirigeantes. — Séparation du capital et du travail. — Partage du capital en coupures mobilisables. — Accession plus facile des capacités aux fonctions dirigeantes et des petits capitaux aux profits de la production. — Séparation de la gestion et du contrôle. — Intervention de la publicité dans le gouvernement de l'industrie. — Causes qui retardent la substitution des entreprises collectives aux entreprises individuelles. — Imperfection du mécanisme des sociétés. — Inexpérience du personnel. — Création d'une science du gouvernement de l'industrie. — Que cette science fera justice des utopies socialistes en matière d'association. —Transformation des affluents qui apportent aux entreprises les agents et les matériaux de la production, personnel dirigeant, travail auxiliaire et capital. — Développement nécessaire de l'enseignement professionnel, des institutions de crédit et du recrutement du travail.
L'avènement de la grande industrie n'a pas eu seulement pour résultats d'accroître la puissance productive de l'homme, d'élever la nature de son travail et de changer la proportion des deux facteurs de la production, il a déterminé encore une modification progressive dans les dimensions, la forme et le gouvernement des entreprises. Sous le régime de la petite industrie, les entreprises, soit qu'il s'agisse d'agriculture, d'industrie ou de commerce, sont généralement peu étendues, et elles appartiennent à un seul individu ou à un petit nombre d'associés qui y consacrent, le plus souvent de père en fils, leur intelligence, leur expérience, leurs connaissances spéciales et leurs capitaux. C'est, sur une échelle réduite, et dans une sphère modeste, l'application du système de la monarchie [34] absolue et héréditaire. Comme le roi de l'ancien régime, l'entrepreneur d'industrie a le droit de dire : l'État, c'est moi. L'entreprise, c'est lui. Il lui donne son nom et en supporte toute la responsabilité. Si elle procure des profits, il se les attribue, si elle laisse des pertes, il les subit, et dans le cas où elle aboutit à la faillite elle peut entraîner, non seulement sa ruine, mais encore sa déconsidération.
Cette forme élémentaire du gouvernement de la production est essentiellement appropriée à la petite industrie. Les grandes entreprises que le progrès industriel a multipliées et qu'il est destiné peut-être à généraliser, exigent une forme de gouvernement plus compliquée, plus savante, et dans laquelle les responsabilités et les fonctions qui sont accumulées sur la tête ou entre les mains de l'entrepreneur d'industrie se séparent conformément au principe économique de la division du travail.
Que l'étendue et le volume des entreprises s'accroissent sous l'influence du progrès industriel, à mesure que le travail et les procédés mécaniques se substituent au travail physique et que la proportion nécessaire du capital s'élève, c'est un fait d'observation. D'abord, il convient de constater que toute entreprise a ses limites naturelles au-dessous et au-dessus desquelles elle devient moins économique. Quelles sont ces limites? Où est-il utile de les fixer? Voilà ce que l'expérience seule est en état de décider. Tout ce qu'on peut affirmer, c'est qu'elles existent et qu'elles sont mobiles; c'est qu'elles dépendent du degré d'avancement de l'industrie et que chaque progrès de celle-ci a pour effet de les élargir.
Nous n'ignorons pas que cette conséquence de la transformation progressive du matériel et des méthodes de la production a été contestée, et qu'elle l'est encore. Pendant longtemps on s'est obstiné à croire que les petits ateliers [35] industriels pourraient continuer à lutter, d'une manière normale, avec les grandes manufactures, et, aujourd'hui encore, on croit volontiers que les petites exploitations agricoles pourront toujours, sans désavantage, faire concurrence aux grandes. Ce sont des illusions sentimentales que l'expérience s'est déjà, en partie, chargée de dissiper. Dans les industries de la filature et du tissage, par exemple, n'a-t-on pas vu depuis l'invention des métiers mécaniques, et pour ainsi dire à chacun de leurs perfectionnements, les entreprises acquérir des proportions plus vastes? Le même phénomène issu de la même cause ne s'observet-il pas dans toutes les autres branches de travail? Si la statistique était une science moins bureaucratique, elle nous apprendrait, non seulement de combien la production s'accroît, mais encore dans quelle mesure les dimensions des entreprises s'augmentent sous l'influence du progrès industriel. Malgré le peu d'aide qu'elle nous apporte, nous possédons toutefois, à cet égard, assez de données positives pour établir que l'agrandissement des exploitations est la conséquence naturelle et nécessaire de la transformation du matériel et des méthodes de la production.
Mais, à son tour, l'agrandissement des exploitations a pour conséquence de substituer aux entreprises individuelles des entreprises collectives, constituées sous la forme de sociétés anonymes ou autrement. Déjà cette évolution dans le mode de gouvernement de l'industrie a atteint un nombre considérable d'exploitations, quoiqu'elle ne soit pourtant qu'à son début, et que bien des causes se joignent pour la retarder. Il y a un siècle, les sociétés industrielles, commerciales ou financières n'existaient qu'à l'état d'exception. Si l'on consulte, par exemple, la cote de la Bourse de Paris en remontant à une cinquantaine d'années, on n'y trouve que trois ou quatre valeurs [36] industrielles à la suite des fonds d'État.[9] Aujourd'hui, on les compte par centaines et même par milliers. Non seulement les chemins de fer, les canaux, les lignes de navigation, les mines, les banques sont presque exclusivement exploités par des Compagnies, mais encore un nombre croissant de manufactures, d'entreprises commerciales et même agricoles se constituent sous cette forme nouvelle, mieux appropriée que l'ancienne à la grande industrie.
Il nous suffira d'une courte analyse pour montrer en quoi elle est supérieure à celle qu'elle remplace.
1° Elle sépare des fonctions différentes qui se trouvent réunies sous le régime des entreprises individuelles, et permet, en conséquence, de les remplir mieux et avec plus d'économie. Un entrepreneur concentre habituellement entre ses mains la direction d'un certain nombre de services, il s'occupe de la fabrication, de la comptabilité, des achats et des ventes : à la rigueur, il peut y suffire lorsque l'entreprise est peu étendue. Mais du moment où elle s'agrandit, il lui devient difficile, sinon impossible, d'apporter une attention et une compétence égales à toutes les parties de sa fonction dirigeante. Il prend alors des associés, mais l'expérience démontre que l'harmonie n'est pas toujours facile à maintenir entre des coopérateurs égaux en pouvoir. D'un autre côté, comme c'était autrefois la règle, comme c'est encore le cas ordinaire, une entreprise individuelle, une « maison, » se lègue de père en fils. Or, la capacité dirigeante ne se transmet pas nécessairement avec la chose dirigée; à un bon gouvernement industriel on en voit succéder un mauvais et la « maison » tombe en décadence.
Dans une grande entreprise constituée sous forme de société, au contraire, les fonctions dirigeantes sont [37] séparées suivant leur nature, et confiées à des spécialités soumises à une autorité supérieure, assujettie elle-même au contrôle et à la surveillance des mandataires du capital responsable de l'entreprise. Dans chaque service, le travail est divisé et les fonctions sont échelonnées en raison de leur importance naturellement inégale; on y proportionne aussi exactement que possible les capacités et les aptitudes, de manière à tirer du personnel la plus grande somme d'utilité avec un maximum d'économie. Enfin, dans une société industrielle bien gouvernée, nul ne s'éternise dans sa fonction, si élevée qu'elle soit, et l'on hésite d'autant moins à mettre à la retraite les fonctionnaires dont les facultés viennent à baisser, que l'importance de l'entreprise permet de leur assurer une retraite. On les remplace en temps utile sans être astreint à prendre leurs remplaçants dans la même famille ou la même coterie, en les demandant sur le marché général des capacités dirigeantes.
2° Non seulement le gouvernement d'une société est un organisme supérieur à celui d'une entreprise individuelle, en ce que la division du travail peut y être portée du haut jusques au bas de la hiérarchie, à sa dernière limite, mais encore, autre progrès non moins considérable, le capital y est séparé de la capacité et du travail. Dans l'entreprise individuelle, le capital appartient communément, pour la plus grande part, à l'entrepreneur, le restant lui est fourni par des commanditaires associés ou non, par des banquiers ou bien encore par ceux qui lui vendent à crédit les matériaux de son industrie. Une partie de ce capital est engagée d'une manière permanente, et l'impossibilité de la dégager à volonté renchérit naturellement les frais de sa coopération. Une autre partie n'est engagée que d'une manière purement temporaire et précaire, et il en résulte un autre inconvénient : les crédits qui mettent [38] cette seconde portion du capital, non moins nécessaire que la première, à la disposition de l'entrepreneur, peuvent être diminués ou même retirés subitement, au gré des prêteurs d'argent ou des fournisseurs de matières premières payables à terme; d'où un risque qui plane incessamment sur les entreprises et qui, venant à écheoir, occasionne une des variétés les plus désastreuses du phénomène des crises.
Dans une entreprise constituée sous forme de société, le personnel dirigeant peut ne posséder qu'une fraction minime du capital; à la rigueur même, il pourrait n'en posséder aucune, et, contrairement à l'opinion généralement admise, cette dernière situation serait la meilleure au point de vue de la bonne gestion des affaires de la société, un personnel dirigeant non actionnaire, n'ayant pas le droit de se contrôler lui-même. 11 lui suffit de posséder la capacité, les connaissances et la moralité requises pour ses fonctions, toutes qualités qui se rencontrent plus aisément, et à moins de frais sur le marché, séparées du capital qu'unies à lui. Il en est de même du capital séparé de la capacité et du travail. Ainsi isolé, il possède un marché dont l'étendue est sans limites, où on le demande sous des formes perfectionnées, qui permettent de l'obtenir avec plus de facilité et à moins de frais que lorsqu'il s'agit d'une entreprise individuelle. On le demande en coupures régulières, accessibles à la multitude des capitalistes, garanties ou non garanties, donnant droit à une part de profit aléatoire ou à un revenu fixe, et, chose essentielle, toujours réalisables. D'où cette conséquence importante que tout co-participant à l'entreprise, actionnaire ou obligataire peut, à volonté, dégager son capital, en rapportant son titre au marché. A cette condition, on conçoit que le capital s'offre davantage, sans avoir besoin d'un taux de loyer aussi élevé que dans le cas où il n'est pas [39] dégageable.[10] D'où cette dernière conséquence que les entreprises constituées sous la forme de sociétés peuvent s'établir plus aisément que les autres, dans les [40] dimensions les plus utiles, et réunir toute la quantité de capital qui leur est régulièrement nécessaire, sans avoir besoin de recourir à la ressource précaire et dangereuse du crédit; elles peuvent être indépendantes des banques et faire leurs achats au comptant; elles peuvent, en un mot, se constituer de la manière la plus économique et la plus sûre.
3° Ce mode de constitution des entreprises présente encore ce double avantage, à la fois économique et social, de permettre à toutes les capacités de s'élever par ellesmêmes aux fonctions dirigeantes de l'industrie et à tous les capitaux, petits ou grands, de participer à ses bénéfices.
Sous le régime des entreprises individuelles, la capacité arrive sans doute, mais avec quelles difficultés, quand elle n'est pas jointe au capital! Sauf dans les circonstances exceptionnelles où l'industrie prend tout à coup un développement extraordinaire, les entreprises restent concentrées dans un petit nombre de familles, même quand des monopoles ou des privilèges n'en interdisent pas l'accès aux simples travailleurs; et ceux-ci ne peuvent guère s'élever aux fonctions dirigeantes, à moins d'avoir réussi à accumuler un capital. La capacité industrielle suffit, au contraire, pour porter celui qui la possède aux rangs supérieurs de la hiérarchie dans les entreprises de la grande industrie. On ne demande point à un administrateur expérimenté, à un ingénieur habile, de posséder un capital; on ne lui demande que d'être capable. D'un autre côté, les entreprises individuelles ne recrutent, habituellement, leurs capitaux que dans un cercle restreint de gros et de moyens capitalistes. Elles ne sont que pour la plus faible part alimentées par les petits capitaux, ceux-ci se récoltant ordinairement de la main à la main, et leurs possesseurs n'aimant pas d'ailleurs à en perdre la disponibilité. Sous le nouveau régime industriel, la situation [41] change à cet égard du tout au tout, le capital se récoltant en petites coupures d'un caractère impersonnel et toujours réalisables, les entreprises deviennent largement accessibles à la démocratie des capitaux, et les couches sociales inférieures peuvent, aussi bien que les couches moyennes et supérieures, participer aux profits de la production.
4° Un autre avantage, et non le moins considérable, de l'évolution progressive du régime des entreprises, c'est la séparation de la direction et du contrôle. L'entrepreneur capitaliste est un roi absolu qui dirige ses affaires à sa guise, sans avoir de comptes à rendre qu'à lui-même, avec la seule obligation de tenir exactement ses livres — encore cette obligation ne s'étend-elle pas à la généralité des branches de la production — sans avoir enfin à redouter aucune immixtion extérieure dans ses affaires aussi longtemps qu'il ne vient pas à tomber sous le coup de la législation des faillites. On prétend volontiers que ce régime est le plus parfait qui se puisse imaginer; que l'entrepreneur, maître de ses délibérations et de ses actes, à la fois dirigé et éclairé par son intérêt personnel, réalise l'idéal du bon gouvernement de l'industrie. Cependant, ne seraitil pas permis de contester que l'absolutisme industriel vaille mieux que l'absolutisme politique? Un entrepreneur d'industrie peut se tromper, il peut aussi tromper en demandant un surcroît de bénéfices à des pratiques véreuses et nuisibles, surtout si son établissement a un caractère précaire. Personne n'a autorité pour le remettre dans la droite voie, et les fautes qu'il peut commettre, les erreurs dans lesquelles il est exposé à tomber, les pratiques malhonnêtes que peut lui suggérer l'appétit immodéré du gain, n'ont d'autre frein que la crainte vague de l'opinion ou l'appréhension lointaine d'une mise en faillite et de l'intervention de la justice dans ses affaires.
[42]
Sous le régime de l'association industrielle ou commerciale, le contrôle se dégage de la gestion. Ce sont deux services organisés séparément, et qui se complètent l'un par l'autre. La direction prend l'initiative des opérations, elle conçoit, décide et agit; le contrôle conseille, surveille, et, au besoin, oppose un veto à des opérations qu'il juge stériles ou imprudentes. Cette séparation des deux fonctions, dans lesquelles se décompose le gouvernement de toute entreprise, présente des garanties de bonne gestion qui ne se rencontrent point lorsqu'elles sont réunies, les facultés qu'elles exigent étant d'une nature différente, sinon opposée.
5° Enfin, l'association a introduit la publicité dans le gouvernement de l'industrie, et ce n'est pas son moindre mérite. Le caractère essentiel des entreprises individuelles, c'est le secret de la gestion et des opérations; la publicité est une nécessité du régime des sociétés. On ne connaît guère que par des on dit ou des conjectures plus ou moins fondées l'importance du capital de l'entrepreneur d'industrie et la situation de ses affaires. Le capital d'une société, au contraire, ne peut se constituer qu'avec l'auxiliaire de la publicité, et elle est obligée, au moins une fois par an, de rendre compte de sa situation à ses co-intéressés. On sait donc, au moment où une société industrielle ou commerciale vient à se fonder, quelle quantité de capital elle demande au public sous une forme ou sous une autre, et, bientôt après, si la souscription a été ou non couverte. On sait encore par les comptes rendus de ses administrateurs, et, d'une manière plus positive, par la fixation du dividende, quel est l'état de ses affaires. On peut mesurer, en conséquence, le degré de confiance qu'elle mérite. On peut, enfin, trouver dans la cote des actions industrielles une indication sur la direction la plus utile à donner aux capitaux d'entreprise, et arriver ainsi à [43] résoudre, avec un minimum de tâtonnements et de forces perdues, le problème de l'équilibre entre les différentes branches de la production et de la consommation.
Tels sont les avantages les plus notables de l'évolution que le progrès a déterminée dans la constitution et le gouvernement des entreprises, évolution qui tend à remplacer l'entrepreneur d'industrie par la société industrielle.
Cependant, l'expérience n'a pas été jusqu'à présent bien favorable à cette forme développée et perfectionnée des entreprises. On a pu même soutenir qu'elle est pratiquement, sinon théoriquement, inférieure à celle qu'elle remplace. A quoi cela tient-il? Cela tient d'abord, et avant tout, à la nouveauté du système, à l'imperfection du mécanisme des sociétés industrielles et à l'inexpérience du personnel chargé de le mettre en œuvre.
En provoquant la création d'entreprises dépassant par leur étendue, leur complication et leurs risques les ressources, la capacité et la responsabilité d'un seul homme, chemins de fer, lignes de navigation à vapeur, mines, etc., en rendant par conséquent nécessaire l'application à ces entreprises d'un mode de constitution et d'une forme de gouvernement, sinon entièrement nouveaux, du moins demeurés jusqu'alors à l'état d'exception, le progrès industriel n'a pu ni créer d'emblée à l'état de perfection dont il est susceptible ce nouvel organisme, ni improviser un personnel pourvu des aptitudes et des qualités requises pour le mettre en œuvre. Si l'on examine les constitutions industrielles ou commerciales, aussi bien que les constitutions politiques qui ont été établies depuis un siècle, on les trouvera certainement fort imparfaites; mais il en est des inventions qui procèdent des sciences morales comme de celles qui procèdent des sciences physiques: elles n'arrivent qu'à la longue, après une suite de [44] tàtonnements, à leur pleine applicabilité. On crée d'abord une machine informe et grossière, telle, par exemple, que la machine à vapeur de Newcomen ou le fardier de Cugnot, et c'est seulement quand l'expérience en a montré l'insuffisance et les défauts, qu'on arrive à y remédier. Les sociétés industrielles ou commerciales sont encore aujourd'hui des machines de Newcomen; elles sont grossières, difficiles à gouverner, et elles éclatent fréquemment. Mais faut-il s'étonner de leur imperfection et se laisser décourager par les dommages et les accidents qui en résultent? Ce qui serait étonnant, c'est que James Watt eût précédé Newcomen, c'est que le mécanisme de la société industrielle fût sorti à l'état parfait du cerveau d'un Solon ou d'un Lycurgue de comptoir, c'est que ce mécanisme n'eût pas eu besoin de passer par les phases ordinaires qu'ont traversées toutes les inventions, à l'aide desquelles s'est constitué le matériel de notre civilisation. Cela serait d'autant plus étonnant que les sciences morales et politiques dont il procède sont incontestablement moins avancées que les sciences physiques. On a fait, sur des données positives, la théorie de la machine à vapeur. A-t-on pu faire, jusqu'à présent, celle de la constitution et du gouvernement des entreprises? Non, ou du moins cette théorie, aussi bien que celle des constitutions politiques, ne repose que sur des données vagues, incomplètes et incertaines. Que faut-il faire pour lui donner une base solide? Il faut, avant tout, accumuler un contingent suffisant d'observations et d'expériences. A mesure que la nouvelle forme des entreprises deviendra plus commune, à mesure que les sociétés industrielles se multiplieront, on pourra observer mieux comment elles fonctionnent, et par quels côtés elles pèchent. On réunira ainsi les matériaux nécessaires pour constituer la théorie de l'association industrielle ou commerciale, et pour dégager les principes qui [45] lui servent de base. Quand cette théorie sera faite, quand ces principes seront établis et vulgarisés, quand la science du gouvernement de l'industrie sera constituée, l'art, qui n'est autre chose que l'application de la science, progressera à son tour plus vite qu'il n'a pu le faire aussi longtemps qu'il s'est étayé sur des données purement empiriques.
A l'imperfection naturelle d'un mécanisme nouveau est venue se joindre l'inexpérience du personnel chargé de le mettre en œuvre. Ce personnel n'est pas sorti encore de sa période d'apprentissage. Recruté principalement dans la classe dirigeante de l'ancien régime industriel, il ne possède à un degré suffisant ni l'intelligence ni les mœurs du nouveau. Il applique au gouvernement essentiellement « constitutionnel » des sociétés industrielles ou commerciales les mêmes errements auxquels il était accoutumé dans les entreprises individuelles, autocratiques de leur nature. Le directeur d'une société s'efforce de se rendre indépendant de son conseil d'administration ou de surveillance; le conseil, à son tour, s'efforce de substituer son autorité à celle des actionnaires, parfois même de se créer un intérêt distinct du leur; la direction est autocratique, le contrôle est illusoire, la publicité des comptes est frelatée, les actionnaires sont ignorants, tantôt crédules et tantôt méfiants à l'excès. De tout cela, il résulte que la nouvelle machine fonctionne trop souvent de manière à faire regretter l'ancienne. Mais, encore une fois, faut-il s'en étonner? Dans un pays où le personnel des chemins de fer serait recruté parmi les ci-devant charretiers et conducteurs de diligence avec un appoint de gens sans profession déterminée, n'y a-t-il pas apparence que le service des transports laisserait à désirer et que les accidents seraient fréquents? N'en serait-il pas de même dans un pays où la mise en œuvre d'une constitution politique [46] libérale serait confiée à un personnel façonné à la pratique et aux mœurs de l'absolutisme? Mais ce sont là des inconvénients temporaires : en poursuivant son évolution, le progrès industriel multipliera les entreprises qui excèdent les forces et les ressources d'un individu, l'association industrielle se propagera, et, en se propageant, elle se perfectionnera, tandis que son personnel acquerra les aptitudes et l'expérience qui lui font encore défaut aujourd'hui. Alors les avantages d'une nature permanente, qui sont inhérents à l'association industrielle deviendront plus sensibles, et il ne sera plus possible de contester la supériorité de ce nouveau mode de gouvernement de l'industrie.
Nous venons de dire que l'expérience du régime des sociétés, et l'observation de plus en plus attentive de la manière d'être de ce régime, fourniront les matériaux d'une « science du gouvernement de l'industrie ». Cette science, encore aujourd'hui dans l'enfance, permettra d'éviter bien des tâtonnements coûteux, en même temps qu'elle fera justice d'une foule d'illusions stériles ou pernicieuses en matière d'association. Si cette science de l'association était faite, si les principes en étaient suffisamment vulgarisés, elle ne tarderait pas à avoir raison du fatras des conceptions purement imaginaires du socialisme, comme la chimie a eu raison de l'alchimie. Qu'est-ce, en effet, que le socialisme, sinon le roman ou l'utopie de l'association? Aux yeux des socialistes, quelle que soit la secte à laquelle ils appartiennent, communistes, fouriéristes, coopérateurs, nihilistes, anarchistes même, l'association, sous un nom ou sous un autre, phalanstère, commune, société ouvrière, etc., est la base de la réorganisation et de la transformation progressives de la société. Comment cette conception a-t-ellepu naître dans leur esprit? Elle n'y est pas venue toute seule et sans cause. Elle est [47] née du spectacle du développement et de la puissance de l'association dans la sphère politique, industrielle, commerciale ou financière, et elle devait surtout germer et se propager à une époque où l'agrandissement de l'industrie a multiplié les associations appliquées à la production, en leur donnant des proportions jusqu'alors inusitées. Seulement, ce véhicule puissant, les socialistes ont négligé d'étudier les principes qui président à sa construction et de se rendre compte des conditions auxquelles il peut fonctionner. Nous ne voulons pas dire, certes, que la liste des combinaisons possibles en matière d'association soit épuisée, et qu'en dehors des formes actuelles du gouvernement de l'industrie, on ne puisse rien concevoir de raisonnable et de pratique. Non! nous sommes persuadé, au contraire, que l'art du gouvernement en est encore à ses premiers bégaiements; mais l'art doit s'appuyer sur la science, et les inventions du socialisme sont de simples produits de l'imagination et de la fantaisie.
Comme une dernière conséquence de l'agrandissement des entreprises de production, sous l'influence du progrès industriel, apparaît la transformation des affluents qui leur fournissent les agents et les matériaux dont elles ont besoin : personnel dirigeant, capital et travail.
Sous le régime de la petite industrie, le personnel dirigeant se forme ordinairement sur place, par voie d'apprentissage. Pendant de longs siècles, les procédés à peu près immobiles de l'industrie constituaient une « routine » dont il était superflu de connaître la théorie. Il suffisait de s'en assimiler la pratique. Cette pratique, les pères la transmettaient à leurs fils dans la fabrique, l'atelier, la ferme ou le comptoir. Ce capital professionnel passait ainsi d'une génération à l'autre, et il en était de même des procédés et des tours de main des simples artisans. Il ne s'accroissait qu'avec une lenteur extrême et parfois on le [48] voyait diminuer. Certains procédés se perdaient, après avoir cessé pendant quelque temps d'être mis en œuvre, ou n'étaient plus qu'imparfaitement appliqués, par suite de l'affaiblissement de la capacité industrielle de la population. La fabrication de la porcelaine, pour ne citer qu'un exemple, a subi, en Chine, une décadence visible. — Dans la grande industrie, le rôle du capital professionnel s'est singulièrement agrandi. Il ne suffit plus aujourd'hui de s'assimiler des procédés et des méthodes séculaires et immobiles. Non seulement l'industrie a renouvelé son matériel, mais son évolution progressive est loin d'être terminée, en admettant qu'elle doive l'être un jour. Si l'on veut acquérir pleinement la capacité de la diriger, on ne doit pas se contenter de se mettre au courant de la pratique actuelle de la branche de travail à laquelle on veut s'adonner, on doit connaître la théorie sur laquelle cette pratique se fonde. Alors seulement, on sera en état de se rendre compte du jeu d'une machine, de l'efficacité d'un procédé ou d'une méthode, d'en saisir les points faibles et d'y remédier, comme aussi d'essayer avec connaissance de cause les innovations utiles et de repousser les innovations nuisibles. L'instruction professionnelle, naguère encore limitée aux branches supérieures de l'activité humaine, aux professions dites libérales, est devenue une nécessité dans toutes branches d'industrie que le progrès a touchées; des écoles spéciales ont, en conséquence, surgi de toutes parts pour former le personnel dirigeant des entreprises de chemins de fer, de mines, des manufactures, des grandes entreprises agricoles, commerciales, financières : écoles des ponts et chaussées, des mines, des manufactures, écoles d'agriculture et de commerce. Et, comme les connaissances spéciales qu'on y acquiert ont besoin d'un terrain déjà préparé, l'enseignement général destiné à former l'intelligence et à la rendre propre à acquérir l'instruction [49] professionnelle, cet enseignement naguère organisé seulement en vue et à l'usage de la petite classe qui se vouait aux professions libérales, est devenu nécessaire au personnel autrement considérable qu'exige la direction de la grande industrie, dans le nombre chaque jour croissant de ses ramifications. Le débouché de l'enseignement général s'est ainsi étendu, à mesure que se créait, sous l'influence du progrès industriel, le faisceau des institutions diverses de l'enseignement professionnel. Ces institutions sont les affluents qui apportent à l'industrie transformée, le contingent de capacités dont elle a besoin, autrement dit, où elle recrute et recrutera de plus en plus son état-major, en ayant égard, non plus aux situations acquises, aux relations de famille, mais simplement à l'instruction et au mérite.
Une transformation analogue est en voie d'accomplissement dans le mode de recrutement du capital et du travail, qui servent à alimenter les entreprises. Sous l'ancien régime industriel, ce mode de recrutement était fort simple: capital et travail se recrutaient sur place, sauf de rares exceptions. Souvent même, la difficulté de les obtenir en quantité suffisante constituait un obstacle insurmontable à l'extension de l'industrie locale. Ce recrutement sur place n'exigeait que peu ou point d'intermédiaires : les capitaux se trouvaient dans l'industrie même à laquelle ils étaient appliqués ou dans les industries avoisinantes. Le « prêt », entravé d'ailleurs par le préjugé et la loi, et plus encore par la non-échangeabilité des titres de créance, était peu développé, chacun travaillait principalement avec le capital qu'il avait constitué lui-même ou qu'il tenait de ses ascendants. Un petit nombre de banquiers, d'usuriers et de notaires recueillaient seuls des capitaux pour les prêter, et la sphère de leurs opérations, sauf dans quelques grands foyers commerciaux, avait un rayon fort limité. [50] De même, les ouvriers étaient attachés de père en fils à l'atelier ou à la ferme, et ceux qui se déplaçaient formaient l'exception, même aux époques et dans les professions où ce déplacement n'était pas formellement interdit. Ceux qui se trouvaient sans emploi allaient individuellement quêter du travail de porte en porte ou attendaient qu'on vînt les embaucher sur la grève. Combien nous sommes déjà éloignés de cet état de choses, surtout en ce qui concerne le recrutement du capital! Les entreprises de chemins de fer, de mines, les grandes manufactures qui ont remplacé les petits ateliers, les énormes magasins qui se sont substitués aux simples boutiques, exigeant des capitaux par masses, il a fallu que tout un système d'affluents se créât pour recueillir les fruits de l'épargne et les porter où le besoin s'en faisait sentir. De là, ce réseau de jour en jour plus serré d'institutions de crédit qui couvrent les pays où l'industrie est en voie de transformation et de développement. Ces pourvoyeurs de capitaux ont successivement élargi leur marché, de telle sorte qu'ils recueillent en Angleterre, en France, en Belgique, etc., le capital qui va s'investir dans les chemins de fer, les mines, les manufactures des États-Unis, de l'Inde et de l'Australie. Quoique le recrutement du travail s'opère encore généralement à l'aide des procédés primitifs, on peut constater, dans la création des Trade's Unions, par exemple, une tendance à le régulariser, tout en étendant le marché de cet agent nécessaire de la production. Il n'y a plus de frontières aujourd'hui pour le travail aussi bien que pour le capital. Des ouvriers anglais ont été employés à la construction des chemins de fer sur les points les plus éloignés du globe, et n'est-il pas question aujourd'hui d'importer des ouvriers chinois en Angleterre?
C'est ainsi que se transforme sous nos yeux la constitution séculaire de l'industrie. A bien des égards cette [51] évolution économique, qui emporte peu à peu l'ancien mobilier industriel de l'humanité en modifiant les conditions de son travail et de sa vie, ressemble aux évolutions qui ont transformé, depuis la naissance du monde, les règnes végétal et animal. Il y a la même distance entre l'industrie à la main des Chinois et notre industrie à la mécanique, qu'entre la végétation de l'époque tertiaire et celle de notre époque. Nous sommes dans ce moment intéressant où le nouveau règne économique sort de l'ancien. Nous voyons la jeune et puissante végétation de la grande industrie s'élever peu à peu sur les débris de sa devancière, non sans causer des désastres et des ruines, mais par une évolution irrésistible et dont les générations futures plus encore que la nôtre recueilleront le fruit. Nous sommes au début de cette évolution dont il est impossible de calculer la durée, mais qui ne s'arrêtera point — si elle s'arrête — avant que les nouvelles formes économiques soient entièrement fixées.
II. — Extension illimitée de la sphère des échanges et solidarisation des intérêts. — Que les échanges naissent de la spécialisation des travaux. — Pourquoi ils étaient peu développés sous le régime de la petite industrie. — Progrès du commerce des peuples civilisés depuis l'avènement de la grande industrie. — Internationalisation croissante des produits, du capital et du travail. — Ses conséquences. — Création d'un État économique dont tous les membres sont unis par la solidarité des intérêts. — Des différentes sortes de solidarité, physique, politique, économique. — Comment la solidarité économique se développe avec l'échange des produits, le prêt des capitaux et la circulation du travail; comment elle finira par embrasser l'humanité entière.
La multiplication des échanges et l'extension de la sphère dans laquelle ils s'accomplissent, apparaissent comme une des conséquences les plus saisissantes de l'avènement de la grande industrie. A l'origine de la civilisation, les hommes, réunis en familles, en communautés ou en tribus, vivant de la récolte des fruits naturels du sol, de la chasse ou de la pêche, ne faisaient que peu ou point [52] d'échanges. Ceux-ci ne commencent à s'opérer qu'avec la spécialisation des travaux de la production. Mais cette spécialisation est lente à s'accomplir sous le régime de la petite industrie, et elle demeure fort incomplète. Jusqu'à une époque encore bien rapprochée de nous, la production alimentaire absorbait, dans les États les plus civilisés, les trois quarts des forces actives de la population, et elle se combinait dans le village, et même dans la famille agricole, avec celle de la presque totalité des autres nécessités de la vie. Le chef de la famille et ses fils cultivaient la terre, bâtissaient eux-mêmes leur cabane et façonnaient leur grossier ameublement; la femme et les filles filaient et tissaient les vêtements. On ne se procurait par voie d'échange que quelques outils et des objets servant à la parure. La portion de la récolte que n'absorbait point la nourriture du ménage agricole était portée au marché voisin, le produit servait à acquitter les redevances dues au propriétaire et les impôts. Souvent même, redevances et impôts étaient acquittés en nature, et employés sous cette forme à nourrir des légions de serviteurs et d'artisans, dont les services et les produits étaient à l'usage exclusif du maître. Dans cet état économique embryonnaire, les seuls articles qui fassent l'objet d'un trafic quelque peu étendu sont les objets de luxe, pourvus d'une grande valeur sous un petit volume et par conséquent faciles à transporter. Nous n'avons pas de données positives sur la valeur du commerce des États civilisés dans l'antiquité et au moyen âge. C'est seulement au commencement du dix-septième siècle qu'apparaissent, en Angleterre, les premiers rudiments d'une statistique commerciale. En 1613, la valeur officielle des importations de l'Angleterre et du pays de Galles ne dépassait pas 2,141,151 liv. sterl., et celle des exportations 2,487,435 liv. sterl. Un peu plus d'un siècle après, en 1720, les [53] importations étaient de 6,090,000 liv. sterl., et les exportations de 6,910,000 liv. sterl.; en 1765, année où Watt prit son brevet pour la machine à vapeur, les importations s'élevaient à 11,812,000 liv. sterl., et les exportations à 15,763,000 liv. sterl. Trente-cinq ans plus tard, en 1800, elles avaient triplé : les importations montent à 30,570,000 liv. sterl., les exportations à 43,152,000 liv. sterl. Le régime prohibitif et la guerre continentale les maintiennent pendant une vingtaine d'années dans un état presque stationnaire, et ce n'est qu'au bout de quarante ans qu'elles se trouvent doublées. En 1840, les importations du Royaume-Uni sont de 67,492,000 liv. sterl., et les exportations, transit compris, de 116,480,000 liv. sterl. Mais à dater de cette époque, sous l'influence du développement des voies de communication perfectionnées et du free trade, elles reçoivent une impulsion extraordinaire; en 1850, les importations atteignent 100,460,000 liv. sterl., et les exportations 197,309,000 liv. sterl. Enfin, en 1875, cent dix ans après la prise du brevet de Watt, les importations s'élèvent à 373,941,325 livr. sterl., et les exportations des seuls produits anglais à 223,494,570 liv. sterl., formant un énorme total de près de 15 milliards de francs. Dans les autres États civilisés, où la grande industrie s'est implantée, en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, la progression n'a guère été moindre. Récemment, un statisticien autrichien, M. Neumann Spallart, évaluait le mouvement commercial du globe à 78 milliards 700 millions, dont 44 pour l'Europe et 10 pour l'Amérique. A ces chiffres, il conviendrait d'ajouter ceux des échanges intérieurs de chaque État, sur lesquels la statistique ne fournit que des renseignements partiels et incomplets. En prenant pour base et pour point de comparaison le commerce extérieur de l'Angleterre, dans l'année de Watt, on n'exagérera [54] certainement pas en disant que la somme des échanges internationaux, depuis cette époque caractéristique de l'éclosion de la grande industrie, a au moins vingtuplé. Maintenant, n'est-il pas permis de conjecturer que cette progression est destinée à s'accentuer encore à mesure que les petits ateliers feront place aux manufactures et que les grandes fermes, pourvues d'un outillage perfectionné, se substitueront aux petites exploitations agricoles, à me-'sure que la machinery du commerce et du crédit grandira concurremment avec celle de l'industrie, à mesure que les chemins de fer et les lignes de navigation à vapeur se multiplieront, à mesure que la sécurité croîtra dans l'espace et dans le temps, et que les douanes s'abaisseront jusqu'au jour, plus prochain peut-être qu'on ne suppose, où elles seront mises au musée des vieilles machines. En tout cas, en admettant même que la progression des échanges demeure simplement ce qu'elle a été depuis l'avènement de la grande industrie, elle constitue, dans l'histoire du monde, un phénomène nouveau et extraordinaire.
La plus grande partie des produits compris dans cette masse croissante d'échanges passe du commerce à la consommation proprement dite. L'autre partie, grossie encore par les titres de crédit, constitue des capitaux d'entreprise, de commandite ou de prêt qui s'exportent des pays où la production en est abondante et la rétribution faible dans ceux où la production en est insuffisante et où ils peuvent trouver une rétribution élevée. Les emprunts publics et la création des chemins de fer ont été, depuis un demi-siècle, les deux grands véhicules de l'exportation et de l'internationalisation des capitaux.
A cette exportation devenue régulière et croissante du capital, il convient de joindre celle du travail. La grande industrie n'a pas donné à celle-ci une impulsion moindre. [55] Sans doute le passé nous fournit l'exemple de grandes migrations de peuples. Des légions de barbares envahissaient les pays civilisés et s'y établissaient après avoir massacré la population autochtone ou l'avoir réduite en esclavage. En même temps, l'homme, passé à l'état d'esclave et devenu un article d'échange, faisait l'objet d'un commerce étendu. L'importance de ce commerce, dans l'antiquité, s'explique par ce fait que le travail physique de l'homme était alors le principal moteur de la production, et par cet autre fait que l'homme est, de toutes les bêtes de somme, celle dont l'exploitation est la plus avantageuse et le transport le plus facile. Mais, en Europe, la transformation, puis la disparition de l'esclavage ont mis fin à ce trafic : l'esclave devenu serf est attaché à la glèbe, le serf devenu libre ne peut se déplacer faute de ressources. Au dix-huitième siècle, à l'avènement de la grande industrie, la circulation du travail en Europe est insignifiante et l'émigration d'Europe, en dépit de la découverte de l'Amérique, est presque nulle. Les soldats embauchés au dehors constituent la plus grande partie de l'importation du travail étranger, avec un nombre très restreint de négociants, d'industriels et d'artisans. L'émigration se recrute seulement parmi les dissidents ou les proscrits pour cause de religion, les criminels et les filles perdues. Seul, le commerce des nègres fournit un contingent de quelque importance à l'émigration; encore, dans les années où ce commerce est le plus actif, n'évalue-t-on pas à plus de vingt ou trente mille le nombre de têtes qu'il transporte dans les plantations du Nouveau-Monde. Avec la grande industrie, et surtout à dater de la transformation des moyens de transport, la circulation du travail prend un essor inaccoutumé. Négociants, banquiers, industriels, ingénieurs , employés, artisans , ouvriers même, passent d'un pays à un autre, en nombre croissant, [56] en dépit des résistances qu'ils rencontrent dans les préjugés et les intérêts de clocher; quant à l'émigration d'Europe, on la voit passer, en un demi-siècle, de 10,000 individus à 500,000; en 1873, les États-Unis, à eux seuls, ont reçu 422,545 émigrants, c'est-à-dire quatre ou cinq fois plus de travail libre que la traite ne fournissait de travail esclave, avant que les puissances européennes se fussent liguées pour la détruire. La grande industrie implantée en Amérique et en Australie n'y attire pas seulement le travail européen, elle exerce aussi son attraction sur le travail asiatique, en déterminant vers ces régions fécondées par les capitaux, les instruments et les procédés perfectionnés venus d'Europe, un courant d'émigration de l'Inde et de la Chine.
Telle est l'évolution, sans précédents dans le monde, que l'avènement de la grande industrie a déterminée dans la circulation des produits, des capitaux et du travail. Or, si l'on considère les vastes espaces que la nouvelle végétation industrielle a encore à conquérir, même dans les pays les plus avancés, on s'apercevra que cette évolution, qui ouvre une nouvelle époque de la civilisation, en est encore à son début, que nous assistons seulement à la création de ce marché général des produits, des capitaux et du travail, qui va se substituant aux marchés morcelés de la petite industrie, et que la somme des échanges internationaux, qui se chiffrait par millions il y a un siècle, qui se chiffre aujourd'hui par milliards, est destinée à s'accroître longtemps encore dans une progression de plus en plus rapide.
La conséquence la plus importante de ce phénomène, c'est le développement et l'extension illimitée de la solidarité des intérêts, c'est la création d'un État économique formé de toutes les individualités que rattachent des intérêts communs issus de l'échange, État qui s'étend [57] par dessus toutes les frontières politiques, qui pénètre au sein des nationalités les plus diverses ou même les plus hostiles, et qui finira par englober l'espèce humaine tout entière. Ce qui caractérise les citoyens de cet État économique, ce qui les distingue des autres hommes, c'est qu'ils sont affectés, dans une mesure plus ou moins forte, par tous les événements, heureux ou malheureux, qui influent sur l'immense communauté dont ils font partie; c'est que chacun d'eux est intéressé pour une part au bien-être des autres membres de la communauté, quelles que soient leur race, leur couleur et leur nationalité politique.
Sans doute, il a existé de tous temps entre les hommes une solidarité naturelle. Nous subissons, par exemple, en vertu de la constitution même de notre globe, des influences fort éloignées. L'incurie, la misère et la malpropreté des peuples de l'Orient engendrent des épidémies qui se propagent dans l'Occident. Le déboisement, en desséchant les cours d'eau et en détruisant les barrières qui ralentissent les mouvements de l'atmosphère, exerce de même, à des distances considérables, une action délétère. Nous subissons encore, à d'autres égards, l'influence de la conduite et du développement intellectuel et moral de peuples avec lesquels nous n'avons jamais entretenu de rapports d'intérêts, ou même qui ont disparu de la surface du globe depuis des milliers d'années. La sécurité des peuples civilisés a été longtemps menacée par les instincts violents et cupides des peuples barbares. D'un autre côté, le capital intellectuel et moral de la civilisation s'est successivement constitué et accru au moyen d'acquisitions faites dans des foyers éloignés dans l'espace et dans le temps. Le fonds de nos connaissances et de nos idées politiques, morales, religieuses nous vient de l'Inde, de l'Égypte, de la Grèce, qui en avaient peut-être reçu les éléments de régions encore plus anciennement civilisées. [58] Nous profitons des fruits de l'observation, de l'expérience et du génie inventif de peuples qui vivaient il y a des centaines de siècles dans d'autres contrées, de même que les générations à venir profiteront, sur tous les points du globe, des résultats de nos travaux, longtemps après que nos cités auront subi le sort de Thèbes, de Memphis et de Baalbeck. Mais cette solidarité élémentaire n'établit point entre ceux qui y participent des liens directs et réciproques. Les conditions climatériques et sanitaires d'une région du globe peuvent être modifiées par la manière d'être et de vivre des populations d'une autre région, sans que celles-ci subissent au même degré ou à un degré quelconque l'influence de la manière d'être et de vivre des habitants de la première. Enfin, si le passé influe sur l'avenir, l'avenir demeure sans action sur le passé.
Une solidarité plus complète naît de la constitution des États politiques, quelles que soient d'ailleurs leur importance et leur étendue, soit qu'ils se composent d'une tribu, d'une commune ou d'un empire. Les membres de l'État sont politiquement solidaires, en ce sens qu'ils se ressentent, quoique à des degrés fort inégaux, de l'augmentation ou de la diminution de la puissance et de la prospérité de l'État. A des degrés fort inégaux, disonsnous. En effet, au sein d'une nation composée de maîtres et d'esclaves, on ne saurait dire que l'existence et les destinées de l'État importent également aux uns et aux autres. Que l'État prospère, la condition des esclaves n'en sera pas améliorée; que l'État soit détruit, elle ne sera guère empirée : ils changeront de maîtres, voilà tout. Le caractère essentiel de cette sorte de solidarité, c'est d'être limitée aux frontières de l'État et, accidentellement, à celles de ses alliés. Un autre de ses caractères, c'est de varier selon les époques et les circonstances. C'est dans les temps de barbarie, où la destruction de l'État implique [59] le massacre, la dépossession et la réduction en esclavage de ses membres, que la solidarité politique a son maximum d'intensité; elle s'affaiblit à mesure que la civilisation se développe et se propage, que les mœurs s'adoucissent et que la conquête cesse d'avoir pour conséquences obligées le meurtre et la spoliation en masse. L'intérêt commun qui lie les membres de l'État est visiblement amoindri; il ne réside plus que dans la différence d'avantages et de charges résultant de la substitution d'un gouvernement civilisé à un autre, et cette différence est généralement peu considérable. On peut donc affirmer que la solidarité politique, sauf dans les États encore exposés à des invasions barbares, est actuellement en voie de pleine décroissance.
Il en est autrement de la solidarité économique. Celleci a reçu, comme nous l'avons dit plus haut, une impulsion extraordinaire de l'avènement de la grande industrie. Elle rattache déjà, à des degrés divers, le plus grand nombre des membres de l'espèce humaine, et elle est visiblement destinée à se renforcer et à s'étendre de jour en jour davantage. Étudions-la à sa source, recherchons comment elle grandit, et quel est son mode d'opération. Elle naît de la division du travail, elle grandit avec la puissance productive, dont chaque progrès étend la sphère des échanges et en augmente la masse. Quand chaque famille produit elle-même tous les objets de sa consommation, il peut exister entre elle et les autres familles de l'État une solidarité politique, il n'y a point de solidarité économique. Que l'une d'elles s'enrichisse ou s'appauvrisse, cela n'influe point sur la prospérité des autres; mais que le travail se divise, que les échanges naissent, aussitôt la solidarité apparaît. Cependant, elle ne se développe que lentement et dans un rayon borné sous le régime de la petite industrie. Sous ce régime, en effet, le [60] marché demeure toujours limité en profondeur et plus encore en étendue, sauf pour le petit nombre des articles qui renferment une grande valeur sous un faible volume. Une autre cause ralentit encore le développement des échanges : c'est la difficulté de la production, se traduisant par une cherté effective, sinon toujours nominale. L'industrie cotonnière nous fournit à cet égard une illustration saisissante. Une pièce de cotonnade représente la valeur de la nourriture et de l'entretien de la série des ouvriers : cultivateurs, transporteurs, fileurs. tisserands, commis, etc., qui ont successivement contribué à la fabriquer et à la mettre à la disposition du consommateur, au moment et dans l'endroit où il en a besoin. Quand l'invention des moteurs mécaniques et le perfectionnement des moyens de communication ont réduit dans une énorme proportion quelques-uns de ces frais, et, par suite, le prix de vente des cotonnades, que s'est-il passé? C'est que les consommateurs ont pu s'en procurer une quantité plus forte en échange d'une moindre part de leur revenu, et consacrer l'économie qu'ils ont réalisée de ce chef à d'autres achats; c'est que, non seulement le débouché de l'industrie cotonnière s'est augmenté, mais encore celui d'une foule d'autres industries; c'est que la masse des échanges s'est accrue, et avec elle la solidarité économique.
Cette solidarité est naturellement complexe; on pourrait la comparer à un réseau nerveux dont les innombrables filets déliés et enchevêtrés enveloppent, individu par individu, intérêt par intérêt, la multitude des échangistes. Elle rattache en premier lieu tous les membres de la série de producteurs, qui contribuent, dans une mesure quelconque, à la confection et à la mise au marché d'un article de consommation. Le planteur de coton est intéressé à la prospérité du filateur, du tisserand, du [61] négociant en cotonnades, et réciproquement. Tous le sont encore à la prospérité des diverses branches de travail qui fournissent des revenus aux consommateurs de coton manufacturé. Ceux-ci, de leur côté, sont intéressés, et comme producteurs d'articles demandés par le personnel de l'industrie cotonnière, et comme consommateurs d'articles de coton, au succès de cette industrie. Si elle vient à décliner, ils subissent un dommage en cette double qualité : ils sont moins bien pourvus d'un article de leur consommation, ce qui les oblige à s'imposer une privation ou un sacrifice, et ils voient se réduire le marché de leurs produits. Or, ce qui se passe pour un article de consommation, se répète pour tous. Les intérêts de chaque industrie se trouvent ainsi liés à ceux des autres.
Ce n'est pas tout. La solidarité économique ne naît pas seulement de l'échange des produits, elle naît encore du prêt des capitaux et du louage des services. Qu'une ménagère active et économe, en France, en Hollande ou en Écosse, ait réussi, au bout de l'année, à réaliser une modeste épargne, il pourra arriver que ce produit de la mise en œuvre des plus humbles vertus domestiques contribue à augmenter le bien-être et la richesse de populations lointaines, de races, de nationalités, de langues et de couleurs différentes. Cette épargne contribuera, par exemple, à la construction des chemins de fer aux États-Unis, dans l'Inde ou au Japon. D'où cette conséquence que les Américains, les Indous et les Japonais sont intéressés à la prospérité des industries qui fournissent des revenus aux ménages économes, en France, en Hollande ou en Ecosse. Enfin, à leur tour, ces ménages économes ne sont-ils pas intéressés à ce que la richesse et le bien-être croissent aux États-Unis, dans l'Inde et au Japon, de manière à y procurer de bons revenus aux entreprises de chemins de fer? De même que les capitalistes, les travailleurs ont [62] intérêt à la prospérité des industries qui leur sont accessibles, et celles-ci sont intéressées à ce que le marché soit approvisionné, d'une manière régulière et continue, de travailleurs actifs, intelligents et laborieux, sans distinction de nationalité ou de race.
C'est ainsi qu'à mesure que s'étend et augmente de volume la triple circulation des produits, des capitaux et du travail, on voit se développer la solidarité économique. Elle date de la naissance de l'industrie divisée. Elle s'établit, mais lentement, dans un rayon borné par la difficulté des communications, et seulement pour les classes encore peu nombreuses qui participent à l'échange, sous le régime de la petite industrie; elle reçoit une impulsion extraordinaire à l'apparition de la grande industrie, et nous la voyons projeter aujourd'hui son réseau sur les parties les plus éloignées de notre globe. Ce n'est rien exagérerque de dire que le nombre des mailles de ce réseau a centuplé depuis un siècle. Il ira désormais s'étendant et se serrant tous les jours davantage jusqu'à ce qu'il recouvre l'humanité entière, jusqu'à ce que le monde ne forme plus qu'un immense « État économique », dont tous les citoyens, placés dans une situation de dépendance mutuelle, seront intéressés à la prospérité les uns des autres.
CHAPITRE III. La concurrence.↩
I. — Loi d'équilibre qui gouverne la valeur des choses. — Comment cette loi sert de régulateur à la production. Exemple. — Comment elle règle la distribution de la richesse, en déterminant le taux des profits et de l'intérêt et le taux des salaires. — Comment, sous l'influence de cette loi, les prix courants de tous les produits et services gravitent incessamment vers les prix naturels ou nécessaires de ces produits et services. — Que cette action régulatrice, qui établit l'ordre dans la production et la justice dans la distribution de la richesse, ne peut s'opérer que dans un milieu libre ou sur un marché de concurrence. — Que la grande industrie est en voie de créer ce milieu libre ou ce marché de concurrence. — État des marchés sous le régime de la petite industrie. — Monopole naturel dont jouissaient les producteurs. — Comment, à défaut de la concurrence, la coutume et les règlements intervenaient pour modérer les prix. — Nécessité de cette réglementation. — Comment l'avènement de la grande industrie et de la concurrence la rend inutile et même nuisible. — Que le nombre des industries pourvues d'un monopole naturel va diminuant à mesure que le progrès industriel agrandit les marchés.
Le monde économique n'est pas abandonné aux impulsions aveugles du hasard, comme l'ont supposé les écoles socialistes; il n'est pas nécessaire qu'un législateur de génie, un Solon ou un Lycurgue, intervienne pour l'organiser. Il s'organise de lui-même, et quoique son organisation soit mobile et progressive, elle est cependant régie par la même loi naturelle immuable qui régit le monde physique : la loi de l'équilibre.
Rappelons brièvement comment se comporte cette loi, en ce qui concerne d'abord la production de la richesse.
Si nous jetons un coup d'œil d'ensemble sur le vaste domaine de la production, qu'apercevons-nous? Une multitude d'industries pourvoyant, les unes à l'alimentation, les autres au vêtement et au logement, d'autres encore au [64] gouvernement, à la défense, à l'instruction, à l'amusement, aux communications de l'espèce humaine. Ces industries se ramifient en des milliers de branches et chacune de ces branches inégalement développées se résout en une série « d'entreprises » plus ou moins vastes et nombreuses. Chacune de ces entreprises est mise en œuvre au moyen de l'application d'une certaine quantité de capital et de travail. Le mobile qui a rassemblé ces deux facteurs de la production et qui leur imprime le mouvement, c'est la perspective d'un profit. Qu'est-à-dire? Cela signifie que les « entrepreneurs », individus ou associations, estiment qu'outre les frais de la production consistant dans la somme nécessaire pour rétablir complètement les matériaux et faire subsister les agents qui y sont employés, ils recueilleront un surplus, autrement dit un profit ou un bénéfice. Or, c'est naturellement dans les branches de la production où ils ont l'espoir, fondé ou non, de recueillir le profit le plus élevé que les hommes entreprenants qui constituent la classe dirigeante du monde économique portent de préférence leur activité et les capitaux dont ils disposent.
Comment sont-ils guidés dans cette recherche de l'emploi le plus avantageux de leurs facultés et de leurs capitaux? Sous le régime de la petite industrie et des marchés restreints, ils peuvent assez aisément se rendre compte du montant des bénéfices réalisés par les entrepreneurs existants comme aussi des quantités supplémentaires que la demande peut absorber, sans abaisser sensiblement le niveau des profits. Sous le régime de la grande industrie et des marchés étendus, cette recherche semble au premier abord plus difficile; cependant la constitution des entreprises par association, au moyen de capitaux fractionnés en actions et en obligations fournit, alors, un indicateur de l'état des profits, merveilleusement clair et précis sinon toujours sûr : c'est le cours des valeurs cotées à la Bourse. [65] Le cours des actions constituant le capital responsable d'une entreprise est-il au-dessous du pair, cela veut dire, non seulement que cette entreprise ne réalise point de profits, mais encore qu'elle est en perte. Est-il, au contraire, au-dessus du pair, cela signifie que l'entreprise rapporte un profit, et plus le pair est dépassé, plus le profit est élevé. Sans doute, dans une même branche d'industrie, toutes les entreprises ne donnent point des profits égaux; il y a, entre elles, des inégalités provenant de la manière plus ou moins économique dont elles sont constituées et gérées; toutefois, en étudiant la cote des charbonnages, par exemple, on peut aisément, quand on a l'expérience des affaires, reconnaître si l'industrie charbonnière est en hausse ou en baisse.
C'est donc vers les branches d'industrie où le niveau des profits est le plus haut, que se dirige de lui-même l'esprit d'entreprise et qu'il porte un supplément de capital et de travail. Quel est le résultat naturel de cet apport? C'est d'augmenter la quantité de produits ou de services que l'industrie ainsi recrutée offre au marché. Et quel est l'effet de l'accroissement de l'offre d'un produit ou d'un service quelconque? C'est d'en faire baisser le prix. Il y a plus. Cette baisse ne s'opère pas simplement en raison arithmétique, elle n'est pas simplement proportionnelle à l'augmentation des quantités, de même que la hausse ne l'est pas à leur diminution; elle s'opère en raison géométrique; d'où il résulte qu'il suffit d'un très faible excédant ou d'un très faible déficit d'un produit ou d'un service pour en faire baisser ou hausser sensiblement le prix. Mais la baisse ou la hausse du prix détermine aussitôt un mouvement correspondant dans le profit. Voilà le régulateur naturel de la production.[11]
[66]
Sous l'influence de cette loi qui gouverne la valeur de toutes choses, l'équilibre s'établit ou tend perpétuellement à s'établir entre la multitude des branches de la production comme aussi entre tous les profits, et l'esprit d'entreprise, avec les capitaux et le travail dont il dispose, se porte incessamment dans les directions les plus utiles.
Pour peu qu'on y réfléchisse, on est frappé de l'importance capitale du rôle que joue cette loi naturelle d'équilibre. En supposant qu'elle n'existât point, on ne verrait pas comment la production pourrait s'établir de manière à répondre en tous temps, et sur tous les points d'un marché, que le progrès agrandit sans cesse, aux besoins de la consommation. Pourquoi appliquerait-on ses facultés et ses capitaux à telle branche d'industrie plutôt qu'à telle autre si l'on n'y était attiré par la supériorité des profits? Et si l'augmentation des profits, à son tour, n'était point déterminée par un exhaussement du prix dépassant l'étendue du déficit, avec quelle lenteur, souvent meurtrière, celui-ci parviendrait à se combler! Supposons, par exemple, qu'un déficit d'un dixième dans la récolte du blé n'amenât qu'une hausse d'un dixième dans le prix, il y a apparence que ce déficit ne serait couvert que par une diminution correspondante du nombre des consommateurs. La hausse, en raison géométrique du prix, a pour effet, au contraire, de stimuler énergiquement le commerce, en lui offrant l'appât d'un profit extraordinaire, les blés arrivent des points les plus éloignés du globe et la famine est évitée. Sur les articles de seconde nécessité ou de luxe l'effet est moins sensible, la consommation étant davantage affectée par l'augmentation du prix, mais il se produit cependant, et l'apport d'une quantité surabondante sur le marché engendre un résultat inverse. C'est ainsi que l'ordre s'établit de lui-même dans le domaine de la [67] production, grâce à un mécanisme naturel d'une simplicité et d'une efficacité merveilleuses.
Examinons un moment de quelle manière fonctionne ce mécanisme dans une des branches principales de l'industrie du vêtement, celle de la fabrication des étoffes de coton, et nous achèverons de nous convaincre que rien ne pourrait suppléer à son action régulatrice. L'industrie eotonnière occupe, par ordre de date, le premier rang dans la grande industrie. Localisée principalement en Angleterre, en France, en Suisse, en Belgique et aux ÉtatsUnis, elle dessert une immense multitude de consommateurs épars sur toute la surface du globe. S'il était possible, à la rigueur, d'imaginer un moyen artificiel de proportionner dans un marché local restreint la production d'un article quelconque aux besoins de la consommation, comment se figurer un mode de réglementation qui répartisse, d'une façon utile et équitable, les cotonnades anglaises, françaises, suisses, belges ou américaines entre les consommateurs africains, indiens ou australiens? Eh bien! ce qu'aucun règlement ne pourrait faire, la loi naturelle des prix, aidée des puissants moyens de communication et d'information que le progrès moderne a mis à son service, l'accomplit avec une promptitude admirable. La situation des marchés les plus éloignés peut être connue, d'une manière pour ainsi dire instantanée, grâce au réseau télégraphique qui est en train de couvrir le globe; la vapeur transporte sans retard la marchandise dans les endroits où le cours du marché indique que le besoin s'en fait le plus sentir; ici le déficit, là l'excédant, ne peuvent se produire que d'une manière accidentelle et temporaire. Si, par hasard, la production eotonnière avait reçu un développement disproportionné avec la consommation, si les prix avaient, en conséquence, cessé d'être aussi rémunérateurs que ceux des autres branches d'industrie, les [68] intelligences et les capitaux s'en détourneraient jusqu'à ce que l'équilibre se fût rétabli. L'effet inverse ne manquerait pas de se produire, en cas d'insuffisance de l'offre par rapport à la demande, et c'est ainsi que l'ordre peut s'établir sur le vaste marché du monde presque aussi aisément que sur le petit marché d'un village.
Cette même loi naturelle gouverne la distribution de la richesse. De même qu'elle agit avec la puissance de la progression géométrique pour mettre en équilibre l'offre et la demande, la production et la consommation de l'infinie variété de produits et de services qu'exigent les besoins de l'homme —besoins matériels, intellectuels et moraux, besoins de première et de seconde nécessité, de confort et de luxe, — de même elle agit pour fixer au taux qui leur est nécessaire les rétributions des facteurs de la production, rétribution de l'industrie dirigeante des entrepreneurs et du capital responsable des entreprises, profits ou dividendes, rétribution du capital auxiliaire, mobilier et immobilier, intérêt ou loyer, rétribution du travail, salaire ou part dans les profits. Toutes ces rétributions sont régies par la même loi, qui détermine la quantité proportionnelle des produits ou des services que la multitude des entreprises de toutes sortes, de toutes formes et de toutes dimensions verse incessamment sur le marché du monde. S'agit-il de la rétribution de l'industrie et du capital d'entreprise? Nous venons de voir que la classe dirigeante de la production, celle qui fonde et gouverne les entreprises, s'applique naturellement à porter ses facultés et ses capitaux vers les branches de travail où elle peut trouver les profits les plus élevés. A moins que ses mouvements ne soient entravés par des obstacles naturels ou artificiels dont nous aurons à nous occuper tout à l'heure, il résulte de ce choix libre et raisonné qu'elle fait des industries les plus avantageuses que les profits doivent tendre invinciblement [69] à se mettre en équilibre. S'ils viennent à dépasser, dans une branche quelconque de la production, ceux des autres branches, l'industrie et les capitaux d'entreprise ne manquent pas d'y être attirés, les quantités produites augmentent, les prix baissent et les profits avec eux; si cette baisse fait tomber les profits au-dessous du niveau de ceux des autres branches, l'apport des capitaux d'entreprise s'arrête, les quantités produites diminuent, les prix se relèvent et les profits avec eux.
Ce qui vient d'être dit de l'industrie et du capital d'entreprise s'applique également à la masse du capital et du travail qui leur servent d'auxiliaires; en d'autres termes, la loi qui met en équilibre les profits ou les dividendes exerce la même action sur l'intérêt ou le loyer d'une part, sur le salaire de l'autre. Il n'est pas nécessaire d'être bien familier avec les questions économiques pour se rendre compte de ce phénomène. Tout homme qui possède un capital investi sous n'importe quelle forme et qui est le maître d'en disposer à sa guise, lui donne naturellement la destination qu'il juge la plus profitable. Il en fait du capital d'entreprise, auquel correspond le profit ou le dividende, ou du capital auxiliaire, auquel correspond l'intérêt ou le loyer, et ce premier choix arrêté, il choisit encore parmi les entreprises auxquelles il apporte le concours de son capital, celle qui procure ou qui lui paraît procurer le profit, le dividende, l'intérêt ou le loyer le plus avantageux. Il en est de même pour le travail, qui n'est au surplus que la mise en œuvre du capital incorporé dans l'ouvrier. Tout homme ayant besoin de travailler pour vivre choisit de préférence l'occupation qui, en répondant à ses aptitudes et à son instruction professionnelle, peut lui procurer le profit le plus élevé. Les rétributions du capital et du travail auxiliaires tendent ainsi à se mettre en équilibre de la même manière que celles de l'industrie et du capital [70] d'entreprise, de la même manière encore que les prix de l'infinie variété des choses qui sont offertes à la consommation.
Cet équilibre est essentiellement instable, en ce sens qu'il tend toujours à se fixer sans se fixer jamais, car il suffit du moindre écart de l'offre ou de la demande pour faire varier le prix en raison géométrique de la variation des quantités. C'est comme une balance d'une extrême sensibilité que le poids d'un cheveu fait osciller. Le point d'équilibre, c'est la somme des frais nécessaires pour entretenir les agents productifs et les développer dans une mesure utile, ce qu'Adam Smith désignait par l'expression caractéristique de prix naturel. Mais si, comme nous venons de le dire, ce point est le centre vers lequel gravitent incessamment tous les prix et toutes les rétributions, ils s'en écartent toujours plus ou moins, tout en y étant toujours aussi d'autant plus énergiquement ramenés qu'ils s'en écartent devantage. Tantôt, en conséquence, les entreprises et les facteurs de la production sont en perte, tantôt ils obtiennent un profit qui excède le nécessaire. Dans ce cas, leur rétribution naturelle s'augmente d'une rente. La rente ou la non-rente apparaît chaque fois que l'équilibre est rompu, dans un sens ou dans un autre; elle agit pour le rétablir, et son action est d'autant plus intense que l'écart provenant de la rupture de l'équilibre est plus considérable.
Telle est la loi naturelle qui gouverne le monde économique, en y faisant régner à la fois l'ordre et la justice. Cependant, cette loi ne peut exercer pleinement son action régulatrice que dans un milieu libre, c'est-à-dire dans un milieu où tous les mouvements économiques s'opèrent sans rencontrer d'obstacles naturels ou artificiels, où les produits, les services, le capital, le travail peuvent se porter, en tous temps, en tous lieux et en toutes [71] circonstances, dans les directions les plus utiles; en d'autres termes, où il y a concurrence. Du moment où, sous l'influence d'un obstacle naturel ou artificiel, les mouvements économiques sont entravés, où l'offre sollicitée par le prix ne peut se mettre au niveau de la demande, la loi d'équilibre se trouve en échec, et il devient nécessaire de suppléer à son pouvoir régulateur par quelque expédient qui en tienne lieu, autant qu'un procédé artificiel puisse tenir lieu de l'action d'une loi naturelle.
Qu'une loi naturelle soit entravée ou paralysée par des obstacles provenant du milieu où elle agit, cela n'a rien qui doive surprendre. Supposons, par exemple, que l'air qui compose l'atmosphère terrestre soit remplacé par du mercure, tous les corps tomberont plus lentement dans cette atmosphère plus dense, et un grand nombre flotteront à sa surface. Cependant, la loi de la chute des corps sera demeurée la même, mais il faudra tenir compte de la résistance du mercure.
L'une des conséquences les plus importantes de l'avènement de la grande industrie, on pourrait dire même la plus importante, a été de créer ce milieu libre où la concurrence peut agir, où le pouvoir régulateur de la loi d'équilibre des valeurs peut s'exercer; en d'autres termes, de substituer au régime du monopole, qui caractérise les marchés isolés et restreints, le régime de la concurrence.
Ce n'est pas à dire, certes, que l'on puisse considérer ce progrès comme accompli, que les obstacles naturels ou artificiels qui ont, depuis la naissance des rapports économiques entre les hommes, entravé l'action de la concurrence, aient disparu. Non! nous ne sommes encore qu'au début de ce progrès, de même que nous ne sommes qu'au début de la grande industrie. Mais on peut déjà en constater aisément l'existence. Partout, les marchés où s'opèrent les échanges sont en voie d'agrandissement, partout [72] se substitue peu à peu un marché général, où la concurrence s'exerce, aux marchés locaux et restreints où elle se trouvait naturellement ou artificiellement entravée; à cet égard, le changement accompli depuis un siècle est énorme, et on ne saurait trop en accentuer la portée. Il n'en est pas de plus considérable dans l'histoire économique du monde.
Sous l'ancien régime de la petite industrie (nous disons l'ancien régime, quoique, à l'époque de transition où nous sommes, la petite industrie, caractérisée par la prédominance du travail physique, n'ait pas cessé de coexister avec la grande, et qu'elle soit encore absolument prédominante dans les pays arriérés), les marchés étaient limités d'une manière plus ou moins étroite par des obstacles naturels ou artificiels, le plus souvent même par les uns et par les autres. Produits ou services ne pouvaient généralement s'échanger ou se prêter — le prêt n'est, remarquons-le en passant, qu'un échange dans le temps — que dans un rayon borné. Il existait toutefois, sous ce rapport, des différences nombreuses et marquées entre les articles d'échange : les produits agricoles, pour la plupart lourds, coûteux à transporter et sujets à se gâter, étaient échangés aux environs des localités où on les produisait, la grande masse dans un rayon de quinze à vingt kilomètres tout au plus. Dans ce rayon se trouvait ordinairement une ville avec un marché, où les paysans d'alentour venaient régulièrement apporter la portion de leurs denrées qu'ils ne consommaient point eux-mêmes, et qui ne servait point à acquitter des redevances; rarement ils la portaient ailleurs. Quelques marchands seuls, qualifiés d'accapareurs, étendaient, à grands risques, leurs opérations dans une sphère plus vaste. En échange de leurs denrées, les paysans se procuraient des articles qu'ils ne pouvaient produire eux-mêmes, des outils, de la vaisselle, des bijoux [73] grossiers, etc., fabriqués le plus souvent dans la cité même. Les redevances seigneuriales étaient d'abord exclusivement acquittées en nature. Une partie était consommée sur place par le seigneur et sa cour. Le restant était porté au marché, et, avec le produit qu'il en tirait, le seigneur achetait des vêtements précieux, des armes, etc., que le commerce intermittent qui se faisait dans les foires apportait de régions plus ou moins éloignées. Ces articles précieux seuls possédaient donc un marché de quelque étendue, mais comme, sauf dans de rares foyers de population et de richesse, on n'en consommait que de faibles quantités, les acheteurs étaient généralement à la discrétion du petit nombre des vendeurs. La sécurité et les routes faisant défaut, le commerce ne pouvait étendre la sphère des échanges des autres articles, sauf peut-être le long des côtes et des rivières. Comment les choses se passaient-elles dans ces marchés restreints? La loi des prix y fonctionnait sans doute, mais son action régulatrice se trouvait entravée, sinon paralysée. Les paysans, et surtout les marchands de grains, profitaient du caractère de nécessité de leurs denrées pour en exagérer les prix, surtout dans les moments de disette; les industriels et les artisans se coalisaient pour limiter leur production, de manière à dominer le marché; en même temps, ils usaient de leur influence dans la cité ou dans l'État pour en faire interdire l'entrée aux articles similaires du dehors. Bientôt chaque branche d'industrie, organisée en corporation, eût ainsi son marché approprié, dans lequel elle réglait son offre de manière à porter le prix de ses produits au taux qui lui paraissait le plus avantageux. Les ouvriers, suivant cet exemple, se coalisaient de leur côté, et ils rendaient difficile l'accès de leur métier pour réduire, dans un but analogue, l'offre de leur travail. Enfin, les prêteurs d'argent, comme les marchands de grains, profitaient du caractère [74] particulier de nécessité de cette marchandise pour en restreindre l'offre et en surélever le prix. Tel était, comme chacun sait, le spectacle qu'offrait partout, jusque vers la fin du siècle dernier, l'ancien régime industriel et dont, malgré tant de progrès accomplis depuis cette époque, il reste encore de trop nombreuses traces.
Sous ce régime donc, le consommateur était, en vertu de la nature des choses, à la merci du producteur, pour l'immense majorité, sinon pour la totalité des articles nécessaires à la satisfaction de ses besoins. Mais le consommateur se défendait à son tour : s'il s'agissait d'articles qu'il pût produire ou confectionner lui-même, il se gardait de les acheter; les ménagères filaient, tissaient ou tricotaient les vêtements de la famille, et cette habitude a survécu assez longtemps à l'avènement de la grande industrie. S'il s'agissait d'articles de confort ou de luxe qu'il ne pouvait produire lui-même, il se résignait le plus souvent à s'en passer. S'il s'agissait, au contraire, d'articles de première nécessité, la coutume d'abord, ensuite des règlements et des tarifs établis par l'autorité de la commune ou de l'État, fixaient un maximum au-dessus duquel ces articles ne pouvaient être vendus ou loués. Il y avait un maximum pour le pain; il y en avait un pour le loyer de l'argent et, dans beaucoup d'endroits, un autre pour le loyer du travail. On taxait une multitude d'articles, et, en particulier, les moyens de transport. Plus tard, lorsque les progrès de la sécurité et le développement des voies de communication perfectionnées eurent agrandi les marchés et rendu la concurrence possible, cette antique réglementation a été attaquée comme tyrannique et finalement presque partout abrogée, mais elle n'en a pas moins eu, pendant de longs siècles, sa raison d'être; elle était le correctif nécessaire, quoique imparfait, du pouvoir excessif que possédaient les détenteurs d'articles de première [75] nécessité, les entrepreneurs, les capitalistes, les ouvriers eux-mêmes dans des marchés trop restreints pour que la concurrence pût s'y manifester avec une efficacité suffisante. Voilà ce qu'oublient ceux qui condamnent l'ancienne constitution et l'ancienne réglementation de l'industrie et du commerce. Ils jugent du passé par le présent, et parce que cette organisation est devenue surannée, parce qu'elle n'est plus, dans les endroits où elle existe encore, qu'un obstacle au progrès, ils affirment qu'elle a toujours été inutile ou nuisible, sans tenir compte du changement survenu dans le « milieu ».
A ces marchés restreints, où la concurrence était entravée dans son action par une combinaison d'obstacles naturels et artificiels, le progrès a substitué des marchés de plus en plus étendus, et qui finiront certainement un jour par n'en plus former qu'un seul. Tous les obstacles qui entravent le jeu de la concurrence n'ont pas cependant disparu. Il en reste encore qui viennent, les uns, de la nature, les autres, des hommes. Ceux-ci disparaîtront à la longue, mais peut-on en dire autant des autres? N'y a-t-il pas des industries qui échapperont toujours, en vertu de leur nature particulière et des circonstances dans lesquelles elles s'exercent, à la loi de la concurrence, et qui devront demeurer soumises à une réglementation analogue à celle de l'ancien régime? N'y a-t-il pas des produits et des services dont les prix et les rétributions devront toujours être réglés par des expédients artificiels, faute de pouvoir l'être par la loi naturelle de la concurrence?
Constatons d'abord que ces industries, ces produits ou ces services, dits de monopole, sont aujourd'hui en faible minorité, tandis qu'ils constituaient, sous l'ancien régime, la presque généralité. Les produits agricoles, par exemple, dont le rayon de consommation ne dépassait guère quelques kilomètres, sont maintenant expédiés aux extrémités [76] du globe. On mange, en Europe, de la viande et du blé d'Amérique, tandis que les conserves alimentaires préparées en Europe, le vin et la bière, s'exportent dans le reste du monde. Même extension, même illimitation du marché pour les produits industriels, depuis le formidable canon Krupp jusqu'à la plus fine aiguille, depuis le calicot ordinaire jusqu'à la dentelle. Les capitaux sont devenus plus mobiles encore, et le taux de l'intérêt est réglé, non plus par l'état de l'offre et de la demande sur un seul marché, mais par celui de tous les marchés que le télégraphe met en communication d'une manière instantanée et qui constituent le marché général. Le travail est resté en retard sous ce rapport; cependant, le développement des moyens de communication et d'information, en facilitant le déplacement des travailleurs, tend à créer, de même, un marché général du travail, où le prix de toute sorte de services sera exclusivement déterminé par le régulateur de la concurrence. Il y a sans doute encore des industries, des produits et des services qui échappent à l'action de ce régulateur, mais on peut prévoir qu'un jour viendra où les mêmes progrès qui y ont assujetti depuis un siècle la presque généralité des industries, des produits et des services, les y soumettront à leur tour, où la concurrence deviendra la loi universelle.
II. — Conséquences de l'avènement de la concurrence. — Qu'elle supprime les obstacles qui empêchent le jeu naturel de la loi régulatrice des valeurs et rend le progrès nécessaire. — Effets perturbateurs du progrès industriel sous le régime de la petite industrie et des marchés limités et appropriés. — Raison d'être du système protecteur dans la période de transition de l'ancien régime au nouveau. — Vices de ce système. — Sa décadence. — Suppression inévitable des douanes et création d'un marché universel.
Analysons maintenant les conséquences diverses de cette évolution, dont le sens et l'importance échappent, aussi bien aux écrivains et aux hommes d'État qui veulent [77] conserver le passé, qu'à ceux qui prétendent tracer sa voie à l'avenir.
La première c'est, comme nous venons de l'indiquer, d'écarter ou de supprimer les obstacles qui s'opposent au jeu naturel de la loi régulatrice des valeurs. A quel moment le monopole cesse-t-il d'exister pour faire place à la concurrence? Quelle étendue doit avoir un marché pour que la loi des prix puisse y exercer pleinement son action régulatrice? Voilà ce qui demeure encore obscur. Mais ce qu'on ne saurait contester, c'est que ce moment est arrivé pour le plus grand nombre des produits et des services; c'est que les marchés, sans être encore complètement débarrassés d'obstacles, sont cependant assez vastes pour que les coalitions ayant pour objet d'élever artificiellement les prix cessent d'y être possibles. Si l'on songe que l'avènement de la grande industrie ne date guère que d'un siècle, si l'on songe que l'application de la vapeur à la locomotive et de l'électricité au transport des informations et des nouvelles est de date plus récente, si l'on songe enfin que ces instruments d'agrandissement des marchés sont loin d'avoir atteint leur plein développement, et que d'ailleurs des barrières artificielles ont été placées à toutes les frontières des États pour contrarier leur action, on ne s'étonnera point que la concurrence demeure encore limitée, mais, en même temps, on se convaincra que nous marchons d'un pas rapide à l'avènement de la concurrence illimitée.
La seconde conséquence de cette évolution, qui substitue aux marchés restreints et isolés des marchés agrandis et en communication entre eux pour aboutir à la création d'un marché général, c'est qu'elle rend le progrès nécessaire dans toute l'étendue de l'État économique; c'est qu'elle ne permet plus à aucune industrie ni à aucune nation de demeurer stationnaire, sous peine d'être condamnée à une destruction inévitable.
[78]
Sous l'ancien régime de la petite industrie et des marchés restreints, non seulement le progrès n'était pas nécessaire, mais encore il était considéré comme un élément de désordre. Qu'un industriel inventât une machine ou découvrît un procédé qui lui permettait de fabriquer un produit en plus belle qualité et à moins de frais que ses confrères, et d'attirer ainsi à lui une partie de leur clientèle, il leur causait un dommage que ne compensait point suffisamment l'économie réalisée par le petit nombre des consommateurs. En outre, les ouvriers dont le nouveau procédé ou la nouvelle machine remplaçait le travail, ne trouvant pas toujours d'autre emploi dans les limites étroites du marché, tombaient dans la misère. Aussi les inventeurs étaient-ils regardés comme des ennemis publics, on les persécutait, et on se refusait, à plus forte raison, à faire usage des innovations pernicieuses qui leur étaient dues. Cette situation se modifia lorsque les marchés commencèrent à s'agrandir. Alors une machine ou un procédé nouveau, qui réduisait les frais de la production, permit à ceux qui l'appliquaient les premiers de réaliser de tels bénéfices et de développer leur industrie au point de contrebalancer, et au delà, les dommages causés par ce progrès dans la localité même. C'est ainsi que la substitution des machines à filer à la mécanique aux métiers à la main, en donnant à l'industrie du coton un essor extraordinaire dans le comté de Lancastre, y multiplia la richesse et les emplois du travail de manière à rejeter tout à fait sur le second plan les souffrances temporaires des fileurs et des tisserands à la main. Il est vrai que la nuisance causée par ce progrès se fit sentir ailleurs, et même avec plus d'intensité. Le progrès réalisé en Angleterre eut pour résultat de substituer, dans tous les marchés accessibles à l'industrie britannique, les cotonnades anglaises fabriquées à la machine aux cotonnades [79] abriquées à la main dans les Indes et sur le continent européen. Dans tous les pays où le progrès accompli en Angleterre ne put être immédiatement réalisé, l'industrie cotonnière se trouva menacée. Elle employa, comme préservatif, l'expédient du système protecteur, mais cet expédient, qui avait d'ailleurs ses inconvénients particuliers, qui n'était en définitive qu'une nuisance opposée à une autre nuisance, eût été insuffisant si les industries menacées n'eussent fini par adopter la machinery perfectionnée de leur rivale. Il convient de remarquer encore que cette adoption rencontrait des obstacles qui ont cessé d'exister depuis; comme les industries perfectionnées, qui déversaient sur les marchés étrangers une portion croissante de leur production, étaient devenues une source de plus en plus considérable de richesses, on s'efforçait d'empêcher l'étranger de s'assimiler un progrès si profitable. On prohibait donc, sous des pénalités extrêmement rigoureuses, l'exportation des machines et des ouvriers capables de les mettre en œuvre. On plaçait ainsi les industries arriérées, que l'on dépouillait de leur clientèle, dans l'alternative de se défendre par des moyens analogues ou de périr.
C'est dans cette période de transition des marchés restreints de l'ancien régime aux marchés illimités du nouveau que s'est généralisé sinon créé, le système protecteur aujourd'hui en pleine décadence. A titre d'expédient limité et temporaire, pour sauvegarder les marchés acquis de longue date à l'industrie indigène, et que des rivales plus promptes à transformer leur machinery menaçaient de lui enlever, le système protecteur a pu avoir sa raison d'être. Cependant, si l'on songe à l'imperfection naturelle de ce système et à l'abus qui en a été fait, on se demandera s'il n'a pas causé à son tour plus de nuisances qu'il n'en a empêchées.
[80]
Lorsque des industries organisées en corporation exploitaient un marché qu'elles considéraient comme leur propriété, les règlements prohibitifs qui contribuaient avec l'obstacle naturel des distances et du défaut de sécurité à en écarter la concurrence extérieure, ces règlements étaient aussi protecteurs qu'ils pouvaient l'être. Les industries incorporées n'avaient rien à craindre pour leur clientèle. Il leur suffisait de continuer à travailler d'après la routine établie pour la conserver. Mais lorsque la vieille organisation de l'industrie eut été entamée, lorsque l'avènement de la liberté du travail eut rendu la concurrence libre à l'intérieur, la situation changea. La garantie que les lois prohibitives accordaient aux industries qui avaient réussi à obtenir cette sauvegarde contre la concurrence étrangère eut pour résultat d'encourager les capitaux à s'y porter. Ils s'y portèrent trop souvent avec excès, et il en résulta l'exagération de la production, l'avilissement des prix et les « crises » qui font dès lors leur apparition dans le monde industriel. Les marchés protégés devinrent trop étroits, et les industries qui les encombraient n'eurent d'autre ressource que de verser au dehors l'excédant de leur production. Elles s'efforcèrent de se créer des débouchés extérieurs, chose difficile, puisque la plupart des nations civilisées s'appliquaient à l'envi à fermer leur marchés et ceux de leurs colonies. Heureusement, le monde est grand, et les marchés tiers offraient encore un débouché assez vaste aux industries rivales; ce débouché, elles se le disputèrent avec acharnement.
Mais dans cette lutte, le système protecteur ne tarda pas à devenir un embarras, une gêne. Accordé d'abord aux industries qui avaient le plus à craindre la concurrence étrangère, il avait bien fallu à la longue l'accorder aussi aux autres. Il en résulta naturellement un enchérissement général de tous les éléments de la production. [81] Si l'on s'était borné à prohiber l'importation des tissus étrangers, il est clair que des fabricants de tissus auraient tiré de la protection tout l'avantage qu'elle pouvait leur donner. Elle ne les aurait pas préservés sans doute de l'excès de la concurrence intérieure, d'autant plus excitée que la protection était plus efficace; mais, tout en leur réservant le marché national, elle leur aurait permis de se faire une place sur les marchés extérieurs. Seulement, les fabricants de tissus ne pouvaient accaparer à eux seuls le monopole de la protection. Il avait fallu protéger aussi les filateurs, et avec les filateurs, les constructeurs de machines, les fondeurs de fer et les fabricants d'acier, matières premières des machines, les propriétaires de houillères qui fournissaient le combustible nécessaire pour les alimenter, les fabricants d'huile indispensable pour les graisser. Il avait fallu protéger les propriétaires et les fermiers qui fournissaient la subsistance des ouvriers, puis les armateurs qui apportaient le coton des pays d'outre-mer, et que savonsnous encore? Le résultat final avait été un renchérissement artificiel de tous les frais de la production. A ne considérer que le marché intérieur, ce système pouvait néanmoins encore paraître avantageux. Le bénéfice qu'en tirait chaque industrie, en écartant la compétition de ses rivales de l'étranger, pouvait sembler supérieur à la perte que lui causait cette accumulation de charges en l'empêchant de diminuer ses prix de revient, et, par cette diminution, d'agrandir son débouché à l'intérieur. Mais à mesure que les marchés du dehors, devenus plus accessibles sous l'influence du développement des moyens de communication, acquirent plus d'importance, la situation se modifia. Sur ces marchés, ouverts également à toutes les productions rivales des nations maintenant engagées en plein dans les voies de la grande industrie, il est clair [82] que l'avantage devait appartenir à celui des concurrents qui pouvait réduire au niveau le plus bas ses prix de revient. Or, parmi les éléments du prix de revient figuraient pour le fabricant de tissus la protection accordée au fil, aux machines, aux houilles, à l'huile, aux céréales, aux transports maritimes, etc. Un moment devait arriver où, en faisant le compte du bénéfice qu'il tirait de la protection sur le marché intérieur et de la perte qu'elle lui causait sur les marchés étrangers, il s'apercevrait que celle-ci l'emportait visiblement sur celui-là. Dès ce moment, le système protecteur se trouva pratiquement condamné et sa disparition ne fut plus qu'une question de temps. La guerre civile s'introduisit parmi ses bénéficiaires, chacun demandant l'abolition des droits protecteurs dont il payait les frais, avec le maintien de ceux dont il tirait profit. Le fabricant de tissus, aussitôt que le progrès eut séparé le tissage de la filature, demanda l'entrée en franchise des fils, le filateur réclama l'abaissement des droits sur les machines, des houilles, des céréales, l'abrogation des surtaxes de pavillon, etc., etc. Enfin, les plus intelligents, comprenant bien qu'il n'était pas possible de conserver la protection qui les servait en supprimant celle qui les gênait, réclamèrent l'abandon d'un système considéré d'abord comme le palladium du « travail national ».
Comme on pouvait aisément le prévoir, les nations qui, les premières, ont renoncé à ce système, ont recueilli un bénéfice notable de leur initiative intelligente. En dégrevant leurs industries des charges de la protection, elles leur ont procuré un avantage sensible sur les marchés extérieurs, où les industries rivales continuaient à se présenter avec des produits grevés. A la vérité, elles donnaient accès à la concurrence étrangère sur leur propre marché, mais cette concurrence d'industries, encore alourdies [83] par le système protecteur, était peu redoutable, et l'expérience ne tarda point d'ailleurs à démontrer que ce qu'on perdait de ce côté ne pouvait entrer en comparaison avec ce qu'on gagnait de l'autre. On comprend aussi que le mouvement, une fois commencé, ne pouvait plus s'arrêter; qu'après que l'Angleterre eut donné le signal de l'abandon du système protecteur, les autres nations qui exportent leurs produits sur les marchés tiers en concurrence avec l'Angleterre, devaient suivre son exemple sous peine d'y être supplantées par elle. C'est ainsi que le système protecteur est tombé aujourd'hui dans une irrémédiable décadence. Il n'a conservé un reste de prestige et d'influence que dans des contrées telles que les États-Unis et la Russie, où le marché intérieur est particulièrement vaste et où les industries protégées n'ont encore qu'un débouché peu important au dehors. Dans cette situation, elles trouvent ou croient trouver avantage à conserver l'exploitation exclusive du marché intérieur, sauf à se contenter d'une part moindre dans le débouché extérieur. Mais cet état de choses ne manquera pas de se modifier à la longue; en attendant, les branches de la production qui alimentent principalement l'exportation de ces deux pays en céréales, laine, coton, etc., et qui supportent sans compensation aucune le fardeau du renchérissement protectionniste, car elles ne sont pas protégées et n'éprouvent pas le besoin de l'être, réagissent contre ce système, et elles contribueront, pour leur part, à en provoquer l'abandon.
Le jour viendra donc bientôt — ce jour est déjà venu en Angleterre — où les douanes ne seront plus qu'un instrument de fiscalité, et il y a apparence que, lorsqu'elles auront cessé d'être au service de puissants intérêts privés, elles ne résisteront plus longtemps aux progrès de la science économique et financière. On mettra à la réforme [84] ces grossières et coûteuses machines fiscales. Alors, le monde ne constituera plus qu'un seul et vaste marché au sein duquel la multiplication des moyens de communication et d'information de tous genres étendra de plus en plus le domaine de la concurrence. Le « milieu libre » sera créé, au moins pour l'immense majorité des produits et services.
III. — Évolution du monde économique vers la concurrence illimitée. — Obstacles qu'elle rencontre. — Que la concurrence est destinée à remplacer la guerre par la lutte pacifique des intérêts. — Que la guerre a été la première forme de la concurrence. — En quoi elle a été utile. — Pourquoi elle a cessé d'avoir sa raison d'être.
Depuis l'avènement de la grande industrie, le monde économique n'a pas cessé d'évoluer, en dépit de tous les obstacles, vers ce régime de concurrence illimitée, sous lequel le jeu naturel de la loi des prix suffira, sans l'auxiliaire d'aucun expédient artificiel, à établir, d'une part, l'équilibre utile de la production et de la consommation; d'une autre part, la répartition équitable des valeurs créées sous forme de produits ou de services, entre les agents productifs. C'est, en résumé, une évolution vers l'ordre et la justice.
Ce n'est pas ainsi, on le sait, que les innombrables adversaires de la concurrence, socialistes, protectionnistes ou réglementaires, ont considéré cette évolution. Ils ont dénoncé à l'envi la concurrence comme une source inépuisable d'oppression et de désordre. Les uns ont entrepris de la limiter, les autres se sont proposé même de la supprimer. On ne doit point s'en étonner. Il est dans la nature du progrès de déranger et d'endommager des intérêts. Ces intérêts, pour lesquels il est une nuisance au moins temporaire, ne manquent pas de se soulever contre lui, tandis que ceux qu'il favorise se montrent généralement [85] plus froids à le défendre que les autres ne sont ardents à l'attaquer. Cependant, à mesure que la concurrence a grandi, à mesure que les marchés où elle agit se sont étendus et qu'ils se sont éclairés en s'agrandissant, on a pu s'apercevoir qu'un ordre merveilleux s'y établissait de lui-même avec une justice distributive plus exacte. Aussi, les anathèmes que les socialistes fulminaient il y a trente ou quarante ans contre la « concurrence anarchique », commencent-ils à paraître surannés, et ils le deviendront de jour en jour davantage.
Est-ce dire que l'avènement de la concurrence doive inaugurer l'âge d'or du repos et des tranquilles jouissances? Non! la concurence, c'est la lutte, c'est la forme civilisée de la guerre, qu'elle est destinée à supprimer en la remplaçant.
La guerre apparaît, en effet, comme la première et, pendant de longs siècles, comme la seule industrie de concurrence. Aussi loin que la tradition et l'histoire nous montrent le passé de l'humanité, qu'apercevons-nous? Des troupeaux d'hommes, des hordes, des peuplades parcourant les régions accessibles du globe pour y chercher leur subsistance et celle de leurs animaux domestiques, mais chacune de ces sociétés en germe vivant à part, n'ayant et ne pouvant avoir avec les autres, en fait de rapports, que des conflits d'intérêts. Aussitôt que les ressources alimentaires de la région parcourue ou occupée par une de ces bandes devenaient insuffisantes, il fallait bien qu'elle se jetât sur la région avoisinante. De là, la guerre. Les plus courageux, les plus forts et les plus intelligents expulsaient ou détruisaient les plus faibles, et c'est par l'action de ce mode primitif de la concurrence pour la vie que les espèces inférieures ont disparu d'une grande partie de la surface du globe. Lorsque l'agriculture et les premières industries eurent été créées, les vainqueurs trouvèrent [86] plus d'avantage à asservir les vaincus et à les utiliser comme bêtes de somme qu'à les détruire et à les manger. Mais alors aussi l'énorme accroissement de richesses réalisé sous l'influence de ce progrès décisif, devint un nouveau stimulant pour la lutte. Toute société en possession des premiers arts et des premiers fruits de la civilisation apparut comme une sorte de placer dont la conquête était particulièrement enviable. Si ce placer n'était pas défendu avec assez de vigueur, si ceux qui l'exploitaient à leur profit, amollis par la jouissance immodérée des fruits du travail de la population assujettie, succombaient dans la lutte, il arrivait, de deux choses l'une, ou que les vainqueurs, encore à l'état barbare, se contentaient du profit temporaire que pouvaient leur procurer le pillage et la destruction de ce dépôt de richesses, ou que, plus éclairés et mieux avisés, ils songeaient à en tirer un profit durable, en prenant la place de ceux qui l'exploitaient auparavant, sauf à le défendre contre la concurrence de nouveaux envahisseurs. Dans cette compétition incessante et universelle, la palme devait naturellement appartenir aux races les plus courageuses et les plus fortes, comme aussi les plus capables de gouverner les pays conquis et d'en accroître les ressources, sans se laisser énerver par l'abus des jouissances, et, chose non moins nécessaire, sans perdre l'habitude de la guerre. C'est ainsi qu'ont grandi et se sont perfectionnées, par la lutte, les races supérieures, politiques et guerrières, qui ont étendu leur domination sur le monde.
Cependant, les progrès de l'industrie et de la civilisation ont agi pour rendre les conquêtes à la fois plus coûteuses et moins productives : d'un côté, il a fallu employer pour les faire des armées mieux outillées et plus nombreuses; de l'autre, il a fallu respecter, dans une mesure de plus en plus large, l'existence et les droits des peuples conquis: [87] plus de confiscation de propriétés privées, le pillage même est interdit dans les armées civilisées, plus de populations emmenées en esclavage ou obligées de cultiver le sol au profit des vainqueurs. A l'époque où nous sommes parvenus, le bénéfice d'une conquête se résout presque uniquement dans l'agrandissement du débouché politique, administratif et militaire de la classe dirigeante du peuple conquérant; encore ce bénéfice restreint se trouve-t-il diminué, sinon annulé, par la nécessité qui s'impose aux vainqueurs d'admettre dans leurs rangs, sur le pied de l'égalité, la classe dirigeante du pays conquis. Dans ce nouvel état de choses, la guerre cesse de posséder le caractère qu'elle avait essentiellement à l'origine : celui d'une lutte nécessaire ou avantageuse pour l'existence, elle n'est plus qu'un moyen barbare, incertain et coûteux de vider les procès qui surgissent entre les États. Après avoir rapporté aux vainqueurs plus qu'elle ne coûtait, elle leur coûte maintenant plus qu'elle ne rapporte, et toute industrie qui en est là ne se trouve-t-elle pas irrémissiblement condamnée à périr? Le jour où il sera devenu évident pour tout le monde que la guerre ne couvre plus ses frais, — et cette démonstration, les dernières guerres ne l'ont-elles pas faite avec une clarté irrésistible? — ne renoncera-t-on pas à employer ce procédé arriéré et désormais improductif de s'emparer de la domination et de se procurer de la richesse?
A titre d'industrie de concurrence, la guerre n'en a pas moins joué un rôle utile dans la vie de l'humanité. Elle a éliminé d'abord les races les moins capables de se défendre et de se gouverner; elle a obligé ensuite celles qui ont survécu à déployer toute leur activité et toutes leurs ressources dans la lutte pour l'existence sous peine d'être asservies; elle a contraint enfin celles qui ont réussi à asservir les autres, à développer tous les éléments de [88] leur puissance pour maintenir leur domination, perpétuellement menacée par une concurrence étrangère ou même intérieure. La guerre a été ainsi un véhicule de progrès; elle a rendu le progrès nécessaire, du moins dans les industries spéciales qui servent à la domination, mais si telle a été la vertu du principe de concurrence impliqué dans la guerre, combien l'efficacité de ce principe ne doit-elle pas se trouver augmentée par son extension à la généralité des branches de l'activité humaine! La lutte pour l'existence ne s'impose plus seulement à une classe dominante, elle s'impose à tout le monde; l'industriel, l'agriculteur, le commerçant, le simple ouvrier libre sont désormais exposés à la concurrence, comme l'étaient jadis presque exclusivement les corporations politiques et militaires qui possédaient et gouvernaient les États. Comme elles, ils sont tenus de déployer et de développper toutes leurs forces physiques et morales pour soutenir une lutte devenue universelle, et dès qu'un progrès est réalisé dans la sphère de leur activité, fût-ce à une autre extrémité du globe, ils sont obligés de l'adopter sous peine de succomber tôt ou tard dans la lutte pour l'existence.
IV. — Comment s'impose le progrès sous un régime de concurrence. — Situation des industries concurrentes. — Qu'elles sont obligées à abaisser incessamment leurs prix de revient. — Éléments des prix de revient. — Possibilité croissante de les égaliser. — Que la concurrence pousse l'humanité en avant, en rendant le progrès nécessaire sous peine de dépossession et de mort.
Comment s'impose à tous les membres de l'État économique, peuples ou individus, et s'imposera de plus en plus, sous le régime de la concurrence généralisée, cette nécessité du progrès? Voilà ce qu'il nous reste à examiner.
[89]
Des peuples qui n'entretiennent point de relations commerciales, qui n'ont ensemble aucun rapport d'intérêt, peuvent subsister indéfiniment, sans que les progrès, réalisés par les uns, soient imités par les autres. Telle a été, pendant une longue suite de siècles, la situation du plus grand nombre des peuples. Chacun n'avait, avec les étrangers, que des rapports d'intérêt peu importants et presque toujours intermittents, chacun vivait chez soi et pour soi. Le progrès ne s'imposait à eux que pour la seule industrie de concurrence qu'ils pratiquassent : la guerre. Ils étaient obligés d'adopter l'armement et la tactique des nations les plus avancées dans l'art de la guerre, sous peine d'être vaincus, exterminés ou assujettis par elles. Mais ils ne ressentaient point, directement du moins, la nécessité de s'assimiler les progrès agricoles, industriels et commerciaux, réalisés ailleurs. Ne faisant que peu ou point d'échanges en dehors de leur frontières et se réservant leurs propres marchés, ils n'avaient rien à redouter de la concurrence des nations plus avancées dans les arts de la production. C'est pourquoi des siècles se passaient souvent avant qu'un procédé nouveau eût franchi les limites étroites du marché local où il avait pris naissance.
Mais, depuis que les progrès extraordinaires réalisés dans les moyens de transport ont commencé à opérer le rapprochement et la fusion des marchés locaux pour en faire un marché général, depuis que la masse croissante des produits de la grande industrie a afflué sur ce marché cosmopolite, depuis que la concurrence internationale s'est développée dans une progression de plus en plus rapide, la nécessité, pour chacun, d'imiter sans retard les progrès réalisés par autrui, et, s'il se peut, de les dépasser, est devenue sensible. Prenons encore, pour exemple, l'industrie cotonnière. Si les manufacturiers français, belges, allemands ou suisses se refusaient à adopter les machines et [90] les procédés perfectionnés qui permettent à leurs concurrents anglais de réduire au minimum le prix de revient des fils et tissus de coton, qu'arriverait-il? C'est qu'ils seraient supplantés sur le marché international par ces concurrents progressistes, c'est qu'ils perdraient peu à peu leur clientèle, et qu'on verrait l'industrie cotonnière décliner et périr en France, en Belgique, en Allemagne et en Suisse, tandis qu'elle grandirait en Angleterre. Or, la ruine d'une industrie entraîne la destruction ou la dispersion de la population à laquelle elle fournit des moyens d'existence. Si nous étendons la même hypothèse à l'ensemble des branches de travail, maintenant soumises à la loi de la concurrence, nous nous convaincrons qu'une population arriérée et paresseuse peut être ruinée et anéantie par la rivalité d'une population progressive et laborieuse, absolument comme pouvaient l'être et comme l'ont été si souvent, aux époques de barbarie, les nations molles et militairement inférieures en lutte avec des races énergiques et rompues au métier des armes. Si donc, comme nous l'avons démontré, l'avènement de la grande industrie a pour conséquence naturelle d'élargir indéfiniment le marché, et, en élargissant le marché, de substituer la concurrence au monopole, si la concurrence étendue à la presque généralité des branches de l'activité humaine, au lieu d'être restreinte à une seule, donne, aussi bien que la guerre, la victoire aux plus forts, en prenant cette expression dans son acception la plus large, qu'en doit-on conclure? N'est-ce pas que le progrès s'impose, sous peine de mort, à toutes les industries de concurrence, autrement dit, qu'elles sont tenues de se placer dans les conditions de production les plus favorables, de se constituer et de s'organiser de la manière la plus économique, d'introduire dans leur machinery et leurs procédés les perfectionnements qui en accroissent [91] l'efficacité, à moins de s'exposer à succomber, tôt ou tard, dans la lutte pour l'existence?
Économiquement, cela revient à dire que la concurrence oblige tous ceux qui se trouvent dans sa sphère d'action à abaisser incessamment leurs prix de revient, sous peine d'être expulsés du marché par ceux qui produisent à moins de frais. Mais cette obligation impérieuse, est-il toujours possible de la remplir? N'existe-t-il pas, dans les conditions de la production et dans la distribution de ses éléments constitutifs, des inégalités qu'il est impossible de combler? Ici, le sol est fertile, le climat est doux, le sous-sol est riche en combustible et en métaux; là, le sol est aride, le climat est rigoureux, le soussol est pauvre. Ici encore, les capitaux sont rares et chers; là, ils sont abondants et à bon marché. Dans telle région, la science de l'industrie et le génie de l'invention ont leurs foyers en même temps que l'esprit d'initiative et l'aptitude à diriger les entreprises; dans telle autre, au contraire, les connaissances professionnelles et les facultés requises pour gouverner l'industrie et la faire progresser existent à peine. Ici, enfin, le travail est rare et de qualité inférieure, tandis qu'ailleurs il est abondant et de qualité supérieure. Comment combler de telles différences? Comment égaliser partout les conditions de la production?
S'il s'agit des agents naturels, et plus ou moins immobiles, fécondité du sol, climat, richesses minérales, il ne faut pas songer, sans doute, à les égaliser, mais il faut s'y accommoder de manière à tirer le meilleur parti possible des éléments particuliers de richesse que contient chacune des diverses régions du globe. A cet égard, l'agrandissement indéfini des marchés, déterminé par l'avènement de la grande industrie, a singulièrement amélioré la situation des contrées les moins favorisées de la nature. Aussi longtemps que les populations qui s'y trouvaient [92] confinées n'eurent point de débouchés au dehors, elles furent obligées d'exploiter indistinctement les maigres productions de leur sol et de leur climat afin de pourvoir aux nécessités de la vie. Avec l'extension du marché commença une ère nouvelle; elles purent s'appliquer à l'exploitation de leurs éléments de production les plus riches en délaissant les plus pauvres, et obtenir ainsi, pour leur travail et leurs capitaux, une rétribution plus abondante. Sans doute, les inégalités naturelles qui existent, au point de vue économique, entre les diverses régions du globe ne s'effacent point, et il est clair que la puissance productive de la France et de l'Angleterre demeurera toujours supérieure à celle de la Laponie et du Spitzberg, mais l'extension du marché permet aux contrées les moins avantageusement dotées de tirer le meilleur parti possible de leurs ressources. S'agit-il maintenant des éléments artificiels et mobiles de la production, le capital, la science, le travail, les inégalités dont ils sont affectés et qui se perpétuaient sous le régime des marchés séparés et restreints tendent, au contraire, à disparaître sous le régime des marchés unifiés et illimités. Tandis qu'il y a un siècle à peine, les capitaux ne sortaient que par exception des localités où ils étaient produits, ils s'exportent aujourd'hui régulièrement des contrées où la production en est abondante, l'Angleterre, la France, la Hollande, la Belgique, la Suisse, dans toutes les autres parties du globe. C'est par milliards que se chiffrent déjà cette exportation et cette internationalisation des capitaux, et elle n'en est encore qu'à ses débuts. De même que les capitaux, les machines, les procédés et les méthodes dont l'invention ou la découverte constitue le progrès industriel demeuraient, sous le régime des marchés isolés et limités, presque entièrement localisés. Chaque foyer d'industrie conservait les secrets de sa fabrication, [93] et les inventions nouvelles, généralement mal accueillies, mettaient des siècles à se propager. Aujourd'hui, que voyons-nous au contraire? Les secrets des métiers sont divulgués dans la multitude des traités professionnels, et les inventions protégées par les brevets se propagent d'une manière instantanée dans les parties les plus reculées du domaine de la production. Tout inventeur, sérieux ou non, s'empresse de se faire breveter à l'étranger, aussi bien que dans son propre pays, afin de tirer de son invention le profit le plus élevé possible. Le progrès se généralise ainsi, porté sur le plus puissant et le plus rapide des véhicules : l'intérêt même de ceux qui le produisent. S'agit-il, enfin, de l'esprit d'entreprise, de la capacité industrielle et finalement, du travail? Même possibilité de les mobiliser désormais dans toute l'étendue du marché de la production. En dépit des obstacles que lui opposent encore l'esprit de monopole et les préjugés nationaux, cette sorte d'exportation, autrefois exceptionnelle, n'est-elle pas devenue un phénomène régulier et constant? Ce sont des entrepreneurs et des ingénieurs anglais, français, belges, allemands, américains qui construisent les chemins de fer, creusent les mines, établissent les exploitations perfectionnées de la grande industrie dans toutes les parties du globe. Partout, de même, les entrepreneurs d'industrie sont à la recherche des ouvriers les plus laborieux, les plus habiles et les moins chers, sans distinction de race ou de nationalité.
Si donc le progrès est devenu universellement nécessaire, il est devenu universellement possible.
Mais cette nécessité et cette possibilité de porter toujours dans les endroits où ils rencontrent les conditions naturelles d'exploitation les plus avantageuses, les éléments mobiles de la production, ont des conséquences économiques et sociales dont la gravité ne saurait être [94] méconnue. Elles n'impliquent rien moins que l'expropriation et la destruction des individualités et des races les moins intelligentes, les moins morales et les moins laborieuses, au profit de celles qui se distinguent par leur esprit d'entreprise, leur aptitude au progrès, leur esprit d'ordre et d'épargne, leur assiduité au travail. Celles-ci sont destinées à constituer d'une manière de plus en plus exclusive, à mesure que disparaîtront les monopoles naturels ou artificiels qui servent de forteresses à l'incapacité et à la paresse, les classes propriétaires et dirigeantes. Cependant, les positions qu'elles acquièrent sous un régime de concurrence leur sont incessamment disputées et elles ne peuvent les défendre qu'en maintenant leur supériorité. Dans cet effort constant et universel, le niveau commun ne manque pas de s'élever. A la vérité, les moins bien doués pour la lutte succombent. Ils descendent dans les rangs inférieurs de la hiérarchie sociale, sans y trouver plus que dans les autres un abri paisible et un refuge assuré. Là aussi, et d'une façon encore plus brutale et sommaire, la concurrence accomplit son œuvre de sélection. Nous avons constaté que la transformation progressive de la machinery de la production a pour résultat de remplacer le travail physique par le travail mécanique, en ne laissant à l'ouvrier que l'accomplissement d'un effort intellectuel et moral. Les travailleurs voués au labeur physique sous le régime de la petite industrie, qui ne pourront s'adapter à ces conditions nouvelles, disparaîtront, comme ont disparu les animaux primitifs lorsque le milieu où ils vivaient s'est modifié, en faisant place à ceux qui réussiront à s'y adapter et à leur descendance. Ainsi, la concurrence pousse, avec une impulsion qui va croissant en étendue et en intensité, l'humanité en avant, sans s'inquiéter des incapables et des traînards. Désormais, plus d'immobilité, plus de repos, il faut progresser ou périr.
[95]
Voilà le résultat le plus considérable de l'avènement de la grande industrie, et ce qui en fait une époque décisive dans la vie de l'humanité. Sans doute, des siècles s'écouleront encore avant que l'évolution dont nous avons essayé d'esquisser les caractères soit terminée, avant que la petite industrie ait cédé partout la place à la grande, avant que tous les marchés locaux et restreints se soient fondus dans un marché général, avant que la concurrence, débarrassée de ses entraves, soit devenue le propulseur et le régulateur universels, mais cette évolution a commencé, et aucune puissance humaine ne saurait l'empêcher de se poursuivre et de s'achever.[12]
[96]
CHAPITRE IV. Premiers effets de l'avènement de la grande Industrie et de la concurrence.↩
I. — Résumé des conséquences bienfaisantes de l'évolution économique issue de l'avènement de la grande industrie. — Progrès acquis : augmentation et diffusion du bien-être. — Diminution de la somme de travail nécessaire pour l'acquérir. — Que le perfectionnement du matériel et des procédés techniques de la production n'est cependant qu'un des éléments du problème de l'amélioration du sort du grand nombre. — Discordance entre le développement des moyens de créer de la richesse et l'augmentation de bien-être effectivement réalisée; le paupérisme. — Causes de cette discordance. — Date récente de l'apparition de la grande industrie. — Des crises qu'engendre tout progrès et, en particulier, la substitution de la concurrence au monopole. — Action perturbatrice des monopoles qui subsistent sous un régime de concurrence.
Dans les précédents chapitres, nous avons esquissé les principaux caractères de l'évolution économique issue de l'avènement de la grande industrie. Nous avons constaté qu'en substituant au vieil outillage mis en œuvre par la force physique de l'ouvrier un matériel mû par des forces mécaniques, la grande industrie n'avait pas seulement augmenté presque sans limites la puissance productive de l'homme, mais qu'elle avait encore engendré une série de phénomènes d'une portée considérable : transformation de la nature du travail, dans lequel l'action de l'intelligence, aidée des forces morales, remplace celle de la force physique; changement dans la proportion du capital et du travail, impliquant une intervention plus active des forces morales dans la production; agrandissement des entreprises et progrès de leur mode de constitution ouvrant un débouché aux capitaux de toute dimension et [97] aux capacités de toute provenance; extension de la solidarité des intérêts à tous les membres de l'État économique progressivement élargi; développement illimité de la concurrence, ayant pour conséquences l'établissement d'un ordre plus parfait dans la production, d'une justice plus exacte dans la distribution de la richesse, et rendant, dans toute la sphère soumise à son influence, le progrès nécessaire.
L'amélioration générale, continue et indéfinie de la condition matérielle et morale de l'homme, voilà, en résumé, la tendance de cette évolution qui a inauguré une nouvelle époque de la vie de l'humanité. En effet, si l'accroissement de la puissance productive rend la richesse plus abondante, et si la concurrence substituée au monopole agit de son côté pour en rendre la distribution plus équitable, ne pourra-t-on pas obtenir, jusque dans les couches sociales les plus basses, une quantité croissante des matériaux du bien-être en échange d'une somme de travail, qui ira s'amoindrissant à chaque progrès de l'industrie? Si la nature du travail de l'ouvrier se transforme, si ses facultés intellectuelles et morales sont demandées au lieu de sa force musculaire, ne se développeront-elles pas de manière à faire prédominer, dans cette nouvelle ère, l'être moral sur la brute? Si la sphère de la solidarité s'élargit, si l'humanité entière finit par ne plus former qu'une grande famille, dont tous les membres seront liés par des intérêts communs, une barrière de plus en plus haute et solide ne sera-t-elle pas opposée aux passions malfaisantes qui poussent à la guerre? Enfin, si la concurrence rend le progrès nécessaire dans le domaine de plus en plus vaste qu'elle est appelée à régir, cette vision consolante d'une société où régnent le bien-être, la justice et la paix, n'apparaît-elle pas comme le terme final de l'évolution industrielle?
[98]
Que quelques-uns de ces résultats soient déjà acquis et que nous nous trouvions en voie d'en acquérir d'autres, on ne saurait le contester. Les créations puissantes et ingénieuses de la grande industrie, manufactures, usines métallurgiques, bateaux à vapeur, chemins de fer, télégraphes, se sont multipliées avec une rapidité merveilleuse, la richesse s'est accrue dans des proportions sans précédent et le bien-être s'est vulgarisé. Dans tous les pays où la grande industrie s'est implantée depuis la fin du siècle dernier, la consommation des articles de confort, le froment, le café, le thé, le sucre, le tabac s'est progressivement développée. Pour les articles servant au vêtement, le progrès a été plus marqué encore, et si l'amélioration des logements a été moins sensible et moins générale, elle est cependant incontestable. Les villes se sont assainies et embellies, les rues ont été pavées, élargies, éclairées au gaz; l'aménagement des habitations est devenu plus commode, et le mobilier du plus petit bourgeois est aujourd'hui, sinon plus luxueux, du moins plus confortable que ne l'était autrefois celui du plus grand seigneur. Les consommations intellectuelles, à leur tour, se sont vulgarisées et, jusqu'à un certain point, raffinées; la lecture est devenu un besoin général, et au premier rang des industries de création moderne qui ont réalisé les progrès les plus saisissants figure la presse, qui apporte une alimentation quotidienne à l'esprit d'une classe de plus en plus nombreuse.
D'un autre côté, quoique la durée du travail à l'aide duquel la multitude achète les matériaux de l'existence et du bien-être n'ait pas cessé d'être excessive, elle a subi des réductions notables dans les pays qui donnent l'impulsion au mouvement industriel, en Angleterre et aux États-Unis. De 11 heures, et même de 12 et 13 heures, la durée effective de la journée de travail dans les manufactures [99] a été réduite à 10 heures ou même à 9, et il est permis d'espérer qu'elle descendra, dans un avenir peu éloigné, à 8 heures. On peut donc affirmer que les masses, qui vivent du produit de leur travail quotidien, se procurent actuellement, en échange d'une moindre somme d'efforts, une quantité accrue des matériaux de l'existence et du bien-être. On peut affirmer encore que tous les progrès nouveaux, qui viendront grossir le capital des progrès déjà réalisés, agiront dans le même sens, autrement dit qu'ils élèveront successivement, et dans une mesure indéfinie, la valeur ou le pouvoir d'échange du travail. Ajoutons que cette transformation des conditions de l'existence humaine ne peut plus être arrêtée. Les acquisitions faites sont indestructibles. On peut rêver les bouleversements politiques et sociaux les plus radicaux; on ne peut pas imaginer que le monde civilisé renonce à se servir de l'imprimerie, des métiers à filer et à tisser à la mécanique, des chemins de fer, des télégraphes et de l'éclairage au gaz pour en revenir à l'industrie des copistes, à la filature au rouet, au tissage à la main, aux diligences et à la chandelle. S'il cesse un jour d'employer son matériel actuel, ce sera parce qu'il aura à son service un matériel encore plus parfait. Non seulement tout progrès demeure acquis, mais il ouvre la voie à un nouveau progrès, en sorte qu'on ne peut assigner aux acquisitions futures de l'humanité d'autres limites que celles des forces et des éléments de production qui constituent son patrimoine.
Est-ce à dire cependant que le bien-être des générations futures doive s'augmenter, en quelque sorte mécaniquement, en raison directe des progrès de la machinery de la production? Non, sans doute. Nous pouvons acquérir en plus grande quantité et avec moins de peine les matériaux de l'existence et du bien-être, mais il ne s'ensuit pas [100] que la somme de notre bonheur ou même de notre richesse doive s'accroître nécessairement, quelle que soit la manière judicieuse ou folle, honnête ou vicieuse, dont nous usions de ces matériaux que le progrès a mis à notre portée. Nous pouvons être plus riches et plus heureux que ne l'ont été nos pères, mais ce n'est qu'une simple possibilité. Notre situation est analogue à celle d'une famille en possession de la fortune acquise par une longue succession d'ancêtres laborieux et économes : il est évident que les chances de bonheur de la dernière génération dépassent celles de la première, mais ce ne sont que des chances. Si elle ne sait point conserver son patrimoine héréditaire et le faire fructifier, si elle le gère mal, elle est exposée à perdre tout le fruit du travail et de l'économie des générations précédentes et à se retrouver dans une condition inférieure à celle des premiers artisans de la fortune de la famille. De même, quand on considère l'ensemble des nations et des familles, entre lesquelles une génération se partage, on s'aperçoit que si toutes peuvent grandir et prospérer, il n'en est cependant aucune qui se trouve à l'abri de la décadence et de la ruine. Leur destinée est entre leurs mains aujourd'hui comme elle l'a été de tout temps, comme elle le sera toujours. Les nations et les familles qui se montrent incapables de faire fructifier leur patrimoine déclinent et disparaissent, tandis que d'autres nations et d'autres familles plus énergiques et plus laborieuses s'étendent, se multiplient et s'enrichissent. On peut dire même qu'à mesure que le prix de la lutte s'élève, cette lutte devient plus serrée, et les risques qu'elle comporte deviennent plus grands. Les concurrents sont plus nombreux, la compétition est plus active, le prix est plus disputé. Ceux qui arrivent au but sont mieux récompensés, mais il est plus difficile d'y arriver, et malheur à ceux qui restent en chemin!
[101]
Que les progrès de la machinery de la production ne soient qu'un des éléments et non point le propulseur unique de l'amélioration du sort de l'espèce humaine, c'est un fait que démontre suffisamment la condition actuelle des sociétés civilisées. Il est impossible, en effet, de n'être pas frappé de la discordance qui existe entre les moyens dont elles disposent pour acquérir du bien-être et ce bien-être même.
Si l'on considère, d'une part, dans quelle proportion énorme s'est augmentée, depuis l'invention de la machine à vapeur, la puissance productive de l'homme, si l'on mesure la distance qui sépare les moyens d'acquérir la richesse de ceux que l'on possédait au commencement du dix-huitième siècle, et si, d'une autre part, on envisage le changement effectif qui s'est accompli dans la condition du grand nombre, on reconnaîtra que l'amélioration obtenue ici, quelque visible qu'elle soit, n'est pas en proportion avec le progrès réalisé là; on s'apercevra que la transformation de la machinery de la production et de la distribution de la richesse est loin d'avoir donné tous les fruits qu'il était permis d'en attendre; qu'une portion considérable de ces fruits est gaspillée sans profit pour le grand nombre ou même à son détriment; que la répartition de la richesse a continué de s'opérer de la façon la plus inégale en dépit du régulateur de la concurrence; que les résultats de la production, devenue plus féconde, s'accumulent par masses entre les mains d'une minorité, tandis que la multitude se trouve, non moins qu'elle l'était autrefois, exposée aux extrémités du dénùment; que si l'on ne peut nier que sa part se soit augmentée dans la distribution des matériaux du bien-être, cette augmentation n'est pas proportionnée à celle de la richesse générale; qu'en tous cas, sa condition, au lieu de devenir plus stable, est devenue plus précaire. Le débordément [102] du paupérisme est contemporain de l'avènement de la grande industrie. Après avoir mis en lumière la face brillante de la médaille du progrès, si nous voulions en montrer le revers, si nous esquissions le tableau des misères et des maux de tous genres qui affligent la masse du peuple, ce tableau ne serait-il pas des plus sombres, quand même nous nous abstiendrions scrupuleusement de le pousser au noir? Au sein des nations qui ont pris l'initiative du mouvement industriel, les couches inférieures de la société sont ravagées par le paupérisme; elles fournissent un contingent régulier à la prostitution et au crime, sans qu'on puisse signaler, dans leur condition avilie et précaire, aucune amélioration profonde et durable, sans que la somme de leurs souffrances semble s'être amoindrie sous l'influence du progrès industriel. Ces classes misérables, qu'entretient le budget grossissant de la charité publique et privée toujours impuissante à les relever, n'étaient représentées, dans l'ancien état de choses, que par de faibles échantillons, et, comme la richesse, la pauvreté se manufacture aujourd'hui par masses.
D'où provient cette discordance entre les moyens et les résultats, entre le progrès possible et le progrès réalisé? Elle provient de causes nombreuses et diverses, les unes tenant à l'imperfection naturelle des choses et à l'état de transition où nous sommes; les autres — et celles-ci de beaucoup les plus importantes — ayant leurs racines dans l'imperfection des hommes.
Passons-les rapidement en revue, en commençant par les premières.
Nous sommes, ne l'oublions pas, encore au début de l'évolution de la grande industrie. Même dans les pays les plus avancés, la petite industrie est encore prédominante. Si la production manufacturière s'y est presque entièrement tranformée, il n'en est pas de même de la [103] production agricole, commerciale, scientifique, littéraire, artistique. La culture, exercée sur de vastes espaces au moyen d'appareils mécaniques mus par la vapeur, n'existe encore qu'à l'état d'exception. Si le commerce en gros des denrées alimentaires s'est étendu et agrandi, le commerce de détail et la préparation des aliments sont demeurés généralement des entreprises et des travaux individuels. Le commerce en détail des articles manufacturés n'est en voie de transformation que depuis une époque récente. La fondation des magasins du Louvre, du Bon Marché et autres analogues, ne date que d'hier, et, malgré la supériorité économique de ces nouveaux appareils commerciaux, ils rencontrent de telles difficultés, soit dans les résistances de la routine, soit dans l'insuffisance professionnelle et morale de leur personnel, qu'ils ne pourront supplanter de sitôt, entièrement, le petit commerce, soutenu d'ailleurs par l'habitude enracinée de l'achat à crédit. C'est tout au plus si, dans les pays qui tiennent la tête du mouvement industriel, on peut évaluer à un quart de la production totale la part de la grande industrie. Les trois autres quarts n'ont pas cessé d'appartenir au vieil outillage, et bien des gens sont persuadés qu'il en sera toujours ainsi. Mais si nous ne sommes qu'au début de l'évolution industrielle, pouvons-nous, dès à présent, lui demander les fruits qu'elle portera seulement plus tard?
D'un autre côté, la transformation de l'industrie est, par elle-même, une cause de perturbation. Le progrès supprime ce qu'il remplace, et cette suppression ne s'opère pas, elle ne peut pas s'opérer, quoi qu'on en dise, sans dommages et sans souffrances. Les métiers mécaniques, en remplaçant les métiers à la main, ont anéanti le capital matériel que ceux-ci représentaient, avec le capital professionnel du personnel qui les mettait en œuvre. Ce personnel, exproprié de son industrie séculaire, a dû [104] en chercher une autre. De là une « crise, » dont les effets se sont fait sentir, d'une part, jusqu'à ce que l'industrie transformée eût reconstitué le capital anéanti; d'une autre part, jusqu'à ce que le personnel exproprié eût retrouvé des moyens d'existence. Chaque progrès, petit ou grand, a sa crise. Cette crise est plus ou moins étendue et intense, mais elle implique toujours des pertes, des perturbations et des souffrances.
Parmi les machines que le progrès a mises en branle, la concurrence est, sans contredit, la plus puissante et la plus bienfaisante. Elle agit à la fois comme un propulseur et un régulateur dans l'appareil perfectionné et agrandi de la production et de la distribution de la richesse. Cela n'empêche pas qu'elle ne provoque une crise au moment où elle vient remplacer le monopole. Malgré les précautions extraordinaires que l'on prend d'habitude pour amortir son premier choc, les entreprises d'une constitution débile et malsaine n'y résistent pas, et elles entraînent, directement ou par contre-coup, une foule d'intérêts dans leur chute. Par une action en sens inverse, la concurrence procure un accroissement de pouvoir et de profits aux branches de la production qui demeurent en dehors de sa sphère, soit que le monopole dont elles continuent à jouir ait un caractère naturel ou artificiel. Que la population vienne à s'augmenter, par exemple, avec la richesse, dans un pays où les terres propres à la production des subsistances sont peu étendues et médiocrement fertiles, où, en même temps, les propriétaires fonciers ont assez d'influence pour entraver l'importation des subsistances produites au dehors, qu'arrive-t-il? C'est que l'augmentation de la population et de la richesse provoquera une demande croissante des denrées alimentaires et qu'entre les divers agents nécessaires pour les produire, la terre, le capital et le travail, le premier étant [105] naturellement limité tandis que les deux autres ne le sont point, la rente de la terre s'élèvera dans une proportion plus forte que le profit du fermier et le salaire de l'ouvrier agricole. Citons encore un exemple emprunté à un genre de production tout différent. Une étoile du chant ou de la danse possède un monopole naturel, qu'elle doit à la rareté de l'offre et à la surabondance de la demande. Qu'en résulte-t-il? C'est qu'à mesure que les recettes des théâtres augmentent, grâce à l'affluence du public et aux subventions des municipalités ou des gouvernements « protecteurs des arts », on voit monter à une hauteur extraordinaire les appointements et les feux de ces étoiles pourvues d'un monopole, tandis que les salaires du commun des artistes et de la masse de leurs auxiliaires, figurants, choristes, machinistes, demeurent stationnaires ou du moins ne s'élèvent qu'avec les autres salaires de concurrence et dans la même proportion. Or, si l'on songe qu'un grand nombre de branches de la production n'ont pas cessé d'être investies d'un monopole plus ou moins complet; que la concurrence est rarement illimitée dans les autres; que des douanes, des privilèges, l'insuffisance des moyens de communication et d'information la restreignent presque toujours, on reconnaîtra qu'il existe ici encore une cause puissante d'inégalité dans la répartition des fruits du progrès, en même temps qu'un obstacle au développement de la production. Cette cause d'inégalité et de retard ira s'amoindrissant sans aucun doute à mesure que la concurrence gagnera du terrain; mais aussi longtemps qu'un monopole subsistera, il obtiendra, en vertu de la nature même des choses, au delà de la rétribution nécessaire à ses services, et cette rétribution s'élèvera d'autant plus que les industries de concurrence, ses tributaires, seront plus nombreuses et plus fécondes.
[106]
S'il était possible de faire le compte de la masse de richesses, dont la limitation de la concurrence à des degrés divers ralentit la production et trouble la distribution, on arriverait à un total énorme, surtout si l'on y comprenait le « passif » du plus gros des monopoles, celui du gouvernement. Depuis un siècle, les dépenses publiques se sont élevées dans une progression plus rapide que celle de l'accroissement de la richesse, accroissement assez correctement indiqué par l'augmentation graduelle du produit des impôts indirects. Les revenus ordinaires ne suffisant pas à la dépense, il a fallu combler la différence au moyen de l'emprunt, et nous avons dit à quelle somme formidable s'élèvent, aujourd'hui, les dettes des États civilisés. Si l'on observe encore que la plus grosse part de leurs dépenses a été employée à des fins improductives ou nuisibles, à armer la paix au delà du nécessaire et à déchaîner la guerre, on pourra se faire une idée de l'étendue du déficit que subit, de ce chef, la multiplication de la richesse.
Voilà bien des causes qui expliquent pourquoi le bienêtre n'a pas suivi la même progression que la puissance productive, d'ailleurs encore dans sa phase initiale d'expansion; pourquoi aussi la distribution de la richesse a échappé jusqu'à présent, en bien des points, à l'action régulatrice de la concurrence. A ces causes, qui tiennent principalement à l'imperfection des choses, viennent se joindre celles qui tiennent à l'imperfection des hommes, et celles-ci sont bien autrement actives et persistantes. Elles se résument dans l'insuffisance ou la perversion des forces physiques, intellectuelles et morales à l'aide desquelles l'homme crée les matériaux du bien-être et les applique à l'entretien de son existence.
[107]
II. — Cause la plus importante du retard du développement du bien-être. — Le personnel de la production n'a pas progressé du même pas que le matériel. — Aperçu sommaire de la production et de la distribution de la richesse. — Les entreprises, les agents productifs et les revenus. — Analyse des fonctions du personnel de la production, personnel dirigeant, capitaliste et ouvrier. — Opérations et obligations impliquées dans la formation des revenus. — Facultés intellectuelles et morales nécessaires pour les accomplir. — Nuisances qui naissent de leur non accomplissement. — Que la multiplication de la richesse et le développement du bien-être dépendent encore du bon emploi du revenu. — Obligations et nuisances. — Objet et résultats de la capitalisation.
La richesse se crée par la coopération des agents naturels, du capital et du travail, constituant le matériel et le personnel de la production. L'évolution économique, issue de l'avènement de la grande industrie, s'est opérée principalement, sinon exclusivement, grâce aux perfectionnements mécaniques et autres qui ont accru la puissance productive du matériel. On ne saurait constater un progrès équivalent ou même approchant dans le personnel. Si l'on compare, d'une manière générale, le matériel de la civilisation du dix-neuvième siècle à celui du dixseptième, on sera frappé de l'énorme distance qui les sépare; si l'on compare le personnel des deux époques, sous le triple rapport des forces physiques, des facultés intellectuelles et morales et de leur culture, la différence paraîtra beaucoup moins sensible. Nous sommes en possession d'un matériel de production incomparablement plus puissant et plus parfait que celui dont disposaient nos ancêtres; mais nous n'avons réalisé en nous-mêmes que des progrès relativement insignifiants, et, à part l'augmentation extraordinaire de nos connaissances technologiques, nous ne sommes guère supérieurs aux hommes des siècles passés; nous n'avons ni plus de vertus ni moins de vices. Nous ne sommes guère plus capables, qu'ils ne le seraient à notre place, de gouverner nos affaires et notre vie, quoique ce double gouvernement exige, sous le [108] nouveau régime de la grande industrie et de la concurrence, une dose d'intelligence et de moralité fort supérieure à celle qui suffisait sous le régime de la petite industrie et du monopole.
Si nous voulons apprécier toute l'importance de cette cause de retard et nous rendre compte de la façon dont elle agit, rappelons-nous comment la richesse se crée. Toute création de richesse implique une entreprise, et toute entreprise, à son tour, implique la coopération d'un personnel et d'un matériel associés ou combinés dans des proportions qui varient suivant la nature de l'entreprise. Tantôt les résultats de l'entreprise ne suffisent pas pour rétablir entièrement le personnel et le matériel qui y sont engagés, et, dans ce cas, il y a diminution et non point augmentation de richesse; tantôt, et c'est le cas le plus fréquent dans une société en progrès, ils suffisent et au delà ; la richesse se trouve accrue et la production peut se développer. Toutefois, son développement est subordonné à l'accomplissement d'une condition essentielle, c'est que l'excédant des résultats de la production soit capitalisé et employé à la formation d'une quantité supplémentaire de personnel et de matériel, qui serviront à agrandir les entreprises existantes ou à en fonder de nouvelles.
La richesse créée dans cette multitude d'officines que l'on nomme des entreprises, est distribuée entre les détenteurs des agents productifs investis dans chaque entreprise, personnel et matériel, et elle constitue leur revenu. Tout homme tire ses moyens d'existence d'un revenu provenant directement ou indirectement d'une entreprise, et il pourvoit à son entretien, aussi bien qu'à celui des êtres dont il est responsable, par l'emploi ou la consommation de ce revenu. L'ensemble des revenus d'une société représente donc exactement la somme de richesses que fournit [109] la production, et cette somme dépend, en premier lieu, de la quantité et du degré de perfection du matériel et des procédés techniques; en second lieu, du nombre et de la capacité du personnel qui met le matériel en œuvre. La production de la richesse s'accroît par l'agrandissement et la multiplication des entreprises; mais celles-ci, à leur tour, ne peuvent s'agrandir et se multiplier que par la capitalisation d'une partie des revenus, et l'investissement du capital ainsi constitué en un supplément de personnel et de matériel dans la proportion nécessaire.
Ces conditions du développement progressif de la production et de la richesse sont-elles remplies autant qu'elles peuvent l'être? Nous avons constaté à quel point le matériel de la production s'est perfectionné depuis un siècle. Le personnel actuel possède-t-il la capacité nécessaire pour en tirer le meilleur parti possible? Est-il au niveau des fonctions qu'il est chargé de remplir? L'analyse de ces fonctions peut seule nous permettre de résoudre cette question d'une manière positive.
Les fonctions du personnel de la production sont de deux sortes : les unes concernent la création, et les autres l'emploi de la richesse. Occupons-nous d'abord des premières.
Nous avons déjà eu l'occasion de remarquer que les fonctions du personnel engagé dans la multitude des branches de la production sont plus ou moins divisées selon la nature et les dimensions des entreprises; qu'elles sont le plus souvent réunies dans la petite industrie, tandis qu'elles sont séparées dans la grande; mais, séparées ou réunies, elles se partagent en trois catégories. Toute entreprise, quelles qu'en soient la nature et les dimensions, implique : 1° l'intervention d'un entrepreneur qui la fonde et d'un personnel qui la dirige et l'administre; 2° le concours d'un personnel de propriétaires ou de capitalistes [110] qui lui fournissent le capital nécessaire pour reconstituer son matériel et pourvoir à l'entretien de ceux qui le desservent, en attendant la réalisation des produits; 3° le concours d'un personnel auxiliaire de travailleurs qui mettent en œuvre, sous la conduite et la surveillance du personnel dirigeant, le matériel fourni par les capitalistes. Outre la vigueur et la santé physiques, chacune des fonctions qui appartiennent, soit au personnel dirigeant ou capitaliste, soit au personnel ouvrier, depuis la plus élevée jusqu'à la plus humble, exige la mise en activité d'un certain ensemble de facultés intellectuelles et morales qui lui soient adaptées. Cet ensemble varie, quant à l'espèce et au degré de puissance des facultés : 1° suivant la nature et l'importance des opérations intellectuelles que la fonction nécessite; 2° suivant le nombre et l'étendue des obligations morales qui y sont attachées.
Étudions à ce point de vue les trois catégories de fonctions que nous venons d'énumérer, à commencer par celles de fondation et de direction.
Une entreprise doit, pour être productive, répondre à un besoin qui ne soit pas pleinement satisfait par les entreprises déjà existantes. Il faut que l'entrepreneur sache découvrir et discerner ce besoin; qu'il apprécie les chances de bénéfices d'un établissement nouveau, et s'assure qu'elles dépassent les risques de pertes; qu'il choisisse le moment et l'endroit le plus propices pour le fonder; qu'il lui assigne les proportions réclamées par l'état d'avancement de l'industrie sans dépasser l'étendue du débouché; qu'il réunisse un capital suffisant pour lui permettre de fonctionner d'une manière régulière et sûre; enfin, qu'il se procure le concours d'un personnel, pourvu de la capacité et de la moralité nécessaires, pour le diriger. Toutes ces opérations exigent, surtout lorsqu'il s'agit d'une entreprise importante, la mise en œuvre d'un [111] ensemble peu commun de qualités intellectuelles : esprit d'investigation, sinon d'invention, jugement exercé et sain, tact fin et sûr dans la connaissance des hommes. Elles n'exigent pas, à un degré moindre, l'intervention des qualités morales. Il ne suffit pas qu'une entreprise couvre ses frais et réalise des bénéfices pour contribuer à l'augmentation de la richesse publique; il faut encore qu'elle n'ait point un but et qu'elle ne recoure point à des pratiques nuisible à autrui. Sinon — si elle se propose, d'une manière ou d'une autre, pour objet l'appropriation indue du bien d'autrui, ou la satisfaction d'une passion malsaine, ou bien encore, si elle s'efforce d'élever ses profits au moyen de pratiques abusives, telles que la falsification de ses produits ou la tromperie sur la qualité de ses marchandises, en un mot, si elle commet des « nuisances »,—elle contribue à diminuer la richesse au lieu de l'accroître. Il faut donc qu'aux qualités intellectuelles, nécessaires pour fonder des entreprises utiles, l'entrepreneur joigne les qualités morales qui détournent de les employer à la création d'entreprises nuisibles. Les fonctions du personnel dirigeant se résolvent de même dans l'accomplissement d'une série d'opérations intellectuelles et d'obligations morales. Les premières exigent, avec l'art de conduire les hommes, cette réunion de qualités, auxquelles on a donné le nom d'esprit des affaires; les secondent imposent l'application assidue de toutes les forces et de toutes les connaissances que l'on possède au bien de l'entreprise, tout en défendant de chercher ce bien dans le mal d'autrui. Sans doute, une entreprise peut prospérer par des voies malhonnêtes, quoique ce genre de prospérité soit naturellement précaire; mais, dans ce cas, le profit qu'elle usurpe n'est jamais équivalent au dommage qu'elle cause, et la différence se traduit par un amoindrissement de la richesse. Un certain nombre [112] d'industriels réalisent des fortunes rapides en falsifiant leurs produits, ou bien encore en profitant de l'imprévoyance et de la misère des ouvriers, dans des moments où la concurrence est insuffisante, pour réduire à l'excès le taux des salaires; mais, si ces deux pratiques nuisibles peuvent contribuer à édifier des fortunes particulières, elles agissent, en revanche, pour diminuer la richesse générale ou ralentir son essor. — N'en déplaise aux socialistes, les fonctions du personnel capitaliste ne sont pas plus que celles des autres coopérateurs de la production de simples sinécures. Il faut que le capitaliste sache défendre son argent, ce qui n'est pas toujours une tâche aisée, qu'il possède le tact et les connaissances indispensables pour choisir les bons placements, éviter les mauvais, et surveiller l'emploi de ses fonds. Comme il est dans la nature des choses que les vices de la fondation et de la gestion retombent sur le capital, chargé des risques des entreprises, le capitaliste est tenu d'exercer un contrôle attentif et efficace sur toutes les affaires dans lesquelles ses fonds sont engagés, s'il ne veut point s'exposer à la ruine. Analysez ce contrôle, et vous verrez qu'il se décompose en une série d'opérations qui demandent des qualités peu ordinaires d'intelligence et de caractère. La fonction du capitaliste implique encore des obligations morales ; en d'autres termes, elle lui impose des responsabilités dépassant de beaucoup celles qui pèsent sur les autres catégories du personnel de la production. Le fondateur ou l'entrepreneur, par exemple, conçoit une affaire, mais le capitaliste seul possède les moyens de faire passer son idée du domaine de la spéculation dans celui des faits, seul il peut appeler une entreprise à la vie et lui fournir les moyens de subsister. Il est donc principalement responsable des maux et des dommages qu'elle cause. S'il a entre les mains un instrument investi d'une puissance [113] extraordinaire, sa responsabilité est proportionnée à cette puissance. On s'explique ainsi que la conscience de tous les peuples ait flétri l'usure, c'est-à-dire l'abus que le capitaliste fait de son pouvoir en exploitant, en l'absence du régulateur de la concurrence, le besoin ou l'imprévoyance de l'emprunteur. Un jour viendra où cette même conscience publique, éclairée par la science, fera peser sur les capitalistes qui commanditent ou subventionnent des guerres et d'autres « nuisances », une réprobation analogue à celle dont elle a justement flétri les usuriers. — Les fonctions du personnel ouvrier comportent, de même, avec l'exécution d'opérations pour lesquelles le progrès industriel exige de plus en plus le concours de l'intelligence, l'accomplissement d'obligations qui sont du ressort des facultés morales. L'ouvrier doit s'acquitter bona fide de la tâche qui lui est assignée, et pour laquelle il reçoit un salaire, sinon, il exploite son patron, et cette exploitation n'est pas moins nuisible et condamnable que celle de l'ouvrier par le patron investi d'un monopole; l'inexactitude, l'incurie, le défaut de conscience avec lesquels il remplit ses obligations professionnelles, nuisent à l'entreprise en occasionnant une déperdition de capital, en empêchant le patron de s'acquitter de ses engagements, en provoquant des accidents, etc. D'un autre côté, si la responsabilité de l'ouvrier qui contribue à l'exécution d'une entreprise malfaisante, est moindre que celle du personnel qui la dirige ou la commandite, on ne saurait dire cependant qu'elle soit nulle; l'obéissance passive elle-même, malgré ce qu'elle a d'impérieux et de nécessaire, ne couvre pas entièrement la responsabilité du soldat; si on lui commande d'égorger des prisonniers, ou bien encore de s'insurger contre la loi en participant à une émeute ou à un coup d'État, son devoir lui commande de désobéir, quel que soit le risque [114] auquel il s'expose. Bref, les fonctions du personnel ouvrier révèlent à l'analyse, aussi bien que celles du personnel dirigeant et capitaliste, quoique dans une sphère plus restreinte, des opérations qui ne peuvent être exécutées, et des obligations auxquelles il ne peut être satisfait sans le concours de l'intelligence et des forces morales.
Supposons maintenant que les diverses fonctions que nous venons de passer en revue soient remplies comme elles doivent l'être; supposons que le personnel qui fonde, dirige et administre les entreprises, le personnel capitaliste qui les alimente, le personnel ouvrier qui les dessert exécutent correctement toutes les opérations qui constituent leur « travail » et s'acquittent non moins correctement de toutes les obligations qui constituent leur « responsabilité », quel sera le résultat? C'est que toutes les entreprises seront productives et qu'il n'y en aura pas de destructives; c'est que la production de la richesse sera aussi abondante que le comporte le degré d'avancement de l'industrie. Cependant, même dans cette hypothèse, à coup sûr fort éloignée de la réalité, la production ne pourra croître qu'à la condition que l'on constitue et que l'on mette à son service un supplément de matériel et de personnel dans la proportion nécessaire. Or, la création de ce supplément d'agents productifs ne dépend pas seulement de la manière dont la richesse est produite et distribuée, elle dépend encore de la manière dont elle est consommée. Ceci nous amène à la seconde partie de la tâche qui incombe au personnel de la production, et qui consiste à bien employer un revenu bien acquis.
A son tour, le bon emploi du revenu implique l'accomplissement d'une série d'obligations qui dérivent de la nature même de l'homme et des conditions de son existence.
Non seulement la vie de l'homme est courte, mais encore [115] elle se partage en deux périodes d'une durée à peu près égale, celle de la jeunesse et de la maturité qui est productive, celle de l'enfance et de la sénilité qui ne l'est point. Il ne peut donc subsister dans la seconde qu'à l'aide des moyens d'existence acquis et accumulés dans la première. Un autre phénomène, dont il faut aussi tenir compte, c'est que tout revenu est naturellement précaire. Il peut diminuer ou tarir : en premier lieu par suite de l'amoindrissement ou de la perte de l'emploi qui le procure; en second lieu, de l'affaiblissement ou de la ruine de la capacité à remplir cet emploi. Ce deux phénomènes exercent une influence déterminante sur les obligations auxquelles l'emploi du revenu doit pourvoir et qui peuvent être ainsi résumées. Tout homme doit : 1° pourvoir à son entretien actuel de manière à conserver en bon état, et, s'il se peut, à augmenter son capital de forces et de facultés productives; 2° s'assurer contre les risques de chômage, d'accidents et de maladies; 3° subvenir, s'il a pris la charge d'une famille, à l'entretien de sa compagne, à l'élève, à l'éducation et à l'établissement de ses enfants; 4° mettre en réserve de quoi subsister dans la période improductive de la vieillesse; 5° assister, dans la mesure de ses ressources, ceux de ses semblables qui n'ont pas été autant que lui favorisés dans la distribution des biens et des avantages de ce monde; enfin 6°, en remplissant ces diverses obligations, se garder d'élever sa dépense audessus de sa recette.
Toutes ces obligations ont un caractère de nécessité en ce sens que leur non-accomplissement engendre toujours une nuisance pour soi ou pour les siens, et, directement ou indirectement, pour autrui. — Si l'on ne règle point sa consommation actuelle de manière à maintenir en bon état ses facultés productives, on subit une déperdition prématurée de forces, on ne peut plus contribuer, dans la [116] même mesure, à la création de la richesse, et on ne peut plus prétendre à en recevoir la même part. On perd ainsi une partie de sa capacité à remplir ses autres obligations. — Si l'on ne s'assure point d'une façon ou d'une autre contre les risques de chômage, d'accidents et de maladies, on s'expose soi et on expose les siens aux dommages attachés à l'échéance de ces risques. Le fardeau de ces conséquences naturelles de l'imprévoyance peut, à la vérité, être rejeté sur autrui, mais, dans ce cas non moins que dans l'autre, il y a nuisance. — Si l'on ne pourvoit point à l'entretien de sa compagne, on la met dans la nécessité de se livrer à des travaux incompatibles avec les soins du ménage et les obligations de la maternité. Nuisance! En tout cas, même lorsque la femme mariée apporte à la communauté un revenu qui suffit à sa dépense, il reste à pourvoir à l'entretien des enfants. Ceux qui mettent un enfant au monde contractent par là même l'obligation de l'élever et de lui donner une éducation appropriée à ses facultés, et cette obligation se résout en une dépense plus ou moins forte. Cette dépense se grossit encore de celle qu'occasionnent les enfants qui meurent avant d'avoir atteint l'âge d'homme. De quelques centaines de francs dans les couches inférieures de la société, elle monte à 10,000 francs, 20,000 francs, 30,000 francs et davantage dans les couches supérieures; mais, faible ou forte, elle doit être prise sur le revenu des parents, à moins qu'ils ne s'en déchargent sur la charité publique ou privée, en d'autres termes, sur les revenus d'autrui. S'ils ne s'acquittent qu'incomplètement de ce genre d'obligations, s'ils ne procurent pas à leurs enfants un entretien suffisant avec l'éducation nécessaire, s'ils entravent leur développement physique et moral en les assujettissant à un travail hâtif et trop souvent meurtrier, il en résulte une autre nuisance. Celle-ci n'atteint pas seulement les enfants, qui [117] ne se développent pas autant qu'ils auraient pu le faire, elle atteint encore la société, à laquelle ils rendent de moindres services, à laquelle ils finissent même généralement par être à charge. — Si l'on ne contribue point, dans la mesure de ses ressources à secourir les misérables, de deux choses l'une : ou on laisse des souffrances sans soulagement ou l'on aggrave pour autrui le fardeau de l'assistance. Enfin, si, en remplissant ces obligations, qu'implique le bon emploi du revenu, on ne maintient point rigoureusement sa dépense au niveau de sa recette, on entame son capital, à moins qu'on n'ait recours aux revenus ou aux capitaux d'autrui. Dans l'un ou l'autre cas, on nuit à soi-même et aux autres.
Parmi les obligations qui viennent d'être énumérées, les unes concernent le présent, les autres l'avenir. Les premières donnent lieu à la consommation actuelle et elles absorbent généralement la portion la plus considérable du revenu; les secondes ne peuvent être satisfaites que par la mise en réserve, l'accumulation, ou, pour nous servir de l'expression consacrée, la capitalisation de l'autre portion, en vue de la consommation future. Cette mise en réserve, cette capitalisation, s'accomplit au moyen d'une opération à laquelle concourent à la fois l'intelligence et les facultés morales et qui porte le nom d'épargne. Ainsi les résultats de la production, distribués sous forme de revenus, fournissent, en quelque sorte, la matière première de la capitalisation, et cette matière première, l'épargne la transforme en capital. Le capital constitué, que devient-il? A quelle destination est-il appliqué? Une portion est incorporée dans la nouvelle génération, qui continue le personnel de la production; une autre portion s'ajoute, sous une forme ou sous une autre, au matériel existant. Tantôt elle demeure provisoirement inactive jusqu'à ce que les obligations en vue desquelles [118] elle a été créée la réclament, tantôt elle est mise immédiatement au service de la production. Grâce aux progrès de la machinery du crédit, cette dernière éventualité tend à devenir le fait général : les capitaux inactifs ne sont plus aujourd'hui que l'exception; à peine la moindre fraction du revenu est-elle saisie par l'épargne qu'elle est aussitôt placée, ou, ce qui revient au même, investie dans le matériel d'une entreprise.
Selon que les revenus qui fournissent la matière première de la capitalisation sont plus ou moins nombreux et élevés, selon que l'épargne est plus ou moins active, la création du capital est rare ou abondante. Les revenus sont essentiellement inégaux, et ils doivent l'être, puisqu'ils répondent à des participations inégales à l'œuvre de la production. Ils se différencient en raison du contingent de forces et de ressources, en personnel et en matériel, que chacun apporte à cette œuvre. Les uns se chiffrent par centaines de milliers de francs et même par millions; ceux qui jouissent de ces grands revenus peuvent, non seulement pourvoir amplement à leur consommation actuelle, mais encore capitaliser bien au delà des sommes nécessaires à leur consommation future; ils peuvent augmenter, à leur gré, le personnel de leur famille et lui léguer cependant une fortune accrue. A l'autre extrémité sociale se présente une situation opposée : les revenus n'y suffisent point, ou y suffisent à peine, pour remplir les obligations auxquelles ils doivent pourvoir; l'épargne y est difficile et rare, et trop souvent le capital y diminue au lieu de s'augmenter. Mais le plus grand nombre des revenus s'échelonnent entre ces deux extrêmes, et c'est surtout grâce à l'activité de l'épargne dans cette région moyenne qu'on voit, en dépit de tant de causes de retard, les sociétés civilisées croître rapidement en nombre et en richesse. Il est incontestable, et nous [119] pouvons même nous dispenser de citer des chiffres à l'appui d'un fait si évident, il est incontestable, disons-nous, que cet accroissement a eu lieu depuis l'avènement de la grande industrie, dans une proportion plus considérable qu'à aucune période antérieure de l'histoire, sauf peutêtre à l'époque reculée qui a vu naître l'agriculture et les premiers arts. Seulement, il présente des inégalités extraordinaires suivant les peuples, et plus encore suivant les classes et les familles. Tandis que les uns ont profité largement de l'accroissement de la puissance productive, les autres sont demeurés dans la condition misérable où ils se trouvaient auparavant, parfois même ils sont descendus plus bas encore, et la paupérisation de ceux-ci a formé un contraste saisissant et douloureux avec l'enrichissement de ceux-là. Quelle conclusion tirer de ce spectacle, sinon que le perfectionnement du matériel et des procédés techniques de la production n'est qu'un des éléments du problème du progrès, sinon encore que le personnel est demeuré en arrière du matériel, qu'il est resté au-dessous des fonctions et de la tâche qu'imposent, sous le nouveau régime de la grande industrie et de la concurrence, la création et le bon emploi de la richesse?
III. — Insuffisance intellectuelle et morale du personnel de la production. — Vices et vertus. — Leur influence sur la multiplication de la richesse. — Analyse des effets économiques de l'incontinence et de l'intempérance. — Nuisances causées par le vice. — Accord de la morale et de l'économie politique. — Le sophisme de Mandeville. — Ce qu'il faut penser du luxe.
Quand on examine, en effet, même dans les pays où la culture physique, intellectuelle et morale de l'homme a réalisé le plus de progrès, comment sont fondées, dirigées, commanditées et mises en œuvre les entreprises qui créent la richesse et la distribuent ensuite, directement ou indirectement, sous forme de revenus, à tous les membres de [120] la société; comment les revenus sont employés, trop souvent sans que ceux qui les dépensent au jour le jour paraissent posséder la plus légère notion des obligations dont ils sont tenus de s'acquitter, sous peine de nuire à eux-mêmes et à autrui; on ne tarde pas à se convaincre que le plus grand nombre des hommes demeure, sous le double rapport de la production et de l'emploi de ses moyens d'existence, singulièrement au-dessous de sa tâche. Son insuffisance à la remplir s'est montrée de tout temps et dans toutes les sociétés, mais peut-être n'a-t-elle jamais été aussi sensible que de nos jours. Non que l'étalon de l'intelligence et de la moralité ait baissé, mais parce que la transformation de l'industrie et l'extension de la concurrence exigent, de la part de ceux qui mettent en activité un matériel perfectionné dans un milieu agrandi, un étalon d'intelligence et de moralité plus élevé.
Toute individualité se compose d'un ensemble de forces physiques, intellectuelles et morales qu'il s'agit de dresser et d'utiliser en vue du plus grand bien de chacun et de tous. C'est un mécanisme puissant, mais compliqué et délicat, dont on peut tirer un parti bon ou mauvais, selon l'usage qu'on en fait. A cause précisément de sa complication et de sa délicatesse, ce mécanisme n'est jamais parfait dans toutes ses parties, et chacune de ses imperfections ou de ses lacunes en diminue l'effet utile. Mais on peut le corriger, et même, jusqu'à un certain point, le perfectionner. Si nous savons contenir, discipliner et diriger les puissances de notre être, si nous les employons conformément à leur nature et dans leur mesure, nous en tirerons tous les services qu'elles sont capables de rendre; mais, si nous sommes incapables de les gouverner, si nous les abandonnons à leurs propres impulsions, elles empiéteront les unes sur les autres, les plus fortes paralyseront et dévoreront les plus faibles, et, par le fait de l'excès de [121] celles-là et de l'insuffisance de celles-ci, toute l'économie de la machine humaine se trouvera viciée et affaiblie: l'attrait des sexes nécessaire à la conservation et à la multiplication de l'espèce étouffera, par son exubérance et sa perversion, toute prévoyance et tout sentiment de responsabilité, il deviendra de l'incontinence ou de la luxure; le besoin de l'alimentation dégénérera en gourmandise et en ivrognerie; le sentiment fortifiant et légitime de la valeur que l'on possède produira, en s'exagérant, la bouffissure de l'orgueil; le désir d'être apprécié par autrui, comme on s'apprécie soi-même, passera à l'état maladif et prendra le nom de vanité; l'abus de la prévoyance donnera naissance à l'avarice; enfin, la nécessité de satisfaire des passions déréglées et excessives fera taire les scrupules de la conscience et transformera le penchant à acquérir en une source inépuisable de fraudes et de violences. Bien équilibrées et dirigées, nos forces intellectuelles et morales produisent les vertus qui président à l'accomplissement des obligations inhérentes à la condition humaine; abandonnées sans règle et sans frein à leurs propres impulsions, elles produisent des vices qui rendent l'homme impropre à s'acquitter de ses obligations ou le poussent à en rejeter le fardeau sur autrui; elles contribuent ainsi, tantôt à augmenter la richesse et le bien-être, tantôt à les diminuer.
On pourrait entrer dans le détail, montrer comment et même dans quelle mesure toutes les vertus, qui sont le fruit d'un bon self government, agissent pour élever le niveau de la richesse et du bien-être; comment, au contraire, tous les vices qu'engendre un mauvais self government agissent pour l'abaisser. Quelque statisticien ingénieux mettra sans doute un jour cette vérité en pleine lumière, en dressant le budget de chacune de nos vertus et de chacun de nos vices. Cette statistique économico-morale [122] fera toucher du doigt mieux qu'aucune autre démonstration la cause principale de la discordance qui existe entre le progrès réalisé et le progrès possible. Sans entreprendre une tâche aussi vaste, et simplement pour donner un exemple de la méthode à suivre, essayons de faire apprécier le dommage que causent à l'humanité deux vices que l'Église a rangés au nombre des péchés capitaux : l'incontinence et l'intempérance.
Les forces physiques et morales, dont le débordement ou la perversion engendre le vice de l'incontinence, ont pour fonction nécessaire de renouveler et d'augmenter le personnel de la production. Ce personnel n'a qu'une durée très bornée : la vie de l'homme est renfermée dans le cadre d'un siècle, et la période productive de sa carrière dépasse rarement trente ou quarante ans; en moyenne, c'est tout au plus même si elle atteint la moitié de cet espace de temps. Quant aux entreprises d'où il tire ses moyens d'existence, leur durée, qui s'étend de quelques jours à quelques siècles, n'a aucune relation avec celle de la vie humaine. Mais, qu'elles soient durables ou éphémères, elles exigent la coopération continue du personnel, qui s'y case comme les abeilles dans les alvéoles d'une ruche. A mesure qu'une génération prend sa retraite ou disparaît, elle laisse vacantes des alvéoles, qui sont aussitôt remplies par la génération suivante, jusqu'à ce que le personnel de la ruche humaine soit entièrement renouvelé. Si la reproduction de l'espèce était toujours réglée d'après le nombre des alvéoles existantes ou en voie de formation, si le personnel ainsi perpétuellement renouvelé était pourvu des facultés et des connaissances requises par les fonctions qu'il est appelé à remplir, ce renouvellement s'opérerait comme celui du matériel, aussi économiquement que possible. Mais l'incontinence, à laquelle se joignent le défaut de prévoyance et [123] l'absence du sentiment de la responsabilité, intervient, et elle occasionne, dans la reproduction de l'espèce, des nuisances qui, non seulement ralentissent le progrès de la richesse, mais encore celui de la population elle-même: 1° elle donne le jour à une multitude d'êtres qui n'arrivent point à l'âge d'homme, soit qu'ils manquent d'une dose suffisante de vitalité, soit que les moyens de les élever fassent défaut ou ne leur soient point appliqués; 2° elle met au marché de la population plus d'hommes qu'il n'y a d'emplois disponibles, ou, ce qui est plus fréquent, elle y met un personnel impropre à s'acquitter de la tâche et des obligations qui lui sont départies, au double point de vue de la production et de la consommation, de la création et de l'emploi du revenu. On peut se rendre aisément compte de la nature et de l'étendue des dommages causés par ces nuisances. En premier lieu, la société perd tout le capital investi dans l'entretien et l'éducation des enfants qui n'arrivent pas à l'âge productif; en second lieu, elle perd encore tout ce que coûte un excédant de population sans emploi ou une population imparfaitement préparée à remplir les emplois auxquels elle est destinée. Additionnez ces deux pertes pendant la durée d'une génération, et vous arriverez à un total véritablement colossal. Supposons que la reproduction de la population cesse de subir l'influence perturbatrice de l'incontinence et des autres vices qui lui font cortège, supposons qu'elle soit réglée de manière à renouveler en nombre et en qualité, avec le moins de déchet et le moins de non-valeurs possibles, le personnel de la production; non seulement de cruelles souffrances seront évitées, mais encore le capital de la société, n'ayant pas à supporter les frais de ce déchet et de ces non-valeurs, s'augmentera plus vite, les entreprises pourront se multiplier davantage et les emplois avec eux, le débouché [124] qu'elles ouvrent au personnel sera plus large, et, en dernière analyse, la population croîtra plus rapidement en nombre et en richesse.
Si nous étudions de même la « nuisance » causée par l'intempérance, nous constaterons une perte de forces et de richesses, moindre sans doute, mais encore énorme. L'intempérance n'est autre chose que le dérèglement et l'abus d'un besoin de première nécessité : celui de réparer ses forces par l'absorption régulière d'une certaine quantité d'aliments, à l'état solide ou liquide. Les boissons spiritueuses, dont le goût immodéré produit la variété la plus malfaisante de l'intempérance, les boissons spiritueuses, disons-nous, prises dans la mesure qui convient au tempérament et aux occupations de chacun, peuvent, comme d'autres stimulants, avoir un effet utile et entrer dans un bon régime alimentaire; prises avec excès, elles agissent comme un poison. L'ivrognerie, qui s'est particulièrement propagée depuis que les classes inférieures ont acquis le droit de se gouverner elles-mêmes, cause une double nuisance : 1° elle donne lieu à une dépense, que des statisticiens ont évaluée, en Angleterre, aux deux tiers du budget du Royaume-Uni; 2° en affaiblissant et en dégradant ceux qui s'y livrent, elle détermine à la fois une perte de forces productives et une incapacité à remplir des obligations nécessaires, qui coûtent à la société bien au delà de la somme dépensée en boissons enivrantes.
Soumettez tous les autres vices, l'orgueil, la vanité, la paresse, la cupidité, l'avarice au même procédé d'analyse; examinez chacune des nuisances qu'il est dans leur nature de produire; faites le compte des dommages causés par l'ensemble de ces nuisances, et vous comprendrez pourquoi le bien-être est demeuré à toutes les époques, mais surtout depuis l'avènement de la grande [125] industrie, infiniment au-dessous des moyens de le créer. En même temps, une conclusion, d'une importance capitale, se dégagera de cette analyse : c'est que tout progrès de la moralité est la source d'un progrès correspondant dans la multiplication de la richesse; c'est que la morale est d'accord avec l'économie politique : on pourrait dire même qu'elle n'en est qu'une branche.
Est-il nécessaire de remarquer que cette vérité d'observation, qui nous paraît maintenant si évidente, a été longtemps contestée, et même que le sophisme contraire subsiste encore à l'état de croyance populaire? Il n'y a pas deux siècles qu'un précurseur de Fourier, Mandeville, se faisant l'écho de l'opinion générale, soutenait, dans sa célèbre Fable des abeilles, que nos vices : l'orgueil, la vanité, la gourmandise, etc., sont les principaux véhicules de la multiplication de la richesse; une société qui n'aurait que des vertus, disait-il, serait, sans contredit, moralement supérieure à la nôtre, mais elle lui serait inférieure au point de vue économique; elle n'aurait point de luxe, et, par conséquent, elle ne posséderait aucune des industries que le luxe alimente : ce serait une société de pauvres.
Si l'auteur de la Fable des abeilles, au lieu de se contenter d'une observation superficielle, avait jeté sur la société un regard plus profond, il ne serait pas tombé dans une erreur analogue à celle du vulgaire sur les mouvements des corps célestes; il se serait aperçu qu'en économie politique, comme en astronomie, l'apparence ne donne qu'une indication trompeuse de la réalité. Il aurait vu que les vices, qui semblent les promoteurs de la richesse, en sont, au contraire, les destructeurs, et qu'en admettant que la ville de Londres, objectif de sa fable, eût renfermé moins de gens adonnés aux sept péchés capitaux, elle n'en eût été que plus florissante. En effet, la [126] richesse d'une société dépend du nombre et de la capacité physique, intellectuelle et morale du personnel de la production, aussi bien que de la quantité et du degré de perfection du matériel. Or, quelle est l'action naturelle des vices que l'auteur de la Fable des abeilles considérait comme les sources de la richesse publique? C'est d'affaiblir, de dégrader et de diminuer le personnel de la production, et, par contre-coup, de faire obstacle à l'augmentation du matériel. Nous venons d'analyser l'action délétère qui est propre à l'incontinence et à l'intempérance. Le luxe engendré par l'orgueil et la vanité, que l'auteur de la Fable des abeilles avait surtout en vue, produit des nuisances analogues quand il n'est pas mesuré aux ressources de ceux qui le déploient, et c'est précisément l'effet des penchants vicieux de rompre cette mesure.
Est-ce à dire qu'il faille condamner le luxe? Cette question, qui a provoqué au dix-huitième siècle des dissertations si fastidieuses, ne comporte, on le conçoit, aucune solution absolue. C'est une affaire de situation. Si vous possédez un revenu suffisant, vous pourrez, après avoir satisfait à toutes vos obligations, après vous être assuré contre les risques qui menacent vos capitaux et vousmême, après avoir mis en réserve la somme nécessaire à l'éducation et à l'établissement de vos enfants, etc., vous pourrez, dis-je, consacrer l'excédant de votre revenu à des dépenses de luxe. Si ce luxe est de nature à développer l'intelligence, à élever et à raffiner le goût, et, par là même, à augmenter la valeur personnelle de ceux qui participent à ses jouissances, il agira comme une cause d'accroissement de la richesse, et on ne saurait le condamner. Mais, même dans ce cas, même quand le luxe n'est pas employé à alimenter des appétits grossiers ou pervers qui dégradent ou affaiblissent, il ne doit venir [127] qu'après que toutes les obligations auxquelles l'emploi du revenu doit pourvoir sont exactement remplies, sinon les nuisances qu'il cause dépassent les avantages qu'il procure.
Une observation superficielle ne démêle point ces différences : que le luxe soit grossier ou raffiné, sain ou malsain, qu'il se trouve mesuré ou non au revenu, il alimente de nombreuses et importantes industries; on peut donc s'imaginer qu'il contribue quand même à l'augmentation de la richesse; mais supposons que, dans la société la plus industrieuse et la plus prospère, les vices qui poussent au dérèglement du luxe, le goût des plaisirs sensuels, le désir de briller viennent à croître et à se généraliser, qu'arrivera-t-il? C'est que les revenus, si élevés qu'ils soient, cesseront bientôt de suffire aux dépenses; c'est qu'une classe, de plus en plus nombreuse, s'habituera à sacrifier l'accomplissement de ses obligations les plus nécessaires à la satisfaction immodérée de ses appétits; c'est que l'incontinence multipliera des fruits qui ne viendront pas à maturité; c'est qu'une élève et une éducation insuffisantes ne formeront qu'un personnel incapable de remplir sa tâche, et qui ira se gâtant de génération en génération; c'est que les entreprises moins bien desservies deviendront moins productives, fussent-elles protégées contre la concurrence étrangère; c'est, enfin, que la société tombera en décadence. A la vérité, cette décadence pourra être ralentie par les progrès de la machinery de la production, soit que ces progrès viennent du dedans ou du dehors, mais si une réforme morale ne porte point remède au mal, le développement de la puissance productive, quelque abondant qu'on le suppose, sera impuissant à en arrêter les effets destructeurs, et l'édifice social finira par tomber en ruines.
Supposons, au contraire, que toutes les obligations [128] qu'impliquent la production et le bon emploi de la richesse soient scrupuleusement remplies, ou du moins que la part du vice soit réduite autant qu'elle peut l'être, les entreprises croîtront en nombre et en importance, grâce à la multiplication et à l'amélioration des agents qui leur sont indispensables, personnel et matériel, la source des revenus deviendra plus abondante, la société s'enrichira, et elle pourra accorder une part de plus en plus large aux dépenses de luxe.
C'est donc une erreur de croire, avec l'auteur de la Fable des abeilles, que les vices de la civilisation créent de la richesse; c'est une autre erreur de s'imaginer qu'en encourageant les dépenses de luxe on contribue à enrichir une nation. Le luxe n'a pas besoin d'être encouragé: il ne présente par lui-même que trop d'attraits, et il est bien rare qu'il ne remplisse pas toute la place qu'il peut utilement remplir. Si on l'encourage en subventionnant des théâtres et en donnant des fêtes publiques, il en résulte une double nuisance. En premier lieu, une partie de l'impôt qui pourvoit à ces prodigalités, et non la moindre, tombe sur des contribuables dont le revenu ne suffit pas même à l'accomplissement de leurs obligations les plus urgentes. En second lieu, les dépenses de luxe, artificiellement excitées, empiètent sur les dépenses nécessaires que l'on ne peut réduire sans dommage pour soi-même ou pour autrui. Est-il besoin d'ajouter que si les encouragements donnés au luxe contribuent à faire aller un certain nombre de branches spéciales d'industrie et de commerce, c'est aux dépens de la prospérité de toutes celles qui servent à satisfaire les obligations qu'un luxe déréglé fait négliger?
[129]
IV. — Résumé des obstacles qui retardent le développement du bien-être et engendrent le paupérisme. — Le mauvais gouvernement des entreprises. — Insuffisance du personnel dirigeant, capitaliste et ouvrier à remplir ses obligations professionnelles. — Résultats : la faillite, les crises. — Solidarité des crises. — Le mauvais gouvernement de la vie privée. — Contagion du vice et de la misère. — L'ensemble des causes du mal. — Que le progrès ne peut s'improviser. — Absurdité des panacées socialistes et des théories rétrogrades. — Comment s'accomplit le progrès. — Stimulant de la concurrence.
Si nous jetons un coup d'œil d'ensemble sur le tableau que nous venons d'esquisser; si nous considérons, d'une part, les progrès de tous genres qui, depuis l'avènement de la grande industrie, ont accru la puissance productive de l'homme, étendu les conquêtes de la civilisation et assuré leur avenir; si, d'une autre part, nous constatons combien faibles et insuffisants sont demeurés, en présence d'une tâche devenue plus compliquée, les progrès de l'intelligence et de la moralité; si nous énumérons et mesurons les obstacles que l'ignorance et les vices de l'immense majorité des hommes opposent à leur bien-être, sans parler de ceux qui proviennent de l'imperfection des choses, nous nous expliquerons les inégalités et les antithèses désolantes et redoutables que présente l'état actuel de nos sociétés, nous comprendrons que l'augmentation prodigieuse de la richesse ait pu être accompagnée du débordement du paupérisme, et qu'au milieu de ces sociétés, en possession de tous les moyens de satisfaire les besoins les plus raffinés, des classes entières semblent fatalement condamnées à la misère et au crime. Nous disposons d'un outillage d'une puissance incomparable et qui va se perfectionnant chaque jour, mais comment en usons-nous? Comment les entreprises, qui sont les sources de notre richesse, sont-elles conduites et mises en œuvre? Comment le monde des affaires est-il gouverné ou, pour mieux dire, se gouverne-t-il? Si nous examinons les [130] différentes branches de la production, à commencer par celles que le progrès a agrandies et transformées, ne serons-nous pas frappés de l'insuffisance du personnel qui s'y trouve engagé, personnel dirigeant, capitaliste et ouvrier? On fonde les plus vastes entreprises à la légère, sans s'assurer si elles ont des chances sérieuses de réussite, on y engage ses capitaux et surtout les capitaux d'autrui sur la foi de promesses mensongères et d'informations suspectes, en se laissant amorcer par l'appât décevant de bénéfices extraordinaires ; puis, l'affaire engagée, on cesse de s'en occuper, sans avoir même l'idée que l'on encourt, de ce chef, une responsabilité. Possède-t-on, d'ailleurs, la capacité et la moralité requises pour exercer sur sa gestion une influence salutaire? On l'abandonne à la merci d'un personnel dirigeant qui ne voit dans toute entreprise que des positions lucratives à accaparer pour lui et les siens, sauf à se décharger sur des subalternes des devoirs qu'elles imposent. Sans aucun souci de l'avenir, il s'efforce d'éblouir les intéressés et de maintenir son ascendant sur eux en grossissant les dividendes au moyen d'opérations hasardeuses, de pratiques malhonnêtes et d'économies mal entendues. Le personnel ouvrier vaut-il mieux que les deux autres? N'en déplaise aux courtisans du peuple, il vaut presque toujours moins. Il se plaint d'être exploité, mais laisse-t-il jamais passer une occasion d'être exploiteur? Que des commandes pressées surviennent: se fait-il scrupule d'exploiter le besoin urgent qu'on a de lui pour exiger une augmentation de salaire? Combien peu d'ouvriers tiennent à honneur de remplir leurs engagements : ils multiplient, au gré de leurs fantaisies, les jours de chômage, et ne prennent le chemin de l'atelier que sous la pression inexorable de la nécessité. Qu'ils aient le droit de demander une rétribution aussi élevée que possible, soit! mais leur vient-il jamais [131] à la pensée qu'ils doivent un bon travail en échange? Que la surveillance à laquelle on les soumet se relâche, aussitôt le travail se ralentit, on dégrade le matériel, on gaspille la matière première quand on ne la vole pas. Qui ignore combien la pratique du piquage d'once est répandue dans les villes manufacturières? Faut-il donc s'étonner si des entreprises fondées à l'aventure, dirigées, commanditées et desservies par un personnel d'une capacité et d'une moralité au-dessous de sa tâche, aboutissent à la faillite? Constituées, pour la plupart, avec un capital trop réduit, vivant des ressources ou des expédients précaires du crédit, elles périssent communément parce que ce crédit vient à leur être retiré ou cesse de suffire à combler leurs déficits croissants. La chute des unes ne manque pas d'entraîner celle des autres. Tantôt c'est une banque qui, en suspendant ses payements pour avoir immobilisé imprudemment ses capitaux, détermine la chute de toutes les entreprises industrielles qu'elle alimentait ; tantôt c'est une ou plusieurs de ces entreprises qui, en succombant, provoquent l'effondrement des banques, et ce désastre, agissant par répercussion, en amène d'autres. Par suite de la solidarité que l'extension illimitée des échanges a établie entre les différents marchés du monde, cette répercussion se prolonge au loin : en succombant, des entreprises américaines, par exemple, ont compromis les intérêts européens qui s'y trouvaient engagés directement ou indirectement par des prêts de capitaux ou des fournitures de marchandises; d'un autre côté, leur chute, en privant du revenu que tirait d'elles un personnel dirigeant, capitaliste et ouvrier plus ou moins nombreux, a contraint ce personnel à restreindre sa dépense; d'où un resserrement du débouché de toutes les industries qui lui fournissaient des articles de consommation, d'autres diminutions de profits et de salaires, se répercutant encore, [132] de marché en marché, jusqu'à ce qu'un retour de l'esprit d'entreprise et de nouveaux apports de capitaux aient comblé le vide de la production et remplacé les ateliers dont les ruines jonchaient le sol. Des événements fortuits et extérieurs à l'industrie, des guerres, des révolutions, de mauvaises récoltes contribuent, sans doute, à précipiter les crises ou à les aggraver, mais ils sont presque toujours impuissants, l'expérience l'atteste, à renverser des entreprises sainement constituées et mises en œuvre par un personnel capable et honnête.
Ces crises du monde des affaires seraient moins désastreuses si tous ceux qu'elles atteignent étaient mieux préparés à supporter les maux qu'il est dans leur nature d'infliger. Mais des hommes qui n'ont ni la capacité ni la moralité nécessaires pour gouverner leurs affaires en manquent aussi pour gouverner leur vie. Cette insuffisance, qui aboutit là à des catastrophes, se fait sentir ici dans une sphère plus restreinte, mais comme ces petites entreprises que l'on nomme des ménages sont innombrables, la somme des nuisances qu'elle y cause n'est pas moindre. Examinez comment les « affaires de ménage » sont conduites du haut au bas de l'échelle sociale, et vous serez aussi frappés de l'imperfection du gouvernement de la vie privée que de celle du gouvernement de l'industrie. En général, l'esprit d'économie et la prévoyance font défaut: la prédominance des appétits matériels, jointe à la faiblesse du sentiment de la responsabilité, fait sacrifier aux besoins du jour la satisfaction des obligations du lendemain; encore ces besoins sont-ils trop souvent déréglés et malsains : dans les couches inférieures de la société, l'ivrognerie; dans les couches supérieures, la vanité, l'ostentation, le goût immodéré du luxe; dans toutes, l'incontinence et la paresse vicient l'emploi du revenu, en diminuent les sources et amoindrissent la capacité [133] productive de la génération en exercice. Comment se-forme et se prépare celle qui est destinée à la remplacer? Parmi les classes inférieures, une proportion considérable d'enfants, fruits d'unions de hasard, périt faute de soins; une autre, traitée comme une matière exploitable à merci par ceux qui ont la charge de l'élever, est affaiblie par un travail prématuré et ne reçoit qu'une éducation insuffisante, tout en se pervertissant sous l'influence des plus détestables exemples; parmi les classes supérieures, où la vigueur de la race se ressent fréquemment des considérations pécuniaires qui déterminent les unions, l'éducation est meilleure; cependant combien elle est encore routinière et mal adaptée aux besoins de ceux qui la reçoivent! Combien, enfin, l'esprit d'intrigue, le monopole des relations, plus que l'aptitude, influent sur le classement de la nouvelle génération dans la hiérarchie économique! Ajoutons que le mauvais gouvernement d'une famille agit directement ou indirectement sur la condition de toutes les familles ambiantes par la contagion naturelle du vice et de la misère en bas, du luxe déréglé en haut. L'appauvrissement des uns devient, ainsi, une cause d'appauvrissement pour les autres, en rétrécissant le débouché d'où ils tirent leurs moyens d'existence.
A l'action affaiblissante et corruptrice du mauvais gouvernement de la production et de la consommation, des affaires et de la vie, joignez celle des crises inhérentes au progrès, des perturbations et des nuisances provenant des monopoles, de la direction vicieuse des affaires publiques, des guerres, etc., et vous aurez un aperçu des causes qui empêchent le bien-être de se multiplier en raison du développement de la puissance productive. Il y a lieu de s'étonner même que la population et la richesse aient pu croître malgré tout, et il faut en tirer cette conclusion consolante, qu'en dépit de tant de vices destructeurs, de [134] passions effrénées et dissolvantes, il reste encore, dans toutes les classes de la société, un fond solide et sain de bon sens, d'intelligence et de vertu. On ne saurait, cependant, se dissimuler l'intensité du mal et même sa tendance à s'étendre et à s'aggraver : si les causes qui le produisent ont agi de tous temps, elles se sont manifestées avec une énergie particulière depuis que chacun est devenu plus libre de gouverner ses affaires et sa vie. La liberté est un puissant véhicule de progrès, mais ceux qui la possèdent savent-ils toujours trouver en eux-mêmes les freins nécessaires pour remplacer ceux qu'elle a détruits?
En dernière analyse, la source principale des « nuisances » qui ralentissent la diffusion générale du bienêtre, en réduisant une portion trop nombreuse de la société à une condition misérable et précaire, réside dans l'imperfection native de la nature humaine, dans l'insuffisance de son développement intellectuel et moral, insuffisance devenue relativement plus grande à une époque où les progrès extraordinaires du matériel de la production demandent, chez ceux qui le mettent en œuvre, un supplément d'intelligence et de moralité. Supposons que ce supplément vienne à être acquis, supposons que le niveau de l'intelligence et de la moralité monte, ne verrat-on pas aussitôt baisser le niveau des « nuisances » causées par l'ignorance et le vice? Supposons, par impossible, que l'homme s'élève à un degré d'intelligence et de moralité tel, qu'il remplisse exactement toutes les obligations impliquées dans le gouvernement de ses affaires et de sa vie, ne verra-t-on pas, sauf la part à faire aux causes qui tiennent à l'imperfection des choses, la richesse croître et le bien-être se répandre dans toute la mesure que comporte l'état de perfectionnement du matériel de la production?
Mais ce progrès peut-il s'improviser? Peut-on élever [135] du jour au lendemain, d'une quantité appréciable, le niveau général de l'intelligence et de la moralité? Peut-on imaginer un système de réorganisation sociale ou autre qui réalise un tel prodige, — un prodige qui laisserait, à coup sûr, loin derrière lui les miracles des thaumaturges les plus vantés? Il est bien clair que cela n'est pas possible. Songez donc à l'immensité et à la difficulté du problème à résoudre! Quelque vaste génie que l'on possède, à moins d'être un Dieu, — encore Dieu lui-même, en pourvoyant l'homme des rudiments de l'intelligence et de la moralité lui a-t-il laissé le soin de les développer, et l'homme a mis des centaines de siècles, peut-être des milliers, à les amener au point où nous les voyons, — de quelque vaste génie que l'on soit doué, disons-nous, peuton faire que tous les fondateurs et directeurs d'entreprises ne commettent jamais d'erreurs et de fautes? que les uns ne fondent que des entreprises utiles et que les autres les dirigent d'une manière toujours irréprochable? que tous les capitalistes deviennent à la fois intelligents, honnêtes et prudents? qu'ils s'abstiennent de participer à des entreprises nuisibles, d'exploiter l'imprévoyance et le besoin? Peut-on faire que tous les ouvriers, devenus instantanément laborieux, sobres et consciencieux, s'appliquent à remplir leur tâche d'une façon exemplaire? Peut-on, enfin, changer les hommes au point qu'ils cessent de s'adonner à la paresse, à l'incontinence, à l'ivrognerie et à tous les autres péchés capitaux pour se transformer, comme par un coup de baguette, en des modèles de sagesse et de vertu? Tout cela n'est-il pas parfaitement chimérique, et, cependant, à moins d'accomplir tant de prodiges, un système quelconque de réorganisation sociale ne demeurerait-il pas inefficace? Quelle ignorance et quelle infatuation les plans destinés à refaire d'emblée la société ne laissent-ils pas supposer chez leurs auteurs, [136] et quelle crédulité naïve dans le troupeau de leurs sectaires! Il y a mieux : non seulement aucune panacée ne pourrait, à moins de transformer les hommes en séraphins, guérir les maux de l'humanité, mais encore tout système communiste ou égalitaire qui transférerait, par voie de confiscation ou par quelque autre procédé sommaire, une partie des biens des classes supérieures aux classes inférieures, agirait comme une cause immédiate d'appauvrissement pour tout le monde, en ce qu'il placerait cette portion du capital de la société en des mains moins capables de le conserver et de le faire fructifier.
Mais, si le remède aux maux de l'humanité ne doit point être cherché dans les utopies socialistes ou communistes, peut-on le trouver davantage dans les conceptions rétrogrades qui veulent reconstituer l'ancien régime? Pour que cette reconstitution fût possible, ne faudrait-il pas replacer préalablement la société dans les conditions économiques où elle se trouvait jadis, c'est-à-dire supprimer toutes les acquisitions du progrès industriel, l'imprimerie, la machine à vapeur, les chemins de fer, les télégraphes, avec la plus puissante et la plus indestructible des machines que le progrès ait suscitées : la concurrence? N'estce point là une conception plus chimérique qu'aucune des utopies du socialisme?
Ce n'est donc point par la vertu d'une panacée, ce n'est pas davantage par un retour au passé que l'on peut remédier aux « nuisances » causées par l'imperfection des hommes et des choses, c'est au moyen d'une série ininterrompue de réformes et de progrès adaptés chacun au défaut ou au mal particulier qu'il s'agit de faire disparaître ou d'atténuer. Ces réformes ou ces progrès, nous les voyons s'opérer tous les jours; ils sont inégalement importants et efficaces, il en est aussi un grand nombre qui ne résistent pas à l'épreuve de l'application. A cet [137] égard, ils ne diffèrent pas de ceux qui ont pour objet d'améliorer le matériel et les procédés techniques de la production. Ils procèdent, d'ailleurs, du même principe: ils sont provoqués par le besoin de remédier à l'insuffisance ou à l'imperfection de ce qui existe, et ils sont créés par le travail assidu des facultés de recherche et d'invention : inventer des machines ou des procédés destinés à accroître la puissance du matériel de la production, ou bien chercher et combiner des lois, des institutions ou des méthodes qui perfectionnent le personnel, en augmentant son aptitude à remplir sa tâche, en prévenant ou en écartant les « nuisances » auxquelles donnent lieu ses défauts et son ignorance, n'est-ce pas, en définitive, participer à la même œuvre : l'amélioration du sort de l'espèce humaine? De même encore que l'augmentation de la puissance productive du matériel est le résultat d'une multitude innombrable de progrès qui viennent, chaque jour, remplacer un outil, une machine ou un procédé en usage par un outil, une machine ou un procédé plus efficace; de même le perfectionnement du personnel se résumant dans l'élévation de son niveau physique, intellectuel et moral est le résultat d'une autre multitude de progrès qui substituent à une méthode de tutelle et d'éducation, à un système de répression, à une pratique ou à une habitude établie, une méthode, un système, une pratique ou une habitude moins imparfaite.
Ces deux sortes de progrès trouvent également dans l'extension de la concurrence un stimulant de plus en plus énergique. A l'époque encore récente où chaque peuple n'avait avec les autres que des relations rares et intermittentes, où la guerre était presque le seul mode d'action de la concurrence internationale, une société pouvait conserver impunément pendant des siècles un matériel arriéré, — à l'exception toutefois de son matériel de [138] guerre; elle pouvait, de même, supporter longtemps un mauvais régime politique, des pratiques et des habitudes morales vicieuses. Il n'en est plus ainsi, nous l'avons remarqué déjà, et l'on ne saurait trop insister sur cette observation capitale, depuis l'avènement de la grande industrie et la généralisation de la concurrence. Ce n'est plus seulement un choc à intervalles plus ou moins éloignés, venant d'un petit nombre de points de l'horizon et portant sur un seul point de son organisme, choc dont elle était préservée d'ailleurs le plus souvent par des barrières naturelles, la distance, les mers, les fleuves, les montagnes, qui menace une société arriérée et affaiblie, c'est un choc de tous les instants, qui vient de tous les points de l'horizon et qui l'atteint par tous les points de son organisme : aucune de ses molécules n'échappe plus à l'action de la concurrence généralisée, aucune barrière ne peut plus l'en préserver; il faut qu'elle progresse ou qu'elle périsse. Et, comme nous avons essayé de le démontrer encore, il ne lui suffit pas d'élever son matériel de production au niveau de celui de ses concurrents, il faut qu'elle y élève aussi son personnel, sinon elle est condamnée à succomber, dans un délai que le progrès luimême rapproche davantage chaque jour, à la lutte pour l'existence.
[139]
II. DÉVELOPPEMENT HISTORIQUE DE L'ÉVOLUTION
CHAPITRE V. Mécanisme du gouvernement de l'homme et de la société.↩
I. — Que la civilisation est le produit des progrès du matériel et du personnel de la production. — Pourquoi il importe qu'ils se développent d'un pas égal. — Que tous les membres des sociétés humaines sont appelés à participer au progrès. — Qu'ils y participent plus ou moins, selon les forces et les ressources dont ils disposent et la manière dont ils en disposent. — Manières d'agir utiles et nuisibles. — Comment elles se reconnaissent. — Régimes divers qui en dérivent : la liberté ou le self government, la tutelle et la servitude. — Supériorité du self government. — Minimum de capacité nécessaire à son exercice.— Raison d'être de la tutelle au-dessous de ce minimum. — Tutelle des enfants, des femmes et des condamnés. — Ce qui la motive. — Autres restrictions au self government.
Ainsi que nous l'avons constaté dans la première partie de ce livre, l'amélioration successive de la condition de l'espèce humaine dépend de deux sortes de progrès : progrès du matériel et des procédés techniques de la production, progrès du personnel, considéré dans ses trois branches maîtresses, auxquelles se rattachent directement ou indirectement tous les membres de la société, personnel dirigeant, capitaliste et ouvrier.
La civilisation est le produit de ces deux sortes de progrès. [140] On ne saurait dire, et il serait oiseux de rechercher lesquels y contribuent davantage, mais on peut affirmer que les uns et les autres sont également nécessaires, en ce sens que la civilisation ne saurait être produite sans leur coopération. Supposons que le matériel et les procédés techniques de la production se perfectionnent : si le personnel ne réalise pas un progrès équivalent, s'il n'acquiert pas le supplément d'intelligence et de connaissances qu'exige la mise en œuvre d'un outillage plus parfait, s'il n'y joint pas le supplément de moralité que nécessite l'accroissement de sa responsabilité, d'une part, et des moyens de satisfaire ses penchants honnêtes ou vicieux, de l'autre, le progrès du matériel demeurera stérile, peut-être même deviendra-t-il nuisible. Admettons, par exemple, que la population actuelle de la Grande-Bretagne vienne à être remplacée par un nombre égal de Peaux-Rouges ou de Boschismen, la perfection même du matériel de la civilisation britannique empêchera ces peuples inférieurs d'en tirer parti; au bout de peu d'années, l'Angleterre ne renfermera plus que des cités en ruines et des campagnes en friche, parcourues par de rares tribus de chasseurs et de cannibales. Supposons, d'un autre côté, que le personnel soit aussi intelligent et aussi moral que possible, mais qu'il existe dans ses facultés une lacune qui le rende incapable d'élever son matériel productif au-dessus de celui des Peaux-Rouges ou des Boschismen, il ne pourra se civiliser, non seulement faute des moyens de se multiplier, de manière à constituer des sociétés suffisamment nombreuses, mais encore faute des instruments nécessaires pour conserver et accumuler ses connaissances.
Il faut donc que l'un et l'autre progrès se développent pour ainsi dire du même pas. Si le matériel devance le personnel, ses progrès demeureront en partie stériles, peut-être même auront-ils des résultats nuisibles. De [141] grandes entreprises, pourvues d'un outillage perfectionné, échoueront si elles sont desservies par un personnel élevé dans l'horizon étroit de la petite industrie et façonné à ses pratiques mesquines. Un accroissement de richesses survenant à une population mal préparée à en faire usage, ne servira qu'à alimenter des guerres suscitées par l'orgueil, la vanité ou la convoitise, ou bien encore à fournir une pâture plus ample à des vices grossiers, l'ostentation, la gourmandise, l'ivrognerie, qui affaiblissent et détériorent précisément les facultés dont une industrie perfectionnée exige la coopération active. Si le personnel, au contraire, devance le matériel, l'essor prématuré ou disproportionné de ses facultés les plus élevées pourra lui devenir funeste en le provoquant à se conduire d'après des règles qui, par cela même qu'elles sont supérieures à sa condition présente, ne s'y trouvent point adaptées. Une tribu n'ayant pour outillage que des arcs, des lances ou des javelots, et vivant de la chair des animaux sauvages, ne tarderait probablement pas à périr, si, à défaut d'autre gibier, elle s'abstenait de toucher à la chair humaine; des cannibales moins scrupuleux auraient bientôt raison de cette tribu affaiblie par les privations, et ils ne manqueraient pas de prendre sa place, après en avoir fait le men ude leurs festins.
En tout cas, c'est à ce double progrès que l'espèce humaine est redevable de sa civilisation et de son bien-être. Il a commencé à s'accomplir dès le premier âge de l'humanité; il s'est poursuivi à travers des obstacles de tous genres, venant de la nature et de l'homme lui-même; il a eu des défaillances et des retours avant d'arriver à la phase nouvelle et décisive marquée par l'avènement de la grande industrie, et il est destiné, selon toute apparence, à se poursuivre d'une manière indéfinie. Comment s'accomplit-il? Comment l'espèce humaine accroît-elle [142] incessamment la somme de ses acquisitions matérielles, intellectuelles et morales? Comment devient-elle plus nombreuse, plus riche, plus éclairée et meilleure? Par la coopération de tous ses membres, soit qu'ils appartiennent ou se rattachent au personnel dirigeant, capitaliste ou ouvrier, chacun agissant dans une sphère plus ou moins étendue selon la quantité de forces et de ressources dont il dispose, et manifestant son activité au double titre de producteur et de consommateur. A titre de producteur, il crée de la richesse. Il la crée en inventant de nouveaux instruments, de nouveaux procédés, de nouvelles méthodes pour développer et améliorer la production, en dirigeant, en commanditant ou en desservant les entreprises qui sont les officines où la richesse se produit. A titre de consommateur, il emploie la portion de richesse que lui vaut sa participation directe ou indirecte aux entreprises, et qui constitue son revenu ou ses moyens d'existence. Il en consacre une partie à la satisfaction de ses besoins actuels; il en accumule une autre en prévision de ses besoins à venir; il en applique une troisième à la formation de la génération, qui est appelée, en vertu des lois de la nature, à remplacer la sienne. Selon qu'il s'acquitte bien ou mal des fonctions et des obligations qu'implique sa double qualité de producteur et de consommateur, il s'enrichit ou s'appauvrit, il s'élève ou il décline, et, comme une société n'est autre chose que la somme des unités produisantes et consommantes qui la composent, plus elle renferme d'unités aptes à bien gouverner leur production et leur consommation, plus elle se développe, s'enrichit et se civilise.
Dans l'accomplissement de cette double tâche du gouvernement de la production et de la consommation, ou, si l'on veut, des affaires et de la vie, il y a une multitude infinie de manières d'agir possibles. Prenez un millier [143] d'individus, et vous n'en trouverez pas deux qui gouvernent de la même manière leur production et leur consommation. Cependant, il existe pour chacun, eu égard à ses conditions d'existence, à sa situation, au milieu où il vit, une manière d'agir qui est la meilleure, la plus utile, c'est-à-dire la plus conforme à l'intérêt de la communauté, dont son intérêt propre est une portion intégrante. Au-dessous de celle-là, il y en a une infinité d'autres qui sont de moins en moins utiles, et, après celles-ci, de plus en plus nuisibles. L'homme est appelé à choisir entre elles: selon le degré de capacité intellectuelle et morale dont il est pourvu, il choisit une manière d'agir qui se rapproche ou s'éloigne plus ou moins de la meilleure.
Mais comment discerner dans cette multitude de manières d'agir possibles celle qui est la meilleure. Il est clair que l'expérience peut seule servir de guide à cet égard. Toute action a des conséquences. Selon que ces conséquences sont bienfaisantes ou malfaisantes pour la communauté, l'action est réputée bonne ou mauvaise, utile ou nuisible. On la loue ou on l'encourage si elle est reconnue utile; on la blâme, au contraire, et on s'efforce d'empêcher qu'elle ne se reproduise si elle est reconnue nuisible. En agissant ainsi, la communauté use du droit légitime de défendre ses intérêts, mais elle peut aller et elle va plus loin. Elle ne se borne pas à interdire les manières d'agir qui lui paraissent nuisibles; elle prescrit, elle ordonne à ses membres d'adopter, à l'exclusion de tout autre, la manière d'agir qui lui paraît la meilleure.
Si l'on se borne à interdire les manières d'agir qui sont considérées comme nuisibles, en laissant cependant l'individu maître de choisir, à ses risques et périls, celles qui lui conviennent, c'est le régime de la liberté; si on lui enlève ce choix, si on lui prescrit la manière d'agir qu'il est tenu de suivre, c'est le régime de la tutelle ou de la servitude. [144] L'individu est en tutelle si son intérêt a été pris en considération dans les prescriptions dont ses actes sont l'objet, il est en servitude si ces prescriptions ont été faites en vue d'un autre intérêt que le sien.
Ces deux régimes, appropriés à des états de développements différents de la personnalité humaine, se trouvent associés dans des proportions diverses chez tous les peuples; mais, jusqu'à nos jours, la liberté ou le self government est demeuré l'exception; la tutelle ou la servitude a été la règle. Depuis l'avènement de la grande industrie, au contraire, le self government tend à devenir la règle, la servitude à disparaître, sauf dans les cas où elle est pénale, et la tutelle à se restreindre graduellement; ce qui ne veut pas dire qu'elle ne soit point appelée à jouer encore, sous des formes et avec des modes d'action perfectionnés, un rôle considérable dans le monde. Que la liberté ou le self government soit le régime le plus parfait sous lequel l'homme puisse vivre, c'est une proposition si évidente qu'il est presque superflu de la démontrer. C'est seulement sous ce régime que toutes les forces qui constituent son être, forces physiques, intellectuelles et morales, peuvent prendre leur plein essor et recevoir leur entier développement; qu'il acquiert, en un mot, toute la valeur qu'il est capable d'acquérir. Car ce n'est que sous ce régime que les facultés supérieures qui président au gouvernement des affaires et de la vie trouvent leur emploi, qu'elles peuvent croître et s'accumuler par l'exercice, comme croît et s'accumule toute force utilisée.
Mais la liberté ou le self government n'est utile ou même possible qu'à une condition, c'est que l'individu possède le minimum de capacité physique, intellectuelle et morale nécessaire pour accomplir les actes et remplir les obligations qu'implique l'entretien de son existence. [145] Nous disons le minimum de capacité. S'il fallait, en effet, que cette capacité fût portée à son degré le plus élevé, c'est-à-dire que l'individu fût capable de choisir toujours, dans toute la sphère ouverte à son activité, la manière d'agir la meilleure, il est clair que la liberté demeurerait un idéal inaccessible à l'homme, aussi longtemps qu'il serait ce qu'il a été de tout temps, ce qu'il sera probablement toujours, une créature faillible et imparfaite. Mais ce maximum de capacité n'est pas nécessaire pour rendre la liberté possible : le minimum suffit.
Nous venons de remarquer que, dans l'œuvre complexe de la gestion de ses affaires et de sa vie, l'homme a le choix entre une infinie variété de manières d'agir, les unes plus ou moins utiles, les autres plus ou moins nuisibles. S'il n'a pas la capacité voulue pour les distinguer les unes des autres, ou s'il est ignorant et vicieux au point de préférer généralement celles qui sont nuisibles à celles qui sont utiles, il vaudra mieux pour lui et pour autrui que le choix lui soit interdit, et qu'au moins en toutes les choses où son incapacité est notoire, une manière d'agir lui soit imposée, qu'il soit en tutelle ou même en servitude. Si, au contraire, il est capable, dans une mesure suffisante, de discerner ce qui est utile de ce qui est nuisible, et de s'arrêter à ce qui est utile, la liberté devient possible, sauf répression des nuisances provenant de l'infériorité de sa capacité intellectuelle et morale. Comment déterminer, cependant, le minimum de capacité audessous duquel la liberté est funeste? C'est une affaire d'observation et d'expérience; on peut ajouter que c'est une affaire qui exige beaucoup de tact. S'il s'agit, par exemple, de remplacer par la tutelle une liberté dont on use mal, il faut se demander si la tutelle sera exercée de manière à donner des fruits meilleurs que ceux de ce self government imparfait et vicieux; si la différence sera [146] assez grande pour compenser le mal inhérent à toute tutelle, c'est-à-dire la limitation ou la suppression de l'exercice des facultés que met en jeu le self government; enfin, si une amélioration du système de la répression des nuisances causées par le mauvais usage de la liberté, ne rendrait pas le maintien de celle-ci préférable à la mise en tutelle.
Quelle que soit, néanmoins, la supériorité naturelle du régime de la liberté ou du self govemment, l'expérience atteste que de nombreuses catégories d'individus ne peuvent vivre et se développer sous ce régime; que la tutelle, soit qu'elle embrasse toute la sphère de leur activité ou seulement une partie, enfin que la servitude elle-même ont leur raison d'être, qu'elles sont nécessaires, dans certains cas, au maintien de l'existence de l'individu et de la société.
La nécessité de la tutelle dérive de l'inégalité naturelle de la capacité physique, intellectuelle et morale exigée pour résoudre ce double problème, dont nous avons énuméré et défini les conditions, de la production et de la consommation, du gouvernement des affaires et de la vie. Cette inégalité est extrême. Entre l'hercule et l'avorton, l'homme de génie et l'idiot, le saint et le scélérat, quel immense espace et quelle multitude innombrable de degrés intermédiaires! Cependant, cet espace peut être partagé en deux régions : dans l'une, se rangent toutes les individualités qui possèdent au delà du minimum de capacité indispensable au gouvernement des affaires et de la vie; dans l'autre, celles qui demeurent au-dessous de ce minimum. Il est nécessaire que celles-là suppléent à ce qui manque à celles-ci, en se chargeant de les conduire, au moins dans les directions et dans la mesure où elles ne peuvent se conduire elles-mêmes, soit qu'elles consentent ou non à être conduites. Sans doute, il est préférable [147] qu'elles y consentent, la tutelle est, en ce cas, plus facile et plus efficace, mais, si elles y résistent, on n'a pas à tenir compte de leur résistance, du moment où l'expérience a suffisamment attesté leur incapacité à se gouverner ellesmêmes; que serait-ce si elles affichaient, en outre, la prétention de gouverner les autres?
Parmi les individualités qui demeurent au-dessous du minimum de capacité nécessaire, viennent se placer d'abord les enfants. Même chez les races les mieux douées, la capacité de se gouverner sans nuire à soi-même et à autrui ne s'acquiert qu'à un certain âge. Cet âge diffère suivant les individus : telle individualité bien douée aura acquis, dès l'âge de quinze ans, le minimum indispensable au bon gouvernement des affaires et de la vie, telle autre ne l'acquerra qu'à vingt-cinq ans, telle autre, enfin, ne la possédera à aucun âge; mais, comme il fallait une règle, on a pris l'âge moyen auquel l'expérience révélait que la capacité à se gouverner avait cru d'une manière suffisante; dans les pays civilisés, cet âge de la majorité est aujourd'hui fixé généralement à vingt et un ans. Jusque-là l'enfant ou l'adolescent est en tutelle. Que cette tutelle soit nécessaire, c'est un point sur lequel il est superflu d'insister. Il est bien clair que l'enfant périrait si ceux qui l'ont mis au monde, ou d'autres à leur défaut, ne se chargeaient point de le nourrir, de l'élever et de le gouverner jusqu'à ce qu'il soit en état de se charger de la responsabilité de son existence. Sans doute, la tutelle de l'enfance est toujours plus ou moins défectueuse, mais, si mauvaise qu'elle soit, elle n'en demeure pas moins, dans son ensemble, incomparablement supérieure au self government de l'enfant, même lorsque celui-ci a atteint l'âge dit de raison. Supposons, en effet, une génération d'enfants libres d'aller ou de ne pas aller à l'école, de travailler ou de s'abandonner à la paresse, de se nourrir à [148] leurs heures, et d'aliments de leur choix, de boire, de fumer à discrétion, etc., etc.; cette génération arriveraitelle à maturité? Que l'enfant y consente ou non, il faut donc, dans son intérêt comme dans l'intérêt commun, qu'il demeure soumis à une tutelle. Rien de plus difficile à exercer que cette tutelle, et, en particulier, rien de plus difficile que de mesurer la dose de liberté qui doit progressivement être accordée à l'enfant, à partir du moment de sa naissance où il n'est encore capable d'en posséder aucune parcelle, jusqu'au moment de son émancipation où il va la posséder tout entière. Le régime de la tutelle de l'enfance a subi des modifications de toutes sortes, et il en subira encore; l'autorité des tuteurs peut être diminuée ou étendue, on peut abandonner cette autorité aux parents ou la leur enlever en totalité ou en partie, on peut changer les méthodes d'éducation et d'apprentissage de la vie, mais on ne peut supprimer la tutelle elle-même, car elle est nécessitée par l'incapacité naturelle de l'enfant. Ce qui est vrai pour l'enfant ne l'est pas moins pour les individus qualifiés d'incapables, fous, idiots, etc., mais est-ce vrai aussi pour la femme, qui est demeurée jusqu'à nos jours dans un état de demi-tutelle? Plus précoce que l'homme, la femme est émancipée avant lui, mais on ne lui reconnaît qu'une capacité moindre, et on la soumet, dans une certaine mesure, à la tutelle de son compagnon d'existence. Est-ce en considération de son intérêt, ou bien est-ce exclusivement dans l'intérêt de l'homme? Autrement dit, le régime auquel la femme est soumise a-t-il le caractère de la tutelle ou de la servitude? Enfin, que ce soit tutelle ou servitude, la femme est-elle intéressée à posséder la même dose de liberté que l'homme? Est-elle aussi capable que lui de gouverner utilement pour ellemême et pour autrui ses affaires et sa vie? C'est là une question qui demeure encore pendante. Chez les nations [149] de race anglo-saxonne ou slave, la tendance est aujourd'hui à l'émancipation de plus en plus complète de la femme. Si cette émancipation produit un meilleur gouvernement des affaires et de la vie de la partie féminine de l'espèce humaine, elle constituera un progrès, et, à ce titre, elle sera durable; si elle produit un gouvernement inférieur à celui qui résulte du régime actuel de demiliberté, on reviendra à celui-ci jusqu'à ce que la femme ait acquis la capacité exigée pour un entier self government.
Le régime de la tutelle est encore appliqué, dans les États les plus civilisés, à une troisième catégorie fort différente des deux précédentes, celle des individus qui ont commis des nuisances, et qui ont été, pour ce motif, condamnés à une peine plus ou moins proportionnée au dommage qu'ils ont causé : ils sont assujettis à la servitude pénale. La peine de l'emprisonnement qui leur est communément infligée implique la privation de la plus grande partie de la liberté, et, même après l'expiration de cette peine, ils ne recouvrent point tous les droits dont ils jouissaient avant de tomber sous le coup de la loi. Cette application du régime de la tutelle ne peut soulever aucune objection raisonnable. Elle est nécessitée et motivée par la défense de la société, contre laquelle ceux qui commettent des nuisances se mettent en état de guerre. Ajoutons que les caractères de la servitude s'y joignent à ceux de la tutelle. En effet, en condamnant un homme à la servitude pénale, ce n'est point son intérêt qu'on a en vue; on ne considère que l'intérêt de la société à laquelle il a nui et qu'il peut menacer encore. Les procédés de la tutelle n'en sont pas moins applicables à cette sorte de servitude : quand il s'agit surtout de pénalités d'une durée temporaire, l'intérêt de la société exige qu'il puisse en devenir un membre utile à l'expiration de sa peine.
[150]
Voilà donc trois grandes catégories d'individualités, les enfants, les femmes, les condamnés, qui sont demeurés de tout temps sous le régime de la tutelle ou de la servitude. Mais ce régime a reçu bien d'autres applications. Il a été appliqué et n'a pas cessé de l'être, non seulement aux enfants, aux femmes et aux condamnés, mais encore, dans des mesures diverses, selon les époques, les lieux et les circonstances, au reste de l'humanité. Dans les pays les plus avancés en civilisation, la liberté, le self government individuel est toujours restreint par quelque côté en deçà de ses limites naturelles: ici, la liberté d'écrire, de travailler, de s'associer, d'échanger est limitée pour tout le monde; là, une classe plus ou moins nombreuse est privée du droit d'intervenir dans la gestion des affaires publiques. Tantôt ces restrictions au self government sont imposées dans l'intérêt général, et, dans ce cas, elles constituent une tutelle; tantôt elles le sont dans l'intérêt d'un groupe ou d'une classe, et elles ont le caractère de la servitude. Tantôt elles sont utiles et elles doivent être maintenues jusqu'à ce que le défaut de capacité qui les motive ait cessé d'exister, tantôt elles sont nuisibles et le progrès consiste à les faire disparaître. Enfin, la servitude, sous les-formes primitives de l'esclavage, du servage, du péonat, etc., continue de subsister dans la plus grande partie du globe.
II. — Définition de la liberté. — Liberté générale et libertés spéciales. — Limites naturelles de la liberté. — Le droit. — Le devoir. — La morale. — Accord de l'intérêt particulier avec l'intérêt général. — Analyse de l'intérêt particulier. — La morale individuelle; qu'elle cesse de suffire à l'individu en société. — Nécessités qui dérivent de l'état de société: reconnaissance et délimitation des droits; définition des devoirs. — Procédés à l'aide desquels on assure le respect du droit et l'accomplissement du devoir. — L'opinion. — La religion. — La répression matérielle. — La conscience. — La tutelle et la servitude. — Des catégories d'individus capables du self government et des incapables. — Analyse de la tutelle. — Formes et applications. — La tutelle individuelle ou privée. — La tutelle publique. — La tutelle par voie de restriction à la liberté ou système préventif. [151] — La tutelle par voie de secours et de direction. — En quelles circonstances et dans quelles limites la tutelle peut être motivée. —La servitude. — Cas dans lesquels elle est nécessaire.
Ainsi, l'observation de l'homme et de la société nous met d'abord en présence de ces deux phénomènes : la liberté ou le self government, et la tutelle, dont la servitude n'est qu'une forme embryonnaire et grossière. Ils nous apparaissent partout et de tous temps coexistant dans des mesures déterminées par le degré de capacité physique, intellectuelle et morale de la multitude diverse et changeante des individualités humaines. Analysons-les aussi complètement que possible.
En quoi consiste la liberté et quelles sont ses limites? Envisagée dans sa généralité, la liberté consiste dans la faculté ou le pouvoir d'agir en mettant en œuvre les forces et les matériaux dont on dispose. Mais cette liberté générale se décompose en une série de libertés spéciales, correspondant aux actes et aux obligations que chacun doit accomplir pour subvenir à l'entretien de son existence. Dans une société avancée en civilisation, où la production et la consommation sont extrêmement développées et diversifiées, ce fractionnement de la liberté est poussé fort loin, et « les libertés » se comptent par douzaines. Il y a celles qui concernent particulièrement la production : liberté du travail ou de l'industrie, liberté d'association, liberté du commerce, liberté de l'enseignement, de la presse, des cultes; il y a celles qui concernent plutôt la consommation ou l'emploi du revenu : liberté de se nourrir, de se vêtir, de se loger, de cultiver son esprit et son moral, de se marier, d'élever ses enfants, de donner, de léguer. Toutes ces libertés partielles et spéciales, que l'on peut encore subdiviser, composent la liberté générale.
Le self government de chacun consiste donc dans l'exercice d'une série de libertés correspondant aux objets de [152] son activité. Si l'individu est entièrement le maître de choisir la manière d'agir qui lui convient dans chacune de ces directions; si aucune des libertés entre lesquelles se fractionne sa liberté n'est supprimée ou restreinte, on peut dire que le self government est complet. Mais, dans le cas même où la liberté est complète, estelle sans limites? Non, la liberté de chacun est naturellement limitée par la liberté d'autrui, et ce qui est vrai pour la liberté générale ne l'est pas moins pour chaque liberté partielle. Cette ligne de démarcation naturelle existe pour toutes les libertés, quoiqu'elle ne soit pas toujours bien facile à reconnaître. Supposons que j'use de la liberté de l'industrie en établissant dans l'enceinte d'une cité populeuse une usine dangereuse ou insalubre, j'infligerai à mes voisins des risques et des inconvénients dont l'effet sera d'amoindrir la valeur de leurs propriétés et de les empêcher d'en tirer le parti le plus avantageux : j'agrandirai ainsi ma liberté aux dépens de la leur. Supposons que j'use de la liberté d'écrire pour propager des imputations fausses et calomnieuses, je porterai atteinte à la liberté des gens que je calomnie en diminuant leur valeur morale. En usant de ma liberté, c'est-à-dire en mettant en œuvre les forces et les matériaux dont je dispose, en agissant, il faut donc que je m'abstienne d'empêcher les autres d'agir pareillement ou d'amoindrir la valeur des forces et des matériaux à l'aide desquels ils agissent. En d'autres termes, chaque self government constitue une propriété ayant sa sphère d'action propre, dans laquelle elle se meut et qui est celle de son droit. On ne peut user de sa liberté que dans la limite de son droit, à moins d'empiéter sur la liberté d'autrui. Le droit est la frontière naturelle de la liberté. Si cette frontière n'était point marquée et respectée, si chacun usait des forces et des matériaux dont il dispose, sans s'inquiéter de savoir s'il empiète ou non sur [153] le domaine d'autrui, aucune société ne pourrait subsister: ce serait une guerre permanente de chacun contre tous et de tous contre chacun, dans laquelle s'entre-détruiraient et s'épuiseraient bientôt les forces et les ressources de la société.
Ainsi, chaque liberté implique un droit. La liberté, c'est la faculté ou le pouvoir d'agir et de choisir entre les manières d'agir celle que l'on préfère pour un motif ou pour un autre. Le droit, c'est la liberté d'agir sans empiéter sur la liberté d'autrui.
Cependant, dans cette sphère d'activité que le droit limite, il y a encore bien des manières d'agir possibles. Celles qui sont positivement nuisibles à la société dont on fait partie s'en trouvent écartées, mais, parmi celles entre lesquelles on peut choisir, il en est de plus ou moins conformes à l'intérêt commun. Il en est une, enfin, qui lui est conforme au plus haut point. C'est celle-ci que le devoir commande de choisir. Ainsi, j'ai la liberté d'écrire, ce qui signifie que je puis écrire tout ce qui me passe par la tête. J'ai le droit d'écrire tout ce qui ne nuit pas à autrui, et j'ai le devoir d'écrire ce qui est le plus utile à autrui. En remplissant ce devoir, j'use de ma liberté de la manière la plus conforme à l'intérêt commun, dans lequel tous les intérêts particuliers sont contenus, ce qui revient à dire que l'accomplissement du devoir est la plus haute expression du droit.
La science du devoir, c'est la morale. Elle contient la science du droit, mais elle est plus vaste et plus haute: plus vaste, en ce que le droit se borne à délimiter la liberté de chacun, en interdisant les actes qui franchissent cette limite et en les frappant d'une peine, tandis que la morale s'occupe de tous les actes de la liberté humaine; plus haute, en ce qu'après avoir classé et évalué ces actes suivant leur caractère plus ou moins prononcé d'utilité [154] ou de nuisibilité, la morale prescrit de choisir le plus utile.
La liberté, le droit et le devoir bien définis, recherchons ce qu'il faut entendre exactement par l'intérêt de chacun ou l'intérêt particulier, et l'intérêt d'autrui, ou bien encore l'intérêt commun ou général, et quels sont leurs rapports naturels. Ces divers intérêts sont-ils harmoniques ou antagoniques? L'intérêt particulier s'accorde-t-il ou non avec l'intérêt général? Chacun est-il intéressé ou non à demeurer dans les limites de son droit et à remplir son devoir?
Que chacun soit intéressé à agir de la manière la plus conforme à l'intérêt général, c'est un point facile à établir. Grâce à l'association des forces et des ressources et à la division du travail, l'individu qui fait partie d'une société se trouve, au double point de vue de la production et de la consommation, dans une condition cent fois, mille fois plus avantageuse que celle de l'individu isolé. Plus la société prospère, grandit, se développe, plus s'accroît la somme de ces avantages, d'où il suit que l'intérêt individuel de chacun des membres d'une société est que l'intérêt général reçoive la satisfaction la plus complète.
Mais, si chacun est intéressé à ce que la société dont il est membre atteigne le maximum de puissance et de richesse, il ne l'est pas moins à obtenir, pour lui-même, la quote-part la plus élevée possible dans cette puissance et dans cette richesse. De là, la lutte des intérêts, lutte nécessaire et qui aboutit à l'équilibre par le jeu du mécanisme naturel de l'échange mais qui exige, avant tout, le fair play, la libre disposition et la libre action des forces et des ressources de chacun. Or, le fair play ne peut être réalisé qu'à la condition que la liberté soit contenue dans les limites du droit. Il faut donc que ces limites soient connues, et qu'on ne les dépasse point. Mais, comme on va le voir, l'intérêt privé est naturellement porté à les dépasser.
[155]
Si nous analysons l'intérêt privé ou individuel, nous constaterons d'abord qu'il correspond aux deux fonctions économiques de la production et de la consommation. A titre de producteur, l'individu est intéressé à tirer le parti le plus avantageux possible des forces et des ressources dont il dispose, à conserver et accroître son capital et le revenu qu'il en tire, tout en se donnant le moins de peine. A titre de consommateur, son intérêt consiste encore à employer ses moyens d'existence de la manière la plus avantageuse à lui ou aux siens. Être riche et heureux, rendre heureux les êtres auxquels on est lié par l'affection ou la sympathie, voilà les fins de l'intérêt individuel. Il se meut dans un cercle naturellement borné. Ce cercle est à son minimum d'étendue chez l'égoïste qui se préoccupe uniquement de sa personne; chez les individualités mieux douées, il s'étend à la famille et aux êtres avec lesquels elles sympathisent. En thèse générale, l'intérêt représente pour l'individu les jouissances qu'il désire, les privations et les souffrances qu'il redoute. Se procurer les unes, éviter les autres, voilà le double but qu'il s'efforce d'atteindre en poursuivant son intérêt. Même en faisant abstraction des rapports de l'individu avec les autres hommes, cette poursuite comporte une grande diversité de manières d'agir, les unes plus ou moins utiles, les autres plus ou moins nuisibles. Il y a des vertus qu'il faut pratiquer, des vices dont il faut s'abstenir. Il y a, pour tout dire, même dans l'état d'isolement le plus absolu, une morale individuelle, que l'expérience révèle. Cette morale individuelle, il faut en observer les règles et les prescriptions si l'on veut acquérir la plus grande somme de biens, éviter la plus grande somme de maux, c'est-à-dire arriver à la satisfaction la plus complète de son intérêt.
Mais cette morale isolée est des plus élémentaires. Elle ne concerne que les manières d'agir de l'individu dans ses [156] rapports avec lui-même et avec les siens, elle ne va pas au delà. Supposons maintenant que cet individu, accoutumé à ne considérer que son intérêt et à n'observer que les règles de la morale isolée, se joigne à d'autres, en vue d'augmenter sa sécurité ou son bien-être : voilà la société constituée. N'ayant d'autres notions expérimentales que celles de la morale individuelle, il sera naturellement porté à poursuivre son intérêt sans se préoccuper de celui des autres membres de la société. Il ne connaît point d'ailleurs la limite, souvent à peine visible, qui sépare la sphère d'action de sa liberté de celle de la liberté d'autrui, et la connût-il, pourquoi s'abstiendrait-il de la franchir s'il croyait y trouver son avantage? Pourquoi ne s'emparerait-il pas du champ du voisin, de son cheval, de son bœuf ou de son âne, s'ils se trouvaient à sa convenance et s'il était le plus fort? Pourquoi, dans un état de civilisation plus avancé, ne s'enrichirait-il pas en abusant de l'ignorance ou de la bonne foi d'autrui, en trompant sur la valeur d'une entreprise, sur la qualité d'une marchandise, etc., etc. Sans doute, cette manière d'agir porte atteinte à l'intérêt d'autrui, mais que lui importe! qu'est-ce qu'autrui? autrui se compose d'une masse confuse d'êtres qui lui sont, pour le plus grand nombre, aussi inconnus et aussi indifférents qne s'ils habitaient une autre planète. Entre son intérêt et celui de ces inconnus et de ces indifférents pourrait-il hésiter? Il n'hésite pas, et chaque fois qu'il trouve quelque avantage à empiéter sur le domaine d'autrui, il pousse en avant, et s'il s'arrête, ce n'est pas devant la limite de son droit, c'est devant la limite de son pouvoir.
Cependant si chacun, suivant l'impulsion aveugle de son intérêt individuel, persistait à agir non dans les limites de son droit, mais dans celles de son pouvoir, quel serait le résultat? Ce serait la guerre en permanence [157] entre les intérêts, et l'impossibilité finale de maintenir la société. Mais la société est nécessaire, même à ceux qui travaillent à la détruire. Car, entre la somme de bien-être que peut se procurer l'individu isolé et celle que se procure, grâce à l'association des forces productives et à la division du travail, l'individu en société, la distance est presque incommensurable. Il faut donc aviser aux moyens de rendre la société possible. Quels sont ces moyens? C'est d'abord de délimiter les libertés ou de fixer les droits, de manière que chacun connaisse ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. L'observation et l'expérience servent à résoudre ce premier problème. On observe les manières d'agir des différents membres de la société et on en apprécie les conséquences; on reconnaît ainsi celles qui sont conformes à l'intérêt commun et celles qui lui sont contraires, celles qui sont utiles et celles qui sont nuisibles. La communauté autorise les unes et interdit les autres. Est-ce suffisant? Non. L'expérience ne manque pas de démontrer que cela ne suffit point. L'expérience démontre qu'il faut intéresser l'individu lui-même à ne pas dépasser son droit, en rendant ses manières d'agir nuisibles moins avantageuses pour lui que ne le seraient les autres. Comment la société réussit-elle à atteindre ce but? Elle y atteint au moyen du triple frein de l'opinion, de la religion et de la répression pénale, sans parler de la tutelle et de la servitude dont il sera question tout à l'heure. L'opinion blâme les actes nuisibles, elle jette la déconsidération, le mépris et la haine sur ceux qui les commettent; la religion les menace de la colère et des châtiments célestes; la répression les frappe dans leurs personnes et dans leurs biens. Si ce triple frein est pourvu de la force nécessaire, si chacun peut se convaincre par son expérience et celle des autres qu'en commettant un acte nuisible, il n'échappera point à une souffrance [158] supérieure à la satisfaction qu'il en tire, il s'abstiendra de le commettre. Il s'en abstiendra, notons-le, en considération de son « intérêt bien entendu ». Alors aussi, il prendra l'habitude de se soumettre à la coutume ou à la loi qui délimite la liberté de chacun, il s'accoutumera à reconnaître les limites dans lesquelles il peut agir et à ne point les franchir. Quand cette habitude sera prise et enracinée, quand la généralité des membres de la société se sera accoutumée à respecter la loi, le maintien de la société cessera d'être précaire. Sera-ce enfin suffisant? Non, pas encore. Il ne suffit pas, pour qu'une société soit mise à l'abri de la destruction, surtout si elle est entourée d'ennemis acharnés à sa ruine, que les individus s'abstiennent de commettre des nuisances, il faut encore, qu'entre toutes les manières d'agir utiles, ils sachent choisir la plus utile à la société, dût-elle être préjudiciable à leur intérêt particulier, dût-elle impliquer le sacrifice entier de cet intérêt à l'intérêt commun. Qu'est-ce qui pourra les y déterminer? Ce ne pourra être que la perspective assurée d'un bien supérieur à celui qu'ils sacrifient. Ce sera l'approbation et la reconnaissance de l'opinion, l'espoir des récompenses de la religion, des honneurs publics pour leur mémoire ou des avantages que les êtres qui leur sont chers retireront de leur sacrifice. Mais, en s'élevant ainsi du simple respect du droit à l'accomplissement du devoir, ils obéiront toujours, en dernière analyse, à leur intérêt. Cependant une force nouvelle surgira, qui s'ajoutera à l'action des freins et des excitants intéressés, qui pourra y suppléer au besoin, pour faire prévaloir l'intérêt général sur l'intérêt particulier; nous voulons parler de la conscience. S'imprégnant de l'opinion commune, chacun aimera les actes utiles et détestera les actes nuisibles; on se reprochera de commettre ceux-ci, on s'efforcera d'accomplir ceux-là : la notion concrète de l'intérêt, au moins dans les âmes d'élite, se [159] résoudra dans la notion abstraite du bien et du mal, et l'amour du bien, la haine du mal agiront, en dehors et au-dessus de toute considération intéressée, pour assurer l'observation du droit et l'accomplissement du devoir. Supposons maintenant que tous les membres d'une société arrivent, par ces divers échafaudages, non seulement à s'abstenir des actes nuisibles, mais encore à pratiquer en toutes choses les manières d'agir les plus utiles, quel sera le résultat? C'est que la société atteindra le plus haut degré de développement et de prospérité que comporte, avec la somme de ses forces et de ses ressources, l'état d'avancement de son industrie; c'est, par conséquent, que les intérêts individuels entre lesquels se décompose l'intérêt social recevront la satisfaction la plus ample possible, en sorte que chacun, ayant agi de la manière la plus conforme à l'intérêt de tous, se trouvera avoir agi de la manière la plus conforme au sien.
Cependant, le self government, quelle que soit la solidité des freins qui le contiennent dans les limites du droit et l'efficacité des excitants qui le poussent dans la ligne du devoir, n'est applicable qu'à une partie des membres de la société. Ç'a été même une opinion longtemps en crédit, qu'il ne convenait, au moins en totalité, à aucune. Il est nécessaire, pour assurer l'existence et les progrès de la société, d'y joindre, dans une mesure que l'expérience se charge de révéler, la tutelle et même la servitude. On s'en convaincra en jetant un coup d'œil sur les différentes catégories d'individus qui composent toute société.
Il y a d'abord les enfants, qui sont incapables de pratiquer le self government, parce que leurs facultés dirigeantes ne sont pas arrivées à leur plein développement; il y a les idiots et les fous, qui sont dépourvus de ces facultés ou qui les ont perdues; il y a enfin les femmes qui ont été jusqu'à nos jours réputées, à tort ou à raison, [160] incapables de se gouverner entièrement elles-mêmes, c'est-à-dire près des trois quarts de l'humanité. De quoi se compose l'autre quart?
Il se compose, pour une immense majorité, d'individus, les uns incapables de se soumettre aux règles du droit et de la morale ou même de les connaître; les autres, qui les connaissent, impuissants à les observer dans toute leur étendue ou disposés de parti-pris à violer celles qu'il leur paraît avantageux de violer. Dans toute société, il existe des individus qui ne connaissent pas la limite de leur droit et chez lesquels la notion du devoir est absente. Ils dépassent donc leur droit sans se douter qu'ils le dépassent, ils n'accomplissent pas leur devoir parce qu'ils l'ignorent. Us poursuivent, sous l'aiguillon de leurs besoins du moment ou de leurs passions sans règle, ce qu'ils croient être leur intérêt, et la crainte du châtiment, à laquelle les animaux eux-mêmes sont sensibles, est seule capable de les empêcher de porter atteinte à l'intérêt commun. Au-dessus de cette couche sociale inférieure, et occupant le vaste espace de la région moyenne, apparaissent les individualités qui possèdent d'une manière approximative les notions du droit et du devoir, mais qui manquent de l'énergie morale nécessaire pour résister toujours victorieusement aux assauts de leur intérêt particulier, s'ils n'y sont point aidés par une force répressive qui les contienne dans le droit et des excitants qui les poussent au devoir. Ceux-ci luttent cependant; ils ne sont pas accessibles seulement à la crainte des châtiments matériels, ils le sont encore à celle des châtiments célestes, à la réprobation de l'opinion et de leur propre conscience, qui distingue le bien et le mal, qui a l'amour de l'un et l'horreur de l'autre. Tantôt, dans cette lutte, les impulsions aveugles et déréglées de l'intérêt particulier sont refoulées, tantôt elles l'emportent. Il en est [161] encore qui, par un calcul cynique, mais le plus souvent inconscient, trouvent bon de profiter des avantages que procure la société en se dérobant, autant qu'ils le peuvent, à ses conditions et à ses charges. S'ils y réussissent, et s'ils parviennent à se soustraire à toute répression, cette manière d'agir pourra en effet leur être profitable, actuellement du moins : tandis que les autres membres de la société sont contenus ou se contiennent dans les limites du droit et s'appliquent à remplir leur devoir, et que, grâce à cette conduite morale, la société croît en puissance et en richesse, ils bénéficient de sa prospérité, sans subir les restrictions, sans participer aux sacrifices par lesquels les autres l'achètent. On respecte leur droit, on remplit à leur égard les devoirs qu'impose l'intérêt commun. Eux, empiètent sur le droit d'autrui, et s'épargnent les sacrifices qu'implique le devoir. Outre leur part légitime dans les avantages de la société, ils jouissent de ce qu'ils peuvent prendre impunément sur la part d'autrui. C'est un double bénéfice. Il y a mieux. Si, en s'entendant et se coalisant, ils parviennent à imposer leurs manières d'agir nuisibles ou à les faire accepter comme conformes à l'intérêt général, non seulement ils jouiront en paix du fruit de leurs rapines, mais encore ils passeront pour des bienfaiteurs de la société; leur bénéfice sera alors à son maximum. Mais, comme ce bénéfice sera acquis au détriment de l'intérêt général, la prospérité de la société en sera diminuée; elle sera moins puissante et moins riche; si elle se trouve en lutte avec d'autres sociétés, elle courra le risque de succomber, et ceux qui l'auront affaiblie, en faisant prévaloir leur intérêt sur l'intérêt commun, seront enveloppés dans sa ruine. Ainsi donc, on peut dire que ceux-là mêmes qui ne respectent pas le droit, et qui se dérobent à l'accomplissement du devoir dans les conditions les plus favorables, agissent contrairement à [162] leur intérêt permanent et bien compris. Cette considération a rarement, à la vérité, le pouvoir de les toucher, et, eu égard à la brièveté de la vie humaine, ils peuvent s'imaginer, et les victimes de leur manière d'agir vicieuse elles-mêmes s'imaginent, qu'une telle manière d'agir est préférable à toute autre, lorsqu'elle est doublée d'une habileté suffisante pour défier toute répression. Mais, de quelque habileté qu'elle soit pourvue, elle n'en a pas moins des conséquences nuisibles qu'il est impossible de supprimer, qui se font sentir tôt ou tard, et auxquelles nul, si artificieux qu'il soit, ne peut se soustraire. Enfin, au-dessus de ces diverses catégories d'individus, plus ou moins réfractaires à la morale sociale, apparaît une faible minorité, qui s'applique, dans toute la sphère de son activité, à respecter le droit d'autrui et à remplir son devoir.
Ces catégories d'individus qui composent la portion de la société capable du self government y sont, comme on vient de le voir, inégalement propres. C'est pourquoi on a jugé nécessaire, même au sein des sociétés les plus civilisées, de les soumettre à un régime dans lequel le self government est plus ou moins mitigé par la tutelle. En dernière analyse, toute société présente nécessairement, dans des proportions déterminées parla quantité et la répartition de la capacité gouvernante, la combinaison d'une certaine somme de self government avec une certaine somme de tutelle.
La tutelle peut être partielle ou totale, temporaire ou permanente, individuelle ou collective, arbitraire ou légale, elle est plus ou moins efficace, elle est même nuisible quand elle n'est pas nécessaire ou quand elle est exercée d'une manière vicieuse. Elle exige des conditions spéciales d'aptitudes et de lumières chez ceux qui l'exercent, elle exige aussi qu'ils aient un intérêt suffisant à la bien exercer. Elle a ses procédés et ses méthodes, et doit [163] toujours être adaptée au tempérament et au degré de capacité de ceux qui y sont soumis. Elle donne naissance à une série d'obligations du tuteur envers le pupille et du pupille envers le tuteur. Est-il besoin d'ajouter qu'elle est, comme toute institution humaine, essentiellement imparfaite, ce qui signifie du même coup qu'elle est perfectible?
Passons rapidement en revue quelques-unes de ses formes et de ses applications. La tutelle de l'enfant appartient naturellement au père de famille, et elle constitue une obligation inhérente à la paternité. C'est à lui que revient le devoir de nourrir et d'élever ses enfants, en supportant les frais qu'implique l'accomplissement de ce devoir. La tutelle fait partie de l'obligation paternelle. Cependant, cette tutelle peut être vicieuse et malfaisante: non seulement la société se charge d'en réprimer les abus, mais elle met, dans quelque mesure, le père lui-même en tutelle, en limitant son pouvoir de tuteur, en l'empêchant, par exemple, d'imposer le travail manufacturier à son enfant avant un certain âge ou en rendant l'instruction obligatoire. Cette tutelle du tuteur est plus étendue encore, lorsque, à défaut du père, un étranger est appelé à remplir les fonctions de tuteur, et l'on en comprend aisément la raison : un étranger n'offre point une garantie équivalant à celle du sentiment paternel. — Au-dessus de la tutelle individuelle ou privée, dont les applications sont d'ailleurs fort nombreuses, apparaît la tutelle collective de la société, exercée communément, du moins à notre époque, par les pouvoirs qui la représentent, autrement dit, la tutelle publique. Cette sorte de tutelle s'exerce de deux façons différentes : par voie de restriction et par voie de direction et de secours. Dans le premier cas, elle est pratiquée au moyen de coutumes, de lois ou de règlements qui limitent l'usage de certaines libertés, telles que la liberté d'écrire, d'enseigner, d'échanger, en spécifiant [164] les restrictions et les conditions que l'État-tuteur impose à leur exercice. L'ensemble de ces restrictions et de ces conditions constitue le système préventif, lequel apparaît partout combiné, dans des proportions diverses, avec le système répressif qui maintient intacte la liberté de l'individu, ou la portion de liberté qui lui est laissée, en se bornant à réprimer les atteintes portées à la liberté d'autrui. Il se peut, quoique la chose soit contestable, que le système préventif ait sa raison d'être lorsqu'il s'agit d'une liberté nouvelle que la multitude n'a pas encore appris à pratiquer, et dont l'abus peut être dangereux pour la société, mais il n'en est pas moins une cause de ralentissement et d'amoindrissement de l'activité générale; comme il ne va point sans un lourd appareil bureaucratique, il détruit la spontanéité des mouvements de l'intérêt privé, et, en affaiblissant son action, il ralentit l'essor de la richesse publique. Il importe donc de ne le laisser subsister, comme au surplus toute autre tutelle, qu'autant que l'expérience en démontre l'absolue nécessité. — La tutelle publique s'exerce ensuite par voie de secours accordés et de directions imposées à certains intérêts, réputés incapables de se suffire à eux-mêmes ou de se diriger d'une manière conforme à l'intérêt général. C'est ainsi que, dans la plupart des États civilisés, l'État ou la commune qui est un sous-État local subventionne l'enseignement, les cultes, les beaux-arts, et un grand nombre de branches d'industrie, qu'il assiste les pauvres, soit en leur distribuant des secours, soit en créant et en entretenant des hôpitaux et des hospices. Ces subventions sont allouées, les unes sans condition, les autres sous la condition que l'intérêt subventionné pratiquera les manières d'agir que l'État estime les meilleures au point de vue de l'intérêt général et permanent de la société. Ce genre de tutelle a acquis un développement extraordinaire [165] à l'époque où nous sommes, et il est constamment en voie d'accroissement. Cet accroissement peut avoir sa raison d'être dans les circonstances particulières et accidentelles où se trouvent les sociétés modernes, mais aucune sorte de tutelle ne soulève plus d'objections et ne s'achète plus cher. Les ressources nécessaires pour la pratiquer sont prélevées sur tous les membres de la société au moyen de l'impôt. Or, qu'est-ce que l'impôt? c'est un tantième perçu d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, mais presque toujours par des procédés coûteux et grossièrement inégaux, sur la propriété de chacun, c'està-dire sur les forces et les ressources à l'aide desquelles s'exerce son pouvoir d'agir ou sa liberté. Il diminue donc la puissance d'action des individus pour créer une puissance d'action publique. La société, laquelle, ne l'oublions pas, n'est point une abstraction ou une idole, mais une réunion d'individus, et dont l'intérêt n'est autre que la collection des intérêts individuels, la société, disons-nous, ne gagne à cette opération qu'autant que la puissance publique agit d'une manière plus utile à l'intérêt de tous que ne le feraient les pouvoirs particuliers aux dépens desquels elle est constituée, ceci en tenant compte de la perte sèche qu'implique la perception de l'impôt. S'il s'agit de l'enseignement, du culte, des lettres et des arts, l'intervention tutélaire de la puissance publique ne se justifie, en premier lieu, que si la multitude est trop peu capable d'apprécier l'utilité de ces divers services, pour leur consacrer une part suffisante de ses revenus; en second lieu, si elle montre encore son défaut de capacité en laissant dépérir les branches supérieures de la culture intellectuelle et morale pour alimenter de préférence les branches inférieures. Encore faut-il, à cet égard, que l'expérience ait été faite et qu'elle soit décisive. S'il s'agit de secourir les pauvres, ce qui revient à suppléer à l'insuffisance des [166] pouvoirs d'une catégorie d'individus aux dépens des pouvoirs des autres catégories, il faut que cette insuffisance soit bien avérée et que la charité privée se montre impuissante à y subvenir. Mais, dans ces divers cas, qu'il s'agisse de l'enseignement, du culte, des arts ou de la charité, il est bien clair que, du moment où un peuple a acquis la capacité nécessaire pour imprimer à ces branches supérieures de l'activité humaine un développement et une direction conformes à l'intérêt commun, l'intervention coûteuse et d'ailleurs toujours faillible de la tutelle publique cesse d'avoir sa raison d'être, et elle doit faire place au self government. En revanche, si la société, représentée par les dépositaires de la puissance publique, juge opportun de subventionner certains intérêts, elle a visiblement le droit de faire ses conditions, et de leur imposer les manières d'agir qu'elle croit les plus conformes à l'intérêt général.
En résumé, le régime de la tutelle, sous ses diverses formes et dans la multitude de ses ramifications, est appliqué aux individus qui ne possèdent pas ou sont censés ne pas posséder le minimum de capacité physique, intellectuelle et morale nécessaire pour pratiquer le self government.
Au-dessous de la tutelle, apparaît enfin la servitude. Dans nos sociétés civilisées, la servitude n'existe plus, au moins sous une forme avouée, qu'à titre de pénalité, et elle a un caractère purement viager. Il en était autrement dans les sociétés anciennes. Plus elles avançaient dans les voies de la civilisation, plus elles acquéraient de la richesse, et plus elles étaient en butte aux agressions des peuplades ou des sociétés moins progressives, mais non moins avides de jouissances. Elles étaient obligées de les détruire ou de les asservir, sous peine d'être détruites ou asservies par elles. De là, la nécessité de la servitude. [167] Le progrès a consisté à transformer, dans le cours des âges, la servitude en tutelle, comme il consiste à substituer, par le développement de la capacité dirigeante, à la tutelle le self government qui est le régime le plus parfait sous lequel l'homme puisse vivre.
III. — Nécessité d'un gouvernement, dérivant de la nature de l'homme et des conditions de son existence. — Que le milieu où il vit renferme les éléments et les forces dont il a besoin, mais qu'il doit utiliser. — Il les utilise en créant et en perfectionnant le matériel de la production, en constituant un personnel capable de le mettre en œuvre. — Comment il y parvient. — Discipline à laquelle il doit se soumettre, dans l'état d'isolement et dans l'état de société. — Morale individuelle et morale sociale. — Machinery nécessaire pour assurer l'application des règles de la morale individuelle et sociale. — Imperfection originaire de cette machinery. — Comment elle se perfectionne et décline dans chaque société. — Causes du progrès et de la décadence des nations. — Progrès général de la machinery du gouvernement provenant de l'accumulation des expériences particulières et successives. — Nécessité de se rendre compte de l'influence politique de la petite industrie, pour apprécier les changements que l'évolution de la grande industrie est destinée à apporter dans le gouvernement de l'espèce humaine.
Telle a été de tous temps la machinery du gouvernement de l'espèce humaine. La nécessité de cette machinery réside dans la nature de l'homme et du milieu où il vit. L'homme est obligé de produire toutes les choses nécessaires à l'entretien de sa vie et de les employer de manière à assurer son existence, non seulement dans la période où il peut produire, mais encore dans celle où il ne le peut pas encore et dans celle où il ne le peut plus. Le globe qu'il habite recèle dans son sein des matériaux suffisants pour fournir à l'entretien d'une multitude innombrable d'individualités humaines, en leur procurant tous les éléments du bien-être, pendant un espace de temps indéfini; il recèle, en même temps, ou il reçoit perpétuellement toutes les forces à l'aide desquelles ces matériaux peuvent être mis en œuvre et façonnés aux besoins de l'homme. Mais il faut découvrir ces matériaux et savoir [168] les utiliser, il faut connaître ces forces et les asservir au moyen d'appareils qui leur soient appropriés. Il faut créer le matériel de la production avec les procédés techniques que comporte sa mise en œuvre. A mesure que ce matériel s'augmente et se perfectionne, à mesure que progresse aussi l'art d'en tirer parti, la puissance de l'homme sur la nature s'accroît. Il peut se procurer une plus grande quantité des matériaux de l'existence en échange d'une peine moindre, s'affranchir progressivement du joug des nécessités matérielles, et s'élever dans une sphère plus haute de civilisation. Après une longue période de recherches, de tâtonnements et d'efforts, il crée le matériel de la petite industrie qui permet à des peuplades errantes clairsemées et misérables de se transformer en des sociétés nombreuses et riches, au sein desquelles se multiplient et s'accumulent les acquisitions de la science et de l'art. Il est en train de créer aujourd'hui le matériel de la grande industrie, qui est destiné à mettre à la place de ces sociétés encore isolées et hostiles une vaste humanité dont tous les membres, rattachés par des intérêts communs, travailleront en paix à l'œuvre du progrès universel.
Mais il ne suffit pas à l'homme de créer un matériel, d'inventer des procédés et d'accumuler des connaissances techniques pour se rendre maître des éléments et des forces de la nature. Il faut encore que l'homme se façonne lui-même, qu'il reconnaisse, assujettisse et discipline ses propres forces pour les utiliser. Il faut qu'il apprenne à se gouverner, s'il veut gouverner le monde, et la machinery dont nous venons de décrire les rouages n'est, à tout prendre, que l'échafaudage qu'il a dû élever pour construire l'édifice du gouvernement de soi-même.
La première pièce de cette machinery, c'est la morale individuelle. Si nous prenons l'homme à son état primitif d'isolement, avant la formation des premiers troupeaux [169] humains, nous trouverons déjà qu'il ne peut subsister sans observer les règles d'une morale rudimentaire. Il faut qu'il pratique certaines vertus, qu'il s'abstienne de certains vices sous peine de périr. Il est obligé de chercher sa subsistance et celle de sa famille, il faut, non seulement qu'il pourvoie à la défense commune, mais encore qu'il aménage économiquement ses ressources, et qu'il pratique, à l'égard de sa femme et de ses enfants, les devoirs élémentaires de la tutelle. L'accomplissement de ces diverses obligations exige de sa part le déploiement d'une certaine somme d'activité, de bravoure et de prévoyance. S'il est paresseux, lâche et imprévoyant, s'il ne protège et ne guide point les êtres faibles dont il a la charge, la famille naissante n'aura que des chances bien incertaines de ne pas succomber dans la lutte pour l'existence, quels que soient d'ailleurs les avantages du milieu où elle se trouve placée, l'abondance des ressources alimentaires, la salubrité et la douceur du climat.
Mais les familles isolées s'accroissent et se réunissent (peu importe d'ailleurs que la famille se soit constituée avant la société ou la société avant la famille), elles forment des troupeaux, des clans ou des tribus, et, finalement, des nations. La morale individuelle ne suffit plus à cet état nouveau; elle s'étend, se complique et s'élève en raison des rapports que l'association établit naturellement entre les hommes. L'homme isolé n'a point à s'occuper des limites de son droit, et il n'a de devoirs à remplir qu'envers les siens et envers lui-même. L'homme en société est obligé, s'il veut que la société subsiste — et il y est intéressé dans la mesure énorme de l'accroissement de puissance et de richesse qui résulte de la combinaison des forces productives et de la division du travail — l'homme en société, disons-nous, est obligé de contenir son pouvoir d'agir ou sa liberté dans les limites du droit et de remplir [170] des devoirs à l'égard d'autrui. Il faut donc qu'il apprenne à connaître son droit afin de pouvoir respecter le droit d'autrui, et ses devoirs envers la société afin de pouvoir les pratiquer. Il doit éviter de blesser l'intérêt des autres s'il ne veut point qu'ils blessent le sien, et agir de la manière la plus conforme à l'intérêt général, s'il veut que la société dont il est membre atteigne le plus haut degré possible de puissance et de prospérité. Cette éducation de la sociabilité ne peut être que le fruit de l'expérience. L'expérience fait reconnaître quels sont les actes nuisibles, les nuisances et les actes utiles, et, parmi ceux-ci, quels sont les plus utiles à la communauté. L'intérêt bien entendu de chacun, consisterait à s'abstenir des uns et à pratiquer les autres, car le résultat d'une telle conduite serait le développement le plus complet de la prospérité générale dont la sienne fait partie. Mais l'homme est ignorant, faible et vicieux; il est trop souvent incapable de s'abstenir de ce qui lui nuit, à plus forte raison de ce qui nuit à autrui; il ne remplit qu'imparfaitement ses obligations envers lui-même et les siens, à plus forte raison est-il incapable de l'effort nécessaire pour remplir suffisamment ses obligations envers les autres. Il faut le contraindre à se tenir dans les limites de son droit et l'exciter à remplir son devoir. L'opinion, la coutume née de l'opinion, la répression et la religion sont les agents à l'aide desquels se crée et se maintient cette discipline indispensable; la conscience individuelle, successivement formée, joint son action interne à celle de ces agents externes, enfin la tutelle et la servitude mettent sous la direction des plus forts et des plus capables les individualités ou les races inférieures. Grâce à cette machinery sociale, l'ordre s'établit, les entreprises de production, qui fournissent la puissance et la richesse, se fondent et elles se multiplient dans la double mesure de l'état d'avancement du [171] matériel, du degré de vigueur physique, d'intelligence et de moralité du personnel, la société peut subsister et grandir.
Mais, comme tous les mécanismes, celui-ci commence par être extrêmement imparfait et grossier, et il ne se perfectionne, de même, que par l'action lente de l'observation et de l'expérience. L'opinion est ignorante et brutale, la répression est à la fois incertaine et violente, la religion se compose de superstitions basses ou mystiques, la conscience individuelle est vague et confuse, la tutelle vaut ce que valent ceux qui l'exercent, la servitude est cruelle. Le droit de chacun est mal délimité; les forts, en se coalisant, poussent le leur au delà de ses limites naturelles, les devoirs sont incomplètement définis et ne répondent point aux vrais intérêts de la société; les appareils qui garantissent ces droits mal délimités et qui servent à l'accomplissement de ces devoirs mal définis et mal adaptés, fonctionnent lourdement, avec une énorme déperdition de forces; ils sont sujets à se vicier et à se détraquer.
Le produit de cet organisme imparfait est nécessairement imparfait. Cependant, l'observation et l'expérience agissent incessamment pour remédier à ses défauts, et un moment arrive où il atteint le degré de perfection que comporte le stock limité des forces et des ressources de chaque société. Alors le progrès s'arrête, et il fait bientôt place à la décadence. De l'imparfaite fixation et de l'insuffisante observation des droits et des devoirs, sont issues des manières d'agir nuisibles, qui se sont généralisées et dont les conséquences se sont accumulées dans le cours des générations. Des habitudes vicieuses se sont enracinées et développées. Les mœurs se sont dégradées et perverties. Une hostilité d'abord latente, puis ouverte, se manifeste entre les classes qui ont usurpé au delà de leur droit et celles qui ont obtenu moins que leur droit. L'orgueil des unes, l'excès de richesses que leurs privilèges [172] leur ont valu, provoquent la haine et l'envie des autres. Les luttes intestines commencent à déchirer la société et à l'affaiblir. En même temps, les vices qu'engendre l'oisiveté corrompent les couches supérieures, tandis que la misère avilit les couches inférieures. Les freins sociaux se détendent, la discipline se relâche. Si des éléments de réforme et de progrès ne sont point importés du dehors, si une religion plus pure, une opinion plus éclairée et plus morale, un appareil moins imparfait de répression et de tutelle ne viennent point remplacer ces freins usés, c'en est fait de la société. Les entreprises qui fournissent la puissance et la richesse ne trouvent plus d'intelligences et de caractères pour les diriger, de capitaux pour les alimenter, de forces pour les desservir. Livrées à un personnel de plus en plus insuffisant et gâté, elles dépérissent et succombent. Vienne une invasion, un choc d'une société plus vigoureuse, l'édifice social s'effondrera en ne laissant que des ruines éparses sur le sol. Tel est le spectacle qu'offre l'histoire de toutes les sociétés, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours.
Cependant, les sociétés qui se succèdent profitent des acquisitions et de l'expérience de leurs devancières. Le capital de la civilisation s'accroît sans cesse : d'une part, le matériel et les procédés techniques de la production se perfectionnent et leurs progrès demeurent acquis, il est dans leur nature de se propager et d'être indestructibles; d'une autre part, les acquisitions qui concernent le gouvernement de l'homme et de la société se perfectionnent de même, se transmettent et s'accumulent; la machinery de ce gouvernement est devenue plus parfaite, quoique les progrès qu'elle a réalisés ne soient point au niveau de ceux qui ont transformé le matériel de la civilisation.
En appelant à l'existence des sociétés nombreuses et riches, la création de la petite industrie a imprimé un [173] essor extraordinaire aux arts du gouvernement, car une nation ne se gouverne point comme une tribu. La création de la grande industrie sera le point de départ d'un progrès analogue. Si l'on veut se former une idée approximative de ce que deviendront, dans cette nouvelle phase économique, le gouvernement et la condition de l'espèce humaine, il est nécessaire d'examiner ce qu'ils ont été dans les deux phases précédentes, dans celle qui a précédé la naissance de la petite industrie et dans celle qui l'a suivie.
[173]
CHAPITRE VI. Le passé.↩
I. — L'homme est d'abord un animal sauvage. — Nécessités et instincts qui ont poussé les hommes primitifs à vivre en troupes. — Aucune réunion d'hommes ne peut subsister sans une organisation hiérarchique. — Comment naissent la morale et les coutumes. — Que la liberté individuelle disparaît sous la règle imposée au nom de l'intérêt commun. — Que la religion renforce de sa sanction l'organisation politique et les coutumes. — Cause physiologique et cause économique de ce fait. — La civilisation en germe dans les institutions primitives de la tribu. — Que cette période embryonnaire subsiste jusqu'à l'avènement de la petite industrie. — Énorme accroissement de la population provoqué par la découverte et la mise en culture des plantes alimentaires. — Conséquences.
L'homme apparaît d'abord — et nous le voyons tel encore aujourd'hui dans ses variétés les moins progressives — à l'état d'animal sauvage, avec cette seule différence qu'il est pourvu d'une organisation plus complète, de facultés plus nombreuses que les autres espèces. Tous ses efforts ont dû naturellement être appliqués, dès son apparition sur le globe, à l'entretien de son existence précaire. Il devait se nourrir, s'abriter, se défendre contre les animaux et les « hommes de proie ». La recherche des végétaux et des fruits propres à son alimentation, la chasse et la pêche, l'aménagement d'un abri, caverne, hutte de terre ou de branchages, la confection de vêtements, d'armes et d'outils grossiers ont été ses premières industries. Sa faiblesse individuelle, en présence des grands carnassiers pourvus d'armes naturelles bien autrement puissantes que les siennes, en développant en lui l'instinct de la sociabilité, l'a porté à vivre en troupes. Même les Australiens autochtones, demeurés à l'échelon le plus bas de l'humanité, [175] forment des peuplades ou des tribus. Ces troupeaux primitifs sont les embryons des nations et des États.
Mais un troupeau d'hommes ou d'animaux ne peut subsister sans une organisation rudimentaire. Avant tout, il lui faut un chef pour diriger et coordonner ses mouvements. Ce chef, à son tour, doit posséder des auxiliaires pour transmettre ses ordres et en assurer l'exécution. L'avantage commun exige que le chef soit le plus fort et le plus capable de la bande, et qu'au-dessous de lui les forces et les capacités s'échelonnent selon l'importance et la difficulté des fonctions. Une hiérarchie et une discipline naturelles s'établissent ainsi et on les retrouve même chez des animaux très inférieurs à l'homme. Le lien de la hiérarchie et la condition du succès de toute action collective, c'est l'obéissance. Aussi est-elle considérée comme le premier des devoirs et la plus nécessaire des vertus. Aux yeux du Dieu de la Bible, la désobéissance est un crime qui ne comporte aucun pardon : c'est pour avoir désobéi que l'homme est chassé du paradis terrestre.
En même temps que la hiérarchie se constitue, et sous l'empire de nécessités analogues, naissent les premiers rudiments de la morale. Des hommes qui vivent réunis doivent s'abstenir de commettre des actes nuisibles les uns à l'égard des autres, sous peine de rendre leur association précaire et d'en provoquer la dissolution. Une communauté au sein de laquelle l'assassinat, le rapt, l'adultère, le vol demeureraient impunis, ne pourrait subsister. L'expérience se charge de faire reconnaître quelles sont, dans la multitude des manifestations de l'activité de chacun, les actes utiles et les actes nuisibles. Une morale se crée ainsi peu à peu, morale étroite et bornée, car elle repose sur l'intérêt exclusif et immédiat d'une tribu isolée, en lutte avec le reste de la création, et cet intérêt même est observé et apprécié par des esprits encore incultes et [176] sauvages. Aussi autorise-t-elle des actes qui, dans un état de civilisation plus avancé, sembleront, à bon droit, entachés d'une immoralité monstrueuse. Si la tribu est trop pauvre pour nourrir ses vieillards, il pourra lui sembler utile de s'en débarrasser et le parricide sera considéré comme un acte moral.[13] D'autres actes qui seront, au contraire, considérés comme immoraux, le fait d'épouser une femme étrangère à la tribu, par exemple, deviendront plus tard moraux. L'opinion publique de la tribu formée, comme elle l'est encore de nos jours, par les individualités les plus fortes et les plus influentes, sanctionne les uns et les rend obligatoires, tandis qu'elle interdit les [177] autres. Telle est l'origine des coutumes qui sont, ellesmêmes, les premières sources des lois. Les coutumes d'une tribu contiennent alors toute sa morale; en d'autres termes, il n'y a d'actes immoraux que ceux qui sont défendus par la coutume. Plus tard, à mesure que les manifestations de l'activité humaine se multiplieront, on verra la morale déborder la coutume ou la loi. De nos jours, la loi ne contient plus que la moindre partie de la morale, en ce sens qu'elle ne prohibe et ne punit que le plus petit nombre des actes immoraux, en abandonnant les autres à la juridiction de l'opinion publique ou de la conscience individuelle. C'est grâce à ce progrès que la sphère de la liberté individuelle s'est successivement agrandie. Mais, aussi longtemps que la morale et la loi ne font qu'un, cette liberté demeure à son minimum. Toutes les manières d'être et d'agir qui sont, ou qui paraissent conformes à l'intérêt de la tribu, étant ordonnées par la coutume, et toutes les autres interdites, la liberté individuelle se trouve à peu près annulée. A sa place apparaît une tutelle plus ou moins intelligente et morale, mais qui produit néanmoins, et à tout prendre, une somme d'actes utiles supérieure à celle qui serait engendrée par l'initiative libre et effrénée d'une collection d'individualités à l'état sauvage. C'est ainsi que le règlement d'une école, en le supposant même fait par des maîtres brutaux et ignorants, vaut mieux que l'absence d'un règlement. Il n'en est pas moins vrai, comme l'a remarqué judicieusement sir John Lubbock, que les sauvages ont été, de tous temps, les moins libres des hommes.[14]
Comment se maintenaient ces coutumes qui emprisonnaient toutes les existences dans un réseau aux mailles rigides et étroites? La crainte des châtiments et de la réprobation publique n'aurait pas suffi seule, selon toute apparence, pour en assurer l'observation, il fallait y joindre une autre sanction, plus efficace en ce sens que nul ne pût y échapper, et celle-ci fut la sanction religieuse. Que le sentiment religieux existe presque généralement dans la nature humaine et qu'il constitue une force considérable, c'est un fait d'observation. Mais comment s'expliquer que cette force ait été mise partout, dès la formation des sociétés, au service de la morale établie? Comment s'expliquer que la religion ait sanctionné de ses terreurs et de ses pénalités formidables l'obéissance aux chefs et l'observation des coutumes? Ce phénomène a une cause physiologique [179] et une cause économique. La première, c'est l'association intime des facultés intellectuelles et morales qui ont créé, non seulement les gouvernements et les religions, mais encore toutes les autres institutions et tous les autres arts de la civilisation. La seconde, c'est l'absence originaire de la division du travail intellectuel et moral. Les individualités qui étaient douées de l'esprit d'observation et de combinaison, et qui, en l'appliquant à la connaissance des phénomènes naturels et sociaux, inventèrent les premiers arts et les premières institutions, ces individualités d'élite étaient peu nombreuses, et celles, en plus petit nombre encore, dont les ressources bornées de la tribu permettaient de rétribuer les services, réunissaient les fonctions et les occupations qui sont aujourd'hui divisées parmi les membres des professions dites libérales; dans les tribus africaines ou polynésiennes qui sont demeurées au point de départ de la civilisation, le même homme résume en lui toute la science et monopolise toutes les professions intellectuelles de la tribu. Il est prêtre, sorcier, médecin, parfois même législateur et juge. Il était donc naturel que des hommes exerçant les fonctions, maintenant séparées, de prêtres, de savants et de législateurs, invoquassent en faveur de leurs découvertes et de leurs créations politiques ou sociales, l'autorité des puissances mystérieuses qui personnifiaient à leurs yeux les forces de la nature, le feu, la lumière, l'électricité, les flots soulevés par l'ouragan, ou qui, pour les intelligences tout à fait supérieures, apparaissaient comme les causes de ces phénomènes. Sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir ici aucun charlatanisme, quoique le charlatanisme ait pu leur venir en aide, on conçoit qu'ils aient placé sous la sanction de ces puissances redoutables les institutions et les pratiques qui leur paraissaient les plus propres à assurer l'existence et le bien-être de la tribu. On [180] conçoit encore que la foule, remplie d'une terreur religieuse à l'aspect des phénomènes étranges et terribles, tempêtes, incendies, tremblements de terre, épidémies, par lesquels se manifestait l'activité de ces « esprits » inconnus et surhumains, ait accepté, avec une soumission respectueuse, les coutumes et les lois qu'ils avaient sanctionnés, sinon dictés.
Ainsi apparaissent, sous l'influence de la nécessité et par le travail des facultés civilisatrices de l'élite de l'espèce humaine, les premiers germes des institutions politiques et sociales. Ces germes se développeront successivement et diversement selon le tempérament particulier de chaque tribu, le milieu où elle se trouvera établie et la nature de ses moyens d'existence. Ici, ils avorteront, et, après des centaines de siècles, la tribu apparaîtra dans son état de primitive barbarie; là, ils donneront naissance à des sociétés puissantes, qui se transmettront une civilisation de plus en plus élevée et complète.
Cette période embryonnaire de la sociabilité subsista sans développements notables pendant la longue période qui a précédé la découverte et la mise en culture des plantes alimentaires, l'invention de l'outillage agricole et l'apparition des premiers rudiments de l'industrie. Des troupeaux d'hommes vivant de la récolte précaire des fruits naturels du sol, de la chasse, et notamment de la chasse à l'homme, plus tard, de l'élève des animaux réduits à l'état de domesticité, ne ressentaient pas, en effet, le besoin d'une organisation savante et compliquée. Mais l'évolution économique, qui fut la conséquence de l'invention de l'agriculture et des premiers arts, en d'autres termes, qui ouvrit l'ère de la petite industrie, rendit nécessaire un développement correspondant des institutions politiques et sociales.
Si l'on veut se faire une idée de l'importance de cette [181] évolution, il suffira de comparer les chiffres de la population possible dans la période qui précéda l'avènement de la petite industrie, et dans celle qui la suivit. On estime tout au plus à un individu par dix kilomètres carrés le maximum de densité possible d'une population vivant de la chasse ou de la récolte des fruits naturels du sol; d'où il résulte que la population totale du globe, en le supposant peuplé dans toutes ses parties habitables, ne devait pas excéder, dans ces temps primitifs, huit ou dix millions d'individus, distribués en troupeaux qui ne pouvaient, en raison de la nature de leurs moyens d'existence, dépasser un nombre très restreint. Quoique l'élève du bétail fût plus productive que la chasse, nous voyons, par l'exemple d'Abraham, que les tribus ou même les familles de pasteurs se séparaient dès que leurs troupeaux se multipliaient trop pour trouver une pâture suffisante dans les régions que la tribu avait l'habitude de parcourir. Mais, aussitôt qu'apparaît la petite industrie, la population possible s'accroît dans une proportion énorme : dix kilomètres carrés peuvent fournir des moyens d'existence, non plus à un individu, mais à 1,000, 2,000 et même davantage. Il est tel canton des Flandres ou de la Lombardie, et telle province de la Chine, où la petite culture nourrit 300 habitants et au delà par kilomètre carré. Et, n'oublions pas que l'outillage et les procédés agricoles sont demeurés à peu près immobiles depuis la naissance de la petite industrie jusqu'à l'avènement de la grande; n'oublions pas non plus que dans ce long intervalle la fécondité naturelle du sol a diminué au lieu de s'accroître.[15] Autre phénomène [182] non moins important. Tandis qu'une famille de chasseurs ou même de pasteurs occupant un vaste espace, ne peut guère pourvoir qu'à sa propre subsistance, une famille d'agriculteurs produit aisément, sur une étendue de terrain mille fois moindre, de quoi nourrir une autre famille. Avec le matériel de la grande industrie, cette proportion peut être largement dépassée. Déjà, en Angleterre par exemple, elle est de 1 à 3, ou même de 1 à 4, et cependant nous ne sommes encore qu'au début de la grande industrie agricole. D'après ces données, nous pouvons nous faire une idée approximative du changement que la découverte des plantes alimentaires et l'invention du matériel de la petite culture apportèrent dans la production des subsistances. Un chasseur ne se procurait que peu de chose au delà de la quantité de gibier nécessaire à sa [183] subsistance et à celle de sa famille, en explorant une surface de dix kilomètres carrés par bouche à nourrir. Mis en culture, un seul kilomètre carré put fournir la subsistance de deux à trois cents bouches, tout en n'exigeant qu'une somme de travail humain représentée par cent ou cent cinquante bouches. Avec le surplus, on put donc nourrir un nombre de prêtres, de savants, de guerriers, d'artisans, de commerçants et de serviteurs, presque égal à celui des agriculteurs. Dès lors, la création d'États populeux, puissants et riches devenait possible.
II. — Aperçu sommaire de la machinery élémentaire du gouvernement des sociétés. — Comment se sont constitués les états primitifs. — Les tribus progressives en possession du matériel de la petite industrie s'emparent des régions les plus propres à la culture, et asservissent les races autochtones. — Possibilité et nécessité de l'émigration dans cette phase du développement de l'humanité. — Nécessité de l'asservissement des races inférieures. — Division nécessaire des sociétés naissantes en classes dominantes et en classes asservies. — Débouché de la classe dominante. Pourquoi ce débouché est limité aux fonctions supérieures de la société. — Éléments constitutifs de la classe dominante. — Guerriers, prêtres ou savants, entrepreneurs et artisans. — Rôle des guerriers. Pourquoi la féodalité militaire a été primitivement la forme nécessaire de la domination. — Comment la centralisation a succédé à la féodalité. — Rôle des prêtres. — Modes successifs de rétribution de leurs services. — Rôle des chefs d'exploitation et des artisans. La classe dominante en minorité. — Les classes asservies. Pourquoi l'esclavage est issu de la petite industrie. — Nécessité de la coopération des classes asservies aux premiers établissements de la civilisation. — Étendue de leur débouché. — Pourquoi ce débouché était moindre chez les Israélites. — Causes des transformations du mode d'assujettissement et d'exploitation des classes asservies. — Le pécule et le colonat. — Le servage. — Origines de la commune et de la communauté agricole; — de la corporation et de la commune urbaine. — Résumé.
Nous n'avons que des données incertaines sur la manière dont les premières agrégations humaines, troupeaux, clans ou tribus se sont constituées, mais il est évident que leur constitution était nécessaire, en ce sens que des familles éparses auraient été impuissantes à lutter contre les causes de destruction qui menaçaient les hommes des premiers âges. C'est le besoin de sécurité qui a déterminé [184] la formation de ces sociétés embryonnaires, et l'association ne s'y applique guère à d'autres objets; au sein des tribus sauvages, chacun pourvoit individuellement à la recherche de sa subsistance : l'homme chasse, construit sa hutte ou creuse sa tanière, la femme prépare les aliments, fabrique les vêtements, etc. -, on poursuit, à la vérité, en commun le gros gibier, et les cannibales se réunissent en troupes pour la chasse à l'homme, mais le but essentiel c'est la défense commune, car l'existence isolée, dans un monde où dominaient les grands carnassiers et les hommes de proie, eût été impossible. La dissolution d'une tribu avait pour conséquence inévitable la destruction de ses membres, et l'expulsion d'une de ces communautés primitives équivalait à un arrêt de mort.
Cependant, une tribu ne peut exister sans un commencement d'organisation politique et sociale qui réponde aux nécessités de la défense extérieure et de l'ordre intérieur. Cette organisation se résume : 1° dans la constitution d'un pouvoir dirigeant avec une hiérarchie qui réunissent et coordonnent les forces de la tribu, de façon à en tirer un maximum d'effet utile; 2° dans l'établissement de « coutumes » qui interdisent les manières d'agir nuisibles à la tribu et commandent les manières d'agir utiles; 3° dans une sanction religieuse qui contribue à assurer l'obéissance aux ordres des chefs et l'observation des coutumes. Grâce à cette machinery élémentaire de gouvernement, des hommes, encore voisins de l'animalité, se plient à une discipline, s'habituent, dans une certaine mesure, au respect mutuel de leurs droits et même à l'accomplissement des devoirs les plus nécessaires. La société est fondée, elle peut subsister, et si quelques-uns de ses membres sont doués d'une intelligence progressive, s'ils parviennent à perfectionner le matériel de la production, la tribu pourra se transformer en une nation et fonder un État.
[185]
Quelles ont été, à l'origine de la civilisation, les tribus progressives, celles qui ont découvert les plantes alimentaires et textiles, les métaux, etc., inventé les outils et les procédés de la petite industrie, voilà ce qui demeure encore obscur; mais, la petite industrie créée, on voit apparaître sur les points du globe les plus favorables à la culture des plantes alimentaires, des États vastes et populeux. Comment ces États ont-ils été fondés et constitués? Quelle transformation a subie l'organisation primitive et rudimentaire de la tribu pour s'adapter aux nécessités du gouvernement d'un État?
Si nous nous reportons aux traditions historiques les plus anciennes, nous verrons se dégager invariablement des fables qui enveloppent les origines des États primitifs, deux phénomènes prédominants : le premier, c'est l'apparition d'une race supérieure pourvue d'un matériel de civilisation relativement perfectionné, armes et outils en métal, instruments et procédés de culture, véhicules de transport maritime et terrestre; le second, c'est l'asservissement des races autochtones par ces immigrants de race supérieure.
Est-il besoin de remarquer que ces deux phénomènes procèdent de causes économiques? Si nous ne savons pas d'une manière absolument certaine dans quelles régions du globe s'est créé le matériel primitif de l'agriculture et de l'industrie, nous connaissons celles où ce matériel s'est perfectionné depuis; nous savons que ce perfectionnement a été l'œuvre d'hommes de race blanche ou légèrement colorée. Nous pouvons en conclure, d'une part, que les inventeurs du premier matériel de la civilisation appartenaient à la même race que ceux qui l'ont perfectionné; d'une autre part, qu'ils habitaient les régions rudes et peu fertiles de la zone tempérée. Car, c'est dans ces régions moyennes seulement que l'intelligence acquiert [186] toute son énergie, et qu'elle est en même temps le plus vivement sollicitée à surmonter les obstacles que l'inclémence du climat et l'insuffisance des ressources alimentaires apportent à l'entretien de la vie. Ces conditions étaient évidemment les plus favorables à l'éclosion du progrès.
Mais le matériel de la culture et de l'industrie primitives une fois créé, ceux qui le possédaient devaient naturellement s'efforcer d'en tirer le parti le plus avantageux possible. Des terres propres à la culture des plantes alimentaires, et des bras assez nombreux pour les mettre en pleine exploitation, voilà ce qu'il leur fallait; c'est à ces deux nécessités que répondent les phénomènes de l'émigration des tribus progressives et de l'asservissement des races inférieures, qui président à la fondation des premiers établissements de la civilisation.
L'émigration n'est pas, comme le supposent les partisans de l'unité de la race humaine, un phénomène primordial. Elle ne peut s'accomplir que dans des conditions économiques qui supposent un progrès déjà réalisé. De nos jours, on n'émigre qu'à la condition de posséder un capital suffisant pour subvenir aux frais de déplacement, de subsistance et de premier établissement qu'implique l'émigration, et il en a été ainsi de tout temps. Il a donc fallu que les émigrants primitifs eussent accumulé un certain capital sous forme de véhicules de transport et de provisions pour s'aventurer dans des régions inconnues. Or, des hommes, qui n'ont d'autres moyens d'existence que la chasse et la récolte des fruits naturels du sol, ne peuvent guère accumuler des provisions; ils sont réduits à vivre au jour le jour dans la région où ils sont nés, qu'ils ont explorée et dont ils connaissent les ressources. En s'aventurant au delà des limites de cette région connue, sans être munis d'une avance de subsistances, ils s'exposeraient à [187] mourir de faim, sans parler du danger d'être exterminés par des peuplades ayant sur eux l'avantage de la connaissance du terrain. Les peuples chasseurs, par exemple, demeurent cantonnés dans les régions giboyeuses qu'ils ont explorées et dont ils se considèrent comme propriétaires. Cette propriété, ils s'efforcent à la fois de la défendre et de l'agrandir aux dépens de leurs voisins. Dans le continent de l'Amérique du Nord, les tribus des PeauxRouges se disputaient incessamment la propriété des terrains de chasse, et les guerres d'extermination auxquelles elles se livraient avant l'arrivée des Européens, n'avaient pas d'autre objet. Les plus fortes s'agrandissaient aux dépens de leurs voisines plus faibles, mais sans émigrer d'une région dans une autre. Les premières émigrations dont l'histoire fasse mention sont celles des peuples pasteurs. On conçoit, en effet, que des tribus qui vivent du produit régulier et relativement abondant de leurs troupeaux, et auxquelles ces mêmes troupeaux fournissent des moyens de transport, puissent entreprendre des expéditions lointaines. La mise en culture des plantes alimentaires, en permettant d'accumuler des provisions en quantité plus considérable, a naturellement facilité les émigrations. Les tribus progressives, qui vivaient sous un climat rude en exploitant un sol ingrat, ont pu alors, avec moins de risques, se mettre à la recherche d'une région plus fertile et d'un climat plus doux.
Mais les émigrants de race blanche qui s'établissent dans une région chaude s'y adaptent difficilement aux travaux de l'agriculture. Il leur faut des auxiliaires sur lesquels ils se déchargent des travaux les plus pénibles. Si les Européens, émigrés dans les régions torrides du Nouveau Monde, n'y avaient point asservi les indigènes et transporté des nègres, ces vastes et fertiles contrées seraient demeurées improductives, à l'exception de celles [188] qui étaient déjà occupées par des peuples à demi civilisés, tels que les Péruviens et les Mexicains Ces auxiliaires, les tribus progressives qui fondèrent les premiers établissements de la civilisation dans les deux péninsules de l'Inde, en Chine, en Mésopotamie, en Egypte, se les procurèrent en asservissant les races autochtones au lieu de les détruire : de même qu'elles avaient réduit à l'état de domesticité un certain nombre d'espèces animales, le cheval, le bœuf, le chameau, le chien, elles y réduisirent ces hommes sauvages. Dès que ce progrès eut été réalisé, dès que les tribus pourvues du matériel agricole et de l'outillage de la petite industrie eurent à leur service cette variété supérieure de bêtes de somme, dans des régions particulièrement propres à la production des denrées alimentaires, elles purent y fonder des États, dont la population et la richesse s'accrurent avec rapidité. Il leur suffit de multiplier leurs esclaves ou de les laisser se multiplier dans la proportion des emplois qu'elles pouvaient leur donner, comme nous multiplions nos animaux domestiques. Elles abandonnèrent généralement les travaux inférieurs qui exigeaient simplement la mise en œuvrede la force physique, en se réservant les fonctions supérieures et dirigeantes. De là ce troisième phénomène de la séparation de la société en classes dominantes ou gouvernantes et en classes asservies, phénomène né de la petite industrie, et qui, tout en se modifiant, a subsisté jusqu'à nos jours.
Jetons un coup d'œil rapide sur l'importance comparative et les fonctions de ces deux éléments constitutifs de toutes les sociétés, qui ont passé de l'état sauvage à l'état civilisé.
§ 1er. Les classes dominantes. — Nous avons remarqué que la création du matériel primitif de l'agriculture et de l'industrie a eu pour résultat un énorme accroissement [189] de la race humaine. A des tribus de chasseurs ou de pasteurs, vivant à raison de 1 individu par 10 kilomètres carrés ont succédé des nations, subsistant des produits de l'agriculture et de l'industrie, à raison de 100 ou 200 individus par kilomètre carré. C'était par centaines, ou tout au plus par milliers de têtes, que se comptait la population des tribus, c'est maintenant par millions et par dizaines de millions que se compte la population des Etats. Dans cet accroissement, quelles sont les parts respectives des classes dominantes et des classes asservies? Ces parts n'ont rien d'arbitraire. Elles sont déterminées par l'étendue des débouchés ouverts aux unes et aux autres. Ces débouchés étaient naturellement inégaux. Les fonctions supérieures que se réservaient les classes dominantes étaient peu nombreuses en comparaison des autres. Dans l'Inde ancienne, par exemple, les trois castes des Brahmes, des Kchattryas et des Vaisyas, qui comprenaient l'étatmajor social — guerriers, prêtres, directeurs d'entreprises agricoles, industrielles et commerciales — ne paraissent pas avoir formé plus du vingtième de la population totale. Dans d'autres sociétés, où les membres les moins favorisés de la classe dominante ne dédaignaient pas les emplois inférieurs, la proportion était plus forte, mais partout et toujours, sauf peut-être au sein de la société israélite, la classe dominante n'a été, en comparaison de la classe asservie, qu'une faible minorité.
Sous notre ancien régime, la ligne de démarcation s'établissait entre les professions nobles et les professions serviles. Les premières seules constituaient le débouché de la classe dominante, tandis que les secondes appartenaient aux roturiers ou aux vilains, issus des races asservies. On aperçoit aisément la nécessité de cette ligne de démarcation. Les classes dominantes ne pouvaient descendre dans les régions inférieures du travail et s'y [190] mêler aux classes assujetties sans perdre le prestige qui était un des éléments essentiels de leur puissance.[16] Il fallait donc, en premier lieu, qu'elles ne dépassassent point le débouché qui leur était ouvert; en second lieu, qu'elles s'organisassent de manière à se conserver assez unies, assez fortes pour maintenir dans l'obéissance, malgré leur infériorité numérique, les races assujetties, comme aussi pour défendre leur domination contre les attaques du dehors et, au besoin, pour l'étendre. Toutes les institutions politiques, économiques et sociales qui se sont succédé depuis l'avènement de la petite industrie et la constitution des États, conséquence de cet avènement, ont été établies en vue de ces nécessités.
Quels ont été dans la transformation de la tribu en classe dominante d'un État le rôle et la place des divers éléments qui la composaient? Il y avait au sein des tribus progressives, qui créèrent les premiers arts de la civilisation, un commencement de hiérarchie politique et militaire, des guerriers, des prêtres, des chefs d'exploitation pastorale ou agricole avec des auxiliaires et des serviteurs. Dans l'œuvre de la conquête d'une région fertile et de l'asservissement des races inférieures, le rôle [191] prépondérant appartenait aux hommes forts et courageux qui constituaient l'armée de la tribu. Cette armée n'avait été d'abord qu'une troupe confuse, mais l'expérience n'avait pas tardé à démontrer, même aux peuplades les moins intelligentes, la nécessité de coordonner leurs efforts pour les rendre plus efficaces : de là l'unité de commandement, la hiérarchie militaire et la discipline. Cette organisation nécessaire impliquait un état-major, un chef, où, comme dans l'Iliade, une série de chefs obéissant au « roi des rois », des officiers chargés de transmettre les commandements et de les faire exécuter. Les soldats ou les compagnons se groupaient naturellement autour des chefs, soit qu'ils les eussent choisis ou qu'ils subissent l'ascendant de la supériorité de la force et du courage unie à une certaine dose d'intelligence. Les luttes de la conquête ne pouvaient manquer de mettre en relief les hommes les plus vaillants et les plus capables, en leur assignant la place et le rang qui leur revenaient. Cependant, la conquête achevée, il fallait aviser aux moyens de conserver le territoire conquis. L'armée de la tribu s'y était disséminée, en se cantonnant dans les localités les plus favorables à l'approvisionnement et à la défense. Les chefs en renom, ceux qui avaient le plus contribué à la conquête, qui avaient groupé autour d'eux les compagnons les plus nombreux, occupaient les cantonnements les plus étendus : chaque troupe s'établissait dans le sien; mais l'armée n'en demeurait pas moins organisée, prête à se réunir à l'appel de ses chefs hiérarchiques, pour défendre sa conquête. Cette organisation, il était nécessaire de la perpétuer, car la sécurité de la possession reposait sur le maintien de l'armée, qui avait été l'instrument de la conquête du sol et de l'asservissement des autochtones. L'hérédité des fonctions pourvut à cette nécessité : le fils aîné continua le père, et les vides que la mort faisait incessamment [192] dans les rangs de l'armée se trouvèrent ainsi comblés de la façon la plus naturelle et la plus simple. Tantôt le chef de chaque troupe se chargea de l'exploitation du cantonnement qui lui était échu, en pourvoyant à l'entretien de ses compagnons; tantôt il s'en réserva seulement une partie, et le restant fut partagé entre les membres inférieurs de la hiérarchie et même les simples soldats, toujours moyennant l'obligation d'apporter, en cas de nécessité, à la sécurité commune, un concours proportionné à l'importance de chaque lot. Les guerriers de la tribu constituaient ainsi une véritable armée, fixée au sol qu'elle s'était partagé après l'avoir conquis, et qu'elle était, au plus haut point intéressée à défendre. Telle fut l'organisation féodale, qui marqua la transition de la tribu à la constitution des grands États centralisés. Cependant, cette organisation ne pouvait être que temporaire : chaque canton, occupé par un chef et ses compagnons, devint un petit État, dont les possesseurs s'efforcèrent naturellement d'étendre les limites, en vue d'accroître les profits qu'ils en tiraient. De là, des luttes intestines, qui s'interrompaient seulement quand la communauté conquérante était menacée par une invasion ou par une révolte des races assujetties; dans ces luttes, les plus forts et les plus habiles s'agrandissaient aux dépens des moins forts et des moins capables : les petites seigneuries étaient absorbées par les grandes, jusqu'au jour où le plus puissant et le plus habile eut soumis tous les autres à sa domination, et remplacé la multitude des petits États féodaux par un grand État centralisé. Voilà l'évolution par laquelle ont passé tous les anciens empires, l'Inde, l'Égypte, la Chine, plus tard la Grèce et Rome, plus tard encore les États barbares, qui se sont partagé les débris de l'empire romain, avec de simples variantes dans les formes politiques. Mais à cette première évolution, on en voit non moins [193] invariablement succéder une seconde : les grands États se désagrègent, se dissolvent par l'action des nuisances intérieures qui les affaiblissent; ils deviennent la proie de races plus vigoureuses, qui s'en partagent les débris; la féodalité reparaît pour faire place de nouveau, après une période plus ou moins longue de luttes et d'annexions, à des États centralisés, monarchies, empires ou républiques unitaires. En dernière analyse, tous ces États, petits ou grands, ne sont autre chose que des entreprises, qui prospèrent ou dépérissent selon que la classe politique et militaire, qui en a la direction, possède à un degré plus ou moins élevé et conserve plus ou moins longtemps les aptitudes professionnelles requises pour les entreprises de ce genre.
Cette classe, qui jusqu'à nos jours a fondé, possédé et gouverné les États, ne se composait pas seulement, à l'origine, des guerriers de la tribu conquérante; à côté d'eux figuraient les prêtres. Quoique les industries primitives de la chasse, de la pêche, de la récolte des fruits naturels du sol fussent extrêmement peu productives, elles rendaient cependant quelque chose de plus que ce qui était strictement nécessaire à la subsistance du chasseur ou du pêcheur. Cet excédant permettait d'entretenir des prêtres ou des sorciers, qui réunissaient une foule de professions, que le progrès devait séparer plus tard, celles de ministres de la divinité, de légistes, de médecins et de pharmaciens, d'instituteurs, etc. L'antique institution des sacrifices suffirait seule pour attester leur existence, quand même nous ne les retrouverions pas dans les tribus demeurées à l'état sauvage. Les sacrifices fournissaient la part du prêtre : au sein d'une tribu de chasseurs, ils consistaient en une partie du gibier; chez les anthropophages, c'était du gibier humain; plus tard, quand la domestication du bétail, en permettant de se procurer de la [194] nourriture animale à moins de frais, eut fait renoncer à l'anthropophagie, les sacrifices humains disparurent, et les offrandes consistèrent principalement en produits de l'industrie pastorale, bœufs, moutons, lait, miel. Quand le sol fut mis en culture, la nature des offrandes se modifia encore; on consacra à la rétribution des services des prêtres une portion des produits du sol; le blé et les autres plantes alimentaires s'ajoutèrent au bétail; enfin, lorsque les tribus progressives allèrent s'établir dans des régions plus fertiles, les prêtres reçurent leur part du butin en terres et en esclaves. Leur rôle, dans ces circonstances nouvelles, se trouva considérablement agrandi. Les hommes forts et courageux de la tribu, les guerriers, avaient conquis le sol et asservi les indigènes; mais, pour organiser l'État et le faire subsister, il fallait autre chose que de la force et du courage, il fallait le concours des aptitudes et des connaissances qui s'étaient accumulées et transmises parmi les prêtres. Comment fonctionneraient nos sociétés civilisées si cette partie de l'état-major social qui comprend les professions libérales venait à disparaître, s'il n'y avait plus ni prêtres, ni savants, ni professeurs, ni magistrats, ni légistes, ni médecins? Or, n'oublions pas que la caste dite des prêtres possédait toutes les sciences et exerçait tous les arts, alors à l'état embryonnaire, que le progrès a séparés depuis et qui composent aujourd'hui le domaine des professions libérales. Le concours des prêtres était donc indispensable aux hommes forts et courageux qui avaient conquis le sol; ils en avaient besoin pour asseoir leur domination et organiser leur conquête. Les nouveaux États, fondés par les tribus conquérantes, sont l'œuvre des guerriers et des prêtres, dont le débouché s'agrandit successivement en proportion de l'importance et de l'étendue que l'État finit par acquérir; sans toutefois que ce débouché ait jamais pu dépasser ou même [195] atteindre, dans les anciens empires de l'Égypte, de l'Inde, de l'Assyrie, celui de l'état-major social, militaire ou civil, des États modernes.
A ces deux éléments supérieurs de la tribu conquérante, devenue la classe dominante d'un État, s'ajoutait un troisième élément composé des hommes impropres à la guerre et à la culture intellectuelle, auxquels étaient abandonnés les métiers et les services inférieurs, mais qui, appartenant à la race dominante, se trouvaient, par là même, dans une situation privilégiée. Dans l'Inde ancienne, ces éléments inférieurs de la tribu conquérante formaient la caste des Vaysias, comprenant les chefs d'exploitation, les commerçants, les artisans de toute sorte, et constituant le personnel dirigeant de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. Au sein de la tribu, le débouché de cette classe était naturellement fort limité; lorsque la tribu, pourvue du matériel de la petite industrie se fut procuré, par l'asservissement des races autochtones, la masse de travail physique nécessaire aux emplois inférieurs de la production, ce débouché ne manqua pas de s'agrandir en raison de la multiplication des entreprises industrielles et commerciales.
Tels ont été les éléments constitutifs des classes dominantes issues des tribus progressives qui ont formé les États, à l'époque de l'éclosion de la petite industrie, et qui les ont gouvernés jusqu'à nos jours. Si l'on considère le petit nombre d'hommes qui composaient les tribus dont elles sont issues, on trouvera qu'elles ont dû se développer rapidement, à la suite de la formation des premiers empires, mais si, d'un autre côté, on considère l'étendue et la population de ces États primitifs et de ceux qui leur ont succédé, si l'on réfléchit encore qu'au sein de ces États le débouché ouvert à l'état-major politique, religieux, scientifique et industriel était limité par la nature [196] des choses, comme il n'a pas cessé de l'être, on trouvera qu'elles ne formaient et ne pouvaient former numériquement qu'une faible minorité, et que leur domination reposait uniquement sur leur supériorité physique, intellectuelle et morale.
§ 2. Les classes asservies. — Au-dessous de cette classe dominante qui constitue l'état-major social apparaît la multitude asservie. L'esclavage prend naissance partout avec la petite industrie. S'il existait auparavant chez les tribus de chasseurs, de mangeurs d'hommes et de pasteurs, c'était à l'état d'exception, et l'on en conçoit aisément la raison. Une tribu de chasseurs, par exemple, en expulsait une autre d'un terrain giboyeux, mais il ne pouvait lui venir à la pensée de la réduire en esclavage et de la contraindre à chasser pour ses maîtres. La nature même de cette industrie primitive s'y opposait. Des esclaves armés pour la chasse n'auraient-ils pas cédé à la tentation assez légitime de traiter leurs maîtres comme un gibier? D'un autre côté, la chasse est une industrie trop peu productive pour nourrir, au-dessous d'un personnel de maîtres, un personnel d'esclaves assujettis aux fonctions de la domesticité. C'est pourquoi les femmes et les enfants sont chargés, même chez les chefs de tribus, de pourvoir à ces fonctions subalternes. Dans l'industrie pastorale, l'esclavage commence à trouver un débouché; il faut des serviteurs pour conduire les troupeaux et en prendre soin, mais il n'est pas nécessaire que ce personnel auxiliaire soit nombreux, et on ne peut le soumettre à un joug trop pesant, car la fuite est facile dans les vastes espaces que parcourent les pasteurs nomades. Avec l'agriculture et les premiers arts industriels, la situation change, le débouché de l'esclavage s'agrandit dans une proportion extraordinaire. Un sol fertile donne un produit qui [197] permet, non seulement de nourrir, de renouveler et d'augmenter graduellement le personnel d'exploitation, mais encore de pourvoir à la subsistance d'une classe presque aussi nombreuse, adonnée à d'autres emplois. Il y a profit alors à se procurer, par la chasse ou l'élève domestique, un nombre croissant d'esclaves.
Au lieu donc d'exterminer les populations autochtones et même de les manger, ce qui était avant la naissance de la petite industrie le parti le plus profitable que l'on en pût tirer, les tribus progressives, probablement de race aryenne, en possession de ce matériel perfectionné et des connaissances nécessaires pour le mettre en œuvre, trouvèrent plus d'avantage à capturer les vaincus et à les employer à l'abattage des arbres, au défrichement du sol, à la construction des habitations et des voies de communication, aux services de la personne et de la maison, en un mot, à la masse des travaux auxquels les autres animaux déjà réduits à l'état de domesticité n'étaient point propres ou ne pouvaient être appliqués avec autant d'efficacité et d'économie. Les membres des tribus progressives assujettirent ces hommes appartenant à des variétés inférieures de l'espèce, et ils les dressèrent aux fonctions de laboureurs, de manœuvres, d'ouvriers maçons, de serviteurs, etc. Ceux dont le naturel indomptable résistait à la domestication furent exterminés ourefoulés dans les bois; ceux que leur manque absolu d'intelligence, leur grossièreté, leurs défauts ou leurs maladies immondes rendaient impropres à tout emploi utile, ou faisaient un objet de dégoût, furent simplement écartés ou réduits, pour subsister, aux fonctions les plus répugnantes; dans l'Inde, ils formèrent la caste des parias. Grâce à l'assujettissement de ces races adaptées au climat des régions prodigieusement fertiles des deux péninsules de l'Inde et de la Mésopotamie, les émigrants aryens, [198] comme plus tard les émigrants européens dans le Nouveau Monde, purent mettre en pleine exploitation les terres qu'ils avaient conquises, et y fonder de vastes et puissants empires. Ainsi se sont constitués partout les premiers établissements de la civilisation. A peu près seuls, les Israélites pourraient être cités comme une exception à cette règle. Ils ne possédèrent, en effet, jamais qu'un petit nombre d'esclaves; mais cette exception s'explique par les circonstances qui présidèrent à leur établissement en Palestine. Ils sortaient de la servitude d'Égypte, où ils avaient rempli les fonctions et exercé les métiers dévolus aux races asservies. Devenus libres, ils continuèrent à remplir ces fonctions et à exercer ces métiers auxquels ils étaient accoutumés. De là, les horribles boucheries qui ensanglantent les pages du Vieux Testament. Ils exterminaient les populations vaincues au lieu de les réduire en esclavage parce qu'ils exerçaient eux-mêmes les emplois qui servaient ailleurs de débouché aux esclaves.
La condition des races assujetties présente une série de transformations et de phénomènes, issus de causes purement économiques, et qui devaient nécessairement les amener au point où nous les voyons aujourd'hui. Avant d'être émancipées d'une façon plus ou moins complète, elles ont passé par l'esclavage, le servage ou le colonat; elles ont formé l'élément inférieur de la corporation industrielle et constitué la commune. Comment ces modes divers d'assujettissement ou de tutelle ont surgi et se sont succédé, nous pouvons nous en rendre compte en prenant les choses à l'origine.
Reportons-nous au moment où une tribu progressive, pourvue du matériel de la petite industrie, a conquis et occupé une région propre à la culture des plantes alimentaires. Elle s'est disséminée sur le territoire conquis; [199] chaque groupe, sous la conduite d'un chef et d'un étatmajor de guerriers et de prêtres, a choisi son cantonnement. On procède au partage du butin, qui consiste principalement, sinon exclusivement, en terres et en prisonniers. Dans ce partage, les chefs ont naturellement la grosse part; d'ailleurs, beaucoup de leurs compagnons, guerriers, prêtres, artisans ou laboureurs, n'ont pas les ressources nécessaires pour subvenir aux frais de leur établissement; ils demeurent groupés autour du chef qui se charge de pourvoir à leur entretien. On vit d'abord sur les provisions que l'on a accumulées en vue de l'émigration, ou peut-être, à leur défaut, sur le butin vivant que l'on a conquis. Entre temps, les prêtres ou les sages, aidés des laboureurs et des artisans, appliquent leurs connaissances, avec le matériel dont ils disposent, à l'établissement de la colonie et à l'exploitation du sol. On dresse les prisonniers à la culture, on les emploie à la construction des forteresses, des habitations et des temples, et, en général, à toutes les fonctions qui exigent seulement de la force physique. L'abondance des récoltes sur un sol vierge permet de les multiplier rapidement, ainsi que les autres animaux domestiques. D'abord, on ne les distingue pas de ceux-ci, et même on les considère comme inférieurs à certaines espèces de bétail. Ils sont réunis en troupeaux. Ils travaillent sous le fouet, on leur distribue leur ration, et on règle leur multiplication, comme celle du bétail, selon le besoin qu'on en a. C'est l'esclavage pur et simple, tel que nous l'avons vu reparaître plus tard dans le Nouveau Monde. Cependant, l'expérience démontre peu à peu que ce régime est susceptible de progrès. On observe qu'en intéressant les esclaves à leur travail, soit en leur abandonnant une part du produit, soit en leur permettant de cultiver pour leur compte une petite portion du sol — un jardin — ils font plus et de meilleure besogne; ils se [200] montrent aussi plus résignés à leur sort et moins disposés à s'y dérober par la fuite ou par la révolte. On leur abandonne donc un pécule. L'accumulation de ce pécule permet à la longue aux esclaves les plus intelligents et les plus économes de se racheter : ils passent à l'état d'affranchis. Mais les affranchis ne peuvent subsister qu'à la condition de continuer à exercer les métiers avec lesquels ils étaient familiers et qui leur fournissaient auparavant les moyens de vivre. Les affranchis de l'agriculture deviennent des colons : ils prennent en location une portion de la terre de leurs maîtres en échange d'une redevance en travail, en denrées ou en argent; les affranchis de l'industrie passent à l'état d'ouvriers libres ou de petits entrepreneurs, selon qu'ils possèdent ou non des capitaux. — Les propriétaires d'ateliers d'esclaves, agricoles ou industriels, s'aperçoivent aussi, qu'en divisant leurs domaines et en les louant à leurs esclaves les plus capables, ils en tirent un profit plus élevé, tout en se débarrassant de la surveillance et des soucis d'une exploitation directe, ou bien encore, tout en continuant à exploiter leurs domaines par eux-mêmes ou par leurs intendants, ils trouvent avantage à se débarrasser de l'entretien direct de leurs ateliers d'esclaves. Ils élargissent en conséquence le système du pécule. Ils abandonnent à leurs esclaves toute la quantité de terre nécessaire pour les faire subsister eux et leurs familles, en échange du travail dont ils ont besoin pour la mise en valeur du domaine seigneurial. C'est le servage et la corvée. Le serf n'en demeure pas moins la chose du seigneur; il lui est interdit de quitter le domaine auquel il est attaché, et il se trouve, sauf l'intervention de l'opinion et des coutumes auxquels l'opinion donne naissance, à la discrétion de son maître. S'il s'agit d'esclaves de métiers, le maître, après avoir exploité d'abord leur travail pour lui-même, le donne en location [201] à des entrepreneurs travaillant pour le public et il finit par le leur louer à eux-mêmes. C'est le système qui s'est perpétué en Russie jusqu'à ces dernières années sous le nom de servage à Yobrok. Tantôt cette transformation naturelle de l'esclavage en servage a lieu individuellement, tantôt collectivement. Dans ce dernier cas, le maître concède un lot de terre à un troupeau d'esclaves, en échange d'une certaine quantité de travail ou de corvées. Les membres du troupeau se partagent ce lot, non pas également, mais en raison de la somme de forces et de capitaux, sous forme de bétail et d'instruments aratoires, qui constituent l'apport de chacun et sa capacité à fournir une quote-part plus ou moins grande de corvées ou de redevances. Comme ces apports se modifient à la longue, certaines familles devenant plus nombreuses et plus riches, tandis que d'autres diminuent en nombre et en ressources, on fait périodiquement — en Russie, c'était tous les quinze ans en moyenne — une nouvelle distribution des lots. Les serfs ainsi associés constituent une commune.[17] Cette commune, le seigneur la laisse maîtresse de se gouverner elle-même, sauf en ce qui concerne ses intérêts de propriétaire. Il veille à ce que la population s'y proportionne à la quantité de terre qui sert à la nourrir ou bien encore aux débouchés qu'il peut trouver pour elle dans d'autres emplois. Dans le cas du colonat et du servage individuel, les colons et les serfs groupés dans la même localité forment de même une commune, sous l'autorité des anciens, pour subvenir à des nécessités auxquelles le seigneur néglige de pourvoir : la sécurité individuelle, le maintien des bonnes mœurs, la création et l'entretien des routes vicinales, l'établissement et le bon entretien des [202] puits et des fontaines, etc., mais, dans ce cas, il n'y a point d'association territoriale, chacun tenant son lot directement du seigneur. Voilà l'origine de la commune agricole. Elle est née de l'esclavage et s'est constituée avec le colonat et le servage. La commune urbaine a une origine mixte; on y distingue, à l'origine, des éléments appartenant à la classe dominante et d'autres éléments, à la vérité plus nombreux, issus de la classe asservie. Au début du régime féodal, qui semble avoir été partout le mode primitif d'occupation et d'exploitation des terres et des populations conquises, les chefs, entourés de leurs compagnons, des prêtres ou sages et des membres inférieurs de la tribu, artisans ou serviteurs, s'établissent dans des cantonnements, qui deviennent ensuite des seigneuries. L'exploitation du sol, au moyen des bras esclaves, fournit un excédant qui permet de nourrir une population croissante d'ouvriers et d'artisans, employés à la construction et à l'ameublement des habitations, à la fabrication des vêtements, des armes et des outils. Les membres inférieurs des classes dominantes, qui ne sont ni guerriers ni prêtres, entreprennent les travaux ou les industries, et ils y dressent les esclaves qui ne sont point appliqués à la culture. A mesure que la population et la richesse s'augmentent dans le cantonnement, le débouché de ces entrepreneurs s'agrandit, les industries se séparent, et ceux qui les exercent s'associent en vue de la défense de leurs intérêts communs; ils constituent des corporations. Les corporations, en se réunissant, forment une commune sous l'autorité du seigneur. A la longue, la commune s'affranchit — ordinairement par voie de rachat — de la tutelle seigneuriale, et elle apparaît alors gouvernée par l'oligarchie des maîtres des corporations.
C'est ainsi que se sont constitués et organisés les États [204] civilisés aussitôt que le matériel de la petite culture et de la petite industrie eût été inventé. A des tribus éparses de chasseurs, d'anthropophages et de pasteurs succédèrent alors des sociétés nombreuses, dont les travaux accumulés ont amené la civilisation au point où nous la voyons aujourd'hui. Le fait caractéristique qui apparaît à cette époque primitive et qui n'a pas cessé de se manifester dans tout le cours de l'histoire, c'est l'extrême inégalité des races et des individualités humaines. Certaines races privilégiées sous le rapport physique et moral ont accumulé un capital d'inventions et de connaissances de toute sorte, à l'aide duquel elles ont augmenté, à un moment donné, leurs moyens de subsistance, tandis que d'autres sont demeurées depuis des milliers d'années dans leur état primitif, fort peu différentes des animaux, et quelques-unes mêmes inférieures aux espèces animales à l'état de domesticité. Cette inégalité étant bien constatée, la constitution des États civilisés par voie de conquête et d'asservissement des races inférieures n'étaitelle pas nécessaire? Peut-on concevoir qu'elle se fût accomplie autrement? Représentons-nous la situation d'une tribu progressive, en possession du matériel de la petite industrie, au milieu de tribus arriérées qui demandent à la récolte des fruits naturels du sol, à la chasse, et notamment à la chasse à l'homme, leurs moyens de subsistance. Elle est obligée de lutter incessamment contre ces hommes sauvages, comme aujourd'hui les colons européens luttent contre les Indiens Peaux-Rouges, avec cette différence que les hommes civilisés ne formaient à l'origine qu'une faible minorité, tandis qu'ils sont aujourd'hui en majorité. Ils n'avaient d'autre alternative que d'exterminer les tribus arriérées ou d'être exterminés par elles, ou bien encore de les utiliser en les asservissant. L'asservissement des tribus ennemies, dans [204] ces conditions, ne peut-il pas être assimilé à la servitude pénale, et, à ce titre, pleinement justifiable? L'esclavage eut, à la vérité, encore d'autres sources : des tribus inoffensives y furent réduites, après la conquête de leur territoire, mais le plus grand nombre des membres de ces tribus ne faisaient guère que changer de servitude, et celle à laquelle la conquête les réduisait avait l'avantage d'être progressive : de l'état d'esclave, l'homme asservi des races inférieures passait à l'état de serf, de colon, d'affranchi et, finalement, de citoyen d'une société civilisée. Sans doute, la condition des classes asservies dans les sociétés primitives était dure; les classes dominantes ne leur accordaient guère, comme aux animaux domestiques, que ce qui était strictement nécessaire à leur subsistance et à leur entretien, mais leur devaient-elles davantage? De nos jours, la création du matériel de la petite industrie eût été l'objet d'une série de brevets d'invention conférant à leurs auteurs le droit d'exploiter à leur profit exclusif ce matériel perfectionné. A l'origine, le brevet d'invention ne s'était pas encore individualisé, il appartenait à l'ensemble de la tribu ou de la corporation progressive; pourquoi ne s'en serait-elle pas réservé le bénéfice exclusif? pourquoi y aurait-elle fait participer des races inférieures, presque toujours hostiles, qui n'avaient eu aucune part à la création de ce matériel perfectionné? Cette participation devait, au surplus, surgir d'un progrès réalisé par les classes asservies elles-mêmes sous l'influence de la domestication. Forcées à travailler régulièrement, elles prirent l'habitude du travail, et un moment arriva où l'on put obtenir d'elles une coopération assidue en substituant le mobile de l'intérêt à celui de la contrainte. Elles travaillèrent en vue du pécule et du rachat qui les introduisit, après un stage plus ou moins long, dans la classe des bénéficiaires de la [205] civilisation. Le prix de ce rachat ne peut-il pas être considéré comme une indemnité due aux héritiers ou ayantsdroit des inventeurs de ce matériel de production et de cet appareil de sociabilité civilisée, que les races inférieures n'auraient jamais réussi à constituer si elles avaient été réduites à leurs propres ressources intellectuelles et morales?
[206]
CHAPITRE VII. Le passé (suite).↩
I. — Résumé du mode de formation des sociétés issues de la petite industrie. — Raison d'être de la division de la classe dominante en castes ou corporations. — Objet des coutumes et de la discipline particulières à chaque caste. — Qu'il faut tenir compte, dans l'appréciation de ces coutumes et de cette discipline, de l'état des choses et des esprits. — De la corporation des hommes de guerre. — Nécessités qui ont présidé à l'organisation des armées; qui ont rendu cette organisation héréditaire chez les peuples conquérants; qui ont imposé des coutumes et une discipline auxquelles tous les membres de la corporation militaire ont dû se soumettre. — Raison d'être de l'étiquette. — Comment les guerriers ont consenti à partager leurs pouvoirs et leurs profits avec les prêtres. — Intervention de l'instinct religieux. — Comment on pouvait le développer et l'utiliser. — Raison d'être des cérémonies du culte, des injonctions et des prescriptions religieuses. — Utilité des religions. — Composition et organisation de la caste des prêtres. — Fonctions et moyens d'existence de ces deux castes dominantes. — Pourquoi elles étaient fermées. — De la propriété et des modifications qu'elle subit sous l'influence de la petite industrie. — Danger des schismes politiques et religieux. — Des corporations industrielles et commerciales. Comment elles se sont formées. Nécessités qui ont présidé à leur organisation. — Raison d'être de leurs règlements et de leurs coutumes. — Les sociétés de compagnonnage. — Régime des classes asservies. — Que l'organisation des anciennes sociétés était naturelle et aussi bien adaptée que possible à leurs éléments et à leurs conditions d'existence.
Les œuvres de l'industrie et les monuments de l'art que le passé nous a légués, excitent à bon droit notre admiration et, cependant, il y a quelque chose de plus merveilleux encore, c'est l'organisation des sociétés dont ces restes imposants et superbes évoquent le souvenir. Pendant la première période de l'existence de l'humanité, l'homme n'occupe, sous le rapport du nombre et de l'importance, qu'un rang inférieur dans la création animale. Les documents géologiques et paléontologiques qui se rapportent à cette période attestent l'existence de nombreuses variétés de grands carnassiers auxquels les autres [207] animaux servaient de pâture, et, s'il faut en juger par la rareté des fossiles humains, notre espèce ne figurait que comme un appoint dans l'inventaire de la création. L'économie politique confirme, sur ce point, les données des sciences préhistoriques. Elle nous apprend que la récolte des fruits naturels du sol, la chasse et la pêche ne pouvaient nourrir que de rares troupeaux d'hommes épars sur d'immenses territoires. Il a donc fallu que l'homme conquît péniblement son rang de maître de la création, en détruisant ou en assujettissant les espèces qui lui étaient supérieures en force; il a fallu qu'il combattît et domptât les monstres auxquels, jusqu'alors, les légendes mythologiques rapportent qu'il avait payé tribut. Combien de temps a duré cette période embryonnaire de l'existence de l'humanité? Nous l'ignorons, mais ce qui est certain, c'est que l'homme a dû sa victoire sur les « monstres » à l'intervention d'un armement qui a suppléé à l'insuffisance de ses forces et que les espèces inférieures étaient incapables d'imiter. Grâce à la création de ce matériel défensif et offensif, l'homme ayant acquis un commencement de sécurité avec une subsistance moins précaire a pu s'appliquer, d'une manière plus assidue, à la recherche des moyens d'améliorer ses conditions d'existence.
L'agriculture et les premières industries apparaissent. Alors, aux troupeaux épars de la période primitive, qui se distinguent à peine des autres espèces animales par la nourriture et la manière de vivre, succèdent des sociétés puissantes en possession des moyens de créer de la richesse et dont les membres se comptent par millions. En outre, une vie intellectuelle et morale, dont le germe seulement se manifeste chez l'homme-animal des temps préhistoriques, circule dans les régions supérieures de ces sociétés civilisées.
[208]
Que s'est-il passé? D'une part, la création du matériel et des procédés de la petite industrie a augmenté dans des proportions si énormes la somme des moyens d'existence que l'homme tirait de l'exploitation d'une étendue déterminée de territoire, qu'un million d'agriculteurs, d'artisans, de guerriers, de prêtres, etc., peuvent vivre, quelques-uns avec luxe, la masse avec le nécessaire, tous avec la sécurité du lendemain, dans la même région où quelques centaines de chasseurs se procuraient difficilement une subsistance précaire. D'une autre part, la création parallèle d'un appareil de gouvernement destiné à garantir contre les nuisances extérieures ou intérieures l'existence des sociétés, a permis à l'espèce humaine de résister à l'action destructive de ces nuisances engendrées par son ignorance et son imperfection natives. Cette machinery du gouvernement des sociétés a été, comme celle de l'industrie, le produit de l'esprit d'observation et du génie de l'invention, stimulés par le besoin; elle s'est adaptée, aussi exactement que possible, sinon d'une manière parfaite, à l'état des choses et des hommes; enfin, elle a été caractérisée par la prédominance de la tutelle. Ces sociétés, issues de la petite industrie, sont constituées généralement par la superposition violente d'une tribu ou d'une collection de tribus en possession du nouveau matériel à des peuplades en retard qu'elles assujettissent et qu'elles utilisent, comme des bêtes de somme, pour les emplois inférieurs. La tribu conquérante forme l'État : elle le possède et le gouverne après l'avoir fondé, elle le défend et elle s'efforce de l'agrandir. Ses membres jouent, dans cette entreprise, un rôle proportionné à leur capacité et à la nature de leurs aptitudes et ils reçoivent, en terres, en esclaves et en butin, une rétribution proportionnée à leurs services. On distingue parmi eux un élément militaire et un élément civil — les guerriers et les [209] prêtres — et, plus bas, un élément industriel et commercial dans lequel entreront ensuite les affranchis de la population assujettie. Ces éléments divers, qui existaient déjà en germe dans la tribu, se développent en raison de l'accroissement de leur débouché, et ils s'organisent conformément à la nature et aux besoins de l'entreprise dont ils sont les co-intéressés. Aussi loin que l'on puisse pousser les investigations historiques, on aperçoit cette société fondatrice et possédante de l'Etat, divisée en castes ou en corporations ayant chacune, outre ses fonctions spéciales qui répondent à des nécessités politiques ou économiques et auxquelles s'adaptent les aptitudes propres à ses membres, des coutumes et une discipline particulières. Ces coutumes et cette discipline sont établies, d'abord en vue de la conservation et de l'agrandissement de l'État, et, plus tard, par une corruption naturelle des institutions humaines, en vue de l'intérêt de la caste ou de la corporation, ou des groupes qui y ont acquis une situation prépondérante. Elles ont pour objet d'assurer le bon accomplissement des services nécessaires au maintien et à la prospérité de l'État, de prévenir ou de réprimer les actes que l'expérience a fait reconnaître comme lui étant nuisibles, de provoquer et de rendre habituels les actes utiles.
Si l'on veut apprécier exactement ces coutumes et cette discipline, on doit tenir compte, en premier lieu, des conditions naturelles qui président à la fondation de l'État et du milieu dans lequel il subsiste. Il ne faut pas oublier que chaque société, dans ces temps primitifs, est, non seulement isolée, mais encore à l'état d'hostilité vis-à-vis de toutes les autres, à l'exception de celles avec lesquelles son intérêt du moment la pousse à conclure des alliances offensives ou défensives; qu'il n'y a point de droit public; enfin, que les sociétés qui doivent leur naissance à la petite industrie succèdent à des tribus continuellement en [210] lutte pour l'existence et habituées à se disputer une subsistance insuffisante, le plus souvent même, quand toute autre nourriture réconfortante leur fait défaut, à se considérer réciproquement comme un gibier. Cet état d'isolement et d'antagonisme devait continuer et même s'aggraver encore dans la période suivante. En effet, toute société qui avait réussi, en employant un matériel perfectionné et en s'emparant d'un sol fertile, à accumuler de la richesse, était une proie autour de laquelle rôdaient incessamment les peuples moins avancés et favorisés. Quelle entreprise eût valu pour les Mèdes et les Perses, par exemple, la conquête et le pillage de Ninive et de Babylone? D'un autre côté, les classes dominantes des sociétés relativement civilisées, n'ayant qu'un débouché limité qu'elles ne pouvaient étendre à l'intérieur, sans déchoir et sans compromettre le prestige qui, eu égard à leur infériorité numérique, faisait la plus grande partie de leur force, les classes dominantes, disons-nous, devaient naturellement s'appliquer à agrandir leur État et à étendre ainsi leur débouché; ajoutons encore qu'en l'agrandissant, au moins dans une certaine mesure, elles le rendaient plus fort, et, par conséquent, plus capable de résister aux aggressions du dehors. Ainsi donc, le maintien et l'agrandissement de l'État, voilà l'objet essentiel en vue duquel les coutumes et la discipline — sans oublier l'opinion qui créait les coutumes et la discipline — étaient et devaient être dirigées. Tout ce qui était contraire à l'accomplissement de ce but constituait une nuisance et devait être empêché. Tout ce qui lui était favorable devait être prescrit ou encouragé.
En second lieu, on doit tenir compte de l'état des intelligences et des connaissances des classes dominantes de ces sociétés qui émergeaient de la barbarie primitive. Les intelligences n'avaient pas encore été affinées par la [211] civilisation, les connaissances étaient rudimentaires. Faut-il donc s'étonner de l'impitoyable rigueur des châtiments, lorsque l'intérêt de l'État ou de la caste était en cause? En revanche, ne doit-on pas admirer l'exactitude merveilleuse avec laquelle ces coutumes et cette discipline étaient adaptées aux conditions d'existence de la société et au tempérament de ses membres, lorsqu'on voit ces anciens États subsister pendant des milliers d'années et leur organisation primitive se perpétuer presque sans modifications, en s'imposant à leurs conquérants successifs?
Si nous examinons maintenant en détail les différentes corporations ou castes entre lesquelles se répartissent les membres de la société qui a fondé l'État, nous nous convaincrons que le rang qu'elles occupent, aussi bien que les coutumes et les lois qui les régissent, la discipline à laquelle elles obéissent, ont été déterminés ou créés par des nécessités ressortant de la nature de l'État et des circonstances ambiantes.
La prépondérance appartient aux hommes de guerre et il semble même, au premier abord, qu'elle doive leur appartenir d'une manière absolue et exclusive. Ils ont fondé l'État et ils le défendent au prix de leur sang. Entouré comme il l'est, d'ennemis avides de proie, il ne subsisterait pas un seul jour s'ils ne lui servaient point de rempart. Mais la conquête, puis la défense et l'agrandissement de l'État, impliquent une organisation et une discipline nécessaires.
Il faut que les hommes de guerre forment une armée, c'est-à-dire un corps organisé, et les conditions naturelles de cette organisation sont l'unité de commandement, la hiérarchie et la discipline. Comment s'établissent ces institutions qui transforment une foule impuissante en une armée redoutable? Elles sont, comme toutes les autres, le fruit de l'observation et de l'expérience. Partout et de [212] tout temps, on s'est aperçu qu'une foule où personne ne commande, où il n'y a point une hiérarchie de volontés, d'intelligences et de forces subordonnées et disciplinées en vue de la lutte, est incapable de soutenir le choc d'une troupe organisée, et voilà pourquoi aussi partout et de tout temps on voit les hommes de guerre se soumettre à une organisation, en acceptant les gênes et les servitudes qu'elle leur impose. Cependant, l'armée conquérante, son œuvre accomplie, se partageait les terres et le butin. Ainsi rétribués et nantis, en raison du rôle qu'ils avaient joué et des services qu'ils avaient rendus dans la conquête, les guerriers se dispersaient pour occuper chacun son lot et l'exploiter, sauf à se rassembler de nouveau, en cas de danger. Mais comment perpétuer l'armée avec son organisation nécessaire? Le procédé le plus simple et celui auquel, selon toute apparence, on revint après en avoir essayé d'autres, était celui de l'hérédité combinée avec le droit d'aînesse.
Le domaine passait à l'aîné des enfants qui prenait dans l'armée le rang de son père, et ce domaine, à la possession duquel était attachée une obligation militaire, il ne pouvait ni le morceler ni le vendre, sans le consentement des autres membres de l'armée. Les cadets et les autres membres de la famille demeuraient sous sa dépendance. Dans l'évolution suivante, lorsque la féodalité eut été absorbée au profit d'un chef souverain — et cette absorption fut encore déterminée le plus souvent par la nécessité d'assurer l'unité du commandement, de serrer les liens de la hiérarchie et de la discipline, de manière à augmenter l'efficacité de la machine militaire — le mode de recrutement et de rétribution se modifia : la solde, rétribution fixe et garantie, remplaça généralement les parts de prise, rétribution éventuelle et incertaine; mais l'armée continua à demeurer le débouché exclusif et approprié [213] de la caste ou de la corporation conquérante, jusqu'à ce que la nécessité commandât de suppléer à son insuffisance par un recrutement dans les régions inférieures de la société ou à l'étranger.
L'organisation de la corporation ou de la caste des hommes de guerre, organisation qui était celle d'une armée héréditaire, répondait donc à des nécessités dérivant de la conquête et de l'occupation du pays conquis. On peut en dire autant de toutes les règles de conduite que la coutume ou la loi imposait aux membres de la caste, depuis le chef, duc ou empereur, jusqu'au simple soldat ou compagnon. L'éducation, à tous les degrés, consistait dans un ensemble d'exercices destinés à développer les qualités de l'homme de guerre, et il en était de même du genre de vie imposé par l'opinion investie dans la coutune. La manière de vivre du roi lui-même, ses actes et jusqu'à ses moindres mouvements étaient minutieusement réglés par l'étiquette aussi bien que ses rapports avec ses inférieurs, — et l'étiquette n'était autre chose que la collection des manières d'être et d'agir que l'observation et l'expérience avaient fait reconnaître comme les plus propres à maintenir l'autorité et le prestige nécessaires au commandement. Bref, tous les membres de la caste, sans excepter le chef suprême, étaient soumis à une multitude de règles imposées par la coutume, qui concernaient la plupart des actes et des moments de leur existence, et constituaient une servitude établie du consentement et dans l'intérêt communs.
Cependant, si l'on conçoit que les hommes rudes et sauvages, qui formaient la caste ou la corporation militaire des anciennes sociétés, se soient pliés à une servitude indispensable à la conquête et à la conservation de l'établissement d'où ils tiraient leurs moyens d'existence, on a plus de peine à comprendre qu'ils aient consenti à [214] partager leur domination et leurs profits avec un élément civil et désarmé, parfois même à reconnaître sa suprématie. Ce phénomène, le plus merveilleux de l'histoire, est dû à l'intervention du sentiment ou de l'instinct religieux, venant en aide à l'intelligence, pour dompter la force brutale. L'élite intelligente qui, stimulée par le besoin, appliquait les procédés de l'observation, de la réflexion, du calcul et de l'esprit de combinaison, non seulement à l'invention du premier matériel de la civilisation, mais encore à la création des sciences et des arts sociaux, à la reconnaissance des nuisances publiques et privées, à la découverte et à l'imposition des droits et des devoirs, en un mot, à la constitution des premiers rudiments de la morale, de la politique et de la législation, cette classe d'élite arrivait par une pente naturelle, de l'observation des phénomènes, qui excitaient sa curiosité, son étonnement, sa joie ou sa crainte, à la recherche de leurs causes; elle était conduite ainsi à attribuer ces phénomènes, qui échappaient au pouvoir de l'homme, à l'action de puissances supérieures à l'humanité. Ces puissances, elle trouvait en elle-même un instinct qui la poussait à les adorer et à se mettre en communication avec elles, et ce même instinct, elle en constatait l'existence chez les individualités les moins intelligentes et les plus voisines de l'animalité. De là à s'en servir comme d'un instrument pour subordonner la force à l'intelligence, il n'y avait qu'un pas, et l'expérience se chargea de montrer combien cet instrument, mis en œuvre avec habileté, avait d'efficacité et de puissance. En vain, les robustes et courageux^Kchattryas possédaient la force; en vain, ils étaient les maîtres de s'attribuer le monopole des biens de la terre, en réduisant à l'état de serviteurs ou d'esclaves les Brahmes comme les vils Soudras : s'ils croyaient qu'au-dessus d'eux existaient des divinités bienfaisantes ou malfaisantes dont le pouvoir dépassait le leur; [215] s'ils croyaient que ces divinités voulaient être obéies comme ils voulaient eux-mêmes qu'on leur obéît, et que toute désobéissance serait suivie des châtiments les plus effroyables dans ce monde ou dans un autre; s'ils croyaient enfin que ces divinités toutes puissantes avaient sur la terre des représentants, des fondés de pouvoirs, chargés de faire connaître et exécuter leurs volontés, il est évident que leur intérêt, leur salut même, exigeait qu'ils eussent pour ces mandataires ou ces ambassadeurs des puissances surnaturelles des égards extraordinaires, et qu'ils se conformassent, sans avoir la hardiesse de les examiner et de les discuter, aux injonctions et aux prescriptions qui leur venaient de cette source sacrée. Si ces injonctions et ces prescriptions leur avaient été par trop antipathiques, s'ils ne s'étaient pas trouvés bien de s'y conformer, il aurait pu leur venir un doute sur l'authenticité du mandat des représentants des puissances surnaturelles ou sur la qualité même de ces puissances. Dans ce cas, ils n'auraient pas manqué de porter leurs hommages et leurs offrandes à d'autres dieux; ce qui arriva, en effet, plus d'une fois, quand la religion n'était pas suffisamment adaptée au tempérament et aux besoins des croyants, ou quand une religion nouvelle survenait, qui s'y adaptait mieux.
Mais n'oublions pas que l'exercice des professions intellectuelles développe et affine l'intelligence du prêtre comme le métier des armes accroît la force et perfectionne les qualités militaires du guerrier. Il sait, lui aussi, comment doit être façonnée et maniée l'arme puissante dont il dispose, et à quelles fins elle doit être employée pour conserver sa pleine efficacité. Comme son pouvoir repose uniquement sur sa qualité d'intermédiaire entre l'homme et les puissances surnaturelles, dont il dispense les faveurs ou les châtiments, dont il peut seul conjurer les colères ou modérer les exigences — car l'homme ne conçoit d'abord [216] que des divinités faites à son image — il s'applique, avant tout, à la recherche des procédés les plus propres à agir sur l'instinct religieux. L'observation et l'expérience sont encore ici ses guides. Elles président à l'invention et au perfectionnement de la machinery du culte aussi bien qu'à ceux de l'outillage agricole et industriel. Chez un peuple sanguinaire, cette machinery portera le cachet de la férocité; chez un peuple gai, spirituel et plein d'imagination, comme étaient les Grecs, l'Olympe se peuplera de divinités attrayantes auxquelles on rendra un culte en harmonie avec elles; bref, on façonnera partout l'instrument destiné à agir sur l'instinct religieux, de manière à en obtenir un maximum d'effet utile. Rien d'arbitraire donc, ni dans les dogmes, ni dans les cérémonies même les plus effroyables et les plus bizarres des cultes primitifs, et l'invention ne s'arrête, en cette matière, qu'au moment où l'appareil est achevé, où le culte, dans toutes ses parties, semble aussi complètement adapté que possible au tempérament et au degré d'intelligence de ceux sur qui il doit agir. Ajoutons que l'acquisition des rudiments des sciences naturelles donne aux prêtres des cultes primitifs un moyen assuré de prouver qu'ils sont les mandataires des puissances supérieures, en leur permettant de produire des phénomènes réputés surnaturels, c'est-àdire que l'homme seul, abandonné à ses propres forces et sans aucune assistance de la divinité, serait incapable de produire. — D'un autre côté, les injonctions et les prescriptions des puissances supérieures, dont le prêtre est l'organe, ont généralement pour objet d'écarter des nuisances, et le bien qui résulte de leur mise en pratique peut être apprécié par les intelligences les moins développées. La divinité défend le vol et l'adultère : il est facile de se convaincre que le vol et l'adultère sont nuisibles. La divinité prescrit l'obéissance aux chefs avec le [217] respect de la hiérarchie et l'observation des lois de la discipline. Comment les chefs méconnaîtraient-ils l'utilité de l'obéissance? Dans l'Inde et dans la plupart des anciennes sociétés, la divinité interdisait les unions entre des individus appartenant à des castes différentes : l'expérience ne démontrait-elle pas que les produits de ces unions interdites étaient vicieux ou tout au moins mal adaptés aux fonctions spécialement dévolues à chaque caste et constituant son patrimoine exclusif? Dans la Judée, la divinité défendait de manger de la viande de porc : l'expérience n'attestait-elle pas que la consommation de la viande de porc engendrait des maladies immondes?
Sans doute, les religions ont été la source d'abus et de maux sans nombre, comme tout ce qui est humain, mais la croyance à l'existence de puissances supérieures ayant des mandataires chargés de transmettre et de faire exécuter leurs ordres n'en a pas moins été l'agent le plus utile de la civilisation. Supposons l'humanité livrée, à son origine, au pouvoir exclusif de la force matérielle. Supposons que les chefs d'armée et leurs auxiliaires eussent été les maîtres d'agir suivant les impulsions effrénées et aveugles de leurs passions et de ce qu'ils croyaient être leur intérêt; supposons que l'élite intellectuelle à laquelle nous sommes redevables de la multitude de progrès dont l'ensemble constitue la civilisation, n'eût point possédé ce moyen d'action irrésistible de la foi à une puissance supérieure à toutes les puissances humaines, imposant par l'intermédiaire de ses élus, auxquels elle les révélait, les décisions de sa volonté souveraine et les créations de son intelligence omnisciente, que serait-il arrivé? C'est que l'immense majorité des hommes serait demeurée à la merci des passions et des appétits de la minorité carnassière de notre espèce, associée et organisée pour vivre de proie; c'est que l'élite intellectuelle qui a créé la [218] civilisation, non seulement eût été à la merci de l'élément inférieur qui possédait la force, mais encore qu'il lui eût été impossible de faire accepter ses conceptions et ses inventions progressives. Même de nos jours, après tant de lumières acquises, de connaissances accumulées et propagées, nous pouvons constater avec quelle répugnance on accepte le progrès : les ouvriers brisent les machines, les savants traitent en ennemis ceux qui font avancer la science. Pourquoi? parce qu'il est dans la nature de tout progrès de causer un dérangement, même quand il n'inflige point de sacrifices. Combien la difficulté d'imposer ces dérangements aux habitudes et ces sacrifices aux intérêts ne devait-elle pas être plus grande encore à une époque de barbarie et d'ignorance? Comment eût-il été possible alors de faire accepter la moindre innovation, si les inventeurs, aussi bien dans la sphère de l'industrie que dans celle des arts politiques et moraux, n'avaient pu s'appuyer sur une autorité infaillible et toute puissante? Toutes les inventions et découvertes qui constituent le matériel de la petite industrie ont été attribuées à des divinités ou à des hommes en communication avec elles; de même tous nos codes et toutes nos pratiques morales et sociales ont une origine divine. Parmi ces innovations, communiquées et imposées par les puissances surnaturelles, il y avait certainement de l'ivraie à côté du bon grain. Les prêtres des anciennes sociétés avaient beau en être l'élite, ils ne possédaient sur les hommes des autres castes, leurs contemporains, qu'une supériorité relative — supériorité due tant à un don de nature qu'au développement de ce don par l'exercice et la transmission héréditaire des professions intellectuelles — ils n'étaient exempts ni de passions ni d'ignorance, mais encore constituaient-ils l'élément supérieur de la société. Si cet élément supérieur et civilisateur a pu dominer et imposer [219] ses conceptions aux autres, quoiqu'il fût moins nombreux et moins fort, c'est à cause du pouvoir surhumain que lui conférait la foi religieuse. Supposons que ce véhicule d'autorité morale n'eût pas existé, l'espèce humaine, livrée au pouvoir exclusif de la force matérielle, ne se serait jamais, selon toute apparence, élevée au-dessus de l'animalité. Enfin si, à l'origine, la foi religieuse a principalement servi à réfréner et à civiliser les hommes forts et courageux, les guerriers, qui fondaient et possédaient les États, plus tard, quand les éléments inférieurs des sociétés se furent accrus en nombre et en puissance, quand la multitude eut été dégagée des liens de l'esclavage, la religion devint le plus efficace des auxiliaires de la force organisée pour contenir cette multitude ignorante et barbare, lui enseigner et lui imposer le respect du droit avec l'accomplissement du devoir, en l'empêchant de profiter de la supériorité du nombre pour déborder sur la minorité riche et cultivée. Supprimez la foi religieuse, au moins jusqu'à ce que la multitude comprenne, en dehors de toute conception surnaturelle, la nécessité de respecter tous les droits et de remplir tous les devoirs qu'implique l'état de société, et l'ordre social ne reposera plus que sur la force.
Cette classe d'élite, que l'on assimile faussement aux clergés des sociétés modernes, et qui correspond plutôt à cette portion de notre élément civil qui exerce l'ensemble des professions dites libérales — puisque la caste des prêtres contenait des savants et des lettrés, des magistrats, des législateurs, des administrateurs, des médecins, etc., cumulant ces fonctions avec celles du sacerdoce, ou bien, quand le marché venait à s'étendre, les exerçant séparément sous le patronage des divinités protectrices de la justice, de la science, des lettres ou de la médecine — cette classe d'élite, disons-nous, put entrer en partage de [220] pouvoir avec les guerriers, grâce à la croyance aux puissances surnaturelles dont ses membres étaient les mandataires. Elle eut sa part dans le butin en terres et en es-' claves; elle se créa un revenu régulier provenant, tant des propriétés qu'elle exploitait directement au moyen des esclaves ou indirectement en les affermant à des colons, que de la part d'impôts, ordinairement le dixième, qui lui était attribuée dans les produits du sol. A l'exemple des guerriers, et sous l'empire de nécessités analogues, les prêtres forment une corporation gouvernée par un grandprêtre ou un collège avec une hiérarchie et une discipline dont les règles sont le produit capitalisé de l'observation et de l'expérience. Ces règles, déterminées par l'intérêt de l'État ou de la caste, concernent la plupart des actes de l'existence. C'est une tutelle qui gouverne la vie de tous les membres de la caste du haut au bas de la hiérarchie, ne laissant au libre arbitre de chacun qu'une route étroitement enclose de hautes murailles.
Ces deux castes dominantes des sociétés primitives ont pour caractère commun d'être fermées, quoique, de l'une à l'autre, la clôture ne scit pas hermétique; elles se partagent la propriété du sol et les fonctions dirigeantes d'où elles tirent leurs moyens d'existence , et l'on conçoit qu'elles s'appliquent à conserver, pour leur postérité aussi bien que pour elles-mêmes, ce patrimoine acquis au prix de travaux incessants du corps et de l'esprit, de peines et de risques de toute sorte. Avant l'avènement de la petite industrie, lorsque la tribu vivait de la récolte des fruits naturels du sol, de la chasse, de la pêche ou de l'élève du bétail, la propriété des terrains de chasse, des pêcheries, des pâturages, était commune à tous les membres de la tribu ; par sa nature et sa destination même, ce domaine ne comportait pas une appropriation morcelée. Cependant, il ne serait nullement exact de dire que ce régime fût celui du [221] communisme, car la tribu veillait avec un soin jaloux à la conservation de son domaine, et elle en interdisait rigoureusement l'exploitation et même l'accès aux étrangers. Les armes, les outils, les vêtements, les habitations, le bétail constituaient seuls des propriétés individuelles. L'avènement de l'agriculture et de l'industrie eut pour résultat naturel de particulariser davantage la propriété, à mesure surtout que la population devint plus dense, qu'il fallut recourir à des terrains moins fertiles et réparer, au moyen d'engrais, le sol épuisé. Le régime de la communauté agricole, tel qu'on peut l'observer encore en Russie, ne subsista guère que dans les pays de plaines, où la qualité des terres était a peu près uniforme, et où il n'était pas nécessaire de recourir aux engrais. Quand les tribus en possession du matériel agricole émigrèrent, probableblement à la recherche d'un sol plus fertile, après qu'elles eurent épuisé le leur, les territoires dont elles s'emparèrent furent répartis, avec les esclaves et le butin mobilier, entre leurs membres. Chaque tribu, représentée par son chef, conserva ce que les jurisconsultes appellent le domaine éminent du territoire, qui fut réparti entre les conquérants en proportion du rang qu'ils occupaient dans la hiérarchie, de l'importance de leurs services et du nombre de leurs compagnons, autrement dit, des forces dont ils disposaient pour la défense commune. C'était la forme primitive de la solde. Des terres furent assignées de même aux prêtres, et elles constituèrent, dans chaque cantonnement, le domaine du temple. Ces différents domaines formèrent des propriétés seigneuriales ou sacrées, dont l'existence fut réglée par des coutumes ou des lois fondées sur l'intérêt commun. Ces propriétés, avec les fonctions qui y étaient attachées, servaient de débouché à la caste, en lui fournissant une somme de moyens d'existence, peu susceptibles de variations, et à laquelle il [222] était facile de proportionner le nombre des ayants-droit. L'excédant se déversait, soit dans l'armée, soit dans des communautés vouées au célibat, quand il n'y était pas remédié par des procédés sommaires. La guerre en absorbait d'ailleurs une portion notable, tandis que la conquête, entraînant le massacre ou l'asservissement des castes supérieures des pays conquis, élargissait le débouché des castes conquérantes.
On conçoit que sous ce régime, dont le caractère essentiel était l'appropriation de l'État, de ses fonctions et de son domaine territorial à des corporations fermées, toute tentative de sécession politique ou de schisme religieux fût considérée comme la plus grave des nuisances et rigoureusement punie. La séparation d'une province affaiblissait l'Etat, et, en diminuant sa puissance, aggravait les risques auxquels il se trouvait exposé; de plus, ceux qui se révoltaient ne se bornaient pas d'habitude à proclamer leur indépendance, ils voulaient s'emparer de l'État aux dépens des chefs de la hiérarchie et se mettre à leur place. Il en était de même des fauteurs de schismes: ils visaient communément à remplacer la hiérarchie existante par la leur, sans oublier le patrimoine du culte et les moyens d'existence qui y étaient attachés. Dans l'un et l'autre cas, le schisme, soit politique, soit religieux, se résolvait en une entreprise contre la propriété collective de la caste ou tout au moins contre celle de son étatmajor. Sans doute, à des époques d'affaiblissement et de décadence, la révolte et le schisme pouvaient avoir des motifs plus élevés — l'ambition généreuse de relever l'État tombé entre des mains indignes ou de réformer un culte corrompu; dans ce cas aussi, le triomphe des révoltés ou des schismatiques pouvait être le point de départ d'une régénération politique et religieuse. Mais ce remède était dangereux : il exposait l'État, au moins [223] pendant la durée d'un conflit qui paralysait ses forces, aux atteintes de ses ennemis extérieurs, et ce mal positif l'emportait généralement sur l'amélioration incertaine qui pouvait résulter de l'avènement d'un nouveau pouvoir politique ou d'un nouveau culte. Aussi l'opinion, d'ailleurs peu favorable aux nouveautés, était-elle d'habitude hostile à la révolte et au schisme.
Au-dessous de ces deux corporations, comprenant l'élément militaire et l'élément civil du personnel gouvernant des anciens Etats, apparaissait la classe vouée aux fonctions inférieures de l'industrie et du commerce. Issue de la couche la plus basse de la tribu conquérante, cette classe devait croître rapidement, en raison de l'extensibilité de son débouché. Comme les deux précédentes, et, sous l'influence de causes analogues, elle se constitua en une corporation fermée, laquelle alla se divisant et se subdivisant en branches et en rameaux, à mesure que l'industrie et le commerce se développèrent, grâce à l'accroissement de leur matériel et à l'agrandissement de leur débouché.
Dans la période qui suivit immédiatement la conquête, les hommes des métiers, confondus avec la foule des compagnons, et jouant un rôle analogue à celui des ouvriers des compagnies hors rang des armées modernes, travaillaient uniquement pour le chef et sa troupe. Plus tard, lorsque la population se fut accrue avec la richesse, leur clientèle s'augmenta; ils cessèrent d'être entretenus par le seigneur, qui les laissa libres de travailler et de vendre dans les limites de son domaine, en se réservant un droit de préférence ou de préemption sur leurs services ou leurs marchandises.[18] Devenus les maîtres de disposer de [224] leur travail, ils s'associèrent d'abord en vue de la protection de leurs personnes et de leurs biens, ensuite en vue de l'exploitation du débouché, dont ils avaient la jouissance exclusive. Ce débouché étant limité par les frontières de chaque seigneurie, il était nécessaire de limiter aussi le nombre des entreprises ou des maîtrises que son étendue pouvait comporter. Cela fait, il était indispensable de borner encore la production de chacune, de déterminer les procédés, les qualités et les prix. Sinon, l'équilibre n'eût point tardé à être rompu en faveur de l'entreprise qui aurait abaissé ses prix de revient par l'emploi de procédés tenus secrets ou par une altération frauduleuse des qualités. L'association corporative se prémunissait contre ces nuisances en réglementant les procédés de fabrication et en imposant à ses membres, au moins dans certains métiers, l'obligation de travailler en public. Chaque marché étant approprié aux différentes corporations qui le desservaient, et ce marché ne subissant que des variations presque insensibles, on parvenait ainsi à maintenir l'équilibre entre la production et la consommation aussi bien qu'entre les producteurs eux-mêmes. Sans doute, les frontières des corporations n'étaient pas toujours nettement marquées — les boulangers et les pâtissiers, les cordonniers, les corroyeurs, les bourreliers et les savetiers, empiétaient fréquemment sur leurs domaines respectifs; il en résultait des conflits et des procès qui parfois duraient des siècles. Mais, en dépit de ses imperfections, ce régime n'en était pas moins adapté à la petite industrie et aux petits marchés qu'elle desservait. Il [225] procurait aux entrepreneurs de métiers, aux artisans et aux commerçants la sécurité et la stabilité : chacun des associés prenait la part qui lui revenait dans le débouché qui formait le patrimoine de la corporation, et le personnel industriel et commercial pouvait en conséquence s'y proportionner de génération en génération. Les prix étaient réglés par la coutume, laquelle était, à son tour, le produit de l'opinion.[19] Quand la coutume ne suffisait pas à modérer les prétentions des vendeurs, maîtres du marché, l'autorité locale tarifait la marchandise en s'efforçant de donner satisfaction aux consommateurs sans nuire aux producteurs. Elle n'y réussissait qu'imparfaitement, mais quand il s'agissait d'articles de première nécessité, son intervention n'en suppléait pas moins utilement à l'absence du régulateur de la concurrence. — La constitution des corporations industrielles et commerciales était, au surplus, modelée sur celle des corporations dirigeantes; elles avaient des chefs ou syndics, et elles étaient soumises à des coutumes qui régissaient la plupart des actes de leurs membres, en vue de prévenir les nuisances qu'une [226] conduite vicieuse, des dépenses exagérées de table ou de toilette pouvaient causer à l'association corporative, en amenant la ruine ou la déconsidération de ses membres.
Les entrepreneurs d'industrie, les artisans et les commerçants ne formaient pas seuls des corporations. Les ouvriers ou compagnons avaient les leurs, instituées dans un but analogue, c'est-à-dire en vue de se protéger mutuellement et de régulariser l'exploitation de leur débouché. Ces corporations ouvrières ou sociétés de compagnonnage, qui font remonter leur origine au roi Salomon et qui étaient probablement beaucoup plus anciennes, se considéraient, à l'exemple des corporations industrielles, militaires ou cléricales, comme propriétaires des marchés de travail, et cette propriété, de même que toute autre, donnait lieu à des conflits et à des procès entre les différentes sociétés ou compagnies. Mais l'appropriation des marchés permettait aux compagnons de proportionner leur nombre au débouché dont ils disposaient. Ils limitaient en conséquence soigneusement le nombre des apprentis. Enfin, ils se protégeaient mutuellement et ils avaient, comme les autres corporations, leur hiérarchie et leurs coutumes destinées à écarter les nuisances et à maintenir la bonne renommée de l'association.[20]
Les corporations industrielles et les sociétés de [227] compagnonnage contenaient la classe inférieure de la tribu conquérante. Dans l'Inde, cette classe, dite des Vayssias, [228] conserva sa pureté originaire, grâce aux coutumes qui interdisaient le mélange des races. Ailleurs, elle se grossit [229] en englobant dans son sein une partie des affranchis des classes asservies.
[230]
La masse du peuple conquis avait été partagée entre les conquérants, et nous avons vu par quelles évolutions [231] successives elle a passé de l'esclavage au servage et au colonat, comment enfin elle a formé des communes. Dans [232] ces différents états, elle était soumise à une tutelle d'abord complète, ensuite partielle, dont les objets principaux [233] étaient de proportionner sa multiplication aux besoins du marché, et de tirer de ses services le parti le plus avantageux possible. Les propriétaires réglaient le croît de leurs esclaves comme celui de leurs autres bêtes de somme. Leur intérêt bien entendu leur commandait d'ailleurs de les bien traiter et ils y mettaient généralement leur amour-propre. C'est ainsi qu'ils évitaient d'assujettir au travail les enfants aussi bien que les jeunes chevaux avant que leurs forces fussent suffisamment développées, et qu'ils leur faisaient donner l'éducation la plus propre à mettre leurs facultés et leurs aptitudes naturelles en pleine valeur. Les travaux qui exigeaient simplement l'emploi de la force physique en absorbaient le plus grand nombre, mais on les appliquait aussi à des fonctions qui comportaient la mise en œuvre des facultés intellectuelles; alors on les élevait et on les dressait de manière à les y rendre propres. A bien des égards, et surtout au point de vue de la sécurité de l'existence, la condition des esclaves était préférable à celle des hommes libres; aussi voyait-on fréquemment ceux-ci reprendre volontairement le joug de la servitude. — Lorsque l'esclavage eut fait place au servage ou au colonat, la tutelle de cette classe, à la fois la plus nombreuse et la moins capable de se gouverner elle-même, se modifia, mais sans s'affaiblir, et en [234] s'améliorant sous certains rapports. A la tutelle du seigneur vinrent se joindre les enseignements et les freins religieux, l'empire des coutumes et le contrôle de l'opinion efficacement concentrée dans la paroisse ou dans la commune. Le seigneur conserva le droit de limiter la population, conformément aux besoins du marché; aucun mariage ne pouvait être contracté sans son consentement, et la religion, d'accord avec l'opinion, prohibait les unions illégitimes. La discipline était moins sévère sans doute dans les seigneuries, et plus tard dans les communes affranchies, qu'elle ne l'avait été dans les domaines à esclaves; une part était faite, quoique bien petite, à l'initiative individuelle, mais la tutelle combinée du seigneur, de la religion, de la coutume et de l'opinion, agissait cependant pour contenir et régler les appétits désordonnés et généraliser les manières d'agir utiles en matière de production et de consommation. Les méthodes de culture que l'expérience avait fait reconnaître comme les meilleures, les heures et les jours de travail et de repos, la nourriture, le vêtement, la conduite à tenir dans les différentes circonstances de la vie, tout cela était prévu, ordonné par une sagesse expérimentale qui n'était assurément pas infaillible, mais qui était bien supérieure à celle d'individus que la nature purement physique de leurs occupations rendait impropres aux spéculations intellectuelles, qui eussent été incapables de trouver par euxmêmes les règles de self government, adaptées à leur condition, et qui possédaient encore moins la force morale nécessaire pour les observer.
Cette organisation des anciennes sociétés était déterminée par la nature même des hommes et des choses; elle n'avait rien d'arbitraire et d'artificiel : chacune de ses parties avait été créée pièce à pièce, en vue d'atteindre une fin utile ou d'écarter une nuisance; elle se retrouve, [235] avec des différences plutôt apparentes que réelles, chez les peuples les plus divers et dans les régions les plus distantes. Partout on rencontre des classes dominantes et des classes asservies. Partout on voit les classes dominantes se constituer en castes ou en corporations, et les classes asservies, à mesure que les liens de la servitude se relâchent, former des communautés au sein desquelles se crée un organisme gouvernemental qui remplace la tutelle du maître ou du seigneur. Partout, dans l'État, dans la caste ou la corporation, dans la seigneurie et dans la commune, on voit s'établir la hiérarchie, les croyances, les coutumes, les opinions, qui constituent les différentes pièces de la machinery nécessaire au maintien de la sécurité extérieure, de l'ordre intérieur et de la prospérité collective. Que cette machinery, telle qu'on peut l'étudier dans l'Inde, en Chine, en Egypte, au Pérou, au Mexique, comme en Grèce, à Rome, et plus tard dans les États issus de la décomposition de l'empire romain, soit à bien des égards imparfaite et grossière, cela n'a rien de surprenant. Même dans les sociétés formées par l'élite de la race humaine, où le génie des observateurs et des inventeurs, dans la sphère des sciences politiques et morales, avait le mieux pourvu à l'élimination des nuisances qui pouvaient menacer l'État et ses membres, la constitution politique, religieuse et sociale n'était point, et surtout ne demeurait point adaptée d'une manière absolument exacte à la nature des hommes et aux conditions d'existence plus ou moins changeantes de la société. C'était une machinery qui péchait toujours par quelque côté, et il ne pouvait en être autrement. Ceux qui l'établissaient et la faisaient fonctionner n'avaient point une intelligence infaillible et ils ne possédaient point la science sociale infuse. Mais, si ces anciennes organisations n'étaient point parfaites, il ne faudrait pas croire non [236] plus, avec les écrivains dépourvus du sens historique qui prétendent faire table rase de l'histoire, qu'elles n'eussent point leur raison d'être, et qu'elles ne fussent point, dans une large mesure, ce qu'elles devaient et ce qu'elles pouvaient être. En général, les États auxquels la petite industrie a donné naissance ont subsisté d'autant plus longtemps qu'ils étaient composés d'éléments plus vigoureux et que leur machinery politique, religieuse et sociale était mieux adaptée aux hommes et aux choses; mais même dans ceux où cette machinery était la plus grossière, elle se trouvait cependant appropriée, dans quelque mesure, à l'état physique et moral des divers éléments de la société et aux circonstances ambiantes.
II. — Résultats de l'ancienne organisation sociale. — Sécurité et stabilité provenant, dans les couches supérieures, des corporations fermées, de l'hérédité des fonctions et de l'appropriation des marchés; dans les couches inférieures, de l'appropriation des hommes. — Que cette organisation était aussi bien adaptée qu'elle pouvait l'être à des sociétés vivant de la petite industrie. — Ses imperfections et son insuffisance. — Destinée invariable des sociétés sous ce régime. — Comment l'évolution de la grande industrie a agi pour déterminer une évolution correspondante dans les sciences et les arts du gouvernement. — Effets de celle-ci. — Destruction des corporations fermées et des marchés appropriés, de la servitude et de la tutelle forcée. — Comment se produit l'organisation nouvelle qui surgit des ruines de l'ancienne. — Des causes qui ont amené la dissolution de la corporation militaire et politique. — L'invention des armes à feu. — Causes de la dissolution des corporations religieuses. — Le progrès des sciences et des arts libéraux. — L'établissement du célibat des prêtres. — L'invention de l'imprimerie. — Causes de la dissolution des corporations industrielles et commerciales. — L'invention de la boussole. — La découverte de l'Amérique et de la nouvelle route de l'Inde. — L'introduction de la machine à vapeur et des métiers mécaniques. — Causes de l'affranchissement des travailleurs. — Progrès réalisés grâce à la chute de cette organisation qui n'était plus adaptée aux nouvelles conditions d'existence des sociétés. — Caractères de l'organisation qui la remplace.
Cette machinery politique, religieuse et sociale, adaptée au régime de la petite industrie, a procuré aux sociétés, au sein desquelles elle a acquis le plus haut degré de perfection, le maximum de prospérité que comportait [237] l'état du matériel et des procédés de la production. Cette prospérité est attestée par les monuments et les ruines splendides qu'ont laissés sur le sol les civilisations des deux péninsules de l'Inde, de l'Egypte, des belles époques de la Grèce, de Rome et du moyen âge. La richesse était, à la vérité, fort inégalement distribuée parmi les membres des classes ou des corporations dont les assises superposées constituaient la pyramide sociale, mais, à tous les degrés de cette pyramide, on retrouvait la première condition du bien-être, savoir : la sécurité et la stabilité des moyens d'existence. Cette condition était réalisée, dans les couches supérieures et moyennes de la société, par la constitution de corporations fermées, l'hérédité des fonctions et l'appropriation des marchés; elle l'était, dans les couches inférieures, par l'appropriation totale ou partielle de l'homme lui-même. Les seigneuries et les temples, avec les fonctions dirigeantes qu'ils comportaient, constituaient le débouché héréditaire des deux corporations supérieures. De même, les maîtrises, avec leur marché approprié, formaient le débouché assuré du personnel dirigeant ou auxiliaire des arts et métiers et du commerce. Des coutumes ou des institutions, fondées sur l'intérêt de l'État ou de la corporation, agissaient, tant pour maintenir l'équilibre entre la population des associés et leurs moyens d'existence que pour empêcher les nuisances publiques ou privées. Dans les régions inférieures, le maître ou le seigneur était intéressé à proportionner le nombre des bras aux emplois disponibles; il l'était encore à ce que son troupeau d'esclaves ou de serfs demeurât vigoureux et sain. Les générations se succédaient, vouées aux mêmes travaux, sans grande perspective de voir leur condition s'améliorer, mais assurées de recevoir, en échange d'un travail proportionné à leurs forces, une pitance suffisante. Cet état de choses nous paraît [238] aujourd'hui humiliant pour la dignité humaine, mais pouvait-il être meilleur? En vertu de la nature même des choses, il y avait dans toute société deux catégories de fonctions à la fois inégales en nombre et en qualité : les fonctions supérieures ou dirigeantes qui concernaient le gouvernement et la défense de la société, la direction ou la gestion des entreprises, et qui exigeaient la mise en œuvre des facultés intellectuelles et morales; les fonctions auxiliaires et subordonnées qui comprenaient la plus grande partie des travaux que les machines exécutent aujourd'hui, et qui n'exigeaient guère qu'un déploiement de force physique. Il était nécessaire que les unes et les autres fussent remplies aussi bien que possible, sinon la société n'eût point tardé à être détruite ou asservie. Comment pouvaient-elles l'être autrement que par une organisation qui plaçait les forts, les courageux et les intelligents au-dessus, les faibles et les incapables au-dessous? L'expérience attestant que les qualités et les aptitudes se fortifiaient par l'exercice et se transmettaient par l'hérédité, l'organisation la plus utile, la mieux adaptée à la nature de l'homme et à la situation des sociétés n'étaitelle pas celle qui maintenait chacun dans sa sphère, en y assurant, autant que possible, ses moyens d'existence? Jusqu'à ce que le progrès eût abrégé la distance énorme qui séparait les fonctions supérieures des inférieures, en remplaçant le travail physique par le travail mécanique, était-il possible, était-il utile de rendre toutes les fonctions accessibles à tous? L'ambition de s'élever à des emplois supérieurs, d'ailleurs en bien petit nombre, au lieu de se contenter de ceux que son infériorité native lui avait assignés, n'aurait-elle pas aggravé la condition de la multitude, en livrant la société à une incurable anarchie ? Estce à dire que les sociétés, ainsi partagées en classes dominantes et en classes asservies, et où chacun était rivé [239] héréditairement à sa fonction ou à son travail, réalisassent l'âge d'or? Nullement, mais elles pouvaient vivre, et parfois prolonger leur existence pendant des milliers d'années, au milieu d'États ennemis et de hordes avides de pillage, et c'était bien quelque chose![26] Elles n'en avaient pas moins à supporter des maux qui tenaient, les uns aux circonstances naturelles dans lesquelles elles se [240] trouvaient placées et à l'imperfection de leur matériel, les autres à l'imperfection des hommes, à l'insuffisance ou à la corruption des institutions. Elles souffraient, par exemple, fréquemment, des disettes, que le peu d'étendue des marchés d'approvisionnement, l'absence de moyens d'information et de communication rendaient particulièrement meurtrières. Elles souffraient des vices que la domination développait chez les classes supérieures et la servitude chez les autres, sans que les institutions, si prévoyantes et si bien adaptées qu'elles fussent au tempérament des hommes et à la situation de la société, réussissent jamais à les réprimer entièrement. A la longue, l'accumulation de ces nuisances affaiblissait et dissolvait l'État, qui devenait alors la proie d'une race plus jeune et plus vigoureuse : la conquête le régénérait ou le faisait disparaître.
Telle eût été, selon toute apparence, jusqu'à la fin des siècles, la destinée des États et des nations, si une nouvelle évolution, pour le moins égale en importance à celle qui a fait succéder l'État et la nation à la tribu primitive, n'était point survenue; si, après être demeurés presque stationnaires pendant des milliers d'années, le matériel et les procédés de la production n'avaient point recommencé à progresser, tandis qu'une évolution correspondante s'accomplissait, en grande partie sous l'influence de ce progrès, dans les sciences et les arts du gouvernement. Cette double évolution a suscité une crise, à la fois économique, politique et sociale, dont les commencements remontent déjà à plusieurs siècles, dont nous pouvons prévoir le terme, mais dont il nous est impossible de calculer la durée.
Tout ce que nous pouvons dire, c'est que la crise économique prendra fin seulement lorsque la petite industrie aura complètement, et dans toutes les branches de [241] l'activite humaine aussi bien que dans toutes les régions du globe, fait place à la grande, c'est-à-dire lorsque toutes les opérations productives, qui ont été jusqu'à présent accomplies au moyen de la force physique des travailleurs, le seront par des forces mécaniques ou chimiques dirigées par l'intelligence de l'homme.
De même la crise politique et sociale ne prendra fin que lorsque la vieille machinery, qui était adaptée au gouvernement des sociétés et des individus vivant de la petite industrie, aura fait place à une machinery adaptée à des sociétés et à des individus vivant de la grande industrie, en tenant compte de la transition entre l'ancien état économique et le nouveau.
Il est évidemment impossible de prévoir la durée de cette double évolution. N'oublions pas qu'il existe encore, dans une grande partie de notre globe, des tribus de chasseurs, de pêcheurs, d'anthropophages même, que n'a pas atteints l'évolution de la petite industrie. Avant que celle-ci ait complètement et partout cédé la place à la grande, il se passera des siècles, — bien que l'avènement de la concurrence industrielle et commerciale constitue à cet égard un élément nouveau et une donnée dont la valeur est encore inconnue.
Ce qu'il importe de rechercher, pour le moment, ce sont les effets que l'invasion de la grande industrie a produits sur la machinery du gouvernement des individus et des sociétés. Comme nous le verrons, elle a agi, d'une part, pour démolir des institutions qui cessaient d'être adaptées à l'état de sociétés dont les conditions d'existence avaient changé; d'une autre part, pour y substituer des institutions appropriées à cet état nouveau. Dans cette recherche, il est nécessaire de remonter bien au delà de l'invention de la machine à vapeur; car les commencements de ce qu'on pourrait nommer la [242] renaissance industrielle datent de beaucoup plus loin. Dès la fin du moyen âge, une série d'inventions et de découvertes, d'une importance extraordinaire, l'introduction des armes à feu et de la boussole, l'invention de l'imprimerie, la découverte de la nouvelle route maritime de l'Inde et d'une nouvelle partie du monde, ont modifié les conditions matérielles de l'existence des sociétés civilisées, et réagi sur leurs institutions politiques et sociales.
Nous ne voulons pas dire que le progrès matériel ait seul déterminé l'évolution en voie d'accomplissement dans les sciences et les arts du gouvernement, mais nous croyons que son action, dans ce sens, a été infiniment plus puissante qu'on ne le suppose généralement. Si le matériel de la production n'avait point été perfectionné et agrandi, les innovations politiques et sociales n'auraient abouti à aucun résultat durable, le régime des corporations eût subsisté dans les régions supérieures et moyennes des sociétés, la servitude eût été à jamais la condition nécessaire des classes inférieures vouées au travail physique, et incapables, en vertu de la nature même de leurs occupations, de s'élever à une haute culture intellectuelle et morale. L'histoire aurait continué de tourner dans le cercle où elle se mouvait depuis la naissance de la petite industrie. Elle nous aurait montré, d'une manière indéfinie, des sociétés isolées se constituant et s'agrandissant par la conquête, s'organisant en corporations fermées avec des marchés appropriés, maintenant la masse vouée aux travaux matériels dans un état de dépendance et de tutelle, passant de la féodalité à l'unité pour se dissoudre à la longue par suite de l'imperfection de leur organisme et de l'accumulation des nuisances produites par l'incapacité et les vices de leurs membres, disparaissant finalement dans l'anarchie ou dans la conquête, sans que de cette succession d'États, ensevelis et oubliés tour à [243] tour, il sortît un progrès continu et croissant dans la condition générale de l'espèce humaine.
L'avènement de la grande industrie a brisé ce cercle uniforme, et un nouvel ordre de choses, aussi différent du précédent que l'était celui-ci du régime de la tribu primitive, a commencé à poindre. Les caractères essentiels de ce nouvel ordre de choses, tel que nous le voyons sortir des ruines de l'ancien, c'est, dans les régions supérieures et moyennes de la société, la destruction, à la vérité encore partielle et inachevée, des corporations fermées et des marchés appropriés; dans les régions inférieures, la disparition de la servitude et de la tutelle forcée. Cette vieille machinery se détraque et tombe, quels que soient les efforts de la routine pour la maintenir, parce qu'elle a cessé et qu'elle cessera de plus en plus d'être adaptée aux conditions nouvelles d'existence des sociétés et des individus, mais avec elle se détraquent et tombent aussi les garanties et les freins nécessaires qu'elle contenait. C'est de reconstituer ces garanties et de reconstruire ces freins, en les adaptant au nouvel ordre de choses, aussi bien que de déblayer les restes d'une organisation surannée, qu'il s'agit aujourd'hui. Ajoutons que cette œuvre de reconstitution a commencé à s'accomplir dès que la nécessité s'en est fait sentir, et qu'elle se poursuit sans interruption tout en subissant des temps d'arrêt et même des retours inévitables. Comme à l'époque où la création de la petite industrie a déterminé celle de la machinery du gouvernement des anciennes sociétés, c'est l'observation et l'expérience, aidées de l'esprit d'invention, qui reconstruisent aujourd'hui, au prix d'une foule de tâtonnements d'erreurs et de mécomptes, cette machinery sur un plan plus vaste, en l'adaptant à des sociétés et à des individus vivant de la grande industrie. Sans doute, ce travail n'est point aussi avancé qu'on pourrait souhaiter [244] qu'il le fût; les sciences et les arts politiques et moraux sont en retard sur les sciences physiques et les arts industriels, mais ils n'en sont pas moins à l'œuvre, et notre organisation politique et sociale va se complétant et se perfectionnant tous les jours en même temps que notre outillage industriel. En tous cas, elle diffère déjà d'une manière sensible de celle de l'ancien régime.
Les deux grandes corporations, l'une militaire et politique, l'autre religieuse et civile, qui se partageaient le gouvernement des États de l'ancien régime ont cessé d'exister, au moins à titre de corporations fermées ayant un marché exclusivement réservé à leurs membres. De nos jours, en exceptant seulement dans les monarchies les fonctions de chef de l'État, roi ou empereur, il n'y a plus de fonction appropriée à une famille et transmissible par voie d'hérédité. Tous les emplois sont ouverts à tous, qu'ils soient politiques, militaires, religieux, judiciaires ou administratifs. Au lieu de constituer des propriétés particulières que l'on pouvait léguer ou même vendre sous de certaines conditions, ils sont recrutés par voie de nomination ou d'élection. En outre, quelques-uns de ces emplois ont été détachés de l'organisme de l'État; ils constituent des fonctions ou des industries privées dont le marché n'est plus ni approprié ni fermé : telles sont celles de la science, de l'enseignement et des cultes libres.
La destruction de la corporation militaire et politique est due, en grande partie, au changement décisif que l'invention des armes à feu a opéré dans le matériel de guerre. D'une part, le nouveau matériel étant à la fois incomparablement plus coûteux et plus efficace que l'ancien, les seigneurs en possession des domaines les plus riches purent s'agrandir plus rapidement aux dépens des autres, la féodalité fit bientôt place à des États unitaires, dans lesquels tous les pouvoirs furent concentrés entre [245] les mains du chef de la maison souveraine, désormais seul propriétaire de l'État et maître de le gouverner selon son bon plaisir. D'une autre part, le nouveau matériel n'exigeant plus au même degré le concours des qualités qui caractérisaient la noblesse féodale, la force, l'adresse et le courage physique, tandis que les armes savantes, par exemple, en exigeaient d'autres qu'elle ne possédait pas, les souverains trouvèrent avantage à recruter, en dehors d'elle, une proportion croissante de l'élément militaire. Déjà, dans les derniers siècles de l'ancien régime, l'artillerie était presque entièrement plébéienne, tandis que la cavalerie demeurait l'arme favorite de la noblesse. En même temps, le souverain ouvrait les services civils, jadis monopolisés par la noblesse et le clergé, à une classe nouvelle que les progrès de l'industrie avaient fait surgir, et que l'habitude des grandes affaires, née de ce progrès même, avait pourvue d'une aptitude supérieure en matière d'administration, sans compter que cette classe inférieure en rang montrait une souplesse plus grande à se plier aux volontés d'un maître placé relativement plus haut. Ce déclassement et cette ouverture des fonctions auparavant réservées à la classe dominante s'opéraient toutefois avec une certaine lenteur. Des révolutions ont été faites pour les hâter, mais, quand même ces convulsions destructives bientôt suivies de réactions aveugles n'auraient pas eu lieu, le progrès se serait accompli, car les anciennes institutions n'étaient plus adaptées aux besoins de l'ordre nouveau.
La dissolution de la caste ou de la corporation religieuse et civile, qui formait le second élément de la classe dominante, doit être attribuée à des causes diverses parmi lesquelles il faut citer le progrès des sciences et des arts libéraux, l'établissement du célibat des prêtres et l'invention de l'imprimerie. A mesure que la somme des [246] connaissances humaines s'augmentait, il s'établissait entre elles, aussi bien qu'entre les arts qui en dérivaient, une division naturelle. Si, dans la tribu primitive, le sorcier pouvait être à la fois ministre du culte, législateur, médecin, astronome et physicien, il n'en alla plus ainsi lorsque le capital des découvertes de la science et des inventions se fut accru. Tout en demeurant, dans l'ancienne Égypte, le domaine exclusif de la caste des prêtres, les sciences et les arts libéraux se spécialisèrent. Cette spécialisation ou cette division du travail ne pouvait manquer de créer une différence de plus en plus marquée entre les manières de voir des prêtres voués uniquement aux études théologiques et aux pratiques du culte et celles des prêtres adonnés à l'étude des sciences physiques et morales, à la pratique de la jurisprudence ou de la médecine. Malgré tous les efforts que l'on put faire pour empêcher la science de se mettre en opposition avec la théologie, en punissant notamment comme des rébellions contre la divinité les théories qui ne s'accordaient point avec les dogmes, la scission s'opéra, et elle devint de plus en plus profonde. Une classe savante et vouée aux professions libérales finit par se constituer, en dehors de la discipline cléricale; elle apparaît en Grèce et à Rome. Si, après l'avènement du christianisme et la destruction de la société antique, on la retrouve englobée dans l'Église, on la voit plus tard, à mesure que les sciences et les arts renaissent, sortir des cloîtres et acquérir une existence propre. L'établissement du célibat des prêtres favorisa naturellement cette séparation, les seules fonctions ou vocations religieuses étant assujetties à la loi du célibat, tandis que la culture des sciences et la pratique des professions libérales en étaient exemptes.
Le célibat des prêtres a été, au surplus, une des institutions qui ont le plus efficacement contribué à dissoudre [247] la vieille organisation des castes fermées. Les raisons qui en ont déterminé l'établissement avaient surtout un caractère économique. L'obligation du célibat était un remède radical aux maux inévitables qu'entraînait la multiplication excessive des familles cléricales, à une époque où chaque profession avait son débouché approprié et fermé. La loi chrétienne, par une réaction contre les excès de la prudence païenne, poussait à la multiplication illimitée de l'espèce. Or, le débouché ouvert au clergé étant naturellement limité et peu extensible, les familles cléricales ne pouvaient manquer de presser sur ce débouché, et de paupériser ainsi la corporation. L'institution du célibat des prêtres a écarté ce danger, mais elle a eu encore un autre résultat que ne prévoyaient point ses auteurs. Elle a été le coin qui a disloqué le vieux régime des castes, en ouvrant les rangs du clergé à des individualités issues des couches sociales les plus basses comme les plus hautes, en tous cas, les plus diverses. Le clergé a cessé d'être une caste se recrutant dans son propre sein; il est devenu le débouché commun, où se sont rencontrés et fusionnés les autres éléments sociaux.
A cette action dissolvante du progrès des sciences et des arts libéraux et de l'institution du célibat des prêtres, est venue se joindre celle de l'invention de l'imprimerie qui a rendu possible la diffusion universelle des connaissances humaines en même temps qu'elle assurait leur conservation indéfinie. Aussi longtemps que les œuvres scientifiques et littéraires ne pouvaient être reproduites et multipliées que par le travail manuel des copistes, leur propagation se trouva concentrée dans un cercle étroit. Grâce à l'imprimerie, ce cercle put s'étendre successivement jusqu'à embrasser la société entière. L'instruction se répandit en dehors du personnel clérical ou soumis à la discipline ecclésiastique, et, avec elle, l'esprit [248] d'examen et de critique. Les schismes, qui jusqu'alors n'avaient guère intéressé que les prêtres et les moines, et dont le bras séculier était aisément venu à bout lorsqu'ils passaient de la théorie à l'action, les schismes se propagèrent désormais avec une rapidité extraordinaire dans toutes les classes de la population et jusque dans les localités les plus reculées. La réforme et les guerres religieuses commencèrent. Le clergé orthodoxe défendit avec énergie son marché approprié. Tantôt, lorsque les chefs de la caste politique et militaire qui disposaient de la force organisée lui demeuraient fidèles, il réussit à le conserver intact; tantôt, il fut supplanté par le clergé schismatique qui se mettait purement et simplement à sa place ou qui entrait en partage avec lui; tantôt, enfin, le marché était ouvert à tous les cultes, et le régime de la concurrence religieuse succédait à celui des débouchés appropriés ou du monopole.
Si nous passons maintenant à la classe qui dirigeait ou desservait les entreprises industrielles et commerciales, nous trouverons qu'une autre série d'inventions et de découvertes, l'invention de la boussole, la découverte de l'Amérique et de la nouvelle route de l'Inde, plus tard enfin, les applications multiples de la force de la vapeur à l'industrie et à la locomotion, ont contribué à démolir les corporations dans lesquelles elle était casée et à ouvrir, au moins dans une certaine mesure, les marchés qui lui étaient appropriés, en provoquant l'établissement de la liberté de l'industrie, du travail et du commerce.
Sous le régime de la petite industrie, avant que le progrès ne l'eût entamé, la masse des produits agricoles et industriels étaient consommés sur place par ceux-là mêmes qui les produisaient dans la ferme ou l'atelier domestique, ou échangés dans les marchés avoisinants, défalcation faite de la portion qui était absorbée par les redevances [249] seigneuriales et autres. Les échanges à distance portaient d'une manière presque exclusive sur les marchandises contenant une grande valeur sous un petit volume, qui pouvaient supporter des frais de transport élevés. Ces marchandises d'élite n'étaient guère abordables que pour les classes supérieures; tandis qu'aujourd'hui la consommation de l'homme le plus pauvre comprend des articles de la moindre valeur qui proviennent des régions les plus éloignées du globe, des grains, des farines et de la viande d'Amérique et d'Australie, du café du Brésil, du sucre de Java, du coton des États-Unis, de l'indigo du Bengale, etc., etc., il n'y entrait jadis (sauf de rares exceptions, le sel, par exemple) que des articles provenant de la localité même ou du voisinage.[27] Le commerce à distance n'avait qu'une faible importance, et il ne subissait, dans le cours des siècles, que des variations presque insensibles; en outre, il puisait toujours aux mêmes marchés de production, et il suivait les mêmes routes. [250] Pendant des milliers d'années les soieries et la porcelaine de la Chine furent apportées dans l'Inde par le désert de Cobi ou les défilés du Thibet, et de l'Inde elles passèrent, avec les perles de Ceylan et quelques autres articles précieux, en Égypte, en Palestine, dans le monde gréco-romain, et, plus tard, dans les États chrétiens, par l'intermédiaire de caravanes qui suivaient depuis un temps immémorial le même itinéraire, ou par la navigation côtière de l'océan Indien et de la mer Rouge. Au moyen âge, ces marchandises précieuses, qui n'avaient point en Europe de similaires auxquels elles fissent concurrence, venaient s'échanger dans des quantités et à des conditions presque invariables sur deux ou trois grands marchés appropriés aux corporations qui en avaient le monopole : Venise, Bruges, Novogorod, Bergen. La situation changea du tout au tout lorsque, d'une part, l'invention de la boussole eut permis à la navigation de se frayer de nouvelles routes plus économiques et plus sûres que les anciennes, lorsque, d'une autre part, les régions récemment explorées ou découvertes commencèrent à envoyer en Europe, en quantités croissantes, des denrées nouvelles ou à peine connues que les consommateurs accueillaient avec avidité : le sucre, le café, le rhum, le tabac, les épices, le thé. En vain, chaque nation s'appropria, par une extension du régime établi, les marchés d'approvisionnement qu'elle avait découverts; en vain, elle en conféra l'exploitation exclusive à des corporations ou des compagnies privilégiées; en vain, elle interdit l'importation des marchandises qui pouvaient faire concurrence aux produits indigènes, les tissus de coton de l'Inde, par exemple; la brèche était ouverte dans l'ancien régime commercial et industriel, et elle devait aller sans cesse en s'élargissant. Les marchandises exotiques se répandaient partout, et elles provoquaient la création d'un supplément d'articles d'échange [251] demandés par ceux qui les produisaient ou les importaient: outils, armes, matériel de navigation, objets de consommation de tous genres, à l'usage des Européens établis dans les pays nouveaux, etc., etc. Cette demande supplémentaire nécessitait la création de nouveaux ateliers que les corporations en possession d'un marché assuré, gênées d'ailleurs par les coutumes et les règlements institués en vue du partage de l'exploitation de ce marché, ne se pressaient point d'établir. L'élévation des profits qu'ils pouvaient procurer en détermina alors l'établissement en dehors des limites du domaine des corporations, ordinairement dans les faubourgs des villes. Affranchis des vieilles coutumes et des vieux règlements, ces ateliers de création moderne accueillaient volontiers les machines et les procédés nouveaux qui accroissaient leurs bénéfices en diminuant leurs prix de revient, et leurs produits fabriqués à meilleur marché ne manquaient pas, en dépit de toutes les prohibitions, de s'infiltrer dans le domaine de l'industrie incorporée. L'introduction de la machine à vapeur et des moteurs mécaniques acheva la défaite de l'industrie réglementée : désormais, il ne lui était plus possible de lutter contre sa rivale libre, à moins de se débarrasser d'un attirail qui la gênait après l'avoir protégée, et le nouveau régime sortit ainsi de l'impossibilité de conserver davantage l'ancien.
En même temps, la nécessité de recruter des masses d'ouvriers pour desservir les ateliers agrandis de l'industrie renouvelée faisait tomber les derniers liens qui retenaient les travailleurs attachés, ici, à la glèbe seigneuriale, là, au petit atelier des maîtrises. L'appât d'une rétribution, comparativement élevée, les attirait dans l'industrie progressive, où ils jouissaient d'ailleurs d'une liberté de mœurs qu'ils ne possédaient point dans la paroisse agricole ou dans les confréries des métiers, où ils [252] pouvaient enfln s'élever eux-mêmes à la condition d'entrepreneurs. Ainsi s'est effondrée, du moins en partie, la vieille organisation des sociétés qui vivaient de la petite industrie, dès qu'elle a cessé de leur être adaptée. Débarrassées des entraves qu'elle opposait à leur essor, toutes les branches de travail se sont développées, la population s'est accrue et la richesse a décuplé. Une nouvelle organisation a surgi, encore à la vérité bien incomplète, ayant pour traits essentiels la liberté des entreprises et des associations, et l'ouverture des marchés à la concurrence universelle. Comment cette nouvelle organisation pourvoit aux nécessités en vue desquelles elle s'établit; en quoi elle est insuffisante et défectueuse; dans quel sens elle se développe; en un mot, ce qu'elle est dans le présent, ce qu'elle sera, autant qu'on puisse le conjecturer, dans l'avenir : voilà ce qu'il nous reste à examiner.
[253]
CHAPITRE VIII. Le présent.↩
État actuel de l'industrie et du gouvernement des sociétés. — Que la petite industrie continue de subsister à côté de la grande, mais qu'elle est fatalement condamnée à périr. — Qu'il en est de même de l'ancienne machinery de gouvernement. — Que la transformation de celle-ci est en retard. — Que le changement déjà accompli dans les institutions économiques est néanmoins considérable. — Nature de ce changement. — La liberté substituée à la tutelle en matière de production, de distribution et de consommation. Avantages de cette substitution. — Imperfection du nouveau régime de self government. Aperçu des nuisances qui en résultent. — Influence de ces nuisances combinées sur la condition actuelle de la société. — Déperdition de forces et de ressources causée par l'affaiblissement de l'appareil préventif ou répressif des nuisances. — Qu'au lieu de diminuer avec l'accroissement de la richesse, le nombre des hommes incapables de couvrir leurs frais d'existence s'est augmenté. — Que cette anomalie atteste l'insuffisance de la capacité nécessaire au self government et la nécessité d'y suppléer. — Que le malaise actuel des sociétés vient de ce que l'ancienne machinery de gouvernement a cessé de leur être adaptée et se trouve en voie de démolition, tandis que la nouvelle est seulement en voie de formation.
Au moment où nous sommes, la grande industrie, quoique ses origines remontent à plusieurs siècles et qu'elle ait reçu une impulsion décisive par l'invention de la machine à vapeur et des métiers mécaniques, bientôt suivie de celle des chemins de fer, de la télégraphie électrique et de tant d'autres merveilles, n'a transformé encore, même dans les pays les plus avancés, que la plus faible partie du matériel de la production et de la consommation. Partout, bien que dans des proportions inégales, la petite industrie n'a pas cessé de coexister avec la grande, partout la lutte est engagée entre la routine qui s'efforce de conserver l'ancien outillage et l'esprit de progrès qui s'applique à lui substituer un matériel et des [254] procédés nouveaux. L'issue de cette lutte ne saurait être douteuse : l'agonie de la petite industrie pourra être plus ou moins longue, mais c'est une agonie! Sa durée dépendra, à la fois, de la rapidité du progrès des sciences positives, de la fécondité de l'industrie des inventeurs et de la puissance des moyens de résistance, dont les intérêts engagés dans l'ancienne industrie disposent pour la protéger contre la nouvelle. Cette protection est impuissante à sauver ce qui est condamné à périr, mais elle peut prolonger la lutte et les souffrances qui l'accompagnent. Cependant, en dépit des causes diverses qui retardent sa marche, l'industrie progressive n'en a pas moins commencé à changer la face du monde et à multiplier la richesse dans des proportions sans précédents dans l'histoire.
De même l'ancienne machinery de gouvernement, destinée à prévenir ou à réprimer les nuisances de toute sorte provenant de l'imperfection des choses et des hommes, n'a subi encore qu'une transformation partielle. Comme nous l'avons remarqué déjà, elle est en retard sur l'évolution industrielle, et le défaut d'accord entre ces deux évolutions qui devraient être parallèles est une nouvelle source de nuisances. Cependant, en ce qui concerne du moins les institutions économiques, les changements accomplis, si incomplets et insuffisants qu'ils soient, ont une importance décisive.
S'agit-il de la production? Au régime des corporations fermées et des marchés appropriés, sous lequel un nombre limité de maîtrises, qui se transmettaient communément par voie d'hérédité, travaillaient avec un outillage et dans des conditions presque immuables et se partageaient un débouché où aucune concurrence intérieure ou extérieure n'était admise, autrement dit, à un régime de tutelle économique adapté à la petite industrie, a succédé, au moins dans une certaine mesure, un régime de liberté [255] adapté à la grande. Dans ce nouvel ordre de choses, le premier venu peut fonder une entreprise avec ou sans associés, avec un capital suffisant ou insuffisant, employer les outils, les machines et les procédés qu'il juge les meilleurs, diriger ses affaires à sa guise; de même, les capitalistes peuvent donner à leurs fonds la destination qu'ils jugent la plus avantageuse et les ouvriers porter leur travail où bon leur semble. Les avantages de ce régime de liberté de la production sautent à tous les yeux. En permettant à tous les membres du personnel de l'industrie, entrepreneurs, capitalistes et ouvriers, d'appliquer leur facultés et leurs ressources à la destination qui leur paraît la plus profitable, comme aussi en les exposant à une concurrence qui les oblige à recourir aux procédés de production les plus économiques et à déployer toutes les qualités qu'exige la lutte pour l'existence, la liberté de l'industrie favorise au plus haut degré la multiplication de la richesse. — S'agit-il de la distribution? Au régime de la fixation du prix des choses, du taux de l'intérêt et des salaires par la décision arbitraire d'une des parties, investie d'un monopole de fait ou de droit, décision toujours imparfaitement tempérée par la coutume ou la loi, et qui, dans le cas de l'esclavage ou du servage, ne laissait le plus souvent au travailleur que le strict nécessaire, a succédé un régime de liberté qui permet aux parties en présence, vendeur et acheteur, prêteur et emprunteur, entrepreneur et ouvrier, de débattre à leur gré les prix de la plupart des produits et des services. Grâce à ce régime de liberté de l'offre et de la demande, produits et services peuvent recevoir la rétribution la plus équitable. — S'agit-il de la consommation? Au régime qui plaçait la multitude asservie sous l'autorité d'un maître investi du pouvoir de régler à sa guise, suivant l'impulsion de son intérêt bien ou mal entendu, la pitance et la reproduction [256] de son troupeau d'esclaves ou de serfs; qui soumettait les classes supérieures à une tutelle étendue à tous les actes de leur existence, qui subordonnait le mariage au consentement arbitraire d'une autorité temporelle ou spirituelle, et le prohibait en dehors du culte ou de la caste, a succédé un régime de liberté presque entière de la consommation et de la reproduction. Chacun peut désormais gouverner à sa guise sa vie aussi bien que ses affaires, et, en admettant que ce self government soit ce qu'il doit être, au double point de vue de l'intérêt de la société et de l'individu, il est une source de jouissances plus nombreuses et plus élevées que celles que l'on peut trouver sous la tutelle la plus éclairée et la meilleure.
Multiplication plus rapide et plus ample de la richesse, distribution plus équitable, consommation plus féconde en jouissances, tels sont les avantages qui découlent du self government. Seulement, ils n'en sont point les conséquences nécessaires; ils n'en sont que les conséquences possibles. Ils ne se produisent qu'à la condition que ceux qui possèdent le self government soient capables de le pratiquer. Or, l'expérience atteste que la capacité nécessaire au bon gouvernement des affaires et de la vie est loin d'être aussi répandue qu'on se l'était imaginé au début de ce régime. Ce gouvernement est presque toujours insuffisant, imparfait et trop souvent vicieux. Son insuffisance, son imperfection et ses vices sont incessamment productifs de nuisances; celles-ci se sont même multipliées au point de compenser en partie les avantages du self government, et qui sait? de rendre, dans certains cas, indispensable le rétablissement de l'ancienne tutelle en l'adaptant aux nouvelles conditions d'existence des sociétés.
Nous avons déjà, dans un chapitre précédent, analysé ces nuisances, dont le débordement a provoqué la réaction [257] du socialisme et du gouvernementalisme contre le self government et la concurrence. Nous reviendrons seulement sur les principales en essayant de les rattacher à leurs causes.
I. Nuisances de la production. — La fondation de toute entreprise, grande ou petite, qu'il s'agisse d'une manufacture, d'une mine, d'un chemin de fer, d'un magasin d'épiceries ou d'un atelier de coiffure, cause une perturbation inévitable. L'individu ou le groupe qui fonde une entreprise a en vue de réaliser un profit supérieur ou tout au moins équivalent aux profits ordinaires de l'industrie. Ce profit, il ne peut l'obtenir qu'à la condition que le supplément de produits ou de services que son entreprise va mettre au marché y comble un vide ou une insuffisance de production, ou bien encore qu'il agrandisse le marché par l'abaissement des frais de la production ou par une amélioration de la qualité des produits. Dans le premier cas, en supposant que l'apport de ce supplément comble simplement l'insuffisance de l'approvisionnement, l'entreprise nouvelle obtiendra un profit rémunérateur tout en faisant baisser les bénéfices des autres entreprises au niveau des siens. Dans le second cas, elle réalisera des profits extraordinaires jusqu'à ce que les autres aient imité les progrès auxquels elle est redevable de sa fortune; toutes seront réduites alors aux profits ordinaires, c'est-à-dire à la rémunération strictement nécessaire au travail et au capital engagés dans cette branche de la production. Survient, sur ces entrefaites, un nouvel entrepreneur, qui, soit mauvais calcul, soit confiance dans sa supériorité industrielle, vient mettre au marché un second supplément de produits ou de services sans en abaisser les frais de production. Le marché se trouvant déjà suffisamment pourvu, l'apport de cette quantité surabondante [258] fait baisser les prix de la totalité du stock et, avec eux, les profits de l'ensemble des entrepreneurs; ces profits tombent au-dessous du taux rémunérateur. La perturbation va naturellement en s'aggravant s'il survient une troisième entreprise, puis une quatrième. L'avilissement des prix provoque, à la vérité, un accroissement de la consommation, accroissement qui est plus ou moins grand selon la nature de la marchandise, mais qui ne suffit point pour relever les prix de manière à reconstituer les profits ordinaires et nécessaires. Que se passe-t-il alors? S'il y a vingt-cinq entreprises où vingt suffisent, cinq devront disparaître et disparaîtront après une période plus ou moins longue de crise et de souffrances communes. Les plus faibles, les plus mal constituées, dirigées et desservies succomberont, en sorte qu'en fin de compte l'industrie, après avoir traversé la crise provoquée par l'excès de la concurrence, se trouvera plus forte qu'elle n'était auparavant. La concurrence est le véhicule de la sélection industrielle, et la nuisance accidentelle et temporaire que causent ses erreurs et ses excès est peu de chose en comparaison du bien permanent qui résulte de cette sélection progressive.
Toutefois, il arrive, dans cette lutte pour l'existence, que quelques-uns des concurrents aient recours à des procédés déloyaux et nuisibles pour s'emparer du marché, au détriment de leurs rivaux; qu'ils falsifient leurs denrées, par exemple, afin d'attirer les acheteurs par l'apparence d'une réduction de prix. Si les acheteurs sont incapables de découvrir la fraude, s'ils ne savent pas distinguer la mauvaise marchandise de la bonne, tous les concurrents seront obligés d'imiter cette pratique malhonnête, la fraude agissant exactement comme une machine ou un procédé qui abaisse les frais de production. De là, une nuisance qui démoralise les [259] producteurs en portant un préjudice matériel aux consommateurs.
L'instabilité des marchés de consommation est une autre source de nuisances. Cette instabilité provient de plusieurs causes.
La capacité des marchés de consommation de la multitude des produits et des services que la production y apporte est déterminée : 1° par les besoins et les habitudes des consommateurs; 2° par leurs ressources; 3° par le prix des produits et des services. Dans les circonstances ordinaires, les besoins et les ressources des consommateurs, aussi bien que le prix des produits, ne se modifient qu'avec lenteur et d'une manière presque insensible. Toutefois, ils sont exposés à des accidents naturels ou artificiels qui jettent la perturbation dans le marché. Telles sont, en premier lieu, les inégalités des récoltes des denrées nécessaires à la vie. Quand il y a disette, la masse des consommateurs, obligée de consacrer une portion plus considérable de son revenu à l'achat de ses aliments, ne peut appliquer une somme aussi forte aux produits ou aux services de luxe et de confort ou bien encore à l'épargne. A la vérité, les producteurs de denrées alimentaires dont le revenu s'est accru — car les prix s'augmentent toujours dans une proportion supérieure à la diminution des quantités — peuvent acheter et épargner davantage, ce qui rétablirait à peu près l'équilibre si les uns et les autres s'approvisionnaient au même marché, mais il n'en est pas ainsi : le supplément d'aliments nécessaire pour combler le vide causé par l'insuffisance de la récolte vient ordinairement de contrées éloignées, où la demande des articles de luxe et de confort ainsi que l'épargne croissent, tandis qu'on les voit diminuer dans les pays où sévit la disette. En second lieu, les guerres et les perpétuels changements dans les tarifs douaniers jettent, [260] de même, la perturbation dans les marchés de consommation, élargissant brusquement ceux-ci, rétrécissant ceux-là et rendant précaire la situation de toutes les branches de travail qui en dépendent. En troisième lieu, le progrès qui abaisse les prix de certains articles de consommation, en augmente le débouché aux dépens d'autres articles; tel a été, notamment, l'effet des progrès de la fabrication des cotonnades qui ont remplacé, en partie, la toile et les lainages; tel a été aussi l'effet de la propagation du goût du sucre, du tabac, des boissons spiritueuses, des vêtements de luxe, dont la consommation a empiété sur celle de denrées ou de services souvent plus utiles ou moins nuisibles. Mais, dans ce cas, le changement est lent, et, d'ailleurs, le progrès général de la richesse, en agrandissant l'ensemble des débouchés, compense les déperditions partielles qui s'y produisent et empêche la modification survenue dans l'assiette de la consommation de jeter le trouble dans la production.
Ces différentes causes de perturbation, les unes naturelles, les autres artificielles, sont un des facteurs des crises qui viennent bouleverser périodiquement le monde des affaires sous le nouveau régime de la liberté industrielle et commerciale, mais elles n'en sont point le facteur le plus important. Il y en a un autre, qui agit d'une manière générale et continue, et qui consiste dans l'insuffisance morale et professionnelle du personnel de la production. Sur un millier d'entreprises, entre lesquelles se partage une industrie, on en compte tout au plus une centaine dont la gestion et la mise en œuvre puissent être considérées comme bonnes, bien peu sont excellentes, et il n'en est point d'absolument irréprochables. Quant aux neuf cents autres, elles forment une série descendante du passable au mauvais. Ces vices de la pratique industrielle ne manquent pas de porter leurs fruits. Les entreprises [261] mal constituées, mal dirigées et desservies s'affaiblissent, leur existence devient précaire, elles finissent par vivre d'expédients et un moment arrive où, à bout de ressources et de crédit, elles succombent. Une chute alors en entraîne une autre : c'est la crise. Les entreprises viciées disparaissent, et d'autres prennent la place qu'elles ont laissée vacante. Seulement, la même cause qui a déterminé cet effondrement, savoir l'insuffisance du personnel, continuant de subsister, elle continue aussi à produire les mêmes effets. De là, le phénomène de la périodicité des crises. Cependant, cette périodicité n'a rien d'immuable. Si un progrès survenait dans la pratique industrielle, si les entreprises venaient à être mieux constituées, gérées et desservies, si, d'un autre côté, les causes accidentelles qui se joignent à cette cause permanente de perturbation se faisaient moins sentir, on verrait s'allonger la périodicité des crises : de dix ans environ, sa durée actuelle, elle serait portée à quinze ans et davantage.[28]
[262]
Sous l'ancien régime des corporations fermées et des marchés appropriés, les crises étaient presque inconnues; en tous cas, la séparation et l'isolement des marchés les empêchaient de se propager et de se généraliser. La capacité du personnel de la production était alors, à bien des égards, moindre qu'elle ne l'est aujourd'hui, mais ce personnel était adapté de longue main à la petite industrie, tandis que le nôtre en est encore à faire son apprentissage de la grande. D'ailleurs, des entreprises en nombre limité, desservant un marché de consommation toujours le même, suivant dans leur constitution, leur gestion et leurs procédés une routine consacrée par les siècles — et dont il était interdit, non sans raison, de s'écarter, car elle consistait dans l'ensemble des pratiques que l'observation et l'expérience avaient fait reconnaître comme les mieux adaptées à l'état de l'industrie et aux circonstances ambiantes des entreprises placées sous ce régime de tutelle — se trouvaient presque entièrement à l'abri des crises qui atteignent maintenant l'industrie libre. Elles jouissaient d'une stabilité qui a cessé d'exister. Seulement, cette stabilité que procuraient la limitation et la tutelle des entreprises, jointes à l'appropriation des marchés, était acquise aux dépens du progrès. Le problème à résoudre consiste à la rétablir, sans nuire au progrès, sous le régime des entreprises libres et des marchés de concurrence.
II. Nuisances de la distribution. —Si de la production nous passons à la distribution de la richesse, nous devrons constater que la substitution, accomplie généralement par les procédés violents ou tout au moins incorrects, du régime de la liberté à celui de la tutelle, n'a pas engendré [163] de moindres nuisances. La richesse produite par l'industrie progressive et distribuée sous forme de revenus, entre les différents coopérateurs de la production, capitalistes et travailleurs, est devenue incomparablement plus grande, mais les inégalités de sa distribution sont devenues aussi, sinon plus marquées, du moins plus variables : les revenus pris dans leur ensemble sont plus élevés, mais ils ne sont guère moins inégaux, parfois même ils le sont davantage, et ils sont moins stables. Sous l'ancien régime, le partage de la richesse produite était influencé sinon déterminé, à défaut de la concurrence, par les institutions et les coutumes. En premier lieu, celles-ci intervenaient dans le règlement des prix, c'est-à-dire de la somme que les producteurs étaient autorisés à demander aux consommateurs pour rétribuer leurs services : l'évaluation de cette somme était le fruit de l'observation et de l'expérience qui avaient créé les institutions et les coutumes. En second lieu, elles intervenaient encore pour déterminer le partage utile de cette même somme, ou, s'il n'y avait pas eu d'échange, le partage des fruits de la production entre ses coopérateurs, et il n'était aucune branche du domaine du travail qui échappât entièrement à leur action régulatrice. Sans doute, l'esclave était à la merci du maître, sa condition ne différait pas de celle des autres bêtes de somme, mais l'expérience n'avait pas manqué de faire connaître la quantité de travail quotidien qu'on pouvait lui demander sans altérer sa constitution et amoindrir ses forces, en même temps que la somme d'entretien qui lui était nécessaire; or, comme les propriétaires avaient intérêt à conserver en bon état leurs troupeaux d'esclaves, le régime de travail et d'entretien le plus utile avait fini par prévaloir, et l'opinion condamnait les mauvais propriétaires qui s'écartaient de ce régime coutumier, de même qu'elle condamnait tous ceux qui ne suivaient point les [264] pratiques considérées, de génération en génération, comme les meilleures en toute matière. La coutume déterminait aussi la somme de redevances et de services qui pouvait être utilement exigée du serf ou du colon, avec la somme de protection et de tutelle qui lui était nécessaire, et comme l'état de la production et des débouchés agricoles demeurait presque immuable, la coutume restait la même ou ne changeait qu'insensiblement dans le cours des siècles. Enfin, la coutume réglait les rapports des entrepreneurs réunis en corporations et des ouvriers réunis en confréries ou en sociétés de compagnonnage. Elle déterminait la durée de la journée de l'ouvrier, la nature et l'étendue des obligations auxquelles il était assujetti, le taux et le mode de sa rétribution. Et comment cette coutume tutélaire s'était-elle créée et établie? Par l'observation et l'expérience des conditions nécessaires, non seulement pour entretenir l'ouvrier en bon état, mais encore pour assurer le renouvellement, dans la proportion et la qualité utiles, du personnel auxiliaire de la production, à une époque et dans des marchés où la difficulté des communications et la coutume elle-même s'opposaient à ce que l'industrie recrutât son personnel au dehors. Ce qui prouve que l'observation et l'expérience sur lesquelles se fondait la coutume ne s'écartaient point trop de la justice, c'est qu'on ne rencontre guère qu'à l'état d'exception, sous l'ancien régime, l'hostilité du maître et de l'esclave ou du serf, du propriétaire de maîtrise et du compagnon; en d'autres termes, l'antagonisme du capital et du travail qui est devenu le trait caractéristique du nouveau régime.
La grande industrie et la liberté du travail ont mis fin au règne de la coutume; elles l'ont remplacée par un régulateur infiniment plus parfait qui est la concurrence. Malheureusement, des causes diverses ont agi pour entraver le fonctionnement de ce régulateur dans la [265] distribution de la richesse en général et dans le règlement des salaires en particulier.
La concurrence ne peut exercer utilement l'office de régulateur qu'à la condition d'être illimitée. Or, combien il existe encore de marchés dans lesquels elle est restreinte d'un côté ou d'un autre, où l'offre est limitée par des obstacles, soit naturels soit artificiels, en présence d'une demande sans limites et vice versa, où, par conséquent, les prix des produits ne pouvant se fixer à leur taux nécessaire, la rétribution des producteurs est surabondante ou demeure insuffisante! Ce qui se passe pour la fixation des prix des produits et la rétribution des producteurs se passe aussi pour le partage de cette rétribution entre les coopérateurs de la production : le capital et le travail.
Dans les industries libres, qui ont pris la place des industries incorporées, sous l'influence des inventions et des découvertes que nous avons précédemment signalées, aucune coutume ne réglait plus les rapports des entrepreneurs et des ouvriers. Ces rapports se trouvaient abandonnés aux convenances des deux parties et le salaire était réglé à la suite d'un débat libre, ou réputé tel, qui s'établissait entre elles. Mais leur situation respective était, surtout au début de la nouvelle ère industrielle, singulièrement inégale. Soit qu'on le considérât dans le temps ou dans l'espace, le marché de l'entrepreneur était plus étendu que celui de l'ouvrier. L'entrepreneur pouvait se passer plus longtemps du travail de l'ouvrier que celui-ci ne pouvait se passer du salaire de l'entrepreneur, d'où il résultait que le premier pouvait contenir ou limiter sa demande dans le temps tandis que le second se trouvait dans l'impossibilité de réserver son offre. Dans l'espace, le marché de l'ouvrier était plus restreint encore. Le défaut de ressources et d'informations, joint à la difficulté des communications, l'empêchait de se déplacer, [266] tandis que l'entrepreneur pouvait, en cas de nécessité, se procurer du travail sur d'autres marchés. En outre, les chefs d'industrie possédant une influence politique supérieure à celle de leurs humbles auxiliaires, ils en usaient pour faire prohiber la sortie des ouvriers, interdire les coalitions et les grèves, etc., etc. La conséquence de cette inégalité d'étendue des deux marchés, dans le temps et dans l'espace, a été que l'entrepreneur a pu élever au maximum la durée du travail qu'il exigeait de l'ouvrier et abaisser au mininum le taux du salaire qu'il lui fournissait en échange.[29] Ajoutons qu'aucune considération tirée [267] de son intérêt n'intervenait plus pour l'empêcher d'abuser du pouvoir que lui conférait la supériorité de sa situation. La classe ouvrière, affranchie de toute tutelle en matière de reproduction, était devenue extraordinairement prolifique. On n'avait donc aucune raison de ménager ses forces, car la mine de travail que la liberté avait ouverte semblait inépuisable. Enfin, l'avilissement des salaires, en abaissant les frais de la production, s'imposait comme s'était imposée la falsification des denrées, et il apparaissait comme une nécessité ou une fatalité du régime de la concurrence. Mais que résultait-il de cette nuisance? D'abord que la classe ouvrière surmenée subissait, dans les principaux foyers d'industrie, une véritable dégénérescence physique et morale, et que le travail baissait en qualité, sinon encore en quantité. Ensuite, qu'un sentiment d'hostilité à l'égard des entrepreneurs d'industrie se créait et grandissait rapidement parmi les ouvriers. Dans leur ignorance, ils rendaient la concurrence et le régime du salariat responsables d'un mal dont ils étaient [268] incapables d'analyser les causes, et ils se laissaient séduire par les panacées du socialisme. Cependant, à mesure que les moyens de communication se sont multipliés et perfectionnés, le marché de l'ouvrier s'est agrandi dans l'espace, et, dans les pays où les habitudes de prévoyance et l'esprit d'épargne commencent à se généraliser, ce marché s'agrandit aussi dans le temps; enfin, les lois sur les coalitions, les grèves, l'émigration qui retenaient l'ouvrier dans un état de demiservitude, sans lui accorder en échange les garanties que la servitude comporte, ont été abrogées ou modifiées, tandis que d'autres lois limitaient l'abus du travail des enfants et des femmes; mais ces remèdes, inégalement efficaces, ont simplement atténué la nuisance causée par l'inégalité originaire des deux marchés et ils n'ont pas suffi pour rétablir l'harmonie entre le capital et le travail.
III. Nuisances de la consommation. — Aux nuisances dont le self government, appliqué d'une manière imparfaite ou vicieuse, a été la source dans la production et la distribution de la richesse, viennent s'ajouter celles de la consommation.
La production, dans la multitude de ses branches, fournit la masse des moyens d'existence qui se distribuent entre ses coopérateurs et constituent leurs revenus. Tous les membres de la société vivent d'un revenu provenant, soit de leurs capitaux, soit de leur travail, à la seule exception de ceux qui vivent sur le revenu d'autrui. Mais, en ce cas encore, c'est le revenu qu'ils tirent d'une sinécure, de la charité publique ou privée, du vol ou du brigandage qui leur procure les moyens de subsister. La consommation se résout dans l'emploi du revenu; elle ne joue pas, dans l'économie des sociétés, un moindre rôle [269] que la production, et il n'est pas plus facile d'employer utilement un revenu que de le créer.
Nous avons analysé précédemment les différentes obligations auxquelles le revenu doit pourvoir. Elles concernent l'individu lui-même, les êtres dont il est responsable et la société dont il est membre. Si elles ne sont point remplies dans la mesure où elles doivent l'être, il en résulte des nuisances privées ou publiques, lesquelles d'ailleurs se répercutent les unes sur les autres. Elles dérivent, comme nous l'avons remarqué, de la nature de l'homme et de la société. L'homme n'a qu'une existence limitée dans le temps, et une partie de sa vie, l'enfance, l'extrême vieillesse, auxquelles s'ajoutent des périodes variables de maladies et de chômages, est improductive. Il faut donc qu'il divise son revenu en deux parts : l'une destinée à la consommation actuelle, l'autre épargnée pour la consommation à venir. La première doit être aménagée et dépensée de manière à satisfaire à toutes ses obligations envers lui-même, envers les siens et envers la société; la seconde doit être calculée en vue de lui permettre de remplir encore ces mêmes obligations lorsque ses facultés productives viennent à s'affaiblir ou à lui faire défaut. Avant tout, il doit s'abstenir de toute consommation de nature à diminuer sa capacité à se créer un revenu, il doit éviter tout excès qui affaiblisse le corps ou l'esprit, l'abus des liqueurs fortes, des plaisirs énervants, etc. Il doit encore, en fondant une famille, pourvoir à l'entretien et à l'éducation des êtres qu'il appelle à la vie, de manière à les mettre en état de se créer à leur tour des moyens d'existence. Il doit enfin remplir ses obligations envers la société en s'acquittant de sa part d'impôts ou en fournissant sa part de services au gouvernement et de secours à ses semblables. Voilà en quoi consiste l'emploi ou la consommation utile du revenu. Tout [270] manquement à ces obligations si nombreuses, si diverses, et parfois si difficiles à remplir dans la mesure où elles doivent l'être, cause des nuisances, et ces nuisances, en se multipliant et en s'accumulant, affaiblissent l'individu, détériorent la race et contribuent plus encore que celles de la production et de la distribution à amener la ruine et la dissolution des sociétés.
Mais l'homme est un être naturellement ignorant, passionné et imprévoyant. Il possède rarement, dans une mesure suffisante, l'intelligence, les lumières et la force morales nécessaires pour gouverner utilement sa consommation. Il est donc continuellement exposé à commettre des manquements, des erreurs, des fautes, qui se traduisent en des nuisances pour lui-même et pour autrui. De là, la nécessité d'une tutelle qui supplée à son défaut d'esprit de conduite et de moralité. Nous avons vu comment cette tutelle s'était établie et organisée dans le passé; comment les manquements aux obligations, qui doivent être remplies sous peine de nuisances, étaient prévenus au moyen d'une série et d'un agencement de freins physiques et moraux; comment les institutions politiques, civiles et pénales d'une part; comment la coutume formée par les observations et l'expérience capitalisées des générations antérieures; comment l'opinion de la génération présente; enfin, comment la loi religieuse s'unissaient pour empêcher la production des nuisances, suppléant ainsi à l'insuffisance de la capacité et de la moralité individuelles au sein des classes dominantes; comment, dans les couches inférieures des sociétés, la servitude prévenait, par des procédés plus rudes mais encore plus efficaces, ces mêmes nuisances.
Les freins et la tutelle, qui suppléaient à l'imperfection du self government individuel dans les classes dominantes, se sont, pour la plupart, affaiblis; la servitude a [271] été abolie. Qu'en est-il résulté? L'expérience a-t-elle démontré que cette machinery préventive ou répressive des nuisances était superflue, que l'individu émancipé possédait la capacité physique, intellectuelle et morale nécessaire, non seulement pour se créer un revenu qui pût suffire à l'accomplissement de toutes ses obligations, mais encore pour gouverner l'emploi de ce revenu sans nuire à lui et aux autres? Non, tel n'a pas été, comme chacun sait, le résultat de l'affaiblissement des freins répressifs et de la diminution de la tutelle dans les classes supérieures, de l'abolition de la servitude dans les classes et dans les races inférieures. Cette expérience a démontré, au contraire, qu'à l'exception d'une faible minorité, ni les unes ni les autres ne possèdent la capacité requise pour un entier self government; elle a démontré encore que l'avènement de la grande industrie, en élargissant l'assiette de la production et en la rendant à la fois plus féconde et moins stable, avait augmenté la difficulté de bien employer son revenu en même temps que celle de le créer.
Dans les couches supérieures de la société, l'insuffisance du self government en matière de consommation est, sans aucun doute, moindre que dans les couches inférieures. Mais on ne saurait nier qu'elle existe. Bien peu d'hommes, même dans la fraction la plus aisée, la plus éclairée et la plus morale de la population, font de leur revenu un emploi complètement utile; bien peu remplissent, comme elles doivent l'être, toutes leurs obligations envers eux-mêmes et envers autrui. Les uns s'affaiblissent physiquement et se dégradent moralement par le mauvais choix et l'abus des plaisirs; ils contractent des unions fondées sur l'intérêt et donnent le jour à des enfants malsains ou vicieux, dont ils sont incapables d'ailleurs de diriger l'éducation, et qu'ils pervertissent par le [272] spectacle de leurs vices; ils se montrent insensibles aux souffrances et aux misères de leurs semblables. Les autres ne se bornent pas à mal employer leur revenu, ils dissipent leur capital. Ces manières d'agir nuisibles amènent fatalement la décadence et la destruction des familles des classes supérieures, en exerçant en outre, sur les autres, la nuisance contagieuse du mauvais exemple.
Comment le gouvernement de la consommation ne serait-il pas plus imparfait encore et plus vicieux dans les classes inférieures? C'est à peine si la somme du revenu y suffit à l'accomplissement des obligations de l'individu envers lui-même, les siens et la société. Le plus souvent les nuisances de la production et de la distribution réduisent ce revenu au strict nécessaire, c'est-à-dire au minimum indispensable à l'individu pour remplir ses obligations diverses, en admettant que son aptitude à gouverner sa consommation soit aussi parfaite que possible, parfois même il tombe au-dessous du strict nécessaire. Dans ces conditions, on conçoit que l'aménagement utile du revenu soit particulièrement difficile, car les privations qu'il faut s'imposer pour faire la part de chaque obligation sont plus rudes, la police qu'il faut exercer sur soi-même doit être plus sévère, l'équilibre entre la recette et la dépense pouvant être rompu au moindre excès. Le gouvernement utile de la consommation exige donc une plus forte dose de moralité et d'énergie. Or, c'est précisément dans les couches inférieures de la société que l'on rencontre le moins de capacité gouvernante. La tutelle impliquée dans la servitude, ayant cessé d'y suppléer, qu'est-il arrivé? C'est que les classes émancipées se sont montrées moins capables encore de bien employer leur revenu que de l'acquérir; c'est qu'elles ont laissé en souffrance la plupart des obligations entre lesquelles se partage la consommation utile. Généralement dépourvu de prévoyance, [273] l'ouvrier ne se préoccupe que des besoins du jour, il ne met rien en réserve pour les maladies, les chômages, la vieillesse. Sa consommation alimentaire est viciée par l'abus des liqueurs fortes; le cabaret lui enlève le plus clair de ses ressources, tout en altérant sa constitution physique et morale. Il se marie et met des enfants au monde sans avoir la moindre idée des obligations qu'impose la formation d'une famille. Faute de moyens suffisants pour entretenir sa femme, élever ses enfants et leur donner l'éducation nécessaire, il oblige l'une à abandonner le ménage pour l'atelier; il condamne les autres à un travail prématuré et dépassant leurs forces. Au lieu d'un père, ils trouvent en lui, trop souvent, un maître ivrogne et fainéant qui les exploite comme des esclaves, sans avoir même pour eux les soins d'un propriétaire intelligent pour son troupeau humain. Ceux qui arrivent à l'âge d'homme, affaiblis par un travail hâtif, le manque de soins et des habitudes précoces de débauche, prises dans un milieu vicié, valent moins que leurs pères : écrémée d'ailleurs par l'impôt du sang, qui enlève la fleur de chaque génération, la classe ouvrière va s'affaiblissant et se gâtant, même sous le rapport professionnel; les bons ouvriers deviennent de plus en plus rares. Comme les sauvages, ils ont emprunté d'abord les vices de la civilisation; le contact des classes civilisées, en l'absence d'un appareil de tutelle, leur a été funeste, et il l'a été d'autant plus que ce contact était plus fréquent et plus proche. Aucune classe ne s'est plus gâtée que celle des domestiques sous le régime du self government.
L'agrandissement du milieu où vivait la masse du peuple a contribué, autant que l'abolition de la servitude et l'affaiblissement de la plupart des freins qui la contenaient, à multiplier les nuisances de sa consommation. Sous l'ancien régime, la classe ouvrière était immobilisée, ici dans [274] un domaine seigneurial, là dans le marché d'une corporation. Comme le milieu où elle vivait et se perpétuait était naturellement resserré, comme on ne pouvait en changer qu'avec une extrême difficulté, l'action des freins préventifs ou répressifs des nuisances y avait une pleine efficacité. Nul ne pouvait impunément désobéir aux injonctions de la coutume et de la religion, s'affranchir des obligations de la tutelle seigneuriale ou corporative, ni se soustraire à la censure de l'opinion. Un acte nuisible, ou réputé tel, ne demeurait pas longtemps ignoré dans le petit cercle où s'écoulait, de génération en génération, l'existence de chacun, et comment aurait-on échappé à la pénalité physique ou morale qu'infligeait, en pareil cas, l'autorité temporelle ou spirituelle, ou simplement l'opinion? L'esclave ou le serf ne pouvait fuir le domaine où il avait ses moyens d'existence, à moins d'aller mener dans les bois l'existence d'une bête fauve; le compagnon ne pouvait trouver du travail hors des limites du marché de la corporation à laquelle il était attaché ou de la société de compagnonnage à laquelle il était affilié. Avec l'avènement de la grande industrie et de la liberté du travail, cette situation a complètement changé. Le milieu où vivait la masse du peuple s'est successivement élargi et les déplacements sont devenus de plus en plus faciles. L'action des freins préventifs ou répressifs des nuisances s'est trouvée ainsi singulièrement affaiblie. Dans les communes agricoles, par exemple, où les freins de la religion, de la coutume et de l'opinion se sont conservés intacts plus longtemps qu'ailleurs, l'individu qui commet une faute ou un manquement à ses obligations peut désormais aisément se soustraire à la déconsidération publique, en allant se perdre dans la foule d'une grande ville. Dans ces énormes foyers de population, comment les freins moraux pourraient-ils agir d'une manière efficace? Venus de tous les [275] points de l'horizon, sans lien qui les rattache, travaillant aujourd'hui dans un atelier, demain dans un autre, les ouvriers des villes ne peuvent contrôler mutuellement leurs actes, et l'opinion qui se forme à l'atelier et au cabaret, leurs seuls lieux de réunion, ne vise guère que leurs relations avec les entrepreneurs d'industrie. Cette opinion est naturellement ignorante et passionnée; elle agit comme un excitant à commettre des nuisances plutôt que comme un frein pour les réprimer. La foi religieuse s'est affaiblie quand elle ne s'est pas éteinte, et aucun autre frein moral n'a encore pris sa place. La répression pénale à peu près seule est demeurée debout, mais elle n'atteint que le petit nombre des nuisances énumérées dans le Code, et elle est demeurée, même dans les pays les plus avancés, imparfaite et incertaine.
Maintenant, si l'on considère, dans sa généralité, l'influence délétère de cette multitude de nuisances combinées de la production, de la distribution et de la consommation, devra-t-on s'étonner si la condition de la société ne s'est point améliorée dans la proportion de l'augmentation de la puissance productive de l'homme, depuis l'avènement de la grande industrie?
Les sociétés qui vivaient de la petite industrie étaient pauvres en comparaison des nôtres, mais leurs membres possédaient, à un plus haut degré que nous, la stabilité des moyens d'existence. Ceux qui appartenaient aux classes dominantes ou libres en étaient redevables au régime des corporations fermées et des marchés appropriés, où chacun exerçait héréditairement la même fonction ou la même industrie avec un ressort ou un débouché immuable. Dans les couches sociales inférieures, la stabilité était le produit de la servitude qui assurait l'existence de l'esclave ou du serf en l'attachant à la glèbe. La grande industrie et la concurrence ont multiplié la richesse, mais [276] aux dépens de la stabilité. Il n'y a plus de fonctions héréditaires, et, à l'exception des monopoles, il n'y a plus de marchés appropriés. Toutes les situations sont devenues plus ou moins précaires. Toutes les entreprises, avec le personnel dont les moyens d'existence en dépendent, sont exposées à succomber dans le struggle for life. D'un autre côté, l'effondrement ou l'affaiblissement de l'antique appareil de tutelle, qui suppléait à l'insuffisance de la capacité de chacun à gouverner ses affaires et sa vie, a causé une énorme déperdition de forces et de richesses, et, dans les classes émancipées de la servitude, en particulier, une rupture presque générale de la balance des recettes et des dépenses. Quoique la masse des revenus se soit énormément accrue, quoique les salaires des classes ouvrières, en dépit des nuisances de la production et de la répartition, représentent une somme de moyens d'existence bien supérieure à celle des esclaves ou des serfs de l'ancien régime, ces moyens d'existence accrus sont cependant demeurés insuffisants, et il a fallu les compléter à l'aide des ressources de la charité publique ou privée. Dans les sociétés où l'accroissement de la richesse a été le plus ample et le plus rapide, des millions d'hommes ne réussissent pas à couvrir entièrement eux-mêmes leurs frais d'existence. Ils vivent, les uns en partie, les autres en totalité, aux dépens d'autrui. C'est là évidemment un état de choses anormal. Si, dans des sociétés et à des époques où la production de la richesse était infiniment moins abondante qu'elle ne l'est devenue depuis l'avènement de la grande industrie, la généralité de la population réussissait à équilibrer sa dépense avec sa recette, n'en devraitil pas être ainsi, à plus forte raison, aujourd'hui? Puisque le nombre et la quotité des revenus se sont accrus, même dans les couches les plus basses de la société, le déficit, au lieu de s'étendre, n'aurait-il pas dû se resserrer et s'amoindrir [277] de jour en jour? S'il en a été autrement, si le paupérisme a débordé en même temps que la richesse s'est multipliée, qu'en faut-il conclure? N'est-ce pas que l'insuffisance de la capacité nécessaire au self government de la production, de la distribution et de la consommation a compensé en partie les bienfaits du progrès de l'industrie?
Cette insuffisance de la capacité requise pour le gouvernement des affaires et de la vie existait sans doute dans les sociétés de l'ancien régime, elle était même plus grande alors qu'elle ne l'est de nos jours, car les lumières de toute sorte étaient moins répandues, mais il y était suppléé par un appareil de tutelle qui a fini par s'user et se détraquer, et dont les restes ne sont plus adaptés au régime de la grande industrie et de la concurrence. Cependant, cet appareil se transforme à son tour pour s'approprier aux nouvelles conditions d'existence des sociétés, mais sa transformation est laborieuse et lente. En attendant, nous souffrons à la fois des maux que causent des institutions qui ont cessé d'être adaptées à l'état présent des choses et des hommes, et de l'absence ou de l'insuffisance de celles qui doivent prendre leur place.
II. — Que la société réagit naturellement contre les nuisances qui la menacent. — Défaut de l'ancien appareil préventif ou répressif des nuisances. Son immobilité tandis que la société s'éclairait et se transformait. — Réaction de l'opinion contre les obstacles qu'il opposait au progrès. — Démolition de cet appareil devenu suranné. — Réaction provoquée par les excès, l'ignorance et la maladresse des démolisseurs. — Tendance à restreindre le self government. — État actuel de la machinery du gouvernement de l'homme et de la société. — La religion. — L'opinion. — La répression pénale des nuisances intérieures et extérieures. — La tutelle. — Diminution ou affaiblissement de la tutelle privée. — Extension de la tutelle publique. — Applications diverses de la tutelle publique. — Insuffisance de la machinery du gouvernement de l'homme et de la société à l'époque actuelle et nécessité de cette machinery.
Comme tous les autres organismes vivants, la société réagit incessamment contre les causes qui travaillent à [278] sa destruction. L'ancienne machinery préventive ou répressive des nuisances sociales ayant cessé d'être adaptée à l'état économique qui est issu de l'avènement de la grande industrie, elle s'est appliquée aussitôt à la réformer et à lui substituer une machinery appropriée à cet état nouveau. C'était à la fois une œuvre de démolition et de reconstruction. Les institutions et les coutumes des sociétés fondées sur la petite industrie avaient eu en vue d'écarter en toutes choses les manières d'agir nuisibles, de consacrer et de faire prévaloir les manières d'agir réputées les plus utiles; mais elles ne tenaient pas compte des changements que le progrès des éléments, des instruments et des méthodes constituant le matériel de l'industrie humaine pouvait rendre nécessaires. Elles ne tenaient pas compte non plus de l'élévation graduelle du niveau intellectuel et moral du personnel, élévation qui nécessitait de même une modification correspondante de l'appareil répressif et une diminution de la tutelle. Ces changements étaient du ressort de l'opinion. Or, celle-ci a obéi de tous temps à deux tendances opposées, qui ont leur origine dans la nature des esprits et des intérêts : savoir une tendance conservatrice ou même rétrograde et une tendance progressive. La première devait naturellement l'emporter sur la seconde dans des sociétés dont le caractère dominant était la tutelle. Les progrès du matériel, aussi bien que l'élévation du niveau du personnel, provoquaient des perturbations et amenaient dans l'outillage de l'industrie et dans la discipline sociale des changements qui causaient un dommage, ou tout au moins un dérangement temporaire aux classes possédantes et dirigeantes. Ajoutons qu'il n'était pas toujours facile de distinguer les innovations utiles des utopies nuisibles. On conçoit donc que les classes dominantes se protégeassent contre les nuisances du progrès et que celui-ci s'en trouvât [279] retardé. Les règlements des corporations prohibaient l'emploi des méthodes et des machines nouvelles; les institutions politiques, civiles et religieuses ne se bornaient pas à faire obstacle aux changements dans les doctrines, les mœurs et les croyances; elles s'efforçaient d'empêcher la production et la propagation des nouveautés intellectuelles et morales. Cependant, en dépit de ces empêchements, à certains égards justifiables, le monde ne demeurait pas immobile, le travail de l'esprit humain ne s'arrêtait point : d'un côté, le progrès des sciences physiques et naturelles déterminait l'éclosion des découvertes et des inventions qui ouvraient l'ère de la grande industrie; de l'autre, le progrès des sciences morales et surtout l'habitude héréditaire de la vie civilisée rendaient les classes supérieures capables de jouir d'une dose plus forte de self government que ne leur en accordaient les institutions et les coutumes, tandis que les classes soumises à la tutelle de la servitude devenaient aussi, par l'effet même de cette tutelle, si grossière et imparfaite qu'elle fût, moins incapables de gouverner leurs affaires et leur vie. De là, le grand mouvement d'opinion qui a déterminé la chute de l'ancien régime et ébauché la construction du nouveau, mouvement d'ailleurs plus passionné que raisonné, et qui a manqué jusqu'à présent d'une direction scientifique. Il convient toutefois de remarquer que la science qui aurait pu le diriger, n'existait pas encore lorsqu'il a commencé à se produire, et que les autres sciences morales et politiques ne pouvaient, à son défaut, suffire à cette tâche. Mais cette lacune se comble peu à peu, et, à mesure qu'elle se comble, la méthode scientifique succède, en matière de progrès, aux tâtonnements de l'empirisme. Un jour viendra certainement où la transformation de la machinery du gouvernement de l'homme et de la société s'accomplira avec une sûreté et [280] une rectitude qui lui ont fait défaut jusqu'ici, et où, aux maux inhérents à toute transformation ne se joindra plus, en conséquence, qu'un minimum d'autres maux provenant de l'ignorance de ceux qui travaillent à l'accomplir aussi bien que de ceux qui s'efforcent de l'empêcher ou de la retarder.
La tendance naturelle des esprits, en présence du développement extraordinaire de la richesse, suscité par les inventions et les découvertes de ce qu'on pourrait appeler la renaissance industrielle et commerciale, en présence aussi de l'énorme accroissement des connaissances humaines et de leur diffusion dans une classe de plus en plus nombreuse, cette tendance, qui s'accentua surtout dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, fut de démolir à la fois les institutions devenues surannées et nuisibles qui entravaient l'essor de l'industrie et celles qui soumettaient les intelligences à une tutelle. A certains égards, cette tendance poussa les novateurs au delà du but qu'il s'agissait d'atteindre, savoir d'adapter dans toutes ses parties la machinery préventive ou répressive des nuisances sociales à l'état nouveau mais non entièrement renouvelé de la société. Qu'en résulta-t-il? C'est qu'aux réformes violentes, mal préparées et mal étudiées, qu'avait provoquées l'opinion progressiste passée à l'état révolutionnaire, succéda une réaction non moins violente et aveugle de l'opinion et des intérêts conservateurs. Après avoir démoli l'ancien régime, on s'appliqua à le reconstruire. La part du self government, un moment exagérée ou plutôt mal réglée, fut réduite au delà du nécessaire, et la tutelle rétablie dans ce qu'elle avait d'excessif et de vicieux. On changea seulement le tuteur et nul ne saurait affirmer que ce changement ait toujours constitué un progrès. A la tutelle que les corporations exerçaient sur leurs membres et les seigneurs sur leurs [281] vassaux, on substitua la tutelle du gouvernement ou de la commune. Au moment où nous sommes, cette réaction est loin d'être épuisée. Le gouvernement devient de plus en plus un tuteur universel. Une tendance opposée ne manquera pas à la vérité de succéder à celle-là quand on s'apercevra que la tutelle des pouvoirs publics est dans bien des cas nuisible, et que dans les autres cas on peut la remplacer par une tutelle moins coûteuse et plus efficace.
Mais, en attendant, à mesure que s'affaiblissaient ou disparaissaient les vieux freins répressifs ou préventifs des nuisances sociales, à mesure aussi que se dissipaient les illusions que l'on avait conçues sur la capacité de l'individu à gouverner ses affaires et sa vie, et, plus encore, sur l'égale distribution de cette capacité indispensable dans toutes les couches de la société, à mesure enfin que se multipliaient et s'aggravaient les maux provenant de l'insuffisance du self government, de la disparition ou de l'affaiblissement des institutions qui y suppléaient, ne devait-on pas être porté à recourir, avant tout, au gouvernement, expression de l'intérêt général de la société, pour remédier à ce débordement de nuisances sociales? Cette tendance à charger le gouvernement central ou local, non seulement de supprimer toute espèce d'actes nuisibles, mais encore de les prévenir en restreignant directement ou indirectement le self government individuel ou librement collectif pour agrandir la tutelle publique, ne trouve-t-elle pas son explication et, jusqu'à un certain point, sa justification dans la destruction hâtive et aveugle, comme toutes les destructions accomplies par la voie révolutionnaire, de l'ancien appareil du gouvernement et de la tutelle?
Sans insister davantage sur ce point, examinons quel est, au moment où nous sommes, l'état de la machinery [282] du gouvernement de l'homme et de la société. Cette machinery se compose de différentes pièces: la religion, l'opinion, la répression pénale et la tutelle, concourant toutes à suppléer à l'insuffisance intellectuelle et morale de l'individu, à l'empêcher de commettre des actes nuisibles et à le déterminer, autant que possible, à choisir entre toutes les manières d'agir qui s'offrent à lui, celles qui sont les plus utiles à la société; autrement dit, ces différentes pièces de la machinery gouvernementale ont pour objet d'imposer dans toutes les manifestations de l'activité humaine le respect du droit et l'accomplissement du devoir. Passons-les en revue, en les considérant bien entendu uniquement sous le rapport de leur efficacité à prévenir ou à réprimer les nuisances sociales.
I. La religion. — Considérée comme un frein social et un véhicule de moralité, la religion a perdu, sans contredit, une grande partie de son efficacité. La base de toute religion, c'est, en premier lieu, la foi absolue en l'existence de puissances supérieures qui récompensent les bons et punissent les méchants : les bons, c'est-à-dire ceux qui pratiquent les manières d'agir utiles à la société; les méchants, c'est-à-dire ceux qui commettent des actes nuisibles; c'est, en second lieu, la confiance non moins absolue dans les délégués commis par ces puissances supérieures pour faire connaître et exécuter leur volonté, proclamer en leur nom ce qui est utile ou nuisible, autrement dit, moral et immoral, vertueux ou vicieux, distribuer les récompenses selon les mérites, et infliger les peines selon le degré de culpabilité. Cette double foi a pu s'établir, grâce à l'instinct naturel qui pousse l'homme à aimer ce qui lui procure une jouissance, à craindre ce qui lui cause une souffrance, à s'incliner devant ce qui lui est supérieur, mais, d'un autre côté, l'homme ne croit [283] volontiers qu'à ce qui lui est démontré par le témoignage de ses sens ou de sa raison. Or, à mesure que la science a progressé, elle a détruit les preuves qui attestaient aux sens de la foule ignorante et primitive l'existence des puissances surnaturelles, et leur intervention active dans les affaires de ce monde; elle a ramené à des causes naturelles les phénomènes astronomiques, géologiques, physiques ou chimiques, les éclipses, les tempêtes, les tremblements de terre, etc., qui apparaissaient comme des manifestations directes de l'action et, par conséquent, de l'existence des puissances divines. Et, tandis que la science leur enlevait ces preuves matérielles qui frappaient les sens, les religions ne réussissaient qu'imparfaitement à les remplacer par des preuves morales propres à convaincre la raison. Qu'est-il résulté de là? C'est que la foi religieuse s'est sensiblement affaiblie au sein des classes savantes ou à demi savantes, et qu'elle n'a conservé son empire que dans les classes ignorantes; encore n'y est-elle entretenue et ravivée que par le subterfuge des miracles qui manifestent aux sens abusés l'existence des puissances surnaturelles. A mesure qu'elle s'est affaiblie, l'efficacité des religions, considérées comme des instruments de discipline sociale, et, à l'origine, le plus puissant de ces instruments, a diminué. Cette efficacité n'a pas cessé d'être considérable, sans doute, l'influence sociale des religions est encore énorme si elle n'est plus prépondérante, mais en même temps qu'elle s'affaiblissait, elle se corrompait. En diminuant l'autorité des ministres de la religion, la décadence de la foi les a obligés à se montrer moins rigides dans la répression des nuisances sociales. Ils ont toléré un certain relâchement des mœurs, en réservant leur sévérité pour les atteintes portées à leur puissance ébranlée, et placé l'observance des obligations envers l'Église avant celle des obligations envers [284] la société. Dans une certaine mesure, cette préférence pouvait être justifiée. Car l'observation scrupuleuse des pratiques du culte étant le signe visible de la foi, sur laquelle reposait leur autorité, un manquement à ces pratiques attestait aux yeux de tous la diminution de la foi; mais la pente était glissante et elle les a poussés jusqu'à tolérer les nuisances sociales les plus graves chez ceux qui se montraient respectueux et surtout généreux envers l'Église. La corruption de l'instrument religieux, au point de vue social, est venue encore de l'alliance de la religion avec la puissance temporelle, alliance qui s'est naturellement resserrée avec la diminution de la foi entraînant l'affaiblissement de l'autorité de l'Eglise. Dans les siècles d'ignorance qui ont précédé la Renaissance, la foi était dans toute sa force. L'Église n'avait pas besoin alors de s'appuyer sur l'État. C'était, au contraire, l'Église qui dominait l'État, et elle jouait le rôle, souvent bienfaisant, de censeur des gouvernements violents et barbares de cette époque. Mais quand la foi orthodoxe, battue en brèche par le libre examen, devint chancelante, non seulement l'Église dût renoncer à son rôle de censeur des puissances temporelles, mais encore elle fut obligée de se montrer tolérante à l'égard de l'oppression, des abus et de la corruption des gouvernements et des classes gouvernantes. C'est à ce prix seulement qu'elle put s'assurer leur appui, soit qu'elle eût à lutter avec le schisme, soit que, devenue schisme, elle essayât de supplanter l'orthodoxie. Cette alliance a assuré jusqu'à nos jours son existence matérielle, mais au détriment de son rôle d'instrument de moralité sociale, et en l'exposant à être confondue dans un même sentiment de réprobation avec les pouvoirs dont elle excusait les vices, pourvu qu'ils lui prêtassent ce qui leur restait de force.
Cependant, en faisant l'inventaire et le départ de toutes [285] les manières d'agir utiles ou nuisibles à la société, en récompensant les unes, en punissant les autres, d'après une échelle savamment graduée de l'utilité ou de la nuisibilité de chacune, les religions ont été l'agent le plus puissant de la formation du sens moral ou de la conscience, en même temps qu'elles encourageaient, du moins à l'origine, le progrès matériel en assignant aux découvertes et aux inventions de la science et de l'industrie une origine divine. Réussiront-elles un jour à rétablir la foi dans son intégrité primitive et à raffermir par là même leur autorité, en remplaçant les preuves matérielles que la science leur a enlevées par des preuves morales ou scientifiques propres à convaincre la raison? Nul ne pourrait le dire. En attendant, l'anéantissement des premières, l'insuffisance des secondes, les ont amenées à une période critique, et sensiblement diminué l'importance de leur rôle dans la grande machinery préventive ou répressive des nuisances sociales.
II. L'opinion. — Qu'est-ce que l'opinion? C'est le jugement que la société ou une fraction de la société porte sur la manière de penser et d'agir de chacun de ses membres. En toutes choses, il y a une manière de penser et d'agir que l'opinion approuve, qu'elle commande même comme la plus conforme à l'intérêt social, tandis qu'elle réprouve ou interdit les autres comme lui étant plus ou moins contraires. De même que la religion s'efforce d'empêcher la production des actes nuisibles et d'encourager celle des actes utiles au moyen d'un système de châtiments et de récompenses qui embrasse à la fois la vie présente et la vie future, l'opinion emploie à la même fin un système analogue, qui consiste, d'une part, dans l'approbation, l'amour, l'estime des contemporains et de la postérité, de l'autre, dans leur blâme et leur exécration. Ce système [286] n'exerce pas seulement une influence morale, il agit aussi, en bien ou en mal, sur la condition matérielle de ceux auxquels il s'applique. Un homme à qui l'opinion inflige un blâme devient aussitôt l'objet d'un ostracisme qui ne manque pas de porter préjudice à ses intérêts : lui et les siens sont exclus du cercle de leurs relations ou tenus en suspicion, et il en résulte pour eux un dommage positif. D'un autre côté, l'approbation de l'opinion, la popularité qu'elle donne, les récompenses honorifiques qu'elle fait conférer, tout en procurant des satisfactions morales, facilitent l'acquisition d'avantages matériels. Comment se forme l'opinion? Avant tout, par l'hérédité et l'éducation. Les manières de penser et d'agir — qui déterminent nos jugements sur les pensées et les actions d'autrui — se transmettent avec les organes qui servent à penser et à agir. L'éducation les modifie, mais seulement dans une faible mesure pendant le cours d'une vie. Elle se continue d'ailleurs dans toute la durée de l'existence : elle commence dans la famille et à l'école, elle se poursuit dans le monde; elle a pour instruments l'expérience et la réflexion, aidées par l'étude, la conversation et la lecture. A la vérité, l'immense majorité des hommes ne prend guère la peine de se former elle-même une opinion; elle accepte de confiance celle qui flatte ses intérêts et ses instincts, et cette opinion qu'elle a acceptée sans la contrôler, elle l'impose volontiers à autrui. Cependant l'opinion est, à tout prendre, plus éclairée et même plus tolérante à l'époque où nous sommes qu'elle ne l'était autrefois. Mais si elle s'est améliorée par certains côtés, elle laisse encore singulièrement à désirer par d'autres. D'abord, elle n'est pas une, ou du moins elle ne l'est que sur un certain nombre de questions, à vrai dire les plus importantes. Elle est généralement unanime à réprouver les atteintes à la vie et à la propriété d'autrui, sauf dans [287] les cas où intervient la raison d'État ou toute autre nécessité d'un ordre réputé supérieur; alors elle se partage et, de plus, elle se montre singulièrement instable : telle action est blâmée par un parti et louée par un autre, tenue pour criminelle aujourd'hui et pour glorieuse demain. De là, un manque d'autorité réelle, auquel elle supplée par sa prétention à imposer quand même ses arrêts. Elle n'en exerce pas moins une influence salutaire sur la conduite ordinaire de la vie, et on peut regretter que l'extension du milieu où elle agit et la facilité à se dérober à sa réprobation, en passant d'un lieu à un autre, aient affaibli son action répressive des nuisances sociales. Toutefois, sa sphère d'action s'est étendue grâce aux progrès des instruments et des moyens de communication intellectuels et autres. Malgré son insuffisance, sa mobilité, ses erreurs et ses vices, elle est une des pièces maîtresses de la machinery du gouvernement des sociétés, et tandis que la puissance de la religion diminue, la sienne va croissant.
III. La répression. — Depuis la chute de l'ancien régime, la répression a réalisé des progrès incontestables; elle est devenue plus éclairée et plus juste, quoiqu'elle laisse certainement encore beaucoup à désirer sous ce double rapport. Mais elle ne s'applique qu'à la moindre partie des nuisances sociales, à celles qui sont considérées comme les plus graves, et telle est encore, malgré ses progrès, l'imperfection de l'appareil répressif, que le plus grand nombre des nuisances qu'il devrait réprimer échappe à son action.[30] Comme nous l'avons remarqué, [288] l'observation et l'expérience ont fait reconnaître les nuisances, l'opinion les a frappées de réprobation, la [289] coutume, puis la loi, les ont interdites, et la répression pénale est venue en aide à l'opinion, à la coutume ou à la loi, [290] en y attachant une peine proportionnée à leur nuisibilité réelle ou supposée. La répression diffère de peuple à [291] peuple, et varie d'une époque à une autre quant à la définition des nuisances, au rang qui leur est assigné, à la nature et au degré de la pénalité, à l'organisation de la justice répressive, aux procédés qu'elle emploie pour découvrir les crimes et les délits, et les punir. De nos jours, la définition des nuisances est devenue plus claire et plus complète, tandis que les pénalités se sont adoucies; mais les procédés de la justice répressive sont demeurés coûteux et lents, et son action est loin encore d'avoir toute la sûreté désirable.
On peut encore ranger, sous le titre générique de répression pénale, l'empêchement ou la punition des nuisances, réelles ou prétendues, que les États étrangers commettent à l'égard de l'État dont on est membre. L'appareil nécessaire à prévenir ou à réprimer ces nuisances absorbe même la meilleure part des forces et des ressources de chaque nation. Aujourd'hui, comme aux époques de [292] barbarie, chaque État juge lui-même dans sa propre cause. Il décide si, dans les manières d'agir des autres États à son égard, il y a ou non nuisance. Dans l'affirmative, il s'efforce, soit de prévenir les nuisances qui le menacent, soit d'obtenir réparation pour celles qu'il a subies, en recourant d'abord aux négociations, ensuite à la guerre. On aperçoit aisément ce que cette procédure et ce mode de répression des nuisances extérieures ont de vicieux et de barbare, mais tels ils étaient jadis, tels ils sont demeurés, et cet état arriéré de la répression des nuisances internationales n'est pas le moindre des obstacles qui s'opposent à la multiplication et à la diffusion du bien-être et de la civilisation.
IV. La tutelle. — La tutelle, considérée dans la multitude de ses formes et de ses applications, a subi des changements considérables. La tutelle privée a été diminuée, en partie au profit du self govemment, en partie au profit de la tutelle publique, et l'on ne saurait affirmer que ce changement ait toujours constitué un progrès. — A l'origine, le chef de famille exerçait sur sa femme et ses enfants un pouvoir analogue à celui du maître sur ses esclaves; il les gouvernait d'une façon despotique, et il avait sur eux droit de vie et de mort. Dans le cours des siècles, ce pouvoir a été successivement amoindri, et la famille a été en grande partie émancipée. La femme n'est plus soumise qu'à une demi-tutelle, dont les droits et les obligations sont spécifiés et limités; les enfants ont, de même, cessé d'être la chose du père, et la tutelle qu'il exerce sur eux est simplement temporaire. Que l'abolition de la servitude au sein de la famille, et même l'amoindrissement du pouvoir marital ou paternel aient été des progrès, on ne saurait le contester, mais si l'ancien régime de la famille avait ses nuisances, le nouveau [293] a aussi les siennes. Lorsque les enfants appartenaient au père, dans le sens juridique du mot, lorsqu'il pouvait les vendre ou exploiter indéfiniment, sans aucune limite de temps, leurs forces ou leurs facultés productives, l'intérêt qu'il avait à développer ces forces et ces facultés, et surtout à n'en point entraver le développement par un travail hâtif, était à son maximum. Il n'en a plus été ainsi du moment où l'enfant a été considéré comme s'appartenant à lui-même, et où, à dater de l'époque fixée pour son émancipation, il a échappé complètement à l'autorité et à l'exploitation du père de famille. Celui-ci n'a plus eu le même intérêt à faire les sacrifices nécessaires pour l'élever et l'instruire, puisque le profit qu'il retirait auparavant de ces sacrifices venait maintenant à lui échapper. Il était intéressé à les diminuer, comme aussi à se couvrir de ses avances d'élève et d'éducation, en exploitant les forces productives de l'enfant avant même qu'elles eussent reçu leur plein développement. Sans doute, l'amour paternel, la religion, l'opinion, et finalement la répression pénale se joignaient au sentiment du devoir et à la conscience pour empêcher cette sorte de nuisance de se produire. Malheureusement, l'expérience a attesté que ces divers véhicules n'ont une efficacité suffisante que dans les couches sociales supérieures, où le père de famille est à l'abri du besoin.
La tutelle privée ne s'est pas seulement affaiblie et amoindrie dans la famille; on a vu disparaître aussi, peu à peu, les différentes sortes de tutelle, qui étaient jadis impliquées dans le régime des corporations, dans l'esclavage ou le servage. Les chefs d'industrie ont acquis une liberté complète; ils sont pleinement affranchis de la tutelle corporative pour le gouvernement de leurs affaires et pour celui de leur vie. — Les ouvriers ne possèdent pas un self government aussi complet, quoiqu'il soit [294] incomparablement plus étendu qu'il ne l'était sous le régime de la servitude. Leur existence est divisée en deux parts : celle qu'ils passent à l'atelier et celle qu'ils passent en dehors de l'atelier. Celle-ci est entièrement livrée à leur self government, mais il n'en est pas de même de l'autre. Dans l'atelier, ils sont soumis à une discipline plus ou moins sévère; ils obéissent à des chefs hiérarchiques, et, sauf dans le cas du travail à la tâche, ils subissent une direction ou une surveillance qui constitue une véritable tutelle. En rassemblant dans la même entreprise des centaines et parfois des milliers d'individus, la grande industrie a dû fortifier la discipline des ateliers, et quoiqu'elle ne dispose plus des châtiments corporels pour l'assurer, quoiqu'elle ne puisse recourir qu'aux amendes et à l'expulsion, elle a établi cependant un ordre et une régularité dans le travail, qui n'existent pas à beaucoup près au même degré dans les ateliers de la petite industrie.
Mais il n'en est pas moins vrai que la tutelle privée, soit qu'on la considère dans la famille ou dans l'ensemble du domaine économique et social, n'occupe plus qu'une faible partie de la place qui lui était dévolue sous l'ancien régime. La part du self government s'est sensiblement agrandie à ses dépens. Cependant, le self government n'ayant point donné tous les résultats qu'on s'en promettait, on a essayé de remédier à son insuffisance par l'extension de la tutelle publique.
La tutelle publique a gagné, de nos jours, la plus grande partie du terrain qui a été enlevé à la tutelle privée, et elle est continuellement en voie de s'étendre aux dépens du self government. Elle intervient à la fois dans la production, la distribution et la consommation des richesses. Nous en avons énuméré les principales applications (chapitre V, Mécanisme du gouvernement de l'homme [295] et de la société). Elle remplace principalement la tutelle corporative et la servitude. Est-ce avec avantage? C'est ce que nous nous réservons d'examiner, lorsque nous nous occuperons spécialement de la constitution et des fonctions du gouvernement. Nous nous bornerons, en attendant, à faire remarquer que le vice radical de la tutelle publique, c'est d'englober dans son action tous les membres de la société, aussi bien ceux qui peuvent se passer d'une tutelle que ceux à qui elle est nécessaire, d'infliger par conséquent à ceux-là des entraves et des gênes qui leur nuisent, afin d'épargner à ceux-ci les maux qui résulteraient pour eux de l'exercice d'un self government qu'ils sont incapables de pratiquer.
Quoi qu'il en soit, tel est, au moment où nous sommes, l'état de la machinery du gouvernement de l'homme et de la société, considérée dans ses différentes parties : la religion, l'opinion, la répression intérieure et extérieure, la tutelle privée et publique. Que cette machinery soit imparfaite, défectueuse, mal adaptée à l'état présent des choses et des hommes, qu'aucune de ses parties ne fonctionne d'une manière pleinement utile, que quelques-unes même agissent d'une manière nuisible, cela est incontestable. Mais ce qui ne l'est pas moins, c'est qu'en dépit de ses imperfections et de ses vices, elle est indispensable pour remédier à l'insuffisance de la capacité du plus grand nombre des membres de la société à gouverner utilement leurs affaires et leur vie, autrement dit, à pratiquer, à l'avantage de tous et de chacun, le self government.
III. — La crise industrielle et sociale. — Stimulant qu'elle apporte aux sciences morales et politiques. — Naissance de l'économie politique. — Comment les économistes sont devenus les apôtres du self government. — Réaction contre le nouveau régime industriel et la concurrence. — Le socialisme. — Ses origines. — Son caractère rétrograde. — Que tous les systèmes socialistes se résument dans la réorganisation et la généralisation de la tutelle. — Idéal du communisme. — Points de ressemblance entre les [296] socialistes et les briseurs de machines. — Que le gouvernement de l'homme et de la société implique à la fois le self government et la tutelle, mais que le progrès consiste à augmenter la part du self government en diminuant celle de la tutelle. — Exagération de la doctrine du self government. La liberté imposée. — Comment se pose aujourd'hui le problème du progrès.
Depuis que la transformation progressive du vieux matériel de la petite industrie a commencé, et avec elle celle de la machinery du gouvernement de l'homme et de la société, le monde civilisé se trouve dans un état de crise, et il y demeurera, selon toute apparence, jusqu'à ce que cette double transformation soit arrivée à son terme. La lutte subsistera jusqu'alors entre la petite industrie et la grande, entre l'ancienne machinery du gouvernement et la nouvelle, celles-là condamnées à périr, mais défendant énergiquement leur existence, celles-ci avançant pied à pied, en se complétant au prix d'une multitude infinie d'expériences infructueuses et d'essais avortés.
Cette crise industrielle et sociale ne pouvait manquer d'imprimer, dès son origine, un essor extraordinaire aux sciences qui s'occupent de la création de la richesse, du gouvernement de l'homme et de la société. L'économie politique, en particulier, lui doit sa naissance. Les phénomènes inusités que provoquaient les découvertes et les inventions qui se multipliaient depuis la fin du moyen âge, les perturbations commerciales que causaient l'ouverture de la nouvelle route de l'Inde et l'annexion du nouveau monde au domaine des peuples civilisés, les variations dans la valeur des métaux précieux, l'entrée dans la consommation générale de denrées auparavant rares ou inconnues, la nécessité de produire un supplément croissant d'articles d'échange pour se les procurer; plus tard, le prodigieux développement de la production déterminé par l'emploi des machines nouvelles substituées à l'outillage séculaire de l'industrie, et surtout par l'introduction de la [297] plus puissante des machines : la concurrence, devaient appeler irrésistiblement l'attention des esprits sur les problèmes économiques et provoquer des « recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations ». Ce qui frappa d'abord les économistes, ce fut l'énorme augmentation de puissance et de fécondité dont l'industrie était redevable au matériel perfectionné et à la concurrence. Ce qui les frappa encore, ce furent les obstacles que le vieux régime industriel et commercial, les corporations avec leurs marchés appropriés et défendus par des prohibitions opposaient aux progrès de l'industrie, à l'extension du commerce et, par conséquent, à la multiplication de la richesse. C'est pourquoi les économistes ne se bornèrent point à étudier, à la manière des naturalistes et sans autre objet que la poursuite platonique des vérités scientifiques, les phénomènes de la production, de la distribution et de la consommation : donnant la main aux philosophes qui sapaient la machinery surannée du gouvernement de l'homme et de la société, ils entrèrent en campagne contre l'ancien régime économique ; ils se firent les apôtres de la liberté du travail en prenant pour devise : laissez faire, laissez passer, et cette devise, leurs successeurs l'appliquèrent, par une extension naturelle et logique, à toutes les branches de l'activité humaine.
Cependant, l'avènement du nouveau régime ne se manifestait pas seulement par des effets bienfaisants : les nouvelles machines dépréciaient le vieux matériel, et elles enlevaient, temporairement du moins, au personnel qui y était attaché ses moyens d'existence accoutumés, la concurrence ruinait les faibles au profit des forts, en rendant toutes les situations précaires, et le paupérisme commençait à envahir les couches sociales inférieures récemment émancipées. Ces phénomènes désastreux, dont la science naissante ne pouvait encore analyser exactement [298] les causes devaient inévitablement susciter une réaction contre le régime sous lequel ils se produisaient; cette réaction, bien facile à expliquer, s'est incarnée dans le socialisme.
Le socialisme n'est certes point une nouveauté; de tout temps, l'imperfection naturelle de l'organisation des sociétés et, en particulier, l'oppression que les classes dirigeantes faisaient peser sur la multitude ont suggéré des plans de réorganisation sociale qui étaient nécessairement le contre-pied de l'organisation existante : aux excès de l'inégalité, les novateurs opposaient l'égalité des hommes, aux abus de la propriété, la communauté, et peut-être le christianisme fut-il redevable de la faveur qu'il obtînt auprès des masses à ce double caractère égalitaire et communiste dont il était marqué à l'origine et dont il se dépouilla, comme tant d'autres doctrines radicales, lorsqu'il eut conquis le pouvoir. Mais ces conceptions généreuses et chimériques étaient le plus souvent étouffées dans le sang de leurs adeptes, et quand, par exception, l'intolérance propre aux doctrines dominantes et aux intérêts établis les laissait subsister, elles ne résistaient point à l'épreuve de l'application. Elles disparaissaient jusqu'à ce que les circonstances redevinssent favorables à leur éclosion. Or, ces circonstances avaient-elles jamais été plus favorables qu'à une époque où la désorganisation et la chute de l'ancien régime, l'anarchie du nouveau et son impuissance apparente à retrouver en lui-même des éléments d'ordre et de stabilité semblaient rendre nécessaire et urgente une réorganisation sociale, où, enfin, aucune limite n'était plus opposée, au nom de la religion ou de la loi, aux spéculations les plus aventureuses de l'esprit?
Si les socialistes avaient été des hommes de science; s'ils avaient commencé par analyser les causes des perturbations économiques et sociales dont ils étaient [299] témoins pour en chercher ensuite les remèdes, ils auraient pu jouer un rôle utile; mais la lenteur des procédés scientifiques ne convenait pas à ces imaginations vives et infatuées d'elles-mêmes. Ils s'en tenaient donc à la cause la plus apparente du mal, qui était la concurrence ou le self government appliqué à l'industrie, et ils s'empressaient d'improviser des « systèmes d'organisation sociale », d'où la concurrence était rigoureusement exclue. Aucun d'eux ne s'avisait naturellement de douter que l'application de son « système » n'eût la vertu de guérir d'une manière instantanée tous les maux de l'humanité. Mais ils ne s'apercevaient pas qu'il n'y a que deux modes possibles de gouvernement de l'espèce humaine, le self government et la tutelle, et qu'en repoussant l'un comme « anarchique », ils devaient nécessairement retomber dans l'autre et y piétiner sur place. En effet, tous les systèmes socialistes, communistes ou nihilistes ne sont autre chose que des modes d'organisation de la tutelle. Entre ces systèmes bigarrés, les différences portent seulement sur la constitution du tuteur, la manière de comprendre et de pratiquer la tutelle; enfin, sur les procédés — la violence ou la persuasion — auxquels il convient d'avoir recours pour l'établir. Le tuteur pour le Saint-Simonisme, la plus originale et la plus scientifique des écoles socialistes, c'est un pouvoir théocratique recruté par en haut, mais dont le mode de constitution demeure obscur; pour toutes les autres écoles socialistes ou communistes, c'est un pouvoir démocratique, c'est l'État constitué au moyen du suffrage universel et gouvernant souverainement la production, la distribution et la consommation, ou bien encore c'est la commune, laquelle n'est autre chose que l'État dans de moindres proportions géographiques. L'État ou la commune produit et distribue les résultats de la production, en règle et en surveille la consommation, soit [300] conformément aux prescriptions de l'inventeur du système, soit conformément à celles qu'il plaît au « peuple » souverain de l'État ou de la commune d'établir. C'est la mise en tutelle de l'individu par la communauté. Sans doute, le pupille fait partie du tuteur, mais en est-il moins en tutelle?
Parmi tous ces systèmes, le plus avancé, c'est le communisme révolutionnaire ou le nihilisme. Voyons comment il procède. Du moment où il se trouve en possession de la force, il supprime toutes les institutions politiques et sociales, le gouvernement, la famille, les associations libres, à commencer par les associations religieuses, il renverse toutes les autorités établies, souverains, prêtres, magistrats, etc.; il dissout, en un mot, l'ancien État et l'ancienne société pour installer sur leurs débris la commune souveraine. Celle-ci confisque, avec ou sans indemnité, tous les capitaux et toutes les industries, et elle se met en devoir d'exploiter toutes les entreprises. C'est la commune qui devient le producteur universel. Elle assigne à chacun sa fonction et sa rétribution. Les capitaux n'obtiennent plus aucune rémunération; ils travaillent gratis. On les reconstitue et on les augmente au besoin, en mettant en réserve une portion plus ou moins forte du produit des entreprises. Le travail seul est rétribué. Comment? autrement dit dans quelles proportions la richesse est-elle distribuée entre les travailleurs qui ont contribué à la créer? Elle est distribuée en parts égales. En ce qui concerne la consommation, les systèmes communistes sont moins tranchants et moins explicites, mais qui ne voit que la commune devra gouverner la consommation et surtout la reproduction de ses pupilles, sous peine d'être bientôt surchargée d'enfants, de débauchés et d'ivrognes? Ainsi, le communisme se résout en une tutelle imposée plus étendue encore que celle à laquelle est assujettie la [301] tribu primitive. A cette tutelle, qui englobe tous les actes de la vie, nul ne peut échapper; elle pèse également sur tous les membres de la commune, et comme l'humanité entière est partagée en communes, elle pèse sur toute l'espèce humaine. Voilà, en fait de progrès, l'idéal des systèmes les plus avancés du socialisme.[31]
[302]
Il nous paraît superflu d'examiner si cet idéal est réalisable. Nous nous bornerons à constater que c'est un idéal rétrograde qui nous ramène à l'enfance de l'humanité, car tout le travail de la civilisation a consisté à diminuer la part de la tutelle pour agrandir celle du self government. Mais cette tendance s'explique si l'on n'oublie pas que le socialisme est le produit d'une réaction contre le self government et la concurrence. Le cas des socialistes est absolument le même que celui des briseurs de machines. Lorsqu'une machine nouvelle vient à être introduite, elle cause un dommage positif et sensible au personnel qui se servait des vieux outils. Que des ouvriers ignorants qui perdent ainsi, du jour au lendemain, leurs moyens d'existence, et qui n'ont aucune idée de l'augmentation de bien-être que l'emploi de cet engin perfectionné est destiné à procurer aux autres et, plus tard, à eux-mêmes, s'efforcent de le supprimer, rien de plus naturel. De même, les désordres et les maux qui accompagnaient l'apparition de la concurrence ne devaient-ils pas exciter les socialistes, aussi ignorants que les ouvriers briseurs de machines, quoique plus lettrés, à supprimer cet engin malfaisant? La seule différence, c'est que les briseurs de machines se contentaient d'en revenir aux vieux outils, [303] tandis que les socialistes substituaient à la machinery funeste et abominable du self government et de la concurrence une machinery de leur invention et, à ce titre, infiniment plus parfaite qu'aucune autre, pour mieux dire, la perfection même. Mais comme, en éliminant le self government et la concurrence, il leur fallait bien, quoi qu'ils en eussent, revenir à la tutelle, comme, d'une autre part, l'organisation existante qu'ils prétendaient remplacer est un composé de self government et de tutelle, ils étaient nécessairement ramenés à une constitution politique et sociale antérieure, et par là même inférieure.
La vérité est qu'il ne faut éliminer ni le self government ni la tutelle, car l'un et l'autre sont des éléments également indispensables de la machinery du gouvernement de l'homme et de la société. Il s'agit seulement de savoir dans quelle proportion ils doivent être combinés à l'époque où nous sommes. Or, cette proportion est naturellement déterminée et marquée par le degré de la capacité à se gouverner soi-même. Si cette capacité est, sinon entière, du moins assez grande pour que l'individu puisse gouverner utilement ses affaires et sa vie, avec le simple auxiliaire de l'appareil répressif des nuisances publiques et privées, le self government est possible; si elle est insuffisante, la tutelle partielle ou totale, libre ou imposée, est nécessaire.
Mais nous nous trouvons ici en présence de deux exagérations contraires. Tandis que les socialistes suppriment le self government individuel comme anarchique et imposent, à la manière d'un dogme, le gouvernement de chacun par tous, certains partisans du self government prétendent imposer la liberté, comme un autre dogme, en déclarant que « l'homme n'est pas libre de n'être pas libre ». Est-il nécessaire de faire remarquer que cette exagération individualiste, laquelle implique d'ailleurs une [304] contradiction, n'est pas plus conforme à la nature des choses et à l'intérêt de la société que l'exagération socialiste? Si les progrès et la diffusion de l'intelligence et de la moralité, qui sont les matériaux de la capacité gouvernante, nous permettent d'espérer que les hommes deviendront, un jour, presque généralement capables de gouverner leurs affaires et leur vie, sans l'intervention d'une tutelle, ce jour est malheureusement encore bien éloigné. L'expérience nous montre que le self government ne convient pas plus aux races et aux individualités inférieures qu'il ne conviendrait aux enfants; qu'il a pour effet inévitable de les corrompre et de les détruire; que ces races et ces individualités inférieures doivent, en conséquence, être soumises, dans leur intérêt aussi bien que dans l'intérêt général, à une tutelle appropriée à leur état de développement intellectuel et moral. Autant le self government est utile à ceux qui sont capables de le pratiquer, autant il est nuisible à ceux qui en sont incapables. Le spectacle des Peaux-Rouges et des autres peuples sauvages qui périssent au contact de la civilisation comme si elle leur communiquait la peste, des nègres émancipés sans transition auxquels le self government est plus funeste encore que ne l'avait été l'esclavage; enfin, des classes paupérisées qui ne parviennent pas à couvrir leurs frais d'existence au sein des sociétés les plus riches du globe; ce spectacle, si saisissant et si lamentable, ne devrait-il pas dessiller les yeux aveuglés par l'esprit de système? N'atteste-t-il pas, d'une manière assez claire, que le self government appliqué à des races et à des individualités qui n'ont point la capacité requise pour l'exercer, constitue une nuisance plus grave encore, car elle est plus destructive, que la tutelle infligée aux races et aux individualités capables du self government?
Nous possédons maintenant toutes les données du [305] problême du progrès; voyons comment ce problème se pose dans la phase actuelle de la civilisation.
L'amélioration générale de la condition de l'espèce humaine dépend de trois sortes de progrès : 1° du perfectionnement du matériel de la production, qui accroît la puissance productive de l'homme par la mise en œuvre de machines et de procédés de plus en plus efficaces, c'est le progrès matériel; 2° du développement de la personnalité humaine, qui augmente à la fois sa capacité professionnelle et son aptitude à se gouverner sans nuire à autrui et à soi-même, c'est le progrès intellectuel et moral; 3° du perfectionnement de la machinery, qui supplée à l'insuffisance de la capacité de l'homme à se gouverner lui-même, en l'excitant ou le contraignant par l'intervention de la religion, de l'opinion, de la coutume ou de la loi, de la répression pénale, de la tutelle et de la servitude, à s'abstenir d'actes nuisibles et à agir de la manière la plus conforme à l'intérêt commun de la société, dans lequel le sien est compris, c'est le progrès politique.
Si nous considérons séparément ces trois facteurs du problème du progrès, nous serons frappés avant tout d'un fait qui a échappé aux inventeurs de panacées sociales, c'est qu'ils n'agissent qu'avec l'auxiliaire du temps. Sans doute, le progrès matériel a reçu une impulsion extraordinaire par l'avènement de la grande industrie. Cependant, il n'a transformé, en deux ou trois siècles, chez les nations les plus progressives, que la moindre partie du matériel de la production et de la consommation, et il commence seulement à s'introduire dans les régions peuplées par la grande majorité de l'espèce humaine. Or, si l'on songe que la première condition de l'accroissement de la richesse et de la multiplication du bien-être dont la richesse est la source, c'est l'augmentation de la puissance productive; si l'on songe quel énorme développement de [306] cette puissance, en la prenant même au point où la grande industrie l'a portée de nos jours, exigerait la satisfaction modérée des divers besoins de la multitude, encore réduite au nécessaire le plus strict et le plus grossier; si l'on songe que les sciences avancent seulement peu à peu, que les inventions et les découvertes qu'elle suscitent sont subordonnées à leurs progrès et ne peuvent d'ailleurs s'accomplir sans diffilcutés et se répandre sans obstacles, on comprendra que la richesse ne puisse s'accroître et le bien-être se propager qu'avec une lenteur extrême.
Le progrès intellectuel et moral, se résumant dans le développement de la capacité professionnelle et surtout de la capacité gouvernante, s'improvise encore moins que le progrès matériel. Au moment où nous sommes, après tant de siècles pendant lesquels l'humanité est demeurée étroitement assujettie aux freins combinés de la religion, de l'opinion, de la coutume ou de la loi, de la répression, de la tutelle et de la servitude, combien l'homme est encore incapable de se gouverner sans nuire à autrui et à lui-même! Ses progrès sont insensibles, et parfois même il recule. La conscience du plus grand nombre ne sait pas discerner, dans les cas les moins compliqués, le bien du mal, et même quand elle aperçoit clairement le bien, la force morale lui manque pour l'accomplir:
... Video meliora proboquc;
Deteriora sequor ...
Mais aussi longtemps que l'intelligence et la moralité ne se seront pas développées et répandues davantage, aussi longtemps que la conscience de la généralité des hommes n'aura pas acquis une notion plus claire et plus étendue du bien et du mal, aussi longtemps qu'elle ne sera pas armée d'une force morale plus grande pour pratiquer le bien et repousser le mal, la masse des nuisances [307] qu'engendre l'insuffisance des lumières et des forces morales nécessaires au bon gouvernement de soi-même continuera de se produire avec une régularité mathématique, le vice et le crime prélèveront leur dîme accoutumée, et il faudra maintenir intact le coûteux appareil indispensable pour les contenir et les empêcher de déborder.
Cet appareil même, considéré dans ses différentes parties, se perfectionne avec plus de difficulté et de lenteur encore que les deux autres facteurs du progrès. La religion perd de son autorité et se corrompt; l'opinion est ignorante et passionnée; la coutume ou la loi, produit de l'opinion des générations antérieures, est mal adaptée aux besoins de la génération présente; la répression est coûteuse et grossière; la tutelle est insuffisante ou excessive, et elle est exercée d'une manière inefficace ou vicieuse; la servitude est barbare. Et combien de difficultés et d'obstacles de tous genres rencontrent la moindre réforme, l'amélioration la plus insignifiante, le progrès le plus modeste dans chacune des parties de l'appareil préventif ou répressif des nuisances sociales! Combien d'intérêts égoïstes, de passions intraitables, de préjugés obstinés et aveugles se mettent en travers! Combien enfin le progrès même est incertain! Que d'expériences il faut tenter, que d'échecs il faut subir avant d'avoir réalisé un progrès qui diminue, au lieu de les augmenter, les nuisances provenant de l'imperfection ou de la mauvaise adaptation de la machinery du gouvernement de l'homme et de la société, un progrès qui soit un progrès et non une nuisance de plus!
Quand on considère la diversité des facteurs du progrès et la lenteur naturelle avec laquelle ils agissent, comment ne serait-on pas frappé de l'imbécile infatuation des utopistes qui s'imaginent que la condition de l'humanité pourrait être, d'une manière instantanée, changée du noir au blanc par la vertu d'une conception de leur génie! [308] Autant vaudrait dire qu'un seul homme aurait pu, en un seul jour, bâtir les pyramides d'Égypte! Le progrès, tel qu'il s'est accompli depuis la naissance de l'humanité, tel que nous le voyons s'accomplir de nos jours, est une œuvre collective à laquelle contribuent directement ou indirectement, dans la mesure de leurs forces et de leurs facultés inégales, les membres de l'élite intellectuelle et morale de l'humanité, et dont les résultats s'accumulent, se capitalisent de génération en génération. Les uns agrandissent le domaine des sciences physiques et naturelles; les autres appliquent les notions et les forces que la science a mises au jour; ils inventent des machines plus puissantes et des procédés plus efficaces; ils découvrent des régions inconnues ou des substances nouvelles; d'autres encore créent et accumulent les capitaux nécessaires pour donner un corps aux inventions et aux découvertes, ou bien ils fondent et dirigent les entreprises qui les mettent en œuvre. Dans une sphère différente et plus élevée, ceux-ci s'appliquent à perfectionner l'homme, à agrandir et à éclairer sa conscience, à développer ses forces morales, de manière à le rendre plus propre à se gouverner lui-même, tandis que ceux-là travaillent à améliorer la machinery qui sert à remédier à l'insuffisance de son intelligence et de sa moralité. C'est par millions que l'on compte, dans chaque génération, les hommes qui, par leurs travaux et leurs exemples, contribuent à faire avancer la civilisation; c'est par milliards qu'on les compterait depuis l'origine de l'humanité.
[309]
CHAPITRE IX. L'avenir. — La production.↩
I. — Pauvreté générale de la société sous le régime de la petite industrie. — Estimation de Vauban. — Que la pauvreté est encore aujourd'hui le fait dominant. — Qu'il n'y a pas, en France, plus d'un million de familles aisées ou riches sur dix. — Que l'accession des familles pauvres ou peu aisées à la richesse exigerait une énorme augmentation de la production. — Que cette augmentation ne peut être obtenue que par l'accroissement de la productivité de l'industrie. — Progrès que cet accroissement implique. — Qu'en dehors de ces progrès, la multiplication de la richesse est impossible. — Que les combinaisons du protectionnisme et du socialisme ne peuvent avoir pour effet que de la ralentir. — Esquisse de la constitution économique des sociétés de l'avenir. — Localisation naturelle de la production. — Transformation de ses machines et de ses procédés. — Substitution des entreprises collectives à capital mobilisable aux entreprises individuelles à capital immobilisé. — Accroissement nécessaire du commerce. — Sa séparation d'avec l'industrie et le crédit. — Développement et spécialisation du commerce du capital et du travail. — Progrès des institutions et des instruments de crédit. — Les Bourses. — Causes qui retardent le développement du commerce du travail. — Aperçu général de la production transformée sous l'impulsion de la concurrence.
Quoique la richesse se soit énormément accrue depuis l'avènement de la grande industrie, les sociétés les plus progressives et les plus riches du globe sont encore pauvres, si l'on considère la condition générale de la population. A la fin du règne de Louis XIV, Vauban estimait qu'il n'y avait pas dans le royaume cent mille familles à leur aise.[32] Depuis cette époque, grâce aux progrès extraordinaires [310] du matériel et des procédés de la production, et à l'extension de la concurrence, ce nombre a certainement décuplé. Sur environ dix millions de familles, il y a bien aujourd'hui en France un million de familles aisées, c'est-à-dire dont les membres obtiennent au moyen du revenu de leurs capitaux (et nous comprenons sous cette dénomination les terres et les autres agents naturels appropriés) et de leur travail, les uns— le petit nombre — au delà de ce qui est nécessaire pour satisfaire aussi largement que possible la totalité de leurs besoins physiques, intellectuels et moraux, les autres de quoi y pourvoir à des degrés divers mais dans une mesure suffisante. Au dessous, s'échelonnent neuf millions de familles dont la condition descend, de degré en degré, de la médiocrité à la gêne et à la plus extrême misère. De même que le progrès de la richesse a adjoint depuis deux siècles neuf cent mille familles appartenant à cette dernière catégorie aux cent mille familles aisées dont parlait Vauban, il s'agit aujourd'hui de continuer ce progrès de manière à faire entrer successivement les neuf millions de familles en retard, dans les rangs de la classe aisée. La solution de ce problème implique une augmentation considérable de la richesse et, par conséquent, de la fécondité de la production; elle implique aussi la diminution de la quantité du travail, à l'aide duquel la richesse est obtenue : à mesure, en effet, que l'aisance s'accroît et que la fortune arrive, l'homme consacre une plus grande partie de son temps au repos et aux délassements de toute sorte. Au lieu de travailler régulièrement 10 ou 12 heures par jour, il travaille [311] 8 heures, moins encore, et il s'accorde des vacances de plus en plus prolongées. Il y a certainement des exceptions à cette règle : on peut citer des millionnaires qui continuent à travailler 10 ou 12 heures par jour jusqu'à l'extrême vieillesse, mais on citerait dans la même catégorie sociale un bien plus grand nombre d'individus qui vivent dans une oisivité presque complète. Ceci est vrai surtout pour les femmes, lesquelles sont, au contraire, obligées dans les couches inférieures de la société, à travailler autant que les hommes et même davantage. En tenant compte des femmes, des enfants, des vieillards et des fonctionnaires publics, on peut affirmer que le million de familles aisées ou riches ne fournit guère que la moitié de la quantité de travail qui est produite par n'importe quel autre million de la catégorie inférieure. Il faut donc, non seulement que le progrès augmente la richesse pour résoudre le problème de l'élévation de la condition des masses, mais encore qu'il permette de diminuer la quantité du travail à l'aide duquel la richesse s'achète. Ajoutons que la solution de ce problème suppose un accroissement extraordinaire de la production. Pour que les neuf millions de familles de la deuxième catégorie fussent nourries d'une manière aussi abondante, aussi variée et aussi délicate que le million de la première, il faudrait que les articles supérieurs d'alimentation, la viande de boucherie, la volaille, le poisson, les mollusques, les légumes, les fruits, les vins, le sucre, le café, le thé, les condiments de toute sorte fussent produits en quantités, tantôt doubles ou triples, tantôt même décuples ou centuples. Pour les vêtements, le mobilier, les objets d'art servant à l'ornementation de la personne ou de l'habitation, la bijouterie, les meubles, les tapisseries, les tableaux, etc., etc., l'augmentation devrait être encore plus considérable; enfin, elle serait énorme pour tous les produits ou services qui [312] entrent dans la consommation intellectuelle et les délassements de la classe aisée ou riche, l'éducation, les voyages, la littérature, la musique, le théâtre. Ce n'est rien exagérer que de dire que la production devrait être au moins décuplée, pour que les neuf millions de familles en retard fussent pourvues de tous les éléments de bien-être et de civilisation dont jouit actuellement le million de familles arrivées.
Comment ce progrès peut-il être réalisé? Avant tout, par l'accroissement de la productivité de l'industrie, ou, ce qui revient au même, par l'augmentation de la puissance du matériel productif et de l'efficacité des moyens de le mettre en œuvre. Est-il chimérique de croire que cette puissance et cette efficacité puissent s'accroître assez pour décupler la production? Non, sans doute, si l'on songe qu'il est telle machine à l'aide de laquelle on produit cent fois, mille fois plus qu'avec l'ancien outillage. N'avons-nous pas cité l'exemple du métier circu'aire qui permet à une ouvrière de faire 480,000 mailles par minute, tandis que la femme la plus habile à tricoter à la main n'en peut faire que 80? Le but qu'il s'agit d'atteindre n'est donc pas hors de notre portée, et un jour viendra où il sera pleinement atteint, mais, encore une fois, il ne peut l'être que par l'accroissement de la productivité de l'industrie.
Cet accroissement est le produit d'un ensemble de progrès qui vont s'accélérant, à mesure qu'une nouvelle acquisition en augmente la masse et la vitesse acquise. On peut les ranger en différentes catégories, quoiqu'ils tendent tous au même but : l'augmentation de la richesse et la diminution des efforts à l'aide desquels on l'achète. Ce sont : 1° la localisation de plus en plus économique de toutes les branches de la production; 2° l'emploi de machines et de procédés plus puissants et efficaces, la découverte [313] de matériaux plus avantageux; 3° la construction plus parfaite et la gestion mieux ordonnée des entreprises; 4° l'abondance plus grande et le bon marché croissant des capitaux, avec une économie plus stricte et mieux entendue dans leur application à l'industrie; 5° l'augmentation de l'efficacité du travail et la réduction de sa quantité au minimum; 6° l'extension illimitée des marchés, entraînant le développement illimité de la concurrence. C'est à la coopération active de ces divers progrès qu'est dû, en dépit des obstacles et des entraves de tous genres qu'ils ont rencontrés, le prodigieux accroissement de la richesse depuis la naissance de la grande industrie.
Supposons maintenant que l'évolution industrielle ait fait un pas décisif, que la production soit partout localisée dans les conditions naturelles de sol, de climat, etc., les mieux adaptées à chacune de ses branches, que les machines et les procédés dont elle se sert aient acquis toute la puissance et l'efficacité désirables, qu'elles aient remplacé généralement l'outillage faible et grossier de la petite industrie; que la constitution et le gouvernement des entreprises soient arrivés à un degré de perfectionnement analogue à celui du matériel; que ces mêmes entreprises soient alimentées aux meilleures conditions possibles de capital et de travail; qu'elles possèdent un marché d'une étendue illimitée; enfin, qu'elles subissent par là même, dans toute sa plénitude, l'action à la fois stimulante et régulatrice de la concurrence, on peut affirmer, en se fondant sur les résultats déjà acquis, que la production fournira amplement de quoi satisfaire à tous les besoins de ceux qui y coopèrent directement ou indirectement, comme directeurs, simples travailleurs, capitalistes et propriétaires, en admettant même que chacun de ces coopérateurs, en s'enrichissant, fasse une part plus large à ses loisirs aux dépens du travail et des affaires.
[314]
En revanche, il n'est pas inutile de remarquer, à l'époque de socialisme, de protectionnisme et de gouvernementalisme où nous vivons, que la richesse ne peut s'augmenter autrement; que les inventions et les combinaisons les plus ingénieuses des hommes d'État et des législateurs socialistes ou protectionnistes (est-il nécessaire d'ajouter que ces deux expressions sont synonymes, que le socialisme c'est le protectionnisme d'en bas, et que le protectionnisme c'est le socialisme d'en haut) ne peuvent avoir d'autre résultat que de déplacer la richesse en la diminuant. Il n'est pas inutile de remarquer, non plus, que tous les obstacles et toutes les entraves que les intérêts engagés dans l'ancienne industrie, les préjugés, les passions, l'ignorance obstinée et aveugle opposent au développement et à l'opération des facteurs du progrès ralentissent la multiplication de la richesse et prolongent ainsi la durée de la période de misère, de souffrance et de barbarie, dans laquelle se débat encore la grande majorité de la population des pays les plus riches et les plus civilisés de la terre.
Essayons maintenant d'esquisser un aperçu de l'édifice majestueux dont nous voyons s'élever les premières assises au milieu des débris du passé, et qui est destiné certainement à dépasser en grandeur et en beauté tout ce que la fantaisie des inventeurs ou des régénérateurs de sociétés a pu imaginer.
Nous serons frappés d'abord du spectacle de cette division naturelle du travail entre les différentes parties de notre globe, dont les avantages ont été mis en relief par les apôtres de la liberté commerciale. Sous le régime de la petite industrie et des marchés appropriés, la presque totalité des articles de consommation est produite dans un rayon extrêmement borné. Il en résulte, en premier lieu, que les industries les moins adaptées au sol, au [315] climat, au génie particulier de la population ne peuvent se développer et se perfectionner faute d'un débouché suffisant; en second lieu, que la population, obligée de produire elle-même la plupart des articles dont elle a besoin, et par conséquent d'exercer des industries qui ne conviennent ni à ses habitudes ni au milieu où elle vit, n'en tire que de chétifs produits achetés au prix d'un travail excessif; enfin, qu'elle est obligée de se passer d'une foule d'autres articles qu'elle est incapable de produire et qu'elle n'a pas les moyens de se procurer par voie d'échange. Telle était la situation sous l'ancien régime industriel, situation que des progrès de plusieurs sortes, le développement de la sécurité, la multiplication et le perfectionnement des moyens de transport, l'abaissement des barrières douanières, etc., ont commencé à modifier.[33] Depuis deux ou trois siècles, la localisation naturelle de la [316] production est en voie de s'accomplir, et ses progrès ont été s'accélérant, surtout depuis une cinquantaine d'années. [317] Nous pouvons les mesurer à ceux des échanges internationaux. D'un milliard, tout au plus, au commencement [318] du dix-septième siècle, ceux-ci se sont élevés graduellement à une dizaine de milliards dans les premières années [319] du dix-neuvième siècle, et, à dater de cette époque, ils ont été croissant, pour ainsi dire, en raison géométrique: de 10 milliards, ils ont passé à près de 80 milliards. En supposant que les mêmes causes continuent à agir pour étendre et universaliser cette division naturelle du travail, on verra toutes les branches de la production, localisées dans les conditions les plus économiques, prendre tout le développement que comporteront les éléments dont elles pourront disposer, et le marché qui leur sera ouvert, autrement dit, arriver à leur maximum de productivité. Alors aussi ce sera par centaines, et peut-être par milliers de milliards, que se chiffrera le commerce international.
Cependant, d'autres progrès sont encore nécessaires pour que la grande industrie atteigne son maximum de productivité. Il faut d'abord que le matériel et les procédés de la production acquièrent toute la puissance et la perfection possibles; mais ne sont-ils pas en voie de les acquérir, et n'est-ce point par milliers que l'on compte tous les ans les brevets d'invention ou de perfectionnement? La machinery des transports par terre et par eau, [320] celle des industries textiles, et tant d'autres, n'ont-elles pas été entièrement transformées? Pourquoi cette transformation progressive viendrait-elle à s'arrêter? N'y a-t-il pas apparence, au contraire, qu'elle continuera de se poursuivre en s'accélérant jusqu'à ce qu'elle soit générale et complète. Il faut ensuite que la constitution des entreprises s'adapte à la nouvelle machinery de la production. A cet égard encore, les progrès, réalisés en un bien court espace de temps, ne nous fournissent-ils pas des indications certaines sur les progrès à venir? Tandis quela petite industrie ne comportait guère que des entreprises individuelles, la grande industrie ne peut — à part des exceptions qui deviendront de plus en plus rares — être mise en œuvre que par des entreprises collectives. Déjà quelques-unes de ses branches les plus avancées, l'industrie des transports, l'exploitation des mines, sont presque exclusivement exploitées par des sociétés anonymes ou autres. Les causes qui retardent encore la généralisation de cette forme perfectionnée des entreprises, savoir : les entraves que la routine oppose à l'adoption des machines et des procédés nouveaux, les imperfections du mécanisme et du gouvernement des sociétés, les empêchements d'une législation surannée; ces causes sont temporaires : la routine finit toujours par être vaincue; l'expérience dénonce et corrige les vices de la constitution et de la gestion des entreprises, les lois restrictives de la liberté des associations sont réformées ou tombent en désuétude. A mesure que ces obstacles disparaissent, à mesure que la nouvelle forme se propage et se perfectionne, ses avantages deviennent plus sensibles. Le plus considérable de ces avantages consiste dans la division du capital d'entreprise, en coupures mobilisables, permettant aux plus petits capitaux de participer aux bénéfices de la production, et ce même avantage contribue, plus que tout le [321] reste, à rendre nécessaire et inévitable la substitution de l'entreprise collective à l'entreprise individuelle, en diminuant le prix de revient de l'emploi des capitaux. La privation qu'implique l'investissement d'un capital dans l'industrie, et qui est le principal élément du loyer ou de l'intérêt, ne se trouve-t-elle pas, en effet, à peu près annulée par la mobilisabilité du titre de propriété du capital investi?
L'avenir appartient donc à l'entreprise collective, et le jour viendra où l'entreprise individuelle sera une rareté comme le rouet ou le métier à tisser à la main. Aucune branche de la production, pas plus l'agriculture et les professions libérales que l'industrie et le commerce, ne saurait échapper à l'invasion de cette forme progressive. Malgré l'énorme changement que cette évolution suppose, les jours de l'agriculture individuelle sont comptés. Aux petites fermes, aux exploitations parcellaires des paysans propriétaires, succéderont, dans un avenir plus rapproché qu'on ne pense, de vastes exploitations agricoles, où les travaux qui, depuis l'invention de la bêche et de la charrue, ont été exécutés à main d'homme seront économiquement accomplis par des machines de toute sorte, où le capital d'exploitation se comptera par millions, le personnel dirigeant et auxiliaire par milliers. L'agriculture sera alors entièrement ce qu'elle est déjà en voie de devenir dans les pays les plus avancés, une grande industrie, et toutes les conditions de la vie rurale seront changées. Prenons un autre exemple dans les professions libérales. Quoi de plus individuel que l'exercice de la médecine! Eh bien! supposons que la richesse venant à croître et à se généraliser de manière à permettre à la masse de la population de subvenir elle-même aux frais d'entretien de sa santé et à agrandir ainsi le débouché de la profession médicale, supposons, dis-je, qu'une société [322] se constitue au capital de 10 millions, 20 millions et davantage, pour remplacer les hôpitaux par des maisons de santé, abondamment pourvues de tous les moyens curatifs et de tout le confort désirable, et ayant à leur service des praticiens spéciaux pour chaque sorte de maladie; supposons encore qu'au système de rétribution actuellement usité, elle substitue celui de l'abonnement, qu'on puisse s'assurer chez elle, moyennant une redevance ou une prime que la concurrence se chargera de réduire au taux le plus bas, contre les risques de maladies et d'accidents, en se faisant traiter à la maison de santé ou à domicile; un progrès considérable ne se trouvera-t-il pas réalisé dans une des industries que le régime de l'entreprise individuelle a laissées le plus en retard? Nous pourrions multiplier ces exemples. Nous pourrions montrer, dans toutes les branches de l'activité humaine, les entreprises, devenues collectives et constituées avec un capital mobilisable, s'établissant dans les proportions les plus utiles, adoptant le matériel le plus perfectionné, spécialisant leur personnel, et arrivant ainsi à multiplier progressivement leurs produits ou leurs services; mais il nous suffit de signaler, d'une manière générale, cette évolution future et d'indiquer ce qui la rend nécessaire. Ajoutons cependant qu'elle ne saurait être hâtée artificiellement; qu'elle ne peut s'accomplir — encore est-ce au prix d'une série d'expériences coûteuses et de tentatives avortées — que dans les industries qui disposent d'un matériel perfectionné, d'un personnel instruit et d'un débouché étendu; alors — quand ces conditions indispensables se trouvent réunies — elle s'accomplit d'elle-même.
En analysant l'immense diversité des opérations à l'aide desquelles la richesse se crée, on s'aperçoit que toutes ces opérations se résolvent en des changements de forme, de lieu et de temps. Le milieu où nous vivons renferme tous [323] les éléments, les matériaux et les forces nécessaires à l'entretien de notre existence. Il s'agit d'abord de les découvrir et d'en modifier les combinaisons et les formes; c'est l'œuvre de l'agriculture et de l'industrie proprement dite. Cette œuvre accomplie, il faut mettre le produit à la portée du consommateur, ce qui implique un changement de lieu et de temps, et telle est la tâche du commerce. Les progrès de l'agriculture et de l'industrie déterminent un développement correspondant du commerce. Sous le régime de la petite industrie, la grande masse des articles de consommation étant produite dans un marché d'une étendue très limitée, l'organisme commercial demeure à l'état embryonnaire, et il apparaît le plus souvent uni à l'organisme de la production agricole ou industrielle. C'est seulement lorsque le marché vient à s'étendre qu'il commence à s'en détacher, mais il contient encore, réunies et confondues, deux branches qui se sépareront plus tard : le commerce des produits, ou le commerce proprement dit, et le commerce des capitaux ou le crédit. Dans cette période de formation, c'est une machine extrêmement compliquée, comme toutes les machines à leur début. On distingue le commerce de gros, de demi-gros et de détail, la vente au comptant ou à terme, avec escompte ou sans escompte, et l'opération commerciale est, dans la plupart des cas, doublée d'une opération de crédit. Combien de négociants ou de commerçants remplissent en même temps l'office de banquiers, faisant des avances en argent aux producteurs et des avances en nature aux commerçants d'un ordre inférieur ou au consommateur! Mais l'industrie s'agrandit et se localise : aussitôt on voit le rouage commercial grandir et se spécialiser de son côté, en se dégageant à la fois du rouage industriel et du rouage du crédit. Il se simplifie par là même et devient de plus en plus économique. Nous [324] assistons au début de cette évolution. Nous voyons le commerce des étoffes et des vêtements se concentrer dans de vastes établissements qui achètent directement au producteur et vendent directement au consommateur, en opérant au comptant, c'est-à-dire sans compliquer leur opération commerciale d'une opération de crédit. La même évolution s'accomplira dans toutes les autres branches, parce qu'il en résulte une économie de frais, laquelle ne manque pas de s'accroître lorsque l'entreprise collective à capital mobilisable se substitue à l'entreprise individuelle à capital immobilisé. Le petit atelier disparaîtra successivement du commerce, aussi bien que de l'agriculture et de l'industrie, pour faire place à la manufacture.
Mais, qu'il s'agisse d'agriculture, d'industrie, de commerce ou de tout autre branche de travail, cette « manufacture », à laquelle appartient l'avenir, doit être alimentée de capital et de travail. De là, le développement et la spécialisation de deux rouages qui apparaissent à peine sous le régime de la petite industrie : le commerce des capitaux, comprenant les institutions de créditât les assurances, et le commerce du travail.
Le progrès, dans le commerce des capitaux, s'est opéré de deux manières : parla multiplication, l'agrandissement et la spécialisation des entreprises, ayant pour objet de les recueillir et de les transmettre à ceux qui en ont besoin, par le perfectionnement des instruments qui servent à les représenter et à les mobiliser.
A mesure que l'industrie progresse, elle absorbe une proportion croissante de capitaux. La quantité qui s'en trouve investie dans les branches progressives de la production a certainement décuplé depuis l'avènement de la grande industrie, et cependant nous ne sommes qu'au début de l'évolution industrielle. En même temps que la [325] demande du capital croissait sous l'influence des progrès de l'industrie, on en voyait, d'un autre côté, croître la production et l'offre sous l'influence de l'augmentation générale de la richesse et de l'avènement du self government qui rendait l'épargne indispensable aux classes émancipées, auxquelles incombait désormais l'obligation de pourvoir elles-mêmes à leurs besoins futurs aussi bien qu'à leur consommation actuelle. Les intermédiaires qui recueillent les capitaux chez ceux qui les produisent pour les distribuer à ceux qui les mettent en œuvre, ne pouvaient manquer de se multiplier et de s'agrandir en proportion de l'augmentation de l'offre et de la demande. A la place des usuriers et des banquiers qui suffisaient à la petite industrie, de puissantes institutions de crédit se sont créées et spécialisées selon la nature des besoins auxquels elles pourvoient, banques d'États, banques de commerce, crédit industriel, crédit agricole ou foncier, caisses d'épargnes, assurances de toute sorte, etc., etc. Elles constituent un immense appareil aspiratoire et distributeur, une pompe aspirante et foulante des capitaux, et, telles sont déjà, au moment où nous sommes, l'étendue et l'efficacité de cet appareil perfectionné qu'il absorbe, en la détournant de ses anciennes destinations, la plus grande partie de la production annuelle du capital.
Le progrès des instruments qui servent soit à l'échange des produits ou des services, soit à la transmission des capitaux dans l'espace et dans le temps, n'a pas été moins considérable que celui des institutions de crédit, et peutêtre l'invention du billet de banque, de l'action et de l'obligation au porteur n'a-t-elle pas une importance moindre que celle des moyens de transport perfectionnés des hommes et des choses.
Nous n'avons pas besoin de rappeler combien l'invention de la monnaie a facilité les échanges, mais quoique [326] l'or et l'argent qui ont fini par être adoptés généralement comme étoffes monétaires soient préférables à tous les autres produits sous le double rapport de la circulabilité et de l'étalonnage, ils constituent cependant un médium circulans fort imparfait. Leur valeur est exposée à des variations continuelles et parfois considérables; d'un autre côté, ils sont d'un emploi coûteux et insuffisant pour les énormes transports de valeurs que nécessite la grande industrie. En admettant que la somme d'or et d'argent encore employée en France aux opérations de l'échange et de l'accumulation des capitaux soit de 3 milliards, c'est une somme d'environ 150 millions qui grève annuellement le transport des valeurs dans l'espace et dans le temps. A mesure que la monnaie et les procédés fiduciaires, tels que les virements de comptes, se substituent à la monnaie réelle, ce transport s'effectue avec plus d'économie et de facilité. Quoique la main mise par les gouvernements sur la monnaie fiduciaire dont ils ont fait du papier-monnaie ait retardé et compromis ce progrès, la masse des échanges s'effectue déjà au moyen des instruments et des procédés perfectionnés du crédit, et le jour n'est pas éloigné où la monnaie réelle ne jouera plus qu'un rôle accessoire, soit dans l'échange, soit dans la capitalisation. [34]
Comment s'opérait la capitalisation sous l'ancien régime? On conservait en nature une partie des produits de la plupart des entreprises, et on les employait à en augmenter la production, on les prêtait ou on les louait à d'autres entrepreneurs, ou bien encore on les échangeait contre de la monnaie que l'on accumulait ou à l'aide de laquelle on se procurait un supplément de matériaux et d'agents productifs. Sous le régime nouveau, la capitalisation [327] en nature est devenue une exception de plus en plus rare, on échange généralement ses produits ou ses services contre de la monnaie, et l'on se sert de celle-ci, partie pour acheter des produits ou des services nécessaires à la consommation, partie pour la capitalisation. Mais on la laisse le moins longtemps possible inactive. On se hâte de l'échanger contre des titres de propriété ou de créances donnant droit, sous une forme ou sous une autre, à une part dans le produit des entreprises. Telles sont les actions et les obligations industrielles, tels sont encore les fonds publics, lesquels ne sont autre chose que des obligations émises par les gouvernements. Le caractère de ces titres de propriété ou de ces créances est d'être mobilisables, c'est-à-dire de pouvoir passer rapidement et à peu de frais de main en main; ils sont en outre divisés en petites coupures, de manière à permettre aux plus faibles portions de capital de s'engager dans la production. Sans doute, toute l'épargne annuelle des nations civilisées ne va pas encore aux titres mobilisables; une partie demeure inactive dans les caisses ou dans les tiroirs sous forme de monnaie; une autre partie est investie dans la multitude des entreprises subsistantes de la petite industrie, sous forme d'apports, de participations, de prêts de toute sorte; une troisième, enfin, est employée à l'acquisition de maisons, de mobilier, de bijoux, de linge, constituant le matériel de consommation; une quatrième est consacrée à l'élève et à l'éducation des enfants; une cinquième à des assurances contre les accidents de la maladie, du chômage, de la vieillesse; toutefois, en attendant que ces deux dernières catégories de dépenses viennent à se présenter, le capital épargné à leur intention peut être engagé dans la production sous la forme de titres mobilisables, sauf à en être dégagé à l'échéance de l'éventualité ou du risque en vue duquel il a été constitué. Mais telle [328] est la supériorité des titres de propriété ou de créances mobilisables qu'ils attirent invinciblement la capitalisalion, aux dépens des anciennes formes des propriétés ou des créances, et c'est là une des causes qui agissent le plus activement et qui agiront de plus en plus pour substituer les entreprises à titres mobilisables de la grande industrie, aux entreprises à titres immobilisés de la petite industrie. Un jour viendra certainement où tous les capitaux engagés dans la production seront représentés par des titres mobilisables. Déjà cette propriété dite « mobilière », quoiqu'elle consiste principalement en titres représentant des parts de propriétés immobilières, chemins de fer, mines, etc., ou des créances sur ces propriétés, se compte par milliards, et elle s'accroît dans une progression extraordinairement rapide. C'est une révolution dans la forme de la propriété, révolution à laquelle échappera seule, selon toute apparence, la propriété du fonds de consommation.
La multiplication des valeurs mobilières a donné naissance à l'institution moderne des Bourses, qui sont les marchés des capitaux de la grande industrie. A mesure qu'ils se constituent on va les y offrir pour les engager, sous forme de titres mobilisables, actions ou obligations, dans les entreprises. Une portion croissante de l'épargne annuelle des nations y est portée, et elle y rencontre la demande des entreprises de toute sorte, États, compagnies de chemins de fer, banques, manufactures, mines. Comme dans tous les autres marchés, quand la demande dépasse l'offre, le prix des valeurs mobilières s'élève, et le revenu qui y est attaché, sous forme d'intérêt ou de dividende diminue, et vice versa. La spéculation prévoit ces fluctuations et les rend moins brusques, partant moins dommageables. C'est, en un mot, par le canal des bourses que s'opère chaque jour sur une échelle plus vaste et par des [329] procédés plus économiques, l'apport des capitaux à la production.
A cet égard, le progrès réalisé depuis un siècle est véritablement énorme, et il semble que l'avenir n'ait plus qu'à développer la machinery existante de l'apport des capitaux et probablement à la simplifier. Il n'en est pas ainsi malheureusement du mécanisme de l'apport du travail. Celui-ci est resté à l'état rudimentaire, le mode de recrutement du travail est demeuré à peu près tel qu'il était à l'époque où la classe ouvrière a été dégagée des liens de l'esclavage ou du servage; en général, les ouvriers sont recrutés et engagés individuellement et sans aucun intermédiaire. Cependant, il est visible que ce mode primitif de recrutement et d'engagement ne suffit plus à la grande industrie. Quand les entreprises agricoles ou industrielles n'employaient qu'un petit nombre d'ouvriers qu'elles recrutaient dans le marché local et qu'elles ne pouvaient recruter ailleurs, par suite de la difficulté et de la cherté des déplacements, les intermédiaires étaient inutiles. Il n'en est plus ainsi depuis qu'elles ont besoin d'un personnel nombreux et habile à desservir un matériel perfectionné. Ce personnel elles ne peuvent le trouver, dans les meilleures conditions, que dans un marché étendu. De leur côté, les ouvriers sont plus intéressés encore à pouvoir se porter toujours dans les directions où leur travail est le plus demandé, partant le mieux rétribué. De là, la nécessité d'un rouage intermédiaire, dont le marchandage, les trades unions, les chambres syndicales, les bureaux de placement sont les rudiments, et qui est destiné à se perfectionner et à se développer à mesure que la nécessité s'en fera davantage sentir, et que les obstacles naturels ou artificiels, cherté des moyens de transport, lois et préjugés, etc., qui s'opposent encore à son développement, s'aplaniront. Nous avons maintes fois [330] déjà esquissé ce mécanisme de l'apport du travail à la production, qui est destiné à former le pendant de celui de l'apport du capital en rétablissant l'équilibre rompu entre les deux facteurs de la production, et en pacifiant par là même, d'une manière définitive, les rapports entre les entrepreneurs et les ouvriers.[35]
[331]
Ce qui nous frappe surtout dans cette constitution économique de l'avenir, telle que nous la voyons s'élever [332] depuis l'avènement de la grande industrie, ce n'est pas seulement la grandeur de ses établissements, la puissance [333] de ses machines, c'est encore la simplicité de son mécanisme et la précision merveilleuse avec laquelle il [334] fonctionne. Naguère morcelé en une multitude de marchés étroits, et, pour la plupart sans communications entre [335] eux, le monde économique ne forme plus qu'un seul marché dont toutes les parties sont rapprochées, unies par la [336] vapeur et l'électricité; toutes les branches de la production se localisent dans les régions auxquelles elles sont le mieux adaptées, où elles rencontrent les conditions de sol, de climat, de situation topographique les plus favorables; les entreprises s'établissent dans les dimensions et sous les formes les plus économiques; elles emploient le matériel le plus puissant et le personnel le plus habile; des rouages auxiliaires leur apportent incessamment toute la masse de capital et de travail nécessaire pour les [337] alimenter. Le résultat, c'est que la production de la multitude des articles de consommation s'opère avec toute l'abondance et l'économie que comporte l'état d'avancement du matériel et des procédés de l'industrie; à quoi il faut ajouter que chaque progrès réalisé dans l'un ou l'autre des rouages de la machinery de la production, doit être immédiatement adopté et se traduire par une augmentation de la richesse produite et une diminution des efforts à l'aide desquels on l'achète.
Mais quel est le grand moteur de ce merveilleux mécanisme? C'est la Concurrence, —la concurrence universalisée qui oblige, sous peine de mort industrielle, toutes les entreprises à s'établir dans les conditions les plus économiques.
II. Les adversaires du progrès. — Qu'il est aujourd'hui hors de leur pouvoir de le supprimer, mais qu'ils peuvent le retarder. — Que tous les progrès qui élèvent et améliorent la condition du peuple commencent par être impopulaires. — Que les communistes et les socialistes sont au premier rang des ennemis du progrès. — Pourquoi? — Mode d'opération du progrès. — Ce que signifie le dicton : « on produit trop. » — Comment agit le progrès pour multiplier la richesse et la faire descendre dans les régions inférieures de la société.
Nous venons d'examiner sommairement par quel ensemble de progrès la production devient plus féconde et la richesse se multiplie. Tout ce qui empêche le développement de l'une ou l'autre des parties de ce vaste ensemble, tout ce qui fait obstacle à la localisation naturelle de l'industrie, à la multiplication des inventions et des découvertes qui élargissent le champ de la production et transforment son matériel, à la constitution et à la gestion progressives des entreprises, au perfectionnement des institutions qui leur apportent le capital et le travail; enfin, tout ce qui retarde la généralisation de la concurrence, propulseur de tous les autres progrès, ralentit la [338] multiplication de la richesse et retient la grande majorité de l'espèce humaine dans l'état de misère et de barbarie, où elle est demeurée jusqu'à l'avènement de la grande industrie, et d'où elle semblait ne devoir jamais sortir. Sans doute, au point où en sont les choses, aucune puissance humaine ne pourrait plus arrêter le mouvement qui emporte les sociétés vers un meilleur avenir, mais on peut le retarder, on peut prolonger l'asservissement de la multitude au travail physique, aux privations et aux souffrances de la pauvreté.
Chose curieuse! ce n'est pas seulement dans les régions supérieures de la société que se rencontrent les adversaires les plus aveugles et les plus obstinés du progrès; ce ne sont pas seulement les grands intérêts engagés dans l'ancienne industrie et dans les institutions du passé qui s'opposent à l'établissement de la nouvelle machinery de la production. Non! l'adversaire le plus intraitable de tous les progrès est cette multitude qu'ils travaillent à tirer de la misère et de la barbarie. Il n'en est pas un seul qui n'ait été et ne soit encore pour elle un objet de méfiance et de répulsion; il n'en est pas un seul que les prétendus amis des classes ouvrières, démagogues ou socialistes, n'aient condamné au nom des intérêts du peuple. Avant que les chefs d'industrie coalisés n'eussent fait prohiber les produits étrangers et retardé ainsi la localisation naturelle de la production, les ouvriers ameutés pillaient ou détruisaient ces produits qui venaient faire concurrence au « travail national », et, aujourd'hui encore, le socialisme donne la main au protectionnisme. Est-il nécessaire de rappeler les exploits des briseurs de machines? S'il avait été au pouvoir des ouvriers fileurs ou tisserands d'anéantir les merveilleuses inventions de Hargreaves et d'Arkwrigkt, et même de pendre leurs auteurs comme des ennemis publics, y [339] auraient-ils manqué? La création des entreprises collectives, sous la forme de sociétés anonymes ou autres, la multiplication et l'agrandissement des institutions de crédit n'ontelles pas été dénoncées par tous les écrivains socialistes, les Saints-Simoniens seuls exceptés, comme devant amener fatalement l'asservissement de la masse des travailleurs à une féodalité industrielle et financière? Les Bourses sont-elles, à leurs yeux, autre chose que des repaires de cette féodalité nouvelle, plus oppressive que l'ancienne, et la démagogie terroriste ne se glorifiait-elle pas d'avoir fermé ces temples de l'agiotage? Si le travail n'a pas encore à son service les institutions et les instruments qui ont permis au capital de se mobiliser, au grand avantage des capitalistes, la faute n'en est-elle pas aux ouvriers ennemis des intermédiaires et du « marchandage »? Enfin, les socialistes ne sont-ils pas unanimes pour jeter l'anathème sur la concurrence? En un mot, de tous les progrès qui agissent pour émanciper la multitude de la servitude du travail physique et lui donner accès à la richesse, il n'en est pas un seul qui ait trouvé grâce devant le peuple et ses amis.
A quoi faut-il attribuer une aberration si complète et si étrange? Comment se fait-il que les adversaires les plus acharnés du progrès soient ceux-là mêmes à qui il doit profiter le plus? Cela tient surtout au mode d'opération du progrès. Cela tient à ce que le progrès commence par être une nuisance pour tous les intérêts, petits ou grands, engagés dans la machinery existante. N'est-il pas naturel qu'ils réagissent contre cette nuisance? Et cette réaction ne doit-elle pas être d'autant plus violente que les intérêts auxquels le progrès porte dommage sont moins en état de se tirer d'affaire, moins capables aussi d'apercevoir le bien futur qui doit sortir du mal présent? On peut invoquer leur ignorance comme [340] une circonstance atténuante, mais il n'en est pas moins vrai que les progrès qui améliorent et élèvent la condition du peuple 's'établissent presque toujours malgré le peuple.
Maintenant, quel est le mode d'opération du progrès? Comment la transformation qu'il détermine dans la machinery de la production agit-elle pour multiplier la richesse et la généraliser? Comment, à chaque degré d'accroissement de la productivité de l'industrie, soit que cet accroissement ait été provoqué par une meilleure localisation de la production, un perfectionnement du mécanisme et de la gestion des entreprises, l'adoption de machines plus puissantes et de procédés plus efficaces, l'apport des capitaux en plus grande abondance et à meilleur marché, l'amélioration de la qualité du travail, comment la richesse s'augmente-t-elle et descend-elle dans des couches plus basses de la société?
Ce phénomène, pourtant bien visible, demeure encore une énigme, même pour les hommes les plus versés dans la pratique des affaires. Nous entendons dire fréquemment, surtout aux époques de crise, que Von produit trop. Comment prétendre cependant, à une époque où le plus grand nombre est à peine pourvu des choses nécessaires à la vie, que l'on produise trop d'articles de luxe, de confort et même de première nécessité, trop d'aliments, de vêtements, d'habitations commodes et saines, de meubles, d'objets d'art, etc.? Que faut-il penser d'une affirmation qui semble dans un désaccord si manifeste avec les faits? Que signifie-t-elle? Elle signifie simplement qu'une ou plusieurs branches d'industrie offrent une quantité de leurs produits supérieure à celle que les consommateurs demandent d'une manière effective, c'est-à-dire qu'ils sont disposés à acheter à un prix suffisant pour couvrir les frais de la production. Ces industries, à l'état pléthorique, [341] sont obligées d'écouler leurs excédants à perte, quand elles n'ont pas les moyens de les garder en magasin, et de réduire leur production sous peine de se ruiner. Ces produits surabondants conviendraient fort cependant à une multitude de gens qui, de leur côté, sont obligés de s'en priver parce qu'ils n'ont pas les moyens de les acheter; en d'autres termes, de rembourser les frais qu'il a fallu faire pour les créer et les mettre au marché. Et pourquoi n'ontils pas les moyens d'acheter ces articles, qu'ils ne demanderaient pas mieux que de consommer? Parce que le revenu à l'aide duquel ils vivent est insuffisant. Pourquoi enfin ce revenu est-il insuffisant? Parce que l'industrie d'où ils le tirent, sous une forme ou sous une autre, n'est pas assez productive. Telle est du moins la cause origiginaire et principale de l'insuffisance des revenus, et cette cause ne peut être combattue, la productivité de l'industrie ne peut être augmentée que par l'intervention de l'un ou l'autre des progrès énumérés plus haut, meilleure localisation, perfectionnement de l'outillage, etc. De quelle façon se manifeste cette intervention du progrès? Elle se manifeste par la diminution des frais de la production, ou, ce qui revient au même, elle permet d'obtenir, en échange des mêmes frais, une quantité plus grande ou une qualité supérieure de produits, ce qui les rend accessibles à une catégorie plus nombreuse de consommateurs.
Tel a été notamment l'effet du progrès réalisé dans les industries textiles : il a permis à une masse croissante de consommateurs d'acheter plus et de meilleurs vêtements, en échange d'une moindre portion de leurs revenus. Le progrès des moyens de communication et de transport a eu un effet analogue, mais encore plus considérable et étendu : non seulement il a mis les voyages à la portée d'une classe plus nombreuse, mais encore il a diminué les frais de production de la généralité des produits, et [342] agrandi par là même la sphère de là consommation ou le débouché de chacun. Mais quel est l'effet de l'extension de la consommation ou du débouché? C'est de provoquer un développement correspondant de la production, et par conséquent un accroissement de la demande des matériaux et des agents productifs. Le progrès réalisé dans les industries textiles a déterminé une augmentation de la demande des machines, du combustible, du coton, de la laine, de la soie, du lin, des matières tinctoriales. Il a fallu multiplier et développer, non seulement toutes les entreprises qui manufacturent des fils, des étoffes et des vêtements, mais encore, par répercussion, toutes celles qui leur fournissent des matériaux et des agents productifs, et cette répercussion n'a pas manqué d'en engendrer une série d'autres. Il n'est pas un seul progrès, si insignifiant qu'il soit, dont l'action ne se fasse sentir de proche en proche, jusqu'à devenir infinitésimale, dans toute l'étendue du monde économique. On ne saurait mieux la comparer qu'à l'effet produit par la chute d'une pierre dans une pièce d'eau. C'est comme une série d'ondes circulaires qui vont s'étendant, en s'affaiblissant, jusqu'à la limite du bassin. Le résultat final, c'est un accroissement général de la demande du capital et du travail nécessaires pour se procurer ce supplément de matériaux de la production et les mettre en œuvre, partant, une augmentation des profits, des intérêts et des salaires, lesquels constituent les revenus de tous les membres de la société. Les revenus augmentant, la demande des choses qu'ils servent à acheter augmente aussi, et elle provoque un exhaussement général des prix. L'exhaussement des prix a pour premier effet d'augmenter les profits, de stimuler la création de nouvelles entreprises, et par conséquent la demande du capital et du travail, de déterminer une nouvelle hausse des revenus, un nouvel accroissement de la [343] demande des choses que les revenus servent à acheter, et ainsi de suite. Cependant, le capital et le travail plus demandés s'accroissent, le taux des revenus qu'ils procurent s'abaisse jusqu'à ce qu'un nouveau progrès survienne et agisse pour le relever, mais, en attendant, la quantité du capital et du travail employés s'est augmentée, la masse des revenus s'est accrue et la richesse s'est multipliée.
Dans ce mouvement ascensionnel de la production et de la richesse, le débouché du capital s'agrandit beaucoup plus que celui du travail, puisque le progrès industriel s'opère principalement par la substitution de la machine à l'homme dans l'œuvre de la production. On emploie plus de capital et moins de travail dans toutes les industries que le progrès a transformées. Toutefois, l'augmentation générale de la production que chaque progrès suscite a pour effet de déterminer une augmentation correspondante de la demande générale du travail, et, à la longue même, de la demande particulière de l'industrie progressive. Il y a aujourd'hui plus d'ouvriers imprimeurs qu'il n'y avait autrefois de copistes, plus de fileurs et de tisserands à la mécanique que de fileurs et de tisserands à la main, plus d'employés de chemins de fer que de charretiers, de palefreniers, de conducteurs de diligences et de malle-postes. Il n'en est pas moins incontestable que la proportion du capital et du travail, engagés dans ces industries comme dans toutes celles qui ont subi l'action du progrès, s'est modifiée à l'avantage du capital. Le capital est donc destiné à se multiplier beaucoup plus que le travail; en revanche, le progrès élève le taux naturel de la rétribution du travail, tandis qu'il abaisse celui de la rétribution du capital.
[344]
CHAPITRE X. L'avenir. — La distribution.↩
I. — Diversité de la distribution de la richesse sous le régime de la petite industrie. — Moyens d'existence des classes dominantes, aristocratie et clergé; des classes industrielles et des classes ouvrières. — Changements que l'avènement de la grande industrie et du self government y a introduits. — Compensations que la plus-value du sol a procurées à l'aristocratie territoriale. — Diminution des revenus du clergé. — Accroissement extraordinaire des revenus des classes industrielles; enrichissement de la bourgeoisie. — Causes qui ont empêché la multitude ouvrière de recevoir toute sa quote-part dans l'augmentation de la richesse.
Sous l'ancien régime de la petite industrie, la distribution de la richesse présente une extrême diversité. Elle diffère suivant les pays et même suivant les localités. N'oublions pas que chaque État, renfermé dans des frontières plus ou moins étendues, est isolé des autres États, et vit des produits de son sol et de son industrie, que le commerce international n'existe pour ainsi dire que d'une manière exceptionnelle et accidentelle et que, même dans l'intérieur des grands États, le faible développement de l'industrie, le petit nombre et l'imperfection des moyens de communication rétrécissent la sphère des échanges. Aucune solidarité économique ne rattache les populations les plus voisines, car cette solidarité ne peut naître que des échanges. La richesse abonde dans certaines régions, tandis que les régions avoisinantes demeurent pauvres. En outre, chacune de ces sociétés isolées, vivant de sa vie propre et économiquement indépendante des autres, sauf pour un faible appoint d'articles de consommation, est partagée en castes ou en corporations [345] distinctes, ayant de même, chacune, ses moyens d'existence particuliers, dont elle conserve soigneusement le monopole. Au sommet de la pyramide sociale apparaît une aristocratie gouvernante, communément issue de la race conquérante, qui possède la plus grande partie du sol, qu'elle fait cultiver par des esclaves, des serfs ou des colons. Une autre portion du domaine territorial appartient à la caste des prêtres ou à la corporation religieuse, et elle est cultivée, comme la précédente, par la population asservie. Les moyens d'existence de ces deux castes, qui se partagent le gouvernement de la société, se composent: 1° du revenu qu'elles tirent de l'exploitation du sol, dont elles sont presque exclusivement propriétaires; 2° des impôts et redevances qu'elles prélèvent sur les autres classes de la population; 3° des bénéfices qu'elles retirent de la guerre, sous forme de butin, de tributs et d'agrandissements de territoire. Ces divers revenus varient d'État à État, selon la richesse et l'étendue du domaine territorial, les qualités productives du cheptel humain qui y est attaché, le rendement des impôts et redevances, les chances plus ou moins heureuses de la guerre. Ils se répartissent aussi d'une manière diverse et inégale: tantôt, comme dans les États asiatiques, le chef de la caste dominante, souverain absolu, est considéré comme le propriétaire du domaine territorial, et il en dispose selon son bon plaisir, plus ou moins tempéré par la coutume; tantôt, la terre, les esclaves, le produit des impôts et des conquêtes se concentrent entre les mains d'une oligarchie issue des chefs de la tribu ou de la nation conquérante; parfois, enfin, ils sont partagés avec une certaine égalité entre les membres de la caste ou de la nation souveraine, comme dans les petites républiques de la Grèce, mais presque toujours, comme à Rome, les petits domaines finissent par être absorbés par les grands.
[346]
Ce domaine territorial, dont l'exploitation constitue la principale branche de leur revenu, aussi bien que les impôts et redevances qu'elles prélèvent, les produits des guerres qu'elles entreprennent, les castes dominantes s'appliquent naturellement à en tirer le rendement le plus élevé possible. Comme elles possèdent la force, aucune autre considération que celle de leur intérêt ne limite l'exploitation à laquelle elles assujettissent les classes subordonnées et les populations que la fortune de la guerre livre à leur merci. Tantôt, elles y mettent une certaine modération; tantôt, au contraire, elles usent à outrance du pouvoir du maître ou du vainqueur. Cependant, l'opinion et la coutume qui en est le produit s'unissent à l'intérêt bien entendu du maître pour tempérer l'exercice de son pouvoir sur les esclaves, les serfs ou les colons de son domaine; les artisans et les trafiquants qui ont acheté leur liberté forment des corporations ou des communes qui opposent aux excès de l'oppression une force de résistance plus ou moins grande; enfin, dans un état de civilisation et de développement économique quelque peu avancé, les populations vaincues constituent des agglomérations assez nombreuses et assez bien pourvues de ressources pour qu'il soit imprudent de les réduire au désespoir : ces freins ou ces contreforces , suivant une expression de l'abbé de Saint-Pierre, agissent avec plus ou moins d'efficacité pour contenir le pouvoir du maître ou du vainqueur sur la fortune et la vie du sujet ou du vaincu, mais cette efficacité n'est jamais entière. En dépit des contrepoids ou des contreforces de l'intérêt bien entendu, de l'opinion, de la coutume, du pouvoir de résistance des corporations ou des communes, les castes dominantes, puissamment organisées et hiérarchisées, demeurent maîtresses de dicter la loi aux classes assujetties ou subordonnées. Elles peuvent s'attribuer et elles s'attribuent [347] communément une rétribution excessive, quoiqu'il convienne de remarquer qu'en préservant de l'anarchie l'État qu'elles ont constitué, et en le protégeant contre les agressions du dehors, elles rendent aux classes subordonnées des services d'une valeur inestimable.
Au-dessous de ces deux castes ou corporations supérieures qui se partagent, à l'origine, le gouvernement des sociétés fondées sur la petite industrie, apparaissent, également constituées en corporations, les classes industrielles et commerçantes. Chaque corporation est propriétaire de son marché, et elle peut, par conséquent, y dicter la loi aux consommateurs. Toutefois, ceux-ci ne sont pas dépourvus de moyens de résistance : les corporations se font contrepoids les unes aux autres, et la coutume ou le règlement du marché remplace, quoiqu'imparfàitement, la concurrence, pour fixer les prix des articles de consommation, le taux de l'intérêt et des salaires. Coutumes et règlements n'en laissent pas moins une certaine marge aux propriétaires de maîtrises; ils s'enrichissent et ils prennent dans l'État une place de plus en plus importante. En revanche, la multitude des ouvriers du sol et de l'atelier, à l'exception de ceux qui sont organisés en sociétés de compagnonnage, demeure réduite à la portion congrue. Les revenus de cette multitude subordonnée ne dépassent guère le minimum indispensable pour la faire subsister et pourvoir à sa reproduction. Ce minimum varie suivant les circonstances locales : dans les pays où la terre est fertile, où le climat est doux, où les premiers besoins de la vie sont faciles à satisfaire, il est moins élevé qu'ailleurs. Sans doute, le travail brut, unskilled d'un ouvrier, sous le régime de la petite industrie, n'a qu'une bien faible valeur, et la part qui lui reviendrait équitablement dans les résultats de la production n'excéderait pas sensiblement le minimum indispensable pour le faire vivre et pourvoir [348] à sa reproduction; il est permis de croire cependant qu'elle le dépasserait s'il pouvait débattre librement — et dans des conditions de parfaite égalité avec l'autre partie contractante — les conditions de son travail; mais telle n'est point la situation. Le maître dicte la loi, et la coutume ne tempère qu'imparfaitement son pouvoir. Le résultat, c'est que la multitude, réduite à un minimum de subsistances, est à la merci de tous les accidents; c'est qu'une mauvaise récolte survenant sous ce régime, une partie de la population est condamnée à périr, non seulement à cause de la difficulté de faire venir du dehors un supplément de substances alimentaires, mais encore et surtout parce que la couche inférieure de la classe subordonnée ne possède pas les ressources nécessaires pour acheter cette subsistance renchérie; c'est enfin qu'un accroissement des impôts sur les nécessités de la vie, une interruption du travail ne manquent pas de déterminer, de même, une augmentation rapide des privations et de la mortalité de cette classe dont les revenus sont au minimum dans les circonstances ordinaires.
Mais depuis la fin du moyen âge, ce vieux régime, fondé sur la petite industrie et la tutelle, est entré en décomposition, et à sa place surgit peu à peu la société nouvelle fondée sur la grande industrie et le self government. Au point de vue de la production de la richesse, les résultats de cette évolution, quoiqu'elle soit encore dans sa première phase de développement, sont déjà énormes: les changements qu'elle a déterminés dans la distribution de la richesse n'ont pas eu une importance moindre. Il n'est pas toujours facile cependant d'en discerner les vrais caractères. Un examen superficiel et partiel de la condition des différentes classes de la société, depuis l'avènement de la grande industrie et de la concurrence, a pu faire croire que les inégalités de la distribution de la [349] richesse s'étaient accrues, et qu'elles devaient s'accroître encore; que, dans ce nouvel état de choses, le riche ne pouvait manquer de devenir plus riche et le pauvre plus pauvre. Telle a été, comme chacun sait, la conclusion uniforme des différentes écoles socialistes ou communistes. Un examen plus approfondi et plus complet — un examen qui tient compte des perturbations temporaires qu'engendre toute transformation économique et sociale — conduit à une conclusion diamétralement opposée à celle-là. Il nous montre que la grande industrie et la concurrence n'aboutissent pas seulement à une multiplication indéfinie de la richesse, mais qu'elles ont encore pour tendance nécessaire et irrésistible de rendre la distribution des produits entre les producteurs de plus en plus égale.
Jetons d'abord un coup d'œil d'ensemble sur les changements accomplis, au point actuel de l'évolution, dans la distribution des revenus des éléments divers que l'ancienne société a légués à la nouvelle. Quelle est, sous ce rapport, la situation des castes ou des corporations gouvernantes que le progrès a dissoutes ou qui sont en voie de dissolution?
L'oligarchie nobiliaire des pays civilisés a perdu la propriété du cheptel d'esclaves ou de serfs qui mettait ses domaines en valeur et pourvoyait à son entretien et à ses services domestiques; elle a perdu aussi le monopole de la propriété territoriale. Ce progrès ne s'est pas accompli toutefois partout à la même époque, au même degré et de la même manière. En Angleterre, l'émancipation des esclaves et des serfs, presque entièrement achevée dès la fin du moyen âge, a privé plus tôt qu'ailleurs l'aristocratie de la propriété de son cheptel humain; en revanche, elle a conservé, grâce au droit d'aînesse et aux substitutions, la plus grande partie du sol. En France, l'aristocratie n'avait gardé, à l'époque de la Révolution, qu'un petit nombre de [350] restes du régime du servage, et elle avait perdu déjà une grande partie de son domaine territorial, passé entre les mains des bourgeois et des paysans. En Russie, le domaine territorial s'est partagé presque en totalité, jusqu'en 1861, entre la couronne et la noblesse. Celle-ci trouvait la principale source de ses revenus dans la propriété du sol combinée avec le servage. Chaque propriété était partagée en deux parts : l'une était concédée aux paysans organisés en communautés, à charge par eux de fournir le travail nécessaire à la mise en valeur de l'autre. L'acte d'émancipation a obligé les propriétaires à se dessaisir, en échange d'une indemnité, de la portion du domaine occupée par les communautés de paysans, et à renoncer au travail de corvée qu'elles lui fournissaient. Dans les États du Sud de l'Union américaine, l'aristocratie a été dépouillée sans indemnité de la propriété de ses esclaves; elle n'a gardé que celle d'un sol presque dénué de valeur. De là, de grandes inégalités dans les revenus et la condition de la classe aristocratique d'un pays à l'autre. Presque partout, sauf au Brésil, à Cuba, et dans les contrées où subsiste le péonat, l'aristocratie a vu tarir les revenus qu'elle tirait de l'exploitation des esclaves et des serfs, et elle a dû partager la propriété du sol avec la bourgeoisie et les paysans. Elle a vu diminuer aussi les revenus que lui procurait le monopole du gouvernement, tant par l'avènement des institutions représentatives qui ont limité son pouvoir que par l'accession des classes inférieures à la gestion des affaires publiques. A mesure que la population urbaine s'enrichissait par l'industrie et le commerce, et qu'elle acquérait une plus grande force de résistance, grâce à son organisation corporative, elle obligeait l'aristocratie gouvernante à compter davantage avec elle; peu à peu, elle conquérait le droit de consentir l'impôt, et elle se mettait ainsi à l'abri des exactions de la tyrannie [351] oligarchique; non seulement la classe qui possédait à l'origine le monopole sans contrôle et sans frein du gouvernement, fut obligée de payer sa quote-part des contributions levées pour la défense et l'entretien de l'État, mais encore elle dût en partager le produit avec un personnel de plus en plus nombreux, issu des autres classes. Enfin, les bénéfices qu'elle tirait de la guerre et de la conquête ont presque entièrement tari : les profits qui provenaient du partage du butin, des terres et des populations réduites en esclavage, ont disparu : le seul avantage que procurent aujourd'hui à la classe supérieure la guerre et la conquête, consiste dans un agrandissement de son débouché politique, administratif et militaire. Encore cet avantage est-il temporaire, au moins dans les pays appartenant à la civilisation européenne, les populations vaincues et annexées étant admises sur le pied de l'égalité avec leurs vainqueurs, à l'exercice des fonctions publiques.
Est-ce à dire cependant que les revenus de l'aristocratie aient diminué sous l'influence des divers progrès qui lui ont successivement enlevé, avec la propriété de son cheptel humain, le monopole de la terre et celui du gouvernement? Non! A mesure que la production, dans ses différentes branches, s'est perfectionnée et développée, à mesure que la population s'est multipliée et enrichie, les produits du sol et le sol lui-même ont été plus demandés, et l'exhaussement de leur valeur a été, en dernier lieu, accéléré par l'élargissement progressif de leurs débouchés, provoqué par l'application de la vapeur au transport des hommes et des marchandises. Sous l'influence de cette cause, les revenus de l'aristocratie terrienne se sont accrus de manière à compenser et au delà la perte que lui a fait subir la diminution ou l'extinction de ses autres ressources.
[352]
Les changements occasionnés par le progrès ont été moins favorables aux corporations cléricales qui partageaient avec les aristocraties conquérantes la possession du domaine territorial et le gouvernement des sociétés. Dans la plupart des États civilisés, les Églises établies et les communautés religieuses qui s'y rattachaient ont été dépouillées des propriétés et de l'impôt spécial — la dîme — d'où elles tiraient leurs moyens d'existence; en échange, on a inscrit au budget les « cultes reconnus », en transformant les prêtres en fonctionnaires préposés aux services religieux. Mais quoique les revenus provenant de cette source s'augmentent d'un casuel, quoique les communautés religieuses aient commencé à reconstituer leur patrimoine, en dépit des obstacles législatifs et autres, les corporations cléricales ont vu baisser partout, relativement du moins, leur influence et leurs revenus.
En revanche, l'avènement de la grande industrie et de la concurrence a été particulièrement favorable à la classe qui possède et dirige les entreprises industrielles, commerciales et agricoles, ou qui les alimente de ses capitaux. Sans doute, l'introduction de la nouvelle machinery de la production, l'abolition des corporations industrielles et le remplacement des « marchés appropriés » par des marchés simplement protégés, ont provoqué d'abord une perturbation générale et profonde dans la vieille industrie réglementée et incorporée; mais le dommage que le nouvelle machinery et la concurrence causaient aux industriels arriérés est demeuré insignifiant en comparaison de l'accroissement énorme des profits de l'industrie transformée et libérée. Les entreprises de tout genre ont décuplé en nombre et en importance, et comme, dans toutes les branches de la production, le progrès augmente la proportion nécessaire du capital en diminuant celle du travail, la demande des capitaux a reçu une [353] impulsion extraordinaire, en même temps que s'accroissait aussi celle des capacités indispensables pour diriger la mise en œuvre d'un matériel perfectionné. Or, la classe moyenne a eu, dans la première période d'incubation de la grande industrie, le monopole des uns et des autres. Les préjugés de l'aristocratie — préjugés issus de coutumes qui avaient perdu leur raison d'être — lui interdisaient de prendre part aux entreprises industrielles et commerciales. Quant à la multitude naguère asservie, elle ne possédait ni la capacité et les connaissances professionnelles, ni les relations et les capitaux nécessaires pour prendre part à la gestion ou à la commandite des entreprises grandissantes : seule, une élite relativement peu nombreuse de la classe ouvrière, a pu s'élever successivement aux fonctions dirigeantes de la production et à la possession du capital qui participe à ses profits.
C'est cette classe moyenne que M. Michel Chevalier a appelée la première moitié du Tiers-État, qui a principalement profité de l'établissement du nouvel ordre de choses; à quoi il est juste d'ajouter que c'est elle qui a principalement contribué à le fonder; c'est la classe moyenne qui a accaparé la plus grosse part de la richesse créée par la nouvelle machinery de la production. Elle s'est agrandie et enrichie.au point d'acquérir une influence prépondérante dans les États qui tiennent la tête du mouvement industriel : après être entrée en partage de pouvoir avec les anciennes corporations dirigeantes, elle les a dissoutes, et elle travaille aujourd'hui à se mettre à leur place.
La multitude qui vit de son labeur quotidien n'a point vu sa condition s'améliorer, à beaucoup près, dans la même proportion; peut-être a-t-elle commencé par souffrir plus des changements occasionnés par le nouvel ordre de choses qu'elle n'en a profité. Les causes qui l'ont empêchée de prendre sa quote-part légitime et nécessaire dans [354] l'augmentation générale de la richesse sont de plusieurs sortes : 1° La nouvelle machinery, modifiant la proportion du capital et du travail nécessaires à la production, à l'avantage du capital, une partie du personnel de l'ancienne industrie devenait inutile, et ne pouvait toujours être immédiatement employée dans les autres branches de la production; l'ouvrier perdait d'ailleurs, en tous cas, la valeur de l'apprentissage, des aptitudes et des connaissances requises par les emplois dont il était dépossédé. 2° Les causes variées qui rendent précaire la situation des entreprises, sous le nouveau régime, les vices de leur constitution et de leur gestion, l'instabilité des législations douanières, etc., créent un état d'instabilité, dont la classe ouvrière a particulièrement à souffrir. 3° La suppression de l'ancien régime de tutelle, en rendant la classe ouvrière maîtresse de se gouverner elle-même, sans qu'elle possédât toute la capacité demandée par le self government, a eu pour premier résultat de l'abandonner aux impulsions désordonnées de ses appétits : elle s'est multipliée à l'excès, sans appliquer à l'élève et à l'éducation de ses enfants les soins et le capital nécessaires pour en faire des coopérateurs utiles de la production; elle a affaibli encore leurs capacités productives en les vouant à un travail hâtif et dépassant leurs forces. La qualité de l'ouvrier a baissé, et une foule croissante de non valeurs ont encombré le marché du travail. 4° Cette incapacité à gouverner utilement sa reproduction, jointe au mauvais aménagement de sa consommation, à l'abus des liqueurs fortes, etc., tout en abaissant la qualité de son travail, a empêché la classe ouvrière d'accumuler des capitaux, autant qu'elle aurait pu le faire si elle avait été plus capable de pratiquer le self government. 5° Les économies que les ouvriers laborieux et rangés parvenaient à accumuler étaient trop fractionnées pour être engagées dans la production et leur [355] procurer ainsi un accroissement sensible de revenus; d'ailleurs, ils manquaient des notions requises pour en faire un emploi judicieux. 6° La situation de l'ouvrier n'était pas égale à celle de l'entrepreneur dans le débat du salaire, l'entrepreneur disposant à un plus haut degré de. Yespace et du temps. Il en est résulté, après la chute des institutions et des coutumes qui intéressaient le maître à la bonne conservation de l'ouvrier ou qui l'empêchaient, dans une certaine mesure, d'abuser de ses forces, il en est résulté, disons-nous, une tendance générale à exiger de l'ouvrier un maximum de travail dépassant ses forces en échange d'un minimum de subsistances, trop souvent insuffisant pour les réparer. Enfin, 7° le service militaire et les impôts de consommation, établis par les classes supérieures de manière à peser principalement sur la multitude, ont amoindri encore la part qu'elle pouvait acquérir ou qui lui revenait dans les résultats de la production et augmenté ses privations et ses souffrances. Sous l'influence de ces causes réunies, les revenus de la classe vivant de salaires — à l'exception d'une élite qui constitue l'étatmajor des entreprises ou qui exerce des professions exigeant des aptitudes spéciales et rares — les revenus de la classe salariée, disons-nous, ne se sont point élevés dans la même proportion que ceux des classes vivant de la rente du sol, des intérêts ou des profits du capital. Les socialistes ont exagéré sans doute cette inégalité dans la répartition de la richesse accrue par le progrès industriel et la concurrence, mais il serait puéril de la nier contre toute évidence. En quoi les socialistes se sont trompés, c'est en lui attribuant un caractère permanent et fatal; c'est en prétendant que la grande industrie et la concurrence conduisent à la constitution d'une féodalité industrielle et financière, dans laquelle le travail est nécessairement exploité au profit du capital. Nous allons nous [356] assurer, au contraire, que le développement naturel et irrésistible de la grande industrie et de la concurrence aboutit à la constitution d'une démocratie industrielle et financière, caractérisée par une répartition de plus en plus égale des résultats de la production, et dans laquelle même les revenus afférents au capital sont destinés à baisser progressivement tandis que s'élèvera la part du travail.
II. — Insuffisance de l'étendue des marchés sous l'ancien régime. — Ses conséquences. — Comment s'agrandissent les marchés, s'unifient et se nivellent les prix sous l'influence de la grande industrie et de la concurrence. — Comment naît la rente; action progressive qu'elle exerce. — Que l'agrandissement des marchés provoque un développement correspondant du rouage commercial dans ses trois branches : commerce des produits, des capitaux et du travail.
Si nous résumons les caractères de la distribution de la richesse sous le régime de la petite industrie, nous trouvons qu'elle varie d'un État à un autre, et qu'elle est en grande partie abandonnée aux hasards de la force. Les classes souveraines qui possèdent le domaine territorial et gouvernent l'État fixent à leur gré le prix de leurs services : la quotité de leur revenu dépend de la fécondité du sol, de la qualité et du nombre du cheptel humain qui le cultive; leur intérêt bien entendu limite seul la quantité de travail et de redevances qu'elles exigent de leurs esclaves ou de leurs sujets. Ce n'est qu'à la longue que des institutions ou des coutumes protectrices des classes possédées ou subordonnées mettent un frein à leurs exigences et bornent ainsi la part du lion qu'elles s'attribuent dans le revenu de la communauté. De même, les classes industrielles, organisées en corporations et maîtresses d'un marché qu'elles se sont approprié du consentement intéressé de la caste gouvernante à laquelle elles paient une redevance, fixent à leur gré le prix de leurs produits, [357] sauf la résistance qu'elles rencontrent chez les consommateurs, et qui prend corps dans des coutumes ou des règlements limitatifs. Enfin, l'intérêt du capital et le salaire du travail se règlent d'après la situation des contractants en présence sur un marché resserré, d'après le pouvoir des uns, le besoin des autres. Les capitalistes ordinairement peu nombreux qui exploitent ce marché, sans avoir à craindre aucune concurrence du dehors, élèvent leurs exigences en raison des besoins de l'emprunteur, et les lois sur l'usure ne leur opposent qu'une barrière presque toujours facile à franchir ou à tourner. Le besoin d'emprunter étant naturellement plus intense que celui de prêter, le taux de l'intérêt est excessif. En revanche, le taux du salaire est communément au-dessous de la part légitime et nécessaire qui devrait revenir au travail — le besoin que l'ouvrier a du salaire du maître étant plus intense que le besoin que le maître a du travail de l'ouvrier. Les coutumes, les coalitions ou les associations que forment entre eux les ouvriers pour résister à la loi qui leur est imposée ne tempèrent que faiblement l'exploitation résultant de cette inégalité des forces et des besoins.
Cet état de choses ne pouvait disparaître en un jour, et, en dépit de l'avènement de la grande industrie et des progrès de la concurrence, il subsiste encore en partie. Il est même arrivé que la destruction hâtive des freins, qui contenaient, dans certaines limites, l'abus du pouvoir des maîtres de l'État politique, propriétaires du domaine territorial, des détenteurs de capitaux et des chefs d'industrie — tandis que la concurrence qui devait remplacer ces freins ne pouvait encore agir avec une efficacité suffisante, soit qu'elle fût naturellement ou artificiellement empêchée — ait aggravé la condition des classes subordonnées.
[358]
Cependant, grâce au développement progressif et irrésistible de la grande industrie et de la concurrence, un nouveau mode de distribution de la richesse, basé sur l'équilibre des forces et non plus sur la prépondérance d'une force, se substitue peu à peu à celui-là. Aux marchés locaux, dans lesquels la partie la plus forte faisait la loi à l'autre, nous voyons succéder un marché général dans lequel les prix de toutes choses tendent à s'équilibrer au niveau des frais nécessaires pour les produire, et où ce niveau même — celui du travail seul excepté — tend incessamment à s'abaisser.
Comment s'accomplit cette évolution naturelle vers la justice dans la distribution de la richesse? Elle s'accomplit à la fois par l'action du progrès industriel qui détruit successivement les murs de séparation des marchés locaux, et par l'action de la concurrence qui unifie les prix sur le marché général.
De quelle façon se sont agrandis et s'agrandissent tous les jours les marchés? Il est facile de s'en rendre compte. L'emploi de machines plus puissantes et de procédés plus efficaces a permis de produire certains articles en quantités dépassant les besoins du marché local, le perfectionnement des moyens de transport a permis de les porter au delà des limites de ce marché. D'abord cet agrandissement du marché primitif a été partiel et lent. Il s'est accéléré et généralisé depuis que les inventions qui augmentent la productivité de l'industrie se sont multipliées, depuis que l'application de la vapeur au transport des hommes et des marchandises et celle de l'électricité au transport des valeurs ont donné les moyens de faire circuler les uns et les autres, sur un immense espace, plus rapidement et à moins de frais qu'ils ne circulaient naguère dans l'étroite enceinte du marché local. Sans doute, tous les obstacles naturels et toutes les clôtures [359] artificielles qui empêchent les marchés de s'étendre et de s'unifier sont loin d'avoir disparu, mais on peut déjà affirmer qu'ils disparaîtront successivement, et qu'un jour viendra où il n'y aura plus de marchés locaux; il n'y aura plus qu'un marché général.
Tandis que la grande industrie unifie les marchés, la concurrence agit de son côté pour unifier les prix en faisant graviter par le jeu, devenu libre, du mécanisme de l'offre et de la demande, le prix du marché ou prix-courant autour des frais de production ou du prix naturel, c'est-à-dire de la somme nécessaire pour entretenir, renouveler et accroître dans la proportion utile les agents productifs. En même temps, elle agit pour abaisser ces frais de production au dernier minimum possible.
Si nous voulons nous faire une idée bien nette de la manière dont s'accomplissent ces différents phénomènes, si nous voulons savoir comment s'agrandit et se perfectionne en s'agrandissant le mécanisme de la distribution de la richesse, prenons les ehoses au début de l'évolution de la grande industrie. Nous sommes en présence de milliers de marchés locaux, pour la plupart sans communication entre eux. Dans chacun de ces marchés, les prix diffèrent plus ou moins de ceux des autres. Un hectolitre de blé, une tonne de fer ou de charbon, un mètre de la même étoffe de coton, de laine ou de soie se vendent à autant de prix qu'il y a de marchés et les différences sont parfois énormes. De même, une somme déterminée de capital se prête — les risques étant supposés égaux — à des taux qui varient du simple au décuple, et des inégalités non moins fortes se rencontrent dans les prix du travail. Mais les obstacles naturels ou artificiels qui séparaient et isolaient les marchés locaux viennent à s'abaisser. Que se passe-t-il alors? C'est que les produits dont les prix sont au niveau le plus bas se portent naturellement dans [360] les directions où ce niveau est plus élevé et ils s'y échangent avec un accroissement de profit d'autant plus considérable que la différence est plus grande. Sous l'influence de ce déplacement de l'offre, les prix se nivellent, comme lorsqu'on met en communication des bassins différents on voit leurs eaux prendre le même niveau. Le niveau s'élève dans le bassin inférieur; il s'abaisse dans le bassin supérieur. Il se crée de la sorte, pour les différents bassins, un niveau unique et moyen. C'est ainsi que les choses se passent pour les prix, soit qu'il s'agisse de produits, de capital ou de travail, et c'est la première phase de l'évolution des prix, au moment où s'opère la mise en communication des bassins, autrement dit l'unification des marchés.
Mais quel a été l'effet de l'élévation du niveau du prix dans le marché où il était le plus bas, de son abaissement dans le marché où il était le plus haut? Ça été d'augmenter là les profits de la production et de les diminuer ici. Dans le premier marché, la production couvre maintenant au delà de ses frais avec adjonction des profits ordinaires. Elle réalise un profit extraordinaire, ou, ce qui revient au même, elle obtient une rente. Dans le second marché, au contraire, elle ne couvre plus ses frais (en admettant toutefois que le prix du marché local ne dépassât pas le taux nécessaire), elle subit une perte, et de deux choses l'une : ou elle renonce à produire; dans ce cas, la suppression du contingent qu'elle apportait au marché élève le niveau général du prix; ou elle continue à produire, en adoptant un outillage et des procédés perfectionnés qui lui permettent de diminuer ses frais, et dans ce cas le prix demeure au niveau moyen où il s'était fixé d'abord, sauf les fluctuations provoquées par les changements survenus dans la demande. Cependant, il ne tarde pas à s'abaisser par l'opération de la rente qui s'est [261] produite dans le premier marché. Cette rente agit comme un aimant pour attirer l'esprit d'entreprise et les capitaux, et cette attraction est d'autant plus énergique et efficace que la rente est plus élevée. Il en résulte une augmentation de la production, partant de Yoffre du produit, une chute du prix et une baisse de la rente. Si le prix ne suffit plus pour permettre aux établissements placés dans les conditions les moins favorables de couvrir leurs frais, si ces établissements viennent à se fermer, l'offre diminue et le prix se relève. Mais la rente se relève du même coup, et l'attraction qu'elle exerce détermine un nouvel apport de l'esprit d'entreprise et des capitaux jusqu'à ce que l'augmentation de la production et de l'offre ait abaissé le prix de manière à supprimer la rente et à réduire l'industrie à la portion congrue des profits ordinaires. S'il y a des obstacles naturels ou artificiels qui s'opposent à l'apport de l'esprit d'entreprise et des capitaux dans l'industrie pourvue d'une rente — et tel a été jusqu'à présent le cas de l'agriculture — la rente subsistera, et elle ne manquera pas de croître à mesure que les produits de cette industrie favorisée seront plus demandés. Mais ces obstacles venant à s'abaisser et à disparaître, la rente s'abaissera et disparaîtra avec eux.
En résumé donc, lorsque des marchés isolés viennent à être mis en communication, lorsque le marché créé par leur réunion est assez étendu pour que le mécanisme de l'offre et de la demande puisse y fonctionner librement, sans que les producteurs conservent la possibilité de restreindre leur offre tandis que les consommateurs pressés par le besoin ne peuvent restreindre dans la même mesure leur demande, la concurrence a pour premier effet de niveler à un taux moyen les prix du marché unifié. Mais les frais de production ou les prix naturels sont inégaux dans ce marché unifié. Le prix moyen découvre les uns [362] pour couvrir davantage les autres. Ceux-ci obtiennent une rente, tandis que ceux-là subissent une perte ou une non rente. On s'ingénie à éviter la perte, en améliorant ici les procédés de la production, et en portant là l'esprit d'entreprise et les capitaux pour jouir de la rente — et le résultat final, c'est l'abaissement général des frais de la production et du prix.
La rente qui naît du jeu libre du mécanisme de l'offre et de la demande est le plus puissant des véhicules du progrès. C'est en vue d'obtenir une rente — autrement dit une rétribution qui s'ajoute aux frais de production augmentés des profits ordinaires de l'industrie, ou d'éviter une non rente qui les laisse à découvert — que l'on s'ingénie à abaisser ces frais, soit en localisant mieux les entreprises, en les établissant dans des dimensions ou sous des formes plus économiques, en améliorant leur gestion, en perfectionnant leur machinery, en économisant l'emploi du capital et du travail et en s'appliquant à les obtenir au meilleur marché possible. Tout progrès réalisé dans l'une ou l'autre de ces parties des frais de production est aussitôt récompensé par l'apparition d'une rente. Cette rente n'est point permanente sans doute : si le progrès réalisé est promptement et généralement imité, elle n'aura qu'une courte durée, mais elle n'en aura pas moins suffi pour récompenser le progrès et en déterminer la diffusion.
C'est encore à la rente qu'est dû le nivellement proportionnel des prix entre toutes les branches de la production. Si les prix viennent à s'élever dans une industrie de manière à attribuer à la généralité des entreprises entre lesquelles elle se partage, outre la compensation des frais de production avec l'adjonction des profits ordinaires, une rente plus ou moins forte, l'esprit d'entreprise et les capitaux abandonneront les autres directions pour se porter [363] vers celle-là jusqu'à ce que la rente ait disparu et que le niveau proportionnel soit rétabli.
En dernière analyse, la grande industrie et la concurrence aboutissent à ces deux résultats, dont l'importance est capitale au point de vue de la distribution de la richesse; c'est d'abord d'établir un marché général dans toutes les parties duquel un hectolitre de blé, une tonne de fer ou de charbon, un mètre de la même étoffe se vendra au même prix; c'est ensuite d'abaisser successivement ce prix au niveau le plus bas des frais de production, c'est-àdire à la somme rigoureusement nécessaire pour entretenir ou renouveler les agents productifs et leur permettre de s'accroître dans la mesure et la proportion utiles.
Ce même travail d'unification des marchés et de nivellement des prix, la grande industrie et la concurrence l'accomplissent pour le capital et le travail aussi bien que pour les produits. Nous avons vu se créer depuis un demi-siècle un marché général des capitaux qui comprend, non seulement l'Europe, mais encore l'Amérique, et où l'on voit hausser ou baisser simultanément, suivant l'influence des événements, les valeurs mobilières. Nous avons vu s'élargir aussi le marché du travail, quoique des obstacles de toute sorte aient retardé et retardent encore son extension. Un jour viendra donc où, d'une part, la même somme de capital se louera et le même travail s'achètera partout au même prix, où, d'une autre part, ce prix se nivellera au taux nécessaire pour entretenir et multiplier dans la mesure et la proportion utiles ces deux catégories d'agents productifs. Avec cette différence essentielle que le progrès a pour effet de diminuer le taux nécessaire de la rétribution du capital, tandis qu'il élève celui de la rétribution du travail.
Ajoutons, enfin, que l'unification des marchés et le nivellement des prix s'accomplissent par la coopération et [364] l'agrandissement du rouage intermédiaire qui sert à transporter, dans l'espace et dans le temps, toutes les choses pourvues de valeur et la valeur même de ces choses, nous voulons parler du commerce dans ses trois grandes branches — commerce des produits, des capitaux et du travail. A mesure que chacune des parties du vaste marché du monde devient plus accessible aux produits, aux capitaux et au travail des autres parties, le commerce se charge de les y porter, mais il ne peut s'acquitter de cette tâche qu'à la condition de se développer en conséquence, à la condition de s'agrandir dans la proportion de l'agrandissement du marché. Tel est, en effet, le phénomène dont nous sommes témoins : le commerce des produits dont le marché s'est le plus étendu, les céréales, les grandes matières premières, les articles manufacturés, a pris, depuis un demi-siècle, une extension extraordinaire. Autant peut-on en dire du commerce des capitaux ou du crédit, et si des causes particulières ont ralenti le progrès du commerce du travail, il est dès à présent visible que cette branche importante du rouage commercial ne tardera plus longtemps à se mettre au niveau des deux autres. Seulement, l'infériorité de ce développement est demeurée une des causes principales qui empêchent le travail de recevoir sa quote-part nécessaire et légitime dans la distribution de la richesse.
III. — Influence de l'unification des marchés et du nivellement des prix des produits, du capital et du travail sur la distribution de la richesse entre les différentes classes de la société. — Causes de l'augmentation du revenu foncier. — Les deux phases de l'évolution de la rente du sol. — Leurs effets sur la condition des classes rurales en Angleterre et en France. — Conséquences économiques et sociales de la chute de la rente. — Causes qui ont maintenu le monopole des capitaux d'entreprise et des fonctions dirigeantes de la production entre les mains de la classe moyenne. — Comment la grande industrie et la concurrence travaillent à détruire ce double monopole après avoir commencé par le rendre plus productif. —Abaissement successif de la rétribution du capital. — Raccourcissement de l'échelle des rétributions du travail. — Unification finale des différentes [365] classes de la société. — Que l'ensemble des progrès issus de la grande industrie et de la concurrence est destiné à profiter principalement à la classe inférieure. — Élévation graduelle de sa condition. — Nécessité d'une tutelle pour les races ou les individualités en retard.
Examinons, maintenant, l'influence que ce double phénomène de l'unification successive des marchés et du nivellement des prix des produits, des capitaux et du travail, est appelé à exercer sur la distribution de la richesse entre les différentes classes de la société, en commençant par la plus élevée, celle qui vit principalement du revenu du domaine territorial.
Nous avons constaté que l'accroissement extraordinaire de ce revenu a procuré à la classe aristocratique dans les pays qui tiennent la tête du mouvement industriel, une ample compensation à la perte de la propriété de ses esclaves et de ses serfs, à celle du monopole du gouvernement et à l'extinction presque complète des profits de la guerre. A quelles causes convient-il d'attribuer cette augmentation du revenu territorial et la plus-value croissante de la propriété foncière qui en a été la conséquence? Avant tout, à la multiplication devenue incomparablement plus rapide de la population et de la richesse. La demande des denrées agricoles s'est accrue en proportion, les prix de ces denrées se sont élevés et la production en a été encouragée. Mais l'insuffisance des moyens de communication, la difficulté et la cherté des transports limitaient d'abord cette production à un rayon assez court, dont le marché de consommation était le centre. L'établissement des grandes routes et des canaux, la suppression des douanes intérieures, puis l'avènement des chemins de fer ont étendu successivement ce rayon, en amenant l'unification graduelle des prix sur tout son parcours. Cependant, le progrès ne s'est pas arrêté aux frontières des États. Les chemins de fer ont continué à se [366] multiplier et ils se sont internationalisés en se multipliant, la navigation à vapeur a franchi les océans, les loiscéréales ont été abolies. Un marché général s'est créé pour les grandes denrées alimentaires, et ce marché a acquis une étendue que l'on n'aurait pas crue possible, il y a un demi-siècle. Des grains et des viandes des régions les plus reculées du globe contribuent aujourd'hui à l'approvisionnement de l'Angleterre, de la France et des autres pays de l'Occident européen. Les prix s'unifient de plus en plus dans cet immense marché où subsiste, cependant, une extrême diversité dans les frais de production du blé, de la viande et des autres denrées alimentaires.
Dans la première phase de cette évolution des marchés et des prix, l'influence de l'accroissement de la demande des denrées alimentaires ne s'étend guère au delà de la région qui avoisine les grands foyers de consommation. Dans cette région, les terres sont inégales en fertilité, ou, si l'on veut, inégalement aptes à produire les denrées alimentaires. En admettant que les terres qui y sont le plus aptes, les terres de première qualité, ne soient pas assez nombreuses pour subvenir à l'augmentation de la demande, on mettra successivement en culture les terres de deuxième, troisième et même de quatrième qualité, si le prix du marché suffit pour couvrir sur ces dernières les frais de production avec adjonction des profits ordinaires. Mais ce prix procurera à l'industrie agricole exercée sur les autres une rente d'autant plus élevée que la terre sera plus fertile, que la quantité produite en échange des mêmes frais sera plus grande. Ce phémomène, observé par Ricardo, et sur lequel s'appuie sa célèbre théorie de la rente, ne saurait être contesté. Puisque le prix du marché est rémunérateur pour la culture des terres de quatrième qualité — et s'il ne l'était point, ces terres ne [367] pourraient être cultivées — la culture des terres de troisième, deuxième et première qualité ne doit-elle pas obtenir une rente proportionnée au degré de fertilité du sol, au degré de puissance de la machine à produire les denrées alimentaires? A qui va cette rente? Au moment où l'augmentation de la demande et du prix crée la rente au profit des terres de première qualité, elle va à l'entrepreneur d'industrie agricole. Si c'est un fermier, il bénéficie de l'exhaussement du prix jusqu'à l'expiration de son bail; si c'est un simple métayer, ce bénéfice se partage entre le propriétaire et lui. Mais l'encouragement que la hausse du prix a donné à l'industrie agricole y fait affluer l'esprit d'entreprise et les capitaux. On trouve profit à mettre en culture successivement les terres de deuxième, troisième et quatrième qualité. Dans cette condition des choses, un entrepreneur de culture n'a-t-il pas autant d'avantage à affermer à haut prix les terres supérieures qu'à cultiver, moyennant un modique fermage, les terres inférieures? La rente finit donc par aller presque tout entière à la classe des propriétaires fonciers en proportion du degré de fertilité ou des avantages de situation de leurs terres; le revenu de cette classe augmente, et on la voit s'enrichir rapidement. Les entrepreneurs de culture voient également leurs profits s'accroître, d'une part, jusqu'à ce que la classe des propriétaires ait réussi à s'attribuer toute la rente; d'une autre part, jusqu'à ce que les ouvriers attachés au sol, et dont les salaires sont demeurés dépendants de la volonté du maître, puissent se déplacer, et acquièrent ainsi le pouvoir effectif de débattre le prix de leurs services. C'est à cette dernière catégorie des coopérateurs de la production agricole que la hausse des prix des denrées alimentaires profite le moins dans cette première phase de l'évolution des marchés. Tout au plus peuvent-ils obtenir une [368] augmentation de salaires équivalente à l'exhaussement du prix des matériaux de l'existence.
Cependant l'évolution se poursuit : la machinery des transports se développe et se perfectionne, le commerce des subsistances acquiert une importance et une extension croissantes, le rayon d'apport des denrées alimentaires aux marchés de consommation s'allonge successivement au double, au triple, au décuple : grâce à la coopération de la vapeur et de la liberté commerciale, il devient presque illimité. Aussitôt une nouvelle série de phénomènes commence à se produire. La demande des denrées alimentaires continue de s'accroître grâce aux progrès de la population et de la richesse, les prix continuent de hausser et la rente de s'élever; enfin, l'esprit d'entreprise, les capitaux et les bras continuent par là même d'être attirés dans l'industrie agricole. Seulement, la sphère dans laquelle ils sont maintenant attirés, et dans laquelle ils se distribuent, se trouve indéfiniment agrandie : après avoir atteint les limites les plus reculées des pays de grande industrie — et jusque-là à la vive satisfaction des propriétaires — elle les dépasse pour englober les terres noires de la Russie, les prairies du far west de l'Union américaine, les pampas de l'Amérique du Sud et même les vastes solitudes de l'Australie. Un courant grossissant d'émigration de l'esprit d'entreprise, des capitaux et du travail agricole se porte dans ces régions nouvelles, dont la vapeur et la liberté du commerce rendent désormais les produits accessibles aux anciens marchés de consommation. C'est la seconde phase de l'évolution, et, quoiqu'elle soit seulement à ses débuts, nous pouvons déjà nous rendre compte de ses effets. Quelle est la situation? Les prix des denrées alimentaires se sont élevés de manière à faire appliquer à la production des subsistances les terres de première, deuxième, [369] troisième et même de quatrième qualité dans le rayon primitif d'approvisionnement, en Angleterre, en France, en Belgique, en Allemagne. Mais ce rayon vient de s'agrandir de façon à mettre une étendue illimitée de terres nouvelles en concurrence avec l'ancien domaine agricole. Il y a toujours, à la vérité, une certaine différence de frais de transport à l'avantage de ce dernier : cette différence, supposons-la équivalente à celle des frais de production d'une qualité de terre à une autre. Que va-t-il se passer? C'est que l'esprit d'entreprise, les capitaux et les bras iront féconder les régions nouvelles, où ils trouvent en abondance des terres de première qualité et où ils seront attirés par un supplément de profits égal à la somme des rentes afférentes aux terres de deuxième et de troisième qualité, en admettant que l'industrie agricole couvre simplement ses frais avec adjonction des profits ordinaires sur les terres de quatrième qualité. Grâce à cette prime, la production des substances alimentaires se développera rapidement dans les régions nouvelles, les quantités offertes augmenteront progressivement et les prix baisseront. A mesure que la baisse s'accentuera, les frais de production cesseront d'être couverts sur les terres de quatrième et de troisième qualité de l'ancien rayon d'appro- -visionnement, et la rente finira par disparaître sur les terres de la deuxième en se réduisant de 4 unités à 1 sur les terres de la première. Cette unité pourra même être entamée si les frais de transport continuent à s'abaisser, en admettant que les terres essentiellement propres à la production alimentaire existent en quantité illimitée dans le rayon agrandi du marché d'approvisionnement. Mais, quelles seront les conséquences de ces phénomènes de la seconde phase de l'évolution sur la condition des classes agricoles? Ces conséquences seront précisément la contrepartie de celles des phénomènes de la première phase. La [370] classe des propriétaires fonciers verra successivement s'abaisser et disparaître le revenu qu'elle retire de la rente. La presque totalité de la perte résultant de la baisse des prix retombera sur elle, de même qu'elle avait pu s'attribuer la presque totalité du bénéfice provenant de la hausse. Les fermiers que la désaffectation des terres de qualité inférieure à la production alimentaire laissera sans emploi, appliqueront leur esprit d'entreprise et leurs capitaux à d'autres branches de la production intérieure, à moins qu'ils ne préfèrent aller mettre en valeur les bonnes terres de la région nouvelle : ils ne perdront que le capital qu'ils avaient investi dans leurs exploitations; enfin, les ouvriers agricoles, à l'état d'excédant dans l'ancienne région, se déverseront dans la nouvelle, et ceux que la culture du domaine primitif continuera d'employer profiteront largement, à titre de consommateurs, de l'abaissement du prix des subsistances; à titre de travailleurs, de l'élargissement du marché du travail.
Cependant, ces deux phases successives de l'évolution de la production alimentaire donnent naissance à une autre série de progrès. La hausse des prix et la crue de la rente, dans la première phase, encouragent d'abord les progrès des moyens de transport et le développement du commerce — en déterminant la suppression des loiscéréales et des autres obstacles à ce développement — qui étendent le rayon des approvisionnements; ensuite, le perfectionnement de la machinery agricole dans les régions nouvelles. La baisse des prix et la décroissance de la rente, dans la seconde phase, encouragent plus énergiquement encore la transformation progressive de l'industrie agricole dans les anciennes régions. Avant de se résigner à laisser en friche un domaine d'où ils tiraient leurs moyens d'existence, propriétaires et fermiers s'ingénient, soit à améliorer les facultés productives du sol, soit à l'appliquer [371] à un emploi plus avantageux ou à diminuer les frais de la culture. Que se passe-t-il, en effet, depuis que le rayon d'approvisionnement de nos marchés s'est étendu bien au delà de nos frontières? Nous avons vu, sous la pression de la concurrence, les terres les moins aptes à la culture du blé recevoir d'autres destinations; en Angleterre, par exemple, d'immenses surfaces emblavées ont été transformées en prairies, et elles ont pu continuer ainsi à fournir une rente; le sol a été amélioré par une application judicieuse de la science et du capital; des terres de la quatrième ou de la troisième qualité ont passé dans la deuxième et même dans la première; la machinery agricole s'est perfectionnée à l'égal de la machinery industrielle et les méthodes de culture ont été renouvelées. Ce mouvement progressif va s'accélérant à mesure que la pression extérieure devient plus intense, et le moment n'est probablement pas éloigné où l'on commencera à substituer économiquement la grande manufacture agricole, à capital mobilisable, au petit atelier à capital immobilisé. Mais la rente afférente au sol n'en diminue pas moins : ce qui croît, c'est le profit afférent aux capitaux et à l'industrie que l'on emploie à améliorer le sol et les cultures. Le propriétaire qui se contenterait de toucher sa rente, en se fiant pour le reste à la protection spéciale qu'il s'imagine lui être due, finirait par être réduit à la besace. Ce n'est qu'en appliquant la science et les capitaux à l'amélioration et au judicieux emploi du sol, en contribuant, pour sa part, aux progrès de la constitution et du gouvernement des entreprises, en favorisant l'introduction de la machinery et des méthodes perfectionnées, qu'il peut désormais conserver et accroître les revenus de son domaine : la plus-value ne lui viendra plus d'elle-même par le fait des progrès réalisés par autrui.
Les phénomènes que nous venons d'esquisser ont affecté [372] et affecteront diversement les pays de grande et de petite propriété. En Angleterre, l'aristocratie, demeurée propriétaire de la presque totalité du domaine territorial, a vu croître ses revenus, dans d'énormes proportions, pendant la phase ascendante de la rente. La classe des fermiers s'est enrichie de même, quoique dans une mesure beaucoup moindre; en revanche, la classe nombreuse des ouvriers agricoles est demeurée pauvre; il semble même qu'elle se soit appauvrie encore pendant que s'enrichissaient les propriétaires et les fermiers. Son ignorance, l'état de sujétion dans lequel elle se trouvait vis-à-vis des entrepreneurs agricoles, relativement en petit nombre, et ne se faisant qu'une insuffisante concurrence pour la location des bras, les obstacles que la loi du domicile de secours opposait à ses mouvements l'ont empêchée de prendre sa part dans l'accroissement des profits de l'industrie agricole : c'est tout au plus si elle a réussi à faire élever son salaire dans la proportion de la hausse du prix des subsistances. Maintenant, que se passe-t-il depuis qu'a commencé la phase descendante de la rente? Propriétaires et fermiers ont fait de louables efforts pour soutenir la concurrence extérieure : les terres et les cultures ont été améliorées, les frais de production ont été abaissés; ils le seront encore. L'agriculture deviendra de plus en plus une grande industrie. Alors le mécanisme des entreprises à capital fractionné et mobilisable s'imposera à elle comme s'est imposé le nouvel outillage agricole : parce qu'il est plus économique — un capital mobilisable exigeant une rétribution moindre qu'un capital immobilisé. Les propriétaires qui mettront leurs domaines en actions bénéficieront de la différence, mais aussitôt que cette transformation économique du régime de la propriété sera accomplie, l'aristocratie territoriale aura cessé d'exister. La propriété foncière, émiettée en coupures de 20 liv. st., [373] de 10, de 5, de 1 liv. st. même, se répandra dans toutes les couches de la société et le plus modeste ouvrier aura sa part dans la propriété du sol et dans la richesse du domaine agricole de l'Angleterre.
En France, où environ les deux tiers du sol sont partagés en petites propriétés, la crue de la rente a favorisé une classe beaucoup plus nombreuse. En outre, les ouvriers agricoles, ayant pour la plupart un lopin de terre, ont acquis une indépendance qui les a émancipés en partie de la sujétion du grand propriétaire ou du gros fermier, et contribué à élever le taux des salaires de l'agriculture. En revanche, l'exiguïté des propriétés, jointe à la passion de les agrandir, a livré le paysan aux usuriers, tout en retardant l'application de l'outillage et des procédés agricoles perfectionnés. La condition de la classe rurale n'en a pas moins été singulièrement améliorée dans cette première phase de l'évolution, et l'abolition du corn laws en ouvrant à ses produits le riche débouché de l'Angleterre, a contribué notamment à lui procurer une prospérité qu'elle n'avait jamais connue. Mais voici venir la seconde phase. La chute de la rente ne manquera pas d'être plus sensible à une classe nombreuse de paysans à petits revenus qu'elle ne le sera au petit nombre des propriétaires à gros revenus de l'Angleterre, et les remèdes, savoir l'amélioration de la machinery agricole et l'introduction du rouage économique du capital mobilisable, seront plus lents et plus difficiles à appliquer. La transformation n'ira probablement pas sans une crise profonde et étendue; elle s'accomplira néanmoins par la force des choses, comme s'accomplissent tous les progrès, et le nombre des propriétaires du sol, passé à l'état de propriété mobilière, sera doublé, tandis que le prix des matériaux de l'existence descendra au taux le plus bas possible.
[374]
Passons à l'influence que le développement futur de la grande industrie et de la concurrence est destiné à exercer sur la condition de la classe moyenne qui vit du profit des entreprises, de l'intérêt ou du loyer des capitaux, de la rétribution des fonctions dirigeantes de la production dont elle constitue l'état-major. La demande extraordinaire des capitaux et des capacités industrielles, dans la première phase de l'évolution, a naturellement profité à la classe dans laquelle les uns et les autres se trouvaient surtout concentrés; elle lui a profité d'autant plus que des obstacles de diverses sortes empêchaient les capacités industrielles et les capitaux des autres classes de venir faire concurrence aux siens : pendant longtemps, les préjugés de l'aristocratie territoriale et gouvernante lui ont interdit de s'occuper des affaires industrielles et commerciales, et c'est seulement à l'époque où les revenus qu'elle tirait du gouvernement, de la guerre et de l'assujettissement de la classe agricole ont commencé à baisser, que ses membres les plus intelligents, s'affranchissant des préjugés, se sont mis à faire valoir leurs capitaux dans l'industrie, et à accepter ensuite des fonctions dans l'état-major des entreprises. Pour d'autres motifs, les profits et les fonctions dirigeantes de l'industrie demeuraient généralement hors de la portée des capitaux et des capacités de la classe ouvrière. Constituées sous une forme individuelle, ou par un petit nombre de partenaires, les entreprises recrutaient leurs capitaux et leur personnel dirigeant dans le cercle restreint de l'ancienne classe industrielle. Celle-ci n'en pouvant fournir cependant qu'une quantité par trop insuffisante, il en venait soit de l'étranger, soit de scouches inférieures, et la bourgeoisie se recrutait, à chaque génération, d'un certain nombre d'hommes partis des derniers rangs de la population, et qui s'élevaient à des positions supérieures, [375] malgré l'insuffisance de leur instruction et de leurs ressources. Mais ce recrutement n'en était pas moins difficile et lent, et, en attendant, quelle était la situation? C'est que les capacités dirigeantes et les capitaux d'entreprise demeuraient rares, et que le monopole de fait dont ils jouissaient leur permettait de s'attribuer une rente en sus de leur rétribution nécessaire, tandis que, dans les régions inférieures, une foule de capacités ne pouvaient être mises en valeur faute de culture, et une multitude de petits capitaux demeuraient improductifs. De là, sans parler de l'état de primitive infériorité où se trouvait l'ouvrier en débattant les conditions de son salaire, l'inégalité de l'accroissement des revenus et du bien-être entre la première et la seconde moitié du Tiers-État émancipé. Mais ce double monopole des capitaux d'entreprise et des capacités dirigeantes que la grande industrie et la concurrence ont commencé par rendre plus productif entre les mains de la classe moyenne, elles se chargeront elles-mêmes de le détruire à mesure qu'elles agrandiront les marchés et qu'elles unifieront les prix.
Aussi longtemps que le marché des produits de toute sorte n'a dépassé que par exception les frontières de chaque État, la nécessité d'abaisser les frais de la production ne s'est pas imposée d'une manière irrésistible. Sans doute, ces frais étaient inégaux, mais les obstacles qui limitaient l'apport des capitaux et des capacités aux entreprises, en empêchant celles-ci de se multiplier, maintenaient le prix du marché à un niveau assez élevé pour permettre aux entreprises les plus mal situées, organisées et desservies de couvrir leurs frais de production, avec adjonction des profits ordinaires. L'extension du marché au delà des frontières a commencé à modifier profondément cet état de choses. Des industries, placées dans des conditions extrêmement diverses et inégales, se sont [376] trouvées en concurrence : aussitôt la nécessité d'abaisser les frais de la production est devenue urgente. A cet égard, on a le choix des moyens : on peut localiser mieux les entreprises et les constituer dans des dimensions et sous des formes plus économiques; on peut employer un matériel plus puissant et un personnel plus actif et plus habile; on peut enfin réduire la rétribution des facteurs de la production, capital et travail. Depuis que l'application de la vapeur aux transports et les progrès de la liberté du commerce ont donné une impulsion décisive à l'unification des marchés, on s'est efforcé partout, en recourant aux moyens qui viennent d'être énumérés, d'abaisser les frais de la production; ajoutons qu'on s'y efforcera davantage à mesure que les voies de communication perfectionnées se multiplieront et que les douanes s'abaisseront et disparaîtront. Mais ces moyens de diminuer les frais de la production et d'augmenter la richesse contribuent aussi à modifier la distribution de celle-ci. L'agrandissement du matériel nécessite l'agrandissement des entreprises et détermine la substitution progressive des sociétés anonymes ou autres, à capital mobilisable, aux entreprises individuelles à capital immobilisé. Ce progrès, à son tour, contribue efficacement à détruire le double monopole des capitaux industriels et des fonctions dirigeantes entre les mains de la classe moyenne. Fractionnés en coupures régulières d'un petit module, transmissibles au porteur et essentiellement mobilisables, les titres de propriété des capitaux engagés dans l'industrie sont à la portée et à la convenance des plus modestes capitalistes dans un rayon devenu illimité. L'action ou l'obligation au porteur, qui représente la propriété d'une fraction de chemin de fer, de mine, de manufacture ou d'un capital emprunté par l'un ou l'autre de ces établissements, peut se négocier dans toute l'étendue du monde civilisé, [377] ou, si l'on veut, de l'État économique, en sorte que telle entreprise qui, sous l'ancien régime de la production, ne comptait que trois ou quatre prêteurs ou commanditaires, appartenant presque toujours à la classe moyenne et résidant le plus souvent dans la localité même, compte maintenant des centaines ou des milliers de propriétaires appartenant à toutes les classes de la société et à toutes les nationalités. D'un autre côté, l'accroissement d'importance et d'étendue des entreprises exige la coopération d'une somme plus considérable de capacités et de connaissances professionnelles, tandis que la pression croissante de la concurrence, oblige de plus en plus à aller chercher ces capacités et ces connaissances où elles se trouvent en plus grande abondance et au plus bas prix. Le marché des capacités et des connaissances professionnelles s'étend ainsi avec celui des capitaux, et la « classe moyenne » perd le monopole des unes et des autres.
Ce n'est pas tout. Un moment viendra où par l'action des progrès que la concurrence met en branle — la localisation naturelle, le perfectionnement de la constitution et du matériel des entreprises, la rigoureuse économie dans l'emploi et la rétribution du capital et du travail — les frais de production de l'ensemble des articles et des denrées de consommation sur le marché unifié et universalisé, seront réduits au minimum, et comme le prix du marché tend irrésistiblement, sous un régime de pleine concurrence, à se niveler avec les frais de production, quel sera le résultat? C'est que les deux facteurs entre lesquels se distribue la valeur de tous les produits et services, le capital et le travail, ne recevront plus, dans toutes les branches de la production et dans toute l'étendue du marché, que la rétribution qui leur est strictement nécessaire.
Or, nous avons déjà remarqué que le progrès industriel [378] a pour résultat à la fois d'abaisser la rétribution nécessaire du capital et d'élever celle du travail. Il abaisse la première en réduisant successivement la prime qui sert à couvrir la privation et les risques des capitaux engagés; il élève la seconde en changeant la nature du travail, en remplaçant le travail physique par l'action des moteurs mécaniques ou des agents chimiques, et en ne laissant plus aux travailleurs que des fonctions exigeant la mise en œuvre de leurs facultés intellectuelles et morales, développées et adaptées à chaque branche de la production par une éducation et un apprentissage ad hoc. Ce personnel supérieur coûte plus cher à former et à renouveler, et c'est pourquoi la rétribution du travail s'élève à mesure que l'industrie progresse.
Jusqu'à quel point pourra descendre la rétribution nécessaire du capital? Non pas sans doute jusqu'à supprimer entièrement le revenu qu'il procure, jusqu'à réduire l'intérêt à zéro, mais jusqu'au point où chacun aimera mieux garder son capital que de l'investir dans des entreprises où la mobilisabilité des titres et la réduction des risques auront abaissé au minimum le taux nécessaire de l'intérêt. Cela étant, il deviendra chaque jour plus difficile de subsister du seul revenu de ses capitaux; cette difficulté, déjà sensible à présent, sera de plus en plus manifeste. C'est au travail que chacun sera obligé de demander le principal de ses moyens d'existence — le revenu des capitaux divisés à l'infini et réduits à un « minimum de subsistance » n'en sera plus qu'un appoint — à quoi il faut ajouter que l'échelle des rétributions du travail se trouvera raccourcie par la suppression progressive des fonctions inférieures, dans lesquelles le travail physique finira par être complètement remplacé par le travail mécanique. Ainsi, le progrès industriel n'a pas seulement pour résultat d'augmenter d'une façon indéfinie la richesse, il a [379] encore pour résultat d'en égaliser, d'une façon non moins indéfinie, la distribution, et par conséquent d'unifier les différentes classes de la société, en faisant rentrer successivement, par l'anéantissement de la rente du sol, l'aristocratie dans la bourgeoisie, par la diffusion du capital et l'abaissement de l'intérêt, la bourgeoisie dans le peuple.
Il serait plus exact de dire, cependant, que la grande industrie et la concurrence auront pour résultat de faire entrer le peuple dans la bourgeoisie, en élevant successivement sa condition matérielle et morale. Nous avons analysé les causes qui ont empêché jusqu'ici cette condition de s'améliorer dans la proportion de l'accroissement de la productivité de l'industrie. Mais ces causes ont, pour la plupart, un caractère accidentel; elles tiennent en grande partie à la façon violente et peu scientifique dont s'est accomplie la transition de l'ancien régime au régime nouveau : la multitude a perdu les garanties que lui offraient la tutelle et même la servitude avant de posséder la capacité requise pour s'en passer ou d'avoir à son service les institutions nécessaires pour y suppléer. Mais peu à peu elle s'adapte aux nouvelles conditions d'existence qui lui sont faites, et, d'une autre part, on voit surgir et se développer, à mesure que le besoin s'en fait davantage sentir et que les obstacles naturels ou artificiels qui s'y opposaient disparaissent, toute une machinery d'institutions adaptées à cet état nouveau, institutions de crédit, d'assurance, trades unions, etc. Les nuisances que l'avènement de la grande industrie et de la concurrence a suscitées ou aggravées, s'atténuent, s'effacent, et on voit apparaître peu à peu les conséquences bienfaisantes de l'unification du triple marché des produits, des capitaux et du travail, sur la condition de cette multitude qui vit du revenu précaire et insuffisant de son labeur quotidien.
[380]
Que la constitution d'un marché universel pour tous les articles de consommation, avec l'unification et l'abaissement progressif des prix qui en sont les conséquences, doivent favoriser particulièrement la classe ouvrière, cela est de toute évidence. C'est en échange de son travail qu'elle achète les produits et services de tout genre qui font l'objet de sa consommation. Ces produits et services peuvent être partagés en deux catégories : ceux qui — et c'était le plus grand nombre — n'étaient point accessibles à la multitude des consommateurs avant l'avènement de la grande industrie, et ceux qui étaient à sa portée. Les premiers étaient le monopole des consommateurs des classes supérieures : ceux-ci n'ont rien perdu assurément en perdant ce monopole, car, à moins d'une aberration vicieuse, la jouissance des uns ne s'accroît pas de la privation des autres; ils ont gagné, au contraire, à l'amélioration de la qualité des produits et des services; il est plus commode de lire un livre imprimé que de déchiffrer un manuscrit; il est plus agréable de voyager en chemin de fer, à raison de 60 kilomètres à l'heure, que de faire 12 kilomètres en malle-poste, et il n'y a pas de comparaison à établir entre le service du télégraphe et celui des courriers les plus rapides. En perdant le monopole de la lecture, de la célérité des voyages et des messages, les classes riches ou aisées ont bénéficié de l'invention de l'imprimerie, des chemins de fer et des télégraphes, mais la classe qui ne pouvait ni entretenir des copistes, ni voyager autrement qu'à pied, ni expédier des courriers, n'en a-t-elle pas profité davantage? Le progrès a mis ainsi à sa portée une multitude de jouissances qui lui étaient interdites; en même temps, il lui a permis de diversifier et de raffiner les grossières consommations auxquelles elle était auparavant réduite, et chaque progrès qui abaisse le prix d'un des nombreux articles que l'ouvrier se [381] procure en échange de son revenu ou qui en élève la qualité, se traduit pour lui, soit en une augmentation de jouissance, soit en une diminution de peine.
C'est à une condition toutefois, c'est à la condition que le progrès qui abaisse le prix des articles de consommation n'ait point pour effet de diminuer le revenu en échange duquel il se les procure. Mais le même progrès agit au contraire par deux côtés différents pour augmenter ce revenu : 1° en universalisant le marché des capitaux, il permet à la plus petite fraction du capital, à la plus modeste épargne, de participer aux profits des plus grandes entreprises; 2° en élevant la nature du travail, et en universalisant le marché où le travail s'échange contre un salaire, il élève, d'une part, le taux nécessaire de la rétribution du travailleur, et établit, d'une autre part, entre l'entrepreneur et l'ouvrier, la même situation d'égalité pour la fixation du taux du salaire, qui existe sur un marché de pleine concurrence entre l'emprunteur et le prêteur pour la fixation du taux de l'intérêt, entre le vendeur et l'acheteur pour la fixation du prix de n'importe quelle marchandise. Ce n'est plus l'intensité inégale des besoins de l'entrepreneur et de l'ouvrier sur un marché restreint qui en décide, c'est la quantité des salaires et du travail respectivement offerts sur le marché général par des intermédiaires qui ne sont pas plus intéressés à voir hausser ou baisser les salaires que ne le sont les agents de change à voir hausser ou baisser la rente. Le prix du marché ne rencontre donc plus, dansces conditions, aucun obstacle à se niveler avec le taux nécessaire de la rétribution du travail, dont le progrès de l'outillage industriel élève incessamment le niveau.
A la vérité, il faut, en premier lieu, que la classe ouvrière sache s'adapter aux fonctions relevées que la grande industrie met à sa disposition; en second lieu, [382] qu'elle sache proportionner son offre devenue générale à la demande généralisée; mais ne voyons-nous pas tous les jours des travailleurs rejetés de la petite industrie, s'adapter à la grande, et le même rouage intermédiaire, qui s'est merveilleusement développé et perfectionné pour ajuster l'offre des produits et des capitaux avec la demande sur le marché général, ne pourra-t-il pas rendre un service analogue au travail?
Objectera-t-on que le progrès n'abaisse le prix des choses qu'en substituant des agents mécaniques au travail physique, autrement dit, en remplaçant du travail par du capital, et par conséquent en rétrécissant incessamment le débouché du travail pour élargir celui du capital? L'objection serait fondée si la baisse du prix n'avait pas pour effet de provoquer une augmentation de la demande, partant une augmentation de la production, d'accroître ainsi le débouché du travail dans l'industrie transformée et par répercussion, dans la série des industries en connexion avec elle, après l'avoir diminué. N'est-il pas visible que l'imprimerie, en se substituant à la copie des manuscrits, a fini par accroître, dans l'industrie typographique, la papeterie, etc., le débouché du travail? N'en peut-on pas dire autant de l'industrie des transports transformée par la vapeur? On peut contester que le débouché du travail puisse s'élargir d'une manière indéfinie, mais rien ne nous autorise à croire que la grande industrie ait pour résultat de le restreindre. Objectera-t-on encore que l'universalisation du marché du travail, en mettant des ouvriers civilisés en concurrence avec des travailleurs appartenant à des races inférieures, dont les besoins sont moins développés, les Chinois par exemple, aura pour résultat d'abaisser le taux général des salaires au niveau du taux nécessaire de la rétribution de ces travailleurs d'une race inférieure et pullulante? On [383] oublie que la grande industrie exige un travail qui met en jeu les facultés intellectuelles et le sentiment de la responsabilité, c'est-à-dire un travail de qualité supérieure. Or, de même qu'un soldat européen, qui met en œuvre un matériel de guerre perfectionné, ne peut être remplacé par un soldat appartenant à une race inculte ou moins civilisée, un ouvrier adapté à la grande industrie n'a rien à craindre de la concurrence d'un ouvrier adapté à un matériel moins parfait. Les races inférieures finiront sans doute par devenir capables de gouverner et de mettre en œuvre, à l'égal des ouvriers de nos manufactures, l'outillage de la grande industrie, mais alors l'accroissement des frais nécessaires pour développer leurs facultés intellectuelles et morales et les pourvoir d'une instruction professionnelle, élèvera le prix de revient de leur travail au niveau de celui des ouvriers d'Europe, et ceux-ci n'auront point à craindre leur concurrence au rabais.
Sans doute, même au sein des races supérieures, de nombreuses individualités ont peine à s'élever des fonctions de la petite industrie à celles de la grande, aussi bien que du régime de la tutelle à celui du self government. Faut-il laisser périr ces retardataires en leur imposant un régime qu'ils sont incapables de supporter? Non, à coup sûr. Pendant longtemps encore la petite industrie leur offrira un débouché, et lorsque ce débouché viendra à se fermer, ils auront eu tout le temps nécessaire pour s'adapter à la grande. Dans l'intervalle, il se peut qu'une tutelle leur convienne mieux que le self govemment, et tel est le cas, notamment pour les nègres hâtivement émancipés des colonies et des États du Sud de l'Union américaine, mais cette tutelle ne s'établira-t-elle pas d'ellemême comme se sont successivement établies toutes les institutions dont la société a reconnu la nécessité? Quand l'expérience aura suffisamment démontré l'incapacité des [384] individualités et des races inférieures à supporter le self government, on les soumettra ou elles se soumettront d'elles-mêmes au régime de tutelle qui convient à leur état de développement, ou, pour mieux dire, on adaptera l'antique régime de tutelle à l'état nouveau des sociétés, en l'appliquant à ceux qui en ont besoin, tout en permettant aux autres de pratiquer pleinement le self government.
[385]
CHAPITRE XI. L'avenir. — La consommation.↩
I. — Comment se pose le problème de la consommation utile. — Des passions et des appétits qui se mettent en travers de sa solution. — Nuisances qui en résultent. — Que les sociétés se sont appliquées de tout temps à prévenir ou à réprimer ces nuisances. — Appareil qu'elles employaient à empêcher les nuisances de la consommation actuelle. — Ce qui subsiste de cet appareil. — Modifications qu'il a subies et qu'il subira encore. — Intervention de l'opinion et de la presse dans la police des nuisances. — Le progrès en matière de consommation. — Comment l'unification des marchés de consommation l'a accéléré. — Progrès des consommations alimentaires, du costume, des habitations, etc.; concurrence des habitudes.
Il ne nous reste plus maintenant qu'à jeter un coup d'œil sur les changements que l'avènement de la grande industrie et de la concurrence a apportés dans la consommation et à chercher, autant que nous le permettent les données que nous possédons, comment sera résolu dans l'avenir le problème de la consommation ou du bon emploi de la richesse.
Examinons d'abord sommairement en quoi consiste ce problème. La production crée la richesse, et celle-ci se distribue sous forme de profits, d'intérêts, de rentes, de salaires, etc., entre tous les membres de la société, dont elle constitue le revenu. Chacun vit d'un revenu, grand ou petit, assuré ou aléatoire, suffisant ou insuffisant. Ce revenu doit pourvoir à l'accomplissement d'une série d'obligations concernant, les unes, le présent : c'est la consommation actuelle; les autres, l'avenir : c'est la consommation future. La première comprend le bon entretien des forces, des facultés et des instruments à l'aide desquels l'homme se procure, dans la période productive de sa [386] carrière, le revenu qui lui fournit ses moyens d'existence. La seconde comprend, en premier lieu, la somme qu'il doit employer à la formation de la génération qui va succéder à la sienne; en second lieu, la somme nécessaire pour subvenir aux accidents et aux risques auxquels il est exposé, maladies, interruptions de son activité productive et, finalement, à son entretien à l'époque où l'affaiblissement naturel de ses forces et de son intelligence ne lui permettra plus de coopérer d'une manière aussi active à la production ou même le contraindra à cesser entièrement d'y contribuer. Cette double nécessité, qui dérive de sa nature, l'oblige, dans la période productive de son existence, à épargner et à capitaliser une portion plus ou moins considérable de son revenu. Enfin, lorsque sa carrière est finie, il lègue à la génération qui lui succède, le capital d'agents productifs de toute sorte qu'il a reçu de la génération à laquelle il a succédé, et selon qu'il a bien ou mal géré ses affaires et gouverné sa vie, ce capital a acquis une plus-value ou subi une moins-value.
Telles sont les données du problème de la consommation. On comprend combien il importe à l'individu et à la société dont il est membre que ce problème soit, dans toutes ses parties, résolu de la manière la plus utile. D'un autre côté, quand on considère l'infirmité de la nature humaine, ses passions, son imprévoyance, la violence de ses appétits physiques, l'insuffisance et les lacunes de ses forces morales, on s'explique que dans aucun temps et dans aucune société, il n'ait été satisfait pleinement à l'ensemble des obligations impliquées dans le problème de la consommation utile. Cependant, il n'est pas une de ces obligations dont la méconnaissance et le non accomplissement ne soient la source d'une nuisance à la fois individuelle et sociale. Si l'individu ne sait point aménager utilement sa consommation actuelle; s'il accorde une trop forte part [387] ou une part déréglée à ses appétits physiques, s'il s'adonne à l'intempérance, s'il fait abus des plaisirs énervants, il s'affaiblit physiquement et moralement, et la société s'affaiblit avec lui. La déperdition de forces qu'elle subit de ce chef est plus ou moins grande, selon que l'abus a été plus ou moins contagieux, mais cet abus produit, en tout cas, une nuisance que la société a le droit et même le devoir de réprimer. Si l'individu, dépourvu de prévoyance et de force morale, ne sait point dérober à sa consommation actuelle une somme suffisante pour subvenir aux éventualités et aux risques de l'avenir, les nuisances qui résultent de son imprévoyance et de son incurie ne sont pas moins graves : il donne le jour à des enfants qu'il ne peut élever et instruire comme il le devrait et qui constitueront plus tard un élément social inférieur, sinon dangereux; il oblige encore la société à couvrir les risques contre lesquels il n'a point su ou voulu s'assurer : les maladies, les accidents, la vieillesse. Enfin, de cet aménagement vicieux de la consommation actuelle, de cette insuffisance de l'épargne en vue de la consommation future, il résultera une diminution absolue ou relative du capital de forces et de ressources à l'aide duquel la société subsiste et grandit. Aux époques où la concurrence pour la vie se manifestait universellement par la guerre, cet affaiblissement avait pour conséquence inévitable la destruction de l'État, le massacre ou la réduction en esclavage des populations vaincues. Depuis que la guerre a commencé à faire place à la concurrence industrielle, les conséquences de l'affaiblissement causé par les nuisances sociales sont moins brutales, mais elles ne sont pas moins destructives. Une société dont le personnel va s'énervant et se corrompant, dont les générations nouvelles valent moins que les anciennes, dont le capital de forces et de ressources s'amoindrit par le mauvais emploi et le [388] gaspillage, est destinée à disparaître, par voie d'infiltration et d'appropriation pacifique, sinon de confiscation violente, et à céder la place à une société plus saine et plus vigoureuse, quelques précautions qu'elle prenne pour se préserver de la concurrence des races plus laborieuses et plus économes. Ces précautions peuvent avoir une efficacité temporaire, elles peuvent retarder la disparition d'une société indigne d'occuper un domaine qu'elle dévaste et dont elle gaspille les fruits, mais elles rendent cette catastrophe d'autant plus certaine, en dissimulant la nécessité impérieuse de remédier aux nuisances qui travaillent avec une activité continue et une efficacité croissante à la destruction de la société.
C'est pourquoi, de tous temps, les sociétés se sont appliquées, quoique le plus souvent d'une manière inconsciente, à prévenir ou à réprimer les nuisances qui les affaiblissent et, entre toutes, celles de la consommation. Elles ont même poussé les précautions à l'excès en soumettant tous les actes de la vie à un code de règles étroites et de prescriptions impératives, qui ne laissait, pour ainsi dire, aucune place à l'activité libre, source de tout progrès. Établies communément au nom de la divinité ou même révélées par elle et placées sous sa sanction, ces prescriptions et ces règles avaient, en outre, le défaut d'être immuables, ou du moins de ne pouvoir être modifiées, quand elles cessaient d'être adaptées aux circonstances et à l'état de la société, autrement que par l'apparition d'un dieu nouveau apportant une loi nouvelle. Cette vaste et rigide tutelle qui gouvernait l'individu en vue du plus grand bien de la société, a été profondément atteinte par l'avènement de la grande industrie et de la concurrence, elle est tombée en partie en ruines et ce qui en reste est ébranlé. Comment elle résolvait le problème de la consommation utile, comment ce problème sera résolu dans [389] l'avenir, voilà ce que nous allons examiner, en passant successivement en revue : 1° la consommation actuelle; 2° la capitalisation et la reproduction; 3° la conservation et la transmission des biens d'une génération à une autre. La consommation actuelle. — La consommation actuelle comprend la satisfaction journalière de la multitude diverse de nos besoins physiques et moraux, la nourriture, le vêtement, le logement, les plaisirs ou les délassements de l'esprit et du corps, etc. Si nous consultons le passé, nous trouverons qu'il n'est pas une seule de ces branches de la consommation qui ait été entièrement abandonnée au self government. La religion, l'opinion, la coutume sanctionnée, aussi bien que la loi religieuse dont elle était communément l'expression, par des pénalités physiques et morales, gouvernaient la manière de vivre des classes qualifiées de libres; la servitude régissait celle des classes inférieures. Ce régime de la consommation, fruit de l'observation et de l'expérience de la portion la plus intelligente de chaque société, était, en général, aussi bien adapté que possible au tempérament des individus, au milieu où ils vivaient et aux nécessités sociales. Partout, il s'appliquait à écarter les nuisances physiques et morales. Les anciens codes religieux sont de véritables manuels d'hygiène interdisant l'usage des aliments reconnus malsains, imposant l'usage des ablutions et des bains, et réglant jusqu'à la coupe des cheveux. Les lois somptuaires, dont l'observation était à Rome, par exemple, sous la surveillance des censeurs, avaient de même pour objet d'obliger chacune des classes de la population libre à vivre selon sa condition, autrement dit, à proportionner sa dépense en aliments, vêtements, etc., à ses moyens d'existence. La coutume imposait généralement une manière de vivre que l'expérience avait fait [390] reconnaître comme la plus utile; elle fixait, d'accord avec la religion, les jours de repos; elle décidait de la nature et même de l'époque des divertissements, en établissant des fêtes publiques. Certains plaisirs étaient prohibés comme immoraux, ce qui signifiait qu'ils étaient reconnus nuisibles à la santé, au développement ou à la conservation du corps ou de l'esprit, de nature à engendrer des habitudes pernicieuses pour l'individu et la société; d'autres étaient favorisés, au contraire, comme propres à développer les qualités et les vertus les plus nécessaires à la communauté, la force, l'adresse, le courage, le mépris de la mort. Enfin, les consommations intellectuelles propres à exciter l'appétit des plaisirs énervants étaient prohibées, quoique moins rigoureusement que celles qui portaient atteinte au pouvoir et à la considération des autorités établies.
Ce système de tutelle, qui avait sa raison d'être dans l'incapacité générale des individus à pratiquer un self government utile, est tombé en désuétude à mesure qu'il a cessé d'être adapté à l'état nouveau de la société, quoique la routine se soit efforcée de perpétuer son existence; les prescriptions de la loi religieuse concernant les jours d'abstinence et de repos ont cessé d'être généralement observées, les lois somptuaires ont été abandonnées, enfin l'affranchissement des classes inférieures a détruit le frein particulier que la servitude opposait au débordement de leurs appétits brutaux. Cependant ce vieux système préventif ou répressif des nuisances de la consommation subsiste encore dans un grand nombre de ses parties. Les prescriptions de la loi religieuse, relativement à l'hygiène alimentaire et aux jours de repos, aux mauvaises lectures, etc., n'ont point été modifiées, et une portion plus ou moins nombreuse de la population continue à les observer, quoique quelques-unes, celles qui concernent [391] l'hygiène alimentaire, carêmes et jours d'abstinence de certains aliments, soient imparfaitement adaptées à des populations dont les conditions d'existence ont changé. Dans d'autres branches de la consommation, la tutelle publique, exercée par le gouvernement central ou communal, a simplement remplacé la tutelle du maître, de la corporation ou de la religion : toute une série de lois et de règlements interdisent le jeu, au moins sous certaines formes, l'ivrognerie, les spectacles immoraux et indécents, les plaisirs barbares, combats d'hommes et d'animaux, ou simplement bruyants et incommodes. La plupart de ces lois et règlements sont, à la vérité, fréquemment enfreints ou éludés et on peut leur reprocher d'ailleurs d'être tantôt excessifs, tantôt insuffisants, et toujours d'être coûteux et gênants, sinon vexatoires. Tels quels, ils remédient néanmoins, dans une certaine mesure, à l'insuffisance du self government individuel, mais ils n'atteignent que le plus petit nombre des nuisances de la consommation. L'opinion, en revanche, exerce un contrôle universel. On peut lui reprocher d'être souvent inintelligente et toujours tyrannique, mais dans l'état actuel d'imperfection du self government individuel, on ne saurait nier l'utilité de son intervention. Elle a organisé tout un vaste système d'inquisition à l'égard des actes et de la manière de vivre de chacun : en dépit de l'axiome « que la vie privée doit être murée », elle cherche avidement à connaître ce qui se passe dans l'enceinte de ce mur, et elle soumet sa récolte quotidienne de « racontars » au crible d'une critique dont le principal défaut n'est pas d'être indulgente. Est-il nécessaire d'ajouter, au surplus, que cet axiome est une simple hérésie économique et sociale? On ne pourrait murer légitimement la vie privée que si les actes et la manière de vivre de chacun n'intéressaient pas les autres membres de la société, s'ils n'influaient [392] d'aucune manière sur leur existence et leur bien-être. Or, il n'en est pas ainsi. C'est le contraire qui est vrai. Il n'est pas, au point de vue économique et social, une seule des manifestations de notre activité qui soit indifférente, une seule qui n'influe en bien ou en mal sur notre condition et, par une répercussion inévitable, sur celle de nos semblables. Personne ne prétendra assurément que les crimes qui se commettent dans l'enceinte du mur de la vie privée doivent demeurer ignorés et impunis, mais, en dehors de ces nuisances caractérisées, combien on peut en citer d'autres! Qu'un homme maltraite ou élève mal ses enfants, qu'il ne proportionne point sa dépense à ses moyens, qu'il s'adonne à l'intempérance et à la débauche, la société subira, de ce chef, une déperdition de ressources matérielles ou de forces physiques et morales et la condition de tous ses membres en deviendra plus mauvaise. Ceux-ci ne font donc qu'user du droit de légitime défense, en s'enquérant de la manière dont chacun gouverne sa vie privée et en infligeant à ceux qui se conduisent d'une façon directement ou indirectement dommageable à autrui les pénalités dont l'opinion dispose : le blâme et l'ostracisme. Que l'on dise que l'opinion ne possède ni la capacité ni l'impartialité nécessaires pour s'enquérir des actes de la vie privée et les juger sainement, on aura raison jusqu'à un certain point, mais la tutelle publique, à laquelle elle s'adjoint, et dont elle corrige souvent les erreurs, n'est-elle pas affligée des mêmes lacunes et des mêmes défauts? Si, malgré ses imperfections, l'opinion remplit utilement le rôle de censeur des mœurs, il n'y a aucune raison pour interdire ce même rôle à la presse, organe ou instrument perfectionné de l'opinion. L'investigation et la critique imprimées des actes de la vie privée sont aussi légitimes que l'investigation et la critique orales, et elles sont incomparablement plus efficaces. La diffamation [393] devrait donc être rayée du code de la presse où la calomnie et le chantage sont seuls à leur place. Il convient de remarquer, à ce propos, que l'animosité avérée de la magistrature à l'égard de la presse n'est, à la bien considérer, qu'une affaire de concurrence : chargée officiellement de la recherche et de la répression des nuisances sociales, la magistrature regarde volontiers la presse comme une concurrente interlope qui empiète sur ses attributions et envahit son ressort. Mais, est-il besoin d'ajouter que la presse a le double avantage d'exercer gratis ses fonctions de censeur et de posséder un ressort naturellement illimité : aucune nuisance, petite ou grande, n'échappe à sa surveillance et à son contrôle, tandis que la magistrature a une sphère d'action limitée aux nuisances qualifiées de crimes et de délits; enfin, si les jugements de l'opinion, formulés par la presse, ne sont point impeccables, on ne saurait affirmer que ceux de la magistrature soient infaillibles.
Cependant le problème de la consommation ne consiste pas seulement à écarter les nuisances qui la vicient; il consiste aussi à la rendre de plus en plus avantageuse à l'individu et à la société. On peut le poser en ces termes: se procurer avec son revenu, en quantités et en qualités croissantes, les matériaux de la consommation et en tirerle parti le plus utile ou, ce qui revient au même, se procurer la plus grande somme possible de jouissances utiles en échange de la moindre dépense. Ce problème, la tutelle et la répression, si intelligentes qu'elles soient, ne le résolvent qu'imparfaitement, il arrive même le plus souvent qu'elles fassent obstacle à sa solution, surtout quand elles ont un caractère religieux. Leur tendance naturelle est de conserver les habitudes établies et de repousser des innovations qui contrarient plus ou moins la loi religieuse ou qui n'ont point été prévues par elles. Or, n'est-ce pas [394] le propre d'une loi révélée d'avoir tout ordonné et tout prévu? Le progrès, en matière de consommation, ne peut donc provenir que de l'initiative libre des individus, et sa propagation, comme celle de tous les autres progrès, dépend de l'étendue du marché où il se produit. Presque insensible, ou du moins extrêmement lent, sous le régime de la petite industrie et de la tutelle, il s'est développé et propagé rapidement depuis que la grande industrie et la concurrence ont commencé à agrandir et à unifier les marchés de la consommation.
Sous l'ancien régime, non seulement chaque société, mais encore chacune des classes entre lesquelles elle se partageait, avait son matériel et ses habitudes de consommation, qui différaient de ceux des autres sociétés et des autres classes et qui demeuraient presque immuables. Elles avaient une alimentation, un costume, une manière de se loger, de se meubler, et même de s'amuser, qui leur étaient propres. Les plaisirs des basses classes différaient de ceux des classes supérieures autant que leur nourriture, leurs vêtements, leurs habitations et leur mobilier. L'avènement de la grande industrie et de la concurrence a profondément modifié cet état de choses.
Qu'est-il arrivé? A mesure que les peuples se sont rapprochés et que leurs relations se sont multipliées, ils ont échangé davantage les matériaux de leur consommation. Au lieu de se contenter de ceux que leur fournissait la région où ils étaient établis, ils se sont procuré ceux des autres régions : l'alimentation est devenue plus abondante et plus variée, par là même plus assurée. C'est ainsi que, dans la période de rénovation et d'expansion qui a commencé aux Croisades pour aboutir à la découverte de l'Amérique, le sucre, le café, le thé, le tabac, les épices et une innombrable quantité d'autres articles sont entrés dans la consommation des peuples civilisés; de même, le [395] coton et la soie ont été ajoutés à la laine, au lin et aux peaux, dans le vêtement et l'ameublement. Cependant, ces emprunts ne sont pas les plus importants que les peuples se soient faits les uns aux autres. Ils se sont communiqué leur capital de connaissances acquises, les instruments les plus efficaces et les procédés de production les plus économiques, avec le matériel et les méthodes de consommation les plus propres à augmenter leurs jouissances ou à diminuer leurs privations. Une concurrence particulière s'est établie entre les manières de vivre, de se nourrir, de se vêtir, de se loger, de s'amuser des différents peuples, que les progrès de l'industrie et du commerce mettaient en communication; peu à peu, les moins utiles ont été abandonnées pour celles que l'observation et l'expérience faisaient considérer comme les plus avantageuses. Rien de plus frappant, par exemple, que le changement qui s'est accompli dans le costume. Chaque pays, chaque localité même avait le sien, qui était façonné avec les matériaux locaux, approprié aux exigences du climat et réglé par la coutume. Ce costume national a été successivement abandonné pour un costume international, qui est aujourd'hui celui de la société civilisée dans toutes les régions du globe. Les hommes ont adopté les modes anglaises ou américaines comme les plus économiques et les plus commodes, tandis que les femmes ont préféré les modes françaises comme les plus élégantes et les plus propres à faire valoir les avantages naturels du beau sexe ou à dissimuler ses imperfections; la question d'économie ne venant ici qu'après la question d'esthétique. Sans doute, cette imitation n'a pas toujours été parfaitement raisonnée, et on peut lui reprocher notamment de n'avoir pas tenu un compte suffisant de la diversité des climats. L'habit noir européen et les vêtements serrés au corps conviennent-ils également à la zone tempérée et à la zone [396] torride? Autant peut-on en dire de l'architecture des édifices et des habitations : aux styles d'architecture locaux ou nationaux, appropriés à la nature des matériaux indigènes et au climat, on a vu, à dater de l'époque de la Renaissance, succéder généralement une architecture imitée de la Grèce ou de Rome, et les monuments à colonnades et à portiques, qui convenaient au beau climat de la Grèce ou de l'Italie, se multiplier sous le ciel brumeux de l'Angleterre ou sous le climat glacé de la Russie; on a vu, de même, la classe civilisée délaisser l'idiome indigène pour une langue réputée supérieure, le latin ou le français, sans tenir compte des particularités de race, de milieu et de climat, dont la langue est l'expression ou dont elle subit l'influence. L'expérience a fait peu à peu justice de ces exagérations ou de ces applications fausses du principe de la concurrence aux consommations du corps et de l'esprit. Mais les vieux moules imposés par la coutume n'en ont pas moins été brisés, et c'est en vain que des novateurs à rebours ont entrepris de ressusciter les costumes nationaux ou de faire revivre les patois locaux. Le costume demeurera unifié sur le modèle le mieux adapté à chaque région climatérique, sans aucun égard pour des frontières artificielles destinées à disparaître, et il en sera de même pour l'architecture des monuments et des habitations; enfin, nous voyons aujourd'hui se substituer à la multitude des idiomes nationaux ou autres un petit nombre de langues appropriées au génie particulier des cinq ou six grands peuples qui tiennent la tête de la civilisation. Peut-être, sans abandonner celle qui convient à leur génie^st à leur milieu, s'accorderont-ils un jour pour adopter une langue d'intercommunication universelle, et leur choix se portera sur la plus simple, la plus claire et la plus facile à adapter au plus grand nombre.
En même temps que les habitudes de la consommation [397] s'unifiaient de pays à pays, en se conformant au type considéré comme le plus parfait ou le plus économique, elles tendaient aussi à s'unifier entre les différentes couches sociales. La manière de se nourrir, de se vêtir, de se loger, de s'amuser diffère de moins en moins d'une classe à une autre : le menu du riche est sans doute plus délicat et plus varié que celui du pauvre, ses habits sont d'une étoffe plus fine et d'une coupe plus élégante, son logement est plus vaste et son ameublement plus luxueux, ses plaisirs sont plus nombreux et plus raffinés, mais le type est le même. Aucune catégorie sociale ne se distingue plus des autres par son costume et sa manière de vivre. Dans les pays en retard, où s'est prolongé le régime du servage, on peut observer encore des différences marquées entre les consommations du peuple et celles de ses anciens maîtres : le paysan russe se nourrit de gruau et de tschi, et il ne connaît pas l'usage de la fourchette; il a conservé le costume national, mais déjà le progrès fait son œuvre : l'ouvrier employé dans les ateliers de la grande industrie varie davantage son alimentation; il se hasarde, en dépit de la coutume et de l'opinion, à porter l'habit européen et le moment n'est pas éloigné où il se servira de la fourchette.[36] Des changements [398] analogues se sont accomplis dans les relations sociales: les anciennes castes ont fusionné d'un pays à un autre, et ce qu'on nomme la société se recrute sans distinction d'éléments indigènes et étrangers; la fusion s'opère aussi, quoique d'une manière plus lente et moins complète, entre les différentes couches sociales du même pays: les différences de races et surtout de couleur, la noblesse, la fortune, la profession font obstacle à cette unification. En général, cependant, ces distinctions s'effacent pour ne laisser subsister que celles qui ont une raison d'être, et qu'il importe de maintenir dans l'intérêt même du progrès des mœurs, savoir : les différences de nature et d'éducation, la grossièreté ou la politesse des sentiments et des manières.
II. — La capitalisation. Nécessité de la capitalisation, en vue de la consommation future. — Ses progrès. — Comment elle s'opérait sous l'ancien régime. — Pourquoi elle était presque exclusivement concentrée dans les régions supérieures de la société. — Causes qui empêchaient les classes inférieures d'y prendre une part suffisante. — Comment ces causes ont subsisté et se sont même aggravées dans la première période de l'évolution de la grande industrie et de la concurrence. — Effets délétères de l'intervention de la charité publique. — Comment ces causes de retard tendent à disparaître. — Accroissement graduel de l'épargne des classes inférieures. — Qu'elle leur permettra de plus en plus de remplir, sans l'intervention de la charité, toutes les obligations qu'implique la consommation future. — Nature de ces obligations.
La capitalisation. — Capitaliser, c'est soustraire une portion de son revenu à la consommation actuelle et l'accumuler, sous une forme ou sous une autre, en vue de la consommation future. C'est une opération qui implique une [399] privation plus ou moins intense et un effort plus ou moins énergique, suivant l'importance du revenu et la propension naturelle à la prodigalité ou à l'avarice de celui qui s'y livre. Il s'impose cette privation; il accomplit cet effort en vue de s'épargner une peine qui les dépasse ou de se procurer une jouissance qui les compense avec bénéfice dans l'avenir. S'assurer contre les maladies et les accidents et, en particulier, contre la maladie commune de la vieillesse, se procurer les joies de la famille; enfin, améliorer son sort en augmentant son revenu, voilà les mobiles ordinaires qui poussent l'homme à épargner ou à capitaliser. Ces mobiles ont existé et agi de tout temps, et c'est grâce à leur action persistante que la population a pu croître et la production se développer, car il ne suffisait pas de perfectionner les instruments et les méthodes de la production, il fallait encore constituer une « avance » pour former le supplément de personnel et de matériel nécessaire à la création et à la mise en œuvre d'un supplément d'entreprises productives. Mais l'abondance de l'épargne, l'importance de la capitalisation a dépendu, de tout temps aussi, de deux facteurs : la productivité de l'industrie et le développement de l'esprit de prévoyance. Lorsque l'homme était réduit à demander sa subsistance aux industries rudimentaires de la chasse et de la récolte des fruits naturels du sol, sa production ne dépassait guère les exigences impérieuses des besoins du jour, et la difficulté de s'assurer contre les éventualités et les risques d'un avenir d'ailleurs incertain était peu propre à favoriser le développement de l'esprit de prévoyance. On ne pouvait, à la vérité, se dispenser d'élever les enfants nécessaires à la conservation de la tribu, mais on laissait périr les vieillards : tout ce que pouvaient faire en leur faveur la religion et la coutume, c'était de les sacrifier pour leur épargner les tortures de [400] l'abandon et de la faim; à plus forte raison ne songeaiton point à capitaliser en vue d'augmenter les ressources de la tribu. C'est l'avènement de la petite industrie qui a donné l'essor à la capitalisation. On a pu alors, non seulement pourvoir avec plus d'abondance et de régularité au besoin de l'alimentation et aux autres, mais encore mettre en réserve et accumuler une partie des produits du sol et de l'industrie. L'esprit de prévoyance a commencé à grandir, on a étendu les défrichements, élevé un plus grand nombre d'enfants et de bestiaux, cessé de sacrifier les vieillards qui pouvaient désormais rendre encore assez de services pour gagner leur subsistance, et bientôt les tribus sont devenues des nations. Cependant, dans ce nouvel état de choses, la capitalisation demeurait encore limitée, d'un côté, par l'insuffisance de la productivité de l'industrie; de l'autre, par l'influence naturelle du régime de la servitude. Seules, les classes libres possédaient les moyens d'épargner et ressentaient le besoin de l'épargne. Le propriétaire d'un domaine agricole, après avoir nourri sur sa récolte, sa famille et son personnel de compagnons d'armes, de domestiques et d'artisans, consacrait le surplus, qui constituait son épargne, à élever un supplément d'esclaves et de bêtes de somme, ce qui lui permettait d'augmenter l'importance de son exploitation, d'agrandir son État ou sa maison. Plus tard, la sphère des échanges venant à s'élargir, il put employer une partie de cette épargne à se procurer des articles de luxe, des bijoux, de l'or, des pierreries, qui augmentaient son bien-être et son prestige, mais qui ne contribuaient point à accroître sa richesse. Dans une classe inférieure, l'artisan et le marchand, aussitôt qu'ils eurent obtenu, par voie d'achat ou autrement, la liberté de travailler et d'échanger pour d'autres que pour le maître, consacrèrent les épargnes qu'ils faisaient sur leurs gains à donner à leur industrie [401] ou à leur commerce toute l'extension que comportaient le marché et les règlements des corporations dont ils faisaient partie; ensuite ils les employèrent, non seulement à agrandir et à embellir leurs habitations, mais encore à des prêts ou à des commandites qui grossissaient leur revenu et leur fortune. Les lois ou les coutumes somptuaires limitaient leurs dépenses de faste ou d'apparat; les enfants qui ne pouvaient aspirer à une condition supérieure à celle de leurs parents étaient élevés à peu de frais; les vieillards passaient leurs derniers jours au foyer de la famille : s'il survenait des accidents ou des revers, on retirait de la cachette où elle était déposée la réserve en monnaie de poids. Ainsi se créaient les capitaux dont l'avènement de la grande industrie allait décupler la productivité, et se préparait la prépondérance de la classe moyenne. En revanche, les classes asservies demeuraient en retard : nourri et entretenu par son maître, l'esclave, qui n'était point mû par la volonté de se racheter, ne sentait pas le besoin de se constituer un pécule; quant au serf ou au colon, la redevance ou l'impôt ne lui laissait communément que le strict nécessaire, et, d'ailleurs, en cas de disette ou d'accidents, la coutume obligeait le proprétaire à venir à son aide. La possibilité même d'épargner manquait donc, le plus souvent, aux classes asservies, et, d'un autre côté, la tutelle sous laquelle elles vivaient, l'assistance que cette tutelle leur procurait, si insuffisante qu'elle fût, les empêchaient de ressentir la nécessité de l'épargne, et retardaient chez elles le développement de l'esprit de prévoyance.
Telle était la situation à l'avènement de la grande industrie et de la concurrence. La classe en possession des capitaux, des aptitudes et des connaissances qu'exigeait l'industrie progressive, a vu croître aussitôt ses revenus, et avec eux la possibilité d'augmenter son épargne. En même [402] temps, les mobiles qui l'excitaient à épargner acquéraient plus de puissance : la diffusion des habitudes de bien-être et de luxe exigeait une mise en réserve plus considérable pour les besoins de la vieillesse; l'élève et l'éducation des enfants devenaient plus raffinées et plus coûteuses; enfin, l'augmentation des profits de l'industrie encourageait davantage à prélever sur le revenu actuel de quoi accroître encore le revenu futur. De là l'enrichissement rapide et extraordinaire de la classe qui fournissait à l'industrie progressive l'état-major propre à la diriger et les capitaux nécessaires pour l'alimenter. Tout autre était malheureusement la situation de la multitude. Le peu d'étendue de la plupart des marchés de travail, en plaçant l'ouvrier à la discrétion de l'entrepreneur, réduisait son salaire à l'excès, tandis que la crise du progrès, aggravée par les perturbations politiques et autres, rendait sa condition de plus en plus précaire. Il n'avait donc qu'à un faible degré la possibilité d'épargner. N'aurait-il pas dû posséder, en de semblables circonstances, un esprit de prévoyance et une force morale hors ligne pour s'imposer les dures privations qu'exigeait de lui l'épargne, si facile à la classe dirigeante et possédante de l'industrie? Or, cet esprit de prévoyance et cette force morale, comment les aurait-il acquis? Pendant de longs siècles, esclave, serf ou compagnon, il avait vécu en tutelle sans avoir à se préoccuper de l'avenir; on l'avait émancipé ou il s'était imprudemment émancipé lui-même avant de posséder la plus légère notion des obligations auxquelles allait le soumettre le self government, et on avait poussé la prévoyance jusqu'à lui interdire de se replacer sous une tutelle. Comment aurait-il été capable de pratiquer ce self government difficile, de faire la part qui revenait à la consommation actuelle et à la consommation future, et d'aménager utilement l'une et l'autre?
[403]
Cette tâche ardue et compliquée n'exigeait-elle pas bien autrement de ressources, de lumières et de force morale qu'il n'en possédait et n'en pouvait posséder? Le résultat, on ne le connaît que trop. Au début de la nouvelle ère industrielle, les revenus de la classe ouvrière ont à peine suffi à sa consommation actuelle, mal aménagée et viciée par l'abus des liqueurs spiritueuses. Il a fallu, en conséquence, suppléer à l'insuffisance ou à la nullité de son épargne par un développement extraordinaire de la charité privée et de la bienfaisance publique. On a été obligé de prélever sur le revenu de la communauté un tantième régulier pour combler le déficit de la classe ouvrière, et, en particulier, pour subvenir à sa « consommation future », élève des enfants, entretien des vieillards, frais de maladies et de chômages. Mais cette intervention de la charité privée ou publique ne pouvait que soulager le mal, elle demeurait impuissante à le guérir, elle devait même contribuer à l'aggraver en rendant moins urgente la nécessité de la prévoyance et de l'épargne. Ce n'est pas à dire, certes, qu'il eut été préférable de s'abstenir de venir en aide aux individus incapables de pourvoir entièrement eux-mêmes aux nécessités et aux charges de leur existence. Non. L'extension du paupérisme, provoquée par l'émancipation hâtive des classes asservies, et aggravée par les accidents de l'évolution industrielle auxquels venaient se joindre les perturbations politiques, rendait indispensable une augmentation correspondante de la subvention de la charité. Ajoutons même qu'il ne sera possible de réduire cette subvention destinée à remédier à l'insuffisance de l'épargne de la classe ouvrière qu'autant que cette épargne ira grossissant et se généralisant de manière à lui permettre de remplir elle-même toutes les obligations impliquées dans la consommation future, au lieu d'en rejeter une partie sur autrui.
[404]
Mais il est permis d'affirmer que ce progrès n'est plus qu'une question de temps. Depuis un quart de siècle surtout, l'accélération du développement de la grande industrie et de la concurrence a sensiblement contribué à accroître les ressources de la classe ouvrière, et elle les accroîtra encore plus dans un avenir prochain. Le « prix naturel » du travail s'augmente, comme nous l'avons vu, à chacun des progrès de la machinery de la production, tandis que l'agrandissement de son marché, en plaçant peu à peu l'ouvrier sur le pied de l'égalité avec l'entrepreneur dans le débat du salaire, fait osciller de plus en plus librement le prix courant autour du prix naturel. Lorsque le rouage en voie de formation du commerce du travail sera arrivé au point d'avancement où se trouvent actuellement les autres branches de commerce, lorsque le travail possédera comme le capital un marché général éclairé à giorno, et dans lequel aucun obstacle n'entravera plus la liberté de ses mouvements, l'ouvrier pourra obtenir et obtiendra toute la part qui lui revient dans les résultats de la production. D'un autre côté, la substitution des capitaux mobilisables, divisés en petites coupures, aux capitaux immobilisés, dans la constitution des entreprises, permet désormais à l'ouvrier de participer, à titre de capitaliste, aux profits de la grande industrie, d'abord accessibles seulement aux gros capitaux. Cette substitution en voie d'accomplissement est-il nécessaire de répéter qu'elle s'accomplira jusqu'au bout et dans toute la vaste sphère de la production, par le motif qu'un capital mobilisable est un instrument plus économique qu'un capital immobilisé? Les revenus de la classe ouvrière ont donc commencé à croître, et ce progrès n'est encore qu'à ses débuts. La possibilité de l'épargne s'est accrue en même temps que l'esprit de prévoyance et la force morale, qui sont les véhicules de l'épargne, se développaient [405] chez les ouvriers, tant par la dure expérience des maux de l'imprévoyance que par l'effet, en quelque sorte mécanique, de l'élévation de la nature du travail, conséquence de l'application, de plus en plus générale, de la machinery perfectionnée de la grande industrie : les facultés intellectuelles et morales que l'ouvrier met désormais en œuvre, à la place de sa force physique, se fortifient et s'accroissent naturellement par l'exercice, et elles lui servent, par contre-coup, à mieux gouverner sa vie.
Déjà les résultats de ce nouvel état de choses sont visibles. L'épargne de la classe ouvrière a été sans cesse grossissant depuis un quart de siècle. En même temps, on a vu se multiplier et se perfectionner les institutions destinées à la recueillir et à faciliter l'accomplissement des obligations auxquelles elle doit pourvoir, caisses d'épargnes, sociétés de secours mutuels, caisses de retraite, etc. C'est toutefois une des nombreuses erreurs de la philanthropie de s'imaginer qu'il soit indispensable d'établir des institutions spéciales pour recueillir les épargnes de la classe ouvrière et pour subvenir aux besoins de sa consommation future. Les valeurs mobilières de toute sorte ouvrent leur débouché grandissant aux capitaux de la classe ouvrière comme à ceux des autres classes, les sociétés d'assurances sur la vie et contre les accidents de toute nature, lui fournissent, avec plus de commodité et d'économie que ne pourraient le faire les caisses de retraite officielles ou même l'institution des «invalides civils», les moyens de s'assurer contre les maladies et la vieillesse.
A mesure que la possibilité d'épargner s'accroîtra, à mesure que l'esprit de prévoyance et les autres facteurs de l'épargne grandiront dans les couches sociales inférieures, on verra s'augmenter davantage leur capitalisation, et un moment viendra où elle rendra superflue la subvention de la charité privée ou publique. Comme les [406] autres membres de la société, les ouvriers pourvoiront eux-mêmes aux frais de leurs maladies; ils déserteront l'hôpital pour la maison de santé; assurés par l'épargne, ils n'iront plus peupler, dans leur triste vieillesse, les hospices et les dépôts de mendicité; ils n'auront plus besoin d'exploiter hâtivement le travail de leurs enfants, qu'ils élèveront et feront instruire à leurs frais; en un mot, les ouvriers rempliront, eux aussi, comme elles doivent être remplies, et sans en rejeter le fardeau sur autrui, toutes les obligations qu'implique le gouvernement utile de la consommation.
III. — La reproduction. Comment se pose le problème de la reproduction- — Nécessité de renouveler incessamment des générations limitées dans leur durée. — Que Voffre de la population doit se proportionner en nombre et s'adapter en qualité à la demande, sinon il y a nuisance. — Des facteurs de la reproduction : la puissance prolifique ; le capital. — Que l'homme est naturellement excité par l'appât du plaisir à mettre en œuvre, d'une manière illimitée, sa puissance prolifique; qu'il est naturellement porté, au contraire, à s'épargner les sacrifices et la peine qu'impliquent la création et l'application d'un capital à la reproduction. — Mobiles qui peuvent le déterminer à s'imposer ces sacrifices et à se donner cette peine : l'intérêt, l'amour et la crainte. — Comment ces mobiles ont été mis en œuvre dans le passé. — La reproduction dans les tribus primitives. — Limitation économique du nombre des femmes. — Agrandissement extraordinaire du marché de la population par suite de l'avènement de la petite industrie. — Comment la reproduction est réglée dans les classes supérieures. — Intervention de la religion, de la coutume et de l'opinion pour empêcher les nuisances du nombre et de la qualité. — Que la reproduction des classes asservies est réglée par l'intérêt des propriétaires. — Modifications amenées par l'affranchissement graduel des classes asservies et, finalement, par l'avènement de la grande industrie et de la concurrence. — Affaiblissement de l'ancien système destiné à empêcher les nuisances en matière de population, et insuffisance de ce système en présence des nouvelles conditions d'existence de la société. — Nuisances qui en résultent. — Multiplication excessive des classes inférieures; stérilisation artificielle des classes supérieures. — Abaissement général de la qualité. — Remèdes. — Impossibilité d'en revenir à l'ancien système de servitude et de tutelle. — Action régulatrice naturelle de la concurrence pour équilibrer l'offre et la demande de la population. — Comment il peut être remédié aux nuisances qui ont un caractère physiologique; à celles qui ont un caractère économique. — L'obligation exigible et remboursable.
La reproduction. — Parmi ces obligations, les plus importantes concernent ce que nous avons nommé en [407] langage économique le renouvellement et l'accroissement utiles du personnel de la production; en d'autres termes, la reproduction de l'espèce.
Résumons d'abord les données de ce problème. Chaque génération est limitée dans sa durée. Cette durée est plus ou moins longue selon le degré de vitalité de la race, les conditions climatériques et autres dans lesquelles elle se trouve placée, les moyens d'existence qu'elle possède, et la dépense de forces à l'aide de laquelle elle les acquiert, la manière dont elle répare cette dépense; autrement dit, son hygiène physique et morale. Ces divers éléments qui déterminent la durée de chaque génération sont perfectibles, et on a pu constater leurs progrès par l'augmentation de la longévité moyenne, mais la vie humaine n'en a pas moins sa limite naturelle. Chaque génération a donc l'obligation d'en former une autre, à laquelle elle lègue le capital de forces, de biens et de connaissances qu'elle a reçu des générations antérieures, augmenté de ses acquisitions et diminué de ses pertes.
Comme toutes les autres branches de la production, celle de l'homme est gouvernée par l'étendue du débouché qui lui est ouvert; en d'autres termes, par le marché de la population. En quoi consiste le marché de la population? Il consiste dans le nombre des emplois ou des revenus qui fournissent aux différents membres d'une société leurs moyens d'existence. Si la population ne se multiplie pas assez pour remplir toutes ces alvéoles de la ruche sociale, un certain nombre d'entre elles demeureront inoccupées à moins qu'elles ne soient remplies par une immigration du dehors, la société s'affaiblira et s'appauvrira; si la population se multiplie avec excès, cet excédant ne pourra être utilisé, il demeurera à la charge de la société à moins qu'il ne périsse ou n'émigre, et, dans ce dernier cas encore, la société sera obligée de faire l'avance de ses frais [408] d'émigration. Dans les deux cas, il y aura nuisance. Il y aura encore nuisance si la nouvelle génération n'est qu'imparfaitement propre à remplir sa tâche, si elle est mal constituée physiquement et moralement, si son éducation est mal adaptée à ses conditions d'existence, si elle est, en conséquence, grevée de non-valeurs ou de demivaleurs. Ainsi, le problème de la population implique à la fois une question de quantité ou de nombre et une question de qualité. Il importe à la prospérité et même à l'existence de la société que la population s'accroisse dans la proportion utile et qu'elle soit, sous le rapport de la qualité, aussi apte que possible à remplir les fonctions qui lui procurent ses moyens d'existence.
Maintenant, quels sont les facteurs de la reproduction? Quels sont les agents qui contribuent à former la nouvelle génération? Ces agents sont au nombre de deux : 1° le pouvoir naturel de reproduction nécessaire pour donner le jour à un enfant; 2° le capital non moins nécessaire pour faire de l'enfant un homme utile.
Le pouvoir naturel de reproduction peut être considéré comme illimité aussi bien que le penchant à en user. Supposons que l'homme ne soit retenu, à cet égard, par aucun frein, qu'il s'abandonne en suivant l'impulsion physique de sa nature à l'attrait des sexes, il pourra donner le jour à un nombre d'enfants assez grand pour qu'en un petit nombre de siècles, en admettant que tous ces enfants arrivent à l'âge d'homme et se reproduisent à leur tour, l'espace même manque sur le globe pour loger l'humanité. Mais la puissance prolifique n'est qu'un des facteurs de la reproduction. Il y en a un autre dont l'intervention n'est pas moins indispensable pour former une nouvelle génération, c'est le capital. Il faut dépenser un capital pour entretenir un enfant, l'élever et l'instruire jusqu'à ce qu'il soit en état de pourvoir lui-même à sa subsistance. [409] Pendant une période de dix ans, quinze ans, vingt ans et même davantage, il ne couvre pas ses frais, et, dans les premiers temps de son existence, il exige les soins assidus de la mère qu'il rend ainsi impropre à d'autres travaux. Tout homme qui met un enfant au monde crée une obligation consistant dans les frais nécessaires pour en faire un homme utile. Le montant de cette sorte de lettre de change est peu élevé dans l'état de barbarie primitive, mais alors aussi la difficulté d'épargner le capital indispensable pour l'acquitter est à son plus haut point; plus tard cette difficulté va diminuant, mais la quantité de capital qu'il faut investir dans un enfant, pour en faire un homme utile, va croissant.
Or, s'il est exact de prétendre, comme l'a fait l'illustre auteur de l'Essai sur le principe de lapopulation, Malthus, que l'homme est naturellement disposé à mettre en œuvre, sans aucune limite, le premier facteur de la reproduction, savoir sa puissance prolifique, il l'a été de tous temps beaucoup moins à s'imposer les privations et les sacrifices nécessaires pour y joindre le second.[37] A cet égard même, on peut lui reprocher de s'être montré originairement inférieur à beaucoup d'espèces animales, dans lesquelles le mâle aide, avec une touchante sollicitude, la femelle à élever ses petits. La légende de Saturne ne le ferait-elle pas assimiler plutôt aux espèces carnassières, dans lesquelles la femelle est obligée de mettre sa progéniture à l'abri de la voracité du mâle? Si l'individu avait été dès l'origine abandonné à ses instincts en matière de reproduction, il y a apparence que l'espèce humaine, au lieu de pulluler comme le redoutait le révérend professeur d'Oxford, aurait depuis longtemps disparu de la terre.
[410]
Est-il bien nécessaire d'expliquer cette contradiction? Si l'homme est disposé à user sans limites de sa puissance de reproduction, c'est parce que la nature y a attaché un plaisir. S'il est beaucoup moins disposé à s'acquitter des obligations qui naissent de l'usage de sa puissance reproductive, c'est parce que cet acquittement implique une peine. Goûter le plaisir, éviter la peine ou s'en décharger sur autrui, voilà, en cette matière comme en bien d'autres, sa propension naturelle et originelle.
Cependant, le problème de la reproduction ne pouvait être résolu qu'à la condition que la peine fut attachée au plaisir; autrement dit. qu'après avoir donné le jour à un enfant, on investit dans cet enfant le capital nécessaire pour en faire un homme. Quels mobiles pouvaient être mis en œuvre pour déterminer l'accomplissement de cette obligation? Ces mobiles ne pouvaient consister que dans l'intérêt, l'amour ou la crainte, et tels sont, en effet, les véhicules qui ont servi de tous temps à résoudre le problème de la population. L'intérêt et la crainte sont intervenus d'abord, l'amour conjugal et paternel est arrivé ensuite, mais sans égaler encore, dans la généralité de l'espèce humaine, la puissance des deux autres mobiles. Nous allons nous en convaincre en jetant un coup d'œil sur le passé de la reproduction.
Le trait caractéristique des tribus primitives, c'est la prépondérance du sexe masculin. On n'élève qu'un petit nombre d'enfants du sexe féminin, on sacrifie les autres, sauf à se procurer économiquement des femmes, en les ravissant aux autres tribus, ce qui coûte moins cher que de les élever. Plus tard, on exigera, à titre de redevance ou de contribution de guerre, après une victoire, un certain nombre de jeunes filles, témoin la légende du minotaure de Crète. Les femmes sont un article de luxe pour une tribu qui se procure au jour le jour une subsistance [411] insuffisante et précaire, car elles ne peuvent pourvoir ellesmêmes entièrement à leurs besoins, et le nombre en est réduit au strict nécessaire. La promiscuité ou plutôt la polyandrie dans le sein de la tribu, apparaît comme le régime prédominant des âges primitifs. Mais la rareté des femmes ayant pour résultat naturel d'augmenter leur valeur, elles acquièrent une importance qu'elles devaient perdre lorsque l'armement et l'outillage des tribus venant à s'améliorer, on put augmenter l'élevage des enfants du sexe féminin et multiplier ainsi ce bétail de choix. La propriété féminine cessa alors d'être collective; chaque guerrier ou chasseur put posséder une femme, et, dans les tribus adonnées à l'industrie pastorale, plus productive que la chasse, il put même en posséder plusieurs; les enfants qui appartenaient à la mère, lorsque celle-ci était une propriété collective, devinrent, comme la mère, la propriété du maître qui les élevait en vue du profit qu'il en pouvait tirer. Mais le marché de la population demeurait limité, et l'infanticide, sous la forme d'un sacrifice aux divinités de la tribu, était une pratique ordinaire et légitime. A mesure que le marché de la population s'agrandit, ce genre de sacrifice devint plus rare, on put se défaire du surcroît des enfants en les vendant ou en les échangeant contre d'autres sortes de bétail; c'est ainsi que les belles races du Caucase se sont fait, jusqu'à nos jours, un revenu régulier en vendant le surcroît de leur progéniture aux Turcs qui faisaient des Mamelucks avec les enfants mâles, et qui recrutaient leurs harems avec les femelles.[38]
[412]
Avec la petite industrie, le marché de la population s'étend, tout en demeurant cependant localisé. Comment [413] se résout alors le problème de la reproduction utile? Il y a deux marchés : celui de la classe dominante et [414] possédante; celui de la classe asservie et possédée. L'un et l'autre ont leurs limites distinctes, mais, dans l'un et dans [415] l'autre, c'est l'intérêt des propriétaires et des maîtres qui sert de régulateur à la reproduction, avec la différence [416] que cet intérêt agit individuellement et sans contrôle en ce qui concerne la classe asservie, tandis qu'il est [417] subordonné dans la région supérieure à l'intérêt commun de la caste, et assujetti à un ensemble de règles établies par la [418] religion et la coutume, en vue d'empêcher les nuisances de la reproduction. Ces règles, fruits de l'observation et de l'expérience, ont principalement pour objet de sauvegarder la qualité de la population : elles interdisent à la fois les unions entre proches parents, et les croisements en dehors de la religion, de la caste ou de la nation, expressions équivalentes à l'origine. Les généalogies qui constatent la pureté du sang sont dressées, dès les temps les plus reculés, avec un soin extraordinaire; on peut en juger par la place qu'elles tiennent dans la Bible. Elles témoignent de la valeur de la race — comme nos Studbook attestent celle de la race chevaline — et servent, par là même, à fixer le rang auquel elle peut prétendre, le prix qu'elle peut demander pour ses filles, etc. Toute reproduction, en dehors des règles établies par la religion et la coutume, est frappée de réprobation et l'objet de pénalités matérielles et morales, qui n'atteignent pas seulement ceux qui enfreignent la loi, mais encore les fruits de cette infraction; les enfants issus des unions défendues sont exclus de la caste. Ce régime, si barbare qu'il nous paraisse, avait évidemment sa raison d'être, et mieux on l'étudie, en se replaçant dans les circonstances du temps, plus on en apprécie la profonde sagesse. Quant à la quantité ou au nombre, on se fiait, pour le régler, à l'intérêt individuel; si nous consultons les préceptes religieux, les coutumes et les lois anciennes, nous nous apercevrons toutefois que l'intérêt individuel avait besoin d'être stimulé plutôt que contenu. La plupart des religions recommandent aux hommes de croître et de multiplier, elles interdisent les pratiques contraires à la multiplication, etc., et cependant, malgré ces préceptes et ces interdictions, la reproduction des classes dominantes est demeurée le plus souvent au-dessous des besoins de leur marché, et elles ont dû se recruter incessamment dans les couches sociales inférieures.
Cette tutelle que la religion et la coutume imposaient aux individus, dans l'intérêt commun de la classe dominante, en vue d'assurer la reproduction utile de cette classe, quant à la qualité et au nombre, elle n'existait pas, du moins à l'origine, pour les classes asservies. Ici, on se fiait entièrement à l'intérêt du propriétaire, sachant bien qu'il ne manquerait pas de proportionner le nombre de ses esclaves aux besoins de son domaine, et qu'il s'appliquerait naturellement à se procurer les esclaves les plus vigoureux ou les mieux adaptés à leur destination, en se chargeant lui-même de veiller aux nuisances en cette matière. Il faisait mieux. Les propriétaires intelligents et soigneux de leurs intérêts, étudiaient les dispositions et les aptitudes de leurs jeunes esclaves, et ils faisaient les avances nécessaires à leur éducation; ils les vendaient ou [420] les louaient ensuite à un prix qui couvrait amplement leurs avances et leur procurait même parfois des profits extraordinaires. Lorsque le servage succéda à l'esclavage, le maître cessa de gouverner directement la reproduction de son cheptel humain, il conserva seulement le droit essentiel d'autoriser ou d'interdire les unions, en considérant l'état des besoins du domaine; la religion et la coutume assujettirent alors le serf à la tutelle qu'elles avaient imposée au maître lui-même, en vue de prévenir les nuisances de la reproduction.
L'avènement de la grande industrie et de la concurrence a eu pour effet de modifier profondément les conditions de la reproduction. Le marché de la population a été élargi comme les autres, en attendant d'être complètement unifié. La liberté du travail a ouvert les différentes branches d'industrie aux travailleurs de toute provenance, en même temps que les emplois publics devenaient accessibles à tous les citoyens du même pays. Cet agrandissement du marché et, en particulier, cette accessibilité de tous les citoyens à des emplois qui étaient auparavant le monopole de la classe supérieure, augmentaient le débouché des autres classes et devaient les exciter à se multiplier; en revanche, le marché de la population devenait plus difficile à connaître. Tandis que chaque classe de la population appréciait aisément, sous l'ancien régime, le débouché local et fermé dont elle disposait à l'exclusion des autres, tandis que le propriétaire d'esclaves pouvait calculer approximativement le nombre auquel il devait arrêter son élève annuelle pour ne point charger son exploitation de bouches inutiles, le débouché généralisé semblait échapper aux prévisions et aux calculs.
Sous ce nouveau régime, l'ancien système de tutelle destiné à prévenir les nuisances en matière de population devenait insuffisant, et, en partie du moins, inapplicable. [421] On pouvait continuer et on continua d'interdire les unions entre parents rapprochés, car ces unions conservaient leur caractère nuisible, mais, du moment où chaque catégorie sociale cessait d'être attachée à une catégorie particulière d'emplois, l'interdiction des alliances entre des individus de races et de professions différentes ne perdaitelle pas sa raison d'être? D'un autre côté, toutes les règles ayant pour objet de limiter le nombre des unions, ne devaient-elles pas disparaître en présence d'un débouché devenu, en apparence du moins, illimité? Après la disparition du servage, la commune ou l'État s'était attribué le pouvoir qu'exerçait auparavant le maître d'autoriser ou de défendre les unions selon qu'il le jugeait utile. Cette autorisation était subordonnée à l'accomplissement de conditions destinées à préserver la communauté de la charge d'une population surabondante. Mais, en l'absence d'une sanction suffisante, ce régime n'aboutissait plus qu'à encourager la multiplication des enfants naturels, et il n'a été conservé que dans un petit nombre de pays. La liberté des unions a généralement prévalu. Seulement, la religion et la loi civile ne reconnaissent et ne sanctionnent, en fait d'unions sexuelles, que le mariage dont elles règlent les conditions, les stipulations et la forme, en s'efforçant de définir et de consacrer les droits et les devoirs réciproques des époux, les obligations des parents envers leurs enfants, et des enfants envers leurs parents. Par malheur, l'appareil de pénalités matérielles et morales, qui protégeait l'observation de ces règles et le mariage lui-même, a été s'affaiblissant. Il s'est affaibli, d'un côté, parce que la foi qui assurait l'obéissance à la loi religieuse, en matière de reproduction comme dans tout le reste, a baissé; d'un autre côté, parce que l'opinion et la législation pénale qui en est l'expression n'ont plus opposé qu'un blâme atténué et une répression molle [422] aux infractions les plus graves aux conventions matrimoniales. L'adultère a cessé d'être puni de mort, et l'opinion, d'accord avec la loi, allant même plus loin que la loi, lui a trouvé des circonstances atténuantes. Enfin, non seulement les unions interlopes ont été tolérées, mais leurs fruits ont cessé d'être rejetés de la société; toutes les carrières ont été ouvertes aux enfants naturels à l'égal des enfants légitimes. Bref, ce qui est resté de l'ancienne tutelle, destinée à prévenir ou à réprimer les nuisances de la reproduction n'a conservé qu'une apparence d'efficacité et de force.
Quels ont été les effets de l'affaiblissement de cette tutelle?
Sur les classes inférieures d'abord. Comme nous l'avons remarqué, celles-ci ont profité de la suppression ou de l'affaiblissement des obstacles qui étaient opposés à leur multiplication — autorisation du maître, puis de la commune ou de l'État pour contracter des unions légitimes; répression des unions interlopes — pour s'adonner à l'appétit physique de la reproduction, sans se préoccuper des conséquences; le nombre des fruits des unions légitimes ou illégitimes s'est rapidement accru dans les couches sociales inférieures; mais, comme le capital nécessaire à l'élève des enfants n'y croissait pas dans la même proportion, la mortalité de ces fruits de l'imprévoyance n'a pas manqué de s'élever. L'intervention de la charité privée ou publique, si bien motivée qu'elle fût pour sauver des existences qu'un penchant maintenant dégagé de frein mettait au jour, ne pouvait guère avoir d'autre résultat que d'aggraver le mal. Ce qui pouvait subsister de scrupules chez ceux qui s'adonnaient à toute l'intempérance de leurs appétits brutaux, ne devait-il pas disparaître à la pensée que le gouvernement lui-même, avec ses ressources inépuisables, se chargerait d'acquitter toutes les [423] lettres de change qu'ils s'exposaient à souscrire? Qu'arriva-t-il alors? Il arriva que ces lettres de change furent présentées en un tel nombre que la charité publique dût renoncer à les accepter sans restriction. En même temps, l'expérience se chargeait de démontrer sa cruelle incapacité à remplir la mission qu'elle avait assumée; les enfants trouvés subissaient dans les hospices les mieux dotés et ordonnés une mortalité extraordinaire, et ceux qui y échappaient constituaient un élément de population affaibli et vicieux. Cependant, malgré la rareté du capital applicable à la reproduction, l'élève des enfants demeurait encore une industrie profitable. Quoique la loi religieuse et la loi civile, issue de la coutume, se fussent unies — tout en se disputant la prééminence — pour tempérer, sinon pour abolir le vieux régime de servitude qui faisait de la femme et de l'enfant la propriété du mari et du père; quoique celui-ci eût cessé d'avoir sur eux droit de vie et de mort; quoique l'enfant arrivé à sa majorité échappât même entièrement à l'autorité paternelle, ce qui subsistait de ce régime suffisait encore, dans les conditions nouvelles de la production, à rétribuer la fondation d'une famille. La femme pouvait, en cumulant les travaux de la fabrique avec ses fonctions domestiques, gagner un salaire assez élevé pour subvenir à son propre entretien, les enfants coûtaient peu de chose à nourrir, surtout avec l'aide de la charité, qui proportionnait ses secours au chiffre de la famille, et dès qu'ils avaient atteint l'âge de cinq ou six ans, on les jugeait mûrs pour le travail; à mesure que leurs forces et leur aptitude industrielle se développaient, leur salaire augmentait, et il ne tardait pas à dépasser leurs frais d'entretien. Une famille nombreuse devenait ainsi une source de profits : le faible capital investi dans l'élève des enfants, et d'ailleurs en partie fourni par la charité, constituait un placement [424] avantageux. La multiplication des classes ouvrières en a été encouragée au point de devenir surabondante, en dépit de la mortalité extraordinaire des enfants élevés dans ces conditions. Mais la qualité de cette population ne pouvait guère manquer de décliner. Les femmes assujetties, même pendant leur grossesse, à un labeur quotidien longuement prolongé, devenaient moins propres à remplir les fonctions de la maternité, les enfants imparfaitement soignés, mal nourris, astreints à un travail prématuré et dépassant leurs forces ne pouvaient prendre tout leur développement; arrivés à l'âge d'homme, ils donnaient le jour à une génération plus affaiblie encore. Les gouvernements ont fini par s'émouvoir de cet état de choses, et des mesures plus ou moins efficaces ont été prises pour protéger les femmes et les enfants contre l'abus de l'exploitation de leur travail, comme aussi pour obliger les parents à joindre à l'alimentation et à l'entretien matériel qu'ils doivent légalement à leurs enfants, un certain minimum d'instruction. Ces mesures se justifient par la nécessité de remédier à la dégénérescence physique et morale de l'espèce, mais n'ont-elles pas pour résultat d'affaiblir l'intérêt qui pousse l'homme des classes inférieures à s'imposer les sacrifices, au moins temporaires, qu'exige la fondation d'une famille? Si l'instruction devenue obligatoire augmente les frais d'élève des enfants, si les lois limitatives du travail des enfants et des femmes ne permettent plus au mari et au père de se couvrir de ses frais avec l'adjonction d'un bénéfice suffisant, il sera moins excité à fonder une famille, et, s'il la fonde, il s'efforcera de la limiter. Le déficit qui en résultera dans l'offre de la population provoquera l'immigration de races inférieures, dont la reproduction aura continué de s'opérer sous un régime moins limité d'appropriation et d'exploitation de la famille, et la qualité de la population baissera de plus en plus.
[425]
L'observation des effets du nouveau régime sur les classes supérieures vient encore à l'appui de cette conclusion. Il semblerait, au premier abord, que ces classes dussent se multiplier infiniment plus que les autres, puisqu'elles possèdent une proportion bien plus considérable de capitaux applicables à la reproduction, et qu'elles peuvent élever leurs enfants avec des soins et dans des conditions hygiéniques qui en réduisent la mortalité au minimum. Cependant, c'est le phénomène opposé qui se produit : les classes supérieures se multiplient moins que les classes inférieures; elles sont, en conséquence, incessamment pénétrées et renouvelées par une immigration de bas en haut, immigration qui leur apporte des éléments plus grossiers sans être toujours plus vigoureux, et qui ne maintient numériquement la race qu'en l'abaissant. A quoi tient cette anomalie apparente?
Nous en aurons l'explication en nous rappelant les mobiles qui peuvent déterminer l'homme à s'imposer la peine et les privations qu'implique la fondation d'une famille, quand il peut d'ailleurs satisfaire autrement, sans encourir aucune responsabilité, et sous un simple risque que les progrès de l'hygiène atténuent tous les jours, ses appétits sexuels. Ces mobiles sont l'intérêt, l'amour et la crainte, se résolvant, soit dans l'acquisition d'une jouissance, soit dans l'épargne d'une peine ou d'une privation supérieure. Sous le régime de la servitude, l'intérêt est le principal sinon l'unique véhicule qui pousse l'homme à s'imposer les privations et à se donner la peine qu'exigent l'entretien régulier des femmes et l'élève des enfants. Il est leur maître et leur propriétaire; il peut les exploiter à sa guise, en obligeant les garçons à travailler pour lui et en vendant les filles. Dans ces conditions, la fondation d'une famille ou d'un atelier de reproduction est une entreprise profitable. A ce mobile grossier mais [426] énergique de l'intérêt viennent se joindre, d'une part, les sentiments que développent la cohabitation et la protection, l'amour conjugal et paternel; d'une autre part, la crainte des châtiments terribles ou honteux que la religion, la coutume et l'opinion infligent à ceux qui se dérobent aux conséquences de la satisfaction de leurs appétits sexuels ou qui en rejettent le fardeau sur autrui.
Le premier et le dernier de ces mobiles, l'intérêt et la crainte, se sont singulièrement affaiblis dans les rangs supérieurs de la société s'ils n'ont pas encore entièrement disparu. L'intérêt n'a pas cessé sans doute d'être une cause déterminante des mariages. La femme se marie en vue d'acquérir une situation dans le monde et de satisfaire son goût pour le luxe et les plaisirs; l'homme, en vue d'augmenter sa fortune, ses relations et son influence, mais ces mobiles intéressés qui poussent au mariage ne contribuent pas à rendre les unions fécondes. Au contraire! Le goût du confort et des plaisirs mondains, le désir de conserver sa beauté, chez la femme; la crainte d'augmenter ses charges, de ne pouvoir élever et caser ses enfants d'une manière conforme au rang de la famille, chez l'homme, agissent dans le sens de la limitation de la fécondité. A quoi il faut ajouter que l'élève et l'éducation des enfants, bien que l'État se soit fait entrepreneur d'enseignement à perte, reviennent de plus en plus cher. Ce n'est rien exagérer que d'évaluer en moyenne à 50,000 francs, dans la région supérieure de la société, ce qu'il en coûte pour élever, instruire et caser un enfant, en y comprenant la dot des filles. Une famille de cinq enfants, en supposant même que la mortalité n'en ait pas augmenté les frais, revient donc à 250,000 francs et représente le sacrifice annuel d'un revenu d'une douzaine de mille francs, et au delà, s'il s'agit de capitaux placés dans l'industrie. On n'a aucun intérêt à faire cette grosse dépense, [427] puisque les enfants coûtent et ne rapportent point. On dote les filles, au lieu de les vendre, comme dans les temps primitifs, et on fait, à tout prendre, plus de frais encore pour élever et établir les garçons. Sans doute, l'amour paternel se résigne volontiers à ces sacrifices; il a même une tendance à les exagérer, mais l'amour paternel enveloppe de sa sollicitude la famille déjà née, il n'excite pas à l'accroître. Sa tendance serait plutôt de la restreindre pour ne point diminuer la part des êtres sur lesquels s'est concentrée une affection trop souvent exclusive et aveugle. Enfin, la crainte de contrevenir à la loi religieuse et de s'exposer à la censure de l'opinion n'agit que bien faiblement quand elle agit. La foi n'existe plus guère, et les croyants eux-mêmes ne mettent pas toujours l'obéissance aux prescriptions religieuses avant la satisfaction de leur intérêt ou de leur passion. Quant à l'opinion, elle hésite, non sans raison, à blâmer des parents qui s'abstiennent de donner le jour à un plus grand nombre d'enfants qu'ils n'en pourraient élever, sans que le surcroît des derniers venus fit tort aux autres; d'ailleurs, on ne la prend pas toujours pour confidente et pour conseillère. On s'explique donc qu'en absence de l'intérêt qui agit encore dans les couches inférieures de la société pour encourager la reproduction, les classes supérieures limitent la leur, au point même de demeurer en deçà des besoins de leur débouché, qu'envahissent les générations du dessous, si mal préparées qu'elles soient à l'occuper.
Tel a été l'apprentissage du self government en matière de reproduction. Si l'on compare les résultats de l'ancien régime à ceux du nouveau, l'avantage ne demeurera point à celui-ci. Non seulement le personnel de la production n'a point réalisé un progrès comparable à celui du matériel, mais on peut contester que les nouvelles générations valent physiquement et moralement les anciennes. [428] La dégénérescence est visible, en dépit des progrès du bien-être et de l'hygiène.
A quels moyens la société peut-elle avoir recours pour remédier aux nuisances que ce nouveau régime a étendues et aggravées, sinon créées : ici, à la multiplication excessive avec un capital insuffisant; là, au contraire, où le capital suffit, à la stérilisation artificielle des unions. Peut-elle revenir au régime primitif et barbare de la servitude? Mais ce régime n'est plus adapté à ses conditions actuelles d'existence, et comment serait-il possible de le rétablir? Qui s'aviserait de proposer le rétablissement de la puissance maritale et paternelle, telle qu'elle existait dans l'ancienne Rome? Qui voudrait restituer au chef de famille, avec le droit de vie et de mort, le pouvoir d'enfermer sa femme, d'exploiter ses enfants mâles, leur vie durant, et de vendre ses filles? La tendance manifeste de l'opinion n'est-elle pas, au contraire, d'effacer, en cette matière comme en toute autre, les traces encore subsistantes du régime de la servitude, en protégeant la femme et les enfants contre la brutalité et l'exploitation du mari et du père? Ne place-t-elle pas, de plus en plus, la femme sur le pied de l'égalité avec l'homme? Ne les considère-t-elle pas l'un et l'autre comme deux créatures libres, et n'est-elle pas portée à assimiler le contrat d'association qui les unit à toutes les autres conventions? Ce contrat n'est-il pas devenu presque partout résiliable pour cause d'inexécution ou de violation réciproque de ses clauses? Et cette violation même, la loi ne la punit-elle pas maintenant des deux côtés, tout en adoucissant ses pénalités au point de les rendre inefficaces? Lorsque la femme était la chose du mari, qui l'avait d'ailleurs achetée à beaux deniers comptants, l'adultère commis par elle et avec elle était puni de mort comme la plupart des autres atteintes à la propriété. Lorsque le [429] mariage a cessé d'être un acte de vente et d'achat pour devenir un engagement mutuel, l'adultère n'a plus été qu'une infraction à un contrat au lieu d'être une atteinte à la propriété, la pénalité s'est atténuée en conséquence, et la tendance de l'opinion serait de l'atténuer encore davantage plutôt que de la rendre plus rigoureuse. Serait-il plus facile de revenir au régime de protection des unions légitimes contre les unions interlopes, tel qu'il existait au moyen âge? L'opinion consentirait-elle à vouer de nouveau les « bâtards » à l'infamie et à l'ostracisme? Non, encore moins qu'elle ne consentirait au rétablissement de la peine de mort contre les adultères. A quoi on peut ajouter que ce qui subsiste de ce régime de protection, savoir l'obligation imposée aux parents de léguer leurs biens à leurs enfants légitimes à l'exclusion des autres, est devenu singulièrement difficile à faire observer depuis l'avènement de la propriété mobilière. On ne saurait donc revenir à l'ancien système de servitude et de tutelle qui prévenait ou réprimait, avec le concours de la religion, de la coutume et de l'opinion, les nuisances de la reproduction dans les sociétés d'autrefois. Ce système a cessé d'être adapté à la nôtre, et on essaierait en vain de l'empêcher de tomber en poussière. Tout au plus réussirait-on à étayer pour quelque temps ses ruines. Que faire donc? Laisser l'évolution suivre son cours, et attendre le remède des progrès mêmes du self government.
Remarquons que, sous ce régime, le problème de la population se résout naturellement, quant au nombre, par l'action régulatrice de la concurrence. L'offre de la population tend incessamment à se mettre en équilibre avec la demande, et cela se conçoit. Lorsque l'offre vient à dépasser la demande, toutes les rétributions afférentes au personnel de la production baissent; on ne peut plus épargner autant sur le revenu actuel en vue de la [430] consommation future, et le capital, qui était employé à la formation de la génération nouvelle, se réduit de luimême. Lorsque la demande a dépassé l'offre, les salaires haussent, et on voit augmenter le capital applicable à la reproduction. Comment connaître, toutefois, le marché de la population, devenu illimité? C'est une difficulté, sans doute, mais cette difficulté n'existe-t-elle pas pour les capitaux et les produits de toute sorte, et n'avonsnous pas vu comment elle se résout, grâce à la multiplication des intermédiaires, jointe au progrès des moyens de communication et d'information? Pourquoi le marché de la population serait-il plus difficile à connaître et à ajuster que les autres? Voilà pour les nuisances qui proviennent de l'excès ou de l'insuffisance du nombre. Celles qui concernent la qualité seraient-elles plus difficiles à éviter ou à écarter?
Déjà l'observation et l'expérience ont fait reconnaître toute une série de nuisances causées par l'union des sexes dans un cercle de parenté trop étroit ou entre des races trop éloignées. Cette branche importante de la science naturelle de l'homme est encore, à la vérité, dans l'enfance, mais le rapprochement de la multitude des variétés de la race humaine ne manquera point d'accélérer ses progrès. Entre ces variétés, quelles unions sont utiles? Quelles autres sont nuisibles? L'interdiction du mariage entre nègres et blancs, qui existe, par exemple, dans quelques États de l'Union américaine, est-elle justifiée ou non? Quels sont les effets de l'hérédité sur certaines maladies physiques et morales, sur la folie, les prédispositions au crime, et, en général, sur les penchants et les aptitudes? Voilà toute une immense série d'observations à faire et de lois à découvrir. Ces observations faites, ces lois découvertes, l'opinion, et au besoin même la loi, puis la conscience individuelle, jetteront l'interdit sur les [431] unions productives de nuisances, tandis qu'elles encourageront, au contraire, les unions utiles.
A cette catégorie de nuisances, qui ont une cause physiologique, se joint la catégorie plus nombreuse encore et plus importante de celles qui ont une cause économique, soit que l'on multiplie les lettres de change de la paternité au delà des moyens qu'on a de les acquitter, soit qu'on s'abstienne d'en mettre en circulation autant qu'on en pourrait acquitter. Ces nuisances économiques appellent un remède économique. Quel sera ce remède? 11 consistera, selon toute apparence, dans un mode d'accomplissement plus utile de l'obligation sut generis que crée la mise au monde d'un enfant, et qui se résout dans une avance de capital. Cette avance, les uns ne peuvent ou ne veulent point la faire; d'autres la font d'une manière insuffisante, et ils s'en remboursent en abusant des forces de l'enfant pendant qu'il est soumis à la puissance paternelle; d'autres, au contraire, font volontiers cette avance, et ils ne songent point à en réclamer le remboursement, mais ils ne veulent point la multiplier. On peut concevoir un progrès qui rendrait, d'une part, l'obligation exigible; d'une autre part, remboursable, et qui donnerait ainsi ouverture à l'intervention du crédit dans l'élève et l'éducation de la génération nouvelle. Nous nous bornons, pour le moment, à indiquer la possibilité de ce progrès sans insister sur les changements qu'il serait dans sa nature de déterminer, et dont on peut aisément se faire une idée. Ce que nous en disons suffira bien pour faire comprendre aux intelligences familières avec les questions économiques que le problème de la reproduction, comme tous les autres, pourra recevoir et recevra la solution la mieux adaptée aux nouvelles conditions d'existence de la société.
[432]
IV. — La transmission et la conservation de la richesse. Comment se transmet et se conserve la richesse. — Tendance primitive de l'homme à emporter ses biens avec soi ou à les employer à assurer son salut futur. — Abus des funérailles et des donations. — Raison d'être du système de transmission imposé par la coutume féodale (droit d'aînesse et substitutions). — Comment cette raison d'être a disparu. — Tendance à abandonner la transmission des biens au self gozcrnment. — Objections que soulève le système de l'égalité des partages. — Que le socialisme a pris, comme de coutume, le contre-pied du progrès en matière de transmission des biens. — Quels seraient les effets de l'abolition de l'héritage. — Impossibilité croissante de cette mesure de confiscation. — Comment la diffusion universelle de la propriété, à laquelle conduisent la grande industrie et la concurrence, constituera la plus efficace des assurances contre le risque d'une révolution sociale.
La transmission et la conservation de la richesse. — Chaque génération hérite de la richesse accumulée sous toutes les formes par les générations précédentes, et la transmet, augmentée de son actif et diminuée de son passif, à la génération qui lui succède. Dans les temps primitifs, lorsque les affections qui ont déterminé plus tard le choix des héritiers étaient encore à l'état de germe; lorsque le chef de famille n'éprouvait guère pour sa femme et ses enfants que le sentiment égoïste du propriétaire, il s'efforçait, autant que la chose était matériellement praticable, d'emporter ses biens dans la tombe. Les principaux personnages de la tribu ou de la nation employaient une portion considérable de leurs richesses à se construire d'énormes tombeaux : ici des tumulus, là des pyramides, où ils se faisaient enterrer avec leurs femmes préférées et leurs esclaves favoris, leurs chevaux de guerre, leurs armes, leurs bijoux. Dans un état de civilisation plus avancé, ils léguaient, toujours sous l'empire du même sentiment égoïste, les biens qu'ils ne pouvaient emporter à leurs divinités, représentées par les ministres du culte, en vue de s'assurer auprès d'elles un accueil favorable. La loi religieuse ne se montrait point réfractaire à cette dernière sorte de dispositions testamentaires; [433] mais l'opinion et la coutume réagirent contre les unes et les autres. On restreignit peu à peu le luxe des nécropoles et des funérailles, et l'on imposa des restrictions analogues aux donations religieuses. Sous le régime féodal, on régla la transmission des domaines et on pourvut à leur conservation, en vue des services qu'ils servaient à rétribuer et à assurer dans l'intérêt commun. Tel fut l'objet du droit d'aînesse et des substitutions. La coutume féodale accordait l'usufruit du domaine à l'aîné des enfants mâles, mais sans lui permettre de disposer du fonds qui devait passer aux aînés successifs. Que ces dispositions préservatrices eussent leur raison d'être sous un régime où l'existence de l'État dépendait de la transmission régulière et de la conservation des domaines, dont la jouissance payait les services nécessaires à la gestion des affaires et à la défense de la communauté, cela ne saurait être contesté; mais cette raison d'être, elles la perdirent lorsque les services politiques et militaires eurent été centralisés et purent être rétribués en argent. Alors l'immobilisation des domaines entre les mains des aînés successifs cessa d'être utile, et lorsque l'évolution de la grande industrie et de la concurrence eût commencé, elle ne tarda pas à devenir onéreuse et nuisible. En empêchant la vente des terres, elle ne permettait point de réaliser toute la plus-value que leur faisaient acquérir le développement de la richesse et l'accroissement de la population; en maintenant entre les mains des anciennes castes gouvernantes un monopole auquel étaient attachés des privilèges politiques et une considération particulière, elle causait aux autres classes un préjudice à la fois matériel et moral. Aussi ce mode de transmission de la propriété foncière est-il abandonné partout, ou en voie de l'être. Il le sera bientôt en Angleterre, où déjà la transmission de toutes les autres catégories de propriétés ou de richesses est [434] pleinement livrée au self government individuel. En France, au contraire, où le droit d'aînesse et les substitutions ont été supprimés, la loi a généralisé le régime de la tutelle, en matière de transmission des biens. Elle impose, comme on sait, au père de famille, l'obligation de léguer sa fortune, en parts égales, sauf une quotité disponible, à ses enfants légitimes. Cette obligation est motivée par l'incapacité réelle ou supposée des testateurs à disposer de leurs biens d'une manière conforme à la justice et à l'intérêt social, et elle a pour objet d'accorder uneprotection spéciale à la famille légitime. Mais on peut contester qu'elle soit également bien adaptée à toutes les situations; elle a, en tous cas, le double inconvénient d'altérer la notion de la propriété et d'affaiblir l'autorité paternelle en donnant aux enfants l'idée fausse qu'ils ont droit à une fortune qu'ils n'ont point créée, et que la loi leur assure sans qu'il leur soit nécessaire de s'en montrer dignes. La généralisation de la propriété mobilière suffirait seule, au surplus, pour emporter ces restrictions à la transmission libre de la richesse. Quand les fortunes seront représentées, pour la plus grande partie, sinon en totalité, par des titres au porteur, comment pourra-t-on limiter encore, d'une manière efficace, la liberté de tester?
Ainsi l'avenir appartient au self government, non seulement pour la production, la distribution et la consommation de la richesse, mais encore pour sa transmission d'une génération à une autre. En cette matière, comme en tout le reste, avons-nous besoin de dire que le socialisme a pris le contre-pied du progrès? Le progrès a consisté à rendre la transmission des biens de plus en plus libre. Le socialisme ne se contente pas de limiter cette liberté acquise par le travail de la civilisation; il la supprime. Il abolit l'héritage, et fait rentrer ainsi toutes les propriétés dans le domaine de la communauté. Quelles seraient [425] les conséquences de l'application de cette doctrine? Quelle situation ferait-elle aux différents membres de la société? Au point de vue de la transmission de la propriété, ceux-ci peuvent être partagés en trois catégories : 1° ceux qui meurent en laissant un passif supérieur à leur actif, autrement dit, qui ne lèguent que des dettes à leurs héritiers; 2° ceux dont l'actif et le passif s'équilibrent; 3° ceux qui lèguent, le passif déduit, un actif plus ou moins considérable à leur postérité. En supposant que la société s'attribuât tous les héritages pour constituer un fonds commun, dans lequel, en cas de liquidation, chacun de ses membres aurait une quote-part égale, l'opération se résoudrait dans la confiscation partielle des biens de la troisième catégorie, au profit des deux autres, considérées apparemment comme plus capables de les faire valoir et de les conserver. Seulement, la mobilisation de la propriété rendra cette opération économique de plus en plus difficile, en sorte que les communistes feront bien de se hâter. En admettant, en effet, que la propriété foncière, industrielle, commerciale, etc., vint à être représentée par des titres impersonnels, transmissibles au porteur, qu'arriverait-il si un gouvernement, tombé aux mains des communistes, s'avisait d'abolir l'héritage? Tout homme ayant une fortune, petite ou grande, s'empresserait d'expédier au delà de la frontière son stock de valeurs mobilières et, pour plus de sûreté, de les échanger contre des valeurs étrangères. A la mort de cet ennemi du communisme, comment pourrait s'y prendre la communauté pour se mettre en possession de son héritage? Tous les biens qu'elle aurait sous la main, terres, fabriques, mines, approvisionnements, etc., appartiendraient à des étrangers, et si l'État communiste s'avisait de les confisquer, ne s'exposerait-il pas à être dépossédé, à son tour, pour avoir violé un principe élémentaire du droit des gens?
[436]
Mais on n'en viendra point à de telles extrémités. Beaucoup mieux qu'aucun système préventif ou répressif, la concurrence du progrès économique tuera l'utopie socialiste. A mesure que s'élèvera et qu'apparaîtra à tous les regards, dans sa simple et majestueuse beauté, l'immense et confortable édifice que la grande industrie et le self government sont en train de bâtir, les conceptions rétrogrades et étroites du communisme, du collectivisme et du nihilisme perdront de leur crédit, car l'avenir qu'elles promettent à la « classe la plus nombreuse et la plus pauvre », pour nous servir d'une expression favorite des Saints-Simoniens, ne saurait soutenir la comparaison avec celui que lui donnera l'évolution économique.
Si cette évolution s'était arrêtée au point qu'elle avait atteint il y a un demi-siècle, si les bénéfices de l'industrie perfectionnée et agrandie avaient dû demeurer à jamais le monopole des classes supérieures, alors presque exclusivement en possession des connaissances techniques requises pour diriger les entreprises et des capitaux nécessaires pour les alimenter, si les classes ouvrières avaient dû se contenter toujours d'un salaire que l'entrepreneur d'industrie, maître du marché et protégé spécialement par la loi, pouvait fixer à sa guise, si la richesse accrue s'était en conséquence concentrée entre les mains d'une féodalité industrielle et financière, certes, le socialisme aurait eu beau jeu, et les conservateurs du temps, qui s'efforçaient de retenir entre leurs mains les profits du progrès, en remplaçant par des barrières artificielles les barrières naturelles qu'il faisait tomber, les conservateursbornes, comme les nommait M. de Lamartine, auraient vainement fait appel à la force pour empêcher la révolution sociale. La propriété monopolisée eût été, tôt ou tard, la proie des « partageux », et la société, livrée aux briseurs de machines et aux communistes, serait retournée, [437] au moins pour quelque temps, à la barbarie. Mais cette période douloureuse de l'enfantement de la grande industrie et de la concurrence tire à sa fin. D'une part, la transformation des entreprises et la multiplication des valeurs mobilières, qui en est la conséquence, rendent les bénéfices de la grande industrie accessibles aux petites épargnes; d'une autre part, l'unification des marchés de la production commence à abaisser le prix des produits, tandis que les progrès de la machinery industrielle élèvent le prix naturel du travail, et que l'élargissement du marché permet à la concurrence d'agir, quoique encore impartement, et de faire osciller le prix courant autour du prix naturel : le revenu de l'ouvrier s'augmente, et il prend l'habitude d'en épargner une partie pour s'assurer contre les risques de l'avenir au lieu de recourir à l'aumône insuffisante et durement achetée de la charité publique.
Supposons maintenant que l'évolution ait fait un pas de plus; que la propriété mobilière se soit universalisée par suite de la transformation économique des entreprises; que le prix des articles de consommation ait continué de s'abaisser et le prix du travail de s'élever, quelle sera la situation de la propriété? Elle apparaîtra divisée à l'infini. Le matériel de la production, dans toutes ses parties, appartiendra à tous. La multitude innombrable des entreprises agricoles, industrielles, commerciales, etc., sera possédée par des groupes d'actionnaires et d'obligataires dans lesquels se trouveront associés des hommes de tous rangs, de toutes nationalités, de toutes couleurs. Cette diffusion universelle de la propriété ne constituera-t-elle pas la plus efficace des assurances contre les risques de dépossession de tous genres et, en particulier, contre ceux d'une révolution sociale? Quand les immeubles parisiens, par exemple, appartiendront à des groupes d'actionnaires et d'obligataires recrutés au faubourg [438] Saint-Antoine et à Belleville, aussi bien que dans le quartier de la Bourse et au faubourg Saint-Germain, l'idée de « brûler Paris » aura-t-elle encore quelque chance de devenir populaire, et, même dans les clubs les plus radicaux, n'accueillera-t-on pas avec froideur la proposition d'exonérer les locataires de l'obligation gênante de payer leur terme? La grande industrie et la concurrence nous conduisent ainsi à un état de choses où la propriété étant descendue jusque dans les couches les plus basses de la société, tout le monde se sentira directement intéressé à la défendre et personne ne s'avisera plus de l'attaquer.
[439]
CHAPITRE XII. Conclusion.↩
Malgré des interruptions partielles et des retours temporaires, l'histoire de l'humanité nous présente le phénomène d'un progrès en voie d'accumulation constante. Sans remonter au delà des données positives qui nous sont fournies par les monuments de l'âge de pierre, sans rechercher comment l'homme a été créé ou s'est successivement créé, par le développement et l'adaptation de ses éléments de vitalité physique et morale, nous le voyons apparaître, au début de l'histoire, dans une condition peu différente de celle des autres espèces animales. Moins bien armé qu'un grand nombre d'entre elles, il n'a acquis, selon toute apparence, qu'au bout de longs siècles, une supériorité décisive sur le reste de l'animalité. Cet ascendant, il l'a obtenu, grâce à la possession d'un clavier intellectuel et moral plus complet que celui des autres espèces. Il est doué, à un plus haut degré qu'aucune de celles-ci, des facultés d'observation et de l'esprit de combinaison : c'est un animal inventeur. C'est aussi un animal religieux. Sans doute, il existe des animaux qui se soumettent par crainte ou par amour à des espèces supérieures et notamment à l'homme; mais l'objet de leur crainte ou de leur amour est visible à leurs regards. Ils sont incapables d'imaginer des êtres auxquels ils seraient obligés d'obéir. Cette faculté qui leur manque, l'homme la possède, et elle a été le principal [440] coopérateur de l'esprit d'observation et de combinaison dans le travail primitif de la civilisation.[39]
C'est une question aujourd'hui fort débattue que celle de savoir si les espèces animales inférieures ont possédé, dès l'origine, les procédés dont nous les voyons se servir pour trouver leur subsistance, se préserver des intempéries et se défendre contre les autres espèces, ou bien si elles les ont créés; autrement dit, si elles ont progressé ou non jusqu'au point que comportaient leur structure physique et leur appareil intellectuel. Cette question est résolue pour l'espèce humaine. On sait que l'homme a créé et perfectionné successivement le matériel et les [441] procédés dont il se sert pour produire, aussi bien que ses institutions civiles, politiques et religieuses. Nous avons distingué, dans cette création du matériel, des procédés et des institutions, qui ont été les facteurs du grand phénomène de la civilisation, trois périodes : 1° l'âge primitif, qui va de la naissance de l'humanité à la découverte des plantes alimentaires et à leur mise en culture régulière; 2° l'âge de la petite industrie, qui va de l'invention de la charrue à celle de la machine à vapeur, et 3° l'âge de la grande industrie, dans lequel nous entrons. Comme toutes les classifications, celle-ci a certainement quelque chose d'arbitraire. Il est clair qu'on ne saurait préciser le moment où une de ces périodes a fini, où une autre a commencé; de plus, elles ont continué de coexister, et on pourrait même indiquer leurs limites topographiques, en dressant une carte économique du globe. On trouve encore aujourd'hui, dans les différentes parties du monde, des populations dont l'outillage et les institutions sont demeurés ceux de l'âge primitif. Le domaine qu'elles occupent vase rétrécissant tous les jours, mais il comprend encore au moins le quart de la terre habitable. L'âge de la petite industrie subsiste dans tout le reste, ici d'une manière exclusive, là en partage avec l'ère naissante de la grande industrie, laquelle empiète incessamment sur les domaines des deux âges précédents, sans avoir acquis toutefois nulle part la prépondérance.
Au point de vue de la science, cette coexistence des trois âges de la civilisation présente un avantage précieux, en ce qu'elle permet d'étudier sur le vif les phénomènes qui les caractérisent et d'observer, à la fois, le passé, le présent et les rudiments de l'avenir. Résumons les caractères de l'âge primitif. Les hommes nous apparaissent alors réunis en troupeaux comme les autres espèces animales, à l'exception de celles où [442] l'individu peut se passer de l'aide de son semblable. La nature de leurs moyens de subsistance ne permet point à ces premières agglomérations humaines de dépasser un nombre fort limité, quelques centaines ou quelques milliers d'individus : l'homme primitif est obligé d'occuper et d'explorer de vastes espaces pour subsister, au moyen de la chasse, de la pêche ou de la recherche des fruits naturels du sol. Il gîte sur des arbres, comme le Papou, dans des cavernes, comme le Troglodyte, dans des huttes de branchages ou de terre glaise, et ses vêtements, quand la rigueur du climat lui en fait sentir le besoin, se composent de la dépouille brute des végétaux et des animaux. On s'explique aisément cette réunion originaire de la généralité de l'espèce en troupeaux, par la nécessité de se défendre contre des animaux et des hommes, individuellement supérieurs en force. On s'explique aussi que cette nécessité ait eu pour résultat de développer les instincts et les qualités de combat, la force, l'agilité, le courage, la ruse, et que l'ensemble de ces qualités constituât la plus haute expression de la valeur. N'en déplaise aux philanthropes, il fallait que l'homme eût, à l'origine, les instincts d'une bête féroce pour réussir à triompher des bêtes féroces. Sous peine de périr misérablement, il devait être, avant tout, un animal de combat. Le lutte permanente avec les animaux et les hommes de proie, voilà le caractère dominant de cette première période, et les nécessités de cette lutte déterminent le mode de constitution des troupeaux ou des tribus : le choix du chef le plus capable de diriger les opérations de chasse et de guerre, la formation d'une hiérarchie, l'établissement d'une discipline, la limitation du nombre des femmes, et, en général, la suppression des bouches inutiles, tout cela s'impose comme dans une ville assiégée ou une armée en campagne. Dans chacune de ces petites sociétés, entourées d'ennemis et [443] perpétuellement sur le qui-vive, une opinion ne manque pas de se former sur tout ce qui, dans les manières d'être et d'agir de chacun, semble conforme ou contraire aux intérêts de la communauté, intérêts qui se résument dans sa sécurité et sa subsistance. Cette opinion impose en toutes choses, et pour tous les actes de la vie, une coutume qui doit être obéie comme les prescriptions d'un code militaire. Les coutumes diffèrent de tribu à tribu quoiqu'on puisse observer dans toutes un fonds commun de dispositions essentielles, car elles répondent partout à des nécessités pareilles. Elles sont aussi bien adaptées que le comporte l'état des intelligences et des mœurs aux besoins des sociétés embryonnaires qu'elles régissent. Ces troupeaux humains, épars sur le globe encore livré à l'animalité, se créent un armement, un outillage, de même qu'une langue et des institutions qui leur sont propres, tout en présentant des analogies tirées de l'identité générale des situations et des besoins. Mais les forces physiques et morales, comme les autres biens naturels, sont inégalement distribuées entre les troupeaux et entre les individualités dont ils se composent. Il y a chez l'homme, aussi bien que chez les autres animaux, des variétés supérieures et des individus d'élite. C'est à cette aristocratie, capable d'observer, de découvrir et d'inventer, que sont dus les progrès qui ont permis à l'espèce humaine de s'élever peu à peu au-dessus des autres espèces animales; c'est grâce à elle que la frontière de l'âge primitif a pu être franchie.
Avec la petite industrie, un monde nouveau commence. La mise en culture régulière du sol permet à des millions d'hommes de naître et de subsister sur une étendue de terre qui était naguère à peine suffisante pour procurer à un millier de chasseurs une subsistance précaire. Aussitôt, par l'action de cette loi naturelle, en vertu de laquelle [444] les hommes, comme toutes les autres espèces animales, se multiplient en raison de leurs moyens d'existence, aussitôt, disons-nous, à la place des tribus primitives, on voit apparaître des sociétés nombreuses, et s'établir des États puissants. Non seulement l'agriculture fournit les moyens de faire subsister cent fois plus d'hommes sur une étendue déterminée de territoire, mais encore le nouveau matériel permet de tirer du sol beaucoup plus de subsistances qu'il n'en faut pour nourrir ceux qui le cultivent. D'où il résulte qu'à côté et au-dessus de ce personnel appliqué à la production des articles de première nécessité, peut prendre place un personnel presque aussi nombreux, voué à d'autres travaux. Alors apparaît la division du travail: la production se spécialise. Tandis qu'une partie de la population s'occupe de produire et de façonner les matériaux de l'alimentation, une autre partie fabrique des armes, des outils et l'immense variété des articles nécessaires au vêtement, à l'habitation, au luxe du corps et de l'esprit, une troisième partie pourvoit aux services domestiques, une quatrième, la plus importante quoique la moins nombreuse, s'emploie à gouverner la société et à la défendre. Cette division du travail, qui demeure toutefois plus ou moins incomplète — l'exercice de divers métiers industriels et autres demeurant fréquemment joint aux travaux agricoles — favorise à un haut degré les progrès ultérieurs de la société. Les échanges en sont la conséquence, et la monnaie est inventée pour les faciliter. Les industries se multiplient et se perfectionnent, les sciences physiques et morales se constituent, un état économique, politique et social nouveau a surgi, et va se développant.
Cependant, le matériel de la production demeure encore imparfait et grossier, la petite industrie est peu productive en comparaison de ce que sera plus tard la grande. [445] A défaut de la force mécanique, elle emploie principalement la force physique de l'homme. Qu'il s'agisse de cultiver la terre, de construire des habitations, de filer et de tisser les étoffes, d'extraire et de façonner les métaux, de transporter les produits et les hommes eux-mêmes, c'est la force physique qui apparaît comme l'agent ou le véhicule universel. Enfin, ces produits insuffisants, créés à grand renfort de main-d'œuvre ne peuvent, sauf de rares exceptions, être transportés qu'à de courtes distances : leur marché est naturellement limité.
Ainsi, l'insuffisance de la productivité, la prépondérance du travail physique et la limitation naturelle des marchés, tels sont les phénomènes qui caractérisent la petite industrie et, l'on peut ajouter, qui déterminent la constitution économique, politique et sociale de ce régime.
L'imperfection du matériel agricole et industriel ne permettait point de multiplier la richesse de manière à satisfaire, même dans une faible mesure, tous les besoins des différents membres de la société. Chez les nations les plus florissantes, la grande majorité de la population était obligée de se contenter du strict nécessaire; la minorité seule vivait dans l'aisance et la richesse était l'exception. Même de nos jours, malgré tant de progrès réalisés, la masse de richesse, annuellement produite, en admettant qu'elle fut répartie également entre tous les membres de la société, ne donnerait à chacun qu'un revenu dépassant de bien peu la somme indispensable à la satisfaction des premières nécessités de la vie. Le caractère dominant des sociétés vivant de la petite industrie, c'est la pauvreté ou l'insuffisance de la richesse; armé d'un outillage encore grossier et incomplet, le travail est peu productif, par conséquent peu rémunérateur. Or, tout travail implique une peine. Pour qu'on consente volontairement à subir cette peine, il faut qu'elle soit rachetée par la [446] perspective d'une jouissance qui la dépasse ou la compense. Cette compensation, pouvait-on l'offrir à la multitude à laquelle on demandait le travail physique nécessaire à l'accomplissement des travaux inférieurs de la production? Non! Même sous un régime aussi égalitaire que possible, l'insuffisance des résultats de la production n'aurait guère permis de lui donner au delà d'un minimum de subsistance, en échange d'un labeur long, pénible et monotone. Mais comment aurait-on pu persuader à des sauvages accoutumés à une vie errante et relativement libre, de s'astreindre volontairement aux travaux prolongés et rebutants du défrichement du sol, de la mouture du blé dans les moulins à bras, du transport des fardeaux, du maniement de la rame, en échange d'une pitance étroitement rationnée? Comment aurait-on pu obtenir de ces hommes-animaux un travail effectif et régulier sans employer la contrainte? L'esclavage apparaît donc comme le seul régime applicable à la multitude, qui remplissait, à l'origine de la petite industrie, les fonctions qui ont été ensuite dévolues, en partie, aux bêtes de somme et aux machines.
Il y a plus. Pour que cette multitude consentit de son plein gré, non seulement à s'astreindre d'une manière continue à des travaux ingrats, mais encore à remplir toutes les obligations qu'implique le self government, il lui aurait fallu un développement intellectuel et moral qu'elle n'avait pu acquérir dans sa condition précédente, et qu'elle ne pouvait acquérir davantage dans sa condition actuelle. De même que l'exercice continu d'une profession intellectuelle a pour effet de développer l'intelligence, au détriment de la force physique, à moins que celle-ci ne soit entretenue au moyen d'une gymnastique et d'une hygiène spéciales, l'application continue à une occupation purement physique monopolise l'activité vitale au profit [447] exclusif de la force musculaire. Dans toutes les sociétés vivant de la petite industrie, la multitude, vouée aux travaux inférieurs de la production, est d'autant plus réfractaire à une culture intellectuelle et morale que sa besogne exige moins le concours de l'intelligence, et implique un moindre degré de responsabilité. On s'explique ainsi l'incapacité que les classes, aujourd'hui émancipées, mais encore attachées à l'ancien matériel, montrent dans l'exercice du self government. En vain essaierait-on d'élever, par des moyens artificiels, leur niveau intellectuel et moral. L'instruction et la moralisation n'ont qu'une bien faible prise sur des êtres dont toute l'activité se résout dans la dépense et la réparation de leur force musculaire. C'est là un point dont les réformateurs modernes, socialistes ou philanthropes, ne tiennent aucun compte, mais qui n'avait pas échappé au pénétrant esprit d'observation des anciens. Aristote disait : Si la navette marchait seule, on pourrait se passer d'esclaves, — sans prévoir, à la vérité, qu'un jour viendrait où la navette marcherait seule. Mais aussi longtemps que la navette n'a pas marché seule, aussi longtemps que la multitude a dû faire la besogne de la bête de somme et de la machine, elle n'a pu acquérir la capacité qu'exige le self government, et il a fallu la maintenir sous un régime de tutelle adapté à l'état d'infériorité auquel la condamnait la nature même de ses occupations. A cela, il n'y avait qu'un remède : il fallait élever la nature du travail en remplaçant l'homme par la machine, pour ne lui laisser que les fonctions de directeur ou de surveillant de la production, et telle est l'œuvre de la grande industrie.
Cette insuffisance de la productivité de l'industrie et cette matérialité de la plus grande partie des fonctions de la production, qui rendaient nécessaire l'asservissement des classes inférieures, obligeaient aussi les classes [448] dirigeantes à se soumettre à une discipline presque aussi rude que celle de l'esclavage.
La richesse ne pouvait être créée avec quelque abondance que dans les régions dont le sol était exceptionnellement fertile et le climat chaud, telles que les deux péninsules de l'Inde, la Mésopotamie et l'Egypte, où l'agriculture donnait un rendement considérable, et où l'on pouvait entretenir, à peu de frais, la masse de maind'œuvre qu'exigeaient les travaux de la production. Plus tard, quand les moteurs de chair et d'os, nourris de blé ou de riz, eurent été remplacés économiquement par des moteurs de fer et d'acier, alimentés avec du charbon de terre, l'industrie a quitté ses foyers primitifs pour se concentrer dans les régions où abondent le fer et le charbon. En dehors des contrées privilégiées, où le blé rendait, au témoignage d'Hérodote, 200 grains pour un, et où un peu de nourriture végétale, un abri et un vêtement légers suffisaient à l'esclave, la richesse ne pouvait être obtenue qu'en petite quantité et à grande peine. Qu'en résultait-il? C'est que, pour les peuples qui n'avaient en partage ni un sol fertile, ni un climat doux, l'industrie la plus productive était la guerre. Malgré toute l'intelligence et l'énergie qu'ils pouvaient déployer, ils demeuraient pauvres, tandis que la conquête d'une contrée favorisée du ciel leur procurait d'emblée, avec la richesse déjà accumulée, la possibilité d'en acquérir davantage. De là, un risque permanent de guerre et de dépossession, et la nécessité pour les classes gouvernantes des sociétés industrieuses et riches de se soumettre à une discipline qui n'était autre chose qu'une forme de la servitude. L'État se trouvant incessamment menacé, la liberté de chacun devait être sacrifiée au salut commun : toutes les manières d'agir qui pouvaient l'affaiblir et compromettre sa sûreté devaient être rigoureusement interdites; toutes celles qui [449] étaient de nature à augmenter sa puissance, encouragées et ordonnées. A mesure que l'industrie est devenue plus productive, qu'elle s'est spécialisée dans les régions les mieux appropriées à chacune de ses branches, que son matériel et ses procédés se sont perfectionnés, en diminuant ainsi la valeur des différences de sol et de climat; à mesure enfin que le développement progressif du matériel de guerre a exigé l'avance et l'immobilisation d'un capital plus considérable, la guerre a cessé, même pour les peuples placés dans de mauvaises conditions naturelles, d'être le plus profitable des moyens d'acquérir de la richesse; les risques d'invasion et de dépossession ont diminué alors, la sécurité générale des peuples civilisés s'est augmentée, mais ces divers progrès ont été lents à s'accomplir, et, en attendant, les nécessités de la sécurité extérieure obligeaient les classes possédantes et gouvernantes à sacrifier la liberté de chacun à l'intérêt de tous.
Les exigences de la sécurité intérieure n'étaient guère moindres. Il fallait d'abord contenir les masses esclaves, dont le nombre dépassait celui de leurs maîtres. Il fallait ensuite empêcher la majorité de la classe non asservie, demeurée pauvre ou peu aisée, de se ruer sur la propriété du petit nombre des riches, comme la tentation ne pouvait manquer de lui en venir quand la richesse était si difficile à acquérir. Il fallait enfin empêcher, dans toutes les classes de la société, le mauvais emploi et le gaspillage de cette richesse dont la conservation et le bon aménagement importaient au salut commun. Ce n'était pas trop du concours de la religion, de la coutume, de l'opinion, de la répression et de la tutelle collective pour maintenir la discipline étroite et rude à laquelle les classes dominantes étaient obligées de s'assujettir afin de se préserver des risques extérieurs ou intérieurs qui menaçaient leur domination et leur existence.
[450]
Enfin, la limitation naturelle des marchés s'ajoutait aux deux causes précédentes pour déterminer le mode de constitution et d'organisation des sociétés vivant de la petite industrie. Si, comme nous l'avons démontré (chapitre IV), la concurrence agit comme un régulateur de la production et de la distribution de la richesse, cette action régulatrice, elle ne peut l'exercer avec une pleine efficacité que dans un milieu libre, c'est-à-dire dans un marché d'une étendue illimitée. Or, l'imperfection de l'outillage, la difficulté des transports, l'insuffisance de la sécurité concouraient partout, sous le régime de la petite industrie, à limiter l'étendue des marchés. Il n'y avait que des marchés locaux, presque toujours fort étroits : il n'y avait pas de marché général. Dans cet état de choses, en l'absence du régulateur naturel de la concurrence, il avait bien fallu recourir à des moyens artificiels pour obtenir un équilibre approximatif de la production et de la consommation, ainsi qu'un règlement utile des prix des produits et des rétributions des agents productifs. Comment y était-on arrivé? Par la constitution des corporations, l'appropriation des marchés et l'établissement des coutumes régulatrices des prix. Dans chaque industrie, les entrepreneurs formaient une corporation limitée et fermée, à laquelle le marché était approprié, à l'exclusion des industries similaires ou même approchantes du dedans et du dehors. L'équilibre pouvait ainsi s'établir entre la production et la consommation. En même temps, l'opinion intervenait par l'établissement de la coutume, pour fixer les prix au taux nécessaire, en y réduisant du même coup les profits. Elle limitait encore l'intérêt et réglait le taux des redevances et des salaires. La coutume était un régulateur grossier, mais indispensable, et l'on est bien obligé d'y recourir actuellement encore, en imposant d'autorité un maœirn um aux industries dont le marché [451] n'est pas assez étendu pour que la concurrence y puisse remplir son office. Mais ce qui n'est plus aujourd'hui que l'exception était la règle dans cette phase du développement de l'industrie, où tous les marchés étaient naturellement limités.
En résumé, les sociétés vivant de la petite industrie ne pouvaient subsister qu'aux conditions suivantes : 1° Que la multitude vouée aux travaux de force de l'agriculture, de l'industrie et des transports par terre ou par eau, fût assujettie à un régime qui la contraignît à exécuter ces travaux, à la fois pénibles et peu productifs, et qui, en même temps, aménageât utilement sa consommation en lui imposant d'autorité les dures privations qu'elle n'avait ni la capacité, ni la force morale nécessaires pour s'imposer elle-même. Or, il ne faut pas oublier que la nature de ses occupations l'empêchait d'acquérir cette capacité et cette force morale qui pouvaient seules la déterminer à travailler librement et à consommer utilement les produits de son travail. 2° Il n'était pas moins nécessaire que la classe possédante et dirigeante fût soumise à une discipline assez forte et assez rigide pour lui permettre de maintenir sous le joug la multitude asservie, et de résister aux agressions du dehors en empêchant ses propres membres de commettre des nuisances et des manquements à leurs devoirs, qui auraient affaibli et désorganisé l'État auquel l'existence de tous était attachée. Il fallait les empêcher de gaspiller les ressources et les capitaux dont le peu de productivité de l'industrie et l'insuffisance de la prévoyance individuelle rendaient l'acquisition si difficile et l'accumulation si laborieuse. Il fallait les préserver surtout de l'affaiblissement physique et moral qu'entraînait une consommation déréglée, et tels étaient les objets que se proposaient les institutions politiques, civiles et religieuses, les coutumes et l'opinion. Elles ne [452] les atteignaient jamais cependant que d'une manière incomplète, tant par suite de l'imperfection inévitable de cette machinery gouvernante que de la résistance des appétits brutaux, des passions vicieuses et destructives qu'il s'agissait de discipliner. Enfin, 3°, il fallait remédier au défaut d'étendue des marchés au moyen d'un ensemble d'institutions et de coutumes qui empêchassent les producteurs de faire la loi aux consommateurs, les prêteurs d'exploiter les entrepreneurs et les entrepreneurs d'exploiter les ouvriers.
Ce régime de tutelle universelle était nécessaire, et il n'a pu être utilement modifié qu'autant que l'industrie est devenue plus productive, que la nature du travail s'est élevée et que les marchés se sont agrandis. C'est seulement à la suite de ces progrès essentiels que l'esclavage a pu se transformer en servage; que le servage, à son tour, a disparu, et, d'une manière générale, que la discipline sociale est devenue moins étroite et moins rude; enfin, que le régime des corporations fermées et des marchés appropriés, avec la réglementation compliquée qui y était adaptée, a commencé à faire place à la concurrence.
Au moment où nous sommes, quoique nous nous trouvions encore certainement fort éloignés de l'époque où la grande industrie aura terminé son évolution et où la société aura, de son côté, achevé de construire l'organisme adapté à ses nouvelles conditions d'existence, nous possédons cependant déjà quelques données positives sur la constitution économique, politique et sociale de l'avenir. Ce que nous apercevons, dès à présent, de l'édifice grandiose qui est en voie de s'élever pour abriter les générations futures nous permet de conjecturer ce qu'il sera plus tard. Nous avons essayé d'en esquisser quelques-unes des lignes principales, sans quitter le terrain solide de la réalité, en montrant simplement le développement [453] logique et harmonieux des constructions encore à l'état d'ébauche.
Comment nous apparaît la production sous le régime de la grande industrie et de la concurrence universalisées? Elle nous apparaît d'abord géographiquement, spécialisée dans les différentes régions du globe, conformément aux conditions du sol, du climat et du travail, en raison de l'abondance des matériaux nécessaires à chacune de ses branches et des facilités à les mettre en œuvre.
« La terre, disions-nous (article Liberté du commerce du Dictionnaire de l'Économie politique), la terre, avec ses innombrables variétés de minéraux, de végétaux et d'animaux, ses océans, ses montagnes, son humus fertile, l'atmosphère qui l'environne, les effluves de chaleur et de lumière qui alimentent la vie à sa surface, voilà le fonds abondant que la Providence a mis au service de l'humanité. Mais, ni les éléments divers qui composent ce fonds naturel de subsistance, ni les facultés dont l'homme dispose pour les utiliser, n'ont été distribués d'une manière égale et uniforme. Chacune des régions du globe a sa constitution géologique particulière : ici, s'étendent d'immenses couches de charbon, de fer, de plomb, de cuivre; là, gisent l'or, l'argent, le platine et les pierres précieuses. Même diversité dans la distribution des espèces végétales et animales : le soleil, qui échauffe et éclaire inégalement la terre, qui prodigue dans certaines zones la chaleur et la lumière, tandis qu'il abandonne les autres à la frigidité et à l'ombre, marque à chaque espèce les limites qu'elle ne peut franchir. Même diversité dans la répartition des facultés humaines. Un court examen suffit pour démontrer que tous les peuples n'ont pas été pourvus des mêmes aptitudes, que les Français, les Anglais, les Italiens, les Allemands, les Russes, les Chinois, les Indous, les Nègres, etc., ont leur génie particulier, provenant soit de [454] la race, soit des circonstances naturelles du sol ou du climat; que les forces physiques, intellectuelles et morales de l'homme varient selon les races, les peuples et les familles; qu'il n'y a pas dans le monde deux individus dont les capacités soient égales et les aptitudes semblables. Diversité et inégalité des éléments de la production dans les différentes régions du globe; diversité et inégalité non moins prononcées des aptitudes parmi les hommes : tel est donc le spectacle que nous présente la création... Mais si, comme l'observation l'atteste, les différents peuples de la terre sont pourvus d'aptitudes particulières, si chaque région du globe a ses productions spéciales, à mesure que s'étendra la sphère des échanges, on verra chaque peuple s'adonner de préférence aux industries qui conviennent le mieux à ses aptitudes, ainsi qu'à la nature de son sol et de son climat; on verra la division du travail s'étendre de plus en plus parmi les nations. Chaque industrie se placera dans ses meilleures conditions de production, et le résultat final sera que toutes les choses nécessaires à la satisfaction des besoins de l'homme pourront être obtenues avec un maximum d'abondance et en échange d'un minimum de peine. »
Cette distribution naturelle des éléments multiples et divers de la production ne semble-t-elle pas attester aussi que notre globe a été façonné pour devenir un seul et immense atelier dans lequel se casera l'humanité, sans distinction de races, de nationalités, de croyances, tous travaillant pour chacun et chacun travaillant pour tous? Mais que fallait-il pour en arriver là? Il fallait, en premier lieu, que le travail se divisât, et que l'industrie, en se spécialisant, devînt assez productive pour subvenir aux besoins d'un nombre de plus en plus considérable de consommateurs. Il fallait, en second lieu, que les obstacles naturels ou artificiels qui rétrécissaient les marchés [455] de consommation, en empêchant les communications d'une région, et même d'une localité à une autre, fussent aplanis. Cette œuvre d'agrandissement et d'unification des marchés est en voie d'accomplissement, et il n'est pas chimérique de croire qu'elle se poursuivra jusqu'à son entier achèvement. Ce qui serait chimérique, ce serait de croire qu'elle puisse être arrêtée.
Comment se présente la production, ainsi économiquement localisée? Chacune de ces branches apparaît distribuée en une série d'entreprises plus ou moins nombreuses. Établies généralement sur un plan colossal, en raison de la puissance et de la perfection de leur outillage, et de l'extension illimitée de leur débouché, ces entreprises versent, sur le marché universel, leurs produits fabriqués dans les conditions naturelles les plus favorables, avec les machines et les procédés les plus économiques; ce qui signifie que les consommateurs peuvent obtenir les produits dont ils ont besoin au meilleur marché possible, ou, ce qui revient au même, « avec un maximum d'abondance et en échange d'un minimum de peine ».
Entrons cependant plus avant dans l'organisation de la production transformée par le progrès. Voyons comment elle est constituée et alimentée de capital et de travail, comment enfin elle met, en tout temps, en tous lieux, et dans les quantités utiles, ses produits à la portée des consommateurs. Elle est constituée sous la forme d'entreprises collectives, et cette constitution est déterminée à la fois par la grandeur des dimensions des entreprises et par l'économie résultant de la division du capital en coupures mobilisables; elle est alimentée par des établissements de crédit de toute sorte qui récoltent le capital chez ceux qui le produisent, et, à mesure qu'ils le produisent, pour le transmettre à ceux qui l'emploient. D'autres intermédiaires leur fournissent régulièrement toutes les quantités [456] et toutes les sortes de travail dont elles ont besoin; enfin, une troisième catégorie d'intermédiaires s'empare de leurs produits au sortir de la fabrication, et se charge de les mettre à la portée des consommateurs. Tel est le mécanisme de l'organisation de la production. Mais quelle est l'àme de ce mécanisme? Quel en est le moteur et le régulateur? C'est la concurrence.
La concurrence agit à la fois pour provoquer la création des produits et des agents productifs, pour la régler et la faire progresser. Comment procède-t-elle?
Sur le triple marché unifié et universalisé — du capital, du travail, des produits — il y a une demande et une offre permanentes de chacun de ces agents ou de ces fruits de la production. Si la demande dépasse l'offre, le prix hausse; si l'offre dépasse la demande, le prix baisse, non pas seulement en progression arithmétique, mais en progression géométrique, en vertu de la loi d'équilibre qui régit les valeurs. Le marché étant désormais pleinement libre, le monopole ayant partout fait place à la concurrence, cette loi agit avec une efficacité entière. Elle agit, en premier lieu, pour déterminer la création des entreprises, l'apport du capital et du travail, la fabrication et la mise au marché des produits, dans la proportion utile. Que, dans une branche quelconque de la production, la demande vienne à dépasser l'offre, les prix s'élèvent et les profits avec eux, l'esprit d'entreprise s'y porte, entraînant à sa suite le capital et le travail, la production se développe, l'offre s'accroît, les prix baissent, les profits diminuent jusqu'à ce que l'offre et la demande se mettent en équilibre au niveau des frais nécessaires pour rétribuer les agents productifs investis dans cette branche de travail comme ils sont rétribués dans les autres. Si le prix du marché, après avoir atteint ce niveau, ne s'y arrête point et descend plus bas, un mouvement inverse se [457] produit, et le prix est toujours, par le fait de cette gravitation économique, agissant dans un milieu libre, irrésistiblement ramené à son taux nécessaire. L'ordre s'établit de lui-même dans l'immense atelier de la production.
En second lieu, la concurrence agit pour rendre le progrès indispensable dans toutes les parties de cet atelier. Il n'y a plus qu'un prix courant sur le marché que la locomotion à vapeur, la télégraphie électrique et la liberté du commerce ont universalisé; mais il peut y avoir une multitude de prix de revient. Les entreprises les mieux localisées, organisées, outillées et desservies ont un prix de revient minimum, et elles jouissent d'une rente, tandis que les autres ont des prix de revient échelonnés jusqu'à un maximum qui couvre simplement les frais de la production. Le désir d'obtenir une rente ou d'augmenter celle que l'on a, la crainte de subir une nonrente, autrement dit, de travailler à perte, agissent incessamment sur les producteurs concurrents pour les déterminer à se placer dans les conditions les plus économiques et à employer les machines, les procédés et les méthodes les plus propres à abaisser leurs prix de revient. Chacun profite d'abord du progrès qu'il a réalisé, mais ce progrès se traduit nécessairement par une augmentation de la production et de l'offre, le prix du marché s'abaisse, et c'est, en définitive, le consommateur ou l'universalité des membres de la société qui profite de tous les progrès réalisés sous l'impulsion de la concurrence.
La concurrence ne joue pas un rôle moins considérable dans la distribution de la richesse. Nous venons de voir comment elle agit pour régler la production de toutes choses dans la proportion utile, et les mettre à la disposition des consommateurs à un prix qu'elle travaille incessamment à réduire au dernier minimum possible, mais il faut que ce prix soit payé. Comment les consommateurs [458] peuvent-ils le payer? Autrement dit, comment peuventils se procurer toutes les choses dont ils ont besoin, en remboursant aux producteurs les frais qu'elles ont coûté, et que représente, en dernière analyse, le prix du marché? Ils ne le peuvent qu'à la condition de contribuer, à leur tour, directement ou indirectement, à la production, à titre de travailleurs ou de capitalistes, et de se créer ainsi un revenu. Tous les revenus proviennent de la mise en œuvre des agents et des instruments qui constituent le matériel de la production, des forces, des aptitudes et des connaissances qui se trouvent investies dans le personnel, ou, en deux mots, que l'on pourrait même réduire à un seul, du capital et du travail. Or, c'est encore la concurrence qui règle la rétribution du capital et du travail, ou la proportion qui leur revient dans les résultats de la production, comme elle règle la proportion des différentes sortes de produits et leur prix. Sur le marché universalisé, le taux courant de l'intérêt, des loyers, des profits, des dividendes, c'est-à-dire des formes diverses de la rétribution du capital, s'unifie, et il gravite vers le taux nécessaire, lequel va s'abaissant d'une manière indéfinie, sous l'influence des progrès qui diminuent la privation et les risques de l'emploi du capital. Sur le même marché, le taux courant des salaires et des autres formes de la rétribution du travail s'unifie aussi au niveau du taux nécessaire, mais avec cette différence que le progrès élève celui-ci en substituant à la mise en œuvre des forces physiques celle des forces intellectuelles et morales. La part du capital diminue, la part du travail augmente, et le résultat final, c'est une tendance à l'égalisation des conditions.
Telle nous apparaît, dans ses traits caractéristiques, la constitution économique que la grande industrie et la concurrence préparent à la société de l'avenir. Grâce à la [459] puissante machinery de la grande industrie, la richesse pourra être produite avec assez d'abondance pour suffire à tous les besoins de la consommation, pendant que l'ordre dans la production, la justice dans la distribution de la richesse s'établiront d'eux-mêmes par l'action de la loi d'équilibre des valeurs, sous le régime de la concurrence universalisée.
Deux autres phénomènes, procédant de ceux-là, caractérisent encore cet état nouveau, savoir l'extension indéfinie de la solidarité parmi les hommes et la généralisation de la lutte pour l'existence.
Tandis que dans les sociétés économiquement isolées de l'ère de la petite industrie, les manières d'agir utiles ou nuisibles des différents membres de ces sociétés n'exercent leur influence, bonne ou mauvaise, que dans les limites de la tribu ou de l'État, il en est autrement dans ce nouvel ordre de choses, où la sphère des échanges embrasse la terre entière, en établissant entre tous les hommes une liaison et une communauté d'intérêts. Il n'y a plus désormais de sociétés isolées, vivant de leur vie propre, et dont les membres n'ont rien de commun avec ceux des autres; il n'y a plus qu'une société universelle, dans laquelle la manière dont chacun gouverne ses affaires et sa vie influe sur la condition de tous; d'où résulte encore pour tous le droit de se défendre contre les manières d'agir nuisibles de chacun, et le devoir pour chacun d'agir de la manière la plus conforme à l'intérêt de tous, impliquant la création d'un code universel de droit et de morale, supérieur à tous les codes particuliers et destiné à les remplacer.
De même, la lutte pour l'existence, qui n'avait, à l'origine, d'autre manifestation que la guerre, s'étend à toutes les branches de l'activité humaine, sous un régime de concurrence universalisée. Les moyens de produire la richesse [460] ont acquis plus de puissance, le mécanisme de la distribution de cette richesse est devenu plus parfait, mais encore faut-il que chaque génération parvienne à caser la multitude de ses membres dans l'atelier universel. Il n'y a plus de privilèges et de situations réservées dans cet atelier: toutes les places, toutes les fonctions sont accessibles à tous, sans distinction de races et de nationalités, mais c'est à la condition qu'ils possèdent la capacité physique, morale et intellectuelle avec les connaissances requises pour les remplir. Cette capacité est naturellement inégale: les uns sont pourvus d'un ample fonds de facultés productives et dirigeantes; ils apportent au capital social, une valeur personnelle considérable, tandis que les autres sont pauvrement doués et n'apportent qu'une valeur minime; quelques-uns même, entièrement disgraciés de la nature, ou, pis encore, nés avec des instincts pervers, sont des non-valeurs qui constitueront une charge pour la société; enfin, les capitaux qui sont investis dans l'atelier, et qui consistent dans l'ensemble des valeurs représentées par le sol, le sous-sol, les constructions, les matériaux de la production, le fonds de consommation, etc., ne sont pas distribués d'une manière moins inégale : de même que le fonds de valeurs personnelles que chacun reçoit de ses ascendants, force physique, beauté, intelligence, aptitudes spéciales, diffère d'un individu à un autre, le fonds de valeurs immobilières et mobilières qui s'ajoute à cet héritage, sous forme de terres, de maisons, de meubles, de parts dans les entreprises, etc., présente dans sa distribution une diversité extrême. Mais l'atelier est immense, et l'on y trouve des places appropriées aux facultés les plus inégales et les plus diverses. D'un autre côté, les titres de propriété des capitaux investis dans l'atelier sont divisés et rendus circulables au point de devenir accessibles aux plus humbles coopérateurs de la production. [461] Chacun peut obtenir sa part dans la propriété de l'atelier, à la seule condition de gouverner utilement sa production et sa consommation, ses affaires et sa vie, ou de se soumettre à une tutelle qui supplée à l'insuffisance de ses facultés dirigeantes. Ajoutons qu'à mesure que la société acquiert plus de richesse et de bien-être, elle devient plus secourable pour les déshérités; elle ne voue pointa la destruction les non-valeurs qui pèsent sur elle, mais elle s'applique à en diminuer le nombre, en perfectionnant les méthodes de la répression, de la bienfaisance et de la tutelle.
Ainsi, nul ne peut plus se dérober à la lutte pour l'existence; nul ne peut plus s'abriter derrière un privilège de caste, de nationalité ou même de sexe; nul ne peut plus se cantonner dans une sinécure; nul, pour tout dire, ne peut plus vivre aux dépens d'autrui. Il faut que chacun fournisse aux autres l'équivalent de ce qu'il reçoit d'eux, mais l'arène est librement ouverte à tous, et en remplissant les conditions requises pour la lutte, chacun peut obtenir, dans les résultats de la production de l'atelier universel, une part proportionnée à l'importance de son apport et à la valeur de ses services.
Voilà l'idéal de bien-être et de justice vers lequel se dirige l'humanité. Elle en est sans doute encore bien éloignée, mais elle y marche; elle n'a jamais cessé d'y marcher depuis le jour où l'invention du premier outil l'a élevée au-dessus des autres espèces animales. Elle est arrivée maintenant à la dernière étape qui précède l'ère nouvelle; il dépend d'elle de la franchir plus ou moins vite. Plus tôt elle aura remplacé le matériel de la petite industrie par celui de la grande; plus tôt elle aura détruit les obstacles naturels et artificiels qui s'opposent à l'universalisation de la concurrence; plus tôt enfin elle aura adapté l'individu, aussi bien que l'appareil qui supplée à son insuffisance intellectuelle et morale à pratiquer le [462] self government, aux conditions d'existence que lui a faites la transformation de la machinery de la production, plus promptement et plus économiquement elle accomplira cette évolution, dont le terme est le bien-être général, la justice et la paix.
Mais la tâche est énorme et compliquée, et le temps qu'elle exigera pour être remplie dépendra, non seulement de la somme des forces et des ressources que les sociétés en voie de civilisation peuvent mettre au service du progrès, mais encore de l'efficacité et de l'économie avec lesquelles ces forces et ces ressources seront mises en œuvre. A cet égard, la « production du progrès » ne diffère pas des autres branches de l'activité humaine, et elle va se développant et se perfectionnant comme elles.
A l'origine, la production du progrès ne dispose que d'un petit nombre d'agents et de matériaux, ses procédés sont grossiers et incertains, et elle ne réussit qu'à grande peine à faire entrer ses produits dans la consommation. Les hommes pourvus de l'esprit d'observation et du génie de l'invention sont rares, et ils ne possèdent le plus souvent ni les loisirs nécessaires pour observer et inventer, ni les ressources non moins nécessaires pour mener à bonne fin leurs recherches et leurs expérimentations; ils ont à lutter avec les habitudes que les innovations dérangent, avec les intérêts établis auxquels elles portent dommage : il ne faut rien moins que l'intervention des dieux pour les imposer. Grâce à cette intervention secourable, les premiers progrès s'accomplissent, les sociétés naissantes sont mises en possession du matériel de la petite industrie et d'une machinery de gouvernement appropriée à leur condition morale et aux nécessités de leur situation, la population se multiplie, la richesse s'accroît, le capital des connaissances acquises s'accumule. Les sciences, d'abord confondues, se divisent, et chaque [463] branche attire les intelligences qui s'y adaptent le mieux; les arts et les industries se spécialisent de même. Il semble que le travail de la civilisation doive redoubler d'activité et de fécondité, mais les obstacles qui l'entravaient se sont multipliés de leur côté. L'atelier du progrès s'est agrandi, soit! les matériaux qui l'alimentent sont devenus plus abondants et plus variés, les ouvriers qui mettent ces matériaux en œuvre sont mieux pourvus de capitaux; ils ont acquis plus d'habileté et leurs méthodes sont plus sûres; mais leur industrie est à l'index. Ces mêmes dieux, qui la patronaient jadis, se sont retournés contre elle. Les classes dominantes conservent avec un soin jaloux les institutions qui assurent leur domination, et elles considèrent comme un sacrilège tout changement qu'un esprit d'innovation impie et téméraire tenterait d'apporter à ces institutions d'origine divine. On ne peut les changer qu'après avoir détrôné les divinités dont elles sont l'œuvre, et voilà pourquoi, dans cette phase de la civilisation, toute réforme politique et sociale procède d'une révolution religieuse. Mais cette révolution ne s'accomplit point sans lutte; les dieux établis se défendent; parfois des siècles s'écoulent avant que l'esprit de progrès ne réussisse à renverser ces idoles surannées et à mettre à leur place un dieu nouveau révélateur d'une loi nouvelle, moins grossière, plus saine et mieux adaptée à la condition actuelle des hommes et des choses. Dans les régions inférieures, les corporations industrielles, instituées à l'imitation et sur le modèle des corporations politiques et religieuses, n'opposent pas au progrès de moindres obstacles. Partout, non seulement les lois et les coutumes, mais les procédés mêmes de la production et les habitudes de la consommation sont comme figés dans le moule qu'il a plu à une sagesse surhumaine de façonner à l'usage de l'homme.
[464]
L'atelier du progrès est alors presque réduit à chômer, car il n'y a plus de débouché pour l'esprit d'observation et d'invention. C'est l'époque des subtilités de la scolastique et des disputes stériles des commentateurs. Cependant, on se lasse des formules vides et du pédantisme de l'école; on se lasse aussi de la vie monotone du château, de la boutique ou de l'atelier dans l'étroite enceinte des villes murées; le goût des nouveautés et des aventures se réveille, et il se propose d'abord un but religieux. On part pour aller délivrer le tombeau du Christ et on finit par découvrir l'Amérique et la nouvelle route de l'Inde. Les esprits en mouvement se dégagent peu à peu de la tutelle immobile du catholicisme, tandis que l'industrie, le commerce et les arts, dont les débouchés se sont agrandis, s'affranchissent de la réglementation étroite des corporations.Le vieux moule social éclate de toutes parts. En vain, on persécute les novateurs de la religion, de la science et de l'industrie, les nouveautés subsistent, et il devient impossible, malgré tout, de ramener la société au point où elle était avant les armes à feu, la boussole, l'imprimerie, la découverte de l'Amérique et la Réforme. Une réaction s'opère contre les institutions et les préjugés qui arrêtent l'essor des idées et des intérêts auxquels ces nouveautés ont donné naissance, et cette réaction est d'autant plus violente et aveugle que la défense de l'ancien régime avait été plus intolérante et plus obstinée. Au dix-huitième siècle, le progrès, naguère prohibé, est l'objet d'une demande universelle; sous cette étiquette favorite, on accepte même les paradoxes les plus subversifs et les utopies les plus malsaines. On ne distingue point ce qui doit être conservé dans l'organisation du passé et ce qui doit être réformé ou supprimé; on veut tout abattre, jusqu'au jour où les désastres que cette exagération a causés ramènent brusquement à l'exagération opposée.
[465]
A travers ces vicissitudes, la production du progrès a réussi cependant à se débarrasser de la plupart de ses entraves, et elle s'est prodigieusement, quoique inégalement accrue. Au petit atelier clandestin, dont les ouvriers étaient proscrits et les produits prohibés, a succédé une immense manufacture qui travaille au grand jour, si elle ne possède pas encore dans toutes ses parties l'ensemble des conditions nécessaires à son développement régulier.
Cette manufacture se partage, au moment où nous sommes, en deux ateliers bien distincts: l'atelier du progrès matériel et celui du progrès moral et politique.
Le premier de ces deux ateliers se divise à son tour en deux compartiments séparés : les savants extraient et préparent, dans l'un, les matériaux que les inventeurs façonnent dans l'autre, en appliquant la science'à l'industrie. Savants et inventeurs jouissent maintenant d'une liberté entière : aucune partie du domaine de la science ou de l'industrie ne leur est plus interdite, mais la liberté seule ne suffit pas pour déterminer la pleine croissance d'une branche quelconque de l'activité humaine, il faut encore que les garanties de la propriété viennent s'y joindre. Sous ce dernier rapport, la condition des savants est inférieure à celle des inventeurs : on ne considère point leurs découvertes comme appropriables, et ils n'en peuvent tirer, directement du moins, aucun profit. Les gouvernements s'appliquent à combler cette lacune, en mettant au service de la science des observatoires et des laboratoires, en accordant des places aux savants et en les ornant de décorations, mais il est permis de douter que ces allocations et ces faveurs officielles remplacent suffisamment la perspective d'un profit pour attirer les intelligences et les capitaux vers les recherches et les expérimentations de la science pure. L'industrie des inventeurs qui utilisent les découvertes des savants se trouve dans [466] une situation économiquement plus favorable. Quoique la propriété des inventions industrielles ne soit encore qu'incomplètement garantie dans l'espace et dans le temps, elle peut être exploitée, et, s'il y a des inventeurs qui ne couvrent pas leurs frais, il y en a, en revanche, qui réalisent des bénéfices extraordinaires.[40] Ces bénéfices ont été croissant à mesure que le débouché des découvertes et inventions s'est agrandi sous l'influence de l'avènement de la liberté de l'industrie et de l'extension de la liberté du commerce. Grâce à la liberté de l'industrie, les obstacles qui s'opposaient à l'adoption des machines et des procédés nouveaux ont disparu : chacun est devenu libre d'adopter l'outillage et les méthodes qui lui paraissent les plus économiques. D'un autre côté, à mesure que s'étend la sphère des échanges, que la concurrence devient plus générale et plus pressante, chacun est obligé de « demander » cet outillage et ces procédés qui permettent de produire à meilleur marché. La production du progrès matériel est donc placée aujourd'hui dans des conditions, sinon absolument satisfaisantes, du moins bien supérieures à celles où elle se trouvait sous l'ancien régime; aussi cette branche de la manufacture du progrès est-elle particulièrement active et florissante.
Il n'en est pas ainsi malheureusement de l'atelier où s'élabore le progrès moral et politique, où l'on s'occupe d'améliorer, non le matériel, mais le personnel de la civilisation, de rendre l'homme plus capable de gouverner ses affaires et sa vie, comme aussi de perfectionner la machinery qui supplée à l'insuffisance de sa capacité gouvernante. La production de ces deux catégories de progrès est loin d'avoir acquis son développement utile. Comme [467] toutes les autres branches de l'activité humaine, elle exige la coopération du capital et du travail. Or, elle réunit bien moins encore que la production du progrès matériel les conditions propres à les attirer. Ni les découvertes, ni les inventions, dans le domaine des sciences morales et politiques et des arts qui en dérivent, ne sont appropriables, et la seule manière d'en tirer parti, c'est de les consigner dans des ouvrages dont la propriété n'est même pas entièrement sauvegardée, et qui sont d'ailleurs peu « demandés ». Aucune branche de littérature ne possède une clientèle moins nombreuse : le roman le plus fade, le vaudeville le plus insignifiant, rapporte plus qu'un traité d'économie politique, de morale ou de droit des gens, qui résume le labeur de toute une vie. Cette indifférence du public pour des travaux qui intéressent au plus haut degré les destinées de la société, tient sans doute à sa légèreté et à son ignorance, mais elle provient aussi de ce que les inventions et découvertes qui appartiennent au domaine des sciences morales et politiques n'ont guère plus de chances d'être appliquées qu'elles n'en avaient à l'époque où elles étaient prohibées et où l'on brûlait leurs auteurs. Tandis que la liberté de l'industrie permet au premier venu d'utiliser une nouvelle invention mécanique ou une combinaison chimique, et que la liberté du commerce l'y oblige, dès que l'expérience en a démontré la supériorité, les inventions et découvertes qui ont pour objet de perfectionner, soit l'homme, soit les institutions politiques, économiques et sociales, sont obligées de demander leur application précisément aux préjugés qu'elles offensent et aux intérêts qu'elles menacent. S'il s'agit, par exemple, d'un nouveau système d'études, on se heurtera à un programme officiel, rédigé par les occupants de l'ancien système et imposé d'autorité, comme un Koran infaillible et immuable, à tous les jeunes gens qui aspirent à [468] entrer dans une carrière libérale. S'il s'agit d'une innovation en matière d'association et de crédit, on aura à compter avec les prescriptions et les interdictions d'un code qui ne reconnaît comme licites que les formes et les applications déjà existantes et autorisées de l'association et du crédit. S'il s'agit enfin de nouvelles institutions politiques, comment pourraient-elles être acceptées par le personnel en possession des anciennes? Supposons que l'introduction de la locomotive, de l'éclairage au gaz, etc., eût été subordonnée au consentement des propriétaires de la machinery existante, ne serions-nous pas réduits encore à voyager en diligence et à nous éclairer à la chandelle? Supposons qu'en ce moment, les actionnaires des compagnies du gaz aient le pouvoir de décider s'il y a lieu ou non d'utiliser la lumière électrique : un homme qui passerait son temps et dépenserait sa fortune à chercher la solution du problème de l'éclairage par l'électricité, ne serait-il pas considéré à bon droit comme un esprit chimérique et ne mériterait-il pas d'être pourvu d'un conseil judiciaire? Telle est la situation des hommes qui entreprennent d'innover dans un domaine encore fermé à la concurrence. Cependant, un moment arrive où une société, dont les conditions d'existence ont changé sous l'influence du progrès matériel, ne peut plus supporter son ancienne machiner)/ de gouvernement. Elle fait alors une « révolution »; elle renverse violemment des institutions qui ne s'adaptent plus à ses besoins et elle s'efforce d'en créer d'autres. Malheureusement, les sciences morales et politiques en retard ne lui fournissent point les lumières nécessaires pour accomplir cette tâche difficile; elle demeure livrée aux tâtonnements des empiriques et aux chimères des utopistes jusqu'à ce qu'une réaction la ramène au point d'où elle était partie, et rétablisse les institutions qu'elle avait renversées, en se bornant le plus souvent à en [469] changer le nom et les apparences extérieures. En attendant, cette convulsion douloureuse et stérile a coûté cher, et elle a retardé l'évolution qu'elle avait pour objet d'accélérer.
Nous examinerons d'une manière plus complète, dans une autre série d'études qui sera consacrée à l'Évolution politique, les maux et les désordres qu'engendre cette inégalité du développement des deux grands ateliers de la « manufacture du progrès ». Cependant, en dépit de cette discordance entre le progrès matériel et le progrès moral et politique, le monde marche, et nous commençons à voir poindre à l'horizon l'aurore des temps nouveaux.
Paris. — Typographie Paul Schmidt, 5, rue Perronet.
Notes.↩
[1] Cette première partie et le commencement de la seconde ont été publiés dans le Journal des Économistes, du mois de janvier 1877 au mois de juin 1879.
[2] On sait que le kilogrammètre est l'unité de travail. C'est le travail correspondant à l'élévation d'un poids de 1 kilogramme à 1 mètre par seconde. Le cheval-vapeur fournit 75 kilogrammètres. L'homme ne peut, dans les meilleures conditions possibles, effectuer en dix heures qu'un travail de 220,000 kilogrammètres. En une heure, une machine del cheval-vapeur fait 270,000 kilogrammètres, soit plus qu'un homme en dix heures. On peut donc avancer qu'il faut, en général, 10 hommes pour faire le travail d'une machine de 1 cheval-vapeur. (henRI De Parville, Causeries scientifiques.)
[3] Introduction aux rapports du jury international de l'exposition de 1867. 1 vol. in-8.
[4] Voici quel a été le nombre total des brevets délivrés en France, du 9 octobre 1844 à la fin de 1877, en vertu de la loi organique du 5 juillet 1844:
| Brevets de 5 ans | 900 |
| Brevets de 10 ans | 1,857 |
| Brevets de 15 ans | 110,945 |
| Brevets étrangers | 8,186 |
| Total des brevets | 121,890 |
| Certificats d'additions | 36,392 |
| Total général | 158,282 |
Ajoutons que la progression dans le nombre des brevets délivrés est constante. De 1862 à 1877, par exemple, ce nombre s'est élevé de 4,410 à 5,610.
(Annales du commerce extérieur. Situation économique et commerciale de la France.)
[5]Cours d'économie politique, t. I, 8e leçon. La part du travail.
[6] A la fin de l'année 1876 l'Europe possédait 149,248 kilomètres de chemins de fer, se répartissant comme suit entre les principaux pays : Allemagne, 29,149 kilom.; Grande-Bretagne et Irlande, 27,247; France, 22,508; Russie, 20,879; Autriche-Hongrie, 17,486, etc.
Les États-Unis avaient 126,649 kilom. de voies ferrées et ce chiffre s'était élevé à 146,000 à la fin de l'année 1877. L'Amérique entière possédait, à la fin de 1876, un réseau de 141,784 kilomètres.
Les Indes anglaises avaient 11,164 kilom. de railways.
A la fin de 1876 il existait dans le monde entier 309,892 kilomètres de chemins de fer, d'une valeur d'environ 3,500 millions sterl. ou 87 milliards 500 millions de francs.
(charles De Scherzek, Données statistiques sur le Commerce universel.)
[7] Ce serait, comme nous l'avons remarqué ailleurs (la Politique et les Affaires, journal le Capitaliste), une statistique curieuse et instructive à faire que celle du développement de la production des capitaux, dans le monde civilisé, depuis la naissance dela grande industrie, et on doit regretter que les bureaux officiels, qui possèdent aujourd'hui le monopole de la statistique, n'aient pas jugéàproposde l'entreprendre. On pourrait dresser, pour la production du capital, des cartes teintées dans le genre de celles que les géographes allemands ont consacrées à la production du sucre, du fer, de la houille, des denrées alimentaires, etc., ou bien encore de la fameuse carte dans laquelle M. le baron Charles Dupin représentait, par des teintes graduées allant du blanc au noir, le degré d'instruction de chacun des départements français. En se servant de la gamme du jaune, et en montant du jaune clair au jaune d'or pour figurer la puissance de production et d'accumulation des capitaux des différents peuples civilisés, on trouverait que la teinte dorée représentant le maximum de l'aptitude à capitaliser couvrirait le RoyaumeUni, moins l'Irlande, la plus grande partie de la France, la Belgique, la Hollande, les cantons français et allemands de la Suisse, et, de l'autre côté de l'Atlantique, les États de l'est de l'Union Américaine, formant le groupe de la Nouvelle-Angleterre.
C'est là que se trouve principalement localisée la production du capital, comme celle de la houille l'est en Angleterre, en Belgique, dans le nord de la France et dans les provinces Rhénanes. En Allemagne, dans la Cisleithanie autrichienne, dans le nord de l'Italie, dans les pays Scandinaves, la teinte serait d'un assez beau jaune, mais en Hongrie, en Russie, dans l'Italie méridionale, en Espagne, dans les pays Orientaux, à part quelques îlots suffisamment colorés, la teinte deviendrait de plus en plus claire, parfois même il n'y aurait pas de teinte du tout. Quelques notes statistiques et même psychologiques pourraient être ajoutées avec avantage à cette carte pour en faciliter l'intelligence et mieux préciser la signification des teintes. On y constaterait, par exemple, que des deux facteurs de la production du capital, l'esprit d'entreprise et l'esprit d'économie, c'est le premier qui domine en Angleterre, tandis qu'il est plus faible dans l'Europe continentale, où en revanche, notamment en France, la masse de la population est beaucoup plus économe qu'en Angleterre, on pourrait même dire plus âpre à l'épargne; on pourrait remarquer encore que si l'Allemagne ne mérite pas les honneurs de la teinte dorée, c'est parce qu'elle investit la plus grosse part de son épargne sous la forme d'un supplément croissant de population, sorte de placement qui est moins recherché en France. Quant aux chiffres, il serait plus difficile de les préciser. Cependant, on évaluait, il y a déjà un quart de siècle, l'épargne annuelle de la France à 1,500 millions, celle de l'Angleterre à pareille somme, et l'on estimait que les autres pays à teinte dorée pouvaient fournir un chiffre équivalant à celui de la France ou de l'Angleterre, ce qui donne un total de 4 ou 5 milliards pour l'ensemble des pays « essentiellement producteurs de capitaux ».
Mais la production des capitaux ne demeure pas plus stationnaire que les autres, elle s'est même accrue depuis vingt-cinq ans au point qu'un statisticien anglais, M. Robert Giffen a pu porter à 200 millions sterling — 5 milliards de francs — le montant de l'épargne annuelle du Royaume-Uni. Ce chiffre nous paraît excessif; il a dû, en tous cas, être singulièrement réduit depuis la crise, mais il est permis de soutenir que la production des capitaux a doublé depuis vingt-cinq ans et de l'évaluer à une dizaine de milliards pour l'ensemble des « pays producteurs ».
[8] D'après les recherches de M. Dudley Baxter (dans son ouvrage National Debts), recherches qui sont, il est vrai, en partie conjecturales pour les périodes un peu éloignées de nous, l'ensemble des dettes nationales des pays civilisés montait, en 1715, à 7 milliards 500 millions de francs. En 1793, l'ensemble des dettes publiques des contrées de notre groupe de civilisation, y compris les États-Unis et l'Inde anglaise, s'élevait à 12 milliards et demi de francs; l'Angleterre devait à elle seule plus de la moitié de cette somme. De 1793 à 1820, les dettes nationales s'accrurent infiniment plus que dans les quatre-vingts années précédentes : l'ensemble, à la dernière de ces dates, en peut être évaluée à 38 milliards de francs dont 23 milliards pour la seule dette anglaise. De 1820 à 1848, le monde jouit d'une paix profonde. Aussi les engagements des nations ne s'élevaient-ils, en 1848, qu'à 43 milliards environ. La révolution de 1848, les guerres du second Empire, etc., ont porté cette somme à 97,774,000,000 de francs en 1870. On peut estimer enfin que l'ensemble des dettes des nations plus ou moins civilisées dépasse actuellement 130 milliards.
(paul Leroy-bëaulieu, Traite de la science des finances, t. II, chap. xiv. Les Dettes des grands Etats.)
[9] Voir A. Courtois, Tableau des cours des principales valeurs, 1797-1876.
[10] Quand on analyse le loyer ou l'intérêt des capitaux, on trouve qu'il se compose de deux éléments bien distincts, savoir : la compensation nécessaire pour couvrir la privation du capital prêté ou engagé, et la prime nécessaire pour couvrir le risque. Personne n'ignore que le taux de l'intérêt est toujours proportionné aux risques du prêt, et que si on engage son épargne au taux de 3 1/2 ou de 4 p. 100 dans les fonds français, tandis qu'on demande dans le même moment 5,75 p. 100 aux fonds portugais et 7 p. 100 aux roumains, c'est à cause de la différence réelle ou supposée des risques. C'est un point sur lequel il n'est pas nécessaire d'insister. Mais la privation n'influe pas moins que le risque sur le taux de l'intérêt, quoiqu'on se rende moins exactement compte de son influence. Supposons qu'on demande à emprunter un million pour développer les opérations d'une industrie ou d'un commerce. Si ce million n'est remboursable qu'à long terme, le prêteur exigera probablement, quelle que soit la solidité de l'emprunteur, un intérêt très élevé; d'abord parce que les gens qui possèdent un million disponible sont peu nombreux, ensuite parce que ceux qui peuvent se passer de la disponibilité d'un million sont moins nombreux encore. L'intérêt que l'industriel sera obligé d'accorder au prêteur s'élèvera, dans ce cas, à 7 ou 8 pour 100, et peutêtre à un chiffre plus élevé encore, quand même le taux ordinaire de l'intérêt ne dépasserait pas 4 ou 5 p. 100. Mais supposons qu'au lieu de demander un million à un seul capitaliste, sous la forme d'un prêt ou d'une commandite à long terme, notre industriel constitue une société par actions, laquelle demande le million au public, en émettant 2,000 obligations de 500 francs chacune, négociables à la Bourse; au lieu de payer 8 p. 100 et davantage, elle réalisera cet emprunt à 6 p. 100 ou à un taux moindre encore. Pourquoi? D'abord parce qu'il est plus facile de trouver 2,000 capitalistes disposés à engager 500 francs chacun dans une entreprise que de rencontrer un seul capitaliste disposé à y investir un million; ensuite parce que, dans le premier cas, le capital constitué sous la forme de valeurs mobilières est toujours réalisable ou dégageable du jour au lendemain, tandis que, dans le second cas, il est immobilisé à long terme. La privation est à son minimum pour le détenteur d'une valeur mobilière; elle est, au contraire, à son maximum pour le propriétaire d'un capital immobilisé. Veut-on un autre exemple? Certains établissements de crédit accordent jusqu'à 4 p. 100 aux dépôts remboursables à long terme, tandis qu'ils n'accordent que 1 p. 100 aux dépôts remboursables at call, et cependant il arrive qu'on leur confie dans le même moment plus de dépôts à 1 p. 100 qu'à 4 p. 100. A quoi cela tient-il î Cela tient à ce qu'une partie de leur clientèle estime que la différence de ces deux taux d'intérêt ne compenserait pas l'inégalité de la privation et qu'elle trouve avantage à conserver son capital entièrement disponible.
Il serait impossible, on le conçoit, d'évaluer exactement, en toutes circonstances, la différence du taux nécessaire pour compenser la privation d'un capital immobilisé et celle d'un capital mobilisable. Cette différence peut s'élever parfois fort haut, mais elle descend rarement à moins de 2 p. 100. Ce qui signifie, en dernière analyse, qu'on peut se procurer un capital mobilisable en le payant 2 p. 100 moins cher qu'un capital destiné à être immobilisé, autrement dit qu'on peut réaliser une économie de 2 p. 100 sur 6 ou 8 p. 100, soit d'un tiers ou un quart en remplaçant dans une industrie quelconque un capital immobilisé par un capital mobilisable.
[11] On trouvera la démonstration complète de cette loi dans notre Cours d'Economie politique, t. 1er, troisième leçon. La valeur et le prix.
[12] En réalité, dit sir John Lubbock, nous ne sommes qu'au seuil de la civilisation. Loin de montrer, par quelque symptôme, qu'elle est arrivée à sa fin, la tendance au progrès semble dernièrement s'être accusée par un redoublement d'audace et un accroissement de vitesse. Pourquoi donc supposerionsnous qu'elle doive maintenant cesser? L'homme n'a certainement pas atteint la limite de son développement intellectuel, et il est positif qu'il n'a pas épuisé les capacités infinies de la nature. Il y a bien des objets auxquels notre philosophie n'a pas encore songé, bien des découvertes destinées à immortaliser ceux qui les feront et à procurer à la race humaine des avantages que nous ne sommes peut-être pas en état d'apprécier. Nous pouvons dire encore, avec notre illustre compatriote sir Isaac Newton, que nous n'avons été jusqu'ici que comme des enfants jouant sur le rivage de la mer, et ramassant çà et là un caillou plus lisse ou un coquillage plus joli que les autres, tandis que le grand océan de la vérité s'étend mystérieux devant nous.
Ainsi donc, toute l'expérience du passé justifie les plus hardies espérances pour l'avenir. Il n'est certainement pas raisonnable de supposer qu'un mouvement qui s'est continué pendant tant de milliers d'années va maintenant s'arrêter tout d'un coup, et il faudrait être aveugle pour s'imaginer que notre civilisation n'est pas susceptible de progrès ou que nous avons atteint l'état le plus élevé auquel l'homme puisse arriver.
(Sir John Lubbock, l'Homme avant l'histoire, I, 504.)
[13] Chez les Vitiens, dit sir John Lubbock, le parricide n'est pas un crime, mais un usage. Les parents sont généralement tués par leurs enfants, parfois les personnes âgées se mettent dans l'esprit que le temps de mourir est venu; parfois ce sont les enfants qui avertissent leurs parents que ceux-ci leur sont à charge. Dans l'un ou l'autre cas, on fait venir les amis et les proches parents, on tient conseil, et l'on fixe un jour pour la cérémonie, qui commence par un grand festin. Les missionnaires ont souvent été témoins de ces horribles tragédies. Un jour, un jeune homme invita M. Hunt à assister aux obsèques de sa mère, lesquelles allaient justement avoir lieu. M. Hunt accepta l'invitation, mais, quand parut le cortège funèbre, il fut surpris de ne point voir de cadavre, et comme il en demandait la raison, le jeune sauvage lui montra sa mère qui marchait avec eux, aussi gaie, aussi allègre qu'aucun des assistants, et, apparemment, aussi contente... Il ajouta que c'était par amour pour sa mère qu'il agissait ainsi; qu'en conséquence de ce même amour, ils allaient maintenant l'enterrer, et qu'eux seuls pouvaient et devaient remplir un devoir aussi sacré... Elle était leur mère, ils étaient ses enfants : ils devaient donc la mettre à mort. En pareil cas, la tombe est creusée à 4pieds environ de profondeur; les parents et les amis commencent leurs lamentations, disent un adieu affectueux à la pauvre victime, et l'enterrent toute vive. On est surpris, après cela, que M. Hunt considère les Vitiens comme pleins de tendresse et de piété filiale. En réalité, pourtant, ils regardent cet usage comme une si grande preuve d'affection qu'on ne peut trouver que des fils pour s'en acquitter. Le fait est que, non seulement ils croient à une vie future, mais qu'ils sont persuadés qu'ils renaîtront dans le même état où ils ont quitté cette terre. Ils ont donc un puissant motif pour abandonner ce monde avant d'être affaiblis par la vieillesse, et, si générale est cette croyance, si considérable est l'influence qu'elle exerce sur eux, que, dans une ville de plusieurs centaines d'habitants, le capitaine Wilkes ne vit pas un seul homme qui dépassât la quarantaine : comme il s'informait des vieillards, on lui répondit que tous avaient été enterrés.
(Sir John Lubbock, l'Homme avant l'histoire. Les sauvages modernes.)
A Céos, selon Strabon, une loi enjoignait aux sexagénaires de boire de la ciguë, afin que leur mort procurât plus d'aisance aux citoyens jeunes et vigoureux.
[14] Ceux qui ont peu étudié ce sujet, dit sir John Lubbock, se figurent que le sauvage a tout au moins cet avantage sur l'homme civilisé qu'il jouit d'une liberté personnelle beaucoup plus grande que celle qui est compatible avec notre état de civilisation. C'est là une profonde erreur. Le sauvage n'est libre nulle part. Dans le monde entier, la vie quotidienne du sauvage est réglée par une quantité de coutumes (aussi impérieuses que des lois) compliquées et souvent fort incommodes, de défenses et de privilèges absurdes; les défenses s'appliquent en général aux femmes, les privilèges sont l'apanage de l'homme. De nombreux règlements fort sévères, quoiqu'ils ne soient pas écrits, compassent tous les actes de leur vie. Ainsi, M. Langnous dit, en parlant des Australiens: « Au lieu de jouir d'une liberté personnelle complète, comme on pourrait le croire au premier abord, ils se laissent mener par un code de règlements et de coutumes qui constitue une des tyrannies les plus épouvantables qui aient jamais peut-être existé sur la terre, car il place, non seulement la volonté, mais les biens et la vie du plus faible à la disposition du plus fort. Le but de ce système est de donner tout aux puissants et aux vieillards, au détriment des faibles et des jeunes gens, et particulièrement des femmes. De par leurs coutumes, les meilleurs aliments, les meilleurs morceaux, les meilleurs animaux, etc., sont interdits aux femmes et aux jeunes gens, et réservés aux vieillards ».
« Croire, dit sir G. Grey (Polynesian researches), qu'un homme à l'état sauvage jouit de la liberté de pensée ou d'action, est une grave erreur. »
A Taïti, « les hommes ont le droit de manger du porc et de la volaille, toute espèce de poissons, des noix de coco, du plantain, et, enfin, tout ce qu'on présente en offrande aux dieux, aliments qu'il est défendu aux femmes de toucher sous peine de mort, car on suppose que leur attouchement les souillerait. Les feux sur lesquels les hommes font cuire leurs aliments sont sacrés aussi, et les femmes ne peuvent s'en servir. Il en est de même des paniers dans lesquels les hommes mettent leurs provisions, de la maison dans laquelle ils prennent leurs repas; tous ces objets sont interdits aux femmes sous peine de mort; aussi les femmes font-elles cuire leurs grossiers aliments sur des feux séparés, et les mangent dans de petites huttes élevées dans ce but ». — « On se tromperait fort, dit l'évêque de Wellington, si on croyait que les indigènes de la Nouvelle-Zélande n'ont ni coutumes, ni lois. Ils sont et ont toujours été les esclaves de la loi, des coutumes et des précédents. »
(Les Origines de la civilisation. Lois.)
[15] « Schoolcraft (Tribus indiennes) estime que, dans une population qui vit des produits de la chasse, chaque chasseur a besoin, en moyenne, de 50,000 acres ou 78,000 milles carrés pour son entretien. Il nous dit que, sans compter le territoire du Michigan, à l'ouest du lac Michigan et au nord de l'Illinois, il y avait aux États-Unis, en 1825, environ 97,000 Indiens, occupant 77 millions d'acres ou 120,312 milles carrés. Cela donne un habitant pour chaque 1/4 de mille carré. En ce cas, toutefois, les Indiens vivaient en partie des subsides que le gouvernement leur fournissait comme indemnité de leur territoire, et la population était, par conséquent, plus nombreuse qu'elle ne l'eût été, si elle n'eût tiré sa subsistance que de la chasse. Il en est de même, quoique dans une moindre mesure, des Indiens qui habitent le territoire de la baie d'Hudson. Sir Georges Simpson, dernier gouverneur des territoires appartenant à la Compagnie de la baie d'Hudson, dans son rapport présenté au comité de la Chambre des communes, en 1857, estimait ces tribus à 139,000 habitants, répartis sur une étendue que l'on suppose être de plus de 1,400,000 milles carrés, auxquels il faut ajouter 13,000 pour l'île de Vancouver, ce qui fait un total de 900,000,000 d'acres, soit, environ, 6,500 acres, ou 10 milles carrés, pour chaque individu. D'un autre côté, l'amiral Fitzroy évalue à moins de 4,000 le nombre des habitants de la Patagonie, au sud du 40° degré, et sans compter Chiloë et la Terre de Feu. Or, le nombre des acres s'élève à 176,640,000; ce qui donne plus de 44,000 acres ou de 68 milles carrés par personne. Toutefois, un écrivain, dans The voice of pity, pense que le chiffre de la population pourrait bien atteindre à 14,000 ou 15,000. Il serait difficile de faire le recensement des aborigènes de l'Australie. M. Oldfield conjecture qu'il y a un naturel par 50 milles carrés, et il est au moins évident que depuis l'introduction de la civilisation, la population totale de ce continent s'est beaucoup accrue.
En effet, la population s'accroît invariablement avec la civilisation. Le Paraguay, avec 100,000 milles carrés, a de 300,000 à 500,000 habitants, c'està-dire environ 4 par mille carré. Les parties sauvages du Mexique contenaient 374,000 habitants répartis sur un espace de 675,000 milles carrés, tandis que le Mexique propre, avec 833,600 milles carrés, avait 6,691,000 habitants. Le royaume de Naples avait plus de 183 habitants par mille carré, laVénétie plus de 200; la Lombardie, 280; l'Angleterre, 280; la Belgique, 320.
(Sir John Lubbock, l'Homme avant l'histoire. Dernières remarques.)
[16] « II était défendu aux Brahmanes et aux Kchattryas de prêter de l'argent à intérêt, de faire le commerce, de se livrer à l'agriculture. N'est-ce pas le dédain qu'on retrouvait en Europe contre les professions industrielles, non seulement chez les Germains au moyen âge, et presque dans nos temps modernes, mais chez les Romains, chez les Grecs, parmi tous les peuples dont l'origine remontait aux castes guerrières... Dans l'Inde, la loi permettait cependant aux castes supérieures de déroger, mais, comme en Europe, il fallait une pressante nécessité. Ancien droit français : « 11 n'est point permis à la « noblesse française d'exercer des professions viles ni de faire aucun com« merce de détail. Ceux qui se trouvent dans ce cas-là perdent leur privilège « et leur noblesse; ils deviennent roturiers et taillables jusqu'à ce qu'ils « aient été réhabilités. » Pour obtenir cette réhabilitation, il fallait s'adresser au roi. Elle s'accordait par lettres du grand-sceau qui devaient être enregistrées. Ainsi, en France, et par toute l'Europe, on perdait sa caste comme dans l'Inde. C'est que les mêmes lois, le même régime des castes avaient passé partout. »
(Études sur le droit civil des Hindous, par E. Gibelin, t. II, p. 226.)
[17] Nous avons exposé l'organisation de la commune russe ou mir dans nos Questions d'économie politique et de droit public. L'abolition du servage en Russie, t. Ier, p. 133.
[18] Ce droit de préférence ou de préemption, au profit du seigneur, passa ensuite du seigneur au roi lorsque celui-ci eût acquis un pouvoir prépondérant. Il subsista en Russie jusqu'au dix-septième siècle. « Le czar exerçait un droit de préemption sur toutes les marchandises, tant indigènes qu'étrangères. Aucun marchand étranger ne pouvait vendre à d'autres qu'au czar, quand il avait déclaré l'intention d'acheter ses marchandises. Le czar envoyait des agents dans les provinces pour y acheter, à des prix minimes et arbitraires, les produits les plus remarquables qu'il revendait ensuite avec un bénéfice considérable aux marchands indigènes ou étrangers, »
(H. Scherer, Histoire du commerce. Les Russes.)
[19] « Ce n'est qu'à une époque comparativement récente, dit M. Stuart Mill, que la concurrence est devenue, dans une proportion considérable, le principe régulateur des contrats. Plus nous nous reportons à des époques reculées de l'histoire, plus nous voyons toutes les transactions et tous les engagements placés sous l'influence de coutumes fixes. La raison en est évidente. La coutume est le protecteur le plus puissant du faible contre le fort; c'est l'unique protecteur du premier lorsqu'il n'existe ni lois ni gouvernement pour remplir cette tâche. La coutume est la barrière que, même dans l'état d'oppression la plus complète de l'espèce humaine, la tyrannie est forcée jusqu'à un certain point de respecter. Dans une société militaire en proie à l'agitation, la concurrence libre n'est qu'un vain mot pour la population industrieuse; elle n'est jamais en position de stipuler des conditions pour elle-même au moyen de la concurrence : il existe toujours un maître qui jette son épée dans la balance, et les conditions sont celles qu'il impose. Mais, bien que la loi du plus fort décide, il n'est pas de l'intérêt, et, en général, il n'est pas dans les habitudes du plus fort d'user à outrance de cette loi, en poussant ses excès aux dernières limites; et tout relâchement en ce sens tend à devenir une coutume, et toute coutume à devenir un droit. Ce sont des droits qui ont cette origine et non la concurrence sous aucune forme, qui déterminent, dans une société grossière, la part de produits dont jouissent les producteurs. »
(john Stuart Mill, Principes d'économie politique, liv. II, chap. iv.)
[20] La corporation était un petit État industriel ou commercial, avec sa constitution, ses lois, son gouvernement, son ressort ou son domaine approprié, exactement comme l'était le domaine de l'État politique ou de l'Église. Elle était propriétaire de son marché et le défendait contre les empiétements intérieurs ou extérieurs, comme on défend toute propriété; en même temps, elle s'efforçait de l'exploiter de la matière la plus profitable. On la voit apparaître, dès la naissance de la petite industrie, dans les anciens empires, en Grèce, à Rome, mais c'est au moyen âge, du onzième au treizième siècle, avant l'avènement des progrès qui devaient amener sa dissolution, qu'on l'observe dans son plein développement. Elle a été la forme d'organisation adaptée à l'industrie dans cette phase intermédiaire où, d'une part, l'état peu avancé du matériel et des procédés de la production industrielle et commerciale restreignait la multiplication des produits et des services; où, d'une autre part, l'insuffisance de la sécurité et des moyens de communication bornait étroitement l'étendue des marchés; où, sous l'influence de ces deux causes, chaque branche de travail se trouvait en possession d'un « monopole naturel », presque inaccessible à l'action de la concurrence. A défaut de ce propulseur et de ce régulateur naturel de la production et de la distribution dela richesse, il fallait bien recourir à une organisation artificielle qui pût en tenir lieu, et tel a été l'objet de l'ensemble des institutions, des règlements et des coutumes qui ont constitué le régime des corporations.
Nous ne connaissons guère, jusqu'à présent, ce régime, et nous ne le jugeons que d'après les attaques et les critiques passionnées auxquelles il a été en butte de la part des économistes du dix-huitième siècle. Ces attaques et ces critiques étaient certainement des mieux fondées à l'époque où elles se produisaient : les découvertes et les inventions, qui ont donné naissance à la grande industrie, commençaient à faire sentir leur influence, le matériel de la production se transformait, les marchés s'agrandissaient et la concurrence apparaissait comme un stimulant énergique, sinon encore comme un régulateur efficace. Dans ces circonstances nouvelles, l'ancienne organisation, viciée d'ailleurs par d'inévitables abus, n'était plus qu'un obstacle; elle empêchait ou retardait l'application des inventions, issues du progrès extraordinaire des sciences physiques, qui transformaient le matériel et les méthodes de la production; elle neutralisait l'effet des progrès qui avaient agrandi les marchés par la découverte de denrées et de régions nouvelles, le développement de la sécurité et des moyens de communication. Le régime des corporations cessait, en un mot, d'être adapté à l'industrie renouvelée et aux débouchés agrandis. Comme tant d'autres institutions, après avoir été nécessaire, il devenait nuisible.
Mais, si l'on remonte au douzième siècle, époque où il était arrivé à son apogée chez les nations les plus riches et les plus civilisées, on demeurera frappé de la merveilleuse sagesse de ses arrangements et de leur parfaite adaptation à l'état de l'industrie et de la société.
Chaque marché étant naturellement limité et peu susceptible de s'étendre, il fallait que le nombre des entreprises ou des maîtrises fut limité aussi, de manière à ne point dépasser les besoins restreints et presque invariables de la consommation. Les maîtrises existantes se perpétuaient ordinairement par voie de succession ou d'achat, et des mesures restrictives de diverses sortes étaient opposées à la création des nouvelles maîtrises, qui auraient diminué la part de chacune dans la clientèle formant la propriété commune et indivise de la corporation; parfois même, elle était formellement interdite. En tous cas, on limitait le nombre des apprentis, en veillant à ce que l'apprentissage fut sérieux; on exigeait de l'aspirant à la maîtrise qu'il exécutât un « chef-d'œuvre », attestant qu'il était rompu à la pratique du métier; on exigeait encore qu'il possédât, outre la capacité, le capital nécessaire à l'établissement d'une maîtrise; on lui imposait, enfin, en sus des droits ou redevances exigés par le seigneur, une contribution qui peut être considérée comme le prix d'achat de sa participation à la clientèle commune.
« Aucune maître, dit M. Ouen Lacroix, ne pouvait avoir d'apprenti s'il ne tenait une boutique ou un atelier sur rue, conséquence nécessaire de l'instruction due à l'élève, qui ne pouvait se former sans l'exercice actuel et assidu du travail dans toutes les parties du métier; en outre, chaque maître ne pouvait en occuper qu'un seul pour la plupart des métiers, ou deux pour certaines branches d'art plus étendues. Cette prescription avait sans doute pour but d'empêcher le trop grand nombre des apprentis qui, ne pouvant obtenir des places de maîtres, seraient condamnés à rester toute leur vie sans emploi, formant ce qu'on appelait alors les faux ouvriers.
« Les fils de maîtres demeuraient affranchis de l'asservissement à l'apprentissage, parce qu'on supposait apparemment que, nés dans une profession à laquelle ils se destinaient, ils en seraient suffisamment instruits par leurs parents; de plus, il paraissait juste que les pères de famille qui avaient servi le public pendant de longues années possédassent, comme récompense, ce moyen facile et ce privilège avantageux d'établir leurs enfants.
« Le temps de sa première instruction terminée (trois, quatre, quelquefois cinq ou sept années), l'élève devait encore, avant de devenir maître, passer quelques années dans l'exercice du métier, non plus gratuitement et sous le nom d'apprenti, mais avec des gages fixes et le titre de compagnon.
«... Lorsque le maître avait reçu chez lui un apprenti, il lui devait le logement, la nourriture, l'instruction exacte dans toutes les parties du métier, et une bienveillance presque paternelle. En retour, l'apprenti devait au maître, honneur, soumission et le service gratuit de son temps d'apprentissage. Si quelque différend s'élevait entre eux, on en référait aux gardes qui, tout en punissant les apprentis rebelles et coupables, surent aussi, en plus d'une rencontre, déployer une équitable rigueur contre des maîtres durs et méchants qui regardaient leurs jeunes apprentis, moins comme des enfants à instruire, que comme des machines dont ils extrayaient, avec une inhumaine avidité, la plus grande somme possible de gain et de bénéfice. Les statuts n'accordaient aux maîtres le droit de prendre un apprenti à leur service, qu'après la seconde année de leur entrée dans la maîtrise. C'était une disposition singulièrement favorable à l'apprenti, puisqu'en recevant son instruction d'un maître plus expérimenté, et déjà éprouvé par deux années de commerce, elle n'en devenait que plus solide et plus profonde. » [FN21: OuEn Lacroix, Histoire des anciennes corporations d'arts et métiers et des confréries reiigieuses de ta capitale de la Normandie.]
« Le titre de maître, dit à son tour M. Levasseur, ne s'obtenait pas gratuitement; pour exercer une profession, il ne suffisait pas d'avoir été apprenti ou valet, il fallait presque toujours payer au seigneur, payer au métier, payer même à chaque confrère, et se soumettre à de nombreuses formalités. A Paris, par exemple, uue partie des métiers appartenaient au roi, qui vendait aux ouvriers le droit d'exercer. C'est ce qu'on appelait» acheter le métier du roi »... Enfin, certains métiers étaient soumis à d'autres exigences : c'est ainsi qu'on ne pouvait devenir mesureur de blé ni jaugeur sans en avoir reçu l'autorisation du prévôt des marchands et des jurés de la corporation.
« Dans toute profession, on voulait au moins que tout artisan qui prenait un établissement eût l'habileté et l'argent nécessaires pour le bien diriger. C'est ce que déclarent positivement, et presque toujours dans les mêmes termes, la plupart des statuts : « Quiconque veut estre de tel mestier, estre « le puet portant qu'il sache le mestier et ait de coi ». Le plus souvent, c'était par l'apprentissage que le candidat prouvait sa science; les maîtres du métier étaient juges de sa richesse. D'autres fois, on faisait examiner le nouveau venu : ainsi, un cuisinier, fils de maître, qui ne savait pas encore suffisamment travailler, était forcé de faire tenir sa maison par un ouvrier expert, jusqu'à ce que les maîtres du métier l'eussent reconnu capable d'exercer par lui-même. Chez les tisserands de lange (drapiers), on n'admettait à la maîtrise que les seuls fils de maîtres.
« Quand l'artisan avait obtenu du roi et des corps de métier la permission de commencer son commerce, il devait, dans le délai de huit jours, se présenter pour être admis dans la corporation. La réception avait lieu en séance solennelle. Le maître du métier, ou son délégué, lisait à haute voix et expliquait les statuts et les règlements de la société. Le récipiendaire jurait sur les reliques des saints qu'il les observerait fidèlement et qu'il exercerait sa profession avec loyauté. On payait ensuite le droit de réception : les crieurs devaient quatre deniers au maître de la corporation, les ouvriers de draps de soie et les braliers, dix sous; les épiciers, vingt sous. Les menuisiers donnaient cinq sous pour boire aux compagnons. Dès lors, le nouveau venu était inscrit au nombre des associés. » [FN22: E. Levasseur, Histoire des classes ouvrières en France, liv. III, chap. III. Les Corps de métiers.]
Mais il ne suffisait pas de limiter le nombre des entreprises ou des maîtrises dans un marché naturellement borné et considéré comme une propriété collective, il fallait encore veiller à ce que nul n'empiétât sur la part de ses co-partageants en travaillant davantage et mieux, ou bien en réalisant des bénéfices frauduleux et nuisibles à la communauté par l'altération de la qualité de ses produits. De là, toute une série de dispositions fixant les procédés et les méthodes de fabrication, la durée de la journée de travail, les jours de chômage et jusqu'à la manière d'appeler les chalands.
« La corporation voulait le monopole pour elle, dit M. Levasseur, mais elle ne voulait pas qu'un de ses membres l'accaparât à son profit et au détriment des autres. De là, les règlements qui défendent expressément à plusieurs artisans de s'associer ensemble, qui limitent le nombre des ouvriers que chacun peut employer, des métiers qu'on peut faire battre dans sa maison... Nul ne pouvait s'élever beaucoup au-dessus des autres; chacun travaillait de ses mains, dans son atelier, à côté de ses ouvriers dont il se distinguait à peine.
«... Afin de maintenir chaque artisan dans les limites de ses droits et de l'empêcher de nuire au commerce de ses confrères, les statuts lui défendaient d'appeler de loin les chalands, de les détourner de la boutique du voisin et de leur faire des offres de service au moment où ils étaient en marché avec un autre. » [FN23: Ibid. Liv. III, chap. v. ]
« Les lettres de maîtrise conféraient à leur possesseur un droit imprescriptible sur toutes les branches du métier. Le maître pouvait étendre son trafic selon les ressources de son activité ou le nerf de sa fortune, mais il ne devait jamais s'écarter des règles imposées, concernant la nature du trafic, la forme ou les dimensions de l'ouvrage. Toute innovation lui demeurait interdite. Si les gardes le surprenaient travaillant à une fabrication hasardeuse, ils le condamnaient inévitablement à l'amende et à la confiscation de son ouvrage.
«... Les jours et les heures de travail étaient fixés par les règlements. La durée du jour naturel était la règle la plus commune : le dimanche et les fêtes, aucun coup de marteau ne devait troubler les rues paisibles de la cité. Tout travail public ou particulier était strictement défendu à peine d'amende. Si un maître, cédant aux tentations d'une cupidité immodérée, exécutait quelque ouvrage dans le recoin protecteur d'une chambre ignorée, ce n'était jamais qu'au milieu des soucieuses angoisses d'un criminel, qu'un voisin soupçonneux ou un rival jaloux se plaisaient malignement à livrer entre les mains des gardes et des magistrats.
« Les heures de travail dans la semaine variaient suivant la nature des occupations de chaque métier : pour plusieurs, notamment pour les orfèvres et les drapiers, on les avait limitées sur le cours du soleil, en interdisant à ces artisans le travail nocturne. Les huchers et menuisiers ne pouvaient commencer avant cinq heures du matin, ni aller au delà de neuf heures du soir.
« ... Enfin, les ateliers des orfèvres devaient être placés en un lieu apparent sur la voie publique, afin de leur enlever ainsi la facilité d'une fabrication frauduleuse . » [FN24: OUen Lacroix, Histoire dss anciennes corporations, etc.]
A plus forte raison, chaque corporation devait-elle veiller avec un soin jaloux à ce que les autres « états » qui avoisinaient le sien dans le marché, aussi bien que les industriels, les artisans ou les marchands du dehors, n'empiétassent point sur sa clientèle. On s'est beaucoup amusé des procès interminables, engagés entre les boulangers et les pâtissiers, les cordonniers et les savetiers, etc., sur les limites naturelles de leurs professions, mais, si l'on n'oublie pas que chaque corporation était propriétaire de la clientèle afférente à son « état », ces procès sembleront moins singuliers. On s'expliquera aussi que les produits ou les services venant du dehors fussent strictement prohibés, et que les chefs des corporations exerçassent à cet égard une surveillance rigoureuse. Les marchandises importées dans le domaine de la corporation étaient saisies et détruites, et telle a été la véritable origine du régime prohibitif; ce régime servait à garantir la propriété du marché et, à ce titre, il eut pleinement sa raison d'être aussi longtemps que subsistèrent les corporations.
Ajoutons que ce droit de propriété, que chacun de ces petits États industriels exerçait sur son marché, était considéré, dans les idées du temps, comme aussi nécessaire et aussi légitime que l'est encore, dans les idées de notre époque, le droit d'un État politique sur son domaine. Toute violation en était réprimée par les « gardes du métier » et, au besoin, par les membres de la corporation. M. Ouen Lacroix cite, à cet égard, des exemples caractéristiques:
« En 1630, on apprend l'arrivée, dans le port, d'un navire anglais chargé de 100,000 livres de drap. Le monopole des drapiers allait gravement en souffrir; ceux de Rouen et de Darnétal se réunissent donc à la hâte, partent en troupes serrées de la Croix de Pierre, se dirigent, les uns, vers le Parlement pour réclamer contre l'usurpation des drapiers anglais, qui apportaient volontiers leurs draps à Rouen, mais faisaient confisquer ceux que les Rouennais expédiaient en Angleterre; les autres, vers les quais où ils brûlent les balles déjà débarquées, se ruent dans les barques, envahissent le vaisseau anglais, déchirent les balles qui y restent encore, et les jettent à l'eau. Ni arquebusiers, ni soldats ne purent suspendre un moment leur prompte vengeance. Les remontrances elles-mêmes du procureur général Brétignières demeurèrent impuissantes à calmer ces artisans, dans l'âme desquels la défense de leur monopole excitait une si vive effervescence. On remarqua qu'ils ne s'approprièrent aucune des pièces de ce drap étranger, ni ne touchèrent au plomb et à l'étain qui composaient, avec le drap, le chargement du navire.
« En 1631, Blackford, marchand anglais, débarqua sans autorisation, sur les quais de Rouen, plus de onze cents livres de chandelles fabriquées en Angleterre. Les gardes chandeliers saisirent les caisses, ordonnèrent que cent livres de cette chandelle étrangère seraient donnés a quatre couvents mendiants, et le reste, leur part réservée, vendu au public à trois sols la livre.
« Les règlements des badestamiers défendaient l'introduction, dans Rouen, des bas fabriqués au dehors. En 1782, les gardes, avertis de la violation de cette loi prohibitive si importante à la conservation de leur art, s'embusquèrent vers les parages où s'arrêtait ordinairement le bateau de Bouille, afin de surprendre les contrebandiers qu'on disait venir par cette voie. En effet, un paysan chargé d'un pesant paquet s'achemina mystérieusement vers la demeure du bonnetier Vauquelin. Les badestamiers, observateurs attentifs de ses démarches, le suivirent et pénétrèrent dans la boutique du bonnetier au moment où il déballait le paquet frauduleux. A la vue des gardes, le fraudeur prit la fuite, le bonnetier resté seul, appela son garçon de magasin, et, avec son aide, repoussa les gardes, les accabla d'injures grossières et finit par les jeter brutalement sur le pavé. Les badestamiers portèrent leurs plaintes devant le Parlement, qui condamna l'insolent bonnetier à cinq cents livres d'amende, à la confiscation des bas saisis et à plusieurs jours de prison. »
Voici, enfin, un exemple emprunté au même auteur, et qui montre que les corporations ne faisaient aucune distinction entre les nationaux et les étrangers, en défendant leur marché:
« La race pauvre et voyageuse des Auvergnats, usurpant quelquefois les privilèges des chaudronniers rouennais, fut opiniâtrement traquée par les gardes du métier. Ces malheureux ouvriers se réfugiaient chez quelques fermiers des faubourgs ou de la banlieue de Rouen. Les chaudronniers obtinrent un arrêt, en 1751, qui défendait à tout laboureur ou aubergiste de recevoir les Auvergnats, sous peine d'une amende de cent livres, ou tout au moins de les loger plus de vingt-quatre heures. Un de ces pauvres Auvergnats, sorti de l'hôpital depuis à peine six semaines, ayant été pris par les gardes dans la rue Malpalu, au moment où il criait : Oh! chaudronnier! fut impitoyablement condamné à quitter la ville sous trois jours. »
Enfin, cet ensemble de dispositions et de règles exigeait un gouvernement. Comme tous autres États, la corporation avait le sien:« Toute société a besoin de chefs et d'administrateurs : le corps de métier avait les siens. On les appelait tantôt conseils, tantôt prud'hommes, bai les, maîtres du métier, eswards ou élus, et quelquefois ils portaient indifféremment l'un ou l'autre nom. Quelques corporations n'avaient qu'une seule espèce de magistrats; la plupart en avaient deux : les magistrats supérieurs qui, désignés le plus souvent sous le nom de maîtres du métier, possédaient les pouvoirs, et les magistrats inférieurs, eswards, élus, gardes ou même prud'hommes, qui n'étaient que les assesseurs des premiers; ils exerçaient la surveillance, faisaient les visites et dénonçaient les coupables aux magistrats supérieurs. Qu'ils fussent d'une ou de deux espèces, les chefs de la corporation avaient pour mission de surveiller le travail, de vérifier la qualité des produits, de dénoncer les fraudes et les abus, de présider à toutes les solennités du corps; ils exerçaient eux-mêmes une certaine juridiction sur les maîtres et sur les compagnons. Dans la plupart des métiers, ils étaient au nombre de deux ou de quatre; cependant on en trouve souvent trois et six; dans certaines corporations, il n'y en avait qu'un seul; dans d'autres, il y en avait jusqu'à douze. Le mode d'élection ne variait pas moins; tantôt le prévôt de Paris, ou l'un des grands officiers de la couronne, les nommait et les cassait à son gré; tantôt la communauté tout entière s'assemblait pour les élire; tantôt les prud'hommes désignaient eux-mêmes leurs successeurs. Ils étaient généralement renouvelés chaque année. Il y avait certaines professions dans lesquelles les femmes étaient admises à ces fonctions, et, alors, elles prenaient le titre de maltresses du métier ou de preudes femmes. Quiconque était élu ne pouvait se dispenser d'accepter; il devait jurer de bien remplir son devoir et veiller aux intérêts communs, même aux dépens de son temps et de ses intérêts particuliers. En retour, il jouissait de privilèges qui rendaient sa charge un peu moins onéreuse : outre l'honneur qui lui en revenait, il était exempt du guet et même, dans plusieurs corporations, il avait le cinquième des amendes. Dans les communes libres, ils avaient bien d'autres privilèges. Ici, ils formaient une sorte de conseil municipal; là, ils étaient directement les chefs de la cité. » [FN25: E. Levasseur, Histoire des classes ouvrières en France.]
Telle était l'économie générale du régime des corporations. A défaut de la concurrence, les prix étaient fixés, sous ce régime, par la coutume, le plus souvent non écrite, mais parfois aussi spécifiée sous la forme d'un règlement ou d'un tarif et rendue obligatoire par l'autorité de la commune. Il semblerait, au premier abord, que des corporations investies de la propriété de leur clientèle eussent le pouvoir de fixer ces prix au-dessus du taux nécessaire pour couvrir leurs frais et rétribuer leur industrie, mais, si une corporation avait abusé de ce pouvoir, toutes les autres, dont les membres étaient ses consommateurs, n'auraient pas manqué de réagir contre cet abus. Les prix fixés par la coutume ou les règlements étaient donc, généralement, ceux qui, dans l'opinion de la communauté, étaient considérés comme justes et nécessaires.
Ainsi, la coutume protégeait, sous ce régime, le consommateur contre l'abus que les maîtres ou les entrepreneurs, associés pour l'exploitation du marché, auraient pu faire de leur monopole; elle protégeait aussi les ouvriers ou compagnons, réunis d'ailleurs, de leur côté, en sociétés de compagnonnage et en confréries. Sociétés de compagnonnage et confréries n'avaient pas moins que les corporations leur raison d'être : non seulement, elles préservaient les ouvriers ou compagnons de l'exploitation des maîtres, mais encore elles établissaient entre eux une association de secours mutuels et une certaine discipline de mœurs. Elles les soumettaient, sous ce dernier rapport, à une tutelle qui leur a manqué plus tard. La célèbre association des tailleurs de pierre, de Strasbourg, par exemple, n'admettait aucun membre vivant en concubinage; elle ne recevait, de même, que ceux qui remplissaient ponctuellement leurs devoirs religieux; enfin, elle excluait ceux qui étaient convaincus de risquer leur argent au jeu.
Malgré ses imperfections et ses abus, cette organisation était aussi bien adaptée que possible à l'état de l'industrie et des marchés. Elle est tombée en ruine lorsque la grande industrie et la concurrence ont fait leur apparition. Peut-être eût-il été sage d'attendre qu'elle se transformât d'elle-même, à mesure que l'industrie se développait et que les marchés s'agrandissaient, au lieu de l'abattre, par voie révolutionnaire, avant que les garanties qu'elle offrait aux classes industrieuses pussent être remplacées. On eût évité ainsi une période de transition pénible et désastreuse. Mais, est-il besoin de remarquer qu'en essayant de la rétablir, on commettrait le plus maladroit et le moins excusable des anachronismes? Depuis que les industries naguère incorporées ont cessé d'être des monopoles naturels, il n'y a plus lieu de les soumettre au régime approprié au monopole. Ce régime n'aurait d'autre résultat, désormais, que d'empêcher leurs progrès et de retarder le développement de la nouvelle organisation adaptée à la grande industrie et à la concurrence.
[26] « Je considère, dit l'abbé Dubois, la division des castes comme le chefd'œuvre de la législation indienne, sous plusieurs rapports... Nous pouvons juger de ce que seraient les Indous, s'ils n'étaient pas contenus dans les bornes des devoirs sociaux par les règlements des castes, d'après ce que sont les peuples qui les avoisinent... et encore en considérant ce que sont les parias de l'Inde qui, ne connaissant aucun frein moral, peuvent se livrer à leurs penchants naturels. Toute personne qui a examiné la conduite et les mœurs de cette classe d'individus, classe qui est la plus nombreuse dans l'Inde, conviendra, je pense, qu'un état formé de pareils citoyens ne saurait subsister et ne pourrait manquer de tomber bientôt dans la barbarie... Je ne suis pas moins convaincu que si les Indous n'étaient pas contenus dans les bornes du devoir et de la subordination, par le système de la division des castes et par les règlements de police propres à chaque tribu, ces peuples deviendraient dans peu de temps ce que sont les parias, et peut-être pires encore.
« Les législateurs indous étaient trop sensés et connaissaient trop bien le génie et les penchants des peuples auxquels ils donnaient des lois, pour qu'ils laissassent à l'arbitraire et au choix de chacun la culture des sciences et l'exercice des diverses professions, des arts et des métiers nécessaires à la conservation et au bien-être de la société. Ils partirent de ce principe, commun à tous les anciens législatéurs, qu'il n'est permis à personne d'être inutile à l'État; mais ils virent en même temps qu'ils avaient affaire à un peuple d'un naturel si indolent et si insouciant, dont le penchant à l'apathie était tellement favorisé par le climat, que s'ils n'assignaient à chacun son emploi et sa profession d'une manière toute particulière, la société ne saurait subsister, et qu'ils devaient s'attendre à voir bientôt ce peuple tomber dans la plus parfaite anarchie et, de là, dans un état de barbarie complet. Ces législateurs, connaissant aussi les dangers des innovations en matières religieuses et politiques, et voulant établir des règles durables et imprescriptibles parmi les diverses castes qui composent la nation indoue, ne virent pas de plus sûr moyen pour parvenir à ce but que d'unir d'une manière inséparable ces deux grandes bases de la civilisation, la religion et la politique. Ainsi, il n'est aucun de leurs usages anciens, aucune de leurs pratiques, qui n'ait la religion pour principe et pour fin. La manière de se saluer, celle de se vêtir, la forme des habillements, des joyaux et des autres parures; leur ajustement et les divers détails de la toilette; la façon de bâtir les maisons, le coin où doit être placé le foyer, celui où l'on doit mettre les vases du ménage; la manière de se coucher et de dormir; les règles de la civilité et de la politesse qui doivent régner parmi eux; tout, en un mot, est réglé par la superstition et a la religion pour objet. »
(L'abbé J. A. Dubois, Mœurs, institutions et cérémonies des peuples de l'Inde.)
[27] Dans l'antiquité, le nombre des objets de commerce était très limité. Le thé, le café et le sucre, la pomme de terre, le beurre, la bière et les spiritueux, soit plus de la moitié du commerce actuel, étaient inconnus des anciens. Leur régime alimentaire se composait presque exclusivement de pain, de viande, de poisson, de légumes, d'huile, de vin, de fromage, de lait et de miel, denrées que chaque pays produisait bien ou mal. Il n'y a de distinction à faire que pour un seul article : le blé. Certaines villes, situées dans une contrée stérile, comme Athènes, ou devenues excessivement populeuses, comme Rome, ne pouvant se suffire avec la production du pays, furent obligées d'acheter leur pain à l'étranger. Ainsi l'approvisionnement de Rome, au temps de l'Empire surtout, constitua une des branches du commerce maritime les plus importantes... Le cercle des consommateurs était aussi borné dans l'antiquité que celui des articles du commerce international. Il suffit, pour s'en convaincre, de jeter les yeux sur un relevé des marchandises étrangères importées à Athènes, à Rome ou ailleurs. Nous y voyons figurer des métaux et des pierres précieuses, des épices, de l'encens et des drogueries, des tissus de soie, de coton et de laine de l'espèce la plus fine, des pelleteries, de l'ivoire, des comestibles délicats, des esclaves, des animaux sauvages pour le cirque, des objets d'art en bronze et en pierre, tous, plus ou moins objets de luxe et de confort, sans intérêt pour les masses, abordables seulement pour les privilégiés. D'importations de matières brutes, comme celles que nous tirons aujourd'hui des contrées les plus éloignées, il n'y a nulle trace.
( H. Scherer , Histoire du commerce. Aperçu général du commerce des temps anciens.)
[28] Parmi les théories auxquelles les crises ont donné lieu, la plus récente et non la moins originale est celle de M. Stanley Jevons, qui les attribue aux inégalités causées sur les « taches » dans l'émission de la chaleur du soleil.
«Les bonnes vendanges sur le continent d'Europe, dit-il (l'Économie politique, traduction de M. Henry Gravez), et les sécheresses dans l'Inde, reviennent tous les dix ou onze ans, et il semble probable que les crises commerciales sont reliées à une variation périodique du temps, affectant toutes les parties du globe, et qui provient sans doute d'un accroissement dans les couches de chaleur reçues du soleil, à des intervalles moyens de dix années et une fraction. Une provision plus grande de chaleur augmente les récoltes, rend le capital plus abondant et le commerce plus lucratif et aide ainsi à créer ces espérances d'où sort la fièvre de la spéculation. Une diminution dans la chaleur du soleil amène de mauvaises récoltes et dérange beaucoup d'entreprises dans les différentes parties du monde. On peut alors prévoir la fin de la fièvre et une crise commerciale. »
Seulement, il faudrait établir que les variations périodiques du commerce coïncident exactement avec celles du temps. Or, d'après un statisticien des plus autorisés, M. Maurice Block (Revue des publications économiques étrangères. Journal des Économistes, juin 1879) cette coïncidence n'est établie que par à peu près. « Que dirait-on, ajoute-t-il, de journées capricieuses de 23 heures, 24 heures, 25 heures, ou d'années astronomiques inégales? Mais admettons qu'il y ait le plus souvent coïncidence entre les taches solaires et une mauvaise récolte, cela ne prouverait nullement qu'il y a un rapport entre les deux faits, ce serait comme si post hoc était toujours propter hoc. Les famines sont tantôt l'effet de la pluie, tantôt l'effet de la sécheresse; d'un autre côté, la même année peut être excellente dans une contrée et mauvaise dans l'autre, c'est pourtant le même soleil qui agit. »
[29] Dans toutes les parties de l'Europe, dit Adam Smith, pour un ouvrier qui est indépendant, il y en a vingt qui servent sous un maître; et partout, quand on parle du salaire du travail, on entend ou l'on suppose deux personnes, l'ouvrier et le propriétaire de capitaux qui l'emploie. Ce qui décide partout du salaire ordinaire du travail, c'est le contrat fait ordinairement entre ces deux personnes, dont les intérêts ne sont point du tout les mêmes. Les ouvriers veulent gagner le plus, les maîtres donner le moins qu'il se peut. Ils sont disposés à se liguer, les uns pour hausser, les autres pour baisser le prix du travail.
Il n'est pas difficile de prévoir de quel côté doit rester ordinairement l'avantage et quelle est celle des deux parties qui forcera l'autre à se soumettre aux conditions qu'elle impose. Les maîtres étant en plus petit nombre, il leur est bien plus facile de s'entendre. D'ailleurs, la loi les autorise, ou du moins ne leur défend pas de se liguer, au lieu qu'elle le défend aux ouvriers. Nous n'avons point d'acte du parlement contre la conspiration de baisser la main-d'oeuvre et nous en avons plusieurs contre celle de la hausser. Ajoutons que dans ces sortes de disputes, les maîtres peuvent tenir bien plus longtemps. Un propriétaire, un fermier, un maître manufacturier, un marchand peuvent généralement vivre une année ou deux des fonds qu'ils ont par devers eux, sans employer un seul ouvrier. La plupart des ouvriers ne pourraient pas subsister une semaine, fort peu l'espace d'un mois et presque aucun l'espace d'un an sans travailler. A la longue, le maître ne peut pas plus se passer de l'ouvrier que l'ouvrier du maître. Mais le besoin qu'il en a n'est pas si urgent.
Il est rare, dit-on, qu'on entende parler d'une ligue de la part des maîtres, et on parle souvent de celles que font les ouvriers. Mais quiconque imagine là-dessus que les maîtres ne s'entendent pas, connaît aussi peu le monde que le sujet dont il s'agit. Il y a partout une conspiration tacite mais constante parmi les maîtres pour que le prix actuel du travail ne monte point. S'écarter de cette loi ou convention tacite est partout l'action d'un faux-frère et une sorte de tache pour un maître parmi ses voisins et ses égaux. Il est vrai qu'on entend rarement parler de cette ligue, parce qu'elle est d'usage et qu'elle n'est, pour ainsi dire, que l'état naturel des choses qui ne fait point sensation. Les maîtres se concertent aussi quelquefois pour faire baisser le salaire du travail au-dessous de son prix actuel. Ce projet est conduit dans le plus grand silence et le plus grand secret jusqu'au moment de l'exécution, et si les ouvriers cèdent sans résistance, comme il arrive quelquefois, quoiqu'ils sentent toute la rigueur du coup, le public n'en parle point. Cependant, ils opposent souvent une ligue défensive et dans certaines occasions ils n'attendent pas qu'on les provoque; ils forment d'eux-mêmes une conspiration pour que les maîtres augmentent leur salaire. Les prétextes ordinaires dont ils se servent sont, tantôt la cherté des denrées, tantôt la grandeur des profits que les maîtres font sur leur ouvrage. Mais, soit que leurs ligues soient offensives ou défensives, elles font toujours grand bruit. Pour faire décider promptement la question, ils ne manquent jamais de remplir le monde de leurs clameurs et ils poussent quelquefois la mutinerie jusqu'à la violence et aux outrages les moins pardonnables. Ils sont forcenés et agissent avec toute la folie et l'extravagance de gens désespérés qui se voient dans l'alternative de mourir de faim ou d'obtenir sur le champ par la terreur ce qu'ils demandent à leurs maîtres. Ceux-ci, de leur côté, crient tout aussi haut et ne cessent d'invoquer le magistrat civil et l'exécution rigoureuse des lois portées avec tant de sévérité contre les complots des domestiques, des ouvriers et des journaliers. En conséquence, les ouvriers ne retirent presque jamais aucun avantage de la violence et de ces associations tumultueuses qui, généralement, n'aboutissent à rien qu'à la punition et à la ruine des chefs, tant parce que le magistrat civil interpose son autorité que parce que les ouvriers sont dans la nécessité de se soumettre pour avoir du pain.
(adam Smith, Richesse des nations, 1. Ier, chap. viii.)
[30] Comme toutes les autres statistiques officielles, les statistiques de l'administration de la justice, malgré l'abondance des chiffres qu'elles étalent, ne contiennent pas les renseignements que le public des justiciables serait intéressé à y trouver. On n'y rencontre, par exemple, que bien rarement des indications propres à établir l'efficacité réelle de l'instrument de la répression. C'est ainsi que nous n'avons trouvé que dans une ancienne statistique belge et dans une récente statistique anglaise, le nombre des crimes dont les auteurs sont restés inconnus, c'est-à-dire le seul chiffre d'après lequel on puisse apprécier le degré d'efficacité de la justice répressive. On va voir, au surplus, pourquoi l'administration ne tient pas généralement à porter ce renseignement à la connaissance du public.
« Dans la période de 1840 à 1849, écrivions-nous dans le journal VÈconomiste belge, en analysant l'Exposé décennal de la situation du royaume de Belgique, le nombre des crimes dénoncés à la justice a été de 12,795. Sur ce nombre, 3,188 seulement, impliquant 4,986 accusés, ont été portés devant les tribunaux. 11 y en a eu 9,607 dont les auteurs sont restés inconnus. En admettant que la proportion des accusés soit la même pour les crimes restés inconnus que pour les autres, on aurait donc 15,025 individus qui auraient échappé à l'action de la police judiciaire. Ainsi, d'emblée, nous trouvons que les Trois Quarts du nombre des crimes dénoncés à la justice échappent complètement à son action répressive; nous trouvons que sur quatre criminels il y a trois qui lui restent inconnus. Ce n'est pas tout. Sur les 3,188 accusations dont les cours d'assises ont été saisies, sur les 4,986 accusés qu'elles ont eu à juger, il y a eu 1,410 acquittements et 235 contumaces. Ainsi donc, sur un chiffre probable de 20,011 auteurs ou complices des crimes commis dans la période de 1840-49, 3,341 seulement, c'est-à-dire un sur six, ont été atteints et punis. Encore sommes-nous obligés d'admettre, pour arriver à cette proportion, que les tribunaux ont été infaillibles dans leurs jugements, qu'il ne leur est point arrivé de condamner des innocents.
« Tel a été le bilan général des opérations de la police judiciaire et de la justice criminelle dans la période de 1840-49. « Entrons maintenant dans quelques détails. Examinons d'abord quelquesuns des principaux articles de la formidable liste des crimes dont les auteurs sont restés inconnus, et comparons-les aux articles correspondants de la liste des crimes portés devant les cours d'assises.
Auteurs restés mis en inconnus. jugement.
| Auteurs | ||
| restés inconnus | mis en jugement. | |
| Assassinat | 55 | 177 |
| Empoisonnement | 21 | 17 |
| Infanticide | 126 | 86 |
| Meutre | 105 | 234 |
| Avortement | 28 | 5 |
| Incendie | 1,507 | 160 |
| Vol de nuit à l'aide d'effraction, fausses clefs, etc. | ||
| Id. dans une maison habituée | ||
| Id. sur un chemin public | 7,266 | 2,605 |
| Id. avec circonstances aggravantes | ||
« Il ressort de ce tableau comparatif que de toutes les catégories de criminels, les assassins sont ceux que l'action de la justice atteint de la manière la plus efficace, la plus complète; en revanche, qu'elle est beaucoup moins efficace contre le vol, et qu'elle demeure presque impuissante contre l'incendie. Mais, il y a encore un autre enseignement à tirer de ce tableau, c'est qu'il se commet un bon nombre de crimes dont la justice n'a même pas connaissance, et qui doivent, en conséquence, grossir dans une proportion qu'il est impossible d'apprécier, le nombre des « crimes dont les auteurs sont restés inconnus ». C'est ainsi, par exemple, qu'alors que les incendies figurent dans le tableau pour un nombre total de 1,667, nous n'y voyons figurer que 33 avortements, c'est-à-dire un peu plus de trois avortements par année pour une population de près de 4,500,000 individus. D'où provient la différence si considérable qui existe entre ces deux chiffres? Uniquement de ce que l'incendie est un crime visible, un crime qui se dénonce de lui-même, tandis que l'avortement est un crime caché, et qu'il est nécessaire de rechercher. La police judiciaire, si mal faite qu'elle soit, ne peut ignorer qu'un incendie a été commis. Il en est autrement pour l'avortement et pour les autres crimes dont la recherche est plus ou moins difficile. Si l'avortement était un crime visible comme l'incendie, ce ne serait point par unités ou par dizaines qu'il se compterait, mais par centaines ou par milliers. Il y a donc, comme on voit, à ajouter à la formidable liste des « crimes dont les auteurs sont restés inconnus », une autre liste peut-être encore plus longue sinon plus effroyable, celle des crimes dont la justice n'a pas eu connaissance.
« Mais laissons de côté, et les crimes que la justice voit sans en découvrir les auteurs, tels que les incendies, et ceux qu'elle ne voit même pas, tels que les avortements; arrêtons-nous à ceux dont la répression est la plus efficace, à l'assassinat, à l'empoisonnement, à l'infanticide et au meurtre, et recherchons comment sont punis ces crimes que l'on poursuit avec un soin particulier; examinons, par exemple, jusqu'à quel point le métier d'assassin peut être considéré en Belgique comme une profession dangereuse.
« Sur un nombre total de 826 assassinats, meurtres, etc., venus à la connaissance de la justice, en 1840-49, il y a eu 311 condamnations à mort et 23 exécutions seulement. 23 exécutions sur 826 assassinats, cela fait 1 sur 36 environ, et cela signifie qu'un homme qui en assassine un autre ne court qu'un risque sur trente-six d'être retranché, à son tour, du nombre des vivants.
« Examinons maintenant quelle est l'intensité des risques qui pèsent sur les industries dites dangereuses, et prenons pour exemple la plus importante de ces industries, celle de l'extraction de la houille. Dans la période de 1835 à 1844, sur laquelle nous avons des renseignements détaillés, cette industrie a employé 45,000 ouvriers, dont 35,000 à l'intérieur des exploitations. Dans la même période de dix années, les accidents dans l'intérieur des mines de houille ont fait 2,035 victimes, dont:
| Tués | 1,175 |
| Blessés | 860 |
| Total | 2,035 |
« En ne comptant que les tués, nous avons 1,175 victimes sur 35,000 ouvriers, c'est-à-dire 1 sur 30, tandis que nous ne comptons parmi les assassins, dans la période de 1840-49, qu'une « victime » de la peine de mort sur 36. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, dans la Belgique civilisée, le métier d'assassin est moins périlleux que celui d'ouvrier mineur; cela signifie qu'une compagnie d'assurances sur la vie qui assurerait des assassins et des ouvriers mineurs, pourrait demander aux premiers une prime inférieure à celle qu'elle serait obligée d'exiger des seconds; cela signifie qu'il est plus dangereux de s'exposer au grisou qu'à la guillotine.
« Jetons maintenant un rapide coup d'oeil sur les conséquences de la déplorable inefficacité de l'administration de la justice. Ces conséquences peuvent être rangées en trois catégories:
« 1" Insuffisance de la sécurité pour les personnes et les propriétés;
« 2° Barbarie nécessaire des peines;
« 3° Cherté de l'appareil destiné à protéger les personnes et les propriétés.
« Nous n'avons pas besoin d'insister sur le dommage matériel que cause à la société tout entière l'insuffisance de la sécurité accordée aux personnes et aux propriétés; nous n'avons pas besoin d'insister non plus sur le mal moral qui résulte de la quasi impunité dévolue à certains crimes, tels que l'avortement et l'incendie, et de la répression incomplète des autres. Passons donc à l'influence qu'exerce l'inefficacité de la recherche et de la répression des crimes sur la pénalité elle-même.
« Depuis un siècle, la pénalité a été considérablement adoucie. La torture a été abolie, le régime pénitentiaire amélioré, la peine de mort moins prodiguée, et tous les jours des écrivains, animés d'une louable philanthropie, demandent que ce vestige des époques de barbarie soit effacé de nos codes.
« La statistique criminelle a démontré, disent-ils, que le crime suit tou« jours la progression de la peine, et qu'il est d'autant plus implacable que « celle-ci est plus terrible. »
« Nous leur en demandons bien pardon, mais les crimes n'étaient point jadis nombreux et atroces parce que la pénalité était cruelle; ils l'étaient quoique la pénalité fut cruelle. S'il en était autrement, en effet, si les crimes croissaient avec la rigueur des peines, le procédé à suivre pour diminuer le nombre des crimes et les rendre moins atroces, serait simple et commode. Il suffirait d'adoucir la pénalité et finalement de la supprimer. Il suffirait de bannir les gendarmes, les geôliers et les bourreaux de notre société pour en bannir du même coup les assassins et les voleurs. Or, les philanthropes euxmêmes conseilleraient-ils au gouvernement d'essayer de ce procédé-là?
« Non I ce n'était point la rigueur barbare des peines qui multipliait les crimes au moyen âge; c'était l'insuffisance, la corruption, parfois même l'absence de la police. Qui donc ignore que les voleurs et les assassins étaient alors organisés en corporation, qu'ils possédaient, à Paris même, tout un quartier où la police ne s'aventurait point et où ils avaient leurs dépôts, leur arsenal et leurs écoles d'apprentissage? Qui ignore que leurs bandes infestaient les campagnes sans courir le risque d'y rencontrer la moindre escouade de gendarmes et que, dans les villes, nul ne s'avisait de leur disputer la voie publique, après le coucher du soleil? Quelquefois, cependant, l'audace des malfaiteurs devenait telle, qu'ils empêchaient même le recouvrement de l'impôt. Alors, le monarque s'émouvait et il envoyait ses gens d'armes faire des razzias, soit dans la cour des Miracles, soit dans les campagnes. Pendant huit jours, on pendait, on rouait, on tenaillait, on écartelait sur la place de Grève, et la population retrouvait un peu de sécurité; mais bientôt l'impression causée par ce terrible exemple s'effaçait, et les malandrins recommençaient leurs exploits un moment interrompus.
« Qu'en résultait-il? C'est qu'il était nécessaire de suppléer par Y intensité' des peines à leur incertitude et à leur rareté; c'est qu'on était obligé de punir de mort même de simples délits, et de déployer pour la répression des grands crimes tous les raffinements de la barbarie. Peu à peu, heureusement, l'administration de la justice s'est améliorée, et l'expérience a démontré que la sûreté et la régularité de la répression ont plus d'efficacité que l'intensité des peines. On a pu alors, sans inconvénient, adoucir la pénalité. Que le même progrès se poursuive ; que le risque que courent les auteurs d'attentats contre les personnes et les propriétés d'être saisis et frappés par la justice, au lieu d'être simplement de 1 sur 6, en moyenne, soit de 2, 3, 4 et 5 sur 6, et la pénalité pourra être de nouveau adoucie, sans qu'il en résulte aucun dommage pour la société. C'est ainsi que la peine de mort, par exemple, qui est aujourd'hui encore indispensable à la sécurité publique, pourra être abandonnée lorsque les assassins, au lieu d'avoir six chances contre une d'échapper à l'action de la justice, n'en auront plus qu'une contre six. C'est ainsi, pour tout dire, que les peines pourront diminuer d'intensité à mesure que l'application en deviendra plus assurée. »
Ce serait une erreur de croire que cet état de choses soit particulier à la Belgique. La justice répressive n'est pas plus efficace en Angleterre, et, d'après un relevé que nous empruntons à la Bibliothèque universelle et Revue suisse, il semble même que son efficacité ait diminué dans ces dernières années:
« En 1869, il y avait eu, à Londres, 14,258 attentats contre la propriété, ayant amené l'arrestation de 3,224 personnes, dont 2,331 ont été convaincues du délit dont elles étaient accusées. En 1878, le nombre des vols a été de 14,409. Cependant, la police n'est parvenue à arrêter que 2,536 personnes et elle n'a pu établir la culpabilité que de 1,886 d'entre elles. »
Les renseignements nous manquent pour la France, mais il est douteux que la répression y soit plus sûre qu'en Belgique et en Angleterre.
[31] L'incarnation la plus récente du socialisme, celle qui s'est produite dans la troisième session du Congrès des ouvriers socialistes réunis à Marseille, à la fin d'octobre 1879, c'est le collectivisme révolutionnaire.
Le but que se proposent les collectivistes révolutionnaires est spécifié dans la déclaration suivante:
« Les soussignés,
« Considérant que la question sociale ne sera résolue que lorsque chaque être humain, l'homme émancipé et la femme devenue son égale, sera arrivé à la satisfaction complète de ses besoins et au développement intégral de ses facultés,
« Déclarent
« Que la propriété individuelle, cause de l'inégalité matérielle et intellectuelle, ne peut assurer cette satisfaction et ce développement, et concluent à l'appropriation collective du sol, sous-sol, machines, voies de transport, bâtiments, capitaux accumulés au bénéfice de la collectivité humaine, seule manière possible d'assurer à chacun le produit intégral de son travail.
« Considérant:
« 1° Que la stérilité absolue des moyens de rachat, de coopération, d'alliance du capital et du travail est scientifiquement et expérimentalement démontrée;
« 2° Que l'impôt progressif ou fixe, de quelque façon qu'il soit perçu en l'état actuel, retombera toujours sur le consommateur, c'est-à-dire le travailleur;
« 3° Qu'une entente pacifique est impossible entre les détenteurs de la fortune publique et ceux qui la revendiquent justement, impossibilité trop démontrée par la différence des intérêts engagés, les soussignés déclarent que l'appropriation collective de tous les instruments de travail et forces de production doit être poursuivie par tous les moyens possibles. »
Il s'agit donc, avant tout, de s'emparer « par tous les moyens possibles » des instruments de travail et forces de production qui constituent aujourd'hui des propriétés individuelles pour en faire des propriétés collectives. Sous quelle forme? Qui sera propriétaire? Selon les uns, ce sera l'État; selon les autres, la commune, qui confiera ces instruments de travail et ces forces de production à des associations ouvrières, sans exiger d'elles aucune rétribution.
Cette conception ne diffère pas sensiblement de celle du communisme, tel qu'il florissait en 1840. Le nom seul est changé, et on pourrait remarquer, à ce propos, que les théories socialistes tournent perpétuellement dans le même cercle vicieux, et qu'à part l'impulsion qu'elles ont donnée aux études économiques, elles sont demeurées stériles.
L'influence du socialisme s'est cependant fait sentir dans la direction qui a été imprimée, dans ces dernières années, à l'économie politique. Une école, dite des socialistes de la chaire, s'est formée de l'autre côté du Rhin, qui a emprunté au socialisme l'idée de la tutelle de l'État ou de la commune, en l'opposant à celle du self government et en s'efforçant de la rendre pratique. Cette école a trouvé faveur auprès des politiciens qui sont naturellement portés à augmenter les attributions du gouvernement, dont ils constituent le personnel dirigeant, et, par conséquent, leur propre importance. Le socialisme de la chaire est devenu, pour tout dire, l'économie politique des politiques. Ce n'en est pas moins une économie politique fausse et rétrograde comme le socialisme dont elle procède.
Nous ne voulons pas dire, certes, qu'il faille bannir l'idée de tutelle, et nous nous sommes efforcé même, dans cet ouvrage, de démontrer que la tutelle n'a pas cessé d'avoir un rôle nécessaire au sein des sociétés les plus avancées; mais il y a tutelle et tutelle. Celle que le socialisme de la chaire prétend faire prédominer — la tutelle gouvernementale — est précisément la moins économique et la moins progressive.
[32] Par toutes les recherches que j'ai pu faire, depuis plusieurs années que je m'y applique, j'ai fort bien remarqué que, dans ces derniers temps, près de la dizième partie du peuple est réduite à la mendicité et mendie effectivement; que des neuf autres parties, il y en a cinq qui ne sont pas en état de faire l'aumône à celle-là, parce qu'eux-mêmes sont réduits, a très peu de chose près, à cette malheureuse condition; que des quatre autres parties qui restent, les trois sont fort maltraitées et embarrassées de dettes et de procès; et que, dans la dizième, où je mets tous les gens d'épée, de robe, ecclésiastiques et laïques, toute la noblesse haute, la noblesse distinguée et les gens en charge militaire et civile, les bons marchands, les bourgeois rentes et les plus accommodés, on ne peut pas compter sur cent mille familles; et je ne croirais pas mentir quand je dirais qu'il n'y en a pas dix mille, petites ou grandes, qu'on puisse dire être fort à leur aise; et qui en ôterait les gens d'affaires, leurs alliés et adhérents couverts et découverts, et ceux que le roi soutient par ses bienfaits, quelques marchands, etc., je m'assure que le reste serait en petit nombre.
(vauban, la Dime royale.)
[33] En permettant de produire en plus grande abondance et à moins de frais un nombre croissant d'articles de consommation, le progrès industriel a nécessité un agrandissement correspondant des marchés. Cet agrandissement, à son tour, nécessitait : 1° l'extension de la sécurité et le développement des moyens de communication; 2° la suppression ou tout au moins l'abaissement des obstacles artificiels, péages, douanes, etc., qui diminuaient l'étendue du rayon des échanges. Sous la pression visible ou latente de ces nécessités, la sécurité des personnes et des propriétés a été successivement garantie avec plus d'efficacité et dans une sphère plus vaste; les étrangers ont été admis au bénéfice des droits de propriété, d'établissement et autres — les droits politiques, à peu près seuls, encore exceptés — dont jouissaient les nationaux, tantôt avec réciprocité, tantôt même sans réciprocité, tandis que l'application de la vapeur à la locomotion détruisait, pour ainsi dire, l'obstacle des distances en créant un merveilleux appareil de moyens de transport rapides et à bon marché. En même temps, un mouvement général se produisait contre le régime de l'appropriation des marchés aux industries incorporées. Les servitudes que ce régime imposait aux consommateurs paraissaient naturellement plus lourdes à mesure que les progrès énumérés plus haut permettaient de se procurer au dehors, avec plus de facilité et à meilleur marché, les articles monopolisés. On autorisa d'abord l'établissement de foires où les marchandises de toute provenance pouvaient être librement apportées et vendues pendant une période de temps limitée; puis, les foires ne suffisant plus, on établit des marchés libres permanents, en dehors des cités où les corporations exerçaient leur monopole. L'industrie ne manqua pas d'y être attirée, car elle s'y trouvait affranchie des règles et des entraves gênantes qui caractérisaient le régime des corporations, mais cette « nouvelle industrie » n'était guère moins que l'ancienne, imbue de l'esprit de monopole; elle s'efforça d'exclure des marchés qu'elle s'était créés et qu'elle considérait comme siens, les produits des autres localités; les communications devenant de plus en plus faciles, il fallut même renforcer, en l'étendant, le vieil appareil défensif de la propriété des marchés. C'est ce qui a pu faire croire que le régime prohibitif ne datait que d'une époque relativement récente (le seizième siècle), tandis que ce régime est, en réalité, contemporain de l'organisation des corporations industrielles. On l'a élargi successivement en reculant les anciennes limites des marchés appropriés jusqu'à celles du canton, de la province et, finalement, de l'État, mais, en considérant les conséquences inévitables de l'avènement de la grande industrie et de la concurrence, nous pouvons prédire avec certitude qu'on ne s'arrêtera pas là.
Quelle était, en effet, la raison d'être du régime des corporations et de l'appropriation des marchés? C'était le monopole naturel dont jouissaient, à l'origine, toutes les branches d'industrie, et qui plaçait le consommateur à la merci du producteur. De là, la nécessité d'un système de garanties et de servitudes réciproques. L'industrie incorporée était soumise à un ensemble de coutumes et de règlements ayant pour objet d'assurer l'équilibre de la production et de la consommation, de préserver l'ouvrier de l'exploitation du maître et le maître de l'exploitation de l'ouvrier, de garantir la bonne qualité des produits et la modération des prix au profit du consommateur; en échange, et comme une condition essentielle du fonctionnement utile et régulier du système, on exigeait du consommateur la garantie de sa clientèle, autrement dit, on lui imposait, comme une servitude, l'obligation de s'approvisionner exclusivement auprès de l'industrie incorporée.
Ce régime était adapté aussi complètement que possible à la petite industrie, mais voici que le progrès et la concurrence surviennent. Aussitôt, la situation change. Les monopoles naturels sont entamés, et l'antique organisation qu'ils comportaient devient une entrave et une charge; elle ne tarde pas à être entamée à son tour; seulement, en se débarrassant des obligations et des gênes que ce régime leur imposait, les chefs d'industrie s'efforcent de maintenir celles qui pesaient sur les ouvriers et sur les consommateurs. Grâce à l'influence prépondérante qu'ils ont acquise, ils y parviennent, au moins d'une manière temporaire. Les coalitions et les « embauchements » d'ouvriers continuent à être interdits sous des pénalités rigoureuses, et les consommateurs restent soumis à l'obligation de s'approvisionner auprès de l'industrie cantonale, provinciale oh nationale, ou tout au moins de lui payer une redevance, chaque fois qu'il leur arrive d'acheter un produit étranger. Alors, les économistes réclament la suppression de cette servitude à laquelle le consommateur continue à être assujetti, en vue de protéger le producteur, tandis que les servitudes qui protégeaient le consommateur ont été abolies. Ils réclament d'abord en vain, tant les intérêts protectionnistes ont de cohésion et de puissance. Heureusement, le développement progressif de l'industrie et des moyens de communication leur vient en aide. A mesure que les marchés étrangers croissent en importance et sont rendus plus accessibles, les servitudes imposées aux consommateurs finissent par devenir onéreuses aux producteurs : en enchérissant leurs prix de revient, elles les placent dans des conditions d'infériorité sur les marchés de concurrence. Les industriels et les négociants exportateurs qui vont se multipliant, à chaque progrès de l'industrie, abandonnent le drapeau de la protection pour celui du libre échange, et l'abolition des servitudes douanières n'est plus alors qu'une question de temps. La cause de la liberté commerciale est gagnée.
Cette œuvre de démolition de l'ancien régime industriel et commercial est en voie de s'accomplir, malgré des temps d'arrêt et des retours, depuis la fin du moyen âge. Elle s'opère au moyen de trois procédés différents : les traités de commerce, les réformes indépendantes et les unions douanières. Le procédé des traités de commerce, le plus anciennement usité, consiste à admettre l'industrie d'un ou de plusieurs pays étrangers à entrer en partage du marché national, sous la condition de réciprocité; il implique le maintien de Vappropriation du marché et ne déroge à ce principe qu'en considération des avantages présumés supérieurs que la réciprocité confère à l'industrie indigène. Le procédé des réformes indépendantes, sinon inauguré, du moins systématisé en Angleterre par l'école du free trade, abaisse et simplifie les tarifs sans condition de réciprocité, en se fondant sur ce fait que l'appropriation du marché et les servitudes qu'elle implique sont désormais nuisibles, non seulement à la consommation, mais encore à la production dans l'ensemble de ses branches. Enfin, le procédé des unions douanières supprime la douane qui sépare deux provinces ou deux pays, et agrandit ainsi le marché intérieur tout en continuant à le séparer des autres marchés.
Ces trois procédés d'abaissement des tarifs et d'unification des marchés ont leurs avantages et leurs inconvénients. On reproche au système des réformes indépendantes de créer un état d'instabilité nuisible à l'industrie et au commerce, en ce qu'il laisse aux législateurs de chaque pays le droit de modifier, du jour au lendemain, les tarifs douaniers et de jeter parla même la perturbation dans les échanges internationaux. Le système des traités de commerce remédie, dit-on, à cet inconvénient en assurant, pour une période déterminée, l'industrie des pays contractants contre une aggravation des droits. Mais les traités de commerce finissent par écheoir et les intérêts protectionnistes se liguent alors pour empêcher ou retarder leur renouvellement. Il en résulte une situation provisoire qui est l'instabilité même. D'un autre côté, on exhausse le tarif général, et on établit des droits dits de combat en vue d'obtenir des concessions plus considérables de l'État avec lequel ou négocie; enfin, le système des traités de commerce implique la coexistence de deux ou trois tarifs : celui qui est appliqué aux nations avec lesquelles on a traité; celui auquel demeurent soumis les produits des nations avec lesquelles on n'a pas traité, enfin, celui qui est infligé aux nations avec lesquelles on est à l'état d'hostilité commerciale. Le système des unions douanières est préférable aux deux précédents, à la condition toutefois que le tarif de l'union ne dépasse pas la moyenne de ceux qu'il remplace; autrement l'avantage de l'agrandissement du marché intérieur pourrait ne pas compenser l'accroissement des entraves opposées au commerce extérieur.
Parmi les unions douanières qui ont été conclues depuis le dix-septième siècle, il faut citer d'abord celle par laquelle Colbert a commencé l'unification du marché français. Il réussit à faire accepter son tarif de 1667 par les provinces qui occupaient le centre de la France et qui étaient désignées sous le nom de provinces des cinq grosses fermes. Ces provinces constituèrent, dès lors, une véritable union douanière avec un tarif protecteur. Les provinces du midi, d'un côté, l'Artois et le Hainaut, de l'autre, conservèrent leurs anciens tarifs, et on les qualifia de provinces réputées étrangères. Venait ensuite une troisième catégorie dite d'étranger effectif qui comprenait l'Alsace, la Lorraine, le pays de Gex, Marseille, Dunkerque, Lorient, dont les provenances étaient complètement assimilées à celles de l'étranger. Ce régime subsista jusqu'à la Révolution française qui acheva d'unifier le régime commercial de la France. — En 1701, avait eu lieu l'union commerciale de l'Angleterre et de l'Ecosse. Celle des deux royaumes unis avec l'Irlande a été commencée en 1782, mais elle n'a été complétée que vers 1820, après avoir rencontré les résistances les plus opiniâtres de la part des manufacturiers et des agriculteurs anglais. « Une réforme qui mettrait l'Angleterre et l'Irlande sur le pied de l'égalité, disaient-ils, serait fatale aux manufactures et au commerce de l'Angleterre... Nos manufacturiers, nos négociants, nos armateurs, nos propriétaires de terres ont pris l'alarme, car tous comprennent qu'ils seront infailliblement ruinés si nous les exposons à la concurrence d'un pays à peu près sans dettes... » Des pétitions contre l'union arrivaient de tous les points du royaume. Les négociants de Glascow suppliaient le Parlement de n'accorder à l'Irlande, soit dans le présent, soit dans l'avenir, aucun avantage qui vînt tourner au détriment de la Grande-Bretagne. Manchester réprouvait énergiquement les concessions proposées et Liverpool n'hésitait pas à déclarer que si ces concessions étaient accordées son port ne tarderait pas à être réduit à sa primitive insignifiance. L'union s'opéra cependant, et Glascow, Manchester et Liverpool ne cessèrent point de voir s'accroître leur prospérité. — Mais la plus importante des unions douanières est celle qui a unifié commercialement, à partir du 1" janvier 1834, la foule des États de l'Allemagne (voir l'Allemagne économique, ou Histoire du Zoll-Verein allemand, par M. Emile Worms). Cette union est la première qui ait été conclue entre des États politiques différents. Est venue ensuite l'union douanière de la Russie et de la Pologne (1850), puis celle des États italiens (1860-1870), l'une et l'autre comme de simples conséquences de l'unification politique. En 1842, M. Léon Foucher publiait un projet d'une union douanière destinée à former la contre-partie du Zoll-Verein (l'Union du Midi, association de douanes entre la France, la Belgique, la Suisse et l'Espagne, avec une introduction sur l'union commerciale de la France et de la Belgique). D'autres projets d'unions, entre l'Espagne et le Portugal, la Belgique et la Hollande, etc., ont encore été formulés à diverses époques; enfin, l'auteur de ce livre a développé (Journal des Débats du 23 janvier 1879) un projet d'union douanière de l'Europe centrale, comprenant la France, la Belgique, la Hollande, le Danemark, l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, auxquels pourraient s'adjoindre ensuite les autres États du continent. Ce projet est fondé sur ce fait que le produit des douanes provient, pour la plus forte part, des denrées exotiques et que les autres articles, en exceptant seulement les produits de provenance anglaise qui arrivent par les frontières maritimes couvrent à peine leurs frais de perception, en sorte que si l'on supprimait les douanes intérieures qui séparent ces divers États, la quote-part qu'ils recevraient dans la totalité des produits de la ligne de ceinture commune équivaudrait au montant actuel de leurs recettes, peut-être même seraitelle supérieure. La faveur avec laquelle a été accueillie ce projet d'un ZollVerein continental atteste combien les douanes sont devenues gênantes et surannées, en présence du développement extraordinaire des moyens de communication et de l'extension du commerce international. On multiplie, disions-nous, les chemins de fer, les lignes de navigation à vapeur, on étend incessamment le réseau télégraphique, on perce des montagnes et des isthmes, on fait circuler l'électricité à travers les océans, on conclut des conventions postales et des unions monétaires; on n'épargne, en un mot, aucune peine et l'on ne marchande aucun sacrifice pour rapprocher les peuples et faciliter leurs relations. N'est-il pas contradictoire de maintenir sans nécessité, et à grands frais, des barrières douanières pour entraver d'un côté les rapports que l'on s'évertue d'un autre à multiplier? N'est-il pas absurde de payer à la fois des ingénieurs pour faciliter le transport des voyageurs et des marchandises, et des douaniers pour y faire obstacle? — La constitution d'une union douanière internationale rencontrerait, sans doute, des difficultés nombreuses, mais l'établissement du Zoll-Verein allemand n'a-t-il pas démontré que ces difficultés ne sont pas insurmontables? Enfin, le résultat qu'il s'agit d'atteindre n'est-il pas assez grand pour encourager des hommes d'État ayant le sentiment du progrès — s'il en existe — à surmonter les obstacles que la routine et les intérêts malentendus opposent à cette œuvre de civilisation? Tôt ou tard, d'ailleurs, les douanes seront emportées par le courant sans cesse grossissant, et finalement irrésistible, de la masse des intérêts issus de la grande industrie qui poussent à l'unification universelle des marchés.
[34] Voir, au sujet du progrès des instruments de circulation, notre Cours d'économie politique, t. II. Les intermédiaires du crédit.
[35] A mesure que se crée la nouvelle organisation adaptée à la grande industrie et à la concurrence, la nécessité du rouage intermédiaire du commerce du travail devient plus sensible. Nous avons analysé ailleurs (le Mouvement socialiste, suivi de la Pacification des rapports du capital et du travail) les causes naturelles et signalé les entraves artificielles qui ont retardé, jusqu'à présent, le développement de ce rouage indispensable en contribuant ainsi à fomenter l'antagonisme qui existe aujourd'hui entre les ouvriers et ceux qui les emploient. Cependant, il est dans la nature des choses qu'une institution nécessaire finisse, en dépit de tous les obstacles, par s'établir. D'abord insuffisante et imparfaite, elle ne manque pas de se compléter et de se perfectionner peu à peu. Les bureaux de placement et le marchandage, d'une part, les trades unions et les chambres syndicales d'ouvriers, de l'autre, peuvent être considérés comme les premiers rudiments de l'organisation du commerce du travail. Les trades unions et les chambres syndicales instituées par les ouvriers sous la forme coopérative, ont toutefois un caractère et des procédés qui appartiennent à la guerre plutôt qu'au commerce. Réussiront-elles à se transformer, de manière à remplir un jour entre l'ouvrier et l'entrepreneur d'industrie, les fonctions d'un intermédiaire neutre, comme l'est le marchand de grains, par exemple, entre le producteur et le consommateur de blé? Il est malheureusement encore permis d'en douter.
On trouvera dans la lettre suivante, écrite à l'occasion des grèves américaines de 1877, un aperçu sommaire des avantages que le développement normal de cette branche de commerce procurerait aux consommateurs aussi bien qu'aux producteurs de travail.
« A M. l'éditeur de l'Abeille de la Nouvelle-Orléans:
« Genève, 28 août 1877.
« J'ai lu avec un vif intérêt les réflexions si judicieuses que vous avez faites au sujet des grèves des employés des chemins de fer et des désordres dont elles ont été l'occasion à Baltimore, Pittsburgh, etc. « Quand le tra« vail fait une guerre aussi inintelligente au capital, dites-vous, il commet « un acte équivalent à un suicide, car, tandis qu'il accumule les ruines d'un « côté, il crée des souffrances et des misères sans nom, de l'autre. » Vous avez mille fois raison, et les grèves, sans parler des émeutes, ne peuvent qu'aggraver la situation des classes ouvrières.
« Mais les grèves ne sont que des accidents produits par un état de choses imparfait et vicieux; elles proviennent des mauvais rapports qui existent hélas! — les derniers événements ne l'attestent que trop — en Amérique, aussi bien qu'en Europe, entre les entrepreneurs et les ouvriers, entre le capital et le travail. Ces mauvais rapports sont-ils, comme l'affirment les socialistes, naturellement inhérents au régime actuel du salariat et faut-il, pour y mettre fin, changer l'organisation sociale? Faut-il exproprier les entrepreneurs au profit des ouvriers ou, comme on l'a soutenu au meeting de Tompkins Square, à New-York, confier à l'État l'exploitation des chemins de fer et les autres industries? Ces remèdes ne m'inspirent, je l'avoue, qu'une confiance médiocre. L'exploitation des chemins de fer et des industries par l'État et la transformation des ouvriers en fonctionnaires publics, m'inspirent même une méfiance positive. L'État a déjà toutes les peines du monde à assurer là sécurité publique — ce qui constitue sa mission spéciale — et à surveiller les faits et gestes de ses quelques milliers d'employés de tous grades. Que serait-ce donc s'il était chargé de transporter les voyageurs et les marchandises par terre et par eau, de fabriquer nos habits, nos chapeaux, nos bottes et le reste; s'il devait, enfin, empêcher des fonctionnaires qui se compteraient désormais par millions, de mettre indûment les mains dans les poches du public? Ne devrait-il pas posséder, pour remplir une pareille tâche à la satisfaction générale, une vigueur et une intelligence intiment supérieures à celles que le ciel lui a naturellement départies?
« Je ne crois point, pour ma part, que les mauvais rapports des entrepreneurs et des ouvriers puissent être améliorés par les procédés socialistes ou communistes, mais je ne crois pas davantage, avec les conservateurs pessimistes, qu'ils soient sans remède. Permettez-moi, en ma double qualité d'ancien employé dans une manufacture de coton et d'ancien professeur d'économie politique, de vous communiquer les résultats de mon expérience et de mes observations à cet égard.
« Les mauvais rapports des entrepreneurs avec les ouvriers proviennent de ce qu'ils sont directement en relations les uns avec les autres, et le plus souvent dans des conditions qui ne sont pas celles d'une pleine et loyale concurrence. Le travail, on l'a dit maintes fois, est une marchandise comme une autre, et le prix en est réglé, aussi bien que celui du coton, du sucre ou du drap, par la loi de l'offre et de la demande. Comment donc se fait-il que les rapports des producteurs et des consommateurs de coton, de sucre ou de drap ne soient jamais troublés par des coalitions et des grèves, et qu'on ne puisse constater entre eux aucune animosité analogue à celle qui existe trop fréquemment entre les ouvriers « producteurs de travail » et les entrepreneurs d'industrie « consommateurs de travail »? Cela ne tient pas, comme on serait tenté de le croire au premier abord, à ce que le coton, le sucre et le drap sont des marchandises d'une nature différente de celle du travail. Non! Il y a eu un temps où les mêmes mauvais sentiments qui se manifestent malheureusement aujourd'hui entre les entrepreneurs et les ouvriers existaient entre les producteurs et les consommateurs d'une denrée qui se rapproche beaucoup plus du sucre ou du coton que du travail : je veux parler du blé. A l'époque où la difficulté des communications, les entraves douanières et le manque d'informations morcelaient les marchés de consommation des subsistances de telle façon que la disette sévissait souvent dans une province, tandis que les provinces voisines étaient affligées d'une surabondance de récolte, l'harmonie était loin de régner entre les cultivateurs ou les marchands de grains qualifiés d'accapareurs et les consommateurs des villes. Les uns s'entendaient volontiers pour créer des disettes factices, autrement dit, pour mettre les subsistances en grève; en revanche, les autorités prenant en main la cause des autres, s'ingéniaient à inventer toute sorte de combinaisons restrictives et vexatoires pour obliger paysans et marchands de grains à apporter régulièrement et abondamment leurs denrées au marché, en les empêchant de les vendre ailleurs. Aujourd'hui, ces démêlés, qui ont duré des siècles, en provoquant des émeutes et des séditions qui ont coûté la vie à des milliers d'hommes, ne sont plus qu'un mauvais souvenir historique. La paix s'est faite entre les producteurs et les consommateurs de blé. Comment s'est-elle faite? A la suite de quels progrès? Tout simplement à la suite des progrès qui ont mis en communication les différents marchés et développé, au grand avantage des producteurs et des consommateurs, le commerce des grains. Chacun sait comment les choses se passent à présent. Grâce à la multiplication extraordinaire des moyens de locomotion parterre et par eau, grâce encore à l'abolition des lois-céréales, les grains peuvent être transportés plus rapidement, et à moins de frais, de la Californie et du Chili en Europe, qu'ils ne pouvaient l'être autrefois de la Normandie en Bretagne. Aussi n'avons-nous plus à craindre ni l'excès de la rareté si funeste aux consommateurs, ni l'excès de l'abondance si nuisible aux agriculteurs, ni les prix trop élevés ni les prix trop bas. Il y a un «marché général » dont le cours, établi d'après l'état des récoltes en Europe et en Amérique, constitue une moyenne et sert de régulateur aux prix de la multitude de petits marchés de consommation, sans qu'aucune manœuvre d'accaparement, aucune tentative de mise en grève des subsistances, ou bien encore aucun règlement de marché puisse y créer une hausse ou une baisse artificielle. En effet, si le prix d'un marché local tombe au-dessous du cours du marché général, les grains ne manquent pas de se porter ailleurs jusqu'à ce que le niveau soit rétabli; si le prix du marché local s'élève, au contraire, au-dessus du cours du marché général, les grains affluent dans cette localité favorable et leur affluence y provoque la baisse. Tous ces mouvements s'effectuent avec une rapidité et une sûreté vraiment merveilleuses. C'est une « révolution silencieuse » qui s'est accomplie à l'avantage de tous — résultat que n'obtiennent pas toujours les révolutions les plus bruyantes — qui a scellé, d'une manière définitive, la paix entre les producteurs et les consommateurs de blé, et dont le principal artisan a été, chose essentielle à remarquer, le plus impopulaire des intermédiaires, le marchand de grains. A mesure que le marché s'est étendu, le commerce des grains s'est développé; des maisons puissantes se sont établies pour le faire sur une grande échelle, et leur premier soin a été de se procurer rapidement et régulièrement des informations sur l'état des récoltes, sur les stocks existants, sur le mouvement des achats et des ventes, sur les variations des cours dans les différentes parties du marché général afin de régler leurs opérations en conséquence. Les journaux se sont faits les échos de ces informations que le télégraphe s'est chargé de transmettre, littéralement avec la rapidité de l'éclair. Peut-être l'habitude que nous avons de cette publicité commerciale, qui répand maintenant la lumière sur tous les marchés du monde et qui s'est successivement étendue à toutes les marchandises de grande consommation — le travail à peu près seul excepté — nous rend-elle inattentifs à ses mérites, mais pour peu qu'on se donne la peine d'y réfléchir, on acquiert la conviction qu'aucun progrès n'a été plus bienfaisant que celui-là. Non seulement cette masse d'informations que la publicité met au grand jour sert à guider les opérations du commerce, mais encore elle prévient une foule de tromperies et de manœuvres véreuses. En ce qui concerne particulièrement le commerce des grains, quelle lecture est plus instructive, pour le simple cultivateur de l'Iowa, du Wisconsin ou de l'Minois, que celle des mercuriales des grands marchés de l'Est et de l'Europe! Il y trouve des indications précieuses, qu'il n'aurait jamais pu se procurer lui-même, réduit à ses seules ressources. Il se fait au moins une idée approximative du prix qu'il peut raisonnablement demander pour sa récolte, et se trouve en mesure de contrôler les informations de fantaisie des amateurs peu scrupuleux de grains à bon marché.
« Eh bien! je le demande, pourquoi le « commerce du travail » ne se ferait-il pas comme se fait le commerce des grains, comme se font tous les autres commerces, par des intermédiaires bien pourvus de capitaux et ayant à leur service les moyens d'informations et la publicité nécessaires pour éclairer un marché qui est demeuré dans une obscurité presque complète? Comme je vais essayer de le démontrer, aussi brièvement que possible, cette machinery progressive ne rendrait pas aux entrepreneurs et aux ouvriers, autrement dit, aux consommateurs et aux producteurs de travail, des services moins considérables que ceux dont les agriculteurs et les mangeurs de pain lui ont été redevables; elle aurait pour résultat de pacifier leurs rapports en supprimant les causes de guerre qui existent entre eux comme elle a pacifié ceux des producteurs et des consommateurs de blé.
« Faisons une simple hypothèse. Supposons que des particuliers ou mieux encore des sociétés honnêtement constituées — je me plais à espérer que cette hypothèse ne vous paraîtra pas trop invraisemblable — s'établissent avec un capital suffisant, 500,000,1 million ou même 2 millions de dollars, pour faire le commerce du travail. Elles se présentent, d'une part, aux entrepreneurs d'industrie et elles leur tiennent le langage que voici:
« Vous employez régulièrement en moyenne 100, 200,500 ou 1,000 ouvriers. Vous êtes obligés, le plus souvent, de recruter ce personnel, individu par individu, sur le marché local où vous avez vos établissements. Faute de moyens d'information, peut-être aussi faute de temps, car votre attention est absorbée par les soins de votre fabrication, vous ne pouvez aller cher cher au delà de ce rayon borné les ouvriers capables et honnêtes dont vous avez besoin, vous ne pouvez non plus vous enquérir, autant que cela serait nécessaire, des antécédents de ceux que vous enrôlez. Dès qu'ils sont entrés dans vos ateliers, il faut que vous les fassiez rigoureusement surveiller s'ils travaillent à la journée; dans le cas où ils travaillent à la pièce, il faut encore que vous fassiez vérifier minutieusement leur ouvrage; et, cependant, s'il y a malfaçon, si, par négligence, mauvais vouloir ou incapacité, ils gâtent ou gaspillent la matière première, s'ils détériorent les outils et les machines, vous n'avez contre eux qu'un recours illusoire, vous devez presque toujours vous contenter de les renvoyer sans essayer de leur faire rembourser la perte qu'ils vous ont causée. Enfin, ce personnel, vous lui payez son travail individuellement et ordinairement à des échéances rapprochées, chaque semaine, chaque quinzaine ou, au plus tard, sauf pour les emplois supérieurs, chaque mois. Vos contremaîtres sont astreints à tenir une comptabilité compliquée, parfois aussi à discuter longuement et dans un esprit qui n'est pas toujours celui de la conciliation, des réclamations « plus ou moins fondées. Mais, ce qui est particulièrement onéreux et gênant « pour vous, c'est de devoir, en toute circonstance, payer comptant ou à peu près et en monnaie cette masse de salaires. Vous êtes obligés d'augmenter, en conséquence, votre capital circulant, ce qui renchérit d'autant votre prix de revient, et, si vous éprouvez des pertes ou des retards dans vos rentrées, vous vous trouvez dans la nécessité de subir les dures conditions des prêteurs d'argent pour satisfaire les réclamations d'ailleurs fort légitimes de vos ouvriers. A quoi il faut ajouter que ce contact et ce conflit permanents d'intérêts, entre eux et vous, ne peut guère engendrer autre chose que des griefs et un mauvais vouloir réciproques. Ils sont à votre merci dans les moments de dépression industrielle ou commerciale, mais si vous cédez à la tentation d'abuser ou même d'user des avantages de votre situation, ils ne manquent pas de vous en garder rancune : au moment où il vous arrive des commandes urgentes, où vous avez besoin du concours le plus assidu et le plus actif de vos ouvriers, ils se mettent en grève, et vous voilà dans l'impossibilité d'exécuter les ordres de votre clientèle, à la vive satisfaction de vos concurrents nationaux ou étrangers. Quelquefois la grève se complique d'une émeute : les ouvriers mécontents ne se bornent pas à abandonner à lui-même l'ouvrage pressé, ils brisent les machines et saccagent les ateliers.
« Voici, maintenant, ce que nous vous proposons pour remédier à ces inconvénients et à ces maux qui vont chaque jour s'aggravant davantage: nous nous chargerons de vous fournir, en gros, le travail que vous avez jusqu'à présent acheté en détail. Nous nous engagerons à mettre à votre disposition le personnel qui vous est nécessaire et à vous assurer la régularité de ses services. Nous surveillerons nous-mêmes l'accomplissement de sa tâche et nous en serons responsables: si des ouvriers gâtent ou dérobent la matière première qui leur est confiée, s'ils détériorent le matériel, etc., nous vous indemniserons pour le dommage causé; s'ils ne se rendent pas ponctuellement à l'atelier, s'ils se mettent en grève, nous les remplacerons, tout en subissant la responsabilité des pertes provenant de leur inexactitude ou de leur désertion. Enfin, nous rétribuerons nous-mêmes ce personnel, vous n'aurez autre chose à faire qu'à constater si le travail stipulé vous a été livré dans les quantités et les qualités requises; vous nous le paierez en bloc, au comptant ou à terme, comme vous payez les autres matériaux servant à votre industrie. »
« En admettant que les industriels « consommateurs de travail acceptent ces arrangements, les nouveaux intermédiaires se tourneront du coté des ouvriers « producteurs de travail ».
« Dans l'état actuel des choses, leur diront-ils, vous êtes obligés de chércher vous-mêmes le placement de votre travail, et il est bien rare que vous ayez le temps, les informations et les ressources nécessaires pour le porter dans les endroits où il peut être le mieux rétribué. Vous l'offrez donc sur place aux entrepreneurs d'industrie en nombre limité qui en ont l'emploi, et comme ils n'ignorent pas que c'est le besoin — et quelquefois un besoin urgent — qui vous pousse à frapper à la porte de leurs ateliers, ils sont naturellement tentés de profiter de cette fâcheuse circonstance pour vous faire la loi. D'ailleurs, ils sont dans leur rôle d'acheteurs en s'efforçant d'obtenir de vous la plus grande quantité possible de travail au moindre prix. Si le salaire qu'ils vous offrent est insuffisant, la nécessité où vous êtes de payer votre boulanger, votre boucher et votre logeur vous contraint à l'accepter quand même, sauf à exiger une hausse à la première occasion favorable. Si vous faites partie d'une trade union, votre situation est un peu meilleure à certains égards : vous n'êtes plus isolés, vous disposez de la puissance et des ressources de l'association dont vous êtes membres; en revanche, à d'autres égards votre situation est pire. Vous êtes à la discrétion des meneurs de l'association. S'ils décident une grève, vous voilà condamnés, vous et les vôtres, à subir des privations cruelles sans parler de la démoralisation qu'engendre l'oisiveté. Mais ils agissent en vue du « bien commun », et qui oserait leur désobéir? Si même ils vous ordonnent des actes que votre conscience réprouve, vous ne pouvez vous dispenser de les commettre sous peine de courir le risque dangereux de passer pour des faux frères et des traîtres. Vous n'êtes plus des hommes libres, vous êtes des esclaves! En tout cas, que vous soyez isolés ou associés, votre condition demeure toujours précaire, vous avez rarement de quoi pourvoir aux tristes mais inévitables éventualités des chômages et des maladies, et quand la vieillesse arrive, bien peu d'entre vous ont réalisé une épargne suffisante pour la passer dans un repos exempt de soucis.
« Eh bien! voici les services que nous pouvons vous rendre. Nous nous chargerons du placement de votre travail, moyennant une commission, ou, si vous le préférez, nous vous l'achèterons pour un temps déterminé, sauf résiliation du marché dans le cas où les conditions n'en seraient pas fidèlement remplies. Comme nous disposons de ressources que vous n'avez point, nous serons en mesure de traiter sur le pied de l'égalité avec les industriels et nous pourrons d'ailleurs leur offrir des garanties de responsabilité, une simplification de rouages et de facilités des paiement que vous n'êtes pas en position de leur donner. D'un autre côté, nos capitaux et nos moyens d'information nous permettront de connaître l'état de l'offre et de la demande et le taux des salaires dans les différentes parties du grand marché du travail; nous pourrons toujours porter cette marchandise dans les endroits où elle est le plus demandée, où, par conséquent, elle se vend le plus cher; nous pourrons encore obtenir, dans ce cas, des réductions sur les frais de transport, au moyen de conventions particulières avec les compagnies de chemins de fer et de navigation à vapeur, etc., etc. Cela nous donnera les moyens de couvrir nos frais et de recueillir les bénéfices ordinaires du commerce, tout en améliorant la situation des entrepreneurs d'industrie et la vôtre, en vous faisant profiter les uns et les autres du progrès que nous aurons réalisé par la séparation économique de la production et du commerce du travail. Si vous nous dites que vous n'aurez fait que changer d'exploitants, que nous abuserons à notre tour de notre situation et de nos capitaux pour vous faire la loi, nous vous répondrons que rien ne vous obligera à recourir à notre entremise, que vous pourrez toujours revenir au système des relations directes avec les entrepreneurs si vous le trouvez plus avantageux, qu'en tous cas, vous profiterez de notre publicité, que cette publicité même vous servira de sauvegarde contre l'abus de nos exigences en vous tenant au courant de la situation et des prix du marché, enfin que la concurrence agira dans le commerce du travail comme elle agit dans tous les autres pour réduire les bénéfices du commerçant au taux de la rétribution nécessaire de ses services. »
« J'ajoute que des sociétés de trade labor pourraient rendre des services encore beaucoup plus étendus et considérables à certaines catégories de travailleurs et à ceux qui les emploient. Pendant l'intéressant voyage que j'ai eu l'occasion de faire, l'année dernière, dans les États du Sud, j'ai été douloureusement ému de la condition misérable et de plus en plus dégradée de la grande majorité du peuple de couleur; je n'étais pas moins frappé, en même temps, des plaintes provoquées par l'irrégularité et l'infériorité du travail du nègre libre. La conclusion à laquelle m'ont conduit mes observations assurément fort impartiales, c'est que les nègres capables de se gouverner eux-mêmes ne constituent encore qu'une très faible minorité, c'est que la grande masse est encore littéralement dans l'enfance et, par conséquent, que le self government privé, sans parler du self government public, lui est aussi nuisible qu'il pourrait l'être à nos enfants de huit à dix ans, enfin, que si ce régime devait se perpétuer, la race nègre finirait immanquablement par s'éteindre en Amérique. A mes yeux, une « tutelle » lui est indispensable dans l'intérêt de sa propre conservation. Cette tutelle, l'esclavage la lui procurait sous une forme grossière et barbare. Des sociétés de trade labor pourraient la lui procurer sous une forme en harmonie avec la justice et la civilisation.
« Mais cet aspect de la question m'entraînerait trop loin et je m'aperçois que cette lettre est déjà d'une longueur inusitée. Il ne me reste qu'à m'excuser de l'avoir écrite, au risque de passer pour un utopiste, en dépit de ma qualité de professeur d'économie politique. On ne manquera pas de me dire, en effet, que si le progrès dont je viens de vous entretenir était réalisable, il serait, selon toute apparence, déjà réalisé. A quoi je me bornerai à répondre que l'on tenait, il a un siècle, précisément le même langage aux économistes qui entrevoyaient les bienfaits du développement futur du commerce des grains, alors frappé de la plus complète impopularité. Le commerce du travail flétri en Europe du nom de marchandage n'est pas moins impopulaire aujourd'hui que ne l'était du temps de Quesnay et de Turgot le commerce des grains. Aux yeux des philanthropes, qui ont pour spécialité de résoudre toutes les questions économiques et autres au moyen du sentiment sans tenir compte de la science, le commerce du travail n'est et ne peut être qu'une des formes de la traite; aux yeux des socialistes, il aie vice irrémédiable d'impliquer la multiplication de ces odieux « intermédiaires » qui sont les sangsues du peuple et qu'il faut, au contraire, se hâter de supprimer pour mettre le producteur directement en rapport avec le consommateur; aux yeux des consommateurs routiniers, enfin, il a le défaut d'être en dehors de la routine et il est bien clair que tout ce qui est en dehors de la routine ne peut être que chimérique et subversif.
« Il n'en est pas moins certain que le jour où quelque homme d'affaires entreprenant, comme les États-Unis en comptent par milliers, trouvera que le commerce du travail « paie », ce commerce sera entrepris, et je suis persuadé que ce jour-là un pas décisif aura été fait vers la pacification des rapports du capital et du travail.
« G. DE MOLINARI. »
[36] Dans une communication intéressante, faite à la Société d'économie politique (séance du 5 juillet 1879), sur la situation agricole et la condition des ouvriers de la Russie méridionale, M. Edmond de Molinari, fils de l'auteur de ce livre, a signalé ce progrès caractéristique des consommations et des habitudes de la classe ouvrière, émancipée du servage:
« Les ouvriers fixés depuis plusieurs années dans les fabriques, dont la position s'est améliorée, grâce à leur assiduité, leur travail et leur bonne conduite, se détachent peu à peu de la foule des ouvriers ordinaires pour former un groupe à part, une petite bourgeoisie, peu nombreuse encore, mais qui s'accroît chaque jour. La formation de cette petite bourgeoisie se remarque principalement dans les fabriques situées dans les villes ou dans leur voisinage. Cette classe nouvelle fait société à part et se considère comme appartenant à un degré supérieur de la hiérarchie sociale. Les petits Russiens qui recrutent cette nouvelle classe changent volontiers leur costume national, la blouse et les bottes traditionnelles, pour le costume européen, tandis que les ouvriers venus de la grande Russie conservent plus longtemps leur vieux costume. Cette élite de la classe ouvrière semble avoir à cœur de donner à ses enfants l'instruction dont elle a été privée; elle paraît en apprécier l'utilité et surtout elle la considère comme un moyen d'élever leur condition au-dessus de son propre niveau. C'est un nouvel élément social d'une valeur incontestable qui est en voie de formation. »
(Journal des Économistes, juillet 1879. Communication de M. Edmond de Molinari à la Société d'économie politique.)
[37] On trouvera l'exposé complet de la doctrine de Malthus, avec les éclaircissements qu'elle comporte et les polémiques auxquelles elle a donné lieu, dans le savant ouvrage de M. Joseph Garnier, Du Principe de la population.
[38] Les travaux de MM. Bachofen (Das Mutterrecht, Stuttgart, 1861), Mac Lennan (Primitive Marriage, Edimburg, 1865), A. Giraud-Teulon (les Origines de la famille, Genève, 1874) et de plusieurs autres savants, ont remis en question la constitution originaire de la famille. Il ressort de leurs recherches que le mariage, c'est-à-dire l'union exclusive d'un homme avec une ou plusieurs femmes, aurait été inconnu aux troupeaux primitifs de notre espèce. On doit admettre cependant que ces troupeaux se sont succèssivement constitués par la réunion d'individus épars, et qu'entre ces individus appartenant aux deux sexes, il existait au moins des unions temporaires, dans lesquelles le mâle pourvoyait, comme dans les espèces inférieures, aux besoins de sa femelle et de ses petits. Telle est, du reste, l'opinion de M. Giraud-Teulon. « Les premières tentatives de mariage, dit-il, ont été des unions temporaires : chez les Hurons, les unions ne sont souvent valables que pour quelques jours. Aux îles Andaman, la vie conjugale d'un homme et d'une femme prend fin, soit à la naissance de l'enfant, soit à son sevrage. » Les familles isolées se sont ensuite fondues dans les troupeaux primitifs, sous l'empire du besoin de sécurité, quoiqu'on ne puisse affirmer que ce fait ait été général. Il est présumable que le régime des unions n'était pas plus uniforme qu'il ne l'est encore de nos jours, mais la promiscuité ou, pour mieux dire, la polyandrie dans le troupeau primitif était, selon toute apparence, le fait le plus commun.
Sur ce point, comme sur bien d'autres, l'économie politique peut apporter un utile contingent de lumières à l'anthropologie. Des troupeaux d'hommes à peine en possession d'un armement et d'un outillage rudimentaires, réduits à la subsistance précaire que pouvaient leur procurer la chasse et la récolte des fruits naturels du sol, entourés de dangers de toute sorte, dépourvus d'ailleurs de prévoyance, comme le sont encore les sauvages, ne pouvaient subvenir qu'avec une extrême difficulté à l'élève des enfants, en les préservant des causes de destruction qui menaçaient leur frêle existence. Ils se débarrassaient donc des nouveau-nés qu'ils ne pouvaient nourrir, et ils sacrifiaient de préférence les filles, que la délicatesse de leur tempérament rendait plus difficiles à élever et qui n'étaient point propres d'ailleurs à concourir au même degré que les garçons, à la défense commune:
« ... Il est possible, dit M. Giraud-Teulon, que l'infanticide des filles ait été déterminé par la pauvreté dans les populations primitives. Chez les Todas du sud de l'Inde, cet usage a été observé de temps immémorial, et n'a pris fin que récemment, grâce aux efforts de l'administration anglaise. Les Todas ne conservaient qu'une fille ou deux par famille; toutes les autres étaient sacrifiées. Le colonel Marshall prétend que la pratique régulière de l'infanticide des nouveau-nés féminins, pendant une longue série de siècles, s'est imprimée dans le caractère physiologique de cette population :
« La tendance à procréer des mâles a fini par devenir une caractéristique fixe des Todas et par former une variété d'hommes produisant spécialement des individus du sexe masculin. » Actuellement, chez eux, les hommes sont aux femmes dans les proportions de 100 à 75. Un vieux Toda, interrogé par l'auteur, lui disait que, dans sa jeunesse, c'était la coutume de tuer les filles. « Je ne sais pas, ajoutait le vieillard, si c'était juste ou non; mais nous ne pouvions pas entretenir nos enfants; aujourd'hui, chacun de nous possède un manteau, mais autrefois nous n'en possédions qu'un pour toute la famille, et celui qui avait à sortir prenait le manteau; les autres restaient tout nus à la maison... » « En Chine, dit M. de Hùbner (Promenade autour du monde), jamais on n'expose les enfants mâles, à moins que la misère, l'impossibilité absolue de les nourrir n'y contraignent leur père. Les filles, considérées comme une charge, sont jetées dans la rue ou dans la rivière, ou bien enterrées vives... » Ailleurs, comme aux iles Fidji, l'infanticide des filles est pratiqué sous le prétexte qu'elles sont inutiles à la guerre. » (giraud-teulon, les Origines de la Famille, p. 127.)
De là, l'habitude du rapt. On trouvait plus de profit à enlever aux autres tribus des femmes tout élevées que de supporter les frais et risques de l'élève. Plus tard, quand l'homme eut commencé à sortir de l'animalité, quand il se fut aperçu que le procédé de l'échange était, dans bien des cas, plus avantageux que celui du vol ou du rapt, on acheta les femmes dans les endroits où elles revenaient le moins cher, de même qu'aujourd'hui les herbagers achètent le bétail au lieu de l'élever.
M. Mac Lennan attribue l'origine de la coutume de l'exogamie (unions avec des femmes prises en dehors de la tribu) à la rareté effective des femmes dans les populations primitives où le défaut de balance entre les deux sexes contraignait les hommes à se procurer, hors de la tribu, le nombre de femmes nécessaire. L'infanticide des individus féminins a été, pense-t-il, aux époques sauvages, pratiqué sur une large échelle, par la raison que les femmes ne pouvaient être au sein d'une horde qu'une source de faiblesse, un appât pour les peuplades voisines, excitées à enlever des jeunes filles nubiles chez leurs ennemis plutôt qu'à les élever pour leur propre compte.
«... Quelle que soit, dit encore M. Giraud-Teulon, la raison qui ait donné naissance à cet usage, le rapt ou l'enlèvement des femmes par la violence a eu, dans les temps reculés, la valeur d'une institution parfaitement régulière pour acquérir des épouses, et a été, aux époques anciennes, si général, qu'on peut présumer qu'il a été imposé par la nécessité de se procurer des femmes hors de la tribu; sans cette nécessité, les hommes n'eussent pas été chercher des femmes chez leurs ennemis au péril de leurs jours. Le rapt se pratique encore, dans toute sa brutalité, en Australie, dans la Nouvelle-Zélande, sur plusieurs îles du Pacifique et dans l'Amérique du Sud. Et l'on doit admettre que, lorsque chez un peuple le symbole du rapt fait partie intégrante des cérémonies du mariage, la coutume du rapt a antérieurement prévalu, ce qui lui assigne dans l'antiquité une zone des plus étendues : l'enlèvement simulé de la fiancée s'observe, en effet, dans l'Inde, dans l'intérieur de l'Asie, chez les Malais, en Afrique, et, enfin, chez les anciens Grecs et Romains. »
A quoi on peut ajouter que l'habitude d'enfermer les femmes, qui s'est perpétuée dans les pays orientaux, a eu probablement pour origine la nécessité de dérober aux recherches ce bétail volé, comme aussi de l'empêcher de fuir.
Cependant, le recrutement des femmes au moyen du rapt ne pouvait donner que des résultats insuffisants et incertains. Le nombre des mâles demeurait généralement supérieur à celui des femelles; d'où la nécessité de la polyandrie dans les limites de la tribu, telle qu'on l'observe encore chez certaines tribus sauvages:
« A l'origine, le mariage, comme la propriété, était l'affaire de toute la tribu : il comportait un grand nombre d'ayants-droit. Lorsqu'un des membres de la communauté enlevait une fille à quelque autre peuplade, toute la tribu l'épousait. De nos jours même, chez certaines hordes sauvages, toute femme est encore, de droit, l'épouse de tous les hommes de la tribu, et celle qui essaie de résister aux droits matrimoniaux de l'un des membres est passible d'une sévère punition. La notion de l'adultère n'apparaît que dans le cas d'une liaison avec un étranger. L'amiral de Wrangel a remarqué, chez les Indiens de la Californie supérieure, que les maris ne prenaient aucun ombrage des relations de leurs femmes avec d'autres hommes de la même tribu et que leur susceptibilité maritale s'éveillait seulement dans le cas où l'amant appartenait à une horde voisine. » (giraud-teulon, les Origines de la famille, p. 59.)
Mais la polyandrie, impliquant l'impossibilité de la reconnaissance de la paternité, avait, pour première conséquence, l'attribution exclusive de l'enfant à la mère, et l'établissement des degrés de la parenté seulement du côté maternel. Tel est le régime qui a généralement prévalu dans les temps primitifs, que l'on observe encore chez les Naïrs de l'Inde et chez un grand nombre de tribus africaines et polynésiennes.
« Chez les Naïrs — la haute caste de la population indigène du Malabar —la parenté paternelle, les droits de la paternité sont complètement ignorés: aucun Naïr ne connaît son père. Le mariage est pratiqué chez eux sous la forme de la polyandrie; la femme a droit d'épouser jusqu'à douze maris, quoiqu'elle se contente généralement de cinq ou six. Chacun d'eux cohabite avec elle, à tour de rôle, pendant une dizaine de jours, et Forbes (Oriental Memoirs) a remarqué que tous ces maris vivaient en parfaite intelligence: rarement ces ménages sont troublés par des querelles; d'ailleurs, un Naïr peut faire partie de plusieurs combinaisons matrimoniales. La femme, même après son mariage, continue à résider dans sa propre famille, avec sa mère et ses frères; ceux-ci vivent ordinairement sous le même toit, gouvernés par la mère ou par la sœur aînée... Aussi, chez les Naïrs, un homme considère-t-il les enfants de sa sœur comme les siens propres; ces derniers lui sont d'ailleurs le plus souvent totalement inconnus. Quant à ses neveux utérins, ils vivent et grandissent depuis leur plus tendre enfance auprès de lui — leurs rapports mutuels d'affection sont ceux du père et du fils dans nos sociétés — et enfin la loi elle-même, issue de ces mœurs, vient confirmer ces rapports étroits : elle constitue les enfants de la sœur les seuls héritiers de cet homme... Ce même droit successoral se retrouve dans les races les plus anciennes, et l'on pourrait, en le suivant à la trace, faire le tour du globe. Il est en vigueur parmi les populations indigènes de l'Inde, telles que les Cossyhas, les Kasias des Pandua Hills, les Kocchs et les Garos. Une antique légende du Maha-Bharata laisserait même supposer qu'il a prévalu parmi les populations vaincues par les Aryas, dans l'Inde. » (giraud-teulon, Ibid.)
Enfin, sous l'influence de la loi économique de l'offre et de la demande, la femme, étant rare dans les tribus primitives, devait y acquérir une valeur, et, par conséquent, une situation supérieure à celle de l'homme. Les témoignages abondent à cet égard, et l'on retrouve, notamment en Afrique, de nombreux vestiges de cette suprématie de la femme, due à sa rareté, aussi bien qu'à la constitution unilatérale de la famille. Cette situation privilégiée, elle devait la perdre lorsque les progrès de la production eurent permis de la multiplier davantage.
Ceci arriva lorsque les troupeaux primitifs eurent ajouté l'élève du bétail à leurs ressources alimentaires et surtout lorsque l'agriculture et les premiers arts eurent été inventés. A l'appropriation collective succéda peu à peu l'appropriation individuelle, déterminée par le changement survenu dans la nature des exploitations. Mais cette évolution ne s'accomplit que par degrés, et on peut en suivre les différentes phases, en ce qui concerne la propriété féminine. La collectivité n'abandonna point sans indemnité son droit sur les femmes de la tribu : ce droit dut être racheté, soit par le propriétaire exclusif, soit par la femme elle-même.
« Historiquement, dit M. Giraud-Teulon, le mariage, c'est-à-dire l'appropriation exclusive d'une femme par un seul possesseur, apparaît chez les races inférieures comme une infraction au droit de la communauté et, partant, comme la violation d'une loi naturelle; de là à le considérer comme la violation d'une loi religieuse il n'y avait qu'un pas... Sous l'empire de pareils sentiments, le mariage nécessita, dans maintes contrées, une expiation et dut se payer au moyen d'un sacrifice momentané et quelquefois réitéré. La femme, pour se marier, fut astreinte à racheter par une période « d'hétai- risme », les bonnes grâces de la divinité offensée... C'était, au fond, un véritable tribut que l'on payait à la communauté lésée dans ses droits. »
Mais si « l'hétairisme » temporaire rachetait la femme, il laissait subsister les droits de la communauté ou de la parenté maternelle sur les enfants.
« En Afrique, sur toute la côte de Guinée, ainsi que parmi plusieurs tribus de l'intérieur, Bazes, Barea, Vouamrima, Kimbundas, Bassoutos, le frère de la mère possède les enfants de sa sœur en toute propriété, et jouit sur eux d'un pouvoir exorbitant : leur vie et leur liberté lui appartiennent sans contrôle; c'est lui, et non pas le père, qui a le droit de les vendre, droit imprescriptible, écrit Burton, qui s'exerce en dépit du père et de la mère, approuvé par l'opinion publique. Parmi presque toutes les populations chez lesquelles la filiation se transmet parles femmes, ce droit de famille a contribué à donner au frère de la mère le rôle et les droits dévolus au père et au mari dans la famille patriarcale. L'achat du droit d'épouser n'a donc pas, de tout temps, transmis au mari l'entière propriété, ni des enfants, ni de la mère, et l'on peut croire que l'antique mode de filiation par les femmes se perpétua jusqu'au jour où la vente transféra le domaine absolu à l'acquéreur. Aussi longtemps que subsista cette parenté utérine, l'autorité du mari sur les enfants et sur la femme fut dérisoire : l'organisation de la famille maternelle donnait à ses enfants, dans les frères de leur mère, des protecteurs nés contre la puissance paternelle, et sa femme elle-même invoquait, au nom de la parenté, le secours de ses proches contre son époux. En certaines régions, l'appui que la femme trouve dans sa propre famille est tel, qu'elle exerce une réelle tyrannie sur celui qui devrait être son maître, et le voyageur hongrois Magyar affirme que les femmes du royaume de Bihé, au sud de l'Afrique, deviennent de véritables despotes dès qu'elles sont soutenues par une parenté un peu nombreuse. Les exemples de ce genre sont assez multipliés pour laisser présumer que chez bien des peuples le mari a dû éprouver, sous le régime de la parenté utérine, de réelles difficultés à se soustraire au joug de la famille de sa femme : à chaque tentative d'émancipation de sa part, il se trouvait en conflit avec tout un clan de parents ou de beaux-frères qui faisaient cause commune avec leur sœur et ne lui abandonnèrent les diverses prérogatives du droit de propriété qu'à la condition de les acheter successivement. » (giraud-teulon, Ibid.)
De là, une tendance naturelle à acheter les femmes en dehors de la tribu, tendance qui s'observe encore aujourd'hui, d'après le voyageur Richardson, chez certaines tribus Berbères, où les hommes épousent des femmes esclaves plutôt que des femmes de leur propre nation, en raison de l'infériorité où les condamnent les mœurs du pays vis-à-vis de leurs compatriotes. Mais l'opinion de la tribu ne manque pas de réagir contre cette tendance, et c'est ainsi qu'après la période de l'exogamie, dans laquelle on se procurait économiquement, des femmes étrangères par voie de rapt, on voit apparaître la prohibition du mariage en dehors de la tribu, notamment chez les Israé-lites : comme toutes les autres lois ou coutumes, c'est au nom de la divinité que celle-ci est édictée.
« Vous ne contracterez point de mariage avec ces peuples (de la terre de Chanaan). Vous ne donnerez point vos filles à leurs fils, ni vos fils n'épouseront point leurs filles; parce qu'elles séduiront vos fils et leur persuaderont de m'abandonner et d'adorer des dieux étrangers plutôt que moi. Ainsi la fureur du Seigneur s'allumera contre vous et vous exterminera dans peu de temps. » (Deutéronome.)
Moïse va même jusqu'à interdire le mariage entre les différentes tribus d'Israël afin que les héritages ne se mêlent point:
« Voici la loi qui a été établie par le Seigneur au sujet des filles de Salphaad : elles se marieront à qui elles voudront, pourvu que ce soit à des hommes de leur tribu, afin que l'héritage des enfants d'Israël ne se confonde point en passant d'une tribu à une autre. Car tous les hommes prendront des femmes de leur tribu et de leur famille, et toutes les femmes prendront des maris de leur tribu, afin que les mêmes héritages demeurent toujours dans les familles et que les tribus ne soient point mêlées les unes avec les autres, mais qu'elles demeurent toujours séparées comme elles l'ont été par le Seigneur. » (Nombres.)
Cependant, la prohibition d'épouser des femmes étrangères ne fut point maintenue d'une manière absolue, témoin cet autre passage du Deutëronome autorisant les Israélites à épouser des captives:
« Si, ayant été combattre vos ennemis, le Seigneur votre Dieu vous les livre entre les mains et que, les emmenant captifs, vous voyez parmi les prisonniers de guerre une femme qui soit belle, que vous conceviez pour elle de l'affection et que vous vouliez l'épouser, vous la ferez entrer dans votre maison où elle se rasera les cheveux et se coupera les ongles; elle quittera la robe avec laquelle elle a été prise et, se tenant assise en votre maison, elle pleurera son père et sa mère un mois durant : après cela vous la prendrez pour vous, vous dormirez avec elle et elle sera votre femme. Que si, dans la suite du temps, elle ne vous plaît pas, vous la renverrez libre, et vous ne pourrez point la vendre pour de l'argent, ni l'opprimer par votre puissance parce que vous l'avez humiliée. » (Deutéronome.)
Dans cette seconde période, l'homme qui possède, grâce à l'accroissement de la production, les moyens d'acquérir et d'entretenir une femme, la rachète à la tribu ou l'achète en dehors de la tribu, quand la coutume ne s'y oppose pas. Il la paie, soit en nature ou en argent, soit en travail, comme dans le cas de Jacob chez Laban. Comme le remarque M. Giraud-Teulon, « pour acheter une femme, il fallait que l'individu, se présentant comme acquéreur, offrit à la famille une valeur correspondant à celle de la femme convoitée... Rarement le prétendant se trouvait en situation de fournir, soit en denrées, soit en bétail, le prix exigé; et le plus souvent il ne lui restait d'autre ressource que de payer le prix de la femme par un temps déterminé de services effectifs ou d'esclavage dans la maison de ses beauxparents, ainsi que fit Jacob dans celle de Laban. De tous les modes de payements, aucun n'est plus commun parmi les peuples barbares: on le retrouve avec une égale fréquence, en Asie, en Afrique et dans les deux Amériques, »
Ce n'est pas, il faut le dire, sous l'influence d'un sentiment élevé que l'homme acquiert la propriété exclusive d'une ou de plusieurs femmes et de leur croft. « Lorsque nous voyons l'homme barbare revendiquer la paternité d'un enfant, ce ne sont pas des motifs de l'ordre moral ou affectif qui le fout agir, mais un vulgaire désir d'acquisition, et l'on peut affirmer d'une manière générale que, chez les peuples non civilisés, les enfants ne sont estimés qu'autant qu'ils offrent pour les parents une richesse, soit comme travailleurs, soit comme valeur négociable. Sur toute la côte d'or d'Afrique, la paternité ne s'accuse que sous les traits d'une opération commerciale; on fait des enfants pour les revendre. Chez les Fantis de la cote de Guinée, les riches prennent autant de femmes qu'ils en peuvent nourrir, afin d'obtenir un nombreux troupeau d'enfants dont ils font ensuite un commerce étendu et lucratif. Et, si l'on observe les peuplades les moins civilisées, on remarque que l'hostilité y est habituelle entre le père et ses enfants. Chez les nègres, c'est le plus souvent une haine déclarée. La première enfance passée, écrit Burton, le père et le fils deviennent généralement ennemis à la manière des animaux sauvages. Sur la côte de Guinée, rien n'est plus ordinaire que de voir le père lui-même faire la traite de ses enfants, qui, en conséquence, s'appliquent à le fuir dès leur jeunesse; mais parviennent-ils à lui dresser une embuscade pour s'en emparer, ils s'empressent de conduire l'auteur de leurs jours au prochain comptoir européen et de le vendre avec une joie peu dissimulée. » (giraud-teulon, Ibid.)
Ajoutons que, sous ce régime d'appropriation individuelle, l'adultère, considéré d'abord uniquement comme une atteinte à la propriété, est passible des peines comminées contre le vol, c'est-à-dire, le plus souvent, d'une amende et de dommages-intérêts.
La femme, devenue une propriété individuelle, cessa d'être rare, on la multiplia même au point que la polygamie put succéder à la polyandrie. Assujettie à un seul maître, elle perdit la situation privilégiée qu'elle avait acquise lorsqu'elle appartenait à la tribu sans être la propriété exclusived'aucun maître, et se trouvait placée d'ailleurs sous la protection de sa famille utérine. Cependant, au moins parmi les races supérieures, souche des peuples civilisés, l'appropriation exclusive de la femme et des enfants détermina un progrès ultérieur, en développant les sentiments de la famille. Peu à peu, le maître devint moralement mari et père; ses facultés affectives se concentrèrent sur sa femme et ses enfants, comme elles se concentrent sur des animaux domestiques ou même des objets matériels que l'on possède d'une manière exclusive. Il cessa de considérer sa femme comme une esclave et ses enfants comme un bétail. Tout en conservant, jusqu'à une époque relativement récente, le droit de les vendre, il s'abstint d'user de ce droit, et, plus tard, la coutume et la religion, expression de l'opinion, le lui interdirent. Les filles eurent leur part dans le bénéfice du développement du sentiment de la paternité. Non seulement on renonça à les vendre, mais, dans les classes supérieures, on s'efforça de leur constituer une dot. C'est à dater de ce moment qu'elles furent réellement émancipées de la servitude. En cessant d'être achetées, elles cessèrent d'être appropriées; elles passèrent de la condition d'esclaves ou de servantes à celle d'associées, et le mariage apparut dans son acception moderne. Ce n'est point la religion qui a émancipé la femme de la servitude, c'est la dot; et la dot elle-même a été le produit de la série de progrès économiques et moraux qui ont, les uns, développé la production et la richesse, les autres, fait naître et croître les sentiments de la famille.
En résumé donc, la femme a commencé par être une propriété collective. Elle appartenait à la tribu ou au troupeau, à l'époque où celui-ci ne possédait pas encore les moyens d'élever et d'entretenir un nombre de femelles égal au nombre des mâles. On se procurait des femmes en les ravissant aux autres troupeaux, ce qui était plus économique que de les élever, ou bien on exigeait des tribus vaincues, comme dans la légende du Minotaure de Crète, une redevance annuelle de jeunes vierges; plus tard, on remplaça le rapt par l'achat dans les localités où les femmes coûtaient le moins cher, et elles furent probablement le premier des articles de commerce. Aussi longtemps que les femmes demeurèrent, à cause de leur rareté, des propriétés collectives, elles jouirent des avantages attachés à la rareté, et on les voit alors acquérir une situation et une influence prépondérantes. Cette situation privilégiée, elles la perdirent lorsque les progrès de la production et de la richesse eurent permis d'élever en plus grand nombre les enfants du sexe féminin ou de se les procurer régulièrement par voie d'achat; les hommes les plus puissants et les plus riches de la tribu se donnent le luxe d'une ou même de plusieurs femmes, à leur usage exclusif, soit en rachetant le droit de la collectivité, soit en achetant des femmes étrangères; la monogamie et même la polygamie succèdent à la polyandrie. L'accroissement de la production, dù à l'invention de l'agriculture et des premiers arts, généralise l'individualisation de la propriété féminine. La femme avec son croit devient, comme tout autre bétail, la propriété de celui qui l'a achetée; elle perd de sa valeur originaire, sa condition s'abaisse, mais pour se relever à mesure que l'amour conjugal et le sentiment paternel se développent chez l'homme sous l'influence de cette appropriation exclusive. On cesse de trafiquer des enfants, et on finit même par doter les filles au lieu de les vendre. La femme dotée n'est plus une esclave ou une servante, elle passe à l'état d'associée et d'égale de l'homme.
[39] A quel mobile l'homme a-t-il obéi en créant avec la machinery de la production, celle du gouvernement? Il a obéi, avant tout, à la nécessité de pourvoir à ses besoins; en d'autres termes, de conserver et d'accroître l'ensemble des matériaux et des forces qui constituent son être — nécessité qui se manifeste à lui par le plaisir et la peine — toute déperdition de force, sauf dans le cas de surabondance, étant productive d'une peine ou d'une douleur croissante, toute acquisition de force étant, au contraire, productive d'un plaisir. Mais, en vertu de la nature du milieu où nous vivons, la plupart de nos besoins ne peuvent être satisfaits sans un travail qui implique une dépense de force, c'est-à-dire une peine préalable. C'est à diminuer celte peine, tout en augmentant le plaisir contenu dans les résultats du travail, que s'applique l'esprit de recherche et d'invention.
Il semblerait donc que toute machine ou tout procédé qui diminue la somme de nos peines et accroît celle de nos plaisirs dût être acceptée, sans rencontrer d'obstacles. Cependant, l'expérience atteste qu'il n'en est pas ainsi. Pourquoi? Parce que, sans parler du dérangement qu'ils apportent dans les habitudes et du dommage qu'ils causent aux intérêts existants, les machines et les procédés nouveaux exigent d'abord un accroissement ou une capitalisation d'efforts qui se traduit par une augmentation de peine. Sans doute, le régime alimentaire des peuplades qui vivaient de la récolte incertaine des fruits naturels du sol ne comportait qu'un minimum de satisfactions et de plaisir avec un maximum de privations et de peine; mais il n'en était pas moins difficile de faire adopter par ces peuplades d'hommes-enfants un système régulier de culture. Comment leur persuader, en effet, de se donner la peine nécessaire pour façonner des instruments aratoires, défricher et cultiver le sol, en vue d'un résultat qui n'était point aussitôt tangible, d'une satisfaction ou d'un plaisir qui ne devait échoir que plus tard, tandis que la peine était immédiate? Comment encore les astreindre aux gênes et aux privations actuelles que leur causaient le respect des droits d'autrui, les prescriptions hygiéniques, etc., en vue d'un bien éventuel, qu'ils étaient incapables d'apprécier? Il ne fallait rien moins que l'intervention d'une autorité toute puissante et infaillible pour imposer des progrès qui commençaient par accroître la privation et la peine présentes en considération d'un bien futur, et telle fut l'autorité religieuse.
[40] On trouvera la démonstration de la légitimité et de l'utilité de la propriété des inventions dans nos Questions d'économie politique et de droit public, t. II, p. 336.