FRÉDÉRIC BASTIAT,
Lettres d’un habitant des Landes (1877)
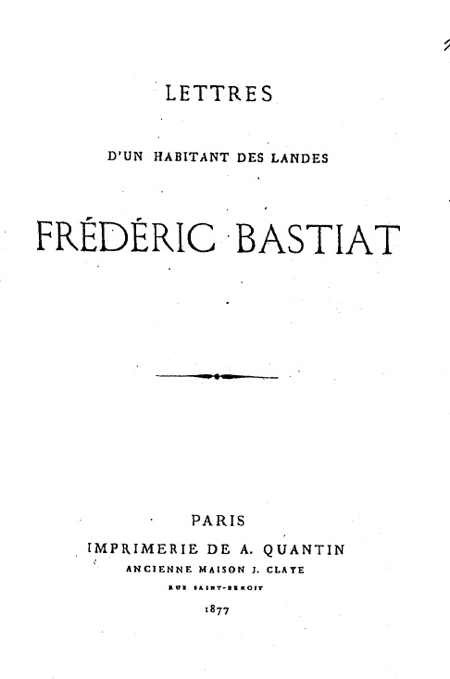 |
[Created: 20 August, 2023]
[Updated: 21 August, 2023 ] |
 |
This is an e-Book from |
Source
, Lettres d’un habitant des Landes (Paris: A. Quantin, 1877).http://davidmhart.com/liberty/Books/1877-BastiatLettres/Bastiat_Lettres1877-ebook.html
Frédéric Bastiat, Lettres d’un habitant des Landes (Paris: A. Quantin, 1877). Anonymous editor. Probably Madame de Cheuvreux.
Editor's Introduction
To make this edition useful to scholars and to make it more readable, I have done the following:
- inserted and highlighted the page numbers of the original edition
- not split a word if it has been hyphenated across a new line or page (this will assist in making word searches)
- added unique paragraph IDs (which are used in the "citation tool" which is part of the "enhanced HTML" version of this text)
- retained the spaces which separate sections of the text
- created a "blocktext" for large quotations
- moved the Table of Contents to the beginning of the text
- placed the footnotes at the end of the book
- formatted short margin notes to float right
- inserted Greek and Hebrew words as images
Table of Contents
- Préface p. 1
- Novembre 1848 p. 9
- Janvier 1849 p. 10
- Vendredi, février 1849 p. 11
- Mercredi, février 1849 p. 12
- Lundi, mars 1849 p. 13
- 3 mai 1849 p. 16
- Juin 1849, Bruxelles, hôtel de Bellevue p. 19
- Juin 1849, Bruxelles p. 25
- Juin 1849, Notes prises d’Anvers p. 27
- 30 août 1849, Mont-de-Marsan p. 31
- 12 septembre 1849, Mugron p. 34
- 16 septembre 1849, Mugron p. 39
- 18 septembre 1849, Mugron p. 41
- 7 octobre 1849, Paris p. 48
- 8 octobre 1849 p. 50
- Novembre 1849, Paris p. 52
- 2 janvier 1850 p. 53
- Janvier 1850 p. 57
- Février 1850 p. 58
- Mars 1850, Paris p. 59
- Vendredi, avril 1850, Paris p. 62
- Mai 1850, Bordeaux p. 65
- 20 mai 1850, Mugron p. 69
- 23 mai 1850, Mugron p. 73
- 27 mai 1850, Mugron p. 76
- 11 juin 1850, Mugron p. 80
- 15 juin 1850 p. 85
- 23 juin 1850, Eaux-Bonnes p. 89
- 4 juillet 1850 p. 95
- 14 juillet 1850, Mugron p. 100
- [Editor's Note]
- 9 septembre, Paris p. 104
- 14 septembre 1850, Lyon p. 107
- Le soir, 14 septembre 1850, Lyon p. 113
- 18 septembre 1850, Marseille p. 115
- 22 septembre 1850, Marseille (à bord du Castor) p. 117
- 2 octobre 1850, Pise p. 120
- 14 octobre 1850, Pise p. 124
- 29 octobre 1850, Pise p. 127
- 8 décembre 1850, Rome p. 130
- Samedi 14 décembre 1850, Rome p. 132
- Lettre de M. Paillotet à Madame Cheuvreux, Rome, 22 décembre 1850 p. 135
- Postface p. 139
[1]
[Préface]↩
Toucher à la liberté de l’homme, ce n’est pas seulement lui nuire, l’amoindrir, c’est changer sa nature ; c’est le rendre, dans la mesure où l’oppression s’exerce, imperfectible ; c’est le dépouillement de sa ressemblance avec le créateur, c’est ternir, sur sa noble figure, le souffle de vie qui y resplendit depuis l’origine.
Les horizons économiques n’ont pas de limites. En apercevoir de nouveaux c’est mon bonheur, que je les découvre ou qu’un autre me les montre.
Bastiat.
Sous le règne de Louis-Philippe, dans le salon de M. Horace Say, fils de Jean-Baptiste, on rencontrait les économistes les plus distingués de l’époque. Malgré la grâce aimable et la fine gaieté du maître de la maison, qui n’entendait pas effrayer la partie féminine de sa société, la présence [2] de ces savants disciples d’Adam Smith donnait aux réceptions du lundi une certaine nuance de gravité. Je vois encore apparaître pour la première fois, au milieu du cercle des élus, Bastiat, récemment découvert par M. Dussard, directeur du Journal des Économistes.
Au fond d’un tiroir de bureau, chez l’éditeur Guillaumin, restaient enfouis depuis quelques semaines plusieurs articles datés d’un lieu inconnu à Paris, signés d’un nom qui ne l’était pas moins.
Ces articles oubliés, tombant à l’improviste sous les yeux du rédacteur en peine de remplir sa feuille mensuelle, le transportent d’étonnement et de satisfaction. Qu’est-ce donc que cet écrivain qui débute en maître ?
Grande rumeur au sein de la petite Église ; on se dispute les pages remarquées, on les médite, on les admire. On complimente, on encourage, on appelle l’auteur. C’est un juge de paix de village qui n’a jamais vu la capitale. Au mois de mai 1845, il cède aux instances qui lui sont faites et vient [3] offrir lui-même aux impatients la première série des sophismes et l’introduction d’un livre qu’il imprime, Cobden et la Ligue. Cette introduction ne tardera pas à attirer l’attention de l’Institut, et le fera nommer membre correspondant de l’Académie des sciences morales et politiques.
Je vois donc Bastiat débarquant des grandes Landes, se présenter rue Boursault, chez M. Say. Sa tournure se détachait si pittoresquement parmi celles qui l’entouraient que l’œil, tout distrait qu’il fût, ne pouvait s’empêcher de se fixer un instant sur lui. La coupe de ses vêtements, due aux ciseaux d’un artiste de Mugron, s’éloignait absolument des formes ordinaires. Des couleurs tranchées mal assorties, étaient mises à côté l’une de l’autre, sans souci de ce genre d’harmonie. Sur des mains gantées de filoselle noire, se jouaient de longues manchettes blanches ; un col de chemise aux pointes menaçantes, enfermait la moitié de son visage, un petit chapeau, de grands cheveux ; tout cet ensemble eût paru burlesque si la [4] physionomie malicieuse du nouveau venu, son regard lumineux et le charme de sa parole n’avaient fait vite oublier le reste.
Assise à table en face de ce campagnard, je constatai que non-seulement Bastiat était un des grands-prêtres du temple, mais un initiateur passionné. Quel feu, quelle verve, quelle conviction, quelle originalité, quel bon sens vainqueur et spirituel ; et à travers cette abondance d’idées nettes, de ces piquantes et neuves démonstrations, le cœur se sentait, le véritable ami des hommes se révélait. « En voilà un, me disais-je, avec lequel il faudra comprendre ou dire pourquoi ; les dames, malgré elles, pourront peut-être s’intéresser à l’influence des tarifs anglais ou français. »
Après le dîner on fit de la musique. L’habitant des Landes nous ménageait encore une surprise : il possédait au suprême degré le sentiment des arts et de la poésie.
Ne voulant que toucher barre à Paris, Bastiat quitte ses coreligionnaires au mois de juillet, s’en va passer quelques jours en [5] Angleterre auprès de Richard Cobden et retourne chez lui. Mais de plus en plus dominé par le besoin d’être utile et de combattre l’erreur, il s’arrache de nouveau à sa chère solitude et revient dans cette Babylone, comme il l’appelle, cette Babylone qui l’attire, l’effraie, l’épuise et le tuera en moins de quatre années. Là il continue l’organisation du libre échange, commencée à Bordeaux, fonde un journal, parle en public, ouvre un cours à la jeunesse des Écoles, prononce des discours en province, au Havre, à Lyon, à Marseille, confie des articles à trois feuilles différentes et publie en même temps des pamphlets, véritables petits chefs-d’œuvre, qui réfutent les funestes théories prêchées d’un bout de la France à l’autre.
Loin de toutes ses douces habitudes, séparé d’une tante qui lui a servi de mère, d’un ami, son frère par le cœur et l’intelligence, Bastiat, atteint déjà d’un mal très-grave, se sent isolé, attristé au milieu de tant d’inconnus.
[6]
La sympathie réelle que lui montrent la famille de M. Horace Say et celle de M. Casimir Cheuvreux le touche. Il se rapproche chaque jour davantage de ces intérieurs qui lui sont si cordialement ouverts. L’affection succède vite à la sympathie. De part et d’autre, on semble pressentir que, pour goûter une intimité précieuse, il faut se hâter, ne pas perdre de temps.
En 1848, le département des Landes l’envoie à l’Assemblée constituante. Devançant d’un quart de siècle la clairvoyance des hommes illustres de notre temps, déjà il jugeait impossible le rétablissement de la monarchie en France. Pour ne pas laisser tomber son pays aux mains des partis qui se disputaient la puissance, il accepta franchement la République. « Je vois, écrivait-il le 8 novembre 1849, que, pour ne pas trop déplaire aux dames, il faut se hâter d’élire un roi ; l’embarras est de savoir lequel, car nous en avons trois en perspective. Qui l’emportera après une guerre civile ?… » Les opinions extrêmes désolaient son patriotisme [7] sans pouvoir le décourager. Tout abus de l’autorité le révoltait, Les réactionnaires d’alors le qualifiaient d’utopiste, ceux d’aujourd’hui accuseraient de radicalisme cet esprit modéré, généreux et sage.
Pendant que Bastiat, nommé représentant pour la seconde fois, siége à la Chambre, son activité d’écrivain redouble. À propos de sa brochure Capital et Rente, il combat dans le journal La Voix du peuple, les fausses doctrines que voudraient propager Proudhon et fait triompher, même parmi un grand nombre d’ouvrier, le principe de la légitimité de l’intérêt. « Labourer en pleine révolution », dit son biographe [1] , l’opinion publique, le sol le plus ingrat, le plus tourmenté, le plus impropre à une moisson prochaine, c’était faire le dangereux métier de pionnier, et l’on sait que ce métier est mortel. » L’ardeur qui le consume quand il cherche à rendre la lumière aux aveugles, ce profond et sévère penseur la porte dans ses [8] sentiments d’amitié. Apôtre d’une des sciences les plus rigoureusement exactes, sa sensibilité son organisation morale sont si délicates que chez lui la moindre impression laisse des traces : joie ou peine, rien ne s’efface.
L’histoire de la vie de Bastiat est une bien simple histoire. Elle se concentre presque tout entière dans l’intérêt précoce et persévérant que lui inspirent l’étude et la solution des problèmes économiques. Un demi-volume de correspondance publié après sa mort le fait déjà connaître et aimer. Une courte série de nouvelles lettres que nous transcrivons ici, ajoutera quelques traits à cette personnalité originale et touchante.
Bastiat, qui avait abandonné son village à l’âge de quarante-cinq ans, ne put jamais s’accoutumer aux rapports sociaux purement mondains, c’est-à-dire l’indifférence aimable cachée sous les formes banales d’une extrême politesse.
[9]
LETTRES
Novembre 1848.↩
Madame,
Il y a, à l’hôtel Saint-Georges, trois santés tellement sympathiques entre elles que si l’une décline, les autres sont menacées. Permettez-moi de faire demander comment vous vous portez. À Mugron, dès neuf heures du matin, nous savions des nouvelles de tous nos amis. Ah ! croyez que la monotonie provinciale a ses compensations.
Si vous avez sous la main l’adresse du savant pharmacien qui a trouvé l’art de rendre supportable l’huile de foie de morue, veuillez me l’envoyer. Je voudrais bien que [10] ce précieux alchimiste pût m’enseigner le secret de faire aussi de l’économie politique épurée ; c’est un remède dont notre société malade a bon besoin, mais elle refuse d’en prendre la moindre cuillerée tant il est répugnant.
Votre dévoué,
F. Bastiat.
Janvier 1849. ↩
Madame,
On vient de me dire que, demain mardi, à deux heures, on exécutera dans l’église Saint-Louis d’Antin de la musique très-curieuse. Ce sont des chants du xiiie siècle, retrouvés aux archives de la sainte chapelle, et empreints de toute la naïveté de l’époque. D’autres assurent que ces chants ne peuvent être anciens, attendu qu’au xiiie siècle on ne connaissait pas l’art de noter la musique.
Quoi qu’il en soit, la solennité offrira un vif intérêt ; il y a là une question moins difficile à juger par impression que par érudition.
J’ai repris hier soir cet affreux breuvage, non sans un terrible combat entre mon [11] estomac et ma volonté. Est—il possible que quelque chose de si détestable soit bon, et messieurs les Médecins ne se moquent-ils pas de nous ?
Au reste, tous les remèdes sont désagréables.
Que faudrait-il à ma chère mademoiselle Louise ? Un peu plus de mouvement physique, un peu moins d’exercice mental : mais elle ne veut pas. Que faudrait-il à sa mère ? Rechercher un peu moins le martyre du salon : mais elle ne veut pas. Que m’ordonne-t-on ? L’huile de foie de morue ? décidément l’art de se bien porter, c’est l’art de se bien contrarier.
F. Bastiat.
Vendredi, février 1849. ↩
Madame,
Je viens de relancer Faucher au sujet de votre protégé ; il l’avait perdu de vue, hélas ! Combien peut-il contenir de pitié sous un front chargé des destinées de la République ! Cependant, il a promis.
Je n’ai aperçu hier aux Italiens ni M. Say, ni Léon, ni M. Cheuvreux ; avez-vous été [12] malade ? Mademoiselle Louise était-elle fatiguée de chant ou de correspondance ? ou bien est-ce pure fantaisie, déesse, dit-on, des Parisiennes ? Au reste, le spectacle était horriblement maussade : Alboni lourde, Ronconi faux, Bordogni nul, toilettes disgracieuses, etc., etc.
Voudriez-vous me faire savoir si vous désirez voir dimanche, en passant, le portail l’Auxerrois et ensuite la sainte Chapelle. Il me semble que Mlle Louise, qui aime tout ce qui est beau, admirera ce monument. Il marque, selon moi, le point extrême où soit parvenu l’art de substituer le vide au plein et le jour à la pierre, art qui paraît être perdu, à en juger par l’architecture moderne.
Votre dévoué,
F. Bastiat.
Mercredi, février 1849. ↩
Madame,
C’est avec un peu de confusion que je vous communique l’issue ressemblant à un fisaco, de ma démarche auprès de Faucher ; mais que voulez-vous, je suis le plus [13] mauvais solliciteur du monde. C’est peut-être heureux. En fait de sollicitations, si j’avais l’habitude du succès, qui sait où je m’arrêterais, puisqu’il est bien reconnu que je n’ai pas d’empire sur moi-même.
M. Ramel peut faire toucher au ministère de l’intérieur, 150 francs ; les formes administratives obligent de donner à cela le nom de secours et non de pension !
J’ai eu toute la nuit la musique d’hier soir dans la tête : Io vorrei saper perche et autres chants délicieux.
Adieu, Madame, je suis votre dévoué et celui de Mlle Louise.
F. Bastiat.
Lundi, mars 1849. ↩
Madame,
Décidément, j’ai laissé chez vous quelque chose de bien précieux ; quelque chose dont les hommes de mon âge ne devraient plus se séparer ; quelque chose que nous devrions toujours sentir sous la main, quand elle se porte sur le côté gauche de notre poitrine, quelque chose dont la [14] perte nous transforme en étourdis et en aveugles, en un mot, mes lunettes.
Si par hasard on les a retrouvées dans votre salon, je vous serai obligé de les faire remettre à ma messagère.
Je profite de cette occasion, pour avoir des nouvelles de la santé de votre Louisette, puisque c’est le nom que vous aimez à lui donner ; je serai heureux d’apprendre qu’elle pourra nous faire entendre demain sa douce voix ; avouez donc que vous en êtes orgueilleuse ?
Oh ! vous avez bien raison ; je n’ose pas trop le répéter ; mais j’aime mieux une romance chantée par elle, qu’un concert tout entier renforcé de vocalises et de tours de force ; après tout, n’est-ce pas la bonne règle de juger des choses et surtout des arts, par l’impression que nous en recevons ? Quand votre enfant chante, tous les cœurs sont attentifs, toutes les haleines suspendues, d’où je conclus que c’est la vraie musique.
Je défends intrépidement ma santé ; j’y tiens beaucoup, ayant la faiblesse de croire qu’elle pourrait encore être bonne à quelque chose.
Hier, je fus voir Mme de Planat. À travers [15] quelques brouillards germaniques, son intelligence laisse distinguer un grand fonds de bon sens, des appréciations neuves ; tout juste assez d’érudition pour qu’il n’y en ait pas trop ; et une parfaite impartialité : nos malheureuses discordes civiles ne troublent pas la sûreté de ses jugements ; c’est une femme qui pense par elle-même ; je voudrais que vous la connussiez. Mais elle m’a fait parler un peu trop.
Je n’ai pas été chez Victor Hugo, croyant qu’il demeurait au Marais ; si j’avais su qu’il habitât vos quartiers, j’aurais fait mon entrée dans son salon, qui doit être curieux, car la pente vers cette région de Paris est facile.
Adieu, je serre la main affectueusement à ce que vous nommez le Trio, que j’aime de tout mon cœur.
F. Bastiat.
[16]
3 mai 1849. ↩
Madame,
Permettez-moi de vous envoyer une copie de ma lettre aux électeurs. Ce n’es certes pas pour avoir votre avis politique, mais ces documents sont surtout une affaire de tact et de délicatesse. Il y fait parler beaucoup de soi, comment éviter la fausse modestie ou la vanité blessante ? Comment se montrer sensible à l’ingratitude, sans tomber dans la ridicule classe des incompris ? Il est bien difficile de concilier à la fois la dignité et la vérité. Il me semble qu’une femme est surtout propre à signaler les fautes de ce genre si elle veut avoir la franchise de les dire. C’est pour cela que je vous envoie ce factum, espérant que vous voudrez bien le lire et m’aider au besoin à éviter des inconvenances. J’ai appris que vous rouvriez vos salons ce soir. Si je puis m’échapper d’une réunion où je serai retenu un peu tard, j’irai recevoir vos conseils. N’est-ce pas une singulière mission que je vous donne, et le cas de dire avec Faucher : « Il faut bien venir des grandes Landes pour être galant de cette manière. »
[17]
Avez-vous eu la patience de lire la séance d’hier [2] ? Quelle triste lutte ! Selon moi, un acte d’une moralité plus que douteuse serait devenu excusable par un simple aveu, d’autant que la responsabilité en remontait aux prédécesseurs de Faucher. C’est le système de défense qui est pitoyable. Et puis les représentants, aspirants ministres, sont venus envenimer et exploiter la faute. Ah ! madame, suis-je condamné à tomber ici de déception en déception ! Faudra-t-il que, parti croyant de mon pays, j’y rentre sceptique ? Ce n’est pas ma foi en l’humanité que je crains de perdre ; elle est inébranlable ; mais j’ai besoin de croire aussi en quelques-uns de mes contemporains, aux personnes que je vous et qui m’entourent. La foi en une généralité ne suffit pas.
Voici une brochure sur Biarritz, je suis sûr qu’en la lisant vous direz : C’est là qu’il fait nous rendre [3] pour faire une forte constitution à ma bien-aimée Louise. »
L’auteur de cette brochure voulait que je [18] la remisse à un de mes amis placé auprès du président de la République (toujours ce Protée de la sollicitation) ; je n’ai pu m’acquitter de sa commission à cause du mot prince, effacé maladroitement devant le mot Joinville ; cet auteur médecin m’avait aussi prié de faire sa préface en matière de réclame. « Mais je n’entends rien en médecine, lui dis-je. — Eh bien, cachez la science derrière le sentiment. » Je me mis donc à l’œuvre. Cette introduction n’a d’autre mérite qu’une certaine sobriété de descriptions, sobriété peu à la mode. Comme je suis passionné pour Biarritz, je cherche à faire de la propagande.
Mais quelle longue lettre ! je vais distancer M. Blondel.
Adieu, madame.
Votre dévoué,
F. Bastiat.
[19]
Bruxelles, hôtel de Bellevue, juin 1849. ↩
Madame,
Vous avez désiré que je vous envoie mes impressions de voyage jetées pêle-mêle sur le papier ; ne saviez-vous pas que le journal a ses dangers ? Il ressemble aux mémoires, on n’y parle que de soi. Oh ! que j’aimerais mieux vous entretenir de vous, de votre Louise bien-aimée, de ses occupations, de ses plaisirs, de ses perspectives, de la Jonchère et quelque peu aussi du Buttard [4] : là tout est poésie, on n’en peut dire autant du Brabant, cette terre classique du travail, de l’ordre, de l’économie et des estomacs satisfaits ; au reste, je n’en parle que par ouï dire, car je n’y suis que depuis hier soir, et ne l’ai vue que par la fenêtre ; à la vérité elle me sert bien puisqu’elle étale devant mes yeux le palais du roi. Ainsi, il y a quelques [20] heures, je respirais un air infecté de républicanisme ; et, me voici plongé dans une atmosphère monarchique ; et bien ! le croiriez-vous, je ne me suis pas même aperçu de la transition ; le dernier mot que j’ai entendu de l’autre côté de la frontière est justement le même qu’on m’a adressé de celui-ci : « Votre passe-port. » Hélas ! je n’en avais pas. Un moment, j’ai espéré qu’on allait me renvoyer à Paris et le cœur m’a battu ; mais tout se civilise, même le gendarme, même le douanier ; bref, on m’a laissé passer, en me recommandant de venir faire une déclaration au ministère de la justice, car, ajoutait le gendarme, « nous y avons été pris plusieurs fois et récemment encore nous avons failli laisser échapper M. Proudhon. » — « Je ne suis pas surpris, ai-je répondu, que vous soyez devenu si avisé, et certes j’irai faire ma déclaration pour encourager la gendarmerie dans cette voie. »
Mais reprenons les choses de plus haut ; samedi, en sortant de la séance (vous voyez que j’écris un journal consciencieux) j’articule le mot Bruxelles : « J’y vais demain, à huit heures et demie, dit Barthélemy Saint-Hilaire, partons ensemble. » Là-dessus je me [21] rends rue La Fayette, croyant arriver à l’heure dite ; le convoi était parti, il m’a fallu attendre celui de midi. Que faire dans l’intervalle ? La butte Montmartre n’est pas loin et l’horizon y est sans bornes. Vers cinq heures, nous avons passé de France à Belgique et j’ai été surpris de n’éprouver aucune émotion ; ce n’est pas ainsi que je franchis pour la première fois notre frontière ; mais, j’avais dix-huit ans et j’entrais en Espagne ! C’était au temps de la guerre civile ; j’étais monté sur un superbe coursier navarrais, et toujours homme de précaution, j’avais mis une paire de pistolets dans mon porte-manteau ; car l’Ibérie est la terre des grandes aventures ; ces distractions sont inconnues en Belgique ; serait-il vrai que la bonne police tue la poésie ? Je me rappelle encore l’impression que faisaient sur moi les fiers Castillans quand je les rencontrais sur une route, à cheval, et flanqués de deux escopettes. Ils avaient l’air de dire : Je ne paie personne pour me protéger, mais je me protége moi-même. Dans tous les genres, il semble que la civilisation qui élève le niveau des masses diminue la valeur des caractères individuels ; je crains que ce pays-ci ne confirme l’observation.
[22]
Il est impossible de n’être pas frappé de l’aspect d’aisance et de bien-être qu’offre la Belgique : d’immenses usines qu’on rencontre à chaque pas, annoncent au voyageur une heureuse confiance en l’avenir ; je me demande si le monde industriel, avec ses monuments, son confort, ses chemins de fer, sa vapeur, ses télégraphes électriques, ses torrents de livres et de journaux, réalisant l’ubiquité, la gratuité et la communauté des biens matériels et intellectuels, n’aura pas aussi sa poésie, poésie collective, bien entendu. N’y a-t-il d’idéal que dans les mœurs bibliques, guerrières ou féodales ? Faut-il, sous ce rapport, regretter la sauvagerie, la barbarie, la chevalerie ? Ne ce cas, c’est en vain que je cherche l’harmonie dans la civilisation ; car l’harmonie est incompatible avec le prosaïsme. Mais, je crois que ce qui nous fait apparaître sous des couleurs si poétiques les temps passés, la tente de l’Arabe, la grotte de l’anachorète, le donjon du châtelain, c’est la distance ; c’est l’illusion de l’optique ; nous admirons ce qui tranche sur nos habitudes ; la vie du désert nous émeut, pendant qu’Abd-el-Kader s’extasie sur les merveilles de la civilisation. Croyez-vous [21] qu’il y ait jamais eu autant de poésie dans une des héroïnes de l’antiquité que dans une femme de notre époque ? Que leur esprit fût aussi cultivé, leurs sentiments aussi délicats, qu’elles eussent la même tendresse de cœur, la même grâce de mouvements et de langage ?
Oh ! ne calomnions pas la civilisation !
Pardonnez-moi, mesdames, cette dissertation, vous l’avez voulue, en me disant d’écrire au hasard, avec abandon ; c’est ce que je fais ; il faut bien que je laisse aller la tête, car deux sources d’idées me sont fermées : les yeux et le cœur ; mes pauvres yeux ne savent pas voir ; la nature leur a refusé l’étendue et la rapidité ; je ne puis donc faire ni descriptions de villes ou de paysages. Quant à mon cœur, il en est réduit à essayer d’aimer une abstraction, à se passionner pour l’humanité, pour la science ; d’autres portent leurs aspirations vers Dieu ; ce n’est pas trop des deux ; c’est ce que je pensais, tout à l’heure en sortant d’une salle d’asile dirigée par des religieuses vouées à soigner des enfants malades, idiots, rachitiques, scrofuleux ; quel dévouement ! quelle abnégation ! Et après tout cette vie de sacrifice [24] ne doit pas être douloureuse, puisqu’elle laisse sur la physionomie de telles empreintes de sérénité. Quelques économistes nient le bien que font ces saintes femmes ; ce dont on ne peut douter, c’est la sympathique influence d’un tel spectacle : il touche, il attendrit, il élève ; on se sent meilleur, on se sent capable d’une lointaine imitation, à l’aspect d’une vertu si sublime et si modeste.
Le papier me manque, sans quoi vous n’échapperiez pas à un long commentaire sur le catholicisme, le protestantisme, le pape et M. de Falloux.
Donnez-moi des nouvelles de M. Cheuvreux ; puisse-t-il trouver aux aux la santé et le calme moral, si troublé par les agitations de notre triste politique ! Il n’est pas comme moi, un être isolé et sans responsabilité. Il pense à vous et à sa Louise ; je comprends son irritation contre les perturbateurs et me reproche de ne l’avoir pas toujours assez respectée.
Adieu, je présente mes hommages à la mère et à la fille.
Votre dévoué,
F. Bastiat.
[25]
Bruxelles, Juin 1849. ↩
Madame,
L’absence de votre beau-frère fera un mauvais effet sur les amis de la paix ; ils s’attendent à une réception qu’ils ne trouveront pas. M. Say est du nombre de ceux qui ont signé l’invitation. Sur cette circulaire plusieurs centaines d’étrangers vont se rendre à Paris, les uns traversant la Manche, les autres l’Océan ; ils s’imaginent trouver chez nous un zèle ardent. Quelle déception, quand on verra la cause de la paix en France représentée pas Guillaumin, Garnier et Bastiat. En Angleterre elle met en mouvement les populations entières, hommes et femmes, prêtres et laïques ; faut-il que mon pays se laisse toujours devancer ?
Je rentrerai à Paris en passant par Gand et Bruges ; je voudrais arriver deux jours avant le Congrès, pour savoir quelles dispositions ont été prises ; car, je vous avoue, que je me sens inquiet sur ce point ; il faut, au moins, que je m’acquitte des devoirs de l’hospitalité envers Cobden ; pour cela peut-être aurais-je recours à votre inépuisable [26] bonté ; je vous demanderai la permission de vous présenter un des hommes les plus remarquables de notre temps. Si je parviens, comme je l’espère, à arriver à Paris samedi, je prendrai la liberté d’aller dimanche à la Jonchère ; n’y trouverais-je rien de changé ?
Mlle Louise sera-t-elle en pleine possession de sa santé et de sa voix ? C’est une bien douce, mais bien impérieuse habitude, que celle d’être informé, jour par jour, de ce qui intéresse ; elle rend pénible la plus courte absence.
Tout bien considéré, mesdames, permettez-moi de ne pas abuser de votre indulgence et de retenir la relation de ma pointe sur Anvers. À quoi bon vous l’envoyer et vous donner la fatigue d’une lecture quand je pourrai y suppléer bientôt par quelques minutes de conversation. D’ailleurs en relisant ces notes, je m’aperçois qu’elles parlent de tout, excepté d’Anvers. J’ai trouvé les Belges très-fiers du bon sens dont ils ont fait preuve pendant ces deux dernières années de troubles européens ; ils se sont hâtés de mettre fin à leurs discordes par des concessions réciproques ; le Roi a donné l’exemple, les Chambres et le peuple ont suivi ; bref, ils [27] sont tous enchantés les uns des autres et d’eux-mêmes. Cependant les doctrines socialistes et communistes ne cessent de continuer leur œuvre souterraine et il me semble qu’on en est assez effrayé. Cela a fait surgir dans ma tête un projet que je vous communiquerai ; mais qu’est-ce que des projets ? Ils ressemblent à ces petites bulles qui paraissent et disparaissent à la surface d’une eau agitée.
Adieu, madame ; n’allez pas croire qu’il en est des sentiments comme des projets ; l’affection que je sens pour vous, pour votre famille, est trop profonde, elle a des bases trop solides pour ne pas durer autant que ma vie et j’espère au delà.
F. Bastiat.
Juin 1849. ↩
notes prises d’anvers
Les extrêmes se touchent. C’est ce qu’on éprouve en chemin de fer : l’extrême multiplicité des impressions les annule. On [28] voit trop de choses pour voir quelque chose. Singulière manière de voyager ; on ne parle pas ; l’œil et l’oreille s’endorment ; on se renferme avec sa pensée, dans la solitude. Le présent qui devrait être tout, n’est rien. Mais aussi, avec quel attendrissement le cœur revient sur le passé ; avec quelle avidité il s’élance vers l’avenir. « Il y a huit jours… dans huit jours. » Ne voilà-t-il pas des textes de méditations bien choisis, quand, pour la première fois, et Vilvorde, et Malines, et le Brabant fuient sous un regard qui ne regarde pas ! Ce matin j’étais à Bruxelles ; ce soir à cinq heures j’étais encore à Bruxelles ; dans l’intervalle j’ai vu Anvers, ses églises, son musée, son port, ses fortifications. Est-ce là voyager ? J’appelle voyager, pénétrer la société qu’on visite ; connaître l’état des esprits, les goûts, les occupations, les plaisirs, les relations des classes, le niveau moral, intellectuel et artistique auquel elles sont parvenues ; ce qu’ont peut en attendre pour l’avancement de l’humanité ; je voudrais interroger les hommes d’État, les négociants, les laboureurs, les ouvriers, les enfants, les femmes surtout, puisque ce sont les femmes [29] qui préparent les générations et dirigent les mœurs.
Au lieu de cela, on me montre une centaine de tableaux, cinquante confessionnaux, vingt clochers, je ne sais combien de statues en pierre, en marbre, en bois ; et l’on me dit : Voilà la Belgique.
À la vérité, il y a pour l’observateur une ressource c’est la table d’hôte ; elle réunissait aujourd’hui autour d’elle, soixante dîneurs, dont pas un belge ; on y remarquait cinq Français et cinq longues barbes ; les cinq longues barbes appartenaient aux cinq Français, ou plutôt les cinq Français aux cinq barbes, car il ne faut pas prendre le principal pour l’accessoire.
Aussitôt, je me suis posé cette question : Pourquoi les Belges, les Anglais, les Hollandais, les Allemands se rasent-ils ? Et pourquoi les Français ne se rasent-ils pas ? En tout pays les hommes aiment à laisser croire qu’ils possèdent les qualités qu’on y prise le plus ; si la mode tournait aux perruques blondes, je me dirais que ce peuple est efféminé ; si dans les portraits je remarquais un développement exagéré du front, je penserais : ce peuple a voué un culte à l’intelligence ; quand [30] les sauvages se défigurent pour se rendre effroyables, j’en conclus qu’ils placent au-dessus de tout la force brutale. C’est pourquoi, j’éprouvais aujourd’hui un sentiment d’humiliation pénible, en voyant tous les efforts de mes compatriotes pour se donner l’air farouche : pourquoi cette barbe et ces moustaches ? Pourquoi ce tatouage militaire ? À qui veulent-ils faire peur et pourquoi ? La peur ! Est-ce là le tribut que mon pays apporte à la civilisation ?
Ce ne sont pas seulement les commis voyageurs qui donnent dans ce ridicule travers ; ne serait-ce pas aux femmes à le combattre ? Mais, est-ce là tout ce que je rapporte d’Anvers ? Il valait bien la peine de faire des lieues sans fin ni compte. J’ai vu des Rubens dans leur patrie ; vous pensez bien que j’ai cherché dans la nature vivante les modèles de ces amples carnations que reproduit si complaisamment le maître de l’école flamande. Je ne les ai pas trouvés, car vraiment, je crois que la race brabançonne est au-dessous de la race normande. On me dit d’aller à Bruges ; j’irais à Amsterdam si c’était mon type de prédilection ; ces chairs rouges ne sont pas mon idéal. Le sentiment, [31] la grâce : voilà le femme, ou du moins la femme digne du pinceau.
F. Bastiat.
Mont-de-Marsan, 30 août 1849. ↩
Madame,
Les organisation un peu éthériques ont le malheur d’être fort sensibles aux contrariétés et aux déceptions ; mais combien elles le sont aussi aux joies inattendues qui leur arrivent ! Qui m’aurait dit que je recevrais aujourd’hui des nouvelles de la Jonchère. L’espace fait l’effet du temps, et parce que je suis séparé de mon cher Buttard par beaucoup de lieues, il me semble que j’en suis séparé aussi par beaucoup de jours passés et à venir ; vous et Mlle Louise, qui êtres si indulgentes, vous me pardonnerez mon expansion à ce sujet ; c’est peut-être parce que je me sens profondément dégoûté du sentimentalisme politique et sociale que je suis devenu un peu sentimental en affection : que voulez-vous, le cœur a besoin de revanche, et puis, mère et fille, je ne sais comment vous faites, vous [32] avez le don et l’art de rendre si contents, si heureux tous ceux qui vous approchent, qu’ils sont bien excusables d’en laisser paraître quelque chose. J’étais sûre que M. Cheuvreux regretterait ne n’avoir pu s’associer à vous pour le bon accueil fait à Cobden chez lui… Mais je suis bien aise de l’apprendre. N’aurait-il pas pu trouver un peu indiscrète ma manière d’exercer l’hospitalité ? Je voulais que la France et l’Angleterre se présentassent l’une à l’autre sous leur plus beau jour. Avec les dames Cheuvreux j’étais fier de Cobden ; avec Cobden j’étais fier des dames Cheuvreux. Il fait que ces insulaires sachent bien que chacun des deux pays a quelque chose à envier à l’autre. C’est d’un bon augure que M. Cheuvreux prolonge son séjour aux eaux, cela prouve qu’il s’en trouve bien.
Le voyage aurait dû me fatiguer davantage ; deux diligences marchaient toujours de conserve, la nôtre à la suite, c’est-à-dire dans un nuage de poussière. J’avais de tristes compagnons de route ; grâce au ciel je me parle à moi-même, et l’imagination me suffit ; elle a produit le plus beau plan, le plus utile à l’humanité qu’on puisse concevoir ; il ne [33] manque plus que la mise en œuvre ; mais encore cette fois j’en serai pour les bonnes intentions. — Que Dieu m’en tienne compte, et je suis sauvé !
Jugez, mesdames, comme je dois trouver amusant d’être retenu ici par le conseil général, sachant que ma tante et mon ami m’attendent à Mugron : ce n’est pas tout, je porte le poids de ma renommée ; ne m’avait-on point réservé les dossiers les plus ardus pour me faire les honneurs de la session ? C’était le cas d’être modeste et Gascon ; j’ai été l’un et l’autre ; et, pour me délivrer de cette étrange politesse, j’ai parlé de ma fatigue ; cependant je en perds pas l’occasion de faire de la propagande économiste, attendu que notre préfet vient d’infecter son discours de socialisme ; cette lèpre prend partout. Demain je saurai laquelle des deux écoles aura la majorité au conseil. Mes concitoyens sont excellents pour moi : ils ont bien des petites peccadilles à me reprocher, mais ils me traitent en enfant gâté, et semble comprendre qu’il faut me laisser agir, travailler et voter capricieusement.
Je voudrais porter à Mlle Louise un souvenir de nos Landes, mais quoi ? Irai-je [34] chercher à Bayonne quelques romances très-tendres du temps de la Restauration, ou bien des boléros espagnols ?
Mesdames, prenez pitié d’un pauvre exilé : n’est-pas singulier d’être exilé quand on est chez soi ? Pour le coup, vous allez me dire que j’aime les paradoxes, celui-là est une vérité bien sentie. Donc écrivez-moi de temps en temps ; je n’ose trop demander ce sacrifice à Mlle Louise : je vous prie d’agréer l’une et l’autre l’expression de mon attachement.
F. Bastiat.
Mugron, 12 septembre 1849. ↩
Madame,
Il me semble que vingt courriers sont arrivés sans m’apporter de lettres. Le temps, comme ma montre, s’est-il arrêté depuis mon retour ici ? ou bien Mlle Louise m’a-t-elle pris au mot ? Mais un savant calcul, déjà refait cent fois, m’avertit qu’il n’y a pas huit jours que ma lettre est partie. Ce n’est pas votre chère fille qui a tort, c’est mon impatience. Je voudrais savoir si M. Cheuvreux [35] vous est revenu en possession de toute sa santé, si vous-même êtes délivrée de ces tristes insomnies ; enfin, s’il y a autant de bonheur à la Jonchère qu’en on mérite, et que j’en souhaite ? Que le télégraphe électrique sera une bonne invention quand on le mettra au service de l’amitié !! Peut-être un jour aura-t-elle une lorgnette qui lui permette de voir à deux cent lieues. L’éloignement alors serait supportable ; maintenant, par exemple, je la tournerais vers votre salon. Mlle Louise est au piano ; je devine, à sa physionomie, la romance qu’elle chante. M. Cheuvreux et vous éprouvez la plus douce joie qu’on puisse ressentir sur cette terre, vos amis oublient que le dernier convoi va passer. — Ce tableau fait du bien au cœur. — Est-ce qu’il y aurait quelque chose de déplacé et de par trop provincial à vous dire que ce spectacle de vertus, de bonheur et d’union, dont votre famille m’a rendu témoin, a été pour moi un antidote contre le scepticisme à la mode, et un préservatif contre le préjugé anti-parisien. Que signifie cette apostrophe de Rousseau : « Paris, ville de boue, etc. ? » Tout à l’heure il m’est tombé sous la main un roman de Jules Janin. Quelle triste et [36] funeste peinture de la société ! — « L’écurie et l’Église se tiennent, » dit-il, pour exprimer qu’on est estimé à Paris que par le cheval qu’on fait parader au bois, ou par l’hypocrisie. Dites-moi, je vous prie, que vous n’avez jamais connu cet homme, ou plutôt qu’il ne vous a jamais connus. — Ces romanciers, à force de présenter la richesse et l’égoïsme comme deux faces d’une même médaille, ont fourni des armes aux déclamations socialistes. J’avais besoin pour mes harmonies de m’assurer que la fortune non-seulement est compatible avec les qualités du cœur, mais qu’elle les perfectionne. Je suis fixé maintenant, et me sens proof, comme disent les Anglais, contre le scepticisme.
À présent, madame, voulez-vous que je vous passe un instant ma lorgnette merveilleuse ? Vraiment, je voudrais que vous pussiez voir derrière le rideau ces scènes de la vie de province : le matin, nous nous promenons dans ma chambre, Félix et moi, lisant quelques pages de Mme de Staël ou un psaume de David ; à la nuit tombante, je vais cherche au cimetière une tombe, mon pied la sait, la voilà ! Le soir, quatre heures de [37] tête-à-tête avec ma bonne tante. Pendant que je suis enfoncé dans mon Shakespeare, elle parle avec l’animation la plus sincère, ayant la complaisance de faire les demandes et les réponses. Mais voici que la femme de chambre, qui se doute que les heures sont longues, se croit obligée de les varier ; elle survient et nous raconte ses tribulations électorales. La pauvre fille a fait de la propagande pour moi : on lui objectait toujours le libre échange ; elle, d’argumenter. Hélas ! quels arguments ; elle me les répète avec orgueil, et pendant qu’elle disserte en jargon basque, patois et français, je me rappelle ce mot de Patru : « Rien de tel qu’un mauvais avocat pour gâter une bonne cause. » Enfin l’heure du souper arrive, chiens et chats font irruptions dans la salle, escortant la garbure. Ma tante entre en fureur. « Maudites bêtes ! s’écrie-t-elle, voyez comme elles s’enhardissent dès que Monsieur arrive ! » Pauvre tante ! cette grande colère n’est qu’une ruse de sa tendresse ; traduisez : voyez comme Frédéric est bon. Je ne dis pas que cela soit, mais ma tante veut qu’on le pense.
Je vous le disais bien, madame, que des lettres du village sont redoutables, nous ne [38] pouvons trouver nos sujets épistolaires que dans le milieu qui nous environne ou dans notre propre fonds.
Quel milieu que Paris pour celui qui écrit ! arts, politique, nouvelles, tout abonde ; mais ici l’extérieur est stérile. Il faut avoir recours à l’autre monde, celui de l’intimité. En un mot, il faut parler de soi ; cette considération aurait dû me déterminer à choisir le plus petit format ; au lieu de cela, je vous envoie maladroitement un arpent de bavardage ; ce qui me rassure, c’est que mon indiscrétion aura beau faire, elle n’épuisera pas votre indulgence.
Je crois que la prorogation a calmé quelque peu l’effervescence politique ; ce serait un grand bien et, sous ce rapport, il faudrait désirer qu’elle ne fût pas si près de son terme. Je voudrais qu’à notre retour le ministère nous livrât en pâture une foule de loi pour absorber notre temps et nous détourner de débats stériles, ou plutôt fertiles, seulement, en haines et exagération.
Veuillez exprimer à M. Cheuvreux et à Mlle Louise tout le plaisir que je me promets de les revoir bientôt. Peut-être le dimanche [39] 30 septembre me retrouverai-je à la Jonchère.
Si je suis à Paris, j’irai m’offrir pour cavalier à Mme Girard, heureux d’être le confident de ses joies et de ses sollicitudes maternelles. Quant aux touristes, je me propose d’écrire prochainement à M. Say.
Adieu, madame, permettez-moi de vous assurer de ma respectueuse affection.
F. Bastiat.
Mugron, 16 septembre 1849. ↩
Vous êtes probablement de retour des eaux, mon cher monsieur Cheuvreux. Je suis un peu surpris d’en être réduit aux conjectures.
Il est de triste époques où les imaginations ébranlées se frappent aisément ; peut-on s’éloigner de Paris sans songer qu’on y a laissé le choléra ? Le silence de nos amis, pénible en tout temps, devient aujourd’hui difficile à supporter.
[40]
La pureté de la Jonchère me rassure. Mais vous avez de nombreux parents à Paris, et vous-même n’y êtes-vous pas retenu presque tous les jours par vos devoirs judiciaires ? Ces dames n’ont pas songé, sans doute, à m’épargner ce genre d’inquiétude. J’aime à attribuer leur silence à des causes moins lugubres : affaires, plaisirs, promenades, visites, musique, causeries, etc., et puis elles ont tant de correspondants ! Il faut bien que chacun attende son tour ; cependant je serais heureux d’apprendre que l’on jouit d’une bonne santé chez vous, chez M. Say, chez les Renouard, à Croissy, etc.
En arrivant ici, j’ai organisé une chasse aux ortolans. J’en partage le produit entre l’hôtel Saint-Georges et la rue Boursault.
Hier, pour mettre de l’ordre dans cette affaire de chasse, je suis allé passer la journée à la campagne, où j’ai vécu autrefois tantôt seul, tantôt entouré. Il y a une grande similitude entre ce pays-ci et celui que vous habitez : chaîné de coteaux, rivière au pied et plaines indéfinies au delà ; le village est au sommet du coteau, ma propriété sur la rive opposée au fleuve. Mais si l’art a plus [41] fait sur les bords de la Seine, la nature est plus nature sur ceux de l’Adour. Il me serait impossible de vous dire l’impression que j’ai éprouvée en revoyant ces longues avenues de vieux chènes, cette maison aux appartements immenses, qui n’ont de meubles que les souvenirs, ces paysans aux vêtements de couleur tranchée, parlant une langue naïve que ne ne puis m’empêcher d’associer avec la vie des champs ; car il me semble toujours qu’un homme en blouse et en casquette, parlant français, n’est pas paysan pour de bon ; et puis ces rapports bienveillants de propriétaire à métayer me paraissent, par l’habitude, une autre condition indispensable pour constituer la vraie campagne. Quel ciel ! quelles nuits ! quelles ténèbres ! quel silence, interrompu seulement par l’aboiement lointain des chiens qui se répondent, ou par la note vibrante et prolongée que projette dans l’espace la voix mélancolique de quelque bouvier attardé ! Ces scènes parlent plus au cœur qu’aux yeux.
Mais me voici de retour au village. Le village ! c’est devenu un degré vers Paris. On y lit la gazette. On y dispute, selon le temps, sur Taïti, ou Saint-Jean d’Acre, sur Rome [42] ou Comorn [5] . Je comptais sur les vacances pour calmer un peu les effervescences politiques ; mais voici que le souffle des passions se ranime. La France est de nouveau placée entre deux impossibilités. La république a été amenée par la ruse et la violence sur un terrain où le légitimisme la battra très-logiquement. Il est triste de penser que M. de Falloux est conséquent et que la France du xixe ne l’est pas. La population a pourtant du bon sens ; elle veut le bien et le comprend ; mais elle a désappris à agir par elle-même. Quelques mouches du coche parviennent toujours à la lancer dans des difficultés inextricables. Mais laissons ce triste sujet.
J’espérais avancer ici mon livre [6] , nouvelle déception. Du reste, je ne suis plus si pressé, car au lieu d’une actualité, il s’est transformé en un ouvrage de pure doctrine et ne pourra avoir d’effet, s’il en a, que sur quelques théoriciens. La véritable solution du problème social aurait besoin, tout en s’appuyant sur un gros livre, d’être propagée par un journal. J’ai quelque idée d’entreprendre une [43] publication mensuelle comme celles de Lamartine et de Louis Blanc. Il me semble que notre doctrine gagnerait comme un incendie, ou plutôt comme une lumière, car elle n’a certes rien d’incendiaire. Partout où je la prêche, je trouve les esprits merveilleusement disposés à la recevoir. J’en ai fait l’expérience sur mes collègues du conseil général. Deux obstacles m’effrayent : la santé et le cautionnement. Nous en causerons bientôt, car j’ai l’espoir de passer avec vous la journée du 30 septembre.
Adieu, mon cher monsieur, si vous avez un moment à perdre, épargnez à ces dames la peine de m’écrire. Veuillez les assurer que le régime de privation où elles me tiennent ne me fait pas oublier leur bienveillance inépuisable.
F. Bastiat.
Mugron 18 septembre 1849. ↩
Madame,
Il y a un fond de tristesse dans votre lettre, madame, c’est bien naturel. Vous veniez de perdre une amie d’enfance. Dans ces circonstances, le premier sentiment est [44] celui du regret, ensuite on jette un regard troublé sur son entourage, et on finit par faire un retour sur soi-même ; l’esprit interroge le grand inconnu et, ne recevant aucune réponse, il s’épouvante ; c’est qu’il y a là un mystère qui n’est pas accessible à l’esprit, mais au cœur. — Peut-on douter sur un tombeau ? Madame, permettez-moi de vous rappeler que que vous n’avez pas le droit d’être longtemps triste. Votre âme est un diapazon pour tous ceux qui vous chérissent et vous être tenue d’être heureuse, sous peine de rendre malheureux votre mère, votre mari et cette délicieuse enfant que vous aimez tant que vous forceriez tout le monde à l’aimer, si elle n’y pourvoyait fort bien elle-même.
Mes idées ont pris la même direction, car nous avons aussi nos épreuves ; le choléra n’a pas visité ce pays, mais li y a envoyé un fâcheux émissaire : la femme de chambre de ma tante est gravement atteinte ; on espère pourtant la sauver ; du même coup il semble que ma tante a perdu vingt ans, car elle est sur pied nuit et jour. Pour moi, je m’humilie devant de tels dévouements, et je vous soutiendrai toujours, mesdames, que [45] vous valez cent fois plus que nous. Il est vrai que je ne suis pas d’accord avec les autres économistes sur le sens du mot valeur [7] .
Vouliez-vous me railler, madame, en me reprochant de ne pas écrire ? — Cinq lettres en quatre semaines ! Mais qu’est donc devenue la précieuse missive dont vous me parlez ? Je ne me consolerais pas qu’elle fût définitivement égarée.
Quel sujet traitait M. Augier pour que vous ayez eu l’aimable attention de m’adresser son œuvre ? J’aime bien les vers du jeune poëte, et je me rappellerai la vive impression que nous avons ressentie à la lecture de son drame [8] . Enfin cette pièce pourra se retrouver ; il en a sans doute conservé la copie, et li voudra bien me la communiquer.
Mais votre lettre, celle de Mlle Louise sont-elles perdues pour toujours ? En ce cas serez-vous en état de me les réciter ? Soyez sûre que je vous le demanderai.
C’est samedi que je pars pour Bayonne ; je n’ai plus que quatre jours à rester ici. Quoique Mugron soit la monotonie réalisée, [46] je regretterai ce séjour de calme, cette parfaite indépendance, cette libre disposition de tout mon temps, ces heures si semblables l’une à l’autre qu’on ne les distingue pas.
L’uniforme habitude
Qui lie au jour le jour ;
Point de gloire ou d’étude,
Rien que la solitude,
La prière et. . . .
Je n’achète pas le vers, car mon maître de littérature m’a appris qu’il ne fallait jamais sacrifier la raison à la rime.
Le 19. — Dans deux heures, j’irai moi-même à Tartas pour remettre au courrier les boîtes contenant des ortolans. Ils partiront jeudi matin et arriveront à Paris samedi ; si, par hasard, on ne les portait pas à l’hôtel Saint-Georges, il faudrait que vous prissiez la peine de faire passer à la poste ; car la ponctualité est nécessaire envers ces petites bêtes.
Je souhaite que mes compatriotes ne se laissent pas corrompre en route, et que vous n’ayez pas à répéter le mot de Faucher à propos des incompatibilités : « Que peut-il venir de bon des grandes Landes ? » Notre ami de [47] Labadie est déjà une bonne protestation ; qu’en pensez-vous, mademoiselle Louise ? Puisque je m’adresse à vous, laissez-moi dire que mes pauvres oreilles sont ici comme dans le vide. Elles ont faim et soif de musique. Réservez-moi une jolie romance, tout ce qu’il y a de plus mineur. Ne voudrez-vous pas aussi perfectionner cette « Nuit des Tropiques » ? Elle finira par vous plaire.
De la musique aux Harmonies la transition est bien tentante. Mais comme il s’agit d’harmonies économiques, cela refroidit un peu. Aussi je ne vous en parlerai pas ; seulement je vous avouerai que mon livre, à cause des développements auxquels j’ai été entraîné, ne touchera plus que les hommes du métier ; je suis donc à peu près résolu, ainsi que je l’ai dit à M. Cheuvreux, à entreprendre une publication mensuelle. Je m’adresserai à vous pour placer des billets. En fait de journaux le placement importe au moins autant que la confection. C’est ce que nos confrères oublient trop. Il faudra que vous intéressiez les femmes à cette œuvre.
Adieu, madame, rappelez-moi au souvenir de M. Cheuvreux. Je ne suis pas surpris qu’il trouve que l’air de la Jonchère vaut mieux [48] que celui de Vichy. Je prie Mlle Louise de me permettre le mot amitié. On est toujours embarrassé avec ces charmantes créatures ; hommages, c’est bien respectueux ; affection, c’est bien familier. Il y a de tout cela ; et on ne sait comment l’exprimer. Il faut qu’elles devinent un peu.
Votre bien dévoué,
F. Bastiat.
Paris, 7 octobre 1849. ↩
Madame,
Il m’arrive ce matin de mes chères Landes une caisse que je suppose contenir des ortolans. Je vous l’envoie sans l’ouvrir. Si c’était des bas de laine ! Oh ! je serais bien confus ; mais en fin j’en serais quitte pour quelques plaisanteries. Hier soir, dans mon empressement et avec le tact qui me caractérise, je suis arrivé chez M. Say au beau milieu du dîner. Pour célébrer la réouverture des lundis, tous les amis se trouvaient là. L’entrain était grand à en juger par les éclats qui me parvenaient au salon. Le vestibule [49] orné de nombreuses pelisses noires, blanches, roses, annonçait qu’il n’y avait pas que des économistes. Après le dîner je m’approche de la belle-sœur de M. D… et, sachant qu’elle arrivait de Belgique, je lui demande si ce voyage avait été agréable. Voici sa réponse : « Monsieur, j’ai éprouvé l’indicible bonheur de ne voir la figure d’aucun républicain parce que je les déteste. » La conversation ne pouvait se soutenir longtemps sur ce texte, je m’adresse donc à sa voisine, qui se met à me parler des douces impressions que lui avait fait éprouver le royalisme belge. « Quand le roi passe, disait-elle, tout est fête : cris de joie, devises, banderoles, rubans et lampions. » Je vois bien que pour ne pas trop déplaire aux dames il faut se hâter d’élire un roi. L’embarras est de savoir lequel, car nous en avons trois en perspective ; qui l’emportera (après une guerre civile) ?
Force m’a été de me réfugier vers les groupes masculins, car vraiment la passion politique grimace sur la figure des femmes. Ces messieurs mettaient leur scepticisme en commun. Fameux propagandistes qui ne croient pas à ce qu’ils prêchent. Ou, plutôt [50] ils ne doutent pas, seulement ils affectent de douter. Dites-moi ce qu’il y a de pire, l’affectation du doute ou l’affectation de la foi ? Vraiment il faut que les économistes cessent cette comédie. Demain il y aura beaucoup de convives au dîner. J’y poserai la question d’un journal destiné à propager un principe absolu. Je regrette que M. Cheuvreux ne puisse être des nôtres. Quoiqu’en dissidence avec lui sur des faits particuliers, sur des appréciations d’hommes ou de circonstances, nous sommes d’accord sur les idées et le fond des choses. Il m’appuierait.
Adieu, madame ; permettez-moi de me dire le plus dévoué comme le plus respectueux de vos amis.
F. Bastiat.
8 octobre 1849. ↩
Madame,
Le hasard fait que le journal des Landes indique la manière traditionnelle dans mon pays d’accompagner les orolans ; le [51] seigneur Trompette ne se blessera pas, sans doute, si je lui adresse par votre intermédiaire un document aussi précieux. Hier, quand je fus porter ma boîte, rue Saint-Georges, M. Cheuvreux n’avait point paru, c’était pourtant jour d’audience. Aujourd’hui nous avions rendez-vous pour aller visiter le télégraphe électrique. Il ne vient pas, serait-il indisposé ?
La discussion sur le socialisme a été très-belle ; Ch. Dupin fort au-dessus de ce qu’on pouvait attendre. Dufaure admirable, la Montagne violente, insensée, ignorante. Quelle triste arène pour cette Chambre ! combien elle est au-dessous, pour les intentions, de la Constituante ! Alors l’immense majorité avait la passion du bien. À présent chacun ne rêve que de révolution et l’on n’est retenu que par le choix. Quoi qu’il en soit, la société progresse. Nul ne peut répondre des accidents particuliers, et je suis fâché que cela contrarie l’aimable Mme Alexandre, mais certainement le mouvement général est vers l’ordre et la sécurité.
Pour vous, mesdames, vous vous êtes préparé, à tout événement, des ressources de bonheur dans l’affection de ceux qui vous [52] approchent, et la mère et la fille ne seront-elles pas toujours l’une pour l’autre des anges de consolation ?
Permettez-moi aussi d’espérer que vous compterez pour quelque chose l’inaltérable dévouement de votre respectueux ami.
F. Bastiat.
Paris, novembre 1849. ↩
Madame,
Voici un document qui vous intéressera. Pour moi, je n’ai pu le lire sans être touché jusqu’aux larmes (nature de montagne n’est pas toujours nature de rocher ) ; pour faire partager mes impressions, à qui m’adresser, si ce n’est à vous ?
Je vais être obligé de discuter l’opinion de mes amis, cela me coûte. Mais je ne sais quel Grec disait : « J’aime Platon, mais j’aime mieux la vérité. » Il me semble à présent indubitable que l’économie politique a ouvert la porte au communisme ; c’est à elle à la fermer.
Si vous avez cinq minutes à perdre, [53] oserais-je vous prier de me donner des nouvelles du trio ?
Votre bien dévoué,
F. Bastiat.
Le 2 janvier 1850. ↩
Madame,
On me tire de mon assoupissement pour me remettre trois volumes, que vous me renvoyez sans les accompagner d’un seul mot ; aurais-je été assez malheureux pour vous déplaire ?
Hier, vous avez réuni autour de votre table votre famille et quelques amis, pour inaugurer le nouvel an ; ce repas ne devait être que fête, joie et cordialité ; hélas ! la politique s’en est mêlée ; il est bien vrai que, sans moi, la politique n’eût pu y jeter ses sombres reflets, car tout le monde peut-être eût été d’accord.
Mais suis-je coupable ? N’ai-je pas longtemps gardé le silence, et n’ai-je pas mis sur le compte de généralités ce que j’aurais pu prendre pour des personnalités ? Des paroles [54] qui ressemblaient à des provocations ?… — Que deviendrais-je, madame, si cette réserve ne suffit pas ?
Isolé, retenant à peine pour le travail un reste de force qui m’échappe, faudra-t-il perdre encore les douceurs de l’intimité, seul charme qui me rattache à l’existence ?
Entre M. Cheuvreux et moi, qu’importe une dissidence d’opinion, alors surtout qu’elle ne porte pas sur le but, sur aucun principe essentiel, mais seulement sur les moyens de surmonter les difficultés du moment ?
C’est par égard pour lui, autant que pour vous, madame, que j’ai dévoré le calice que ces messieurs ont approché de mes lèvres. Et, après tout, ces opinions qu’on me reproche, sont-elles donc si extravagantes ?
Je souhaiterais bien que l’on consentît à me considérer comme un solitaire, un philosophe, un rêveur, si vous voulez, qui ne veut se livrer à un parti, mais qui les étudie tous, pour voir où est le péril et si l’on peut essayer de le conjurer.
Je vois, en France, deux grandes classes qui, chacune, se subdivise en deux. Pour me [55] servir de termes consacrés, quoique improprement, je les appellerai le peuple et la bourgeoisie.
Le peuple, c’est une multitude de millions d’êtres humains, ignorants et souffrants, par conséquent dangereux ; comme je l’ai dit, il se partage en deux, la grande masse assez attachée à l’ordre, à la sécurité, à tous les principes conservateurs ; mais, à cause de son ignorance et de sa souffrance, proie facile des ambitieux et des sophistes ;cette masse est travaillée par quelques fous sincères et par un plus grand nombre d’agitateurs, de révolutionnaires, de gens qui ont un penchant inné pour le désordre, ou qui comptent sur le désordre pour s’élever à la fortune et à la puissance.
La bourgeoisie, il ne faudrait jamais l’oublier ; c’est le très-petit nombre ; cette classe a aussi son ignorance et sa souffrance, quoiqu’à un autre degré ; elle offre aussi des dangers d’une autre nature. Elle se décompose aussi en un grand nombre de gens paisibles, tranquilles, amis de la justice et de la liberté, et un petit nombre de meneurs. La bourgeoisie a gouverné ce pays-ci, comment s’est-elle conduite ? Le petit nombre a fait le [56] mal, le grand nombre l’a laissé faire ; non sans en profiter à l’occasion.
Voilà la statistique morale et sociale de notre pays.
Tenant très-peu et croyant encore moins aux formes politiques, irai-je consumer mes efforts et déclamer contre la république ou la monarchie ? Conspirer pour changer des institutions que je regarde comme sans importance ? Non ; mais quand j’ai l’occasion de m’adresser au peuple, je lui parle de ses erreurs, de ses fausses aspirations ; je cherche à démasquer à ses yeux les imposteurs qui l’égarent, je lui dis : « Ne demande que justice, car il n’y a que la justice qui puisse t’être bonne à quelque chose. » — Et quand je parle à la bourgeoisie, je lui dis : « Ce ne sont pas les fureurs ni les déclamations qui te sauveront, il faut en toutes rencontres accorder au peuple ce que la justice exige, afin d’être assez fort pour lui refuser tout ce qui dépasse la justice. »
Et c’est pourquoi les catholiques me disent que j’ai une doctrine à deux tranchants ; et c’est pourquoi le « Journal des Débats » dit que je dois m’habituer à déplaire aux deux partis. Eh ! mon Dieu, ne serait-il pas plus [57] commode pour moi de me lancer corps et âme dans un des deux camps, d’en épouser les haines et les illusions, de me faire le flagorneur du peuple ou de la bourgeoisie, de m’affilier aux mauvaises fractions des deux armées.
F. Bastiat.
Janvier 1850. ↩
Madame,
Je viens de rencontrer le commandant Matt, qui prétend qu’on sera souffrant demain à l’hôtel Saint-Georges. Puisse-t-il être aussi mauvais prophète que brave soldat ! Soyez assez bonne pour me faire savoir la vérité. Vous ne permettrez pas que je parle de santé sans dire quelque chose de la mienne. Je suis mieux et Charruau, comme Sgnarelle, assure que je dois être guéri. Cependant hier soir, une quinte fatigante a déterminé ce symptôme rouge aussi effrayant en physiologie qu’en politique. Malgré tout, j’aurais encore bien assez de force pour me charger de ce qu’il peut rester de toux à votre Louisette, si cela était possible ; mais [58] l’affection ne peut faire ce miracle, c’est une harmonie qui manque à ce monde.
Adieu, madame.
F. Bastiat.
Samedi.
Février 1850. ↩
Madame,
Je vous rends, à regret, le discours prononcé par M. de Boislembert, à l’occasion de l’inauguration du buste de M. Girard, en vous rappelant que vous m’en avez promis un exemplaire. Je l’ai lu avec enthousiasme, et voudrais le relire une fois par mois, pour me retremper. C’est une vie de Plutarque, en harmonie avec notre siècle. Que j’admire cette vie si belle, si digne, si bien remplie ! Quelle magnifique réunion de toutes les qualités qui honorent le plus la nature humaine : génie, talent, activité, courage, persévérance, désintéressement, grandeur, force d’âme dans les revers ! Jusque-là, pourtant, le portrait est bien imposant et ne représente que des lignes pures, mais sévères ; on admire, on n’aime pas encore ; mais bientôt la [59] sympathie est complète quand l’auteur nous peint, avec trop de sobriété peut-être, sa verve étincelante, cette gaieté douce, cette inépuisable bienveillance, que M. Girard rapportait toujours au foyer domestique, dons du ciel les plus précieux de tous, que votre père n’a pas emportés dans la tombe. Ces nobles figures, madame, font paraître les hommes bien petits, et l’humanité bien grande.
F. Bastiat.
Paris, mars 1850. ↩
Madame,
Comment voulez-vous guérir ? Votre rhume est la proie de tous ceux à qui il plaît de le faire jaser, et le nombre en est grand.
Depuis samedi jusqu’à hier matin, je n’ai eu qu’une quinte. Elle a duré douze heures. Je ne puis comprendre comment les fragiles enveloppes de la respiration et de la pensée n’éclatent pas sous ces secousses violents et prolongées. Au moins je n’ai rien à me reprocher, j’obéis docilement à mon médecin. [60] Retenu pendant ces deux jours, il faudra bien que j’aille, ce soir, chez M. Say, me mêler à mes coreligionnaires. C’est un effort. Vous ne sauriez croire avec quelle vivacité mon indisposition fait renaître en moi mes vieux penchants solitaires, mes inclinaisons provinciales. Une chambre paisible pleine de soleil, une plume, quelques livres, un ami de cœur, une douce affection : c’était tout ce qu’il me fallait pour vivre. En faut-il davantage pour mourir ? Ce peu, je l’avais au village, et quand le temps sera venu dans beaucoup d’années je ne le retrouverai plus.
J’envoie à Mlle Louise quelques stances sur la femme qui m’ont plu. Elles sont pourtant d’un poëte économiste, car il a été surnommé The free-trade rhymer : le poëte du libre échange. Si j’en avais la force je ferais de cette pièce une traduction libre en prose et en trente pages ; cela ferait bien dans le journal de Guillaumin. Votre chère petite railleuse (je n’oublie pas qu’elle possède au plus haut degré l’art de railler, non-seulement sans blesser, mais presqu’en caressant) n’a pas grande foi dans la poésie industrielle ; elle a bien raison. C’est que j’aurais dû dire Poésie sociale, celle qui désormais, je [61] l’espère, ne prendra plus pour sujet de ses chants les qualités destructives de l’homme, les exploits de la guerre, le carnage, la violation des lois divines et la dégradation de la dignité morale, mais les biens et les maux de le vie réelle, les luttes de la pensée, toutes les combinaisons et affinités intellectuelles, industrielles, politiques, religieuses, tous les sentiments qui élèvent, perfectionnent et glorifient l’humanité. Dans cette épopée nouvelle, la femme occupera une place digne d’elle et non celle qui lui est faite dans les vieilles Iliades. Son rôle était-il de compter parmi le butin ?
Aux premières phases de l’humanité, la force étant le principe dominant, l’action de la femme s’efface. Elle a été successivement bête de somme, esclave, servante, pur instrument de plaisir. Quand le principe de la force cède à celui de l’opinion et des mœurs, elle recouvre son titre à l’égalité, son influence, son empire ; c’est ce qu’exprime bien le dernier trait de la petite pièce de vers que j’adresse Mlle Louise.
Vous voyez combien les lettres des pauvres reclus sont dangereuses et indiscrètes. Pardonnez-moi ce bavardage, pour toute réponse [62] je ne demande qu’à être rassuré sur la santé de votre fille.
F. Bastiat.
Lundi.
Paris, avril, vendredi, 1850. ↩
Bien chère madame Cheuvreux,
Pardonnez-moi ce mot échappé à un moment d’effusion. Nous autres souffreteux, nous avons, comme les enfants, besoin d’indulgence, car, plus le corps est faible, plus l’âme s’amollit et il semble que la vie, à son dernier comme à son premier crépuscule, souffle au cœur le besoin de cherche partout des attaches. Ces attendrissements involontaires sont l’effet de tous les déclins ; fin du jour, fin de l’année, demi-jour de basiliques, etc., etc., je l’éprouvais hier sous les sombres allées des Tuileries. Ne vous alarmez pas, cependant, de ce diapason élégiaque. Je ne suis point Millevoie, et les feuilles qui s’ouvrent à peine ne sont pas près de tomber. Bref, je ne me trouve pas plus mal, au contraire, mais seulement plus faible, et je ne puis guère reculer devant la demande d’un congé. C’est, en perspective, une solitude [63] encore plus solitaire ; autrefois je l’aimais ; je savais la peupler de lectures, de travaux capricieux, de rêves politiques, avec intermèdes de violoncelle ; momentanément, tous ces vieux amis me délaissent, même cette fidèle compagne de l’isolement, la méditation. Ce n’est pas que ma pensée sommeille, elle n’a jamais été si active ; à chaque instant elle saisit de nouvelles harmonies et il semble que le livre de l’humanité s’ouvre devant elle ; mais c’est un tourment de plus, puisque je ne puis continuer à transcrire les pages de ce livre mystérieux, sur un livre plus palpable édité par Guillaumin ; je chasse donc ces chers fantômes, et comme ce tambour-major grognard qui disait : « Je donne ma démission, que le gouvernement s’arrange comme il le pourra ; » moi aussi, je donne ma démission d’économiste et que la postérité s’en tire, si elle peut. Bon, voilà une jérémiade pour expliquer une maladresse. On dit des malheurs, qu’ils n’arrivent jamais seuls ; cela est encore plus vrai des maladresses ; que de mots pour en justifier un que vous auriez pardonné, sans tous ces commentaires, car vous ne m’en voudrez pas si, dans cette indigence [64] d’occupations, ma pensée se réfugie vers l’hôtel Saint-Georges, où l’on est toujours si bon pour moi. Ce cher hôtel ! il est maintenant tout plein d’une préoccupation très-grave. L’avenir de votre Louise s’y décide peut-être, et par conséquent le vôtre et celui de M. Cheuvreux. L’idée que tant de paix, d’union et de bonheur domestique vont être domestique vont être mis à l’épreuve d’une révolution décisive est vraiment effrayante. Mais prenez courage, vous avez tant de bonnes chances !
Vraiment, mes lettres dépassent de cent coudées celles de M. B… Je vous prie, madame, d’accepter mes excuses. La plus valable, c’est que je n’ose guère paraître chez vous ce soir ; n’est-ce pas bien de l’égoïsme d’aller chercher des distractions là où on ne peut apporter de quintenses importunités ? Bien entendu, je ne dis pas cela pour mes amis ; ce serait de l’ingratitude. Mais la société est-elle solidaire de votre bienveillance ?
Adieu, madame ; croyez-moi votre dévoué,
F. Bastiat.
Mme Shwabe vient d’arriver sans ses [65] enfants. Je désire vous faire faire sa connaissance.
Bordeaux, mai 1850. ↩
Me voici à Bordeaux plongé avec délice dans l’atmosphère du midi. Quoique je quitte le tumulte parisien pour aller retrouver le calme du toit paternel, je vous assure que ma pensée, tout le long de la route, s’est retournée bien plus souvent en arrière qu’elle ne s’est portée en avant ; aussi je m’empresse de déployer le secrétaire de voyage que je dois aux soins si délicats de M. Cheuvreux.
En être réduit à faire de ma santé le premier chapitre de mes lettres, m’humilie un peu, mais votre bonté l’exige ; je le comprends, les maladies dont la toux se mêle ont le tort de trop alarmer nos amis. Elles portent avec elles comme une cloche importune qui ne cesse de poser cette question : qui l’emportera, du rhume ou de l’enrhumé ? Le voyage, au lieu de me fatiguer, m’a soulagé ; il est vrai que j’ai eu à ma disposition, pendant trois jours, un excellent remède, le [66] silence ; ce n’est que depuis Ruffec que je me suis un peu écarté à cet égard de vos prescriptions ; mes deux compagnons, montés tour à tour dans le cabriolet du courrier, pour se livrer aux douceurs du cigare, ont eu la curiosité de visiter la feuille de route. — Or il s’est rencontré que c’étaient deux enthousiastes d’économie politique ; en reprenant leur place, ils ont tenu à me montrer qu’ils connaissaient mes opuscules (car le titre même des harmonies ne leur était pas parvenu) et, alors l’occasion, l’herbe tendue, et sans doute quelque diable aussi me poussant, j’ai tondu de ce pré (la causerie) la largeur de ma langue ; je n’en avais nul doit, puisqu’on me l’avait défendu. Mais, j’ai donc succombé et le larynx n’a pas manqué de m’en punir ; ne me grondez pas, madame ; est-ce que le silence n’est pas un régime qui vous conviendrait quelquefois, autant qu’à moi ? et pourtant c’est le dernier auquel vous vous soumettiez.
Que Mme Girard, maintenant près de vous, interpose son autorité pour vous mettre sous le séquestre ; que vous sert de rester dans vos appartements si vous en faites ouvrir les portes à deux battants depuis [67] dix heures du matin ? Ne sauriez-vous sacrifier à votre santé quelques moments de conversation ? Mais vous savez que le sacrifice retomberait sur les autres, et c’est pour cela que vous ne voulez pas le faire. Vous voyez que je connais la vieille tactique qui est de gronder le premier afin de n’être pas grondé. Après tout, je vois bien que nous descendons tous de notre mère Ève. Votre fille, elle-même, qui a tant de raison, se laisse souvent prendre au piége de la musique. À propos de musique, on a bien tort de s’imaginer qu’un son s’éteint dans l’étroit espace d’un salon et d’une seconde ; une note, ou plutôt un cri de l’âme que j’ai entendu samedi, a fait avec moi deux cents lieues ; il vibre encore dans mon oreille, pour ne pas dire plus.
Pauvre chère enfant, je crois bien avoir deviné la pensée dont elle a empreint le triste chant de Pergolèse ; cette voix touchante, dont les derniers accents semblaient se perdre dans une larme, ne disait-elle pas adieu aux illusions du jeune âge, aux beaux rêves d’une félicité idéale ? Oui, il semblait que votre chère Louise se sentait amenée par les circonstances à cette limite fatale et [68] solennelle qui sépare la région des songes du monde de la réalité. Puisse la vie réelle lui apporter au moins un bonheur calme, solide, quoiqu’un peu grave ; pour cela, que faut-il ? Un bon cœur et du bon sens dans celui qui sera chargé de ses destinées ; c’est la première condition ; les hommes dont l’imagination ardente et artistique jette un grand éclat, offrent des chances souvent dangereuses ; mais n’en doutons pas, les nobles aspirations de votre enfant trouveront un jour satisfaction.
Comment allez-vous passer le mois prochain ? Resterez-vous à Paris ? Irez-vous à Auteuil, à Saint-Germain ou à Londres ? Je voterais assez pour l’Angleterre, c’est là que vous trouveriez une désirable combinaison de tranquillité et de distraction ; à la vérité, mes votes ne sont pas en bonne odeur, quoiqu’ils aient consciencieusement pour but d’éloigner les malheurs que vous redoutez ; mais ne glissons pas sur la pente de la politique. Il y a tant d’imprévu dans vos résolutions qu’il me tarde de savoir à quoi vous vous arrêterez. Je crains d’apprendre votre départ pour Moscou ou Constantinople. De grâce, que je vous retrouve confortablement installés aux environs de Paris ; la France est comme la Française, elle peut avoir quelques caprices, mais après tout, c’est la plus aimable, la plus gracieuse, la meilleur femme du monde et aussi la plus aimée.
Adieu, mesdames ; que ces deux mois d’absence ne m’effacent pas de votre mémoire ; adieu encore, monsieur Cheuvreux et mademoiselle Louise.
Votre dévoué,
F. Bastiat.
Mugron, 20 mai 1850. ↩
Combien je vous remercie, madame, de penser à l’exilé des Landes au milieu de toutes vos préoccupations ; j’oserais à peine vous demander de continuer cette œuvre charitable si je ne savais combien la bonté est en vous persévérante ; croyez bien qu’il n’y a ni cordial ni pectoral qui vaillent pour moi quelques lignes venues de Paris, et ma santé dépend plus du facteur que du pharmacien ; la plume, il est vrai, est une lourde et fatigante machine ; ne m’envoyez pas de [70] longues lettres, mais quelques mots le plus souvent possible, afin que je sache ce qu’on fait, ce qu’on pense, ce qu’on sent, ce qu’on résout à l’hôtel Saint-Georges.
Voici, par exemple, une péripétie que je ne puis dire complétement inattendue ; quelques paroles de M. Cheuvreux me l’avaient fait pressentir ; ce pauvre M. D… est congédié, je suis sûr que le cœur de votre Louise est bien soulagé, c’est toujours cela de gagné ; si mes vœux s’accomplissaient, elle traverserait la vie sans toutes ces épreuves.
Après vous avoir écrit de Bordeaux, je fis des visites ; heureusement plusieurs de mes amis étaient absents, car je n’aurais pu éviter de parler et de crier beaucoup ; ceux que j’ai rencontrés sont dans un tel état d’exaltation que la conversation calme n’est pas possible avec eux ; les malheureux sont persuadés que depuis deux ans on n’ose pas ouvrir les magasins à Paris ; partant de cette donnée, ils veulent à tout prix d’une pareille situation et pour cela ne reculent pas même devant l’idée d’une guerre civile ou de la guerre étrangère. Mon département m’a paru plus modéré ; notre préfet s’y consacrait sans relâche à concilier les opinions ; aussi il a été [71] destitué le jour le mon passage à Mont-de-Marsan ; on nous en envoie un qui saura chauffer un peu mieux les esprits.
J’arrivai vendredi ; en revoyant le clocher de mon village, je fus surpris de ne pas éprouver ces vives émotions que sa vue ne manquait jamais autrefois de faire naître. — Sommes-nous de la nature des végétaux et les fibres du cœur deviennent-elles ligneuses avec l’âge, ou bien ai-je maintenant deux patries ? — Je me rappelle que Mlle Louise m’avait prédit que la vie rustique aurait perdu pour moi beaucoup de ses charmes.
Dans un conseil de famille composé de ma tante, de sa femme de chambre et de moi (et je pourrais dire, résumé dans sa femme de chambre), il a été décidé que Mugron valait les Eaux-Bonnes, et qu’en tout cas il ne faisait pas encore assez chaud pour les Pyrénées ; donc me voici Landais jusqu’à nouvel ordre. Ceci conclu, notre Basquaise s’est mise à visiter ma malle ; bientôt nous l’avons vue rentrer au salon toute bouleversée et s’écriant : « Mademoiselle, le linge de Monsieur, il est tout perrec, perrec, perrec ! » Je regrette que de Labadie ne soit plus auprès de vous pour expliquer l’énergie de ce mot [72] perrec ; il renferme les trois idées de lambeaux, chiffons et haillons ; quel profond mépris doit ressentir la pauvre fille pour Paris et ses blanchisseuses ! — C’est à donner sa démission de représentant !
Samedi, je vus voir le reste de ma famille à la campagne ; j’en revins fatigué. Les quintes ont reparu assez fortes pour que la respiration n’y pût suffire ; je pensais à la description de la pêche de la baleine que vous faisait votre cousin : « Tout va bien, disait-il, quand on peut donner du câble à l’animal blessé ; » la toux est peu de chose aussi, tant que les poumons peuvent lui donner du câble ; après quoi, la position devient incommode.
Vraiment, madame, ces détails vous prouvent que je me laisse aller à l’affection que j’ai pour vous et que je compte bien sur la vôtre ; aussi que cela ne sorte pas, je vous en prie, de ce que nous appelons le trio.
Le courrier m’apporte une lettre ; comment vous exprimer ma reconnaissance ! Vous avez donc deviné mes vœux ? Ma tante et moi avons commencé à disputer sur le nord et le midi ; elle exalte la supériorité du [73] Midi, sans doute pour que j’y reste ; je lui soutiens que ce tout ce qu’il y a de bon vient du Nord, même le soleil. (C’est du Nord aujourd’hui que nous vient la lumière), il m’envoie votre bon souvenir, des nouvelles rassurantes sur Mlle Louise, quelques détails sur ces douces scènes d’intérieur, dont j’ai été souvent témoin et que je sais si bien apprécier.
F. Bastiat.
Mugron, 23 mai 1850. ↩
Chère madame Cheuvreux, ma dernière lettre a à peine atteint l’autre extrémité de la longue ligne qui nous sépare, qu’en voici une seconde prête à se lancer sur la même voie ; n’y a-t-il pas dans cet empressement indiscrétion, ou inconvenance ? Je n’en sais rien, car je ne suis par encore bien rompu aux usages du monde ; mais soyez indulgente ; bien plus, permettez-moi de vous écrire capricieusement sans trop regarder aux dates, et sous l’empire de l’impulsion, cette loi des natures faibles. Si vous saviez [74] combien Mugron est vide et triste, vous me pardonneriez de tourner toujours mes regards vers Paris. Ma pauvre tante, qui fait à peu près toute ma société, a bien vieilli, la mémoire l’abandonne ; elle n’est plus qu’un cœur ; il semble que ses facultés affectives gagnent tout ce que perdent les autres ; aussi je l’aime plus que jamais, mais, en sa présence même, je ne puis retenir mon imagination voyageuse, et puis ne suis-je pas malade ? À quoi donc les maladies seraient-elles bonnes, si elles ne donnaient le privilége de faire tolérer nos fantaisies ? Ainsi, voilà chose convenue, je mets mon indiscrétion sous le patronage de mes prétendues souffrances ; c’est une ruse dont un cœur de femme sera toujours dupe ; pourtant ceci ne doit pas m’induire à vous tromper et à me représenter comme un moribond. Voici le bulletin : la toux est moins fréquente, les forces reviennent ; je puis monter l’escalier sans être hors d’haleine ; je retrouve ma voix, qui peut fredonner dans toute l’étendue d’un octave complet ; la seule chose qui m’importune est une petite douleur au larynx, mais je ne lui en donne pas pour quatre jours ; enfin, [75] quoique je n’en sois pas encore à offrir aux regards dangereux de Mlle Louise une figure au milieu d’un visage, il me semble que j’ai meilleure mine.
Me voilà quitte envers ma conscience et obéissant à vos ordres. À propos de Mlle Louise et du visage en question, cette chère enfant est toujours destinée à être en proie à un doute douloureux pour une jeune fille : c’est d’ignorer, malgré son tact exquis, si on la recherche pour elle-même… c’est un des revers de médaille de la fortune ; mais ce qui doit la rassurer, c’est que fût-on d’abord attiré par cette fortune on l’appréciera bien vite pour sa propre valeur ; je vous ai dit que je bonté de cœur pouvait remplacer toutes les autres qualités ; je me trompais, quelque chose peut-être vaut mieux encore : c’est le sentiment du devoir ; une disposition naturelle à se conformer à la règle, disposition que le bon cœur n’implique pas toujours.
Quels que soient le nombre et le mérite de vos amis, conservez-moi une place dans votre affection ; pour moi, je puis bien vous le dire, à mesure que le temps et la mort brisent des liens autour de moi, à mesure que je perds la faculté de me réfugier dans [76] la vie politique ou studieuse, votre bienveillance, celle de votre famille, me deviennent de plus en plus nécessaires ; c’est la dernière lumière qui brille sur ma vie, c’est pour cela, sans doute, qu’elle est aussi la plus douce, la plus pure, la plus pénétrante ; après elle viendra la nuit, que ce soit au moins la nuit du tombeau.
F. Bastiat.
Mugron, le 27 mai 1850. ↩
Jétais brouillé avec le calendrier, et voilà que mon exil a opéré la réconciliation ; nous sommes au 27.
Mon congé date du 12, en sorte que le quart des deux mois est écoulé, encore trois fois autant de temps et je reverrai Paris.
Je fais, madame, un autre calcul qui me sourit moins, votre dernière lettre porte le timbre du 17. Il y a dix jours que vous l’avez écrite, et huit que je l’ai reçue ; huit jours ! Ce n’est rien pour vous, qui les passez tantôt entourée des vôtres, tantôt parcourant les [77] bords de la Seine ou de la Marne, causant presque toujours délicieusement avec votre fille et votre mari ! Si au moins je pouvais être sûr qu’aucun rhume ne vous empêche d’écrire !
Hier on reçut une dépêche télégraphique annonçant le vote de l’article Ier ; je pensai que je télégraphe pourrait être mieux employé, du moins en ce qui me touche.
Vous avez des myriades d’amis et d’amies qui, tout en vous recommandant le repos, vous poursuivent du matin au soir ; comme il me tarde d’apprendre que vous avez mis pas mal de kilomètres entre leur empressement et votre gracieuseté !
Je dois avouer, madame, que La Fontaine avait raison et que bon nombre d’hommes sont femmes à l’endroit du babil ; en venant chercher ici la santé, je n’avais pas songé que j’y rencontrerais l’impossibilité absolue d’y éviter les longues causeries ; les Mugronais n’ont rien à faire, aussi ne tiennent-ils pas compte des heures, si ce n’est de celles du dîner et du souper ; puis ils ressemblent un peu à Pope : ce sont des points d’interrogations ; je vous laisse à penser s’il faut enfiler des paroles. Par une manœuvre habile je [78] les mets bien sur les cancans du village ou sur le dada de leur originalité ; par là je gagne quelque répit, mais en définitive franchement, je parle trop et c’est ce qui m’a valu encore une crise qui heureusement n’a pas eu de suite. Maintenant je suis beaucoup mieux, et prêt à partir pour les Eaux-Bonnes, quand il plaira au soleil de jouer son rôle, mais c’est un paresseux ; nous voyons d’ici les montagnes couvertes de neige, elles ne seront guère habitables avant le mois de juin.
En regardant Mugron avec des yeux devenus citadins, je crois que j’aurais honte de vous le montrer, je rougirais pour lui de ses maisons enfumées, de son unique rue déserte, de ses mobiliers patriarcaux, de sa police négligée ; son seul charme consiste dans une rusticité naïve, une pauvreté qui ne cherche pas à se cacher, une nature toujours silencieuse et calme, une complète absence d’agitation, toutes choses qui ne plaisent et ne sont comprises que par l’habitude ; pourtant, dans cette uniformité d’existence placez deux affections et je soutiens que c’est l’uniformité de bonheur ; comme cela aussi devient l’uniformité de l’ennui et du néant, si ces [79] affections. J’y ai retrouvé celle de Félix. Il est impossible de dire avec quelle joie nous avons repris nos entretiens interrompus, et ce qu’il y a d’attrait dans ce commerce de deux âmes sympathiques, de deux intelligences parallèles nées le même jour, jetées au même monde, nourries du même lait, et portant sur toutes chose un jugement identique ; religion, philosophie, politique, économie sociale, tout y passe sans que sur aucun sujet nous réussissions à voir poindre entre nous la moindre dissidence ; cette identité d’appréciation nous est une grande garantie de certitude, d’autant que, n’ayant jamais eu que très-peu de livres, ce sont bien nos opinions propres qui sont en contact, et non l’opinion d’un maître commun ; mais, malgré les douceurs de cette société, il y a ici un vide ; Félix et moi, nous nous touchons surtout par l’intelligence ; quelque chose manque au cœur : me voilà en pleine personnalité ; j’en ai honte et pour me punir je vous quitte jusqu’à demain.
Le 28. — Le courrier arrive, les mains vides ; car qu’est-ce que ce tas de lettres et de journaux ? Pourtant je reconnais l’écriture [80] de Paillottet, que peut-il me dire ? Il ne vous connaît pas, il n’aura pas rencontré M. Cheuvreux ; je regrette maintenant de n’avoir pas osé vous le présenter, car je pressentais qu’il serait exact, qu’il serait bon pour moi. Oh ! j’espère bien qu’il n’est rien survenu d’affligeant à l’hôtel Saint-Georges.
Adieu, mesdames, je sens que je recommence à écrire en fa mineur ; il vaut mieux m’arrêter en vous assurant de mon attachement respectueux et dévoué.
F. Bastiat.
Mugron, le 11 juin 1850. ↩
Chère demoiselle,
C’était ma résolution, toujours bien arrêtée, de laisser passer une grande semaine sans vous écrire ; car, on a beau compter sur la bienveillance de l’amitié, encore faut-il n’en pas abuser ; mais il me semble que mon empressement a bien des excuses ; vous m’annoncez que votre mère est souffrante et je suis au bout du monde, [81] je ne puis plus envoyer ma rustique Franc-comtoise à l’hôtel Saint-Georges, pour y prendre des informations. Enfin, vous voilà installés à Fontainebleau, loin du bruit ; il faut espérer que huit jours de retraite et de silence rétabliront toutes les santés ébranlées ; c’est hier, pas M. Say, que j’ai appris votre disparition. Cette nouvelle m’a d’abord fait un singulier effet, comme si une autre centaine de lieues était venue se placer entre nous ; c’est que n’ayant jamais été à Fontainebleau, mon imagination est toute déroutée.
Je ne puis assez, chère demoiselle, vous remercier de tout ce que vous me dites d’affectueux ; vous m’envoyez des paroles si douces qu’elles ressemblent à ces réminiscences d’accords ou de parfums, dont les gens se souviennent quelquefois tout à coup, et auxquels se mêlent quelque souvenirs d’enfance.
Mais, je distingue dans votre lettre que la gaieté ne vous est pas encore revenue , voyons si je me trope : vous avez ce noble empire sur vous-même qui fait, dès qu’il le faut, vaincre les émotions, mais vous n’avez [82] pas cette insouciance qui les fait oublier ; votre nature excitera toujours la sympathie et l’admiration, mais elle rencontrera difficilement dans ce monde le calme, d’où naît la gaieté durable. Que dites-vous de cet essai psychologique ? Juste ou non, je vous le livre, de grâce ne cherchez pas à vous changer, vous n’y gagneriez rien.
Je pars demain pour les Eaux-Bonnes ; c’est encore une excuse dont cette lettre se précautionne ; ce mot Eaux-Bonnes me rappelle la triste chance que je cours ; qui sait si je n’en partirai pas au moment où vous y arriverez ? Qui sait si votre chaise de poste ne croisera pas l’énorme véhicule qui me reportera à Paris ? — Avouez que ce serait bien dépitant pour moi.
Oh ! venez aux Pyrénées ! venez dès à présent respirer cet air pur toujours embaumé ; venez jouir de cette nature si paisible, si imposante ; là, vous oublierez les troubles de cet hivers et la politique ; là vous éviterez les ardeurs de l’été ; tous les jours vous varierez vos promenades, vos excursions, vous contemplerez de nouvelles merveilles ; les forces, la santé, l’élasticité morale vous reviendront, vous vous réconcilierez avec l’exercice [83] physique, vous aurez la joie de voir votre père perdre de vue toutes ces inquiétudes, trop inséparables aujourd’hui de la vie parisienne ; décidez-vous donc ; je vous mènerai à Biarritz, à Saint-Sébastien, dans le pays basque ; voyage pour voyage, cela ne vaut-il pas mieux que le Belgique et la Hollande ?
Il n’y a que deux peuples au monde, dit un écrivain : « Celui de la bière et celui du vin. » Si vous voulez savoir comment on gagne de l’argent, allez étudier le peuple de la bière ; si vous préférez voir comment on rit, on chante, on danse, venez visiter le peuple du vin.
Je m’étais fait un peu d’illusion sur l’influence de l’air natal ; quoique la toux soit moins fréquente, j’ai toutes les nuits un peu de fièvre, mais la fièvre et les Eaux-Bonnes n’ont jamais pu marcher ensemble.
Je voudrais bien guérir aussi d’un noir dans l’âme, que je ne sais m’expliquer. D’où vient-il ? Est-ce des lugubres changements que Mugron a subis depuis quelques années ? Est-ce de que les idées me fuient sans que j’aie la force de les fixer sur le papier au grand dommage de la postérité ? Est-ce… [84] Est-ce ? Mais, se je le savais, cette tristesse aurait une cause et elle n’en a pas… Je m’arrête tout court, avant d’entamer la fade jérémiade des spleenitiques, des incompris, des blasés, des génies méconnus, des âmes qui cherchent une âme, race maudite que je déteste ; j’aime mieux qu’on me dise tout simplement comme à Bazile : c’est la fièvre, buono sera.
Adieu, dites à votre père et à votre mère combien je suis sensible à leur souvenir. Adieu, quand vous reverrai-je tous ? Adieu, je répète ce mot qui n’est jamais neutre ; car c’est le plus pénible ou le plus doux qui puisse sortir de mes lèvres.
Croyez, chère demoiselle, au tendre attachement de votre dévoué,
F. Bastiat.
[85]
15 juin 1850. ↩
Ma chère madame Cheuvreux,
Arrivé hier soir aux Eaux-Bonnes, je suis allé ce matin à la poste ; la raison me disait qu’il n’y aura rien, et le pressentiment murmurait il y aura quelque chose ; en effet, la raison a eu tort, comme il advient souvent malgré son nom.
Ainsi, grâce à votre bonté, je me sens un fonds de joie qui m’avait abandonné, et notre délicieuse vallée ne perdra rien à ce que je la revoie sous ces impressions.
Jeudi, j’entrai à Pau vers spet heures ; je fus à la rue du Collége, où je crois avoir deviné l’hôtel que vous avez habité. Que cette vue de Pau est à la fois riante et imposante ; de légers nuages cachaient la montagne, on ne jouissait que du premier plan : le Gave, Gélos, Bizanos, les coteaux et les villas de Jurançon.
Si mon astre, en naissant, m’avait créé poëte, au lieu de faire de moi un froid économiste, je vous adresserais des stances, car il y avait en moi un peu de Lamartine ; [86] vous et votre Louise, n’avez-vous pas envoyé bien des sourires à ce paysage, et, ne semble-t-il pas en avoir gardé le souvenir ! Mais la poésie a des a des licences que la prose n’admet pas.
J’ai pris aux Eaux-Bonnes une chambre à trois croisées, bien aérée ; bien soleillée, mon horizon est admirable. Pour la première nuit, j’ai dormi douze heures, au murmure du Valentin ; déjà en me levant, je me sentais dans la meilleure disposition, quand est survenue l’aimable surprise de votre lettre ; elle m’a accompagnée dans mon excursion matinale et me voici mieux d’esprit et de corps, que je ne l’ai été depuis longtemps. Avis à mes amis ; il ne faut jamais prendre trop au sérieux les élégies d’un homme nerveux.
Vous me grondez, mesdames, d’avoir été infidèle à mes chères Harmonies ; mais ne m’ont-elles pas montré le mauvais exemple ? — Quel gage m’ont-elles donné de leur affection ? Depuis six mois elles ne m’adressent la parole que par la bienveillante entremise de ce bon Paillotet ; — sérieusement, je vois bien que ce livre, s’il doit jamais être utile, ne le sera que dans un temps fort éloigné ; et peut-être cette appréciation est-elle encore [87] un refuge de l’amour-propre. L’occasion s’étant présentée de faire une petite brochure plus actuelle, je l’ai saisie ; j’en ai une seconde dans la tête ; je voudrais peindre tel que je le comprends l’état moral de la nation française ; analyser et disséquer les éléments très-divers qui constituent nos deux grands partis politiques : le socialisme et la réaction ; distinguer ce qu’il y a en eux de justifiable, de raisonnable de ce qu’ils contiennent de faux, d’exagéré, d’égoïste et d’imprudent ; le tout terminé par une solution, ou l’aperçu de ce qu’il y a à faire ou plutôt à défaire.
Les élections n’auront lieu qu’en 1854 ; ne portons pas pas si loin notre prévoyance ; je sais dans quel esprit les électeurs m’ont nommé et je ne m’en suis jamais écarté. Ils ont changé, c’est leur droit. Mais je suis convaincu qu’ils ont mal fait de changer ; il avait été convenu qu’on essayerait loyalement la forme républicaine, pour laquelle je n’ai, quant moi, aucun engouement ; peut-être n’eût-elle pas résisté à l’expérience même sincère ; alors, elle serait tombée naturellement, sans secousse, de bon accord, sous le poids de l’opinion politique : au lieu de cela, on [88] essaye de la renverser par l’intrigue, le mensonge, l’injustice, les frayeurs organisées, calculées, le discrédit ; on l’empêche de marcher, on lui impute ce qui n’est pas son fait ; et on agit ainsi contrairement aux conventions, sans avoir rien à mettre à la place.
Ne serait-il pas singulier qu’après tant de projets et d’hésitation, vous en revinssiez tout simplement à la Jonchère ? Cette campagne a été un peu calomniée ; demandez plutôt à la jardinière ? Au demeurant, vous y avez passé un bon été. J’irai vous y voir le plus souvent possible. M. Piscatore veut m’offrir son Buttard une seconde fois.
Votre prochaine lettre me dira ce qui a été résolu. Savez-vous que sous ce rapport, elles sont redoutables ! Jamais la précédente ne me laisse entrevoir ce qu’annonce la suivante ; passe encore pour quatre jours à Fontainebleau, mais je crains que vous ne finissiez par m’écrire de Rome ou de Spa.
Mlle Louise sera rentrée à temps pour jouir des jeunes cousines dont elle s’éloigne à regret ; pourquoi donc ne veut-elle pas s’assurer dans ce genre, un bonheur rapproché, plus direct, plus permanent ? [89] Elle devrait quelquefois se poser cette simple question : que seraient mon père et ma mère s’ils ne m’avaient pas ?
En vous disant adieu, je pense, avec une joie bien vive, que ce n’est pas un adieu à grande distance, un adieu pour plusieurs mois ; je serai à Paris à l’expiration du congé.
Votre ami respectueux et dévoué,
F. Bastiat.
Eaux-Bonnes, 23 juin 1850. ↩
Vous vous êtes donc concertée avec Mlle Louise, madame, pour me faire supporter l’éloignement. Au milieu des soucis d’une installation, vous avez trouvé le temps de m’écrire et, qui plus est, vous me faites pressentir que les absents ne perdront rien à vos loisirs de la Jonchère. Oh ! qu’il y a de bonté dans les cœurs de femmes ! Je sais bien que je dois beaucoup à ma chétive santé ; rappelez-vous que je disais un jour que les moments dont je me souvenais avec le plus de plaisir étaient ceux de la souffrance, à cause des soins touchants qu’elle [90] m’avait valus de la part de ma bonne tante ; vraiment, mesdames, vous donneriez envie d’être malade ; pourtant il ne faut pas que je fasse ici l’hypocrite ; et, dût votre prochaine lettre en être retardée de vingt-quatre heures, je dois bien avouer que je suis mieux ; je prends les eaux avec précaution, quoique sans l’assistance d’un médecin ; à quoi bon ? Les médecins des eaux sont comme les confesseurs, ils ont toujours le même remède. Mais, n’abusez pas de mon aveu, et si vous ne m’écrivez pas à cause de ma santé, écrivez-moi pour me parler des vôtres.
Vous voilà à la Jonchère ; puisque vous vous vantez d’être franches campagnardes, tâchez de vous lever plus matin et de gagner chaque jour quelques minutes ; promenez-vous beaucoup plus ; lisez un peu, le moins possible de journaux ; n’attirez près de vous qu’un petit nombre d’amis à la fois : telle est ma consultation, elle nargue celle de M. Chaumel qui a perdu ma confiance.
Les Eaux-Bonnes commencent à être fort peuplées ; ma table d’hôte n’est cependant pas aussi bien composée qu’à mon dernier voyage ; il se peut que le soin d’éviter la politique [91] refroidisse la conversation ; aujourd’hui, il est arrivé deux Hâvrais qui m’ont mis sur le chapitre de ma Solution du problème social. J’ai profité de l’occasion pour faire de la propagande à fond, récitant à peu près une brochure, que j’ai écrite à Mugron. Chose singulière ! tous disent c’est cela ! c’est cela ! jusqu’à l’application ; là, on m’abandonne. Il est déplorable que les classes qui font la loi ne veuillent pas pas être justes quoi qu’il en coûte, car alors chaque classe veut faire la loi : fabricant, agriculteur, armateur, père de famille, contribuable, artiste, ouvrier ; chacun est socialiste pour lui-même, et sollicite une part d’injustice ; puis on veut bien consentir envers les autres à l’aumône légale, qui est une seconde injustice ; tant qu’on regardera ainsi l’État comme une source de faveurs, notre histoire ne présentera que deux phases : les temps de luttes, à qui s’emparera de l’État ; et les temps de trêve qui seront le règne éphémère d’une oppression triomphante, présage d’une lutte nouvelle. Mais, Dieu me pardonne, je me crois encore à table d’hôte ; je vais me coucher, il vaut mieux jeter la plume que d’en abuser.
[92]
24 juin.
Vous avez vu les Pyrénées à Paris ; moi, je retrouve Paris aux Pyrénées ; ce ne sont que belles dames, belles toilettes, comtesses et marquises ; ce matin, des enfants ont chassé loin d’eux un de leurs camarades, parce qu’il était vêtu en coutil : vous n’êtes pas assez beau ! voilà les propres expressions ; le père, médecin, en était tout humilié.
Ces jours-ci, j’ai été au village d’Aas, vous savez qu’il faut descendre la vallée et la remonter de l’autre côté ; je fus visiter le cimetière, il est chargé de monuments : jeunes hommes et jeunes filles sont venues aux Eaux-Bonnes chercher la fin de leurs souffrances ; ils ont réussi plus qu’ils ne l’espéraient ; faut-il envier leurs sort ? Oh non ! pas encore. Je rencontrai deux dames, et me retirai avec elles ; la fille était faible, svelte, pensive, et redoutant la marche elle cheminait à cheval ; la mère était bien portante, infatigable ; ajoutez à cela le langage le plus pur, les manières les plus distinguées et vous comprendrez que cela devait me rappeler une promenade de la Jonchère.
[93]
Hier dimanche, nous avons eu quelques réjouissances ; mais, hélas ! toute couleur locale s’en va ; les montagnards faisaient leur ronde au son du violon, et des Espagnols ont dansé le fandango en blouse : tambourins, castagnettes, vestes bariolées, résilles et mantilles, qu’allez-vous devenir ? Le violon envahit tout, et pour la blouse il n’y a plus de Pyrénées. Oh ! la blouse, ce sera le symbole du siècle prochain ! Mais, après tout, ce qui nous semble une profanation, n’est-il pas un progrès ? Nous sommes plaisants, nous autres civilisés, si fiers de nos arts et de nos toilettes, de vouloir qu’ailleurs on conserve à tout jamais, pour distraire les touristes, la culotte et le galoubet.
Ai-je bien lu, mesdames, vous me parlez de l’impossibilité de revenir à Paris sans être guéri ; de la nécessité de passer l’hiver à Mugron ! Vous me trouvez donc d’une bien aimable absence ?
Ah ! vous avez beau faire, je prends vos paroles pour des marques d’intérêt, car je suis le plus complaisant interprète du monde ; aussi j’espère rentrer à Paris le 20 juillet, à moins que la Chambre ne se proroge ; ce sera un retard de huit jours sur mon congé : il [94] serait plaisant que l’Assemblée me mît en pénitence pour être revenu trop tard, tandis que vous me gronderiez pour être revenu trop tôt.
Qu’il me tarde d’avoir une lettre de la Jonchère, de savoir si M. Cheuvreux s’est décidé à prendre quelque repos ; si vous poursuivez vos projets de solitude ? Une solitude à trois ! mais c’est l’univers : et puis Croissy n’est-il pas à portée de la main ? et la famille Renouard, les Say, Mme Freppa ? En conscience, je ne puis m’apitoyer sur votre sort !
Mon Dieu ! que j’abuse du joli pupitre de M. Cheuvreux : il a résolu pour moi le problème des plumes ; aussi je n’ai jamais écrit de lettres si incommensurables !
Obtenez mon pardon de Mlle Louise ; et ce que d’autres pourraient appeler indiscrétion, appelez-le amitié.
Adieu, votre dévoué,
F. Bastiat.
[95]
4 juillet 1850. ↩
Enfin, j’ai une lettre de la Jonchère, ma chère madame, et je suis maintenant bien sûr que vous êtes quelque part. De plus, vous m’annoncez que vos débuts à la campagne ont été heureux, que vous faites de longues promenades dans les bois, et que vous recevez de fort aimables visites, puisque vous avez aujourd’hui la famille Say.
Comme j’ai votre première lettre de la Jonchère, voici, je crois, ma dernière lettre des Eaux-Bonnes. Je les quitterai le 8, à moins que d’ici-là je n’apprenne que l’Assemblée prendra des vacances. Mais, dans le doute, il faut que je parte. Ce n’est pas que je sois radicalement guéri ; si ma santé s’améliore, le larynx s’opiniâtre à souffrir.
Décidément aux Eaux-Bonnes, cette année, le ridicule de la gentilhommerie est poussé si loin qu’il gâte tout. On s’y donne un accent, une tournure et des manières dignes du pinceau de Molière ; je ne vois ici que Mme de Latour-Maubourg qui persiste à être simple. Si c’est une leçon qu’elle offre aux précieuses qui l’entourent, cette leçon est perdue ; bien [96] entendu, je n’abuse pas de ce monde-là, car j’ai remarqué qu’on n’y accueille que les personnes qui fournissent l’occasion de dire : « J’étais avec M. de … nous nous sommes promenés avec le comte de, etc. » Ma société se compose d’un lieutenant bien malade, d’un jeune Espagnol presque mort et d’un Parisien de vingt-trois ans, aussi souffrant que deux autres.
Je suis surpris que ce temps d’exil, dont je désirais si vivement le terme, m’ait paru si court : « Tout ce qui doit finir passe vite. » Ce mot est aussi vrai que triste. Au fait, ce n’est pas sans quelques charmes que j’avais retrouvé mes habitudes provinciales. Indépendance, heures libres, travaux et loisirs capricieux, lectures au hasard, pensées errantes au gré de l’impulsion, promenades solitaires, admirable nature, calme et silence, voilà ce qu’on rencontre dans nos montagnes, et la puissance d’un si, d’un seul si en ferait un paradis. Que faudrait-il autre chose qu’une goutte de cette ambroisie qui parfume tous les détail de la vie, et qu’on nomme l’amitié ?
Vous avez vu dans les journaux les succès et les ovations de MM. Scribe et Halevy ; cela vous aura réjouie et fait sans doute un peu [97] regretter de n’en pas être témoin. Mlle Louise avait le pressentiment que d’agréables diversions l’attendaient à Londres. Félicitons-nous de tout ce qui rapproche et unit les peuples : sous ce rapport, la tentative de vos amis portera de bons fruits. Elle induira de plus en plus de nos voisins à étudier le français. La réciprocité serait bien utile, car nous aurions beaucoup à apprendre de l’autre côté de la Manche. J’ai vu avec bonheur que Richard Cobden, dans une circonstance difficile, qui devait être pour lui une épreuve cruelle, n’a ni glissé ni bronché. Il est resté conséquent avec lui-même ; mais ce sont choses que nos journaux ne remarquent pas.
Avez-vous lu, dans la Revue des Deux Mondes, l’article de M. de Broglie sur Chateaubriand ? Je n’ai pas été fâché de voir ce châtiment infligé à une vanité poussée jusqu’à l’enfantillage. Avec un si exclusif égoïsme au cœur, on peut être grand écrivain, mais croyez-vous qu’on puisse être un grand homme ? Pour moi, je déteste ces aveugles orgueilleux qui passent leur vie à poser, à se draper ; qui mettent l’humanité dans le plateau d’une balance, se placent sur l’autre [98] et croient l’emporter. Je regrette que M. de Broglie n’ait pas cherché à apprécier la valeur philosophique de Chateaubriand ; il aurait trouvé qu’elle est bien légère. Dans le onzième volume de ses mémoires, j’ai copié ce paradoxe : « La perception du bien et du mal s’obscurcit à mesure que l’intelligence s’éclaire ; la conscience se rétrécit à mesure que les idées s’élargissent. »
S’il en est ainsi, l’humanité est condamnée à une dégradation fatale et irrémédiable : un homme qui a écrit ces lignes est un homme jugé.
Le 5 juillet.
Voici une autre lettre de la Jonchère, mais qui ne confirme pas la précédente. Dans l’intervalle, j’avais eu des nouvelles par M. Say, et je croyais que vous étiez tous en bonne santé. Je vois que le sommeil vous boude, que Mlle Louise est fatiguée par la chaleur, et que M. Cheuvreux lui-même est indisposé ! Voilà un trio bien organisé ! Ce qui me contrarie vivement, c’est que je ne saurai rien de vous d’ici au 20 juillet, à moins que vous ne soyez assez bonne pour m’écrire encore une fois, ne fût-ce qu’un billet à Mugron. [99] Décidément je quitte les Eaux-Bonnes en répétant le refrain de notre ballade :
Aigues caoutes, aigues rèdes,
Lou mein maou n’es pot guari.
« Eaux chaudes, eaux froides, rien ne peut guérir mon mal. » Il est vrai que le bon chevalier parlait sans doute de quelque blessure étrange, sur laquelle toutes les sources des Pyrénées ne peuvent rien. J’étais plus fondé à compter sur elles pour mon larynx ; il a résisté ; que faire ?
J’aurai probablement de rudes assauts à soutenir à Mugron pour obtenir là aussi un congé. Mais je résisterai, ne pouvant me dispenser de paraître à l’Assemblée.
Voulez-vous aller visiter les Cormiers [9] ! c’est un lieu bien calme, frais et solitaire. Si j’y passe deux mois, je viendrai peut-être à bout de me lancer dans le monde des Harmonies. Ici je ne m’en suis pas occupé ; mon éditeur me presse : je lui dis que la froideur du public me refroidit. En cela, j’ai le tort de mentir. Les auteurs ne perdent pas courage pour si peu. Dans ces sortes de mésaventures, l’ange ou le démon de l’orgueil [100] leur crie : « C’est le public qui se trompe, il est trop distrait pour te lire, ou trop arriéré pour te comprendre. — C’est fort bien, dis-je à mon ange, mais alors je puis me dispenser de travailler pour lui. — Il t’appréciera dans un siècle, et c’est assez pour la gloire », répond l’opiniâtre tentateur.
La gloire ! Le ciel m’est témoin que je n’y prétendais pas ; et si un de ses rayons égarés, bien faible, était tombé sur ce livre, je m’en serais réjoui pour l’avancement de la cause, et aussi quelque peu pour la satisfaction de mes amis ; qu’ils m’aiment sans cela et je n’y penserai plus.
Votre dévoué,
F. Bastiat.
Mugron, 14 juillet 1850. ↩
Votre bonne lettre, mon cher monsieur Cheuvreux, m’est remise à l’instant. Quelques heures plus tard, elle aurait eu à refaire le voyage de Paris dans la même malle que son destinataire, car je me prépare à partir demain. J’ai tort sans doute ; il [101] faut bien que cela soit, puisque tout le monde le dit, et j’ai essuyé déjà je ne sais combien de bourrasques verbales et épistolaires. Je ne prétends pas avoir raison contre tous, quoique Mme Cheuvreux me traite, d’avance, de sophiste. La vérité est que je ne pouvais guère me dispenser de faire acte de présence à la Chambre avant les vacances ; après cela, j’avoue que je cède un peu à la fantaisie. Depuis quelque temps, j’ai une douleur toute locale au larynx, insupportable à cause de sa continuité ; il me semble que je trouverai du soulagement en changeant de place.
Mlle Louise peut craindre que sa lettre se soit égarée dans les Pyrénées. Veuillez la rassurer, on me l’a remise ici à mon arrivée ; vraiment, c’eût été pour moi une grande privation, car votre chère enfant a l’art (si c’est un art) de mettre dans ses lettres son âme et sa bonté. Elle me parle de l’impression que fait sur elle la littérature anglaise ; puis elle déplore la perte des croyances qui caractérise la nôtre.
Je me disposais à répondre une dissertation sur ce texte, mais je la lui épargne ; puisque je pars demain ; je prendrai de vive voix ma revanche.
[102]
Vous avez raison, bien cher monsieur Cheuvreux, de m’encourager à continuer ces insaisissables Harmonies. Je sens aussi que c’est un devoir pour moi de les terminer, et je tâcherai d’y consacrer mes vacances.
Le champ est si vaste qu’il m’effraie.
En disant que les lois de l’économie politique sont harmoniques, je n’ai pas entendu seulement qu’elles sont harmoniques entre elles, mais encore avec les lois de la politique, de la morale et même de la religion (en faisant abstraction des formes particulières à chaque culte) ; s’il n’en était pas ainsi, à quoi servirait qu’un ensemble d’idées présentât de l’harmonie, si cet ensemble était en discordance avec des groupes d’idées non moins essentielles ?
Je ne sais si je me fais illusion, mais il me semble que c’est par là, et par là seulement, que renaîtront au sein de l’humanité ces vives et fécondes croyances que Mlle Louise déplore la perte. Les croyances éteintes ne se ranimeront plus et les efforts qu’on fait, dans un moment de frayer et de danger, pour donner cette ancre à la société sont plus méritoires qu’ils ne seront efficaces. Je crois qu’une épreuve inévitable attend le [103] catholicisme. Un acquiescement de pure apparence que chacun exige des autres, et dont chacun se dispense pour lui-même, ce ne peut être un état permanent.
Le plan que j’avais conçu exigeait que l’harmonie politique fût ramenée à la certitude rigoureuse puisque c’est la base ; cette certitude, il paraît que je l’ai mal établie, car elle n’a frappée personne, pas même les économistes de profession. Peut-être le second volume donnera-t-il plus de consistance au premier. Je me recommande à vous et à Mme pour me détourner dorénavant avant de faire autre chose.
Adieu, mon cher monsieur,
Votre dévoué,
F. Bastiat.
[Editor's Note]↩
Après avoir quitté les Pyrénées au mois de juillet, Bastiat s’établit aux environs de Paris. Il passe ses matinées en solitaire au Buttard [104] et la fin de ses journées à la Jonchère. Mais cette cruelle laryngite s’aggrave ; un travail suivi lui devient chaque jour plus difficile. Ses amis, qui l’avaient vu l’année précédente écrire plusieurs chapitres des Harmonies au milieu du bruit, du mouvement, dans un coin de leur salon, sur le bord d’une table, trempant sa plume unique au fond d’une bouteille d’encre, simple appareil qu’il tirait de sa poche ; ses amis le surprenaient alors repoussant d’un geste impatient le papier posé devant lui ; inactif, et le front courbe, Bastiat restait muet jusqu’au moment où son ardente pensait jaillissait comme une fusée brillante en paroles éloquentes. Mais cette parole ramenait bien vite la douleur de gorge et lui imposait de nouveau le silence.
Le 9 septembre 1850, le malade, avec un sang-froid stoïque, rendait compte lui-même à Richard Cobden des conséquences redoutables de sa situation.
Paris, 9 septembre.↩
Mon cher Cobden, je suis sensible à l’intérêt que vous voulez bien prendre à ma santé. Elle est toujours chancelante. En [105] ce moment, j’ai une grande inflammation, et probablement des ulcérations à ces deux tubes qui conduisent l’air aux poumons et les aliments à l’estomac. La question est de savoir si ce mal s’arrêtera ou fera des progrès. Dans ce dernier cas, il n’y aurait plus moyen de respirer, ni de manger, a very awkward situation indeed. J’espère n’être pas soumis à cette épreuve, à laquelle cependant je ne néglige pas de me préparer, en m’exerçant à la patience et à la résignation. Est-ce qu’il n’y a pas une source inépuisable de consolation et de force dans ces mots : Non sicut ego volo, sed sicut tu ? Une chose qui m’afflige plus que ces perspectives physiologiques, c’est la faiblesse intellectuelle dont je sens si bien le progrès. Il faudra que je renonce sans doute à achever l’œuvre commencée. Mais, après tout, ce livre a-t-il toute l’importance que je me plaisais à y attacher ? La postérité ne pourra-t-elle pas fort bien s’en passer ? Et s’il faut combattre l’amour désordonné de la conservation matérielle, n’est-il pas bon d’étouffer aussi les bouffées de vanité d’auteur, qui s’interposent entre notre cœur et le seul objet qui soit digne des aspirations ? [106] D’ailleurs, je commence à croire que l’idée principale que j’ai cherché à propager n’est pas perdue ; et hier un jeune homme m’a envoyé en communication un travail intitulé : Essai sur le capital. J’y ai lu cette phrase :
« Le capital est le signe caractéristique et la mesure du progrès. Il en est le véhicule nécessaire et unique, sa mission spéciale est de servir de transition de la valeur à la gratuité. Par conséquent, au lieu de peser sur le prix naturel, comme on dit, son rôle constant est de l’abaisser sans cesse. »
Or cette phrase renferme et résume le plus fécond des phénomènes économiques que j’aie essayé de décrire. En elle est le gage d’une réconciliation inévitable entre les classes propriétaires et prolétaires. Puisque ce point de vue de l’ordre social n’est pas tombé, puisqu’il a été aperçu par d’autres qui l’exposeront à tous les yeux mieux que je ne pourrais faire, je n’ai pas tout à fait perdu mon temps, et je puis chanter avec un peu moins de répugnance mon Nunc dimittis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tout en politiquant, écrit-il plus loin, j’oubliais de vous dire que, pour me [107] conformer aux ordonnances des médecins, sans y avoir grand foi, je pars pour l’Italie. Ils m’ont condamnée à passer cet hiver à Pise, en Toscane ; de là, j’irai sans doute visiter Florence et Rome. Si vous avez à quelques amis assez intimes pour que je puisse me présenter à eux, veuillez me les signaler sans vous donner la peine de faire des lettres de recommandation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F. Bastiat.
Lyon, 14 septembre 1850. ↩
Chère demoiselle Louise,
Me voici à Lyon depuis hier soir ; à la rigueur vous auriez pu avoir cette lettre vingt-quatre heures plus tôt, mais en arrivant j’ai hésité entre le pupitre et le lit. Le cœur me poussait vers l’un et le corps vers l’autre : qui m’eût jamais dit que celui-ci l’emporterait dans une lutte de ce genre ? Cependant à peine couché il a été en proie [108] à une forte fièvre, ce qui explique sa victoire et me justifie à ses mes propres yeux. Du reste, soyez sans inquiétude sur cette fièvre, elle est tout accidentelle et ce matin il n’y paraît plus. Mardi, après vous avoir quittés, j’assistai au dîner des Économistes. M. Say nous présidait. Par suite de cette fatigue qui me prend toujours le soir, il me fut impossible d’aller dire adieu à Mme Say, ce dont j’ai bien du regret.
Mercredi je partis à dix heures et demie. Jusqu’à Tonnerre le voyage se fait à Merveille. Nous allions si rapidement que l’on pouvait à peine jouir du paysage ; en sorte que mes yeux s’étant fixés sur un nuage probablement visible à la Jonchère, je me rappelai que vous étiez peu satisfaite des paroles qu’on a mises à la jolie mélodie de Félicien David.
J’en adressai d’autres à mon nuage. Malheureusement elles ne sont pas rimées ; il est donc inutile que je les reproduise ici. De Tonnerre à Dijon commencent des tribulations de toutes sortes. Si vous suivez cette route, comme je l’espère, il faut que M. Cheuvreux se mette en rapport épistolaire [109] avec M. G… qui procure des voitures de poste.
N’étant responsable que de moi-même, je me suis confié au hasard qui aurait pu mieux me servir. Nous étions six dans une rotonde faite pour quatre. Sur six personnes il y avait quatre femmes ; c’est vous dire que nous avions sous les pieds, sur les genoux, dans les flancs, force paquets, cabas, paniers, etc., etc. Vraiment les femmes, si adorables d’abnégation dans la vie domestique, semblent ne pas comprendre que l’on se doit aussi quelque chose, même entre inconnus, dans la vie publique.
De Châtillon à Dijon, j’ai été huché sur une impériale, en quatorzième. C’est pendant ce trajet qu’on franchit le point culminant dont un côté regarde l’Océan, l’autre la Méditerranée. Quand on traverse cette ligne, il me semble qu’on se sépare une seconde fois de ses amis, car on ne respire plus le même air, on n’est plus sous le même ciel. Enfin de Dijon à Châlon, il ne s’agit que de deux heures en chemin de fer, et de Châlon à Lyon c’est une ravissante promenade sur l’eau.
Mais est-ce que je puis dire que je voyage ? [110] J’assiste à une succession de paysages, voilà tout. Ni dans les voitures, ni sur les bateaux, ni dans les hôtels, je n’entre ne communication avec personne. Plus les physionomies paraissent sympathiques, plus je m’en éloigne. Le chapitre des aventures fortuites, des rencontres imprévues, n’existe pas pour moi. Je parcours l’espace comme un ballot de marchandises, sauf quelques jouissances pour les yeux qui en sont bientôt rassasiés.
Vous me disiez, chère demoiselle, que la poétique Italie me serait une source d’émotions nouvelles. Oh ! je crains bien qu’elle ne puisse me tirer de cet engourdissement qui s’empare peu à peu de toutes mes facultés. Vous m’avez donné bien des encouragements et des conseils, mais pour que je fusse impressionnable à la nature et à l’art, il aurait fallu me prêter votre âme, cette âme qui voudrait s’épanouir au bonheur, qui se met si vite à l’unisson de tout ce qui est beau, gracieux, doux, aimable ; qui a tant d’affinité avec ce qu’il y a d’harmonieux dans la lumière, les couleurs, les sons, la vie. Non que ce besoin de bonheur révèle en elle rien d’égoïste, au contraire ; si elle le [111] cherche, si elle l’attire, si elle le désire, c’est pour le concentrer en elle comme en un foyer, et de là le répandre autour d’elle en esprit, en fine malice, en obligeance perpétuelle, en consolations et en affection. C’est avec une telle disposition de l’âme que je voudrais voyager, car il n’y a pas de prisme qui embellisse plus les objets extérieurs. Mais je change de dieux et de ciel sous une bien autre influence.
Oh ! combien est profonde la fragilité humaine ! Me voici le jouet d’un petit bouton naissant dans mon larynx ; c’est lui qui me pousse du midi au nord et du nord au midi ; c’est lui qui ploie mes genoux et vide ma tête ; c’est lui qui me rend indifférent à ces perspectives italiennes dont vous me parlez. Bientôt je n’aurai plus de pensées et d’attention que pour lui, comme ces vieux infirmes qui remplissent toutes leurs conversations et toutes leurs lettres d’une seule idée. Il me semble que me voilà pas mal sur le chemin.
Pour en sortir, mon imagination a une voie toujours ouverte, c’est d’aller à la Jonchère. Je me figure que vous jouissez avec délice des belles journées que septembre [112] tenait en réserve. Vous voilà tous réunis ! Votre cher père et M. Édouard sont revenus de Cherbourg enchantés des magnificences dont ils ont été témoins, et bien pourvus de narrations. Ne fut-ce que la présence de Marguerite, cela suffirait pour faire de votre montagne un séjour charmant. En voilà une qui pourra se vanter d’avoir été caressée ! J’aime beaucoup entendre les parents se reprocher mutuellement de gâter les enfants, petite guerre bien innocente, car les plus gâtés, c’est-à-dire les plus aimés, sont ceux qui réussissent le mieux.
Chère demoiselle, permettez-moi de vous rappeler qu’il ne faut pas chanter trop longtemps, surtout avec les fenêtres ouvertes. Défiez-vous des fraîcheurs de l’automne, évitez de prendre un rhume en cette saison. Songez que s’il vous survenait par votre faute, ce serait comme si vous rendiez malades tous ceux qui vous aiment. Redoutez ces retours de Chatou à onze heures de la nuit. Pour concilier le soin de votre santé et votre goût pour la musique, les soirées ne pourraient-elles pas se transformer en matinées ? Adieu, chère mademoiselle Louise.
[113]
Permettez-moi de vous offrir l’expression de toute mon affection.
F. Bastiat.
Le soir, Lyon, 14 septembre 1850. ↩
Chère madame Cheuvreux,
Je pars demain pour Marseille. En prenant le bateau de onze heures, on n’a que l’inconvénient de coucher à Valence, et ce n’en sera pas un pour moi puisque j’aurai le plaisir de porter des nouvelles à votre frère le capitaine.
Si vous passez à Lyon ne manquez pas de gravir Fourvières ! C’est un horizon admirable où l’on embrasse d’un coup d’œil les Alpes, les Cévennes, les montagnes du Forez et celles de l’Auvergne. Quelle image du monde que ce Fourvières ! En bas, le travail et ses insurrections ; au milieu, des canons et des soldats ; en haut, la religion avec toutes ses tristes excroissances. N’est-ce pas l’histoire de l’humanité ?
En contemplant le théâtre de tant de luttes sanglantes, je pensais qu’il n’est pas de besoin [114] plus impérieux chez l’homme que celui de la confiance dans un avenir qui offre quelque fixité. Ce qui trouble les ouvriers, ce n’est pas tant la modicité des salaires que leur incertitude ; et si les hommes qui sont arrivés à la fortune voulaient faire un retour sur eux-mêmes, en voyant avec quelle ardeur ils aiment la sécurité, ils seraient peut-être un peu indulgents pour les classes qui ont toujours, pour une cause ou une autre, le chômage en perspective. Une des plus belles harmonies économiques c’est l’accession successive de toutes les classes à une fixité de situation de jour en jour plus stable. La société réalise cette fixité à mesure que la civilisation se fait, par le salaire, le traitement, la rente, l’intérêt, enfin par toute ce que repoussent les socialistes. De telle sorte que leurs plans ne font que ramener l’humanité à son point de départ, c’est-à-dire au moment où l’incertitude arrive au plus haut degré pour tout le monde… Il y a là un sujet de recherches nouvelles pour l’économie politique… Mais de quoi vais-je vous entretenir à propos de Fourvières ! Quelle poésie, grand Dieu ! Pour l’oreille délicate d’une femme !… Aideu encore, pardonnez ce torrent de [115] paroles ; je me venge de mon silence, mais est-il juste que vous en soyez victime ?
F. Bastiat.
Marseille, 18 septembre 1850. ↩
Mon cher monsieur Cheuvreux,
Il m’a été pénible de quitter Paris sans vous serrer la main, mais je ne pouvais retarder mon départ sous peine de manquer ici le paquebot-poste. En effet, je suis arrivé hier et n’ai qu’un jour pour tous mes préparatifs, passe-port, etc.
Il n’est pas même certain que je m’embarque ; j’apprends que les voyageurs qui suivent la voie de mer sont accueillis en Italie par une quarantaine. Trois jours de lazaret, c’est fort peu séduisant !
En arrivant à Marseille, ma première visite a été pour la poste, j’espérais y trouver une lettre ; savoir que vous jouissiez tous les trois d’une bonne santé à la Jonchère m’aurait rendu si heureux ! cette lettre n’y était pas. La réflexion m’a fait comprendre mon trop [116] d’exigence, car enfin il y a à peine huit jours que j’ai quitté cette chère montagne ; le silence fait paraître le temps si long ; il n’est point étonnant que j’attache tant de prix à la réception d’une lettre.
Qu’il me tarde d’être à Pise, qu’il me tarde de savoir si ce beau climat raffermira ma tête et mettra à sa disposition deux heures de travail par jour. Deux heures ! ce n’est pas trop demander, et pourtant c’est encore là une vanité.
Sans doute comme à André Chénier, comme à tous les auteurs, il me semble que j’ai quelque chose là ; mais cette bouffée d’orgueil ne dure guère. Que j’envoie à la postérité deux volumes ou un seul, la marche des affaires humaines n’en sera pas changée.
N’importe, je réclame mes deux heures, sinon pour les générations futures, du moins dans mon propre intérêt. Car, si l’interdiction du travail doit s’ajouter à tant d’autres, que deviendrai-je dans cette tombe anticipée ! J’ai passé à Valence la nuit du dimanche au lundi. Malgré le désir que j’avais de voir le capitaine et les efforts que j’ai faits pour cela, je n’ai pu réussir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[117]
Le 19. Décidément je pars demain et par terre. Me voici lancé dans une entreprise dont je ne vois pas le terme.
Ce matin j’espérais encore une lettre, je serais parti plus gaiement ; maintenant le bon Dieu sait où et quand j’entendrai parler de vous tous ; me faudra-t-il attendre quinze jours ?
Veuillez, cher monsieur Cheuvreux, me rappeler au souvenir de la mère et de la fille, les assurer de ma profonde amitié. Ne m’oubliez pas non plus auprès de M. Édouard et de Mme Anna, qui me permettront bien d’embrasser tendrement, quoique de bien loin, leur aimable enfant.
Adieu, cher monsieur Cheuvreux.
F. Bastiat.
Marseille (à bord du Castor), 22 septembre 1850. ↩
Chère madame Cheuvreux,
Avant de quitter la France, permettez-moi de vous adresser quelques lignes. La date de cette feuille va vous surprendre, en voici l’explication.
[118]
Vous savez que, résolu à prendre la voie de terre, j’ai laissé partir le bateau du 19. Dès lors un jour plus tôt ou plus tard n’importait guère, et je ne pouvais me décider à quitter Marseille, sachant qu’une de vos lettres était sur le point d’arriver. J’ai attendu et j’ai bien fait, puisque je reçois enfin vos encouragements si bienveillants, si affectueux, et de plus je sais la grande détermination prise à la Jonchère.
Bref, hier je devais partir par la diligence, mais je ne me dissimulais pas que, pour éviter le Lazaret, je tombais dans d’autres inconvénients : traverser des flots de poussière, aller d’auberge en auberge, de voiturin en voiturin, lutter du larynx avec les portefaix ; toute cela ne me souriait guère. À 11 heures, lisant le journal de Marseille, je vis que le Castor partait pour Livourne dans l’après-midi. Quoique vous me recommandiez d’éviter l’imprévu, je fis arrêter et payer une place, pensant que la quarantaine devrait s’avaler d’un trait en fermant les yeux. Le soir la mer fut si grosse que le bateau ne sortit pas, et voilà comment je griffonne maintenant cette épître pendant qu’on lève l’ancre.
[119]
Depuis que je suis à bord, je m’aperçois qu’on a bien tort d’arrêter sa place le dernier. Au lieu d’avoir une bonne cabine pour soi, on a sa part de la cabine commune.
O imprévoyant ! tu traverseras la Méditerranée dans la cabine commune d’un paquebot, tu mourras dans la salle commune d’un hôpital, et tu seras jeté dans la fosse commune d’un Campo santo ! Qu’importe ! si le bonheur que j’ai rêvé dans ce monde-ci m’attend dans l’autre. Pourtant mieux vaut avoir une cabine à soi ; c’est pour cela que je vous écris afin que vous preniez toutes vos précautions.
Votre voyage me préoccupe ; je croyais d’abord tenir une solution (qui ne cherche des solutions, aujourd’hui ?). Je pensais que Sa Sainteté, qui met son infaillibilité sous la protection de nos baïonnettes, devait épargner une quarantaine dérisoire à ses soldats. Dès lors il eût été facile à M. Cheuvreux et à M. Édouard Bertin d’obtenir passage sur un vaisseau de l’État allant à Civita-Vecchia ; mais il paraît que nos troupes mêmes sont soumises aux mesures sanitaires (mauvaise solution). Enfin, un voyage à travers les [120] Apennins me paraît bien hasardé à la fin d’octobre.
Je comptais écrire à Mlle Louise, car, ainsi qu’un bon gouvernement veut bien prélever beaucoup d’impôts mais les répartit également, je sens la nécessité de diviser le poids de mes lamentations ; ma lettre n’eût pas été aimable, hélas ! En route je n’ai su voir que le côté répréhensible et critiquable des choses. Les couleurs ne sont pas sur les objets, je le sens ben, elles sont en nous-mêmes. Selon qu’on est noir ou rose, on voit tout en noir ou en rose.
Adieu, je ne puis plus tenir la plume sous le frémissement de la vapeur.
Votre dévoué,
F. Bastiat.
Pise, 2 octobre 1850. ↩
Chère madame Cheuvreux,
Sans doute nous nous plaignons tous deux l’un de l’autre : vous de ce déluge de lettres dont je vous accable, et moi je me [121] désole de n’en recevoir aucune. Mais je ne vous accuse pas, il est impossible que vous ayez laissé passer tout ce temps sans m’écrire ; j’attribue mon désappointement à quelque malentendu de la poste italienne. Cette explication est d’autant plus vraisemblable que je suis aussi sans nouvelles de ma famille et de Paillotet. J’ignore si vous persistez dans votre projet de voyage, quelle route vous prendrez, etc. Je suis allé à Livourne pour m’assurer de l’état du Lazaret. Ces grands appartements manquent de meubles ; mais dès que je serai fixé sur votre arrivée, je m’occuperai de préparer deux chambres. Un traiteur passable pourvoira à la nourriture, puis, si vous le permettez, je me mettrai aussi avec plaisir en quarantaine : « … et Phèdre au labyrinthe. » Malheureux ! j’oublie que je ne puis parler et que ma société n’est qu’un nuisance.
Si vous saviez, madame, combien votre entreprise me préoccupe pour Mlle Louise. Ce n’est pas qu’elle présente le moindre danger ; j’espère même du beau temps en octobre, puisque les vents soufflent au mois de septembre, mais je crains que vous ne [122] souffriez toutes deux. J’invoque les bénignes influences du ciel et de la mer !
Enfin voici un moment de bonheur ! Je l’ai lue votre lettre du 25, elle m’arrive accompagnée d’une missive de ma tante et d’une autre de Cobden. Je voudrais que vous me vissiez, je ne suis plus le même.
Est-ce bien digne d’un homme de se mettre ainsi tout entier sous la dépendance d’un événement extérieur, d’un accident de poste ? N’y a-t-il pas pour moi des circonstances atténuantes ? Ma vie n’est qu’une longue privation. La conversation, le travail, la lecture, les projets d’avenir, tout me manque. Est-il étonnant que je m’attache, peut-être avec trop d’abandon, à ceux qui veulent bien s’intéresser à ce fantôme d’existence ? Oh ! leur affection est plus surprenante que la mienne. Vous partez donc le 10 ? Si cette lettre vous parvient, répondez-y de suite.
Vous me recommandez de vous parler comme à la justice, de dire la vérité, toute la vérité ; je le voudrais bien, mais il m’est impossible de savoir si je vais mieux ou plus mal. La marche de cette maladie, qu’elle avance ou qu’elle recule, est si lente, si imperceptible qu’on n’aperçoit aucune [123] différence entre la veille et le lendemain. Il faut prendre des points de comparaison plus éloignés. Par exemple, comment étais-je il y a un an au Buttard ? comment y étais-je cette année, et comment suis-je maintenant ? Voilà trois époques, et je dois avouer que le résultat de cet examen n’est pas favorable.
Le départ de votre frère et de sa famille aura laissé un grand vide à la Jonchère, il suffit d’une gentille enfant comme Marguerite pour remplir toute une maison.
Adieu, chère madame Cheuvreux.
Venez, venez bientôt rendre un peu de mouvement à cette Italie qui me semble morte. Quand vous y serez tous j’apprécierai mieux son soleil, son climat, ses arts. Jusque-là je vais suivre votre conseil, m’occuper exclusivement de mon corps, en faire une idole, lui vouer un culte et me mettre en adoration devant lui. Puissé-je réussir à recouvrer la parole quand vous serez là ! car, madame, auprès de vous le mutisme est pénible ; vous avez une collection de paradoxes que vous défendez fort bien, mais auxquels on est bien aise de répondre.
Adieu, M. Cheuvreux ne va pas être [124] le moins occupé des trois. Je vois prie de croire à ma vive et respectueuse affection.
Votre dévoué,
F. Bastiat.
Pise, le 14 octobre 1850. ↩
Chère madame Cheuvreux,
Enfin ! si rien n’a dérangé vos combinaisons, s’il n’y a pas eu un coup d’État à Paris, si Mlle Louise ne s’est pas laissé gagner par quelque maudite indisposition, ou M. Cheuvreux par la migraine, s’il s’est mis en règle envers son tribunal, si… si vous avez fait en ce moment le premier pas, le plus difficile, celui qui coûte le plus, vous voilà sur le rail-way, en route pour Tonnerre. Chaque soir je pourrai dire : Il y a cinquante lieues de moins entre nous. Oh ! que nos neveux seront heureux d’avoir des télégraphes électriques qui leur diront : « Le départ s’est effectué il y a une minute ! » Et maintenant, mesdames, pourquoi les vœux de l’amitié sont-ils complétement inutiles ? [125] Si les miens pouvaient être exaucés, votre voyage ne serait qu’une succession d’impressions agréables ; vous auriez un beau soleil pour constante société, sans compter d’aimables rencontres tout le long du chemin ; Mlle Louise sentirait ses forces s’accroître d’heure en heure, sa gaieté, son intérêt sympathique à tout ne se démentirait pas un instant. Cette disposition gagnerait son père et sa mère, et vous arriveriez ainsi à Marseille. Là vous trouveriez la mer unie comme une glace, la quarantaine supprimée, etc. Mais tous les souhaits du monde n’empêcheront pas que vous n’ayez choisi le jour de votre départ de manière à grossir beaucoup les difficultés du voyage. Cela tient un peu à ma mauvaise réputation. Vous êtes si convaincu que je ne sais pas discerner la gauche de la droite, à force de le répéter, vos préventions à cet égard sont tellement invétérées, que je passe pour absolument incapable d’exécuter la moindre manœuvre, et bien plus encore de conseiller les autres. C’est pourquoi vous n’avez pas lu un seul mot de tout ce que j’ai écrit à ce sujet. D’après ce que vous me dites, il est clair comme le jour que vous avez sauté à pieds joints tous les [126] passages de mes lettres où je me pose en donneur d’avis. Mais il est inutile de revenir là-dessus, puisque ces avis, en supposant que vous en fissiez cas, arriveront trop tard.
Au lieu d’un bon paquebot français, n’aurez-vous pas un petit bateau sarde bourré de marchandises, couvert de toute espèce de passagers, sans police ni discipline, où les voyageurs de seconde envahissent les premières places et viennent fumer sous le nez des dames ? ce dont on peut se plaindre d’autant moins au capitaine que celui-ci donne l’exemple de toutes les infractions à la règle. Enfin ce pèlerinage commence à la grâce de Dieu, il faut bien qu’il se termine de même.
Bien chère madame, comment finir cette lettre sans solliciter un pardon dont j’ai bien besoin ? Je me suis beaucoup récrié à propos de votre silence ; j’étais ben ingrat, bien injuste, car j’ai reçu plus de lettres, non pas que je n’en désirais, mais que je n’osais en espérer. Seulement, la première a tardé et s’est trouvée un peu laconique ; voilà la cause de tout ce bruit. Soyez indulgente pour les doléances des malades : on les plaint, on [127] les excuse, on y condescend quand on est bonne comme vous, mais on ne s’en fâche pas.
Adieu, votre dévoué,
F. Bastiat.
Pise, le 29 octobre 1850. ↩
Chère madame Cheuvreux,
Que votre voyage de Florence à Rome a dû être pénible [10] ! Malgré ce fonds de philosophie avec lequel vous savez prendre les contrariétés, malgré la bonne humeur que chacun de vous aura apporté à la communauté, il n’est pas possible que vous n’ayez pas souffert avec un si horrible temps, à travers des routes défoncées et dans un pays sans ressources. Mon imagination ose à peine vous suivre dans cette Odyssée ; toutes les prédictions de M. Sturler se dressent devant elle. Combien je bénis pourtant l’heureuse inspiration qui [128] vous a fait prendre la mer à Marseille le 19 ! Deux jours plus tard la traversée est devenue dangereuse, la Méditerranée s’est soulevée au point de désorganiser tous les services, et le bateau arrivé à Gênes, qui vous a suivis, n’a pu parvenir jusqu’à Livourne. Il a relâché à la Spezzia, où il a abandonné ses passagers. Grâce au ciel, vous avez échappé à ces périls, et cette idée me console un peu de vos privations actuelles, qui heureusement finiront ce soir. La vue de la ville éternelle fait tout oublier. Cette ville éternelle, je compte y entrer samedi 2 novembre. Je partirai de Livourne par le paquebot de l’État (tempo permettendo), et vous comprenez que je ne m’arrêterai pas à Civita-Vecchia.
Chère madame, ne parlons pas de ma santé, c’est une sonate dont j’aurai tout le temps de vous étourdir à Rome. Quand je pense que vous êtes venue pour procurer à votre mari, à votre fille surtout, plaisirs et distractions, j’ai quelques remords de me jeter au milieu de vous comme un trouble-fête, car je m’aperçois bien que depuis longtemps je tourne au Victor Hugo, à ses Derniers jours d’un condamné, ce qui devient peu récréatif pour [129] mes amis. Encore je m’avise de trouver le héros de Victor Hugo bien heureux ; car enfin il pouvait penser et parler ; il était dans la même position que Socrate, pourquoi n’a-t-il pas pris les choses comme lui ?
Ce petit livre que je vous ai demandé nous montre ce philosophe athénien, condamné à mort, dissertant sur son âme et son avenir ; cependant Socrate était païen, il était réduit à se créer, par le raisonnement, des espérances incertaines. Un condamné chrétien n’a pas ce chemin à parcourir ; la révélation le lui épargne, et son point de départ est précisément cette espérance, devenue une certitude, qui pour Socrate était une conclusion. Voilà pourquoi le condamné de Victor Hugo n’est qu’un être pusillanime. Ne vaut-il pas mieux avoir devant soi un mois de force et de santé, un mois de vigueur de corps et d’âme, et la ciguë au bout, qu’un an ou deux de déclin, d’affaiblissement, de dégoût, pendant lesquels tous les liens se rompent, la nature ne semblant plus prendre d’autre soin que de vous détacher de la terrestre existence ? Enfin, à Dieu d’ordonner, à nous de nous résigner.
Il me paraît bien que je suis un peu mieux ; [130] j’ai pu faire d’assez longues séances chez M. Mure, de plus j’ai reçu un très-grand nombre de visites.
Paillotet m’a écrit ; c’est toujours le même homme, bon, obligeant, dévoué et de plus naïf, ce qui est assez rare à Paris. Ma famille me donne aussi de ses nouvelles.
Adieu, chère madame Cheuvreux, à samedi ou dimanche ; d’ici là, veuillez assurer M. Cheuvreux et votre fille de toute mon amitié, n’oubliez pas le capitaine et veuillez présenter mes compliments et mes respects à M. Édouard et à Mme Bertin.
F. Bastiat.
Rome, 8 décembre 1850. ↩
Cher Paillotet,
Suis-je mieux ? Je ne puis le dire, je me sens toujours plus faible. Mes amis croient que les forces me reviennent ; qui a raison ?
La famille Cheuvreux quitte Rome immédiatement par suite de la maladie de [131] Mme Girard. Jugez de ma douleur. J’aime à croire qu’elle vient surtout de celle de ces bons amis, mais assurément des motifs plus égoïstes y ont une grande part. Par un hasard heureux, j’écrivis hier à ma famille pour qu’on m’expédiât une espèce de Michel Morin, homme plein de gaieté et de ressources, cocher, cuisinier, etc., etc., qui m’a souvent servi et qui m’est entièrement dévoué. Dès qu’il sera ici, je serai maître de partir pour la France quand je voudrai ; car il faut que vous sachiez que le médecin et mes amis ont pris à ce sujet une délibération solennelle.
Ils ont pensé que la nature de ma maladie me crée des difficultés si nombreuses que tous les avantages du climat ne compensent pas les soins domestiques. D’après ces disposition, mon cher Paillotet, vous ne viendrez pas à Rome gagner auprès de moi les œuvres de la miséricorde. L’affection que vous m’avez vouée est telle que vous en serez contrarié, j’en suis sûr. Mais consolez-vous un peu en pensant que vous auriez pu faire bien peu pour moi, si ce n’est me tenir compagnie deux heures par jour, chose encore plus agréable que raisonnable.
[132]
Je voudrais pouvoir vous donner à ce sujet des explications, mais bon Dieu ! des explications, il faudrait beaucoup écrire et je ne puis.
Mon ami, sous des milliers de rapports, j’éprouve le supplice de Tantale. En voici un nouvel exemple, je voudrais vous dire toute ma pensée, et je n’en ai pas la force…
Rome, samedi 14 décembre 1850. ↩
Bien chère madame Cheuvreux,
J’espère m’asseoir quelquefois à ce pupitre, ajouter une ligne à une ligne pour vous envoyer un souvenir.
Je n’ai jamais été si près du néant et je voudrais être tout-puissant pour rendre la mer calme comme un lac.
Quelles émotions, quels devoirs vous attendent à Paris ! Ma seule consolation, c’est de me dire que vous êtes prête à entrer, avec une courageuse énergie, dans la voie que Dieu vous aura préparée, fût-ce la plus pénible.
Ma santé est la même. Si j’entreprenais [132] d’en parler, ce ne pourrait être que par une série de petits détails qui, le lendemain, n’ont plus aucune importance.
Au fond, je crois que le docteur Lacauchy a raison de ne pas écouter un mot de ce que je lui dis.
Je me réjouis à l’idée que M. Cheuvreux verra bientôt l’excellent, le trop excellent Paillotet et le décidera à renoncer à un acte de dévouement aujourd’hui tout à fait inutile. Je crains bien que sa présence à Paris ne me soit absolument indispensable si on réimprime les Harmonies. Je ne pourrai pas m’en occuper, tout retombera sur lui.
Dimanche, 15 décembre.
Vous voilà à Gênes, encore un peu de patience et vous voilà en France. Il est cinq heures, c’est l’heure où vous veniez me voir. Alors je savais quelle galerie Mlle Louise avait visitée, quelle ruine, quel tableau l’avait intéressée. Cela éclairait un peu ma vie. Tout est fini, je suis seul vingt-quatre-heures, sauf les deux visites de mon cousin de Monclar. L’heure à laquelle je fais allusion est devenue amère parce qu’elle était trop douce ; [134] vous me prouviez avec la science de votre père que j’avais raison d’être le plus maussade, le plus bête, le pus irritable et souvent le plus injuste des hommes. Au reste, il me semble que j’apprends la résignation et que j’y trouve un certain parfum.
Lundi, 16 décembre.
Quand Jospeh est venu me faire ses adieux, le pauvre homme s’est confondu en remercîments. Hélas ! des remercîments, personne ne m’en doit et j’en doit à tout le monde, surtout à Joseph, qui m’a été d’un secours si réel.
Nouvelle découverte ! Un mouvement précipité m’a ôté toute respiration. Une haleine ne pouvant joindre l’autre, c’est une souffrance des plus pénibles. J’en ai conclu que je devais agir en tout lentement comme un automate.
Mardi, 17 décembre [11] .
Paillotet est arrivé. Il m’annonce l’affreux événement. Oh ! pauvre femme ! pauvre [135] enfant ! vous avez reçu le coup le plus terrible, le plus inattendu. Comment l’aurez-vous supporté avec une âme si peu faite pour souffrir ? Louise saura se posséder davantage dans la douleur. Jetez-vous dans les bras de cette force divine, la seule force qui puisse soutenir en de telles épreuves. Que cette force ne vous abandonne jamais. Chers amis, je n’ai pas le courage de continuer ces mots sans suite, ces propos interrompus.
Adieu, malgré mon état d’anéantissement je retrouve encore de vives étincelles de sympathie pour le malheur qui est venu vous visiter.
Adieu, votre ami,
Frédéric Bastiat.
De M. Paillotet à Mme Cheuvreux. Rome, 22 décembre 1850. ↩
Madame,
J’acquitte une dette personnelle et remplis les intentions de notre ami en vous donnant de ses nouvelles. Vous vous faisiez [136] peu d’illusion lorsque vous l’avez quitté ; et cependant vous ne pouviez croire que le déclin de ses forces serait aussi rapide. Ce déclin est bien sensible depuis mon arrivée ici. Le pauvre malade s’en aperçoit et s’en réjouit intérieurement comme d’une faveur du ciel qui veut abréger ses souffrances. Il a d’abord protesté en paroles et en gestes contre ce qu’il appelait ma folie. Nous avons eu peine à lui faire entendre raison à ce sujet M. de Monclar et moi. Toutefois je n’ai pas tardé à reconnaître que ma présence était une consolation et je vous sais un gré infini, madame, de m’avoir mis à même de la lui procurer. « Puisque vous avez accompli ce voyage, je suis bien aise maintenant que vous soyez ici, » m’a-t-il dit le troisième jour. Il ne manque jamais d’ailleurs de me demander lorsque je le quitte : « Et à quelle heure vous verrai-je demain ? »
Voici comment, avec M. de Monclar, dont tout naturellement j’ai consulté les convenances, nous nous sommes partagé ses journées. M. de Monclar lui fait une visite matinale et se retire au moment où j’arrive, c’est-à-dire à onze heures et demie. Moi, je lui [137] tiens compagnie jusqu’à cinq heures après midi, et, dans l’après-dîner, c’est M. de Monclar qui revient.
C’est un bien douloureux spectacle que celui auquel j’assiste ; mais je regretterais beaucoup, par affection et par devoir, de n’être pas là. Presque toujours, la mort est en tiers dans nos entretiens. Nous évitons, lui et moi, d’en prononcer le nom ; lui pour ne pas m’affliger, moi pour ne pas lui donner l’exemple de l’attendrissement et des pleurs, lorsqu’il me donne celui du courage. Il meurt, en effet, comme j’ai toujours pensé qu’il devait mourir, en regardant la mort en face et avec une complète résignation.
Les sujets de nos entretiens sont les amis absents, parmi lesquels vous et les vôtres avez la première place ; puis sa science chérie, cette économie politique pour laquelle il a tant fait, pour laquelle il eût voulu tant faire encore. Je n’ai pas besoin de vous dire que ces entretiens sont fort courts et que c’est de loin en loin que j’approche mon oreille de ses lèvres. Les quelques phrases qu’il prononce, je les recueille avec un religieux respect.
[138]
Hier nous avons fait une promenade qui l’a ravi. En sortant par la porte del Popolo, nous sommes allés au ponte Molle et revenus par la porte Angelica. Un beau soleil illuminait les sites que nous avions sous les yeux. Il me répétait souvent : « Quelle délicieuse promenade ! Comme nous avons bien réussi ! » La sérénité du ciel avait passé dans son âme. Il adressait comme un dernier adieu aux splendeurs de la nature qui ont si souvent excité son enthousiasme.
Depuis le 20 de ce mois il s’est confessé. « Je veux, m’a-t-il dit, mourir dans la religion de mes pères. Je l’ai toujours aimée, quoique je n’en aie pas suivi les pratiques extérieures. »
Je me borne à ces quelques détails et peut-être même dois-je m’excuser de vous les présenter, à vous qui êtes déjà sous le poids de la plus légitime affliction causée par la plus cruelle des pertes.
Il s’en est peu fallu que je ne vous rencontrasse à Livourne, où nous étions, à ce qu’il paraît, le même jour, ce que j’ai su depuis. Je me suis d’ailleurs applaudi de ce que cette rencontre n’avait pas eu lieu, car vous aviez encore alors un reste [139] d’espoir qu’il m’eût été difficile de ne pas vous enlever.
Veuillez bien offrir, madame, à M. Cheuvreux mes affectueux souvenirs et recevoir, ainsi que Mlle Cheuvreux, l’hommage de mon respectueux dévouement.
P. Paillotet.
[Editor's Note]↩
Jusqu’à son dernier jour, Bastiat a voulu, d’une volonté invicible, éclairer, servir et unir les hommes. Convaincu que tous leurs intérêts légitimes sont harmoniques et non pas antagonistes, il supplie la jeunesse, à laquelle son livre est dédié, d’acquérir de la science et de l’expérience. « Esprits dégagés de préjugés invétérés, libres de toute haine, dit-il, cœurs dévoués, enthousiastes de tout ce qui est bon, beau, simple, grand, honnête, étudiez, observez le problème social ; vous comprendrez bientôt que Dieu ne s’est pas plu à fonder le monde sur une dissonance révoltante et irrémédiable. »
Épuisé, détruit par un mal toujours croissant qui le martyrisait, il combattait encore le scepticisme dont il redoutait par-dessous tout les progrès : « Jeunes gens, répétait-il, [140] pour aider au triomphe du bien, croyez en vous-mêmes, en votre responsabilité qui ne peut se concevoir sans la liberté. »
Les forces du patient étaient vaincues, mais sa foi de missionnaire restait inébranlable. La tendresse qu’il avait vouée à sa seconde mère, aux siens, à ses amis, comme sa foi, malgré les plus vives souffrances, ne s’est jamais altérée. Sans cesse ramené par ses méditations à la contemplation des œuvres divines, chaque preuve nouvelle de la sagesse, de la bonté du Créateur lui causait des enchantements [141] ineffables ; son âme, profondément religieuse, naturellement tournée vers la lumière, sembla l’entrevoir tout entière au moment suprême. « La vérité, la vérité, » répéta-t-il deux fois en pressant le crucifix de ses lèvres. Quelques minutes plus tôt, on l’avait entendu murmurer : « Je suis heureux que mon esprit m’appartient. » Bastiat allait atteindre sa cinquantième année quand il mourut à Rome le 26 décembre 1850. Dans l’église de Saint-Louis-des-Français, une dalle de marbre recouvre sa tombe et rappelle à ses compatriotes un nom qui honore leur patrie. Aujourd’hui, en 1877, sur la place du village de Mugron, vis-à-vis de la maison qui fut la sienne, un monument s’élève à sa mémoire. Déjà près de vingt-sept ans se sont écoulés depuis que l’auteur des Harmonies a cessé d’exister, et sa doctrine comprise se propage. Sa gloire est consacrée, la postérité a commencé pour lui.
Endnotes
[1] Fontenay.
[2] Discussion à la Chambre, à propos d’une dépêche télégraphique adressée par le ministre de l’intérieur Faucher aux préfets quelques jours avant les élections du 18 mai 1849.
[3] Paroles de Gœthe dans Mignon.
[4] M. Pescatore, propriétaire des bois du Buttard, avait mis à la disposition de M. Bastiat le pavillon qui servait autrefois de rendez-vous de chasse. Dans ce lieu solitaire et charmant, situé tout près du château de la Jonchère, le travailleur écrivit les premiers chapitres des Harmonies.
[5] Place force de Hongrie.
[6] Les Harmonies.
[7] Voyez les Harmonies, chapitre de la valeur.
[8] Gabrielle.
[9] Bois du Buttard.
[10] Les amis de Bastiat, après avoir passé deux jours près de lui à Pise, étaient allés l’attendre à Rome.
[11] Cette lettre, la dernière qu’il ait écrite, n’a précédé sa mort que de huit jours.