Gustave de Molinari
Les Soirées de la Rue Saint-Lazare:
Entretiens sur les lois économiques et défense de la propriété (1849)
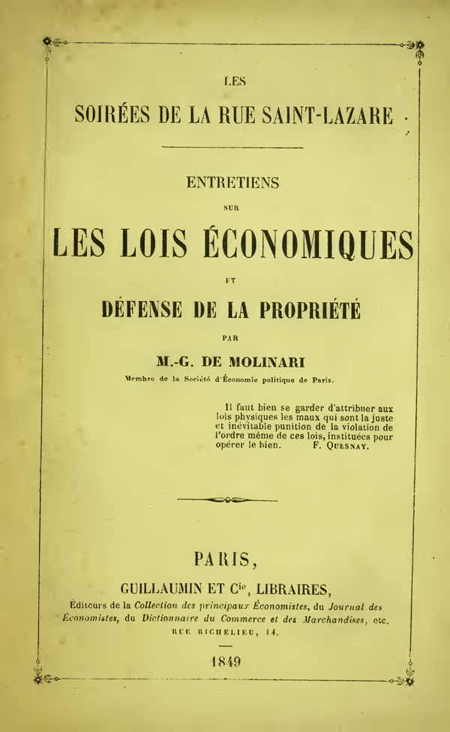 |
Il faut bien se garder d’attribuer aux lois physiques les maux qui sont la juste et inévitable punition de la violation de l’ordre même de ces lois, instituées pour opérer le bien. F. Quesnay.
 |
This is an e-Book from |
Source
Gustave de Molinari, Les Soirées de la rue Saint-Lazare; entretiens sur les lois économiques et défense de la propriété (Paris: Guillaumin, 1849).
TABLE DES MATIÈRES
- PRÉFACE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
- PREMIÈRE SOIRÉE.
- SOMMAIRE: Position du problème social.—Que la société est gouvernée par des lois naturelles, immuables et absolues.—Que la propriété est la base de l’organisation naturelle de la société.—Définition de la propriété.—Énumération des atteintes actuellement portées au principe de la propriété. . 5
- DEUXIÈME SOIRÉE.
- SOMMAIRE: Atteintes portées à la propriété extérieure.—Propriété littéraire et artistique.—Contrefaçon.—Propriété des inventions. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
- TROISIÈME SOIRÉE
- SOMMAIRE: Suite des atteintes portées à la propriété extérieure.—Loi d’expropriation pour cause d’utilité publique.—Législation des mines.—Domaine public, propriétés de l’État, des départements et des communes.—Forêts.—Routes.—Canaux.—Cours d’eau.—Eaux minérales. . .70
- QUATRIÈME SOIRÉE.
- SOMMAIRE: Droit de tester.—Législation qui régit l’héritage.—Le droit à l’héritage.—Ses résultats moraux.—Ses résultats matériels.—Comparaison de l’agriculture française avec l’agriculture britannique.—Des substitutions et de leur utilité.—Organisation naturelle des exploitations agricoles sous un régime de propriété libre. . . . . . . . . .92
- CINQUIÈME SOIRÉE.
- SOMMAIRE: Droit de prêter.—Législation qui régit le prêt à intérêt.—Définition du capital.—Mobiles qui poussent l’homme à former des capitaux.—Du crédit.—De l’intérêt.—Éléments qui le composent.—Travail.—Privation.—Risques.—Comment ces éléments peuvent être réduits.—Qu’ils ne peuvent l’être par des lois.—Résultats désastreux de la législation limitative du taux de l’intérêt. . . . . .117
- SIXIÈME SOIRÉE
- SOMMAIRE: Droit d’échanger.—De l’échange du travail.—Lois sur les coalitions.—Articles 414 et 415 du Code pénal.—Coalition des charpentiers parisiens en 1845.—Démonstration de la loi qui fait graviter le prix des choses vers la somme de leurs frais de production.—Son application au travail.—Que l’ouvrier peut quelquefois faire la loi au maître.—Exemple des Antilles anglaises.—Organisation naturelle de la vente du travail. . . . . . . . . .142
- SEPTIÈME SOIRÉE.
- SOMMAIRE: Droit d’échanger, suite.—Échanges internationaux.—Système protecteur.—Son but.—Aphorismes de M. de Bourrienne.—Origine du système protecteur.—Système mercantile.—Arguments en faveur de la protection.—Épuisement du numéraire.—Indépendance de l’étranger.—Augmentation de la production intérieure.—Que le système protecteur a diminué la production générale.—Qu’il a rendu la production précaire et la distribution inique. . 177
- HUITIÈME SOIRÉE.
- SOMMAIRE: Atteintes portées à la propriété intérieure.—Industries monopolisées ou subventionnées par l’État.—Fabrication de la monnaie.—Nature et usage de la monnaie.—Pourquoi un pays ne saurait être épuisé de numéraire.—Voies de communication.—Exploitées chèrement et mal par l’État.—Transport des lettres.—Maîtres de postes.—Que l’intervention du gouvernement dans la production est toujours nécessairement nuisible.—Subventions et priviléges des théâtres.—Bibliothèques publiques.—Subvention des cultes.—Monopole de l’enseignement.—Ses résultats funestes. 206
- NEUVIÈME SOIRÉE.
- SOMMAIRE: Suite des atteintes portées à la propriété intérieure.—Droit d’association.—Législation qui régit, en France, les sociétés commerciales.—La société anonyme et ses avantages.—Du monopole des banques.—Fonctions des banques.—Résultats de l’intervention du gouvernement dans les affaires des banques.—Cherté de l’escompte.—Banqueroutes légales.—Autres industries privilégiées ou réglementées.—La boulangerie.—La boucherie.—L’imprimerie.—Les notaires.—Les agents de change et les courtiers.—La prostitution.—Les pompes funèbres.—Les cimetières.—Le barreau.—La médecine.—Le professorat.—Article 3 de la loi des 7–9 juillet 1833. . . . . . . . . . . . . . .239
- DIXIEME SOIRÉE.
- SOMMAIRE: De la charité légale et de son influence sur la population.—Loi de Malthus.—Défense de Malthus.—De la population en Irlande.—Moyen de mettre fin aux misères de l’Irlande.—Pourquoi la charité légale provoque un développement factice de la population.—De son influence morale sur les classes ouvrières.—Que la charité légale décourage la charité privée.—De la qualité de la population.—Moyens de perfectionner la population.—Croisement des races.—Mariages.—Unions sympathiques.—Unions mal assorties.—Leur influence sur la race.—Dans quelle situation, sous quel régime la population se maintiendrait le plus aisément au niveau de ses moyens d’existence. . . .276
- ONZIÈME SOIRÉE.
- SOMMAIRE: Du gouvernement et de sa fonction.—Gouvernements de monopole et gouvernements communistes.—De la liberté de gouvernement.—Du droit divin.—Que le droit divin est identique au droit au travail.—Vices des gouvernements de monopole.—La guerre est la conséquence inévitable de ce système.—De la souveraineté du peuple.—Comment on perd sa souveraineté.—Comment on la recouvre.—Solution libérale.—Solution communiste.—Gouvernements communistes.—Leurs vices.—Centralisation et décentralisation.—De l’administration de la justice.—Son ancienne organisation.—Son organisation actuelle.—Insuffisance du jury.—Comment l’administration de la sécurité et celle de la justice pourraient être rendues libres.—Avantages des gouvernements libres.—Ce qu’il faut entendre par nationalité. . . . . . . . . . . . . . . 303
- DOUZIÈME ET DERNIÈRE SOIRÉE.
- SOMMAIRE: La rente.—Sa nature et son origine.—Résumé et conclusion. . . . . . . . . . . . . . . . . .238
- NOTES
PRÉFACE↩
La société, disaient les économistes du dixhuitième siècle, s’organise en vertu de lois naturelles; ces lois ont pour essence la Justice et l’Utilité. Lorsqu’elles sont méconnues, la société souffre; lorsqu’elles sont pleinement respectées, la société jouit d’un maximum d’abondance, et la justice règne dans les relations des hommes.
Ces lois providentielles sont-elles aujourd’hui respectées ou méconnues? Les souffrances des masses ont-elles leur source dans les lois économiques qui gouvernent la société ou dans les entraves apportées à l’action bienfaisante de ces lois? Telle est la question que les événements ont posée.
A cette question, les écoles socialistes répondent tantôt en niant que le monde économique soit, comme le monde physique, gouverné par des lois naturelles; tantôt en affirmant que ces lois sont imparfaites ou vicieuses, el que les maux de la [2] société proviennent de leurs imperfections ou de leurs vices.
Les plus timides concluent qu’il les faut modifier; les plus audacieux sont d’avis qu’il faut faire table rase d’une Organisation radicalement mauvaise et la remplacer par une Organisation nouvelle.
La base sur laquelle repose tout l’édifice de la société, c’est la propriété; les socialistes s’efforcent donc d’altérer ou de détruire le principe de la propriété.
Les conservateurs défendent la propriété; mais ils la défendent mal.
Voici pourquoi.
Les conservateurs sont naturellement partisans du statu quo; ils trouvent que le monde va bien comme il va, et ils s’épouvantent à la seule idée d’y rien changer. Ils évitent, en conséquence, de sonder les profondeurs de la société, dans la crainte d’y rencontrer des souffrances qui nécessiteraient une réforme quelconque dans les institutions actuelles.
D’un autre côté, ils n’aiment pas les théories, et ils ont peu de foi dans les principes. Ce n’est qu’à leur corps défendant qu’ils engagent une discussion sur la propriété; on dirait qu’ils redoutent la lumière pour ce principe sacré. A l’exemple de ces [3] chrétiens ignorants et sauvages qui proserivaient jadis les hérétiques au lieu de les réfuter, ils invoquent la loi, de préférence à la science, pour avoir raison des aberrations du socialisme.
Il m’a semblé que l’hérésie socialiste exigeait une autre réfutation et la propriété une autre défense.
Reconnaissant, avec tous les économistes, la propriété comme la base de l’organisation naturelle de la société, j’ai recherché si le mal dénoncé par les socialistes, et que nul, à moins d’être aveugle ou de mauvaise foi, ne saurait nier, j’ai recherché si ce mal provient, oui ou non, de la propriété.
Le résultat de mes études et de mes recherches a été que les souffrances de la société, bien loin d’avoir leur origine dans le principe de la propriété, proviennent, au contraire, d’atteintes directement ou indirectement portées à ce principe.
D’où j’ai conclu que la solution du problème de l’amélioration du sort des classes laborieuses réside dans l’affranchissement pur et simple de la propriété.
Comment le principe de la propriété sert de base à l’organisation naturelle de la société; comment ce principe n’a pas cessé d’être limité ou méconnu; quels maux découlent des blessures profondes dont [4] on l’a criblé; comment enfin l’affranchissement de la propriété restituera à la société son organisation naturelle, organisation équitable et utile par essence, telle est la substance de ces dialogues.
La thèse que j’entreprends de soutenir n’est pas nouvelle; tous les économistes ont défendu la propriété, et l’économie politique n’est autre chose que la démonstration des lois naturelles qui ont la propriété pour base. Quesnay, Turgot, Adam Smith, Malthus, Ricardo, J.-B. Say ont passé leur vie à observer ces lois et à les démontrer; leurs disciples, MM. Mac Culloch, Senior, Wilson, Dunoyer, Michel Chevalier, Bastiat, Joseph Garnier, etc., poursuivent avec ardeur la même tâche. Je me suis borné à suivre la voie qu’ils ont tracée.
On trouvera peut-être que j’ai été trop loin, et qu’à force de vouloir me tenir dans le droit chemin des principes, je n’ai pas su éviter l’abîme des chimères et des utopies; mais il n’importe! j’ai la conviction profonde que la vérité économique se cache sous ces chimères et sous ces utopies apparentes; j’ai la conviction profonde que l’affranchissement complet, absolu de la propriété seul peut sauver la société, en réalisant toutes les nobles et généreuses espérances des amis de la justice et de l’humanité.
[5]
ENTRETIENS sur LES LOIS ÉCONOMIQUES
INTERLOCUTEURS: Un conservateur.—Un socialiste.—Un économiste.
PREMIÈRE SOIRÉE↩
SOMMAIRE: Position du problème social.—Que la société est gouvernée par des lois naturelles, immuables et absolues.—Que la propriété est la base de l’organisation naturelle de la société.—Définition de la propriété.—Énumération des atteintes actuellement portées au principe de la propriété.
le conservateur.
Débattons ensemble, sans passion, les problèmes redoutables qui ont été soulevés dans ces derniers temps. Vous qui faites une guerre acharnée aux institutions actuelles, vous qui les défendez, sous réserves, que voulezvous donc?
le socialiste.
Nous voulons reconstruire la société.
l’économiste.
Nous voulons la réformer.
le conservateur.
O rèveurs, mes bons amis, je ne demanderais pas [6] mieux, si cela était possible. Mais vous poursuivez des chimères.
le socialiste.
Eh! quoi, vouloir que le règne de la force et de la ruse fasse enfin place à celui de la justice; vouloir que le pauvre cesse d’être exploité par le riche; vouloir que chacun soit récompensé selon ses œuvres, est-ce donc poursuivre une chimère?
le conservateur.
Cet Idéal que tous les utopistes se sont proposé depuis le commencement du monde ne saurait malheureusement être réalisé sur la terre. Il n’est pas donné aux hommes de l’atteindre!
le socialiste.
Je crois tout le contraire. Nous avons vécu jusqu’à ce jour au sein d’une organisation sociale imparfaite, vicieuse. Pourquoi ne nous serait-il pas permis de la changer? Si la société est mal faite, disait M. Louis Blanc, ne pouvons-nous donc la refaire? Les lois sur sur lesquelles repose cette société gangrenée jusqu’à la moelle des os, sont-elles éternelles, immuables? Nous qui les avons jusqu’à présent subies, sommes-nous condamnés à les subir toujours?
le conservateur.
Dieu l’a voulu ainsi.
l’économiste.
Prenez garde d’invoquer le nom de Dieu en vain. Êtes-vous bien sûr que les maux de la société proviennent véritablement des lois sur lesquelles la société repose?
le socialiste.
D’où viendraient-ils?
l’économiste.
Ne se pourrait-il pas que ces maux eussent leur origine dans des atteintes portées aux lois fondamentales de la société?
le socialiste.
La belle apparence que ces lois existent!
l’économiste.
Il y a des lois économiques qui gouvernent la société, comme il y a des lois physiques qui gouvernent le monde matériel.
Ces lois ont pour essence l’Utilité et la Justice. Ce qui signifie qu’en les observant, d’une manière absolue, on est sûr d’agir utilement et équitablement pour soi-même et pour les autres.
le conservateur.
N’exagérez-vous pas, un peu? Y a-t-il bien véritablement, dans les sciences économiques et morales, des principes absolument applicables à tous les temps et à tous les lieux. Je n’ai jamais cru, je l’avoue, aux principes absolus.
l’économiste.
A quels principes croyez-vous donc?
le conservateur.
Mon Dieu! je crois avec tous les hommes qui ont observé de près les choses de ce monde que les lois de la justice et les règles de l’utilité sont essentiellement mobiles, variables. Je crois, en conséquence, qu’on ne saurait baser aucun système universel et absolu sur ces lois. M. Joseph de Maistre avait coutume de dire: Partout j’ai vu des hommes, mais nulle part je n’ai vu l’homme. Eh! bien, je crois qu’on peut dire, de même, qu’il y a des sociétés, ayant des lois particulières, appropriées à [8] leur nature, mais qu’il n’y a pas une société gouvernée par des lois générales.
le socialiste.
Sans doute, puisque nous voulons la fonder cette société unitaire et universelle.
le conservateur.
Je crois encore avec M. de Maistre que les lois naissent des circonstances et qu’elles n’ont rien de fixe... Ne savez-vous pas que telle loi considérée comme juste chez une nation est souvent regardée comme inique chez une autre? Le vol était permis, sous certaines conditions, à Lacédémone; la polygamie est autorisée en Orient, la castration y est tolérée. Direz-vous pour cela que les Lacédémoniens étaient des voleurs éhontés et que les Asiatiques sont d’infâmes débauchés? Non! si vous envisagez sainement les choses, vous direz que les Lacédémoniens en permettant le vol, obéissaient à des exigences particulières de leur situation, et que les Asiatiques, en autorisant la polygamie comme en tolérant la castration, subissent l’influence de leur climat. Relisez Montesquieu! Vous en conclurez que la loi morale ne se manifeste pas en tous lieux et en tous temps de la même manière. Vous en conclurez que la justice n’a rien d’absolu. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au delà, disait Pascal. Relisez Pascal!
Ce qui est vrai du juste ne l’est pas moins de l’utile. Vous parlez des lois de l’utile comme si elles étaient universelles et permanentes. Quelle erreur profonde est la vôtre! Ignorez-vous que les lois économiques ont varié et varient encore à l’infini comme les lois morales?... Objecterez-vous que les nations méconnaissent leurs véritables [9] intérêts en adoptant des législations économiques, diverses et mobiles. Mais vous aurez contre vous l’expérience des siècles. N’est-il pas avéré, par exemple, que l’Angleterre a dû sa fortune au régime prohibitif? N’est-ce pas le fameux acte de navigation de Cromwell qui a été le point de départ de sa grandeur maritime et coloniale? Cependant, elle vient d’abandonner ce régime tutélaire. Pourquoi? Parce qu’il a cessé de lui être utile, parce qu’il ferait sa ruine après avoir fait sa richesse. Il y a un siècle, la liberté commerciale aurait été funeste à l’Angleterre; elle donne aujourd’hui un nouvel essor à l’industrie et au commerce britanniques. Tant les circonstances ont changé!
Il n’y a que mobilité et diversité dans le domaine du Juste et de l’Utile. C’est s’égarer lamentablement, c’est méconnaître les conditions mêmes de l’existence des sociétés que de croire, comme vous semblez le faire, à l’existence de principes absolus.
l’économiste.
Ainsi donc, vous pensez qu’il n’y a de principes absolus ni en morale ni en économie politique; vous pensez que tout est mobile, variable, divers dans la sphère du juste aussi bien que dans celle de l’utile; vous pensez que la Justice et l’Utilité dépendent des lieux, des temps et des circonstances. Eh! bien, les socialistes sont du même avis que vous. Que disent-ils? Qu’il faut des lois nouvelles pour des temps nouveaux. Que l’heure est venue de changer les vieilles lois morales et économiques qui gouvernent les sociétés humaines.
le conservateur.
Crime et folie!
le socialiste.
Pourquoi? Vous avez jusqu’à présent gouverné le monde, pourquoi ne le gouvernerions-nous pas à notre tour? Êtes-vous d’une essence supérieure à la nôtre? Où bien pouvez-vous affirmer que nul n’est plus apte que vous à gouverner les hommes? Nous en appelons à la voix universelle! Consultez les misérables qui croupissent dans les bas-fonds de vos sociétés, et demandezleur s’ils sont satisfaits du lot que vos législateurs leur ont laissé? Demandez-leur s’ils croient avoir obtenu une part équitable dans les biens de la terre? Vos lois... Eh! si vous ne les aviez point faites dans l’intérêt égoïste d’une classe, cette classe serait-elle seule à prospérer? Pourquoi donc serions-nous criminels en établissant des lois qui profitent également à tous?
Vous nous accusez d’attaquer les principes éternels et immuables sur lesquels la société repose, la religion, la famille, la propriété. Mais, de votre aveu même, il n’y a pas de principes éternels et immuables.
La propriété! mais, aux yeux de vos légistes, qu’est-ce donc que la propriété? Une institution purement humaine, une institution que les hommes ont fondée, décrétée, et qu’ils sont par conséquent les maîtres d’abolir. Ne l’ontils point d’ailleurs incessamment remaniée? La propriété actuelle ressemble-t-elle à la propriété égyptienne ou romaine ou même à la propriété du moyen âge? On admettait jadis l’appropriation et l’exploitation de l’homme par l’homme; vous ne l’admettez plus aujourd’hui, légalement du moins. On réservait à l’État, dans le plus grand nombre des sociétés anciennes, la propriété du sol; vous avez rendu la propriété territoriale accessible à tout le [11] monde. Vous avez, en revanche, refusé de reconnaître pleinement certaines propriétés; vous avez dénié à l’inventeur l’absolue propriété de son œuvre, à l’homme de lettres l’absolue propriété de son livre. Vous avez compris aussi que la société devait être protégée contre les excès de la propriété individuelle, et vous avez édicté la loi d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Eh bien! que faisons-nous? nous limitons un peu plus encore la propriété; nous la soumettons à des gênes plus nombreuses, à des charges plus lourdes dans l’intérêt public. Sommes-nous donc si coupables? Cette voie, où nous marchons, n’est-ce pas vous qui l’avez tracée?
La famille! mais vous admettez qu’elle a pu légitimement recevoir, dans d’autres temps et dans d’autres pays, une organisation différente de celle qui prévaut aujourd’hui parmi nous. Pourquoi donc nous serait-il interdit de la modifier de nonveau? Tout ce que l’homme a fait, l’homme ne peut-il le défaire?
La religion! mais vos législateurs n’en ont-ils pas toujours disposé à leur guise? N’ont-ils pas débuté par autoriser la religion catholique à l’exclusion des autres? N’ont-ils pas fini par permettre tous les cultes et par en pensionner quelques-uns? S’ils ont pu régler les manifestations du sentiment religieux, pourquoi nous serait-il interdit de les régler à notre tour?
Propriété, famille, religion, cires molles que tant de législateurs ont marquées de leurs empreintes successives, pourquoi ne vous marquerions-nous pas aussi des nôtres? Pourquoi nous abstiendrions-nous de toucher à des choses que d’autres ont si souvent touchées? Pourquoi respecterions-nous des reliques que leurs gardiens [12] eux-mêmes ne se sont fait aucun scrupule de profaner?
l’économiste.
La leçon est méritée. Conservateurs qui n’admettez aucun principe absolu, préexistant et éternel, en morale non plus qu’en économie politique, aucun principe également applicable à tous les temps et à toús les lieux, voilà où aboutissent vos doctrines. On les retourne contre vous. Après avoir entendu vos moralistes et vos légistes nier les lois éternelles du juste et de l’utile pour mettre à la place je ne sais quels expédients passagers, des esprits aventureux et passionnés, substituant leurs conceptions aux vôtres, veulent gouverner le monde après vous et autrement que vous. Et si vous avez raison, ô conservateurs, quand vous affirmez qu’aucune règle fixe et absolue ne préside à l’arrangement moral et matériel des affaires humaines, peut-on condamner ces réorganisateurs de la société? L’esprit humain n’est pas infaillible. Vos législateurs ont pu errer. Pourquoi ne serait-il pas donné à d’autres législateurs de mieux faire?
Quand Fourier, ivre d’orgueil, s’écriait: Tous les législateurs se sont trompés jusqu’à moi, et leurs livres ne sont bons qu’à être brûlés, ne pouvait-il, selon vous-mêmes, avoir raison? Si les lois du Juste et de l’Utile viennent des hommes, et s’il appartient aux hommes de les modifier selon les temps, les lieux et les circonstances, Fourier n’était-il pas fondé à dire, en consultant l’histoire, ce long martyrologe des peuples, que les antiques législations sociales avaient été conçues dans un faux système, et qu’il fallait organiser un état social nou-veau? En affirmant qu’aucun principe absolu et surhumain ne gouverne les sociétés, n’avez-vous pas ouvert [13] les écluses aux grandes eaux de l’utopie? N’avez-vous pas autorisé le premier venu à refaire ces sociétés que vous prétendez avoir faites? Le socialisme n’est-il pas un écoulement de vos propres doctrines?
le conservateur.
Qu’y pouvons-nous faire? Nous connaissons bien, veuillez m’en croire, le défaut de notre cuirasse. Aussi n’avons-nous jamais nié absolument le socialisme. Quel langage tenons-nous, le plus souvent, aux socialistes? Nous leur disons: Entre vous et nous ce n’est qu’une question de temps. Vous avez tort aujourd’hui, mais peut-être aurez-vous raison dans trois cents ans. Attendez!
le socialiste.
Et si nous ne voulons pas attendre?
le conservateur.
Alors, tant pis pour vous! Comme sans rien préjuger sur l’avenir de vos théories, nous les tenons pour immorales et subversives pour le présent, nous les poursuivrons à outrance. Nous les supprimerons comme la faux supprime l’ivraie... Nous vous enverrons, dans nos prisons et dans nos bagnes, attaquer les institutions actuelles de la religion, de la famille et de la propriété.
le socialiste.
Tant mieux. Nous comptons beaucoup sur la persécution pour faire avancer nos doctrines. Le plus beau piédestal qu’on puisse donner à une idée c’est un échafaud ou un bûcher. Mettez-nous à l’amende, emprisonnez-nous, transportez-nous... nous ne demandons pas mieux. Si vous pouviez rétablir l’Inquisition contre les socialistes, nous serions assurés du triomphe de notre cause.
le conservateur.
Nous pouvons nous passer encore de ce remède extrême. Nous possédons la Majorité et la Force.
le socialiste.
Jusqu’à ce que la Majorité et la Force se tournent de notre côté.
le conservateur.
Oh! je n’ignore pas que le danger est immense, mais enfin nous résisterons jusqu’au bout.
l’économiste.
Et vous perdrez la partie. Conservateurs, vous êtes impuissants à conserver la société.
le conservateur.
Voilà un arrêt bien formel.
l’économiste.
Nous allons voir s’il est mal fondé. Si vous ne croyez pas à des principes absolus, vous devez, n’est-il pas vrai, considérer les nations comme des aggrégations factices, successivement constituées et perfectionnées de main d’homme. Ces aggrégations peuvent avoir des principes et des intérêts semblables, mais elles peuvent avoir aussi des principes et des intérêts opposés. Ce qui est juste pour l’une peut n’être pas juste pour l’autre. Ce qui est utile à celle-ci peut être nuisible à celle-là. Mais, quel est le résultat nécessaire de cet antagonisme de principes et d’intérêts? La guerre. S’il est vrai que le monde ne soit point gouverné par des lois universelles et permanentes, s’il est vrai que chaque nation ait des principes et des intérêts qui lui soient propres, intérêts et principes essentiellement variables selon les circonstances et les [15] temps, la guerre n’est-elle point dans la nature des choses?
le conservateur.
Il est certain que nous n’avons jamais rêvé la paix perpétuelle comme ce digne abbé de Saint-Pierre. M. Joseph de Maistre a parfaitement démontré d’ailleurs que la guerre est indestructible et nécessaire.
l’économiste.
Vous admettez donc et, en effet, vous ne pouvez pas ne pas admettre que le monde est éternellement voué à la guerre?
le conservateur.
La guerre était dans le passé, elle est dans le présent, pourquoi cesserait-elle d’être dans l’avenir?
l’économiste.
Oui, mais dans le passé, l’immense majorité des populations se composait d’esclaves ou de serfs. Or les esclaves et les serfs ne lisaient pas les journaux, ne fréquentaient point les clubs, et ne savaient ce que c’est que le socialisme. Voyez les serfs de Russie! N’est-ce pas une pâte que le despotisme pétrit à sa guise? N’en fait-il pas, selon sa volonté, de la chair à corvées ou de la chair à canon?
le conservateur.
Il est évident que le servage avait du bon.
l’économiste.
Par malheur, il n’y a plus moyen de le rétablir parmi nous. Vous n’avez donc plus ni esclaves ni serfs. Vous avez des multitudes besoigneuses, à qui vous ne pouvez interdire les libres communications de la pensée, à qui vous ètes, au contraire, sollicités tous les jours de rendre [16] plus accessible le domaine des connaissances générales. Empêcherez-vous ces multitudes, aujourd’hui souveraines, de s’abreuver à la source empoisonnée des écrits socialistes? Les empêcherez-vous d’écouter les rêveurs qui leur disent qu’une société où la foule travaille beaucoup pour gagner peu, tandis qu’au-dessus d’elle vivent des hommes qui gagnent beaucoup en travaillant peu, est une société vicieuse et qu’il la faut changer? Non! vous aurez beau proscrire les systèmes socialistes, vous ne les empêcherez pas de se produire et de se propager. La presse défiera vos défenses.
le conservateur.
Ah! la presse, cette grande empoisonneuse!
l’économiste.
Vous aurez beau la museler ou la proscrire, vous ne viendrez jamais à bout de la tuer. C’est une hydre dont les millions de têtes défieraient le bras d’Hercule.
le conservateur.
Si nous avions une bonne monarchie absolue...
l’économiste.
La presse tuerait la monarchie absolue comme elle a tué la monarchie constitutionnelle, et à son défaut les livres, les brochures et la conversation suffiraient.
Eh bien, aujourd’hui, pour ne parler que de la presse, cette puissante baliste n’est plus seulement dirigée contre le gouvernement, elle est dirigée contre la société.
le socialiste.
Oui, depuis quelques années la presse a marché, Dieu merci!
l’économiste.
Elle provoquait naguère des révolutions pour changer [17] la forme du gouvernement; elle en provoque aujourd’hui pour changer la forme de la société. Pourquoi ne réussirait-elle pas dans ce dessein comme elle a réussi dans l’autre? Ah! si les nations étaient pleinement garanties contre les luttes du dehors, peut-être réussirait-on à maîtriser toujours, au-dedans, les factions violentes et anarchiques. Mais, vous en convenez vous-même, la guerre extérieure est inévitable, car les principes et les intérêts sont mobiles, divers, et nul ne peut répondre que la guerre, aujourd’hui nuisible à certains pays, ne leur sera pas utile demain. Or si vous n’avez de foi qu’en la Force pour dompter le socialisme, comment donc réussirez-vous à le contenir, lorsque vous serez obligé de tourner contre l’ennemi du dehors, cette Force qui est votre raison suprême? Si la guerre est inévitable, l’avénement du socialisme révolutionnaire ne l’est-il pas aussi?
le conservateur.
Hélas! j’en ai bien peur. Aussi ai-je toujours pensé que la société marche à grands pas vers sa ruine. Nous sommes des Grecs du Bas-Empire, et les barbares sont à nos portes.
l’économiste.
Voilà donc où vous en êtes venus? Vous désespérez des destinées de la civilisation, et vous regardez monter la barbarie en attendant l’heure suprême où elle aura débordé vos derniers remparts. Vous êtes des Grecs du Bas-Empire..... Eh! s’il en est ainsi, laissez donc entrer les barbares. Faites mieux, allez au-devant d’eux, et remettez-leur humblement les clefs de la ville sacrée. Peut-être réussirez-vous à désarmer leur fureur. Mais [18] craignez de la redoubler en prolongeant inutilement votre résistance. L’histoire ne rapporte-t-elle point que Constantinople fut mise à sac, et que le Bosphore charria, pendant quatre jours, du sang et des cadavres? O Grecs du nouvean Bas-Empire, redoutez le sort de vos aînés, et, de grâce, épargnez-nous l’agonie d’une résistance vaine et les horreurs d’une prise d’assaut. Hâtez-vous de livrer Byzance, si Byzance ne peut être sauvée.
le socialiste.
Vous avouez donc que l’avenir est à nous?
l’économiste.
Dieu m’en garde! mais je pense que vos adversaires ont tort de vous résister s’ils désespèrent de vous vaincre, et je conçois qu’en ne se rattachant à aucun principe fixe, immuable, ils aient cessé de compter sur la victoire. Conservateurs, ils sont impuissants à conserver la société, voilà tout ce que j’ai voulu prouver. Maintenant, je vous dirai à vous autres organisateurs, que vous seriez impuissants à l’organiser. Vous pouvez prendre Byzance et la mettre à sac, vous ne sauriez la gouverner.
le socialiste.
Qu’en savez-vous! N’avons-nous pas dix organisations pour une?
l’économiste.
Vous venez de mettre le doigt sur la plaie. A quelle secte socialiste appartenez-vous, veuillez bien me le dire. Êtes-vous saint-simonien?
le socialiste.
Non? le saint-simonisme est usé. C’était, à l’origine, une àspiration plutôt qu’une formule... Et les disciples ont gâté l’aspiration sans trouver la formule.
l’économiste.
Phalanstérien?
le socialiste.
C’est séduisant. Mais la morale du fouriérisme est bien scabreuse.
l’économiste.
Cabétiste?
le socialiste.
Cabet est un esprit ingénieux mais incomplet. Il n’entend rien, par exemple, aux choses de l’art. Imaginezvous qu’en Icarie on peint les statues. Les figures de Curtius, voilà l’Idéal de l’art icarien. Barbare!
l’économiste.
Proudhonien?
le socialiste.
Proudhon, ah! que voilà un beau destructeur? comme il démolit bien! Mais, jusqu’à présent, il n’a su fonder que sa banque d’échanges. Et cela ne suffit pas.
l’économiste.
Ni saint-simonien, ni fouriériste, ni cabétiste, ni proudhonien. Eh! qu’êtes-vous donc?
le socialiste.
Je suis socialiste.
l’économiste.
Mais encore! à quelle variété du socialisme appartenez-vous?
le socialiste.
A la mienne. Je suis convaincu que le grand problème de l’organisation du travail n’est pas résolu encore. On a déblayé le terrain, on a posé les assises, mais on n’a pas élevé l’édifice. Pourquoi ne chercherais-je pas comme [20] un autre à le bâtir? Ne suis-je pas animé du pur amour de l’Humanité? N’ai-je pas étudié la Science et médité longtemps sur le Problème? Et je crois pouvoir affirmer que... non! pas encore... il y a certains points qui ne sont pas complétement élucidés (montrant son front), mais l’Idée est là... et vous verrez plus tard.
l’économiste.
C’est-à-dire que vous aussi vous cherchez votre organisation du travail. Vous êtes un socialiste indépendant. Vous avez votre Bible particulière. Au fait, et pourquoi pas? Pourquoi ne recevriez-vous pas comme un autre l’esprit du Seigneur? Mais aussi, pourquoi d’autres ne le recevraient-ils pas comme vous? Voilà bien des organisations du travail.
le socialiste.
Tant mieux, le peuple pourra choisir.
l’économiste.
Bon! à la majorité des suffrages. Mais que fera la minorité?
le socialiste.
Elle se soumettra.
l’économiste.
Et si elle résiste? Mais j’admets qu’elle se soumette, de gré ou de force. J’admets que l’organisation adoptée à la majorité des suffrages soit mise en vigueur. Qu’arrivera-t-il si quelqu’un, vous, moi, un autre, découvre une organisation supérieure?
le socialiste.
Cela n’est pas probable.
l’économiste.
Au contraire, c’est très probable. Ne croyez-vous pas au dogme de la perfectibilité indéfinie?
le socialiste.
Assurément. Je crois que l’Humanité ne cessera de progresser qu’en cessant d’être.
l’économiste.
Or d’où dépend principalement le progrès de l’humanité? S’il faut en croire vos docteurs, c’est la société qui fait l’homme. Lorsque l’organisation sociale est mauvaise, l’homme reste stationnaire ou il rétrograde; lorsque l’organisation sociale est bonne, l’homme se développe, progresse...
le socialiste.
Quoi de plus vrai?
l’économiste.
Y a-t-il donc rien de plus souhaitable au monde que de faire progresser l’organisation sociale? Mais s’il en est ainsi, quelle devra être la préoccupation constante des amis de l’humanité? ne sera-ce point d’inventer, de combiner des organisations de plus en plus parfaites?
le socialiste.
Oui, sans doute. Quel mal y voyez-vous?
l’économiste.
J’y vois une anarchie permanente. Une organisation vient d’être mise en vigueur et elle fonctionne, tant bien que mal, car elle n’est pas parfaite...
le socialiste.
Pourquoi pas?
l’économiste.
La doctrine de la perfectibilité indéfinie n’exclut-elle pas la perfection? D’ailleurs, je viens de vous citer une demi-douzaine d’organisations et vous n’avez été satisfait d’aucune.
le socialiste.
Cela ne prouve rien contre celles qui viendront plus tard. Ainsi, par exemple, j’ai la ferme conviction que mon système....
l’économiste.
Fourier trouvait son mécanisme parfait et cependant vous ne voulez pas du mécanisme de Fourier. De même, il se rencontrera des gens qui ne voudront pas du vôtre. Donc, une organisation bonne ou mauvaise est en vigueur. La majorité en est satisfaite, mais la minorité ne l’est point. De là un conflit, une lutte. Et remarquez bien que l’organisation future possède un avantage énorme sur l’organisation présente. On n’en a pas encore ressenti les défauts. Selon toutes probabilités elle finira par l’emporter.... jusqu’à ce qu’elle soit, à son tour, remplacée par une troisième. Mais croyez-vous qu’une société puisse, sans péril aucun, changer journellement d’organisation. Voyez dans quelle crise épouvantable nous a précipités un simple changement de gouvernement. Que serait-ce s’il s’agissait de changer la société?
le conservateur.
On frémit rien que d’y penser. Quel gâchis effroyable? Ah! l’esprit d’innovation? l’esprit d’innovation?
l’économiste.
Vous aurez beau faire, vous ne le supprimerez point. L’esprit d’innovation existe...
le conservateur.
Pour le malheur du monde.
l’économiste.
Non pas. Sans l’esprit d’innovation, les hommes n’auraient point cessé encore de se nourrir de glands ou de [23] brouter l’herbe. Sans l’esprit d’innovation, vous seriez un grossier sauvage, gîtant dans la feuillée, au lieu d’être un digne propriétaire ayant maison à la ville et maison aux champs, confortablement nourri, vêtu, logé.
le conservateur.
Pourquoi l’esprit d’innovation n’est-il point demeuré dans de justes limites?
le socialiste.
Égoïste!
l’économiste.
L’esprit d’innovation n’a point de limites. L’esprit d’innovation qui est dans l’homme ne périra qu’avec l’homme. L’esprit d’innovation modifiera perpétuellement tout ce que les hommes ont établi, et si, comme vous l’affirmez, les lois qui régissent les sociétés sont d’origine humaine, l’esprit d’innovation ne s’arrêtera point devant elles. Il les modifiera, les changera, les bouleversera aussi longtemps que l’humanité séjournera sur la terre. Le monde est voué à d’incessantes révolutions, à d’éternels déchirements, à moins que...
le conservateur.
A moins que...
l’économiste.
Eh! bien, à moins qu’il n’y ait des principes absolus, à moins que les lois qui gouvernent le monde moral et le monde économique, ne soient des lois préétablies comme celles qui gouvernent le monde physique. S’il en était ainsi, si les sociétés avaient été organisées de la main de la Providence, ne devrait-on pas prendre en pitié le pygmée gonflé d’orgueil qui essayerait de substituer son œuvre à celle du Créateur? Ne serait-il pas aussi pueril [24] de vouloir changer les bases sur lesquelles la société repose que d’entreprendre de déplacer l’orbite de la terre?
le socialiste.
Sans aucun doute. Mais existent-elles, ces lois providentielles? et, à supposer même qu’elles existent, ont-elles bien pour caractères essentiels la Justice et l’Utilité?
le conservateur.
Voilà une grosse impiété. Si Dieu a organisé luimême les sociétés, s’il a fait les lois qui les régissent, il est évident que ces lois sont essentiellement justes et utiles, et que les souffrances des hommes proviennent de leur non observation.
l’économiste.
Bravo. Mais, à votre tour, vous devez admettre que ces lois sont universelles et immuables?
le socialiste.
Eh! quoi, vous ne répondez pas? Ignorez-vous donc que la nature ne procède que par des lois universelles et immuables? Et, je vous le demande, peut-elle procéder autrement? Si les lois naturelles étaient partielles, ne se heurteraient-elles pas sans cesse? Si elles étaient variables, ne livreraient-elles pas le monde à de perpétuelles perturbations? Je ne conçois pas plus qu’une loi naturelle ne soit point universelle et immuable, que vous ne concevez qu’une loi émanée de la Divinité n’ait point pour essence la Justice et l’Utilité. Seulement, je doute que Dieu se soit mêlé de l’organisation des sociétés humaines. Et savez-vous pourquoi j’en doute? Parce que vos sociétés sont détestablement organisées; parce que l’histoire de l’humanité n’a été jusqu’à présent que la [25] lamentable et hideuse légende du crime et de la misère. Attribuer à Dieu lui-même l’organisation de ces sociétés misérables et infâmes, ne serait-ce pas le rendre responsable du mal? ne serait-ce pas justifier les reproches de ceux qui l’accusent d’être injuste et inhumain?
l’économiste.
Permettez! de ce que ces lois providentielles existent, il ne s’ensuit pas nécessairement que l’humanité doive prospérer. Les hommes ne sont pas des corps dépourvus de volonté et de vie, comme ces globes que vous voyez se mouvoir dans un ordre éternel sous l’impulsion des lois physiques. Les hommes sont des êtres actifs et libres; ils peuvent observer ou ne pas observer les lois que Dieu leur a données. Seulement, quand ils ne les observent point, ils sont criminels et misérables.
le socialiste.
S’il en était ainsi, ils les observeraient toujours.
l’économiste.
Oui, s’ils les connaissaient; et, si les connaissant, ils savaient que la non observation de ces lois doit inévitablement leur porter préjudice; mais voilà précisément ce qu’ils ignorent.
le socialiste.
Vous affirmez donc que tous les maux de l’humanité ont leur source dans la non observation des lois morales et économiques qui gouvernent les sociétés?
l’économiste.
Je dis que si l’humanité avait de tout temps observé ces lois, la somme de ses maux eût été, de tout temps aussi, la plus faible possible. Cela vous suffit-il?
le socialiste.
Assurément. Mais je serais; en vérité, bien curieux de les connaître, ces lois miraculeuses.
l’économiste.
La loi fondamentale sur laquelle repose toute l’organisation sociale, et de laquelle découlent toutes les autres lois économiques, c’est la propriété.
le socialiste.
La propriété! allons donc; mais c’est précisément de la propriété que découlent tous les maux de l’humanité.
l’économiste.
J’affirme le contraire. J’affirme que les misères et les iniquités dont l’humanité n’a cessé de souffrir ne viennent point de la propriété; j’affirme qu’elles viennent d’infractions particulières ou générales, temporaires ou permanentes, légales ou illégales, commises au principe de la propriété. J’affirme que si la propriété avait été, dès l’origine du monde, religieusement respectée, l’humanité aurait constamment joui du maximum de bienêtre que comportait, à chaque époque, l’état d’avancement des arts et des sciences, comme aussi d’une entière justice.
le socialiste.
Voilà bien des affirmations. Et vous êtes apparemment en mesure de prouver ce que vous affirmez.
l’économiste.
Apparemment.
le socialiste.
Eh! bien, prouvez-le!
l’économiste.
Je ne demande pas mieux.
le conservateur.
Avant tout, veuillez, je vous prie, définir la propriété.
l’économiste.
Je ferai mieux, je commencerai par définir l’homme, du moins au point de vue économique.
L’homme est un composé de forces physiques, morales et intellectuelles. Ces forces diverses ont besoin d’être incessamment entretenues, réparées par l’assimilation de forces semblables à elles. Lorsqu’on ne les répare point, elles périssent. Cela est vrai, aussi bien pour les forces intellectuelles et morales que pour les forces physiques.
L’homme est donc obligé de s’assimiler perpétuellement des forces nouvelles. Comment est-il averti de cette nécessité? par la douleur. Toute déperdition de forces est accompagnée d’une douleur. Toute assimilation de forces, toute consommation est accompagnée, au contraire, d’une jouissance. Excité par ce double aiguillon, l’homme s’attache incessamment à entretenir ou à augmenter la somme des forces physiques, morales et intellectuelles qui composent son être. Telle est la raison de son activité.
Lorsque cette activité s’exerce, lorsque l’homme agit dans la vue de réparer ou d’augmenter ses forces, on dit qu’il travaille. Si les éléments dans lesquels l’homme puise les virtualités qu’il s’assimile étaient toujours à sa portée, et naturellement préparés pour la consommation, son travail se réduirait à fort peu de chose. Mais il n’en [28] est pas ainsi. La nature n’a pas tout fait pour l’homme; elle lui a laissé beaucoup à faire. Si elle lui fournit libéralement la matière première de toutes les choses nécessaires à sa consommation, elle l’oblige à donner une multitude de façons diverses à cette matière première pour la rendre consommable.
La préparation des choses nécessaires à la consommation se nomme production.
Comment s’accomplit la production? par l’action des forces ou facultés de l’homme sur les éléments que lui fournit la nature.
Avant de consommer l’homme est donc obligé de produire. Toute production impliquant une dépense de forces occasionne une peine, une douleur. On subit cette peine, on souffre cette douleur dans la vue de se procurer une jouissance, ou, ce qui revient au même, de s’épargner une souffrance plus forte. On se procure cette jouissance et on s’épargne cette souffrance par la consommation. Produire et consommer, souffrir et jouir, voilà toute la vie humaine.
le conservateur.
Qu’osez-vous dire? A vos yeux, la Jouissance serait la fin unique que l’homme aurait à se proposer sur la terre?
l’économiste.
N’oubliez pas qu’il s’agit ici des jouissances morales et intellectuelles aussi bien que des jouissances physiques. N’oubliez pas que l’homme est un être physique, moral et intellectuel. Se développera-t-il à ce triple point de vue ou se dégradera-t-il, voilà toute la question. S’il néglige ses besoins moraux et intellectuels pour ne satisfaire que ses appétits physiques, il se dégradera moralement et [29] intellectuellement. S’il néglige ses besoins physiques pour augmenter ses satisfactions intellectuelles et morales, il se dégradera physiquement. Dans l’une et l’autre éventualités, il souffrira d’une part, tout en jouissant avec excès d’une autre. La sagesse consiste à maintenir l’équilibre des facultés dont on est pourvu ou à produire cet équilibre lorsqu’il n’existe point. Mais l’économie politique n’a pas à s’occuper, directement du moins, de cette ordonnance intérieure des facultés humaines. L’économie politique n’examine que les lois générales de la production et de la consommation des richesses. La manière dont il convient que chaque individu distribue les forces réparatrices de son être concerne la morale.
Souffrir le moins possible, physiquement, moralement et intellectuellement, jouir le plus possible, à ce triple point de vue, voilà quel est, en définitive, le grand mobile de la vie humaine, le pivot autour duquel se meuvent toutes les existences. Ce mobile, ce pivot se nomme l’Intérêt.
le socialiste.
Vous regardez l’intérêt comme le mobile unique des actions humaines, et vous dites que l’intérêt consiste à s’épargner de la peine et à se procurer du plaisir. Mais n’est-il donc, dans l’homme, aucun mobile plus noble auquel on puisse faire appel? Au lieu d’être excité par l’appât inférieur d’une satisfaction personnelle, ne peuton l’être par le stimulant plus élevé de l’amour de l’humanité? Au lieu de ceder à l’intérêt, ne peut-on obeir au dévouement?
l’économiste.
Le dévouement n’est qu’une des parties constituantes de l’intérêt.
le conservateur.
Qu’est-ce à dire? Oubliez-vous que dévouement implique sacrifice et que sacrifice implique souffrance?
l’économiste.
Oui, sacrifice et souffrance d’un côté, mais satisfaction et jouissance d’un autre. Quand on se dévoue pour son prochain, on se condamne, le plus souvent, du moins, à une privation matérielle, mais on éprouve en échange une satisfaction morale. Si la peine l’emporte sur la satisfaction on ne se dévoue pas.
le conservateur.
Et les martyrs?
l’économiste.
Les martyrs eux-mêmes me fourniraient un témoignage à l’appui de ce que j’avance. Le sentiment moral de la religion dépassait chez eux l’instinct physique de la conservation. En échange de leurs souffrances physiques, ils éprouvaient des jouissances morales plus intenses. Lorsqu’on n’est pas pourvu à un haut degré du sentiment religieux, on ne s’expose pas, volontairement du moins, au martyre. Pourquoi? Parce que la satisfaction morale étant faible, on la trouve trop chèrement achetée par la souffrance physique.
le conservateur.
Mais, s’il en est ainsi, les hommes en qui les appétits physiques prédominent, sacrifieront toujours à la satisfaction de leurs besoins inférieurs, celle de leurs besoins [31] plus élevés. Ces hommes auront intérêt à se vautrer dans la fange....
l’économiste.
Cela serait, si l’existence humaine se trouvait hornée à cette terre. Les individus en qui les appétits physiques prédominent n’auraient, en ce cas, aucun intérêt à les réprimer. Mais l’homme n’est pas ou ne se croit pas une créature d’un jour. Il a foi dans une existence future, et il s’efforce de se perfectionner pour monter dans un monde meilleur, au lieu de descendre dans un monde plus mauvais. S’il se prive de certaines satisfactions icibas, c’est en vue d’acquérir des satisfactions supérieures dans une autre vie.
S’il n’a pas foi dans ces satisfactions futures ou s’il les croit inférieures aux satisfactions présentes que la religion et la morale lui commandent de sacrifier pour les obtenir, il ne consentira point à ce sacrifice.
Mais que la satisfaction soit présente ou future, qu’elle se trouve placée dans ce monde ou dans un autre, elle est toujours la fin que l’homme se propose, le mobile constant, immuable de ses actions.
le socialiste.
Ainsi élargi, on peut, je pense, accepter l’intérêt, comme mobile unique des actions de l’homme.
l’économiste.
Sous l’impulsion de son intérêt, où qu’il le place, l’homme agit, travaille. C’est à la religion et à la morale à lui enseigner à le bien placer.....
L’homme s’efforce donc incessamment de réduire la somme de ses peines et d’augmenter celle de ses jouissances. Comment peut-il atteindre ce double résultat? En [32] obtenant, en échange de moins de travail, plus de choses propres à la consommation, ou, ce qui revient au même, en perfectionnant son travail.
Comment l’homme peut-il perfectionner son travail? Comment peut-il obtenir un maximum de jouissances en échange d’un minimum d’efforts?
C’est en dirigeant bien les forces dont il dispose. C’est en exécutant les travaux qui conviennent le mieux à ses facultés et en accomplissant sa tâche le mieux possible.
Or l’expérience démontre que ce résultat ne peut-être obtenu qu’à l’aide de la plus complète division du travail.
Les hommes sont donc naturellement intéressés à diviser le travail. Mais division du travail implique rapprochement des individus, société, échanges.
Que les hommes demeurent isolés; qu’ils satisfassent individuellement à tous leurs besoins, et ils dépenseront un maximum d’efforts pour obtenir un minimum de satisfactions.
Cependant cet intérêt que les hommes ont à s’unir en vue de diminuer leur labeur et d’augmenter leurs jouissances n’aurait peut-être pas suffi pour les rapprocher, s’ils n’avaient été attirés les uns vers les autres d’abord par l’impulsion naturelle de certains besoins qui ne peuvent être satisfaits dans l’isolement, ensuite par la nécessité de défendre, quoi? leurs propriétés.
le conservateur.
Comment? La propriété existe-t-elle dans l’état d’isolement? Selon les jurisconsultes, c’est la société qui l’institue.
l’économiste.
Si la société l’institue, la société peut aussi l’abolir, et les socialistes qui demandent son abolition ne sont pas de si grands coupables. Mais la société n’a pas institué la propriété; c’est bien plutôt la propriété qui a institué la société.
Qu’est-ce que la propriété?
La propriété émane d’un instinct naturel dont l’espèce humaine tout entière est pourvue. Cet instinct révèle à l’homme avant tout raisonnement qu’il est le maître de sa personne et qu’il peut disposer à son gré de toutes les virtualités qui composent son être, soit qu’elles y adherènt, soit qu’il les en ait séparées.
le socialiste.
Séparées! qu’est-ce à dire?
l’économiste.
L’homme est obligé de produire s’il veut consommer. En produisant, il dépense, il sépare de lui-même une certaine partie de ses forces physiques, morales et intellectuelles. Les produits contiennent les forces dépensées par ceux qui les ont créés. Mais ces forces que l’homme sépare de lui-même, sous l’empire de la nécessité, il ne cesse pas de les posséder. La conscience humaine ne s’y trompe pas, et elle condamne indistinctement les atteintes portées à la propriété intérieure et à la propriété extérieure.1
Lorsqu’on dénie à l’homme le droit de posséder la [34] portion de ses forces qu’ll sépare de lui-même en travaillant, lorsqu’on attribue à d’autres le droit d’en disposer; qu’arrive-t-il? Cette séparation ou cette dépense de forces impliquant une douleur, l’homme cesse de travailler à moins qu’on ne l’y force.
Supprimer le droit de propriété de l’homme sur les produits de son travail, c’est empêcher la création de ces produits.
S’emparer d’une partie de ces produits, c’est, de même, décourager de les former; c’est ralentir l’activité de l’homme en affaiblissant le mobile qui le pousse à agir.
De même, porter atteinte à la propriété intérieure; obliger un être actif et libre à entreprendre un travail qu’il n’entreprendrait pas de lui-même, ou lui interdire [35] certaines branches de travail, détourner par conséquent ses facultés de leur destination naturelle, c’est diminner la puissance productive de l’homme.
Toute atteinte portée à la propriété intérieure ou extérieure, séparée ou non séparée, est contraire à l’Utilité aussi bien qu’à la Justice.
Comment donc se fait-il que des atteintes aient été, de tout temps, portées à la propriété?
Tout travail impliquant une dépense de forces, et toute dépense de forces une peine, certains hommes ont voulu s’épargner cette peine tout en s’attribuant la satisfaction qu’elle procure. Ils ont, en conséquence, fait métier de dérober les fruits du travail des autres hommes, soit en [36] les dépouillant de leurs biens extérieurs, soit en les réduisant en esclavage. Ils ont constitué ensuite des sociétés régulières pour protéger eux et les fruits de leurs rapines contre leurs esclaves ou contre d’autres ravisseurs. Voilà l’origine de la plupart des sociétés.
Mais cette usurpation abusive des forts sur la propriété des faibles a été successivement entamée. Dès l’origine des sociétés, une lutte incessante s’est établie entre les oppresseurs et les opprimés, les spoliateurs et les spoliés; dès l’origine des sociétés, l’humanité a tendu constamment vers l’affranchissement de la propriété. L’histoire est pleine de cette grande lutte! D’un côté, vous voyez les oppresseurs défendant les priviléges qu’ils se sont [37] attribués sur la propriété d’autrui; de l’autre, les opprimés réclamant la suppression de ces priviléges iniques et odieux.
La lutte dure encore, et elle ne cessera que lorsque la propriété sera pleinement affranchie.
le conservateur.
Mais il n’y a plus de priviléges!
le socialiste.
Mais la propriété n’a que trop de franchises!
l’économiste.
La propriété n’est guère plus franche aujourd’hui qu’elle ne l’était avant 1789. Peut-être même, l’est-elle moins. Seulement il y a une différence: avant 1789, les restrictions apportées au droit de propriété profitaient à quelques-uns; aujourd’hui, elles ne profitent, le plus souvent, à personne, sans être cependant moins nuisibles à tous.
le conservateur.
Mais où donc les voyez-vous ces restrictions malfaisantes?
l’économiste.
Je vais énumérer les principales....
le socialiste.
Une observation encore. J’admets volontiers la propriété comme souverainement équitable et utile dans l’état d’isolement. Un homme vit et travaille seul. Il est parfaitement juste que cet homme jouisse seul du fruit de son travail. Il n’est pas moins utile que cet homme soit assuré de conserver sa propriété. Mais ce régime de propriété individuelle peut-il se maintenir équitablement et utilement dans l’état de société?
[38]Je veux bien admettre encore que la Justice et l’Utilité commandent de reconnaître à chacun, dans cet état comme dans l’autre, l’entière propriété de sa personne et de cette portion de ses forces qu’il sépare de lui-même en travaillant. Mais les individus pourraient-ils véritablement jouir de cette double propriété, si la société n’était pas organisée de manière à la leur garantir? Si cette organisation indispensable n’existait point; si, par un mécanisme quelconque, la société ne distribuait point à chacun l’équivalent de son travail, le faible ne se trouverait-il pas à la merci du fort, la propriété des uns ne serait-elle pas perpétuellement envahie par la propriété des autres? Et si l’on commettait l’imprudence d’affranchir pleinement la propriété, avant que la société fût dotée de ce mécanisme distributif, ne verrions-nous pas se multiplier encore les empiétements des forts sur la propriété des faibles? Le complet affranchissement de la propriété n’aggraverait-il pas le mal au lieu de le corriger?
l’économiste.
Si l’objection était fondée, s’il était nécessaire de construire un mécanisme pour distribuer à chacun l’équivalent de son travail, le socialisme aurait pleinement sa raison d’être, et je serais socialiste comme vous. Mais ce mécanisme que vous voulez établir artificiellement, il existe naturellement et il fonctionne. La société est organisée. Le mal que vous attribuez à son défaut d’organisation vient des entraves apportées au libre jeu de son organisation.
le socialiste.
Vous osez affirmer qu’en permettant à tous les hommes de disposer librement de leurs propriétés, dans le milieu [39] social où nous sommes, les choses s’arrangeraient d’elles-mêmes de manière à rendre le travail de chacun le plus productif possible, et la distribution des fruits du travail de tous pleinement équitable?...
l’économiste.
J’ose l’affirmer.
le socialiste.
Vous croyez qu’il deviendrait superflu d’organiser sinon la production du moins la distribution, l’échange, de désobstruer la circulation...
l’économiste.
J’en suis sûr. Laissez faire les propriétaires, laissez passer les propriétés et tout s’arrangera pour le mieux.
Mais on n’a jamais laissé faire les propriétaires; on n’a jamais laissé passer les propriétés.
Jugez-en.
S’agit-il du droit de propriété de l’homme sur luimême; du droit qu’il possède d’utiliser librement ses facultés, en tant qu’il ne cause aucun dommage à la propriété d’autrui? Dans la société actuelle les fonctions les plus élevées et les professions les plus lucratives ne sont pas libres; on ne peut exercer librement les fonctions de notaire, de prêtre, de juge, d’huissier, d’agent de change, de courtier, de médecin, d’avocat, de professeur; on ne peut être librement imprimeur, boucher, boulanger, entrepreneur de pompes funèbres; on ne peut fonder librement aucune association commerciale, aucune banque, aucune compagnie d’assurances, aucune grande entreprise de transport, construire librement aucun chemin, établir librement aucune institution de charité, vendre librement du tabac, de la poudre, du salpêtre, transporter [40] des lettres, battre monnaie; on ne peut librement se concerter avec d’autres travailleurs pour fixer le prix du travail. La propriété de l’homme sur lui-même, la propriété intérieure, est de toutes parts entravée.
La propriété de l’homme sur les fruits de son travail, la propriété extérieure ne l’est pas moins. La propriété littéraire ou artistique et la propriété des inventions ne sont reconnues et garanties que pendant une courte période. La propriété matérielle est généralement reconnue à perpétuité, mais elle est soumise à une multitude de restrictions et de charges. Le don, l’héritage et le prêt ne sont pas libres. L’échange est lourdement grevé tant par les impôts de mutation, d’enregistrement et de timbre, les octrois et les douanes, que par les priviléges accordés aux agents servant d’intermédiaires à certains marchés; parfois aussi l’échange est complétement prohibé hors de certaines limites. Enfin, la loi d’expropriation pour cause d’utilité publique menace incessamment la faible portion de Propriété que les autres restrictions ont épargnée.
le conservateur.
Toutes les restrictions que vous venez d’énumérer ont été établies dans l’intérêt de la société.
l’économiste.
C’est possible; mais ceux qui les ont établies ont eu la main malheureuse, car toutes agissent, à différents degrés, et quelques-unes avec une puissance considérable, comme causes d’injustices et de dommages pour la société.
le conservateur.
De sorte qu’en les détruisant, nous jouirions d’un véritable paradis sur la terre.
l’économiste.
Je ne dis pas cela. Je dis que la société se trouverait dans la situation la meilleure possible, eu égard au degré actuel d’avancement des arts et des sciences.
le socialiste.
Et vous vous engagez à le prouver?
l’économiste.
Oui.
le conservateur et le socialiste.
Voilà un utopiste!
DEUXIÈME SOIRÉE↩
SOMMAIRE: Atteintes portées à la propriété extérieure.—Propriété littéraire et artistique.—Contrefaçon.—Propriété des inventions.
le socialiste.
Vous avez entrepris de nous prouver que les maux que le socialisme attribue à la propriété, proviennent d’atteintes portées à la propriété. Êtes-vous disposé à commencer la démonstration de ce paradoxe?
l’économiste.
Ah! plût à Dieu que vous enseignassiez de tels paradoxes!... J’ai distingué la propriété intérieure et la propriété extérieure. La première consiste dans le droit que possède tout homme de disposer librement de ses facultés physiques, morales et intellectuelles, comme aussi du corps qui leur sert à la fois d’enveloppe et d’instrument; la seconde réside dans le droit que conserve l’homme sur la portion de ses facultés, qu’il a jugé à propos de séparer de lui-même et d’appliquer aux objets extérieurs.
le socialiste.
Où commence notre droit de propriété sur les objets extérieurs et où finit-il?
l’économiste.
Il commence au moment où nous appliquons aux choses que la nature a mises gratuitement à notre disposition, [43] une portion de nos forces, de nos facultés; au moment où nous complétons l’œuvre de la nature en donnant à ces choses une façon nouvelle; au moment où nous ajoutons à la valeur naturelle qui est en elles une valeur artificielle; il finit au moment où cette valeur artificielle périt.
le conservateur.
Qu’entendez-vous par valeur?
l’économiste.
J’entends par valeur, la propriété qu’ont les choses ou qui leur est donnée de satisfaire aux besoins de l’homme.
L’homme possède donc son être et les dépendances naturelles ou artificielles de son être, ses facultés, son corps et ses œuvres.
Les œuvres de l’homme, objet de la propriété extérieure, sont de deux sortes, matérielles et immatérielles.
La loi reconnaît à perpétuité la propriété matérielle, à perpétuité, c’est-à-dire, autant que dure l’objet de la propriété; en revanche elle limite à un délai assez bref la propriété immatérielle. Cependant l’une et l’autre ont la même origine.
le conservateur.
Comment? vous assimilez la propriété d’une invention ou d’un air de musique à la propriété d’une maison ou d’une terre.
l’économiste.
Absolument. L’une et l’autre n’ont-elles pas également leur origine dans le travail? Du moment qu’il y a effort accompli et valeur créée, que l’effort vienne des nerfs ou des muscles, que la valeur soit appliquée à un objet palpable [44] ou intangible, une nouvelle propriété est créée. Peu importe la forme sous laquelle elle se manifeste!
S’il s’agit d’un fonds de terre mis en culture, c’est principalement de la force physique qui a été dépensée; s’il s’agit d’un air de musique, ce sont des facultés intellectuelles aidées de certaines facultés physiques ou morales qui ont été mises en œuvre. Mais à moins de placer les facultés de l’intelligence au-dessous des forces physiques, ou bien encore, à moins de prétendre que l’homme possède son intelligence à un titre moins légitime que sa force physique, peut-on établir une différence entre ces deux sortes de propriétés?
le conservateur.
Vous voudriez donc que l’inventeur d’une machine, l’auteur d’un livre, ou d’un air de musique, demeurassent les maîtres absolus de leurs œuvres; qu’ils pussent à perpétuité les donner, les léguer et les vendre. Vous voudriez qu’on leur accordât même le droit de les détruire. Vous voudriez qu’il eût été permis aux héritiers de Bossuet, de Pascal, de Molière, de priver l’humanité des œuvres immortelles de ces puissants génies. Voilà, en vérité, une exagération sauvage!
le socialiste.
Bravo!
l’économiste.
Applaudissez, c’est justice. Savez-vous bien quelle doctrine vous venez de soutenir, mousieur le conservateur?
le conservateur.
Eh, la doctrine du sens commun, je pense.
l’économiste.
Non pas! la doctrine du communisme.
le conservateur.
Vous vous moquez. J’ai soutenu les droits de la société sur les produits de l’intelligence, voilà tout!
l’économiste.
Les communistes ne font pas autre chose. Seulement, ils sont plus logiques que vous. Ils soutiennent les droits de la société sur toute chose, sur les produits matériels aussi bien que sur les produits immatériels. Ils disent aux travailleurs: Remplissez votre tâche de chaque jour, travaillez selon vos forces, mais au lieu de vous attribuer à vous-mêmes les produits de votre travail, les valeurs que vous avez créées, remettez-les à l’association générale des citoyens, à la communauté qui se chargera de répartir équitablement entre tous les fruits du travail de chacun. Vous en aurez votre part! Voilà n’est-il pas vrai, le langage des communistes?
le conservateur.
Oui, c’est bien le langage de cette secte insensée qui ravit au travailleur le fruit légitime de son travail, pour lui donner une part arbitraire du travail de tous.
l’économiste.
Véritablement vous parlez d’or. Vous n’admettez donc pas qu’on ravisse au travailleur tout ou partie du fruit de son travail, pour mettre ce tout ou cette partie dans la communauté?
le conservateur.
C’est un vol!
l’économiste.
Eh! bien, ce vol, la société le commet tous les jours au [46] détriment des gens de lettres, des artistes et des inventeurs.
Vous connaissez la loi qui régit en France la propriété littéraire. Tandis que la propriété des choses matérielles, terres, maisons, meubles, est indéfinie, la propriété littéraire est limitée aux vingt années qui suivent la mort de l’auteur propriétaire. L’Assemblée constituante n’avait même accordé que dix années.
Avant la révolution, la législation était, sous certains rapports, beaucoup plus équitable...
le conservateur.
Avant la révolution, dites-vous?
l’économiste.
Oui. Vous savez qu’alors tous les droits, le droit de travailler aussi bien que le droit de posséder émanaient du roi. Les auteurs obtenaient donc pour eux et pour leurs héritiers, lorsqu’ils en faisaient la demande, le droit d’exploiter exclusivement leurs livres. Ce privilége n’avait pas de limites; malheureusement il était révocable à volonté; en outre, il était soumis, dans l’usage, à des restrictions vexatoires. Lorsqu’un auteur cédait son œuvre à un libraire, le droit exclusif d’exploitation se perdait à sa mort. Seuls, les héritiers pouvaient conserver exclusivement ce droit.
le socialiste.
Ainsi donc, les héritiers de Molière, de La Fontaine, de Racine, ont pu exploiter exclusivement jusqu’en 1789, les œuvres de leurs illustres ancêtres?
l’economiste.
Oui. On trouve, par exemple, un arrêt du conseil du 14 septembre 1761, qui continue aux petits-fils de La [47] Fontaine le privilége de leur aïcul, soixante-dix ans après sa mort. Si l’Assemblée constituante avait eu pleinement l’intelligence de sa mission, elle aurait reconnu et garanti, en la débarrassant des entraves du privilége, cette propriété que l’ancien régime même avait sanctionnée en l’opprimant. Malheureusement les idées communistes avaient déjà germé, alors, dans la société française. Résumé vivant des doctrines philosophiques et économiques du dix-huitième siècle, l’Assemblée constituante renfermait dans son sein des disciples de Rousseau et de Morelly, aussi bien que des disciples de Quesnay et de Turgot. Elle recula donc devant la reconnaissance absolue de la propriété intellectuelle. Elle mutila cette propriété légitime, afin d’abaisser le prix des œuvres de l’intelligence.
le conservateur.
Ce but louable ne fut-il pas atteint? Supposez que la propriété littéraire de Pascal, de Moliere, de La Fontaine n’eùt pas été éteinte au bénéfice de la Communauté, ne serions-nous pas obligés de payer plus cher les œuvres de ces illustres génies? Et peut-on mettre l’intérêt de quelques-uns en balance avec l’intérêt de tous?
l’économiste.
“Quand les sauvages de la Louisiane veulent avoir du fruit, dit Montesquieu, ils coupent l’arbre au pied et cueillent le fruit. Voilà le gouvernement despotique.” Voilà le communisme, aurait ajouté l’auteur de l’Esprit des Lois s’il avait vécu de nos jours. En limitant la propriété littéraire que faites-vous? Vous en diminuez la valeur vénale.—Je fais un livre et j’offre à un libraire de le lui céder. Si la possession de ce livre lui est garantie à perpétuité, il pourra évidemment m’en payer et m’en [48] payera un prix plus élevé que si, vingt années après ma mort, cette propriété périt.
le conservateur.
Oh! ceci a bien peu d’importance dans la pratique. Combien peu de livres vivent encore vingt années après la mort de leurs auteurs?
l’économiste.
Vous me fournissez une nouvelle arme contre vous. Il y a deux sortes de livres, ceux qui ne durent pas et ceux qui durent. Votre loi limitative de la propriété littéraire laisse intacte la valeur des premiers pour amoindrir celle des seconds. Exemple: un homme de génie a écrit un livre destiné à traverser les âges; il va le porter à son libraire. Celui-ci peut-il payer cette œuvre immortelle beaucoup plus cher que le commun des œuvres destinées à l’oubli, après un succès éphémère? Non! car si l’œuvre ne périt pas, la propriété de l’œuvre périt, ou, ce qui revient au même, elle devient commune. Au bout d’un certain nombre d’années le détenteur en est légalement dépossédé. Votre loi respecte la médiocrité, mais elle met le génie à l’amende.
Aussi qu’arrive-t-il? C’est qu’on voit diminuer le nombre des œuvres durables et augmenter celui des œuvres éphémères. “Le Temps, dit Eschyle, ne respecte que ce qu’il a fondé.” A peu d’exceptions près, les chefs-d’œuvre que le passé nous a légués ont été le fruit d’un long travail. Descartes consacrait la plus grande partie de sa vie à composer ses Méditations. Pascal copiait jusqu’à treize fois ses Lettres provinciales avant de les livrer à l’impression. Adam Smith observait pendant trente années les phénomènes économiques de la société, [49] avant d’écrire son immortel traité de la Richesse des Nations. Mais quand l’homme de génie ne jouit point d’une certaine aisance, peut-il semer si longtemps sans recueillir? Pressé par l’aiguillon des nécessités de la vie n’est-il pas obligé de livrer encore vertes les moissons de son intelligence?
On déclame beaucoup contre la littérature facile, mais pouvons-nous en avoir une autre? Comment n’improviserait-on pas lorsque la valeur des œuvres laborieusement finies est raccourcie jusqu’à celle des œuvres improvisées? En vain, vous recommanderez aux hommes de lettres de sacrifier leurs intérêts à ceux de l’art, les hommes de lettres ne vous écouteront point et, le plus souvent, ils auront raison. N’ont-ils pas, eux aussi, des devoirs de famille à remplir, des enfants à élever, des parents à soutenir, des dettes à payer, une position à conserver? Peuvent-ils négliger, pour l’amour de l’art, ces devoirs naturels et sacrés?
On improvise donc et l’on se précipite dans les branches de littérature où l’improvisation est le plus facile. Dans la science, la même cause engendre les mêmes résultats déplorables. Ce n’est plus l’observation qui domine dans la science moderne, c’est l’hypothèse. Pourquoi? Parce qu’on bâtit une hypothèse plus vite qu’on n’observe une loi. Parce qu’on fait plus facilement des livres avec des hypothèses qu’on n’en peut faire avec des observations. A quoi il faut ajouter que l’hypothèse est souvent plus frappante. Le paradoxe étonne plus que la vérité. Il conquiert beaucoup plus vite le succès. Il le perd promptement aussi, sans doute. Mais, en attendant, l’improvisateur de paradoxes fait fortune tandis que le patient [50] chercheur de vérités se débat contre la misère. Faut-il s’étonner après cela si le paradoxe fourmille et si la véritable science devient de plus en plus rare?
le conservateur.
Vous négligez de dire que le gouvernement se charge de récompenser les hommes qui se distinguent dans la carrière des sciences et des lettres. La société a des récompenses et des honneurs pour les vrais savants et les vrais littérateurs.
l’économiste.
Oui; et ce n’est pas ce qu’il y a de moins absurde dans ce système absurde. Voyez plutôt! Vous dépréciez la propriété des vrais savants et des vrais littérateurs dans l’intérêt prétendu de la postérité. Mais je ne sais quel sentiment d’équité naturelle vous avertit que vous les spoliez. Vous prélevez donc sur la société un impôt dont vous leur allouez le produit. Vous avez un budget des beaux-arts et des lettres. Je suppose que les fonds de ce budget soient toujours équitablement répartis; qu’ils aillent directement à ceux-là que la loi atteint (et vous savez si l’hypothèse est fondée), cette indemnité en est-elle moins entachée d’iniquité? Est-il juste d’obliger les contribuables à payer un impôt au profit des consommateurs de livres de l’avenir? N’est-ce pas un communisme de la pire espèce que ce communisme d’outre-tombe?
le conservateur.
Où le voyez-vous ce communisme?
l’économiste.
Dans une société communiste, que fait le gouvernement? Il s’empare du produit du travail de chacun pour le distribuer gratuitement à tous. Eh bien, que fait le [51] gouvernement, en limitant la propriété littéraire? Il prend une partie de la valeur de la propriété du savant et du littérateur pour la distribuer gratuitement à la postérité; après quoi, il oblige les contribuables à donner gratuitement une partie de leur propriété aux savants et aux littérateurs.
Ceux-ci perdent à cette combinaison communiste, car la portion de propriété qu’on leur ravit est supérieure d’ordinaire à l’indemnité qu’on leur alloue.
Les contribuables y perdent plus encore, car on ne leur donne rien en échange de l’indemnité qu’on les oblige à payer.
Au moins, les consommateurs de livres y gagnentils quelque chose?
Les consommateurs actuels n’y gagnent rien, puisque les auteurs jouissent temporairement d’un droit de propriété absolu sur leurs œuvres.
Les consommateurs futurs peuvent, sans doute, acheter à meilleur marché les ouvrages anciens; en revanche, ils en sont moins abondamment pourvus. D’un autre coté, les livres qui traversent les âges subissent, sous le régime de la propriété limitée, tous les inconvénients attachés au communisme. Tombés dans le domaine public, ils cessent d’être l’objet des soins attentifs et vigilants qu’un propriétaire sait donner à sa chose. Les meilleures éditions fourmillent d’altérations et de fautes.
Parlerai-je des dommages indirects qui résultent de la limitation de la propriété littéraire; parlerai-je de la contrefaçon?
le conservateur.
Quel rapport voyez-vous entre la contrefaçou et la limitation légale de la propriété littéraire?
l’économiste.
Qu’est-ce donc que la contrefaçon, sinon une limitation de la propriété littéraire dans l’espace, comme votre loi en est une limitation dans le temps? Y a-t-il, en réalité, la moindre différence entre ces deux sortes d’atteintes à la propriété? Je dirai plus. C’est la limitation dans le temps qui a engendré la limitation dans l’espace.
Lorsque la propriété matérielle était considérée comme un simple privilége émané du bon plaisir du souverain, ce privilége expirait aux frontières de chaque État. La propriété des étrangers était soumise au droit d’aubaine.
Lorsque la propriété matérielle a été partout reconnue comme un droit imprescriptible et sacré, le droit d’aubaine a cessé de lui être appliqué.
Seule la propriété intellectuelle est demeurée assujettie à ce droit barbare. Mais, en bonne justice, pouvonsnous nous en plaindre? Si nous respectons la propriété intellectuelle moins que la propriété matérielle, pouvonsnous obliger les étrangers à la respecter autant?
le socialiste.
Soit! mais vous ne tenez aucun compte des avantages moraux de la contrefaçon. C’est grâce à la contrefaçon que les idées françaises se répandent au dehors: nos gens de lettres et nos savants y perdent, sans doute; mais la civilisation y gagne. Qu’importe l’intérêt de quelques centaines d’individus, en présence des grands intérêts de l’humanité!
l’économiste.
Vous employez en faveur des consommateurs étrangers l’argument dont vous vous serviez tout à l’heure, [53] en faveur des consommateurs futurs. Je me placerai pour le réfuter au point de vue de la consommation générale.
La France est peut-être le pays du monde où la production littéraire est la plus active et la plus abondante; cependant les livres y sont fort chers. On y paye 15 fr. un roman en deux volumes, tandis qu’en Belgique les deux mêmes volumes ne coûtent que 1 fr. 50 c. Faut-il attribuer cette différence de prix uniquement aux droits d’auteurs? Non pas! de l’aveu des intéressés eux-mêmes, elle provient principalement de l’exiguité du marché dont peut disposer le libraire français. Si la contrefaçon venait à être supprimée, les deux volumes, qui se vendent 15 francs en France, tomberaient probablement à 5 francs sur le marché général, peut-être plus bas encore. Dans ce cas, le consommateur étranger payerait 3 fr. 50 c. de plus que sous le régime de la contrefacon; en revanche, le consommateur français payerait 10 fr. de moins. Au point de vue de la consommation générale, n’y aurait-il pas évidemment avantage?
J’ai entendu, il y a quelques années, à la Chambre des Députés, M. Chaix-d’Est-Ange défendre la contrefaçon au point de vue de la diffusion des lumières. C’est grâce à la contrefaçon, disait-il, que les idées françaises pénètrent à l’étranger.—C’est possible, aurait-on pu répondre à l’illustre avocat; en revanche, c’est la contrefaçon qui empèche les idées françaises de pénétrer en France.
Les consommateurs étrangers payeraient nos livres un peu plus cher, si la contrefaçon cessait d’exister, et encore! mais nous leur en fournirions de meilleurs et [54] en plus grand nombre. N’y gagneraient-ils pas autant que nous-mêmes?
le conservateur.
Allons! je crois décidément que vous avez raison, et je me sens assez disposé à me rallier à la cause de la propriété littéraire.
l’économiste.
J’aurais pu développer encore quelques considérations sur l’extension et la stabilité que la reconnaissance entière de la proprieté littéraire donnerait non seulement à l’industrie des gens de lettres, mais encore à celle des libraires.... Mais puisque ma cause est gagnée, je n’insiste pas.
Si vous m’accordez la propriété littéraire, vous devez m’accorder aussi la propriété artistique.
le conservateur.
En quoi consiste la propriété artistique?
l’économiste.
S’il s’agit d’un tableau, d’une statue ou d’un monument, la propriété artistique consiste dans le droit d’en disposer comme de toute autre propriété matérielle, puis d’en opérer ou d’en autoriser exclusivement la reproduction par le dessin, la gravure, etc. S’il s’agit d’un modèle ou d’un dessin, la propriété artistique réside de même dans un droit de reproduction exclusif. Il est bien entendu que cette propriété peut être cédée, vendue comme toute autre.
le conservateur.
Je n’y vois aucun inconvénient. Cependant il conviendrait d’établir une exception pour les modèles et dessins de fabrique. Les artistes, dessinateurs ou modeleurs [55] deviendraient par trop exigeants, si on leur accordait l’absolue propriété de leurs œuvres.
l’économiste.
Ah! ah! je vous y prends encore une fois, monsieur le conservateur-communiste! Eh bien, sachez donc que, par une inadvertance des législateurs réglementaires de l’Empire, cette propriété-là a échappé seule à la limitation. Cet oubli salutaire n’a pas manqué de produire d’excellents fruits. Nos modèles et dessins de fabrique sont aujourd’hui sans rivaux dans le monde.
Cela s’explique aisément. D’une part, les industriels qui achètent aux artistes la propriété des modèles et dessins de fabrique, étant assurés de conserver perpétuellement cette propriété, peuvent la payer le plus cher possible. D’une autre part, les artistes, assurés de recevoir une rémunération suffisante, mettent le temps et le soin nécessaires à l’exécution de leurs œuvres.
le socialiste.
Mais, savez-vous aussi ce qui est arrivé? je vous le donne en mille. Ces industriels, qui sont des gardiens si farouches de la propriété, s’avisèrent un beau jour de penser qu’ils payaient trop cher leurs modèles et dessius de fabrique. La question fut mise à l’ordre du jour dans leurs chambres de commerce et de perfectionnement: à l’unanimité, on reconnut que le mal venait de ce que la propriété était perpétuelle. On demanda, en conséquence, au gouvernement de la limiter. Le gouvernement s’empressa d’obtempérer à cette demande des hauts-barons de l’industrie. Le ministre de l’agriculture et du commerce bâcla un projet de loi, réduisant à trois, cinq, dix et quinze années la propriété des modèles et dessins [56] de fabrique. Le projet fut présenté aux Chambres, discuté à la Chambre des pairs....
le conservateur.
Et adopté?
le socialiste.
Non! la révolution de février le fit écarter de l’ordre du jour; mais soyez sûr que la discussion en sera reprise et que la loi passera. Cependant ces conservateurs, qui attentent sans scrupule à la propriété des artistes, ces conservateurs qui n’hésitent pas à faire du communisme quand cela leur profite, sont les mêmes qui traquent les communistes comme des bêtes fauves.
l’économiste.
Si les industriels dont vous parlez avaient bien réfléchi sur leurs véritables intérêts; s’ils avaient eu quelques notions saines d’économie politique, ils auraient compris qu’en nuisant aux artistes, ils ne pouvaient manquer de se nuire aussi à eux-mêmes. Lorsque la loi aura limité la propriété des modèles et dessins de fabrique, ces œuvres d’art se vendront à plus bas prix sans doute; mais conserveront-elles le même degré de perfection? Les artistes d’élite ne se détourneront-ils pas de cette branche de travail, lorsqu’on ne pourra plus payer suffisamment leurs œuvres?
le conservateur.
On le pourra toujours, ce me semble.
l’économiste.
Si les maisons ne pouvaient être possédées que pendant une période de trois années, ne baisseraient-elles pas de prix?
le socialiste.
Assurément. On ne mettrait pas un prix bien élevé à une maison dont on pourrait être dépossédé au bout de trois années.
le conservateur.
Avec ce système on ne bâtirait plus que des masures.
l’économiste.
Eh bien, si la loi abaisse de même la valeur vénale des modèles et des dessins, en ne fera plus que des modèles et des dessins de pacotille.
Mais alors nos étoffes et nos bronzes, dont le dessin ou le modèle font souvent tout le prix, pourront-ils encore soutenir la concurrence de l’étranger? En limitant la propriété des artistes, les industriels n’auront-ils pas coupé l’arbre pour avoir le fruit?
le conservateur.
C’est vrai.
l’économiste.
Vous voyez où conduit la limitation de la propriété. Les choses deviennent communes, soit! mais elles se produisent mal ou elles ne se produisent plus.
Si vous admettez la propriété illimitée des œuvres d’art, vous devez admettre aussi la propriété illimitée des inventions.
le conservateur.
La propriété illimitée des inventions! mais ce serait la mort de l’industrie déjà rançonnée sans merci par les inventeurs.
l’économiste.
Cependant les inventions sont le fruit du travail de l’intelligence comme les œuvres littéraires et les œuvres [58] d’art. Si celles-ci donnent lieu à un droit de propriété illimité, absolu, pourquoi celles-là, qui ont la même origine, ne donneraient-elles lieu qu’à un droit limité et conditionnel?
le conservateur.
L’intérêt de la société n’est-il pas ici en cause? Je conçois qu’on accorde un droit de propriété illimité, absolu aux littérateurs et aux artistes. Cela n’a qu’une faible importance. Le monde pourrait, à la rigueur, se passer d’artistes et de littérateurs.
le socialiste.
Oh! oh!
le conservateur.
Mais on ne pourrait se passer d’inventeurs. Ce sont les inventeurs qui fournissent des instruments et des procédés à l’agriculture et à l’industrie.
l’économiste.
Aussi n’est-il nullement question de supprimer les inventeurs ou d’en réduire le nombre. Il est question, au contraire, de les multiplier en assurant à leur travail la rémunération qui lui est due.
le conservateur.
Je le veux bien; mais en décrétant la perpétuité de la propriété des inventions, ne mettrez-vous pas, à perpétuité, l’agriculteur et l’industrie sous le joug d’un petit nombre d’inventeurs? N’assujettirez-vous pas les branches les plus nécessaires de la production à des monopoles exigeants, intraitables, odieux? Supposez, pas exemple, que l’inventeur de la charrue eût conservé la propriété de son invention, et que cette propriété eût été transmise intacte jusqu’à nos jours, que serait-il arrivé?
l’économiste.
Il serait arrivé que nous aurions aujourd’hui des instruments aratoires plus nombreux et plus parfaits.
le conservateur.
C’est une aberration pure!
l’économiste.
Discutons. Vous connaissez la législation qui régit actuellement les inventions. On garantit aux inventeurs la propriété de leurs œuvres pour cinq, dix et quinze années, à la condition de payer au fisc 500 francs dans le premier cas, 1,000 dans le second, 1,500 dans le troisième. Or, il peut fort bien arriver qu’une invention ne donne point les résultats que l’auteur en avait attendus. Dans ce cas, il se trouve puni, mis à l’amende pour avoir inventé.
le conservateur.
Je n’ai jamais prétendu que la loi actuelle fût parfaite. On peut la réformer. Mais accorder à l’inventeur la propriété perpétuelle de son œuvre, folie!
l’économiste.
Dans quel intérêt voulez-vous dépouiller l’inventeur d’une partie de sa propriété? Est-ce dans l’intérêt des consommateurs actuels? Nou, car vous accordez à l’inventeur une propriété de cinq, dix et quinze années. Dans cet intervalle, il tire naturellement tout le parti possible d’une propriété qui doit lui échapper bientôt; il exploite rigoureusement son monopole. C’est donc uniquement en vue de l’intérêt de la postérité que vous dépouillez les inventeurs.
le conservateur.
C’est dans l’intérêt du progrès, de la civilisation. [60] D’ailleurs, comment serait-il possible de démêler et de délimiter les droits des inventeurs. Toutes les inventions se touchent par quelque point.
l’économiste.
Comme toutes les propriétés matérielles. Cela n’empêche pas que chacun ne réussisse, en fin de compte, à maintenir l’intégrité des siennes.
le conservateur.
Oui, mais cela serait bien plus malaisé dans le domaine de l’invention. La reconnaissance de la propriété des inventeurs ne donnerait-elle pas naissance à des myriades de procès?
l’économiste.
N’est-ce pas un moyen singulier de préserver la propriété du danger des procès que de la supprimer? Au reste, la difficulté que vous venez de soulever se présente tous les jours et elle est tous les jours résolue. La propriété des inventions étant garantie pour cinq, dix et quinze ans, donne lieu à des procès, tout comme si elle était perpétuelle. Ces procès on les juge, et tout est dit. Votre objection tombe devant les faits. Je reprends. C’est en vue de l’intérêt de la postérité que vous voulez limiter la propriété des inventions.
le conservateur.
Sans doute.
l’économiste.
Il y a dans l’ouest de l’Union américaine d’immenses terrains vierges, qui sont journellement entamés par des émigrants audacieux. Lorsque ces pionniers de la civilisation aperçoivent un site qui leur convient, ils arrêtent leurs wagons, plantent leur tente, et, avec la cognée [61] d’abord, avec la charrue ensuite, ils déblayent et défrichent le sol. Ils donnent une valeur à ce sol qui naguère n’en avait point. Eh! bien, cette valeur que le travail a créée, trouveriez-vous équitable que la communauté se l’appropriât au bout de cinq, dix et quinze années, au lieu de permettre au travailleur de la léguer à sa postérité.
le conservateur.
Juste ciel! mais ce serait du communisme, ce serait de la barbarie! Qui voudrait défricher des terres à ces conditions-là?—Mais y a-t-il la moindre analogie entre le travail du pionnier et celui de l’inventeur. L’intelligence n’est-elle pas un fonds commun qui appartient à l’humanité? Peut-on s’en attribuer exclusivement les fruits? L’inventeur ne profite-t-il point d’ailleurs, largement, des découvertes de ses devanciers et des connaissances qui se trouvent accumulées dans la société? S’il n’inventait pas, un autre profitant de ces découvertes et de ces connaissances communes, n’inventerait-il pas à sa place?
le socialiste.
L’objection s’applique au défricheur aussi bien qu’à l’inventeur. La société ne devrait-elle pas dire à ce premier occupant de la terre: Vous allez mettre en valeur un sol demeuré jusqu’à présent improductif, soit! j’y consens; mais n’oubliez pas que ce sol est l’œuvre de Dieu et non la vôtre? n’oubliez pas que les fruits sont à tous et que la terre n’est à personne! Jouissez donc, pendant quelques années, de cette portion de terre, mais restituez-la ensuite fidèlement à l’humanité qui la tient de Dieu. Et si vous ne consentez point de bonne grâce à cette restitution légitime, je saurai bien employer la force [62] pour faire prévaloir le Droit de Tous sur l’Égoïsme d’un seul..... Eh! quoi, vous resistez, vous objectez que vous seul avez créé, au prix de vos sueurs, la valeur que je prétends vous ravir, mais, ô propriétaire rebelle et dénaturé, eussiez-vous pu la créer, cette valeur, sans les instruments et les connaissances que la communauté vous a fournis? Répondez!
l’économiste.
Et le propriétaire aurait répondu sans doute:—La communauté m’a fourni des instruments et des connaissances, cela est vrai, mais je les lui ai payés. Mes ancêtres et moi, nous avons acquis par notre travail tout ce que nous possédons. La société n’a donc aucun droit sur les fruits de mon travail actuel. Et si, abusant de sa force, elle me ravit ma propriété, pour la mettre en commun ou la distribuer à des hommes qui ne l’ont point créée, elle commettra la plus inique et la plus odieuse des spoliations.
le conservateur.
Bien répondu. Parez-moi celle-là, messieurs les communistes!
le socialiste.
Parez-la vous-même. Si la société reconnaît n’avoir aucun droit sur la propriété des défricheurs, bien qu’ils exploitent des terrains naguères communs, bien qu’ils utilisent des découvertes et des connaissances antérieures, elle ne saurait évidemment rien prétendre sur la propriété des inventeurs.
le conservateur.
Cela dépend des exigences de l’intérêt général. Si la [63] communauté s’empare d’une terre cinq, dix et quinze années après qu’elle a été défrichée.....
l’économiste.
..... Et si elle oblige le défricheur à payer cinq cents francs, mille francs ou quinze cents francs avant qu’il ne sache si la terre sera ou non féconde.....
le socialiste.
..... Et quelle que soit l’étendue du terrain défriché.
le conservateur.
Il est certain que les défrichements seront extrêmement rares, et que la communauté, elle-même, y perdra.
l’économiste.
Il en est de même pour les inventions. On invente beaucoup moins sous le régime de la propriété limitée qu’on n’inventerait sous le régime de la propriété illimitée. Or, comme la civilisation ne marche qu’à coups d’inventions, la postérité, dont vous avez invoqué les intérêts, gagnerait évidemment à la reconnaissance de la propriété des inventeurs, comme elle a gagné à la reconnaissance de la propriété foncière.
le conservateur.
Vous avez peut-être raison pour le plus grand nombre des inventions. Mais il y en a de si nécessaires qu’on ne saurait les laisser longtemps appropriées. J’ai cité la charrue. Ne serait-ce pas un malheur effroyable, si un seul individu avait le droit de fabriquer et de vendre des charrues, si la propriété de cet instrument, indispensable à l’agriculture, n’était pas tombée dans le domaine public?
le socialiste.
En effet, ce serait désastreux.
l’économiste.
Examinons ensemble comment les choses se seraient passées si l’inventeur de la charrue avait joui de la propriété de son invention, au lieu d’en être frustré. Mais avant tout, voici ma réponse: Non! la société n’a point servi son véritable intérêt en méconnaissant le droit de l’inventeur de la charrue, en s’attribuant cette propriété due au travail de l’un des siens et en la rendant commune. Non! elle a entravé le progrès des cultures au lieu de le faciliter, et en spoliant l’inventeur elle s’est spoliée elle-même.
le conservateur.
Paradoxe!
l’économiste.
Nous allons bien voir. Qu’est-ce que la charrue et à quoi sert-elle?
La charrue est un instrument mû par des bêtes de somme, des chevaux ou des bœufs, sous la direction de l’homme, et qui sert à ouvrir le sol. Avant l’invention de la charrue, de quoi se servait-on pour cultiver la terre? On se servait de la bêche. Voilà donc deux instruments bien distincts, à l’aide desquels la même œuvre peut être accomplie; deux instruments qui se font concurrence l’un à l’autre. Cette concurrence est, à la vérité, fort inégale, car la charrue est infiniment préférable à la bêche; et plutôt que d’en revenir à ce dernier outil, le moins économique de tous, la plupart des cultivateurs se résigneraient à payer une surtaxe considérable aux détenteurs de la propriété de la charrue. Mais enfin les champs ne demeureraient pas incultes. On se servirait de la bêche, jusqu’à ce que les détenteurs de la charrue [65] s’apercevant qu’on peut, à la rigueur, se passer d’eux, se montrassent plus traitables.
Mais de cette situation de la société, en butte aux prétentions exagérées des propriétaires de certains instruments indispensables, que résulterait-il? Qu’il y aurait un immense intérêt à multiplier le nombre de ces instruments, à en créer de plus parfaits. Dans un moment où le prix de la charrue, par exemple, se trouverait surélevé, celui qui inventerait un instrument aussi économique ou plus économique pour remplir le même office, ne réaliserait-il pas une fortune? Et s’il voulait, à son tour, surélever le prix de son instrument, ne se trouverait-il pas arrêté dans ses prétentions, d’abord par le fait même de l’existence des deux anciens véhicules, auxquels on pourrait toujours revenir, ensuite par la crainte de faire surgir une concurrence nouvelle, en augmentant l’intérêt attaché à la découverte d’un instrument plus parfait.—Vous voyez donc que le monopole ne serait jamais à redouter; car il y aurait toujours, d’une part, la concurrence existante, effective, des instruments moins parfaits; d’une autre part, la concurrence éventuelle, prochaine des instruments plus parfaits.
le conservateur.
Le domaine de l’invention n’est-il pas limité?
l’économiste.
Les plaines de l’intelligence sont plus vastes encore que celles de la terre. Dans quelle branche de la production peut-on affirmer qu’il n’y a plus de progrès à réaliser, plus de découvertes à faire? Ne craignez pas que la carrière de l’invention se ferme; les forces défailleront [66] à l’humanité avant qu’elle ne l’ait parcourue jusqu’au bout.
Croyez-vous, par exemple, qu’on ne puisse rien trouver de mieux, en fait d’instruments aratoires, que les instruments actuels? Comparée aux véhicules dont on se sert dans la production manufacturière, la charrue n’estelle pas un instrument barbare? La charrue est un véhicule mû par une force animée. Or, l’industrie manufacturière ne doit-elle pas les immenses progrès qu’elle a réalisés, depuis un demi-siècle, à la substitution d’un moteur inanimé, la vapeur, à la force animée des brutes? Pourquoi cette substitution économique d’un moteur inanimé à un moteur animé ne s’opèrerait-elle point aussi en agriculture? Pourquoi un véhicule à vapeur ne remplacerait-il pas la charrue comme la mull-Jenny a remplacé la machine à filer, comme le moulin à vapeur a remplacé la meule, mise en mouvement par un cheval aveugle, comme la charrue même, mue par la force des bêtes de somme, s’est substituée à la bêche, mue par la force de l’homme?
Si, dès l’origine, la propriété des inventions avait été reconnue et respectée au même degré que la propriété matérielle, n’est-il pas au moins probable que ce progrès bienfaisant se trouverait déjà accompli? N’est-il pas probable que la vapeur aurait déjà transformé et multiplié la production agricole comme elle a transformé et multiplié la production industrielle? N’en résulterait-il pas un avantage immense pour l’humanité tout entière?
De tout cela je conclus que la société aurait eu, dès l’origine, le plus grand intérêt à reconnaître et à respecter [67] la propriété de l’invention, s’agit-il même de celle de la charrue?
le conservateur.
Vous croyez donc qu’on invente d’autant plus que la propriété de l’invention est plus étendue et mieux garantie?
l’économiste.
Assurément, je le crois. Ce n’est guère qu’au dix-huitième siècle qu’on a commencé à reconnaître la propriété des inventions. Comparez donc les découvertes accomplies dans une période déterminée, avant et après cette époque.
le conservateur.
Voilà qui témoigne contre vos théories, puisque la propriété des inventions n’est pas illimitée.
l’économiste.
Si la propriété d’un champ de blé, après avoir été longtemps commune, venait à être reconnue et garantie pour cinq, dix ou quinze années à un seul individu, l’augmentation de la production du blé prouverait-elle quelque chose contre la propriété illimitée?
le conservateur.
Non, sans doute...Mais certaines choses ne se découvrent-elles pas, pour ainsi dire, toutes seules? Il y a des découvertes qui sont dans l’air.
l’économiste.
Comme il y a des récoltes qui sont sous la terre. Il ne s’agit que de les en faire sortir. Mais soyez bien certain que “le hasard” ne se chargera pas de ce soin.—Comment avez-vous découvert la loi de la gravitation, demandait-on un jour à Newton?—En y pensant toujours, répondit l’homme de génie. Watt, Jacquart, Fulton [68] auraient fait probablement la même réponse à une question semblable. Le hasard n’invente rien; il ne défriche pas plus le domaine de l’intelligence que celui de la matière. Laissons donc le hasard.
On dit que si une découverte n’était pas faite aujourd’hui, elle serait faite demain; mais cette hypothèse ne peut-elle pas tout aussi justement s’appliquer aux défrichements des terres qu’aux nouvelles combinaisons d’idées, aux inventions? Si les Backwoodsmen qui émigrent aujourd’hui à l’ouest demeuraient chez eux, ne peut-on pas admettre que d’autres Backwoodsmen iraient s’établir sur les mêmes terrains vierges avant cinq, dix ou quinze années? pourquoi donc ne point limiter le droit de propriété des premiers? Pourquoi? parce que si on le limitait personne ne voudrait s’enfoncer dans les solitudes de l’ouest, ni aujourd’hui ni demain. De même, croyez-le bien, nul ne s’efforcerait de saisir les découvertes qui sont dans l’air si nul n’avait intérêt à les saisir.
le conservateur.
Vous oubliez que la gloire et le désir plus noble encore de servir l’humanité, agissent non moins puissamment que l’intérêt sur les inventeurs.
l’économiste.
La gloire et le désir de servir l’humanité font partie de l’intérêt et n’en sont pas distincts, ainsi que je vous l’ai démontré déjà. Mais ces mobiles élevés ne suffisent pas. Comme les écrivains et les artistes, les inventeurs sont soumis aux infirmités humaines. Comme eux, ils sont obligés de se nourrir, de se vêtir, de se loger, et, le plus souvent aussi, de soutenir une famille. Si vous ne leur offrez d’autre appât que la gloire et la satisfaction d’avoir [69] servi l’humanité, ils devront pour la plupart renoncer à suivre la carrière de l’invention. Les gens riches seuls pourront inventer, écrire, sculpter et peindre. Or, comme les gens riches ne sont pas des travailleurs bien actifs, la civilisation n’avancera guère.
le socialiste.
Allons, allons, monsieur le conservateur, convenez de bonne grâce que vous êtes battu. Si vous admettez la perpétuité de la propriété matérielle, vous ne pouvez pas ne pas admettre celle de la propriété intellectuelle. Il y a même droit et mêmes nécessités des deux parts (en supposant, bien entendu, que l’on reconnaisse ce droit et ces nécessités). Consentez donc à reconnaître la propriété de l’invention comme vous avez reconnu les autres.
le conservateur.
Tout cela peut être vrai en théorie, mais, ma foi! dans la pratique je prefère m’en tenir au statu quo.
le socialiste.
Si nous voulous bien le permettre1!
TROISIÈME SOIRÉE↩
SOMMAIRE: Suite des atteintes portées à la propriété extérieure.—Loi d’expropriation pour cause d’utilité publique.—Législation des mines.—Domaine public, propriétés de l’État, des départements et des communes.—Forêts.—Routes.—Canaux.—Cours d’eau.—Eaux minérales.
l’économiste.
Nous avons constaté que la propriété des œuvres de l’intelligence est fort maltraitée sous le régime actuel. La propriété matérielle est plus favorisée, en ce sens qu’on l’a reconnue et garantie et perpétuité. Toutefois cette reconnaissance et cette garantie n’ont rien d’absolu. Un propriétaire peut être dépouillé de sa propriété, en vertu de la loi d’expropriation pour cause d’utilité publique.
le conservateur.
Eh quoi! vous voulez abolir cette loi tutélaire sans laquelle aucune entreprise d’utilité publique ne serait possible?
l’économiste.
Qu’entendez-vous par entreprise d’utilité publique?
le conservateur.
Une entreprise d’utilité publique, c’est...une entreprise [71] utile à tout le monde, un chemin de fer, par exemple.
l’économiste.
Ah! et une ferme où l’on produit des aliments pour tout le monde n’est-elle pas aussi une entreprise d’utilité publique? Le besoin de manger n’est-il pas tout au moins aussi général et aussi nécessaire que le besoin de voyager?
le conservateur.
Sans doute, mais une ferme est une entreprise particulière assez bornée.
l’économiste.
Pas toujours. En Angleterre, il y a des fermes immenses; aux colonies, il y a des plantations qui appartiennent à de nombreuses et puissantes compagnies. D’ailleurs, qu’importe! L’utilité d’une entreprise n’est pas toujours en raison de l’espace qu’elle occupe, et la loi ne recherche point si une entreprise dite “d’utilité publique” appartient à une association ou a un individu isolé.
le conservateur.
On ne saurait établir aucune analogie entre une ferme ou une plantation et un chemin de fer. Une entreprise de chemin de fer est soumise à certaines exigences naturelles; la moindre déviation dans le tracé, par exemple, peut entraîner une augmentation considérable dans les dépenses. Qui payerait cette augmentation? Le public. Eh bien, je vous le demande, l’intérêt du public, l’intérêt de la société doit-il être sacrifié à l’obstination ou à la cupidité d’un propriétaire?
le socialiste.
Ah! monsieur le conservateur, voilà des paroles qui me réconcilient avec vous. Vous êtes un digne homme. Touchez-là!
l’économiste.
Il y a dans la Sologne de vastes étendues de terre d’une excessive pauvreté. Les misérables paysans qui les cultivent ne recoivent qu’un faible produit en échange des plus laborieux efforts; mais auprès de leurs chétives cabanes, s’élèvent des châteaux magnifiques, avec d’immenses pelouses où le blé pousserait à ravir. Si les paysans de la Sologne demandaient l’expropriation de ces bonnes terres pour les transformer en champs de blé, l’intérêt public ne commanderait-il pas de la leur accorder?
le conservateur.
Vous allez trop loin. Si l’on se servait de la loi d’expropriation pour cause d’utilité publique pour transformer les pelouses et les pares d’agrément en champs de blé, que deviendrait la sécurité de la propriété? qui voudrait embellir une pelouse, planter un parc, orner un château?
le socialiste.
On n’exproprie pas sans accorder une indemnité.
le conservateur.
Mais l’indemnité ne suffit pas toujours. Il y a des choses qu’aucune indemnité ne saurait payer. Peut-on payer le toit qui a abrité les générations, le foyer auprès duquel elles ont vécu, les grands arbres qui les ont vus naître et mourir? N’y a-t-il pas quelque chose de sacré dans ces nids séculaires, où vivent les traditions des ancêtres, [73] où respire, pour ainsi dire, l’âme de la famille? N’est-ce pas commettre un véritable attentat moral que d’expulser à jamais une famille de son vieux patrimoine?
l’économiste.
Excepté, n’est-il pas vrai, quand il s’agit de construire un chemin de fer.
le conservateur.
Tout dépend du degré d’utilité de l’entreprise.
le socialiste.
Eh! est-il rien de plus utile qu’une exploitation consacrée à la subsistance du peuple? Quant à moi, j’espère bien que la loi d’expropriation pour cause d’utilité publique recevra bientôt une extension nouvelle. La Convention faisait cultiver des pommes de terre dans le jardin des Tuileries. Exemple sublime! Puissent nos Assemblées législatives l’avoir, sans cesse, sous les yeux? Combien de milliers d’heetares demeurent improductifs, autour des habitations de plaisance des seigneurs de la terre? Combien de bouches on pourrait nourrir, combien de travail on pourrait distribuer, en livrant ces bonnes terres aux travailleurs qui seraient disposés à les mettre en culture? Ah! riches aristos, on plantera, un jour, des pommes de terre dans vos somptueux parterres; on sèmera des navets et des carottes à la place de vos dahlias et de vos rosiers du Bengale! On vous expropriera pour cause d’utilité publique!
le conservateur.
Heureusement les jurys d’expropriation ne donneront pas les mains à ces projets barbares.
le socialiste.
Pourquoi pas? si l’Utilité Publique exige que vos châteaux [74] avec pelouses et parcs d’agrément soient remplacés par des champs de pommes de terre, pourquoi les jurys ne consentiraient-ils pas à l’expropriation? S’ils l’accordent bien quand il s’agit de transformer des exploitations agricoles en chemins de fer, ne l’accorderont-ils pas, à plus forte raison, quand il s’agira de transformer des parcs de luxe en exploitations agricoles? M’opposerezvous la composition actuelle des jurys d’expropriation? Ils sont composés de grands propriétaires, je ne l’ignore pas. Mais ce jury-là n’échappera pas plus que l’autre à la loi du suffrage universel. On y fera entrer des petits propriétaires et des ouvriers, et alors, ma foi... la grande propriété la dansera.
le conservateur.
Voilà un propos subversif, au premier chef!
l’économiste.
Que voulez-vous? on élargit, on généralise l’application d’une loi que vous avez établie vous-même, en vue de l’Utilité Sociale. On complète votre œuvre. Pouvez-vous vous en plaindre?
le conservateur.
Je sais bien que l’expropriation pour cause d’utilité publique a ses dangers, surtout depuis cette révolution maudite.... Mais n’est-elle pas indispensable? Les intérêts privés ne sont-ils pas perpétuellement en hostilité avec l’intérêt public?
D’ailleurs cette loi ne contient-elle pas une reconnaissance implicite de la propriété? Si l’État ne respectait pas le droit de propriété, se serait-il donné la peine de demander une loi d’expropriation aux Chambres législatives? De simples ordonnances n’auraient-elles pas suffi? [75] La loi d’expropriation pour cause d’utilité publique ne renferme-t-elle pas une reconnaissance implicite de la propriété?
l’économiste.
Oui, comme le viol renferme une reconnaissance implicite de la virginité.
le conservateur.
Et l’indemnité?
l’économiste.
Croyez-vous qu’aucune indemnité puisse dédommager d’un viol? Or si je ne veux pas vous céder ma propriété et qu’usant de votre supériorité de forces vous me la ravissiez, n’est-ce pas un viol que vous commettrez? L’indemnité n’effacera point cette atteinte portée à mon droit.—Mais, objectez-vous, l’intérêt public peut exiger le sacrifice de certains intérêts privés, et il faut pourvoir à cette nécessité.—Eh, quoi! c’est vous, un conservateur, qui me tenez ce langage? C’est vous qui me dénoncez l’antagonisme de l’intérêt public et des intérêts privés? Mais prenez-y garde, vous faites du socialisme?
le socialiste.
Sans doute. Suum cuique. Nous avons dénoneé, les premiers, ce lamentable antagonisme de l’intérêt public et des intérêts privés.
le conservateur.
Oui, mais comment y mettez-vous un terme?
le socialiste.
C’est bien simple. Nous supprimons les intérêts privés. Nous faisons rentrer les biens de chacun dans le domaine de Tous. Nous appliquous sur une échelle immense [76] la loi d’expropriation pour cause d’utilitê publique.
l’économiste.
Et s’il y a véritablement antagonisme entre l’intérêt de chacun et l’intérêt de tous, vous agissez très sagement et votre adversaire a tort de ne pas vous suivre jusque-là!
le socialiste.
Vous faites de l’ironie! Croyez-vous, par hasard, que les intérêts privés s’accordent naturellement, d’euxmêmes, avec l’intérêt public?
l’économiste.
Si je n’en étais pas convaincu, je serais depuis longtemps socialiste. Je ferais comme vous une immortelle guerre aux intérêts privés, je demanderais l’association intégrale, la communauté, que sais-je encore? Je ne voudrais à aucun prix maintenir un état social où nul ne prospérerait qu’à la condition de nuire à autrui. Mais grâces à Dieu, la société n’est pas ainsi faite! Naturellement tous les intérêts s’accordent. Naturellement l’intérêt de chacun coincide avec l’intérêt de tous. Pourquoi donc faire des lois qui mettent celui-là à la merci de celui-ci? Ou ces lois sont inutiles, ou, comme l’affirment les socialistes, la société est à refaire.
le conservateur.
Vous raisonnez comme si tous les hommes étaient de justes appréciateurs de leur intérêt. Eh bien! c’est faux. Les hommes se trompent fréquemment sur leur intérêt.
l’économiste.
Je sais parfaitement que les hommes ne sont pas infaillibles; mais je sais aussi que chacun est le meilleur juge de son intérêt.
le conservateur.
Vous avez peut-être raison en théorie, mais, dans la pratique, il y a des gens si entêtés et si stupides.
l’économiste.
Pas si entêtés et pas si stupides, lorsqu’il s’agit de leur intérêt. Toutefois, j’admets que ces gens-là fassent avorter quelques entreprises utiles. Croyez-vous que la loi actuelle ne cause pas plus de mal qu’ils n’en pourraient causer? Ne compromet-elle pas la sécurité de la propriété dans le présent et ne la menace-t-elle pas dans l’avenir?
le conservateur.
Il est certain que le socialisme pourrait faire un bien déplorable usage de la loi d’expropriation pour cause d’utilité publique.
l’économiste.
Et vous autres conservateurs qui avez établi cette loi, auriez-vous bonne grâce à vous opposer à son application? N’est-ce pas une arme dangereuse que vous avez forgée, à l’usage de vos ennemis? En déclarant qu’une majorité quelconque a le droit de mettre la main sur la propriété d’un individu lorsque l’intérêt public l’exige, n’avezvous pas fourni d’avance au socialisme une justification et un moyen légal d’exécution?
le conservateur.
Hélas! mais qui pouvait prévoir cette révolution infernale!
l’économiste.
Lorsqu’on se mêle de faire des lois, il faut tout prévoir.
A côté de cette loi qui menace la propriété jusque dans [78] ses racines, notre Code renferme d’autres lois qui atteignent partiellement certaines propriétés; la législation des mines par exemple. Comme les œuvres de l’intelligence, les mines se trouvent placées en dehors de la loi commune.
le conservateur.
N’est-ce pas une propriété spéciale, et ne doit-elle pas être, en conséquence, régie par des lois spéciales?
le socialiste.
Quelle est actuellement la législation des mines?
l’economiste.
La législation française sur les mines a subi des modifications très diverses, depuis un siècle. Sous l’ancien régime, les mines étaient considérées comme appartenant au domaine royal. Le roi en accordait la concession à qui bon lui semblait, au découvreur, au proprietaire du sol ou à tout autre, moyennant une redevance annuelle du dixième des produits. Lorsque la révolution affranchit la propriété et le travail on devait espérer que ce bienfait s’étendrait aussi à la propriété des mines; malheureusement, il n’en fut pas ainsi. Le législateur refusa d’accorder à la propriété du sous-sol sa charte d’affranchissement.
Trois opinions se produisirent au sujet de cette propriété. Selon les uns, la propriété du sous-sol se rattachait à celle de la surface; selon les autres, elle rentrait dans le domaine de la communauté; selon les troisièmes, elle revenait aux découvreurs. Dans ce dernier système, qui était le seul équitable, le seul conforme au droit, les propriétaires du sol ne pouvaient exiger qu’une simple indemnité pour les parties de la surface, nécessaires à l’exploitation des gîtes mineraux, et le gouvernement [79] ne pouvait, de même, exiger autre chose qu’un impôt pour la protection dévolue aux exploitants.
le socialiste.
Selon vous, la propriété des mines devrait donc être rangée dans la même catégorie que la propriété des inventions?
l’economiste.
Précisément. Vous êtes un chercheur d’or, je suppose. Après bien des recherches, vous êtes parvenu à découvrir un filon de ce précieux métal. Vous avez le droit d’exploiter seul ce filon que vous avez decouvert seul.
le socialiste.
A ce compte, l’Amérique entière aurait dû appartenir à Christophe Colomb qui l’avait découverte.
l’économiste.
Vous oubliez que l’Amérique était déjà, en grande partie, possédée à l’époque de la découverte de Christophe Colomb. Au reste, c’est une règle du droit des gens qu’une terre inhabitée appartient au premier qui la découvre.
le socialiste.
Mais si, apres l’avoir découverte, il ne juge pas à propos de l’exploiter, son droit de propriété périt. Comment expliquez-vous cette mort du droit de propriété?
l’économiste.
Le droit de propriété ne meurt point. On ne cesse de posséder qu’en renonçant à posséder. Si j’ai découvert une mine, je l’exploiterai, ou je la céderai à quelqu’un qui l’exploitera. Il en sera de même si j’ai découvert une terre: je l’exploiterai ou je la vendrai.
le socialiste.
Et si vous la gardez sans l’exploiter?
l’économiste.
Ce sera mon droit, mais ce ne sera point mon intérêt. Toute chose coùte à garder: il faut payer la sécurité de la propriété. Si donc je ne veux pas exploiter la terre ou la mine que j’ai découverte, et si personne ne veut me l’acheter, je renoncerai bientôt a la garder; car elle me causera une perte au lieu de me donner un profit. Il n’y a, vous le voyez, aucun inconvénient à laisser au découvreur la pleine disposition de l’objet de sa découverte.
le conservateur.
Que le découvreur d’une mine possède un droit sur cette mine, cela me semble assez légitime. Il est juste que son travail de découverte soit rémunéré. Mais la société et les propriétaires de la surface, n’ont-ils pas bien aussi quelques droits sur le sous-sol? La société protége les exploitants des mines, et elle leur fournit les moyens d’exploiter. Quant aux propriétaires de la surface, n’ont-ils pas un droit de revendication sur le soussol, par le fait de l’occupation du sol? Où est la limite des deux propriétés?
le socialiste.
Oui, où est la limite?
l’économiste.
Ni la société ni les propriétaires de la surface ne peuvent revendiquer le moindre droit sur le sous-sol. Je vous ai déjà prouvé, à propos des inventions, que la société ne possède aucun droit sur les fruits du travail des individus. Il est inutile de revenir là-dessus. Quant [81] aux propriétaires de la surface, Mirabeau a fait bonne justice de leurs prétentions sur la propriété du sous-sol: “L’idée d’être maître d’un torrent ou d’une rivière, qui répond sous la terre à la surface de nos champs, me paraît, disait-il, aussi absurde que celle d’empêcher le passage d’un ballon dans l’air, qui répond aussi, à coup sûr, au sol d’une propriété particulière.” Et pourquoi est-ce absurde? Parce que la propriété des champs réside uniquement dans la valeur que le travail a donnée à la surface, et que les propriétaires du sol n’ont donné aucunc valeur au sous-sol non plus qu’à l’atmosphère. Recherchez qui a travaillé ou travaille, et vous saurez toujours qui possède ou doit posséder.
le conservateur.
Mais est-il possible de découvrir une mine et de l’exploiter sans le concours des propriétaires de la surface?
l’économiste.
Voici comment les choses se passent. On demande aux propriétaires de la surface l’autorisation d’explorer le sol, en s’engageant à leur donner une indemnité ou une part de propriété dans la mine pour compenser le dommage qu’on pourra leur causer. La mine découverte, on fait les parts et l’on exploite. Si l’exploitation du soussol est de nature à nuire à la propriété du sol, les propriétaires de la surface ont évidemment le droit de s’y opposer ou de réclamer une nouvelle indemnité. Ils choisissent de préférence l’indemnité; car l’ouverture d’une mine, en donnant un nouveau débouché à leurs produits, augmente directement ou indirectement leurs revenus. C’est ainsi que des intérêts en apparence opposés sc concilient d’eux-mêmes.
[82]Par malheur, l’Assemblée constituante et Mirabeau lui-même ne comprirent pas que la propriété minérale pouvait être laissée libre, sans inconvénient aucun. Ils attribuèrent à la nation la propriété des mines. Ils firent du communisme souterrain. La loi de 1791 accorda au gouvernement le pouvoir de disposer de la propriété minérale, et limita à cinquante années la durée des concessions. Le gouvernement fut investi, en outre, du pouvoir de retirer ces concessions, lorsque les mines ne seraient pas tenues en bon état ou lorsqu’elles cesseraient momentanément d’être exploitées.
La disposition la plus funeste de cette loi était, sans contredit, celle qui limitait la durée des concessions. L’exploitation des mines exigeant d’immenses capitaux et des travaux préparatoires qui se prolongent quelquefois pendant plusieurs années, il importait, par dessus tout, aux entrepreneurs d’être assurés de l’avenir; borner leur jouissance, c’était les mettre dans l’obligation de borner aussi leurs sacrifices; c’était apporter un obstacle presque insurmontable au développement des exploitations minérales.
Le Droit attribué au gouvernement, de retirer les concessions, dans certaines circonstances déterminées, entraînait aussi des inconvénients très graves. Il n’est pas facile de décider si une mine est bien exploitée ou si elle l’est mal. Les avis peuvent être partages sur le mode d’exploitation le plus convenable. On argnait par exemple contre l’exploitation libre, que les exploitants épuisaient d’abord les filons les plus riches et négligeaient les autres, mais ne suivaient-ils pas, en cela, la marche la plus rationnelle? N’était-il pas naturel de commencer par les parties [83] les plus productives des exploitations? En débutant par exploiter les filons les moins riches, les concessionnaires n’auraient-ils pas discrédité leurs entreprises naissantes? On ne pouvait décider avec plus de certitude si un exploitant avait tort ou raison d’abandonner momentanément tout ou partie de son exploitation. Son intérêt personnel, qui était de la tenir constamment en activité, offrait, sous ce rapport, une garantie suffisante. A moins que la demande ne vint à se ralentir, et dans ce cas, la suspension partielle ou totale de l’extraction minérale se justifiait d’elle-même, quel intérêt pouvait-il avoir d’interrompre les travaux?
le conservateur.
On a réformé cette mauvaise loi.
l’économiste.
On l’a réformée fort incomplètement. La loi du 21 avril 1810 qui l’a remplacée, a maintenu au gouvernement le droit d’accorder et de retirer les concessions. Seulement les concessions ont cessé d’être limitées à cinquante années. Mais, sous d’autres rapports, la situation des propriétaires du sous-so! a été aggravée. La loi de 1810 leur interdit de vendre par lots et de partager leurs mines, sans une autorisation préalable du gouvernement, et elle assujettit leurs exploitations à la surveillance d’une administration créée ad hoc; de plus, elle réserve les prétendus droits des propriétaires de la surface, et elle commet au conseil d’État le soin de déterminer le montant des indemnités à leur accorder. Les exploitations minérales se trouvent, de la sorte, étroitement réglementées et lourdement grevées.
Aussi, quel a été le résultat de cette loi? Ca été de [84] reduire au minimum la production minerale. Qui voudrait aujourd’hui se faire découvreur de mines? qui voudrait s’occuper spécialement de rechercher de nouveaux gîtes métallifères? Avant de faire valoir sa découverte, n’est-on pas obligé d’en solliciter, pendant de longues annécs, la concession (la concession d’une propriété que l’on a créec par son travail), et après l’avoir obtenue, de se soumettre a la surveillance inquiète et à la direction inintelligente de l’administration des mines? Que deviendrait, je vous le demande, la culture de nos champs, si nos agriculteurs ne pouvaient remuer une pelletec de terre sans l’approbation d’un agent du ministère de l’agriculture? s’il ne leur était pas pernus de vendre la moindre parcelle de leurs champs, sans l’approbation du gouvernement? si enfin l’administration s’attribuait le droit de leur retirer, à sa volonté, leur propriété? Ne scrait-ce pas la mort de notre agriculture? Les capitaux ne se détourneraient-ils pas avec empressement, d’une industrie si detestablement opprimce?... Eh! bien, les capitaux se sont détournés des exploitations minérales. Il a fallu leur accorder des priviléges spéciaux pour les y ramener. Il a fallu écarter la concurrence étrangère, et faciliter ainsi a l’interieur l’etablissement d’un immense monopole, pour décider les capitaux à s’aventurer dans une industrie asservie au bon plaisir administratif. Il a fallu rejeter sur les consommateurs des produits mineraux une partie du dommage qu’on infligeait a la propriété des mines. N’est-ce pas de la barbarie?
Supposons, au contraire, qu’on eùt purement et simplement supprime, en 1789, le droit abusil que s’attribuaient les monarques de concéder la propriéte des [85] mines; supposons que cette propriété eût été librement abandonnée et garantie à ceux dont le travail l’avait créée, la production des mines ne se serait-elle pas développée au maximum, sans qu’il eût été nécessaire de la protéger? Cette source de travail qui ne laisse échapper encore que de maigres filets, ne coulerait-elle pas à longs flots?
le conservateur.
Oui, c’est une chose merveilleuse que la propriété. Avec quelle ardeur on travaille quand on est sûr de posséder a toujours le fruit de son labeur, et d’en disposer librement, de le consommer, de le donner, de le prêter, de le vendre, sans être entravé, gêné, vexé. La propriété, voilà la vraie Californie. Vive la propriété!
le socialiste.
Vive le travail!
l’économiste.
Travail et propriété se tiennent, puisque c’est le travail qui crée la propriété, et la propriété qui suscite le travail. Vivent donc le travail et la propriété!
Le gouvernement nuit au développement de la production, non seulement en entravant la proériéte individuelle, mais encore en s’attribuant certaines propriétés. A côté du domaine des particuliers, il y a, vous le savez, le domaine public ou commun. L’État, les départements, les communes possèdent des biens considérables, des champs, des prairies, des forêts, des canaux, des routes, des bâtiments, et que sais-je encore. Ces diverses propriétés, qui sont gérées au [86] nom de la société, ne constituent-elles pas un véritable communisme?
le conservateur.
Oui, dans une certaine mesure. Mais les choses pour-raient-elles être arrangées autrement? Le gouvernement ne doit-il pas nécessairement disposer de certaines propriétés? Le gouvernement est institué pour rendre à la société des services...
l’économiste.
Quels services?
le conservateur.
Le gouvernement doit...gouverner.
le socialiste.
Parbleu! mais qu’entendez-vous par gouverner? N’est-ce pas diriger les intérêts, les accorder?
l’économiste.
Les intérêts n’ont besoin ni d’être dirigés ni d’être accordés. Ils se dirigent et s’accordent bien sans que personne s’en mêle.
le socialiste.
S’il en est ainsi, que doit faire le gouvernement?
l’économiste.
Il doit garantir à chacun le libre exercice de son activité, la sécurité de sa personne et la conservation de sa propriété. Pour exercer cette industrie particulière, pour rendre ce service spécial à la société, le gouvernement doit disposer d’un certain matériel. Tout ce qu’il possède en sus est inutile.
le conservateur.
Mais s’il rend d’autres services encore à la société; s’il donne de l’éducation, s’il salarie des cultes, s’il contribue [87] au transport des hommes et des marchandises par terre et par eau, s’il fabrique du tabac, de la porcelaine, des tapis, de la poudre, du salpêtre....
l’économiste.
En un mot, s’il est communiste! Eh bien! il ne faut pas que le gouvernement soit communiste! Comme tout entrepreneur, le gouvernement ne doit faire qu’une seule chose sous peine de faire fort mal ce qu’il fait. Tous les gouvernements ont pour industrie principale, la production de la sécurité. Qu’ils s’en tiennent là.
le conservateur.
Voilà une application bien rigoureuse du principe de la division du travail. Vous voudriez donc que le domaine public cessât d’exister, que l’État vendit la plus grande partie de ses propriétés, que toutes choses, en un mot, fussent spécialisées.
l’économiste.
Je le voudrais, dans l’intérêt du développement de la production. On a fait récemment, en Angleterre, une enquête sur la gestion des propriétés publiques. Rien d’instructif comme les renseignements recueillis dans cette enquête. Le domaine public se compose, en Angleterre, des anciens fiefs de la couronne, devenus propriétés nationales. Ces propriétés sont vastes et magnifiques. Entre les mains des particuliers, elles donneraient un produit considérable; entre les mains de l’État, elles ne rapportent presque rien.
Permettez-moi de vous citer un seul détail.
Les principaux biens du domaine consistent dans les quatre forêts de New-Forest, Walham, Whittlcwood et Whyehwood. Ces forêts sont confiées à des gardiens qui [88] les administrent. Ce sont les ducs de Cambridge et de Grafton, lord Mornington et lord Churchill. Les gardiens ne reçoivent aucune rétribution apparente, mais il leur est alloué une indemnité assez considérable en nature, gibier, bois, etc. Le revenu annuel de la New-Forest s’élève, en moyenne, à 56 ou 57,000 livres sterlings, soit près de 1,500,000 francs. Sur ce revenu, le trésor n’a jamais touché plus de 1,000 livres, et, de 1841 à 1847, l’entretien, de la forêt en a coûté plus de 2,000 à l’État.
le conservateur.
Voilà un abus flagrant; mais c’est dans l’aristocratique Angleterre que ces choses se passent, ne l’oubliez pas!
l’économiste.
Il s’en passe bien d’autres dans notre France démocratique. On a reconnu depuis bien longtemps, en France comme en Angleterre, que la gestion des biens de l’État est détestable.
le conservateur.
Cela n’est que trop vrai. Cependant, il y a des propriétés qui doivent évidemment demeurer entre les mains de l’État, les routes, par exemple.
l’économiste.
En Angleterre, les routes se trouvent entre les mains des particuliers et l’on n’en voit, nulle part, de si bien entretenues.
le conservateur.
Et les barrières donc? La circulation n’est pas libre en Angleterre, elle est libre en France.
l’économiste.
Pardon! elle est beaucoup plus libre dans la Grande-Bretagne, [89] car les voies de communication y sont beaucoup plus nombreuses. Et savez-vous à quoi cela tient? Tout simplement à ce que le gouvernement a laissé les particuliers construire des routes sans se mêler d’en construire lui-même?
le conservateur.
Mais, encore une fois, les péages?
l’économiste.
Eh! croyez-vous donc qu’en France les routes se construisent et s’entretiennent pour rien? Croyez-vous que le public n’en paye pas la construction et l’entretien, comme en Angleterre? Seulement, voici la différence. En Angleterre, les frais de construction et d’entretien des routes sont couverts par ceux qui s’en servent; en France ils sont couverts par tous les contribuables, y compris les chevriers des Pyrénées et les paysans des Landes qui ne foulent pas deux fois par an le sol d’une route nationale. En Angleterre, c’est le consommateur de transports qui paye directement les routes sous forme de péages; en France, c’est la communauté qui les paye indirectement sous forme d’impôts le plus souvent abusifs et vexatoires. Lequel est préférable?
le conservateur.
Et les canaux, ne convient-il pas de les laisser dans le domaine public?
l’économiste.
Pas plus que les routes. Dans quels pays les canaux sont-ils le plus nombreux, le mieux construits et le mieux entretenus? Est-ce dans les pays où ils se trouvent entre les mains de l’État? Non! c’est en Angleterre et aux [90] États-Unis où ils ont été construits et où ils sont exploités par des associations particulières.
le socialiste.
Les routes et les canaux ne constitueraient-elles point des monopoles oppressifs si elles étaient appropriées?
l’économiste.
Vous oubliez qu’elles se font mutuellement concurrence. Je vous démontrerai plus tard, que dans toute entreprise soumise au régime libre de la libre-concurrence, le prix doit nécessairement tomber au niveau des frais réels de production ou d’exploitation, et que les propriétaires d’un canal ou d’une route ne peuvent rien recevoir en sus de l’équitable rémunération de leur capital et de leur travail. C’est une loi économique aussi positive et aussi exacte qu’une loi physique.
La plupart des cours d’eau naturels, qui exigent certains travaux d’exploitation et d’entretien, pourraient de même être appropriés avec avantage. Vous savez à quelles difficultés inextricables le communisme des cours d’eau donne lieu aujourd’hui. Les barrages occasionnent des myriades de procès et les irrigations se trouvent partout entravées. Il en serait autrement si chaque bassin avait ses propriétaires contre lesquels les riverains pourraient avoir recours en cas de dommages et qui se chargeraient de fournir des chutes d’eau et d’établir des canaux d’irrigation où besoin serait.
L’État est encore propriétaire de la plupart des sources d’eaux minérales. Aussi sont-elles fort mal administrées, bien que les administrateurs et les inspecteurs ne manquent pas. En outre, sous le prétexte que les eaux minérales factices servent de médicaments on en a mis la [91] fabrication sous la surveillance de l’administration. Autres administrateurs et autres inspecteurs!
le conservateur.
Ah! l’administration est notre grande plaie.
l’économiste.
Il n’y a qu’un moyen de guérir cette plaie-là, c’est de moins administrer.
QUATRIÈME SOIRÉE↩
SOMMAIRE: Droit de tester.—Législation qui régit l’héritage.—Le droit à l’héritage.—Ses résultats moraux.—Ses résultats matériels.—Comparaison de l’agriculture française avec l’agriculture britannique.—Des substitutions et de leur utilité.—Organisation naturelle des exploitations agricoles sous un régime de propriété libre.
l’économiste.
Ceux qui se sont arrogé le droit de limiter la propriété n’ont pas manqué d’en limiter aussi la libre disposition. Le don, le test, le prêt et l’échange ont été soumis à une multitude d’entraves.
Le don de certaines propriétés est assujetti à des formalités gênantes et coûteuses. Le test est plus entravé encore. Au lieu de laisser au père de famille la libre disposition de ses biens, la loi lui enjoint de les léguer par portions à peu près égales à ses enfants légitimes. Si l’un des enfants se trouve lésé dans le partage, il a le droit de faire casser le testament1.
le conservateur.
Vous attaquez donc aussi cette loi protectrice de la famille et de la propriété?
l’economiste.
J’attaque cette loi destructive de la famille et de la propriété. C’est au nom d’un droit supérieur à celui des pères de famille, que la société a réglé les héritages, n’est-il pas vrai? Mais pourquoi donc n’userait-elle pas de ce droit supérieur pour s’attribuer demain cette propriété dont elle a disposé hier? Si elle a pu dire au père de famille: tu ne disposeras pas de tes biens selon ta volonté, mais selon la mienne; ne peut-elle pas bien lui dire aussi: il me convient désormais que tu disposes de ta propriété en ma faveur. L’abolition de l’héritage, c’est-à-dire la suppression de la propriété individuelle, n’estelle pas contenue dans une loi qui attribue à la société le droit de disposer souverainement de l’héritage?
L’annihilation de l’autorité paternelle, c’est-à-dire la [94] destruction de la famille, n’est-elle pas contenue de même, dans une loi qui retire au père de famille la libre disposition de ses biens pour accorder aux enfants un véritable droit à l’héritage.
le conservateur.
Un droit à l’héritage, dites-vous?
l’économiste.
Dire aux enfants: vous avez le droit d’exiger de votre père des parts à peu près égales d’héritage, quelle qu’ait été votre conduite, quels que soient vos sentiments à son égard; vous avez le droit de faire casser son testament si vous vous trouvez lésés dans le partage, n’est-ce pas consacrer le droit à l’héritage? n’est-ce pas donner à l’enfant une action sur la propriété de son père? n’est-ce pas lui permettre de considérer et d’exiger comme une dette, ce qu’il regardait et ce qu’il recevait naguère comme un bienfait? Où la nature avait mis un fils, votre loi ne met-elle pas un créancier?
le conservateur.
Mais n’est-ce rien d’obliger le père à partager équitablement [95] son héritage entre ses enfants? Sans la loi qui règle les partages, les enfants ne seraient-ils pas incessamment frustrés de leur légitime par des fraudes ou des captations? La loi n’a-t-elle pas prévenu toutes les fraudes, tranché toutes les difficultés.
l’économiste.
En brisant le lien des familles; en rendant illusoire l’autorité du père. Si le droit de tester était libre, le père pourrait sans doute mal disposer de sa fortune. Mais n’est-il pas retenu toujours par ces freins puissants qu’aucune loi fabriquée de main d’homme ne saurait remplacer, l’amour paternel et le sentiment de la justice? Si ces deux sentiments se taisent au dedans de lui-même, croyez-vous que votre loi les fera parler? croyez-vous que le père ne trouvera point quelque moyen détourné de disposer de sa fortune au détriment de ses enfants? S’ils y sont vivaces, à quoi bon votre loi? Et puis, vous posez en principe l’égalité des partages comme l’idéal de l’équité, mais êtes-vous bien sûr que cette égalité brutale soit toujours de la justice? Êtes-vous bien sûr qu’un père ne puisse favoriser un de ses enfants sans spolier les autres? En admettant même que le fils ait virtuellement quelque droit sur les biens de son père...
le conservateur.
Quoi! le fils n’aurait aucun droit sur l’héritage paternel? Mais s’il en était ainsi, on pourrait donc le dépouiller, en l’absence d’un testament.
l’économiste.
La conséquence est fausse. Le droit des enfants se fonde, en ce cas, sur la probabilité du legs. L’héritage doit leur revenir, non parce qu’ils possèdent un droit [96] virtuel sur cet héritage, mais parce que le père le leur aurait probablement légué.
En donnant naissance à un enfant, le père contracte envers lui l’obligation morale de le nourrir et de le mettre en état de vivre de son travail, rien de plus, rien de moins. S’il lui plaît de donner quelque chose en sus à son enfant, c’est un effet de son bon plaisir.
Mais en admettant même votre prétendu droit à l’héritage, croyez-vous qu’un mauvais fils ait sur l’héritage paternel le même droit qu’un bon fils? croyez-vous qu’un père soit tenu, au point de vue de l’équité naturelle, de léguer une partie de son bien au misérable qui aura fait le désespoir et la honte de sa famille? croyez-vous qu’il ne sera pas tenu, au contraire, de priver cet être dégradé des moyens d’assouvir ses passions malfaisantes? L’usage du droit de déshériter ne peut-il être quelquefois utile et juste?
Mais aux yeux de vos législateurs, le père est un être dépourvu à la fois de la notion de la justice et du sentiment paternel. C’est une bête féroce qui guette incessamment sa progéniture pour la dévorer. Il faut que la loi intervienne pour la protéger; il faut que la société lie les pieds et les mains à ce barbare sans entrailles qu’on appelle un père, pour l’empêcher de sacrifier son innocente famille à ses immondes appétits.
Ils n’ont pas vu, ces tristes législateurs, que leur loi n’aurait d’efficacité que pour affaiblir le respect de l’autorité et le sentiment de la famille. Le respect de l’autorité existe-t-il encore en France?
le conservateur.
Ah! vous venez de toucher à la plus lamentable plaie [97] de notre époque. La génération actuelle a perdu le respect de l’autorité; oui, cela n’est que trop vrai. Quels admirables articles l’Union a publiés là-dessus. Le respect de l’autorité! qui nous le rendra? Le fils ne respecte plus son père. L’homme fait ne respecte plus rien, pas même Dieu. Le respect de l’autorité, voilà l’ancre de salut de notre société ballottée au sein de la tourmente révolutionnaire comme un navire qui.....
le socialiste.
Ah! de grâce, laissez, nous avons lu les articles de l’Union.
l’économiste.
Cette ancre de salut, vous l’avez brisée de vos propres mains le jour où vous avez porté atteinte aux droits sacrés des pères de famille; le jour où vous avez donné au fils une action sur la propriété de son père; le jour où, en enlevant à celui-ci l’arme redoutable de l’exhérédation, vous l’avez livré à la merci des rébellions de ses enfants.
le conservateur.
Et la maison de correction?
l’économiste.
Oui, vous la lui avez donnée en échange. Mais, à moins d’avoir perdu tout sentiment humain, un père peut-il consentir à mettre son fils dans ce grand chemin du bagne? Mieux vaut souffrir une rébellion que d’attirer l’infamie sur soi et sur les siens.
Je sais bien que le père peut défier votre loi et deshériter en fait son fils rebelle s’il ne le peut en droit; mais il est obligé d’agir dans l’ombre et d’éviter l’œil avide et jaloux de son créancier. Il n’use plus du droit légitime [98] de disposer de son bien; il porte une atteinte immorale au droit de son fils sur ce bien. Sa conduite n’est plus celle d’un propriétaire disposant souverainement d’un domaine libre; c’est la conduite d’un débiteur qui aliène subrepticement une propriété hypothéquée. Ce qui ferait respecter l’autorité paternelle, si le droit à l’héritage n’existait point, ne peut plus aujourd’hui que l’avilir.
Je ne vous parlerai point des haines qui surgissent dans les familles, lorsqu’un père juge à propos de favoriser un de ses enfants. Dans les pays où le droit à l’héritage n’existe pas, aux États - Unis par exemple, les autres enfants courbent respectueusement la tête devant cet acte souverain de la volonté paternelle et ils ne conçoivent aucun mauvais sentiment contre l’enfant que le père a favorisé; dans les pays où le droit à l’héritage est reconnu, un tel acte devient au contraire une cause profonde de désunion dans la famille. En effet, cet acte si simple et souvent si bien justifié par les circonstances, la faiblesse ou l’incapacité de l’enfant préféré, les soins qu’il a rendus au père, n’est-il pas, au point de vue de votre légalité, une véritable spoliation, un vol? Nouvelle harpie, votre loi a corrompu les sentiments de la famille, en les touchant! Plaignez-vous après cela de ce que le désordre que vous avez jeté dans la famille s’est propagé dans la société?
le conservateur.
Mais si les résultats moraux de la loi sur l’égalité des partages laissent quelque chose à désirer, cette loi n’a-t-elle pas eu d’admirables résultats économiques? Tout le monde est devenu propriétaire. Chaque paysan ayant [99] son lopin de terre à cultiver s’est trouvé à l’abri du besoin.
l’économiste.
En êtes-vous bien sûr? Pour moi, je tiens qu’aucune loi n’a agi d’une manière plus funeste sur la condition des classes laborieuses, manufacturières ou agricoles?
le conservateur.
Aimeriez-vous mieux, par hasard, le droit d’aînesse et les substitutions?
l’économiste.
C’est un autre genre d’abus; une autre sorte d’atteintes au droit de propriété; mais, je crois bien, en vérité, que je les préférerais.
le socialiste.
Il est certain que le morcellement est la plaie de notre agriculture, que l’Association est notre seule planche de de salut.
l’économiste.
Je le pense comme vous.
le conservateur.
Comment? Vous préférez le régime féodal du droit d’ainesse et des substitutions à l’égalité des partages, et vous êtes pour l’association. Voilà une contradiction manifeste.
l’économiste.
Je ne le pense pas. Quelles sont les conditions essentielles de toute production économique? La stabilité, la sécurité dans la possession d’une part; la concentration de forces productives suffisantes de l’autre. Or, le régime actuel ne comporte ni stabilité ni concentration suffisante des forces productives.
le conservateur.
Je conviens avec vous que les baux sont à de trop courts termes, et que notre loi sur l’héritage a rendu la possession indivise d’une exploitation territoriale, singulièrement précaire; je conviens aussi que l’agriculteur manque de capitaux, mais qu’y faire? On a parlé de l’organisation du crédit agricole, et pour ma part, j’y inclinerais assez s’il n’était si difficile de trouver un bon système.
l’économiste.
Un système de crédit agricole, si excellent qu’il fut, ne remédierait à rien. Avec le régime actuel de la propriété, c’est à peine si la multiplication des institutions de crédit ferait baisser le taux de l’intérêt dans nos compagnes. Il en serait autrement si nos exploitations agricoles étaient solidement assises, comme elles le sont en Angleterre.
le socialiste.
Vous osez nous proposer l’Angleterre pour modèle. Ah! certes, la situation des ilotes de nos campagnes est bien misérable, mais n’est-elle pas mille fois préférable à celle des paysans anglais? Les travailleurs anglais ne sont-ils pas exploités par une aristocratie qui dévore leur substance comme le vautour dévorait le foie de Prométhée? L’Angleterre n’est-elle pas le pays où se jouent les plus tristes scenes du sombre drame de l’exploitation de l’homme par l’homme? L’Angleterre n’est-elle pas la grande prostituée du capital? L’Angleterre! ah! ne me parlez pas de l’Angleterre?
l’économiste.
Cependant la condition du paysan anglais, exploité [101] par l’aristocratie, est infiniment supérieure à celle du paysan indépendant, propriétaire de France.
le conservateur.
Allons donc!
l’économiste.
J’aperçois dans votre bibliothèque deux ouvrages de MM. Mounier et Rubichon sur l’Agriculture en France et en Angleterre, et sur l’Action de la noblesse duns les sociétés modernes, qui me fourniront des preuves irrécusables à l’appui de ce que j’avance.
le conservateur.
J’avoue humblement ne les avoir pas lus.
l’économiste.
Vous avez eu tort. Vous y auriez trouvé toutes les lumières nécessaires pour vider la question qui nous occupe. C’est un résumé des volumineuses enquêtes publiées par ordre du parlement anglais sur la situation de l’agriculture et la condition des agriculteurs. Je feuillette au hasard Voici un extrait de l’enquête la plus récente (1846).
Le président s’adresse a M. Robert Baker, fermier dans le comté d’Essex, qui cultive une terre de 230 hectares.
D. Quelle est la nourriture générale des ouvriers agricoles?
R. Ils se nourrissent de viande et de pommes de terre; mais si la farine est à bon marché, ils ne consomment point de pommes de terre; cette année (1846) ils mangent le meilleur pain blanc.
M. Robert Hyde-Gregg, qui est depuis vingt ans un des plus grands manufacturiers de la Grande-Bretagne, [102] donne à son tour les renseignements suivants sur la situation des ouvriers des manufactures.
D. Quand vous dites qu’il se consomme beaucoup de pommes de terre dans les districts de manufacture, entendez-vous que ces pommes de terre sont, comme en Irlande, le fond de la nourriture du peuple, ou sont-elles mangées avec de la viande?
R. En général, le diner se compose de pommes de terre et de porc, le déjeuner et le souper de thé et de pain.
D. Les ouvriers ont-ils, en général, du porc?
R. Je puis dire que tous mangent de la viande à dîner.
D. Depuis que vous observez, y a-t-il eu un changement considérable dans la nourriture des ouvriers manufacturiers; ont-ils substitué la farine de froment à la farine d’avoine?
R. Certainement, ce changement a eu lieu. Je me rappelle que dans toutes les maisons d’ouvriers on voyait des galettes suspendues en l’air; il n’y a plus rien de semblable.
D. La population d’aujourd’hui a donc, sous le rapport du pain, amélioré sa nourriture, puisqu’elle consomme de la farine de froment au lieu de farine d’avoine?
R. Oui, complétement.
Voici maintenant un témoignage relatif à la situation des ouvriers de France et d’Angleterre.
M. Joseph Cramp, expert pour estimer les terres dans le comté de Kent, et fermier depuis quarante-quatre ans, a été en France et il s’y est appliqué à connaître l’état de l’agriculture. On l’interroge sur la condition des ouvriers agricoles en Normandie.
D. D’après vos observations sur l’état des ouvriers en [103] Normandie, pensez-vous qu’ils sóient mieux habillés et mieux nourris que les ouvriers dans l’île de Thanet que vous habitez?
R. Non. J’ai été dans leurs habitations, et je les ai vus à leurs repas qui sont tels que jamais, je l’espère, je ne verrai un Anglais assis à si manvaise table.
D. Les ouvriers dans l’île de Thanet mangent le meilleur pain blanc, n’est-ce pas?
R. Toujours.
D. Et en Normandie, les ouvriers agricoles n’en mangent-ils pas?
R. Non. Ils mangeaient du pain dont la couleur approchait de celle de cet encrier.
D. Combien d’hectolitres de froment récolte-t-on par hectare dans l’île de Thanet?
R. Environ vingt-neuf hectolitres.
D. Ayant habité et cultivé si longtemps dans l’île de Thanet, pouvez-vous dire si la condition des classes ouvrières s’est améliorée ou s’est empirée, depuis le moment que vous avez connu ce pays?
R. Elle s’est améliorée.
D. Sous tous les rapports?
R. Oui.
D. Vous pensez donc que les ouvriers sont mieux habillés et mieux élevés.
R. Mieux nourris, mieux habillés et mieux élevés.
Vous voyez que la condition des populations agricoles de l’Angleterre est infiniment supérieure à celle des nôtres. Comment ce fait s’explique-t-il? Ces populations ne sont pas propriétaires du sol. La terre de la Grande-Bretagne [104] appartient à trente-cinq ou trente-six mille propriétaires, descendant pour la plupart des anciens conquérants.
le socialiste.
Oui, le sol de l’Angleterre appartient à l’aristocratie, et le peuple anglais paye chaque année deux ou trois milliards à cette caste orgueilleuse et fainéante pour avoir le droit de cultiver le sol.
l’économiste.
C’est bien un peu cher. Aussi les Anglais ont-ils commencé à rogner la portion de leurs landlords, en supprimant les lois-céréales. Cependant, vous allez voir que, même à ce prix abusivement surélevé, les Anglais ont trouvé un réel avantage à conserver leur aristocratie, tandis que nous commettions la faute de supprimer hâtivement la nôtre.
le socialiste.
Oh! oh!
l’économiste.
Laissez-moi achever. De quelle manière les Anglais sont-ils parvenus à tirer de leur sol beaucoup plus et de meilleures subsistances que nous n’en tirons du nôtre? C’est en perfectionnant leur agriculture. C’est en faisant subir à leurs exploitations agricoles une série de transformations progressives.
le conservateur.
Quelles transformations?
l’économiste.
Les propriétaires de la Grande-Bretagne ont successivement substitué à leurs petites fermes, alimentées par des capitaux insuflisants, de grandes fermes alimentées [105] par des capitaux considérables. C’est grâce à cette substitution économique de la manufacture agricole au petit atelier que le progrès s’est accompli. Je trouve dans l’enquête reproduite par MM. Mounier et Rubichon, les renseignements suivants sur la répartition de la population dans la Grande-Bretagne:
| Familles occupées à l’agriculture, | 961,134 |
| Familles employées par l’industrie, le commerce, etc., | 2,453,041 |
Ces 961,134 familles employées a l’agriculture fournissent 1,055,982 travailleurs effectifs qui cultivent 13,849,320 hectares de terres et font naître un produit de 4,000,500,000 francs.
En France, l’agriculture ne donnait en 1840 qu’un produit total de 3,523,861,000 francs, et cependant elle était exercée par une population de dix-huit millions d’individus donnant cinq à six millions de travailleurs effectifs. Ce qui signifie que le travail d’un ouvrier agricole français est quatre à cinq fois moins productif que le travail d’un ouvrier agricole de l’Angleterre. Vous devez comprendre maintenant pourquoi nos populations sont plus mal nourries que celles de la Grande-Bretagne.
le socialiste.
Vous ne tenez aucun compte du tribut énorme que les agriculteurs anglais payent à l’aristocratie.
l’économiste.
Si, comme l’attestent les statistiques, les populations agricoles de l’Angleterre sont mieux nourries que les nôtres. nonobstant le tribut quelles payent à l’aristocratie, n’est-ce pas une preuve incontestable qu’en preduisant davantage elles reçouvent aussi davantage?
le conservateur.
C’est évident.
l’économiste.
Et s’il est vrai que c’est au maintien de l’aristocratie, que l’agriculture britannique doit ses immenses et rapides progrès; s’il est vrai que le maintien de l’aristocratie est cause qu’un ouvrier agricole produit et reçoit plus en Angleterre qu’en France, l’Angleterre n’a-t-elle pas eu raison de maintenir son aristocratic?
le conservateur.
Mais, au moins, le paysan français est propriétaire du sol.
l’économiste.
Est-il préférable de gagner dix sur sa propre terre, ou de gagner vingt sur celle d’un propriétaire étranger?
le conservateur.
Il est préférable de gagner vingt, n’importe où.
le socialiste.
Fort bien! mais y a-t-il véritablement un rapport essentiel entre ces deux choses, maintien de l’aristocratie et progrès de l’agriculture britannique? N’est-il pas vraisemblable que l’agriculture britannique aurait réalisé de plus grands progrès encore, si l’Angleterre s’était débarrassée de son aristocratie, comme nous nous sommes débarrassés de la nôtre? L’agriculture française n’a-t-elle pas progressé depuis 89?
l’économiste.
Je ne le pense pas. MM. Mounier et Rubichon affirment résolument qu’au lieu de progresser, elle a rétrogradé. Un champ qui rendait 10 avant 1789, disent-ils, ne rend plus que 4 aujourd’hui; peut-être exagèrent-ils le [107] mal. Mais voici un fait incontestable: si la quantité des subsistances produites à l’aide d’une même quantité de travail n’a pas diminué, la qualité de la masse générale des subsistances a baissé. La consommation de la viande a notoirement diminué. A Paris même, dans ce foyer où convergent les forces productives de la France, on mange moins de viande qu’en 1789. Selon Lavoisier, la moyenne de la consommation de Paris (volailles et gibier compris) était alors de 81,50 kil. par tête; en 1838, elle n’était plus que de 62,30 kil. La baisse n’a pas été moins sensible dans le reste du pays. D’après d’anciens documents cités par la statistique impériale, la consommation moyenne de chaque habitant de la France (non compris la charcuterie) était, en 1789, de 13,13 kil.; en 1830 elle n’était plus que de 12,36 kil., et en 1840 de 11,29 kil. La consommation d’une viande inférieure, la chair de porc, a, au contraire, augmenté. On en consomme actuellement 8,65 kil. par tête.
En définitive, la consommation de la viande en France ne va qu’à 20 kil. par tête.
| Aux États-Unis, la moyenne est de | 122 | kil. |
| En Angleterre, | 68 | — |
| En Allemagne, | 55 | — |
De plus, il est probable que notre consommation ira sans cesse diminuant, si notre régime agricole demeure le même, car le prix de la viande hausse progressivement.
En divisant la France en neuf régions, le prix de la viande a haussé de 1824 à 1840:
| Dans la première région, | le nord-ouest | de | 11 | p. % |
| Dans la deuxième, | nord | de | 22 | — |
| Dans la troislème région, | le nord-est | de | 28 | p. % |
| Dans la quatrième, | ouest | de | 17 | — |
| Dans la cinquième, | centre | de | 19 | — |
| Dans la sixième, | est | de | 21 | — |
| Dans la septième, | sud-ouest | de | 23 | — |
| Dans la huitième, | sud | de | 30 | — |
| Dans la nèuvieme, | sud-est | de | 38 | —1 |
Or, vous savez que l’élévation du chiffre de la consommation de la viande est le plus sûr indice de la prospérité d’un peuple.
le socialiste.
J’en tombe d’accord avec vous, mais encore une fois montrez-nous bien clairement la relation qui existe, selon vous, entre la décadence de notre agriculture et notre loi d’égalité des partages. Comment ceci a-t-il amené cela?
l’économiste.
J’ai oublié encore une circonstance c’est que notre sol est naturellement plus fertile que le sol britannique.... Je réponds à votre question. L’Angleterre doit la stabilité de ses exploitations agricoles au maintien de son aristocratie et aux lois qui assurent chez elle, partiellement du moins, la liberté de l’héritage.
le conservateur.
La liberté de l’héritage, dites-vous. Et les substitutions, et le droit d’aînesse?...
l’économiste.
Sont parfaitement libres en ce sens qu’aucune loi n’oblige le père de famille à les établir. C’est la coutume qui [109] en décide, et cette coutume est fondée sur des nécessités économiques.
Voici en quoi consistent les substitutions:
A l’époque du mariage de son fils aîné, le plus souvent, ou à toute autre époque qu’il lui convient de choisir, le propriétaire d’un domaine lègue sa propriété à l’aîné de ses petits-fils, ou, à défaut d’enfants mâles, à l’aînée de ses petites-filles Si, au moment de la substitution, le propriétaire a un fils et un petit-fils vivants, il peut la faire remonter à un degré plus haut et désigner son arrière petit-fils, ou son arrière petite-fille. Mais son droit reconnu n’atteint que la première génération à naître. En Écosse, ce droit est sans limites. Un propriétaire peut substituer son bien à perpétuité.
L’acte de substitution accompli, le propriétaire et ses héritiers vivants perdent la libre disposition de la terre, ils n’en sont plus que les usufruitiers. Ils ne peuvent ni la grever d’hypothèques ni la vendre en tout ou en partie. Un bien substitué ne peut être ni saisi ni confisqué. On le considère comme un legs sacré qu’il n’est permis à personne de détourner de sa destination.
A l’âge de vingt-un ans, l’héritier en faveur duquel la substitution a été opérée peut la rompre; mais il ne la rompt communément que pour la renouveler, en y introduisant certaines clauses nécessitées par la situation présente de la famille. Les propriétés passent, de la sorte, indivises, intactes, de génération en génération.
Voici maintenant à quoi servent les substitutions.
Elles donnent aux exploitations agricoles ce qui manque aux nôtres, la stabilité. En France tout est viager, en Angleterre tout est perpétuel. Nos exploitations agricoles [110] sont exposées incessamment à être morcelées par un partage; les exploitations britanniques n’ont à courir aucun risque de cette nature.
le conservateur.
Ce risque a-t-il bien toute l’importance que vous lui attribuez? Il importe assez peu que la terre soit plus ou moins morcelée, si elle est bien cultivée.
l’économiste.
Consultez les agriculteurs, et tous vous diront que les cultures doivent avoir une certaine étendue pour être exploitées avec un maximum d’économie. Cela se conçoit. On ne peut employer les méthodes et les instruments perfectionnés que dans une vaste exploitation En Angleterre, les fermes ordinaires ont trois cent cinquante ou quatre cents hectares. Ces fermes sont munies d’un capital considérable. En France, le nombre de ces grandes exploitations est excessivement restreint.
le conservateur.
Pourquoi?
l’économiste.
Celui qui fonde une exploitation agricole ignore si elle ne sera point morcelée, détruite à sa mort. Il ne peut rien faire pour la préserver du morcellement. La loi n’a-t-elle pas limité son droit de tester? Il est donc peu excité à appliquer de grands capitaux à l’agriculture. Le fermier l’est-il davantage? En France, les baux sont de très courte durée: c’est merveille de voir un bail de vingt-un ans. Je n’ai pas besoin de vous expliquer la raison de cette courte durée des baux; vous la devinez! Quand la possession même est à courte échéance, il n’est pas possible de stipuler un long bail. Mais lorsqu’un fermier [111] n’occupe une terre que pour trois, six ou neuf ans, il y applique le moins de capital possible; il économise les engrais, il n’élève pas de clôtures, il ne renouvelle pas son matériel; d’un autre côté, il épuise la terre autant que faire se peut.
En Angleterre, la stabilité que le régime des substitutions a donnée aux exploitations agricoles, a engendré la stabilité des fermages, les baux à long terme. Aussi les fermiers, bien assurés de recueillir eux-mêmes les fruits qu’ils ont semés, appliquent-ils généralement leurs économies à féconder le sol.
le socialiste.
Cependant le fermier est soumis, en Angleterre comme en France, à la tyrannie des propriétaires.
l’économiste.
Oui, mais cette tyrannie est fort douce. Il y a, en Angleterre, des fermiers qui tiennent la même ferme, de père en fils, depuis un temps immémorial. La plupart n’ont point de bail, tant est profonde la confiance que leur inspirent les propriétaires du sol. Rarement cette confiance est trompée, rarement un propriétaire se décide à expulser un fermier que des liens séculaires attachent à sa famille. Il y a toutefois, en Angleterre comme ailleurs, différents modes de tenure. Dans le nord, le système des baux pour la vie de trois personnes est généralement usité; le fermier se désigne lui-même, ainsi que deux de ses enfants, et le bail court jusqu’à la mort du dernier des trois. La durée moyenne de ces baux est estimée à cinquante-quatre ans. Lorsqu’un des enfants désignés vient à mourir, le fermier obtient ordinairement l’autorisation de substituer un autre nom [112] à celui du défunt, et de prolonger ainsi la durée du bail.
Quand le bail est à terme fixe, la durée en est communément déterminée par celle des assolements. Pour les assolements de six et neuf elle est de dix-neuf ans, mais il est rare que le bail ne soit point renouvelé.
Les fluctuations considérables auxquelles le prix du blé se trouve exposé depuis quelque temps ont donné naissance à une nouvelle espèce de baux; je veux parler des baux mobiles, variant d’année en année selon le cours des céréales. Une ferme se louera, par exemple, pour la valeur de mille quarters de blé; si, en 1845, le prix du blé est de 56 shell. le quarter, le fermier payera 2,800 liv. sterl. de fermage; si, en 1846, le prix monte à 60 schell., il payera 3,000 liv. sterl. On choisit pour ces évaluations le prix moyen du blé dans le comté.
On conçoit que les fermiers hasardent sans crainte leurs capitaux dans des entreprises si solidement assises. On conçoit aussi que les capitalistes leur en prêtent volontiers. Les gros fermiers trouvent généralement à emprunter à quatre pour cent, et même à trois. On ne court, en effet, presque aucun risque à placer ses capitaux sur la terre. Les exploitations ne sont pas exposées à perdre de leur valeur par le morcellement ou la vente pour sortir de l’indivision. Fermiers et propriétaires étant établis, pour ainsi dire, à perpétuité, offrent un maximum de garanties aux prêteurs. De là la modicité du taux de l’intérêt agricole; de là aussi le nombre considérable de banques qui se sont établies pour servir d’intermédiaires entre les capitalistes et les entrepreneurs d’industrie agricole, propriétaires ou fermiers.
[113]Le peuple anglais, qu’on vous représente sans cesse comme privé de la propriété de la terre de la Grande-Bretagne, possède, en réalité, beaucoup plus de valeurs territoriales que le peuple français lui-même. S’il n’emploie pas ses capitaux à acheter des fonds de terre, il les place sur ces fonds mêmes, dont il augmente ainsi les forces productives.
En France, au contraire, on achète de la terre, mais on ne place guère ses capitaux sur la terre. Il n’en saurait être autrement. On ne prête pas volontiers à un petit fermier, dont l’existence n’est à demi assurée que pour quelques années; on hésite même à prêter au petit propriétaire dont la faible parcelle de terrain peut, du jour au lendemain, être morcelée de nouveau entre plusieurs héritiers. Ajoutez à cela les formalités coûteuses, les lenteurs et l’insécurité du prêt hypothécaire, et vous aurez l’explication de l’élévation du taux de l’intérêt agricole.
le conservateur.
Oui, l’usure ronge nos campagnes.
l’économiste.
L’usure soit! Mais examinez de quoi se composent les dix ou quinze pour cent que nos agriculteurs payent aux usuriers, pesez les risques de perte et les menus frais, et vous vous convaincrez que cette usure n’a rien d’illégitime, vous vous convainerez qu’eu égard à l’étendue et à l’intensité des risques agricoles, l’intérêt des prèts faits à l’agriculture ne dépasse aucunement l’intérêt des prêls ordinaires. Or, comme les banques agricoles dont on s’est engoué ne détruiront pas ces risques, elles ne contribueront que faiblement à abaisser le taux de l’intérêt agricole.
le conservateur.
Qu’y a-t-il donc à faire pour restituer à nos exploitations territoriales la sécurité qu’elles ont perdue? Faut-il rétablir les substitutions?
l’économiste.
A Dieu ne plaise! il faut, avant tout, restituer aux propriétaires le droit de disposer librement de leurs propriétés. On ralentira ainsi le morcellement, et l’on donnera aux exploitations un peu de cette stabilité précieuse qui leur manque aujourd’hui. Les capitaux viendront alors plus aisément à l’agriculture, et ils se feront payer moins cher. Si en même temps on débarrasse le sol des lourds impôts qui le grèvent, si l’on améliore notre régime hypothécaire, si l’on affranchit les associations industrielles et agricoles des entraves auxquelles la législation impériale les a soumises, on verra s’opérer bientôt une véritable révolution dans notre agriculture. Des compagnies nombreuses se formeront pour l’exploitation du sol, comme il s’en est formé pour l’exploitation des chemins de fer, des mines, etc. Or, ces associations ayant intérêt à s’établir à long terme, les exploitations territoriales acquerront une stabilité presque immuable. Divisée en actions, la propriété de la terre s’échangera, se partagera sans que des cultures en reçoivent la moindre atteinte. L’agriculture se constituera de la manière la plus économique possible.
le socialiste.
Oui, l’Association appliquée à l’agriculture mettra fin à nos maux.
l’économiste.
Nous n’entendons peut-être pas l’association de la même [115] manière. Quoi qu’il en soit, je pense que l’avenir de notre agriculture et de notre industrie appartient à la société anonyme perpétuelle. En dehors de cette forme d’exploitation, à la fois élastique et stable, je ne vois aucun moyen de proportionner toujours l’effort du travail à la résistance de la nature. Mais, en attendant qu’elle puisse s’établir, on s’est trop pressé d’en finir avec les institutions anciennes. En détruisant hâtivement les substitutions, en entravant ensuite l’établissement des associations agricoles, on a livré l’agriculture à toutes les misères du morcellement. Exécutée dans des ateliers de plus en plus bornés, la production a rétrogradé au lieu d’avancer. Le travail de l’ouvrier agricole est devenu de moins en moins productif. Tandis que l’ouvrier anglais, aidé des machines perfectionnées de la grande industrie agricole, produit cinq, l’ouvrier français ne produit qu’un ou un et demi, et la plus grande partie de ce faible resultat va aux capitalistes qui aventurent leurs capitaux dans nos pauvres ateliers agricoles.
Voilà l’explication de la misère qui ronge les campagnes de la France. Voilà comment il se fait que nous soyons menacés d’une nouvelle Jacquerie. Cette Jacquerie, ne l’imputez pas au socialisme, imputez-la aux tristes législateurs, qui, en décrétant d’une main l’égalité des partages, entravaient de l’autre la formation des sociétés industrielles, et accablaient d’impôts les exploitations agricoles. Ceux-là sont les vrais coupables!
Peut-être réussirons-nous à éviter les catastrophes que de si lamentables fautes ont préparées, mais il faut se hâter. De jour en jour le mal s’aggrave; de jour en jour, la situation de la France se rapproche davantage de celle [116] de l’Irlande. Or, nos paysans n’ont pas la longanimité des paysans irlandais.....
le conservateur.
Ah! nous vivons dans de bien tristes temps. Les campagnes sont pourries.
l’économiste.
A qui la faute, si ce n’est aux législateurs qui ont porté atteinte à la stabilité de la propriété et à la sainteté de la famille? Les prédicateurs socialistes auront beau attaquer ces deux institutions sacrées, ils ne leur feront jamais un mal comparable à celui que vous leur avez fait vousmêmes en inscrivant dans vos Codes le droit à l’héritage.
CINQUIÈME SOIRÉE↩
SOMMAIRE: Droit de prêter.—Législation qui régit le prêt à intérêt.—Définition du capital.—Mobiles qui poussent l’homme à former des capitaux.—Du crédit.—De l’intérêt.—Éléments qui le composent.—Travail.—Privation.—Risques.—Comment ces éléments peuvent être réduits.—Qu’ils ne peuvent l’être par des lois.—Résultats désastreux de la législation limitative du taux de l’intérêt.
le conservateur.
Chien d’usurier! prêter à un écervelé qui dissipe d’avance son héritage avec des demoiselles de l’Opéra, et à quel taux, juste ciel?
l’économiste.
A qui donc en avez-vous?
le conservateur.
A un usurier maudit, qui s’est avisé de prêter une grosse somme à l’un de mes fils.
l’économiste.
A quel taux?
le conservateur.
A deux pour cent par mois, vingt-quatre pour cent par an, ni plus ni moins!
l’économiste.
Ce n’est pas trop cher. Songez que vous êtes encore [118] dans la fleur de l’âge, robuste et bien portant. Songez ensuite que la loi interdit formellement l’usure. L’intérêt légal est de cinq pour cent en matière civile, et de six pour cent en matière commerciale.
le conservateur.
Eh! c’est précisément parce que l’intérêt légal est de cinq et six pour cent, qu’on ne devrait pas prêter à vingtquatre.
l’économiste.
On prête cependant. Et s’il faut tout vous dire, je tiens pour sûr que la loi est pour quelque chose dans ces vingtquatre pour cent.
le conservateur.
Comment? Mais la loi ne m’autorise-t-elle pas à poursuivre cet infâme usurier.....
le socialiste.
Ce vampire du capital.....
l’économiste.
Qui prête au dessus du taux légal. Eh! c’est à cause de cela même. Voici ce qui va arriver: Vous allez poursuivre l’usurier chez qui votre fils s’est permis d’escompter son droit à l’héritage. Il sera obligé de se défendre. Le procès sera jugé, et il le gagnera faute de preuves suffisantes. Mais ce procès ne lui aura pas moins coûté quelque argent. De plus, sa réputation aura reçu un nouvel accroc. Tous risques auxquels il ne serait point exposé, si la législation qui limite le taux de l’intérêt n’existait point. Or il faut bien qu’un prêteur couvre ses risques.
le conservateur.
Oui, mais vingt quatre pour cent?
l’économiste.
Si l’on considère combien les capitaux sont rares aujourd’hui, combien les placements sont chanceux, surtout quand l’emprunteur est un habitué de Breda-Street, combien encore le régime réglementaire a exagéré le prix des procès, on trouvera, en fin de compte, que vingtquatre pour cent, ce n’est pas trop cher.
le conservateur.
Vous plaisantez. S’il en était ainsi, pourquoi le législateur aurait-il limité à cinq et six pour cent le taux légal de l’intérêt?
l’économiste.
Parce que ce législateur-là était un pauvre économiste.
le conservateur.
Vous voulez donc que l’usure soit désormais permise.
le socialiste.
Vous voulez que le travail soit livré sans merci à la tyrannie du capital.
l’économiste.
Je veux, au contraire, que le taux de l’intérêt soit toujours le plus bas possible; et voilà pourquoi je supplie le législateur de ne plus s’en occuper.
le conservateur.
Mais si l’on ne met aucun frein à la cupidité des usuriers, où donc s’arrêtera l’exploitation des pères de famille?
le socialiste.
Mais si la loi ne borne point la puissance des capitalistes, où s’arrêtera l’exploitation des travailleurs?
l’économiste.
Ouf!
le conservateur.
Justifiez donc cette doctrine anarchique et immorale du laisser-faire.
le socialiste.
Oui, justifiez cette doctrine bancocratique et malthusienne du laisser-faire.
l’économiste.
Que cet accord me charme..... Dites-moi donc, ô digne et excellent conservateur, n’avez-vous pas applaudi à la fameuse proposition de M. Proudhon, relative à la suppression graduelle de l’intérêt?
le conservateur.
Moi!!! Mais je l’ai flétrie de toute mon indignation.
l’économiste.
Vous avez eu tort. Vous vous êtes montré souverainement illogique en la flétrissant. Que voulait M. Proudhon? Il voulait faire descendre, par l’action du gouvernement, l’intérêt à zéro.
le conservateur.
L’abominable utopiste!
l’économiste.
Cet utopiste se contentait pourtant de suivre les traces de vos législateurs. Seulement, au lieu de s’en tenir à votre limite légale de cinq à six pour cent, il demandait que la limite fût abaissée à zéro.
le conservateur.
N’y a-t-il donc aucune différence entre ces deux limites? Certes, on peut bien dire aux gens: Vous ne prêterez pas au dessus de cinq ou six pour cent. C’est un taux [121] raisonnable, honnête! Mais les obliger à prêter pour rien, n’est-ce pas les spolier, les..... Ah! les brigands de socialistes!
l’économiste.
J’en suis bien fâché; mais c’est vous qui les avez engendrés, ces brigands-là. Le socialisme n’est autre chose qu’une exagération radicale, mais parfaitement logique de vos lois et règlements. Vous avez décidé, dans l’intérêt de la société, que la loi disposerait de l’héritage du père de famille; le socialisme décide, dans l’intérêt de la société, que la loi attribuera à la communauté, l’héritage du père de famille. Vous avez décidé que diverses industries seraient exercées ou salariées par l’État, le socialisme décide que toutes les industries seront exercées ou salariées par l’Etat. Vous avez décidé que l’intérêt serait limité à cinq et à six pour cent, le socialisme décide que l’intérêt sera réduit à zéro.
Si vous aviez le droit de limiter le taux de l’intérêt, c’est-à-dire de supprimer partiellement l’intérêt, le socialisme a bien le droit, ce me semble, de le supprimer totalement.
le socialiste.
C’est incontestable. Nous avons pour nous le droit, de l’aveu même de nos adversaires, et nous en usons jusqu’au bout. En quoi donc sommes-nous blâmables?
Que les conservateurs gardent des ménagements à l’égard du capital, cela se conçoit. Ils en vivent. Cependant ils ont senti eux-mêmes la nécessité de mettre des limites à l’exploitation capitaliste; et ils se sont protégés contre les plus habiles ou les plus avides de leur bande. Les capitalistes ont proscrit le prêt à gros intérêt en le [122] flétrissant du nom d’usure. Mais, à notre tour, nous sommes venus, et reconnaissant l’insuffisance de cette loi, nous avons entrepris de couper le mal à sa racine et nous avons dit: Que le taux légal de l’intérêt soit désormais abaissé de cinq et six pour cent à zéro. Vous réclamez! Mais si les capitalistes ont pu légitimement demander la suppression de la grosse usure, pourquoi commettrions-nous un crime en demandant la suppression de la petite? En quoi l’une est-elle plus légitime que l’autre?
l’économiste.
Vos prétentions sont parfaitement logiques. Seulement, vous ne réussiriez pas plus à réduire le taux de l’intérêt à zéro que les législateurs du régime impérial n’ont réussi à l’abaisser à un maximum de cinq et six pour cent. Vous n’aboutiriez comme eux qu’à le faire hausser davantage.
le socialiste.
Qu’en savez-vous?
l’économiste.
Je pourrais invoquer l’histoire de toutes les lois de maximum, et vous prouver, pièces en main, que chaque fois qu’on a voulu limiter le prix des choses, travail, capitaux ou produits, on l’a invariablement fait hausser. Mais j’aime vous faire voir le pourquoi de cette hausse. J’aime mieux vous expliquer comment il se fait que l’intérêt soit naturellement, tantôt à dix, quinze, vingt et trente pour cent, tantôt à cinq, quatre, trois, deux pour cent et même au-dessous; comment il se fait encore qu’aucune loi ad hoc ne puisse le faire baisser.
Savez-vous de quoi se compose le prix des choses?
le socialiste.
Vous autres économistes, vous dites communément [123] que le prix des choses se compose de leurs frais de production.
le conservateur.
Et de quoi se composent les frais de production?
le socialiste.
Selon les économistes encore, les frais de production se composent de la quantité de travail qu’il faut dépenser pour produire une marchandise et la mettre au marché.
le conservateur.
Oui, mais le prix auquel les choses se vendent représente-t-il toujours exactement la quantité de travail qu’elles ont coûté, ou leurs frais de production?
le socialiste.
Non! pas toujours. Les frais de production constituent ce qu’Adam Smith a nommé, assez judicieusement à mon avis, le prix naturel des choses. Or, le même Adam Smith constate que le prix auquel les choses se vendent, le prix courant ne coïncide pas toujours avec le prix naturel.
l’économiste.
Oui, mais Adam Smith constate aussi que le prix naturel est comme le point central autour duquel le prix courant gravite sans cesse, et auquel il est irrésistiblement ramené.
le conservateur.
D’où cela vient-il?
l’économiste.
Quand le prix d’une marchandise dépasse ses frais de production, ceux qui la produisent ou qui la vendent réalisent un bénéfice exceptionnel. L’appât de ce bénéfice [124] extraordinaire attire la concurrence, et à mesure que la concurrence augmente, le prix s’abaisse.
le conservateur.
A quelle limite s’arrête-t-il?
l’économiste.
A la limite des frais de production. Quelquefois aussi il tombe au dessous. Mais dans ce dernier cas, la production cessant de donner un bénéfice suffisant se ralentit d’elle-même, le marché se dégarnit et les prix remontent. Grâce à cette gravitation économique, les prix tendent toujours, irrésistiblement, à prendre leur niveau naturel; c’est-à-dire à représenter exactement la quantité de travail que la marchandise a coûté. J’aurai occasion de revenir encore sur cette loi, qui est véritablement la clef de voûte de l’édifice économique.
Je reprends. L’intérêt se compose de frais de production. Autour de ces frais de production gravite incessamment le prix courant de l’intérêt.
le socialiste.
Et de quoi, je vous prie, se composent les frais de production de l’intérêt?
l’économiste.
Ils se composent de travail et de risques de pertes ou de dommages, dont il faut déduire...
le conservateur.
Quoi donc?
l’économiste.
Du travail et des risques de pertes ou de dommages.
le conservateur.
Voilà qui n’est pas clair.
l’économiste.
Cela s’éclaircira tout à l’heure. Et d’abord que prêtet-on?
le conservateur.
Eh! mais on prête des choses qui ont une valeur.
l’économiste.
Avoir une valeur, c’est, vous le savez, être propre à satisfaire l’un ou l’autre des besoins de l’homme. Cette propriété, comment les choses l’acquièrent-elles? Tantôt elles la possèdent naturellement, tantôt on la leur donne par le travail.
La valeur que la nature donne aux choses est gratuite. La nature travaille pour rien. L’homme seul fait payer son travail, ou pour mieux dire il échange son travail contre le travail d’autrui. Les choses s’échangent en raison de leurs frais de production, c’est-à-dire en raison des quantités de travail qu’elles contiennent. Ces quantités de travail sont le fondement de leur valeur échangeable. Plus on a de choses contenant du travail et plus on est riche: mieux, en effet, on peut satisfaire à ses besoins, soit en consommant ces choses, soit en les échangeant contre d’autres choses consommables. Si l’on ne veut pas les consommer immédiatement on peut encore les garder ou les prêter.
Ces choses qui contiennent du travail utile s’appellent des capitaux.
Les capitaux s’accumulent par l’épargne.
Deux mobiles excitent l’homme à épargner.
Le premier dérive de la nature même de l’homme. La période du travail ne s’étend guère au delà des deux tiers de la vie humaine. Dans son enfance et dans sa vieillesse [126] l’homme consomme sans produire. Il est donc obligé de mettre en réserve une partie de son travail de chaque jour afin d’élever sa famille et de pourvoir à sa propre subsistance dans sa vieillesse. Tel est le premier mobile qui pousse l’homme à ne pas consommer immédiatement tout le fruit de son travail, à accumuler des capitaux.
Il y en a un autre encore.
A la rigueur, l’homme peut produire sans capitaux...
le conservateur.
Où cela s’est-il vu?
l’économiste.
Croyez-vous que les premiers hommes soient nés avec un arc et des flèches, une hache et un rabot à leurs côtés? A la rigueur, on peut donc produire sans capitaux, mais on ne peut pas produire grand’chose. Pour créer beaucoup de choses utiles moyennant peu d’efforts, il faut des instruments nombreux et perfectionnés; certaines choses exigent, en outre, beaucoup de temps pour être produites. Or, le producteur ne peut vivre pendant ce temps, s’il ne possède une avance suffisante de subsistances, s’il n’a devers lui un certain capital. On est donc intéressé à épargner du travail, à accumuler des capitaux, afin de pouvoir augmenter sa production tout en diminuant ses efforts, afin de rendre son travail plus fructueux.
le conservateur.
C’est cela.
l’économiste.
Mais ce deuxième mobile qui porte à accumuler des capitaux est bien moins général que le premier. Il n’agit [127] que sur les entrepreneurs d’industrie et sur ceux qui aspirent à le devenir?
le conservateur.
C’est-à-dire sur tout le monde.
l’économiste.
Non! il y a beaucoup d’ouvriers de manufactures qui ne songent pas à devenir manufacturiers, beaucoup d’ouvriers laboureurs qui n’ont pas l’ambition de diriger une ferme, beaucoup de commis-banquiers qui n’aspirent pas à fonder une banque. Et à mesure que l’industrie se développera sur une échelle plus vaste, il y en aura de moins en moins.
Dans l’état actuel des choses, les entrepreneurs de production sont déjà en minorité. Si ces entrepreneurs étaient réduits à leurs seules épargnes de travail, aux capitaux qu’ils peuvent accumuler eux-mêmes, cela serait tout à fait insuffisant.
le conservateur.
Sans aucun doute. Si chaque entrepreneur de production, manufacturier, agriculteur ou négociant se trouvait réduit à ses seules ressources; s’il n’avait à sa disposition que ses propres capitaux, la production se trouverait incessamment entravée faute d’avances suffisantes.
le socialiste.
Tandis qu’il y aurait entre les mains des non-entrepreneurs une quantité considérable de capitaux inactifs.
l’économiste.
On a surmonté cette difficulté au moyen du crédit.
le socialiste.
Dites qu’on aurait dû la surmonter. Malheureusement, la société n’a pas su encore organiser le crédit.
l’économiste.
Le crédit s’est organisé de lui-même, dès le commencement du monde. Le jour ou, pour la première fois, un homme a prêté à un autre homme un produit de son travail, le crédit a été inventé. Depuis ce jour, il n’a cessé de se développer. Des intermédiaires se sont placés entre les capitalistes et les entrepreneurs. Ces marchands de capitaux, banquiers ou agents d’affaires se sont multipliés à l’infini. On a établi des hourses, où l’on vend des capitaux en gros et en détail.
le socialiste.
Ah! les bourses... ces vils repaires, où les proxénètes du capital viennent négocier leurs marchés impurs. Quand donc fermera-t-on ces temples de l’usure?
l’économiste.
Fermez donc, en même temps, le marché des lnnocents, car on y vole aussi... Le prêt des capitaux s’est donc organisé sur une échelle immense, et il est destiné à se développer bien plus encore lorsqu’il aura cessé d’être directement et indirectement entravé.
On accumule des capitaux sous toutes les formes. Mais sous quelle forme les accumule-t-on le plus volontiers? Sous la forme d’objets durables, peu encombrants et facilement échangeables. Certains objets réunissent ces qualités à un plus haut degré que tous les autres, je veux parler des métaux précieux. Le loyer des métaux précieux est devenu, en conséquence, le régulateur de tous les loyers. Lorsqu’on prête son capital sous une forme moins durable et plus aisément dépréciable, on fait payer à l’emprunteur cette différence de durabilité et de dépréciabilité. On loue un mobilier ou une maison [129] plus cher qu’une somme d’argent de même valeur.
Lorsqu’on prête un capital sous forme de métaux précieux, le prix du prêt prend le nom d’intérêt, lorsque le prêt s’effectue sous une autre forme, lorsqu’on prête des terres, des maisons, des meubles, etc., le prix se nomme loyer.
L’intérêt, c’est donc la somme que l’on paye pour avoir l’usage d’une certaine quantité de travail accumulé sous la forme la plus durable, la moins encombrante et la plus aisément échangeable.
Tantôt cet usage se paye plus ou moins cher, tantôt il est gratuit, tantôt aussi les capitalistes payent une prime à ceux à qui ils confient leurs capitaux.
le conservateur.
Plaisantez-vous? Où a-t-on vu des prêteurs payer un intérêt à leurs emprunteurs? Ce serait le monde renversé!
l’économiste.
Savez-vous à quelles conditions les premières banques de dépôt qui furent établies à Amsterdam, à Hambourg et à Gênes recevaient des capitaux? A Amsterdam, les capitalistes payaient d’abord une prime de 10 florins quand on leur ouvrait un compte; ils payaient ensuite un droit de garde annuel de un pour cent. En outre, les monnaies subissant en ce temps-là des dépréciations considérables, la banque prélevait un agio plus ou moins élevé sur la somme déposée. A Amsterdam, l’agio était communément de cinq pour cent. Eh! bien, malgré la dureté de ces conditions, les capitalistes aimaient mieux confier leurs capitaux a la banque que de les garder ou de les prêter directement aux gens qui en avaient besoin.
le socialiste.
L’intérêt était alors en moins.
l’économiste.
Vous l’avez dit. Or comme, en tout temps, l’homme qui a accumulé un capital est obligé de se livrer à une certaine surveillance et de courir certains risques en le conservant lui-même; comme il peut arriver qu’il se donne moins de peine et courre moins de risques en le prêtant, l’intérêt peut donc, en tout temps, tomber à zéro ou même au dessous de zéro.
Mais vous concevez aussi que si cette partie négative des frais de production de l’intérêt venait à s’élever très haut; si la conservation des capitaux était soumise à de très gros risques, par le manque de sécurité ou l’exagération de l’impôt; si le prêt n’offrait de même qu’une sécurité insuffisante, l’accumulation s’arrêterait. On cesserait d’épargner des capitaux, si l’on cessait d’avoir la certitude de les consommer soi-même, du moins en grande partie. L’homme se mettrait à vivre au jour le jour sans souci de sa vieillesse ou de l’avenir de sa famille, sans se préoccuper non plus de perfectionner ou de développer son industrie. La civilisation rétrograderait rapidement sous un tel régime.
Plus la partie négative de l’intérêt est faible, et plus est énergique le stimulant qui pousse l’homme à épargner.
Examinons maintenant la partie positive de l’intérêt.
Celle-ci représente du travail, des dommages et des risques.
Si vous prenez une certaine peine, si vous subissez certains dommages, et si vous courez certains risques en [131] gardant vos capitaux, vous êtes communément obligé de prendre plus de peine encore, de supporter plus de dommages, et de courir plus de risques en les prêtant.
Dans quelles circonstances, vous, capitaliste, êtes-vous disposé à prêter un capital?
C’est lorsque vous n’en avez pas vous-même l’emploi actuellement. Vous le prêtez volontiers jusqu’à l’époque où vous en aurez besoin. Deux emprunteurs, deux hommes qui ont actuellement besoin d’un capital, se présentent à vous: avec lequel des deux ferez-vous affaire? Vous choisirez, n’est-il pas vrai, celui qui vous présentera les meilleures garanties matérielles et morales, le plus riche et le plus probe, c’est-à-dire celui qui vous remboursera le plus sûrement. A moins toutefois que son concurrent ne vous offre une somme plus forte, auquel cas vous apprécierez la différence des risques et celle des offres, et vous prononcerez. Si vous vous décidez pour le second, c’est que le surplus de l’offre vous aura paru balancer, et un peu au delà, la différence des garanties matérielles et morales.
L’intérêt sert donc à couvrir des risques.
Vous prêtez votre capital pour une période déterminée; mais êtes-vous bien sûr de n’en avoir pas besoin dans cette période? ne vous peut-il survenir quelque accident qui vous oblige à recourir à votre épargne? n’arrive-t-il pas, aussi fréquemment, que l’on prête un capital dont on a besoin soi-même? Dans le premier cas, le dommage n’est qu’éventuel; dans le second, il est réel; mais éventuel ou réel, ne doit-il pas être compensé?
L’intérêt sert donc à compenser des dommages.
[132]Vous conservez votre capital dans un coffre, dans une grange ou ailleurs. Si vous le prêtez, vous serez obligé de prendre une certaine peine, d’exécuter un certain travail, en le déplaçant, en faisant constater le prêt, comme aussi en surveillant l’emploi du capital prêté. Ce travail doit être rémunéré.
L’intérêt sert donc à salarier un travail.
Une prime servant à couvrir un risque, une compensation servant à couvrir un dommage, un salaire servant à rémunérer un travail, tels sont les éléments positifs des frais de production de l’intérêt.
Ces trois éléments se retrouvent, à des degrés différents, dans tous les prêts à intérêt.
le socialiste.
On les supprimerait en organisant le crédit.
l’économiste.
Voyons! S’agit-il des risques? Vous aurez beau faire, vous prêtcur, que vous soyez un banquier, un intermédiaire, ou un producteur de capitaux, un épargneur, vous courrez toujours des risques en prêtant.
A moins que:
1° Vous n’ayez affaire à des gens d’une probité absolue et d’une intelligence parfaite;
2° A des gens dont l’industrie ne soit exposée, soit directement, soit indirectement, à aucune catastrophe fortuite.
Jusque-là vous courrez des risques, et on sera obligé de vous payer une prime pour les couvrir.
le socialiste.
J’en conviens; mais si l’industrie était moins chanceuse, [133] cette prime pourrait être considérablement réduite.
l’économiste.
Oui, considérablement. Étudiez donc les causes réelles qui rendent l’industrie chanceuse au lieu de fonder des banques d’échange. Étudiez encore les causes qui altèrent la moralité des populations ou dépriment leur intelligence.
le conservateur.
Voici un point de vue qui me paraît assez neuf. L’intérêt peut donc être plus bas dans un pays où il y a beaucoup de moralité et d’intelligence pratique des affaires que dans un pays où il y en a peu.
l’économiste.
Dites qu’il doit être plus bas. Ne prêtez-vous pas plus volontiers à un honnête homme qu’à un demifripon?
le conservateur.
Cela va sans dire.
l’économiste.
Eh bien! ce que vous faites, tout le monde le fait comme vous. Le taux de l’intérêt monte à mesure que la moralité baisse; il monte encore à mesure que l’intelligence se déprime ou se fausse. Retenez bien ces maximes économiques, et sachez en faire l’application à propos.
Les risques qui forment indubitablement la partie la plus considérable des frais de production de l’intérêt, peuvent baisser dans une proportion trés forte; mais je doute qu’ils puissent complétement disparaître.
le socialiste.
Si j’ai bonne mémoire, l’un des chefs de l’école saint-simonienne, M. Bazard, pensait tout le contraire.
l’économiste.
Vous faites confusion. Voici ce que M. Bazard écrivait dans sa préface de la traduction française de la Défense de l’usure de Jérémie Bentham:
“.... Il est permis de conclure que l’intérêt, en tant que représentant le loyer des instruments de travail, tend à disparaître complétement, et que des parties qui le composent aujourd’hui, la prime d’assurance est la seule qui doive rester en se réduisant elle-même, par suite des progrès de l’organisation industrielle, sur la proportion des seuls risques qui peuvent être considérés comme au-dessus de la prévoyance et de la sagesse humaines1.”
Avec M. Bazard, je doute que les risques du prêt disparaissent jamais complétement; car je ne pense pas qu’on réussisse jamais à supprimer tous les accidents, naturels ou autres, qui menacent les capitaux prètés. Les employeurs de capitaux, ceux qui les exposent à être détruits, auront donc toujours une prime d’assurance à payer pour couvrir ce risque.
le socialiste.
Cependant la mutualité.....
l’économiste.
Aucune mutualité ne saurait empêcher un risque qui existe de tomber sur quelqu’un. Vous prêtez un capital à un fermier dont les bâtiments d’exploitation peuvent [135] être détruits par un incendie, dont les récoltes peuvent être ravagées par la grêle, les charançons, et que sais-je encore? Vous courez en conséquence différents risques. Ces risques doivent être couverts, sinon vous ne prêterez pas.
le socialiste.
Mais si le fermier est assuré contre l’incendie, la grêle et les charançons?
l’économiste.
Il n’en payera pas moins une prime annuelle sur le capital que vous lui aurez prêté pour augmenter son matériel d’exploitation ou pour développer ses cultures; seulement, au lieu de vous la payer à vous, il la payera à des assureurs. Il la leur payera moins cher, car c’est leur spécialité d’assurer, et ce n’est pas la vôtre; mais il la leur payera. Les parties de l’intérêt qu’il déboursera annuellement pour avoir l’usage de votre capital seront séparées, mais elles n’en subsisteront pas moins.
le conservateur.
Et le loyer, pensez-vous avec M. Bazard qu’il puisse disparaître?
l’économiste.
Le loyer, tel que le définit M. Bazard, c’est la partie des frais de production de l’intérêt, représentant la compensation du dommage et le salaire du travail.
Peut-on se dessaisir d’un capital, sans éprouver aucun dommage par suite de son absence? Oui, si l’on est sûr de n’en avoir pas besoin jusqu’à l’époque où il sera remboursé, ou bien encore de pouvoir le récupérer ou le réaliser sans perte. Ces deux circonstances se présenteront-elles un jour d’une manière régulière, normale, permanente? [136] Arrivera-t-il que tout le capital utilisé dans la production soit remboursable ou réalisable sans perte, à la volonté des prêteurs?
le conservateur.
Chimère!
l’économiste.
Je ne serai point si affirmatif. Il faut bien remarquer que tous les capitaux employés ou même employables dans la production ne constituent pas tout le capital disponible de la société. On ne prête généralement que les capitaux dont on n’a pas besoin actuellement. Eh bien, il pourra arriver qu’on n’en prête plus d’autres. On ne subira plus alors aucun dommage effectif en prêtant. Sera-t-il possible de supprimer, de même, le dommage éventuel? Le roulement des capitaux finira-t-il par s’opérer d’une manière assez parfaite pour que les sorties des capitaux de la production soient régulièrement compensées par les entrées? Voilà ce que je ne saurais dire, mais ce qui est possible. Si la production et la circulation des capitaux n’étaient pas ralenties et troublées par mille entraves, on serait bientôt pleinement édifié à cet égard.
Reste le salaire rémunérant le travail du prêt, la peine que se donne le prêteur en prêtant. Ce travail est réel, et comme tout travail réel, il mérite salaire.
Depuis l’invention et la multiplication des banques, ce travail s’est déplacé ou divisé. Le capitaliste qui envoie son argent à une banque ne se donne qu’une très faible peine. En revanche, la banque qui prête cet argent à un entrepreneur d’industrie accomplit un véritable travail et supporte des frais assez considérables. Ce travail doit être rémunéré, ces frais doivent être couverts. Qui doit [137] les payer? Évidemment celui qui emploie le capital, à charge de les rejeter sur le consommateur de la denrée produite à l’aide de ce capital.
Peut-on supposer que ces frais disparaissent jamais? Non! s’ils peuvent se réduire, par la multiplication du nombre des intermédiaires exerçant spécialement le métier de prêteurs de capitaux, ils ne sauraient s’annuler tout à fait. Une banque doit et devra toujours payer son local, ses employés, etc. Voilà, au moins, une partie des frais de production de l’intérêt qui est indestructible.
le conservateur.
Ah! c’est fort heureux.
l’économiste.
Pourquoi donc? La société qui consomme les produits du travail n’est-elle pas intéressée à ce qu’ils se vendent au prix le plus bas possible? Or, l’intérêt du capital figure pour une part plus ou moins forte dans le prix de toutes choses. S’il n’existait pas ou s’il était plus faible, on se procurerait ces choses en échange d’une moindre quantité de travail, puisqu’elles en contiendraient moins.
L’aisance générale des populations croît à mesure que l’intérêt s’abaisse; elle serait à son maximum si l’intérêt venait à tomber naturellement à zéro.
le socialiste.
Je saisis parfaitement cette analyse des frais de production de l’intérêt; je vois que l’intérêt se compose de parties réelles qu’il faut couvrir, sans quoi.... sans quoi.....
l’économiste.
... les capitalistes ne prêteraient point leurs capitaux, ou si on les forçait à les prêter, ils cesseraient d’en former, [138] ils cesseraient d’épargner. Or comme les capitaux, sauf peut-être les métaux précieux et quelques autres denrées, sont essentiellement destructibles, les capitaux actuels de la société, champs de blé, pâturages, vignes, maisons, meubles, outils, approvisionnements disparaitraient d’ici à un petit nombre d’années, si l’on ne prenait soin de les entretenir et de les renouveler par le travail et l’épargne.
le socialiste.
Vous avez rendu ma pensée. Je vois aussi que ces différentes parties des frais de production tendent naturellement à se réduire. Mais le prix courant de l’intérêt est-il donc toujours la représentation exacte des éléments ou frais de production de l’intérêt?
l’économiste.
Il en est du capital comme de toute chose. Lorsqu’on offre plus de capitaux qu’on n’en demande, le prix courant de l’intérêt baisse. Néanmoins il ne saurait jamais tomber beaucoup au-dessous des frais de production, car on aime mieux garder un capital que de le prêter à perte. Il peut monter au-dessus, lorsque la demande des capitaux est plus active que l’offre. Mais si la disproportion devient trop forte, les capitaux attirés par la prime de plus en plus considérable qui leur est offerte, affluent bientôt au marché et l’équilibre se rétablit. Le prix courant se confond alors, de nouveau, avec le prix naturel.
Cet équilibre s’établit de lui-même, à moins que des obstacles factices ne l’empêchent de s’établir. Je vous parlerai de ces obstacles lorsque nous nous occuperons des banques. Mais c’est principalement sur les frais de production qu’il faut agir pour abaisser d’une manière [139] régulière et permanente le taux de l’intérêt. Or ces frais ne sauraient être supprimés, en tout ou en partie, au moyen d’une loi.
le conservateur.
Enfin, nous voici revenus au taux légal!
l’économiste.
On ne peut pas plus dire à un capitaliste: “Tu ne céderas point ton capital, au-dessus d’un intérêt maximum de cinq et six pour cent”, qu’on ne peut dire à un marchand: “Tu ne vendras point ton sucre au-dessus d’un prix maximum de huit sous la livre.” Si avec huit sous le marchand ne peut rembourser les frais de fabrication du sucre, et rémunérer son propre travail, il cessera de vendre du sucre. De même, si avec un intérêt maximum de cinq ou six pour cent le capitaliste ne couvre pas les risques du prêt, le dommage résultant de la privation de son capital et la peine qu’il se donne en prêtant, il cessera de prêter.
le conservateur.
On ne cesse pas cependant. Mon usurier...
l’économiste.
Ou s’il continue à prêter, ne sera-t-il pas obligé d’ajouter à l’intérêt la prime des risques supplémentaires qu’il court en violant la loi? C’est ce que n’a pas manqué de faire votre usurier. Sans la loi limitative du taux de l’intérêt, il n’aurait exigé peut-être que vingt pour cent, ou moins encore.
le conservateur.
Quoi! vous pensez que les frais de production de l’intérêt du capital prêté à mon fils s’élèvent bien à vingt pour cent?
l’économiste.
Je le pense. On court de gros risques en prêtant aux jeunes habitués de Breda-Street. Ces aimables escompteurs du droit à l’héritage n’offrent pas, avouez-le, des garanties morales bien solides?
le socialiste.
Cependant, à tout prendre, la loi prohibitive de l’usure n’a pu avoir des résultats bien funestes. On s’y dérobe si aisément.
l’économiste.
Détrompez-vous! Beaucoup d’hommes se trouvent dans une situation telle qu’ils ne peuvent emprunter, à moins de payer un gros intérêt. Or la loi ayant interdit le prêt dit usuraire, les gens qui respectent religieusement la loi existante, qu’elle soit bonne ou mauvaise, s’abstiennent de prêter à ces hommes besoigneux. Ceux-ci sont réduits à s’adresser à certains individus qui n’ont point de ces scrupules, et qui profitent de leur petit nombre et de l’intensité des besoins de leurs clients pour surélever encore le taux de l’intérêt.
La loi limitative du taux de l’intérêt établit, vous le voyez, un véritable monopole au bénéfice des prèteurs les moins scrupuleux, et au détriment des emprunteurs les plus misérables. C’est grâce à cette loi absurde, que les prêteurs interlopes ou usuriers égorgent les ouvriers et les petits marchands qui empruntent à la petite semaine, les négociants qui viennent d’éprouver un sinistre, et tant d’autres.
Comprenez-vous maintenant que l’économie politique s’élève, au nom de l’intérêt des masses, contre cette limitation [141] du droit de prêter, et qu’elle entreprenne la défense de l’usure?
le socialiste.
Oui, je le comprends. Je vois que la loi n’empêche pas l’usure; je vois, au contraire, qu’elle la rend plus âpre. Je vois que si cette loi restrictive venait à être abolie, les emprunteurs les plus besoigneux payeraient une prime de moins aux prêteurs.
l’économiste.
Ce serait un bienfait immense pour les classes les plus misérables de la société. Réclamons donc l’abolition de l’intérêt légal, ce sera le meilleur moyen d’avoir raison des usuriers et d’en finir avec l’usure.
SIXIÈME SOIRÉE↩
SOMMAIRE: Droit d’échanger.—De l’échange du travail.—Lois sur les coalitions.—Articles 414 et 415 du Code pénal.—Coalition des charpentiers parisiens en 1845.—Démonstration de la loi qui fait graviter le prix des choses vers la somme de leurs frais de production.—Son application au travail.—Que l’ouvrier peut quelquefois faire la loi au maître.—Exemple des Antilles anglaises.—Organisation naturelle de la vente du travail.
l’économiste.
L’échange est plus entravé encore que le prêt. L’echange du travail est atteint par la législation des passeports et des livrets, par les lois sur les coalitions; l’échange de propriétés immobilières est soumis à des formalités coûteuses et abusives; l’échange des produits est grevé, à l’intérieur, par divers impôts indirects, no-tamment par les droits d’octrois, à l’extérieur par les douanes. Ces différentes atteintes portées à la propriété des échangistes ont uniformément pour résultats de diminuer la Production et de troubler la Distribution équitable de la richesse.
Occupons-nous d’abord des obstacles apportés au libre échange du travail.
le socialiste.
Ne devrions-nous pas, auparavant, achever d’examiner ce qui concerne la propriété extérieure?
l’économiste.
On peut considérer le travail comme une propriété extérieure. L’entrepreneur qui achète du travail n’achète pas les facultés, les forces de l’ouvrier; il achète la portion de ces forces que l’ouvrier sépare de lui-même en travaillant. L’échange n’est véritablement conclu ou terminé qu’après que l’ouvrier, qui a séparé de lui-même une partie de ses forces physiques, morales et intellectuelles, a reçu en échange des produits (le plus souvent des métaux précieux) contenant de même une certaine quantité de travail. C’est donc bien un échange de deux propriétés extérieures.
Tout échange ne peut être équitable qu’à la condition d’être parfaitement libre. Deux hommes qui font un échange ne sont-ils pas les meilleurs juges de leur intéret? un tiers peut-il légitimement intervenir pour obliger l’un des deux contractants à donner plus ou à recevoir moins qu’il n’aurait donné ou reçu si l’échange eût été libre? Si l’un ou l’autre juge que la chose qu’on lui offre est trop chère, il ne l’achète point.
le socialiste.
Et s’il est forcé de l’acheter afin de pouvoir vivre? Si un ouvrier, pressé par la faim, est obligé d’aliéner une quantité considérable de son travail en échange d’un faible salaire?
l’économiste.
Voilà une objection qui va nous obliger à décrire un bien long circuit.
le socialiste.
Mais avouez anssi qu’elle est bien forte...elle contient véritablement tout le socialisme. Les socialistes ont reconnu, [144] constaté qu’il n’y a point et qu’il ne peut y avoir égalité dans le mode actuel d’échange du travail; que le maître est naturellement plus fort que l’ouvrier; qu’il peut, en conséquence, toujours lui faire la loi, et qu’il la lui fait. Après avoir bien constaté cette inégalité manifeste, ils ont recherché les moyens de la faire disparaître. Ils en ont trouvé deux: l’intervention de l’État entre le vendeur et l’acheteur de travail, et l’Association qui supprime la vente du travail.
l’économiste.
Êtes-vous bien sûr que l’inégalité dont vous parlez existe?
le socialiste.
Si j’en suis sûr? Mais les maîtres de l’économie politique eux-mêmes l’ont reconnue cette-inégalité. Si j’avais les œuvres d’Adam Smith sous la main.....
le conservateur.
Les voici dans ma bibliothèqne.
l’économiste.
Voici la page.
le socialiste.
Prêtez-moi attention, je vous prie:
“Ce qui décide partout du salaire ordinaire du travail, dit Adam Smith, c’est le contrat passé entre le maître et l’ouvrier, dont les intérêts ne sont pas du tout les mêmes. Les ouvriers veulent gagner le plus, les maîtres donner le moins qu’il se peut. Ils sont disposés à se liguer les uns pour hausser, les autres pour abaisser le prix du travail.
“Il n’est pas difficile de prévoir de quel côté doit rester ordinairement l’avantage, et quelle est celle des deux parties qui forcera l’autre à se soumettre aux conditions [145] qu’elle impose. Les maîtres étant en plus petit nombre, il leur est bien plus facile de s’entendre. D’ailleurs la loi les autorise, ou du moins ne leur défend pas de se liguer, au lieu qu’elle le défend aux ouvriers. Nous n’avons point d’acte du parlement contre la conspiration de baisser la main-d’œuvre, et nous en avons plusieurs contre celle de la hausser. Ajoutons que dans ces sortes de disputes les maîtres peuvent tenir bien plus longtemps. Un propriétaire, un fermier, un maître manufacturier, un marchand peuvent généralement vivre une année ou deux des fonds qu’ils ont par devers eux, sans employer un seul ouvrier. La plupart des ouvriers ne pourraient pas subsister une semaine, fort peu l’espace d’un mois et presque aucun l’espace d’un an sans travailler. A la longue, le maître ne peut pas plus se passer de l’ouvrier que l’ouvrier du maître; mais le besoin qu’il en a n’est pas si urgent.”
Écoutez, je vous prie, encore ceci:
“Il est rare, dit-on, qu’on entende parler d’une ligue de la part des maîtres, et on parle souvent de celles que font les ouvriers. Mais quiconque imagine là-dessus que les maîtres ne s’entendent pas, connaît aussi peu le monde que le sujet dont il s’agit; il y a partout une conspiration tacite, mais constante, parmi les maîtres, pour que le prix actuel du travail ne monte point. S’écarter de cette loi ou convention tacite est partout l’action d’un faux frère et une sorte de tache pour un maître parmi ses voisins et ses égaux. Il est vrai qu’on entend rarement parler de cette ligue, parce qu’elle est d’usage et qu’elle n’est pour ainsi dire que l’état naturel des choses, qui ne fait point sensation. Les maîtres se concertent aussi quelquefois [146] pour faire baisser le salaire du travail au-dessous de son prix actuel. Ce projet est conduit dans le plus grand silence et le plus grand secret jusqu’au moment de l’exécution; et si les ouvriers cèdent sans résistance, comme il arrive quelquefois, quoiqu’ils sentent toute la rigueur du coup, le public n’en parle point. Cependant ils opposent souvent une ligue défensive, et dans certaines occasions ils n’attendent pas qu’on les provoque; ils forment d’eux-mêmes une conspiration pour que les maîtres augmentent leur salaire. Les prétextes ordinaires dont ils se servent sont tantôt la cherté des denrées, tantôt la grandeur des profits que les maîtres font sur leur ouvrage. Mais soit que leurs ligues soient offensives ou défensives, elles font toujours grand bruit. Pour faire décider promptement la question, ils ne manquent jamais de remplir le monde de leurs clameurs, et ils poussent quelquefois la mutinerie jusqu’à la violence et aux outrages les moins pardonnables; ils sont forcenés et agissent avec toute la folie et l’extravagance de gens désespérés, qui se voient dans l’alternative de mourir de faim ou d’obtenir sur-lechamp par la terreur ce qu’ils demandent à leurs maîtres. Ceux-ci, de leur côté, crient tout aussi haut, et ne cessent d’invoquer le magistrat civil et l’exécution rigoureuse des lois portées avec tant de sévérité contre les complots des domestiques, des ouvriers et des journaliers. En conséquence, les ouvriers ne retirent presque jamais aucun avantage de la violence et de ces associations tumultueuses qui, généralement, n’aboutissent à rien qu’à la punition et à la ruine des chefs, tant parce que le magistrat civil interpose son autorité, que parce que la plupart des ouvriers sont dans [147] la nécessité de se soumettre pour avoir du pain.”
Voilà, n’est-il pas vrai, une condamnation éloquente de votre système de libre concurrence, tracée de la main même du maître de la science économique? Dans les débats du salaire, le maître est plus fort que l’ouvrier, c’est Adam Smith lui-même qui le constate! Après cet aveu du maître, qu’auraient dû faire les disciples? S’ils avaient été véritablement possédés de l’amour de la justice et de l’humanité, n’auraient-ils pas dù rechercher les moyens d’établir l’égalité dans les relations des maîtres avec les ouvriers? Ont-ils rempli ce devoir?... Qu’ont-ils proposé à la place du salariat, cette dernière transformation de la servitude, comme l’a si bien nommé M. de Châteaubriand? Qu’ont-ils proposé à la place de ce laisser-faire inique et sauvage qui asseoit la prospérité du maître sur la ruine de l’ouvrier? qu’ont-ils proposé, je vous le demande?
l’économiste.
Rien.
le socialiste.
En effet, ils ont dit qu’ils ne pouvaient rien contre les lois naturelles qui gouvernent la société; ils ont avoué honteusement leur impuissance à venir en aide aux travailleurs. Mais ce devoir de justice et d’humanité qu’ils ont méconnu, nous autres socialistes nous l’avons rempli. En substituant l’Association au salariat, nous avons mis fin à l’exploitation de l’homme par l’homme et à la tyrannie du capital.
l’économiste.
Je....
le conservateur.
Permettez-moi d’abord de faire une simple observation. Dans le passage d’Adam Smith qui vient d’être cité, il est question de lois qui répriment inégalement les coalitions des maîtres et celles des ouvriers. Nous n’avons, Dieu merci, rien de pareil en France. Nos lois sont égales pour tous. Il n’y a plus d’inégalités sur la terre française!
l’économiste.
Vous vous trompez. La loi française a établi, au contraire, une inégalité flagrante entre le maître et l’ouvrier. Il me suffira de lire les articles 414 et 415 du Code pénal, pour vous le prouver.
“Art. 414. Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à forcer injustement et abusivement l’abaissement des salaires, suivie d’une tentative ou d’un commencement d’exécution, sera punie d’un emprisonnement de six jours à un mois, et d’une amende de deux cents à trois mille francs.
Art. 415. Toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser, en même temps, de travailler, interdire le travail dans un atelier, empêcher de s’y rendre et d’y rester avant ou après certaines heures, et, en général, pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s’il y a eu tentative ou commencement d’exécution, sera punie d’un emprisonnement d’un mois au moins et de trois mois au plus.—Les chefs ou moteurs seront punis d’un emprisonnement de deux à cinq ans.”
Vous le voyez, les maîtres ne peuvent être poursuivis que lorsqu’il y a tentative injuste et abusive de leur part, pour faire baisser le salaire; les ouvriers sout poursuivis [149] pour la tentative pure et simple de coalition; en outre, les pénalités sont monstrueusement inégales.
le conservateur.
L’Assemblée nationale n’a-t-elle pas réformé ces deux articles?
le socialiste.
Elle les aurait réformés peut-être sans l’opposition d’un économiste. En attendant ils subsistent, et Dieu sait quelle désastreuse influence ils exercent sur le prix du travail. Souvenez-vous de la coalition des charpentiers parisiens en 1845. Les compagnons se coalisèrent pour obtenir une augmentation de 1 fr. sur le salaire qui était de 4 fr. Les patrons se coalisèrent pour résister.
le conservateur.
Le fait ne fut pas établi.
le socialiste.
Le fait fut au contraire parfaitement établi. A cette époque, où les associations étaient soigneusement interdites, les maîtres charpentiers avaient obtenu l’autorisation de constituer une chambre syndicale pour le perfectionnement de leur industrie; mais, dans cette chambre de perfectionnement, on s’occupait des salaires plus que de toute autre chose.
le conservateur.
Qu’en savez-vous?
le socialiste.
Les débats du procès l’ont clairement établi. Les délégués des ouvriers s’adressèrent au président de la chambre syndicale pour obtenir l’augmentation du salaire. Le président la leur refusa, après une longue délibération de l’assemblée. Cependant les maîtres ne furent point [150] poursuivis, et, en effet, ils ne pouvaient pas l’être. Ils s’étaient coalisés à la vérité, mais non pour abaisser “injustement et abusivement” le salaire; ils s’étaient coalisés pour empêcher le salaire de hausser.
l’économiste.
Ce qui revenait absolument au même.
le socialiste.
Mais les législateurs du régime impérial ne l’avaient pas entendu ainsi. Les maîtres furent donc renvoyés absous. Les chefs de la coalition ouvrière furent condamnés, les uns à cinq ans, les autres à trois and d’emprisonnement.
l’économiste.
Oui, ce fut une des condamnations les plus déplorables dont les annales judiciaires fassent mention.
le conservateur.
Si je ne me trompe, la coalition occasionna des sévices particuliers. Certains ouvriers coalisés maltraitèrent des compagnons qui n’avaient point voulu prendre part à la coalition. Mais votre système de laisser faire autorise peut-être ces procédés-là.
l’économiste.
Beaucoup moins que le vôtre. Quand on dit liberté illimitée, on entend liberté égale pour tout le monde, respect égal aux droits de tous et de chacun. Or, lorsqu’un ouvrier empêche par intimidation ou violence un autre ouvrier de travailler, il porte atteinte à un droit, il viole une propriété, il est un tyran, un spoliateur, et il doit être rigoureusement puni comme tel. Les ouvriers qui avaient commis ce genre de délit dans l’affaire des charpentiers n’étaient nullement excusables et l’on fit bien [151] de les condamner. Mais tous ne l’avaient pas commis. Les chefs de la coalition n’avaient ni excercé ni ordonné aucune violence. Cependant ils furent punis plus sévèrement que les autres.
le conservateur.
La loi sera réformée.
l’économiste.
Tant qu’elle subsistera, ce sera une loi inique.
le conservateur.
Quoi? alors même qu’elle n’établirait plus aucune différence entre les maîtres et les ouvriers?
l’économiste.
Oui. Que dit Adam Smith? que les maîtres peuvent s’entendre avec beaucoup plus de facilité que les ouvriers, et que la loi peut beaucoup plus difficilement les atteindre. Or, si la loi atteint quatre coalitions d’ouvriers sur une coalition de maîtres, est-ce une loi juste?
Dans la pratique, l’influence de cette loi est désastreuse pour les ouvriers. Les maîtres, sachant que la loi les atteint difficilement, tandis qu’elle atteint facilement les ouvriers, sont excités à élever et à soutenir des prétentions abusives dans le règlement du prix du travail. Toute loi sur les coalitions, si égale qu’on la fasse, constitue donc une intervention de la société, en faveur du maître. On a fini par s’en convaincre en Angleterre, et l’on a aboli cette loi sur les coalitions, qui excitait les justes réclamations d’Adam Smith.
le conservateur.
Mais voyons! Les coalitions sont-elles légitimes ou ne le sont-elles pas? Constituent-elles un accord frauduleux ou un accord licite? Voilà la question! Or, sur cette question, [152] l’opinion de nos grandes assemblées n’a jamais été douteuse. Les membres de notre première Assemblée constituante et de la Convention elle-même, se montraient unanimes pour empêcher toute union, toute entente entre les entrepreneurs ou les ouvriers. Le conventionnel Chapelier écrivait, dans un de ses rapports, cette phrase qui est demeurée célèbre: “Il faut absolument empêcher les entrepreneurs et les ouvriers de se réunir pour se concerter sur leurs prétendus intérêts communs.” Qu’en pensez-vous?
l’économiste.
Je pense que le plus subtil criminaliste ne saurait voir aucun délit dans l’action de deux ou de plusieurs hommes qui s’entendent pour obtenir une augmentation sur le prix de leur marchandise; je pense qu’en édictant des lois pour réprimer ce prétendu délit on porte une atteinte injuste et nuisible à la propriété des industriels et des ouvriers.
Je dis plus. En interdisant les coalitions, on empêche un accord souvent indispensable.
le socialiste.
Les économistes n’ont-ils pas toujours considéré les coalitions comme nuisibles ou tout au moins comme inutiles?
l’économiste.
Cela dépend des circonstances et de la manière dont les coalitions sont conduites. Mais pour vous faire bien voir dans quelles circonstances une coalition peut être utile, et comment elle doit être conduite pour donner de bons resultats, je suis obligé de rentrer dans le fond du débat. Vous avez affirmé qu’il n’y a point de justice possible sous [153] le régime du salariat; que le maître étant naturellement plus fort que l’ouvrier doit naturellement aussi l’opprimer.
le conservateur.
La conséquence n’est pas rigoureuse. Il y a des sentiments philanthropiques qui tempèrent ce que l’intérêt privé peut avoir de trop âpre.
l’économiste.
Nullement. J’accepte la conséquence comme rigoureuse et je la crois telle. On ne fait pas de philanthropie dans le domaine des affaires, et l’on a raison, car la philanthropie n’y serait pas à sa place. Nous reviendrons là-dessus plus tard....
Donc vous êtes d’avis que le maître peut toujours faire la loi à l’ouvrier, partant que le salariat exclut la justice.
le socialiste.
Je suis de l’opinion d’Adam Smith.
l’économiste.
Adam Smith a dit que le maître peut opprimer l’ouvrier plus aisement que l’ouvrier ne peut opprimer le maître; il n’a pas dit que le maître se trouve toujours nécessairement en position de faire la loi à l’ouvrier.
le socialiste.
Il a constaté une inégalité naturelle, qui existe en faveur du maître.
l’économiste.
Oui, mais cette inégalité peut ne pas exister. Il peut se rencontrer telle situation où l’ouvrier soit plus fort que le maître.
le socialiste.
S’il y a coalition entre les ouvriers?
l’économiste.
Non, sans coalition. Je vous en citerai un exemple tout à l’heure. Or, si l’inégalité ne se produit pas toujours, ne peut-il pas se faire qu’elle ne se produise jamais?
le socialiste.
Bon! vous allez arriver à l’organisation du travail.
l’économiste.
Dieu m’en préserve!
En venant ici, j’ai passé devant la boutique de Fossin. Il y avait, à l’étalage, de fort belles parures de diamants. Sur le trottoir en face, une marchande d’oranges débitait sa marchandise. Elle avait des oranges de deux ou trois qualités, et, dans un coin de son éventaire, un paquet d’oranges moisies qu’elle offrait à vil prix.
le conservateur.
Quel est ce logogriphe?
l’économiste.
Remarquez bien, je vous prie, la différence des deux industries. Fossin vend des diamants, c’est-à-dire une marchandise essentiellement durable. Que l’acheteur vienne ou non, le marchand de diamants peut attendre, sans craindre que sa marchandise subisse le moindre déchet. Mais que la marchande d’oranges ne réussisse pas à se défaire de sa provision, et bientôt il ne lui restera plus une seule orange saine. Elle sera obligée de jeter sa marchandise sur le fumier.
Voilà, certes, une différence notable entre les deux industries. Fossin peut attendre longtemps des acheteurs, sans craindre que sa marchandise se gâte, la marchande d’oranges ne le peut pas. Est-ce à dire que la marchande [155] d’oranges soit exposée plus que Fossin à recevoir la loi de ses acheteurs?
le socialiste.
C’est selon! si la marchande d’oranges n’a pas soin de proportionner exactement la quantité de sa marchandise au nombre de ses acheteurs, elle sera obligée de réduire ses prix ou de perdre une partie de ses oranges.
le conservateur.
Elle fera, ma foi! un fort mauvais commerce.
l’économiste.
Aussi toute marchande d’oranges qui entend son métier évite-t-elle soigneusement de se charger de plus de marchandise qu’elle n’en peut vendre au prix rémunérateur?
le conservateur.
Qu’entendez-vous par prix rémunérateur?
l’économiste.
J’entends le prix qui couvre les frais de production de la denrée, y compris le bénéfice naturel de la marchande.
le socialiste.
Vous ne résolvez pas la difficulté. Dans une année où la récolte des oranges est surabondante, que fera-t-on du surplus, si les marchandes n’en demandent pas plus que de coutume? Faudra-t-il laisser pourrir les oranges surabondantes?
l’économiste.
Si l’on récolte plus d’oranges, on en offrira davantage, et le prix baissera. Le prix venant à baisser, la demande augmentera, et le surplus de la récolte trouvera ainsi à se placer.
le socialiste.
Dans quelle proportion la baisse aura-t-elle lieu?
l’économiste.
D’après toutes les observations qui ont été jusqu’à présent recueillies, on peut affirmer que:
Lorsque l’offre dépasse la demande en progression arithmétique, le prix baisse en progression géométrique, et, de même, lorsque la demande dépasse l’offre en progression arithmétique, le prix hausse en progression géomètrique.
Vous ne tarderez pas à apercevoir les résultats bienfaisants de cette loi économique.
le socialiste.
Si une telle loi existe, ne doit-elle pas avoir, au contraire, des résultats essentiellement funestes? Supposez, par exemple, qu’un propriétaire d’orangers recueille communément cinq cent mille oranges par année et qu’il trouve à les vendre à raison de deux centimes piece. Cela lui fait une somme de dix mille francs avec laquelle il paye ses ouvriers, rémunère son travail de directeur d’exploitation, couvre, en un mot, ses frais de production. Survient une année abondante. Au lieu de cinq cent mille oranges, il en récolte un million. Il offre, en conséquence, deux fois plus d’oranges au marché. En vertu de votre loi économique, le prix tombe de deux centimes à un demi-centime, et le malheureux propriétaire, victime de l’abondance, ne reçoit que cinq mille francs pour un million d’oranges, tandis que l’année précédente, il avait reçu dix mille francs pour une quantité de moitié moindre.
le conservateur.
Il est certain que la surabondance des biens est quelquefois nuisible. Demandez plutôt à nos fermiers laquelle ils préfèrent d’une année d’abondance ou d’une année moyenne, d’une année où le blé est à vingt-deux francs ou d’une année où il tombe à dix francs.
l’économiste.
Voilà des phénomènes économiques que la loi qui vient d’être formulée peut seule expliquer. Mais il ne résulte pas du tout de cette loi que le doublement d’une récolte doive amener une baisse des trois quarts dans le prix, car la demande augmente toujours, plus ou moins, à mesure que le prix baisse. Reprenons l’exemple du propriétaire d’orangers. A deux centimes pièce, ce propriétaire couvrait les frais de production de cinq cent mille oranges. Si la récolte vient à doubler, les frais de production n’augmenteront pas dans la même proportion. Toutefois ils augmenteront. Il faut plus de travail pour récolter un million d’oranges que pour en récolter cinq cent mille. En outre, les propriétaires seront obligés de payer ce travail plus cher, car le salaire hausse toujours lorsque la demande du travail augmente. Les frais de production s’élèveront donc de moitié peut-être. Ils monteront de dix mille à quinze mille francs. Pour couvrir cette dernière somme, qui représente ses frais de production, le propriétaire devra vendre sa récolte d’oranges à raison de un centime et demi pièce.
La question est de savoir si, de même qu’il réussissait à vendre cinq cent mille oranges en les offrant à deux centimes, il réussira à en vendre un million, en les offrant à un centime et demi; la question est de savoir si un demicentime [158] de baisse suffira pour faire doubler la demande.
Si cette baisse ne suffit point, notre propriétaire sera obligé de réduire encore son prix, sous peine de garder une partie de sa marchandise. Mais alors il sera en perte. S’il ne vend que neuf cent mille oranges à un centime et demi, il ne couvrira pas ses frais; s’il en vend un million à un centime et un quart, il les couvrira encore moins.
L’expérience seule peut servir de guide, dans ce cas. Une certaine baisse dans le prix n’augmente pas également la consommation de toutes les denrées. Une baisse de moitié dans le prix du sucre, par exemple, pourra en doubler la consommation. Une baisse de moitié dans le prix de l’avoine ou du sarrasin pourra n’augmenter que d’une quantité assez faible la demande de ces deux denrées. Dans une année où la récolte a dépassé les prévisions habituelles, c’est donc une question difficile de savoir s’il convient d’élever l’offre en proportion de l’augmentation de la récolte ou s’il vaut mieux conserver une partie de la denrée afin d’en maintenir le prix.
le socialiste.
Et si la denrée n’est point de nature à se conserver on pourra donc trouver avantage à la laisser se perdre.
l’économiste.
Oui, ou ce qui revient économiquement au même, à la distribuer gratis à des gens qui ne l’eussent achetée à aucun prix. Mais il y a fort peu de denrées que l’on ne puisse conserver sous une forme ou sous une autre.
S’il vous reste quelque doute sur l’existence de la loi économique que je viens de signaler, examinez ce qui s’est passé récemment dans le commerce du blé. En 1847, notre récolte de blé a été en déficit; au lieu de [159] récolter soixante millions d’hectolitres de blé, on n’en a récolté que cinquante millions environ. Vous savez quel a été le résultat commercial de ce déficit de la récolte. De vingt ou vingt-deux francs, son cours ordinaire, le blé a monté à quarante ou cinquante francs. L’année suivante, au contraire, la moisson a été abondante, on a récolté huit ou dix millions d’hectolitres de plus que de coutume. De quarante ou cinquante francs, le prix est tombé alors, par gradations successives, à quinze francs et, dans certaines localités, jusqu’à dix francs. Dans la première de ces deux années, une diminution d’un quart dans l’offre a rapidement amené le doublement du prix; dans la seconde, une augmentation d’un quart dans l’offre, a fait descendre successivement le prix à la moitié de son taux ordinaire.
La même loi gouverne les prix de toutes les denrées. Seulement, il faut toujours bien tenir compte, en l’observant, de l’augmentation de la demande qui résulte de la diminution du prix, et vice versâ.
le socialiste.
Si une faible diminution dans l’offre peut amener une augmentation si considérable dans le prix, je m’explique un fait qui était demeuré jusqu’à présent fort obscur pour moi. A la fin du siècle dernier, la disette régnait à Marseille. Le prix du blé était monté fort haut... pas assez cependant au gré de certains marchands qui entreprirent de le faire hausser encore. Ils imaginèrent, en conséquence, de jeter à la mer une partie de leur approvisionnement. Cette idée heureuse leur valut de gros bénéfices. Mais un enfant avait été témoin de leur action impie et criminelle. Sa jeune àme en conçut une indignation [160] profonde. Il se demanda quelle était donc cette société, où il était utile aux uns d’affamer les autres, et il déclara une immortelle guerre à une civilisation qui enfantait de si abominables excès. Il consacra sa vie à combiner une Organisation nouvelle... Cet enfant, ce réformateur, vous le connaissez, c’est Fourier.
l’économiste.
L’anecdote peut être vraie, car le fait s’est produit fréquemment dans les années de disette, comme aussi dans les années d’abondance; mais, à mes yeux, elle ne prouve qu’une seule chose: c’est que Fourier était un fort mauvais observateur.
le socialiste.
Par exemple!
l’économiste.
Fourier voyait l’effet, mais il ne voyait pas la cause. A cette époque, les achats de blé à l’extérieur étaient entravés, à la fois, par la difficulté des communications et par les lois de douanes. Aussi les détenteurs de blé à l’intérieur jouissaient-ils d’un véritable monopole. Pour rendre ce monopole plus fructueux encore, ils ne mettaient au marché, ils n’offraient qu’une partie de leur approvisionnement. Si la loi ne s’était pas mêlée de leurs affaires, ils auraient gardé le reste en magasin, car le blé est une des denrées qui se conservent le plus longtemps. Malheureusement il y avait, en ce temps-là, des lois contre les accapareurs. Ces lois interdisaient aux négociants de garder en magasin au dela d’une certaine quantité de substances alimentaires. Placés dans l’alternative de mettre tout leur blé au marché ou d’en détruire une partie, ceux-ci trouvaient souvent plus d’avantage à [161] adopter ce dernier parti. C’était barbare, c’était odieux, si vous voulez; mais à qui la faute?
Sous un régime de pleine liberté économique, rien de pareil ne pourrait avoir lieu. Sous ce régime, le prix de toutes choses tend naturellement à tomber au taux le plus bas possible. Par cela même, en effet, qu’une faible différence entre les deux niveaux de l’offre et de la demande amène un écart considérable dans les prix, l’équilibre doit nécessairement s’établir. Aussitôt que l’approvisionnement d’une denrée ne suffit pas à la demande, le prix monte avec une rapidité telle, qu’on trouve bientôt grand profit à apporter au marché un supplément de cette denrée. Or, les hommes étant naturellement à l’affût de toutes les affaires qui leur présentent quelque avantage, les concurrents affluent pour combler le déficit.
Aussitôt que le déficit est comblé et l’équilibre rétabli, les expéditions s’arrêtent d’elles-mêmes; car les prix tendant a baisser progressivement à mesure que les approvisionnements augmentent, les expéditeurs ne tarderaient pas à être en perte.
Si donc on laisse aux producteurs ou aux marchands pleine liberté de porter toujours leur denrée où le besoin s’en fait sentir, les approvisionnements seront toujours aussi justement proportionnés que possible aux exigences de la consommation; si, au contraire, on porte atteinte, d’une manière ou d’une autre, à la liberté des communications, si on entrave les négociants dans le libre exercice de leur industrie, l’équilibre sera longtemps à s’établir, et, dans l’intervalle, les producteurs maîtres du marché pourront réaliser d’énormes bénéfices, aux dépens des malheureux consommateurs.
[162]Remarquons encore que ces bénéfices croissent d’autant plus qu’on peut moins se passer de la denrée. Supposons qu’une compagnie obtienne le monopole de la vente des oranges dans un pays. Si cette compagnie profite de son monopole pour diminuer de moitié la quantité des oranges précédemment offertes, dans l’espoir d’en quadrupler le prix, elle pourra fort bien éprouver un mécompte. Les oranges n’étant pas, en effet, une denrée de première nécessité, à mesure que la diminution de l’offre fera croître le prix, la demande décroîtra de même. L’écart entre l’offre et la demande demeurant en conséquence, toujours très faible, le prix courant des oranges ne pourra s’élever beaucoup au-dessus du prix naturel.
Il n’en sera pas de même, si une compagnie réussit à accaparer le monopole de la production ou de la vente des céréales. Le blé étant une denrée de première nécessité, une diminution de moitié dans l’offre et, par suite, une hausse progressionnelle dans le prix n’entraînerait qu’une assez faible réduction dans la demande. Telle diminution de l’offre, qui ferait hausser à peine le prix des oranges, aurait pour résultat de doubler ou de tripler le prix du blé.
Quand une denrée est de toute première nécessité, comme le blé, la demande ne diminue qu’avec l’extinction d’une partie de la population ou l’épuisement de ses moyens.
Enfin, dans certaines circonstances, telle denrée, dont le prix ne pouvait monter bien haut dans un milieu ordinaire, acquiert tout à coup une valeur inusitée. Transportez, par exemple, une marchande d’oranges au milieu d’une caravane qui traverse le désert. Dans les [163] premiers jours, elle est obligée de débiter sa marchandise à un taux modéré, sous peine de n’en pas vendre. Mais l’eau vient à manquer: aussitôt la demande des oranges se double, se triple, se quadruple. Le prix monte progressivement à mesure que la demande s’éleve. Il ne tarde guère à dépasser les ressources des voyageurs les moins fortunés, et à atteindre celles des voyageurs les plus riches: en quelques heures, la valeur d’une orange peut s’élever de la sorte à un million. Si la marchande, souffrant elle-même de la soif, diminue son offre à mesure que son propre besoin devient plus intense, un moment arrive où le prix des oranges dépasse toutes les ressources disponibles de ses compagnons de la caravane, fussent-ils des nababs.
En observant bien cette loi économique, vous vous rendrez compte d’une multitude de phénomènes qui ont dû jusqu’à présent vous échapper. Vous saurez au juste pourquoi les producteurs ont toujours visé à obtenir le privilége exclusif ou monopole de la vente de leurs produits dans certaines circonscriptions; pourquoi ils se montrent par-dessus tout friands des monopoles qui affectent les denrées de première nécessité; pourquoi enfin ces monopoles ont été de tout temps la terreur des populations.
Je reviens maintenant à ma marchande d’oranges et à Fossin.
le conservateur.
Enfin!
l’économiste.
Grâce à la nature particulière de sa marchandise, qui est durable, Fossin peut sans trop d’inconvénient, élever [164] son approvisionnement de pierres précieuses au delà des besoins du moment. Rien ne l’oblige à offrir immédiatement le surplus. La marchande d’oranges se trouve dans une situation bien différente. Si elle a acheté plus d’oranges qu’elle n’en peut vendre à un prix rémunérateur, elle n’a point la ressource de tenir indéfiniment le surplus en réserve, car les oranges sont sujettes à se gâter. Mais en offrant toute sa provision, elle s’expose à faire baisser le prix des oranges au point de perdre au delà même de la valeur de l’excédant. Que fera-t-elle donc? Détruira-t-elle cet excédant dont elle s’est maladroitement chargée? Non! elle le vendra en dehors de son marché ordinaire, ou bien elle attendra qu’une partie de ses oranges soient légèrement gâtées pour les vendre à une catégorie particulière d’acheteurs, de manière à ne point faire concurrence au reste de sa provision. Voilà ce qui vous explique la présence de ces petits tas d’oranges à moitié gâtées, au coin de l’éventaire des marchandes.
le conservateur.
Que nous importe?
l’économiste.
Vous allez voir. Ces tas sont d’autant plus considérables que les marchandes entendent plus mal leur métier, ou que la consommation des oranges subit des fluctuations plus fortes. Mais on ne les verrait point encombrer les éventaires, si les marchandes savaient exactement proportionner leurs achats à leurs ventes, si encore la consommation n’éprouvait jamais de variations subites. Si les choses se passaient ainsi les marchandes d’oranges pourraient comme Fossin proportionner toujours [165] leur offre à la demande, sans éprouver aucun dommage; elles cesseraient de vendre à perte une partie de leur marchandise dans la crainte que l’excédant ne vienne à se gâter, ou d’attendre que cet excédant se gâte afin de s’en débarrasser à vil prix.
le conservateur.
Sans doute!
l’économiste.
Eh! bien, si vous examinez de près la situation des ouvriers vis-à-vis des entrepreneurs d’industrie, vous la trouverez parfaitement analogue à celle des marchandes d’oranges vis-à-vis de leurs acheteurs.
Si vous examinez de même la situation des entrepreneurs vis-à-vis des ouvriers, vous la trouverez absolument semblable à celle de Fossin vis-à-vis de sa clientèle.
Le travail, en effet, est une denrée essentiellement périssable, en ce sens que le travailleur, dénué de ressources, est exposé à périr dans un bref délai, s’il ne trouve point à placer sa marchandise. Aussi le prix du travail peut-il tomber excessivement bas, dans les moments où l’offre du travail est considérable et où la demande est faible.
Heureusement, la bienfaisance s’interpose alors, en enlevant du marché pour les nourrir gratis une partie des travailleurs qui offrent inutilement leurs bras. Si la bienfaisance est insuffisante, le prix du travail continue à baisser jusqu’à ce qu’une partie du travail inutilement offert périsse. Alors l’équilibre commence de nouveau à se rétablir.
L’entrepreneur qui offre des salaires aux ouvriers [166] n’est pas obligé, communément du moins, de se hâter si fort. Lorsque le travail est rare sur le marché il peut tenir en réserve une partie de ses salaires, et proportionner, comme Fossin, son offre à la demande.
Cependant, il y a des exceptions à cette règle. Il arrive parfois que les entrepreneurs sont obligés de vendre leurs salaires à vil prix, de céder de gros salaires en échange de faibles quantités de travail, ou, pour me servir de l’expression commune, de recevoir la loi des ouvriers. Cela arrive lorsqu’ils ont un besoin urgent de plus de bras qu’il ne s’en offre sur le marché.
Cela est arrivé notamment aux Antilles anglaises, à l’époque de l’émancipation. Lorsque l’esclavage retenait les travailleurs sur les plantations, les colons disposaient d’une quantité de travail à peu près suffisante pour mettre leurs exploitations en valeur. Mais lorsque l’esclavage vint à être aboli, un grand nombre d’esclaves se mirent à travailler pour leur propre compte. Le nombre de ceux qui continuèrent à s’employer à la culture des cannes se trouva insuffisant. A l’instant même la loi économique de l’offre et de la demande fit sentir son influence sur les prix du travail. A la Jamaïque, où la journée d’un esclave revenait à peine à 1 fr., la même quantité de travail libre se vendit successivement 3, 5, 10 et même jusqu’à 15 et 16 fr.1. La plus grande partie de l’indemnité accordée aux colons y passa. Mais bientôt une foule de colons ayant abandonné leurs plantations, faute de pouvoir payer ces salaires exorbitants, la demande [167] diminua; d’un autre côté, l’appât de ces salaires ayant attiré des travailleurs de tous les pays, même de la Chine, l’offre s’augmenta. Grâce à ce double mouvement qui rapprochait incessamment et irrésistiblement l’offre de la demande, les salaires baissèrent, et, aujourd’hui, le prix du travail aux Antilles anglaises a pris à peu près son niveau naturel.
le socialiste.
Qu’entendez-vous par le niveau naturel du salaire?
l’économiste.
J’entends par là la somme nécessaire pour couvrir les frais de production du travail. Je vous expliquerai cela plus au long dans un prochain entretien.
Vous voyez, en définitive, que les entrepreneurs ne peuvent pas plus se soustraire à la loi de l’offre et de la demande que les ouvriers eux-mêmes. Lorsque l’équilibre est rompu contre eux, lorsque la balance du travail est en faveur des ouvriers, ils peuvent sans doute tenir en réserve,—le plus souvent du moins,—une partie de leurs salaires, et empêcher ainsi le prix du travail de monter trop haut; ils peuvent imiter les joailliers qui gardent leurs bijoux et leurs pierreries plutôt que de les vendre au-dessous du prix rémunérateur; mais, en fin de compte, un moment arrive où, sous peine de faire banqueroute ou de renoncer à leur industrie, ils sont obligés de mettre leurs salaires au marché.
Lorsque l’équilibre est rompu contre les ouvriers, lorsque la balance du travail est en faveur des entrepreneurs, les ouvriers sont communément obligés de vendre leur travail quand même, à moins que la Charité ne vienne à leur secours, ou qu’ils ne réussissent, d’une manière ou [168] d’une autre, à retirer du marché le travail surabondant. Leur situation est alors plus mauvaise que celle des entrepreneurs manquant de travail, car ils vendent, comme les marchandes d’oranges, une denrée peu durable, prompte à s’avarier ou à se détruire.
Mais si, connaissant bien la nature de leur denrée, ils avaient assez de prudence pour ne jamais en surcharger les marchés, pour proportionner toujours leur offre à la demande, ne pourraient-ils pas aussi, comme les marchandes d’oranges qui savent leur métier, vendre toujours leur marchandise à un prix rémunérateur?
le socialiste.
Est-il bien possible de proportionner toujours l’offre du travail à la demande? Les ouvriers sont-ils les maîtres d’empêcher les Crises de bouleverser l’industrie? Peuvent-ils encore transporter aisément d’un lieu à un autre un excédant de travail, comme on transporte des ballots de marchandises? Cet équilibre, qui permettrait aux ouvriers de vendre leur travail à un prix rémunérateur, ne doit-il pas, en vertu de la nature même des choses, être incessamment rompu contre eux? Et alors le prix du travail, comme celui de toute marchandise peu durable, ne doit-il pas baisser d’une manière effrayante?
l’économiste.
Les obstacles que vous attribuez à la nature des choses sont le plus souvent artificiels. Étudiez mieux les crises industrielles, et vous verrez qu’elles ont presque toujours leur origine dans les lois qui entravent la production ou la circulation des richesses sur les différents points du globe. Recherchez mieux aussi pourquoi les ouvriers réussissent [169] si malaisément à proportionner leur offre à la demande, et vous trouverez que cela vient principalement, d’une part, des institutions de charité légale, qui les excitent à se multipher sans mesure; d’une autre part, des obstacles apportés à la facile entente des travailleurs et à la libre circulation du travail, lois économiques sur les coalitions, sur l’apprentissage, sur les livrets, sur les passeports, lois civiles refusant aux étrangers des droits égaux à ceux des nationaux. Si faible que soit l’action de ces obstacles artificiels sur le mouvement de l’offre et de la demande, elle devient considérable, énorme sur le prix, puisque la progression arithmétique d’un côté engendre une progression géométrique de l’autre.
Je vous ai démontré déjà que les lois sur les coalitions font nécessairement, inevitablement pencher la balance du côté du maître dans le débat du salaire. Sans ces lois funestes, les ouvriers auraient, en outre, des facilités qui leur manquent aujourd’hui pour proportionner toujours promptement l’offre des bras à la demande du travail. Voici comment.
Je reprends l’exemple de la marchande d’oranges: elle vend, je suppose, journellement une centaine d’oranges. Un jour la demande baisse de moitié, on ne lui en demande plus que cinquante. Si elle persiste ce jour-là à en vouloir vendre cent, elle sera obligée d’abaisser notablement son prix, et elle éprouvera une perte sensible. Il y aura avantage pour elle à retirer du marché l’excédant de cinquante oranges, dussent ces oranges réservées pourrir dans la journée.
Eh bien! la situation est absolument la même pour les ouvriers marchands de travail.
le conservateur.
Je le veux bien, mais qui consentira à jouer le rôle des oranges destinées à moisir en magasin?
l’économiste.
Individuellement, personne! maîs si les ouvriers sont intelligents et si la loi ne les empêche pas de s’entendre, savez-vous ce qu’ils feront? au lieu de laisser le salaîre tomber progressivement à mesure que la demande baîssera, ils retireront du marché l’excédant dont la présence motive cette baisse.
le conservateur.
Mais, encore une fois, qui consentira à se laisser retirer du marché?
l’économiste.
Personne sans doute, si la masse n’indemnise pas ceux qui se retireront; mais il y aura concurrence pour quitter le marché, si elle alloue aux ouvriers retirés une indemnité égale au salaire qu’ils recevaient en travaillant.
le conservateur.
Croyez-vous que les ouvriers occupés trouveraient leur compte à cette combinaison?
l’économiste.
Je le crois. Prenons un exemple. Cent ouvriers reçoivent un salaire de 4 fr. par jour. La demande vient à baisser d’un dixième. Si nos cent ouvriers persistent néanmoins à offrir leurs bras, de combien baissera le salaire? Il baissera, non d’un dixième, mais de près d’un cinquième (ce serait exactement d’un cinquième, si la baisse du prix n’augmentait pas toujours quelque peu la demande), il sera réduit à 3 fr. 20. La somme totale des salaires tombera de 400 fr. à 320 fr. Mais si les ouvriers [171] unis retirent du marché les dix travailleurs surabondants, en leur attribuant une indemnité égale au salaire, soit 40 fr.; au lieu de ne recevoir plus que 320 fr. (100 × 3 fr. 20), ils recevront 360 fr. (90 × 4). Au lieu de perdre 80 fr., ils ne perdront que 40 fr.
Vous voyez que les coalitions peuvent avoir leur utilité, qu’elles sont nécessitées même, accidentellement, par la nature de la marchandise que l’ouvrier met au marché. C’est donc commettre un acte de spoliation véritable à l’égard de la masse des travailleurs que de les interdire.
Si les unions d’ouvriers étaient permises, si, en même temps, les lois sur les livrets et les passeports ne gênaient point les mouvements des travailleurs, vous verriez la circulation du travail se développer rapidement sur une échelle immense. Adam Smith, examinant les causes de l’abaissement excessif des salaires dans certaines localités, disait: “Après tout ce qui s’est dit de la légèreté et de l’inconstance de la nature humaine, il paraît évidemment par l’expérience que, de toutes les espèces de bagages, l’homme est le plus difficile à transporter.” Mais les moyens de communication sont bien plus perfectionnés aujourd’hui qu’ils ne l’étaient du temps d’Adam Smith. Avec les chemins de fer, aidés des télégraphes électriques, on peut transporter rapidement et à bas prix une masse de travailleurs, d’un lieu où le travail surabonde dans un lieu où il manque.
Vous comprenez, toutefois, que ce commerce de travail ne saurait prendre le développement dont il est susceptible aussi longtemps que la loi continuera de l’entraver.
le socialiste.
Le gouvernement devrait même guider les travailleurs [172] dans leurs recherches, il devrait leur indiquer les endroits où le travail abonde et ceux où il est rare.
l’économiste.
Laissez faire l’industrie privée, elle servira beaucoup mieux les travailleurs que ne pourrait le faire le gouvernement. Donnez pleine liberté de mouvement et d’accord aux ouvriers, et ils sauront bien chercher les endroits où la vente du travail s’opère avec le plus d’avantages; des intermédiaires actifs et intelligents les seconderont au plus bas prix possible (pourvu toutefois qu’on ne s’avise pas de limiter le nombre de ces intermédiaires et de réglementer leur industrie). L’offre et la demande du travail qui gravitent naturellement l’une vers l’autre, s’équilibreront alors sans obstacles.
Laissez faire les travailleurs, laissez passer le travail, voilà toute la solution du problème du salariat1.
SEPTIÈME SOIRÉE↩
SOMMAIRE: Droit d’échanger, suite.—Échanges internationaux.—Système protecteur.—Son but.—Aphorismes de M. de Bourrienne.—Origine du système protecteur.—Système mercantile.—Arguments en faveur de la protection.—Épuisement du numéraire.—Indépendance de l’étranger.—Augmentation de la production intérieure.—Que le système protecteur a diminué la production générale.—Qu’il a rendu la production précaire et la distribution inique.
l’économiste.
Le libre échange des produits est plus entravé encore que le libre échange du travail. Le commerce des biens immobiliers est soumis à des formalités vexatoires et coûteuses, le commerce des objets mobiliers est grevé ou totalement empêché par divers impôts indirects, notamment par les octrois et les douanes.
Permettez-moi de laisser de côté, pour le moment, les lois restrictives qui ont l’impôt pour objet, et de m’occuper de celles qui ont été établies principalement pour entraver.
Je veux parler des douanes.
le conservateur.
Les douanes n’ont-elles pas été établies en vue de l’impôt?
l’économiste.
Quelquefois, mais rarement. Le plus souvent, les douanes ont été instituées uniquement pour faire obstacle aux échanges.
le socialiste.
C’est le système protecteur.
l’économiste.
Or le système protecteur prédomine dans tous les pays civilisés, sauf peut-être en Angleterre et aux États-Unis, où la douane tend à devenir purement fiscale.
Partout les douanes fiscales, celles qui n’ont d’autre but que de remplir les coffres du Trésor public sont violemment combattues par les partisans du système protecteur. Ceux-ci veulent qu’on écarte l’intérêt du Trésor dans la question des douanes pour s’occuper exclusivement de ce qu’ils appellent les intérêts de l’industrie.
le conservateur.
Ces deux intérêts sont-ils donc contradictoires?
l’économiste.
Quand on se place au point de vue du système protecteur, oui. En 1822, M. de Bourrienne, rapporteur de la loi relative à l’importation des fers étrangers, signalait clairement et acceptait pleinement cette opposition.
“Un pays, disait-il, où les droits de douane ne seraient qu’un objet de fiscalité, marcherait à grands pas vers sa décadence; si l’intérêt du fisc l’emportait sur l’intérêt général, il n’en résulterait qu’un avantage momentané que l’on payerait cher un jour.
Un pays peut jouir d’une grande prospérité et avoir peu de produits de douane; il pourrait avoir de grandes recettes de douanes et être dans un état de gêne et de [179] dépérissement; peut-être pourrait-on prouver que l’un est la conséquence de l’autre.
Les droits de douane ne sont pas un impôt c’est une prime d’encouragement pour l’agriculture, le commerce et l’industrie; et les lois qui les établissent doivent être des lois quelquefois de politique, toujours de protection, jamais d’intérêt fiscal.
Les douanes ne devant pas être dans l’intérêt du fisc, l’impôt qui résulte du droit n’est qu’accessoire.
Une preuve que l’impôt en fait de douane n’est qu’accessoire, c’est que le droit à l’exportation est presque nul, et que le législateur, en frappant d’un droit à l’importation, certains objets, a pour but qu’il n’en entre point ou le moins possible. L’augmentation ou la diminution du produit ne doit jamais l’arrêter.
... Si la loi qui vous est soumise amène une diminution dans le produit des douanes, vous devez vous en féliciter. Ce sora la preuve que vous aurez atteint le but que vous vous proposez, de ralentir des importations dangereuses et de favoriser des exportations utiles.”
Le but dont parle M. de Bourrienne a été parfaitement atteint en France. Notre tarif est essentiellement protecteur. Nos lois de douanes ont été établies de manière à empêcher, autant que possible, les marchandises étrangères d’entrer en France. Or, des marchandises qui n’entrent pas ne payent pas de droit, comme l’a spirituellement prouvé l’auteur des Sophismes économiques, M. Bastiat. Un tarif protecteur doit être le moins productif possible, pour atteindre le but qu’il se propose.
Un tarif fiscal doit être, au contraire, le plus productif possible.
le conservateur.
Mais si un tarif protecteur nuit d’un côté aux intérêts du Trésor, d’un autre côté il les sert bien davantage en protégeant l’industrie nationale contre la concurrence étrangère. La protection comble la différence qui existe naturellement entre les prix de revient de certaines denrées à l’intérieur et les prix de leurs similaires à l’étranger.
l’économiste.
C’est la doctrine de M. de Bourrienne. Nous verrons bien tout à l’heure si elle remplit son objet. Mais d’abord je remarquerai que les douanes n’ont été établies, dans les trois derniers siècles, ni pour remplir les coffres du Trésor ni pour égaliser les prix de revient des produits nationaux avec ceux des produits étrangers.
Pendant longtemps, ça été une opinion généralement répandue que la richesse résidait seulement dans l’or et l’argent. Chaque pays s’est donc ingénié à rechercher les moyens d’attirer l’or étranger, et, après l’avoir attiré, de l’empêcher de sortir. On a imaginé pour cela d’encourager l’exportation des denrées nationales, et d’entraver l’importation des denrées étrangères. Aux yeux des théoriciens du système, la différence devait inévitablement se payer en or ou en argent. Plus cette différence était forte, plus la nation s’enrichissait.
Lorsque les exportations dépassaient les importations (ou du moins lorsqu’on croyait qu’elles les dépassaient) on disait qu’on avait la balance du commerce en sa faveur.
Le système se nommait système mercantile.
le conservateur.
Vous prenez les choses de bien haut. Sachez donc que les partisans éclairés du système protecteur répudient aujourd’hui, comme vous, les illusions de la balance du commerce. Vous ne verrez jamais, en Angleterre, les défenseurs de la protection s’appuyer sur la balance du commerce. Si nous confondions le système protecteur avec le système mercantile, ferions-nous donc une distinction entre les produits similaires et les produits non similaires? Si nous nous proposions pour but d’attirer les métaux précieux dans le pays et de les empêcher d’en sortir, ne prohiberions-nous pas indistinctement toutes les denrées étrangères, afin de recevoir seulement de l’or et de l’argent en échange?—Nous nous contentons, vous le savez, de faire la guerre aux similaires, et encore pas à tous! Nous admettons volontiers les produits inférieurs aux nôtres.
l’économiste.
La générosité n’est pas grande, avouez-le. Je ne vous ai pas dit que le système mercantile se confondît avec le système protecteur, je vous ai dit qu’il en était le point de départ. On commença par entraver l’importation des marchandises étrangères, afin d’importer plus d’or et d’argent. Plus tard on pensa que ce but serait plus promptement atteint encore, si l’on excitait le développement des industries d’exportation. On favorisa, en conséquence, par des prohibitions et des primes, cette catégorie d’industries. On employa les mêmes procédés pour implanter de nouvelles industries dans le pays.
le conservateur.
C’est cela.
l’économiste.
On voulait délivrer la nation du tribut qu’elle payait à l’étranger pour les produits de ces industries. Ce fut Colbert qui développa et perfectionna de la sorte le système mercantile.
le conservateur.
Le grand Colbert! le restaurateur de l’industrie française!
l’économiste.
Je dirais plus volontiers le destructeur de l’industrie française.
Vous voyez donc que le système mercantile a engendré la protection. Le plus souvent, à la vérité, la théorie de la balance du commerce n’a été invoquée que comme un prétexte. Si la protection appauvrissait les masses, elle enrichissait certains industriels...
le socialiste.
Cela se conçoit. Si le prix des choses augmente en progression géométrique lorsque l’approvisionnement diminue en progression arithmétique, les industriels qui obtenaient l’exclusion des produits de leurs concurrents étrangers, devaient réaliser des bénéfices considérables.
l’économiste.
Ils les réalisaient en effet. Aussi, la plupart de nos grandes fortunes industrielles datent-elles de l’établissement des principaux droits protecteurs.
le conservateur.
Selon vous, nos industriels seraient donc redevables de leur fortune à la seule protection de la loi. Leur travail ne méritait apparemment aucune rémunération.
le socialiste.
Leur travail méritait la rémunération qu’il obtenait naturellement avant l’établissement des droits protecteurs. On n’attaque point ce bénéfice légitime; on attaque le gain réalisé abusivement, frauduleusement, grâce aux droits protecteurs.
le conservateur.
Frauduleusement!
l’économiste.
Le mot est trop vif1. Sans doute les industriels qui invequaient la théorie de la balance du commerce se preoccupaient, en réalité, fort peu des résultats généraux de cette théorie. Ils n’avaient guère en vue que les avantages particuliers qu’ils pouvaient en tirer...
le conservateur.
Qu’en savez-vous?
l’économiste.
Je vous en fais juge. Vous aviseriez-vous jamais de solliciter une loi qui ne favoriserait point votre intérêt particulier.
le conservateur.
Non, sans doute. Mais je ne solliciterais pas non plus une loi qui favoriserait mon intérêt particulier aux dépens de l’intérêt général.
l’économiste.
J’en suis convaincu. Voilà pourquoi je repousse ce mot frauduleusement. Les industriels d’antrefois demandaient des droits protecteurs en vue d’augmenter leurs profits; mais le système mercantile, en recommandant la protection, ne les mettait-il pas en règle avec leurs consciences?
le socialiste.
Si le système mercantile était faux, la masse de la nation s’en trouvait-elle moins spoliée?
l’économiste.
Mon Dieu! combien de gens seraient spoliés si les théories du socialisme venaient à être appliquées. Cependant il y a de fort honnêtes gens parml les socialistes.
le socialiste.
Je n’admets pas cette assimilation. Les industriels qui invoquaient les sophismes du système mercantile se préoccupaient uniquement de leur intérêt privé; à leurs yeux l’intérêt général n’était qu’un prétexte ou une formule vide de sens. Nous autres, au contraire, nous n’avons en vue que l’intérêt général.
l’économiste.
S’il en est ainsi, si l’intérêt de l’humanité seul vous [185] pousse à réclamer des mesures, dont l’application serait funeste à l’humanité, vous ètes, en effet, plus excusables que les industriels en question. Mais oseriez-vous bien affirmer que vous n’obéissez à aucune impulsion de la vanité, de l’orgueil, de l’ambition ou de la haine? Vos apôtres, sont-ils tous également doux et humbles de cœur?...
Les industriels qui réclamaient l’établissement des droits protecteurs s’appuyaient sur le système mercantile. Si l’on m’abandonne ce système, on convient donc qu’ils étaient dans le faux?
le conservateur.
Entendons-nous. Je condamne, en effet, le système mercantile. Je ne crois pas à la balance du commerce. C’est une vieille erreur économique. Mais résulte-t-il de la que les industriels eussent tort de demander des droits protecteurs?
l’économiste.
La conséquence me paraît assez logique. Si ces industriels quémandeurs de protection avaient eu de bonnes raisons à mettre en avant, pourquoi se seraient-ils servis d’une mauvaise?
le socialiste.
C’est juste!
le conservateur.
Doucement. Je n’admets pas le système mercantile dans toutes ses exagérations, mais ce système ne contient-il pas aussi quelques vérités? Le numéraire ne constitue pas toute la richesse, sans doute, mais n’est-ce pas une partie importante de la richesse? Une nation ne s’exposet-elle point à des catastrophes épouvantables, lorsqu’elle se laisse épuiser de numéraire? Le système protecteur [186] la préserve de ces sinistres désastreux, en empèchant des importations exagérées de produits étrangers.
Selon vous, la protection a pour résultat unique de permettre aux industriels nationaux de vendre à gros bénéfice des marchandises qu’ils vendaient auparavant à petit bénéfice. Mais vous avez oublié de dire que la protection, en implantant de nouvelles industries dans le pays, affermit l’indépendance nationale, et donne un emploi fructueux à des capitaux et à des bras auparavant inactifs; vous avez oublié de dire que la protection accroît la puissance et la richesse d’un pays.
l’économiste.
Vous venez d’exposer les trois principaux arguments du système protecteur. Permettez-moi de laisser le premier de côté; je le reprendrai lorsque nous nous occuperons de la monnaie. Quant à l’argument de la dépendance de l’étranger, il a été cent fois percé à jour. Et vous-même, si vous repoussez la théorie de la balance du commerce, si vous admettez que les produits s’achètent avec des produits, ne devez-vous pas admettre aussi qu’entre deux nations, trafiquant ensemble, la dépendance est mutuelle?
le conservateur.
Il faut tenir compte de la nature des denrées échangées. Est-il prudent, par exemple, de dépendre de l’étranger pour une denrée de première nécessité?
l’économiste.
L’Angleterre est, vous en conviendrez, une nation essentiellement prudente. Cependant l’Angleterre s’est volontairement exposée à dépendre de la Russie et de l’Union américaine, ses deux grandes rivales, pour ses [187] approvisionnements de blé. C’est apparemment qu’elle n’a pas considéré l’argument de la dépendance de l’étranger comme bien valable. Je crois inutile d’insister sur ce point1.
Je passe à votre troisième argument qui a beaucoup plus de valeur, et dont la réfutation est bien plus difficile. Vous dites que le système protecteur, en déterminant l’importation de certaines industries, a augmenté l’emploi des capitaux et des bras, et développé ainsi la richesse nationale.
le conservateur.
Cela me paraît incontestable, et puisque vous aimez les exemples je vais vous en citer un. L’Angleterre tirait autrefois ses cotonnades de l’Inde. Un jour, elle imagina de prohiber les indiennes. Qu’arriva-t-il? Le marché se trouvant dégarni de la plus grande partie de ses approvisionnements ordinaires, la fabrication et la vente des [188] cotonnades indigènes donnèrent aussitôt de gros bénéfices. Les capitaux et les bras s’y portèrent en masse. L’Angleterre, qui produisait naguère à peine quelques milliers de yards de cotonnades, en fabriqua des milliards. Au lieu de quelques centaines de fileurs et de tisserands en chambre, elle en eut des milliers qui peuplèrent d’immenses manufactures. Sa richesse et sa puissance s’accrurent soudainement dans des proportions énormes. Oserez-vous prétendre, après cela, que la prohibition des fils et des cotonnades de l’Inde ne lui a pas été avantageuse?
le socialiste.
Mais, d’un autre côté, les Indiens, qui perdirent le débouché de l’Angleterre, furent ruinés. Des millions d’hommes se trouvèrent privés d’ouvrage sur les rives de l’Indus et du Gange. Tandis que les manufacturiers de Manchester jetaient les assises de leurs fortunes colossales, tandis que les ouvriers attirés par des salaires inusités, affluaient vers cette métropole nouvelle de la manufacture de coton, les ateliers de l’Inde tombaient en [189] ruine, et les ouvriers indous étaient moissonnés par la misère et la famine.
l’économiste.
Le fait est vrai. Le débouché des fileurs et des tisserands de l’Inde venant à se fermer, ces ouvriers furent obligés de se rabattre sur les autres branches d’industrie. Malheureusement, celles-ci se trouvaient déjà suffisamment pourvues de bras. Le taux des salaires dans l’Inde baissa donc au-dessous des frais de production du travail, c’est-à-dire au-dessous de la somme nécessaire à l’ouvrier pour se maintenir et se perpétuer. Il baissa... jusqu’à ce que la misère, la famine et les épidémies, qui sont leurs inséparables compagnes, ayant fait leur office, l’équilibre entre l’offre et la demande des bras commença à se rétablir et le salaire à remonter.
le socialiste.
Ainsi la prospérité des manufacturiers anglais eut pour marche-pied les cadavres des travailleurs de l’Inde.
le conservateur.
Que voulez-vous? Le proufict de l’un fait le dommage de l’autre, disait Montaigne.
le socialiste.
Si le système protecteur ne peut s’établir sans ce funèbre cortége de ruines et de misères, c’est un système immoral, odieux. Je le repousse.
le conservateur.
Mon Dieu! si la Providence n’avait fait de l’humanité tout entière qu’une seule nation, un système qui abaisserait certains membres de cette nation immense pour en élever d’autres, qui ruinerait les Indous pour enrichir les Anglais, ce système pourrait être, en effet, qualifié d’immoral [190] et d’odieux. Mais la Providence n’a pas placé qu’un seul peuple dans le monde; elle a semé les nations comme des grains de blé, en leur disant: Croissez et prospérez!—Maintenant que les intérêts de ces nations diverses soient divers ou opposés, c’est un malheur, mais qu’y faire? Chaque peuple doit naturellement s’attacher à augmenter sa puissance et sa richesse. Le système protecteur est un des moyens les plus énergiques et les plus sûrs qu’on puisse employer pour obtenir ce double résultat. On se sert donc du système protecteur! Sans doute, il est fâcheux de dépouiller les ouvriers étrangers de leurs moyens d’existence. Mais l’intérêt du Travail National ne doit-il pas passer avant tout le reste? S’il suffit d’une simple mesure legislative pour donner du travail et du pain aux travailleurs nationaux, le législateur n’est-il pas tenu d’adopter cette mesure sans rechercher si les habitants des bords du Gange ou de l’Indus en souffriront? Chacun ne doit-il pas s’occuper de ses pauvres avant de songer à ceux d’autrui? Et si cet exemple est universellement suivi, si chaque nation adopte la législation qui convient le mieux à ses intérêts particuliers, toutes choses n’iront-elles pas, en définitive, le mieux possible? Tous les peuples ne jouiront-ils pas de toute la somme de prospérité dont ils peuvent jouir?... Vous voyez donc que le système protecteur n’est immoral et odieux que lorsqu’on l’examine à la superficie. Vous voyez que les hommes d’État auraient grandement tort de prêter les mains à votre faux cosmopolitisme.
l’économiste.
M. Huskisson prononça un jour, au sein du Parlement anglais, ces paroles remarquables: “Le système protecteur [191] est une invention dont le brevet commence à expirer; il a déjà perdu une grande partie de sa valeur, depuis que toutes les nations s’en sont emparées.” Il me suffira de commenter ces paroles de l’un des plus illustres promoteurs de la liberté commerciale en Angleterre pour détruire vos objections.
Qu’arriva-t-il, en effet, lorsque l’Angleterre eut ravi, au profit des fabricants de Manchester et de leurs ouvriers, l’industrie des tisserands de Surate, de Madras et de Bombay? Il arriva que toutes les autres nations, séduites par cet avantage apparent, voulurent à leur tour, ravir des industries à l’étranger. La France, qui ne produisait qu’une partie du coton, de la laine, du fer, de la poterie, etc., nécessaires à sa consommation, voulut produire tout le coton, toute la laine, tout le fer, toute la poterie qu’elle pouvait consommer. L’Allemagne et la Russie de même. Il n’y eut pas jusqu’aux plus petits pays, la Belgique, la Hollande et le Danemark, qui ne cherchassent à ravir des industries à l’étranger. Bref, l’entrainement vers le système protecteur fut général.
Ce qui en résulta, vous le savez! Il en résulta que les ravisseurs d’industries se virent, à leur tour, ravir leur propre travail. L’Angleterre, qui avait enlevé à l’Inde l’industrie des cotonnades, perdit, avec une partie de cette industrie même, plusieurs de ses autres branches de production. La France, qui avait ravi, à l’exemple de l’Angleterre, plusieurs industries étrangères, se vit ravir aussi une partie des siennes. L’Allemagne notamment se protégea, en guise de représailles, contre ses soieries, ses articles de modes et ses vins.... Vous enleviez à votre voisin une partie de ses débouchés, il vous enlevait [192] une partie des vôtres. C’était un pillage universel.
A l’époque où ce pillage d’industries s’opérait avec le plus d’activité, une brochure fort spirituelle fut publiée en Angleterre. On voyait, au frontispice, une vignette représentant une barraque de singes. Une demi-douzaine de singes, logés dans des compartiments séparés, avaient devant eux leur pitance du jour. Mais, au lieu de manger en paix la portion que le maître de la ménagerie leur avait libéralement servie, chacun de ces malfaisants animaux s’efforçait de dévaliser la part de ses voisins, sans s’apercevoir que ceux-ci lui rendaient la pareille. Chacun se donnait beaucoup de peine pour ravir à ses voisins une subsistance qu’il pouvait prendre aisément devant lui, et une grande quantité d’aliments se perdaient dans la bagarre.
le conservateur.
Mais les plus forts ne devaient-ils pas avoir l’avantage dans la lutte? Ne pouvaient-ils pas s’emparer de la part d’autrui, tout en préservant la leur?
l’économiste.
Entre singes, la chose est possible; elle ne l’est pas entre nations. Aucune nation n’est assez puissante pour dire aux autres: Je me protégerai contre vos industries, mais je vous défends de vous protéger contre les miennes; je vous ravirai une partie de vos débouchés, mais je vous défends de toucher aux miens. Si une nation s’avisait de tenir un semblable langage, toutes les autres s’uniraient pour la mettre en interdit, et la coalition demeurerait certainement la plus forte.
le socialiste.
De sorte qu’en fin de compte personne ne gagne à ces déprédations mutuelles, et que les pillards y gagnent [193] d’autant moins que le pillage devient plus géneral.
l’économiste.
Précisément.
le conservateur.
Mais lorsque le système protecteur a été adopté par une nation, toutes les autres ne sont-elles pas tenues de l’adopter aussi? Doivent-elles laisser piller leurs industries sans user de représailles?
l’économiste.
Ceci est un point à debattre.
Mais je tiens, avant tout, à complétement vous démontrer que le système protecteur a été nuisible au développement général de la production.
Examinons donc comment les choses se passaient à l’époque où fut établi le système protecteur. Chaque nation se procurait chez ses voisins une partie des choses nécessaires à sa consommation et leur fournissait d’autres produits en retour.
Quels produits fournissait-elle, et quels produits recevait-elle?
Elle fournissait les choses que la nature du sol et le génie particulier de ses producteurs lui permettaient de produire avec le moins d’efforts; elle recevait les choses qu’elles n’aurait pu produire sans y consacrer plus d’efforts.
Voilà, n’est-il pas vrai, quel devait être l’état des échanges internationaux avant la naissance du système producteur?
le socialiste.
C’est la marche naturelle des choses.
l’économiste.
Que fit le système protecteur? Augmenta-t-il la somme totale de la production? Pas plus que les singes pillards de la brochure anglaise n’augmentaient la somme de leurs provisions, en se dérobant mutuellement leurs pitances. Jugez-en.
L’Angleterre dérobait à l’Inde l’industrie du coton; si l’Angleterre produisait d’autant plus, l’Inde produisait d’autant moins. La France dérobait à l’Angleterre une partie de l’industrie du lin; si la France produisait d’autant plus, l’Angleterre produisait d’autant moins. L’Allemagne dérobait à la France une partie de l’industrie des soies; si l’Allemagne produisait d’autant plus, la France produisait d’autant moins... Le système protecteur n’avait donc et ne pouvait avoir pour résultat d’augmenter la masse générale de la production.
Je dis, maintenant, que ce système a eu et a dû avoir pour résultat d’abaisser la masse générale de la production.
Voici comment:
Pourquoi l’Angleterre se protégeait-elle contre les cotonnades de l’Inde, les soieries de la France et les draps de la Belgique? Parce que ces denrées étrangères envahissaient une partie de son marché. Pourquoi l’envahissaient-elles? Parce qu’elles étaient, toutes différences de qualité compensées, à meilleur marché que leurs similaires anglais. Si elles n’avaient point été à meilleur marché, elles ne seraient pas entrées en Angleterre.
Cela posé, quel fut le premier résultat de la loi qui interdit à ces denrées l’accès du marché anglais? Ce fut de creuser un déficit factice dans l’approvisionnement intérieur. [195] Plus large était ce déficit, plus haut devait naturellement s’élever le prix des marchandises indigènes.
Avant l’établissement du système producteur, la consommation annuelle du drap en Angleterre était, je suppose, de vingt millions d’aunes, dont l’étranger fournissait la moitié.
le socialiste.
Comment l’Angleterre pouvait-elle fournir le reste, si les draps étrangers étaient à plus bas prix que les siens?
l’économiste.
Il y a une multitude de variétés de la même denrée. Il y a, par exemple, un grand nombre de qualités de draps. L’Angleterre fabrique certaines de ces qualités à plus bas prix que la Belgique; la Belgique en fabrique d’autres à plus bas prix que l’Angleterre.
Je reprends. Les draps étrangers viennent à être prohibés en Angleterre. L’approvisionnement étant réduit de moitié, de combien le prix va-t-il hausser? Il haussera en progression géométrique. S’il était de 15 fr. l’aune, il pourra monter jusqu’à 60 fr.
Mais lorsque le prix d’une denrée vient tout à coup à hausser, qu’arrive-t-il? A moins que cette denrée ne soit de toute première nécessité, auquel cas la demande ne saurait sensiblement baisser, la hausse du prix amène dans la consommation une réduction plus ou moins considérable, selon la nature de la denrée. Si la demande de draps était de vingt millions d’aunes à quinze francs, elle ne sera guère que de quatre ou cinq millions d’aunes à soixante francs. Le prix baissant alors, la demande haussera de nouveau. Ces fluctuations se prolongeront presque indéfiniment. Toutefois, après avoir parcouru les degrés [196] extrêmes de l’échelle, elles se rapprocheront successivement d’un point central, qui est la somme des frais de production du drap en Angleterre.
Vous savez déjà pourquoi les prix ne sauraient demeurer longtemps en dessus, ni en dessous des frais de production d’une denrée.
Mais les frais de production des draps anglais sont plus élevés que ceux des draps étrangers. Ils le sont et doivent l’être, sinon la protection serait parfaitement inutile. Quand on peut vendre à plus bas prix que ses concurrents on n’a pas besoin de protection pour les écarter du marché; ils se retirent d’eux-mêmes. Les frais de production des draps étrangers étant de 15 fr., ceux des draps anglais seront, je suppose, de 18 fr. C’est donc vers ce niveau que le prix du drap gravitera désormais en Angleterre. Mais, au prix de 18 fr. on consomme moins de draps qu’au prix de 15 fr. Si l’on en consommait vingt millions d’aunes à l’époque de la libre introduction, on n’en consommera plus que seize ou dix-sept millions après la prohibition.
le conservateur.
Soit! mais l’augmentation de la production nationale qui aura monté de dix millions d’aunes à dix-sept millions ne compensera-t-elle pas, et au delà, la légère diminution de la consommation?
l’économiste.
La question n’est pas là pour le moment. Le système producteur a-t-il pour résultat de diminuer ou d’augmenter la production générale, voilà la question. Or, si la production des draps anglais s’est augmentée de sept millions, en revanche celle des draps étrangers a baissé [197] de dix, ce qui fait bien, je pense, une diminution de trois millions dans la production générale.
le conservateur.
Oui, mais cette diminution n’est que temporaire. L’augmentation d’une industrie dans un pays amène toujours un perfectionnement dans les procédés de fabrication. Où le prix de revient était de 18 fr., il tombe promptement à 17, 16, 15 fr., ét même au-dessous. La consommation se relève alors au niveau où elle était avant la prohibition; elle finit même par le dépasser.
l’économiste.
En attendant, je constate qu’il y a eu hausse dans le prix, diminution corrélative de la consommation, partant baisse de la production générale. Je constate que le système protecteur a eu et dû avoir pour premier résultat de diminuer la production générale. C’est un fait désormais acquis à la discussion.
Je prétends, en outre, que la baisse générale de la production n’est pas accidentelle, temporaire, je prétends qu’elle est perpétuelle... entendons-nous, qu’elle dure autant que la protection même.
Pourquoi les industriels anglais ne produisaient-ils pas les vingt millions d’aunes de draps consommés dans leur pays? Parce que l’étranger produisait à meilleur marché, à moins de frais, la moitié de ces vingt millions d’aunes.
Où est la raison de cette différence des frais de production d’une même denrée d’un pays à un autre? Elle est dans les différences naturelles du climat, du sol, du génie des peuples. Or, ces différences naturelles une loi de douanes les supprime-t-elle? Parce qu’on aura décrété [198] que les draps belges ou français n’entreront plus en Angleterre, aura-t-on donné aux producteurs anglais les moyens de fabriquer à aussi bas prix et aussi bien ces qualités particulières de draps? La loi aura-t-elle doté le climat, les eaux, le sol, les travailleurs eux-mêmes, des qualités ou des aptitudes nécessaires à ce genre particulier de production?... Mais si la loi de douanes n’a pas opéré cette transformation merveilleuse, les variétés de draps que l’Angleterre retirait de la France et de la Belgique ne seront-elles pas produites plus chèrement et plus mal par les Anglais?
le conservateur.
Souvent, ces différences sont peu sensibles. Le progrès résultant du développement instantané d’une industrie sur le sol national suffit alors pour les compenser, et au delà.
l’économiste.
Voyons comment les choses se passent dans la pratique.
On interdit brusquement le marché national à une certaine catégorie de produits étrangers. L’Allemagne, par exemple, établit un droit prohibitif sur les bronzes et la quincaillerie de Paris. Les fabricants de bronze et les quincailliers de l’Allemagne se mettent, en conséquence, a fabriquer des articles dont ils ne s’étaient point occupés jusque-là. Avant d’avoir achevé leur apprentissage de cette fabrication nouvelle, ils font une foule d’écoles et ils livrent aux consommateurs des produits imparfaits et chers. Des années se passent avant qu’ils n’atteignent le niveau de l’industrie étrangère, quand ils l’atteignent.
Je suppose, maintenant, que la prohibition n’eût pas [199] été établie; la quincaillerie et l’industrie des bronzes seraient-elles demeurées stationnaires à Paris?
Quelle a été l’influence de la loi de douane allemande sur ces deux industries parisiennes? En les privant d’une partie de leur débouché, cette loi les a fait rétrograder ou du moins elle a ralenti leurs progrès. Vous savez, en effet, comment procède le progrès industriel. Il procède par la division du travail. Plus le travail se divise, plus les produits se perfectionnent et se multiplient.
Or, dans quelle circonstance la division du travail peut-elle être portée à son maximum? N’est-ce pas lors-que le marché est le plus étendu possible?
Lorsqu’un debouché vient à se fermer, lorsque l’étendue du marché vient à se réduire, peu de fabricants cessent tout à fait de travailler, mais la plupart réduisent leur fabrication. Réduisant leur fabrication ils ne peuvent plus autant diviser le travail; ils sont obligés d’employer des procédés moins économiques
Le progrès de la quincaillerie et de l’industrie des bronzes s’est donc ralenti en France. S’est-il activé en Allemagne, de manière à compenser cette perte dans la production générale? Voyons. Plusieurs années se sont écoulées avant que les quincailliers et les bronziers allemands aient atteint le niveau où se trouvaient leurs rivaux français, à l’époque de l’établissement de la prohibition. Pendant ce temps, l’industrie française aurait continué de progresser. Naturellement plus favorisée que sa rivale, n’aurait-elle pas progressé davantage, au grand profit de la consommation générale?
Voulez-vous une dernière preuve.
Le système protecteur est universellement en vigueur [200] depuis un demi-siècle. A coup sûr, les industries augmentées à coup de tarif ont eu le temps d’égaler et de dépasser leurs anciennes rivales. Les ont-elles dépassées? Les ont-elles même égalees? Sont-elles en état de braver la concurrence étrangère? Consultez-les, et vous verrez quelle sera leur réponse?
le socialiste.
Oh! elles vous répondront unanimement, comme elles l’ont fait en 1834, qu’elles ont plus que jamais besoin de protection.
l’économiste.
Ce qui signifie qu’elles ne peuvent produire encore a aussi bas prix et aussi bien que leurs rivales, malgré une protection d’un demi-siècle.
En déplaçant une foule d’industries à contre-sens de la nature, le système protecteur a donc eu et dû avoir pour résultat d’augmenter les frais de production de toutes choses, ou, ce qui revient au même, de retarder l’abaissement naturel de ces frais.
Or, c’est une loi de la nature que le prix courant des choses tende toujours à s’équilibreŕ avec les frais de production, et c’est une autre loi de la nature que la consommation diminue à mesure que le prix s’élêve.
Que le système protecteur ait augmenté les frais de production des choses, je vous l’ai, je crois, mathématiquement prouvé. Que l’augmentation des frais de production entraîne celle des prix, et celle-ci la diminution de la consommation, partant de la production, cela n’est pas moins exactement établi. Je suis donc fondé à conclure que le système protecteur a diminué la richesse générale du monde.
le conservateur.
Cette démonstration me paraît, je l’avoue, difficile à réfuter. Mais enfin, la richesse générale a pu être diminuée et la richesse particulière de certains pays être augmentée. Cette éventualité admise, les pays favorisés n’ont-ils pas eu raison d’adopter le système protecteur?
l’économiste.
Mais l’éventualité dont vous parlez n’est guère admissible, convenez-en. Si l’adoption du système protecteur a nécessairement occasionné une diminution, une perte dans la richesse de l’ensemble des nations, cette perte générale a dû, nécessairement aussi, se résoudre en des pertes particulières. Si tout le monde a perdu, il est difficile que quelques-uns aient gagné.
L’Angleterre, que vous avez en vue, a ravi sans doute beaucoup d’industries à l’étranger, mais l’étranger lui en a ravi beaucoup aussi. Si l’Angleterre n’avait pas adopté le système protecteur, elle aurait produit peut-être moins de blé, de cotonnades et de soieries, mais elle aurait produit plus de fer, d’acier, d’étain, de machines, etc. Sa part dans le dividende général serait peut-être relativement plus faible, mais le dividende étant plus élevé cette part serait effectivement plus forte.
Mais le système protecteur n’a pas seulement diminué l’abondance de la richesse, il a rendu encore la production nécessairement instable et la répartition nécessairement inique.
Si ce système était appliqué partout d’une manière complète et stable, si une barrière infranchissable séparait à jamais chaque nation de ses voisines, on réussirait peut-être à éviter les perturbations dans ces marchés [202] toujours les mêmes. Mais le système protecteur n’est nulle part appliqué d’une manière stable et complète, et il ne saurait l’être. Toutes les nations ont des relations au dehors, et elles ne peuvent se passer d’en avoir.
Or, ces relations indispensables sont journellement troublées par les modifications apportées aux douanes des quarante ou cinquante nations qui ont des douanes. Tantôt c’est un droit que l’on élève, tantôt c’est un droit que l’on abaisse; tantôt c’est une prime que l’on établit, tantôt c’est une prime que l’on retire. Quel est le résultat de ces modifications incessantes des tarifs? Une diminution de travail d’un côté, une augmentation de travail d’un autre. Toute loi qui ferme ou rétrécit un débouché ravit leurs moyens d’existence à des centaines ou à des milliers de travailleurs, en édifiant, ailleurs, des fortunes colossales... Et ces lois, on les compte par milliers depuis l’établissement du système protecteur.
Soumise à ces perturbations incessantes, l’industrie devient essentiellement précaire. On a consacré un capital considérable à fonder une manufacture de draps ou de soieries. Des centaines d’ouvriers y trouvent des moyens d’existence. Soudain, l’exhaussement d’un tarif étranger ferme le débouché. On est obligé de renvoyer les ouvriers et de laisser rouiller le matériel, ou de le vendre au prix du vieux fer. Mais le mal ne s’arrête pas là. Lorsqu’une manufacture vient à se fermer, toutes les industries qui l’alimentaient sont atteinte à leur tour. Celles-ci étant frappées répandent autour d’elles la contagion du mal. La perturbation venue d’un point isolé, se prolonge successivement sur toute la surface du monde [203] industriel. On est frappé et, le plus souvent, on ignore même d’où est parti le coup.
Si un tarif est abaissé, la production générale étant augmentée, il y a bénéfice définitif; mais si un tarif est relevé, il y a, de même, perte définitive. Cette perte se rêsout en une diminution des profits et des salaires. Le capitaliste perd son capital, le travailleur perd son travail; l’un est inévitablement voué à la ruine, l’autre à la mort.
le socialiste.
C’est affreux.
l’économiste.
Tout en produisant de ces résultats d’un côté, la loi enrichit de l’autre, rapidement, comme d’un coup de dé, les industriels devenus maîtres du marché. A la vérité, leur prospérité ne dure guère. Les capitaux et les bras se portent en foule vers les industries protégées. Souvent même, ils s’y portent avec excès. Autres perturbations, autres ruines!
Sous ce régime, l’industrie n’est plus qu’un jeu de hasard où les uns s’enrichissent, où les autres se ruinent selon les caprices de la fortune; où le laborieux entrepreneur, naguère ouvrier, voit se dissiper soudainement le fruit de toute une vie de travail et d’épargne, tandis qu’ailleurs de riches capitalistes voient se doubler ou se tripler leurs capitaux.
Mais on ne meurtrit jamais impunément l’humanité. Un long cri d’amertume, de colère retentit, un jour, aux oreilles des rares privilégiés de ce systême. Malheureusement ceux qui le poussèrent et ceux qui s’en firent les échos n’aperçurent point la cause du mal. M. de Sismondi [204] qui, le premier, exprima éloquemment la plainte universelle, ne sut point remonter à la source de tant de perturbations désastreuses. Ses successeurs socialistes firent pis encore: ils attribuèrent le mal à des causes apparentes qui étaient précisément l’opposé des causes réelles; ils imputèrent à la propriété des maux qui provenaient précisément d’atteintes portées au libre exercice ou à la libre disposition de la propriété.
le socialiste.
Oui, ce système a dû causer de grands maux, et nous n’en avons, peut-être, pas assez tenu compte.
le conservateur.
On aurait mieux fait de s’en passer, j’en conviens. Mais puisqu’on l’a adopté ne faut-il pas bien le conserver? La plupart de nos industries ont grandi sous l’aile de la protection, ne l’oublions pas? Ne serait-il pas imprudent de la leur ravir?
l’économiste.
Si le système protecteur est mauvais, il faut évidemment y renoncer. Déjà l’Angleterre nous a donné l’exemple du retour à la liberté commerciale. Imitons-la!1
le socialiste.
Par quoi remplaceriez-vous les tarifs protecteurs?
le conservateur.
Par des tarifs fiscaux, sans doute?
le socialiste
Au point de vue de la stabilité de la production, les tarifs fiscaux ne sont guère préférables aux autres. On les modifie tout aussi fréquemment. En outre, un tarif fiscal est toujours plus ou moins protecteur.
l’économiste.
Je ne l’ignore pas. Aussi n’accepterais-je un tarif fiscal que comme un pis-aller. C’est moins mauvais qu’un tarif protecteur, mais c’est encore mauvais. Il faut arriver à la suppression de toute espèce de tarifs, à la pleine liberté des échanges, au respect absolu du droit d’échanger, si l’on veut donner à la production toute la fécondité et toute la stabilité possibles.
Remarquez bien, du reste, que ce résultat ne pourra être complétement atteint avant la suppression entière de toutes les douanes. Aussi longtemps qu’une douane restera debout, elle occasionnera des perturbations et des ruines dans toute l’étendue de l’arène de la production.
Cependant, que les principales nations industrielles renoncent à ces vieux instruments de guerre, et l’amélioration sera déjà sensible.
le socialiste.
Que de réformes à faire!
l’économiste.
Oui, que de réformes véritables!
HUITIÈME SOIRÉE↩
SOMMAIRE: Atteintes portées à la propriété intérieure.—Industries monopolisées ou subventionnées par l’État.—Fabrication de la monnaie.—Nature et usage de la monnaie.—Pourquoi un pays ne saurait être épuisé de numéraire.—Voies de communication.—Exploitées chèrement et mal par l’État.—Transport des lettres.—Maîtres de postes.—Que l’intervention du gouvernement dans la production est toujours nécessairement nuisible.—Subventions et priviléges des théâtres.—Bibliothèques publiques.—Subvention des cultes.—Monopole de l’enseignement.—Ses résultats funestes.
l’économiste.
On n’atteint pas seulement la propriété extérieure, ou atteint encore la propriété de l’homme sur sa personne, sur ses facultés, sur ses forces, la propriété intérieure.
On viole la propriété intérieure, lorsqu’on défend à l’homme d’utiliser ses facultés comme bon lui semble, lorsqu’on lui dit: Tu n’exerceras point telle industrie, ou, si tu l’exerces, tu seras assujetti à certaines gênes, tu seras tenu d’observer certains règlements. Le droit naturel que tu possèdes d’employer tes facultés de la manière la plus utile à toi et aux tiens, ce droit sera diminué ou réglementé.—En vertu de quel droit?—En vertu du droit supérieur de la société.—Mais si je ne fais de mes [207] facultés aucun usage nuisible?—La société est convaincue que tu ne saurais exercer librement certaines industries sans lui nuire.—Mais si la société se trompe? Si en appliquant librement mes facultés à n’importe quelle branche de la production je ne lui porte point dommage?—Eh bien, tant pis pour toi! la société ne saurait avoir tort.
Cependant, en se trompant ainsi, la société ne s’inflige-t-elle pas, à elle-même, un dommage? Des règlements qui entravent l’activité du producteur n’ont-ils pas pour résultat inévitable, certain, de diminuer la production en augmentant le prix des produits? Si une industrie est réglementée, vexée, en présence d’autres industries demeurées libres, ne se portera-t-on pas de préférence dans celles-ci? ou, si l’on se résigne à exercer l’industrie réglementée, ne rejettera-t-on pas sur les consommateurs une partie du fardeau des vexations et des règlements?
Laissons de côté les régimes où toutes les industries sont réglementées, ceux encore où aucun travailleur ne peut disposer librement de ses facultés, où le travail est encore esclave. Grâce à Dieu, ces monstruosités commencent à devenir rares. Occupons-nous seulement de ces régimes bâtards où certaines industries sont libres, où d’autres sont réglementées, où d’autres encore sont accaparées par l’État.
Tel est le régime déplorable qui prévaut actuellement en France.
le conservateur.
Vous prétendez que le gouvernement nuit à la société en réglementant certaines branches de la production, et en exerçant, lui-même, certaines industries?
l’économiste.
Je le prétends.
Toute réglementation, aussi bien que tout monopole, se traduisent en une augmentation directe ou indirecte du prix des produits, partant en une diminution de la production.
Le gouvernement produit plus chèrement et plus mal que les particuliers; en premier lieu, parce qu’en exerçant plusieurs industries, il méconnaît, sinon dans les détails, du moins dans la direction supérieure, le principe économique de la division du travail; en second lieu, parce qu’en s’attribuant, directement ou indirectement, le monopole d’une industrie, il méconnaît le principe économique de la libre concurrence.
le conservateur.
Ainsi donc, le gouvernement fabrique la monnaie, construit les routes et les chemins de fer, distribue l’enseignement plus chèrement et plus mal que ne feraient les particuliers.
l’économiste.
Sans aucun doute.
le conservateur.
Même la monnaie!
l’économiste.
La monnaie comme toute autre denrée.
le conservateur.
N’est-ce pas un attribut de la souveraineté que de battre monnaie?
l’économiste.
Pas plus que de fabriquer des clous ou des boutons de guêtres. Pourquoi la fabrication de la monnaie serait-elle [209] un attribut de la souveraineté? Qu’est-ce que la monnaie? un instrument à l’aide duquel l’échange des valeurs s’opère.....
le socialiste.
Il y a des échanges directs. Une multitude d’échanges s’opèrent aussi avec du papier.
l’économiste.
Il y a fort peu d’échanges directs, et il y en aura de moins en moins, à mesure que la division du travail s’etendra davantage. Un homme qui passe sa vie à fabriquer la dixième partie d’unc épingle ne saurait échanger directement ce produit contre les choses dont il a besoin. Il est obligé de le troquer d’abord contre une marchandise intermédiaire, laquelle puisse toujours aisément s’échanger contre toutes choses. Cette marchandise intermédiaire doit être durable, facile à diviser et à transporter. Divers métaux, l’or, l’argent, le cuivre, réunissent, à différents degrés, ces qualités. Voilà pourquoi on en a fait des instruments d’échanges, de la monnaie.
Quant au papier, il peut aussi faire office de monnaie, mais à la condition de représenter une valeur positive, une valeur déjà créée, une valeur concrétée dans un objet existant, disponible, et pouvant servir de monnaie.
le conservateur.
Voilà ce que ne comprennent pas malheureusement les partisans du papier-monnaie.
l’économiste.
Mais vous-même, vous me faites l’effet de n’avoir pas une idée bien juste de la monnaie, lorsque vous dites que la fabrication de ce véhicule des échanges est un attribut de la souveraineté. Ce n’est point parce qu’un souverain [210] a marqué une pièce d’or on d’argent à son effigie, que cette pièce a une valeur, c’est parce qu’elle contient une certaine quantité de travail. Qu’elle soit fabriquée et marquée par un gouvernement ou par un particulier, cela importe peu. Je me trompe! des particuliers la fabriqueraient mieux, à meilleur marché; ils auraient soin aussi de mieux pourvoir le marché de l’assortiment de monnaies que réclament les besoins de la circulation. En outre, si, dès l’origine, la monnaie avait été fabriquée par des particuliers, les falsifications eussent été plus rares.
le socialiste.
Qu’en pouvez-vous savoir?
l’économiste.
Les falsifications étant commises autrefois par ceux-là mêmes qui avaient le droit exclusif de réprimer toute espèce de rapines et de fraudes, demeuraient nécessairement impunies. A quoi il faut ajouter que le public n’avait aucun moyen de s’y soustraire, puisque les souverains s’attribuaient aussi le droit exclusif de battre monnaie.
Si la fabrication des monnaies était demeurée libre, des particuliers l’auraient entreprise comme on entreprend toute industrie qui peut donner un bénéfice.
le conservateur.
La fabrication des monnaies peut-elle donner un bénéfice?
l’économiste.
Comme toute autre fabrication. En France, le gouvernement fait payer trois francs le monnayage d’un kilogramme d’argent, et neuf francs le monnayage d’un kilogramme d’or. Il couvre à peu pres les frais de production [211] de la monnaie. En Angleterre, le monnayage est gratuit.
le conservateur.
Ah! trouvez-moi donc un particulier qui consente à travailler gratis?
l’économiste.
Défiez-vous, de grâce, de ces mots gratis, gratuit, gratuité. Rien de ce qui coûte du travail n’est gratuit; seulement, il y a différentes manières de rémunérer ce travail. En France, les consommateurs de monnaie en payent directement la fabrication; en Angleterre, les contribuables payent ces frais de fabrication, indirectement, sous forme d’impôts.
Laquelle de ces deux manières de rémunérer un travail est la plus économique et la plus équitable? C’est évidemment la première. En France, la fabrication de la monnaie coûte annuellement une certaine somme, un million par exemple. Les particuliers qui font transformer des lingots en monnaie remboursent directement ce million. Si le monnayage était gratuit comme en Angleterre, les frais de production en seraient payés par les contribuables. Mais la perception des impôts ne s’opère pas pour rien; en France, elle ne s’élève pas à moins de treize pour cent du principal. Si donc notre monnayage etait gratuit, il coûterait non pas un million, mais onze cent trente mille francs.
Voilà pour l’économie de la gratuité.
Voici maintenant pour l’équité de la production gratuite. Qui doit payer une denrée? Celui qui la consomme, n’est-il pas vrai?—Qui doit, en conséquence, supporter [212] les frais de fabrication de la monnaie? Ceux qui se servent de la monnaie.
le conservateur.
Mais tout le monde s’en sert.
l’économiste.
Avec cette différence que certains individus, les plus riches, s’en servent beaucoup; et que d’autres, les plus pauvres, s’en servent peu. Quand le monnayage se paye directement, il est remboursé par les consommateurs de numéraire en proportion de leur consommation; quand il se paye indirectement, quand il est gratuit, il est remboursé par tout le monde, par les petits consommateurs comme par les gros, souvent par les uns plus que par les autres. Cela dépend de l’assiette de l’impôt. Estce de la justice?
Si le gouvernement monnaye gratis, les frais de production de la monnaie se trouvent portés à leur maximum; s’il se fait rembourser directement le monnayage, il fabrique tout de même plus cher que l’industrie privée, parce que ce n’est pas sa spécialité de fabriquer de la monnaie.
Si le monnayage était demeuré libre, il aurait vraisemblablement été exécuté par de grandes maisons d’orfévrerie. Sous ce régime, les consommateurs pouvant refuser la monnaie des falsificateurs, et, de plus, leur faire infliger une punition exemplaire, les falsifications eussent été excessivement rares.
le socialiste.
Mais, en se coalisant pour rendre l’approvisionnement de monnaie inférieur à la demande, vos fabricants libres [213] n’auraient-ils point réalisé des bénéfices énormes aux dépens du public?
l’économiste.
Non. D’abord parce qu’on peut, à la rigueur, se servir de lingots à défaut de monnaie; ensuite, parce que la concurrence libre ne tarde guère à briser les coalitions les plus fortes. Lorsque l’équilibre entre l’approvisionnement et la demande vient à être rompu, les prix donnent bientôt un bénéfice tel que la concurrence s’en mêle. On se met alors à produire en dehors de la coalition, jusqu’à ce que le prix courant retombe au niveau des frais de production.
le socialiste.
Ah! c’est toujours la même loi.
l’économiste.
Toujours. Et cette loi explique aussi pourquoi un pays ne saurait jamais être épuisé de numéraire. Quand les besoins de la circulation viennent à dépasser l’approvisionnement du numéraire, le prix des métaux croît progressivement. On cesse alors d’exporter des lingots; on trouve, au contraire, avantage à en importer, jusqu’à ce que l’équilibre soit rétabli.
le socialiste.
Voilà qui détruit un des gros arguments des protectionnistes.
Une objection encore. Si la fabrication des monnaies était libre, serait-il possible d’arriver à l’unité monétaire? Chaque fabricant ne fournirait-il pas une monnaie particulière? On ne s’y reconnaîtrait plus.
l’économiste.
Il y a des milliers de fabricants de calicots, et cependant [214] il n’y a qu’un petit nombre de variétés de calicots. A Manchester, vingt ou trente manufacturiers tissent des pièces de qualité et de dimensions pareilles. Il en serait de même pour la monnaie; on ne frapperait que les pièces dont le public trouverait commode et avantageux de se servir. Si tous les peuples voulaient se servir de la même monnaie, on arriverait naturellement à l’unité monétaire. S’ils préféraient des monnaies et des mesures différentes, appropriées à leurs habitudes et à leurs besoins particuliers, pourquoi, je vous prie, s’aviserait-on de leur imposer une unité monétaire?
le socialiste.
Vous pourriez bien avoir raison. Je conçois, jusqu’à un certain point, qu’on abandonne la fabrication des monnaies à l’industrie privée. Les fabricants peuvent, en effet, se faire concurrence de manière à rendre impossible la constitution d’un monopole. Mais en est-il de même pour toutes les industries dont le gouvernement s’est emparé? les voies de communication, par exemple, ne constituent-elles pas des monopoles naturels?
l’économiste.
Il n’y a pas de monopoles naturels. Comment les constructeurs et les exploitateurs des voies de communication pourraient-ils réaliser des bénéfices de monopole? En élevant le prix des transports au-dessus des frais de production. Mais aussitôt que le prix courant dépasse les frais de production, la concurrence est irrésistiblement attirée...
le socialiste.
On construirait donc deux ou trois routes parallèles d’un point à un autre?
l’économiste.
Cela ne serait pas nécessaire. La concurrence des voies de communication, notamment des voies perfectionnées, chemins de fer, canaux, etc., s’exerce dans un rayon considérable. Que le chemin de fer du Havre à Strasbourg surélève, par exemple, ses prix de transport, et aussitôt le transit des voyageurs et des marchandises vers le centre de l’Europe se déplacera en faveur d’Anvers ou d’Amsterdam. Pour les points intermédiaires, il y a la concurrence des canaux, des rivières, des tronçons à peu près parallèles ou des routes ordinaires, concurrence qui devient plus active, en présence d’une tentative de monopole... à la condition bien entendu que la concurrence demeure libre.
A cette condition, le prix courant des transports ne saurait jamais en dépasser longtemps les frais de production.
Or, vous m’accorderez bien, je pense, que les particuliers construisent et exploitent les routes à meilleur marché et mieux que les gouvernements. Comparez les routes de l’Angleterre avec celles de la France?
le socialiste.
Le fait ne saurait être contesté. Mais n’est-il pas essentiel que la circulation demeure libre et gratuite?
l’économiste.
N’avons-nous pas approfondi déjà le mystère de la gratuité? Avez-vous oublié qu’une denrée quelconque, monnaie, enseignement, transport, ne saurait être fournie gratis par le gouvernement à moins d’être payée par les contribuables? Avez-vous oublié qu’en ce cas la denrée coûte, en sus des frais de production ordinaires, les frais [216] de perception de l’impôt? Si donc nos routes n’étaient point gratuites, elles seraient payées par ceux qui s’en servent, en proportion de ce qu’ils s’en servent, et elles seraient moins chères.
Ce qui est vrai des grandes voies de communication ne l’est pas moins des petites. Ces gouvernements au petit pied qu’on nomme des départements et des communes construisent des routes à leurs frais, sauf toutefois l’approbation du gouvernement central. Votées par les majorités des conseils communaux ou départementaux, ces routes sont construites et exploitées aux frais de tous les contribuables. Sous le régime monarchique, lorsque les contribuables riches avaient seuls voix dans les conseils de la commune, des départements et de l’État, les pauvres paysans étaient tenus de contribuer pour une large part à des travaux décrétés... au profit de qui? je vous le laisse à penser. Les corvées de l’ancien régime avaient reparu déguisées sous le titre benin de prestations en nature.
Le seul moyen de mettre fin à ces scandaleuses iniquités c’est d’abandonner à l’industrie privée les voies de communication grandes ou petites, aussi bien que toute espèce de transports.
le conservateur.
Sans en excepter le transport des lettres?
l’économiste.
Sans un excepter le transport des lettres.
le socialiste.
Allons donc!
l’économiste.
La poste n’a pas toujours été entre les mains du gouvernement. [217] Avant la révolution de 89, le transport des lettres était affermé à des compagnies particulières. En 1788, ce bail rapportait douze millions à l’État. Mais, comme bien vous pensez, le tarif des lettres était fort élevé. Les gros fermiers savaient distribuer à propos des pots-de-vin aux administrateurs chargés de débattre et de régler les tarifs. Ils florissaient sous ce régime. Mais le public payait largement leur embonpoint.
Qu’y avait-il à faire pour remédier aux abus criants de ce système de fermages? Il y avait tout simplement à abandonner le service des postes à la libre concurrence. Le transport des lettres serait promptement descendu au prix le plus bas possible, sous ce nouveau régime. On aima mieux remettre les postes entre les mains de l’État. Le public n’y gagna rien, au contraire! Le transport des lettres continua de coûter fort cher, et il devint beaucoup moins sûr. Vous n’ignorez pas que les abus de confiance et les infidélités se sont effroyablement multipliés dans le service des postes.
le conservateur.
Cela n’est que trop vrai.
l’économiste.
Pendant longtemps, le gouvernement s’arrogea, en outre, le droit de violer le secret des correspondances. Il n’y a pas bien longtemps que le cabinet noir a été supprimé, et aucuns prétendent qu’il existe encore. Le pis c’est qu’on n’est pas le maître de se soustraire à ces risques et à ces avanies. Il est sévèrement interdit aux particuliers de transporter des lettres. Le transport interlope des correspondances est soumis à des pénalités rigoureuses.
le socialiste.
Quelle barbarie!
l’économiste.
Voilà les avantages du communisme.... Si le transport des lettres était libre, vous pourriez rendre les transporteurs responsables de la violation de vos correspondances et des vols commis à votre préjudice. Avec le monopole communiste du gouvernement, rien de tout cela n’est praticable. Vous êtes à la merci de l’administration.
le socialiste.
Au moins, on a fini par nous donner la réforme postale.
l’économiste.
Oui, mais la réforme postale n’a détruit un abus que pour le remplacer par un autre. En Angleterre, elle a occasionné, pendant plusieurs années, un déficit considérable dans les recettes; on avait tellement abaissé le tarif que la moitié des frais de transport des lettres tombait à la charge des contribuables. Il y avait demi-gratuité. Or, n’est-il pas juste que les frais de tout correspondance soient payés par les correspondants? Pourquoi un pauvre paysan illettré qui n’écrit ni ne reçoit lettres en sa vie contribuerait-il à payer le port des lourdes missives de M. Turcaret ou des billets doux de M. Lovelace son voisin? Est-il un communisme plus inique et plus odieux que celui-là?
Parlerai-je des priviléges de la poste aux chevaux? Autrefois les maîtres de poste institués par Louis XI jouissaient du monopole du transport des voyageurs. Peu a peu, ils furent obligés de partager ce monopole avec [219] les messageries royales, et, enfin, de laisser une place aux entreprises libres. Mais, sur leurs réclamations pressantes, on obligea les nouveaux entrepreneurs à payer aux maîtres de relais, dont ils n’employaient pas les chevaux, une indemnité de vingt-cinq centimes par poste et par cheval attelé (loi du 15 ventôse an xiii). L’indemnité s’est élevé jusqu’au chiffre de six millions par an. Mais les chemins de fer ont diminué considérablement cette aubaine. De là les grandes clameurs des maîtres de postes. Ils ont voulu obliger les compagnies de chemins de fer à les subventionner aussi. Les compagnies ont résisté. L’affaire est pendante.
Il faut dire, à la décharge des maîtres de postes, que des règlements datant du règne de Louis XI, les obligent à tenir sur pied des relais de chevaux dans des endroits où ces relais sont parfaitement inutiles. Mais n’est-il pas absurde de pensionner une industrie, qui ne fonctionne plus, aux dépens d’une industrie qui fonctionne? N’est-il pas absurde et grotesque à la fois, de contraindre les entrepreneurs de diligences à fournir une rente aux chevaux oisifs des maîtres de postes?
le socialiste.
C’est absurde et grotesque, en effet. Mais si le gouvernement, les départements et les communes cessaient complétement d’intervenir dans l’industrie des transports, dans la construction des routes, des canaux, des ponts, des rues, s’ils cessaient d’établir des communications entre les diverses parties du pays et de veiller à ce que les communications établies fussent maintenues, les particuliers se chargeraient-ils de cette tâche indispensable?
l’économiste.
Croyez-vous que la pierre lancée dans les airs finira par tomber?
le socialiste.
C’est une loi physique!
l’économiste.
Eh! bien, c’est en vertu de la même loi physique que toutes les choses utiles, routes, ponts, canaux, pain, viande, etc., se produisent aussitôt que la société en a besoin. Lorsqu’une chose utile est demandée, la production de cette chose tend naturellement à s’opérer avec une intensité de mouvement égale à celle de la pierre qui tombe.
Lorsqu’une chose utile est demandée sans être produite encore, le prix idéal, le prix qu’on y mettrait si elle était produite croît en progression géométrique à mesure que la demande croît en progression arithmétique1. Un moment arrive où ce prix s’élève assez haut pour surmonter toutes les résistances ambiantes et où la production s’opère.
Cela étant, le gouvernement ne saurait se mêler d’aucune affaire de production sans causer un dommage à la société.
S’il produit une chose utile après que les particuliers l’eussent produite, il nuit à la société, en la privant de cette chose, dans l’intervalle.
S’il la produit au moment même où les particuliers l’eussent produite, son intervention est encore nuisible, car il produit à plus haut prix que les particuliers.
[221]Si, enfin, il la produit plus tôt, la société n’est pas moins lésée... vous vous récriez. Je vais vous le prouver.
Avec quoi produit-on? Avec du travail actuel et du travail ancien ou capital. Comment un particulier qui entreprend une industrie nouvelle se procure-t-il du travail et du capital? En allant chercher des travailleurs et des capitaux dans les endroits où les services de ces agents de la production sont le moins utiles, où, en conséquence, on les paye le moins cher.
Lorsqu’un produit nouveau est plus faiblement demandé que les produits anciens, lorsqu’on ne couvrirait pas encore ses frais en le créant, les particuliers s’abstiennent soigneusement de le créer. Ils n’en commencent la production qu’au moment où ils sont assurés de couvrir leurs frais.
Où le gouvernement qui les devance, va-t-il puiser le travail et le capital dont il a besoin? Il les puise où les particuliers les auraient puisés eux-mêmes, dans la société. Mais en commençant une production avant que les frais n’en puissent encore être couverts, ou bien avant que les profits naturels de cette entreprise nouvelle ne soient au niveau de ceux des industries existantes, le gouvernement ne détourne-t-il pas les capitaux et les bras d’un emploi plus utile que celui qu’il leur donne? N’appauvrit-il pas la société au lieu de l’enrichir?
Le gouvernement a entrepris trop tôt, par exemple, certaines lignes de canaux qui traversent des déserts. Le travail et le capital qu’il a consacrés à la construction de ces canaux, encore inachevés après un quart de siècle, étaient certainement mieux employés où il les a pris. En revanche, il a commencé trop tard et trop peu multiplié [222] les télégraphes, dont il s’est réservé le monopole ou la concession. Nous ne possédons que deux ou trois lignes de télégraphes électriques; encore sont-elles à l’usage exclusif du gouvernement et des compagnies de chemins de fer. Aux États-Unis, où cette industrie est libre, les télégraphes électriques se sont multipliés à l’infini et ils servent à tout le monde.
le socialiste.
J’admets ces observations pour les industries purement matérielles; mais vous serez bien forcé d’accorder, je pense, que le gouvernement doit se préoccuper un peu du développement intellectuel et moral de la société. N’a-t-il pas le droit, que dis-je? le devoir d’imprimer une direction salutaire aux arts et aux lettres, à l’enseignement et d’intervenir dans le service des cultes? peut-il abandonner ces nobles branches de la production à tous les vents de la spéculation privée?
l’économiste.
Sans doute, il aurait ce droit et il serait tenu de remplir ce devoir, si son intervention, dans cette partie du domaine de la production, n’était pas toujours et nécessairement nuisible aussi bien que dans l’autre?
S’agit-il des beaux-arts? Le gouvernement pensionne quelques hommes de lettres et subventionne certains théâtres. Je crois vous avoir prouvé que les gens de lettres se passeraient aisément de la misérable subvention qu’on leur alloue, si leurs droits de propriété étaient pleinement reconnus et respectés.
Les subventions accordées aux théâtres sont un des abus les plus criants et les plus scandaleux de notre époque.
le conservateur.
Il a été prouvé maintes fois que le Théâtre-Français et l’Opéra ne sauraient subsister sans subventions. Voudriez-vous, par hasard, qu’on supprimàt le Théâtre-Français et l’Opéra?
l’économiste.
Remarquez d’abord quelle profonde iniquité se cache sous ce régime des subventions. L’État dépense chaque année plus de deux millions pour soutenir deux ou trois théâtres de Paris. Ces théâtres sont précisément ceux que fréquente la portion la plus aisée de la bourgeoisie parisienne. Qui paye ces deux millions? Tous les contribuables, le pauvre paysan bas-breton, qui de sa vie n’est entré et n’entrera dans une salle de spectacle, comme le riche habitué de l’orchestre de l’Opéra. Est-ce de la justice? est-il juste d’obliger un pauvre laboureur, qui passe sa vie courbé sur le manche de sa charrue, à contribuer aux menus plaisirs des riches hourgeois de Paris?
le socialiste.
C’est de l’exploitation!
le conservateur.
Mais, encore une fois, aimeriez-vous mieux qu’il n’y eût ni Opéra, ni Théâtre-Français? Et les intérêts de notre gloire nationale!
l’économiste.
Quand Louis XIV écrasait les peuples d’impôts pour bâtir son froid et lamentable château de Versailles; quand il réduisait les misérables habitants des campagnes à vivre d’herbes, pour subvenir aux fastueuses dépenses de sa cour, n’invoquait-il pas aussi la gloire de la France? La gloire! en quoi donc la faites-vous consister?
le conservateur.
Dans les grandes choses qu’un peuple sait accomplir.
l’économiste.
Rien n’est plus grand, rien n’est plus splendide que la justice. Le siècle où l’on cessera de spolier le grand nombre au bénéfice du petit, où la justice deviendra la loi souveraine des sociétés, sera le plus grand des siècles.
Mais je ne crois pas que les subventions soient nécessaires aux théâtres; je suis convaincu, au contraire, qu’elles leur sont nuisibles. Les théâtres subventionnés sont ceux qui font le plus mal leurs affaires. Pourquoi? Je vais vous le dire.
Remarquez d’abord qu’une partie de leurs subventions leur est ravie sous différentes formes. Un théâtre subventionné est tenu d’accorder des entrées gratuites aux ministres, aux représentants influents, à une foule de membres de l’administration haute ou basse. La subvention sert donc, en premier lieu, à procurer gratuitement le plaisir du spectacle à une foule de gens...
le socialiste.
Qui sont fort en état de payer leur place.
l’économiste.
Beaucoup plus, à coup sûr, que ceux qui la leur payent. En second lieu, les subventions servent à enrichir les directeurs les moins scrupuleux. Un théâtre est en déficit de cinquante mille francs, le directeur demande cent cinquante mille francs de subvention. On les lui accorde. Il comble le déficit, cède son privilége, et s’en va jouir paisiblement des rentes que l’État lui a faites.
Les théâtres subventionnés sont continuellement en [225] déficit. Est-ce malgré la subvention ou à cause de la subvention? Vous allez en juger.
Une entreprise libre, une entreprise qui est obligée de couvrir elle-même tous ses frais, accomplit des efforts prodigieux pour atteindre ce but. Elle améliore la qualité de sa denrée, elle en diminue le prix, elle invente tous les jours quelque nouveau procédé pour attirer la clientèle. C’est pour elle une question de vie ou de mort. Une entreprise privilégiée et subventionnée ne fait pas de ces efforts. Assurée de vivre, alors même que sa clientèle la déserterait tout à fait, alors même que son déficit annuel serait égal au montant total de ses frais, elle prend naturellement ses aises vis-à-vis du public.—Si Tortoni recevait une subvention du gouvernement pour vendre ses glaces, continuerait-il à se donner autant de peine pour faire aller son commerce? Ses glaces ne finiraient-elles pas par devenir détestables comme certaines pièces d’un certain théâtre, et le public, amateur de bonnes glaces, ne déserterait-il pas en masse son établissement? Voilà à quoi aurait servi la subvention accordée à l’industrie des glaces nationales!
Mais il y a pis encore que les subventions, il y a les priviléges. L’industrie des théâtres n’est pas libre en France. Il n’est pas permis au premier venu d’ouvrir un théâtre, ni même aucun établissement qui en approche. Récemment, lorsque les cafés lyriques commencèrent à prendre faveur, les théâtres privilégiés s’émurent. Les directeurs pétitionnèrent collectivement pour obtenir la suppression de cette industrie rivale. Le ministre refusa de faire droit à la pétition des directeurs, mais il défendit au cafés lyriques: 1° de jouer des pièces de [226] théâtre; 2° de costumer leurs chanteurs. L’arrêt n’est-il pas digne du moyen-âge?
le conservateur.
J’avoue que c’est burlesque.
l’économiste.
Ceci s’est passé en l’an 1849 et chez le peuple le plus spirituel de la terre. Cependant les directeurs ne sont pas si coupables! Ils obéissent à des nécessités que le privilége a créées.
Le régime du privilége est essentiellement précaire. Tous les priviléges sont temporaires. Or la première condition de toute production économique, c’est un possession sûre et illimitée. Il y a dans toute industrie des frais généraux qui exigent un long délai pour être couverts. Tels sont les frais de construction, d’amélioration ou d’embellissement des locaux. Que ces frais soient répartis sur une longue période d’exploitation et ils deviendront à peu près insensibles. Qu’ils soient concentrés, au contraire, dans une courte période et ils élèveront considérablement le chiffre de la dépense. Sous un régime de jouissance temporaire, on fait le moins possible de ces sortes de frais. Peu de salles sont plus mal construites et plus mal entretenues que les salles de spectacle de Paris. Néanmoins les frais d’embellissement grèvent encore très lourdement les budgets des directeurs.
En outre, les théâtres ont, comme toute industrie, leur bonne et leur mauvaise saison. Dans les industries libres, on travaille moins dans la mauvaise saison que dans la bonne, afin de ne pas travailler à perte. Les théâtres sont obligés de travailler en toute saison, qu’ils fassent [227] des bénéfices ou qu’ils n’en fassent point. C’est une condition expresse de leurs priviléges.
le socialiste.
Quelle inconcevable absurdité!
l’économiste.
Leurs frais de production s’augmentent donc de toute la somme qu’ils sont obligés de perdre dans la mauvaise saison. Ajoutez à cela un impôt exorbitant au profit des établissements de bienfaisance et vous vous rendrez compte de l’élévation excessive du prix des spectacles1. Vous comprendrez aussi pourquoi les directeurs poursuivent avec tant d’acharnement les concurrences.
Si l’industrie des théâtres était libre, on pourrait répartir les frais de construction et d’entretien des salles sur une période indéfinie. On pourrait aussi proportionner toujours la production aux exigences de la consommation. On jouerait beaucoup dans la bonne saison, on jouerait moins dans la mauvaise. Les frais de production tomberaient alors au taux le plus bas possible, et la concurrence se chargerait de niveler toujours le prix courant avec les frais de production. L’abaissement des prix augmenterait la consommation, partant la production. Il y aurait plus de théâtres, plus d’acteurs, plus d’auteurs.
le conservateur.
L’art ne s’abaisserait-il pas en se vulgarisant?
l’économiste.
Je suis convaincu, au contraire, qu’il s’élèverait et s’élargirait. Chaque fois que la production se développe, elle se perfectionne. On se plaint aujourd’hui de ce que l’art dramatique languit et s’abaisse. Fiez-vous à la liberté pour le relever et le vivifier.
Ce qui est vrai pour les théâtres, ne l’est pas moins pour les bibliothèques, les musées, les expositions, les académies.
le socialiste.
Quoi! vous voudriez que l’État cessât d’ouvrir librement ses bibliothèques au public?
l’économiste.
Je suis d’avis qu’il faudrait fermer les bibliothèques publiques dans l’intérêt de la diffusion des lumières.
le conservateur.
Ah! le paradoxe est par trop violent. Je m’insurge à la fin.
l’économiste.
Insurgez-vous, mais écoutez. L’État possède un certain nombre de bibliothèques. Le gouvernement en ouvre quelques-unes gratuitement au public. Il ne les ouvre pas toutes, notez-le bien. Certaines bibliothèques ne sont que des prétextes à bibliothécaires. Les dépenses de gestion des bibliothèques publiques, en y comprenant l’entretien des bâtiments s’élèvent annuellement à plus d’un million. Ce qui signifie que tous les contribuables sont imposés, taxés, pour que certains individus puissent aller étudier ou lire gratis à la Bibliothèque nationale, à la bibliothèque Mazarine et ailleurs. Si les bibliothèques publiques étaient exploitées par des particuliers, on économiserait [229] d’abord tout le montant des frais de perecption de l’impôt. Les consommateurs de livres débourseraient une somme inférieure à celle qui est aujourd’hui payée par la nation.
le conservateur.
Oui, mais ils payeraient quelque chose, et, aujourd’hui, ils ne payent rien. Et n’est-ce pas une détestable économie que celle qui consiste à lésiner avec la science?
l’économiste.
C’est une détestable économie, en effet. Mais recherchez bien, je vous prie, comment on emploie ce million dont les contribuables font annuellement cadeau aux consommateurs de livres. Examinez les établissements particuliers de France, et si vous en trouvez un seul dont l’administration soit aussi mauvaise que celle de la Bibliothèque nationale, par exemple, un seul où la richesse soit aussi mal utilisée et le public aussi mal servi, je vous donne gain de cause.
le socialiste.
Le service de la Bibliothèque nationale est déplorablement organisé, cela est certain. Il n’y a pas en France un seul établissement industriel qui ne fasse chaque année son inventaire; la Bibliothèque n’a pu réussir encore à achever le sien. Commencé depuis un temps immémorial, son catalogue n’est point terminé. Mais on pourrait administrer mieux ce grand établissement national.
l’économiste.
Je ne le pense pas. Aussi longtemps qu’elle demeurera enclavée dans le vaste communisme de l’État, la Bibliothèque nationale ne saurait être bien administrée.
En réalité donc, la gestion communiste des bibliothèques [230] publiques a pour résultat de soustraire au public, la plus grande partie des trésors de la science. Mettez ce capital entre les mains de l’industrie particulière et vous verrez quel parti elle en saura tirer. Vous verrez combien les richesses scientifiques aujourd’hui si lentes et si difficiles deviendront rapides et faciles. On ne perdra plus de longues heures et souvent de longues journées à attendre vainement un livre ou un manuscrit; on sera servi tout de suite. L’industrie privée ne fait pas attendre.
La science y perdrait-elle?
le conservateur.
Un moyen-terme n’est-il pas possible? Les bibliothèques ne peuvent-elles subsister auprès des bibliothèques exploitées par l’industrie privée?
l’économiste.
C’est le régime bâtard qui existe actuellement. D’un côté, vous avez des bibliothèques publiques, où des richesses innombrables demeurent à peu près improductives; de l’autre, des cabinets de lecture chers et mal pourvus.
Si les bibliothèques gratuites n’existaient point, les cabinets de lecture prendraient des proportions considérables; toutes les richesses de la science et des lettres viendraient s’y accumuler utilement; chaque catégorie de connaissances aurait bientôt sa bibliothèque spéciale, où rien ne manquerait aux faiseurs de recherches; où les richesses scientifiques et littéraires seraient mises à la disposition du public aussitôt qu’elles seraient produites. La concurrence libre obligerait, en même temps, ces établissements à abaisser leurs prix au taux le plus bas possible.
le socialiste.
N’importe! Les étudiants pauvres et les savants besoigneux seruient à plaindre sous ce régime.
l’économiste.
Les frais de bibliothèque ou de cabinet de lecture forment la moindre partie des dépenses d’une éducation. Quant aux savants pauvres, ils travaillent généralement pour des libraires qui leur tiennent compte de leurs frais de recherches. Une partie de ces frais retombent aujour-d’hui à la charge des contribuables. Ne serait-il pas plus juste qu’ils fussent exclusivement à la charge des acheteurs de livres? Ceux-ci, du reste, n’y perdraient rien, car les livres deviendraient plus substantiels, si les recherches devenaient plus faciles.
Je n’ai donc pas fait le moindre paradoxe, en disant qu’il faut fermer les bibliothèques publiques dans l’intérêt de la diffusion des lumières. La gratuité des bibliothèques c’est du communisme; et, qu’il s’agisse de science ou d’industrie, le communisme c’est de la barbarle.
Ce communisme détestable se retrouve encore dans le régime de l’enseignement et des cultes.
le conservateur.
Attaquez l’université tant qu’il vous plaira, mais, de grâce, respectez les cultes. La Religion est notre dernière ancre de salut.
l’économiste.
C’est dans l’intérêt même de la Religion que l’État devrait cesser de subventionner les cultes.
Est-il juste qu’un homme qui ne pratique aucun des cultes reconnus par l’État, soit tenu néanmoins de leur fournir un salaire? Est-il juste que l’on paye une chose [232] dont on ne se sert point? Toute morale religieuse ne condamne-t-elle point un abus, une spoliation de cette nature? Cependant cette spoliation, cet abus sont commis tous les jours en France, au profit des cultes reconnus. Tant pis pour les contribuables qui pratiquent des cultes que l’État ne reconnaît point1!
Croyez-vous que cette iniquité flagrante soit profitable à la Religion?
Croyez-vous encore que les cultes ne seraient pas mieux administrés si l’État ne les subventionnait point? Croyez-vous que les services religieux ne seraient point distribués avec plus d’intelligence et de zèle, si l’État cessait d’assurer aux ecclésiastiques une rémunération quand même? Au reste, l’expérience a déjà prononcé à cet égard. Nulle part les services religieux ne sont mieux distribués qu’aux États-Unis, où les cultes ne reçoivent aucune subvention. Beaucoup d’ecclésiastiques éclairés sont convaincus que le même régime donnerait en France les mêmes résultats.
le socialiste.
C’est une expérience à faire.
l’économiste.
Le régime actuel de l’enseignement est plus vicieux encore que le régime des cultes. La nation alloue annuellement une somme de dix-sept millions à une entreprise qui distribue de l’enseignement au nom de l’État, et qui a la haute mam sur les entreprises rivales.
Sous l’ancien régime, l’enseignement se trouvait, [233] comme toutes les autres industries, entre les mains de certaines corporations privilégiées. La révolution détruisit ces priviléges. Malheureusement l’Assemblée co stituante et la Convention se hâtèrent de décréter l’établissement d’écoles publiques, aux frais de l’État, des départements ou des communes. Napoléon étendit et aggrava cette conception communiste en fondant l’Université.
Greffée sur les traditions de l’ancien régime, élevée sous l’œil jaloux du despotisme, l’Université distribua, au dix-neuvième siècle, l’enseignement du quinzième ou du seizième. Elle se mit à enseigner les langues mortes comme on les enseignait alors, sans se douter le moins du monde que ce qui pouvait être utile au seizième siècle, pouvait aussi ne l’être plus au dix-neuvième.
le conservateur.
Pourquoi donc?
l’économiste.
Je conçois qu’on ait généralement enseigné les langues anciennes à l’époque de la renaissance. Les peuples, à peine sortis des ténèbres du moyen âge, avaient peu cultivé encore les sciences et les lettres. Pour se procurer des connaissances, des idées, des images, il fallait aller puiser dans le vaste magasin de l’antiquité, dont les richesses venaient d’être mises au jour. L’instrument indispensable pour s’assimiler ces richesses, c’était la langue. On ne pouvait apprendre ce que savaient les anciens, sans connaître le grec et le latin.
Au dix-neuvième siècle, la situation a changé. Toutes les idées, toutes les connaissances de l’antiquité ont passé dans les langues modernes. On peut apprendre tout ce que savaient les ancieus sans posséder les langues anciennes. [234] Les langues modernes sont un passe-partout universel qui ouvrent le passé comme le présent. Les langues mortes ressemblent aujourd’hui à ces antiques et respectables machines qu’on met au Conservatoire des Arts et Métiers, mais dont on ne se sert plus dans les manufactures.
On a prétendu, je ne l’ignore pas, qu’il est essentiel de connaître les langues mortes pour bien apprendre les langues vivantes. Mais, s’il en était ainsi, ne serions-nous pas obligés d’apprendre une demi-douzaine de vieilles langues pour savoir le français, car Dieu sait de combien d’aggrégats notre langue s’est formée! Une vie entière n’y suffirait pas. Combien de pédants de collége écrivent d’ailleurs couramment en latin, et ne savent pas mettre l’orthographe en français? Voltaire était certainement moins fort en latin que le Jésuite Patouillet ou le Père Nonotte. Les langues mortes sont des instruments qui encombrent inutilement le cerveau et souvent l’oblitèrent.
le conservateur.
Que voulez-vous dire?
l’économiste.
Je dis qu’en enseignant le grec et le latin aux enfants, on leur communique prématurément les idées, les sentiments, les passions de deux peuples, fort civilisés sans doute pour l’époque où ils vivaient, mais qui seraient aujourd’hui de véritables barbares. Cela est vrai surtout au point de vue des sentiments moraux. En mettant les enfants modernes au régime du grec et du latin, on fait passer dans leurs âmes les préjugés et les vices d’une civilisation à peine ébauchée, au lieu de leur communiquer [235] les connaissances et les notions morales d’une civilisation avancée; on en fait de petits barbares passablement immoraux...
Si l’enseignement avait joui du blenfait de la liberté, au lieu de passer du détestable régime du privilége au régime plus détestable encore du monopole communiste, il aurait rejeté depuis longtemps ce vieux outillage des langues mortes, comme les industriés de libre concurrence se sont débarrassées de leurs vieilles machines. On enseignerait aux enfants ce qui peut leur servir; on cesserait de leur enseigner ce qui leur est inutile ou nuisible. Le latin et le grec seraient relégués dans les cerveaux de ces hommes-musées qu’on appelle des polyglottes.
le conservateur.
Il y a des réformes considérables à opérer dans le régime de l’Université, j’en conviens avec vous. Il était odieux, par exemple, d’obliger les institutions rivales de l’Université à lui payer une rétribution annuelle; il ne l’était guère moins d’empêcher ces établissements de s’ouvrir sans une autorisation spéciale, et de leur imposer l’inspection des agents de l’Université. Mais ne serait-il pas bon de laisser subsister, à côté des institutions particulières désormais pleinement libres, les institutions de l’État et des communes? Cette rivalité salutaire ne servirait-elle pas admirablement les progrès de l’enseignement?
l’économiste.
Ce régime ne serait guère préférable au régime actuel. Voici pourquoi:
Les établissements d’éducation appartenant à l’État et aux communes ne font pas leurs frais et ne sont pas [236] tenus de les faire. Le trésor public et les caisses communales se chargent de combler leurs déficits. Les contribuables, ceux qui ne font pas d’enfants, comme ceux qui en font, supportent une partie des frais de cette éducation communiste. Or, je vous le demande, l’industrie privée peut-elle lutter d’une manière régulière contre des établissements à moitié gratuits. Cette demi-gratuité est, à la vérité, souvent fort chère, soit à cause de la mauvaise qualité de l’enseignement, soit à cause de l’élévation totale des frais. Mais les établissements de l’État et des communes n’ont-ils pas la ressource d’abaisser indéfiniment leurs prix? N’a-t-il pas été question même de rendre l’enseignement tout-à fait gratuit? Ce serait, en réalité, le rendre le plus cher possible, mais ce serait, en même temps, rendre toute concurrence impraticable. Si l’État se chargeait de fournir libéralement du drap à moitié prix ou gratis, qui s’aviserait de fabriquer encore du drap? L’industrie libre du drap prendrait-elle jamais des proportions bien vastes, en présence d’un concurrent qui donnerait sa marchandise pour rien?
La liberté de l’enseignement sera une pure illusion jusqu’à ce que l’État, les départements et les communes cessent complétement, absolument de se mèler de l’éducation publique.
le socialiste.
Les établissements de l’État et des communes ne pourraient-ils donc faire leurs frais aussi bien que ceux de l’industrie privée?
l’économiste.
Qu’ils l’essaient! Que l’ou supprime le budget de l’instruction publique, que l’on oblige les établissements de [237] l’Université et des communes à couvrir tous leurs frais et vous m’en donnerez bientôt des nouvelles.
le conservateur.
Au moins, vous m’accorderez que l’État doit conserver la surveillance des établissements d’éducation?
l’économiste.
Je n’y vois pas d’inconvénient. Mais je pense que la surveillance de l’État, deviendrait promptement inutile sous un régime de liberté véritable.
Ce qui empêche aujourd’hui les établissements d’éducation de s’améliorer au double point de vue de la qualité et du prix, c’est l’existence précaire que leur a faite la concurrence inégale de l’Université. La liberté leur donnerait la stabilité. L’enseignement s’organiserait alors sur un plan immense comme s’organise et se développe toute industrie dont l’avenir est assuré. Intéressés à faire connaître les progrès réalisés dans leurs établissements, les directeurs d’institutions, en ouvriraient les portes au public. Les pères de famille pourraient apprécier, par eux-mêmes, la qualité des aliments matériels, intellectuels et moraux qui seraient distribués à leurs enfants. Cette surveillance-là vaudrait bien, je pense, celle des inspecteurs de l’Université.
le socialiste.
Cette publicité de l’instruction publique me plairait assez; mais encore une fois, croyez-vous que l’industrie privée puisse satisfaire à tous les besoins de l’éducation?
l’économiste.
Fiez-vous pour cela à la loi de l’offre et de la demande. Aussitôt qu’un besoin d’enseignement se ferait véritablement [238] sentir, on aurait intérêt à le satisfaire. Sous ce régime, la production de l’enseignement, que les entraves du système réglementaire ont emprisonnée dans des limites trop étroites, ne tarderait pas à prendre ses proportions utiles. L’enseignement serait meilleur et à plus bas prix, partant plus étendu. Enfin, il serait équitablement distribué. Le pauvre ne contribuerait plus à payer les frais d’éducation de l’enfant du riche, le célibataire ne serait plus taxé au profit de l’homme marié. Il y aurait une production plus abondante et une répartition plus juste. Que pourriez-vous demander de plus?
NEUVIÈME SOIRÉE↩
SOMMAIRE: Suite des atteintes portées à la propriété intérieure.—Droit d’association.—Législation qui régit, en France, les sociétés commerciales.—La société anonyme et ses avantages.—Du monopole des banques.—Fonctions des banques.—Résultats de l’intervention du gouvernement dans les affaires des banques.—Cherté de l’escompte.—Banqueroutes légales.—Autres industries privilégiées ou réglementées.—La boulangerie.—La boucherie.—L’imprimerie.—Les notaires.—Les agents de change et les courtiers.—La prostitution.—Les pompes funèbres.—Les cimetières.—Le barreau.—La médecine.—Le professorat.—Article 3 de la loi des 7–9 juillet 1833.
le socialiste.
J’ai cru jusqu’à présent que la révolution de 1789 avait complétement affranchi le travail et que nous vivions sous un régime de laisser-faire absolu. Je commence à revenir de mon erreur.
l’économiste.
Non seulement le travail n’a pas été complétement affranchi, mais, dans certaines branches de la production, on a rétrogradé au-delà des compagnies privilégiées. Au lieu de rendre libres des industries qui étaient privilégiées, on en a fait des monopoles de l’État. Or, le monopole de l’État, c’est l’enfance de toute société. Aux [240] institutions du moyen âge, on a substitué, quoi? les institutions de l’ancienne Égypte. Cela n’a pas empêché toutefois de conserver des industries privilégiées, car notre système économique est une étrange bigarrure d’industries monopolisées, privilégiées et libres.
le conservateur.
Où donc voyez-vous des industries privilégiées? D’après M. Thiers, tous les priviléges n’ont-ils pas été abolis dans la fameuse nuit du 4 août?
l’économiste.
D’après M. Thiers, oui; d’après la vérité, non. Il existe encore en France une multitude d’industries privilégiées ou réglementées. En première ligne, il faut placer les banques. Viennent ensuite la boulangerie, la boucherie, l’imprimerie, les théâtres, les assurances, le commerce des effets publics, la médecine, le barreau, les offices ministériels, la prostitution, et plusieurs autres que j’oublie.
Ajoutons encore que l’Association, ce véhicule indispensable du progrès industriel, n’est pas libre en France.
le conservateur.
Ah! cette fois je vous prends en flagrant délit d’inexactitude. Je connais ma Constitution.
ART. 8. Les citoyens ont le droit de s’associer, de s’assembler paisiblement et sans armes, de pétitionner, de manifester leurs pensées par la voie de la presse ou autrement.
L’exercice de ces droits n’a pour limites que les droits ou la liberté d’autrui et la sécurité publique.”
[241]Vous voyez donc que le droit de s’associer existe en France. Peut-être même n’existe-t-il que trop?
l’économiste.
Les associations politiques sont libres en France...plus ou moins. Il n’en est pas de même des associations commerciales. L’association comporte, vous le savez, un nombre presque infini de variétés. Or, la loi française ne reconnaît que trois sortes d’associations: la société en nom collectif, la société en commandite et la société anonyme. Sauf quelques formalités gênantes, les deux premières sont libres; mais la troisième, qui est la plus parfaite, celle qui s’adapte le mieux aux grandes entreprises industrielles, est soumise à l’autorisation préalable.
le conservateur.
Eh bien! on demande l’autorisation, et, après un mûr examen, le gouvernement l’accorde s’il y a lieu.
l’économiste.
Oui, s’il y a lieu. Et vous oubliez de dire que l’autorisation n’arrive fréquemment qu’après six mois, un an, deux ans, c’est-à-dire trop tard. Vous connaissez assez l’industrie pour savoir qu’un retard de six mois suffit pour faire avorter le plus grand nombre des entreprises.
Les socialistes se plaignent de la lenteur avec laquelle l’association s’implante en France. Ils ne voient pas que le Code de commerce y a mis bon ordre, en emprisonnant étroitement le droit d’association. Singulier aveuglement!
La société en nom collectif ne comporte pas de grandes accumulations de capitaux, surtout dans un pays où les fortunes sont très divisées; la société en commandite, telle qu’elle est actuellement réglementée, met les actionnaires [242] à la merci d’un gérant, et vous savez ce qui en résulte.... La société anonyme seule comporte d’immenses agglomérations de capitaux par petites fractions, et la meilleure gestion possible.
le conservateur.
Ceci n’est pas prouvé.
l’économiste.
Décomposez l’entrepreneur d’industrie et que trouverez-vous? Un capitaliste et un directeur de travail, un homme qui reçoit un intérêt pour son capital et un salaire pour son travail. Décomposez la société anonyme et que trouverez-vous? Des travailleurs qui fournissent du travail et reçoivent un salaire, des capitalistes qui fournissent des capitaux et reçoivent un intérêt. Ce qui est réuni dans l’entrepreneur d’industrie est séparé dans la société anonyme. Cette séparation est un pas de plus, fait dans la voie de la division du travail; c’est un progrès.
Je vous en donnerai la preuve en vous signalant quelques-uns des avantages propres aux sociétés anonymes.
Le premier de tous c’est de pouvoir effectuer des entreprises de production sur une échelle immense; c’est de pouvoir toujours proportionner la puissance de l’effort à celle de la résistance, et de réduire ainsi les frais de production au minimum.
Le second avantage des sociétés anonymes réside dans la meilleure administration qu’elles comportent. Un entrepreneur d’industrie n’a de responsabilité qu’envers lui-même. Un directeur de compagnie est responsable vis-à-vis de ses actionnaires. Il est tenu de leur rendre compte de ses actes et de les justifier. Cette obligation inherente à la nature même de la société anonyme entraîne [243] pour le directeur la nécessité d’agir toujours avec intelligence et probité. S’il ne dirigeait point l’entreprise avec intelligence, les actionnaires ne manqueraient point de le destituer; s’il s’engageait dans des opérations véreuses oserait-il bien en rendre un compte public à une assemblée d’actionnaires? Or, avec le système de comptabilité actuellement en usage il ne pourrait laisser secrète aucune de ses opérations.
Sous le régime de la société anonyme, les entreprises industrielles seraient nécessairement conduites avec intelligence et probité. L’industrie serait nécessairement dirigée par les hommes les plus capables et les plus probes.
Les fraudes industrielles disparaîtraient sous ce régime. Dans quelles industries les fraudes sont-elles le plus fréquentes? Dans les industries les plus fractionnées et les plus précaires. Lorsqu’on ne peut compter sur l’avenir ni se faire une grande existence commerciale, on cherche, par tous les moyens possibles, à gagner beaucoup d’argent en peu de temps. On altère la qualité des produits. On vend, comme bonne, une marchandise que l’on sait être mauvaise. Lorsqu’on a, devant soi, au contraire, une période d’existence illimitée, et lorsqu’on met en œuvre un capital considérable, on est intéressé à acquérir une bonne réputation, afin de conserver sa clientèle. On fournit donc de bons produits et l’on se montre loyal en affaires.
Dans les industries organisées largement et d’une manière stable, il y a plus de probité que dans les industries chétives et précaires. Observez et comparez les diverses branches de la production en France, en Angleterre, en [244] Hollande, etc., et vous vous convaincrez de l’entière exactitude de ce fait. Les falsifications et les fraudes n’ont pas leur origine dans la liberté industrielle; elles proviennent, au contraire, d’obstacles apportés au libre et plein développement de l’industrie.
Le troisième avantage des sociétés anonymes et le plus considérable peut-être, c’est de rendre publique la situation de chaque industrie; c’est d’indiquer journellement l’état de prospérité ou de souffrance des diverses branches de la production.
le conservateur.
Comment cela?
l’économiste.
Lorsqu’une industrie réussit à vendre ses produits à un prix exactement rémunérateur, on dit qu’elle est au pair; lorsque les frais de production ne sont pas couverts, l’industrie est en perte; lorsque les frais de production sont dépassés, elle est en bénéfice. Sous le régime de la production individualisée, il est fort difficile de connaître au juste ces différentes situations industrielles, et de savoir quand on peut utilement porter ses capitaux dans une industrie et quand on ne le peut. On s’expose souvent à grossir une branche exubérante de la production, alors que d’autres branches appellent vainement les capitaux et les bras. Ces erreurs cessent d’être possibles sous le régime de la société anonyme. Chaque compagnie ayant intérêt à publier le cours de ses actions afin d’en faciliter la négociation, on est informé jour par jour de la situation des différentes branches de la production. En jetant un coup d’œil sur le cours de la Bourse, on sait quelle industrie est en perte, quelle industrie est en [245] gain, quelle autre est au pair. On sait, au juste, dans laquelle il faut placer ses capitaux pour réaliser les plus gros profits. Si, par exemple, le cours des hauts-fourneaux est supérieur à celui des exploitations de calamines, on portera ses capitaux dans l’industrie du fer plutôt que dans celle du zinc. On augmentera ainsi la production du fer. Qu’en résultera-t-il? que le prix courant du fer tombera jusqu’à ce qu’il réponde exactement aux frais de production: le cours des actions descendant alors au pair, on cessera de se porter vers cette branche de la production, dans la crainte de ne plus couvrir ses frais.
Grâce à cette publicité du cours des actions industrielles, la production se régularise d’elle-même, d’une manière pour ainsi dire mathématique. On n’est plus exposé à produire trop d’une chose et trop peu d’une autre, à laisser certains prix s’exagérer et d’autres s’abaisser sans mesure. Une cause sans cesse agissante de perturbation disparaît de l’arène de la production.
Remarquez enfin le caractère singulièrement démocratique des compagnies anonymes. L’entrepreneur d’industrie c’est le monarque irresponsable, absolu; la société anonyme gouvernée par des actionnaires et administrée par un directeur et un comité responsables, c’est la république. Après avoir été monarchique la production devient républicaine. Ceci vous prouye, une fois de plus, que la monarchie s’en va.
le socialiste.
La société se fractionnne en une multitude de petites républiques, ayant chacune un objet spécial et économiquement limité. Voilà une transformation bien remarquable.
l’économiste.
Et que l’on ne remarque pas assez. Malheureusement la législation barbare du Code impérial fait obstacle à cette transformation salutaire.....
le conservateur.
Mais la transformation dont vous parlez n’est-elle pas circonscrite naturellement à certaines industries? N’y aurait-il pas de graves inconvénients à ce que le régime de la société anonyme fût appliqué à l’exploitation du sol, par exemple?
l’économiste.
Quels inconvénients? La société anonyme résoudrait le double problème de la diffusion de la propriété territoriale, et de la concentration économique des exploitations agricoles. La société anonyme permettrait d’exécuter les travaux agricoles sur une échelle immense, et de rendre les exploitations perpétuelles, tout en divisant à l’infini, en actions de mille francs, de cinq cents francs; en coupons de cent francs, de cinquante francs, de dix francs, la propriété territoriale. Au point de vue de l’économie de l’exploitation, ce changement aurait une portée incalculable. Quels inconvénients y verriez-vous? Une société anonyme h’aurait-elle pas intérêt à cultiver le sol, le mieux possible? Si elle le cultivait mal, ne serait-elle pas obligée de se dissoudre, après avoir dévoré son capital, et de laisser la place, soit à d’autres associations, soit à des individus isolés? Si vous ne voyez aucun inconvénient à ce qu’une terre soit possédée à perpétulté par un seul individu, pourquoi en verriez-vous à ce qu’elle le fût par une collection d’individus? Le propriétaire [247] isolé ne se continue-t-il point aussi bien que l’association de propriétaires?
le socialiste.
C’est fort juste. Je ne conçois pas, en vérité, que la société anonyme n’ait pas encore été appliquée à l’exploitation du sol?
l’économiste.
Pourquoi l’agriculture est-elle en France, comme ailleurs, la plus grevée des industries? Pourquoi la société anonyme est-elle si étroitement reglementée?
le conservateur.
Peut-être l’autorisation préalable exigée pour la constitution d’une société anonyme est-elle inutile; mais avouez que le gouvernement ne saurait se dispenser d’exercer une surveillance rigoureuse sur cette sorte d’association?
l’économiste.
Il serait bien plus nécessaire de surveiller les entreprises individuelles. Les sociétés anonymes publient le compte-rendu de leurs opérations, elles fonctionnent à ciel ouvert, tandis que les entreprises individuelles tiennent leurs opérations secrètes.....
Savez-vous à quoi sert la surveillance du gouvernement sur les sociétés anonymes? Elle sert d’abord à endormir la vigilance des actionnaires, qui se fient bénévolement à la surveillance du gouvernement. Elle sert ensuite à entraver la marche des opérations industrielles. Elle sert enfin à procurer des emplois confortables aux créatures du gouvernement.
le socialiste.
Voilà le fin de l’affaire!
l’économiste.
Les commissaires impériaux, royaux ou nationaux près les compagnies d’assurances, de chemins de fer et autres, ne sont ni plus ni moins inutiles, ni plus ni moins abusifs que ces fameux conseillers langueyeurs de porcs, conseillers préposés aux empilements de bois, etc., qui florissaient sous l’ancien régime.
Vous voilà édifiés, je pense, sur l’utilité des entraves apportées au droit d’association1.
[249]Outre ces restrictions qui s’appliquent, d’une manière générale, aux associations industrielles et commerciales, il y en a d’autres qui s’appliquent spécialement à diverses associations, notamment à celles qui s’adonnent au commerce de banque.
Nos banques publiques sont encore soumises au régime du privilége.
le conservateur.
Je vous ferai sur ce chapitre une opposition à outrance, je vous en avertis. Je ne suis point partisan de la liberté des banques et je ne le serai jamais. Je ne puis concevoir que le gouvernement permette à tout le monde de battre de la monnaie de papier, de fabriquer des assignats et de les lancer librement dans la circulation. Au reste, [251] cette belle utopie de la liberté des banques s’est réalisée déjà...
l’économiste.
Où?
le conservateur.
Aux États-Unis, et l’on sait ce qu’elle y a produit. Ça été une banqueroute générale. Dieu nous préserve d’une [252] calamité semblable! Mieux vaut un peu moins de liberté et un peu plus de sécurité.
l’économiste.
Il n’y a qu’un malheur, c’est que vos renseignements sont parfaitement faux. Les banques ne sont libres aux [253] États-Unis, que dans six États particuliers, Rhode-Island, Massachussets, Connecticut, New-Hampshire, Maine et Vermont, et ces six États sont précisément demeurés seuls en dehors de la banqueroute générale.
Si vous en doutez, lisez, je vous prie, les remarquables ouvrages de MM. Carey et Coquelin sur les banques1. Vous y apprendrez que les banques libres de l’Amérique ont causé moins de sinistres que les banques privilégiées de l’Europe.
le conservateur.
J’ai pourtant entendu affirmer souvent tout le contraire.
l’économiste.
Par des gens aussi bien informés que vous, par des esprits imbus des préjugés du régime réglementaire, qui ne manquent jamais, à priori, avant toute information, de mettre les désordres industriels sur le compte du laisser-faire.
le conservateur.
Convenez au moins que ce serait commettre une imprudence rare d’autoriser le premier venu à battre monnaie avec du papier.
l’économiste.
En vérité, vous n’y songez pas! Est-ce que tout le monde, vous, moi, monsieur, ne bat pas monnaie avec du papier? Ne donnons-nous pas tous les jours à nos créanciers des promesses de payer à telle date, telle [254] somme en espèces?—Nous leur donnerions des billets payables en autres marchandises, en produits de notre industrie par exemple, s’ils voulaient bien accepter des billets ainsi faits. Malheureusement, ils ne le veulent pas. Pourquoi? Parce qu’ils peuvent toujours échanger du numéraire contre toutes sortes de marchandises, tandis qu’ils ne peuvent tirer parti aussi aisément des autres denrées. Que ferait mon bottier, par exemple, avec un article de journal que je m’engagerais à lui livrer à trois mois de date, en échange d’une paire de bottes? Sans doute c’est bien, en définitive, avec des articles de journaux que, moi journaliste, je paye mes bottes; mais il faut d’abord que je réussisse à placer mes articles. Si je donnais à mon bottier une promesse payable en premiers-Paris au lieu d’une promesse payable en argent, ce serait à lui de placer ces premiers-Paris, et Dieu sait s’il y réussirait! Aussi n’accepte-t-il que des billets payables en belle et bonne monnaie.
A quoi servent ces billets jusqu’à l’échéance? Ils servent, pour la plupart, à la circulation. S’ils n’existaient point, on devrait les remplacer par des sommes d’or et d’argent. Moi particulier, qui émets de ces billets à terme, je bats donc monnaie. Puis-je battre indéfiniment de cette monnaie de papier? J’en ai le droit; je puis faire, si bon me semble, des millions de promesses de payer, je puis en entasser une chambre pleine. Mais la question n’est pas de les faire, la question est de les échanger contre des valeurs existantes, des valeurs concrétées sous forme de numéraire, d’habits, de bottes, de meubles, etc. Or, me sera-t-il possible d’échanger indéfiniment mes promesses de payer contre de ces valeurs réelles? Non pas! [255] je n’en pourrai guère échanger que la somme qu’on me supposera en état de payer. Avant d’accepter mes billets, on s’enquerra de ma position, de mes moyens d’existence, de mon intelligence, de ma probité, de ma santé, et d’après tout cela on jugera si ma promesse de payer est valable ou non. Il y a des gens habiles qui réussissent à placer de leurs billets plus qu’ils n’en peuvent payer; il y a, en revanche, des maladroits qui ne réussissent point à en placer autant; mais, en général, le crédit de chacun se proportionne à ses facultés.
le socialiste.
C’est pourtant d’une appréciation bien difficile.
l’économiste.
Aussi faut-il un tact exquis pour faire cette appréciation. Ce tact, les banquiers l’acquièrent et le développent par une longue habitude. Ceux qui ne le possèdent point se ruinent. Si le gouvernement s’avisait de faire la banque comme il fait tant d’autres choses, vous verriez promptement disparaître les capitaux de ce banquier omnibus.... Heureusement, le gouvernement n’est pas devenu encore le banquier universel. Aussi ne peut-on guère lancer dans la circulation plus de promesses qu’on n’en peut rembourser.
Quelle différence y a-t-il entre la promesse de payer d’une banque et celle d’un particulier? Aucune, si ce n’est que l’une est payable à vue, tandis que l’autre est payable à terme. L’une et l’autre doivent également s’appuyer sur des valeurs réelles pour être acceptées. On n’accepte votre promesse que si l’on présume qu’elle sera payée à l’échéance; on n’accepte un billet de banque que [256] si l’on a la certitude d’en obtenir toujours le remboursement en espèces.
Lorsque les billets de banque ne sont point remboursables en espèces, c’est-à-dire en une marchandise toujours aisément échangeable, circulable, lorsqu’ils sont remboursables en terres ou en maisons par exemple, ils subissent une dépréciation précisément équivalente à la difficulté d’échanger ces terres ou ces maisons contre une denrée parfaitement circulable; lorsqu’ils ne sont remboursables, ni à vue, ni à terme en aucune valeur réelle, espèces, maisons, terres, meubles, etc., ils perdent toute valeur, ils ne sont plus que des chiffons de papier.
le conservateur.
Comment donc se fait-il qu’on accepte des billets de banque, au lieu d’exiger du numéraire?
l’économiste.
Parce qu’ils sont des instruments de circulation plus commodes, plus faciles à transporter et moins coûteux, voilà tout!
le conservateur.
Mais, encore une fois, le gouvernement n’a-t-il pas raison d’intervenir pour empêcher les banques d’émettre plus de billets qu’elles n’en pourraient rembourser?
l’économiste.
Il devrait donc intervenir aussi pour empêcher les particuliers de souscrire plus de promesses qu’ils n’en peuvent payer. Pourquoi ne le fait-il point? parce que c’est impossible d’abord, parce que c’est inutile ensuite. Je n’ai pas besoin de vous démontrer que c’est impossible, je vous démontrerai, en deux mots, que c’est inutile. Vos [257] émissions particulières ne sont pas limitées par votre volonté, à vous; elles sont limitées par la volonté d’autrui. Lorsqu’on juge que vous avez dépassé vos moyens de payer, on refuse d’accepter vos promesses de payement, et votre émission se trouve ainsi arrêtée. Aucun gouvernement ne pourrait certes apprécier aussi justement que les intéressés eux-mêmes, le moment où un particulier dépasse ses moyens de payer. L’intervention du gouvernement pour régler le crédit des particuliers, à supposer qu’elle fût possible, serait donc parfaitement inutile.
Ce qui est vrai pour les particuliers qui émettent des billets à terme, ne l’est pas moins pour les banques qui émettent des billets à vue.
Quelle est la fonction des banques, ou du moins quelle est leur fonction principale? C’est d’escompter des billets. C’est de donner en échange d’une valeur réalisable à terme une valeur réalisée ou immédiatement réalisable, et parfaitement circulable. C’est d’acheter des billets à terme contre du numéraire ou des billets représentant du numéraire.
Si une banque se sert uniquement de numéraire pour faire l’escompte, ceux qui lui vendent des billets payables à terme ne courrent aucun risque, à moins que la monnaie ne soit fausse. Or les détenteurs de billets payables à terme ne sont pas assez imbéciles pour les céder contre de la fausse monnaie.
Si la banque donne en échange de ces billets payables à terme, non point du numéraire, mais des billets payables à vue, la situation n’est plus la même, j’en conviens. Il peut arriver que la banque, alléchée par les [258] bénéfices de l’escompte, émette une quantité considérable de billets sans s’inquiéter si elle pourra toujours, en toutes circonstances, les rembourser.
Mais de même que la banque n’accepte point les billets des particuliers, lorsqu’elle n’a pas une foi suffisante dans le remboursement de ces billets, de même les particuliers n’acceptent point les billets de la banque lorsqu’ils n’ont pas la certitude de pouvoir toujours, en toutes circonstances, les réaliser.
Si les particuliers jugent que la banque n’est pas en état de rembourser ses billets, ils ne les prennent point et demandent du numéraire. Ou bien encore ils les prennent, mais déduction faite des risques de non payement.
Comment le public peut-il savoir si une banque est en état ou non de rembourser ses billets payables à vue?
Comme il ne les accepte point s’il n’est pleinement édifié à cet égard, les banques sont intéressées à rendre leur situation publique. Elles publient donc, chaque mois ou chaque semaine, le compte-rendu de leurs opérations.
Dans ce compte-rendu, le public voit quel est le chiffre des émissions, le montant des réserves en numéraire, des valeurs diverses en portefeuilles, il compare le passif avec l’actif, et il juge, en conséquence, s’il peut continuer ou non à accepter les billets de la banque, et à quel taux.
le conservateur.
Et si la banque présente un faux aperçu de sa situation?
l’économiste.
En un mot, si elle commet un faux. En ce cas, les [259] détenteurs de billets peuvent ou doivent pouvoir faire punir comme faussaires, faux monnayeurs, les directeurs de cette banque, et se faire rembourser, par les actionnaires responsables, le montant du vol commis à leur préjudice.
Au reste, le public, guidé par son intérêt, est assez prudent pour ne s’adresser qu’aux banques dont les directeurs et les administrateurs lui offrent des garanties morales suffisantes.
Vous voyez donc que si le gouvernement peut se passer d’intervenir pour empêcher les particuliers de duper les banques, il pourrait se passer tout aussi bien d’intervenir pour empêcher les banques de duper les particuliers.
L’expérience s’accorde ici pleinement avec la théorie. Les banques libres des Massachussets, du Vermont, etc., ont causé, je vous l’ai dit, beaucoup moins de sinistres que les banques privilégiées de l’Europe.
S’il est inutile que le gouvernement intervienne pour régler l’émission des billets de banques, à quoi donc peut servir son intervention?
Je vais vous exposer brièvement à quoi elle sert.
L’intervention du gouvernement dans les affaires de crédit se réduit toujours, en définitive, à ceci: à accorder à une banque le privilége exclusif d’émettre des billets payables à vue. Lorsqu’une banque est pourvue de ce privilége, elle peut aisément défier toute concurrence. Les autres entreprises, ne pouvant escompter qu’avec du numéraire ou des billets à terme, se trouvent hors d’état de lutter avec la banque privilégiée:
En premier lieu, parce que les billets payables à vue [260] sont des instruments de circulation plus parfaits que le numéraire ou les billets à terme.
En second lieu, parce que la monnaie de papier peut être livrée à plus bas prix que le numéraire. En voici la raison.
Sans doute, les billets de banque doivent s’appuyer toujours sur des valeurs réelles et circulables. La banque doit toujours être en mesure de les rembourser en espèces. Mais voici ce qui arrive: lorsqu’une banque est solidement assise, on ne lui présente, en temps ordinaire, qu’un petit nombre de billets à rembourser. Elle peut donc se dispenser d’avoir constamment en caisse une somme de numéraire égale à la somme de ses billets en circulation. Qu’elle soit en mesure de se la procurer, dans le cas où l’on viendrait lui demander le remboursement total de ses émissions; qu’elle ait à sa disposition une quantité suffisante de bonnes valeurs aisément réalisables en espèces, voilà tout ce qu’il faut! On ne saurait rien exiger de plus. Mais ces bonnes valeurs, actions de chemins de fer, de compagnies d’assurances, titres de rentes, sont moins chères que le numéraire de tout le montant de l’intérêt qu’elles portent.
Moins la banque est obligée de conserver de numéraire en réserve, et moins cher elle peut vendre ses billets payables à vue, plus bas elle peut faire descendre le taux de l’escompte. Ordinairement les banques ne conservent pas, en numéraire, plus du tiers de la somme de leurs émissions. Toutefois le chiffre de la réserve du numéraire est complétement subordonné aux circonstances. Une banque doit conserver une proportion d’espèces plus ou moins considérable, selon que les crises monétaires sont [261] plus ou moins à redouter, selon aussi que les autres valeurs composant sa réserve, sont plus ou moins aisément réalisables en espèces. C’est une affaire de tact. La banque est, du reste, bientôt avertie par la diminution de ses escomptes, qu’elle se trouve en-dessous de la limite nécessaire, car le public ne tarde pas à lui acheter moins de billets lorsqu’il a moins de contiance en leur remboursement.
Une banque autorisée exclusivement à émettre des billets payables à vue, possède donc un double avantage: elle peut fournir un instrument de circulation perfectionné aux demandeurs de monnaie, et cet instrument perfectionné, elle peut le livrer à meilleur marché que les entreprises rivales ne peuvent livrer un instrument plus grossier, le numéraire. Aussi se débarrasse-t-elle aisément de toute concurrence.
Mais si la banque privilégiée réussit à demeurer seule maîtresse du marché n’imposera-t-elle pas la loi aux acheteurs de monnaie? Ne leur fera-t-elle pas payer ses billets plus cher qu’ils ne les payeraient sous un régime de libre concurrence.
le socialiste.
Cela me paraît inévitable. C’est la loi du monopole.
l’économiste.
Les actionnaires de la banque privilégiée bénéficieront de la différence. A la vérité, ils seront obligés d’admettre des co-partageants aux profits de leur fructueux monopole.
Lorsqu’une banque obtient, dans un grand pays, le privilége exclusif de l’émission des billets à vue, toute concurrence venant à succomber devant ce privilége, elle voit s’accroître énormément sa clientèle. Bientôt elle [262] ne peut plus y suffire: elle abandonne alors une partie de sa besogne, partant de ses profits, à un certain nombre de banquiers. Elle n’accepte plus que les billets garantis par trois signatures, et elle entoure l’escompte de formalités et de difficultés telles que les demandeurs de billets sont obligés de recourir à l’intermédiaire des banquiers ayant un compte ouvert à la banque1.
Cela simplifie considérablement la besogne de la banque privilégiée. Au lieu d’avoir affaire à plusieurs milliers d’individus, elle n’a plus affaire qu’à un petit nombre de banquiers, dont il lui est facile de surveiller les opérations; mais ces intermédiaires privilégiés font naturellement payer cher leurs services. Grâce à leur petit nombre ils peuvent faire la loi au public. Il se constitue ainsi, sous l’aile de la banque privilégiée, une véritable aristocratie financière qui partage avec elle les bénéfices du privilége.
Ces bénéfices ne sauraient toutefois dépasser certaines limites. Lorsque la banque et ses intermédiaires élèvent trop haut le prix de l’escompte, le public s’adresse aux banquiers qui escomptent avec du numéraire ou des billets à terme. Malheureusement la concurrence meurtrière de l’établissement privilégié réduisant beaucoup le nombre [263] de ceux-ci, et ne leur laissant qu’une existence précaire, le prix de l’escompte demeure toujours fort exagéré.
Dans les temps de crise, le privilége des banques a un résultat plus funeste encore.
Je vous ai dit qu’une banque doit toujours être en mesure de rembourser ses billets en espèces. Qu’arrive-t-il lorsqu’elle se trouve hors d’état de les rembourser tous? Il arrive que les billets dont le remboursement ne peut s’opérer, se déprécient. Par qui la dépréciation est-elle supportée? par les porteurs de billets; ceux-ci subissent une véritable banqueroute.
Eh! bien, savez-vous à quoi sert le privilége? Il sert à autoriser les banques à commettre impunément, légalement, cette sorte de banqueroute. La Banque de France et la Banque d’Angleterre ont été, à diverses reprises, autorisées à suspendre leurs payements en espèces. La Banque d’Angleterre l’a été notamment en 1797. Les porteurs de billets ont perdu jusqu’à trente pour cent dans le cours de la suspension. La Banque de France a joui du même bénéfice en 1848.
le conservateur.
Ses billets ont perdu fort peu de chose.
l’économiste.
Le chiffre de la perte ne fait rien à l’affaire. N’eussent-ils perdu qu’un seul jour un millième pour cent, les porteurs n’en auraient pas moins été victimes d’une banqueroute.
Si ces deux Banques n’avaient pas été privilégiées, leurs actionnaires auraient été obligés de payer jusqu’au dernier sou, les billets présentés au remboursement. Dans cette éventualité, les porteurs de billets n’auraient rien perdu; en revanche, les actionnaires auraient dû s’imposer [264] d’assez durs sacrifices pour satisfaire à tous les engagements de la Banque. Mais c’est là un risque que courent tous les capitalistes dont les fonds sont engagés dans la production... à l’exception toutefois de ceux qui jouissent du privilége de rejeter leurs pertes sur le public.
le socialiste.
Je m’explique maintenant pourquoi les actionnaires de la Banque de France ont reçu, en 1848, leurs dividendes accoutumés, tandis que toutes les entreprises industrielles ou commerciales étaient en perte.
l’économiste.
Soyons justes toutefois. Il faut accuser bien moins les actionnaires des banques privilégiées que les gouvernements distributeurs de priviléges. En France, comme en Angleterre, le privilége de la Banque a été accordé à titre onéreux. En échange de cette faveur, le gouvernement s’est emparé de tout ou partie du capital versé par les actionnaires. Hors d’état de le leur restituer dans les temps de crise, il s’est tiré de cet embarras, en autorisant la Banque à suspendre ses payements en espèces. Faute de pouvoir s’acquitter de ses engagements envers la Banque, il a autorisé la Banque à manquer à ses engagements envers le public1.
[265]Jadis, lorsque les gouvernements se trouvaient hors d’état de payer leurs dettes, ils falsifiaient leurs monnaies, en y ajoutant du cuivre ou du plomb, ou bien encore en diminuant le poids des pièces. De nos jours, ils procèdent autrement: ils empruntent de grosses sommes à des établissements qu’ils autorisent exclusivement à fabriquer de la monnaie de papier. Privée de sa base naturelle et nécessaire, cette monnaie se déprécie dans les moments de crise. Le gouvernement intervient alors pour obliger le public à supporter la dépréciation.
[266]Ou est la différence des deux procédés?
Sous un régime de libre concurrence aucune de ces combinaisons spoliatrices ne serait possible.
Sous ce régime, les banques devraient disposer d’un capital suffisant pour remplir leurs engagements, faute de quoi le public n’accepterait point leurs billets. Dans les temps de crise, elles supporteraient seules la perte naturellement occasionnée par le resserrement de la circulation; il ne leur serait plus permis de la rejeter sur le public.
Sous ce régime encore, la concurrence des banques [267] ferait promptement descendre le prix de l’escompte, aujourd’hui surélevé, au prix le plus bas possible.
Sous ce régime enfin, les billets de banque représentant des valeurs réelles et non plus des créances irrécouvrables, se fractionnant selon les besoins du public et non plus selon la convenance des privilégiés, se multiplieraient dans une proportion considérable. La circulation presque entière se ferait économiquement en papier au lieu de se faire chèrement en numéraire.
le socialiste.
Vous avez singulièrement ébranlé mes convictions, je l’avoue. Quoi! cette féodalité financière, dont j’attribuais l’existence à la libre concurrence, s’est élevée grâce au monopole. Quoi! la cherté de l’escompte et les perturbations désastreuses de notre circulation monétaire proviennent du privilége et non de la liberté.
l’économiste.
Précisément. Vous autres socialistes, vous vous êtes trompés sur les banques comme sur tout le reste. Vous avez cru que les banques étaient soumises au régime du laisser-faire, et vous avez attribué à la liberté des abus et des maux qui ont leur origine dans le privilége. Ç’a été, en toutes choses, votre grande et déplorable erreur.
le socialiste.
Au fait, c’est bien possible.
l’économiste.
Si nous avions assez de loisirs pour passer en revue toutes les autres industries privilégiées ou réglementées, la boulangerie, la boucherie, l’imprimerie, le notariat, le courtage, la vente des effets publics, le barreau, la médecine, la prostitution, etc., vous verriez qu’en toutes choses le privilége et la réglementation ont donné les mêmes résultats désastreux: diminution et altération de la production d’une part, perturbation, iniquité de la répartition de l’autre.
On a limité le nombre des boulangers dans les principaux centres de population. Mais on s’est aperçu que cette limitation mettait les consommateurs à la merci des boulangers, et l’on a établi un maximum pour le prix du pain. On a voulu corriger un règlement par un autre. A-t-on réussi? Les manœuvres qui s’opèrent journellement à la halle aux farines attestent le contraire. Des spéculateurs s’entendent avec les boulangers pour faire hausser d’une manière factice le cours des farines, le maximum est porté au dessus du cours réel du grain, et les auteurs de ces manœuvres immorales empochent la différence.
[269]Il y a en France quelques villes ou la boulangerie est demeurée libre, à Lunel par exemple, et nulle part on ne mange du pain de meilleur qualité et à aussi bas prix.
Vous savez combien le privilége des agents de change a été profitable au petit nombre de ceux qui en ont été investis; vous savez aussi combien le privilége des notaires a élevé le prix des actes civils tout en diminuant la sécurité des dépôts. Dans aucune industrie libre, les faillites ne sont aussi nombreuses ni aussi scandaleuses que dans le notariat.
Le privilége des imprimeurs a eu pour résultat d’augmenter le prix des impressions, en créant de véritables charges d’imprimeurs. A Paris, ces charges ne coûtent pas moins de vingt-cinq mille francs. Les ouvriers imprimeurs aussi bien que les garçons boulangers, bouchers et les clercs de notaire se trouvent cantonnés à vie dans les derniers grades de l’industrie; à moins de posséder un capital suffisant pour acheter un brevet ou une charge, ils ne peuvent devenir entrepreneurs ou directeurs d’industrie. Autre iniquité!
le conservateur.
Vous nous avez signalé aussi la prostitution. La limitation du nombre des maisons de tolérance n’est-elle pas commandée par l’intérêt de la moralité publique?
l’économiste.
Les entraves apportées à la multiplication des maisons de tolérance ont pour résultat unique d’augmenter les profits des directrices et des commanditaires de ces établissements, tout en diminuant le salaire des malheureuses qui trafiquent de leur beauté et de leur jeunesse. Des fortunes considérables sont sorties de cette exploitation [270] immonde.... Le monopole des maisons de tolérance est renforcé encore par les règlements de police qui interdisent aux prostituées le séjour des maisons garnies. Celles qui n’ont pas les moyens d’acheter des meubles sont obligées de se mettre à la merci des entrepreneurs de prostitution ou de faire de la prostitution interlope.
le socialiste.
Ne pensez-vous pas que la prostitution disparaîtra un jour?
l’économiste.
Je l’ignore. En tous cas, ce n’est point à coups de règlements qu’on la fera disparaître. On la rendra, au contraire, plus dangereuse!
Sous un régime où la propriété serait pleinement respectée, où, par conséquent, la misère serait réduite à son minimum, la prostitution diminuerait considérablement, car la misère est la grande et infatigable pourvoyeusede la prostitution. Il n’y aurait plus, sous ce régime, que des prostituées volontaires. Cela étant, il vaut mieux, je pense, que la prostitution se concentre, conformément au principe de la division du travail, plutôt que de s’universaliser. J’aime mieux peu de femmes se prostituant beaucoup, que beancoup de femmes se prostituant un peu.
Vous ne devineriez guère où le privilége et le communisme sont allés se nicher encore: dans les cercueils où l’on dépose nos tristes dépouilles; dans les cimetières où l’on enfouit la poussière humaine. Pompes funèbres et cimetières sont privilégiés ou communs. On ne peut librement enterrer un mort, on ne peut librement ouvrir un cimetière.
A Paris, l’administration des pompes funèbres est affermée [271] à une entreprise particulière. Le prix du bail est véritablement excessif; la redevance s’élève aux trois quarts de la recette présumée environ. Et cette redevance est payée non pas à la municipalité, mais aux fabriques des églises reconnues par l’État. Tant pis pour les morts qui appartiennent à des cultes non reconnus! Le montant de cet impôt funéraire sert à couvrir les menues dépenses des paroisses, à salarier les prédicateurs en renom, à payer les décorations somptueuses du mois de Marie, etc. Hérétiques ou orthodoxes, les morts ne réclament guère!
Ainsi livré à une administration privilégiée et exorbitamment imposée, le service des pompes funèbres ne saurait manquer d’être cher et défectueux. Il coûte huit ou dix fois plus cher qu’il ne coûterait sous un régime de liberté, et son insuffisance est régulièrement constatée à toutes les époques de mortalité extraordinaire.
Avec ce système, le modeste héritage de l’ouvrier disparaît dans les frais d’enterrement, à moins que les enfants du défunt ne se résignent à recevoir l’aumône du convoi des pauvres. Est-il une inégalité plus monstrueuse?
Les cimetières, ces vastes hôtelleries de la mort, appartiennent aux municipalités. Il n’est pas permis de leur faire concurrence en ouvrant un cimetière libre. Aussi les places réservées coûtent-elles fort cher. Six pieds carrés du cimetière du père Lachaise coûtent plus cher qu’ailleurs un arpent de terre. Le riche seul peut aller s’agenouiller sur la tombe de ses Pères; le pauvre est réduit à s’incliner sur le bord de la fosse commune où se succèdent, pressées comme des gerbes dans une [272] meule, les générations des misérables. Les hordes les plus sauvages auraient horreur de ce communisme de de la tombe; nous y sommes accoutumés... ou pour mieux dire nous le supportons comme tant d’autres abus qui nous meurtrissent... Avez-vous remarqué quelquefois, dans nos cimetières, des femmes du peuple cherchant de l’œil le lieu où l’on a déposé leur père, leur mari ou leur enfant. Elles y avaient planté une petite croix avec une inscription peinte de blanc. Mais la croix a disparu sous une nouvelle couche de cercueils. Fatiguées d’une recherche vaine, elles s’éloignent le cœur gros, en remportant avec elles la couronne d’immortelles, achetée sur le chétif salaire de la semaine...
le conservateur.
Laissons ce sujet lamentable. Dans votre nomenclature d’industries privilégiées vous avez cité le barreau, la médecine, le professorat. Cependant chacun est libre de devenir médecin, avocat, professeur,
l’économiste.
Oui, sans doute, mais ces professions sont étroitement réglémentées. Or, tout règlement qui obstrue l’entrée d’une profession ou d’une industrie, ou qui en embarrasse l’exercice, contribue inévitablement à en élever les frais.
le conservateur.
Comment! vous voudriez qu’on pût exercer librement la médecine, pratiquer le barreau, enseigner... Mais que deviendrions-nous, bon Dieu?
l’économiste.
Ce que nous deviendrions? Nous serions guéris plus promptement et à moins de frais; nos procès nous coûteraient [273] moins cher et nos enfants recevraient une éducation plus substantielle, voilà tout! Fiez-vous pour cela à la loi de l’offre et de la demande, sous un régime de libre-concurrence. Si l’enseignement devenait libre, les entrepreneurs d’éducation cesseraient-ils de demander de bons professeurs? ceux-ci ne seraient-ils pas intéressés, en conséquence, à pouvoir offrir des connaissances solides et vastes? Leur salaire ne se proportionnerait-il pas à leur mérite? Si l’exercice de la médecine venait à être débarrassé des règlements qui l’entravent, les malades n’en continueraient-ils pas moins à s’adresser aux meilleurs médecins? Parmi les études aujourd’hui imposées aux médecins et aux avocats combien sont inutiles dans la pratique? Combien tiennent la place de connaissances indispensables? A quoi servent, je vous le demande, aux avocats et aux médecins le latin et le grec?
le conservateur.
Vouloir que les avocats et les médecins cessent d’apprendre le latin et le grec, en vérité c’est trop fort?
l’économiste.
Les frais de ce latin et de ce grec sont remboursés en partie par les contribuables, qui soutiennent les établissements universitaires, en partie par les clients des avocats et des médecins. Or, je me demande en vain ce qu’un avocat et un médecin, qui ont à discuter des lois françaises et à guérir des malades français, peuvent faire du latin et du grec. Toutes les lois romaines sont traduites aussi bien qu’Hippocrate et Gallien.
le conservateur.
Et la nomenclature médicale donc?
l’économiste.
Croyez-vous qu’une maladie nommée en français ne puisse être aussi aisément guérie que la même maladie nommée en latin ou en grec? Quand donc fera-t-on justice de ce mauvais charlatanisme d’étiquettes et de formules que Molière poursuivait de son impitoyable bon sens?...
Mais il faudrait des volumes pour dénombrer cette armée de priviléges et de règlements qui obstruent l’entrée des professions les plus utiles et qui entravent l’exécution des travaux les plus nécessaires1.
Je finis en citant une dernière disposition de ce monument de barbarie qu’on appelle le Code français.
On se plaint généralement de ce que les grandes entreprises d’utilité publique ont peine à se développer en France. Voulez-vous savoir pourquoi? Lisez cet article de la loi des 7–9 juillet 1833.
“Art. 3. Tous grands travaux publics, routes royales, [275] docks, entrepris par l’État ou par compagnies particulières, avec ou sans péages, avec ou sans subsides du Trésor, avec ou sans aliénation du domaine public, ne pourront être exécutés qu’en vertu d’une loi qui ne sera rendue qu’après une enquête administrative. Une ordonnance suffira pour autoriser l’exécution des routes, des canaux et chemins de fer d’embranchement de moins de vingt mille mètres de longueur, des ponts et de tous autres travaux de moindre importance. Cette ordonnance devra également être précédée d’une enquête.”
Or vous savez combien de temps il faut pour faire une enquête administrative, combien pour discuter une loi ou rendre une ordonnance? Plaignez-vous donc, après cela, de ce que l’esprit d’entreprises ne se développe pas en France! Plaignez-vous de ce que les malheureux que vous avez garottés ne marchent pas!
DIXIÈME SOIRÉE↩
SOMMAIRE: De la charité légale et de son influence sur la population.—Loi de Malthus.—Défense de Malthus.—De la population en Irlande.—Moyen de mettre fin aux misères de l’Irlande.—Pourquoi la charité légale provoque un développement factice de la population.—De son influence morale sur les classes ouvrières.—Que la charité légale décourage la charité privée.—De la qualité de la population.—Moyens de perfectionner la population.—Croisement des races.—Mariages.—Unions sympathiques.—Unions mal assorties.—Leur influence sur la race.—Dans quelle situation, sous quel régime la population se maintiendrait le plus aisément au niveau de ses moyens d’existence.
l’économiste.
Je vous entretiendrai aujourd’hui des perturbations et des désastres occasionnés par la charité légale, par les institutions de bienfaisance organisées et entretenues aux frais du gouvernement, des départements et des communes. Ces institutions, dont les frais sont mis à la charge de tous les contribuables indistinetement, constituent une atteinte des plus nuisibles à la propriété. Au point de vue de la population...
le socialiste.
Enfin! ecce iterùm Crispinus. Voici revenir le malthusien. Vous allez, je le parie, demander la suppression des établissements de bienfaisance dans l’intérêt des pauvres; [277] mais vous ne serez point écouté, je vous en avertis. La constitution de 1848 a imposé à la Société le devoir de l’assistance.
le conservateur.
Et ce devoir la Société saura le remplir.
l’économiste.
Tant pis! Comment un gouvernement peut-il assister les pauvres? En leur donnant de l’argent ou des secours en nature. Cet argent ou ces secours, où peut-il les prendre? Dans les poches des contribuables. Le voilà donc conduit à recourir à la Taxe des pauvres, c’est-à-dire à la plus épouvantable machine de guerre qui ait jamais été dirigée contre les misérables.
le socialiste.
Malthusien! malthusien! malthusien!
l’économiste.
Certes, voilà une injure dont je m’honore. Je suis malthusien quand il s’agit de la population, comme je suis newtonien quand il s’agit de la gravitation, smithien quand il s’agit de la division du travail.
le socialiste.
Décidément, nous allons nous brouiller. Je commencais, s’il faut vous l’avouer, à me laisser ébranler par vos doctrines. Je me surprenais à bénir la propriété et à admirer ses résultats si féconds... mais, en vérité, il me serait impossible d’admirer Malthus, et encore moins de le bénir. Quoi! vous oseriez entreprendre de le justifier ce blasphémateur qui a osé dire: “qu’un homme arrivant sans moyens d’existence sur une terre déjà occupée est tenu de s’en alter”, cet économiste sans entrailles [278] qui a fait l’apologie de l’infanticide, de la peste et de la famine. Défendez donc plutôt Attila ou Mandrin.
le conservateur.
Vous nous rendrez ce témoignage que nous détestons Malthus autant que vous-mêmes. Le Constitutionnel se montrait dernièrement fort peu respectueux à l’endroit de ce déplorable fétiche de l’économie politique anglaise.
l’économiste.
Avez-vous lu Malthus?
le conservateur.
J’ai lu les passages cités par le Constitutionnel.
le socialiste.
Et moi les passages cités par M. Proudhon.
l’économiste.
Ce sont les mêmes, ou, pour mieux dire, c’est le même, car on ne cite jamais que celui-là. Au reste, si barbare que paraisse ce passage il n’en est pas moins l’expression de la vérité.
le conservateur.
Abomination!
le socialiste.
Infamie!
l’économiste.
Et d’une vérité essentiellement humaine, comme je vous le prouverai.
Dites-moi donc, croyez-vous que la terre puisse fournir toutes les matières premières nécessaires à l’entretien d’un nombre illimité d’hommes?
le socialiste.
Non, à coup sûr. La terre ne saurait nourrir qu’un nombre limité d’habitants. Fourier évaluait ce nombre à [279] trois ou cinq milliards. Mais c’est à peine si la terre compte aujourd’hui un milliard d’habitants.
l’économiste.
Vous admettez une limite, et, en effet, il serait absurde d’affirmer que la terre peut nourrir deux, trois, quatre ou cinq cents milliards d’hommes.
Croyez-vous que la force reproductrice de l’espèce humaine soit limitée?
le socialiste.
Je ne saurais le dire.
l’économiste.
Observez tout ce qui vit ou végète, et vous remarquerez que la nature a prodigué les semences et les germes. Chaque espèce de végétaux répand mille fois plus de semences que la terre n’en féconde. Les espèces animales sont, de même, pourvues d’une surabondance de germes.
Les choses pouvaient-elles être arrangées autrement? Si les animaux et les végétaux ne possédaient qu’une force reproductrice bornée, ne suffirait-il pas de la moindre catastrophe pour anéantir leurs espèces? L’ordonnateur des choses pouvait-il se dispenser de les pourvoir d’une force reproductrice presque illimitée?
Cependant, les espèces végétales et animales ne dépassent jamais certaines limites, soit que tous les germes ne reçoivent point de fécondation, soit qu’une partie de ceux qui ont été fécondés, périsse. C’est grâce à la non-fécondation des germes ou à la destruction hâtive des germes fécondés, qu’elles se proportionnent à la quantité d’aliments que leur offre la nature.
Pourquoi l’homme serait-il soustrait à cette loi qui régit toutes les espèces animales et végétales?
[280]Supposez que son pouvoir de reproduction eût été limité, supposez que toute union ne pût produire que deux individus, l’humanité se serait-elle, je ne dis pas multipliée mais simplement maintenue? Au lieu de se propager de manière à peupler la terre, les différentes races d’hommes ne se seraient-elles pas successivement éteintes, par l’action des maladies, des guerres, des accidents, etc? N’était-il pas nécessaire que l’homme fût pourvu, comme l’animal ou la plante, d’une puissance reproductrice surabondante?
Si l’homme possède comme les autres espèces animales et végétales une puissance de reproduction surabondante, que doit-il faire? Doit-il pulluler comme elles, en laissant à la nature le soin de détruire l’excédant de son croît? Doit-il se reproduire sans s’inquiéter plus que l’animal ou la plante du sort de sa progéniture? Non! Être pourvu de raison et de prévoyance, l’homme est tenu d’agir concurrement avec la Providence pour maintenir son espèce dans de justes limites; il est tenu de ne pas donner naissance à des êtres voués d’avance à la destruction.
le socialiste.
Voués à la destruction...
l’économiste.
Voyons. Si l’homme utilisait toute sa puissance reproductrice comme il n’y est que trop disposé; si le nombre des hommes venait, en conséquence, à dépasser un jour la limite des moyens de subsistance, que deviendraient les individus produits au delà de cette limite? Que deviennent les plantes qui se multiplient au delà des facultés nutritives du sol?
le conservateur.
Elles périssent.
l’économiste.
Et rien ne peut les sauver?
le socialiste.
On peut augmenter les forces productives de la terre.
l’économiste.
Jusqu’à une certaine limite. Mais cette limite atteinte, supposez que les plantes se multiplient de manière à la dépasser, que doit-il advenir?
le socialiste.
Alors évidemment le surplus doit périr.
l’économiste.
Et rien ne peut le sauver?
le socialiste.
Rien ne peut le sauver.
l’économiste.
Eh! bien, ce qui arrive aux plantes, arrive aussi aux hommes lorsque la limite de leurs moyens d’existence se trouve dépassée. Voilà la loi que Malthus a reconnue, constatée; voilà l’explication de ce fameux passage que vous et les vôtres lui imputez a crime: “Un homme qui arrive dans un monde déjà occupé, etc.” Et comment Malthus a-t-il reconnu cette loi? en observant les faits! en constatant que dans tous les pays où la population a dépassé les moyens de subsistance, le surplus a péri par la famine, les maladies, les infanticides, etc., et que la destruction n’a point cessé de remplir son office funèbre, jusqu’au moment où la population a été ramenéc à son équilibre nécessaire.
le socialiste.
A son équilibre nécessaire... Vous pensez donc que les pays où Malthus a observé sa loi n’auraient pu nourrir leur excédant de population; vous pensez que notre belle France, où le mal-être décime les générations des pauvres, ne pourrait nourrir ceux qui meurent hâtivement.
l’économiste.
Je suis convaincu que la France pourrait nourrir plus d’habitants et les noùrrir mieux si la multitude des abus économiques que je vous ai signalés avaient cessé d’exister. Mais en attendant que la lumière se soit faite sur ces abus, en attendant qu’ils aient disparu, il est sage de ne point dépasser les moyens de subsistance actuels. Réclamons donc, à la fois, activement les réformes qui doivent reculer les limites des moyens de subsistance, et recommandons, jusque-là, avec Malthus, la prudence, l’abstention, le moral restraint. Plus tard, lorsque l’affranchissement complet de la propriété aura rendu la production plus abondante et la répartition plus juste, l’abstention deviendra moins rigoureuse sans cesser toutefois d’être nécessaire1.
le socialiste.
Cette abstention, ce moral restraint ne cache-t-il pas une grosse immoralité?
l’économiste.
Laquelle? Malthus pensait qu’on se rendait coupable d’un véritable crime en donnant le jour a des êtres inévitablement destinés à périr. Il conseillait, en conséquence, [283] de s’abstenir de les créer. Que voyez-vous d’immoral dans ce conseil?
le socialiste.
Rien! mais vous savez fort bien que l’abstention complète n’est pas possible dans la pratique, et Dieu sait quel compromis immoral vous avez imaginé.
l’économiste.
Nous n’avons rien imaginé du tout, je vous prie de le croire. Le compromis dont vous parlez se pratiquait avant que Malthus s’occupât de la loi de la population. L’économie politique ne l’a jamais recommandé, elle n’a parlé que du moral restraint..... Quant à décider si ce compromis est immoral ou non, ce n’est pas notre affaire à nous autres économistes; adressez-vous pour cela à l’Académie des sciences morales ct politiques (section de morale).
le socialiste.
Je n’y manquerai pas.
le conservateur.
Je conçois que la population puisse dépasser la limite des moyens de subsistance, mais est-il bien facile de fixer cette limite? Peut-on dire, par exemple, que la population dépasse la subsistance en Irlande?
l’économiste.
Oui, et la preuve c’est qu’une partie de la population irlandaise meurt chaque année de faim et de misère.
le socialiste.
Tandis que la riche et puissante aristocratie qui exploite l’Irlande mène une existence splendide à Londres et à Paris.
l’économiste.
Si vous examiniez de près les causes de cette inégalité monstrueuse, vous les trouveriez encore dans des atteintes portées à la propriété. Pendant plusieurs siècles, la confiscation a été à l’ordre du jour en Irlande. Non seulement les Saxons vainqueurs ont confisqué les terres du peuple irlandais, mais encore ils ont détruit son industrie, en la chargeant d’entraves meurtrières. Ces barbaries ont eu un terme, mais l’état social qu’elles ont établi s’est maintenu et aggravé, au grand dommage de l’Angleterre.
le socialiste.
Dites donc à son profit.
l’économiste.
Non, car la misère irlandaise est aujourd’hui entretenue et augmentée d’un côté par les taxes extraordinaires que l’Angleterre s’impose pour nourrir les pauvres de l’Irlande, de l’autre par les taxes ordinaires qu’elle prélève pour protéger les personnes et les propriétés de l’aristocratie irlandaise.
le socialiste.
Quoi! vous voudriez que l’Angleterre laissât périr sans secours les pauvres de l’Irlande?
le conservateur.
Quoi! vous voudriez que l’Angleterre laissât assassiner les propriétaires irlandais et piller leurs propriétés?
l’économiste.
Je voudrais que l’Angleterre dît à l’aristocratie propriétaire de l’Irlande: vous possédez la plus grande partie du capital irlandais et de la terre irlandaise, eh bien! défendez vous-même vos propriétés. Je ne veux plus consacrer un homme ni un schelling à ce service. Je ne veux [285] pas continuer davantage à entretenir les pauvres que vous avez laissés pulluler sur la terre d’Irlande. Si les misérables paysans de l’Irlande se liguent pour brûler vos châteaux et se partager vos terres, tant pis pour vous! Je ne veux plus m’occuper de l’Irlande.
L’Irlande ne demanderait pas mieux, vous le savez. “Par grâce, disait le vieux O’Connell aux membres du parlement britannique, ôtez vos mains de dessus nous. Abandonnez-nous à notre destinée. Permettez-nous de nous gouverner nous-mêmes!”
Si l’Angleterre satisfaisait à ce vœu constant des grands champions de l’indépendance irlandaise, qu’adviendraitil de l’Irlande? Croyez-vous que l’aristocratie abandonnerait ses riches domaines à la merci des bandes affamées des white-boys? Non, à coup sûr! elle se hâterait de quitter ses splendides habitations du West-End à Londres et du faubourg Saint-Honoré à Paris, pour aller défendre ses propriétés menacées. Elle comprendrait alors la nécessité de guérir les lamentables plaies de l’Irlande. Elle appliquerait ses capitaux à développer et à perfectionner l’agriculture, elle se mettrait à créer des aliments pour ceux qu’elle a réduits aux dernières extrémités de la misère. Si elle ne prenait point ce parti, si elle continuait à dépenser oisivement ses revenus à l’étranger, pendant que la famine fait son œuvre en Irlande, réussirait-elle longtemps à préserver, sans appui extérieur, ses terres et ses capitaux? Ne serait-elle pas promptement dépossédée de ses domaines par les légions de misérables qui couvrent la terre d’Irlande?
le socialiste.
Si l’Angleterre lui retirait l’appui de ses forces de terre [286] et de mer, cela changerait singulièrement sa situation; rien n’est plus certain. Mais les Irlandais n’auraient-ils pas intérêt à confisquer purement et simplement les biens de cette aristocratie sans entrailles?
l’économiste.
Ce serait appliquer dans toute sa rigueur la peine du talion. J’ignore jusqu’à quel point il est juste, il est moral de faire peser sur une génération la peine des crimes des générations précédentes; j’ignore si les descendants des victimes de Drogheda et de Wexford ont le droit de faire expier aux propriétaires actuels de l’Irlande, les crimes des bandits à la solde d’Henri VIII, d’Élisabeth et de Cromwell. Mais, à envisager la question au simple point de vue de l’utilité, les Irlandais auraient tort de confisquer les biens de leur aristocratie. Que feraient-ils de ces biens? Ils seraient obligés de les répartir entre une multitude innombrable de paysans, qui achèveraient d’épuiser le sol, faute de pouvoir y appliquer un capital suffisant. En respectant, au contraire, les propriétés de l’aristocratie, ils permettraient à cette classe riche, puissante, éclairée, de diriger la transformation des cultures et de contribuer ainsi, pour sa bonne part, à l’extinction de la misère irlandaise. Les pauvres de l’Irlande y gagneraient tous les premiers.
Mais aussi longtemps que les contribuables anglais se chargeront de fournir de la sécurité aux propriétaires, et des aliments aux pauvres de l’Irlande, soyez bien persuadés que ceux-là continueront à dépenser oisivement leurs revenus à l’étranger, ceux-ci à pulluler au sein d’une effroyable misère; soyez bien persuadés que la situation de l’Irlande ira de mal en pis.
le socialiste.
Que les contribuables anglais cessent de pourvoir aux frais du gouvernement de l’Irlande, cela me semble parfaitement juste; mais ne serait-il pas inhumain d’abandonner à leur destinée les pauvres de l’Irlande?
l’économiste.
Il faut laisser les propriétaires irlandais se débattre avec eux. Abandonnée à elle-même, l’aristocratie irlandaise s’imposera les plus durs sacrifices pour soulager ses pauvres. Ce sera son intérêt, car la charité coûte, à tout prendre, moins cher que la répression. Cependant elle mesurera exactement ses secours aux besoins réels de la population. A mesure que le développement de la production augmentera les emplois du travail, elle diminuera la somme de ses aumônes. Le jour où le travail sera suffisant pour alimenter toute la population, elle cessera ses distributions régulières de secours. Aucune cause artificielle ne contribuera plus alors à faire pulluler la population en Irlande.
le socialiste.
Vous pensez donc que la charité légale provoque un développement factice, anormal de la population.
l’économiste.
C’est un fait qui a été clairement établi, à la suite des enquêtes relatives à la Taxe des pauvres en Angleterre. Et ce fait s’explique aisément. Quel office remplissent les institutions dites de bienfaisance? Elles distribuent gratis des moyens de subsistance aux pauvres. Si ces institutions sont établies par des lois, si elles ouvrent une source assurée de revenus, si elles constituent un patrimoine des pauvres, on trouvera toujours des gens pour manger [288] ce revenu, pour jouir de ce patrimoine; on en trouvera d’autant plus, que les institutions de charité seront plus nombreuses, plus riches et plus accessibles.
Vous verrez alors se détendre le ressort puissant qui pousse l’homme à travailler pour nourrir lui et les siens. Si la paroisse ou la commune accorde à l’ouvrier un supplément de salaire, il réduira d’autant la longueur de sa journée ou la somme de ses efforts; si l’on ouvre des crèches ou des asiles pour l’enfance, il procréera plus d’enfants; si l’on fonde des hospices, si l’on établit des pensions de retraite pour les vieillards, il cessera de s’inquiéter du sort de ses parents et de sa propre vieillesse; si, enfin, on ouvre des hôpitaux pour les malades indigents, il cessera d’économiser pour les jours de maladie. Bientôt vous verrez cet homme que vous aurez déchargé de l’obligation de remplir la plupart de ses devoirs envers les siens et envers lui-même s’adonner, comme une brute, à ses instincts les plus vils. Plus vous ouvrirez d’institutions de bienfaisance, plus vous verrez s’ouvrir aussi de cabarets et de lupanars... Ah! philanthropes benins, socialistes de l’aumône, vous vous chargez de pourvoir aux besoins des pauvres comme le berger se charge de pourvoir à ceux de son troupeau, vous substituez votre responsabilité à la responsabilité individuelle, et vous croyez que l’ouvrier continuera de se montrer laborieux et prévoyant! Vous croyez qu’il travaillera encore pour ses enfants lorsque vous aurez organisé dans vos crèches l’élève économique de ce bétail humain; vous croyez qu’il ne cessera point de soutenir son vieux père lorsque vous aurez ouvert à ses dépens vos hospices gratuits; vous croyez qu’il persistera à économiser pour les [289] mauvais jours lorsque vous aurez mis à son service vos bureaux de bienfaisance et vos hôpitaux. Détrompez-vous! En effaçant la responsabilité, vous aurez détruit la prévoyance. Où la nature avait mis des hommes, votre communisme philanthropique ne laissera bientôt plus que des brutes.
Et ces brutes que vous aurez faites, ces brutes dépourvues de tout ressort moral, elles pulluleront au point que vous deviendrez impuissants à les nourrir. Vous pousserez alors des cris de détresse en accusant les mauvais penchants de l’âme humaine et les doctrines qui les surexcitent. Vous jetterez l’anathème sur le sensualisme, vous dénoncerez les excitations de la presse quotidienne, et que sais-je encore? Pauvres gens!
le conservateur.
L’abus des institutions de bienfaisance peut, sans doute, occasionner de graves désordres dans l’économie de la société; mais est-il bien possible de se passer entièrement de ces institutions? Peut-on laisser expirer sans secours la foule des misérables?
l’économiste.
Qui vous dit de les laisser expirer sans secours? Laissez faire la charité privée et elle les secourra mieux que vos institutions officielles! Elle les secourra sans briser le lien des familles, sans séparer la mère de son enfant, sans enlever le vieillard à son fils, sans priver le mari malade des soins de sa femme et de ses filles. La charité privée se fait avec le cœur et elle respecte les attaches du cœur.
le conservateur.
La charité légale ne fait pas obstacle à la charité privée.
l’économiste.
Vous vous trompez. La charité légale tarit ou décourage la charité privée. Le budget de la charité légale s’élève en France à une centaine de millions. Cette somme est prise sur le revenu de tous les contribuables. Or la charité privée ne puise pas à une autre source. Lorsqu’on augmente le budget de la charité publique, on diminue donc nécessairement celui de la charité privée. Et la diminution d’un côté excède l’augmentation de l’autre. Quand la société se charge de l’entretien des pauvres n’est-on pas naturellement porté à renvoyer les pauvres à la société? On a payé une contribution pour le bureau de bienfaisance, on adresse les pauvres au bureau de bienfaisance. C’est ainsi que le cœur se ferme à la charité!
Mais on a employé un moyen plus efficace encore pour déraciner des âmes ce sentiment le plus noble et le plus généreux que le Créateur y ait déposé. Si l’on n’a pas osé défendre aux riches de faire l’aumône, on a défendu aux pauvres de la demander. La loi française considère la mendicité comme un délit et elle punit le mendiant comme un voleur. La mendicité est sévèrement interdite dans le plus grand nombre de nos départements. Or, si le pauvre commet un délit en recevant une aumôme, le riche ne se se rend-il pas son complice en la lui donnant. La charité est devenue criminelle de par la loi. Comment donc voulez-vous que cette noble plante demeure vivace, lorsque vous n’épargnez rien pour la dessécher et la flétrir?
le socialiste.
Il se peut, en effet, que la charité imposée ait diminué la charité volontaire. Mais d’après vos propres doctrines [291] est-ce un mal? Si la charité provoque le développement factice de la population, si, par conséquent, elle engendre plus de maux qu’elle n’en peut guérir, n’est-il pas souhaitable qu’on la réduise à son minimum, voire même qu’on la supprime tout à fait?
l’économiste.
Je vous ai dit que la charité légale a pour résultat nécessaire de provoquer le développement factice de la population, je ne vous ai pas parlé de la charité privée. Ne confondons pas, je vous prie! Si développée que soit la charité privée, elle est essentiellement précaire, elle n’offre point une issue stable et régulière à une certaine partie de la population; en outre, elle n’altere aucun des ressorts moraux de l’âme humaine.
Celui qui reçoit les dons d’un bureau de bienfaisance ou qui entre dans un hôpital, où il est froidement accueilli, où parfois aussi il sert de chair à expériences, celui-là n’éprouve et ne saurait éprouver aucune reconnaissance pour le service qui lui est rendu. A qui s’adresserait d’ailleurs sa gratitude? A l’administration, aux contribuables? Mais l’administration est représentée par de froids comptables et les contribuables payent avec répugnance leur impôt. L’homme que la société secoure ne saurait se croire moralement obligé envers cette froide idéalité. Il incline plutôt à penser qu’elle acquitte envers lui une dette, et il lui reproche de ne pas s’en acquitter mieux.
Celui dont une charité active et délicate soulage la misère conserve, au contraire, presque toujours, la mémoire de ce bienfait. En recevant un secours il contracte une obligation morale. Or, riche ou pauvre, l’homme [292] n’aime point à contracter plus d’obligations qu’il n’en peut acquitter moralement ou matériellement. On accepte un bienfait avec reconnaissance, mais on ne consent pas à vivre de bienfaits. On se résignerait aux plus durs sacrifices, on se chargerait des fonctions les plus rudes et les plus répugnantes plutôt que de demeurer toujours à la charge de son bienfaiteur. On mourrait de honte si on augmentait encore le fardeau de sa dette par une imprévoyance coupable. Au lieu de briser le ressort moral de l’âme humaine, la charité privée l’affermit et quelquefois le développe. Elle élève l’homme, au lieu de l’avilir.
La charité privée ne saurait donc activer le développement de la population. Elle contribuerait bien plutôt à le ralentir.
Elle ne saurait devenir, non plus, comme la charité légale, une source dangereuse de divisions et de haines. Multipliez en France les institutions dites philanthropiques, continuez à mettre la charité en régie, complétez votre œuvre en interdisant l’aumône à celui qui la donne comme vous la défendez déjà à celui qui la reçoit, et vous verrez quel sera le résultat!
D’un côté, vous aurez un troupeau immense d’hommes qui recevront comme une dette l’aumône rude et avare du fisc. Ces hommes reprocheront amèrement aux classes riches de trop mesurer leur charité, en présence d’une misère que cette charité même aura rendue sans cesse croissante.
D’un autre côté, vous aurez des contribuables accablés sous le faix des impôts et qui se garderont d’aggraver un fardeau déjà trop lourd, en ajoutant une aumône volontaire à l’aumône imposée.
[293]Dans cette situation, la paix publique sera-t-elle long-temps possible? Une société ainsi divisée, une société où aucun lien moral ne rattachera plus les pauvres et les riches, pourra-t-elle subsister sans déchirements? L’Angleterre a failli périr submergée par les misères que la taxe des pauvres avait soulevées. Craignons de nous engager dans la même voie! Faisons de la charité individuelle, cessons de faire de la philanthropie communautaire!...
le socialiste.
Oui, j’aperçois clairement la différence des deux charités; mais la charité privée ne devrait-elle pas être dirigée, organisée?...
l’économiste.
Laissez-la faire! Elle est assez active et assez ingénieuse pour distribuer ses dons de la manière la plus utile. Son instinct la sert mieux que vos décrets ne pourraient le faire.
le socialiste.
J’admets avec vous que la charité libre soit préférable à la charité légale. J’admets même que celle-ci ait pour résultat de faire pulluler la misère. Mais enfin, supposez que la population se soit accrue de manière à dépasser les emplois disponibles de la production et le budget de la charité privée, que faudra-t-il faire alors? Faudra-t-il laisser périr l’excédant de la population?
l’économiste.
Il faudra engager la charité privée à redoubler de zèle, et surtout bien se garder de faire de la charité légale, car celle-ci ayant pour résultats inévitables de diminuer [294] le budget total de la misère et d’augmenter le nombre des pauvres, aggraverait le mal au lieu de le soulager.
Mais je dis que sous un régime où la propriété de tous serait pleinement respectée, sous un régime où les lois économiques qui gouvernent la société cesseraient d’être méconnues et violées, cet excédant ne se produirait point.
le socialiste.
Prouvez-le!
l’économiste.
Permettez-moi, auparavant, de vous dire quelques mots des causes qui dépriment la qualité de la population, qui diminuent le nombre des hommes propres au travail pour augmenter celui des invalides, idiots, crétins, aveugles, sourds-muets que la charité doit nourrir.
le conservateur.
Ah! voilà un côté de la question qui ne manque pas d’intérêt.
l’économiste.
Et que l’on a beaucoup trop négligé.
L’homme est un composé de virtualités ou de forces diverses. Ces virtualités ou ces forces, instincts, sentiments, intelligence, affectent des proportions différentes selon les individus. L’homme le plus complet est celui dont les facultés ont le plus d’énergie; l’homme le plus parfait est celui dont les facultés sont, à la fois, le plus énergiques et le mieux équilibrées.
le conservateur.
Je vois à peu pres ou vous en voulez venir; mais pensez-vous [295] donc qu’on puisse agir sur la génération des hommes comme on agit sur celle des animaux?
l’économiste.
Les Anglais sont parvenus à perfectionner d’une manière presque merveilleuse leurs races ovines et bovines; ils fabriquent des moutons,—c’est à la lettre,—d’une certaine dimension, d’un certain poids et même d’une certaine couleur. Comment ont-ils obtenu ces résultats? En croisant certaines races, et, en choisissant parmi ces races les individus qui s’accouplent le plus utilement.
N’est-il pas vraisemblable que les lois qui régissent la génération des espèces animales, gouvernent aussi celle de l’homme? Remarquez que les races ou variétés nombreuses dont se compose l’humanité sont très diversement douées. Chez les races inférieures, les facultés morales et intellectuelles n’existent qu’à l’état embryonaire. Certaines races ont des facultés particulièrement développées, tandis que le reste de leur organisation est arriéré ou déprimé. Les Chinois, par exemple, sont pourvus à un haut degré du sentiment de la couleur; en revanche, ils sont presque entièrement privés de l’instinct de la lutte ou combativité. Les Indiens peaux-rouges de l’Amérique du Nord se distinguent, au contraire, par les instincts de la combativité et de la ruse, comme aussi par la perception harmonieuse des sons1. Les facultés distinctives des races se transmettent sans modification importante, lorsque les races ne se mêlent point. Les Chinois ont toujours été coloristes; ils ne se sont jamais distingués par leur bravoure. Les Indiens peaux-rouges [296] n’ont jamais cessé d’être braves, rusés, et de parler des dialectes sonores et harmonieux.
le conservateur.
Ceci nous conduirait à établir des haras destinés au perfectionnement de la race humaine.
l’économiste.
Nullement. Ceci nous conduirait à supprimer les obstacles artificiels qui empêchent les différentes variétés de l’espèce humaine de se rapprocher.
le socialiste.
Mais il faudrait diriger, organiser les rapprochements.
l’économiste.
Ces rapprochements-là se dirigent, s’organisent bien tout seuls. Les forces diverses qui ont le cerveau humain pour foyer, obéissent, à ce qu’il semble, à la même loi de gravitation qui gouverne la matière. Les facultés les plus énergiques attirent les facultés les plus faibles de même espèce. C’est, par exemple, une observation commune que les caractères les plus doux et les moins personnels sont invinciblement portés vers les caractères les plus altiers et les plus enclins à la lutte. Les grandes forces attirent les petites, la résultante est une moyenne plus rapprochée de l’équilibre idéal de l’organisation humaine.
Cet équilibre tend à s’établir de lui-même par la manifestation naturelle, spontanée des sympathies ou des affinités individuelles. Et comme toute l’organisation physique dépend de l’ordonnance des facultés physiques, morales et intellectuelles, le corps se perfectionne aussi bien que l’âme.
Si vous admettez cette théorie, vous devez admettre [297] aussi qu’au milieu de l’immense diversité des especès et des individus, il doit se rencontrer deux êtres qui s’attirent avec un maximum d’intensité, et dont le rapprochement donne, en conséquence, la moyenne la plus utile. Entre ces deux êtres, l’union est nécessaire et éternelle. Cette union s’appelle le mariage.
le conservateur.
Ah! vous êtes partisan du mariage.
l’économiste.
Je crois que le mariage est d’institution naturelle. Malheureusement voici ce qui est arrivé: par suite des immenses perturbations morales et matérielles que la société a subies, une multitude d’hommes ont cessé de conclure des unions purement sympathiques. Les préjugés de race ou les intérêts d’argent ont été consultés de préférence aux affinités naturelles, dans la grande affaire du mariage. De là, les unions mal assorties, et, à la suite de ces unions, la dégénérescence des individus et des races. Les unions mal faites, étant sujettes à se dissoudre, les législateurs ont proclamé l’indissolubilité du mariage et édicté des pénalités rigoureuses contre les adultères. Mais la nature n’a point cessé d’agir en dépit de la loi. Les mauvais mariages ne s’en sont pas moins dissous en fait.
Quand une union est mal assortie, quand deux êtres incompatibles se rapprochent, le produit de cet accouplement monstrueux ne saurait être qu’un véritable monstre.
Tout le monde sait que les races supérieures qui ont gouverné l’Europe depuis la chute de l’empire romain se sont, pour la plupart, abâtardies. Pourquoi? Parce que les affinités naturelles déterminaient rarement leurs [298] unions. Les races royales particulièrement ne s’alliaient guère qu’en vue d’intérêts politiques. Aussi ont-elles dégénéré plus rapidement et plus complétement que les autres. Que serait devenue la race des Bourbons de France après l’imbécile Louis XIII si elle ne s’était retrempée dans le sang généreux des Buckingham? Que sont devenus les Bourbons d’Espagne et de Sicile, les Hapsbourg, les rejetons de la maison de Hanovre? Quelles familles ont fourni autant de crétins, d’idiots, de monomanes et de scrofuleux?
Examinez, à ce point de vue, l’histoire de la noblesse française. Au moyen âge, les considérations purement matérielles semblent n’avoir exercé qu’une faible influence sur les unions aristocratiques. L’histoire et la littérature du temps en font foi. Aussi la race se maintenait-elle saine et vigoureuse. Plus tard, les mariages devinrent de simples associations de terres et de noms. Les alliances se négocièrent entre les familles au lieu de s’arranger entre les véritables intéressés. On s’épousa sans se connaître. Qu’en résulta-t-il? Que les unions légitimes devinrent purement fictives, et que les adultères se multiplièrent au point de devenir la règle. Une immonde promiscuité finit par envahir la noblesse française et par la gangrener jusqu’à la moelle des os.
Les mêmes abus renaissent de nos jours. Les fortunes exagérées que les monopoles et les priviléges ont suscitées tendent à s’associer, en dépit des convenances naturelles. La loi civile, en établissant le droit a l’héritage, a contribué encore à transformer les mariages en de pures affaires d’intérêt; enfin, l’instabilité qui menace toutes les existences sous le régime économique actuel, a fait [299] rechercher avec avidité ces accouplements sordides qu’on est convenu d’appeler de bons mariages.
Les êtres imparfaits et vicieux qui sortent des unions mal assorties ou des liaisons clandestines ne pouvant ni gérer leurs biens ni gagner leur vie, retombent à la charge de leur famille ou de la charité publique. A Sparte, on les noyait dans l’Eurotas. Nos mœurs sont plus douces. On laisse végéter ces apparences humaines, fruits de la cupidité ou du libertinage. Mais si ce serait un crime de les détruire, n’est-ce pas un crime plus grand encore de leur donner le jour?
Faites bonne justice des lois et des préjugés qui empêchent le rapprochement utile des races ou qui encouragent les accouplements d’intérêts sordides au détriment des unions sympathiques et vous améliorerez sensiblement la qualité de la population, vous déchargerez par là même la charité d’une notable portion de son fardeau.
Toutes choses se trouvant remises dans leur ordre naturel, un excédant de la population ne serait jamais à redouter.
J’appelle excédant ce qui dépasse et les emplois disponibles de la production et les ressources ordinaires de la charité.
le socialiste.
Vous pensez-donc qu’on sera toujours obligé de recourir à la charité?
l’économiste.
Je l’ignore. Cela dépendra absolument des lumières et de la prévoyance des individus. Supposons une société, où la propriété étant pleinement respectée, les emplois du [300] travail seraient portés à leur maximum, ou, en même temps, la publicité des transactions du travail permettrait de savoir toujours s’il y a un excédant de bras offerts ou un excédant de bras demandés, il est évident que dans cette société la proportion utile de la population serait aisément maintenue.
Lorsque l’offre des bras excède la demande, vous ai-je dit, le prix du travail tombe avec une rapidité telle, que les travailleurs, comme tous les autres marchands, ont intérêt à retirer du marché une partie de leur denrée. S’ils ne la retirent point, si, en même temps, la charité n’agit pas suffisamment, pour secourir ceux qui sont rejetés de l’atelier dans la rue, le prix courant du travail peut tomber beaucoup au-dessous des frais de production....
le socialiste.
Qu’entendez-vous par frais de production du travail?
l’économiste.
J’entends les frais nécessaires pour que le travail se produise et se perpétue. Ces frais varient essentiellement selon la nature du travail. Un homme qui emploie seulement ses forces physiques peut, à la rigueur, ne consommer que des choses purement matérielles; un homme qui met en activité des forces morales et intellectuelles, ne peut les conserver et les perpétuer, s’il ne les entretient comme ses forces physiques. Les frais de production d’un travail sont d’autant plus élevés que ce travail exige le concours plus actif d’un plus grand nombre de facultés. Les frais de production du travail se proportionnent, pour tout dire, à l’étendue et à l’intensité des efforts.
Que la rémunération d’un genre de travail cesse d’en couvrir les frais de production, et aussitôt les travailleurs [301] se rejetteront vers les branches de la production qui exigent moins d’efforts à salaire égal. Le prix du travail haussera alors dans l’industrie désertée, et l’équilibre ne tardera pas à se rétablir. C’est ainsi que se dresse naturellement l’immense échelle des salaires depuis la rémunération du monarque jusqu’à celle du plus humble manouvrier. Malheureusement les priviléges et les monopoles rompent souvent cette harmonie naturelle, en établissant au profit de certaines professions ou de certaines industries un salaire exagéré. La liberté seule comporte une distribution équitable des salaires.
A mesure que l’ouvrier exerce davantage ses facultés intellectuelles et morales en travaillant, les frais de production du travail s’élèvent. Or, dans toutes les branches de la production, le progrès des machines a pour résultat de rendre le travail moins physique et plus intellectuel. A mesure que le progrès se développe on voit donc s’élever aussi les frais de production du travail. En même temps, l’accroissement de la production, fruit du progrès, permet de mieux couvrir ces frais augmentés. A une époque de barbarie, le travail, purement physique, exige peu de chose et obtient moins encore, à une époque de civilisation, le travail, devenu intellectuel, exige beaucoup et peut obtenir davantage.
Mais c’est à la condition que le nombre des bras ne dépassera pas celui des emplois disponibles, sinon le prix courant du travail baissera irrésistiblement au-dessous des frais de production.
le socialiste.
A moins que les travailleurs ne retirent l’excédant du marché.
l’économiste.
Ce qu’ils ne manqueraient pas de faire sous un régime de pleine liberté. Cet excédant serait nourri par les travailleurs occupés, avec l’assistance de la charité volontaire. Dans une situation semblable, la population ne tendrait-elle pas d’elle-même à se resserrer? A mesure que les subventions des travailleurs et les aumônes de la charité s’étendraient sur un plus grand nombre de têtes, la difficulté de plus en plus grande qu’on éprouverait à placer ses enfants ne porterait-elle pas à en élever moins? Le moral restraint agirait alors, et l’équilibre naturel de la population se rétablirait sans efforts. Un phénomène opposé se produirait si les bras venaient à manquer aux emplois. Bien assurés de pouvoir nourrir et placer tous leurs enfants, les pères de famille en éleveraient davantage. Les mariages deviendraient plus nombreux et seraient plus féconds jusqu’à ce que l’équilibre de la population et des moyens d’existence se fût de nouveau rétabli.
Voilà comment se résoudrait le problème de la population sous un régime de pleine liberté économique. C’est ainsi, du reste, qu’il se résout toujours, en définitive. Mais, en attendant, combien de souffrances causées tantôt par les resserrements factices et inopinés du travail, tantôt par l’insuffisance de la charité légale ou les excitations qu’elle donne à l’accroissement de la population! Ces souffrances seraient sinon complétement supprimées sous un régime où le nombre des emplois du travail et les dons de la charité volontaire seraient portés à leur maximum, du moins réduits à la proportion la plus faible possible.
ONZIÈME SOIRÉE↩
SOMMAIRE: Du gouvernement et de sa fonction1.—Gouvernements de monopole et gouvernements communistes.—De la liberté de gouvernement.—Du droit divin.—Que le droit divin est identique au droit au travail.—Vices des gouvernements de monopole.—La guerre est la conséquence inévitable de ce système.—De la souveraineté du peuple.—Comment on perd sa souveraineté.—Comment on la recouvre.—Solution libérale.—Solution communiste.—Gouvernements communistes.—Leurs vices.—Centralisation et décentralisation.—De l’administration de la justice.—Son ancienne organisation.—Son organisation actuelle.—Insuffisance du jury.—Comment l’administration de la sécurité et celle de la justice pourraient être rendues libres.—Avantages des gouvernements libres.—Ce qu’il faut entendre par nationalité.
le conservateur.
Dans votre système d’absolue propriété et de pleine liberté économique, quelle est donc la fonction du gouvernement?
l’économiste.
La fonction du gouvernement consiste uniquement à assurer à chacun la conservation de sa propriété.
le socialiste.
Bon, c’est l’État-gendarme de J.-B. Say.
A mon tour, j’ai une question à vous faire:
Il y a aujourd’hui, dans le monde, deux sortes de gouvernements: les uns font remonter leur origine à un prétendu droit divin.....
le conservateur.
Prétendu! prétendu! c’est à savoir.
le socialiste.
Les autres sont issus de la souveraineté du peuple. Lesquels préférez-vous?
l’économiste.
Je ne veux ni des uns ni des autres. Les premiers sont des gouvernements de monopole, les seconds sont des gouvernements communistes. Au nom du principe de la propriété, au nom du droit que je possède de me pourvoir moi-même de sécurité, ou d’en acheter à qui bon me semble, je demande des gouvernements libres.
le conservateur.
Qu’est-ce à dire?
l’économiste.
C’est-à-dire, des gouvernements dont je puisse, au gré de ma volonté individuelle, accepter ou refuser les services.
le conservateur.
Parlez-vous sérieusement?
l’économiste.
Vous allez bien voir. Vous êtes partisan du droit divin, n’est-il pas vrai?
le conservateur.
Depuis que nous vivons en république, j’y incline assez, je l’avouc.
l’économiste.
Et vous vous croyez un adversaire du droit au travail?
le conservateur.
Si je le crois? mais j’en suis sûr. J’atteste.....
l’économiste.
N’attestez rien, car vous êtes un partisan avoué du droit au travail.
le conservateur.
Mais encore une fois, je.....
l’économiste.
Vous êtes partisan du droit divin. Or le principe du droit divin est absolument identique au principe du droit au travail.
Qu’est-ce que le droit divin? C’est le Droit que possèdent certaines familles au gouvernement des peuples. Qui leur a conféré ce droit? Dieu lui-même. Lisez plutôt [306] les Considérations sur la France, et la brochure sur le Principe générateur des Constitutions politiques, de M. Joseph de Maistre:
“L’homme ne peut faire de souverain, dit M. de Maistre. Tout au plus il peut servir d’instrument pour déposséder un souverain, et livrer ses États à un autre souverain déjà prince. Du reste, il n’a jamais existé de famille souveraine dont on puisse assigner l’origine plébéïenne. Si ce phénomène paraissait, ce serait une époque du monde.
..... Il est écrit: C’est moi qui fais les souverains. Ceci n’est point une phrase d’église, une métaphore de prédicateur; c’est la vérité littérale, simple et palpable. C’est une loi du monde politique. Dieu fait les rois, au pied de la lettre. Il prépare les races royales, il les nourrit au milieu d’un nuage qui cache leur origine. Elles paraissent ensuite couronnées de gloire et d’honneur; elles se placent1.”
Ce qui signifie que Dieu a investi certaines familles du droit de gouverner les hommes, et que nul ne peut les priver de l’exercice de ce droit.
Or, si vous reconnaissez à certaines familles le droit exclusif d’exercer cette espèce particulière d’industrie qu’on appelle le gouvernement, si, encore, vous croyez avec la plupart des théoriciens du droit divin, que les peuples sont tenus de fournir, soit des sujets à gouverner, soit des dotations, en guise d’indemnités de chômages aux membres de ces familles,—et cela pendant toute la durée des siècles,—êtes-vous bien fondé à repousser le [307] Droit au travail? Entre cette prétention abusive d’obliger la société à fournir aux ouvriers le travail qui leur convient, ou une indemnité suffisante, et cette autre prétention abusive d’obliger la société à fournir aux ouvriers des familles royales un travail approprié à leurs facultés et à leur dignité, un travail de gouvernement, ou une Dotation à titre de minimum de subsistances, où est la différence?
le socialiste.
En vérité, il n’y en a aucune.
le conservateur.
Qu’importe! si la reconnaissance du droit divin est indispensable au maintien de la société.
l’économiste.
Les socialistes ne ponrraient-ils pas vous répondre que la reconnaissance du droit au travail n’est pas moins nécessaire au maintien de la société? Si vous admettez le droit au travail pour quelques-uns, ne devez-vous pas l’admettre pour tous? Le droit au travail est-il autre chose qu’une extension du droit divin?
Vous dites que la reconnaissance du droit divin est indispensable au maintien de la société. Comment donc se fait-il que tous les peuples aspirent à se débarrasser des monarchies de droit divin? Comment se fait-il que les vieux gouvernements de monopole soient les uns ruinés, les autres sur le point de l’être?
le conservateur.
Les peuples sont saisis de vertige.
l’économiste.
Voilà un vertige bien répandu! Mais, croyez-moi, les peuples ont de bonnes raisons pour se débarrasser de [308] leurs vieux dominateurs. Le monopole du gouvernement ne vaut pas mieux qu’un autre. On ne gouverne pas bien, et surtout on ne gouverne pas à bon marché, lorsqu’on n’a aucune concurrence à redouter, lorsque les gouvernés sont privés du droit de choisir librement leurs gouvernants. Accordez à un épicier la fourniture exclusive d’un quartier, défendez aux habitants de ce quartier d’acheter aucune denrée chez les épiciers voisins, ou bien encore de s’approvisionner eux-mêmes d’épiceries, et vous verrez quelles détestables drogues l’épicier privilégié finira par débiter et à quel prix! Vous verrez de quelle façon il s’engraissera aux dépens des infortunés consommateurs, quel faste royal il étalera pour la plus grande gloire du quartier... Eh bien! ce qui est vrai pour les services les plus infimes ne l’est pas moins pour les services les plus élevés. Le monopole d’un gouvernement ne saurait valoir mieux que celui d’une boutique d’épiceries. La production de la sécurité devient inévitablement coûteuse et mauvaise lorsqu’elle est organisée en monopole.
C’est dans le monopole de la sécurité que réside la principale cause des guerres qui ont, jusqu’à nos jours, désolé l’humanité.
le conservateur.
Comment cela?
l’économiste.
Quelle est la tendance naturelle de tout producteur, privilégié ou non? C’est d’élever le chiffre de sa clientèle afin d’accroître ses bénéfices. Or, sous un régime de monopole, quels moyens les producteurs de sécurité peuvent-ils employer pour augmenter leur clientèle?
[309]Les peuples ne comptant pas sous ce régime, les peuples formant le domaine légitime des oints du Seigneur, nul ne peut invoquer leur volonté pour acquérir le droit de les administrer. Les souverains sont donc obligés de recourir aux procédés suivants pour augmenter le nombre de leurs sujets: 1° acheter à prix d’argent des royaumes ou des provinces; 2° épouser des héritières apportant en dot des souverainetés ou devant en hériter plus tard; 3° conquérir de vive force les domaines de leurs voisins. Première cause de guerre!
D’un autre côté, les peuples se révoltant quelquefois contre leurs souverains légitimes, comme il est arrivé récemment en Italie et en Hongrie, les oints du Seigneur sont naturellement obligés de faire rentrer dans l’obéissance ce bétail insoumis. Ils forment dans ce but une sainte alliance et ils font grand carnage des sujets révoltés, jusqu’à ce qu’ils aient apaisé leur rébellion. Mais si les rebelles ont des intelligences avec les autres peuples, ceux-ci se mêlent à la lutte, et la conflagration devient générale. Seconde cause de guerre!
Je n’ai pas besoin d’ajouter que les consommateurs de sécurité, enjeux de la guerre, en payent aussi les frais.
Tels sont les avantages des gouvernements de monopole.
le socialiste.
Vous préférez donc les gouvernements issus de la souveraineté du peuple. Vous mettez les républiques démocratiques au-dessus des monarchies et des aristocraties. A la bonne heure!
l’économiste.
Distinguons, je vous prie. Je préfère les gouvernements [310] issus de la souveraineté du peuple. Mais les républiques que vous nommez démocratiques ne sont pas le moins du monde l’expression vraie de la souveraineté du peuple. Ces gouvernements sont des monopoles étendus, des communismes. Or, la souveraineté du peuple est incompatible avec le monopole et le communisme.
le socialiste.
Qu’est-ce donc à vos yeux que la souveraineté du peuple?
l’économiste.
C’est le droit que possède tout homme de disposer librement de sa personne et de ses biens, de se gouverner lui-même.
Si l’homme-souverain a le droit de disposer, en maître, de sa personne et de ses biens, il a naturellement aussi le droit de les défendre. Il possède le droit de libre défense.
Mais chacun peut-il exercer isolément ce droit? Chacun peut-il être son gendarme et son soldat?
Non! pas plus que le même homme ne peut être son laboureur, son boulanger, son tailleur, son épicier, son médecin, son prêtre.
C’est une loi économique, que l’homme ne puisse exercer fructueusement plusieurs métiers à la fois. Aussi voit-on, dès l’origine des sociétés, toutes les industries se spécialiser, et les différents membres de la société se tourner vers les occupations que leurs aptitudes naturelles leur désignent. Ils subsistent en échangeant les produits de leur métier spécial contre les divers objets nécessaires à la satisfaction de leurs besoins.
L’homme isolé jouit, saus conteste, de toute sa souveraineté. [311] Seulement ce souverain, obligé d’exercer lui-même toutes les industries qui pourvoient aux nécessités de la vie, se trouve dans un état fort misérable.
Lorsque l’homme vit en société, il peut conserver sa souveraineté ou la perdre.
Comment perd-il sa souveraineté?
Il la perd lorsqu’il cesse, d’une manière totale ou partielle, directe ou indirecte, de pouvoir disposer de sa personne et de ses biens.
L’homme ne demeure complétement souverain que sous un régime de pleine liberté. Tout monopole, tout privilége est une atteinte portée à sa souveraineté.
Sous l’ancien régime, nul n’ayant le droit de disposer librement de sa personne et de ses biens, nul n’ayant le droit d’exercer librement toute industrie, la souveraineté se trouvait étroitement limitée.
Sous le régime actuel, la souveraineté n’a point cessé d’être atteinte par une multitude de monopoles et de priviléges, restrictifs de la libre activité des individus. L’homme n’a pas encore pleinement recouvré sa souveraineté.
Comment peut-il la recouvrer?
Deux écoles sont en présence, qui donnent à ce problème des solutions tout opposées: l’école libérale et l’école communiste.
L’école libérale dit: Détruisez les monopoles et les priviléges, restituez à l’homme son droit naturel d’exercer librement toute industrie et il jouira pleinement de sa souveraineté.
L’école communiste dit, au contraire: Gardez-vous d’attribuer à chacun le droit de produire librement [312] toutes choses. Ce serait l’oppression et l’anarchie! Attribuez ce droit à la communauté, à l’exclusion des individus. Que tous se réunissent pour organiser en commun toute industrie. Que l’État soit le seul producteur et le seul distributeur de la richesse.
Qu’y a-t-il au fond de cette doctrine? On l’a dit souvent: il y a l’esclavage. Il y a l’absorption et l’annulation de la volonté individuelle dans la volonté commune. Il y a la destruction de la souveraineté individuelle.
Au premier rang des industries organisées en commun figure celle qui a pour objet de protéger, de défendre contre toute agression la propriété des personnes et des choses.
Comment se sont constituées les communautés dans lesquelles cette industrie s’exerce, la nation et la commune?
La plupart des nations ont été successivement agglomérées par les alliances des propriétaires d’esclaves ou de serfs et par leurs conquêtes. La France, par exemple, est un produit d’alliances et de conquêtes successives. Par les mariages, par la force ou la ruse, les souverains de l’Ile de France étendirent successivement leur autorité sur les différentes parties des anciennes Gaules. Aux vingt gouvernements de monopole qui occupaient la surface actuelle de la France, succéda un seul gouvernement de monopole. Les rois de Provence, les ducs d’Aquitaine, de Bretagne, de Bourgogne, de Lorraine, les comtes de Flandres, etc., firent place au roi de France.
Le roi de France était chargé du soin de la défense intérieure et extérieure de l’État. Cependant il [313] ne dirigeait pas seul la défense ou police intérieure.
Chaque seigneur châtelain faisait originairement la police de son domaine; chaque commune, affranchie de vive force ou à prix d’argent de l’onéreuse tutelle de son seigneur, faisait la police de sa circonscription reconnue.
Communes et seigneurs contribuaient, dans une certaine mesure, à la défense générale.
On peut dire que le roi de France avait le monopole de la défense générale, et que les seigneurs chàtelains et les bourgeois des communes avaient celui de la défense locale.
Dans certaines communes, la police était sous la direction d’une administration élue par les bourgeois de la cité, dans les principales communes des Flandres par exemple. Ailleurs, la police s’était constituée en corporation comme la boulangerie, la boucherie, la cordonnerie, en un mot comme toutes les autres industries.
En Angleterre, cette dernière forme de la production de la sécurité a subsisté jusqu’à nos jours. Dans la cité de Londres, la police était naguère encore entre les mains d’une corporation privilégiée. Et chose singulière! cette corporation refusait de s’entendre avec les polices des autres quartiers, si bien que la Cité était devenue un véritable lieu de refuge pour les malfaiteurs. Cette anomalie n’a disparu qu’à l’époque de la réforme de sir Robert Peel1.
Que fit la Révolution française? Elle déposséda le roi de France du monopole de la défense générale, mais elle ne détruisit pas ce monopole; elle le remit entre les mains [314] de la nation, organisée désormais comme une immense commune.
Les petites communes dans lesquelles se divisait le territoire de l’ancien royaume de France continuèrent de subsister. On en augmenta même considérablement le nombre. Le gouvernement de la grande commune eut le monopole de la défense générale, les gouvernements des petites communes exercèrent, sous la surveillance du pouvoir central, le monopole de la défense locale.
Mais on ne se borna pas là. On organisa encore dans la commune générale et dans les communes particulières d’autres industries, notamment l’enseignement, les cultes, les transports, etc., et l’on établit sur les citoyens divers impôts pour subvenir aux frais de ces industries ainsi organisées en commun.
Plus tard, les socialistes, mauvais observateurs s’il en fut jamais, ne remarquant point que les industries organisées dans la commune générale ou dans les communes particulières, fonctionnaient plus chèrement et plus mal que les industries laissées libres, demandèrent l’organisation en commun de toutes les branches de la production. Ils voulurent que la commune générale et les communes particulières ne se bornassent plus à faire la police, à bâtir des écoles, à construire des routes, à salarier des cultes, à ouvrir des bibliothèques, à subventionner des théâtres, à entretenir des haras, à fabriquer des tabacs, des tapis, de la porcelaine, etc., mais qu’elles se missent à produire toutes choses.
Le bon sens public se révolta contre cette mauvaise utopie, mais il n’alla pas plus loin. On comprit bien qu’il serait ruineux de produire toutes choses en commun. On [315] ne comprit pas qu’il était ruineux de produire certaines choses en commun. On continua donc de faire du communisme partiel, tout en honnissant les socialistes qui réclamaient à grands cris un communisme complet.
Cependant les conservateurs, partisans du communisme partiel et adversaires du communisme complet, se trouvent aujourd’hui divisés sur un point important.
Les uns veulent que le communisme partiel continue à s’exercer principalement dans la commune générale; ils défendent la centralisation.
Les autres réclament, au contraire, une plus large part d’attributions pour les petites communes. Ils veulent que celles-ci puissent exercer diverses industries, fonder des écoles, construire des routes, bâtir des églises, subventionner des théâtres, etc., sans avoir besoin de l’autorisation du gouvernement central. Ils demandent la décentralisation.
L’expérience a montré les vices de la centralisation. L’expérience a prouvé que les industries exercées dans la grande commune, dans l’État, fournissent des produits plus chers et plus mauvais que ceux de l’industrie libre.
Mais est-ce a dire que la décentralisation vaille mieux? Est-ce à dire qu’il soit plus utile d’émanciper les communes, ou, ce qui revient au même, de leur permettre d’établir librement des écoles et des institutions de bienfaisance, de bâtir des théâtres, de subventionner des cultes, ou même encore d’exercer librement d’autres industries?
Pour subvenir aux dépenses des services dont elles se chargent, que faut-il aux communes? Il leur faut des capitaux. Ces capitaux où peuvent-elles les puiser? Dans [316] les poches des particuliers, non ailleurs. Elles sont obligées, en conséquence, de prélever différents impôts sur les habitants de la commune.
Ces impôts consistent généralement aujourd’hui dans les centimes additionnels ajoutés aux contributions payées à l’État. Toutefois certaines communes ont obtenu aussi l’autorisation d’établir autour de leurs limites une petite douane sous le nom d’octroi. Cette douane, qui atteint la plupart des industries demeurées libres, augmente naturellement beaucoup les ressources de la commune. Aussi les autorisations d’établir un octroi sont-elles fréquemment demandées au gouvernement central. Celui-ci ne les accorde guère, et en cela il agit sagement; en revanche il permet assez souvent aux communes de s’imposer extraordinairement, autrement dit, il permet à la majorité des administrateurs de la commune d’établir un impôt extraordinaire que tous les administrés sont obligés de payer.
Que les communes soient émancipées, que, dans chaque localité, la majorité des habitants ait le droit d’établir autant d’industries qu’il lui plaira, et d’obliger la minorité à contribuer aux dépenses de ces industries organisées en commun; que la majorité soit autorisée à établir librement toute espèce de taxes locales, et vous verrez bientôt se constituer en France autant de petits États différents et séparés qu’on y compte de communes. Vous verrez successivement s’élever, pour subvenir aux taxes locales, quarante-quatre mille douanes intérieures sous le nom d’octrois; vous verrez, pour tout dire, se reconstituer le moyen âge.
Sous ce régime, la liberté du travail et des échanges [317] sera atteint et par les monopoles que les communes s’attribueront de certaines branches de la production, et par les impôts qu’elles prélèveront sur les autres branches pour alimenter les industries exercées en commun. La propriété de tous se trouvera à la merci des majorités.
Dans les communes où prédomine l’opinion socialiste, que deviendra, je vous le demande, la propriété? Non seulement la majorité lèvera des impôts pour subvenir aux dépenses de la police, de la voirie, du culte, des établissements de bienfaisance, des écoles, etc., mais elle en lèvera aussi pour établir des ateliers communaux, des magasins communaux, des comptoirs communaux, etc. Ces taxes locales, la minorité non socialiste ne sera-t-elle pas obligée de les payer?
Sous un tel régime, que devient donc la souveraineté du peuple? Ne disparaît-elle pas sous la tyrannie du plus grand nombre?
Plus directement encore que la centralisation, la décentralisation conduit au communisme complet, c’est-à-dire à la destruction complète de la souveraineté.
Que faut-il donc faire pour restituer aux hommes cette souveraineté que le monopole leur a ravie dans le passé; et que le communisme, ce monopole étendu, menace de leur ravir dans l’avenir?
Il faut tout simplement rendre libre les différentes industries jadis constituées en monopoles, et aujourd’hui exercées en commun. Il faut abandonner à la libre activité des individus les industries encore exercées ou réglementées dans l’État ou dans la commune.
Alors l’homme possédant, comme avant l’établissement des sociétés, le droit d’appliquer librement, sans entrave [318] ni charge aucune, ses facultés à toute espèce de travaux, jouira de nouveau, pleinement, de sa souveraineté.
le conservateur.
Vous avèz passé en revue les différentes industries encore monopolisées, privilégiées ou réglementées, et vous nous avez prouvé, avec plus ou moins de succès, que ces industries devraient être-laissées libres pour l’avantage commun. Soit! je ne veux pas revenir sur un thème épuisé. Mais est-il possible d’enlever à l’État et aux communes le soin de la défense générale et de la défense locale.
le socialiste.
Et l’administration de la justice donc?
le conservateur.
Oui, et l’administration de la justice. Est-il possible que ces industries, pour parler votre langage, soient exercées autrement qu’en commun, dans la nation et dans la commune.
l’économiste.
Je glisserais peut-être sur ces deux communismes-là si vous consentiez bien franchement à m’abandonner tous les autres; si vous réduisiez l’État à n’être plus désormais qu’un gendarme, un soldat et un juge. Cépèndant, non!...car le communisme de la sécurité est la clef de voûte du vieux édifice de la servitude. Je ne vois d’ailleurs aucune raison pour vous accorder celui-là plutôt que les autres.
De deux choses l’une, en effet:
Ou le communisme vaut mieux que la liberté, et, dans ce cas, il faut organiser toutes les industries en commun, dans l’État ou dans la commune.
[319]Ou la liberté est préférable au communisme, et, dans ce cas, il faut rendre libres toutes les industries encore organisées en commun, aussi bien la justice et la police que l’enseignement, les cultes, les transports, la fabrication des tabacs, etc.
le socialiste.
C’est logique.
le conservateur.
Mais est-ce possible?
l’économiste.
Voyons! S’agit-il de la justice? Sous l’ancien régime, l’administration de la justice n’était pas organisée et salariée en commun; elle était organisée en monopole, et salariée par ceux qui en faisaient usage.
Pendant plusieurs siècles, il n’y eut pas d’industrie plus indépendante. Elle formait, comme toutes les autres branches de la production matérielle ou immatérielle, une corporation privilégiée. Les membres de cette corporation pouvaient léguer leurs charges ou maîtrises à leurs enfants, ou bien encore les vendre. Jouissant de ces charges à perpétuité, les juges se faisaient remarquer par leur indépendance et leur intégrité.
Malheureusement ce régime avait, d’un autre côté, tous les vices inhérents au monopole. La justice monopolisée se payait fort cher.
le socialiste.
Et Dieu sait combien de plaintes et de réclamations excitaient les épices. Témoin ces petits vers qui furent crayonnés sur la porte du Palais de Justice après un incendie:
[320]- Un beau jour dame Justice
- Se mit le palais tout en feu
- Pour avoir mangé trop d’épice.
La justice ne doit-elle pas être essentiellement gratuite? Or, la gratuité n’entraîne-t-elle pas l’organisation en commun?
l’économiste.
On se plaignait de ce que la justice mangeait trop d’épices. On ne se plaignait pas de ce qu’elle en mangeait. Si la justice n’avait pas été constituée en monopole; si, en conséquence, les juges n’avaient pu exiger que la rémunération légitime de leur industrie, on ne se serait pas plaint des épices.
Dans certains pays, où les justiciables avaient le droit de choisir leurs juges, les vices du monopole se trouvaient singulièrement atténués. La concurrence qui s’établissait alors entre les différentes cours, améliorait la justice et la rendait moins chère. Adam Smith attribue à cette cause les progrès de l’administration de la justice en Angleterre. Le passage est curieux et j’espère qu’il dissipera vos doutes:
“Les honoraires de cour paraissent avoir été originairement le principal revenu des différentes cours de justice en Angleterre. Chaque cour tâchait d’attirer à elle le plus d’affaires qu’elle pouvait, et ne demandait pas mieux que de prendre connaissance de celles mêmes qui ne tombaient point sous sa juridiction. La cour du banc du roi, instituée pour le jugement des seules causes criminelles, connut des procès civils, le demandeur prétendant que le défendeur, en ne lui faisant pas justice, s’était rendu coupable de quelque faute ou malversation. La [321] cour de l’échiquier, préposée pour la levée des dossiers royaux et pour contraindre à les payer, connut aussi des autres engagements pour dettes, le plaignant alléguant que si on ne le payait pas, il ne pourrait payer le roi. Avec ces fictions, il dépendait souvent des parties de se faire juger par le tribunal qu’elles voulaient, et chaque cour s’efforçait d’attirer le plus de causes qu’elle pouvait au sien, par la diligence et l’impartialité qu’elle mettait dans l’expédition des procès. L’admirable constitution actuelle des cours de justice, en Angleterre, fut peut-être originairement, en grande partie le fruit de cette émulation qui animait ces différents juges, chacun s’efforçant à l’envi d’appliquer à toute sorte d’injustices, le remède le plus prompt et le plus efficace que comportait la loi1.”
le socialiste.
Mais, encore une fois, la gratuité n’est-elle pas préférable?
l’économiste.
Vous n’êtes donc pas revenu encore de l’illusion de la gratuité. Ai-je besoin de vous démontrer que la justice gratuite coûte plus cher que l’autre, de tout le montant de l’impôt, prélevé pour entretenir les tribunaux gratuits et salarier les juges gratuits. Ai-je besoin de vous démontrer encore que la gratuité de la justice est nécessairement inique, car tout le monde ne se sert pas également de la justice, tout le monde n’a pas également l’esprit processif? Au reste, la justice est loin d’être gratuite sous le régime actuel, vous ne l’ignorez pas.
le conservateur.
Les procès sont ruineux. Cependant pouvons-nous nous plaindre de l’administration actuelle de la justice? L’organisation de nos tribunaux n’est-elle pas irréprochable?
le socialiste.
Oh! oh! irréprochable. Un Anglais que j’accompagnai un jour à la cour d’assises, sortit de la séance tout indigné. Il ne concevait pas qu’un peuple civilisé permit à un procureur du roi ou de la république, de faire de la rhétorique pour demander une condamnation à mort. Cette éloquence, pourvoyeuse du bourreau, lui faisait horreur. En Angleterre, on se contente d’exposer l’accusation; on ne la passionne pas.
l’économiste.
Ajoutez à cela les lenteurs proverbiales de nos cours de justice, les souffrances des malheureux qui attendent leur jugement pendant des mois, et quelquefois pendant des années, tandis que l’instruction pourrait se faire en quelques jours; les frais et les pertes énormes que ces délais entraîent, et vous vous convaincrez que l’administration de la justice n’a guère progressé en France.
le socialiste.
N’exagérons rien, toutefois. Nous possédons aujourd’hui, grâce au ciel, l’institution du jury.
l’économiste.
En effet, on ne se contente pas d’obliger les contribuables à payer les frais de la justice, on les oblige aussi à remplir les fonctions de juges. C’est du communisme pur: Ab uno disce omnes. Pour moi, je ne pense pas que [323] le jury vaille mieux pour juger, que la garde nationale, une autre institution communiste! pour faire la guerre.
le socialiste.
Pourquoi donc?
l’économiste.
Parce qu’on ne fait bien que son métier, sa spécialité, et que le métier, la spécialité d’un juré n’est pas d’être juge.
le conservateur.
Aussi se contente-t-il de constater le délit, et d’apprécier les circonstances dans lesquelles le délit a été commis.
l’économiste.
C’est-à-dire d’exercer la fonction la plus difficile, la plus épineuse du juge. C’est cette fonction si délicate, qui exige un jugement si sain, si exercé, un esprit si calme, si froid, si impartial que l’on confie aux hasards du tirage au sort. C’est absolument comme si l’on tirait au sort les noms des citoyens qui seront chargés, chaque année, de fabriquer des bottes ou d’écrire des tragédies pour la communauté.
le conservateur.
La comparaison est forcée.
l’économiste.
Il est plus difficile, à mon avis, de rendre un bon jugement que de faire une bonne paire de bottes ou d’aligner convenablement quelques centaines d’alexandrins. Un juge parfaitement éclairé et impartial est plus rare qu’un bottier habile ou un poëte capable d’écrire pour le Théâtre-Français.
Dans les causes criminelles, l’inhabileté du jury se [324] trahit tous les jours. Mais on ne prête, hélas! qu’une médiocre attention aux erreurs commises en cour d’assises. Que dis-je? on regarde presque comme un délit de critiquer un jugement rendu. Dans les causes politiques, le jury n’a-t-il pas coutume de prononcer selon la couleur de son opinion, blanc ou rouge, plutôt que selon la justice? Tel homme qui est condamné par un jury blanc ne serait-il pas absous par un jury rouge, et vice versâ?
le socialiste.
Hélas!
l’économiste.
Déjà les minorités sont bien lasses d’être jugées par des jurys appartenant aux majorités. Attendez la fin...
S’agit-il de l’industrie qui pourvoit à la défense intérieure et extérieure? Croyez-vous qu’elle vaille beaucoup mieux que celle de la justice? Notre police et surtout notre armée ne nous coûtent-elles pas bien cher pour les services réels qu’elles nous rendent?
N’y a-t-il enfin aucun inconvénient à ce que cette industrie de la défense publique soit aux mains d’une majorité?
Examinons.
Dans un système où la majorité établit l’assiette de l’impôt et dirige l’emploi des deniers publics, l’impôt ne doit-il pas peser plus ou moins sur certaines portions de la société, selon les influences prédominantes? Sous la monarchie, lorsque la majorité était purement fictive, lorsque la classe supérieure s’arrogeait le droit de gouverner le pays à l’exclusion du reste de la nation, l’impôt ne pesait-il pas principalement sur les consommations des [325] classes inférieures, sur le sel, sur le vin, sur la viande, etc.? Sans doute, la bourgeoisie payait sa part de ces impôts, mais le cercle de ses consommations étant infiniment plus large que celui des consommations de la classe inféricure, son revenu s’en trouvait, en définitive, beaucoup plus légèrement atteint. A mesure que la classe inférieure, en s’éclairant, acquerra plus d’influence dans l’État, vous verrez se produire une tendance opposée. Vous verrez l’impôt progressif, qui est tourné aujourd’hui contre la classe inférieure, être retourné contre la classe supérieure. Celle-ci résistera sans doute de toutes ses forces à cette tendance nouvelle; elle criera, avec raison, à la spoliation, au vol; mais si l’institution communautaire du suffrage universel est maintenue, si une surprise de la force ne remet pas, de nouveau, le gouvernement de la société aux mains des classes riches à l’exclusion des classes pauvres, la volonté de la majorité prévaudra, et l’impôt progressif sera établi. Une partie de la propriété des riches sera alors légalement confisquée pour alléger le fardeau des pauvres, comme une partie de la propriété des pauvres a été trop longtemps confisquée pour alléger le fardeau des riches.
Mais il y a pis encore.
Non seulement la majorité d’un gouvernement communautaire peut établir, comme bon lui semble, l’assiette de l’impôt, mais encore elle peut faire de cet impôt l’usage qu’elle juge convenable, sans tenir compte de la volonté de la minorité.
Dans certains pays, le gouvernement de la majorité emploie une partie des deniers publics à protéger des propriétés essentiellement illégitimes et immorales. Aux [326] États-Unis, par exemple, le gouvernement garantit aux planteurs du sud la propriété de leurs esclaves. Cependant il y a, aux États-Unis, des abolitionnistes qui considèrent, avec raison, l’esclavage comme un vol. N’importe! le mécanisme communautaire les oblige à contribuer de leurs deniers au maintien de cette espèce de vol. Si les esclaves tentaient un jour de s’affranchir d’un joug inique et odieux, les abolitionnistes seraient contraints d’aller défendre, les armes à la main, la propriété des planteurs. C’est la loi des majorités!
Ailleurs, il arrive que la majorité, poussée par des intrigues politiques ou par le fanatisme religieux, déclare la guerre à un peuple étranger. La minorité a heau avoir horreur de cette guerre et la maudire, elle est obligée d’y contribuer de son sang et de son argent. C’est encore la loi des majorités!
Ainsi qu’arrive-t-il? C’est que la majorité et la minorité sont perpétuellement en lutte, et que la guerre descend parfois de l’arène parlementaire dans la rue.
Aujourd’hui c’est la minorité rouge qui s’insurge. Si cette minorité devenait majorité, et si, usant de ses droits de majorité, elle remaniait la constitution à sa guise, si elle décrétait des impôts progressifs, des emprunts forcés et des papiers-monnaie, qui vous assure que la minorité blanche ne s’insurgerait pas demain?
Il n’y a point de sécurité durable dans ce système. Et savez-vous pourquoi? Parce qu’il menace incessamment la propriété; parce qu’il met à la merci d’une majorité aveugle ou éclairée, morale ou immorale, les personnes et les biens de tous.
Si le régime communautaire, au lieu d’être appliqué [327] comme en France à une multitude d’objets, se trouvait étroitement limité comme aux États-Unis, les causes de dissentiment entre la majorité et la minorité étant moins nombreuses, les inconvénients de ce régime seraient moindres. Toutefois ils ne disparaîtraient point entièrement. Le droit reconnu au plus grand nombre de tyranniser la volonté du plus petit pourrait encore, en certaines circonstances, engendrer la guerre civile.
le conservateur.
Mais, encore une fois, on ne conçoit pas comment l’industrie qui pourvoit à la sécurité des personnes et des propriétés pourrait être pratiquée si elle était rendue libre. Votre logique vous conduit à des rêves dignes de Charenton.
l’économiste.
Voyons! ne nous fâchons pas. Je suppose qu’après avoir bien reconnu que le communisme partiel de l’État et de la commune est décidément mauvais, on laisse libres toutes les branches de la production, à l’exception de la justice et de la défense publique. Jusque-là point d’objection. Mais un économiste radical, un rêveur vient et dit: Pourquoi done, après avoir affranchi les différents emplois de la propriété, n’affranchissez-vous pas aussi ceux qui assurent le maintien de la propriété? Comme les autres, ces industries-là ne seront-elles pas exercées d’une manière plus équitable et plus utile si elles sont rendues libres? Vous affirmez que c’est impraticable. Pourquoi. D’un côté, n’y a-t-il pas, au sein de la société, des hommes spécialement propres, les uns à juger les différends qui surviennent entre les propriétaires et à apprécier les délits commis contre la propriété, les autres [328] à défendre la propriété des personnes et des choses contre les agressions de la violence et de la ruse? N’y a-t-il pas des hommes que leurs aptitudes naturelles rendent spécialement propres à être juges, gendarmes et soldats. D’un autre côté, tous les propriétaires indistinctement n’ont-ils pas besoin de sécurité et de justice? Tous ne sont-ils pas disposés, en conséquence, à s’imposer des sacrifices pour satisfaire à ce besoin urgent, surtout s’ils sont impuissants à y satisfaire eux-mêmes ou s’ils ne le peuvent à moins de dépenser beaucoup de temps et d’argent?
Or s’il y a d’un côté des hommes propres à pourvoir à un besoin de la société, d’un autre côté, des hommes disposés à s’imposer des sacrifices pour obtenir la satisfaction de ce besoin, ne suffit-il pas de laisser faire les uns et les autres pour que la denrée demandée, matérielle ou immatérielle, se produise, et que le besoin soit satisfait?
Ce phénomène économique ne se produit-il pas irrésistiblement, fatalement, comme le phénomique physique de la chute des corps?
Ne suis-je donc pas fondé à dire que si une société renonçait à pourvoir à la sécurité publique, cette industrie particulière n’en serait pas moins exercée? Ne suis-je pas fondé à ajouter qu’elle le serait mieux sous le régime de la liberté qu’elle ne pouvait l’être sous le régime de la communauté?
le conservateur.
De quelle manière?
l’économiste.
Cela ne regarde pas les économistes. L’économie politique [329] peut dire: si tel besoin existe, il sera satisfait, et il le sera mieux sous un régime d’entière liberté que sous tout autre. A cette règle, aucune exception! mais comment s’organisera cette industrie, quels seront ses procédés techniques, voilà ce que l’économie politique ne saurait dire.
Ainsi, je puis affirmer que si le besoin de se nourrir se manifeste au sein de la société, ce besoin sera satisfait, et qu’il le sera d’autant mieux que chacun demeurera plus libre de produire des aliments ou d’en acheter à qui bon lui semblera.
Je puis assurer encore que les choses se passeront absolument de la même manière si, au lieu de l’alimentation, il s’agit de la sécurité.
Je prétends donc que si une communauté déclarait renoncer, au bout d’un certain délai, un an par exemple, à salarier des juges, des soldats et des gendarmes, au bout de l’année cette communauté n’en posséderait pas moins des tribunaux et des gouvernements prêts à fonctionner; et j’ajoute que si, sous ce nouveau régime, chacun conservait le droit d’exercer librement ces deux industries et d’en acheter librement les services, la sécurité serait produite le plus économiquement et le mieux possible.
le conservateur.
Je vous répondrai toujours que cela ne se peut concevoir.
l’économiste.
A l’époque où le régime réglementaire retenait l’industrie prisonnière dans l’enceinte des communes, et où chaque corporation était exclusivement maîtresse du [330] marché communal, on disait que la société était menacée chaque fois qu’un novateur audacieux s’efforçait de porter atteinte à ce monopole. Si quelqu’un était venu dire alors qu’à la place des malingres et chétives industries des corporations, la liberté mettrait un jour d’immenses manufactures fournissant des produits moins chers et plus parfaits, on eût traité ce rêveur de la belle manière. Les conservateurs du temps auraient juré leurs grands dieux que cela ne se pouvait concevoir.
le socialiste.
Mais voyons! Comment peut-on imaginer que chaque individu ait le droit de se faire gouvernement ou de choisir son gouvernement, ou même de n’en pas choisir... Comment les choses se passeraient-elles en France, si, après avoir rendu libres toutes les autres industries, les citoyens français annonçaient de commun accord, qu’ils cesseront, au bout d’une année, de soutenir le gouvernement de la communauté?
l’économiste.
Je ne puis faire que des conjectures à cet égard. Voici cependant à peu près de quelle manière les choses se passeraient. Comme le besoin de sécurité est encore très grand dans notre société, il y aurait profit à fonder des entreprises de gouvernement. On serait assuré de couvrir ses frais. Comment se fonderaient ces entreprises? Des individualités isolées n’y suffiraient pas plus qu’elles ne suffisent pour construire des chemins de fer, des docks, etc. De vastes compagnies se constitueraient donc pour produire de la sécurité; elles se procureraient le matériel et les travailleurs dont elles auraient besoin. Aussitôt qu’elles se trouveraient prêtes à fonctionner, [331] ces compagnies d’assurances sur la propriété appelleraient la clientèle. Chacun s’abounerait à la compagnie qui lui inspirerait le plus de confiance et dont les conditions lui sembleraient le plus favorables.
le conservateur.
Nous ferions queue pour aller nous abonner. Assurément, nous ferions queue!
l’économiste.
Cette industrie étant libre on verrait se constituer autant de compagnies qu’il pourrait s’en former utilement. S’il y en avait trop peu, si, par conséquent, le prix de la sécurité était surélevé, on trouverait profit à en former de nouvelles; s’il y en avait trop, les compagnies surabondantes ne tarderaient pas à se dissoudre. Le prix de la sécurité serait, de la sorte, toujours ramené au niveau des frais de production.
le conservateur.
Comment ces compagnies libres s’entendraient-elles pour pourvoir à la sécurité générale?
l’économiste.
Elles s’entendraient comme s’entendent aujourd’hui les gouvernements monopoleurs et communistes, parce qu’elles auraient intérêt à s’entendre. Plus, en effet, elles se donneraient de facilités mutuelles pour saisir les voleurs et les assassins, et plus elles diminueraient leurs frais.
Par la nature même de leur industrie, les compagnies d’assurances sur la propriété ne pourraient dépasser certaines circonscriptions: elles perdraient à entretenir une police dans les endroits où elles n’auraient qu’une faible clientèle. Dans leurs circonscriptions elles ne pourraient [332] néanmoins opprimer ni exploiter leurs clients, sous peine de voir surgir instantanément des concurrences.
le socialiste.
Et si la compagnie existante voulait empêcher les concurrences de s’établir?
l’économiste.
En un mot, si elle portait atteinte à la propriété de ses concurrents et à la souveraineté de tous... Oh! alors, tous ceux dont les monopoleurs menaceraient la propriété et l’indépendance se lèveraient pour les châtier.
le socialiste.
Et si toutes les compagnies s’entendaient pour se constituer en monopoles. Si elles formaient une sainte-alliance pour s’imposer aux nations, et si fortifiées par cette coalition, elles exploitaient sans merci les malheureux consommateurs de sécurité, si elles attiraient à elles par de lourds impôts la meilleure part des fruits du travail des peuples?
l’économiste.
Si, pour tout dire, elles recommençaient à faire ce que les vieilles aristocraties ont fait jusqu’à nos jours... Eh! bien, alors, les peuples suivraient le conseil de Béranger:
- Peuples, formez une Sainte-Alliance
- Et donnez-vous la main.
Ils s’uniraient, à leur tour, et comme ils possèdent des moyens de communication que n’avaient pas leurs ancêtres, comme ils sont cent fois plus nombreux que leurs vieux dominateurs, la sainte-alliance des aristocraties serait bientôt anéantie. Nul ne serait plus tenté alors, je vous jure, de constituer un monopole.
le conservateur.
Comment ferait-on sous ce régime pour repousser une invasion étrangère?
le socialiste.
Quel serait l’intérêt des compagnies? Ce serait de repousser les envahisseurs, car elles seraient les premières victimes de l’invasion. Elles s’entendraient donc pour les repousser et elles demanderaient à leurs assurés un supplément de prime pour les préserver de ce danger nouveau. Si les assurés préféraient courir les risques de l’invasion, ils refuseraient ce supplément de prime; sinon, ils le payeraient, et ils mettraient ainsi les compagnies en mesure de parer au danger de l’invasion.
Mais de même que la guerre est inévitable sous un régime de monopole, la paix est inévitable sous un régime de libre gouvernement.
Sous ce régime, les gouvernements ne peuvent rien gagner par la guerre; ils peuvent, au contraire, tout perdre. Quel intérêt auraient-ils à entreprendre une guerre? serait-ce pour augmenter leur clientèle? Mais, les consommateurs de sécurité étant libres de se faire gouverner à leur guise, échapperaient aux conquérants. Si ceux-ci voulaient leur imposer leur domination, après avoir détruit le gouvernement existant, les opprimés réclameraient aussitôt le secours de tous les peuples....
Les guerres de compagnie à compagnie ne se feraient d’ailleurs qu’autant que les actionnaires voudraient en avancer les frais. Or, la guerre ne pouvant plus rapporter à personne une augmentation de clientèle, puisque les consommateurs ne se laisseraient plus conquérir, les [334] frais de guerre ne seraient évidemment plus couverts. Qui donc voudrait encore les avancer?
Je conclus de là que la guerre serait matériellement impossible sous ce régime, car aucune guerre ne se peut faire sans une avance de fonds.
le conservateur.
Quelles conditions une compagnie d’assurances sur la propriété ferait-elle à ses clients?
l’économiste.
Ces conditions seraient de plusieurs sortes.
Pour être mises en état de garantie aux assurés, pleine sécurité pour leurs personnes et leurs propriétés, il faudrait:
1° Que les compagnies d’assurances établissent certaines peines contre les offenseurs des personnes et des propriétés, et que les assurés consentissent à se soumettre à ces peines, dans le cas où ils commettraient euxmêmes des sévices contre les personnes et les propriétés.
2° Qu’elles imposassent aux assurés certaines gênes ayant pour objet de faciliter la découverte des auteurs de délits.
3° Qu’elles perçussent régulièrement pour couvrir leurs frais une certaine prime, variable selon la situation des assurés, leurs occupations particulières, l’étendue, la nature et la valeur des propriétés à protéger.
Si les conditions stipulées convenaient aux consommateurs de sécurité, le marché se conclurait, sinon les consommateurs s’adresseraient à d’autres compagnies ou pourvoiraient eux-mêmes à leur sécurité.
Poursuivez cette hypothèse dans tous ses détails, et vous vous convaincrez, je pense, de la possibilité de [335] transformer les gouvernements monopoleurs ou communistes en gouvernements libres.
le conservateur.
J’y vois bien des difficultés encore. Et la dette, qui la payerait?
l’économiste.
Pensez-vous qu’en vendant toutes les propriétés aujourd’hui communes, routes, canaux, rivières, forêts, bâtiments servant à toutes les administrations communes, matériel de tous les services communs, on ne réussirait pas aisément à rembourser le capital de la dette? Ce capital ne dépasse pas six milliards. La valeur des propriétés communes en France s’élève, à coup sûr, bien au delà.
le socialiste.
Ce système ne serait-il pas la destruction de toute nationalité? Si plusieurs compagnies d’assurances sur la propriété s’établissaient dans un pays, l’Unité nationale ne serait-elle pas détruite?
l’économiste.
D’abord, il faudrait que l’Unité nationale existât pour qu’on pût la détruire. Or, je ne puis voir une unité nationale dans ces informes agglomérations de peuples que la violence a formées, que la violence seule maintient le plus souvent.
Ensuite, on a tort de confondre ces deux choses, qui sont naturellement fort distinctes: la nation et le gouvernement. Une nation est une lorsque les individus qui la composent ont les mêmes mœurs, la même langue, la même civilisation; lorsqu’ils forment une variété distincte, originale de l’espèce humaine. Que cette nation [336] ait deux gouvernements ou qu’elle n’en ait qu’un, cela importe fort peu. A moins toutefois que chaque gouvernement n’entoure d’une barrière factice les régions soumises à sa domination, et n’entretienne d’incessantes hostilités avec ses voisins. Dans cette dernière éventualité, l’instinct de la nationalité réagira contre ce morcellement barbare et cet antagonisme factice imposés à un même peuple, et les fractions désunies de ce peuple tendront incessamment à se rapprocher.
Or, les gouvernements ont jusqu’à nos jours divisé les peuples afin de les retenir plus aisément dans l’obéissance; diviser pour régner, telle a été, de tous temps, la maxime fondamentale de leur politique. Les hommes de même race, à qui la communauté de langage offrait un moyen de communication facile, ont énergiquement réagi contre la pratique de cette maxime; de tous temps ils se sont efforcés de détruire les barrières factices qui les séparaient. Lorsqu’ils y sont enfin parvenus, ils ont voulu n’avoir qu’un seul gouvernement afin de n’être plus désunis de nouveau. Mais, remarquez bien qu’ils n’ont jamais demandé à ce gouvernement de les séparer des autres peuples... L’instinct des nationalités n’est donc pas égoïste, comme on l’a si souvent affirmé; il est, au contraire, essentiellement sympathique. Que la diversité des gouvernements cesse d’entrainer la séparation, le morcellement des peuples, et vous verrez la même nationalité en accepter volontiers plusieurs. Un seul gouvernement n’est pas plus nécessaire pour constituer l’unité d’un peuple, qu’une seule banque, un seul établissement d’éducation, un seul culte, un seul magasin d’épiceries, etc.
le socialiste.
Voilà, en vérité, une solution bien singulière du problème du gouvernement!
l’économiste.
C’est la seule solution conforme à la nature des choses.
DOUZIÈME ET DERNIÈRE SOIRÉE↩
SOMMAIRE: La rente.—Sa nature et son origine.—Résumé et conclusion.
l’économiste.
Nos entretiens vont finir. Voulez-vous que je vous présente un résumé de nos travaux, comme on dit à l’Assemblée.
le socialiste.
J’ai un éclaircissement à vous demander auparavant.
Vous nous avez dit que les frais de production de toutes choses se composent du salaire du travail, et de l’intérêt du capital; vous avez ajouté que le prix courant des choses tend naturellement et d’une manière irrésistible à s’équilibrer avec leurs frais de production. Mais vous ne nous avez pas dit un mot de la rente.
l’économiste.
La rente ne fait point partie des frais de production des choses.
le socialiste.
Que dites-vous là? nierez-vous que des milliers d’individus vivent non d’un intérêt ou d’un salaire, mais d’une rente?
l’économiste.
Je ne le nierai pas.
le socialiste.
Eh! bien, où donc gît cette rente sinon dans le prix des choses? Si le cultivateur ne payait point de rente à son propriétaire, ne pourrait-il pas vendre son blé moins cher? n’est-il pas obligé de compter la rente dans les frais de production du blé?
l’économiste.
Il ne vend pas son blé plus cher parce qu’il paye une rente; il paye une rente parce qu’il vend son blé plus cher. La rente n’agit pas comme cause dans la formation des prix; elle n’est qu’un résultat.
le socialiste.
Cause ou résultat, en existe-t-elle moins, et en estelle moins inique? Quoi? voilà un homme qui possède, en vertu d’un héritage, une immense étendue de terre ou ni lui ni les siens n’ont déposé aucun travail. Cette terre lui appartient parce qu’elle est tombée jadis entre les mains d’un de ses ancêtres, chef d’une des hordes barbares qui ont envahi et dévasté le pays. Depuis cette époque, le seigneur de la terre a obligé le paysan à lui remettre le tiers ou la moitié du fruit de son rude labeur, à titre de rente. Des milliers d’hommes ont vécu et vivent encore en prélevant ce tribut sur le travail de leurs semblables. Est-ce juste?
Les gouvernements ne devraient-ils pas mettre fin à un si monstrueux abus, soit en s’emparant de la terre pour la restituer aux travailleurs, soit en imposant aux propriétaires des obligations qui absorbent la valeur de la rente? Tous les revenus ont leur origine dans le travail, celui-là seul excepté. N’est-il pas temps que l’exception cesse? J.-B. Say, lui-même, ne convenait-il pas que le [340] revenu provenant de la rente était le moins respectable de tous? Abandonnez-moi la rente et je vous accorde la propriété.
l’économiste.
Accordez-moi la propriété et je vous garantis que la rente s’en ira d’elle-même.
le socialiste.
La rente s’en aller d’elle-même? ce serait curieux!
l’économiste.
La rente n’est pas, comme vous avez l’air de le croire, un fruit de la propriété. La rente est, au contraire, le produit des atteintes diverses portées à la propriété, depuis l’origine des sociétés.
En recherchant les origines de la rente, Ricardo a reconnu qu’elle ne fait point partie des frais de production. Ce qui signifie que si les produits ne se vendaient jamais au dessus de leurs frais de production, au dessus de la quantité de travail qu’ils ont coûté, il n’y aurait pas de rente.
Si la rente ne fait point partie des frais de production, qu’est-elle donc?
C’est la différence qui existe entre le prix courant des choses (le prix auquel elles se vendent) et leurs frais de production.
le socialiste.
Qu’importe, encore une fois, que la rente ne soit pas comprise dans les frais de production, si elle est comprise dans le prix courant, si, par conséquent, elle est payée.
l’économiste.
Cela importe énormément. Les frais de production se [341] composant de la quantité de travail nécessaire à la formation d’un produit, ne peuvent pas ne pas être. Tout ce qui les dépasse peut, au contraire, ne pas être.
le socialiste.
Je commence à comprendre.
le conservateur.
Et moi je crains d’avoir trop compris.
l’économiste.
Ne craignez rien. Si la rente n’est pas comprise dans les frais de production, il en résulte:
1° Qu’elle ne représente aucun travail accompli ni aucune compensation de pertes subies ou à subir.
2° Qu’elle est le résultat de circonstances artificielles, lesquelles doivent disparaître avec les causes qui les ont suscitées.
Quelles sont ces causes? Quelles causes élèvent et maintiennent le prix courant des choses au-dessus de leurs frais de production, ou le font tomber en dessous, en opposition avec la loi naturelle qui agit incessamment pour rapprocher le prix courant des frais de production?
Voilà comment la question se pose.
le socialiste.
Si la loi économique qui rapproche le prix courant des frais de production est identique à la loi physique qui préside à la chute des corps et maintient l’équilibre des surfaces liquides, je ne conçois pas que son action puisse être troublée par des causes artificielles.
l’économiste.
Vous ne songez pas aux barrages et aux accidents de terrain qui troublent le cours naturel de l’eau.
le socialiste.
Oui, mais le niveau se rétablit toujours.
l’économiste.
Vous vous trompez. Il s’établit des niveaux factices. Le niveau naturel ne reparaît qu’après la rupture du barrage. Or, chacun ayant voulu faire affluer les eaux de son côté sans se préoccuper de son voisin, le champ de production a été traversé par une multitude de barrages. Quelques-uns ont eu plus d’eau qu’il ne leur en fallait, mais d’autres ont été mis à sec.
Ces barrages économiques se nomment des monopoles et des priviléges.
Voici maintenant de quelle façon agissent les monopoles et les priviléges pour produire la rente.
Si une industrie est soumise à la loi de la libre concurrence, elle ne pourra longtemps vendre ses produits audessus ni an-dessous de ses frais de production; elle ne donnera donc lieu à aucune rente. Ceux qui l’entreprendront ne recevront que la rémunération légitime de lour travail et les compensations nécessaires pour l’emploi de leur capital.
Si, au contraire, certains industriels sont investis du privilége exclusif de vendre leur marchandise dans une circonscription déterminée, ces industriels pourront s’entendre pour offrir toujours de cette denrée une quantité inférieure à la quantité demandée. Ils réussiront par ce moyen à en élever le prix courant au-dessus des frais de production. La différence constituera leur rente.
D’un autre côté, lorsqu’une denrée a été produite en quantité trop considérable, eu égard au nombre de consommateurs [343] qui peuvent en rembourser les frais de production, le prix courant tombe au-dessous de ces frais, et la différence constitue encore une rente. Seulement cette rente, au lieu d’être payée par le consommateur, est payée par le producteur. On conçoit qu’elle ne saurait être qu’accidentelle.
La production des objets de première nécessité seule peut donner lieu à une rente considérable.
Si l’on réduit d’une manière factice l’offre des objets de luxe, le prix haussant, la demande diminuera. Le prix baissera alors rapidement, et la rente avec lui.
Mais il n’en est pas de même pour les objets de première nécessité.
Supposons qu’il s’agisse du blé. Si l’offre est inférieure à la demande, le prix courant du blé pourra s’élever d’une manière presque illimitée. Examinons comment les choses se passent à cet égard, et comment naît la rente de la terre.
Une peuplade vit au milieu d’une vaste étendue de terres. Peu nombreuse, elle se contente de mettre en culture les meilleurs terrains, ceux qui donnent un produit considérable, en échange d’une faible quantité de travail. La population de cette peuplade vient à s’augmenter. Si elle ne peut s’étendre davantage, soit à cause du manque de sécurité à l’extérieur, soit à cause des obstacles intérieurement apportés à son expansion naturelle, qu’arrivera-t-il?
S’il ne lui est pas permis de tirer du dehors, c’est-à-dire des contrées où les bonnes terres suffisent et au delà pour nourrir la population, la portion de subsistances qui lui manque, le déficit intérieur l’obligera a payer le [344] prix du blé au-dessus de ses frais de production. La rente de la terre naîtra alors.
Mais aussitôt, l’élévation du prix du blé engagera à cultiver en céréales les terres de seconde qualité, ou pour mieux dire, les terres moins propres à cette culture spéciale. La production du blé revenant plus cher sur ces terres, que sur celles de première qualité, leurs propriétaires obtiendront une rente moindre. Il pourra arriver même que l’apport au marché d’une nouvelle quantité de blé, en fasse tomber le prix courant au niveau des frais de production des terres récemment mises en culture, ou bien encore au-dessous. Dans le premier cas, les propriétaires de ces terres couvriront juste le montant de leurs frais de production, et ne recevront aucune rente; dans le second cas, les frais de production ne seront pas même couverts, et la rente tombera en—; ce qui déterminera l’abandon des terres cultivées au delà du nécessaire.
Si, au contraire, les terres récemment mises en culture ne suffisent pas encore pour combler le déficit de la demande, le prix courant du blé continuant à donner une rente, de nouvelles terres, inférieures aux précédentes, seront consacrées à la culture du blé. Ce mouvement se continuera jusqu’à ce que le prix courant cesse de dépasser les frais de production des céréales sur les terres le plus récemment mises en culture.
C’est ainsi qu’on voit dans certains pays où la population s’est démesurément accrue sans pouvoir s’étendre, où, en même temps, les denrées alimentaires du dehors ne peuvent pénétrer, des terres à peu près stériles porter de chétives moissons de blé et les bonnes terres donner lieu a une rente énorme.
le socialiste.
Croyez-vous que si aucun obstacle factice n’avait été opposé à l’expansion naturelle des populations, si, aucune institution ou aucun préjugé n’avait surexcité le développement de la population, si, enfin, la circulation des aliments avait toujours été libre, la rente de la terre n’eût jamais été créée?
l’économiste.
J’en suis convaincu. Dans ce cas, voici ce qui serait arrivé. Les différents peuples de la terre auraient appliqué à chaque qualité de terre la culture qu’elle était le plus propre à recevoir, et ils auraient subsisté en échangeant le superflu de leurs productions naturelles contre les denrées produites dans les mêmes conditions, par les autres peuples. Aussi longtemps que la demande de ces denrées diverses, cultivées sur leurs terrains spéciaux, n’aurait pas dépassé l’offre, il n’y aurait pas eu de rente. Or, avec ce mode naturel d’exploitation, la terre donnant un maximum de production, la population aurait pu aisément se proportionner toujours aux moyens de subsistance disponibles.
le socialiste.
Cela serait vrai si les différentes sortes de matériaux dont la terre est le réceptacle et que le travail transforme en produits consommables se trouvaient proportionnés, dans leurs quantités, aux divers besoins de l’homme; si les terres à blé étaient proportionnées en étendue, à la consommation générale du blé; les terres à oliviers et à colzas à la consommation générale de l’huile; les gîtes métallifères et houillers à la consommation générale des métaux et de la houille; mais cette harmonie entre nos [346] divers besoins et la quantité des matériaux propres à les satisfaire existe-t-elle naturellement? Certaines choses ne se rencontrent-elles pas en quantité trop faible, eu égard au besoin qu’on en a, et n’est-on pas obligé, en conséquence, de les payer toujours au-dessus de leurs frais de production? Les terres qui recèlent ces choses à l’état de matière première ou les personnes qui sont pouvues des facultés à l’aide desquelles elles se produisent, ne jouissent-elles pas d’un véritable monopole naturel, en ce sens qu’elles doivent inévitablement donner ou obtenir une rente?
l’économiste.
Il n’y a pas de monopoles naturels. La Providence a exactement proportionné à nos besoins divers, les richesses diverses qu’elle a mises à notre disposition. Mais si nous avons employé notre libre-arbitre et nos forces à détruire ou à gaspiller une partie de ces richesses au lieu de les utiliser toutes, si nous avons passé des siècles à nous disputer des lambeaux de territoire au lieu de nous épandre librement sur les immenses espaces, ouverts devantnous; si en nous cantonnant dans des limites étroites, nous avons surexcité directement ou indirectement la multiplication de notre espece, si nous avons refusé les denrées provenant des lieux où elles étaient produites avec le plus d’avantage, pour les produire nous-mêmes à contre-sens de la nature, si, nous avons ainsi faussé, dans notre ignorance, l’ordre essentiel que le créateur avait établi dans sa sagesse, est-ce la faute de la Providence?
Si, pour ne parler que de la France, nos institutions de charité légale ont encouragé le développement anormal [347] de la population; si, en même temps, nos lois de douanes ont entravé l’entrée des céréales étrangères, de telle sorte qu’il soit devenu avantageux de couper de magnifiques bois d’oliviers pour les remplacer par de maigrès champs de blé, est-ce la faute de la Providence?
Si notre législation sur les mines en arrêtant le développement de notre production minérale, tandis que nos lois de douanes empêchaient l’introduction des produits minéraux de l’étranger, a créé un vide factice dans notre approvisionnement de fer, de plomb, de cuivre, d’étain, etc., est-ce la faute de la Providence?
Si un monopole détestable, en détournant l’éducation de ses voies naturelles, a rendu un grand nombre d’hommes inhabiles à remplir divers emplois utiles, tout en les portant avec excès dans d’autres, est-ce la faute de la Providence?
Si enfin, à la suite de la perversion occasionnée par les monopoles et les priviléges, dans l’ordre essentiel de la société, certains individus devenant les maîtres de satisfaire leurs désirs les plus effrenés, tandis que la masse pouvait à peine subvenir à ses premiers besoins, l’ordre naturel de la consommation a été troublé, si quelques denrées ont été relativement trop demandées et si d’autres l’ont été trop peu, est-ce la faute de la Providence?
le socialiste.
Non! vous avez raison, c’est la faute de l’homme!
l’économiste.
Mais que ces causes de perturbation disparaissent, et vous verrez bientôt se rétablir l’ordre naturel des sociétés comme on voit se rétablir le cours naturel de l’eau après la destruction d’un barrage; vous verrez la production [348] se concentrer dans les lieux où elle peut s’opérer avec le plus d’avantage et la consommation reprendre ses proportions normales; vous verrez, en conséquence, les oscillations du prix courant et du prix naturel s’atténuer de plus en plus, devenir presque insensibles et finir par disparaître en emportant la rente avec elles. Vous verrez alors la production s’opérer avec un maximum d’abondance et la distribution se faire conformément aux lois de la justice.
Ceci vous apparaîtra plus visiblement encore lorsque j’aurai résumé la doctrine que je vous ai exposée dans ces causeries.
le conservateur et le socialiste.
Ayez donc l’obligeance de nous faire ce résumé.
l’économiste.
Volontiers.
Nous avons pris l’homme pour point de départ. Sous l’empire de ses besoins physiques, moraux et intellectuels, l’homme est excité à produire. Il utilise dans ce but ses facultés physiques, morales et intellectuelles. L’effort qu’il impose à ses facultés pour produire se nomme travail. Chaque effort exige une réparation correspondante, sinon les forces se perdent, les facultés s’altèrent, l’être humain dépérit au lieu de se maintenir ou de progresser.
Chaque effort impliquant une souffrance, chaque réparation ou consommation une jouissance; l’homme s’attache naturellement, sous l’impulsion de son intérêt, à [349] dépenser moins d’efforts et à recevoir plus de choses propres à sa consommation.
Ce résultat est atteint au moyen de la division du travail.
Division du travail implique échanges, relations, société.
Ici se présente un grave problème.
Dans l’état d’isolement (à supposer que cet état ait jamais existé) les efforts de l’homme ont un minimum de puissance, mais l’individu qui les accomplit s’en attribue tout le résultat. Il consomme tout ce qu’il produit.
Dans l’état de société, les efforts de l’homme acquièrent un maximum de puissance, grâce à la division du travail, mais le résultat de ses efforts peut-il être toujours conservé intact à chaque producteur? L’état de société comporte-t-il, à ce point de vue, la même justice que l’état d’isolement? Comment, par exemple, un homme qui passe sa vie à fabriquer la dixième partie d’une épingle peut-il obtenir une rémunération aussi justement proportionnée à ses efforts que le sauvage isolé qui, après avoir abattu un daim, consomme seul ce produit de son travail?
Comment? Au moyen de la propriété.
Qu’est-ce que la propriété? C’est le droit naturel de disposer librement de ses facultés et du produit de son travail.
Comment s’opèrent la production et la distribution de la richesse sous le régime de la propriété?
L’homme produit toutes les choses dont il a besoin, au moyen de son travail, agissant sur les matières premières [350] fournies par la nature. Sou travail est de deux sortes:
Lorsque l’homme accomplit un effort en vue de la production, cet effort se nomme simplement travail. Lorsque l’effort est accompli, lorsqu’un produit en a été le résultat, ce produit prend le nom de capital. Tout capital se compose de travail accumulé.
Or toute production exige le concours de ces deux agents: travail actuel et travail accumulé.
C’est entre ces deux agents de la production que se partage le produit.
Comment se partage-t-il? En raison des frais de production de chacun, c’est-à-dire en raison des sacrifices que s’imposent, ou des efforts auxquels se livrent le propriétaire du travail actuel ou ouvrier, et le propriétaire du travail accumulé ou capitaliste.
De quoi se composent les frais de production à la charge du capitaliste?
Ils se composent du travail accompli par le capitaliste, en appliquant son capital à une entreprise de production, de la privation qu’il s’impose, et des risques qu’il court en engageant son capital dans la production.
Ce travail, cette privation et ces risques constituent les éléments de l’intérêt.
De quoi se composent les frais de production à la charge du travailleur?
De la somme d’efforts que le travailleur dépense en mettant ses facultés en œuvre. Ces efforts sont de diverses sortes, physiques, moraux ou intellectuels, selon la nature du travail. Ils exigent pour être accomplis, sans altérer les facultés productives du travailleur, une certaine [351] somme de réparations, variable encore selon la nature du travail.
Ces réparations nécessaires à l’accomplissement du travail constituent les éléments du salaire.
La réunion de l’intérêt et du salaire compose les frais de production de toute espèce de produits.
Exemple:
En quoi consistent les frais de production d’une pièce de calicot?
Ils consistent, en premier lieu:
Dans le salaire des ouvriers, des contre-maîtres et des entrepreneurs du tissage.
Dans l’intérêt du capital mis en œuvre par l’entrepreneur de tissage.—Ce capital se compose de bâtiments, de machines, de matières premières, de numéraire destiné au payement des ouvriers, etc. Le capitaliste qui s’en est dessaisi reçoit un intérêt destiné à couvrir son travail de prêteur ou d’actionnaire, sa privation et ses risques de détérioration ou de perte.
Premier intérêt et premier salaire.
Avant d’être tissé, le coton a été filé.—Pour le filer, il a fallu, de même, mettre en œuvre du capital et du travail.—Travail des entrepreneurs, des contre-maîtres, des ouvriers de la filature; capital sous forme de bâtiments, de machines, de combustibles, de matières premières, de numéraire.
Second intérêt et second salaire.
Avant d’être filé, le coton a été transporté. Pour le transporter, il a fallu le concours des négociants, des courtiers, des portefaix, des armateurs, des entrepreneurs de roulage.—Travail des négociants, des courtiers, des [352] portefaix, des armateurs, des matelots, des voituriers; capital sous forme de magasins, de bureaux, de chariots, de navires, de provisions pour l’équipage, de voitures ou de wagons, de numéraire.
Troisième intérêt et troisième salaire.
Avant d’être transporté, le coton a été cultivé. Pour le cultiver, il a fallu encore du capital et du travail.—Travail des directeurs d’exploitation, des contre-maîtres, des ouvriers; capital sous forme de terres rendues cultivables, de bâtiments, de semences, de machines, de numéraire (Si les travailleurs sont libres, on les paye communément en numéraire; s’ils sont esclaves, on les paye, sans libre débat, en aliments, en vêtements et en logements; dans les deux cas, le prix du coton doit couvrir leur salaire avec celui de l’entrepreneur et des contre-maîtres, comme aussi l’intérêt du capital avancé aux travailleurs avant la réalisation du produit de la récolte).
Quatrième intérêt et quatrième salaire.
Ajoutez a cela le salaire des marchands, qui mettent les pièces de calicot à la portée du consommateur et les lui débitent en détail selon ses besoins, et l’intérêt du capital mis en œuvre par ces intermédiaires indispensables, et vous aurez l’ensemble des frais de production du calicot.
Supposez qu’une plantation ait fourni mille balles de coton, et qu’on ait fabriqué avec ces mille balles de coton vingt-cinq mille pièces de calicot de cinquante aunes chacune. Supposez encore que ces vingt-cinq mille pièces de calicot se soient débitées en écru, à raison de 30 centimes l’aune, vous aurez un total de. . . 375,000 fr.
[353]Cette somme de 375,000 fr. aura été distribuée à tous ceux qui auront concouru à la production du calicot, depuis l’esclave et le planteur, jusqu’au débitant et à son garçon de boutique.
Mais, en vertu de quelle loi s’est opérée la distribution de cette valeur de 375,000 fr. entre tous ceux qui ont contribué à la former? Quelle loi a déterminé le juste intérêt des capitalistes et le juste salaire des travailleurs, comme aussi le juste prix du produit qui a fourni cet intérêt et le salaire?
Cette loi qui est le véritable régulateur du monde économique, je l’ai exprimée ainsi:
Lorsque l’offre dépasse la demande en progression arithmétique, le prix baisse en progression géométrique, et, de même, lorsque la demande dépasse l’offre en progression arithmétique, le prix hausse en progression géométrique.
Sous l’empire de cette loi, agissant dans un milieu libre, chacun ne peut vendre un intérêt, un salaire ou un produit au-dessus ni au-dessous de la somme nécessaire pour mettre au marché cet intérêt, ce salaire ou ce produit, c’est-à-dire au-dessus ni au-dessous de la somme des efforts et des sacrifices qu’ils ont réellement coûtés.
Car, en vertu de cette loi, le prix courant de toutes choses, intérêts, salaires et produits, est incessamment et irrésistiblement ramené au niveau de leurs frais de production.
Comment?
A la fois producteur et consommateur, l’homme est incessamment obligé, dans une société où la division du travail a séparé la plupart des actes de la production, [354] d’offrir ce qu’il produit pour demander, en échange, les choses dont il a besoin.
Quand on demande une chose, on ne consulte que l’étendue et l’intensité du besoin qu’on en a; on ne s’occupe pas de ce qu’elle a pu coûter à produire. Il peut donc arriver qu’on s’impose, pour se la procurer, des sacrifices et des efforts, bien supérieurs à ceux qu’elle a coùtés. Au témoignage de l’expérience, cela arrive lorsqu’un grand nombre d’individus ont besoin d’une denrée, et que peu d’individus la produisent, lorsqu’une denrée est beaucoup demandée et peu offerte. Dans ce cas, l’expérience atteste encore qu’une faible disproportion entre la demande et l’offre engendre un mouvement rapide dans le prix. A mesure que la disproportion s’agrandit en progression arithmétique, le mouvement du prix croît et s’accélère en progression géométrique.
Mais, à mesure que le prix s’élève davantage, il agit plus fortement aussi pour ramener l’équilibre entre l’offre et la demande.
Lorsque le prix auquel une chose se vend dépasse de beaucoup la somme des efforts et des sacrifices qu’elle a coutés pour être produite, aussitôt la foule des hommes qui s’adonnent à des productions moins avantageuses, ou dont les capitaux, les intelligences et les bras se trouvent momentanément inactifs, sont excités à produire cette chose. L’excitation est d’autant plus vive que le prix est plus élevé, que l’écart entre la demande et l’offre est plus considérable. Sous l’empire de cette excitation, des concurrents plus ou moins nombreux se présentent donc pour augmenter la production et satisfaire d’une manière plus complète à la demande.
[355]Cependant l’augmentation de la production aura une limite. Quelle sera cette limite?
Si le prix hausse en progression géométrique lorsque la demande s’élève au-dessus de l’offre, il s’abaisse de même en progression géométrique, lorsque l’offre dépasse la demande. Si donc, excités par l’appât du bénéfice, les producteurs augmentent l’offre, un moment arrive où le prix courant de la denrée tombe au niveau de ses frais de production. Si l’on continue alors à apporter au marché des quantités de plus en plus considérables de cette denrée et si l’augmentation de la demande n’équivaut pas à celle de l’offre, on voit le prix courant tomber progressivement au-dessous des frais de production.
Mais, à mesure que la disproportion s’élargit dans ce sens, les producteurs couvrant moins leurs frais ont plus d’intérêt à se rejeter vers les autres branches de la production. A mesure que le prix s’abaisse davantage il agit plus énergiquement pour ralentir le mouvement de l’offre, jusqu’à ce que ce ralentissement le ramène au niveau des frais de production.
C’est ainsi qu’on voit graviter incessamment et irrésistiblement le prix courant de toutes choses, travail, capitaux et produits, vers la limite des frais de production de ces choses, c’est-à-dire vers la somme des efforts et des sacrifices réels qu’elles ont coûtés pour être produites1
[356]Mais si le prix de toutes ces choses est incessamment et irrésistiblement ramené à la limite de leurs frais de production, à la somme des efforts et des sacrifices réels qu’elles ont coûtés, chacun doit inévitablement recevoir, dans l’état de société comme dans l’état d’isolement, la juste rémunération de ses efforts et de ses sacrifices.
Avec cette différence: que l’homme isolé produisant lui-même toutes choses, est obligé de dépenser beaucoup d’efforts pour obtenir un petit nombre de satisfactions, tandis que l’homme en société, jouissant de l’avantage de la division du travail, peut obtenir de nombreuses satisfactions en échange d’un petit nombre d’efforts. Ces satisfactions seront d’autant plus considérables, ces efforts [357] seront d’autant plus faibles, que le progrès aura développé davantage la division du travail, et, par là même, diminué les frais de production des choses.
Malheureusement, si de nombreux efforts ont été accomplis pour développer économiquement la production, de nombreux obstacles ont été élevés, en même temps, par l’ignorance ou la perversité humaine, pour entraver ce développement comme aussi pour troubler la distribution naturelle et équitable de la richesse.
C’est dans un milieu libre, dans un milieu où le droit de propriété de chacun sur ses facultés et les résultats de [358] son travail est pleinement respecté, que la production se développe au maximum, et que la distribution de la richesse se proportionne irrésistiblement aux efforts et aux sacrifices accomplis par chacun.
Or, dès l’origine du monde, les hommes les plus forts ou les plus rusés attentèrent à la propriété intérieure ou extérieure des autres hommes, afin de consommer à leur place une partie des fruits de la production. De là l’esclavage, les monopoles et les priviléges.
En même temps qu’ils détruisaient l’équitable distribution de la richesse, l’esclavage, les monopoles et les priviléges ralentissaient la production, soit en diminuant l’intérêt que les producteurs avaient à produire, soit en les détournant du genre de production qu’ils pouvaient le plus utilement accomplir. L’oppression engendra la misère.
Pendant de longs siècles, l’humanité gémit dans les limbes de la servitude. Mais, d’intervalle en intervalle, de sombres clameurs de détresse et de colère retentissaient au sein des masses asservies et exploitées. Les esclaves se soulevaient contre leurs maîtres en demandant la liberté.
La liberté! c’était le cri des captifs d’Égypte, des esclaves de Spartacus, des paysans du moyen âge, et, plus tard, des bourgeois opprimés par la noblesse et les corporations religieuses, des ouvriers opprimés par les maîtrises et les jurandes. La liberté! c’était le cri d’es pérance de tous ceux dont la propriété se trouvait confisquée par le monopole ou le privilége. La liberté! c’était l’aspiration ardente de tous ceux dont les droits naturels étaient comprimés sous la force.
[359]Un jour vint où les opprimés se trouvèrent assez forts pour se débarrasser des oppresseurs. C’était à la fin du dix-huitième siècle. Les principales industries qui pour-voyaient aux besoins de tous n’avaient point cessé d’être organisées en corporations fermées, privilégiées. La noblesse qui pourvoyait à la défense intérieure et extérieure, corporation; les parlements qui rendaient la justice, corporation; le clergé qui distribuait les services religieux, corporation; l’université et les ordres religieux qui pourvoyaient à l’enseignement, corporation; la boulangerie, la boucherie, etc., corporations. Ces différents états étaient, pour la plupart, indépendants les uns des autres, mais tous se trouvaient subordonnés au corps armé qui garantissait matériellement les priviléges de chacun.
Malheureusement, lorsque l’heure sembla venue d’abattre ce régime d’iniquité; on ne sut par quoi le remplacer. Ceux qui avaient quelques notions des lois naturelles qui gouvernent la société opinaient pour le laisser-faire. Ceux qui ne croyaient point à l’existence de ces lois naturelles s’élevaient, au contraire, de toutes leurs forces contre le laisser-faire, et demandaient la substitution d’une organisation nouvelle à la place de l’ancienne. A la tête des partisans du laisser-faire figurait Turgot, à la tête des organisateurs ou nèo-réglementaires figurait Necker.
Ces deux tendances opposées, sans compter la tendance réactionnaire, se partagèrent la révolution française. L’élément libéral dominait dans l’Assemblée constituante, mais il n’était pas pur. Les libéraux eux-mêmes n’avaient pas encore assez de foi en la liberté pour lui abandonner [360] entièrement la direction des affaires humaines. La plupart des industries matérielles furent affranchies des liens du privilége, mais les industries immatérielles et, en première ligne, la défense de la propriété et la justice, furent organisées en vertu des théories communistes. Moins éclairée que l’Assemblée constituante, la Convention se montra plus communiste encore. Comparez les deux déclarations des Droits de l’homme de 1791 et 1793, et vous en acquerrez la preuve. Enfin, Napoléon, qui réunissait les passions d’un jacobin aux préjugés d’un réactionnaire, sans aucun mélange de libéralisme, essaya de concilier le communisme de la Convention avec les monopoles et les priviléges de l’ancien régime. Il organisa l’enseignement communautaire, subventionna des cultes communautaires, institua un corps des ponts et chaussées dans le but d’établir un vaste réseau de voies de communication communautaires, décréta la conscription, c’est-à-dire l’armée communautaire; en outre, il centralisa la France comme une grande commune, et ce ne fut pas sa faute s’il n’organisa point dans cette commune centralisée toutes les industries sur le modèle de l’Université et de la régie des tabacs1. Si la guerre ne l’en avait empêché, comme il le déclare lui-même dans ses Mémoires, il aurait certainement accompli ces grandes choses. D’une autre part, il ressuscita dans cette France organisée la plupart des priviléges et des restrictions de l’ancien régime; il reconstitua la noblesse apanagée, rétablit les priviléges de la boucherie, de la boulangerie, [361] de l’imprimerie, des théâtres, des banques, limita la libre disposition du travail par la législation de l’apprentissage, des livrets et des coalitions, le droit de prêter par la loi de 1807, le droit de tester par le Code civil, le droit d’échanger par le blocus continental et la multitude de ses décrets et règlements relatifs aux douanes; il refit, pour tout dire, sous l’influence de deux inspirations venues de points opposés, mais également réglementaires, le vieux réseau d’entraves qui opprimait naguère la propriété.
Nous avons vécu jusqu’à présent sous ce déplorable régime, encore aggravé par la Restauration (rétablissement de la vénalité des charges, en 1816, exhaussement des barrières douaniàres, en 1822), mais bien loin de lui imputer les iniquités et les misères de la société actuelle, c’est la propriété et la liberté qu’on a accusées. Les docteurs du socialisme méconnaissant l’organisation naturelle de la société, ne voulant point voir les déplorables résultats de la restauration des priviléges de l’ancien régime et de l’instauration du communisme révolutionnaire ou impérialiste, affirmèrent que la vieille société péchait par sa base même, la propriété, et il s’efforcèrent d’organiser sur une autre base une société nouvelle. Cela les conduisit à des utopies, les unes simplement absurdes, les autres immorales et abominables. Au reste, on les a vus à l’œuvre.
Les conservateurs opposèrent heureusement une digue à l’invasion foudroyante du socialisme; mais n’ayant pas plus que leurs adversaires des notions précises de l’organisation naturelle de la société, ils ne pouvaient les vaincre ailleurs que dans la rue. Partisans du statu quo parce [362] qu’ils y trouvaient profit et sans s’inquiéter du reste, les conservateurs s’opposèrent aux innovations socialistes, comme ils s’étaient, dans le courant des années précédentes, opposés aux innovations propriétaires des partisans de la liberté de l’enseignement et de la liberté du commerce.
C’est entre ces deux sortes d’adversaires de la propriété, les uns voulant augmenter le nombre des restrictions et des charges qui pèsent déjà sur la propriété, les autres voulant conserver purement et simplement celles qui existent, que le débat se trouve actuellement porté. D’un côté apparaisseut M. Thiers et l’ancien comité de la rue de Poitiers; de l’autre MM. Louis Blanc, Pierre Leroux, Cabet, Considérant, Proudhon. C’est Necker sons les deux espèces. Mais je ne vois plus Turgot.
le socialiste.
Si la société est naturellement organisée et s’il suffit de détruire les obstacles apportés au libre jeu de son organisation, c’est-a-dire les atteintes portées à la propriété pour élever le chiffre de la production au maximum que comporte l’état actuel d’avancement des arts et des sciences, et rendre la distribution de la richesse pleinement équitable, il est fort inutile assurément de chercher encore des organisations factices. Il n’y a autre chose à faire qu’à ramener la société a la propriété pure.
le conservateur.
Mais combien de changements à opérer pour en venir la? Cela fait trembler!
l’économiste.
Non! car toutes les réformes à accomplir ayant un caractère de justice et d’utilité ne sauraient offenser aucun [363] intérêt légitime ni causer aucun dommage à la société.
le socialiste.
Au reste, dans un sens ou dans un autre, pour la propriété ou contre la propriété, les réformes ne peuvent manquer de se faire. Deux systèmes, sont en présence: le communisme et la propriété. Il faut aller vers l’un ou vers l’autre. Le régime mi-propriétaire, mi-communiste sous lequel nous vivons ne saurait durer.
l’économiste.
Il nous a déjà valu de déplorables catastrophes et peutêtre nous en réserve-t-il de nouvelles.
le conservateur.
Hélas!
l’économiste.
Il faut donc en sortir. Or, on n’en peut sortir que par la porte du communisme ou par celle de la propriété:
Choisissez!
FIN.
Notes↩
[1 Un de nos économistes les plus distingués, M. L. Leclerc, a exposé récemment, sur la source de la propriété extérieure, une théorie qui a beaucoup d’analogie avec celle-ci. Les différences sont dans la forme plutôt que dans le fonds. Au lieu d’une séparation des forces intérieures, M. Leclerc voit dans la propriété extérieure une consommation de la vie et des organes. Je cite:
“Le phénomène de la consommation graduelle et de l’extinction finale, non pas du moi, il est immortel, mais de la vie; cet inconcevable affaissement des facultés et des organes, quand il s’accomplit par suite de l’effort utile appelé travail, me paraît très digne d’attention; car, si ce résultat ést indispensable, soit pour entretenir la force même qui agit, soit pour suppléer à celle qui ne peut agir encore, ou bien à celle qui ne peut plus agir, il est certain que ce résultat est acquis à titre onéreux; il a réellement coûté la portion de durée, el, si cela peut se dire, la portion de facultés et d’organes irrévocablement consommée pour l’obtenir. Cette quotité de ma vie et de ma puissance est perdue sans retour; je ne la recouvrerai jamais; la voici comme déposée dans le résultat de mes efforts; lui seul représente donc ce que je possédais légitimement, et ce que je n’ai plus. Je n’usais pas seulement de mon droit naturel en praliquant cette substitution, j’obéissais à l’instinct conservateur, je me soumettais à la plus impérieuse des nécessités: mon droit de propriété est là! Le travail est donc le fondement certain, la source pure, l’origine sainte du droit de propriété: ou bien le moi n’est point propriété primordiale et originelle, ou bien les facultés, expansion du moi, et les organes mis à son service ne lui appartiennent pas, ce qui serait insoutenable.
Employer son temps, le perdre, en user bien ou mal; se tuer pour vivre; donner une heure, un jour: voilà des paroles familières proférées depuis des siècles, parties intégrantes de tout langage humain, qui lui-même est la pensée visible. Le moi a donc conscience parfaite de la consommation folle ou sage, utile ou improductive de sa propre puissance, et, comme il sait aussi que cette puissance lui appartient, il en conclut sans peine un droit exclusif et virtuel sur les résultats utiles de cette inévitable extinction, quand elle s’est laborieusement et fructueusement accomplie. La conscience publique va droit et d’elle-même à ces graves principes, à ces vérités éclatantes d’évidence, sans se livrer apparemment aux longues dissertations auxquelles nous nous croyons obligés nous autres.
Oui, ma vie m’appartient, avec le droit d’en faire librement le généreux sacrifice à l’humanité, à ma patrie, à mon semblable, à mon ami, à ma femme, à mon enfant! Ma vie m’appartient; j’en consacre une portion pour obtenir ce qui doit la prolonger; ce que j’ai obtenu est donc à moi, et je puis également en faire abandon aux chers objets de ma tendresse. Si l’effort est heureux, ce que la religion explique par la faveur divine; si l’effort est habile, ce que l’économiste peut attribuer au jeu plus parfait des facultés; s’il arrive que le résultat dépasse le besoin, de toute évidence cet excédant m’appartient encore. J’ai donc le droit d’en user pour ajouter d’autres satisfactions à celle de vivre; j’ai droit de le mettre en réserve pour l’enfant qui peut me naître, et pour l’époque terrible de l’impoissante vieillesse. Que je transforme l’excédant, que je l’échange, utilité contre utilité, valeur contre valeur, toujours, c’est toujours mien, car, on ne saurait trop insister, c’est toujours la représentation manifeste d’une portion de mon existence, de mes facultés, de mes organes, usés dans le travail, qui produit cet excédant. Pour posséder à titre honorable et légitime ce qu’en fermant les yeux je lègue à ceux que j’aime, le vêtement, le meuble, la marchandise, la maison, la terre, le contrat, l’argent, qu’importe! n’ai-je point dépensé partie du temps que j’avais à vivre sur la terre? N’est-ce point, en réalité, léguer à ceux que j’aime ma vie et mes facultés? Je pouvais m’épargner quelque effort ou me le rendre moins pénible, ou bien accroître mes satisfactions; ah! combien il m’est plus doux de reporter sur mes bien-aimés ce qui était de mon droit! Pensée généreuse et consolante, qui soutient le courage, charme le cœur, inspire et sauvegarde la vertu, dispose aux nobles dévouements, unit les générations et conduit à l’amélioration du sort de l’humanité, par l’accroissement graduel des capitaux.
(L. Leclerc.—Simple observation sur le droit de propriété.—Journal des Économistes, n° du 15 octobre 1848.).
[1] La propriété intellectuelle, si déplorablement méconnue par les propriétaires de nos jours, a trouvé un spirituel et persévérant défenseur en M. Jobard, directeur du Musée de Bruxelles. A Paris, un romancier distingué, M. Hip. Castille, avait fondé en 1847 un journal pour défendre cette cause qui intéresse un si grand nombre de travailleurs. Malheureusement, l’entreprise de M. Castille n’oblint point le succès qu’elle méritait si bien. Au bout de quelques mois, le Travail intellectuel cessa de paraître. Je me suis borné à résumer ici divers articles publiés par moi dans ce journal d’un des défenseurs les plus dévoués de la propriété intellectuelle.
[1] Le droit de tester est limité en France, principalement par les articles 913 et 915 du Code civil.
Art. 913. Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testaments, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant légitime; le tiers, s’il laisse deux enfants; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
Art. 915. Les libéralités par actes entre vifs ou par testaments ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d’enfants, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle; et les trois quarts, s’il ne laisse d’ascendants que dans une ligne.
Il faut dire toutefois, à la justification des auteurs du Code civil, qu’ils avaient en des prédécesseurs beaucoup moins libéraux encore. Par une loi du 7 mars 1793, la Convention avait complétement supprimé le droit de tester. Cette loi était ainsi conçue:
Disposition unique. La faculté de disposer de ses biens, soit à cause de mort, soit entre vifs, soit par donation contractuelle en ligne directe, est abolie; en conséquence, tous les descendants auront un droit égal à partager les biens de leurs ascendants.
Les auteurs du Code civil furent unanimes à reconnaître que cette loi avait porté une grave atteinte à l’autorité paternelle. Malheureusement, ils n’osèrent la réformer qu’à demi.
Sous la république romaine, le droit illimité de tester avait été consacré par la loi des Douze tables. Mais diverses atteintes furent successivement portées à ce droit. Justinien limita la portion disponible de l’héritage, au tiers quand il y avait quatre enfants, à la moitié quand il y en avait cinq ou plus.
En Angleterre, il est permis de disposer par testament de tous ses immeubles, sans aucune réserve, et du tiers seulement de ses meubles; les deux autres tiers appartiennent à la femme et aux enfants. Les propriétés territoriales ne vont de droit à l’aîné de la famille que lorsqu’il n’y a pas de testament.
Aux Etats-Unis, le droit de tester est entièrement libre.
[1] Discours prononcé par M. Guizot dans la discussion du traité de commerce avec la Sardaigne.—Séance du 31 mars 1845.
[1] Préface de la Défense de l’usure, de J. Bentham.—Mélanges d’Économie politique, t. II, p. 518. Edition Guillaumin.
[1] Rapport adressé à M. le duc de Broglie sur les questions coloniales par M. Jules Lechevalier.
[1] Frappé, il y a quelques années, de la difficulté qu’éprouvent les travailleurs à connaître les endroits où ils peuvent obtenir un bon débouché de cette espèce de marchandise qu’on nomme du travail, je demandai l’établissement de bourses du travail avec publicité des cours, à l’exemple de ce qui se pratique pour les capitaux et les denrées de consommation*. Plus tard, j’essayai de réaliser cette idée, et j’adressai, dans le Courrier français, dirigé alors par M. X. Durrieu, l’appel suivant aux ouvriers de Paris:
Depuis longtemps, les capitalistes, les industriels et les négociants se servent de la publicité que leur offre la presse pour placer le plus avantageusement possible leurs capitaux ou leurs marchandises. Tous les journaux publient régulièrement un bulletin de la Bourse, tous ont ouvert aussi leurs colonnes aux annonces industrielles et commerciales.
Si la publicité rend aux capitalistes et aux négociants des services dont on ne saurait plus aujourd’hui nier l’importance, pourquoi ne serait-elle pas mise aussi à la portée des travailleurs? Pourquoi ne serait-elle pas employée à éclairer les démarches des ouvriers qui cherchent de l’ouvrage, comme elle sert déjà à éclairer celles des capitalistes qui cherchent de l’emploi pour leurs capitaux, comme elle sert encore aux négociants pour trouver le placement de leurs marchandises? L’ouvrier qui vit du travail de ses bras et de son intelligence, n’est-il pas aussi intéressé pour le moins à savoir en quels lieux le travail obtient le salaire le plus avantageux, que peuvent l’être le capitaliste et le négoicant à connaître les marchés où les capitaux et les marchandises se vendent le plus cher. Sa force physique et son intelligence sont ses capitaux à lui: c’est en exploitant ces capitaux-là, c’est en les faisant travailler, et en échangeant leur travail contre les produits du travail d’autres ouvriers comme lui qu’il parvient à subsister.
... C’est la presse qui public le bulletin de la Bourse et les annonces industrielles: ce serait la presse qui publierait le bulletin du travail.
Nous proposons, en conséquence, à tous les corps d’état de la ville de Paris de publier gratuitement chaque semaine le bulletin des engagements d’ouvriers avec l’indication du taux des salaires et de l’état de l’offre et de la demande. Nous répartirons les bulletins des corps d’état entre les différents jours de la semaine, de telle sorte que chaque métier ait sa publication à jour fixe.
Si notre offre est agréée par les corps d’état, nous inviterons nos confrères des départements à publier les bulletins du travail de leurs localités, comme nous publierons le bulletin du travail de Paris. Chaque semaine, nous rassemblerons tous ces bulletins et nous en composerons un bulletin général. Chaque semaine, tous les travailleurs de France pourront avoir de la sorte sons les youx le tableau de la situation du travail dans les différentes parties du pays.
“Nous nous adressons surtout aux ouvriers des corps d’état de la ville de Paris. Déjà ils se trouvent organisés, déjà ils possèdent des bureaux de placement réguliers. Rien ne leur serait plus facile que de livrer à la publicité le bulletin de leurs transactions quotidiennes; rien ne leur serait plus facite que de doter la France de la publicité du travail.” (Courrier français du 26 juillet 1846.)
A la suite de cet appel, je m’abouchai avec quelques-uns des corps de métiers parisiens, entre autres avec la corporation des tailleurs de pierre. On me mit en rapport avec un compagnon surnommé Parisien la Douceur, un des ouvriers les plus intelligents que j’aie rencontrés. Parisien la Douceur goûta fort mon plan, et il me promit de l’exposer à la réunion des tailleurs de pierre. Malheureusement, la réunion ne pariagea pas l’opinion de son délégué: elle craignit que la publication des prix du travail a Paris n’attirât une affluence plus considérable d’ouvrlers dans ce grand centre de population, et elle me refusa son concours. Mes tentatives ne furent pas plus heureuses ailleurs.
Après la révolution de février, j’essayai de remettre cette idée à flot. J’écrivis à M. Flocon, alors ministre de l’agriculture et du commerce, pour l’engager, sinon à faire bâtir une Bourse du travail à Paris, du moins à mettre au service des travailleurs la Bourse déjà bâtie. Les gens d’affaires vont à la Bourse dans l’après-nudi, les ouvriers ne pourraient-ils pas y aller le matin? Telle est la question que je posais à M. Flocon; mais M. Flocon, qui avait bien d’autres affaires, ne me répondit point.
La même idée fut reprise à quelque temps de là, et un projet de Bourse du travail fut même présenté au préfet de police, M. Ducoux, par an architecte, M. Leuiller. M. Emile de Girardin prêta son appui à cette tentative, et il offrit même de consacrer une partie de la quatrième page de la Presse à la publicité des transactions du travail.
Pour donner une idée de l’extension que pourrait prendre celle publicité si nécessaire, et les services qu’elle pourrait rendre aux ouvriers marchands de travail, avec l’auxiliaire des télégraphes électriques et des chemins de fer, je reproduis un extrait d’une brochure où j’ai développé assez longuement cette idée:
Examinons de quelle manière la télégraphie électrique devrait être établie pour donner aux travailleurs de toutes les nations les moyens de connaître instantanément les lieux où le travail est demandé aux conditions les plus avantageuses.
C’est le long des chemins de fer que s’établissent les lignes télégraphiques.
Dans chacun des grands Etats de l’Europe, les principales lignes de chemins de fer se dirigent vers la capitale comme vers un centre commun. Elles rattachent à la métropole toutes les villes secondaires. Celles-ci, à leur leur, deviennent les foyers d’autres voies de communication qui vont aboutir à des centres de population de troisième ordre.
Admetions qu’en France, par exemple, il s’établisse, dans une vinglaine de villes secondaires, des marchés, des Bourses, servant à la fois à la vente du travail et au placement des capitaux et des denrées. Admettons aussi que la matinée soit consacrée aux transactions des travailleurs et l’après-midi à celles des capitalistes et des marchands. Voyons ensuite comment se tiendra le marché de travail.
Le jour de l’ouverture des vingt Bourses, les ouvriers qui manquent d’emploi et les directeurs industriels qui ont besoin d’ouvriers, se rendent au marché, les uns pour vendre, les autres pour acheter du travail. Il est tenu note du nombre des transactions effectuées, des prix auquels elles l’ont été et de la proportion relative des emplois offerts et des emplois demandés. Le bulletin du marché, rédigé à la fin de la séance, est envoyé à la Bourse centrale par voie télégraphique. Vingt bulletins arrivent en même temps à ce point de réunion où l’on en compose un bulletin général. Ce dernier, qui est adressé aussitôt soit par le chemin de fer, soit par le télégraphe, à chacune des vingt Bourses secondaires, peut être publié partout avant l’ouverture de la Bourse du lendemain.
Instruits par le bulletin général du travail de la situation des divers marchés du pays, les travailleurs disponibles dans certains centres de production peuvent envoyer leurs offres dans ceux où il y a des emplois vacants. Supposons, par exemple, que trois charpentiers soient sans ouvrage à Rouen, tandis qu’à Lyon le même nombre d’ouvriers de cet état se trouvent demandés au prix de 4 fr. Après avoir consulté le bulletin de travail publié par le journal du matin, les charpentiers de Rouen se rendent à la Bourse, où vient aboutir la ligne télégraphique, et ils expédient à Lyon une dépêche ainsi conçue:
“Rouen—3 charpentiers à 4 50—Lyon.”
La dépêche envoyée à Paris est, de là, transmise à Lyon. Si le prix demandé par les charpentiers de Rouen convient aux entrepreneurs de Lyon, ceux-ci répondent immédiatement par un signe d’acceptation convenu. Si le prix est jugé par eux trop élevé, un débat s’engage entre les deux parties. Si enfin elles tombent d’accord, les ouvriers, munis de la réponse d’acceptation timbrée par l’employé au télégraphe, se rendent aussitôt à Lyon par le chemin de fer. La transaction a été conclue aussi rapidement qu’ette aurant pu l’être dans l’enceinte de la Bourse de Rouen.
Admettons encore maintenant que Francfort-sur-Mein soil le point de réunion vers lequel convergent les lignes télégraphiques aboutissant aux diverses bourses centrales de l’Europe. C’est a Francfort-sur-Mein que sont adressés les bulletins genéraux de chaque pays, c’est là aussi que l’on en compose un bulletin européen qui est envoyé à toutes les bourses centrales et qui est transmis de celles-ci à toutes les bourses secondaires. Grâce à ce mécanisme de publicité, le nombre des emplois et des bras disponibles avec les prix offerts ou demandés se trouvent connus, d’une manière presque instantanée, sur toute la surface du continent.
Supposons donc qu’un marin, sans occupation à Marseille, apprenne, en consultant le bulletin du travail européen, que les matelots manquent à Riga et qu’il leur est offert, dans ce port, un salaire avantageux. Il se rend à la Bourse et envoie à Riga ses offres de services par dépêche télégraphique. De Marseille, la dépêche arrive à Paris, en deux ou trois étapes, selon la force de l’agent de locomotion: de Paris, elle est envoyée à Francfort, de Francfort elle va à Moscou, bourse centrale de la Russie, et de Moscou à Riga. Ce trajet, d’environ 4,000 kilomètres, pent être parcouru en deux ou trois minutes. La réponse est transmise de la même manière Si la correspondance lélégraphique est tarifée à raison de cinq centimes par 100 kilomètres, notre marin payera 4 fr. environ pour la dépêche envoyée et la dépêche reçue. Si sa demande est agrééc, il prend le chemin de fer et arrive à Riga en cinq jours. En supposant que le prix de la locomation se trouve fixé au plus has possible, soit à ½ centime par kilomètre, ses frais de déplacement, poste télégraphique comprise, s’élèveront à 24 fr.
L’Europe devient ainsi un vaste marché où les transactions des travailleurs s’effectuent aussi rapidement, aussi aisément que dans le marché de la Cité. Par constantinople, les hourses de l’Europe correspondent avec celles de l’Afrique et de l’Asie.
Ainsi la locomotion à la vapeur et la télégraphic électrique sont, en quelque sorte, les instruments matériels de la liberté du travail. En procurant aux individus le moyen de disposer librement d’eux-mêmes, de se porter toujours dans les contrées où l’existence est la plus facile et la plus heureuse, ces véhicules providentiels poussent irrésistiblement les sociétés dans les voies du progrès.
Êtudes économiques, p. 56.
[*] Journal la Nation, du 2d juillet 1843.—Des Moyens d’améliorer le sort des classes laborieuses.—Brochure, fevrier 1844.
[1] Quelquefois cependant la protection était due à des manœuvres que l’on ne saurait qualifier trop sévèrement. Voici, par exemple, un renseignement curieux que j’emprunte à l’Enquête sur les houilles (1832), an sujet de la protection accordée aux mines d’Anzin:
“La prime dont jouit la compagnie d’Anzin, sur le prix de l’hectolitre de charbon extrait au couchant de Mons (Belgique), est de 75 centimes, ou 7 fr. 50 c. par tonneau Elle a obtenu cette prime, après l’achèvement du canal de Condé, par les droits et péages qu’on a établis et par la position topographique de ses établissements.
Elle l’avait antérieurement, en 1813, par un maximum qu’elle était parvenue à faire imposer sur le prix du fret de la Haine, par un arrêté des consuls du 13 pralrial an xi. A cette èpoque, Cambacérès, second consul, Talleyrand-Pèrigord, Lecouteulx-Canteleu et plusieurs autres personnages marquants et très influents, étaient actionnaires de la compagnie des mines d’Anzin.
Enquête, p. 410.
[1] Un des membres éminents de la Ligue contre les lois-céréales, M. W.-J. Fox, a admirablement réfuté cet argument de la dépendance de l’étranger. Quoique le morceau ait été souvent cité, je cède à la tentation de le reproduire encore. C’est un petit chefd’œuvre.
“Ètre indépendant de l’étranger, c’est le thême favori de l’aristocratic. Mais qu’est-il donc ce grand seigneur, cet avocat de l’indépendance nationale, cet ennemi de toute dépendance étrangère? Examinons sa vie. Voilà un cuisinier français qui prépare le dîner pour le maître, et un valet suisse qui apprête le maître pour lediner.—Mylady qui accepte sa main est toute resplendissante de perles, qu’on ne trouve jamais dans les huîtres britanniques, et la plume qui flotte sur sa tête ne fit jamais partie de la queue d’un dindon anglais. Les viandes de sa table viennent de la Belgique, ses vins du Rhin ou du Rhône. Il repose sa vue sur des fleurs venues de l’Amérique du Sud, et il gratifle son odorat de la fumée d’une feuille venue de l’Amérique du Nord. Son cheval favori est d’origine arabe, et son chien de la race de Saint-Bernard. Sa galerie est riche de tableaux flamands et de statues grecques.—Veut-il se distraire? il va entendre des chanteurs italiens, vociférant de la musique allemande, le tout suivi d’un ballet français. S’élève-t-il aux honneurs judiciaires? l’hermine qui décore ses épaules n’avait jamais figuré jusque-là sur le dos d’une bête britannique.—Son esprit même est une bigarrure de contributions exotiques. Sa philosophie et sa poésie viennent de la Grèce et de Rome; sa géométrie d’Alexandrie; son arithmétique d’Arabie; et sa religion de Palestine. Dès son berceau, il pressa ses dents naissantes sur du corail de l’Océan indien; et lorsqu’il mourra, le marbre de Carare surmontera sa tombe... Et voilà l’homme qui dit: Soyons indépendants de l’etranger!”—Meeting du 26 janvier 1844.—Cobden et la Ligue, de M. F. Bastiat, p. 182.
[1] On sait que c’est principalement aux efforts de la Ligue contre les lois-céréales, dirigée par M. Cobden, que l’Angleterre doit la conquête de la liberté commerciale. Voir, pour l’histoire de cette admirable association, le livre de M. Bastiat, Cobden ou la Ligue et l’Association anglaise; les Études sur l’Angleterre, de M. Léon Faucher; Richard Cobden ou les Ligueurs, par M. Joseph Garnier, et surtout les esquisses pittoresques et colorées de notre excellent et regrettable ami A. Fonteyraud, dans la Revue britannique et dans l’Annuaire de l’Économie politique.
[1] Voir le sixième entretien.
[1] Dans les départements et dans la banlieue de Paris, les directeurs de spectacles prélèvent en revanche un droit d’un cinquième de la recette brute sur les représentations des saltimbanques, des joueurs de gobelets, etc. Ces plaisirs du pauvre sont taxés au profit des plaisirs du riche. Voilà l’égalité que nous avail faite le régime monarchique.
[1] Les cultes reconnus sont au nombre de quatre, savoir: la religion catholique romaine, la religion protestante (confession d’Augsbourg), la religion luthérienne, la religion juive.
[1] Dans un article sur les Sociétés commerciales en France et en Angleterre, publié dans la Revue des Deux Mondes (1er août 1843), M. Charles Coquelin a insisté, le premier, sur la nécessité d’accorder une entière liberté aux associations commerciales. Voici quelques extraits de ce travail remarquable:
“Il s’est formé de nos jours des écoles philosophiques qui ont eu la prétention de conduire l’humanité, par l’association, à des destinées inconnues. Est-il besoin de les nommer, quand les derniers échos de leurs paroles sonores relentissent encore autour de nous? Que voulaient les chefs de ces écoles? Améliorer l’ordre existant, purger de ses taches cette société humaine que le travail des temps a formée, continuer l’œuvre des générations passées en perfectionnant par degrés ses procédés et ses formes? Tout cela ne suffisait point à l’ambition de ces docteurs. La société actuelle n’était pas assez régulière à leurs yeux; elle n’était pas assez absolue, assez étroite: elle laissait trop de place au libre arbitre de l’homme, et respectait trop l’action spontanée de l’individu. Ce qu’ils voulaient, c’était une société une, avec un seul centre et an seul chef, une société universelle par son étendue, universelle par son objet, où l’individualité humaine disparût dans le courant de l’action sociale, qui n’eût qu’une seule âme, un seul mobile, où l’homme ne connût aussi qu’un seul lien, mais un lien tel qu’il l’étreignit, pour ainsi dire, tout entier. Voilà ce que demandaient ces prétendus apôtres de la sociabilité humaine. Est-ce là ce que l’avenir nous promet? Est-ce ainsi que le progrès doit s’accomplir? Loin de là: l’étude du véritable caractère de l’homme et la connaissance des faits historiques nous montrent au contraire que, dans le cours naturel des choses, le lien social va chaque jour se fractionnant et se multipliant; que l’humanité, dans ses développements normaux, dans ses aspirations réelles vers le progrès, au lieu de ramener l’association à cette unité étroite et misérable, tend sans cesse à la diviser, à diversifler ses formes, à l’éparpiller en quelque sorte sur des objets chaque jour plus nombreux et plus variés.
L’homme est un être sociable, dit-on, et sur ce fondement on veut qu’il s’absorbe tout entier dans une société unique, comme si ce penchant social qu’on lui attribue ne pouvait s’exercer que là. Oui, l’homme est un être sociable; il l’est plus que nul être sensible; c’est là son attribut le plus distinctif et son plus noble apanage. Mais avec le sentiment de la sociabilité, il nourrit en lui un besoin impérieux de liberté et une certaine spontanéité dans ses rapports. C’est d’ailleurs un être mobile et divers autant que sociable, et il se porte d’instinct vers un état de société mobile et divers comme sa nature elle-même. Au lieu donc de se lier une fois pour toutes, dans une société unique, par une chaîne lourde qui entraverait la liberté de ses allures, il doit se lier plulôt par des milliers de fils légers qui, en l’attachant, de toutes parts, à ses semblables, respectent pourtant le jeu de sa nature mobile. Voilà ce que la raison commande; là est le progrès.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dans aucun temps, le principe de l’association n’a été largement appliqué en France. Soit avant, soit depuis la Révolution, on n’y trouve guère qu’un certain nombre de ces sociétés chétives que le niveau commun atteint, peu ou point de ces puissants concours de capitaux ou d’hommes qui mettent le commerce d’un pays à la hauteur des grandes entreprises. Bien des gens s’en prennent au génie du peuple français, peu propre, dit-on, à se prêter aux combinaisons de l’association commerciale. Sans nous arrêter à cette explication, qui nous paraît prématurée, nous essaierons de montrer que la cause du mal est toute dans la loi qui régit nos sociétés.
La loi de 1807, qui régit les sociétés commerciales, a subsisté sans altération jusqu’à nos jours: c’est dans ses dispositions et ses tendances qu’il faut chercher la cause de l’état de torpeur où l’association languit parmi nous, aussi bien que des abus et des seandales qui ont suivi ses trop rares applications.—On peut la résumer ainsi: La loi reconnaît trois espèces de sociétés commerciales, la société en nom collectif, la société en commandite et la société anonyme.
Dans la société en nom collectif, tous les associés doivent être nominalement désignés dans un acte rendu public, et leurs noms peuvent seuls faire partie de la raison sociale. Ils sont d’ailleurs unis par les liens d’une étroite solidarité, chacun étant indéflniment responsable, sur sa personne et sur ses biens, de tous les engagements contractés par la société, et les engagements sociaux pouvant être contractés par chacun d’eux, pourvu qu’il ait signé sous la raison sociale.
La société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds, que l’on nomme commanditaires ou associés en commandite. Les noms des associés responsables et solidaires figurent seuls dans l’acte de société, et seuls aussi peuvent faire partie de la raison sociale. La gestion leur est exclusivement réservée. Par rapport à eux, la société entraîne tous les effets de la société en nom collectif: quant aux associés commanditaires, ils ne sont passibles des pertes que jusqu’à concurrence des fonds qu’ils ont mis ou dû mettre dans la société.
La société anonyme n’existe point sous une raison sociale; elle n’est désignée sous le nom d’aucun des associés; elle est qualifiée par la désignation de l’objet de l’entreprise. Tous les associés indistinctement y joulssent de l’avantage de n’être engagés que jusqu’à concurrence de leur mise convenue. Elle est administrée par des mandataires à temps, révocables, associés ou non associés, salariés ou gratuits, qui ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire, relativement aux engagements de la société, et qui ne sont responsables que de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu.
Quand on considère dans son ensemble le système dont on vient de voir l’exposé, on ne peut s’empêcher d’être frappé de l’esprit restrictif qui le domine, et qui se révèle d’ailleurs dans ces seuls mots: la loi reconnaît trois espèces de sociétés commerciales. L’association n’étant qu’un acte naturel, il semble qu’elle doive être spontanément réglée entre les parties contractantes avec des formes et des conditions librement déterminées par elles, suivant leurs intérêts et leurs besoins. Nous voyons au contraire que la loi se substitue, à certains égards, aux contractants: elle empiète sur leur libre arbitre pour leur dicter le mode d’association, en ne leur laissant que le choix entre les trois formes particulièrement déterminées par elle. Elle fait plus encore, en imposant à chacune des formes qu’elle spécifie, des règles étroites et rigoureuses, qui ne permettent pas même d’en modifier l’application selon les cas.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Qu’est-ce maintenant que la société anonyme en France? Est-ce par hasard une forme d’association que le commerce puisse appliquer à son usage? Évidemment non; c’est une forme réservée par privilége à certaines entreprises extraordinaires qui se recommandent par une grandeur ou un éclat inusités. Celles-là seules, en effet, peuvent se présenter devant le conseil d’État avec des chances raisonnables de succès, sur lesquelles l’opinion publique est formée et qui ont pour elles l’appul des autorités constituées et de quel ques hommes puissants. Les entreprises de ce genre sont rares, et quelle que soit leur importance particulière, elles sont, par leur rareté même, d’un intérêt secondaire pour le pays. Quant à la foule des entreprises de second ordre, ou plutôt dont l’utilité est moins apparente, et ne peut souvent s’apprécier que sur les lieux, la forme de la société anonyme leur est tout à fait interdite.
Avec de tels éléments, on comprend que l’association n’a pu faire de grands progrès en France, et que le commerce y doit être presque entièrement privé de ses bienfaits. En effet, jusqu’à ces dernières années, où l’esprit d’association, pressé de se faire jour, a rompu les barrières de la loi, c’est à peine si l’aspect de la France pouvait donner une idée de ce qu’engendre l’union des forces commerciales. Aujourd’hui même, qu’est-ce que ces rares sociétés par actions répandues çà et là autour de nous? En Angleterre, avec des conditions plus favorables, quoique trop rigoureuses encore, l’association s’est propagée depuis longtemps avec une bien autre puissance. Le nombre est incalculable des sociétés par actions que ce pays renferme; l’imagination serait confondue de la masse des capitaux qu’elles représentent, et, avec la mesure de liberté dont elles jouissent, ces sociétés ont enfanté des merveilles. Il en est de même aux États-Unis. Sans compter les innombrables banques fondées par actions, qui peuplent ce pays, chaque place importante de l’Union compte une foule d’associations de tous genres, dont quel-ques-unes sont gigantesques. Les moindres villes, les bourgs, les villages mêmes ont les leurs. Elles soutiennent l’industrie privée: elles la secondent et l’animent, en même temps qu’elles la complètent. Toutes ensemble, soit qu’elles se renferment dans ce rôle de protectrices des établissements particuliers, soit qu’elles s’attachent à des opérations d’une nature exceptionnelle, elles accroissent de leur activité et de leurs immenses ressources la puissance industrielle et la richesse du pays. A quelle distance ne sommes-nous pas de ce merveilleux développement!”
[1] The Credit system in France, Great-Britain and the United-States. Philadelphia, 1838.—What in Currency, by J.-C. Carey.—Du Crèdit et des Banques, par Charles Coquelin. Paris. 1848. Chez Guillaumin et compagnie.
[1] A la Banque de France, les jours d’escompte ont été fixés aux lundi, mercredi et vendredi de chaque semaine, et aux trois derniers jours qui précèdent la fin de chaque mois, quels que soient ces jours. Pour être admis à l’escompte et avoir un compte-courant à la Banque, il faut en faire la demande par écrit au gouverneur, et l’accompagner d’un certificat signé de trois personnes qui déclarent connaître la signature du demandeur et sa fidélité à ses engagements.
(Dictionnaire du commerce et des marchandises, art. Banques.)
[1] Dans une lettré adressée à M. Napier, à Édimbourg, J.-B. Say a fait un historique intéressant du privilége de la Banque de France. Voici quelques extraits instructifs de cette lettre:
“..... La Banque fut reconnue par le gouvernement de Bonaparte et reçut de lui, par une loi du 24 germinal an xi (14 avril 1803), le privilége exclusif de mettre en circulation des billets au porteur.
Le motif apparent fut de présenter au public une garantie plus respectable des billets en émission. Le motif réel fut de faire payer par la Banque le privilége exclusif d’avoir dans la circulation des billets ne portant point intérêt. Elle acheta ce privilége, comme la Banque d’Angleterre, en faisant des avances au gouvernement.
Les événements marchèrent. La bataille d’Austerlitz eut lieu. Le public, qui savait que la Banque avait été obligée de prêter à Bonaparte vingt millions de ses billets, et voyant sur les bras de ce prince l’Autriche et la Russie, le crut perdu et se porta en foule à la Banque pour avoir le remboursement de ses billets. Elle en suspendit le payement en décembre 1805. La bataille d’Austerlitz eut lieu le 2 décembre. La capitulation de Presbourg fut la suite de cette victoire. Bonaparte devint maître, plus que jamais, des ressources de la France. Il s’acquitta envers la Banque, qui reprit ses payements au commencement de 1806.
Bonaparte se prévalut des extrémités où lui-même avait jeté la Banque, et pour prévenir à l’avenir, disait-il, les embarras qui lui avaient fait suspendre le payement de ses billets au porteur, il en changea l’administration par une loi qu’il fit rendre le 22 avril 1806.
Par cette loi, l’administration de la Banque fut donnée à un gouverneur (Jaubert) et à deux sous-gouverneurs, tous trois à la nomination du chef de l’État, mais qui devaient compte à l’assemblée des actionnaires, représentés par deux cents des plus forts d’entre eux.
En même temps, le capital de la Banque, qui était composé de quarante-cinq mille actions à mille francs, fut porté à quatre-vingt-dix mille actions formant un capital de quatre-vingt-dix millions.
Les besoins du public qui, disait-on, réclamaient de plus forts escomptes, et le dessein qu’il manifestait de prendre des actions dans cet établissement, furent le motif apparent. Le motif réel fut, de la part du gouvernement, la facilité que cet accroissement du capital de la Banque lui présentait pour obtenir de plus fortes avances.
Les nouvelles actions furent vendues avec avantage au profit de l’établissement. Le crédit et la puissance du gouvernement étaient portés au comble par des succès inespérés.
Le gouverneur de la Banque exerçait une grande influence sur le conseil d’administration, composé de gros négociants, dont les uns obtenaient des décorations, les autres des places pour leurs protégés. Cette influence n’était pas forcée, mais insurmontable. Les caractères fermes et qui méprisaient les avantages qu’on peut retirer du crédit se trouvaient en minorité dans toutes les délibérations. Le capital de la Banque fut, sous différentes formes (soit en cinq pour cent consolidés, soit en obligations du Trésor et des receveurs de contributions), presque entièrement conflé au gouvernement; mais en même temps, on se défendait autant qu’on pouvait de lui prêter des billets au porteur, lesquels n’ayant pour gage que des engagements non exigibles du gouvernement, n’auraient pu être remboursés à présentation.
..... En 1814, lorsque la France, divisée d’intérêts et d’opinions fut envahie par toutes les armées de l’Europe, le gouvernement obligea la Banque de lui faire des prêts extraordinaires. A cette époque, ses billets et ses engagements exigibles excédèrent d’environ vingt millions son numéraire et ses effets à courte échéance. En conséquence, le 18 janvier, lorsque les porteurs de billets, poussés par la crainte, se présentèrent en foule pour obtenir le remboursement de leurs billets, elle fut obligée, non d’en suspendre complétement le payement, mais de réduire le remboursement à cinq cent mille francs par jour. On ne payait qu’un seul billet de mille francs à chaque personne. Elle réduisit ses escomptes, fit rentrer ses créances, et, dès le mois de février suivant, elle reprit ses payements à bureau ouvert et pour toutes sommes.
En ce moment, ses prêts faits au gouvernement sur des bons du Trésor ou des receveurs, ou sous toute autre forme, portant intérêts, s’élèvent à vingt-six millions.
J.-B. Say.
Paris, 14 août 1816.”
(Mélanges d’Économie politique.—OEuvres de J.-B. Say; collection Guillaumin et compagnie).
On sait que la Banque n’a pas cessé d’être la pourvoyeuse du gouvernement, au grand dommage de ceux qui sont obligés de subir son privilége.
[1] Le privilége qui, en France, résulte de la vénalité des charges instituées à titre onéreux par la loi du 28 avril 1816, et, en divers autres pays, s’appuie sur des règlements qui ont fixé dans un intérêt public, réel ou supposé, le nombre des personnes admises à exercer de certains ministères, n’existe pas aux États-Unis. Chacun est libre de se faire commissaire-priseur, agent de change, huissier, avoué, notaire, autant que ces professions ont leurs analogues en Amérique, car le mécanisme judiciaire et ministériel y est tout différent.
La tendance aujourd’hui est de supprimer même les garanties que la société avait cru devoir exiger de l’homme qui aspire à défendre la veuve et l’orphelin, ou de celui qui prétend instrumenter la vie de ses concitoyens. Dans le Massachussets (je cite de préférence les États les plus éclairés), pour être avocat, il fallait, jusqu’en 1836, avoir été reçu bachelier ès lois dans une université, ou blen avoir effectivement passé un certain nombre d’années dans le cabinet d’un praticien qui présentait ensuite le candidat à la cour. Pour exercer la médecine, ou, ce qui est déjà différent, pour avoir le droit de poursuivre un client en payement d’honoraires, il fallait avoir acquis ses grades au collége médical qui fait partie de l’université de Harvard, voisine de Bosion. Aujourd’hui on est avocat, dans le Massachussets, sous la seule condition de passer un examen public devant un jury d’hommes de loi, choisi à chaque session par le juge. Quant à la médecine, la clause d’un examen n’est plus nécessaire, même pour la revendication des honoraires: depuis 1836, la petite barrière qui séparait l’exercice de cette profession d’une liberté complète a disparu.
(Michel Chevalier. De la Liberté aux États-Unis.—Extrait de la Revue des Deux-Mondes du 1er juillet 1849, p. 20).
[1] J’emprunte cette partie de mon argumentation au savant et judicieux auteur des Notes sur Malthus, M. Joseph Garnier.
[1] Cours de Phrénologie de M. le docteur Ch. Place.
[1] Pendant longtemps, les économistes ont refusé de s’occuper non seulement du gouvernement, mais encore de toutes les fonctions purement immatérielles. J.-B. Say a fait entrer, le premier, cette nature de services dans le domaine de l’économie politique, en leur appliquant la dénomination commune de produits immatériels. En cela, il a rendu à la science un service plus considérable qu’on ne suppose:
“L’industrie d’un médecin, dit-il, et, si l’on veut multiplier les exemples, d’un administrateur de la chose publique, d’un avocat, d’un juge, qui sont du même genre, satisfont à des besoins tellement nécessaires, que, sans leurs travaux, nulle société ne pourrait subsister. Les fruits de ces travaux ne sont-ils pas réels? Ils sont tellement réels qu’on se les procure au prix d’un autre produit matériel, et que, par ces échanges répétés, les producteurs de produits immatériels acquièrent des fortunes.—C’est donc à tort que le comte de Verri prétend que les emplois de princes, de magistrats, de militaires, de prêtres, ne tombent pas immédiatement dans la sphère des objets dont s’occupe l’économie politique.”
J.-B. Say, Traité d’Économie politique, l. 1, chap. XIII.
[1] Du Principe générateur des Constitutions politiques.—Préface.
[1] Voir les Études sur l’Angleterre, de M. Léon Faucher.
[1] De la Richesse des Nations, liv. 5, chap. Ist.
[1] Sans déterminer cette loi, comme aussi sans bien définir le rôle qu’elle joue dans la production et la distribution de la richesse, Adam Smith l’a clairement indiquée dans ce passage:
“Le prix du marché pour chaque marchandise particulière est réglé par la proportion entre la quantité qu’on en apporte au marché et celle qu’en demandent les gens qui veulent en payer le prix naturel, c’est-à-dire toute la valeur de la rente, du travail et du profit qui doivent être payés pour qu’elle vienne au marché.
Lorsque la quantité d’une marchandise qu’on apporte au marché est au-dessous de la demande effective, il n’y en aura point assez pour fournir aux besoins de tous ceux qui sont résolus de payer toute la valeur de la rente, du salaire et du profit qui doivent être payés pour qu’elle y vienne. Plutôt que de s’en passer entièrement, quelques-uns des demandeurs en offriront davantage. Dès ce moment, il s’établira parmi eux une concurrence, et le prix du marché s’élèvera plus ou moins, selon que la grandeur du déficit augmentera plus ou moins l’ardeur des compétiteurs. Ce même déficit occasionnera généralement plus ou moins de chaleur dans la concurrence, selon que l’acquisition de la marchandise sera plus ou moins importante pour les compétiteurs. De là le prix exorbitant des choses nécessaires à la vie durant le blocus d’une ville ou dans une famine.
Lorsque la quantité qu’on apporte au marché est au-dessus de la demande effective, on ne peut vendre le tout à ceux qui sont disposés à en payer le prix naturel ou toute la valeur de la rente, etc. Il faut en vendre une partie à ceux qui en offrent moins, et le bas prix qu’ils en donnent fait nécessairement une réduction sur le prix du tout. Le prix du marché baissera plus ou moins au-dessous du prix naturel, selon que la grandeur du surabondant augmentera plus ou moins la concurrence des vendeurs, ou selon qu’il sera plus ou moins important pour eux de se défaire de la marchandise. La même surabondance dans l’importation des marchandises qui peuvent se gâter et se perdre, comme les oranges, occasionnera une concurrence bien plus animée que ne le feront celles qui sont durables comme la ferraille.
Si la quantité portée au marché suffit juste pour fournir à la demande effective et rien de plus, le prix du marché sera exactement le même que le prix naturel, ou il en approchera le plus possible, autant qu’on en peut juger. Toute la quantité qu’il y en a peut être vendue à ce prix, et pas plus cher. La concurrence des vendeurs les oblige à la donner pour cela et pas davantage.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ainsi le prix naturel est, pour ainsi dire, le prix central vers lequel gravitent continuellement les prix de toutes les marchandises. Divers accidents peuvent les tenir quelquefois suspendus assez haut au-dessus de ce prix et les faire descendre même quelquefois un peu plus bas. Mais quels que soient les obstacles qui les empêchent de s’établir dans ce centre de repos et de stabilité, elles tendent constamment à s’y mettre.”
Adam Smith. De la Richesse des Nations, liv. 1, chap. VII.
[1] La fabrication du tabac, rendue libre par l’Assemblée constituante, fut mise en régie par un décret du 29 décembre 1810.