CHARLES COMTE,
Traité de législation,
ou exposition des lois générales suivant lesquelles les peuples prospèrent, dépérissent ou restent stationnaire. Tome quatrième (1827).
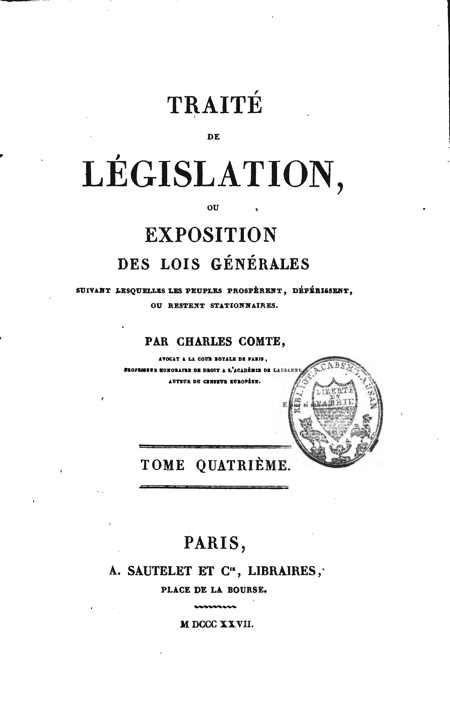 |
[Created: 21 November, 2021]
[Updated: 16 September, 2023 ] |
 |
This is an e-Book from |
Source
, Traité de législation, ou exposition des lois générales suivant lesquelles les peuples prospèrent, dépérissent ou restent stationnaire, 4 vols. (Paris: A. Sautelet et Cie, 1826-27). Tome quatrième.http://davidmhart.com/liberty/Books/1827-Comte_TraiteLegislation/Comte_TdL1827_T4-ebook.html
Charles Comte, Traité de législation, ou exposition des lois générales suivant lesquelles les peuples prospèrent, dépérissent ou restent stationnaire, 4 vols. (Paris: A. Sautelet et Cie, 1826-27). Tome quatrième.
Editor's Introduction
To make this edition useful to scholars and to make it more readable, I have done the following:
- inserted and highlighted the page numbers of the original edition
- not split a word if it has been hyphenated across a new line or page (this will assist in making word searches)
- added unique paragraph IDs (which are used in the "citation tool" which is part of the "enhanced HTML" version of this text)
- retained the spaces which separate sections of the text
- created a "blocktext" for large quotations
- moved the Table of Contents to the beginning of the text
- placed the footnotes at the end of the book
- formatted short margin notes to float right
- inserted Greek and Hebrew words as images
[IV-537]
TABLE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE QUATRIÈME VOLUME
LIVRE CINQUIÈME.
De l'esclavage domestique considéré dans les faits qui le constituent et dans les effets qu'il produit, sur les facultés physiques, intellectuelles et morales des diverses classes de la population, sur les richesses, sur la nature du gouvernement, et sur les relations des nations entre elles. — De quelques genres d'associations qui se rapprochent de l'esclavage.
- Chap. I. De l'importance du sujet de ce livre, dans l'état actuel des nations. 1
- Chap. II. Nature des divers genres d'esclavage domestique. 18
- Chap. III. De l'influence de l'esclavage sur la constitution physique et sur les facultés industrielles des maîtres et des esclaves. 33
- Chap. IV. De l'influence de l'esclavage domestique sur les facultés intellectuelles des maîtres et des esclaves. 54
- Chap. V. De l'influence de l'esclavage sur l'existence des personnes libres et industrieuses qui n'ont point d'esclaves. 70
- Chap. VI. De l'influence de l'esclavage sur les mœurs des Romains. 80
- Chap. VII. De l'influence de l'esclavage sur les mœurs des maîtres et des esclaves dans les colonies modernes, et particulièrement dans les colonies hollandaises. 106
- Chap. VIII. De l'influence de l'esclavage domestique sur les mœurs des maîtres et des esclaves dans les colonies an- glaises. 140
- Chap. IX. De l'influence de l'esclavage domestique sur les mœurs des maîtres et des esclaves dans les Etats-Unis d'Amé- rique. 159
- Chap. X. De l'influence de l'esclavage sur les mœurs des maîtres et des esclaves dans les colonies françaises. 187
- Chap. XI. De l'influence de l'esclavage sur les" mœurs de quelques peuples de l'Amérique méridionale, originaires d'Espagne. 198
- Chip. XII. De l'influence de l'esclavage sur la liberté des individus qui appartiennent à la classe des maîtres y et sur l'existence de ceux qui n'appartiennent ni à la classe des maîtres, ni à celle des esclaves. 223
- Chap. XIII. De l'influence de l'esclavage domestique sur la production, l'accroissement et la distribution des richesses. 237
- Chap. XIV. De l'influence de l'esclavage domestique sur l'accroissement des diverses classes de la population. 283
- Chap. XV. De l'influence de l'esclavage domestique sur l'esprit et la nature du gouvernement. 299
- Chap. XVI. De l'influence de l'esclavage domestique sur l'indépendance des peuples possesseurs d'esclaves. 330
- Chap. XVII. De l'influence qu'exercent les peuples possesseurs d'esclaves, sur les mœurs et sur la liberté des peuples chez lesquels l'esclavage est aboli ou n'a point été admis. 354
- Chap. XVIII. De l'influence réciproque de l'esclavage sur la religion, et de la religion sur l'esclavage. 378
- Chap. XIX. De l'influence de l'esclavage sur l'industrie et le commerce des nations qui ont des relations commerciales avec des peuples chez lequel l'esclavage est établi. — Du système colonial. 408
- Chap . XX. De la protection accordée aux esclaves contre les violences ou les cruautés de leurs maîtres, par les goovernemens des métropoles. 443
- Chap. XXI. De l'abolition de l'esclavage domestique. 460
- Chap. XXII. De l'inégalité des rangs et du pouvoir produite par l'esclavage. — De la fusion Ou du mélange de familles de diverses races. 486
- Chap. XXIII. De l'inégalité des fortunes produite par l'esclavage. — Des communautés de biens et de travaux, considérées comme moyens de rétablir l'égalité parmi 'es hommes. — Des sociétés de ce genre établies en Amérique, et des effets qu'elles ont produits. 502
- NOTES
TRAITÉ DE LÉGISLATION,
OU EXPOSITION DES LOIS GÉNÉRALES SUIVANT LESQUELLES LES PEUPLES PROSPÈRENT, DÉPÉRISSENT OU RESTENT STATIONNAIRES
PAR CHARLES COMTE
Avocat à la Cour royale de Paris,
Professeur honoraire de droit à l’Académie de Lausanne,
Auteur du Censeur Européen.
E pur si muove !
TRAITÉ DE LÉGISLATION.
[IV-1]
LIVRE CINQUIÈME
De l’esclavage domestique considéré dans les faits qui le constituent et dans les effets qu’il produit, sur les facultés physiques, intellectuelles et morales des diverses classes de la population, sur les richesses, sur la nature du gouvernement, et sur les relations des nations entre elles. — De quelques genres d’associations qui se rapprochent de l’esclavage.
CHAPITRE PREMIER.↩
De l’importance du sujet de ce livre, dans l’état actuel des nations.
Nous avons vu, dans les livres précédents, quelle est l’action que les hommes exercent les uns à l’égard des autres individuellement ou collectivement, dans l’état le plus barbare où ils aient été trouvés ; nous les avons observés dans leurs relations de mari et de femme, de parents et d’enfants, de membres d’une même association, de chefs et de subordonnés, nous les avons considérés ensuite dans les relations qu’ils ont entre eux de horde à horde ou de nation à nation ; nous avons vu comment l’industrie, les mœurs et l’état social de chaque peuple sont d’abord déterminés par les circonstances locales au milieu desquelles ce peuple est placé ; et comment cette industrie, ces mœurs et cet état social déterminent ensuite l’action que les nations exercent les unes sur les autres ; enfin, nous avons vu quels sont les effets que cette action produit sur les facultés physiques, intellectuelles et morales de ceux qui l’exercent, et de ceux qui la subissent, sur la création et sur la distribution des richesses, et sur l’accroissement ou le décroissement de la population.
Nous avons ainsi été conduits à observer la nature, les causes et les effets du despotisme ou de l’asservissement politique. Nous avons vu des armées de barbares s’organiser pour envahir des pays occupés par des populations industrieuses, se partager, après la victoire, les terres et les hommes conquis, les exploiter en commun, vivre dans l’abondance et le luxe, ne laisser au peuple asservi que ce qui lui est rigoureusement nécessaire pour travailler, s’abandonner à l’oisiveté ou ne se livrer qu’aux exercices propres à maintenir dans l’esclavage la population vaincue. Nous avons à observer maintenant un état analogue au précédent : c’est celui d’un pays où l’on voit sur le même sol deux peuples : l’un, qui exécute tous les travaux, ne jouit d’aucune sûreté, et vit dans la plus profonde misère ; l’autre, qui vit dans l’oisiveté, consomme les produits du travail du premier, et dispose de lui de la manière la plus absolue. La principale différence qui existe entre cet état et celui que j’ai précédemment décrit, consiste en ce que, dans ce cas, l’exploitation de la population asservie s’opère d’une manière plus individuelle que dans l’autre, et en ce que les hommes asservis sont abandonnés à un arbitraire plus actif et plus continu ; cet état est celui qu’on désigne sous le nom d’esclavage domestique.
Il existe, entre l’esclavage politique et l’esclavage domestique, une différence analogue à celle que nous observons entre les propriétés territoriales d’une horde de barbares, et les propriétés territoriales d’un peuple civilisé : dans le premier cas, le territoire national appartient à tous en commun ; dans le second, les parts sont faites, et chacun dispose de la sienne comme bon lui semble. De même, dans l’esclavage politique, le peuple asservi est exploité en commun, et les produits en sont partagés entre les maîtres, chacun ayant une part selon son grade ; dans l’esclavage domestique, au contraire, la population asservie est divisée en fractions entre les maîtres, et chacun exploite la sienne et en dispose comme il juge convenable. Ces deux états sont susceptibles de diverses modifications : si le chef des possesseurs partage les produits de l’exploitation d’une manière arbitraire, et si le pouvoir militaire reste concentré dans ses mains, comme cela se pratique en Perse, en Turquie et dans d’autres pays, cela se nomme du despotisme ; si, au contraire, les maîtres se partagent entre eux, selon leurs rangs et d’une manière régulière, les produits du peuple subjugué, cela se nomme de l’aristocratie. Le despotisme et l’aristocratie n’ont point dans tous les pays la même intensité : les intervalles qui séparent les aristocraties de Berne, de la Grande-Bretagne, des archipels du grand Océan et des nègres du centre de l’Afrique sont fort grands. Il peut également y avoir une grande distance entre le despotisme, tel qu’il est exercé dans l’empire turc, et celui qui est exercé dans l’empire russe. L’esclavage domestique paraît susceptible de moins de gradations que l’esclavage politique ; cependant, nous verrons qu’il est aussi sujet à de grandes variations.
Il est dans la nature de l’homme, que tout vice et toute vertu produisent pour les individus qui les ont contractés, une certaine somme de biens et de maux, ou de plaisirs et de peines. Or, l’esclavage, quelle qu’en soit la nature, a toujours pour objet dans l’intention de ceux qui l’établissent, de faire tomber sur les hommes asservis tous les maux qu’engendrent les vices des diverses classes de la population, et de leur ravir en même temps tous les biens qui sont les conséquences naturelles de la pratique des vertus. Cette intention, qui a pour but de paralyser des lois inhérentes à la nature humaine, peut-elle être accomplie ? Est-il en la puissance d’un certain nombre d’hommes de s’attribuer le monopole des jouissances, et de rejeter toutes les peines et tous les travaux sur une partie plus ou moins nombreuse de la population ? Cette question sera résolue dans le cours de ce livre. Mais mérite-t-elle d’être soumise à l’examen ? N’a-t-elle pas été déjà suffisamment éclaircie ? Et, si elle ne l’a pas été, avons-nous quelque intérêt à ce qu’elle le soit ?
Il est, parmi nous, des personnes qui s’imaginent que la raison humaine a déjà fait tant de progrès, qu’il n’y a plus d’erreurs à détruire dans le monde. Suivant elles, il ne s’agit plus que d’exposer la vérité dans un petit nombre de maximes, et de savoir la mettre en pratique. Je ne doute pas qu’en lisant le titre de ce livre, ces personnes n’éprouvent un sentiment analogue à celui que produirait sur un savant de nos jours, la vue d’un ouvrage qui aurait pour objet de réfuter les erreurs de l’alchimie. Est-il possible d’écrire sur un tel sujet sans nous reporter deux ou trois mille ans en arrière, ou du moins dans la barbarie du Moyen-âge ? Qui songe aujourd’hui à défendre ou à rétablir un tel système ? Parler de l’esclavage domestique à des peuples qui sont arrivés à la monarchie constitutionnelle et au gouvernement représentatif, à des peuples qui ont médité sur la liberté de la presse et sur la responsabilité des ministres, n’est-ce pas ramener aux premiers éléments du calcul des hommes qui ont l’esprit familiarisé avec les écrits de Newton et de Laplace ?
Il semble, en effet, lorsqu’on ne considère que la superficie de la société au milieu de laquelle on vit, et qu’on ne porte pas ses regards au-delà du petit cercle dont on se trouve environné, qu’il n’est pas plus nécessaire de traiter de la nature et des effets de l’esclavage, que de traiter des erreurs les plus grossières qui ont disparu depuis des siècles. Mais, lorsqu’on ne se laisse pas enivrer par les éloges continuels que des écrivains donnent à l’époque actuelle, éloges que se sont donnés, au reste, les peuples de tous les âges ; lorsque, laissant de côté les livres dans lesquels sont consignés, à côté de nos systèmes, les témoignages irrécusables de notre vanité, on porte ses regards sur ce qui se passe dans le monde, on se sent un peu moins disposé à céder à ces mouvements d’orgueil ; loin de croire que les nations soient aussi avancées dans les sciences de la morale et de la législation, que quelques écrivains le prétendent, on est porté à penser, au contraire, qu’elles sont encore environnées d’épaisses ténèbres, et qu’elles n’en possèdent peut-être pas même les premiers éléments.
Que les hommes qui croient que les peuples sont déjà très avancés dans ces sciences, se donnent la peine d’aller écouter ce qu’on enseigne dans les hautes écoles des nations les plus civilisées, dans celles où ces sciences doivent être le mieux connues. Qu’est-ce qu’ils y entendront ? Des professeurs qui, suivant les principes d’une législation considérée comme la raison écrite, apprennent à leurs élèves que les hommes se divisent en deux classes ; que les uns sont des personnes, et que les autres sont des choses; que les hommes, qui sont des personnes, jouissent de toutes les garanties légales ; mais que les hommes qui sont des choses, n’ont ni droits ni volontés ; que ces hommes-choses, capables de créer des richesses par leurs travaux, sont incapables de rien faire pour eux-mêmes, de rien acquérir, de rien posséder ; qu’ils peuvent s’unir passagèrement à une femelle de leur espèce, mais qu’ils ne peuvent pas former cette union durable et permanente que nous désignons sous le nom de mariage ; que parmi eux l’union des sexes ne peut produire aucun devoir réciproque ; qu’ils peuvent engendrer des enfants, mais qu’ils ne peuvent avoir sur eux aucune autorité ou aucune puissance ; qu’ils ne sont tenus, à leur égard, à aucun devoir, et que, de leur côté, ils ne peuvent rien en exiger ; qu’ils sont incapables de contracter aucune obligation, mais qu’ils ont néanmoins une multitude de devoirs à remplir envers les hommes qui sont des personnes ; qu’en leur qualité de choses, ils sont incapables de rendre témoignage, mais qu’on peut, en leur qualité d’hommes, les appliquer à la torture pour leur arracher la vérité sur des faits qui leur sont étrangers ; que, sensibles en leur qualité d’hommes, ils doivent se montrer insensibles en leur qualité de choses, et que de leur part tout acte de défense ou de conservation, à l’égard de leurs possesseurs, est un crime.
Et qu’on ne pense pas qu’en exposant à leurs élèves ces phénomènes de l’état social des peuples barbares, nos savants professeurs les leur présentent comme des faits dont il est bon d’étudier la nature, les causes et les conséquences. Non, pour eux, ce sont des droits ou des principes de législation ; à leurs yeux, l’asservissement des neuf dixièmes de la population, aux caprices et aux passions d’un petit nombre d’individus, est une manière d’être aussi naturelle qu’une autre. On parcourrait vainement tous leurs livres de jurisprudence, et les ouvrages élémentaires dans lesquels ils en ont exposé les principes, qu’on n’y trouverait pas une seule réflexion, ni sur les causes, ni sur les effets de la servitude, pas un seul rapprochement entre les faits qu’ils décrivent, tels que la force et la stupidité les avaient établis, et les phénomènes qui furent les résultats de ces faits. Les jeunes gens auxquels on apprend à diviser ainsi les hommes en choses et en personnes, sont particulièrement ceux qui se destinent à l’administration de la justice, ou à remplir d’autres fonctions du gouvernement ; et il n’est pas rare de les voir appliquer plus tard, sous des dénominations différentes, les doctrines qu’ils ont puisées dans la raison écrite.
Si l’on passe des phénomènes qui sont enseignés dans les écoles, sous le nom de doctrines, à ceux qui sont défendus hautement dans les assemblées législatives, on ne trouvera entre les uns et les autres qu’une différence de mots : au lieu de diviser les hommes en personnes et en choses, on les divise en propriétaires et en propriétés. Les hommes qui sont des propriétaires, doivent jouir de toutes les garanties légales ; les hommes qui sont des propriétés, doivent être traités comme des meubles que l’on conserve, que l’on use ou que l’on brise arbitrairement. Cette distinction entre les êtres humains qui sont des personnes ou des propriétaires, et les êtres humains qui sont des choses ou des propriétés, n’est pas professée seulement en théorie ; elle est écrite dans la législation, et reconnue par les gouvernements des peuples qui sont les plus éclairés, comme ceux de la France, de l’Angleterre, des Pays-Bas, et même des États-Unis d’Amérique. Les Anglais possèdent dans leurs colonies environ 800 000 de ces propriétés qui sont des hommes ; les citoyens des États-Unis en possèdent un peu plus d’un million ; les Français, les Hollandais et les Espagnols en possèdent un nombre un peu moins considérable, et ce n’est pas leur faute s’ils n’en possèdent pas davantage. À la vérité, tous les individus qui sont propriétaires ne possèdent pas de ce genre de propriétés ; mais tous, sans exception, paient des impôts considérables pour conserver à ceux d’entre eux qui en possèdent, la faculté d’en disposer de la manière la plus absolue.
Ce qu’il y a de plus singulier, c’est que les mêmes hommes qui seraient disposés à se révolter contre leur gouvernement, s’il exigeait d’eux arbitrairement une portion de leurs revenus ou une partie de leur temps, se révolteraient également contre lui, s’il voulait garantir aux hommes mis au rang des propriétés, une partie de leur temps ou des produits de leurs travaux. Ravir aux premiers une portion de leur fortune, les enfermer de force pendant quelques heures dans tel ou tel lieu ; leur infliger, sans jugement légal, la peine la plus légère, ce sont des offenses contre les mœurs, contre les lois, contre la religion, contre la nature humaine ; mais ce sont des attentats également graves que de ne pas souffrir que les seconds soient dépouillés, enchaînés, emprisonnés, torturés, mis à mort, sans examen ni jugements. Porter atteinte à la puissance qui garantit à ceux-là la sûreté de leurs biens et de leurs personnes, est un acte de tyrannie qui justifie la révolte, et mérite le dernier supplice ; mais attenter à la force qui soumet les seconds à des spoliations et à des violences continuelles, est un acte non moins criminel. Les premiers, en s’appropriant régulièrement tous les produits des travaux des seconds, font des actes justes et légitimes ; mais les seconds qui tentent de reprendre une petite partie des fruits de leur travail, qu’on leur a ravis, commettent une spoliation, un vol qui mérite d’être puni de châtiments arbitraires.
Et qu’on ne s’imagine pas qu’en rapportant ces preuves irrécusables des immenses progrès que les peuples ont faits dans les sciences morales, je vais les prendre chez les nations les plus ignorantes, ou dans les temps les plus barbares. Je les prends, au contraire, chez un des peuples les plus éclairés, et à une époque qui n’est pas éloignée de nous : c’est dans les débats qui ont eu lieu il y a moins d’une année, en Angleterre, au sein même du parlement, ou dans les écrits qui ont été publiés vers la même époque, par les planteurs anglais ou par leurs amis. Il est même remarquable que la société formée pour la mitigation et pour l’abolition graduelles de l’esclavage, n’a pas cru prudent de demander la cessation immédiate de cette distinction entre les hommes qui se disent des propriétaires et ceux qui sont dits des propriétés. Cependant, elle a rencontré une opposition très vive ; ses adversaires ont considéré ses tentatives de faire accorder quelque protection légale à 800 000 êtres humains, comme des atteintes à la justice. On est allé bien plus loin dans les colonies : là, les possesseurs d’hommes ont considéré comme une tyrannie insupportable, tout obstacle apporté à la violence et à la cruauté ; ils ont vu dans les hommes qui ont voulu faire étendre sur tous les garanties légales, des provocations au meurtre et au brigandage ; ils ont traité de spoliation la nécessité dans laquelle on a voulu les mettre de ne pas ravir à la partie la plus nombreuse de la population tous les produits de ses travaux. On n’est pas plus avancé dans les autres États de l’Europe, qu’on ne l’est dans l’empire britannique ; on peut même dire qu’on l’est beaucoup moins ; car personne n’y songe à effacer de la législation la distinction entre les hommes qui sont mis au rang des choses, et les hommes qui sont des personnes. Le métier d’enlever, d’acheter ou de vendre des hommes est, sinon protégé, au moins faiblement poursuivi : il y aurait moins de danger à introduire et à vendre, dans telle colonie européenne, une cargaison d’hommes, de femmes et d’enfants dont on se serait rendu maître par la violence, qu’à y introduire et à y vendre certaines marchandises qu’on aurait légitimement acquises du propriétaire [1].
[IV-13]
Si l’on passe des maximes et des pratiques des nations qui se disent les plus civilisées, aux maximes et aux pratiques des nations qui le sont moins, on y trouvera l’esclavage bien plus étendu encore. Dans la législation de l’empire russe, comme dans notre législation coloniale, la population se divise entre des hommes qui sont des personnes, et des hommes qui sont des choses ; et le nombre des seconds est infiniment plus grand que le nombre des premiers. Il en est de même en Pologne et dans presque tout le nord de l’Allemagne. Pense-t-on qu’un homme qui, dans ces pays, s’aviserait d’attaquer cette classification, et de prouver que si, par leur propre nature, ils ne sont pas tous des personnes, ils doivent tous être mis au nombre des choses, n’avancerait que des propositions évidentes aux yeux de tous ? Croit-on qu’en y exposant tous les résultats que produit l’esclavage, il ne ferait que reproduire des observations que chacun a déjà faites ?
L’esclavage est une manière d’être fort ancienne parmi les hommes ; mais c’est se tromper étrangement que de s’imaginer qu’une chose est connue par la raison qu’elle est ancienne, et qu’on en parle depuis longtemps : la plupart des sciences ne datent que de nos jours, et les choses qui en sont l’objet sont aussi vieilles que le monde. La servitude personnelle a paru un état si naturel aux philosophes de l’antiquité, qu’ils semblent tous avoir pensé que le genre humain ne pouvait pas exister autrement ; ceux même qui ont exposé avec le plus de talent les effets du despotisme, n’ont pas paru se douter qu’il existât quelque analogie entre cet état et les relations qui existent entre un maître et ses esclaves. Les jurisconsultes modernes, qui convertissent en principes de droit les phénomènes décrits par les jurisconsultes romains, n’ont pas même songé à exposer les conséquences de l’esclavage ; et si quelques philosophes du dernier siècle en ont fait le sujet de leurs déclamations, d’autres ont paru le considérer comme une condition nécessaire de tout état social régulier [2].
Puisque l’esclavage existe encore dans un grand nombre d’États, et que dans tous on rencontre un nombre considérable de personnes qui le défendent ou qui l’attaquent, il faut bien que les phénomènes qui en résultent, ne soient pas évidents pour tout le monde ; s’ils l’étaient, on ne disputerait plus. L’intérêt qu’on croit avoir à le défendre ou à l’attaquer ne suffirait pas pour le mettre en discussion ; car, lorsque des faits deviennent évidents ils cessent par cela même d’être un objet de controverse, quels qu’en soient les résultats. Il suffit d’ailleurs que l’esclavage existe encore chez un grand nombre de nations, pour qu’elles soient toutes intéressées à connaître les effets qu’il produit. À toutes les époques, les peuples ont exercé les uns sur les autres une influence très étendue, et la nature de cette influence a toujours dépendu des mœurs, de l’intelligence, des richesses et du gouvernement de la nation qui l’a exercée ; mais, comme l’esclavage influe lui-même d’une manière puissante sur les mœurs, l’intelligence, les richesses et le gouvernement des nations chez lesquelles il est établi, il s’ensuit que les peuples qui le repoussent de leur sein, en seront affectés aussi longtemps qu’il existera chez d’autres peuples.
Enfin, l’esclavage n’est pas un état tellement déterminé qu’on ne puisse le modifier sans le détruire : depuis le point où un homme ne jouit d’aucune liberté, jusqu’au point où il est parfaitement libre, il est une multitude de degrés intermédiaires. Un peuple ne passe presque jamais de l’un à l’autre, d’une manière rapide ; ce mouvement, tantôt progressif et tantôt rétrograde, paraît même si naturel aux hommes, qu’il semble avoir été éprouvé par toutes les nations du globe ; lorsqu’il n’est pas très rapide, les peuples l’éprouvent souvent sans s’en apercevoir. Le meilleur moyen de juger, à chaque époque, le degré de liberté dont on jouit, c’est d’exposer nettement chacun des éléments dont se forme la servitude la plus complète, et de voir ensuite quels sont ceux de ces éléments qui existent ou qui ont été détruits. En procédant ainsi, tel peuple qui se croit libre, pourrait bien s’apercevoir qu’il a peu de chemin à faire pour être complètement esclave.
On ne doit jamais perdre de vue qu’en écrivant cet ouvrage, je ne m’occupe que des masses, et que je n’ai pas à exposer les faits qui ne sont que des exceptions individuelles aux faits généraux que je décris. En parlant des effets que l’esclavage produit sur les facultés physiques, intellectuelles et morales des diverses classes de la population, je n’ai donc point à parler des maîtres ou des esclaves qui, par des circonstances particulières et accidentelles, auront échappé à ces effets. Il est sans doute possible de rencontrer un esclave adroit ou d’une constitution vigoureuse, sans qu’on puisse tirer de ce fait la conséquence que l’esclavage a pour résultat de développer l’industrie ou de fortifier les organes physiques de la population asservie. On peut rencontrer aussi, dans un pays d’esclaves, un petit nombre de maîtres éclairés, sans qu’on puisse en conclure que la possession d’un pouvoir arbitraire sur une partie de l’espèce, est favorable au développement des facultés intellectuelles. Enfin, on peut rencontrer, soit parmi les esclaves, soit parmi les maîtres, un homme qui ait des mœurs pures ou même sévères, sans qu’il en résulte que l’esclavage est favorable aux bonnes mœurs.
[IV-18]
CHAPITRE II. ↩
Nature des divers genres d’esclavage domestique.
J’ai exposé précédemment quelles sont les circonstances sous lesquelles certaines facultés de l’homme se développent de préférence à d’autres ; j’ai fait voir que la plupart des causes qui contribuent à maintenir un peuple dans la barbarie, tendent à lui donner toutes les qualités et tous les vices qui sont propres à faire de lui un peuple conquérant ; j’ai fait voir aussi que les mêmes causes qui déterminent un peuple à adopter la vie agricole, ou à exercer d’autres arts paisibles, lui font négliger d’abord l’exercice des facultés qui lui seraient nécessaires pour sa défense : de là, j’ai tiré la conséquence que l’esclavage, et les vices et les préjugés qui en sont inséparables, ont dû être et ont été réellement portés des pays âpres et froids, vers ceux qui, par leur température, sont les plus propres à la culture.
Mais il ne faut pas perdre de vue que cette action des peuples les uns sur les autres, résulte d’une différence d’exercices, de développements et de besoins, et qu’il n’est pas le produit immédiat et nécessaire d’une différence dans la température de l’atmosphère, comme l’ont pensé plusieurs philosophes. Si, lorsqu’un peuple de barbares a envahi le territoire d’un peuple civilisé, et qu’il en a réduit les habitants en servitude, il conserve ses préjugés et ses habitudes ; s’il continue à se livrer aux exercices qui ont fait de lui un peuple conquérant, il est clair qu’il restera propre à la vie militaire et qu’il en aura toutes les passions, quoique placé sur le sol le plus favorable à l’agriculture ou à d’autres genres d’industrie. C’est même ce qui est arrivé dans tous les pays plus ou moins civilisés, lorsqu’ils ont été soumis par des peuples barbares. Pour maintenir leur empire, les individus de la caste conquérante et ceux qui se sont affiliés à eux, ont conservé ou acquis toutes les qualités et tous les vices développés sous d’autres climats. On a pu voir alors des armées conquérantes sortir des pays les plus favorables à la civilisation, et se porter sur des populations moins heureusement situées, pour les asservir à leur tour. En pareil cas, ce ne sont pas les vices des pays propres à la civilisation qui agissent sur les peuples situés dans des contrées moins favorables ; ce sont les vices et les préjugés de la barbarie qui réagissent sur les peuples au milieu desquels ils ont pris naissance, ou sur des peuples placés dans une position analogue.
Il ne peut pas être question d’exposer ici toutes les circonstances particulières qui, dans chaque pays, ont concouru à l’établissement de l’esclavage ; il suffit que j’aie exposé les causes générales qui ont mis les nations en guerre, et qui ont assuré le triomphe des unes sur les autres. Il ne s’agit maintenant que d’examiner ce qui constitue l’esclavage, et d’exposer les effets généraux que cet état a produits dans les lieux où il a été établi. Pour connaître ces effets dans toute leur étendue, il faut les chercher dans les facultés physiques, intellectuelles et morales des diverses classes de personnes qui en éprouvent les effets immédiats ; dans l’accroissement ou le décroissement de chacune des classes de la population ; dans les principes moraux ou religieux des maîtres et des esclaves ; dans la formation, la distribution et la consommation des richesses nationales ; dans l’industrie et le commerce des nations qui possèdent des colonies exploitées par des esclaves ; dans les progrès ou dans l’état stationnaire des peuples étrangers ; dans la nature des gouvernements, et enfin dans les relations mutuelles des nations.
L’esclavage, n’étant pas un état tellement déterminé qu’il ne soit susceptible de plus et de moins, n’a pas eu les mêmes caractères dans tous les temps et chez tous les peuples ; et les effets qu’il a produits ont été plus ou moins étendus, selon qu’il a eu plus ou moins d’intensité. On pourrait en diviser l’histoire en trois grandes périodes ; la première est celle qui a eu lieu depuis les temps les plus anciens qui nous sont connus, jusqu’à la chute de l’empire romain ; la seconde est celle du régime féodal ; la troisième celle de l’établissement des colonies européennes en Amérique ou dans quelques autres parties du monde, depuis le seizième siècle jusqu’à nos jours. Ces périodes ne sont pas aussi distinctes dans l’histoire, qu’elles le sont ici ; les Romains, dans les derniers temps de l’empire, avaient des esclaves qui ressemblaient beaucoup à ceux de la glèbe ; et, après l’invasion des barbares, il a continué d’exister un genre d’esclavage qui différait peu de celui qui existait du temps de la république ; mais, comme je me propose moins de faire l’histoire de la servitude que d’en exposer les effets, je n’ai pas besoin ici d’une plus grande précision dans l’ordre des temps.
Durant la première de ces trois époques, l’esclavage a été admis par toutes les nations européennes. Il n’existait aucune distinction d’espèce entre les maîtres et les esclaves. Les hommes asservis étaient employés à toute sorte d’occupations ; il n’y avait d’exception que pour les fonctions publiques et pour le service militaire. Il résultait de là que l’action exercée par les peuples les uns à l’égard des autres, n’avait jamais pour but de mettre des bornes au pouvoir des maîtres sur leurs esclaves. Il n’arrivait même que très rarement qu’un peuple, après la victoire, songeât à revendiquer les prisonniers qu’on avait faits sur lui. Dans l’alternative d’abandonner ceux de ses concitoyens qui n’avaient pas le moyen de se racheter, ou de s’exposer à rendre les hommes qu’on possédait à titre de propriétaire, on prenait le parti qui semblait le plus lucratif. La restitution d’une armée de prisonniers, pour la nation qui l’aurait obtenue, n’aurait, en général, profité qu’aux classes pauvres d’où sortaient les soldats ; mais la restitution d’une multitude d’esclaves, pour le peuple qui l’aurait faite, aurait pesé particulièrement sur la classe aristocratique. Les patriciens romains qui, pour prendre les habitants d’une ville et les transformer en esclaves, perdaient un certain nombre de soldats, ne voyaient dans cette opération qu’une bonne affaire. C’était un échange dans lequel tout était gain pour l’aristocratie ; car un bon esclave étranger valait mieux pour elle que deux prolétaires nationaux : c’est sur cet intérêt que la législation était calculée [3].
Par les mêmes raisons qu’un peuple n’agissait jamais sur un autre pour mettre des bornes au pouvoir des maîtres sur leurs esclaves, une classe de la société n’agissait jamais sur les autres dans un but semblable. Les hommes les plus influents étaient ceux qui possédaient le plus grand nombre d’esclaves ; et leur autorité, comme membres du gouvernement, ne tendait qu’à étendre ou à garantir le pouvoir qu’ils possédaient en qualité de maîtres ou de propriétaires. Si la religion intervenait quelquefois dans les affaires de l’État ou dans les guerres étrangères, c’était toujours pour seconder le pouvoir de l’aristocratie, ou pour partager le butin fait par les conquérants. Les prêtres d’Apollon présageaient la victoire à tous ceux qui invoquaient leur dieu, pourvu qu’on leur promît la dîme des dépouilles ; et loin de réclamer la liberté des captifs ou des captives, ils exigeaient que leur part leur fût délivrée en nature, quand ils étaient jeunes [4].
L’esclavage, pendant la seconde époque, a été également admis par toutes les nations de l’Europe ; mais il a eu cependant alors un caractère particulier ; les esclaves ont été généralement attachés à l’agriculture, et ont été considérés comme faisant partie du sol qu’ils cultivaient. Les autres genres d’industrie n’ayant fait que très peu de progrès, les possesseurs d’hommes ne pouvaient se procurer que très difficilement un petit nombre d’objets de luxe. Ils étaient, par conséquent, obligés de consommer eux-mêmes immédiatement et sans échange la plus grande partie des revenus qu’ils retiraient des terres qu’ils avaient envahies ; et, comme il est impossible qu’un individu consomme, en pareil cas, le fruit des travaux de cent, les hommes possédés étaient soumis à des travaux moins rudes ou avaient à consommer une part plus grande dans les produits. L’autorité qui unissait les maîtres étant d’ailleurs très faible, celui d’entre eux qui aurait traité trop durement ses esclaves, aurait pu les voir déserter de ses domaines pour se livrer à un autre maître [5]. Enfin, le chef commun des maîtres les trouvait souvent disposés à lui résister, et, pour les assujettir, il cherchait un point d’appui chez leurs esclaves : ceux-ci profitaient donc des pertes que ceux-là éprouvaient dans leur indépendance. Ces causes et quelques autres qu’il est inutile de rapporter, contribuèrent à rendre l’esclavage moins dur à la seconde époque qu’il ne l’avait été à la première. Les esclaves qui sont encore attachés à la glèbe dans plusieurs parties de l’Europe, sont infiniment moins misérables que ne l’étaient ceux qui existaient avant la chute de l’empire romain.
À la troisième époque, l’esclavage domestique s’est montré sous un nouvel aspect. Les esclaves n’ont plus appartenu à la même espèce ou à la même race que les maîtres ; ils ont différé d’eux par la couleur, par les traits, par la religion, par le langage. Les hommes asservis ont été portés sur des îles ou sur des portions de continent dans lesquelles la servitude a été circonscrite ; ils ont été généralement voués à une branche spéciale de travaux agricoles. Les produits obtenus par eux ne pouvant être consommés sur les lieux, mais étant destinés à être livrés au commerce, et un individu ayant acquis la puissance de consommer d’immenses richesses, au moyen des progrès qu’ont faits les arts, on a exigé d’eux des travaux excessifs, et on ne leur a laissé que ce qui a été rigoureusement nécessaire pour les faire vivre. Mais, d’un autre côté, les possesseurs d’hommes n’ont pas été absolument maîtres chez eux : soumis à des gouvernements ou à des nations qui n’ont pas admis la servitude domestique sur leur propre territoire, ils ont été entravés dans l’exercice de leur puissance. Les hommes qui n’ont pas été appelés à prendre part aux bénéfices de la servitude, se sont alors plus ou moins prononcés, ainsi que cela arrive toujours, en faveur des opprimés contre les oppresseurs. Enfin, parmi les sectes entre lesquelles le christianisme s’est divisé, les plus morales ont énergiquement demandé l’abolition de l’esclavage, et quelquefois elles ont fortifié leurs préceptes par leurs exemples [6].
Ainsi, quoique les résultats généraux de la domination et de la servitude aient été à peu près les mêmes dans tous les temps, on conçoit que ces résultats ont dû être modifiés par les circonstances que je viens de faire observer, ou par d’autres analogues. Il était nécessaire de les indiquer, avant que d’aller plus loin, afin de mieux voir les relations qui existent entre les effets et les causes.
Selon les usages des Romains, les hommes tombaient dans l’esclavage de plusieurs manières. Tous les soldats pris les armes à la main, toutes les personnes trouvées dans une ville emportée d’assaut étaient esclaves des vainqueurs. Ces esclaves de tous les âges, de tous les sexes, de tous les rangs, étaient vendus à l’enchère au profit de la république. Quelquefois, ils étaient vendus en détail ; d’autres fois ils étaient vendus en gros à des marchands qui suivaient les armées, et qui allaient les revendre dans les foires ou marchés [7]. Des enfants romains devenaient esclaves, s’ils étaient vendus par leurs pères ; des débiteurs, s’ils étaient livrés comme tels à leurs créanciers. Un père pouvait vendre ses enfants quoiqu’ils fussent mariés ; il pouvait vendre aussi ses petits-enfants. La vente d’un citoyen par un autre, même du consentement de celui-ci, fut d’abord déclarée illégale ; mais, comme il arriva que des individus se laissèrent vendre pour réclamer leur liberté après avoir profité du prix pour lequel ils avaient été vendus, et comme ces ventes frauduleuses nuisaient à la prospérité du commerce de la république, on finit par les déclarer valables. Les hommes condamnés pour crimes étaient quelquefois réduits en servitude, et devenaient une propriété publique ; enfin, tout enfant né d’une femme esclave était esclave.
Il existait à Rome un marché toujours ouvert dans lequel étaient exposés en vente des hommes, des femmes, des enfants. Ce marché était abondamment fourni par les citoyens qui spéculaient sur ce genre de marchandise, et surtout par les illustres patriciens qui étaient mis à la tête des armées. Un consul qui parvenait à se rendre maître d’une ville industrieuse, et qui, après avoir fait égorger presque tous les hommes en état de porter les armes, conduisait en triomphe au marché quarante ou cinquante mille individus de tout sexe et de tout âge, produisait une admiration qui dure encore. On voyait régner dans ces marchés, la bonne foi, la loyauté et toutes les vertus romaines : afin de ne pas tromper les acheteurs, les marchands mettaient à nu leurs marchandises ; la mère de famille et la jeune fille étaient, aussi bien que les hommes, dépouillées de leurs vêtements, exposées publiquement aux regards des curieux, et soumises à tous les examens propres à prévenir les fraudes. C’est au milieu de ce marché que le jeune homme à grande fortune et le vieux soldat que la guerre avait enrichi, allaient acheter les femmes dont ils avaient besoin ; c’est là aussi que les respectables matrones allaient choisir les jeunes hommes nécessaires au service de leur maison.
Afin de donner aux vendeurs et aux acheteurs toutes les facilités possibles et d’augmenter ainsi la prospérité du commerce, on n’avait aucun égard aux liens de famille qui pouvaient exister entre les individus exposés en vente. Lorsque après la prise d’une ville industrieuse, la population était mise en détail aux enchères, le mari était vendu à un individu, la femme à un autre, la fille à un troisième, et ainsi du reste de la famille, selon que les goûts ou les caprices des enchérisseurs en décidaient. La même liberté régnait dans les ventes privées que dans les ventes publiques : le citoyen qui possédait plusieurs couples d’êtres humains, pouvait vendre les enfants et garder la mère, ou vendre la mère et garder les enfants, selon que ses intérêts le demandaient. Quant au père, on ne se donnait même pas la peine de savoir s’il existait, ou qui il était : l’enfant qui naissait d’une femme mise au rang des choses, n’était lui-même qu’une chose, fût-il le fils d’un sénateur ou d’un consul.
Les Romains étant un peuple fort jaloux de leur liberté, et leurs premiers législateurs leur ayant inspiré pour la propriété un respect religieux, aucune force ne protégeait les hommes ou les femmes qui étaient des choses, contre les violences des hommes ou des femmes qui étaient des personnes ; une force qui eût protégé les premiers contre les seconds, eût été une atteinte à la propriété. Si les individus, hommes ou femmes, qui appartenaient à un citoyen romain, se montraient rebelles à ses désirs quels qu’ils fussent, le magistrat de la république arrivait avec une force suffisante pour soumettre cette propriété révoltée, et veillait ainsi au maintien du bon ordre et des bonnes mœurs [8].
Un individu qui, suivant les mœurs romaines, était placé au rang des choses, n’avait donc aucune propriété, pas même celle de la plus petite partie de sa personne. Il n’avait que l’industrie qu’il plaisait à son maître de lui faire exercer ; les produits de son travail lui étaient constamment ravis par l’homme qui le possédait. Il n’avait d’aliments, de vêtements, de logement que ceux que son maître lui accordait. Il n’existait pour lui aucun lien de famille : il ne pouvait rien ni pour la femme à laquelle il s’unissait, ni pour les enfants auxquels il avait donné le jour ; il ne pouvait ni les protéger contre l’insulte, ni leur accorder le moindre secours dans leurs besoins ; il ne pouvait rien exiger de sa femme, pas même la fidélité ; il ne pouvait rien exiger de ses enfants, pas même la déférence ; de son côté, la femme ne pouvait rien exiger de son mari, pas même une simple protection ; elle ne pouvait rien lui devoir, pas même la chasteté [9].
L’esclavage de la glèbe qui a existé chez toutes les nations de l’Europe, et qui est encore l’état d’une partie considérable des nations du nord, est moins dur sous beaucoup de rapports que l’esclavage usité chez les Romains. Les esclaves sont en quelque sorte considérés comme faisant partie du sol, et passent d’un maître à l’autre avec la terre sur laquelle ils se trouvent. Ils ne sont donc point vendus en détail au marché, et par conséquent les liens de famille ne sont pas brisés parmi eux, comme ils l’étaient parmi les esclaves romains. Les produits qui résultent de leurs travaux pouvant difficilement être transportés au loin, étant de peu de valeur comparativement à leur volume, il en reste aux cultivateurs une part plus ou moins considérable.
L’esclavage introduit dans les colonies d’Amérique ressemble, sous plusieurs rapports, à celui qui existait chez les Romains ; mais il en diffère sous trois points remarquables : les esclaves et les maîtres appartiennent à des espèces différentes ; les produits obtenus par les travaux des esclaves sont généralement destinés à l’exportation, et par conséquent la population asservie est réduite à ce qui lui est rigoureusement nécessaire pour vivre ; enfin, les maîtres sont placés sous l’influence de nations qui n’admettent point l’esclavage sur leur territoire, et ne peuvent par conséquent se livrer sans réserve à leurs inclinations naturelles. On verra, plus loin, comment ces diverses circonstances concourent à modifier l’existence des diverses classes de la population.
[IV-33]
CHAPITRE III. ↩
De l’influence de l’esclavage sur la constitution physique et sur les facultés industrielles des maîtres et des esclaves.
Pour juger des effets que produit l’esclavage sur les diverses classes de la population, il est nécessaire, avons-nous dit, de considérer les hommes dans leurs facultés physiques, intellectuelles et morales ; mais il faut, de plus, se rappeler les diverses espèces de perfectionnement ou de dégradation dont ces facultés sont susceptibles.
Le perfectionnement de nos organes physiques s’entend de deux manières, ainsi qu’on l’a vu précédemment : dans un sens, il se prend pour la bonne constitution de chacun de ces organes ; dans l’autre, pour l’aptitude que l’exercice leur a donnée de remplir les diverses fonctions qu’exige le bien-être de l’individu, de sa famille et même de son espèce.
L’esclavage n’est pas toujours un obstacle au premier genre de perfectionnement physique chez les individus qui appartiennent à la race des maîtres ; il n’a pas nécessairement pour effet d’empêcher les individus de cette race d’avoir des aliments sains et abondants, de leur faire respirer un air insalubre, ou même de leur interdire les exercices qui sont les plus propres à développer leurs forces physiques et un certain genre d’adresse. Des barbares qui, après avoir réduit en servitude un nombre considérable d’hommes industrieux, trouvent dans la domination le moyen de vivre dans l’abondance, peuvent continuer à se livrer aux exercices qui les ont rendus vainqueurs. Après avoir été chasseurs et guerriers par besoin, ils peuvent rester tels par plaisir, par habitude, par préjugé, et surtout par politique ; c’est le moyen le plus sûr, non seulement de faire de nouveaux esclaves et de rétablir leurs fortunes par le pillage, mais encore d’assurer leur domination sur les premiers hommes qu’on a asservis.
Chez les anciens, comme chez les modernes, nous voyons tous les peuples, qui avaient fondé leur existence sur l’asservissement d’une partie de leur espèce, faire de la chasse, de l’exercice des armes et des jeux gymnastiques, les privilèges des maîtres. On sait à quels exercices se livrèrent les peuples de la Grèce, aussi longtemps qu’ils conservèrent leur indépendance. Les Romains, tant qu’il exista à leur connaissance des hommes industrieux et libres à réduire en servitude, ne discontinuèrent pas de s’exercer à manier des armes, à traverser des fleuves à la nage, à faire de longues courses chargés d’un lourd bagage, à donner à leur voix le son le plus propre à inspirer la terreur à leurs ennemis : quelquefois ils poursuivaient le cours de ces exercices jusque dans la vieillesse la plus avancée [10]. Nous voyons également, dans les divers États de l’Europe, après l’invasion des barbares, les exercices propres à développer un certain genre de forces musculaires, tels que la chasse, l’escrime, les tournois, rester au nombre des privilèges des nouveaux dominateurs [11]. Enfin, dans les îles du grand Océan, où une partie de la population vit aux dépens de l’autre, les individus de la race des maîtres se livrent tous à des exercices gymnastiques et à l’usage des armes. L’esclavage, loin d’être une cause de dégradation des organes physiques chez la classe des dominateurs, a contribué au contraire à renforcer leur constitution ; il leur a fourni des aliments en abondance, il les a dispensés des travaux qui auraient pu vicier leurs organes, et leur a donné le moyen, ou même leur a imposé la nécessité de se livrer aux exercices les plus favorables à leur développement.
[IV-36]
Une autre cause a contribué, dans presque tous les pays, au perfectionnement physique des maîtres ; c’est la faculté de s’emparer des plus belles femmes qui se rencontraient parmi les esclaves. Cet usage, pratiqué pendant des siècles, a dû finir par établir une différence sensible entre les deux classes de la population ; car la même cause qui contribue à perfectionner l’une, a nécessairement pour effet de produire la dégradation de l’autre.
Cette faculté de s’emparer des femmes les plus belles, a produit, pour la classe des dominateurs, des effets moins étendus dans les pays où l’orgueil aristocratique a interdit toute union légitime entre un maître et son esclave ; mais, dans les pays où un tel orgueil n’a point existé, l’exercice de cette faculté, pendant quelques siècles, a suffi, en quelque sorte, pour changer l’espèce : c’est ce qu’on observe particulièrement chez les Persans et chez les Turcs, et peut-être est-ce à une pareille faculté qu’il faut attribuer, au moins en partie, la beauté des formes grecques [12].
[IV-37]
Si nous jugions de la constitution physique des hommes de l’antiquité, qui appartenaient à la classe des maîtres, par celles de leurs statues qui sont arrivées jusqu’à nous, ou par ce que nous ont raconté de leurs forces quelques-uns de leurs historiens, nous nous ferions peut-être des idées exagérées de la bonté de leur constitution physique ; car il est probable que les statuaires d’alors, comme ceux d’aujourd’hui, ne prenaient pour modèles que les hommes qui étaient les plus remarquables par la régularité et la beauté de leurs formes ; cependant, lorsqu’on fait attention, d’un côté, à toutes les circonstances qui concouraient à leur développement, et qu’on se rappelle, d’un autre côté, les descriptions que nous donnent des voyageurs modernes de quelques peuples situés dans des circonstances analogues, il est difficile de ne pas croire que ces peuples jouissaient d’une excellente organisation physique.
Mais les mêmes circonstances qui concouraient à donner aux maîtres une bonne organisation, concouraient à vicier l’organisation des esclaves ; ceux-ci n’avaient d’aliments, de vêtements, d’habitations qu’autant qu’il plaisait aux maîtres de leur en laisser [13]. Tout exercice qui aurait pu leur donner de la force, de l’adresse et du courage, leur était interdit comme étant dangereux pour leurs possesseurs [14]. Le petit nombre d’opérations mécaniques auxquelles ils étaient obligés de se livrer, dans l’intérêt de leurs maîtres, ne pouvaient développer que quelques-uns de leurs organes. Ce développement ne pouvait même être que très restreint, parce qu’un exercice forcé, excessif et accompagné de privation d’aliments, est une cause de faiblesse bien plus qu’une cause de force. Qu’on ajoute à ces considérations que les hommes asservis ne pouvaient avoir pour compagnes que les femmes les moins belles, les autres devenant les concubines des maîtres, et l’on concevra aisément comment la partie asservie du genre humain a dû tous les jours se dégrader davantage. Nous possédons peu de documents propres à nous faire connaître quelle fut, chez les peuples de l’antiquité, la constitution physique des esclaves ; mais on peut croire, sans craindre de se tromper, que ce ne fut pas parmi les Ilotes que Phydias alla chercher ses modèles [15].
[IV-39]
Il serait difficile de juger des effets que peut produire un long esclavage sur la constitution physique des esclaves dans les colonies européennes. L’excès des travaux auxquels ils sont soumis, les mauvais traitements dont on les accable, et le défaut d’aliments sains et abondants, ne leur ont jamais permis de s’y perpétuer au-delà d’un petit nombre de générations. Il a fallu, pour que l’espèce ne s’éteignît pas, qu’elle fût constamment renouvelée par des hommes libres importés des côtes d’Afrique. Suivant un historien, le nombre des esclaves, dans les colonies françaises, décroissait d’un quinzième toutes les années ; et cependant ces esclaves étaient traités moins durement que ceux des colons anglais et hollandais [16].
Le perfectionnement physique qui consiste dans l’art d’employer nos organes, et qui est le résultat de l’exercice, a des rapports si intimes avec le développement intellectuel et le perfectionnement moral, qu’il est difficile d’exposer la manière dont le premier est affecté par l’esclavage, avant que d’avoir exposé les effets que la même cause produit sur les idées et sur les mœurs. Cependant, comme chacune des parties de l’homme réagissent sur les autres, et comme il est impossible de faire connaître tous les phénomènes en même temps, il faut bien les exposer les uns après les autres, en commençant par ceux qui sont les plus évidents.
On a vu précédemment que le genre de perfectionnement que l’exercice donne à nos organes physiques, s’évalue par les avantages qui en résultent pour l’individu, pour sa famille, pour sa nation, et enfin pour le genre humain. On ne peut procéder, dans l’appréciation de ce perfectionnement, autrement qu’on ne procède dans le jugement des actions, des habitudes et des lois humaines [17]. Il me semble évident, par exemple, que l’homme qui, à force d’étude et d’exercice, a donné à ses mains la puissance de fournir à deux individus les choses nécessaires à leur existence, sans nuire à personne, a acquis dans cette partie de lui-même un perfectionnement plus grand que celui qu’a acquis un homme qui ne peut fournir qu’à l’existence d’un seul. Il ne paraît pas moins évident qu’on ne saurait considérer comme un perfectionnement la puissance qu’un individu a donnée à quelques-uns de ses organes, de procurer des moyens d’existence à une famille, s’il ne peut obtenir ce résultat qu’en en faisant périr deux. Pour adopter une opinion contraire, il faudrait faire consister le perfectionnement du genre humain dans sa destruction [18].
Le premier effet que l’esclavage produit, à l’égard des maîtres, est de les dispenser des travaux qui fournissent immédiatement aux hommes des moyens d’existence. Le second est de leur faire voir ces travaux avec mépris : nous trouvons chez les maîtres de toutes les races et de toutes les époques les mêmes sentiments. Dans tous les temps, les possesseurs d’hommes ont considéré comme un acte avilissant l’application de leurs organes à un travail productif. Cette manière de juger s’était si bien établie chez les peuples de la Grèce, que leurs philosophes qui, comme cela arrive presque toujours, n’ont fait que réduire en maximes générales les phénomènes qu’ils ont observés, en ont fait un principe de politique. Dans un État parfaitement gouverné, dit Aristote, les citoyens ne doivent exercer ni les arts mécaniques, ni les professions mercantiles, il ne faut pas même qu’ils soient laboureurs [19]. Si l’on veut que ceux qui doivent cultiver la terre soient tels qu’on peut les souhaiter, il faut essentiellement que ce soient des esclaves, mais non pas de même nation, ni d’un cœur trop élevé [20]. Platon avait les mêmes idées sur tous les travaux industriels ; ils lui inspiraient tant de mépris qu’il s’indignait qu’on eût avili les sciences jusqu’au point de les rendre utiles en les appliquant aux arts [21].
Les Romains, au commencement de leur république, et avant qu’ils eussent acquis par la victoire un nombre suffisant d’esclaves pour faire exécuter les travaux qui étaient nécessaires à leur existence, ne méprisèrent aucune occupation utile. Mais à mesure que leurs esclaves se multiplièrent, ils dédaignèrent eux-mêmes les arts mécaniques, le commerce, et même l’agriculture qu’ils avaient d’abord honorée [22]. Les campagnes qui, dans l’origine, avaient été cultivées par des mains libres, se peuplèrent rapidement d’esclaves, et les citoyens en disparurent [23]. Les hommes même qui tenaient le plus aux anciennes mœurs, comme M. Caton, renoncèrent à la culture des champs [24]. L’abandon de l’agriculture, par les hommes libres, devint si général, que, lorsque Caïus Gracchus traversa la Toscane pour se rendre à Numance,
« il trouva, dit Plutarque, le pays presque désert, et ceux qui y labouraient la terre ou y gardaient les bêtes pour la plupart esclaves barbares, venus de pays étranger [25]. »
Le grand nombre d’esclaves qu’on avait acquis dans les guerres, ayant fait tomber dans leurs mains l’exercice de toutes les professions productives, on établit comme maxime de politique, que ces professions étaient avilissantes, et qu’il était indigne d’un citoyen de les exercer. Nous avons besoin, disait Menenius au sénat, de soldats aguerris, et non pas de laboureurs, de mercenaires, de marchands, ou d’autres gens de cette espèce, accoutumés à exercer des professions viles et méprisables [26]. Le reproche le plus grave qu’Antoine adressait à Octave, n’était pas de s’être rendu coupable d’hypocrisie, de vengeance ou de cruauté ; c’était d’avoir eu, parmi ses ancêtres, un homme qui avait exercé une industrie utile, qui avait été banquier [27]. Les lois suivirent naturellement la marche des mœurs et des idées ; bientôt il cessa d’être permis aux citoyens de se livrer à aucun métier, ou d’exercer aucun commerce. L’on parvint ainsi au dernier degré de perfection qu’avait marqué Aristote [28].
[IV-44]
Il est cependant une industrie que l’esclavage n’avilissait point aux yeux des maîtres ; c’est l’industrie qui consiste à dresser, à louer, à acheter et à vendre des hommes. L’aristocratie romaine, qui aurait cru s’avilir en appliquant ses nobles mains à la culture d’un champ ou à l’exercice d’une profession, ne croyait pas déroger en dressant elle-même ses esclaves à faire les métiers qu’elle jugeait les plus vils, même celui de gladiateurs. Un citoyen qui eût été loueur de chevaux, eût été peut-être noté d’infamie, mais un sénateur ou un consul pouvait être loueur d’hommes sans déroger à sa dignité [29]. Un des ancêtres d’Octave avait, disait-on, déshonoré sa postérité en faisant la banque ; mais M. Caton achetait et vendait des hommes, il vendait particulièrement les vieux, qui ne lui rapportaient que peu de profit et qui pouvaient devenir inutiles, et Caton était le gardien des mœurs [30].
[IV-45]
L’esclave de la glèbe en Europe a produit sur les maîtres, sur leurs descendants et sur ceux qui se sont affiliés à eux, un effet exactement semblable à celui qu’il produisit sur les maîtres grecs et sur les maîtres romains. L’industrie et le commerce ont été jugés avilissants, et tout homme noble qui s’y est livré, a par cela même dérogé ; il a fallu d’abord, pour vivre noblement, tirer immédiatement sa subsistance des travaux de la population asservie. Lorsque la servitude de la glèbe a été abolie, il a fallu tirer sa subsistance de la même source, sous la forme de contributions, à moins qu’on n’ait eu des terres suffisantes. On a considéré comme seules professions nobles, l’état militaire et l’état de fonctionnaire public ; dans l’une comme dans l’autre, quand on ne vit pas de pillage, on vit au moins de contributions, ce qui quelquefois se ressemble fort.
Dans les colonies, les individus même qui sont sortis des derniers rangs de l’ordre social, ont considéré tous les travaux utiles comme avilissants, à l’instant où ils sont devenus possesseurs d’hommes. Au cap de Bonne-Espérance, un paysan ne travaille jamais ; son unique occupation, c’est la chasse [31]. Un soldat qui, après avoir obtenu son congé, se livre à une profession manuelle, cesse de travailler dès qu’il est en état d’acheter un esclave [32]. Non seulement les travaux agricoles et le commerce sont dédaignés par les maîtres et abandonnés aux esclaves, mais les simples artisans n’exercent leur métier que par les mains de leurs noirs [33]. Un manœuvre européen de la race des maîtres, eût-il été flétri comme malfaiteur, s’il devenait possesseur d’un homme, croirait aussitôt qu’il ne peut plus se livrer à un travail productif sans déroger à sa noblesse. Le mépris et l’aversion qu’ont les maîtres, dans cette colonie, pour les travaux utiles, sont tels qu’un homme qui a étudié les mœurs de ce peuple, a pensé que, pour faire faire des progrès au pays, il fallait y appeler des Chinois [34].
Les Hollandais, qui savent si bien apprécier chez eux tous les genres de travaux utiles, se montrent à Batavia, tels qu’ils sont au cap de Bonne-Espérance. À l’instant où ils parviennent à y être des possesseurs d’hommes, ils éprouvent pour toute occupation industrielle un mépris et une aversion insurmontables [35]. Ces sentiments ont sur eux un tel empire que, suivant un voyageur, ils se laisseraient mourir de faim plutôt que de travailler : ce sont des Chinois libres qui exécutent la plupart des travaux nécessaires à leur existence [36]. Dans leurs colonies d’Amérique, aujourd’hui soumises au gouvernement anglais, les Hollandais font faire tous les travaux de la ville et de la campagne par leurs esclaves ; ce sont des esclaves qui ont le soin intérieur de la maison, qui cultivent la terre, qui vont à la chasse et à la pêche, qui exercent les arts de charpentier, de tonnelier, de maçon, et même de chirurgien [37].
L’effet de l’esclavage sur les Anglais a été le même que sur les Hollandais. À Sainte-Hélène, où l’esclavage a été longtemps admis, les hommes de la race des maîtres ne se livrent à aucun travail : l’île est cultivée presque exclusivement par des nègres, affranchis ou descendants d’affranchis [38].
Dans la partie méridionale des États-Unis d’Amérique, un homme cesse de travailler du moment qu’il est possesseur de deux esclaves, car un seul ne suffirait pas pour le faire subsister. Posséder des hommes est l’objet principal de l’ambition de chacun ; il n’y a pas d’autre moyen de vivre noblement et d’être admis parmi les maîtres. Il n’est aucun genre de travail qui ne soit exécuté par des esclaves ; eux seuls sont agriculteurs, charrons, charpentiers, tourneurs, serruriers, fabricants d’étoffes, tailleurs, cordonniers [39]. La crainte qu’ont les maîtres de déroger en travaillant, est telle, suivant M. de Larochefoucault, que, s’il se manifeste un incendie chez eux, c’est à leurs esclaves qu’ils abandonnent le soin de l’éteindre : ils s’aviliraient en se mêlant parmi eux [40]. Là, on mesure la considération par le nombre d’esclaves que chacun possède ; celui qui n’en a que cinquante, a moitié moins de mérite que celui qui en a cent [41]. Quant à celui qui n’en possède point et qui est réduit à vivre du produit de ses propres travaux, il est tellement méprisé et délaissé, qu’il est obligé de quitter le pays et de porter ailleurs son industrie.
Ainsi, quoique l’esclavage ne vicie pas nécessairement les organes physiques des hommes qui appartiennent à la classe des maîtres, il a pour effet d’en rendre l’exercice nul dans tous les genres d’occupation qui sont nécessaires à l’existence des peuples. Ce sont des instruments qui, non seulement sont inutiles au genre humain considéré en masse, mais qui ne servent à l’individu qui en est pourvu, que par le mal qu’ils produisent pour une multitude d’autres. Si, par quelque grande catastrophe, la race des maîtres disparaissait tout à coup d’un pays où l’esclavage est admis, il n’est aucun genre de travail qui demeurât suspendu, aucune richesse dont on eût à déplorer la perte. Les travaux prendraient une direction plus utile aux hommes, les intervalles de repos seraient mieux ménagés : mais le travail gagnerait en énergie et en intelligence beaucoup plus qu’il perdrait en durée.
Les effets que la servitude produit, relativement aux organes physiques des esclaves, sur le genre de perfectionnement qui résulte de l’exercice, sont moins faciles à connaître que ceux que produit la même cause relativement aux organes physiques des maîtres. Les écrivains de l’antiquité nous ont fait connaître les idées et les mœurs des diverses races de dominateurs ; mais ils se sont peu occupés de décrire les idées et les mœurs des populations asservies. Les objets d’art qui nous restent des anciens, ne peuvent nous donner à cet égard que de faibles lumières, soit parce que nous ignorons quelle est la progression que suivit l’esclavage dans chaque État, soit parce que nous ne possédons, en général, que l’histoire des nations conquérantes.
[IV-50]
L’Italie, avant la conquête des Romains, était couverte d’une multitude de nations industrieuses et déjà très avancées dans la civilisation ; mais les historiens de Rome ne nous parlent d’elles que pour nous faire connaître les campagnes que les armées romaines ont ravagées, les villes qu’elles ont détruites, les richesses qu’elles en ont emportées, le nombre des combattants qu’elles ont égorgés, le nombre des personnes libres dont elles ont fait des esclaves. Nous ne connaissons pas beaucoup mieux l’état social de la plupart des autres peuples d’Europe avant leur asservissement.
Nous ignorons ou du moins nous ne connaissons que d’une manière très imparfaite, l’industrie des esclaves romains ; mais quand même nous aurions une connaissance complète de ce qu’elle fut depuis le commencement jusqu’à la fin de la république, elle ne pourrait nous servir à juger des effets que l’esclavage produit sur l’industrie de la population asservie. Les Romains, depuis l’expulsion de leurs rois jusqu’à l’établissement de l’empire, ont été constamment en guerre, et presque toujours avec des peuples moins barbares qu’eux. Les victoires qu’ils ont remportées et les villes innombrables qu’ils ont détruites, leur ont donné le moyen d’importer annuellement sur leur territoire, en qualité d’esclaves, un nombre immense de personnes qui avaient toujours été libres et industrieuses. Ces personnes ont nécessairement été employées à exécuter leurs travaux, ou à instruire leurs autres esclaves : mais, quelle qu’ait été leur adresse ou leur habileté dans les arts, on ne peut la considérer comme l’effet de la servitude, puisque c’était sous la liberté qu’elle s’était développée. Il faut, pour bien juger des effets que produit l’esclavage sur l’industrie des hommes asservis, se porter au temps où des hommes libres et industrieux cessèrent d’être faits esclaves, c’est-à-dire à l’époque où, toute la partie du monde connu ayant été conquise, il n’exista presque plus de guerre de nation à nation. Or, il est évident qu’à partir de cette époque, tous les arts tombèrent rapidement en décadence.
Aucun peuple n’a jamais possédé un aussi grand nombre d’esclaves que le peuple romain ; aucun n’a jamais été si constamment en guerre ; mais, quoiqu’il reste encore de lui de grands travaux, il ne faut attribuer ceux qui ont exigé de l’adresse ou de l’intelligence, ni à la classe des maîtres, ni à celle des esclaves. La ville de Rome ne fut longtemps, ainsi que l’a observé Montesquieu, qu’une enceinte de murs destinée à mettre à l’abri les produits des rapines ou du pillage, et fort ressemblante aux villes de Barbarie. Les chefs qui revenaient vainqueurs, attachaient à leurs portes, à l’exemple de quelques chasseurs sauvages, les dépouilles sanglantes des ennemis vaincus, et ces dépouilles n’étaient jamais enlevées. La plupart des monuments publics étaient semblables à ceux dont les soldats victorieux ornaient le devant de leurs maisons. Jusqu’au moment où les Romains se rendirent maîtres de Syracuse et la mirent au pillage, Rome conserva le même aspect. Suivant le témoignage de Plutarque,
« elle était seulement pleine d’armes barbaresques, et de harnais et de dépouilles toutes souillées de sang et couronnées de trophées et de monuments de victoire et de triomphe, gagnés sur divers ennemis, qui n’étaient point spectacles plaisants, mais plutôt effroyables à voir [42]. »
Les tableaux, les statues et les autres objets d’art que les Romains emportèrent de Syracuse, furent les premières choses de ce genre qu’ils possédèrent : jusqu’alors ils n’avaient rien connu de semblable [43].
Il existait cependant à Rome quelques monuments publics d’une plus haute antiquité ; mais, si les Romains libres ou esclaves avaient concouru à les élever, ce n’avait été qu’en qualité de manœuvres ; ce sont les autres États libres de l’Italie qui avaient produit les artistes. Les ouvrages faits sous le dernier des Tarquin, tels que les égouts, les temples, les places publiques, furent dirigés et exécutés par des Toscans ou des Étrusques [44]. Lorsque ce roi voulut placer sur un temple qu’il avait fait construire, un chariot en terre cuite, il ne trouva pas dans son royaume un artiste capable de l’exécuter ; il fut obligé de le faire faire chez les Véïens [45]. C’est par le pillage ou par les tributs qu’ils imposaient aux vaincus, que les Romains se procuraient des objets de luxe. L’agriculture, quoiqu’elle n’eût peut-être pas été portée très loin, dégénéra promptement, ainsi qu’on le verra bientôt, aussitôt qu’elle eut été abandonnée aux esclaves. Quant aux arts les plus communs de la vie, il serait difficile de déterminer exactement quel est le point auquel ils étaient parvenus ; mais nous verrons bientôt que ce n’était pas par des esclaves qu’ils pouvaient être perfectionnés, et encore moins inventés.
Je devrais exposer maintenant ici quelle est l’influence que l’esclavage exerce sur le genre de perfectionnement qui tient à l’adresse donnée par l’exercice aux organes physiques des esclaves, soit dans le système de la servitude de la glèbe, soit dans le système colonial ; mais le développement de ces organes est tellement subordonné au développement intellectuel et aux passions des maîtres, qu’il est nécessaire d’exposer quelle est l’influence que l’esclavage produit sur l’esprit de ceux-ci, avant que d’exposer l’influence que la même cause produit sur l’intelligence et l’industrie de ceux-là.
[IV-54]
CHAPITRE IV. ↩
De l’influence de l’esclavage domestique sur les facultés intellectuelles des maîtres et des esclaves.
Pour connaître comment l’esclavage agit sur les facultés intellectuelles des maîtres, il faut les considérer sous plusieurs points de vue différents ; il faut les considérer dans les rapports qu’ils ont entre eux, dans ceux qu’ils ont avec le gouvernement, et dans ceux qu’ils ont avec la population asservie.
Chez les Romains, depuis le commencement jusqu’à la fin de la république, les hommes qui appartenaient à la classe des maîtres, n’étaient pas subordonnés les uns aux autres, comme les vassaux sous le régime féodal. S’ils n’étaient pas égaux entre eux, nul ne pouvait du moins commander à un autre, à moins d’avoir été investi d’une magistrature par une partie de la population. De là résultait, pour tout homme qui aspirait à exercer quelque influence sur ses concitoyens, la nécessité de gagner leur confiance, soit par des discours, soit par des actions. Il fallait, par conséquent, que l’art de la parole fût cultivé, ainsi que toutes les connaissances qui s’y rattachent ; avant que d’être orateur, un citoyen devait être grammairien, logicien, moraliste, jurisconsulte, publiciste. C’est aussi dans ces parties des connaissances humaines, que les hommes qui appartenaient à la classe des maîtres, firent de grands progrès, aussi longtemps que, parmi eux, nul n’eut le moyen de mettre la force ou l’autorité à la place du raisonnement. Ce genre de développement, loin d’être jugé avilissant pour les maîtres, devait être, au contraire, jugé honorable, parce qu’il accroissait la puissance de l’homme sur l’homme. Il était, d’ailleurs, le résultat de la liberté ; car les citoyens n’étaient, les uns à l’égard des autres, ni des maîtres, ni des esclaves.
Mais si un individu de la classe des maîtres était dans la nécessité de développer ses facultés intellectuelles dans les rapports qu’il avait avec ses égaux, il n’était pas dans la même nécessité dans ses rapports avec ses esclaves. À l’égard des premiers, il était un homme libre ; il n’avait de force que le raisonnement. À l’égard des seconds, il était un despote ; il n’avait rien à expliquer, rien à démontrer ; il lui suffisait de commander. Il existait donc, chez les hommes de cette classe, deux obstacles insurmontables aux progrès des connaissances qui ont pour objet d’accroître la puissance de l’homme sur la nature : le premier, est l’avilissement dans lequel l’esclavage avait fait tomber tous les travaux industriels, et qui interdisait aux hommes libres de s’en occuper ; le second, la faculté que possédaient les maîtres d’employer la force ou l’autorité au lieu du raisonnement. Lorsque, à leur tour, les maîtres eurent été asservis, les connaissances qu’ils avaient acquises du temps de leur liberté s’éteignirent, et l’esclavage domestique continua d’agir sur eux. Relativement à leur gouvernement, ils ne furent plus que des esclaves ; relativement à leurs esclaves, ils continuèrent d’être des despotes : il leur était difficile, avec cette double qualité, de faire des progrès intellectuels.
Sous le régime féodal, les maîtres n’ont pas été organisés comme l’étaient ceux de la Grèce et de Rome. Ils ont fait entre eux un usage plus fréquent de la ruse, de la fourberie ou de la force que de l’éloquence et de la raison ; aussi ne trouve-ton rien, chez eux, qui annonce un développement quelconque de l’art de la parole et des connaissances qui s’y rapportent. Ceux de ces peuples qui, sans cesser d’être possesseurs d’esclaves, sont tombés sous le despotisme d’un individu ou d’une famille, comme les Polonais et les Russes, se sont trouvés dans une position semblable à celle où furent les Romains après l’établissement de l’empire. Ils ont eu à souffrir les inconvénients attachés à deux conditions opposées, à celle d’esclave et à celle de maître ; aussi, avons-nous vu précédemment que les philosophes qui étaient allés étudier les mœurs de ces peuples, avaient été surpris de les trouver semblables à ce que furent les Romains dans leur décadence.
Les colonies fondées par les Européens en Afrique, en Amérique, et dans les Antilles, n’ont pas été livrées à elles-mêmes ; les gouvernements des peuples qui les ont fondées, ont conservé sur elles une puissance à peu près égale à celle dont ils jouissaient sur le territoire national. Cette puissance a même été quelquefois plus étendue dans les colonies que dans la mère-patrie : c’est ce qui est arrivé particulièrement dans les colonies françaises. Les maîtres, ne jouissant en général d’aucune liberté politique, et ne formant même pas, à proprement parler, des nations indépendantes, n’ont eu à développer aucune de ces facultés intellectuelles qui, dans les pays où la liberté politique est établie, assurent l’empire à ceux qui leur ont donné le plus d’extension. Les colonies anglaises sont les seules auxquelles le gouvernement de la mère-patrie ait toujours laissé quelque pouvoir politique ; et ce sont aussi les seules dans lesquelles on ait trouvé le genre de développement dont je viens de parler. Dans les autres, les maîtres ont généralement montré la stupidité qui est le propre des despotes et des esclaves, à moins qu’ils n’aient reçu leur éducation dans des pays où l’esclavage domestique ne faisait pas sentir son influence : c’est du moins ce que nous attestent les voyageurs, et l’état même dans lequel se trouvent les pays où l’esclavage est admis.
Les colons hollandais du cap de Bonne-Espérance ont un tel mépris pour toute espèce d’instruction que, quoiqu’ils ne soient pas assez riches pour envoyer leurs enfants étudier en Europe, le gouvernement, ni le clergé, ni la persuasion, ni la force, n’ont jamais pu les obliger à se cotiser pour l’établissement d’une école publique. Il n’existe, dans la ville du Cap, ni libraires, ni sociétés littéraires ; rien n’est plus rare que de voir un livre dans une maison [46] ; l’instituteur le plus habile peut tout au plus donner des leçons d’écriture [47]. Privés de tous les plaisirs de l’esprit, de ceux de la conversation, comme de ceux de la lecture, pour eux le jour présent n’est jamais que la répétition du jour passé. Rien, dit Barrow, n’interrompt cette triste uniformité que la visite accidentelle d’un voyageur, ou la visite moins agréable des Boschismans ; si quelque chose vient la varier, c’est la défiance pour les Hottentots qui les servent, et la crainte d’être égorgés par leurs propres esclaves. Leur ignorance est telle, suivant le même voyageur, qu’on ne les verra jamais profiter de nouvelles plantes que les étrangers leur apportent, ni perfectionner celles qu’ils possèdent depuis longtemps, à moins qu’un grand nombre d’étrangers industrieux ne viennent leur en donner l’exemple [48].
Les colons hollandais d’Amérique, placés relativement à leur gouvernement et à leurs esclaves, dans la même position que ceux du cap de Bonne-Espérance, ne cultivent pas plus qu’eux leurs facultés intellectuelles.
Les colons français de la Louisiane, aussi longtemps qu’ils n’ont joui d’aucune liberté politique, sont restés étrangers aux arts, aux sciences et même aux connaissances les plus ordinaires. Ils ont livré l’éducation de leurs enfants à leurs esclaves, et n’ont pu avoir par conséquent des idées plus étendues que celles de leurs instituteurs [49]. Leur réunion aux États-Unis doit sans doute les avoir mis dans la nécessité de donner à leurs facultés intellectuelles quelques développements analogues à ceux que les maîtres romains donnaient aux leurs avant leur asservissement ; mais le maintien de l’esclavage ne peut que les avoir écartés de toutes les connaissances qui donnent à l’homme le moyen d’agir sur les choses.
Les Espagnols-Américains, en leurs qualités de sujets, de conquérants et de maîtres d’esclaves, n’ont pas été plus disposés que les colons français et hollandais à développer leurs facultés intellectuelles. Avant que ces peuples eussent conquis leur indépendance, on ne rencontrait dans les plus grandes villes, telles que Caracas, aucun établissement public propre à caractériser un peuple instruit et civilisé. Il existait, il est vrai, quelques collèges de théologie dans lesquels on enseignait aussi le droit canon, le droit civil et même un peu de médecine ; mais on n’exigeait guère des élèves que de savoir défendre la doctrine de l’immaculée conception [50]. Les hommes même les plus instruits du pays, ne connaissaient pas les plantes précieuses qui croissaient autour d’eux ; ils faisaient venir de loin et à grands frais, des racines qu’ils foulaient sous leurs pieds [51]. Cependant, comme le nombre des esclaves était peu considérable, comme dans quelques parties du pays on n’en trouvait même presque pas, les hommes libres, obligés de travailler, ont quelquefois aussi été obligés d’exercer leur intelligence sur les objets de leur travail [52].
Les Anglo-Américains qui ont tiré leur subsistance du travail de leurs esclaves, se sont trouvés, sous plusieurs rapports, dans une position analogue à celle où étaient les Romains avant le renversement de leur république ; libres, les uns à l’égard des autres, ils ont été despotes relativement à la population asservie. Le développement de leurs facultés intellectuelles a répondu à cette double position ; en leur qualité de maîtres, ils ont dédaigné les connaissances qui leur eussent donné le moyen d’agir sur les choses ; ils n’ont agi sur la nature que par leur autorité et par les muscles de leurs esclaves ; mais, comme en leur qualité d’hommes libres ils ne pouvaient employer la force à l’égard de leurs concitoyens, ni à l’égard de leurs confédérés, il a fallu qu’ils fissent usage de leur intelligence ; il a fallu qu’ils acquissent par leurs talents ou par leur caractère, l’autorité que la violence ne pouvait leur donner. Washington et Kosciusko, destinés à combattre ou à gouverner des hommes, pouvaient naître sur une terre exploitée par des esclaves ; mais Franklin, destiné à éclairer le monde et à accroître la puissance de l’homme sur la nature, ne pouvait se développer que dans un pays où les arts étaient exercés par des mains libres. Si les États du sud ont fourni à l’union un plus grand nombre d’hommes propres au gouvernement que les États du nord, et si les États du nord ont donné naissance à un nombre plus grand d’hommes actifs et laborieux que les États du sud, ce n’est point au hasard qu’il faut attribuer ce phénomène ; c’est à la présence de l’esclavage d’un côté, et à la présence de la liberté de l’autre. Là, on aspire principalement à agir sur les hommes, soit par le talent, soit par la force ; ici, on aspire surtout à agir sur les choses, et à les rendre propres à satisfaire nos besoins. On va voir quelles sont les différences qui se trouvent dans les résultats de ces deux directions, relativement aux facultés industrielles [53].
Les Hollandais sont au nombre des peuples les plus intelligents, les plus actifs, et les plus industrieux de l’Europe ; mais dans les colonies où ils font faire leurs travaux par des esclaves, ils ne montrent ni intelligence, ni activité, ni industrie. Au cap de Bonne-Espérance, leur charrue est une lourde machine, traînée par quatorze ou seize bœufs, qui ne fait que racler la surface du sol, et qui même n’y pénètre pas du tout, lorsqu’il est un peu ferme. Si les paysans ont besoin de cordes, ils se servent de longes de cuir ; s’ils ont besoin de fil, ce sont les fibres des bêtes fauves qui leur en tiennent lieu ; s’ils ont besoin d’encre, ils en font avec de l’eau, de la suie, et un peu de sucre. Si la nécessité ne rendait inventif et ne forçait au travail, dit Barrow, le paysan du Cap ne s’aiderait en rien et se laisserait manquer de tout. Il faut que la contrée soit couverte de cailloux tranchants, pour qu’il se fasse des souliers avec la peau de ses animaux. On peut juger, par la manière de vivre des maîtres, de l’industrie des esclaves [54].
[IV-63]
Dans les colonies d’Amérique où tous les travaux manuels sont exécutés par des esclaves, les maîtres sont obligés de faire venir des pays où l’esclavage n’est point admis, tout produit industriel qui, pour être obtenu, exige quelque intelligence. Les maîtres peuvent employer leurs esclaves à abattre et à transporter des arbres ; mais, s’il s’agit de construire des navires, il faut qu’ils envoient ces arbres dans les pays où l’on trouve des ouvriers libres [55]. Ils peuvent leur faire cultiver grossièrement la terre, et obtenir du blé par leurs travaux ; mais, quand il faut convertir ce blé en farine, on est obligé de l’envoyer dans des lieux où l’on trouve des ouvriers capables de faire des moulins [56]. Les esclaves ne peuvent même pas se livrer à tous les soins qu’exige l’agriculture ; ils n’ont ni assez d’intelligence, ni assez de soin pour cultiver des légumes ou des arbres à fruits [57]. Enfin, leur incapacité est telle, que l’agriculture est encore dans l’état le plus barbare, et les maîtres font venir d’Angleterre le charbon qui leur sert de chauffage, quoiqu’ils n’aient les forêts qu’à six milles de distance [58]. Quelquefois même ils en font venir jusqu’à la brique dont ils bâtissent leurs maisons [59].
Les esclaves employés au service intérieur de la maison ne sont pas plus habiles que ceux qui sont employés aux autres genres de travaux.
« Sans idées conservatrices d’ordre et d’économie pour eux, dit un voyageur, ils ne sauraient en avoir pour leurs maîtres : aussi, ceux qu’on réserve pour la domesticité intérieure des maisons, ont-ils un service désagréable. On ne peut les accoutumer à cet arrangement journalier dont l’homme social est soigneux et jaloux ; il faut chaque jour leur répéter l’ordre de tous les jours ; il faut le leur redire à tous les moments ; et une maîtresse de maison dont la famille est nombreuse, dont les détails sont un peu multipliés, se trouve assez occupée toutes les heures du jour, seulement à commander plusieurs de ses domestiques. Ce qui leur est le plus recommandé, comme plus important, n’est pas mieux exécuté que ce qui est indifférent ; et ces vases, ces meubles chéris pour leur prix ou leurs formes, vont être brisés ou mutilés, comme la chose la plus indifférente, tant leur attention est incapable de discerner ou de se rappeler les circonstances où il faut redoubler de surveillance et de précaution [60]. »
Les causes de l’incapacité des esclaves dans tous les genres d’industrie sont faciles à apercevoir. La main n’exécute bien que ce que l’esprit a bien conçu ; nos organes physiques ne sont, ainsi que je l’ai déjà dit, que les instruments de notre intelligence, et lorsque l’intelligence n’a reçu aucun développement, elle ne peut diriger que mal les organes qui sont à sa disposition. Or, dans les pays où l’esclavage est établi, non seulement les maîtres sont incapables de développer les facultés intellectuelles de leurs esclaves, mais ils ont presque tous une tendance naturelle à en arrêter le développement ; le besoin de la sécurité, plus fort que la passion de l’avarice, les oblige à tenir les hommes asservis aussi près de la brute que cela leur est possible. Le voyageur que je viens de citer rapporte qu’un colon français de la Louisiane répétait sans cesse qu’il ne craignait rien tant que des nègres avec de l’esprit ; il dit que son attention se portait à empêcher qu’ils n’en acquissent, et qu’il n’y réussissait que trop [61]. Il n’y a rien là qui doive nous surprendre ; tels ont été, à toutes les époques, les sentiments et la conduite de tous les possesseurs d’hommes ; les colons ne jugent pas autrement que ne jugeaient les Romains. Le censeur Caton ne voyait rien de plus dangereux que des esclaves avec de l’intelligence ; quand les siens ne travaillaient pas, il les condamnait à dormir, tant il avait peur qu’ils ne s’avisassent de penser [62]. Les Anglo-Américains des États du sud, qui sont aujourd’hui les moins ignorants et les moins brutaux des maîtres, repoussent cependant avec effroi l’idée de faire apprendre à lire à leurs esclaves. Les colons soumis au gouvernement anglais, ne voient pas avec moins de terreur les efforts que font plusieurs habitants de la Grande-Bretagne, pour donner quelques lumières à leurs esclaves. Dans quelques colonies, ils ont repoussé ou condamné à mort des missionnaires qui venaient enseigner la religion chrétienne. Ils ont démoli, de leurs propres mains, le temple dans lequel des hommes asservis s’assemblaient, pour entendre la lecture de l’Évangile. Les mêmes hommes qui auraient cru s’avilir en posant eux-mêmes une pierre pour la construction d’un édifice, n’ont pas craint de déroger en se livrant à la destruction d’un temple [63].
[IV-67]
Les maîtres se croyant intéressés à prévenir le développement des facultés intellectuelles de leurs esclaves, et ceux-ci ne pouvant avoir ni le désir, ni le moyen de s’éclairer, on conçoit qu’ils doivent être dans un état fort voisin d’un complet abrutissement.
« De tels hommes, dit Robin, doivent avoir l’intelligence extrêmement bornée, et elle l’est en effet à un degré dont l’Européen prend difficilement la mesure. J’en ai vu ne pas pouvoir faire le compte de cinq à six pièces de monnaie ; il est rare d’en trouver en état de dire leur âge, celui même de leurs enfants, ou de déterminer depuis combien d’années ils sont sortis de leur pays, dans quel temps ils ont appartenu à tels maîtres, ou sont passés à tels autres. Avec si peu d’idées du passé, ils doivent en avoir beaucoup moins de l’avenir ; aussi, ils sont d’une insouciance déplorable. Ils usent ou plutôt gâtent ce qu’ils ont de vêtements particuliers, sans penser, s’ils en auront un jour besoin ; ils brisent et détruisent ce qui se trouve sous leurs mains, avec la même insouciance ; ce qui les flatte le plus, ils l’abandonnent ensuite avec la plus grande indifférence [64]. »
Cependant, c’est par leurs esclaves que les colons font exercer toute espèce de métiers ; mais, comment des métiers peuvent-ils être exercés par des hommes que tout concourt à rendre stupides ? Qui peut se charger de les instruire dans les arts ? Ce ne sont pas les maîtres, puisqu’ils les ignorent et qu’ils craindraient de s’avilir en les exerçant : il faut donc que les esclaves soient dressés par des esclaves. Celui qui enseigne n’a aucun intérêt à rien enseigner ; celui qu’on instruit n’a aucun intérêt à rien apprendre, et le maître commun tend à les abrutir tous les deux. Aussi, n’ont-ils aucune idée de ce qui est beau, utile, commode.
« J’ai eu occasion d’en employer de plusieurs professions, dit le voyageur que je viens de citer, et je les ai toujours trouvés au-dessous de la médiocrité du talent, même pour le pays. La même chose qu’ils me faisaient deux fois, avait à chaque fois des imperfections particulières [65]. »
Il résulte des faits qui précèdent, premièrement que l’esclavage n’a pas nécessairement pour effet de vicier les hommes qui appartiennent à la classe des maîtres dans la constitution de leurs organes physiques, mais qu’il a toujours eu pour résultat d’empêcher l’application de ces organes au perfectionnement des choses que la nature a mises à notre disposition. Il en résulte, en second lieu, que l’esclavage a pour effet de favoriser le développement intellectuel des individus de la même classe, en tout ce qui est propre à étendre l’empire de l’homme sur ses semblables, mais qu’il a pour effet aussi d’arrêter le développement des mêmes facultés sur tout ce qui peut étendre l’empire de l’homme sur la nature. Il en résulte, en troisième lieu, que l’esclavage a pour effet de vicier les hommes qui appartiennent à la classe des esclaves, dans la constitution de leurs organes physiques, et de les mettre dans l’impuissance d’en faire aucun emploi avantageux, soit pour eux-mêmes, soit pour les autres. Il en résulte, enfin, que l’esclavage est un obstacle invincible au développement des facultés intellectuelles de la même classe de la population.
[IV-70]
CHAPITRE V. ↩
De l’influence de l’esclavage sur l’existence des personnes libres et industrieuses qui n’ont point d’esclaves.
Les effets de la servitude sur les mœurs des maîtres et des esclaves, sont des phénomènes fort importants à observer ; mais il est nécessaire, avant que de nous livrer à ces observations, d’exposer les effets que la même cause produit sur les organes physiques et sur les facultés intellectuelles des hommes qui vivent dans un pays où l’esclavage est établi, mais qui, pour exister, ont besoin d’exercer quelque branche d’industrie.
L’esclavage ne produit pas chez les modernes, sur cette dernière classe d’hommes, exactement les mêmes effets qu’il produisit chez les peuples de l’antiquité. Deux causes ont amené les différences que nous allons observer dans ces effets. Chez les anciens, un peuple voyait presque toujours dans un autre un ennemi ; si l’on songeait à émigrer, ce n’était jamais que les armes à la main. Chez les modernes, au contraire, il peut y avoir inimitié entre deux gouvernements, ou entre un gouvernement et une nation ; mais entre deux nations il ne peut plus exister de guerre. Il n’y a d’exceptions à cet égard que chez les sauvages. Un individu qui entend la langue d’un peuple étranger, peut aller s’établir sur son territoire, et y exercer son industrie : il peut avoir à craindre les vexations du gouvernement, mais il n’en a aucune à redouter de la population. Il est aujourd’hui un grand nombre de nations du milieu desquelles l’esclavage domestique a complètement disparu ; de sorte que, si un homme qui n’est ni un esclave ni un maître, a à souffrir de l’existence de l’esclavage, il peut aller s’établir dans un pays où il n’aura pas à éprouver le même genre de maux. Chez les peuples de l’antiquité qui nous sont les plus connus, les hommes n’avaient pas cette ressource : un Romain qui n’avait que ses bras pour toute fortune, ne pouvait aller s’établir dans un pays où il n’existait pas d’esclaves ; et les émigrations eussent été difficiles quand le monde connu eût été conquis.
Un sentiment commun à tous les hommes, de quelque classe qu’ils soient, est l’horreur du mépris ; beaucoup de personnes se résignent à être ignorées, inconnues, mais nul ne peut se résoudre à être méprisé ; les individus même qui sont nés dans l’esclavage, se révoltent à la manifestation de ce sentiment. Nous avons vu qu’un des premiers effets de l’esclavage est d’avilir toutes les occupations qui exigent que l’homme agisse sur les choses, dans le but d’en accroître l’utilité ; nous avons vu également que le mépris dont ces occupations sont l’objet, se répand toujours sur les personnes qui s’y livrent. Il résulte de là que, dans un pays où l’esclavage est établi, un homme qui n’appartient ni à la classe des maîtres, ni à celle des esclaves, est obligé, ou de rester oisif, ou d’être méprisé, ou de porter ailleurs son industrie. Le dernier parti est celui que prennent en général tous les hommes qui en ont le moyen ; au cap de Bonne-Espérance, ainsi qu’on l’a vu, les artisans eux-mêmes n’exercent leur métier que par les mains de leurs esclaves ; aux États-Unis, les ouvriers libres disparaissent de tous les lieux où il existe des esclaves ; et l’émigration des uns est en raison de l’importation des autres [66].
Outre le mépris qui s’attache aux occupations industrielles dans les pays exploités par des esclaves, il existe une autre cause d’émigration qui exerce une grande influence ; c’est la difficulté de se procurer un travail constant et régulier. Un ouvrier libre se trouve en concurrence, non avec les esclaves qui exercent la même industrie que lui, mais avec les maîtres auxquels ces esclaves appartiennent et qui vivent du revenu qu’ils en retirent en les louant. Ces concurrents, qui jouissent souvent d’une autorité très étendue, trouvent parmi leurs égaux un appui qu’un simple ouvrier, jugé d’avance méprisable, chercherait vainement auprès d’eux. Il est possible, cependant, que des hommes qui n’ont pas d’autre moyen d’existence que leur travail, n’aient pas le moyen d’aller former ailleurs un établissement : ils sont placés alors entre la honte qui s’attache à la mendicité, et le mépris qui est inséparable des occupations industrielles ; le premier parti est souvent celui qu’ils préfèrent, parce qu’aux yeux d’un maître un mendiant est au-dessus d’un esclave. Si des hommes libres consentent quelquefois à travailler, ce n’est qu’autant que l’élévation du salaire compense le mépris attaché au travail, et même alors un ouvrier libre achète des esclaves ou disparaît, aussitôt qu’il a fait quelques économies [67]. Une classe moyenne ne peut même que difficilement se former dans le pays ; car, lorsqu’un homme n’a qu’une petite propriété, il se hâte de la vendre pour aller s’établir ailleurs [68].
Nulle part, l’esclavage domestique n’a produit sur les hommes qui n’appartiennent, ni à la classe des maîtres, ni à celle des esclaves, des effets plus remarquables et plus terribles que dans la république romaine.
Il paraît que, dès le commencement de la république romaine, la population se trouva divisée en deux classes : à la première, qui formait l’aristocratie, étaient exclusivement dévolues les fonctions civiles, militaires et sacerdotales ; à la seconde étaient dévolus le soin des troupeaux, la culture des terres, les arts et le commerce [69]. Les Romains ne pouvaient pas posséder alors un grand nombre d’esclaves ; il fallait bien, par conséquent, que l’industrie fût exercée par des mains libres. Les choses changèrent à mesure que les esclaves devinrent plus nombreux ; les maîtres les employèrent d’abord à la culture des terres ; et, dès ce moment, les cultivateurs libres commencèrent à disparaître des campagnes. Vers la fin de la république, le sol de l’Italie n’était exploité que par des esclaves de toutes les nations ; et, comme un des effets de l’esclavage est de réduire aux moindres dimensions possibles l’intelligence de la population asservie, il fallut que l’agriculture fût réduite aux opérations les plus simples et les plus faciles. Les champs furent donc convertis en pâturages, et une population intelligente et libre fut remplacée par des troupeaux, et par des captifs que leurs qualités de pâtres et d’esclaves rendaient doublement stupides.
Les habitants libres des campagnes avaient pu se réfugier à Rome ou dans quelques autres villes, lorsque la culture des terres et le soin des troupeaux furent livrés aux esclaves ; mais il n’y eut plus de refuge possible lorsque l’aristocratie commença à faire exercer à son profit, par les mains de ses esclaves, les arts et le commerce. Il n’y eut alors de moyens d’existence assurés que pour les maîtres et pour les hommes qui leur appartenaient ; il fallut que la classe nombreuse de la population, qu’on a désignée sous le nom de prolétaire, vécût au moyen des distributions publiques, du pillage qu’elle faisait en temps de guerre, des sommes que les grands lui distribuaient pour acheter son suffrage, des emprunts qu’elle faisait et qu’elle n’avait jamais le moyen de rendre, ou bien de quelque industrie exercée clandestinement. Le nombre des familles qui se trouvaient dans cette nécessité devint immense ; dans le dénombrement qui eut lieu vers l’an 278 de la fondation de Rome, le nombre des citoyens, dit un historien, montait à 110 000 hommes, sans compter les enfants, les valets, les marchands, les artisans, et une infinité d’autre petit peuple qui gagnait sa vie du travail de ses mains, et auquel il n’était pas permis de négocier publiquement, ni d’exercer aucun métier. Il était difficile de soulager tant de monde, qui allait à trois fois autant que les citoyens mêmes [70].
[IV-78]
L’histoire de Rome offre des phénomènes qu’on ne trouve dans l’histoire d’aucun autre peuple : c’est une suite de séditions et de guerres causées par la dureté des créanciers et par une multitude de débiteurs insolvables. On a d’abord de la peine à concevoir comment des hommes destitués de toute ressource, qui considéraient le travail comme avilissant, et auxquels il n’était pas permis d’ailleurs de se livrer au commerce ou à l’industrie, trouvaient de l’argent à emprunter, et comment un débiteur, maltraité par son créancier, pouvait exciter une sympathie telle, qu’il lui suffisait de se montrer pour causer une insurrection. Mais cela s’explique aisément : tout débiteur insolvable pouvait être réduit à l’esclavage, et non seulement lui, mais encore ses enfants [71] ; les grands, qui possédaient exclusivement des richesses, étaient intéressés à capter par des prêts ou des dons les suffrages de la multitude ; l’aspect d’un débiteur outragé rappelait à la masse de la population qu’elle ne s’appartenait plus, et que les hommes auxquels elle s’était vendue en empruntant, pouvaient exercer, sur la plupart des individus dont elle se composait, des cruautés semblables à celles dont on lui montrait les marques.
Les hommes qui se sont constitués les défenseurs de la partie de la population la plus nombreuse, ont été, dans tous les temps, l’objet de tant d’accusations de la part des oppresseurs, que nous sommes tout naturellement disposés à flétrir leurs reproches et leurs plaintes du nom de déclamations. Il ne serait donc pas impossible que quelques lecteurs accusassent d’exagération la harangue que Plutarque met dans la bouche de Tibérius Gracchus, lorsqu’il lui fait dire :
« Les bêtes sauvages qui sont en Italie, ont au moins leurs gîtes, leurs tanières, leurs cavernes, où elles peuvent se retirer ; mais les hommes qui combattent et meurent pour la défendre, n’y possèdent autre chose que l’air et la lumière, et sont contraints d’aller, errant çà et là, avec leurs femmes et leurs enfants, sans séjour et sans maison où ils puissent se loger [72]. »
Mais, lorsqu’on voit les sénateurs eux-mêmes dire en plein sénat qu’il y a deux peuples dans Rome, l’un gouverné par l’indigence et la bassesse, l’autre par l’abondance et par l’orgueil [73] ; lorsqu’on voit César repeupler Corinthe, Carthage et plusieurs autres villes avec des Romains qui n’avaient point de retraite, et en envoyer jusqu’à 80 000 au-delà de la mer en une seule fois [74], il est difficile de ne pas croire à l’excessive misère à laquelle la multiplicité des esclaves avait réduit la partie de la population qui n’appartenait pas à la classe des maîtres [75].
Ainsi, l’esclavage eut, chez les Romains, l’effet qu’il a eu dans les colonies formées par les Européens en Amérique : il avilit, aux yeux de la population libre, tous les travaux utiles, et il fit disparaître des campagnes où il fut introduit les hommes libres qui les cultivaient. Il eut pour effet, relativement aux habitants des villes, de les rendre incapables d’exercer aucun genre d’industrie, et de les empêcher de développer leurs facultés intellectuelles sur les moyens qui auraient pu les faire vivre, sans nuire à personne. Il ne leur laissa la puissance d’exercer leurs facultés physiques et intellectuelles que dans l’art d’asservir ou de détruire des peuples, c’est-à-dire dans l’art de multiplier le nombre des esclaves, d’accroître ainsi l’orgueil et la puissance de l’aristocratie, et d’augmenter par conséquent leur propre misère.
On comprendra mieux comment l’esclavage ne laisse aucun moyen d’existence honorable aux hommes libres qui ont besoin d’exercer leur industrie, lorsque j’aurai exposé les effets qu’il produit sur les mœurs et sur les richesses.
[IV-80]
CHAPITRE VI. ↩
De l’influence de l’esclavage sur les mœurs des Romains.
Si, pour juger des effets moraux de l’esclavage, nous n’avions que les observations faites par les colons européens sur eux-mêmes ou sur leurs esclaves, nous ne saurions ce que nous devons en penser ; car aucun d’eux ne s’est encore avisé d’écrire sur un tel sujet. Dans les pays mêmes où les maîtres jouissent d’une liberté civile et d’une liberté politique très étendues, comme aux États-Unis d’Amérique, personne ne s’est permis de rechercher et encore moins d’exposer les effets que la servitude produit sur les mœurs. Ces pays ont donné naissance à de grands généraux, à des hommes d’État habiles, mais à peu d’observateurs de la nature humaine [76]. Il a fallu, pour qu’il nous fût possible de nous former quelques idées sur l’objet de nos recherches, que des hommes nés et élevés dans des pays où l’esclavage n’est plus admis, allassent en étudier les effets dans les lieux où il existe. Les contrées d’Europe où la servitude domestique est encore établie, n’ont pas été plus fertiles en observateurs : ce que nous connaissons des effets que l’esclavage y produit, nous le devons à des hommes qui y étaient étrangers, et qui n’appartenaient ni à la classe des maîtres ni à celle des esclaves.
Les peuples de l’antiquité n’ont pas été moins réservés à cet égard que les peuples modernes. Les philosophes de la Grèce et de Rome ont écrit sur une multitude de sujets ; mais aucun, même parmi les moralistes, n’a abordé le sujet de l’esclavage. On pourrait croire que l’état d’asservissement d’une partie du genre humain à l’autre, leur a paru si naturel, qu’ils n’ont pas conçu qu’il pût exister une autre manière d’être. Cependant, lorsqu’on voit les possesseurs d’hommes qui existent de notre temps, garder, sur l’esclavage, le même silence que ceux de l’antiquité, ou ne prendre la parole que pour répondre à ceux qui l’attaquent, ne peut-on pas croire aussi que le sujet est par lui-même si terrible, soit pour les hommes qui commandent, soit pour ceux qui obéissent, que nul n’a eu le courage d’en faire l’objet de ses recherches ? Nous ne pouvons avoir, pour juger des effets de l’esclavage chez les anciens, les ressources que nous possédons pour juger des résultats qu’il produit chez les modernes. Non seulement nous ne connaissons aucun ouvrage de l’antiquité écrit par un homme qui appartint à un peuple chez lequel l’esclavage ne fût point admis ; mais nous ignorons s’il exista jadis de tels peuples. L’histoire ne nous parle des esclaves que dans les circonstances rares où ils ont inspiré des craintes ou donné des secours à leurs maîtres, ou dans les circonstances moins rares où ils ont été sacrifiés aux amusements de leurs possesseurs.
Mais, si les historiens ne se sont pas occupés de faire connaître à la postérité les relations qui existaient entre les maîtres et les esclaves ; s’ils n’ont pas observé la liaison qui existait entre l’esclavage et les mœurs qu’ils ont décrites, il est facile de suppléer à leur silence ; ils nous ont exposé les faits ; c’est à nous à examiner comment ces faits s’enchaînent. Les événements qu’ils ont décrits et les lois dont ils ont constaté l’existence, s’accordent d’ailleurs si bien avec ce que nous connaissons des conséquences de l’esclavage chez les modernes, qu’on peut à peine considérer leur silence sur la liaison des effets et des causes, comme une lacune dans l’histoire du genre humain.
En parlant des mœurs que l’esclavage domestique produit chez les diverses classes de la population, je dois rappeler ici une observation que j’ai faite précédemment ; c’est que je n’ai à m’occuper que des mœurs de la partie la plus nombreuse de la population, et que quelques exceptions individuelles, produites par des circonstances particulières, ne peuvent rien prouver contre des faits généraux quand ils sont bien constatés.
Nous avons vu, dans le chapitre précédent, qu’un des premiers effets de l’esclavage est d’arrêter le développement des facultés intellectuelles des diverses classes de la population, sur les phénomènes de la nature ; les hommes que la force ou la ruse a investis du pouvoir de commander à d’autres, cessent d’appliquer leur intelligence ou leurs organes physiques à l’étude ou au perfectionnement des choses ; ils n’agissent plus sur elles que par l’intelligence et par les organes physiques de leurs esclaves. De leur côté, les esclaves n’étant mus que par la crainte des châtiments, ne livrent à leurs maîtres que la portion de leurs forces qu’ils ne peuvent pas leur refuser ; celles qui peuvent être cachées, comme la plus grande partie des forces intellectuelles, sont toujours soustraites à leur empire, et restent sans développement. Un maître peut commander à son esclave d’exécuter bien ou mal une chose dont il lui montre le modèle ; il peut bien le contraindre à répéter certaines paroles, à apprendre par cœur certains livres ; mais il ne saurait exiger de lui une découverte ou seulement une pensée nouvelle ; il ne saurait exiger de lui le perfectionnement de rien.
Il est même évident que lorsque, chez une nation, une partie de la population n’agit sur les choses que par l’intermédiaire de l’autre partie, et que celle-ci se trouve réduite à exécuter machinalement ce que celle-là lui prescrit, tout ce qui tient aux sciences, aux arts, à l’industrie, doit marcher rapidement vers la décadence. Les objets que produit l’industrie humaine ne sont pas éternels ; la plupart se détruisent même assez rapidement. Si les choses qui sont à notre usage et qui forment l’aisance d’un peuple civilisé, n’étaient pas incessamment renouvelées, les nations les plus riches seraient en peu de temps réduites au même état que les sauvages. Mais, lorsque tous les travaux nécessaires au bien-être d’un peuple tombent dans les mains des esclaves, lorsque la partie industrieuse de la population se trouve réduite à exécuter aveuglément ce que lui prescrivent des maîtres qui sont étrangers aux sciences, aux arts, à l’industrie, il arrive nécessairement qu’on a tous les jours de plus mauvais modèles. Le praticien romain qui, par la prise d’une ville, devenait possesseur d’un homme libre et industrieux, pouvait l’employer à instruire ses esclaves ; il pouvait leur donner pour modèles les objets d’art que cet homme avait produits ; mais quand il n’exista plus de peuples industrieux à asservir, il fallut qu’un homme né esclave fût employé à instruire un autre esclave, et le disciple dut toujours être pire que le maître : l’ouvrage grossier que l’un avait fabriqué, devint le modèle d’un ouvrage plus grossier encore. Les maîtres ne pouvaient exiger davantage, car leur goût n’était formé que par les choses qu’ils avaient sous les yeux, et il n’était pas en leur puissance de concevoir et encore moins de faire exécuter quelque chose qui fût au-dessus de l’intelligence, ou de la capacité d’un esclave élevé par un autre esclave [77].
L’esclavage, qui est un obstacle au développement des facultés intellectuelles dans l’étude des sciences naturelles et des arts industriels, n’est pas toujours un obstacle à ce que ces mêmes facultés se développent chez les maîtres, dans les arts qui sont propres à donner à l’homme un empire sur ses semblables. Aussi voyons-nous que chez les peuples de l’antiquité les hommes qui appartenaient à la classe des maîtres, cultivèrent les arts de la guerre, de l’éloquence et du gouvernement aussi longtemps qu’ils ne furent pas eux-mêmes asservis. Les époques auxquelles ils déployèrent à cet égard le plus de talents, furent celles où les luttes, pour arriver au commandement, furent les plus violentes. Mais, quand Rome n’eut plus d’ennemis extérieurs à combattre, que les maîtres eurent été asservis par un des plus puissants d’entre eux, il n’exista plus pour les possesseurs d’hommes de sujets d’activité intellectuelle ou physique. Une des premières conséquences morales que l’esclavage produisit chez les maîtres, avant même que la liberté politique eût été détruite, fut l’amour de l’oisiveté. Nous verrons qu’en effet cette passion est inséparable du mépris qui s’attache aux occupations industrielles, toutes les fois que les possesseurs d’hommes ne peuvent pas employer leur activité à étendre leur domination sur leurs semblables. Ce phénomène se reproduit à toutes les époques et sous tous les climats.
De l’absence d’activité intellectuelle et physique, et de la possession de richesses acquises par le pillage ou par l’oppression, naquit une passion effrénée pour toutes les jouissances sensuelles. La gourmandise et la voracité des grands arrivèrent à un point dont il est impossible aujourd’hui de se faire aucune idée ; la terre fut ravagée pour fournir à leurs débauches, et les richesses d’une province furent englouties dans un repas [78]. La mollesse se joignit à la sensualité : la coutume de s’étendre sur des coussins pendant qu’ils prenaient leurs aliments, fut apportée de l’Orient, et bientôt elle fut adoptée par les femmes comme elle l’avait été par les hommes. Pendant que les maîtres étaient ainsi mollement couchés sur le duvet et la pourpre, des esclaves étaient toujours présents pour leur épargner le moindre mouvement, tandis que d’autres, avec des éventails, prenaient soin de rafraîchir l’air, ou de les garantir des mouches. Un plat extraordinaire leur causait tant de plaisir, qu’il était apporté au son de la flûte [79].
Les femmes n’étant point recluses comme elles le sont dans quelques contrées de l’Orient, et la maison d’un grand renfermant une multitude de jeunes esclaves des deux sexes, les mœurs des maîtres éprouvèrent promptement les effets qui devaient résulter d’un tel mélange. En lisant les écrivains de l’antiquité, on observe que chez ces peuples l’amour n’avait aucun des caractères de délicatesse qu’il a chez les modernes ; c’était presque toujours une passion brutale qui ne différait en rien de celle des animaux. La raison de cette différence est sensible : un maître qui n’avait qu’à manifester un signe de sa volonté pour faire battre de verges une jeune esclave, ou même pour la faire mettre à mort, devait être accoutumé à peu de résistance. L’homme ne s’abaisse à la persuasion et à la prière, il ne se résigne à l’attente, que lorsqu’il ne peut pas faire usage de la force et de l’autorité. L’habitude de vivre avec des esclaves fut pour les jeunes gens des deux sexes une cause de corruption très active. Chez ceux qui possédaient un grand nombre d’esclaves, l’intervalle qui séparait la naissance de l’extinction des désirs, devait toujours être d’une courte durée ; et chez un peuple au sein duquel l’aristocratie avait jeté de profondes racines, l’exemple des grands devait toujours entraîner la multitude. Aussi, l’histoire est-elle remplie de faits qui attestent l’immoralité de toutes les classes de la population ; quand le nombre des esclaves se fut très multiplié, la corruption devint telle qu’on parut oublier jusqu’aux lois même de la pudeur [80].
En général, les historiens se mettent peu en peine de nous faire connaître les mœurs privées des nations ; la vie domestique, qui est presque tout dans l’existence de l’homme, paraît à peine digne de fixer leurs regards. Il nous est donc impossible de bien savoir quelle est la manière dont les femmes romaines étaient traitées par leurs maris, et quel est le genre de bonheur qui était réservé au sexe le plus faible. Mais, lorsque nous voyons que tout individu qui jouissait d’une fortune un peu considérable, possédait ou pouvait acquérir une multitude de jeunes esclaves, il est difficile de croire que les hommes à grande fortune fussent des maris très attentifs. Il est également difficile de croire que les femmes qui voyaient des rivales dans chacune de leurs esclaves, fussent des épouses fidèles, ou qu’elles ne fussent pas dévorées de jalousie [81]. L’histoire ne rapporte pas les discordes particulières auxquelles l’existence de l’esclavage donna naissance entre les époux, ni les crimes individuels qui furent les conséquences de ces discordes. Mais un fait qu’elle nous atteste, suffit, à lui seul, pour nous faire juger de l’intérieur des familles au sein desquelles il existait un grand nombre d’esclaves : c’est la conspiration des femmes des patriciens contre leurs maris ; c’est la condamnation à mort, en une seule fois, de cent soixante d’entre elles, toutes femmes de sénateurs, convaincues, à leur égard, du crime d’empoisonnement [82].
[IV-90]
Ce fut, sans doute, pour se mettre à l’abri de ces actes de désespoir de la part de leurs femmes, que les hommes finirent par leur accorder la faculté de la répudiation, faculté qui n’avait, pendant longtemps, appartenu qu’aux maris. Mais alors naquit un autre genre de désordres ; les hommes ne renoncèrent pas à leurs esclaves ; mais leurs femmes, blessées des préférences que celles-ci obtenaient sur elles, changèrent de maris aussi souvent qu’elles en eurent le moyen. Ces changements devinrent si fréquents, qu’ils firent dire à quelques écrivains, que les femmes ne comptaient plus les années par le nombre des consuls, mais par le nombre de leurs maris.
La conduite licencieuse du sexe le plus fort entraîne nécessairement la dépravation du sexe le plus faible ; il était impossible qu’une fille élevée au milieu d’une foule de femmes esclaves, témoin en quelque sorte obligé de leur corruption et des liaisons qui existaient entre elles et ses frères ou son père, fût une épouse fort retenue. Aussi, ne trouve-t-on nulle part des exemples d’une dépravation aussi grossière que celle des femmes romaines. Si l’histoire a conservé les noms de quelques-unes d’entre elles recommandables par leurs mœurs, ce ne sont que des exceptions rares qui attestent la corruption générale. L’écrivain de l’antiquité qui s’est le plus attaché à décrire les mœurs privées des individus dont il a publié la vie, ne parle presque jamais d’un homme célèbre sans faire mention en même temps des débauches de ses sœurs, de ses filles ou de sa femme. Suivant lui, les filles et les femmes des grands faisaient un commerce de leurs charmes ; c’était pour de l’argent qu’elles se livraient à leurs amans. L’adultère et l’inceste étaient des crimes si communs et si publics dans les derniers temps de la république, qu’il semble que les grands ne prenaient plus la peine de s’en cacher [83]. Le sénat crut arrêter ce désordre en exilant les femmes les plus connues par le dérèglement de leurs mœurs ; mais ce fut un impuissant remède ; une multitude d’hommes et de femmes formèrent d’effroyables associations pour se livrer en commun à la débauche [84]. Une de ces associations fut découverte à l’époque la plus florissante de la république : le nombre des coupables, dont les femmes formaient la plus grande partie, s’éleva au-dessus de 7 000 ; plus de la moitié furent condamnés au dernier supplice. Les femmes qui étaient sous la puissance de leurs pères, de leurs maris, ou de leurs tuteurs, leur furent livrées pour être mises à mort en particulier ; les autres, dit Tite-Live, furent exécutées en public, à défaut de parents autorisés par la loi à se charger de l’exécution [85].
N’ayant à se livrer à aucune occupation d’esprit, et laissant les travaux industriels à leurs esclaves, les Romains se montrèrent aussi passionnés pour les jeux et les spectacles qu’ils l’étaient pour les jouissances physiques ; mais ces jeux et ces spectacles n’étaient pas ceux qui auraient plu à une population active et intelligente, ayant besoin de délassement ; c’étaient ceux qui convenaient à un peuple oisif, grossier, ignorant, et susceptible d’être ému seulement par les mouvements physiques les plus violents ; des courses de chars et de chevaux, la lutte, le pugilat, des représentations de batailles, des combats de bêtes féroces, et surtout des combats de gladiateurs, tels étaient les jeux pour lesquels les individus de toutes les classes se passionnaient, les femmes aussi bien que les hommes, les patriciens aussi bien que les plébéiens [86].
[IV-93]
Le besoin de spectacles violents se développa à mesure que les esclaves se multiplièrent, c’est-à-dire à mesure qu’il devint plus facile de vivre dans l’oisiveté. Les généraux qui voulurent gagner les faveurs de la multitude, n’eurent pas de meilleur moyen que de faire venir de toutes les parties de la terre des multitudes de bêtes féroces pour les faire détruire les unes par les autres, ou de donner des combats de gladiateurs. Il paraît que d’abord il avait suffi au peuple de Rome de voir des combats de cailles ou de coqs ; mais quand ses armées eurent détruit ou réduit en esclavage un nombre immense de peuples libres et industrieux, il fallut lui donner des combats d’hommes, de lions ou de tigres. Pompée, dans son second consulat, fit paraître cinq cents lions et dix-huit éléphants ; le carnage de tous ces animaux amusa le peuple de Rome pendant cinq jours entiers. Les combats de gladiateurs suivirent, dans leur accroissement, la même progression que les combats de bêtes féroces. On ne sacrifia qu’un petit nombre de victimes, tant que la rareté des esclaves en tint le prix très élevé ; mais, quand les hommes asservis devinrent une marchandise commune et sans valeur, on fut prodigue de sang humain. César et Pompée qui, dans ce genre de marchandise, furent deux des plus grands fournisseurs de la république, en firent périr dans le cirque un nombre immense. Trajan se montra plus généreux encore : il donna à ses heureux sujets une fête qui eut 123 jours de durée ; et chaque jour il fit égorger, pour leurs menus plaisirs, environ 90 animaux féroces et près de 82 hommes, en tout 10 000 hommes et 11 000 bêtes [87]. Aussi, les littérateurs du temps ont-ils fait passer jusqu’à nous la mémoire de cet excellent prince, et sa gloire a-t-elle été portée jusqu’au ciel par des littérateurs du nôtre [88].
Lorsqu’un homme est placé dans une position telle, qu’il ne peut se livrer à aucun travail sans qu’aussitôt le fruit de ses peines lui soit ravi, il cesse naturellement de travailler. Si l’on veut qu’il se livre à quelque genre d’occupation, il faut que le principe d’activité qu’on a détruit en lui, soit remplacé par un autre principe ; la crainte des peines doit faire alors ce que ne fait plus l’espoir des récompenses. Il n’est donc pas possible de mettre en doute que les Romains n’aient excité au travail, par des châtiments, les hommes qu’ils avaient asservis, comme les y excitent les maîtres des colonies modernes. Mais en quoi consistaient ces châtiments ? Par quel genre de supplices les esclaves étaient-ils forcés à exécuter les travaux qui leur étaient prescrits ? Quels étaient les aliments, les vêtements, les habitations que les maîtres leur donnaient ? Les historiens de Rome ne se sont pas plus occupés du traitement des esclaves que les nôtres ne s’occupent du traitement de nos animaux domestiques. Il est aisé de voir cependant qu’à mesure que la multiplication des esclaves en fit baisser la valeur, leur sort devint de plus en plus misérable.
Dans les premiers temps, les peuples vaincus furent incorporés parmi les citoyens et jouirent des mêmes prérogatives ; ceux qui furent réduits en esclavage devinrent les compagnons de travail de leurs maîtres ; ils eurent les mêmes aliments et probablement aussi les mêmes vêtements. Lorsque le nombre s’en fut accru, les travaux leur furent exclusivement abandonnés ; il devint honteux de se livrer à aucun genre d’industrie. L’usage pratiqué par plusieurs nations barbares, d’immoler quelques prisonniers sur le tombeau des généraux tués dans les combats, avait fait égorger quelques esclaves. On multiplia les victimes à mesure que le nombre des captifs en fit baisser le prix ; bientôt la croyance religieuse, qui avait commandé ces meurtres, fut perdue de vue ; et, après avoir fait tuer quelques hommes pour obéir à une horrible superstition, on en fit égorger des milliers pour se donner le plaisir de voir couler du sang.
Les maîtres, en renonçant au travail et en se livrant avec une sorte de fureur à toutes les jouissances physiques, multiplièrent les fatigues de leurs esclaves, et leur laissèrent une part moins grande dans les produits de leurs travaux ; ils furent obligés par conséquent de donner aux châtiments deux fois plus d’intensité ; il fallut les augmenter d’abord, parce qu’on exigea de la population asservie une quantité de travail plus considérable, et ensuite parce qu’en exigeant d’elle de plus grandes fatigues, on accorda moins à ses besoins. Les supplices et l’avilissement auxquels étaient assujettis les citoyens que leurs dettes avaient rendus esclaves, peuvent nous donner une idée de la dégradation et des châtiments réservés aux étrangers qui étaient tombés en servitude par suite des malheurs de la guerre. Nous voyons souvent, dans l’histoire, des esclaves d’origine romaine s’échapper des prisons où ils étaient détenus, se présenter sur les places publiques le corps déchiré par les verges, et implorer la protection de leurs concitoyens. Ce n’était pas seulement le désir d’obtenir d’eux des travaux excessifs qui avait produit les cruautés dont ils portaient les sanglants témoignages ; c’était la résistance qu’ils avaient opposée aux infâmes passions de leurs maîtres. Mais ces cruautés ne sont racontées par l’histoire qu’à cause des séditions qu’elles amenèrent ; celles qui furent exercées sur des esclaves d’origine étrangère, celles mêmes qui, exercées sur des individus nés Romains, ne donnèrent lieu à aucun événement politique, ont été ensevelies dans l’oubli ; elles ont toujours été considérées comme l’exercice légitime de la puissance d’un maître sur sa propriété [89].
La multiplication des esclaves et les cruautés dont ils furent l’objet, devaient compromettre et compromirent en effet la sûreté de leurs possesseurs. Les patriciens romains, pour se mettre à l’abri de leurs conspirations, avaient soin de fomenter entre eux des divisions, des discordes ; ils ne se croyaient en sûreté que lorsque chacun de leurs esclaves se méfiait de tous les autres. Ils portèrent plus loin les précautions : une loi fut rendue, qui ordonna que, toutes les fois qu’un maître serait trouvé mort chez lui, tous ses esclaves, de quelque âge et de quelque sexe qu’ils fussent, seraient, sans forme de procès, envoyés au supplice. L’application de cette loi en fit périr sans doute un grand nombre ; nous voyons, dans les Annales de Tacite, qu’un citoyen ayant été trouvé mort dans sa maison, quatre cents esclaves qu’il possédait, furent égorgés par ordre du sénat ; les enfants et les femmes ne furent pas plus épargnés que les hommes d’un âge mûr [90].
Toutes les fois que des hommes sont condamnés à des travaux sans relâche et sans fruit, qu’ils ne sont maîtres d’aucun de leurs mouvements, et qu’ils sont constamment exposés au mépris, à l’insulte et à des châtiments arbitraires, la mort simple cesse d’être une peine ; il faut, pour qu’elle devienne redoutable, qu’elle soit accompagnée de tourments qui excèdent par leur intensité, toutes les douleurs répandues dans le cours de la vie. Il fallut donc que les Romains qui voulaient punir de mort leurs esclaves, imaginassent des supplices propres à effrayer les hommes les plus fatigués de supporter la vie. Ces supplices ne pouvaient être déterminés que par les caprices des maîtres, puisque les lois ne voyaient dans les esclaves que des propriétés. L’usage de les déchirer à coups de verges, et de les clouer ensuite à une croix, fut le genre de supplice le plus généralement adopté. Les tourments de l’individu qu’on avait ainsi cloué, duraient plusieurs jours avant que la mort vînt y mettre un terme, à moins que, par pitié, l’exécuteur n’eût attaqué quelqu’une des parties essentielles à la vie. Les écrivains qui nous ont donné la description de ce supplice, ne disent pas qu’on en ait exempté les femmes, ni même les enfants de l’âge le plus tendre, qu’on condamnait à périr quand leur maître était mort par une cause inconnue [91].
Cependant, il est un degré de misère qu’aucune crainte ne saurait rendre supportable ; les esclaves romains se révoltèrent souvent, quelque soin que les maîtres prissent de les abrutir et de les diviser. Les nombreuses séditions que les historiens [IV-100] rapportent sont presque toutes causées par des débiteurs réduits en esclavage [92]. Les esclaves d’origine étrangère ne pouvaient pas trouver les mêmes ressources dans la population libre ; ils n’y avaient ni parents, ni amis, ni patrons ; pour eux, personne dans la république n’éprouvait la moindre sympathie. Néanmoins, ils parvinrent à organiser des conspirations, et se montrèrent quelquefois redoutables à leurs possesseurs ; mais leurs efforts furent toujours trahis par leur inhabileté dans les armes ; ils n’eurent pas d’autres résultats que d’augmenter la dureté des maîtres, et d’accroître les malheurs de leurs victimes.
L’orgueil qui se manifesta dans l’aristocratie romaine, dès le moment de sa formation, ne fit que s’accroître à mesure que les patriciens étendirent leur pouvoir sur un plus grand nombre d’esclaves. Les hommes qui n’appartenaient pas à cette caste et qu’on désignait sous le nom de plébéiens, furent d’abord tellement avilis, qu’ils furent exclus des fonctions civiles, des fonctions sacerdotales, et des commandements militaires. Les patriciens, craignant de souiller la pureté de leur sang par des alliances avec des plébéiens, s’interdirent eux-mêmes, par une loi, d’épouser des personnes qui n’appartiendraient pas à leur caste ; ils ne laissèrent aux autres femmes que l’honneur d’aspirer à être leurs concubines. En même temps qu’ils opprimaient, en qualité de corps privilégié, la multitude placée au-dessous d’eux, chacun des membres de ce corps vendait sa protection à une fraction de cette multitude. Il était impossible que cette protection diminuât en rien les privilèges des patriciens, puisque, dans chaque cause, les protégés n’avaient pour appui qu’un seul individu contre l’aristocratie tout entière. Mais si les protégés y gagnaient peu de chose, les protecteurs y gagnaient beaucoup : les clients, qui ne pouvaient pas épouser les filles de leurs patrons, étaient obligés de leur faire une dot, si elles n’étaient pas riches ; ils étaient obligés de plus de les racheter eux et leurs enfants, s’ils tombaient en servitude [93]. Toute personne qui n’appartenait pas à la classe aristocratique, devait se choisir un patron parmi ses membres, et tout individu qui avait un patron, était abject [94].
Si l’orgueil des grands possesseurs d’hommes était excessif à l’égard des individus qui se trouvaient dans les rangs des plébéiens, il était bien plus énergique encore à l’égard des hommes qui avaient passé par l’état d’esclave. Le titre seul d’affranchi inspirait un tel mépris pour celui qui le portait, qu’il a passé jusqu’à nous, à travers les siècles et les révolutions ; nous jugeons tous comme si nous étions des descendants de sénateurs romains. Ce mépris ne s’arrêtait pas sur les individus qui avaient eu le bonheur d’échapper à la servitude : il passait à leurs descendants et les poursuivait jusqu’à la dernière postérité. Quant aux hommes qui se trouvaient en état d’esclavage, les maîtres les voyaient à une telle distance au-dessus d’eux, qu’ils ne pouvaient pas s’imaginer qu’ils eussent quelque chose de commun ensemble.
Les hommes qui ne tendent vers leur prospérité qu’en se livrant à l’étude des choses, ou en agissant sur elles, n’ont aucun succès à attendre de la ruse ou de la fourberie : ce n’est point par surprise qu’un agriculteur peut tirer de ses champs une riche moisson, ou qu’un manufacturier peut mettre en jeu des machines ; pour eux, il n’y a de succès que dans la vérité, ni de ruine que dans l’erreur. Mais il n’en est pas de même des hommes aux yeux desquels l’industrie est avilissante, qui ne voient l’honneur que dans le commandement, et qui fondent leur prospérité sur le travail gratuit du reste de la population ; pour ceux-ci, la ruse et la mauvaise foi se placent parmi les premiers moyens de succès ; la franchise et la vérité sont des causes de ruine. Nous ne connaissons, en effet, aucun peuple qui ait porté l’art de séduire, de corrompre ou de tromper les hommes, aussi loin que l’aristocratie romaine ; pour maintenir ses esclaves dans l’obéissance trois moyens lui suffisaient : l’abrutissement, la force et la terreur ; mais, pour réduire les plébéiens à n’être, dans ses mains, que des instruments, ou pour subjuguer et dépouiller les nations étrangères, elle avait besoin de plus de recourir à la ruse et à la perfidie. Aussi ne cessa-t-elle jamais d’en faire usage, depuis son origine jusqu’à sa destruction ; l’art profond avec lequel elle trompa les nations, lui servit peut-être plus à les rendre esclaves que les armes de ses légions [95].
[IV-104]
On peut juger par ce qui précède, des effets que l’esclavage produisit sur les mœurs de cette partie du peuple qui tenait le milieu entre l’aristocratie et ses esclaves. La plupart des vices que j’ai déjà fait observer lui étaient communs avec les patriciens ; on trouvait chez les uns comme chez les autres, le mépris du travail, l’amour de l’oisiveté, le besoin des jouissances physiques, l’avidité, la passion des spectacles les plus grossiers, la cruauté, l’orgueil, la perfidie et la vengeance. Quelques-uns de ces vices étaient modifiés cependant par la différence des positions sociales ; le patricien, dans son orgueil, ne voyait rien au-dessus de lui ; le plébéien était orgueilleux à l’égard des esclaves, des affranchis et des étrangers qu’il opprimait ; mais, à l’égard de l’aristocratie, il était l’homme le plus vil et le plus rampant ; il avait encore moins d’indépendance et de dignité personnelle, que n’en ont chez les modernes les mendiants de profession [96]. On verra mieux quelles furent les mœurs de cette classe de la population, quand j’exposerai l’influence de l’esclavage sur la nature du gouvernement, et sur les rapports des nations entre elles [97].
[IV-106]
CHAPITRE VII. ↩
De l’influence de l’esclavage sur les mœurs des maîtres et des esclaves dans les colonies modernes, et particulièrement dans les colonies hollandaises.
Les effets moraux que l’esclavage de la glèbe a produits sur les mœurs des maîtres et des esclaves, après la chute de l’empire romain, sont analogues à ceux que j’ai exposés dans le chapitre précédent ; cependant, ils se sont manifestés avec moins d’énergie, parce que la domination a été moins violente : chez les Romains, l’esclavage produisit dans la race des maîtres le mépris de tous les travaux industriels ; chez les modernes, il a produit un effet semblable, et il n’a pas encore complètement cessé : chez les premiers, pour vivre honorablement, il fallut vivre aux dépens d’une partie de l’espèce humaine, subjuguer des hommes par la ruse ou par la force, s’emparer des richesses déjà produites par eux, et les forcer à en reproduire de nouvelles pour s’en emparer encore, furent les seuls emplois que se réserva l’aristocratie ; chez les seconds, il n’a été permis de s’enrichir que par le pillage des nations vaincues, ou par les contributions levées sur les classes laborieuses ; les richesses acquises par l’industrie et le commerce ont été longtemps considérées comme viles, et dignes tout au plus des affranchis : les premiers repoussaient des fonctions publiques toutes personnes qui n’étaient pas sorties de leurs rangs ; les seconds ont tenu la même conduite toutes les fois qu’ils en ont eu la puissance : ceux-là considéraient toute alliance avec une famille qui n’était pas de la classe des maîtres, comme propre à souiller la pureté de leur sang ; ceux-ci ont porté un jugement semblable. Il serait inutile de pousser plus loin la comparaison, puisque, parmi nous, il n’existe rien de semblable à ce qui avait lieu en Europe avant la chute de l’empire romain.
Habitués à juger des peuples de l’antiquité par des héros de théâtre ou par les descriptions fantastiques des poètes, nous ne pouvons passer des possesseurs d’hommes des anciens temps, aux possesseurs d’hommes des colonies modernes, sans faire à nos idées une forte violence. Cependant, dans tous les pays, à toutes les époques et chez toutes les races, des causes semblables ont produit les mêmes effets. Nous avons vu, dans le quatrième chapitre de ce dans toutes les colonies modernes où l’esclavage a été établi, les maîtres ont considéré le travail comme avilissant, qu’ils l’ont abandonné à leurs esclaves, et ont cessé d’appliquer leurs organes physiques et même leurs facultés intellectuelles, à la production des choses nécessaires à leur existence. Sous ce rapport, ils ont été dans la même position, et ont pris les mêmes idées que les possesseurs d’hommes de l’antiquité ; mais, sous d’autres rapports, leur position a été différente. Les Romains, pour remplacer les esclaves que les misères attachées à la servitude faisaient incessamment périr, pour en multiplier le nombre, pour dépouiller les nations dont ils convoitaient les richesses, et pour se garantir des agressions étrangères, étaient obligés d’avoir sans cesse les armes à la main ; ils étaient, par conséquent, dans la nécessité d’exercer continuellement leurs forces physiques. Les possesseurs d’hommes des colonies modernes n’ont pas été, en général, dans la même nécessité ; ils n’ont pas eu besoin, comme les Romains, de faire la traite à main armée ; d’avides et féroces spéculateurs l’ont faite pour eux. Ils n’ont pas eu besoin de s’exercer aux armes pour leur défense ; les gouvernements, sous la protection desquels ils ont acquis des esclaves, se sont chargés de veiller à leur sûreté, et de les garantir des dangers auxquels les exposeraient leur cruauté, leur orgueil et leur avarice. Ils n’ont pas eu besoin de se procurer par les armes les objets de luxe qu’ils ne peuvent obtenir du travail de leurs esclaves ; des gouvernements ont établi, à leur profit, dans la mère-patrie, le monopole des denrées que ces esclaves peuvent produire, et ce monopole leur a donné le moyen d’acquérir les richesses qui ne peuvent être produites que par des mains libres. Ils ont été délivrés ainsi de tout travail de corps et d’esprit ; ils n’ont eu qu’à s’abandonner à l’oisiveté, et à s’occuper de leurs jouissances physiques ; et c’est en effet à cela que se bornent leurs soins.
Les possesseurs d’esclaves du cap de Bonne-Espérance ne connaissent pas de jouissances plus vives que de se livrer à l’oisiveté, et de satisfaire leur appétit ; boire, manger, dormir, ou faire quelques visites, sont les principales occupations d’un colon [98]. Pour lui, tous les jours se ressemblent ; et voici comment il en fait l’emploi : à peine est-il levé, qu’il boit son café, et fume sa pipe en se promenant, en bonnet de nuit, devant sa porte ou autour de sa maison ; à neuf heures, il déjeune copieusement, reprend sa pipe, se promène ou fait des visites jusqu’à midi ; à midi, il se remet à table, fait un dîner plus copieux encore, se couche, et dort jusqu’à cinq heures ; en se réveillant, il reprend sa pipe, se met à boire, se promène ou fait des visites pendant trois ou quatre heures ; à neuf heures, il se remet à table ; on lui sert huit, dix et même vingt plats de viande et de poisson, accommodés de diverses manières ; il boit et mange comme si ce qu’il a bu et mangé dans la journée n’avait fait qu’aiguiser son appétit : c’est ainsi, dit Barrow, que tous les jours ce glouton s’abandonne à la paresse et s’engraisse dans le sommeil [99].
[IV-110]
L’oisiveté et la gloutonnerie ne sont pas le partage seulement des riches possesseurs d’esclaves qui vivent à la ville ; les fermiers eux-mêmes sont d’une paresse sans égale, dans toute l’étendue de la colonie ; dormir et manger est l’emploi de toute leur vie ; ils laissent incultes des terres qui fourniraient aux besoins d’un grand nombre de familles industrieuses ; ils renoncent même à se procurer du pain et des végétaux salutaires, plutôt que de se livrer à un léger travail ; ils se contentent de la chair que leur fournissent leurs troupeaux, parce que, pour l’obtenir, il ne leur faut ni travail, ni intelligence [100].
Il n’y a pas plus d’activité chez les femmes que chez les hommes, elles se lèvent, boivent, mangent et dorment aux mêmes heures que leurs maris ; leurs occupations se bornent à gourmander leurs esclaves et à leur assigner leur travail ; elles se débarrassent même du soin de leurs enfants, quand elles en ont le moyen : chacun d’eux est commis par elles à la garde et aux soins d’un esclave [101].
Chez les Romains, les maîtres appartenant à la même espèce d’hommes que les esclaves, les enfants nés dans l’esclavage n’apportaient, en venant au monde, aucune marque au moyen de laquelle on pût juger des liaisons qui existaient entre les femmes esclaves et leurs maîtres ; il n’en a pas été de même dans les colonies modernes ; toutes les fois qu’une femme esclave a donné le jour à un enfant, on a pu juger, par la couleur de cet enfant, à quelle espèce d’hommes appartenait son père. Il a été d’autant plus difficile de se tromper sur les liaisons des maîtres avec leurs femmes asservies, qu’il n’y a jamais eu de mariage entre les blancs et les noirs ; tout enfant de sang mêlé a été le produit d’une union immorale, il a été presque toujours le fruit de la violence du maître sur son esclave. Ainsi, pour connaître quels sont les effets que l’esclavage produit sur les mœurs, relativement à l’union des sexes, il est peu nécessaire de rechercher, dans les voyageurs, quelles sont les relations qui existent entre un maître et les femmes qu’il possède à titre d’esclaves ; il suffit d’examiner quelles sont les couleurs diverses entre lesquelles la population se partage.
« En arrivant au cap de Bonne-Espérance, dit Levaillant, on est surpris de la multitude d’esclaves aussi blancs que les Européens qu’on y voit [102]. » Cependant, jamais aucun blanc n’a été réduit en esclavage dans ce pays ; les esclaves, au contraire, y ont toujours été d’origine éthiopienne. Comment est-il donc arrivé que leurs descendants sont devenus blancs ? Par une longue suite de violences des maîtres sur les femmes réduites en servitude. De leurs liaisons avec des Éthiopiennes sont nées des filles mulâtres ; de leurs liaisons avec celles-ci sont nées des filles moins foncées encore ; enfin, les traces de sang éthiopien ont disparu, et les esclaves ont fini par être de la même espèce que leurs possesseurs.
Mais, dans ce changement de races, il est un phénomène qu’il est important d’observer, parce que nous le retrouverons dans presque toutes les autres colonies. Un colon n’affranchit pas les enfants qui naissent de lui et de ses femmes esclaves ; il exige d’eux les travaux et la soumission qu’il exige de tous les autres. Il les vend, les échange ou les transmet à ses héritiers selon qu’il le juge convenable. Si un de ses enfants légitimes les reçoit à titre de succession, il ne fait entre eux et ses autres esclaves aucune distinction ; un frère devient ainsi le propriétaire de ses sœurs et de ses frères. Il exerce sur eux la même tyrannie ; il exige d’eux les mêmes travaux ; il les déchire du même fouet ; il assouvit sur eux les mêmes désirs. Cette multitude d’esclaves blancs qui étonnent les regards d’un Européen, sont donc presque toujours les fruits de l’adultère et de l’inceste. Un voyageur observe qu’il existe si peu d’affection entre les parents, dans cette colonie, qu’on voit rarement deux frères converser ensemble [103]. Comment un frère pourrait-il avoir de la tendresse pour un autre, quand peut-être il a dix ou douze frères et sœurs qu’il considère comme la plus vile des propriétés, et qu’il emploie à satisfaire les passions les plus brutales ? Chez les gens sans éducation, les mœurs se manifestent ordinairement par le langage, et, suivant Barrow, celui des habitants du Cap est d’une indécence qu’on ne tolérerait dans aucune société [104].
Les esclaves ayant plus ou moins de valeur, selon qu’ils tiennent plus ou moins de l’espèce blanche ou de l’espèce noire, les colons favorisent les liaisons de leurs femmes esclaves avec les soldats européens préposés à la garde de la colonie ; toute négresse que son maître ne réserve pas pour son usage, obtient de lui la permission de consacrer le dimanche au soldat de la garnison qui a daigné l’honorer de ses regards [105].
Toutes les fois que dans un pays on voit une partie de la population vivre dans l’oisiveté, la mollesse et l’abondance, on peut être assuré qu’il en existe une autre partie beaucoup plus nombreuse, qui vit dans une extrême misère, et qui est condamnée à un travail sans relâche. Au cap de Bonne-Espérance, les possesseurs d’hommes ne travaillent jamais, et consomment une quantité d’aliments immense. Les esclaves employés à la culture sont mal nourris, mal vêtus, accablés de travaux, et châtiés avec la plus grande rigueur [106]. Les esclaves attachés au service personnel de leurs maîtres et vivant à la ville, sont les seuls qui soient bien vêtus et bien nourris [107]. Il y a, entre eux et ceux qui sont employés aux travaux des champs, la même différence qu’il y a, dans certains États de l’Europe, entre les laquais qui fourmillent dans les maisons des grands, et les ouvriers qui vivent dans la misère en travaillant quatorze heures par jour. C’est de l’analogie qu’on observe entre les hommes qui commandent, que naît l’analogie qu’on observe entre les hommes qui obéissent. Nous trouverons le même phénomène dans toutes les colonies.
Les esclaves employés aux travaux les plus pénibles n’y étant excités par l’espérance d’aucun profit, il n’y a que la crainte des châtiments qui puisse les y contraindre ; la cruauté des colons envers eux est telle, qu’il n’est aucun voyageur qui n’en ait été révolté. La moindre contradiction, le moindre retard dans l’exécution de leurs désirs les irritent et les rendent féroces ; ils finissent par trouver, dans l’exercice de la cruauté, une sorte de jouissance.
« J’ai connu quelques colons, dit Sparrman, qui, non seulement dans la chaleur de la colère, mais de sang-froid et par réflexion, ne rougissaient pas de se faire eux-mêmes bourreaux, de déchirer, pour la moindre négligence, le corps et les membres de leurs esclaves, de prolonger exprès leur supplice et leurs tortures, et, plus cruels que des tigres, de jeter sur leurs blessures du poivre et du sel ; mais, ce qui me parut encore plus étrange et plus horrible, ce fut d’entendre un de ces colons chrétiens décrire, avec une apparence de satisfaction, tout le procédé de ces exécutions diaboliques, et même se glorifier de les pratiquer lui-même, s’épuiser en sophismes pour justifier ces excès, et, en général, le trafic des esclaves auquel il était personnellement intéressé [108]. »
L’instrument dont les colons se servent pour châtier leurs esclaves, est un fouet d’une énorme dimension, dont ils font également usage pour conduire les chevaux. Ils l’appliquent quelquefois avec tant de fureur, que si la victime n’expire pas sous les coups, il est difficile qu’elle en échappe. Barrow, témoin des violences continuelles commises sur les esclaves, en rapporte quelques-unes qui peuvent faire juger des mœurs particulières à leurs maîtres.
« Nous vîmes, dit-il, une jeune femme hottentote, tenant un enfant dans ses bras, et gisant sur la terre dans l’état le plus déplorable. Elle avait été déchirée de la tête aux pieds avec un de ces fouets terribles faits avec du cuir de rhinocéros ou de vache marine, et connus sous le nom de sambocs. Son corps n’était exactement qu’une plaie ; son enfant, en se cramponnant autour d’elle, n’avait pas échappé aux coups. Nous eûmes beaucoup de peine à la mettre dans une situation propre à recevoir les secours de la médecine. Mais elle était tellement meurtrie et la fièvre éclata avec tant de violence, qu’on désespéra de sa vie pendant plusieurs jours. Le seul crime reproché à cette femme était d’avoir tenté de suivre son mari, qui était du nombre des Hottentots qui avaient résolu d’implorer la protection anglaise [109]. »
« La ferme voisine, ajoute le même voyageur, nous offrit un exemple de brutalité encore plus horrible. Nous vîmes dans un coin de la maison un bel enfant hottentot d’environ sept ans, qui avait aux pieds une chaîne de fer de dix ou douze livres ; ses jambes étaient enflées, et les fers pénétraient dans les chairs. Ce pauvre enfant était si accablé sous leur poids, qu’il se traînait et ne pouvait marcher ; il y avait plus d’un an qu’il était dans cet état [110] ».
Quelquefois, la colère des maîtres l’emporte sur leur cruauté, et ne leur laisse pas le temps de prolonger les tourments de leurs esclaves ; suivant le témoignage du même voyageur, un Hottentot refusant de fusiller un déserteur, sur l’ordre de son maître, celui-ci l’étendit à ses pieds d’un coup de fusil, et fit massacrer ensuite le déserteur, sa femme et son enfant [111].
Le gouvernement hollandais, pour mettre un frein à la cruauté des colons, leur avait défendu de leur donner la mort ; il avait même autorisé les esclaves à porter plainte devant les magistrats, dans les cas où ils seraient injustement maltraités ; mais ces règlements n’ont jamais été exécutés [112].
« Si un blanc tue son esclave, dit Barrow, il l’enterre et on n’en parle plus ; s’il tue celui d’un autre, il se tire d’affaire en payant sa valeur au maître, à moins que celui-ci, implacable dans son ressentiment, ne le traduise devant la cour de justice, ce qui, je crois, n’est jamais arrivé [113]. »
En même temps qu’un maître, ou même tout homme libre, peut impunément maltraiter un esclave, il est interdit à celui-ci, sous peine de mort, de lever la main pour se défendre : le seul acte d’avoir frappé un Européen est puni du dernier supplice, parce qu’on présume que le coup a été porté dans l’intention d’assassiner [114].
La mort réservée aux esclaves n’est pas la simple privation de la vie. Les maîtres ont senti, comme ceux de l’antiquité, qu’un tel châtiment paraîtrait léger à des êtres pour lesquels la vie n’est qu’un long supplice. Ils ont donc cherché un genre de mort qui pût remplacer la crucification dont les Romains faisaient usage. Sparrman a plusieurs fois été témoin des peines infligées aux esclaves ; il les a vu déchirer par le fouet, ou livrer au dernier supplice, et il en rend compte dans les termes suivants :
« J’ai plusieurs fois été témoin, dit-il, de ces scènes atroces. J’ai souvent entendu, surtout le matin et le soir, les cris et les gémissements de ces malheureux. Dans ces cruels instants, ils demandent grâce ; mais, m’a-t-on dit, ils implorent avec encore plus d’instance un verre d’eau qu’on a grand soin de leur refuser, tant leur sang est enflammé par les souffrances. L’expérience a montré qu’alors un verre d’eau, ou toute autre boisson, leur donnait la mort dans l’espace de quelques heures et quelquefois dès qu’ils avaient bu. La même chose arrive aussi à ceux qui sont empalés vivants, après avoir été rompus, ou même sans avoir subi ce supplice. On leur enfonce la pique le long du dos et des vertèbres du cou, entre la peau et l’épiderme, en sorte que le patient est dans la position d’un homme assis. Cependant, quelques-unes de ces victimes vivent encore l’espace de plusieurs jours dans cette position, lorsque le temps est sec ; mais, s’il devient pluvieux, leurs plaies se gangrènent, et leurs tourments finissent en quelques heures avec leur vie [115].
Les cadavres des hommes qui ont ainsi péri dans les supplices, sont suspendus à des chaînes sur les grands chemins ; et ils y restent jusqu’à ce qu’ils soient dévorés par les vautours, ou qu’ils tombent en pourriture [116].
La perfidie n’est pas considérée comme un vice par les colons : quiconque trompe son voisin, dit Barrow, passe pour un habile homme. La vérité n’est pas au nombre des vertus morales, et le mensonge est pris pour de l’esprit. La propriété n’est pas plus respectée que la vérité ; le vol n’est pas regardé comme une action criminelle ; il ne déshonore pas. En un mot, les colons, suivant le même voyageur, n’ont de l’activité que pour faire le mal : ils applaudissent toujours aux crimes heureux [117].
Indifférents sur tout ce qui touche à leur réputation relativement aux mœurs, les colons sont d’une susceptibilité extraordinaire sur la distinction des rangs. L’homme qui donne sa fille à l’individu le plus infâme, sans craindre de déroger, se croirait déshonoré si sa femme ou sa fille avaient perdu leur rang à l’église. La préséance est une des principales causes de leurs nombreuses querelles ; avoir le premier pas dans l’église, ou placer son siège le plus près de la chaire, est pour eux une affaire de la plus haute importance [118]. Leur orgueil, qui leur fait voir avec tant de mépris toute personne qu’ils jugent d’un rang inférieur, se manifeste envers tout homme dont ils n’ont rien à espérer ni rien à craindre, et particulièrement envers les étrangers. La plupart d’entre eux n’ont cependant pour ancêtres que des mendiants, des malfaiteurs et des prostituées, qui furent jadis déportés dans ce pays par le gouvernement hollandais. Mais en même temps que les colons manifestent le plus insolent orgueil envers tout homme qu’ils supposent d’un rang inférieur au leur, ils se montrent d’une servilité et d’une bassesse sans bornes, envers les principaux membres du gouvernement auquel ils sont soumis : ils réunissent ainsi dans leurs personnes les vices des maîtres et ceux des esclaves [119].
Les possesseurs d’hommes de la Guyane ont, sous plusieurs rapports, les mêmes mœurs que ceux du cap de Bonne-Espérance ; cependant, comme il existe plusieurs différences entre la nature du sol et des productions des deux pays, on observe dans les mœurs et dans les rapports qui existent entre les diverses classes de la population, des différences correspondantes.
Le sol du cap de Bonne-Espérance est généralement pauvre ; il est employé à élever des troupeaux, à produire les mêmes espèces de grains qu’on recueille en Europe, et différentes espèces de vins. Si l’on fait exception des vins, tous les produits du pays sont consommés sur les lieux, ou vendus aux navigateurs qui manquent de provisions. Aucun de ces produits n’exige de travaux pénibles et continus ; ceux qui sont les plus nécessaires à la vie, sont ceux qui exigent le moins de fatigues, et qui se vendent au plus bas prix. La viande de boucherie, qui est la base de la subsistance de la population, se donne presque pour rien. Il résulte de là que les maîtres ne peuvent ni acquérir de grandes richesses, ni s’adonner à un grand luxe ; et qu’ils ne sont excités par aucun intérêt puissant, à exiger de leurs esclaves un travail excessif, ou à les priver des aliments qui leur sont nécessaires pour réparer leurs forces. Un esclave préposé à la garde d’un troupeau, n’a pas à se donner beaucoup plus de peine qu’un homme libre ; il peut être presque aussi paresseux que son maître. Le cultivateur qui peut bien nourrir un esclave avec une valeur de deux ou trois sous par jour, ne peut aspirer à faire de grandes économies sur sa nourriture. Aussi, quoique les esclaves de cette colonie soient durement traités, ils sont moins mal nourris que ceux des autres colonies.
Le sol de la Guyane est, au contraire, d’une très grande fertilité ; la chaleur du climat le rend impropre à servir de pâturage, ou à produire des céréales ; mais elle le rend très propre à produire du sucre ou d’autres denrées qui ne croissent qu’entre les tropiques. Ces productions ne s’obtiennent que par de longs et pénibles travaux ; elles ont, comparativement aux céréales et à la viande de boucherie, une grande valeur, et sont généralement destinées à l’exportation. Il résulte de là que les maîtres peuvent avoir plus de luxe et se donner des jouissances plus nombreuses et plus variées que les colons du cap de Bonne-Espérance ; mais il en résulte aussi qu’ils sont plus intéressés à exiger de leurs esclaves un travail plus pénible et plus continu, et à ne leur laisser que ce qui leur est rigoureusement nécessaire pour vivre. Les esclaves étant soumis à des fatigues plus dures, et n’ayant que des aliments peu abondants et de mauvaise qualité, perdent plus vite leurs forces et vivent moins longtemps ; mais les pertes que le maître fait de cette manière, sont plus que compensées par le surcroît de travail qu’il obtient d’eux, et par les économies qu’il fait sur leur subsistance et leurs vêtements [120].
Les différences dans la nature et les productions du sol et dans la température de l’atmosphère étant connues, on comprendra facilement les différences qui existent dans les mœurs des deux populations.
Les colons hollandais de la Guyane ont pour le travail, soit de corps, soit d’esprit, la même aversion et le même mépris que les autres possesseurs d’hommes : leur vie tout entière est consacrée à l’oisiveté et à la satisfaction de leurs jouissances physiques ; ils n’ont de distractions que celles qu’ils trouvent dans les châtiments de leurs esclaves et dans les soins de leur propre sûreté. Placé sous un climat brûlant, le planteur qui vit au milieu de sa plantation, se lève avec le soleil ; il se rend sous une espèce de portique appelé piazza : là il trouve son café, sa pipe, et six des plus beaux esclaves de l’un et de l’autre sexe prêts à le servir. Le chef de la plantation ou commandeur se présente pour faire son rapport de ce qui s’est passé la veille ou dans le cours de la nuit ; il est suivi des esclaves cultivateurs, coupables de quelque négligence, des esclaves exécuteurs, armés d’un fouet terrible, et de l’esclave chirurgien qui doit panser les blessures. Le rapport entendu, le maître fait un signe, et aussitôt les accusés sont attachés aux colonnes du portique ou à un arbre, et déchirés à coups de fouet, jusqu’à ce qu’un nouveau signe arrête la fureur des bourreaux. S’il est résulté des châtiments quelque blessure grave, l’esclave chirurgien la panse, et les esclaves punis sont renvoyés au travail. À son tour, le chirurgien fait son rapport sur la santé des autres esclaves, et les plus jeunes sont passés en revue.
« Sa seigneurie, dit Stedman, se promène alors dans son vêtement du matin, qui consiste en un caleçon de toile de Hollande, la plus fine, en bas de soie blancs, et en pantoufles de maroquin jaune ou rouge ; le col de sa chemise reste ouvert, et il ne porte en-dessus qu’une robe flottante de belle toile des Indes ; sa tête est couverte d’un bonnet de coton d’une finesse extrême, et d’un énorme castor qui garantit de l’ardeur du soleil son maigre et sombre visage…
« Ayant erré lentement autour de sa maison, ou étant monté à cheval pour visiter ses champs et calculer l’augmentation de ses richesses, il revient sur les huit heures, afin de s’habiller s’il a envie de faire quelques visites, sinon il reste tel qu’il est. Dans le premier cas, il échange seulement son caleçon contre une culotte d’une toile légère ou de soie ; ensuite, il s’assied, et tend les deux jambes à un jeune nègre qui les chausse ; un autre en même temps le coiffe ou le rase ; un troisième est occupé à écarter de lui les moustiques. Cette partie de sa toilette achevée, il prend une autre chemise, passe un autre habit toujours de toile blanche ; alors, sous un vaste parasol porté par un jeune nègre, on le conduit à sa barge, qui l’attend avec six ou huit rameurs, et que son commandeur a eu soin de pourvoir de fruits, de vin, d’eau et de tabac. S’il ne s’éloigne pas de la plantation, il déjeune à dix heures. À la chaleur du jour, il s’étend dans son hamac et dort. Pendant son sommeil, deux jeunes négresses l’éventent pour le rafraîchir. À trois heures, il s’éveille, se lave, se parfume, et se met à table où il trouve tout ce qui peut flatter sa sensualité. À six heures, la même scène que le matin avec le commandeur, les esclaves qui ont failli et les exécuteurs ; ensuite, le punch, le jeu, la pipe. À dix heures, ajoute Stedman, monseigneur choisit dans son sérail celle de ses esclaves avec laquelle il veut passer la nuit. Le lendemain les mêmes scènes se répètent [121]. »
Il n’est pas besoin de dire qu’un maître qui est armé d’un pouvoir sans limites, qui ne vit habituellement qu’au milieu de ses esclaves, et qui n’a rien à craindre de l’opinion, ne saurait trouver aucune résistance chez les femmes soumises à son empire ; mais, ce qu’il faut observer, c’est que tous les hommes auxquels il délègue une part de sa puissance, jouissent à peu près du même privilège que lui ; le commandeur, sur le rapport duquel les esclaves sont châtiés, sans qu’il leur soit permis de rien dire pour leur défense, est plus redoutable que le maître lui-même, puisqu’il n’est pas arrêté par la crainte de détruire sa propriété; il n’y a pas jusqu’aux esclaves qui remplissent les fonctions de bourreaux, qui ne jouissent d’une sorte de puissance ; car, dans leurs mains, le fouet peut être un instrument plus ou moins terrible, selon qu’ils sont bien ou mal disposés.
Il arrive quelquefois cependant qu’une femme esclave résiste aux désirs du maître ou du commandeur, surtout si elle a fait un choix parmi ses compagnons d’infortune : en pareil cas, la résistance est punie par le châtiment le plus sévère. Le premier exemple de cruauté dont Stedman fut témoin, en arrivant à Surinam, fut produit par une telle cause. Une belle fille, âgée d’environ dix-huit ans, et entièrement nue, était attachée à un arbre par les bras. Dans cette position, deux nègres, armés de deux fouets énormes, lui en infligèrent deux cents coups. Au moment où Stedman l’aperçut, elle venait de subir son châtiment : la tête penchée sur le sein, le sang ruisselant de la tête jusqu’aux pieds, elle présentait le plus épouvantable spectacle.
« Je courus au commandeur, dit Stelman, et le suppliai de la faire détacher promptement, puisqu’elle avait totalement subi son supplice. Il me répondit tout simplement que, pour empêcher les étrangers de se mêler de son administration, il s’était fait une règle invariable de doubler le châtiment toutes les fois qu’on intercéderait pour le coupable, et le barbare fit recommencer l’exécution à l’instant. Je voulus, mais vainement, l’arrêter ; il me déclara que le moindre délai, loin d’arrêter sa détermination, ne rendrait sa vengeance que plus implacable et plus terrible. Je n’eus d’autre parti à prendre que de fuir ce détestable monstre, et de le laisser se rassasier de sang comme une bête féroce... Ayant cherché le motif de cette barbarie, j’appris avec certitude que le seul crime de cette infortunée était de s’être constamment refusée aux embrassements de son détestable bourreau [122]. »
Les femmes des maîtres n’ont pas des mœurs plus pures ni plus douces que celles de leurs maris ; elles s’abandonnent aux mêmes désordres qu’eux, quand elles en trouvent l’occasion, ou elles sont dévorées de jalousie, et se portent aux excès les plus violents envers les femmes esclaves qui sont l’objet de leurs soupçons. Stedman, qui raconte de si nombreux exemples de l’immoralité des hommes, a voulu se montrer moins sévère à l’égard des femmes ; il nous apprend cependant qu’elles s’abandonnent, en général, à toutes leurs passions, et principalement à la plus constante cruauté [123]. Il dit qu’en peu de mois les officiers qui étaient allés dans cette colonie pour soumettre ou détruire des esclaves réfugiés dans les forêts, furent, en grande partie, mis sur les bords de la tombe par les bontés des dames [124]. Il raconte qu’une des grandes dames de la colonie, dans les repas qu’elle donnait aux officiers, faisait servir ses convives par les plus belles de ses esclaves complètement nues, et qu’elle justifiait cet usage en disant qu’il leur enlevait le moyen de cacher leur grossesse. Enfin, il assure que l’impudence des femmes de la bonne compagnie était telle, qu’elle faisait rougir les officiers européens qui n’y étaient pas habitués [125]. Cependant il se fait un scrupule de révéler tous les faits dont il a été témoin : « Je dois, dit-il, tirer le rideau sur toutes les imperfections du sexe dans ce climat. »
La licence des mœurs ne calme pas les fureurs de la jalousie. Cette passion se montre d’autant plus terrible, que les malheureuses qui la causent sont dans un état plus abject, et qu’elles sont plus dénuées de protection. Une femme qui fait châtier une de ses esclaves, cherche surtout à la défigurer et à la rendre hideuse : c’est sur le sein qu’elle fait appliquer les coups de fouet, quelquefois même des coups de poignard. Stedman raconte qu’une dame créole apercevant dans sa plantation une jeune et belle esclave, lui fit aussitôt appliquer un fer brûlant sur le front, sur les joues et sur la bouche, et ordonna qu’on lui coupât en même temps le tendon d’Achille. Elle fit ainsi, en un instant, d’une belle personne une espèce de monstre de difformité. Les sentiments les plus exaltés chez tous les possesseurs d’hommes sont l’orgueil, et l’amour des jouissances physiques ; une femme esclave qui est l’objet des préférences de son maître, offense donc sa maîtresse de la manière la plus sensible ; elle l’humilie à ses propres yeux, et lui ravit une partie de ses plaisirs ; c’est plus qu’il n’en faut pour allumer sa vengeance et sa cruauté [126].
Les effets de la jalousie ne s’arrêtent pas sur les femmes qui en sont l’objet ; ils s’appesantissent particulièrement sur les enfants qui, par leur couleur, annoncent qu’ils doivent le jour à leur maître ou à des hommes de son espèce. Ces enfants, quel que soit le sexe auquel ils appartiennent, sont odieux aux femmes des maîtres, parce qu’ils sont une preuve irrécusable des préférences que leurs esclaves obtiennent sur elles ; mais, s’ils appartiennent au sexe féminin, ils sont odieux de plus, parce que leurs maîtresses voient en elles des rivales futures pour elles-mêmes ou du moins pour leurs filles [127].
Les maîtres pourraient mettre les enfants qu’ils ont de leurs esclaves, à l’abri des violences de leurs femmes : il leur suffirait de leur donner la liberté ; mais deux obstacles s’y opposent : les mœurs, et les lois qui n’en sont que l’expression. La tendresse qu’un père manifeste pour ceux de ses enfants qui sont nés dans l’esclavage est, en général, considérée comme une faiblesse et presque comme une folie. Leur donner la liberté, c’est se dépouiller d’une propriété utile et se priver de la faculté de disposer d’eux arbitrairement ; il les laisse donc confondus avec ses autres esclaves ; il les vend, il les échange, ou les transmet à son héritier [128].
On a pu, par ce qui précède, se faire une idée du luxe et des jouissances des possesseurs d’hommes à Surinam ; il reste à exposer par quels travaux et par quelles peines ces avantages sont achetés.
Le sucre est la principale denrée qu’on retire de ce pays ; et comme, dans toutes les colonies, cette denrée exige les mêmes travaux et demande les mêmes soins, on peut appliquer à toutes ce que je dirai d’une seule.
[IV-132]
Les travaux de l’agriculture, dans les colonies, sont tous exécutés à force de bras ; on ne fait usage ni de machines, ni de la force des animaux. Dès le lever du soleil, les claquements des fouets annoncent aux esclaves qu’il est temps de se rendre au travail. Dans chaque plantation, un conducteur, armé d’un fouet de charretier, les conduit aux champs par troupes ; et, pendant qu’ils travaillent, il marche à leur suite, pressant à coups de fouet ceux qu’il ne juge pas assez diligents [129]. Les enfants, dès l’âge de six ou sept ans, sont aussi menés aux champs par troupes, pour en arracher les mauvaises herbes ou pour se livrer à d’autres travaux. L’esclave qui les conduit est armée d’une longue baguette, et elle en frappe les plus tardifs ou les plus maladroits : pour eux, comme pour leurs pères, il n’existe pas d’autres motifs d’activité que les châtiments.
En même temps qu’ils sont soumis à des fatigues sans termes, et qu’ils sont sans cesse exposés à être déchirés à coups de fouet, les esclaves n’obtiennent qu’une nourriture peu abondante, peu substantielle, et qui jamais ne varie : c’est de la farine de manioc, quelques harengs, un peu de légumes qu’ils cultivent eux-mêmes. Il leur est rigoureusement interdit de manger de la canne à sucre qu’ils cultivent ; celui qui serait seulement soupçonné d’en avoir goûté aurait les dents arrachées [130].
[IV-134]
Les fautes ou les négligences sont punies, ainsi qu’on l’a déjà vu, par un nombre de coups de fouet appliqués sur les parties nues du corps, selon la volonté ou les caprices du maître ou du commandeur ; souvent aussi on fend le nez, ou on coupe les oreilles aux esclaves qui ont entre eux des querelles. Les règlements défendent aux maîtres de donner la mort à leurs esclaves ; mais ils sont aisément éludés ; le témoignage des blancs libres étant seul admis, il n’est pas possible de trouver des témoins pour convaincre les coupables. On ne trouverait d’ailleurs ni accusateurs pour le poursuivre, ni juges pour le condamner, puisque les magistrats appartiennent à la classe des maîtres et font cause commune avec eux. Aussi, n’est-il pas rare de trouver des colons qui se font un jeu de la vie de leurs esclaves ; s’ils en ont dont ils veulent se débarrasser, ils les entraînent avec eux à la chasse, et aussitôt qu’ils sont parvenus dans un lieu écarté, ils les tuent d’un coup de fusil. Quelquefois, ils les font périr dans de longs et douloureux supplices en présence de tous leurs autres esclaves, et alors la mort est attribuée à un accident, ou à la faiblesse de la constitution du patient [131].
Les fautes légères des esclaves étant punies par les châtiments les plus graves, et la vie étant dépouillée de tout ce qui peut la rendre chère, les fautes graves ou les délits ne peuvent être punis que par de grands supplices. Un esclave que l’excès du malheur porte à se détruire, doit prendre garde de ne pas survivre à la tentative qu’il fait ; car, s’il en échappe, il expie dans de longs tourments l’atteinte qu’il a voulu porter, dans sa propre personne, à la propriété de son possesseur. On le déchire à coups de fouet, en prenant garde toutefois de n’offenser aucune partie essentielle à la vie ; ou bien on le soumet au supplice du spanso-bocko, qui est plus cruel encore [132].
[IV-135]
Les colons s’adressent quelquefois aux magistrats pour faire punir leurs esclaves : ils ont cette précaution dans les cas où ils craignent que les esclaves n’expirent pendant l’exécution du châtiment ; si cela arrive quand c’est par ordre du juge que la peine est infligée, ils n’ont pas à craindre d’être condamnés à l’amende. Un maître qui a repris un esclave fugitif, peut requérir la cour de justice de lui faire couper une jambe, pour prévenir le même délit. Stedman, pendant son séjour à Paramaribo, vit neuf exécutions de ce genre, autorisées par les magistrats, et faites par le chirurgien de l’hôpital. Quatre des patients moururent immédiatement après l’opération, et un cinquième se fit mourir lui-même en arrachant ses bandages pendant la nuit [133]. Les crimes plus graves que la fuite, tels que la révolte, la résistance et autres semblables, sont punis des tourments les plus longs et les plus cruels que l’imagination des maîtres puisse inventer. Être brûlé à petit feu, rompu vif, ou écartelé par quatre chevaux, sont des supplices qu’on fait subir indistinctement à des vieillards, à des femmes et même à des enfants, et ces supplices ne sont pas rares. Si l’on veut prolonger les tourments du patient, on le suspend par les côtes à un crochet de fer, et il reste là vivant quelquefois pendant trois jours, les pieds et la tête pendants vers la terre [134].
La constance et la fermeté des esclaves se mettent au niveau de la cruauté des maîtres. Quelle que soit la rigueur des supplices qu’on leur inflige, il ne leur arrive presque jamais de proférer une plainte. Ils montrent, dans les tourments, la constance que nous avons observée chez les sauvages tombés dans les mains de leurs ennemis. Quelquefois, ils cherchent à irriter leurs bourreaux par des sarcasmes ou des plaisanteries ; ils les bravent en accusant leur cruauté d’impuissance. Savoir souffrir et mourir est la seule gloire dont les maîtres ne puissent priver leurs esclaves [135].
L’orgueil des maîtres dans cette colonie est égal à leur cruauté. Ils considéreraient comme une insolence intolérable de la part d’un esclave, l’action de boire ou de manger en leur présence, ou en présence d’un homme de la même espèce qu’eux. Un mot, même un regard, qui ne porteraient pas ce caractère d’abaissement qu’on exige de la population asservie, seraient suivis des châtiments les plus terribles. L’esclave qui passerait auprès d’un simple matelot et qui négligerait de lui donner quelques signes de respect, s’exposerait à avoir le crâne fracassé à coups de bâton, pour une telle insolence. Cette susceptibilité n’existe pas seulement à l’égard des esclaves ou des hommes de couleur ; elle existe à l’égard de tout homme qu’un maître juge d’un rang inférieur au sien [136].
On pourrait supposer que les mœurs que nous observons dans les colonies hollandaises, tiennent à d’autres causes qu’à l’existence de l’esclavage et à l’espèce de culture à laquelle les esclaves sont employés ; on pourrait croire que les premiers habitants de ces colonies n’ont été que le rebut de la société de la mère-patrie, et que les mœurs actuelles ne sont que des conséquences nécessaires des mœurs qui existaient à l’époque de la colonisation ; mais on va voir qu’il existe des mœurs semblables dans les colonies anglaises, françaises et espagnoles, où l’esclavage est admis, et où l’on observe quelque analogie dans la nature des travaux auxquels la population asservie est assujettie.
Les mœurs des Hollandais établis dans les îles de la Sonde, nous sont un peu moins connues que celles des colons du Cap, et de ceux de la Guyane. On voit cependant, par ce qu’en disent les voyageurs, qu’elles diffèrent peu de celles que nous avons déjà observées ; l’oisiveté, l’orgueil et la cruauté sont les caractères qui, dans ces îles, ont frappé d’abord les observateurs. On a vu précédemment que l’aversion des Hollandais pour tout genre d’occupation y est si forte, que, sans les Chinois, ils seraient exposés à manquer de tout. L’orgueil a marqué les rangs, dans ces îles, avec autant de force que dans aucun pays. Les titres de grand-marchand, de marchand, de sous-marchand, de teneur de livres, d’assistant, répondent aux titres de prince, de duc, de conte, de marquis, de baron, de chevalier. Ceux qui les portent se distinguent par un costume particulier, et ont plus de morgue et d’insolence que n’en a la noblesse dans aucun pays de l’Europe. Les chefs militaires portent les mêmes titres : un major peut prétendre au rang de grand-marchand ; un capitaine n’est élevé qu’au rang de sous-marchand [137]. Les chefs supérieurs ne sortent jamais de chez eux sans se faire précéder de gardes. Quand un gouverneur passe dans sa voiture, tout le monde s’arrête, les personnes qui sont en équipage mettent pied à terre, et l’on s’incline avec respect devant la dignité du grand personnage ; les sénateurs seuls sont exceptés de cette marque de respect. Les grands exigent pour leurs femmes tous les mêmes honneurs qu’ils exigent pour eux [138].
Dans les pays où l’esclavage existe, le premier titre à la considération, c’est d’être de la race des maîtres ; la première cause de mépris, c’est d’être de la race des esclaves. Ces dispositions se manifestent à Batavia avec la même énergie que dans la Guyane et au cap de Bonne-Espérance. Si des hommes de la race des maîtres commettent des crimes, ils n’en sont point punis, ou ils ne le sont que très légèrement ; mais, si des hommes de la race asservie commettent des fautes, ils sont pendus, rompus vifs, ou empalés sans miséricorde [139].
[IV-140]
CHAPITRE VIII. ↩
De l’influence de l’esclavage domestique sur les mœurs des maîtres et des esclaves dans les colonies anglaises.
Les colonies anglaises, dans les îles ou sur le continent d’Amérique, peuvent être divisées en deux classes, selon le plus ou le moins de fertilité du sol : les unes ne sont pas assez fertiles pour que le sucre puisse y être avantageusement cultivé ; elles produisent des denrées qui sont, en grande partie, consacrées à la consommation immédiate des habitants : la principale production des autres, au contraire, consiste en sucre ; et cette denrée est exportée, soit dans la mère-patrie, soit dans d’autres pays. Le traitement des esclaves est dur dans toutes ; mais il l’est infiniment plus dans les dernières que dans les premières : dans celles-ci, ils sont mieux nourris, moins accablés de travail, et moins châtiés que dans celles-là. Les raisons de cette différence sont les mêmes que celles que j’ai fait observer, dans le chapitre précédent, en parlant du cap de Bonne-Espérance et de Surinam [140].
[IV-141]
Un grand nombre des propriétaires des colonies anglaises, ceux particulièrement dont les terres sont assez riches pour produire du sucre ou d’autres denrées propres à l’exportation, résident habituellement en Angleterre avec leurs familles, et font diriger leurs plantations par des agents. N’ayant aucun rapport direct avec leurs esclaves, n’exigeant rien d’eux par eux-mêmes, et ne leur faisant infliger spécialement aucune punition, ils ne peuvent prendre les mœurs qui caractérisent les maîtres. Leurs femmes et leurs enfants sont encore plus qu’eux-mêmes à l’abri de l’influence de l’esclavage ; car ils ignorent ou ne connaissent qu’imparfaitement les sources des revenus dont ils vivent. La qualité de possesseurs d’hommes doit donc influer moins fortement sur leurs idées et sur leurs habitudes sociales ; la principale influence qu’elle produit sur eux, c’est de fausser leur jugement sur les principes de la morale, de les placer plus que les autres Anglais sous la dépendance de leur gouvernement, et de les disposer par conséquent à soutenir toutes ses mesures [141].
[IV-142]
Mais, quoique les facultés intellectuelles et morales des maîtres qui vivent en Angleterre soient moins affectées par l’existence de l’esclavage dans les colonies, que les facultés intellectuelles et morales de ceux qui vivent parmi leurs esclaves ; quoiqu’ils ne puissent pas ressentir cet appétit de toutes les jouissances physiques, que nous avons observé chez les colons du cap de Bonne-Espérance et de Surinam, ils ne sont guère moins intéressés à exiger de leurs esclaves tout le travail qu’il est possible d’obtenir d’eux, et à ne leur laisser que ce qui leur est rigoureusement nécessaire pour vivre.
Un planteur qui vit au milieu de sa plantation est intéressé à faire croître, au moins pour sa consommation personnelle et celle de sa famille, diverses espèces de végétaux qu’on ne peut jamais tirer de loin ; il est également intéressé à élever quelques espèces d’animaux, et il est difficile qu’il calcule tellement les produits de ce genre, qu’il n’en reste absolument rien pour un certain nombre de ses esclaves, après que les besoins de sa famille ont été satisfaits. Si le sol qu’il cultive n’est pas assez riche pour produire des denrées propres à être exportées au loin, il faut que ses revenus soient consommés en nature sur les lieux ; et, comme le prix ne peut en être très élevé, ses esclaves en profitent. Mais un planteur qui vit en Angleterre, ne peut tirer son revenu que des denrées qui sont vendues, et rien n’est vendu que ce qui est exporté. Tout produit qui se consomme sur les lieux, s’il n’est pas rigoureusement nécessaire à la vie de ses esclaves, non seulement n’a point de valeur pour lui, mais lui cause une perte ; car ce produit ne peut croître qu’autant qu’on y consacre et du temps et du terrain. D’un autre côté, les planteurs anglais vivant dans un pays où il existe d’immenses fortunes, et où les richesses sont indispensables à la considération, ils sont excités par un sentiment de vanité à attirer en Angleterre tout ce qu’il est possible de faire produire à leurs plantations. Enfin, les agents auxquels est confiée l’exploitation des terres et des hommes qui la cultivent, ne sont pas retenus, dans l’exercice de leur pouvoir, par la crainte de détruire leur propriété ; l’avarice ne peut être un frein à aucune autre de leurs passions. Ces diverses circonstances, si elles influent peu sur les mœurs des familles des planteurs, ont, comme on le verra bientôt, une grande influence sur le sort des esclaves.
Il est impossible que les agents employés par les planteurs se livrent à cette oisiveté d’esprit et corps que nous avons observée chez les possesseurs d’hommes des colonies hollandaises ; mais leur activité ne s’exerce que sur des êtres humains ; ils n’agissent sur les choses que par l’intermédiaire des esclaves ; ils considèrent comme indigne d’eux l’action de l’homme sur les choses [142]. Il est également impossible qu’ils s’adonnent au même luxe, puisqu’ils n’ont pas les mêmes richesses. Les jouissances physiques qu’il leur est permis de se procurer ne peuvent être qu’en raison des salaires qu’ils reçoivent et des richesses qu’ils trouvent le moyen de soustraire à leurs maîtres. En général, ces hommes ne se marient point, soit parce qu’un planteur ne voudrait pas employer des agents qui seraient chargés de famille, soit parce que des femmes, nées et élevées dans des pays libres, seraient incapables de s’accoutumer aux vices grossiers et aux violences dont elles seraient obligées d’être incessamment les témoins [143]. En parlant des colonies anglaises les plus riches, et particulièrement de la Jamaïque, nous avons donc peu à nous occuper des mœurs des femmes et des enfants légitimes de la classe des maîtres, le nombre en étant très borné [144].
Tous les hommes auxquels quelque pouvoir est délégué dans les colonies anglaises, disposent de toutes les femmes esclaves avec le même arbitraire que nous avons trouvé dans les autres colonies. Dans l’île de la Jamaïque, tous les blancs, sans distinction de rangs, s’abandonnent ouvertement à la plus grossière licence ; tout homme non marié tient chez lui une concubine noire ou mulâtre, et cela n’empêche pas ses parentes ou les femmes de sa connaissance de lui rendre visite, de s’asseoir à sa table, de jouer avec ses enfants. Un homme, même lorsqu’il est marié, peut vivre publiquement avec une femme noire ou de couleur, sans en être moins considéré, surtout s’il a une importance personnelle, et s’il jouit de quelque influence dans la colonie. Celui qui fait la cour à une femme libre qu’il se propose d’épouser, ne croit pas nécessaire de renoncer à la concubine qu’il tient publiquement ; et la future épouse n’est pas assez exigeante pour lui en demander le sacrifice. Les membres du clergé eux-mêmes vivent souvent avec des concubines noires ou mulâtres, sans renoncer à leurs fonctions ; la raison qu’ils en donnent, est qu’ils ne sont pas pires que leurs voisins, et qu’il doit leur être permis de vivre comme tout le monde vit [145]. Enfin, il règne une telle licence dans l’union des sexes, et les femmes sont traitées avec tant de mépris, qu’un homme qui est en visite chez un ami, ne se fait aucun scrupule, quand l’heure de se coucher arrive, de demander ouvertement qu’on lui envoie une des esclaves de la maison [146].
Mais, quoiqu’on ne puisse attendre beaucoup de retenue de la part de femmes que tout tend à dégrader et à corrompre, ce n’est pas toujours sans violence que les maîtres parviennent à en obtenir la possession. Un homme, quoique esclave, reste quelquefois le gardien et le surveillant de sa fille ; et la fille obéit aux ordres de son père jusqu’à ce que son maître, ou celui auquel il a délégué son pouvoir, lui intiment des ordres contraires. La femme reste également sous la protection de l’homme qu’elle a choisi pour mari, et reconnaît son autorité jusqu’au moment où une force supérieure la sépare de lui. Si donc un maître ou un de ses délégués veut abuser d’une jeune fille que son père protège, ou d’une femme que son mari défend, il s’établit un conflit entre le pouvoir du maître et l’autorité paternelle ou l’autorité maritale ; et ce conflit se termine toujours par le châtiment du père ou du mari, et par le rapt de la fille ou de la femme. La résistance, en pareil cas, serait vaine, puisque la force publique viendrait se joindre à la force du maître et de ses satellites, et que les magistrats des colonies, par cela seul qu’ils rendent irrésistibles les forces des possesseurs d’hommes sur leurs esclaves, sont les protecteurs nécessaires du viol et de l’adultère. Un mari auquel un maître a ravi sa femme, et qui a été sévèrement châtié parce qu’il a refusé de la céder volontairement, peut s’en plaindre au magistrat ; mais il devra se considérer comme fort heureux si sa plainte n’est pas suivie d’un nouveau châtiment [147].
[IV-148]
Les esclaves doivent être à leur travail au lever du soleil, c’est-à-dire à cinq heures du matin, et ils ne peuvent le quitter qu’à la nuit ; ils n’ont de repos que pour le temps de leur déjeuner et de leur dîner ; on leur accorde une demi-heure pour le premier repas et deux heures pour le second ; de sorte que le temps du travail est d’environ douze heures par jour [148]. Mais lorsque la saison de la récolte arrive, il faut que le travail redouble ; un esclave est alors obligé de travailler pendant trois nuits par semaine, sans que cette surcharge diminue en rien ses occupations de la journée : femmes, enfants, vieillards, tout le monde est soumis à la même condition [149]. En rentrant le soir dans leurs cabanes, qui sont formées ordinairement de quelques troncs d’arbres, à travers lesquels le vent et la pluie ont un libre passage, les esclaves ne trouvent rien de préparé ; il faut qu’ils se procurent eux-mêmes le bois dont ils ont besoin, qu’ils allument leur feu, et donnent à leurs aliments la préparation qu’ils jugent convenable : ils sont également obligés de prendre sur la nuit le temps dont ils ont besoin pour faire leurs vêtements, ou pour blanchir le peu dont ils se couvrent [150].
Dans les colonies où les esclaves ne tirent pas leurs provisions de la terre qu’ils cultivent pour leur propre compte, les maîtres leur accordent, par semaine, environ cent vingt-six onces de blé et cinq harengs. Chacun a ainsi à consommer par jour les cinq septièmes d’un hareng et dix-huit onces de blé, toutes les fois que l’avarice des maîtres ou de leurs agents ne soustrait rien à cette ration légale [151]. Dans les colonies où les esclaves cultivent eux-mêmes leurs provisions, ils n’ont que le dimanche pour se livrer à cette culture ; il faut même qu’ils prennent sur ce jour le temps nécessaire pour aller au marché, placé quelquefois à une distance de dix ou douze milles, et qu’ils se livrent à tous les autres travaux que demandent les soins de leurs familles [152]. Ils sont obligés de faire en outre leurs vêtements avec un peu de toile grossière que les maîtres leur [IV-150] accordent. Quant à leur lit, on ne juge pas qu’ils aient besoin d’autre chose que de la terre et quelquefois d’un peu de feuillage [153].
Si les esclaves sont aussi mal nourris, aussi mal vêtus et aussi mal logés, qu’est-ce donc qui peut les stimuler au travail excessif qu’on exige d’eux ? les châtiments continuels qu’on leur inflige. Les esclaves des deux sexes sont conduits en troupes dans les champs, par des hommes dont le bras vigoureux est armé d’un long et pesant fouet. Afin qu’ils puissent mieux sentir cet emblème de l’autorité des maîtres, comme ceux-ci l’appellent, ils ont les épaules nues pendant le travail [154]. On donne à chaque douzaine d’esclaves un conducteur ; de sorte que, lorsque la troupe est un peu nombreuse, les claquements des fouets retentissent incessamment à leurs oreilles [155]. Chaque coup de cet instrument déchire la peau, et les conducteurs en font un si fréquent usage que les hommes qui ont observé le plus grand nombre d’esclaves, n’en n’ont pas rencontré un seul dont le corps ne portât des marques de violences [156]. Les enfants, dès qu’ils sont capables de faire quelque travail, sont conduits dans les champs par troupes, et traités avec la même violence que leurs pères et leurs mères [157].
Les moindres fautes, le moindre relâchement dans le travail sont punis de coups violents ; il n’est pas même permis aux esclaves de rompre le silence ; si une conversation s’établit entre eux, et qu’elle ne cesse pas au premier ordre, le conducteur administre une volée de coups à toute la troupe, en commençant par le premier et finissant par le dernier [158]. Ce n’est pas assez pour les esclaves d’être sévèrement punis pour les fautes les plus légères, il faut, de plus, qu’ils se montrent insensibles aux châtiments infligés aux personnes qui leur sont les plus chères. Des femmes qui n’auraient pas la force de retenir leurs pleurs et d’étouffer leurs sanglots au bruissement des coups de fouet qui déchirent les muscles de leurs frères, de leurs maris ou de leurs enfants, seraient elles-mêmes soumises au même supplice. Celle qui, dans une pareille circonstance, oserait dire un mot pour implorer la pitié de son maître, fût-elle dans un état de grossesse, s’exposerait à être étendue nue, la face contre terre, à avoir les membres attachés à quatre piquets, et à être ensuite déchirée à coups de fouet jusqu’au point de rendre le dernier soupir. Si l’exécuteur, ému de pitié, ou affaibli par la fatigue, diminuait la force de ses coups, son maître, armé d’un lourd bâton, et placé derrière lui, aurait bientôt trouvé le moyen de réveiller son énergie [159].
[IV-153]
Les règlements coloniaux ne permettent pas aux maîtres de tuer leurs esclaves ; au contraire, ils le leur défendent. Le maître qui se rendrait coupable d’un tel crime s’exposerait dans quelques îles à être poursuivi judiciairement, et à être condamné à une amende de dix livres. Si la personne tuée n’était pas du nombre de celles qui sont considérées comme sa propriété, il pourrait de plus être condamné à en payer la valeur à celui qui en est réputé propriétaire [160]. Mais ces règlements ne sont guère exécutés ; et les maîtres peuvent tuer pour rien les hommes ou femmes qu’ils possèdent. Les cours de justice n’admettent que le témoignage des personnes de la race des maîtres, et outre que ces personnes font toujours cause commune, contre les esclaves, rien n’est si facile à un maître d’entraîner sa victime dans un lieu où il n’y a pas de témoins [161].
Les maîtres n’admettent pas, en général, qu’il puisse exister de mariage légal, ni de mariage religieux, entre deux personnes possédées par une troisième à titre de propriété : les exceptions qui existent à cet égard sont si peu nombreuses, qu’elles méritent à peine d’être comptées [162]. Si donc un homme et une femme esclaves s’unissent, sous quelques conditions que ce soit, il n’y a pas sur la terre d’autorité qui leur garantisse l’exécution de leurs promesses mutuelles. Le mari aurait inutilement recours au maître ou au commandeur, pour se plaindre des infidélités ou de l’abandon de sa femme ; la femme ne se plaindrait pas moins inutilement de son mari ; les plaintes de l’un ou de l’autre, ne seraient écoutées que dans la mesure de l’intérêt ou des passions de leur possesseur commun ; l’homme et la femme esclaves, en un mot, devant tout à leur maître, ne peuvent, par cela même, rien se devoir mutuellement. Les enfants se trouvent placés, relativement à leurs parents, dans la même position où le mari et la femme se trouvent à l’égard l’un de l’autre ; la raison en est la même, les maîtres ne reconnaissent pas une autorité ou des devoirs qui mettraient des limites à leur puissance.
Cependant, quoiqu’il n’existe, pour la population asservie, aucune autorité destinée à faire respecter les liens de l’association conjugale ou de la parenté ; quoiqu’une force invincible tende sans cesse, au contraire, à relâcher ou à dissoudre ces liens, les esclaves se forment en familles et restent unis jusqu’à ce que la violence les sépare. L’homme et la femme qui se sont librement associés, se forment une cabane et y vivent en commun ; c’est en commun qu’ils prennent soin de leurs enfants, et qu’ils leur consacrent le temps dont il leur est permis de disposer. Le père et la mère n’ignorent pas que leurs descendants, naissant esclaves comme eux, ne pourront ni les soulager dans leurs travaux, ni les secourir dans leur vieillesse, et qu’ils appartiendront tout entiers à leurs maîtres. Cependant, ils ont pour eux la même tendresse, et leur font les mêmes sacrifices que s’ils pouvaient attendre d’eux les secours les plus efficaces, les soins les plus attentifs. La mère, que les cris de son fils appellent, suspend le travail des champs, et court lui présenter le sein, avec la certitude que, si elle est surprise, elle sera déchirée par le fouet d’un impitoyable maître [163]. Dans les îles où la population asservie peut disposer, pour elle-même, d’un peu de temps, un père et une mère se soumettent aux travaux les plus fatigants, s’imposent les plus dures privations dans l’espoir de faire quelques économies. Si, parvenus au terme de leur carrière, ils parviennent à amasser un petit trésor, ils vont l’offrir à leur maître, non pour se racheter eux-mêmes, mais pour acheter la liberté de quelqu’un de leurs enfants [164].
Les possesseurs d’hommes ne peuvent empêcher complètement la formation des familles, puisque cette formation est une condition nécessaire de la reproduction de leurs propriétés, ou de leurs possessions ; mais, lorsque leurs intérêts on leurs convenances le demandent, ils ne se font aucun scrupule de vendre les membres de la famille à des acheteurs divers, et de les séparer de manière qu’ils ne puissent même pas conserver l’espérance de se revoir, quel que soit l’attachement qu’ils aient les uns pour les autres. Ainsi, un mari voit vendre sa femme, ou une femme son mari pour aller cultiver une autre plantation, ou habiter dans une autre île, tandis que celui des deux qui n’est pas vendu reste dans la même demeure ; une mère et un père voient quelquefois vendre successivement chacun de leurs enfants, et perdent jusqu’à l’espérance de savoir ce qu’ils sont devenus. Si, dans ces moments d’une éternelle séparation, une mère s’abandonne à son désespoir, si elle laisse entendre des cris ou des gémissements, le redoutable fouet du commandeur, en lui déchirant les muscles, lui apprend à supprimer des larmes ou des cris qui annoncent qu’elle a méconnu l’autorité de son maître [165].
[IV-157]
Les hommes et les femmes asservis supportent l’excès des travaux auxquels on les soumet ; ils supportent la privation d’aliments et de vêtements ; ils supportent l’injure, le mépris, les châtiments ; mais il est rare qu’ils puissent survivre aux séparations auxquelles la cupidité les condamne. Des hommes qui ont ainsi perdu leurs femmes ou leurs enfants, renoncent souvent à la vie, et cherchent à se détruire sans exciter toutefois les soupçons de leurs maîtres. Le moyen le plus habituel qu’ils emploient, est de manger des substances qui altèrent leur constitution et les conduisent insensiblement au tombeau ; ils espèrent qu’après avoir quitté la vie, ils se retrouveront, avec les objets de leurs affections, dans leur pays originaire. Des tyrans ont fait servir cette opinion à prolonger la durée de leur tyrannie : ils ont persuadé à la population asservie que tout individu qui avait la tête tranchée, était privé du bonheur de revoir son pays natal. Toutes les fois que les colons se sont aperçus que le désespoir de quelques-uns de leurs esclaves les entraînait vers leur propre destruction, ils les ont fait décapiter, et ont planté leurs têtes devant leurs compagnons de servitude. Ainsi, la mort a cessé d’être un asile contre les maux les plus intolérables, et les maîtres ont trouvé jusque dans les croyances religieuses, des auxiliaires de leurs vices et de leurs crimes [166].
Cette esquisse des mœurs des habitants des colonies anglaises est loin d’être complète ; mais on les connaîtra mieux lorsque j’aurai exposé les autres effets que l’esclavage produit sur les diverses classes de la population [167].
[IV-159]
CHAPITRE IX. ↩
De l’influence de l’esclavage domestique sur les mœurs des maîtres et des esclaves dans les États-Unis d’Amérique.
J’ai fait observer, dans le livre second de cet ouvrage, que, si l’on veut ne pas tomber dans de nombreuses erreurs, il faut distinguer la puissance dont une loi se compose, et la description des dispositions d’une loi. Les éléments de puissance qui constituent une loi, se trouvent dans les hommes ou dans les choses ; ce sont des faits dont chacun peut vérifier l’existence par l’observation. La description des dispositions d’une loi est l’énoncé écrit du phénomène matériel que la loi produit ; cette description peut être incomplète, infidèle ou entièrement fausse. Quelquefois le phénomène réel que produit la puissance à laquelle nous donnons le nom de loi, est moins malfaisant que celui qui a été décrit ; quelquefois le phénomène décrit est, au contraire, moins malfaisant que le phénomène réel. C’est surtout en jugeant des États-Unis de l’Amérique, qu’il importe de ne pas perdre de vue cette distinction ; car nulle part il n’existe une plus grande différence entre la description des théories et l’état réel de la société [168].
Quand les Anglo-Américains voulurent combattre pour leur indépendance, ils sentirent qu’ils avaient besoin d’invoquer des principes de morale et de justice, qui fussent favorables aux opprimés. Ils proclamèrent, en conséquence, que tous les hommes naissaient libres et égaux, et que tous avaient le droit de résister à l’oppression : ces principes, qui leur étaient nécessaires pour justifier leur insurrection contre le gouvernement de la métropole, devinrent le fondement de la plupart des constitutions particulières des divers États. Mais, lorsque les esclaves voulurent à leur tour employer à l’égard de leurs maîtres les principes que ceux-ci avaient employés à l’égard du gouvernement anglais, les possesseurs d’hommes trouvèrent que ces principes n’étaient point applicables. Les esclaves ne prirent pas les armes, à l’exemple de leurs maîtres, pour faire triompher leurs maximes : ils s’adressèrent aux cours de justice pour en obtenir l’application. Dans les États où ils étaient peu nombreux, et où il existait un grand nombre de citoyens qui n’appartenaient ni à leur classe, ni à celle des maîtres, ils gagnèrent leur cause, parce qu’ils furent jugés par un parti neutre. Dans les États, au contraire, où la population presque tout entière se divisait en maîtres et en esclaves, les premiers étant juges, les seconds furent condamnés. Ce fut la force, et non une description philosophique, qui fut la loi [169].
[IV-161]
Ainsi, quoiqu’on trouve dans presque toutes les constitutions des États-Unis, que tous les hommes sont libres et égaux, et d’autres maximes semblables, il ne faut pas se figurer que l’état réel de la société est tel qu’il a été décrit par des philosophes, dans des registres ou des livres auxquels on donne le nom de constitutions. Ce sont là de fausses descriptions analogues à celles dont j’ai parlé ailleurs ; elles peuvent être un sujet d’orgueil pour ceux qui en furent les auteurs ou pour ceux à qui elles ont été transmises, mais elles n’ont aucune influence sur le sort d’une grande partie de la population. Les Anglo-Américains sont divisés en trois classes très distinctes, sans compter celles des riches et des pauvres, des ignorants et des gens instruits ; ces trois classes sont : 1° celle des individus de race européenne, nés de parents libres ; 2° celle des affranchis ou de leurs descendants nés d’Européens et d’individus de race éthiopienne ; 3° celle des esclaves. Chacune d’elles est dans une position qui lui est propre.
Des voyageurs européens, en arrivant aux États-Unis, ont été surpris de voir que l’état réel de la société ne répondait pas aux idées qu’ils s’en étaient formées par la lecture de leurs déclarations de principes ; mais, en examinant quelle a été l’origine de ces peuples et les circonstances dans lesquelles ils sont placés, ils ont fini par se convaincre qu’ils avaient eu tort de concevoir de trop belles espérances ; en considérant franchement toutes ces circonstances, dit Fearon, nous ne devons pas être surpris de trouver que les théories des Américains sont plus avancées de deux siècles au moins que leurs pratiques [170].
Deux circonstances ont contribué à établir cette discordance entre un système qui est la description d’un état social imaginaire, et la pratique que l’état réel de la société. Lorsqu’ils ont formé leurs systèmes, les Américains se sont considérés dans leurs rapports avec le gouvernement d’Angleterre par lequel ils étaient opprimés. Lorsqu’ils ont établi leurs pratiques, ils se sont considérés dans leurs rapports mutuels, et surtout dans les rapports qu’ils avaient avec des hommes dont ils étaient les oppresseurs, c’est-à-dire avec leurs esclaves ou les descendants de leurs esclaves. D’un autre côté, les hommes qui ont décrit l’état social dont ils désiraient l’établissement, étaient des philosophes plus avancés que ne l’était la population ; ils ont consulté leurs idées bien plus qu’ils n’ont consulté les relations sociales, les préjugés et les habitudes de leurs compatriotes. Or, ce sont ces habitudes, ces préjugés et ces relations qui ont fait la loi telle qu’elle existe [171].
J’aurais pu, en décrivant les effets moraux que produit l’esclavage domestique dans les colonies anglaises, exposer ceux qu’il produit dans les États-Unis d’Amérique, puisque ces populations ont toutes la même origine, et ont été longtemps soumises aux mêmes lois. Mais, depuis environ un demi-siècle, il existe de si nombreuses différences entre les colonies assujetties au gouvernement anglais, et les républiques du nord de l’Amérique, qu’on pourrait aisément supposer que ce qui est vrai pour les unes peut ne pas l’être pour les autres. Nous aurons d’ailleurs bien mieux constaté les effets moraux de l’esclavage, lorsque nous aurons exposé ce qu’ils sont sous toutes les formes de gouvernement, et avec tous les genres de culture.
L’esclavage domestique a jadis existé presque dans toute l’étendue des États-Unis ; mais le nombre des esclaves n’a pas été partout dans la même proportion. Dans les États du nord, ils étaient en petit nombre, comparativement aux hommes libres ; là, ils ont été affranchis, et l’esclavage a été déclaré illégal. Dans les États du sud, au contraire, les esclaves étaient très nombreux, comparativement aux maîtres, et ils ont été maintenus dans l’esclavage, malgré les déclarations sur les droits de l’homme. Tous ces États ayant adopté des gouvernements et des principes semblables, à quoi faut-il attribuer la différence de leur conduite ? Faut-il penser que les esclaves du nord ont été des hommes plus énergiques que les esclaves du sud ? Faut-il croire que les maîtres des pays froids ont été plus généreux ou moins enclins au despotisme que les maîtres des pays chauds ? Aucune de ces deux causes n’a produit le phénomène que nous observons ici.
Les esclaves qui existaient dans les États du nord, ne sont pas devenus libres par leurs propres forces : leur liberté leur a été restituée, sans qu’ils eussent rien fait pour la reprendre. Ce n’est pas non plus par la générosité de leurs maîtres qu’ils sont devenus libres ; c’est par l’action des hommes qui n’étaient ni dans la classe des maîtres, ni dans celle des esclaves ; ces hommes, formant la partie la plus nombreuse de la population, ont imprimé le mouvement à tout le reste. Dans les États du sud, il n’existait presque point d’hommes qui ne fussent esclaves ou maîtres ; et l’action des uns a été paralysée par celle des autres. En Amérique, comme dans tous les pays, les hommes qui tendent avec le plus d’énergie à la destruction de l’esclavage ne sont pas ceux qui gémissent dans la servitude, et encore moins ceux qui profitent de la domination ; ce sont ceux qui n’appartiennent ni à l’une ni à l’autre de ces deux classes ; ceux qui n’ont ni la lâcheté, ni l’abrutissement, ni l’ignorance des esclaves, ni l’orgueil, ni l’oisiveté, ni les préjugés des maîtres.
Nous avons vu précédemment que, dans la partie des États-Unis où l’esclavage est établi, il a pour effet d’avilir toutes les occupations industrielles ; l’action immédiate des organes de l’homme sur la nature est devenue le partage exclusif des esclaves. Les maîtres n’ont considéré comme digne d’eux que l’action de l’homme sur d’autres hommes ; ils n’ont généralement agi que comme maîtres ou comme gouvernants. Aucun de ces deux genres d’action n’exige beaucoup d’exercices physiques ; le premier ne demande pas de grands efforts d’esprit, ni même quelquefois le second. L’oisiveté a donc été le partage des Anglo-Américains du sud aussi bien que celui des colons des îles [172]. Suivant un voyageur, un riche possesseur d’esclaves de la Virginie fait consister sa principale occupation dans la satisfaction de ses jouissances physiques : manger, boire ou dormir sont les seules manières dont il sait employer son temps ; il se lève pour déjeuner, puis il s’étend sur son lit, et s’endort. À midi, il boit une sorte de liqueur ; il dîne à deux ou trois heures, et, après son repas, il se remet encore sur son lit. Pendant son sommeil, deux esclaves sont employés à rafraîchir l’air, à le garantir des mouches avec un balai de jonc. À son réveil, il se remet à boire, et continue jusqu’au soir, où il soupe [173]. Un maître ni une maîtresse, ne faisant rien par eux-mêmes et ne se donnant même pas la peine de prendre soin de leurs enfants, ont besoin d’une multitude d’esclaves, même quand ils ne jouissent pas d’une grande fortune : il en faut une vingtaine pour le service d’une maison. Marcher est une fatigue, surtout pour les femmes : aussi, elles ne sortent à pied dans aucune saison de l’année ; la course la plus rapprochée est toujours faite en voiture, et, à cet égard, leurs maris ne sont guère moins paresseux qu’elles. La principale distraction des hommes est le jeu, et quelquefois la chasse [174].
[IV-167]
Dans la Louisiane, où les esclaves sont très nombreux, l’indolence et l’oisiveté des femmes est extrême. Elles ne sauraient se baisser pour ramasser un chiffon échappé de leurs nonchalantes mains ; elles ne marchent pas, dit Robin, elles se traînent ; il faut qu’une esclave les suive, pour leur épargner la fatigue de porter leurs ridicules. Une excessive paresse se manifeste jusque dans leur langage ; leur prosodie est languissante, leurs accents sont traînants ; chaque syllabe s’allonge comme si la voix expirante articulait ses derniers sons. On dirait qu’elles regrettent de ne pouvoir rejeter sur leurs esclaves la fatigue de la pensée et le travail de la parole. Ni la nouveauté des objets, ni des événements inattendus ne peuvent les faire sortir de leur apathie ; mais, si elles éprouvent une contrariété, si leur orgueil reçoit une légère atteinte, elles se réveillent de leur assoupissement et montrent dans leurs vengeances l’énergie des despotes [175].
L’influence de l’esclavage s’étend même sur les personnes libres qui ne possèdent point d’esclaves, même sur les individus de la classe ouvrière ; ils sont moins entreprenants, moins robustes, moins éclairés, moins propres à convertir le désert en pays cultivé, que ne le sont les personnes de la même classe dans les États où l’esclavage n’est point admis. Les femmes de ces derniers États, marchent hardiment au-devant de leurs chariots dans leurs migrations ; tandis que dans les pays où il existe des esclaves, les femmes des cultivateurs ne vont qu’à cheval, ou se traînent nonchalamment à la suite des bagages [176]. Aussi, existe-t-il dans ces derniers pays une étendue de terres incultes, bien plus vaste que celle qui existe dans les pays où l’esclavage est aboli [177].
Les Anglo-Américains, dans leurs liaisons avec leurs femmes esclaves, sont plus réservés que ne le sont les colons anglais ; chez eux, l’opinion flétrit tout individu qui vit ouvertement, non pas seulement avec une esclave, mais avec une femme qui porte quelques signes d’origine africaine ; mais cette sévérité de mœurs est plus apparente que réelle ; il existe dans les États où l’esclavage est admis, et particulièrement en Virginie, des multitudes d’esclaves qui, par leur couleur, décèlent le secret de leur origine ; l’abus que les maîtres ont fait à cet égard de leur puissance, a été tel, qu’un grand nombre d’esclaves ont perdu jusqu’à la nuance qui aurait pu indiquer leur origine africaine [178]. L’influence de l’esclavage s’est étendue jusque sur les mœurs d’un grand nombre de ministres de la religion ; la proscription des jésuites n’ayant pas atteint les riches établissements que ces religieux avaient formés dans quelques-uns de ces États, ils sont restés en possession de leurs terres et de leurs femmes esclaves ; dans un petit nombre de générations, les descendants de ces femmes, sans cesser d’être esclaves, ont perdu les traits et la couleur des peuples d’Afrique, et sont devenus aussi blancs que leurs maîtres [179].
Dans l’État de la Louisiane, les liaisons entre les hommes de la classe des maîtres, et les femmes de la classe des esclaves, ne sont pas proscrites par l’opinion, comme elles le sont chez les Anglo-Américains ; aussi, les blancs, mariés ou célibataires, se lient publiquement avec des femmes de cette classe ; cette licence des mœurs s’étend jusque dans les campagnes. De leur côté, les femmes des maîtres favorisent la prostitution de leurs femmes esclaves avec les blancs, soit pour qu’elles leur donnent des enfants d’une plus belle espèce, soit pour éviter les frais de leur entretien, soit même pour prendre part aux profits de leur métier. « L’indulgence s’accroît pour les femmes esclaves, dit Robin, selon qu’elles peuvent mieux se passer des secours du maître ; la dame de la maison, que ce soin ordinairement regarde, voit, de son appartement, les amans aller et venir chez sa négresse, et la nuit elle favorise aussi complaisamment leur entrée. Ce sont les mêmes mœurs que nous avons observées au cap de Bonne-Espérance [180].
L’abus de la force sur les femmes esclaves, influe sur le jugement que le public porte relativement à la conduite des femmes libres. La prostitution n’est pas un vice qui soit flétri avec la même sévérité qu’il l’est dans la plupart des États de l’Europe. La femme qui s’y est publiquement livrée, trouve facilement à se placer en qualité de domestique, ou même à se marier si elle en a le désir [181]. Telle est l’influence de l’esclavage, que, suivant l’expression d’un voyageur philosophe, là où il est établi, tous les dangers moraux sont communs [182].
La passion du jeu, qui se développe presque toujours dans le désœuvrement en même temps que la passion des jouissances physiques, a été portée à l’excès dans les États où les esclaves ont été les plus nombreux. On a tenté de la réprimer par des actes de la législature ; mais, après avoir décrété des peines contre les joueurs, les législateurs et les magistrats ont été les premiers à se moquer de leurs décrets [183]. On a vu quelquefois des bandes d’esclaves former l’enjeu d’un pari, à une course de chevaux, et passer pendant des journées entières d’une troupe de joueurs ivres à l’autre [184]. Les possesseurs d’hommes des États-Unis montrent, à l’égard de la plupart de leurs esclaves, les mêmes vices que nous avons observés dans les colonies anglaises. Ne cultivant point la canne à sucre, ils n’ont pas besoin d’exiger d’eux les mêmes travaux ; mais, à cela près, c’est la même avidité, les mêmes craintes, la même cruauté et le même orgueil. S’ils traitent un peu mieux un certain nombre de leurs esclaves, c’est parce qu’ils résident eux-mêmes dans le pays, tandis que les possesseurs anglais résident habituellement dans la métropole. Un homme peut étaler son luxe dans les esclaves qui peuplent l’intérieur de sa maison, comme dans les chevaux qu’il attelle à sa voiture. Un possesseur d’hommes, américain, lorsqu’il est riche, tient quelquefois, en effet, à ne voir autour de lui que des esclaves qui sont bien nourris et bien vêtus [185]. Ce sont des preuves vivantes de son luxe et de son opulence ; c’est la mesure de la considération et du respect qu’il attend de ses concitoyens.
Mais les esclaves qui sont attachés à la culture sont traités d’une manière différente, quelle que soit d’ailleurs la richesse de l’individu auquel ils sont assujettis. Les huttes dans lesquelles ils sont logés, sont formées de troncs d’arbres non équarris, et si mal joints ensemble, que, pendant la nuit, la lumière se répand à l’extérieur comme à travers une lanterne. Les meubles consistent en quelques grossiers ustensiles de bois : quant aux lits, des esclaves sont supposés n’en avoir jamais besoin, et ils couchent sur la terre, ou sur quelques feuilles sèches ; ceux qui appartiennent aux maîtres les plus humains n’obtiennent, de plus que les autres, qu’une mauvaise couverture. Dans la mauvaise saison, quand le vent et la pluie passent à travers les troncs d’arbres dont leurs misérables habitations sont formées, ils n’ont pas d’autres moyens de se garantir du froid et de l’humidité pendant la nuit, que de tenir le feu constamment allumé. Leur nourriture est analogue à leur habitation : on leur distribue un peu de riz, de blé de Turquie et de poisson sec ; les maîtres ont calculé quel est le prix le plus bas auquel il est possible de soutenir l’existence humaine, et les aliments qu’ils leur ont accordés, n’ont été que les résultats de ce calcul [186].
[IV-173]
Les esclaves peuvent être châtiés pour deux causes différentes : pour ne pas s’être conformés aux volontés ou aux caprices de leurs possesseurs, ou pour avoir enfreint les règlements de police auxquels ils sont assujettis. Dans le premier cas, c’est le maître offensé ou son délégué qui détermine lui-même la mesure du châtiment ; dans le second, c’est un officier de police. Le maître n’a point sur son esclave un pouvoir sans limites : il lui est défendu de le tuer, sous peine d’environ cent livres sterling d’amende si l’homicide est prémédité, et sous peine d’une amende d’environ cinquante livres sterling si l’homicide est volontaire, mais sans préméditation. Une amende de quatorze livres est imposée à tout possesseur d’hommes qui, en châtiant un homme, une femme ou un enfant autrement qu’à coups de fouet, de verges ou de lanières, leur coupe la langue, les membres, ou leur inflige d’autres tortures. Le possesseur, dont l’esclave a été estropié ou cruellement battu, est présumé auteur de la contravention, à moins qu’il n’affirme le contraire sous la foi du serment [187]. Les châtiments sont si communs et si sévères, même dans les villes, que les claquements de fouet et les cris des victimes n’attirent pas même l’attention des passants, et qu’il n’est pas rare de voir des esclaves qui se donnent la mort [188].
Le penchant à la cruauté que donne l’exercice du pouvoir arbitraire à ceux qui le possèdent, est fortifié par la crainte que leur inspire le désespoir de leurs victimes. Pour contraindre au travail des hommes auxquels on en ravit sans cesse le fruit, on est obligé de recourir aux châtiments ; et, pour prévenir les vengeances dont ces châtiments inspirent le désir, on est forcé de recourir à des cruautés nouvelles. Les Anglo-Américains n’ont pu imaginer encore d’autres moyens de contenir la population asservie, que l’abrutissement, la division et la terreur.
Il est expressément défendu à tout possesseur d’hommes de développer les facultés intellectuelles des individus qu’il possède à titre de propriété. Celui qui serait convaincu d’enseigner à écrire à un de ses esclaves serait puni d’une amende sept fois plus forte que celle qu’il encourrait en lui coupant les mains ou la langue. Dans ce dernier cas, il ne serait condamné qu’à une amende de quatorze livres ; dans le premier, il en encourrait une de cent [189]. Il est également défendu à tout possesseur d’hommes de leur laisser faire aucun genre de trafic pour leur propre compte, une telle licence ne pouvant être propre qu’à leur inspirer du goût pour la liberté [190].
Toute réunion est interdite aux hommes asservis ; un individu de la race des maîtres, qui trouve, sur un grand chemin, plus de sept esclaves ensemble, est tenu de leur administrer des coups de fouet, sur le derrière nu (on the bare back), sans qu’il lui soit permis cependant d’excéder le nombre de vingt coups pour chacun. Nul individu de la race des esclaves ou de sang mêlé ne peut paraître dans les rues après la tombée de la nuit sans une permission spéciale. Les délinquants, libres ou esclaves, sont enlevés par une police militaire qui parcourt sans cesse les rues, et punit selon les circonstances [191]. Un esclave, à moins qu’il ne soit aveugle ou estropié, ne peut paraître en public avec une canne ou un bâton, sous peine de vingt-cinq coups de fouet ; s’il est attaqué, il lui est interdit de se défendre. La peine de vingt-cinq coups de fouet est infligée à celui qui est trouvé dormant, sans une permission écrite, dans un lieu qui n’appartient ni à son possesseur, ni à celui par lequel il est immédiatement employé [192]. Ces précautions ne suffisent pas pour rassurer les maîtres ; ils se croient sans cesse menacés d’une insurrection, et sont habituellement armés de poignards [193]. Les maîtres de la Louisiane vivent dans des alarmes continuelles ; ils sont toujours épiant, écoutant aux cases des nègres. Le moindre propos couvert, quelques liaisons plus marquées redoublent leurs craintes et leur espionnage ; pendant la nuit, ils font eux-mêmes de fréquentes patrouilles [194].
L’acte par lequel les Américains ont fixé les amendes qui sont imposées aux maîtres qui égorgent leurs esclaves, et à ceux qui les mutilent autrement qu’à coups de fouet, de verges et de lanières, déclare, au reste, de la manière la plus formelle, que la cruauté est non seulement condamnable chez des hommes qui se disent chrétiens, mais qu’elle est odieuse aux yeux de tous les hommes qui ont quelque sentiment de vertu et d’humanité [195]. Cette espèce d’hypocrisie n’est pas rare dans les pays où il existe des esclaves : j’aurai bientôt occasion d’en citer d’autres exemples.
[IV-177]
Les violences continuelles commises sur des individus asservis, soit dans l’intérieur des familles, soit par des officiers de police, dépravent, presque dès leur naissance, les individus qui appartiennent à la race des maîtres. L’existence de l’esclavage parmi nous, dit un philosophe américain, doit avoir sans doute une funeste influence sur les mœurs du peuple. Le seul commerce qui existe entre un maître et son esclave, est un exercice continuel des plus violentes passions : d’un côté, le despotisme le plus inflexible ; de l’autre, la plus dégradante soumission. Nos enfants sont témoins de ces relations, et ils apprennent à les imiter. Le parent s’emporte ; l’enfant le regarde ; il saisit chacun des traits de la colère, prend les mêmes airs parmi les jeunes esclaves, et s’abandonne aux passions les plus odieuses. Ainsi, nourri, élevé et continuellement exercé à la tyrannie, il ne peut qu’en porter les caractères. L’homme qui, au milieu de telles circonstances, peut conserver des manières douces et des mœurs pures, doit être considéré comme un prodige [196].
L’habitude de l’arbitraire et de la violence envers la population asservie, rend les maîtres violents, vindicatifs et cruels les uns à l’égard des autres. Les querelles sont fréquentes parmi eux ; elles se terminent ordinairement par le duel, et il est rare qu’un des deux combattants ne soit pas frappé de mort. Celles qui ont lieu entre des hommes qui appartiennent aux rangs inférieurs de la société, ont aussi un degré de violence qu’elles ont rarement dans les pays où l’esclavage domestique est inconnu. Les combattants, dans leur fureur, cherchent à se mutiler les uns les autres, à s’emporter le nez, à s’arracher les yeux ou les oreilles. Celui des deux qui est le plus fort traite le plus faible en esclave ; et, en effet, il n’y a pas d’autre différence entre les maîtres et les esclaves que la force. La liberté et l’égalité règnent partout où cette différence disparaît [197].
L’orgueil a toujours été, dans tous les pays, un des traits saillants de toute aristocratie ; et, comme la division de la population en maîtres et en esclaves, est le degré le plus élevé du système aristocratique, nulle part l’orgueil humain n’est plus exalté que dans les pays où la partie laborieuse de la population est considérée comme la propriété des oisifs qui vivent des produits de son travail.
Les personnes asservies sont traitées, dans les États-Unis, avec autant de mépris que les objets les plus vils ; elles sont vendues au marché comme des bêtes. Le commerce de ce genre de marchandise n’est pas moins honoré que tout autre. Les hommes, les femmes et les enfants, exposés en vente, sont mis à nu, et examinés avec le soin qu’on apporte dans l’examen d’un cheval dont on veut faire l’acquisition. On leur ouvre la bouche de force pour examiner les dents ; on vérifie s’ils ont la vue bonne ; on les tourne, on les retourne pour voir s’ils n’auraient pas quelque vice caché. Les femmes de la race des maîtres vont elles-mêmes à ce marché pour acheter les individus dont elles ont besoin, et font elles-mêmes, pour n’être pas trompées, toutes les vérifications usitées en pareille circonstance ; elles ne paraissent pas même se douter des lois de la pudeur. Dans ces ventes, on n’a aucun égard aux liens de parenté : on vent le mari séparément de la femme, les enfants séparément de leur mère, selon que le demandent les convenances du vendeur et de l’acheteur [198].
Le mépris que les hommes de la race des maîtres font tomber sur les esclaves, se répand sur tous les individus qui portent dans leurs veines une goutte du sang de la race asservie. La teinte la plus légère, qui annonce qu’une personne compte au rang de ses ancêtres un individu d’espèce éthiopienne, suffit pour la faire traiter avec le mépris le plus profond, de la part de l’homme le plus vil auquel on ne peut pas reprocher une telle souillure. Dans les États mêmes où l’esclavage est proscrit, l’orgueil des blancs, à l’égard des personnes qui ont quelque teinte de couleur, est aussi exalté qu’il puisse l’être. Les mœurs les plus pures, les connaissances les plus étendues et les plus variées, le jugement le plus droit, l’industrie la plus active, les richesses les plus honorablement acquises, ne peuvent racheter le crime d’être lié par le sang à une race opprimée. Toute personne coupable de ce crime est exclue sans distinction de tous les lieux où se réunissent les individus qui appartiennent à la race des oppresseurs. Dans les théâtres, les personnes de cette caste sont reléguées dans une galerie particulière ; elles n’osent pas même se montrer dans les temples à côté des blancs qui professent la même religion qu’elles ; il faut, si elles veulent remplir les devoirs que leur prescrit leur culte, qu’elles fassent construire des églises qui leur soient propres. Un homme qui se voue par métier à rendre quelque genre de services personnels, doit opter entre les deux castes ; celui qui rendrait un service à une personne de couleur, perdrait, par cela même, les pratiques qu’il aurait dans la caste des blancs. Un blanc, condamné pour ses crimes, ne mangerait point à la table où un homme de couleur serait assis ; il faut, dans les prisons, une table pour les criminels de chaque couleur. Enfin, quoique des actes de législature proclament indistinctement que tous les hommes sont égaux, il est des États où un homme qui remplirait d’ailleurs toutes les conditions requises pour être citoyen, ne croirait pas pouvoir en sûreté se présenter dans une assemblée pour en exercer les droits, s’il portait la marque la plus légère d’origine africaine. Il y a encore ici une différence immense entre les puissances qui régissent la société, et les fausses descriptions auxquelles on donne le nom de lois [199].
Dans les États où il existe un grand nombre d’esclaves, l’estime étant presque exclusivement attachée à l’aristocratie de la couleur, une femme blanche ne peut déchoir par la conduite la plus vicieuse, ni rien perdre par conséquent de son orgueil ; mais aussi une femme qui porte sur son teint la nuance la plus légère de sang africain, quelque vertueuse qu’elle soit, ne peut sortir de son abaissement. Les femmes des maîtres de la Louisiane sont si fières de la noblesse de leur peau, qu’il nous est difficile de nous faire une idée de leur orgueil.
« Une de celles-ci, mariée et connue par des intrigues avec des hommes en place, dit Robin, entre un jour dans un grand bal. Il y a ici du sang mêlé, s’écrie-t-elle superbement. Ce propos court dans le bal ; on y remarque, en effet, deux demoiselles quarteronnes, estimées par l’excellente éducation qu’elles avaient reçue, et bien plus encore par leur conduite décente. On les avertit, et elles sont obligées de s’éclipser en hâte, devant l’impudique dont la société aurait été pour elles une véritable souillure [200]. »
L’influence de l’esclavage sur les mœurs de la classe des maîtres, n’est pas renfermée dans les États où il existe un grand nombre d’esclaves ; elle se fait sentir dans toute l’étendue de l’Union. L’existence de l’esclavage dans les États-Unis, dit un voyageur, produit l’effet le plus sensible sur le caractère national ; il donne de la brutalité aux esprits des habitants du sud et de l’ouest ; il abaisse le ton des sentiments de droiture et d’humanité dans toutes les parties du pays, et contribue d’une manière insensible à établir l’immense différence qui existe entre la théorie et la pratique [201].
Les individus nés et élevés dans la servitude, ont, aux États-Unis, les mœurs qu’ils ont dans tous les pays. Tenus dans l’abrutissement par l’orgueil des maîtres, n’ayant ni le moyen, ni le désir de s’instruire, obligés de s’interdire tout exercice qui aurait pour résultat d’accroître leur adresse et leur puissance, contraints de souffrir l’injure et la violence, ne connaissant aucune autorité qui les protège, et la défense leur étant interdite, la plupart de leurs sentiments moraux sont éteints ou dégradés ; l’on ne conçoit pas quelle qualité morale pourrait leur être propre, à moins que ce ne soit la patience à souffrir les vices de leurs maîtres.
L’homme qui, pour la première fois, aperçoit un esclave, dit un voyageur anglais, éprouve une sensation pénible ; il voit devant lui un être pour lequel les lois de l’humanité sont renversées, qui n’a connu de la société que les injustices, qui n’a éprouvé de la part de ses semblables qu’un dur et atroce égoïsme. La rampante humilité, les expressions serviles avec lesquelles un noir approche d’un blanc, frappent les sens, non comme la politesse d’un paysan français ou italien, qui donne de la grâce à la pauvreté, mais avec l’indication d’une âme brisée. Le son du fouet se fait sentir dans les accents de sa soumission ; son œil, qui évite le mien, a puisé la crainte dans les regards de l’homme sous lequel il travaille. L’habitude empêche les habitants du pays de faire de semblables observations ; et il ne faut pas espérer que des objets qu’on a sans cesse sous les yeux, produisent le même effet qu’ils causent lorsqu’on les observe pour la première fois. Mais l’individu qui, voyant un esclave pour la première fois de sa vie, le regarde avec la même indifférence que tout autre objet que le hasard lui fait rencontrer, peut se réjouir du bonheur qu’il a eu de naître libre, mais dans le fond de l’âme il est un esclave. Comme être moral, il est même de beaucoup au-dessous du noir ; car, si celui-ci a perdu le sentiment de la liberté, c’est par la tyrannie qu’on a fait peser sur lui, et non par une insensibilité qui lui soit naturelle [202].
Les effets moraux de l’esclavage dans les États-Unis d’Amérique, diffèrent donc de fort peu de ce qu’ils sont dans les colonies soumises au gouvernement anglais. Il faut dire cependant que les esclaves y sont, en général, moins mal nourris, excédés de moins de fatigues, et traités avec moins de cruauté : ce qui le prouve c’est l’accroissement de la population asservie. Mais, s’ils éprouvent des traitements moins durs, il ne faut l’attribuer ni à la nature de l’esclavage, ni à la nature du gouvernement ; il faut l’attribuer à des circonstances accidentelles. La première est une différence dans la nature du sol et par conséquent de la culture ; les denrées que cultivent les Américains exigent un travail moins forcé, et ont une valeur moins grande que celles qui sont cultivées à la Jamaïque ou dans la Guyane ; les esclaves qui cultivent le riz sont accablés de moins de travail et moins mal nourris que ceux qui cultivent du sucre ; ceux qui cultivent le blé, comme ceux de Russie ou de Pologne, sont obligés de moins travailler, et sont mieux nourris que ceux qui cultivent le riz ; enfin, ceux qui sont préposés à la garde des troupeaux, comme ceux des Arabes, sont à peu près au niveau des maîtres.
La seconde circonstance qui influe sur les effets de l’esclavage, est la résidence des maîtres sur leurs propriétés ; les esclaves les mieux traités sont toujours ceux qui sont attachés au service personnel de la famille du maître. Dans nos États d’Europe, les laquais qui fourmillent dans les maisons des grands, travaillent moins et sont mieux logés, mieux vêtus, et mieux nourris que les ouvriers qui cultivent la terre ; dans les pays où l’esclavage est admis, la différence est plus grande encore, entre les esclaves attachés à la culture, et ceux qui sont attachés au service de la maison. Mais les propriétaires des colonies anglaises résident presque tous dans la métropole ; de sorte que ce sont des valets anglais qui jouissent des avantages de la domesticité, avantages qui, chez les Anglo-Américains du sud, sont le partage des esclaves.
Enfin, la troisième circonstance qui influe sur les effets de l’esclavage, est l’action des États qui l’ont proscrit sur ceux qui l’ont conservé. Cette action, qui est continue, est d’autant plus forte, que les premiers sont plus nombreux, plus éclairés, plus industrieux et plus riches. L’Angleterre, il est vrai, agit aussi sur ses colonies pour tempérer les effets de l’esclavage ; mais l’action qu’elle exerce ne se fait sentir que depuis un petit nombre d’années ; et cette action est en partie paralysée par l’éloignement des colonies, par l’influence qu’exercent dans la métropole les propriétaires d’esclaves, et par la nature de son gouvernement [203].
[IV-187]
CHAPITRE X. ↩
De l’influence de l’esclavage sur les mœurs des maîtres et des esclaves dans les colonies françaises.
Les colonies françaises ont perdu une grande partie de l’importance qu’elles avaient jadis ; Saint-Domingue, qui était la plus considérable, forme une république indépendante, et elle ne compte, dans son sein, ni maîtres, ni esclaves ; la Louisiane forme une partie des États-Unis, et j’en ai parlé en décrivant les mœurs des maîtres de cette partie de l’Amérique ; l’île de France et quelques autres peu considérables, sont sous la puissance de l’Angleterre. La Martinique et la Guadeloupe sont les seules qui nous restent, et qui méritent d’être comptées.
La population entière de la première était, en 1805, de 95 413 ; sur ce nombre, on comptait 9 206 blancs, 8 630 gens de couleur, et 77 577 esclaves. La population de la seconde était portée, en 1788, à 101 971 habitants ; savoir : 13 476 blancs, 3 044 gens de couleur libres, et 85 461 esclaves. Aujourd’hui, l’on estime que la population s’élève à 159 520 individus ; mais nous ignorons si, dans cet accroissement, les proportions qui existaient entre les diverses classes de la population n’ont pas été altérées. En supposant qu’elles soient les mêmes, la population coloniale, qui s’élève à environ 255 000 individus, se répartit à peu près de la manière suivante : 25 000 ou 30 000 individus qui sont des personnes ou des propriétaires, 190 000 ou 200 000 individus qui sont des choses ou des propriétés, et 20 000 ou 25 000 individus qui tiennent tout à la fois de la nature des choses et de la nature des personnes. Comme l’esclavage exerce une influence immense, non seulement sur la population chez laquelle il est établi, mais encore sur les peuples qui se trouvent en contact avec elle, il était nécessaire de faire connaître, au moins approximativement, le nombre des personnes qui prétendent en tirer quelques avantages, afin de mieux apprécier ce qu’il coûte à ceux qui en portent le poids [204].
Le nombre des individus qui appartiennent à la race asservie est très grand, comparativement à ceux qui appartiennent à la race des maîtres : il est presque de un à dix. Les travaux auxquels les esclaves sont assujettis, et les produits que les maîtres en retirent, sont de la même nature que ceux des colonies anglaises. Ces produits sont également destinés à l’exportation, et, par conséquent, les esclaves sont réduits à la moindre consommation possible. Les principales circonstances de l’esclavage étant les mêmes que celles que nous avons précédemment observées, les effets moraux qu’il produit ne peuvent être différents. Aussi, me bornerai-je à en indiquer les principaux traits, pour éviter, autant qu’il se peut, la monotonie qui s’attache nécessairement à la description d’une série de phénomènes qui sont partout les mêmes.
Dans les colonies françaises, comme dans toutes les autres, le premier effet de l’esclavage a été d’avilir, aux yeux des hommes de la classe des maîtres, toute occupation industrielle. Tous les travaux de l’agriculture sont donc restés le partage des esclaves : dans les bourgs ou dans les villes, tous les arts, toutes les professions lucratives sont exercés ou par des esclaves au profit de leurs maîtres, ou par des affranchis ou descendants d’affranchis. Tout individu blanc est noble, en vertu de la couleur de sa peau ; et tout individu noble est tenu, sous peine de déroger, de vivre des produits du travail d’autrui [205].
Le mépris des classes laborieuses est inséparable du mépris du travail : tout homme qui porte sur lui quelques marques d’origine africaine est donc avili par ce seul fait. Ici, comme aux États-Unis d’Amérique, rien ne peut absoudre un homme ou une femme du crime d’avoir le teint plus ou moins brun, ni la probité, ni les talents, ni la fortune, ni la conduite la plus pure et la plus irréprochable ; mais aussi il n’est point de vice qui puisse flétrir un homme ou une femme qui a l’honneur d’avoir la peau blanche. Dans les colonies où le nombre des blancs a été considérable, comme à Saint-Domingue, l’aristocratie ne s’est pas bornée à flétrir les personnes issues des deux races ; elle s’est elle-même subdivisée. Les hommes qui ont possédé un grand nombre d’esclaves, se sont appelés les grands blancs, et ils ont désigné sous le nom de petits blancs ceux qui en ont possédé un nombre moins considérable [206].
Les liaisons qui existent entre les maîtres et leurs femmes esclaves, sont les mêmes que nous avons observées dans les autres colonies. Suivant un voyageur, il résulte de ces liaisons des vices et des crimes inconnus dans les régions de l’ancien monde les plus dépravées. Un père y voit avec indifférence la prostitution de sa fille : il devient même, au besoin, le confident de ses nombreux amants. Souvent, un possesseur laisse dans l’esclavage les enfants qu’il a de ses esclaves, et les transmet à ses héritiers avec ses autres biens. Souvent encore il les vend ; et ces exemples sont si fréquents, que l’habitude ne laisse même pas de place au remords [207].
La cruauté des colons est en raison de leur immoralité ; ils traitent les individus de la race asservie avec beaucoup plus de mépris et de brutalité que n’en montrent parmi nous les hommes les plus grossiers à l’égard des plus vils animaux [208]. Lorsqu’il s’agit d’un châtiment qui peut entraîner la mort de l’esclave, le maître est obligé cependant de s’adresser à une commission, à laquelle on donne le nom de chambre ardente. Mais, devant cette commission, le maître ou son économe est tout à la fois accusateur, témoin et rapporteur, et c’est lui qui dicte la sentence. Il arrive même quelquefois qu’un individu qui possède beaucoup d’esclaves, un grand blanc, condamne lui-même au supplice du feu un de ses esclaves, et fait exécuter la sentence, de son autorité privée, au milieu de sa plantation [209]. Ici, comme à la Louisiane et à Surinam, les femmes sont encore plus cruelles que les hommes, surtout à l’égard des esclaves de leur sexe qui peuvent leur inspirer quelque jalousie [210].
Il s’est trouvé des personnes, cependant, qui ont vanté le régime auquel sont soumis les esclaves dans les colonies françaises ; on a prétendu qu’il existait de vastes et magnifiques hôpitaux dans lesquels ils étaient reçus pendant leurs maladies ; que les maîtres avaient des magasins dans lesquels ils tenaient toujours une grande provision de vivres, et que l’opinion générale, parmi les colons, était que, pour être bon administrateur, il fallait traiter doucement ses esclaves [211]. Ces faits pourraient être vrais, sans que les esclaves en fussent moins misérables ; on peut être fort maltraité dans un vaste hôpital ; un maître peut avoir des magasins, et ne donner à ses esclaves qu’une mauvaise et chétive subsistance ; enfin, un homme peut débiter de belles maximes, et se conduire d’une manière atroce. Chez les possesseurs d’hommes, les mots ont souvent une signification opposée à celle qu’ils ont chez nous ; cela doit être, puisqu’ils ne voient que des choses là où nous voyons des êtres humains ; ce qu’ils appellent liberté, garantie, nous l’appelons oppression, arbitraire ; ce qu’ils appellent modération, nous l’appelons violence, cruauté [212].
Une seule observation peut nous faire juger de la douceur des maîtres et du bonheur des esclaves dans nos colonies. Depuis que le gouvernement anglais a prohibé l’importation de nouveaux esclaves dans ses colonies, la population asservie est un peu moins cruellement traitée qu’elle ne l’était auparavant ; cependant, nous avons vu qu’elle est encore exposée à des violences excessives. Sous le régime actuel, la diminution la plus forte à laquelle on ait pu estimer le décroissement annuel de la population esclave de la Jamaïque, a été de 1,5% ; dans l’île de la Trinité, qui est celle où le décroissement est le plus rapide, il est de 3% 2/5 toutes les années [213]. Suivant Raynal, la perte annuelle des noirs s’élevait, dans nos colonies, à 5%, et les accidents la faisaient monter à 6% 2/3 ; il fallait donc que nos esclaves fussent encore plus maltraités que ne le sont ceux des colonies anglaises. On a observé, dans ces colonies, que le décroissement annuel de la population asservie est en raison directe de la quantité de sucre qu’on fait produire à chaque esclave [214] ; et puisque Saint-Domingue était la colonie qui en produisait le plus, comparativement à la population, on peut en conclure que les esclaves y étaient, au moins, aussi misérables que dans aucune autre île.
Enfin, plusieurs colonies françaises sont depuis plusieurs années sous la domination du gouvernement anglais ; les maîtres sont obligés, par conséquent, de renfermer leur pouvoir dans les limites circonscrites par les lois anglaises ; mais ces lois, qui obligent les possesseurs d’hommes à laisser un certain intervalle entre le châtiment et l’offense, qui limitent le nombre de coups de fouet qu’il est permis d’infliger à chaque fois, et qui exigent qu’on dresse procès-verbal de l’infliction de la peine, ne sont pas moins gênantes pour les colons originaires de France, qu’elles ne le sont pour ceux qui sont originaires d’Angleterre : les uns comme les autres se plaignent de ne pouvoir pas se livrer, avec assez de liberté, à la violence de leurs passions [215].
[IV-198]
CHAPITRE XI. ↩
De l’influence de l’esclavage sur les mœurs de quelques peuples de l’Amérique méridionale, originaires d’Espagne.
Si je décris les effets moraux que l’esclavage a produits dans quelques-unes des contrées de l’Amérique, jadis soumises à l’Espagne, ce n’est pas pour faire connaître des phénomènes nouveaux ; c’est pour mieux constater que ceux que j’ai rapportés dans les chapitres précédents, ne sont que les résultats des causes auxquelles je les ai attribués. On ne peut disconvenir que l’oisiveté, l’orgueil, le mépris du travail, la passion des jouissances physiques, ne soient des vices qui caractérisent les Anglo-Américains du sud et les autres possesseurs d’hommes des îles et du continent d’Amérique ; mais on ne convient pas également que ces vices soient les résultats de l’esclavage ; suivant quelques personnes, ils ne sont produits que par la chaleur du climat. Si les hommes des classes laborieuses cessaient d’être stimulés par le fouet, dit-on, ils seraient aussi paresseux que les maîtres ; ils ne se livreraient qu’au travail qui leur serait rigoureusement nécessaire pour subsister, et ils se contenteraient de si peu de chose, qu’ils ne s’élèveraient pas au-dessus des sauvages. Nous verrons tout à l’heure si l’expérience confirme cette assertion.
[IV-199]
De toutes les colonies formées par les peuples d’Europe, il n’en est point dont l’approche ait été plus sévèrement défendu aux étrangers, que les colonies espagnoles [216]. Le gouvernement d’Espagne ne s’est pas borné à interdire à ses sujets d’Amérique tout échange de marchandises avec des nations autres que la sienne ; il leur a interdit aussi toute espèce de commerce intellectuel. Il n’est point d’ouvrage philosophique publié chez les peuples que nous considérons comme les plus éclairés, dont l’entrée n’ait été sévèrement interdite sur tout le vaste territoire que l’Espagne possédait en Amérique. Pour veiller à l’exécution de cette défense, on ne s’en est pas rapporté au zèle des douaniers ordinaires ; on a placé sur divers points du pays plusieurs tribunaux d’inquisition, et ces tribunaux ont placé leurs officiers dans tous les lieux par où ils ont cru que quelque rayon de lumière pourrait pénétrer [217]. L’imprimerie a été proscrite même dans les villes les plus populeuses, et les agents du gouvernement ont eux-mêmes renoncé à se servir de ce moyen de multiplier les copies de leurs ordonnances, de peur que l’usage qu’ils en feraient, ne contribuât à éclairer la population [218].
[IV-200]
En même temps que le gouvernement espagnol usait de toute sa puissance pour plonger ou retenir ses sujets d’Amérique dans l’ignorance la plus profonde, des croyances et des pratiques nées dans des temps barbares tendaient avec force à la corruption de la morale et à la multiplication des crimes. Le commerce des indulgences, qui faisait une partie du revenu du clergé romain et du gouvernement de la métropole, avait reçu la plus grande extension [219]. Le gouvernement papal livrait au gouvernement espagnol, et celui-ci livrait au commerce dans ses colonies, cinq espèces de bulles : la bulle des vivants, celle des morts, celle du laitage et des œufs, celle la composition, et celle de la croisade [220]. Tout acheteur de la bulle des vivants, eût-il tué son père, sa mère et ses enfants, eût-il été coupable de tous les crimes qui outragent le plus l’humanité, pouvait aller trouver un prêtre, exiger de lui une entière absolution, et mettre ainsi sa conscience en repos [221]. La bulle de composition avait le merveilleux effet de rendre légitime propriétaire l’injuste détenteur du bien d’autrui ; le voleur qui, au milieu d’une foule de personnes, était parvenu à escamoter une bourse bien garnie, n’avait qu’à aller trouver le marchand d’indulgences et à lui délivrer une petite part de sa prise, et l’un et l’autre devenaient légitimes possesseurs du bien volé [222]. Il faut ajouter qu’un malfaiteur qui s’était rendu coupable d’un crime et qui ne se croyait pas en sûreté dans sa caverne, n’avait qu’à se réfugier dans une église pour devenir inviolable [223]. Chacune de ces circonstances ayant sur les mœurs une grande influence, il était nécessaire d’en tenir compte, pour ne pas rapporter à l’esclavage des vices ou des crimes qui auraient pu être produits par d’autres causes [224].
[IV-202]
Les Espagnols n’arrivèrent point en Amérique, comme les Anglais et les Hollandais, pour mettre en culture de vastes forêts ou des terres marécageuses ; ils y arrivèrent en qualité de conquérants et dans l’intention de vivre sur une population qui avait déjà fait des progrès dans la culture. Les hommes et les terres furent partagés entre les conquérants en raison de leurs grades, et la plupart des coutumes du gouvernement féodal passèrent d’Espagne en Amérique. Les nouveaux possesseurs y portèrent particulièrement l’usage des majorats, suivant lequel le premier né d’une famille hérite des propriétés territoriales de son père à l’exclusion de ses frères et sœurs. La population se trouva ainsi partagée en deux castes, celle des conquérants et celle des peuples conquis : les premiers auraient pu être distingués des seconds par leurs titres, par leurs richesses, ou par l’étendue de leurs possessions ; mais la nature avait établi entre eux des distinctions plus prononcées, celles qui distinguent les deux espèces, et particulièrement celle de la couleur. Depuis la conquête, un grand nombre d’Espagnols ont passé en Amérique et s’y sont établis : ceux-ci n’y sont pas arrivés en conquérants, mais comme appartenant à la même famille. Des individus d’espèce éthiopienne y ont été amenés comme esclaves ; ils ont été employés à la culture et se sont plus ou moins multipliés dans quelques provinces. Ces diverses races se sont mêlées entre elles, et en ont produit de nouvelles, chacune desquelles a été distinguée par une teinte plus ou moins foncée.
Mais, quoique les indigènes aient été conquis et soumis d’abord à un régime très dur, ils n’ont pas été traités comme le sont les esclaves chez les Anglo-Américains, ou comme le sont les esclaves des colonies européennes. Avant même que les colons eussent conquis leur indépendance, les habitants primitifs étaient devenus presque entièrement libres ; et le nombre des esclaves importés d’Afrique était très peu considérable. Nous ne connaissons pas exactement quelle est, sur tous les points, la proportion qui existe entre les personnes libres et les esclaves ; mais il est facile de juger des parties qui nous sont inconnues par celles que nous connaissons le mieux, par le Mexique et par la Terre-Ferme.
M. de Humboldt a estimé la population totale de la partie du continent américain, jadis soumise à l’Espagne, à environ quatorze ou quinze millions. Sur ce nombre, il a pensé qu’on pouvait compter trois millions de créoles blancs, deux cent mille européens, et tout le reste d’indigènes, de noirs ou de métis [225]. Le Mexique seul comprenait, en 1808, 6 500 000 individus de la population totale ; mais, dans ce nombre, on comptait très peu d’individus d’espèce éthiopienne, et presque point d’esclaves. On pouvait parcourir toute la ville de Mexico sans rencontrer de visage noir ; le service d’aucune maison ne s’y faisait jamais avec des esclaves. Sous ce rapport, le Mexique avait déjà un avantage immense sur les États-Unis [226]. Les contrées dans lesquelles on trouvait le plus d’esclaves étaient Caracas et Lima [227]. La province de Venezuela, que le gouvernement espagnol désignait sous le nom de capitainerie générale de Caracas, contenait, à la même époque, suivant M. de Humboldt, près d’un million d’habitants, sur lesquels on comptait soixante mille esclaves [228]. Ainsi, la proportion des individus esclaves aux personnes libres, était un peu moins de un à seize, dans les provinces où les premiers étaient les plus nombreux ; il faut même ajouter que la population asservie se concentrait particulièrement dans les villes. Dans les provinces de Cumana et de Barcelone, où les esclaves étaient nombreux comparativement au Mexique, la population entière s’élevait à 110 000 habitants, et le nombre des esclaves n’excédait pas 6 000. On comptait donc par esclave un peu plus de dix-huit personnes libres [229].
Dans une grande partie de l’Amérique espagnole, les esclaves étaient employés à la garde des troupeaux, ou à d’autres travaux domestiques peu fatigants. D’un autre côté, les denrées alimentaires étant généralement peu chères, ou n’étant pas susceptibles d’exportation, les maîtres ne pouvaient pas faire de grandes économies sur la nourriture de leurs esclaves [230]. Les mœurs et les lois du pays étaient plus favorables que dans aucun autre aux affranchissements : il était très commun qu’un maître léguât la liberté à tous ses esclaves par testament [231]. Si un individu asservi avait des raisons de croire qu’il était devenu un objet d’antipathie pour son possesseur, rien ne lui était plus facile que d’obtenir du magistrat d’être vendu à un autre maître [232]. Enfin, le gouvernement avait fixé le prix auquel un esclave pouvait acheter sa liberté ; et il ne s’agissait, pour chaque individu, que de trouver la somme que la loi l’obligeait de donner à son maître [233]. Ces circonstances étant connues, il s’agit de voir comment elles ont influé sur les mœurs des diverses classes de la population.
On voit, par ce qui précède, que les divisions par les couleurs sont celles qui dominent toutes les autres. Les individus d’origine purement européenne, ou ceux chez lesquels les caractères propres à cette race sont les plus prononcés, se placent au premier rang. Aucun d’eux, en Amérique, ne peut se considérer à l’égard d’un autre comme un conquérant ou comme descendant d’un ancien maître. Il règne donc, en général, chez les hommes de cette classe, quelles que soient d’ailleurs leur fortune et leur naissance, un sentiment d’égalité très énergique, lorsqu’ils se considèrent les uns à l’égard des autres. Si un des hommes titrés du pays manifeste l’intention d’humilier un homme né dans la classe commune, l’orgueil de celui-ci se soulève, et le place à son niveau : « Serait-il possible, lui dit-il, que vous crussiez être plus blanc que moi [234]. » Si un homme dans la misère est offensé de la vanité de celui qui possède une grande fortune, il se met à l’instant au niveau de lui : « Ce blanc si riche, se croirait-il plus blanc que moi ? » Suivant M. de Humboldt, ce sentiment d’égalité a pénétré toutes les âmes : partout où les hommes de couleur sont regardés ou comme esclaves ou comme affranchis, c’est la liberté héréditaire, c’est la persuasion intime de ne compter parmi ses ancêtres que des hommes libres, qui constitue la noblesse : on trouve cet esprit au Mexique comme au Pérou, à Caracas comme à l’île de Cuba [235].
Les familles qui descendent des anciens conquérants, et celles qui tenaient en Espagne un rang distingué, prétendent former sans doute une noblesse particulière ; mais ces prétentions sont généralement repoussées par tous les hommes de leur race. Ces hommes ont une telle idée de leur égalité, suivant Azara, que quand bien même le roi aurait accordé des lettres de noblesse à quelques particuliers, du temps de la domination espagnole, personne ne les aurait regardés comme nobles, et qu’ils n’auraient obtenu ni distinctions, ni services de plus que les autres [236]. Il est résulté de cet esprit d’égalité que, dans les villes, un blanc n’a osé se mettre au service d’un autre, tant il a craint de s’avilir ; dans le temps où le gouvernement espagnol dominait encore dans ces contrées, un vice-roi même n’y aurait pu trouver un laquais, ou un cocher parmi les individus d’espèce purement européenne [237].
[IV-208]
Le sentiment d’égalité qu’on observe chez les hommes de cette classe, quand ils se comparent à des hommes de leur espèce qui possèdent une grande fortune, ou qui jouissent d’une ancienne illustration, est loin d’exister quand ils se comparent aux indigènes, aux nègres ou aux métis. Le degré de mépris qui tombe sur les descendants des peuples conquis ou asservis, est moins en raison du plus ou moins de couleur qu’en raison de l’espèce. Les indigènes, qui ont été les premiers exploités, et qui sont par conséquent l’espèce sur laquelle la servitude a pesé le plus longtemps, sont les plus méprisés. Les individus d’espèce éthiopienne sont placés immédiatement au-dessus d’eux ; les individus issus du commerce d’un blanc et d’une négresse viennent ensuite ; de sorte que, plus une personne approche de la race des maîtres, et moins elle est avilie. Le gouvernement espagnol voulut renverser jadis cette mesure d’appréciation ; il déclara que les mulâtres formeraient le plus bas échelon de l’ordre social, mais il échoua contre la force de l’opinion [238]. Dans d’autres temps, il a accordé des lettres de blanc à des hommes de couleur ; mais ses efforts n’ont pas eu beaucoup plus de succès. Il a pu conférer lui-même directement quelques faveurs à des individus de cette classe ; mais partout où les blancs ont dominé, ils les ont exclus des emplois [239].
[IV-209]
Cependant, quelle que soit la fierté des descendants des Européens quand ils se comparent aux individus des autres races, elle est loin de porter ces caractères d’insolence et de dureté que nous avons observés chez les blancs des autres colonies, et jusque chez les Anglo-Américains du nord. Les indigènes, les noirs, les mulâtres, ne sont point exclus des églises où les blancs se rassemblent ; la seule distinction qui puisse les blesser, consiste dans le privilège dont jouissent les femmes des blancs, de se placer dans l’église, sur des tapis qu’elles y font porter [240]. On ne lit nulle part que, dans les théâtres, ils soient relégués dans des lieux particuliers ; que leurs enfants soient exclus des écoles publiques, ou qu’ils soient assujettis à ces distinctions humiliantes et brutales que nous avons trouvées chez les habitants de New-York, et même chez ceux de Philadelphie [241].
[IV-210]
Le mépris du travail est inséparable du mépris des classes laborieuses ; il ne faut donc pas être étonné qu’il se soit montré dans les colonies espagnoles, comme dans toutes les autres. Mais il est remarquable, cependant, que ce mépris s’est particulièrement manifesté dans les lieux où les esclaves ont été les plus nombreux, et qu’il s’est éteint dans la plupart de ceux où les travaux ont été exécutés par des hommes libres. Dans la ville de Caracas, sur une population que Depons évalue à 41 000 ou 42 000 habitants, on compte environ 14 000 esclaves et environ 10 000 ou 11 000 blancs ; le reste de la population se compose d’affranchis et d’un très petit nombre d’indigènes [242]. Là, les descendants des Européens ont pour le travail un profond mépris ; ils croiraient s’avilir s’ils se livraient à aucun genre d’industrie [243]. Tous les métiers, tous les arts mécaniques sont abandonnés aux affranchis, qui ne s’y livrent qu’avec répugnance, et qui préfèrent souvent la mendicité [244]. La cause de leur inactivité ou de leur défaut d’énergie est la même que celle qui produit l’oisiveté des blancs : l’aversion ou le mépris des occupations industrieuses [245]. La mendicité est si commune, que le nombre des mendiants s’élève à 2 400 [246].
Dans la même province, mais dans les lieux où il paraît moins d’esclaves, les Européens sont actifs et industrieux. Les habitants de Valence, qui se considèrent tous comme issus de familles nobles, même en Espagne, dédaignaient toute occupation industrieuse, il y a un peu plus d’un demi-siècle ; mais un gouverneur ayant été obligé, pour prévenir la disette, de leur faire une loi du travail, le préjugé nobiliaire est tombé, et dès ce moment la population est devenue industrieuse [247]. Cependant, on a vu, longtemps après, les hommes d’origine européenne se retirer à la campagne, afin de s’y livrer au travail avec plus de liberté, et de se dérober ainsi à l’influence du préjugé qui flétrit une vie laborieuse, partout où il existe quelques traces d’esclavage [248]. La population qui, en 1801, n’était que de 6 500 personnes, s’était déjà élevée à 10 000 en 1810. À cette dernière époque, il existait dans la ville beaucoup d’industrie et d’aisance ; les campagnes étaient bien cultivées, et la misère avait disparu [249].
Sur la partie orientale du lac de Valence, et dans l’une des vallées d’Aragua, est un village qui méritait à peine le nom de hameau il y a cinquante ans ; la population se composait alors d’individus d’origine biscayenne, n’ayant ni préjugés, ni maîtres, ni esclaves. Vingt-cinq ans plus tard, le hameau était devenu une jolie petite ville de huit mille âmes ; les trois quarts des maisons étaient bâties en maçonnerie et avaient autant d’élégance que de solidité ; l’industrie, l’activité, en un mot l’amour du travail, formaient la passion dominante des habitants. De nombreuses plantations de coton, d’indigo, de café, de blé, faites avec intelligence et entretenues avec soin, attestaient combien ces hommes étaient laborieux ; ces plantations s’étendaient déjà dans toutes les vallées d’Aragua. Soit qu’on y entrât par Valence, soit qu’on y arrivât par les montagnes de San-Pedro, qui les séparent de Caracas, on se croyait transporté chez un autre peuple, et dans un pays possédé par la nation la plus industrieuse et la plus agricole.
« On ne voit, dit Depons, dans toute l’étendue de quinze lieues, est et ouest, qu’occupent ces vallées, que denrées coloniales artistement arrosées, que des moulins à eau, que des bâtiments superbes pour servir à la fabrique et à la préparation de mêmes denrées. Il faut ajouter que tous les travaux les plus pénibles, tels que les plantations, les sarclaisons et les récoltes s’exécutent par des ouvriers libres payés à la journée ; que les indigènes eux-mêmes sont laborieux ; que l’aisance, la propreté, les bonnes mœurs règnent partout, et qu’on n’y rencontre presque point d’esclaves [250]. »
On trouve, dans les mêmes contrées, d’autres villes où l’activité et l’industrie règnent également. À Vittoria, ville peuplée de 7 800 individus, de gens de toutes les couleurs, tout le monde travaille sans distinction [251]. À Carora, à dix degrés seulement de l’équateur, une population de 6 200 habitants, placée sur un sol ingrat, se livre tout entière à l’industrie, sans distinction de castes ni de couleurs [252]. À Mérida, sous le huitième degré huit minutes au nord, sur une population de 11 500 individus, aucune classe ne dédaigne le travail, et l’aisance qui règne dans la ville, n’y laisse point voir de malheureux [253].
Les hommes d’origine européenne n’ont donc pas ici, pour le travail et l’industrie, le mépris que nous leur avons trouvé dans tous les pays où il existe de nombreux esclaves. Ils n’ont pas non plus pour les noirs ou pour les hommes de couleur, le même mépris, puisqu’ils consentent à se mêler avec eux et à concourir aux mêmes travaux [254]. Ce phénomène est d’autant plus digne d’observation que le contraste qu’il présente est plus frappant ; les Hollandais et les Anglais, si industrieux dans leur pays natal, méprisent tous le travail et deviennent oisifs, en passant dans une contrée où il existe un grand nombre d’esclaves ; les Espagnols, qui ont au contraire la réputation d’être oisifs dans leur propre pays, deviennent laborieux en passant dans un pays où il y a peu ou point d’esclaves. La température du climat ne peut expliquer l’activité des uns ou l’oisiveté des autres ; car le soleil qui échauffe les vallées d’Aragua n’est pas moins ardent que celui qui éclaire le cap de Bonne-Espérance. En même temps que les habitants de ces contrés, qui sont d’origine européenne, ont moins d’aversion pour le travail que ceux des colonies anglaises et hollandaises, on observe qu’ils ont plus d’intelligence. « La vérité, dit Depons, est que les créoles de la Terre-Ferme ont l’esprit vif, pénétrant, et sont plus susceptibles d’application que les créoles de nos colonies [255]. »
Il est une passion particulière aux castes dominantes, qui s’est longtemps conservée chez les Hispano-Américains, et qui probablement ne s’est pas éteinte, quand ils ont conquis leur indépendance, c’est un amour excessif des grades et des emplois ; commander ou gouverner est la passion des descendants ou des affiliés de tous les conquérants, même quand, sous d’autres rapports, ils ont pris les mœurs des nations civilisées. Il faut ajouter cependant que cette passion n’est point exclusive des travaux qu’exigent les besoins de la société, et que, par conséquent, elle est moins malfaisante dans ce pays qu’elle ne l’est dans beaucoup d’autres. « On voit quelquefois, dit M. de Humboldt, ces officiers de milices en grand uniforme et décorés de l’ordre royal de Charles III, assis gravement dans leurs boutiques, se livrer aux plus petits détails de la vente des marchandises ; mélange d’ostentation et de simplicité de mœurs, qui étonne le voyageur européen [256].
Aucun des voyageurs qui ont visité ces contrées, ne dit avoir remarqué chez les habitants cette passion des jouissances physiques, que nous avons observée chez les possesseurs d’hommes, quels que soient d’ailleurs les lieux et les époques dans lesquels ils aient vécu. On n’a pas non plus observé chez eux cette immoralité dans l’union des sexes que nous avons trouvée chez la plupart des maîtres des colonies. Depons assure, il est vrai, que dans une des villes où il existe le plus d’esclaves, les femmes blanches ont souvent pour rivales les femmes de couleur, et que la discorde se manifeste dans le sein d’un grand nombre de ménages ; mais il a attribué ce défaut d’harmonie entre les époux, à des causes étrangères à l’esclavage. Il ne dit rien surtout qui puisse faire soupçonner qu’il existe quelque analogie entre les mœurs de ce pays et celles de Surinam ou de la Jamaïque [257].
[IV-217]
Les esclaves étant peu nombreux, n’inspirent aux maîtres aucune crainte ; d’où il suit que leurs possesseurs ne se croient point intéressés à les abrutir, à les tenir dans un état continuel de terreur et à les marquer d’un fer brûlant pour les reconnaître [258]. De là il résulte aussi qu’on n’est pas obligé de faire des lois qui attentent à la sûreté de tous, pour garantir à quelques maîtres ce qu’ils appellent leurs propriétés.
Mais, quoique ces circonstances tendent à rendre le sort des esclaves moins misérable, ceux d’entre eux qui sont attachés à des plantations, ont beaucoup à souffrir de la pauvreté, de l’avarice ou de la cruauté de leurs maîtres. Un des effets que l’esclavage a produits dans les colonies espagnoles, comme dans toutes les autres, a été de retenir ou de plonger les possesseurs d’esclaves dans la misère. Beaucoup d’entre eux n’ont souvent pour se loger avec leur nombreuse famille, qu’un misérable appartement qui ne les met pas à l’abri de la pluie, et ils couchent sur des cuirs faute de lits. D’autres sont tellement accablés de dettes, que les intérêts qu’ils en paient à leurs créanciers, absorbent la plus grande partie de leurs revenus [259]. Il faut donc qu’ils économisent le plus qu’ils peuvent sur les dépenses de leur maison, et sur celles de leurs esclaves.
Dans les plantations, la maison du propriétaire, placée sur un tertre de quinze à vingt toises d’élévation, est entourée des cases des nègres. On assigne à ceux qui sont mariés un petit terrain à cultiver, et ils y emploient les samedis et les dimanches, seuls jours de la semaine dont ils puissent disposer. Il faut qu’avec le terrain et le temps qu’on leur accorde, ils pourvoient eux-mêmes à leur subsistance et à celle de leur famille. Suivant Depons, les propriétaires, à l’exception d’un petit nombre, laissent leurs esclaves couverts de haillons, et ne leur donnent d’autres vivres que ceux qu’ils cultivent eux-mêmes dans les morceaux de terre qui leur sont répartis. Ils ne s’embarrassent point si la récolte a été bonne ou mauvaise, si le temps a été favorable, ou s’il a été contraire ; tant pis pour l’esclave si elle a manqué. La subsistance de ceux qui sont employés au service de la maison, n’est pas mieux assurée que celle des autres ; les rations qu’on leur distribue le matin pour toute la journée, peuvent suffire à peine au déjeuner. Ils n’ont pas d’autres vêtements que ceux qu’on nomme de livrée, parce qu’ils s’en parent quand ils suivent leurs maîtres ; mais aussitôt qu’ils rentrent, ils s’en dépouillent et restent nus, ou bien ils se couvrent de quelques misérables chiffons. Les maîtres, du reste, vantent leur bonheur, dit M. de Humboldt, comme dans le nord de l’Europe les seigneurs se plaisent à vanter l’aisance des paysans attachés à la glèbe [260].
Il ne paraît pas que les maîtres fassent conduire leurs esclaves dans les champs par des individus armés de fouets comme cela se pratique dans les autres colonies ; mais il se trouve quelquefois parmi eux des hommes qui les traitent d’une manière fort cruelle. Le petit nombre de ceux qu’ils possèdent, n’est pas pour eux une raison d’être plus humains.
« À Cariaco même, dit M. de Humboldt, peu de semaines avant mon arrivée dans la province, un planteur qui ne possédait que huit nègres en fit périr six, en les fustigeant de la manière la plus barbare. Cet acte de cruauté avait été précédé, dans la même année, d’un autre dont les circonstances étaient également effrayantes [261]. »
Un voyageur espagnol assure cependant qu’on ne connaît point, dans ces contrées, ces châtiments atroces qu’on prétend nécessaires pour tenir la population dans la soumission ; il dit que le sort des esclaves ne diffère en rien de celui des blancs de la classe pauvre, et qu’il est même meilleur ; qu’ils sont bien habillés et bien nourris ; que, dans leurs maladies, ils sont soignés par les femmes même de leurs maîtres ; qu’on laisse marier les hommes avec des femmes indiennes, afin que leurs enfants naissent libres ; que plusieurs refusent la liberté qu’on leur offre, et ne veulent l’accepter qu’à la mort de leur maître ; enfin, que les siens ne voulurent l’accepter que par force [262].
Ces témoignages paraissent d’abord contradictoires, et cependant il est aisé de les concilier. Les deux premiers voyageurs parlent d’une province où l’on cultive des denrées propres à l’exportation, et où on ne les obtient que par un travail pénible ; le troisième parle d’une province où l’on s’occupe plus particulièrement de l’éducation des bestiaux. J’ai déjà fait observer ailleurs que les Arabes bédouins traitent souvent leurs esclaves comme les membres de leurs familles, surtout quand ils se montrent intelligents. Deux faits suffisent, au reste, pour caractériser la différence qui existait entre l’esclavage établi dans les colonies espagnoles et celui des colonies hollandaises ; dans celles-ci, les magistrats, sur la demande des maîtres, faisaient couper une jambe à l’esclave accusé de vouloir prendre la fuite ; dans celles-là, un magistrat affranchissait des esclaves qui se plaignaient justement d’avoir été traités avec cruauté par leurs maîtres, dans des mouvements de colère. Il faut ajouter que dans la première le magistrat était un possesseur d’esclaves, tandis que dans la seconde le magistrat n’en possédait point [263].
[IV-221]
Ainsi, quoique les colonies espagnoles fussent soumises au joug de l’inquisition, quoique l’introduction de tout ouvrage qui aurait pu étendre les idées ou réformer les mœurs de la population, y eussent été sévèrement interdits ; quoique nul étranger ne fût admis à s’y établir, et que les indulgences et les asiles accordés aux criminels tendissent à y multiplier les vices et les crimes, les mœurs de la population étaient infiniment supérieures à celles de tous les autres peuples des îles ou du continent d’Amérique, chez lesquels il existait de nombreux esclaves.
Il résulte de là une conséquence qui mérite d’être observée, c’est que ni l’existence des journaux, ni la libre introduction de tous les ouvrages philosophiques, ni les communications avec des étrangers, ni même l’influence de la religion, ne peuvent neutraliser l’influence de l’esclavage ; toutes ces causes, si puissantes chez les peuples où l’esclavage n’existe plus, ont existé relativement aux colonies anglaises et hollandaises, et elles n’y ont jamais produit aucun effet [264].
[IV-223]
CHAPITRE XII. ↩
De l’influence de l’esclavage sur la liberté des individus qui appartiennent à la classe des maîtres, et sur l’existence de ceux qui n’appartiennent ni à la classe des maîtres, ni à celle des esclaves.
Dans les pays ou la population se divise en hommes libres et en esclaves, une grave difficulté se présente d’abord pour les premiers. Comment garantiront-ils l’existence de la servitude, sans compromettre leur propre liberté ? ou comment garantiront-ils leur propre liberté sans affaiblir ou sans briser les liens de la servitude ? Tout individu sera-t-il présumé libre, jusqu’à ce qu’on ait prouvé qu’il est esclave ? Sera-t-il présumé esclave jusqu’à ce qu’on ait prouvé qu’il est libre ? Pendant les procès auxquels donneront lieu les contestations sur l’état des personnes, à qui appartiendra la possession provisoire de l’individu dont la liberté sera mise en question ? Si une personne est présumée libre jusqu’à ce qu’il ait été prouvé qu’elle ne l’est point, comment les maîtres parviendront-ils à garder leurs esclaves ? Comment les poursuivront-ils, s’ils prennent la fuite ? Comment sauront-ils dans quels lieux ils se sont réfugiés ? Si, au contraire, tout individu est présumé esclave, jusqu’à ce qu’il ait été prouvé qu’il est libre, comment les personnes libres ne seront-elles pas sans cesse exposées à être traitées en esclaves ?
[IV-224]
Il ne faut pas douter que des questions semblables ne se soient souvent élevées chez les peuples qui admirent jadis l’esclavage domestique, et qu’elles n’aient compromis la liberté de beaucoup de personnes, et troublé la sécurité du plus grand nombre. L’histoire de Rome nous a transmis le souvenir du procès auquel donna lieu la personne de Virginie, parce que le meurtre de cette jeune fille produisit une révolution ; mais, si son père ne lui eût pas plongé un poignard dans le sein, pour la soustraire aux embrassements impudiques du décemvir, elle eût passé des bras de sa mère sous la puissance du patricien qui la convoitait, et l’histoire n’eût jamais parlé d’elle. Comment pouvait-il exister quelque sécurité pour des enfants, des pères et des mères, dans un pays où il existait toujours un marché ouvert pour la vente d’êtres humains ? dans un pays où chacun confiait ses enfants à la garde de ses esclaves, et où il n’était presque plus possible de les trouver quand ils avaient disparu [265] ?
Dans les colonies anglaises, toute personne d’origine éthiopienne, ou portant la plus légère teinte de la couleur qui distingue les peuples de cette espèce, est présumée esclave jusqu’à la preuve contraire. Un individu de l’espèce des maîtres, pourvu qu’il soit de race pure, peut donc s’emparer de toute personne, homme, femme ou enfant, qui est un peu colorée, et la retenir à titre de propriété, jusqu’à ce qu’elle prouve qu’elle est libre, ou jusqu’à ce qu’elle soit réclamée par un autre propriétaire. Celui qui peut enlever, par ruse ou par violence, les titres qui prouvent que tel ou tel individu est libre, fait de lui un esclave par ce seul fait ; et, pour se l’approprier, il lui suffit d’en prendre possession. Si une personne a le malheur de perdre les titres qui prouvent qu’elle n’est point esclave, elle le devient, quand même personne ne se présenterait pour la revendiquer à titre de propriétaire. Dans ce cas, l’autorité publique s’empare d’elle, l’enferme dans une maison de force, et annonce, par la voie des journaux, que si, dans tel délai, personne n’en a réclamé la propriété, elle sera vendue publiquement, ce qui, en effet, est exécuté [266].
Dans les parties des États-Unis où l’esclavage est établi, il existe une loi semblable. Un acte adopté en 1740 dans les Carolines, et confirmé à perpétuité en 1783, déclare que tous les noirs et mulâtres qui sont dans ces colonies, ainsi que leurs enfants, nés et à naître, sont et demeureront à jamais esclaves. Dans une seconde disposition, il est dit que tout noir sera toujours présumé esclave, jusqu’à la preuve du contraire. Il résulte de ces deux dispositions des iniquités exactement semblables à celles qui ont lieu dans les colonies anglaises. Si une personne libre perd les titres qui prouvent sa liberté, ou s’ils lui sont ravis par fraude ou par violence, elle devient l’esclave du premier individu qui juge à propos de s’emparer d’elle [267].
L’existence de l’esclavage dans les États du sud influe même sur la liberté des citoyens dans les États du nord. Les gouvernements de ces derniers États ont compris que s’ils admettaient sur leur territoire le principe établi en France, que tout homme est libre dès qu’il a posé le pied sur le territoire, les esclaves du sud tendraient sans cesse à émigrer sur leur propre sol. Mais, comme ils ne voulaient ni favoriser la fuite des esclaves, ni reconnaître expressément la légitimité de l’esclavage, ils ont eu recours à des moyens détournés : ils ont fait des lois qui maintiennent l’esclavage d’une manière indirecte, et qui s’appliquent aux hommes de toutes les couleurs.
Dans notre législation, l’obligation de faire une chose ou de rendre certains services, se résout en dommages, lorsque celui par lequel elle a été contractée, ou au nom de qui elle l’a été, ne veut pas, ou ne peut pas la remplir. S’il en était autrement, on arriverait à l’établissement de l’esclavage, puisqu’un homme aurait la faculté de se vendre, et que celui qui l’aurait acheté aurait la faculté de l’aliéner.
Les Anglo-Américains ne pouvant se résoudre à proscrire franchement l’esclavage, ont trouvé le moyen de conserver la chose et de bannir le nom. Chez eux, l’obligation de faire une chose, ou de rendre certains services, ne se résout jamais en dommages-intérêts : quand elle a été contractée, il faut, de gré ou de force, qu’elle soit exécutée. L’individu engagé ne peut pas espérer de se soustraire à son engagement par la fuite ; car la loi défend à toute personne de lui donner asile, sous peine d’amende. Il est ramené à son maître par la force publique aussitôt qu’il est repris, et il est condamné, de plus, à servir pendant un nombre de semaines égal au nombre des jours qu’il a fait perdre à son propriétaire. Si le maître ne veut pas le poursuivre, il le vend à celui qui veut l’acheter, et l’acquéreur est substitué à sa place. En vertu de cette loi, si le citoyen d’un État où l’esclavage est proscrit veut avoir des esclaves, il se rend dans un des États où il est permis d’en acheter ; mais, au lieu de se faire faire un acte de vente, il se fait faire un acte d’apprentissage pour dix ou quinze années [268], et il amène chez lui ses apprentis, dont il use comme de sa propriété. Au terme fixé pour l’apprentissage, il a le choix de les laisser en liberté, ou d’aller les revendre à perpétuité dans le pays où il les a achetés. Celui qui les revend, peut, au moyen du prix qu’il en retire, se procurer de nouveaux apprentis, qu’il ira vendre encore avant l’expiration du terme de l’apprentissage. Les habitants du sud qui vont dans le nord, peuvent y amener leurs esclaves, et les emmener ensuite, sans que cela paraisse faire la moindre difficulté. Les constitutions des pays où cela se pratique disent, en termes exprès : Tous les hommes sont nés également libres et indépendants [269].
Les mesures prises pour prévenir ou rendre vaine la fuite des esclaves, ont établi un genre de commerce qui ressemble beaucoup à la traite des blancs. Des capitaines américains prennent, en Europe, des individus qui s’engagent à un certain nombre d’années de service, pour payer leur passage aux États-Unis. Ces capitaines, arrivés dans leur pays, font annoncer dans les journaux qu’ils amènent tel nombre de personnes de tel âge, de tel sexe, de telle profession, et qu’ils en feront la vente publique à tel ou tel jour. Les passagers sont vendus, en effet, au plus offrant, qui peut, à son tour, aller les revendre dans les pays où le prix de la main-d’œuvre est le plus élevé. Des hommes, et même des femmes, peuvent ainsi être vendus et revendus jusqu’à ce que le terme de leur engagement soit expiré. Des Américains peuvent aussi se vendre eux-mêmes ou vendre leurs enfants, pour un nombre d’années déterminé [270].
Dans les États du sud, tout individu étant présumé esclave, par cela seul qu’il a le teint plus ou moins foncé, et tout homme qui se livre à un travail manuel quelconque étant avili, il s’ensuit que les individus qui ont échappé à l’esclavage sans s’être élevés à la dignité d’oisifs et de possesseurs d’hommes, restent dans le mépris le plus profond. Le mépris étant le produit de leur couleur et du besoin qu’ils ont de travailler, ils ne peuvent espérer de se faire estimer par aucune qualité morale ; il n’est point de vertu capable d’affaiblir l’effet que produit la couleur de leur teint. Un vice qui leur donne le moyen de s’enrichir ou seulement de vivre dans l’oisiveté comme la race des maîtres, les rend plus estimables aux yeux de ceux-ci, qu’un travail honorable qui les enrichit, mais qui a le désavantage de les faire descendre au niveau des esclaves. Il faut donc qu’ils soient oisifs et paresseux, pour être moins méprisés ; car la pauvreté oisive est encore moins avilie que l’aisance laborieuse [271].
[IV-230]
L’avilissement dans lequel sont plongés les individus qui ont besoin, pour exister, de se livrer à quelque genre d’industrie, les détermine à quitter le pays, et à se réfugier dans les pays cultivés par des mains libres, aussitôt qu’ils en ont les moyens. Ceux mêmes qui ont quelques petites propriétés se hâtent de les vendre, pour aller en acheter dans les pays où un homme libre peut travailler sans être avili [272]. Dans ces pays, les hommes de couleur ont encore à souffrir le mépris qui est attaché à leur teint ; mais, en travaillant, ils ne se dégradent pas, ils ne se mettent pas au-dessous des blancs. La désertion des hommes qui n’appartiennent ni à la classe des maîtres, ni à celle des esclaves, se manifeste de plusieurs manières ; mais il n’en est aucune qui la démontre d’une manière plus frappante que l’aspect général du pays, et le grand nombre de personnes de couleur qu’on rencontre dans les États du nord. Dans la Caroline du sud, il n’y a ni classes, ni propriétés intermédiaires : tout est planteur ou esclave. Un planteur est sur sa plantation entouré de ses nègres, qui couchent dans de mauvaises cahutes près de sa maison. À quelques milles de là un autre vit de la même manière, et puis un autre ; enfin, toujours de même, tant que s’étend la partie basse de la Caroline du sud [273].
Si le misérable état des noirs, dit Francis Hall, leur laissait le moyen de réfléchir, ils pourraient rire dans leurs chaînes, en voyant combien l’existence de l’esclavage a rendu le pays hideux. Les villages riants et l’heureuse population des États de l’est et du centre, sont remplacés ici par les équipages splendides d’un petit nombre de planteurs, et par une misérable population de noirs rampant dans de sales huttes ; car, après avoir traversé les Susquehanna, on ne rencontre presque plus de villages, mais seulement des plantations ; ce seul mot en dit plus que des volumes [274].
Cependant, quoique les hommes pour lesquels le travail est un besoin, émigrent autant qu’ils le peuvent des pays cultivés par des esclaves dans les pays où le travail est exécuté par des mains libres, tous n’ont pas cette faculté. Dans les villes, il en reste plusieurs qui sont retenus par leurs habitudes, par l’espoir du gain, ou par l’impossibilité de se transporter ailleurs. La condition des personnes de cette classe, dit le voyageur que je viens de citer, est à peine préférable à celle des esclaves. Sujets au même mode de procédure, exposés à la même surveillance, privés des droits ou des privilèges des citoyens, environnés de pièges de tous les genres, légaux et illégaux, leur liberté paraît une moquerie ajoutée à l’oppression de la servitude. La loi déclare que toute personne de couleur est présumée esclave, et toutes les feuilles publiques sont les commentaires journaliers de cette injuste et barbare disposition ; elles annoncent tous les jours que des hommes de couleur ont été arrêtés sur le soupçon d’être esclaves ; qu’ils ont été mis en prison, et que, si aucun propriétaire ne se présente, ils seront vendus pour payer leur dépense [275].
On a vu quelquefois des hommes de la race des maîtres se coaliser pour réduire en servitude des hommes de couleur libres. Lorsque ce genre de voleurs avaient jeté leur dévolu sur leur victime, homme ou femme, un d’eux portait contre elle une fausse accusation ; sur cette plainte, un mandat d’arrêt était lancé, et l’accusé mis en prison. Là, sans amis et sans argent, il attendait d’être jugé pour un crime qu’il ignorait, et sur une accusation portée par un inconnu. En peu de temps, il perdait courage, et ses craintes lui faisaient prévoir ce qui pourrait lui arriver de pire. Un officier de police se présentait alors ; il lui exagérait les dangers de sa situation, et lui exposait combien était petite la chance qu’il avait de recouvrer sa liberté, même quand il serait reconnu innocent, à cause de ses dépenses dans la prison ou des frais de justice. Mais, ajoutait-il, je connais un digne homme qui s’intéresse en votre faveur, et qui fera ce qui est nécessaire pour vous faire recouvrer votre liberté ; il ne vous impose pas d’autre condition que de le servir pendant un certain nombre d’années. Le digne marchand d’esclaves paraissait alors sur la scène ; il faisait au malheureux un tableau charmant de la vie de campagne qu’il allait mener. L’acte d’esclavage était passé ; la victime était jetée sur un vaisseau, et on n’entendait plus parler d’elle. Ce trafic a duré longtemps avant que d’être découvert [276].
Dans les colonies anglaises, le sort de la partie de la population qui n’appartient ni à la classe des maîtres, ni à celle des esclaves, diffère peu de ce qu’il est dans la partie méridionale des États-Unis. Les mœurs des maîtres y étant les mêmes, les esclaves у étant traités d’une manière plus dure encore, et les lois sur les hommes de couleur libres у étant semblables, le sort de ces hommes ne peut pas y être différent ; à peu de chose près, il est aussi dur que celui de la population asservie. Les craintes qu’inspirent aux possesseurs d’esclaves les hommes de couleur libres, paraissent même plus vives dans les colonies anglaises qu’elles ne le sont aux États-Unis, si nous en jugeons par les mesures qui ont été prises pour prévenir leur multiplication. Dans presque toutes les îles, une forte amende est imposée sur les maîtres qui affranchissent leurs esclaves ; dans plusieurs, il est défendu aux noirs et aux hommes de couleur, sous peine de confiscation, d’acquérir des terres à titre de propriétaires, et de louer une maison pour un terme qui excède sept années ; dans quelques-unes, un esclave ne peut être affranchi avant qu’il ait atteint l’âge de quarante années et sous la condition qu’il sera immédiatement déporté [277].
Enfin, dans les colonies françaises les hommes de couleur libres sont traités par la race des maîtres, presque aussi durement que les esclaves : il n’existe pour eux presque aucune espèce de garantie.
Dans tous les pays où la masse de la population se divise en maîtres et en esclaves, les individus qui n’appartiennent ni à l’une ni à l’autre de ces deux classes, n’ont qu’une existence précaire, et ne peuvent presque pas sortir de l’indigence. Le service de l’intérieur des maisons et les travaux de la campagne étant faits par des individus asservis, il ne reste pour les ouvriers libres que des travaux accidentels. Les arts ne peuvent être une ressource pour eux, soit parce que l’existence de l’esclavage en empêche le développement, ainsi qu’on le verra dans le chapitre suivant, soit parce que les maîtres s’en attribuent le monopole au moyen de leurs esclaves. Ils sont donc condamnés à une éternelle indigence, d’abord par l’opinion qui avilit les hommes laborieux, et ensuite par l’impossibilité de se livrer à aucune occupation lucrative. Lorsque, dans un tel pays, des individus de la classe des maîtres tombent dans la misère, ils ne peuvent presque plus en sortir, à moins que ce ne soit par des conquêtes ou des concussions.
Les mœurs de la partie de la population dont je me suis occupé dans ce chapitre, tiennent tout à la fois de celles des maîtres et des esclaves, sans être cependant aussi vicieuses que celles des uns ou des autres. Elles tiennent des mœurs des maîtres, par l’estime accordée à l’oisiveté, par le mépris pour la population asservie, et par les vices que l’oisiveté engendre. Elles tiennent des mœurs des esclaves par la bassesse à l’égard des maîtres, par la fausseté qui naît du sentiment de l’oppression, et par la lâcheté que donne le sentiment de la faiblesse [278].
[IV-237]
CHAPITRE XIII. ↩
De l’influence de l’esclavage domestique sur la production, l’accroissement et la distribution des richesses.
Le travail fait par des esclaves est-il moins dispendieux que celui qui est exécuté par des hommes libres ? Cette question, sur laquelle des écrivains fort éclairés se sont divisés, me semble peu philosophique. Ne préjugerait-elle pas, en effet, que les hommes qui concourent à la production des richesses, ne sont que des machines dont un petit nombre d’oisifs peuvent arbitrairement diriger, accélérer ou ralentir les travaux, et qui ont d’autant plus de valeur qu’elles absorbent une part moins considérable des richesses qu’elles produisent ? Que des voleurs de grand chemin discutent entre eux, si les propriétés qu’ils acquièrent en rançonnant les voyageurs leur coûtent plus cher que celles qui sont acquises par des hommes qui exercent quelque branche d’industrie, je le conçois ; que des pirates mettent en discussion si les peines, les soins et les dangers de la piraterie sont plus grands ou plus productifs que les peines, les soins et les dangers du commerce maritime, je le conçois encore ; pour les premiers comme pour les seconds, la question peut ne pas être éclaircie, et ni les uns ni les autres n’ont à la discuter, ni comme moralistes, ni comme législateurs. Mais élever une question analogue chez des peuples policés, et en traitant une science, c’est, à ce qu’il me semble, renoncer à l’impartialité qui doit présider à toute recherche scientifique, et rétrograder vers la barbarie. Adam Smith, dont l’esprit était d’ailleurs si juste, a mal posé la question, et il a entraîné dans l’erreur presque tous ceux qui l’ont traitée après lui [279].
J’ai fait observer ailleurs que, lorsqu’on traite des sciences morales, il faut écarter avec soin les dénominations qui peuvent fausser notre jugement, en nous faisant voir des êtres différents dans des individus qui sont de même nature. Il ne peut y avoir dans les sciences morales, pas plus que dans les sciences physiques, ai-je dit, ni maîtres ni esclaves, ni rois ni sujets, ni citoyens ni étrangers. Il ne peut y avoir que des hommes ou des agrégations d’hommes, différant entre eux par leurs habitudes, par leurs préjugés, par leurs lumières, par leurs prétentions, agissant bien ou mal les uns sur les autres et portant des noms divers [280].
En partant de ce fait, on ne peut donc voir dans les esclaves comme dans les maîtres, que des créatures humaines, et dès lors la question posée au commencement de ce chapitre revient à celle de savoir si le travail qu’un homme obtient d’un grand nombre d’autres en leur déchirant la peau à coups de fouet, lui coûte plus que le travail qu’il obtiendrait d’eux en leur en payant un juste salaire. On voit, par la manière dont la question a été posée, que les premiers écrivains qui l’ont agitée, se sont trouvés dans la race des maîtres, et que c’est principalement dans l’intérêt des plus forts qu’ils l’ont examinée. Jamais des hommes asservis ne se fussent avisés de mettre en question, si les fatigues et les souffrances au prix desquelles ils obtiennent leur chétive subsistance, sont moins grandes que les travaux et les peines au moyen desquels des ouvriers libres achètent leur salaire. Cette question est cependant la même que la précédente ; il n’y a de différence entre l’une et l’autre, qu’en ce que dans la première ce sont les maîtres qui examinent si la servitude est conforme ou contraire à leurs intérêts, tandis que dans la seconde ce sont les esclaves qui se livrent à un semblable examen [281].
[IV-240]
Le calcul qu’a fait Adam Smith, lorsqu’il a voulu comparer le prix du travail exécuté par des hommes libres au prix du travail exécuté par des hommes asservis, aurait dû le convaincre qu’on ne pouvait établir à cet égard aucun parallèle, et que la question, ainsi considérée, n’était pas même du domaine des sciences morales. Pour déterminer le prix de deux choses, il ne suffit pas, en effet, de les comparer l’une à l’autre ; il faut un troisième terme de comparaison ; il faut des hommes qui aient besoin d’effectuer un échange ; mais si c’est un être humain qui entre dans le marché ou qui en est la matière, comment en déterminera-t-on la valeur ? Sera-ce par la demande de l’individu qui le tient asservi, et par l’offre de celui qui veut en acquérir la possession ? Mais ici une difficulté se présente : c’est de savoir pourquoi, dans la fixation du prix, on ne consultera pas la volonté de l’homme possédé, aussi bien que la volonté de celui qui le possède ; quelle est l’échelle sur laquelle un homme peut fixer la valeur d’un homme ? Ce n’est pas tout : lorsque le prix d’un homme a été convenu entre le vendeur et l’acheteur, et que celui-ci l’a payé, il doit faire son marché avec l’homme vendu pour obtenir de lui qu’il travaille ; mais que lui offrira-t-il pour se faire livrer cette marchandise que nous appelons du travail, et dont nous cherchons à connaître le prix ? Il lui offrira ce qui lui est rigoureusement nécessaire pour vivre, plus un nombre de coups de fouet suffisant pour le contraindre à accepter le marché : or, ce dernier poids jeté dans la balance trouble singulièrement le calcul.
Supposons, en effet, qu’un individu, ayant la bourse légère et le bras vigoureux, se présente chez un marchand ; qu’il offre de lui payer un dixième de sa marchandise en bonne monnaie, et le surplus en coups de bâton ; s’il est assez fort pour faire agréer sa proposition, faudra-t-il considérer le traité comme ayant fixé le cours régulier des marchandises ? Tel est cependant le calcul que font les possesseurs d’hommes, quand ils comparent ce que coûte le travail d’un ouvrier asservi à ce que coûte le travail d’un ouvrier libre.
Un planteur peut croire que le travail d’un homme qu’il tient enchaîné et qu’il stimule à coups de fouet, ne lui coûte que le prix auquel il l’a acheté, et les frais de son entretien, comme un pirate peut croire que les marchandises et les hommes dont il s’est rendu maître, ne lui ont coûté que quelques livres de poudre et quelques boulets de canon ; mais nous, qui n’avons aucun tarif pour fixer la valeur de nos semblables ; nous, qui ne savons pas quel est le prix légitime auquel on achète la faculté de faire violence à des hommes, à des enfants ou à des femmes ; nous, qui n’admettons pas que la partie la plus considérable du genre humain ait été créée pour les plaisirs d’un petit nombre d’oisifs ; nous, qui ne pouvons voir dans les relations qui ont lieu entre un maître et ses esclaves, que l’action de la force et de la brutalité sur la faiblesse et sur l’ignorance ; nous, aux yeux de qui les esclaves sont des hommes aussi bien que les maîtres, et qui devons calculer ce que coûte un produit, non pas à tels ou tels individus, mais au genre humain tout entier ; nous, qui ne pouvons pas ne compter pour rien les violences et les misères auxquelles des populations sont assujetties pour les plaisirs d’un petit nombre d’individus, nous devons raisonner autrement que des possesseurs d’hommes.
Nous devons exposer, sans doute, les effets que produit la servitude sur l’accroissement et sur la diminution des richesses ; mais, en faisant cette exposition, nous ne devons pas oublier que les richesses ne sont qu’un moyen, et que nous devons les évaluer, moins par la quantité, que par l’influence qu’elles exercent sur le bien-être des nations. Nous devons prendre garde surtout, lorsque nous calculons la somme de richesses produites dans une circonstance donnée, de ne pas jeter les yeux seulement sur celles que possède une petite fraction de la population ; nous devons considérer celles que possèdent toutes les classes d’hommes, sans distinction de rangs ni de nations. Si nous calculons d’un côté ce que coûte à un possesseur de terres ou à un manufacturier le travail qu’il fait faire, nous devons calculer, de l’autre, ce que coûte à l’homme pauvre la subsistance qu’il achète avec du travail. Le pays le plus misérable est celui dans lequel il faut donner la somme la plus considérable de travail pour obtenir la somme la plus petite des moyens d’existence, car dans tous les pays la masse de la population se compose de familles laborieuses.
Extorquer les capitaux du riche par des violences, ce n’est pas créer des richesses ou en accroître la somme, c’est les déplacer ; de même, extorquer le travail du pauvre par des coups de fouet ou par des moyens analogues, ce n’est pas diminuer les frais de production, c’est ravir à la masse de la population ses moyens d’existence pour engraisser un petit nombre d’oisifs. Ce qui est vrai pour des individus comparés à des individus, est vrai pour des nations comparées à d’autres nations ; il n’y a de différence entre le premier cas et le second, qu’en ce que, dans celui-ci, le brigandage est établi sur une base plus large.
Adam Smith et quelques-uns des écrivains qui sont venus après lui et qui ont traité la même question, semblent avoir cru que, pour juger de l’effet que l’esclavage domestique produit sur les richesses, il suffisait de calculer ce que coûte à un entrepreneur le travail d’un homme esclave et le travail d’un homme libre ; c’est à peu près comme si l’on jugeait de la difficulté de faire avancer une pesante voiture, par la résistance que lui offrent les atomes qui voltigent dans les airs.
Pour juger de l’influence de l’esclavage sur les richesses, il faut comparer d’abord la quantité qui en est produite dans un pays où l’esclavage est inconnu, à la quantité qui en est produite dans un pays où tous les travaux sont exécutés par des esclaves, toutes circonstances étant égales d’ailleurs ; il faut examiner ensuite comment, dans l’un et l’autre pays, ces richesses se distribuent entre les diverses classes de la population ; il faut déterminer de plus quelle est l’influence qu’exercent les divers modes de distribution sur la consommation ; enfin, il faut examiner quelle est la somme de travaux ou de peines au prix desquelles elles sont achetées.
Toutes les richesses que possèdent les nations sont le produit du travail de l’homme combiné avec les forces de la nature. La plupart des choses qui existent, concourent sans doute, de concert avec l’industrie humaine, à la formation des objets qui nous sont nécessaires. L’air, la terre, l’eau, le feu, le vent, nous prêtent leurs forces, pour produire des richesses, pour créer, ou pour mettre en mouvement des machines productives. Mais, si l’homme n’avait jamais su diriger ces forces, il n’existerait pas plus de richesses dans les pays qui sont aujourd’hui les plus florissants, qu’il n’en existait dans la Nouvelle-Hollande avant que les Européens y fussent arrivés. Si tout travail cessait chez les nations les plus riches, elles auraient en peu de temps disparu de la surface de la terre, et le sol qu’elles habitent serait, dans un petit nombre d’années, semblable aux déserts sur lesquels la civilisation n’a jamais pénétré.
Il ne peut donc pas, à proprement parler, exister de richesses, à moins que l’homme ne concoure à les produire. Mais, comment peut-il y concourir ? De trois manières : par le développement de son intelligence, qui lui fait connaître les forces de la nature et qui lui apprend à en tirer parti ; par l’habileté qu’il donne à ses organes physiques d’exécuter les opérations que son intelligence a conçues ; enfin, par des habitudes morales qui lui donnent le moyen de conserver et d’accroître ses richesses, ou d’en disposer de la manière la plus avantageuse. Il est donc nécessaire, pour apprécier les effets que l’esclavage produit sur l’accroissement ou la diminution des richesses, de juger d’abord des effets qu’il produit sur toutes les facultés humaines.
Le premier effet que l’esclavage a toujours produit sur les mœurs des maîtres, a été d’avilir à leurs yeux le travail de l’homme sur les choses. Nous ne trouvons à cet égard aucune exception ni chez les anciens, ni chez les modernes ; les maîtres grecs ont pensé comme les maîtres romains ; les possesseurs des noirs ou des hommes de couleur comme les possesseurs de blancs attachés à la glèbe. Le travail étant avili, les maîtres renoncent à toute profession industrielle ; ils s’abstiennent d’appliquer leurs organes physiques à la production des choses nécessaires à l’existence de l’homme. Ainsi, partout où la population est divisée en maîtres et en esclaves, l’action des premiers sur les choses est complètement perdue pour la production des richesses.
En même temps que l’esclavage inspire aux individus de la classe des maîtres le mépris du travail, l’oisiveté à laquelle il les condamne fait naître chez eux la passion des jouissances physiques et de tout ce qui peut rompre la monotonie de leur existence, sans exiger d’eux aucune fatigue : la table, les femmes, les jeux de hasard, les spectacles absorbent alors tout le temps qui n’est pas consacré à la domination ou au sommeil ; si à cet égard il a existé quelques exceptions individuelles, on n’en trouve point en considérant les nations en masse. Ainsi, tandis que l’esclavage rend nul le travail des maîtres, et qu’il met à leur disposition les richesses produites par le travail d’autrui, il leur donne les vices nécessaires pour les dissiper. Et comme la production annuelle des richesses est en raison composée du travail et de la cumulation des capitaux, il est clair que la production ne peut jamais être très grande là où tous les revenus sont consommés improductivement à mesure qu’ils sont produits.
Les travaux intellectuels sont un peu moins avilis chez les individus de la classe des maîtres, que ne le sont les travaux manuels ; cependant, il est très rare de voir des maîtres développer leur intelligence, à moins que ce ne soit pour multiplier le nombre de leurs esclaves, pour consolider ou pour étendre leur domination. Dans les pays où ils ont conservé leur liberté politique, ils exercent quelquefois leur esprit dans l’art de persuader ou de commander ; mais jamais ils ne l’exercent dans l’art de rendre plus productif le travail de l’homme sur la nature. Ils croiraient, en se livrant à des études de ce genre, qu’ils se fatiguent pour épargner de la peine à la population asservie, et ils ne lui portent pas assez d’intérêt pour chercher à lui rendre le travail plus léger. Quant aux maîtres qui ne jouissent d’aucune liberté politique, les vices et les préjugés que leur donne l’esclavage, ne leur permettent de développer leur intelligence sur rien. S’il se trouve des individus qui sortent de la classe commune, ils ne cherchent guère qu’à acquérir les connaissances qui leur paraissent les plus favorables à leur propre affranchissement. Les facultés intellectuelles et morales des maîtres sont donc perdues pour la production et la conservation des richesses, aussi bien que leurs forces physiques.
L’effet que produit l’esclavage sur les facultés intellectuelles de la partie de la population qui est asservie, est encore plus étendu que celui qu’il produit sur les facultés intellectuelles des maîtres. Trois causes concourent à l’abrutissement des esclaves : la première est le soin que les maîtres prennent de les rendre stupides, pour assurer leur propre sécurité ; la seconde, les travaux dont ils les accablent, et qui ne leur laissent le temps de réfléchir sur rien ; la troisième, l’absence complète de tout intérêt à s’éclairer.
Un esclave ne cherche à développer son intelligence que pour échapper à la violence de son maître ; il devient rampant, menteur ou flatteur ; mais quelle raison aurait-il de devenir plus intelligent et plus industrieux, puisqu’il ne peut jamais disposer des produits de son industrie ? Chez lui tout principe d’activité est éteint. Quel motif en effet pourrait avoir un esclave de faire quelque progrès ? Pour qui se donnerait-il de la peine ? Pour lui-même ? il ne peut rien sur sa propre destinée. Pour ses enfants ou pour sa femme ? il ne peut rien pour eux ; il ne peut leur transmettre ni richesses, ni lumières, ni sentiments. Pour ses compagnons de servitude ? il ne peut leur rendre aucun service, et à leur tour ils ne peuvent rien pour lui. Travaillerait-il pour sa réputation, pour sa gloire ? il n’y en a point pour des esclaves. Pour la race des maîtres ? ce sont des ennemis que son intérêt est de détruire. Il ne peut exister, en un mot, parmi des esclaves ni transmission de richesses, ni transmission de connaissances, ni transmission d’idées morales. L’esclave n’est comptable que de l’emploi de ses forces physiques brutes, et quand il en a livré le produit à son maître, celui-ci n’a plus rien à lui demander. L’esclavage a donc pour effet de faire descendre les esclaves au dernier terme de misère et d’abrutissement auquel il soit possible à l’homme d’arriver, et de rendre stationnaire ou rétrograde toute la partie de la population asservie.
Les esclaves n’ont pas plus d’influence, par leurs mœurs, sur la production et l’accroissement des richesses, qu’ils n’en ont par leurs facultés intellectuelles. Réduits à ce qui leur est rigoureusement nécessaire pour vivre, ils n’ont rien à économiser ; et quand même il leur resterait du superflu, ils ne feraient aucune économie, puisqu’ils ne peuvent rien posséder en propre. Ceux qui ont quelque puissance sur les richesses possédées par leurs maîtres, sont intéressés à en consommer le plus possible. Pour eux, prendre n’est pas voler, c’est se remettre en possession d’une valeur que leurs travaux ont produite, et dont le prix ne leur a été payé qu’à coups de fouet. S’il leur arrive de s’emparer de quelque valeur, il faut qu’ils la consomment à l’instant, ou qu’ils courent le risque d’en être dépouillés ; ils sont à cet égard dans la même position que les sauvages. Enfin, toutes les facultés de la partie de la population qui n’appartient ni à la classe des esclaves, ni à celle des [IV-250] maîtres, sont également nulles pour la production des richesses. Quand les hommes de cette classe n’ont pas le moyen d’émigrer, ils vivent dans l’oisiveté ; ils mendient ou volent ; aux yeux des maîtres, ce genre de vie est moins déshonorant que le travail : il est plus analogue à la manière dont ils vivent eux-mêmes. Dans un pays exploité par une population asservie, il ne reste donc pour la production des richesses, que les organes physiques des esclaves, destitués de tout principe d’intelligence et d’activité, et stimulés seulement par l’action du fouet. Or, des châtiments corporels peuvent bien exiger certain mouvement du corps, mais ils ne peuvent créer cette énergie que donne une volonté libre ; et quand même ils parviendraient à la créer, une force destituée d’adresse, d’intelligence et de moralité, ne saurait produire et encore moins conserver beaucoup de richesses, quelque énergique qu’elle fût d’ailleurs.
Les faits généraux que j’énonce ici ne sont pas de simples conjectures tirées de la connaissance que nous avons de la nature de diverses espèces d’hommes ; ce sont des observations faites chez tous les peuples qui ont eu des esclaves. De ces faits, il résulte trois conséquences : la première, que l’esclavage s’oppose à la cumulation des capitaux qui constituent la richesse ; la seconde, qu’il est un obstacle à toute invention, ou à l’adoption de toute découverte propre à faciliter la production ; la troisième, qu’il est un obstacle à l’exercice de tout art qui exige, de la part de l’artiste, de l’attention, de l’intelligence, de l’adresse.
Pour savoir si les faits particuliers répondent à ces observations, il suffit de connaître quelles sont les diverses branches d’industrie exercée par les maîtres ou par les esclaves ; quels sont les travaux auxquels se livrent des individus qui n’appartiennent à aucune de ces deux classes, et quelle est l’abondance dont les uns et les autres jouissent [282].
Nous ne connaissons pas assez quelle fut l’industrie des peuples anciens, depuis leur origine jusqu’à leur décadence, ni quelle fut la part qu’y prirent les diverses classes de la population, pour entrer à cet égard dans des détails bien précis. Nous voyons seulement que tout dégénéra, lorsque les conquêtes des Romains, ayant mis tous les peuples au même niveau, eurent multiplié jusqu’à l’excès le nombre des esclaves, et lorsque l’état de paix ne permit plus de réduire des hommes libres en servitude. Nous pourrons juger d’ailleurs des effets que l’esclavage produisit dans tous les arts, par l’influence qu’il exerça sur l’agriculture, suivant le témoignage même des écrivains de cette nation [283].
J’ai déjà fait observer qu’à mesure que le nombre des esclaves s’était accru en Italie, le pays était devenu moins fertile, et qu’il avait fini par être converti en pâturages. Pline s’est demandé quelle avait été la cause de ces abondantes récoltes qui existaient dans les premiers temps de la république ; et la principale cause qu’il en a trouvée, est que, dans ces temps, des hommes parvenus à la dignité consulaire cultivaient leurs champs de leurs propres mains, tandis que de son temps la culture en a été livrée à des misérables chargés de fers, et portant sur leurs fronts la marque de leur servitude. Columelle et Varron ont observé également la funeste influence qu’exerça l’esclavage sur l’agriculture [284].
« Les propriétaires, dit un savant historien de notre temps, ayant étendu leur patrimoine à Rome, par les terrains confisqués sur les peuples conquis ; en Grèce, par les richesses qu’ils devaient au commerce ; ils abandonnèrent le travail manuel, et bientôt après ils le méprisèrent. Ils fixèrent leur séjour dans les villes ; ils confièrent l’administration de leurs terres à des régisseurs et à des inspecteurs d’esclaves ; et dès lors la condition de la plus grande partie des habitants des campagnes devint intolérable. Le travail, qui avait établi un rapport entre les deux rangs de la société, se changea en une barrière de séparation : le mépris et la dureté remplacèrent les soins ; les supplices se multiplièrent, d’autant plus qu’ils étaient ordonnés par des subalternes, et que la mort d’un ou de plusieurs esclaves, ne diminuait point la richesse des régisseurs. Ces esclaves, mal nourris, maltraités, mal récompensés, perdirent tout intérêt aux affaires de leurs maîtres et presque toute intelligence. Loin de soigner avec affection les produits de la terre, ils éprouvaient une secrète joie toutes les fois qu’ils voyaient diminuer la richesse, ou tromper les espérances de leurs oppresseurs...
« L’étude des sciences et l’habitude de l’observation, firent faire, il est vrai, des progrès à la théorie de l’agriculture ; mais en même temps sa pratique déclinait rapidement, et tous les agronomes de l’antiquité s’en plaignent [285]. Le travail des terres fut absolument dépouillé de cette intelligence, de cette affection, de ce zèle qui avaient hâté ses succès. Les revenus furent moindres, les dépenses plus considérables, et dès lors on chercha à épargner sur la main-d’œuvre plutôt qu’à augmenter ses produits. Les esclaves, après avoir chassé des campagnes tous les cultivateurs libres, diminuèrent eux-mêmes rapidement en nombre. Pendant la décadence de l’empire romain, la population de l’Italie n’était pas moins réduite que l’est aujourd’hui celle de l’Agro romano, et elle était en même temps descendue au dernier degré de souffrance et de misère [286]. ».
Les effets que produit l’esclavage sur les richesses dans les colonies, sont encore plus faciles à apprécier que ceux qu’il produisit chez les anciens. L’agriculture est presque la seule branche d’industrie qui existe dans les colonies où l’esclavage est établi ; mais elle y est exercée sans soins, sans intelligence. On a vu ailleurs quelle est la stupidité des paysans du cap de Bonne-Espérance ; elle est telle qu’on peut être tenté de mettre en doute si, sous le rapport du développement intellectuel, les colons sont au-dessus de leurs troupeaux. Ils sont riches dans ce sens qu’ils sont abondamment pourvus de viande de boucherie, leurs troupeaux se multipliant sans aucun soin de leur part ; mais, à cela près, ils sont dépourvus de toutes les commodités de la vie. Quant à la population esclave, là, comme ailleurs, elle est réduite au dernier degré de misère ; elle est possédée, et ne possède rien [287].
Dans les colonies anglaises, l’agriculture est également le seul art qui soit cultivé, et il l’est de la manière la plus misérable. L’art d’employer la charrue et le travail des animaux y est encore inconnu ; on ne sait y remuer le sol qu’au moyen d’une houe que peut soulever à peine la faible main des hommes ou des femmes esclaves. Les progrès qu’a faits l’agriculture dans la plupart des États européens y sont également ignorés ; et des récoltes qui épuisent le sol, s’y succèdent sans interruption et sans repos [288]. Enfin, pour donner une idée des progrès que les arts ont faits dans ces colonies, il suffira de dire que quelques-unes comptent la brique parmi les objets d’importation qu’elles tirent de l’Angleterre [289].
On a vu précédemment que la population esclave des colonies anglaises est plus mal nourrie, plus mal vêtue, plus mal logée que les classes les plus misérables des pays de l’Europe les plus pauvres. La portion de richesses dévolue à cette partie de la population est donc presque nulle ; elle ne peut décroître sans que la famine ou d’autres fléaux analogues se manifestent. Cependant, le nombre de cette partie de la population excède 800 000 personnes [290].
En voyant les travaux excessifs qui sont imposés aux esclaves, et la misère à laquelle ils sont condamnés, on pourrait être naturellement porté à croire que les maîtres du moins possèdent de grandes richesses ; mais il n’en est point ainsi. Ils ne sont qu’au nombre de 1 700[291] ; cependant les neuf dixièmes sont toujours dans la détresse ; ils ne peuvent pas trouver le moyen de payer leurs dettes, quoiqu’un impôt très fort leur donne en quelque sorte le monopole de la vente de leurs denrées en Angleterre. Leurs vastes possessions ne peuvent presque plus payer les frais d’exploitation ; et la plupart n’ont pas le moyen de satisfaire leurs créanciers.
L’état des colonies françaises est encore pire que celui des colonies anglaises. La population asservie n’y est pas moins misérable, et la classe des possesseurs d’hommes y jouit encore de moins d’aisance. Les esclaves qu’aucun intérêt n’excite, et qui ne sont mus que par la crainte, ne se livrent au travail qu’avec une nonchalance extrême. Un voyageur qui les a observés dans la Martinique, a trouvé qu’à égalité de prix, ils faisaient à peine la dixième partie des travaux que des ouvriers exécutent en France.
« Je voyais fréquemment à Saint-Pierre, dit Robin, une quarantaine d’esclaves porter d’un air morne, sur leurs têtes, de petits paniers de fumier qu’ils venaient prendre au bord de la mer, pour se rendre à une habitation voisine. Quelle différence, me disais-je, de charge et de pas avec nos Bourguignons grimpant leurs raides coteaux, courbés sous le poids de leurs hottes, remplies de terre humide et compacte, et avec nos robustes paysannes égayant encore leur course pénible par des chants villageois ! Sept à huit sous paient la journée vigilante de celles-ci, et quatre à cinq fois autant ne paieraient pas la brute esclave, qui ne presse un peu ses pas que sous la douleur du fouet. Ces esclaves ne font donc pas produire à l’agriculture autant que nos paysans libres ; de là, les denrées, fruit de leur travail, sont nécessairement plus chères. Il faut donc aussi que l’Européen les paie plus que si elles venaient de mains libres [292]. »
On pourrait penser que l’état de barbarie dans lequel sont restés tous les arts dans les colonies formées par les Européens, doit être attribué à l’oppression que les métropoles ont fait peser sur elles ; mais l’effet de cette oppression a été presque insensible à côté de celui qui est résulté de l’esclavage. Les États-Unis d’Amérique jouissent, depuis plus d’un demi-siècle, de l’indépendance la plus complète ; ils ont, de plus, l’avantage de posséder les gouvernements les moins dispendieux ; les hommes qui appartiennent à la classe des maîtres, y jouissent d’une liberté civile et politique plus grande que celle des peuples les plus libres de l’Europe ; et cependant, dans ceux de ces États où l’esclavage est établi, il existe peu de richesses, et presque aucune branche d’industrie n’a pu se développer. Ce phénomène est d’autant plus remarquable que tous les arts font des progrès rapides dans les États où les travaux sont exécutés par des hommes libres.
L’agriculture est à peu près le seul art qui soit exercé dans les États du sud ; mais les opérations de cette branche d’industrie ne sont pas aussi nombreuses, aussi variées, aussi compliquées qu’elles le sont chez la plupart des peuples européens ; elles sont aussi simples et aussi peu nombreuses que l’exigent les intelligences bornées des esclaves. L’usage de la charrue est aussi étranger dans quelques-uns que dans les colonies anglaises [293].
Le riz, le maïs et le coton sont les principales et presque les seules productions qui y soient cultivées ; l’on n’y trouve presque aucun des nombreux végétaux qui enrichissent notre sol, quoiqu’il fût aisé, pour des cultivateurs libres, de les у faire venir tous ; ceux que l’on y rencontre s’y vendent à un prix excessif. Ce sont les ouvriers libres de New-York ou de Philadelphie, qui fournissent aux possesseurs d’hommes des États du sud, des pommes de terre, des oignons, des carottes, des betteraves, des pommes, de l’avoine, du maïs et même du foin. La plupart des arbres à fruits ne sont connus que de nom dans certaines parties du pays ; pour faire exécuter les opérations les plus grossières de l’agriculture, des coups de fouet suffisent ; mais ils sont insuffisants pour former l’intelligence et l’activité nécessaires à un jardinier [294].
En même temps que l’ignorance des propriétaires et l’incapacité des esclaves les mettent dans l’impossibilité de cultiver les plantes qui, parmi nous, sont les plus communes, une succession de récoltes qui ne varient jamais épuisent la terre et la rendent de moins en moins propre à donner les produits qu’on lui demande. La détérioration du sol, partout où l’esclavage est établi, est un fait si notoire dans les colonies et dans la partie méridionale des États-Unis, qu’on ne croit pas nécessaire d’en donner des preuves. Les colons de la Jamaïque qui sollicitent auprès du parlement d’Angleterre, un accroissement de droits en faveur de leur sucre, en donnent pour raison qu’ils ne peuvent plus le produire à bas prix, parce que le sol, qui est très fertile quand il est neuf, est stérile quand il est vieux. Dans les îles de Bahama et dans quelques parties de la Dominique, une étendue considérable de terres jadis fertiles, sont devenues tellement stériles, que les propriétaires ont perdu les moyens d’employer et de nourrir leurs esclaves. Plusieurs pétitions présentées, il y a peu d’années, au parlement anglais, par les colons, établissent les mêmes faits. Enfin, les derniers voyageurs qui ont visité le sud des États-Unis, ont été témoins du même phénomène [295].
L’art d’élever et de soigner des animaux domestiques n’est pas mieux connu que celui d’aménager les terres, ou que celui de cultiver des végétaux. On les laisse dans les bois pendant tout le cours de l’année, et ils pourvoient à leur subsistance comme ils peuvent ; en hiver, on se borne à donner un peu de paille de maïs aux bœufs qu’on destine au marché. La viande de boucherie est donc de mauvaise qualité, et toujours inférieure à ce qu’elle est dans les pays où la culture est exercée par des mains libres [296].
La culture ayant fait infiniment plus de progrès dans les pays où tous les travaux sont exécutés par des hommes libres, que dans ceux où ils sont abandonnés aux esclaves, il existe dans les seconds des forêts plus vastes et plus rapprochées que dans les premiers. Le bois de charpente et de chauffage devrait donc être moins cher dans les États du sud que dans les États du nord : il devrait y être d’autant plus commun qu’on doit en consommer moins, le climat étant plus doux. Les forêts, dans les pays exploités par des esclaves, ne sont, en effet, qu’à cinq ou six lieues des villes les plus considérables, et particulièrement de Charleston ; cependant, ce sont les États du nord exploités par des hommes libres, qui envoient aux États du sud des planches pour construire leurs maisons ; ce sont les mineurs libres de l’Angleterre qui leur expédient du charbon pour leur chauffage [297].
Des hommes qui, ayant des forêts immenses presque à leurs portes, sont cependant obligés de tirer de l’étranger des planches pour la construction de leurs maisons, et du charbon pour leur chauffage, ne sauraient avoir une capacité suffisante pour exercer l’art du charpentier, du menuisier ou du maçon ; et comme ils ne peuvent se faire expédier des maisons de New-York ou de Philadelphie, ils font venir à grands frais les ouvriers dont ils ont besoin pour les construire. Ces ouvriers, avant que d’arriver au lieu de leur destination, ont quelquefois deux cents lieues à parcourir ; pour obtenir qu’ils aillent travailler dans un pays d’esclaves, il faut leur payer les frais de voyage et de retour ; il faut les indemniser du mépris qu’on attache à l’exercice des arts et des métiers, et élever par conséquent le prix de leurs journées au-delà de ce qu’il serait dans leur propre pays [298]. Quand une maison a été construite, il faut l’entretenir : un peu plus tôt ou un peu plus tard, elle a besoin de réparation ; mais les ouvriers libres disparaissent aussitôt que les travaux pour lesquels on les a appelés sont terminés, et les esclaves, dont l’insouciance et la maladresse sont propres à tout dégrader, ne peuvent porter remède à rien. Si les vitres des fenêtres sont cassées, si les portes sont brisées, si le toit a besoin de réparation, il faut attendre des années avant que de pouvoir rien réparer. Aussi, est-il peu de maisons qui soient en bon état, et il arrive quelquefois de voir une table somptueusement servie et couverte d’argenterie, dans une chambre où la moitié des vitres manquent depuis dix ans [299].
Il faut, pour construire des navires, soit dans les entrepreneurs, soit dans les ouvriers, plus d’intelligence et plus d’adresse qu’il n’en faut pour construire des maisons. Il est donc presque inutile de dire que le petit nombre de vaisseaux qui sont construits dans les ports des États du sud, le sont par des ouvriers venus du nord. Je dois ajouter que le fret dans les seconds est beaucoup plus cher que dans les premiers, et que, par ces deux raisons réunies, ceux-ci ne peuvent presque pas avoir de marine [300].
Les esclaves étant incapables d’exercer les arts les plus communs qui demandent du soin et de l’intelligence, tels que ceux du jardinier, du menuisier, du charpentier, du maçon, sont incapables à bien plus forte raison d’exercer aucun de ceux qui demandent plus d’adresse, ou des facultés intellectuelles plus développées. Ce n’est pas chez un peuple où tous les travaux sont livrés à des hommes asservis, qu’on peut espérer de trouver ni un horloger, ni un mécanicien, ni un graveur, ni une multitude d’autres artistes dont les talents nous sont devenus indispensables. Il faut donc que les maîtres tirent de l’étranger non seulement une partie de leurs aliments, mais tous les produits manufacturés.
La plupart des substances alimentaires sont généralement plus chères dans les États du sud, qu’elles ne le sont dans les États du nord ; il n’est point de voyageur qui n’ait été frappé de la différence. Les objets manufacturés y sont plus chers encore ; outre les frais de transport qu’il faut payer de plus, le commerce y demande de plus gros bénéfices [301].
Des esclaves étant incapables de porter dans la culture de la terre l’exercice et l’intelligence qui appartiennent à des hommes libres, les produits qu’ils en obtiennent ne sont ni aussi considérables, ni aussi variés. Ces produits sont presque tous de même nature ; ils ne peuvent donc être immédiatement consommés sur les lieux, les maîtres ne peuvent en jouir qu’au moyen d’exportations et d’échanges, puisqu’ils n’ont pas autour d’eux une population industrieuse qui puisse les consommer. Il résulte de ces diverses circonstances que les terres ont beaucoup moins de valeur dans les pays cultivés par des esclaves, que dans les pays cultivés par des hommes libres ; la différence est de près du double [302]. Ainsi, un propriétaire des États du sud, qui a une terre égale, en bonté et en étendue, à celle que possède un propriétaire des États du nord, n’a cependant que la moitié du revenu de celui-ci, et avec ce revenu il est obligé de payer tout beaucoup plus cher. Que l’on ajoute à ces diverses causes de misère les effets des vices que l’esclavage produit, et l’on sera convaincu qu’il est impossible que les possesseurs d’hommes ne soient pas dans une détresse continuelle [303].
[IV-266]
Si les richesses possédées par les maîtres sont peu considérables, celles qui sont possédées par la population esclave sont complètement nulles ; dans aucune partie de l’Europe, sans excepter même les pays occupés par les Turcs, il n’existe aucune classe d’hommes aussi avilie, et aussi misérable que celle qui est attachée à la culture des terres dans la partie méridionale des États-Unis.
J’ai précédemment fait observer que, dans les transactions qui ont lieu entre les hommes possédés et leurs possesseurs, ceux-ci offrent aux premiers, en échange de leur travail, ce qui leur est rigoureusement nécessaire pour vivre ; et que la chose offerte ayant une valeur inférieure de beaucoup au travail demandé, la différence se paie en coups de fouet. Ce dernier genre de marchandise, qui détermine l’homme possédé à livrer son travail à son possesseur, coûte peu à ceux qui la délivrent ; d’où il suit, à ce qu’il semble, que les hommes de la classe des maîtres, achètent la valeur que nous appelons du travail, à aussi bas prix qu’il est possible. Mais la réalité ne répond point aux apparences ; nulle part la main-d’œuvre n’est aussi chère que dans les pays cultivés par des esclaves. Cette cherté est un fait si manifeste, qu’il a frappé la plupart des voyageurs.
Au cap de Bonne-Espérance, où la viande se vend quatre sous la livre (deux sous anglais) et le pain bis deux sous, un esclave est loué à raison de cinquante sous par jour (deux schellings) et un ouvrier libre six ou sept francs (cinq ou six schellings). Cette cherté du travail est l’obstacle le plus grand qui s’oppose aux progrès de la colonie. Suivant Barrow, on ne saurait espérer de grandes améliorations, à moins qu’on ne trouve le moyen d’augmenter la quantité du travail, et de diminuer le prix de la main-d’œuvre [304].
Dans la partie des États-Unis où il existe des esclaves, la main-d’œuvre est plus chère encore qu’elle ne l’est au cap de Bonne-Espérance. À Charleston en Caroline, et à Savannah en Géorgie, un ouvrier blanc de l’état de menuisier, charpentier, maçon, ferblantier, tailleur, cordonnier, gagne deux piastres par jour, et n’en dépense pas tout à fait une [305]. Ce haut prix de la main-d’œuvre ne permet pas aux habitants de faire abattre et transporter à une distance de six milles, les arbres de leurs forêts, dont ils ont besoin pour leur chauffage. Ils trouvent qu’il leur en coûte moins de payer en Angleterre les mineurs qui tirent le charbon du sein de la terre, les propriétaires qui le vendent, et les marins qui le transportent [306]. C’est également à la cherté de la main-d’œuvre, qu’il faut attribuer le haut prix de la plupart des choses nécessaires à la vie, et la préférence qu’on donne aux denrées qui sont importées des États libres, sur celles qui pourraient être produites dans le pays [307]. Les terres étant moins chères de moitié dans les États où il existe des esclaves, que dans ceux où il n’en existe point, le prix excessif de la plupart des produits agricoles ne peut avoir pour cause que la cherté de la main-d’œuvre. Dans le Maryland, comme au cap de Bonne-Espérance, la journée d’un homme libre est évaluée trois fois la valeur de la journée d’un esclave.
La journée de travail qui coûte deux piastres en Géorgie ou dans la Caroline du sud, n’en coûte qu’une dans l’État de New-York [308]. Au Mexique, où l’on ne trouve presque point d’esclaves, les meilleurs ouvriers qui travaillent aux mines, gagnent 25 ou 30 francs par semaine, sans y comprendre le dimanche ; les ouvriers qui travaillent à l’air libre, comme les laboureurs, se contentent, par semaine, de 7 fr. 80 sur le plateau central, et de 9 fr. 60 près des côtes [309]. Dans la vallée d’Aragua, où presque tous les travaux sont également exécutés par des hommes libres, et où croissent le sucre, le coton et l’indigo, la main-d’œuvre est moins chère qu’en France ; on ne paie un ouvrier libre que 4 ou 5 piastres par mois, sans la nourriture, qui est très peu coûteuse à cause de l’abondance de la viande et des légumes [310].
[IV-270]
Dans la Louisiane, où les ouvriers libres sont très rares, parce qu’ils cessent de travailler aussitôt qu’ils ont acquis le moyen d’acheter un homme qui travaille pour eux, la main-d’œuvre est plus chère encore qu’elle ne l’est au cap de Bonne-Espérance. Un maître qui possède un bon esclave, le loue à raison de 20 ou 30 piastres par mois, et comme on a observé que la journée d’un bon ouvrier libre vaut deux ou trois fois la journée d’un ouvrier asservi, on peut calculer à quel prix revient le travail [311]. La cherté de la main-d’œuvre oblige les possesseurs de terres à négliger les détails de l’économie agricole, et à renoncer à la multiplication des denrées [312]. De là, la rareté des légumes dans les marchés, et le prix excessif auquel ils se vendent. La viande de boucherie qu’on obtient sans travail, parce que les animaux se multiplient sans qu’on en prenne soin, est beaucoup moins chère [313].
[IV-271]
La différence entre le prix de la main-d’œuvre dans les États libres, et le prix de la main-d’œuvre dans les États où les travaux sont exécutés par des esclaves, se manifeste à l’aspect seul du pays ; dans les États du nord où des hommes libres cultivent la terre, les forêts disparaissent avec rapidité, et les campagnes se couvrent de cultivateurs ; dans les États du sud où presque tous les travaux sont faits par des esclaves, les défrichements, au contraire, se font avec une telle lenteur qu’il n’est pas possible de prévoir l’époque à laquelle le pays tout entier sera mis en état de culture ; dans les premiers, les possesseurs de terres en retirent un revenu plus ou moins considérable, après avoir payé le prix de la main-d’œuvre ; dans les seconds, les frais d’exploitation égalent ou surpassent la valeur des produits [314].
Nous avons vu que, suivant M de Humboldt, un bon cultivateur libre qui travaille dans les lieux les plus pénibles, gagne au Mexique, pour six jours de travail, 9 fr. 60, ce qui lui fait 1 fr. 60 par jour ; et que, dans les vallées d’Aragua, un ouvrier se contente de 4 ou 5 piastres par mois. Nous avons vu, en même temps, qu’un bon esclave se loue au cap de Bonne-Espérance, 2 fr. 50 par jour, et à la Louisiane environ 5 fr. 50, ou 30 piastres par mois. Mais un esclave ne fait guère que le tiers du travail d’un homme libre ; supposons cependant qu’il en fait la moitié, et qu’il le fait avec la même intelligence, ce qui n’arrive jamais : dans cette supposition, la quantité de travail qu’un agriculteur des vallées d’Aragua fait exécuter par un ouvrier libre pour une somme de 6 francs, coûte 9 fr. 50 à un cultivateur du Mexique, 30 francs à un cultivateur du cap de Bonne-Espérance, et 60 francs à un cultivateur de la Louisiane. Ici on ne peut pas dire que la différence du prix résulte de la différence dans le climat ou dans le genre de culture ; car, si le Mexique produit toutes les denrées de l’Europe, il produit aussi toutes les denrées qui peuvent croître sous les tropiques. En voyant de tels résultats, comment n’est-il pas évident, pour les hommes les plus aveugles, que si les propriétaires qui font cultiver leurs terres par des esclaves, ne sont pas déjà complètement ruinés, ils le seront infailliblement dans un petit nombre d’années.
Et qu’on ne pense pas que c’est à la différence qui existe entre le climat du sud et le climat du nord, ou à la différence qui existe entre les hommes blancs et les hommes noirs, qu’il faut attribuer les phénomènes que nous observons ici. Les Espagnols qui n’ont point eu d’esclaves, et qui ont joui de quelque liberté, se montrent, sous la zone torride, sobres, intelligents, actifs, industrieux comme les Anglo-Américains du nord. Ils prouvent et ils prouveront tous les jours davantage que les denrées des tropiques peuvent être cultivées par des hommes libres encore mieux que par des esclaves. Nous avons vu d’ailleurs que les phénomènes produits par l’esclavage sous la zone torride, se manifestèrent sous les climats les plus tempérés, aussitôt que les Romains у eurent introduit un régime analogue à celui qui existe aujourd’hui dans nos colonies ou dans une grande partie des États-Unis ; cependant les cultivateurs ou les ouvriers appartenaient alors à la même espèce d’hommes que les maîtres. Dans le nord de l’Europe, où l’esclavage existe encore, les maîtres et les esclaves sont de même espèce, et ni les uns ni les autres n’y sont énervés par un excès de chaleur ; cependant, l’esclavage y produit exactement tous les effets que nous avons observés dans tous les autres pays ; ce sont les mêmes préjugés, la même ignorance, les mêmes vices, la même misère ; les seigneurs russes qui ont affranchi leurs esclaves, et qui ont fait cultiver leurs terres par des mains libres ont doublé leurs revenus [315].
[IV-274]
Depuis deux siècles, les arts et les sciences ont fait des progrès immenses ; mais en quoi ont contribué à ces progrès les peuples qui sont divisés en maîtres et en esclaves ? Je ne voudrais pas assurer qu’ils y ont été complètement étrangers ; mais j’avoue que je ne connais aucune invention, aucune idée nouvelle qui puisse leur être attribuée. Non seulement ils paraissent avoir été étrangers aux progrès de l’esprit humain, ils sont même restés en arrière des autres peuples de plusieurs siècles. Ne comparons point les progrès des colonies anglaises au progrès de leur métropole, ni les progrès des colonies françaises à ceux de la France ; la différence serait trop immense. Demandons-nous seulement quelles sont les branches d’industrie qui sont exploitées par des maîtres ou par des esclaves, dans les pays que nous connaissons le mieux ; demandons-nous quel est le degré de perfectionnement auquel ces branches d’industrie ont été portées.
Deux des principales causes des progrès qu’ont faits les arts et les sciences chez les modernes, sont la division des occupations, et l’usage des machines : or l’esclavage domestique met un obstacle invincible à l’usage des machines et à la division des occupations. Les arts ont été portés si loin, et les occupations qu’ils exigent ont été tellement divisées, que l’individu dont les besoins sont les plus bornés, ne peut espérer de les satisfaire sans le concours de plusieurs milliers de personnes. Suivant une observation d’Adam Smith, la seule fabrication d’une épingle exige la coopération immédiate de dix-huit ou vingt individus ; si l’on ajoute à ce nombre les individus qui ont fabriqué les outils ou les machines nécessaires aux ouvriers ; ceux qui ont tiré le métal de la mine et qui lui ont donné les diverses préparations dont il a besoin, on en trouvera un nombre immense. Le nombre sera bien plus grand encore, si l’on calcule le nombre de mains qui concourent à produire l’étoffe la plus commune, depuis celui qui fournit la matière première jusqu’à celui qui délivre la marchandise au consommateur : or, parmi cette multitude d’opérations, il n’en est que très peu qui puissent être exécutées par des esclaves.
L’esclavage offre de tels obstacles à la multiplication des richesses, que, si les peuples chez lesquels il est en usage étaient livrés à leurs propres forces, s’ils n’avaient de communications qu’entre eux, en peu d’années ils tomberaient encore plus bas que les nègres du centre de l’Afrique ; ils n’auraient pas d’autres maisons que des huttes de paille ; ils n’auraient pour vêtements que des peaux de bêtes, et pour instruments d’agriculture que des branches d’arbres. Des esclaves peuvent se livrer à quelques genres de fabrication quand des ouvriers libres les élèvent et leur fournissent des instruments et des machines ; mais je ne craindrai pas d’affirmer que, quand même tous les esclaves des États-Unis s’uniraient à ceux des colonies européennes, et mettraient en commun leur intelligence et leur adresse, ils ne parviendraient pas à fabriquer une bonne épingle.
Ayant exposé l’influence que l’esclavage produit sur la formation des richesses, il me reste à faire voir l’influence que la même cause exerce sur leur distribution.
Au rapport de Plutarque, un patricien romain disait qu’un citoyen n’était pas riche s’il n’avait pas les moyens d’entretenir une armée. Faut-il conclure de là que la population romaine possédait d’immenses richesses ? On pourra se faire aisément une idée de celles qu’elle possédait, en examinant quel était le sort de chacune des principales classes entre lesquelles elle était divisée.
Les esclaves, dont le nombre était immense dans les derniers temps de la république, ne possédaient rien en propre. Ceux qui cultivaient les terres étaient enchaînés comme des forçats ; ils étaient presque nus, n’avaient pour habitations que des antres souterrains dans lesquels ils étaient enfermés pendant la nuit, et se nourrissaient des aliments les plus grossiers. Les esclaves attachés au service personnel des maîtres, étaient moins misérables ; quelques-uns pouvaient même jouir d’une certaine aisance ; mais aucun n’avait rien qu’il pût dire à lui. Le nombre des esclaves peut être évalué à quatre fois le nombre des maîtres, sans être porté très haut.
Les individus qu’on désignait sous le nom de prolétaires, n’étaient guère moins misérables que les esclaves ; ils ne possédaient point de terres, et la plupart n’avaient pas d’habitations dans lesquelles il leur fût permis de se reposer. Les arts ou les métiers qui étaient alors connus, étant exercés par des esclaves au profit de l’aristocratie, il n’existait en général, pour les prolétaires, d’autres moyens d’existence que les distributions publiques, ou quelques métiers qu’ils exerçaient clandestinement. Le nombre d’individus de cette classe que renfermait la ville de Rome, dans les derniers temps de la république, s’élevait à plus de 300 000 ; c’était les deux tiers de la population libre.
Il restait donc environ 100 000 individus qui n’étaient ni esclaves, ni obligés de vivre de distributions gratuites ; mais, entre un individu qui se trouve dans la classe des mendiants, et celui qui vit dans l’abondance, il existe une multitude de degrés intermédiaires. On ne peut pas douter que dans cette troisième classe, il n’y eût un nombre plus ou moins grand de familles aisées ; mais on ne peut pas douter non plus qu’il n’y en eût beaucoup qui touchaient à la classe des prolétaires, ou qui étaient accablés de dettes.
Les richesses se trouvaient donc concentrées dans un très petit nombre de mains ; et les esclaves en formaient une grande partie. Ainsi, dans les temps même où la république paraissait avoir atteint le plus haut degré de prospérité, l’immense majorité de la population vivait dans la misère la plus profonde ; elle était plus pauvre et plus avilie que ne le sont, chez les modernes, les individus placés aux derniers rangs de l’ordre social. Les grands qui possédaient des richesses, ne les avaient point créées par leur industrie ; ils les avaient ravies aux peuples industrieux qu’ils avaient vaincus ; la fortune d’un patricien ne se composait que des débris des fortunes de plusieurs milliers de familles ; un consul ne pouvait s’enrichir que par le pillage et la ruine de plusieurs villes.
Les Romains ont consommé les richesses des nations qu’ils ont conquises : ils ont converti en pâturages ou en déserts des contrées florissantes ; mais il serait difficile de dire quelles sont les richesses qu’ils ont créées.
Dans les colonies anglaises, le nombre des esclaves s’élève à plus de 800 000 ; les individus de cette classe sont plus misérables que ne le sont chez nous les ouvriers les plus pauvres ; ils n’ont ni terres, ni maisons, ni vêtements. La partie la plus considérable des richesses est concentrée dans les mains des planteurs, dont le nombre ne s’élève qu’à 1 700 ou 1800 ; dans ce nombre, la plupart peuvent à peine payer leurs dettes, et fournir aux frais d’exploitation ; presque toutes les années, ils sont obligés de faire au parlement anglais l’exposition de leur détresse, et de solliciter des monopoles, c’est-à-dire des impôts en leur faveur, sur la population libre de l’Angleterre. Les contributions qu’ils perçoivent sur les Anglais, au moyen des monopoles qui leur ont été accordés, sont la partie la plus claire de leurs revenus. Il faut ajouter à ce tableau des richesses, celles que peuvent posséder quelques hommes de couleur libres, dans les villes des colonies [316].
Dans la partie méridionale des États-Unis, le nombre des esclaves s’élevait, en 1810, à près de 1 200 000. Cette partie de la population, qui s’est augmentée depuis cette époque, est presque aussi misérable que la population correspondante qui existe dans les colonies anglaises. Les richesses se concentrent encore ici dans les mains des possesseurs de terres, puisque, dans le pays, il n’existe presque pas d’autres branches d’industrie que l’agriculture. Quoique plusieurs individus affectent un grand luxe, il est difficile de croire qu’ils possèdent tous de grandes richesses, lorsqu’on voit le prix excessif de la main d’œuvre, la nonchalance et l’incapacité des esclaves, les seuls individus qui travaillent, et la cherté de toutes les productions qu’on est obligé de tirer de l’étranger.
La partie française de Saint-Domingue avait, en 1788, une population de 520 000 habitants ; sur ce nombre, 452 000 ne possédaient rien, puisqu’ils étaient esclaves ; ils n’avaient pour habitations que de misérables huttes, pour vêtements qu’un pagne de toile bleue, et pour aliments que ce qui leur était rigoureusement nécessaire pour ne pas mourir de faim. Les richesses territoriales, qui étaient presque les seules qui existaient dans le pays, se concentraient dans les mains d’environ 40 000 individus d’origine européenne ; mais, parmi ceux-ci, il se trouvait un grand nombre de familles qui avaient plus de dettes que de biens, ou qui ne possédaient qu’une fortune très bornée.
Nous observons les mêmes phénomènes à la Martinique et à la Guadeloupe. Dans cette dernière île, le nombre des individus plongés dans la plus profonde misère, s’élevait à 85 471, en 1788 ; tandis que le nombre des maîtres blancs ne s’élevait qu’à 13 466. La population était à peu près la même dans la Martinique, en 1815 ; le nombre des individus réduits à la plus excessive misère s’élevait à 77 577, tandis que le nombre des individus d’origine européenne, ne s’élevait qu’à 9 206. Aujourd’hui, la misère de la classe laborieuse est aussi profonde qu’elle l’était à cette époque ; des siècles de travail et de privation n’ont rien ajouté au bien-être des hommes de cette classe. Mais la classe des maîtres s’est-elle enrichie de tout ce qu’elle a ravi à la classe laborieuse ? Les fatigues et les privations qu’elle lui a imposées ont-elles mis dans ses mains une somme très considérable de richesses ? Bien loin de là, les planteurs de nos colonies ont improductivement consommé, d’abord tout ce qu’ils pu arracher à la population asservie, et ensuite toutes les valeurs qu’ils ont empruntées. Aujourd’hui, les dettes de la plupart d’entre eux excèdent de beaucoup la valeur de leurs possessions ; cependant, les colons ayant en France le monopole de la vente de leurs produits, perçoivent sur la population française un impôt très lourd, puisqu’elles nous font payer leurs denrées beaucoup plus cher que nous ne les paierions si le commerce était libre.
De ce qui précède, il résulte, premièrement que l’esclavage est un obstacle invincible à la formation et à la cumulation des richesses, parce qu’il ravit à la classe laborieuse tout moyen de travailler avec intelligence et de faire des économies, et qu’il donne à la classe des maîtres, des vices qui leur font consommer improductivement le fruit du travail de la population asservie ; il en résulte, en second lieu, que, dans les pays exploités par des esclaves, le travail est infiniment moins productif pour l’ouvrier et surtout pour le maître, qu’il ne l’est dans les pays où tous les travaux sont exécutés par des hommes libres ; enfin, il en résulte que, dans l’état d’esclavage, la petite quantité de richesses qui peuvent être produites, se distribuent de la manière la plus contraire à l’égalité, à la morale et à la justice.
[IV-283]
CHAPITRE XIV. ↩
De l’influence de l’esclavage domestique sur l’accroissement des diverses classes de la population.
On a vu, dans les chapitres précédents, comment l’esclavage domestique affecte les diverses classes de la population, dans leurs mœurs, dans leurs facultés intellectuelles, dans leurs organes physiques et dans leurs richesses : j’ai à exposer maintenant comment il les affecte dans leur multiplication.
Des philosophes ont observé que tous les êtres du règne animal, et même du règne végétal, tendent à se multiplier à l’infini, et qu’ils se multiplient en effet jusqu’à ce qu’ils se soient mis au niveau des moyens d’existence qui leur sont offerts. Le genre humain ne fait point exception à cet égard à la règle universelle ; cependant, les différences qui existent entre lui et tous les autres genres d’animaux, produisent quelques différences remarquables dans les lois d’accroissement et de décroissement auxquelles il est assujetti.
Les hommes, par leur propre nature, tendent à se perfectionner, c’est-à-dire à développer leurs facultés physiques, intellectuelles et morales ; ils tendent en même temps à transmettre à leurs descendants les divers genres de perfectionnement qu’ils croient avoir acquis. De cette qualité, qui leur est particulière, il résulte qu’aussitôt qu’un peuple a fait les premiers pas dans la civilisation, il se trouve chez lui des individus ou des familles qui sont, ou qui s’imaginent être plus avancés que les autres. Elles ont ou croient avoir des connaissances plus variées, des idées plus élevées, des mœurs plus pures ou plus douces, des manières plus polies, une puissance plus grande, une fortune plus considérable ou d’autres avantages analogues. Par cela même que chaque individu tend à s’élever et à voir prospérer sa race, chacun éprouve une répugnance invincible à descendre dans un rang inférieur, ou à y voir descendre ses enfants.
Les hommes peuvent se diviser et ils se divisent en effet quelquefois sur quelques-unes des qualités qui constituent la grandeur ou la dégradation ; il existe des erreurs à cet égard comme il en existe sur une multitude de sujets, et ces erreurs produisent tous les effets dont j’ai parlé dans le premier livre de cet ouvrage ; mais il n’est personne qui n’éprouve, plus ou moins, la tendance que je fais observer ici ; il n’est personne qui n’aspire à s’approcher le plus qu’il peut de ce qui, dans ses idées particulières, constitue la grandeur, et à s’éloigner de ce qui constitue la dégradation ; ceux qui sont les plus amoureux de l’égalité, sont peut-être ceux chez lesquels cette tendance est la plus forte ; s’ils sont satisfaits de la position dans laquelle ils sont placés, ils n’aspirent pas à descendre, ou à faire descendre leurs égaux, ils cherchent à élever à leur niveau le plus grand nombre d’individus possible.
Ce phénomène, qui se manifeste chez les peuples de toutes les espèces et à tous les degrés de civilisation, avait besoin d’être observé pour prévenir les fausses conséquences qu’on pourrait tirer d’un autre phénomène que je viens de rappeler, de la tendance qu’ont tous les êtres organisés à se multiplier, jusqu’à ce qu’ils ne trouvent plus de moyens d’existence. Les hommes obéissent à cette dernière tendance, comme tout ce qui existe ; mais ils n’y obéissent qu’autant qu’ils le peuvent, sans descendre du rang auquel ils sont parvenus, et sans faire déchoir leur race. Dans l’ordre social, les moyens d’existence varient avec les mœurs et les idées de chacune des classes de la population : ce qui suffit pour élever une famille d’ouvriers, ne suffirait pas pour élever une famille, dans la classe moyenne ; ce qui suffit à celle-ci serait insuffisant pour élever une de ces familles qui, dans les monarchies, sont placées aux premiers rangs ; enfin, une fortune qui donnerait à un homme de cour le moyen d’élever une famille, pourrait ne pas le donner à un prince. Il résulte de là que chacun se considère comme touchant au dernier terme de ses moyens d’existence, lorsqu’il ne peut pas se marier sans descendre et sans faire descendre ses enfants à un rang qu’il juge inférieur à celui dans lequel il a été élevé ; et un homme peut arriver à ce point, non seulement sans manquer de rien de ce qui est nécessaire à la vie, mais avec une fortune suffisante pour élever plusieurs familles de laboureurs.
Dans les pays où la plupart des travaux sont exécutés par une race asservie, les hommes qui appartiennent à la classe des maîtres, ne peuvent donc pas se multiplier aussi rapidement que les esclaves. S’il faut, par exemple, le travail de vingt esclaves pour faire vivre dans l’oisiveté un homme de la classe des maîtres, le nombre des possesseurs d’hommes ne peut pas s’accroître de dix individus, sans que le nombre des hommes possédés ne s’accroisse de deux cents. Si l’accroissement du nombre des esclaves avait lieu dans une proportion moins grande, il faudrait que les maîtres consommassent moins de richesses ou se livrassent à quelque genre de travail, ce qui, dans leurs idées, les dégraderait en les rapprochant de leurs esclaves. Dans un pays où il se formerait de grandes fortunes, le nombre des esclaves devrait s’accroître dans une proportion plus grande encore ; puisque plus un individu consomme des richesses, et plus il faut de mains qui travaillent pour lui.
Les faits constatés dans les colonies répondent aux déductions que nous tirons de la nature de l’homme. Dans la Jamaïque, la plus considérable des colonies à sucre de l’Angleterre, la population se divisait, en 1658, en 1 400 esclaves, et 4 500 personnes libres. Depuis cette époque, les deux classes se sont multipliées dans les proportions suivantes : de 1658 à 1670, le nombre des personnes libres s’est accru de 3 000, le nombre des esclaves de 6 600 ; de 1670 à 1734, le nombre des personnes libres s’est accru de 3 100, celui des esclaves de 78 546 ; de 1734 à 1746, le nombre des personnes libres s’est accru de 2 356, celui des esclaves de 25 882 ; de 1746 à 1768, le nombre des personnes libres s’est accru de 7 947, celui des esclaves de 54 486 ; de 1768 à 1775, les personnes libres ne se sont accrues que de 553, les esclaves ont augmenté de 24 000, auxquels il faut ajouter 3 700 affranchis [317] ; enfin, de 1775 à 1817, le nombre des esclaves s’est accru de 155 000 ; tandis que le nombre des maîtres paraît s’être accru d’une manière plus lente encore que dans les années précédentes [318].
Dans l’île d’Antigoa, nous observons un phénomène plus curieux encore que le précédent, mais qui n’est cependant que le résultat des mêmes causes. En 1741, le nombre d’individus qui appartenaient à la classe des maîtres s’élevait à 3 538, tandis que le nombre des esclaves s’élevait à 27 418 ; il existait donc près de neuf esclaves pour une personne libre. À partir de cette époque, le nombre des individus libres commença à décroître, et cependant celui des esclaves continua de s’augmenter [319]. Enfin, en avril 1821, le nombre des premiers était tombé de 3 538 à 1 980 ; et le nombre des seconds s’était élevé de 27 418, à 32 259, plus 4 182 affranchis [320]. Il résulte de là que, dans un espace de 80 ans, près de la moitié de la race des possesseurs d’hommes s’est éteinte, tandis que la race des hommes possédés s’est accrue de près d’un tiers. Le décroissement de la première et l’accroissement de la seconde ne doivent pas même s’arrêter là ; car dans la classe des personnes libres, le nombre des hommes excède celui des femmes de 300, tandis que dans celle des esclaves le nombre des femmes excède celui des hommes de 2 153[321].
Les deux classes de la population ont suivi, dans les colonies françaises, à peu près la même progression dans leur accroissement. En 1700, le nombre de personnes libres d’origine, était, à la Martinique, de 6 597 ; le nombre des esclaves était de 14 566 ; le nombre des affranchis et des indigènes s’élevait seulement à 507. De 1700 à 1736, le nombre des esclaves s’accrut de 57 434, et il s’accrut de 8 000 de 1736 à 1778. Dans un intervalle de 78 ans, les esclaves s’accrurent donc de 65 434, tandis que le nombre de personnes libres d’origine ne s’accrut que de 6 000. La même différence d’accroissement, entre les personnes libres et les esclaves, a eu lieu à la Guadeloupe, puisqu’en 1777 on y comptait 100 000 esclaves, et seulement 12 700 individus d’origine libre [322].
La proportion entre les personnes libres et les esclaves était à peu près la même à Saint-Domingue. Dans l’espace d’un siècle et demi, le nombre de personnes libres d’origine s’est élevé à 40 000, tandis que le nombre de personnes asservies s’est élevé jusqu’à 452 000, et le nombre d’affranchis à 28 000 : tel était l’état de la population en 1788[323]. Depuis cette époque, les hommes de la race asservie ont conquis leur liberté ; leur nombre s’est élevé jusqu’à 935 335, et les individus de la race des maîtres ont disparu.
Les États-Unis d’Amérique nous présentent un phénomène qui ne mérite pas moins que les précédents de fixer notre attention. Les divers États dont la fédération se compose n’admettent pas tous le système de l’esclavage, tel du moins qu’il est pratiqué dans les îles à sucre. Plusieurs de ces États n’ont jamais eu qu’un très petit nombre d’esclaves, et, sur vingt-deux, il en est douze qui en ont décrété l’abolition. Il est résulté de là que, dans les parties de l’Union qui ont été exploitées par des hommes libres d’origine européenne, cette partie de la population s’est accrue d’une manière très rapide. Cependant, en partant d’une époque donnée, on trouve que les individus de la race asservie se sont multipliés dans la même proportion que les individus de race européenne. En 1784, on comptait aux États-Unis 2 650 000 blancs, 600 000 esclaves et 50 000 affranchis. Depuis cette époque jusqu’en 1790, le nombre des esclaves s’accrut de 297 719, c’est-à-dire qu’il fut presque doublé dans un espace de six années, tandis que le nombre des hommes libres, en n’y comprenant pas les affranchis, ne s’accrut que d’environ un quart, ou de 62 607. De 1790 jusqu’à 1800, le nombre des esclaves se multiplia de 200 000 ; celui des hommes libres, y compris les affranchis, se multiplia de 1 172 210. De 1800 à 1804, le nombre des esclaves s’accrut de 95 051 ; celui des affranchis s’éleva à 126 000 ; celui des blancs s’accrut d’environ 600 000. Enfin, en 1809, la population des affranchis et des esclaves s’élevait à 1 305 000, et celle des individus d’origine européenne à 5 810 000. Ainsi, la proportion entre les hommes des deux races était, en 1809, la même qu’en 1784 ; l’une et l’autre s’étaient accrues un peu plus que du double [324].
Dans le Brésil, la disproportion, entre les personnes libres et les esclaves, a été moins grande. En 1798, sur une population de 3 300 000 individus, on comptait 800 000 blancs ; le surplus se composait d’un million d’indigènes, d’un million d’esclaves, et de plusieurs individus de races mélangées [325]. Diverses causes ont contribué à multiplier le nombre des blancs dans ce pays, plus que dans les colonies françaises et anglaises, et il faut sans doute mettre au nombre des principales, l’existence d’un grand nombre d’indigènes, la différence de culture, la persévérance avec laquelle la mère-patrie a continué à envoyer dans ce pays les hommes condamnés par les tribunaux, et particulièrement ceux qui étaient proscrits par l’inquisition, tels que les Juifs et les individus soupçonnés de philosophie et d’opinions condamnées par le clergé romain [326].
[IV-293]
Les Espagnols, ayant envahi la partie la plus civilisée de l’Amérique, n’eurent pas besoin d’acheter des Africains pour leur faire cultiver le sol ; les indigènes continuèrent de se livrer à la culture, et le régime auquel ils furent assujettis eut plus d’analogie avec le système féodal qu’avec le genre d’esclavage établi dans les îles. Aussi, quoique l’esclavage domestique ne fût point prohibé dans les colonies espagnoles, il n’y existait qu’un très petit nombre d’esclaves au moment où elles se sont déclarées indépendantes, et les esclaves y étaient traités d’une manière moins dure que dans aucun autre pays [327].
[IV-294]
Le nombre des esclaves s’accroît donc, en général, d’une manière plus rapide que celui des maîtres ; cependant, l’accroissement n’est pas uniforme dans tous les cas ; il arrive quelquefois que les proportions varient. Plusieurs causes contribuent à ces variations ; les principales sont, tantôt l’affranchissement, et tantôt l’importation d’un plus grand nombre d’esclaves ; si, par quelques circonstances accidentelles, le nombre des affranchis est plus considérable dans une année que dans une autre, le nombre des maîtres paraît s’accroître dans une proportion plus rapide que celui des esclaves ; de même, si des circonstances extraordinaires favorisent l’importation des esclaves, ceux-ci paraissent se multiplier plus rapidement que les maîtres. Dans le premier cas, ce n’est pas la race des maîtres qui se multiplie, quoique le nombre des hommes libres devienne plus considérable ; c’est, en quelque sorte, une classe moyenne qui sort de l’une et de l’autre, et qui participe des qualités et des vices de toutes les deux.
Le nombre des hommes possédés se multipliant dans une proportion plus grande que leurs possesseurs, ne faut-il pas conclure de ce phénomène que la condition des premiers est moins misérable qu’elle ne le paraît ? Cette conséquence serait juste, en effet, si l’accroissement des esclaves avait lieu par génération ; mais ce n’est pas ainsi qu’il s’opère : il a lieu par l’importation continuelle de nouveaux esclaves. La population asservie, bien loin de se multiplier naturellement dans l’esclavage, décroît, au contraire, d’une manière rapide.
Dans le temps où l’île de Saint-Domingue était possédée par des maîtres d’origine européenne, la perte des individus asservis s’élevait tous les ans à un vingtième, et les accidents la faisaient monter au quinzième [328]. Ainsi, les possesseurs d’hommes de cette colonie fondaient leur revenu sur la destruction annuelle de 30 130 personnes, et sur les supplices et les privations infligées à 450 000. Dans le cours d’un siècle, le nombre d’êtres humains détruits, s’élevait à plus de trois millions, sans compter un nombre au moins égal d’individus qu’il fallait égorger sur les côtes d’Afrique, pour tenir au complet le nombre des esclaves. Saint-Domingue, disait-on, était la reine des colonies.
Les esclaves ne sont pas également misérables dans tous les pays. Leur sort dépend du genre de travail qu’ils ont à exécuter, et des subsistances qui leur sont accordées ; et ces circonstances varient avec la nature et la position du sol, et avec les relations commerciales. Leur sort dépend également de la facilité avec laquelle les maîtres peuvent remplacer ceux que la misère et les mauvais traitements font périr, facilité que les gouvernements diminuent ou accroissent, selon qu’ils protègent ou répriment le commerce des esclaves. Il ne faut donc pas juger du décroissement de la population esclave dans toutes les colonies, par celui qui a été observé dans l’île de Saint-Domingue.
Les colonies anglaises dans lesquelles les productions sont analogues à celles que donnait autrefois Saint-Domingue, sont celles dans lesquelles le décroissement est le plus rapide. Ce décroissement a beaucoup diminué depuis que le gouvernement anglais a restreint le pouvoir des maîtres sur les esclaves, surtout depuis qu’il a sévèrement interdit la traite. Il est évident que, dès ce moment, les possesseurs d’hommes ont été dans la nécessité de ménager leurs possessions, sous peine de ne pouvoir pas les renouveler. Cependant, telles sont les calamités attachées à l’esclavage, que même depuis cette époque, la population asservie continue de décroître. Dans l’île de la Trinité, le décroissement annuel est de 3% 3/5 ; à Demerari, il est de 2 à 3% ; à Sainte-Lucie, il est de 2,1%. Dans quelques îles où le sucre n’est point cultivé, le décroissement est nul [329].
Dans tous les pays, les possesseurs d’hommes ne considèrent comme digne d’eux que le commandement ; tout autre genre d’occupation leur paraît indigne de leurs nobles mains. Les possesseurs d’hommes des colonies ne peuvent tirer un revenu que de leurs terres, et ce revenu est toujours en raison du nombre de leurs esclaves. Si donc ils continuent de les traiter avec leur cruauté accoutumée, ils détruiront la source de leurs richesses, puisqu’il deviendra tous les jours plus difficile de les recruter sur les côtes d’Afrique. Si au contraire, le sort des esclaves est adouci, ils augmenteront en nombre ; mais alors les possesseurs auront à craindre un autre danger, celui de voir multiplier cette partie de la population dans une proportion telle, que leur sécurité sera de plus en plus compromise.
Dans les États où l’esclavage domestique n’est point toléré, la crainte de tomber dans une excessive misère est un obstacle à un accroissement de population disproportionné aux moyens d’existence. La plupart des domestiques s’imposent le célibat parce que, s’ils avaient des enfants, leurs gages ne pourraient suffire à les élever, et qu’ils ne pourraient tout à la fois soigner leur propre famille et exécuter les travaux attachés à la domesticité. Mais quand des ouvriers ou des domestiques sont considérés comme la propriété des maîtres, ils ne craignent pas d’être renvoyés ; s’ils ont des enfants, c’est le possesseur qui doit les faire élever. Il faut, par conséquent, qu’il reste chargé de toutes les dépenses de la famille, et que de plus il renonce aux services de la mère pendant qu’elle prend soin des enfants. Les esclaves étant essentiellement imprévoyants et n’ayant à craindre ni d’être renvoyés, ni de voir descendre leur postérité dans un rang plus bas, doivent s’abandonner naturellement à toutes leurs passions. Les maîtres se trouvent donc dans l’alternative de recourir à des violences pour restreindre la multiplication des hommes asservis, ou de voir croître autour d’eux une population ennemie qui absorbe leurs revenus en même temps qu’elle menace leur existence.
Telle est déjà la position critique dans laquelle se trouvent les Anglo-Américains du sud, et dans laquelle se trouveront tôt ou tard tous les maîtres des colonies. Comment en sortiront-ils ? C’est une question que l’expérience n’a pas encore résolue d’une manière satisfaisante ; mais il est temps d’y penser.
[IV-299]
CHAPITRE XV. ↩
De l’influence de l’esclavage domestique sur l’esprit et la nature du gouvernement.
J’ai fait observer précédemment que les peuples changent de maximes selon le point de vue sous lequel ils se considèrent ; s’ils se regardent dans leurs rapports avec les individus que la force ou le hasard leur a donnés pour maîtres, ils proclament volontiers comme des principes de droit ou de morale, la liberté individuelle, la liberté des opinions, le respect du travail et des propriétés ; mais s’ils se considèrent dans leurs rapports avec les individus que la violence ou la ruse leur a soumis, ils invoquent la légitimité de leurs possessions, l’inviolabilité des lois ou des forces existantes, le respect des autorités établies par la divinité elle-même ; ce qui signifie toujours que ceux qui ont été les plus forts, désirent de conserver les avantages de la force, même quand elle les abandonne.
Cette double doctrine ne se manifeste nulle part d’une manière plus naïve que dans les États où il existe une classe de maîtres et une autre d’esclaves, et où les individus de la première ne sont pas complètement asservis. Un homme qui tenterait, en Amérique ou en Angleterre, une usurpation [IV-300] semblable à celle qu’un chef d’armée exécuta en France à la fin du dernier siècle, se verrait foudroyé de toutes parts avec les maximes des droits imprescriptibles de l’homme ; mais celui qui s’armerait des mêmes maximes pour appeler à la liberté des hommes dont on dispose comme de bêtes, et qu’on traite beaucoup plus cruellement, soulèverait contre lui l’opinion générale, et serait poursuivi comme un malfaiteur.
Mais c’est vainement que les possesseurs d’hommes se forment deux morales et deux justices : ils peuvent les établir dans la théorie ; tôt ou tard, il faut que, dans la pratique, l’une ou l’autre règne en souveraine. Ce qui est juste et vrai est tel par lui-même ou par la nature des choses, et non par un effet des caprices de la puissance. La plus folle ou la plus insolente des prétentions serait celle d’un individu qui s’imaginerait que c’est à lui qu’il appartient de rendre une proposition fausse ou vraie, juste ou injuste, selon que cela convient à ses intérêts. Ce qui serait absurde dans un individu, est absurde dans une collection d’individus, quelque nombreuse qu’elle soit ; le genre humain se lèverait tout entier pour déclarer faux un axiome de géométrie, que les choses resteraient les mêmes ; il y aurait seulement dans le monde une absurdité de plus ; or, les vérités morales ne dépendent pas plus de nos caprices que les vérités physiques ou mathématiques. Un homme qui, par ruse ou par violence, parviendrait à s’emparer de la personne d’un autre ; qui l’entraînerait de force dans sa maison ou sur son champ, où il le contraindrait à coups de fouet à travailler pour lui, ne serait pas jugé par un moraliste autrement que comme un brigand qu’il est urgent de réprimer. Si cet homme, arrivé chez lui, s’avisait d’écrire dans un registre et de proclamer, au sein de sa famille, qu’il est légitime propriétaire de la personne qu’il a ravie, qu’il a le droit de disposer d’elle selon ses caprices, et que nul ne peut, sans iniquité, mettre des bornes à ses violences, ces déclarations ni ses prétentions ne changeraient rien à la nature des faits. Ce qui, dans un individu, serait un crime, en est également un dans une multitude armée ; une bande qui, au lieu de s’emparer d’une personne, s’emparerait de cinquante ou de cent, serait dans un cas semblable à celui de l’individu que j’ai déjà supposé ; il n’y aurait pas d’autre différence si ce n’est que le crime serait beaucoup plus grave dans le second cas que dans le premier. Mais une nation n’est qu’une collection d’individus, et quand elle procède comme ceux que j’ai supposés, elle se trouve dans le même cas ; les déclarations qu’elle fait et qu’elle écrit avec plus ou moins de solennité, que tel ou tel acte est juste, que telle ou telle possession est légitime, ne changent rien à la nature des choses. En pareil cas, la loi c’est la force ; la légitimité c’est la conformité de la conduite des faibles à la volonté des plus forts. Pour apprécier l’esclavage, nous n’avons donc point à nous occuper de ce que les peuples qui l’ont établi ont écrit dans les registres de leurs délibérations ; leurs résolutions et leurs écritures, même quand ils les appellent des lois, ne peuvent en changer ni la nature, ni les causes, ni les effets.
Lorsque l’esclavage domestique existe chez un peuple, et que les individus de la classe des maîtres veulent établir un gouvernement, ils doivent tenir à ceux d’entre eux auxquels ils confient les fonctions de magistrats, de chefs militaires ou d’administrateurs, à peu près le langage suivant :
1° Vous n’exercerez aucune violence sur nos personnes quand même vous en auriez la force, parce que, à notre égard, la force ne serait pas la justice ; vous empêcherez qu’aucune cruauté ne soit exercée contre nous ; vous réprimerez toutes les atteintes portées à notre sûreté, sans acception de personnes ; vous nous écouterez tous également, et vous administrerez la justice avec impartialité, toutes les fois que nous vous adresserons nos plaintes ; mais vous n’accorderez aucune protection aux hommes ou femmes que nous possédons, et s’il nous plaît d’exercer des violences ou des cruautés sur eux, vous nous prêterez main-forte en cas de besoin, parce que, à leur égard, la force et la cruauté sont la justice ; non seulement vous ne réprimerez aucune des atteintes qui pourraient être portées par nous à leur sûreté, mais, s’ils venaient se plaindre, vous ne les écouterez point, et vous ferez toujours acception de personnes ; entre eux et nous, vous administrerez toujours la justice d’une manière partiale.
2° Vous protégerez la faculté dont nous prétendons jouir d’aller ou de venir à notre gré, de changer de lieu aussi souvent que cela nous conviendra ; vous empêcherez surtout que nul ne nous enferme, soit chez nous, soit dans aucun autre lieu, excepté dans le cas où nous serions accusés de quelque crime contre les maîtres, et en observant les formes légales que nous aurons établies ; mais vous protégerez en même temps la faculté dont nous prétendons jouir, d’empêcher les personnes que la force nous a soumises, d’aller ou de venir à leur gré, ou de changer de place lorsque cela leur convient ; vous nous aiderez, en cas de besoin, à les enfermer dans tel lieu qu’il nous plaira choisir, sans que nous ayons besoin de motiver nos volontés ou d’observer aucune formalité légale.
3° Vous protégerez notre industrie et l’usage que nous entendons faire de notre intelligence et de nos membres ; vous nous garantirez la faculté de suivre la profession qui conviendra le mieux à nos moyens, et de travailler ou de nous reposer selon que nous le jugerons utile à nos intérêts ; mais vous protégerez aussi la faculté que nous avons, de donner aux hommes possédés par nous, l’industrie qui nous convient, et de régler l’usage de leurs facultés selon nos caprices ; vous ne souffrirez point qu’ils travaillent ou se reposent selon leurs besoins ; mais vous les obligerez à travailler ou à rester oisifs selon les nôtres.
4° Vous nous garantirez la faculté de manifester nos opinions, soit verbalement, soit par des écrits imprimés ou autres ; vous souffrirez que chacun de nous exprime hautement ce qu’il pense, quand même nos pensées pourraient vous déplaire ou contrarier vos projets ; mais vous nous garantirez, en outre, la faculté d’empêcher que les hommes qui nous sont soumis, manifestent, par aucun moyen, des opinions qui puissent nous déplaire ; et s’ils contreviennent à nos défenses à cet égard, vous protégerez les châtiments arbitraires qu’il nous plaira leur infliger.
5° Vous nous garantirez la faculté d’exercer le culte religieux que nous jugerons le plus raisonnable ou le plus agréable à la Divinité, ainsi que la faculté de prier ou de nous reposer tel jour que nous aurons choisi, et vous n’userez d’aucune force pour nous imposer vos propres croyances ; mais vous nous garantirez de plus la faculté de faire exercer, par les hommes qui nous sont soumis, le culte qu’il nous plaira de leur imposer, et de les empêcher de rendre à la Divinité tel hommage qui pourrait leur être commandé par leur conscience.
6° Vous ne percevrez sur nos revenus, ou sur les produits de nos travaux, que les sommes qui vous seront rigoureusement nécessaires pour une bonne administration, et vous nous rendrez un compte clair, net et public de toutes celles que vous aurez perçues et dépensées ; mais, en même temps, vous protégerez la faculté que nous avons de nous approprier le fruit des travaux des hommes qui nous sont soumis, et de ne leur laisser que qui leur est rigoureusement nécessaire pour soutenir leur existence ; car, à leur égard, les extorsions sont de la justice.
7° S’il s’élevait parmi nous, qui sommes les maîtres, des hommes qui voulussent nous soumettre à un pouvoir arbitraire, vous ferez usage de votre puissance pour les réprimer et pour nous protéger ; vous les punirez suivant toute la rigueur des lois ; mais, s’il s’élevait des hommes qui voulussent soustraire à notre arbitraire les individus que la force nous a soumis, vous vous souviendrez que vous êtes les protecteurs de cet arbitraire ; vous livrerez aux tribunaux tout individu qui tenterait de protéger, contre nos violences, les personnes que nous possédons, pour les placer sous la protection de la justice.
8. Vous protégerez surtout la vertu de nos filles et de nos femmes, et vous punirez avec rigueur les misérables qui oseraient attenter à leurs personnes ; mais vous nous protégerez aussi dans l’exercice du pouvoir arbitraire que nous entendons exercer sur les filles ou sur les femmes des hommes qui nous sont soumis ; si un mari s’avisait de défendre sa femme, ou un père sa fille, contre nos entreprises, vous nous prêterez la force dont vous disposez, pour les châtier de leur témérité, et faciliter ainsi l’accomplissement de nos désirs.
« Vous jurez d’être fidèles à cette déclaration des droits de l’homme et des droits du maître ; et si vous y manquez, en protégeant contre nos extorsions, contre notre violence, et même contre notre luxure, les hommes ou les femmes que la force nous a soumis, nous espérons de la sagesse et de la justice de l’Être suprême qui nous entend, qu’il vous punira de vos prévarications par des châtiments éternels. »
L’esprit humain se prête si facilement aux diverses impressions qu’on veut lui donner, et il est si difficile de se rendre raison des opinions qu’on a reçues dans l’enfance, que je conçois très bien que des possesseurs d’hommes inculquent dans l’esprit de leurs enfants, une série de propositions contradictoires, semblables à celles dans lesquelles je viens de réduire les prétentions d’un planteur ou d’un Anglo-Américain du sud. Je conçois même qu’après avoir lu ces propositions que les colons français, hollandais et anglais, ou américains, aspirent à mettre en pratique, les uns et les autres les trouvent raisonnables et justes, précisément parce qu’elles sont absurdes. Mais c’est se tromper étrangement que de s’imaginer que les hommes règlent leur conduite par les formules qu’on leur fait réciter, et non par leurs besoins ou par leurs habitudes. Les brigands italiens et espagnols qui vont s’embusquer sur les grandes routes, pour dévaliser les voyageurs, ne sont ni des idolâtres, ni des athées ; ils ont le même évangile, et une foi aussi robuste que les hommes honnêtes et industrieux qui peuplent nos grandes villes. Ils savent réciter les maximes morales et religieuses qu’on leur a apprises dès leur enfance, aussi couramment qu’un Anglo-Américain du sud peut réciter les droits de l’homme et les droits du maître inscrits dans les lois de son pays ; cependant, leurs maximes et même leurs croyances ne suffisent pas pour mettre les voyageurs en sûreté.
Les hommes ne sont dirigés que par l’habitude et par l’exemple ; quelque contradictoires que soient leurs doctrines ou leurs raisonnements, ils se montrent dans leur conduite conséquents à ce qu’ils ont toujours pratiqué ou vu pratiquer. Ce n’est point dans les écoles ou dans les livres des législateurs, que les citoyens se forment au gouvernement ; c’est dans leurs maisons et dans les relations qu’ils ont avec les individus qui les environnent. Un enfant qui, depuis sa naissance jusqu’au moment où il est parvenu à l’âge d’homme, se voit environné de maîtres et d’esclaves, observe nécessairement les relations qui existent entre les uns et les autres. Il ne voit, dans ces relations, que ce qui s’y trouve en effet, l’emploi continuel de la force contre la faiblesse ; le triomphe constant des désirs et des caprices des uns, et l’abnégation complète de la volonté des autres ; l’autorité au lieu de raisonnement. Il ne peut pas encore parler, qu’il a déjà pris le ton absolu et l’air impérieux d’un maître ; il voit dans ses parents les membres d’un gouvernement ; dans les esclaves, il voit des sujets : il a contracté les habitudes d’un despote avant même que de savoir ce que c’est que des magistrats.
Quelle est la différence, qu’un homme ainsi élevé, peut voir entre les individus qu’il possède à titre d’esclaves, et les individus qui ne sont point dans l’esclavage ? Il n’en est que deux, c’est la force, et le préjugé que les uns sont nés pour obéir, travailler et souffrir, et les autres pour commander et vivre dans l’oisiveté. Chaque individu libre, pour considérer tous les autres comme ses esclaves, n’a donc besoin que de se trouver investi du commandement, et de posséder des instruments qui lui donnent sur ses égaux la force qu’il a sur ses esclaves. Or, nous verrons bientôt que ces instruments ne peuvent être difficiles à trouver dans les pays où une partie de la population est née et élevée dans la pratique de l’arbitraire, et où l’autre partie est façonnée pour la servitude.
Un des effets les plus remarquables de l’esclavage est de mettre dans une contradiction perpétuelle les hommes qui exercent une partie de l’autorité publique, et de les condamner à approuver ou à flétrir alternativement les mêmes actions. Il faut ou qu’ils mentent sans cesse à leur conscience, ou qu’ils se flétrissent eux-mêmes dans leurs jugements. Cette nécessité est le résultat de l’opposition qui existe entre les prétentions que forment les maîtres en leur qualité de citoyens, et celles qu’ils veulent exercer en leur qualité de possesseurs d’hommes. Afin de mieux faire comprendre ma pensée, je citerai quelques exemples.
Un individu qui possède un troupeau d’hommes ou de femmes, en emploie une partie à cultiver ses terres ; il loue les autres à des gens qui lui en paient le louage. Mais, comme cela se pratique, il ne laisse aux uns et aux autres que ce qui leur est rigoureusement nécessaire pour ne pas mourir de faim ; quant à lui, il vit dans l’abondance au moyen du produit de leurs travaux. Cet homme, après avoir arraché aux malheureux que la force lui a soumis, tout ce que leur travail a pu produire, va dans une cour de justice en qualité de magistrat ou même de juré. Il se place sur son siège ; des ouvriers ou des artisans se présentent et demandent la condamnation d’un homme qui, après les avoir longtemps fait travailler, a refusé de leur payer leur salaire. Les faits sont constatés ; les lois sont positives ; le magistrat condamne l’individu amené devant lui, attendu qu’il est injuste de faire travailler les gens, et de ne pas leur payer la valeur de leur travail. La sentence prononcée, notre magistrat descend de son siège, et va dîner avec le produit d’un travail qu’il n’a payé que par des coups de fouet.
Un autre possesseur d’hommes donne à un de ses esclaves un ordre qui n’est pas assez promptement exécuté, ou bien il s’imagine que cet esclave a manifesté une opinion peu respectueuse. À l’instant, il commande qu’on le dépouille, lui fait attacher les membres à quatre piquets, et lui administre deux cents coups de fouet. L’expédition finie, et encore tout bouillant de colère, ce maître passe dans une salle de justice, et va siéger sur le banc des magistrats. Là, il attend que la force publique lui amène les malfaiteurs qui doivent être soumis à un jugement ; un accusé se présente ; son crime est de s’être montré trop sensible à l’injure, et d’avoir infligé un châtiment barbare à un être plus faible, qui lui avait manqué de respect. Les lois étant encore positives, le magistrat prononce la sentence ; il condamne l’accusé à des peines infamantes. Le jugement prononcé, il va faire déchirer à coups de fouet les enfants et les femmes qu’il tient enchaînés.
Un troisième, pressé d’argent, s’adresse à un marchand d’esclaves ; celui-ci consent à lui en acheter quelques-uns, mais il ne veut en recevoir que de jeunes. Notre possesseur va dans sa plantation ; il choisit les plus beaux enfants ; les arrache des bras de leurs mères ou de leurs pères, et les livre au marchand ; et si les cris des parents blessent ses oreilles, il leur fait imposer silence à coups de fouet. Mais notre planteur est magistrat ; quand il a réglé ses propres affaires, il faut qu’il administre la justice ; il va donc prendre sa place auprès de ses collègues, et une cause importante attire son attention. Une mère dans le désespoir se présente ; un misérable lui a enlevé son fils et l’a vendu au loin comme esclave ; le fait est constaté, le malfaiteur est dans les mains de la justice ; mais il n’est pas possible de retrouver l’enfant qui a été ravi. Le magistrat fait encore son devoir : il condamne à être pendu l’accusé qu’il sait ne pas être plus coupable que lui-même, ni que la plupart des autres possesseurs d’hommes.
Un quatrième est appelé comme magistrat ou comme juré : il doit prononcer sur une grave accusation portée contre un de ses concitoyens. Un père a dénoncé un attentat commis avec violence contre la pudeur de sa fille ; il a saisi le scélérat, et il produit de nombreux témoins de son crime. Nos juges possesseurs d’hommes font encore l’application de la loi : l’accusé est condamné et pendu sans miséricorde. Mais le fait pour lequel il subit le dernier supplice n’est pas considéré comme un crime en lui-même : les témoins, les jurés et les juges eux-mêmes, après avoir condamné ou fait condamner l’accusé et avoir été les témoins de son supplice, rentreront chez eux et pourront se livrer, avec impunité, à des attentats plus graves encore que celui qu’ils viennent de punir ; ils pourront les commettre contre des êtres plus faibles, et même contre leurs sœurs ou contre leurs propres filles nées dans la servitude.
Enfin, il n’est presque pas un crime, de quelque nature qu’il soit, auquel un individu ne puisse impunément se livrer en sa qualité de possesseur d’hommes, et qu’il ne puisse être appelé à punir en qualité de magistrat. De cette opposition entre la conduite, et les principes qui doivent diriger le jugement, il résulte que les sentiments moraux s’éteignent, et que la justice n’est plus qu’une force brutale, dirigée par l’orgueil et par l’intérêt des maîtres. Lorsque les mêmes dispositions se rencontrent chez tous les hommes dont un gouvernement se compose, depuis les plus humbles fonctionnaires jusqu’aux chefs de l’État, peut-il exister de la sécurité pour un seul individu ? Peut-on espérer que des hommes qui se livrent habituellement chez eux à l’arbitraire, à la violence et à tous les vices, deviendront tout à coup justes, humains, désintéressés, et que ce miracle s’opérera dans leur personne, par cela seul qu’ils changeront de dénomination ?
Un des faits les mieux constatés dans les sciences morales, c’est que l’habitude d’exercer l’arbitraire en donne le besoin et en quelque sorte la passion ; lorsque des hommes se sont habitués à vivre sur leurs semblables, tout autre genre de vie leur est en horreur ; le travail qui s’exerce sur les choses, est tellement vil à leurs yeux, qu’il ne peut convenir qu’à des esclaves. Nous avons constaté ce fait, non par quelques observations isolées et individuelles, mais par des observations faites sur des races entières, chez les peuples de toutes les espèces, sur les principales parties du globe, et à toutes les époques de la civilisation.
Un autre fait qui n’est pas moins bien constaté que le précédent, c’est que, lorsque des possesseurs d’hommes ne peuvent pas rétablir leurs fortunes par le pillage des nations étrangères, ils ne reconnaissent pas d’autres moyens honorables de s’enrichir que le pillage de leurs propres concitoyens. Nous avons vu, en effet, que quoique les colons anglais et français eussent obtenu, pour la vente de leurs denrées, des monopoles dans des marchés très étendus, ils étaient tous dans la détresse. Un phénomène semblable se manifesta chez les Romains, lorsque le nombre des esclaves se fut très multiplié, et surtout lorsque l’état de paix eut concentré dans les mains du maître de l’empire les impôts levés sur les peuples vaincus. Les principaux complices de Sylla, de Catilina, de César, étaient des maîtres ruinés, qui n’avaient pas même le moyen de payer leurs dettes.
Des deux phénomènes que je fais observer ici, il en résulte un troisième qui mérite d’être remarqué ; c’est la tendance de tous les maîtres à s’emparer du gouvernement. Chacun, selon sa position, aspire à obtenir un emploi qui le mette à même d’agir sur des hommes et de s’enrichir, ou de vivre du moins, s’il le peut, sans travailler. Tacite observait, de son temps, que les Romains renonçaient volontiers à la liberté, pour entrer en partage des produits que donne l’exercice du pouvoir arbitraire. Des voyageurs ont déjà observé chez les Anglo-Américains une avidité d’emplois publics, plus grande que celle que nous observons dans la plupart des États de l’Europe. S’ils avaient recherché de quels rangs sortaient les aspirants, il ne faut pas douter qu’ils n’eussent trouvé que le plus grand nombre appartenaient à des familles possédant ou ayant jadis possédé des esclaves. Il est un fait irrécusable que confirme cette observation : c’est le grand nombre d’hommes qu’ont fourni au gouvernement fédéral les États exploités par des esclaves. L’État de Virginie seul en a fourni plus qu’aucun des États du nord, quoiqu’il leur soit de beaucoup inférieur par l’industrie, par les richesses et par les lumières. Dans les États du nord, où l’esclavage est à peu près aboli, on naît agriculteur, manufacturier, commerçant, artisan. Dans les États du sud, quand on naît possesseur d’hommes on naît gouvernant, ou l’on n’est propre à rien [330].
L’existence de l’esclavage poussant les hommes de la classe des maîtres vers les emplois du gouvernement, leur faisant un besoin de s’enrichir par ce moyen, et leur donnant en même temps les préjugés et les habitudes de l’arbitraire, il reste à voir quelles sont les ressources que présentent les diverses classes de la population aux gouvernants qui aspirent à se maintenir dans le pouvoir et à établir le despotisme.
Je dois faire observer d’abord que les mêmes mots n’ont pas, dans un pays où l’esclavage est établi, le même sens qu’ils ont dans un pays où il n’existe point d’esclaves. Lorsque des Anglo-Américains ou des planteurs de la Jamaïque, ou même des seigneurs polonais, disent que les propriétés doivent être garanties, et que nul ne doit être dépouillé des siennes sans avoir été préalablement indemnisé, ils n’attachent point à ces mots la même signification que nous. À leurs yeux, garantir les propriétés, c’est abandonner à leur arbitraire les hommes, les femmes, les enfants que la force leur a soumis ; porter atteinte à la propriété, c’est mettre la population asservie à l’abri de la violence ; c’est lui garantir une portion du fruit de ses travaux ; c’est, en un mot, donner des limites à l’arbitraire de ses possesseurs. Cela étant entendu, on comprendra facilement comment il est de l’intérêt de la population esclave, de seconder de tous ses efforts les hommes qui aspirent à l’asservissement des maîtres.
De tous les genres de despotisme, il n’en est point de plus actif, de plus violent, de plus continu que celui qu’exerce un maître sur ses esclaves. Les violences et les extorsions qu’exerce un despote sur la masse d’une population, ne sont rien en comparaison des extorsions et des violences qu’ont exercées, de tout temps, la plupart des maîtres. Peut-on établir quelque analogie entre la plupart des sujets de Tibère et de Néron, et ces multitudes d’esclaves que les propriétaires romains faisaient travailler dans leurs champs, chargés de chaines, stimulés à coups de bâton, privés de vêtements, nourris d’aliments grossiers et peu abondants, et enfermés pendant la nuit dans des cavernes souterraines ? Le sort des paysans de Perse n’est-il pas cent fois préférable à celui des esclaves des colonies anglaises, françaises, hollandaises ou espagnoles ? L’intérêt de tous les esclaves les dispose donc à seconder tout ambitieux qui se présente pour asservir la race des maîtres, et quand même leurs efforts auraient pour résultat d’établir le gouvernement le plus tyrannique qui ait jamais existé, ce gouvernement serait pour eux un bienfait.
Entre les maîtres et les esclaves, il est une classe d’hommes pour laquelle l’asservissement des premiers est un bienfait et un progrès, c’est la classe des affranchis ; les hommes de cette classe ont à gagner, de trois manières, à l’établissement d’un gouvernement absolu ; d’abord, ils cessent d’être exclus des fonctions publiques, les maîtres n’ayant plus la nomination aux emplois ; en second lieu, ils sont moins avilis, parce que les maîtres peuvent moins facilement les opprimer, et que le pouvoir établi au-dessus d’eux les met tous au même niveau ; enfin, les maîtres peuvent moins facilement s’emparer du monopole de toutes les professions industrielles ; le gouvernement, ne pouvant pas exploiter chaque individu en particulier, est obligé d’établir des impôts sur la masse de la population, et il faut qu’il accorde une sorte de protection à tout individu qui travaille.
Dans l’ancienne Rome, tous les hommes qui voulurent tenter d’établir le despotisme cherchèrent et trouvèrent un appui dans les classes de la population qui n’appartenaient ni aux maîtres, ni aux esclaves, c’est-à-dire parmi ceux qu’on désignait sous le nom de prolétaires. Nous voyons d’abord les hommes de cette classe vendre, en leur qualité de citoyens, leurs suffrages à ceux qui leur en offrent le plus d’argent. Nous les voyons ensuite s’allier à Marius, et le seconder dans toutes les mesures qui ont pour objet l’asservissement ou la destruction des maîtres. Nous les voyons bientôt après devenir les alliés de César, remplir les cadres de ses légions, et marcher avec lui à la conquête de Rome. Nous les voyons, à la mort du dictateur, s’allier à de nouveaux tyrans, et venger sur les grands le meurtre de leur chef. Plus tard, nous les voyons s’allier à Néron, le servir de toute leur puissance, et le regretter après sa mort. Enfin, nous les voyons, sous le nom de légionnaires, rester maîtres de l’empire, le vendre au plus offrant, et le reprendre pour le vendre encore, quand le possesseur cesse de se conformer à leurs volontés.
Est-il nécessaire d’indiquer les causes de la persévérance des hommes qui ne sont ni esclaves, ni possesseurs d’esclaves, à s’allier à tous les ennemis des maîtres ? N’avons-nous pas vu ceux-ci s’emparer de toutes les terres, à titre de propriétaires ou sous le nom de fermiers de la république, et les faire exploiter exclusivement par les mains des étrangers possédés sous le nom d’esclaves ? Ne les avons-nous pas vus chasser ainsi de toutes les campagnes d’Italie les cultivateurs libres et ne leur laisser aucun moyen d’existence ? Ne les avons-nous pas vus s’emparer dans le sein de Rome, au moyen de leurs capitaux et de leurs esclaves, de toutes les branches d’industrie et de commerce ? Ne les avons-nous pas vus flétrir d’abord et prohiber ensuite le travail exécuté par des mains libres, afin de mieux s’en assurer le monopole par les mains de leurs esclaves ? Les classes libres qui correspondaient, à Rome, à nos classes laborieuses, ne pouvaient donc pas avoir d’ennemis plus redoutables ni plus cruels que les possesseurs d’hommes. La classe des maîtres, qui était, pour les individus possédés, le fléau le plus terrible, était, pour tous les individus classés sous le nom méprisant de prolétaires, un fléau non moins redoutable. Pour de tels hommes, Marius, César et Néron lui- même étaient des bienfaiteurs ; car, en même temps qu’ils leur donnaient des moyens d’existence, ils détruisaient leurs ennemis.
Mais, lorsqu’il existe, au sein d’une nation, une classe aristocratique dont tous les membres cherchent à s’arracher le pouvoir, et à s’enrichir par son moyen quand ils le possèdent, une classe nombreuse qui ne possède ni propriétés, ni industrie, et une classe plus nombreuse encore qui non seulement ne possède rien, mais qui est considérée comme la propriété de l’aristocratie, les guerres civiles qu’enfante l’habitude et l’amour de la domination, prennent un caractère d’avidité et de cruauté dont on ne peut avoir aucune idée chez les peuples qui n’ont point d’esclaves. C’est alors que tous les vices développés dans l’intérieur des familles par l’usage perpétuel de l’arbitraire, se manifestent au grand jour, et s’exercent sur la masse entière de la population ; chaque chef est le représentant de tous les vices de la fraction de peuple qu’il gouverne. La haine, la vengeance, la délation mettent en mouvement une population d’esclaves ou d’affranchis ; l’orgueil, l’ambition, la cruauté, l’avidité mettent les armes dans les mains des maîtres, et une population de prolétaires devient l’instrument de tout ambitieux qui veut la servir. La crainte, l’ambition, la vengeance, commandent des proscriptions qui sont toujours suivies de la confiscation des biens, et de la ruine des familles ; et, d’un autre côté, le besoin de richesses et la nécessité de récompenser les misérables qui servent d’instrument, font proscrire les individus ou les familles qui ont assez de richesses pour tenter les vainqueurs. Tels sont les caractères des guerres civiles des Romains, depuis le moment où les grands eurent acquis un grand nombre d’esclaves, jusqu’au renversement de leur empire.
Lorsque nous lisons, dans l’histoire romaine, les plaintes que forment les patriciens sur l’influence des affranchis, sur leurs délations, et sur le zèle qu’ils mettaient à servir les empereurs, nous sommes naturellement disposés à prendre parti pour les maîtres contre leurs anciens esclaves ; nous ne voyons pas que c’est là le commencement de la terrible réaction des hommes asservis contre leurs oppresseurs, réaction qui avait le même but et le même principe que celle des prolétaires, et qui ne devait plus cesser que par l’extermination complète de la race des maîtres. Un affranchi pouvait avoir quelques obligations à l’individu qui lui avait rendu la liberté ; ces obligations étaient analogues à celle qu’inspire un voleur, ou l’héritier d’un voleur, à l’individu auquel il restitue une partie des biens qui lui ont été volés, pouvant impunément les retenir. Mais la reconnaissance d’un affranchi ne pouvait pas plus s’étendre sur toute la classe des maîtres, que ne pourrait s’étendre sur la classe entière des voleurs la reconnaissance d’un homme auquel un bien volé aurait été restitué. Les affranchis et les esclaves formaient une nation particulière, essentiellement ennemie de la classe des maîtres ; le nom même d’affranchi était une flétrissure qui ne pouvait être effacée que par la destruction de la race qui l’avait imposée.
Chez les peuples parmi lesquels aucune justice n’est établie, les vengeances individuelles ou de famille deviennent terribles et passent de génération en génération, jusqu’à ce qu’elles aient été satisfaites, ou jusqu’à ce que les races qui en sont l’objet aient été complètement détruites. C’est encore un caractère commun aux hommes de toutes les espèces, et que nous avons observé chez toutes les races et sous tous les climats. Or, les relations de maître et d’esclave ne laissent point de place à la justice ; elles en excluent jusqu’à l’idée. La vengeance qui fermente dans le sein de l’esclave, est d’autant plus énergique qu’elle est plus dissimulée, que les injustices se multiplient de jour en jour, et que chaque individu, outre ses propres outrages, est le témoin journalier de ceux qui sont faits à son père, à sa mère, à ses sœurs, à ses frères, à ses fils ou à ses filles. Quand des crimes ont été ainsi cumulés pendant des siècles, et que les obstacles qui en rendent le châtiment impossible, finissent par se rompre, faut-il s’étonner de la violence de la réaction, et de la persévérance avec laquelle les races opprimées poursuivent leurs oppresseurs ?
Plusieurs des tyrans romains qui succédèrent à la république des maîtres, furent des monstres par leurs cruautés, si nous les comparons aux mœurs des peuples actuels de l’Europe ; mais, si nous comparons leur conduite à l’égard des maîtres, à la conduite de ceux-ci à l’égard de leurs esclaves, nous les jugerons d’une manière moins sévère. Tibère n’a jamais manifesté à l’égard de ses sujets, les sombres défiances, l’avarice, la cruauté ni le mépris que manifestaient et que manifestent encore de nos jours les possesseurs d’hommes envers leurs esclaves. À aucune époque, ni dans aucun pays, aucun tyran n’a réduit ses sujets à l’excès de dénuement et de misère auquel étaient réduits les cultivateurs enchaînés des campagnes romaines ; aucun n’a jamais fait descendre ses sujets à la condition des esclaves des colonies modernes.
Il est vrai que les sujets des despotes romains, sur lesquels pesaient les malheurs de la servitude, étaient plus nombreux que les esclaves d’un des membres de l’aristocratie ; et qu’un ordre de Tibère ou de Néron frappait un plus grand nombre d’individus que l’ordre d’un riche possesseur de terres. Mais, pour juger équitablement, il faut comparer les violences, les extorsions, les cruautés de tous les maîtres, aux violences, aux extorsions, aux cruautés d’un seul despote : il faut comparer les effets du despotisme collectif des premiers, aux effets du despotisme individuel du second. Or, en faisant cette comparaison, on conçoit très bien comment les hommes qui avaient appartenu ou qui appartenaient encore à la race asservie, cherchaient un abri sous un pouvoir qui se montrait l’ennemi des riches possesseurs d’esclaves. Les possesseurs d’hommes, pour mieux assurer leur domination, avaient soin d’abrutir leurs esclaves, d’entretenir entre eux la méfiance, d’encourager, de récompenser la délation. Lorsqu’ils eurent été asservis à leur tour, ils recueillirent le fruit de ce qu’ils avaient semé : les affranchis mirent en pratique à leur égard, les leçons qu’ils avaient reçues quand ils étaient esclaves.
Ce serait, au reste, juger d’une manière fort étroite que de s’imaginer que le despotisme ne commença, à Rome, que le jour où elle eut des empereurs ; Rome eut des despotes le jour même où un homme eut la faculté de disposer d’un autre d’une manière arbitraire ; le jour où un individu put impunément maltraiter, rançonner, abrutir un autre individu. Si les hommes asservis et les affranchis avaient eu leurs historiens, comme les maîtres ont eu les leurs, et si ces historiens nous avaient décrit les vices et les crimes des maîtres, l’histoire des empereurs nous paraîtrait moins horrible ; nous ne trouverions sous leurs règnes que l’application en grand des doctrines établies et pratiquées sous la république.
Ainsi, dans un État où une partie de la population est possédée par l’autre à titre de propriété, nous trouvons qu’une grande partie de la classe des maîtres est naturellement disposée à envahir le pouvoir, et à s’emparer des richesses créées par d’autres ; nous trouvons que la partie de la population qui ne peut vivre que de son travail et dont l’esclavage avilit ou empêche l’industrie, est également disposée à se liguer avec tout individu qui se propose d’asservir ou de détruire la race des maîtres ; enfin, nous trouvons que le despotisme même le plus violent, qui affaiblit ou qui détruit le pouvoir des maîtres, est un bienfait pour les esclaves ; la tendance de la masse de la population, la porte donc vers l’établissement du despotisme d’un seul, et quand le despotisme est établi, il est exercé avec la rapacité, la brutalité, la cruauté et la stupidité que mettent des maîtres dans l’exploitation de leurs esclaves.
Diverses circonstances modifient, dans les colonies européennes et chez les Anglo-Américains du sud, les effets que produit l’esclavage domestique sur l’esprit et sur la nature du gouvernement. Les colonies ne sont point indépendantes : elles reçoivent des gouverneurs et une partie de leurs magistrats et de leurs militaires, des pays auxquels elles sont soumises. Ces militaires, ces gouverneurs, ces magistrats sont nés et élevés chez les peuples qui n’admettent point l’esclavage domestique, et qui, par conséquent, peuvent ne pas avoir les vices que la servitude engendre. Par la perte complète de toute indépendance nationale, les possesseurs d’hommes des colonies évitent une partie des maux attachés à leur position. Il faut qu’ils soient possédés par un pouvoir étranger à leur pays, par un pouvoir sur lequel ils ne peuvent avoir d’influence, pour ne pas être les victimes de l’état social établi parmi eux. De là il résulte qu’ils sont tout à la fois atteints des vices et des calamités qui appartiennent à l’esclavage et à la domination ; en leur qualité de possesseurs d’hommes, ils ont les vices et les maux réservés aux despotes ; en leur qualité de sujets d’un pouvoir étranger, ils ont les vices qu’imprime la servitude. Mais cet état ne saurait être éternel ; la domination est une charge pesante pour les nations qui l’exercent ; elle ne durera qu’avec les erreurs qui la soutiennent et qui sont déjà bien affaiblies. Lorsqu’elle n’existera plus, la domination des maîtres les uns sur les autres se fera sentir, et l’on verra quelles en sont les conséquences.
[IV-326]
Une seconde circonstance concourt à modifier les effets de l’esclavage ; c’est la faculté qu’ont les maîtres de faire élever leurs enfants chez des nations où l’esclavage domestique est hors d’usage. En employant ce moyen, ils peuvent jusqu’à un certain point affaiblir les mauvais effets que produit sur l’intelligence et sur les mœurs, le spectacle continuel de la violence et de la servilité ; mais cette ressource ne peut être employée que par des familles riches, et par conséquent elle est hors de la portée de la masse de la population.
Une troisième circonstance qui a pour effet de modifier les effets de l’esclavage, est la faculté qu’ont les hommes libres de la classe industrieuse d’émigrer chez les nations où le travail n’est point avili. L’usage de cette faculté condamne les nations esclaves à rester éternellement stationnaires ; mais aussi elle délivre en partie les maîtres des dangers qu’aurait pour elle une classe nombreuse qui n’aurait ni propriétés, ni industrie. La facilité de l’émigration peut ne pas être la même dans tous les pays ; elle est plus grande chez les Anglo-Américains du sud, qu’elle ne l’est dans les colonies françaises : d’où il suit que le danger n’est pas égal pour tous les possesseurs d’esclaves.
Les effets de l’esclavage sont modifiés par une quatrième circonstance chez les Anglo-Américains du sud : par l’influence qu’exercent sur eux les États du nord. Il est évident, en effet, qu’un des principaux résultats de la fédération est de prévenir, dans les États du sud, soit les usurpations de pouvoir, soit les insurrections des esclaves. La division du pays en divers États indépendants, contribue également à rendre les usurpations difficiles. Un individu qui aurait subjugué un État, pourrait n’avoir pas le moyen de subjuguer les autres.
En exposant les diverses manières dont les Anglo-Américains agissent sur les esclaves, il en est une qui paraît incroyable, tant, dans nos mœurs, elle est absurde et atroce : c’est l’interdiction absolue imposée à tous les maîtres d’apprendre à lire à leurs esclaves ; un maître qui couperait les mains ou qui crèverait les yeux à un des hommes qu’il considère comme sa propriété, serait puni par les autres maîtres moins sévèrement que s’il lui avait appris à lire et à écrire. Nous ne devons pas considérer cette loi comme une atrocité gratuite ; elle est une des conditions de la liberté et de la sécurité des maîtres. Nous ne concevons pas que la liberté d’un peuple puisse se maintenir, si chacun ne jouit pas de la faculté de publier ses opinions ; mais nous ne concevons pas davantage que la servitude puisse se perpétuer dans un pays où la publicité règne. Les Anglo-Américains du sud, voulant rester libres, ont admis, pour tous les citoyens, la faculté illimitée de publier leurs opinions ; et voulant en même temps perpétuer la servitude parmi eux, ils ont fait une loi de l’abrutissement des esclaves. Ils ont déterminé qu’ils les rendraient assez stupides pour que la liberté de la pensée ne pût contribuer en rien à leur instruction. Si les esclaves savaient lire, en effet, il se trouverait bientôt des affranchis qui sauraient écrire ; et, dès ce moment, les maîtres ne pourraient plus assurer leur repos, qu’en soumettant à une censure préalable tous les écrits qui seraient publiés ou introduits sur leur territoire. Ils seraient, par conséquent, obligés de renoncer à une des portions les plus précieuses de leurs libertés, à celle qui sert de garantie à toutes les autres [331].
Cependant, les Anglo-Américains sentent déjà vivement les maux attachés à l’esclavage, et ils voudraient s’en débarrasser ; mais comment s’y prendre ? S’ils déportent annuellement une partie de leurs esclaves, les naissances excèderont les déportations ; car il faudra assurer la subsistance des déportés, et cela en réduira de beaucoup le nombre. S’ils les affranchissent, il faudra les éclairer et leur donner une industrie ; alors ils se multiplieront rapidement, ils profiteront des avantages de la publicité, voudront exercer les droits des citoyens, et les maîtres les jugeront redoutables. Si, pour prévenir le danger de leur domination, les hommes de la race des maîtres renoncent à une partie de leur liberté ; s’ils soumettent les écrits a une censure préalable, ils auront à craindre que, pour les opprimer, leurs gouvernements ne cherchent un appui dans les hommes de la race affranchie.
[IV-330]
CHAPITRE XVI. ↩
De l’influence de l’esclavage domestique sur l’indépendance des peuples possesseurs d’esclaves.
L’effet immédiat de l’esclavage est de mettre l’homme possédé en état d’hostilité contre celui qui le possède ; cet état ne résulte pas seulement des violences et des extorsions auxquelles l’esclave est incessamment assujetti, il résulte surtout du désir inhérent à chaque individu de perpétuer son espèce et de contribuer au bien-être des générations à venir. Un homme qui est considéré comme la propriété d’un autre, et qui est ainsi tombé au dernier terme de dégradation auquel un être de son espèce puisse descendre, voit toutes les misères de la servitude s’étendre sur ses descendants jusqu’à la postérité la plus reculée. Aussi longtemps que durera sa race, les pères et mères seront impuissants pour adoucir le sort de leurs enfants, les maris ne pourront rien pour leurs femmes, les femmes pour leurs maris, les frères pour leurs sœurs, les enfants pour leurs parents ; tous les liens les plus chers au cœur de l’homme seront sans cesse brisés. Des hommes faits esclaves, ne peuvent donc pas avoir des ennemis plus terribles et plus persévérants que leurs maîtres, et que les descendants de leurs maîtres.
[IV-331]
Il suit de là que les mêmes motifs qui portent une population asservie à se rallier à tout homme qui veut priver les maîtres de leur puissance, et les soumettre à un gouvernement despotique, les porte à se rallier à une puissance étrangère qui aspire à les subjuguer. Des esclaves, ne possédant aucune propriété, ne craignent pas le pillage ; ils peuvent, au contraire, profiter du désordre qui suit une invasion, pour ressaisir quelque faible portion des richesses que leurs travaux ont produites ; il est possible même qu’en rendant des services aux vainqueurs, ils en soient récompensés par la liberté. Dans aucun cas, ils n’ont pas à craindre de voir empirer leur condition ; un changement de maîtres par suite d’une invasion, ne peut être considéré comme une calamité plus grande qu’un changement de maîtres par suite d’un échange, d’une vente, ou de toute autre transaction commerciale.
Aussitôt que des possesseurs d’hommes se trouvent en état de guerre avec une nation étrangère, ils ont donc à se mettre en garde contre deux sortes d’ennemis : d’abord, contre ceux qui se trouvent déjà dans l’intérieur de leurs familles, et ensuite contre ceux qui viennent pour les subjuguer. Il est rare que ces deux classes d’ennemis ne soient point d’intelligence ; ceux de l’intérieur servent volontiers d’espions et de guides à ceux de l’extérieur, en attendant que l’occasion de les seconder d’une manière plus efficace se présente. Les maîtres sont donc obligés d’avoir en même temps deux armées : l’une, qui surveille les mouvements des esclaves et qui prévienne ou réprime leurs insurrections ; l’autre, qui surveille et combatte l’ennemi étranger.
L’invasion d’un pays exploité par des esclaves, n’est pas favorisée seulement par la disposition dans laquelle se trouve la population asservie, de se rallier à tous les ennemis des maîtres, elle l’est aussi par la misère qui pèse généralement sur le pays, et par la facilité avec laquelle une puissance étrangère attire dans son parti les grands possesseurs accablés de dettes. Il n’est point de guerre chez les peuples modernes, qui n’entraîne une nation dans de grandes dépenses, et qui n’exige l’établissement de nouvelles contributions ; mais si la partie la plus nombreuse de la population est considérée comme une propriété, sur qui fera-t-on peser les impôts ? Ce ne peut pas être sur les esclaves, car ils ne possèdent rien, leurs maîtres ne leur laissant rien au-delà de ce qui leur est rigoureusement nécessaire pour subsister. Il faut donc fournir aux dépenses que la guerre exige, par les contributions levées sur les possesseurs d’esclaves ; mais ces contributions ne peuvent fournir que de faibles moyens, d’abord, parce que le nombre des contribuables est nécessairement très borné, et, en second lieu, parce que l’esclavage est un obstacle à la cumulation des capitaux dans les mains des maîtres. Ajoutons que l’état de détresse dans lequel se trouvent habituellement la plupart des possesseurs d’hommes, dispose un grand nombre d’entre eux à devenir les instruments de toute puissance qui veut les payer. Un État où la population laborieuse ne se compose que d’esclaves, est donc d’une extrême faiblesse, comparativement à une nation libre.
L’influence que l’esclavage exerce sur le nombre de la population, se fait sentir aussi sur l’indépendance nationale. Il est évident, en effet, que lorsqu’une faible population se trouve disséminée sur un vaste territoire, il est très difficile de s’opposer à une invasion. Il n’y a plus que des armées réglées qui puissent faire résistance, et, pour former ces armées, il faut dépeupler des provinces entières. C’est ce qu’on a vu dans la guerre qui a eu lieu, dans le dernier siècle, entre la Russie et la Pologne ; le recrutement des armées avait tellement épuisé d’hommes les provinces du nord, que les filles n’y trouvaient plus de maris. Suivant Rulhière, quand il y naissait un enfant mâle, on voyait aussitôt vingt filles nubiles accourir et s’offrir pour prendre soin de l’enfant, en restant servantes dans la maison où il était né, sans aucun autre salaire que la promesse de les épouser un jour [332]. Dans les contrées où, par une conséquence de l’esclavage, une population peu nombreuse est répandue sur un immense territoire, il suffit de la perte d’une bataille, pour livrer le pays tout entier à la discrétion de l’ennemi.
Enfin, les effets que l’esclavage produit sur la nature du gouvernement, influent d’une manière non moins étendue sur l’indépendance nationale. Il existe une relation si intime et si manifeste, entre la force d’une nation relativement à des puissances étrangères, et la nature de son gouvernement, qu’il n’est pas nécessaire de la démontrer. Si donc il est dans la nature de l’esclavage de vicier le gouvernement du peuple qui l’admet chez lui, ainsi que je crois l’avoir précédemment démontré, il est clair que, sous ce rapport, l’asservissement d’une partie de la population est une cause de faiblesse.
Les esclaves ne sont pas également misérables dans toutes les circonstances ; plusieurs peuvent même se trouver assez doucement traités pour s’attacher à leurs possesseurs. Les dangers que fait naître la servitude pour l’indépendance des maîtres, ne sont donc pas toujours les mêmes, et il est quelquefois arrivé que des esclaves ont été armés pour la défendre. Mais ce sont là des exceptions qui se présentent rarement, et sur lesquelles il n’est pas sûr de compter ; les Romains, dès le commencement même de leur république, et dans un temps où la servitude n’avait pas encore acquis le caractère de dureté qu’elle eut plus tard, virent leurs esclaves se rallier aux armées qui assiégeaient leur ville [333]. De la peur de voir insurger leurs esclaves naquit la politique de porter toujours la guerre sur le territoire de l’ennemi. Cette politique éloigna longtemps le danger ; mais, quand les légions furent impuissantes pour défendre les barrières de l’empire, la désertion des esclaves en accéléra la chute. Lorsque Alaric et Rhadagaise parcoururent l’Italie, leur armée se grossit de toute la foule qui parlait encore la langue teutonique, et de tout esclave qui pouvait se dire Goth ou Germain [334]. Rome, avant que d’avoir asservi toutes les nations qui avaient déjà fait quelques progrès dans la civilisation, pouvait faire subsister ses armées sur le territoire de ses ennemis ; mais, lorsque toutes les nations industrieuses eurent été asservies, l’empire se trouva hors d’état de supporter les frais de la guerre : les esclaves ne possédaient rien, et la plupart des maîtres étaient ruinés.
Les grands de Rome, à mesure que leurs armées envahissaient le territoire des autres nations, en faisaient disparaître les hommes libres ; ils les distribuaient comme esclaves dans des pays qui leur étaient étrangers. Ils se partageaient le sol pour en faire de vastes domaines, ou le prenaient à ferme de la république, et le faisaient exploiter par d’autres hommes amenés comme esclaves. Les prisonniers goths ou germains étaient dispersés dans les campagnes d’Italie, les prisonniers gaulois étaient transportés sur les côtes de l’Afrique ou de l’Asie mineure. Lorsque les peuples barbares fondirent de toutes parts sur l’empire, ils ne trouvèrent donc que des contrées à moitié désertes, et peuplées par des hommes pour lesquels l’invasion était un bienfait plutôt qu’une calamité. L’histoire ne nous dit pas ce que devenaient, à mesure que les conquérants avançaient dans le pays, les familles des possesseurs d’hommes, qui se trouvaient placées au milieu de leurs esclaves ; mais nous pouvons nous en faire une idée, par ce qui arriva dans le dernier siècle à la Pologne, dans la guerre qui en amena le partage.
Avant que la Pologne eût été partagée, son extrême faiblesse, résultat nécessaire de l’esclavage de la partie la plus nombreuse de la population, avait frappé les esprits.
« Le plus faible de ses ennemis, disait un historien, peut impunément, et sans précaution, entrer sur son territoire, у lever des contributions, détruire ses villes, ravager ses campagnes, massacrer ses habitants ou les enlever. Sans troupes, sans forteresses, sans artillerie, sans munitions, sans argent, sans généraux, sans connaissances des principes militaires, quelle résistance pourrait-elle songer à opposer ? Avec une population suffisante, assez de génie et des ressources pour jouer un rôle, la Pologne est devenue l’opprobre et le jouet des nations [335]. »
Dès que le gouvernement russe eut formé le dessein d’asservir les nobles polonais, il commença par exciter des soulèvements parmi les esclaves. Des écrits séditieux furent répandus parmi les paysans, ou affichés aux portes des églises ; en même temps, des émissaires secrets étaient envoyés dans les campagnes, pour exciter des insurrections. Une troupe de sauvages zaporoves venaient à suite des missionnaires russes et fournissaient des armes aux insurgés. Ceux-ci, dit Rulhière, les conduisaient de maisons en maisons. Tout ce qui n’était pas de la religion grecque, vieillards, femmes, enfants, gentilshommes, valets, moines, artisans, juifs et luthériens, tout fut massacré. Toute la noblesse éparse dans ses maisons en Ukraine у fut égorgée [336].
Dans les provinces où les esclaves n’avaient pas encore été insurgés, les possesseurs n’osaient abandonner leurs terres, dans la crainte que leur départ ne fût le signal de l’insurrection ; mais, en même temps, ils étaient saisis de terreur en se voyant, eux et leurs familles, au milieu d’une population ennemie, qui n’attendait qu’un signe pour les massacrer. Les troupes russes parcouraient le pays sans crainte et sans danger, convaincues qu’elles n’avaient besoin que d’un signal pour trouver des auxiliaires dans les paysans. Si les nobles polonais osaient se plaindre, l’ambassadeur russe leur faisait entendre qu’il soulèverait les esclaves, et par ce seul mot il leur commandait le silence. En effet, dit l’historien que je viens de citer, des émissaires étaient envoyés dans toute la Pologne pour y soulever les paysans : tout était fureur, désolation, désespoir [337]. Cependant, la noblesse n’avait point de troupe pour se défendre ; car pour en avoir, il aurait fallu armer des esclaves, et les esclaves étaient des ennemis [338].
Dans les guerres que le gouvernement russe a eues à soutenir, il ne s’est trouvé aucune puissance qui ait appelé ses paysans à l’indépendance ; mais, si l’on juge de ce que les maîtres doivent craindre de leurs esclaves, par ce qui se passa chez eux au commencement du dix-septième siècle, ils ne sont pas plus en sûreté que ne l’étaient les Polonais quand leur pays fut asservi. On vit alors, en effet, un esclave fugitif appeler à l’indépendance ses compagnons de servitude, se mettre à leur tête, livrer les villes au pillage, et s’emparer des filles et des femmes des maîtres.
« Leur exemple, dit un historien, répandit au loin l’esprit d’anarchie. Les paysans crurent que le temps était venu de rétablir l’égalité et d’exterminer la noblesse. Le sang des nobles coulait à longs flots, et leurs membres déchirés et exposés à la vue du peuple étaient autant de signaux qui l’appelaient à la liberté. Les forces qu’on rassembla contre eux furent aisément dissipées. Malheur aux nobles qui leur furent livrés par des traîtres, ou que le sort des armes fit tomber entre leurs mains. Ils s’étudiaient à les faire périr dans des supplices nouveaux [339]. »
Cependant, l’esclavage expose moins les Russes à être asservis par une nation étrangère, qu’il n’exposait les Polonais. Il existe plusieurs raisons de cette différence, mais une des principales est dans la nature du gouvernement. Quand les esclaves russes entrent dans l’armée, leurs maîtres n’ont plus d’empire sur eux, au moins en qualité de maîtres. Ils ne dépendent alors que du gouvernement ou des officiers qu’il leur donne, et leur sort est peu différent des soldats des autres nations ; le recrutement des armées est donc plus facile et moins dangereux. D’un autre côté, les nobles étant eux-mêmes les esclaves du gouvernement, peuvent exercer sur les paysans un pouvoir moins despotique. Les atteintes portées à la liberté des maîtres, affaiblissent, dans ce cas comme dans tous, les dangers attachés à l’asservissement des classes laborieuses. Rulhière observe que les esclaves de la Russie font la force de ses armées [340]. La raison en est simple : c’est qu’un paysan enrôlé est une espèce d’affranchi.
L’influence de l’esclavage sur l’indépendance des îles d’Amérique est si manifeste, que l’idée de l’existence des maîtres est inséparable de l’idée de leur asservissement à des peuples ou à des gouvernements qui existent sous d’autres climats. Les possesseurs d’hommes des colonies anglaises, françaises, hollandaises, espagnoles, ont besoin, pour conserver leur empire sur leurs esclaves, d’être sans cesse sous la protection d’armées étrangères. Ils peuvent passer alternativement sous la domination de toutes les puissances auxquelles le hasard de la guerre donne momentanément l’empire des mers ; mais il ne leur est pas permis d’espérer d’être maîtres de leurs destinées, aussi longtemps qu’ils règneront sur une population esclave ; leur asservissement est une condition inséparable de leur domination. La domination étrangère qui pèse sur les colons n’est pas pas celle qu’un gouvernement régulier exerce sur ses sujets ; c’est celle qu’exerce un maître sur ses propriétés. Il n’y a aucune analogie entre le pouvoir auquel est soumis un colon de la Martinique, et le pouvoir auquel est soumis un habitant de la France. Celui-ci trouve des garanties dans les tribunaux, dans les chambres, dans la publicité et dans l’opinion publique qui en est la conséquence ; celui-là ne peut en trouver que dans ses intrigues, dans son obéissance et dans la merci du pouvoir. Si les habitants des colonies inspirent quelque sympathie aux métropoles, cette sympathie n’existe que pour la partie de la population qui est opprimée, pour les esclaves et pour les hommes de couleur. Une multitude de sociétés se sont formées dans toutes les villes de l’Angleterre pour venir au secours des esclaves ; des hommes des plus recommandables de tous les rangs, sont entrés dans ces sociétés ; les écrivains ou les orateurs connus par l’indépendance de leur caractère, ont défendu et propagé leurs principes ; mais qui s’est jamais avisé de s’associer pour protéger les colons, ou pour mettre un terme à leur détresse ?
Les habitants d’Haïti, dont le plus grand nombre était esclave il n’y a pas fort longtemps, ont joui de fait de leur indépendance pendant près de trente ans ; ils l’ont maintenue contre une des premières puissances de l’Europe pendant le même espace de temps, et ils ont fini par la faire reconnaître par toutes les nations. Quelle est l’île exploitée par des esclaves et possédée par des maîtres, qui pourrait se flatter d’en faire autant ? La population de la Jamaïque est presque égale à celle d’Haïti ; et cependant quelle résistance opposerait-elle à une invasion, si la population libre de l’Angleterre lui retirait sa protection ? L’île de Cuba renferme aussi un grand nombre d’habitants ; mais si les maîtres y étaient abandonnés à leurs seules forces, ils seraient incapables d’opposer aucune résistance à une puissance qui s’unirait à leurs esclaves. La dépendance dans laquelle les maîtres se trouvent vis-à-vis de tout pouvoir étranger est telle, que les possesseurs des colonies françaises tremblent de voir paraître sur leurs côtes le pavillon haïtien, quoiqu’ils soient protégés par toute la puissance du gouvernement français, et qu’ils ne soient en guerre avec personne, si ce n’est avec leurs esclaves.
Les peuples des îles ou du continent d’Amérique qui font exécuter tous leurs travaux par des esclaves, sont d’une telle faiblesse, lorsqu’on les considère comme corps de nation, qu’il suffit de quelques esclaves fugitifs pour compromettre leur existence. Dans le temps où l’île d’Haïti était occupée par des colons français, quelques esclaves s’étant réfugiés dans les montagnes, s’y multiplièrent bientôt au point qu’ils pouvaient offrir un asile assuré à tout homme qui voulait aller les joindre, et qu’ils faisaient trembler toute la colonie. C’est là, dit Raynal, que, grâce à la cruauté des nations civilisées, ils deviennent libres et féroces comme des tigres, dans l’attente peut-être d’un chef et d’un conquérant qui rétablisse les droits de l’humanité violée [341]. La colonie hollandaise de Surinam a vu également son existence compromise par des esclaves réfugiés dans les forêts. Les guerres qui ont eu lieu entre les nègres indépendants et leurs anciens possesseurs, est devenue si dangereuse pour les derniers, qu’ils ont été obligés de suspendre leurs défrichements. Ils auraient été vaincus et exterminés, s’ils n’avaient été secourus par la mère-patrie et par des officiers et des soldats européens ; et ils ont fini par traiter de puissance à puissance avec les esclaves fugitifs [342].
Les possesseurs d’hommes des îles et du continent d’Amérique peuvent se flatter qu’ils auront peu de dangers à courir, aussi longtemps que les peuples de l’Europe et leurs gouvernements se croiront intéressés à conserver la domination qu’ils exercent sur eux. Mais cette croyance qui n’existe déjà plus dans la partie la plus éclairée des nations, pourra ne pas être de longue durée dans l’esprit des gouvernements ; tout le monde est déjà convaincu que les colonies coûtent fort cher et rapportent fort peu aux peuples dont les gouvernements se permettent ce genre de luxe. Qu’arriverait-il cependant, si tout à coup l’Angleterre, la France et les Pays-Bas, supprimaient de leurs sujets, comme charges inutiles, les monopoles accordés aux colons, et les énormes dépenses qu’exige leur sûreté ? Qu’arriverait-il, si on leur laissait le soin de se protéger et de se gouverner eux-mêmes ? Iraient-ils se placer sous la protection d’autres puissances ? Ils pourraient le tenter ; mais ils en trouveraient difficilement ; les Russes et les Turcs ne sont pas aussi fins que nous ; s’ils se font payer par les sujets qu’ils oppriment, ils se feraient payer, à plus forte raison, par ceux auxquels ils accorderaient une dispendieuse protection [343].
Il ne serait pas impossible d’ailleurs que dans une guerre entre deux puissances continentales, l’une d’elles cherchât à insurger les esclaves de l’autre.
« Nos colonies des Indes occidentales, dit un écrivain anglais, ne possèdent pas les ressources que nous avons aux Indes orientales. Elles ont toutes protesté contre toute intention de confier leur défense à des natifs du pays ; elles veulent, quoi qu’il en coûte d’hommes et d’argent, n’être gardées que par des soldats européens. Les esclaves excédant de vingt fois au moins le nombre des hommes libres, sont les principales causes de leurs craintes, et c’est contre eux qu’ils ont à multiplier leurs précautions. S’ils avaient eu la sagesse de s’attacher les noirs et les hommes de couleur, ils auraient pu se confier à eux dans le moment du danger ; mais dans quelle vue peut-on considérer maintenant ces colonies, si ce n’est comme un amas de matières combustibles qui n’attendent qu’une étincelle pour s’enflammer et produire la plus terrible des explosions ? Parler de la sécurité de possessions où les dix-neuf vingtièmes de la population sont courbés sous le joug et sous la plus dégradante servitude, est une véritable folie, surtout quand on considère qu’Haïti plane au-dessus d’elles dans la force et la vigueur d’une liberté nouvellement conquise par le sang et par la vengeance, et que l’Amérique méridionale a proclamé la liberté de tous ses esclaves... N’oublions pas d’ailleurs que nous n’avons aucune garantie contre une autre guerre avec l’Amérique. Nous lui avons montré le point vulnérable de nos colonies ; dans la dernière guerre, nous avons appelé ses esclaves à se placer sous nos étendards, à prendre les armes contre leurs maîtres et à conquérir leur liberté. Supposez que dans une autre guerre avec cette puissance, une armée de nègres américains font une descente dans la Jamaïque, avec le dessein d’affranchir leurs frères. Que pourraient opposer les blancs contre une telle force ? Nous pourrions envoyer d’Europe à leur aide, régiment après régiment ; le climat les moissonnerait à mesure de leur arrivée. Rappelons-nous ce qu’une poignée de nègres marons fut capable d’exécuter, il y a vingt-sept ans, contre les forces entières de la Jamaïque. Il ne leur fallut que deux cents combattants pour tenir toutes ces forces en haleine pendant huit ou neuf mois, et ils ne mirent bas les armes que sur la promesse d’une amnistie. Si, au lieu de n’avoir que deux cents hommes, ils en avaient eu cinq mille ou seulement deux mille, l’île était à jamais perdue pour l’Angleterre [344]. »
Les Anglo-Américains du sud sont moins menacés dans leur indépendance, par suite de l’esclavage établi parmi eux, que ne le sont les planteurs des îles. Les hommes de l’espèce des maîtres sont plus nombreux chez eux qu’ils ne le sont dans les colonies, et leur union avec les États qui n’ont plus d’esclaves, est pour eux une garantie. Il ne faut pas douter, cependant, que leur indépendance ne soit déjà affectée par l’existence, au milieu d’eux, d’une multitude d’esclaves. Si une puissance avec laquelle ils seraient en guerre formait quelques régiments de noirs ou d’hommes de couleur, parlant la même langue que ceux qu’ils tiennent asservis, et si elle les portait sur leur territoire, ils pourraient bien voir se renouveler chez eux le spectacle qu’a présenté la Pologne à l’époque de l’envahissement des Russes. Le soin que prennent les Anglo-Américains de tenir leurs esclaves dans l’abrutissement, en s’interdisant, sous des peines sévères, de leur apprendre à lire, rendrait les provocations à la révolte un peu plus difficiles ; mais aussi les insurrections n’en seraient que plus terribles, car les esclaves les plus abrutis sont toujours les plus féroces [345].
Tant que les principales îles d’Amérique seront exploitées par des esclaves, les dangers que présente l’esclavage à l’indépendance des Anglo-Américains du sud, seront moins grands, parce que les possesseurs blancs se feront un scrupule d’employer des moyens qui compromettraient leur propre existence ; mais cet état ne sera pas éternel ; déjà, une des îles les plus étendues et les plus fertiles n’est possédée que par des nègres ou par des hommes de couleur libres ; les Anglais, qui possèdent les îles les plus considérables, tendent à l’abolition de l’esclavage avec cette constance et cette énergie qui sont dans leur caractère ; ils parviendront à leur but comme ils y sont parvenus, quand ils ont voulu l’abolition de la traite. Ils ont commencé à interdire, dans leurs propres colonies, l’introduction et le commerce de nouveaux esclaves ; puis, ils ont fait subir aux autres nations la loi qu’ils s’étaient imposée ; maintenant, ils font quelques pas de plus ; ils marchent à l’abolition de la servitude. Je n’examine point s’ils s’arrêteront là, où s’ils exigeront que les autres suivent leur exemple ; si jamais ils l’exigeaient, j’ignore où serait la résistance qu’ils pourraient rencontrer. Je veux seulement faire observer que l’affranchissement des esclaves des colonies anglaises, placera les Anglo-Américains du sud dans la position la plus critique, à moins qu’ils ne se hâtent de suivre l’exemple qui leur est donné. L’époque à laquelle les Anglais seront parvenus au but vers lequel ils tendent de concert avec leur gouvernement, peut être éloignée relativement à la vie d’un homme, mais elle est fort prochaine relativement à l’existence d’une nation [346].
[IV-349]
L’existence de l’esclavage menace l’indépendance des Anglo-Américains du sud d’une autre manière. On a vu, lorsque j’ai exposé les effets de l’esclavage relativement à l’accroissement des richesses et des diverses classes de la population, que, dans les pays où tous les travaux sont exécutés par des hommes asservis, les richesses ne s’accroissent qu’avec une extrême lenteur, et que la population se multiplie d’une manière plus lente ; souvent même la population et les richesses décroissent simultanément. Dans les États de l’Union, où tous les travaux sont exécutés par des mains libres, les richesses et les hommes se multiplient, au contraire, avec une rapidité dont on n’avait pas d’exemple ; non seulement le nombre des individus s’accroît rapidement dans chaque État ; mais le nombre des États libres tend à se multiplier. Il suivra nécessairement de là, que plus les Anglo-Américains du nord prospéreront, et plus les États du sud perdront de leur importance ; leur influence décroîtra en raison de l’accroissement de la population, des richesses et des lumières des autres États.
Sans doute, une fraction de population peut croître en nombre, en richesses et en lumières sans que les autres fractions en souffrent ; il arrive même souvent que cet accroissement est un bien pour elles ; mais cela n’a lieu que lorsqu’il y a identité de sentiments, d’opinions, d’intérêts : or, cette identité ne peut pas exister entre une [IV-350] population composée d’hommes industrieux et libres, et une population composée de possesseurs d’esclaves. Les premiers attachent l’honneur à l’activité, au travail, à l’économie, aux bonnes mœurs ; ils attachent le mépris à la paresse, à l’incapacité, à la dissipation. Les seconds attachent l’honneur à l’oisiveté, à l’ostentation, au nombre d’hommes qu’ils possèdent ; ils attachent le mépris au travail, à l’industrie. Comment de tels hommes pourraient-ils tendre vers le même but ? Comment pourraient-ils avoir quelque estime les uns pour les autres [347] ?
Les intérêts, tels qu’ils sont conçus de part et d’autre, ne sont pas moins opposés que les opinions, les sentiments et les habitudes. Les maîtres voient leur intérêt à maintenir leur domination sur leurs esclaves dans toute son étendue. Ils considèrent comme une atteinte à leur propriété, toute garantie accordée aux hommes dont ils sont en possession. À leurs yeux, leur sûreté dépend de l’abrutissement de la population asservie ; ce qui leur importe, ce n’est pas que leurs esclaves soient actifs, laborieux, intelligents ; c’est qu’ils soient soumis, et que l’idée d’un meilleur avenir ne se présente jamais à leur esprit. Il ne s’agit pas, pour les maîtres, d’augmenter les produits de l’agriculture, de multiplier les défrichements ; il s’agit de conserver les possessions qui existent. Les possesseurs d’esclaves sont comme les despotes, quand ils ne rétrogradent pas, ils veulent du moins rester stationnaires.
Les hommes qui ne sont ni maîtres, ni esclaves, et qui exercent quelque branche d’industrie, sont intéressés, au contraire, à voir dans tous les États de l’Union, une population homogène. Leur sécurité sera d’autant plus grande, que chaque État pourra mieux pouvoir par lui-même à sa propre défense. Ils seront d’autant plus riches que les produits de leur sol et de leur industrie trouveront un plus grand nombre de consommateurs dans les États du sud, et qu’ils pourront acheter à meilleur marché les produits de ces derniers États. Pour des peuples industrieux et commerçants, il n’est pas de plus mauvaises pratiques que les nations chez lesquelles la population se divise en maîtres et en esclaves ; les uns ne peuvent rien acheter, et les autres payent mal. Les peuples industrieux des États libres sont intéressés à voir tous les autres États marcher de pair avec eux ; peu leur importe que ceux avec lesquels ils auront des relations de commerce, aient toujours été maîtres ou qu’ils aient été des affranchis. Quelque puissant que soit le préjugé des Américains du nord contre les noirs et contre les hommes de couleur, il est chez eux une puissance plus grande encore : c’est l’amour du gain. L’Américain le plus vain et le plus orgueilleux de la couleur et de la noblesse de sa peau, préférera toujours un homme un peu basané avec lequel il fera de bonnes affaires, à un blanc qui ne lui sera bon à rien, et qui ne paiera pas ses dettes.
Il est des hommes qui ont présagé une séparation entre les États où une partie de la population est considérée comme la propriété de l’autre, et les États où l’esclavage est aboli. Si cette séparation s’effectuait jamais, ce ne seraient pas les États du sud qui l’auraient provoquée ; livrés à eux-mêmes, ils seraient d’une telle faiblesse, que, s’ils conservaient l’esclavage, ils pourraient être envahis aussi facilement que le fut la Pologne au dernier siècle. Il faudrait, pour qu’il s’opérât une séparation, que les États libres repoussassent l’alliance des possesseurs d’hommes, comme une charge et comme une cause de corruption parmi eux. Mais même dans ce cas, les États exploités par des esclaves ne seraient point indépendants ; ils obéiraient à l’influence qu’il plairait aux autres nations d’exercer : il n’est pas une puissance qui ne pût leur dire comme l’ambassadeur russe aux nobles polonais : Si vous remuez, j’insurgerai vos esclaves !
Il résulte des faits exposés dans ce chapitre deux vérités importantes : la première, c’est que tous les hommes qui en réduisent d’autres en servitude, ou qui se font possesseurs d’esclaves, se mettent, par ce seul fait, entre deux ennemis ; ils s’exposent à être massacrés par les hommes qu’ils possèdent, ou à être asservis par des étrangers ; la seconde, c’est que, toutes les fois qu’il se forme une véritable coalition entre les ennemis intérieurs et les ennemis extérieurs, les maîtres n’ont aucun moyen de résistance.
[IV-354]
CHAPITRE XVII. ↩
De l’influence qu’exercent les peuples possesseurs d’esclaves, sur les mœurs et sur la liberté des peuples chez lesquels l’esclavage est aboli ou n’a point été admis.
Le sujet de ce chapitre est si vaste, que celui qui voudrait le traiter d’une manière complète, aurait à faire un fort grand ouvrage. L’histoire du genre humain, en effet, se compose presque tout entière de l’action des nations les unes sur les autres ; et lorsque l’on considère de près la nature, les causes et les effets de cette action, on y démêle constamment les erreurs, les passions ou les vices enfantés par l’esclavage. Mais je ne veux pas embrasser ici, dans toute son étendue, un sujet si vaste ; je me propose seulement d’indiquer quelques-uns des effets que la servitude produit sur les peuples mêmes qui l’ont rejetée, quand ils se trouvent en contact avec des nations chez lesquelles elle existe encore. Dans le chapitre précédent, j’ai fait connaître les dangers et les maux auxquels l’esclavage expose les possesseurs d’esclaves, de la part des nations étrangères ; dans celui-ci, je veux exposer les maux et les dangers que les nations libres éprouvent ou qu’elles ont à craindre de la part des peuples possesseurs d’esclaves.
Les nations au sein desquelles on n’admet plus qu’un homme puisse être la propriété d’un autre, sont aujourd’hui nombreuses et puissantes ; et il est permis d’espérer qu’à l’avenir leur influence sera plus forte que celle des peuples chez lesquels on voit régner encore des principes et des pratiques contraires. Cependant, lorsque l’on compare les peuples chez lesquels l’esclavage est aboli, aux peuples chez lesquels la population se divise en esclaves et en maîtres ; lorsque l’on compare surtout l’étendue de territoire occupée par les uns à l’étendue de territoire occupée par les autres, on trouve que les possesseurs d’hommes exercent, et pourront exercer encore longtemps, une influence immense sur le sort du genre humain.
Près des deux tiers du territoire européen sont occupés par des populations qui admettent, sans restriction, le principe et la pratique de l’esclavage. La Russie, l’Autriche, la Pologne, la Turquie, et une partie de l’Allemagne, admettent, en pratique comme en théorie, que des hommes peuvent être possédés par d’autres, à titre de propriété ; et, dans presque tous ces États, le nombre des esclaves est immense, comparativement à celui des maîtres. Dans les pays mêmes au sein desquels l’esclavage domestique est proscrit, les gouvernements admettent qu’un homme peut en posséder d’autres, et qu’il peut disposer d’eux d’une manière à peu près arbitraire, pourvu qu’il ne tienne pas les possessions de ce genre sur le territoire d’Europe.
[IV-356]
En Amérique, le territoire occupé par des populations qui se divisent en maîtres et en esclaves, est au moins égal à celui qui est occupé par des peuples chez lesquels l’esclavage est proscrit. Dans l’Amérique du nord, dix États sur vingt-deux sont sous la domination absolue de possesseurs d’esclaves ; dans l’Amérique du sud, les nations chez lesquelles la population est divisée en maîtres et en esclaves, ne sont guère moins nombreuses. Les colonies que possèdent sur cette partie du continent américain, les Anglais, les Hollandais et les Français, le vaste empire du Brésil, et une partie des États qui se sont formés des anciennes colonies espagnoles, sont exploités par des esclaves. Enfin, dans toutes les îles qui sont à l’est de l’Amérique, à l’exception de celle d’Haïti, la masse de la population se compose d’esclaves possédés par un petit nombre de maîtres.
En Asie, nous trouvons également la population divisée en deux classes, celle des hommes possédés et celle de leurs possesseurs. Tout le nord de ce vaste continent fait partie de l’empire russe, et par conséquent le principe de l’esclavage n’y règne pas moins que dans la Russie d’Europe. Dans les autres parties de l’Asie, l’esclavage est presque partout admis, quoique le nombre des esclaves y soit très petit, comparativement aux autres classes de la population.
Enfin, en Afrique, on ne connaît aucune nation chez laquelle l’esclavage n’existe pas, à moins que ce ne soit quelques tribus qui sont encore nomades.
Pour déterminer les causes, la nature et les effets de l’action qu’exercent les peuples chez lesquels l’esclavage existe, sur les nations qui l’ont proscrit, il est nécessaire de se rappeler l’influence qu’exerce l’esclavage sur les idées et sur les mœurs des maîtres et des esclaves, et sur les individus qui se trouvent placés entre les uns et les autres, soit qu’ils aient été affranchis, soit qu’ils aient perdu leurs possessions.
Le premier effet que produit l’esclavage sur les mœurs et sur les idées de toutes les classes de la population, est d’avilir l’action des organes de l’homme sur les choses, toutes les fois que cette action a pour objet d’en accroître l’utilité. Nous avons vu que, dans tous les pays où il existe de nombreux esclaves, aussitôt qu’un homme en possède un autre, il cesse à l’instant de travailler. Fût-il né dans l’état le plus misérable et le plus avili, eût-il exercé le métier le plus grossier pendant la moitié de sa vie, il croirait déroger s’il travaillait. Le même orgueil se manifeste jusque dans les hommes qui ne possèdent point d’esclaves ; s’ils ne peuvent pas émigrer, ils mendient.
Le second effet de l’esclavage est de donner aux hommes de la classe des maîtres la passion des jouissances physiques, l’amour du faste et de la dissipation. Nous voyons que, dans tous les pays et à toutes les époques, les possesseurs d’hommes ont allié le faste et la misère, et que les plus riches ont toujours fini par être accablés de dettes. À l’origine des colonies formées par les Européens, on a vu, il est vrai, quelques possesseurs d’hommes faire fortune, par la raison que ces possesseurs, nés et élevés chez des peuples libres, avaient contracté les habitudes d’ordre et d’économie qui naissent de l’industrie ; mais les descendants de ces mêmes hommes n’ont pas tardé à être ruinés.
Le troisième effet de l’esclavage, qui est une suite des deux précédents, est de prévenir le développement des connaissances qui n’ont pas pour objet d’étendre l’empire de l’homme sur ses semblables, et de mettre obstacle par cela même au développement des arts industriels et du commerce. Partout où les travaux qu’exige l’industrie sont livrés à des esclaves, il faut les réduire aux opérations mécaniques les plus simples, afin qu’ils ne soient pas hors de la portée de l’intelligence de ces misérables ouvriers [348].
Un quatrième effet de l’esclavage, est de rendre stationnaire ou même de faire décroître la classe des esclaves et celle des maîtres. Nous avons vu, en effet, que partout où les maîtres peuvent tirer un parti avantageux des travaux des esclaves, ils ne leur laissent que ce qui leur est rigoureusement nécessaire pour subsister, et qu’ils leur arrachent par des châtiments les travaux qu’ils veulent ne pas exciter par des récompenses. De là il résulte que les esclaves ne peuvent pas se multiplier, ou qu’ils décroissent, et comme c’est de leur travail que les maîtres tirent tous leurs revenus, ils ne peuvent pas eux-mêmes croître en nombre, quand le nombre de leurs esclaves diminue.
Enfin, un cinquième effet de l’esclavage, est d’obliger les maîtres qui veulent conserver leur empire, à se livrer à tous les exercices propres à assurer la domination de l’homme sur ses semblables, et particulièrement les exercices qui conviennent à l’art militaire. Le dévouement des possesseurs d’esclaves à la patrie n’est que le dévouement au maintien de leurs possessions, en comprenant sous ce dernier mot les hommes qu’ils exploitent, et sur les travaux desquels ils fondent leurs revenus. C’est là ce qui les détermine tous à se jeter dans la carrière militaire.
Ces effets de l’esclavage étant connus, il est facile de voir quel est le genre d’action que les peuples possesseurs d’hommes exercent ou tendent à exercer sur les nations industrieuses qui ont aboli l’esclavage.
Tous les hommes, de quelque espèce qu’ils soient, tendent, par leur propre nature, à se multiplier et à accroître leurs moyens d’existence ; mais, lorsqu’une population considère le travail comme indigne d’elle, elle ne peut accroître ses moyens d’existence, ni par conséquent se multiplier, à moins qu’elle ne ravisse les richesses produites par d’autres. Ainsi, des hommes qui possèdent des esclaves, sont, par ce seul fait, portés à subjuguer des peuples industrieux ; ils y sont portés d’abord par le désir de s’approprier des richesses qu’ils ne peuvent obtenir qu’en les ravissant, ensuite par le désir de réduire au nombre de leurs esclaves les individus qui les ont produites, et enfin, par le genre d’exercices auquel ils se sont livrés en leur qualité de maîtres.
Les sénateurs romains, les plus riches possesseurs d’hommes de l’antiquité, pour prévenir ou pour arrêter les séditions, dit Denys d’Halicarnasse, avaient toujours une guerre préparée [349]. Plutarque a fait une observation semblable : « Les Romains, dit-il, usaient sagement de ce remède-là, tournant au dehors, comme bons médecins, les humeurs qui étaient pour troubler la chose publique [350]. » Pour avoir une idée bien nette de ces possesseurs d’esclaves tournaient en dehors, il faut se rappeler que l’aristocratie romaine s’était attribué le monopole de tous les travaux par les mains des hommes qu’elle tenait asservis ; qu’il existait ainsi au sein de Rome une population nombreuse sans industrie et sans fortune, et que les patriciens qui s’étaient ruinés, ne pouvaient amasser des richesses que par le pillage. Dans les temps de paix, cette populace oisive et nécessiteuse, poussée par le besoin, et par les membres de l’aristocratie qui avaient à rétablir leur fortune, devenait remuante, et menaçait les possessions des riches sénateurs. Ceux-ci, selon l’expression de Plutarque, tournaient alors les humeurs en dehors ; c’est-à-dire qu’ils dirigeaient contre des nations industrieuses, des armées animées par le désir du pillage et par l’espoir de revenir dans leur pays avec du butin et surtout avec de nombreux esclaves.
L’aristocratie romaine ne traitait pas mieux ses esclaves que ne les traitent les planteurs des colonies modernes ; il fallait donc, pour que ses terres ne devinssent pas désertes, qu’elle réduisît de nouveaux peuples en esclavage. D’un autre côté, les conquêtes qu’elle faisait pour se procurer des esclaves, et les terres qu’elle était dans l’usage d’enlever aux vaincus, accroissaient l’étendue ou le nombre de ses possessions, et, pour faire cultiver ces nouveaux domaines, il lui fallait de nouveaux esclaves, qu’elle ne pouvait acquérir que par de nouvelles guerres. Le commerce de créatures humaines qui se faisait sur les marchés de Rome, était immense ; la traite se faisait à main armée, et c’étaient les généraux et les légions qui en étaient les agents. Si les nations n’étaient pas vendues en détail sous la lance du préteur, comme cela arrivait fréquemment, elles étaient soumises à une exploitation méthodique, dont le résultat était également de faire passer leurs richesses dans les mains des Romains possesseurs d’esclaves.
Chez les modernes, comme chez les anciens, les possesseurs d’esclaves considèrent comme indigne d’eux toute profession industrielle. Ils ne voient d’honneur que dans la vie militaire, parce qu’elle leur donne le moyen de maintenir leurs esclaves dans l’obéissance, et qu’elle peut les conduire à s’emparer des richesses des autres nations. Cependant, comme ils sont eux-mêmes asservis à des maîtres, et comme les peuples industrieux sont plus puissants qu’ils ne l’étaient jadis, on ne pratique plus, à leur égard, les usages des beaux jours de la république romaine. On se borne, quand on peut les conquérir, à les soumettre en masse à une exploitation plus ou moins régulière, analogue à celle qui existait du temps des empereurs romains. C’est un progrès que nous devons à l’asservissement des possesseurs d’esclaves, progrès qui ne peut qu’en amener d’autres [351].
Les maux et les dangers auxquels sont exposés les peuples industrieux de l’Europe, de la part des nations chez lesquelles la population se divise en maîtres et en esclaves, sont moins grands que ceux auxquels ils étaient exposés jadis ; cependant, il faut bien se garder qu’il n’en existe point. La classe des maîtres, par sa position, ses préjugés et ses habitudes, est poussée tout entière dans la carrière militaire, et elle a besoin tout à la fois d’activité et de richesses. La classe des esclaves, du sein de laquelle sortent les soldats, doit être naturellement portée vers la même carrière, parce qu’elle s’y trouve moins avilie, et que, dans l’alternative d’être opprimés en qualité d’esclaves, ou de devenir des agents d’oppression, le dernier parti est celui que tous les hommes préfèrent. La qualité de soldat élève en quelque sorte un esclave au rang de son maître, ou du moins elle ne laisse subsister entre eux que les distances établies par les grades militaires, distances qui sont peu considérables, quand on les compare à celle qui existe entre un maître et les individus qu’il possède à titre de propriétaire. Un despote qui aurait les passions d’un conquérant, ne pourrait donc recruter nulle part une armée avec plus de facilité que chez une nation composée de maîtres et d’esclaves. Il n’y a, pour prévenir les dangers dont les peuples civilisés sont menacés à cet égard, que la misère qui s’attache partout à la suite de l’esclavage.
On a vu précédemment que les possesseurs d’esclaves, pour maintenir leur domination, tendent en général de toute leur puissance à abrutir la partie de la population sur laquelle ils dominent. Ils ont pour cela deux moyens : l’un est de rendre leurs esclaves tellement stupides, qu’ils soient incapables de recevoir aucune des lumières qui sont répandues autour d’eux ; l’autre est d’étouffer les lumières qui existent autour d’eux, afin qu’aucun rayon ne puisse en arriver jusqu’à la population asservie. Le premier moyen, que nous avons vu employé par les Anglo-Américains, est rarement jugé suffisant : un esclave, quelque stupide qu’il soit, a des yeux et des oreilles ; on peut bien empêcher qu’il n’apprenne à lire, mais, à moins de le rendre inutile à son maître, on ne peut l’empêcher de voir et d’entendre. De là, cette tyrannie ombrageuse et minutieuse, qui dans les pays exploités par des esclaves, prévient toute manifestation libre de la pensée, et qui empêche la circulation des écrits et des personnes avec le même soin qu’on porte dans d’autres États à prévenir la circulation de marchandises infectées de la peste.
Cette surveillance ne se renferme point dans les États au milieu desquels il existe des populations asservies ; elle s’étend dans les pays où il n’existe point d’esclaves, et qui peuvent faire sentir leur influence au-delà de leur territoire. Des hommes qui considèrent comme leur propriété la population industrieuse de leur pays, voudraient lui laisser ignorer qu’il existe, dans d’autres parties du monde, des peuples industrieux et libres. Ils tâchent d’abord d’enlever à sa connaissance tout ce qui pourrait lui révéler leur existence ; et, comme ils ne peuvent avoir la certitude de réussir, ils cherchent ensuite à réaliser ce qu’ils veulent lui faire croire. C’est donc du besoin qu’éprouvent les maîtres de conserver leur domination, que naît l’influence qu’ils exercent par leurs gouvernements, sur les gouvernements des peuples chez lesquels on ne trouve ni esclaves, ni maîtres. L’équilibre tend à s’établir dans les forces morales comme dans les forces physiques partout où l’on trouve des nations ; quand des possesseurs d’hommes existent sur un point, ils portent leurs préjugés et leurs vices sur tous les points qui les environnent. Ne nous plaignons point de cette tendance ; c’est la puissance qui lie aux intérêts des peuples esclaves, les intérêts des peuples libres : pour les nations, comme pour les individus, l’égoïsme est le plus faux des calculs.
L’influence qu’exercent, en Amérique, les États dans lesquels la population est divisée en maîtres et en esclaves, sur les États où l’esclavage est aboli, est un peu moins puissante que celle que nous observons en Europe, par la raison que la masse de la population industrieuse est comparativement plus nombreuse, mieux organisée, plus forte et plus éclairée qu’elle ne l’est dans beaucoup d’autres pays. Mais il ne faut pas douter cependant que les possesseurs d’hommes ou les hommes possédés des États du sud, n’exercent sur leurs idées, sur leurs mœurs et sur leurs lois, une funeste influence. Quand même cette influence n’aurait pas été observée par des voyageurs, il suffirait d’avoir quelques connaissances de la nature des hommes pour être convaincu qu’elle existe.
Sur vingt-deux États dont la fédération se compose, il en est dix qui ont maintenu l’esclavage. Ainsi, dans les diverses branches dont le gouvernement fédéral se compose, il faut, sur vingt-deux hommes, compter toujours dix possesseurs d’esclaves, en supposant que chaque État en fournisse un nombre égal. Mais l’égalité doit être souvent rompue, puisque les possesseurs d’hommes sont portés vers les emplois du gouvernement par une tendance beaucoup plus forte que celle qu’éprouvent des hommes industrieux, et puisque les Américains du nord se plaignent de l’influence des Américains du sud. Si, sur cinq présidents, l’État de Virginie seul en a fourni quatre, il est impossible qu’elle n’ait fourni un plus grand nombre d’employés qu’aucun autre État. Un homme qui jouit d’une grande influence, ne se déplace guère sans entraîner après lui l’atmosphère au milieu de laquelle il est placé. Les personnes avec lesquelles il a eu quelque communauté d’opinions viennent à sa suite, puis les frères, les cousins, les flatteurs. Quelle que soit sa fermeté et son impartialité, il est bien difficile qu’il se débarrasse de tout ce monde, tant qu’il a quelque moyen de les placer.
En supposant même que chaque État fournisse un nombre égal de représentants ou de fonctionnaires au gouvernement fédéral, il faut compter que, sur vingt-deux représentants et sur vingt-deux membres du sénat, il y a habituellement dix possesseurs d’esclaves, et qu’on en trouve dans une égale proportion parmi les agents du pouvoir exécutif, depuis le ministre jusqu’au sous-lieutenant. Or, est-il possible que, dans des assemblées ou dans des corps ainsi constitués, il existe toujours des idées justes et un sentiment moral bien délicat ? Si, dans la vue d’assurer leurs possessions, les possesseurs d’esclaves sollicitent des mesures générales contre les noirs ou contre les hommes de couleur, pense-t-on que les représentants des États libres seront assez indifférents au sort de leurs confédérés du sud, pour ne pas se prêter à leurs désirs ? Pourront-ils leur refuser de poursuivre jusque sur leur territoire les esclaves fugitifs ? Il faudra donc qu’il s’établisse entre tous les États une espèce de coalition contre une race tout entière. Cette coalition sera d’autant plus redoutable qu’elle sera formée, non contre des malfaiteurs, non contre des ennemis du pays ou du gouvernement, mais contre des êtres innocents dont le crime sera d’avoir le teint un peu foncé, ou de n’avoir pas le nez un peu aquilin. Cependant, comme par suite des liaisons que les maîtres ont avec les femmes asservies, les esclaves finissent par avoir les traits et la couleur de leurs possesseurs, on ne pourra refuser aux maîtres la faculté de poursuivre leurs esclaves blancs dans les États où l’esclavage est aboli, et dès ce moment que deviendra la sûreté des hommes libres ?
Les possesseurs d’hommes du sud pouvant être obligés de faire dans le nord de fréquents voyages, soit pour leurs intérêts personnels, soit comme membres du gouvernement, on n’a pu leur refuser de s’y faire suivre par quelques-uns de leurs esclaves, de l’un ou de l’autre sexe ; mais quel est, dans les États où l’esclavage est, dit-on, aboli, le pouvoir qu’un maître peut, sans violer les lois du pays, exercer sur son esclave ? Les injures, les outrages, les violences et le meurtre même restent-ils impunis dans les États libres, quand c’est un possesseur d’hommes qui s’en rend coupable sur son esclave ? Si, dans un de ces États, un individu en maltraite un autre, s’il l’enferme arbitrairement dans un lieu quelconque, s’il se rend coupable de mutilation ou de viol, lui suffira-t-il pour suspendre l’action de la justice criminelle, de prétendre qu’il est le légitime propriétaire de la personne offensée ? Faudra-t-il d’abord renvoyer la cause devant des magistrats civils, pour qu’ils aient à juger si la partie plaignante est une personne ou une chose ?
Le seul effet de la présence des maîtres et de leurs esclaves suffirait pour fausser le jugement et dépraver les mœurs d’un peuple libre. Si la simple qualité d’homme ou de femme n’est point suffisante pour garantir un individu de toute peine ou de tout châtiment arbitraire, il n’y a pas d’autre règle de morale que la force. Que peuvent penser, à Philadelphie, un enfant, une femme ou toute personne d’une instruction ordinaire, en voyant un Américain de la Caroline ou de la Virginie traîner à sa suite des hommes ou des femmes qu’il appelle ses propriétés, et disposer d’eux comme bon lui semble ? Que peuvent-ils penser quand ils lisent, ou qu’on leur raconte que, dans des États confédérés, on fait commerce d’hommes, de femmes ou d’enfants ? Lorsqu’ils voient que ces possesseurs d’hommes sont reçus, honorés par leurs concitoyens ou par leurs parents, et que c’est même parmi eux que sont choisis les principaux membres de leur gouvernement ?
Un enfant, je suppose, voit un Américain amener à sa suite des hommes ou des femmes dont il se dit le maître, et dont il dispose ou qu’il maltraite, sans que les magistrats y prennent garde. Il s’adresse à sa mère : pourquoi, lui demande-t-il, cet homme peut-il disposer de cet autre ? — C’est parce que l’individu dont il dispose est son esclave. — Pourquoi cet individu est-il son esclave ? — Parce que les lois le veulent ainsi. — Une chose est donc juste toutes les fois que la loi le veut ? — Sans doute, mon fils. — Et qui a fait la loi ? — Ce sont les possesseurs des terres. — Les possesseurs des terres ont donc fait la justice ? — Je le pense. — Pourquoi ont-ils fait une loi pour rendre l’esclavage juste ? — Parce que c’était leur intérêt. — Ce qu’on fait est donc juste, quand on suit son intérêt ? — Quelquefois. — Pourquoi les hommes esclaves n’ont-ils pas rendu une loi pour faire que leur liberté soit juste ? — C’est parce qu’ils n’étaient pas les plus forts. — On a donc toujours raison quand on est le plus fort ? Mon papa est-il un propriétaire ? — Oui, mon enfant. — Pourquoi ne fait-il pas une loi pour rendre nos domestiques esclaves ? Cela serait bien commode ; car ils ne pourraient pas nous quitter, et ils feraient tout ce que je voudrais. — C’est que cela ne serait pas bien. — Nous ne sommes donc pas les plus forts ? — Non, mon enfant. — Pourquoi cet homme n’est-il pas puni quand il bat son esclave, comme on punit ici les hommes qui battent les autres ? — C’est que cela ne serait pas juste. — Et quelle est la raison de cela ? — L’homme battu est son esclave. — Si l’enfant du jardinier était mon esclave, je pourrais donc le battre aussi, et cela serait juste ?
Voilà la sublime morale qu’apportent les possesseurs d’hommes, chez les peuples mêmes qui ont prétendu proscrire l’esclavage. L’intérêt et la force qui existent à un instant donné, deviennent les seules règles de morale que tout individu consulte. La masse de la population peut ne pas suivre toujours la série d’idées que je viens d’exposer ; mais il est impossible qu’elle n’arrive pas aux mêmes conclusions, quand elle voit ce qui se pratique sous ses yeux, et ce qui se professe dans les assemblées législatives et dans les cours judiciaires. Aussi, lorsque des voyageurs anglais nous assurent que l’existence de l’esclavage sur quelques États, donne de la brutalité à tous les esprits et affaiblit les sentiments d’humanité dans toute l’étendue des États-Unis, non seulement on se sent disposé à ajouter foi à leur témoignage, mais on ne concevrait pas que le contraire pût arriver.
Il est peu de questions de législation qui puissent être bien résolues sans les secours des principes de la morale ; mais comment ces principes seraient-ils entendus dans des assemblées où près de la moitié des membres sont des possesseurs d’hommes ? Est-ce à de tels individus qu’il sera permis de parler du respect qu’on doit aux personnes, au travail, à l’industrie ? Dans quel code de morale trouveront-ils la ligne de séparation entre l’être humain qui est une personne, et l’être humain qui est une chose ? Dans toutes les questions où l’intérêt de la liberté des citoyens se trouvera en opposition avec l’intérêt des possesseurs d’hommes, pense-t-on que ce ne sera pas le premier qui sera sacrifié ? Si la possession des maîtres est menacée, il faudra qu’ils la justifient ; il faudra réduire en maximes générales ce qui se passe dans la pratique ; il faudra établir que leur possession est juste, par cela seul que la loi l’a consacrée : or, une fois que l’on arrive à pareilles maximes, il ne s’agit que d’avoir une force suffisante pour faire la loi ; car, dès ce moment, toutes les tyrannies sont justifiées. On dit que les possesseurs d’esclaves sont des défenseurs très zélés du gouvernement démocratique, et qu’ils ne parlent de la liberté qu’avec enthousiasme. Cela se peut ; mais, si les habitants des pays libres peuvent alors les entendre sans dégoût ou sans pitié, il faut que la contagion de la servitude ait singulièrement aveuglé les esprits ou dépravé les sentiments.
La distance qui sépare la nation anglaise de ses colonies, affaiblit les effets que produit, sur une population libre, le contact d’une population de maîtres et d’esclaves ; mais, malgré la distance, ces effets sont encore fort étendus. Dans la chambre des communes, qui a été dernièrement dissoute, le nombre de possesseurs d’esclaves s’élevait à quarante-six ; et rien ne fait présumer que ce nombre soit moins considérable dans la chambre actuelle. Plusieurs possesseurs d’hommes siègent également dans la chambre des lords, et il est probable qu’ils y sont au moins en aussi grande proportion que dans la chambre des communes. Ainsi, voilà deux branches de la puissance législative, qui ne reconnaissent d’autre justice que leur force et leur intérêt ; il est clair que l’esclavage ne peut être juste à leurs yeux, que parce qu’il est conforme aux lois de leurs pays, et comme ce sont eux qui font les lois, il est clair que ce sont eux aussi qui font la justice.
L’influence de l’esclavage sur l’esprit des autres membres du gouvernement, est la même que celle qui se fait sentir dans les deux chambres. Les ministres et leurs agents ont sans cesse à délibérer sur les rapports des maîtres et des esclaves ; mais dans ces rapports, on n’aperçoit jamais que l’action d’une force brutale et de l’intérêt le plus grossier. Ajoutons que le gouvernement de la métropole envoie dans les colonies de nombreux agents, qui vont former leurs mœurs et leurs habitudes près des maîtres et des esclaves. Ces agents reviennent tôt ou tard dans leur pays ; ils se font récompenser de leurs services par des emplois dans leur pays natal, et ils sont tout disposés à croire que l’Angleterre n’est qu’une grande plantation qui n’appartient qu’à un maître, et qu’il ne faut exploiter avec plus de prudence, que par la raison que les hommes possédés sont un peu moins endurants que ceux des colonies.
Les discours et les écrits que répandent les possesseurs d’esclaves, et les divers intérêts qui se rattachent aux leurs, contribuent à corrompre la morale publique : dans ces écrits ou dans ces discours, on professe continuellement que l’esclavage est juste, et doit être maintenu, par cela seul que des lois l’ont établi ; mais comme l’esclavage implique nécessairement dans un individu la faculté de disposer arbitrairement d’un autre, de le maltraiter, de lui faire violence, de le contraindre de travailler, et de lui arracher les produits de son travail, il s’ensuit que les désirs et la force du gouvernement sont les règles seules d’après lesquelles il faut juger de la justice, et de la moralité des actions : les mauvais traitements, les extorsions, le viol, l’adultère et même l’assassinat deviennent des actions morales et légitimes, aussitôt que la volonté d’un prince et de la majorité de deux assemblées ont garanti l’impunité de ces crimes à des individus qu’ils ont appelés des maîtres.
On peut exécuter légitimement, ce qu’on peut légitimement permettre : si pour rendre morales les violences et les cruautés qu’exercent certains individus sur des hommes ou des femmes dans les colonies, il suffit qu’un gouvernement laisse leurs actions impunies ou les protège, on ne voit pas pourquoi il ne peut pas légitimer chez lui ce qu’il peut bien légitimer chez les autres ; si donc il considère comme sa propriété les hommes et les femmes qui lui sont soumis, s’il se conduit à leur égard comme des planteurs à l’égard de leurs esclaves, que pourrait-on lui opposer qu’un esclave ne puisse pas opposer à son maître ? La possession n’existe-t-elle pas dans un cas comme dans l’autre ? N’est-elle pas légitimée par les mêmes désirs et par la même force ? Ainsi, tout peuple qui reconnaît que son gouvernement peut légitimer l’esclavage, reconnaît par cela même qu’il peut être légitimement fait esclave, et que les violences et les extorsions n’ont besoin, pour être conformes à la justice et à la morale, que de l’autorisation expresse ou tacite des chefs de son gouvernement. Les Anglais n’arrivent pas jusqu’à cette conséquence relativement à eux ; mais les hommes, dans lesquels réside la faculté de rendre légitimes les vices et les crimes de l’esclavage, y sont conduits par la nature même des choses ; quand des principes sont universellement reconnus, les conséquences en découlent d’elles-mêmes, et sans qu’on ait besoin d’y songer.
La France éprouve un peu moins que l’Angleterre l’influence de l’esclavage établi dans ses colonies : d’abord, parce qu’avec une population plus considérable, elle possède moins de colonies ; en second lieu, parce que les communications, et les intérêts qui se rattachent à ceux des planteurs, sont moins nombreux ou moins forts ; enfin, parce que les planteurs résident dans leurs possessions, et qu’il leur est moins facile de propager leurs doctrines parmi nous. Ne croyons pas cependant que cette influence soit nulle. Le gouvernement a sous son empire deux peuples : celui des colonies, et celui de la mère patrie. Le pouvoir qu’il a sur le premier est à peu près sans limites : ce pouvoir lui suffit pour légitimer l’esclavage et les conséquences qui en résultent. Le pouvoir qu’il a sur le second est restreint par des lois, par des maximes, par quelques autorités et par la puissance de l’opinion.
Cette combinaison de deux pouvoirs dans les mêmes personnes influe nécessairement sur l’exercice de l’un et de l’autre. Si, par exemple, des ministres ont à prendre une délibération, il faut qu’ils commencent par déterminer si le peuple sur les intérêts duquel ils délibèrent, est le peuple qui se compose d’esclaves et de maîtres, ou si c’est le peuple chez lequel nul individu n’est ni maître ni esclave. Les principaux agents de l’autorité se trouvent, en quelque sorte, dans la position de maître Jacques ; s’ils veulent parler au peuple esclave, il faut qu’ils endossent l’habit et s’arment du fouet de cocher ; s’ils veulent parler au peuple chez lequel nul homme n’est la propriété d’un autre, il faut qu’ils reprennent le costume du cuisinier, c’est-à-dire qu’ils consultent un peu son goût. Mais est-il aussi facile de changer d’esprit, de maximes et de mœurs, qu’il est facile de changer d’habit ? L’homme qui vient de régler arbitrairement certains intérêts, et qui n’a eu à consulter que sa volonté et sa puissance, ne se laissera-t-il pas entraîner par l’esprit qui l’a dirigé, s’il a à délibérer sur des intérêts de même nature ? Si, dans un cas, il peut penser que sa volonté suffit pour rendre un fait ou une action conforme à la justice et à la morale, n’aura-t-il pas la même pensée dans tous ? Pense-t-on, par exemple, qu’un homme qui passerait alternativement du gouvernement d’un peuple esclave au gouvernement d’un peuple libre, ne porterait pas dans l’un les habitudes qu’il aurait prises dans l’autre ?
Les lois de la justice et de la morale ne plient pas selon nos intérêts ou selon nos caprices ; il faut les admettre pour tous les hommes et pour toutes les nations, ou y renoncer pour soi-même. Du moment que la justice et la morale cessent d’être universelles, il n’y a plus pour les hommes ni morale, ni justice ; il n’y a qu’une force brutale qu’on peut quelquefois faire subir, mais qui peut aussi se tourner à l’instant contre ceux qui en ont fait la règle de leurs jugements et de leur conduite.
[IV-378]
CHAPITRE XVIII. ↩
De l’influence réciproque de l’esclavage sur la religion, et de la religion sur l’esclavage.
Depuis qu’il s’est formé en Angleterre des associations pour l’abolition graduelle de l’esclavage dans les colonies, on a recherché quel est le meilleur moyen de préparer à la liberté les populations asservies. Celui sur lequel tous les esprits paraissent s’être accordés, est l’instruction religieuse ; on a pris, en conséquence, toutes les mesures qu’il a été possible de prendre pour instruire ou pour élever les esclaves dans les principes de la religion chrétienne. On a cherché à leur assurer, par semaine, un jour de repos ; on leur a envoyé des missionnaires qui se sont dévoués à leur instruction avec un courage et un désintéressement dignes des plus grands éloges. Des intentions et des sacrifices si honorables peuvent-ils avoir les résultats qu’on en espère ? La servitude n’est-elle pas essentiellement exclusive, pour les esclaves comme pour les maîtres, des principes de religion qu’on voudrait donner aux uns et aux autres ? Si la pratique de l’esclavage et la pratique de la religion étaient incompatibles, c’est en vain qu’on voudrait les faire marcher de front : le talent, le courage, le désintéressement ne sauraient concilier des contradictions.
[IV-379]
Deux genres d’intérêt dirigent les hommes qui aspirent à l’abolition de l’esclavage : l’un est celui d’un monde à venir, l’autre est celui du monde présent. Ces deux intérêts n’étant point inconciliables, il est naturel qu’on cherche à les faire triompher par les mêmes moyens, et que des philosophes et des ministres de plusieurs cultes chrétiens agissent de concert, quoiqu’ils n’aient pas, en tout, des opinions communes ; mais l’ordre dans lequel ces moyens doivent être employés est ici d’une grande importance. Pour faire passer de l’esclavage à la liberté les populations asservies, faut-il d’abord leur donner les mœurs et les doctrines de la religion chrétienne ? Ou pour leur faire prendre les mœurs et les principes de la religion chrétienne, faut-il commencer par leur assurer quelque liberté ? S’il était vrai que l’esclavage, par sa propre nature, repoussât les principes de cette religion, il faudrait que l’affranchissement précédât l’enseignement religieux, ou que du moins il marchât de front avec lui, sans quoi l’on ferait de vains efforts pour arriver au but qu’on se propose.
Un des principaux motifs qui dirigent les défenseurs des populations esclaves, dans les efforts qu’ils font pour leur donner des sentiments religieux, est de prévenir les catastrophes que fait craindre la transition de la servitude à la liberté ; on pense que ces catastrophes seraient évitées si, avant que d’être libres, les esclaves avaient les principes et les mœurs de la religion chrétienne. Il ne s’agit donc pas seulement d’inculquer des dogmes ou des maximes stériles dans les esprits des esclaves ; il faut leur donner de plus des principes qui dirigent leur conduite, et dont l’observation soit pour eux un devoir. Leur faire apprendre des formules de croyance, qui seraient sans influence sur leurs mœurs ou sur leurs actions, ce ne serait pas faire d’eux des hommes religieux et moraux, ce serait faire de la religion un vain formulaire. Un tel procédé n’éviterait aucune des calamités qu’on veut prévenir ; car un peuple peut savoir réciter des formules, avoir une croyance plus ou moins forte, et être cependant un peuple atroce. Les hommes qui exécutèrent les Vêpres Siciliennes et la Saint-Barthélemy n’étaient ni des païens, ni des incrédules ; ils avaient des prédicateurs ; ils savaient lire les Évangiles beaucoup mieux que les esclaves ne sauront les lire de longtemps ; ils avaient une foi aussi vive que la nôtre, et les haines ou les vengeances qu’ils avaient à satisfaire, étaient moins profondes, et n’étaient pas plus justes que celles que les planteurs des colonies ont allumées dans le sein de leurs esclaves.
Toute idée de religion ou de morale emporte nécessairement avec elle l’idée de devoirs à remplir, et il est impossible de séparer l’idée de devoirs de l’idée d’indépendance et de volonté. Les devoirs que la religion chrétienne impose se rapportent, ou à l’individu lui-même, ou à d’autres personnes, ou à la Divinité. Tous ces devoirs, qui sont fort nombreux, rentrent nécessairement les uns dans les autres, et si on les divise, ce n’est que pour les mieux faire concevoir. Il est évident, en effet, que, si tout homme se doit à lui-même de se garantir des habitudes ou des actions qui peuvent dégrader ses facultés morales ou même ses organes physiques, il est dans la même obligation relativement à toutes les personnes envers lesquelles il a été soumis à des devoirs. Il n’est pas moins évident que les devoirs qu’un homme doit remplir envers ses semblables, sont également des devoirs envers l’Être qui les lui a imposés : s’il en était autrement, la religion pourrait se concilier avec l’immoralité la plus profonde, et même avec les plus grands crimes.
Mais, du moment que nous admettons que tout individu a des devoirs à remplir en sa qualité d’homme ou de femme, en sa qualité d’époux ou d’épouse, en sa qualité de père ou d’enfant, de sœur ou de frère, nous élevons l’esclave au niveau du maître, nous posons des limites à l’autorité de l’un et à l’obéissance de l’autre ; c’est-à-dire que nous abolissons l’esclavage, car il n’y a plus d’esclavage aussitôt que les relations des hommes sont déterminées par les devoirs qui résultent de leur propre nature, et non par les caprices de ceux auxquels la force les a soumis.
En admettant, en effet, que des hommes ont des devoirs à remplir, on admet qu’ils doivent y rester fidèles, même quand l’accomplissement devrait être suivi pour eux de peines plus ou moins graves. Le mot de devoirs implique seul que celui auquel ces devoirs sont imposés, peut, en les remplissant, en éprouver de fâcheuses conséquences. L’estime que nous accordons aux hommes, n’est bien souvent qu’en raison des sacrifices auxquels ils se sont volontairement soumis pour y rester fidèles. Le martyre même n’est point, dans l’esprit de la religion chrétienne, une raison suffisante pour violer les obligations auxquelles on est soumis. Jamais le christianisme ne se fût propagé, s’il eût admis, comme excuse d’un vice ou d’un crime, la peur des châtiments ou même de la mort. Les héros de la religion chrétienne ne sont que des hommes qui ont sacrifié leur vie pour rester fidèles à leurs consciences.
Si nous voulons savoir maintenant si la religion chrétienne est conciliable avec l’esclavage, supposons, d’un côté, un nombre plus ou moins grand de personnes que nous appelons des esclaves, et, de l’autre côté, une autre personne, que nous appelons un maître ; supposons de plus que les esclaves sont pleinement convaincus de la vérité des maximes de la religion qu’on leur a enseignée, qu’ils ont la ferme résolution d’y conformer leur conduite, et que, de son côté, le maître n’est pas moins persuadé de sa toute-puissance, et qu’il dispose de la force publique pour faire exécuter ses volontés. Voyons ce qui va se passer entre une multitude désarmée, mais résolue de se conduire selon les préceptes de sa religion, et une troupe armée, qui considère comme un devoir l’exécution aveugle des ordres donnés par un individu qu’on appelle un maître.
Un des préceptes les plus positifs du christianisme, c’est l’interdiction de tout travail servile pendant les jours de dimanche ; mais le maître ne tient aucun compte de cette défense ; il ordonne à ses esclaves de se livrer à leurs travaux accoutumés. Les esclaves font leur devoir : ils résistent. Le maître les fait déchirer à coups de fouet ; n’importe : ils se soumettent au supplice et restent fidèles à leur croyance. Voilà une première limite au pouvoir du propriétaire ; il ne peut tenter de la franchir sans attirer sur lui la haine de ses esclaves, sans les exciter à la résistance, ou sans détruire sa propriété.
Un autre précepte de la religion chrétienne, non moins positif que le précédent, est celui qui commande aux époux de rester unis, et qui leur fait un devoir mutuel de la fidélité. Un maître vend une de ses esclaves, et l’acquéreur se dispose à l’emmener ; mais cette esclave est mariée ; elle ne veut pas se séparer de son mari, et le mari de son côté ne veut pas se séparer d’elle. Qu’arrivera-t-il ? Les maîtres feront déchirer ces deux esclaves à coups de fouet pour vaincre leur résistance ; mais, fidèles à leur croyance, ils resteront unis. Si la violence les sépare momentanément, le devoir les réunira au premier moment où ils cesseront d’être surveillés ; car la religion qui enseigne que la femme doit quitter son père et sa mère pour s’attacher à son mari, n’enseigne nulle part que la femme doit quitter son mari pour s’attacher à un acheteur.
Les relations de famille ou de parenté entraveront à chaque instant l’exercice du pouvoir du maître, ou l’accomplissement des devoirs moraux et religieux des esclaves. Si une femme esclave reçoit un ordre de son maître, et si son mari lui donne un ordre contraire, auquel des deux obéira-t-elle ? Un des premiers devoirs des parents est sans doute de prendre soin de leurs enfants, de veiller à leur éducation, de former leurs mœurs, de protéger leur faiblesse. Un des premiers devoirs des enfants est de respecter leurs parents, de leur obéir, de prendre soin d’eux dans leur vieillesse. Mais, si un maître abrutit ses jeunes esclaves, s’il les maltraite injustement, s’il leur donne de fausses croyances, s’il les prostitue, ne sera-ce pas un devoir dans les parents de les protéger, s’ils en ont la puissance ? S’ils ne peuvent pas les protéger par la force, ne sera-ce pas un devoir de les sauver par la fuite ? Si, d’un autre côté, un maître maltraite ses vieux esclaves ou s’il les laisse manquer des choses nécessaires à leur existence, ne sera-ce pas un devoir pour leurs enfants de prendre soin d’eux et de leur obéir de préférence à leur possesseur ?
[IV-385]
Il n’est pas d’usage, chez les possesseurs d’hommes et encore moins chez leurs agents, d’avoir un grand respect pour les femmes esclaves ; il faut qu’elles se soumettent à leurs désirs et à leurs caprices sous peine d’être déchirées à coups de fouet. Mais, d’un autre côté, la religion fait un devoir de la chasteté ; elle n’admet entre les sexes que les rapports qui résultent du mariage ; elle considère l’adultère comme un crime des plus graves. Cependant, qu’arrivera-t-il si un maître ou son régisseur veut faire violence à une esclave ? Cette esclave ne pourra-t-elle pas légitimement se défendre ? Son père, ses frères, son mari ne devront-ils pas voler à son secours ? Devront-ils se laisser arrêter, dans l’accomplissement de ce devoir, par la crainte des supplices ? Ceux d’entre eux qui succomberont dans ces horribles luttes, ne devront-ils pas être considérés par les autres, comme des martyrs de la religion et de la morale ? Ne seront-ils pas dans une position analogue à celle des premiers chrétiens qui subissaient le martyre pour rester fidèles à leur croyance ?
Ce n’est pas tout : les relations qui existent dans une société, ne sont pas toutes des relations de parenté. Pour préparer les esclaves à la liberté, il faut leur faire un devoir de respecter le bien d’autrui, de rendre à chacun ce qui lui est dû ; il faut leur expliquer le commandement qui défend à chacun de prendre ou de retenir ce qui appartient à d’autres ; il faut surtout leur faire bien comprendre qu’ils ne peuvent, sans se rendre coupables d’un crime, s’emparer, par violence, de la propriété des autres ou des fruits de leur travail. Mais comment leur donner un tel enseignement sans qu’aussitôt ils n’exigent pour eux-mêmes l’accomplissement des devoirs qu’on leur impose envers autrui ? Si c’est un crime, de leur part, d’employer la ruse, la force ou la violence pour s’emparer du fruit des travaux des autres, c’est un crime de la part des autres, de s’emparer, par les mêmes moyens, du fruit de leurs propres travaux. Ils pourront donc conserver légitimement tout ce qu’ils auront produit par leur industrie ; en retenant les fruits de leurs peines, ils ne feront que remplir leurs devoirs ; car il leur sera plus facile de donner des secours à leurs femmes et aux enfants auxquels ils se doivent d’abord, et ensuite ils empêcheront les maîtres de se rendre coupables d’extorsion.
Il ne suffit pas, pour que l’affranchissement des esclaves soit sans danger pour leurs possesseurs, de leur faire un devoir de rendre à chacun ce qui lui est dû ; il faut surtout, et c’est ici le point le plus important, leur enseigner à respecter les personnes ; il faut leur apprendre que la vengeance et la cruauté sont des crimes ; qu’il n’appartient qu’à la justice d’infliger des châtiments aux hommes qui les ont mérités. Mais, si en même temps qu’on leur donne cet enseignement, ils continuent d’être soumis à des châtiments arbitraires ; s’ils continuent d’être déchirés à coups de fouet sans motifs et sans procédures, pourront-ils considérer leurs maîtres autrement que comme une troupe de brigands, qui n’échappent aux peines légales que par la partialité des magistrats ? S’ils deviennent les plus forts, leur premier devoir ne sera-t-il pas d’organiser des tribunaux moins iniques, et de leur livrer tous les hommes qu’une longue impunité aura corrompus ?
Ainsi, en donnant aux esclaves une instruction religieuse, on leur enseignera qu’il est pour les hommes des devoirs à remplir, et l’on parviendra à les convaincre ; ou bien l’on se bornera à leur enseigner quelques dogmes, sans leur parler de devoirs. Si on leur donne le sentiment de leurs devoirs afin de les préparer à faire un bon usage de la liberté, on les affranchit par cela même ; car on leur apprend à résister à tout ordre qui serait en opposition avec les devoirs qu’on leur a tracés. Si, dans la crainte de les disposer à la résistance, on se borne, au contraire, à leur enseigner quelques dogmes, sans leur parler de leurs devoirs, ou du moins sans les convaincre qu’il leur importe de les observer même quand il y a du danger, on ne fait rien ni pour la religion, ni pour la sûreté des maîtres.
Il est d’autres devoirs que ceux qui naissent des relations entre les hommes : on pourrait enseigner aux esclaves l’amour du travail, la tempérance, l’économie, la décence, la propreté et d’autres vertus sociales ; mais l’enseignement même de ses devoirs serait encore vain, s’il n’existait aucune liberté. Ne serait-ce pas une dérision cruelle d’aller prêcher la tempérance et l’économie à des hommes qui n’ont à consommer par semaine que cinq harengs et quelques livres de farine ? Sur quoi et pour quel motif feraient-ils des économies, puisqu’ils n’ont rien au-delà de ce qui leur est rigoureusement nécessaire pour soutenir leur existence, et qu’ils ne peuvent rien posséder en propre, ni rien transmettre à leurs enfants ? Ne serait-ce pas une dérision plus cruelle encore d’aller faire des sermons contre la paresse et l’oisiveté, à des hommes qui, dès le point du jour, sont éveillés par le claquement des fouets, qui sont harcelés de coups pendant toute la journée, et qui ne peuvent rentrer qu’à la nuit dans leurs misérables cabanes ? À quoi servirait-il de recommander la décence et la pudeur à des êtres qui n’ont point de vêtements pour se couvrir, et qui sont enfermés dans des huttes comme des bêtes ? Il ne faut pas se le dissimuler : l’enseignement des devoirs moraux que la religion impose, doit détruire l’esclavage, ou l’esclavage doit empêcher l’établissement de la religion [352].
[IV-389]
Les possesseurs d’hommes ne se sont point trompés sur les effets que produirait l’enseignement des devoirs moraux sur l’esprit de leurs esclaves. Je crains, dit un respectable missionnaire envoyé à la Jamaïque, je crains que les planteurs eux-mêmes ne mettent obstacle à l’instruction morale et religieuse des esclaves. Il est certain qu’un grand nombre d’entre eux, bien loin d’encourager les noirs à fréquenter les lieux consacrés à la religion, sont opposés à toute instruction, et particulièrement au moyen par lequel on peut la donner le plus efficacement ; c’est-à-dire à la fréquentation des plantations par des membres du clergé ou par d’autres personnes, dans la vue d’instruire les esclaves... La principale objection des planteurs est, j’en ai la certitude, que les esclaves étant instruits, seraient moins appliqués à leur travail, seraient moins disposés à obéir aux agents de l’exploitation, et seraient plus impatiens et plus capables de secouer le joug [353].
L’auteur qui a fait ces observations, paraît croire que les craintes des planteurs sont mal fondées. La religion chrétienne, dit-il, au lieu de rendre un homme mécontent de la position dans laquelle la Divinité l’a placé, a une tendance contraire. Elle ne tient pas l’esprit de l’homme attaché à la terre, mais elle le porte vers des objets plus grands et plus élevés, vers un bonheur éternel. Elle lui fait considérer les travaux et les fatigues de cette courte vie, comme un objet secondaire et digne à peine d’un être appelé à jouir de l’immortalité... Elle enseigne de plus à tous les hommes à se soumettre aux ordres de l’homme pour l’amour de Dieu, et aux esclaves, à obéir à leurs maîtres en toutes choses ; bien plus, elle leur enseigne à les honorer et à ne pas chercher à acquérir leur liberté par des moyens illégitimes [354].
S’il était possible de déterminer, par ruse, les possesseurs d’hommes à renoncer à l’exercice du pouvoir arbitraire, peut-être ne faudrait-il pas s’en faire trop de scrupule ; reprendre par la finesse ce qui a été ravi par la violence, peut ne pas être un grand mal dans la morale. Mais on s’abuserait si l’on s’imaginait que les planteurs ne comprennent pas la nature de leurs possessions, et qu’ils sont incapables de discerner ce qui peut les compromettre ou leur en assurer la disposition absolue. Il faut donc exposer les choses telles qu’elles sont, et telles qu’ils les voient : dans la morale, comme dans toutes les sciences, il n’y a d’infaillible que la vérité.
La religion chrétienne enseigne, dit-on, à l’homme à être content de sa position ; elle le détache de la terre, et lui donne le courage de supporter les souffrances de la vie humaine ; elle enseigne à l’esclave à obéir à son maître et même à le respecter. Sans doute, elle enseigne cela ; mais n’enseigne-t-elle pas autre chose ? Ceux de ses ministres qui traversent les mers, pour aller instruire des esclaves, ne se proposeraient-ils que de devenir les auxiliaires des régisseurs qui les conduisent dans les champs, le fouet à la main ? La religion enseigne aux esclaves à obéir à leur maître ! Mais le fouet qui leur déchire la peau, ne leur donne-t-il pas la même leçon ? Elle les détache de ce monde ! Mais les outrages, les violences, les supplices qui leur font désirer la mort, les en détachent-ils moins ? Qui dira cependant que c’est là un enseignement religieux ? Si la morale de la religion se bornait à prêcher l’obéissance aux ordres d’un maître ; si les ministres qui vont l’enseigner, ne se proposaient que de faire l’office des fouets des régisseurs, les maîtres, bien loin de les repousser, les accueilleraient avec reconnaissance.
La morale du christianisme enseigne à l’homme à être content de la position dans laquelle la Providence l’a placé, lorsque cette position est une conséquence inévitable de l’accomplissement de ses devoirs. Elle détache l’homme de la terre, mais c’est pour l’attacher plus fortement aux devoirs qui lui sont imposés ; car ce n’est pas à celui qui les foule aux pieds, qu’elle promet un meilleur avenir. Elle lui apprend à supporter les souffrances, mais c’est pour le déterminer à faire ce qu’il doit, sans s’enquérir des conséquences qui peuvent tomber sur lui, et non pour l’engager dans la carrière du vice. Elle lui fait un devoir de l’obéissance, quand les commandements sont justes et conformes à la morale ; mais elle l’oblige à la résistance quand il ne peut obéir qu’en violant ses devoirs. Elle l’oblige surtout à résister aux passions viles et malfaisantes, et, parmi les passions de ce genre, il n’en est pas de plus funeste que la peur des maux qui suit l’accomplissement de ses devoirs. Enfin, elle commande à l’esclave le respect pour ses maîtres, mais elle lui commande plus fortement encore la haine et le mépris des vices dont la plupart des maîtres sont infectés.
Ce sont donc les préceptes mêmes par lesquels les ministres de la religion veulent la recommander aux possesseurs d’esclaves, qui la rendent odieuse à leurs yeux. Il faut, pour qu’un possesseur d’hommes règne en souverain, que ses esclaves ne connaissent pas une autorité supérieure à sa volonté, et qu’à leurs yeux, rien ne soit au-dessus des récompenses qu’il peut accorder ou des châtiments qu’il peut infliger. Or, du moment que l’enseignement religieux impose des devoirs à un esclave, du moment qu’il lui présente des récompenses infinies s’il y reste fidèle, et des châtiments sans terme s’il les trahit, les promesses et les menaces du maître n’ont plus d’importance. Ce ne sont plus, pour me servir des termes de l’écrivain que je viens de citer, que des objets secondaires qui sont à peine dignes de fixer l’attention d’un être appelé à jouir de l’immortalité. Un esclave, en effet, n’est-il pas affranchi du moment qu’il ne compte pour rien ni les craintes ni les espérances que peut lui inspirer son maître ?
J’ai fait observer que l’enseignement des devoirs moraux devait limiter et réduire à presque rien le pouvoir des maîtres sur leurs esclaves, ou que l’esclavage devait repousser l’enseignement et la diffusion de tous les devoirs moraux que la religion impose. Il pourrait suffire, pour être convaincus de la vérité de cette observation, de savoir, d’un côté, quels sont la nature et les effets de l’esclavage, et de connaître, de l’autre, la nature morale de l’homme et les préceptes moraux que la religion chrétienne impose. Cependant, pour rendre cette vérité plus sensible, j’exposerai quel est le caractère religieux des diverses classes de la population dans les principales colonies.
La religion chrétienne défend de séparer l’homme et la femme unis par les liens du mariage. Les possesseurs d’hommes ont trouvé le moyen de concilier ce précepte avec l’exercice d’un pouvoir absolu sur leurs esclaves ; à l’exemple des Romains, ils ont, en général, laissé vivre les hommes et les femmes asservis comme ils ont jugé convenable, sans faire précéder leur union d’aucune cérémonie ni religieuse, ni légale. Dans les colonies anglaises, si l’on fait exception d’un petit nombre de paroisses de la Jamaïque, on ignore ce que c’est que le mariage de deux esclaves ; on n’est pas plus avancé, à cet égard, dans les colonies des autres nations. Le mariage, en effet, imposant des devoirs mutuels aux époux, et les possesseurs d’hommes n’admettant pas que leurs esclaves puissent avoir des devoirs à remplir, si ce n’est envers leur personne, ils ont dû proscrire toute union légitime [355].
Afin de laisser aux esclaves la faculté de remplir, le dimanche, les devoirs qu’impose la religion chrétienne, le gouvernement anglais a interdit à leurs possesseurs de les contraindre au travail ce même jour. Mais cette défense ne profite guère à ceux en faveur desquels elle a été faite ; l’avarice des maîtres a trouvé le moyen de les contraindre au travail, le jour où il est prohibé, en ne leur laissant que ce jour pour gagner leur vie, ou pour aller chercher au loin les objets dont ils ont besoin pendant le cours de la semaine. Aussi, quoique les églises soient très peu nombreuses, elles sont généralement désertes, même dans les lieux où l’on trouve des troupes d’esclaves. Il résulte de là que les esclaves employés à la culture, qui, dans la Jamaïque, forment les neuf dixièmes de la population, n’ont pas même les apparences extérieures de la religion ; ils sont encore aussi idolâtres que s’ils étaient sur les rives de la Gambie ou du Niger [356].
Cet état d’abrutissement des esclaves n’est pas le seul effet de l’insouciance ou même de la cupidité des maîtres ; non, c’est l’effet de leur calcul. Il faut que tout sentiment moral soit éteint chez la population asservie, afin que les vices de ses possesseurs puissent se développer sans obstacle. On a vu, il n’y a pas longtemps, dans les Barbades, un ministre de la religion qui, ayant réussi à se former un auditoire composé d’affranchis ou d’esclaves, a irrité les maîtres au point qu’il a manqué périr de leurs mains. Dans le mois d’octobre 1823, les hommes de la classe des maîtres, après s’être livrés à une longue série d’outrages envers un missionnaire et les membres de sa congrégation, s’assemblent en comité secret, rédigent une proclamation et la publient. Cette proclamation porte que la bourgeoisie (the gentry) et autres habitants des Barbades ont arrêté de s’assembler, le dimanche suivant, dans le dessein de renverser la chapelle des méthodistes, et elle invite les personnes auxquelles elle est adressée de se trouver sur la place, bien pourvues des outils nécessaires. La proclamation produit son effet ; au jour indiqué, l’église est environnée par la populace armée des possesseurs d’hommes ; ils enfoncent la porte et les fenêtres ; ils détruisent les bancs et la chaire ; ils déchirent et foulent aux pieds un nombre considérable de bibles ou d’autres livres religieux à l’usage des noirs et de leur école, et renversent une partie de l’édifice. De là, ils se portent sur l’habitation des missionnaires, détruisent chacun de ses meubles, coupent en morceaux les tables et les chaises, enlèvent le toit de la maison, font des drapeaux de son linge, les agitent dans les airs, et trois fois trois, ils poussent des hurlements féroces en signe de leur victoire. La fatigue les oblige de suspendre leurs destructions ; ils se donnent rendez-vous pour le jour suivant ; et, en effet, le lendemain, ils se portent à l’église ; ils ne laissent pas pierre sur pierre. L’opération finie, ils publient la proclamation suivante :
Bridgetown, mercredi, 21 octobre 1823.
« Les habitants de cette île sont respectueusement informés qu’en conséquence des attaques non provoquées et non méritées, qui ont été faites, à plusieurs reprises, par la communauté de missionnaires méthodistes, autrement connus comme agents de la vilaine Société Africaine (otherwise known as agents to the villanous African Society) [357], un nombre de messieurs respectables (respectable gentlemen) ont formé la résolution de mettre fin à l’affaire des méthodistes ; que, dans cette vue, ils ont commencé leurs travaux dimanche soir, et qu’ils ont la très grande satisfaction d’annoncer qu’à minuit ils ont terminé la ruine de l’église. Ils doivent ajouter à cette information que le missionnaire a effectué son évasion, dans un petit vaisseau, hier à midi, et s’est réfugié dans l’île Saint-Vincent, évitant par là la manifestation, à son égard, des sentiments publics qu’il avait si bien mérités. Il est à espérer que, comme cette proclamation sera répandue dans toutes les îles et colonies, toutes personnes qui se considèrent comme de véritables amis de la religion suivront le louable exemple des Barbadiens, en mettant fin au méthodisme et aux églises des méthodistes. »
Cependant, le missionnaire reçoit avis que les maîtres ont formé la résolution de démolir la maison des parents chez lequel il s’est réfugié, et de le pendre lui-même s’ils peuvent le trouver. Convaincu qu’ils exécuteraient leur résolution, s’il leur en laissait le temps, il fait cacher sa femme dans la hutte d’un nègre, et va se cacher près du rivage de la mer ; de là il s’embarque pour l’île Saint-Vincent. Arrivé dans cette île, le gouverneur le suspend provisoirement de ses fonctions, ne pouvant supposer que tous les torts sont du côté des planteurs ; et il envoie un autre missionnaire à la Barbade pour recueillir les témoignages.
Ce nouveau missionnaire arrive ; mais il n’a pas la permission de débarquer. Il apprend d’abord qu’on a résolu de mettre le feu à son vaisseau. Bientôt après, on lui annonce que des bateaux sont préparés pour venir l’enlever et le mettre à mort. Cependant, on lui fait dire qu’on lui donne vingt-quatre heures pour se retirer ; mais que, s’il ne profite pas de ce délai, il ne devra pas se plaindre des conséquences de son obstination. Le capitaine, effrayé de ces menaces, se retire, et va se placer sous la protection de l’artillerie d’un vaisseau de guerre [358].
En lisant les descriptions de ces violences, on pourrait penser que les missionnaires contre lesquels elles étaient dirigées provoquaient les esclaves à l’insurrection, ou que, du moins, ils leur décrivaient avec des couleurs trop vives les vices de leurs maîtres ; bien loin de là, ils les exhortaient à prendre patience, à travailler avec zèle, et à pratiquer les vertus que le christianisme enseigne. À peine celui que nous avons vu si indignement outragé se fut-il retiré à Saint-Vincent, qu’il se hâta d’écrire à ses amis, de peur que les violences dont ils étaient l’objet ne les portassent à quelque excès. « Soyez patients à l’égard de tous les hommes, leur disait-il ; ne parlez jamais qu’avec respect de toute personne constituée en autorité, et n’usez jamais de représailles envers ceux qui vous injurient [359]. »
Des violences non moins graves ont été commises, dans d’autres colonies, contre des ministres de la religion. À Déméray, les maîtres, sous le prétexte d’une insurrection que leurs violences avaient excitée, ont condamné à la potence un missionnaire dont la conduite et les discours étaient irréprochables. S’il est des colonies où les ministres de la religion ne soient pas exposés aux mêmes violences, c’est parce qu’en général [IV-400] ces ministres ne donnent aucune instruction aux esclaves, ou parce qu’ils ont eux-mêmes déjà pris les mœurs qui caractérisent les maîtres.
J’ai fait connaître précédemment le soin extrême avec lequel les possesseurs d’hommes des États-Unis veillent à l’abrutissement de leurs esclaves. Si l’on ne peut, sans se rendre coupable aux yeux des maîtres, apprendre à lire ou à écrire à un individu asservi, à plus forte raison n’est-il pas permis de lui enseigner qu’il existe pour lui des devoirs supérieurs aux ordres de son maître. Là aussi, l’on a vu des églises, non démolies, mais incendiées par les hommes qui ont craint que l’enseignement des préceptes religieux ne restreignît leur pouvoir sur leurs esclaves [360]. À la Louisiane, la population asservie n’est pas moins dépourvue de religion qu’à la Jamaïque. Un voyageur a même pensé qu’il était impossible de lui en donner aucune teinte. L’esclavage, en opposition avec la religion, dit-il, tend nécessairement à la détruire [361].
L’esclavage est beaucoup plus exclusif de tout sentiment de religion chez le maître que chez l’esclave. Celui-ci, quelque arbitraire que soit le pouvoir auquel il est soumis, peut croire qu’il existe pour lui des devoirs, soit envers lui-même, soit envers les autres, soit envers la Divinité ; il peut les observer aussi longtemps qu’il n’en est pas empêché par une force invincible ; il peut affronter les châtiments et même la mort plutôt que de se livrer à une action vicieuse ou criminelle ; mais un maître ne peut pas croire en même temps qu’il existe des devoirs pour tous les hommes, et qu’il peut légitimement disposer de ses semblables comme d’une propriété. Ces deux croyances sont exclusives l’une de l’autre ; s’il est convaincu que les individus qu’il tient asservis n’ont des devoirs qu’envers lui, il est nécessairement convaincu qu’ils n’ont des devoirs ni envers eux, ni envers d’autres hommes, ni même envers la Divinité.
Dans tous les pays, on a beaucoup écrit contre les philosophes ; on les a accusés d’incrédulité, d’athéisme, de matérialisme, et enfin de toutes les opinions qu’on a cru propres à les rendre odieux aux nations. Je n’ai point à examiner si ces reproches ont été de bonne foi, et s’ils ont été bien ou mal fondés ; mais je crois pouvoir faire observer ici que, s’il est au monde une classe d’individus à laquelle ils conviennent, il n’en est aucune qui les mérite aussi bien que les possesseurs d’hommes. Est-il, en effet, une incrédulité plus effrayante pour le genre humain, que celle des individus qui nient l’existence de toute espèce de devoirs ? Les hommes auxquels on a reproché d’avoir affecté le cynisme dans leur impiété, ont-ils jamais eu l’impudence de soutenir qu’un père ne doit rien à ses enfants, qu’un fils ne doit rien à sa mère ? Ont-ils jamais osé publier qu’un mari ne doit rien à sa femme, ni une femme à son mari ? Ont-ils jamais dégradé les hommes jusqu’au point de soutenir qu’un être humain n’a aucun devoir à remplir, ni envers lui-même, ni envers les autres ?
L’incrédulité qui porte sur l’existence de tous les devoirs moraux, est plus funeste et je dirai même plus impie que celle qui porterait sur une vie à venir ou sur l’existence d’un être suprême. Qu’importerait, en effet, la croyance dans une autre vie ou même celle de la Divinité, à celui qui croirait en même temps qu’il n’a aucun devoir à remplir, ni envers lui-même, ni envers les autres, ni envers celui qui lui a donné la vie ? Celui qui fait de la ruse et de la force la mesure de ses droits, et qui ne reconnaît pas d’autre devoir que celui d’obéir aux caprices d’un maître, ne dénie-t-il pas l’existence de tous les devoirs moraux, l’existence de la justice, et les préceptes de toute religion ? Ne dénie-t-il pas, par conséquent, l’existence de tout rapport entre l’homme et un être suprême ? En se faisant lui-même le but et le centre de tous les devoirs des hommes qu’il tient asservis, ne se substitue-t-il pas à la place, non seulement du genre humain tout entier, mais de la Divinité elle-même ?
Si l’on reconnaît en effet qu’un être humain, par cela seul qu’il existe, a des devoirs à remplir envers lui-même, envers ses enfants, envers ses parents, envers son époux ou son épouse, envers l’humanité, enfin, envers la Divinité, on reconnaît par cela même qu’il ne peut ni s’aliéner ni être aliéné par d’autres ; les engagements qu’il peut contracter ou que d’autres peuvent contracter pour lui, sont nécessairement limités par les devoirs qui lui sont imposés. Ces devoirs, étant antérieurs à tout, ne peuvent être détruits, ni par le caprice, ni par la force ; ils peuvent se servir mutuellement de limites ; mais tout acte qui tend à en empêcher l’accomplissement est un acte illicite ou immoral. Un pirate qui enlève des êtres humains sur une terre qui lui est étrangère, commet un crime ; mais il ne détruit pas les devoirs qui sont imposés aux malheureux qu’il a ravis ; il n’est pas en sa puissance de faire que ces devoirs se rapportent à lui. S’il va livrer ses victimes à un homme qui lui paie le prix de son brigandage, il n’est pas en sa puissance de faire que l’individu avec lequel il traite, devienne le but auquel ces devoirs se rapportent ; n’ayant pu se substituer lui-même à la place du genre humain, et encore moins à la place de la Divinité, il n’a pas pu y en substituer d’autres. Les devoirs qui sont imposés aux hommes les suivent donc dans leur esclavage, et ces devoirs bornent de toutes parts la puissance du maître : il faut qu’ils soient déniés, pour que cette puissance soit exercée [362].
[IV-404]
Il est donc évident que la simple qualité de possesseur d’hommes, exclut, dans celui qui la porte, toute idée de devoirs moraux, et par conséquent de religion ; l’incrédulité dans l’existence de ces devoirs exclut la croyance des préceptes et même des dogmes du christianisme ; elle exclut la croyance de tout rapport entre cette vie et une vie à venir, entre les hommes et la Divinité. Faut-il maintenant être surpris des efforts que font tous les possesseurs d’hommes pour abrutir tous les êtres humains qu’ils possèdent ? Faut-il être surpris que, pour prévenir le développement de leurs sentiments moraux et la connaissance de leurs devoirs, ils se portent, à leur égard, à des violences excessives et les mettent dans l’impuissance de recevoir aucune instruction ? Faut-il s’étonner que des hommes qui ne croient à l’existence d’aucun devoir chez les autres, se livrent eux-mêmes sans remords à l’incendie, à la cruauté, au meurtre, toutes les fois qu’ils en ont besoin pour assurer leurs possessions ?
Cependant, les possesseurs d’hommes se livrent souvent à des pratiques qu’ils disent religieuses ; mais ce ne sont que des grimaces dont ils se servent pour tromper plus facilement les nations : c’est une espèce de ruse qui supplée à ce qui leur manque de force.
« La religion, dans cette colonie, dit Robin en parlant de la Louisiane, est toute en forme, le fond n’y est plus rien. J’appelle fond, ces notions que la religion donne sur la Divinité, sur la nature de l’âme, sur sa destination, sur les devoirs de la société, et particulièrement sur l’art, non d’éteindre les passions mobiles de l’homme, mais de les diriger. Ces objets ne font plus partie de la religion de ces contrées, et je doute que les ministres s’y entendissent [363]. »
Dans les États-Unis, surtout dans les contrées où l’esclavage est pratiqué, la religion se réduit également en grimaces : elle n’est en général qu’un ressort politique, c’est-à-dire un moyen de tromper [364]. Au cap de Bonne-Espérance, les maîtres se montrent fort attachés aux formes extérieures du culte : les paysans, dit Barrow, poussent la dévotion à un excès qui ferait croire qu’eux aussi connaissent l’hypocrisie [365]. Dans les colonies anglaises, il est tellement reconnu que les maîtres n’ont aucun sentiment des devoirs imposés par la religion, que ce fait ne peut pas même faire l’objet d’une question [366]. Dans les colonies espagnoles où il existe des esclaves, la religion se réduit en pratiques ou en cérémonies ; mais tout ce qui tient aux devoirs moraux en a disparu [367].
L’incrédulité à l’existence des devoirs moraux, et par conséquent à tout précepte de morale que la religion impose, étant une condition attachée à la qualité de possesseur d’hommes, il s’ensuit que les individus qui appartiennent à la classe des maîtres, ne reconnaissent d’autorité que la fourberie et la violence ; de là, les efforts auxquels ils se livrent pour abrutir les hommes qu’ils possèdent ou qu’ils aspirent à posséder, pour prévenir le développement de leurs idées et de leurs sentiments moraux ; de là aussi, cette tendance à substituer aux préceptes religieux de la morale, des pratiques ridicules, des croyances absurdes, et tout ce qui est propre à dépraver l’intelligence humaine [368].
[IV-407]
Si l’esclavage n’existait que dans les îles de l’Amérique, exploitées par des noirs, on pourrait espérer d’en restreindre les effets dans d’étroites limites ; mais, lorsqu’on songe qu’une grande partie de la population de l’Asie, de l’Amérique, de l’Afrique et de l’Europe est divisée en possesseurs d’hommes et en hommes possédés ; lorsqu’on songe à l’influence que les premiers exercent sur le sort des nations, on peut être effrayé des calamités qui menacent encore le genre humain, mais on ne peut être surpris que les hommes aient été et qu’ils soient encore en grande partie gouvernés par l’hypocrisie et par la brutalité.
[IV-408]
CHAPITRE XIX. ↩
De l’influence de l’esclavage sur l’industrie et le commerce des nations qui ont des relations commerciales avec des peuples chez lequel l’esclavage est établi. — Du système colonial.
Il est difficile de concevoir un système dont les effets soient plus funestes, et s’étendent aussi loin que ceux qui résultent de l’esclavage. Il est difficile surtout d’imaginer un genre d’esclavage aussi atroce que celui que nous voyons établi dans les colonies formées par les Européens, ou sur quelques parties du continent d’Amérique. Ce système n’a été établi, et ne se maintient qu’avec l’approbation et par le concours de la plupart des peuples des gouvernements de l’Europe. Le sort des esclaves est tellement misérable que les maîtres ont besoin de compter sur l’appui de soldats étrangers pour se livrer impunément à la violence de leurs passions. Cependant, puisque ce système ne se soutient que par l’appui que nous lui donnons, et puisqu’il a pour effet de corrompre les principes moraux des nations qui se mettent en contact avec des possesseurs d’hommes, il faut bien que, sous d’autres rapports, il présente quelques avantages ; car, s’il ne produisait que des maux pour tout le monde, se trouverait-il quelqu’un qui voulût le soutenir ?
Il est évident, en effet, que l’esclavage est pour la nation chez laquelle il est établi, la plus grande des calamités : il déprave les maîtres encore plus que les esclaves ; il détruit chez les uns et chez les autres tout principe de morale ; il prévient le développement de toutes les facultés intellectuelles sur les choses qu’il importe le plus aux nations de connaître ; il ne permet d’exercer que l’industrie la plus grossière ; il condamne la population asservie à une misère profonde et à des châtiments terribles, en même temps qu’il est pour la classe des maîtres un principe d’appauvrissement ; il ne prive de toutes garanties les hommes possédés qu’en ravissant toute sécurité à leurs possesseurs, et en les mettant dans l’impossibilité d’avoir jamais un gouvernement impartial et juste ; il interdit aux maîtres l’espérance de jamais exister comme nation indépendante, et les mettrait à la discrétion de tout peuple ou de tout gouvernement étranger, si l’autorité qui les protège les abandonnait à eux-mêmes ; enfin, il corrompt jusqu’aux gouvernements ou aux nations qui ont des relations d’amitié avec les possesseurs d’hommes.
Mais ces maux, qui sont incontestables, sont rachetés, à ce qu’on s’imagine, par les avantages que tirent plusieurs États de l’Europe de la possession de leurs colonies. On prétendait autrefois que les nègres étaient faits esclaves pour leur bien ; on n’avait pas l’impudence de soutenir que l’esclavage était pour eux un état de bonheur, mais on disait qu’on les arrachait à l’idolâtrie, et qu’il n’y avait pas de meilleur moyen de les envoyer au ciel que d’en faire des instruments chrétiens d’agriculture. Cet intérêt prétendu de la vie à venir des hommes asservis, doit être maintenant écarté, puisqu’il est prouvé par une longue expérience, que l’esclavage non seulement ne rend pas les esclaves religieux, mais qu’il détruit même chez les maîtres tout principe de religion. Les nations de l’Europe qui soutiennent un tel système dans les colonies, et qui appuient de leurs forces le pouvoir des maîtres, ne peuvent donc plus être dirigées que par les intérêts matériels de leur industrie et de leur commerce. Ainsi, que l’esclavage soit une source inépuisable de calamités et de crimes, nous l’admettrons et personne ne le contestera ; mais ces calamités et ces crimes nous donnent du profit, et dès lors nous devons nous montrer peu scrupuleux ; voyons donc ce qu’ils nous rapportent.
Si l’esclavage était aboli dans les colonies, dit-on, les possesseurs des terres seraient obligés de changer de culture, et de substituer à quelques-unes de leurs productions des productions d’un autre genre ; la culture de la canne à sucre, par exemple, deviendrait si dispendieuse, qu’il n’y aurait plus moyen de soutenir la concurrence avec le sucre de l’Inde. Les colonies ne produisant plus les denrées que les métropoles demandent, celles-ci ne pourraient plus leur envoyer en échange les produits de leur industrie. De là, l’inactivité de nos manufactures et la stagnation de notre commerce.
Il n’y a pas une seule de ces propositions qui ne soit une erreur manifeste. Il a été précédemment établi que la journée d’un esclave devient infiniment plus chère au cultivateur qui la paie, que la journée d’un homme libre ; la différence est même si grande qu’elle serait incroyable, si elle n’était pas constatée par des faits nombreux et irrécusables. Or, peut-on soutenir sérieusement que, si les possesseurs des terres étaient obligés de moins payer leurs ouvriers, ils ne pourraient continuer de se livrer à la culture, à moins de demander un plus haut prix de leurs denrées ?
Admettons cependant que les colons n’eussent pas le moyen de soutenir, dans la vente du sucre, la concurrence avec d’autres pays, avec les Indes ou l’Amérique méridionale, par exemple ; admettons qu’ils seraient obligés de changer leur mode de culture, et que nous n’aurions plus besoin d’une partie de leurs denrées ; comment notre industrie et notre commerce pourraient-ils être affectés par un tel événement ? Ils en seraient affectés sans doute, mais ce serait d’une manière très avantageuse : la quantité de nos produits avec laquelle nous payons une livre de sucre quand nous l’achetons à un possesseur d’hommes de la Martinique, nous servirait à en payer deux livres, si nous l’achetions à un cultivateur qui ne fait exécuter ses travaux que par des mains libres : il n’y aurait d’autre mal à cela que de mettre d’accord l’intérêt avec la morale. Mais cette question se rattache à l’affranchissement des colonies, et ce n’est pas encore le moment de l’examiner.
Le système colonial présente deux questions bien distinctes, l’une est relative à l’affranchissement des esclaves, l’autre à l’indépendance des colonies : on conçoit fort bien que les esclaves pourraient être affranchis, sans que les colonies fussent indépendantes ; on conçoit aussi que les colonies pourraient être abandonnées à elles-mêmes, sans que les esclaves fussent affranchis. Je ne me propose, dans ce moment, que d’exposer les effets de l’esclavage sur l’industrie et le commerce, soit des métropoles, soit des nations qui, sans posséder des colonies, ont des relations commerciales avec des peuples chez lesquels l’esclavage est établi.
Les possesseurs d’esclaves, colons ou autres, envoient une partie de leurs productions agricoles aux peuples industrieux chez lesquels l’esclavage n’est point admis ; mais, ils ne les envoient pas en présents ; ils exigent qu’on leur paie le prix qu’ils у mettent, sans quoi ils les garderaient ou les enverraient ailleurs. De leur côté, les peuples industrieux envoient des productions manufacturées aux peuples possesseurs d’esclaves ; mais, ils ne les envoient pas gratuitement ; ils ne les livrent qu’à ceux qui leur en paient la valeur. C’est donc un échange qui se fait entre deux nations : la question est de savoir si la circonstance de l’esclavage rend plus avantageuse la condition de la nation qui livre ses produits manufacturés aux possesseurs d’esclaves.
Les principales productions que les colonies envoient à leurs métropoles, consistent en sucre, en café ou en autres denrées qui ne croissent généralement qu’entre les tropiques. Ces productions sont-elles offertes par les possesseurs d’esclaves à des prix plus bas que ceux auxquels peuvent les livrer les cultivateurs libres ? S’il est vrai, comme je crois l’avoir précédemment établi, que, dans toutes les circonstances, le travail fait par des esclaves revient plus cher à celui qui le paie, que le travail fait par des hommes libres, il est évident que les nations chez lesquelles la servitude domestique n’existe pas, et qui produisent les mêmes denrées que les colonies, peuvent les livrer à meilleur marché ; car, moins une marchandise coûte de frais de productions, et plus il est facile de la livrer à bas prix. Il est vrai que le travail exécuté par des esclaves pourrait être plus cher que celui qui est exécuté par des hommes libres, dans le plus grand nombre de cas, et ne pas l’être dans tous ; il pourrait ne pas l’être particulièrement dans la production des denrées que les colonies envoient à leurs métropoles ; mais j’ai déjà fait voir que, même dans la production des denrées équinoxiales, le propriétaire qui fait exécuter ses travaux par des esclaves, les paie infiniment plus cher que le propriétaire qui les fait exécuter par des mains libres. Ainsi, on ne peut pas même soutenir que la production des denrées qui ne croissent qu’entre les tropiques, se trouve dans un cas d’exception. Il est d’ailleurs un moyen bien simple de savoir si les travaux exécutés par des esclaves, pour obtenir des denrées de ce genre, coûtent plus cher aux propriétaires des terres, que les travaux employés à la même production, dans les pays où l’esclavage n’existe pas : c’est de comparer le prix que les habitants des métropoles sont obligés de donner de ces denrées, quand ils les reçoivent des planteurs, au prix qu’ils en donneraient s’ils les recevaient des pays où les travaux sont exécutés par des hommes qui ne sont point esclaves.
Nous avons vu ailleurs que la population de la Martinique se composait, en 1815, de 77 577 esclaves, de 8 630 gens de couleur libres, et de 9 206 blancs. Dans la Guadeloupe, ces trois classes de la population existent à peu près dans les mêmes proportions. Ainsi, dans nos colonies, sur deux personnes libres de toute couleur, on compte neuf esclaves, ou quatre esclaves et demi par personne libre. Dans l’île de Cuba, la population, qui est portée à 722 000, se divise en 465 000 esclaves et 257 000 personnes libres de toute couleur ; c’est un peu moins de deux esclaves par personne libre. Quelles sont cependant celles de ces îles dans lesquelles le sucre est produit au plus bas prix ? C’est celle où il y a moitié moins d’esclaves que dans les autres, comparativement au nombre des personnes libres. Suivant M. J.-B. Say, la France paie à la Martinique et à la Guadeloupe le sucre qu’elle reçoit de ces colonies, sur le pied de cinquante francs les cent livres, non compris les droits, et les obtiendrait à la Havane pour trente-cinq francs, non compris les droits également. La différence est donc de près d’un tiers en faveur du pays qui, comparativement à la population libre, possède le moins d’esclaves [369].
Lorsque nos colonies et les colonies hollandaises sont tombées sous la puissance anglaise, le sucre produit par ces colonies a été admis en Angleterre, moyennant les droits payés par ses anciennes colonies ; mais lorsque le sucre de l’Inde, cultivé par des mains libres, est venu en Angleterre en concurrence avec celui qu’on fait venir dans les colonies au moyen du travail des esclaves, il a fallu établir, sur le premier, un droit d’entrée énorme pour protéger la vente du second. Cependant, pour transporter des denrées de l’Inde jusqu’en Europe, il en coûte infiniment plus que pour les transporter des îles d’Amérique. Il faut ajouter que les procédés employés par les cultivateurs indiens pour extraire le suc de la canne à sucre, sont grossiers, longs et dispendieux. Ces cultivateurs ne connaissent pas les machines que l’industrie des peuples d’Europe a introduites dans leurs colonies. Il leur faut, pour extraire le sucre, un emploi considérable de main-d’œuvre et de combustible. S’ils connaissaient nos procédés, ils pourraient livrer cette denrée à un prix plus bas encore [370].
Un voyageur recommandable assure que le sucre blanc de première qualité se vend, à la Cochinchine, à raison de trois piastres ou seize francs de notre monnaie le quintal cochinchinois, qui équivaut à cent cinquante de nos livres, poids de marc, ce qui ne fait presque que deux sous de France la livre. À ce prix, dit M. Say, la Chine en tire plus de quatre-vingts millions de livres tous les ans. En ajoutant à ce prix trois cents francs pour cent, pour les frais et les bénéfices du commerce, ce sucre blanc ne nous reviendrait, en France, qu’à huit ou neuf sous la livre [371].
Cette différence en faveur des productions obtenues par des cultivateurs libres, sur les productions obtenues par des esclaves, est si grande qu’elle paraît d’abord incroyable. Comment concevoir, en effet, que des cultivateurs libres qui sont privés des procédés et des machines employés dans nos colonies, et qui sont placés à une double distance, puissent cependant nous offrir leurs productions à un prix inférieur à celui que les colons sont obligés d’en exiger ? Les faits que j’ai précédemment rapportés expliquent ce phénomène : nous avons vu que, partout où le travail est exécuté par des esclaves, il est plus cher que dans les pays où il est exécuté par des mains libres. Au cap de Bonne-Espérance, la journée du travail d’un esclave, qui ne vaut que la moitié de la journée d’un homme libre, se paie cependant 2 fr. 50, et elle se paie un peu plus de 5 fr. dans la Louisiane, où la journée d’un homme libre vaut plus du double, parce que le nombre d’esclaves y est encore plus considérable. Dans nos colonies, le prix de la journée d’un esclave est un peu moins élevé ; on le porte à environ 4 fr. ; supposant qu’il soit seulement de 3 fr., le planteur des colonies devra, dans cette supposition, donner, pour la journée d’un esclave, une somme dix fois plus forte que celle que donne un cultivateur de l’Inde pour la journée d’un homme libre ; car, dans ce dernier pays, un ouvrier libre se contente de 30 centimes par jour. Peut-on être surpris, en présence de tels faits, qu’un cultivateur auquel le travail ne coûte que la dixième partie de ce qu’il coûte à d’autres, puisse donner ses denrées à meilleur marché ?
La quantité de sucre qui se consomme annuellement en France, est de cinquante millions de kilogrammes ou de cent millions de livres [372]. Ce sucre, à raison de 50 fr. les cent livres, nous coûte cinquante millions. Si, au lieu de l’acheter dans des îles où il existe quatre esclaves et demi pour une personne libre, nous l’achetions dans une île où il existe moitié moins d’esclaves, nous ne le paierions que trente-cinq millions, c’est-à-dire que nous ferions une économie de quinze millions. Si nous l’achetions dans les pays où les travaux de l’agriculture sont exécutés par des ouvriers libres, l’économie serait plus grande ; car, nous paierions vingt-cinq millions de moins. La préférence donnée aux productions des peuples libres nous procurerait des avantages bien plus grands encore ; la consommation du sucre deviendrait plus étendue, plus générale : une multitude de personnes qui sont obligées de s’en priver ou d’en restreindre leur consommation, au prix où il est actuellement, en achèteraient ou en consommeraient davantage, s’il se vendait à plus bas prix.
Ainsi, en donnant la préférence aux productions que nous vendent les possesseurs d’hommes de nos colonies, nous leur donnons gratuitement, sur une seule denrée, au moins quinze millions toutes les années. Nos sacrifices ne s’arrêtent pas là : nous payons, en outre, plus de la moitié de leur administration ; nous payons les troupes qui les gardent, les navires qui les protègent. Suivant le rapport du ministre de la marine, fait en 1820, l’administration intérieure des deux Antilles, coûte annuellement 11 860 000 fr. ; sur cette somme, les recettes locales ne fournissent que 5 790 000 fr., de sorte qu’il nous reste à payer un peu plus de six millions. Il faut ajouter les dépenses d’une marine militaire, les dépenses que fait, en France, l’administration chargée de cette partie du gouvernement, et ce qu’il faut payer les autres denrées équinoxiales, en sus de ce qu’elles nous coûteraient ailleurs. Enfin, il faut observer que toutes ces dépenses sont calculées sur l’état de paix, et qu’en cas de guerre, les frais de garde des colonies deviennent immenses. En évaluant toutes ces dépenses à cinquante millions, ce n’est pas les porter trop haut [373].
Mais les possesseurs d’hommes des colonies assurent que ces dépenses ne sont pas faites en pure perte, et que nous en retirons des avantages d’une valeur égale, si même elle n’est pas supérieure. Ces avantages se renferment tous dans le monopole que la France exerce dans les colonies, pour la vente de tous ses produits. Il faut donc que les cinquante millions que nous coûtent annuellement nos colonies, se trouvent dans les profits que fait le commerce, en leur apportant nos marchandises. Je ne saurais dire précisément quelles sont les valeurs que la France envoie dans ses colonies ; mais il est, pour s’en assurer, des moyens que nous pouvons en quelque sorte considérer comme infaillibles. Le premier est d’examiner quels sont le nombre et les ressources des diverses classes de la population coloniale. Le second est d’examiner quelles sont les valeurs que les colonies envoient à la mère-patrie. Il est évident, d’un côté, que les habitants des colonies ne peuvent pas acheter de nos produits au-delà de la valeur de leurs propres revenus. Il n’est pas moins évident, d’un autre côté, que les valeurs qu’ils reçoivent ne peuvent jamais être qu’en raison de celles qu’ils envoient.
En portant le nombre des esclaves de la Guadeloupe et de la Martinique à 200 000 individus, ce serait l’estimer très haut ; supposons cependant qu’il en existe un tel nombre. Quels sont les bénéfices que peuvent faire, sur cette classe de la population, l’industrie et le commerce de France ? Il n’y a aucun bénéfice à faire ni sur leur nourriture, ni sur leur ameublement ; il faut donc que tous les bénéfices soient faits sur leurs vêtements. Mais quelle est la dépense annuelle que fait un individu asservi pour ses vêtements ? Les Anglais estiment qu’un esclave, quand il est bien entretenu, leur coûte, pour son habillement et pour son lit, pendant une année, 27 sh., environ 33 fr. 75[374]. Mais cette somme n’est dépensée que pour des esclaves qui sont parvenus à l’âge d’homme ; les enfants vont nus, ou peu s’en faut. Admettons, cependant, que la dépense est la même pour tous : dans cette supposition, la population esclave des deux Antilles consommera de nos produits manufacturés pour une somme de 6 750 000 fr. ; mettons huit millions, de peur de rester au-dessous de la vérité.
Ces huit millions, payés par les maîtres pour l’habillement annuel des esclaves, ne seront pas un bénéfice net pour les marchands ou pour les fabricants ; car, ni les uns ni les autres n’obtiennent leurs marchandises pour rien. Le commerce français exerce un monopole dans nos colonies, pour la vente de tous nos produits ; mais ce monopole n’existe qu’à l’égard des autres nations. Les manufacturiers et les commerçants nationaux se font concurrence mutuellement, et chacun d’eux est obligé de se contenter du plus petit bénéfice possible. Quels peuvent être les bénéfices qu’ils font dans leur commerce avec les colonies ? je ne sais ; mais je crois l’estimer très haut en le portant à 25%. Ce sera donc deux millions de francs de bénéfice que laissera, toutes les années, le commerce auquel donneront lieu les besoins de la population esclave.
La classe des possesseurs d’hommes et celle des affranchis ont des besoins plus nombreux que la classe des esclaves, en même temps qu’elles ont plus de moyens de les satisfaire ; mais aussi le nombre des individus dont elles se composent est moins considérable. Cette partie de la population peut s’élever aujourd’hui de 30 000 à 35 000 individus ; dans ce nombre, il y a beaucoup d’affranchis dont quelques-uns ont de l’aisance, dont plusieurs ne possèdent presque rien ; il y a aussi beaucoup de possesseurs de terres qui sont accablés de dettes, et qui sont par conséquent obligés de réduire leurs dépenses autant qu’il leur est possible. C’est cependant avec les hommes de cette classe qu’il faut que les négociants français fassent un commerce assez étendu pour recouvrer les sommes énormes que nous coûtent les colonies. En portant encore ici les bénéfices à 25%, il faudra qu’il y ait pour environ 235 millions d’affaires toutes les années. Lorsqu’on aura fait des ventes pour une telle somme, on aura recouvré les dépenses que nous coûtent les colonies ; mais on n’aura pas encore fait un centime de bénéfice ; les profits ne commenceront que quand toutes les dépenses seront couvertes.
La population de la Martinique et de la Guadeloupe est à peu près ce qu’elle était en 1775 ; l’agriculture n’a fait aucun progrès ; et, les terres, loin d’y être plus fertiles, le sont probablement moins, puisqu’elles sont plus épuisées. Cependant, quelles étaient à cette époque les valeurs exportées de ces deux îles ? La première exportait des denrées pour près de 19 millions de livres tournois ; la seconde en exportait pour un peu moins de 13 millions [375]. La valeur totale des denrées exportées par les principales colonies qui nous restent, ne s’élevait donc pas tout à fait à 32 millions ; de sorte qu’en admettant que ces îles sont encore aussi fertiles qu’elles l’étaient alors, la France serait en perte avec elles, quand même elles lui enverraient toutes leurs productions pour rien. Il est vrai que le commerce peut faire quelques bénéfices avec les habitants de l’île Bourbon ; mais ces bénéfices se réduisent également à fort peu de chose [376].
Il est, en Europe, peu de villes d’une grandeur moyenne qui ne pussent offrir à l’industrie et au commerce français, un débouché plus avantageux que celui qui nous est offert par toutes les colonies dont nous sommes tributaires, et que nous prétendons posséder. Cependant, quel est l’homme de bon sens qui oserait proposer de donner, même à une des plus considérables, 40 ou 50 millions toutes les années, sous la seule condition qu’elle viendrait se pourvoir chez nous des produits manufacturés dont elle aurait besoin ? La ville de Genève, par exemple, est infiniment plus riche que toutes nos colonies ensemble ; elle fait donc annuellement beaucoup plus de consommation. Je suis persuadé, néanmoins, que, si nous lui offrions de lui faire une rente annuelle seulement de 30 millions, elle s’engagerait à acheter de nos marchandises au prix courant, de préférence à toutes les autres nations du monde. Il est vrai qu’elle en achète beaucoup, sans que nous ayons besoin de nous ruiner pour obtenir sa pratique ; mais, par la même raison, les colons en achèteraient également, quand même nous ne dépenserions pas dix centimes pour les garder ou les administrer.
Enfin, une nation ne vend rien à ceux de qui elle ne veut rien recevoir en échange ; lorsque, dans l’achat des denrées équinoxiales dont nous avons besoin, nous donnons la préférence aux uns, nous repoussons par cela même la pratique des autres. Pour vendre les produits de nos fabriques à des colons de la Martinique ou de la Guadeloupe, nous sommes obligés de recevoir leurs denrées qu’ils nous vendent très cher ; mais, quand nous avons reçu ces denrées, nous sommes obligés de repousser les denrées de même nature qui nous sont offertes par d’autres peuples ; en les repoussant, nous mettons ceux qui les produisent dans l’impossibilité d’acheter chez nous les produits qui leur conviennent, et que nous avons le désir de leur vendre ; c’est-à-dire, en d’autres termes, que nous repoussons de bonnes pratiques pour en avoir de mauvaises. Tel peuple, par exemple, consentirait à échanger la valeur de cent kilogrammes de sucre contre la valeur d’un mètre de drap ; et nous donnons la préférence à un peuple qui ne nous donne que cinquante kilogrammes de sucre pour la même valeur, et qui exige de plus que nous fassions des dépenses énormes pour conserver sa pratique.
L’Angleterre se conduit à l’égard de ses colonies comme la France à l’égard des siennes. Comme la consommation des denrées coloniales est encore plus considérable chez elle qu’elle ne l’est chez nous, comparativement à la population, les pertes qu’elle fait sont beaucoup plus grandes. En France, la consommation annuelle de sucre est d’environ trois livres trois onces par personne ; en Angleterre, elle est de seize à dix-sept livres. La quantité de sucre consommée annuellement dans la Grande-Bretagne, est d’environ 150 000 tonneaux, ou 300 millions de livres. Quoique cette consommation paraisse immense, elle est cependant de beaucoup au-dessous de ce qu’elle serait si des droits d’entrée énormes et le monopole accordé aux planteurs, ne mettaient pas une grande partie de la population dans la nécessité de se priver de cette denrée, ou d’en réduire la consommation. On estime que, si le prix du sucre était réduit au prix où il tomberait naturellement si le commerce était libre, la Grande-Bretagne en consommerait quatre ou cinq fois plus qu’elle n’en consomme actuellement [377].
Afin de mettre les possesseurs d’hommes des colonies à même de vendre leur sucre, il a fallu établir des impôts énormes sur cette denrée, quand elle est produite dans d’autres pays. Le sucre de l’Inde est produit dans les possessions anglaises ; mais il est cultivé par des ouvriers libres. Le trajet qu’il a à parcourir, pour arriver jusqu’en Angleterre, en élève le prix d’environ un tiers. Cependant, il a fallu établir un impôt de dix schellings (12 fr. 50) par quintal, en sus de l’impôt qui pèse sur le sucre des Antilles. Outre cet impôt, et afin de faciliter encore davantage aux planteurs la vente de leur sucre, on paie, à la sortie de cette denrée, une somme plus forte que celle qu’elle a payée à l’entrée. La différence est d’environ 7 fr. 50 par quintal [378].
Les possesseurs d’hommes des colonies n’ont pas obtenu seulement le monopole de la vente du sucre, par l’effet des impôts énormes qui ont été mis sur tous les sucres produits ailleurs que dans les îles d’Amérique ; ils ont obtenu, par le même moyen, un monopole semblable sur presque toutes les denrées équinoxiales. Outre ces charges qui pèsent sur tous les habitants de la Grande-Bretagne, et qui les obligent à payer très cher une multitude d’objets qu’ils pourraient obtenir à bas prix, la défense militaire et navale des colonies coûte, en temps de paix, 1 600 000 liv. st., c’est-à-dire près de 40 millions de francs. En réunissant, dit un écrivain anglais, les dépenses directes que nous coûtent la conservation et la défense de nos colonies, la prime accordée à l’importation des sucres, les droits d’entrée établis sur cette denrée et sur un grand nombre d’autres, dans la vue de favoriser exclusivement la vente des denrées coloniales, les restrictions mises à notre commerce avec l’Inde et avec d’autres parties du monde afin de favoriser les possesseurs d’esclaves, ce serait estimer très bas la perte annuelle que nous faisons pour maintenir ce funeste système, que de la porter à quatre millions de livres sterling, à quoi il faut ajouter l’opprobre et les crimes qui en sont inséparables [379].
Quels sont les avantages que les Anglais achètent par ces énormes sacrifices ? Les denrées équinoxiales leur sont-elles livrées gratuitement par les possesseurs d’esclaves ? Leur sont-elles vendues au-dessous du prix qu’en exigeraient des cultivateurs libres ? Au contraire, elles leur sont vendues à un plus élevé. Le seul avantage qu’ils obtiennent est de vendre exclusivement les produits de leurs manufactures aux habitants de leurs colonies ; et cet avantage se réduit à acheter la pratique de 800 000 ou 900 000 individus qu’on appelle des esclaves, et qui sont plus misérables que les mendiants d’aucun des États de l’Europe, et la pratique de quelques milliers d’individus qu’on appelle des maîtres, et dont la plupart sont écrasés de dettes. Si les Anglais calculaient quelle est la quantité de marchandises qu’ils doivent vendre aux possesseurs d’hommes, pour recouvrer les dépenses qu’ils font dans la vue de s’assurer leur pratique, ils se convaincraient que ce qu’ils ont de mieux à faire est de leur livrer leurs marchandises pour rien, et d’acheter, à ce prix, la liberté du commerce. Avec la moitié des sommes qu’ils dépensent annuellement pour les colonies, les négociants anglais obtiendraient, pour la vente de leurs marchandises, un monopole bien plus étendu que celui qu’ils ont dans leurs colonies. S’ils offraient, par exemple, au gouvernement d’Espagne une rente annuelle de deux millions de livres sterling, pour acquérir le privilège de vendre, dans la péninsule, les produits de leurs manufactures, il n’est pas douteux que le marché serait accepté avec reconnaissance. Ce traité serait infiniment moins désavantageux pour l’Angleterre, que son système colonial, puisqu’il lui coûterait moitié moins, qu’il lui donnerait un nombre de pratiques dix fois plus considérable, et que chacune de ces pratiques aurait le moyen de lui acheter une plus grande quantité des produits de ses manufactures. Les Espagnols les plus pauvres le sont, en effet, beaucoup moins que les esclaves des colonies, et ceux qui jouissent de quelque aisance sont plus nombreux et plus riches que les possesseurs d’esclaves.
On conçoit qu’une nation dont l’industrie est encore grossière, et qui est moins avancée que ne le sont les autres, achète d’abord ses pratiques ou leur donne ses marchandises pour rien, dans l’espérance qu’elle parviendra à faire mieux, et qu’elle regagnera ce qu’elle aura perdu ; c’est encore un très mauvais calcul, mais on le conçoit, parce qu’il peut être fondé sur quelque apparence de raison. Mais conçoit-on également que les nations qui sont les plus avancées dans l’industrie, qui fabriquent mieux et à plus bas prix que toutes les autres, fassent des frais énormes pour acheter des chalands ? Si l’Angleterre ni la France n’accordaient aucun privilège aux possesseurs d’hommes des îles ou du continent d’Amérique, si elles renonçaient l’une et l’autre au monopole qu’elles entendent exercer pour la vente de leurs produits manufacturés, quels sont les peuples auxquels ces possesseurs d’hommes iraient offrir leurs denrées et acheter des marchandises ? Quels sont les peuples qui pourraient leur offrir des objets mieux fabriqués et moins chers ? Quels sont ceux qui pourraient ouvrir un débouché plus large à leurs propres produits ? Les pays qui n’ont point de colonies, tels que l’Italie, l’Allemagne, la Suisse, les États-Unis d’Amérique, achètent les denrées équinoxiales à plus bas prix que la France et l’Angleterre ; si nous abandonnions à elles-mêmes nos misérables colonies, nous serions dans le même cas que les peuples qui n’en ont point ; nous paierions les denrées équinoxiales à un prix moins élevé ; nous éviterions une dépense annuelle d’environ cinquante millions, et nous vendrions une quantité un peu plus considérable de nos produits manufacturés.
Il semble, au premier aperçu, qu’en se réservant dans leurs colonies le monopole de la vente de leurs produits manufacturés et en donnant aux colons le monopole de la vente de leurs denrées dans la mère-patrie, les nations industrieuses ont traité d’égal à égal avec les possesseurs d’hommes, et que, par conséquent, les avantages et les désavantages sont réciproques : mais il n’en est point ainsi ; tous les désavantages sont du côté des peuples chez lesquels il n’existe point d’esclaves.
L’industrie manufacturière d’un peuple n’est pas bornée par l’étendue de son territoire ; sur un espace de quelques lieues carrées, il se développe quelquefois une industrie plus étendue que celle qui peut se développer dans un vaste empire. L’industrie et les richesses qui existent dans les villes de Paris ou de Londres, par exemple, excèdent probablement celles qui existent dans l’ancienne Pologne, et elles peuvent s’accroître indéfiniment. Les produits manufacturés n’ont pas d’autres bornes que l’étendue des capitaux et les besoins des consommateurs. Les progrès des lumières rendent de jour en jour la production moins dispendieuse et plus parfaite ; il est une multitude de choses qu’on peut avoir aujourd’hui pour le quart de ce qu’elles coûtaient jadis, quoiqu’elles soient d’une qualité supérieure.
Mais l’industrie agricole n’est pas dans le même cas, surtout chez les peuples où tous les travaux sont exécutés par des esclaves. Les produits agricoles sont bornés par l’étendue du sol, par les capitaux qu’il est possible d’employer à l’agriculture, et par l’incapacité des maîtres et des esclaves. Les îles à sucre sont bornées, et il ne dépend pas des possesseurs d’en étendre les limites. J’ai fait voir ailleurs que l’esclavage réduit les facultés intellectuelles des maîtres et des esclaves dans les limites les plus étroites, surtout dans ce qui est relatif à l’industrie. J’ai également prouvé que les possesseurs d’hommes, loin d’avoir de nouveaux capitaux à consacrer à la culture, sont en général accablés de dettes. Enfin, j’ai fait voir que les terres exploitées par des esclaves, sous la direction de propriétaires qui n’ont point de capitaux, deviennent de moins en moins productives [380].
[IV-433]
Ainsi, tandis que, d’un côté, les richesses et la population se multiplient, que les produits manufacturés sont offerts en plus grande abondance et à plus bas prix, et que les demandes des denrées équinoxiales s’accroissent, la production de ces denrées reste concentrée dans le même espace, et devient de plus en plus chère. Les possesseurs d’hommes sont donc les seuls qui aient un véritable monopole, puisque le nombre en est invariable et qu’aucun ne peut augmenter l’étendue de ses possessions ; tandis que le nombre des consommateurs des denrées coloniales s’accroît indéfiniment, et que les produits des manufactures s’élèvent toujours au niveau des besoins ou des demandes.
En Angleterre, la consommation du sucre a décuplé dans l’espace d’un peu plus d’un siècle ; elle n’était que de 15 000 tonneaux en 1700 ; en 1730, elle fut de 42 000 ; en 1760, de 58 000 ; elle fut de 81 000 en 1790, et de 150 000 en 1820 ; mais depuis 1700 jusqu’en 1820, le nombre des colonies anglaises s’est augmenté dans la même proportion, et une plus grande quantité de terres ont été mises en culture [381]. Depuis environ trente années seulement, la population française s’est augmentée de cinq millions d’individus ; l’industrie a fait des progrès plus rapides encore ; les richesses de chacun se sont par conséquent augmentées, et avec elles la demande des denrées équinoxiales ; mais la production de ces denrées a-t-elle suivi la même progression ? Elle a suivi une progression inverse ; il y a trente-cinq ou quarante ans, les possesseurs d’hommes de Saint-Domingue, ceux de l’île de France, ceux de la Louisiane, ceux de la Martinique, de la Guadeloupe, et d’autres, se faisaient concurrence dans la vente de leurs denrées. Aujourd’hui, il n’y a plus de concurrence possible, et l’on ne conçoit pas même que les trois îles qui ont la jouissance du monopole, puissent produire les denrées équinoxiales qui se consomment en France ; on le conçoit d’autant moins que la consommation s’est accrue en même temps que le nombre des colonies a diminué des trois quarts.
On a vu qu’en Angleterre, la consommation du sucre est de quinze à dix-sept livres par personne, et qu’en France elle n’est que d’environ trois livres et un quart. La France, pour en consommer dans la même proportion que l’Angleterre, devrait donc en recevoir au moins cinq fois plus que ses colonies ne peuvent en produire ; et, s’il est vrai qu’en Angleterre la consommation pourrait être cinq fois plus forte, la France ne pourrait faire les mêmes progrès qu’en ayant vingt-cinq ou trente fois plus de colonies qu’elle n’en possède. Il faut même observer que, si le monopole accordé aux habitants de trois misérables îles, n’élevait pas le prix du sucre au point de le mettre hors de la portée de la masse de la population, cette denrée serait employée à la préparation et à la conservation de nos fruits, et que, par conséquent, la consommation pourrait en être portée bien plus loin qu’elle ne peut l’être en Angleterre. La conservation des fruits, au moyen du sucre, donnerait aux agriculteurs le moyen de les multiplier et de les livrer au commerce ; et les peuples du midi auraient un nouveau moyen d’échange avec les peuples du nord.
J’ai fait observer précédemment que, pour obtenir le travail d’un esclave, un maître lui en paie une petite partie en denrées ou en vêtements, et l’autre partie en coups de fouet. Nous ne pouvons considérer ce qui est acquis avec ce dernier genre de monnaie, autrement que nous considérons les bénéfices faits par les individus qui vont rançonner les voyageurs sur les grands chemins. Ainsi, quand nous accordons un monopole aux denrées vendues par des possesseurs d’hommes, au préjudice des propriétaires qui vendent les mêmes denrées, mais qui ne font cultiver leurs terres que par des personnes libres, nous sommes dans le même cas qu’un homme qui refuserait d’acheter des marchandises de ceux qui les ont produites, et qui ne voudrait acheter que des marchandises volées. Un tel commerce, fait par un malhonnête homme, serait naturel, si les marchandises volées étaient livrées à un prix beaucoup plus bas que le prix courant du commerce ; mais, si les voleurs, considérant les dangers de leur profession, en demandaient un prix plus haut que le prix courant, que penserions-nous de celui qui leur donnerait la préférence ? Nous penserions que cet homme-là porte l’improbité jusqu’à l’extravagance. Cependant, quelle est la différence que nous pourrions assigner entre lui et un peuple qui paie chèrement des denrées dont les possesseurs n’ont payé la valeur qu’à coups de fouet, et qui repousse des denrées de même nature qu’on lui offre à plus bas prix, et que les possesseurs ont légitimement acquises ?
En exposant les effets que l’esclavage produit sur les richesses, j’ai fait voir que, s’il est pour les esclaves une source de calamités, il est pour les maîtres une cause de ruine ; de là, nous pouvons tirer la conséquence que la tyrannie n’est guère moins funeste à la race des oppresseurs qu’à celle des opprimés. Nous pouvons maintenant pousser cette conséquence un peu plus loin ; nous pouvons dire que, si la domination qu’un individu exerce sur d’autres, est tôt ou tard une cause de ruine pour lui ou pour sa race, la domination qu’un peuple exerce sur un autre peuple, est également pour lui une cause de despotisme et de ruine.
Les peuples au milieu desquels il existe des esclaves, exercent, ainsi qu’on l’a vu, une funeste influence sur les peuples chez lesquels l’esclavage n’existe point. De même, les nations qui tiennent d’autres nations sous leur dépendance, exercent une influence qui n’est pas moins funeste, sur celles qui ne sont ni asservies ni dominatrices. Une partie considérable de l’Amérique du sud pourrait nous fournir, à des prix très modérés, toutes les denrées équinoxiales. Les terres propres à la culture de ces denrées sont tellement vastes que, quelque étendus que soient nos besoins, la production pourra toujours être mise au niveau de la demande. En échange de leurs denrées, les peuples qui habitent ces contrées ne nous demandent ni or, ni argent, car ces matières ont chez eux un peu moins de valeur que chez nous. Ils nous demandent des produits de nos manufactures, et, comme chez eux les cultivateurs sont libres, ils peuvent en absorber une quantité immense. Ils ne nous demandent pas non plus, pour recevoir nos marchandises, que nous nous chargions de payer leurs administrateurs, leur armée, la marine qui les protège. Avec eux, tout serait profit, et les échanges pourraient s’accroître à l’infini ; mais nous les repoussons par la raison toute naturelle que des sujets qui nous ruinent valent mieux que des amis qui nous enrichiraient. Je dis que nous les repoussons, quoique nous allions leur offrir nos marchandises ; car ils ne peuvent donner, en échange des produits étrangers, que les produits qui viennent chez eux.
Plusieurs des peuples de l’Amérique méridionale chez lesquels l’esclavage est aboli, possèdent des terres immenses qui n’ont jamais été mises en culture, et qui sont susceptibles de produire des denrées équinoxiales beaucoup plus qu’ils ne peuvent en consommer. Il faudrait, pour que ces terres fussent mises en culture, qu’il se trouvât des peuples qui eussent besoin d’en acheter les produits, et qui pussent donner en échange les objets dont on manque dans le pays. Mais où trouver de tels peuples ? Les Anglais ne demanderont pas de vendre aux cultivateurs de l’Amérique du sud les produits de leurs manufactures ; mais ils refuseront de recevoir en échange des produits agricoles, tels que le sucre, le café, l’indigo et d’autres. Les Français se montreront aussi fort empressés de leur porter des produits manufacturés, mais à condition que des agriculteurs ne donneront pas en échange des produits de leur agriculture, c’est-à-dire les seules richesses dont ils puissent disposer. Il faudra donc que les agriculteurs, pour acheter des produits de l’industrie française ou de l’industrie anglaise, trouvent ailleurs des peuples qui consentent à recevoir leurs productions. Ils ne peuvent pas les porter dans l’Inde ou dans le sud de l’Asie ; car là ils trouveraient les mêmes denrées produites à meilleur marché. Ils ne peuvent pas les porter chez les Asiatiques du nord ; car, outre qu’il n’y a point de route qui les y conduise, ils n’y trouveraient rien à recevoir en échange. Il faut donc qu’ils les portent chez les Anglo-Américains du nord, ou chez les peuples d’Europe qui n’ont point de colonies ; mais ces peuples ont peu de chose à leur donner en retour. La Russie peut fournir à l’Angleterre du bois de construction, du chanvre, du suif, du blé, et quelques autres matières premières ; mais que peut-elle donner aux peuples qui vivent entre les tropiques ? Ainsi, en même temps que les peuples industrieux se ruinent et arrêtent le développement de leur commerce par les monopoles qu’ils accordent, chez eux, aux possesseurs d’esclaves, ils arrêtent le développement de la civilisation dans les parties les plus fertiles et les plus riches de la terre.
Les monopoles que les nations industrieuses accordent, chez elles, aux possesseurs d’hommes de quelques colonies, ont un effet qu’elles n’ont pas prévu ; c’est de créer des monopoles en faveur d’autres nations qu’elles considèrent souvent comme rivales ou comme ennemies. Supposons, en effet, qu’une puissance telle que la Russie, voulant acheter au plus bas prix possible les denrées équinoxiales, rend un décret par lequel elle interdit aux nations les plus industrieuses d’acheter ces denrées dans les pays où la main-d’œuvre est à très bas prix, par la raison qu’il n’y a point d’esclaves ; supposons de plus qu’elle leur enjoint d’aller se pourvoir dans des îles où les mêmes denrées sont très chères, où les neuf dixièmes de la population vivent dans la misère la plus profonde, et où l’autre dixième est accablé de dettes ; supposons, enfin, qu’après s’être réservé le marché le plus avantageux pour l’achat comme pour la vente, elle a une force suffisante pour faire exécuter ses décrets ; quel est l’homme qui ne considérerait point cette mesure comme la plus oppressive et la plus propre à ruiner l’industrie et le commerce des peuples qui seront obligés de s’y soumettre ? Cependant, quelles seraient les différences entre cette mesure et le système que les peuples à colonies font exécuter avec tant d’opiniâtreté ? Il y en aurait deux : dans un cas, ce serait la nation réputée oppressive qui paierait les frais de l’oppression, tandis que, dans le système actuel, ce sont les nations contre lesquelles la prohibition est portée, qui en paient elles-mêmes les frais ; la seconde différence consisterait en ce que, dans le premier cas, on éviterait les maux de la défense par la contrebande, tandis qu’on ne peut pas les éviter dans le second.
En définitive, le seul commerce étranger qui peut laisser un grand bénéfice, est celui que l’on fait avec une population nombreuse, dont tous les individus vivent dans l’aisance, sont bien nourris, bien vêtus, et ont toujours quelque chose à vendre et à acheter. Le commerce étranger le moins avantageux est, au contraire, celui que l’on fait avec une population dont les neuf dixièmes vivent dans une profonde misère, et ne peuvent se procurer ni meubles, ni vêtements, ni aliments, et où l’autre dixième, accablé de dettes, est sans cesse à la veille de faire banqueroute.
On a pu voir, par la lecture de cet ouvrage, qu’il existe la plus grande analogie entre les peuples soumis au régime de l’esclavage, les peuples qui ne sont jamais sortis de la barbarie, et les peuples soumis aux gouvernements les plus despotiques : or, il n’est pas concevable que, pour entretenir avec de tels peuples des relations de commerce exclusives, on repousse les relations commerciales de peuples civilisés ; qu’on donne ainsi à d’autres nations, considérées comme rivales, les monopoles des marchés les plus avantageux, et qu’on fasse des dépenses énormes pour arriver à ce beau résultat.
Ce que pourraient faire de plus sage les peuples qui paient un tribut immense à des colonies sur lesquelles ils prétendent régner, serait donc de renoncer à leur empire ; mais les peuples ne tiennent pas moins que les princes à tout ce qui a les apparences du commandement : l’Espagne, sous le régime des cortès, nous en a donné un mémorable exemple. Qu’ils gardent donc leurs colonies, puisqu’il leur plaît de se ruiner pour elles ; mais qu’ils tâchent du moins de les faire cultiver par des hommes libres ; ils y trouveront un grand nombre d’avantages. En premier lieu, les denrées équinoxiales étant produites à moins de frais, ils les achèteront à meilleur marché. En second lieu, une population de fermiers et d’ouvriers remplaçant une population d’esclaves, ils vendront une quantité plus considérable de leurs produits manufacturés. En troisième lieu, les propriétaires des terres ayant cessé d’être oppresseurs, nulle partie de la population n’aura besoin de se mettre en garde contre une autre, et les soldats d’Europe seront inutiles. Enfin, toutes les classes d’hommes étant plus riches, nous n’aurons pas à payer les frais de leur administration.
Le système colonial présente des inconvénients très graves ; mais il ne faut pas croire qu’il ne donne de profits à personne. Quand on a des colonies, il faut avoir des gouverneurs, des sous-gouverneurs et autres employés qu’on paie chèrement. Il faut avoir aussi une nombreuse marine, et par conséquent des capitaines de vaisseaux, des amiraux, des ingénieurs, des ministres, des commis, et une foule d’autres personnes qui vivent de leurs emplois. Tous ces intérêts méritent sans doute d’être considérés ; il s’agit seulement de ne pas les évaluer au-delà du bien qu’en retirent les intéressés.
[IV-443]
CHAPITRE XX.↩
De la protection accordée aux esclaves contre les violences ou les cruautés de leurs maîtres, par les gouvernements des métropoles.
Lorsque la plupart des gouvernements européens autorisèrent leurs sujets à mettre des êtres humains et vivants au nombre de leurs marchandises, et qu’ils classèrent ainsi des hommes, des enfants et des femmes au rang des choses, ils prévirent, sans doute, une partie des violences et des crimes qui allaient résulter de ce nouveau régime : afin de rassurer leurs consciences à cet égard, plusieurs essayèrent de tracer des limites au pouvoir des maîtres sur leurs esclaves ; quelques-uns laissèrent aux autorités coloniales composées de maîtres, le soin de limiter elles-mêmes leur puissance.
Il est souvent arrivé qu’on a jugé des mœurs des maîtres et du sort des esclaves, par les règlements destinés à limiter la puissance et à déterminer les devoirs des premiers à l’égard des seconds : dans ce cas, comme dans beaucoup d’autres, on a pris des descriptions pour des réalités, et des mots pour des puissances. J’ai fait voir, dans les chapitres précédents, que le sort des esclaves dépend surtout du genre d’occupation auquel ils sont employés, de la proportion qui existe entre le nombre des individus libres et le nombre des individus asservis, et de l’action qu’exercent les nations chez lesquelles l’esclavage est aboli, sur celles chez lesquelles il existe encore. J’ai fait voir également, qu’il est peu de violences ou de cruautés dont un maître s’abstienne par la crainte des amendes ou des châtiments, toutes les fois qu’il n’est pas retenu par son caractère moral ou par les forces qui agissent immédiatement sur lui. De ces faits, on peut tirer la conséquence que, si les règlements envoyés par les gouvernements d’Europe dans leurs colonies, n’arrivent pas accompagnés d’une puissance plus énergique et plus active que celle des maîtres, ils n’ont aucune influence sur leurs mœurs, ni sur le sort des esclaves.
Il est peu de voyageurs, en effet, qui n’aient observé l’inefficacité, et l’on peut même dire l’entière nullité de ces règlements. Le gouvernement hollandais avait défendu, sous peine d’amende, le meurtre ou l’assassinat des esclaves dans toutes ses colonies : on a vu cependant, qu’au cap de Bonne-Espérance et à Surinam, un maître qui assassine son esclave n’encourt aucune peine, et que, s’il assassine l’esclave d’autrui, il en est quitte pour en payer la valeur ; dans ces colonies, les magistrats même qui font des règlements pour la protection de la population asservie, sont les premiers à les violer [382].
[IV-445]
Dans les colonies anglaises, les règlements faits par les autorités locales ou par le gouvernement de la métropole, n’ont pas beaucoup plus de force, toutes les fois qu’ils ont pour but de modérer l’action que les maîtres exercent sur leurs esclaves ; l’inefficacité de ces règlements est un sujet continuel de plaintes pour les membres des sociétés qui se sont formées pour la protection et l’affranchissement des esclaves [383].
Dans la Louisiane, les règlements de cette nature n’ont pas eu plus d’effet ; non seulement ils n’ont pas mis les esclaves à l’abri des châtiments arbitraires, mais ils ne leur ont pas même garanti les aliments ou les vêtements qu’on avait jugé leur être dus [384].
Les colonies espagnoles, qui étaient celles où le gouvernement de la métropole avait le plus fait pour la protection des esclaves, n’ont éprouvé aucun avantage des règlements qui leur ont été donnés ; les hommes qui ont le plus admiré ces règlements en théorie, ont reconnu qu’en pratique ils avaient été sans effet [385].
S’il fallait s’étonner ici de quelque chose, ce ne serait pas de l’inefficacité des règlements envoyés aux possesseurs d’esclaves par les gouvernements des métropoles, ce serait de la confiance que ces règlements ont inspirée à ceux qui les ont faits ou sollicités. Une loi, je l’ai déjà dit, n’est que de la puissance, c’est une force qui subjugue des forces opposées ; mais un gouvernement ne multiplie pas la puissance au gré de ses désirs ; il ne l’expédie point par lettres, comme un marchand expédie une facture ou des échantillons de marchandise. Il peut envoyer des ordres partout, mais pour que ces ordres soient exécutés, il faut que les agents auxquels il en confie l’exécution, aient le désir de les faire exécuter ; il faut de plus que ces agents ne rencontrent pas une puissance opposée, qui soit plus énergique et plus persévérante que la leur.
Lorsqu’une population est divisée en deux fractions, et que la plus grande est considérée comme la propriété de la plus petite, il n’est pas possible de mettre des limites au pouvoir de celle-ci sur celle-là, à moins de détruire le principe qui en a été la base. Dans le système de l’esclavage, comme dans le système de la propriété, on commence par établir que le maître peut faire de son esclave ou de sa chose, tout ce qui ne lui est pas défendu par les lois. Ayant posé cette maxime on tâche de donner quelques limites au pouvoir absolu qu’on a établi ou dont on a reconnu l’existence : on fixe, par exemple, le nombre de coups de fouet qu’il sera permis de donner à l’esclave pour chaque offense ; on détermine la ration de vivres qu’on devra lui accorder, et les jours de repos dont il devra jouir. Mais, comme un tel règlement est toujours terminé par la clause exprimée ou sous-entendue, que tout ce qui n’est pas défendu au maître lui est permis, le domaine de l’arbitraire reste si vaste, que les limites qu’on y a mises ne produisent aucun bien : le possesseur d’hommes inflige sous une forme, le châtiment qui lui a été interdit sous une autre. Quelques exemples feront mieux sentir combien sont illusoires ces prétendues bornes posées au pouvoir des maitres.
Le gouvernement anglais a limité à vingt-cinq le nombre des coups de fouet qu’un maître peut infliger à un esclave dans un temps donné ; mais il n’a déterminé ni la nature des offenses pour lesquelles cette peine serait infligée, ni le mode de conviction, ni les dimensions du fouet, ni la force du bras qui infligerait le châtiment. Un maître peut donc, sans sortir des termes du règlement, se livrer à des cruautés effroyables envers chacun de ses esclaves ; car, vingt-cinq coups de fouet de charretier, appliqués par un bras vigoureux à un faible enfant, à un malade en convalescence, ou à une femme en état de grossesse, sont plus qu’il n’en faut pour les tuer ; le même supplice infligé à l’homme le plus fort et répété aussi souvent que le règlement le permet, peut rendre la vie tellement insupportable que la mort soit considérée comme un bienfait. Ce châtiment d’ailleurs n’exclut pas tous les autres ; la brutalité d’un possesseur d’hommes peut se manifester de mille manières : elle peut s’exercer par des menaces, par des injures, par des coups, par des travaux excessifs, par l’emprisonnement dans des cachots, et par une multitude d’autres moyens.
En supposant qu’il fût possible de calculer mathématiquement la force des coups de fouet qu’un maître peut faire infliger à un esclave dans un temps donné, on tomberait dans une erreur fort grave, si l’on s’imaginait que la cruauté ne consiste que dans l’intensité de la peine, considérée en elle-même. Ce qui fait qu’une peine est juste ou cruelle, modérée ou atroce, c’est moins la force du châtiment, que la proportion qui existe entre la peine et la nature du fait puni ; c’est la justice ou l’injustice de la punition infligée : qu’un maître fasse donner vingt-cinq coups de fouet à un esclave qui se sera rendu coupable de cruauté envers un de ses compagnons de servitude, la peine pourra être modérée ; qu’il fasse infliger le même châtiment à un individu coupable d’une légère négligence, la peine sera sévère ; qu’il le fasse infliger à un convalescent qui aura travaillé selon ses forces, mais non selon les désirs de son possesseur, la peine sera cruelle ; enfin, elle sera une atrocité révoltante, si elle est infligée à un esclave par la raison qu’il aura rempli un devoir ; si elle est infligée, par exemple, à une mère qui aura suspendu son travail pour donner des secours à son enfant, ou à une jeune fille, pour ne pas s’être livrée à la prostitution, à un père, parce qu’il aura voulu protéger sa fille ou sa femme.
L’obligation de faire procéder à l’exécution en présence d’un homme libre, et d’en dresser procès-verbal, n’est pas non plus une garantie : le maître ayant le choix du témoin et pouvant insérer dans son procès-verbal tel motif qu’il lui plaît d’assigner à sa vengeance, on ne peut avoir aucune certitude sur le nombre des coups de fouet qui ont été infligés, ni sur les causes pour lesquelles ils ont été donnés.
La fixation des aliments et des vêtements qui doivent être distribués aux esclaves, ne leur est pas beaucoup plus profitable que la fixation du nombre des coups de fouet. L’âge, le sexe, la santé, la maladie, le genre de travail auquel on se livre, modifient singulièrement le besoin qu’on a d’aliments. Il ne suffit pas d’ailleurs d’en déterminer la quantité, il faudrait aussi en fixer la qualité ; un maître qui aurait pris quelques-uns de ses esclaves en antipathie, ou qui voudrait s’en défaire, par la raison qu’ils ne lui seraient plus bons à rien, pourrait leur donner des aliments tels qu’en peu de temps il les conduirait au tombeau.
Mais ce qui rend surtout inefficaces les règlements envoyés par les métropoles à leurs colonies, et ceux mêmes qui sont faits par les autorités [IV-450] coloniales, c’est l’impossibilité d’en assurer l’exécution.
Il faut, pour que des ordres ou des défenses soient observés, que les individus auxquels ils sont adressés, soient disposés à s’y soumettre volontairement, c’est-à-dire qu’ils aient des idées et des passions conformes aux passions et aux idées de ceux par qui les défenses ont été faites ou les ordres ont été donnés ; ou bien il faut que les auteurs de ces ordres ou de ces défenses aient le moyen de convaincre et de punir les infracteurs. Si l’exécution des ordres que les gouvernements d’Europe intiment à leurs sujets européens, trouve peu d’obstacles, c’est d’abord parce que ces ordres sont généralement conformes aux vues d’une partie plus ou moins considérable de la population ; c’est, en second lieu, parce qu’il existe, sur toute l’étendue du territoire, de nombreux agents judiciaires, administratifs et militaires ; c’est, enfin, parce qu’il est facile de trouver des témoins pour convaincre les infracteurs, des accusateurs pour les poursuivre, des juges pour les condamner, des forces pour les punir.
Aucune de ces circonstances ne se rencontre quand il s’agit d’exécuter les ordonnances envoyées par les gouvernements des métropoles, aux possesseurs d’hommes des colonies. Il n’existe aucune identité de sentiment ou de pensées entre les uns et les autres. Les maîtres, ayant donné des valeurs sur lesquelles ils avaient un pouvoir incontestable et absolu, en échange de personnes appelées des esclaves, prétendent exercer sur ces personnes le même pouvoir qu’ils avaient sur les choses au moyen desquelles ils les ont acquises. Ils considèrent donc comme des atteintes à leurs propriétés, toutes les limites que les gouvernements aspirent à mettre à leur pouvoir sur la population asservie, et se sentent disposés à la résistance, comme nous y serions disposés nous-mêmes si l’on tentait de nous dépouiller de nos propriétés. Un gouverneur européen qui arrive dans une colonie, ayant dans son portefeuille la copie d’une ordonnance destinée à protéger les esclaves, se trouve tout à coup environné d’une population qui a, sur tous les points, des vues et des sentiments opposés aux ordres qu’il a reçus. Il peut avoir été accompagné d’un petit nombre d’officiers destinés à seconder l’exécution de ces ordres ; mais, lorsque ces officiers auront été placés sur les parties du territoire où ils doivent commander, chacun se trouvera environné d’hommes disposés à résister à leurs desseins, à les éluder, ou du moins à ne rien faire pour en faciliter l’exécution. Si ces envoyés sont fidèles à leurs devoirs, ils auront pour ennemis toute la race des maîtres, et la bienveillance de la population esclave ne sera pas pour eux un dédommagement ; il faudra qu’ils restent séquestrés chez eux, et qu’ils ignorent, par conséquent, ce qui se passe dans la colonie. S’ils se lient, au contraire, avec les possesseurs d’hommes, leur séjour parmi eux pourra devenir lucratif et agréable ; mais alors il faudra fermer les yeux sur les violences dont les esclaves seront l’objet.
Supposons, cependant, qu’un officier, envoyé dans une colonie, reste inébranlable dans ses devoirs, comment parviendra-t-il à faire exécuter ses ordres ? Comment fera-t-il punir ceux des maîtres qui ne s’y conformeront pas ? Comment saura-t-il ce qui se passe au milieu de chaque plantation ? Les esclaves viendront se plaindre, dira-t-on ; mais en auront-ils le courage ? La portion d’arbitraire dont tout maître pourra faire usage, ne sera-t-elle pas suffisante pour effrayer les esclaves, et pour les condamner au silence ? Un maître peut, sans encourir aucune peine, faire donner vingt-cinq coups de fouet de charretier à un esclave. Supposons que, trouvant la peine trop faible pour l’offense qu’il veut punir, il en fasse donner cinquante ; l’esclave châtié ira-t-il se plaindre ? Il le pourra, sans doute ; mais, après avoir reçu cinquante coups de fouet pour son délit, il en recevra trois cents pour sa dénonciation ; seulement, le maître aura soin, pour se mettre à l’abri de toute dénonciation nouvelle, de les distribuer de manière qu’ils ne puissent donner lieu à aucune plainte ; il en donnera douze fois vingt-cinq. Si, après une telle expérience, les esclaves continuent à se plaindre que les règlements n’ont pas été observés, il faudra croire que l’esclavage donne des vertus particulières, inconnues aux hommes libres.
Je veux admettre, toutefois, que la portion d’arbitraire laissée dans les mains des maîtres, ne suffira pas, quelque immense qu’elle soit, pour intimider les esclaves à l’égard desquels les règlements auront été violés. Dans cette supposition, les magistrats envoyés dans les colonies connaîtront les délits des possesseurs d’hommes à l’égard des hommes possédés ; mais comment convaincront-ils les coupables ? Où trouveront-ils des témoins ? Dans aucune colonie, le témoignage des esclaves n’est reçu en justice ; on a même refusé, dans quelques-unes, de recevoir, contre les blancs, le témoignage de personnes libres qui comptaient parmi leurs ancêtres quelque individu d’origine africaine. Mais, dans leurs plantations, les maîtres ou leurs agents ne sont environnés que d’esclaves ; ce sont des esclaves qui conduisent les travailleurs dans les champs à coups de fouet ; ce sont des esclaves qui font l’office de bourreaux, et quelquefois même de chirurgiens. Il n’y aura donc pas moyen de réprimer les violences commises par les maîtres, puisqu’il n’y aura pas moyen de les en convaincre. On ne peut pas compter sur le témoignage des individus d’origine purement européenne, d’abord parce que les exécutions ne se font qu’en présence des esclaves, et, en second lieu, parce que les possesseurs d’hommes font tellement cause commune entre eux contre les individus de la race des esclaves, qu’on ne peut pas espérer qu’ils concourent jamais à se convaincre mutuellement.
Les hommes qui, en Angleterre, luttent pour amener l’abolition graduelle de l’esclavage, ont très bien compris qu’il n’y avait aucun progrès à espérer, aussi longtemps qu’il n’y aurait pas moyen de convaincre et de condamner les possesseurs d’hommes qui abuseraient jusqu’à l’excès de leur puissance sur les personnes possédées ; ils sont même parvenus à faire partager leur conviction à leur gouvernement. Des ordres ont été expédiés, en conséquence, aux gouverneurs des principales colonies, pour qu’ils eussent à proposer aux assemblées coloniales de déclarer les esclaves capables de porter témoignage en justice, même contre leurs maîtres. Cette proposition a été rejetée presque à l’unanimité ; les maîtres ont mis ainsi les magistrats coloniaux dans l’impossibilité de jamais les convaincre, et de protéger la population esclave.
On ne peut mettre en doute ni les bonnes intentions des hommes qui ont proposé d’admettre les esclaves à porter témoignage en justice, ni les desseins des hommes par lesquels cette proposition a été rejetée ; mais ce dont on peut raisonnablement douter, c’est de l’efficacité de la mesure proposée. Les esclaves, ayant l’esprit extrêmement borné, sont naturellement imprévoyants ; il est donc probable que les premiers d’entre eux qui auraient été appelés en justice comme témoins, auraient fait connaître la vérité, si les maîtres n’avaient cherché ni à les corrompre par des promesses, ni à les intimider par des menaces. Mais, revenus dans leurs plantations, les récompenses données aux faux témoins, et les coups de fouet distribués aux témoins véridiques, n’auraient pas tardé à apprendre à tous que, pour un esclave, il n’y a de bien ou de mal que ce qui plaît ou déplaît à son possesseur. L’individu même qui aurait consenti à s’exposer à la haine et à la vengeance de son maître, pour faire connaître la vérité, n’aurait pas voulu y exposer ses enfants et sa femme. Il aurait craint qu’en se montrant insensible à ses propres maux, son maître ne fût excité à le punir dans les objets de ses affections, soit en leur imposant des privations ou des travaux au-delà de leurs forces, soit en leur infligeant des peines non méritées, soit en les vendant à un autre maître.
Il faut, pour admettre des personnes en témoignage, leur faire un devoir de dire la vérité, et leur garantir que l’accomplissement de ce devoir ne sera suivi d’aucune peine ; il faut de plus leur faire un crime du mensonge, et menacer de peines plus ou moins sévères les individus qui se rendront coupables de ce crime. Mais toutes ces règles, sans lesquelles il n’y aurait pas de justice possible, seraient renversées pour l’esclave : pour lui, le crime serait de dire la vérité, car c’est la vérité qui attirerait sur lui des châtiments terribles ; le devoir serait de mentir, car c’est le mensonge seul qui serait sans danger, ou qui serait suivi d’une récompense. Quand un gouvernement établit ou sanctionne l’esclavage, il déclare, par ce seul fait, que les désirs et les forces des maîtres seront les lois des esclaves, et que, par conséquent, le devoir de ceux-ci sera de se conformer à ces désirs ou à ces forces. Si le même gouvernement veut ensuite imposer des devoirs aux hommes asservis, s’il veut les soumettre à d’autres lois, il ne le peut qu’en révoquant les premières ; il faut qu’il mette les esclaves à l’abri de toute force qui les placerait dans l’impossibilité de remplir les nouveaux devoirs qu’il leur impose.
Mais déclarer, d’un côté, que la volonté du maître est la loi de l’esclave, et soumettre, d’un autre côté, l’esclave à des règles ou à des devoirs qui ne sont pas la volonté du maître, ce n’est pas seulement se mettre en contradiction avec soi-même, c’est préparer les esclaves à la liberté, en les habituant au mensonge et au parjure. En effet, lorsque deux lois ou deux puissances sont en opposition directe, celle des deux dont l’action est la plus continue, la plus étendue et la plus forte, ne tarde pas à paralyser l’autre. Or, il est évident que la volonté du maître est pour l’esclave une puissance plus continue, plus étendue et même plus forte que les désirs ou les volontés de l’autorité publique. Elle est plus continue, puisqu’elle s’exerce sans relâche. Elle est plus étendue, puisqu’elle atteint l’esclave dans chacune des parties de son être et qu’elle le frappe jusque dans les objets de ses plus chères affections. Elle est plus forte, puisqu’elle peut lui faire considérer la mort comme un bienfait. La volonté du maître est pour l’esclave une loi si puissante, qu’elle suffit pour paralyser toutes les autres, celles de la religion, celles de la morale et celles des gouvernements.
Des peuples de l’antiquité ont quelquefois senti la nécessité de faire comparaître des esclaves en justice comme témoins ; mais alors ils ont pris des mesures pour rendre sans effet la volonté des maîtres. Le plus souvent, ils ont soumis les esclaves à la torture, détruisant ainsi par une douleur énergique et présente, les effets que pouvait produire la crainte d’un châtiment futur. Quelquefois aussi ils ont affranchi les esclaves, avant que de leur imposer les devoirs que les lois prescrivent aux témoins. Ils ont très bien compris qu’avant que de soumettre des hommes aux lois sociales, il fallait les soustraire aux lois qui les soumettaient à la volonté des maîtres.
Quand même le témoignage des esclaves serait admis, et qu’il serait possible d’y avoir quelque confiance, les maîtres trouveraient dans leur position, et dans la portion d’arbitraire qui leur serait laissée, des moyens suffisants pour assurer leur impunité. Tous les magistrats chargés de la poursuite et de la punition des délits, ne peuvent être envoyés par le gouvernement de la métropole. Il faut donc qu’une partie soit prise parmi les possesseurs d’hommes, et il suffit qu’on donne du pouvoir à quelques-uns, pour que ceux-là assurent l’impunité de tous les autres.
Enfin, un maître ayant le pouvoir de conduire tel de ses esclaves dans tel lieu qu’il juge convenable, ayant le pouvoir d’écarter tous les autres et de choisir le lieu et le temps de sa vengeance, rien ne lui est plus facile que se débarrasser des témoins. Si, parmi nous, les malfaiteurs avaient ainsi la faculté d’entraîner leurs victimes dans les lieux les plus propices à l’exécution de leurs projets, s’ils pouvaient en même temps choisir le moment le plus favorable à l’exécution, pense-t-on qu’il serait facile de les convaincre, quand même nos lois sur l’ordre judiciaire resteraient telles qu’elles sont ? Pense-t-on que les crimes ne se multiplieraient pas d’une manière effrayante, sans qu’il fût possible néanmoins de convaincre les criminels ? Les colons de Surinam qui veulent se défaire d’un esclave, l’entraînent à la chasse ; quand ils sont parvenus au milieu d’une forêt, ils lui donnent un coup de fusil ; puis ils vont faire leur déclaration que leur esclave est mort par accident.
Ainsi, lorsqu’un savant observateur nous atteste que l’autorité civile est impuissante en tout ce qui regarde l’esclavage domestique, et que rien n’est plus illusoire que l’effet vanté de ces lois qui prescrivent la forme du fouet et le nombre des coups qu’il est permis de donner à la fois, non seulement on est convaincu de la vérité de cette observation par les faits qu’il rapporte, mais on ne conçoit pas comment il pourrait en être autrement [386].
[IV-460]
CHAPITRE XXI. ↩
De l’abolition de l’esclavage domestique.
L’enseignement des préceptes de la morale et de la religion, et la protection des gouvernements, seront sans influence sur le sort et sur les mœurs des esclaves, aussi longtemps que le pouvoir arbitraire restera dans les mains de leurs possesseurs. Il est même à craindre que les efforts que l’on fait pour conduire graduellement à la liberté la population asservie, ne produisent des résultats contraires à ceux que l’on se propose. En même temps, en effet, qu’on laisse sans limites le pouvoir des possesseurs d’hommes, on enseigne aux hommes possédés qu’ils ont des devoirs moraux et religieux à remplir ; on leur expose un certain nombre de règles, et on les excite à les observer. Les esclaves se trouvent ainsi soumis à des lois de deux genres : à celles qui les mettent dans les rangs des choses ou des propriétés, et à celles qui les mettent aux rangs des êtres moraux. En leur qualité de choses, on leur enseigne que les lois suprêmes sont les volontés de leurs maîtres ; en leur qualité de personnes, on leur enseigne que les lois suprêmes sont les préceptes de la morale et de la religion. Ces diverses lois étant dans une opposition directe les unes avec les autres, il n’est pas difficile de voir quelles sont celles qui doivent triompher dans la pratique. Je crois les missionnaires des hommes fort éloquents ; mais il est une éloquence au-dessus de la leur, c’est celle des fouets de charretier déposés dans les mains des régisseurs. Ainsi, en même temps qu’on enseigne aux esclaves les devoirs de la morale, on les oblige à les violer ; mieux vaudrait qu’ils les ignorassent, car ils ne prendraient pas l’habitude d’agir en sens contraire de leur croyance.
N’y aurait-il même pas une absurdité barbare à maintenir des lois qui soumettent une multitude d’hommes, d’enfants et de femmes aux volontés arbitraires d’un certain nombre de maîtres, et à leur faire enseigner en même temps qu’ils ont des devoirs à remplir indépendamment des volontés de leurs possesseurs ? N’est-ce pas, par exemple, une absurdité cruelle que d’enseigner à une jeune fille que la chasteté est un devoir, et de donner, en même temps, à un être que l’usage du despotisme a dégradé, le pouvoir de la déchirer à coups de fouet jusqu’à ce qu’elle se soit prostituée ? N’est-ce pas une absurdité également atroce que d’enseigner à un mari qu’il doit être le protecteur de sa femme, à un père qu’il doit être le protecteur de sa fille, et de les condamner ensuite l’un et l’autre aux supplices les plus cruels, s’ils tentent de remplir les devoirs qu’on leur a enseignés ? N’est-ce pas une autre absurdité d’apprendre à des hommes que la Divinité leur a fait un devoir de se reposer tel ou tel jour de la semaine, et de donner en même temps à d’autres hommes le pouvoir de les déchirer à coups de fouet, s’ils ne travaillaient au temps défendu ? Il n’y a pas de terme moyen entre l’obéissance due aux préceptes de la morale, et l’obéissance due aux volontés arbitraires du maître. Si vous enseignez à des hommes qu’ils ont des devoirs moraux ou religieux à remplir, ne laissez à aucun autre la puissance de leur en commander la violation ; apprenez-leur qu’il est des cas où la résistance est permise, et lorsque ces cas se présentent, unissez-vous à eux pour résister. Si, au contraire, vous laissez à un maître les moyens de les contraindre à se conformer à ses volontés ou à ses désirs, ne leur dites pas qu’il existe pour eux des devoirs moraux ou religieux ; enseignez-leur, au contraire, que le seul devoir qu’ils aient, est de se conformer en tout aux volontés de leur maître ; dites-leur que l’adultère, l’inceste, le vol, l’assassinat, sont des devoirs quand ils leur sont commandés par l’individu qui les possède ; alors les doctrines ne seront pas en opposition avec la conduite ; on n’aura pas un plus grand nombre de vices, et l’on aura l’hypocrisie de moins !
Cependant, s’il n’est pas en la puissance des gouvernements des métropoles de protéger la population esclave, aussi longtemps que le principe de l’esclavage existe ; si l’enseignement de la morale ou de la religion est sans effet sur les mœurs, ou s’il n’a pas d’autre effet que d’habituer les hommes à agir en sens contraire de leurs pensées, comment est-il possible d’arriver à l’abolition graduelle de l’esclavage ? Comment peut-on l’abolir tout à coup sans compromettre à la fois l’existence des maîtres, et même le bien-être à venir de la population asservie ?
Il ne faut pas se le dissimuler ; les difficultés qui se présentent sont graves, et je doute même qu’il soit possible de les éviter toutes. J’ai fait observer ailleurs qu’il est dans la nature de l’homme que tout vice et tout crime soit suivi d’un châtiment. J’ai fait voir qu’on ne peut soustraire un individu coupable à la peine qui est la conséquence naturelle de ses vices ou de ses crimes, sans faire tomber sur soi-même ou sur d’autres un châtiment beaucoup plus terrible [387]. Or, de tous les faits que nous considérons comme criminels, il n’en est pas de plus graves que d’avoir dégradé une partie du genre humain, en la mettant au rang des choses ; d’avoir dénié, à son égard, l’existence de tous devoirs moraux ; d’avoir exercé sur elle, pendant une longue suite de générations, tous les vices et tous les crimes dont des hommes peuvent être susceptibles. Maintenant que les conséquences de cet horrible système nous pressent de toutes parts, on cherche comment on en sortira, sans en subir les conséquences ; mais il est difficile d’en trouver les moyens. Il faut se bâter cependant, car l’édifice tombe en ruine de toutes parts ; et plus on hésitera à prendre un parti, plus la catastrophe peut être terrible.
[IV-464]
Les possesseurs d’hommes des colonies anglaises résistent de toute leur puissance à l’action que la métropole exerce sur eux pour adoucir le sort de leurs esclaves et les préparer à la liberté ; et il est probable que, si la France et les autres nations qui possèdent encore des colonies, voulaient agir dans le même sens, elles rencontreraient les mêmes résistances. Existe-t-il des moyens de vaincre cette opposition, sans recourir à la violence ? Il en est deux bien simples : le premier et le plus efficace serait l’abolition du monopole accordé aux possesseurs d’esclaves pour la vente de leurs denrées ; le second serait le rappel des troupes envoyées chez eux pour seconder l’action qu’ils exercent sur leurs esclaves. Il est constaté, en effet, que les possesseurs de terres, qui font exécuter leurs travaux par des esclaves, paient la main-d’oeuvre beaucoup plus cher que ceux qui font exécuter les leurs par des hommes libres. Si les premiers n’avaient la jouissance d’aucun monopole, ils seraient donc obligés, pour vendre leurs denrées, d’employer les mêmes moyens de culture que les seconds ; c’est-à-dire qu’ils seraient obligés, sous peine de périr de misère, d’affranchir leurs esclaves. Il n’est pas moins évident que, s’ils étaient abandonnés à leurs propres forces ils se livreraient moins à leurs vices, parce qu’ils auraient un peu plus de crainte des insurrections. Mais les possesseurs d’hommes ont un tel excès d’ignorance, de présomption et d’orgueil, que, s’ils étaient tout à coup livrés à eux-mêmes, ils pourraient bien attirer sur eux quelque catastrophe terrible. Il est donc du devoir des métropoles de les mettre à l’abri de leurs propres folies, et de les aider à sortir de la position où ils se trouvent, sinon avec profit, du moins avec la moindre perte possible.
Il est des personnes qui portent à tous les possesseurs d’hommes un si tendre intérêt, que, pour ne pas compromettre leur repos et leurs jouissances, elles consentiraient volontiers à fermer les yeux sur les maux innombrables que la servitude enfante ; mais elles doivent considérer qu’il n’y a jamais eu, pour les maîtres, de sûreté dans l’esclavage, et qu’il y en a aujourd’hui moins qu’à aucune époque. Les générations qui secondèrent l’établissement d’un tel système, dans les îles ou sur le continent d’Amérique, ont disparu, et elles ne se lèveront pas pour le défendre. Les générations qui leur ont succédé, sont plus éclairées ; leurs habitudes ou leurs pratiques sont encore en arrière de leur entendement, mais c’est un désaccord qui ne saurait durer longtemps. L’Angleterre a déjà retiré l’appui qu’elle prêtait au commerce des esclaves ; la France marche sur la même route ; l’Espagne ne peut rien faire pour le soutenir ; d’autres États du continent l’ont prohibé. En Amérique, non seulement la traite a été prohibée, mais plusieurs des États les plus considérables ont complètement aboli l’esclavage. Les parties dans lesquelles il existe le plus d’esclaves sont environnées de toutes parts de peuples libres qui croissent en richesses, en nombre et en lumières. Au centre même, une population jadis esclave jouit d’une entière indépendance, et, par le seul fait de son existence, elle est un avertissement continuel pour les maîtres et les esclaves. Si les possesseurs d’hommes ont des dangers à courir, les plus graves naissent, non de l’abolition régulière de l’esclavage, mais de la persistance à le conserver.
Les possesseurs d’hommes et les individus qui veulent les maintenir dans leurs possessions, semblent voir dans l’abolition de l’esclavage une multitude de dangers ; ceux qui aspirent à cette abolition partagent une partie de leurs craintes ; mais, de part et d’autre, on semble n’être agité que de terreurs paniques, car personne n’ose préciser les faits positifs qu’on paraît redouter. Cependant, si l’affranchissement des esclaves offre des dangers, il faut savoir les considérer en face, et déterminer nettement en quoi ils consistent ; c’est le seul moyen de les prévenir. Fermer les yeux afin de n’avoir pas peur, et marcher ensuite au hasard vers le but qu’on se propose, est un mauvais moyen d’éviter les faux pas.
Les hommes qui appartiennent à la race des maîtres peuvent voir dans l’abolition de l’esclavage trois dangers : ils peuvent craindre que leur existence personnelle ne soit menacée, que leurs propriétés ne soient point en sûreté, et que les affranchis refusent de travailler pour eux, ou ne se livrent au travail qu’autant qu’ils y seront forcés par la faim.
Ce dernier danger est le moins grave ; mais peut-être aussi est-il celui qui est le plus à craindre, au moins pour quelque temps. Un des effets les plus infaillibles de l’esclavage est d’avilir l’action de l’homme sur les choses ; dans un pays exploité par des esclaves, être libre, c’est être oisif, c’est vivre gratuitement sur le travail d’autrui. Cette manière de juger ne changera point immédiatement après l’abolition de l’esclavage ; les individus de la race des maîtres continueront de voir l’avilissement dans le travail, et la noblesse dans l’oisiveté. Les affranchis jugeront d’abord comme les maîtres, et les imiteront s’ils le peuvent ; s’ils n’ont pas le moyen de vivre oisifs comme eux, ils aspireront du moins à le devenir. C’est là l’histoire de toutes les populations qui ont été divisées en maîtres et en esclaves : sous ce rapport, il n’y a point de différence entre les noirs et les blancs.
Il ne faut pas croire, cependant, que cet inconvénient soit aussi grave qu’il le paraît d’abord. Dans les pays où il existe des esclaves, la journée d’un affranchi se paie deux fois plus que la journée d’un esclave. Il faut donc que le premier travaille deux fois plus que le second, ou que son travail ait deux fois plus de valeur. Dans tous les pays, le meilleur parti qu’un maître peut tirer de son esclave, est de lui laisser l’entière disposition de son temps, et d’exiger de lui une somme pour chacune de ses journées de travail. L’esclave, stimulé par l’espérance de faire des économies, travaille d’abord pour payer à son maître l’impôt établi sur lui, et il travaille ensuite pour s’entretenir et souvent même pour se racheter. L’homme qui est mû par l’espoir des récompenses, agit donc avec plus d’intelligence et d’énergie que celui qui n’est mû que par la crainte des châtiments. Un homme libre porte en lui un autre principe d’activité qui ne se trouve point dans l’esclave : c’est le désir d’avoir une famille et le besoin de la faire vivre. Un esclave n’a point à s’occuper du sort de ses enfants ; son travail est sans influence sur leur destinée : c’est le maître qui doit les nourrir. Ainsi, en supposant au préjugé que l’esclavage crée contre le travail, toute l’énergie qu’il peut avoir, l’affranchissement développe des principes d’activité plus énergiques et plus continus dans leur action que les châtiments infligés par les maîtres. L’Angleterre a été soumise à un esclavage analogue à celui qui existe en Russie ; aujourd’hui dix ouvriers anglais font plus de travail, dans un temps donné, que cinquante esclaves russes ; tel lord anglais qui possède la même étendue de terres que tel seigneur russe, est dix fois plus riche que lui, quoiqu’il ne possède pas un esclave, tandis que le second en possède des milliers.
[IV-469]
Un des préjugés les plus invétérés des possesseurs d’hommes, est de considérer les individus possédés comme de malfaisantes machines, qui ne vont d’une manière tolérable qu’autant qu’elles sont dirigées par une intelligence étrangère, et qui, pour ne pas être nuisibles à leurs possesseurs, ont besoin d’être enchaînées et conduites à coups de fouet. Un maître auquel on parle de l’affranchissement des esclaves, éprouve un sentiment analogue à celui que nous éprouverions nous-mêmes, si l’on nous parlait de déchaîner, au milieu d’une nombreuse population, une multitude de bêtes féroces. Ayant toujours réglé lui-même tous leurs mouvements et puni leurs fautes selon ses caprices, il s’imagine que tout va tomber dans le désordre et la confusion, si on lui arrache son fouet. C’est là l’erreur de tous les gouvernements arbitraires ; cette erreur vient de ce qu’on attache au mot affranchissement des idées que non seulement il ne comporte pas, mais qu’il exclut.
Qu’est-ce qu’affranchir un homme asservi ? C’est tout simplement le soustraire aux violences et aux caprices d’un ou de plusieurs individus, pour le soumettre à l’action régulière de l’autorité publique ; c’est, en d’autres termes, empêcher un individu qu’on appelle un maître, de se livrer impunément envers d’autres qu’on appelle des esclaves, à des extorsions, à des violences, à des cruautés. Affranchir des hommes, ce n’est pas ouvrir la porte au trouble, au désordre, c’est les réprimer ; car le désordre existe partout où la violence, la cruauté, la débauche, n’ont point de frein. Le plus effroyable des désordres règne partout où la partie la plus nombreuse de la population est livrée sans défense à quelques individus, qui peuvent s’abandonner sans réserve à tous les vices et à tous les crimes, c’est-à-dire partout où l’esclavage existe. L’ordre règne, au contraire, partout où nul ne peut se livrer impunément à des extorsions, à des injures, à des violences, partout où nul ne peut manquer à ses obligations sans s’exposer à des châtiments, partout où chacun peut remplir ses devoirs sans encourir aucune peine ; l’ordre, c’est la liberté.
Cela étant entendu, la question devient facile à résoudre ; elle se réduit à savoir si les violences et les mauvais traitements inspirent de la bienveillance et de la douceur, et si la protection et la justice donnent de l’énergie à la vengeance ; si le père dont on outrage la fille, ou le mari dont on ravit la femme, sont moins à craindre pour le ravisseur, que n’est à craindre pour un homme inoffensif l’individu dont il respecte la famille ; si l’homme qui jouit en toute sécurité de ses travaux et qui peut enrichir ses enfants par ses économies, est moins disposé à respecter les propriétés d’autrui, que celui qui se voit sans cesse ravir par la violence les produits de son travail ; si celui qui pourra, sans danger, remplir tous les devoirs que la morale lui prescrit, aura des mœurs moins pures que celui qui ne peut remplir aucun devoir sans s’exposer à des châtiments cruels.
Il faut observer, en effet, qu’en échappant à l’arbitraire de son possesseur, l’homme qu’on appelle un esclave n’acquiert pas l’indépendance des sauvages ; il se trouve sous l’autorité de la loi commune, et sous la puissance des magistrats ; il ne peut pas plus qu’auparavant se livrer impunément à des crimes. S’il se rend coupable de quelque délit, il en sera puni comme il l’aurait été quand il était esclave, mais la peine sera plus proportionnée à l’offense ; elle sera appliquée sans partialité, sans vengeance ; elle aura pour but et pour résultat la répression du mal, et non la satisfaction d’un sentiment de haine ou d’antipathie. S’il se livre à un vice, il en portera la peine bien plus infailliblement qu’il ne l’aurait portée dans l’état de servitude ; l’oisiveté ou l’intempérance seront châtiées par la misère, comme le travail et l’économie seront récompensés par l’aisance ou par la richesse.
Les hommes qui se proposent l’abolition de l’esclavage, n’ont presque point à s’occuper de la population asservie. Leur action doit s’exercer bien plus sur les maîtres que sur les esclaves ; elle doit avoir pour effet, non de les soumettre à des violences, mais d’empêcher qu’ils n’en exercent sur d’autres impunément. L’asservissement d’un homme à un autre n’étant pas autre chose qu’un privilège d’impunité accordé au premier pour tous les crimes dont il peut se rendre coupable à l’égard du second, l’affranchissement n’est pas autre que la révocation de ce privilège. Déclarer que, dans tel pays, l’esclavage est aboli, c’est déclarer tout simplement que les délits ou les crimes seront punis sans acception de personnes ; établir ou maintenir l’esclavage, c’est accorder ou garantir des privilèges de malfaiteur. Cela est si évident que, pour abolir complètement la servitude dans tous les lieux où elle existe, il suffirait de soumettre aux dispositions des lois pénales les délits exécutés par les possesseurs d’hommes, sans faire aucune distinction entre les personnes offensées.
On craint que, si la justice est rendue à tout le monde, et si, par conséquent, les maîtres perdent le privilège de commettre des iniquités, les hommes de la race asservie ne profitent des garanties qui leur seront données ; qu’ils ne se coalisent entre eux, et ne détruisent leurs anciens possesseurs, ou du moins ne les expulsent du pays. Il est très probable que, tôt ou tard, les îles cultivées par des esclaves seront exclusivement possédées par des hommes de leur espèce ; ces hommes sont de beaucoup les plus nombreux ; ils peuvent se passer de leurs maîtres, et leurs maîtres ne peuvent pas se passer d’eux. Il у aura par conséquent des noirs ou des mulâtres dans les colonies, aussi longtemps qu’il y aura des blancs ; mais il n’est pas également certain qu’il y ait des blancs aussi longtemps qu’il y aura des noirs, puisque ceux-ci peuvent vivre sans les secours de ceux-là. Toutes les chances sont donc en faveur des derniers.
Mais cette révolution, dans les colonies européennes, peut s’opérer de deux manières : elle peut s’exécuter d’une manière violente et rapide comme celle qui s’est opérée à Saint-Domingue ; ou bien elle peut s’exécuter d’une manière lente et progressive, et de telle sorte qu’en se retirant, les individus de la race des maîtres emportent la valeur de leurs propriétés et les moyens d’aller s’établir ailleurs ; la persistance des maîtres à maintenir l’esclavage ne peut amener que la première ; l’affranchissement des esclaves amènerait probablement la seconde.
Si, par suite de quelque événement extraordinaire, il y avait, en effet, une insurrection d’esclaves, leur première pensée serait d’expulser leurs maîtres, et peut-être de les exterminer. Placés entre la nécessité de conquérir leur indépendance, et le danger de périr dans les supplices, ils finiraient probablement par rester maîtres du pays ; et une fois qu’ils l’auraient conquis, il ne serait pas facile de le leur enlever. Les métropoles trouvent que leurs colonies sont une charge trop lourde pour faire de grands sacrifices pour les conquérir, si elles venaient à les perdre.
La révolution qui, par suite de l’affranchissement, placerait des noirs à la tête des affaires publiques, arriverait d’une manière si lente et si insensible, qu’il n’est guère possible de prévoir l’époque à laquelle elle serait terminée. Il faudrait connaître bien peu les hommes pour s’imaginer qu’en sortant de l’esclavage le plus dégradant qui ait jamais existé, ils aspireront à commander, et s’organiseront entre eux pour s’emparer du pouvoir. Quelque nombreux qu’ils soient, comparativement à leurs maîtres, leur ignorance, leur misère, la difficulté d’acquérir aucune propriété territoriale, et l’influence des gouvernements européens, ne permettront guère aux idées ambitieuses de germer dans leurs esprits, à moins que des violences ne les portent au désespoir. Lorsqu’une aristocratie s’est profondément enracinée dans un pays, elle se soutient pour ainsi dire par son propre poids. Les luttes ne commencent pour elle que lorsqu’il se trouve, dans les rangs des hommes jadis asservis, des individus qui, par leurs richesses ou par leurs lumières, aspirent au gouvernement. Ces luttes ne sont même dangereuses qu’autant que l’aristocratie exclut de son sein les hommes qui, par leur position, peuvent aspirer à y entrer ; car, si elle absorbe les richesses ou les talents qui se développent dans les autres classes de la population, il n’y a plus de raison pour qu’elle finisse. Le petit nombre des dominateurs ne suffit pas pour amener la fin de leur empire : huit mille Mamloucks ont régné pendant des siècles sur trois ou quatre millions d’Égyptiens ; et leur règne durerait encore, s’ils n’avaient pas été détruits par un pouvoir étranger.
La lutte entre les descendants des maîtres et les descendants libres des esclaves commencera donc à se manifester lorsque les derniers auront acquis assez de richesses et de lumières pour aspirer à l’exercice des pouvoirs politiques. Il est très probable que des électeurs d’espèce éthiopienne qui trouveraient parmi les hommes de leur race des individus capables de les bien gouverner, leur donneraient la préférence sur des blancs. Il arriverait alors ce que nous avons vu dans une ville des anciennes colonies espagnoles ; les blancs cesseraient d’être appelés aux emplois publics, et leur position deviendrait tellement désagréable, qu’ils prendraient le parti d’émigrer. Mais, pour qu’un tel événement arrivât, il faudrait que l’industrie et les richesses des affranchis se fussent de beaucoup augmentées, et alors les descendants des maîtres pourraient aliéner leurs propriétés plus avantageusement qu’ils ne le pourraient aujourd’hui. Leurs terres perdront, en effet, d’autant plus de leur valeur, qu’ils mettront plus de persistance à maintenir l’esclavage ; car la main-d’œuvre deviendra de plus en plus chère, et il deviendra de plus en plus à craindre que propriétaires ne soient expulsés.
Quoi qu’il en soit de ces conjectures sur l’avenir, il est certain qu’il n’y a plus de sécurité pour les possesseurs d’hommes des colonies ; que l’Angleterre lutte de toute sa puissance pour abolir l’esclavage, et que, par conséquent, la question ne porte plus que sur le moyen le plus sûr de l’abolir.
Dans le système de l’esclavage, on pose en principe que la personne qu’on appelle un esclave est une chose ; que cette chose appartient au propriétaire, et qu’il peut faire d’elle tout ce qu’une ordonnance de son gouvernement ne lui a pas défendu. En conséquence, on cherche à mettre des limites à la disposition de cette propriété, comme on en a mis à la disposition de toutes les autres. J’ai fait voir, dans le chapitre précédent, qu’en suivant ce système, il n’y a pas moyen d’arriver à l’abolition de l’esclavage, parce que l’arbitraire qu’on proscrit sous une forme, se montre immédiatement sous une autre. Il est aussi impossible d’arriver à la liberté en partant du principe de la servitude, qu’il est impossible d’arriver à la vérité en prenant une erreur pour la base de ses raisonnements.
Quelque lente que soit la marche qu’on se propose de suivre dans l’abolition de l’esclavage, il est un pas qu’il faut nécessairement franchir d’une seule fois, parce que entre l’erreur et la vérité il n’y a point d’intermédiaire. Il ne faut pas partir du fait mensonger qu’un être humain est une chose, ou un quart de chose, ou un huitième de chose ; il faut reconnaître franchement ce qui est, c’est-à-dire qu’il est une personne ayant des devoirs à remplir envers lui-même, envers son père, sa mère, sa femme, ses enfants, et l’humanité tout entière. Tant que ces vérités ne sont pas reconnues, il n’y a pas de progrès à faire ; on ne peut qu’opposer de la force à de la force. Mais aussi, à l’instant où l’on reconnaît qu’un homme asservi est un homme, et qu’il a des devoirs moraux à remplir comme tous les autres, les positions changent ; comme être moral, il devient l’égal de son maître, puisqu’il a les mêmes devoirs à remplir que lui.
En considérant ainsi les hommes qu’on appelle des esclaves et les hommes qu’on appelle des maîtres, on ne peut pas suivre le procédé qu’on emploie quand on limite les pouvoirs d’un propriétaire sur sa propriété ; on ne peut pas dire que le maître peut tout ce qui ne lui est pas interdit par l’autorité publique, ou que l’esclave doit tout, excepté ce que les ordonnances du gouvernement lui ont réservé ; on est obligé de déclarer, au contraire, que le maître ne peut rien exiger au-delà de ce que le gouvernement lui a positivement accordé, et que l’individu qu’on appelle un esclave, est libre sur tous les points qui n’ont pas été restreints par une disposition positive.
Ces deux manières de procéder peuvent paraître identiques ou ne différer que dans les termes ; et cependant il y a entre l’une et l’autre une différence immense. Dans l’une, on reconnaît qu’il existe des devoirs moraux indépendants des caprices de la puissance ; c’est la liberté qui est le principe ; l’obligation envers le maître est une exception. Dans l’autre, on fait dériver tous les devoirs de la volonté des gouvernements ; c’est le despotisme, qui est le principe ; l’exception, c’est la liberté, ou ce qu’on appelle les libertés, mot inventé pour rappeler aux affranchis qu’ils ne s’appartiennent que dans les parties d’eux-mêmes qui leur ont été concédées par leurs possesseurs.
La description spéciale de chacune des obligations imposées à l’homme qu’on appelle un esclave, envers l’homme qu’on appelle un maître, et la reconnaissance positive que le premier ne doit rien au second, au-delà de ce qui est décrit, sont d’une si haute importance que les possesseurs d’hommes croiraient avoir perdu la partie la plus précieuse de leur autorité, s’ils étaient obligés de spécifier ainsi chacune de leurs prétentions, et si on les réduisait, pour en exiger l’accomplissement, à suivre les formes légales.
Si chacune des obligations des esclaves était déterminée par un acte de l’autorité publique, les ministres de la religion, qui veulent les préparer à la liberté par l’enseignement de la morale, pourraient leur parler de devoirs sans les exciter indirectement à la révolte ; les devoirs ne seraient bornés alors que par les obligations imposées envers les maîtres ; tandis que, lorsque les obligations envers le maître restent indéfinies, il ne peut pas exister d’autres devoirs que celui d’une obéissance aveugle [388].
Mais quelles sont les obligations à imposer à l’homme qu’on appelle un esclave, envers l’homme qu’on appelle un maître ? Si les questions qui divisent les hommes étaient toujours résolues selon les règles de la morale, il faudrait renverser celle-ci ; il ne faudrait pas demander quelles sont les obligations de l’homme possédé envers son possesseur ; il faudrait demander, au contraire, quelles sont les obligations de celui-ci envers celui-là ; qu’est-ce qu’il lui doit pour le travail qu’il lui a arraché, et dont il ne lui a point payé la valeur, pour les violences qu’il a exercées sur lui, ou pour les souffrances auxquelles il l’a condamné, et dont il ne l’a point indemnisé ? Mais, ne devançons point notre siècle ; recevons, comme une grace, l’abandon fait à l’homme faible et pauvre d’une petite part des produits de ses travaux, et considérons comme une faveur le ralentissement de l’injustice et de la violence.
Quelque élevées que soient les prétentions des possesseurs d’hommes et de leurs amis, je suppose que tous les services qu’ils prétendent leur être dus par les hommes possédés, sont appréciables en argent ; un maître n’oserait réclamer ostensiblement de son esclave que des travaux ; et, si l’on admet cette réclamation comme juste, il ne doit pas se plaindre qu’on est trop exigeant. Ce point étant convenu, la première mesure à prendre est de déterminer quelle est la valeur courante d’une journée de travail fait par un esclave de tel âge et de tel sexe. Il est bien probable que des individus sortiront souvent de la règle commune, que leur travail vaudra tantôt un peu plus, et tantôt un peu moins ; mais, comme nous raisonnons maintenant dans un système d’expédients, et non sur les règles de la justice, il ne s’agit pas d’arriver à une exactitude mathématique.
Le prix d’une journée d’esclave étant fixé, le possesseur d’hommes ne peut pas se plaindre d’injustice, si l’on accorde à l’individu asservi la faculté de livrer son travail ou d’en payer la valeur. Cette alternative place en quelque sorte l’esclave dans la même position que l’homme libre ; elle rétablit en lui, au moins en partie, le principe d’activité que la servitude détruit. Le prix de la journée d’un homme libre ayant, en général, deux ou trois fois la valeur de la journée d’un esclave, il est évident qu’en donnant un principe d’activité à la population, on doublerait la quantité de travail, en même temps qu’on bannirait les supplices au prix desquels on l’obtient. Les esclaves obtiendraient ainsi la facilité de se racheter et de racheter les membres de leurs familles.
Par la même raison qu’un possesseur d’hommes ne pourrait pas accuser d’injustice la mesure qui accorderait à l’esclave la faculté de livrer son travail ou d’en payer la valeur, il ne saurait se plaindre si un esclave est admis à se racheter ou à racheter sa femme et ses enfants. Les obligations imposées à un individu asservi étant appréciables en argent, rien n’est plus facile que de déterminer le prix auquel un esclave peut s’affranchir. Il suffit de calculer quel est, dans l’esclavage, le terme moyen de la vie, et de distraire des journées de travail dont ce terme se compose pour chaque individu, les jours consacrés au repos, et ceux pendant lesquels le travail peut être interrompu par des accidents ou des maladies.
Le rachat des esclaves est une des mesures auxquelles les possesseurs d’hommes sont le plus opposés. Si l’on veut connaître les raisons de leur opposition, il ne faut pas les chercher dans leurs discours ; il faut observer les circonstances qui influent sur le prix des individus exposés en vente. Si l’on examine, dans un marché où des êtres humains sont vendus, quels sont les individus qui obtiennent la préférence, et dont le prix est le plus élevé, on verra que, parmi les femmes, ce sont celles qui peuvent le plus facilement allumer les passions de leurs maîtres, et que, parmi les hommes, ce sont également les mieux faits et les plus beaux. La quantité de travail qu’ils peuvent exécuter n’est, en général, qu’une considération secondaire ; une jeune et belle fille qui, par les traits et la couleur, se rapproche de l’espèce des maîtres, se vendra deux fois plus qu’une négresse qui sera deux fois plus forte, mais qui aura des formes et une physionomie peu agréables. Cette seule circonstance est une preuve irrécusable que les possesseurs d’hommes entendent imposer à leurs esclaves d’autres obligations que celle de travailler ; mais ces obligations ne sont pas de nature à être avouées, et nous pouvons ne pas en tenir compte.
Du fait reconnu qu’un homme est un homme, et que comme tel il a des devoirs moraux à remplir, il résulte que, lorsque l’individu que nous appelons un esclave, a livré, en nature ou en argent, la quantité de travail qu’il est tenu de payer à l’individu que nous appelons un maître, il ne lui doit plus rien. Dès ce moment, il ne dépend plus que des lois générales et des magistrats ; s’il se rend coupable, il doit être poursuivi et puni comme tous les hommes ; si, par sa bonne conduite et par son industrie, il acquiert quelques propriétés, elles doivent lui être garanties par les mêmes autorités qui garantissent celles des maîtres ; son domicile doit être inviolable comme celui de tous les autres hommes ; il est le protecteur de ses enfants et de sa femme ; et si sa force ne lui suffit pas pour remplir ses devoirs de père ou de mari, c’est aux magistrats à y suppléer [389].
En accordant à un individu asservi la faculté de livrer à son possesseur son travail ou la valeur de ce travail, on attaque de la manière la plus puissante le préjugé qui flétrit les occupations industrielles dans les pays exploités par des esclaves, et l’on fait prendre en même temps à la population asservie des habitudes d’activité et d’économie. L’homme qui, pendant quelques années, aura travaillé et fait des épargnes pour acquérir sa liberté, continuera de travailler et de faire des épargnes quand il sera devenu libre, pour assurer son indépendance et se ménager des ressources dans sa vieillesse. L’emploi de ce moyen produirait en peu de temps des effets très considérables : il développerait l’intelligence de la population esclave ; il formerait ses mœurs et ses habitudes ; il lui donnerait des moyens d’existence, et formerait, pour les possesseurs des terres, une classe d’ouvriers intelligents et laborieux. Le commerce et l’industrie des métropoles y trouveraient également leur avantage ; les productions équinoxiales seraient moins chères, et les demandes des produits manufacturés se multiplieraient, parce que le nombre des consommateurs serait plus grand. Il faut ajouter que les colonies pourraient bientôt se garder elles-mêmes, et qu’elles ne seraient plus une cause de ruine pour les nations auxquelles elles sont soumises.
Je ne me suis pas proposé d’exposer, dans ce chapitre, un projet d’affranchissement ; j’ai voulu seulement démontrer que le système de l’esclavage repose sur un principe diamétralement opposé au principe de la liberté, et qu’il est impossible de passer d’un régime à l’autre, si l’on n’abandonne pas complètement le principe du premier pour adopter le principe du second. Le seul fait du changement de principes, il ne faut pas se le dissimuler, est une révolution complète ; et tout procédé fondé sur ce changement et suivi avec persévérance, conduira promptement à l’abolition complète de l’esclavage. Si j’ai indiqué un mode particulier d’affranchissement, ce n’est pas parce que je l’ai considéré comme le seul bon, ou comme étant complet : je ne me suis proposé que de faire voir quelques-unes des principales conséquences auxquelles on était amené par le seul fait de changement de principes. Mais tant que l’on considérera comme une vérité l’erreur grossière sur laquelle repose l’esclavage, c’est vainement qu’on se débattra contre les conséquences ; on pourra, pour les arrêter ou les affaiblir, employer beaucoup de temps, de talents et même de richesses ; vaincues en théorie, elles triompheront dans la pratique.
L’affranchissement des esclaves, ou pour parler avec plus de justesse, le frein mis aux passions et au pouvoir arbitraire des possesseurs d’hommes, n’est pas un phénomène tellement nouveau qu’on ne puisse pas être éclairé par l’expérience. Dans un espace de quarante années, on a vu six exemples d’un grand nombre d’esclaves affranchis en masse, sans qu’il soit jamais résulté aucun inconvénient de leur affranchissement [390]. Les affranchis ont toujours eu une conduite plus régulière que les maîtres. J’en ai fait voir ailleurs les raisons.
[IV-486]
CHAPITRE XXII. ↩
De l’inégalité des rangs et de pouvoir produite par l’esclavage. — De la fusion ou du mélange de familles de diverses races.
Déjà l’esclavage domestique a été aboli dans une grande partie du monde ; et, quelle que soit l’opiniâtreté avec laquelle il est défendu dans les lieux où il existe, les lumières ont assez fait de progrès pour nous faire espérer qu’un peu plus tôt ou un peu plus tard, il disparaîtra de tous les pays. Mais, quand l’esclavage ne se montrera plus sous les formes hideuses que nous lui avons vues chez les peuples de l’antiquité et chez plusieurs peuples modernes, les effets s’en feront sentir longtemps encore ; peut-être même se présentera-t-il sous des formes nouvelles. L’impression que la servitude produit sur les mœurs et sur les esprits des diverses classes de la population, est si profonde, qu’elle se transmet des pères aux enfants, et passe jusqu’aux générations les plus reculées. Il n’est point de peuple, en Europe, qui n’en porte encore les marques ; c’est même une des principales causes des troubles ou des désordres qui règnent dans cette partie du monde.
Lorsque la conquête a rassemblé sur le même sol des peuples de diverses races, chacune d’elles conserve et transmet à ses descendants les préjugés, les mœurs et jusqu’aux caractères physiques qui la distinguent. Quelque nombreuses que soient les révolutions que l’Égypte a éprouvées, les observateurs y distinguent encore, au seul aspect de la physionomie, les Cophtes, les Arabes, les Juifs, les Turcs, et jusqu’à des Grecs [391]. Dans l’Indostan, la race des Mongols et celle des Indous et, en Asie, celle des Tatars et celle des Chinois, sont aussi distinctes qu’elles l’étaient au jour de la conquête [392]. À Timor et dans les îles de la Sonde, on trouve trois espèces d’hommes établies sur le même sol depuis un temps immémorial ; et les différences qui distinguent ces peuples, sont aussi prononcées qu’elles l’étaient avant qu’aucun d’eux fût sorti de son pays originaire [393]. En Europe, tous les peuples appartiennent à la même espèce ; et, cependant, on trouve, dans chaque État, des hommes d’origines différentes, et dont les uns gouvernent ou aspirent à gouverner les autres, par la seule raison qu’ils appartiennent à telle caste ou qu’ils se sont affiliés à elle. Mais, parmi les divers mélanges de races, on n’en trouve point qui aient des différences aussi prononcées que celles qu’on observe dans les colonies formées par les Européens. Dans les îles et sur quelques parties du continent d’Amérique, on observe, au milieu d’une multitude de noirs, un petit nombre de blancs et de basanés ; dans quelques autres parties du même continent, les espèces ou les variétés sont plus nombreuses encore [394].
Si les seules différences qui existent entre les diverses races, ne consistaient que dans la couleur ou dans la forme des traits, je ne m’en occuperais point ici ; mais elles consistent principalement dans les principes, suivant lesquels on juge du mérite ou du démérite des hommes. Ces différences exercent ainsi une influence très étendue sur les mœurs, sur les lois et sur le gouvernement. Dans tout pays où il existe deux races d’hommes, l’une qui se compose des descendants des peuples conquis, et l’autre des descendants des conquérants ou de leurs affiliés, les hommes sont estimés ou méprisés, non en raison de leurs qualités ou de leurs défauts personnels, mais en raison de la race à laquelle ils appartiennent et de la place qu’ils occupent parmi les hommes de cette race. Si les deux castes appartiennent à la même espèce d’hommes, et si, par conséquent, elles ne peuvent se distinguer par les caractères physiques, elles se distinguent par des signes artificiels, par des dénominations, par des costumes particuliers, et surtout par le rang qu’elles occupent ou par les occupations auxquelles elles se livrent. Lorsqu’elles n’appartiennent pas à la même espèce, les différences physiques deviennent les signes qui servent à distribuer l’estime ou le mépris. Un Anglo-Américain de mœurs dissolues traitera d’une manière insultante la personne la plus respectable par ses qualités personnelles, qui aura le malheur d’avoir le teint plus ou moins obscur. Un Européen traitera avec considération un misérable sans mœurs et sans talents, parce qu’il aura l’avantage de faire précéder son nom d’une certaine dénomination. Ce que l’Américain méprise, ce n’est pas la couleur en elle-même ; ce ne sont pas les défauts de la personne qui la porte : c’est le fait de l’oppression exercée par les ancêtres de l’un sur les ancêtres de l’autre. De même, ce que l’Européen estime, ce n’est pas tel nom ou tel signe considéré en lui-même, c’est le fait de compter parmi ses ancêtres un individu de la race conquérante ou affilié à cette race.
Il ne faut pas croire que l’orgueil que manifestent les individus des castes dominantes, naisse de la conviction qu’ils n’ont jamais compté d’esclaves parmi leurs ancêtres ; car ce sentiment est aussi énergique chez les colons qui sont récemment descendus de malfaiteurs ou de prostituées, qu’il l’est chez les familles dont l’illustration remonte aux temps les plus anciens ; la véritable cause d’orgueil se trouve dans les relations que la conquête ou la domination établit entre deux races.
L’unité de l’espèce et d’autres circonstances dont je n’ai pas à m’occuper ici, ont beaucoup affaibli en Europe, et en France plus que dans aucun autre pays, le sentiment hostile qui divise les races ; mais en Amérique, où la conquête a eu, pour les hommes asservis, des conséquences les plus funestes, et où tous les individus portent sur leur physionomie les caractères indélébiles de la race à laquelle ils appartiennent, les effets de la conquête ou de l’asservissement seront beaucoup plus durables [395].
Les plus remarquables et les plus funestes de ces effets sont de fausser le jugement des hommes sur ce qui mérite l’estime ou le mépris, d’avilir les professions industrielles, de faire un objet de monopole des emplois publics, de convertir les contribuables en tributaires, de mettre aux progrès des peuples de puissants obstacles, et d’amener, tôt ou tard, des troubles, des guerres civiles, et finalement le despotisme. Il est plus ou moins en la puissance de chaque individu de développer son intelligence et son industrie, de corriger ses mauvaises habitudes, et d’élever convenablement ses enfants ; mais il ne dépend d’aucun homme, soit de renverser l’ordre des événements passés, soit de modifier les caractères physiques qu’il apporte en naissant ou qu’il transmet à ses descendants.
En attachant exclusivement le mépris à telle couleur et l’estime à telle autre, en honorant ou en flétrissant les individus, selon qu’ils naissent dans tel ou tel ordre de filiation, on condamne par cela même la partie la plus nombreuse de la population à un avilissement éternel, et on place l’autre à un point d’élévation indépendant de toute qualité personnelle. Il résulte de là qu’il n’y a point de vertus ni de bonnes qualités qui puissent élever les premiers, ni de vices qui puissent faire descendre les seconds ; ceux-là ne peuvent sortir de leur abaissement par l’acquisition d’aucune qualité morale ; ceux-ci ne peuvent déchoir de leur rang par aucun vice ou par aucun genre d’incapacité. Un tel régime a beaucoup d’analogie avec le système de l’esclavage ; il n’en est en quelque sorte qu’une modification ; il produit des effets moins énergiques, mais ces effets sont de même nature.
Cependant, comme il est dans la nature de tous les hommes de tendre sans cesse vers leur développement, d’honorer ce qui est réellement honorable, et d’aspirer à se placer au rang auquel leurs qualités les rendent propres, une caste dominante se trouve réduite à l’alternative de maintenir la caste asservie dans l’avilissement et la misère, ou de lui laisser prendre part à tous les avantages sociaux, ou de se trouver en état de guerre avec elle à l’instant où celle-ci aura acquis le sentiment de sa puissance. Il n’y a pas d’autre moyen de maintenir une classe nombreuse de la population dans la misère et l’abaissement, que l’esclavage, et sous quelque dénomination que s’établisse un pareil état, il produit, pour toutes les classes d’hommes, les effets que j’ai exposés dans les chapitres précédents. Tôt ou tard, ces effets sont aussi funestes pour la race des dominateurs que pour celle des opprimés ; ils le sont même davantage, car les individus de la première étant plus nombreux que ceux de la seconde, ayant moins à craindre les invasions, et tenant au sol de plus près, ils peuvent finir par en rester les maîtres. Si, d’un autre côté, les descendants de la race asservie peuvent librement se développer, et s’ils sont admis à partager tous les avantages sociaux, les souvenirs d’anciennes injures et d’anciennes spoliations peuvent se réveiller, et les descendants ou les affiliés des conquérants, devenus des objets de jalousie et de haine, peuvent être dépouillés de leur pouvoir en même temps que de leurs possessions.
Les aristocraties européennes ont évité ces dangers en admettant dans leur sein des individus sortis de la classe jadis asservie, ou en leur accordant les mêmes titres, les mêmes dénominations, les mêmes prérogatives. Quand elles ont craint de s’affaiblir, elles se sont recrutées en distribuant à propos des lettres de noblesse, ou en absorbant par des alliances les grandes fortunes développées dans les autres classes de la société. Mais les individus d’espèce européenne établis dans les îles et sur le continent d’Amérique, n’ont pas les mêmes moyens de se multiplier ou d’accroître leur puissance. Les lettres de blanc que les rois d’Espagne donnaient jadis à des hommes noirs ou basanés de l’Amérique, ne produisaient pas les mêmes effets que les lettres de noblesse en Europe. La noblesse étant manifestée par la couleur de la peau et par la constitution physique, nul ne pouvait ni la donner à celui qui en était privé, ni la ravir à celui qui la possédait. En Europe, un individu de la classe aristocratique qui rétablit sa fortune au moyen de ce qu’on appelle une mésalliance, ne transmet à ses enfants aucun signe qui puisse les faire déchoir de leur rang ; ce fait n’est qu’une dégradation passagère qu’on oublie facilement, et que rien ne rappelle dans la suite. Mais un Anglo-Américain ne pourrait pas ainsi s’allier impunément à une femme qui appartiendrait à la caste asservie ; il transmettrait à ses enfants des signes ineffaçables de sa mésalliance, et les dégraderait en les enrichissant. Il semble donc que les descendants des Européens établis dans quelques parties d’Amérique sont condamnés à être oppresseurs, jusqu’à ce qu’ils soient à leur tour opprimés ou expulsés. Ce danger paraît menacer surtout les habitants des îles où l’on ne trouve qu’un petit nombre de blancs au milieu d’une multitude de noirs, les États Hispano-Américains, où les blancs ne forment que la cinquième partie de la population, et même les blancs du Brésil, qui semblent ne pas exister dans une proportion beaucoup plus grande.
De tous les préjugés, il n’en est point de plus opiniâtres ni de plus propres à mettre les hommes en état de guerre que celui qui tient à la supériorité des castes ; il peut être affaibli par le progrès des lumières, mais l’expérience n’a pas encore prouvé qu’il soit possible de l’effacer complètement. Cependant, il n’est peut-être pas impossible de l’affaiblir au point de le rendre inoffensif ; mais par quels moyens peut-on y parvenir ? Est-ce en déclarant que les cuivrés sont blancs ou que les blancs sont cuivrés ? Suffit-il de déclarer que les blancs, les basanés et les cuivrés sont tous de même couleur, ou que les couleurs sont abolies ? On pourrait faire, sans doute, de pareilles déclarations et d’autres semblables ; mais il est probable qu’elles ne produiraient pas plus d’effet dans les États américains que n’en a produit en France la déclaration qu’il n’existait point de noblesse, et que tous les hommes étaient égaux. On n’avancerait pas beaucoup plus en démentant le fait de la conquête ou de l’asservissement, ou en déclarant que ce fait n’aura point de conséquence ; ce qui a été, est irrévocable ; et quand un fait a existé, il produit des résultats qu’il n’est pas au pouvoir des hommes d’empêcher.
Si l’on veut se donner la peine d’observer ce qui produit l’orgueil et l’abaissement, on trouvera que c’est, d’une part, le sentiment de la force et de la sécurité, et de l’autre le sentiment de la faiblesse ou de l’impuissance. Le mépris que les individus d’une race ont pour les individus de l’autre, ne tient pas seulement à la pensée que les ancêtres des seconds furent jadis opprimés impunément par les ancêtres des premiers ; il tient surtout à la pensée qu’il existe pour les descendants des uns, des garanties qui n’existent pas pour les descendants des autres. Ce qui inspire à certains hommes du mépris pour les autres, ce n’est pas le sentiment de leurs qualités personnelles, c’est la persuasion, bien ou mal fondée, qu’ils ne peuvent pas être opprimés par eux. Le moyen le plus efficace d’éteindre l’antipathie observée entre les races dans tous les pays où il a existé une classe d’oppresseurs et une classe d’opprimés, c’est la justice. Il ne faut pas déclarer que tous les hommes sont égaux, car ce serait un mensonge, et les mensonges sont un mauvais moyen de gouvernement ; il faut faire, autant que cela se peut, que tous les hommes jouissent d’une protection égale ; il faut que les mêmes qualités ou les mêmes services obtiennent les mêmes récompenses, et que les mêmes vices ou les mêmes crimes soient suivis de peines semblables. S’il n’y a pas moyen d’arriver à un tel résultat, il faut que les hommes restent sous l’empire d’une force brute ; c’est-à-dire qu’il faut que l’esclavage continue d’exister avec tous les préjugés, tous les dangers et toutes les calamités qui en sont inséparables.
Le préjugé qui attache le mépris à l’industrie, et l’estime à l’oisiveté, n’est guère moins propre que le mépris des races les unes pour les autres, à perpétuer l’esclavage. Nulle part il ne peut exister de richesse sans travail, et quand une classe de la population dédaigne de travailler, il faut qu’elle mendie ou qu’elle vole. Il est vrai qu’on peut vivre longtemps sur les produits d’un travail ancien ; mais, comme il n’y a pas de fortune, quelque bien établie qu’elle soit, qui ne soit susceptible de périr ou d’être dissipée, il est évident qu’une classe de la population, dont les biens ne pourraient jamais s’accroître et seraient exposés à toutes les chances de décroissement, finirait tôt ou tard par tomber dans la misère. Il faudrait, pour qu’elle continuât d’exister, que sous forme d’impôts ou sous toute autre, elle absorbât les richesses produites par les classes laborieuses, et qu’elle s’emparât, par conséquent, du monopole des fonctions publiques. La caste dominante substituerait ainsi une exploitation collective à l’exploitation individuelle telle qu’elle a lieu dans l’esclavage domestique.
Pour effacer la flétrissure qui, dans les pays cultivés par des esclaves, a été attachée au travail, il n’y a que deux moyens, l’un est de garantir à chacun les produits de son industrie ; l’autre, d’appeler, dans le pays, des individus de la classe des conquérants qui n’aient pas leurs préjugés. On se plaint que les indigènes de l’Amérique du sud manquent d’activité et dédaignent l’industrie ; il peut y avoir à cela plusieurs raisons ; mais, si l’insécurité des produits du travail n’est pas la principale, c’est l’exemple des blancs, juges suprêmes de ce qui est avilissant et de ce qui est honorable. L’Amérique est bien loin d’avoir la population que son sol peut nourrir : dans la partie du sud, et même dans le Mexique, il existe des provinces entières qui ne sont encore que des déserts. Si les habitants de ces contrées employaient, pour y appeler des ouvriers européens, des moyens analogues à ceux dont les Anglo-Américains ont fait usage, il ne faut pas douter qu’ils ne donnassent ainsi une impulsion très forte à l’activité des anciens habitants. Il arriverait nécessairement alors, ou que l’ancienne population deviendrait active et laborieuse, ou bien qu’elle resterait stationnaire dans son accroissement, et que le pays, se peuplerait d’individus de race européenne ; car partout, la partie la plus industrieuse de la population est celle qui se multiplie avec le plus de rapidité.
L’émigration d’ouvriers européens, dans les États du Mexique ou dans la partie méridionale de l’Amérique, aurait pour les habitants actuels un avantage plus grand encore, ce serait la fusion des races. Un des obstacles les plus grands que M. de Humboldt a vus à l’établissement d’un bon gouvernement dans les anciennes colonies espagnoles, est la difficulté de déterminer les hommes des diverses castes à se considérer comme concitoyens [396]. Cette difficulté ne pourra être vaincue aussi longtemps que les individus d’une caste repousseront comme flétrissante toute alliance avec les individus des autres castes ; mais en appelant des ouvriers européens dans le pays, cette difficulté serait aisément vaincue. Des hommes de cette classe arriveraient sans aucun préjugé de couleur ou de naissance, et ils ne pourraient s’allier, dans le pays, qu’à des personnes d’une classe correspondante à la leur. Cette fusion des races, qui produirait pour toutes de si grands avantages, est indiquée par la nature elle-même, car on a observé qu’elles s’améliorent en se croisant.
[IV-499]
Lorsque les Espagnols arrivèrent en Amérique, ils n’y amenèrent point de femmes, ou s’ils y en amenèrent quelques-unes, le nombre en fut extrêmement petit. Le gouvernement d’Espagne ne fit pas comme celui de France et d’Angleterre ; il n’envoya pas des cargaisons de prostituées aux colons. Les conquérants épousèrent donc des femmes du pays ; il est vrai que, passé la première génération, ils ne s’allièrent qu’entre eux [397]. Mais cette première alliance, loin d’avoir une influence funeste sur les individus qui en issurent, leur fut au contraire très favorable. Les Hispano-Américains forment aujourd’hui une race plus belle que celle des Espagnols. Azara, dont le témoignage ne doit pas être suspect, les a trouvés supérieurs par leur taille, par l’élégance de leurs formes, et même par la blancheur de leur peau ; il leur a trouvé aussi plus d’activité, plus de sagacité, plus de lumières qu’aux individus de race purement européenne, nés en Amérique [398]. On peut d’autant moins douter du mélange des races, et des effets qui en résultent, que, dans le Paraguay, les individus de race mélangée parlent généralement la langue de leur mère [399].
Les mêmes phénomènes ont été observés dans [IV-500] le mélange des nègres et des cuivrés. Les hommes qui naissent de l’union des individus de ces deux races, ont plus d’intelligence, plus d’énergie, plus de force et des formes plus belles que les individus de l’une et de l’autre espèce ; ils sont même généralement plus forts que les individus nés du mélange des Européens avec les Indiens, mais ils sont moins intelligents [400].
Le mélange de l’Européen et du nègre produit une race d’hommes plus active et plus assidue au travail que le mélange de l’Européen et de l’Indien Mexicain [401]. Ceux qui naissent des blancs et des mulâtres forment une race plus belle encore [402]. Enfin, tous les individus de race croisée se distinguent par une constitution plus saine et plus vigoureuse, par plus d’énergie vitale, et par une inclination plus forte vers leur reproduction, que les individus nés sous le même climat, d’individus appartenant à la même race [403].
Il ne m’appartient point d’expliquer les causes de ces phénomènes ; il me suffit d’avoir fait observer que, si la conquête et l’esclavage créent des préjugés et des vices propres à diviser les hommes, les intérêts de tous les portent à s’unir.
[IV-502]
CHAPITRE XXIII. .↩
De l’inégalité des fortunes produite par l’esclavage. — Des communautés de biens et de travaux, considérées comme moyens de rétablir l’égalité parmi les hommes. — Des sociétés de ce genre établies en Amérique, et des effets qu’elles ont produits.
Un des effets les plus durables de l’asservissement d’un peuple, est l’inégalité des fortunes. Dans tous les pays où la population a été possédée par une race de conquérants, nous voyons en effet que les richesses se sont concentrées dans les mains de leurs descendants ou de leurs affiliés, et que la plupart des descendants des vaincus sont restés dans la misère. L’inégalité de biens et de maux, qui a été le résultat de l’inégale distribution des propriétés, a frappé un grand nombre d’esprits, et divers moyens ont été proposés pour y mettre un terme. Il est des hommes qui ont pensé qu’on ne pouvait y remédier que par l’action lente des temps, et en répartissant également les biens entre les membres de chaque famille. D’autres ont cherché à fondre les sociétés sur de nouvelles bases, et à répartir, d’une manière parfaitement égale, les biens et les maux qui sont inséparables de la nature humaine. Ce dernier système est celui dont je me propose de faire connaître ici la nature et les effets.
Les hommes qui, à diverses époques, se sont proposé d’établir des sociétés dans lesquelles chaque individu aurait une part égale de biens et de maux, ont eu un but directement opposé au but de ceux qui ont établi l’esclavage. La servitude, dans l’intention de ceux qui l’établissent, a pour objet, en effet, de faire tomber sur une fraction de la population, les peines, les fatigues et les privations auxquelles un peuple peut être assujetti, et d’assurer à l’autre fraction le privilège de l’oisiveté et des jouissances. Le système que j’expose maintenant, a pour but, au contraire, de faire tomber sur chacun des membres de la société une égale part de peines ou de fatigues, et de lui garantir une égale somme de biens. Je n’ai pas besoin de dire que les hommes qui se sont proposé ce dernier objet, soit qu’ils aient été dirigés par des sentiments purement religieux, soit qu’ils aient été guidés par des principes philosophiques, ont généralement eu des intentions pures et bienveillantes ; la simple exposition du but des associations de ce genre, suffit pour en convaincre.
Mais la nature des choses ou des hommes ne se modifie point selon nos désirs ; les fondateurs de l’esclavage ne sont jamais parvenus à exempter les maîtres de tous maux, ni à leur assurer le monopole des jouissances ; les hommes qui ont tenté de répartir les plaisirs et les peines d’une manière égale, entre tous les membres d’une société, n’ont pas mieux réussi. Les premiers ont échoué, parce qu’ils ont eu à lutter contre la nature humaine ; les seconds ont échoué parce qu’ils ont eu à lutter contre les mêmes obstacles. On verra, cependant, que les derniers sont arrivés plus près de leur but que les premiers, et que leurs erreurs ont eu des traces moins durables.
Nous trouvons la communauté des travaux et des biens dans l’enfance de plusieurs sociétés ; il paraît qu’un tel système exista jadis chez quelques peuples de la Germanie, et nous avons vu que, dans le dix-septième siècle, on le trouvait encore chez plusieurs peuplades de l’Amérique septentrionale. Nous voyons un système analogue chez quelques peuples de l’antiquité ; des conquérants, après avoir établi une égalité de misère entre les individus de la race asservie, ont cherché à établir entre eux une égalité de jouissances. Le système des Lacédémoniens, si vanté par les philosophes de l’antiquité et par plusieurs philosophes modernes, n’avait pas d’autre but que de faire régner l’égalité entre les maîtres ; et l’égalité des hommes possédés était une conséquence naturelle de l’égalité qui régnait entre leurs possesseurs.
Plusieurs sectes chrétiennes ont fait de l’égalité entre tous les hommes, un des principes fondamentaux de leurs doctrines. Dans l’opinion des Anabaptistes, toute société dans laquelle la communauté des biens n’existe pas, est une assemblée impure, une race dégénérée ; un vrai chrétien n’a pas besoin de magistrats, et ne doit pas l’être. Les Frères Moraves, en Amérique, ont également établi la communauté de biens entre eux ; mais il paraît que cet établissement a été le résultat de quelques circonstances particulières, bien plus que le produit d’un système arrêté d’avance. À l’époque de la colonisation de l’Amérique septentrionale, des Anglais établirent aussi entre eux une communauté de travaux et de biens ; mais les inconvénients qui en résultèrent, les contraignirent d’y renoncer. Les missionnaires espagnols qui soumirent les peuples du Paraguay établirent, dans cette vaste contrée, un semblable système, et ce système paraît y exister encore. Une colonie allemande, composée de sept ou huit cents personnes, a fondé, dans l’Amérique septentrionale, un établissement de ce genre, il n’y a pas encore longtemps. Enfin, en Angleterre, il existe une association nombreuse, sous le nom de Cooperative Society, dont le but est de former ou de provoquer des associations dans lesquelles les biens soient communs, et où chacun travaille au profit de tous.
Pour faire connaître la nature et les effets des associations de ce genre, je parlerai seulement des communautés établies par des missionnaires espagnols dans diverses parties de l’Amérique et de la colonie allemande formée sur le même continent, sous le nom d’Harmony (harmonie). Je parlerai des premières, parce que nous n’en connaissons point qui aient été aussi nombreuses, et qui aient eu une aussi longue durée ; je parlerai de la seconde, parce qu’elle est une des plus récentes et des mieux connues.
En exposant les résultats que produisent naturellement de semblables associations, j’ai moins pour but de détruire des opinions qui me semblent fausses, que de trouver quel est l’état social qui convient le mieux à la nature de l’homme. Il y a deux manières de prouver la vérité d’une proposition : l’une, qu’on nomme directe, et qui consiste à faire voir les conséquences immédiates d’un principe reconnu ; l’autre, qui consiste à démontrer que toutes les suppositions contraires à la proposition donnée, conduisent à l’absurde. J’ai fait voir ce qui arrive lorsque les richesses, créées par les travaux de la partie la plus nombreuse de la population, sont absorbées par une autre partie à mesure qu’elles sont produites : toutes les misères sortent de ce système. Je vais exposer maintenant ce qui arrive lorsque tous les travaux et les produits qui en résultent, sont partagés également entre tous les travailleurs ; s’il est démontré que ce dernier mode d’existence ne convient pas beaucoup mieux que le précédent à la nature de l’homme, il sera facile de voir quel est l’état social le plus favorable au bien-être des nations.
Lorsque les missionnaires jésuites s’établirent dans le Paraguay, et prirent les indigènes sous leur domination, la terre y était déjà cultivée et partagée en propriétés particulières. Nous ignorons de quelle manière les partages avaient été faits ; mais il ne paraît pas qu’il y existât une grande inégalité de fortune. Cependant, l’établissement de la communauté des travaux et des biens fut, dans le gouvernement des missionnaires, la circonstance la plus insupportable pour ces peuples. Mais ces nouveaux législateurs, à l’exemple de Lycurgue, qui leur servit probablement de modèle, ne se laissèrent point intimider par les murmures des mécontents, et ils exécutèrent rigoureusement le plan qu’ils avaient formé. Tous les biens devinrent donc communs entre tous les membres de la société [404]. Le même système fut établi dans les deux Californies et dans d’autres parties des possessions de l’Espagne.
L’établissement des jésuites dans le Paraguay date de 1580 ; environ deux siècles après, leur empire avait deux cents lieues du nord au sud, et cent cinquante lieues de l’est à l’ouest. Ils régnaient ainsi sur un pays un peu plus étendu que la France ; mais la population n’était que de 300 000 individus, ou dix habitants par lieue carrée [405]. La population était, comme elle paraît être encore, divisée en gouvernements auxquels on donnait le nom de missions. Les missionnaires avaient obtenu qu’ils seraient indépendants des vice-rois, et qu’aucun Espagnol ne pourrait pénétrer dans le pays. À ces deux conditions, ils s’étaient chargés de civiliser les indigènes, et de les convertir au christianisme [406]. Les succès des missionnaires furent d’abord assez rapides : les Portugais faisant alors une guerre d’extermination aux Indiens, un grand nombre cherchèrent un refuge sous la protection de ces religieux. Le nombre de leurs colonies, dans cette partie de l’Amérique, s’éleva jusqu’à trente-trois [407]. Les peuples soumis au même régime que les indigènes du Paraguay, occupaient un territoire encore plus vaste. M. de Humboldt a évalué l’étendue du pays soumis au régime des missions, à quatre ou cinq fois l’étendue de la France [408].
Chaque peuplade avait deux missionnaires ; un ancien, qui s’occupait de l’administration temporelle, dont il était le directeur, et un vicaire moins âgé, qui remplissait les fonctions sacerdotales. Outre ces deux magistrats, il en existait d’autres qui étaient élus parmi les indigènes, par les jésuites eux-mêmes ou par le peuple, après que les missionnaires avaient exclu les individus dont la nomination aurait pu leur déplaire [409]. En 1768, les jésuites furent expulsés de ce pays, et remplacés par d’autres missionnaires ; mais rien ne fut changé dans le mode d’administration, de sorte que nous n’avons pas à nous occuper de l’ordre auquel appartiennent les régisseurs [410].
Dans une société où tous les travaux se font en commun, et où les produits sont distribués à chacun par portions égales, il ne faut pas une législation fort compliquée. On n’a aucun besoin de lois, pour la garantie ou pour le partage des propriétés. On n’en a pas besoin pour régler l’état des familles, puisqu’il n’y a point de successions à recueillir, et que tous les enfants sont nourris aux dépens de la société générale. Enfin, on n’en a pas besoin pour l’établissement ou la répartition des impôts, puisque chacun contribue par son travail, et que les fonds publics en sont déposés dans des magasins publics. Il ne faut, à une telle société, qu’une administration semblable à celle d’une grande famille ; et, en effet, il n’en a jamais existé d’autre dans le Paraguay, ou dans les autres établissements formés par des missionnaires. Tout a été réglé par la volonté des chefs principaux : les délits même, étant plutôt considérés comme des péchés ou comme des offenses à la Divinité, que comme des offenses à la société, ont été punis par les ministres de la religion [411].
Les fonctions des membres du gouvernement consistent à déterminer l’emploi que chacun doit faire de ses talents, selon les besoins de la société, à distribuer les outils nécessaires à l’exercice de chaque métier, à régler les heures pendant lesquelles chacun doit travailler, à recueillir et à conserver dans des magasins les produits de l’industrie de tous, à les distribuer de manière à ce qu’ils durent pendant tout le cours de l’année, à faire avec l’étranger le commerce que les besoins communs exigent, et à veiller à ce que chacun exécute la tâche qui lui est imposée. Telles ont été, en effet, les fonctions des missionnaires [412].
Quoique l’égalité des travaux et de biens ait été la base fondamentale de ce genre d’associations, les fondateurs ont compris qu’il n’était pas possible d’établir une égalité absolue ; ils ont en conséquence accordé à chaque famille un petit espace de terrain, et deux jours de la semaine pour les cultiver [413]. Quelquefois, il a été permis aux hommes d’aller à la chasse ou à la pêche pour leur propre compte, sans autre obligation que de faire quelques petits présents de gibier ou de poisson aux chefs principaux de la mission [414]. Ainsi, outre la propriété commune résultant du travail de tous les membres de la société, il a pu exister quelques propriétés privées résultant du travail de deux jours par semaine, et du peu de temps accordé pour la pêche et la chasse.
Les chefs de chaque communauté distribuent à chacun la tâche qu’il doit exécuter. Les hommes sont généralement chargés de la culture des champs et de l’exercice de quelques arts grossiers ; ceux qui sont sacristains, musiciens ou enfants de chœur, sont chargés de tous les travaux à l’aiguille. Les femmes, outre les soins qu’elles donnent à leur ménage, sont chargées, tous les matins, de torréfier et d’écraser, sur une pierre, le grain qui doit servir d’aliments pendant le cours de la journée ; elles doivent de plus filer, par jour, une once de coton. Chacun devant son travail à la communauté, il n’est permis à personne de travailler en particulier [415].
Il y a, par jour, deux heures de prières et sept heures de travail ; les dimanches étant consacrés au repos, le temps des prières est de quatre ou cinq heures. À huit heures du matin, la peuplade s’assemble, et, après avoir baisé la main du missionnaire, elle est conduite, par des chefs, aux lieux de travail, les uns dans les champs, les autres dans des ateliers. Ils sont toujours sous l’inspection d’un magistrat, de sorte que le travail ne peut jamais se ralentir [416].
La communauté ne doit des aliments à ses membres que pendant les jours qu’ils travaillent pour son compte ; ils doivent se nourrir, pendant les autres jours, des produits du terrain qui leur est accordé. Voici en quoi consistent les aliments que la société leur donne, et comment ces aliments sont préparés et distribués. Pendant que la peuplade assiste à la messe, on fait cuire au milieu de la place, dans trois grandes chaudières, de la farine d’orge dont le grain a été rôti avant d’être moulu ; cette espèce de bouillie n’est assaisonnée ni de beurre ni de sel. Chaque cabane envoie prendre la ration de tous les habitants dans un vase d’écorce ; lorsque les chaudières sont vides, on distribue le gratin aux enfants qui ont le mieux retenu leur catéchisme. Ce repas dure trois quarts d’heure. À midi, les cloches annoncent le dîner ; les Indiens laissent leur ouvrage, et envoient prendre leur ration dans le même vase que pour le déjeuner. Cette seconde bouillie est un peu plus épaisse que la première ; on mêle au blé et maïs dont elle est composée des pois et des fèves ; ils retournent au travail à deux heures, et en reviennent à quatre ou cinq pour faire la prière. Quand elle est finie, et qu’ils ont baisé de nouveau la main du missionnaire, on leur distribue une bouillie semblable à celle du déjeuner. Tous les jours se ressemblent, dit La Pérouse ; et, en traçant l’histoire d’un de ces jours, le lecteur aura celle de toute l’année [417]. Il est cependant des jours de fête où l’on distribue de la viande crue ; et, dans quelques missions, on en donne un peu aux hommes qui travaillent pour la communauté, mais sans s’occuper de leurs familles [418].
Les chefs de la communauté doivent distribuer à chacun des membres de la toile pour leurs vêtements. Les règlements ont déterminé la quantité qui leur en serait donnée par année : les hommes doivent en avoir six varas (cinq mètres), et les femmes cinq. Quant aux enfants, on a jugé qu’ils n’en avaient pas besoin [419]. Les filles, qui sont quelquefois nubiles à huit ans, vont complètement nues jusqu’à neuf, sans que les missionnaires s’en offensent [420]. Le vêtement des femmes et celui des hommes consiste en une chemise de toile grossière fabriquée dans le pays, et qui ne les couvre pas mieux que ne ferait une chemise de gaze [421]. Un caleçon, des souliers et un chapeau sont des objets de luxe inconnus parmi eux [422]. Dans quelques missions, les plus riches possèdent quelquefois un manteau de peau de loutre qui leur tombe jusque au-dessous des aines ; du reste ils sont aussi nus que ceux qui vivent dans les bois [423].
Les membres de ces communautés ne sont pas mieux logés qu’ils ne sont vêtus.
« Leurs cabanes, dit La Pérouse, sont les plus misérables qu’on puisse rencontrer chez aucun peuple ; elles sont rondes, de six pieds de diamètre sur quatre de hauteur ; quelques piquets de la grosseur du bras, fixés en terre et qui se rapprochent en voûte par le haut, en composent la charpente ; huit à dix bottes de paille mal arrangées sur ces piquets garantissent, bien ou mal, les habitants de la pluie ou du vent, et plus de la moitié de cette cabane reste découverte quand le temps est beau ; leur seule précaution est d’avoir chacun deux ou trois bottes de paille en réserve. »
Chacune de ces cabanes renferme, cependant, quatorze ou quinze personnes [424]. Les habitations et la population présentent un aspect si misérable, que Vancouver a pensé qu’on ne pouvait mettre en parallèle que les habitants de la Terre-de-Feu [425].
Les fautes ou les péchés sont punis à coups de fouet ou par le cep. Les fouets sont faits de peaux de lamentin, et ressemblent à ceux qu’emploient les planteurs dans les colonies. Le cep se compose de deux poutres entre lesquelles on place les jambes du patient. Un individu, homme ou femme, qui manque à la prière ou qui n’exécute pas ponctuellement l’ordre qui lui est donné, est puni de vigoureux coups de fouet. La même peine est infligée aux femmes qui sont chargées d’écraser le grain, et qui se rendent coupables de l’infidélité la plus légère. Si le patient, vaincu par la douleur, implore sa grâce, l’exécuteur diminue quelquefois la force des coups ; mais il en donne toujours le nombre déterminé. Les hommes reçoivent le fouet en présence de la communauté assemblée ; mais les femmes sont fouettées en secret, de peur que leurs cris et leur désespoir n’excitent les hommes à la révolte. Ces châtiments ont souvent le même degré de cruauté que ceux qui sont infligés aux esclaves, même pour des fautes qui sont peu graves. Quelquefois, au lieu de châtier eux-mêmes les femmes ou les enfants coupables, les chefs font faire les exécutions par les pères ou par les maris, qui s’en acquittent aussi bien que les magistrats peuvent le désirer [426].
Le gouvernement de chacune de ces communautés étant théocratique, les magistrats ont, pour découvrir les fautes ou les délits, un moyen qui leur est particulier, c’est la confession. Mais, comme les peines infligées aux coupables sont de vigoureux coups de fouet, on conçoit que les pénitents ne se pressent pas de déclarer leurs fautes : on supplée à leur silence, en les obligeant à confesser les péchés d’autrui. Il arrive de là que lorsqu’un pénitent se présente, le prêtre sait déjà quels sont les points sur lesquels il doit l’interroger, et comment il doit s’y prendre pour le convaincre.
« Il s’établit, entre le ministre de l’Église et l’Indien qui se confesse, dit Depons, des débats d’une singularité piquante. Il est rare qu’on obtienne de l’Indien l’attitude d’un pénitent ; il s’agenouille en débutant ; il est bientôt assis à terre : et là, au lieu de déclarer ses péchés, il nie fortement tous ceux dont le confesseur lui demande l’aveu ; il faut qu’il soit évidemment convaincu de mensonge pour qu’il se reconnaisse coupable de quelque péché ; c’est souvent ce qu’il ne fait qu’à la dernière extrémité, et en maudissant ceux qui en ont informé le prêtre [427] ».
La confession finie, le pénitent est vigoureusement fouetté en public [428]. Chaque individu se devant presque tout entier à la communauté du moment qu’il peut se livrer à quelque travail, il a été nécessaire de prévenir la désertion. Les chefs ne se sont donc pas bornés à interdire l’entrée de leur territoire à tous les étrangers sans distinction, mais ils ont défendu d’en sortir à tous leurs subordonnés. Afin que cette défense ne devint pas illusoire, l’usage du cheval a été interdit d’une manière générale, et l’interdiction n’a été levée qu’en faveur d’un très petit nombre d’individus auxquels on a cru pouvoir se fier. Les précautions ont été portées plus loin : chaque peuplade a été environnée de fossés profonds ; des portes ont été mises à toutes les entrées, et des sentinelles ont été préposées à la garde de ces portes. Ainsi, chaque individu a été circonscrit dans un espace d’environ cinq cents mètres de rayon (600 varas), qu’il ne lui a jamais été permis de dépasser, sous peine d’être puni de coups de fouet. L’usage des armes a été également interdit [429].
Les peuples soumis à un tel régime ne manifestent aucun genre d’activité physique ou intellectuelle. Ils se portent au travail avec une telle nonchalance, que soixante ou soixante-dix d’entre eux ne font pas plus de travail que huit ou dix de nos ouvriers d’une activité médiocre [430]. Ils joignent la malpropreté à la paresse, et ne portent d’intérêt à rien ; que les chefs des missions les élèvent à une dignité ou qu’ils les en fassent descendre, peu leur importe [431]. La vie même ne leur inspire aucun attachement ; ils ne se plaignent point quand ils souffrent ; ils meurent sans éprouver ni sans inspirer de regret [432]. Ils sont si loin de mettre à rien la moindre importance, que les femmes ignorent la chasteté, comme les hommes la jalousie. Ils semblent n’avoir pas assez de vie pour se propager [433]. Ils ne sont pas moins indifférents pour une vie à venir que pour ce qui existe dans ce monde [434].
Ces peuples ont cependant des vices nombreux ; outre la paresse et l’oisiveté dont j’ai déjà parlé, ils ont toutes les mauvaises habitudes que nous avons observées chez les sauvages et chez les esclaves.
« Depuis près de trois siècles qu’on cherche à donner à cette misérable espèce d’hommes quelque idée du juste et de l’injuste, dit Depons, on n’a pu obtenir qu’ils respectassent la propriété d’autrui lorsqu’ils peuvent la ravir ; qu’ils ne fussent pas dans un état continuel d’ivresse lorsque la boisson ne leur manque pas ; qu’ils ne commissent point d’inceste lorsqu’ils en ont l’occasion ; qu’ils ne fussent pas menteurs et parjures lorsque le mensonge ou la violation du serment doivent leur être profitables ; qu’ils se livrassent au travail lorsque la faim du moment ne les y oblige pas [435]. »
Leurs facultés intellectuelles sont aussi peu développées que leurs facultés morales ; s’ils étaient moins paresseux, et moins indifférents sur tout ce qui les environne, ils auraient plus d’analogie avec les abeilles et les castors qu’avec des hommes. Ils cultivent tous les mêmes plantes ; ils rangent leurs cabanes de la même manière ; ils se nourrissent des mêmes aliments, travaillent le même nombre d’heures, se livrent aux mêmes pratiques [436]. Leur industrie se borne à cultiver quelques végétaux, et à fabriquer la toile grossière qui leur sert de vêtements. Les arts les plus usuels parmi nous n’y sont pas connus [437]. Ils sont d’une telle stupidité, que leur curiosité ne peut pas être excitée même par les spectacles les plus inaccoutumés, et que, suivant l’opinion même des missionnaires, ils meurent dans l’âge le plus avancé, sans être jamais sortis de l’enfance [438].
Mais ces mêmes hommes, si stupides et si indolents, qui se laissent fustiger patiemment à la porte des églises, se montrent rusés, actifs, impétueux et cruels, chaque fois qu’ils agissent en masse dans une émeute populaire. Leur volonté se réveille avec le sentiment de leurs forces, et ils marchent vers leur but avec une énergie qui leur fait braver tous les dangers [439].
Il est impossible de considérer attentivement l’état social de ces peuples, leurs mœurs, le développement intellectuel qui leur est propre, leur faiblesse quand ils sont isolés, leur énergie quand ils ont secoué le joug de l’autorité, sans être frappé de l’analogie qui existe entre eux et les nègres des colonies européennes. La ressemblance est si parfaite qu’elle a été d’abord aperçue par les hommes les plus disposés à rendre justice au zèle des chefs de ces établissements.
« J’avoue, dit La Pérouse après avoir fait l’éloge de leur piété et de leur sagesse, que plus ami des droits de l’homme que théologien, j’aurais désiré qu’aux principes du christianisme on eût joint une législation qui, peu à peu, eût rendu citoyens des hommes dont l’état ne diffère presque pas aujourd’hui de celui des nègres des habitations de nos colonies régies avec le plus de douceur et d’humanité [440]. »
L’influence exercée par le régime de la communauté de travaux et de biens, sur l’intelligence et sur les mœurs des chefs du gouvernement, n’est pas aussi facile à constater que l’influence exercée par un tel régime sur les mœurs et sur les facultés intellectuelles des autres membres de la communauté. Les chefs du gouvernement ne peuvent pas se livrer aux travaux des champs ; leur occupation est de gouverner et de prier. Nous ne pouvons connaître qu’imparfaitement leur vie privée, parce qu’ils admettent rarement des étrangers à visiter l’intérieur de leurs maisons, et que, dans ces rares occasions, ils ne se montrent que comme ils désirent être vus. Cependant, comme ils sont tous soumis aux mêmes règles et qu’ils exercent les mêmes pouvoirs, ce que nous savons sur quelques-uns pourra nous faire juger de ce que sont les autres. L’uniformité des règles monastiques simplifie singulièrement les recherches.
Les missionnaires, en arrivant dans le pays, y apportent la quantité de connaissances qui leur ont été données ailleurs, et paraissent ne pas faire beaucoup de cas de l’instruction, si l’on en juge du moins par quelques-uns d’entre eux.
« Notre missionnaire, dit M. de Humboldt, semblait d’ailleurs très satisfait de sa position.... La vue de nos instruments, de nos livres, et de nos plantes sèches lui arrachait un sourire malin, et il avouait avec la naïveté qui est propre à ces climats, que de toutes les jouissances de la vie, sans en excepter le sommeil, aucun n’était comparable au plaisir de manger de la bonne viande de vache, carne de vacca : tant il est vrai, ajoute M. de Humboldt, que la sensualité se développe par l’absence des occupations de l’esprit [441]. »
Un autre voyageur nous dit, en parlant d’un missionnaire qu’il peint comme un des meilleurs, qu’il considérait tous les savants anciens et modernes comme des députés de Satan, envoyés pour corrompre le genre humain, et qu’il se serait volontiers fait démon, pendant quelques années, pour assouvir sur eux sa sainte vengeance [442]. On peut juger d’après cela que les chefs de ces communautés n’ont pas les facultés intellectuelles très développées, et le genre de vie qu’ils mènent n’est pas propre à les étendre.
Le chef d’une mission, après avoir dit sa messe, donne sa main à baiser à tous les membres de la communauté, puis il déjeune, mais sans envoyer prendre sa ration de bouillie dans la chaudière commune. Ayant déjeuné, il travaille avec les corrégidors qui sont ses ministres, et visite ensuite les ateliers ; s’il sort, ce n’est jamais qu’à cheval, et en grand cortège. Il dîne à onze heures, seul avec son vicaire. À deux heures, il s’enferme dans son intérieur, et dort jusqu’au soir. À sept heures, il soupe ; à huit, dit Bougainville, il est sensé couché [443]. Il ne nous est pas possible de savoir en quoi consistent les repas des membres de ce gouvernement ; mais, peut-être, pourrons-nous le présumer, lorsque nous aurons vu ce que deviennent les revenus annuels de la communauté.
Les missionnaires ayant un costume réglé par leur ordre, ne peuvent mettre beaucoup de luxe dans leurs vêtements. Les revenus de la communauté sont employés d’abord à la construction de leurs maisons, et ensuite à la construction et à l’ornement des églises ; l’habillement des autres membres de l’association n’est placé qu’en troisième ligne, et chacun doit aller nu, jusqu’à ce que ces premiers besoins soient satisfaits. Un vieux missionnaire assurait à M. de Humboldt que cet ordre ne pouvait être changé sous aucun prétexte [444]. Les maisons et les églises doivent varier selon que les communautés sont plus ou moins anciennes, et qu’elles ont des revenus plus ou moins considérables. Les églises sont, en général, les plus magnifiques de ces contrées ; elles sont pleines de très grands autels, de sculptures et de dorures ; les ornements ne peuvent pas être plus précieux [445].
Les chefs du gouvernement sont naturellement chargés de la garde et de l’administration des biens communs ; ils sont chargés aussi de faire le commerce que l’intérêt de la société demande. Mais tous les produits des travaux communs ont fini par devenir la propriété exclusive des administrateurs, et les personnes employées à l’exécution de ces travaux ont perdu jusqu’à l’espérance d’en recueillir jamais le fruit ; les neuf dixièmes d’entre eux ont même cessé de recevoir le misérable vêtement qui leur était accordé. Tandis que les moyens d’existence ont diminué, les travaux sont devenus plus rudes et plus continus ; les femmes ont été conduites dans les champs comme les hommes, et quelquefois on a même privé ces infortunés des deux jours pendant lesquels ils pouvaient travailler pour eux. Les menaces et les promesses de la religion sont tour à tour employées pour obtenir d’eux des travaux au-dessus de leurs forces. « On les pousse continuellement au travail, dit Azara, et finalement tous les biens de la communauté se partagent entre les chefs, leurs favoris, et les administrateurs [446]. »
Les membres des communautés suppléent par la peinture aux vêtements qui leur manquent, et leurs administrateurs ont trouvé le moyen de se faire de ce besoin une source de revenus. Plusieurs se sont emparés du commerce de la couleur qui leur sert à se peindre en rouge, et ils la leur vendent à un prix excessif ; ils leur enlèvent ainsi les produits des jours libres qui leur sont laissés [447]. À l’aide de ce moyen et d’autres semblables, la plupart parviennent à amasser une fortune que quelques personnes ont évaluée de 60 000 à 80 000 piastres, et que les plus modérés ont portée à la moitié de cette somme [448].
Les chefs des communautés ne sont pas seulement les administrateurs des biens communs, ils sont aussi les gardiens de la vertu des filles et des femmes. Deux corps de logis tiennent à la maison du chef principal : dans l’un, on exerce les arts que demandent les besoins communs ; dans l’autre se trouvent un grand nombre de jeunes filles occupées à divers ouvrages, sous la garde et l’inspection de vieilles femmes. Suivant Bougainville, l’appartement du curé communique intérieurement avec ces deux corps de logis [449] ; le même fait nous est attesté par La Pérouse :
« Les religieux, dit-il, se sont constitués les gardiens de la vertu des femmes. Une heure après le souper, ils ont soin d’enfermer sous clef toutes celles dont les maris sont absents, ainsi que les jeunes filles au-dessus de neuf ans ; et, pendant le jour, ils en confient la surveillance à des matrones [450]. »
La Pérouse ne nous dit pas dans les mains de qui cette précieuse clef reste déposée ; mais il le laisse conjecturer.
Les voyageurs parlent peu, en général, des mœurs privées des chefs de ces communautés ; mais, lorsque les jésuites furent remplacés par d’autres religieux, il se répandit en Amérique des bruits qui leur étaient peu avantageux. Bougainville, qui se trouvait alors dans le pays, n’en parle que d’une manière obscure :
« Ma plume se refuse, dit-il, au détail de tout ce que le public de Buenos-Aires prétendait avoir été trouvé dans les papiers saisis aux jésuites ; les haines sont encore trop récentes pour qu’on puisse discerner les fausses imputations des véritables [451]. »
Lorsque la domination devient lucrative, on cherche naturellement à l’étendre ; c’est ce qu’ont fait la plupart des chefs de ces associations, quand ils ont commencé à s’apercevoir des avantages que produisait une communauté de travaux et de biens ; ils sont allés à la conquête des âmes, conquista de almas. Au milieu de la nuit, un missionnaire, suivi d’une troupe de soldats qu’excitaient l’espoir des récompenses, se précipitait sur une peuplade ; on massacrait tout ce qui faisait résistance, on brûlait les cabanes, on détruisait les plantations, et l’on amenait comme prisonniers les vieillards, les femmes et les enfants. Ces âmes conquises étaient distribuées ensuite dans les missions, et l’on avait soin de séparer les mères des enfants, de peur qu’ils ne concertassent ensemble les moyens de s’enfuir. Les enfants conquis étaient traités en esclaves, jusqu’à ce qu’ils eussent atteint l’âge de se marier [452].
Les nuances qui séparent de la traite et de l’esclavage cette manière de conquérir et de gouverner les âmes, sont tellement légères qu’il était difficile que les chefs des communautés ne passassent pas d’un régime à l’autre. Aussi, les missionnaires ont fini par faire le commerce des esclaves, et plusieurs en avaient même un très grand nombre. Lorsque les jésuites ont été remplacés par d’autres, la seule maison de Cordoue en possédait 3 500. On a trouvé aussi les magasins remplis de marchandises, parmi lesquelles il y en avait de beaucoup d’espèces qui ne se consommaient pas dans les missions [453].
Ainsi, après plus de deux siècles d’existence, des communautés qui avaient pour objet d’assurer à chacun une égalité de plaisirs et de peines, ont produit la plus grande des inégalités ; elles ont mis tous les biens d’un côté et tous les travaux de l’autre. Il faut dire cependant que l’égalité a été aussi grande qu’elle pouvait l’être entre tous les individus de la classe laborieuse ; mais ce n’a été qu’une égalité d’ignorance, de stupidité, de vices et de misère ; une égalité semblable à celle qui peut exister entre des esclaves.
Les effets que nous avons observés, ont été des conséquences du système, et n’ont pas été produits par les vices particuliers à une classe d’hommes. Il n’y a même pas longtemps que ce système était considéré par des philosophes comme le chef-d’œuvre de l’esprit humain. Raynal l’a mis au-dessus de tout ce que les législateurs ont jamais produit de plus parfait. Il prétend que ce système prévenait les crimes et dispensait des punitions ; il dit que les mœurs étaient belles et pures ; qu’on y craignait sa conscience et non les châtiments ; il ne parle qu’avec dédain des politiques qui firent voir, dans le défaut de propriété, un obstacle insurmontable à la population ; et cela lui fournit une occasion de faire voir les malheurs et les vices auxquels donne naissance l’existence de la propriété. Persuadé que l’expulsion des jésuites allait entraîner la chute du système de la communauté de travaux et de biens, Raynal termine son panégyrique en ces termes : « Quoi qu’il arrive, le plus bel édifice qui ait été élevé dans le Nouveau-Monde sera renversé [454]. »
Bougainville, avant que d’avoir vu de près ces communautés, en avait la même opinion que Raynal ; mais il a été promptement désabusé [455].
[IV-530]
Les premiers Anglais qui passèrent en Amérique pour s’y établir, formèrent aussi des associations dans lesquelles les travaux et les biens devaient être communs ; les produits qu’ils obtenaient de la terre étaient enfermés dans des magasins publics, et on en distribuait une partie toutes les semaines ; mais, en peu de temps, les abus devinrent tellement graves, que les membres de ces associations furent obligés de se séparer [456].
Les Frères Moraves, quoique soutenus par le zèle religieux, ont éprouvé tant d’inconvénients de leurs associations, que tous les membres ont fini par éprouver un égal mécontentement [457].
Une association religieuse, composée d’environ sept cents Allemands, s’est établie depuis peu d’années dans l’Amérique septentrionale. Sortis d’un pays où la concurrence leur avait fait une nécessité de développer leurs facultés intellectuelles et physiques, excités par le zèle religieux, et placés sur une terre où tout homme qui travaille est assuré de jouir des fruits de son travail, ils ont fait des progrès rapides.
Les individus dont cette association se compose ayant été formés sous un autre régime, et n’étant encore qu’à leur première génération, il n’est pas possible de déterminer d’une manière exacte quelles en seront les conséquences futures. Cependant, on peut prévoir, dès ce moment, que si l’association se prolonge longtemps, elle aura la plupart des effets que nous avons observés dans les communautés formées par les missionnaires.
Les opinions religieuses des membres de cette société leur font considérer le mariage comme contraire à la perfection de l’homme, et ces opinions ont sur eux une telle puissance, que, si elles continuaient d’agir pendant cinquante années avec la force qu’elles ont eue jusqu’à ce jour, la société serait détruite faute de membres. Ces opinions, qui menacent l’association d’une destruction future peu éloignée, sont une garantie de son existence actuelle ; mais si elles viennent à s’affaiblir chez quelques individus jeunes et bien constitués, les croyants seront, en peu de temps, les esclaves des incrédules. Il faudra qu’ils travaillent pour eux-mêmes et pour les enfants d’autrui ; et s’ils se voient réduits à cette nécessité, ils ne tarderont pas à user de représailles et à mettre leurs enfants à la charge des autres.
Afin de ne pas ébranler leurs croyances, ils repoussent d’au milieu d’eux l’usage de l’imprimerie, et n’admettent aucune discussion religieuse ou politique, surtout avec des étrangers ; de sorte qu’ils se trouvent naturellement dans la voie que les missionnaires espagnols ont parcourue. Leur pasteur est, en même temps, chef de la religion et de l’administration ; ils ne pensent et n’agissent que sous sa direction, et sont ainsi placés sous un gouvernement théocratique analogue à celui du Paraguay
Quoique établie depuis peu d’années, l’égalité n’existe déjà plus entre les chefs et les subordonnés, si même on peut dire qu’elle a jamais existé. L’usage du thé et du café est interdit aux gouvernés, et réservé aux gouvernants. Un livre des recettes et des dépenses avait été d’abord établi ; mais, des valeurs considérables ayant passé dans les mains des administrateurs, le livre a été perdu, et il n’a pas été possible de le retrouver. Afin de ne pas faire à l’avenir des pertes de ce genre, il a été déterminé qu’on ne tiendrait plus compte de rien. Les membres du gouvernement ont donc sur les biens communs un pouvoir égal à celui dont jouissent les missionnaires dans les colonies espagnoles. On peut, sans être prophète, prédire que cette association n’aura ni plus de durée, ni de meilleurs résultats que celles dont j’ai précédemment parlé [458].
Les associations de travaux et de biens, formées par un grand nombre de personnes et pour les générations à venir, portent dans leur sein un principe de décadence et de destruction que rien ne saurait paralyser ; elles auront toujours pour résultat la dégradation de la population, et la plus dure et la plus inique des inégalités. Il suffit, pour se convaincre de cette vérité, de se rappeler quelques-uns des faits que j’ai cités dans le premier volume de cet ouvrage.
J’ai fait observer que les actions que nous qualifions vertueuses, comme celles que nous appelons vicieuses, produisent toutes un mélange de biens et de maux ; mais que ces biens et ces maux n’arrivent pas en même temps, et ne se répartissent pas d’une manière égale. J’ai dit que le moyen le plus efficace de rendre communes les habitudes vicieuses, est de laisser à ceux qui les ont contractées toutes les jouissances qu’elles produisent, et de faire tomber sur d’autres les maux qui en sont le résultat. J’ai ajouté que le moyen le plus efficace d’extirper les bonnes habitudes est, au contraire, de concentrer sur ceux qui les ont contractées les peines qui les suivent ou les accompagnent, et d’en accorder tous les avantages à ceux qui y sont étrangers. Or, si l’on veut se donner la peine d’examiner comment agissent les communautés dont je me suis occupé dans ce chapitre, on verra qu’elles ont nécessairement ce double effet. Sous ce rapport, elles ont une ressemblance parfaite avec l’esclavage, et doivent, par conséquent, amener les mêmes résultats.
Supposons que cinquante individus pris au hasard, et différant, par conséquent, les uns des autres par leurs forces, soient conduits au travail, et que les produits doivent être partagés par portions égales ; la part du plus faible et du plus paresseux devant être égale à celle du plus diligent et du plus fort, la quantité de travail qui sera exécutée par chacun sera réglée par la quantité qu’en donnera le plus faible. Si un individu travaille avec zèle, il n’aura que la cinquantième partie des produits de son travail, et il en portera toute la fatigue ; s’il se livre à la paresse, il jouira seul des plaisirs qu’elle donne, mais il ne sentira que la cinquantième partie de la misère qui la suit. Ainsi, en voulant obtenir une égalité de travaux et de biens, on n’obtient qu’une égalité de paresse et de misère ; on n’élève pas les hommes paresseux et pauvres au niveau des hommes actifs et aisés, on fait descendre ceux-ci au niveau de ceux-là.
On peut faire, pour les travaux intellectuels, les mêmes raisonnements que pour les travaux purement physiques : l’homme le plus borné ou le plus stupide ayant les mêmes avantages que l’homme le plus intelligent, nul n’est disposé à prendre une peine qui tomberait tout entière sur lui, tandis qu’il ne recueillerait qu’une portion infiniment petite des avantages qui en seraient la suite. On obtient ainsi une égalité d’ignorance et de stupidité, quand on laisse aux travaux de l’esprit la fatigue qui en est inséparable, et qu’on attribue aux hommes les plus bornés les mêmes avantages qu’aux plus intelligents ; on n’élève pas les premiers au niveau des seconds, on fait descendre les seconds au niveau des premiers.
[IV-535]
Dans ce système, un homme est presque sans influence sur sa destinée : si, en se livrant à l’intempérance ou à d’autres vices, il se rend incapable de travailler, peu lui importe ; d’autres travailleront pour lui, pour sa femme et pour ses enfants. Il lui est aussi impossible de se ruiner qu’il lui est impossible de s’enrichir ; il n’a donc besoin ni de prévoyance, ni d’économie. Il n’a même pas besoin d’estime, puisque sa part dans les richesses communes est toujours la même, et qu’il ne peut pas déchoir sans que la population tout entière descende en même temps que lui.
Il n’a pas plus d’influence sur la destinée de sa femme et de ses enfants que sur la sienne ; il peut les maltraiter puisqu’il est le plus fort, mais il est incapable de leur transmettre aucun bienfait : qu’il soit malade ou qu’il meure, peu leur importe ; sa perte ne sera pas sentie. De son côté, le père ne peut rien attendre de ses enfants : n’ayant rien fait pour eux, ils ne lui doivent point de reconnaissance, et, s’ils lui en devaient, ils seraient incapables de s’acquitter.
Si chaque individu, parvenu à l’âge de puberté, juge à propos de se marier, la population manquera bientôt de subsistances ; si, au contraire, les plus prévoyants s’imposent des privations pour ne pas accroître la misère commune, ils n’éprouveront ni moins de privations ni moins de fatigues, puisqu’il faudra nourrir et élever les enfants des autres.
[IV-536]
Un tel régime, en un mot, n’est propre qu’à éteindre dans l’homme tout principe d’activité, d’affection, de bienveillance, en supposant même que les travaux et les produits qui en résultent soient distribués de la manière la plus impartiale ; mais, s’il arrive que les administrateurs se fassent une part plus avantageuse que les autres, les hommes qui travaillent ne peuvent manquer de devenir en peu de temps esclaves.
Les maux qui pèsent sur une nation sont donc toujours également graves, soit qu’une fraction de la population s’approprie les produits des travaux de l’autre, soit que les individus dont elle se compose aspirent à établir entre eux une égalité de bien et de maux. Il résulte de là que l’inégalité entre les individus dont un peuple se compose, est une loi de leur nature ; qu’il faut, autant qu’il est possible, éclairer les hommes sur les causes et sur les conséquences de leurs actions ; mais que la position la plus favorable à tous les genres de progrès est celle où chacun porte les peines de ses vices, et où nul ne peut ravir à un autre les fruits de ses vertus ou de ses travaux.
FIN DU QUATRIÈME ET DERNIER VOLUME.
Notes↩
[1]Les contradictions grossières que je viens de faire observer se retrouvent dans les actions et dans les discussions politiques. Tels Anglais et tels citoyens des États-Unis d’Amérique, qui voient avec une orgueilleuse pitié des écrivains du continent européen soutenir le principe de la légitimité des familles royales, traiteraient de révolutionnaire tout homme qui ne parlerait pas avec un respect suffisant de la légitimité des planteurs. Qu’on demande, par exemple, aux citoyens américains qui ont rendu au général Lafayette des honneurs inconnus jusqu’alors, ce qu’ils penseraient d’un homme qui rendrait à leurs esclaves des services analogues à ceux qu’ils ont eux-mêmes si bien récompensés, et l’on verra à quoi se réduisent leurs principes de morale. Lorsque les grands de Pologne ont été asservis, nous avons été émus de pitié, et nous avons maudit l’injustice de leurs oppresseurs ; mais ces grands tiennent des millions d’hommes dans l’asservissement, et nous n’y voyons rien à dire. On trouve, chez les peuples de l’antiquité, les mêmes inconséquences que chez les modernes : quelle grande et terrible leçon les meurtriers de César donnèrent à leurs propres esclaves ! Il n’y a que les hommes qui admettent une morale et une justice universelles qui puissent, sans inconséquence, honorer les défenseurs de la liberté ou combattre la servitude.
[2] Aristote met en quelque sorte l’esclavage sur la même ligne que le mariage : l’un ne lui paraît pas moins nécessaire que l’autre à l’existence d’une famille. Polit., liv. I, ch. IV, V et VI, tome I, p. 6 et de la traduct. de M. Thurot.
[3]Les patriciens pouvaient aussi être faits prisonniers, mais ils avaient pour se racheter, des moyens que n’avaient pas les hommes du peuple. S’ils étaient riches, ils payaient une rançon et devenaient libres ; s’ils étaient pauvres, leurs clients étaient dans l’obligation de payer pour eux. Les patriciens étaient donc toujours rachetés ; mais les plébéiens ne l’étaient jamais. Plusieurs de nos écrivains politiques ont vu dans cet abandon des prisonniers plébéiens, les calculs d’une sage et profonde politique de la part des sénateurs romains. Ils auraient mieux jugé les hommes, s’ils n’y avaient vu que l’effet de la dureté, de l’avarice et de l’insolence aristocratiques.
Annibal ayant fait sur les Romains un grand nombre de prisonniers, en fit proposer le rachat au sénat ; mais ce corps refusa de les racheter pour ne pas violer ses anciennes maximes, et surtout par esprit d’économie. Cependant, comme il manquait d’hommes pour se défendre, il acheta huit mille esclaves et leur donna des armes sans leur donner la liberté. Tite-Live, tome VII, p. 393 et 397 de la traduction de Dureau de Lamalle.
[4] Les prêtres de l’ancienne Rome, qui étaient tirés de la classe aristocratique, encourageaient, par leurs prédictions, les armées au pillage, parce qu’ils avaient part au butin. Tit.-Liv., lib. V, tome III, p. 84 et 101 de la traduction de Dureau de Lamalle.
[5] C’est à l’impuissance dans laquelle se trouve un possesseur d’hommes de consommer immédiatement les produits agricoles d’un très grand nombre d’individus, qu’il faut attribuer en grande partie l’hospitalité tant vantée des anciens temps ; comme c’est à la facilité qu’ont les despotes de s’approprier les richesses de leurs sujets, qu’il faut attribuer ce qu’on nomme quelquefois leur générosité. Le très petit nombre des princes qui se sont fait quelque scrupule de s’emparer de force ou frauduleusement du bien des autres, ont toujours été accusés d’avarice : je ne connais à cet égard aucune exception. On accuse aussi les hommes de s’être endurcis et de moins valoir que les anciens, par la raison qu’ils ne prodiguent pas en faveur des premiers venus, ce qu’ils gagnent laborieusement, ou ce qu’ils peuvent dépenser d’une manière plus agréable.
[6] On assure que la religion chrétienne condamne l’esclavage ; j’en suis convaincu ; aussi ferai-je voir ailleurs que ceux qui le soutiennent ou qui l’approuvent ne sont pas chrétiens. À l’exception des Quakers, dont la plupart ont affranchi leurs esclaves par principes de religion, il n’est point de sectes se disant chrétiennes qui n’admettent et ne protègent l’esclavage. Les catholiques de France, d’Espagne, de Portugal, font métier d’acheter et de vendre des êtres humains dans leurs colonies ; les reformés d’Hollande, d’Angleterre et des États-Unis se livrent au même commerce ; les catholiques, les reformés, et les peuples du nord de l’Europe, qui suivent le rit grec, ont de nombreux esclaves.
[7] Après la prise d’une seule ville gauloise, César en mit cinquante mille en vente.
[8] Les lois ne mettaient aucune borne au pouvoir de l’homme ou de la femme qui était une personne, sur l’homme ou la femme qui était une chose ; mais les censeurs et le sénat qui étaient investis d’une autorité en quelque sorte arbitraire, punissaient quelquefois les maîtres qui avaient, sans motifs, exercé sur leurs esclaves des cruautés révoltantes. Ainsi, un sénateur qui, au milieu d’un repas et pour l’amusement d’un convive avec lequel il avait des liaisons criminelles, avait fait couper la tête à un homme, fut jugé de mauvaise compagnie et cessa d’être admis au sénat. Plutarque, Vies de M. Caton et de Flaminius. Voyez Denys d’Halicarnasse, liv. VII, § LXXIII. — Tit.-Liv., tome XIII, p. 325.
[9] On trouve, dans les lois romaines, peu de dispositions relatives aux esclaves. La raison en est simple ; étant mis, par une disposition spéciale, au nombre des choses, et la loi ne leur accordant aucune protection, on n’a pas eu à s’occuper d’eux plus que de tout autre objet mobilier.
[10] « Sa coutume, dit Plutarque en parlant de M. Caton, était de frapper rudement... montrer un visage terrible à l’ennemi, et user de menaces en lui parlant d’une voix âpre et effroyable : ce qu’il prenait très bien et enseignait très sagement aux autres à le faire ainsi... Au moyen de quoi, ajoute le même historien, M. Caton enseigna à son fils, la grammaire, les lois, l’escrime, non seulement pour lancer le javelot, jouer de l’épée, voltiger, piquer chevaux et manier toutes armes, mais aussi pour combattre à coups de poing, endurer le froid et le chaud, passer à la nage le courant d’une rivière impétueuse et raide. » Plutarque, Vie de Marcus Caton, p. 400 et 414.
[11] L’invention de la poudre à canon a établi, en quelque sorte, l’égalité de forces physiques entre tous les hommes, et les exercices gymnastiques ont été négligés.
[12]Chez les Européens modernes, les hommes placés dans les rangs aristocratiques ont choisi bien souvent leurs femmes dans les classes industrieuses ; mais ils ont été déterminés dans leurs choix par des considérations de fortune plus que par des considérations de beauté. La polygamie n’étant plus admise, plusieurs ont pensé qu’avec les richesses des unes, ils achèteraient les charmes des autres ; la corruption a ainsi succédé à la violence ; c’est un pas dans la civilisation. L’influence de cette cause, jointe à celle de l’invention de la poudre, a rétabli l’équilibre des avantages physiques entre toutes les classes de la population.
[13] Un maître ne pouvait rien donner à son esclave, c’est-à-dire qu’il avait toujours la faculté de reprendre ce qu’il lui avait donné. Dig., lib. XL, tit. I, l. IV, § 1.
[14] L’exercice de la lutte était interdit aux esclaves, même sous les empereurs. Dig., lib. IX, tit. II, l. VII, § IV.
[15]Il existait chez les Romains une espèce d’esclaves dont les maîtres développaient les forces et l’adresse : c’étaient ceux qui étaient destinés à être gladiateurs. Mais ceux-là étaient tenus enfermés comme des bêtes féroces, jusqu’au moment où ils étaient jetés dans le cirque pour s’y égorger mutuellement, et servir ainsi aux menus plaisirs du peuple roi. Ces esclaves inspiraient une telle terreur à la population qui les dressait pour les faire égorger, que, du temps de César, on rendit une loi pour limiter le nombre de ceux qu’il serait permis d’introduire dans la ville. Deux cents étant une fois parvenus à s’échapper avec leurs armes, se précipitèrent sur tous les individus de la race des maîtres qui se trouvèrent sur leur passage, et leur donnèrent la mort. Il leur fut impossible de se sauver ; mais aucun d’eux ne se laissa prendre vivant. Les combats de gladiateurs n’étaient pas moins agréables aux dames qu’aux hommes. Plutarque, Vie de Sylla, p. 565. — Vie de Crassus, p. 654.
[16] Raynal, Hist. phil.
[17] Voyez le tome I, liv. II, ch. VIII et IX.
[18] Il suit de là que les qualités militaires sont d’un genre neutre, et que la qualification qu’on doit leur donner dépend des dispositions morales qui en dirigent l’emploi : elles sont un perfectionnement quand elles ont pour but la défense, la conservation ou la liberté ; elles sont une dégradation quand elles ont pour but la conquête, la tyrannie ou la destruction.
[19] La Morale et la Politique d’Aristote, liv. VII, chap. VII, tome II, p. 458 et 459 de la traduction de M. Thurot.
[20] Aristote, Ibid., ch. IX, p. 465.
[21] Plutarque, Vie de Marcellus.
[22] Denys d’Halicarnasse, liv. II, § XXVIII.
[23] Ibid., liv. IV, § XIII.
[24] Plutarque, Vie de Caton.
[25] Plutarque, Vie des Gracques.
[26] Denys d’Halicarnasse, liv. VI, § LIII, tome II, p. 53. — L’historien qui rapporte ce discours, parle de Menenius comme du plus sage des sénateurs.
[27] Suétone, Vie d’Auguste, § II et III, p. 221 et 225.
[28] Denys d’Halicarnasse, liv. IX, § XXV, tome II, page 322. L’aristocratie avait un intérêt particulier à renforcer le préjugé que crée l’esclavage contre l’exercice de toute industrie utile : elle prenait à ferme les terres conquises par la république, et les faisait cultiver par ses esclaves ; elle faisait aussi exercer par ses esclaves les arts et le commerce ; de sorte qu’elle concourait à avilir tous les travaux productifs, afin de mieux s’en assurer les profits. Lorsque les terres conquises excédaient ce qu’il était possible de faire cultiver par des esclaves, l’aristocratie refusait de les distribuer au peuple et les laissait incultes ; par ce moyen, elle s’assurait le monopole de la vente des grains. Plutarque, Vie des Gracques. — Denys d’Halicarnasse, liv. IX, § LI et LII, et liv. X, § XXXV. — Voyez Tit.-Liv., passim.
[29] Plutarque, Vie de M. Caton.
[30] Plutarque, Vie de M. Caton, pag. 402. — Chez les peuples d’Afrique où les Européens ont établi l’usage d’acheter et de vendre des êtres humains, la profession la plus noble est celle qui consiste à faire le commerce des hommes : l’aristocratie des nègres ne juge pas autrement que l’aristocratie romaine. Voyez supra, tome II, liv. III, ch. XXVII.
[31] Barrow, Nouveau voyage dans la partie méridionale de l’Afrique, tome I, ch. I, p. 98 et 99.
[32] Barrow, ibid., pages 35 et 36 de l’introduction.
[33] Barrow, Nouveau voyage dans la partie méridionale de l’Afrique, tome II, ch. V, p. 132.
[34] Barrow, Voyage dans la partie méridionale de l’Afrique, tome II, ch. V, p. 132.
[35] Barrow, tome I, p. 35 et 36 de l’introduction.
[36] Voyez supra, tome III, liv. III, ch. III. p. 28.
[37] Stedmann, Voyage à Surinam, tome III, ch. XXIX, p. 184 et 185.
[38] Macartney, Voyage en Chine et en Tartarie, tome IV, ch. III, page 197.
[39] Weld, Voyage au Canada, tome I, ch. XI et XVIII, pag. 172 et 278. — Larochefoucault-Liancourt, Voyage aux États-Unis, troisième partie, tome VI, p. 84. — Michaux, Voyage à l’ouest des monts Alleghanys, ch. XXXII, p. 304 et 305. — Robin, Voyage dans la Louisiane, tome II, ch. XXXVII, p. 113.
[40]Voyage aux États-Unis, deuxième partie, tome IV, pag. 59, 172, 99 et 100.
[41] M. de Larochefoucault-Liancourt, Voyage aux États-Unis, troisième partie, t. VI, p. 84. — Robin, Voyage dans la Louisiane, tome II, ch. XLVII, p. 245.
[42] Vie de Marcellus.
[43] Plutarque, Vie de Marcellus, p. 365.
[44] Denys d’Halicarnasse, liv. III, § LIII et LXVII ; liv. IV, § LIX, tome I, p. 255 et 329.
[45] Plutarque, Vie de Publicola, p. 120.
[46] Barrow, Voyage dans la partie méridionale de l’Afrique, tome II, ch. V, p. 202.
[47] Levaillant, premier Voyage, tome I, p. 14 et 15.
[48] Barrow, Voyage dans la partie méridionale de l’Afrique, tome II, ch. V, p. 141, 190 et 191.
[49] Robin, Voyage dans la Louisiane, t. II, ch. XXXVII, p. 119.
[50] Depons, tome III, ch. X, p. 11 et 99. — Dauxion-Lavaysse, tome II, ch. VI, p. 147.
[51] Thiery, De la culture du nopal, etc., tome I, p. 59 et 60.
[52] De Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, livre V, ch. XV, tome V, p. 152 et 155. — L’Amérique méridionale a éprouvé deux révolutions qui en changeront la face en peu d’années : la première est la conquête de son indépendance ; la seconde, l’abolition de l’esclavage dans une grande partie des pays.
[53] Si l’on s’en rapporte au témoignage des voyageurs, il ne paraît pas que les Anglo-Américains se donnent beaucoup de peine pour développer leur intelligence. « I have not seen a book, dit Fearon, in the hands of any person since I left Philadelphia. » Sketches of America, 5th report, p 252, 290 et 293.
[54] Barrow, Voyage dans la partie méridionale de l’Afrique, tome II, ch. V, p. 208, 209, 214 et 215. — Les médecins du Cap, en 1772, ignoraient encore l’usage de la vaccine. Thumberg, Voyage en Afrique, ch. II, p. 34.
[55] Larochefoucault, Voyage aux États-Unis, deuxième partie, tome IV, p. 63, 228, 229 et 230.
[56] Larochefoucault, Voyage aux États-Unis, deuxième partie, tome IV, p. 62 et 63.
[57] Ibid., page 65. — Michaux, Voyage à l’ouest des monts Alleghanys, ch. XXXI, p. 294 et 295.
[58] Michaux, Voyage à l’ouest des monts Alleghanys, ch. I, pages 9 et 10.
[59] Voyez le chap. de l’influence de l’esclavage sur les richesses.
[60] Robin, Voyage dans la Louisiane, tome III, chap. LXVII, pages 181 et 182.
[61]Robin, Voyage dans la Louisiane, tome III, chap. LXVIII, page 197.
[62] Plutarque, Vie de M. Caton.
[63]Voyez les débats de la chambre des communes d’Angleterre, du 23 juin 1825.
C’est encore ici un des effets de l’esclavage qu’il importe de faire remarquer. L’application des organes à la création d’un ouvrage utile, est pour un maître un acte avilissant, c’est un acte réservé à la population esclave ; mais l’application des mêmes organes à la destruction d’un tel ouvrage, est au contraire un acte noble, quand cette destruction n’a pas pour but une plus grande utilité. Cette manière de juger est commune à presque tous les hommes qui sont ou qui se prétendent issus d’une race de maîtres, ou qui se sont affiliés à eux. Tel gentilhomme ou tel général qui se croirait déshonoré pour le reste de sa vie, s’il appliquait ses mains à exercer une industrie ou un commerce quelconque, croirait avoir illustré sa postérité s’il pouvait lui transmettre la preuve qu’il a incendié de ses propres mains une ville industrieuse et commerçante. Le chef-d’œuvre de M. Caton, au jugement de ses compatriotes et de Plutarque son historien, fut la destruction de Carthage.
[64] Voyage dans la Louisiane, tome III, ch. LXVII, p. 180 et 181.
[65] Voyage dans la Louisiane, tome III, ch. LXVII, p. 182 et 183. — Il est, dans quelques pays et particulièrement au cap de Bonne-Espérance, des esclaves qui doivent être un peu moins mal habiles que les autres : ce sont ceux qui paient par semaine à leurs maîtres une somme déterminée, et qui jouissent, sous cette condition, de la faculté d’employer leur temps comme il leur plaît. Ceux-là doivent être moins misérables que les autres ; on peut dire même que si un tel état leur était garanti, et si la somme qu’on exige d’eux était invariable pour eux et pour leur postérité, en peu de temps la position de la plupart d’entre eux serait de beaucoup préférable à celle des peuples qui se croient libres et qui se voient arracher annuellement, sous le nom d’impôts, la moitié de leurs revenus. Si Guillaume-le-Conquérant, par exemple, s’était déclaré propriétaire légitime de tous les hommes qui habitaient le sol de l’Angleterre ; s’il les avait soumis à la même obligation à laquelle plusieurs colons soumettent leurs noirs ; et si lui ni ses successeurs n’avaient jamais augmenté cette obligation, n’est-il pas évident que les plus pauvres seraient aujourd’hui moins imposés qu’ils ne le sont ; que la plus grande partie de la population serait depuis longtemps devenue assez riche pour se racheter, et qu’elle n’appartiendrait plus qu’à elle-même ? Mais les domaines de la couronne sont inaliénables !
[66] Larochefoucault, deuxième partie, tome IV, pag. 87 et 88, tome V, p. 76, 77 et 78 ; troisième partie, tome VI, p. 86 et 198 ; et tome VII, p. 54.
[67] Larochefoucault, Voyage aux États-Unis, deuxième partie, tome IV, p. 293 et 294, et troisième partie, tome VI, p. 75.
[68] Ibid., deuxième partie, tome IV, p. 87, et troisième partie, tome VI, p. 290 et 201.
[69] Denys d’Halicarnasse, liv, II, § IX, et liv. IV, § XIII, tome I, pages 106 et 279.
[70] Denys d’Halicarnasse, liv. IX, § XXV, tome II, p. 322. — À la fin de la république, le nombre d’individus qui recevaient dans Rome des distributions gratuites en blé, s’élevait à 320 000. Suivant Suétone, César réduisit ce nombre de près de moitié. (Suét. cap. XLI.) Deux causes fort étrangères au développement de l’industrie expliquent cette réduction. La première est le nombre immense de Romains tués dans les guerres civiles qui eurent lieu à la fin de la république. Le dernier dénombrement qui avait été fait avant ces guerres, avait porté le nombre des citoyens à 320 000 ; celui qui eut lieu quand elles furent terminées, ne porta ce nombre qu’à 150 000. (Plutarque, Vie de César, p. 888.) La seconde cause de la réduction des distributions gratuites, fut la déportation d’un nombre immense de familles pauvres dans les villes dont la guerre avait moissonné les habitants : c’est au moyen de semblables déportations que l’aristocratie formait des colonies.
[71] Denys d’Halicarnasse, liv. VI, § XXVI et XXIX.
[72] Plutarque, Vie des Gracchus, p. 995. — Voyez Denys d’Halicarnasse, liv. X, § XXXVII, tome II, p. 424.
[73] Denys d’Halicarnasse, liv. VI, § XXXVI, tome II, p. 36.
[74] Suétone, Vie de César, ch. XLII, p. 139. — Plutarque, Vie de César.
[75] Non seulement il résulte du témoignage direct des historiens, que la classe de la population qui n’appartenait ni à la classe des maîtres ni à celle des esclaves, était excessivement misérable ; mais il eût été difficile qu’elle ne le fut pas, lorsqu’on voit que l’aristocratie possédait tout à la fois de grands capitaux et une multitude de bras pour les faire valoir. Crassus avait, selon le témoignage de Plutarque, cinq cents esclaves qui étaient tous maçons, charpentiers ou architectes. Il en avait, de plus, un très grand nombre qui labouraient ses terres ou travaillaient à ses mines. « Mais, ajoute l’historien, son plus grand revenu venait de ses esclaves qui étaient lecteurs, écrivains, orfèvres, argentiers, receveurs, maîtres d’hôtel, écuyers tranchants et autres officiers de table. » (Plut., Vie de Crassus.) Si tous ces arts ou tous ces métiers étaient exercés par des esclaves au profit de l’aristocratie, et si de plus elle avait la possession de toutes les terres qu’elle faisait cultiver par ses esclaves, quelles étaient les ressources qui pouvaient rester aux plébéiens ? En voyant de tels phénomènes, on conçoit fort bien pourquoi l’aristocratie prenait tant de peine pour avilir les occupations industrielles, et les faire déclarer indignes des hommes libres : c’était le moyen de s’en assurer le monopole, par les mains de ses esclaves.
[76] Th. Jefferson est, je crois, le seul qui se soit permis de publier quelques observations sur les effets moraux de l’esclavage domestique.
[77] Les écrivains politiques qui ont cherché à expliquer la décadence des arts, du goût, des mœurs et même du langage chez les anciens, se sont livrés aux suppositions les plus bizarres : ils ont supposé qu’il était dans la destinée des nations, comme dans celle des individus, d’avoir leur enfance, leur virilité, leur vieillesse et leur mort, et avec cette supposition ils ont expliqué toutes les révolutions du monde ; mais aucun ne s’est avisé de rechercher en quoi l’esclavage avait contribué à cette décadence. Machiavel, dans ses discours sur Tite-Live, ne dit pas un seul mot qui puisse faire supposer qu’il a jamais songé aux effets de l’esclavage. Montesquieu ne s’en occupa pas beaucoup plus. Rousseau, si zélé défenseur de la liberté politique, était si loin de soupçonner les effets que la servitude domestique produit, qu’il a fait, en quelque sorte, de celle-ci la condition de celle-là.
[78] Vescendi causâ, dit Salluste, terrâ marique omnia exquirêre. Cat. XIII. — La capacité de leur estomac ne répondant pas à leur voracité, plusieurs se faisaient vomir avant ou après le repas pour manger plus longtemps et plus copieusement. Cicéron dit en parlant de César: Post cœnam, vomere volebat, ideòque largiùs edebat.
[79] Voyez Plutarque, Vies de Sylla, de Lucullus, de César et surtout d’Antoine ; voyez aussi la description que donne des repas romains A. Adam, Roman antiquities.
[80]« Les Romains, dit Plutarque, ayant appris des Grecs à se baigner nus avec les hommes, ils leur ont maintenant en récompense enseigné à se dépouiller et se baigner nus avec les femmes. » Vie de M. Caton, p. 414. — On pourrait croire, d’après ce passage, que les anciens Romains étaient de rigoureux observateurs des lois de la décence ; mais on se tromperait si l’on se formait d’eux une telle opinion ; je n’en veux pas d’autres preuves que l’usage des prêtres de conduire dans un lieu secret les vestales coupables de quelque faute, et de les fouetter eux-mêmes après les avoir mises à nu. Plutarque, Vie de Numa, p. 79. — La fidélité conjugale de la part des maris était une vertu peu commune :
Quis minùs vir unâ uxore contentus siet ?
PLAUT, Mercator, act. IV, scen. VIII.
[81] Les poètes ont suppléé au silence des historiens. Voyez les comédies de Plaute et de Térence.
[82]Tite-Live, liv. VIII, tome IV, page 83 de la traduction. — Il est impossible de ne pas reconnaître à ces crimes les effets des fureurs de la jalousie des femmes, qu’avaient pour elles les riches possesseurs d’esclaves. Il est bon d’ajouter que ce fait rapporté par Tite-Live, s’est passé dans les plus beaux temps de la république. Qu’on juge d’après cela quelles durent être les mœurs, lorsque les conquêtes eurent amené à Rome, en qualité d’esclaves, des populations entières de toutes les parties du monde alors connu. À Rome, même du temps de Justinien et, par conséquent, bien longtemps après l’adoption du christianisme, non seulement le concubinage n’était pas considéré comme immoral, mais les lois elles-mêmes déclaraient qu’il ne l’était pas. Dig., lib. XXIII, tit. II, l. VIII, et lib. XXIV, tit. VII. Voyez tout ce dernier titre.
[83] Voyez Plutarque, Vies de Lucullus, de Pompée, de César, de Caton, de Cicéron et d’Antoine, pag. 618, 764, 768, 781, 863, 931, 1051 et 1106. — Denys d’Halicarnasse, liv. IV, § XXIV, tome I, p. 291. — Suétone, Vie de César. — On verra bientôt comment l’inceste et l’adultère sont des conséquences naturelles de l’esclavage.
[84] Tit.-Liv., an de Rome 539, tome VIII, page 273 de la traduction de Dureau de Lamalle.
[85] Tit.-Liv., tome XIII, p. 251.
[86] Ce fut principalement pour satisfaire les goûts de cette populace, dont l’aristocratie formait incontestablement la portion la plus dégradée, que César saisit toutes les occasions d’attaquer des nations innocentes, et même des alliés des Romains ; qu’il livra au pillage les villes et les temples ; qu’il réduisit en servitude une multitude de personnes industrieuses et libres, et vendit jusqu’à des royaumes. Suet., Vie de César, ch. XXIV et LIV, p. 107 et suivantes.
[87] Dio., lib. XLVIII, § XV.
[88] Si un voyageur nous racontait d’un prince barbaresque ou d’un despote asiatique une série de faits tels que ceux que l’histoire attribue à Trajan, nous le considérerions comme le plus féroce et le plus horrible de tyrans ; mais ces faits furent commandés par un homme qui parlait latin ; ils furent ordonnés pour l’amusement des maîtres ; ils furent exécutés sur des hommes que la force avait asservis, et par conséquent celui qui les ordonna est un héros. Nos poètes le mettent sur nos théâtres, et le beau monde va l’applaudir.
[89] Les esclaves pris à la guerre étaient toujours chargés de chaînes, soit qu’ils fussent attachés à la porte de la maison de leurs maîtres comme des bêtes féroces, soit qu’ils fussent chargés de la culture des champs.
[90] Tac. Ann., lib. XIV, cap. XLIII.
[91]Il résulte, au contraire, d’un passage de Plaute, que les femmes étaient mises en croix comme les hommes :
Continuo herclè ego te dedam discipulam cruci.
Aulularia, act. I, scen. II.
On n’a cessé de faire périr les esclaves en les clouant sur une croix, que lorsque les empereurs romains ont eu adopté la religion chrétienne ; et qu’il y a de remarquable dans l’abolition de cet horrible supplice, c’est qu’elle a été amenée, non par un sentiment d’humanité envers les hommes asservis, mais à cause, au contraire, du mépris excessif qu’on avait pour eux ; on les a jugés indignes de mourir du même genre de mort que le fondateur de la religion du prince.
Il paraît que les Romains, après avoir cloué vivant un esclave sur une croix, ne l’en détachaient plus, et le laissaient là jusqu’à qu’il tombât en lambeaux. Cela me parait d’autant plus vraisemblable qu’ils n’ensevelissaient jamais les cadavres des ennemis restés sur le champ de bataille. Ces deux causes réunies étaient plus que suffisantes pour infecter le pays ; aussi fut-il attaqué de la peste presque aussi régulièrement que la Turquie l’est de nos jours. L’histoire de Tite-Live constate qu’elle se manifesta onze fois dans le cours d’un siècle ; savoir : dans les années 288, 300, 320, 322, 327, 344, 356, 363, 367, 371 et 391 de la fondation de Rome. Lorsque ce peuple barbare était infecté de la peste, il n’en recherchait pas plus les causes, et ne prenait pas plus de précautions que les Turcs ; mais il chassait les savants et faisait des processions.
[92] Les patriciens ne pouvaient jamais tomber dans l’esclavage de leurs créanciers, leurs clients plébéiens étant dans l’obligation de payer leurs dettes. Si l’on ajoute à cette circonstance que la plupart des créanciers appartenaient à l’aristocratie, on comprendra comment les lois contre les débiteurs insolvables furent toujours si cruelles.
[93] Ceci explique la politique du sénat de ne jamais échanger ni racheter les prisonniers : les membres de l’aristocratie étaient rachetés par les plébéiens ; mais les plébéiens n’étaient rachetés par personne.
[94]Denys d’Halicarnasse, livre XI, paragraphe 30, t. II, p. 487. — Les aristocraties modernes ont été moins habiles que l’aristocratie romaine : elles ont souvent, comme celle-ci, absorbé les richesses des hommes qu’elles considéraient comme avilis, mais ce n’a été qu’en s’alliant à eux. Pour avoir la dot, il a fallu épouser la femme ; un patricien romain laissait la femme et prenait la dot. Par ce moyen, il maintenait la splendeur de sa race sans en souiller la pureté. J.-J. Rousseau a regretté que cette institution antique des patrons et des clients n’ai point passé jusqu’à nous.
[95]Je n’ignore pas que j’attaque ici un préjugé fort répandu : il n’est pas de jeune homme sortant du collège, il n’est pas d’écolier à barbe grise, qui ne parlent avec une imperturbable assurance, de la bonne foi romaine et de la perfidie carthaginoise. Nous ne connaissons point d’histoire de Carthage écrite par des hommes de cette nation, ou par des juges impartiaux ; et les Romains, avant la destruction de leur république, n’allaient guère chez les nations étrangères, si ce n’est pour savoir ce qu’il y avait à piller et pour y exercer leurs rapines. Il nous serait difficile, par conséquent, de dire quelles furent les mœurs des Carthaginois ; nous savons seulement qu’ils étaient un peuple très actif et très laborieux ; qu’ils réparaient par leur industrie et par leur commerce les ravages qu’avait produits la guerre, et que, pour vivre dans l’abondance, ils n’avaient besoin de tromper personne. Mais, pour connaître les mœurs des Romains, il n’est pas nécessaire de recourir à des inductions : il suffit de lire leur histoire, non telle que l’ont faite la plupart des écrivains modernes, mais telle que nous l’ont transmise leurs propres historiens ou les historiens grecs. « On voit que les Romains, même dans les commencements de leur empire, dit Machiavel, ont mis en usage la mauvaise foi. Elle est toujours nécessaire à quiconque veut d’un état médiocre s’élever aux plus grands pouvoirs ; elle est d’autant moins blâmable qu’elle est plus couverte, comme fut celle des Romains. » Discours sur Tite-Live, liv. II, ch. XIII.
[96] Denys d’Halicarnasse, liv. VI, ch. V, tome II, p.51.
[97]Il est une vertu qui a fait pardonner aux Romains les vices nombreux dont l’histoire a constaté l’existence : c’est le patriotisme ; à l’approche de l’ennemi, les dissensions s’apaisaient, les partis se réunissaient dans l’intérêt du salut commun ; dans le moment du danger, des généraux se dévouaient à une mort certaine, pour assurer la victoire à leur armée ; on honorait par des récompenses éclatantes les généraux qui revenaient victorieux ; un citoyen accusé d’un crime capital avait la faculté d’échapper au dernier supplice en s’exilant de son pays, de sorte que la perte de la patrie était mise au niveau de la peine de mort.
Il n’y a dans tout cela rien d’extraordinaire, rien qu’on ne vît chez quelque peuple que ce soit, qui serait placé dans les mêmes circonstances. Chez les peuples de cet âge, la défaite ne livrait pas seulement l’armée vaincue à la discrétion du vainqueur, elle livrait à l’esclavage chacun des membres de la famille ; s’ils étaient pris, ils étaient dispersés et vendus comme un vil troupeau, sans qu’ils pussent avoir l’espérance de se revoir. Un soldat était donc dans l’alternative de vaincre ou de voir tomber au rang des choses son père, sa mère, sa femme, ses fils, ses filles ; c’est là, suivant Denys d’Halicarnasse, le secret du patriotisme des Romains (liv. VI, § VII, tome II, p. 7.) C’est sur des causes analogues qu’est fondé le patriotisme des sauvages. La faculté laissée aux accusés de crimes capitaux, de s’exiler avant le jugement, est expliquée par l’état de la législation. Un Romain qui passait chez un peuple étranger, était, par ce seul fait, considéré comme ayant cessé d’exister ; il perdait sa femme, ses enfants, ses biens ; il était au-dessous de ce qu’est chez les modernes un individu mort civilement : renoncer à sa patrie c’était renoncer à tout ce qui pouvait rendre la vie supportable.
[98] Barrow, Nouveau voyage, tome II, ch. V, p. 200 et 201.
[99] Barrow, Nouveau voyage dans la partie méridionale de l’Afrique, tome I, ch. I, pag. 130 et 131. — Levaillant, deuxième Voyage, tome I, p. 46 et 47.
[100] Barrow, ibid., tome I, ch. I, p. 96 et 97, et tome II, ch. V, page 172.
[101] Barrow, ibid., tome I, ch. I, p. 131 et 132.
[102] Levaillant, premier Voyage, tome I, p. 76.
[103] Barrow, ibid., tome I, ch. I, p. 130.
[104] Barrow, ibid., tome I, ch. I, p. 128.
[105] Levaillant, premier Voyage, tome I, p. 76. — Les femmes des possesseurs d’esclaves dans les colonies, ont un frein que n’avaient pas les femmes romaines : elles ne pourraient se lier avec leurs esclaves sans que les enfants qui naîtraient de ces liaisons portassent les marques de leur incontinence.
[106] Barrow, ibid., tome I, ch. I, p. 136, 137 et 138.
[107] Barrow, ibid., tome I, ch. I, p. 136.
[108] Sparrman, Voyage au cap de Bonne-Espérance, tome III, ch. XVI, p. 264 et 265. — Les premiers objets qui attireront les regards de Sparrman, en arrivant au cap de Bonne-Espérance, furent des roues et des gibets, et sept individus qui avaient été pendus ou rompus le même jour. (Tome I, ch. II, sect. IV, p. 72 et 73.) Ce qui frappa d’abord Levaillant, ce fut une multitude d’esclaves blancs. Celui-là put juger au premier aspect de la cruauté des maîtres ; celui-ci de leur immoralité.
[109] Barrow, ibid., tome I, ch. I, p. 121 et 142.
[110] Barrow, tome I, ch. I, p. 122 et 123.
[111] Ibid., tome I, ch. I, p. 171.
[112] Levaillant, premier Voyage, tome I, p. 77. — Thumberg, Voyage en Afrique, etc., ch. II, p. 18.
[113] Barrow, ibid., tome I, ch. I, p. 138 et 139.
[114] Thumberg, ch. II, p. 28. — Barrow, ibid., tome I, ch. I, page 138.
[115] Sparrman, tome III, ch. XVI, p. 264, 265 et 266. — Barrow, ibid., tome I, ch. I, p. 52.
[116] Barrow, ibid., tome I, ch. I, p. 52. — Les colons ne sont pas moins cruels envers leurs animaux domestiques qu’envers leurs esclaves ; mais le tableau de leurs mœurs est déjà si horrible que je dois éviter de le charger.
[117] Barrow, ibid., tome I, chap. I, page 130. Il est sans exemple qu’un étranger, plaidant au Cap contre un colon, ait gagné son procès.
[118] Barrow, ibid., tome I, ch. I, p. 132 et 133.
[119] Levaillant, deuxième Voyage, tome I, p. 46 et 50. — Raynal a peint avec les plus brillantes couleurs la candeur, la simplicité, la bonté, l’innocence des colons du cap de Bonne-Espérance ; son imagination a fait souvent les frais de ses tableaux. Histoire philosoph. des deux Indes, tome I, liv. II, p. 408 et 409.
[120] Des maîtres de poste anglais trouvent qu’il est plus économique d’épuiser en peu d’années un bon cheval et de le remplacer ensuite, que de n’en exiger qu’un travail modéré et de le bien nourrir pour le faire durer plus longtemps : c’est le calcul que font les possesseurs d’hommes dans les colonies.
[121] Stedman, Voyage à Surinam et dans l’intérieur de la Guyane, tome II, ch. XVIII, p. 209 et 215.
[122] Stedman, tome II, ch. XIII, p. 19, 20 et 21. — Voyez aussi les p. 31 et 32 du même volume, et le tome I, ch. IX, p. 266 et 267.
[123] Voyage à Surinam, tome II, ch. XVII, p. 216.
[124] Ibid., tome I, ch. VI, p. 160.
[125] Ibid., passim.
[126] Voyage à Surinam, tome II, ch. XVII, p. 190 et 171, et t. III, ch. XXVII, p. 101 et 102.
[127]Il n’y a que les sentiments de l’orgueil offensé et de la jalousie qui puissent expliquer les cruautés commises par les femmes des colons sur les enfants de leurs femmes esclaves. Stedman rapporte que la femme d’un colon, sur les représentations que se permirent quelques-uns de ses esclaves au sujet d’un excès auquel l’avait entraînée sa jalousie, brisa le crâne à un enfant qui se trouvait là ; mais il était ce qu’on nomme quarteronné, c’est-à-dire fils d’une mulâtre et d’un blanc. Elle fit aussi couper la tête à deux enfants nègres qui avaient voulu s’opposer au meurtre ; mais ces deux enfants appartenaient à la même famille. Voici quelles furent, au rapport de Stedman, les conséquences de ces trois meurtres :
« Lorsqu’elle (la maîtresse) eut quitté la plantation les deux têtes furent enveloppées dans un mouchoir de soie et portées par leurs parents à Paramaribo, où ils les déposèrent aux pieds du gouverneur, à qui ils adressèrent le discours suivant :
« Votre excellence, voici la tête de mon fils et voici celle de son frère, que notre maîtresse a fait couper parce qu’ils avaient voulu prévenir un des meurtres qu’elle commet journellement. Nous savons bien qu’étant esclaves, on ne reçoit pas notre déposition ; mais si ces têtes sanglantes paraissent une preuve suffisante de ce que nous disons, nous supplions qu’on empêche le renouvellement de pareilles atrocités ; nous en serons à jamais reconnaissants, et nous verserons avec plaisir notre sang pour la conservation de notre maître, de notre maîtresse et de la colonie. »
« On répondit à ces malheureux qu’ils étaient des menteurs, et qu’on les condamnait à être fustigés dans toutes les rues de Paramaribo. Cette sentence inique fut exécutée avec la plus grande cruauté. » Voyage à Surinam, tome II, ch. XVII, p. 170 et 172. — Voyez aussi sur les jalousies des femmes et sur les crimes qui en sont les conséquences, le tome I, ch. VI et IX, p. 166, 167, 266 et 267.
[128] Stedman, tome III, ch. XXIX, p. 198.
[129]Ces instruments de supplice sont des cordes de chanvre d’une très grande longueur, qui entrent dans la chair à chaque coup, et font un claquement semblable à la détonation d’un pistolet. Stedman, tome II, ch. XXV, p. 210.
[130] Stedman, tome III, ch. XXV, p. 82 et 83.
[131]Raynal, Histoire philosoph., tome VI, liv. XII, page 421. — Stedman, tome III, ch. XXV, p. 81, 82 et 83. — La sévérité des châtiments est moins en raison des fautes des esclaves qu’en raison de leur valeur. Un beau jeune homme et une belle femme peuvent commettre de graves délits, et en être quittes pour un léger châtiment, si l’offense ne touche pas directement le maître. Ce sont des propriétés dont on craint de diminuer la valeur en les dégradant ; on trouve plus avantageux de les vendre que de les détruire. Mais un vieillard, un individu faible ou mal constitué, ne peuvent commettre la moindre négligence sans encourir les châtiments les plus sévères. Ce sont des propriétés sans valeur, qui finissent même par devenir à charge ; aussitôt qu’elles sont devenues improductives, l’intérêt des maîtres est d’en accélérer la destruction, et c’est en effet ce qu’ils font. (Stedman, tome II, ch. XIV, p. 45 et 46.) Les colons font le même raisonnement que Caton le censeur.
[132] Le châtiment nommé spanso-bocko est infligé de la manière, suivante : On lie les mains au condamné et on lui fait passer les genoux entre les bras ; on le couche ensuite de côté, et on le tient ainsi retroussé comme un poulet au moyen d’un pieu auquel on l’attache, et qu’on enfonce en terre. Dans cette situation, il ne peut pas plus remuer que s’il était mort. Alors un nègre armé d’une poignée de branches noueuses de tamarin, le frappe jusqu’à ce qu’il lui ait enlevé la peau ; il le tourne ensuite de l’autre côté, le frappe de même, et le sang trempe la terre à la place de l’exécution. Lorsqu’elle est achevée, pour empêcher la mortification des chairs, on lave le malheureux avec du jus de citron, dans lequel on a fait fondre de la poudre à canon. Cette opération terminée, on le renvoie dans sa case se guérir, s’il le peut. Stedman, t. III, ch. XXVII, p. 122 et 123, et tome II, ch. XIII, p. 24 et 25.
[133] Stedman, t. I, ch. XII, p. 393.
[134]Stedman, tome I, ch. VI, p. 145 et 147. — Report of the committee of the society for the mitigation and gradual abolition of slavery, p. 15. London 1824. — Ces détails des cruautés des colons, que j’affaiblis beaucoup en les abrégeant, paraîtront incroyables à plus d’un lecteur. Peut-être aussi sera-t-on disposé à penser qu’elles ont été commises dans des circonstances extraordinaires, et à une époque remarquable de barbarie. J’ai eu moi-même d’abord cette pensée, mais j’en ai reconnu plus tard l’inexactitude. Le gouvernement anglais, qui possède aujourd’hui cette colonie, s’est proposé d’adoucir le sort des esclaves. Afin de ne rien faire au hasard, il a envoyé à Démerary un officier supérieur qu’il a chargé de l’examen des faits. Pendant le séjour que j’ai fait en Angleterre, j’ai eu occasion de connaître cet officier, et je l’ai prié de me dire si les mœurs décrites par Stedman étaient véritablement celles des colons. « Ce qui rend les colons si cruels, m’a-t-il répondu, c’est la facilité qu’ont les esclaves de s’enfuir dans les forêts, et la difficulté de les reprendre. » Cette explication, qui confirme les rapports du voyageur, est exactement la même que celle qu’a donnée Raynal, Hist. philosoph., tome VI, liv. XI, p. 421.
[135] Stedman, tome I, ch. XII, p. 393.
[136] Ibid, ch. I et V, p. 31 et 131 ; tome III, ch. XXV et XXVII, p. 16, 17, 120 et 121.
[137] Bougainville, deuxième partie, t. II, ch. VIII, p. 228 et 231.
[138] Thumberg, ch. VIII, p. 227, 228, 234 et 235. — Cook, premier Voyage, liv. III, ch. XII, tome IV, p. 345.
[139] Cook, premier Voyage, liv. II, ch. XII, tome IV, p. 346. — Les Chinois et les Malais ont des juges particuliers dans les matières civiles. Ibid. — Voyez Bougainville, t. II, deuxième partie, p. 169 et 175. — Cook, premier voyage, liv. III, ch. VIII, IX et XII, p. 207, 252, 253 et 354. — Thumberg, ch. VII, p. 238 et 239. — Dentrecasteaux, t. I, ch. VII, p. 155 et 156. — Labillardière, t. I, chapitre VIII. — Mac-Leod, chapitre IX.
[140] « The Bahama Islands are the poorest and least productive of the west Indian colonies. They raise scarcely any exportable produce. Their productions are chiefly confined to cattle, live stock and provisions. Hence the pecuniary resources of the proprietors are generally small. In the Bahama Islands, however, the slaves are far better off than they are in any other British colony. They are better treated, more lightly worked, and more abundantly fed. The common allowance of food is from two to three times as great as in the Leeward Islands. » Report of the committee of the society for the mitigation and gradual abolition of slavery, etc., p. 34 et 35. London, 1824. — East and west India sugar, etc., p. 86.
[141] Ce sont particulièrement les planteurs des colonies à sucre qui résident en Angleterre. East and west India sugar, or a refutation of the claims of the west India colonists, etc., p. 56. London, 1823.
On peut se faire une idée du nombre des planteurs anglais qui résident en Angleterre, par le nombre de ceux qui siègent dans la chambre des communes ; ce dernier nombre, en 1825, était de cinquante-six. Second report of the committee of the society for the mitigation and gradual abolition of slavery throughout the British dominions, p. 63. London, 1825.
[142] L’île de Sainte-Hélène n’est presque cultivée que par des nègres. Ils у ont été transportés comme esclaves par les premiers colons ; et il est rare que des hommes blancs veuillent se soumettre à travailler à un ouvrage en commun, dans les endroits où il y a des esclaves nègres par qui on peut le faire faire. Macartney, Voyage en Chine et en Tartarie, t. IV, ch. III, p. 197.
[143] Cooper’s Facts illustrative of the condition of the negro slaves in Jamaïca, p. 47. London, 1824.
[144] Quoique les agents des planteurs ne puissent pas s’adonner au même luxe que les maîtres, ils sont assez riches pour se livrer habituellement à l’intempérance. Ce vice est si général, et paraît si naturel, que, dans les meilleures sociétés, chacun raconte qu’il a été ivre, ou qu’il se propose de s’enivrer, comme on raconte ailleurs qu’on a pris ou qu’on se propose de prendre une tasse de thé ou de café. On voit, par là, que l’ivrognerie n’est pas l’apanage exclusif des climats froids, comme l’a prétendu Montesquieu. Cooper’s Facts illustrative of the condition of the negro slaves in Jamaïca, p.37.
[145] Stewart’s View of the past and present state of Jamaïca, p. 173, 174 et 175. — Cooper’s Facts illustrative of the condition of the negro slaves in Jamaïca, p. 35, 36 et 37. — Negro Slavery, or a view of some of the more prominent features of that state of society, etc., p. 56, 57, 58, 59. London, 1824.
[146] Cooper’s Facts illustrative of the condition of the negro slaves in Jamaïca, p. 42.
[147] Le gouvernement anglais a autorisé, dans ses colonies, les esclaves à porter plainte devant un magistrat, dans le cas où ils se croiraient injustement maltraités. Voici la plainte d’un père et la déposition d’une de ses filles, contre l’administrateur d’une plantation. Je la rapporte textuellement pour ne pas en altérer la naïveté. Le père dit : The manager wanted my daughter Peggi. I said « No ». He followed her. I said, « No. » He asked me three times. I said, « No. » Manager asked me again friday night. I refused. Satursday morning he flogged me. This thing hurt me, and I come to complain.
Peggi étant malade, et n’ayant pu comparaître devant le magistrat, sa sœur Aqueshaba fait la déposition suivante : Says, that manager sent aunty grace to call Peggi, and to say if she would not come I must. We said, daddy said must not go ; I was to young. Grace left us and went to daddy ; shortly afterwards she returned and tried to coax me to go, but I would not, as my daddy ad forbid it. Grace went and told manager ; manager sent to call Fanny ; Fanny went. The manager was up in his room ; and all of us, the creoles, got orders to watchmen at manager’s door. The slave colonies of Great-Britain, or a Picture of negro slavery drawn by the colonist themselves ; being an abstract of the various papers recently laid before parlement on that subject, p. 145, 146 et 147. London, 1825.
[148] Thomas Cooper’s Facts illustrative of the condition of the negro slaves in Jamaïca, p. 31 et 32.
[149] Ibid., p. 3 et 32.
[150] Thomas Cooper’s Facts, etc., p., 2, 3, 32 et 33.
[151] Cette ration a été fixée par la législature d’Antigoa ; et l’acte par lequel elle a été déterminée a été appelé l’acte d’amélioration. James Cooper’s Relief for the West-Indian distress, p. 19. London, 1823.
[152] Negro Slavery, etc. London, 1824, p. 36 et 57. Quatrième édition.
[153] The slave colonies of Great-Britain, p. 16. London, 1825.
[154] Thomas Cooper’s Facts illustrative of the condition of the negro slaves in Jamaïca, p. 16 et 17. — Negro Slavery, p. 63, 64.
[155] Whether we consider the frightful sound which reaches our ears every minute in passing trough states, by the crack of the lash; or the power with which drivers are provided to excroise punishment ; it would be desirable that such a weapon of arbitrary and unjust authority were taken from them. Negro Slavery, etc. p. 63 et 64. 4th. London, 1824.
[156] Thomas Cooper’s Facts illustrative of the condition of the negro slaves in Jamaïca, p. 22. — Negro Slavery, p. 64 et 67.
[157] Roughley’s Guide, p. 70, 80. — T. Cooper’s Facts illustrative of the condition of the negro slaves in Jamaïca, p. 49.
[158] Th. Cooper’s Facts illustrative of the condition of the negro slavery in Jamaïca, p. 57.
[159] Je m’abstiens de rapporter les horribles détails de ces cruautés, constatés devant le parlement d’Angleterre. On peut en trouver la substance dans les débats de la chambre des communes du 16 mars 1824. (Debate in the house of commons on the 16th day of march 1824, p. 32, 33, 34.) Je me bornerai à citer l’exécution faite par un colon lui-même sur ses esclaves, parce que le jugement qui l’accompagne peut servir à faire connaître quel est l’esprit des maîtres.
En 1810, un magistrat, nommé Huggins, armé d’un fouet de charretier, en infligea publiquement, sur la place du marché de Nevis, en présence de plusieurs autres magistrats, le nombre de coups suivants à des hommes ou à des femmes nus ; savoir :
À un nègre, 115 ; à un autre, 65 ; à un autre, 47 ; à un autre, 165 ; à un autre, 242 ; à un autre, 212 ; à un autre, 181 ; à un autre, 59 ; à un autre, 187. À une femme négresse, 110 ; à une autre femme, 58 ; à une autre femme, 97 ; à une autre femme, 212 ; à une autre femme, 291 ; à une autre femme, 83 ; à une autre femme, 49 ; à une autre femme, 68 ; à une autre femme, 89 ; à une autre, 56. — En tout, 2 286.
Le fils de ce magistrat, interrogé sur les motifs de ces châtiments, répondit que son père avait pensé que des mesures modérées, poursuivies avec fermeté, devaient très probablement produire l’obéissance : He conceived that moderate measures, steadily pursued, were most likely to produce obedience. Debate in the house of commons on the 16th day of march 1824, p. 31.
Si tels sont les effets de la modération, qu’on juge des effets que doit produire l’emportement chez des hommes excessivement irascibles.
Debate in the house of commons on the 16th day of march 1824, p. 33. London, 1824.
[160] Second report of the committee of the society for the mitigation and gradual abolition of slavery, p. 144, 145.
[161] Debate in the house of commons, on the 16th of march 1824, p. 37, 38. — Les magistrats coloniaux, dans plusieurs îles, sont, pour leurs salaires, sous la dépendance des maîtres. On peut juger, d’après cela, de la protection qu’ils accordent aux esclaves. Report of the committee, etc., p. 7, 58, 59.
[162] The slave colonies of Great-Britain, or a Picture of negro slavery drawn by the colonist themselves, p. 8, 40. — Second report of the committee of the society for the mitigation and gradual abolition of slavery throughout the British dominions, p. 141, 143, 147, 148, 150, 151, 152.
[163] The slave colonies of Great-Britain, or a Picture of negro slavery drawn by the colonist themselves, p. 150.
[164] Substance of the debate in the house of commons, on the 15th may 1823, etc., appendix S., p. 204, 205.
[165] Substance of the debate in the house of commons, on the 15th may 1823, appendix, p. 224, 225. London, 1823. — Debate in the house of commons, 16th march 1824, p. 38, 39. — The slave colonies of Great-Britain, or a Picture of negro slavery drawn by the colonist themselves, p. 42.
[166] Williamson’s Medical and Miscellaneous observations, relative to the West-India islands, vol. I, p. 93. — Negro slavery, or a View of some of the more prominent features of that state of society, etc., p. 65.
[167] « Les Turcs, dit R. Bickell, sont assurément des maîtres bien durs ; ils volent ou pillent les différentes races de peuples qui leur sont soumises, outre l’impôt qu’ils les obligent à payer ; mais, dans aucune partie de leur empire, il n’est point d’hommes qui soient dégradés au point d’être obligés de travailler à leur profit cinq ou six jours de la semaine presque gratuitement, d’être tenus dans l’ignorance, et d’être condamnés à perpétuité à n’être que des coupeurs de bois ou des tireurs d’eau. » The West Indies as they are, p. 62.
[168] Voyez le liv. II, ch. I et II, t. I, p. 378 et suivantes.
[169] Larochefoucault, Voyage aux États-Unis, deuxième partie, t. V, p. 176 et 177.
[170] Looking fairly therefore to all these circumstances, we ought not to be surprised to find that American theory is at least two centuries in advance of American practice. Fearon, 7th report, p. 366. — C’est en 1816 que Fearon écrivait cela : il avait été envoyé aux États-Unis par une réunion de personnes qui voulaient quitter l’Angleterre pour aller s’établir dans ces États, et il se proposait lui-même d’émigrer ; mais, après qu’il eut examiné le pays, les mœurs des habitants et la difficulté d’y vivre, il renonça à ce projet, et y fit renoncer ses amis.
[171]Rien n’est si commun que de rencontrer, dans tous les pays, des hommes qui ont deux doctrines opposées : l’une qui leur sert à combattre l’oppression qu’ils supportent ; l’autre qui leur sert à justifier l’oppression qu’ils exercent. C’est là l’histoire de toutes les révolutions, et particulièrement de la nôtre. On forme la théorie quand on est opprimé ; mais c’est quand on est vainqueur qu’on établit la pratique.
[172]Francis Hall, p. 457 et 460. — « Оf the proprietors of slaves, a very small proportion, indeed, are ever seen to labour. » Jefferson’s Notes, p. 241. — « Tous les petits fermiers cherchent à s’en procurer (des esclaves) dès le moment où ils ont amassé l’argent nécessaire pour en acheter, et, dès qu’ils en possèdent, ils cessent eux-mêmes de travailler, et se livrent à l’indolence à laquelle l’état de maître d’esclave dispose naturellement. » De Larochefoucault, deuxième partie, t. IV, p. 172.
[173] J. F. D. Smith, Voyage au Canada et aux États-Unis, t. I, ch. VI, p. 20 et 21.
[174] De Larochefoucault-Liancourt, Voyage aux États-Unis, deuxième partie, t. IV, p. 10, 11 et 111, et t. V, p. 92 et 93. — Travels in Canada and the United-States, by Francis Hall, p. 457 et 460.
[175] Robin, Voyage dans la Louisiane, t. III, ch. LXVIII, p. 213 et 214.
[176] Michaux, Voyage à l’ouest des monts Alleghanys, ch. XXIV, p. 242. — Fearon’s Sketches of America, 5th report, p. 190, 191.
[177] Larochefoucault, deuxième partie, t. V, p. 92 et 93.
[178] Ibid., deuxième partie, t. V, p. 35.
[179]« Ces révérends pères, dit un voyageur, entretenaient des harems d’esclaves noires, qui sont devenues blanches par une succession de commerce illégitime avec leurs premiers maîtres.
« Il subsiste encore un grand nombre de ces belles créatures qui sont consacrées aux plaisirs et au libertinage de ces vieux prêtres qui en sont demeurés possesseurs ; car, depuis la destruction de leur société, le gouvernement les a laissé jouir sans trouble de leurs propriétés. » J. F. D. Smith, t. II, ch. IX, p. 84.
[180] Robin, t. II, ch. XXXVIII, p. 119 et 120, et t. III, ch. LXVIII, p. 199 et 200.
[181]Larochefoucault-Liancourt, quatrième partie, tome VIII, p. 166.
[182] Ibid., deuxième partie, t. IV, p. 62. — Weld, Voyage au Canada, t. I, ch. XI, p. 174 et 175. — Francis Hall’s Travels in Canada and the United-States, p. 457, 460. — Negro Slavery, page 21.
[183] Larochefoucault-Liancourt, Voyage aux États-Unis, deuxième partie, t. IV, p. 111, 312 et 313.
[184] Weld, Voyage au Canada, t. I, ch. XI, p. 175 et 176.
[185] Francis Hall, p. 426 et 427.
[186] Travels in Canada and the United-States, by lieut. Francis Hall, p. 429. — Michaux, Voyage à l’ouest des monts Alleghanys, ch. XXXII, p. 304.
[187] Travels in Canada and the United-States, by Francis Hall, p. 424.
[188]Fearon’s Sketches of America, p. 239 et 241.
Francis Hall, p. 429 et 432. — « Les Américains, qui se vantent d’être les plus humains de la terre sont tout aussi barbares que les autres envers leurs esclaves. » (Robin, Voyage dans la Louisiane, t. I, ch. XX, p. 283.) Les châtiments infligés aux esclaves de la Louisiane portent les mêmes caractères d’atrocité que nous avons observés dans la colonie hollandaise de la Guyane. L’abrutissement des colons arrive au point que les supplices les plus horribles et même l’assassinat ne leur causent plus de remords. Robin, t. III, ch. LXVII, p. 177, 178 et 180.
[189] Il suit évidemment de là que le crime d’enseigner à lire à un homme asservi est un peu plus grave que le crime d’en avoir mutilé sept. On peut, d’après cela, se faire une idée des mœurs et de la religion des peuples d’Amérique qui ont des esclaves.
[190] Francis Hall, p. 424.
[191] Ibid., p. 424.
[192] Fearon, p. 268. — J. F. D. Smith, t. I, ch. VI, p. 24.
[193] A dirk is said to be the common appendage to their dress. Fearon, 7 th report, p. 400.
[194] Robin, t. II, ch. XLVII, p. 245.
[195] Francis Hall, p. 424.
[196] Jefferson’s Notes on Virginia, p. 241. — Robin a observé dans la Louisiane les mêmes phénomènes que Jefferson dans la Virginie. Voyage dans la Louisiane, t. III, ch. LXVII et LXVIII, p. 179 et 209.
[197] Small provocations, dit Fearon, insure the most relentless and violent resentments, duels are frequent. The dirk is an inseparable companion of all classes. Sketches of America, 5th report, p. 264.
[198] Larochefoucault, Voyage aux États-Unis, deuxième partie, t. IV, p. 49 et 88. — Robin, Voyage dans la Louisiane, t. III, ch. LXVII, p. 169. — Fearon, 6th report, p. 269, 270. — Francis Hall, p. 357, 360.
[199]Fearon, p. 58, 59, 60, 87, 115, 159 et 167. — F. Hall, p. 424 et 426. — Robin, Voyage à la Louisiane, t. II, ch. XXXVIII, p. 120 et 121 ; et t. III, ch. LXXII, p. 134 et 120. — À Philadelphie même l’aristocratie de la couleur est aussi fortement prononcée que dans les États où l’on compte le plus grand nombre d’esclaves. « There exist a penal law, dit Fearon, deeply written in the minds of the white population, which subjects their colored fellow-citizens to unconditional contumely and neverceasing insult. No respectability, however unquestionable, no property, however large, no character, however unblemished, will gain a man whose body is (in American estimation) cursed with even a twentieth portion of the blood of his African ancestry, admission into society! They are considered as mere pariahs, as out-cast and vagrants upon the face of the earth! » Sketches ofAmerica, 4th report, pag. 168 and 169.
[200] Robin, t. II, ch. XXXVI, p. 120 et 121. — Les colons de la Louisiane descendent, pour la plupart, de prostituées qui y furent portées par cargaisons à l’époque de la colonisation. Robin, t. II, ch. XXXII, p. 74 et 76.
[201] Fearon, 7th report, p. 382. — Morris Birkbeck’s Notes on a Journey in America, p. 20. — Larochefoucault, deuxième partie, t. IV, p. 179 et 180. — Robin, t. III, ch. LIX, p. 246. — Depons, t. I, ch. II, p. 242.
[202] Francis Hall, p. 319, 320.
[203]On comptait en Angleterre, dans la chambre des communes, qui a été dissoute en 1826, cinquante-six membres possesseurs d’esclaves (second report of the committee of the society for the mitigation and gradual abolition of slavery, p. 63). Des auteurs anglais assurent que les bouchers ne peuvent pas être jurés en matière criminelle ; mais, comment des possesseurs d’hommes peuvent-ils être membres du gouvernement dans un pays libre ? Si la première de ces deux qualités exclut les sentiments d’humanité, quelles sont les idées morales qui sont compatibles avec la seconde ?
[204] Il n’est pas possible d’exposer la statistique de nos colonies avec la même exactitude que la statistique des colonies anglaises. Le ministère anglais n’a rien de secret à cet égard, ni pour le parlement ni pour la nation. Le nôtre, au contraire, ne publie rien sur l’état des colonies, et paraît craindre qu’on ne porte les yeux sur ce qui les concerne. En Angleterre, il existe une multitude de sociétés qui s’occupent de faire jouir les personnes asservies des garanties sociales, et qui recueillent et publient en conséquence tous les faits qui les intéressent. En France, il est peu de personnes qui pensent à la population des colonies, ou qui du moins s’en occupent activement.
[205] Robin, Voyage à la Louisiane, tome I, chap. III, pag. 40. — Rien ne prouve mieux l’humiliation dans laquelle les planteurs des colonies françaises ont toujours tenu les hommes de la race asservie, que les actes des magistrats coloniaux contre les hommes libres qui avaient quelque teinte d’origine africaine. Un magistrat du Port-au-Prince écrivait en 1770 : « Il est nécessaire d’appesantir sur cette classe le mépris et l’opprobre qui lui est dévolu en naissant ; ce n’est qu’en brisant les ressorts de leur âme qu’on les conduit au bien. » Cette opinion est remarquable en ce qu’elle est conforme à l’idée qu’Aristote se faisait des qualités propres à un esclave. En 1761, le conseil de Port-au-Prince enjoignit aux notaires et aux curés d’insérer dans leurs actes les qualités des nègres, des mulâtres et des quarterons. En 1773, il fut défendu aux hommes de prendre les noms de leurs pères blancs, et il leur fut ordonné d’ajouter au nom de baptême un surnom tiré de l’idiome africain, pour ne pas détruire cette barrière insurmontable que l’opinion publique (des colons) a posée et que la sagesse du gouvernement maintient. En 1779, il fut défendu aux gens de couleur de porter les vêtements et les parures en usage chez les blancs, et il leur fut ordonné de porter des marques caractéristiques propres à les faire discerner, quand par la couleur ils se rapprocheraient des maîtres. Voyez les lois et constitutions des colonies françaises, par Moreau de Saint-Méri. Voyez aussi l’écrit intitulé : De la Noblesse de la peau, etc., par M. Grégoire, ancien évêque de Blois, chap. I, pag. 9, 10 et 11.
[206] Robin, t. I, chap. XX, p. 281. — On a observé que le mépris pour les noirs n’a existé que chez les peuples qui les ont faits esclaves. « Le préjugé sur la noblesse de couleur n’exista jamais chez les nations qui n’avaient pas de colonies ; chez celles qui en avaient, des mœurs radoucies admettaient quelques exceptions. Amo, nègre, prenait ses grades de docteur à l’université de Wittemberg et présidait ensuite à des thèses soutenues par des blancs ; Annibal, en Russie, devenait lieutenant-général et directeur du génie ; Angelo-Soliman, généralement estimé à la cour de Vienne, épousait une dame noble de Christiani ; Jean Latinus était professeur à Grenade. » De la noblesse de la peau, ou du préjugé des blancs contre la couleur des Africains et celle de leurs descendants noirs et sangs mêlés, par M. Grégoire, ancien évêque de Blois, chap. III, p. 21.
[207] Robin, tome I, chap. III, pag. 44 et 45. — L’usage de laisser ses enfants dans l’esclavage ou de les vendre comme des bêtes, est si général chez les possesseurs d’hommes, qu’ils sont étonnés des scrupules qu’éprouvent à cet égard les personnes élevées dans des pays libres. Stedman ayant affranchi un enfant qu’il avait eu d’une esclave de Surinam, dit que quelques personnes honnêtes applaudirent à sa sensibilité ; mais, ajoute-t-il, « le plus grand nombre désapprouva ma tendresse paternelle, et la traita de faiblesse ou de folie. » Tome III, ch. 29, p. 198.
[208] Dauxion-Lavaysse, tome I, chap. 6, p. 284 et 285.
[209] Dauxion-Lavaysse, tome I, chap. VI, p. 271.
[210] Raynal, Hist. philosoph., t. VI, liv. II, p. 269.
[211] Depons, Voyage à la partie orientale de la Terre-Ferme.
[212] Voyez un exemple remarquable dans la note de la page 251 de ce volume.
[213] Second report of the committee of the society for the mitigation and gradual abolition of slavery, p. 149, 150, 154.
[214] Ibid. p. 157.
[215]Plusieurs de ces procès-verbaux ont été communiqués au parlement d’Angleterre. En voici un du chevalier de Gannes, colon de l’Ile de France. Je le rapporte de préférence à d’autres, par la raison qu’il prouve en même temps l’incapacité des esclaves, les inconvénients attachés à leur service, et l’orgueil et l’irascibilité des maîtres. Il faut convenir cependant que le cas était grave ; car il s’agissait du dîner du chevalier, et le coupable était son cuisinier.
« Ce jour, dimanche du mois de septembre, de l’année 1824, à cinq heures de l’après-midi, arrivant de la ville où j’avais été entendre la messe, je demandai mon dîner, qui me fut servi aussitôt. Trouvant que rien n’était cuit, et qu’il y manquait le beurre que j’avais donné moi-même avant mon départ (en l’absence de mon épouse), je fis appeler mon cuisinier nommé Raphael Faxa, jeune nègre, âgé de vingt-deux à vingt-cinq ans. Il était déjà parti et ne se trouva plus dans ma cuisine ; je l’attendis jusqu’à sept heures du soir que je le fis appeler. Il répondit des cases à nègres où il se trouvait, et revint à sa cuisine : je lui demandai d’où il sortait, pourquoi il s’était absenté avant que j’eusse dîné, pourquoi rien n’était cuit, sans apprêt, sans beurre et autres ingrédients qui entrent dans l’accommodement des mets. Il me répondit avec brutalité et forçant sa voix à outrance, que quand le dîner était servi il pouvait s’en aller, qu’il était aux cases à nègres, et que c’était de là qu’il avait répondu. Je lui ordonnai de baisser sa voix. La bouche est pour parler, me dit-il, et personne ne peut m’en empêcher. Je vais vous mettre au ceps, vous dis-je, pour votre voix, vos cris et vos réponses insolentes et peu respectueuses. Non je n’irai point au ceps, parce que je n’ai rien fait ; et on ne met au ceps que les voleurs, et je n’ai point volé. Étant jeune et fort ingambe, à chaque pas que je faisais, il s’éloignait, se tenant toujours à une grande distance de moi. N’ayant personne auprès de moi que deux servantes incapables de l’arrêter, je fus forcé de me retirer. Le lendemain lundi, à sept heures du soir, les nègres rassemblés pour faire la prière, je fis appeler le nommé Manuel Gaytan, homme de couleur libre, majeur, qui était dans une de mes cases à nègres, et en sa présence, je lui fis donner par mon commandant, devant la porte de ma maison, douze coups de fouet, étant debout et habillé de ses vêtements. Il ne proféra aucune parole pendant les coups qu’il recevait ; mais, le fouet cessant, il resta un gros moment debout dans la même posture, après quoi, pour braver son maître, il dit, Est-ce tout ? resta là quelques minutes et s’en fut !
« Signé, le ch. de Gannes, commandant.
« MANUEL GAETAN. »
Il n’est rien qui irrite les possesseurs d’hommes autant que la fermeté et l’apparente insensibilité des esclaves, parce qu’il n’est rien qui leur fasse mieux sentir leur impuissance. Dans un autre procès-verbal, le même chevalier de Gannes raconte qu’après avoir fait donner quinze coups de fouet à un esclave de dix-huit ans, qui était sorti de sa case une demi-heure plus tard que les autres, il voulut lui faire des remontrances. « À chaque parole que je proférais, dit-il, il s’efforçait de tousser avec violence, et si fortement qu’il étouffait ma voix et me contraignait de me taire. Les dernières ordonnances ne permettant pas deux châtiments successifs, je fus obligé de me retirer avec la risée de mon esclave et d’avaler cette humiliation!!!) The slave colonies of Great-Britain, p. 121, 122.
[216] Depons, Voyage à la partie orientale de la Terre-Ferme dans l’Amérique méridionale, t. I, ch. II, p. 182, 183 et 184.
[217] Depons, t. II, ch. V, p. 93, 94, 95, 96 et suivantes. — Dauxion-Lavaysse, passim.
[218]De Humboldt, Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, t. V, liv. VI, ch. XIV, pag. 65. — Depons, tom. II, ch. VII, p. 325 et 326.
Voici les noms de quelques écrivains dont les ouvrages étaient prohibés par l’inquisition : Bayle, Voltaire, Rousseau, Raynal, l’abbé Racine, Fleuri, Adisson, Arnaud, d’Argenson, Beccaria, Marmontel, Boileau, La Fontaine, La Bruyère, Burlamaqui, Condillac, Montesquieu, Helvétius, Fontenelle, Hume, Puffendorf, Vatel, Filangieri, Mably, Millot. Depons, t. II, ch. VI, p. 101 et 102.
[219] De Humboldt, Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, t. V, l. VI, ch. XIII, p. 12. — Dauxion-Lavaysse, Voyage aux îles de la Trinidad, etc., t. II, ch. VIII, p. 254 et 255, et ch. X, p. 445 et et 464.
[220] Depons, Voyage à la partie orientale de la Terre-Ferme, t. III, p. 34 et suivantes. — Dauxion-Lavaysse, t. II, ch. VIII, p. 262.
[221]Dauxion-Lavaysse, t. II, ch. VIII, p. 263 et suivantes. — Depons, t. III, p. 34 et suivantes.
[222] Depons, Voyage à la partie orientale de la Terre-Ferme, t. III, ch. IX, p. 40 et suivantes.
[223] Depons, t. II, ch. VI, p. 153 et suivantes.
[224]La bulle des vivants avait pour effet de rassurer les consciences, relativement à toute espèce de vices ou de crimes ; la bulle de composition légitimait un grand nombre de vols ; la bulle des morts était un passeport que les vivants expédiaient à leurs amis ou à leurs parents défunts, pour entrer en paradis ; la bulle de la croisade était une dispense de l’obligation d’aller exterminer les infidèles ; la bulle des œufs et du laitage était la permission de manger deux espèces d’aliments pendant tous les jours de l’année. Depons, t. III, ch. IX, et Dauxion-Lavaysse, t. II, ch. VIII.
[225] Voyage aux régions équinoxiales, t. IV, ch. XII, p. 165.
[226] De Humboldt, Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, t. I, l. I, ch. I, et l. II, ch. IV, p. 221 et 342, et t. II, l. II, ch. VII, page 38.
[227] Ibid., t. II, l. II, ch. VII, p. 38.
[228] De Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, t. IV, l. IV, ch. XII, p. 346 et 147. — Depons ne porte la population de la même province qu’à 728 000 individus sur lesquels il compte 291 200 affranchis, désignés sous le nom de gens de couleur : t. I, ch. III, p. 251 et 252.
[229] De Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, t. II, l. II, ch. V, p. 313.
[230]Dauxion-Lavaysse, t. II, ch. VIII, p. 160, 206 et 207. — De Humboldt, Tableaux de la Nature, t. I, p. 41, 42 et 176. — Voyage aux régions équinoxiales, t. V, l. V, ch. XV, p. 132 et 133, et t. VI, l. VI, ch. XVI, p. 160. — Azara, Voyage dans l’Amérique méridionale, t. II, ch. XIV, p. 269 et 270.
[231]De Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, t. IV, l. IV, ch. XII, p. 161, et t. V, l. V, ch. XV, p. 132. — Depons, t. II, ch. VII, p. 319.
[232] De Humboldt, Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, t. II, l. 1, ch. VII, p. 46.
[233] De Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, t. IV, l. IV, ch. XII, p. 161.
[234] De Humboldt, Essai politique, t. II, l. II, ch. VII, p. 51.
[235] De Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, t. IV, l. IV, ch. XIII, p. 210 et 211.
[236] Voyage dans l’Amérique méridionale, t. II, ch. XV, p. 276, 277 et 278.
[237] Azara, Voyage dans l’Amérique méridionale, t. II, ch. XV, p. 284.
[238] Azara, t. II, ch. XIV, p. 273.
[239] Depons, t. I, ch. III, p. 261 et 262. — Le roi d’Espagne ayant accordé des lettres de blanc à tous les habitants d’un village, les zambos, race issue de cuivrés et de noirs, se trouvèrent en majorité dans les élections municipales. Dès ce moment, les blancs furent considérés comme la race avilie, et exclus en conséquence de toutes les fonctions qui étaient à la nomination du peuple. Ils trouvèrent l’orgueil des zambos si insupportable, qu’ils abandonnèrent tous le village. Dauxion-Lavaysse, t. II, ch. VIIII, p. 171, 172 et 173.
[240] Depons, t. I, ch. III, p. 260.
[241] L’orgueil des blancs porte sa peine, parce qu’elle les prive souvent des secours qu’ils pourraient trouver dans les autres classes. Un vieux sergent, natif de Murcie, demandait à M. de Humboldt et à son compagnon de voyage un remède contre la goutte dont il souffrait cruellement. « Je sais, leur disait-il, qu’un zambo de Valencia, qui est un fameux curioso, peut me guérir ; mais le zambo veut être traité avec les égards qu’on ne peut avoir pour un homme de sa couleur, et je préfère rester dans l’état où je suis. » Voyage aux régions équinoxiales, t. VI, l. VI, ch. XVII, p. 8.
[242] Depons, t. III, ch. X, p. 99.
[243] Ibid., ch. X, p. 10.
[244] Ibid., p. 106 et 107.
[245] Depons, t. III, ch. X, p. 108 et 109.
[246] Ibid., p. 115, 116 et 117. Il faut ajouter à la circonstance de l’esclavage la présence de toutes les autorités administratives, judiciaires et ecclésiastiques. — Il y a longtemps qu’Adam Smith a observé que l’industrie fuit toujours la présence des grandes autorités, et que les mendiants les accompagnent.
[247] Depons, t. III, ch. X, p. 144 et 145. — Depons place Valence sous le dixième degré de latitude nord, environ huit degrés plus près de l’équateur que Saint-Domingue.
[248] De Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, t. V, l. V, ch. XVI, p. 230.
[249] Dauxion-Lavaysse, t. II, ch. VII, p. 156 et 157.
[250] Depons, t. III, ch. X, p. 147, 148, 149 et 150. — Dauxion-Lavaysse, t. II, ch. VIII, p. 157. — M. de Humboldt, qui a été frappé de l’aspect d’aisance qui règne dans ces vallées, en porte la population à 52 000 habitants, ou à 2 000 âmes par lieue carrée : c’est la même proportion qu’on observe dans les parties les plus peuplées de la France. Le propriétaire de ces vallées, le comte de Tovar, est l’auteur de l’étonnante révolution qui s’y est opérée dans un petit nombre d’années ; il s’est proposé d’affranchir les esclaves de la tyrannie de leurs maîtres, de transformer les affranchis en fermiers, et de délivrer les maîtres de la lèpre de l’esclavage ; ses efforts ont obtenu le succès qu’ils méritaient. Voyez M. de Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, t. V, liv. V, ch. XV, p. 142, 143 et suivantes.
[251] Depons, t. III, ch. X, p. 151.
[252] Depons, t. III, ch. X, p. 158 et suivantes.
[253] Ibid., ch. X, p. 234 et 235. — Dauxion-Lavaysse, t. II, ch. VIII. — De Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, t. V, l. V, ch. XV, p. 152.
[254] Un très grand nombre de cultivateurs des vallées d’Aragua sont noirs ou mulâtres ; mais ils sont libres. De Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, ibid.
[255]Voyage à la partie orientale de la Terre-Ferme, t. I, ch. III, p. 195. — Azara avait déjà fait la même observation, et M. de Humboldt l’a confirmée.
Dans le Mexique, le gouvernement espagnol employait les forçats aux travaux des manufactures, et il fallait par conséquent que les ateliers fussent convertis en prisons : de là résultait un profond mépris pour ce genre d’occupations, et par conséquent les hommes de la classe ouvrière se faisaient mendiants. De Humboldt, Essai politique, t. IV, l. V, ch. XII, p. 294, 295 et suivantes.
[256] Essai politique, t. V, l. VI, ch. XIV, p. 59.
[257] Voyage à la partie orientale de la Terre-Ferme, t. I, ch. III, p. 205, 206, 207 et 260.
[258] L’usage de marquer d’un fer brûlant les individus asservis est presque général dans quelques-unes des colonies anglaises. R. Bickell’s west Indies as they are, p. 38, 39 and 40.
[259] Depons, t. I, ch. I, p. 247, 248 et 249.
[260] De Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, t. V, liv. V, ch. XV, p. 101. — Depons, t. I, ch. III, p. 244 et suivantes.
[261] Voyage aux régions équinoxiales, l. III, ch. VIII, t. III, p. 225 et 226. — Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, t. II, l. II, ch. VII, p. 46. — Depons, t. I, ch. III, p. 257.
[262] Azara, Voyage dans l’Amérique méridionale, t. II, ch. XIV, p. 269 et 270.
[263] De Humboldt, Essai politique, t. II, l. II, ch. VII, p. 46.
[264]Il faut placer, sans doute, parmi les causes les plus puissantes de l’état stationnaire des colonies espagnoles, l’oppression que le gouvernement espagnol faisait peser sur elles, et qui leur inspirait de l’aversion contre les habitants de la mère-patrie, longtemps avant qu’elles eussent tenté de secouer le joug. « Il est clair, dit Azara, que ce sont les villes qui engendrent et qui propagent... cette espèce d’éloignement, ou pour mieux dire d’aversion décidée, que les créoles ou enfants d’Espagnols nés en Amérique ont pour les Européens et pour le gouvernement espagnol. Cette aversion est telle, que je l’ai souvent vu régner entre les enfants et le père et entre le mari et la femme, lorsque les uns étaient Européens et les autres Américains. »
Voyage dans l’Amérique méridionale, tome II, chapitre XV, page 279.
[265] Rien n’est plus commun, dans les comédies de l’antiquité, que de voir de jeunes filles esclaves, qui n’ont perdu leur liberté que parce qu’elles ont été volées à leurs parents.
[266] Negro slavery, or a view of some of the more prominent features of that state of society, etc., 4th edition, p. 68, 75. — The slave colonies of Great-Britain, or a picture of negro slavery drawn by the colonists themselves, p. 17.
[267] Francis Hall, p. 422.
[268] Fearon, 5th report, p. 264.
[269] Larochefoucault, Voyage aux États-Unis, quatrième partie, t. VII, p. 294. — Tearon, 2nd report, p. 56, 58 ; 5th, report, p. 226, 227, 264.
[270] Raynal, Hist. philosoph., t. IX, l. XVIII, p. 177 et 178. — Weld, Voyage au Canada et aux États-Unis, t. I, ch. IX, p. 143. — Fearon’s Sketches of America passim.
[271] Chez les Romains, la culture des terres par des esclaves chassa les hommes libres des campagnes dans la capitale ; et, comme la classe des maîtres s’était emparée du monopole de tous les métiers par les mains de ses esclaves, la population, qui n’appartenait à aucune de ces deux classes, se trouva privée de tout moyen d’existence : de là cette multitude immense de prolétaires, qui ne vivait que de distributions publiques ou de la vente des suffrages dans les élections, et qui se trouva l’alliée naturelle de Marius et de César. Dans la partie méridionale des États-Unis d’Amérique, les individus qui ne sont ni maîtres ni esclaves émigrent dans les États où les travaux sont faits par des mains libres, et vont se louer comme domestiques. Fearon, 2nd report, p. 57 et 58. —Larochefoucault-Liancourt, deuxième partie, t. IV, p. 293 et 291 ; t. V, p. 76, 77 et 78, troisième partie ; t. VI, p. 86, et t. VII, p. 54.
[272] Larochefoucault. Liancourt, troisième partie, t. VI, p. 198, 199, 200 et 201.
[273] Larochefoucault, deuxième partie, t. IV, p. 87.
[274] Francis Hall, p. 318 et 320.
[275] Francis Hall, p. 424, 426.
[276] Francis Hall, p. 424, 426.
[277] Second report of the committee of the society for the mitigation and gradual abolition of slavery throughout the British dominions, p. 145, 148. — The slave colonies of Great-Britain, or a picture of negro slavery drawn by the colonists themselves, p. 29 et 97.
[278] Adam Smith a observé que l’industrie fuit les lieux qui sont la résidence habituelle des grands, et que par conséquent la population y est paresseuse, dissolue et pauvre. La cause de ce phénomène est la même que celle qui existe dans les lieux où l’esclavage domestique est établi ; c’est le mépris attaché au travail de l’homme sur la nature, et l’honneur accordé à l’exploitation d’un peuple asservi. Smith’s Inquiry, book II, ch. III, t. II, p. 10, 11 et 12.
[279] J’ai dit que la question posée au commencement de ce chapitre préjuge que la partie la plus considérable du genre humain ne doit être considérée que comme une machine de production qui a d’autant plus de valeur qu’elle absorbe une part moins considérable des richesses qu’elle produit. Je ne veux pas d’autres preuves de cela que les termes mêmes dans lesquels s’est exprimé Adam Smith : The wear and tear of a free servant is equally at the expense of his master, and it generally cost him much less than that of a slave. The sum destined for replacing and repairing, if I may say so, the wear and tear of a slave, is commonly managed by a negligent master, or careless overseer. That destined for performing the same office with regard to the free man, is managed by the free man himself. Adam Smith’s Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. Book I, ch. VIII, page 122.
[280] Tome I, liv. I, ch. III, p. 78 et 79.
[281]« Ce sont de faibles calculateurs, dit M. J.-B. Say, que ceux qui comptent la force pour tout et l’équité pour rien. Cela conduit au système d’exploitation des Arabes bédouins qui arrêtent une caravane, et s’emparent des marchandises qu’elle transporte, sans qu’il leur en coûte autre chose, disent-ils, que quelques jours d’embuscade et quelques livres de poudre à tirer. Il n’y a de manière durable et sûre de produire que celle qui est légitime, et il n’y a de manière légitime que celle où les avantages de l’une ne sont point acquis aux dépens de l’autre. » Traité d’économie politique, liv. I, ch. XIX, tome I, p. 365, 5e édit.
[282] Il a jadis existé et il existe sans doute encore des possesseurs d’esclaves qui ont possédé ou qui possèdent de grandes richesses ; il y avait, parmi les patriciens romains, des familles qui possédaient des fortunes immenses, et l’on trouverait sans doute, parmi nos modernes colons, plusieurs hommes qui sont fort riches. Mais, en disant que l’esclavage est un obstacle invincible à la production, à l’accroissement et à la bonne distribution des richesses, je n’entends nullement affirmer qu’il est un obstacle à leur extorsion ou à leur déplacement. Les Romains qui possédaient de grandes fortunes ne les devaient, en général, qu’au pillage exercé pendant le cours de la guerre, ou aux rapines qu’ils exerçaient pendant la paix sur les peuples subjugués. Les colons qui ont des richesses les doivent au monopole qui leur a été accordé pour la vente de leurs denrées, c’est-à-dire à un impôt établi sur des peuples chez lesquels l’esclavage domestique n’est pas admis.
[283]Il existe, chez les peuples modernes qui ont fait quelques progrès dans la civilisation, une multitude d’arts et de métiers dont les peuples de l’Italie et de la Grèce n’avaient aucune idée. Ces peuples ne connaissaient point l’usage du linge, et leurs vêtements ne se composaient que d’une laine grossière qui était travaillée par les mains de leurs femmes. Or, que l’on calcule seulement le nombre de personnes qui sont employées à la production, à la fabrication et à la vente du coton, du lin et de la soie, depuis l’agriculteur qui recueille ces matières jusqu’à la lingère, à la marchande de modes, ou même jusqu’à la blanchisseuse, et l’on pourra se former une légère idée de la différence qui existe entre l’industrie des anciens et l’industrie des modernes, surtout si l’on n’oublie pas les machines employées à mettre ces matières en œuvre, les arts et les connaissances que ces machines exigent.
[284] Columella, de Re rustica, lib. I. En exposant les effets de l’esclavage sur l’intelligence, j’ai fait voir ceux qu’il produit sur l’industrie. Adam Hodgson a recueilli les opinions d’un grand nombre d’écrivains anciens et modernes, sur l’influence qu’exerce l’esclavage sur l’agriculture. A letter to J.-B. Say, on the comparative expense of free and slave labour.
[285] Columella, de Re rustica, lib. 1, in proœmio.
[286]De Sismondi, Nouveaux principes d’économie politique, ou de la Richesse dans ses rapports avec la population. Tome I, liv. II, chap. 4, p. 17, 18 et suiv., 2e édit.
[287] Voyez le chapitre VII de ce livre.
[288] Second report of the committee of the society for the mitigation et gradual abolition of slavery, etc., p. 32, 34 et 62.
[289] Relief for West-Indian distress, showing the inefficiency of protecting duties on East-India sugar, by James Cropper, p. 18.
[290] Second report of the committee of the society for the mitigation and gradual abolition of slavery, p. 31 and 157.
[291] The slave colonies of Great-Britain, or a picture of negro slavery, p. 48. — Relief for West-Indian distress, passim.
[292] Voyage dans la Louisiane, tome I, ch. V, p. 92.
[293]C’est par économie que les planteurs emploient les bras des hommes esclaves au lieu de la charrue. « Ils calculent, dit Michaux, que dans le cours de l’année, un cheval, tant pour la nourriture que pour l’entretien, coûte dix fois plus qu’un nègre dont la dépense annuelle n’excède pas quinze à seize piastres. » Voyage à l’ouest des monts Alleghanys, ch. XXXII, p. 304 et 305.
Les chameaux furent introduits au Pérou après la conquête de ce pays par les Espagnols ; mais les conquérants en arrêtèrent la propagation prétendant que la multiplication des bêtes de somme les empêcherait de louer les indigènes aux voyageurs ou aux négociants pour servir dans l’intérieur du pays au transport des provisions et des marchandises. De Humboldt, Essai politique, tome IV, liv. V, ch. XII, p. 345. Voyage aux régions équinoxiales, tome V, liv. V, ch. XVI, p. 223 et 224.
[294] Michaux, voyage à l’ouest des monts Alleghanys, ch. I, p. 9, et ch. XXXI, p. 294 et 295. — Robin, Voyage dans la Louisiane, tome II, ch. XXXVII, p. 114.
[295] James Cropper’s Relief for West-Indian distress, p. 20, 21 et 22.
[296] Raynal, Histoire philosoph., tome VI, liv. XI, p. 227 et 228. — Larochefoucault, Voyage aux États-Unis, deuxième part., tome IV, page 65.
[297]Michaux, voyage à l’ouest des monts Alleghanys, ch. I et VIII, p. 10 et 84.
[298] Ibid., ch. XXII, p. 223 et 224.
[299]Larochefoucault, Voyage aux États-Unis, tome V, deuxième part., page 95.
[300] Michaux, Voyage à l’ouest des monts Alleghanys, ch. I, p. 10. — Fearon’s Sketches, passim.
[301] Michaux, ch. II et XIV, p. 15, 133 et 134. — Robin, Voyage dans la Louisiane, tome II, ch. XXXVII, p. 114 et 115. — Fearon’s Sketches of America, p. 43, 44, 113, 128, 160, 161, 162 et 210.
[302] A. Hodgson’s Letter to M. J.-B. Say, on the comparative expense of free and slave labour.
[303] Un rapport du comité de l’assemblée des colons de la Jamaïque, présenté à la chambre des communes d’Angleterre, le 25 février 1805, expose la détresse des colons, dont la plupart sont accablés de dettes, et qui presque tous ont perdu leur crédit. Ce rapport se termine en ces termes : « Par ces faits, la chambre sera en état de juger de l’étendue alarmante qu’a prise la détresse des planteurs de sucre, et avec quelle rapidité elle s’accroît tous les jours. Les plantations à sucre, depuis peu abandonnées et mises en vente par la justice, se montent à environ un quart de celles qui existent dans la colonie. » East and West-India sugar, or a refutation of the claim of the West-India colonists, to a protecting duty on East-India sugar, p. 121, 122 et 128. — James Cropper’s Relief for west-indian distress.
[304] Voyage dans la partie méridionale de l’Afrique, tome II, ch. V, p. 192 et 251.
[305] Michaux, ch. XIV, p. 133 et 134.
[306] Michaux, ch. I et ch. VIII, p. 10 et 84.
[307] Michaux, chap. I, p. 9. — Larochefoucault.
[308] Larochefoucault, troisième partie, t. VI, p. 85. — Michaux, ch. XIV, p. 13.
[309] Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, tome IV, liv. IV, ch. XI, p. 45 et 46. — En 1777, un ouvrier libre, nègre ou mulâtre, se louait au Mexique à raison de quatre piastres par mois, et ces ouvriers étaient très rares. Il n’y avait point d’esclaves. (Thierry, Traité de la culture du nopal, tome I, p. 82.) Je n’ai pas besoin de faire observer que l’argent et l’or, dans les lieux où ils sont produits et où l’on cultive les objets nécessaires à la vie, ont nécessairement un peu moins de valeur que dans les lieux où ils sont importés.
[310]De Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, tome V, liv. V, ch. XV, p. 252, 253, 254 et 255. — Au Mexique, on compte la journée, dit ailleurs de M. Humboldt, de deux réales de plata (de 26 sous) dans les régions froides, et de deux réaux et demi (de 32 sous) dans les régions chaudes, où l’on manque de bras et où les habitants sont en général très paresseux. Ce prix de la main-d’œuvre doit paraître assez modique, lorsqu’on considère la richesse métallique du pays, et la quantité d’argent qui y est constamment en circulation. Aux États-Unis, où les blancs ont repoussé la population indienne au-delà de l’Ohio et du Mississipi, la journée est de 3 liv. 10 sous à 4 francs : en France, on peut l’évaluer de 30 à 40 sous, et au Bengale, d’après M. Fitzing, à 6 sous. Aussi, malgré l’énorme différence du fret, le sucre des Grandes-Indes est à meilleur marché à Philadelphie que celui de la Jamaïque. Il résulte de ces données, qu’actuellement le prix de la journée, au Mexique, est au prix de la journée
| en France, | :: 10 : 12 |
| aux États-Unis, | :: 10 : 23 |
| au Bengale, | :: 10 : 2 |
(Humboldt, Nouv.-Esp., tome III, liv. IV, ch. IX, p. 103 et 104.) Pour terminer le parallèle, il faut ajouter que le prix de la journée de l’homme libre de la Louisiane est le double de ce qu’elle est au nord des États-Unis, c’est-à-dire comme 10 : 46.
[311] Larochefoucault, troisième part., tome VI, p. 60, 61 et 79.
[312] Robin, tome I, ch. vi, p. 92, et tome II, ch. XXXVII, p. 114 et 115.
[313]Ibid., tome II, ch. XXXVI, p. 44. — Il semble qu’un maître qui tire de la journée d’un bon esclave 20 ou 30 piastres par mois, doit faire des bénéfices considérables ; mais, pour connaître ces bénéfices, il est une multitude de circonstances qu’il faudrait prendre en considération ; je me bornerai à en indiquer une seule : « Ici comme ailleurs, dit M. de La Rochefoucault en parlant du Maryland, quand on examine de près l’utilité dont sont les nègres esclaves aux intérêts du maître, comparée à l’emploi de toute autre espèce de moyen de travail, on trouve qu’elle n’a aucune réalité. Il faut nourrir, habiller les vieux, les enfants, les femmes grosses, les soigner dans leurs maladies. Rien n’est plus commun que de voir le propriétaire de quatre-vingts esclaves n’en pas pouvoir mettre trente au travail des champs. Dix ouvriers loués à l’année feraient au moins autant de travail que les trente esclaves. » Troisième part., tome VI, p. 85.
[314] Larochefoucault, deuxième part, tome VI, p. 87 et 88.
[315] Storch, Cours d’Économie politique. — La plupart des grands de Pologne, à l’époque de la guerre qui amena le partage de leur pays, étaient accablés de dettes. Un d’eux, le prince Lubomirski, voulut donner l’exemple de la réforme. Il se soumit à une direction, puis il fit annoncer, au son du tambour, que personne n’eût à lui faire crédit, sous peine de perdre ce qu’on lui avancerait. Rulhière, tome II, liv. VII, p. 405.
[316] Il est bien clair que je ne parle que des richesses que les Anglais possèdent en leur qualité de planteurs. Un homme à qui sa plantation ne produit rien, peut posséder d’ailleurs de très grandes richesses. — Les colons hollandais de la Guyane, dont les mœurs ont tant d’analogie avec celles qui ont été attribuées aux satrapes, étaient accablés de dettes, longtemps avant que de tomber sous la domination anglaise. « Tel est, dit Raynal, l’état des trois colonies que les Hollandais ont successivement formées dans la Guyane. Il est déplorable, et le sera longtemps, peut-être toujours, à moins que le gouvernement ne trouve dans sa sagesse, dans sa générosité ou dans son courage, un expédient pour décharger les cultivateurs du poids accablant des dettes qu’ils ont contractées. » Histoire philosoph. des deux Indes, tome VI, liv. XII, p. 414. — Cela signifie, en termes plus clairs, que les travaux excessifs auxquels les esclaves sont condamnés, ne peuvent suffire à la voracité des possesseurs d’hommes des colonies, et qu’il faut se hâter de leur livrer la subsistance des hommes industrieux et libres de la mère-patrie. Voilà une étrange morale pour une histoire philosophique !
[317] Raynal, Hist. philosoph des deux Indes, tome VII, liv. XIV, p. 430 et 431. — En 1658, le nombre des esclaves de la Jamaïque n’était que de 1 400, tandis que celui des hommes libres était de 4 500 ; il y avait donc trois personnes libres pour un esclave. En 1817, il y avait 346 150 esclaves, et environ 17 000 ; c’est-à-dire environ vingt esclaves pour une personne libre.
[318] Second report of the committee of the society for the mitigation and gradual abolition of slavery, p. 149, 150. — Les états présentés au parlement d’Angleterre portent le nombre d’esclaves de la Jamaïque, en 1817, à 346 150. — Un des phénomènes les plus intéressants à observer est la proportion dans laquelle les diverses classes de la société se multiplient, surtout si l’on déterminait en même temps la source où chacune d’elles puise ses revenus ; ce serait peut-être un des moyens les plus sûrs de prévenir le sort des générations à venir, et de les garantir des calamités qui peuvent les menacer.
[319] Raynal, Hist. philosoph., tome VII, liv. XIV, p. 385.
[320] Second report of the society, etc., p. 139, 140.
[321] Second report of the society, etc., p. 139, 140.
[322] Raynal, Hist. philosoph., tome VII, liv. XIII, p. 95, 115 et 143. — Le recensement de 1788 portait la population de cette île à 13 466 blancs, 3 044 gens de couleur libres et 85 471 esclaves.
[323] Ibid., Histoire philosoph, des deux Indes. — Maltebrun, Précis de la Géographie universelle. — Alex. de Humboldt, Nouvelle-Espagne, tome II, liv. II, ch. VII, p. 5 et 6. — Robin, Voyage à la Louisiane, tome I, ch. XXII, p. 295 et 296.
[324] Voyez les tableaux statistiques insérés dans le Précis de la géographie universelle, tome V, liv. CII, p. 419, 420 et 421.
[325] Al. de Humboldt, Nouvelle-Espagne, tome V, sup., p. 144.
[326] Raynal, Histoire philosoph., tome V, liv. IX, p. 9, 10 et 13. — Il est presque impossible d’évaluer les effets que l’esclavage produit au Brésil sur l’accroissement ou le décroissement de la population. Cette contrée est si vaste, et les trois principales races d’hommes qui y existent sont si diversement réparties sur le territoire, qu’il faudrait se livrer à un examen particulier pour chaque province, et l’on manquerait de documents à l’égard de plusieurs. Au temps où Raynal écrivait, il n’évaluait la population du Brésil qu’à 802 235 individus (tome V, liv. IX, p. 201 et 202) ; tandis que M. de Humboldt croit que, vers la même époque, elle s’élevait à 1 900 000 âmes. (Nouvelle-Espagne, supp., p. 142 et 143.) Raynal évaluait le nombre des esclaves de la province de Rio-Janeiro à 54 091, et le nombre des esclaves de toute la colonie à 347 858 (ibid., p. 202) ; tandis que Cook portait, en 1768, le nombre des esclaves et des hommes de couleur de la seule ville de Rio-Janeiro à 666 000. (Premier voyage, liv. I, ch. II, tome II, p. 299.) Le secret dans lequel le gouvernement portugais tenait ses établissements coloniaux, est plus que suffisant pour expliquer ces contradictions.
[327]Si, dans les républiques du sud de l’Amérique, on comparait l’accroissement qu’a éprouvé la classe des conquérants, à l’accroissement qu’ont éprouvé les autres classes de la population, on arriverait probablement à des résultats semblables à ceux que je viens d’exposer. M. de Humboldt estimait, en 1808, la population totale des colonies espagnoles à treize ou quatorze millions d’habitants, et, dans ce nombre, il ne comptait qu’environ trois millions d’individus de race européenne. Il fallait donc qu’il y eut déjà à cette époque dix ou onze millions d’individus indigènes, noirs ou de sang mêlé. Les Espagnols éprouvent aux Philippines un sort analogue à celui qu’éprouvaient les Mamlouks en Égypte. « On ne compte dans l’île entière de Luçon, dit La Pérouse, que douze cents Espagnols créoles ou européens. Une remarque assez singulière, c’est qu’il n’y a aucune famille espagnole qui s’y soit conservée jusqu’à la quatrième génération, pendant que la population des Indiens a augmenté depuis la conquête, parce que la terre n’y recèle pas, comme en Amérique, des métaux destructeurs dont les mines ont englouti les générations de plusieurs millions d’hommes employés à les exploiter. » (La Pérouse, tome IV, p. 125, 128.) Si, dans le nord de l’Europe, les seigneurs comparaient la proportion dans laquelle ils se multiplient, à la proportion dans laquelle se multiplient les esclaves, on serait probablement fort étonné des résultats de la comparaison.
[328] Raynal, Histoire philosoph., tome VII, liv. XIII, p. 194.
[329] Second report of the committee of the society for the mitigation and gradual abolition of slavery. Appendix, G. p. 138, 162.
[330]« La dynastie virginienne, comme on l’a appelée, je crois avec raison, est un sujet de plainte dans toutes les autres parties de l’Amérique. Cet État a fourni quatre des cinq présidents, et un grand nombre d’occupants de tous les autres emplois du gouvernement. » Fearon, 6th report, p. 293.
Quand la Louisiane a été abandonnée aux États Unis, les Anglo-Américains se sont jetés avec tant d’avidité sur les emplois publics qui y ont été créés, qu’ils les ont exclusivement occupés, quoiqu’ils n’en connussent ni la langue ni les lois. Robin, tome II, ch. IV, p. 387.
L’avidité des emplois publics n’est pas un vice particulier à une époque ou à une nation. C’est un mal qui peut être le résultat d’un grand nombre de causes ; voici, je crois, les principales :
1° L’existence de l’esclavage, ou les préjugés nés d’un tel état ;
2° Le monopole, de la part du gouvernement, d’un nombre plus ou moins grand de professions privées, transformées en emplois publics ;
3° Une grande facilité de parvenir aux emplois, sans frais et sans capacité ;
4° La sécurité attachée aux fonctions publiques, ou l’inviolabilité des fonctionnaires ;
5° Des salaires ou des honneurs sans proportion aux travaux à exécuter ;
6° L’insécurité attachée à l’exercice des fonctions privées, et les vexations auxquelles sont exposées les personnes qui les exercent.
[331]Les Hollandais établis aux Moluques emploient un moyen analogue pour maintenir leurs sujets dans la servitude. « Ils se gardent bien, dit Labillardière, de leur apprendre leur langue maternelle, afin de n’en être pas entendus lorsqu’ils conversent entre eux. » Voyage à la recherche de La Pérouse, ch. VII, tome I, page 355.
C’est par des motifs analogues que les prêtres d’Égypte employaient, entre eux, un langage inintelligible pour la population qu’ils avaient assujettie. Les druides, dont le pouvoir n’était guère moins absolu que celui des prêtres d’Égypte, employaient aussi, suivant le témoignage de César, une langue que le peuple ne pouvait pas comprendre.
[332] Histoire de Pologne, tome III, liv. IX, p. 146.
[333] Denys d’Halicarnasse, liv. V, ch. XXVI.
[334] Sismonde de Sismondi, Nouveaux principes d’économie politique, liv. III, ch. IV, p. 181.
[335] Raynal, Histoire philosoph. des deux Indes, tome X, liv. XIX, page 60.
[336] Rulhière, Histoire de l’anarchie de Pologne, tome III, liv. IX et X, p. 93 et 91, 214 et 215.
[337] Rulhière, tome III, liv. IX et X, p. 99, 100 et 244.
[338] Ibid., liv. IX, p. 66.
[339] Lévesque, Histoire de Russie, tome III, p. 286.
[340] Rulhière, tome III, liv. IX, p. 67.
[341] Histoire philosoph. des deux Indes, t. VII, liv. XIII, pages 236 et 237.
[342] Stedman, Voyage à Surinam et dans l’intérieur de la Guyane, tome I, ch. III et IV, p 95, 104 et 105 ; tome II, ch. III, p. 94. — Raynal, tome VI, liv. XII, p. 413.
[343]Les peuples d’Europe qui ne possèdent point de colonies sont ceux qui paient le moins cher les denrées des tropiques, par la raison qu’ils n’accordent le monopole de la vente à aucune île. En Suisse, par exemple, le peuple paie le sucre, le café et les autres denrées qui viennent des colonies ou des Indes à un prix beaucoup plus bas que ne les paient les peuples de France et d’Angleterre. Dans ces deux derniers pays, le public commence par payer un impôt fort lourd, pour protéger les colons et leurs possessions ; et quand il a payé cet impôt et qu’il les a protégés, il jouit de l’avantage de payer leurs produits plus chèrement que ne les paie aucune autre nation.
[344] East and West-India sugar, 1823, p. 60, 61, 62.
[345]« Les propriétaires de nègres se plaignent déjà que, depuis que la population noire augmente, ils sont moins soumis, plus remuants qu’ils ne l’étaient autrefois. Tous ces symptômes devraient les aviser de la prompte nécessité de faire quelque chose pour préparer une fin à cet état d’esclavage, qui sera tôt ou tard d’un grand danger pour les maîtres ; mais on s’endort sur ce danger comme sur tous les autres ; et, dans ce cas comme dans tous les autres, on reconnaît que la prévoyance est nulle parmi le peuple américain. » De Larochefoucault Liancourt, Voyage aux États-Unis, troisième partie, tome VI, p. 86.
Il y a déjà trente ans que M. de Larochefoucault a fait ces observations ; et, depuis cette époque, le nombre des esclaves est beaucoup augmenté.
[346] Au mois de juin 1824, il existait déjà, en Angleterre, 220 associations formées dans le but de seconder celle qui s’est établie à Londres pour l’abolition de l’esclavage ; depuis cette époque le nombre s’en est considérablement augmenté. En 1823, il a été présenté 500 pétitions au parlement pour le même objet. En 1824, il a en été présenté près de 600. — Report of the committee of the society for the mitigation and gradual abolition of slavery, p. 37.
[347]Franklin, que l’on peut considérer comme le représentant de la population industrieuse de l’Amérique, n’a pas fait connaître directement tout ce qu’il pensait des possesseurs d’hommes ses compatriotes ; mais, si l’on veut savoir quelle était son opinion à leur égard, on en a un moyen facile : il suffit de se rappeler les mœurs de l’animal auxquelles il comparait les mœurs d’un gentilhomme, et de comparer les mœurs qu’il attribuait à un gentilhomme aux mœurs d’un planteur. Deux quantités étant égales à une troisième, disent les mathématiciens, sont égales entre elles : qu’on juge, d’après cet axiome, de l’accord qui peut exister entre les opinions des Américains industrieux et des Américains qui vivent sur les produits du travail de leurs esclaves.
[348] On dit que les grands de Russie dressent un certain nombre de leurs esclaves dans l’art de faire de la musique ; mais, comme ces esclaves ont l’intelligence fort bornée, chacun d’eux est réduit à ne donner qu’un son, c’est-à-dire à faire l’office d’un tuyau d’orgue. Le développement du talent musical de ces esclaves est l’emblème du développement des talents industriels de tous les esclaves des colonies modernes.
[349] Liv. VI, ch. XXII.
[350] Vie de Camille, traduction d’Amiot.
[351] Au milieu du seizième siècle, les Russes, dans leurs guerres, se conduisaient encore comme les Romains du temps de César. Dans la guerre qu’ils soutinrent contre Gustave-Vasa, le nombre des Suédois qu’ils firent esclaves, soldats, paysans, femmes ou enfants, fut si considérable qu’ils les vendaient pour quelques petites pièces de monnaie. On remarque, dit leur historien, que les petites filles se vendaient un peu plus cher que les males. Lévesque, Histoire de Russie, tome III, p. 53.
[352] J.-J. Rousseau prétend que le christianisme ne prêche que servitude et dépendance ; que son esprit est trop favorable à la tyrannie pour qu’elle n’en profite pas toujours, et que les vrais chrétiens sont faits pour être esclaves. (Contrat social, liv. IV, ch. VIII.) Pour admettre cette opinion, il faut supposer que l’esprit du christianisme repousse toute idée de devoirs envers soi-même et envers les autres, ou que le seul devoir qu’il impose est celui de n’en avoir aucun, ce qui est une contradiction ; ou bien il faut admettre qu’il impose le devoir de se livrer au vice et au crime, quand on ne peut s’en abstenir sans s’exposer à un châtiment, ce qui est encore une contradiction ; car les crimes et les vices entraînent tôt ou tard après eux leur châtiment. On va voir, au reste, que les possesseurs d’esclaves ont jugé l’esprit du christianisme autrement que Rousseau.
[353] The Rev. R. Bickell’s West-Indies as they are, or A real picture of slavery, part. II, p. 83 and 84.
[354]The Rev. R. Bickell’s West-Indies as they are, part. II, p. 84, 85 and 86.
[355] Second report of the committee of the society for the mitigation and gradual abolition of slavery, p. 141, 142 and 149.
[356] R. Bickell’s West-Indies as the are, part. II, p. 165, 166, 167, 168 and 173. — Le gouvernement anglais ayant obligé les maîtres à accorder à leurs esclaves le dimanche comme jour de repos, les maîtres ont fait du dimanche un jour de marché. Ils en ont donné pour motif que dans ce temps de détresse générale, plusieurs planteurs sont extrêmement endettés, et que, pour raison de leurs dettes, il leur est impossible de permettre à leurs esclaves de sortir si ce n’est le dimanche. The slave colonies of Great-Britain, p. 48 and 49.
[357] Cette société compte au nombre de ses membres les personnes les plus distinguées de l’Angleterre, par leurs talents, par leur position sociale, ou par leur dévouement à la cause de l’humanité.
[358] An authentic report of the debate of the house of commons. June the 23d, 1825, on Mr. Burton’s motion. — À toutes les époques où l’on a tenté d’instruire les esclaves ou les affranchis des préceptes de la religion, les maîtres ont opposé la même résistance.
[359] An authentic report of the debate in the house of commons, June, the 23d. 1825, etc., p. 33 and 34. — Il résulte de la proclamation même du gouverneur que les violences des maîtres n’ont pas eu d’autre cause que la crainte de voir les sentiments moraux des affranchis et des esclaves développés par l’enseignement des préceptes religieux. « Je vous en prie, dit le gouverneur aux auteurs de ces violences, réfléchissez aux conséquences de votre conduite. Si vous vous plaisez à renverser les maisons et les églises de ceux qui instruisent les noirs (of the teachers of the negroes), qui peut dire que les noirs ne suivront pas votre exemple, en démolissant vos propres maisons ? » Ibid., p. 27 et 28.
[360] De Larochefoucault-Liancourt, troisième partie, tome VI, p. 181.
[361] Robin, Voyage dans la Louisiane, tome III, ch. LXVIII, p. 198 et 197.
[362] Raynal, qui a défendu la liberté avec un zèle si ardent et quelquefois si aveugle, reproche à Montesquieu de n’avoir pas osé mettre au nombre des causes de la décadence de l’empire romain, la loi de Constantin qui, suivant lui, déclarait libres tous les esclaves qui se feraient chrétiens. Histoire philosoph., tome I, liv. I, p. 12 et 13. — Jamais les empereurs romains n’ont accordé la liberté à tous les esclaves qui se feraient chrétiens ; s’ils la leur avaient accordée, les invasions des barbares eussent rencontré plus d’obstacles.
[363] Voyage dans la Louisiane, tome II, ch. XXXVIII, p. 123.
[364]De Larochefoucault, Voyage aux États-Unis, tome I, p. 282 ; tome III, p. 174 ; tome IV, p. 78 ; tome V, p. 69 et 79. Le seul fait que les Anglo-Américains repoussent de leurs temples toute personne de couleur, n’est-il pas une preuve évidente que la religion n’est pour eux qu’un moyen de gouvernement ?
[365] Nouveau voyage dans la partie méridionale de l’Afrique, tome II, ch. V, p. 248 et 249.
[366] J. Stephen’s Slavery of the British West-India colonies, as it exist both in law and practice, ch. V, sect. III, IV and V. — R. Bickell’s West-Indies as they are, part. II. — The slave colonies of Great-Britain, or a Picture of negro slavery, drawn by the colonists themselves. — Voyez les écrits publiés par la société formée pour la modification et l’abolition graduelles de l’esclavage.
[367] Dauxion-Lavaysse, tome II, ch. VIII, p. 252 et suivantes. — Depons, tome II, ch. VI, p. 153 et suiv. ; tome III, ch. IX, p. 34 et suiv. — De Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, liv. III, ch. VIII, tome III, p. 224.
[368] On lit, dans l’article 13 de la Constitution fédérative de Guatemala: « Celui qui fait le commerce d’esclaves ne peut être citoyen. » Cette disposition est très sage et très juste ; un peuple qui tient à sa liberté ne doit jamais permettre l’exercice d’aucun pouvoir politique à des individus qui n’admettent l’existence d’aucun devoir, ou qui règlent l’étendue de leurs droits par l’étendue de leurs forces.
[369] « La France paie à la Martinique et à la Guadeloupe le sucre qu’elle consomme 50 fr. les cent livres, non compris les droits, et les obtiendrait à la Havane pour 35 fr., non compris les droits également. » (J. B. Say, Traité d’économie politique, tome I, liv. I, chap. XIX, p. 365 et 366.) La différence en faveur du pays qui possède le moins d’esclaves comparativement à la population libre serait donc, suivant M. Say, de près d’un tiers, s’il n’existait pas d’autres causes de la différence que l’esclavage. Je suppose cependant qu’elle n’est que d’un quart ; mais aussi le prix du sucre de nos colonies a été porté un peu trop haut, et celui de la Havane un peu trop bas. Au reste, comme les prix varient d’un jour à l’autre, il ne peut pas être ici question d’une exactitude mathématique.
[370] East-India sugar, or an Inquiry respecting the means of improving the quality and reducing the cost of sugar raised by free labour in the East-Indies, p. 3, 4 et 5. London, 1824. — On calcule que le prix moyen que coûte la culture nécessaire à la production d’un quintal de sucre, en y comprenant la rente payée au propriétaire de la terre, est de 4 sch. 9 d. 1/2 ou environ 6 francs. (Ibid. p. 27.) Le sucre cultivé par des ouvriers libres, pourrait être livré à Calcutta sur le pied du 16 ou 17 francs le quintal, et sur le pied de 26 fr. 80 c. rendu en Europe. (Ibid., p. 13.) Ce serait un peu plus de 5 sous la livre.
[371] Traité d’économie politique, tome I, p. 365 et 366.
[372]Traité d’économie politique, t. I, liv. I, ch. XIX, p. 365.
[373]Il faut observer que les dépenses qu’exigent l’administration, la conservation et la défense de trois misérables îles doivent être à peu près les mêmes que celles que la France était obligée de faire quand elle avait de nombreuses colonies. La défense navale, pour être efficace, doit être, en effet, en raison des forces de l’ennemi, et non en raison de l’objet qu’il s’agit de garder. Il faut, en France, pour administrer deux ou trois îles, un ministère aussi complet et aussi dispendieux que pour en administrer dix.
[374] R. Bickell’s West-Indies as they are, p. 244 and 245.
[375] Raynal, Histoire philosoph., tome VII, liv. XII, p. 116, 117 146. — Cet historien porte les valeurs exportées par la Martinique à 18 975 974 liv., et les valeurs exportées par la Guadeloupe à 12 751 404 liv.
[376] La France tire de la Guadeloupe et de la Martinique presque tout le sucre qu’elle consomme, et la consommation s’élève à 50 millions de kilogrammes ; mais comment est-il possible que deux îles dont les richesses ni la population n’ont presque pas varié depuis que leurs exportations s’élevaient à peine à 32 millions, exportent aujourd’hui, en sucre seulement, une valeur à peu près égale ? Serait-il vrai, comme le croient quelques personnes, que des colons introduisent dans leurs pays des sucres étrangers, et qu’ils nous les expédient ensuite pour obtenir une prime de 37 fr. 50 les cent kilogrammes ? Si cela arrivait pour le sucre, cela arriverait probablement aussi pour toutes les denrées coloniales ; et l’on conçoit quel énorme tribut les possesseurs d’hommes des colonies lèveraient alors sur la France.
[377] James Cropper’s Relief for west-indian distress, p. 26 and 27. London 1823. — East and West-India sugar, p. 4 and 5.
[378] Le quintal anglais est de 108 livres ; 50 kil. égalent 111 livres anglaises.
[379] Second report of the committee of the society for the mitigation and gradual abolition of slavery, p. 166 and 167.
[380]Je dis que les possesseurs d’hommes sont plus disposés à faire des dettes qu’à cumuler des capitaux ; à l’appui des faits que j’ai déjà cités j’en ajouterai ici quelques autres qui me semblent trop remarquables pour ne pas être observés.
Dans un espace de vingt années, de 1760 à 1780, le nombre de ventes forcées qui ont eu lieu pour dettes, dans la Jamaïque, s’est élevé à 80 000, et le montant de ces dettes a été de 22 500 000 liv. st. (572 500 000 fr). Dans le cours du même espace de temps, près de la moitié des propriétés foncières ont changé de mains par suite de ces ventes forcées. East and West-India sugar, appendix D, p. 127.
[381] James Cropper’s Relief for west-indian distress, p. 12.
[382] Stedman, tome III, ch. XXIX, p. 187. — Le Vaillant, premier Voyage, tome I, p. 77.
[383] Voyez les rapports de la société formée pour l’abolition de l’esclavage, et les débats parlementaires sur le même sujet.
[384] Robin, Voyage à la Louisiane, tome III, ch. LXVII, p. 178 et 179
[385] De Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, liv. III, ch. VIII, tome III, p. 225 et 226. — Depons, tome I, ch. II, p. 257, et tome II, ch. V, p. 65 et 66. — Robin, tome I, ch. XX, p. 283.
[386] De Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, liv. III, ch. VIII, tome III, p. 225 et 226.
Dans les pays où l’esclavage est admis, les hommes de la race des maîtres considèrent, en général, comme leurs esclaves, tous les individus qu’ils peuvent soumettre, et comme leurs propriétés, tous les biens qu’ils peuvent usurper. De là, les guerres, les meurtres et les spoliations dont les colons du cap de Bonne-Espérance se sont rendus coupables envers les Hottentots ; de là aussi, les crimes, les meurtres et les spoliations commis contre les indigènes d’Amérique par les Anglo-Américains des frontières. Les gouvernements de Hollande et des États-Unis ont fait tout ce qu’ils ont pu pour réprimer ces attentats, et jamais ils n’ont pu en venir à bout. Cela a tenu à ce que la puissance ne s’étend pas au-delà de certaines limites, et que les lois cessent au point où la puissance finit.
[387] Voyez le tome I, liv. II, ch. II.
[388] La même opposition de principes se trouve quelquefois dans les gouvernements : ceux qui ont pour principe la force ou le despotisme, prétendent qu’il leur est permis de se livrer, envers les hommes et leurs propriétés, à toutes les actions qu’ils ne se sont pas positivement interdites ; ceux, au contraire, qui ont pour principe la morale et la liberté, reconnaissent qu’ils ne peuvent exercer, sur les hommes ou sur leurs biens, que les actions que des lois spéciales leur ont positivement permises.
[389] Les banques d’épargnes, si utiles aux familles des classes ouvrières, seraient indispensables à des esclaves auxquels il serait permis de se racheter. Il faudrait même qu’elles présentassent des garanties tellement fortes qu’elles fussent capables de vaincre la méfiance naturelle à des esclaves.
[390] T. Clarkson’s Thoughts on the necessity of improving the condition of the slaves, p. 15, 16, 17.
[391] Denon, tome I, p. 135, 136 et suivantes.
[392] Barrow, Voyage en Chine, tome II, ch. VIII, p. 220.
[393] Péron, tome I, liv. II, ch. VII, p. 144. — Freycinet, tome II, ch. X, p. 336.
[394] « En faisant abstraction des subdivisions, dit M. de Humboldt, en parlant de la population du Mexique, il en résulte quatre castes : les blancs, compris sous la dénomination générale d’Espagnols ; les nègres ; les Indiens, et les hommes de race mixte, mélangés d’Européens, d’Africains, d’Indiens américains et de Malais ; c’est par la communication fréquente qui existe entre Acapulco et les îles Philippines, que plusieurs individus d’origine asiatique, soit chinois, soit malais, se sont établis dans la Nouvelle-Espagne. » Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, tome I, liv. II, ch. VI, p. 367 et 368.
[395] La France est le pays dans lequel l’orgueil de race est le moins marqué ; et c’est là une des causes qui font que les individus de cette nation inspirent moins que d’autres de l’antipathie aux étrangers. « C’est une chose étonnante et bien digne de remarque, dit un voyageur anglais, que malgré les présents considérables distribués, chaque année, aux Indiens du Haut-Canada, par des agents anglais de nation, malgré le respect que ceux-ci ne cessent d’avoir pour leurs usages et leurs droits naturels, un Indien qui cherche l’hospitalité préfère, même aujourd’hui, la chaumière d’un pauvre fermier français à la maison d’un riche fermier anglais. » (Weld, Voyage au Canada, tome II, ch. XXIX, p. 180 et 181.) La raison de la préférence est toute simple : le fermier français ignore ce que c’est que to keep his distance, ce que l’anglais n’oublie jamais.
[396] Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, tome II, liv. II, ch. VII, p. 67.
[397] Azara, tome II, ch. XII et XIV, p. 203, 264 et 265.
[398] Voyage dans l’Amérique méridionale, tome II, ch. XIV, p. 265.
[399] Ibid., ch. XV, p. 276. — Dauxion-Lavaysse, tome II, ch. VII, p. 174 et 175.
[400] Dauxion-Lavaysse, tome II, ch. VI, p. 174 et 175. — Azara, tome II, ch. XIV, p. 266 et 267.
[401] De Humboldt, Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, tome I, liv. II, ch. V, p. 362, et tome II, liv. II, ch. VII, p. 38.
[402] Stedman, tome II, ch. XIII, p. 21.
[403] Dauxion-Lavaysse, tome II, ch. VII, p. 174 et 175. — La Pérouse a observé que l’union des Russes aux Kamtchadales produisait une race d’hommes plus active et plus laborieuse que celles des pères, et plus belle que celle de mères. Tome III, ch. XXII, p. 189 et 190.
[404] Robertson’s History of America, book II, note 35, p. 396.
[405] Bougainville, première partie, ch. VI, tome I, p. 124, 125 et 126.
[406] Bougainville, première partie, ch. VII, p. 120, 121 et 122.
[407] Azara, tome II, ch. XIII, p. 224, 225, 226 et 232.
[408] Voyage aux régions équinoxiales, tome III, liv. III, ch. VI, p. 4, 5 et 6.
[409] Bougainville, première partie, ch. VII, t. I, p. 126 et 127. — La Pérouse, tome II, ch. XI, p. 301.
[410] Azara, tome II, ch. XII, p. 253 et 254.
[411] La Pérouse, tome II, ch. XI, p. 296. — Azara, tome II, ch. XIII, p. 232. — Raynal, tome IV, liv. VIII, p. 302 et 303.
[412] Azara, tome II, ch. XIII, p. 234 et 235. — Raynal, tome IV, liv. VIII, p. 315. — De Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, liv. III, ch. VII, tome III, p. 149. — Les règlements des jésuites ont servi de modèle à tous les missionnaires. (La Pérouse, tome II, ch. XI, p. 308. — Azara, tome II, ch. XII, p. 117 et 218.) Il ne faut pas en être étonné, puisqu’ils étaient soumis à une autorité commune. De Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, tome III, liv. III, ch. VI, p. 52.
[413] Azara, tome II, ch. XII, p. 218.
[414] La Pérouse, tome II, ch. XI, p. 302.
[415] De Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, tome III, liv. III, ch. VIII, p. 197. — Ulloa, Discours philosoph., tome II, Disc. XVIII, p. 44 et 45. — Vancouver, liv. IV, ch. IX, tome IV, p. 154. — La Pérouse, tome II, ch. XI, p. 299 et 301. — Azara, tome II, ch. XII et XIII, p. 218, 233, 234 et 250.
[416] La Pérouse, tome II, ch. XI, p. 296. — Bougainville, première partie, ch. VII, tome I, p. 128 et 229. — Ulloa, Discours philosoph., Disc. XVIII, p. 44 et 45.
[417] La Pérouse, tome II, ch. XI, p. 298, 299 et 300. — Bougainville, première partie, ch. VII, tome I, p. 128 et 129.
[418] Azara, tome II, ch. XII, p. 218 et 219. — La Pérouse, t. II, ch. XI, p. 302.
[419] Azara, ch. XII et XIII, p. 218 et 252.
[420] De Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, liv. II, ch. IX, tome III, p. 288, 289 et 290. — Azara.
[421] Azara, tome II, ch. XIII, p. 252.
[422] De Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, liv. III, ch. IX, p. 290.
[423] La Pérouse, tome II, ch. XI, p. 304. — De Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, liv. VII, ch. IX, tome VI, p. 285.
[424] La Pérouse, tome II, ch. XI, p. 294 et 295.
[425] Vancouver, liv. III, ch. I, p. 267, 276 et 277 . — Azara, tome II, ch. X, p, 165. — L’état social de ces peuples a une grande analogie avec celui des Spartiates : le brouet noir n’était pas supérieur à la bouillie, et les vêtements et les logements étaient peu différents.
[426] La Pérouse, tome II, ch. XI, p. 296, 297, 301 et 302. — Bougainville, première partie, ch. VII, tome I, p. 126. — De Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, liv. VI, ch. XVII, et liv. VII, ch. XIX, tome VI, p. 238 et 342. — Depons, tome I, ch. IV, p. 311, 312 et 342. — Azara, tome II, ch. XIII, p. 256.
[427] Depons, tome I, ch. IV, p. 331 et 332.
[428] Bougainville, première partie, ch. VII, tome I, p. 126. — Raynal assure, sur la foi des missionnaires, que plus les coups de fouet sont vigoureux, et plus les pénitents éprouvent de bonheur. Histoire philosoph., t. IV, liv. VIII, p. 302.
[429] Azara, tome II, ch. XII, p. 217, 218, 243, 244 et 245. — Depons, tome I, ch. IV, p. 323 et 324, et II, ch. VI, p. 136 et 137. — De Humboldt, Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, tome I, liv. II, ch. VI, p. 436 et 437. — Raynal, Hist. philosoph., tome IV, liv. VIII, p. 314, 345 et 346.
[430] Ulloa, Discours philosophiques, disc. XVIII, p. 44 et 45.
[431] Azara, tome II, ch. XIII, p. 255 et 257.
[432] Bougainville, première partie, ch. VII, tome I, p. 128 et 129. — Azara, tome II, ch. XIII, p. 256, 257 et 258.
[433] Raynal, Hist. philosoph., tome IV, liv. VIII, p. 304 et 305. — Azara, tome II, ch. XIII, p. 256.
[434] Ulloa, Disc. philosoph., disc. XX, p. 85 et 86. — Azara, tome II, ch. XIII.
[435] Depons, tome I, ch. IV, p. 337 et 338. — Azara, tome II, ch. XIII, p. 255. — Dans quelques missions ils respectent les propriétés privées. La Pérouse, tome II, ch. XI, p. 302.
[436] De Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, tome III, liv. III, ch. IX, p. 372.
[437] La Pérouse, tome II, ch. XI, p. 308. — Azara, tome II, ch. XIII, p. 251.
[438] Bougainville, première partie, ch. VII, tome I, p. 129, 131 et 135. — La Pérouse, tome II, ch. XI, p. 293 et 303. — Ulloa, Disc. philos., disc. XX, p. 85 et 86. — De Humboldt, Voyages aux régions équinoxiales, tome III, liv. III, ch. VI, p. 5, 6 et suiv. — Dauxion-Lavaysse, tome I, ch. VI, p. 326 et 327.
[439] De Humboldt, Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, tome II, liv. II, ch. VI, p. 448.
[440] Tome II, ch. XI, p. 288 et 289.
[441] Voyage aux régions équinoxiales, tome III, liv. III, ch. VI, p. 53 et 54.
[442] Dauxion-Lavaysse, tome I, ch. VI, p. 325.
[443] Bougainville, première partie, ch. VII, tome I, p. 127 et 128.
[444] Voyage aux régions équinoxiales, tome III, liv. III, ch. VI, p. 126 et 127.
[445] Azara, tome II, ch. XI, p. 251.
[446] Azara, tome II, ch. XII, p. 218, 219, 248 et 249. — De Humboldt, Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, tome I, liv. II, ch. VI, p. 436 et 437. — Depons, tome II, ch. VI, p. 136 et suivantes.
[447] De Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, liv. VII, ch. XIX, tome VI, p. 320.
[448] Depons, tome II, ch. VI, p. 136 et suivantes.
[449] Bougainville, première partie, ch. VII, tome I, p. 127.
[450] La Pérouse, tome II, ch. XI. — Ce voyageur a vu des hommes au bloc et des femmes aux fers pour avoir trompé la vigilance de leurs argus.
[451] Bougainville, première partie, chap. VII, tome I, pag. 136 et 137.
[452] De Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, tome VI, liv. VII, ch. XIX, p. 335, 336 et 337. — Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, tome II, liv. II, ch. VII, p. 40 et 41. — Cette manière de conquérir des âmes a une parfaite ressemblance avec la manière dont les colons du cap de Bonne-Espérance font des esclaves parmi les Hottentots.
[453] De Bougainville, tome I, première partie, ch. VII, p. 236 et et 237.
[454] Hist. philosoph., tome IV, liv. VIII, p. 324 et 325.
[455] Tome I, première partie, ch. VII, p. 124 et 125. — Les missionnaires ne pouvant attribuer l’état stationnaire de leurs peuplades ni à leurs institutions, ni à eux-mêmes, l’ont attribué à la nature des peuples ; mais il est impossible d’admettre une telle explication, lorsqu’on voit que des peuples de même espèce, qui sont soumis à un régime différent, sont actifs et laborieux, et font des progrès comme les Espagnols. Azara, tome II, ch. XII, p. 217. — De Humboldt, Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, tome II, liv. II, ch. VIII, p. 320 et 396. — Voyage aux régions équinoxiales, t. III, liv. III, ch. IX, p. 264 et 265. — Depons, tome II, ch. VI, p. 143 et 144. — Dampier, tome I, ch. V, p. 138. — Raynal, tome V, liv. IX, p. III.
[456] Robertson’s History of America, vol. IV, p. 199 et 267.
[457] De Larochefoucault-Liancourt, Voyage aux États-Unis, troisième partie, tome VII, p. 13 et 18.
[458] William Hebert’s Visit to the colony of Harmony, in Indiana, in the United-States of America. London 1825.