CHARLES COMTE,
Traité de législation,
ou exposition des lois générales suivant lesquelles les peuples prospèrent, dépérissent ou restent stationnaire. Tome second (1827).
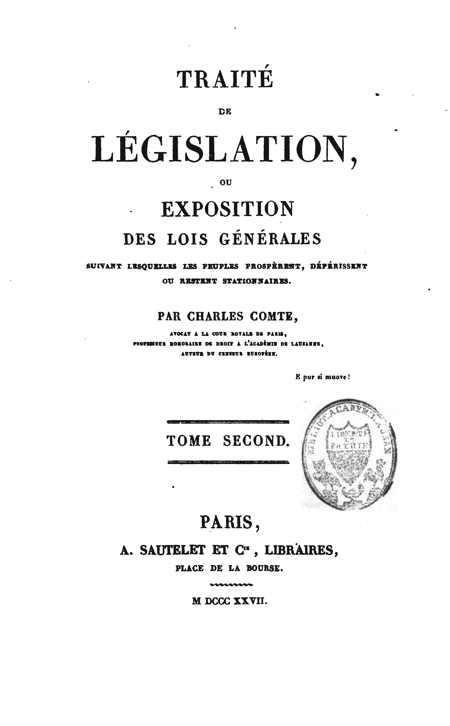 |
[Created: 21 November, 2021]
[Updated: 16 September, 2023 ] |
 |
This is an e-Book from |
Source
, Traité de législation, ou exposition des lois générales suivant lesquelles les peuples prospèrent, dépérissent ou restent stationnaire, 4 vols. (Paris: A. Sautelet et Cie, 1826-27). Tome second.http://davidmhart.com/liberty/Books/1827-Comte_TraiteLegislation/Comte_TdL1827_T2-ebook.html
Charles Comte, Traité de législation, ou exposition des lois générales suivant lesquelles les peuples prospèrent, dépérissent ou restent stationnaire, 4 vols. (Paris: A. Sautelet et Cie, 1826-27). Tome second.
Editor's Introduction
To make this edition useful to scholars and to make it more readable, I have done the following:
- inserted and highlighted the page numbers of the original edition
- not split a word if it has been hyphenated across a new line or page (this will assist in making word searches)
- added unique paragraph IDs (which are used in the "citation tool" which is part of the "enhanced HTML" version of this text)
- retained the spaces which separate sections of the text
- created a "blocktext" for large quotations
- moved the Table of Contents to the beginning of the text
- placed the footnotes at the end of the book
- formatted short margin notes to float right
- inserted Greek and Hebrew words as images
[II-475]
TABLE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE SECOND VOLUME
LIVRE TROISIÈME.
Du perfectionnement et de la dégradation dont les facultés humaines sont susceptibles De la distinction des diverses espèces ou variétes d'hommes. — Des causes auxquelles la production de ces espèces ou variétés est attribuée. — Du développement acquis par les peuples de diverses espèces sous différens degrés de latitude.—De l'influence des lieux, des eaux et du climat sur ce développement.
- Chapitre Premier. De ce qui constitue le perfectionnement et la dégradation des diverses parties de l'homme. —Des conséquences qui résultent de ce perfectionnement et de cette dégradation. — De l'influence des gouvernemens sur le développement des facultés humaines. 1
- Chap. II. Des limites mises par la nature au perfectionnement des facultés humaines. 40
- Chap. III. Des diverses espèces ou variétés dont se compose le genre humain.—De l'opinion «le quelques écrivains à cet égard. 51
- Chap. IV. Des causes physiques auxquelles a été attribuée la production des diverses variétés ou espèces d'hommes, et particulièrement de l'influence des climats. 70
- Chap. V. De l'influence attribuée à l'action des climats sur la production des diverses espèces ou variétés d'hommes. — Des invasions des peuples de diverses espèces sur le territoire les uns des autres, et de la confusion qui en est résultée. 94
- Chap. VI. Des difficultés que présente la question de l'influence des climats sur les facultés humaines. — Exposition du système de Montesquieu sur cette influence. —Vices de ce système. 114
- Chap. VII. Du développement physique acquis, en Amérique et dans les îles du grand Océan, sous differens degrés de latitude, par des peuples d'espèces ou de variétés américaine, malais et nègre. 132
- Chap. VIII. Du développement physique acquis en Asie, en Afrique et en Europe, sous diflerens degrés de latitude, par des peuples d'espèces mongole, caucasienne et éthiopienne. — Des causes physiques de ce développement. 154
- Chap. IX. Du développement intellectuel acquis en Amérique , sous diflerens degrés de latitude, par des peuples d'espèce cuivrée ou américaine. 177
- Chap. X. Du développement intellectuel acquis, dans les îles du grand Océan, sous différens degrés de latitude, par des peuples d'espèce malaie, et par des peuples d'espèce nègre ou éthiopienne. 207
- Chap. XI. Du développement intellectuel acquis en Asie, sous diflerens degrés de latitude, par des peuples d'espèce mongole et par des peuples d'espèce caucasienne. 226
- Chap. XII. Du développement intellectuel acquis en Afrique et en Europe, sous diflerens degrés de latitude, par des peuples d'espèce éthiopienne et par des peuples d'espèce caucasienne. 247
- Chap. XIII. Du développement moral des peuples de diverses espèces. — De l'analogie qui existe entre les mœurs et les lois. — Des rapports entre le développement intellectuel et le perfectionnement moral des hommes. — Méthode suivie dans cette exposition. 257
- Chap. XIV. Des rapports observés entre les moyens d'existence et la nature des gouvernemens des peuples d'espèce cuivrée, du nord de l'Amérique. — Du genre d'inégalité qui existe chez ces peuples. —Des moyens de sûreté employés par les individus. — Des mœurs qui résultent de l'emploi de ces moyens. 268
- Chap. XV. Des rapports qui existent entre les deux sexes, chez les peuples d'espèce cuivrée, du nord de l'Amérique.— Des rapports entre les parens et leurs enfans. — Des mœurs qui sont les conséquences de ces rapports. 292
- Chap. XVI. Des relations qui existent entre les diverses peuplades d'espèce cuivrée, du nord de l'Amérique. — Des causes des guerres qu'elles se font.—De l'esprit qu'elles y portent. 313
- Chap. XVII. Des vices et des maladies qui resultent chez les peuples d'espèce cuivrée, du nord de l'Amérique, de leurs relations sociales, de leur défaut de developpement intellectuel , et des circonstances physiques au milieu desquelles ils sont placés. 319
- Chap. XVIII. De l'état social et des mœurs des peuples d'espèce cuivrée, placés entre les tropiques.—Parallèle entre ces peuples et ceux de même espèce placés sous les climats froids du nord. 336
- Chap. XIX. Des rapports observés entre les moyens d'existence et l'état social des peuples d'espèce malaie du grand Océan.—Du genre d'inégalités qui existent chez ces peuples. 359
- Chap. XX. Des relations qui existent entre les deux sexes chez les peuples d'espèce malaie du grand Océan.— Des relations entre les parens et leurs enfans. 377
- Chap. XXI. Des relations qui existent chez les peuples d'espèce malaie du grand Océan, entre la classe aristocratique et les autres classes de la population.—Des mœurs qui résultent de ces rapports. 382
- Chap . XXII. Des relations qui existent entre les divers peuples ou entre la fédération de peuples d'espèce malaie. — De l'influence de leur organisation sociale sur la nature de ces relations. — Des causes et des résultats de leurs guerres. 387
- Chap. XXIII.Opposition entre la conduite des peuples d'espèce malaie à l'égard des navigateurs européens, et leur conduite à l'égard les uns des autres. — Explication de ce phénomène. 392
- Chap. XXIV. Parallèle entre les mœurs des peuples d'espèce malaie placés sous un climat froid, et les mœurs des peuples de même espèce placés entre les tropiques. 400
- Chap. XXV. Des rapports observés entre les moyens d'existence et l'état social des peuples d'espèce nègre, de la Nouvelle-Hollande et de quelques lies du grand Océan.—Dés mœurs de ces peuples sous différens degrés de latitude. 412
- Chap. XXVI. Des rapports observés entre les moyens d'existence et l'état social des peuples d'espèce nègre de l'extrémité australe de l'Afrique—Des mœurs qui résultent de cet état. 435
- Chap. XXVII. Des rapports observés entre les moyens d'existence et l'état social des peuples d'espèce nègre des côtes^occidentales d'Afrique situées entre les tropiques. — Du genre d'inégalités qui existent cbez ces peuples.—Des mœurs qui résultent de ces inégalités Parallèle entre les mœurs de ces peuples et les mœurs des peuples de même espèce qui vivent à l'extrémité australe de ce continent. 454
- NOTES
TRAITÉ DE LÉGISLATION,
OU EXPOSITION DES LOIS GÉNÉRALES SUIVANT LESQUELLES LES PEUPLES PROSPÈRENT, DÉPÉRISSENT OU RESTENT STATIONNAIRES
PAR CHARLES COMTE
Avocat à la Cour royale de Paris,
Professeur honoraire de droit à l’Académie de Lausanne,
Auteur du Censeur Européen.
E pur si muove !
[II-1]
TRAITÉ DE LÉGISLATION. LIVRE TROISIÈME.
Du perfectionnement et de la dégradation dont les facultés humaines sont susceptibles. — De la distinction des diverses espèces ou variétés d’hommes. — Des causes auxquelles la production de ces espèces ou variétés est attribuée. — Du développement acquis par les peuples de diverses espèces sous différents degrés de latitude. — De l’influence des lieux, des eaux et du climat sur ce développement [1].
CHAPITRE I.↩
De ce qui constitue le perfectionnement et la dégradation des diverses parties de l’homme. — Des conséquences qui résultent de ce perfectionnement et de cette dégradation. — De l’influence des gouvernements sur le développement des facultés humaines.
L’objet de cet ouvrage étant d’exposer quelles sont les principales causes de la prospérité et de la décadence des nations, il convient, avant que de faire cette exposition, de déterminer le sens qu’on attache à ces mots de décadence et de prospérité. Tant que nous nous bornerons à l’énonciation de ces expressions générales, nous rencontrerons peu de contradictions ; mais si nous cherchons à en déterminer le sens, nous ne tarderons pas à nous apercevoir que l’accord qui semble exister à cet égard, n’a qu’une apparence de réalité. Les mêmes mots ne représentent pas, dans l’esprit de tous les hommes, le même nombre d’idées ; quelquefois ils réveillent chez les uns des idées opposées à celles qu’ils réveillent chez les autres, et cela arrive pour les expressions les plus communes, pour celles que nous employons à désigner les objets qui nous sont les plus familiers.
Des philosophes se sont rendu ridicules pour avoir tenté de donner une définition de l’homme. Rien ne serait, en effet, plus inutile qu’une telle définition, si elle n’avait pour objet que de nous empêcher de confondre, dans le cours ordinaire de la vie, les individus qui appartiennent au genre humain, avec les individus qui appartiennent à d’autres genres. Il n’est aucun animal, même parmi les plus stupides, qui ne sache distinguer au premier aspect un individu de sa race, d’un individu appartenant à une race différente ; et un homme qui serait incapable de faire par lui-même une distinction semblable, ne saurait apprendre à la faire au moyen d’une définition.
Mais, quoique toute personne possède une capacité suffisante pour distinguer un individu de son espèce de tout autre ; quoique chacun ait sur le genre humain un certain nombre d’idées générales, il faut bien se garder de croire que tous les hommes ont à cet égard des idées complètes. La plupart d’entre eux n’ont que quelques idées relatives à leur organisation extérieure, et à quelques-unes de leurs facultés les plus frappantes. Ils ne connaissent d’eux que les parties qu’ils ont observées ; celles qu’ils n’ont pas remarquées sont à leurs yeux comme si elles n’existaient pas. Les hommes qui se sont livrés à l’étude de la physiologie ont des idées plus étendues ; ils considèrent comme parties constitutives d’eux-mêmes, des facultés ou des organes inconnus aux premiers. Ceux qui ont joint à cette étude celle de l’entendement humain, ont des idées plus étendues encore. Cependant aucun ne peut se vanter de n’avoir plus rien à apprendre, et d’avoir par conséquent des connaissances complètes sur sa propre nature.
La signification attachée à ce mot homme s’étend donc à mesure que les recherches auxquelles on se livre sur la nature humaine, sont plus variées ou plus profondes ; et le plus savant est celui à qui il reste le moins à apprendre. Rien n’est si commun que de rencontrer, même parmi les philosophes, des hommes qui n’ont sur leur espèce que des idées incomplètes. On verra plus loin à quelles erreurs, et je ne craindrai pas de dire à quelles folies plusieurs sont arrivés pour avoir porté l’esprit de système dans l’étude de la nature humaine, et avoir cru qu’ils en avaient une parfaite connaissance, quand ils n’en avaient que des idées partielles.
Dans le livre précédent, nous avons considéré l’homme sous trois points de vue différents : dans son organisation physique, dans ses facultés intellectuelles, et dans ses affections ou dans ses passions. Chacune de ces principales parties est susceptible d’être divisée en une multitude d’autres : dans l’étude des organes physiques, on peut considérer séparément les organes internes et les organes externes ; et, après avoir fait cette seconde division, on peut en faire une troisième qui comprendra un nombre de parties beaucoup plus grand. On peut de même considérer, dans l’entendement, chacune des parties dont il se compose, depuis la sensation la plus simple jusqu’au raisonnement le plus profond. Enfin, le même procédé peut être suivi dans l’étude des affections morales ; on peut les diviser en affections bienveillantes, et en affections malveillantes ; on peut considérer séparément l’amour, l’amitié, le patriotisme, la haine, la vengeance, la cruauté et d’autres.
Il serait impossible de se faire des idées justes du genre humain, si l’on ne commençait par se faire des idées justes des individus ; et il n’y aurait pas moyen de se faire des idées justes des individus, si l’on ne se faisait d’abord des idées justes des diverses parties dont eux-mêmes se composent. Ainsi, pour savoir ce qui constitue la prospérité et la décadence d’un peuple, nous avons besoin de connaître en quoi consiste le perfectionnement ou la dégradation de chacune des parties dont la réunion forme un individu. Le perfectionnement et la dégradation de chacune des parties de nous-mêmes étant connus, rien ne sera plus facile que de nous faire des idées exactes de la dégradation et du perfectionnement d’un homme, d’une famille, d’une nation, et enfin du genre humain tout entier.
Nos organes physiques sont susceptibles de deux genres de perfectionnement : l’un qui consiste dans leur formation ou dans la bonté de leur constitution ; l’autre qui consiste dans l’aptitude que l’exercice leur a donnée d’exécuter certaines opérations. Un individu qui, en venant au monde, apporte une bonne constitution physique ; qui est élevé sous une température douce et dans une atmosphère pure ; qui se nourrit d’aliments sains et abondants ; qui se livre à un exercice modéré, et n’a l’esprit troublé d’aucune crainte, peut acquérir une organisation physique aussi parfaite que sa nature le comporte, si d’ailleurs il n’éprouve aucun accident et n’est atteint d’aucune maladie. En pareil cas, la force de ses organes, leur exacte proportion les uns à l’égard des autres, leur aptitude à remplir les fonctions diverses auxquelles la nature les a destinés, ou à exécuter les diverses opérations auxquelles l’étude et l’habitude peuvent les rendre propres, en constituent la perfection.
Ce premier genre de perfectionnement ne se rencontre quelquefois que dans quelques-uns de nos organes : un individu peut avoir quelqu’un de ses organes internes vicié, tandis que ses organes externes sont bien constitués ; il peut avoir l’organe de la vue ou celui de l’ouïe excellent, tandis qu’il n’existe aucune proportion entre ses membres ; il peut, par un exercice ou un travail particulier, avoir donné à ses bras une force extraordinaire, tandis que, faute d’exercice ou pour d’autres causes, il peut avoir les extrémités inférieures très faibles ; enfin, quoique les diverses parties de l’homme exercent les unes sur les autres une certaine influence, elles se fortifient ou s’affaiblissent rarement dans une proportion exacte.
Les organes physiques de l’homme sont susceptibles d’un second genre de perfectionnement : ils sont susceptibles d’apprendre à exécuter une multitude d’opérations plus ou moins utiles, soit à l’individu lui-même, soit à ses semblables. Ce genre de perfectionnement s’évalue par les avantages qui en résultent pour l’individu, pour sa famille, pour l’humanité. Un homme peut exercer ses organes à se rendre habile dans l’art de la pêche, de la chasse, de l’agriculture, dans la fabrication de certains objets, ou dans les beaux-arts. La perfection qu’il leur donne est en raison de la rapidité avec laquelle il exécute les opérations auxquelles il se livre, de la variété des objets qu’il a la capacité de produire, et de la valeur de ces produits, ou des plaisirs qui en naissent.
Ces deux genres de perfectionnement influent plus ou moins l’un sur l’autre : l’homme qui est doué d’une bonne organisation physique, a plus d’adresse et de force que celui dont l’organisation est défectueuse ; il peut se livrer à de plus longs et de plus pénibles travaux ; il peut faire de plus longues études et acquérir par conséquent plus d’habileté. Nos organes physiques sont les premiers instruments que la nature met au service de notre intelligence ; et il est évident que plus ces instruments ont de perfection, et plus il est facile d’en tirer un parti avantageux. D’un autre côté, plus nous exerçons chacun de nos organes, et plus nous en augmentons la force, la souplesse et la finesse : l’habitude de regarder ou d’écouter nous rend plus habiles à voir et à entendre ; l’habitude d’exercer nos bras ou nos jambes, en augmente la force, la vitesse ou la dextérité.
Cependant, quoique ces deux genres de perfectionnement exercent l’un sur l’autre une influence réciproque, ils existent rarement chez le même individu dans une égale proportion. Souvent un homme doué d’une organisation physique excellente, n’a donné aucune habileté à ses organes, et ne peut en tirer que peu de services. Souvent aussi un individu doué d’une faible organisation, a acquis, par l’étude et l’exercice, une grande habileté, et tire de ses facultés des avantages inconnus au premier. L’homme qui réunit ces deux genres de perfectionnement, est supérieur à celui qui n’en possède qu’un seul ; et celui qui possède le second est supérieur à celui qui possède le premier. Un instrument d’une qualité médiocre dont on sait tirer parti, vaut incontestablement mieux que l’instrument qui serait en lui-même le plus parfait, mais dont on ne saurait faire aucun usage.
Il y a aussi deux manières de considérer le perfectionnement intellectuel de l’homme. Dans un sens, on dit qu’un individu a l’entendement bien formé, si chacune de ses facultés intellectuelles est propre à remplir les fonctions auxquelles la nature l’a destinée. Ainsi entendu, le perfectionnement consiste dans la susceptibilité qu’ont les organes intellectuels d’être développés par l’étude ou l’exercice. Tous les esprits ne sont pas susceptibles du même genre de développement : quelques-uns sont plus propres que d’autres à acquérir certain genre de connaissances, ou à se livrer à des travaux particuliers. Il est hors du sujet que je traite de rechercher quelles sont les causes physiques ou morales qui produisent ces différences ; il me suffit de les indiquer.
[II-9]
Dans un autre sens, on dit qu’un homme a les facultés intellectuelles perfectionnées, lorsque, par l’étude et l’exercice, il leur a donné tout le développement dont elles sont susceptibles. Il n’arrive jamais qu’un individu développe ses facultés intellectuelles, avec la même étendue, dans toutes les branches des connaissances humaines. Chacun choisit ordinairement un sujet d’études et y consacre la plus grande partie de son attention : s’il se livre à des recherches relatives à d’autres connaissances, ce n’est, en général, que pour éclairer la science qu’il cultive d’une manière spéciale. Un homme peut donc avoir les facultés intellectuelles très développées sur un sujet particulier, tandis qu’il ne leur a donné aucun développement sur des sujets différents. Il peut, par exemple, avoir un entendement très étendu sur l’anatomie ou sur la zoologie, tandis qu’il n’a que des notions confuses sur les sciences morales : comme il peut avoir sur ces sciences des connaissances très vastes et être étranger aux mathématiques ou à l’astronomie. Il n’est aucun genre de connaissances qui ne soient utiles à ceux qui les possèdent et à leurs semblables ; mais on juge encore ici du plus ou moins de perfectionnement intellectuel d’un individu ou d’une nation, par le degré d’utilité que le genre humain retire de ses connaissances.
Dans les facultés intellectuelles comme dans les facultés physiques, le perfectionnement qui consiste dans la bonne organisation de l’individu, influe considérablement sur celui qui est le résultat de l’étude ou de l’exercice, et celui-ci influe à son tour sur celui-là. Un homme doué d’un entendement sain, s’il se livre à l’étude, donne à ses facultés intellectuelles un perfectionnement que ne saurait donner aux siennes l’individu qui a reçu de la nature un entendement vicieux ou faiblement constitué. Et celui qui exerce son intelligence, lui donne une force et une promptitude qu’elle ne saurait avoir sans exercice ; la force de l’esprit comme celle du corps, est autant en raison de l’exercice qu’on lui a donné, qu’en raison de ses dispositions naturelles. L’homme qui joint l’étude à une bonne organisation primitive, a une supériorité incontestable sur celui qui n’a que l’un ou l’autre de ces deux genres de perfectionnement. Mais celui qui a cultivé, par l’étude et le travail, une intelligence médiocre, a une supériorité non moins incontestable sur celui qui, étant né avec une excellente constitution intellectuelle, ne s’est livré à aucun genre d’étude, ou, ce qui est pire, qui a eu l’esprit faussé dès son enfance. Un homme né avec une intelligence faible, mais bien élevé, pourrait avoir une immense supériorité intellectuelle sur un individu né avec les dispositions les plus heureuses, mais abruti par le fanatisme ou par l’oppression.
Le perfectionnement intellectuel de l’homme consistant dans l’aptitude de chacune de ses facultés à remplir, le mieux qu’il est possible, les diverses fonctions auxquelles elles sont propres, il s’ensuit que l’individu qui peut appliquer son attention avec le plus de persévérance et le moins de fatigue aux objets qu’il a besoin de connaître ; celui dont la mémoire retient avec le plus de fidélité et conserve le plus longtemps les impressions qu’il a reçues ; celui qui peut comparer le mieux et avec le plus de promptitude les diverses idées qu’il conçoit, et apercevoir les rapports qui existent entre elles ; celui dont l’esprit suit avec le plus de facilité l’enchaînement des faits ou des idées, soit qu’il remonte des effets aux causes, soit qu’il descende des causes aux effets ; celui qui sait le mieux combiner les images qu’ont produites sur son esprit les objets dont il a été frappé ; enfin, celui qui peut le mieux connaître ce que les choses sont et ce qu’elles produisent, est aussi celui dont l’entendement est le mieux organisé, ou dont les facultés intellectuelles sont les plus parfaites. Un individu ne peut exercer toutes les facultés de son esprit sur tous les objets qui sont dans la nature : pour cela, la vie humaine n’est point assez longue ; mais plus les objets sur lesquels il peut les exercer sont étendus, et plus aussi ses facultés intellectuelles ont reçu de perfection.
Le perfectionnement moral de l’homme consiste, non dans l’absence des diverses affections dont il est susceptible ; non dans l’extinction d’un certain nombre de passions, et dans le développement de quelques autres ; mais dans la juste direction de toutes, et dans l’empire qu’il exerce sur chacune d’elles, conformément aux règles d’une intelligence éclairée. Ainsi, la perfection morale de l’homme consiste, non pas précisément dans la nature des passions dont il est affecté, mais dans le discernement et dans la mesure avec lesquels il les applique. Aimer n’est en lui-même ni une vertu ni un vice : c’est une manière agréable de sentir dont nous sommes rarement les maîtres. Aimer sa femme, ses enfants, ses parents, ses amis, sa patrie, est une vertu, aussi longtemps que cette passion ne nous entraîne point à des actions funestes au genre humain. Elle commence à devenir vicieuse du moment qu’elle nous fait commettre des actions plus funestes aux hommes qu’elle n’est utile à ceux qui en sont l’objet. Haïr est en soi un sentiment pénible, et sous ce rapport c’est une passion vicieuse ; mais haïr les habitudes et les actions malfaisantes, et ne céder à sa haine que dans la mesure nécessaire pour la répression de ces actions ou de ces habitudes, ce n’est pas un vice, c’est une vertu. Le perfectionnement moral de l’homme consiste donc dans l’accord entre ses affections et son entendement, lorsqu’il est éclairé.
Ayant vu en quoi consiste le perfectionnement des diverses parties dont l’homme se compose, il est aisé de comprendre en quoi consiste la dégradation ou le défaut de développement. Nos organes physiques étant susceptibles de deux genres de développement, l’un qui consiste dans la bonté de leur constitution, et l’autre dans les divers genres d’aptitude que l’exercice leur a donnés, on peut dire qu’ils sont susceptibles de deux genres d’imperfections correspondants. Leur faiblesse, leur défaut de proportions, la difficulté avec laquelle ils remplissent les fonctions qu’exige la conservation de l’individu ou de l’espèce, constituent la dégradation du premier genre ; la cessation complète de ces fonctions est la mort de l’individu.
L’inhabileté, la maladresse, l’engourdissement qui résultent du défaut d’application et d’exercice, constituent le second genre de dégradation ; cette dégradation est profonde en raison de l’importance des actions que l’individu est incapable d’exécuter. Ainsi, par exemple, l’homme qui ne sait employer ses organes physiques qu’à poursuivre du gibier, leur a donné un genre de perfection au-dessous de celui qui a de plus exercé les siens à cultiver la terre ; car le premier obtient de ses travaux une quantité d’aliments infiniment inférieure à celle que le second peut obtenir des siens.
Les facultés intellectuelles de l’homme sont également susceptibles de deux genres d’imperfections : l’un qui résulte d’un vice d’organisation, l’autre qui est produit ou par une absence complète d’exercice, ou par une fausse application. Un individu qui ne peut fixer son attention sur aucun objet, d’une manière suivie, ou retenir les impressions faites sur son esprit par les objets extérieurs, ou combiner le petit nombre d’idées qu’il a reçues, est atteint du premier genre d’imperfection. Il en est de même de celui qui ne peut apercevoir les rapports qui existent entre ses idées, ou en suivre la liaison ; il en est encore de même de celui qui est incapable de recevoir des impressions justes, ou de corriger par l’application de ses organes, les fausses idées qui ont pénétré dans son esprit. Ces diverses espèces d’imperfection sont susceptibles de gradation : lorsqu’elles sont portées jusqu’à un certain degré, on les désigne sous le nom d’imbécillité, de faux jugement ou de manie, sans qu’il soit possible cependant de fixer le point auquel la manie ou l’imbécillité commencent.
L’imperfection ou la dégradation morale de l’homme peut tenir à trois causes : à la fausse direction des passions, à leur faiblesse, ou à un excès de force. Les passions ont reçu une fausse direction, si les affections bienveillantes, telles que l’amour, l’amitié, la sympathie, la pitié, l’admiration, le respect, se dirigent vers des actions ou des objets funestes au genre humain, et si les passions malveillantes, telles que la haine, l’aversion, l’antipathie et le mépris, se portent sur des objets ou des actions contraires. La faiblesse des passions est dans l’homme une imperfection morale, lorsqu’elles n’ont pas assez d’énergie pour le déterminer à exécuter les actions que sa position et l’intérêt de son espèce exigent de lui. Enfin, la force des passions est une imperfection morale, toutes les fois que l’homme se laisse entraîner par elles au-delà des limites qu’une raison éclairée lui a tracées.
Chacune des principales parties de l’homme exerce sur les autres une influence plus ou moins étendue. Il est évident, par exemple, qu’un individu dont tous les organes physiques sont bien constitués et remplissent bien les fonctions auxquelles ils sont propres, a plus de moyens de développer son intelligence que celui qui a reçu de la nature une organisation vicieuse ; il a plus d’énergie, de force et de persévérance. De même, celui dont l’entendement est très développé, a plus de moyens de perfectionner ses facultés physiques et morales, que celui dont les facultés intellectuelles n’ont reçu aucun développement. Il sait quels sont les exercices qui le fortifient, et connaît les causes capables de l’affaiblir ou de le détruire ; pouvant mieux juger des conséquences de ses actions, il a le moyen de régler ses affections de la manière la plus utile. Enfin, l’homme dont la morale est très perfectionnée conserve mieux ses facultés physiques et intellectuelles ; il peut donner aux unes et aux autres plus de développement que ne peut en donner aux siennes celui dont les mœurs sont corrompues ; car, en général, les vices détruisent les organes physiques en même temps qu’ils affaiblissent les facultés intellectuelles.
Cependant, quoique chacune de nos facultés soit susceptible de développement, et qu’elles exercent les unes sur les autres une certaine influence, il est rare que dans le même individu elles soient développées au même degré, et qu’elles se trouvent dans une parfaite harmonie ; il arrive, au contraire, presque toujours, que quelques-unes de ces facultés dominent sur toutes les autres. Un homme peut être parfaitement constitué, voir régner, dans les diverses parties de son individu physique, des proportions exactes, être doué d’une force musculaire considérable et d’une grande agilité, et avoir cependant une intelligence bornée ou des passions désordonnées. Un autre peut, au contraire, être doué d’une intelligence extraordinaire et posséder des connaissances très étendues, avec une santé délicate et des organes physiques défectueux ; il n’est pas rare de voir les qualités de l’esprit et les infirmités du corps réunies dans le même individu, ou de rencontrer des personnes capables des conceptions les plus ingénieuses ou les plus profondes, qui ne savent pas employer leurs mains aux usages les plus communs. Enfin, des passions faibles ou énergiques peuvent se trouver chez un homme doué d’une bonne organisation physique, mais dont les facultés intellectuelles sont peu développées, comme elles peuvent se trouver chez un homme d’une constitution physique défectueuse, mais d’un entendement très éclairé. Nous verrons ailleurs ce qui arrive, lorsque chez une nation on donne à quelques-unes de ces facultés un développement particulier et qu’on néglige les autres.
Un homme ne peut perfectionner aucune partie de lui-même, sans qu’il résulte de ce perfectionnement plusieurs avantages, soit pour lui-même, soit pour ses semblables. Le perfectionnement de ses organes physiques produit la santé, la force, l’adresse, l’agilité ; il met l’individu à même d’exécuter une multitude d’opérations nécessaires à la satisfaction de ses besoins ou de ses plaisirs, et de se garantir d’une foule d’accidents ; il lui rend moins nécessaires les secours gratuits de ses semblables, et contribue ainsi à son indépendance ; il le délivre des craintes qui sont une suite naturelle de la faiblesse ou de la maladresse ; enfin, il contribue à sa satisfaction intérieure, en lui donnant la conscience des services qu’il peut rendre, soit à lui-même, soit à d’autres.
Le perfectionnement de ses facultés intellectuelles le met à même de faire de ses organes physiques et des choses dont il peut disposer, l’usage le plus avantageux pour lui et pour ses semblables ; il lui donne une influence plus ou moins étendue sur les personnes dont l’intelligence est moins développée, et accroît ainsi sa puissance ; il lui fournit le moyen de diriger les forces de la nature, de les contraindre à travailler pour lui et à produire les choses propres à satisfaire ses besoins de préférence à celles qui lui seraient funestes ou inutiles ; il contribue, de même que le perfectionnement de ses organes physiques, à accroître son indépendance, à le garantir de plusieurs dangers, et à le délivrer des craintes qui environnent les personnes dont l’entendement est faible ou peu développé ; il lui fait prévoir les conséquences éloignées de ses actions, et le met à même de prendre, dans toutes les occasions, le parti le plus avantageux pour lui et pour les autres ; il lui donne le moyen de rendre à autrui un grand nombre de services, et accroît ainsi sa satisfaction intérieure par le sentiment même de son utilité ; enfin, il le met en communication avec les personnes dont l’entendement est également développé, et le fait participer à leurs découvertes et à leurs progrès.
Le perfectionnement de ses facultés morales, qui est la suite ordinaire du perfectionnement de ses facultés intellectuelles, quoiqu’il ne le soit pas toujours, produit des avantages qui ne sont pas moins étendus. Le premier, c’est de mettre l’homme en paix avec ses semblables, et de lui assurer, dans tout état civilisé, le plus grand des biens, celui de la sécurité. Il est évident, en effet, que l’homme qui n’éprouve que des passions bienveillantes pour les objets utiles à son espèce, et qui ne sent ou ne manifeste de l’aversion que pour les objets funestes, n’a pour ennemis que les individus malfaisants, tandis qu’il a pour appuis tous ceux dont il est connu. Les passions bienveillantes, que nous pouvons nommer aussi sociales, produisent une multitude de jouissances, non seulement pour ceux qui les éprouvent, mais aussi pour tous ceux qui en sont l’objet ; et elles inspirent toujours plus ou moins de reconnaissance. Les passions malveillantes ou antisociales, au contraire, sont pénibles pour ceux qui en sont possédés, comme pour ceux qui en sont les victimes ; et il y a ici réaction de peines, comme là réaction de plaisirs. Les peuples répriment, en général, l’orgueil des individus par la haine, la cruauté par la vengeance, la perfidie par la méfiance, la bassesse par le mépris, et tous les vices par l’abandon.
Le perfectionnement des facultés humaines n’influe pas seulement sur le bien-être des individus, il influe aussi sur le nombre de la population. Un homme doué d’une bonne organisation physique, d’une intelligence étendue et de mœurs pures, en même temps qu’il se sent plus disposé à se marier et à élever une famille, en a bien plus le moyen que celui qui ne possède pas les mêmes avantages, si toutes choses sont égales d’ailleurs. La différence à cet égard est si grande qu’il est impossible de s’en former une idée, sans avoir comparé ensemble un nombre considérable de faits dont on trouvera plus loin l’exposition. Il me suffit dans ce moment d’avoir indiqué ce phénomène : j’en donnerai ailleurs la démonstration.
Il résulte de ce qui précède, que l’individu que nous désignons sous le nom d’homme, ne peut pas être considéré comme un être tellement déterminé qu’on ne puisse en restreindre ou en étendre l’existence sans l’anéantir. Dans la science des nombres, une quantité change de dénomination, par l’addition ou par la soustraction qu’on lui fait subir : si l’on y ajoute, ou si l’on en retranche quelque chose, elle perd sa dénomination primitive pour en prendre une autre qui indique la modification qu’elle a subie. Il n’en est pas de même de l’homme ; son existence s’étend ou se restreint, sans qu’on suppose que l’identité de l’individu a été détruite ; il suffit qu’on le désigne toujours par un même mot, pour qu’on s’imagine qu’il est toujours exactement le même. C’est une illusion que j’ai déjà fait observer et que je dois reproduire ici, parce qu’elle a entraîné de grands philosophes et des écrivains célèbres dans les plus graves erreurs [2].
Ce qui constitue tel individu, que nous désignons sous le nom d’homme, ce ne sont pas seulement ses organes physiques, ce sont en même temps ses facultés intellectuelles et ses facultés morales ; ce sont ses idées, ses sentiments et ses affections ; c’est l’aptitude même qu’il a donnée à ses organes d’exécuter telles ou telles opérations ; c’est, en un mot, toute son existence, telle que la nature, l’habitude ou l’éducation l’ont modifiée. Si, par l’exercice ou par les aliments dont il se nourrit, un individu ajoute quelque chose à ses organes matériels, on ne doute pas que ce qu’il y a ajouté ne fasse partie de lui-même ; s’il donne à quelqu’un de ses organes une qualité particulière, s’il en accroît la finesse, la souplesse, la force ou la dextérité, on ne doute pas davantage que cette qualité ne soit une partie de lui-même, comme l’élasticité donnée à telle pièce de métal fait partie de tel ressort ; mais si, par l’étude, il accroît le nombre de ses idées, s’il donne de la force ou de l’étendue à ses affections, pourquoi ces affections ou ces idées ne seraient-elles pas aussi bien une partie de lui-même qu’aucune de ses facultés physiques ? N’est-il pas évident que tout ce qui accroît en nous la puissance de sentir, de penser, d’agir, donne de l’étendue à notre existence, puisque nous n’existons que par nos sensations, nos pensées, nos actions ?
Ainsi, depuis l’instant où l’homme commence à se former jusqu’à celui où il commence à décliner, son existence peut se développer d’une manière graduelle dans chacune des parties dont elle se compose ; elle peut se développer dans les organes physiques, dans les facultés intellectuelles et dans les facultés morales. Le développement de chacune de ses facultés accroît la capacité qu’il a de sentir, c’est-à-dire la capacité qu’il a d’éprouver des plaisirs ou des peines. On a vu précédemment comment chacun des développements qu’il reçoit, est suivi d’un avantage ; or, un homme ne peut être susceptible d’éprouver une jouissance, sans être par cela même susceptible d’éprouver une douleur correspondante. Le même sentiment qui nous fait prendre part aux plaisirs des personnes qui nous sont chères, nous fait prendre part à leurs douleurs. Un homme éclairé, attaché à son pays, ne pourra le voir prospérer sans en éprouver de vives jouissances ; mais aussi nul ne sentira d’une manière plus douloureuse que lui, les maux que produit une invasion de barbares.
Les diverses parties de l’homme peuvent s’éteindre de la même manière et dans le même ordre qu’elles se développent. Quelquefois la destruction commence par les organes physiques ; d’autres fois ce sont les facultés intellectuelles et morales qui s’éteignent les premières ; d’autres fois aussi toutes les facultés s’éteignent en même temps et d’une manière graduelle ; cela arrive le plus souvent dans la vieillesse. Comme il est impossible de déterminer d’une manière exacte l’instant précis où chacune des parties intérieures ou extérieures de l’homme s’éteint, on ne voit la mort que dans la cessation complète de toutes les fonctions vitales. Mais la vie n’est pas moins divisible que la matière ; elle peut cesser dans un grand nombre de parties de l’homme, avant que d’avoir cessé dans toutes. Un soldat reçoit une blessure grave ; il subit une amputation : voilà une partie de lui-même qui n’existe plus ; il a perdu sans retour un de ses organes physiques. À la suite de l’opération une fièvre violente se déclare ; ses facultés intellectuelles s’altèrent ; les idées qu’il avait disparaissent de son esprit ; il devient incapable d’en former de nouvelles : voilà une autre partie de l’individu qui a cessé d’exister, ou qui est frappée de mort. L’extinction de ses facultés intellectuelles ne lui laisse aucun souvenir de ses parents, de ses amis, de sa patrie, ni même de ses ennemis ; ses sentiments d’affection ou de haine s’éteignent à leur tour : c’est encore une partie de l’homme qui meurt, avant qu’il cesse d’être tout entier. Chaque partie de l’individu, en un mot, peut périr avant que les organes essentiels à la vie aient complètement cessé de remplir leurs fonctions.
On a fait sur la nature de l’homme deux systèmes entièrement opposés. Des philosophes stoïciens ont considéré nos organes physiques comme n’étant point une partie essentielle de nous-même. Épictète a dit : Mes membres, ce n’est pas moi ; mon corps, ce n’est pas moi ; ma vie, ce n’est pas moi ; ma réputation, mes biens, ma femme, mes enfants, ce n’est pas moi. Il a vu l’homme tout entier dans quelques-uns des sentiments qui l’animent. Ne pouvant soustraire à l’action de la tyrannie, que ses sentiments et ses pensées, c’est en cela qu’il a placé le moi humain ; il a placé l’homme dans une abstraction, afin de ne pas voir en lui le misérable jouet d’un tyran furieux ou imbécile. Mais notre manière de considérer les choses n’en change pas la nature : en donnant exclusivement à un sentiment, ou à une pensée, un nom qui désignait beaucoup plus que cela, Épictète dénaturait la langue, et se faisait de fausses idées, sans rendre plus supportable la condition du genre humain.
J.-J. Rousseau, en présentant le tableau d’un homme imaginaire qu’il a appelé l’homme de la nature, a fait un système opposé à celui d’Épictète : il a vu l’homme tout entier dans ses organes physiques et matériels. L’homme d’Épictète dit : Mes membres, mon chétif corps, ma misérable vie, ce n’est pas moi. L’homme de Rousseau dit : Mes sentiments, mes affections, mes pensées, mes opinions, en un mot mes facultés intellectuelles et morales, ce n’est pas moi. Le premier s’isole tellement de tout objet matériel, il se transforme tellement en sentiments et en opinions, qu’on finit par ne plus l’apercevoir, et qu’il ne reste de lui qu’un seul mot. Le second se dépouille tellement d’idées, de sentiments, d’affections, d’intelligence, qu’il ne reste de lui que ses muscles, ses os et son estomac ; c’est le plus brute, le plus imprévoyant, le plus stupide des animaux.
Il n’est pas besoin de raisonnement pour démontrer l’erreur d’Épictète : chacun sait fort bien que ses organes physiques sont une partie de lui-même ; qu’on ne peut les offenser sans lui nuire, ni leur procurer une jouissance, sans lui causer un plaisir. Mais on n’est pas également convaincu que nos facultés intellectuelles et morales soient une partie de nous-même : dans la théorie, on veut être l’homme d’Épictète ; dans la pratique, on est souvent l’homme de Rousseau. On consulte son médecin pour rétablir les forces de son estomac et restaurer son appétit, pour redresser un membre qui nous fait marcher de travers ; mais on ne consulte pas un philosophe pour donner de la force à des affections bienveillantes, pour détruire des inclinations perverses, ou redresser un jugement faux. On dirait que ce qui constitue l’homme à nos yeux, c’est la matière dont ses organes physiques sont composés, mais que les qualités qui font un homme de génie, ou les vices qui font un imbécile ou un scélérat, ne sont point une partie des individus dans lesquels elles se trouvent.
Supposer, avec Épictète, que nos organes physiques ne sont pas une partie essentielle de nous-même, et que nous ne devons tenir aucun compte des peines ou des plaisirs qui les affectent, est un système tellement absurde qu’on n’a nul besoin de le combattre ; il est peu à craindre que les nations se perdent par un excès de spiritualité. Mais il ne serait pas moins insensé de considérer nos facultés intellectuelles comme étrangères à l’individu, que de ne compter pour rien nos organes physiques. L’existence des unes n’est pas moins incontestable que l’existence des autres ; et c’est à elles que nous devons attribuer le bon usage que nous sommes en état de faire de toutes nos autres facultés.
Enfin, nos affections sont une partie aussi essentielle de nous-même qu’aucun de nos organes physiques : nous ne donnons de valeur à notre existence, nous ne calculons la durée de la vie que par la valeur et la durée des impressions que nous recevons ou des sentiments qui sont en nous. À proprement parler, nous ne comptons point le temps du sommeil comme faisant partie de la vie ; car l’individu qui s’endormirait à sa naissance et qui mourrait en se réveillant, nous paraîtrait n’avoir point vécu, son sommeil eût-il duré un siècle. Nous vivons donc par nos souvenirs, par nos craintes, par nos espérances, par nos affections de tous les genres, aussi bien que par les impressions que font immédiatement les objets extérieurs sur nos organes physiques. Nous sommes affectés par les impressions produites sur nos enfants, sur nos amis, sur nos concitoyens, sur nos semblables, comme par celles qui sont produites sur nous d’une manière immédiate. Nos affections morales ont quelquefois sur nous une telle puissance, qu’elles absorbent tout autre sentiment : pour éviter ou pour mettre fin à une douleur morale, ou pour se procurer une jouissance du même genre qui n’a qu’un instant de durée, l’homme sacrifie quelquefois jusqu’à son existence physique. Nous considérerions en quelque sorte comme étranger à l’humanité, l’individu qui, accessible aux plaisirs et aux peines physiques, ne connaîtrait ni peines, ni plaisirs moraux.
J’ai considéré séparément chacune des parties de l’homme, afin d’avoir du tout des idées plus complètes ; mais, ses parties ne sont pas séparées dans la nature, comme elles le sont dans un ouvrage : nous ne les considérons les unes après les autres que parce que nous n’avons pas le moyen de les voir toutes à la fois. Toutes les parties de l’homme ne forment qu’un seul système, et agissent ou réagissent sans cesse les unes sur les autres. La division des parties est bien loin d’être aussi prononcée dans la nature qu’elle l’est dans le langage ; telle faculté que je mets au rang des facultés morales, peut être classée par un autre au rang des facultés physiques. Une classification, je l’ai déjà dit, n’est qu’une méthode plus ou moins imparfaite ; c’est un instrument dont l’esprit ne peut se passer, et qui participe de l’imperfection de tous nos ouvrages.
Ayant déterminé ce qui constitue le perfectionnement et la dégradation de chacune des principales parties de l’homme, il est aisé de se faire une idée générale de ce qui constitue le perfectionnement ou la dégradation de l’individu considéré dans son ensemble. L’homme dont tous les organes physiques sont le mieux formés, et ont reçu, par l’étude ou par l’exercice, l’aptitude d’exécuter, dans le moins de temps et avec le moins de peine possible, les opérations diverses qu’exige le bien-être de l’individu et de son espèce ; celui dont les facultés intellectuelles ont reçu le développement le plus étendu, sur les objets qu’il lui importe le plus de connaître ; enfin, celui dont les inclinations s’accordent le mieux avec les intérêts du genre humain, est aussi celui dont le perfectionnement est le plus avancé. L’individu le plus dégradé est celui chez lequel se trouvent les défauts ou les vices contraires. Un peuple qui marche vers sa prospérité, est celui chez lequel les individus tendent à acquérir les divers genres de développement dont nous venons de parler, en même temps qu’ils se multiplient. Un peuple qui marche, au contraire, vers sa décadence, est celui chez lequel les facultés physiques, morales et intellectuelles des individus, se restreignent ou se dépravent, en même temps que la population diminue ; ce dernier phénomène est ordinairement la conséquence du premier.
Si je me bornais à ces propositions générales, elles seraient probablement peu contredites : le plus grand nombre des lecteurs en reconnaîtraient volontiers la vérité. Mais en serait-il de même, si de la théorie je passais à l’application ? Les jugements qu’on porte généralement sur les nations, ne me permettent pas de le croire. Quel est l’homme, par exemple, qui ne soit disposé à penser que le peuple romain, après avoir vaincu Carthage, ne fût parvenu au plus haut degré de prospérité auquel il lui fût possible d’atteindre ? Et cependant examinez en quoi consistaient les divers genres de perfectionnement auxquels étaient parvenues les facultés de chacun des individus dont ce peuple était composé. Par une nourriture abondante et des exercices continuels, les Romains étaient parvenus à donner à leurs forces musculaires une grande puissance : c’était un genre de perfectionnement. Mais quelles étaient les opérations qu’ils avaient appris à leurs organes à exécuter ? Celles qui leur étaient nécessaires pour détruire, ou dépouiller des peuples moins barbares qu’eux. Ils ne possédaient même pas le genre d’industrie le plus simple de tous, celui qui consiste à pourvoir à sa propre subsistance. C’étaient les Toscans, les Siciliens, les Égyptiens qui leur donnaient du pain ; c’étaient des affranchis ou des esclaves qui seuls savaient cultiver les arts dont ils ne pouvaient se passer. Leurs facultés intellectuelles étaient bien moins développées encore que leurs organes physiques ; ils ignoraient les lois les plus simples de la nature : ils voyaient partout des prodiges, et étaient sans cesse environnés de terreurs superstitieuses. Ils n’avaient que la sagacité propre aux animaux qui vivent de proie : ils savaient tromper ou vaincre les peuples dont ils avaient résolu la ruine ; mais en général leurs lumières n’allaient point au-delà. Le perfectionnement moral était en raison du développement intellectuel : en leur qualité de maîtres, ils étaient en état d’hostilité contre leurs esclaves ; en leur qualité de patriciens et de plébéiens, ils étaient en état d’hostilité les uns contre les autres ; en leur qualité de Romains, ils étaient en état d’hostilité contre le genre humain ; car ils voyaient des ennemis partout où ils ne voyaient pas des sujets, et leurs sujets étaient toujours traités en ennemis. Toutes les passions malveillantes, l’orgueil, la fourberie, la vengeance, la cruauté, la haine fermentaient dans leurs âmes ; et l’on en voyait des explosions fréquentes ou dans les soulèvements des esclaves, ou dans les dissensions civiles ou dans les guerres étrangères.
Il est rare, ou pour mieux dire, il n’arrive jamais que les écrivains qui jugent de la grandeur ou de la décadence d’un peuple, se rendent bien compte du sens qu’ils attachent à ces mots. Quelques-uns, considérant les hommes comme des machines de guerre, voient la grandeur d’un peuple dans le nombre de ses armées, dans les victoires qu’il a remportées, dans le nombre d’individus qu’il a tués, dans l’étendue des campagnes qu’il a ravagées, dans le nombre de villes qu’il a détruites, dans les monuments des arts destinés à transmettre à la postérité le souvenir de ces effroyables destructions.
D’autres écrivains, considérant les hommes comme des machines de production ou de transport, voient exclusivement la prospérité d’un peuple dans la quantité de marchandises qu’il produit, dans la rapidité avec laquelle certains objets sont fabriqués, transportés d’un lieu dans un autre, et échangés. Ils s’embarrassent peu si la population se compose d’hommes débiles ou robustes, intelligents ou stupides, moraux ou sans morale ; si le talent de chacune de ces machines produisantes se borne à l’opération mécanique la plus simple, ou s’il s’étend à un grand nombre d’opérations diverses ; si la partie de la population par laquelle les travaux sont exécutés, est ou n’est pas réduite à ce qui lui est rigoureusement nécessaire, à la conservation des forces que demande la production ; si la partie la plus sûre de son travail ne lui est pas régulièrement enlevée par une aristocratie féodale, sacerdotale ou militaire, sous le nom de dîmes, de taxes ou d’impôts ; ils s’embarrassent moins encore de savoir si l’existence de la masse de la population se réduit à une vie purement animale, ou s’il existe pour elle quelque genre de vie intellectuelle et morale ; tout est bien à leurs yeux pourvu que les magasins se vident et se remplissent dans le moins de temps possible : dans ce système, on peut savoir que la prospérité de telle nation dépasse la prospérité de telle autre de tant d’aunes de draps ou de tel nombre de machines.
D’autres calculent la prospérité d’un peuple exclusivement par la quantité de grain que le sol produit, ou par le nombre et la force des animaux qu’il nourrit ; s’ils voient des champs bien cultivés, des prés bien arrosés, des propriétés bien closes, et des routes bien percées et bien entretenues, il ne leur en faut pas davantage pour leur persuader que la population a atteint le dernier terme de prospérité auquel elle puisse arriver ; ils ne s’embarrassent pas de savoir si la partie la plus considérable de la population vit dans l’aisance ou dans la misère ; si elle n’est pas réduite à un sort plus misérable que celui des animaux qu’elle élève ; si elle n’est pas abrutie par la superstition ; si elle n’est pas courbée sous le sceptre d’un prêtre, sous le sabre d’un soldat, ou sous le bâton d’un officier de police ; peu leur importe que les hommes qui cultivent les champs, soient, comme les ilotes, le jouet du petit nombre de ceux qui en consomment les produits ; qu’ils se prosternent devant les plus vils animaux comme les Égyptiens, ou qu’ils tremblent sous le bambou comme les Chinois : ce qui fait la grandeur d’un peuple, ce n’est pas la grandeur de chacun des individus dont il se compose ; c’est l’état du sol sur lequel il est placé ; c’est le nombre et l’embonpoint des animaux qu’il élève.
D’autres mesurent la prospérité d’une nation par le nombre des individus qui se trouvent sur un espace donné de terrain : si, sur deux pays égaux en étendue, ils remarquent que l’un a une population double de l’autre, ils déclareront que la prospérité du premier est double de la prospérité du second. Ils n’examineront pas quel est celui des deux, chez lequel on trouve les hommes les plus forts, les plus robustes, les plus intelligents, les plus moraux ; pour eux la première qualité c’est de multiplier. C’est en vertu de ce principe d’estimation que tel gouvernement accordera des privilèges, des exemptions ou des pensions, non aux pères de famille qui auront le mieux élevé leurs enfants, et qui auront su les rendre heureux, mais à ceux qui en auront eu le plus grand nombre : comme si le mérite consistait à les faire naître, et non à faire d’eux des hommes utiles à leurs semblables.
Enfin, il est des hommes qui dans leurs calculs sur ce qui constitue la prospérité d’une nation, oublient la moitié du genre humain, et qui ne comptent pour rien le développement physique, moral et intellectuel des femmes. Il leur importe peu qu’elles soient incapables de se rendre à elles-mêmes ou de rendre à autrui aucun service ; et qu’elles soient privées d’intelligence même sur les choses qui les intéressent le plus. Tout défaut ou toute imperfection qui a pour effet de les rendre plus dépendantes, est considéré comme une heureuse qualité ; les liens qui arrêtent le développement de leurs facultés intellectuelles et morales, leur paraissent aussi bien imaginés que les liens au moyen desquels les Chinois arrêtent le développement des pieds de leurs filles : les uns comme les autres ont pour but et pour effet de les empêcher de se soutenir par leurs propres forces.
Lorsqu’on examine ce qui constitue la prospérité d’une nation, il faut faire entrer en ligne de compte, non seulement chacune des parties dont un individu se compose, mais chacun des individus qui appartiennent à cette nation ; les dénominations diverses sous lesquelles on désigne les hommes dans chaque état, ne les font pas changer de nature ; à Sparte, les ilotes ne faisaient pas moins partie du genre humain que les Spartiates ; à Athènes, à Rome, les affranchis et les esclaves étaient des hommes comme les citoyens ; en Pologne, en Russie, les serfs sont aussi bien des hommes que les seigneurs ; en France, en Angleterre et dans d’autres pays, les paysans, les ouvriers, les domestiques, ne sont pas moins une partie de l’espèce que les bourgeois, les gentilshommes ou les lords ; enfin, partout les femmes sont une partie aussi essentielle de l’espèce que les hommes : tous les individus, sous quelque dénomination qu’on les désigne, sont susceptibles de développement et de dépérissement, et c’est par la prospérité et la grandeur de chacune des parties, qu’il faut évaluer la grandeur et la prospérité de l’ensemble.
[II-35]
Les progrès de l’industrie, du commerce, de l’agriculture, sont sans doute des éléments essentiels de la prospérité des nations ; mais ils ne la constituent pas exclusivement. Prendre la prospérité d’une chose quelconque pour la prospérité d’un peuple, c’est confondre le moyen avec la fin. Un riche propriétaire de terres peut les rendre très fertiles et les cultiver avec le plus grand soin, tandis que les individus qu’il emploiera à la culture manqueront des choses nécessaires à la vie, et seront dans l’état le plus misérable. La quantité ou la qualité des produits ne prouvera même pas toujours le perfectionnement de l’individu auquel ils seront livrés, car cet individu pourra les dépenser en consommations frivoles ; il pourra être atteint de vices nombreux, soit au moral, soit au physique. Ce qui peut être vrai pour un individu, peut l’être pour une multitude ; et on peut dire d’un capitaliste ou d’un fabricant, ce que je dis d’un propriétaire de terres [3].
En considérant le genre humain dans son ensemble, on peut dire que tous les individus dont il se compose sont formés pour tous ; mais qu’aucun n’est spécialement fait pour un autre. Les femmes ne sont pas plus faites pour les hommes, que les hommes ne sont faits pour les femmes ; les enfants pour les pères, que les pères pour les enfants ; les domestiques pour les maîtres, que les maîtres pour les domestiques. Dans toutes les positions, il se fait un échange de services qui n’est équitable qu’autant que les intérêts de tous sont également respectés. Et ce qui fait qu’on tombe si souvent dans l’erreur, c’est la tendance qu’ont, dans la société, les classes les plus influentes à se considérer comme la fin à laquelle tout doit aboutir. Chacun entend par la prospérité de l’espèce, la prospérité de sa caste, ou des hommes qui occupent le même rang que lui ; et il se trouve toujours des écrivains qui se dévouent à des intérêts particuliers, et qui cherchent à fortifier cette tendance.
Les gouvernements formés de classes privilégiées se considèrent souvent aussi comme le but pour lequel les nations existent. Ils ne veulent admettre de développement chez elles, que dans la mesure de ce qu’ils considèrent comme leur intérêt ; ils tâchent de restreindre l’existence de chaque individu à ce qui leur est nécessaire pour les fins qu’ils se proposent ; ils agissent sur les facultés physiques, intellectuelles et morales de l’homme, par tous les moyens qui sont en leur puissance, et leur action a toujours pour but de dominer sur les unes et sur les autres.
Ils agissent sur les facultés physiques, non en arrêtant le développement matériel, mais en en empêchant l’application. Un gouvernement ne fera pas mutiler, par exemple, les mains des citoyens, mais il empêchera qu’ils en fassent usage pour exploiter tel ou tel genre d’industrie, pour manier des armes, ou pour se livrer à des exercices qui développeraient leurs forces et leur adresse, qui accroîtraient leur courage, leur donneraient de la sécurité, et assureraient leur liberté et leur indépendance. Il ne les privera pas de la vue ; mais il leur interdira de l’appliquer à l’étude de certains objets qu’il se croira intéressé à tenir cachés ; à l’étude de la physique, de l’astronomie, du corps humain, ou de toute autre science.
L’action qu’il exercera sur l’intelligence aura pour but, ou de la fausser, ou d’en arrêter le développement : il la faussera en répandant des notions erronées, ou en propageant certains mensonges ; il en empêchera le développement en interdisant d’en faire usage dans l’étude de l’histoire, de la morale, de la politique, ou dans d’autres études propres à éclairer les hommes sur leurs intérêts.
Enfin, il agira sur leurs facultés morales, non en détruisant leurs passions, mais en les dirigeant d’une manière contraire aux intérêts de l’humanité ; il leur inspirera de l’affection ou de la bienveillance pour des choses ou des personnes qui leur sont funestes, et de l’aversion ou de l’antipathie pour des choses, ou des personnes qui leur sont utiles ; il développera chez eux des passions vicieuses, telles que l’orgueil, la fausseté, l’ambition, l’oisiveté, le faste, la prodigalité, l’amour du jeu ; tandis qu’il affaiblira ou éteindra des passions vertueuses, telles que la simplicité, le patriotisme, la sincérité, l’économie, et l’amour du travail.
J’ai dit que les individus dont le genre humain se compose, sont tous susceptibles de développement et de dégradation ; mais il est, dans les progrès comme dans la décadence, des limites au-delà desquelles il n’est pas possible d’aller. Nous ignorons quel est le point précis auquel peut être porté le perfectionnement physique, intellectuel et moral de l’homme ; mais cela n’empêche pas que nous ne puissions affirmer sans témérité, que nous sommes circonscrits par notre propre nature, dans des limites qu’il ne nous est pas donné de franchir. Des êtres limités quant à leur durée, à leur étendue, au nombre et à la puissance de leurs facultés, ne sauraient être susceptibles d’un perfectionnement sans bornes. Nous ignorons également jusqu’à quel point de dégradation l’homme peut descendre ; mais l’infinité n’est pas plus le partage de la décadence que de la prospérité. Il est un point auquel l’homme ne peut plus déchoir sans s’éteindre, et si nous ne pouvons le déterminer d’une manière exacte, cela nous est peu nécessaire.
[II-39]
Un grand nombre de causes peuvent influer sur la prospérité et sur la décadence d’une nation. Mais est-il en notre puissance d’influer nous-mêmes sur chacune de ces causes ? Pouvons-nous les créer ou les détruire à volonté ? Quelles sont celles qui sont hors de notre puissance, et celles qui sont à notre portée ? Ces questions sont ici d’une haute importance ; elles forment, en quelque sorte, la base de la science de la législation.
Plusieurs écrivains ont considéré le climat comme ayant une influence immense sur le perfectionnement et la dégradation des facultés physiques, morales et intellectuelles de l’homme. Quelques-uns ont même prétendu qu’il fallait attribuer à cette influence la production des différentes espèces ou variétés d’hommes répandues sur la surface de la terre. Si cette influence est telle qu’ils la supposent, les peuples ne peuvent presque rien sur leur destinée ; car il n’est pas en leur puissance de changer le climat sous lequel ils se trouvent placés. Dans le cours de cet ouvrage j’aurai donc à examiner quel est le genre d’influence que le climat exerce sur l’existence des nations. Mais avant que d’exposer en quoi consiste cette influence sur l’état des peuples, il est nécessaire de constater quel est cet état. Ce n’est qu’après s’être bien assuré de la nature et de l’existence des effets qu’on peut se permettre d’en assigner les causes.
[II-40]
CHAPITRE II.↩
Des limites mises par la nature au perfectionnement des facultés humaines.
En parlant du perfectionnement de l’homme, je ne me suis occupé que de la puissance plus ou moins grande qu’ont chacun de nos organes de remplir les fonctions auxquelles la nature les a destinés ; ainsi, l’individu dont les facultés ont reçu le plus de développement ou de perfectionnement, n’est pas celui dont les organes ont reçu telle forme ou dont le teint a telle couleur ; c’est celui chez lequel chacune des parties est constituée pour l’avantage du tout, celui qui a reçu, dans chacune de ses facultés, le moyen d’être aussi utile à lui-même et à ses semblables que le comporte sa propre nature.
Mais n’est-ce pas considérer le perfectionnement de l’homme d’une manière incomplète ? La forme des traits, la couleur du teint, la nature des cheveux n’ont-elles pas un genre de perfection indépendant de l’aptitude de nos organes à remplir telles ou telles fonctions ? Un individu de l’espèce basanée ou malaie n’approche-t-il pas plus de la perfection dont la nature humaine est susceptible, qu’un individu de l’espèce noire ou éthiopienne ? Un individu de l’espèce cuivrée ou américaine n’est-il pas plus perfectionné qu’un individu qui appartient à l’espèce mongole ou couleur d’olive ? Enfin, un individu de l’espèce caucasienne, n’est-il pas plus perfectionné qu’un individu de l’espèce cuivrée ? Si ces questions étaient données à résoudre à un tribunal, il est probable que la solution dépendrait moins de la nature des choses considérées en elles-mêmes, que de l’espèce à laquelle appartiendraient les juges.
On a observé qu’en général, chaque peuple attache des idées particulières de beauté aux traits qui le distinguent des autres : pour lui, la perfection consiste dans l’exagération même de ces traits. Les indigènes de l’île de Van-Diemen ont le teint presque aussi noir que celui des nègres ; à leurs yeux, une partie essentielle de la beauté est d’être complètement noir, et pour approcher de ce genre de perfection, ils se barbouillent avec du charbon [4]. Les Hottentots du cap de Bonne-Espérance ont aussi le teint très obscur ; ils augmentent, par la peinture, ce genre de perfection. Ils ont de plus le nez très épaté et très petit ; et, suivant le rapport de Kolbe, ils accroissent ce caractère de leur beauté en enfonçant d’un coup de pouce le nez de leurs enfants naissants [5]. Un des traits caractéristiques de l’espèce américaine c’est la couleur cuivrée : pour elle la beauté c’est d’être rouge ; aussi, les peuples de cette espèce exagèrent par la peinture leur couleur naturelle : chez eux, on parle de la misère d’un homme qui n’a pas de quoi se peindre en rouge, comme on parle chez nous d’un homme qui n’a pas de linge pour se couvrir [6]. Un autre trait caractéristique des peuples de cette espèce, c’est d’avoir le poil rare : la beauté c’est de n’en avoir point du tout, et en conséquence ils s’épilent avec tant de soin qu’on a cru longtemps qu’ils n’avaient point de barbe [7]. Il est parmi eux des tribus qui ont le front singulièrement affaissé ; la beauté c’est d’avoir la tête aplatie, et pour donner à leurs enfants ce genre de perfection les parents dès leur naissance leur pressent le front entre deux planches [8]. Un des traits particuliers à l’espèce caucasienne ou européenne, c’est la blancheur de son teint, et une teinte rose répandue sur les joues ; c’est là un des caractères de la beauté ; lorsque ce trait manque à certaines personnes, elles y suppléent par des moyens analogues à ceux qui sont mis en usage par les nègres de la terre de Van Diemen, et par les cuivrés de l’Amérique. Les Grecs, loin d’avoir la tête aplatie comme certaines peuplades américaines, avaient, au contraire, l’angle facial très ouvert : pour eux l’être le plus parfait était celui qui se distinguait par un semblable caractère ; c’est ce qu’on observe dans les statues de Jupiter et d’Apollon qu’ils nous ont transmises [9]. Une observation analogue a été faite sur les peuples et les statues d’Égypte : il suffit de jeter les yeux sur ces statues et de les comparer aux statues grecques, pour se convaincre que les idées de beauté ou de perfection n’étaient pas les mêmes dans les deux pays [10]. Enfin, des voyageurs ont observé que les peuples de race mongole, qui habitent les côtes orientales de l’Asie, ont naturellement les pieds et les mains d’une petitesse remarquable [11] ; et cela pourrait nous expliquer peut-être les peines que se donnent les Chinois pour réduire les pieds de leurs femmes au plus petit volume possible [12].
[II-44]
Il existe, sans doute, dans plusieurs cas, quelques rapports entre les formes extérieures de nos organes, et l’aptitude qu’ils ont à remplir les fonctions auxquelles ils sont destinés. Il n’est pas impossible que les idées que les peuples ont de la beauté ne soient nées d’un certain genre de perfection, de quelque qualité réelle. L’intelligence peut se manifester par la forme de tels organes extérieurs, la force ou l’adresse par la forme de tels autres, la jeunesse et la santé par tels autres signes. Mais les mêmes formes ou les mêmes signes peuvent ne pas indiquer les mêmes qualités morales ou physiques, chez tous les individus ou chez toutes les espèces [13]. Le teint qui chez un individu d’espèce caucasienne est le signe de la santé, ne l’est pas chez un individu d’espèce africaine, et par conséquent, ce qui est une beauté pour l’un ne peut pas en être une pour l’autre. Il n’entre pas, au reste, dans le plan de cet ouvrage chercher quels sont les rapports qui existent entre la forme de nos organes et leur aptitude à remplir certaines fonctions ; ce sont des recherches qui appartiennent à un autre genre de connaissances ; il me suffit d’avoir déterminé ce que j’entends ici par le mot de perfectionnement.
Nous avons vu, dans le chapitre précédent, que, quoique nous n’ayons pas le moyen de déterminer le point de perfectionnement auquel peut arriver la nature humaine, on ne peut pas mettre en doute que ce perfectionnement n’ait des bornes. Des philosophes ont paru croire cependant le contraire ; mais cette croyance n’a été fondée que sur des hypothèses : les faits, loin de la justifier, en démontrent au contraire le peu de fondement. Les obstacles que les hommes trouvent à leur perfectionnement sont de deux genres : les uns se trouvent dans la nature même de l’homme ; les autres dans les choses dont l’homme est environné. Il ne s’agit ici que des premiers.
Les progrès des arts et des sciences ont mis les peuples civilisés à l’abri de certaines maladies, et leur ont donné le moyen de se guérir de quelques autres ; le terme moyen de la vie humaine a été ainsi prolongé. Mais, quelque immenses qu’aient été ces progrès, nul n’a découvert encore le moyen d’accroître de quelques années la durée de la vie, lorsqu’elle n’est attaquée par aucun accident ou par aucun genre de maladie. Les hommes les mieux constitués ne parviennent pas de nos jours à un âge plus avancé que celui auquel parvenaient les hommes également bien constitués dans les temps de la plus profonde ignorance. La vieillesse arrive de notre temps exactement au même âge auquel elle arrivait il y a trois mille ans ; et si l’on pouvait avoir quelque confiance dans des traditions fabuleuses, on serait porté à croire qu’elle est à présent plus précoce qu’elle ne l’a été jadis.
Il ne paraît pas non plus que les hommes aient porté le développement des forces musculaires au-delà de ce qu’elles étaient dans les siècles les plus reculés. Nous voyons, par ce qui nous reste des temps les plus antiques, que les hommes avaient autrefois les mêmes dimensions qu’ils ont aujourd’hui. Ce que les poètes et les historiens nous racontent des temps anciens pourrait même nous faire croire que nos forces physiques sont au-dessous de ce qu’étaient celles de quelques peuples d’alors. Le changement qui s’est opéré dans les machines ou les armes propres à la guerre, joint à l’abandon des exercices gymnastiques serait plus que suffisant pour rendre raison de la différence.
Enfin, aucun fait ne constate que les organes de la vue, de l’ouïe, de l’odorat aient maintenant plus de finesse ou d’étendue qu’ils n’en avaient jadis. La durée de l’enfance et de la vieillesse, les douleurs qui sont la suite de l’accroissement ou de la destruction, sont aujourd’hui ce qu’elles ont été dans tous les temps. Il nous faut pour nous nourrir ou nous vêtir à peu près la quantité d’aliments et de vêtements qu’il fallait à nos ancêtres. Nous ne sommes pas plus insensibles à la douleur ou plus sensibles au plaisir que ne l’étaient les hommes du temps d’Homère. En un mot, si l’on ne jugeait de l’homme que par ses organes physiques et matériels, on croirait qu’il est aujourd’hui ce qu’il a toujours été ; peut-être même serait-on disposé à croire qu’il a dégénéré sous quelques rapports. Le système qui présenterait chacune de nos facultés comme susceptible d’un perfectionnement sans bornes, bien loin d’être soutenu par les faits, serait donc démenti par l’expérience. Ce qui s’est perfectionné en nous, c’est l’art de faire usage de nos organes physiques ou intellectuels, l’art d’en accroître la puissance par des machines ou des méthodes nouvelles ; l’art de prévoir les résultats de nos actions, et de régler en conséquence nos affections d’une manière plus avantageuse à nous-même et à nos semblables. La partie de nous-même la moins susceptible de perfectionnement, c’est celle qui consiste dans une force en quelque sorte matérielle. Les parties les plus susceptibles d’être perfectionnées, sont nos facultés morales et intellectuelles, l’aptitude de quelques-uns de nos organes à exécuter certaines opérations.
Mais tous les individus, placés dans une position semblable, sont-ils susceptibles du même genre de perfectionnement, tous rencontrent-ils dans leur propre nature les mêmes obstacles ? Un philosophe a résolu affirmativement ces questions. Helvétius a prétendu que tous les hommes étaient susceptibles, sinon du même développement physique, au moins du même perfectionnement intellectuel et moral. Ce système, soutenu avec beaucoup d’esprit, n’est cependant pas fondé sur l’expérience, et par conséquent nous devons le considérer comme n’étant fondé sur rien. Il est bien évident que les hommes ne sont point égaux par leurs organes physiques ; et qu’on ne saurait donner à ceux qui naissent faibles et mal constitués, la même agilité, la même adresse, la même force qu’à ceux qui naissent avec une constitution forte et vigoureuse. Il est très difficile de trouver dans la nature organisée deux êtres parfaitement semblables ; et comment concevoir une ressemblance parfaite dans tous les individus de l’espèce dont l’organisation est la plus compliquée ? Les hommes différant les uns des autres dans leur organisation physique, on ne saurait prouver qu’ils sont tous susceptibles du même perfectionnement intellectuel et moral, avant que d’avoir prouvé que les organes physiques sont sans influence sur les facultés morales et intellectuelles, proposition tellement démentie par l’expérience, qu’on peut douter si elle mérite d’être réfutée. Aussi, en demandant si tous les hommes sont susceptibles du même développement, n’est-ce pas d’une différence d’individu à individu que j’entends parler ; c’est d’une différence d’espèce ou de variété.
Cette question sur le développement dont sont susceptibles les diverses espèces ou variétés d’hommes, se lie à une question qui est, pour le genre humain, de la plus haute importance, celle de l’influence des lieux et des climats sur toutes les facultés humaines. Un grand nombre de naturalistes et de philosophes ont considéré le climat comme la cause productive des espèces qu’on a observées dans le genre humain. Plusieurs ont pensé que toutes les espèces ou variétés d’hommes n’étaient pas susceptibles d’un égal développement. Ils ont cru que quelques-unes avaient sur les autres une grande supériorité d’organisation physique, et que cette supériorité leur permettait de porter plus loin le perfectionnement de leurs facultés intellectuelles et morales. Cette opinion n’a pas été adoptée seulement par des philosophes ; elle l’a été aussi par des théologiens. Dès les premières années de la conquête de l’Amérique, les prêtres espagnols se divisèrent sur la question de savoir si les individus d’espèce cuivrée étaient doués d’assez d’intelligence pour être admis à participer aux mystères de la religion catholique. Un grand nombre d’entre eux considérèrent les Indiens comme appartenant à une espèce inférieure dont les facultés intellectuelles n’étaient pas susceptibles de développement, et la décision de la cour de Rome ne fut pas suffisante pour les [II-50] faire changer d’opinion. D’autres ont porté le même jugement sur les individus de l’espèce éthiopienne et de l’espèce malaie ; ce jugement leur a même servi à motiver l’esclavage des premiers. La question des variétés ou des espèces se lie ainsi à celle de l’esclavage, en même temps qu’à celle qui est relative à l’influence des climats.
De toutes les questions relatives au perfectionnement de l’ordre social, il n’en est peut-être pas de plus importantes que celles qui se rattachent aux différents ordres d’aristocratie. Ce sont des questions de cette nature qui ont agité le monde, depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours ; cependant, dans toutes ces querelles, les diverses classes de la population appartenaient à la même espèce d’hommes. Mais, depuis que les Européens se sont établis en Amérique, au sud de l’Asie, dans quelques-unes des îles du grand Océan, et au sud et à l’occident de l’Afrique, nous voyons paraître un genre d’aristocratie dont nous n’avions aucune idée, l’aristocratie des espèces. Cette nouvelle combinaison influera considérablement sur l’existence des républiques américaines, et, sous ce rapport, elle mérite toute notre attention.
[II-51]
CHAPITRE III.↩
Des diverses espèces ou variétés dont se compose le genre humain. — De l’opinion de quelques écrivains sur ce sujet.
Pour déterminer d’une manière exacte chacun des points dans lesquels les diverses espèces ou variétés d’hommes se ressemblent, et ceux dans lesquels elles différent, il faudrait entrer dans des développements qui seraient étrangers à cet ouvrage, et qui exigeraient des observations auxquelles je ne me suis point livré ; car, sur ces matières, les livres sont une source d’instruction très imparfaite ; l’histoire naturelle de l’homme est d’ailleurs trop peu avancée pour ne nous rien laisser à désirer à cet égard. Lorsqu’on lit les ouvrages qui ont été écrits sur ce sujet, on est étonné du petit nombre de faits que les savants ont observés sur la plupart des espèces entre lesquelles se partage le genre humain ; et l’on hésite à en tirer des conclusions générales, dans la crainte de convertir en règles, des faits qui n’ont été peut-être que des exceptions ou des bizarreries de la nature. Aussi, dans ce chapitre, n’ai-je pas d’autre objet que d’exposer les traits généraux qui, suivant quelques physiologistes, caractérisent chacune des principales espèces qu’on a observées, et de rechercher si le climat a quelque influence sur leur production. J’examinerai ensuite si la supériorité morale et intellectuelle qu’on a attribuée aux unes sur les autres est prouvée par des faits bien constatés, et quelles sont, en morale et en législation, les conséquences qu’on peut tirer de cette supériorité, en supposant qu’elle existe.
Blumenbach, et après lui W. Lawrence, ont divisé le genre humain en cinq races ou variétés : la race caucasienne, la race mongole, la race éthiopienne, la race américaine, et la race malaie [14].
Ils comprennent dans le race caucasienne les habitants anciens et modernes de l’Europe, exceptant seulement les Lapons et les autres peuples de race finnoise ; les habitants anciens et modernes de l’ouest de l’Asie jusqu’à la rivière d’Obi, la mer Caspienne et le Gange, tels que les Assyriens, les Mèdes et les Chaldéens, les Sarmates, les Scythes et les Parthes ; les Philistins, les Phéniciens, les Juifs et tous les habitants de la Syrie ; les Tatars proprement dits ; les tribus diverses qui occupent le Caucase, les Géorgiens, les Circassiens, les Mingréliens, les Arméniens, les Turcs, les Perses, les Arabes, les Afghans, les Indous des hautes castes ; les habitants du nord de l’Afrique, en y comprenant non seulement ceux qui habitent le nord du grand Désert, mais encore quelques tribus qui vivent dans des régions plus australes ; les Égyptiens, les Abyssiniens et les Guanches.
Ils comprennent dans la race mongole les nombreuses tribus, plus ou moins grossières et en grande partie nomades, qui occupent le centre et le nord de l’Asie, comme les Mongols, les Calmouks, les Burats, les Manchous ou Mandshurs, les Daouriens, les Tongouses et les Coréens ; les Samoïèdes, les Coriaks, les Tschutsks, les Kamtchadales ; les Chinois, les Japonais, les habitants du Tibet et de Bhoutan, ceux de Tonkin, de la Cochinchine, d’Ava, de Pégu, de Cambodge, de Laos et de Siam ; les races finnoises du nord de l’Europe, comme les Lapons ; et les tribus des Esquimaux, répandues dans l’Amérique septentrionale, depuis le détroit de Béring jusqu’à l’extrémité du Groenland.
[II-54]
Tous les indigènes de l’Afrique, à l’exception de ceux qui ont été compris dans la race caucasienne, sont désignés sous le nom de la race éthiopienne ; on classe aussi sous la même dénomination les habitants des îles qui sont au sud-ouest du grand Océan, tels que les habitants de la Nouvelle-Hollande, de l’île de Van-Diemen, de la Nouvelle-Guinée, de la Nouvelle-Bretagne, des îles Salomon, de la Nouvelle-Géorgie, des îles Charlotte, des Nouvelles-Hébrides, de Tanna, de Mallicollo, de la Nouvelle-Calédonie et des îles Fidji [15].
L’espèce américaine comprend, suivant les mêmes écrivains, tous les indigènes de l’Amérique, à l’exception des Esquimaux. Des voyageurs croient cependant avoir rencontré, soit dans l’intérieur de ce continent, soit sur les côtes du nord-ouest, quelques tribus appartenant à des espèces différentes, ainsi qu’on le verra plus loin.
Enfin l’espèce malaie comprend tous les habitants des îles de l’océan Pacifique, depuis la Nouvelle-Zélande jusqu’aux îles Sandwich, et depuis l’île de Pâques jusqu’à la presqu’île de Malacca. Il faut excepter seulement les habitants de quelques îles, qui ont été compris dans l’espèce éthiopienne : encore paraît-il douteux que cette exception doive être admise.
Chacune de ces espèces ou variétés a des caractères généraux qui la distinguent des autres, et qui se perpétuent de génération en génération. Voici quels sont ces caractères, suivant les deux physiologistes que je viens de citer :
Les caractères de l’espèce caucasienne sont la peau blanche, le teint rosé ou inclinant vers le brun ; les joues colorées de rouge ; les cheveux épais, doux, plus ou moins ondoyants ou bouclés, noirs ou de couleurs variées plus ou moins claires ; l’iris noir chez les individus d’un teint brun, et bleu, gris ou verdâtre chez les individus dont le teint est rosé ; le crâne grand et la face comparativement petite ; les régions supérieures et antérieures du crâne très développées, et la face perpendiculairement au-dessous ; la figure ovale et droite, les traits distincts les uns des autres ; le front développé ; le nez étroit et généralement un peu aquilin ; la bouche petite ; les dents antérieures des deux mâchoires, perpendiculaires ; les lèvres, et particulièrement la lèvre inférieure, un peu tournées en dehors ; le menton plein et arrondi ; les sentiments moraux et les facultés intellectuelles très énergiques, et susceptibles d’un grand développement.
Les individus dont cette espèce se compose sont désignés sous le nom d’espèce ou variété caucasienne, soit parce qu’on a supposé que leur berceau primitif a été dans les montagnes du Caucase, soit parce que chez les peuples qui ont toujours habité et qui habitent encore ces montagnes, les caractères particuliers à l’espèce sont plus prononcés que chez aucun autre peuple [16].
Les peuples d’espèce mongole sont caractérisés par un teint couleur d’olive, qui dans plusieurs cas est très léger ; les yeux noirs, les cheveux noirs, droits, forts et rares ; peu ou point de barbe ; la tête carrée ; le front petit et bas ; le nez large et plat ; les traits se confondant les uns dans les autres ; le nez petit et aplati ; les joues arrondies, se projetant extérieurement ; les paupières peu ouvertes et bridées ; les yeux placés très obliquement ; le menton légèrement projeté ; les oreilles grandes ; les lèvres épaisses ; la stature, particulièrement chez les peuples du nord, inférieure à celle des Européens.
Les caractères de l’espèce éthiopienne sont la peau et les yeux noirs ; les cheveux noirs et laineux ; le crâne comprimé latéralement, et allongé sur le devant ; le front bas, étroit, et déprimé en arrière ; les mâchoires étroites, et projetées en avant ; les dents de devant de la mâchoire supérieure placées obliquement ; le menton retiré ; les yeux proéminents ; le nez large, épais, épaté, et se confondant avec une grande mâchoire ; les lèvres, et particulièrement la lèvre supérieure, épaisses ; les genoux souvent tournés en dedans [17].
Les caractères de l’espèce américaine sont une peau brune d’une teinte plus ou moins rouge ; les cheveux noirs, droits et forts ; la barbe rare et généralement détruite par un moyen artificiel ; le crâne et l’air du visage mongols ; le front bas ; les yeux enfoncés ; la figure large, particulièrement dans la partie des joues, mais un peu moins aplatie que chez les individus d’espèce mongole ; le nez et les autres traits plus distincts ; la bouche grande ; les lèvres épaisses [18].
[II-58]
Les caractères de l’espèce malaie sont la peau brune, depuis une légère teinte tannée comme celle des Portugais et des Espagnols, jusqu’au brun foncé approchant du noir ; les cheveux noirs, touffus, et plus ou moins bouclés ; la tête un peu étroite ; les os de la figure grands et proéminents ; le nez plein et large vers le bout ; la bouche grande [19].
[II-60]
Tous les peuples compris sous chacune de ces espèces n’ont pas exactement les mêmes caractères ; on pourrait diviser chacune d’elles, en un nombre plus ou moins considérable de variétés, différant entre elles autant que les premières diffèrent les uns des autres. L’espèce caucasienne est celle qui comporterait la division la plus considérable. On a attribué le grand nombre de variétés qu’on remarque chez elle à une organisation plus flexible, plus douce, plus délicate, et à une civilisation plus ancienne. L’espèce éthiopienne, qui est celle qui semble le plus s’éloigner de l’espèce caucasienne, comprend elle-même un grand nombre de variétés très prononcées. Il y a plus de différences, par exemple, entre un Boschisman, un Cafre, et un habitant de l’Éthiopie, classés dans la même variété, qu’il n’y en a entre tel Malais, tel Européen et tel Cafre appartenant à des espèces différentes. La division du genre humain en cinq espèces ou variétés n’est donc pas exempte d’arbitraire ; et il était peut-être plus facile de porter la division à quinze ou vingt, que de prouver que tous les peuples du monde rentrent dans une des cinq espèces précédemment exposées [20].
[II-61]
C’est une question, parmi les physiologistes, si le genre humain se divise en plusieurs espèces, ou si, au contraire, il n’en comprend qu’une seule dont les différents peuples qui existent sur la terre ne sont que des variétés. Buffon et Blumenbach ont pensé que le genre humain ne comprend qu’une seule espèce ; ils ont cru que la race caucasienne était la souche dont toutes les autres étaient dérivées, et que les hommes olivâtres, cuivrés, noirs ou basanés, n’étaient que des Caucasiens dégénérés.
W. Lawrence a recherché si les diverses espèces ou variétés qu’il a reconnues doivent être considérées comme ayant existé depuis l’origine du genre humain, ou comme étant des résultats de variations subséquentes à la formation des hommes. Il a adopté l’opinion de Buffon et de Blumenbach ; et, jugeant du genre humain par les faits qu’il a cru observer chez certaines espèces d’animaux, il a attribué à l’état de domesticité les diverses variétés entre lesquelles le genre humain se divise.
Il est reconnu, parce que l’expérience de tous les jours nous le démontre, que les hommes de toutes les espèces ou variétés sont susceptibles de dégradation et de perfectionnement. Mais quels sont les faits à l’aide desquels nous pouvons établir que telle ou telle variété est la souche primitive de laquelle toutes les autres sont dérivées ? Un individu d’espèce caucasienne s’imagine que toutes les autres sont nées de la sienne ; mais pourquoi un Malais ne croirait-il pas qu’il appartient lui-même à l’espèce primitive ? Pourquoi ne considèrerait-il pas un nègre comme un Malais dégénéré, et un blanc comme un Malais perfectionné, en supposant qu’il reconnaisse notre supériorité sur lui ? Des individus d’espèce caucasienne ont pu produire, dit-on, des individus de variété éthiopienne, africaine ou malaie ; mais si cela a pu arriver, le contraire a pu arriver aussi ; et je ne vois pas sur quoi l’on se fonderait pour admettre une supposition plutôt que l’autre. Chaque espèce ou variété peut faire, pour prouver l’ancienneté de son origine, les mêmes raisonnements qu’on a faits pour l’ancienneté de la variété ou de l’espèce caucasienne ; et il y aurait autant de raisons à donner, pour prouver que celle-ci est un perfectionnement d’une de celles-là, que pour prouver que les premières sont des dégénérations de la dernière. Il est vrai qu’on a observé que des peuples du Caucase se sont répandus sur des contrées fort éloignées ; mais toutes les autres parties du monde étaient-elles désertes lorsque ces migrations ont commencé ? Qui nous apprendra si ces peuples, qui, suivant notre manière de voir, forment la plus belle espèce, tiennent leur beauté de leur organisation primitive, ou s’ils la tiennent d’un perfectionnement qu’ils ont acquis dans les lieux mêmes qu’ils habitent ? Les plus beaux individus de l’espèce malaie que l’on connaisse, sont ceux qui habitent les îles Marquises ; en est-ce assez pour supposer que c’est dans ces îles que l’espèce a pris naissance ?
Le genre d’orgueil qui s’éteint le dernier dans l’esprit de l’homme, est l’orgueil de race ; un homme peut renoncer à l’orgueil individuel, à l’orgueil de famille, même à l’orgueil de nation ; mais l’orgueil de l’espèce n’est pas si facilement abandonné. C’est à ce sentiment qu’il faut attribuer nos systèmes sur la formation et la division des peuples. Pour sentir combien sont faibles les fondements sur lesquels ces systèmes reposent, on n’a qu’à faire des systèmes semblables sur des genres où l’orgueil est désintéressé, sur des genres différents du nôtre. Qu’on se demande, par exemple, si tous les ours descendent d’une souche commune ; si les noirs sont une dégénération des gris ou des blancs, ou si ceux-ci sont un perfectionnement de ceux-là ; si les gris ont pris une telle couleur parce qu’ils ont passé, d’un climat froid ou chaud, dans un climat tempéré ; si les noirs sont tels parce qu’ils ont passé d’un climat tempéré dans un climat chaud ; si les blancs ont acquis leur blancheur parce qu’ils ont abandonné des climats chauds ou tempérés pour vivre dans des climats froids ; on sentira que ces questions, sur l’état primitif des espèces, ne sont pas des questions que les sciences puissent résoudre ; parce que, pour en donner la solution, il faudrait connaître des faits dont nous n’avons encore aucun moyen de nous assurer, et qu’on ne peut suppléer aux faits qui nous manquent, par de vagues conjectures ou de prétendues possibilités [21]. W. Lawrence croit que toutes les races qui existent sont des variétés de la race caucasienne ; il se fonde sur ce que l’on observe des variétés analogues parmi les animaux que l’homme a réduits en état de domesticité. Cette manière de raisonner est peu concluante ; premièrement, toutes les races d’hommes vivent en état de société, et chacune peut considérer toutes les autres comme des variétés d’elle-même avec autant de raison que la race caucasienne. En second lieu, les animaux que l’homme a soumis à son empire, ne sont libres ni dans le choix de leurs aliments, ni dans le choix de leurs habitations, ni dans le choix des individus de leur espèce avec lesquels ils s’associent. Il faudrait, pour que l’analogie fût exacte, que les hommes fussent soumis à des êtres d’un genre supérieur à eux-mêmes, et qu’ils fussent assujettis comme le sont les animaux domestiques. En troisième lieu, les variétés observées parmi ces animaux résultent principalement, suivant Lawrence lui-même, de la différence de climat, d’aliments et de soins ; et il reconnaît qu’aucune de ces causes ne produit le même effet sur les hommes. En quatrième lieu, de ce que tel genre d’animaux est susceptible d’éprouver telle variation, on ne peut pas conclure que des êtres d’un genre tout différent sont susceptibles d’éprouver une modification semblable, et surtout qu’ils l’ont éprouvée. Lors même qu’il serait établi que les choses ont pu arriver de telle manière, on ne pourrait tirer la conséquence qu’en effet elles sont arrivées ainsi, qu’après avoir prouvé qu’elles n’ont pas pu arriver autrement. Enfin, des millions de naissances nous prouvent la constance avec laquelle les espèces se perpétuent et se conservent pures ; mais nous ne connaissons aucun fait duquel nous puissions conclure que deux individus de race caucasienne peuvent engendrer un nègre, ou deux nègres un individu de race caucasienne.
La procréation d’un blanc par deux noirs, ou d’un noir par deux blancs, serait déjà un phénomène fort extraordinaire, et cependant ce phénomène ne suffirait pas pour produire l’une ou l’autre des deux variétés ; il faudrait de plus un autre individu semblable, mais d’un sexe différent. Nous ne voyons pas, en effet, que l’union d’un individu d’espèce caucasienne à un individu d’espèce éthiopienne, produise des individus tantôt blancs et tantôt noirs, ou des individus tachetés, comme cela arrive parmi les animaux. Les enfants qui naissent d’une telle union ont une couleur uniforme qui tient le milieu entre les deux espèces. Il faut, pour produire un individu de race pure, que le père et la mère appartiennent à la même race ; et ce phénomène suffirait pour prouver combien est peu concluante l’analogie qu’on tire d’un genre d’animaux à un autre [22].
[II-67]
Une autre raison a déterminé W. Lawrence à penser que toutes les espèces d’hommes sont des variétés d’une espèce primitive ; c’est le grand nombre d’espèces qu’il faudrait admettre dans la science, si l’on admettait qu’il en existe plus d’une. Chacune des variétés devrait, dit-il, être divisée en plusieurs autres, et le nombre en serait si grand que l’esprit en serait accablé. J’avoue que je ne saurais comprendre ce raisonnement : je ne vois point comment la difficulté de classer un certain ordre de faits ou de s’en rendre compte, pourrait être une preuve de l’existence de tel ou tel phénomène. Cette difficulté prouverait tout au plus les bornes de notre esprit, l’imperfection de nos méthodes, le peu de certitude de nos connaissances ; mais elle ne prouverait rien de plus. La formation de cinq espèces primitives n’est pas un phénomène moins inconcevable que la formation de vingt ; la formation d’une seule est un mystère aussi impénétrable que la formation de cent. Les sciences ne peuvent à cet égard nous donner aucune connaissance ; car nous ne devons mettre au rang des connaissances ni de vagues conjectures, ni de fausses analogies. Du moment qu’il nous est impossible de rien savoir sur la filiation des peuples, la question de l’unité ou de la multiplicité des espèces n’est plus qu’une question de méthode. La meilleure solution est celle qui donne à l’esprit le plus de facilité pour embrasser un certain ordre de faits ; mais nulle classification ne saurait nous expliquer des faits que la nature nous a cachés.
[II-69]
CHAPITRE IV.↩
Des causes physiques auxquelles a été attribuée la production des diverses espèces d’hommes, et particulièrement de l’influence des climats.
S’il nous est impossible de connaître, par le seul secours des sciences, des événements qui sont antérieurs à tous nos monuments historiques, et sur lesquels l’expérience ne nous donne aucune lumière, nous pouvons apprendre au moins si tels faits bien constatés, sont ou ne sont pas des conséquences de tels autres faits également bien constatés. Nous pouvons savoir si les caractères qui distinguent chaque espèce ou chaque variété, comme on voudra les appeler, se transmettent ou non de génération en génération ; s’ils peuvent être produits par des opérations artificielles sur les individus, par les aliments dont ils se nourrissent, ou par la température de l’atmosphère dans laquelle ils se trouvent placés.
Plusieurs savants ont imaginé que, pour modifier l’espèce, il suffisait de modifier artificiellement les individus ; qu’en imprimant par un moyen artificiel, par exemple, telle couleur à tel homme et à telle femme, et en répétant la même opération sur leurs descendants pendant quelques générations, on finirait par altérer la couleur de l’espèce ; qu’en donnant, par un moyen quelconque, telle ou telle forme à tel organe, et en continuant la même opération sur les enfants pendant un certain temps, les hommes finiraient par naître avec telle ou telle forme. C’est cette opinion, qu’aucune expérience ne justifie, qui a fait penser à quelques-uns, non que les indigènes d’Amérique se peignaient en rouge parce qu’ils étaient cuivrés, mais qu’ils naissaient cuivrés parce que leurs ancêtres s’étaient peints en rouge. La même opinion a fait croire à Volney que le caractère des traits et de la physionomie des nègres, était le résultat d’une lumière trop forte pour la vue humaine. L’observation exacte des faits prouve jusqu’à l’évidence que des opinions semblables n’ont aucun fondement [23].
Presque tous les habitants des îles de l’océan Pacifique s’impriment dans la peau des couleurs ineffaçables : ces couleurs ne tiennent pas seulement à l’épiderme, elles sont introduites dans le tissu même de la peau, au moyen d’instruments aigus ; c’est, en général, avant la puberté que l’opération commence à s’exécuter ; les femmes y sont assujetties comme les hommes. Nous ignorons depuis quelle époque cet usage est mis en pratique ; mais on peut croire qu’il remonte aux temps les plus reculés, puisqu’il se retrouve dans presque toutes les îles, et qu’il est probable qu’il y a été apporté au moment où elles se sont peuplées. Cependant, dans aucune les enfants ne naissent tatoués ; à chaque génération l’opération doit être faite, comme si elle n’avait jamais eu lieu sur les générations précédentes.
La réduction que les Chinois font éprouver aux pieds de leurs filles par une compression artificielle, ne se transmet jamais d’une génération à l’autre ; cette déformation qui affecte l’individu, est sans influence sur ses descendants. Les hommes et les femmes caribes, dont la tête a été artificiellement aplatie dès leur naissance, engendrent des enfants avec les proportions qui caractérisent leur espèce, et ils ne peuvent les rendre semblables à eux-mêmes qu’en leur faisant subir la même compression [24]. Les indigènes du nord-ouest de l’Amérique, qui se font sous la lèvre inférieure une large ouverture à laquelle ils donnent l’apparence d’une seconde bouche, ne transmettent pas, par la génération, cette difformité à leurs descendants [25]. Les individus de quelques tribus africaines, qui, par des incisions, produisent sur quelques parties de leur corps des élévations artificielles, ne sont pas encore parvenus à modifier leur race par des moyens semblables [26]. Presque tous les peuples d’espèce américaine, une partie de ceux qui appartiennent à l’espèce malaie, et les Orientaux d’espèce caucasienne, s’épilent une partie du corps avec beaucoup de soin ; mais cet usage est sans influence sur la constitution physique de leurs descendants. Dans presque tous les pays, les femmes se percent les oreilles pour y suspendre divers ornements, et nous ne connaissons aucun exemple d’enfant né avec les oreilles percées. Enfin, quelle que soit la persistance avec laquelle nous mutilons certains animaux, nous ne sommes point parvenus à en affecter l’espèce. Les chevaux et les chiens auxquels on a coupé la queue ou les oreilles, n’engendrent que des individus semblables à ceux qui n’ont pas subi cette opération.
L’opinion de Buffon et de quelques autres naturalistes qui ont attribué les différences caractéristiques des espèces à des moyens artificiels, qui ont cru, par exemple, que le teint olivâtre de l’espèce mongole, et le teint cuivré de l’espèce américaine, étaient produits en grande partie par leur saleté ou par la fumée de leurs huttes, non seulement n’est pas fondée sur l’expérience, mais se trouve démentie par elle. Ceux de nos ouvriers qui travaillent dans les mines ou dans les forges, les charbonniers et les ramoneurs, engendrent des enfants aussi blancs que ceux des individus les plus propres. Si les causes dont parle Buffon produisaient les effets qu’il leur attribue, une partie des Européens seraient aussi noirs que des Africains. Il est vrai que ce grand écrivain attribue à plus d’une cause les variétés qu’on a observées parmi les hommes : suivant lui, le climat est l’agent qui a le plus contribué à la production de ces variétés ; mais on va voir que cet agent prétendu n’a pas eu l’effet qu’on lui attribue, et que les rayons du soleil, en modifiant le teint de l’individu, n’affecte pas plus l’espèce, que ne l’affecte le tatouage des habitants des îles du grand Océan.
Les diverses couleurs du teint sont au nombre des caractères qui servent à distinguer les espèces ; mais ces caractères ne sont pas les seuls. Les nègres pourraient avoir le teint des Européens, et en différer encore sous beaucoup d’autres rapports. Or, les naturalistes qui ont cherché à expliquer la différence de teint par la différence de climat, ont laissé sans explication toutes les autres différences. Elles sont cependant assez nombreuses pour caractériser les espèces, et pour nous empêcher de les confondre.
Le teint des individus de l’espèce caucasienne varie avec la température de l’atmosphère, pour tous les hommes qui restent exposés au grand air. Les Maures qui habitent les côtes de Barbarie ont le teint plus foncé que les habitants du Portugal et de l’Espagne ; ceux-ci plus que les Français, et les Français plus que les Allemands et les Anglais [27]. Ces différences sont le produit incontestable de l’air, ou de l’atmosphère qui nous environne ; tel Allemand qui irait vivre en Espagne y prendrait le teint d’un Espagnol, et tel Espagnol qui irait vivre parmi les Allemands, prendrait le teint des peuples d’Allemagne. Tant que les naturalistes se sont bornés à observer superficiellement ces phénomènes, et tant qu’ils n’ont connu des peuples noirs que dans la partie la plus brûlante de l’Afrique, il est naturel qu’ils aient attribué la différence de couleur à la différence de climat ; mais aussitôt que les faits ont été soumis à une observation plus réfléchie, et que le nombre s’en est multiplié, il n’a plus été possible de conserver la même opinion.
L’action de l’atmosphère, si puissante sur l’individu, est sans influence sur sa postérité. Les enfants d’espèce caucasienne naissent blancs sous toutes les latitudes et à tous les degrés de température, et ils demeurent tels jusqu’à ce que l’action de l’air ou de la lumière ait plus ou moins modifié leur teint. Il n’y a aucune différence de couleur entre l’enfant d’un Algérien, l’enfant d’un Espagnol et celui d’un Suédois ou d’un Russe. Les enfants des créoles anglais, qui naissent entre les tropiques, naissent exactement de la même couleur que ceux qui reçoivent le jour dans la Grande-Bretagne. Les descendants des Espagnols dans l’Amérique du sud, ont le teint aussi beau que ceux qui ne sont jamais sortis du territoire espagnol, peut-être même l’ont-ils plus beau, lorsqu’ils ne s’exposent pas aux rayons du soleil. Les enfants des Hollandais qui naissent à côté des Cafres, sont aussi blancs que ceux qui naissent à Amsterdam. Non seulement l’influence du climat n’affecte pas la couleur de l’espèce, mais elle n’affecte pas même l’individu tout entier ; les parties du corps qui restent couvertes ont autant de blancheur chez les peuples du Midi, que chez les peuples du Nord ; elles paraissent même souvent en avoir davantage, par le contraste qui existe entre elles et celles auxquelles l’action de l’air ou du soleil a imprimé une teinte plus ou moins basanée [28].
Les individus de l’espèce éthiopienne naissent à peu près de la même couleur que les individus de l’espèce caucasienne : ils sont rougeâtres en venant au monde. Au troisième jour, les organes de la génération, le tour des ongles et des mamelons sont entièrement noirs ; au cinquième ou au sixième jour, le corps de l’enfant a complètement acquis la couleur particulière à son espèce. Ce changement s’opère dans les climats les plus froids comme dans les plus chauds ; Camper l’a observé à Amsterdam, sur un enfant né dans l’hiver, dans une chambre bien fermée, et tenu soigneusement enveloppé dans des langes [29]. Kolbe a fait sur des enfants de Hottentot des observations semblables : ces enfants ont en naissant la couleur des Européens ; mais au bout de dix ou douze jours cette couleur fait place à une couleur noirâtre qui leur couvre tout le corps, excepté la paume des mains et la plante des pieds, qui demeurent toujours blanchâtres, comme chez tous les individus de même race [30]. Les nègres répandus sur la surface du continent américain, sous toutes les latitudes, et à tous les degrés d’élévation, quoique descendus de parents qui étaient nés et qui avaient vécu dans le pays, sont d’une couleur aussi foncée que ceux qui sont nés au centre de l’Éthiopie, et qui n’ont jamais quitté leur pays natal. Les nègres établis dans le nord de l’Europe, non seulement conservent leur couleur originelle, mais la transmettent à leurs descendants aussi foncée qu’ils l’ont reçue : j’ai eu souvent occasion d’observer en Angleterre les enfants nés d’un noir et d’une femme remarquable par sa blancheur ; ils étaient aussi basanés que le sont les mulâtres nés et élevés sous les tropiques. Les parties du corps des nègres qui ne sont jamais exposées à l’action du soleil ou de la lumière, sont aussi noires que celles qui ne sont jamais couvertes.
Divers peuples d’espèce nègre sont répandus dans quelques-unes des îles de l’océan Pacifique ; on ignore depuis quel temps ils y sont établis, et quelle fut leur origine ; on sait seulement qu’ils y étaient déjà lorsque les Européens firent la découverte de ces îles. Mais, quoiqu’ils vivent à une grande distance les uns des autres, quoique quelques-uns soient placés sous l’équateur, que d’autres vivent dans un climat tempéré, et d’autres sous un climat comparativement froid, on n’a observé entre eux aucune différence de couleur. Les habitants de l’île de l’Amirauté, sous le deuxième degré onze minutes quarante-cinq secondes de latitude australe [31] ; ceux de l’île Bouka, sous le cinquième degré trente secondes de la même latitude [32] ; ceux des îles Salomon, entre le huitième et le dixième degré [33] ; ceux de l’île des Lépreux, sous le quatorzième [34] ; ceux des Nouvelles-Hébrides, sous le dix-huitième [35] ; et ceux de la Nouvelle-Calédonie, entre le vingtième et le vingt-deuxième [36], ont une couleur uniforme et qui approche de celle des nègres ; ils ont comme eux les cheveux crépus ou laineux, quoique les îles sur lesquelles ils sont placés, rafraichies par les vents, se trouvent sous des températures différentes.
Les habitants de l’île de Van-Diemen, placés sous une latitude beaucoup plus élevée, entre le quarante-et-unième et le quarante-troisième degré de latitude australe, sont noirs, et ont les cheveux aussi crépus que ceux de l’île de Bouka, qui ne sont placés que sous le cinquième degré de latitude, ou même que ceux des nègres de Guinée [37]. On peut difficilement supposer cependant que ce peuple est venu de la Nouvelle-Hollande, puisque ceux qui habitent ce continent sont d’une couleur moins foncée, et différent de lui sous une multitude d’autres rapports.
« L’exclusion de tous les rapports entre les peuples de la terre de Diemen et ceux de la Nouvelle-Hollande, dit un savant naturaliste qui les a visités ; la couleur plus foncée des Diemenois, leurs cheveux courts, laineux et crépus, dans un pays beaucoup plus froid que la Nouvelle-Hollande, m’ont paru de nouvelles preuves de l’imperfection de nos systèmes sur les communications des peuples, leurs migrations, et l’influence des climats sur l’homme [38].
« De toutes les observations qu’on peut faire en passant de la terre de Diemen à la Nouvelle-Hollande, ajoute le même voyageur, la plus facile sans doute, la plus importante et peut-être aussi la plus inexplicable, c’est la différence absolue des races qui peuplent chacune de ces deux terres. En effet, si l’on en excepte la maigreur des membres, qui s’observe également chez les deux peuples, ils n’ont presque rien de commun, ni dans leurs mœurs, leurs usages, leurs arts grossiers, ni dans leurs instruments de chasse ou de pêche, leurs habitations, leurs pirogues, leurs armes, ni dans leur langue, ni dans l’ensemble de leur constitution physique ; la forme du crâne, les proportions de la face, etc. Cette dissemblance absolue se reproduit dans la couleur ; les indigènes de la terre de Diemen sont beaucoup plus bruns que ceux de la Nouvelle-Hollande. Elle se reproduit même dans un caractère que tout le monde s’accorde à regarder comme le plus important de ceux qui servent à distinguer les diverses races de l’espèce humaine ; je veux parler de la nature des cheveux : les habitants de la terre de Diemen les ont courts, laineux et crépus ; ceux de la Nouvelle-Hollande les ont droits, longs et raides [39].
« Comment concevoir qu’une île de soixante lieues au plus, qui se trouve repoussée jusqu’aux confins de l’hémisphère oriental, et séparée de toute autre terre connue par des distances de cinq, huit, douze et même quinze cents lieues, puisse avoir une race d’hommes absolument différente de celle du vaste continent qui l’avoisine ? Comment concevoir cette exclusion de tous rapports, si contraire à nos idées sur les communications des peuples et sur leurs transmigrations ? Comment expliquer cette couleur plus foncée, ces cheveux crépus et laineux dans un pays beaucoup plus froid [40] ? »
Tous les individus classés sous le nom d’espèce ou de variété éthiopienne, conservent donc, sous tous les climats et dans toutes les températures, la couleur qui est un de leurs caractères distinctifs. On ne voit, dans aucun pays, des individus de cette espèce prendre la physionomie ou engendrer des enfants qui appartiennent à quelqu’une des autres. Leurs traits et leur physionomie restent aussi invariables sous les latitudes les plus élevées, que les traits et la physionomie propres à l’espèce caucasienne sous la zone torride [41].
[II-82]
L’espèce américaine ou cuivrée, quoique moins nombreuse que la plupart des autres, est répandue sur un territoire plus vaste que celui sur lequel se trouvent les autres espèces : elle occupe un million et demi de lieues carrées, depuis les îles de la terre de Feu jusqu’au fleuve Saint-Laurent et au détroit de Béring. Ainsi, on la trouve dans des contrées que leur éloignement de l’équateur rend presque glaciales ; dans les montagnes les plus élevées et par conséquent les plus froides, comme dans les vallées les plus profondes, exposées au soleil le plus ardent. Si le teint, qui est un des caractères distinctifs des espèces ou variétés, était un effet du froid ou de la chaleur du climat, on trouverait en Amérique des peuplades de toutes les nuances, depuis le blanc le plus éblouissant jusqu’au noir le plus foncé. Mais les faits sont ici peu d’accord avec un tel système : les variations de couleur qu’on observe parmi les peuplades américaines, n’ont aucun rapport avec la température dans laquelle ces peuplades se trouvent. Sous toutes les latitudes et à tous les degrés d’élévation, elles portent la couleur qui distingue leur espèce, celle du cuivre plus ou moins foncée, depuis le rouge jusqu’au brun [42].
Les habitants de la terre de Feu, exposés, pendant tout le cours de l’année, au froid le plus rigoureux, et les Patagons, qui sont leurs plus proches voisins, sont d’une couleur cuivrée ou approchant de la rouille de fer mêlée d’huile [43]. Tous les peuples qui habitent depuis l’extrémité australe de l’Amérique jusqu’au centre de la zone torride ont une couleur semblable [44]. Les peuplades qui habitent à l’autre extrémité du même continent, sont d’une teinte aussi foncée que celles qui sont placées sous l’équateur : la couleur de leur peau, dit Hearne, est celle du cuivre foncée [45]. Les voyageurs qui ont parcouru ces immenses contrées dans toutes les directions, en ont porté le même témoignage [46].
Il existe cependant quelques variations de couleur parmi ces peuples ; mais ces variations n’ont aucun rapport avec le plus ou moins de chaleur du climat. Dans le Canada, les Mississaguis qui habitent sur les bords du lac Ontario, sont d’une couleur plus foncée que les peuplades plus rapprochées du sud. Leur peau, dit un voyageur, est d’une teinte plus noire que celle d’aucunes nations indiennes que j’aie rencontrées ; quelques-uns ressemblent à des nègres par la couleur [47]. Les Californiens, qui habitent sous un climat tempéré, ont le teint plus foncé que les Mexicains, ou que d’autres peuples qui habitent des pays beaucoup plus chauds [48]. Les Mexicains à leur tour sont plus basanés que les peuples qui habitent les contrées les plus brûlantes de l’Amérique [49]. Le climat exerce si peu d’action sur le teint des peuples de cette espèce, que, lorsque des individus qui habitent différents climats se trouvent ensemble, il est impossible de déterminer, par la couleur, le pays de chacun d’eux [50].
Cependant, au milieu de cette multitude de peuplades au teint cuivré, qui sont répandues sur le continent américain, il s’en trouve quelques-unes dont le teint est très peu foncé, et qui, par la couleur, par les traits, et même par le langage, semblent appartenir à une espèce différente. On trouve dans le Canada, à côté de peuplades qui sont presque noires, d’autres peuplades dont le teint n’est pas plus foncé que celui des habitants de l’Espagne ou du midi de la France. On trouve aussi sur la côte nord-ouest du même continent, des peuples qui n’ont pas le teint plus basané que les paysans de France, qui ont des traits européens, et dont les enfants naissent blancs [51].
Ces différences, entre les peuples d’un même continent, nous expliquent comment Volney a pu trouver en Amérique des raisons pour croire à l’unité du genre humain. N’ayant vu qu’un petit nombre d’individus appartenant à la même peuplade, ayant observé qu’un de ces individus n’avait pas le teint plus foncé que les paysans du midi, et ayant appris de lui que leurs enfants naissaient aussi blancs que ceux de la race caucasienne, que cet Américain n’avait probablement jamais vus, il a pensé que tous les indigènes de l’Amérique étaient semblables, et que leur teint prétendu cuivré n’était qu’un effet du climat.
« Si, comme la physique le démontre, dit-il, il n’y a de couleur que par la lumière, il est évident que les diverses couleurs des peuples ne sont dues qu’à diverses modifications de ce fluide avec d’autres éléments qui agissent sur la peau, et qui même la composent. Tôt ou tard il sera démontré que le noir des Africains n’a pas d’autre origine [52]. »
Isaac Weld, que j’ai précédemment cité, a trouvé dans le Canada des peuplades semblables à celle dont Volney a observé quelques individus ; mais il en a trouvé aussi, sous la même latitude, de couleur de cuivre très foncée. Il a observé des enfants nés d’individus d’espèce cuivrée, et il s’est convaincu qu’ils portaient, en venant au monde, les caractères qui distinguent leurs parents. Il lui a paru évident que ces peuples doivent à la nature les différentes nuances qui les caractérisent. « Je me suis formé cette opinion, dit-il, après avoir observé que les enfants nés de parents dont le teint était obscur, l’ont aussi obscur [53]. » Les enfants de l’espèce cuivrée ressemblent si peu, à leur naissance, aux enfants de l’espèce caucasienne, que lorsqu’un enfant né d’une femme cuivrée était présenté au baptême, les missionnaires distinguaient, au premier aspect, si le père appartenait à l’une ou à l’autre de ces deux espèces [54]. Enfin, M. de Humboldt, qui a fait un long séjour parmi les Américains, et qui les a observés sous diverses latitudes et à divers degrés d’élévation, s’est convaincu qu’ils portent en naissant le teint qui est particulier à l’espèce américaine.
« Je n’ai pas vu, dit-il, les nations du Canada dont parle le chef des Miamis (observé par Volney) ; mais je puis assurer qu’au Pérou, à Quito, sur la côte de Caracas, sur les bords de l’Orénoque et au Mexique, les enfants ne sont jamais blancs en naissant, et que les caciques indiens, qui jouissent d’une certaine aisance, qui se tiennent vêtus dans l’intérieur de leurs maisons, ont toutes les parties de leur corps (à l’exception de l’intérieur de leurs mains et de la plante des pieds) d’une même teinte rouge, brunâtre ou cuivrée [55]. »
[II-88]
Les nombreuses observations que M. de Humboldt a faites sur le continent américain, l’ont convaincu que la couleur particulière aux indigènes de ce continent, n’est pas susceptible d’être changée par l’influence des climats, et qu’elle tient à des dispositions organiques qui, depuis des siècles, se propagent de génération en génération [56].
« L’effet de cette influence, dit-il, paraît presque nul chez les Américains et chez les Nègres. Ces races, dans lesquelles le carbure d’hydrogène se dépose abondamment dans le corps muqueux ou réticulaire de Malpighi, résistent singulièrement aux impressions de l’air ambiant. Les nègres des montagnes de la haute Guinée, ne sont pas moins noirs que ceux qui avoisinent les côtes [57]. »
[II-89]
Les Malais sont, de toutes les espèces, celle qui présenté le moins de variétés. Répandus dans toutes les parties du grand Océan, ils occupent, depuis la Nouvelle-Zélande jusqu’aux îles Sandwich, une étendue de soixante degrés de latitude ou de douze cents lieues ; et, depuis l’île de Pâques jusqu’aux Nouvelles-Hébrides, une étendue de quatre-vingt-trois degrés de longitude, ou de seize cents soixante lieues de l’est à l’ouest ; c’est de toutes les espèces celle qui est répandue sur la surface la plus étendue. Toutes les peuplades qui appartiennent à cette espèce parlent des dialectes de la même langue, et, à quelques exceptions près, cultivent les mêmes végétaux, élèvent les mêmes animaux, pratiquent les mêmes arts, observent la même religion, et ont à peu près le même teint ; il n’existe de différences entre eux que celles qui sont le produit d’un peu plus ou d’un peu moins de civilisation.
La couleur qui distingue cette espèce, varie depuis une légère teinte tannée, comme celle des Espagnols, jusqu’au brun foncé approchant du noir. Les habitants de la Nouvelle-Zélande n’ont pas tous le même teint ; quelques-uns sont jaunâtres ou olive ; d’autres sont d’une couleur très foncée, sans être cependant aussi noirs que les indigènes de l’île de Van-Diemen [58]. Les habitants de l’île de Pâques ont le teint basané, mais moins foncé que ceux de la Nouvelle-Hollande, quoique beaucoup plus rapprochés de l’équateur [59]. Le teint des habitants des îles des Amis, varie selon que les individus s’exposent plus ou moins à l’action du soleil. Chez le plus grand nombre, le teint est plus foncé que le cuivre brun ; plusieurs ont le teint jaunâtre, et quelques femmes approchent de la couleur des Européens [60]. Ceux de ces peuples qui ont le teint le plus clair, sont ceux qui sont les plus rapprochés de l’équateur ; ce sont les habitants des îles Marquises [61].
Le teint olivâtre qui caractérise les individus d’espèce mongole, se conserve sous toutes les latitudes et à tous les degrés d’élévation, comme le teint cuivré de l’espèce américaine. Ceux d’entre les Perses dont la couleur n’a pas été altérée par leur mélange avec des individus d’espèce caucasienne, ont le teint très foncé. Ceux qui habitent sous le climat le plus chaud, ne sont pas différents de ceux qui habitent les climats froids des montagnes : les uns comme les autres ont le teint mêlé de jaune et de noir [62]. Les Chinois répandus sur un territoire immense ont généralement le teint brun et sale des peuples de Perse [63].
Les Mongols que La Pérouse observa dans la baie de Castries, sous le cinquante-et-unième degré vingt et une minutes de latitude boréale, avaient la peau olivâtre et vernissée d’huile et de fumée [64]. Enfin, les peuples placés le plus près du pôle septentrional, dans le continent américain, et appartenant à la même espèce, ont le même teint que ceux qui habitent le centre de l’Asie [65].
Les diverses couleurs propres à chaque espèce sont donc indépendantes de toute cause artificielle et de l’action de la lumière et de la chaleur. Si, par des moyens artificiels ou par l’action d’un soleil plus ou moins brûlant, on peut modifier le teint des individus de certaines espèces, ces modifications n’affectent jamais leurs descendants ; elles périssent avec les individus qui les ont éprouvées, et cessent même souvent avec l’action des causes qui les ont produites.
[II-94]
CHAPITRE V.↩
De l’influence attribuée à l’action des climats sur la production des diverses espèces ou variétés d’hommes. — Des invasions des peuples de diverses espèces sur le territoire les uns des autres, et de la confusion qui en est résultée.
Mais ce n’est pas seulement par la couleur du teint que les diverses espèces ou variétés d’hommes diffèrent les unes des autres ; il existe entre elles un certain nombre de différences qui suffiraient pour les caractériser, quand même elles se ressembleraient par la couleur. Ces différences ne peuvent pas être produites par des moyens artificiels employés par les hommes sur eux-mêmes ; mais ne peuvent-elles pas l’être par l’action des climats ? En d’autres termes, les caractères particuliers à chaque espèce sont-ils les mêmes sous toutes les latitudes ? Si ces caractères varient, les variations doivent-elles être attribuées à la différence des climats ?
Pour résoudre ces questions, il ne faut pas comparer les individus d’une espèce aux individus d’une autre espèce ; il faut comparer entre elles les diverses nations entre lesquelles chaque espèce se subdivise. Les différences qui existent parmi quelques-unes d’entre elles sont très nombreuses, et on est bien loin de les avoir observées toutes. Aussi n’ai-je ici pour but que de m’occuper de celles qui ont le plus d’importance ou qui indiquent un entendement plus ou moins susceptible de développement.
L’espèce caucasienne s’est répandue sur le globe dans toutes les directions ; on la rencontre sur tous les continents et sous toutes les latitudes. Elle occupe presque exclusivement l’Europe, car le territoire habité par les Lapons et par les Finnois mérite à peine d’être compté. Elle s’est répandue d’Europe dans toutes les autres parties du monde ; les Français, les Anglais, les Hollandais, les Espagnols et les Portugais occupent le continent américain et les îles qui l’avoisinent, depuis la baie d’Hudson jusqu’au Rio-Négro. Dans chacune des parties de ce continent, tous ont conservé non seulement la couleur particulière à leur espèce, mais tous les traits principaux qui la caractérisent. Les Français, les Hollandais, les Anglais et les Portugais se sont également répandus sur les côtes d’Afrique depuis le Sénégal jusqu’au cap de Bonne-Espérance. Les traits distinctifs de leur espèce sont restés invariables comme la couleur. Les descendants des Hollandais n’ont pris au Cap aucun trait de ressemblance avec les Hottentots, les Boschismans ou les Cafres. Les descendants des Portugais, sur le canal de Mozambique, et les descendants des Français, dans l’Ile de France, n’ont pas pris davantage les traits des peuplades qui habitent la côte orientale d’Afrique. Les Maures et les Arabes ont conservé sur ce continent tous les traits particuliers à leur espèce. Les Anglais établis dans l’Hindoustan, les Hollandais établis aux Moluques, les Espagnols aux Philippines, n’ont pris aucun des caractères de l’espèce mongole ou de l’espèce malaie. Enfin, les caractères particuliers à l’espèce mongole ont fini par disparaître chez les Perses qui se sont alliés constamment à des femmes d’espèce caucasienne. L’influence de l’espèce s’est montrée supérieure à l’influence attribuée au climat.
Les peuples chez lesquels les traits qui caractérisent l’espèce caucasienne sont les plus marqués, sont ceux qui habitent les montagnes du Caucase. Les peuples chez lesquels les traits propres à l’espèce mongole sont les plus prononcés, sont ceux qui habitent au centre de l’Asie. C’est particulièrement chez eux qu’on observe des hommes ayant le visage plat, large et carré, les yeux petits et placés diagonalement, la bouche grande, le nez écrasé, la tête volumineuse, le col peu allongé, les cheveux noirs, grossiers et lisses, la taille courte et ramassée. Ces traits n’ont pas plus cédé à l’influence des climats que le teint jaunâtre ou basané qui appartient aux mêmes peuples ; ils sont les mêmes dans les provinces les plus rapprochées de l’Hindoustan que dans les montagnes du nord [66]. Ils sont les mêmes dans toute l’étendue de la Chine [67], sur les côtes orientales de l’Asie [68], dans les îles qui en sont voisines [69], au Kamtchatka [70], dans les îles des Renards [71], et dans le nord de l’Amérique [72]. La nubilité est plus précoce chez les femmes d’espèce mongole que chez les femmes des autres espèces ; elle se manifeste depuis neuf ans jusqu’à douze. Ce caractère, qu’on a attribué à la chaleur du climat, parce qu’on l’a d’abord observé dans le sud de l’Asie, existe dans les climats les plus froids comme dans les plus chauds. On le retrouve à la côte nord-ouest de l’Amérique, chez les Esquimaux ; et en Asie chez les Kamtchadales et chez les Korockas, où des filles de dix ans sont souvent mères [73].
Les peuples que les naturalistes ont classés sous la dénomination d’espèce ou de variété éthiopienne diffèrent tellement les uns des autres, que, si on ne les caractérise pas par la couleur, il est très difficile de leur trouver des traits communs, et de déterminer par conséquent les caractères généraux qui les distinguent. L’histoire ni la tradition ne nous ayant jamais fait connaître les migrations d’aucun de ces peuples ; tous, depuis qu’ils nous sont connus, étant restés attachés au sol qu’ils occupent aujourd’hui ou ne s’étant déplacés du moins que pour se transporter à de petites distances, nous n’avons aucun moyen de déterminer si les différences qui les distinguent sont ou ne sont pas le produit du climat. Il est vrai qu’en faisant le trafic des esclaves, les Européens sont parvenus à former des colonies de nègres loin du continent de l’Afrique. Mais il est résulté de la manière dont ces colonies ont été formées, un mélange de races qui ne permet plus de reconnaître quelle a été l’origine de la population nègre actuelle. Les effets produits par ces transmigrations forcées ont été d’ailleurs trop peu observés, pour qu’on puisse se flatter de les connaître et surtout d’en assigner les causes. On se trouve donc réduit à raisonner sur des conjectures ou des analogies.
Nous avons vu que la couleur des variétés nègres n’est point susceptible d’être modifiée par la température de l’atmosphère, et nous n’avons aucune raison de croire que les autres caractères particuliers à ces peuples soient plus susceptibles de modification. Nous devons penser, au contraire, que ces caractères ne peuvent être changés par une telle cause, lorsque nous voyons que toutes les autres espèces conservent les traits qui leur sont propres, sous tous les climats. Si les descendants des Européens établis au cap de Bonne-Espérance, par exemple, ne prennent aucun des traits particuliers aux Boschismans ; si les Mongols établis au nord de l’Amérique ne prennent pas les traits qui distinguent l’espèce américaine ; si les Malais, dans les îles de la Sonde, ne prennent ni les traits de l’espèce africaine, ni ceux de l’espèce mongole [74], quelles raisons pourrions-nous avoir de penser que les nègres du Congo transportés au cap de Bonne-Espérance y deviendraient des nains semblables aux Boschismans, ou que les Boschismans transportés au Congo y prendraient une taille colossale ? Les Cafres, si remarquables par leur haute stature, par la beauté de leurs proportions, par la régularité de leurs traits, ne sont éloignés que d’une petite distance des Boschismans, dont la taille n’excède pas quatre pieds, et dont la conformation nous paraît monstrueuse. Est-il quelque raison qui puisse nous déterminer à croire que, si ces deux peuples prenaient la place l’un de l’autre, en conservant leur même genre de vie, ils changeraient aussi de proportions par le seul effet du climat ?
[II-100]
Si les traits qui distinguent l’espèce nègre de l’espèce caucasienne étaient le produit du climat, les Hottentots du Cap seraient de tous les peuples africains ceux qui se rapprocheraient le plus des Européens, et cette ressemblance s’affaiblirait à mesure qu’on s’avancerait vers la zone torride ; mais ce n’est pas ce qui arrive : des peuples qui vivent sous un climat beaucoup plus chaud que celui qu’habitent les Hottentots, se rapprochent beaucoup plus qu’eux des peuples du Caucase. Les Cafres diffèrent si peu de nous par les traits, qu’un voyageur les a cru descendus des Arabes bédouins [75]. Les mêmes traits se retrouvent chez d’autres tribus africaines qui habitent un climat encore plus chaud :
« Je ne crains pas d’avancer, dit Dauxion-Lavaisse, que malgré la similitude de la couleur des nègres, il y a beaucoup de variété dans la forme des têtes des diverses nations ou tribus, et que les Mandingues, les Koromantins et les Mozambiques, par exemple, ont la tête d’une aussi belle forme que l’Européen, et le reste du corps aussi beau et aussi fort. Si jamais on fait une collection de crânes de ces trois nations, je ne crains pas de prédire qu’on en trouvera beaucoup dont l’angle facial dépassera quatre-vingts degrés [76]. »
[II-101]
En s’avançant davantage vers l’équateur, des phénomènes plus remarquables se présentent : ce sont des peuples nombreux qui se composent de trois espèces ou variétés très distinctes, de noirs, de basanés et de blancs. Les hommes des deux dernières espèces ont les traits aussi fins que les peuples d’Europe, quoique placés presque au-dessous de l’équateur [77].
Les peuples noirs qui habitent dans plusieurs îles du grand Océan, ne sont pas tous sous la même latitude ; les traits des uns se rapprochent plus que les traits des autres des caractères qu’on croit plus particuliers à l’espèce éthiopienne ; mais ces traits ne sont pas plus prononcés chez ceux qui sont le plus près de l’équateur que chez ceux qui en sont le plus éloignés ; on a vu, au contraire, que les habitants de l’île de Van-Diemen ont les cheveux laineux des noirs, tandis que ceux de la Nouvelle-Hollande, placés sous un climat plus chaud, ont les cheveux longs et lisses ; les habitants de la Nouvelle-Calédonie, quoique plus rapprochés de l’équateur que ceux de l’île de Van-Diemen d’environ vingt-un degrés, et paraissant, par la couleur et la nature des cheveux, appartenir à la même espèce, sont bien faits, forts et robustes, et ont, pour la plupart, les traits plus réguliers [78] ; tandis que ceux des Nouvelles-Hébrides, qui ne sont avancés que de deux degrés de plus que ceux de la Nouvelle-Calédonie, sont petits, ont les bras et les jambes longues et grêles, le nez large et plat, les os des joues proéminents, le front très court et quelquefois extrêmement comprimé, et ressemblent à des singes [79] ; les habitants des îles Salomon, ont des traits moins irréguliers, quoique placés sous un climat plus ardent [80] ; enfin, les habitants de l’île de l’Amirauté diffèrent peu des Européens par la physionomie, quoique par la nature des cheveux et par la couleur du teint, ils appartiennent à l’espèce nègre [81].
Il résulte de ces faits que les peuples classés sous la dénomination d’espèce ou de variété éthiopienne, se subdivisent en un très grand nombre de variétés, qui diffèrent considérablement les unes des autres ; que, si la couleur qui est commune à toutes existe indépendamment du froid ou de la chaleur qu’elles éprouvent, les autres traits qui les caractérisent sont également indépendants du climat ; que, par conséquent, l’histoire naturelle ne fournit aucune raison pour faire croire que ces peuples ont une origine commune, je ne dis pas avec les individus d’espèces caucasienne, mongole, américaine ou malaie, mais même avec les tribus de nègres qui peuplent l’Afrique. Ces peuples qui sont répandus sur le grand Océan, et qu’on trouve également noirs sous tous les degrés de latitude, ne diffèrent pas seulement des peuples d’espèce malaie au milieu desquels ils habitent, par la couleur, les cheveux et les proportions du corps ; ils diffèrent d’eux surtout par la langue, par les usages, par les mœurs, par le degré de civilisation. Quoique souvent très rapprochés les uns des autres, ils paraissent n’avoir jamais eu de communication ensemble ; tandis qu’au premier aspect on reconnaît les habitants des îles Sandwich, ceux de la Nouvelle-Zélande, ceux de l’île de Pâques et ceux de l’île de Sumatra pour appartenir à la même espèce, quoique les premiers soient éloignés des seconds de soixante degrés ou onze cents lieues, et que les troisièmes soient séparés des quatrièmes par une distance de cent cinquante degrés, près de la moitié de la circonférence de la terre.
Les peuples d’espèce américaine diffèrent les uns des autres par une teinte plus ou moins foncée, par une taille plus ou moins élevée, et surtout par le langage ; mais sous tous les autres rapports, il existe entre eux une si grande ressemblance, que, suivant Ulloa, lorsqu’on a vu un Indien de quelque contrée que ce soit, on peut dire qu’on les a vus tous [82]. M. de Humboldt a trouvé de l’exagération dans cette assertion sur la similitude des formes ; mais il a été frappé néanmoins de l’air de famille qui existe chez tous ces peuples, quel que soit le climat sous lequel ils vivent. Sur un million et demi de lieues carrées, dit-il, depuis les îles de la terre de Feu, jusqu’au fleuve Saint-Laurent et au détroit de Béring, on est frappé au premier abord de la ressemblance que présentent les traits des habitants. On croit reconnaître que tous descendent d’une même souche, malgré l’énorme différence des langues, et la distance qui les éloigne les uns des autres [83]. Il faut bien que cette ressemblance de famille soit frappante, puisqu’en lisant les diverses relations de voyages faits sur les côtes ou dans l’intérieur de ce continent, on trouve que tous les voyageurs ont attribué aux indigènes à peu près les mêmes caractères [84].
[II-105]
Les peuples d’espèce cuivrée répandus sur la surface du continent américain, habitent sous toutes les zones, depuis la zone torride jusqu’à la zone glaciale ; cependant leurs traits comme leur couleur restent invariables. Les variations qu’il est possible d’apercevoir entre eux, n’ont aucun rapport avec le plus ou moins de chaleur qu’ils éprouvent. Ce n’est donc pas à la chaleur du climat qu’il est possible d’attribuer les différences qu’on observe entre les hommes de l’espèce cuivrée et les hommes des autres espèces. Depuis que les Européens se sont établis sur le continent d’Amérique, et qu’ils y ont porté des hommes d’espèce éthiopienne, les Américains ne sont pas devenus plus semblables aux hommes de ces deux espèces, que ceux-ci ne sont devenus semblables aux Américains. Chaque espèce, si elle n’a pas été modifiée par des alliances, a conservé tous les caractères qui lui sont propres.
Les peuples d’espèce malaie sont ceux qui, par leur constitution physique, se rapprochent le plus des individus d’espèce caucasienne. Les variations qu’on observe chez eux portent particulièrement, comme celles que nous avons observées chez les peuples d’espèce américaine, sur la taille, et sur le teint que les uns ont un peu plus foncé que les autres. Les traits varient d’un individu à un autre comme chez les Européens ; mais les différences qui existent entre eux n’ont aucun rapport avec la température du climat. Dans la Nouvelle-Zélande, à l’île de Pâques et dans les îles Marquises, on trouve également des individus qui ont des traits européens et des cheveux noirs, châtains, lisses et bouclés. Suivant un voyageur, la face des habitants de l’île de Pâques ne diffère de celle des Européens que par la couleur, et il ne manque aux femmes que le teint pour être belles, dans le sens que nous attachons à ce mot [85]. Les habitants des îles Marquises, beaucoup plus rapprochés de l’équateur, ne diffèrent d’eux et de ceux de la Nouvelle-Zélande, que par une plus grande régularité dans leurs traits. Ils ont le cou long et d’une belle forme, de beaux yeux grands et noirs, de belles dents, et toutes les parties du corps bien proportionnées. Les femmes, dit Krusenstern, sont en général très belles ; leur tête surtout est admirable ; elles l’ont bien proportionnée ; le visage plutôt rond qu’ovale, de grands yeux brillants, le teint fleuri, de très belles dents, et des cheveux qui bouclent naturellement [86]. Ces peuples sont exactement sous la même latitude que les nègres des îles Salomon.
Aucune des espèces que nous avons observées ne dévie donc des traits qui les distinguent, ni par des moyens artificiels, tels que des peintures, des compressions, des mutilations, ni par le moyen du froid ou de la chaleur ; sous toutes les latitudes et à tous les degrés d’élévation, les individus transmettent à leurs descendants les caractères distinctifs de leur espèce particulière. Les sciences ne nous ont point appris, et probablement elles ne nous apprendront jamais si les principales races que nous connaissons appartiennent à autant d’espèces primitives, ou si elles sont dérivées d’une espèce unique. Elles ne peuvent encore moins nous apprendre si l’espèce unique que l’on supposerait avoir existé, était semblable à telle espèce que nous connaissons plutôt qu’à telle autre ; si, par exemple, les Éthiopiens sont des Caucasiens dégénérés, ou si les Caucasiens sont des nègres qu’une bizarrerie de la nature a rendus blancs. Les naturalistes divisent en plusieurs espèces tous les autres genres d’animaux et se mettent peu en peine de nous persuader que toutes les espèces qu’ils classent sous le même genre, sont ou non dérivées d’une seule. Ils trouvent dans les variations qu’ils observent parmi certains animaux domestiques, comme les chats, les chiens, les lapins et les ânes, des raisons de croire à l’unité du genre humain. Mais celui qui chercherait chez d’autres animaux, chez les singes, par exemple, des raisons de croire à la pluralité des espèces parmi les hommes, leur paraîtrait un mauvais raisonneur. Ceux mêmes qui n’admettent pas que des questions d’histoire naturelle ou d’astronomie puissent être toujours bien résolues par des connaissances théologiques, ne peuvent se résoudre à ignorer ce que les sciences ne sauraient leur apprendre. Leur orgueil se révolte à la pensée que le genre humain a pu se composer d’autant d’espèces primitives que nous comptons de variétés ; et que leur espèce, unique dans l’univers, n’a pas donné naissance à toutes les autres.
En exposant les caractères physiques qui sont particuliers à chaque race, et en examinant si ces caractères ont été produits par des moyens artificiels ou par l’influence des climats, je ne me suis point proposé de rechercher s’il a existé plusieurs espèces primitives, ou s’il n’en a existé qu’une seule. Cette question, que je ne crois pas susceptible d’être résolue par les sciences naturelles, et qui par conséquent n’est point, à mes yeux, une question philosophique, est étrangère à l’objet que je me propose. Ce que je veux, c’est de rechercher si les hommes de toutes les races sont également susceptibles de perfectionnement ; si les mêmes causes produisent sur toutes des effets semblables, ou si elles peuvent arriver aux mêmes résultats par les mêmes moyens ; c’est de rechercher particulièrement quels sont les effets qui résultent de la domination d’une espèce sur l’autre, du mélange de plusieurs sur le même territoire, et surtout de leurs alliances.
Cette question sur le mélange des espèces, et sur la domination des unes sur les autres, serait peut-être peu importante, si la terre était restée partagée entre elles selon les lois que la nature semblait avoir elle-même établies ; si les peuples d’espèce cuivrée avaient conservé la possession exclusive du continent américain ; si les peuples d’espèce mongole ne s’étaient pas troublés mutuellement dans la possession de leurs territoires, et surtout s’ils n’avaient jamais dépassé les frontières de l’Asie ; si les peuples d’espèce malaie n’avaient jamais été inquiétés dans la possession des îles du grand Océan ; si l’espèce éthiopienne était restée maîtresse exclusive de l’Afrique ; enfin, si l’espèce caucasienne, maîtresse de l’Europe, n’en était jamais sortie et n’y avait jamais été troublée.
Mais les Mongols, du centre de l’Asie, ont débordé de toutes parts et sont allés aussi loin que leurs chevaux ont pu les conduire : non seulement ils ont porté leur domination sur tous les autres peuples qui appartiennent à la même espèce qu’eux-mêmes ; ils l’ont portée même chez les peuples d’espèce caucasienne et se sont confondus avec eux. Les peuples d’espèce caucasienne à leur tour, en même temps qu’ils ont cherché à dominer les uns sur les autres, se sont répandus sur toutes les parties de la terre, et se sont mêlés avec les peuples de toutes les autres espèces. En Afrique, ils ont établi leur domination sur les côtes de la Méditerranée et de la mer Rouge, sur les bords du Sénégal, au cap de Bonne-Espérance, sur le canal de Mozambique et dans les îles qui en sont voisines. En Asie, ils se sont mêlés avec les Perses, ils se sont établis dans l’Hindoustan et dans les îles innombrables qui se trouvent entre la Nouvelle-Hollande et le continent asiatique. Là on trouve réunis sur le même sol des Nègres, des Mongols, des Malais et des Caucasiens, ayant chacun leur couleur, leur physionomie, leurs mœurs, leur langue, leur croyance. Dans le grand Océan leur domination se fait déjà sentir par leur établissement sur l’île de Van-Diemen, dans la Nouvelle-Hollande et dans les îles Sandwich, et il ne faut pas douter qu’ils ne finissent par se mêler avec les peuples d’espèce malaie.
Mais, de tous les mélanges d’espèces, le plus important et le plus digne d’observation est celui qui, depuis plus de trois siècles, s’opère sur le continent et sur les îles d’Amérique. Les peuples d’espèce caucasienne, tels que les Français, les Anglais, les Hollandais, les Espagnols et les Portugais, ne se sont pas bornés à s’établir sur les terres déjà occupées par les peuples d’espèce cuivrée, depuis le Canada jusqu’aux pampas de Buenos-Aires ; ils ont transporté sur le même sol des multitudes d’individus d’espèce éthiopienne, et plusieurs d’espèce malaie. Les peuples d’espèce cuivrée qui se trouvent au nord de l’Amérique septentrionale, ne peuvent compliquer beaucoup l’état de l’espèce caucasienne, car le nombre en diminue d’une manière sensible. Mais il n’en est pas de même des peuples d’espèce éthiopienne qui se trouvent dans les îles ou dans la partie méridionale des États-Unis ; leur nombre, loin de décroître, se multiplie au contraire dans une proportion plus grande que celle dans laquelle se multiplient les Européens. Dans l’Amérique méridionale et à l’extrémité australe de l’Amérique du Nord, les individus d’espèce cuivrée, déjà fort nombreux, se sont multipliés depuis la conquête. Le mélange de ces peuples avec des Européens, des noirs et des malais, a produit des variétés nouvelles, et la population de cette partie du monde présente des phénomènes dont l’état de l’Europe ne peut nous donner aucune idée. [87]
[II-112]
Tant que l’Amérique n’a été considérée que comme un vaste domaine exploité au profit des Européens, il est naturel que les faits qui avaient lieu sur ce continent et qui n’avaient aucun rapport au commerce, aient peu fixé l’attention des observateurs. Mais tout est bien changé depuis que l’Amérique du Nord a fait reconnaître son indépendance, qu’elle a établi des formes de gouvernement étrangères aux Européens, et que l’Amérique du Sud a suivi son exemple. L’Europe par ses mœurs, ses connaissances, ses arts, ses richesses, en un mot sa civilisation, tient encore le premier rang dans le monde ; mais, lorsque l’on considère la position, l’étendue, la fertilité du continent américain, le nombre et l’étendue des lacs qu’il possède, les rivières et les fleuves immenses qui l’arrosent, la variété et la richesse des produits de son agriculture, et la nature de ses institutions, on peut prévoir qu’il viendra un temps où l’importance relative des peuples d’Europe aura beaucoup diminué. Il n’est donc pas indigne des sciences morales de s’occuper des phénomènes que ce pays leur offre.
L’objet de ces recherches sur le mélange des races et sur la domination des unes sur les autres, est de savoir quels sont les effets que cette domination et ce mélange produisent sur la constitution physique et sur les facultés intellectuelles et morales de l’ensemble de la population qui en résulte. Mais, pour apprécier ces effets, il faut les distinguer de ceux qu’on a attribués à des causes sur lesquelles la volonté de l’homme a moins d’influence, je veux parler du climat, des lieux et du cours des eaux.
Nous avons vu, dans ce chapitre, qu’aucun des caractères qui distinguent les espèces les unes des autres, ne sont produits ni par le climat ni par aucun moyen artificiel. Mais, quoique le climat ne produise aucune déviation dans les espèces, on conçoit qu’il pourrait diminuer ou accroître les forces physiques des individus, affaiblir ou fortifier leurs facultés intellectuelles, irriter ou calmer leurs passions, sans leur faire perdre aucun des caractères qui sont propres à leur espèce. J’examinerai cette question en exposant quelle est l’influence qu’exercent les choses dont les hommes sont de toutes parts environnés, sur la prospérité et la décadence des nations, quelle que soit d’ailleurs l’espèce à laquelle elles appartiennent.
[II-1]
CHAPITRE VI.↩
Des difficultés que présente la question de l’influence des climats sur les facultés humaines. — Exposition du système de Montesquieu sur cette influence. — Vices de ce système.
En exposant quelle est l’influence de la méthode analytique sur la morale et sur les lois des peuples, j’ai fait voir que la simple connaissance des faits et des causes qui les engendrent, peut, dans certaines circonstances, produire le perfectionnement des mœurs et des lois ; et que l’ignorance et les erreurs des hommes sont au nombre des causes les plus puissantes qui produisent les vices et les mauvaises institutions. Si les observations que j’ai faites à ce sujet sont exactes, il s’ensuit que tout peuple dont l’intelligence est susceptible de développement, est susceptible de perfectionner ses mœurs et ses organes physiques, si d’ailleurs les choses qui l’environnent ne mettent pas à ses progrès des obstacles invincibles. Il s’agit donc de savoir si tous les peuples sont capables de concevoir les mêmes vérités ; si tous ont ou peuvent acquérir une capacité suffisante pour apercevoir les liaisons qui existent, en morale et en législation, entre les effets et les causes. En supposant qu’ils aient ou qu’ils puissent acquérir une capacité suffisante, n’existe-t-il pas de causes extérieures capables de paralyser la puissance de la vérité sur leur esprit ?
S’il en est du genre humain comme de tous les genres d’êtres animés, s’il se subdivise en plusieurs espèces, et si elles diffèrent les unes des autres par leur organisation, il n’est pas impossible qu’elles ne soient pas toutes susceptibles du même développement intellectuel, et par conséquent du même perfectionnement moral et physique. Aussi, dans les questions que je viens de poser, mon intention n’est pas de comparer diverses espèces entre elles ; je n’ai pour objet que de comparer entre elles des nations qui sont de même espèce, mais qui se trouvent dans des circonstances différentes, ou qui ne vivent pas sous la même latitude. La question, pour ces nations, est de savoir si, par des circonstances accidentelles de position, elles sont devenues incapables de discerner la vérité de l’erreur, de contracter de bonnes habitudes et d’en perdre de mauvaises ; ou si, ayant en elles-mêmes la capacité de concevoir la vérité, elles ne sont pas arrêtées dans leurs progrès par des circonstances locales.
De fausses religions et des gouvernements vicieux sont des obstacles très puissants au développement des nations ; mais, si une fausse religion et un mauvais gouvernement étaient des obstacles invincibles au perfectionnement des hommes, quel est le peuple qui ne serait pas resté dans une éternelle barbarie ? Car quel est celui qui n’a jamais été soumis à un gouvernement despotique, ou chez lequel on n’a jamais vu régner une religion mensongère ? Il n’est point d’erreur ou de fausse opinion qui n’ait eu un commencement, et qui par conséquent ne puisse être détruite. L’homme, en venant au monde, n’apporte point dans son esprit un système religieux et un système politique tout formés. Les idées de gouvernement et de religion qu’il acquiert, lui sont données à mesure que son entendement se forme, et les circonstances qui président à cette formation peuvent varier à l’infini. Il ne s’agit ici que de rechercher les causes qui agissent constamment sur l’homme, et qu’il n’est pas en son pouvoir de détruire, telles que le climat, la position des lieux, le cours des eaux, la nature du sol et autres semblables. La chaleur du climat, suivant le système de plusieurs écrivains, et la vieillesse des peuples suivant quelques autres, peuvent être des obstacles invincibles au perfectionnement des hommes. En exposant l’état physique, intellectuel et moral des peuples de toutes les espèces, sur les diverses parties du globe, je ferai voir que ces opinions sont loin d’être fondées sur l’exacte observation des faits.
Pour déterminer d’une manière complète quelle est l’influence du climat et des lieux sur le genre humain, il faudrait se livrer à des recherches qui excéderaient de beaucoup les limites que je me suis prescrites, et la nature même de cet ouvrage.
Il faudrait examiner d’abord quelle est l’influence qu’exercent, sur les aliments propres aux diverses espèces d’hommes, la température de l’atmosphère, la nature et l’exposition du sol, la qualité des eaux et même la direction et la force des vents ; il faudrait examiner ensuite quelle est l’influence qu’exercent sur l’homme ses aliments ainsi modifiés. Il faudrait rechercher comment cette influence des aliments est elle-même modifiée par les effets de la culture, du commerce et de l’inégalité des fortunes. Il faudrait examiner de plus quelle est l’action qu’exercent directement sur l’homme la température, la sécheresse ou l’humidité de l’atmosphère, le cours ou la force des vents, et la qualité des eaux. Il faudrait examiner comment cette influence est elle-même modifiée par le plus ou moins de richesse d’un peuple, et par les moyens que cette richesse donne de se soustraire à l’action de la chaleur, du froid, des vents ou des eaux. Enfin, il faudrait déterminer quelle est la part d’influence qui doit être attribuée à la religion, au gouvernement, aux préjugés nationaux, à la nature de la langue, à la diversité des espèces, et aux nations environnantes.
Il est évident que, pour se livrer à ces recherches, il faudrait embrasser non seulement l’histoire naturelle tout entière, mais encore l’histoire physique, morale et politique du genre humain ; et l’on rencontrerait en chemin beaucoup de questions qu’on n’aurait aucun moyen de résoudre. Mais les écrivains qui ont attribué au climat une influence immense sur les lois, sur les religions et sur les mœurs des peuples ; et ceux qui ont prétendu que cette influence est nulle, ne se sont point donné tant de peine. Les uns et les autres n’ont vu dans les climats que l’action de la chaleur ou du froid exercée directement sur les organes de l’homme : c’est cette action dont les uns ont exagéré les effets, et dont les autres ont contesté l’importance.
Montesquieu semble avoir fixé à cet égard l’opinion populaire ; son jugement n’a point entraîné celui de tous les hommes instruits ; de grands écrivains, d’illustres savants n’y ont vu qu’une funeste erreur ; mais cette erreur n’a été détruite ni par les attaques d’Helvétius, ni par les plaisanteries de Voltaire, ni par les raisonnements de Volney ; il est encore un grand nombre de personnes, même parmi les gens instruits, qui considèrent les institutions et les mœurs des peuples comme le produit du climat qu’ils habitent : cette opinion est devenue en quelque sorte un préjugé populaire.
L’opinion de Montesquieu sur les effets du froid et de la chaleur n’est pas née, comme on pourrait le croire, de l’examen approfondi des faits ; c’est un système qu’il a pris de Chardin qui lui-même l’avait emprunté à d’autres, et à l’appui duquel il a rapporté quelques faits, sans beaucoup se mettre en peine si ces faits étaient des conséquences du principe qu’il leur attribuait, ou même s’ils n’étaient pas en opposition avec une multitude de faits contraires. L’identité entre le système de Chardin et celui de Montesquieu est si frappante, même dans les détails, qu’il suffit de les placer l’un à côté de l’autre pour être convaincu que le philosophe n’a rien ajouté au voyageur [88].
Chardin prétend avoir observé dans ses voyages, que la chaleur du climat énerve l’esprit comme le corps ; qu’elle dissipe ce feu d’imagination nécessaire pour l’invention et la perfection des arts ; qu’elle rend incapable de ces longues veilles et de cette forte application qui enfantent les beaux ouvrages dans les arts libéraux et dans les arts mécaniques ; que de là vient que les connaissances des peuples de l’Asie sont si limitées, et qu’elles ne consistent qu’à retenir et à répéter ce qui se trouve dans les livres des anciens ; que leur industrie est brute ; et que c’est dans le septentrion qu’il faut chercher les sciences et les métiers dans la plus haute perfection [89].
« Je trouve toujours, dit ailleurs le même voyageur, la cause ou l’origine des mœurs et des habitudes des orientaux, dans la qualité de leur climat, ayant observé dans mes voyages que comme les mœurs suivent le tempérament du corps, selon la remarque de Galien, le tempérament du corps suit la qualité du climat ; de sorte que les coutumes ou habitudes des peuples ne sont point l’effet du pur caprice, mais de quelques causes ou de quelque nécessité naturelles qu’on ne découvre qu’après une exacte recherche [90]. »
En adoptant ce système, Montesquieu n’a cependant pas voulu s’en rapporter aveuglément à l’opinion de Chardin ; il a soumis cette opinion à l’épreuve des faits, et l’expérience, d’après laquelle il l’a jugée, est d’une nature si extraordinaire, qu’elle serait incroyable s’il ne l’avait pas lui-même consignée dans l’Esprit des Lois. Le jurisconsulte philosophe a pris la moitié d’une langue de mouton ; il l’a soumise alternativement à une température chaude, et à une température froide jusqu’à la glace ; il a examiné, à l’aide d’une loupe, les effets produits par le froid et par le chaud, sur cette moitié de langue, et ces effets lui ont servi à déterminer l’influence que le froid et la chaleur exercent sur le physique et sur le moral de l’homme, dans toutes les parties de notre globe. Voici quels sont les résultats de cette singulière expérience.
Par le seul effet de la température, l’homme du nord a un plus grand corps, et par conséquent plus de confiance en lui-même, c’est-à-dire plus de courage ; plus de connaissance de sa supériorité, c’est-à-dire moins de désir de vengeance ; plus d’opinion de sa sûreté, c’est-à-dire plus de franchise, moins de soupçons, de politique et de ruses. Les peuples des pays chauds sont timides comme les vieillards ; ceux des pays froids, courageux comme les jeunes gens. Les peuples du nord doivent avoir peu de vivacité ; ils doivent avoir peu de sensibilité pour les plaisirs et pour la douleur : il faut écorcher un Moscovite pour lui donner du sentiment. Dans les climats du nord, à peine le physique de l’amour a-t-il la force de se rendre sensible ; dans les pays chauds, l’âme est souverainement mue par tout ce qui a du rapport à l’union des deux sexes.
Dans les pays du nord, une machine saine et bien constituée, mais lourde, trouve ses plaisirs dans tout ce qui peut mettre les esprits en mouvement, la chasse, les voyages, la guerre, le vin. Vous trouverez dans les climats du nord des peuples qui ont peu de vices, assez de vertus, beaucoup de sincérité et de franchise. Approchez des pays du midi, vous croirez-vous éloigner de la morale même ; des passions plus vives multiplieront les crimes ; chacun cherchera à prendre sur les autres tous les avantages qui peuvent favoriser ces mêmes passions. Dans les pays tempérés, vous verrez des hommes plus inconstants dans leurs manières, dans leurs vices même et dans leurs vertus : le climat n’y a pas une qualité assez déterminée pour les fixer eux-mêmes.
La chaleur du climat peut être si excessive que le corps y sera absolument sans force. Pour lors, l’abattement passera à l’esprit même ; aucune curiosité, aucune noble entreprise, aucun sentiment généreux ; les inclinations y seront toutes passives, la paresse y fera le bonheur ; la plupart des châtiments y seront moins difficiles à soutenir que l’action de l’âme, et la servitude moins insupportable que la force d’esprit qui est nécessaire pour se conduire soi-même [91].
Les Indiens sont naturellement sans courage par une conséquence de leur climat ; et s’ils exécutent des actes qui exigent de l’énergie, comme de se précipiter volontairement dans les flammes, ou de s’infliger les peines les plus cruelles, c’est parce que le climat exalte leur imagination. Du temps des Romains, les peuples du nord de l’Europe vivaient sans arts, sans éducation, presque sans lois, et cependant, par le seul bon sens attaché aux fibres grossières de ces climats, ils se maintinrent avec une sagesse admirable contre la puissance romaine, jusqu’au moment où ils sortirent de leurs forêts pour la détruire [92].
Le climat qui produit l’abattement du corps et de l’esprit, qui prévient toute curiosité, toute noble entreprise, rend immuables, par cela même, la religion, les mœurs, les manières, les lois ; comme il porte les hommes vers la spéculation, il engendre le monachisme ; il engendre la paresse, et l’orgueil qui en est une conséquence ; les hommes ne sont donc portés à un devoir pénible que par la crainte des châtiments ; la servitude est donc naturelle à certains pays particuliers de la terre [93].
La loi qui interdit l’usage du vin ne serait pas bonne dans les pays froids où le climat semble forcer à une certaine ivrognerie de nation. L’ivrognerie se trouve établie par toute la terre dans la proportion de la froideur et de l’humidité du climat. Passez de l’équateur jusqu’à notre pôle, vous y verrez l’ivrognerie augmenter avec les degrés de latitude. Passez du même équateur au pôle opposé, vous y verrez l’ivrognerie aller vers le midi, comme de celui-ci elle avait été vers le nord [94].
Le climat ne produit pas seulement des vices moraux, il engendre aussi des maladies, telles que la lèpre et la peste. C’est le climat qui porte les Anglais au suicide, au sein même de la prospérité. Enfin, c’est à la même cause qu’il faut attribuer les mœurs atroces des Japonais, et la méfiance que ces mœurs inspirent aux lois et aux magistrats de ce peuple [95].
Tel est le système de Montesquieu sur les effets du climat, ou, pour parler avec exactitude, du froid et de la chaleur ; car cet illustre écrivain ne s’est occupé que de l’influence immédiate produite sur l’homme par la température de l’atmosphère. J’ai réduit ses opinions au plus petit nombre de termes possible, toutes les fois que je l’ai pu sans craindre d’altérer ses pensées : j’ai rapporté les expressions mêmes dont il s’est servi dans les passages les plus remarquables. En examinant ce système, je ne rechercherai pas si les phénomènes moraux et politiques que Montesquieu atteste, doivent résulter des phénomènes physiologiques auxquels il les attribue, tels que le resserrement et le raccourcissement des fibres extérieures par la privation du calorique, et l’accroissement de force qui en résulte ; le relâchement et l’allongement des mêmes fibres par l’action de la chaleur, et la diminution de force qui en est la conséquence ; je n’examinerai pas si l’action du cœur et la réaction des extrémités des fibres se font mieux sentir dans le nord que dans le midi, si les liqueurs y sont mieux en équilibre, si le sang est plus déterminé vers le cœur, et si réciproquement le cœur a plus de puissance. Quoique peu versé en physiologie, j’ai de la peine à me persuader que ces faits puissent être constatés par des expériences faites sur une moitié de langue de mouton ; et quand même ils seraient constatés par de telles expériences, je ne saurais voir aucune liaison entre eux et les conséquences morales que Montesquieu en déduit. J’avoue qu’un système moral et politique qui reposerait sur de semblables expériences, me paraîtrait reposer sur une base fort peu solide. Avant que d’examiner si les phénomènes moraux que Chardin et Montesquieu attribuent à l’influence des climats, sont des conséquences de l’action du froid ou de la chaleur sur les fibres extérieures, il eût fallu bien constater l’existence de ces phénomènes ; il eût fallu rechercher ensuite si ces phénomènes étaient le produit d’une seule cause, et quelle était cette cause. Mais on a fait, dans ce cas, comme dans beaucoup d’autres : on a commencé par imaginer un système, et ensuite on a recueilli çà et là quelques faits pour le justifier, sans même se donner la peine de faire voir la liaison prétendue entre les effets et la cause.
L’examen du système sur l’influence des climats me conduit à des recherches de la plus haute importance : il m’oblige à distinguer les causes de prospérité ou de misère qui existent dans les hommes considérés en eux-mêmes, de celles qui existent dans les choses dont ils se trouvent environnés. Si l’on ne fait pas cette distinction, si l’on attribue exclusivement aux hommes ce qui est le produit de la nature des choses, ou aux choses ce qui est le produit des volontés humaines, on ne peut chercher à influer sur le sort d’une nation sans s’engager dans une lutte dangereuse ou tout au moins inutile. L’homme exerce sur la plupart des objets qui l’environnent une influence immense ; mais à leur tour les choses exercent sur lui une influence qui n’est guère moins étendue. C’est cette influence qu’il s’agit de constater, si nous voulons savoir jusqu’à quel point les peuples sont maîtres de leurs destinées, et comment ils doivent agir s’ils veulent faire des progrès. L’influence des choses sur les hommes n’a été aperçue par les publicistes et par les moralistes que d’une manière confuse : ils l’ont désignée sous le nom vague d’influence des climats ; mais ils n’ont pas été heureux, lorsqu’ils ont voulu déterminer les effets qu’ils ont attribués à cette influence.
[II-127]
Suivant Montesquieu, le climat du nord, ou, pour mieux dire, une température froide, donne donc à l’homme un grand corps et peu de vivacité, de la confiance en lui-même, du courage, de la sécurité, de la franchise, peu de désirs de vengeance. Il lui donne peu de soupçons et de ruses, peu de sensibilité aux plaisirs et aux peines, peu de penchant à l’amour et à la jalousie, peu de vices et assez de vertus. Enfin, il lui donne du bon sens attaché à des fibres grossières, et un penchant irrésistible à l’ivrognerie [96].
Un climat ou un pays tempéré donne à l’homme de l’inconstance dans ses manières, dans ses vices et dans ses vertus, et plus de sensibilité pour les plaisirs et pour les peines.
Un climat chaud prive l’homme de force, lui abat l’esprit, le prive de courage, d’imagination, de sentiment généreux, le porte à la contemplation, à la paresse et à l’orgueil, le rend méfiant, soupçonneux, rusé, faux, vindicatif, lui donne une sensibilité excessive aux plaisirs et aux peines, le porte à l’amour et à la jalousie, le rend stationnaire dans sa religion, dans ses mœurs et dans ses lois ; enfin, ce climat lui fait une nécessité de l’esclavage.
Si ce système est vrai, tous les peuples qui vivent sous une certaine latitude, sont condamnés par la nature elle-même à vivre éternellement dans le vice, le crime, l’ignorance et la misère. C’est en vain qu’on porterait chez eux la lumière : une puissance à laquelle ils ne sauraient se soustraire, les rend incapables de mieux voir ou de mieux se conduire. Les peuples situés dans les climats tempérés d’Europe, d’Amérique et d’Asie, sont condamnés par la même puissance à changer éternellement de mœurs, de lois et d’opinions ; à passer alternativement du vice à la vertu, de la vertu au vice, des lumières à l’ignorance, de l’ignorance aux lumières, du despotisme à la liberté, de la liberté au despotisme. Les peuples placés sous un climat froid, sont les seuls auxquels la nature ait été décidément favorable.
La première difficulté qui se présente lorsqu’on veut soumettre ce système à l’examen, est de savoir quelles sont les limites des trois climats qui produisent des effets si différents. Pour les peuples qui vivent entre les tropiques, dans les lieux peu élevés au-dessus du niveau de la mer, l’Italie, l’Espagne et le Portugal sont des pays tempérés, si même ce ne sont pas des pays froids ; mais, pour les Russes, ce sont des pays chauds. Les habitants des îles Salomon, de Quito ou de Sumatra, pourraient s’imaginer, en lisant l’Esprit des Lois , que les Italiens, les Espagnols et les Portugais ont un grand corps et peu de vivacité ; mais les Russes, en faisant la même lecture, doivent croire que ces mêmes peuples n’ont ni courage, ni imagination, ni génie, et qu’ils sont aussi immuables dans leurs manières que les abeilles et les castors. Les mots froid et chaleur, appliqués à la sensation que produit sur nous l’atmosphère, sont des mots relatifs, dont la valeur n’est déterminée que par nos habitudes. La même température qu’un habitant de la Syrie trouverait glaciale, ferait suer un Suédois ou un habitant de Saint-Pétersbourg. Les habitants de Charleston sont saisis de froid et ne peuvent se passer de feu, quand le thermomètre de Réaumur ne se soutient qu’à douze degrés au-dessus de glace ; et quoique chez eux les hivers soient très courts, que le froid n’y dure pas trois jours de suite et que la plus forte gelée ne pénètre pas la terre à deux pouces, ils consomment, pour leur chauffage, autant de bois que les habitants de Philadelphie [97]. Les Russes ne se plaignent pas du froid quand le thermomètre ne tombe que de quelques degrés au-dessous de zéro. Qu’est-ce donc qu’un climat froid, un climat chaud et un climat tempéré pour les uns et pour les autres [98] ?
[II-130]
Mais prenons les mots dans le sens que Chardin et Montesquieu ont sans doute entendu leur donner ; dans cette acception, un climat tempéré sera celui dont un Parisien à l’habitude ; un climat chaud sera celui qui produit sur lui de l’abattement et qui lui cause une transpiration trop abondante ; un climat froid sera celui où l’impression de l’atmosphère lui cause habituellement une sensation désagréable et lui rend la présence du feu nécessaire. Cela est encore fort vague, mais il n’est pas possible de donner aux termes une plus grande précision : dans ce sens, la Pologne, la Suède, la Russie et le Danemark sont en Europe des climats froids ; il en est de même de toutes les parties de l’Asie et de l’Amérique, placées sous la même latitude ; nous pouvons considérer comme des climats chauds toutes les parties basses du globe situées entre les tropiques. La température d’un pays ne dépend pas seulement, en effet, du degré de latitude sous lequel ce pays est placé ; elle dépend aussi du plus ou moins d’élévation du sol, et de la manière dont il est exposé ; elle dépend, en outre, de l’état du pays : sous le même degré de latitude, un sol couvert de forêts n’a pas la même température qu’un sol qui est couvert de sable ou qui est en état de pâturage ; un sol placé au centre d’un vaste continent, comme l’Afrique, n’a pas la même température qu’une île placée au milieu de l’Océan. Montesquieu n’a tenu compte d’aucune de ces circonstances, ni d’un grand nombre d’autres également influentes ; elles méritaient cependant d’être considérées.
[II-132]
CHAPITRE VII.↩
Du développement physique acquis, en Amérique et dans les îles du grand Océan, sous différents degrés de latitude, par des peuples d’espèces ou de variétés américaine, malaie et nègre.
Suivant les raisonnements de Montesquieu, les hommes qui habitent des climats froids doivent avoir de grands corps, une machine saine, bien constituée, mais lourde. Cet écrivain ne dit pas positivement quel doit être le physique des peuples qui habitent des pays chauds ou tempérés ; mais il est aisé de voir, par l’ensemble de son système, que, dans cette partie comme dans les autres, l’effet de la chaleur doit être opposé à celui du froid. Montesquieu ne cite point de faits pour prouver la vérité de son système ; il se borne à une simple affirmation et à des raisonnements sur l’effet que produisent sur nos fibres la chaleur et l’absence de la chaleur. Il a pensé sans doute que les faits étaient à la portée de tout le monde, et qu’il n’avait qu’à les expliquer. Examinons donc si les faits sont tels qu’il les affirme, sans nous arrêter à ses explications.
Comme, pour déterminer le sens des mots froid et chaleur , nous avons été obligés de prendre pour terme moyen la température à laquelle nous sommes habitués, nous sommes également obligés de prendre notre constitution physique comme étant le terme moyen du genre humain ; mais nous ne devons pas oublier qu’un des deux extrêmes nous considère comme une espèce de géants, tandis que l’autre ne voit en nous que des nains.
Si le système de Montesquieu est fondé, nous devons trouver aux extrémités de la terre habitable, qui se rapprochent le plus des deux pôles, et sur les montagnes les plus élevées, les hommes les plus grands ; nous devons trouver les hommes les plus faibles et les plus petits sous l’équateur, entre les tropiques ou dans les lieux les moins élevés, et des hommes d’une taille moyenne dans les autres parties du monde. Avant que d’examiner si les faits sont d’accord avec ce système, il est bon d’observer que plus un peuple est près de l’état sauvage, et plus l’action du climat sur lui doit être marquée. Un seigneur russe qui jouit d’un immense revenu, peut trouver à Saint-Pétersbourg toutes les jouissances que le climat donne à un homme qui habite sur les rives de la Seine : il peut y jouir toute l’année de la même température, des mêmes aliments, des mêmes vêtements. Le climat est même plus rude pour un pauvre habitant d’un faubourg de Paris, que pour un ministre du gouvernement russe. Mais les sauvages habitants de la terre de Feu, du Groenland, des îles Aléoutiennes, de la Guyane ou du Congo, ne peuvent pas se soustraire ainsi à l’influence du froid ou de la chaleur ; pour eux, rien ne modifie l’influence du climat ; c’est donc sur eux et sur les peuples qui sont dans une position analogue, qu’on en peut le mieux observer les effets.
Les Esquimaux qui habitent sur les bords de la rivière de Cuivre, près du soixante-dixième degré de latitude nord, sont généralement petits ; leur taille ordinaire est de quatre pieds, et la plupart sont même au-dessous ; ils présentent une assez grande surface, mais ils ne sont ni bien faits, ni forts [99]. Ceux qui habitent les îles de la Résolution, un peu au-delà du soixantième degré, sont d’une taille médiocre [100] ; des voyageurs n’ont même porté qu’à quatre pieds la taille des hommes qui habitent la baie d’Hudson [101]. Les indigènes du Canada, situés entre le quarante-cinquième et le cinquantième degrés, à peu près sous la même latitude que la France, mais dans un pays plus froid, ont généralement peu de corpulence [102] ; mais ils sont droits, bien faits et grands, particulièrement les Iroquois et les Hurons. Il existe cependant sous la même latitude plusieurs tribus qui sont d’une taille médiocre [103]. Les femmes, en général, sont petites et ont une complexion très délicate [104]. À mesure qu’elles avancent en âge, elles deviennent massives et grasses ; à trente ans, elles ont les yeux caves, le front sillonné, la peau lâche et ridée [105]. Les Illinois, plus rapprochés du midi, sont d’une taille au-dessus de la moyenne, et ont de l’embonpoint [106]. Enfin, les indigènes de la Louisiane, plus rapprochés encore du sud, et plus près du niveau de la mer, sont forts et robustes. Les hommes, les femmes et les enfants sont d’une vigueur extrême ; ils sont plus énergiques, plus infatigables que les Iroquois [107].
La constitution physique de l’homme est donc plus forte dans la partie nord-est de l’Amérique, sous un climat tempéré, que sous un climat froid [108]. Nous observons le même phénomène dans la partie nord-ouest du même continent. Les Indiens qui habitent sur la rivière de Mackenzie, vers le soixante-dixième degré de latitude, sont maigres, petits, laids, mal faits, et paraissent très malsains ; ils ont les jambes grosses et couvertes de croûtes [109]. Ceux qui vivent dans la baie de Behring, à l’entrée du Prince Guilhaume, étant placés sous une latitude moins élevée, sont aussi moins faibles : plusieurs sont d’une taille ordinaire, mais un grand nombre sont au-dessous [110]. Ceux du Port des Français, sous le cinquante-huitième degré trente-sept minutes de latitude, sont d’une taille moyenne, mais la charpente de leurs corps est faible ; plusieurs ont les jambes enflées, et, suivant le témoignage de La Pérouse, le plus fort d’entre eux eût été culbuté par le plus faible de ses matelots [111]. Les habitants de Nootka, placés sous le quarante-neuvième degré trente-six minutes, sont un peu au-dessous de la taille moyenne ; mais ils ont le corps bien arrondi ; et leurs membres, quoique potelés, ne paraissent jamais acquérir trop d’embonpoint [112]. Enfin, les Indiens de Monterrey, sous le trente-sixième degré quarante et une minute de latitude, sont bien faits et robustes, et leurs ouvrages annoncent beaucoup d’adresse [113].
La constitution physique de l’homme, étant plus forte sous les climats tempérés que sous les climats froids, dans le nord du continent américain, s’affaiblit-elle lorsqu’on avance sous les tropiques ? Plusieurs tribus, qui vivent entre le vingtième et le vingt-deuxième degré de latitude australe, excèdent de beaucoup les Européens par leur taille et leur force. La taille commune des Mbayas est de cinq pieds huit pouces ; celle des Lenguas est de cinq pieds neuf pouces : leurs formes et leurs proportions sont très belles. Beaucoup d’autres peuplades sont constituées dans les mêmes proportions [114]. Les Caribes, qui vivent presque sous l’équateur, entre le huitième et le dixième degré de latitude australe, sont d’une constitution encore plus forte. Ce sont, suivant M. Alexandre de Humboldt, des hommes d’une stature presque athlétique. Ils ont paru à ce voyageur plus élancés que les Indiens qu’il avait vus jusqu’alors ; leurs femmes sont également très grandes. Les forces et l’énergie de ces peuples sont proportionnées à leur stature. Lorsqu’ils sont excités par quelque motif, ils rament contre le courant le plus rapide, pendant quatorze ou quinze heures de suite, par une chaleur de trente degrés du thermomètre de Réaumur [115]. Les hommes qui vivent sur l’Amazone, sous l’équateur, ont la même force et la même énergie [116]. Les Indiens Tenateros, qui travaillent aux mines du Mexique, restent chargés continuellement, pendant cinq ou six heures, de deux cent vingt-cinq à trois cent cinquante livres, étant en même temps exposés à une température très élevée, et montant huit à dix fois de suite des escaliers de dix-huit cents gradins [117]. On ne peut, dit M. de Humboldt, se lasser d’admirer la force musculaire de ces Indiens, et des Métis de Guanaxato, surtout lorsqu’on se sent excédé de fatigue en sortant de la plus grande profondeur de la mine de Valenciana, sans avoir été chargé du poids le plus léger [118].
Si du centre de l’Amérique on se transporte à l’extrémité australe de ce continent, sur la terre de Feu, entre les cinquante-deuxième et cinquante troisième degré de latitude, on y trouve un climat très rigoureux et une population toute différente. Ce sont des hommes petits, maigres et vilains [119] ; ayant une figure qui annonce la misère et la saleté la plus horribles ; des yeux petits et sans expression ; le nez répandant continuellement du mucus dans leur bouche entr’ouverte ; les épaules et l’estomac larges et osseux, et les autres parties du corps si minces et si grêles qu’en les voyant séparément, on ne pourrait pas croire qu’elles appartiennent aux mêmes individus [120]. Ce peuple vit sous la même latitude que le Danemark, du côté du pôle opposé, mais sous une température beaucoup plus froide.
La première peuplade qu’on ait rencontrée sur le continent américain, en revenant du côté de l’ouest, du détroit de Magellan vers l’équateur, sont les Patagons, dont la taille a paru colossale aux voyageurs qui les ont vus les premiers. Le capitaine Byron, en comparant leur taille à la sienne a estimé qu’ils devaient avoir environ sept pieds anglais (environ six pieds six pouces de France) : ils sont formés dans des proportions très belles. Ce sont plutôt, dit ce voyageur, des géants que des hommes [121]. Deux individus de cette tribu, étant allés à Buenos-Aires, y ont été mesurés ; l’un avait six pieds sept pouces, l’autre six pieds cinq pouces. Azara, qui rapporte ce fait, estime que la taille commune est, chez cette peuplade, de six pieds trois pouces [122]. Bougainville, à qui ces hommes ont également paru avoir une taille extraordinaire, en a cependant trouvé d’autres, en s’avançant vers l’équateur, d’une constitution plus forte et d’une taille plus élevée [123].
Cette peuplade, qui a été vue vers le quarante-cinquième degré de latitude australe, paraît être du nombre des nomades qui vivent au sud de Buenos-Aires. Presque tous les hommes étaient à cheval et couverts d’une peau de guanaque [124]. Azara croit que ce sont les mêmes que les Tchuelchus. D’autres tribus qui vivent entre le trente-sixième et le quarantième degré, presque sous la même latitude, se distinguent également par leur haute taille et par leurs forces musculaires. Toutes ces peuplades sont remarquables par leur énergie et par leur courage [125].
Si l’on devait juger par ces faits de l’influence qu’exerce, en Amérique, le climat sur la constitution physique de l’homme, on penserait que cette influence est analogue à celle qui paraît être exercée sur le règne végétal. Sous l’équateur, on rencontre dans ces contrées une végétation vigoureuse ; elle s’affaiblit à mesure qu’on avance vers les deux pôles, et enfin on ne trouve plus que quelques sapins et quelques bouleaux rabougris. On pourrait, à l’aide de ces faits, fonder un système diamétralement opposé à celui de Montesquieu ; mais ce serait encore un système ; car on trouve, à côté des grands et vigoureux Caribes, quelques peuplades dont la taille est même au-dessous de la nôtre [126]. Tandis qu’à côté des peuples faibles qui vivent vers le pôle du Nord, on en trouve d’une force moyenne. Ces variations ont fait croire à plusieurs voyageurs que le froid et la chaleur sont sans influence sur la taille et la force des hommes [127].
Les observations faites sur les peuples qui habitent les îles du grand Océan ne démentent pas moins le système de Montesquieu, que celles qui ont été faites sur le continent américain. Les hommes les plus grands et surtout les mieux constitués de cet Océan sont ceux qui habitent les îles Marquises de Mendoça, observés sous le dixième degré vingt-cinq minutes de latitude australe. Leur taille ordinaire est de cinq pieds huit pouces ; ils ont la poitrine et les épaules larges ; les cuisses pleines et musculeuses ; la voix forte et sonore. Leur beauté est telle que les sculpteurs pourraient les prendre pour modèles : on trouverait parmi eux, dit Fleurieu, des Hercule, des Antinoüs et des Ganimede. [128] Ces peuples surpassent tellement en beauté les peuples des autres archipels qu’on ne peut pas établir entre eux des comparaisons [129].
Les habitants des îles des Navigateurs vivent entre le treizième et le quatorzième degré de latitude australe ; ils ne sont par conséquent éloignés que de quatre degrés de plus de l’équateur que les habitants des îles Marquises : ils ne diffèrent d’eux que de fort peu. Ce sont les plus grands et les mieux faits que La Pérouse ait rencontrés dans ses voyages ; leur taille ordinaire est de cinq pieds neuf, dix ou onze pouces ; mais ils sont moins remarquables par leur taille que par les proportions colossales des différentes parties de leur corps. Un très petit nombre sont au-dessous de cette taille ; quelques-uns n’ont que cinq pieds quatre pouces ; mais, dit le célèbre voyageur qui nous en a donné la description, ce sont les nains du pays ; et quoique leur taille semble se rapprocher de la nôtre, leurs bras forts et vigoureux, leurs poitrines larges, leurs jambes, leurs cuisses, sont encore dans une proportion très différente ; on peut assurer qu’ils sont aux Européens ce que les chevaux danois sont à ceux des différentes provinces de France [130]. La taille des femmes est proportionnée à celle des hommes, elles sont grandes, sveltes, et ont de la grâce ; quelques-unes sont très jolies [131]. Les descendants des Malais, ajoute La Pérouse, ont acquis dans ces îles une vigueur, une force, une taille et des proportions qu’ils ne tiennent pas de leurs pères, et qu’ils doivent sans doute à l’abondance des subsistances, à la douceur du climat, et à l’influence des différentes causes physiques qui ont agi constamment et pendant une longue suite de générations [132].
En s’avançant de quatre ou cinq degrés vers le pôle austral, sous le dix-septième degré vingt-neuf minutes de latitude, on trouve les îles de la Société. Les habitants de ces îles sont éloignés de l’équateur de sept degrés seulement de plus que les habitants des îles Marquises. Quoique inférieurs à ceux-ci et même aux habitants des îles des Navigateurs, on trouve parmi eux de si beaux hommes, que, suivant Bougainville, ils pourraient servir de modèle pour peindre Hercule et Mars. On en voit, dit ce voyageur, dont la taille excède six pieds [133]. D’autres voyageurs les ont jugés d’une taille moins élevée [134]. La stature de quelques-uns, et particulièrement des chefs, est d’une force et d’une fermeté remarquables. La circonférence d’une des cuisses d’un d’eux, dit Cook, égalait presque celle du corps d’un de nos plus gros matelots mesuré à la ceinture [135]. Mais tous les hommes n’ont pas, dans ces îles, une stature également forte et élevée ; il en est un grand nombre dont la taille est médiocre et qui diffèrent tellement des autres par la couleur, les cheveux, les traits, et la force, que Bougainville a cru qu’ils appartenaient à une espèce différente [136].
Les habitants des îles des Amis, un peu plus éloignés encore de l’équateur (sous le vingt-septième degré de latitude australe), excèdent rarement la taille ordinaire ; mais ils sont forts et bien constitués [137] ; ils ont de très belles formes, et leurs muscles sont très prononcés [138]. Ils sont cependant inférieurs aux habitants des îles des Navigateurs, ce qu’on a attribué à l’aridité du sol et à d’autres circonstances physiques du territoire et du climat [139]. Il existe aussi, dans ces îles, deux classes d’hommes qui diffèrent assez les uns des autres pour que des voyageurs aient pensé qu’ils n’appartenaient pas à la même race. Les individus qui appartiennent aux dernières classes, n’ont ni la taille, ni la constitution, ni la force de ceux qui appartiennent aux premières. Ils sont au-dessous de la taille moyenne, quelquefois même ils sont très petits ; ils ont le teint plus obscur, les traits plus grossiers, les cheveux crépus et durs comme du crin [140].
Les îles Sandwich, placées à la même distance de l’équateur que les îles des Amis, mais du côté du nord, renferment des habitants de même taille, mais moins bien constitués. La taille commune, parmi eux, est d’environ cinq pieds trois pouces ; ils ont les muscles fortement prononcés, peu d’embonpoint, et les traits du visage grossiers. Les femmes sont petites et ont la taille mal prise ; elles sont grosses, lourdes et gauches ; elles ont les traits grossiers et l’air sombre [141]. Dans ces îles, comme dans quelques autres situées plus près de l’équateur, les chefs se distinguent cependant du reste de la population par une taille plus élevée et une constitution plus forte [142]. La population de ces îles semble plus sujette aux maladies de la peau [143]. Les habitants de l’île Charlotte situés à peu près sous la même latitude que ceux des îles Sandwich, mais de l’autre côté de l’équateur, sont également d’une taille moyenne ; mais les femmes y sont mieux faites [144].
Les habitants de l’île de Pâques, placés sous le vingt-septième degré neuf minutes de latitude australe, et par conséquent plus éloignés de l’équateur que les habitants des îles des Amis d’environ sept degrés, sont de beaucoup inférieurs à eux. Leur taille ordinaire est d’environ cinq pieds quatre pouces ; on n’en voit aucun de cinq pieds six pouces (six pieds anglais), taille si commune dans les îles situées entre les tropiques. Le médecin qui accompagnait La Pérouse, les a jugés d’un embonpoint ordinaire, mais les voyageurs anglais, en les comparant aux hommes de même espèce placés dans les îles plus rapprochées de l’équateur, les ont trouvés d’une constitution faible, ayant le corps plus maigre, le visage plus mince qu’aucun des autres peuples de ces mers [145].
Les habitants de la Nouvelle-Zélande, placés entre le trente-cinquième et le quarante-cinquième degré de la même latitude, et appartenant à la même espèce d’hommes, n’excèdent pas la stature ordinaire des Européens. En général, ils ne sont pas aussi bien faits, surtout des bras, des jambes et des cuisses ; quelques-uns ont les muscles forts et présentent une belle carrure mais il y en a peu qui aient de l’embonpoint [146]. Dans quelques parties cependant, ils sont mieux constitués ; ils égalent les Européens les plus grands, sans approcher des habitants des îles des Navigateurs [147].
Ainsi, les hommes qui, dans le grand Océan, sont placés le plus près de l’équateur sont les plus grands, les mieux constitués, les plus vigoureux, en un mot les plus beaux ; et à mesure qu’on avance vers l’un ou l’autre pôle, on trouve que les hommes dégénèrent. Mais il n’est pas possible de suivre la gradation sur l’océan comme sur le continent américain ; les îles innombrables dont une partie de ces mers sont couvertes, sont presque toutes placées entre les tropiques. Pour continuer nos observations, il faut franchir du côté du sud un intervalle de près de treize degrés, et un intervalle de près de quarante degrés du côté du nord ; de ce côté-ci, il faut passer des îles Sandwich aux îles Alantiennes dans la mer du Kamtchatka ; et de celui-là, des îles de Pâques à la Nouvelle-Zélande, et à l’extrémité du sud de la Nouvelle-Hollande. Mais, si la différence d’un climat à l’autre est grande, celle qui existe entre les populations ne l’est pas moins. Dans l’échelle des proportions des forces humaines, il y a presque aussi loin des indigènes du port Jackson, ou de la terre de Van-Diemen, aux indigènes des îles des Navigateurs, qu’il y a loin, dans l’échelle des distances, de l’équateur à l’extrémité australe de la Nouvelle-Hollande. Il faut observer cependant que les hommes de cette dernière contrée appartiennent à une espèce différente.
Les indigènes de la terre de Van-Diemen, placés entre le quarante-unième et le quarante-troisième degré de latitude australe, sont d’une taille moyenne qui varie entre cinq pieds deux pouces et cinq pieds quatre pouces. Ils ont, comme les habitants de la terre de Feu, les épaules et la poitrine larges ; mais, comme eux, ils ont les extrémités grêles et faibles, le ventre gros, saillant et comme ballonné. Ils ont les bras et les jambes si grêles, qu’ils s’étonnaient de voir ceux des hommes de l’équipage français. La faiblesse de leurs membres correspond à leur mauvaise constitution ; lorsqu’ils ont voulu lutter contre des matelots ou des officiers de la marine française, ils ont été aisément renversés [148]. Ils ont les[II-150] poignets aussi faibles que les reins ; dans les expériences qui ont été faites sur eux au moyen du dynamomètre, les mieux constitués ont été de beaucoup inférieurs aux Français qu’un long voyage avait cependant affaiblis [149].
Les indigènes de la Nouvelle-Hollande, quoiqu’un peu plus rapprochés de l’équateur que ceux de la terre de Van-Diemen, ne sont ni mieux constitués, ni plus forts. Leur stature est à peu près la même ; mais ils ont le torse moins développé [150], et les membres d’une petitesse remarquable [151]. Les expériences faites sur eux au moyen du dynamomètre, ont donné les mêmes résultats ; elles ont constaté qu’ils sont d’une faiblesse extrême, non seulement comparativement aux habitants des îles des Navigateurs, mais comparativement aux Européens [152]. Les femmes sont plus mal constituées encore que les hommes ; elles ont les formes maigres et décharnées, la gorge flétrie, et pendante jusqu’aux cuisses, et la malpropreté la plus dégoûtante ajoute à leur laideur naturelle [153].
Les peuples de même race qui habitent la Nouvelle-Guinée, et qui sont par conséquent beaucoup plus rapprochés de l’équateur, sont d’un noir luisant, robustes, et d’une taille élevée ; ils ont les yeux grands et la bouche très fendue [154].
Je ne dirai rien ici des peuplades qui habitent les îles Aleutiennes, elles appartiennent à la race mongole ou asiatique. Mais j’en parlerai dans le chapitre suivant, et l’on verra qu’ici les climats froids ne sont pas plus favorables qu’ailleurs au développement des forces humaines.
Dans les îles du grand Océan, de même qu’en Amérique, on remarque plusieurs espèces d’hommes, et sous la même latitude on en trouve qui n’ont entre eux aucune ressemblance. Ainsi, les habitants des Nouvelles-Hébrides, placés à peu de distance des îles des Navigateurs, sous la même latitude que les habitants des îles des Amis, mais appartenant à une espèce différente, sont infiniment plus petits. Leur taille s’élève à peine à cinq pieds, leurs membres manquent souvent de proportion ; ils ont les bras et les jambes longs et grêles ; ils sont noirs et ont les traits et les cheveux laineux des nègres [155]. Les habitants de la Nouvelle-Calédonie, placés sous la même latitude que ceux des îles de la Société, ont le corps faible, les bras et les jambes grêles. Leur excessive maigreur décèle leur misère ; ils sont semblables aux habitants de la terre de Van-Diemen [156]. Les habitants de Mallicollo sont beaucoup plus petits encore ; ils ont le teint bronzé, la laine des nègres et la figure des singes : ayant le corps serré par une corde, ils ressemblent à de grosses fourmis [157]. D’autres variétés ont été observées, sous diverses latitudes, sans qu’on ait pu attribuer les différences qu’on a remarquées entre elles à la différence des climats [158]. Mais ce sont là des exceptions, et il est même remarquable que, lorsqu’à côté de peuplades fortes et bien constituées, il s’en trouve quelqu’une de faible, celle-ci appartient toujours à une espèce différente, est moins industrieuse et habite une terre moins fertile ; de sorte que, si le plus ou moins de chaleur du climat a quelque influence sur la constitution physique des hommes, cette influence est inappréciable ou imperceptible [159]. Nous verrons, dans le chapitre suivant, quelles sont les parties de l’Asie, de l’Afrique et de l’Europe dans lesquelles les facultés physiques des hommes qui habitent ces contrées se sont le mieux développées. Nous tâcherons de déterminer ensuite les causes et les effets de ce développement.
[II-154]
CHAPITRE VIII.↩
Du développement physique acquis en Asie, en Afrique et en Europe, sous différents degrés de latitude, par des peuples d’espèces mongole, caucasienne et éthiopienne. — Des causes physiques de ce développement.
Les voyageurs ont fait sur les peuples qui habitent la côte orientale de l’Asie et les îles qui en sont voisines, des observations semblables à celles qui ont eu lieu sur la côte et les îles occidentales de l’Amérique. Les Kamtchadales, qui vivent entre le cinquantième et le soixantième degré de latitude nord, et sous un climat infiniment plus rigoureux que ne le sont les contrées de l’Europe situées sous la même latitude, sont petits et faiblement constitués. Au jugement de La Pérouse, ces peuples, comme les Lapons et les Samoïedes, sont au genre humain ce que leurs bouleaux et leurs sapins rabougris sont aux arbres des forêts plus méridionales [160]. Leurs voisins, qui vivent sur la côte, entre le quarante-cinquième et le cinquante-deuxième degré, sont comme eux mal constitués et petits ; leur taille moyenne est au-dessous de quatre pieds dix pouces ; ils ont le corps grêle, la voix faible et aiguë comme celle des enfants [161]. Le médecin qui accompagnait l’expédition de La Pérouse, assure que ce sont les hommes les plus laids et les plus chétifs qu’il ait jamais vus [162].
Les habitants de l’île Tchoka ou Sakhalien, qui ne sont séparés d’eux que par un canal de trois ou quatre lieues, qui vivent par conséquent sous la même latitude et qui ont le même régime diététique, sont généralement bien faits, d’une constitution forte, et d’une physionomie agréable. La taille la plus commune, parmi eux, est de cinq pieds, et la plus haute de cinq pieds quatre pouces ; mais les hommes de cette dernière stature sont rares. Ces insulaires diffèrent tellement des hommes qui habitent la côte continentale voisine, que La Pérouse a douté s’ils appartenaient à la même espèce et s’ils étaient d’origine asiatique. Il est vrai, ajoute-t-il, que le froid des îles est moins rigoureux par la même latitude que celui du continent, mais cette seule cause ne peut avoir produit une différence si remarquable [163].
Les Japonais, plus rapprochés du midi, sont en général d’une taille moyenne ; ils sont bien faits, et ont les membres bien formés. Ils ont cependant une constitution moins forte que plusieurs des habitants de l’Europe, et on en voit rarement qui aient de l’embonpoint.
[II-156]
Les Chinois, qui habitent un climat tempéré, sont à peu près de la même taille que la plupart des peuples européens. Les peuples de même espèce qu’eux, qui habitent les climats froids de l’Asie, sont beaucoup plus petits. Il est rare de voir parmi eux des hommes dont la taille excède cinq pieds deux pouces [164].
Les Persans qui appartiennent à la même race que les Chinois, ont avec eux, pour la plupart, une forte ressemblance. Mais, chez un grand nombre de familles, l’espèce s’est beaucoup améliorée par leur mélange avec l’espèce caucasienne, quoiqu’ils vivent dans un climat plus chaud que les Chinois.
« Le sang de Perse, dit Chardin, est naturellement grossier. Cela se voit aux Guébres, qui sont le reste des anciens Perses. Ils sont laids, mal faits, pesants, ayant la peau rude et le teint coloré. Cela se voit aussi dans les provinces les plus proches de l’Inde, où les habitants ne sont guère moins mal faits que les Guèbres, parce qu’ils ne s’allient qu’entre eux. Mais dans le reste du royaume, le sang persan est présentement devenu fort beau, par le mélange du sang géorgien et circassien, qui est assurément le peuple du monde où la nature forme les plus belles personnes, et un peuple brave et vaillant, de même que vif, galant et amoureux. Sans le mélange dont je viens de parler, les gens de qualité de Perse seraient les plus laids hommes du monde ; car ils sont originaires de ces pays, entre la mer Caspienne et la Chine, qu’on appelle la Tartarie, dont les habitants, qui sont les plus laids hommes de l’Asie, sont petits et gros, ont les yeux et le nez à la chinoise, les visages plats et larges, et le teint, mêlé de jaune et de noir, fort désagréable [165]. »
Cette constitution, particulière à l’espèce mongole et qu’on observe dans les pays les plus froids comme dans les plus chauds, a donc été modifiée par le mélange des espèces ; la chaleur du climat n’a pas fait dégénérer les descendants des circassiennes.
Les habitants de la petite Bucharie, au nord des montagnes du Petit-Tibet, sont beaucoup au-dessous de la taille ordinaire.
« J’ai fort observé ces petits Tartares en Perse et aux Indes, en divers lieux et en diverses fois, dit Chardin. Leur taille est communément plus petite de quatre pouces que la nôtre, et plus grosse à proportion ; leur teint est rouge et basané ; leurs visages sont plats, larges et carrés ; ils ont le nez écrasé et les yeux petits [166] ».
Les hommes de même espèce qui habitent sur les bords des fleuves de la mer Glaciale, sont, en général, d’une taille au-dessous de la médiocre ; ils ont le teint pâle et jaune ; ils manquent de force et de vigueur. Un Russe peut lutter avantageusement contre plusieurs d’entre eux, quoiqu’ils soient de même âge et de même taille que lui [167].
Les Arabes n’appartiennent pas à la race mongole. Leur constitution physique varie, non selon le plus ou moins de chaleur du climat, mais selon l’abondance ou la rareté de la nourriture, et selon la quantité de travail auquel il faut se livrer pour l’obtenir. En général, les Bédouins sont petits, maigres et hâlés. La taille commune est de cinq pieds deux pouces ; ils ont les jambes sèches, des tendons sans mollets, et le ventre collé au dos. Ceux qui vivent sur la frontière des pays cultivés sont mieux constitués que ceux qui vivent dans le Désert ; et les laboureurs sont mieux constitués encore que ceux qui vivent sur leurs frontières. Enfin, les chaiks et leurs serviteurs, c’est-à-dire ceux qui possèdent la plus grande quantité d’aliments, sont plus grands et plus charnus que le peuple. La taille de plusieurs d’entre eux excède souvent cinq pieds six pouces. On n’en doit attribuer la raison, dit Volney, qu’à la nourriture qui est plus abondante pour la première classe que pour la dernière [168]. Ainsi, quoique les Arabes habitent un climat beaucoup plus chaud que les Chinois et les Persans, ils ont une stature plus élevée, toutes les fois qu’ils ne souffrent pas une privation habituelle d’aliments.
Les peuples d’Afrique ne sont-ils pas soumis à la même loi que les peuples des contrées que nous avons déjà parcourues ? Ceux qui habitent l’extrémité australe et l’extrémité septentrionale de ce continent, sont-ils plus grands, plus forts que ceux qui habitent entre les tropiques ? Le cap de Bonne-Espérance, entre le trentième et le trente-cinquième degré de latitude australe, est habité par deux peuples différents, sans compter les colons : par les Hottentots et les Boschismans. Suivant Kolbe, ceux-ci ne sont que des Hottentots que leurs crimes ont fait bannir de leurs tribus, ou qui se sont eux-mêmes réfugiés volontairement sur les montagnes, pour y mener une vie plus indépendante [169]. Mais des voyageurs plus instruits, et surtout meilleurs observateurs que lui, ont vu dans les Boschismans un peuple tellement distinct de tous les autres, qu’ils ont cru qu’il formait une espèce particulière. Ces hommes ne vivent que sur des montagnes inaccessibles et dans les creux des rochers, et par conséquent dans une température plus froide que celle des plaines ou des vallées habitées par les Hottentots. Leur stature est si petite que celle des hommes excède rarement quatre pieds [170]. Leur constitution physique n’est pas même en rapport avec leur taille ; elle y est inférieure.
« Ce ne fut pas sans étonnement, dit Sparrman, que je vis pour la première fois un jeune Boschi dans Lange-Kloof ; sa figure, ses bras, ses jambes et tout son corps, étaient si maigres et si exténués, que je ne doutai point d’abord que ce ne fût une fièvre épidémique qui l’eût réduit à ce déplorable état ; mais à l’instant je le vis courir avec la rapidité d’un oiseau [171]. »
Les Hottentots, suivant Dampier, ont la taille médiocre, le corps fluet et les membres petits [172]. Sparrman n’a pas trouvé qu’ils fussent pour la taille au-dessous de la plupart des Européens ; mais ils lui ont paru beaucoup plus minces [173]. Les Kabobiquois et les Koraquois, de même espèce que les Hottentots, mais plus avancés vers l’équateur, sont beaucoup plus grands et plus forts qu’eux. Les Kabobiquois, autre tribu de même race, sont aussi grands que les Cafres ; ils excèdent de toute la tête les Hottentots d’une taille moyenne [174].
Les Cafres, qui sont de quelques degrés plus avancés vers l’équateur que les Hottentots, ont sur eux une supériorité très grande. Ils sont d’une stature plus haute, mieux conformés et plus robustes : ils sont grands, forts et bien proportionnés [175]. Ils sont plus fiers, plus hardis, et ont une figure plus agréable. Il est telle femme cafre, dit Levaillant, qui peut passer pour très jolie à côté d’une Européenne [176]. Ces peuples sont, au jugement de Barrow, la souche des Arabes Bédouins [177].
Depuis la Mozambique jusqu’à Mélinda, c’est-à-dire depuis le quinzième degré jusqu’au troisième degré de latitude australe, la côte orientale d’Afrique est habitée par les Makouas ou Macouanas et par d’autres peuplades plus nombreuses et plus puissantes que les Cafres. Ces peuples sont très robustes et ont des formes athlétiques. Ils se sont rendu terribles aux Portugais établis sur la même côte, et les ont forcés à abandonner la campagne [178]. Les peuples les plus rapprochés de l’équateur sur cette côte, sont donc les plus grands, les mieux constitués et les plus énergiques [179].
Les indigènes du Congo, placés sous la même latitude, sur la côte occidentale, sont, en général, de beaux hommes. Ils sont très noirs ; mais ils ont de jolis traits ; leurs dents surtout sont d’une beauté admirable [180].
Les nègres du Sénégal, placés entre le dixième et le vingtième degré de latitude nord, sont des hommes forts et bien constitués. Les femmes у sont aussi bien faites que les hommes, ce qui est très rare chez les peuples qui ne sont pas civilisés. Elles ont la peau belle et douce, les yeux noirs et grands, la bouche et les lèvres petites, et tous les traits bien proportionnés. Plusieurs d’entre elles sont extrêmement belles ; elles ont beaucoup de vivacité, l’air aisé et agréable [181].
Enfin, les Ashantees, placés entre le cinquième et le dixième degré de latitude nord, semblent former la nation la plus nombreuse et la plus énergique de ces climats. Dans les guerres qu’ils ont soutenues contre les Anglais, ils ont remporté des victoires signalées, quoique les troupes anglaises eussent sur eux l’avantage des armes et de la tactique. Les avantages qu’ils ont obtenus ont été si grands que beaucoup d’Anglais se sont plaints de ce que leur gouvernement ne renonçait pas aux établissements formés sur cette côte, quoiqu’il n’eût pas alors d’autres guerres à soutenir.
Les peuples de la côte septentrionale d’Afrique, classés parmi ceux qui appartiennent à l’espèce caucasienne, ne sont ni plus petits, ni plus faibles, ni plus inactifs que les Siciliens, les Napolitains, et les Espagnols, beaucoup plus avancés vers le nord. Les degrés de chaleur que ces peuples éprouvent habituellement, ne doivent pas être appréciés seulement par les degrés de latitude sous lesquels les uns et les autres sont placés ; ils doivent s’apprécier surtout par la position de chaque pays. Les vents d’est et du sud n’arrivent en Espagne, en Sicile et en Italie qu’après avoir été rafraîchis par la Méditerranée : tandis qu’ils n’arrivent sur les côtes septentrionales d’Afrique qu’après avoir été échauffés par les sables brûlants du Désert. Ne faudrait-il pas conclure de ces circonstances, si la chaleur du climat était une cause de faiblesse et de lâcheté, que les habitants de Tunis, d’Alger et du Maroc sont les tributaires des rois de Naples et de Sicile ?
Des voyageurs et des physiologistes ont observé, parmi les habitants de l’Égypte, trois variétés d’hommes au moins. Des Coptes, des Indiens, et des individus de race berbère. Mais nul n’a observé que la chaleur du climat eût rendu quelqu’une de ces races inférieure à ce qu’elles sont sous des climats moins ardents. Là, comme ailleurs, les hommes sont forts ou faibles, selon que les aliments sont abondants ou rares, selon qu’ils se livrent à un exercice modéré ou à des travaux excessifs.
Si nous portons maintenant les yeux sur l’Europe, il nous sera difficile d’y trouver des nations auxquelles quelques degrés de chaleur de plus ou de moins, aient donné une constitution physique plus ou moins mauvaise. Il n’est point de nations, si l’on excepte la nation anglaise, qui, dans les quinze premières années de ce siècle, n’ait vu sur son territoire de nombreuses armées de presque tous les pays ; et nulle part on n’a remarqué qu’aucune d’elles eût une supériorité physique sur les autres. Les troupes d’élite de chaque peuple sont aussi belles que les troupes d’élite des peuples voisins ; et les soldats pris sans distinction de taille sont à peu près partout les mêmes. En jugeant de la population russe par ses armées, on peut croire que la classe la plus belle est celle dans laquelle sont pris les officiers ; mais il est remarquable que c’est la classe sur laquelle l’influence du climat se fait le moins sentir ; c’est celle qui a les moyens de se soustraire soit aux rigueurs du froid, soit aux excès de la chaleur, et qui peut jouir tout à la fois des avantages que lui procure son propre climat, et des productions des climats du midi. Mais les classes qui sont obligées de se borner aux productions de leur sol, et qui sont le plus soumises à l’action directe ou indirecte de leur climat, loin d’être supérieures aux classes correspondantes des autres pays de l’Europe, leur sont au contraire de beaucoup inférieures. Il n’y a pas de comparaison à établir entre les paysans russes et les habitants les plus pauvres de la Grèce, d’Espagne ou d’Italie [182].
On peut trouver, sans doute, dans quelques parties du nord de l’Allemagne, des populations qui ont une plus haute stature que certaines populations de France, d’Italie ou d’Espagne ; mais aussi on trouverait aisément, chez ces trois dernières nations, des populations plus belles qu’un grand nombre de celles qui existent dans le nord de l’Europe. Dans plusieurs provinces de France, en Normandie et dans les plaines et les montagnes d’Auvergne, par exemple, on trouverait d’aussi beaux hommes que dans quelques parties de l’Europe que ce soit. On peut en dire autant de quelques provinces de l’Italie et de l’Espagne ; le premier de ces deux pays surtout renferme des hommes remarquables par leur belle constitution [183].
J’ai fait observer précédemment que Montesquieu avait pris dans Chardin son système sur les effets produits par les climats chauds. En parlant des effets produits par les climats froids, il n’a fait qu’exprimer d’une manière générale ce que César et Tacite ont dit de la taille et de la force des peuples de Germanie. Nos soldats, dit César, questionnent les Gaulois et les marchands, qui leur racontent « que les Germains sont d’une énorme stature, d’une valeur incroyable, très aguerris, et d’un aspect si farouche qu’ils n’avaient pas seulement pu soutenir leurs regards, dans plusieurs combats qu’ils leur avaient livrés » [184]. César dit ailleurs que les Germains passent toute leur vie à la chasse ou dans les exercices guerriers [185], et Montesquieu réduit encore ce fait en système général comme il y a réduit celui qui le précède. Dans les pays du nord, dit-il, une machine saine et bien constituée, mais lourde, trouve le plaisir dans tout ce qui peut remettre les esprits en mouvement, la chasse, les voyages, la guerre [186] Montesquieu ajoute le vin, mais depuis César on a multiplié la vigne.
En admettant que les Germains étaient un peuple grand et fort, ce fait seul ne suffirait pas pour fonder un système sur la taille et la force de tous les peuples du globe, et surtout pour affirmer que la grandeur et la force du corps sont une conséquence de l’impression du froid sur les organes. Deux phénomènes peuvent exister simultanément sur le même lieu, sans qu’on soit fondé à croire que l’un est la conséquence de l’autre.
De l’ensemble des faits qui précèdent devons-nous conclure que le climat produit sur la constitution physique de l’homme des effets contraires à ceux que lui attribue Montesquieu ? Si l’on jugeait sur un premier aperçu et sans rechercher la liaison des effets et des causes, telle serait sans doute la conséquence qu’il faudrait tirer de ces faits ; car nous avons vu que, dans toutes les parties du globe, les populations qui sont les plus rapprochées des pôles sont les plus faibles, les plus mal constituées ; que c’est dans les pays tempérés que se trouvent les populations d’une force moyenne, et entre les tropiques que se trouvent, en général, les populations les plus fortes, les hommes les plus robustes. On peut trouver, dans les pays les plus chauds et même dans les pays tempérés, des populations faibles ; mais à aucune des deux extrémités du globe, on ne trouve des hommes grands et forts, à moins qu’ils n’aient le moyen de se soustraire aux rigueurs du climat.
En restreignant le mot climat au sens naturel qu’il a, en le prenant pour le degré de latitude, il ne peut avoir presque aucun effet par lui-même, puisqu’il n’indique pas toujours le degré de froid ou de chaleur. On peut trouver, dans toutes les parties du monde, le froid de la Sibérie ; il ne s’agit pour cela que de parvenir à un certain degré d’élévation. En partant du pied des Alpes et en s’élevant jusqu’au sommet, on passe successivement dans toutes les températures. En Amérique, des peuples nombreux jouissent d’une température modérée, quoique placés entre les tropiques. En partant du pied des montagnes et en s’élevant jusqu’à une certaine hauteur, on passe de la zone torride à une zone glaciale, sous le même degré de latitude. Les productions du sol changent à mesure qu’on s’élève : on trouve, sous la même latitude, les productions qui ne croissent que dans les pays brûlants, et celles que nous ne trouvons, dans nos climats, que sur le sommet des Alpes [187].
[II-170]
Ce sont donc les effets de la chaleur ou du froid sur la constitution physique de l’homme qu’il s’agit d’apprécier, et si nous considérons ces effets dans leur ensemble, nous verrons qu’ils ne sont pas tels que Montesquieu les a vus. Rien ne saurait vivre dans un pays entièrement privé de chaleur ; on n’y trouverait point de végétation, par conséquent point d’animaux, ni d’aliments pour l’homme. En parlant des climats froids favorables au genre humain, Montesquieu n’a donc voulu parler que des pays où l’on a des alternatives de froid et de chaleur, mais où la durée de la saison rigoureuse excède la durée de la belle saison : le Kamtchatka, par exemple, a près de neuf mois d’hiver et environ trois mois d’été ; c’est un pays froid. Un pays tempéré est celui où le temps de la végétation égale à peu près en durée le temps pendant lequel la nature se repose ; telle est une grande partie de l’Europe. Enfin, un pays chaud est celui où la nature n’a point de repos, celui où la végétation est dans un travail continuel.
Quel est donc celui de ces trois pays le plus favorable au développement du genre humain ? Il est évident que l’homme ne saurait vivre dans les pays que nous avons appelés froids, si dans la belle saison il ne formait point de provisions pour l’hiver, et si, lorsque les grands froids arrivent, il n’avait aucun moyen artificiel de se procurer de la chaleur. Les Kamtchadales, avant que les Russes leur eussent appris à se former de moins mauvaises habitations, passaient l’hiver sous terre et y vivaient de poisson desséché. Ils ne se conservaient pas au moyen de l’intempérie de leur climat, mais en parvenant à s’y soustraire. Ils se formaient sous terre, s’il est permis de s’exprimer ainsi, un climat tempéré. Si les provisions qu’ils avaient faites au moyen de la pêche étaient insuffisantes, ils y suppléaient en tendant des pièges à des animaux ; mais les animaux eux-mêmes ne pouvaient être communs, puisqu’ils manquaient de moyens de subsistance.
Dans les pays tempérés où les peuples n’ont fait presque aucun progrès dans la civilisation, comme étaient plusieurs contrées de l’Amérique il n’y a pas fort longtemps, le nombre de la population est toujours réduit à ce que le pays peut nourrir pendant l’hiver. Mais ici les subsistances sont moins rares et de meilleure qualité que dans les pays qui n’ont que trois mois de végétation. L’homme, sans doute, ne peut pas se nourrir des végétaux qui commencent à pousser dès le printemps et qui se conservent pendant l’hiver, même sous la neige ; mais d’autres animaux s’en nourrissent, et il se nourrit lui-même d’animaux. La saison étant moins rigoureuse, il est moins obligé de se tenir renfermé ; la chasse lui est moins difficile. Il peut d’ailleurs se livrer à la pêche pendant plus de temps que l’habitant des pays froids ; puisque les lacs et les rivières sont moins longtemps gelés, et que la glace est plus facile à rompre. Enfin, pendant la belle saison, la terre peut lui fournir pendant plus longtemps une plus grande quantité de végétaux. Cela nous explique comment, en partant de l’extrémité septentrionale de l’Amérique et en s’avançant vers l’équateur jusqu’à la Louisiane, on trouve des hommes qui sont toujours plus nombreux et mieux constitués.
Un pays chaud où la végétation est toujours en activité offre à la population toutes les ressources de la chasse et de la pêche, et ces ressources sont les mêmes presque pendant tout le cours de l’année. Il offre, de plus, des productions végétales qui se renouvellent sans cesse, et qui fournissent soit à l’homme, soit aux animaux dont il se nourrit, des aliments, sinon abondants, répartis au moins d’une manière moins inégale pendant les diverses saisons. La prévoyance qui consiste à distribuer pendant tout le cours de l’année les produits de quelques mois, est ici moins nécessaire à l’homme : la nature elle-même s’est chargée de la distribution. Les Caribes ou Caraïbes sont, dit-on, les plus imprévoyants des sauvages : la raison en est sensible ; c’est que la terre et les eaux sur lesquelles ils vivent, les ont en quelque sorte dispensés de prévoyance. Si, aux avantages d’une température chaude et toujours à peu près égale, se joignent les avantages d’une terre fertile, de végétaux et d’animaux propres à la subsistance de l’homme, d’une exposition heureuse, et d’un exercice modéré, la constitution humaine acquerra tout le développement et toute la force dont elle est susceptible : alors on trouvera, comme au milieu du grand Océan, au centre de l’Amérique et dans quelques parties de l’Afrique, des hommes qui joindront aux formes les plus belles une stature colossale [188].
[II-174]
Mais une chaleur égale et continuelle ne suffit point pour développer la constitution physique des hommes. Si un soleil ardent n’échauffe qu’une terre nue et aride comme les Steppes de l’Asie et de l’Amérique ; s’il n’y fait croître que quelques plantes rares et peu substantielles, des graminées que la sécheresse réduit en poudre ; si partout l’aridité semble poursuivre le voyageur altéré, on pourra y voir encore quelques peuplades comme on en voit dans les déserts de l’Arabie ; mais ce seront des populations différentes : les hommes y seront sains comme l’air qu’ils y respirent, petits et desséchés comme les plantes dont se nourrissent leurs chameaux.
Même dans nos pays à demi civilisés, la constitution physique des hommes varie avec les circonstances dans lesquelles ils se trouvent placés ; elle varie avec l’éducation qu’ils reçoivent, avec le genre de culture auquel ils se livrent, avec les exercices auxquels ils s’adonnent, avec la nature de l’air qu’ils respirent, avec les eaux dont ils s’abreuvent, avec les aliments dont ils se nourrissent ; le degré de latitude sous lequel ils se trouvent placés, est, en général, la circonstance qui influe le moins sur eux. La civilisation et le commerce placent, s’il est permis de s’exprimer ainsi, sous le même climat tous les hommes qui jouissent d’une fortune moyenne ; tous parviennent à obtenir des aliments et des boissons de même nature ; tous savent proportionner leurs vêtements et leurs habitations au degré de froid du pays qu’ils habitent. La température dans laquelle vit, au milieu de l’hiver, un habitant de la Russie, est peut-être même plus élevée que celle dans laquelle vit dans la même saison un habitant de la France. Les hommes du Midi qui voyagent dans le Nord pendant l’hiver, trouvent ordinairement que les appartements y sont beaucoup trop échauffés. Les habitants des pays chauds ne peuvent pas, il est vrai, se soustraire à l’action de la chaleur avec la même facilité que les habitants des pays froids peuvent se soustraire aux intempéries de l’air ; mais nous avons vu, par de nombreux exemples, que la chaleur est loin d’être contraire au développement physique des hommes.
Nous avons observé précédemment que nos organes physiques sont susceptibles de deux genres de perfectionnement : celui qui consiste dans la bonté de leur constitution, et celui qui consiste dans la dextérité ou l’habileté qu’ils ont acquise par l’étude et l’exercice : nous ne nous sommes occupés que du premier dans ce chapitre et dans le chapitre précédent. Nous nous occuperons du second en exposant quel est l’ordre qu’a suivi le développement intellectuel dans les diverses parties du globe. Il me suffit d’avoir démontré ici que les peuples des pays froids ne sont pas nécessairement mieux constitués que les peuples des pays chauds ou des pays tempérés.
Mais la chaleur du climat pourrait avoir peu d’influence sur notre constitution physique, et en avoir beaucoup sur nos facultés morales et intellectuelles. Il reste donc à savoir si l’opinion formée ou adoptée par plusieurs philosophes à cet égard, est mieux fondée que celle que nous venons d’examiner. En soumettant cette opinion à l’examen, nous constaterons quelles sont les parties du globe qui ont été les plus favorables au développement de l’intelligence humaine, et quelles sont celles qui lui ont opposé le plus d’obstacles. Nous chercherons à déterminer ensuite quelles sont les causes qui, placées hors de la nature humaine, ont le plus contribué soit à faire faire des progrès aux nations, soit à les retenir dans la barbarie.
[II-177]
CHAPITRE IX.↩
Du développement intellectuel acquis en Amérique, sous différents degrés de latitude, par des peuples d’espèce cuivrée ou américaine.
Chardin croit avoir observé que la chaleur du climat énerve l’esprit, dissipe le feu de l’imagination et rend l’homme incapable de ces longues veilles, de cette forte application qui enfantent les beaux ouvrages. Montesquieu pense également qu’un climat chaud produit l’abattement de l’esprit, détruit toute curiosité, éteint toute noble entreprise, tout sentiment généreux. Il croit de plus qu’un climat tempéré inspire de l’inconstance et ne laisse par conséquent aucune fixité aux idées, et qu’un climat froid attache du bon sens à des fibres grossières. Ces opinions, dont quelques-unes remontent à la plus haute antiquité, ont été reproduites par des écrivains de notre époque, et elles sont encore fort répandues dans tous les pays où nos livres sont parvenus.
Les facultés intellectuelles d’un peuple peuvent être affectées de trois manières : par l’altération de ses organes physiques, par l’affaiblissement ou par l’extinction de ses affections morales, par les circonstances physiques au milieu desquelles il est placé. Toutes les espèces d’hommes n’ont pas le cerveau également développé ; si les différences qui existent entre elles avaient été produites par les différences qui existent entre les climats ; si les peuples des climats froids avaient la tête mieux organisée que les peuples de même espèce des climats chauds, on concevrait comment les facultés intellectuelles d’un peuple peuvent être affectées par le climat qu’il habite. Mais je n’ai rencontré nulle part aucun fait duquel on puisse raisonnablement induire que le froid et le chaud produisent sur l’homme de semblables phénomènes. Les voyageurs et les naturalistes qui nous ont donné la description des hommes de tous les climats, n’ont pas observé que les habitants des pays froids eussent la tête mieux formée que les hommes de même espèce qui habitent les pays chauds. Les peuples d’Italie ne sont, sous ce rapport, inférieurs à aucun peuple d’Allemagne, et les Grecs ne sont pas plus mal organisés que les Russes.
On pourrait croire aussi que la chaleur du climat est un obstacle au développement des facultés intellectuelles, s’il était prouvé qu’elle affaiblit ou éteint les affections de l’homme. Il ne suffit pas, en effet, à un peuple, pour faire de grandes choses, que les individus dont il se compose soient susceptibles de recevoir un développement intellectuel considérable. Il faut de plus qu’ils y soient excités par quelques désirs, et que la force de ces désirs soit en raison des obstacles qui sont à vaincre. Un peuple bien organisé, mais chez lequel il n’existerait aucune volonté forte, resterait dans une éternelle médiocrité, comme un peuple qui aurait des passions très énergiques, mais qui ne serait susceptible d’aucun développement intellectuel.
Enfin, on pourrait croire que le genre humain est plus perfectible dans les pays froids que dans les autres, si les objets sur lesquels les peuples exercent leur intelligence étaient plus susceptibles de perfectionnement sous un climat froid que sous un climat chaud ou tempéré. Il est évident, en effet, que le développement intellectuel de l’homme n’est pas moins subordonné aux choses dont il est environné, qu’il n’est subordonné à sa constitution physique ou à ses facultés morales. Une nation qui se trouverait environnée de choses auxquelles il lui serait impossible de faire éprouver aucune modification avantageuse, resterait éternellement stationnaire. Un peuple, en général, ne peut faire des progrès que par les progrès qu’il peut faire faire aux choses dont il a la disposition : quand ces choses sont immuables, il cesse de les étudier, parce que l’étude n’en est plus bonne à rien. La question est donc de savoir quelles sont les circonstances dans lesquelles les hommes peuvent exercer, sur les objets qui les environnent, l’influence la plus étendue. J’examinerai cette question dans une autre partie de cet ouvrage ; il ne s’agit maintenant que d’exposer quelles sont les parties du globe sur lesquelles l’intelligence humaine s’est d’abord développée, et celles où elle a reçu le moins de développement. Avant que de rechercher les causes qui ont produit tel ou tel phénomène, il faut d’abord constater que ce phénomène existe ou a existé.
Lorsqu’on n’observe aucune différence dans l’organisation de plusieurs peuples qui appartiennent à la même espèce, il n’y a qu’un moyen de juger de la force intellectuelle des uns et des autres ; c’est d’examiner comment cette force se manifeste, ou quels sont les ouvrages qu’elle produit. Il est vrai qu’il faut tenir compte, dans ce calcul, de beaucoup de circonstances accidentelles, telles que la nature du sol, le cours des eaux, la nature de la langue ; il faut tenir compte des opinions religieuses, de la nature du gouvernement, de l’action que les nations exercent les unes sur les autres, et d’autres faits moins importants, mais dont la réunion exerce une grande influence. Il est facile de se tromper dans l’évaluation de toutes ces circonstances ; mais il n’est pas question d’arriver ici à une exactitude mathématique. Les mêmes difficultés se rencontrent d’ailleurs des deux côtés de la question ; et l’on ne peut pas faire en faveur de l’opinion de Montesquieu une seule objection, qui ne puisse être faite contre elle. Il faut donc examiner quelles sont les circonstances sous lesquelles chaque espèce s’est le plus développée sur chacune des principales parties du globe.
En exposant quel a été le développement intellectuel acquis par des peuples de diverses espèces ou variétés, sous différents degrés de latitude, je devrais peut-être exposer quelles ont été leurs religions, leurs lois et les formes de leurs gouvernements ; car chacun de ces sujets se rattache en grande partie au développement des facultés intellectuelles. Mais il n’en est aucun qui ne se rattache aussi aux mœurs de chaque peuple : j’en parlerai donc lorsque j’exposerai le développement moral des diverses nations sur différentes parties du globe. La difficulté qui se rencontre ici de classer convenablement les sujets qui nous occupent, est une nouvelle preuve que nos divisions et nos classifications ne sont que des méthodes plus ou moins imparfaites, que nous sommes obligés d’employer pour faciliter les opérations de notre esprit.
Le continent américain renferme aujourd’hui des peuples de diverses espèces ; mais, pour juger quelle a été, sur ce continent, l’influence des lieux et des climats sur les facultés intellectuelles, il ne faut comparer entre eux que des peuples qui appartiennent à la même espèce, et qui n’ont reçu des autres aucune influence bonne ou mauvaise. Il est évident qu’on n’obtiendrait qu’un faux résultat, si l’on comparait les indigènes du Canada aux descendants des Européens établis dans le Mexique, ou les indigènes des bords de l’Orénoque aux citoyens de Philadelphie. Il faut, pour établir une comparaison qui soit juste, examiner quels étaient en Amérique, à l’arrivée des Européens, les peuples dont l’entendement était le plus développé.
Au moment où les Espagnols firent la conquête d’une grande partie de ce continent, il n’y existait que deux peuples qui eussent déjà fait dans la civilisation des progrès considérables, les Mexicains et les Péruviens. L’un et l’autre étaient placés entre les tropiques, et la capitale du plus civilisé se trouvait sous l’équateur. Il est vrai que l’élévation du sol y tempérait l’ardeur du soleil ; mais il n’est cependant pas possible de classer au nombre des climats froids des pays où la chaleur est la même pendant toute l’année, où par conséquent la nature ne se repose jamais, et où la température est assez élevée pour qu’ils produisent la banane, le sucre, le coton, le cacao et l’indigo. Si les pays placés entre les tropiques, où croissent des denrées que ne peuvent produire les parties les plus méridionales de l’Europe, n’étaient pas des pays chauds, il serait fort difficile de déterminer ce qu’on entend par les mots de froid et de chaleur.
Si l’on compare l’état de civilisation auquel étaient parvenus les peuples du centre de l’Amérique à la fin du quinzième siècle, à l’état auquel se trouvent aujourd’hui les peuples les plus civilisés, on trouvera sans doute que les premiers n’avaient pas fait de grands progrès. Mais, si l’on compare les peuples des deux continents aux mêmes époques ; si, de plus, l’on fait attention que les Européens du quinzième siècle avaient recueilli, par l’intermédiaire des Grecs et des Romains, les inventions et les productions des peuples les plus anciennement civilisés de l’Afrique et de l’Asie ; que, depuis une époque qu’il est impossible d’assigner, et qui remonte de beaucoup au-delà de trois mille ans, ils possédaient le fer et savaient le travailler ; qu’ils avaient de plus que les Américains, une multitude d’animaux domestiques tels que le cheval, le bœuf et d’autres ; qu’ils possédaient les grains sur lesquels se fonde la subsistance d’une grande partie du genre humain tandis que les Américains ne possédaient que le maïs ; si, dis-je, l’on fait attention à toutes ces circonstances et aux progrès que les Européens ont faits depuis trois siècles, on jugera que le climat de la zone torride n’avait pas été moins favorable au développement des facultés intellectuelles de l’espèce américaine, que le climat du nord ne l’avait été au développement intellectuel de la population russe, plongée alors dans une complète barbarie, et inconnue des nations les plus éclairées de la terre.
Mais ce sont des peuples de même espèce, placés sous différentes zones, qu’il s’agit comparer, et non des peuples qui appartiennent à des espèces différentes. Quelle était donc la civilisation des habitants du Mexique, de la Nouvelle-Grenade, du Pérou et des rives du Mississipi, au moment où ils furent conquis par les Espagnols ? La destruction de la partie éclairée de ces deux peuples fut si complète, qu’il est impossible de savoir aujourd’hui, d’une manière exacte, en quoi consistaient leurs connaissances. Les descendants des hommes qui échappèrent à la destruction, ne savent pas, même par tradition, quels furent les arts, le gouvernement, la religion de leurs ancêtres. Ils sont, à cet égard, suivant M. de Humboldt, aussi ignorants que le seraient, dans trois siècles, les arrière-petits-neveux de nos laboureurs les plus pauvres et les moins instruits, si par suite de quelque grande catastrophe qui aurait fait disparaître toute la partie éclairée de la population, et anéanti tous les ouvrages qui renferment le dépôt de nos connaissances, ils avaient eux-mêmes été faits esclaves et soumis à une religion nouvelle [189]. Il ne reste donc, pour connaître le développement intellectuel auquel étaient parvenus les Américains, que les monuments qu’ils ont laissés, et les témoignages de leurs conquérants, témoignages dont il faut toujours se méfier.
À l’époque de la conquête ou pour mieux dire de la destruction des Mexicains et des Péruviens, ces peuples étaient déjà fort avancés dans les arts et dans quelques sciences. Ils possédaient des villes considérables, des grandes routes, des aqueducs ; ils avaient des connaissances en arithmétique et même en astronomie. Ils possédaient l’art de fondre et de séparer les métaux ; celui de donner au cuivre la trempe du métal le plus dur, et d’en faire des instruments ou des armes ; celui de tailler les pierres précieuses ; celui de filer et de tisser le coton et la laine ; ils savaient fondre des statues en or et en argent. Enfin, ils étaient aussi avancés, sous le rapport du gouvernement, que l’étaient alors et que le sont aujourd’hui plusieurs peuples de l’Europe [190].
Il reste encore, dans le Pérou et dans le Mexique, des traces remarquables de l’ancienne civilisation. Dans la partie maritime du Pérou, M. de Humboldt a vu des restes de murs sur lesquels on conduisait l’eau par un espace de cinq à six mille mètres, depuis le pied de la Cordilière jusques aux côtes. Les conquérants du seizième siècle détruisirent ces aqueducs ; et cette partie du Pérou, comme la Perse, est devenue un désert dénué de végétation. Telle est la civilisation que les Européens ont portée chez des peuples qu’ils se sont plu à nommer barbares [191]. Le plateau de la Puébla offre également des vestiges de la plus ancienne civilisation mexicaine [192].
[II-186]
La population la plus nombreuse et la plus civilisée de l’Amérique, après celle du Mexique et celle du Pérou, était celle qui était placée entre les deux. Les habitants de Bogota, dans la Nouvelle-Grenade, existaient principalement des produits de leur agriculture. La propriété des terres était établie parmi eux, garantie par des lois, et transmise des pères aux enfants. Ils habitaient dans des villes qu’on peut dire grandes, comparativement aux villages des autres peuples. Ils étaient vêtus d’une manière décente, et leurs maisons étaient commodes. Ils avaient un gouvernement régulier, chargé de la poursuite et de la punition des crimes. Ce gouvernement se maintenait par les impôts qu’il percevait sur les habitants [193].
Dans la Floride et sur les rives du Mississipi, la population avait déjà fait beaucoup de progrès dans les arts, autant du moins que nous pouvons en juger par les distinctions des rangs établies entre eux, par les prérogatives dont jouissaient leurs chefs. La population de Cuba et celle de quelques autres îles situées entre les tropiques paraissaient également fort avancées. Mais ces peuples ayant été complètement détruits par les conquérants, il est difficile de déterminer jusqu’à quel point leur intelligence s’était développée [194].
[II-187]
Les peuples qui habitent la partie nord-est de l’Amérique équinoxiale, la Terre-Ferme et les rives de l’Orénoque, sont aujourd’hui dans un état presque entièrement sauvage. Quelques-uns, comme les Maquitains et les Makos, ont des demeures fixes, se livrent à l’agriculture, vivent des fruits qu’ils cultivent, ont de l’intelligence et des mœurs douces ; mais c’est le plus petit nombre [195].
Les Guaranis, qui habitent à l’embouchure de l’Orénoque et qui appartiennent à une nation jadis nombreuse, n’ont jamais pu être asservis par les Espagnols. Ils ont trouvé un refuge sur les arbres placés à l’embouchure du fleuve dans des îles qui sont complètement inondées pendant les six mois que dure la saison des pluies, et qui, pendant les autres six mois, sont couvertes par la marée deux fois par jour [196]. Pour y former leurs habitations, ils tendent des nattes d’un tronc à l’autre à une grande élévation ; ils en couvrent une partie avec de la glaise, afin de pouvoir y allumer le feu qu’exigent les soins du ménage ; et là, ils établissent leurs familles, au milieu d’un nuage d’insectes qui les a garantis des soldats et des missionnaires espagnols [197]. Les Guaranis, dit M. de Humboldt, doivent leur indépendance physique, et peut-être aussi leur indépendance morale, au sol mouvant et tourbeux qu’ils foulent d’un pied léger, et à leur séjour sur les arbres ; république aérienne où l’enthousiasme religieux ne conduira jamais un stylite américain [198].
Ce peuple n’a pas d’autre industrie que la pêche, la fabrication des hamacs et des instruments qui lui sont nécessaires pour prendre le poisson. Il fréquente les villages espagnols qui sont au nord et au sud de l’Orénoque, où il va échanger une partie des produits de son industrie contre d’autres produits dont il a besoin. Ayant du poisson en abondance, pouvant échanger ce qu’il ne consomme pas contre d’autres denrées, et étant à l’abri de l’oppression, il est un des peuples les plus gais de ce continent, et ne trouble point l’ordre chez ses voisins qui se disent civilisés. Cette population est de beaucoup au-dessus de celle qui, en Chine, vit sur les fleuves et sur les rivières. Elle est même au-dessus des Indiens de la même race que les Espagnols ont réduits en villages ; puisque ceux-ci ne sont ni plus intelligents, ni plus moraux, ni mieux pourvus des choses nécessaires à la vie.
La nation des Guaranis, une des plus répandues dans l’Amérique méridionale au temps de la conquête, était divisée en une multitude de peuplades. L’occupation principale de chacune d’elles était l’agriculture : elles cultivaient le maïs, des haricots, des citrouilles, des mani ou mandubi (exachides ), des patates et des mandiocas (manioc ou camanioc). Lorsque la récolte était faite, elles la déposaient dans un grenier commun ; c’était là le fond de leur subsistance. Les peuplades qui étaient situées près des rivières et des fleuves se livraient à la pêche ; d’autres s’adonnaient à la chasse ; mais elles ne s’adonnaient à l’une ou à l’autre de ces occupations que lorsqu’elles n’avaient plus de temps à donner à la culture des terres [199].
D’autres peuples des rives de l’Orénoque avaient à peu près le même genre de vie.
« Au lever du soleil, dit Depons, tous les Indiens otomaques capables de travailler, se rendaient chez leurs capitaines respectifs qui désignaient ceux d’entre eux qui devaient aller, ce jour-là, à la pêche ou rechercher des tortues, ou à la chasse du sanglier, selon la saison. Un certain nombre était aussi destiné, dans le temps des semailles ou de la récolte, aux travaux des champs, dont les fruits se déposaient dans des greniers publics, pour être répartis par le chef. Jamais les mêmes Indiens n’allaient deux jours de suite aux travaux [200] ».
[II-190]
Les Caribes s’adonnaient également à l’agriculture. Lorsque des établissements européens ont été formés dans leur pays, ils ont servi d’intermédiaires aux Hollandais et aux Espagnols pour faire le commerce. Ils cueillaient, sur l’indication des premiers, les baumes, les résines, les gommes, les huiles, les bois qui pouvaient entrer dans le commerce ; ils recevaient en échange des marchandises européennes, et allaient les revendre dans les colonies espagnoles [201].
Un missionnaire s’étant avancé, dans le dernier siècle, sur le territoire des Indiens indépendants, jusque dans le pays de Moqui, traversé par le rio de Yaguesila, fut étonné d’y trouver une ville indienne avec deux grandes places, des maisons à plusieurs étages, et des rues bien alignées et parallèles les unes aux autres [202].
Il existe, sans doute, entre les tropiques, des peuples qui sont encore très bas dans l’échelle de la civilisation ; mais il est douteux si ces peuples et ceux dont je viens de parler, n’ont jamais pu s’élever plus haut, ou s’ils sont descendus à l’état où ils se trouvent, par quelque grande catastrophe, par suite des invasions des Européens, ou des invasions intérieures. M. de Humboldt a cru voir en remontant l’Orénoque, dans des figures gravées sur des rochers, des preuves que jadis cette solitude fut le séjour d’une nation parvenue à un certain degré de connaissances. Elles attestent, dit-il, les vicissitudes qu’éprouve le sort des peuples, de même que la forme des langues qui appartiennent aux monuments les plus durables de l’histoire des hommes [203].
« La partie nord-est de l’Amérique équinoxiale, dit ailleurs le même voyageur, la Terre-Ferme et les rives de l’Orénoque ressemblent, sous le rapport de la multiplicité des peuples qui les habitent, aux gorges du Caucase, aux montagnes de l’Hindoukho, à l’extrémité septentrionale de l’Asie, au-delà des Tungouses, et des Tartares stationnés à l’embouchure du Léna.
« La barbarie qui règne dans ces diverses régions, est peut-être moins due à une absence primitive de toute civilisation qu’aux effets d’un long abrutissement. La plupart des hordes que nous désignons sous le nom de sauvages, descendent probablement de nations jadis plus avancées dans la culture. Et comment distinguer l’enfance prolongée de l’espèce humaine (si toutefois elle existe quelque part) de cet état de dégradation morale dans lequel l’isolement, la misère, des migrations forcées, ou les rigueurs du climat, effacent jusqu’aux traces de la civilisation ? » [204]
Il paraît difficile de concevoir, en effet, qu’à côté de peuples aussi avancés dans la civilisation que l’étaient les Mexicains et les Péruviens, il se trouvât des peuples de même espèce qui n’étaient pas encore sortis de l’état sauvage. Un tel phénomène semble d’abord plus extraordinaire que la décadence dont M. de Humboldt croit avoir reconnu les preuves. Plusieurs causes qui n’existaient ni pour les habitants du Pérou, ni pour ceux du Mexique, ont pu cependant, ainsi qu’on le verra dans la suite, prolonger la barbarie des peuples qui vivaient sur les terres les moins élevées. L’état d’abjection et la profonde ignorance dans lesquels ont été plongés les Indiens qui sont restés soumis au gouvernement espagnol, les ont placés d’ailleurs bien au-dessous des Indiens qui sont restés indépendants à l’embouchure ou sur les rives de l’Orénoque.
« Les Péruviens, tous les Péruviens sans exception, dit Raynal, sont un exemple de ce profond abrutissement où la tyrannie peut plonger les hommes ; ils sont tombés dans une indifférence stupide et universelle » [205]. « L’oubli des arts a été porté si loin, dit un auteur espagnol, que les Indiens civilisés ne pourraient faire une flèche, y ajuster une pierre, ni y poser les plumes pour en diriger le trajet. À plus forte raison ne sauraient-ils faire un arc avec de justes proportions. Ainsi, ce qui n’est qu’un jeu pour les sauvages indépendants, est une chose impossible pour les successeurs des Indiens qui ont été les plus industrieux [206]. »
Dans le Mexique, les indigènes ont été relégués par les conquérants dans les terres les moins fertiles. Plus indolents encore par leur situation politique que par caractère, ils ne vivent qu’au jour le jour, et, en les considérant en masse, ils présentent tous le tableau de la misère [207]. Dans les églises, ils ne se montrent que couverts de haillons qui remplissent bien moins le vœu de la pudeur, dit Depons, que ne le remplirent des feuilles de figuier ; souvent même entièrement nus, ils restent couchés ou accroupis pendant le service divin [208]. Le dénuement dans lequel ils se trouvent, est tel que les effets de la famine se font sentir dans presque toutes les régions équinoxiales. Dans l’Amérique méridionale, dans la province de la Nouvelle-Andalousie, j’ai vu, dit M. de Humboldt, des villages dont les habitants, forcés par la famine, se dispersent de temps en temps dans les régions incultes, pour y chercher de la nourriture parmi les plantes sauvages [209]. Il n’est pas rare de les voir manger des fourmis, des lézards, des millepieds ou scolopendres qu’ils retirent de la terre, des racines de fougère, de la gomme, et surtout de la terre glaise. Tel est l’état auquel la conquête a fait descendre une nation jadis florissante [210].
L’état des Indiens que les conquérants et les moines espagnols ont civilisés à leur manière, pourrait donc servir à nous expliquer l’état des Indiens indépendants : on concevrait que ceux-ci fussent descendus très bas dans l’échelle de la civilisation, sans être arrivés au point où se trouvent réduits les Indiens ; que les Guaranis qui vont vendre leur poisson dans les villages espagnols, y puisassent toujours plus d’attachement pour leur indépendance, et qu’ils fussent sourds aux exhortations des missionnaires qui cherchent à les convertir. Mais nous trouverons ailleurs, dans la nature du sol et dans d’autres circonstances physiques, les causes qui ont retenu ces derniers peuples dans l’état de barbarie où ils se trouvent [211].
La chaleur des régions équinoxiales n’avait donc pas été un obstacle, en Amérique, au développement des facultés intellectuelles d’une partie de la population ; puisque les Mexicains, les Péruviens et quelques autres peuples avaient déjà fait beaucoup de progrès dans les arts, dans les sciences, et surtout dans le gouvernement, avant les conquêtes des Espagnols. S’il existe aujourd’hui, dans les mêmes régions, des peuples auxquels nous donnons le nom de sauvages, par la raison qu’ils repoussent notre domination et nos croyances religieuses, il est au moins douteux si quelques-uns de ces peuples n’ont pas été plongés dans l’état où ils se trouvent par suite d’une invasion. Enfin, ces peuples mêmes avaient déjà fait le pas le plus difficile pour sortir de la barbarie, puisqu’ils tiraient de l’agriculture leurs principaux moyens d’existence, et que parmi eux il était extrêmement rare de rencontrer des hordes de chasseurs [212].
En nous dirigeant vers des climats tempérés ou froids, trouverons-nous des peuples de même espèce dont les facultés intellectuelles aient reçu plus de développement ? Les indigènes du Brésil et ceux de l’Uruguay ou Paraguay, placés entre le vingtième et le trentième degré de latitude australe, faisaient partie de la nation des Guaranis, et avaient peut-être dépassé ceux dont je viens de parler. L’art de l’agriculture, quoique dans l’enfance, leur fournissait leurs principaux moyens d’existence. Ils avaient déjà converti la terre en propriétés privées, et ils tiraient de la chasse ou de la pêche ce que le sol ne pouvait pas leur fournir [213]. Ces peuples, attachés à la terre par la culture, furent plus facilement asservis que ceux qui n’étaient pas encore arrivés au même degré de civilisation [214].
Les nombreuses peuplades qui vivent depuis le trente-sixième degré de latitude australe, jusqu’au détroit de Magellan, vers le cinquante-cinquième degré, ont toujours été complètement étrangères à l’agriculture. Celles d’entre elles qui habitent sur les bords des fleuves ou de la mer, tirent de la pêche la principale partie de leurs subsistances ; celles qui vivent dans l’intérieur des terres, vivent particulièrement sur les produits de leurs chasses [215]. Cependant, depuis que les Européens ont transporté en Amérique des bœufs, des chevaux et des mulets ; depuis que ces animaux se sont excessivement multipliés dans les steppes américaines, et qu’un grand nombre sont même devenus sauvages, plusieurs tribus d’Indiens en ont formé des troupeaux, et adopté le genre de vie des Tartares. Aussi habiles que les Arabes à monter leurs chevaux, ils parcourent avec rapidité des plaines entrecoupées de montagnes ; ils enlèvent les troupeaux des Espagnols, et dévalisent les voyageurs [216]. Ceux dont le territoire est le plus rapproché du territoire de Magellan, tels que les Patagons, errent aussi dans les savanes de l’Amérique comme les barbares du centre de l’Asie ; mais c’est de la chasse qu’ils tirent la plus grande partie de leurs subsistances [217]. Leurs habits consistent dans les peaux des animaux qu’ils ont tués, et dans lesquelles ils s’enveloppent [218] ; leurs tentes sont formées des peaux de vache ou de buffle, fixées sur quatre piquets ; et, quand ils voyagent, ils en chargent leurs chiens, comme les peuplades de l’Asie boréale [219].
De tous les hommes qui habitent l’Amérique méridionale, il n’en est point dont les facultés intellectuelles soient moins développées que ceux qui vivent sur le détroit de Magellan ou sur la terre de Feu. Placés sous un climat plus rigoureux que celui de la Norvège, ils ne savent se vêtir qu’en jetant sur leurs épaules une peau de veau marin [220]. Leurs cabanes consistent en quelques pieux plantés en terre, inclinés les uns sur les autres par leurs sommets et formant une espèce de cône, et sur lesquels ils jettent du côté du vent, quelques branchages ou un peu de foin [221]. Sans autre industrie que celle qui leur est nécessaire pour faire leurs instruments de pêche, ils ne donnent à leurs aliments aucune préparation et dévorent le poisson cru et la viande pourrie. Les aliments dont ils se nourrissent et la saleté dans laquelle ils vivent, leur font exhaler une puanteur horrible [222].
Leur défaut de développement intellectuel ne se manifeste pas seulement par la manière grossière dont sont faits leurs vêtements, leurs instruments et leurs cabanes, et par le défaut de préparation de leurs aliments ; elle se manifeste surtout par une absence complète d’étonnement et de curiosité ; leur stupidité est telle, qu’elle a frappé tous les voyageurs qui les ont visités [223]. On ne peut pas dire cependant que c’est la chaleur du climat qui éteint en eux toute curiosité , puisqu’il y tombe de la neige dans la plus belle saison de l’année ; que les indigènes ne peuvent jamais s’y passer de feu, et que des Européens y sont morts de froid au milieu de l’été [224].
À l’autre extrémité du continent américain, on trouve des peuplades qui vivent presque uniquement sur les produits de la pêche ; ce sont les Esquimaux. Ces peuplades, quoique placées sous une latitude très élevée, sont un peu moins stupides que les habitants de la terre de Feu. Leurs habits, faits de peaux de veaux marins, de bêtes fauves, et quelquefois même de peaux d’oiseaux terrestres et aquatiques, sont bien cousus, et [II-200]les mettent à l’abri de l’intempérie du climat [225]. Les huttes, creusées sous terre, grossièrement faites, et dans lesquelles on ne peut entrer qu’en rampant sur le ventre, sont cependant plus propres à mettre les habitants à l’abri du froid [226]. Enfin, ces peuples fabriquent avec beaucoup d’adresse les instruments dont ils ont besoin pour subsister. Plusieurs circonstances peuvent expliquer la supériorité qu’ils ont sur les habitants de la terre de Feu ; ils ne sont pas séparés du continent par un détroit qui les isole du reste du globe ; il leur est moins difficile de pourvoir à leur subsistance, la terre qu’ils habitent étant moins dépourvue d’animaux ; ils sont par conséquent obligés d’acquérir un plus grand nombre d’idées, puisqu’ils ont à se livrer à des exercices plus variés, et qu’ils ont un peu plus de temps pour s’exercer ou pour réfléchir ; je n’ajouterai pas qu’ils appartiennent à une espèce différente, parce que cette circonstance me paraît ici sans influence.
Quelques-unes des peuplades qui habitent la partie nord de l’Amérique, depuis le soixante-huitième degré jusque vers le quarante-huitième, sont peut-être un peu plus avancées que les Esquimaux ; mais elles le sont beaucoup moins que celles qui habitent depuis le quarante-huitième degré jusque vers le trente-sixième. Les premières vivent de chasse et de pêche ; mais elles sont entièrement étrangères à l’agriculture. Les hommes poursuivent les animaux, ou leur tendent des pièges ; ils tuent le poisson à coups de lance ; les femmes vont à la pêche avec des filets. Les peuplades plus rapprochées du sud, ont également la ressource de la pêche et de la chasse, mais, en même temps, elles cultivent la terre ; et plus elles se rapprochent des pays chauds, plus aussi la portion d’aliments que leur fournit l’agriculture est considérable, comparativement à ce qu’elles retirent de la chasse et de la pêche.
Les nombreuses peuplades qui étaient répandues dans cette partie de l’Amérique, à l’arrivée des Européens, cultivaient la terre en commun, et en déposaient les produits dans des magasins publics, de la même manière que plusieurs des peuplades qui habitaient entre les tropiques ; et, quoique ce mode de culture soit très peu favorable aux progrès de la civilisation, il leur donnait le moyen de faire d’immenses provisions. Dans les guerres qui avaient lieu entre ces peuples, un des premiers soins des vainqueurs, comme chez les Romains, était de ravager les moissons des vaincus ou de brûler leurs magasins, dans l’espérance de les affamer. Les Européens, qui prenaient parti tantôt pour les uns et tantôt pour les autres, les secondaient toujours dans ce genre de destruction :
« Nous fûmes occupés pendant cinq ou six jours, dit un officier français qui, dans le dix-septième siècle, se trouvait dans une de ces guerres, à couper le blé d’Inde avec nos épées dans les champs. De là, nous passâmes aux deux petits villages de Thegaronhiers et Danoncaritaouis, éloignés de deux ou trois lieues du précédent. Nous y fîmes les mêmes exploits [227]. »
Charlevoix raconte que des soldats, après avoir déjà fait beaucoup de ravages, découvraient encore des magasins creusés dans la terre, suivant la coutume des sauvages, et qui étaient tellement remplis de grains, qu’on aurait pu en nourrir toute la colonie (du Canada) pendant deux ans. Les Indiens qui occupaient le territoire situé entre le Canada et le golfe du Mexique, paraissent avoir été un peu plus avancés [228].
Les côtes nord-ouest de l’Amérique présentent un phénomène remarquable : celui d’une population dont l’industrie et les facultés intellectuelles ont reçu un développement considérable, au milieu de peuplades qui sont restées ou descendues dans l’état de barbarie le plus grossier. Les Tchinkitanés, placés entre le cinquantième et le cinquante-cinquième degré de latitude nord, et dont quelques-uns se sont même élevés jusqu’au soixantième degré, sur les bords de la rivière de Cook, sont un peuple qui se distingue de tous ceux de la même race qui habitent le continent américain [229]. Sans autre secours que celui du feu et des outils qu’ils ont formés avec de la pierre, des os de quadrupèdes, des arêtes de poisson, et des peaux rudes de cétacée, ils parviennent à construire des maisons à deux étages, de cinquante pieds de longueur, de trente-cinq de profondeur, et de quatorze de hauteur ; ils forment des planches longues de vingt-cinq pieds, larges de quatre pieds, et épaisses de deux pouces et demi ; ils exécutent des sculptures en bois, au moyen desquelles ils représentent des hommes, des oiseaux, ou d’autres animaux ; ils peignent l’extérieur de leurs maisons, et ornent l’intérieur de tableaux ; ils filent et tissent le poil des animaux, et se servent de leurs tissus pour faire des manteaux ; ils taillent la serpentine et lui donnent le poli du marbre ; ils fabriquent des flûtes et un instrument de musique qui a quelque ressemblance avec la harpe. Ce peuple met de l’ordre dans le commerce qu’il fait avec les Européens, et n’est ni bruyant, ni importun. Il est vêtu à l’européenne ; et, dans ses échanges, des habits, des armes, et des vases propres à la préparation de ses aliments, sont les marchandises auxquelles il donne la préférence [230].
Mais, sur les mêmes côtes, soit qu’on s’élève vers le nord ou qu’on descende vers le sud, on trouve des peuplades qui sont presque aussi misérables et aussi stupides que celles qui habitent la terre de Feu, des peuplades dont les habitations offrent l’aspect le plus dégoûtant, et qui se nourrissent des aliments les plus grossiers [231].
À quelles causes faut-il attribuer la supériorité d’intelligence des Tchinkitanéens ? Le savant qui a publié les voyages du capitaine Marchand, a pensé que ce peuple descend de Mexicains qui se réfugièrent sur ces côtes, à l’époque de l’invasion des Espagnols. M. de Humboldt ne croit point que des fugitifs aient pu parcourir l’immense distance de trente degrés de latitude pour chercher un refuge sur des côtes stériles. Mais n’aurait-il pas existé, en Amérique, d’autres nations civilisées plus rapprochées du nord, qui auraient péri avant même que la nation mexicaine eût succombé ? Les nombreuses fortifications découvertes sous les latitudes les plus favorables de l’Amérique septentrionale, donnent à cette opinion beaucoup de probabilité [232].
Lorsque des événements violents, comme sont les invasions et les conquêtes, ne troublent pas l’ordre que la nature suit dans toutes ses créations, la civilisation ne se répand que graduellement sur la surface de la terre. S’il se forme quelque part un foyer de lumières, et si les peuples ne sont pas séparés par des déserts inhabitables ou par des monts inaccessibles, on ne passe pas subitement d’un jour éclatant à des ténèbres profondes. Tout ce qui environne le lieu où le foyer s’est formé, en est d’abord éclairé ; la lumière s’affaiblit à mesure qu’on s’éloigne, et enfin on arrive à un point où elle ne peut plus parvenir. Ce n’est pas seulement en considérant les peuples en masse, qu’on s’aperçoit de cette gradation ; on l’observe aussi dans chaque état particulier ; chez tous les peuples, on trouve des centres de lumière plus ou moins grands, dont l’effet diminue à mesure qu’on s’éloigne. Or, quel a été en Amérique le climat sous lequel s’est formé le premier centre de lumières ? celui sous lequel les facultés intellectuelles de l’homme ont reçu les premiers développements ? C’est entre les tropiques, sous la zone torride : la civilisation semble s’être répandue de là dans des lieux tempérés et d’une culture facile ; mais elle n’est jamais arrivée dans les pays froids ; on ne trouve dans la partie la plus septentrionale de l’Amérique, aucun monument qui atteste une ancienne civilisation [233].
[II-207]
CHAPITRE X.↩
Du développement intellectuel acquis dans les îles du grand Océan, sous différents degrés de latitude, par des peuples d’espèce malaie, et par des peuples d’espèce nègre ou éthiopienne.
Nous observons chez les peuplades qui habitent les îles nombreuses du grand Océan, un phénomène analogue à celui que nous avons observé sur le continent américain. Ces peuplades, à un très petit nombre d’exceptions près, appartiennent à la même espèce ; elles ont la même organisation physique ; elles parlent des dialectes de la même langue. Leur origine commune est, à ce qu’on suppose, peut-être sans beaucoup de raison, la presqu’île de Malaca, à l’extrémité australe de l’Asie, entre le deuxième et le dixième degré de latitude boréale. C’est sous la zone torride que la race malaie, comme la race américaine, a manifesté les premiers développements intellectuels.
Lorsque les Européens ont visité pour la première fois les îles du grand Océan situées entre les tropiques, tous les insulaires ignoraient l’usage ou même l’existence des métaux ; ils ne possédaient par conséquent aucun des outils à l’aide desquels nous exécutons toutes les choses qui nous sont nécessaires, et sans lesquels nous ne serions peut-être pas beaucoup plus avancés que ne l’étaient la plupart des indigènes de l’Amérique septentrionale, à l’arrivée des Européens ; de tous les animaux domestiques qui concourent à l’exécution de nos travaux, ou qui nous servent d’aliments, ils ne possédaient que des chiens, des poules et des cochons ; enfin, ils ne possédaient aucun de nos légumes, ni de nos grains. Cependant, ils ne tiraient de la chasse aucune ressource, et la pêche était abandonnée à la partie la plus misérable de la population. Leurs outils consistaient en pierres tranchantes, en morceaux de coquilles, en dents de requin et en peaux de raie : c’est à l’aide seule de ces outils qu’ils eurent à abattre des arbres, défricher les sol, fabriquer leurs armes, tisser leurs toiles, construire leurs pirogues et leurs maisons [234] : les arbres qu’ils avaient à abattre et à façonner avaient souvent huit pieds de circonférence dans le tronc et quatre dans les branches [235] ; le sol qu’ils avaient à défricher était souvent dur, couvert d’arbres et de broussailles [236].
[II-209]
Ayant de si faibles moyens d’exécution, étant placés sous un climat jugé si défavorable au développement de l’intelligence, et appartenant à une espèce dont on croit les facultés intellectuelles moins susceptibles de perfectionnement que les nôtres, ces peuples étaient-ils restés ou retombés dans l’état sauvage ? Ceux qui sont placés sous l’équateur, avaient-ils fait moins de progrès que ceux qui en sont plus ou moins éloignés ?
Les peuples des îles Marquises, qui, suivant les témoignages des voyageurs, sont les plus beaux qu’on ait rencontrés sur le grand Océan, sont agriculteurs, comme le sont presque tous ceux qui se trouvent entre les tropiques. On nous a donné des détails peu étendus sur leur agriculture ; nous voyons cependant que la terre y est partagée avec plus d’égalité que dans aucun autre archipel ; que les propriétés y sont mieux garanties ; que le sol, qui consiste en un riche terreau, est couvert de belles plantations de bananiers ou de bocages d’arbres fruitiers, et que la pêche, qui est la principale ressource des peuples sauvages placés sur les bords des lacs ou des fleuves, y est dédaignée par quiconque possède une portion de terre suffisante à son entretien [237]. Nous voyons que leurs ustensiles, leurs meubles, leurs vêtements, leurs parures, tout annonce dans les hommes qui les inventèrent, et dans ceux qui les fabriquent, de l’intelligence et de l’industrie, et que leurs instruments de pêche diffèrent peu des nôtres [238]. Nous pourrons juger, au reste, de leur agriculture, de leurs habitations et de leurs pirogues, par celles des peuples qui sont les plus rapprochés d’eux et que nous connaissons mieux.
Les îles des Navigateurs, qui ne sont qu’au treizième degré de latitude australe, sont remarquables par la propreté des villages et des habitations : la Pérouse, qui les visita, en fut saisi d’admiration. Il s’écarta des gens de son équipage d’environ deux cents pas, pour aller visiter un village placé au milieu d’un bois, ou plutôt d’un verger, dont les arbres étaient chargés de fruits. Les maisons étaient placées sur la circonférence d’un cercle d’environ cent cinquante toises de diamètre, dont le centre formait une vaste place, tapissée de la plus belle verdure ; les arbres qui l’ombrageaient entretenaient une fraicheur délicieuse [239].
« L’imagination la plus riante, dit-il, se peindrait difficilement des sites plus agréables que ceux de leurs villages : toutes les maisons sont bâties sous des arbres à fruits, qui entretiennent dans ces demeures une fraîcheur délicieuse. Elles sont situées au bord d’un ruisseau qui descend des montagnes, et le long duquel est pratiqué un sentier qui s’enfonce dans l’intérieur de l’île [240]. »
L’architecture de ces insulaires a pour objet principal de les préserver de la chaleur, et ils savent joindre l’élégance à la commodité. Leurs maisons, assez grandes pour loger plusieurs familles, sont entourées de jalousies qui se lèvent du côté du vent, et se ferment du côté du soleil. Les insulaires dorment sur des nattes très fines, très propres et parfaitement à l’abri de l’humidité.
« J’entrai dans la plus belle de ces cases, qui vraisemblablement appartenait au chef, dit encore La Pérouse, et ma surprise fut extrême de voir un vaste cabinet de treillis, aussi bien exécuté qu’aucun de ceux des environs de Paris. Le meilleur architecte n’aurait pu donner une courbure plus élégante aux extrémités de l’ellipse qui terminait cette case. Un rang de colonnes, à cinq pieds de distance les unes des autres, en formait le pourtour : ces colonnes étaient faites de troncs d’arbres très proprement travaillés, entre lesquels des nattes fines artistement recouvertes les unes par les autres en écailles de poisson, s’élevaient ou se baissaient avec des cordes comme nos jalousies. Le reste de la maison était couvert de feuilles de cocotier [241]. »
Ces peuples fabriquent des nattes très fines, des toiles qui ont la souplesse et la solidité des nôtres, des meubles de bois si bien polis qu’ils semblent couverts du vernis le plus fin. Ils construisent aussi des pirogues ; mais elles sont moins grandes que celles qui sont construites dans d’autres îles. Les plus communes ne portent que cinq ou six hommes ; les plus grandes n’en portent pas au-delà de quatorze [242]. Tous les villages étant situés sur les bords de la mer, les insulaires ne communiquent entre eux qu’au moyen de leurs pirogues. On ne pénètre dans l’intérieur du pays que par de petits sentiers ; et La Pérouse n’a pu voir l’état de l’agriculture. Les habitants des îles de la Société ne sont pas moins avancés que ceux des îles des Navigateurs ; avec les mêmes instruments, ils fabriquent les mêmes objets, mais leurs pirogues sont beaucoup plus grandes. Toutes les terres y sont partagées et bien cultivées. Les habitants les arrosent en élevant l’eau par le moyen d’écluses. Le soin qu’ils mettent à extirper des champs les plantes inutiles est tel, que dans une excursion de trois jours faite dans l’intérieur de l’île, des naturalistes n’ont pu trouver que trois plantes différentes [243].
Ces peuples, au moyen de leurs pirogues, font des voyages de quatre cents lieues, sans autres guides que le soleil pendant le jour, que les étoiles pendant la nuit [244], et que la direction des vents quand le temps est couvert [245]. Ils distinguent les étoiles par des noms particuliers ; ils connaissent dans quelle partie du ciel elles paraîtront, à chacun des mois où elles sont visibles sur l’horizon ; enfin, ils savent le temps de l’année où elles doivent se montrer et disparaître [246]. La grandeur et la solidité des pirogues avec lesquelles ces peuples voyagent et commercent entre eux, sont telles, qu’au jugement de Cook, il n’est pas plus difficile de construire un grand navire avec nos instruments, que de construire une de ces pirogues avec les outils que possédaient les habitants de ces îles, à l’arrivée des Européens [247]. Enfin, à la même époque ces peuples avaient déjà fait des progrès en chirurgie et en médecine ; ils avaient des éléments de calcul ; ils employaient le système décimal et pouvaient compter jusqu’à deux mille [248].
Nous trouvons le même développement intellectuel chez les habitants des îles des Amis. Les terres y sont partagées, environnées de haies et couvertes de plantations. On n’y voit de terres incultes que celles que les habitants croient avoir besoin de laisser reposer, et elles sont peu considérables. Les propriétés, dit Dentrecasteaux, y sont marquées et garanties par des enclos beaucoup mieux faits encore que ceux d’Amboine [249]. Le pays est percé de routes larges, unies, environnées de haies, et garanties des ardeurs du soleil par des arbres fruitiers [250]. Les maisons n’y paraissent cependant pas aussi soignées qu’elles le sont dans l’archipel des Navigateurs [251]. Leurs pirogues diffèrent peu de celles des habitants des îles de la Société. Les îles Sandwich semblent moins fertiles que la plupart de celles qui sont placées sous l’équateur ; et cela peut expliquer comment la population en est moins belle. Les habitants appartiennent également à l’espèce malaie ; ils sont placés comme les autres dans les régions équinoxiales ; mais ils ont les facultés intellectuelles un peu moins développées. Cependant, avant de communiquer avec les Européens, ils avaient fait, dans l’agriculture, tous les progrès que comportaient leur situation et les avantages naturels dont ils jouissaient. Leurs instruments, leurs productions, étaient les mêmes que dans les autres îles placées sous la même latitude [252]. Leurs pirogues étaient beaucoup plus légères et beaucoup plus frêles [253]. Ce peuple parut surtout fort curieux, et manifesta beaucoup de surprise en voyant la supériorité qu’avaient sur lui les Européens [254].
Les habitants de l’île de Pâques, plus éloignés de l’équateur que les habitants des îles de la Société d’environ huit degrés, ont aussi fait beaucoup moins de progrès dans les arts. Leurs outils sont très imparfaits, et l’on n’a observé chez eux aucun instrument d’agriculture [255]. Il paraît qu’après avoir nettoyé la terre, ils y font des trous avec des piquets de bois et qu’ils plantent ainsi le petit nombre de végétaux qu’ils possèdent [256]. Leurs champs sont cependant cultivés avec intelligence, quoiqu’ils ne soient point clos. Les herbes qu’ils en arrachent, sont amoncelées et brûlées ; les cendres sont employées à fertiliser la terre [257]. Ces insulaires cultivent les patates, les ignames, les bananes, les cannes à sucre ; ils recueillent, sur les rochers au bord de la mer, un petit fruit semblable aux grappes de raisin qu’on trouve aux environs des tropiques [258]. Ils ne possèdent pas d’autres animaux qu’un très petit nombre de volailles d’une très petite espèce, d’un plumage peu fourni [259]. Une partie de leurs habitations sont souterraines ; les autres sont faites de jonc [260]. Enfin, on n’a vu dans l’île tout entière que trois ou quatre pirogues construites de plusieurs morceaux de bois joints ensemble, très mauvaises, et capables tout au plus de porter trois ou quatre personnes [261].
Les peuples de la Nouvelle- Zélande habitent un climat froid comparativement à ceux qui sont placés entre les tropiques, et même aux habitants de l’île de Pâques ; il y a entre eux et les habitants des îles de la Société une distance d’environ vingt degrés de latitude. Ils appartiennent à la même espèce d’hommes, parlent la même langue, et sont pourvus des mêmes instruments ; il y a cependant entre le développement intellectuel des uns et des autres une immense différence. Les peuples de la Nouvelle-Zélande savent faire des pirogues ; ils cultivent la terre et construisent des fortifications pour se mettre à l’abri des invasions de leurs ennemis [262]. Mais ils sont, presque sur tout, si inférieurs à la plupart des peuples qui habitent entre les tropiques, qu’on ne peut établir entre eux aucune analogie. Ils n’ont pour habitations que de petites cabanes pleines de fumée et d’ordures ; ils portent des vêtements très mauvais, très sales et couverts de vermine. Ils sont eux-mêmes couverts d’un tel amas d’ordures, qu’il est impossible de discerner la couleur de leur teint, et qu’ils exhalent une puanteur horrible [263]. Ils se nourrissent des aliments les plus grossiers, dévorant le poisson et la viande pourris ; ils s’abreuvent de l’huile rance de veau marin avec une telle avidité, qu’en vidant les lampes du capitaine Cook, ils en avalaient les mèches enflammées [264]. Enfin, il n’est pas jusqu’à la vermine qui les couvre qui ne leur serve d’aliments [265]. Du reste, ils voient les équipages européens sans étonnement et sans curiosité, et ils n’ont pas su cultiver les plantes semées dans leur île, quoiqu’ils les aiment passionnément [266].
Les indigènes de la terre de Van-Diemen, placés sous la même latitude que la partie la plus australe de la Nouvelle-Zélande, mais appartenant à une variété de l’espèce nègre, ont l’intelligence moins développée encore. Aussi dépourvus de curiosité que ceux de la terre de Feu, et paraissant encore plus stupides, ils n’ont aucune idée de la culture de la terre, quoique placés sur un sol très fertile [267]. Sans cesse errants sur le rivage de la mer, ils n’ont pour vivre que des coquillages et quelques poissons qu’ils prennent avec de grandes difficultés. Ils s’abreuvent, sans répugnance, de l’eau la plus croupie et la plus bourbeuse [268]. Complètement nus, quoique sous un climat où les hivers sont rigoureux, ils sont sans cesse exposés aux injures du temps et aux piqûres des insectes les plus venimeux ; ils sont déchirés par les broussailles à travers lesquelles ils passent, et dévorés de vermine dont ils se débarrassent en la mangeant [269]. Leurs habitations consistent en quelques misérables abat-vent faits d’écorce, ou elles sont formées dans les troncs des arbres au moyen du feu [270]. Leurs pirogues ne sont que des radeaux formés au moyen de quelques faisceaux d’écorce d’arbres [271]. Leurs meubles, un panier fait également d’écorce, un sac fait d’algues marines, un casse-tête grossièrement fait, et un bâton pointu qu’ils lancent avec maladresse et à une petite distance [272]. Leurs villages, s’il est permis de leur donner ce nom, ne se composent jamais que de trois ou quatre habitations temporaires, chacune desquelles peut abriter trois ou quatre personnes. Enfin, ces hommes n’ont ni gouvernement, ni chefs : ils vivent dans une parfaite indépendance les uns des autres. Ils sont faibles, soupçonneux et méchants : ce sont, dit Péron, les enfants de la nature par excellence [273].
Les habitants de la Nouvelle-Hollande, plus rapprochés de l’équateur, et appartenant à d’autres variétés de la même espèce, ont l’intelligence un peu plus développée. Ils ne manifestent pas plus de curiosité que ceux de la terre de Van-Diemen, et ne reçoivent pas avec moins d’indifférence les présents qu’on leur fait [274] ; ils ne sont pas moins étrangers à la culture de la terre, et ne connaissent pas mieux l’art de se vêtir. Mais ils sont un peu moins malhabiles à se procurer des aliments, à former leurs pirogues, leurs huttes et leurs armes., Leurs hordes sont un peu plus nombreuses, et on trouve chez eux un premier germe d’organisation sociale, puisqu’ils reconnaissent des chefs. Ceux qui vivent sur les rivages de la mer, en tirent la principale partie de leurs subsistances ; mais ils connaissent de plus que les habitants de la terre de Van-Diemen, l’usage de l’hameçon, l’art de fabriquer des filets, et de construire des digues ou des chaussées qui retiennent le poisson à la descente de la marée [275]. Ils ajoutent aux subsistances que leur fournit la pêche, celles qu’ils peuvent se procurer par la chasse ; ils vont prendre sur les arbres les animaux qui s’y réfugient, ou le miel que les abeilles y déposent ; ils y grimpent en faisant des entailles sur le tronc [276]. Ils creusent dans la terre des cabanes dans lesquelles ils entrent en rampant, et se mettent ainsi à l’abri du froid, des ardeurs du soleil, et des piqûres des insectes [277]. Leurs pirogues en écorce peuvent porter jusqu’à trois personnes, et ils en font même, à l’aide du feu et en creusant des troncs d’arbres, qui ont jusqu’à quatorze pieds de longueur [278]. Leurs armes, quoique grossières, sont plus dangereuses [279]. Enfin, ils peuvent compter jusqu’à quatre [280]. Péron, qui a pu par lui-même comparer ces peuples à ceux de la terre de Van-Diemen, a trouvé que ceux-ci leur étaient inférieurs sous beaucoup de rapports.
« Pour ce qui concerne l’état social, dit-il, les habitants de la Nouvelle-Hollande sont, à la vérité, tout à fait étrangers encore à la culture des terres, à l’usage des métaux ; ils sont comme le peuple de la terre de Van-Diemen, sans vêtements, sans arts proprement dits, sans lois, sans culte apparent, sans aucun moyen assuré d’existence, contraints comme eux d’aller chercher leur nourriture au sein des forêts, ou sur les rivages de l’océan. Mais déjà les premiers éléments de l’organisation sociale se manifestent parmi eux : les hordes particulières sont composées d’un plus grand nombre d’individus ; elles ont des chefs ; les habitations, quoique bien grossières encore, sont plus multipliées, mieux construites ; les armes sont plus variées et plus redoutables ; la navigation est plus hardie, les canots sont mieux travaillés ; les chasses plus régulières ; les guerres plus générales. Le droit des gens n’y est déjà plus étranger. Enfin, ces peuples ont assujetti le chien ; il est le compagnon de leurs chasses, de leurs courses, et de leurs guerres [281]. »
Les habitants de la Nouvelle-Calédonie, qu’on a jugé appartenir à la même espèce que les habitants de la terre de Van-Diemen et qui sont plus rapprochés qu’eux de l’équateur d’environ vingt-trois degrés, sont aussi bien moins barbares : ils ont déjà fait beaucoup de progrès dans l’agriculture. Non seulement ils ont partagé la terre entre eux, mais les peines qu’ils prennent pour la fertiliser, paraissent même excéder celles qu’on prend dans des îles où les habitants sont plus avancés. Ils construisent des murs dans les montagnes pour prévenir l’éboulement des terres, comme les peuples de l’Asie mineure et de plusieurs contrées de l’Europe [282]. Ils tracent des sillons pour conduire l’eau dans les lieux où elle manque [283]. Enfin, ils mettent dans la fabrication de leurs armes beaucoup d’intelligence, quoiqu’ils ignorent l’usage de l’arc [284].
Les habitants de Tanna, voisins de ceux de la Nouvelle-Calédonie et appartenant à la même espèce, ont également tourné leur industrie vers l’agriculture et la pêche. Leurs pirogues, leurs lances, leurs massues, leurs nattes et leurs étoffes sont grossièrement faites, et participent à la rudesse de leur situation [285]. Mais ils se donnent beaucoup de peine pour défricher la terre, et pour améliorer les productions du sol ; ils mettent dans leurs travaux toute l’intelligence que comporte la grossièreté de leurs instruments. Ils tirent de la terre presque tout ce qui leur est nécessaire pour leur subsistance ; ils soignent bien leurs arbres ; ils environnent de murailles leurs plantations [286].
Les habitants des Nouvelles-Hébrides, plus rapprochés de l’équateur et appartenant à la même espèce, ont fait plus de progrès dans leur industrie. Ils construisent des canots qui peuvent suivre pendant longtemps les meilleurs de nos vaisseaux et qui ne marchent pas moins vite [287].
Enfin, les nègres de la Nouvelle-Guinée, placés sous un ciel plus ardent, sont plus avancés encore ; ils fabriquent des nattes, des vases de terre, des pirogues, et se procurent par le commerce qu’ils font avec les Chinois, les ustensiles, les instruments et les toiles dont ils ont besoin [288].
Je ne parle point des peuples qui habitent les îles de la Sonde, les Philippines et les Moluques, parce que plusieurs espèces s’y trouvent confondues ensemble, et que les faits que je rapporterais ne feraient d’ailleurs que confirmer les observations qui précèdent.
Ainsi, bien loin que les climats froids ou même tempérés aient été pour les peuples du grand Océan une cause de développement de leur intelligence, nous voyons que c’est au contraire entre les tropiques que l’esprit humain a fait le plus de progrès, et que ce sont les peuples les plus rapprochés des pôles, qui sont restés le plus en arrière dans la civilisation [289].
[II-226]
CHAPITRE XI.↩
Du développement intellectuel acquis en Asie, sous différents degrés de latitude, par des peuples d’espèce mongole et par des peuples d’espèce caucasienne.
Il n’est aucune partie du globe sur laquelle l’influence des lieux, des eaux, et de la température de l’atmosphère, sur les nations, se soit manifestée avec plus d’évidence et avec plus d’énergie qu’en Asie. C’est là qu’on rencontre, plus que partout ailleurs, des peuples parvenus à tous les degrés de civilisation, et qu’on peut le mieux observer l’action que les nations exercent les unes sur les autres.
Les géographes ont divisé l’Asie en cinq grandes régions physiques. La région centrale, qui embrasse une étendue d’environ vingt degrés de latitude et de cinquante degrés de longitude, est composée d’un immense plateau au-dessus duquel s’élèvent des montagnes couvertes de neiges éternelles. L’élévation de cette partie de l’Asie au-dessus du niveau de la mer, est prouvée moins par les mesures des voyageurs que par la stérilité du sol, par l’intensité du froid qui y règne dans toutes les saisons, et par les fleuves nombreux et immenses qui en sortent de tous côtés.
Au nord de ce vaste plateau, est une région encore plus vaste ; c’est la Sibérie ou l’Asie septentrionale, qui s’étend depuis le cinquantième degré jusqu’à la mer glaciale. Cette région arrosée par des fleuves nombreux, est aussi froide et non moins stérile que l’Asie centrale. Les vents qui y soufflent sont toujours glacés, parce qu’ils n’y arrivent qu’après avoir traversé la mer Glaciale, ou après avoir parcouru les neiges dont les montagnes sont éternellement couvertes.
La région orientale se confond insensiblement avec le plateau central, et se divise elle-même en trois parties. La première, qui est une large chaîne de montagnes couvertes en partie de neiges dans toutes les saisons de l’année, s’étend du plateau de Mongolie jusqu’en Corée. Au nord de ces montagnes, l’Amur se tourne d’abord vers le sud-est, et ensuite vers le nord-est. Le sol paraît ici très élevé, si l’on en juge par le froid rigoureux qui y règne. Cette partie du pays ressemble à l’Asie septentrionale. La seconde partie de cette région est la Chine, qui, par sa position et proximité où elle se trouve des montagnes, renferme tous les climats de l’Europe. La troisième partie est formée d’une prodigieuse chaîne d’îles et de presqu’îles volcaniques, dont le climat est analogue à la partie du continent à laquelle elles correspondent
La région du sud, qui s’appuie au midi du plateau central, est placée en grande partie sous la zone torride. Garantie des vents du nord par les montagnes du Tibet, arrosée par des fleuves larges et nombreux, échauffée par un soleil ardent, mais que tempèrent les vents qui viennent du côté de l’Océan, cette région renferme le sol le plus fertile de l’Asie : c’est l’Hindoustan.
Enfin la région occidentale, par la nature du sol et par la proximité où elle se trouve de l’Afrique, est en grande partie sous un ciel encore plus ardent que celui de l’Inde. Elle renferme la Perse, l’Asie-Mineure et l’Arabie [290].
L’ordre dans lequel les facultés intellectuelles des peuples se sont développées, paraît correspondre en tout à la nature physique de chacune de ces principales régions. Les hordes nombreuses qui habitent le plateau central de l’Asie, placées sur un sol immuable, sont restées immuables comme lui. Elles vivent encore comme elles vécurent toujours, de la chasse, de la pêche, et du lait de leurs troupeaux. Attachées à la vie vagabonde dont la nature de leurs déserts leur a fait une nécessité, elles méprisent l’agriculture, la vie sédentaire, et surtout le séjour des villes. Rien ne ressemble tant aux hommes des premiers âges, a dit un historien, que les Tartares du nôtre [291].
Les peuplades qui habitent au nord de l’Asie et sur les bords glacés des fleuves qui se dirigent vers le pôle arctique, sont aussi barbares que celles qui habitent sur le plateau central. Quelques voyageurs les ont nommées les Hottentots du nord ; d’autres les ont comparées aux peuples les plus sauvages de l’Amérique. Les Russes, qui sont parvenus sans peine à les subjuguer, ont établi quelques petites villes sur quelques points de ces vastes contrées, et y cultivent quelques céréales. Mais jamais ils ne parviendront à changer ni la nature du sol, ni la température du climat, ni la direction des fleuves ; et aussi longtemps que la nature restera immuable, les peuples seront obligés de conserver leur manière de vivre [292].
La partie nord-est de l’Asie, soumise à la Russie depuis plus d’un siècle, n’est pas sortie et ne sortira probablement jamais de la barbarie où elle était au moment de la conquête. On n’aperçoit encore au Kamtchatka, ni jardins, ni prés, ni plantations, ni enclos qui annoncent quelque culture, quoique la terre y soit très fertile. On n’y trouve pas un chemin battu, ou même un simple sentier, sur lequel on puisse marcher sans danger. On n’y voit que quelques misérables cabanes tombant en ruine, des jourtes ou habitations souterraines, et quelques poutres sur lesquelles on passe les ruisseaux. Ce sont là les seuls progrès que la civilisation y ait faits ; car l’industrie des habitants s’y borne encore à l’art de prendre quelques bêtes sauvages dont ils vendent les fourrures, et le poisson qui leur est nécessaire pour leurs aliments [293].
Les côtes de Tartarie sont si peu habitées, que quelques voyageurs ont pensé qu’elles étaient complètement désertes [294]. Cependant les hommes qu’on y a rencontrés sont un peu plus avancés que les habitants du Kamtchatka, placés sous un climat plus froid. Ils tirent de la chasse et de la pêche tous leurs moyens d’existence ; mais ils échangent une partie de leurs produits contre quelques marchandises de la Chine. Ces peuples sont si peu nombreux, et leurs objets d’échange sont tellement restreints, que, sur des côtes qui ont un développement de plus de deux mille lieues, on ne parviendrait pas à compléter le chargement d’un vaisseau de trois cents tonneaux [295]. Leurs vêtements sont faits de peaux de chien ou de poisson, et quelquefois de nankin [296]. Leurs cabanes sont faites de tronçons de sapin, et couvertes d’écorces d’arbres. Le climat y est si froid qu’il y tombe de la neige au milieu de l’été.
On ne peut suivre les gradations que la civilisation suit sur ces côtes depuis le climat le plus froid jusqu’au climat tempéré, parce que les voyageurs qui s’y présentent en sont repoussés par les agents du gouvernement chinois [297]. Les îles placées à l’extrémité boréale de ces mers, entre le continent asiatique et le continent américain, ont, sous une latitude égale, une température moins froide que l’un ou l’autre des deux continents. Les insulaires sont plus forts, et ont l’intelligence plus développée que les habitants de ces deux contrées placés sous les mêmes latitudes. Ils sont plus habiles à former leurs instruments de pêche et de chasse ; ils ont des canots avec lesquels ils naviguent à une grande distance ; ils ont des chefs qui rendent la justice entre eux, et la population de leurs villages est assez nombreuse [298].
Les habitants de l’île Ségalien ou Sakhalien, placés sous la même latitude que les Tartares dont nous venons de parler, mais sous une température moins froide, leur sont très supérieurs en intelligence comme en force physique [299]. Quoiqu’ils ne soient pas très éloignés du Japon et de la Chine, ils n’ont jamais été asservis. Ces peuples ne cultivent point la terre et ne possèdent aucuns troupeaux. Ils trouvent, dans la chasse et la pêche et dans quelques plantes qui croissent sans culture, leurs principaux moyens d’existence. Mais ils se montrent, à cet égard, aussi habiles que prévoyants ; ils ont, à côté de leurs cases, des magasins dans lesquels ils rassemblent, pendant l’été, toutes leurs provisions d’hiver : des poissons secs, de l’huile, et diverses plantes qu’ils ont l’art de conserver [300]. Ils savent filer le poil des animaux ; ils tirent du fil de l’écorce du saule ou de la grande ortie, et en forment des tissus au moyen de la navette. Ces tissus et la dépouille de divers animaux leur servent à former leurs vêtements [301]. Leurs cabanes sont construites avec intelligence, et couvertes de paille séchée, comme le chaume de nos maisons de paysans dans quelques parties de la France. Enfin, ils ont montré une grande curiosité pour tous les objets nouveaux qui ont frappé leurs regards.
« Nos arts, nos étoffes, dit La Pérouse, attiraient l’attention de ces insulaires ; ils retournaient en tous sens nos étoffes ; ils en causaient entre eux, et cherchaient à découvrir par quels moyens on était parvenu à les fabriquer [302]. »
Les habitants de l’île Iesso, plus rapprochés du sud, de quelques degrés, semblent avoir fait un peu plus de progrès. Leur asservissement aux Japonais exclut de chez eux les étrangers, et leur laisse peu le moyen de les juger. Cependant, on voit chez eux quelques champs de maïs et de millet [303], ce qu’on ne rencontre pas chez les peuples de même race plus avancés vers le nord.
Les îles du Japon, plus rapprochées encore du sud et placées entre le quarante-et-unième et le trente-deuxième degré de la même latitude, jouissent d’une civilisation si ancienne que nous en ignorons l’origine. La population de ces îles, qu’on estime de quinze à trente millions, avait déjà fait des progrès très grands dans les arts, dans le commerce et surtout dans l’agriculture, lorsque les Européens la visitèrent pour la première fois.
À environ dix degrés au sud du Japon, il est des îles où la civilisation paraît plus avancée encore. Le voyageur qui les a visitées n’a pas été admis à en parcourir l’intérieur ; mais la manière dont il a été reçu par les habitants, la propreté de leurs maisons et de leurs meubles ; la richesse de leurs vêtements ; l’empressement avec lequel ils lui ont fourni tout ce qu’il leur a demandé ; le désintéressement avec lequel ils lui ont donné les vivres de tout genre dont il avait besoin pour son équipage, annoncent un peuple très éloigné de la barbarie. Il est douteux si des voyageurs inconnus qui se présenteraient en état de détresse, dans quelque port de l’Europe que ce soit, y recevraient un accueil aussi hospitalier, aussi bienveillant [304].
Les peuples qui habitent les régions froides de l’Asie n’ont donc jamais cessé d’être barbares ; ceux, au contraire, qui sont placés sous la zone torride ou sous une zone tempérée, ont une civilisation si ancienne, que nous n’avons aucun moyen d’en connaître l’origine. Les progrès de ces peuples remontant à une époque plus reculée que les plus vieux de nos monuments historiques, il nous est impossible de savoir quelle est la marche que la civilisation a suivie parmi eux. Les facultés de l’esprit humain se sont-elles développées en même temps chez les Indous, chez les Chinois, chez les Perses et chez les peuples de l’Asie occidentale ; ou bien quelqu’un de ces peuples a-t-il précédé tous les autres, et leur a-t-il fait part de ses lumières ? C’est ce que nous ignorons et ce que probablement nous ne saurons jamais ; mais nous pouvons affirmer du moins, sans craindre de nous tromper, qu’aucun de ces peuples n’a été éclairé, ni par les habitants de l’Asie centrale, ni par ceux de l’Asie boréale.
Les Indous paraissent n’avoir fait aucun progrès depuis près de deux mille ans. Il ne s’agit pas ici de savoir pourquoi ils sont restés stationnaires, c’est un phénomène dont je pourrai indiquer ailleurs quelques-unes des causes. Je veux seulement faire observer que ce peuple avait fait d’immenses progrès, avant qu’aucune des nations qui habitent les climats tempérés de l’Europe fût sortie de la barbarie. Si nous comparons ceux des produits de son industrie que le commerce nous apporte, à ceux que donnent l’industrie française et l’industrie anglaise, il est probable que les derniers nous paraîtront préférables. Mais si nous nous reportons à trois siècles en arrière, nous trouverons une différence qui ne sera pas moins remarquable, et elle ne sera pas en notre faveur. Enfin, si nous voulons voir une différence plus grande encore, nous n’avons qu’à comparer l’industrie et les connaissances des Indous, à l’industrie et aux connaissances des peuples du Tibet.
La civilisation des Chinois est également fort ancienne ; nous pouvons juger de quelques-uns des produits de leur industrie, puisque le commerce les met à notre disposition ; mais il nous est néanmoins fort difficile de déterminer jusqu’à quel point les facultés intellectuelles de la masse de la population ont été développées dans ce pays. Les voyageurs qui l’ont récemment visité, et qui sont ceux dont les relations auraient pu nous inspirer le plus de confiance, n’y ont été admis que sous la surveillance la plus sévère. Obligés de se renfermer dans les maisons qui leur étaient assignées, constamment accompagnés dans leurs courses par des agents du gouvernement chinois, ne pouvant communiquer avec les habitants du pays qu’en présence de ces agents, il est difficile qu’ils aient acquis par eux-mêmes beaucoup de connaissances ; et on ne peut croire que des hommes qui inspiraient une telle méfiance, et qui n’ont pu faire un long séjour dans le pays, aient obtenu, sur l’état et les mœurs de la population, des communications impartiales. Il est également difficile de juger de l’intérieur de la Chine, par les rapports des voyageurs ou des négociants qui sont admis dans le port de Canton. On a dit, avec raison, que ce serait vouloir juger de l’intérieur d’un couvent par ce qu’on aurait vu dans le parloir. Cependant, quelque imparfaites que soient nos connaissances à cet égard, il est aisé de juger qu’il n’y a point de comparaison à faire entre le développement intellectuel auquel sont parvenus les peuples de cet immense pays, et les peuples de même espèce qui habitent le plateau central ou le nord de l’Asie [305].
Les Chinois ont eu longtemps la réputation d’être le peuple du monde le plus habile dans l’art de l’agriculture. Les progrès récents que cet art a faits chez quelques nations d’Europe, ont fait accuser d’exagération les éloges que donnèrent à l’habileté de ce peuple les premiers voyageurs européens qui le visitèrent. Mais, en admettant qu’il existe un petit nombre de points en Europe, où la culture est plus avancée qu’elle ne l’est dans aucune partie de l’Asie, il est douteux si l’on trouverait un grand peuple qui mette plus de soin et d’intelligence dans la culture de ses terres. Nulle part on ne trouve d’aussi nombreux canaux pour la facilité des irrigations et des transports ; nulle part les engrais ne sont recueillis avec plus de soin ; nulle part on ne voit si peu de terres incultes, ni des champs mieux cultivés. À l’époque peu éloignée où Macartney visita ce pays, chaque champ, suivant lui, avait l’air d’un jardin propre et régulier [306]. Il n’est aucune partie de l’Europe où un prince rende à l’agriculture des hommages analogues à ceux que lui rendent, toutes les années, les empereurs chinois, et où les soldats soient employés à la culture des champs, excepté dans les courts intervalles pendant lesquels ils sont de service [307].
Il paraît qu’on ne trouve point en Chine ces grands propriétaires, ces riches fermiers qui mènent de vastes exploitations, et qui peuvent employer à l’agriculture les meilleures machines, le plus beau et le meilleur bétail [308]. Mais, si les terres sont un peu moins productives par suite d’une grande division, ce désavantage ne serait-il pas plus que compensé par une répartition plus égale des produits ? Cent familles qui vivent dans une médiocre aisance, ne valent-elles pas une famille qui regorge de superflu, plus quatre-vingt-dix-neuf familles qui manquent du nécessaire ? Ces immenses propriétés que nous jugeons si favorables à l’agriculture, n’existent guère que dans les pays où la population laborieuse a été dépouillée par une race de conquérants. Elles peuvent être un sujet d’orgueil pour les descendants des hommes qui s’en emparèrent ; mais comment pourraient-elles être un sujet de vanité pour les enfants de ceux à qui elles furent ravies ? Les Chinois, comme tous les peuples européens, ont été soumis à une race étrangère ; mais, après la défaite, ils n’ont été ni dépouillés de leurs terres, ni attachés à la glèbe. Ils n’ont pas ainsi acquis les avantages des grandes propriétés ; mais ils n’en ont pas éprouvé non plus les inconvénients. On ne voit point parmi eux, dit Macartney, de ces fermiers spéculateurs qui cherchent par des monopoles à tirer un grand parti de leur récolte et à triompher, par leurs richesses, du pauvre cultivateur, jusqu’à ce qu’ils l’aient enfin réduit à l’état de simple manœuvre [309].
[II-239]
Les Chinois ne manquent ni de génie pour concevoir, ni d’adresse pour exécuter ; ils ont l’esprit vif et la conception facile ; ils portent au plus haut degré le talent de l’imitation [310]. Ils sont si actifs et si industrieux, que, dans la colonie hollandaise de Batavia, ils exercent seuls tous les arts et tous les métiers [311]. Il n’existe point en Chine, comme dans quelques États européens, de grands capitalistes qui fassent travailler pour leur compte des multitudes d’ouvriers, et il y a très peu de villes manufacturières. En général, chacun exerce sa profession pour son propre compte [312]. Mais cet état de l’industrie tiendrait-il à ce qu’il n’y a jamais eu, dans le pays, de ces monopoles qui enrichissent quelques individus aux dépens de la masse de la population ? Tiendrait-il à d’autres causes qui ont pour résultat de rendre les fortunes plus égales qu’elles ne le sont parmi nous ? Les voyageurs gardent le silence sur ces questions, et je ne tenterai pas de les résoudre ; je me bornerai à faire observer que les grandes fortunes mobilières sont souvent produites par des causes analogues à celles qui ont produit la plupart des grandes fortunes territoriales.
Les sciences ne paraissent pas faire en Chine les mêmes progrès que dans quelques États de l’Europe ; il en est quelques-unes qui y sont même complètement ignorées [313] ; mais si les connaissances y sont moins profondes, elles y sont peut-être répandues d’une manière plus égale. On trouve, dans chaque ville, outre une salle d’audience où l’on entend toute personne qui a quelque plainte à porter, et un grenier pour les temps de disette, une bibliothèque ouverte à tous ceux qui veulent en profiter, et un collège où l’on examine les étudiants [314]. Les multiplications des ouvrages classiques et des écrits qui appartiennent à la littérature légère, y tiennent les presses dans une activité continuelle. Enfin, pour parvenir au pouvoir, aux honneurs et à toutes espèces d’emplois publics, il n’y a pas d’autre route que l’étude de la politique, de l’histoire et de la morale [315].
Il est, en Chine, un art dont l’imperfection a frappé les voyageurs européens : c’est l’architecture. En général, les maisons n’y ont qu’un étage ; les ministres n’y sont pas mieux logés que ne le sont chez nous les domestiques des grandes maisons ; l’habitation de l’empereur, si elle était dépouillée de l’or et des ornements qui la décorent, ne serait pas de beaucoup au-dessus d’une belle grange [316]. Cette infériorité de l’architecture peut tenir à bien des causes ; mais il en est deux qui méritent surtout d’être remarquées : c’est le goût et les idées de la caste conquérante. Quand les nomades du centre de l’Asie envahirent ce pays, ils logèrent leurs chevaux dans les maisons des membres du gouvernement, et se logèrent eux-mêmes sous leurs tentes ; c’est une circonstance que la population vaincue n’a point oubliée, et qu’elle cite encore comme une preuve de la barbarie de ses conquérants. D’un autre côté, la domination paraît si mal affermie, que les dominateurs prévoient qu’ils pourront un jour être repoussés dans les lieux qui furent le berceau de leurs ancêtres. Avec de tels goûts et de telles idées, il serait difficile que l’art de bâtir fit de grands progrès. Si la population chinoise, au lieu d’avoir été subjuguée par des nomades, eût été conquise par nos commis ou seulement par leurs valets, la simplicité de la demeure des grands ne choquerait pas aujourd’hui nos secrétaires d’ambassades [317].
La Perse, comme la Chine, a été plusieurs fois conquise, et c’est du centre de l’Asie que sont presque toujours venus ses conquérants. Il existe donc, sur le même sol, deux races d’hommes : les enfants de ceux qui le mirent jadis en culture, et les enfants de ceux qui descendirent plus tard des montagnes pour s’en emparer. Aux premiers appartient l’ancienne civilisation du pays ; aux seconds, sa moderne barbarie.
Le sol de la Perse est arrosé par des rivières moins nombreuses et plus petites que celles de la Chine. Il n’y en existe pas une seule qui soit capable de porter bateau, ou de servir de moyen de transport [318]. La terre y est donc beaucoup moins susceptible de culture, et si la main de l’homme cesse d’y conduire les eaux qui coulent des montagnes, elle se convertit en désert [319]. Cependant, malgré les obstacles naturels que le sol présente à la culture, ce pays parvint jadis à l’état le plus florissant ; l’ingénieuse industrie des habitants porta l’eau sur tous les points où il fut possible de la conduire. Suivant les registres publics, on comptait jadis dans une seule province, jusqu’à quarante-deux mille aqueducs souterrains. Quelque prodigieux que paraisse ce nombre, il n’a rien d’invraisemblable, lorsqu’on voit que, dans une autre province, il a suffi d’un espace de soixante années pour en détruire quatre cents [320].
Il serait difficile de déterminer d’une manière exacte quelle fut jadis l’industrie des peuples de cette contrée, puisque les plus florissantes de leurs villes ont été renversées, que la plus grande partie des ruines ont disparu de la surface du sol, et que la charrue a passé sur la place où elles existaient [321]. Cependant ce qui reste encore de l’ancienne capitale suffit pour nous prouver que les arts y avaient été portés à un haut degré de perfection [322]. Les diverses branches d’industrie qu’ils cultivaient au dix-septième siècle, et dont Chardin nous a transmis la description, étaient plus avancées qu’elles ne l’étaient à la même époque dans aucune partie de l’Europe [323]. L’art avec lequel ils travaillent encore l’acier, le cuir, la poterie, la soie et divers genres de tissus, prouve que, sous le rapport de l’adresse et de l’intelligence, ils ne sont inférieurs à aucun peuple. Le respect qu’ils ont pour le commerce, excède de beaucoup celui qu’on lui accorde dans la plupart des États de l’Europe [324].
Diverses branches de connaissances ont fait jadis beaucoup de progrès en Perse, et quoique les conquérants anciens et modernes y aient fait rétrograder les esprits, ils n’ont pu éteindre la considération attachée à la culture des sciences et des lettres. La multitude d’établissements d’éducation qui existent dans toutes les villes, et les richesses que ces établissements possèdent, prouvent au moins l’importance qu’on attache à l’instruction. Au temps où Chardin visita ce pays, rien n’y donnait plus de réputation que d’instruire gratuitement des jeunes gens, et de favoriser les sciences. Si le premier ministre était en même temps homme de lettres, il prenait le titre de chef des étudiants. Les grands qui s’étaient retirés des affaires et ceux que la disgrâce en avait éloignés, se vouaient souvent à l’enseignement public. Ils donnaient soir et matin des leçons aux jeunes gens qui voulaient les entendre, et leur fournissaient même des moyens pécuniaires pour faire leurs études [325]. Les Perses ont eu des poètes qui n’ont manqué ni d’imagination, ni de grâce, et leurs maximes de morale prouvent qu’ils savent observer et réfléchir [326].
[II-245]
La partie de l’Asie occidentale dont le sol est peu élevé au-dessus du niveau de la mer, est placée sous une température plus chaude qu’aucune contrée de l’Europe ; mais aussi c’est peut-être la partie du monde qui est la plus fertile en grands souvenirs ; c’est là que l’industrie, le commerce et toutes les connaissances humaines avaient fait des progrès immenses, avant que les peuples européens qui sont aujourd’hui les plus civilisés, se fussent à peine élevés au-dessus de l’état sauvage ; Tyr, Palmire, Babylone et tant d’autres villes célèbres que des barbares ont détruites, mais dont ils n’ont pu effacer le souvenir, attestent que, sous les climats les plus ardents, les peuples ne manquent ni d’activité ni de génie.
Ainsi, sur le vaste continent de l’Asie, les facultés intellectuelles des peuples ne se sont développées que sous les climats chauds ou tempérés. Il est vrai que les peuples les premiers civilisés ont été asservis ; que la conquête a fait peser sur tous d’effroyables calamités, et que plusieurs ont été même complètement détruits. Mais si nous comparons, même dans l’état actuel, les nations qui sont placées sous un climat chaud ou tempéré, à celles qui sont placées sous un climat froid, nous trouverons qu’en général les premières sont beaucoup plus avancées que les secondes. Les facultés humaines sont plus développées chez les Indous que chez les habitants du Tibet ; elles le sont plus dans l’empire de la Chine, que sur les côtes de Tartarie, au Kamtchatka, sur le plateau central de l’Asie et dans la Sibérie ; elles le sont plus chez les Perses que chez les habitants de la Tartarie indépendante et de la petite Bucharie ; enfin elles le sont plus dans l’Anatolie que dans les montagnes du Caucase.
[II-247]
CHAPITRE XII.↩
Du développement intellectuel acquis en Afrique et en Europe, sous différents degrés de latitude, par des peuples d’espèce éthiopienne et par des peuples d’espèce caucasienne.
Le genre humain a suivi en Afrique, dans ses développements, la même marche qu’en Asie et en Amérique. De tous les peuples d’espèce éthiopienne, les moins avancés sont ceux qui habitent l’extrémité australe de ce continent. Rien n’établit qu’à l’arrivée des Européens, les Hottentots du cap de Bonne-Espérance connussent l’art de cultiver la terre [327]. Ils vivaient comme la plupart vivent encore, de lait, d’animaux tués à la chasse, de racines sauvages, de sauterelles dont les vents leur amènent des nuages, de nymphes de fourmis, d’araignées, de chenilles, et, s’il est possible, d’aliments plus grossiers et plus rebutants [328]. Pour se vêtir, ils ne connaissent pas d’autre art que de s’envelopper d’une peau de mouton, et des intestins encore frais des animaux qu’ils ont égorgés. Enfin, leurs cabanes, dans lesquelles ils ne peuvent entrer qu’en rampant et où il leur est impossible de se tenir debout, ne reçoivent du jour et ne laissent échapper la fumée que par un trou fait près de terre, au moyen duquel ils y pénètrent [329]. C’est dans ces obscures tanières qu’ils restaient jusqu’à ce qu’ils en soient chassés par la vermine qui les couvre [330]. Ces peuples sont au nombre des plus sales et des plus fétides que les voyageurs aient jamais rencontrés [331]. Suivant Raynal, leur intelligence ne s’élève guère au-dessus de celle de leurs troupeaux [332]. Les Anglais ont commencé à en civiliser quelques-uns.
Les Cafres, placés sous une latitude moins élevée, se livrent aussi à la chasse et possèdent de nombreux troupeaux : mais ils s’adonnent en même temps à l’agriculture ; ils ont des champs et même des jardins. Leurs villages ou kraals se composent d’un plus grand nombre de cabanes, et ces cabanes sont plus proprement et plus solidement construites. Elles sont plus élevées et d’une forme plus régulière que celles des Hottentots ; le corps se compose d’une espèce de treillage solide et uni ; il est enduit ensuite en dehors et en dedans d’une espèce de torchis qui lui donne un air de propreté [333]. Enfin, à mesure qu’on pénètre davantage sur le territoire qu’habite ce peuple, on trouve qu’il a fait plus de progrès. « Nous trouvâmes, dit Barrow, une grande étendue de terre cultivée en jardins, et nous arrivâmes vers le midi à Litakou, bien étonnés de trouver dans cette partie du monde une ville grande et très peuplée » [334]. Les peuples de Mozambique sont également cultivateurs ; leurs villages, semblables à ceux des Indiens, sont ombragés d’arbres fruitiers plantés d’une manière régulière [335].
Les habitants de la côte occidentale d’Afrique, depuis le dix-septième degré de latitude boréale jusque vers le dixième degré de latitude australe, ont fait plus de progrès dans les arts que les Cafres. Les peuples qui habitent les bords du Sénégal cultivent leurs champs avec soin. Chaque village a des tisserands, des cordonniers, même des forgerons. Leurs étoffes sont tissues avec soin, et ornées de dessins d’un goût délicat. Enfin ils possèdent l’art de fondre le fer [336].
[II-250]
Les peuples de ces côtes nous semblent aujourd’hui bien barbares ; mais lorsqu’on examine attentivement leur organisation sociale, la subordination qui règne entre les chefs des diverses tribus, le pouvoir qu’ils exercent les uns à l’égard des autres ou sur les simples particuliers, la manière dont ils administrent la justice, et les épreuves auxquelles ils soumettent les accusés, on n’est pas peu étonné de trouver chez eux les mœurs, les lois, les gouvernements et jusqu’aux préjugés qui régnaient sur toute l’étendue de l’Europe au Moyen-âge : c’est le gouvernement féodal dans toute sa pureté originelle. Si, dans les derniers siècles, les Asiatiques étaient venus en Europe faire la traite, ils auraient trouvé nos paysans dans le même état où les marchands d’esclaves de nos contrées trouvent aujourd’hui les Africains [337].
Le climat brûlant des tropiques n’a donc pas été plus défavorable, en Afrique, au développement des facultés intellectuelles de l’espèce éthiopienne, que le climat tempéré de l’extrémité australe de ce continent. Les peuples qui appartiennent à d’autres espèces et qui ont habité les côtes septentrionales de ce continent, ont-ils été arrêtés dans leur développement intellectuel par la chaleur du climat ? Les sciences et les arts furent-ils étouffés en Égypte par les rayons du soleil ? Ces ruines, répandues sur un sol que ne put jamais épuiser l’avidité des barbares, y furent-elles apportées des forêts de la Germanie, ou des rives glacées du Volga ? Ces monuments célèbres, dont les restes, mutilés par la main de pâtres stupides, excitent encore notre admiration, furent-ils conçus, exécutés par des hommes dont la chaleur avait énervé l’esprit et éteint l’imagination ? [338]
Serait-ce en Europe que les climats froids auraient été particulièrement favorables aux progrès de l’intelligence humaine ? N’est-ce pas, au contraire, en Italie, en Espagne, en France que s’est opérée la renaissance des sciences et des arts ? Les connaissances ne se sont-elles pas répandues graduellement vers le nord, et les pays les plus froids ne sont-ils pas les derniers où elles sont parvenues ? On peut trouver, sans doute, en Pologne et même en Russie, des hommes qui sont arrivés à une haute civilisation ; mais ce n’est point par un petit nombre d’individus jouissant d’une grande fortune, qu’il faut juger des progrès d’une nation ; c’est par la population entière. Or, dans ces pays, la population, si l’on fait exception d’une partie des habitants de quelques grandes villes, est encore moins avancée que ne l’était au quinzième siècle la nation française [339].
En considérant le genre humain d’un point de vue élevé, nous voyons que, depuis les temps les plus reculés, il est soumis à une action et à une réaction continuelles de civilisation et de barbarie. Les nations placées sous les plus heureux climats, sont les premières qui se développent ; elles jettent quelques lumières sur les barbares qui les environnent ; mais elles sont à leur tour plongées dans les ténèbres par d’autres barbares, chez lesquels les lumières n’ont jamais pénétré. Les peuples situés dans les plus belles contrées de l’Asie, ont devancé tous les autres dans la carrière de la civilisation ; ce sont eux qui paraissent avoir porté la lumière en Égypte, d’où elle s’est répandue en Grèce, en Italie, et dans toute la partie du sud-est de l’Europe. Mais les barbares qui habitaient les plaines centrales du continent asiatique, se sont répandus à leur tour sur le monde civilisé, et l’ont replongé dans les ténèbres autant qu’il a été dans leur puissance. Nous pouvons observer le même mouvement d’action et de réaction dans tous les états de l’Europe ; les peuples du sud ont fait pénétrer quelques faibles rayons de lumière vers leurs voisins du nord, et ces voisins les en ont récompensés en cherchant à les ramener dans les ténèbres.
Il est vrai que les peuples civilisés du centre de l’Amérique ont été asservis et replongés dans la barbarie ; les Indous, les Chinois, les Persans, ont également été conquis par des peuples venus du nord ; les peuples du midi de l’Europe ont aussi subi le joug des peuples qui habitaient sous des climats froids. Mais faut-il conclure de là que les climats chauds sont un obstacle au perfectionnement du genre humain ? Les peuples civilisés du centre de l’Amérique ont été replongés dans la barbarie ; mais les peuples de même espèce, situés aux extrémités de ce continent, n’en sont jamais sortis ; le nombre des premiers s’est accru, malgré l’oppression des Espagnols ; le nombre des seconds diminue d’une manière effrayante, malgré les efforts que fait le gouvernement des États-Unis pour les conserver : cela prouverait-il en faveur des climats froids ? La Perse, la Chine, l’Hindoustan ont été asservis ; mais les contrées d’où sont partis les conquérants sont toujours restées barbares ; elles sont plus pauvres que les nations vaincues, sans être pour cela moins esclaves. Le sud de l’Europe a été asservi par le nord ; et cependant les peuples y sont généralement plus éclairés, plus riches et même plus libres : s’il n’y a pas plus de liberté politique, il y a beaucoup plus de liberté civile.
Chardin, Montesquieu et tous les écrivains qui ont adopté leurs opinions, ont observé que depuis des siècles l’esprit humain ne faisait plus de progrès dans les climats les plus chauds de l’Asie, et qu’au contraire les peuples de l’Europe qui vivent sous des climats froids ou tempérés, avançaient rapidement ; ils ont conclu de ces deux grands phénomènes, que la chaleur est un obstacle au perfectionnement du genre humain, et que le froid lui est favorable. Mais pour raisonner juste, il eût fallu comparer les progrès des peuples asiatiques qui vivent sous un climat chaud ou tempéré, aux peuples de même espèce qui vivent dans les climats froids de cette partie du monde, et qui sont soumis à des gouvernements et à des religions semblables ; car, s’il est évident que l’état de ceux-là est plus stationnaire encore que l’état de ceux-ci, je ne vois pas quelle est la conséquence qu’on peut en tirer en faveur des premiers. Sans doute, on ne suppose pas que la civilisation n’a jamais eu de commencement dans l’Hindoustan, en Chine ou en Perse : ces peuples, comme tous les autres, sont partis d’un état d’ignorance et d’abrutissement, pour arriver au point où ils se trouvent. À une époque quelconque, ils ont donc fait d’immenses progrès : il y a infiniment plus loin des peuples du Kamtchatka jusqu’à eux, qu’il n’y a loin d’eux aux peuples que nous jugeons les plus avancés. Or, comment la cause qui les empêche de faire le second pas, ne les a-t-elle pas empêchés de faire le premier ? [340]
En exposant la nature, les causes et les effets de l’esclavage, je ferai voir d’une manière plus spéciale quelles sont les causes qui rendent les peuples stationnaires, ou qui les font rétrograder. Je me proposais d’exposer, dans les chapitres qui précèdent, quelques-unes des circonstances physiques sous lesquelles les peuples prospèrent ou restent stationnaires : je voulais rechercher de plus si la chaleur du climat, considérée en elle-même, est un obstacle au développement des facultés de l’esprit humain ; s’il est vrai qu’elle dissipe le feu de l’imagination, qu’elle détruit toute curiosité, qu’elle éteint toute noble entreprise, et rend l’homme incapable de cette forte application qui enfante les beaux ouvrages. Je n’ai rien trouvé qui fût propre à justifier de telles assertions ; j’ai vu, au contraire, que c’est toujours sous des climats chauds ou tempérés que la civilisation s’est développée. Faudrait-il conclure de là qu’un certain degré de chaleur est seul suffisant pour développer les facultés intellectuelles des peuples ? Ce serait un système qu’on pourrait soutenir par bien des raisons, et qui ne serait pas plus absurde que celui que nous venons d’examiner.
[II-257]
CHAPITRE XIII.↩
Du développement moral des peuples de diverses espèces. — De l’analogie qui existe entre les mœurs et les lois. — Des rapports entre le développement intellectuel et le perfectionnement moral des hommes. — Méthode suivie dans cette exposition.
Pour connaître les lois auxquelles les peuples obéissent, il faut, ainsi que je l’ai fait observer ailleurs, déterminer l’action que les hommes exercent les uns à l’égard des autres, comme individus ou comme collection d’individus ; il faut observer, de plus, les causes qui les déterminent à agir ou à céder à l’action qui est exercée sur eux, et les conséquences qui résultent de cette action. Les lois ne sont, en effet, que de la puissance, et cette puissance ne peut exister que dans les hommes ou dans les choses : la portion de force qui existe dans les hommes se trouve dans leurs idées ou dans leurs passions ; la portion de force qui existe dans les choses, se trouve dans les qualités au moyen desquelles elles nous affectent en bien ou en mal. Les livres ou les registres des assemblées ne peuvent renfermer, ainsi que je l’ai déjà dit, que des descriptions plus ou moins exactes des phénomènes que produisent ces puissances auxquelles nous donnons le nom de lois.
La distinction que j’ai précédemment établie entre les puissances qui constituent les lois, et les descriptions des phénomènes que ces puissances produisent, devient ici d’autant plus importante, que j’ai à faire connaître les lois auxquelles sont soumis une multitude de peuples qui n’ont jamais décrit leur ordre social ; j’ai à faire connaître l’action que les hommes de toutes les espèces exercent sur eux-mêmes, ou sur d’autres qu’eux, d’une manière individuelle ou collective ; j’ai à faire voir, en même temps, comment cette action de l’homme sur lui-même ou sur des êtres du même genre que lui, est modifiée par la différence des espèces, par la température de l’atmosphère, par la nature et l’exposition du sol, par le cours des eaux, ou par d’autres circonstances analogues. En me livrant à cette exposition, je serai encore obligé d’examiner l’opinion de plusieurs philosophes sur l’influence des climats.
Lorsque j’ai exposé les divers éléments de puissance dont les lois se composent, j’ai fait voir qu’il faut comprendre au nombre de ces éléments, les idées, les préjugés, les sentiments, les besoins ou les passions des diverses classes de la population ; j’ai fait voir que, dans l’étude des lois, les idées et les passions d’un peuple se présentent tantôt comme causes, ou comme éléments de force, et tantôt comme effets. L’identité entre les lois d’une nation et les mœurs qui les constituent, ou qui en sont l’expression, est si réelle, que les écrivains qui ont décrit l’état des peuples barbares, n’ont jamais songé à les distinguer les unes des autres. Il n’a fallu souvent, pour donner le nom de lois aux phénomènes qu’on désigne sous le nom de mœurs, qu’en avoir trouvé une description plus ou moins authentique. Tacite, qui nous a tracé le tableau des mœurs des Germains, nous aurait probablement tracé le tableau de leurs lois, s’il avait trouvé que les phénomènes qu’il a décrits sous le nom de mœurs, avaient été décrits par les peuples dont il a parlé. Ainsi, de ce que plusieurs des nations dont j’ai à décrire l’état social, ne connaissent ni livres, ni archives, il ne faut pas conclure qu’ils ne sont soumis à aucune loi. Il n’y a pas beaucoup de siècles que la plupart des nations de l’Europe étaient dans le même cas, et cependant elles étaient régies par des lois auxquelles nous avons donné le nom de coutumes.
Si l’existence des peuples est modifiée par les circonstances physiques au milieu desquelles ils sont placés, telles que la nature et l’exposition du sol, la nature, la direction et le volume des eaux, la division des saisons, la température de l’atmosphère, et d’autres analogues, ces circonstances elles-mêmes sont à leur tour modifiées jusqu’à un certain point par l’action que les peuples exercent sur elles. Les hommes modifient la nature du sol, par des plantations ou des déboisements, par de défrichements, par des engrais, ou par une succession de récoltes qui l’épuisent. Ils agissent sur les eaux, tantôt en en resserrant les limites, tantôt en les dirigeant dans les lieux où elles manquent, tantôt en détruisant les forêts qui alimentent les rivières. Ils agissent sur la température de l’atmosphère et même sur la nature de l’air qu’ils respirent, par des déboisements, par le dessèchement des marais, ou par d’autres moyens artificiels. Il s’exerce, en un mot, une action et une réaction continuelles des choses sur les hommes, et des hommes sur les choses, et cette action et cette réaction influent toujours plus ou moins sur les relations qu’ont entre eux les individus et les agrégations d’individus dont le genre humain se compose.
De toutes les circonstances physiques au milieu desquelles les hommes se trouvent placés, il n’y en a aucune qui paraisse plus indépendante d’eux que la température de l’atmosphère. Cependant, ils parviennent à la modifier dans l’action qu’on suppose la plus influente, dans celle qui les affecte d’une manière immédiate. À mesure qu’ils font des progrès, ils apprennent à se créer une atmosphère tempérée, en variant leurs vêtements et leurs habitations ; de sorte que si le froid et la chaleur produisent les effets que la plupart des philosophes leur ont attribués, ces effets doivent se manifester avec d’autant plus de force que les peuples sont plus barbares.
Si nous voulons savoir comment les circonstances physiques au milieu desquelles les peuples sont placés, influent sur eux, et comment cette influence des choses sur les hommes concourt ensuite à modifier l’action qu’ils exercent, soit sur eux-mêmes, soit les uns à l’égard des autres, nous devons continuer à considérer séparément chacune des divisions principales entre lesquelles on a partagé le genre humain ; nous devons chercher à constater l’état auquel est parvenue chacune des espèces ou variétés d’hommes que nous connaissons, sous tous les climats et dans toutes les positions. Cette esquisse de la civilisation comparée des peuples de toutes les espèces, et de toutes les parties du globe, a exigé des recherches fort nombreuses. J’ai tâché de l’abréger le plus qu’il m’a été possible ; cependant, pour être suivie, elle demande quelque patience de la part de ceux qui veulent la connaître.
En observant la marche que la civilisation a suivie sur chacune des principales parties de la terre, nous avons vu les lumières se former d’abord sous les climats chauds ; se répandre ensuite dans les climats tempérés, et s’arrêter devant les climats froids ou n’y pénétrer qu’avec peine. J’exposerai ailleurs quelles ont été les principales causes de ce phénomène ; dans ce moment, nous avons seulement à examiner si les passions et les lois vicieuses ont suivi la même marche que les lumières ; et si les peuples les plus barbares ont eu plus de vertus et de meilleures lois. Nous avons à examiner surtout si les vices et les vertus, les bonnes et les mauvaises lois qu’on observe chez des peuples de diverses espèces, placés sous différentes zones, sont des effets de la température du climat, ou s’ils doivent être attribués à d’autres causes.
Suivant Montesquieu, la chaleur du climat abat la force de l’âme en même temps que celle du corps ; elle produit la lâcheté, la paresse, la jalousie, la méfiance, la ruse, la fausseté, l’orgueil, la vengeance, la cruauté ; enfin, elle éteint tout sentiment généreux ; suivant lui, on trouve dans les climats du nord des peuples qui ont peu de vices, assez de vertus, beaucoup de sincérité et de franchise. Approchez des pays du midi, dit-il, vous croirez vous éloigner de la morale même ; des passions plus vives multiplieront les crimes ; chacun cherchera à prendre sur les autres tous les avantages qui peuvent favoriser ces mêmes passions.
S’il est vrai, comme cela me semble prouvé, que la civilisation s’est d’abord développée dans les climats chauds, toutes fois qu’elle n’y a pas été arrêtée par des causes insurmontables, telles que l’aridité du sol ; et si la chaleur produit les effets moraux que Montesquieu lui attribue, il faudra admettre, avec J.-J. Rousseau, que les connaissances humaines ont toujours été accompagnées de la corruption des mœurs ; il faudra reconnaître que, si les vices ne sont pas des conséquences des sciences et des arts, ils sont produits au moins par les mêmes causes. Dans cette hypothèse, il sera vrai de dire que la même force qui retient les peuples des pays froids dans l’ignorance et la barbarie, leur donne ou leur conserve leurs vertus [341].
L’esprit se fatigue à réfuter des opinions qui ne sont fondées sur aucune observation bien faite, et que démentent des faits sans nombre. Mais lorsqu’une opinion, quelque fausse qu’elle paraisse à ceux qui l’ont soumise à l’examen, a été professée par des hommes tels que Montesquieu, Rousseau, Raynal, Robertson, et d’autres moins célèbres ; lorsque cette opinion porte sur les plus grands intérêts de l’espèce humaine, la morale, les lois et même la religion [342] ; enfin lorsqu’on voit des hommes qui ne manquent ni de jugement, ni de connaissances, publier sur les sciences morales les opinions les moins sensées, faut-il croire que la multitude, qui n’a point d’opinion qu’elle puisse dire à elle, et qui ne pense que d’après les livres, saura se garantir de toutes les erreurs ? Peut-on penser qu’elle ne croira point à l’influence des climats sur les mœurs, lorsqu’on voit des écrivains, qu’on peut croire sensés, attribuer l’esprit révolutionnaire des peuples à la charge électrique de l’atmosphère, et leur réformation morale à l’usage du café [343] ?
Il est aisé d’enfanter des systèmes, et d’expliquer, à l’aide de quelques mots, aux hommes les moins éclairés, toutes les révolutions du monde. Mais ce n’est pas ainsi que procèdent les sciences ; personne ne les devine, ni ne les improvise : il faut qu’elles sortent de l’étude lente et pénible des faits, ou qu’elles restent inconnues. Il ne faut pas perdre de vue d’ailleurs que l’examen du système sur l’influence immédiate du froid et de la chaleur sur les organes des diverses espèces d’hommes, n’est ici qu’un objet secondaire. L’objet principal que je me propose, est de déterminer, ainsi que je l’ai déjà dit, l’action que les choses, considérées sous un point de vue général, exercent sur les hommes ; celle que les hommes exercent à leur tour sur les choses, et celle qu’ils exercent ensuite les uns à l’égard des autres.
Montesquieu, en affirmant que les peuples placés sous des climats froids ont plus de vertus et moins de vices que les peuples placés sous des climats chauds, et qu’en s’approchant des pays du midi on croit s’éloigner de la morale même, déduit ces faits, non de l’examen des mœurs de chaque peuple, mais de la faiblesse physique produite, suivant lui, par la chaleur sur les organes de l’homme : et comme il a été précédemment prouvé que les peuples placés sous des climats chauds, sont en général mieux constitués et plus forts que les peuples de même espèce placés sous les climats les plus froids, on pourrait renverser son système ; on pourrait dire que, d’après ses principes, les vices sont réservés aux climats froids et les vertus aux climats chauds. Mais avant que d’affirmer que telle ou telle constitution physique produit tel ou tel genre de passions, il eût fallu examiner les faits ; il eût fallu se convaincre que partout où se trouve une telle constitution, on voit régner telles passions, et qu’on ne les voit jamais régner dans les lieux où les hommes sont différemment constitués : or, c’est un examen auquel ne s’est livré, ni Montesquieu, ni aucun des écrivains qui ont adopté son système.
Moins les hommes ont fait de progrès, et plus il est facile d’observer l’action qu’exerce sur eux la nature inculte et sauvage. Nulle part l’influence des choses sur les mœurs des nations ne se manifeste avec plus d’énergie que dans les contrées où la civilisation n’a jamais pénétré. C’est donc une nécessité d’observer les peuples de toutes les espèces, dans toutes les circonstances où ils ont été placés. En nous livrant à ces observations, et en voyant quelle est l’action que les nations ont exercée les unes sur les autres, nous trouverons l’origine d’un grand nombre de nos préjugés, de nos passions, de nos lois. En comparant entre eux des peuples qui appartiennent à la même espèce, mais qui sont placés dans des positions différentes, il nous sera plus facile de trouver les causes de la prospérité des uns, de la décadence ou de l’état stationnaire des autres. En comparant entre eux des peuples de différentes espèces placés dans des situations semblables, il nous sera plus facile de juger s’il existe quelque supériorité entre les uns et les autres, et quel est ce genre de supériorité. Si l’anatomie comparée nous a fait faire de grands progrès dans la connaissance du physique des hommes, un traité de morale ou de législation comparée, ne sera peut-être pas inutile au progrès des sciences morales.
Afin de mettre de l’ordre dans l’exposition des mœurs ou des lois des peuples des diverses espèces, je ferai connaître d’abord quelles sont les diverses classes dans lesquelles chaque nation, chaque horde ou chaque peuplade se divisent ; j’exposerai ensuite quels sont les rapports qu’ont les individus de chaque classe, soit entre eux, soit avec des individus qui appartiennent à des classes différentes ; j’exposerai, en troisième lieu, quelle est, dans chaque état, la condition des femmes, des enfants et des vieillards ; j’exposerai, de plus, quelles sont les habitudes qui n’affectent immédiatement que les individus qui les ont contractées ; enfin, je ferai connaître quelles sont les relations qui existent de peuple à peuple ; on pourra voir ainsi comment les habitudes morales de chaque fraction dont l’espèce se compose, influent sur le sort de l’ensemble, et comment des migrations, des invasions ou des conquêtes transportent les idées, les mœurs, les institutions formées sous certaines circonstances locales, chez des peuples places dans des circonstances différentes.
[II-268]
CHAPITRE XIV.↩
Des rapports observés entre les moyens d’existence et la nature des gouvernements des peuples d’espèce cuivrée, du nord de l’Amérique. Du genre d’inégalité qui existe chez ces peuples. Des moyens de sûreté employés par les individus. — Des mœurs qui résultent de l’emploi de ces moyens.
Les moyens que chaque peuple emploie pour pourvoir à son existence dépendent, en général, du développement de l’intelligence des individus dont ce peuple est formé ; et les mœurs de ces individus sont en grande partie déterminées par leurs moyens d’existence ; il existe ainsi une relation intime entre le développement intellectuel d’une nation et son perfectionnement moral. On verra, dans ce chapitre et dans les suivants, des preuves nombreuses de cette relation : on verra que, si, à mesure que les peuples s’éclairent, ils sont mieux pourvus de tout, ils ont aussi des mœurs plus pures et plus douces, à mesure qu’ils savent mieux pourvoir à leurs besoins ; on verra, de plus, que les formes de leurs gouvernements, et, s’il est permis de s’exprimer ainsi, leur physionomie sociale, sont déterminées par les diverses manières dont chaque fraction de la population pourvoit à ses premiers besoins.
En exposant les divers degrés de développement intellectuel auxquels étaient parvenus les indigènes d’Amérique avant que l’existence de ces peuples eût été troublée, ou leur ordre social renversé par les invasions des Européens, nous avons vu qu’aux deux extrémités de ce continent les hommes vivaient principalement des produits de la pêche ou de la chasse ; qu’en partant du côté du nord, on ne commençait à apercevoir quelques traces de culture que vers le quarante-cinquième degré de latitude ; que la culture devenait plus considérable à mesure qu’on avançait vers l’équateur ; qu’on ne trouvait presque plus de peuples chasseurs sous la zone torride, chacun vivant principalement des produits de son agriculture ; et que les seuls peuples qui eussent fait des progrès dans les arts se trouvaient entre les tropiques ou en étaient du moins très rapprochés.
Il n’est pas aussi facile de suivre sur ce continent le progrès des mœurs, que les progrès de l’industrie. En général, les observations sur les mœurs exigent plus de temps et de sagacité que les observations sur les arts. Elles ne peuvent être faites que sur les lieux, et il est impossible de les renouveler, quand les peuples ont disparu ou que de violentes secousses ont modifié leur existence. Il a suffi, pour juger de l’intelligence des peuplades qui habitent aux deux extrémités du continent américain, de considérer quelques instants leurs instruments de chasse ou de pêche, et d’examiner de quelle manière sont formés les vêtements ou les cabanes qui les garantissent du froid. Les produits des arts peuvent être transportés au loin, et nous pouvons souvent refaire par nous-mêmes, sans presque nous déplacer, les observations que les voyageurs ont faites sur les les lieux. Il nous est facile, par exemple, de juger si les descriptions que les navigateurs nous ont données de l’industrie des insulaires du grand Océan sont exactes : il nous suffit de nous transporter dans les cabinets dans lesquels sont déposés les objets d’art que plusieurs de ces voyageurs en ont apportés. Les produits de l’industrie survivent d’ailleurs fort souvent aux peuples qui les ont créés ; et c’est ainsi que nous pouvons juger, au moins partiellement, sans avoir recours à aucune description, de l’industrie des anciens peuples de l’Italie et de la Grèce. Nous pouvons juger de la même manière des progrès qu’avaient faits dans quelques arts les Mexicains et les Péruviens, à l’époque où leur pays fut envahi par les Espagnols.
Mais les observations sur les mœurs présentent des difficultés bien plus graves et bien plus nombreuses. Si le climat sous lequel un peuple se trouve placé est très rigoureux, comme l’est celui de l’extrémité australe et celui de l’extrémité boréale de l’Amérique, les voyageurs ne peuvent pas s’y arrêter, et sont par conséquent incapables de faire sur les mœurs des habitants aucune observation suivie. Aussi, quoique les peuples qui vivent près du détroit de Magellan, sur la terre de Feu, et à l’embouchure des rivières qui se dirigent vers l’océan arctique, aient été visités par des voyageurs doués de beaucoup de sagacité, nous ne connaissons d’eux que leur stupidité et leur excessive misère. Nous ne connaissons pas beaucoup mieux les mœurs des peuples du centre de l’Amérique, qui, au quinzième siècle, étaient les plus civilisés de ce continent, et qui furent asservis ou détruits par les Espagnols. Les conquérants, sont de tous les hommes les moins en état de juger les mœurs des nations qu’ils asservissent ; parce que des peuples se montrent rarement tels qu’ils sont à des étrangers, surtout si ces étrangers se présentent en ennemis. Mais, lorsque ces conquérants ne sont mus que par la passion des richesses, et ne savent même estimer que l’or ; lorsqu’à une ignorance profonde ils joignent le fanatisme le plus ardent et la superstition la plus basse ; lorsqu’ils ignorent la langue des peuples qu’ils asservissent, et n’aspirent qu’à détruire ceux qu’ils ne peuvent pas rendre esclaves, on ne peut attendre d’eux aucune observation propre à inspirer de la confiance. Nous ne pouvons donc savoir que très peu de chose sur les mœurs des Mexicains et des Péruviens, avant la conquête ; puisque nous ne possédons à cet égard que les écrits des Espagnols, et qu’il n’est plus possible de renouveler ou d’étendre les observations qu’ils contiennent. Cependant, quelque imparfaites que soient nos connaissances, elles suffisent pour nous convaincre que les peuples du nord, loin d’avoir quelque supériorité morale sur les peuples de même espèce qui vivent entre les tropiques, leur sont au contraire généralement inférieurs.
On a vu précédemment que les peuples situés à l’extrémité boréale du continent américain au-delà du soixante-sixième degré de latitude vivent principalement des produits de la pêche, et que la chasse ne leur fournit qu’accidentellement un supplément aux subsistances qu’ils tirent de la mer ou des fleuves. Les peuples qui vivent entre le soixante-sixième et le quarante-cinquième degré de latitude trouvent au contraire dans les produits de la chasse leurs principaux moyens d’existence. Quoique les lacs et les fleuves leur fournissent une partie de leurs subsistances, cette partie est moins considérable que celle que leur fournissent les animaux terrestres. Depuis le quarante-cinquième degré de latitude jusque vers le trentième, sur le golfe du Mexique, la population vit des produits de la chasse, de la pêche et de l’agriculture. La terre n’est cultivée que d’une manière très imparfaite ; elle est divisée entre les peuplades ; mais elle n’est pas partagée entre les individus ou entre les familles ; la culture se fait en commun, et les produits en sont déposés dans des magasins publics. Enfin, entre les tropiques, on ne trouve presque plus de peuples chasseurs : le territoire occupé par chaque peuplade est presque partout divisé en propriétés particulières. Chacun cultive les siennes comme il l’entend, et jouit exclusivement des produits qu’il en retire [344].
Une nation qui possède des moyens d’existence très variés, est, en général, moins exposée à manquer d’aliments que celle qui n’en possède que d’une seule espèce. Si un peuple qui, par sa position locale ou par toute autre cause, ne peut tirer sa subsistance que de la pêche, reste plusieurs jours sans prendre de poisson, ou s’il n’en prend pas assez pour faire sa provision accoutumée, il est assailli nécessairement par la famine ou tout au moins par la disette. Celui qui réunit à l’art de prendre du poisson, l’art de prendre du gibier, peut trouver dans l’un le supplément de ce qui a manqué à l’autre : il est moitié moins exposé à périr de faim. Celui qui réunit à ces deux moyens l’art de cultiver un champ est moins exposé encore : deux de ces ressources peuvent lui manquer, sans qu’il coure le danger de périr. Enfin, celui qui, en se livrant à la culture, sait en varier les produits, de manière que la saison qui fait manquer un certain genre de végétaux en fasse prospérer un autre, a encore moins de chances à courir : s’il est exposé à éprouver des disettes, il est presque impossible qu’il soit attaqué par la famine.
La population qui est la plus exposée à manquer de subsistances est en même temps celle qui a besoin d’occuper le territoire le plus étendu, et de se donner le plus de peine pour acquérir les aliments qui lui sont nécessaires. Si l’on suppose, par exemple, une peuplade vivant presque exclusivement du poisson qu’elle tire d’un lac ou d’un fleuve, il faudra qu’elle en parcoure toute l’étendue pour y trouver des ressources peu considérables ; il faudra de plus, que des terres très vastes portent leurs eaux vers le même point, pour former le fleuve ou le lac au moyen duquel le poisson peut exister. Si l’on suppose une peuplade vivant exclusivement du produit de la chasse, il faudra qu’elle occupe un territoire qui ne sera guère moins étendu ; la quantité de gibier que peut nourrir une contrée abandonnée à sa fertilité naturelle, doit s’évaluer, en effet, non par les aliments que la terre offre aux animaux dans la saison la plus favorable de l’année, mais par ceux qu’elle leur présente dans la saison la plus rigoureuse. En supposant, par exemple, que la consommation annuelle d’une famille soit de six cents pièces de gibier, il faudra que cette famille occupe un territoire suffisant pour nourrir pendant l’hiver un nombre pareil d’animaux, et de plus un nombre suffisant pour perpétuer l’espèce, et pour remplacer ceux que des accidents peuvent soustraire à la consommation de l’homme. Un individu qui ne vit que du produit de la chasse a donc besoin d’une étendue de terrain immense : on a évalué à environ deux lieues carrées le territoire nécessaire à chaque sauvage de l’Amérique septentrionale ; mais il est douteux que cette étendue fût suffisante pour le faire exister, si les fleuves ou les lacs ne lui fournissaient aucune ressource, et s’il ne se livrait à aucun genre de culture. On peut juger, d’après cela, quelle est l’étendue de territoire nécessaire à l’existence d’une horde de sauvages un peu nombreuse [345].
La rigueur du climat de l’extrémité boréale de l’Amérique n’a pas permis aux Européens qui y ont pénétré, d’y faire un séjour assez long pour acquérir une connaissance parfaite des mœurs des habitants ; ils ont seulement observé la nature de leurs aliments, la forme de leurs vêtements et de leurs cabanes, et leurs relations avec d’autres peuples ; mais on peut juger de leurs mœurs, soit par celles de leurs voisins, soit par celles d’autres peuples qui ont adopté le même genre de vie. Les Esquimaux vivent, en grande partie, de poisson ; ils s’abreuvent d’eau, et d’huile de baleine : ils mangent du veau marin, du cheval de mer, du poisson pourri, et des aliments plus dégoûtants encore. Il est impossible de douter que ces grossiers aliments ne leur manquent même souvent, lorsque, d’un côté, on voit, sur le même continent, des peuples, vivant sous un climat moins rigoureux et ayant une industrie moins bornée, assiégés souvent par la famine ; et lorsqu’on sait, d’un autre côté, que les indigènes de la Nouvelle-Hollande et de la terre de Van-Diemen, qui vivent principalement de poisson et de coquillages, s’égorgent sur les restes pourris d’une baleine pour s’en disputer les lambeaux : si, sous un climat tempéré, la pêche n’offre que des ressources incertaines et fortuites, elle ne peut en offrir que de plus incertaines encore sous un climat dont la rigueur est excessive. Or, une disette habituelle, et les autres calamités inséparables de la vie sauvage, ne peuvent que produire, chez eux, les effets qu’elles produisent sur toutes les hordes qui sont dans une position semblable. Suivant Ellis, ces peuples sont rusés, traîtres, soupçonneux, rampants et cruels [346]. Suivant Charlevoix, leurs mœurs sont aussi barbares et aussi féroces que celles des loups et des ours dont leurs déserts sont remplis : ils ne diffèrent des brutes que par la figure [347]. Ils profitent, dit Mackenzie, de toutes les occasions pour attaquer ceux qui sont hors d’état de se défendre ; joignant la perfidie à la cruauté, ils tombent à l’improviste sur les hommes auxquels ils ont juré amitié, et les massacrent [348].
Les ressources qu’offre la chasse aux peuples les plus voisins des Esquimaux, ne sont guère moins incertaines que celles qu’offre la pêche ; quelquefois même elles le sont davantage. Les animaux herbivores, qui sont les seuls qui présentent aux hommes des aliments considérables, vont presque toujours par troupe. Il faut quelquefois, pour en rencontrer quelques-uns, qu’une horde de chasseurs parcoure un espace de dix ou douze lieues [349]. Souvent même elle parcourt, pendant trois ou quatre jours, un espace immense de pays, sans atteindre un seul animal dont elle puisse se nourrir [350]. Les hommes finissent par contracter ainsi, comme les bêtes de proie, l’habitude de passer plusieurs jours sans manger, ou de se contenter d’une quantité d’aliments extrêmement bornée [351]. S’ils ont le bonheur de rencontrer et de cerner une troupe d’animaux, ils égorgent tous ceux qu’ils peuvent en atteindre ; chacun dévore alors autant de viande que son estomac peut en contenir. Un sauvage qui a longtemps supporté la faim, consomme autant d’aliments que pourraient en consommer six hommes de bon appétit. Parmi eux, on s’honore également en supportant une longue abstinence, et en mangeant avec excès [352].
Les peuples qui vivent de chasse ou de pêche, étant exposés à des disettes ou même à des famines fréquentes, prennent l’habitude de se nourrir d’aliments grossiers et repoussants. Les indigènes du nord de l’Amérique, quand la chasse et la pêche ne leur fournissent rien, mangent de l’écorce de certains arbres, de la mousse bouillie, de l’herbe, du poisson pourri, et des vers [353] ; ils mangent leurs souliers et les peaux dont ils font commerce, après en avoir arraché le poil, même quand elles sont à demi pourries ; ils mangent la vermine qui les couvre et les insectes qui s’attachent à la peau des animaux ; enfin, quand ils n’ont pas d’autres ressources, ils mangent leurs propres enfants ou se dévorent entre eux [354]. Les aliments dont ces peuples se nourrissent, dans les temps de disette ou de famine, diffèrent peu de ceux dont se sont nourris, dans de pareilles circonstances, des peuples civilisés. Nous trouvons dans l’histoire de toutes les nations, plusieurs exemples où la famine a porté les hommes à dévorer des objets qui leur auraient inspiré de l’horreur dans une situation moins misérable. Mais, chez des peuples industrieux, ce sont des cas extrêmement rares, qui n’existent même que pour un petit nombre d’individus, et qui ne peuvent avoir aucune influence sur les mœurs ou sur les habitudes nationales. Chez les peuples chasseurs ou pêcheurs, ce sont, au contraire, des événements fréquents et presque habituels, qui affectent les peuplades entières, et qui ont sur leurs mœurs une grande influence.
Un peuple chez lequel il n’existe qu’une seule profession pour tous les individus, et chez lequel la propriété individuelle est presque inconnue, ne connaît guère d’autre inégalité que celle qui résulte de l’adresse ou de la force ; et il n’a besoin de chef que dans le moment où il est question d’agir en commun, soit pour l’attaque, soit pour la défense. Lorsqu’une tribu de sauvages se prépare à environner la proie qu’elle a longtemps poursuivie, ou à surprendre un ennemi avec lequel elle est en guerre, elle se soumet à la direction de celui de ses membres qu’elle a reconnu pour le plus habile chasseur ou pour le plus habile guerrier. La subordination est alors aussi parfaite, la soumission aussi entière que dans l’armée la mieux disciplinée ; chacun fait dépendre son intérêt individuel de l’intérêt général, avec un dévouement sans réserve ; le corps tout entier paraît animé par une volonté unique [355].
Mais, hors de ces occasions, il n’existe chez ces hordes aucune autorité commune. Un homme qui commande en maître à ses femmes et à ses enfants, n’a aucune autorité hors de sa famille [356]. Ses enfants mêmes ne lui obéissent qu’aussi longtemps qu’ils dépendent de lui pour leur subsistance : dès qu’ils ont la même adresse ou la même force que lui, ils sont ses égaux [357]. Les délibérations que prennent les membres de la peuplade, soit pour aller à la chasse, soit pour attaquer un ennemi, n’ont par elles-mêmes aucune autorité : tout individu qui les désapprouve est libre de ne pas s’y conformer [358]. Enfin, les individus qui dirigent les expéditions, et que, par cette raison, nous considérons comme les chefs, n’ont ni une meilleure cabane, ni de meilleurs vêtements, ni de meilleurs aliments que les autres membres de la tribu ; s’il leur arrive d’être mieux pourvus, c’est en vertu de leur force individuelle, et non en vertu de l’autorité dont ils sont revêtus [359]. Il n’existe donc, dans le sein d’une peuplade, aucune autorité pour terminer les différends qui peuvent s’élever entre les membres dont elle se compose [360].
Chez ceux de ces peuples qui sont les moins avancés et qui sont habituellement en état de guerre, les chefs sont électifs ; et les individus qui montrent le plus de force à supporter les maux attachés à la vie sauvage, sont ceux sur lesquels les suffrages se réunissent : ainsi, le candidat qui supporte le plus longtemps les douleurs de la faim, les morsures des insectes, la fumée dont leurs cabanes sont habituellement remplies, est assuré d’être élu, s’il possède d’ailleurs les talents que la guerre et la chasse exigent [361]. Chez les peuplades qui ont fait un peu plus de progrès, et chez lesquelles la terre a commencé à être divisée en propriétés particulières, il existe des chefs dont l’autorité est héréditaire ; mais cette autorité se réduit à quelques légères marques d’égards ou de déférences. Les individus qui en sont revêtus, n’ont en réalité aucun commandement ; ils sont obligés de travailler comme les autres s’ils veulent vivre, et ne sont pas mieux pourvus que ceux qui ne jouissent d’aucune autorité [362].
Des peuplades peu nombreuses, qui errent sans cesse dans des forêts immenses à la poursuite du gibier, qui n’ont pour vêtements que quelques peaux d’animaux, pour logement que de misérables cabanes faites de terre et de branches d’arbres, et pour aliments que les produits de la chasse ou de la pêche, ne peuvent être soumises à l’oppression méthodique d’un individu ou d’une famille ; il ne peut exister chez elles ni royauté, ni aristocratie de naissance ou de richesses. Mais on se tromperait si l’on s’imaginait qu’il se commet chez elles moins d’actes d’oppression ou de violence, qu’il ne s’en commet chez les peuples moins barbares du sud. Il existe chez ces peuples un genre d’inégalité dont rien ne tempère les effets : c’est celle de la force. On va voir comment cette inégalité agit chez les peuplades qui vivent sous les climats les plus froids.
Ces peuplades, ne se livrant à aucun genre de culture, ne connaissent pas d’autre propriété individuelle que les armes, les vêtements et les ornements que chacun possède ; les femmes sont aussi considérées comme les propriétés de leurs pères ou de leurs maris. La valeur des armes d’un sauvage est fort petite pour des hommes qui vivent d’agriculture ; mais, pour lui, elles sont sans prix ; puisque, s’il vient à les perdre, il court risque de mourir de faim. Ces propriétés sont cependant peu respectées, et les forts se font rarement scrupule de dépouiller les faibles ; si une troupe de chasseurs en rencontre une autre qui soit moins puissante, elle lui enlève non seulement le gibier qu’elle a tué, les peaux dont elle a fait provision, mais ses instruments de chasse et de pêche, ses filles et ses femmes [363] ; si un chef vient à mourir, laissant des enfants moins vigoureux que lui, les propriétés qui lui ont appartenu passent à ceux de ses compagnons qui ont assez de force pour s’en emparer [364] ; si un individu possède une chose qui tente un homme plus fort que lui, celui-ci l’en dépouille et s’en empare [365] ; quelquefois aussi celui qui convoite une chose qu’il ne peut obtenir par un simple acte de violence, s’en rend maître au moyen d’un assassinat [366].
Les femmes sont les propriétés que les chasseurs du nord se disputent le plus fréquemment. Celui qui convoite la femme dont un autre est en possession, le provoque à la lutte, et, s’il est vainqueur, la femme lui appartient. Si celui dont la femme est convoitée ne la cède pas volontairement aussitôt qu’il a été renversé, ses amis et ses parents lui représentent les dangers auxquels il s’expose par une plus longue résistance, et l’engagent à se soumettre à la nécessité. Un individu doué d’une grande force possède quelquefois sept ou huit femmes, tandis que les hommes les plus faibles n’en ont aucune. La force musculaire ne décide cependant pas toujours de la propriété des femmes. Il arrive souvent que l’homme qui veut conserver celle qu’il a, ou reprendre celle qu’on lui a ravie, poignarde l’individu qu’il croit n’avoir pas la force de vaincre à la lutte ; quelquefois aussi le ravisseur assassine le premier possesseur, afin de n’avoir plus rien à craindre de lui. Les plus forts s’emparent des subsistances des plus faibles, par les mêmes moyens qu’ils s’emparent de leurs femmes : ils considèrent comme un honneur de vivre aux dépens de ceux qui n’ont le pas moyen de se défendre [367].
Nul n’ayant de garantie que sa force personnelle, et celle des individus auxquels il est lié par le sang ou par l’amitié, chacun est le juge de la peine que méritent les injustices ou les offenses qui lui sont faites. De là résulte, chez tous les indigènes d’Amérique qui ne sont soumis à aucun gouvernement régulier, un esprit de vengeance qui ne s’éteint que par la mort de celui qui en est animé, ou par l’assassinat de celui qui en est l’objet. La moindre querelle leur fait mettre le poignard à la main ; un seul mot jugé insultant allume dans leur sein une flamme qui ne peut s’éteindre que dans le sang de l’offenseur ; car jamais une injure ne se pardonne de bonne foi [368]. Un individu dissimule quelquefois pendant vingt ans ses sentiments vindicatifs, pour attendre que l’occasion de les satisfaire impunément se présente [369]. Pour atteindre celui qui l’a offensé, il parcourt, à travers les forêts, plusieurs centaines de milles ; se cache dans le creux d’un arbre ; y reste plusieurs jours et plusieurs nuits sans manger ; et, si son ennemi se présente, il fond sur lui avec la rapidité d’un oiseau de proie, l’égorge, lui arrache la chevelure, et disparaît, glorieux de pouvoir raconter aux siens le triomphe qu’il a obtenu [370]. La vengeance ne s’arrête pas sur l’individu qui l’a allumée ; elle s’étend sur ses enfants, sur les membres de sa famille, sur toutes les personnes qui appartiennent à sa tribu [371]. Elle n’est pas excitée seulement par des offenses personnelles ; elle l’est par celles qui sont faites à ses parents, à ses amis, aux membres de sa horde [372].
La crainte des représailles oblige quelquefois ces hommes à dissimuler leur vengeance, ou à en suspendre les effets ; mais lorsque l’ivresse leur a ôté toute prévoyance, il n’est aucune violence à laquelle ils ne s’abandonnent. Quoique, dans de pareilles circonstances, les femmes prennent soin de cacher les armes de leurs maris, une horde ne se plonge jamais dans l’ivresse sans que plusieurs individus ne se livrent au meurtre. Les maris égorgent leurs femmes, ou les femmes leurs maris : les enfants massacrent leur père, ou le père ses enfants. Les chefs eux-mêmes ne sont pas épargnés, et tombent sous le poignard de ceux qui croient avoir reçu d’eux l’offense la plus légère. Souvent des individus s’enivrent dans la vue secrète de se livrer avec impunité à leur vengeance, et dans l’espérance qu’ils seront plus facilement excusés. Les meurtres commis dans l’ivresse excitent, en effet, un ressentiment moins profond que ceux qui sont commis de dessein prémédité. Cependant ceux-là même sont souvent punis par les représailles [373]. La passion de la vengeance n’est point particulière aux nations du nord de l’Amérique ; elle est commune à toutes les peuplades de ce continent qui appartiennent à la même espèce, et qui ne jouissent d’aucune garantie sociale, depuis celles qui habitent au-delà de la baie d’Hudson jusqu’à celles qui habitent sur le golfe du Mexique ; chez celles qui habitent sur la côte de l’ouest, comme chez celles qui vivent sur les côtes de l’est [374]. Nous verrons plus loin cependant que cette passion se prononce d’une manière moins énergique chez les peuples qui vivent sous un climat doux, que chez ceux qui vivent sous un climat rigoureux.
Mais quelque violente que soit chez ces peuples la passion de la vengeance, elle ne peut excéder leur perfidie. S’ils ont reçu une injure, ils la dissimulent avec un art profond, jusqu’au moment où l’occasion de se venger se présente. C’est l’instant même où ils méditent une trahison ou un assassinat, qu’ils se montrent prévenants et flatteurs. Ils portent la dissimulation à un excès qu’on aurait peine à croire si on ne l’avait éprouvé : ils savent joindre les fausses larmes aux fausses caresses, si le besoin l’exige [375]. Ce n’est pas seulement pour perdre leurs ennemis qu’ils sont faux et menteurs ; c’est aussi pour s’approprier les objets qu’ils désirent, et qu’ils ne peuvent obtenir par la force. Ils cherchent à attendrir les personnes auxquelles ils s’adressent, par le récit de malheurs supposés ; ils affectent d’être estropiés ou aveugles afin de mieux exciter la pitié. Les femmes excellent surtout dans ces artifices ; je puis affirmer, dit Hearne, en avoir vu dont un côté de la figure exprimait la joie, tandis que l’autre était baigné de larmes [376]. S’ils veulent obtenir une chose qu’ils convoitent ardemment, ils deviennent, tout à coup, bas, serviles, rampants, trompeurs et dépravés en tout point [377]. La flatterie est un art qu’ils possèdent au suprême degré. Ils l’emploient aussi longtemps que le leur prescrit leur intérêt, mais jamais au-delà [378]. La même perfidie que les voyageurs ont observée chez les peuples les plus élevés vers le nord, se retrouve chez les peuples du nord-ouest. « Lorsqu’ils prenaient un air riant et doux, dit La Pérouse, j’étais assuré qu’ils avaient volé quelque chose [379]. »
Ces peuples savent si bien cacher leurs vices, ils affectent la franchise et la bonne foi avec tant de naturel, qu’il n’y a que les voyageurs qui ont longtemps vécu parmi eux, qui ont pu les juger. Ceux qui ne les ont vus que peu de temps, ou qui se sont présentés chez eux avec des forces imposantes et leur ont inspiré de la crainte, en ont quelquefois porté un jugement favorable que l’expérience a plus tard démenti [380].
Les Américains du nord sont essentiellement égoïstes, et il ne paraît pas qu’ils aient dans leur langue de mot pour exprimer la reconnaissance [381]. Ils se montrent insensibles aux douleurs d’autrui, et semblent à peine connaître ce sentiment de compassion que les autres peuples accordent même aux souffrances des animaux. La vue de la douleur, loin d’exciter chez eux des sentiments de pitié, ne fait qu’exciter leurs plaisanteries ou leurs railleries.
« J’ai vu un de ces Indiens, dit Hearne, causer les plus violents éclats de rire à toute une compagnie, dont je ne partageais certainement pas la joie, en contrefaisant les gémissements et les convulsions d’un homme qui était mort au milieu des plus terribles douleurs [382]. »
Tous les individus qui appartiennent à cette espèce sont cependant très sérieux et même très taciturnes : il n’y a que les mouvements d’une joie extraordinaire qui puissent les faire sortir de leur gravité [383].
[II-292]
CHAPITRE XV.↩
Des rapports qui existent entre les deux sexes, chez les peuples d’espèce cuivrée, du nord de l’Amérique. — Des rapports entre les parents et leurs enfants. — Des mœurs qui sont les conséquences de ces rapports.
Les rapports qui existent entre les deux sexes, chez les indigènes du nord de l’Amérique, ressemblent bien plus à ceux que la servitude établit entre le maître et l’esclave, qu’à ceux que produit le mariage chez des peuples civilisés. La force physique étant, chez ces peuples, presque la seule cause de supériorité qui soit reconnue, les femmes sont avilies parce qu’elles sont faibles. Chez les peuples placés le plus au nord, et chez les tribus du sud, dont la civilisation n’est pas plus avancée, leur avilissement est tel, que, dans chaque horde, elles paraissent former une espèce inférieure, peu différente des animaux domestiques. Elles ne sont point admises à prendre part aux danses ou aux autres amusements des hommes ; elles n’y paraissent que pour leur préparer et leur présenter leurs boissons [384]. Elles sont exclues de l’enceinte où se célèbrent les cérémonies religieuses ; mais elles dansent ou chantent autour [385]. Elles préparent les aliments des hommes ; mais il ne leur est point permis de manger avec eux. Les femmes même des chefs ne peuvent manger qu’après que tous les hommes, sans en excepter ceux qui leur sont attachés comme domestiques, ont pris ce qui leur convient. Dans les temps de disette, elles ne sont comptées pour rien, et quelquefois elles meurent de faim avant que les hommes se soient imposé aucune privation. Elles peuvent soustraire, il est vrai, quelque partie des aliments qu’elles préparent ; mais si elles étaient surprises commettant une semblable infidélité, elles en seraient sévèrement punies [386]. Un homme se croirait en quelque sorte déshonoré s’il buvait dans la coupe où sa femme a bu, ou si, quand il est assis, elle lui passait par-dessus les jambes [387].
Il est, pour les femmes parvenues à leur puberté, certaines époques auxquelles il leur est interdit d’habiter dans les mêmes tentes que les hommes ; elles se construisent alors une cabane à quelque distance, et y restent pendant quatre ou cinq jours. Aussi longtemps qu’elles sont dans un tel état, elles ne peuvent, ni toucher aux armes ou autres ustensiles des hommes, ni approcher des lieux où ils font la chasse ou la pêche, ni même les suivre de loin dans le même sentier : non seulement les maris les considèrent comme impures, mais ils s’imaginent qu’elles communiquent leur souillure à ce qu’elles touchent [388]. Chez certaines peuplades, un mari qui a approché de sa femme depuis vingt-quatre heures, même quand elle est dans son état ordinaire, se considère comme souillé, et n’oserait se permettre de toucher un calumet. C’est surtout après leur accouchement, que les femmes sont considérées comme impures ; leur impureté dure trente jours si elles sont accouchées d’un garçon, et quarante jours ou six semaines, si elles sont accouchées d’une fille. Pendant ce temps, elles sont reléguées dans une cabane loin des hommes ; et si la peuplade est en marche, elles sont obligées de la suivre de loin [389]. L’avilissement dans lequel les femmes sont plongées se manifeste par l’aspect même qu’elles présentent ; car, tandis que chez quelques peuplades les hommes offrent un extérieur propre et décent, les femmes se montrent d’une saleté dégoûtante [390].
Un père se considère comme le propriétaire de sa fille : il la marie ou pour mieux dire il la vend, sans consulter ni son goût ni sa volonté ; les présents qu’il reçoit de l’individu auquel il la livre, ne sont que le prix qu’il y a mis [391]. Un homme ne pouvant procurer des moyens d’existence à une famille que lorsqu’il a acquis de la force et de l’expérience, les parents ne vendent ordinairement leurs filles qu’à des individus qui ont atteint l’âge de trente-cinq ou quarante ans ; et comme en les livrant ils en reçoivent la valeur, et que de plus ils se déchargent du soin de les nourrir, ils les vendent à l’âge de dix ou douze ans, et quelquefois beaucoup plus tôt [392]. Les parents, au lieu de vendre leurs filles, se contentent quelquefois de les louer à des hommes pour un certain temps ; car quelque peu nombreuses que soient ces peuplades, la prostitution n’y est pas rare ; les femmes y sont livrées dès l’âge le plus tendre, et ce sont ordinairement les parents qui en sont les agents [393].
Un homme peut posséder autant de femmes qu’il a le moyen d’en acheter ou d’en ravir : car la polygamie est usitée, sans restriction, chez toutes les peuplades cuivrées de l’Amérique. La pluralité des femmes est, chez ces peuples, comme chez tous ceux où elle est en usage, le privilège de la puissance. Un chef doué d’une grande force ou d’un talent particulier pour la pêche ou la chasse, en possède souvent huit, dix et jusqu’à douze. Il n’y a, à cet égard, aucune différence entre les nations qui vivent sous le climat le plus froid et celles qui vivent sous le climat le plus chaud, si d’ailleurs elles ne sont pas plus avancées dans la civilisation les unes que les autres. Les chefs des tribus qui vivent au-delà du soixante-cinquième degré de latitude boréale, sur un sol couvert de neige pendant neuf mois de l’année, en ont un aussi grand nombre que ceux qui vivent dans la Floride sous le trentième [394]. Plusieurs n’en ont que deux ou trois ; mais, comme il ne paraît pas que le nombre total des femmes excède celui des hommes, quelques-uns sont réduits à s’en passer, et la plupart à n’en avoir qu’une [395]. La polygamie n’est pas moins en usage sur les côtes de l’ouest, qu’elle l’est sur les côtes de l’est ou dans l’intérieur du continent [396].
L’usage de la polygamie fait que la parenté est rarement, chez ces peuples, un obstacle au mariage. Un individu épouse quelquefois deux ou trois sœurs en même temps ; chez quelques tribus, il suffit même qu’un homme ait épousé l’aînée de la famille, pour être autorisé à exiger toutes les sœurs. L’homme qui perd sa femme, épouse sa belle-sœur ; la femme qui perd son mari, est épousée par un de ses beaux-frères [397]. Il est des peuplades chez lesquelles un homme devient le mari de sa sœur, où un père épouse sa fille, un fils sa propre mère [398].
Si les indigènes de l’Amérique prennent plusieurs femmes, ce n’est pas qu’ils soient passionnés pour elles ; ils sont, au contraire, à leur égard, d’une indifférence complète. Soit que la facilité qu’ils ont de satisfaire leurs passions naissantes, en prévienne l’énergie, soit que les misères de l’état sauvage contre lesquelles ils sont obligés de lutter sans cesse, en empêche le développement, soit que l’avilissement des femmes détruise leur empire, il est certain que les hommes n’éprouvent pour elles presque aucune affection : chez eux, l’amour dans sa plus grande force porte à peine les caractères d’une simple bienveillance [399]. Ils les considèrent comme des propriétés qui ont plus ou moins de valeur, selon qu’elles leur sont plus ou moins utiles ; l’estime qu’ils leur accordent est en raison de la force qu’elles ont, ou des travaux qu’elles peuvent exécuter [400]. Ils les échangent, ils les vendent, ils jouent leurs faveurs ; enfin, ils disposent d’elles comme des plus vils animaux [401]. Dans les luttes qu’ils se livrent entre eux pour s’en disputer la possession, elles attendent patiemment que la force ait décidé quel est le maître auquel elles appartiennent. Quel que soit leur attachement pour le vaincu, ou leur répugnance pour le vainqueur, elles sont obligées de renoncer au premier et de suivre le second [402].
Le motif pour lequel les hommes aspirent à posséder plusieurs femmes, est de leur faire faire les travaux que leur position exige : celles qui peuvent traîner ou porter les plus lourds fardeaux, sont celles qui obtiennent la préférence [403]. Dans les contrées où l’agriculture a commencé à faire quelques progrès, ce sont les hommes qui donnent au terrain la première préparation, parce qu’eux seuls ont, pour cela, une force suffisante ; mais, cela fait, ils ne se mêlent plus de rien : tous travaux agricoles sont à la charge des femmes [404]. Si les hommes vont à la chasse ou à la pêche, une partie des femmes sont obligées de les y suivre, pour leur préparer leurs aliments, dresser leurs tentes, porter leurs provisions, le gibier, les fourrures, et tout ce qui pourrait les embarrasser dans leur marche [405]. Tandis qu’elles sont accablées sous les fardeaux qu’elles portent, les hommes marchent libres devant elles, sans autre embarras que leurs armes [406] ; quelquefois même ils sont à cheval, tandis qu’elles portent le bagage sur leur dos, et leurs enfants par-dessus [407]. L’état de grossesse ne suspend point les travaux auxquels elles sont condamnées : elles les continuent jusqu’au moment de leur accouchement, et les reprennent presque immédiatement après [408].
Si, dans leurs expéditions lointaines, les hommes jugent que les femmes qu’ils ont amenées ne leur [II-300]sont plus nécessaires ou sont un obstacle à leurs desseins, ils les abandonnent au milieu des forêts et des neiges, sans se mettre en peine de ce qu’elles deviendront. Les cris lamentables que fait pousser à ces malheureuses la crainte de s’égarer dans les déserts et de périr de froid et de misère, loin d’exciter l’intérêt de leurs pères, de leurs frères ou de leurs maris, n’interrompt pas même leur joie. Si quelques-uns laissent apercevoir quelques regrets, c’est seulement en faveur des plus jeunes enfants qu’ils abandonnent avec les mères [409].
Dans un tel état d’asservissement, les femmes ne peuvent avoir une volonté à elles ; au premier signe de leur maître, elles doivent obéir : la moindre observation, la plus légère résistance seraient punies de châtiments cruels et quelquefois même de la mort [410]. L’obéissance doit être la même, quel que soit l’ordre qu’elles reçoivent, soit qu’il s’agisse de suivre un nouveau maître auquel elles ont été vendues, soit qu’il s’agisse d’allaiter de jeunes ours à la place des enfants qu’elles ont perdus ; car, lorsque les hommes prennent de ces animaux trop jeunes pour être mangés, c’est par leurs femmes qu’ils les font allaiter, jusqu’à ce qu’ils aient acquis la grosseur convenable [411].
Il semble que des hommes qui traitent leurs femmes avec tant de mépris, qui les vendent, les échangent, les reprennent, et disposent d’elles comme de leurs meubles, devraient être étrangers au sentiment de la jalousie ; il est cependant peu de peuples chez lesquels ce sentiment se manifeste avec plus d’énergie et produise des effets plus terribles que chez les indigènes qui habitent à l’extrémité septentrionale de l’Amérique : tous ces peuples, et surtout ceux dont le pays est couvert de glace ou de neige pendant les trois quarts de l’année, en sont également susceptibles [412]. Un simple doute, surtout quand ils sont dans un état d’ivresse, suffit pour leur faire assassiner leur rival supposé [413]. Les peuples du nord-ouest qui habitent sous la même latitude, entre le cinquantième et le soixante-cinquième degré, se montrent également jaloux ; un homme qui croit que sa femme lui a été infidèle, est capable de la poignarder et de dévorer son enfant [414]. Dans le haut Canada, un mari qui croit que sa femme s’est rendue coupable d’adultère, la tue ou lui arrache le nez et les oreilles avec les dents [415]. La jalousie paraît ne pas exister chez quelques peuples du bas Canada, dans la Californie et entre les tropiques. Si ce sentiment s’y trouve, il est si faible qu’Azara a cru que les indigènes n’étaient pas susceptibles de l’éprouver [416].
Quelque misérables que soient les femmes sous la puissance de leurs maris, il est pour elles un malheur encore plus grand : c’est celui d’être abandonnées à leurs propres forces. Telles sont les calamités attachées à l’état de peuple chasseur ou pécheur, que, si un homme vient à mourir, sa famille périt de misère, à moins qu’un autre ne veuille s’en charger ; la mort d’un chef est suivie quelquefois de la mort de six ou sept femmes et de tous les enfants qui lui appartiennent [417]. Chez quelques peuplades, un homme se charge quelquefois de la famille d’un ami ou d’un frère, dont il épouse la femme [418] ; mais s’il ne se trouve personne qui se charge d’eux, il est rare qu’ils échappent à la destruction. Cependant la répudiation est admise et souvent pratiquée chez tous ces peuples [419]. La femme qui est ainsi renvoyée par son mari, s’empoisonne quelquefois pour abréger la durée de ses souffrances, à moins qu’elle ne soit reçue chez ses parents, ou qu’elle ne trouve un autre mari [420].
Enfin, les maux qui pèsent habituellement sur les femmes dans l’état de barbarie sont tels, qu’elles se font souvent avorter, pour supporter les travaux auxquels elles sont condamnées, ou pour ne pas donner l’existence à des êtres aussi misérables qu’elles [421] ; quelquefois aussi, excitées par un sentiment de pitié, elles tuent leurs filles au moment où elles viennent de naître, afin de les délivrer des malheurs attachés à leur sexe [422]. Les peines et les fatigues qu’elles éprouvent, et la brutalité avec laquelle elles sont traitées, détruisent de bonne heure leur constitution, et leur donnent en quelque sorte la stupidité des animaux. À trente ans, elles sont dans l’âge de la décrépitude [423] ; et à l’exception des devoirs domestiques auxquels elles sont habituées de bonne heure, dit Hearne, leur esprit et leurs sens sont aussi engourdis et aussi froids que la zone sous laquelle elles habitent [424].
[II-304]
Les femmes étant livrées par leurs parents, dans un âge très tendre, à des hommes qu’elles n’ont point choisis et qui sont ordinairement trois ou quatre fois plus âgés qu’elles, ou bien étant la proie des hommes les plus forts, et n’éprouvant de la part de leurs maris que mépris et dureté, ne sauraient avoir pour eux une affection très forte ; elles ne sauraient leur être fidèles ni par principe d’honneur, ni par attachement ; tout ce qu’il est permis au mari d’attendre d’elles, c’est l’obéissance à ses ordres, et l’observation de ses commandements, dans toutes les circonstances où il y a plus de danger à les enfreindre que d’avantage à les violer : les femmes ne peuvent avoir, en un mot, relativement à leurs maris, que les vices ou les qualités des esclaves, et c’est, en effet, ainsi qu’est formé leur caractère moral.
Il est cependant des voyageurs qui ont fait l’éloge de leur fidélité et de leur attachement à leurs maris ; suivant Lahontan, elles aimeraient mieux être mortes que d’avoir commis un adultère [425] ; et, au jugement de Weld, il n’y a pas de nation sur la terre où les femmes mariées soient plus chastes et plus dévouées à leurs maris [426]. Cet attachement et cette fidélité ont dû paraître à ces deux voyageurs d’autant plus extraordinaires, que chez les mêmes peuples ils ont trouvé toutes les femmes non mariées extrêmement licencieuses. Le premier dit que les filles sont folles, et que les garçons font souvent des folies avec elles [427]. Le second attribue la lenteur des progrès de ces peuples dans la population, à la conduite de leurs femmes. « L’usage pernicieux où elles sont, dit-il, de se prostituer dès l’âge le plus tendre, ne peut manquer de corrompre les humeurs et de contribuer à leur stérilité [428]. » Cette différence, entre la conduite des filles et la conduite des femmes, s’explique aisément.
On a vu précédemment qu’il n’y a pas de peuples plus habiles dans la dissimulation et la perfidie que les indigènes du nord de l’Amérique : ils savent cacher leur haine sous les apparences de la bienveillance ; ils sont bas et flatteurs quand, par ce moyen, ils peuvent obtenir ce qu’ils ne sauraient acquérir par la force ; et en fait d’artifices et de fausseté, les femmes surpassent les hommes. Étant sans cesse environnées de dangers, et le moindre sujet de plainte qu’elles donnent à leurs maris les exposant aux traitements les plus cruels ou même à la mort, il faudrait être surpris si elles ne se montraient pas soumises et dévouées, quels que soient leurs sentiments secrets, et si elles étaient moins fausses à leur égard, qu’elles ne le sont à l’égard d’étrangers qui n’ont aucun empire sur elles. Aussi, toutes les fois que la crainte qu’elles éprouvent habituellement vient à s’affaiblir, elles se montrent sous un aspect tout différent.
Les mêmes femmes auxquelles on a prodigué des éloges quand on ne les a vues que sous l’influence de leurs maris, manifestent une licence effrénée aussitôt qu’elles croient n’avoir rien à craindre d’eux : elles montrent la grossièreté des brutes [429]. Il suffit même quelquefois que leur mari soit à une petite distance, pour qu’elles accourent avec empressement vers les étrangers, et qu’elles remplacent l’air sévère et farouche qu’elles prennent en présence des individus de leur peuplade, par un sourire animé, par une affabilité prévenante, des avances trop expressives pour qu’il soit possible de se méprendre sur l’intention [430]. Si un mari s’absente, sa femme le remplace ordinairement par un autre qui exige la même soumission et exerce sur elle la même tyrannie. [431] La répudiation, si commune chez les peuplades les plus élevées dans le nord, n’a pour cause que la mauvaise conduite, le libertinage, l’antipathie mutuelle des époux [432]. La haine des femmes pour leurs maris est quelquefois si forte qu’elle se porte jusque sur les enfants, et qu’elle est une des causes pour lesquelles elles se font avorter [433]. Les hommes qui vivent sous un climat très rigoureux, étant exposés à plus de peines et de fatigues que ceux qui vivent sous un climat tempéré, contractent un caractère plus dur envers les êtres qui les environnent. Leurs femmes sont donc obligées à plus de ménagements et d’hypocrisie ; mais elles ont moins d’affection pour eux, et n’ont pas des mœurs plus pures que les femmes du sud [434].
Les rapports qui existent entre les parents et leurs enfants, sont moins durs que ceux qui existent entre les époux ; un homme est ordinairement moins brutal envers son fils ou envers sa fille, qu’il ne l’est envers sa femme. Mais les difficultés que présente l’état de chasseur ou de pêcheur sous un climat rigoureux, rendent la condition des enfants très misérable, et en font périr un grand nombre. La saleté qui les couvre ou les environne, le mauvais air qu’ils respirent dans les cabanes, la difficulté de leur donner des aliments appropriés à leur âge, le défaut de traitement ou de soin dans leurs maladies, et les tortures que, chez quelques peuplades, les parents leur font éprouver pour leur façonner la tête ou les membres, produisent chez eux une grande mortalité [435]. Cependant les mères prennent soin d’eux autant que le leur permettent les travaux dont elles sont accablées, l’inclémence des saisons, une privation habituelle d’aliments, et une ignorance complète des moyens de les traiter. Lorsqu’elles les perdent, elles en manifestent quelquefois de vifs regrets, quoiqu’il ne soit pas toujours difficile de les consoler [436].
Mais les pères ne s’intéressent à leurs enfants que faiblement, surtout à ceux qui n’appartiennent pas à leur sexe ; lorsque leurs femmes sont accouchées, ils restent un mois ou six semaines sans les voir, ni elles, ni leurs enfants. La raison qu’ils en donnent, est que ces enfants sont si laids à leur naissance, que, s’ils les voyaient, il serait à craindre qu’ils ne leur inspirassent une antipathie que le temps ne pourrait plus détruire [437]. Les enfants, chez ces peuples, n’éprouvent aucune des contraintes que l’éducation rend nécessaires chez les nations civilisées. Dès qu’ils peuvent se traîner sur leurs pieds et sur leurs mains, on les laisse se rouler nus dans l’eau, dans la boue, dans la neige [438]. Un père, dit Volney, caresse les siens comme tout animal caresse ses petits. Quand il les a ballottés, embrassés, il les quitte pour aller à la chasse ou à la guerre sans y plus penser ; il s’expose au péril sans s’inquiéter de ce qu’ils deviendront [439]. Si un homme répudie sa femme, il lui laisse souvent tous les enfants, et ne songe plus à eux [440].
Si un père semble à peine connaître ses enfants, les enfants, de leur côté, ont peu d’attachement et de respect pour leurs parents : ils montrent de l’affection pour leur mère, parce qu’elle les a élevés, mais leur père leur est à peine connu [441]. Chez les peuples qui vivent sous le climat le plus rigoureux, aussitôt qu’un homme ne peut plus travailler, ses enfants le méprisent et le négligent ; dans leurs repas, non seulement ils le servent le dernier, mais ils ne lui servent que ce qu’il y a de plus mauvais ; ils ne lui donnent pour se couvrir que les peaux qu’ils ont rebutées, et qui sont les plus grossièrement cousues. Ce mépris des vieux parents est si général, que la moitié de leurs vieillards des deux sexes meurent faute de soins [442]. Chez quelques peuplades qui vivent vers le cinquante-huitième degré, près de la baie d’Hudson, lorsqu’un individu est trop avancé en âge pour se suffire à lui-même, ses enfants creusent une fosse, l’y placent, et l’étranglent ; s’il n’a point d’enfants pour lui rendre ce service, c’est par ses amis qu’il lui est rendu [443] ; quelquefois, au lieu de faire périr les vieillards par la violence, on les abandonne ; on en use de même avec les malades, quoiqu’il ne soit pas sans exemple qu’on en soigne quelques-uns [444]. Mais, quelle que soit leur indifférence ou leur dureté envers leurs vieux parents, lorsqu’ils les perdent ils en portent le deuil, ils poussent des cris lamentables, ils se coupent les doigts en signe de désespoir : c’est une affaire d’étiquette [445].
La conduite des enfants envers leurs vieux parents semble peu se concilier avec l’influence qu’on attribue aux vieillards dans presque toutes les tribus sauvages ; mais il n’y a rien en cela de contradictoire : on a vu que, chez quelques peuplades, les femmes exercent sur l’esprit de leurs maris une influence très étendue, sans qu’elles soient traitées pour cela avec plus de ménagement ; les vieillards sont à peu près dans le même cas. Des nations chez lesquelles rien n’est écrit, ne savent rien que par expérience ou par tradition : dans les nombreuses occasions où elles ont besoin de connaître les lieux où elles trouveront du gibier ou du poisson, la saison la plus favorable à la chasse ou à la pêche, les limites de leurs territoires, les guerres ou les traités qui ont eu lieu avec d’autres peuplades, il faut qu’elles consultent les anciens, les seuls qui ont de l’expérience, qui connaissent les événements passés depuis longtemps, ou qui peuvent faire prévoir les événements à venir. Cette nécessité de s’en rapporter, dans une foule de circonstances, au jugement des vieillards, leur donne sans doute une grande influence : de là vient qu’un fils qui méprise l’opinion de son père, a du respect pour l’opinion de son grand-père [446].
Mais ce respect ou cette déférence qu’on a pour l’opinion des anciens, est sans influence sur leur propre destinée ; c’est un hommage que les plus jeunes rendent à leur sûreté personnelle et au besoin de leur conservation, et non un sentiment de reconnaissance. Les enfants, quand ils ont acquis assez de force pour pourvoir à leurs besoins, traitent leurs pères sans ménagement, et les battent même quelquefois. Ils traitent les autres vieillards d’une manière grossière : ils sont sans égard pour eux dans toutes les occasions où ils croient n’avoir pas besoin de leur expérience [447].
[II-313]
CHAPITRE XVI.↩
Des relations qui existent entre les diverses peuplades d’espèce cuivrée, du nord de l’Amérique. — Des causes des guerres quelles se font. — De l’esprit qu’elles y portent.
S’il existe si peu d’harmonie et si peu de bienveillance, dans les relations d’individu à individu, il en existe bien moins encore dans les relations qui ont lieu de horde à horde. Chez les peuplades qui vivent principalement au moyen de la chasse ou de la pêche, la propriété privée est peu de chose : elle se réduit en quelque sorte aux armes et aux instruments que chacun possède. Mais la propriété publique ou commune, celle qui fournit des aliments à la population entière, est très étendue. Elle comprend tout le territoire dans l’étendue duquel on se livre à la chasse, elle comprend de plus, les rivières, les fleuves, les lacs, les golfes qui fournissent du poisson pour l’existence de chaque jour. Les limites du territoire ou des possessions d’une horde de sauvages, ne sont guère moins précises que celles du territoire d’une nation civilisée, et elles ne sont pas gardées avec moins de jalousie [448]. Une peuplade qui pénètre dans le territoire d’une autre pour y chercher des moyens d’existence, s’expose infailliblement à la guerre, si elle est surprise ; et cette guerre se fait avec d’autant plus de fureur, que des deux côtés ce sont des hommes affamés qui combattent pour leur subsistance. Cependant il est difficile que des individus dans la disette ou la famine, qui voient passer sur un territoire qui n’est point à eux la proie qu’ils ont longtemps poursuivie, s’arrêtent tout à coup, par respect pour la propriété d’autrui. C’est un effort de courage ou de vertu dont sont rarement capables même des hommes qui sont moins barbares et surtout moins affamés.
L’usage dans lequel sont ces peuples de considérer l’offense faite à un individu comme une offense faite à la horde entière, et celui de se venger d’une injure qu’on a reçue, sur tout individu qui appartient à la famille ou à la peuplade de l’offenseur, sont des sources de guerre non moins fécondes. Il dépend ainsi de chacun de mettre sa nation en guerre avec telle autre qu’il lui plaît de provoquer ; et les antipathies individuelles se changent toujours en antipathies nationales [449]. Aussi, toutes les peuplades qui habitent au nord et au nord-ouest de l’Amérique sont-elles dans un état d’hostilité continuel les unes contre les autres ; moins elles sont civilisées, et plus la guerre qu’elles se font est cruelle et destructive [450]. Dans leurs victoires elles ne font grâce, ni à l’âge, ni au sexe : les vieillards, les femmes, les enfants, tout est massacré. S’il leur arrive de faire des prisonniers, c’est pour les réserver à une mort plus lente et plus douloureuse [451]. La distance à laquelle on se trouve d’un ennemi, les difficultés qu’il a à franchir, les dangers auxquels il doit s’exposer, ne sont pas des garanties contre ses attaques. Une troupe de sauvages parcourt, à travers les forêts, un espace de cinq cents lieues ; elle franchit les montagnes, s’avance à travers les glaces et les neiges, s’expose à périr de famine, pour aller surprendre et massacrer une tribu de laquelle elle croit avoir reçu quelque injure [452]. L’esprit de vengeance qui les anime ne s’apaise que par la destruction complète de la nation qu’ils considèrent comme ennemie. C’est à la violence de cette passion, qu’il faut surtout attribuer l’extinction d’une multitude de peuplades qui existaient il n’y a pas encore deux siècles dans le nord de l’Amérique, et dont on ne trouve aujourd’hui plus de restes [453].
L’esprit dans lequel ces peuples se font la guerre se manifeste par l’éducation qu’ils donnent à leurs enfants, et par la manière dont ils se préparent à leurs expéditions. Des enfants qui se livrent à des actes de violence, ne sont jamais réprimés même quand les auteurs de leurs jours en sont les victimes ; car on craindrait de diminuer leur courage [454]. On les habitue dès leur bas âge à sucer le sang des prisonniers. « Je veux, disait à un missionnaire une mère qui élevait ainsi son fils, je veux que mes enfants soient guerriers ; il faut qu’ils soient nourris de la chair de leurs ennemis [455]. » Aussitôt que les enfants sont arrivés à l’âge de l’adolescence, on les exerce à tourmenter eux-mêmes les captifs faits à la guerre, et à prolonger leur supplice [456].
Lorsqu’un guerrier a résolu d’entreprendre une expédition militaire, il va de village en village inviter les jeunes gens au festin ; ceux-ci se rendent dans sa cabane, en chantant : Je vais à la guerre, je vais venger la mort de mon parent ; je tuerai, je brûlerai, j’amènerai des esclaves, je mangerai des hommes. La proclamation de guerre de quelques-unes de ces peuplades est courte, mais énergique : Marchons, et mangeons ce peuple [457].
Ne faisant jamais leurs attaques que par surprises et souvent au milieu de la nuit, ces hordes vivent toutes dans des alarmes continuelles. Aussi, lorsque l’exposition des lieux les favorise, elles placent leurs villages sur des montagnes escarpées, sur des rochers presque inaccessibles qu’elles fortifient avec soin. Si elles ne peuvent pas profiter de la position des lieux, elles s’environnent de fortifications artificielles ; elles placent leurs cabanes à de grandes distances les unes des autres, comme si chaque famille redoutait le voisinage de toutes celles dont la peuplade se compose. Mais ces précautions ne suffisent pas pour les mettre à l’abri ; et il n’est pas rare pour les voyageurs de rencontrer des villages détruits et déserts dans des lieux qui paraissaient inaccessibles aux attaques de l’ennemi. La fureur de détruire, qui a rendu célèbres des Romains trop vantés, est une passion qui n’est ni moins énergique, ni moins irrésistible chez une peuplade de sauvages qu’elle ne le fut chez les sénateurs de Rome [458].
[II-318]
Cependant, quelle que soit la violence avec laquelle ces peuples se font la guerre, le besoin d’y mettre un terme, l’emporte souvent sur la haine qui les anime. Ils s’envoient alors des ambassadeurs, et les individus qui sont chargés de cette mission, ne sont pas moins respectés par l’ennemi, que ne le sont chez les peuples les plus civilisés tous les hommes placés en pareille circonstance. Les agents chargés de négocier la paix, portent, dans leurs relations, la même circonspection et la même finesse qu’on observe chez les diplomates européens. Peut-être même sont-ils plus habiles à persuader, par la raison que la faveur et l’intrigue ont moins d’influence dans leur élection. Les traités de paix deviennent des lois qui dirigent la conduite des parties contractantes, jusqu’à ce que quelque événement imprévu les oblige à les transgresser et à recommencer les hostilités.
[II-319]
CHAPITRE XVII.↩
Des vices et des maladies qui résultent chez les peuples d’espèce cuivrée, du nord de l’Amérique, de leurs relations sociales, de leur défaut de développement intellectuel, et des circonstances physiques au milieu desquelles ils sont placés.
Les relations qui existent chez ces peuples, soit d’individu à individu, soit de horde à horde, déterminent en grande partie leurs mœurs privées. Ne jouissant d’aucun genre de sécurité, pour le peu de biens qu’ils possèdent, ou même pour leur vie, leur existence tout entière se concentre toujours dans le moment présent. Ainsi, quoiqu’ils aient souvent éprouvé des disettes, ils ne cherchent jamais à les prévenir. Quelle que soit l’abondance dans laquelle ils se trouvent, ils ne se couchent jamais sans avoir tout consommé, si cela leur est possible [459]. S’ils sont obligés de laisser quelque chose, ils se lèvent dans la nuit pour manger, à moins qu’ils aient placé leurs aliments à leur portée, car alors ils mangent couchés [460]. Lorsque leur estomac, ne pouvant plus contenir d’aliments, en rejette une partie, ils se mettent à boire et à manger encore [461]. Ceux qui ont la passion des liqueurs fortes, et qui peuvent s’en procurer, en usent pour la boisson comme pour les autres aliments ; de là les désordres dont j’ai précédemment parlé [462].
La même cause qui les détermine à consommer autant d’aliments qu’ils en possèdent, les empêche de se donner la moindre peine pour s’en procurer de nouveaux, quand ils ne sont pas pressés par le besoin actuel. Si, après avoir pris une certaine quantité de poisson, ils ont tendu de nouveau leurs filets, ils ne vont les visiter que lorsque toutes leurs provisions ont été consommées ; ils laissent ainsi pourrir le poisson dont ils auraient pu faire provision [463]. Dans leurs excursions, ils détruisent, sans utilité, tout ce qui se rencontre sur leur passage et qui pourrait être utile à d’autres hommes ; s’ils aperçoivent un nid d’oiseau, quelque petit qu’il soit, ils en brisent les œufs ou en écrasent les petits, incertains s’ils passeront jamais dans le même lieu, ou s’ils manqueront d’aliments [464]. Cette insouciance pour l’avenir suffit pour expliquer comment, avec un caractère dur et égoïste, ils peuvent cependant se montrer libéraux ou hospitaliers lorsqu’ils se trouvent dans l’abondance [465].
Lorsque la faim les presse ou qu’une passion violente les agite, ces hommes sont actifs et énergiques ; mais, quand ils sont rassasiés et qu’ils n’ont aucune vengeance à satisfaire, ils s’abandonnent à la paresse : aucun d’eux ne voudrait se donner une peine dont il n’aurait pas la certitude de recueillir les fruits. Ceux qui habitent les climats les plus rigoureux, sont aussi nonchalants et aussi paresseux que ceux qui vivent sous la zone torride [466]. Les Chypiouyans dont le pays est couvert de neige pendant neuf mois, préfèrent le sommeil à toute espèce de jeux et d’exercices [467]. Les habitants du haut Canada ont le même penchant pour la paresse ; et les travaux qui leur inspirent le plus d’antipathie, sont ceux qui supposent le plus de prévoyance et de sécurité, comme l’agriculture : à leurs yeux, de tels travaux sont indignes d’un guerrier [468]. Les peuples les plus élevés dans le nord-ouest, et ceux qui habitent la Californie, ont pour le travail une aversion semblable. Les premiers, oisifs pendant la plus grande partie du jour, ne satisfont au besoin d’activité qui semble inhérent à la nature de l’homme, qu’en passant au jeu presque tout leur temps [469]. Les seconds passent des journées entières couchés sur le ventre, étendus dans le sable, lorsqu’il est échauffé par la réverbération des rayons solaires [470].
Des hommes qui ont en aversion toute occupation qui n’est pas rigoureusement nécessaire pour vivre, ne peuvent se donner les soins qu’exige la propreté. Aussi n’en est-il point de plus sales que ceux qui habitent les contrées les plus froides de l’Amérique : la même saleté se rencontre dans leurs vêtements, dans leurs aliments et dans leurs cabanes. Ces peuples se couvrent, en général, ou de peaux grossièrement tannées, ou de grosses toiles qu’ils se sont procurées par des échanges ; mais, quelle que soit la nature de leurs vêtements, ils ne les lavent jamais, et ne les quittent que lorsqu’ils s’en vont en lambeaux et tombent de pourriture. Habitués à se peindre de diverses couleurs, à se barbouiller les cheveux, la figure, et souvent toutes les parties du corps, de graisse ou d’huile de poisson, et la rigueur du climat sous lequel ils vivent ne leur permettant pas de se plonger dans l’eau, leur extérieur est sale et dégoûtant ; la puanteur qu’ils exhalent est si repoussante, qu’elle ne permet pas d’approcher d’eux de plusieurs pas [471]. Les enfants, enveloppés dans de la mousse, sont si peu soignés, sous le rapport de la propreté, qu’ils portent sur leur corps, le reste de leur vie, les cicatrices des scoriations qui ont été produites par la saleté [472].
Ils ne mettent pas plus de soins dans la préparation de leurs aliments que dans l’entretien de leurs vêtements : on a vu précédemment qu’ils mangent les objets les plus dégoûtants, comme la vermine qui les couvre ou qui s’attache à la peau des animaux, les peaux dont ils ont fait leurs chaussures ou leurs vêtements ; jamais ils ne nettoient les vases dans lesquels ils préparent leurs aliments, et de quelque nature que soient les ordures qui s’y mêlent, elles ne leur inspirent aucune répugnance ; un homme qui croirait se déshonorer s’il buvait dans la coupe où a bu sa femme, mange sans difficulté dans le vase le plus sale qui a servi au repas de son chien [473].
Mais c’est surtout dans l’intérieur de leurs cabanes que se montre la plus dégoûtante et la plus hideuse saleté. Ils y vident leurs poissons, dont les entrailles se mêlent aux os et aux fragments qui sont la suite des repas, et à d’autres ordures ; et ils ne les enlèvent que lorsque la quantité en est devenue si considérable qu’elles empêchent de marcher. S’ils ont des besoins à satisfaire, ils ne s’écartent jamais de deux pas, et ne cherchent ni l’ombre ni le mystère. Enfin, leurs habitations sont d’une telle malpropreté et d’une telle puanteur qu’on ne peut les comparer à la tanière d’aucun animal connu [474].
Au sein de leur oisiveté, ces peuples sont agités par une passion violente, celle des jeux de hasard : ils s’y livrent avec une fureur dont on trouverait peu d’exemples chez les peuples civilisés. Ils jouent quelquefois plusieurs jours et plusieurs nuits de suite, et ni la crainte de perdre ce qu’ils possèdent, ni les sollicitations de leurs femmes, ne peuvent les arracher à leur partie. Lorsqu’ils ont perdu tout ce qu’ils possèdent, ils offrent souvent de se jouer eux-mêmes. Cet amour du jeu est chez eux une des principales sources de leurs querelles et de leurs violences : lorsqu’ils s’y livrent, ils deviennent bruyants, rapaces, colères et presque frénétiques [475].
Chez les peuples civilisés, la vie de chacun est, en général, uniforme et régulière : on consomme tous les jours à peu près la même quantité d’aliments ; on se livre aux mêmes exercices ou aux mêmes travaux. En variant ses vêtements, ou par d’autres moyens, la température dans laquelle on est placé change aussi peu que possible : on se garantit de l’humidité, comme d’un excès de sécheresse. Enfin, on jouit à peu près toujours de la sécurité. Mais cette uniformité, si favorable au développement et à la conservation des forces humaines, n’existe point pour les indigènes non civilisés de l’Amérique, ni pour aucun autre peuple barbare. Chez de tels peuples tous les membres dont chaque horde se compose, passent rapidement d’un extrême à l’autre : ils passent alternativement de la disette à l’abondance et aux indigestions ; d’un excès de fatigue à une oisiveté absolue ; d’un excès de chaleur à un excès de froid ; d’une exaltation excessive à un complet abattement. Ces alternatives, jointes aux mauvais aliments dont souvent ils se nourrissent, au mauvais air qu’ils respirent dans leurs cabanes, à l’humidité dans laquelle ils vivent dans les temps des pluies, aux excès auxquels les femmes se livrent dès leur enfance, et aux alarmes continuelles que leur inspirent leurs ennemis, altèrent leur constitution, et leur causent un grand nombre de maladies.
Les enfants sont exposés à une multitude de maux inconnus chez les peuples civilisés. Le régime auquel ils sont soumis aussi longtemps qu’ils ne peuvent pas courir ; les écorces dans lesquelles ils sont longtemps attachés sans pouvoir remuer, et le fumier dans lequel ils croupissent, leur causent d’excessives douleurs, et sont pour eux une espèce de torture dont ils ne sont délivrés que vers leur troisième ou quatrième année ; leurs souffrances se manifestent par leur faiblesse, leur maigreur, et des hernies ; il n’y a que ceux qui apportent en venant au monde la constitution la plus vigoureuse qui puissent y résister [476].
[II-327]
Chez les peuplades qui habitent sous les climats les plus rigoureux, la plupart des hommes, des femmes et des enfants sont couverts de gales, de dartres, de boutons purulents, ou atteints d’affections scorbutiques ; ces maladies arrivent au plus haut degré d’intensité [477] ; un grand nombre ont l’estomac dégradé par de longues abstinences ou de fréquentes indigestions [478] ; les passages brusques d’une température à l’autre leur donnent des maladies de poitrine presque toujours mortelles, ou des rhumatismes qui les rendent perclus [479] ; l’éclat de la neige, la fumée qui les enveloppe dans leurs cabanes, ou d’autres causes, leur gâtent la vue, et rendent parmi eux les ophtalmies communes [480] ; ils sont sujets, en un mot, à la plupart des maladies qu’on observe chez les peuples civilisés ; mais, comme les malades ne sont point soignés, comme ils n’observent aucun régime, ni n’emploient aucun remède, il est rare qu’ils s’en relèvent [481].
Mais ce sont surtout les maladies épidémiques qui font chez ces peuples de grands ravages. Ne sachant ni s’en garantir, ni les traiter, il est rare qu’ils n’en soient pas tous atteints, et qu’elles n’enlèvent pas la plus grande partie de la population. Quelquefois des peuplades disparaissent ; et l’on ne trouve plus d’autres traces de leur existence que les ossements répandus dans les lieux qu’occupaient leurs villages [482]. Le tableau qu’a tracé Mackenzie d’une peuplade atteinte par la petite vérole, peut donner une idée des maux qu’éprouvent ces peuples quand une épidémie se répand parmi eux.
« La petite vérole, dit-il, étendit ses ravages parmi eux avec autant de rapidité que la flamme consume l’herbe sèche des campagnes. Ils ne pouvaient ni fuir ses atteintes, ni résister aux cruels effets de son poison : elle fit périr des familles et des tribus entières. Quel horrible spectacle pour ceux qui étaient alors dans ce pays ! Il n’offrait de toutes parts que des infortunés prêts à expirer à côté des cadavres de leurs parents et de leurs amis, et des hommes désespérés, qui, pour ne pas devenir la proie de la contagion, prenaient l’affreux parti de se donner eux-mêmes la mort.
« La malheureuse habitude qu’ont ces peuples imprévoyants de ne jamais songer aux besoins du lendemain accrut beaucoup les maux que leur fit souffrir la petite vérole. Ils étaient dépourvus non seulement des remèdes contre ce mal, mais de toute autre espèce de soulagement, et ils n’avaient à opposer à la disette que la fureur et un vain désespoir. Pour achever cet horrible tableau, j’ajouterai qu’une partie des cadavres était traînée hors des cabanes par les loups, que cette proie semblait rendre encore plus féroces, tandis que le reste était dévoré dans les cabanes mêmes par les chiens affamés.
« On voyait souvent le père d’une famille que la contagion épargnait encore, appeler ses enfants autour de lui pour leur faire contempler leurs parents ou leurs amis dont il attribuait l’état affreux à quelque mauvais esprit qui voulait exterminer leur race. Alors il les exhortait à braver les horreurs de la mort, et à employer les secours de leur poignard pour terminer leur propre existence. S’ils n’avaient pas le courage de suivre un si triste conseil, il les égorgeait lui-même, en croyant leur donner une dernière marque d’affection ; et, tournant ensuite son glaive contre sa poitrine, il s’empressait de s’ôter la vie pour aller les rejoindre dans le séjour où l’on est à l’abri des maux qui affligent l’humanité [483]. »
Les souffrances inséparables de l’état de barbarie dans lequel vivent ces peuples, les rendent sérieux et graves. Plusieurs ne connaissent ni le chant, ni la danse ; ceux qui possèdent un certain genre de musique, n’ont qu’un chant lugubre et mélancolique. S’ils entrent dans une cabane, ils ne saluent ni ne regardent personne : ils s’accroupissent à la première place qui se présente, allument leur pipe et fument sans dire un seul mot ; si on les interroge, leur réponse est concise et presque monosyllabique [484]. Les questions qu’ils se font, quand ils se rencontrent après quelques jours d’absence, ont pour objet de connaître les malheurs qui leur sont arrivés ; les amis ou les parents qu’ils ont perdus, les disettes ou les famines qu’ils ont éprouvées [485]. La mort est en elle-même un accident si peu à craindre, qu’ils la considèrent souvent comme un événement heureux : ils n’y voient que la fin de leurs misères ; aussi n’est-il pas rare qu’ils se la donnent eux-mêmes [486].
[II-331]
Les tourments horribles qu’ils font souffrir à leurs prisonniers n’ont pour cause que l’opinion où ils sont que la mort qui n’est pas accompagnée de douleurs, est un bien plutôt qu’un mal.
« Lorsque les Européens, dit Lahontan, s’ingèrent de reprocher à ces sauvages leur férocité, ils vous répondent froidement que la vie n’est rien ; qu’on ne se venge pas de ses ennemis en les égorgeant, mais en leur faisant souffrir des tourments longs, âpres et aigus ; et que, s’il n’y avait que la mort à craindre dans les guerres, les femmes les feraient aussi librement que les hommes [487]. »
L’état de souffrance est pour eux si habituel, et leur imagination est tellement familiarisée avec les douleurs les plus atroces, qu’ils supportent, sans se plaindre ou même en excitant leurs bourreaux, les tortures les plus longues et les plus horribles que leurs ennemis puissent inventer [488].
Sous les climats âpres du Canada, les sauvages sont poursuivis, dans les temps de disette, par l’image des calamités, jusque dans leur sommeil.
« Ils rêvent, dit Raynal, qu’ils sont entourés d’ennemis ; ils voient leur bourgade surprise nager dans le sang ; ils reçoivent des outrages, des blessures ; on leur enlève leurs femmes, leurs enfants, leurs amis. À leur réveil, ils prennent ces visions pour un avis des dieux ; et la crainte que met cette opinion dans leur âme, ajoute à leur férocité par la mélancolie dont elle teint toutes leurs idées et leurs sombres regards [489]. »
Cependant, quelque misérable que soit l’état de ces peuples, quelque profond que soit leur abaissement dans l’échelle de la civilisation, ils ont un orgueil farouche, indomptable. Ils se croient une race supérieure, et s’imaginent faire beaucoup d’honneur à un Européen que de traiter d’égal à égal avec lui. Les Iroquois, dit Hennepin, s’appellent les hommes par excellence, comme si toutes les autres nations n’étaient que des bêtes à leur égard. Les Cherokees sont si remplis de l’idée de leur supériorité, qu’ils appellent les Européens des Riens, ou la race maudite, et qu’ils se disent eux-mêmes le peuple bien-aimé [490]. Les Esquimaux, comme les Iroquois, paraissent se considérer presque exclusivement comme des hommes ; ils ne désignent les Européens que par la qualification méprisante de barbares [[491] .
L’orgueil, la vengeance et la perfidie, et les craintes qu’ils s’inspirent mutuellement leur donnent une qualité qu’on serait peu disposé à rechercher parmi de pareils peuples : c’est la politesse. Jamais ils ne contredisent une personne qui leur parle ; quelque absurde que leur paraisse le discours qu’on leur tient, ils répondent, voilà qui est bien, tu as raison, mon frère ; mais aussi ils exigent des autres les mêmes déférences qu’ils leur accordent. Ils sont, suivant Volney, aussi réservés et aussi polis que les membres d’un corps diplomatique : un manque d’égards, une violation de l’étiquette, pourraient avoir chez eux des conséquences non moins terribles que chez les peuples les plus attachés au point d’honneur [492].
Les nombreuses peuplades qui sont répandues sur le vaste continent de l’Amérique, ont entre elles tant de ressemblance, qu’au premier coup d’œil elles paraissent presque toutes appartenir à la même famille. Cette ressemblance existe non seulement dans la couleur et dans la plupart des traits de leur caractère physique ; elle se remarque aussi dans leurs mœurs : on trouve partout à peu près les mêmes qualités et les mêmes vices. Les principales différences morales qui existent entre eux, se trouvent, non dans la nature de leurs passions, mais dans la force plus ou moins grande avec laquelle ces passions se manifestent. Ce sont, au reste, les mêmes différences qu’on observe entre la horde la plus barbare et la nation la plus civilisée ; de part et d’autre on trouve de l’orgueil, de la fausseté, de la dureté, de la vengeance, de la paresse, de l’imprévoyance, la passion du jeu ; de part et d’autre on trouve de l’amitié, du courage, de l’amour pour ses enfants, du patriotisme ; mais de part et d’autre toutes ces passions n’ont pas la même énergie : dans l’état de barbarie ce sont les passions malfaisantes ou antisociales qui affectent la plus grande partie de la population et qui sont les plus énergiques. Dans l’état de civilisation, au contraire, ces passions sont les plus faibles et n’affectent que le petit nombre, tandis que ce sont les affections sociales qui dominent [493].
[II-336]
CHAPITRE XVIII.↩
De l’état social et des mœurs des peuples d’espèce cuivrée, placés entre les tropiques. — Parallèle entre ces peuples et ceux de même espèce placés sous les climats froids du nord.
On a vu précédemment comment les moyens à l’aide desquels les peuples cuivrés du nord de l’Amérique pourvoient à leur subsistance, influent sur leurs relations sociales, et sur leurs mœurs privées. On a pu remarquer que, moins leurs moyens d’existence sont assurés, et plus les passions malfaisantes ou antisociales sont énergiques. Il s’agit d’exposer maintenant l’état et les mœurs des peuples de même espèce placés au centre de ce continent, et de voir quels sont les points de ressemblance ou de dissemblance qui ont existé entre eux. Afin de rendre la comparaison plus facile, je suivrai dans ce chapitre le même ordre que j’ai suivi dans les chapitres précédents.
Les nations cuivrées placées au centre du continent américain, entre les tropiques, tiraient de l’agriculture leurs principaux moyens d’existence, longtemps avant que les Européens les eussent asservies. Il était rare de rencontrer parmi elles des peuplades vivant principalement des produits de la chasse. Non seulement la terre était cultivée, mais chacun avait la propriété exclusive du sol qu’il cultivait, et des produits qu’il en retirait. Même dans le Paraguay, où les jésuites espagnols ont introduit la communauté des biens, chaque individu avait la propriété exclusive de la terre qu’il avait mise en valeur. La culture commune, qui les a fait rétrograder au point où en étaient quelques peuplades du nord, était si contraire à leurs idées, qu’elle a toujours été pour eux la partie la plus insupportable de l’administration de leurs conquérants [494].
Mais en même temps que nous trouvons des peuples vivant au moyen des produits de leur agriculture, nous trouvons aussi que ces peuples sont composés de deux races d’hommes, ou que dans chaque état la population est divisée en deux castes : l’une qui cultive le sol et vit dans l’oppression ; l’autre qui vit sur ce que la première produit ou fait produire à la terre. Nous trouvons ici un régime social à peu près semblable à celui que nous verrons dans la plupart des îles du grand Océan, dans le centre de l’Afrique, et qui a longtemps existé dans la plupart des États de l’Europe.
Chez les Natchez, tribu jadis puissante qui vivait sur les bords du Mississipi, mais qui est aujourd’hui éteinte, la population était divisée en deux classes. La première jouissait de prérogatives héréditaires ; la seconde était considérée comme vile, et formée seulement pour la servitude. Cette distinction était marquée par des dénominations qui désignaient le rang élevé des uns, et la profonde dégradation des autres : ceux-là se désignaient sous le nom de respectables , et ils désignaient ceux-ci sous le nom de puants. Le chef, dont le pouvoir était de même nature que celui des nobles, et par conséquent héréditaire, était considéré comme ayant une origine divine : il était le frère du soleil que ces peuples adoraient ; ses ordres avaient la même force que s’ils avaient été donnés par la divinité [495].
Dans le Mexique, il existait un ordre à peu près semblable ; la population était divisée d’abord en deux grandes fractions. Celle qui comprenait la partie la plus considérable, et qui exécutait tous les travaux au moyen desquels les hommes existent, était vile et esclave. Celle qui vivait sur les travaux de la première, se disait respectable ; elle était noble. Les cultivateurs, désignés sous le nom de mayeques , étaient dans un état à peu près semblable à celui où se trouvaient les paysans en Europe, au temps où le régime féodal était dans toute sa force. Ils étaient considérés comme des instruments de culture, et ne pouvaient quitter le sol auquel ils étaient attachés, sans la permission de leur maître. Ils passaient d’un propriétaire à l’autre, avec le sol, dans les cas où il était aliéné. Ils étaient tenus de cultiver la terre, et d’exécuter d’autres travaux jugés vils. Plusieurs étaient réduits en état de servitude domestique ; ils étaient, comme les esclaves des Romains, mis au rang des choses. Leurs maîtres pouvaient disposer d’eux de la manière la plus absolue, ou même les tuer, sans encourir aucune peine [496].
La classe des hommes forts, à laquelle nous donnons le nom de supérieure, était elle-même divisée en diverses fractions. Un petit nombre d’entre eux possédaient de vastes territoires, partagés en plusieurs classes, à chacune desquelles divers titres d’honneur étaient attachés ; quelques-uns transmettaient ces titres à leurs descendants à l’infini, avec les terres dont ils faisaient partie. D’autres ne tenaient des terres qu’à cause des fonctions qu’ils remplissaient ; ces terres constituaient leur salaire, et cessaient de leur appartenir quand les fonctions dont elles étaient la récompense leur étaient enlevées. Enfin, plusieurs, sans remplir aucune fonction et sans être esclaves, possédaient des terres dont ils avaient la propriété exclusive, et qu’ils transmettaient à leurs enfants. On avait réservé, dans chaque district, une certaine étendue de terres qui était cultivée en commun par la basse classe du peuple, et qui servait à son existence. Il y avait, au-dessus de la population entière, un chef unique ; ce chef ne tenait pas son pouvoir de ses ancêtres : il était élu par les principaux membres de l’État. Le nombre des grands de la première classe s’élevait à trente ; chacun d’eux avait au-dessous de lui environ trois mille nobles, qui lui étaient subordonnés ; et le nombre total des individus que chacun des principaux chefs avait dans son territoire, était d’environ cent mille [497].
Dans le Pérou, la population était aussi divisée en plusieurs classes. La première se composait de ceux qui remplissaient tous les emplois, soit en temps de paix, soit en temps de guerre : c’étaient les nobles. La seconde se composait d’hommes qui ne remplissaient aucun emploi, mais qui n’étaient assujettis à aucun genre de servitude. La troisième était formée d’individus employés aux travaux jugés les plus vils de la société : ils portaient les fardeaux, ou se livraient à d’autres occupations qui sont le partage des esclaves dans les pays où la servitude est établie. La population était soumise à un chef unique dont la personne était sacrée : c’était un messager des dieux, un enfant du soleil : pour maintenir la pureté de cette divine race, les frères épousaient leurs sœurs [498]. Les terres n’étaient pas possédées par les grands comme dans le Mexique. Une part était consacrée au soleil et destinée au culte ; le produit en était employé à la construction et au maintien des temples, à la célébration des cérémonies de la religion, et, dans les temps de disette, à la subsistance du peuple. Une seconde part appartenait à l’Inca, et était employée à payer les dépenses du gouvernement. La troisième et la plus considérable était destinée à la subsistance du peuple. La culture, dans chaque canton, se faisait en commun, les produits en étaient ensuite distribués à chacun en raison de ses besoins [499].
Nous ne pouvons savoir d’une manière positive de quelle manière se formèrent, au centre de l’Amérique, les diverses classes que les Espagnols y trouvèrent ; mais, en considérant les traditions qui existaient encore dans ce pays à l’arrivée de ces conquérants, la manière dont la population était divisée, et les idées qui régnaient parmi elle, il n’est pas difficile de voir que là aussi un peuple agricole, industrieux et pacifique, avait été asservi et partagé par une armée de barbares. À l’époque où les Espagnols firent la conquête du Mexique, les grands ou nobles de ce pays étaient convaincus qu’ils n’en étaient pas originaires : ils savaient que vers le dixième siècle de notre ère, les premiers occupants avaient été asservis par d’autres tribus, et que vers le treizième, environ deux siècles avant la découverte de l’Amérique, le Mexique avait été conquis par une tribu puissante, venue des bords du golfe de Californie. Il paraît donc qu’à une époque peu reculée, une confédération semblable à celle des nations iroquoises, s’empara du pays ; que le général conserva le pouvoir que lui donnait sa position ; que les trente grands n’étaient que les chefs des hordes qui avaient élu leur général ; que les trois mille nobles étaient les soldats de chaque horde, et enfin que les cultivateurs étaient la population asservie.
Nous ne pouvons déterminer quelles étaient les mœurs de ces peuples à l’arrivée des Espagnols, avec la même précision que nous avons déterminé celles des peuplades qui habitent le nord. Il y avait déjà deux siècles qu’ils avaient été asservis et en grande partie détruits par les Européens, lorsque les philosophes ont commencé à s’occuper de l’observation de leurs mœurs. Nous ne pouvons donc connaître qu’un petit nombre de faits relativement à eux ; mais le peu que nous apprennent les premiers écrivains espagnols, est suffisant pour nous faire juger des faits qu’eux-mêmes ne surent pas observer.
On a vu combien est étendue, sur les mœurs des indigènes du nord de l’Amérique, l’influence de leurs moyens d’existence ; combien l’état de chasseur endurcit le caractère des individus qui s’y livrent, et rend misérable le sort des femmes, des enfants, des vieillards, des malades, qui sont obligés de suivre les hommes les plus robustes dans les forêts et au milieu des neiges, ou de rester exposés à la famine et aux attaques de leurs ennemis. Aucun de ces maux ni des vices qui en sont la suite, ne pouvait atteindre les peuples du centre de l’Amérique, puisqu’ils étaient tous agriculteurs : les plus avancés dans l’agriculture étaient en général ceux qui étaient les plus rapprochés de l’équateur ; les Natchez ne tiraient presque plus rien de la chasse, et les habitants de Bogota y avaient complètement renoncé [500].
Dans le Pérou, l’agriculture et les arts de première nécessité étaient plus avancés que dans aucune autre partie de l’Amérique. La quantité de terre qui devait être mise en culture, était proportionnée aux besoins des habitants ; on avait même prévu, autant que possible, les effets d’une mauvaise récolte ; les produits mis en réserve pour les frais du culte ou pour l’entretien du gouvernement, étaient distribués au peuple dans les temps de disette. Non seulement tous les terrains naturellement fertiles avaient été mis en culture ; mais, au moyen d’aqueducs et d’irrigations artificielles, on avait fertilisé des terrains improductifs : sous les mains de ces peuples actifs et industrieux, des sables stériles s’étaient transformés en campagnes florissantes. Les Espagnols, au temps de la conquête, trouvèrent le pays si bien pourvu de provisions de tout genre, que, dans leurs relations, on trouve peu de ces tristes scènes de détresse occasionnées par la famine, si fréquentes dans l’histoire des conquérants du Mexique [501].
Les rapports de subordination que nous avons observés chez les peuplades du nord, entre les chefs et les autres membres de la tribu, ne sont bien marqués que dans les occasions où le concours de tous est requis pour obtenir un résultat qui les intéresse également. Dans les autres circonstances, il n’existe d’autre supériorité que celle de la force, et chaque individu est en quelque sorte sous l’empire de tout homme plus puissant que lui [502]. Chez les peuples placés sous les tropiques, nous trouvons aussi qu’une partie de la population était soumise à l’empire de la force ; cet empire se manifestait par les qualifications données aux uns et aux autres, par la différence de leurs habitations, de leurs vêtements, de leurs occupations. Mais, comme tous n’étaient pas soumis au même régime, il est nécessaire de les considérer séparément.
Si, comme cela paraît indubitable, les peuples agriculteurs des tropiques ont été asservis par leurs voisins moins civilisés du nord, il ne faut pas douter que ceux-ci n’aient conservé, après la conquête, le mépris qu’ont les conquérants pour le travail, et surtout pour celui de la terre ; il ne faut pas douter qu’ils n’aient fait de l’industrie la marque de la servitude, et de l’oisiveté l’apanage de la noblesse ; la guerre, et le pillage des vaincus, leur auront paru les seules occupations dignes d’eux : nous avons vu que telles sont encore les idées des sauvages du nord. Il existe cependant une différence remarquable entre les peuplades de la partie la plus élevée de l’Amérique septentrionale, et celles qui ont envahi le Mexique et les contrées qui en sont les plus voisines. Quand les premiers surprennent une horde ennemie, ils en massacrent tous les individus ; ils sont sans intérêt à les conserver, car ils ne sauraient qu’en faire. Les seconds n’ont pas exterminé le peuple conquis, ils sont entrés en partage avec lui des produits de ses travaux : les parts ont été sans doute fort inégales ; mais celle qui est restée aux vaincus, a été cependant plus considérable et surtout plus assurée que celle qui tombe en partage aux hommes les plus forts qui vivent de chasse ou de pêche. La partie la plus misérable de la population des tropiques, avant la conquête des Espagnols, était condamnée à moins de fatigues, à moins de privations, et même à moins de violences que les populations barbares du nord. Les serfs des Natchez et des Mexicains, par lesquels les travaux de l’agriculture étaient exécutés, étaient moins dégradés et moins accablés de travail, ils avaient moins à souffrir que les femmes, que les vieillards, que les enfants chez les peuples chasseurs. Quant à la classe des dominateurs, il est évident que leur sort était infiniment au-dessus de celui des individus les moins misérables qui se trouvent parmi des hordes de chasseurs.
Il est même remarquable que plus on approche de l’équateur, et plus les rapports entre les diverses classes de la population s’adoucissent. Chez les Natchez et chez les Mexicains, les travaux de l’agriculture et ceux qui s’y livraient, étaient encore avilis aux yeux des conquérants. Mais il n’en était plus de même au Pérou ; ici la classe gouvernante, loin de considérer les occupations de l’agriculture comme avilissantes, cherchait au contraire à les rendre honorables. Les chefs de l’État, quoiqu’ils s’attribuassent une origine divine, donnaient eux-mêmes l’exemple du travail : les enfants du soleil cultivaient de leurs propres mains un champ près de Cusco, et ils appelaient cela leur triomphe sur la terre [503]. Loin de ravir à la population ses moyens d’existence, ils lui distribuaient, au contraire, dans les temps de disette, une partie des produits destinés à l’entretien du culte et du gouvernement. L’autorité des chefs était exercée d’une manière si douce que les rébellions étaient inconnues ; et que sur une succession de douze princes, on n’en comptait aucun qui eût été un tyran, exemple si rare dans l’histoire, qu’il est à peine croyable [504].
Si la conquête de ces contrées par les incas et les caciques, n’avait été que le triomphe de la force, ce triomphe du moins n’avait pas été permanent, et n’était pas devenu général. Au temps de la conquête des Espagnols, la propriété territoriale était fixée presque chez toutes les nations placées entre les tropiques. Il était chez les Mexicains des magistrats chargés de veiller au respect des propriétés et à la sûreté des personnes ; et, si l’on peut s’en rapporter au jugement des écrivains espagnols, les lois étaient aussi sages et la justice aussi bien administrée que chez les peuples les plus civilisés. Sous le rapport de la justice et de quelques autres parties du gouvernement, les Mexicains et les Péruviens étaient plus avancés que ne l’étaient alors les peuples qui avaient fait le plus de progrès en Europe [505].
La force ne décidait donc plus chez eux, comme chez les autres peuples du même continent, du sort des propriétés ; la punition des délits n’était plus abandonnée à la discrétion et à la force des personnes qui se croyaient offensées. De là il résultait plusieurs conséquences morales. L’esprit de vengeance, que nous avons trouvé si énergique chez les peuples chasseurs, avait infiniment moins de force, n’étant plus nécessaire à la sûreté de chacun. Les haines étaient nécessairement moins énergiques, moins générales, moins durables, la justice faisant tomber le châtiment sur le coupable, et garantissant ses enfants ou les membres de sa famille des atteintes qui auraient pu être portées à leur sûreté. Les vengeances étant moins à craindre, il devait exister moins de fausseté ou de perfidie dans les relations habituelles des individus ; les uns n’ayant pas à dissimuler, pour se venger avec plus de certitude et d’impunité, les autres pour prévenir ou désarmer la vengeance.
La sûreté des propriétés n’avait pas sur les mœurs moins d’influence que la sûreté des personnes. Dans les moments d’abondance, la masse de la population ne consommait pas au-delà de ses besoins, puisqu’elle avait la faculté de conserver ses ressources pour un autre temps. Aussi ces peuples s’étaient-ils fait de la tempérance une si grande habitude, qu’ils considérèrent comme une espèce de prodige la voracité des Espagnols ; ils n’auraient manifesté aucun étonnement à cet égard, si, comme les chasseurs du nord, ils avaient été accoutumés à consommer en un seul repas ce qui leur eût suffi pour en faire six. Ayant moins à craindre de se voir ravir les fruits de leur travail, ils étaient moins portés à l’oisiveté. Lorsque l’on considère, en effet, les travaux que ces peuples avaient déjà exécutés au quinzième siècle, sans le secours d’aucun instrument de fer et d’aucun de nos animaux domestiques ; leurs routes, plus belles qu’aucune de celles qui existaient en Europe à cette époque ; leurs aqueducs et leurs palais dont le temps n’a pas encore effacé les débris ; leurs établissements de postes, inconnus alors parmi nous ; leurs connaissances astronomiques ; leur division du temps, et les progrès de plusieurs arts, il n’est pas possible de croire qu’ils eurent moins d’activité que les peuples des climats froids, incapables de se donner aucun mouvement à moins que la faim ne les presse, ou qu’ils ne soient excités par la vengeance.
Les Espagnols nous apprennent peu de choses sur les relations de famille qui existaient chez ces peuples au temps de la conquête ; nous ne pouvons pas douter cependant que l’état des femmes, des enfants, des vieillards, ne fût de beaucoup supérieur à ce qu’il était chez les tribus du nord. La population existant principalement au moyen des travaux de l’agriculture, les hommes se livraient à ces travaux comme les femmes, chacun dans la mesure de ses forces. Le genre d’occupation auquel les femmes se livraient, loin [II-350]d’être pour elles une cause de mépris, devait être au contraire une cause d’estime, puisqu’il les élevait au niveau des hommes, et en quelque sorte au niveau du prince qui s’honorait de son triomphe sur la terre. Elles n’étaient pas obligées de suivre les hommes à travers les forêts et au milieu des neiges, accablées de fardeaux qui excédaient leurs forces, sans cesse exposées à être outragées par leurs maris, à être enlevées par des hordes ennemies, ou à périr de misère. Rien n’établit et ne peut faire même présumer qu’elles fussent exposées, comme chez les peuples du nord, à être la proie des lutteurs les plus forts, à être vendues, échangées, jouées comme une marchandise. L’état de civilisation auquel ces peuples étaient parvenus exclut un ordre de choses semblable.
Les enfants ni les vieillards n’étaient pas non plus exposés aux mêmes dangers : il était plus facile de pourvoir à leurs besoins ; ils n’avaient pas à suivre des chasseurs à la poursuite du gibier, ou à échapper par une fuite rapide aux fureurs d’un ennemi implacable.
Mais c’est surtout dans les relations de nation à nation que la différence des mœurs se manifeste. Chez les peuples chasseurs des climats froids, pour lesquels la vie est souvent un fardeau et la mort un événement heureux, la guerre entre les hordes est un état habituel. Le but de chacune d’elles est de détruire toutes celles qui l’environnent, et l’on ne croit pas s’être vengé d’un ennemi fait prisonnier, si avant de le tuer on ne lui a pas fait souffrir les tourments les plus horribles. Chez les peuplades plus rapprochées des tropiques, on immolait les prisonniers ; mais on les traitait d’une manière moins cruelle que chez les peuples plus élevés dans le nord, et l’on conservait les enfants et les femmes comme esclaves [506]. Les Mexicains dévouaient aussi leurs prisonniers à la mort ; ils les offraient à leurs dieux en sacrifice ; mais ils ne les tourmentaient pas. Enfin, les Péruviens n’infligeaient à leurs ennemis vaincus, ni la mort, ni aucun genre de torture.
« Les Péruviens, même dans leurs guerres, dit Robertson, montraient un esprit différent de celui des autres Américains. Ils ne combattaient pas comme des sauvages, pour détruire et exterminer, ou comme les Mexicains, pour offrir des sacrifices humains à des divinités altérées de sang. Ils faisaient des conquêtes pour civiliser les vaincus et les unir à eux, pour leur faire part de leurs connaissances, de leurs arts, et de leurs institutions. Les prisonniers n’étaient exposés ni aux tortures, ni aux insultes qui étaient leur partage dans les autres parties du Nouveau-Monde. Les incas prenaient sous leur protection les peuples qu’ils avaient vaincus, et les admettaient à jouir de tous les avantages qui étaient assurés à leurs autres sujets [507]. »
À l’époque où l’Amérique fut conquise par les Européens, un grand nombre des peuplades du nord étaient dans l’usage de manger leurs prisonniers. Cet usage, commun à presque toutes les hordes qui vivent sur les côtes du nord-ouest, n’avait pas encore cessé chez elles, à la fin du siècle dernier [508]. Les grands du Mexique, qui, à l’arrivée des Espagnols, se vantaient d’être des conquérants récemment venus du nord-ouest, n’avaient pas non plus renoncé aux usages de leurs ancêtres : comme eux, ils sacrifiaient leurs prisonniers, et les mangeaient ensuite. Mais les Péruviens, placés sous l’équateur, et beaucoup plus anciens dans le pays [509], étaient étrangers à ces horribles sacrifices : ils n’offraient à leur divinité que des animaux, des fruits de leurs champs, et quelques produits de leurs arts [510].
[II-353]
On ne peut juger par les mœurs actuelles des indigènes de l’Amérique, qui vivent entre les tropiques, des mœurs qui existaient chez eux à l’arrivée des Européens. La destruction de leurs gouvernements et de leurs religions ; l’extermination de la partie la plus éclairée de leur population ; l’asservissement des autres parties à une race d’étrangers qui différaient d’eux par leur langage, par leurs mœurs, par leurs opinions religieuses, et même par plusieurs de leurs traits physiques, ont suffi pour les rendre méconnaissables. Cependant, quoique plusieurs de ces peuples aient évidemment rétrogradé, la plupart sont encore de beaucoup supérieurs aux peuplades du nord, sous le rapport des habitudes morales.
Les relations des voyages faits dans les régions équinoxiales, nous donnent souvent des preuves de l’abrutissement dans lequel la servitude a plongé ou retenu les indigènes ; mais on n’y trouve pas ces actes de vengeance et de cruauté si fréquents chez les peuples du nord. Les voyageurs nous disent, au contraire, que les nations agricoles sont toutes douces, pacifiques, et ne font tout au plus que se défendre, lors même que leur taille et leurs forces sont très supérieures à celles des autres. Si quelques-unes de ces peuplades font des prisonniers, elles les laissent jouir de leur liberté, et les traitent en compatriotes. Les sauvages de la Guyane, placés presque sous l’équateur, sont aussi courageux que les sauvages les plus intrépides du Canada ; ils sont plus vites à la course ; mais, dit un voyageur qu’ils avaient fait esclave, ils sont moins inhumains : ils ne mangent pas leurs prisonniers [511]. Chez les mêmes nations, les femmes, quoique obligées de se livrer à des travaux pénibles, sont moins avilies et moins misérables que chez les peuplades du nord ; les deux sexes se livrent au même genre d’occupations [512].
Un homme peut épouser plusieurs femmes ; mais, comme le divorce est libre aux deux sexes chez plusieurs nations, toute femme peut abandonner un mari polygame, si elle le juge convenable [513]. Les femmes ne sont pas la propriété du plus fort : chez quelques peuplades, elles ne consentent à se marier, que lorsqu’elles ont fait leurs conventions soit avec leur futur mari, soit avec ses parents [514]. Les peuples errants du nord ne passent jamais dans un lieu sans détruire tout ce qui se rencontre sur leur passage ; les peuples du sud, que l’agriculture n’a pas encore entièrement fixés, sèment quelque chose partout où ils passent, dans l’espérance qu’un jour ils en recueilleront les fruits [515]. Les peuples les plus abrutis des tropiques manquent de propreté ; mais, comme ils sont souvent dans l’eau, leur saleté n’approche pas de celle des peuples qui vivent sous des climats froids [516].
Les historiens espagnols assurent que les incas et les caciques jouissaient d’un pouvoir sans bornes ; mais, outre que cette assertion s’accorde peu avec les éloges qu’ils donnent à leurs lois et à la manière dont ils disent que la justice était administrée, elle est démentie par les coutumes que ces peuples ont conservées, et qu’il n’a pas été au pouvoir des conquérants espagnols de détruire. Les indigènes du Pérou sont dans l’usage de se réunir à certaines époques pour délibérer sur leurs intérêts communs ; et tout ce que le gouvernement espagnol a jamais pu obtenir d’eux à cet égard, c’est que leurs assemblées seraient présidées par un officier de son choix.
« Il est impossible, dit à ce sujet Ulloa, de faire renoncer ces peuples à leurs anciens usages ; on ne le tenterait qu’en courant les plus grands risques. Si on leur interdisait absolument toute assemblée connue, ils iraient en tenir de nuit dans des endroits éloignés, et il serait très difficile d’être instruit de leurs délibérations [517]. »
En même temps que les peuples du Pérou ont tenu avec une constance invincible à l’usage de s’assembler pour délibérer sur leurs intérêts communs, ceux du Mexique ont conservé pour leurs caciques tout le respect que portaient leurs ancêtres aux hommes de cette classe. Par la conquête des Espagnols, tous les indigènes ont été réduits au même niveau ; il est difficile de distinguer, par leur extérieur, ceux qui descendent des anciens grands de ceux qui descendent des dernières classes du peuple.
« Le noble, dit M. de Humboldt, par la simplicité de son vêtement et de sa nourriture, par l’aspect de misère qu’il aime à présenter, se confond facilement avec l’Indien tributaire. Ce dernier témoigne au premier un respect qui indique la distance prescrite par les anciennes constitutions de la hiérarchie aztèque [518]. »
Ce respect, transmis par les dernières classes du peuple à leurs descendants, en faveur des descendants des maîtres déchus, ne serait-il pas une preuve que la domination d’une classe sur les autres n’était pas aussi dure qu’on le suppose ?
Ainsi, nous ne saurions trouver chez les indigènes de l’Amérique qui habitent sous les climats du nord, aucune supériorité morale sur les peuples placés entre les tropiques. Ils leur sont, au contraire, généralement inférieurs sous un grand nombre de rapports : ils ont plus de rapacité, de cruauté, de perfidie, d’intempérance, de paresse, de saleté, d’imprévoyance et d’orgueil. Il semble qu’ils devraient leur être supérieurs par la constance à supporter l’adversité ; mais, même sous ce rapport, ils sont de beaucoup au-dessous des autres.
« Ces peuples, dit Hearne, ne sont jamais heureux à demi, car le malheur des autres n’est rien pour eux. Mais si la moindre prospérité les enivre, le moindre revers personnel ou domestique les accable. Comme les autres peuples non civilisés, ils supportent les peines physiques avec beaucoup de résignation, quoique je regarde les Indiens du sud supérieurs à eux à cet égard [519]. »
Les écrivains qui ont prétendu qu’on ne pouvait trouver des vertus que chez les sauvages ou les barbares, ont attribué les vices des Américains du nord aux communications que ces peuples ont eues avec les Européens. Pour donner à cette assertion une apparence de vraisemblance, il eût fallu prouver que les peuplades placées dans la même position, mais n’ayant jamais communiqué avec les nations de l’Europe, avaient des mœurs moins vicieuses. Mais c’est précisément le contraire qui est constaté : ce sont les hordes qui ont toujours été les plus isolées, comme celles de Van-Diemen, de la Nouvelle-Hollande, des îles Alentiennes et de la côte nord-ouest de l’Amérique, chez lesquelles on a trouvé les vices les plus nombreux et les plus énergiques. C’est en parlant des derniers que La Pérouse, après avoir tracé le tableau de leurs mœurs atroces, a écrit :
« J’admettrai, si l’on veut, qu’il est impossible qu’une société existe sans quelques vertus ; mais je suis obligé de convenir que je n’ai pas eu la sagacité de les apercevoir [520] ».
[II-359]
CHAPITRE XIX.↩
Des rapports observés entre les moyens d’existence et l’état social des peuples d’espèce malaie du grand Océan. — Du genre d’inégalités qui existent chez ces peuples.
Les îles du grand Océan, en exceptant celles qui sont les plus rapprochées de l’Asie et qui se rattachent à ce continent, sont partagées entre des peuples de deux espèces : entre des peuples classés sous le nom d’espèce malaie, et des peuples classés sous le nom d’espèce nègre ou éthiopienne. Ces deux espèces d’hommes différant les unes des autres par leur constitution physique, par le degré de développement intellectuel auquel ils sont parvenus, par leurs mœurs et par leur langage, il importe de ne pas les confondre. Quant aux peuples qui habitent les îles situées près du continent asiatique, et qui sont classés sous le nom d’espèce mongole, je ferai connaître leurs mœurs et leur état social, lorsque je parlerai des peuples de cette espèce qui habitent l’Asie.
En décrivant l’état social des peuples d’espèce malaie, je suivrai l’ordre que j’ai observé dans l’exposition des mœurs des peuples d’espèce cuivrée : je ferai connaître d’abord la constitution générale de chaque association ; je considérerai ensuite, chez chaque peuple, les individus dans les relations qu’ils ont les uns avec les autres comme membres d’une famille, comme époux ou comme parents ; je les considérerai, en second lieu, dans les relations que les uns ont avec les autres comme chefs et comme subordonnés, comme domestiques et comme maîtres, comme gouvernants et comme gouvernés ; je les considérerai, en troisième lieu, en corps de nation, et dans les rapports que les peuples ont les uns avec les autres, comme alliés ou comme ennemis ; enfin, je les considérerai par les vertus ou par les vices qui n’ont aucun rapport spécial avec quelqu’une des précédentes qualifications, ou par les habitudes dont les effets principaux sont ressentis par l’individu lui-même, et qui n’affectent pas les autres d’une manière immédiate.
Nous avons vu précédemment que les peuples d’espèce malaie qui occupent les îles du grand Océan situées entre les tropiques, en les comparant en corps de nation, diffèrent peu entre eux dans leur organisation physique, dans leur langage et dans le développement de leurs facultés intellectuelles ; nous allons voir qu’ils diffèrent également de fort peu dans la constitution de leurs sociétés, dans leurs mœurs publiques et privées, et dans les relations qu’ils ont les uns avec les autres.
Tous les peuples d’espèce malaie qui sont placés entre les tropiques, ou qui en sont à peu de distance, vivent des produits de l’agriculture ; chez eux, la terre est partagée en propriétés privées depuis une époque qui nous est inconnue ; les champs sont clos et bien cultivés ; le pays est généralement traversé de routes bien entretenues ; la navigation a déjà fait quelques progrès, et la pêche, quoique abondante, n’est cependant considérée que comme un supplément à leurs moyens d’existence. Ces diverses circonstances suffisent pour nous faire juger que, chez ces peuples, les liens sociaux doivent être plus forts que ceux qui existent chez les peuples cuivrés placés sous le climat le plus froid de l’Amérique.
Des voyageurs ont observé, dans les archipels du grand Océan et chez les mêmes peuples, des individus qui différaient tellement les uns des autres par leur constitution physique, qu’ils ont cru qu’ils appartenaient à deux races particulières [521]. Les différences physiques qu’ils ont observées, ne sont peut-être pas suffisantes pour nous faire admettre comme un fait constaté, l’existence sur le même sol de deux espèces d’hommes ; mais, en admettant que toutes les classes qu’ils ont observées, sont de même espèce, toutes ne paraissent pas également anciennes dans le pays. Là, comme dans tous les États de l’Europe avant la destruction du régime féodal, il existe deux peuples sur chaque terre : celui qui en fut le premier possesseur, qui la défricha, et qui la cultive encore ; et celui qui, arrivé plus tard, s’empara du sol et des cultivateurs, et qui vit au moyen de ce qu’ils produisent. Lorsqu’une armée de barbares s’empare d’un territoire précédemment occupé, le moyen d’exploitation le plus simple qui se présente, c’est de considérer les cultivateurs comme des bêtes, et de les attacher à la culture. Si, pour la conservation de la conquête, l’armée reste organisée, si les individus dont elle se compose restent subordonnés les uns aux autres, il s’établit une espèce d’ordre qu’on a désigné sous le nom de régime féodal ; ordre dans lequel les individus des classes conquises sont mis au rang des choses, et où les autres sont considérés en raison de l’élévation de leur grade et de l’étendue de leurs possessions.
Tel est l’état social des peuples d’espèce malaie, qui occupent presque toutes les îles du grand Océan. Dans les îles des Amis, dont quelques-unes sont fort considérables, et dont le nombre excède cent cinquante, il existe un chef suprême, et ce chef est le général de l’armée [522]. L’île principale, dans laquelle il réside, est divisée en quarante-trois districts, chacun desquels est soumis à un chef particulier [523]. Toutes les autres îles ont également des chefs qui sont subordonnés les uns aux autres, et dont les plus élevés en grade sont les subordonnés immédiats du chef général ; par l’effet de cette subordination, les rangs sont aussi multipliés dans ces îles qu’ils le sont en Angleterre.
Ces chefs sont possesseurs de toutes les terres [524] ; ils possèdent aussi les cultivateurs, et même tous les individus qui appartiennent aux classes laborieuses, puisqu’ils exercent sur eux le pouvoir de vie et de mort [525]. Si le pays est menacé, chaque chef de district fournit un certain nombre de soldats qu’il commande lui-même, et l’armée entière est commandée par le chef général [526]. L’autorité de ce chef ou roi est héréditaire dans sa famille, quoiqu’elle passe ordinairement à ses frères avant que d’arriver à ses enfants [527]. Elle ne rend pas inviolable celui qui la possède ; car, s’il se rend coupable envers les chefs, ils peuvent le déposer ou même le faire mettre à mort. L’individu qui jouit du privilège d’exécuter la sentence, peut en même temps être revêtu du commandement général de l’armée [528].
[II-364]
Les chefs ne jouissent pas d’un pouvoir absolu sur ceux qui leur sont subordonnés ; celui de chaque district délibère sur les affaires locales avec les officiers inférieurs [529] ; le chef suprême délibère sur les affaires générales avec les principaux officiers ; c’est à la majorité que les délibérations sont prises [530]. L’autorité de tous les officiers est héréditaire, comme celle du chef général ; elle est transmise avec les terres qui en dépendent, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture [531].
Le rang que chaque individu occupe dans l’État est marqué par les signes qu’il porte, par les dénominations qu’on lui donne, ou par les honneurs qu’on lui rend. Le respect que témoignent au chef principal les personnages même les plus considérables, est extrême ; s’il se présente devant eux, ils se prosternent, lui prennent le pied et le posent sur leur cou ou sur leur tête [532] ; s’il s’absente, il laisse à sa place un des meubles qui sont à l’usage de sa personne sacrée, le vase dans lequel il lave ses mains, par exemple, et l’on paie à ce meuble le même respect qu’à lui-même [533] ; s’il est dépouillé de son autorité, il en conserve le titre et les signes ; car sa qualité est inhérente à sa personne et à une origine divine ; les membres de sa famille portent le même nom qu’ils donnent à leurs dieux [534].
Les grands respectent la personne du roi, non à cause des qualités qu’il possède, mais parce que cette autorité est de même nature que la leur : par les hommages qu’ils lui rendent, ils font voir les hommages qui leur sont dus. Cook ayant eu à remercier un de ces rois des présents qu’il avait reçus de lui, espérait voir un jeune homme vigoureux, d’une figure spirituelle et d’un courage entreprenant.
« Nous trouvâmes, dit-il, un vieillard faible et décrépit, que les ans avaient presque rendu aveugle, et si indolent et si stupide, qu’il paraissait à peine avoir assez d’intelligence pour entrevoir que ses cochons et ses femmes nous avaient fait plaisir [535]. »
Les avantages qui résultent pour le roi de la possession de l’autorité, avantages qu’il partage avec les principaux chefs, sont, outre les plaisirs du commandement, de consommer dans chaque repas une incroyable quantité d’aliments [536], de posséder plusieurs femmes [537], et d’en avoir quelques-unes qui le préservent de l’incommodité des mouches avec un éventail, ou qui le frappent doucement sur les cuisses quand il veut dormir [538].
Les membres de la famille du chef général prennent le même titre que les dieux, ainsi qu’on l’a vu précédemment ; les autres chefs, outre le titre de seigneurs de la terre, prennent le titre de seigneurs du soleil et du firmament [539]. Chacun d’eux a une cour nombreuse, composée des cadets de famille qui tiennent un rang égal au sien ; c’est par ces cadets qu’il fait faire ses messages, ou remplir d’autres offices de sa maison [540]. Chacun d’eux a aussi une livrée particulière pour ses valets ; cette livrée consiste dans la manière de se couvrir, et varie selon les rangs ; les valets des nobles de dernière classe ne peuvent se couvrir que les reins [541]. Les grands se distinguent de plus par la nature du bois avec lequel ils s’éclairent pendant la nuit ; car les gens de la classe du peuple ne peuvent faire usage du même bois qu’emploient les seigneurs du soleil et du firmament [542]. Un homme d’un rang inférieur, qui approche d’un grand, se découvre toute la partie supérieure du corps en signe de respect [543]. Si un grand meurt, ses inférieurs donnent les mêmes marques de douleur que s’ils avaient perdu leurs amis les plus intimes, les parents les plus chers ; ils se meurtrissent le corps, ils se déchirent le visage, jusqu’à ce que le sang en sorte à gros bouillons [544]. Quelques-uns d’entre eux sont égorgés sur sa tombe [545] ; le nombre des victimes qu’on immole en pareille occasion s’élève dans quelques îles jusqu’à dix, si le chef auquel on les immole appartient à un rang distingué [546]. C’est le grand prêtre qui choisit les victimes, après avoir consulté en secret la divinité, mais il ne peut pas les choisir parmi les nobles [547]. Le prêtre chargé du sacrifice arrache l’œil gauche de la victime, le présente au roi, en lui commandant d’ouvrir la bouche, et le retire sans l’y avoir enfoncé. On appelle cette cérémonie manger l’homme , ou le régal du chef. Elle semble avoir pour objet de constater l’antique droit des vainqueurs de manger les vaincus [548]. Les privilèges des grands ne sont pas bornés dans cette vie ; ils jouissent, dans un autre monde, de tous les plaisirs qu’ils ont goûtés dans celui-ci, et leurs âmes sont immortelles. Les âmes des gens du peuple, aussitôt qu’elles se séparent des corps, sont mangées par leur dieu ou par un oiseau qui voltige autour des cimetières, et qu’ils nomment loata [549]. Dans ces îles les croyances religieuses sont formées dans la vue de perpétuer le pouvoir de l’aristocratie, l’avilissement et la servitude du peuple [550].
[II-369]
Les grands sont chargés du maintien de la police, et ils exercent sur les hommes des rangs inférieurs un pouvoir sans bornes. Les choses ou les actions qu’ils défendent sont dites tabou [551], et leurs défenses sont toujours sanctionnées par la religion. Si un individu exécute une action ou touche à une chose qui est tabou, il est assommé à coups de massue [552]. Les femmes des grands sont tabou pour tous les hommes d’un rang inférieur : on tue en conséquence ceux de ces derniers qui sont surpris avec une d’elles [553]. Les filles même des grands ne peuvent pas s’allier aux classes inférieures ; les enfants qui naissent de ces alliances sont mis à mort. Le père est également mis à mort, si la femme appartient à la famille du chef principal. Mais les femmes des rangs inférieurs ne sont pas tabou pour les grands : les enfants qui naissent de leurs liaisons avec elles, entrent, au contraire, dans les castes privilégiées et peuvent succéder à leurs pères [554], à moins que ceux-ci ne jugent à propos de les mettre à mort [555].
Les grands, qui veillent à ce que les hommes des rangs inférieurs cultivent la portion de terre qui leur est assignée, désignent, par le tabou, quelles sont les choses qu’il est permis au peuple de manger, et quelles sont celles qu’il doit s’interdire ; s’ils jugent à propos de multiplier le nombre des cochons ou des volailles, ils les déclarent tabou , et alors personne ne peut ni les manger ni les vendre ; si le chef principal entre dans une maison, cette maison est tabou, et le propriétaire ne peut plus l’habiter [556].
Cette aristocratie se perpétue, ainsi qu’on l’a déjà vu, par la transmission qui s’opère, en faveur du premier enfant mâle, du pouvoir et des propriétés qui ont appartenu au père. Mais que deviennent les autres enfants ? Les filles ne peuvent s’allier à des hommes des rangs inférieurs, puisque les enfants qui naîtraient de ces alliances seraient mis à mort. Les garçons doivent être peu disposés à faire de telles alliances, quoiqu’elles ne leur soient pas interdites, puisque ces femmes ne possèdent point de terres et ne peuvent par conséquent leur donner des moyens d’existence. Enfin, les classes non privilégiées n’ayant pas d’autre industrie que de cultiver la terre des grands et de travailler à leur profit, il n’est pas possible de lever sur elles des impôts assez considérables ou de créer des emplois inutiles assez lucratifs pour enrichir les familles des cadets. Ces inconvénients sont évités par la création d’une corporation de célibataires, que les voyageurs désignent sous le nom d’Arreoys ou Erreoe , et à laquelle sont agrégés les enfants cadets des classes privilégiées, hommes et femmes ; le métier des hommes est de faire la guerre ; leurs moyens d’existence sont les produits des travaux des classes laborieuses [557].
Dans cette association, les deux sexes vivent en commun, et il est rare qu’un même homme et une même femme restent ensemble plus de deux ou trois jours. Une des premières lois de la corporation est de ne point conserver d’enfants : si donc une femme devient enceinte, l’enfant est mis à mort dès sa naissance ; on l’étouffe en lui appliquant un morceau d’étoffe mouillé sous le nez et sur la bouche. Une mère peut sauver cependant l’enfant qu’elle porte, si elle sent pour lui quelque mouvement de tendresse ; mais il faut pour cela qu’elle renonce à la société dont elle fait partie, et qu’elle trouve un homme qui consente à servir de père à son enfant. Les individus qui appartiennent à cette société jouissent de plusieurs privilèges et d’une grande considération ; n’avoir point d’enfants vivants est pour eux un sujet d’orgueil [558].
Il est une autre condition nécessaire au maintien et à la durée des classes aristocratiques : c’est que l’estime et la considération soient exclusivement attachées aux qualités qui constituent seules l’aristocratie, c’est-à-dire à la naissance, et à l’hérédité des terres et du pouvoir. La considération qui serait accordée au mérite personnel, à des vertus ou à des talents, serait une atteinte au principe constitutif d’un tel ordre social ; puisqu’elle donnerait aux hommes des classes inférieures le moyen de sortir de leur abaissement et de se mettre au niveau des classes privilégiées. Aussi ces insulaires voient-ils avec un souverain mépris toute personne de leur nation qui n’est pas née dans les rangs supérieurs, quelles que soient d’ailleurs ses richesses et ses qualités personnelles.
« Il paraît, dit Cook en parlant d’un habitant de Tahiti qui était revenu dans cette île longtemps après en être sorti, il paraît qu’il connaissait mal le caractère des habitants des îles de la Société, et qu’il avait perdu de vue, à bien des égards, leurs coutumes ; autrement il aurait senti qu’il lui serait d’une difficulté extrême de parvenir à un rang distingué dans un pays où le mérite personnel n’a peut-être jamais fait sortir un individu d’une classe inférieure pour le porter à une classe plus relevée. Les distinctions et le pouvoir qui en est la suite semblent être fondés ici sur le rang ; les insulaires sont soumis à ce préjugé d’une manière si opiniâtre et si aveugle, qu’un homme qui n’a pas reçu le jour dans les familles privilégiées sera sûrement méprisé et haï s’il veut s’arroger une sorte d’empire. Les compatriotes d’Omaï (que Cook avait ramené dans son île et enrichi) n’osèrent pas trop montrer leur disposition pour lui, tant que nous fûmes parmi eux ; nous jugeâmes toutefois qu’il leur inspirait un sentiment de haine et de mépris [559]. »
Les individus qui n’appartiennent pas à la classe aristocratique, sont distingués par une marque piquetée qui annonce leur infériorité [560]. Ils cultivent la terre, vont à la pêche, font le service intérieur de la maison des grands, et préparent leurs aliments [561]. Mais, quoique ce soit eux qui, par leurs travaux, produisent toutes les subsistances, ils n’en ont qu’une faible partie ; la viande et le poisson sont réservés pour la classe des grands ; les fruits, les légumes et les rats sont les aliments réservés au peuple. Les hommes même qui se livrent à la pêche, n’en consomment pas le produit ; s’ils veulent goûter du poisson, il faut qu’ils le mangent cru, au moment où ils viennent de le prendre [562]. Enfin, ces hommes n’ont pas même de maisons sous lesquelles ils puissent trouver un abri. Si le temps est beau, ils dorment au grand air comme les animaux ; s’il est mauvais, ils cherchent un refuge sous les bords des habitations des grands [563]. Ils sont couverts de vermine dont ils se débarrassent en la mangeant [564]. Leur genre de vie et surtout les aliments dont ils se nourrissent, les affectent de telle manière qu’ils sont presque tous infectés d’une espèce de gale ou de maladie cutanée [565].
L’aristocratie, dans son organisation, se propose deux objets : l’un de maintenir dans l’assujettissement les hommes obligés de cultiver le sol à son profit ; l’autre de défendre ses possessions contre des invasions étrangères, ou d’envahir les terres qui sont à sa convenance. S’il se manifeste quelque trouble parmi les hommes asservis, les maîtres terminent eux-mêmes la querelle ; mais si c’est parmi les grands qu’un différend s’élève, il n’y a point de juges communs, et c’est la force qui décide. Chacun de son côté arme ses vassaux, implore ses amis, et les plus forts s’emparent des terres et des cultivateurs possédés par les vaincus. Le seul cas où l’on ait recours à un procédé judiciaire, est celui où le chef principal est accusé d’avoir blessé les intérêts de ses grands vassaux. De l’absence de toute justice entre les grands naissent les vices que nous avons vus se développer chez les peuples cuivrés du nord de l’Amérique : la dissimulation, la perfidie, la vengeance, la cruauté [566]. On verra comment ces passions se manifestent dans les relations que les peuplades ont les unes avec les autres.
Tel est l’ordre social établi dans tous les archipels du grand Océan situés entre les tropiques. Cet ordre n’a pas été observé dans toutes les îles avec le même soin qu’il l’a été dans celles de la Société et dans celles des Amis ; mais les parties qu’on a reconnues dans le plus grand nombre, correspondent exactement à ce qu’on a observé dans les principales. Dans les îles Sandwich, la population est divisée de la même manière que dans celles des Amis [567]. Dans les unes comme dans les autres on immole des gens du peuple sur la tombe des hommes qui appartiennent à la classe aristocratique. La principale différence qu’on observe entre elles, est que, dans les îles Sandwich, le nombre des victimes est plus considérable qu’il ne l’est dans les autres [568]. Les voyageurs français et anglais qui ont observé les habitants des îles Marquises, n’ont point parlé de leur organisation sociale ; mais les voyageurs américains ont trouvé chez eux le régime féodal dans toute sa puissance [569].
Il existe cependant quelques différences entre les peuples de ces archipels. Les individus qui appartiennent à la classe asservie semblent moins nombreux dans les uns que dans les autres ; mais il se peut que ces différences soient plus apparentes que réelles. Les chefs supérieurs, qui, dans toutes les îles, sont les hommes les plus grands et les mieux constitués, environnent ordinairement le chef général ou le roi [570]. Les navigateurs qui ont abordé dans les îles principales, ont dû trouver par conséquent un plus grand nombre d’hommes forts et bien constitués, que les navigateurs qui ont abordé dans d’autres îles [571].
[II-377]
CHAPITRE XX.↩
Des relations qui existent entre les deux sexes chez les peuples d’espèce malaie du grand Océan. — Des relations entre les parents et leurs enfants.
Ayant exposé quelle est l’organisation sociale des peuples d’espèce malaie dans les archipels du grand Océan, il sera facile de comprendre quelles sont leurs mœurs. Les femmes de tous les rangs n’existent, comme les individus des classes inférieures, que pour les plaisirs des hommes de la classe aristocratique. Dès leur enfance, et avant qu’elles soient capables d’éprouver aucune affection, elles sont dressées de manière à leur procurer le seul genre de jouissances qu’ils sont susceptibles d’éprouver [572]. Jamais elles ne peuvent se soustraire à l’empire de la force : filles, elles appartiennent à leurs pères, qui les prêtent, les donnent, ou les vendent, comme il leur plaît ; femmes, elles appartiennent à leurs maris, qui en disposent de la même manière [573]. Si elles résistent à la prostitution, ce sont les parents ou les maris qui emploient la violence à les contraindre [574]. La naissance, le rang et le pouvoir étant les seuls titres à l’estime, la chasteté, la décence, la pudeur, ne sont point considérées comme des vertus, Ainsi, les femmes nées dans les rangs inférieurs ne peuvent jamais acquérir des titres à la considération ; les femmes nées dans les rangs élevés ne peuvent jamais encourir le mépris ; ce qui est essentiel à l’existence et à la durée d’un ordre aristocratique. Les grands remplacent d’ailleurs la chasteté par la cérémonie religieuse du tabou, qui met leurs femmes à l’abri des plébéiens, sans mettre les filles ou les femmes de ceux-ci à l’abri de leurs propres entreprises.
Les femmes n’étant point libres, les grands en possèdent ordinairement plusieurs ; un seul individu en possède quelquefois jusqu’à neuf. Il ne paraît pas que le nombre de celles que peuvent avoir les chefs, soit limité. Les hommes des rangs inférieurs n’en peuvent avoir qu’une [575]. Les femmes n’oseraient se permettre, ni de prendre leurs repas à la même table que leurs maris, ni de faire usage des mêmes aliments. Elles mangent dans un lieu écarté, et se nourrissent des choses réservées aux personnes des basses classes : la viande et les poissons les plus délicats leur sont interdits [576]. Elles doivent obéir à leurs maris dans tout ce qu’ils leur ordonnent, même lorsqu’ils leur commandent de se livrer à la prostitution ; mais les infidélités qu’elles se permettraient sans leur aveu seraient lavées dans leur sang [577]. Elles portent le deuil de leurs maris ; mais leurs maris ne portent point le leur [578]. Enfin, outre les humiliations auxquelles elles sont soumises, en ce qui a rapport aux aliments et à la manière de les prendre, elles sont traitées avec une dureté, ou plutôt avec une brutalité qui semble exclure la plus légère affection : rien n’est plus ordinaire que de les voir impitoyablement battre par les hommes [579]. Élevées uniquement pour les jouissances les plus grossières qu’elles peuvent donner, elles deviennent des objets de dégoût aussitôt que l’âge commence à flétrir leurs charmes. Les femmes qui n’appartiennent point aux hautes classes, sont plus maltraitées encore que celles des rangs supérieurs. C’est parmi les premières que sont prises celles qui sont offertes aux équipages des vaisseaux européens [580]. Les grands les prostituent pour s’emparer ensuite du prix de la prostitution [581].
Des femmes traitées d’une manière si brutale ne sauraient conserver longtemps leur fraîcheur. Aussi, quoique dans leurs premières années elles soient grandes, sveltes, et qu’elles aient de la grâce, elles perdent, avant la fin de leur printemps, dit La Pérouse, cette douceur d’expression, ces formes élégantes, dont la nature n’a pas brisé l’empreinte chez ces peuples barbares, mais qu’elle paraît ne leur avoir laissée qu’un instant et à regret. [582]
Cependant, les femmes sont moins méprisées chez ces insulaires, et leur sort est moins misérable chez les peuples d’espèce cuivrée du nord de l’Amérique. Elles n’ont pas à se livrer aux mêmes travaux ; elles ne sont pas exposées aux mêmes dangers et aux mêmes fatigues. Les vieillards et les enfants sont également moins misérables : ils n’ont à craindre ni l’abandon, ni les rigueurs des climats.
Les relations qui existent entre les parents et leurs enfants, sont analogues à celles qui existent entre les maris et les femmes. On a vu précédemment que les pères traitent leurs filles comme une marchandise, qu’ils les donnent, les vendent, selon que cela leur convient. On a vu aussi que c’est un devoir pour tous les fils cadets de l’aristocratie, engagés dans l’association militaire, de faire périr tous leurs enfants quel que soit le sexe auquel ils appartiennent. Les possesseurs des terres conservent, sans doute, la plupart des leurs : mais comme, chez ces peuples, la propriété mobilière est nulle, et comme les immeubles passent de plein droit au premier-né, un homme ne peut rien pour ses enfants ; ils ne lui doivent par conséquent aucune reconnaissance. Cependant, en tout ce qui ne touche point à la distribution des biens, la puissance paternelle n’a point de bornes : quel que soit l’usage qu’un homme en fasse, les chefs ne tentent point de la limiter [583].
[II-382]
CHAPITRE XXI.↩
Des relations qui existent chez les peuples d’espèce malaie du grand Océan, entre la classe aristocratique et les autres classes de la population. — Des mœurs qui résultent de ces rapports.
Les rapports qui ont lieu entre les membres de l’aristocratie et leurs inférieurs, sont aussi durs que peut le faire supposer leur état social. Les grands, armés de bâtons ou de massues, accompagnent de coups tout ordre qui n’est pas sur le champ exécuté. Quelquefois ils assomment sur la place l’individu qu’ils frappent, s’il appartient à la classe inférieure [584]. S’ils veulent écarter la foule, ils la dissipent à grands coups de pierres, ou en agitant violemment leurs massues. Si c’est sur un navire que la multitude se trouve, elle n’a pas d’autre moyen d’échapper aux coups que de se précipiter dans la mer [585]. Quelquefois cependant les grands s’abstiennent de traiter avec dureté ou insolence les hommes des derniers rangs qui ne peuvent entrer en comparaison avec eux ; mais ce n’est que pour faire sentir d’une manière plus dure leur supériorité à ceux qui, étant nés comme eux dans les rangs privilégiés, se trouvent cependant un peu moins élevés. L’esprit aristocratique se montre à l’égard de ceux-ci avec toute la violence naturelle à des hommes à qui l’éducation n’a pas appris à dissimuler leurs sentiments [586]. Le chef général se conduit, à l’égard de ses subordonnés, comme ceux-ci à l’égard de ses inférieurs : si, placé dans sa grande pirogue, il rencontre sur sa route des embarcations qui ne peuvent pas l’éviter, parce que le respect oblige les hommes qui les conduisent à se tenir couchés en sa présence, il passe sur eux et les submerge, sans faire même attention qu’ils se trouvent sur son passage [587]. Les grands, dans le cas où ils jugent coupable un individu qui est leur sujet, ne dédaignent pas de faire l’office de bourreau [588].
Les propriétés des individus qui n’appartiennent pas aux ordres privilégiés, ne sont pas plus respectées que leurs personnes. On a vu que, pour enlever à une famille sa maison, il suffit au chef général d’y mettre le pied, et que pour interdire à la population l’usage de tels ou tels aliments, il suffit de les déclarer tabou. Si un individu des rangs inférieurs possède un objet qui convienne à un chef, celui-ci lui commande de le lui donner ; et, s’il n’est pas obéi, il le frappe de sa massue, jusqu’à ce que la résistance cesse [589]. Les fils du roi prennent les choses qui leur conviennent partout où ils les trouvent ; le roi lui-même, s’il rencontre des hommes venant de la pêche, leur enlève leur poisson sans aucune nécessité. Lorsqu’il sonne d’une conque qui produit un son très éclatant, tous ses sujets sont obligés de lui apporter des comestibles de tous les genres. Les personnes des rangs inférieurs ne possèdent, en un mot, que ce qu’il plaît aux chefs de leur laisser [590].
Un peuple qui a fondé son existence sur les terres et sur le travail d’une population conquise, ne reconnaît pour être à autrui que ce qu’il n’a pas la force ou l’adresse de ravir. La force et la ruse sont chez lui les seules mesures du juste et de l’injuste ; dès l’instant qu’il peut traiter des hommes libres comme ceux dont il a la possession, il ne met entre les uns et les autres aucune différence, parce qu’en effet toute différence disparaît. Cependant, quelque vigilants que soient des maîtres, ils ne peuvent pas empêcher que la population asservie ne détourne à son profit une part des biens qui lui sont ravis, ou qu’elle ne cherche à se rendre libre, à moins qu’ils n’établissent chez elle un certain genre de devoirs. C’est, en effet, le parti qu’ont pris les peuples malais du grand Océan : ils ont établi qu’il n’y a de sacré que ce qui est tabou , c’est-à-dire ce que la religion a défendu de toucher ; et comme les prêtres appartiennent à leur caste et qu’ils sont maîtres de la religion, il n’y a de tabou que leurs personnes et leurs propriétés. Il résulte de là que les grands ne sont tenus à rien envers les personnes qui ont moins de puissance qu’eux, tandis que la population asservie est, au contraire, assujettie à des devoirs nombreux à leur égard.
Les individus qui appartiennent aux classes privilégiées, les grands possesseurs des terres, les militaires et les prêtres, ayant établi qu’il n’y a de mal que ce qui est tabou , c’est-à-dire ce qu’ils ont eux-mêmes prohibé, le vol qui tend à les enrichir n’est ni criminel, ni même honteux. Il ne faut donc pas être surpris si les navigateurs qui ont fréquenté ces îles, en ont considéré les habitants, presque sans exception, comme les voleurs les plus adroits et les plus impudents [591] ; les vols ont presque toujours été commis à l’instigation et au profit des grands. Les habitants des îles Sandwich qui n’avaient rien enlevé dans les vaisseaux de Cook, tant que les chefs avaient été absents, commirent plusieurs vols aussitôt que ceux-ci furent arrivés.
« Nous attribuâmes ce changement de conduite, dit le rédacteur du voyage, à la présence et à l’encouragement des chefs ; car, en général, nous trouvâmes dans les mains des grands personnages de l’île, les choses qu’on nous avait dérobées, et nous eûmes bien des raisons de croire que les larcins avaient été commis à leur instigation. » [592]
Les vols commis dans les îles des Amis sur des navires français, ont également été faits au profit des chefs, même lorsque ce sont des hommes des derniers rangs qui s’en sont rendus coupables [593].
[II-387]
CHAPITRE XXII.↩
Des relations qui existent entre les divers peuples ou entre la fédération de peuples d’espèce malaie. — De l’influence de leur organisation sociale sur la nature de ces relations. — Des causes et des résultats de leurs guerres.
Dans aucun pays, l’influence qu’exerce l’organisation sociale d’un peuple, sur les peuples voisins, ne se manifeste avec plus d’énergie que dans les archipels du grand Océan situés entre les tropiques. Chez ces peuples, les cadets de famille n’ont aucune part dans la succession de leurs pères, comme on l’a vu ; ils ne peuvent donc vivre que des aliments que leur donnent leurs aînés, s’ils restent dans la famille, ou de ce que peut leur donner la population asservie, s’ils entrent dans l’association militaire des Arreoys. Mais, quel que soit celui de ces deux partis qu’ils prennent, ils ne peuvent espérer de perpétuer leur race ; l’impuissance de transmettre à leurs enfants aucune propriété, et de les maintenir dans le rang où ils naissent, est sans doute ce qui leur a fait une loi de les étouffer [594].
Ils ont un moyen cependant de sortir de l’état où ils se trouvent et de se mettre sur le même rang que leurs aînés : c’est la destruction des grands possesseurs de terres des autres États. Ainsi, dans chaque pays, la partie la plus nombreuse et la plus énergique de la classe aristocratique est poussée, par le désir même que la nature a donné à toutes les espèces de se conserver, vers la destruction des classes aristocratiques qui existent chez les peuples voisins ; et, comme le même ordre de choses est établi partout, et que nulle part il n’existe des classes industrieuses aux dépens desquelles les cadets de l’aristocratie puissent s’enrichir, les aînés ne les excluent de l’héritage paternel que sous la condition que tous les cadets des autres États s’armeront contre eux pour les exterminer. Les mêmes passions qui poussent vers la guerre les individus qui n’ont pas d’autre moyen de perpétuer leur race, y poussent aussi leur roi ; car à mesure que ceux-là acquièrent des terres, celui-ci multiplie le nombre de ses grands vassaux [595].
Les peuples de ces archipels sont donc toujours en état de guerre les uns contre les autres, et l’animosité qu’ils y portent est en raison de la puissance de la cause qui les y excite, et des calamités qui sont réservées aux vaincus [596]. La guerre n’ayant pour but que l’agrandissement ou la multiplication des fils des seigneurs de la terre, du soleil et du firmament, on y prélude de part et d’autre par le sacrifice de victimes humaines, toujours choisies dans les rangs inférieurs, parmi les descendants des hommes qui furent jadis vaincus. On suit, dans ce sacrifice, les usages qui sont pratiqués aux funérailles des grands, et particulièrement celui qu’on appelle le régal du chef. Des voyageurs ont pensé que les habitants des îles de la Société, des îles des Amis et des îles Sandwich, dévoraient leurs prisonniers [597] ; mais on n’a pu en acquérir la certitude, et le mouvement d’étonnement et d’horreur manifesté par un de ces insulaires en voyant un habitant de la Nouvelle-Zélande dévorer les restes d’un corps humain, semble prouver que cet usage n’est point admis chez eux [598]. Mais, s’ils ne se nourrissent pas de leurs prisonniers, ils les font périr dans les tourments ; ils se précipitent sur les cadavres de leurs ennemis vaincus et les déchirent de leurs dents [599]. Ce sont, ainsi qu’on le verra bientôt, les moins barbares des nobles guerriers de ces îles.
Lorsque les peuples attaqués ne peuvent empêcher l’ennemi de pénétrer dans le pays, ils se retirent aussi loin qu’ils le peuvent, emportant tout ce qu’il leur est possible de lui soustraire. Si le conquérant craint de ne pouvoir pas se maintenir dans sa conquête, il agit à la manière romaine : il détruit les habitations, les canaux, les arbres, les récoltes, les animaux, enfin tout ce qui est l’œuvre de l’industrie humaine ; la misère et la famine emportent alors les vaincus et quelquefois même les vainqueurs [600]. Mais, s’il reste maître du pays, il partage les terres entre ses nobles compagnons ; ceux-ci sortent alors du corps militaire des Arreoys, ne sont plus obligés d’étouffer leurs enfants, et donnent naissance à d’autres cadets qui devront comme eux exterminer de nouveaux peuples, ou faire périr leurs propres enfants à mesure qu’ils verront le jour [601].
La guerre ayant pour objet de s’emparer des terres qu’ils convoitent, la conquête a pour résultat la destruction des nobles possesseurs. Si donc la victoire les rend maîtres d’un pays, ils exterminent toute la partie mâle de la population, pères, enfants, vieillards, et probablement aussi les femmes qu’ils jugent indignes d’élever au rang de leurs épouses. S’ils ne massacrent pas leurs prisonniers sur-le-champ, c’est pour les faire périr dans les supplices, et savourer plus à leur aise les plaisirs de la vengeance. Les raffinements qu’ils portent dans la cruauté sont analogues à ceux que mettent en usage les indigènes du nord de l’Amérique. On trouve dans leurs traditions et dans le langage, des preuves que leurs ancêtres ont jadis dévoré leurs prisonniers [602] ; et les noms, que prennent leurs chefs de tombeau des hommes , de voleurs de pirogues [603], attestent l’honneur qu’ils attachent au meurtre et au brigandage.
Ces guerres, dont le principal objet est de donner des moyens d’existence aux cadets déshérités des grands, sont si destructives, que quelquefois il a suffi de quelques années pour plonger dans la misère les îles les plus florissantes, et pour en moissonner la plus grande partie de la population [604].
[II-392]
CHAPITRE XXIII.↩
Opposition entre la conduite des peuples d’espèce malaie à l’égard des navigateurs Européens, et leur conduite à l’égard les uns des autres. — Explication de ce phénomène.
Il est commun parmi les voyageurs de juger des mœurs des nations par l’accueil qu’ils reçoivent d’elles : cette manière de juger est cependant peu sûre ; peut-être même n’en est-il pas de plus trompeuse. On a vu, dans les chapitres précédents, que les rapports qui existent, chez les peuples d’espèce malaie, entre les deux sexes, entre les parents et les enfants, entre les possesseurs du sol et les cultivateurs, et entre les diverses peuplades, sont généralement fort durs : ils sont tels que ceux qui peuvent exister entre des maîtres et des esclaves, ou entre les ennemis les plus cruels ; ces peuples cependant paraissent remplis de bienveillance à l’égard de la plupart des voyageurs qui les visitent ; et ceux qui sont les plus rapprochés de l’équateur, sont ceux dont les navigateurs sont généralement les plus satisfaits.
Les habitants des îles Marquises paraissent toujours gais et contents, et la bonté semble peinte sur leur figure ; les femmes sont douces ; leurs regards n’expriment que la volupté [605]. La manière dont ces peuples se sont conduits avec les Européens qui les ont visités, si l’on fait exception des vols, a eu l’air de la franchise et de la générosité. Leur conduite avec les Français les a fait regarder par eux comme le peuple le plus doux, le plus humain, le plus pacifique, le plus hospitalier, le plus généreux de tous ceux qui occupent les îles du grand Océan [606]. Ils ont eu les mêmes procédés à l’égard des voyageurs russes ; ils se sont toujours conduits à leur égard avec la plus grande honnêteté, même dans leur commerce d’échange. Le chef de l’expédition russe assure qu’il aurait emporté de ces insulaires l’opinion la plus favorable, s’il n’avait pas rencontré parmi eux un Anglais et un Français qui les lui firent mieux connaître [607].
Les habitants des îles de la Société et des îles des Amis ont montré les mêmes dispositions envers les navigateurs européens. Les premiers ont toujours manifesté, dans leur physionomie, de la gaieté, de la joie, de la générosité, le sentiment du bonheur [608]. Ils ont reçu chez eux les voyageurs qui s’y sont présentés, les ont admis à parcourir l’intérieur du pays, les ont invités dans leurs maisons, leur ont offert à manger [609]. Les seconds ont fait aux voyageurs un accueil semblable.
« Il n’y a peut-être pas sur le globe, dit Cook, de peuplade qui mette plus d’honnêteté et moins de défiance dans le commerce. Nous ne courûmes aucun risque à leur permettre d’examiner nos marchandises et de les manier en détail, et ils comptaient également sur notre bonne foi. Si l’acheteur ou le vendeur se repentaient du marché, on se rendait réciproquement d’un commun accord et d’une manière enjouée ce qu’on avait reçu. En un mot, ils semblent réunir la plupart des bonnes qualités qui font honneur à l’homme, telles que l’industrie, la candeur, la persévérance, l’affabilité, et peut-être des vertus moins communes, que la brièveté de notre séjour ne nous a pas permis d’observer [610]. »
Les voyageurs ont donné des éloges moins grands aux habitants des îles Sandwich. Cook dit cependant qu’il n’a jamais trouvé des peuples sauvages moins défiants et aussi libres dans leur maintien ; d’autres navigateurs ont vanté la générosité de leurs sentiments. Ceux de ces insulaires qui visitèrent les vaisseaux de La Pérouse s’y conduisirent de la manière la plus régulière : ils étaient si dociles, ils craignaient si fort d’offenser les Français, qu’il était extrêmement aisé de les faire rentrer dans leurs pirogues. La Pérouse dit qu’il n’avait pas d’idée d’un peuple si doux, si plein d’égards.
« Lorsque je leur eus permis de monter sur ma frégate, ajoute-t-il, ils n’y faisaient pas un pas sans mon agrément ; ils avaient toujours l’air de craindre, de nous déplaire ; la plus grande fidélité régnait dans leur commerce [611]. »
Les habitants de l’île de Pâques, plus éloignés encore de l’équateur que ceux des îles Sandwich et des îles de la Société, ont aussi paru avoir moins de qualités morales. Cependant, lorsqu’ils abordèrent le vaisseau de La Pérouse, ils montèrent à bord avec un air riant et une sécurité qui donnèrent à ce voyageur la meilleure opinion de leur caractère. Lorsqu’ils virent mettre le vaisseau à la voile, ils ne manifestèrent aucune crainte de se voir enlever et arracher à leur terre natale ; l’idée d’une perfidie ne parut pas même se présenter à leur esprit ; ils étaient au milieu des étrangers, nus et sans aucune arme [612].
Enfin les habitants de la Nouvelle-Zélande, qui sont les peuples de race malaie les plus éloignés de l’équateur et ceux dont l’industrie a fait le moins de progrès, ont manifesté des sentiments de bienveillance et d’amitié aux navigateurs qui ont visité leurs terres, et leur ont rendu les services qui ont dépendu d’eux [613].
Tous ces insulaires ont donc reçu à peu près les mêmes éloges. Nous pouvons observer cependant qu’à mesure qu’on s’éloigne de l’équateur, l’admiration des navigateurs diminue : les habitants des îles Marquises sont plus admirés que ceux des îles de la Société et des îles des Amis ; ceux-ci plus que les habitants des îles Sandwich ; ceux des îles Sandwich plus que ceux de l’île de Pâques [614]. Tous ces éloges ne se rapportent d’ailleurs qu’à la conduite de ces insulaires envers les navigateurs européens, et non à la conduite qu’ils tiennent les uns envers les autres. Je ferai même observer ici que ceux qui ont fourni le plus d’exemples de violence et de brutalité les uns à l’égard des autres, sont ceux chez lesquels les rangs sont le plus marqués. On n’a pas observé, par exemple, chez les habitants de la Nouvelle-Zélande, qui, sous d’autres rapports, sont les peuples les plus barbares, des chefs faisant la police à coups de bâton et de massue.
Mais comment des peuples qui dans leurs relations mutuelles ont si peu de douceur, et qui semblent ne reconnaître d’autre loi que la force, se sont-ils d’abord montrés si doux envers les navigateurs européens ? Ces navigateurs nous donnent eux-mêmes la solution de ce problème :
« Il n’y a personne, dit La Pérouse, qui, ayant lu les relations des derniers voyageurs, puisse prendre les Indiens de la mer du Sud pour des sauvages ; ils ont, au contraire, fait de très grands progrès dans la civilisation, et je les crois aussi corrompus qu’ils peuvent l’être relativement aux circonstances où ils se trouvent : mon opinion là-dessus n’est pas fondée sur les différents vols qu’ils ont commis, mais sur la manière dont ils s’y prenaient [615]. Les plus effrontés coquins de l’Europe sont moins hypocrites que ces insulaires ; toutes leurs caresses étaient feintes ; leur physionomie n’exprimait pas un seul sentiment vrai : celui dont il fallait le plus se défier, était l’Indien auquel on venait de faire un présent, et qui paraissait le plus empressé à rendre mille petits services [616]. — Les Malais, dit ailleurs La Pérouse, sont aujourd’hui la nation la plus perfide de l’Asie, et leurs enfants n’ont pas dégénéré, parce que les mêmes causes ont préparé et produit les mêmes effets [617]. »
Les observations que fait La Pérouse d’une manière générale, sont confirmées d’une manière particulière par lui-même et par d’autres voyageurs, relativement aux habitants de presque toutes les îles ; elles sont prouvées surtout par la multitude des faits qu’ils rapportent. Les habitants des îles de la Société, dont la conduite envers les Européens a été un sujet d’éloge pour Cook et Bougainville, n’ont montré de la douceur qu’après avoir vainement tenté de surprendre l’équipage de Wallis, et avoir éprouvé la puissance de son artillerie : il a fallu qu’ils vissent leurs pirogues les plus fortes dispersées ou brisées par la mitraille et les boulets, pour mériter les louanges que les navigateurs leur ont données plus tard [618]. Les avantages qu’ils ont retirés de leur commerce avec les vaisseaux européens, le danger qu’ils ont vu à les attaquer, et l’impossibilité de s’en rendre maîtres, étaient plus que suffisants pour leur inspirer de la douceur [619].
Il me semble cependant que l’on se tromperait si l’on attribuait à la crainte et à l’hypocrisie toutes les marques de bienveillance que les voyageurs ont reçues de ces peuples. Les vieilles offenses qu’ils ont reçues les uns des autres, et les vengeances qui en sont résultées, les ont habitués à voir des ennemis dans tous les hommes qui ne sont pas de leur nation ; mais ce préjugé, qui a été commun à tous les peuples de l’antiquité que nous connaissons, peut céder à une conviction contraire. La perfidie et la vengeance naissent partout de la crainte, et du besoin de sécurité : les hommes cessent d’être faux et vindicatifs, toutes les fois qu’ils se croient en sûreté, et qu’ils n’ont point d’injustice à redouter ; ils cessent d’être violents et injustes toutes les fois qu’ils sont convaincus qu’ils ne peuvent pas l’être impunément ; on verra même qu’il suffit quelquefois d’un intervalle très court pour éteindre les sentiments de haine et de vengeance les plus invétérés, lorsqu’un événement quelconque fait cesser les causes qui les ont produits.
[II-400]
CHAPITRE XXIV.↩
Parallèle entre les mœurs des peuples d’espèce malaie placés sous un climat froid, et les mœurs des peuples de même espèce placés entre les tropiques.
Ce que j’ai dit dans les chapitres précédents sur l’état social et sur les mœurs des peuples d’espèce malaie, ne s’applique qu’à ceux de ces peuples qui vivent entre les tropiques ou qui n’en sont placés qu’à une très petite distance ; si donc on observe entre eux quelques différences, on ne peut guère les attribuer à la différence des climats. Mais il existe, dans le grand Océan, d’autres peuples qui appartiennent à la même espèce et qui sont placés sous une latitude plus élevée ; ce sont les habitants de l’île de Pâques, qui vivent sous le vingt-septième degré de latitude australe, et ceux de la Nouvelle-Zélande, qui vivent entre le trente-quatrième et le quarante-septième. C’est en faisant la description de leurs mœurs, que nous verrons en quoi elles différent de celles des peuples des tropiques.
Dans l’île de Pâques et dans la Nouvelle-Zélande, on ne trouve qu’une seule espèce d’hommes. On ne voit pas ici, comme dans les archipels des tropiques, des cultivateurs asservis qui ne peuvent toucher aux aliments qu’ils font croître, ni des conquérants organisés pour vivre sur les terres et les travaux des anciens possesseurs. Ces insulaires sont donc exempts des maux qu’enfante l’esclavage pour les maîtres comme pour les esclaves ; ils sont en outre placés sous un climat froid ou du moins fort tempéré, ce qui, suivant plusieurs philosophes, est une circonstance très favorable à la vertu. Ils sont loin cependant d’avoir des mœurs plus pures que celles des peuples de même espèce que nous avons déjà vus.
Les habitants de la Nouvelle-Zélande sont divisés en une multitude de peuplades, et chacune d’elles est toujours en guerre contre les autres. Ces insulaires n’ont point d’organisation sociale, et par conséquent chacun est le juge et le vengeur des offenses qu’il croit avoir reçues. Aussi il n’y a point d’hommes sur le globe qui soient plus soupçonneux, plus défiants, plus disposés à la vengeance [620]. Soit qu’ils travaillent, soit qu’ils voyagent, ils sont toujours sur leurs gardes : toujours ils ont les armes à la main ; les femmes même sont armées ; elles portent des piques de dix-huit pieds de long [621]. Chaque peuplade ayant reçu des injustices ou des outrages des peuplades voisines, ils vivent tous dans des transes continuelles, sans cesse occupés de se garantir de la vengeance, ou épiant l’occasion de se venger. Ils ont fait un fort de chaque village, et ils osent à peine en sortir pour cultiver quelques étroits morceaux de terre [622]. Le désir de la vengeance, le besoin de la sécurité, et la faim qui toujours les assiège, les poussent continuellement à la destruction les uns des autres ; et les villages déserts et ruinés rencontrés par les voyageurs attestent que la destruction complète d’une peuplade est la conséquence de la défaite [623]. Cook, sollicité par plusieurs de ces insulaires de donner la mort à un de leurs chefs, assure qu’il aurait pu exterminer la race entière, s’il avait suivi les conseils de cette espèce qu’il reçut ; les habitants de tous les villages ou hameaux le prièrent chacun à leur tour de détruire leurs voisins. Il n’est pas aisé, dit Cook, de concevoir les motifs d’une animosité si terrible ; et elle prouve d’une manière frappante jusqu’à quel point ces malheureuses peuplades sont divisées entre elles [624]. Ces peuples ne sont pas poussés à la guerre seulement par le désir de se venger ou de se mettre à l’abri de la vengeance ; ils y sont poussés aussi par le désir de se nourrir du cadavre de leurs ennemis. Ils ne mangent pas seulement les hommes tombés sur le champ de bataille ; ils mangent tous ceux qu’ils prennent vivants, sans excepter les enfants [625].
[II-403]
Les femmes des Zélandais sont asservies comme celles des peuples placés entre les tropiques ; mais elles sont traitées d’une manière plus dure. Il n’est pas rare de voir un homme qui en possède deux ou trois. Un père prostitue sa fille, un mari sa femme, comme dans les autres îles [626]. La moindre faute qu’une femme commet, est punie par de violents outrages [627]. Une mère qui, offensée par son fils, lui inflige une punition légère, est elle-même châtiée par son mari d’une manière cruelle. Les voyageurs anglais eurent souvent occasion de voir de pareils exemples de cruauté ; ils virent des fils qui frappaient leurs mères, tandis que les pères les guettaient pour les battre eux-mêmes si elles entreprenaient de se défendre ou de châtier leurs enfants. Chez les sauvages, dit un de ces voyageurs, les femmes sont les serviteurs ou les esclaves qui font tous les travaux, et sur lesquelles se déploie toute la sévérité du mari. Il semble que les Zélandais portent cette tyrannie à l’excès : on apprend aux garçons, dès leur bas âge, à mépriser leurs mères [628]. Cependant, il est pour les femmes un malheur plus grand encore que celui d’être exposées à la brutalité de leurs maris ; c’est de n’être point mariées ; alors elles sont abandonnées à elles-mêmes et deviennent le jouet de quiconque a de la force [629].
Les mauvais traitements que les maris font éprouver à leurs femmes dans les cas où elles infligent quelques légères corrections à leurs enfants, ne sont pas l’effet de la tendresse paternelle ; c’est l’effet du mépris qu’ils ont pour le sexe le plus faible. Les parents de deux jeunes Zélandais qui suivirent Cook, quoique instruits qu’ils ne les reverraient plus, ne manifestèrent aucun genre de regrets.
« Je crois, dit le voyageur en parlant du père de l’un de ces deux enfants, qu’il aurait quitté son chien avec moins d’indifférence. Il s’empara du peu de vêtements que portait l’enfant, et il le laissa complètement nu. J’avais pris des peines inutiles pour leur faire comprendre qu’ils ne reviendraient plus à la Nouvelle-Zélande ; ni leurs parents ni aucun des naturels ne s’inquiétaient de leur sort [630]. »
[II-405]
Les habitants de l’île de Pâques ont les mêmes mœurs que la plupart des peuples plus rapprochés de l’équateur ; on observe seulement que leurs vices ont plus d’énergie ; ils ont paru plus hypocrites, plus voleurs, et moins susceptibles de reconnaissance. Les femmes n’ont pas montré plus de délicatesse que celles des autres îles ; leurs maris ou leurs pères les ont offertes avec la même impudence. Les voyageurs français qui les ont visités, n’ont fait contre eux aucun usage de leurs forces, que ces insulaires ne méconnaissaient pas, puisque le seul geste d’un fusil en joue les faisait fuir. Ils n’ont, au contraire, abordé dans leur île que pour leur faire du bien : ils les ont comblés de présents ; ils ont accablé de caresses tous les êtres faibles, particulièrement les enfants à la mamelle ; ils ont semé dans leurs champs toute sorte de graines utiles ; ils ont laissé dans leurs habitations des cochons, des chèvres et des brebis ; ils ne leur ont rien demandé en échange : néanmoins, ces mêmes insulaires leur ont jeté des pierres ; ils leur ont volé tout ce qu’il leur a été possible d’enlever [631].
Les habitants des îles de la Société et des îles des Amis se montrent impitoyables dans leurs guerres ; mais ils sont beaucoup moins barbares que ceux de la Nouvelle-Zélande : ils ne se nourrissent pas de la chair de leurs prisonniers. Ils sont très brutaux à l’égard de leurs inférieurs ; mais ils ne sont pas étrangers à la reconnaissance comme les habitants de l’île de Pâques. Lorsqu’ils apprennent la perte d’hommes qu’ils avaient considérés comme leurs amis, ils manifestent de très vifs regrets ; et quelques-uns ont prouvé qu’ils pouvaient conserver longtemps le souvenir des bienfaits qu’ils avaient reçus [632]. Ils traitent leurs femmes moins durement que les Zélandais ; ils ne les chargent pas des occupations les plus pénibles ; ils ne leur imposent que les travaux intérieurs de la maison, ou les laissent vivre dans l’oisiveté [633]. La tendresse et les soins des femmes des îles Sandwich pour leurs enfants, ont frappé les navigateurs anglais, qui ont vu souvent les hommes les aider dans ces occupations domestiques [634]. Enfin, ces peuples se sont fait remarquer par une propreté qu’on ne trouve pas chez les peuples situés sous des climats plus froids [635].
[II-407]
Les îles des Navigateurs, plus rapprochées de l’équateur que les îles Sandwich et que les îles de la Société, ont été moins fréquentées. Une partie de l’équipage de La Pérouse éprouva, de la part des habitants de ces îles, une attaque semblable à celle qu’essuya Wallis de la part des habitants des îles de la Société ; mais la résistance n’eut pas le même succès ; les assaillants restèrent vainqueurs ; l’officier et les matelots français furent massacrés. Si ces insulaires eussent échoué dans leur entreprise ; si, comme les habitants des îles Sandwich et des îles de la Société, ils avaient éprouvé la puissance de l’artillerie, il est probable qu’ils auraient eu la même conduite. Mais on n’a pu connaître d’eux que leur perfidie, leur audace, leur force, et la facilité avec laquelle ils prodiguent les faveurs de leurs filles ou de leurs femmes.
Ces insulaires furent d’abord jugés très doux par les hommes de l’équipage que commandait La Pérouse ; ils leur avaient vendu plus de deux cents pigeons ramiers privés, qui ne voulaient manger que dans la main ; ils avaient aussi échangé les tourterelles et les perruches les plus charmantes, aussi privées que les pigeons. Quelle imagination ne se serait peint le bonheur dans un séjour aussi délicieux ! Ces insulaires, disaient les navigateurs, sont sans doute les plus heureux habitants de la terre ; entourés de leurs femmes et de leurs enfants, ils coulent au sein du repos des jours purs et tranquilles ; ils n’ont d’autre soin que celui d’élever des oiseaux ; et, comme le premier homme, de cueillir, sans aucun travail, les fruits qui croissent sur leur tête [636].
Mais quels que soient les vertus ou les vices de ces peuples dans leurs relations privées, il est certain du moins qu’on ne trouve chez eux ni cette inactivité ni cette faiblesse qu’on attribue aux peuples qui vivent sous des climats chauds ; ils paraissent, au contraire, plus actifs, plus énergiques, plus audacieux que les peuples de même espèce placés à une plus grande distance de l’équateur ; leurs corps, robustes et couverts de cicatrices, prouvent assez qu’ils ne vivent pas dans la mollesse [637].
Les navigateurs anglais ont fait éprouver la puissance de leurs armes aux habitants des îles Marquises, la première fois qu’ils les ont visités. L’équipage de Cook, voyant trois de ces insulaires s’éloigner dans leur bateau, et ayant appris qu’un d’eux emportait un chandelier de fer, fit feu sur eux, et un tomba mort au troisième coup [638]. Les Français et les Russes qui ont visité plus tard les mêmes peuples ont rendu témoignage de leur douceur, de leur humanité, de leur hospitalité, de leur caractère pacifique. Non seulement les Français n’ont reçu d’eux aucun outrage, mais après en avoir grièvement blessé un par imprudence en parcourant le pays, ils ont continué de recevoir de lui des marques de bienveillance. Le capitaine Chanal remarqua avec sensibilité, qu’un jeune homme qu’un coup d’espingole avait grièvement blessé, et qu’il avait pris soin de faire panser, marchait au-dessus de lui, et que plusieurs fois, dans ses embarrassements, il lui offrit l’appui du seul bras dont l’imprudence des Français lui avait laissé l’usage [639]. Les navigateurs français ont quitté ces îles sans qu’aucun fait ait détruit ou affaibli la bonne opinion qu’ils avaient conçue de ces insulaires. Le navigateur russe qui les a visités n’a pas eu davantage à se plaindre d’eux. Il les a vus toujours gais et contents, la bonté paraissant peinte sur leur figure. Pendant les dix jours qu’il a passés avec eux, il n’a jamais été obligé de tirer un coup de fusil chargé à balle [640].
Le voyageur russe nous donne cependant des idées peu avantageuses des mœurs de ces peuples sur le témoignage d’un Français et d’un Anglais établis depuis longtemps parmi eux. Il a interrogé séparément ces deux hommes, et il a appris d’eux que ces peuples sont tous aussi faux et aussi perfides que ceux dont parle La Pérouse ; qu’ils sont continuellement en guerre les uns contre les autres ; qu’ils cherchent à vaincre leurs ennemis plutôt par surprise que par force ; et enfin qu’ils mangent leurs prisonniers [641]. Krusenstern a cru trouver la confirmation de ces rapports dans les crânes dont les insulaires lui ont proposé la vente, dans les cheveux et dans les ossements humains dont leurs armes et leurs meubles étaient ornés, et enfin dans leurs pantomimes [642]. Les navigateurs français, qui avaient cherché à découvrir quelles étaient les relations de ces peuples avec leurs voisins, n’avaient pu se procurer à cet égard des informations exactes ; mais, en voyant leurs armes offensives et les blessures graves dont quelques-uns portaient les cicatrices, ils avaient conjecturé que le fléau de la guerre ne leur était pas étranger [643].
Les deux individus dont le navigateur russe a recueilli les rapports ont affirmé, de plus, que, dans les temps de famine, les insulaires dévorent des enfants et des femmes ; mais les phénomènes qu’on observe dans les temps de famine ne peuvent que difficilement caractériser les mœurs d’un peuple dans son état naturel. On a vu des faits semblables à ceux qu’on reproche aux habitants des îles Marquises, chez les peuples les plus civilisés ; lorsque des équipages européens, abandonnés au milieu des mers, ont été réduits à l’horrible nécessité de faire comme eux ou de périr, ce dernier parti est celui qu’ils ont repoussé. Pour juger d’ailleurs que ces insulaires sont inférieurs, sous ce rapport, aux habitants des autres îles, il faudrait les avoir observés tous dans les mêmes circonstances. Cook a trouvé dans la Nouvelle-Zélande des parents qui lui ont abandonné leurs enfants avec autant de facilité qu’ils eussent abandonné les plus méprisables des animaux. Marchand, au contraire, a observé dans les îles Marquises, des pères qui accablaient leurs enfants de caresses. « Souvent, dit-il, des hommes pressaient tendrement dans leurs bras des enfants dont ils se glorifiaient d’être pères [644]. »
On ne trouve donc chez les peuples d’espèce malaie qui habitent sous des climats froids ou tempérés, aucune supériorité morale sur les peuples de même espèce qui habitent sous des climats chauds. On trouve, au contraire, chez plusieurs de ceux-ci moins d’énergie dans les passions malveillantes, et plus de force dans les affections sociales que dans ceux-là.
[II-412]
CHAPITRE XXV.↩
Des rapports observés entre les moyens d’existence et l’état social des peuples d’espèce nègre, de la Nouvelle-Hollande et de quelques îles du grand Océan. — Des mœurs de ces peuples sous différents degrés de latitude.
Les peuples d’espèce nègre ou éthiopienne, répandus dans quelques îles du grand Océan, sont inférieurs, sous beaucoup de rapports aux peuples d’espèce malaie. Leur industrie étant nulle ou du moins très peu avancée, les navigateurs n’ont pu se procurer des vivres chez eux ; ils ont eu par conséquent moins d’occasions de les observer. Ils nous ont cependant donné un nombre suffisant de faits pour comparer entre elles les peuplades qui appartiennent à cette espèce d’hommes, et pour déterminer quelques-unes des principales circonstances physiques qui ont arrêté ou favorisé leur développement.
La fausseté est un des caractères qu’on rencontre chez tous les peuples qui ne sont pas encore sortis de l’état de barbarie. Il n’en est presque aucun qui ne sache cacher les sentiments de haine et de malveillance qui l’animent, sous les dehors de la bonté et de la franchise. Les peuples les plus sauvages, qui sont toujours les moins forts et les moins nombreux, sont donc les plus difficiles à juger, lorsqu’ils sont visités par des hommes qui ont évidemment plus de force qu’ils n’en ont eux-mêmes. Il faut, pour que leur naturel se montre tel qu’il est, ou qu’il se rencontre des circonstances dans lesquelles ils se croient les plus forts, ou qu’ils attribuent à des sentiments de crainte les ménagements et la bienveillance qu’on a pour eux. On a plusieurs fois observé une différence considérable de mœurs entre deux peuplades peu éloignées l’une de l’autre et également peu avancées dans la civilisation. Lorsqu’on a cherché les causes de la férocité de l’une et de la douceur de l’autre, on a presque toujours remarqué qu’on s’était présenté chez celle-là avec les apparences de la faiblesse, tandis qu’on s’était présenté chez celle-ci avec des forces et un appareil imposants [645]. Ainsi, il ne faut pas se hâter de juger trop favorablement d’un peuple encore barbare, s’il manifeste des sentiments de douceur, de bienveillance, envers des hommes qui ont le moyen de lui faire plus de bien qu’il ne peut leur faire de mal.
On n’a vu chez les indigènes de la terre de Van-Diemen aucun genre d’organisation sociale. On a observé seulement que deux individus qui étaient les plus grands et les plus forts de la peuplade, avaient chacun deux femmes, tandis que les autres n’en avait qu’une [646]. C’est là, sans doute, ce qui constitue la prérogative de ceux qui dirigent les autres, lorsqu’ils font une partie de chasse ou qu’ils vont attaquer les peuplades avec lesquelles ils sont en guerre, seules circonstances où le besoin de chefs puisse se faire sentir par des hommes qui vivent des fruits de la chasse et de la pêche, ou des produits spontanés de la terre. Il n’y a donc pas chez ces peuples une classe qui soit asservie à une autre.
Les indigènes de la terre de Van-Diemen n’ont point d’habitations fixes : ils errent en petites troupes, de place en place, pour chercher de la nourriture. On ne voit jamais plus de trois ou quatre huttes dans un endroit, chacune pouvant contenir tout au plus trois ou quatre personnes. Les familles vivent dans une parfaite indépendance les unes des autres ; quelquefois on en rencontre qui errent isolées sur le rivage de la mer ; mais on observe toujours une grande subordination des membres au chef. Faibles par leur isolement, par leur organisation physique, par leur ignorance et par leur maladresse, ces hommes vivent dans une méfiance et dans des alarmes continuelles. L’apparition d’un individu inconnu leur fait prendre la fuite, à moins qu’ils ne le jugent beaucoup plus faible qu’eux ; car, alors, leur premier mouvement est de l’attaquer [647].
[II-415]
L’absence de subordination sociale, de culture et de richesses, abrège beaucoup l’examen des mœurs de ces insulaires ; car il ne peut être question de leurs relations comme gouvernants et comme gouvernés, comme propriétaires et comme cultivateurs, comme maîtres et comme domestiques. Les seuls rapports sous lesquels on ait à les considérer, sont ceux qui résultent de l’état de famille, de l’état de communauté, et ceux qu’ils peuvent avoir avec d’autres peuplades ou avec des individus qui ne font point partie de leur association.
Si l’on peut juger du sort de leurs femmes par leur physionomie, et par l’aspect qu’elles présentent, il est douteux qu’il en existe de plus misérables. Une figure ignoble et grossière, barbouillée de charbon et de graisse, un regard sombre et farouche, des formes généralement maigres et flétries, des mamelles longues et pendantes, le corps couvert de cicatrices, et l’air inquiet et abattu qu’impriment le malheur et la servitude sur le front de tous les être asservis, tels sont les traits sous lesquels elles se sont présentées aux naturalistes français. La terreur que leur inspirait la présence de leurs maris, et les dangers ou les travaux auxquels on les a vues condamnées, ont expliqué d’une manière non équivoque les causes de leur dégradation et de leurs cicatrices [648].
[II-416]
Les femmes sont chargées de pourvoir à la subsistance de la famille, et se livrent seules aux travaux que la pêche exige. Lorsque l’heure des repas arrive, les mères, suivies de leurs filles, ayant un sac ou un panier attaché au cou, s’arment d’un bâton, et vont se précipiter au fond de la mer, au risque de rester engagées dans les plantes marines, ou d’être dévorées par les requins. Là, elles cherchent à faire provision d’oreilles de mer ou de homards ; quand la respiration leur manque, elles paraissent un instant sur l’eau, et s’y replongent encore, jusqu’à ce que la provision soit complète. Elles font ensuite cuire, à des feux qu’elles ont allumés d’avance, les produits de leur pêche ; et, pendant que les hommes s’en nourrissent sans leur en offrir aucune partie, elles se retirent en groupe derrière ces maîtres sévères, n’osant se permettre ni de parler, ni même de lever les yeux. Le repas fini, elles se lèvent et vont leur chercher l’eau dont ils ont besoin pour s’abreuver [649]. S’il s’agit de changer de lieu, les femmes sont transformées en bêtes de somme ; elles mettent dans des sacs les objets qui doivent les suivre ; fixent ces sacs autour du front par un cercle de cordages ; et, quel qu’en soit le poids, les emportent sur leur dos. Les hommes ne leur prêtent aucun secours, et marchent libres derrière elles [650].
La dureté des hommes ne se manifeste pas seulement par les nombreuses cicatrices qu’on observe sur les corps des femmes, par la terreur qu’ils leur inspirent, par les travaux auxquels ils les condamnent ; elle se manifeste surtout par l’expression de leur physionomie. Les passions qui les agitent s’y peignent avec force, s’y succèdent avec rapidité. Mobiles comme leurs affections, tous leurs traits se changent, se modifient suivant elles. Leur figure, effrayante et farouche dans la menace, est, dans le soupçon, inquiète et perfide ; dans le rire, elle est d’une gaieté folle et presque convulsive chez les jeunes gens ; chez les plus âgés, elle est triste, dure et sombre. Mais, en général, dans tous les individus et dans quelque moment qu’on les observe, le regard conserve toujours quelque chose de sinistre et de féroce, qui ne saurait échapper à un observateur attentif, et qui ne correspond que trop au fond de leur caractère [651].
Un naturaliste a fait sur ces peuplades une remarque singulière : il a observé qu’elles ne paraissent avoir aucune idée de l’action d’embrasser. L’idée de caresse ne semble pas leur être moins étrangère ; en vain on leur a fait tous les gestes propres à caractériser cette action, leur surprise a toujours prouvé qu’ils ne la concevaient pas. Ainsi, ces deux actions qui nous paraissent si naturelles, les baisers et les caresses affectueuses, sembleraient être inconnues à ces peuplades grossières [652].
Cependant, quelle que soit la dureté des hommes de la terre de Van-Diemen envers les êtres de leur espèce qui sont plus faibles qu’eux, ils n’ont point cherché à trafiquer des faveurs de leurs femmes ni de leurs filles ; ils se sont, au contraire, montrés fort jaloux. Il paraît même, autant qu’on a pu les comprendre, que, dans chaque peuplade, les hommes respectent les femmes les uns des autres, et qu’ils considèrent la fidélité conjugale comme un devoir, au moins de la part du sexe le plus faible [653]. Les matelots anglais qui ont cherché à obtenir les faveurs des Diemenoises, ont été repoussés.
« On observera, dit Cook à ce sujet, que, parmi les peuplades peu civilisées, où les femmes se montrent d’un accès facile, les hommes sont les premiers à les offrir aux étrangers ; et que, s’ils ne les offrent pas, on essaiera en vain de les séduire avec des présents, on cherchera inutilement des lieux écartés. Je puis assurer que cette remarque est juste pour toutes les îles où j’ai relâché [654]. »
[II-419]
Cette différence que nous observons ici entre la conduite des habitants de la terre de Van-Diemen, et la conduite des peuples d’espèce malaie, se reproduit dans toutes les îles habitées par des peuples classés sous le nom d’espèce éthiopienne, quelle que soit la latitude sous laquelle ils sont placés : dans aucune île, les hommes de cette dernière espèce n’ont prostitué leurs femmes, ni souffert qu’elles se prostituassent.
Les peuplades de la terre de Van-Diemen sont si peu nombreuses, elles sont placées à une si grande distance les unes des autres, et leur temps est si complètement absorbé par le besoin de se procurer des subsistances, qu’on n’a pu observer les rapports qui peuvent exister entre les unes et les autres [655] ; mais la conduite qu’elles ont tenue envers les voyageurs qui leur ont paru inférieurs à elles en force ou en adresse, suffit pour faire voir que tout individu qui est étranger à une horde est traité par elle en ennemi ; elles ont le même caractère de perfidie et de férocité que les voyageurs ont reproché aux Malais les plus barbares ; lorsqu’elles ont rencontré l’occasion d’attaquer les voyageurs qui les avaient comblées de bienfaits, elles en ont profité, et leur férocité a paru s’accroître avec les ménagements qu’on a eus pour elles [656].
« J’avoue, dit Péron en parlant de ces peuples, que je suis surpris, après tant d’exemples de trahisons et de cruautés rapportés dans les voyages de découvertes, d’entendre répéter à des personnes sensées, que les hommes de la nature ne sont point méchants, que l’on peut se fier à eux ; qu’ils ne seront agresseurs qu’autant qu’ils seront excités par la vengeance. Malheureusement beaucoup de voyageurs ont été les victimes de ces vains sophismes. Pour moi, je pense, d’après tout ce que nous avons pu voir, qu’on ne saurait trop se méfier des hommes dont la civilisation n’a pas encore pu adoucir le caractère, et qu’on ne doit aborder qu’avec prudence sur les rivages habités par de tels hommes [657]. »
— Les indigènes de la Nouvelle-Hollande, quoique placés sous différents degrés de latitude, et répandus sur un immense territoire, ont tous à peu près les mêmes mœurs. Les hordes, un peu plus nombreuses, un peu moins rares, un peu moins dépourvues d’industrie que celles de la terre de Van-Diemen, sont aussi un peu plus avancées dans leur organisation sociale [658]. Cependant les peuplades les plus considérables comptent à peine une centaine d’individus, et la plupart en comptent moins de cinquante. Chez elles, toute différence de conditions, d’exercices, d’aliments, est inconnue : avec les mêmes besoins, avec les mêmes ressources, tous les individus de même âge et de même sexe ont les mêmes travaux à supporter, les mêmes privations à subir, les mêmes jouissances à partager. Cette uniformité qui se reproduit dans tous les détails de leur existence, et qui se soutient à toutes les époques de la vie, imprime aux individus un caractère de similitude physique et morale dont on aurait peine à se former une juste idée dans notre état social [659].
Aucune des hordes de la Nouvelle-Hollande ne connaît l’agriculture, aucune n’est parvenue à soumettre d’autre animal que le chien ; et comme cet animal se nourrit des mêmes substances que l’homme, il ne peut pas être une ressource pour lui. La terre, abandonnée à sa fertilité naturelle, ne produit d’autres plantes alimentaires, dans ce pays, que quelques pieds de céleri sauvage ; le seul fruit que les arbres y donnent, est une espèce de figue qui ressemble à la pomme de pin, et qui a causé de violentes nausées aux Européens qui ont tenté d’en manger [660]. On n’y trouve point, comme dans le nord de l’Amérique, de ces nombreux troupeaux de bêtes sauvages, qui fournissent aux indigènes une proie abondante quand ils ont le bonheur de les cerner ; on n’y rencontre que deux quadrupèdes qui sont fort difficiles à prendre, et dont le plus gros, quand il n’est plus jeune, n’est guère meilleur à manger que le renard.
La pêche est la principale ressource des peuplades qui vivent sur les bords de la mer ; la chasse est le moyen qu’emploient à pourvoir à leur existence, celles qui vivent dans l’intérieur des terres ; mais, ni les unes ni les autres ne faisant jamais de provisions, il faut que le travail de chaque jour leur procure la subsistance de chaque jour : si la chasse et la pêche ne produisent rien, ce qui arrive fréquemment, la horde tout entière est réduite à jeûner, ou à chercher un supplément de subsistances dans des productions d’un autre genre ; aux approches de l’hiver, le poisson devenant rare, les hordes du sud émigrent vers le nord, pour y trouver des subsistances plus abondantes [661].
Les peuplades de l’intérieur ne se procurent qu’avec les plus grandes peines leur chétive subsistance. Pour prendre les animaux les plus petits, tels que l’oppossum et l’écureuil volant, ou pour recueillir un peu de miel, il faut que les hommes grimpent sur de grands arbres, et ils ne peuvent parvenir jusqu’aux branches qu’en faisant sur le tronc, ordinairement très élevé, des entailles pour poser leurs pieds et leurs mains [662]. S’ils restent plusieurs jours sans prendre de gibier, ce qui arrive fréquemment, la famine se manifeste : ils font alors une guerre active aux grenouilles, aux lézards, aux serpents, aux chenilles et aux araignées ; ils mangent de l’herbe et rongent l’écorce de certains arbres ; enfin, ils pétrissent des fourmis avec leurs larves et des racines de fougère, et calment leur estomac avec la pâte qui résulte de ce mélange. Dans ces temps de famine, qui sont très fréquents, ces hommes arrivent à un tel excès de maigreur qu’on les prendrait pour des squelettes, et qu’ils paraissent sur le point de succomber d’inanition [663].
[II-424]
Les hordes qui vivent sur les côtes ne sont pas moins exposées à la famine que celles de l’intérieur. Si la saison ou l’état de la mer ne leur permettent pas de prendre du poisson ou des coquillages, elles se nourrissent de gros vers qui répandent une odeur infecte, ou d’autres aliments aussi grossiers. Quelquefois le mauvais temps, qui leur rend la pêche impossible, fait échouer une baleine sur les côtes ; les hordes qui la rencontrent poussent des cris de joie, oublient leurs haines mutuelles, se précipitent sur leur proie, et ne songent plus qu’à se rassasier : on la déchire de tous les côtés à la fois ; chacun mange, dort, se réveille, mange et dort encore ; mais dès que les derniers lambeaux corrompus ont été dévorés, les ressentiments se réveillent, des combats meurtriers succèdent à ces dégoûtantes orgies, et l’on l’égorge sur des ossements [664].
Les diverses peuplades qui habitent la Nouvelle-Hollande, diffèrent sur quelques points dans leur constitution physique ; elles semblent former trois variétés de la même espèce ; mais on n’a observé entre elles aucune différence intellectuelle ou morale : elles pourvoient toutes à leurs besoins par des moyens semblables, et ont par conséquent une manière uniforme de se conduire. N’ayant pas d’autre propriété individuelle que quelques mauvaises armes, et ne faisant jamais de provision, elles n’ont aucun besoin de gouvernement. Il doit leur suffire d’avoir un chef qui les dirige lorsqu’elles sont en guerre les unes contre les autres ; et il ne paraît pas, en effet, qu’elles aient un gouvernement plus compliqué.
Les rapports qui existent entre les deux sexes, sont ici tels qu’on les trouve chez tous les peuples sauvages ; mais ils s’établissent cependant d’une manière particulière. Quand un homme veut se procurer une femme, il épie, dans une tribu autre que la sienne, quelle est celle qui peut lui convenir. Ayant fait son choix, il cherche à surprendre cet objet de ses amours ; s’il l’aperçoit à l’écart, il fond sur elle, l’étourdit d’un coup de massue sur la tête, la saisit par un bras ou par une jambe, et la traîne à travers les broussailles, jusqu’à ce qu’il l’ait conduite en lieu de sûreté [665].
Ici, comme sur la terre de Van-Diemen, les femmes sont les esclaves des hommes ; elles sont chargées de ramasser les coquillages, d’aller à la pêche, et de conduire les canots : ces travaux ne sont pas suspendus pendant le temps de l’allaitement [666]. Elles sont traitées d’une manière dure et cruelle : aussi, elles ont généralement l’air plus sombre que les hommes [667]. On ne voit jamais sur elles aucune espèce d’ornement, tandis que les hommes se parent de dents de chien, de bras d’écrevisse, ou de petits os [668].
Ces peuples, quand ils se sentent les plus faibles, affectent la douceur et la bienveillance ; mais aussitôt qu’ils ont quelques raisons de se croire les plus forts, ils se montrent insolents et féroces ; les ménagements dont on use à leur égard sont imputés à la faiblesse, et ne servent qu’à augmenter leur insolence : ils sont donc faux et méfiants comme tous les sauvages [669].
Ils sont tous d’une malpropreté dégoûtante, non seulement dans leurs aliments, mais dans toute leur personne ; ils exhalent une forte odeur d’huile, et ils sont couverts d’un tel amas d’ordures qu’il est très difficile de connaître la véritable couleur de leur peau.
« Nous avons essayé plusieurs fois, dit Cook, de la frotter avec les doigts mouillés pour en ôter la croûte, mais toujours inutilement. Ces ordures les font paraître aussi noirs que des nègres, et, suivant ce que nous pouvons en juger, leur peau est couleur de suie [670]. »
Les habitants de la Nouvelle-Calédonie, plus avancés vers l’équateur que ceux de la terre de Van-Diemen et que la plupart de ceux de la Nouvelle-Hollande, appartiennent à la même espèce ; ils ont déjà fait quelques progrès dans l’industrie, ainsi qu’on l’a vu ailleurs ; ils forment une population plus nombreuse, et sont soumis à des chefs qui ont sur eux un peu plus d’autorité [671]. Ces chefs s’emparent quelquefois des choses qui appartiennent à leurs inférieurs, et qui excitent leur cupidité ; cependant ils ne se livrent pas à ces actes de violence si communs parmi les chefs d’espèce malaie [672] ; leur autorité paraît, au contraire, si faible, que les égards qui leur sont accordés approchent plus de la déférence que de la soumission [673]. Ces peuples paraissent n’avoir été ni conquis, ni conquérants ; chez eux, aucune classe n’est assujettie à une autre.
Les femmes, parmi eux, sont traitées aussi d’une manière moins dure que chez les peuples de même espèce qui vivent sous un climat plus froid. Elles sont chargées d’une partie des travaux de l’agriculture et de la pêche ; elles défrichent ou bêchent la terre ; elles vont dans la mer chercher des coquillages, et sont quelquefois chargées de transporter de pesants fardeaux. Cependant les hommes partagent avec elles les premiers de ces travaux ; et dans leurs pêches, elles ne se donnent pas les mêmes peines et ne s’exposent pas aux mêmes dangers que les femmes de la terre de Van-Diemen. Toutes ne paraissent pas d’ailleurs condamnées au même sort ; quelques-unes seulement s’avancent assez dans la mer pour avoir de l’eau jusqu’à la ceinture [674]. L’on n’a pas remarqué sur elles ces nombreuses cicatrices que portent les femmes de la terre de Van Diemen et de la Nouvelle-Hollande, quoiqu’elles se tiennent comme elles éloignées de leurs maris, et paraissent craindre de les offenser même par leurs regards ou par leurs gestes [675]. Elles ont d’ailleurs les traits désagréables et le regard féroce [676].
Les diverses peuplades de cette île, lorsqu’elles sont en guerre les unes contre les autres, y portent la même animosité et la même fureur que nous avons observées chez les peuples d’espèce malaie ; dans les invasions qu’elles font sur le territoire les unes des autres, elles incendient les habitations, détruisent les récoltes, abattent les arbres [677]. La faim attaque alors ceux que les armes n’ont point détruits ; et, pour échapper aux horreurs de la famine, ou pour en sauver leurs femmes et leurs enfants, ceux qui ont été défaits reprennent les armes, fondent à leur tour sur leurs ennemis, les dévorent s’ils sont vainqueurs, ou leur servent de pâture s’ils sont de nouveau vaincus [678].
Ces insulaires, qui semblaient être en paix entre eux lorsqu’ils furent visités par le capitaine Cook, reçurent les navigateurs anglais avec bienveillance, et leur laissèrent librement parcourir leur pays :
« Il est aisé de voir, dit Cook en parlant d’eux, qu’ils n’ont reçu en partage de la nature qu’un excellent caractère. Sur ce point, ils surpassaient toutes les nations que nous avions connues ; et, quoique cela ne satisfît pas nos besoins, nous étions charmés de lui trouver cette qualité qui nous procurait une paix et une liberté précieuses [679]. »
Mais, lorsqu’ils ont été visités par des navigateurs français, leur position était changée, et l’on a trouvé chez eux la misère, les ravages et les mœurs qui, chez de tels peuples, sont les conséquences de la guerre.
Les Français leur ayant fait voir des cocos et des ignames en les engageant à leur en apporter, les insulaires, bien loin d’en aller chercher, voulurent acheter ceux qu’on leur montrait, et offrirent en échange leurs sagaies et leurs massues ; ils faisaient connaître qu’ils avaient grand faim, en montrant leurs ventres qui étaient extrêmement aplatis [680]. Les officiers et le naturaliste de l’équipage, ayant pénétré dans l’intérieur de l’île, trouvèrent les habitants d’une maigreur extrême ; les femmes et les enfants ressemblaient à de véritables squelettes [681]. Les aliments dont ils se nourrissaient, étaient des araignées, des pousses d’arbres, des racines peu substantielles ; et quand cela ne suffisait pas, ils apaisaient leur faim en mangeant de la terre [682].
On doit être peu surpris que des peuples encore barbares qui sont réduits à une si horrible misère, finissent par dévorer leurs ennemis, et s’habituent à se nourrir de chair humaine.
« Quelques-uns, dit Labillardière, se rapprochèrent des plus robustes d’entre nous et leur tâtèrent à différentes reprises les parties les plus musculeuses des bras et des jambes, en prononçant kapareck d’un air d’admiration et même de désir, ce qui n’était pas très rassurant pour nous ; cependant ils ne nous donnèrent aucun sujet de mécontentement [683]. »
Pendant le séjour des Français dans cette île, ils virent des habitants disparaître pendant quelques temps et revenir avec les cadavres des ennemis qu’ils avaient tués, et qu’ils apportaient à leurs familles comme des chasseurs apportent du gibier [684].
Les habitants de Tanna, situés sous une latitude un peu moins élevée que ceux de la Nouvelle-Calédonie, semblent aussi en différer de fort peu par les mœurs. Chaque village et chaque famille paraissent indépendants ; les vieillards, et les hommes les plus remarquables par leur force, sont ceux qui semblent avoir le plus d’autorité : on ne remarque parmi eux aucune distinction de rangs [685]. Les villages sont en guerre les uns contre les autres, et les usages, en pareille circonstance, ne paraissent pas différents de ceux de la Nouvelle-Calédonie [686]. Les Anglais, en abordant à Tanna, ont été reçus par les habitants avec des provocations et des menaces ; mais ils sont parvenus cependant à les calmer, en les intimidant par le bruit des armes [687].
Les femmes sont encore ici chargées des travaux les plus pénibles : tandis que les hommes marchent libres derrière elles, portant seulement leurs armes, elles sont obligées de porter tout à la fois leurs enfants et les fardeaux dont leurs maris les accablent ; si elles ne peuvent pas porter ces fardeaux, elles les traînent ; elles ne sont proprement que des bêtes de somme et obéissent au moindre signe des hommes [688]. Cependant, quelque dure que soit leur condition, elle l’est moins que celle des femmes de la Nouvelle-Calédonie ; les hommes ne leur inspirent pas la même terreur, ne les tiennent pas à la même distance [689]. Ils exécutent d’ailleurs eux-mêmes les travaux les plus pénibles, ceux qui consistent à mettre la terre en culture, à couper ou à déraciner des arbres et des broussailles avec des haches de pierre [690]. Ces insulaires ont pour la propriété plus de respect qu’on n’en trouve ordinairement chez les peuples qui ne sont pas plus avancés dans la civilisation. Dans le premier moment de leur entrevue avec les Anglais, ils s’emparaient de tout ce qui leur tombait sous la main ; mais quand il se fut établi entre eux des relations amicales, ils ne se rendirent coupables d’aucun vol [691].
« Les Tahitiens, dit Forster, sont ordinairement obligés de suspendre leurs richesses aux toits de leurs maisons, pour les ôter de la portée des voleurs ; mais ici elles sont en sûreté sur le premier buisson. À l’appui de cette remarque, j’observerai que, durant notre séjour parmi les insulaires à Tanna, ils n’ont pas dérobé la moindre bagatelle à qui que ce soit de l’équipage [692]. »
Les habitants des Nouvelles-Hébrides qui appartiennent à la même espèce et qui sont plus rapprochés de l’équateur de quelques degrés, se sont mieux conduits encore. Non seulement ils n’ont donné aucun sujet de plainte aux navigateurs anglais ; mais, lorsqu’ils auraient pu, sans danger et même sans pouvoir être accusés de mauvaise foi, retenir des objets qu’ils avaient vendus, ils ont fait tout ce qui a dépendu d’eux pour les rendre aux propriétaires.
« Ils nous donnèrent, dit Cook, des preuves si extraordinaires de leur loyauté que nous en fûmes surpris. Comme le vaisseau marcha d’abord fort vite, nous laissâmes en arrière plusieurs de leurs canots qui avaient reçu nos marchandises, sans avoir eu le temps de donner les leurs en échange. Au lieu de profiter de cette occasion pour se les approprier, comme auraient fait nos amis des îles de la Société, ils employèrent tous leurs efforts pour nous atteindre et nous remettre ce dont ils avaient reçu le prix. Un des Indiens nous suivit pendant un temps considérable, et le calme survenant il parvint à nous joindre. Dès qu’il fut au vaisseau, il montra ce qu’il avait vendu ; plusieurs personnes voulurent le lui payer ; mais il refusa de s’en défaire jusqu’à ce qu’il aperçût celui qui le lui avait déjà acheté. La personne ne le connaissant pas, lui en offrit de nouveau la valeur ; mais cet honnête Indien ne voulut point l’accepter, et lui fit voir ce qu’il avait reçu en échange [693]. »
Les peuples d’espèce nègre du grand Océan, qui sont les plus rapprochés des tropiques, sont donc, en général, beaucoup moins barbares que ceux qui en sont les plus éloignés.
[II-435]
CHAPITRE XXVI.↩
Des rapports observés entre les moyens d’existence et l’état social des peuples d’espèce nègre de l’extrémité australe de l’Afrique. — Des mœurs qui résultent de cet état.
Les peuplades qui habitent à l’extrémité australe de l’Afrique, diffèrent tellement entre elles par leur constitution physique, elles diffèrent tellement des peuples du même continent placés entre les tropiques, qu’il n’est peut-être pas très juste de les classer sous la même dénomination. Cependant, comme c’est ainsi que ces peuples ont été déjà classés, et comme il s’agit moins de déterminer les différences physiques qui existent entre eux que de constater l’influence des lieux et des climats sur le perfectionnement moral des hommes des diverses espèces, j’adopte la classification qui a été faite, sans prétendre néanmoins qu’elle soit la meilleure.
Trois races d’hommes existent au cap de Bonne-Espérance, sans compter les colons, ni les nègres qu’ils y ont introduits : ce sont les Cafres, les Hottentots et les Boschismans. Les premiers, habitant sur les côtes de la mer, dans les lieux les plus bas et les plus rapprochés de l’équateur, jouissent du sol le plus fertile et de la température la plus douce ou la plus chaude : ces peuples sont agriculteurs, pasteurs et chasseurs. Les seconds habitent sur des plaines élevées et arides, ils sont un peu plus éloignés de l’équateur, et jouissent par conséquent d’une température moins douce : ils ne sont que pasteurs et chasseurs. Les troisièmes habitent sur des montagnes élevées et arides : ils sont sous un climat comparativement froid : ils ne vivent que de chasse ou de proie.
Nous avons déjà vu que les individus qui appartiennent à la première de ces trois races d’hommes, jouissent d’une constitution physique plus forte et ont une taille plus élevée que les individus de la seconde race, et que ceux-ci à leur tour sont plus grands et mieux constitués que les individus dont la troisième race est composée ; nous avons vu ensuite que les facultés intellectuelles sont un peu plus développées chez les premiers que chez les seconds, et qu’elles le sont un peu plus chez ceux-ci qu’elles ne le sont chez les troisièmes. Il s’agit maintenant d’exposer quel est le perfectionnement moral auquel chacune de ces trois classes d’hommes est parvenue, et de comparer leurs mœurs à celles des peuples qu’on a classés sous la même dénomination, mais qui vivent sous la zone torride.
Les Cafres, quoiqu’ils cultivent la terre, tirent de leurs troupeaux la partie la plus considérable de leur subsistance, et sont obligés de changer souvent de lieu pour les faire paître [694]. Ils ne sont ni conquérants ni conquis, et ont par conséquent une organisation sociale moins compliquée que celle des peuples de ce continent placés entre les tropiques. Ils reconnaissent un chef héréditaire ; mais ce chef n’a presque point de prérogatives, et vit de la même manière que tous les autres individus de sa tribu [695].
Les femmes ne sont cependant pas moins esclaves chez eux que chez les autres peuples nègres ; elles sont condamnées aux travaux les plus pénibles ; non seulement elles labourent la terre, sèment et recueillent le grain, mais elles fabriquent leurs meubles, bâtissent les habitations et en rassemblent les matériaux [696]. La garde des troupeaux, la chasse et la guerre sont le partage des hommes [697]. Les femmes étant asservies, un individu en possède souvent plusieurs. Dans le temps de leurs incommodités périodiques, elles sont obligées de se séquestrer comme les femmes de Guinée, et comme celles des peuples cuivrés du nord de l’Amérique. Elles n’ont aucune part des biens que leurs parents laissent en mourant. Dans leur parure elles sont moins recherchées que les hommes [698].
Les Cafres portent, dans leurs guerres, le même esprit d’animosité et de vengeance que les autres peuples qui vivent sur les mêmes côtes. Si un village est surpris, tous les habitants en sont exterminés, et le pays est converti en désert [699]. Ces peuples cependant mettent moins de perfidie dans leurs guerres que les Hottentots ; ils attaquent souvent leurs ennemis de front, et n’empoisonnent point leurs flèches.
« Le Cafre, dit Levaillant, cherche toujours son ennemi face à face ; il ne peut lancer sa sagaie qu’il ne soit à découvert. Le Hottentot, au contraire, caché sous une roche ou derrière un buisson, envoie la mort sans s’exposer à la recevoir ; l’un est le tigre perfide qui fond traîtreusement sur sa proie ; l’autre est le lion généreux qui s’annonce, se montre, attaque, et périt s’il n’est pas vainqueur [700] ».
Les Cafres ont eu assez d’énergie et de puissance pour mettre des bornes aux usurpations des colons hollandais ; les Hottentots ont laissé envahir tout leur territoire [701]. Enfin, les Cafres, sans être très propres, sont beaucoup moins sales que les Hottentots [702].
[II-439]
Les tribus hottentotes n’ont pas toutes les mêmes mœurs : elles avaient généralement adopté la vie pastorale quand les Hollandais prirent possession du cap de Bonne-Espérance ; elles suppléaient, par le moyen de la chasse, à ce qu’elles ne pouvaient pas retirer de leurs troupeaux ; un petit nombre seulement était étranger à la vie pastorale et ne vivait que de proie. Quoique l’envahissement de leur territoire par les Européens, et l’oppression qui en a été la conséquence, aient beaucoup altéré leurs mœurs, on peut juger de leur ancien état par les descriptions que les voyageurs nous ont données de l’état où ils les ont vus.
Chaque peuplade est soumise à un chef ou capitaine qui n’avait probablement pas d’autres fonctions autrefois que de marcher à la tête de sa tribu, lorsqu’elle allait à la chasse, ou qu’elle voulait attaquer une tribu ennemie. Ce chef n’est maintenant qu’un officier de police, qui tient son autorité, et le bâton qui en est le signe, du chef de la colonie hollandaise, aujourd’hui soumise aux Anglais. Son autorité n’est pas toujours très respectée, et dans les querelles qui surviennent, il lui arrive quelquefois de voir briser sur lui-même son bâton de commandement [703].
Les femmes ne sont pas moins esclaves, ni moins avilies dans cette partie de l’Afrique que sous les climats les plus brûlants. Un Hottentot, qui donne un bœuf pour avoir un clou ou tout autre morceau de fer, croit faire un excellent marché en donnant une de ses filles en échange d’une vache [704]. Un homme peut avoir le nombre de femmes qu’il juge convenable ; mais il est rare qu’il en prenne plus de deux, et il n’y a même que les chefs qui se permettent ce genre de luxe [705]. Aussitôt qu’une femme appartient à un homme, c’est elle qui fait tous les travaux qu’exige l’entretien du ménage : elle va couper le bois dont elle a besoin pour préparer les aliments ; elle va à la recherche des racines dont ces peuples se nourrissent ; elle est en un mot traitée comme une esclave. Le mari, qui n’a d’autre occupation que de boire, de manger, de fumer et de dormir, ne lui laisse prendre de repos que dans le petit nombre d’occasions où il s’éloigne, soit pour aller à la chasse ou à la pêche, soit pour veiller sur ses troupeaux. Une fille partage l’esclavage de sa mère, et concourt aux mêmes travaux aussitôt qu’elle en a la force [706].
La femme n’est pas admise à manger avec son mari, ni même à loger toujours dans la même hutte ; elle vit dans une cabane séparée, et se nourrit d’aliments que son mari considère comme vils ou impurs [707]. Lorsqu’un garçon est jugé digne d’être admis parmi les hommes, il se sépare de ses sœurs et de sa mère, et ne les admet plus à manger avec lui : il peut alors les insulter et les traiter en esclaves, sans craindre d’en être puni par son père. Une mère est sans cesse exposée aux mauvais traitements de ses enfants ; loin que ces outrages soient considérés comme les effets d’un mauvais naturel, les hommes les considèrent comme des preuves non équivoques d’un courage mâle et d’une bravoure distinguée, et en applaudissent l’auteur [708]. Les Hottentotes sont obligées de se tenir séquestrées à une certaine distance de la horde, dans le même cas que les femmes des Cafres [709]. Elles peuvent être renvoyées par leurs maris, et rester privées de toutes ressources, si elles ne sont pas défendues par leurs propres parents [710]. Elles sont généralement chastes et réservées dans leur conduite : on n’a trouvé qu’une seule tribu où elles aient paru ne pas l’être [711].
Si des enfants incapables de pourvoir par eux-mêmes à leurs besoins, perdent leur père et leur mère, non seulement ils ne sont secourus et protégés par personne, mais on se hâte de les ensevelir vivants, quel que soit leur âge, pour leur épargner les horreurs d’une plus longue agonie ; un enfant est enterré vivant, même lorsqu’il ne perd que sa mère, s’il n’est pas sevré au moment où elle meurt ; une femme qui accouche de deux jumeaux, en détruit ordinairement un, dans l’impuissance de les élever l’un et l’autre [712].
Les individus qui arrivent à la vieillesse, et qui ne peuvent plus ni se suffire à eux-mêmes, ni rendre des services à d’autres, sont relégués dans une cabane construite exprès ; on leur porte une fois à manger, et ensuite on les abandonne. Là, ils périssent de faim ou sont dévorés par les bêtes féroces : ce sort est réservé même aux vieillards qui possèdent des troupeaux et qui ont des enfants ; c’est celui de leurs fils à qui leurs biens sont exclusivement dévolus, qui prononce et exécute la sentence [713]. Les malades qu’on croit n’avoir pas le moyen de guérir, éprouvent le même sort [714].
Si telle est la destinée de tous les êtres faibles dans le cours ordinaire de la vie, il est aisé de voir quel est leur sort dans les cas où l’on ne peut échapper à l’ennemi que par la fuite, et dans les cas plus communs encore où une peuplade est attaquée par la famine. Dans de pareilles circonstances, les enfants, les vieillards, les malades, les traîneurs, en un mot, tous les êtres faibles, sont abandonnés ; ils meurent dans les tourments de la faim, ou sont massacrés. Ceux qui fuient, dit Levaillant, ne sont pas plus sûrs eux-mêmes d’échapper au fléau général : plus des trois quarts périssent dans la route, au milieu des sables et des rochers, brûlés par la soif et consumés par la faim ; le petit nombre qui survit, fait de longues marches avant que d’avoir trouvé quelques légères ressources [715].
Les Hottentots se distinguent de tous les peuples de la même espèce, par une saleté excessive, et par une invincible paresse. Ils se frottent habituellement, de la tête aux pieds, d’un mélange de graisse, de suie et d’excréments de leurs animaux ; et on les sent par l’odeur qu’ils exhalent, longtemps avant que de les voir. Les peaux de mouton qui les couvrent, et les huttes qu’ils habitent, sont, s’il est possible, plus sales encore que leurs personnes. Ils sont couverts de vermine, et ils ne s’en débarrassent que pour la manger [716].
Leur paresse de corps et d’esprit est telle, que rien n’est capable de les y faire renoncer, pas même la faim. Il n’est point de peuple sous le soleil, dit Kolbe, qui ait une pareille aversion pour penser et pour agir. On dirait qu’ils font consister leur félicité à vivre dans l’inaction et dans l’indolence [717]. Quand ils ont rassasié leur faim ils dorment ; et, si les moyens de l’apaiser leur manquent, ils dorment encore, et en calment ainsi les douleurs.
Éprouvant, comme tous les animaux qui vivent de proie, des alternatives de disette et d’abondance, ils contractent les mêmes habitudes.
« Le Hottentot, dit Levaillant, est gourmand tant qu’il a des provisions en abondance ; mais aussi, dans la disette, il se contente de peu ; je le compare, sous ce rapport, à l’hyène, ou même à tous les animaux carnassiers, qui dévorent toute leur proie dans un instant, sans songer à l’avenir, et qui restent en effet plusieurs jours sans trouver de nourriture, et se contentent de terre glaise pour apaiser leur faim. Le Hottentot est capable de manger en un seul jour dix à douze livres de viande : et, dans une autre circonstance défavorable, quelques sauterelles, un rayon de miel, souvent aussi un morceau de cuir de ses sandales, suffisent à ses besoins pressants. Je n’ai jamais pu faire comprendre aux miens qu’il était sage de réserver quelques aliments pour le lendemain ; non seulement ils mangent tout ce qu’ils peuvent, mais ils distribuent le superflu aux survenants ; la suite de cette prodigalité ne les inquiète en aucune façon. On chassera, disent-ils, ou l’on dormira. Dormir est pour eux une ressource qui les sert au besoin ; je n’ai jamais passé dans des contrées âpres et stériles où le gibier est rare, que je n’aie trouvé des hordes entières de sauvages endormis dans leurs kraals, indice trop certain de leur position misérable ; mais ce qui surprendra beaucoup, et que je n’annonce que sur des observations vingt fois répétées, c’est qu’ils commandent au sommeil, et trompent à leur gré le plus puissant besoin de la nature.
« Il est pourtant des moments de veille au-dessus de leurs forces et de l’habitude. Ils emploient alors un autre expédient non moins étrange, et qui, pour n’inspirer nulle croyance, ne cessera pas d’être un fait incontestable et sans réplique ; je les ai vus se serrer l’estomac avec une courroie ; ils diminuent ainsi leur faim, la supportent plus longtemps, et l’assouvissent avec bien peu de chose [718]. »
Leur imprévoyance égale leur paresse : les femmes, qui sont chargées de faire les provisions nécessaires à l’existence de la famille, en font rarement pour plus d’un jour. S’il leur arrive d’avoir quelques approvisionnements d’avance, ils sont disposés à les céder pour le premier objet qui les frappe, et qui ne peut être pour eux d’aucune utilité. Lorsque le mauvais temps, des pluies excessives ou des orages ne leur permettent pas de sortir selon leur coutume, la famille se trouve réduite à la plus grande disette, et ne vit qu’en mangeant les peaux desséchées qui lui ont longtemps servi de sandales [719].
Les fréquentes disettes qui sont la suite de leur imprévoyance et de leur paresse, leur font contracter l’habitude de se nourrir d’objets qui inspireraient une répugnance invincible à des peuples moins stupides et moins grossiers. Si le vent leur amène un de ces nuages de sauterelles qui sont un fléau pour les parties cultivées de l’Asie ou de l’Afrique, ils en manifestent une joie extraordinaire. Ils se hâtent de ramasser celles qui tombent ou se posent à terre ; ils en remplissent leurs magasins, et quelque infecte que soit l’odeur qu’elles exhalent, ils les mangent avec délices [720]. Si une baleine, un hippopotame, ou tout autre animal est jeté mort et à demi pourri sur le rivage de la mer, les Hottentots y courent et le dévorent sur la place, même quand ils ne sont pressés par aucun besoin extraordinaire [721]. Le vautour, qui exhale l’odeur putride des animaux dont il s’est toujours nourri, et que repoussent les animaux les plus carnassiers, est un mets qui n’est pas désagréable pour eux [722]. Ils mangent avec tant d’avidité et de saleté, qu’on les prendrait pour des bêtes féroces affamées [723].
En s’établissant au cap de Bonne-Espérance, les Hollandais, pour mieux assurer l’assujettissement des Hottentots, les ont privés de la faculté de porter des armes, même pour leur défense personnelle [724] ; s’il s’élève quelque différend entre deux tribus, ce sont eux-mêmes qui en décident [725]. Les haines et les antipathies nationales que la guerre produit chez toutes les nations, et qui sont si violentes chez les peuples encore barbares, doivent donc être très affaiblies chez les Hottentots, en supposant qu’elles y aient existé avec la même force qu’on a observée chez d’autres nations. Les voyageurs qui les ont visités n’ont éprouvé de leur part que de bons procédés ; ils ont trouvé chez eux de la générosité, de la reconnaissance, de la probité, de l’exactitude à tenir leurs promesses. Ils sont incapables de perfidie et même de dissimulation ; le mensonge leur est si étranger, qu’ils ne savent même pas cacher les crimes qu’ils ont commis ; si on les accuse d’un fait vrai, ils le reconnaissent et cherchent seulement à s’excuser. Ils sont susceptibles d’un attachement inviolable et d’une fidélité à toute épreuve envers les maîtres qu’ils servent [726]. Levaillant assure cependant que ceux qui vivent habituellement avec les colons, sont des hommes complètement dépravés : il est bien rare, dit-il, qu’ils ne deviennent pas des monstres ; mais il ne dit pas en quoi leurs vices consistent [727].
Les peuples dont je viens d’esquisser les mœurs, sont ceux qui, à l’extrémité australe de l’Afrique, ont adopté la vie pastorale. Mais il est, au milieu d’eux, des hommes qui sont encore moins avancés, et qui vivent dans une température plus froide ; ce sont les Boschismans, peuples qui ont fixé leurs habitations sur les montagnes. Il n’existe, parmi eux, aucune espèce de subordination sociale, quoiqu’on les rencontre quelquefois en troupes. Ils sont tellement isolés les uns des autres, qu’à côté de la caverne où vit une bête sauvage, on trouve une caverne dans laquelle vit la famille d’un Boschisman. Ils habitent dans les buissons ou dans les creux des rochers comme les bêtes féroces, dont ils ont adopté les mœurs. Ils vont ordinairement nus, à moins qu’une chasse heureuse ne leur ait donné le moyen de s’emparer d’un animal, car alors ils en portent la peau sur les épaules, jusqu’à ce qu’elle tombe en lambeaux [728]. Tant qu’ils peuvent trouver, au sein de leurs montagnes, des racines sauvages, des serpents, des chenilles, des araignées, des sauterelles, des fourmis ou d’autres insectes, ils s’en nourrissent et descendent rarement dans les plaines [729]. Mais, [II-450]quand ces aliments leur manquent, ils s’arment de leur petit arc et de leurs flèches empoisonnées ; ils descendent dans les vallées et vont se mettre en embuscade, attendant, comme les bêtes féroces, que le hasard fasse passer à leur portée quelque animal dont ils puissent faire leur proie [730].
« C’est dans les rochers les plus escarpés et dans les cavernes les moins accessibles, dit Levaillant, qu’ils se retirent et passent leur vie. Dans ces endroits élevés, leur vue domine au loin sur la plaine, épie les voyageurs et les troupeaux épars ; ils fondent comme un trait, et tombent à l’improviste, sur les habitants et les bestiaux, qu’ils égorgent indistinctement ; chargés de leur proie et de tout ce qu’ils peuvent emporter, ils regagnent leurs antres affreux qu’ils ne quittent, pareils aux lions, que lorsqu’ils s’en sont rassasiés, et que de nouveaux besoins les poussent à de nouveaux massacres. Mais comme la trahison marche toujours en tremblant, et que la seule présence d’un homme déterminé suffit souvent pour en imposer à ces troupes de bandits, ils évitent avec soin les habitations où ils sont assurés que réside le maître ; l’artifice et la ruse, ressources ordinaires des âmes faibles, sont les moyens qu’ils emploient et les seuls guides qui les accompagnent dans leurs expéditions [731]. »
[II-451]
Les Boschismans sont assujettis à des privations plus longues encore que celles qu’éprouvent les Hottentots ; mais c’est surtout dans les temps où leurs forces sont affaiblies ou ne sont pas encore développées, que ces hommes sont sujets à manquer d’aliments : alors leur principale nourriture se compose de fourmis. Souvent j’ai vu avec peine, dit Sparrman, quelques-uns de ces pauvres vieillards fugitifs épuiser sur ces monticules endurcis le reste de leurs forces, pour n’y trouver, lorsqu’ils sont enfin brisés, qu’un animal usurpateur, qui, après s’être glissé dans le nid, a mangé les fourmis et consommé leurs provisions [732]. Ces hommes, comme les animaux qui vivent de proie, supportent la faim pendant un temps très considérable ; mais, quand ils peuvent se rendre maîtres d’une pièce de gros gibier, ils mangent une quantité prodigieuse de viande ; s’ils sont obligés de rejeter une partie des aliments qu’ils ont pris, parce que la capacité de leur estomac n’est pas en proportion de la voracité de leur appétit, ils se remettent à manger pour remplir le vide qui s’est opéré [733].
Les Boschismans sont en état de guerre avec tous les peuples qui les environnent ; mais ce sont les colons hollandais qui sont pour eux les ennemis les plus dangereux. Souvent, les colons et même les autres peuplades qui environnent les Boschismans, dit Péron, font une chasse ou battue sur ces malheureux, et tuent sans pitié comme sans remords tous ceux qu’ils trouvent. Les Hollandais conservent cependant quelquefois les jeunes enfants, pour les élever à garder leurs troupeaux ; mais ils prétendent que jamais, même quand ils sont élevés chez eux, ils ne peuvent leur faire perdre leurs premières inclinations vagabondes [734].
Ces peuples sont sans courage ; lorsqu’ils sont surpris, les plus intrépides cherchent leur salut dans la fuite, les autres se laissent prendre ou égorger sans résistance. Il suffit de six ou sept colons, pour environner pendant la nuit une troupe de cinquante ou même de cent individus, et pour se rendre maîtres de la plupart d’entre eux. Quand les colons se sont formés en cercle autour de la peuplade, ils donnent l’alarme par quelques coups de feu : ce bruit inattendu répand parmi les sauvages une si grande consternation, qu’il n’y a que les plus hardis et les plus intelligents qui osent franchir le cercle et se sauver ; et les colons, débarrassés de ceux qu’ils craignaient le plus, amènent les autres tremblants et stupides de frayeur [735].
Ces peuples sont trop sauvages et trop dénués de toutes ressources pour qu’aucun voyageur ait pu aller s’établir parmi eux, et étudier leurs mœurs domestiques ; mais il est facile de voir que, de tous les indigènes du cap, les plus faibles, les plus lâches et les plus barbares, sont ceux qui habitent dans les lieux les plus élevés, les plus froids et les plus arides ; et que les peuples qui habitent sur le rivage de la mer et sur les bords des rivières, sont les plus forts, les plus courageux et les moins reculés dans la civilisation.
[II-454]
CHAPITRE XXVII.↩
Des rapports observés entre les moyens d’existence et l’état social des peuples d’espèce nègre des côtes occidentales d’Afrique situées entre les tropiques. — Du genre d’inégalités qui existent chez ces peuples. — Des mœurs qui résultent de ces inégalités. — Parallèle entre les mœurs de ces peuples et les mœurs des peuples de même espèce qui vivent à l’extrémité australe de ce continent.
Les diverses classes dont un peuple se compose, exercent les unes sur les autres une influence si étendue, qu’il n’est presque pas possible de se faire des idées exactes des mœurs de chacune des fractions dont il est formé, si l’on ne commence par se faire une idée générale de l’ordre social vu dans son ensemble. Je dois donc faire connaître ici, comme dans les chapitres précédents, quelle est la constitution générale de chaque association, avant que d’exposer quels sont les rapports qui existent, soit entre les diverses fractions dont chaque peuple se compose, soit entre les nations que mettent en contact des relations de commerce ou une contiguïté de territoire.
En étudiant les mœurs des peuples d’espèce malaie, répandus dans les îles du grand Océan, nous avons aperçu, dans les archipels les plus rapprochés de l’équateur, deux races d’hommes sur le même sol : une race de vaincus cultivant la terre dont ils furent jadis les maîtres, vivant dans le mépris et la misère, n’ayant pas même d’habitations pour se reposer, obligés de se nourrir des aliments les plus vils, et étant sans liaisons les uns avec les autres ; et une race de vainqueurs, organisés pour l’intérêt de la conquête ; vivant dans l’oisiveté ou ne se livrant qu’aux exercices propres à maintenir leur supériorité sur les vaincus, n’accordant de l’estime qu’aux objets dont ils peuvent avoir la possession exclusive, maîtres absolus des habitations, des terres et même des cultivateurs. Nous avons vu de plus l’organisation sociale, assez compliquée dans les mêmes archipels, s’affaiblir ou se simplifier à mesure qu’on s’éloigne des îles qui ont fait le plus de progrès dans les arts, et disparaître presque entièrement lorsqu’on arrive à l’extrémité des terres australes, dans la Nouvelle-Zélande ou dans la terre de Van-Diemen. Enfin, nous avons vu les passions malveillantes se multiplier et devenir plus énergiques, et les êtres faibles traités d’une manière plus dure ou plus cruelle, à mesure que nous nous sommes plus rapprochés de l’état de barbarie.
Les peuples d’espèce éthiopienne nous offrent au centre et à l’extrémité australe de l’Afrique, un spectacle analogue à celui que nous a présenté l’espèce malaie dans le grand Océan, et l’espèce cuivrée en Amérique. La différence la plus remarquable que nous trouverons entre les peuples d’espèce nègre d’Afrique et les peuples de même race observés dans la Nouvelle-Hollande et la terre de Van-Diemen, est que les premiers ont fait un peu plus de progrès que les derniers.
Les peuples de la côte occidentale d’Afrique situés entre l’équateur et le tropique du capricorne, quoique appartenant tous à l’espèce éthiopienne, ne paraissent pas habiter le sol depuis la même époque. Si on les juge d’après leur organisation sociale, et d’après les dénominations à l’aide desquelles ils désignent quelques-uns de leurs chefs, on s’aperçoit à l’instant qu’une race de conquérants s’est rendue maîtresse du sol et des hommes qui l’habitaient, et qu’elle s’est organisée pour se maintenir en possession du territoire et des peuples conquis, comme les Malais du grand Océan et les barbares qui se sont répandus sur presque toutes les parties de l’Europe [736].
Les peuples de ces contrées tirent de l’agriculture presque tous leurs moyens d’existence. La terre, partagée en propriétés particulières, est d’une fertilité extraordinaire. À l’exception du froment, elle produit toutes les plantes alimentaires qui croissent en Europe, et pourrait produire toutes celles qui ne peuvent croître que sous les tropiques ; elle donne deux et quelquefois trois récoltes dans le cours d’une année. Les habitants sont donc obligés d’avoir des demeures fixes, et par conséquent ils sont plus assujettis que ne le sont les indigènes de la terre de Van-Diemen et de la Nouvelle-Hollande [737].
Les nègres du Congo sont soumis à un chef général qu’ils nomment foumou et auquel les voyageurs européens donnent le nom de roi. Ce chef, qui dans l’origine ne fut probablement que le général d’une armée conquérante, fait sa résidence à Loango, la partie la plus agréable du pays. Tous les chefs qui résident dans d’autres parties du territoire, le considèrent comme leur supérieur. Le roi, outre le pouvoir qu’il a sur ses grands vassaux ou sur sa noblesse, est maître de plusieurs villages qui dépendent immédiatement de lui, et qui forment, à proprement parler, le domaine de la couronne.
Le chef général ne transmet pas son pouvoir au premier-né de ses enfants ; s’il meurt, ses grands officiers forment un conseil de régence, et lui nomment un successeur : les grands d’espèce nègre ont conservé une prérogative qu’ont laissé éteindre les conquérants des autres espèces. Le roi ne peut être élu que parmi les grands ; mais il suffit d’être né prince pour être éligible.
« On pourrait supposer, dit Degrandpré, que le vainqueur, après avoir établi le siège de sa puissance en ce pays, donna des fiefs à ses enfants ou à ses principaux chefs à foi et hommage, et à charge d’un tribut qui vraisemblablement fut toujours en diminuant, ainsi que l’autorité du suzerain, et qui ne se reconnaît plus qu’au léger vestige de l’hommage qui subsiste aujourd’hui [738]. »
Les distinctions de rang sont aussi prononcées chez les nègres de la côte occidentale d’Afrique, et les lois de l’étiquette aussi bien observées que dans l’état le plus monarchique de l’Europe. Dans la hiérarchie féodale des nègres, le roi est le premier personnage de l’État ; les princes nés sont placés au second rang ; les maris des princesses tiennent le troisième ; les suzerains ou grands-vassaux sont au quatrième ; les courtiers et les marchands viennent ensuite, et enfin les individus qui forment la masse du peuple, et qu’on désigne sous le nom de garçons tiennent le dernier rang [739].
Les chefs ou nobles ont, sur tous les individus qui sont dans l’étendue de leurs domaines, un pouvoir sans limites. Ils peuvent les vendre, les échanger, les mettre à mort, comme ils le jugent convenable. Le seul frein qui les arrête, dans l’exercice de leur pouvoir, est la crainte de les voir émigrer sur une autre terre, et d’affaiblir ainsi leur puissance comparativement à leurs rivaux. Il existe, chez eux, deux sortes d’esclaves : les uns qui tiennent à la terre, comme ceux de notre régime féodal ; les autres qui ne tiennent à rien, et qui sont mis au rang des objets mobiliers. Ni les uns ni les autres n’ont rien en propre : leur seigneur ou maître considère comme sa propriété tout ce qu’ils acquièrent. Il les oblige à le suivre à la guerre ; et s’ils s’échappent, il les réclame auprès des autres grands, sur les terres desquels ils se sont retirés. La guerre est quelquefois nécessaire pour en obtenir la restitution.
Les princes nés et les maris des princesses ont eux-mêmes des grands vassaux sur lesquels ils exercent le même pouvoir que ceux-ci ont sur leurs esclaves ; mais ce pouvoir est modifié par la puissance que possèdent ces vassaux, et probablement aussi par la crainte de les voir se placer sous la protection d’un autre maître.
Enfin, le roi prétend avoir sur tous les grands, de quelque ordre qu’ils soient, les princes nés exceptés, un pouvoir sans limites ; mais cette prétention n’est admise que lorsqu’elle est soutenue par une force suffisante. Les grands lui résistent quand son pouvoir devient abusif ; cependant, comme chacun d’eux peut espérer d’être élu roi, ils respectent des prérogatives qui, quelque jour, peuvent être les leurs. Plusieurs de ces grands vassaux ont une si haute importance, qu’ils ne rendent foi et hommage au chef général qu’en lui envoyant un prince de leur sang, et qu’ils prennent eux-mêmes le titre de roi ou de foumou du pays sur lequel ils dominent : tels sont ceux de Cabende, Malembe et Mayombe. L’émissaire du roi, ou grand vassal de Cabende, prend le pas sur tous les autres dans les cérémonies ; car les grands de l’espèce nègre ne sont pas moins pointilleux sur les règles de l’étiquette que les grands des autres couleurs.
Le pouvoir de tous les grands est héréditaire, et se transmet par ordre de primogéniture. Mais plus jaloux que les princes des autres races de conserver la pureté de leur sang, ou moins confiants dans la vertu des femmes des princes, les nègres pensent que la noblesse ne se transmet que par les femmes. Ainsi, les enfants d’une femme de sang royal sont toujours princes quel que soit leur père ; mais les enfants d’un prince ne prennent jamais d’autre rang que celui que leur donne leur mère. Les infidélités des princesses ne sont donc jamais des affaires d’État chez les peuples d’espèce nègre, et quand l’enfantement est un fait non contesté, la légitimité ne peut jamais être un sujet de doute.
Le roi jouit de la prérogative de distribuer à ses vassaux immédiats tout terrain qui n’est pas occupé, privilège qui appartient, en général, à tout chef d’une armée conquérante. C’est au moyen des terres dont il dispose ainsi, et d’un certain nombre de serfs qu’il prend dans ses domaines particuliers, qu’il forme des apanages pour les princes qui n’en ont point. Le roi a de plus la prérogative de recevoir un tribut en femmes, que lui paient les grands vassaux à certaines époques, et particulièrement à son avènement à la couronne. Il établit les impôts qu’il se sent la puissance de faire payer ; ces impôts sont établis sur des objets de luxe, sur la vente des esclaves, ou bien ils sont perçus comme droits de péage ; enfin, il vend les emplois publics qui sont à sa nomination.
Les officiers qui sont à la nomination du monarque, sont des personnes d’une haute importance. Un premier ministre, qui prend le titre de capitaine-mort, est celui qui est l’organe des volontés du roi, et qui les fait parvenir, soit aux grands vassaux, soit à ses autres officiers ; comme il peut inspirer lui-même ou modifier les volontés qu’il est chargé de transmettre, il se rend redoutable à tous les sujets de son maître. Un second ministre, qu’on désigne sous le nom de mafouc, est l’intendant général du commerce ; toutes les affaires commerciales sont dans sa juridiction ; et, comme il ne peut y suffire seul, il a sous ses ordres un certain nombre d’officiers. Un troisième ministre, qui porte le nom de mambouc, sert d’intermédiaire entre le roi et les marchands, et fait le métier de courtier : ces fonctions étant dévolues au premier prince qui possède d’ailleurs une grande puissance, lui donnent une influence très étendue. Un quatrième ministre, désigné sous le nom de monibanze, est investi de l’administration des finances : c’est lui qui est chargé de la recette des impôts et du paiement des dépenses. Un cinquième officier, connu sous le nom de maquimbe, est chargé de faire la police du port ; il juge les affaires litigieuses conjointement avec le mafouc. Une sixième espèce d’officiers, sont les gouverneurs des villages qui dépendent immédiatement du pouvoir royal, espèce de préfets dont les principales fonctions consistent à faire la police. Enfin, les monibèles sont une septième espèce d’officiers ; leurs fonctions consistent à être porteurs des ordres de leurs supérieurs immédiats. Chacun des grands a un monibèle ; celui du roi est un des premiers dignitaires de l’État, et on ne s’avise pas plus de mettre en doute les ordres dont il dit être porteur, qu’on ne s’avise de douter en France des ordonnances ou des lois publiées par le Moniteur.
Chacun des vassaux du roi rend la justice aux hommes qui sont dans ses domaines ; mais il ne juge pas seul ; il est seulement le président d’un tribunal que les nègres désignent sous le nom de cabale, mot qu’ils ont adopté, du français. Ce tribunal ne rend la justice qu’en public, et au milieu de la multitude assemblée. Si une cause doit être jugée dans un ressort étranger, le seigneur se transporte dans le pays où le jugement doit être rendu ; il prend la défense de ses vassaux et tâche de faire rendre une décision en leur faveur. Il répond d’eux jusqu’à un certain point ; il paie leurs dettes, à moins qu’elles ne soient trop considérables ; car alors il les vend lui-même pour s’acquitter.
Si l’une des parties est mécontente du jugement rendu par le tribunal de son seigneur, ou si elle a à se plaindre d’un déni de justice, elle peut en appeler au roi. Mais le seul avantage qu’elle puisse espérer de son appel, consiste à trouver un refuge sur les terres royales, avantage qui cesse d’exister toutes les fois que l’émigration est un mal plus grave que celui dont on se plaint. Cependant, comme les grands vassaux de la couronne craignent de voir leurs serfs déserter leurs domaines, ils ne se livrent impunément à l’oppression, que lorsqu’ils sont soutenus par leur propre maître.
Dans les procédures criminelles, les accusés sont soumis au jugement de leur Dieu. Si un grand crime est commis, l’accusé comparaît devant les prêtres en présence du peuple, et demande l’épreuve du poison. Un prêtre lui présente aussitôt dans une tasse, une liqueur qu’il a préparée ; si le poison ne produit aucun effet, l’accusé est acquitté ; si, au contraire, il agit, l’accusé est mis en pièces aux premiers symptômes d’empoisonnement qui se manifestent. Cette épreuve se nomme avaler le fétiche.
Les prêtres peuvent refuser à un accusé l’épreuve du poison, et le soumettre à l’épreuve du feu. Celle-ci consiste à tenir dans la main un charbon ardent ; si l’accusé n’en ressent aucun effet, il sort triomphant de l’épreuve ; on le reconduit chez lui avec solennité, en portant devant lui le fétiche qui l’a défendu.
« Quel que soit le moyen que les prêtres emploient pour préserver la peau de l’action du feu, dit de Degrandpré, il est certain qu’ils savent la rendre incombustible ; et qu’au moyen d’une préparation préalable, ils font succomber à leur gré ceux que leur haine ou leur vengeance dévouent à la mort. Ils sont, sous ce rapport, d’autant plus redoutables qu’ils dirigent les accusations et qu’on n’en sort acquitté qu’à force de présents.
« Il arrive quelquefois, continue le même écrivain, qu’un homme est soumis à l’épreuve pour un crime commis à vingt lieues de lui, quoique l’alibi soit prouvé. Telle est leur superstition, qu’ils sont fermement persuadés qu’on a le pouvoir d’envoyer à qui l’on veut le mauvais vent (c’est ainsi qu’ils désignent, en français, le mauvais esprit), et que, par ce moyen, on peut se rendre coupable de la mort d’un homme quoique très éloigné. Toutes les morts inopinées sont pour les prêtres des motifs d’épreuves dont on ne sort acquitté qu’en satisfaisant leur cupidité, à moins qu’ils n’aient des raisons particulières de faire succomber l’accusé, que rien alors ne peut sauver [740]. »
[II-465]
Un grand peut être accusé d’un délit comme un homme des derniers rangs ; il peut, par conséquent, encourir la peine de mort ou l’esclavage ; mais, s’il lui arrive d’être condamné, il livre un homme de ses terres, et c’est sur celui-ci que s’exécute la sentence [741].
Le gouvernement féodal dont je viens de tracer le tableau est établi chez tous les peuples de la côte occidentale d’Afrique, sur une étendue de près de quarante degrés de latitude ; et il n’y est probablement pas moins ancien que dans les États de l’Europe [742].
Ces rois, ces ministres, ces grands d’espèce nègre, ne sont ni moins fiers de leurs titres et de leur naissance, ni moins jaloux de leurs prérogatives que ne le sont les personnages correspondants qui existent chez les peuples des autres espèces. Mais il ne faut pas s’imaginer que la même similitude se trouve dans les circonstances extérieures : le monarque de Loango est un nègre qui ne porte point de vêtements, qui marche pieds nus, qui habite une hutte de paille, qui s’asseoit par terre et mange avec les doigts ; ses ministres, ses grands vassaux, ne sont pas mieux pourvus et ne vivent pas mieux que lui ; mais cela n’affecte en aucune manière leur dignité, ni leur importance ; le pouvoir, les rangs, les distances, sont les mêmes [743].
Ayant exposé l’organisation sociale ou la distribution des pouvoirs des peuples qui habitent la côte occidentale d’Afrique, depuis le cap Negro jusqu’au désert du Sahara, il faudrait exposer maintenant quelle est la manière dont ces pouvoirs sont mis en usage. Le chef général use-t-il de son pouvoir sur ses grands vassaux et sur les hommes de ses domaines, d’une manière cruelle ? Les grands vassaux traitent-ils leurs subordonnés et leurs serfs avec plus d’humanité que les grands de race malaie ne traitent les leurs ?
Les mœurs des peuples d’espèce éthiopienne ont été observées en Afrique, avec moins de soin et de persévérance que les peuples d’espèce malaie des îles du grand Océan. Les voyageurs qui les ont visités ont eu, en général, moins d’instruction, et ont été moins nombreux : les faits que nous possédons sont, par conséquent, en plus petit nombre et n’ont pas la même certitude. Nous en possédons cependant assez pour nous faire juger de l’état moral de la population.
Ces peuples, comme ceux des îles du grand Océan, sont divisés en diverses classes ; ils ne reconnaissent d’autres distinctions que celles de naissance ou de race ; toutes leurs richesses consistent en terres, et les terres n’appartiennent qu’aux grands. De là nous pouvons tirer la conséquence que tous les travaux utiles sont méprisés et rejetés sur les classes inférieures, et que le fils d’un conquérant d’espèce nègre ne croirait pas moins s’avilir que le fils d’un conquérant d’espèce malaie ou d’espèce caucasienne, s’il se livrait à quelque genre de travail. C’est, en effet, ce qu’on observe dans les colonies d’Amérique où l’esclavage est établi ; si un noble d’espèce nègre, vendu par son suzerain ou pris à la guerre, se trouve au nombre des esclaves, rien ne peut l’obliger à déroger à sa naissance. Les prières, les promesses, les menaces, les coups de fouet ne sauraient le contraindre au travail ; né pour vivre sur les hommes de son espèce, tout autre moyen d’existence lui est en horreur et lui paraît pire que la mort. Les nègres même qui ne sont pas nés dans les classes aristocratiques, en ont reçu de leurs possesseurs tous les préjugés ; ils travaillent pour eux dans les colonies européennes comme sur les côtes d’Afrique. Dans les occasions où ces nobles esclaves refusent de travailler, on voit d’autres esclaves tomber à genoux et supplier les colons, leurs maîtres, d’ajouter à leur tâche la tâche du prince captif ou du personnage distingué, ce qu’on leur accorde quelquefois ; et ils continuent à témoigner au noble personnage le même respect que s’il était dans son pays [744].
Les grands sont quelquefois vendus par leurs supérieurs, ou par ceux de leurs égaux qui les ont vaincus ; mais à leur tour ils vendent les hommes qui se trouvent sur leurs terres. Le commerce d’hommes, depuis surtout que les chrétiens d’Europe y prennent part, est très considéré sur les côtes d’Afrique. C’est la seule marchandise que les grands de race nègre puissent donner en échange de celles que les Européens leur apportent. Un grand qui se laisserait déchirer à coups de fouet, plutôt que de s’avilir jusqu’à cultiver la terre, s’honore en faisant le métier de vendre des êtres humains : c’est au premier prince du sang que sont exclusivement dévolues les nobles fonctions de courtier [745].
[II-469]
La facilité avec laquelle les trafiquants d’esclaves en chargent leurs vaisseaux sur les côtes d’Afrique, prouve que les nobles noirs vendent leurs serfs avec plus de facilité que ne le dit le voyageur qui nous a donné la description de leur gouvernement. Les personnages par qui ces ventes sont faites, ne se font pas illusion sur le sort réservé aux captifs ; car, dans l’opinion de ces peuples, les Européens n’achètent des hommes que pour les manger [746]. Quand un roi veut vendre un nombre considérable d’esclaves aux trafiquants chrétiens, il fait une invasion dans un de ses propres villages, massacre ceux des habitants qui résistent, met aux fers ceux qui pourraient se sauver par la fuite, et laisse les autres en liberté jusqu’à ce que le moment de les livrer soit arrivé [747].
Les parents ont sur leurs enfants un pouvoir sans bornes ; ce pouvoir ne cesse pour les femmes que lorsqu’elles se marient, et alors elles deviennent la propriété de leurs maris. La volonté des femmes n’étant point consultée dans leur mariage, un homme peut en prendre plusieurs ; il peut les vendre comme il les a achetées, toutes les fois qu’elles sont d’un rang inférieur au sien. Chacune des femmes vit avec ses enfants dans une case séparée : celles qui ne sont pas princesses, sont toutes traitées également, ou du moins il n’y a pas entre elles d’autres différences que celles qu’il plaît au mari d’établir ; elles sont toutes confondues avec les esclaves. Si le mari meurt, ses femmes sont la propriété de son héritier [748].
Les princes choisissent, pour leurs femmes, les personnes qui leur conviennent, sans les consulter ni elles, ni leurs parents ; ils les renvoient ou les vendent, quand ils en sont mécontents. Les princesses choisissent pour mari tel individu qui leur plaît ; mais elles ne peuvent en avoir qu’un à la fois ; elles ont la faculté d’en changer aussi souvent qu’elles jugent convenable. Il arrive souvent qu’elles prennent un homme riche, le ruinent, et le renvoient pour en prendre un autre qu’elles renvoient également après l’avoir ruiné. Les enfants ne succèdent jamais qu’à leur mère : moyen infaillible de conserver les biens dans les familles selon le principe du gouvernement féodal [749].
Les principales prérogatives de la classe aristocratique consistant à vivre dans l’oisiveté et au moyen des travaux des autres classes, le travail est le lot exclusivement réservé à la partie la plus avilie de la population ; il est le partage des femmes. Ce sont elles qui cultivent les champs, qui sont chargées de tous les soins domestiques, et qui doivent pourvoir à la subsistance et aux besoins de la famille ; le jour, elles se livrent aux travaux de la campagne ; la nuit elles pilent le mil qui leur sert d’aliment [750].
Par l’effet de la distinction des rangs, le chef général domine sur tous les hommes et ne peut jamais se confondre avec eux. Les princes et les princesses dominent sur les grands et les traitent avec mépris, car ils peuvent les vendre. Les grands traitent leurs vassaux avec plus de mépris encore, et les tiennent à une plus grande distance ; enfin, les femmes, comme les êtres les plus faibles, forment le plus bas échelon de l’ordre social. Elles ne paraissent devant leurs maris que dans une posture humiliante ; elles leur servent à manger, et ne se nourrissent que de ce qu’ils ont rebuté. Cet état d’abjection que nous avons trouvé chez les Malais et chez les nègres du grand Océan est commun à toutes, à celles des dernières classes, comme à celles qui se trouvent dans les premiers rangs : il n’y a d’exception que pour les princesses. Toutes les autres ont à éprouver la brutalité de leurs maris ; mais il est rare qu’elles en reçoivent quelques caresses. Dans leurs incommodités périodiques, elles sont obligées de se séquestrer dans une cabane séparée, comme chez les peuples cuivrés du nord de l’Amérique ; elles ne peuvent communiquer même avec la personne qui leur porte des aliments [751].
Les grands ne pouvant se distinguer du peuple par le luxe, se distinguent de lui par l’abjection dans laquelle ils le tiennent : ils ne laissent approcher qu’à genoux les hommes qui leur sont inférieurs : c’est un des privilèges les plus précieux de l’aristocratie.
La vengeance est une passion qui, chez ces peuples, est toujours portée à l’excès, par tout individu qui s’imagine avoir reçu une injure ou une insulte ; c’est la cause la plus fréquente de leurs guerres. Lorsque la guerre est allumée entre deux tribus ou deux nations, tous les individus dont chacune d’elles se compose, sont traités en ennemis ; une querelle particulière produit ordinairement une guerre générale. Ils cherchent à vaincre leurs ennemis par surprise, et évitent les combats où ils les voient préparés [752].
Si nous comparons l’état social des peuples dont j’ai décrit les mœurs dans le chapitre précédent, à l’état social des peuples dont les mœurs ont été décrites dans celui-ci, quelques-uns des premiers paraîtront d’abord avoir l’avantage. Cependant, lorsqu’on examine séparément le sort de chacune des classes de la population, on trouve que cet avantage a plus d’apparence que de réalité.
La terre est infiniment plus fertile sur les côtes occidentales d’Afrique, situées entre les tropiques, qu’elle ne l’est au cap de Bonne-Espérance. Dans l’un et l’autre des deux pays, les femmes sont obligées de se livrer aux travaux qu’exige l’existence de la famille : mais, dans le dernier, avec la même quantité de travail on obtient une plus grande quantité de subsistances. Les femmes, en même temps qu’elles sont mieux nourries, sont donc obligées de moins travailler.
Dans un pays qui est naturellement très fertile et où l’on cultive plusieurs plantes alimentaires, on ne voit aucune de ces fréquentes disettes que nous avons observées au Cap, et qui obligent les habitants à dévorer les aliments les plus grossiers et les plus repoussants. C’est dans ces moments terribles que chacun ne consulte que son intérêt individuel, et que l’égoïsme se montre dans toute sa nudité. Les plus faibles sont alors sacrifiés, et par conséquent les vieillards, les malades, les femmes, les enfants, sont les premiers qui succombent. Ces misères n’ont pas lieu aussi souvent, ou sont moins considérables dans un pays où la culture a déjà fait des progrès, que dans un pays où la chasse et le lait des troupeaux forment les principaux moyens d’existence.
Les nègres des tropiques sont soumis à une subordination très dure ; un grand nombre d’entre eux sont même attachés à la glèbe ; mais ce mal, qui est fort grave, n’égale pas celui qui résulte des guerres continuelles qui ont lieu entre toutes les hordes de sauvages. Entre les tropiques, des hommes ont à craindre d’être enlevés pour être vendus comme esclaves ; mais chez des hordes sauvages chacune d’elles doit craindre à chaque instant d’être surprise et exterminée. Nous avons vu, en exposant les mœurs des peuples d’espèce malaie, qu’il existe moins de sécurité chez les hommes les plus forts de la Nouvelle-Zélande qu’il n’en existe chez les plus faibles dans les îles des Amis ; nous avons vu également que les hommes les plus forts parmi les sauvages du nord de l’Amérique sont exposés à plus de dangers que ne l’étaient les hommes les plus faibles parmi les peuples agriculteurs de même espèce qui vivaient entre les tropiques.
FIN DU SECOND VOLUME.
Notes↩
[1] Des savants se sont divisés sur la question de savoir s’il faut désigner les peuples noirs, blancs, cuivrés ou basanés, sous le nom de races, de variétés ou d’espèces. Je ne résous point cette question, par des raisons que j’exposerai ailleurs ; mais comme je suis obligé de me servir d’une de ces dénominations, faute d’en trouver une qui laisse la question indécise, chaque lecteur peut substituer à celle que j’emploie telle autre qui lui conviendra mieux.
[2] Voyez le tome I, liv. II, chap. I, p. 278 et suiv.
[3] La misère ou la prospérité d’une partie de la population influe généralement sur le sort des autres parties ; mais il peut très bien arriver que certaines classes de la société vivent dans l’abondance, possèdent de riches ameublements, de belles maisons et des campagnes agréables, tandis que d’autres classes vivent dans la misère, sont mal vêtues, et habitent de misérables luttes. J’aurai occasion d’en faire voir plus d’un exemple.
[4] Anderson, 3e voyage de Cook, liv. I, ch. VI, tom. I, p. 234 ; Cook, 2° voyage, liv. III, ch. I, tom. 5, p. 1 et 2.
[5] Kolbe, Description du cap de Bonne-Espérance, tome I, ch. VI, et XVII, p. 83 et 368.
[6] De Humboldt, Voyage aux rég. équinox. tome VI, liv. VII, ch. 19. p. 223, 324 et 331.
[7] Robertson’s History of America. Voltaire, Dictionnaire philosophique, au mot Barbe.
[8] Al. de Humboldt, Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, tome I, liv. II, ch. 6, p. 398.
[9] Cuvier, Anatomie comparée, tome II, p. 6.
[10] V. Denon, Voyage dans la basse et la haute Égypte, tome II, p. 20.
[11] Rollin, Voyage de La Pérouse, tome IV, p. 89.
12] C’est cette tendance qu’a chaque espèce à se considérer comme le type de la perfection, qui les a toutes déterminées à faire leurs dieux semblables à elles, et à se prosterner devant leurs propres images. Si les triangles faisaient un dieu, a dit un philosophe, ils lui donneraient trois côtés. Si je voulais prouver que, dans les théories que les peuples ont faites sur le beau, ils ont toujours pris pour modèle leur propre espèce, je serais obligé de m’écarter beaucoup de mon sujet. Je me bornerai à faire connaître les traits auxquels les indigènes du nord de l’Amérique reconnaissent la beauté : « Demandez à un Indien du Nord, dit Hearne, en quoi elle consiste ? Il vous répondra qu’une figure large et plate, de petits yeux, des joues creuses, trois ou quatre traits noirs à travers chacune d’elles, un front bas, un grand menton, un nez gros et recourbé, une peau basanée et une gorge pendante constituent la véritable beauté. » Voyage à l’Océan du Nord, ch. 4, p. 84.
Chez les nègres, le blanc est la couleur de la tristesse et du deuil ; c’est sous cette couleur qu’ils se figurent les esprits infernaux ; les esprits célestes et bienfaisants sont noirs comme eux. Nous jugeons autrement ; et la meilleure raison que nous puissions donner de notre jugement, c’est que nous sommes blancs.
[13] Si l’on jugeait de l’intelligence de certains animaux par la forme extérieure de leur tête, on la croirait beaucoup plus étendue qu’elle ne l’est réellement. Les Athéniens ne jugèrent peut-être pas autrement, lorsqu’ils firent du hibou l’oiseau de Minerve.
[14] La dénomination de chaque espèce ne me paraît pas très bien choisie : ces dénominations supposent résolues des questions d’origine qui ne le sont point du tout. Des dénominations tirées des caractères distinctifs de chaque espèce, auraient été plus convenables que celles qu’on a tirées des lieux d’où on les suppose originaires : les peuples peuvent changer de lieu, mais ils portent partout les caractères qui les distinguent. On désignerait beaucoup mieux, par exemple, les indigènes d’Amérique par la dénomination d’espèce cuivrée, et les peuples qui ont la peau noire, par la dénomination d’espèce nègre, qu’on ne les désigne par les dénominations d’espèce américaine et d’espèce éthiopienne. Il n’est pas aisé de voir pourquoi les peuples noirs répandus dans les îles de l’océan Pacifique, sont désignés sous le nom d’espèce éthiopienne ; ni pourquoi les peuples cuivrés qu’on suppose une variété de l’espèce dite caucasienne, porteraient le nom d’espèce américaine, lorsque l’Amérique presque tout entière est couverte d’individus d’une autre espèce, qui sont également nés sur le sol, et qui, dans le système suivant lequel tous les peuples appartiennent à la même souche, ont avec eux une origine commune.
[15] Les Anglais écrivent Feejee.
[16] « Le sang des Mingreliens, dit Chardin, est fort beau ; les hommes sont bien faits, les femmes sont très belles. Celles de qualité ont toutes quelque trait et quelque grâce qui charment. J’en ai vu de merveilleusement bien faites, d’air majestueux, de visage et de taille admirables ; elles ont outre cela un regard engageant qui caresse tous ceux qui les regardent, et semble leur demander de l’amour. » Voyage en Perse, tome I, p. 168 et 169.
[17] Tous les peuples de race nègre n’ont pas les caractères que leur attribuent ici Blumenbach et Lawrence. Il en est plusieurs, ainsi qu’on le verra plus loin, qui ont les organes aussi bien formés que les peuples de race caucasienne les mieux constitués. Les descriptions des physiologistes seraient différentes, si, au lieu d’avoir été faites sur quelques individus appartenant à certaines peuplades, elles avaient été faites sur des individus appartenant à d’autres peuplades. Les faits particuliers qui ont servi de base à leurs descriptions générales, sont si peu nombreux, qu’il est douteux qu’ils puissent servir à caractériser des races entières. Le portrait que Blumenbach et W. Lawrence font des peuples de race éthiopienne, ne ressemble pas plus aux Cafres et à d’autres peuples africains, que les paysans de la Basse-Bretagne ne ressemblent aux statues grecques.
[18] Ce tableau qu’a tracé W. Lawrence des caractères particuliers à l’espèce américaine, n’est ni complet, ni même tout à fait exact.
Les individus de cette espèce ont, presque sans exception, les mains et les pieds petits et bien faits ; c’est un caractère qu’on a observé chez tous les peuples de cette race, depuis les Patagons jusqu’aux habitants du Canada. Wallis, Voyage autour du Monde, tome II, ch. I ; p. 18 et 19. — Ulloa, Discours philosophiques, t. II, disc. 17, p. 4. — Azara, Voyage dans l’Amérique méridionale, tome II, ch. X, p. 9.
Ils ont les yeux petits, noirs et enfoncés. Rollin, Voyage de La Pérouse, t. IV, p. 52 et 53. — Dampier, Voyage autour du Monde, t. I, ch. VII, p. 183. — De Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, tome III, liv. 3, ch. IX, p. 278. Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, tome I, liv. 2, ch. VI, p. 387 et 388. — Ulloa, Discours philosophiques, tome II, p. 4.
Mais c’est surtout dans la forme de la tête que les indigènes d’Amérique diffèrent de tous les autres peuples. « L’ostéologie nous apprend, dit M. de Humboldt, que le crâne de l’Américain diffère essentiellement de celui de la race mongole : le premier offre une ligne faciale plus inclinée, quoique plus droite que celle du nègre ; il n’y a pas de race sur le globe dans laquelle l’os frontal soit plus déprimé en arrière, ou qui ait le front moins saillant. L’Américain a les os de la pommette presque aussi proéminents que le Mongol ; mais les contours en sont plus arrondis, à angles moins aigus : la mâchoire inférieure est plus large que chez le nègre ; les branches en sont moins écartées que dans la race mongole ; l’os occipital est moins bombé, et les protubérances qui correspondent au cervelet, et auxquelles le système de M. Gall donne une grande importance, sont peu sensibles. » Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, tome I, liv. II, ch. VII, p. 397, 398 et 399.
Les os du crâne ont, chez les individus de cette espèce, plus d’épaisseur qu’ils n’en ont chez l’espèce caucasienne. Ulloa, Disc. philosoph., tome II, disc. 17, p. 12 et 13.
Les individus d’espèce cuivrée ont aussi la peau plus épaisse, et semblent doués de moins de sensibilité. Ulloa, tome II, p. 12. — Azara, tome II, ch. II, p. 181.
Leurs os, déposés dans la terre, se dissolvent dans un moindre espace de temps. Azara, tome II, ch. X, p. 59.
Ils ne sont sujets à perdre ni les dents ni les cheveux. Ils ne grisonnent que très rarement et fort tard. Azara, Voyage dans l’Amérique méridionale, tome II, ch. X, p. 9. — De Humboldt, Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, tome I, liv. II, ch. 6, p. 394. Dans les contrées où ils ne sont pas détruits par la guerre ou par des excès, ils parviennent à une vieillesse plus avancée que nous. Azara, tome II, ch. X, p. 24, 25, 104 et 110. — De Humboldt, Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, tome I, liv. II, ch. 6, p. 394. — Ulloa, tome II, p. 35. — Charlevoix, Nouvelle-France, t. III, liv. II, p. 18. — Lalontan, tome II, p. 96.
Les hommes ont les parties sexuelles comparativement petites ; les femmes ont les diamètres du bassin et les parties sexuelles très grands. Elles accouchent sans le secours de personne, avec la plus grande facilité, et presque sans douleur. L’accouchement ne les oblige pas d’interrompre leurs travaux habituels. Elles sont très sujettes aux avortements. Rollin, Voyage de La Pérouse, tome IV, p. 58. — Azara, Voyage dans l’Amérique méridionale, tome II, ch. X, p. 59, 152, 180 et 181. — Stedman, Voyage à Surinam, tome II, ch. XIV, p. 122 et 123.
[19] W. Lawrence’s lectures on physiology, zoology and the natural history of man, sect. 2, ch. 10, p. 549-572.
Les peuples de race malaie sont ceux qui se rapprochent le plus de la race caucasienne. Ils n’ont pas tous les cheveux noirs comme l’a pensé W. Lawrence. Ceux des îles Marquises de Mendoça offrent dans leurs cheveux les mêmes variétés que les Européens : chez eux on voit des cheveux blonds, de châtains, de noirs, de longs, de frisés, et quelquefois de très lisses et même de très rudes. Ces peuples ont les traits réguliers et agréables, dans le sens que nous attachons à ces mots. Leur teint, sans être blanc, approche cependant du nôtre chez les personnes qui ne s’exposent pas au soleil. Ce qui les distingue, c’est une teinte jaunâtre, et l’absence des couleurs particulières aux visages des peuples de race caucasienne. (Rollin, Voyage de La Pérouse, t. IV, p. 20. — Fleurieu, Voyage du capitaine Marchand, tome I, ch. II, p. 97, 152 et 153. — Krusenstern, Voyage autour du monde, tome I, ch. IX, p. 205.) Cook observe que les Malais n’ont point sur les joues les teintes que nous appelons du nom de couleurs. (Premier Voyage, liv. I, ch. XVII, t. II, p. 537 et 338.) Ce trait leur est commun avec toutes les autres espèces. Les individus d’espèce caucasienne sont les seuls qui ont été doués de la faculté de rougir.
[20] M. Bory de Saint-Vincent a divisé le genre humain en quinze espèces. Il n’admet point qu’il n’existe qu’une espèce primitive qui s’est divisée en plusieurs variétés. Il pense, au contraire, que les divisions qu’on a considérées comme de simples variétés, forment autant d’espèces primitives. On peut voir les raisons sur lesquelles il se fonde, dans le Dictionnaire classique d’Histoire naturelle, au mot Homme.
[21] « Les peuples qui ont la peau blanche, dit M. Alexandre de Humboldt, commencent leur cosmogonie par des hommes blancs. Selon eux, les nègres et tous les peuples basanés ont été noircis ou brunis par l’ardeur excessive du soleil. » Cette théorie adoptée par les Grecs, quoique non sans contradiction, s’est propagée jusqu’à nos jours. Buffon a redit en prose ce que Théodectes avait exprimé en vers deux mille ans avant « que les nations portent la livrée des climats qu’elles habitent ».
« Si l’histoire avait été écrite par des peuples noirs, ils auraient soutenu ce que récemment des Européens même ont avancé, que l’homme est originairement noir ou d’une couleur très basanée, qu’il a blanchi dans quelques races par l’effet de la civilisation et d’un affaiblissement progressif, de même que les animaux, dans l’état de domesticité, passent d’une teinte obscure à des teintes plus claires.
« Dans les plantes et dans les animaux, des variétés accidentelles, formées sous nos yeux, sont devenues constantes, et se sont propagées sans altération. Mais rien ne prouve que, dans l’état actuel de l’organisation humaine, les différentes races d’hommes noirs, jaunes, cuivrés et blancs, lorsqu’elles restent sans mélange dévient considérablement de leur type primitif, par l’influence des climats, de la nourriture, et d’autres agents extérieurs. » Voyage aux régions équinoxiales, livre III, chapitre IX, pages 367 et 369.
[22] Cette erreur, qui consiste à juger, par analogie, des lois auxquelles la nature humaine est soumise, par les lois que suivent des animaux d’un genre tout différent, est une erreur fort commune ; elle sert de base, ainsi qu’on le verra ailleurs, à un grand nombre des sophismes de J.-J. Rousseau.
« Dans l’homme, dit M. de Humboldt, les déviations du type commun à la race entière portent plutôt sur la taille, sur la physionomie, sur la forme du corps que sur la couleur. Il n’en est point ainsi chez les animaux, où les variétés se trouvent plutôt dans la couleur que dans la forme. Le poil des mammifères, les plumes des oiseaux, et même les écailles des poissons, changent de teinte, selon l’influence prolongée de la lumière et de l’obscurité, selon l’intensité de la chaleur et du froid.
« Dans l’homme la matière colorante paraît se déposer dans le système dermoïde par la racine ou la bulbe des poils, et toutes les bonnes observations prouvent que la peau varie de couleur par l’action du stimulus extérieur, dans les individus, et non héréditairement dans la race entière. » Voyage aux régions équinoxiales, tome III, livre chapitre IX, pages 366 et 367.
[23] J’observe, dit ce savant voyageur, que la figure des nègres représente précisément cet état de contraction que prend notre visage lorsqu’il est frappé par la lumière et une forte réverbération de chaleur. Alors le sourcil se fronce, la pomme des joues s’élève, la paupière se serre, la bouche fait la moule. Cette contraction qui a lieu perpétuellement dans le pays nu et chaud des nègres, n’a-t-elle pas dû devenir le caractère propre de la figure ? » Voyage en Syrie et en Égypte, tome Ier, page 74.
[24] De Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales.
[25] La Pérouse, tome IV, page 54 et 55. — Fleurieu, Voyage du capitaine Marchand, tome II, ch. IV, p. 48 et 49. — Cook, troisième Voyage, tome V, liv. 4, ch. V, p. 247.
[26] Henri Salt, Voyage en Abyssinie, tom. I, chap. I, pag. 50. — Degrandpré, Voyage à la côte occidentale d’Afrique, tom. II, chap. IV, pag. 38 et 39.
[27] Il y a même à cet égard beaucoup d’exceptions individuelles.
[28] De tous les peuples connus, les Arabes du Désert sont ceux dont la race s’est conservée la plus pure ; jamais ils n’ont été asservis ; jamais ils ne se sont mêlés à d’autres races ; ils habitent aujourd’hui sur le même sol qu’ils habitaient dans les siècles les plus reculés ; ils ont les mœurs qu’ils avaient dans les temps les plus antiques dont l’histoire ou la tradition fassent mention ; et cependant, quoique placés sous un ciel brûlant et exposés au grand air, ils n’ont pris ni la couleur, ni les cheveux, ni les traits des Éthiopiens ; suivant J. Bruce, plusieurs de leurs femmes sont, au contraire, très blondes. Voyage aux sources du Nil, tome II, liv. I, ch. 6, p. 270.
Les Maures qui s’exposent au grand air ont le teint très brun ; mais ceux qui vivent continuellement dans l’intérieur des maisons sont très blancs. « Les femmes des villes, dit Poiret, n’étant point comme les montagnardes brûlées par le soleil et accablées de travaux, sont presque toutes d’une grande beauté, d’une blancheur éblouissante, et d’une taille très avantageuse. » Poiret, Voyage en Barbarie, ou Lettres écrites de l’ancienne Numidie, t. I, lett. XXI, p. 144, 145 et 146.
[29] W. Lawrence’s, lectures on physiology, zoology, etc., section II, ch. 9, p. 522 et 523.
[30] Description du cap de Bonne-Espérance, tome I, ch. 7, p. 91.
[31] Labillardière, tome II, chapitre XIV, page 276.
[32] Bougainville, Voyage autour du monde, deuxième partie, tome II, p. 122. — Dentrecasteaux, Voyage à la recherche de La Pérouse, tome I, chapitre V, page 124. — Labillardière, tome I, chapitre VI, page 227.
[33] Dentrecasteaux, ibid., chapitre VI, page 132 ; Labillardière, chapitre VII, pages 254 et 263.
[34] Bougainville, deuxième partie, chapitre IV, tome II, page 90.
[35] Cook, deuxième voyage, tome IV, chapitre V, page 97.
[36] Cook, deuxième voyage, tome V, chapitre I, pages 1 et 2.
[37] Cook, troisième voyage, livre I, chapitre VI, tome I, pages 192 et 193.
[38] Péron, Voyage de découvertes aux terres australes, tome II, livre IV, chapitre XXVII, section 2, page 182.
[39] Il y a, à cet égard, des exceptions que Péron paraît n’avoir pas connues. Labillardière, Voyage à la recherche de La Pérouse, tome I, chapitre V, page 176. C’est particulièrement au nord de la Nouvelle-Hollande, c’est-à-dire, dans la partie la plus éloignée de la terre de Van-Diemen, qu’on trouve une race de nègres à cheveux laineux. Dampier, Nouveau Voyage autour du monde, tome II, chapitre XVI, page 141.
[40] Péron, Voyage de découvertes aux terres australes, tome II, livre IV, chapitre XXVIII, section I, pages 163 et 164. — Labillardière, Voyage à la recherche de La Pérouse, tome II, chapitre X, pages 33 et 34. — L. Freycinet, Voyage de découvertes aux terres australes, livre II, chapitre IX, page 292. — De Papy qui écrivait avant la découverte de la plupart des îles de l’océan Pacifique, a prétendu, comme Buffon, que la différence de la température des climats avait produit les différences de couleur qu’on observe entre les peuples d’espèce éthiopienne et ceux d’espèce caucasienne. « Il n’existe nulle part des nègres, dit-il, sinon dans les pays excessivement chauds du globe : il n’y en a point hors des bornes de la zone torride. » Recherches philosophiques sur les Américains, tome I, première partie, section II, page 178.
[41] Les peuples compris sous la dénomination d’espèce éthiopienne, se subdivisent en une multitude de races différentes ayant chacune des caractères particuliers qui se transmettent par la génération, et sur lesquels le climat paraît n’avoir aucune influence. Les nomades Tibbos et Tuaryks sont les seuls que le plus ou le moins de chaleur affecte : « Ils offrent, dit M. de Humboldt, un phénomène physiologique bien remarquable ; car quelques-unes de leurs tribus sont, suivant la nature du climat, blanches, jaunâtres ou presque noires, mais sans avoir les cheveux crépus ni les traits nègres. » Tableau de la Nature, tome I, page 101.
On a prétendu, en Amérique, qu’un nègre, nommé Henri Moss, était devenu blanc, et que ses cheveux étaient devenus lisses et châtains comme ceux des Européens. On ne dit pas si son nez devint aquilin, si ses lèvres s’amincirent, si sa figure devint perpendiculaire, si son cerveau se développa. M. de Larochefoucault-Liancourt parle de cette transmutation, dans son Voyage aux États-Unis, tome V, pages 124, 525 et 526 ; et Volney assure avoir vu, non le fait, mais un procès-verbal authentique de la transformation ; Tableau du climat et du sol des États-Unis, tome II, page 437. — Voltaire était persuadé qu’à aucun âge les indigènes d’Amérique n’avaient de barbe ; et il fondait sa croyance sur des attestations juridiques d’hommes en place. Dictionnaire philosophique, au mot Barbe.
[42] Ulloa, Discours philosophiques, tom. II, D. 17, pag. 3, 4 et 5. — Alexandre de Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, liv. III, chap. IX, tom. III, pag. 277 et 278.
[43] Cook, troisième voyage, liv. I, chap. V, tom. II, pag. 336. — Bougainville, Voyage autour du Monde, prem. part., chap. VIII, tom. I, pag. 163 et 164. — Wallis, Voyage autour du Monde, tom. II, ch. I, pag. 18 et 19.
[44] De Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, tom. III, liv. III, chap. 9, pag. 227 et 278. — Dampier, Nouveau Voyage autour du Monde, tom. I, chap. XVII, pag. 183.
[45] Hearne, Voyage à l’océan du Nord, chap. IX, pag. 285.
[46] Lahontan, Voyage dans l’Amérique septentrionale, tom. II, pag. 93 et 94. — Ellis, Voyage à la baie d’Hudson, pag. 233. — Mackenzie, Voyage dans l’Amérique septentrionale, tome I, p. 230, 231, 281 et 282. — Weld, Voyage au Canada, tome III, ch. 35, page 63.
[47] Weld, Voyage au Canada, tome II, ch. XXX, p. 247.
[48] Raynal, Histoire philosophique, tome III, liv. VI, p. 519.
[49] De Humboldt, Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, tome I, liv. II, ch. VI, p. 385.
[50] Ulloa, Discours philosophique, tome II, Dis. XVII, p. 3.
[51] La Pérouse, Voyage autour du Monde, tome II, ch. IX, p. 229 et 230. — De Humboldt, Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, tome I, liv. II, ch. VI, p. 387 et 388. — Cook, troisième voyage, tome V, liv. IV, ch. II, p. 100 et 106.
[52] Tableau du climat et du sol des États-Unis, tome II, p. 437.
Sans discuter ici les effets que produit la lumière sur les corps, on conviendra du moins qu’elle ne produit pas sur tous des effets semblables. Nous voyons croître sur le même sol, et sous les rayons d’un soleil également ardent, des roses de toutes les couleurs ; les cygnes, blancs dans les climats froids, ne deviennent pas gris sous les climats tempérés, et noirs sous la zone torride ; les lis demeurent blancs sous le ciel le plus ardent, comme sous le climat le plus froid où il leur est possible de se développer.
[53] Voyage au Canada, tome III, ch. XXXV, p. 64 et 65.
[54] Hennepin, Mœurs des sauvages de la Louisiane, p. 34.
[55] Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, tome I, liv. II, ch. VI, p. 388 et 389. — L’exception qu’observe M. de Humboldt à l’égard de la race cuivrée, a été observée par Campe à l’égard des races nègres, et par Kolbe à l’égard des Hottentots.
[56] Voyage aux régions équinoxiales, liv. III, ch. IX, tome III, p. 277 et 278.
[57] Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, tome II, ch. VI, p. 385.
On trouve, dans le Voyage aux régions équinoxiales de M. de Humboldt, des observations qui confirment celles qu’il a faites dans son Essai politique. Ce savant voyageur divise la population qui existait en Amérique avant la conquête, en plusieurs races ; voici dans quels termes il parle de ceux qui appartiennent à la race cuivrée : « Les hommes qui appartiennent à cette seconde branche sont plus grands, plus forts, plus guerriers, plus taciturnes. Ils offrent aussi des différences très remarquables dans la couleur de la peau. Au Mexique, au Pérou, dans la Nouvelle-Grenade, à Quito, sur les rives de l’Orénoque et de l’Amazone, dans toute la partie de l’Amérique méridionale que j’ai examinée, dans les plaines comme sur les plateaux très froids, les enfants indiens, à l’âge de deux ou trois mois, ont le même teint bronzé que l’on observe dans les adultes. L’idée que les naturels pourraient bien être des blancs hâlés par l’air et le soleil, ne s’est jamais présentée à un Espagnol, habitant de Quito, ou des rives de l’Orénoque. » Liv. III, ch. IX, tome III, p. 360 et 366.
[58] Anderson, troisième voyage de Cook, liv. I, ch. VIII, tome I, p. 319 et 321. — Dentrecasteaux, Voyage à la recherche de la Pérone.
[59] Cook, deuxième Voyage, tome III, ch. I, p. 140. — Rollin, Voyage de la Pérouse, tome IV, p. 19 et 20.
[60] Cook, troisième Voyage, liv. II, ch. X, tome III, p. 90. Labillardière dit que les femmes qui se tiennent constamment à l’abri du soleil, ont le teint très blanc. (Voyage à la recherche de La Pérouse, tom. II, ch. XI, p. 117.) Mais son témoignage se trouve en opposition avec celui des nombreux voyageurs qui ont visité ces îles. Les îles Sandwich, placées à la même distance de l’équateur que les îles des Amis, sont soumises à la même influence. Les habitants des unes et des autres, appartenant à la même espèce, doivent par conséquent être d’une couleur égale, lorsqu’ils se trouvent dans les mêmes rangs. J’ai vu, en Angleterre, le chef de la première de ces îles, ainsi que sa femme et les personnes de leur suite ; et, loin de trouver leur teint très blanc, je l’ai trouvé olivâtre, ou d’un brun très foncé. On ne peut pas croire cependant que le soleil les eût plus noircis que les femmes observées par Labillardière. Si, au lieu de comparer le teint des femmes des îles des Amis, au teint des hommes basanés qui les environnaient, ou au teint des matelots de l’équipage, ce voyageur l’eût comparé au teint de la plupart des Européennes, il est douteux qu’il l’eût trouvé très blanc. Cook dit qu’il vit chez ces peuples trois individus d’une blancheur parfaite ; mais, ajoute-t-il, je présume que leur couleur est plutôt une maladie qu’un phénomène de la nature. Troisième Voyage, livre II, ch. X, tome III, p. 90. Chez ces peuples, un grand nombre d’individus prennent cependant des soins extrêmes pour se blanchir le teint ; ils passent plusieurs mois sans sortir de leurs maisons ; ils portent une quantité considérable d’étoffes pour se mettre à l’abri du contact de l’air, et ils ne mangent que du fruit de l’arbre à pain, qui, suivant eux, a la propriété de blanchir la peau. Anderson, troisième Voyage de Cook, liv. III, ch. IX, tome IV, p. 113.
[61] Krusenstern, Voyage autour du Monde, tome I, ch. IX, p. 205. — Fleurieu, Voyage du capitaine Marchand, tome I, ch. II, p. 97, 152 et 153.
[62] Chardin, Voyage en Perse, tome III, ch. XI, p. 403, et tome VIII, p. 177.
[63] Macartney, Voyage en Chine et en Tartarie, tom. III, ch. IV, p. 58.
[64] La Pérouse, Voyage autour du Monde, tome III, ch. XIX, pages 104 et 105.
[65] Hearne, Voyage à l’océan du Nord, chapitre VI, page 157 ; — Ellis, Voyage à la baie d’Hudson, pages 172 et 173.
Les Esquimaux du Groenland, du Labrador et de la côte septentrionale de la baie d’Hudson, les habitants du détroit de Béring, de la péninsule d’Alaska, et du golfe du prince Guillaume, appartiennent tous à la même race. « Le rameau oriental et le rameau occidental de cette race polaire, les Esquimaux et les Tchogazes, malgré l’énorme distance de huit cents lieues qui les sépare, sont liés par l’analogie la plus intime des langues. Cette analogie s’étend même, comme cela a été prouvé récemment, d’une manière indubitable, jusqu’aux habitants du nord-est de l’Asie ; car l’idiome des Tchouktches, à l’embouchure de l’Anadyr, a les mêmes racines que la langue des Esquimaux qui habitent la côte de l’Amérique opposée à l’Europe. Les Tchouktches sont les Esquimaux de l’Asie. Voyage aux régions équinoxiales, livre III, chapitre IX, pages 360 et 361.
[66] Chardin, Voyage en Perse, tome III, ch. XI, p. 403 et 404, et tome VIII, p. 177.
[67] Macartney, Voyage en Chine et en Tartarie, tome III, ch. IV, p. 252 et 257.
[68] De La Pérouse, Voyage autour du Monde, tome III, ch. XIX, p. 104 et 105. — Rollin, Voyage de La Pérouse, tome IV, p. 90, 91, 98 et 99.
[69] Thumberg, Voyage en Afrique, en Asie et au Japon, ch. XIII, p. 411 et 412.
[70] La Pérouse, tome III, ch. XXI, p. 193.
[71] Coxe, Nouvelles découvertes des Russes.
[72] Fleurieu, Voyage du capitaine Marchand, tome II, ch. IV, p. 46, 47 et 48. — La Pérouse, tome I, ch. IX, p. 231 et 232. — Cook, troisième Voyage, liv. IV, ch. V, tome V, p. 240 et 241. — Hearne, Voyage à l’Océan du Nord, ch. VI, p. 157. — Ellis, Voyage à la baie d’Hudson, p. 172 et 173.
[73] Chardin, Voyage en Perse, tome VI, ch. XVI, p. 82 et 83. — Thumberg, Voyage en Afrique et en Asie, et principalement au Japon, ch. II, p. 47. — De Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, liv. II, ch. IX, tome III, p. 292 et 293.
[74] Péron, Voyage de découvertes aux terres Australes, liv. II, ch. VII, p. 144.
[75] Barrow, Nouveau Voyage dans la partie méridionale de l’Afrique, tome I, ch. I, p. 148.
[76] Voyage dans les îles de la Trinidad, de Tabago, etc., tome I, ch. I, p. 118. — Molien, Voyage dans l’intérieur de l’Afrique, tome I, ch. IV, p. 289 et 290.
[77] Voy. Malte-Brun, Précis de la Géographie universelle, tome V, liv. XCIII, p. 94 et 108.
[78] Cook, troisième Voyage, tome V, ch. I, p. 1 et 2.
[79] Forster, deuxième Voyage de Cook, tome IV, ch. III, p. 97. — Cook, deuxième Voyage, tome IV, ch. III, p. 128.
[80] Labillardière, tome II, ch. XIV, p. 275 et 276.
[81] Labillardière, tome I, ch. VII, p. 254.
[82] Discours philosophique, tome II, disc. XVII, p. 5.
[83] Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, tome I, liv. II, ch. VI, p. 81 et 82.
[84] Buffon, Voltaire, Robertson et de Paw, ont prétendu que les individus de race américaine n’avaient point de barbe ; c’est une erreur qui n’a presque plus besoin d’être réfutée. Les hommes de cette espèce ont de la barbe comme ceux de l’espèce mongole ; ils l’ont rare mais forte et grossière. C’est le soin qu’ils prennent à s’épiler, qui a fait croire qu’ils n’en avaient point du tout. S’il se rencontre des individus qui en soient privés, ce sont des exceptions rares, et qui ne s’étendent jamais à une peuplade. De Humboldt, Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, tome I, liv. II, ch. VI, p. 389 et 390, et Voyage aux régions équinoxiales, liv. III, ch. IX, tome III, p. 293 et 294. — Depons, Voyage à la Terre-Ferme, tome I, ch. IV, p. 298. — La Pérouse, Voyage autour du Monde, tome II, ch. 18, p. 229 et 230. — Rollin, Voyage de La Pérouse, t. IV, p. 52, 53 et 58. — Stedmann, Voyage à Surinam, tome II, ch. XIV, p. 93 et 95. — Dixon, Voyage autour du Monde, t. II, p. 10 et 11. — Hearne, Voyage à l’Océan du Nord, ch. IX, p. 285. — Mackenzie, Voyage dans l’intérieur de l’Amérique septentrionale, tome I, p. 230 et 231, et 282 et 283. — Les philosophes qui, sur la foi de quelques voyageurs superficiels, ont prétendu que les Américains n’avaient point de barbe, ont longuement exposé les raisons de ce prétendu phénomène. Ceux qui seraient curieux de les connaître peuvent consulter de Paw, Recherches philosophiques sur les Américains, tome I, 1ère partie. Il est difficile d’exposer avec plus de talent les causes d’un fait qui n’existe pas.
[85] Rollin, Voyage de La Pérouse, tome IV, p. 19 et 30.
[86] Krusenstern, Voyage autour du Monde, tome I, ch. IX, p. 206. — Fleurieu, Voyage du capitaine Marchand, tome I, ch. 2, p. 97, 151 et 153.
[87] La population mexicaine, dit M. de Humboldt, est composée des mêmes éléments que ceux qu’offrent les colonies espagnoles. On distingue sept races : 1° les individus nés en Europe vulgairement appelés Gachupières ; 2° les Espagnols créoles, ou les blancs de race européenne nés en Amérique ; 3° les métis (Mestizos), descendants de blancs et d’Indiens ; 4° les mulâtres, descendants des blancs et des nègres ; 5° les Zambos, descendants de nègres et d’Indiens ; 6° les indiens mêmes ou la race cuivrée des indigènes ; 7° les Nègres africains. Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, t. I, liv. II, ch. VI, p. 367.
[88] Si nous faisions l’histoire de la plupart des fausses opinions qui gouvernent les hommes, nous trouverions qu’elles sont nées presque toutes, non seulement avant que les faits qui auraient dû en être la base eussent été observés, mais avant même qu’il eût été possible de les connaître. C’est ainsi que l’opinion sur l’influence des climats émise d’abord par Hippocrate et par Diodore de Sicile, dans un temps où la plus grande partie du globe était inconnue aux hommes les plus éclairés, fut aveuglément adoptée par Bodin, dans sa République, lequel la transmit à Chardin, qui la transmit à l’abbé Dubos et à Montesquieu, qui à leur tour l’ont transmise à Robertson, à Gibbon, à l’abbé Raynal, et à la plupart des écrivains qui sont venus après eux. Si, en lisant l’Esprit des Lois, on s’aperçoit que l’opinion de Chardin у est adoptée sans examen, on s’aperçoit en lisant Robertson qu’il a aveuglément adopté l’opinion de Montesquieu. L’historien fait arriver les faits pour justifier un système, au lieu de faire naître ses opinions de l’exposé des faits : History of America, Book IV, vol. II, p. 138 et 139, the 10th edit. — M. Malte-Brun a très bien aperçu l’erreur dans laquelle sont tombés les écrivains qui ont fondé un système sur l’opinion d’Hippocrate relativement à l’influence des climats : Précis de Géographie universelle, tome III, liv. XLVI, p. 19 et 22, 2e édit.
[89] Chardin, Voyages et Perse, tome IV, ch. XVII, p. 91.
[90] Ibid., tome VI, ch. XII, p.9.
[91] Esprit des Lois, liv. XIV, ch. II.
[92] Esprit des Lois, liv. XIV, ch. III.
[93] Ibid, ch. IV, VII, IX et X ; liv. XV, ch. VI et VIII.
[94] Esprit des Lois, liv. XIV, ch. X.
[95] Ibid. ch. XI, XII et XV.
[96] Gibbon, à l’exemple de Montesquieu, considère comme un effet du climat la haute stature attribuée par Tacite à quelques peuples germains : The History of the decline and fall of the roman empire, vol. I, ch. IX, p. 348.
[97] Larochefoucault-Liancourt, Voyage aux États-Unis d’Amérique, deuxième partie, t. IV, p. 55. — Weld, Voyage au Canada, tome I, ch. VI, p. 119 et 120.
[98] Les habitants de la Nouvelle-Calédonie, pour se délivrer de l’importunité des moustiques, sont obligés d’avoir toujours du feu et de la fumée dans leurs étroites cabanes. L’habitude du feu les rend si frileux, que, quoique placés entre les tropiques et sur un sol peu élevé, ils n’osent pas s’exposer à la fraîcheur de la nuit. « Ils paraissaient transis de froid, dit Dentrecasteaux, quand ils venaient à bord les jours où le temps était frais ; aussi recevaient-ils avec plaisir toutes les espèces d’habillements qu’on leur donnait, et s’en couvraient-ils très volontiers. » Voyage à la recherche de La Pérouse, tome I, ch. XXVI, p. 356.
Les habitants des îles des Amis, placés sous la même latitude, mais n’étant pas obligés de faire usage du feu pour se délivrer des insectes, couchent nus dans des cabanes ouvertes à tous les vents et couvertes seulement d’un peu de feuillage, et ils ne sont pas accessibles au froid. Bougainville, Voyage autour du monde, deuxième partie, tome II, ch. I, p. 50.
[99] Hearne, Voyage à l’océan du Nord, chap. VI, p. 157. — De Paw, Recherches philosophiques sur les Américains, tome I, troisième partie, p. 259.
[100] Ellis, Voyage à la baie d’Hudson, page 172.
[101] Raynal, Hist. philosoph., tome VIII, liv. XVII, p. 357.
[102] Hearne, Voyage à l’océan du Nord, ch. IX, p. 284.
[103] Lahontan, Voyage dans l’Amérique septentrionale, tome II, page 93.
[104] Hearne, ch. IV, p. 83.
[105] Weld, Voyage au Canada, tome III, ch. XXXV, p. 68.
[106] Michaux, Voyage à l’ouest des monts Alleghanis, ch. XXII, page 236.
[107] Hennepin, Mœurs sauvages de la Louisiane, pag. 14 et 17. Les femmes, à la Louisiane, dit Hennepin, ont tant de vigueur qu’il y a peu d’hommes en Europe qui en aient autant quelles ; elles portent des fardeaux que deux ou trois de nous autres auraient peine à soulever. Quelquefois elles prennent sur leur dos, lorsque leurs maris ont fait bonne chasse, trois cents livres de viande, et jettent leurs enfants par-dessus leur fardeau, qui ne leur paraît pas plus à charge que l’épée au côté d’un soldat. Elles font ainsi plus de deux cents lieues à travers les forêts. Hennepin, ibid, p. 17, 82 et 123. — Les hommes qui habitent à l’extrémité boréale du continent américain sont considérés comme appartenant à l’espèce mongole, et les hommes de cette espèce sont généralement plus petits que les autres ; mais on verra plus loin que les hommes de cette espèce qui habitent des pays froids sont plus petits que ceux qui habitent des pays chauds ou tempérés.
[108] Plusieurs voyageurs ont pensé qu’en Amérique le climat était sans influence sur la taille et la force des hommes. Ulloa, Discours philosophiques, tome II, D. XVII, p. 5. — Azara, Voyage dans l’Amérique méridionale, tome II, ch. XI, p. 17 et 178.
[109] Mackenzie, Voyages dans l’intérieur de l’Amérique septentrionale, tome I, ch. 2, p. 383 et 384.
[110] Cook, troisième voyage, liv. IV, ch. V, tome V, p. 240 et 241.
[111] La Pérouse, Voyage autour du monde, tome II, ch. IX, p. 208, 229 et 230.
[112] Cook, troisième voyage, liv. IV, ch. II, tome V, p. 100 et 106.
[113] Broughton, Voyage de découvertes, tome I, liv. I, ch. III, page 93.
[114] Azara, Voyage dans l’Amérique méridionale, tome II, ch. X et XI, p. 105, 149, 182 et 183.
[115] De Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, liv. VII, ch. XIX, tome VI, p. 257 et 258.
Il ne faut pas confondre les Caribes dont parle ici M. de Humboldt, avec les Zambos dégénérés de l’île de Saint-Vincent, qu’on désignait jadis sous le même nom ou sous celui de Caraïbes.
[116] De Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, tome II, liv. II, ch. V, p. 360 et 361, et tome VI, liv. VII, p. 379 et 580.
[117] De Humboldt, Essai politique, tome I, liv. II, ch. V, p. 362.
[118] Ibid, tome IV, liv. IV, ch. XI, p. 36 et 37.
[119] Bougainville, Voyage autour du monde, tome I, première partie, ch. IX, p. 196.
[120] Cook, Voyage autour du monde, deuxième partie, tome V, liv. III, ch. V.
[121] Byron, Relation des Voyages autour du monde, ch. II, p. 34 et suivantes.
[122] Azara, Voyage dans l’Amérique méridionale, tome II, ch. X, pages 50 et 51.
[123] Bougainville, Voyage autour du monde, tome I, première partie, ch. VIII, p. 166.
[124] Ce qui me porte à croire que les peuples qui vivent au sud de la Plata, jusqu’au détroit de Magellan, sont nomades, c’est la nature même du sol, qui ne permet pas à l’homme d’y avoir des demeures fixes. Ce sol, dépourvu d’arbres, est trop salé pour qu’on puisse s’y livrer à la culture des céréales. « On peut dire que depuis la rivière de la Plata jusqu’au détroit de Magellan il n’existe point d’arbres, et qu’on ne trouve pas même un buisson. » Azara, Voyage dans l’Amérique méridionale, tome I, liv. V, p. 103 et 104, et liv. VI, p. 141.
En admettant que les peuples qui habitent au sud de la rivière de la Plata sont nomades, comme cela paraît prouvé, on ne sera plus étonné des contradictions dans lesquelles paraissent tombés les voyageurs qui ont visité la côte des Patagons ; les peuplades vues par les uns, peuvent ne pas être les mêmes que celles qui ont été vues par les autres. Bougainville n’a pas mis en doute que ces peuples ne fussent nomades. Voyage autour du monde, première part., ch. VII, tome I, p. 166.
[125] Azara, Voyage dans l’Amérique méridionale, tome II, ch. X, p. 35, 41, 42, 50 et 51.
[126] De Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, tome III, liv. II, ch. 18, p. 277 et 278.
[127] Ulloa, Discours philosophiques, tome II, disc. XVI, p. 5. — Azara, Voyage dans l’Amérique méridionale, tome II, ch. XI, pages 17 et 18.
[128] Fleurieu, Voyage du capitaine Marchand, tome I, ch. II, pag. 151 et 152. — Cook, deuxième voyage, tome III, ch. IV, pag. 179 et 199.
[129] Krusenstern, Voyage autour du monde, tome I, ch. VII et IX, p. 164, 180, 203, 204 et 206. — Langsdorff’s Voyages and travels in various parts of the world, tome V, p. 108. — Cook, deuxième voyage, tome III, ch. V, p. 217 et 218.
Cook donne sur les habitants des îles Marquises des détails moins circonstanciés que le capitaine Marchand ; mais il porte de la beauté de leur constitution un jugement semblable ; il dit qu’ils sont la plus belle race des habitants de cette mer, et paraissent surpasser toutes les autres nations par la régularité de leur taille et de leurs traits ; il ajoute en parlant des jeunes gens qui n’étaient pas encore tatoués : « Leur beauté était si frappante qu’elle excitait notre admiration ; nous mettions la plupart d’entre eux à côté des modèles fameux de l’antiquité. »
[130] La Pérouse, Voyage autour du monde, tome III, ch. XXV, p. 272 et 273.
[131] La Pérouse, tome III, ch. XXV, p. 234 et 274.
[132] Ibid., p. 278.
[133] Bougainville, Voyage autour du monde, deuxième partie, tome II, ch. I, p. 51.
[134] Cook, premier voyage, liv. I, ch. XVII, tome II, p. 537 et 538 ; deuxième voyage, tome II, ch. I, p. 82 et 83.
[135] Cook, deuxième Voyage, tome II, ch. II, p. 163 et 164. — Bligh, Voyage à la mer du Sud, ch. V, p. 88.
[136] Bougainville, Voyage autour du Monde, deuxième partie, tome II, p. 51.
[137] Cook, troisième Voyage, liv. II, ch. X, tome III, p. 88.
[138] Labillardière, Voyage à la recherche de La Pérouse, ch. XII, tome II, p. 176.
[139] La Pérouse, Voyage autour du Monde, tome III, ch. XXVI, page 303.
[140] Bougainville, deuxième partie, ch. III, tome II, p. 51. — Dentrecasteaux, tome I, ch. XIV, p. 320. — Cook, premier Voyage, liv. I, ch. XVII, tome II, p. 537 et 538.
[141] La Perouse, tome IV, p. 25.
[142] Cook, troisième Voyage, liv. V, ch. VII, tome VII, p. 83.
[143] Broughton, Voy. de découvertes, t. I, liv. I, ch. IV, p. 103.
[144] Wallis, Relation d’un voyage fait autour du Monde, ch. IV, tome II, p. 102, de la collection d’Hawkesvorth.
[145] Rollin, Voyage de La Pérouse, tome IV, p. 19 et 20. — Forster, deuxième Voyage de Cook, t. II et III, p. 90, 91 et 141.
[146] Cook, troisième Voyage, liv. I, ch. VIII, tome I, p. 319 et 321.
[147] Cook, premier Voyage, liv. II, ch. X, tome III, p. 311 et 313. — Dans un combat à la manière anglaise, engagé entre un matelot de Cook et un indigène, le premier a eu l’avantage ; mais cet avantage peut être attribué autant à l’adresse qu’à la force. — Cook, deuxième Voyage, tome I, ch. VIII, p. 424 et 425.
[148] Cook, troisième Voyage, liv. I, ch. VI, tome I, p. 198, 234 et 236. —Dentrecasteaux, Voyage à la recherche de La Pérouse, tome I, ch. II, p. 240. — Péron, Voyage de découvertes aux terres australes, tome I, liv. III, ch. XII, p. 280 et 283.
[149] Péron, Voyage de découvertes aux terres australes, tome I, ch. XIII et XX, p. 280, 281, 286 et 449.
[150] Ibid., liv. III, ch. XX, p. 450.
[151] Cook, premier voyage, liv. II, ch. IV, t. IV, p. 48 et 49. — L. Freycinet, Voyage de découvertes aux terres australes, liv. II, ch. IX, p. 292.
[152] Péron, Voyage de découvertes aux terres australes, tome I, liv. III, ch. XX, p. 451.
[153] Péron, liv. II, ch. V, p. 81.
[154] Forrest, cité par Malte-Brun, Précis de Géographie universelle, tome IV, liv. LXVIII, p. 380.
[155] Cook, deuxième Voyage, tome IV, ch. III, p. 97.
[156] Dentrecasteaux, Voyage à la recherche de La Pérouse, tome I, ch. XXV, p. 330.
[157] Cook, deuxième Voyage, tome IV, chapitre III, pages 97 et 128.
[158] Ibid., ch. VI, p. 346. — Bougainville, Voyage autour du Monde, deuxième partie, ch. IV, tome II, p. 90, ch. V, p. 114. — Dentrecasteaux, Voyage à la recherche de La Pérouse, tome I, ch. XIX, p. 414. — Dampier, nouveau Voyage autour du Monde, tome II, ch. XII et XVI, p. 3, 141 et 146.
[159] Dentrecasteaux, Voyage à la recherche de La Pérouse, t. I, ch. XV, p. 330. — Labilladière, tome II, ch. XIII, page 210. — Cook, deuxième Voyage, liv. III, tome V, ch. I, p. 1, 2 et 4.
[160] La Pérouse, Voyage autour du Monde, tome III, ch. XX, p. 127 et 128.
[161] Ibid. ch. XIX, p. 104 et 105.
[162] La Pérouse, Voyage autour du Monde, tome IV, p. 98 et 99. — Krusenstern, Voyage autour du Monde, tome II, ch. XV, p. 89.
[163] La Pérouse, tome III, ch. XVIII, XX et XXI, p. 75, 125, 127, 128, 156, et tome IV, p. 90 et 91.
[164] Mac-Leod, Voyage de l’Alceste, p. 110. — Macartney, Voyage en Chine et en Tartarie, tome III, ch. IV, p. 257.
[165] Chardin, Voyage en Perse, tome III, ch. II, p. 403 et 404.
[166] Voyage en Perse, tome VIII, p. 177.
[167] Fischer et Georgi, cités par Malte-Brun, Précis de Géographie universelle, tome III, liv. LIX, p. 372 et 380.
[168] Volney, Voyage en Syrie et en Égypte, tome I, ch. XXII, p. 357, 358 et 359. — Niebuhr, Description de l’Arabie, p. 45.
[169] Kolbe, Description du cap de Bonne-Espérance, tome I, ch. IX, p. 333.
[170] Peron, Voyages de découvertes aux terres australes, tome II, liv. IV, ch. XXXIII, p 308 et 309. — Le jugement que Barrow porte du Boschismans ou Bosjesmen est le même que celui de Péron. Sparrman, tome I, ch. V, p. 63 ; — Levaillant, deuxième voyage, tome III, p. 165, 166 et 181.
[171] Sparrman, tome I, ch. V, p. 64 et 65.
[172] Dampier, Nouveau Voyage autour du Monde, tome II, ch. XX, p. 215.
[173] Sparrman, Voyage au cap de Bonne-Espérance, tome I, ch. V, p. 236 et 238.
[174] Levaillant, deuxième Voyage dans l’intérieur de l’Afrique, tome III, p. 87 et 88.
[175] Thumberg, Voyage en Afrique, ch. II, p. 117. — Barrow, nouveau Voyage dans la partie méridionale de l’Afrique, tome I, ch. I, p. 142.
[176] Levaillant, premier Voyage dans l’intérieur de l’Afrique, tome II, p. 250 et 251.
[177] Barrow, nouveau Voyage dans la partie méridionale de l’Afrique, tome I, ch. I, p. 148.
Barrow, après avoir dit que les Cafres ont les plus belles figures qu’il ait jamais vues, ajoute qu’un jeune homme d’environ vingt ans haut de six pieds dix pouces (anglais), avait la figure la plus belle qui eût peut-être été jamais créée. Il était, dit-il, un parfait Hercule ; et une statue faite sur son modèle n’aurait pas été déplacée sur le piédestal de cette divinité dans le palais Farnèse. Ibid.
[178] Salt, Voyage en Abissinie, tome I, ch. I, p. 46, 47, et 48.
[179] Les peuples de ces côtes sont généralement peu connus : plusieurs sont un mélange de diverses espèces ou variétés. Voy. Malte-Brun, Précis de la Géographie universelle, tome V, liv. CXIII, p. 94 et 108.
[180] De Grandpré, tome II, p. 13.
[181] Histoire naturelle du Sénégal, p. 21 et 22.
[182] « La hauteur des plus grands Lapons, dit Regnard, n’excède pas trois coudées, et je ne vois pas de figure plus propre à faire rire. Ils ont la tête grosse, le visage large et plat, le nez écrasé, les yeux petits, la bouche large, une barbe épaisse qui leur pend sur l’estomac. Tous leurs membres sont proportionnés à la petitesse du corps : leurs jambes sont déliées ; les bras longs, et toute cette petite machine semble remuée par un ressort... Voilà la description de ce petit animal qu’on appelle Lapon, et l’on peut dire qu’il n’y en a point, après le singe, qui approche plus de l’homme. » Voyage de Laponie, tome I, p. 118 et 119, édit. de 1823.
On peut comparer cette description des peuples qui habitent au-delà du soixante-cinquième degré de latitude boréale, à celle des hommes qui habitaient jadis dans la partie la plus méridionale de l’Europe, et qui servirent aux sculpteurs grecs de modèle pour faire l’image de leurs dieux.
[183] Des physiologistes anglais en ont été particulièrement frappés. W Lawrence’s Lectures on physiology, zoology, and the natural history of man, delivered at the royal college of Surgeons, chap. IV, p. 352 et 353.
[184] Cæs. Bell. gall., lib. I, cap. VIII.
Si les descendants des Gaulois faisaient aujourd’hui la description des descendants des Germains, ils vanteraient sans doute leur courage ; mais ils n’en feraient pas cependant un portrait si effrayant. Faut-il penser que les uns ont dégénéré et que les autres se sont perfectionnés ? Le climat d’Allemagne est-il devenu plus chaud, ou celui de France s’est-il refroidi ? Il est remarquable que César fait lui-même sur les Gaulois une observation analogue à celle que les Gaulois faisaient eux-mêmes sur les Germains. « Leur taille avantageuse, dit-il, fait mépriser aux Gaulois la petitesse de la nôtre » (Ibid. c. VII) ; d’où l’on pourrait conclure ou que les Romains étaient des nains, ou que les Germains étaient des géants.
[185] Cæs, Bell. gall. lib. VI, cap. IV.
[186] Esprit des lois, liv. XIV, ch. II.
[187] « Nulle part, dit M. Alexandre de Humboldt, on ne reconnaît mieux l’ordre admirable avec lequel les différentes tribus de végétaux se suivent comme par couches, les unes au-dessus des autres, qu’en montant depuis le port de la Vera-Cruz vers le plateau de Perote. C’est là qu’à chaque pas on voit changer la physionomie du pays, l’aspect du ciel, le port des plantes, la figure des animaux, les mœurs des habitants et les genres de culture auxquels il se livrent. » Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, tome II, liv. III, ch. VIII, p. 336.
Ce savant voyageur dit ailleurs : « Ces considérations générales sur la division physique de la Nouvelle-Espagne, offrent un grand intérêt politique. En France, même dans la plus grande partie de l’Europe, l’emploi du territoire et les divisions agricoles dépendent presque entièrement de la latitude géographique ; dans les régions équinoxiales du Pérou, dans celles de la Nouvelle-Grenade et du Mexique, le climat, la nature des productions, l’aspect, j’ose le dire, la physionomie du pays, sont uniquement modifiés par l’élévation du sol au-dessus de la surface des mers. L’influence de la position géographique se perd auprès de l’effet de cette élévation. Des lignes de culture semblables à celles qu’Arthur Young et M. Decandolle ont tracées sur les projections horizontales de la France ne peuvent être indiquées que sur des profils de la Nouvelle-Espagne.
« Sous les dix-neuvième et vingt-deuxième degrés de latitude, le sucre, le coton, surtout le cacao et l’indigo, ne viennent abondamment que jusqu’à six ou huit cents mètres de hauteur. Le froment d’Europe occupe une zone qui, sur la pente des montagnes, commence généralement à quatorze cents, et finit à trois mille mètres. Le bananier (musa paradisiaca), plante bienfaisante qui constitue la nourriture principale de tous les habitants des tropiques, ne donne presque plus de fruit au-dessus de quinze cent cinquante mètres. Les chênes du Mexique ne végètent qu’entre huit cents mètres et trois mille cents mètres. Les pins ne descendent vers les côtes de la Vera-Cruz que jusqu’à dix-huit cent cinquante mètres ; mais aussi ces pins ne s’élèvent, près de la limite des neiges perpétuelles, que jusqu’à quatre mille mètres de hauteur. »
Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, tome I, liv. I, ch. 21, p. 290 et 291.
[188] « La nature, dit Raynal, avait pourvu au bonheur des Malais ; un climat doux, sain, et rafraîchi par les vents et les eaux, sous le ciel de la zone torride ; une terre prodigue de fruits délicieux, qui pourraient suffire à l’homme sauvage, ouverte à la culture de toutes les productions nécessaires à la société ; des bois d’une verdure éternelle ; des fleurs qui naissent à côté des fleurs mourantes ; un air parfumé ; des odeurs vives et suaves qui s’exhalent de tous les végétaux d’une terre aromatique, allument le feu de la volupté dans les êtres qui respirent la vie. » Histoire philosophique des deux Indes, tome I, liv. I, p. 172.
[189] Alexandre de Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, liv. II, ch. V, tome II, p. 377 et 378 ; et tome III, liv. III, ch. IX, p. 259 et 260.
[190] Roberson’s History of America, book VII. Voyez aussi les Lettres de Carli, les Discours philosophiques d’Ulloa, et l’Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, liv. II, chapitre V, par M. de Humboldt.
[191] Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, tome II, liv. III, ch. VIII, p. 142.
[192] Ibid., p. 268.
[193] Robertson’s History of America, b. iv, vol. II, pag. 141 et 142.
[194] Ibid., p. 139, 140 et 141.
[195] De Humboldt, Tableaux de la nature, tome I, p. 62.
[196] Depons, Voyage à la partie orientale de la Terre-Ferme, tome I, ch. IV, p. 309 et 311.
[197] « La diversité et la multitude d’insectes dont il se forme un nuage qui couvre ces îles, les rendent inhabitables pour quiconque n’y a pas vu le jour. Cette incommodité en a éloigné jusqu’ici les missionnaires. » Depons, t. I, p. 310 et 311.
[198] Tableaux de la nature, tome I, p. 39 et 40.
[199] Azara, Voyage dans l’Amérique méridionale, tome II, ch. X et XI, p. 56, 57, 173 et 174.
[200] Depons, Voyage à la partie orientale de la Terre-Ferme, tome I, ch. IV, p. 295. — Cette communauté de biens qui annonce l’enfance de la civilisation, est cependant démentie par Robertson, dont le témoignage pourrait balancer au moins celui d’Azara et de Depons si la même communauté n’avait pas été également constatée chez les Indiens du Nord. Robertson’s History of America, vol. II, note 35, p. 396.
[201] Depons, Voyage à la partie orientale de la Terre-Ferme, tome III, ch. XI, p. 318.
[202] De Humboldt, Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, tome II, liv. III, ch. VIII, p. 409.
[203] Tableaux de la nature, tome I, p. 62 et 63.
[204] De Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, tome III, liv. III, ch. IX, p, 259 et 260 ; et tome VI, liv. VII, ch. XIX, p. 165, 268 et 269.
[205] Histoire philos. des deux Indes.
[206] Ulloa, Discours philosophiques, tome II, Dis. XXI, p. 94. Les vieillards péruviens civilisés ne savent pas même tenir compte du nombre de leurs années. Ibid., tome II, p. 33 et 35. — M. de Humboldt a observé la même ignorance au Mexique. Essai polit., tome I, liv. II, ch. vi, p. 393.
[207] De Humboldt, Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, tome I, liv. II, ch. VI, p. 429. — Depons, Voyage à la partie orientale de la Terre-Ferme, tome I, ch. III, p. 263.
[208] Depons, tome I, ch. IV, p. 340.
[209] Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, tome I, liv. II, ch. V, p. 357.
[210] De Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, tome II, ch. IV. p. 259 ; et tome VI, liv. VII, ch. XIX, p. 301. — Tableaux de la nature, tome I, p. 62, 195 et 201.
[211] « Les missionnaires profitent de ces occasions pour les catéchiser, dit Depons en parlant des Indiens qui vont vendre du poisson aux Espagnols ; mais s’il faut en juger par le peu de succès de leur morale depuis plus d’un siècle, ces Indiens persistent dans la vie sauvage plus par convenance que par l’ignorance des avantages que promet la vie civile. » Voyage à la partie orientale de la Terre-Ferme, tome I, ch. IV, pag. 310 et 311. — Quels avantages en effet, s’ils sont tels que nous les décrit M. de Humboldt et Depons lui-même !
[212] « Sous la zone torride, dit M. de Humboldt, les peuples chasseurs sont extrêmement rares. » Voyage aux régions équinox., liv. III, ch. IX, tome III, p. 297 et 298.
[213] Robertson’s Hist. of America, vol. II, p. 396.
[214] Azara, Voyage dans l’Amérique mérid., tome II, chap. XI, p. 176 et 177.
[215] Ulloa, Discours philosophiques, tome II, Disc. XXII, p. 126, et Azara, Voyage dans l’Amérique méridionale, tome II, chap. X, page 144.
[216] De Humboldt, Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, tome II, liv. III, ch. VIII, p. 377 et 378. — Azara, Voyage dans l’Amérique méridionale, tome II, ch. X, p. 13, 17, 152 et 163.
[217] Azara, ibid., p. 52.
[218] Bougainville, Voyage autour du Monde, première partie, ch. VIII, tome I, p. 164, 165 et 166.
[219] De Humboldt, Essai polit. sur la Nouvelle-Espagne, tome II, liv. III, ch. VIII, p. 377 et 398. — Azara, Voyage dans l’Amérique méridionale, tome II, ch. X, p. 12.
[220] Wallis, Relation d’un Voyage fait autour du Monde, ch. II, tome II, p. 65 et 66.
[221] Cook, premier Voyage, liv. I, chi V, tome II, p. 335.
[222] Wallis, Relation d’un Voyage fait autour du Monde, tome II, ch. II, p. 44, 45, 65, 66 et 67.
[223] Bougainville, Voyage autour du Monde, première partie, ch. IX, tome I, p. 196. — Cook, premier voyage, liv. I, chap. III, tome II, p. 321. — Wallis, Voyage autour du Monde, chap. II, tome II, p. 47.
[224] Cook, premier Voyage, livre I, chap. V, tome II, p. 341, et deuxième Voyage, ch. V, tome V, p. 205. — Bougainville, Voyage autour du Monde, première partie, chap. IX, tome I, page 198. — Wallis, Voyage autour du Monde, chap. II, tome II, pages 65 et 66.
[225] Ellis, Voyage à la baie d’Hudson, p. 177 et 178.
[226] Mackenzie, premier Voyage dans l’intérieur de l’Amérique septentrionale, ch. IV, tome II, p. 23.
Raynal assure que les Esquimaux passent l’hiver sous des huttes construites de cailloux liés entre eux par un ciment de glace ; et que la chaleur de leur sang et de leur haleine, jointe au feu d’une lampe, suffit pour changer leurs cases en étuves. Voilà, sans contredit, des étuves bien cimentées. Histoire philosoph. des deux Indes, tome VIII, liv. XVII, p. 359.
[227] Lahontan, Voyage dans l’Amérique septentrionale, tome I, lettre XIII, p. 101.
[228] Charlevoix, Nouvelle-France, tome II, liv. IX, p. 158.
Voyez, sur l’agriculture des indigènes de l’Amérique du nord, Lahontan, Voyage dans l’Amérique septentrionale, tome I, p. 100, 117, 161 et 170, et tome II, p. 110 et 153 ; — Charlevoix, Nouvelle-France, tome I, liv. IV, p. 230 ; tome II, liv. IX, p. 158 ; liv. X, p. 252 ; liv. XI, p. 355 ; tome III, liv. XVI, p. 253 et 295 ; tome IV, liv. XX, p. 119 ; — Weld, Voyage au Canada, tome III, ch. XXXIV, p. 32 ; — Lervis et Clarke, Voyage à l’océan Pacifique, p. 71, 73, 83, 84, 94, 402, 420 et 421 ; — Hennepin, Description de la Louisiane, p. 83, 84, 137 et 138 ; — Charlevoix, Nouvelle-France, tome III, liv. XII, p. 22 et 23 ; tome IV, liv. XX, p. 192.
[229] G. Dixon, Voyage autour du Monde, tome II, p. 11 et 12.
[230] La Pérouse, Voyage autour du Monde, tome II, ch. IX, p. 233. — Fleurieu, Voyage du capitaine Marchand, tome II, ch. IV, V et VI, p. 4-236. — G. Dixon, Voyage autour du Monde, tome II, p. 11 et 24. — Cook, troisième Voyage, liv. IV, ch. III ; tome v, p. 129 et 161.
[231] G. Dixon, Voyage autour du Monde, tome I, p. 435 et 436. — Vancouver, Voyage à la côte nord-ouest de l’Amérique septentrionale, tome II, p. 24-25.
[232] On a découvert, sur le Missouri, une fortification de mille deux cent cinquante toises de long, et parallèle à cette rivière, « La description de cette fortification correspond exactement à celle des nombreuses fortifications anciennes, découvertes dans la partie de l’ouest, et qui sont représentées comme étant généralement d’une forme oblongue, et situées dans une position forte et bien choisie, en même temps qu’elles sont contiguës à quelque rivière. D’après l’examen qui a été fait de ces ouvrages, on a supposé qu’ils avaient été construits depuis plus de mille ans, ou sept cents ans avant la découverte de l’Amérique par Colomb. Il paraît qu’ils ont tous été érigés à la même époque dans toute la vaste étendue ou du moins dans la plus grande partie du pays borné par les monts Alleghany à l’est, par les montagnes pierreuses à l’ouest, et qui sont placées sous les latitudes les plus favorables de l’Amérique septentrionale. » Lewis et Clarke, Voyage à l’océan Pacifique, chap. III, pag. 40 et 41.
Il existe dans l’Amérique méridionale, comme sur le Missouri et à l’ouest des monts Alleghany, des traces d’un peuple plus civilisé que les habitants actuels, et qui avait disparu même avant la conquête des Espagnols. De Humboldt, Voyage aux régions équinox., liv. VI, ch. XVII, tome VI, p. 65 et 66.
[233] Volney, Tableau du climat et du sol des États-Unis.
[234] La Pérouse, Voyage autour du Monde, tome III, ch. XXV, p. 275 et 277. — Fleurieu, Voyage du capitaine Marchand, tome I, ch. II, p. 190. — Bougainville, Voyage autour du Monde, tome II, deuxième partie, ch. II, p. 62. — Labillardière, Voyage à la recherche de La Pérouse, tome II, ch. XII, p. 118 et 144.
[235] Cook, premier Voyage, tome II, liv. I, ch. XVIII, p.590.
[236] Le défrichement qui précède une plantation, dit Cook en parlant des habitants de Tanna, doit être un travail bien pénible, en considérant les instruments aratoires dont se servent les habitants, et qui, quoique inférieurs à ceux des îles de la Société, sont faits sur le même modèle. Leur pratique néanmoins est judicieuse et aussi expéditive qu’elle peut l’être. Ils coupent les petites branches des grands arbres, creusent la terre sous les racines, et ils brûlent les branches, les arbustes et toutes les plantes qu’ils déracinent. Cook, deuxième Voyage, tome IV, ch. V, p. 292. Ce peuple, placé sous le dix-neuvième degré trente-deux minutes de latitude australe, appartient à une variété de nègres.
[237] Krusenstern, Voyage autour du Monde, tome I, chap. IX, p. 204 et 220, — Forster, cité dans le deuxième Voyage de Cook, tome III, ch. IV, p. 197 et 200.
[238] Fleurieu, Voyage du capitaine Marchand, tome I, ch. II, page 190.
[239] La Pérouse, Voyage autour du Monde, tome III, ch. XXIV, p. 235 et 236.
[240] La Pérouse, ch. XXV, p. 282.
[241] La Pérouse, Voyage autour du Monde, tome III, ch. XXIV, p. 235 et 236.
[242] Ibid., tome III, ch. XXV, p. 275 et 281.
[243] Cook, deuxième Voyage, tome II, p. 45, 46, 47 et 135.
[244] Bougainville, Voyage autour du Monde, deuxième partie, ch. III, tome II, p. 68. — Dentrecasteaux, Voyage à la recherche de La Pérouse, tome I, ch. XIV, p. 311.
[245] Cook, troisième Voyage, liv. II, ch. X, tome III, p. 79 et 80.
[246] Cook, premier Voyage, liv. I, ch. XVII, tome II, p. 601, et Bougainville, deuxième partie, ch. III, tome II, p. 68.
[247] Cook, troisième Voyage, liv. III, ch. VIII, tome IV, p. 91. — Wallis, Voyage autour du Monde, chap. VIII, tome II, pages 194 et 195.
[248] Cook, premier Voyage, liv. I, ch. XIX, tome II, p. 603, 604, 611 et 613.
[249] Dentrecasteaux, Voyage à la recherche de La Pérouse, tome I, ch. XIV, p. 318. — Labillardière, ch. XII, tome II, p. 149.
[250] Cook, deuxième Voyage, liv. II, ch. II, tome II, p. 331, et troisième Voyage, liv. II, ch. IV et VIII, p. 139 et 295.
[251] Dentrecasteaux, Voyage à la recherche de La Pérouse, tome I, ch. XIV, p. 308.
[252] Cook, troisième Voyage, tome VII, liv. V, ch. V, VI et VII.
[253] La Pérouse, Voyage autour du Monde, tome II, chap. VI, page 128.
[254] Cook, troisième Voyage, tome IV, liv. III, ch. XI, p. 287, et tome VII, liv. V, ch. VII, p. 92.
[255] Cook, deuxième Voyage, tome III, ch. II, p. 159 et 160.
[256] La Pérouse, tome II, ch. V, p. 116.
[257] Forster, cité dans le deuxième Voyage de Cook, tome III, p. 126 et 127. — La Pérouse, tome II, ch. IV, p. 107.
[258] La Pérouse, tome II, ch. IV, p. 106. — Cook, deuxième Voyage, tome III, ch. II, p. 136.
[259] Forster, deuxième voyage de Cook, tome III, ch. II, p. 106. — La Pérouse, tome II, ch. IV, p. 106.
[260] La Pérouse, tome II, ch. IV, p. 101.
[261] Cook, deuxième Voyage, tome III, ch. III, p. 147.
[262] Cook, premier Voyage, tome III, liv. II, ch. III, IV et XI, p. 79, 144 et 340. — Troisième Voyage, tome I, liv. I, chap. VIII, page 327.
[263] Forster, cité dans le deuxième Voyage de Cook, tome II, liv. II, ch. IV, page 445.
[264] Anderson, troisième Voyage de Cook, tome I, liv. I, ch. VIII, p. 331 et 332.
[265] Forster, cité dans le deuxième Voyage de Cook, tome I, ch. VII, p. 424 et 439.
[266] Cook, troisième Voyage, tome I, liv. I, ch. VII, pages 259 et 290.
[267] Anderson, troisième Voyage de Cook, tome I, liv. I, ch. VI, p. 232 et 233.
[268] Dentrecasteaux, Voyage à la recherche de La Pérouse, tome I, ch. IV, p. 56. — Cook, troisième Voyage, tome I, liv. I, ch. VI, p. 199. — Labillardière, Voyage à la recherche de la Pérouse, tome I, ch. V, p. 167, et tome II, ch. X et XI, p. 55, 56 et 72.
[269] Dentrecasteaux, Voyage à la recherche de La Pérouse, tome I, ch. XI, p. 229. Labillardière, tome II, ch. X, pages 35 et 50. — Péron, Voyage de découvertes aux terres australes, tome I, liv. III, ch. XII, p. 229 et 230.
[270] Péron, Voyage de découvertes aux terres australes, tome I, liv. III, ch. XX, p. 448. — Dentrecasteaux, Voyage à la recherche de La Pérouse, tome I, ch. IV, p. 61.
[271] L. Freycinet, Voyage de découvertes aux terres australes, liv. II, ch. I, p. 44 et 61. — Dentrecasteaux, tome I, ch. IV, p. 93. — Labillardière, tome I, ch. V, p. 184 et 185.
[272] Péron, tome I, liv. II, ch. XIII, p. 269. — Dentrecasteaux, tome I, ch. IV, p. 56. — Labillardière, tome I, ch. V, p. 177. — Cook, troisième Voyage, tome I, liv. I, ch. VI, p. 200. — Anderson, troisième Voyage de Cook, liv. I, ch. VI, tome I, p. 232.
[273] L. Freycinet, Voyage de découvertes aux terres australes, liv. II, ch. I, p. 43. — Péron, Voyage de découvertes aux terres australes, tome I, liv. III, ch. XX, p. 448.
[274] Cook, premier Voyage, tome IV, liv. III, ch. VI, p. 145. — Péron, Voyage aux terres australes, tome II, liv. V, ch. XXXVIII, page 372.
[275] L. Freycinet, Voyage de découvertes aux terres australes, liv. II, ch. IV et V, p. 148 et 162. — Péron, Voyage de découvertes aux terres australes, tome II, liv. IV, ch. XXVII, p. 151. — Dampier, nouveau Voyage autour du Monde, tome II, ch. XVI, p. 143. — Phillip., Voyage à Botany-Bay, ch. XIV, p. 162.
[276] White, Voyage à la Nouvelle-Galles du sud, p. 135.
[277] Péron, Voyage aux terres australes, tome II, liv. IV, ch. XXX, p. 207 et 214.
[278] Cook, premier Voyage, tome III, liv. III, ch. I, p. 400, et tome IV, ch. VI, p. 159 et 161. — L. Freycinet, Voyage de découvertes, livre II, ch. IX, p. 293.
[279] Dampier, nouveau Voyage autour du Monde, tome II, ch. XVI, p. 143.
[280] L. Freycinet, Voyage de découvertes aux terres australes, liv. II, ch. IX, p. 294.
[281] Péron, Voyage de découvertes aux terres australes, tome I, liv. III, ch. XX, p. 450.
[282] Labillardière, Voyage à la recherche de La Pérouse, tome II, ch. XIII, p. 193.
[283] Cook, deuxième Voyage, tome IV, ch. VIII, p. 434, 447, 451 et 452. — Dentrecasteaux, Voyage à la recherche de La Pérouse, tome I, ch. VI, p. 356. — Labillardière, tome II, ch. XIII, p. 212.
[284] Labillardière, tome II, ch. XII, p. 247.
[285] Cook, deuxième Voyage, tome IV, ch. VI, p. 356.
[286] Cook, deuxième Voyage, tome IV, ch. V et VI, p. 232, 259, 292 et 336. — Forster, ibid., p. 271.
[287] Cook, deuxième Voyage, tome IV, ch. III, p. 126.
[288] Hawkesbury et Abel Tasman, cités par Malte-Brun, tome IV, liv. LXXVIII, p. 380 et 381.
[289] Les habitants de la terre de Van-Diemen et de la Nouvelle-Hollande, n’appartiennent pas à l’espèce malaie, ainsi que je l’ai déjà fait observer ; mais l’infériorité des premiers ne peut pas être attribuée à la différence d’espèce ou de race ; premièrement parce que cette infériorité se trouve en grande partie chez les habitants de la Nouvelle-Zélande, qui sont incontestablement d’espèce malaie ; et, en second lieu, parce qu’il existe, entre les peuples de la terre de Van-Diemen, et des peuples de même espèce plus avancés vers l’équateur, des différences intellectuelles très marquées.
[290] Voyez Malte-Brun, Précis de la Géographie universelle, tome III, liv. XLVI, p. 5 et suiv.
[291] Raynal, tome III, liv. V, p. 129 et 130.
[292] Voyez le Voyage de Pallas.
[293] Krusenstern, Voyage autour du Monde, tome II, ch. XXI, p. 288 et 290. — La Pérouse, tome III, ch. III, p. 208.
[294] Broughton, Voyage de découvertes, tome II, liv. II, ch. VI, page 208.
[295] La Pérouse, tome III, ch. XXI, p. 150 et 151.
[296] La Pérouse, tome III, ch. XIX, p. 105 et 106, et tome IV, page 1oo.
[297] La Pérouse, tome III, ch. XVII, p.46. — Broughton, tome II, liv. II, ch. VII, p. 235 et 241.
[298] Coxe, Nouvelles découvertes des Russes entre l’Asie et l’Amérique, première partie, ch. XII et XV, p. 160 à 166.
[299] La Pérouse, tome III, ch. XIX, p. 115.
[300] La Pérouse, tome III, ch. XVIII, p. 73 et 78.
[301] Ibid., ch. XX, pag. 126. — Rollin, Voyage de La Pérouse, tome IV, p. 94 et 95.
[302] La Pérouse, tome III, ch. XVI, p. 73 et 78.
[303] Broughton, tome I, liv. I, ch. V, p. 142, 145 et 162.
[304] Broughton, tome II, liv. II, ch. II et III.
[305] Les Chinois, même lorsqu’ils ont admis chez eux des Européens qu’ils voulaient honorer, tels que des ambassadeurs, ne leur ont pas laissé la liberté de visiter le pays. « Nous résidions au milieu de Pékin, dit lord Macartney ; mais on ne nous permettait pas de nous y promener à notre gré ; nous étions, au contraire, gardés chez nous comme dans une espèce de prison. » Voyage en Chine et en Tartarie, tome V, ch. I, p. 226.
[306] Macartney, tome II, ch. III et IV, p. 234, 270 et 324 ; et tome IV, ch. I et II, p. 21, 115 et 116. — Barrow, Voyage en Chine, tome II, p. 227, et tome III, ch. XII, p. 73 et 74. — Raynal, Hist. philosph., tome I, liv. I, p. 193.
[307] Marcartney, tome IV, ch. II, p. 116.
[308] Barrow, Voyage en Chine, tome III, ch. XII, p. 69 et 70.
[309] Voyage en Chine et en Tartarie, t. III, ch. IV, p. 258 et 259.
[310] Barrow, Voyage en Chine, tome II, ch. VII, p. 53 et 54.
[311] Ibid., tome I, ch. IV, p. 297.
[312] Ibid., tome III, ch. XIII, P. 106.
[313] Mac-Leod, Voyage de l’Alceste, ch. V, p. 197. — Macartney, tome V, ch. I, p. 222. — Barrow, tome II, ch. VII, p. 18 et 23.
[314] Macartney, tome III, ch. IV, p. 263.
[315] Ibid., ch. I, p. 165 et 169.
[316] Barrow, Voyage en Chine, tome I, ch. III, p. 154, 155, 172 et 210. — Macartney, tome II, ch. III, p. 229.
[317] Barrow, Voyage en Chine, tome I, ch. III, p. 182 et 183.
[318] Chardin, Voyage, en Perse, tome III, p. 267 et 268.
[319] Niebuhr, Voyage en Arabie, tome II, p. 137. — Chardin, tome III, p. 269 et 270.
[320] Chardin, tome IV, ch. XVII, p. 97.
[321] Niebuhr, tome II, p. 98. — Chardin, tome II, p. 304 et 305.
[322] Langlès, mémoire sur Persépolis, inséré dans sa collection de Voyages.
[323] Chardin, tome IV, p. 136.
[324] « En Orient, dit Chardin, les négociants sont des gens sacrés à qui on ne touche jamais ; même durant la guerre, eux et leurs effets passent libres au milieu des armées. C’est à leur égard surtout que la sûreté des chemins est si grande en toute l’Asie, et particulièrement en Perse. » Tome IV, ch. XIX, p. 159.
[325] Chardin, tome IV, ch. II, p. 225 et 231.
[326] Si les proverbes d’un peuple ne sont pas toujours une preuve de la bonté de ses mœurs, ils sont du moins une preuve de son intelligence. Voici quelques-uns de ceux que Chardin a recueillis en Perse :
« L’ignorance est une rosse qui fait broncher à chaque pas celui qui la monte, et qui rend ridicule celui qui la mène.
« Qui augmente ses expériences, augmente sa science ; qui augmente sa crédulité augmente ses erreurs.
« Quiconque n’apprend pas une profession à son enfant, ne fait pas autrement que s’il lui enseignait la filouterie.
« La faim est un nuage d’où il sort une pluie d’éloquence et de science ; la satiété est un nuage d’où il sort une pluie d’ignorance et de grossièreté ; quand le ventre est vide, le corps devient esprit ; mais quand il est rempli l’esprit devient corps.
« Ne prenez jamais de maison dans un quartier dont le menu peuple est tout ensemble ignorant et dévot.
« N’ayez jamais de querelle contre trois hommes à la fois, de peur qu’un ne se fasse partie et les deux autres témoins.
« Craignez qui vous craint. » Chardin, tome V, ch. XII.
[327] Kolbe, Description du cap de Bonne-Espérance, tome I, ch. VI, p. 58 et 59.
[328] Sparrman, Voyage au cap de Bonne-Espérance, tome I, ch. V, p. 263 à 265. — Thumberg, Voyage en Afrique et en Asie, ch. VI, p. 120, 150 et 151. — Kolbe, tome I, ch. XVI, p. 241. — Levaillant, premier voyage dans l’intérieur de l’Afrique, tome II, p. 283, 284, 298 et 299 ; et deuxième Voyage, tome I, p. 128, 129, 199, 229 et 232, et tome III, p. 412 et 413.
[329] Dampier, tome II, ch. XX, p. 215. — Kolbe, tome I, ch. XIX, p. 289 à 291. — Sparrman, Voyage au cap de Bonne-Espérance, tome I, ch. V, p. 256 à 258. — Levaillant, premier Voyage, tome II, p. 37 et 38.
[330] Dampier, t. II, ch. XX, p. 214. — Thumberg, ch. III, p. 108.
[331] L. Degrandpré, Voyage à la côte occidentale d’Afrique, tome II, p. 186 et 187. — Dampier, tome II, ch. XX, p. 213. Kolbe, tome I, ch. XVI.
[332] Histoire polit. et philosoph, des deux Indes, tome I, livre II, page 393.
[333] Levaillant, premier Voyage, tome II, p. 228, 255 et 256.
[334] Barrow, nouveau Voyage dans la partie méridionale de l’Afrique, tome I, ch. I, p. 144 et 145.
[335] H. Salt, Voyage en Abyssinie, tome I, p. 15 et 16.
[336] Mollien, Voyage dans l’intérieur de l’Afrique, tome I, ch. II, p. 103 et 104 ; ch. III, p. 255 et 256, et ch. IV, p. 287 et 288.
[337] J. Mathews, A voyage to the river Sierra-Leone, lett. II, III, IV, V et VI. — J. Degrandpré, Voyage à la côte occidentale d’Afrique, chap. I et II. — Mollien, Voyage dans l’intérieur de l’Afrique, ch. II et V.
[338] L’Égypte a été si souvent décrite, qu’on ne peut rien dire sur ses monuments, sans répéter ce que presque tout le monde sait. Cependant, je ne puis m’empêcher de faire connaître ici l’impression que produisit sur un voyageur l’aspect des ruines qui couvrent le sol de ce pays :
« Qu’on ne me parle plus de Rome, écrivait Norden au baron Stosch ; que la Grèce se taise, si elle ne veut pas être convaincue qu’elle n’a jamais rien su que par le moyen de l’Égypte. Quelle vénérable architecture ! quelle magnificence ! quelle mécanique ! quelle nation enfin, qui a eu le courage d’entreprendre des ouvrages si surprenants ; ils surpassent, en vérité, l’idée qu’on s’en peut former. » Norden, Voyage d’Égypte et de Nubie, p. 46 de la préface. L’armée française tout entière éprouva à l’aspect des mêmes ruines un sentiment semblable à celui de Norden. Denon, tome II, p. 27.
[339] Dans une partie de la nation, dit M. de Humboldt, le développement intellectuel peut faire des progrès très marquants, sans que la situation des dernières classes devienne plus heureuse. Presque tout le nord de l’Europe nous confirme cette triste expérience ; il y existe des pays dans lesquels, malgré la civilisation vantée des hautes classes de la société, le cultivateur vit encore aujourd’hui dans le même avilissement sous lequel il gémissait trois ou quatre siècles plus tôt. Essai politique, tome I, livre II, chap. VI, page 421 Même en comparant les classes instruites entre elles, la supériorité demeure aux peuples des pays chauds. Que peuvent opposer tous les peuples des pays froids du monde entier aux œuvres du Dante, de Pétrarque, de Boccace, du Tasse, de l’Arioste, de Métastase, d’Alfieri, de Galilée, de Gassendi, de Torricelli, de Machiavel, de Davila, de Bentivoglio, de Guichardini, de Raphaël, de Michel-Ange, de Canova et d’une multitude d’autres savants, poètes ou artistes qu’a produite la seule Italie, même depuis l’invasion des barbares ?
[340] La Chine est le pays qui a principalement servi de base au système de Montesquieu ; mais la Chine n’est pas un climat très chaud ; elle jouit, au contraire, d’une température fort douce. « Tout ce que dit de la Chine cet éloquent et ingénieux écrivain, et principalement ce qui a rapport au climat, est absolument inexact, et les conséquences qu’il en tire sont fausses... La Chine jouit d’un climat tempéré d’un bout de l’empire à l’autre. » Barrow, Voyage en Chine, tome I, ch. IV, p. 249 et 250.
La Chine jouissant d’un climat tempéré, les Chinois devraient être, d’après le système de Montesquieu, le peuple le plus inconstant et le plus changeant du monde.
[341] Raynal a partagé l’opinion de Montesquieu sur les climats, et celle de Rousseau sur les effets moraux de la civilisation. « À mesure que les sociétés s’accroissent et durent, dit-il, la corruption s’étend ; les délits, surtout ceux qui naissent de la nature du climat dont l’influence ne cesse point, se multiplient, et les châtiments tombent en désuétude, à moins que le code ne soit mis sous la sanction des dieux. » Hist. philosoph., tome I, liv. i, p. 88.
Voilà, dans cinq lignes, quatre erreurs, chacune desquelles, si elle était pleinement adoptée, suffirait pour plonger ou pour retenir à jamais un peuple dans la barbarie.
[342] « Les religions ont toujours été cruelles dans les pays arides, sujets aux inondations, aux volcans ; et elles ont toujours été douces dans les pays que la nature a bien traités. Toutes portent l’empreinte du climat où elles sont nées. » Raynal, Hist. philos., tome II, liv. III, p. 36.
[343] Voici comment un abbé physicien, Giraud Soulavie, explique les révolutions qui, à des époques diverses, se sont opérées parmi les hommes : « Les basaltes et les amygdaloïdes augmentent la charge électrique de l’atmosphère, et influent sur le moral des habitants, en les rendant légers, révolutionnaires et enclins à abandonner la religion de leurs pères. » De Humboldt, Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, tome II, liv. V, ch. XII, p. 496.
« Je pourrais citer, dit un autre écrivain en parlant de l’adoucissement des mœurs, les atrocités qui ont souillé la Révolution et qui ont fait croire que Paris n’était pas ce bon peuple tant vanté ; ces atrocités n’ont été exercées que par des malheureux étrangers aux habitudes du café. » Robin, Voyage dans la Louisiane, tome I, ch. VIII, p. 137.
[344] Tel est l’aspect général sous lequel se sont présentés les peuples d’Amérique, lorsque les Européens en ont fait la découverte ; mais des différences de position ont produit plusieurs exceptions à cette division générale des peuples. Chez les nations même les plus civilisées, les parties de la population qui vivent sur les rivages de la mer, sur des golfes, ou sur les bords des fleuves, tirent de la pêche une partie considérable de leurs subsistances. Il en a été de même des peuplades américaines, sous quelque latitude qu’elles se soient trouvées situées ; plus la pêche a été facile ou plus les produits en ont été abondants, et moins les peuples se sont sentis disposés à adopter tout autre genre d’industrie. La difficulté ou l’impossibilité de cultiver le sol s’est jointe quelquefois à la facilité de la chasse ou de la pêche pour arrêter les progrès d’un peuple.
[345] Robertson observe qu’il faut, à une tribu composée de deux ou trois cents individus vivant des produits de la chasse, un territoire aussi étendu que quelques-uns des royaumes de l’Europe. History of America, b. iv, vol. II, p. 128 et 129.
[346] Ellis, Voyage à la baie d’Hudson, p. 181.
[347] Charlevoix, Nouvelle-France, tome II, liv. VIII, p. 97.
[348] Mackenzie, premier Voyage, tome II, ch. V, p. 59.
[349] Lewis et Clarke, Voyage à l’océan Pacifique, ch. V, p. 84 et 85. — Hennepin, Description de la Louisiane, p. 121.
[350] Hearne, Voyage à l’océan du nord, ch. II, IV, et IX, p. 12, 13, 23, 64, 65, 66 et 307. — Weld, Voyage au Canada, tome III, ch. IV, pag. 49. — Hennepin, Mœurs des sauvages de la Louisiane, pages 14 et 15.
[351] Charlevoix, Nouvelle-France, tome I, liv. I, pag. 51. — De Humboldt, Nouvelle-Espagne, tome III, liv. IV, ch. IX, p. 32 et 46.
[352] Lahontan, Voyage dans l’Amérique septentrionale, tome II, p. 145. — Hearne, ch. IV, p. 66. — Volney, Tableau du climat et du sol des États-Unis, tome II, p. 445 et 446. — La Pérouse, tome IV, p. 59.
[353] Charlevoix, Nouvelle-France, tome II, liv. VIII, p. 115. — Mackenzie, deuxième Voyage, tome I, p. 298, et tome III, ch. IX, p. 126. — Hearne, ch. IX, p. 305.
[354] Ellis, Voyage à la baie d’Hudson, p. 250 et 251. — Mackenzie, premier Voyage, tome II, ch. VII, p. 148 et 149. — Hearne, ch. II, VI, VII et IX, p. 32, 33, 151, 152, 186, 302 et 303. — Hennepin, p. 296 et 297.
[355] Hearne, ch. IV, p. 42.
[356] Hearne, ch. VI et VIII, p. 153 et 268. — La Pérouse, tome IV, p. 6 et 62. — Fleurieu, Voyage du capitaine Marchand, tome II, ch. IV, p. 83 et 84. — Azara, tome II, ch. X, p. 15, 54 et 63. — Bougainville, première partie, ch. VIII, tome I, p. 166.
[357] Lahontan, tome II, p. 110. — Weld, tome III, ch. XXXV, p. 115. — Hearne, ch. IX, p. 321. — Hennepin, Mœurs des sauvages de la Louisiane, p. 53.
[358] Charlevoix, Nouvelle-France, tome III, p. 266 et 267. — Robertson’s History of America, tome II, b. IV, pages 134 et 135.
[359] Robertson, vol. II, b. IV, p. 132 et 133. — Azara, tome II, ch. X, p. 62.
[360] Robertson observe que le gouvernement des indigènes du nord de l’Amérique a pour objet les affaires étrangères bien plus que les affaires domestiques ; et son opinion est fondée sur le témoignage de presque tous les voyageurs qui ont vécu chez ces peuples. Cependant, puisque les chasses et les pêches se font en commun, puisque c’est également en commun que la terre est cultivée et que c’est dans des magasins publics que les produits en sont déposés, n’a-t-il pas fallu une autorité quelconque pour faire la distribution ou le partage, soit du gibier, soit du maïs ? Mais peut-être les repas se font-ils aussi en commun.
[361] Raynal, tome VII, liv. XIII, p. 25.
[362] Azara, tome II, ch. X, p. 15 et 62.
[363] Hearne, ch. V et VIII, p. 116, 154 et 165.
[364] Volney, Tableau du climat et du sol des États-Unis, tome II, page 451.
[365] Cook, troisième Voyage, tome V, liv. IV, ch. I, p. 45.
[366] Hennepin, pag. 205 et 206. — Lewis et Clarke, chap. XVII, page 283.
[367] Hearne, ch. V, p. 97, 98, 99, 100, 101 et 104. — Mackenzie, deuxième Voyage, tome II, ch. II, p. 195 et 196. — Des hommes qui ont si peu de respect pour les propriétés de leurs compatriotes, doivent en avoir moins encore pour celles qui appartiennent à des étrangers ; aussi se montrent-ils généralement très disposés et très habiles à s’emparer de tout ce qui les tente. « Nous avions déjà éprouvé, dit La Pérouse en parlant de ceux de la côte nord-ouest, que les Indiens étaient très voleurs ; mais nous ne leur supposions pas une activité et une opiniâtreté capables d’exécuter les projets les plus longs et les plus difficiles : nous apprîmes bientôt à les mieux connaître. Ils passaient toutes les nuits à épier le moment le plus favorable pour nous voler ; mais nous faisions bonne garde.... Bientôt, ils m’obligèrent à lever l’établissement que j’avais sur l’île : ils y débarquaient la nuit du côté du large ; ils traversaient un bois très fourré dans lequel il nous était impossible de pénétrer le jour ; et, se glissant sur le ventre comme des couleuvres, sans remuer presqu’une feuille, ils parvenaient, malgré nos sentinelles, à dérober quelques-uns de nos effets : enfin, ils eurent l’adresse d’entrer la nuit dans la tente où couchaient MM. Lauriston et Darbaud, qui étaient de garde à l’observatoire ; ils enlevèrent un fusil garni d’argent ainsi que les habits de ces deux officiers qui les avaient placés par précaution sous leur chevet : une garde de douze hommes ne les aperçut pas, et les deux officiers ne furent point réveillés. » Tome II, ch. VII, p. 177, 178 et 179. — Voyez Cook, troisième Voyage, liv. IV, ch. I et II ; tome V, pag. 40 et 122. — Hennepin, p. 91.
[368] Charlevoix, Nouvelle-France, tome IV, liv. XIX, pag. 7. — Weld, tome III, ch. XXXV, p. 109. — Lahontan, tome II, p. 102. — J. Long, ch. IX, pag. 149. — La Pérouse, tome II, ch. IX, p. 216 et 217.
[369] Weld, tome II, ch. XXX, p. 248 et 249.
[370] J. Long, ch. IX, p. 147. — Weld, tome III, ch. XXXV, p. 109 — Michaux, Voyage à l’ouest des monts Alleghanys, ch. XVII, p. 175 et 176. — J. F. D. Smith, tome I, ch. XLIII, p. 173 et 174.
[371] Volney, Tableau du climat et du sol des États-Unis, tome II, p. 158 et 159. — Weld, tome II, ch. XIX, p. 248 et 249.
[372] Ulloa, Discours philosoph., tome II, disc. XVIII, p. 28.
[373] Un chef de sauvages du Canada s’étant enivré, en rencontra un autre contre lequel il portait, depuis vingt-deux ans, un sentiment de vengeance. Se voyant seul, il profita de l’occasion et le tua. Le lendemain toute la famille en armes demanda sa mort. Il vint au fort Miami, dit Volney, trouver le capitaine Marshal, commandant, de qui je tiens le fait, et lui dit : « Qu’ils veuillent me tuer, cela est juste ; mon cœur a éventé mon secret : la liqueur m’a rendu fou, mais tuer mon fils comme ils en menacent, cela n’est pas juste. Père, voyez si cela peut s’arranger. Je leur donnerai tout ce que je possède : deux chevaux, mes bijoux d’or et d’argent, mes plus belles armes ; excepté une paire. S’ils ne veulent pas accepter, qu’ils prennent jour et lieu ; je me rendrai seul et ils me tueront. » Tableau du climat et du sol des États-Unis, tome II, p. 458 et 459. — Voyez Charlevoix, Nouvelle-France, tome III, liv. XV, p. 180 et 181. — J. Long, ch. VII, VIII, X et XI, pag. 97, 99, 111, 125, 163 et 197. — Ellis, pag. 242. — J. F. D. Smith, tome I, ch. XXIV, p. 93 et 94. — Weld, tome III, ch. XXXV, pag. 116. — Dampier, tome I, ch. I, pag. 14. — Ulloa, Disc. philos., disc. XVII, pag. 15, 16, 17 et 19. — Robertson’s, History of America, vol. II, b. IV, p. 152, et note 38, p. 398.
[374] Lahontan, tome II, pag. 102. — Charlevoix, N.-F., tome IV, liv. XIX, p. 7. —Michaux, ch. XVII, p. 175 et 176. — Stedman, tome II, ch. XIV, p. 92 et 93. — Depons, tome III, ch. X, p. 112 et 113. — Ulloa, tome II, p. 19. — Raynal, tome V, liv. X, p. 256. — Cook, troisième Voyage, tome V, liv. IV, ch. II, p. 119.
[375] Charlevoix, Nouvelle-France, tome I, liv. V, p. 285 ; tome II, liv. VIII, p. 81 et 82. — Hennepin, p. 227. — J. Long, ch. X, p. 184 et 185. — J. F. D. Smith, tome I, ch. XXXIV, p. 173 et 174. — Robin, tome II, ch. LIV, p. 370.
[376] Hearne, ch. IX, p. 286, 287 et 288.
[377] Weld, tome III, ch. XXXV, p. 117. — Lahontan, tome II, page 117.
[378] Hearne, ch. IX, p. 287.
[379] La Pérouse, tome II, ch. IX, p. 218.
[380] Charlevoix, N. F., tome I, liv. II, p. 82 et 83 ; tome III, liv. XIII, p. 16.
[381] Hearne, ch. IX, p. 286.
[382] Hearne, p. 316 et 317, et ch. III, p. 49.
[383] Lahontan, tome II, p. 102. — Hennepin, p. 35 et 51. — De Humboldt, Essai politique, tome I, liv. II, ch. VI, p. 414. — Azara, tome II, ch. X, p. 60.
[384] Hearne, ch. IX, p. 312. — Weld, tome III, ch. XXXV, p. 137. — De Humboldt, Nouvelle-Espagne, tome I, liv. II, ch. VI, p. 414.
[385] Mackenzie, Premier voyage, tome I, p. 252.
[386] Hearne, ch. IV, p. 85. — Raynal, tome V, liv. X, p. 253.
[387] Ellis, p. 244 et 245.
[388] Hearne, ch. IX, p. 291, 292 et 293. — Mackenzie, tome I, p. 289 et 290.
[389] Lahontan, tome II, pages 138 et 139. — Hearne, chap. IV, p. 86 et 87.
[390] Mackenzie, deuxième Voyage, tome II, ch. I, p. 161 et 162.
[391] J. Long, ch. XIII, p. 248. — Hennepin, p. 38.
[392] Hearne, ch. IX, p. 289. — Mackenzie, tome I, p. 289.
[393] Hearne, ch. V, p. 99, 121, 122 et 123. — Mackenzie, tome I, p. 289. — Lahontan, tome II, p. 143. — Weld, tome III, ch. XXXII et XXXIV, p. 21 et 61. — Lewis et Clarke, ch. VI, p. 108, et ch. XVIII, p. 299. — Fleurieu, Voyage du capitaine Marchand, tome II, ch. V, p. 173 et 198. — Hennepin, p. 34, 35 et 36. — Azara, tome II, chap. X, p. 60.
[394] Hearne, ch. IV et V, p. 83, 88, 117, 118 et 122. — Mackenzie, deuxième Voyage, tome II, p. 204, et tome III, p. 268. — Charlevoix, N.-F., tome II, liv. VIII, p. 115. — J. Long, ch. X, p. 180. — Hennepin, p. 37 et 38. — Depons, tome I, ch. IV, p. 304 et 305.
[395] Mackenzie, deuxième Voyage, tome III, ch. XII, p. 268. — Charlevoix, tome I, liv. I, p. 43, et liv. III, p. 194. — Hennepin, page 33.
[396] La Pérouse, tome II, ch. XI, p. 303, et tome IV, p. 61. — Dauxion-Lavaysse, tome I, ch. VI, p. 344.
[397] Hearne, ch. V, pag. 192. — Lahontan, tome II, pag. 141. — Hennepin, p. 37 et 38.
[398] Hearne, p. 122 et 123.
[399] Lahontan, tome II, p. 130 et 131. — Azara, tome II, ch. X ; p. 60. — Raynal, tome VIII, liv. XV, p. 36 et 37.
[400] Hearne, ch. V, p. 104. — Mackenzie, prem. Voy., t. I, p. 289.
[401] Mackenzie, tome I, p. 282. — Hearne, chap. V, pag. 121. — Depons, tome I, ch. IV, p. 305 et 306. — Charlevoix, N.-F., tome I, liv. III, p. 194. — La Pérouse, tome II, ch. XI, p. 307.
[402] « Je n’assistais jamais à un de ces combats, dit Hearne, sans être vivement ému de voir l’objet de la querelle attendant, dans un morne silence, ce que le sort déciderait d’elle, tandis que son mari la disputait à son rival. À la pitié que je ressentais pour la pauvre victime se joignait la plus vive indignation, quand je la voyais passer entre les mains d’un homme qu’elle haïssait peut-être mortellement. La répugnance qu’éprouvent alors ces malheureuses à suivre leurs nouveaux maris va quelquefois si loin, que ceux-ci ont recours à la violence envers elles. J’ai vu plusieurs de ces infortunées mises absolument nues, et amenées de force à leur nouveau logement. » Ch. V, p. 100 et 101. — Cet usage de lutter pour la propriété des femmes a lieu chez toutes les tribus du Nord. Ibid., p. 99.
[403] Heargo, ch. IV, p. 83.
[404] J. F. D. Smith, tome I, ch. XIV, pag. 97. — Volney, Tableau, etc., tome II, p. 451. — Larochefoucault, tome I, p. 266 et 267. — Hennepin, p. 36. — Dampier, tome I, ch. I, p. 14.
[405] Hearne, ch. III, IV et V, p. 52, 84, 99 et 118. — Mackenzie, premier Voyage, tome I, pag. 241 et 242, et deuxième Voyage, tome II, ch. II, p. 200 et 201. — Hennepin, p. 36. — Robin, tome II, ch. IV, p. 372 et 373. — J. Long, ch. XIII, p. 250 et 251.
[406] Mackenzie, deuxième Voyage, tome II, ch. II, p. 200 et 201. — Dauxion-Lavaisse, tome I, ch. VI, p. 127, 330 et 331.
[407] Weld, tome III, ch. XXXV, p. 133 et 138. — Azara, tome II, ch. X, p. 17.
[408] Hearde, ch. IV, p. 86. — Hennepin, p. 18.
[409] Hearne, ch. V, p. 107.
[410] J. Long, ch. XIII, p. 250. — Hearne, ch. VIII, p. 246. — Mackenzie, premier Voyage, tome I, p. 282.
[411] Hearne, ch. X, p. 347.
[412] Mackenzie, premier Voyage, tome I, p. 282 et 283 ; deuxième Voyage, tome II, p. 199 et 200. — Hearne, ch. IX, p. 289.
[413] J. Long, ch. X, p. 177.
[414] La Pérouse, tome II, liv. VIII, pag. 205 et 206. — Fleurieu, Voyage du capitaine Marchand, tome II, ch. IV, p. 94.
[415] Charlevoix, N.-Fr., tome I, liv. III, p. 194 et 195, et tome II, liv. VIII, p. 99. — Hennepin, p. 38.
[416] Lahontan, tome II, p. 139. — La Pérouse, tome II, p. 303, et tome IV, p. 61. — Azara, tome II, ch. X, pag. 60. Dans la Guyane les maris sont très jaloux ; ils tuent à l’instant les femmes infidèles. Stedman, tome II, ch. XIV, p. 92. — Hennepin, p. 296 et 297.
[417] Hearne, ch. IX, p. 389.
[418] Hearne, ch. V, p. 122.
[419] Mackenzie, premier Voyage, tome I, pag. 289. — Hearne, ch. IX, p. 290 et 291. — J. F. D. Smith, tome I, ch. XXIV, p. 95. — Lahontan, tome II, pag. 135. Hennepin, p. 34. — Depons, tome I, ch. IV, p. 305.
[420] Hennepin, p. 35 et 36.
[421] Weld, tome III, ch. II, p. 62. — Mackenzie, premier Voyage, tome I, p. 241 et 242.
[422] Mackenzie, premier Voyage, tome I, p. 241 et 242. — Raynal, tome IV, liv. VII, p. 116. — Azara, tome II, ch. II, p. 93, 94, 115, 146, 152 et 156.
[423] Hearne, ch. IV, p. 83.
[424] Hearne, ch. IX, p. 312. — Quelque misérable que soit l’état des femmes, elles ont sur l’esprit de leurs maris beaucoup d’influence ; leur ascendant n’est nul que pour ce qui concerne leur propre état. — Mackenzie, premier Voyage, tome I, p. 289 ; et deuxième Voyage, tome II, ch. II, p. 200 et 201.
[425] Lahontan, tome II, p. 132 et 137.
[426] Weld, tome II, ch. XXII, p. 53.
[427] Lahontan, tome II, p. 132.
[428] Weld, tome III, ch. XXXIV, p. 61.
[429] Hearne, ch. V, p. 118 et 119.
[430] Fleurieu, Voyage du capitaine Marchand, tome II, ch. IV, p. 96 et 97. — La Pérouse, tome II, ch. IX, p. 228.
[431] Mackenzie, deuxième Voyage, tome II, ch. II, p. 199 et 200.
[432] Hearne, ch. IX, p. 290 et 291.
[433] Mackenzie, premier Voyage, tome I, p. 241 et 242.
[434] Mackenzie, deuxième Voyage, tome III, ch. XII, p. 268. — Lewis et Clarke, ch. XVIII, p. 299. — Charlevoix, N.-F., tome III, liv. XIII, p. 23. — Hennepin, p. 34 et 35. — Azara, tome II, ch. XV, page 293.
[435] Charlevoix, N.-Fr., tome II, liv. VIII, page 118, et livre IX, p. 228. — George-Dixon, tome II, p. 12 et 13.
[436] Mackenzie, importuné par les chiens des sauvages, près de la rivière à laquelle il a donné son nom, en tua un d’un coup de pistolet. « La femme à laquelle le chien appartenait, dit-il, en paraissait très chagrine, et déclara que la perte de cinq enfants, qui étaient morts l’hiver précédent, ne l’avait pas tant affectée que celle de cet animal... Quelques grains de verre suffirent pour dissiper sa douleur. » Premier Voyage, tome II, ch. VI, p. 87.
[437] Hearne, ch. IV, p. 86 et 87.
[438] Weld, tome III, ch. XXXV, p. 89.
[439] Tableau du climat et du sol des États-Unis, tome II, p. 452. — La Pérouse, tome II, ch. IX, p. 219. — Ulloa, tome II, disc. XVII, p. 9. — Depons, tome I, ch. IV, p. 306.
[440] Hennepin, p. 33 et 34.
[441] La Pérouse, tome II, ch. XI, p. 305.
[442] Hearne, ch. IX, p. 321.
[443] Ellis, pag. 245. — Volney, Tableau du climat et du sol des États-Unis, tome II, p. 444 et 445.
[444] Robertson’s History of America, vol. II, b. IV, p. 219. — Mackenzie, premier Voyage, tome I, p. 301 et 302, et deuxième Voyage, tome II, ch. II, p. 188, et tome III, ch. IX, pag. 95. — Hearne, ch. VII, p. 190 et 191.
[445] Hearne, ch. IX, pag. 317. — Mackenzie, deuxième Voyage, tome II, ch. II, p. 188.
[446] Lahontan, tome II, p. 110. — Weld, tome III, ch. XXXV, page 115.
[447] Weld, tome, III, ch. XXXV, p. 115. — La Pérouse, tome II, ch. XI, p. 305. — Hennepin, p. 52, 53 et 56. — Depons, tome I, ch. IV, p. 306 et 307. — Azara, tome II, ch. X, p. 23. — Le seul individu pour lequel un sauvage de l’Amérique ait une véritable affection, est l’ami qu’il a choisi. Le sentiment de l’amitié a quelquefois chez ces peuples une grande énergie. Hearne, ch. V, p. 121 et 122. — Volney, Tableau du climat et du sol des États-Unis, tome II, page 452.
[448] Robertson’s History of America, vol. II, note XXXV, p. 396.
[449] Weld, tome II, ch. XXX, p. 248 et 249. — Volney, tome II, p. 158 et 159. — Ulloa, tome II, disc. XVIII, p. 28.
[450] Hearne, ch. VIII, pag. 248. — Mackenzie, premier Voyage, tome I, p. 291 ; tome II, ch. V, p. 59 ; deuxième Voyage, tome II, ch. VII, p. 406. — Charlevoix, N.-Fr., tome III, liv. XIV, p. 85. — Lewis et Clarke, ch. III, p. 59. — G. Dixon, tome I, p. 512 et 513, et tome II, p. 8. — Vancouver, tome IV, liv. IV, ch. VI, p. 18 et 39, et tome V, liv. V, ch. X, p. 236.
[451] Hearne, ch. VI, p. 144 et 145. — Mackenzie, premier Voyage, tome I, p. 291. — Charlevoix N.-F., tome II, liv. VII, p. 3 et 4. — Lahontan, tome II, p. 181 et 182. — Hennepin, p. 63.
[452] Hearne, ch. V, p. 108 et 110. — Lahontan, tome II, p. 85. — Hennepin, p. 304. Les sauvages voient plus d’honneur à détruire leur ennemi par surprise qu’à le détruire en l’attaquant à force ouverte : telle était aussi la manière de voir des Spartiates : « À Sparte, dit Plutarque, le capitaine qui, par astuce ou par amiable voie, a fait ce qu’il a voulu, sacrifie aux dieux un bœuf : et celui qui l’a fait par bataille et force d’armes sacrifie un coq. » Vie de Marcellus.
[453] Mackenzie, premier Voyage, tome I, p. 158, 159 et 180. — Charlevoix, N.-F., tome I, liv. VI, pag. 377 et 378, et tome II, liv. VI et VIII, p. 19, 29, 43, 62 et 107. — Hennepin, p. 7.
[454] Hennepin, p. 53.
[455] Hennepin, p. 68. — Raynal, tome VIII, liv. XVI, p. 296.
[456] Lahontan, tome II, p. 184 et 185.
[457] Hennepin. p. 41. — Charlevoix, Nouvelle-France.
[458] Vancouver, tome IV, liv. IV, ch. VI, p. 28 et 39, et tome V, liv. V, ch. X, p. 236. — G. Dixon, tome I, p. 512 et 513, et tome II, p. 8. — Mackenzie, deuxième Voyage, tome II, ch. V, p. 310. — Lewis et Clarke, ch. XIV, p. 242. — Robin, tome II, ch. II, p. 305,
[459] Hearne, ch. II, p. 22. — Lahontan, tome II, pag. 145. — Volney, tome II, p. 446 et 447.
[460] Hennepin, p. 14 et 15.
[461] Charlevoix, N.-F., tome III, liv. XIII, p. 16 et 17.
[462] Montesquieu, qui a fait de la jalousie l’apanage des climats chauds, fait de l’ivrognerie l’apanage des climats froids. Cette dernière passion est une conséquence de la barbarie ou du défaut de développement intellectuel, et non une conséquence de la fraîcheur du climat : elle existe presque chez toutes les nations dont l’intelligence est peu développée. Les indigènes des Florides, ceux de la Guyane et de quelques autres parties de l’Amérique méridionale, n’y sont guère moins adonnés que les indigènes du Canada. Charlevoix, N.-F., tome III, liv. XIII, p. 16 et 17. — Dampier, tome I, ch. I, p. 14. — Ulloa, tome II, disc. XVII, pag. 15, 16, 17, 45 et 46. — Dauxion-Lavaysse, tome I, ch. VI, p. 338 et 339.
Il existe, d’un autre côté, dans les parties les plus élevées de l’Amérique septentrionale, quelques peuplades qui ont peu de goût pour les liqueurs fortes. Hearne, ch. IX, p. 288. — Mackenzie, premier Voyage, tome I, p. 292. — L’ivrognerie est fort commune en Perse, malgré la religion et l’influence du climat, ainsi qu’on peut le voir dans Chardin. Cependant il est vrai de dire que peuples des climats froids sont plus enclins à cette passion que ceux des climats chauds ; mais c’est encore plus à cause de leur barbarie qu’à cause du froid.
[463] Hearne, ch. II, p. 24.
[464] Hearne, ch. IV et V, p. 72, 73 et 111.
[465] Weld, tome III, ch. XXXV, p. 118.
[466] Hearne, ch. II, p. 24.
[467] Mackenzie, premier Voyage, tome I, p. 291 et 300.
[468] J. Long, ch. VII, pag. 101. — Weld, tome III, ch, XXXV, p. 140. — Raynal, tome VIII, liv. XV, p. 18.
[469] La Pérouse, tome II, ch. IX, p. 216 et 217.
[470] De Humboldt, Nouvelle-Espagne, tome II, liv. III, ch. VIII, page 419.
[471] Weld, tome II, ch. XXX, p. 247. — Lewis et Clarke, ch. III, p. 59. — Fleurieu, Voyage du capitaine Marchand, tome II, ch. IV et V, p. 46, 170 et 172. — Ulloa, tome II, disc. XVII, p. 15.
[472] Fleurieu, Voyage du capitaine Marchand, tome II, ch. IV, p. 88. — G. Dixon, tome II, p. 12 et 13.
[473] La Pérouse, tome II, ch. IX, p. 221. — Hennepin, pages 53, 54 et 55.
[474] Weld, tome III, ch. XXXV, p. 143 et 144. — La Pérouse, tome II, ch. IX, p. 221. — Fleurieu, Voyage du capitaine Marchand, tome II, ch. IV et V, pag. 94 et 144. — Cook, troisième Voyage, tome V, liv. IV, ch. III, p. 132 et 133.
[475] Mackenzie, deuxième Voyage, tome II, ch. II, p. 205. — Charlevoix, N.-F., tome III, p. 261 et 318. — Raynal, tome VIII, liv. XV, p. 49. — G. Dixon, tome II, p. 25. — La Pérouse, tome II, ch. IX, p. 216, 217 et 235. — Fleurieu, Voyage du capitaine Marchand, tome II, ch. V, p. 177. — Robertson’s History of America, b. IV, vol. II, p. 213, 214.
[476] Fleurieu, Voyage du capitaine Marchand, tome II, ch. IV, p. 88 et 89. — La Pérouse, tome IV, pag. 74 et 75. — G. Dixon, tome II, p. 12 et 13. — Raynal, qui oublie souvent les faits dont il vient de rendre compte, lorsqu’il s’agit de faire l’éloge des hommes de la nature, dit, en parlant des enfants : « Comme on ne leur apprend que ce qu’ils doivent savoir, ils sont les enfants les plus heureux de la terre. » Tome VIII, liv. XV, p. 43. Il dit ailleurs qu’on leur apprend à boire le sang de leurs ennemis, et à dévorer leur chair palpitante, ce qui vaut mieux sans doute que de leur apprendre à lire ; mais il oublie toutes les calamités inséparables de la vie sauvage ; on dirait qu’il n’y a de malheur que d’aller à l’école, et que la faim, le froid, la saleté, les maladies, l’abandon, ne sont rien ; ce n’est même rien que d’être enseveli vivant, car suivant lui-même c’est le sort réservé à tout enfant qui perd ses parents, et qui n’est pas assez fort pour se livrer à la chasse. Tome IV, liv. VII, p. 9 et 10. Il fait le tableau de tous les vices qui souillent la vie de l’homme sauvage ; puis il dit qu’il n’y a point de mauvais pères dans les forêts, et qu’ils sont tous dans les villes. Il ne manque plus que d’en dire autant pour les maris, après avoir fait le tableau de l’état des femmes.
[477] Hearne, ch. ix, p. 312 et 313. — Fleurieu, Voyage du capitaine Marchand, tome I, ch. v, pag. 168. — Raynal, tome VIII, liv. xvil, p. 361 et 362. — La Pérouse, tome IV, p. 65, 66 et 73.
[478] Hearne, ch. iv, p. 66.
[479] Ellis, p. 241 et 242. — Lahontan, tome II, p. 144 et 154.Mackenzie, premier Voyage, tome 1, page 236. — La Pérouse, tome IV, p. 63. — Lewis et Clarke, ch. XXI, p. 345. — Volney.
[480] Raynal, tome VIII, liv. xvii, p. 361 et 362. — Lewis et Clarke, ch. xx, p. 341. — La Perouse, tome IV, p. 64 et 65.
[481] La Pérouse, tome IV, p. 63 et 64. — Charlevoix, N.-F., tome I, liv. VI, p. 379. — Lahontan, tome II, p. 154. — Hearne, ch. IX, page 312.
[482] Charlevoix, N.-F., tome I, liv. V, p. 296 ; tome II, livre IX, p. 221 et 222 ; tome III, liv. XVIII, p. 394, 413 et 414. — Weld, tome III, ch. XXXIV, p. 63.
[483] Mackenzie, premier Voyage, tome I, p. 33-36.
[484] Charlevoix, N.-F., tome I, liv. IV, p. 230. — Lahontan, tome II, p. 102. — Hennepin, p. 14 et 51. — Azara, tome II, ch. X, p. 14 et 60. — De Humboldt, Essai politique, tome I, liv. II, ch. VI, page 414.
[485] Hearne, ch. IX, p. 308 et 309.
[486] Lahontan, tome II, p. 96, 97 et 151. — Volney, Tableau du climat et du sol des États-Unis, tome II, p. 452.
[487] Lahontan, tome II, p. 195.
[488] Charlevoix, N.-F., tome I, liv. IV et VI, passim. — Hennepin, J. Long, etc.
[489] Tome VIII, liv. XV, p. 52 et 53.
[490] Hennepin, p. 62. — Charlevoix, N.-F., tome I, liv. III, p. 199, et tome II, liv. VII, p. 73 et 74. — Lahontan, tome II, p. 98. — Weld, tome III, ch. XXXIII et XXXV, p. 14 et 81. — Robertson’s, History of America, vol. II, b. IV, pag. 237. — Ces sauvages, sans renoncer à leur orgueil, ont cependant fini par reconnaître la supériorité des blancs. J. Long, ch. VIII, p. 133.
[491] De Paw, Recherches philosoph. sur les Américains, tome I, troisième partie, p. 354 et 355.
[492] Hennepin, pag. 38 et 39. — Lahontan, tome II, pag. 93, 98 et 131. — Volney, tome II, p. 493. — Weld, tome III, pag. 115 et 116. — Raynal, tome VIII, liv. XV, p. 29.
[493] Les admirateurs de l’état de nature parlent rarement de morale sans se livrer à quelques déclamations sur les vices des peuples civilisés. Il existe sans doute des vices chez les nations civilisées ; mais ces vices ne sont pas le fruit de la civilisation ; ils ont été presque tous apportés de l’état de barbarie dont ils sont de malheureux restes. La passion de la vengeance et celle de la pitié peuvent se rencontrer chez tous les peuples du monde ; mais il est curieux de suivre la marche que ces deux passions ont suivie depuis les temps les plus barbares jusqu’à nos jours : il suffit pour cela de comparer le sort des prisonniers de guerre aux principales époques. « Quand ils sont près de leurs villages, dit Hennepin en parlant des guerriers sauvages de l’Amérique, ils font de grands cris auxquels ceux de leur nation connaissent que ce sont leurs guerriers qui reviennent avec des esclaves. En même temps les hommes et les femmes mettent leurs beaux atours, et les vont recevoir à l’entrée du village, où ils se rangent en haie pour faire passer les esclaves au milieu ; mais c’est une pitoyable réception pour ces infortunés ; car ces canailles se jettent sur eux comme des chiens sur leur proie, commençant dès lors à les tourmenter, pendant que les guerriers passent à la file, tout superbes de leurs exploits. Les uns donnent des coups de pied à ces pauvres esclaves, les autres des coups de bâton, plusieurs des coups de couteau, quelques-uns leur arrachent les oreilles, leur coupent le nez ou les lèvres, en sorte que la plupart succombent et meurent à cette pompeuse entrée ; ceux qui ont plus de vigueur sont réservés à un plus grand supplice. » Mœurs des sauvages de la Louisiane, p. 64 et 65.
Chez les Romains, dont les mœurs étaient un peu moins barbares que celles des Iroquois, les prisonniers de guerre suivaient le char du vainqueur à travers une insultante multitude ; mais ils n’étaient ni déchirés, ni mis à mort ; on se contentait de faire périr leurs chefs sous la hache ou dans des cachots ; les autres étaient vendus comme esclaves.
Chez les modernes les prisonniers de guerre sont différemment traités. Nous avons vu, en 1814, après une guerre de plus de trente ans, des troupes de prisonniers traverser Paris, dans l’état le plus misérable, au moment où cette ville allait être prise. La multitude ne les a point insultés ; elle leur a porté du pain.
Si nous faisions l’histoire des autres passions vicieuses, de la perfidie, de la paresse, de l’intempérance, même du jeu, nous trouverions qu’elles ont perdu de leur empire au moins autant que la vengeance.
[494] Robertson’s History of America, book IV, note 35, tome II, p. 395 et 396.
[495] Robertson’s History of America, vol. II, b. IV, p. 139.
[496] Robertson’s History of America, vol. III, b. IV, p. 287 et 288.
[497] Robertson, vol. III, b. VII, p. 283.
[498] Ibid., vol. II, b. VII, p. 339.
[499] Robertson, ibid., p. 338.
[500] Robertson, vol. II, b. IV, p. 145.
[501] Robertson, vol. III, b. VII, p. 341.
[502] Une femme, par exemple, est obligée de porter le fardeau dont il plait à son mari de la charger ; mais elle est souvent obligée de porter, en outre, le fardeau de l’individu qui a encore plus de force que son mari.
[503] Cette dénomination ferait soupçonner ou que les Incas n’appartenaient pas à une race de conquérants, ou qu’à l’époque de la conquête, ils étaient déjà très civilisés. Les conquérants et leurs descendants se glorifient, en effet, des triomphes qu’ils ont obtenus sur des hommes : ils se vantent d’avoir massacré des armées, incendié des villes, asservi des nations ; mais il n’y a que des hommes très civilisés, je pourrais même dire des savants ou des philosophes, qui se glorifient des triomphes qu’ils obtiennent sur les choses, en faveur de l’humanité.
Les honneurs rendus à l’agriculture par les incas du Pérou sont analogues aux honneurs que rend à cet art l’empereur de la Chine.
[504] Robertson, vol. III, b. VII, p. 336, 341 et 342.
[505] Robertson, vol. III, b. VII, p. 295 et 323.
[506] Charlevoix, tome I, liv. I, p. 42.
[507] Robertson, vol. III, b. VII, p. 337.
[508] Charlevoix, N.-F., tome II, liv. XI, p. 354, et tome III, liv. XIII, p. 49, 50 et 51. — Hennepin, pages 39 et 40. — Cook, troisième Voyage, tome V, liv. IV, ch. I, p. 39. — La Pérouse, tome II, ch. IX, p. 240 et 241.
[509] Robertson, vol. III, b. VII, p. 326.
[510] Robertson, vol. III, b. VII, p. 334. — Robertson attribue la douceur des mœurs et du gouvernement des Péruviens à la douceur de leur religion (vol. III, b. VII, p. 336) ; et c’est à la férocité de la religion mexicaine, qu’il attribue la dureté des mœurs et du gouvernement du peuple du Mexique. Mais quelles étaient les causes qui avaient produit une religion douce chez le premier de ces peuples et une religion atroce chez le second ? Si Robertson se fût livré à cette recherche, peut-être aurait-il trouvé que les mêmes causes qui avaient déterminé la nature des deux religions, avaient aussi déterminé la nature des mœurs et des gouvernements des deux peuples.
[511] Azara, tome II, ch. X et XI, p. 20 et 173. — De Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, tome VI, live VI, chap. XVIII, p. 218 et 219. — Hennepin, Mœurs des sauvages, p. 68 et 69.
[512] De Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, tome III, ch. IX, p. 297 et 298.
[513] Azara, tome II, ch. X, p. 22 et 23.
[514] Ibid., p. 92.
[515] Azara, tome II, ch. X, p. 160.
[516] De Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales, tome III, liv. III, ch. IX, p. 296. — Azara, tome II, ch. X, p. 13 et 14. — Ulloa dit qu’en général les Indiens du Pérou, civilisés ou sauvages, sont très inhumains ; que ceux qui sont civilisés ne se livrent point à leur inclination parce que le gouvernement les en empêche ; mais qu’on leur voit faire à l’égard des animaux des choses qui ne laissent aucun doute sur leur barbarie naturelle. (Tome II, d. XVII, p. 10 et 11). Mais il est difficile de concilier ce qu’il dit ici, avec ce qu’il a dit ailleurs en parlant des mêmes peuples « Ils ont, dit-il, pour tous les animaux domestiques, mais surtout pour leurs llamas, un genre d’affection qui ne se voit chez aucun peuple de la terre ; toutes leurs démonstrations extérieures le manifestent assez... Avant de l’avoir mis au service, ajoute-t-il en parlant du llama, ils l’ont en général traité avec tant de modération que jamais, ou rarement, par la suite, ils ne le traitent durement en route ; au contraire, ils s’assujettissent absolument à sa marche, et se servent d’un sifflet pour le guider. » Tome I, disc. VII, p. 160.
Les Guaraoüns qui vivent aux bouches de l’Orénoque, sont moins indolents que les autres sauvages de l’Amérique méridionale, passionnés pour la danse, gais, sociables et hospitaliers. Ils sont habiles pêcheurs. Ils ont des chiens dont ils se servent pour prendre les poissons dans les bas-fonds. Ils caressent continuellement ces animaux et les traitent avec bienveillance. Dauxion- Lavaysse, tome I, ch. I, p. 3 et 4.
[517] Ulloa, tome II, disc. XVII, p. 41. — Les Européens se sont montrés plus traitables quand on les a dépouillés de leurs libertés communales.
[518] De Humboldt, Essai politique, tome I, liv. II, chap. VI, page 422.
[519] Hearne, ch. IX, p. 320.
[520] La Pérouse, tome II, ch. IX, p. 219.
[521] Bougainville, Voyage autour du Monde, deuxième partie, ch. II, tome II, p. 5. — Dentrecasteaux, Voyage à la recherche de La Pérouse, tome I, ch. XIV, p. 320. — Cook, premier Voyage, liv. I, ch. XVII, tome II, p. 537 et 538.
[522] Cook, troisième Voyage, liv. II, ch. X, p. 61 et 62.
[523] Ibid. ch. IV, tome II, p. 131, et deuxième Voyage, t. III, ch. VIII, p. 388.
[524] Cook, troisième Voyage, liv. II, ch. XI, tome III, p. 154.
[525] Bougainville, Voyage autour du Monde, deuxième partie, ch. III, tome II, p. 69. — Cook, deuxième Voyage, liv. II, ch. III, tome II, pag. 413, et troisième Voyage, liv. II, ch. XI, tome III, pages 141 et 142.
[526] Cook, premier Voyage, liv. I, ch. XIX, tome II, p. 360.
[527] Dentrecasteaux, Voyage à la recherche de La Pérouse, tome I, ch. XIV, p. 303. — Labillardière, tome II, ch. XII, p. 164 et 165.
[528] Cook, troisième Voyage, liv. II, ch. XI, tome III, p. 152.
[529] Bougainville, Voyage autour du Monde, deuxième partie, ch. III, tome II, p. 56.
[530] Cook, troisième Voyage, liv. III, ch. II, tome III, p. 229.
[531] Cook, troisième Voyage, liv. III, ch. IX, tome IV, p. 166. Les fils, pour succéder à l’autorité et aux terres de leurs pères, ont besoin de recevoir l’investiture du chef ou roi. Cook, troisième Voyage, liv. II, ch. XI, tome III, p. 30.
[532] Labillardière, tome II, ch. XII, p. 126, 127 et 163. — Cook, troisième Voyage, liv. II, ch. XI, tome III, p. 148.
[533] Cook, troisième Voyage, liv. II, ch. VIII, tome II, pag. 320 et 321.
[534] Cook, troisième Voyage, liv. II, ch. XI, tome III, p. 143, et liv. III, ch. VII, tome IV, p. 68 et 69. — Dentrecasteaux, Voyage à la recherche de La Pérouse, tome I, ch. IV, p. 303 et 309.
[535] Cook, premier Voyage, liv. II, ch. I, tome III, p. 30, troisième Voyage, liv. II, ch. VI, tome II, p. 197 et 198.
[536] Cook, premier Voyage, liv. I, ch. XVII, tome II, p. 562.
[537] Bougainville, deuxième partie, ch. II, tome II, p. 58. — La Pérouse, ch. XII, tome II, pag. 151. — Dentrecasteaux, tome I, ch. XIV, pag. 309, 310 et 315. — Cook, troisième Voyage, livre II, ch. XI, tome III, p. 130.
[538] Cook, troisième Voyage, liv. II, ch. VIII, tome II, p. 314 ; liv. II, ch. IX, tome III, p. 19, et liv. III, ch. IX, tome IV, p. 165 et 166.
[539] Cook, troisième Voyage, liv. I, ch. XI, tome III, p. 143.
[540] Cook, premier Voyage, liv. I, ch. XIX, tome II, pages 628, 629 et 630.
[541] Bougainville, Voyage autour du Monde, deuxième partie, ch. III, tome II, p. 70.
[542] Bougainville, 2e partie, ch. III, tome II, p. 70.
[543] Cook, premier Voyage, liv. I, ch. XIX, tome II, p. 629 et 630.
[544] Cook, troisième Voyage, liv. II, ch. XI, tome III, pag. 132 et 133.
[545] Bougainville, deuxième partie, ch. III, tome II, pag. 69. — Cook, troisième Voyage, liv. III, ch. XI, tome IV, p. 231 et 232.
[546] King, troisième Voyage de Cook, liv. V, ch. VIII, tome VII, page 152.
[547] Bougainville, deuxième partie, ch. III, tome II, p. 69. — Cook, deuxième Voyage, tome II, liv. I, ch. IV, p. 277. — Quelquefois c’est le chef qui ordonne le sacrifice, qui choisit lui-même la victime. Cook, troisième Voyage, liv. III, ch. II, tome III, page 249.
[548] Cook, troisième Voyage, liv. III, ch. II, tome III, pag. 234, 240 et 257.
[549] Cook, troisième Voyage, liv. II, ch. XI, tome III, pag. 139 et 141, et liv. III, ch. II, tome III, p. 256.
[550] Les prêtres, auxquels la faculté de choisir les victimes donne un pouvoir terrible sur les hommes asservis, persuadent aux rois qu’ils ne peuvent renoncer aux sacrifices des victimes humaines sans courir le plus grand danger. « Nous demandâmes, dit Cook, la raison de ces meurtres barbares. On se contenta de nous répondre qu’ils étaient nécessaires à la Natche (Dieu), et que la divinité exterminerait sûrement le roi, si on ne se conformait pas à l’usage. » Troisième Voyage, liv. II, ch. IX, tome III, p. 32.
Pour dominer plus sûrement sur l’esprit du peuple, ces prêtres ont dans leur temple une espèce de coffre que le même voyageur compare à l’arche des Juifs. « Lorsque nous en demandâmes le nom au valet de Tupia, il nous dit qu’il s’appelait Ewharee-no-Eatua, la maison de Dieu. » Premier Voyage, liv. II, chap. I, tome III, pages 7 et 8.
[551] Les Anglais écrivent taboo.
[552] Cook, troisième Voyage, liv. II, ch. IX, tome III, p. 6.
[553] Ibid., p. 46 et 47.
[554] Anderson, troisième Voyage de Cook, liv. II, ch. IX, tome IV, pages 165 et 166.
[555] Anderson, ibid., p. 170. — Cook, troisième Voyage, liv. III, ch. IX, tome IV, p. 134.
[556] Cook, troisième Voyage, liv. II, ch. XI, tome III, p. 151, et liv. III, ch. IX, tome IV, pag. 130. — Les prêtres ont trouvé le moyen de soumettre les rois eux-mêmes au tabou. Vancouver, liv. V, ch. I, tome IV, p. 169 et 170.
[557] Cook, premier Voyage, liv. I, ch. XVII, tome II, pag. 170 et 172. — Forster, deuxième Voyage de Cook, tome III, chap. X, pages 433 et 442.
[558] Anderson, troisième Voyage de Cook, l. III, ch. IX, tome IV, pag. 135 et 137. — Forster, deuxième Voyage de Cook, tome III, ch. III, p. 433 et suivantes.
[559] Cook, troisième Voyage, liv. II, ch. VI, tome IV, p. 30 et 31.
[560] King, troisième Voyage de Cook, liv. V, ch. VII, tome VII, p. 101 et 102.
[561] Cook, premier Voyage, liv. I, ch. XIX, tome II, p. 629 et 630.
[562] Bougainville, Voyage autour du Monde, deuxième partie, ch. III, tome II, p. 70. — Labillardière, Voyage à la recherche de La Pérouse, tome II, ch. XII, p. 115. — Cook, troisième Voyage, liv. II, tome III, p. 123 et 124, et liv. V, ch. VII, tome VII, page 111.
[563] Cook, premier Voyage, liv. I, ch. XVII, tome II, p. 515.
[564] Cook, Ibid., p. 541.
[565] Dentrecasteaux, Voyage à la recherche de La Pérouse, tome I, ch. XIV, p. 320.
[566] Cook, premier Voyage, liv. I, ch. XIX, tome II, p. 630. — Anderson, troisième Voyage de Cook, liv. II, ch. IX, tome IV, p. 165. — Cook, troisième Voyage, liv. III, ch. VI, tome IV, p. 31.
[567] Cook, troisième Voyage, liv. V, ch. VIII, tome VII, p. 136. — Rollin, Voyage de La Pérouse, tome IV, p. 26.
[568] King, troisième Voyage de Cook, ch. V, tome VII, liv. V, page 152.
[569] De Larochefoucault-Liancourt, Voyage aux États-Unis d’Amérique, première partie, tome III, p. 22.
[570] Cook, troisième Voyage, liv. II, ch. XI, tome III, p. 151.
[571] Cela peut expliquer comment le capitaine Marchand n’a vu dans les îles Marquises que des hommes grands et forts, comme le sont tous ceux des hautes classes, tandis que d’autres navigateurs en ont vu un grand nombre qui appartenaient à la classe asservie. Voyage cité par M. de Larochefoucault-Liancourt, tome III, première partie, p. 22.
[572] Cook, premier Voyage, liv. I, ch. XVII, tome II, pages 569 et 570.
[573] Bougainville, deuxième partie, ch. I, tome II, p. 21 et 22. — La Pérouse, tome II, ch. IV, pag. 105 et 106. — Cook, troisième Voyage, liv. III, ch. IX, tome IV, p. 134. — Wallis, tome II, ch. VI, page 184.
[574] La Pérouse, Voyage autour du Monde, tome II, chap. IV, p. 105 et 106. — Fleurieu, Voyage du capitaine Marchand, tome I, ch. II, p. 172 ; ch. III, p. 237, et tome II, ch. VII, p. 285. — Krusenstern, tome I, ch. VII, p. 160.
[575] Bougainville, deuxième partie, ch. III, tome II, pag. 58. — Labillardière, tome II, ch. XII, p. 151. — Dentrecasteaux, tome I, ch. XIV, pages 309, 310 et 315. — Cook, troisième Voyage, liv. II, ch. XI, tome III, p. 130.
[576] Bougainville, deuxième partie, ch. III, tome II, pag. 70. — Cook, premier Voyage, liv. I, ch. XVII, tome II, p. 564 ; troisième Voyage, liv. III, ch. IX, tome IV, p. 133, et liv. V, ch. VII, tome VII, p. 113 et 114. — Krusenstern, tome I, ch. IX, p. 216 et 217.
[577] Bougainville, deuxième partie, ch. II, tome II, p. 58.
[578] Ibid., p. 70.
[579] Anderson, troisième Voyage de Cook, liv. III, ch. IX, tome IV, p. 139 et suivantes.
[580] Cook, troisième Voyage, liv. II, ch. XI, tome III, p. 131.
[581] Voyage autour du Monde, tome III, ch. XXV, p. 274.
[582] Labillardière, tome II, ch. XII, p. 172. — Cook, troisième Voyage, liv. II, ch. XI, tome III, p. 131. — Bougainville, deuxième partie, ch. I, tome II, p. 21 et 22.
[583] Anderson, troisième Voyage de Cook, liv. II, chapitre IX, tome IV, p. 170.
[584] Dentrecasteaux, tome I, ch. XIV, pag. 308. — Labillardière, tome I, ch. VII, p. 251 et 252, et tome II, ch. XII, p. 99, 111 et 112. — Cook, premier Voyage, liv. I, ch. XI, tome II, p. 340 et 434, et troisième Voyage, liv. II, ch. IV, tome II, p. 133.
[585] Labillardière, tome II, ch. XII, pag. 96. — Cook, troisième Voyage, liv. V, ch. I, tome VI, pag. 272. — G. Dixon, tome I, page 327.
[586] King, troisième Voyage de Cook, liv. V, ch. VIII, tome VII, pages 143 et 144.
[587] Cook, troisième Voyage, liv. II, ch. VI, tome II, p. 221, et liv. II, ch. XII, tome IV, p. 321.
[588] Labillardière, tome II, ch. XI, p. 115 et 136. — Bougainville, deuxième partie, ch. III, tome II, p. 54 et 55.
[589] Labillardière, tome I, ch. VII, p. 261.
[590] Cook, troisième Voyage, tome II, liv. II, chap. VI et VIII, p. 201, 305, 316 et 317 ; liv. III, ch. IX, tome IV, p. 162 et 163. — Dentrecasteaux, tome I, ch. XIV, p. 307 et 309. — Labillardière, tome II, ch. XII, p. 172. — G. Dixon, tome I, p. 280 et 281.
[591] La Pérouse, tome II, ch. IV, p. 94 et 105. — Labillardière, tome II, ch. XI, p. 155 et 157. — Fleurieu, Voyage du capitaine Marchand, tome I, ch. I, p. 49. — Krusenstern, tome I, ch. IX, p. 223. — Cook, premier Voyage, liv. I, ch. X, tome II, p. 404 et 405 ; deuxième Voyage, tome III, ch. II et IV, p. 87 et 202 ; troisième Voyage, liv. II, ch. IV et X, p. 97 et 155. — Broughton, tome I, liv. I, ch. IV, p. 114.
[592] King, troisième Voyage de Cook, liv. V, chap. I, tome VI, page 274.
[593] Labillardière, tome II, ch. XII, p. 141, 142, 143 et 155.
[594] Anderson, troisième voyage de Cook, liv. III, ch. IX, t. IV, p. 335.
[595] Ne serait-ce pas ici le secret de la plupart des guerres qui ont déchiré l’Europe ?
[596] Bougainville, deuxième partie, ch. III, tome II, page 55. — Cook, troisième Voyage, liv. III, ch. III et IX ; tome III, page 287, et tome IV, p. 116.
[597] Anderson, troisième Voyage de Cook, liv. III, ch. XVIII. — King, Ibid, liv. V, ch. VII, tome VII, p. 95. — Krusenstern, tome I, ch. IX, p. 246.
[598] Cook, liv. II, ch. V, tome II, p. 486.
[599] Cook, troisième Voyage, liv. II, ch. II, tome III, p. 287. — King, troisième Voyage de Cook, liv. V, ch. VII, tome VII, page 97.
[600] G. Bligh, Voyage à la mer du Sud, ch. V, p. 97 et 98. — Vancouver, tome III, liv. II, ch. VII, pages 197 et 123. — Broughton, tome I, liv. I, ch. II et IV, p. 58, 59, 60, 62 et 104.
[601] Cook, deuxième Voyage, tome III, ch. X, p. 494 et 495 ; troisième Voyage, liv, III, ch. VI et VII, tome IV, p. 32, 81 et 82. — Broughton, liv. I, ch. II, tome I, p. 53.
« Je crois, dit Cook, que la conquête de ces îles n’a procuré à Pouni (le roi) d’autres avantages qu’un moyen de récompenser ses nobles, qui, en effet, se sont emparés de la meilleure partie des terres. » Lorsqu’un roi, fils d’un ancien conquérant, est dépossédé par un conquérant nouveau, il persiste à conserver le titre que la conquête donna jadis à ses ancêtres. Cook, premier Voyage, liv. I, ch. XIX, tome II, p. 631.
[602] Cook, deuxième Voyage, tome III, ch. VII, p. 300.
[603] Cook, premier Voyage, liv. I, ch. XV, tome II, p. 492.
[604] Si jamais il s’établissait dans ces archipels une classe manufacturière ou commerçante, ces guerres deviendraient moins fréquentes, parce que l’aristocratie territoriale pourrait lever, sur cette partie de la population, des impôts suffisants pour enrichir ou du moins pour faire vivre ses cadets. On aurait alors un ordre social analogue à celui qui existe en Angleterre.
[605] Krusenstern, tome I, ch. IX, p. 240 et 243.
[606] Fleurieu, Voyage du capitaine Marchand, tome I, chap. II, page 199.
[607] Krusenstern, tome I, ch. IX, p. 240. — Forster, cité dans le deuxième Voyage de Cook, tome III, ch. IV, p. 199.
[608] Cook, premier Voyage, liv. I, ch. VIII, tome II, pag. 581 et 382. — Anderson, troisième Voyage de Cook, liv. III, chap. IX, tome IV, p. 116 et 117.
[609] Bougainville, deuxième partie, ch. II, tome II, p. 24 et 31.
[610] Cook, troisième Voyage, liv. II, ch. X, tome III, p. 95 et 96. — Forster, cité dans le deuxième Voyage de Cook, tome IV, ch. II, p. 34. — Vancouver, liv. III, ch. VII, tome III, p. 110, 111 et 112.
[611] La Pérouse, tome II, ch. VI, p. 130, 131 et 132. — Rollin, Voyage de La Pérouse, tome IV, p. 25.
[612] Ibid., tome II, ch. II, p. 88 et 89.
[613] Cook, premier Voyage, liv. II, ch. VII et X, tome III, p. 234, 236 et 237 ; deuxième Voyage, liv. II, ch. III et V, p. 234, 235 et 490.
On n’a observé dans l’île de Pâques et dans la Nouvelle-Zélande, ni distinctions de rangs, ni maîtres, ni serviteurs, ni race conquise, ni race conquérante. L’anarchie la plus complète a paru régner dans l’île de Pâques ; cependant les terres y sont partagées en propriétés particulières. Cook, deuxième Voyage, tome III, ch. II et III, p. 109 et 149. — La Pérouse, tome II, ch. V, p. 116, et tome IV, p. 120. Dans la Nouvelle-Zélande, l’autorité d’aucun individu ne paraît s’étendre au-delà de sa famille. Si le besoin de la défense commune oblige un village à choisir un chef, on prend celui qui montre le plus de courage et de prudence. Anderson, troisième Voyage de Cook, liv. I, ch. III, tome I, p. 335.
[614] La Pérouse, tome II, ch. VI, p. 134 et 135.
[615] La Pérouse avait emporté, dans ses voyages, les idées que donne J.-J. Rousseau sur l’innocence de la vie sauvage et sur les vices qu’enfante l’état social. Il dit en conséquence que les Malais ne doivent pas être pris pour des sauvages ; qu’ils ont, au contraire, fait de très grands progrès dans la civilisation, et qu’il les croit aussi corrompus qu’ils peuvent l’être relativement aux circonstances où ils se trouvent. Mais à mesure qu’il a avancé dans ses voyages, l’expérience a corrigé cette erreur ; il a fini par se convaincre par de funestes expériences, ainsi qu’on le verra plus loin, que plus les hommes sont près de l’état sauvage et plus leurs vices sont multipliés. Dentrecasteaux, parti avec la même erreur, s’en est corrigé de la même manière.
[616] La Pérouse, tome II, ch. IV, p. 105.
[617] La Pérouse, tome III, ch. XIV, p. 279.
[618] Wallis, Voyage autour du Monde, tome II, chapitre V, pages 130 et 133.
[619] Broughton, Voyage de découvertes, tome I, liv. I, ch. II, page 56.
[620] Anderson, troisième Voyage de Cook, liv. I, ch. VIII, tome I, page 334.
[621] Cook, deuxième Voyage, tome I, ch. VIII, p. 445 et 446.
[622] Cook, premier Voyage, liv. II, ch. IV, tome III, pages 152 et 156.
[623] Ibid., ch. VII, tome III, p. 231.
[624] Troisième Voyage, liv. I, ch. VII, tome I, p. 257.
[625] Dentrecasteaux, tome I, ch. XII, p. 272. — Labillardière, tome II, ch. XII, p. 86. — Cook, premier Voyage, liv. II, ch. VII et XI, tome III, p. 322, 328 et 349, et deuxième Voyage, tome I, ch. VII, p. 397, et liv. II, ch. V, tome II, p. 485. — Forster, ibid., p. 488 ; troisième Voyage, liv. I, ch. VII, tome I, p. 283 et 284.
On peut être étonné que ces peuples aient montré un très bon caractère aux voyageurs anglais ; mais ce phénomène est facile à expliquer quand on connaît leur hypocrisie : « On leur inspira la terreur par les armes à feu, on leur fit des signes d’amitié, et on finit par gagner leur confiance. » Cook, premier Voyage, liv. II, tome III.
[626] Cook, troisième Voyage, liv. I, ch. VII, tome I, p. 289.
[627] Forster, cité dans le deuxième Voyage de Cook, tome I, ch. VIII, p. 418 et 419 ; et Cook, ibid., p. 454.
[628] Forster, cité dans le deuxième Voyage de Cook, liv. II, ch. V, tome II, p. 483 et 484. — « Les habitants de la Nouvelle-Zélande, dit Cook, semblent faire moins de cas des femmes que les insulaires de la mer du Sud, et telle était l’opinion de Tuipa, un de ces insulaires, qui s’en plaignait comme d’un affront fait au sexe. » Premier Voyage, liv. II, ch. XI, tome III, p. 353.
[629] Cook, troisième Voyage, liv. I, ch. VII, tome I, p. 289.
[630] Cook, troisième Voyage, liv. I, ch. VII, tome I, pages 282 et 283. — Il existe entre les habitants de la Nouvelle-Zélande et ceux des îles de la Société une différence qui mérite d’être observée. Les premiers n’ont chez eux aucune classe aristocratique, et en conséquence les femmes n’y sont pas élevées pour les plaisirs des grands ; aussi a-t-on observé chez elles des sentiments de pudeur qu’on n’a point remarqués chez les autres. Cook, premier Voyage, liv. II, ch. X, tome III, p. 328 et 329.
[631] La Pérouse, tome II, ch. IV, p. 94, 95, 105, 107 et 108.
[632] Labillardière, tome II, ch. XII, p. 146, 175 et 176. — Cook, troisième Voyage, liv. II, ch. XI, tome III, p. 132 et 133. — Vancouver, liv. III, ch. VII, tome III, p. 110, 10 et 112.
[633] Bougainville, deuxième partie, ch. II, tome II, pag. 58. — Cook, troisième Voyage, liv. II, ch. XI, t. III, p. 108, 110 et 111.
[634] Cook, troisième Voyage, liv. III, ch. XII, tome IV, p. 288. — King, troisième Voyage de Cook, liv. V, ch. VII, tome VII, p. 90.
[635] Bougainville, deuxième partie, ch. II, tome II, pag. 53. — Fleurieu, Voyage du capitaine Marchand, tome I, ch. II, p. 179. — King, troisième Voyage de Cook, liv. V, chap. VII, tome VII, page 113.
[636] La Pérouse, tome III, ch. XXIV, p. 237 et 238.
[637] Ibid.
[638] Cook, deuxième Voyage, tome III, ch. IV, p. 174.
La Pérouse défendait de tirer sur les voleurs, et pour prévenir les querelles il payait à ses matelots la valeur de ce qui leur était enlevé ; aussi trouva-t-il les insulaires plus audacieux.
[639] Fleurieu, Voy. du cap. Marchand, tome I, ch. I, p. 73.
[640] Krusenstern, tome I, ch. IX, p. 240. — Le penchant irrésistible que ces insulaires ont pour le vol est cependant pour tous les voyageurs un sujet de crainte.
[641] Krusenstern, tome I, ch. IX, p. 242.
[642] Ibid., p. 242 et 243.
[643] Fleurieu, Voyage du capitaine Marchand, tome I, ch. II, page 196.
[644] Fleurieu, Voyage du capitaine Marchand, t. I, ch. II, p. 206.
[645] Labillardière, tome I, ch. VII, p. 261.
[646] Dentrecasteaux, tome I, ch. XI, p. 235 et 236. — Labillardière, tome II, ch. X, p. 55.
[647] Cook, deuxième Voyage, tome I, p. 386 et 387. — Péron, tome I, liv. II, ch. XI, p. 269 — Labillardière, tome I, chap. V, p. 184 et 185. — L. Freycinet, liv. II, ch. I, p. 43.
[648] Péron, tome I, liv. III, ch. XII, p. 252, 253, 255 et 256.
[649] Dentrecasteaux, tome I, ch. XI, p. 236 et 237. — Labillardière, tome II, ch. X, p. 52, 53 et 54. — Péron, tome I, liv. III, ch. XII, p. 255 et 256.
[650] Péron, tome I, liv. III, ch. XI, p. 254 et 255.
[651] Ibid., ch. XIII, p. 280.
[652] Péron, tome I, liv. III, ch. XI, p. 282.
[653] Dentrecasteaux, tome I, ch. XI, pag. 235. — Labillardière, tome II, ch. X, p. 56.
[654] Cook, troisième Voyage, liv. I, ch. VI, tome I, p. 212. — Les femmes des îles de la Société et des îles des Amis, qui ont paru si prodigues de leurs faveurs, lorsqu’on leur a expliqué les mœurs des peuples d’Europe, les ont admirées, et ont prouvé par cela même combien peu leur volonté a d’influencé sur leur conduite.
[655] Péron, tome I, liv. III, ch. XX, sect. IV, p. 454.
[656] Péron, tome I, liv. III, ch. XIII, p. 236, 237, 244 et 285. — L. Freycinet, liv. II, p. 43 et 61.
[657] Ibid., p. 238. — Dentrecasteaux, qui n’avait vu ces peuples qu’un moment et qui avait l’imagination remplie des idées de J.-J. Rousseau sur la perfection de l’homme de la nature, a d’abord porté d’eux un jugement très favorable ; il s’exprime à leur égard avec l’enthousiasme de l’auteur du discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes. Mais comme son opinion n’est prouvée par aucun fait, comme elle est démentie, au contraire, par les faits même qu’il cite, et comme une cruelle et longue expérience l’a obligé plus tard de la rétracter, j’ai jugé inutile de la rapporter ici.
[658] Péron, tome I, liv. III, ch. XX, p. 450.
[659] Ibid., p. 454 et 455.
[660] Phillip, ch. XIV, p. 161.
[661] L. Freycinet, liv. II, ch. IX, p. 292 et 293.
[662] Ces entailles existent souvent jusqu’à la hauteur de quatre-vingts pieds, et sont faites avec une hache de pierre. Collins, cité par Maithus, tome I, ch. III, p. 39 et 40 de la cinquième édition.
[663] Péron, tome I, liv. III, ch. XX, p. 463. Des déportés anglais se sont quelquefois réfugiés dans les forêts parmi les sauvages, pour échapper aux travaux auxquels ils sont condamnés ; mais la famine les a toujours contraints de revenir prendre leurs chaînes. Les fatigues et les privations de la vie sauvage ont paru excéder les fatigues et les privations auxquelles les condamnés sont assujettis. Phillip, ch. XII, p. 140 et 141. — Broughton, tome I, liv. I, ch. I, page 24.
[664] Péron, tome II, liv. IV, ch. XXIII, p.50. — Freycinet, liv. II, ch. IX, p. 292 et 293. — Phillip, ch. XIV, p. 161. — Broughton, tome I, liv. I, ch. I, p. 26. — Dampier, tome II, ch. XVI, p. 142.
[665] Collins, cité par Malthus, tome I, ch. III.
[666] Phillip, ch. IX, p. 95.
[667] Freycinet, liv. II, ch. IX, p. 293.
[668] Phillip, ch. XIV, p. 164.
[669] Péron, tome I, liv. II, ch. V, p. 89. — Labillardière, tome I, ch. IX, p. 415. — Cook, premier Voyage, liv. III, ch. IV, tome IV, p. 46 et 47. — Phillip, ch. VII, p. 69. — Broughton, tome I, liv. I, ch. I, p. 23.
[670] Cook, premier Voyage, liv. III, ch. VI, tome IV, p. 141. — Phillip, ch. XIV, p. 165.
[671] Labillardière, tome II, ch. XIII, p. 212.
[672] Dentrecasteaux, tome I, ch. XVI, p. 350.
[673] Labillardière, tome II, ch. XIII, p. 247. — Dentrecasteaux, tome I, ch. XVI, p. 349.
[674] Forster, cité dans le deuxième Voy. de Cook, tome IV, ch. VIII, p. 479 et 492. — Labillardière, tome II, ch. XII, p. 226 et 227.
[675] Forster, deuxième Voyage de Cook, tome IV, ch. VIII, p. 479.
[676] Dentrecasteaux, tome I, ch. XVI, p. 251 et 252.
[677] Labillardière, tome II, ch. XIII, p. 232. — Dentrecasteaux, ch. XV et XVI, p. 341 et 355.
[678] Dentrecasteaux, tome I, ch. XV et XVI, p. 341 et 355. — Labillardière, Voyage à la recherche de La Pérouse, tome II, ch. XIII, p. 197, 215, 216, 217 et 233.
[679] Cook, deuxième Voyage, tome IV, ch. VIII, p. 439. — Forster, ibid., p. 484 et 485.
[680] Labillardière, tome II, ch. XI, p. 184.
[681] Dentrecasteaux, tome I, ch. XVI, p. 355.
[682] Dentrecasteaux, tome I, ch. XV, pag. 340. — Labillardière, tome II, ch. XIII, p. 205, 206, 209 et 214. — Les nègres de Guinée ont l’habitude de manger une sorte de terre onctueuse qu’ils mêlent à leurs aliments et qui se dissout comme le beurre. (J. Mathews, lett. II et IV, p. 23 et 38.) L’habitude de manger de la terre leur en rend le besoin si grand, qu’ils ne peuvent s’en passer dans les colonies d’Amérique ; mais celle qu’ils mangent sur ce continent leur est toujours funeste. Alexandre de Humboldt, Tableaux de la Nature, tome I, p. 202 et 203.
[683] Labillardière, tome II, ch. XIII, p. 197.
[684] Ibid., p. 191 et 217. — Dentrecasteaux, ch. XV, p. 133 et 139.
[685] Cook, deuxième Voyage, tome IV, ch. IV, p. 163 et 164. — Forster, ibid., p. 369.
[686] Cook, deuxième Voyage, tome IV, ch. V, p. 249.
[687] Ibid., ch. IV, p. 193, et ch. V, p. 210 et 211.
[688] Forster, cité dans le deuxième Voyage de Cook, tome IV, ch. V, p. 237 et 286. — Cook, ibid., ch. VI, p. 351.
[689] Forster, deuxième Voyage de Cook, tome IV, ch. VIII, p. 479.
[690] Forster, ibid., ch. V, p. 271 et 272.
[691] Cook, deuxième Voyage, tome IV, ch. IV, p. 195.
[692] Forster, deuxième Voyage de Cook, tome IV, ch. V, p. 256.
[693] Cook, deuxième Voyage, tome IV, ch. II, p. 126.
[694] Barrow, nouveau Voyage dans la partie méridion. de l’Afrique, tome I, ch. I, p. 143 et 144. — Thumberg, Voyage en Afrique et en Asie, ch. III, p. 119.
[695] Levaillant, premier Voyage dans l’intérieur de l’Afrique, tome II, p. 227, 228 et 263.
[696] Levaillant, premier Voyage dans l’intérieur de l’Afrique, tome II, p. 255. — Barrow, nouveau Voyage, etc., tome I, ch. 1, page 147.
[697] Thumberg, ch. III, p. 119.
[698] Levaillant, premier Voyage, tome II, pag. 255, 262, 263 et 264.
[699] Levaillant, premier Voyage, tome II, p. 212, 213, 226 et 229.
[700] Ibid., p. 262.
[701] Barrow, Voyage dans la partie méridionale de l’Afrique, tome II, ch. V, p. 171 et 172.
[702] Levaillant, premier Voyage, tome II, p. 151.
[703] Levaillant, premier Voyage, tome I, p. 230 et 231 ; tome II, p. 90, et deuxième Voyage, tome III, p. 459 et 460. — Les capitaines ont cependant quelquefois assez de puissance pour s’emparer des femmes qui leur conviennent. Kolbe, tome I, ch. VI, p. 67.
[704] Levaillant, deuxième Voyage, tome II, p. 411, et tome III, p. 17 et 18.
[705] Sparrman, Voyage au cap de Bonne-Espérance, tome II, ch. VIII, page 90. — Levaillant, premier Voyage, tome II, page 55 et 56.
[706] Kolbe, tome I, ch. XV, p. 235, 236 ct 237.
[707] Kolbe, tome I, ch. XV, p. 238, 239, 240 et 252. — Levaillant deuxième Voyage, tome II, p. 187.
Kolbe dit que les femmes hottentotes ont le privilège de manger du lièvre ; mais on voit aisément à quoi se réduit ce privilège quand ont lit dans le voyage de Levaillant : « Les Hottentots ont pour la chair de lièvre une répugnance invincible, et ne peuvent se résoudre à en manger. »
[708] Kolbe, tome I, ch. XV et XVIII, p. 237, 282 et 283.
[709] Levaillant, premier Voyage, tome II, p. 51 et 52. — Kolbe, tome I, ch. XVII, p. 268 et 269.
[710] Levaillant, premier Voyage, tome II, p. 54 et 55.
[711] Kolbe, tome I, ch. VI, p. 59. — Levaillant, premier Voyage, tome II, p. 56, et deuxième Voyage, tome III, p. 89 et 90.
[712] Sparrman, tome II, ch. VIII, p. 93 et 94. — Kolbe, tome I, ch. XVII, p. 263.
[713] Kolbe, tome I, ch. XXV, p. 264, 265 et 267. — Sparrman, tome II, ch. VIII, p. 91, 92 et 94.
[714] Levaillant, premier voyage.
[715] Levaillant, premier Voyage, tome II, p. 87 et 88.
[716] Dampier, nouveau Voyage autour du Monde, tome II, ch. XX, p. 213, 214 et 218. — Kolbe, tome I, chap. VI, VII, XVI et XVII, pages 80, 81, 83, 84, 87, 89, 249 et 260. — Sparrman, tome I, chapitre V. — Levaillant, premier Voyage, tome II, pages 219 et 220. — Degrandpré, tome II, p. 186 et 187. — Thumberg, ch. III, page 108.
Les Européens ont commencé à leur faire contracter des habitudes de propreté. Barrow, tome I, ch. I, p. 63.
[717] Description du cap de Bonne-Espérance, tome I, chap. VI, page 80.
[718] Levaillant, premier Voyage, tome I, pag. 287 et 288. — Le moyen que Levaillant rapporte comme un fait incroyable est employé par les nègres de Mallicolo et même par les Arabes. Mollien, tome I, ch. I, p. 14.
[719] Levaillant, deuxième Voyage, tome III, p. 18 et 19. — Kolbe, tome I, ch. XVI, p. 250 et 251.
[720] Levaillant, premier Voyage, tome II, pag. 283, 287, 288 et 297 ; deuxième Voyage, tome I, p. 199, 229 et 230. — Barrow, Voyage dans la partie méridionale de l’Afrique, tome I, chap. I, pages 139 et 140.
[721] Thumberg, Voyage en Afrique et au Japon, ch. II, p. 120. — Levaillant.
[722] Levaillant, deuxième Voyage, tome I, p. 128 et 129.
[723] Kolbe, tome I, ch. XVI, p. 243. — On peut être étonné que des peuples pasteurs soient si souvent réduits à la famine, et qu’ils se nourrissent d’aliments si grossiers. La raison en est qu’ils élèvent des animaux, non pour les manger, mais pour en boire le lait ou pour transporter leurs bagages. Ce n’est que très rarement qu’ils peuvent se permettre de tuer un bœuf ou un mouton. Leurs pâturages ne sont ni assez étendus ni assez grands pour que chaque famille puisse avoir un nombreux troupeau. Levaillant, premier Voyage, tome II, p. 67.
[724] Levaillant, deuxième Voyage, tome II, p. 75.
[725] Kolbe, tome I, ch. VI, p. 67.
[726] Kolbe, tome I, ch. III et VI, p. 29, 60 et 61. — Leraillant, deuxième Voyage, tome I, p. 158 et 159, et tome III, p. 95, 98 et 99. — Barrow, Voyage dans la partie méridionale de l’Afrique, tome I, ch. I, p. 118, 135 et 136. — Raynal, tome I, liv. I, p. 393.
[727] Levaillant, premier Voyage, tome I, p. 232.
[728] Sparrman, tome I, ch. V, p. 263 et 264.
[729] Levaillant, deuxième Voyage, tome III, pag. 163 et 164. — Sparrman, tome I, ch. V, p. 263 et 264.
[730] Levaillant, tome I, ch. V, p. 259 et 260.
[731] Levaillant, premier Voyage, tome II, p. 305 et 306. — Ce voyageur, croit comme Kolbe, que les Boschismans, dont il n’a vu que trois qui traversaient une montagne opposée à celle sur laquelle il était, ne sont que des esclaves déserteurs de la colonie ; cette opinion est démentie par d’autres voyageurs plus instruits.
[732] Sparrman, tome II, ch. VIII, p. 22. — Levaillant, premier Voyage, tome II, p. 220 et 222.
[733] Péron, Voyage de découvertes aux terres australes, tome II, liv. IV, ch. XXXIII, p. 310. — Sparrman, tome I, ch. V, p. 264 et 265.
[734] Voyage de découv. aux terres australes, t. II, liv. IV, ch. XXXII, p. 310 et 311. — Péron croit que la manière dont les colons traitent ces enfants est la cause de leur attachement à la vie sauvage ; et il rapporte à l’appui de cette opinion un fait qui paraît décisif. Si ce voyageur philosophe eût eu le temps d’étudier les mœurs des colons, ce qui pour lui n’était qu’un doute se fut changé en certitude.
[735] Sparrman, tome I, ch. V, p. 265.
[736] L. Degrandpré, Voyage à la côte occidentale d’Afrique, tome I, ch. III, p. 171 et 172. — J. Mathews, Voyage to the river Sierra-Leone, on the coast of Africa, lett. V, p. 74. — G. Mollien, Voyage dans l’intérieur de l’Afrique, aux sources du Sénégal et de la Gambie, tome I, ch. II, p. 148.
[737] On peut voir quelles sont les plantes alimentaires de ce pays dans le Précis de la Géographie universelle, tome V, liv. XC, p. 7, et dans les auteurs cités par M. Malte-Brun.
[738] Voyage à la côte occidentale d’Afrique, tome I, ch. III, p. 167.
[739] Degrandpré, tome I, ch. II, p. 105, 106 et suiv.
[740] Voyage à la côte occidentale d’Afrique, tome I, ch. II, p. 52, 53, 54 et 55. — Les mêmes épreuves se pratiquent au Sénégal. Mollien, Voyage dans l’intérieur de l’Afrique, tome I, chap. II, page 105.
[741] Ibid., ch. III, p. 210.
[742] L. Degrandpré, tome I, ch. I et II, pag. 52 et suivantes. — G. Mollien, tome I, ch. III, pag. 148. — J. Mathew’s Voyage to the river Sierra-Leone, lett. V, p. 74.
[743] L’état social des peuples de la côte occidentale d’Afrique explique un phénomène dont on avait eu de la peine à se rendre raison : l’établissement à Saint-Domingue d’une monarchie complète, par le nègre Christophe. On trouvait, dans cette monarchie, les mêmes rangs, les mêmes titres, les mêmes dignités que dans le gouvernement impérial créé par Napoléon. Les admirateurs de ce conquérant ne doutaient pas que le roi Christophe ne l’eût pris pour modèle ; mais ses détracteurs disaient au contraire, que c’était au roi nègre qu’appartenait le mérite de l’invention. Si l’on eût songé aux institutions établies, de temps immémorial, chez les nègres de la côte occidentale d’Afrique, on n’eût pas contesté le mérite de Christophe : on eût reconnu qu’il avait transporté à Saint-Domingue les institutions de son pays natal ; qu’il s’était conformé, par conséquent, au génie de sa nation, et qu’il ne devait pas être mis au rang des serviles imitateurs. Ceci n’est pas un reproche aux auteurs immortels des institutions impériales ; c’est un sujet d’admiration pour le profond génie des nègres, qui ont atteint, dans un état encore barbare, ce haut point de perfection sociale que plusieurs de nos philosophes et de nos hommes d’État ont admiré.
[744] J.-G. Stedman, Voyage à Surinam et dans l’intérieur de la Guyane, tome III, ch. XXV, p. 73 et 74.
[745] L. Degrandpré, tome I, ch. III, p. 197.
[746] Mollien, Voyage dans l’intérieur de l’Afrique, tome I, ch. III, p. 143. — Degrandpré, tome II, ch. IV, p. 54, 55 et 56.
[747] Mollien, tome I, ch. II, p. 47 et 48.
[748] J. Mathew’s, lett. VI, pag. 116. — L. Degrandpré, tome I, ch. II, p. 101, 102 et 149. — Raynal, Hist. philosoph., tome VI, liv. XI, p. 92.
[749] Degrandpré, tome I, ch. II, p. 109, 110 et 111.
[750] Mollien, tome I, ch. IV, p. 292 et 293.
[751] Mollien, tome I, ch. IV, p. 292 et 293. — Raynal, tome VI, liv. II, p. 192 et 193. — Degrandpré, tome I, ch. II, p. 102 et 103.
[752] J. Mathew’s Voyage to the river Sierra-Leone, 5th. lett., pag. 86 et 87.